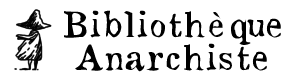L’Encyclopédie Anarchiste — S
S
L’autorité toujours contestable des savants. Savants officiels et autres. Leurs bévues. Leur doute.
II. LA SÉCURITÉ PAR LES ARMEMENTS.
III. SÉCURITÉ PAR LE DÉSARMEMENT.
IV. LES ÉLÉMENTS DE LA SÉCURITÉ FRANÇAISE.
V. LE CARACTÈRE VÉRITABLE DE LA SÉCURITÉ.
SOCIALISME, COLLECTIVISME, COMMUNISME
II. — LE PROGRAMME : BUTS ET MOYENS.
SOVIETS (LES) : Leur naissance. Leur vie. Leur mort.
La naissance du premier Soviet.
La vie, la maladie et la mort des Soviets.
LES COURSES DE TAUREAUX. — LA TAUROMACHIE.
SUBJECTIF, SUBJECTIVISME, SUBJECTIVITÉ
a) Extrait de l’Encyclique Quanta Cura
LE SYMBOLISME ET SON ÉCOLE. (Fin du XIXème siècle).
SYMBOLISME (fétichisme ou fantaisisme) SEXUEL
L’existence des Syndicats après la Révolution.
Substitution de la notion de classe à la notion de parti.
SABBAT
n. m.
Repos sacré observé par les Juifs le septième jour de la semaine, en vertu de la loi de Moïse. Les Juifs s’abstenaient, ce jour-là, de tout travail, et celui qui enfreignait cette loi était puni de mort.
Le sabbat était également, dans les superstitions médiévales, l’assemblée nocturne des sorciers qui se réunissaient, sous la présidence de Satan, pour prendre part à des festins diaboliques, recevoir les initiés, préparer des maléfices et cueillir des herbes magiques. Il est possible que de telles réunions aient eu lieu quelquefois ; Michelet n’y voit que la révolte nocturne du serf contre le seigneur : les assemblées mystérieuses des sorciers parisiens autour du gibet de Montfaucon ne sont pas sans analogie avec le scandale d’Helsingfors, en Finlande, qui a révélé l’existence, en 1932, d’une société secrète internationale, dont les membres se réunissent la nuit dans les cimetières pour déterrer les cadavres et se livrer à des mutilations rituéliques ... Mais, le plus souvent, le sabbat médiéval fut la création de la féconde imagination populaire, création entretenue par les veillées. Des sorcières, brisées par la torture, ont pu avouer s’y être rendues sans l’avoir jamais fait, uniquement pour échapper aux tourments. Comme l’a dit Maxwel, le sabbat « est le fait de l’érudition des inquisiteurs et des juges interrogeant, et de l’ignorance suggestible des sorciers interrogés ». (Voir Sorcellerie.)
— Jean BOSSU.
SABOTAGE
n. m.
Selon le Dictionnaire Larousse, ce mot se rapporte simplement à la fabrication de sabots. Ce n’est pour lui qu’un nom masculin. Apprendre le sabotage, c’est apprendre le métier de sabotier. — C’est aussi l’opération qui consiste à entailler obliquement les traverses sur les voies de chemins de fer, pour y fixer les coussinets ou les rails. — Pourtant, ce Dictionnaire indique encore que :
« Sabotage, c’est l’action d’exécuter un travail vite et mal. — Imprimerie : acte malhonnête du typographe qui, volontairement, introduit des erreurs dans la composition ou détériore le matériel d’imprimerie qui lui est confié. »
Cette dernière définition du sabotage n’est pas la nôtre. Il n’est pas admissible qu’un ouvrier s’en prenne sans raison à son travail ou au matériel. Quand un travail est ainsi compris, c’est que l’ouvrier est un mauvais ouvrier qui n’aime pas son métier, qui n’a pas l’amour du travail qui rend- ou devrait rendre — l’homme fier et libre... Et puis, pourquoi citer l’imprimerie comme exemple et le typographe comme type de saboteur, alors qu’il y a tant d’autres métiers où le travail est plus sérieux et le matériel plus précieux ? Le saboteur du Larousse est un pauvre d’esprit ou un sournois mécontent qui se venge.
Ainsi, en peu de lignes, le Dictionnaire Larousse dit tout ce qu’il peut dire du sabotage. En quelques mots, il effleure cependant ce qui peut, ici, nous intéresser. Mais il est nécessaire de préciser, de mettre au point, la forme d’Action Directe que, dans notre théorie du Syndicalisme révolutionnaire, nous avons propagée, sous le nom de sabotage.
C’est justement parce que les ennemis de la classe ouvrière organisée n’ont cessé de dénaturer ou de ridiculiser le sens, l’action, le but du sabotage, qu’il a paru indispensable aux militants syndicalistes de l’expliquer, par la parole et par la plume, à chaque occasion.
Selon le Dictionnaire Larousse, le sabotage est simplement l’action d’exécuter un travail vite et mal. Le saboteur n’est autre que l’ouvrier, l’employé, le salarié qui, volontairement, exécute vite et mal un travail.
Voilà qui est clair et bref.
Mais ce bon Dictionnaire Larousse, à la portée de tous, n’agit pas inconsciemment en s’abstenant d’approfondir un peu l’action du sabotage et en oubliant volontairement de développer toute la valeur que nous lui attribuons dans la lutte quotidienne de revendication et de défensive des exploités contre leurs exploiteurs. Tâchons donc, ici, d’y suppléer.
D’une brochure, déjà vieille (1908), mais quand même d’actualité sur ce sujet, nous croyons bon d’extraire ceci :
L’Action Directe comporte aussi le sabotage. — Que n’a-t-on pas dit et écrit sur le sabotage ? En ces derniers temps, la presse bien pensante s’est appliquée à en dénaturer le sens. Heureusement, divers écrits des militants syndicalistes ou leurs déclarations devant les tribunaux ont rétabli le sens exact du sabotage ouvrier, qui ne doit pas être confondu avec le sabotage patronal.
Chez le patron, le « sabotage » s’attaque au public, par la falsification des denrées, la fraude des vins, du beurre, du lait, des farines, etc., la mauvaise qualité des matières premières et matériaux nécessaires aux travaux d’utilité publique. I1 faudrait un volume pour énumérer les vols, les escroqueries, les fraudes, les malfaçons dues à la crapulerie et à la rapacité des patrons et des entrepreneurs. De nombreux procès récents, de graves affaires de marchandage, des tripotages honteux ont montré combien peu les exploiteurs et les commerçants ont le souci de la santé du public et de son intérêt. Au point de vue militaire, les mêmes crimes des gros fournisseurs ont montré quel était le patriotisme de ces marchands. Ce qu’on ne sait pas, c’est le nombre de scandales étouffés par la seule puissance du jour : l’argent.
Le « sabotage » ouvrier, contre lequel les journaux ont saboté le jugement du public, contre lequel les juges ont saboté la justice et l’équité, est tout autre.
Il consiste d’abord, pour l’ouvrier, à donner son travail pour le prix qu’on le paie : à mauvaise paie, mauvais travail. L’ouvrier pratique assez naturellement ce système. On pourrait même dire qu’il est des travailleurs qui le pratiquent inconsciemment, d’instinct. C’est sans doute ce qui explique la mauvaise qualité et le bon marché de certains produits. On dit couramment d’un mauvais produit, vendu très bon marché : c’est du travail qui sort des prisons.
Mais le « sabotage » est parfois praticable d’une façon assez paradoxale. Par exemple, un employé de commerce, un garçon de magasin est un employé fidèle s’il soutient bien l’intérêt de son patron ; et souvent cet intérêt consiste à tromper, à voler le client. Pour saboter, cet employé n’aurait qu’à donner la mesure exacte au lieu de se tromper de mesure aux dépens du client et à l’avantage du patron, comme il fait d’habitude. Une demoiselle de magasin n’aurait qu’à vendre un mètre exact d’étoffe ou de ruban, au lieu d’en donner, comme à l’ordinaire 90 ou 95 centimètres pour un mètre. Ainsi, pour certains ouvriers, il leur suffirait d’être honnêtes avec le consommateur, scrupuleux avec le client, pour saboter l’intérêt patronal et n’être pas complice de ses vols.
Ils sabotent, et ils ont raison, ceux qui, ayant fabriqué un mauvais produit, dangereux à la consommation, en préviennent les consommateurs. Ils sabotent, et ils ont raison, ceux qui versent aux consommateurs la véritable boisson demandée au lieu de la boisson frelatée sur laquelle il y a gain de cent pour cent. Ils sabotent aussi, et ils ont raison, ceux qui, comme nos camarades boulangers, défendent leur pain et leur salaire, en sachant rendre inutilisables, en temps de grève, le four ou le pétrin où le patron escomptait les remplacer par des jaunes ou par des soldats. Ils sabotent enfin, et ils ont raison, ceux qui, pour un motif louable de solidarité ouvrière, coupent les fils télégraphiques et téléphoniques, éteignent les lumières, suppriment toutes communications, entravent tous transports et font, par ces moyens, capituler exploiteurs et gouvernants. Ce genre de sabotage est aussi de l’action directe superbement efficace contre les ennemis des ouvriers.
Le « sabotage » intelligent de l’ouvrier s’attaque en général à l’intérêt direct de l’exploiteur. Il est de bonne guerre ; il est défensif ; il est une revanche. Le « sabotage » patronal s’attaque seulement à l’intérêt du public, sans distinction. Il est toujours nuisible et bien souvent criminel, puisqu’il attente à la santé, à la sécurité, à la vie du public. La confusion n’est pas possible.
Le sabotage est donc de l’action directe, puisqu’il s’attaque au patron sans l’intermédiaire de personne Le « sabotage » est l’action directe qui peut s’exercer dans les moments de paix relative entre le Patronat et le Salariat, comme en temps de grève ou de conflit. (Extrait de l’A. B. C. syndicaliste.)
Voilà donc une définition du sabotage qui correspond assez bien à ce que l’ouvrier comprend lorsqu’il s’agit pour lui de protester ou de se défendre de la manière la meilleure qui soit à sa portée et qui, loin d’être néfaste à une collectivité quelconque, la protège aux dépens des intérêts du patronat.
On pourrait citer encore bien des exemples de sabotage. Ainsi, lors d’une grève des Inscrits maritimes, les grévistes firent acte de sabotage intelligent en dénonçant par affiches le sabotage scélérat des Compagnies Maritimes. Ces affiches prévenaient les voyageurs que tel bateau était dangereux à prendre vu le mauvais état de la chaudière (dûment constaté), ou des machines, ou du foyer ; que tel autre pouvait, en cours de navigation, s’arrêter subitement du fait, incontestable, que l’arbre-couche de la machine était fêlé et devait fatalement briser, d’un instant à l’autre, en plein service et, par conséquent, immobiliser le bateau en pleine mer. Il est bon de remarquer ceci : les inscrits qualifiés saboteurs prévenaient les voyageurs du risque couru par eux en se livrant avec confiance à l’impéritie des Compagnies Maritimes. Celles-ci, par rapacité criminelle, restaient muettes sur le danger qu’elles connaissaient, mais elles faisaient payer très cher, et d’avance, le voyage. Toutefois, elles ne payaient qu’après le voyage les hommes d’équipage du bateau et ne versaient jamais d’appointements à l’avance. Ce calcul intéressé des Compagnies est le même pour toutes. Ces administrations n’admettraient pas que fût qualifiée de sabotage leur malhonnête façon d’agir. Clientèle ou usagers des Compagnies de transports n’ont jamais protesté contre un tel système. Quant à l’État, il n’intervient jamais contre les Compagnies ; les poursuites sont pour les exploités de ces Compagnies, lorsqu’ils dénoncent leurs crimes. Les forces policières de provocation et de répression sont employées avec empressement contre les grévistes revendiquant sécurité, mieux-être, respect de leur dignité de travailleurs. L’État intervient toujours aussi, pour plaindre des mêmes discours les naufragés et pour « renflouer » ces pauvres Compagnies de navigation toujours en déficit. Ce genre de sabotage capitaliste et de sabotagegouvernemental n’a jamais fait verser autant d’encre que le simple fait d’un prétendu sabotage ouvrier, dénaturé sciemment par une presse servile et intéressée. Celle-ci sait toujours rendre criminel l’acte de sabotage. Elle excelle àsaboter les faits. Le sabotage de l’opinion publique est, pour le journalisme contemporain, au service du capitalisme, un devoir professionnel. Il y a donc sabotage et sabotage. — C. Q. F. D.
N’oublions pas encore de constater qu’il y a des lois et décrets qui surgissent presque toujours après de retentissantes protestations du parlement, de l’opinion et de la grande presse, au lendemain d’une catastrophe. Mais ces lois et décrets sont toujours inappliqués ou inapplicables et, le sabotage continue contre la vie des mineurs, des employés de chemins de fer, des inscrits maritimes et de tous les travailleurs qui risquent sans cesse la mort pour gagner leur vie et enrichir les exploiteurs de toutes catégories : ceux qui entreprennent, administrent, aussi bien que ceux qui profitent en ne faisant rien que palper les dividendes et en jouir toute leur vie.
Il y a différentes sortes de sabotages. Aussi nous ne prétendons pas les énumérer complètement et parfaitement. Nous n’y arriverions pas.
Qu’on imagine un avocat (sabotant sa jolie profession libérale en ne défendant jamais que ce qu’il croit juste et noble de défendre ; un juge, saboteur de la justice, refusant de reconnaître et de déclarer non coupable l’accusé volant pour manger, s’il a faim, étant sans ressource ; un saboteur policier secourant un vieillard au lieu de le molester en l’emmenant au poste pour flagrant délit de vagabondage ou de mendicité ; un prêttre laissant dormir et se chauffer dans son église un miséreux grelottant et rompu de fatigue ; un restaurateur n’appelant pas la police pour empoigner un affamé qui s’est restauré pour plus qu’il ne peut payer ; un gendarme n’inquiétant pas, sur la route, un maraudeur qui se sauve ou un trimardeur qui se cache ; un médecin donnant ses soins et n’ordonnant pas une copieuse fourniture de pharmacie ; un gradé n’insultant pas un inférieur ; un patron payant convenablement ses ouvriers ; un contremaître ne jouant pas, à l’usine ou sur le chantier, à l’adjudant Flic ou au mouchard, vis-à-vis de ses anciens compagnons ; un gardien de prison ayant de la pitié au lieu de la brutalité envers les détenus, etc., etc. Enfin, oui, imaginez tous ces saboteurs de l’ordre bourgeois dans l’exercice de leurs fonctions ; ne croyez-vous pas qu’il y aurait vraiment danger pour la .Société bourgeoise en présence de ce paradoxalsabotage difficile à concevoir et pourtant possible ?... Pourquoi pas ?...
Eh ! oui ; possible, puisque nous avons bien des saboteurs du journalisme, en ce qu’ils osent dire sur tous les événements, politiques et sociaux tout ce qu’ils pensent, si subversive que soit leur opinion ! — Eh ! oui ; possible, puisqu’il se trouve, en conseil de guerre, des officiers saboteurs de l’imbécillité militariste pour acquitter de braves jeunes gens trop fiers pour supporter la discipline et respecter les bourreaux galonnés ; il en est aussi de ses saboteurs qui, dans l’armée, commencent à comprendre, à admettre l’objection de conscience et s’inclineront demain devant les héros qui se refusent à porter une arme, à toucher un engin qui donne la mort à des êtres humains. — Voilà du sabotage conscient.
Ne désespérons pas de voir des saboteurs non seulement conscients, mais aussi organisés, pour se refuser collectivement à tout ce qui peut servir la Guerre et rendre plus facile la Paix. Qui sait même, s’il ne se trouvera pas des saboteurs héroïques pour saboter énergiquement la Guerre et les Guerriers, pour saboter surtout ceux qui la veulent pour les autres et ceux qui la font par sauvagerie, inconscience ou lâcheté ; pour saboter enfin, ceux qui en sont la cause, les organisateurs, ou les profiteurs ! Ce sabotage ne nous semble pas du tout déplacé et nous dirions même qu’il est d’extrême urgence à l’époque trouble où nous vivons.
Ce n’est pas saboter la raison humaine que de croire à un monde renouvelé par la bonne volonté et la cohésion dans l’effort des meilleurs parmi les hommes qui pensent, travaillent, s’élèvent et rêvent de l’affranchissement intégral de l’individu par une transformation sociale, favorable au règne de l’Entente entre tous et de la Liberté pour tous.
Le « sabotage » s’apparente à cet autre mot, moins connu peut-être, mais qu’il est intéressant de ne pas ignorer : c’est le mot Boycottage. Voici, d’abord, ce qu’en dit le Dictionnaire Larousse :
« Boycottage (rad. boycotter) n. m. Mise en interdit des propriétés ou des fermiers irlandais qui n’obéissent pas aux injonctions de la Ligue agraire.
« encycl. Vers 1880, un capitaine anglais, nommé James Boycott, gérant des propriétés que le comte Erne possédait dans le comté de Mayo (Irlande), fit preuve d’une telle dureté à l’égard des fermiers placés sous ses ordres qu’il s’en fit exécrer. Ils s’entendirent pour le mettre en quarantaine. Tout Irlandais dut lui refuser son travail ; il fut même interdit de lui acheter ou de lui vendre un objet quelconque, surtout des vivres. Le pacte fut fidèlement observé. Malgré l’intervention du gouvernement qui lui envoya une garde, et l’aide des dissidents de l’Ulster qui rentrèrent ses récoltes, Boycott fut obligé de quitter le pays.
Le nom de boycottage fut, depuis lors, appliqué aux excommunications du même genre, qui furent lancées, pour la plupart, par les associations secrètes irlandaises, notamment par la Ligue agraire. »
Le mot « boycottage » signifie donc : mettre en quarantaine, frapper d’interdit ; l’usage s’en étendit un peu partout. Lesabotage et le boycottage sont devenus deux formes de l’action directe, de défensive surtout. Déjà, en 1897, la question vint au congrès des Bourses du Travail de France, qui se tint à Toulouse. Un rapport sur le boycottage et le sabotage y fut discuté et des résolutions adoptées.
Les congrès ouvriers, constatant l’inefficacité relative des grèves partielles où s’épuisaient les forces et les ressources de résistance du prolétariat cherchaient donc des moyens de lutte plus efficaces.
Voici ce qu’on lisait à l’époque, dans les publications ouvrières :
« L’homme qui a donné son nom au boycottage est mort tout récemment. Le capitaine Boycott était le middleman de lord Erne, un des grands propriétaires du comté de Mayo, en Irlande. Le middleman est l’homme qui afferme, en bloc, au propriétaire foncier, une étendue plus ou moins considérable de terres, pour la sous-louer en détail à d’autres fermiers ou la faire cultiver par des ouvriers ruraux. Le capitaine Boycott se fit particulièrement détester par son oppression. Les tenanciers étaient incapables d’acquitter leurs fermages, en ce comté de Mayo où il était le maître et où, coup sur coup, pendant plusieurs années,, les récoltes avaient été dévastées par les intempéries. Malgré cela, il fit valoir ses droits de propriétaire.
« On n’a point oublié cette dramatique époque. Les soldats anglais, requis par le middleman, pénétraient dans la chaumière du fermier insolvable, saisissant le misérable mobilier, expulsant les habitants ; puis, pour que ces malheureux, dépourvus d’asile, ne cédassent pas à la tentation de réintégrer celui-ci, même vide, les soldats enlevaient le toit de la maison et les châssis des fenêtres. Il ne restait plus que les quatre murs de pierres.
« La haine des Irlandais contre le capitaine Boycott fut telle qu’on le mit à l’index dans le pays tout entier. La Ligue agraire décida de lui infliger la quarantaine. C’était l’inauguration d’un nouveau système de lutte. Défense fut faite à tout Irlandais de fournir au capitaine Boycott, non seulement du travail, mais aussi des vivres. Pendant plusieurs semaines il vécut seul dans sa maison, ne trouvant ni ouvrier, ni laboureur, ne pouvant rien acheter, même à prix d’or. S’il n’avait pas eu de provisions, il serait littéralement mort de faim. Enfin, il dut quitter la place et partir pour l’Angleterre.
« Les landlords ne tardèrent pas, à leur tour, à employer contre les malheureux Irlandais la méthode de combat que ceux-ci avaient employée contre le capitaine Boycott. Ils menaçaient les ouvriers de réduction de salaire, de privation de travail ; ils menaçaient les commerçants de leur retirer la clientèle de leurs fermiers ; enfin, ils allaient jusqu’à menacer les pauvres de ne plus donner d’aumônes. — (Telle fut l’origine du Boycottage).
« Ainsi « popularisé », le boycottage traversa la mer.
« À Berlin, en 1894, les brasseurs, cédant à la pression gouvernementale, refusèrent leurs, salles de réunions aux socialistes. Les brasseurs furent boycottés et si rigoureusement, qu’au bout de quelques mois ils durent se soumettre. — A Berlin, encore, la compagnie des chemins de fer circulaires, s’étant aperçue que le public fermait lui-même les portières des wagons, sup- prima les deux cents employés à qui, jusqu’alors, était confiée cette tâche. Aussitôt, les socialistes intervinrent, firent comprendre au public qu’il devait désormais s’abstenir de fermer les portières et obtinrent ainsi que la compagnie reprenne son personnel.
« A Londres, en 1893, les employés de magasins exigèrent de leurs patrons la fermeture des magasins un après-midi par semaine, pour compenser l’après-midi du samedi pendant lequel ils travaillaient, tandis que les ouvriers chômaient. C’est par le boycottage qu’ils forcèrent la main aux patrons ; les magasins qui refusèrent d’obtempérer aux désirs de leurs employés furent mis à l’index. Les employés allèrent plus loin. Ils n’hésitèrent pas, pour obtenir gain de cause, à recourir aux procédés révolutionnaires. Un jour, entre autres, ils entrèrent chez un marchand de jambons et lancèrent dans la rue toutes les victuailles. Les boycotteurs triomphèrent et, depuis cette époque, les magasins ferment leurs portes une fois par semaine entre 3 et 5 heures de l’après-midi. »
Telle fut l’origine du système.
En France, il y aurait trop à citer pour montrer l’efficacité du boycottage sous toutes ses formes, tant légales querévolutionnaires.
Eh ! oui, légales, car il est des règles et des méthodes qu’il suffirait de mettre en application pour paralyser les rouages les plus importants de la vie sociale. Il est des lois et décrets qui, s’ils étaient strictement respectés, bouleverseraient toute l’administration.
Le Boycottage et le Sabotage figuraient donc, en une seule question, à l’ordre du jour du Congrès de Toulouse (1897). La Commission chargée de l’examiner rédigea des conclusions et un rapport fut présenté où nous glanons ces passages intéressants :
« ... La Commission vous demande de prendre en considération les propositions qu’elle vous soumet. Elle est convaincue qu’après mûre réflexion vous pratiquerez le boycottage, chaque fois que vous en trouverez l’occasion, et elle est convaincue aussi que, s’il est mis en vigueur avec énergie, les résultats qu’en retirera la classe ouvrière vous encourageront à persévérer dans cette voie.
« Nous avons examiné de quelle façon peut se pratiquer le boycottage. Qui pouvons-nous boycotter ? Est-ce l’industriel, le fabricant ? Contre lui le boycottage reste inégal ; ses capitaux le mettent a l’abri de nos tentatives. L’industriel n’a que de rares rapports avec le public ; pour la diffusion de ses produits, il s’adresse aux commerçants qui, en général, sont des conservateurs de la société actuelle... Donc, laissons pour l’instant l’industriel de côté, nous réservant de dire bientôt comment l’atteindre. Parions du commerçant avec lequel nous sommes directement en contact et que nous pouvons boycotter.
« Il y a quelques semaines, a Toulouse, une petite tentative de boycottage a été faite contre les magasins qui refusaient de fermer le dimanche ; par affiches, les camarades toulousains engageaient le public à ne rien acheter le dimanche. « Ce que les employés toulousains ont fait en petit, nous vous invitons à le faire en grand. Que chaque fois que besoin sera, quand le commerçant voudra réduire les salaires, augmenter les heures de travail, ou quand le travailleur, désireux d’être moins tenu, de gagner plus, imposera ses conditions au commerçant ; qu’alors, avec toute l’activité, dont nous pouvons disposer, son magasin soit mis à l’index ; que, par tous les moyens dont l’initiative des travailleurs croira bon d’user, le public soit invité à ne rien acheter chez lui, jusqu’au jour où il aura donné entière satisfaction à ses employés.
« Ainsi ont fait nos camarades d’Angleterre et d’Allemagne qui, dans maintes circonstances, ont remporté la victoire.
« Quant aux industriels, le boycottage les atteint difficilement. Par contre, le fonctionnement de la société capitaliste leur permet normalement un sabotage qui, sous forme de boycottage spécial (consistant en baisse de salaire, augmentation d’heures de travail ou chômage partiel, ainsi que renvois brutaux) leur permet, répétons-nous, contre leurs ouvriers un boycottage meurtrier. Nulle contrainte ne s’oppose aux fantaisies malfaisantes du patronat qui boycotte même la conscience ouvrière en mettant à l’index les travailleurs osant revendiquer leurs droits, les empêchant ainsi, non seulement de propager les idées d’émancipation qui les animent mais même de vivre... Que de militants ont dû quitter les lieux où ils vivaient en famille, pour chercher du travail en d’autres lieux, loin du pays natal, parfois et plus souvent en d’autres régions, tout au moins quand ils en trouvaient. Car il est des régions industrielles où l’ouvrier n’est embauché que s’il a des papiers et certificats indemnes de tous reproches patronaux ou s’il fait partie de certaines organisations cléricales, patriotiques ou très bourgeoisement sociales.
« Cela existe en certaines villes du Nord, malgré des municipalités socialistes. Cela existe un peu partout, si la force syndicale n’y a pas mis le holà. Si la politique a pu y semer la division ouvrière, le règne du bon plaisir patronal n’a plus de limite ; il crée des grèves, les suscite, selon ses besoins. La masse ouvrière croit lutter d’elle-même, alors qu’elle est menée selon les intérêts patronaux. La. grève ainsi partie cesse ou dure et, de toute façon, épuise par la misère le travailleur qui fnit par se rendre, à discrétion et rentre vaincu, affamé, aux conditions que dicte le patron.
« Bien différente est la grève accompagnée du boycottage consciemment exercé par les gréviste et le sabotage intelligemment pratiqué contre l’intérêt direct du patron.
« Par quels moyens résister au boycottage patronal et arrêter l’expansion de l’œuvre réactionnaire et sinistre dont certains capitalistes, dans certaines villes, donnent l’exemple à leurs confrères ?
« Ici, votre Commission — disait le rapport — croit que le boycottage, que nous pourrions tenter contre les exploiteurs en question ne donnerait que des déceptions. Aussi vous propose-t-elle de le compléter par une tactique de même essence que nous qualifierons de sabotage.
« Cette tactique, comme le boycottage, nous vient d’Angleterre où elle a rendu de grands services dans la lutte que les travailleurs soutiennent contre les patrons. Elle est connue là-bas sous le nom de Go Canny. »
À ce propos, nous croyons utile de vous citer l’appel lancé dernièrement par l’Union internationale des Chargeurs de navires, qui a son siège à Londres : Qu’est-ce que Go Canny ? C’est un mot court et commode pour désigner une nouvelle tactique, employée par les ouvriers, au lieu de la grève.
Si deux Écossais marchent ensemble et que l’un coure trop vite, l’autre lui dit :
« Go Canny. »
Ce qui veut dire :
« Marche doucement, à ton aise. »
Si quelqu’un veut acheter un chapeau qui vaut cinq francs, il doit payer cinq francs. Mais s’il ne veut en payer que quatre, eh ! bien, il en aura un de qualité inférieure. Et ainsi de suite pour toute marchandise.
Si une ménagère veut acheter une pièce de bœuf qui vaut trois francs et qu’elle n’offre que deux francs, alors on lui offre une autre pièce inférieure à celle qu’elle désirait. Le bœuf est aussi une marchandise en vente sur le marché. Or, l’on ne peut avoir même marchandise pour un prix inférieur à celui convenu pour une qualité supérieure. Eh ! bien, les patrons déclarent que le travail, l’habileté et l’adresse sont des marchandises en vente sur le marché tout comme le vêtement et la nourriture.
— « Parfait, répondons-nous, nous vous prenons au mot, comme le chapelier vend ses chapeaux, comme le boucher vend sa viande, nous vendrons aux patrons notre travail, notre habileté, notre adresse. Pour de mauvais prix, ils vendent de la mauvaise marchandise, nous en ferons autant.
« Les patrons n’ont pas droit à compter sur notre charité. S’ils refusent même de discuter nos demandes, eh ! bien, nous pouvons mettre en pratique le Go Canny, la tactique de : travaillons doucement, en attendant qu’on nous écoute. »
Voilà clairement défini le Go Canny, le Sabotage : à mauvaise paye, mauvais travail.
Cette ligne de conduite, employée par nos camarades anglais, nous la croyons applicable en France, car notre situation sociale est identique à celle de nos frères, les travailleurs d’Angleterre.
Il nous reste à définir sous quelle forme doit se pratiquer le sabotage. Nous savons tous que l’exploiteur choisit habituellement, pour augmenter notre servitude, le moment où il nous est le plus difficile de résister à ses empiétements par la grève partielle, seul moyen employé jusqu’à ce jour. Les résultats n’ont pas toujours été ce qu’on en espérait. Sans négliger le moyen de lutte qu’est la grève, il faut employer encore d’autres méthodes, avec ou sans la grève.
Faute de pouvoir se mettre en grève, les travailleurs frappés subissent les exigences du capitaliste.
Avec le sabotage, il en est tout autrement. La résistance est possible. Les exploités ne sont plus à la merci complète de l’exploiteur, ils ont le moyen d’affirmer leur virilité et de prouver à l’oppresseur qu’ils sont des hommes. Ils ont en mains l’arme défensive qui peut devenir l’arme offensive suivant les circonstances et la façon de s’en servir.
D’ailleurs, le sabotage n’est pas si nouveau qu’on pense : depuis toujours, les travailleurs l’ont pratiqué individuellement, quoique sans méthode. Il ne fut pas souvent sans efficacité. Il inspira dans le camp des profiteurs de l’exploitation une crainte salutaire qui n’a fait que croître lorsque s’est affirmée la puissance du sabotage collectif. Donc, d’instinct, les travailleurs ont su ralentir leur production quand le patron a augmenté ses exigences. Avec plus ou moins de conscience, les ouvriers ont appliqué la formule : à mauvaise paye, mauvais travail.
Le Patronat a cru parer à cette tactique défensive des esclaves de l’usine et du chantier en substituant la méthode fameuse du travail aux pièces ou à la tâche à celui du travail à la journée. Il a pu s’apercevoir que son intérêt moins lésé sur laquantité le devenait beaucoup plus sur la qualité. Si, par exemple, c’était le contraire, c’est-à-dire si le patron substituait autravail aux pièces le travail à la journée croyant asservir l’ouvrier, celui-ci, naturellement, employait aussi la méthode contraire pour aboutir au même résultat. Qu’on ne vienne pas dire que ceux-là étaient de mauvais ouvriers qui agissaient ainsi, car, nous affirmons que c’étaient les plus habiles, les plus intelligents et par conséquent les plus conscients de leur valeur. Le mauvais ouvrier est l’éternel saboteur et ne peut être autre chose et le patron le sait ; d’ailleurs, Celui-là n’a de valeur que par la collectivité dont il fait partie, car individuellement, il ne compte guère. Il a tout intérêt à suivre les plus audacieux pour ne pas être employé à de malpropres besognes pour conserver sa place.
Le sabotage s’adapte à toutes les sortes de travaux ; il se pratique dans tous les métiers et se modernise parallèlement aux progrès dans la production. Il devient redoutable avec le perfectionnement du machinisme. On ne peut tout dire ici sur l’application du sabotage ; mais les années 1900 à 1914, en France, ont amplement démontré la puissance redoutée du Syndicalisme révolutionnaire incitant à l’Action Directe du Prolétariat conscient et organisé, en vue de s’affranchir par lui-même de l’exploitation de l’homme par l’homme. Le rapport fourni au Congrès ouvrier de Toulouse (1897) Se terminait ainsi :
« Le sabotage peut et doit être pratiqué pour le travail aux pièces en s’attachant à donner moins de soin au travail, tout en fournissant la quantité pour ne pas amoindrir le salaire. Le patron pris ainsi, sera dans l’alternative d’accorder les revendications faites par ses ouvriers ou de perdre sa clientèle. S’il est intelligent, il remettra l’outillage dont il est possesseur aux seuls producteurs qui sauront l’utiliser au mieux sans le saboter. »
Mais ce serait le commencement de la fin du patronat et de l’exploitation. N’y comptons pas.
Le sabotage dans les usines, dans la production centralisée, sur les chantiers, dans les grandes entreprises, peut s’exercer avec discernement et intelligence sur l’outillage et les forces motrices sans le moindre danger pour le public et seulement au détriment du capitalisme. On se souvient encore de l’émotion produite dans le monde bourgeois quand le secrétaire du Syndicat des Chemins de Fer, il y a trente-trois ans, déclara qu’un employé, un chauffeur, un mécanicien des chemins de fer pouvait, avec dix centimes d’un certain ingrédient, paralyser complètement, pour longtemps, une locomotive ou plusieurs.
« Avec le boycottage, et avec son frère siamois, le sabotage, les travailleurs ont une arme de résistance efficace, qui, en attendant qu’ils soient assez puissants pour s’émanciper intégralement, leur permettra de tenir tête à l’exploitation dont ils sont victimes. Il faut que les capitalistes le sachent : les travailleurs ne respecteront la machine que le jour où elle sera devenue pour eux une amie qui abrège le travail, au lieu d’être comme aujourd’hui, l’ennemie, la voleuse de pain, la tueuse de travailleurs. »
On pourrait faire ici l’apologie du sabotage et du boycottage en ne citant que nos souvenirs.
Il y eut, en France, à Paris surtout, des événements de sabotage qui furent, les uns comiques, les autres tragiques ou menaçant de l’être. Ce que furent certaines journées et certaines nuits n’était pas sans nous faire espérer beaucoup pour la Révolution sociale et pour rendre impossible la guerre.
Les ordres du jour de nos Congrès ouvriers d’avant 1914, nous présageaient des triomphes qui n’ont été que des déceptions amères et cruelles sur lesquelles nous aimons mieux ne pas insister pour nous éviter de saboter les espoirs nouveaux qui nous animent encore, tellement sont indéracinables nos convictions révolutionnaires, tellement est inaltérable l’idéal anarchiste au cœur et à l’esprit de l’homme sincère et modeste qui croit à l’avenir de Liberté et d’Entente des homme de bonne Volonté entre eux.
— Georges Yvetot
SACERDOCE
n. m. (du latin : sacerdos, prêtre)
Le sacerdoce est la dignité et la fonction des ministres d’un culte. C’est aussi l’ensemble des prêtres attachés à ce culte. Nous avons au mot « prêtre » défini et résumé l’action de cet intermédiaire entre ce monde et l’autre. Nous allons étudier ici, l’action collective de la caste sacerdotale.
Ce que le primitif remarque d’abord dans le monde ambiant, c’est sa propre faiblesse en face des êtres et des choses au milieu desquels il vit. Cette observation lui est imposée par les misères mêmes dont il souffre : le froid, le chaud, la sécheresse, la pluie, la tempête, les animaux hostiles, la faim, la maladie, etc... Au milieu de ces inimitiés, il cherche à se faire des alliances. Ces premiers alliés seront les fétiches. Plus tard, le subjectivisme croissant de l’humanité ne se contentera plus de cet animisme primordial. L’homme détachera les phénomènes naturels de leurs formes visibles et leur en imposera une autre qui sera celle de l’homme lui-même. Les esprits des mondes terrestre, météorologique et sidéral deviendront autant d’êtres revêtus de la forme humaine, doués des mêmes passions, des mêmes sentiments, des mêmes besoins et des mêmes volontés que l’homme et ne différant de lui que par le privilège d’une puissance plus considérable. Ce sera l’aube du polythéisme et le commencement des cultes organisés. Le fétichisme n’a souvent ni culte, ni prêtre. Le polythéisme possède les deux. Pendant une longue suite de siècles, les pères de famille, les chefs de tribus offriront des sacrifices, selon un rituel déterminé mais assez simple d’abord. Peu à peu s’ajouteront des complications, à mesure que l’homme exercera son observation et sa sagacité sur les détails des phénomènes qui ont donné naissance au culte. Finalement ces complications élimineront les premiers sacrificateurs et les soins du culte passeront aux mains d’une catégorie spéciale d’hommes qui ont fait des rites une étude particulière. Cette catégorie d’hommes ce sont les prêtres. Après être restés longtemps au service des pères de famille, des chefs de tribus, qui se déchargeaient des soins du culte, moyennant une redevance, les prêtres qui surent presque partout s’organiser en caste, réclamèrent l’indépendance et la souveraineté.
L’Afrique noire nous présente l’ébauche de toutes les formes qu’a pu revêtir l’institution sacerdotale. Ici, la sorcellerie est une profession libre ; là, elle affecte déjà une hiérarchie. Assez souvent le sorcier cumule la médecine, la guérison des maladies, l’interprétation des songes avec le culte et les pratiques sacrées. Mais plus généralement, à chaque fonction correspond une classe de prêtres qui a un nom particulier et son rang dans la hiérarchie. Les uns s’occupent de la pluie, du tonnerre, des récoltes. D’autres jettent les sorts, consultent les oracles, prédisent l’avenir. Ou bien ceux-ci guérissent les maladies, assurent le succès des batailles, consacrent des gris-gris. Ceux-là évoquent les morts, purifient les maisons hantées, maîtrisent les esprits, préservent la tribu des calamités qu’elle redoute. La puberté, le mariage, la grossesse, l’enfantement, la mort ont leurs féticheurs spéciaux.
Intermédiaires entre les hommes et les dieux, dépositaires des secrètes formules qui savent désarmer les colères divines, armés de terribles pouvoirs magiques et, de plus, ayant pour complices l’ignorance générale, la crainte et l’espérance, les clergés sont arrivés au plus haut degré de puissance et ils ont usé, presque partout, du pouvoir que leur conféraient leurs momeries, pour organiser la société civile à leur profit.
Le « Chitouré » du Congo, comme le sorcier Polynésien, commande au peuple, au roi, aux puissants. Il frappe et punit à son gré. Personne ne discute ses ordres. Il réalise, en plus petit, l’idéal théocratique du pape Grégoire VII. A côté des clergés déjà fort puissants des tribus sauvages ou barbares, se situent des organisations sacerdotales vraiment achevées avec officiants, sacrificateurs, confréries régulières, concourant à des cérémonies pompeuses. Citons, en Amérique, les clergés du Mexique et du Pérou ; dans l’Antique Egypte où la pensée de la mort et le soin des cadavres occupaient toute la vie, tous les nomes étaient sous la main des collèges sacrés. L’histoire de l’Egypte est pleine de la lutte sans cesse renouvelée entre rois et prêtres. En moins de 500 ans le cléricalisme égyptien mit en pièces par deux fois le vaste édifice édifié par la monarchie thébaine. Sous la 20ème dynastie, les prêtres avaient envahi toutes les hautes fonctions. Ils étaient devenus généraux, magistrats, gouverneurs. Ils s’étaient octroyé le titre de princes de Kouch, jusqu’alors réservé exclusivement aux fils des pharaons. Finalement, le chef des prêtres d’Ammon déposséda le roi régnant et ceignit la couronne. En Inde, le brahmane s’est établi au-dessus de toutes lois et de toutes rivalités : les guerriers et les rois lui doivent la déférence ; quant au restant de la population, elle n’existe pas pour lui, sauf pour le nourrir, l’enrichir, l’adorer. Sans atteindre à ce degré de puissance, les clergés de la Perse, des Assyries et de Chaldée, occupèrent un rang très élevé. En Europe, les druides avaient la main-mise sur la justice et le pouvoir civil. Leur pouvoir spirituel savait très bien s’harmoniser avec la direction des affaires publiques et de la vie privée. En Grèce et en Italie, l’ambition et la soif du pouvoir furent les caractéristiques des clergés d’alors. Le sacerdoce chrétien a à son actif, tant de crimes, de spoliations, de dols, que son histoire demanderait, pour être bien contée, plusieurs volumes. L’Inquisition, les guerres de religion, la soif de richesses et de pouvoir des ordres religieux, les ambitions théocratiques de la papauté, les massacres d’hérétiques, les persécutions dirigées contre la pensée libre et les savants indépendants, la lutte sournoise ou déclarée du clergé moderne contre tout ce qui est vrai et juste, indiquent que le clergé catholique n’a jamais eu en vue que l’obtention et la conservation du pouvoir absolu, facteurs de richesses et de jouissances matérielles, les seules qui comptent pour lui.
Au sein de l’humanité, le sacerdoce constitue un embranchement où se succèdent et coexistent des classes, des espèces, des genres et des sous-genres qui tous ont un caractère commun : la prétention d’être les seuls et obligés intermédiaires entre l’homme et les dieux. C’est dans cette prétention que réside le fait capital d’où procèdent tous les actes sacerdotaux et qui persiste à travers les temps et les races. Tantôt le sacerdoce est libre : est prêtre qui peut se faire accepter comme tel. Tantôt il est conféré à la suite d’épreuves au cours d’une élection, ou imposé par l’arbitraire d’un chef. Il est exercé par le père, le magistrat, ou bien il est organisé savamment en hiérarchie compliquée. Mais quel qu’il soit, il est partout et avant tout : l’ensemble de ceux qui parlent, agissent, commandent, absolvent ou condamnent et s’enrichissent au nom des dieux.
Après avoir imposé à la terre la constitution qui s’accorde le mieux avec les intérêts de leur caste, les prêtres ont étendu leur domination jusqu’au ciel et ont investi les dieux. Il existait avant eux une armée divine composée des dieux de la terre, de l’atmosphère et du ciel ; ils ont inventé et créé les divinités nées du sacrifice, les dieux médiateurs nés de la parole du prêtre et sans lui, impuissants. Ces dieux on les retrouvera partout où il y a des prêtres, mais ils n’occupent la première place dans les panthéons que là où la classe sacerdotale a dominé. Aux dieux terrestres, météorologiques ou célestes, ils ont substitué des dieux cachés, mystérieux, dont la puissance s’exerce par des canaux invisibles et qui se prêtent à la métaphysique absurde qu’ils préparent. On peut dire que c’est de l’invention de ces dieux médiateurs, de ces dieux fils du prêtre que date la véritable origine de la religion, car c’est d’alors que se précise la distinction du naturel et du surnaturel.
C’est le sacerdoce qui a introduit dans le monde l’absurde, le surnaturel pur ; c’est lui qui en a fait le signe caractéristique de la religion et qui a, par là, établi entre elle et la science ce fossé si profond qui va toujours en s’élargissant.
L’essentiel et la marque fondamentale par laquelle les conceptions religieuses se distinguent de toutes les autres, c’est qu’elles accentuent à mesure que s’accroît la puissance scientifique de l’humanité, chaque jour davantage, le caractère d’absurdité qui est leur essence même.
Sans le sacerdoce, l’évolution religieuse de l’humanité eût été inoffensive. D’époque en époque, une crédulité moins obtuse eût écarté les croyances vieillies, une erreur moindre eût remplacé une absurdité plus grossière, jusqu’au jour où la raison eût trouvé la vérité. La preuve, c’est que l’évolution des choses s’est accomplie ainsi. Mais, que de misères, que de stagnations, que de reculs, que de larmes et de sang répandus, que de souffrances et de peines subies avant que l’humanité n’ait trouvé peu à peu la vérité ! Cela parce que le sacerdoce avait tout envahi : terre et cieux. Parce que partout il s’est cramponné à ses autels, cherchant à maintenir, avant tout et à n’importe quel prix, sa puissance menacée par les claires découvertes de la raison humaine. Oui, nous pouvons considérer que le sacerdoce, parmi les autres éléments mythiques, fut un des facteurs principaux du maintien de la religion.
— Charles ALEXANDRE.
SACREMENT
n. m. (du latin Sacramentum)
Signe visible d’une chose invisible, institué de Dieu pour la sanctification et la purification des âmes. Dans l’Eglise catholique, le sacrement est un rite religieux institué par Jésus-Christ, pour donner ou accroître la grâce. La religion catholique compte sept sacrements : le baptême, la confirmation, l’eucharistie, le mariage, la pénitence, l’extrême-onction et l’ordre. Les derniers sacrements sont ceux que les catholiques reçoivent quand ils sont ou se croient en danger de mort : la pénitence, l’eucharistie et l’extrême-onction. Le pouvoir d’administrer les sacrements appartient aux évêques et aux prêtres. Toutefois, en cas d’urgente nécessité (in extremis) toute personne peut conférer le baptême.
Il me paraît que c’est dans l’institution des sacrements que s’affirme, de la façon la plus certaine, bien que fort habilement dissimulée, la volonté de domination dont l’Eglise catholique, apostolique et romaine n’a cessé de poursuivre et poursuit toujours la réalisation. — (Voir les mots Confession, Confessionnal).
— S. F.
SACRIFICE
(du latin sacrificium ; de sacrificare : sacrifier)
On appelle « sacrifice » toute offrande faite aux divinités au cours de certaines cérémonies solennelles. Le sacrifice est le corollaire de tous les cultes. On exprimerait difficilement toutes les formes qu’il a revêtues. Le sacrifice religieux a deux buts : 1° nourrir les dieux ; 2° réconcilier l’homme avec la divinité. Le principal souci de l’homme étant la nourriture, il est naturel que les dieux calqués à son image partagent ce souci élémentaire. Les premiers sacrifîces se composèrent donc d’aliments, de boissons, de liqueurs. L’homme a toujours cru que les dieux mangeaient et buvaient l’offrande ; qu’ils étaient doués d’appétit et d’organes digestifs. Le culte direct des animaux, encore pratiqué aujourd’hui en Afrique occidentale, a concouru à renforcer cette croyance et, plus tard, lorsque les animaux jadis adorés ne furent plus considérés que comme les représentants des divinités antropomorphes, ils continuèrent néanmoins à dévorer l’offrande au nom des dieux qu’ils remplacent. On peut encore citer comme exemple les éléphants sacrés et les vaches saintes de l’Inde moderne qui sont toujours abondamment pourvus de nourriture, ainsi que les alligators, soigneusement entretenus dans les bassins des temples indous. Si les divinités minérales et végétales ne mangent pas, elles savent tout au moins boire. On versait à leurs pieds, de l’eau, du lait, des liqueurs fermentées ; on les arrosait de sang, de graisse et de beurre fondu. On les nourrissait même, en insinuant dans les fentes de l’écorce ou de la pierre ou en suspendant dans les branches de l’arbre qui les abritait, des lanières de viandes que les animaux et les oiseaux se chargeaient vite de faire disparaître. Et, de cette disparition, les dévôts supposaient que l’offrande était agréée.
On s’est adressé aussi à la terre, au feu, an vent, aux eaux. Tous les fleuves, toutes les sources, tous les lacs sur le globe entier, ont reçu des offrandes de tous genres et les ont agréées. La terre, notamment, est une divinité qui a reçu le plus de sacrifices. L’air et le vent n’ont pas non plus été oubliés.
Le feu, qu’il ait été considéré comme un dieu ou comme un intermédiaire entre l’homme et les dieux, fut souvent le principal agent du sacrifice. C’est lui qui fut chargé, au cours des siècles et chez tous les peuples, de transformer l’offrande des fidèles : celle-ci étant consumée par le feu. Mais le suppléant de la divinité qui s’est montré partout le plus difficile à rassasier, ce fut le prêtre : le sorcier des sauvages s’empare des gâteaux et des victuailles destinées aux dieux ; le féticheur polynésien se charge de faire parvenir aux esprits les aliments à eux offerts ; le brahmane reçoit, moyennant finance, l’offrande de quiconque ne possède pas le feu sacré pour la consumer ; et le prêtre chrétien offre à son dieu le sacrifice de la messe et de ses prières, moyennant une honnête redevance !
Qu’a-t-on offert aux puissances surnaturelles ?
Dès les commencements, les viandes, les breuvages, les aliments de tous genres, ont été les aliments du sacrifice. On offrit aux dieux du sang, des parfums, la fumée des offrandes consumées ; on leur sacrifia les produits de la terre, des animaux, des parures, des objets précieux et rares, et souvent des créatures humaines. Les sacrifices humains s’accompagnant de cérémonies cultuelles compliquées eurent lieu un peu partout. Rappelons les coutumes barbares des aborigènes du Mexique et du Pérou ; les sacrifices humains de la Malaisie ; les offrandes humaines à Moloch et à Baal en Phénicie. Les écritures juives ne nous disent-elles pas que la fumée des chairs brûlées est une odeur agréable aux narines de Jéhovah ? ...
Plus tard, quand l’homme inventa que la nature des dieux était identique à celles des esprits, des fantômes, des choses mortes, il renonça à les nourrir de substances matérielles, il les supposa capables de déguster l’âme des offrandes. Les matières alimentaires ne furent plus offertes directement aux divinités, la vapeur odorante qui s’en échappe est censée les nourrir. Nous en arrivons ainsi aux parfums brûlés sur l’autel en l’honneur des êtres invoqués. La fumée de tabac, les résines odorantes, les bois odoriférants, les fumigations de plantes, l’encens et la myrrhe ont été offerts aux dieux. L’animisme ne voyait, dans ses pratiques, rien de choquant. Puisque les esprits et les dieux sont des fantômes impalpables, faits d’autre matière que celle des vivants, il est juste qu’ils se nourrissent de l’âme des êtres et des choses sacrifiées. De même que les fantômes des morts emportent avec eux les fantômes des esclaves, des femmes, des armes, des objets immolés sur leurs tombes ou brûlés avec eux, de même les dieux se repaissent d’essences réelles mais invisibles.
Evoluant, l’homme sans cesser de croire à l’appétit des dieux, à l’avidité des animaux sacrés, de l’eau, du feu, finit par restreindre le montant et la valeur des sacrifices. Tantôt la partie sera donnée pour le tout ; tantôt la substitution d’une personne à une autre ou celle, plus fréquente, d’un animal à un homme suffira à contenter le dieu.
Comme conséquence du sacrifice par substitution, apparut bientôt le sacrifice par effigie qui, lui aussi, fut en grand honneur. On a offert aux entités surnaturelles des figurines d’hommes et d’animaux, en bronze, en terre cuite, en farine, en cire, en pâte, en beurre. Ces figurines remplaçaient les victimes désignées et les dieux parurent fort bien se contenter de cette substitution. Les ex-votos offerts si libéralement par les dévôts aux dieux qu’ils implorent se rattachent au sacrifice par substitution et sont, actuellement, une des plus riches mines exploitées par les clergés.
Dans les temps où s’est développé le sentiment moral, où l’homme a idéalisé dans la personne de ses dieux, ses plus hautes facultés, on admit vite que l’hommage le plus agréable à une puissance céleste était une vie pure, la pratique de la vertu, l’effort vers le bien. De cette donnée du sacrifice moral, le mysticisme a tiré les plus étranges et les plus funestes conséquences. Il a placé la vertu dans l’étouffement des facultés naturelles, dans la suppression des qualités les plus nobles de l’homme ; il en est revenu aux mutilations physiques, aux ascétismes barbares faisant de la divinité un être malfaisant se complaisant aux douleurs, aux désespoirs, aux calamités de l’homme. La résignation passive et stérile aux pieds des autels est ainsi devenue l’instrument d’un salut imaginaire.
Ajoutons à la théorie du sacrifice l’aberration suprême : celle qui offre à la divinité, non plus les peines de l’homme mais les souffrances des dieux. On avait sacrifié aux divinités des victimes humaines, la vie des femmes, des enfants, des choses bonnes et belles ; on leur offrit finalement des dieux, fils de dieux. Des victimes humaines, considérées comme l’image, la réplique vivante des dieux, étaient nourries et soignées pendant des mois chez les Aztèques et les Colombiens avant d’être finalement offertes en holocauste à leur père céleste. Dans l’Inde Védique, le dieu Sorna — la liqueur sacrée — était immolé par Agni, aux puissances célestes. Le sacrifice chrétien, l’Eucharistie, n’est pas autre chose que l’offrande d’un dieu fils à un dieu père, comme gage d’expiation et de rédemption.
Mais, quelque forme qu’il prenne, le sacrifice religieux est, avant tout, un troc, un échange, donnant, donnant ! C’est un marché entre l’homme et les dieux. Il procède de la même conception que la prière et, comme elle, il se réduit à ce fait très humain que le meilleur moyen de gagner la bienveillance d’un ami ou de désarmer la colère d’un ennemi est de lui faire cadeau d’un objet qu’il soit heureux de posséder. Il est naturel, quand on achète, de s’en tirer à meilleur compte et d’essayer de faire accepter des valeurs médiocres, c’est pourquoi nous avons vu les dévôts offrir la partie pour le tout, l’image pour le corps, des paroles, des gestes pour des présents. D’un autre côté, l’intérêt dominé par la crainte et la vanité, a jeté le fidèle dans la voie de la prodigalité. Qui donne le plus reçoit davantage. Les dieux savent toujours réserver leurs faveurs à ceux qui peuvent les gorger de choses agréables. Mais, avant tout, le mobile moteur de tous les sacrifices, c’est la crainte ! L’homme ne traite pas d’égal à égal avec les dieux. Il doit réparer les fautes commises, expier les peccadilles, les péchés dont il s’est rendu coupable. En même temps qu’il négocie les bienfaits qu’il implore, il doit essayer d’alléger le joug des charges et des obligations que lui imposent les divinités. Le sacrifice, hommage et moyen d’expiation à la fois, lui fournit la possibilité de faire ces deux choses. Il faut donner, toujours donner, pour soi et pour les siens. Et il faut mesurer l’offrande non seulement à son intérêt, mais au rang de la divinité. Et les hommes ont offert aux dieux ce qu’ils avaient de plus précieux : captifs, femmes, bijoux, etc..., leur représentation humaine, leur image et, fantaisie ironique, des dieux à d’autres dieux. Plus tard, ce furent des actes méritoires : les vertus, les efforts, les épreuves, les travaux de l’humanité. Si bien que, finalement, les « dieux bons » se muèrent en despotes barbares appréciant plus les larmes et le sang que les bienfaits rendus à la race humaine ! Est-il besoin d’ajouter que les clergés trouvèrent amples bénéfices à cette théorie du sacrifice qu’ils ont su maintenir vivace à travers les siècles.
Le langage courant donne au mot « sacrifice », très abusivement du reste, le sens de désintéressement absolu. Une grande partie des hommes d’aujourd’hui ont cessé de sacrifier aux dieux, mais ils accomplissent quand même des sacrifices aussi inutiles que destructifs.
Faut-il parler des sacrifices consentis aux conceptions, imposées par l’éducation, du droit et du devoir, de la conscience, pour obtenir l’estime des autres ?
Est-il nécessaire de rappeler et d’insister longuement sur la nocivité des sacrifices consentis à la patrie, aux autorités de tous genres qui régentent les hommes ?
Est-il besoin de faire ressortir la puissance des mille et une concessions faites — dans un esprit de sacrifice — aux interdictions multiples des codes moraux qui enserrent l’homme dans un réseau serré qui réduit la liberté au strict minimum ? Les sacrifices laïcs, consentis à la patrie, aux gouvernants, aux morales officielles, aux us et coutumes de nos contemporains, se rattachent, par des affinités profondes aux plus vaines erreurs, aux plus stupides pratiques de nos aïeux et de leurs successeurs, fossiles attardés parmi nous. Ils sont juste bons à restreindre, au profit de quelques-uns, notre liberté et notre joie, car chacun d’eux est une concession faite aux mensonges et aux erreurs d’un passé lourd de souffrance.
Il nous reste cependant à parler d’une espèce de sacrifices accomplis par des hommes dignes de ce nom. Ce sont les sacrifices consentis, au cours de l’histoire, par tous les novateurs, les savants, les philosophes, les artistes, les chercheurs, pour le bonheur et l’éducation de l’humanité. Qui ne sait, au prix de quelles peines, de quelles souffrances, ces hommes, mûs par un noble idéal, ont pu, malgré les avanies et les persécutions dirigées contre eux par l’ignorance du peuple et la haine des puissants, dont ils menaçaient, par leur apostolat, les privilèges, se donner tout entiers à leur oeuvre d’émancipation intellectuelle et morale de l’humanité ! Oui, ces sacrifices accomplis, au cours des siècles par ces hommes, depuis le savant qui peine et cherche les remèdes efficaces contre la souffrance humaine, jusqu’à l’artiste qui synthétise dans son oeuvre le cri de révolte et la protestation de tous ceux qui peinent et qui souffrent, en passant par l’humble propagandiste ouvrier qui, malgré l’hostilité ambiante, sacrifie son repos et sa sécurité, pour apporter à ses frères de misère, un peu de la vérité que d’autres lui ont apprise ; ces sacrifices, dis-je, sont aussi dignes d’éloges et d’admiration que l’est celui de l’être qui risque sa vie pour arracher à la mort une existence menacée. Ce sont les seuls utiles, car ils ont pour but unique de soulager la peine des hommes et ils sont aussi éloignés de l’intérêt grossier et égoïste des sacrifices religieux et laïcs que nous le sommes de la plus lointaine étoile perdue aux confins de la Galaxie.
— Charles ALEXANDRE.
SAGE
Le mot « sage » est un cas assez rare en sémantique (science des changements de sens des mots). La plupart des mots se dégradent à l’usage. « Garce », longtemps, fut aussi peu injurieux que son correspondant masculin, le simple féminin de garçon. Pour prendre un exemple plus voisin de mon sujet, quel outrage est devenu le nom de « sophiste » qui, à l’origine, désignait un maître de sagesse ! Sage, au contraire, s’est plutôt ennobli. Et nous avons un sursaut quand nous lisons dans La Fontaine :
Or le fabuliste parle comme la haute antiquité grecque, celle qui a honoré, dans les Sept Sages, plus d’hommes habiles que de philosophes.
Les listes des sept sages ont beaucoup varié : à réunir tous les noms qu’elles donnent, les Sept seraient seize. Dans son Protagoras, Platon fait nommer par Socrate : Thalès, Pittacus, Bias, Solon, Cléobule, Myson et Chilon. A une exception près, c’est cette liste qui est devenue classique. Myson, dont nous savons uniquement qu’il était laboureur et que quelques-uns lui attribuent la paternité — ordinairement accordée à Chilon — du fameux « Connais-toi toi-même », est ordinairement remplacé par Périandre.
Ce Périandre était, à Corinthe, un abominable tyran. Il eut, sans doute, la sagesse de mépriser le tabou de l’inceste et de coucher, puisque ça plaisait à l’un et à l’autre, avec sa mère Cratéa. Mais sa cruauté froide était terrible, et aussi sa colère : dans un accès de fureur, il précipita du haut des degrés de son palais sa femme enceinte, et elle mourut de la chute. Un habitant de Corcyre ayant tué son fils Lycophron, il voulut faire des eunuques avec trois cents jeunes Corcyréens qu’il détenait en otages. Un hasard ayant arraché ces jeunes gens de ses mains, il mourut de rage à quatre-vingts ans. Mais on l’admirait comme général et comme subtil politique. Le geste fameux de Tarquin abattant symboliquement les fleurs les plus hautes était imité de Périandre conseillant son ami Thrasibule, tyran de Milet. Il disait :
« L’ami même d’un tyran doit lui être suspect. »
Est-ce à son habileté pratique qu’il doit surtout sa place dans la liste glorieuse ? Est-ce à quelques maximes nettes et bien frappées ?
« Sois modeste dans la prospérité, ferme dans l’adversité. » — « Que ton ami soit heureux ou malheureux, sois le même avec lui. » — « Le gain honteux est un trésor trop lourd. »
Celle-ci est plus digne d’un tyran et fait du prétendu sage un glorieux précurseur des inquisiteurs et du signore Mussolini :
« Punis non seulement le crime, mais l’intention. »
Un questionneur hardi demandait à Périandre pourquoi il n’accordait point, par une abdication, le repos à sa vieillesse inquiète. Il répondit :
« C’est qu’il est aussi dangereux de quitter volontairement le trône que d’en être renversé. »
Pittacus, tyran de Mytilène, semble, malgré les injures méritées dont l’accable le poète Alcée, avoir été moins inhumain que Périandre. Le hasard des combats ayant fait de l’injurieux Alcée son prisonnier, il lui rendit la liberté en disant :
« Il est meilleur de pardonner que de punir. »
Les sentences qu’on a conservées de lui sont, la plupart, de bons conseils d’arriviste :
« Saisis l’occasion. » — « N’annonce pas ton projet ; s’il échoue on se moquerait de toi. » — « Ne blâme jamais ton ami ; ne loue jamais ton ennemi. »
En voici une plus généreuse :
« Les véritables victoires sont celles qui ne coûtent point de sang. »
Il se fatigua de régner, quoi qu’il eût prononcé :
« Le commandement est l’épreuve de l’homme. »
C’est sans doute après son abdication qu’il formula :
« Parmi les animaux sauvages, le pire est le tyran ; parmi les animaux domestiques, le pire est le flatteur. »
Solon est-il beaucoup meilleur que ce tyran aux qualités mêlées ? Il est coupable d’avoir fait entreprendre et d’avoir conduit la guerre contre Salamine. Et, si ses lois sont moins dures que celles de Dracon qu’elles remplacèrent, est-ce à lui qu’on le doit ou à l’adoucissement général des mœurs ? Poète remarquable, il est probablement, avec Thalès, le mieux doué intellectuellement des sept sages. Il philosopha et resta poète jusqu’à la fin. Il disait :
« Je vieillis en apprenant toujours. »
Bias paraît bilatéralement noble, qui disait : « Je porte tout mon bien avec moi » et qui, très éloquent, ne voulut jamais défendre que les causes qui lui paraissaient justes. Ses sentences sont belles :
« Pendant que tu es jeune, prépare à ta vieillesse un viatique de sagesse : c’est le plus sûr des trésors. » — « Sois lent à entreprendre, persévérant quand tu as entrepris. » — « Désirer l’impossible est une maladie de l’âme ; une autre maladie de l’âme, c’est de ne pas songer aux maux d’autrui. »
Une autre de ses maximes est bien désenchantée :
« Aime comme si tu devais haïr un jour, car la plupart des hommes sont pervers. »
Chilon est l’auteur probable du « Connais-toi toi-même ». Voici d’autres sentences de lui :
« Si tu es puissant, sois bienveillant et applique-toi à inspirer plus de respect que de crainte. » — « Plutôt une perte qu’un gain honteux : la perte ne t’afflige qu’une fois ; le gain honteux te cause des regrets éternels. » — « Que ta langue ne devance pas ta pensée. » — « Sois plus empressé auprès de ton ami quand il est malheureux. »
Cléobule, vantant toujours la mesure et le juste milieu, est le précurseur d’Aristote moraliste.
Il y a, parmi les Sept Sages, un véritable grand homme, Thalès de Milet, père de la philosophie naturelle. Celui-ci a une doctrine systématique. C’est par lui que s’ouvre l’histoire de la philosophie et de la science grecques. Comme frappeur de sentences, on connaît surtout ses ingénieuses réponses :
« Qu’y a-t-il de plus grand ? — L’espace, qui contient tout. — De plus puissant ? — La nécessité, qui soumet tout. — De plus sage ? — Le temps, qui découvre tout. — De plus commun ? — L’espérance, qui reste même à qui n’a plus rien. »
Les sophistes — dont le nom signifie à peu près sages professionnels — sont, en moyenne, très supérieurs à la moyenne des Sept Sages officiels et ils comptent parmi eux des intelligences de premier ordre, comme Protagoras, Gorgias, Prodicus, Socrate ou Hippias. Prodicus et Socrate sont aussi, paroles et conduite, de véritables sages, ce qui leur valut d’être abondamment raillés par leurs contemporains et de boire la ciguë.
Entre la génération des Sept Sages (fin du VIIe siècle avant J.-C. et commencement du VIe) et la génération des sophistes (Vè siècle), Pythagore, très suivi dans cette voie, avait renoncé à un titre trop ambitieux et se disait non plus sage, mais simple Ami de la Sagesse (Philosophe). Pourtant, nous donnons volontiers le titre de Sages à Prodicus et à son élève Socrate, à Diogène, à Zénon de Cittium, à Cléanthe, à Epictète, à Dion Bouche-d’Or ou à Epicure. Nous n’hésiterions guère plus à en décorer Jésus, si nous étions certains que le Sermon sur la Montagne a quelque authenticité. Même parmi les modernes, un Spinoza, un Tolstoï, un Elisée Reclus ou un Gandhi (malgré, chez ce dernier, un fâcheux relent de nationalisme) sont des sages. Et ce titre ne doit-il pas encore être accordé à tous les hommes de bonté et de tolérance, aux célèbres et aux inconnus, à un Voltaire comme à un Castellion ?
A moins que nous ne voulions, avec les stoïciens, le réserver à un idéal si absolu, que personne ne peut l’atteindre, sauf peut-être, dans les rêveries des philosophes cyniques et dans sa légende mi-divine, Hercule lorsqu’il n’était pas fou jusqu’à tuer ses enfants.
— HAN RYNER.
SAGESSE
Le mot sagesse a quelques significations un peu folles, celles par exemple que Littré classe 2° et 3°.
« 2° La connaissance inspirée des choses divines et humaines. »
Bossuet qui, d’une langue éloquente, lèche les pieds puissants, nous apprend que Michel Le Tellier, grand artisan de la Révocation de l’Edit de Nantes, possédait :
« Cette sagesse qui vient d’en haut, qui descend du père des lumières et qui fait marcher les hommes dans les sentiers de la Justice. »
Plaisante sagesse, ou odieuse, et odieuse ou plaisante justice qui, étant infinie en Dieu, doit, d’après le même Bossuet, s’exercer « à la fin par un supplice infini et éternel ». La troisième signification enregistrée par Littré, greffier des usages successifs, n’est pas moins étourdissante. Cette Sagesse-là (avec une majuscule, S. V. P.) c’est le très lui-même Verbe et, quand on songe qu’au rêve du Quatrième Evangile, il s’est fait homme, on l’appelle : La Sagesse incarnée. Mais cette chasteté qu’on nomme sagesse « en parlant des femmes » est-elle beaucoup moins déraisonnable, ou même cette docilité endormie qui vaut aux petits enfants « le prix de sagesse » et aux grands bébés les prix et les fauteuils académiques ?...
Le terme sagesse a pourtant une signification que j’aime. I1 désigne la prudence persuasive des anciens par opposition avec le tyrannique et absurde dogmatisme des théologiens modernes, de ceux même qui se croient philosophes et indépendants ; Pour mon livreLa Sagesse qui rit, j’avais rédigé cette bande : A bas les morales, vive la Sagesse ! Oui, je méprise quiconque prétend imposer une morale, fausse science de la Vie : mais j’aime ceux qui ont connu et pratiqué la sagesse, art souriant et individualiste de la conduite.
Nulle part ne se rencontre une science du désirable. Toute discipline du désirable ne peut être qu’un art et garde la grâce d’être diverse avec les divers artistes. Désintéressée au point d’ignorer tout effort téléologique, la science cherche la vérité, non la beauté, ce qui est au réel, non ce que j’aimerais.
Devant les morales qui se prétendent scientifiques et universelles, qui osent affirmer et qui osent ordonner, rions et gaussons-nous en immoralistes. Mais nous pouvons considérer d’un œil fraternel et parfois admiratif les sagesses qui conseillent fraternellement et qui harmonisent.
Quand nous aimons ou admirons un artiste, nous ne lui faisons pas l’injure et nous ne faisons pas à nous-même le tort de l’imiter. Les seuls conseils que nous donnent notre amour et notre admiration pour ceux qui se sont exprimés, c’est de nous chercher et de nous réaliser nous-mêmes.
Et, comme nous aimons des poètes très différents, comme nous ne voulons sacrifier ni La Fontaine ou Paul Verlaine à Victor Hugo, ni Victor Hugo à Racine ou à Vigny, nous admirons dans leurs émouvantes divergences, Diogène et Cléanthe, Jésus et Epicure. Nous les aimons d’être aussi différents que Shakespeare ou Molière, que Marivaux ou Calderon.
Et nous ne voyons pas ici, comme dans la science, un progrès qui nous engage à écouter le plus récent de préférence aux plus anciens. Archimède sait moins de vérités physiques que M. Branly ou même que le plus vulgaire de nos licenciés ès-sciences. Tolstoï n’est pas plus avancé que François d’Assise ; l’individualisme d’Ibsen n’est pas plus complet que celui de Diogène ; la vérité d’Elisée Reclus ou de Sébastien Faure s’exprime en un langage plus voisin de notre langage, mais n’est pas, par elle-même, plus instructive et libératrice que celle chantée par Cléanthe ou précitée par Dion Bouche d’Or.
La morale se veut absolue, comme la religion ou comme le prétendu immoralisme du Surhomme. Leurs impératifs, pour parler allemand, se prétendent catégoriques.
Or il ne saurait y avoir — pour conserver le vocabulaire kantien — que des impératifs hypothétiques. L’hypothèse reste inexprimée quand on suppose que je veux la réaliser. Parce que le médecin suppose que je veux guérir et que j’ai confiance en lui, il appelle tyranniquement « ordonnances » ses conseils.
Impératif catégorique, devoir : mots grotesques. A qui est-ce que je dois le prétendu devoir ? Où est le créancier dont je serais le débiteur ? A moi seul, à mon bonheur, à ma beauté, à mon harmonie je puis faire tel ou tel sacrifice.
Mais mon rêve de bonheur et d’harmonie ne peut que me conseiller et me persuader. Et tout autre but que mon bonheur, si je ne suis pas fou, me touche moins et a moins d’autorité sur moi.
Quel autre but, d’ailleurs ? Le bonheur d’autrui. Je puis lui attribuer une valeur égale à celle que j’accorde au mien. La sympathie ne saurait aller au-delà et i1 n’y a aucune raison raisonnable pour que je me préfère qui que ce soit. Or je sais que je peux pour autrui moins que pour moi, que je risque de me tromper pour lui plus que pour moi. Les conseils qui le concernent sont plus hypothétiques que ceux qui me concernent : ils s’appuient et chancellent sur un monde de suppositions.
Des fins plus générales que le bonheur d’un homme ? Il y en a ; mais ma puissance s’y dilue vite, ou mon intelligence. Je ne réussis guère mes volontés générales et je me pardonne parce que, sachant encore ce que je veux ou plutôt ce que je voudrais, je ne sais plus ce que je fais. D’ailleurs, si universelle qu’on suppose une fin, dès que, comme un généreux canal d’irrigation, elle ne se divise pas en bras nombreux et en biens individuels, elle devient chimère et grimace.
La morale, la religion, le nietschéisme, tout ce qui est mensonge est condamné à ordonner. Les mensonges théologiques, patriotiques ou la volonté de puissance exigent toujours — et le conseil n’y saurait suffire — des sacrifices humains. Parfois les bûchers de Moloch, de l’Inquisition ou de l’Oeta deviennent internes. Même alors, ils me commandent de brûler un homme : moi-même. Pour me purifier, paraît-il, ou pour m’apprendre à me surmonter. Eh bien, non, ce n’est jamais à moi-même, à un moi réel et concret que j’offre l’étrange sacrifice. C’est toujours à quelque « dieu inconnu ». Quelque nom qu’il porte, Tu-Dois et Dieu personnel ou Je-veux et Surhomme, c’est un fantôme ; et c’est un aveugle ; et c’est un dément. C’est un des sous-hommes qu’il me faut mater en moi.
La sagesse veut l’homme complet et harmonieux. L’harmonie ne s’obtient ni par des amputations, ni par des ordres, ni par des brutalités. La sagesse sourit et conseille.
— HAN RYNER.
SAINT-OFFICE
Dans l’usage commun, Saint-Office est synonyme d’Inquisition (voir ce mot). Au sens propre, la Congrégation du Saint-Office n’est que l’inquisition de Rome. Deux caractères particuliers distinguent le Saint-Office : il montrait une douceur relative et on devine que, espagnol, Galilée n’eût pas évité le bûcher ; les autres Inquisitions ont disparu, mais le Saint-Office existe toujours, attente et menace.
— H. R.
SAINT-SIÈGE
Le siège ne se définit pas seulement un « meuble fait pour s’asseoir » ou « la partie inférieure du corps sur laquelle on s’asseoit ». Le même mot désigne un « évêché et sa juridiction ». Quand il s’agit de l’évêché de Rome, on dit le siège pontifical, le siège apostolique ou le Saint-Siège. Pourtant, le Saint-Siège fut assez longtemps transféré à Avignon et il y eut même, quelques années, un Saint-Siège à Perpignan.
La primauté du siège de Rome fut longue à s’établir et on n’ignore pas que, durant des siècles, chaque évêque était indépendant ou, comme on disait, autocéphale et prenait, avec autant d’humilité que ceux de Rome ou de Constantinople, les titres de pape et de patriarche. Depuis longtemps, on enseigne aux fidèles que la primauté de Rome est d’origine divine, puisque Jésus, qui est Dieu, a dit à Pierre : « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église » et puisque Pierre fut, nous assure-t-on, le premier évêque de Rome. Or, dans la mesure où une négation historique peut se démontrer, il est prouvé que Jésus n’a jamais prononcé le précieux Tu es Petrus, et, aussi, que saint Pierre n’est jamais allé à Rome.
Remarquons, en souriant, avant d’entrer dans cette souriante démonstration, que Jésus, quand il parlait à Pierre, avait d’autant moins l’intention de s’adresser à Alexandre VI ou à Pie XI, que les deux interlocuteurs attendaient la fin du monde avant la fin de leur génération.
Saint Irénée, mort en 202, a écrit Un ouvrage célèbre Contre les hérésies. Il cite tout ce qu’il peut trouver dans les Ecritures en faveur de l’Unité et particulièrement, qui ne prouvent pas grand chose, les versets 16 et 17 du seizième chapitre de Mathieu. Mais il ignore les versets l8 et 19 qui forment ce qu’on appelle aujourd’hui un argument massue :
« Et moi je te dis aussi que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église et les portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des deux ; et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. »
Irénée cherchant éperdument aux Évangiles tout ce qui peut affermir unité et orthodoxie citant de nombreux passages peu pertinents et négligeant la citation capitale, prouve, pour quiconque n’a pas la foi, que le Tu es Petrus lui est postérieur. (Or, du temps d’Irénée, les Évangiles sont relativement complets. Le révérend Père Lodiel, de la Compagnie de Jésus, qui s’est amusé à compter Nos raisons de croire, (p. 57), a trouvé dans Irénée 469 citations des Évangiles ; dans Justin martyr, mort 35 ans plus tôt, les recherches les plus minutieuses n’en découvrent encore que 18.)
Ajoutons à cette preuve des indications corroborantes : Jésus, au temps de la Synagogue, n’a pu prononcer le mot Église. Cet anachronisme date l’interpolation. D’autre part, si on lit le texte en supprimant les deux versets, trop favorables à Pierre, les idées se suivent de façon beaucoup plus naturelle. Pierre ayant déclaré (verset 10) que Jésus est le Christ, Jésus lui répond (Verset 17) que seul le Père a pu lui révéler cette vérité et il défend (verset 20) de la répéter à personne. Même la suture est assez maladroite, puisque Jésus est censé rattacher l’interpolation à un discours commencé par cette manière d’exorde :
« Et moi je te dis aussi. »
Quant aux preuves du séjour de Pierre à Rome, je les copie dans un ouvrage d’enseignement approuvé par deux évêques et un archevêque. Histoire de l’Église de l’abbé E. Beurlier.
Je lis, pages IX et X :
« Saint Ignace, contemporain de l’empereur Trajan, Saint Clément, qui vivait sous Domitien, parlent du martyre de Saint Pierre et de Saint Paul comme ayant eu lieu dans la capitale. (C’est moi qui souligne, on verra bientôt pourquoi, ces mots effrontés.) Bien plus, l’épître de Saint Pierre, datée de Babylone, est elle-même un témoignage irréfutable ; car on sait que ce nom désignait la ville impériale dans le langage symbolique des Juifs. A supposer même, avec les rationalistes, que ce document fût apocryphe, il serait encore un argument en faveur de notre thèse, car le faussaire n’aurait pas commis l’imprudence de dater la lettre d’un endroit où l’apôtre ne serait jamais allé. Enfin, le dernier chapitre de l’Évangile de Saint Jean suppose que l’apôtre connaissait la mort de Saint Pierre. »
Admirable faisceau de preuves. Sur l’ignorant qui lit vite — sur presque tout le monde — il produit conviction ou au moins ébranlement. Or il n’y a là qu’un hardi entassement de mensonges et d’apparences.
Accordons un certain nombre de choses inaccordables. Supposons que le tardif évangile, dit effrontément selon Saint Jean, présente les connaissances de Jean dit effrontément l’évangéliste. Ne supposons aucune interpolation dans son dernier chapitre. Oublions que l’aventure de Marc, dont les douze derniers versets sont encore ignorés des manuscrits du IVe siècle, nous met particulièrement en garde contre les derniers chapitres. Ne remarquons pas que la suite bizarre des idées dans Jean XXI, 15–19, oblige le critique à tous les soupçons. Lisons avec la plus imméritée des confiances. Que trouvons-nous dans ces fameux versets ? Une prédiction de la mort de Pierre par Jésus qui prouve, pour nous comme pour l’abbé Beurlier, que Pierre était mort quand cette prédiction fut écrite. Personne ne conteste à M. Beurlier que Pierre soit mort. Malheureusement, l’Évangile néglige le seul détail qui ferait du raisonnement à Beurlier autre chose qu’une fumisterie : il ne nous apprend pas en quel lieu Pierre est mort. Nulle mention ici, ni de Rome, ni même de Babylone. Ce premier témoignage est donc admirablement ridicule comme preuve du séjour de Pierre à Rome.
Examinons le second, probablement plus ancien que le premier. Saint Clément, que les listes catholiques des papes nous donnent comme évêque de Rome de 88 à 97 ou de 91 à 100, a écrit son épître aux Corinthiens avant le quatrième Évangile. J’emprunte à l’abbé Fleury (tome I, pp. 209–210) la traduction du témoignage de Clément :
« C’est par une jalousie injuste que Pierre a souffert, non une ou deux fois, mais plusieurs fois et, ayant ainsi accompli son martyre, il est allé dans le lieu de gloire qui lui était dû. »
C’est tout, et Rome n’est point mentionnée. Pourtant un savant catholique me prie de continuer ma lecture. Il est maintenant question du martyre de Paul. Clément ajoute à ces deux hommes « une grande multitude d’élus ». Et toutes ces victimes de l’envie « ont été parmi nous un illustre exemple ». Parmi nous, sous la plume de Clément Romain signifie clairement à Rome et l’allusion est lumineuse à la persécution de Néron. Ainsi triomphe le savant catholique. Je lui réponds que cet argument aurait une valeur si Clément ne citait pas d’autres victimes de l’envie que Pierre, Paul et les martyrs de l’an 64. Par malheur, il a nommé auparavant quelques autres personnages qui, je crois bien, ne sont pas tous morts à Rome : Abel, Jacob, Moïse, Aaron, Marie, sœur de Moïse, et David.
D’ailleurs, si Pierre est mort en 64, la confusion de Rome et de Babylone, inexplicable avant 70 et le Siège de Jérusalem, devient d’une telle bizarrerie... Selon la thèse catholique, Pierre serait à Rome dès l’an 42. Alors, comment Paul, en 58, écrit-il aux Romains qu’il se propose d’aller les évangéliser et leur envoie-t-il une longue dissertation bien inutile à des gens qui jouiraient de l’enseignement de Pierre ? Et comment, lui qui salue une vingtaine de fidèles, néglige-t-il de saluer Pierre ?
Si l’Epître aux Corinthiens de Clément ne fait aucune allusion au séjour de Pierre à Rome, il n’en est pas de même desRecognitions que plusieurs appelaient l’Itinéraire de Saint Pierre. Malheureusement, les critiques catholiques eux-mêmes reconnaissent depuis longtemps les Recognitions comme apocryphes. A supposer l’œuvre authentique et son témoignage véritable, Pierre aurait séjourné à Rome. Mais, loin d’avoir aucune primauté, il se serait reconnu l’humble subordonné de Jacques, évêque de Jérusalem, lui aurait adressé, pour obéir à un ordre, un rapport annuel sur ses actes et ses paroles. Il aurait salué en Jacques :
« l’évêque des évêques, qui dirige à Jérusalem la sainte Église des Hébreux et toutes celles que la Divine Providence a établies en quelque lieu que ce soit. »
D’après ce témoignage, Pierre aurait donc séjourné à Rome ; mais Rome et Pierre sont dégradés au profit de Jacques et de Jérusalem. Si nous consentons au titre anachronique, Jacques fut, pour le saint Pierre des Recognitions, le premier pape.
L’épître de Saint Ignace aux Romains, à la croire authentique et sans interpolation — mais Mgr Duchesne n’ose aucune des deux affirmations — contiendrait peut-être, suivant la façon de comprendre un passage, la première trace de la tradition du séjour de Pierre à Rome. Ignace adresse aux chrétiens de Rome des prières.
« Je ne vous ordonne pas — ajoute-t-il humblement — comme Pierre et Paul. »
Faut-il entendre : comme Pierre et Paul ordonnaient aux Romains ou comme ils ordonnaient à tous les chrétiens ? Ordonnaient-ils de vive voix ou, comme prie Ignace, par écrit ? Avec quelque complaisance, on trouve donc, vers l’an 110, le fragile commencement d’une tradition qui prendra des forces en vieillissant.
N’oublions pas la première épître de Pierre datée de Babylone. Elle est reconnue apocryphe par tous les critiques indépendants. D’ailleurs, une lettre écrite à Rome ne se datait pas de Babylone. Dans la littérature chrétienne primitive, nous ne trouvons l’identification des deux villes que dans l’Apocalypse, le plus symboliste des pamphlets. On croit généralement que la fausse lettre de Pierre a été fabriquée précisément pour donner à une église un titre de noblesse. La Babylone dont il s’agit ici n’est pas la grande ville de Mésopotamie qui n’eut d’église qu’assez tard. C’est la Babylone d’Égypte (le vieux Caire), dont l’Église voulut se donner pour plus ancienne et plus noble que sa voisine d’Alexandrie qui se réclamait de Marc.
Saint Paul a écrit une longue épître aux Romains et il ne les a pas appelés Babyloniens. Authentiques ou apocryphes, les épîtres que Paul écrivit à la fin de sa vie ou qu’on supposa écrites dans cette période sont datées de Rome, jamais de Babylone. On y trouve les mentions :
« Écrite de Rome aux Galates », « Écrite de Rome aux Ephésiens », etc...
On peut vérifier toute la série. Quand une lettre était écrite à Rome ou qu’on voulait lui faire supposer cette origine, les exemples de Paul et de pseudo-Paul prouvent, comme nous nous en doutions, qu’on datait de Rome, non de Babylone.
La primauté de Pierre et son séjour à Rome d’où on tire, par un raisonnement hardi, l’infaillibilité d’Alexandre VI ou de Pie XI, sont deux mensonges. Mais n’y a-t-il pas prescription et ne devons-nous pas respecter, avec le Saint-Siège, d’aussi vénérables mensonges ?...
— HAN RYNER
SALAIRE
n. m.
Le salaire, a-t-on coutume d’affirmer, est la somme destinée à quelqu’un qui effectue un travail ou rend un service. Il est à peine besoin d’insister sur le caractère simpliste de cette définition. En effet, pour être exacte, il faudrait qu’elle spécifiât que la somme reçue représente, aussi justement que possible, la rétribution totale de l’effort produit, du travail accompli, du service rendu. En outre, le salaire représentant le pouvoir d’achat, la puissance de consommation du producteur, du travail, il faudrait qu’il correspondît toujours aux nécessités de l’existence, dans l’ordre social actuel et, pour le moins, qu’il suivît le coût de la vie dans ses fluctuations constantes.
Au cours de l’étude que j’ai consacrée : Chère (la vie) (pp. 330 à 332 de l’Encyclopédie anarchiste), j’ai montré quelle était la différence existant entre le salaire nominal et le salaire réel, en faisant intervenir, précisément, ce facteur : le coût de la vie (voir à ce sujet Etudes et Documents du Bureau International du Travail, série D, n°10, de juin 1925), dont les réactions sur le salaire nominal sont telles qu’elles déterminent de façon constante le salaire réel dans un endroit donné. C’est ainsi que le salaire réel de 1933, par rapport à celui de 1913, basé sur l’indice 100 à cette époque — en admettant qu’en 1913 le salaire réel et le coût de la vie étaient à égalité — se détermine comme suit :
Salaire réel = Salaire nominal × 100 / Coût de la vie
Encore, convient-il de faire remarquer que ces calculs ne sont qu’approximatifs, en raison des différences de conditions de vie existant aux deux époques considérées : 1913 et 1933 et d’admettre — ce qui est manifestement inexact — que les besoins de l’homme sont restés identiques. La loi du progrès condamne formellement une telle conception. A mon avis, l’homme a sans cesse des besoins nouveaux, différents en tout cas, et aucune assimilation n’est possible entre les deux époques dont il s’agit.
Quoi qu’il en soit, un fait indiscutable subsiste : l’individu ne reçoit, à tout moment et en toute circonstance, sous forme de salaire, qu’une rétribution partielle de son effort et cette rétribution, en vertu de la loi d’airain, mise en avant par Lassalle et assez justement formulée, ne permet à l’homme que de produire et se reproduire, c’est-à-dire : de satisfaire ses besoins immédiats et de se perpétuer, pour assurer la pérennité du système capitaliste. Le reste — la partie la plus importante — est conservé par l’employeur et sert à rétribuer d’abord le capital engagé par d’autres qui se partagent le fruit d’un travail effectué par autrui ; ensuite, à augmenter, sous le nom de bénéfice, ce capital initial. C’est le système de l’accumulation et de la plus-value sur lequel repose, depuis des siècles, le capitalisme quelle qu’en soit la forme : individuelle ou étatique.
La lutte, aussi vieille que le monde, menée par les travailleurs pour conquérir des salaires meilleurs et aussi adéquats que possible au coût de la vie, n’a guère modifié cette situation. Et on peut dire que, d’une façon constante, le salaire est resté inférieur aux besoins. Le patronat a toujours su — et par les mêmes moyens — rendre inopérantes toutes les augmentations de salaire arrachées, souvent au prix de luttes ardentes et parfois sanglantes, par les travailleurs. Il lui a toujours suffi d’augmenter parallèlement le coût de la vie pour diminuer le pouvoir d’achat du travailleur et ramener, ainsi, le salaire réel au taux précédent.
Avec ce système, on tourne en rond, dans un cercle infernal, sans pouvoir s’en évader. Il fallait en sortir ou, tout au moins, tenter d’en sortir.
Pour ce faire, la Confédération Générale du Travail Syndicaliste Révolutionnaire (C. G. T. S. R.) a déclaré dans son deuxième Congrès, tenu à Lyon les 2, 3 et 4 novembre 1928, que le coût de la vie ne pouvait servir exclusivement de base au calcul du salaire. Il a signifié au capitalisme qu’il entendait que les travailleurs mesurent et fixent eux-mêmes leurs besoins et il a engagé les prolétaires à exiger du patronat des salaires correspondant à ces besoins, à tous leurs besoins. Il a nié que le salaire soit une marchandise soumise, comme telle, à la loi de l’offre et de la demande. Il a proclamé le droit, pour le travailleur, au bonheur, à la jouissance des biens et richesses de ce monde, produit de la nature et de son effort créateur et transformateur.
Allant plus loin, après avoir refusé à l’employeur de déterminer le salaire du producteur et de mesurer ses besoins réels, il a pris position contre cette autre formule : A travail égal, salaire égal, toujours en honneur à la C. G. T. et à la C. G. T. U. et adopté cette autre formule, infiniment plus humaine et plus juste : A besoins égaux, salaires égaux, plaçant ainsi la femme et l’homme sur un plan d’égalité économique et sociale complète. Ce faisant, le Congrès a non seulement indiqué clairement que la femme, dont la somme des besoins est égale à ceux de l’homme, même si certains d’entre eux sont différents, ne devait pas être astreinte, dans chaque métier où son activité s’exerce aux côtés de l’homme, à produire une quantité de travail égale à celle fournie par l’homme pour recevoir un salaire égal à ce dernier.
La formule : à travail égal, salaire égal, est essentiellement barbare, inhumaine. Son application exige de la femme un effort physique que sa complexion ne lui permet pas de fournir et elle ne tient aucun compte des nécessités de l’existence en ce qui concerne la femme. Si on peut concevoir que le capitalisme l’accepte, quand il y a avantage, on a du mal à comprendre que des organisations ouvrières l’aient faite leur. Certaine d’être dans la bonne voie, la C. G. T. S. R. l’a rejetée. Et elle a eu pleinement raison d’agir ainsi. De ce fait, si le prolétariat comprend la valeur de la formule nouvelle, il obligera le patronat à reconnaître pour tous l’égalité du droit à la vie, sans distinction de sexe.
En outre et par voie de conséquence, il détruira cette conception qui veut que le salaire de la femme ne constitue qu’un appoint à celui de l’homme (sans même considérer que la femme est souvent seule et parfois chargée de famille) et que, partant, il est « normal » que le salaire féminin soit inférieur à celui de l’homme, même si elle produit autant que celui-ci. Enfin, ayant réalisé, sur le plan de la revendication, l’égalité entre les sexes, la C. G. T. S. R. a pensé qu’il fallait aller plus loin encore : réaliser l’égalité des salaires entre tous les travailleurs, quels que soient leurs métiers et les pays où ils exercent leur activité.
Dans ce but, elle a lancé la formule du salaire unique universel. En adoptant cette revendication, en spécifiant que le salaire unique doit être attribué à tout producteur, quels que soient son âge et son sexe, la C. G. T. S. R. a dépassé de loin — et elle le sait — le cadre des réalisations immédiates. Mais elle a considéré que c’était le seul moyen de faire sortir de l’ornière cette question des salaires, de la poser franchement sur un terrain nouveau, en s’inspirant d’un principe général d’une indéniable valeur à tous points de vue. Pour réaliser intégralement ce que contient cette revendication, le prolétariat sait qu’il doit faire des efforts considérables et répétés, mais il sait aussi qu’à l’encontre du passé, ces efforts seront fructueux et apporteront vraiment une solution et non plus des palliatifs sans portée ni durée.
En imposant au patronat le salaire unique universel, le prolétariat empêchera les immigrations massives qui viennent submerger de main-d’oeuvre à bas prix les pays où les travailleurs, par leur action, ont acquis des conditions de vie et de travail meilleures.
Lorsque le salaire sera identique en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Russie, aux Indes, en Chine, en Amérique et au Japon, les travailleurs ne seront plus tentés de répondre aux offres des recruteurs de main-d’oeuvre. S’ils se déplacent, ce sera de leur propre initiative, avec la certitude de retrouver partout des conditions de vie semblables.
De même que la réduction de la journée de travail permettra à tous de travailler, le salaire unique assurera à chacun — où qu’il se trouve — une vie décente. Le prix de la vie — à peu près partout identique — est d’ailleurs un argument de poids qui vient à l’appui de la revendication du salaire unique. La généralisation de la main-d’oeuvre non qualifiée, l’introduction du manoeuvre spécialisé dans les usines et les chantiers, aux lieu et place des professionnels complets, ont eu pour conséquence un nivellement général du salaire par le patronat.
C’est un autre argument de poids, au moins égal, qu’il convient d’utiliser. En opposant à la conception du nivellement par en bas, celle du nivellement par en haut, on obtiendra ainsi le salaire unique que le patronat ne peut plus combattre qu’avec des armes ébréchées par lui-même. Ah ! certes, il y aura, avant de parvenir au sommet, bien des paliers à franchir. Il faudra, sans doute, conquérir un salaire unique local, régional, corporatif, industriel, puis national, mais il ne faudra pas se décourager.
La réalisation du salaire unique, même local, fera plus pour faire tomber les barrières corporatives entre tous les ouvriers d’une même ville que toutes les réunions, tous les appels à la conscience. Le prolétariat, en plaçant la question des salaires sur ce terrain, est assuré de la poser sous son véritable aspect.
Le caractère international d’une telle revendication est évident et, sur ce terrain, face au capitalisme, le prolétariat a pris la seule position possible. En marchant vers l’homogénéité, en opposant au prix de vente unique — qui détermine la cherté de vie unique, qu’il subit comme consommateur — la revendication du salaire unique universel, il prouve son intelligence, sa clairvoyance, son esprit d’organisation et de méthode.
Par son caractère permanent et général, la revendication du salaire unique doit figurer au programme du Syndicalisme révolutionnaire international. Et le prolétariat doit avoir à coeur de la réaliser le plus rapidement, s’il veut qu’un jour, enfin, la question des salaires fasse vraiment un pas en avant.
Je considère, pour ma part, que c’est le seul moyen de sortir de l’impasse dans laquelle nous sommes enfoncés, sans espoir, depuis toujours.
— Pierre BESNARD.
SALARIAT
Etat de celui qui reçoit un salaire. Employé par opposition à patronat, état de celui qui paie un salaire.
— P. B.
SALUT (ARMÉE DU)
L’Armée du Salut est aujourd’hui une des institutions les plus en honneur dans le monde bien pensant et dirigeant. La presse publie ses communiqués et entonne ses louanges et elle jouit d’une réputation si bien établie (?) que, dans les milieux avertis et même dans les journaux qui se targuent de dire à leurs lecteurs la vérité, toute la vérité, on impose le silence aux reporters assez hardis pour oser s’y attaquer (Lectures du Soir, n° du 10 septembre 1932). Récemment, le « Commissaire » qui préside à ses destinées en France, M. Albin Peyrou-Roussel a été fait chevalier de la Légion d’honneur, et par M. Herriot, s’il vous plaît. M. Albin Peyron-Roussel est le fils d’un grand négociant de Nîmes, ancien président de la Chambre de commerce de Montpellier, protestant zélé, venu assez tard au Salutisme. M. Albin Peyron-Roussel épousa la fille du pasteur Napoléon Roussel, décédé récemment, qui eut des démêlés avec les autorités sous le second Empire. Ceci simplement pour situer le milieu où se recrutent les dirigeants de cette organisation qui fait beaucoup de publicité autour de ses oeuvres sociales, que des membres du gouvernement républicain et laïque honorent volontiers de leur présence aux jours d’inauguration.
Il y a un demi-siècle, lorsque les chapeaux 1830 des premières salutistes apparurent sur les boulevards, l’accueil fut loin de ressembler aux honneurs d’aujourd’hui. La fille aînée du fondateur de l’Armée du Salut, Miss Catherine Booth — plus connue sous le nom de la Maréchale — venait de débarquer à Paris, suivie d’un certain nombre de disciples enthousiastes et elle avait édifié son quartier général, non pas comme aujourd’hui, rue de Rome, ou naguère rue Auber, mais quai Valmy, mal éclairé alors, et plus mal fréquenté encore. Des réunions s’y tenaient chaque soir et chaque dimanche après-midi. Les costauds de la Courtille et du Combat s’amusaient fort de cette prédication intensive, de ces costumes bizarres, de ce journal En avant ! colporté dans les bouges et les assommoirs par des fillettes aux yeux candides dont l’accent trahissait la nationalité. Invités à assister aux réunions, les gars de la Villette obtempéraient, mais qui pourrait décrire le chahut dont était témoin la salle du quai Valmy, chahut homérique, inénarrable, où les imitations de cris d’oiseaux se mêlaient aux « aoh yes » et aux Interjections les plus grossières. Malgré la patience à toute épreuve des orateurs salutistes, ce chahut dégénérait parfois en des rixes qu’aucune intervention policière n’arrivait à calmer. Dans les rues, on poursuivait parfois à coups de pierre les vendeuses de l‘En avant ! dont le populaire ne pouvait supporter le fameux chapeau 1830 et l’accoutrement sans grâce (pas plus ridicule, après tout, que le costume des ordres féminins religieux).
L’obstination véhémente des apôtres salutistes, en majorité anglais, provoqua un tel scandale que le préfet de police d’alors — qui n’était autre que M. Andrieux — fit appeler la Maréchale et l’informa que si le tumulte ne cessait pas, il interdirait de par son pouvoir discrétionnaire le port du chapeau des salutistes du beau sexe ou tout au moins des S garnissant le col des uniformes ou du ruban rouge qui porte en lettres dorées l’appellation : « Armée du Salut ». Aujourd’hui, M. Chiappe assiste aux cérémonies d’inauguration d’asiles ou de restaurants populaires créés par les salutistes, Comment expliquer le revirement toujours croissant des gouvernants vis-à-vis de l’Armée du Salut ? C’est qu’il faut distinguer deux phases bien distinctes dans l’histoire de cette puissante organisation religieuse.
En 1865, un pasteur de Londres, encore jeune, et déjà nanti d’une certaine réputation, William BOOTH, qui exerçait son ministère dans les quartiers populaires de Londres, se séparait de l’église méthodiste, ne jugeant pas cette organisation assez combative. Il créa, dans l’est de Londres, une oeuvre d’évangélisation qu’il appela « Christian Mission ». dont le but était de s’occuper de l’état spirituel des classes misérables de Whitechapel et des districts environnants. William Booth, organisateur de grande envergure et prédicateur de talent, ne rencontrait — bien qu’aidé par une femme supérieure et pieuse, sa compagne Catherine Booth, — qu’un succès relatif, lorsqu’il eut, en 1878, l’idée géniale de rompre avec la façon traditionnelle dont on présentait. le christianisme au bas peuple et de transformer sa mission en une organisation militaire, avec des grades, des uniformes et des règlements, sans faire de différence entre les hommes et les femmes. J’ai dit que William et Catherine Booth rompirent avec la prédication évangélique traditionnelle ; en effet, ce ne fut plus uniquement dans des salles destinées à cet effet qu’Ils annoncèrent « la bonne nouvelle du Salut » , mais partout où ils avaient accès ou trouvaient une occasion : sous une tente, dans un cabaret, au fond d’une cave, sous une arche de viaduc, sous un hangar, dans un magasin ou un atelier abandonné, des salutistes s’installèrent qui lurent un verset du Nouveau Testament, le commentèrent à la bonne franquette, chantèrent des cantiques sur l’air de chansons il la mode, accompagnant les refrains, les chœurs, les soli et les duos d’instruments qui n’avaient que de lointains rapports avec l’orgue ou l’harmonium — cornets, trombones, saxhorns de toute taille, tambourins, caisses, etc. — et racontèrent comment leur conversion avait transformé leur vie. Tel ivrogne incorrigible était devenu un ardent abstinent ; tel qui battait sa femme comme plâtre, s’était mué en un agneau ; tel autre, pilier de prison, s’était transformé en un honnête homme, qui serait mort de faim plutôt que de toucher un sou ne lui appartenant pas. Cette prédication éveilla l’attention, la curiosité et, il faut bien ajouter, l’hostilité. Les mauvais garçons de l’est de Londres poursuivaient de leurs sarcasmes, de leurs injures et de leurs cailloux les défilés des salutistes, couvraient leurs chants de leurs hurlements, dispersaient brutalement leurs fanfares, rendaient impossibles leurs réunions, à l’intérieur des salles ou en plein air. Ce fut l’époque héroïque de l’Armée du Salut, celle où, pour narguer sa pauvreté apostolique, on promenait en avant et en arrière de ses cortèges, des placards portant comme inscription les mots « The Starvation Army » (L’armée de la famine), ridiculisant ainsi son appellation officielle de The Salvation Army.
L’Armée du Salut n’avait pas seulement contre elle la lie des quartiers populaires où elle opérait ; les églises établies persécutaient les salutistes, que leurs ministres accusaient de caricaturer la vraie religion avec leurs drapeaux sur lesquels se détachaient en lettres flamboyantes la devise « Blood and Fire » (Sang et feu), leurs costumes et leurs commandements militaires, leurs extravagances verbales ou musicales, leurs convertis sortis de la populace. Il faut dire aussi que la nouvelle organisation ne se confinait plus à Londres ; elle rayonnait à travers toute l’Angleterre, elle s’installait aux Etats-Unis, elle débarquait dans les autres pays protestants ! Dans les protestations et les critiques des autres sectes religieuses, il se glissait de la jalousie et de l’envie. Parfois assez basse. De leur côté, les autorités civiles en voulaient aux soldats de William Booth de provoquer le tumulte, d’entretenir le désordre.
« Certains officiers » zélés, comme les Pierre et les Paul du Christianisme primitif, résistèrent « en face » aux magistrats. On en jeta en prison, peu de temps il est vrai. En Suisse même, ce pays où cent sectes trouvent un abri, le salutisme engendra des troubles ; le vieux château de Chillon hospitalisa quelques semaines une officière, la « capitaine » Stirling — d’origine écossaise, si nous nous souvenons bien. De leur côté, les salutistes ne se laissaient pas faire. C’est ainsi qu’ils brisèrent les scellés posés par ordre du Grand Conseil sur les portes de leur salle de réunion, à Neuchâtel.
Voilà tracée, à grands traits, la première phase de l’histoire de l’Armée du Salut, jusqu’à la mort de Catherine Booth en 1890. A ce moment-là, on commençait déjà à s’accoutumer aux originalités de cette organisation et ses excentricités s’intégraient dans le train-train quotidien de la vie des pays protestants. Mais William Booth ne s’intéressait pas seulement à l’âme des pécheurs. Il se préoccupait de leur situation temporelle ; à sa manière, il se souciait de leurs misères sociales. En cette même année 1890, il lança un livre : In darkest Engtand and the way out (Dans l’Angleterre la plus ténébreuse et le moyen d’en sortir), qui fit plus pour sa renommée que toute sa prédication évangélique. C’est qu’en Angleterre — dans les périodes de prospérité comme dans les époques de crise — il a toujours existé une nombreuse classe déshéritée et des bas-fonds (Slums) : The submerged tenth : le « dixième submergé », Si l’exposé de William Booth était palpitant, le remède proposé était simpliste. Il consistait à procurer du travail aux inoccupés, grâce à l’intervention des classes riches, mandatant des institutions de relèvement économique ou moral, telle l’organisation qu’il dirigeait. Dès ce livre paru, multipliant ses œuvres sociales (maisons de relèvement pour filles perdues, asiles de nuit, restaurants et hôtels populaires, bureaux de placement, fabriques, ateliers, colonies agricoles, tant dans la métropole que dans ses dépendances, etc.), l’Armée du Salut va s’efforcer sinon de supprimer le paupérisme, tout au moins d’atténuer la misère sociale. Partant de ce principe que celui qui a recours à son assistance doit, par son travail, récupérer la dépense qu’il occasionne, l’Armée du Salut se défend de faire l’aumône, elle consent une avance à rembourser sur le travail qu’elle fournit.
Les Œuvres sociales prendront désormais une telle, importance dans l’organisation créée par le Général Booth — maintenant répandue dans toutes les parties du monde blanc, jaune, noir, éditant des journaux, des tracts, des brochures en de nombreuses langues — qu’elles viseront à reléguer au second plan l’œuvre spirituelle. Les classes aisées et les gouvernants, voyant dans l’Armée du Salut un nouveau moyen d’apaiser les exigences de ceux que la faim et les privations prennent à la gorge, lui accorderont leur appui pratique. C’est pourquoi Williarn Booth trouva cent mille livres sterling à la suite de la publication de son livre ; c’est pourquoi l’Armée trouve des réponses à ses appels quand elle sollicite des fonds pour édifier quelque « palais » qu’elle présente comme un extincteur de paupérisme : les classes dirigeantes savent fort bien qu’assagie, pacifique, absorbée par son activité à la fois religieuse et humanitaire, l’Armée du Salut enseigne la résignation à l’ordre social actuel et que ses représentants officiels, parce que la vie de leur œuvre en dépend, s’attacheront à éteindre toute étincelle de révolte qui couverait encore dans le cerveau du sans-travail ou du sans-logis qui vient frapper à la porte de l’une quelconque de ses institutions.
Les Eglises se sont réconciliées avec l’Armée du Salut ; elle n’est plus dangereuse pour l’ordre établi et cela explique pourquoi Edouard VII reçut William Booth quelque temps avant la mort de celui-ci (1912).
Nous avons fait allusion à la constitution militaire de l’Armée du Salut, qui présente une ressemblance marquée avec celle de certains ordres religieux catholiques. si bien que, se rattachant au protestantisme orthodoxe quant au dogme, elle s’apparente au catholicisme quant à l’importance qu’elle attache aux œuvres et à sa. hiérarchie. Au sommet, un chef suprême dénommé général (le titre Maréchale porté par Miss Catherine Booth — plus tard Mme Booth-Clibborn — n’était qu’une dénomination destinée à frapper l’esprit public), aidé par un chef d’état-major, contrôle l’activité de l’Armée du Salut dans le monde entier et ses ordres ne souffrent aucune contradiction. Au-dessous du général et du chef d’état-major qui surveille l’exécution de ses décisions, un quartier général comprenant de nombreux départements et occupant un personnel très important. Ce quartier général, situé à Londres, est Ie centre de l’administration de l’Armée. A partir du Général, s’échelonne une hiérarchie de grades : des Commissaires, placés à la tête des services les plus importants ou envoyés dans les différents pays où est installée l’Armée, pour les diriger. Des colonels, des lieutenants-colonels, des brigadiers, parmi lesquels se recrutent les secrétaires généraux des commissaires, etc. ; des majors, des capitaines d’état-major, des adjudants, des enseignes qui dirigent les provinces, les divisions, les districts, les sections, entre lesquels sont partagées les contrées où opère l’Armée ; un état-major subalterne auquel sont aussi confiés des missions temporaires et des services de second ordre. Au-dessous, la foule des « capitaines » et des « lieutenants » en charge des postes (ou localités consistant en un ou plusieurs villages, en une ville ou partie d’une ville), ou encore dirigeant des œuvres sociales de toutes sortes, ou enfin aidant dans leurs besognes les officiers des grades supérieurs. Il va sans dire que, comme la prédication, tous les grades sont accessibles aux femmes autant qu’aux hommes. Cette égalité des deux sexes, surtout dans la prédication, fut une des raisons qui, à l’origine, souleva l’opinion religieuse contre l’Armée du Salut.
Tous ces officiers se consacrent entièrement à l’œuvre de l’Armée, à laquelle ils doivent un minimum de travail quotidien de neuf heures. Selon l’état des finances de leur organisation dans les différents pays où elle opère, ils reçoivent un salaire qui leur permet de vivre mais pas plus, D’ailleurs, en entrant, ils s’engagent à ne faire aucune réclamation contre l’Armée du Salut ou contre qui que ce soit s’ils ne reçoivent aucun salaire. comprenant qu’aucune solde ne leur est garantie. (Il convient de rappeler qu’un ami leur ayant fait une rente viagère, William et Catherine Booth n’eurent point à recourir aux fonds de l’Année du Salut pour leur entretien personnel.) Ils renoncent à l’usage des boisons alcooliques et du tabac, au port de toute bijouterie, On ne saurait contester la foi, la conviction souvent naïve des officiers inférieurs, dépourvus en général de tout sens critique. Leur sincérité ne saurait être mise en doute, pions qu’ils sont sur un vaste échiquier où ils accomplissent une œuvre qui les dépasse. Dans certains pays orientaux comme les Indes, la Chine, le Japon, etc., les officiers, même européens, se vêtent comme les indigènes et s’astreignent à leur nourriture. Notons, en passant, que, pour le moment, la Russie soviétique ne tolère pas chez elle l’Armée du Salut.
Mais il n’y a pas que les officiers et les officières. Il y a des « soldats » et des « soldates » dont l’activité multiple est contrôlée par des officiers locaux ou sousofficiers : sergents-majors, sergents, caporaux, trésoriers, secrétaires, etc. qui continuent à travailler au bureau, à l’atelier, à l’usine. Ils sont la masse, le gros de l’Armée, recrutés en général dans les milieux les plus humbles, attirés par les allures bizarres ou la renommée de l’organisation. Ils sont les « venus à Jésus », les « convertis » qui se sont découverts un jour l’âme « noire », « remplie de péchés » et que le sang de l’agneau a « lavés ». Ce sont eux qui vendent dans les rues et à la terrasse des cafés le War Cry, le Cri de Guerre, l’En avant, constituent les fanfares, parlent aux prostituées, catéchisent les ivrognes et les débauchés, rendent « témoignage » dans les réunions publiques, c’est-à-dire racontent comment le Seigneur s’est « révélé » à eux, versent la dîme ou font les différentes collectes qui permettent à l’œuvre de subsister.
Un beau jour, les plus jeunes d’entre eux se sentent appelés à leur tour à se consacrer entièrement « à Dieu dans les rangs de l’Armée ». Le quartier général de leur pays examine leur candidature, soumise au préalable au chef du poste dont ils dépendent. Si l’examen est favorable, ils entrent en une espèce de séminaire dénommé « école militaire », à titre de « cadets » ou « cadettes », où ils séjournent peu de mois, au cours desquels on juge de leurs aptitudes aux fonctions d’officiers. S’ils sont agréés, promus au grade de cadet-lieutenant ou de lieutenant, ils s’en vont à leur destin, très souvent pour débuter dans quelque poste lointain dont le « capitaine » a perdu de son enthousiasme primitif, où les réunions sont peu fréquentées, où l’on a peine à boucler le budget, dans quelque Œuvre sociale ingrate, peut-être dans quelque obscure besogne bureaucratique, etc ... Une sélection s’opère : les plus aptes, les mieux doués, comme partout, gravissent plus ou moins lentement les échelons qui mènent aux paliers supérieurs de la hiérarchie.
Quant à ceux qui ne sont pas reçus on les ajourne le plus souvent, parfois on les refuse définitivement. Dans l’un ou l’autre cas, ils rentrent dans le rang, à moins qu’ils ne quittent l’organisation.
Un grand nombre d’officiers eux-mêmes — et non des moindres — ont quitté l’Armée du Salut. Les uns parce qu’ils n’ont pas pu s’accommoder, en fin de compte, de la dictature du Quartier Général ; les autres parce qu’ils avaient perdu la foi ou qu’ils étaient en désaccord avec les doctrines prêchées par l’Armée ; certains démissionnèrent enfin, parce qu’ils comprirent que l’organisation à laquelle ils appartenaient constituait une force redoutable de conservation sociale et morale, et que cela seul justifiait la considération dont elle jouit parmi les classes nanties des biens de ce monde. Parmi ceux qui se rebellèrent contre l’absolutisme du sommet, rappelons deux des enfants du Général Ballington-Booth, qui créa l’Armée des Volontaires aux Etats-Unis, et la Maréchale (Mme BoothClibborn), qui finit par entreprendre une œuvre d’évangélisation à son compte. D’ailleurs, si, à la mort de William Booth, on accepta la clause des Ordres et Règlements qui laisse au général la désignation de son successeur, en I’occurence, son fils aîné Bramwell Booth ; en revanche, lorsque celui-ci fut près de sa fin, il y a deux ans, un conseil de Commissaires le destitua contre sa volonté et, sans se soucier de son opinion, nomma Général à sa place un des leurs : le Commissaire Higgins. Cette substitution, qui reléguait à l’arrière-plan la dynastie des Booth, ne s’accomplit pas sans des scènes qui n’offraient rien d’évangélique.
Comme toute congrégation religieuse qui se respecte, surtout quand elle est organisée militairement, l’Armée du Salut possède ses Monita Secreta, sous la forme d’Ordres et Règlements pour les officiers. C’est un document peu connu, bien que, originairement, édité en anglais, il ait été traduit en plusieurs langues. A la vérité, il n’a rien de secret, puisque les officiers qui démissionnent de l’Armée ou en sont exclus peuvent le conserver. Une fois acquis, il demeure leur propriété. Ce volume définit ce que doivent être l’officier et son activité. C’est un véritable manuel de vie pratique qui vise à faire de celui qui le prend à cœur un « parfait » salutiste : il embrasse toutes les circonstances de la vie publique et privée de l’officier, lui indique comment résoudre les difficultés qu’il peut rencontrer dans sa carrière, lui inculque une profonde confiance en l’organisation à laquelle il a promis de se consacrer jusqu’à la fin de ses jours. L’Armée du Salut doit devenir, pour l’officier, une société mise à part par Dieu dans la grande société humaine, et il n’est rien dans le monde qu’on puisse placer au-dessus de son intérêt. Aussi, avant d’accomplir un acte, l’officier devra-t-il se demander s’il est ou non dans l’intérêt de l’Armée, s’il lui portera ou non préjudice de quelque manière que ce soit.
Sans doute, l’officier doit être un saint, c’est-à-dire être délivré de toute manifestation extérieure du péché, y compris l’esprit de légèreté ; sans doute il doit être convaincu qu’il est un instrument choisi par Dieu pour le relèvement et le salut des pécheurs ; mais cela ne doit pas lui faire perdre de vue les intérêts pratiques de l’Armée : il doit être en même temps « vrai soldat » et « homme d’affaires »,
Parmi les choses dont l’officier doit être convaincu, notons l’obéissance, qui est « un des principes essentiels de tout gouvernement » (O. et R., I, II, 7. Ed. 1892) ; le plan de Dieu qui a toujours été de « gouverner les hommes par I’entremise des individus » (O. et R., II, I, 2) ; la vraie discipline qui comprend :
-
l’habitude pour tous d’obéir sans discuter ;
-
la découverte de ceux qui sont désobéissants ;
-
la réhabilitation de ceux qui ont pu être accusés faussement ;
-
le repentir et le relèvement de ceux qui ont enfreint les règlements ;
-
la punition des coupables. (O. et R., III, IV, 1)
Et le but légitime de la peine disciplinaire qui est :
-
d’empêcher la personne de recommencer ;
-
d’empêcher les autres de suivre son exemple ;
-
d’amener le coupable au repentir et au relèvement (Id.)
Les officiers de l’Armée du Salut peuvent se marier, mais aucun d’eux ne peut contracter ou rompre des fiançailles sans l’assentiment de l’officier supérieur qui dirige la partie de territoire où il exerce ses fonctions. Les Ordres et Règlements fournissent toutes sortes de conseils sur le type de femme qui doit faire une bonne épouse salutiste. D’une façon générale, il faut trois ans de service actif, pour que l’officier de l’un ou l’autre sexe puisse convoler en justes noces,
Pour en finir avec les « Ordres et Règlements », ils constituent, en général, un manuel de morale religieuse et civique d’une telle orthodoxie, qu’aucune morale bourgeoise ne saurait en prendre ombrage.
Avant de conclure, notons encore que l’Armée du Salut fait un grand usage du chant : elle a compris la suggestion de la voix humaine modulée d’une certaine façon et quel parti on peut en tirer, accompagnée ou non de chants, pour jeter le trouble dans l’esprit. Combien de ceux qui sont venus au « banc des pénitents » ne l’ont fait qu’hypnotisés par un refrain, un chœur, une mélodie répétée à satiété, jusqu’à ce qu’ils aient perdu toute faculté de contrôle sur leur sensibilité.
L’Armée du Salut, conçue et hiérarchisée comme elle l’est, aurait pu jouer dans les pays protestants un rôle analogue à celui de la compagnie de Jésus dans les pays catholiques. Mais son recrutement s’opère dans des milieux en général déshérités au point de vue intellectuel. D’autre part, la mentalité des peuples protestants répugne il la mise en uniforme de la religion.
Les masses populaires profondes deviennent complètement indifférentes à la question du salut spirituel, et, quant à ce que leur offre l’armée, au point de vue temporel, elles n’y aperçoivent rien de libérateur. Cette organisation ne condamne aucunement le salariat comme système ; au contraire, les Ordres et Règlements recommandent la soumission et la docilité à l’égard des employeurs. Enfin, le peu de culture du troupeau salutiste lui interdit de jouer un rôle politique quelconque.
Alliance de religion et de philanthropie, tout ce à quoi peut viser l’Armée du Salut, c’est de servir de tampon entre les possédants et les dépossédés dont, en les secourant, elle retarde l’explosion de colère. C’est parce qu’elle est une fabrique à résignés que les riches l’assistent de leurs biens, que les gouvernants la protègent et que les philanthropes se pâment devant l’os qu’elle jette aux affamés.
Dans le mouvement qui entraîne le monde vers une conception et une pratique de la vie qui ignore toute religion révélée, qui considère la philanthropie comme un frein social, aucun avenir n’est réservé à l’Armée du Salut.
— AD HOC.
SANATORIUM
n. m.
Ce mot est dérivé d’un adjectif : sanatoire qui, en latin, sanare : guérir, indique : qui est propre à guérir ou qui opère la guérison. En termes précis, le sanatorium est une station hygiénique.
C’est un milieu particulièrement salubre, curatif par lui-même, indépendant des médicaments et des interventions chirurgicales. Les malades y font une cure d’air, complétée par l’emploi méthodique des mesures d’hygiène.
En France, existent d’abord les sanatoria maritimes pour la cure des enfants débiles, lymphatiques, rachitiques, scrofuleux ou atteints de tuberculose locale. Comme leur nom l’indique, ils sont situés sur le bord de la mer ; le traitement marin étant à la fois curatif et préventif, ils préservent ces mêmes enfants de la tuberculose pulmonaire à laquelle ils sont particulièrement disposés.
Les principaux sanatoria maritimes sont : Berck-sur-Mer, appartenant à l’Assistance publique de la Ville de Paris, fondé de 1861 à 1869 ; l’hôpital sanatorium Rothschild ; le sanatorium maritime d’Arcachon, fondé en 1887 ; celui de Pen Bron (Loire-Inférieure), fondé en 1887 ; celui de Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), ouvert en 1888 ; l’Asile départemental de Cap-Breton (Landes), ouvert en 1889 ; le sanatorium d’Hyères-Giens (Var), depuis 1890 ; celui de Saint-Pol, à Dunkerque, ouvert la même année ; de Saint-Trojan (Ile d’Oléron) ; celui d’Hendaye, appartenant à l’Assistance publique de la Ville de Paris ; de Roscoff, de Cannes, Malo-les-Bains, Cette, etc ...
Puis existent les sanatoria pour le traitement de la tuberculose pulmonaire, où les malades riches peuvent se procurer un traitement hygiéno-diététique. C’est la cure libre applicable à la majorité des malades.
A côté des établissements où, pour des raisons de fortune, les malades doivent renoncer à la cure libre, il a été créé des établissements où, sous la surveillance incessante des médecins, les malades sont méthodiquement soumis à la triple cure qui constitue le traitement hygiéno-diététique : cure d’air, alimentation généreuse réglée et surveillée, cure de repos ou d’exercice modéré.
En France, existent plusieurs sanatoria payants, très bien situés et parfaitement aménagés : au Canigou (Pyrénées-Orientales), à Durtol (Puy-de-Dôme), au Trespoey (Pau), à Meung-sur-Loire (Loiret), à Aubrac (Aveyron), au Gorbier (Alpes-Maritimes), etc ...
La Suisse compte également un nombre important de sanatoria, ils sont de haute altitude généralement et rendent particulièrement des services dans les formes du début de la maladie.
Celui d’Arosa est situé à 1.880 mètres ; celui de Davos à 1.558 mètres ; de Leysin à 1.450 mètres.
À Davos, la température moyenne varie considérablement suivant qu’on se place à l’ombre ou au soleil et, pour être bienfaisante, la durée du séjour doit être au moins de six mois.
| Mois | à l’ombre | au soleil |
|---|---|---|
| Octobre | 15 | 56 |
| Novembre | 2 | 41 |
| Décembre | 4 | 42 |
| Janvier | 2 | 42 |
| Février | 1,5 | 44 |
| Mars | 2 | 45 |
En Allemagne, où la cure hygiéno-diététique a été constituée en premier, on a obtenu dix pour cent de guérisons après un séjour prolongé.
Puis existent encore les sanatoria populaires pour le traitement de la tuberculose pulmonaire des ouvriers ou malades pauvres. C’est l’Allemagne qui en a ouvert le plus grand nombre.
En France, il en existe plusieurs : Hauteville (Ain), appartenant à l’Assistance publique de Lyon ; Angicourt, à l’Assistance publique de Paris ; Pessac (Gironde) ; Lay-Saint-Christophe, autour de Nancy ; Bligny, dans la banlieue parisienne ; Chécy (Loiret), etc... Un dernier sanatorium, dont les dépenses ont atteint une dizaine de millions se termine et va s’ouvrir à Enval (Puy-de-Dôme), près de Volvic, en septembre 1933. Edifié par les dons recueillis par Etienne Clémentel, sénateur du Puy-de-Dôme, destiné à accueillir des centaines de malades, c’est l’établissement départemental le plus approprié aux conditions rnodernes du traitement de la tuberculose pulmonaire. Un sanatorium situé à Chanat (Puy-de-Dôme) appartient particulièrement à l’usine Michelin ; bâti à environ 700 mètres d’altitude, il ne reçoit que des ouvriers des deux sexes ayant contracté la tuberculose, ou cette dernière s’étant aggravée, dans les grandes usines du roi du caoutchouc.
Les Allemands nous fournissent des statistiques d’après lesquelles 67 pour 100 des ouvriers tuberculeux sortent guéris de leurs sanatoria après trois mois de séjour et ces guérisons permettent à l’ouvrier un travail équivalent au tiers du travail d’un ouvrier bien portant ; ces guérisons se maintiendraient encore après un an chez 41 pour 100 ; après deux ou trois ans, chez 30 pour 100 ; après quatre ans, chez 27 pour 100 des malades ainsi soignés. Ces chiffres seraient à contrôler, car ils ont été fortement discutés par les médecins et les hygiénistes. On a cependant remarqué que l’amélioration d’un indigent ou même d’un ouvrier tuberculeux placé dans un sanatorium se fait sentir plus rapidement que celle d’un tuberculeux riche, parce que la différence favorable entre son régime habituel et son régime nouveau est beaucoup plus sensible. Cette même différence se retrouve en sens inverse quand, après quelques mois de cure, l’ouvrier reprend chez lui ses anciennes habitudes, ses mauvaises conditions d’habitat, de nourriture ou de vie de travail.
En dehors des établissements signalés plus haut, il existe encore des hôpitaux et sanatoria pour enfants tuberculeux et pulmonaires pauvres : Villepinte, Ormesson, Villiers et leurs annexes de Champrosay, asile Feignez, les colonies agricoles de l’oeuvre des enfants tuberculeux qui ont le désir de dresser un rempart entre les enfants frappés de ce mal et la mort.
Le sanatorium doit être disposé de préférence en montagne et même à une haute altitude à cause de la pureté de l’air et de l’absence de microbes dans les stations élevées, loin des villes importantes ; il doit être préservé du vent par des montagnes ou des arbres, notamment des pins ou des sapins. Regnard écrit que :
« Le feuillage de ce genre d’arbres persiste l’hiver et disperse le vent aussi bien qu’en été ; son ombre est épaisse sans être froide, il n’est pas tellement serré qu’il ne laisse circuler l’air et la lumière ; enfin, le tapis d’aiguilles sèches qu’il forme sur le sol est dur et assez lourd pour n’être pas soulevé par le vent ; il préserve donc admirablement l’air contre l’immixtion des poussières. »
L’exposition d’un sanatorium doit être au sud ou au moins au sud-ouest ; l’ameublement doit être sommaire : aucun tapis, aucun rideau, aucune tenture ; parquet couvert de linoléum, facile à laver ; suppression des angles des murs remplacés par des surfaces arrondies. Les fenêtres doivent être ouvertes continuellement, par n’importe quel temps. Les malades s’accoutument très rapidement à cette pratique. La chambre est chauffée et éclairée.
Les malades qui ne peuvent se promener s’allongent le matin sur une chaise longue, soit dans leur chambre, soit dans la galerie de cure. Regnard décrit ainsi la dite galerie :
« On appelle ainsi un long couloir placé en plein midi, où on accède sans passer dehors et qui est séparé par des planches mobiles à mi-hauteur et une série de chambrettes qui ouvrent toutes sur l’extérieur par une grande baie, devant lequel on peut lever ou abaisser un store. »
Dans un sanatorium, il est interdit, sous peine d’expulsion, de cracher par terre ; le malade porte continuellement sur lui un crachoir contenant une solution antiseptique ; le soir, il est vidé et son contenu brûlé, le linge est désinfecté comme la chambre du malade.
J’ai constaté qu’à Durtol par exemple, le personnel, presque sans exception, est choisi parmi les tuberculeux améliorés ou guéris. J’estime qu’il y a là un excès de prudence car les personnes saines qui séjournent dans les sanatoria pour tenir compagnie aux malades ne sont jamais atteintes de leur maladie.
Nous avons lu, plus haut, les résultats indiqués par une statistique allemande. Knopf a dressé une autre statistique qui porte sur 60.000 malades. Sur ce nombre, il trouve 8.400 guérisons absolues, 8.400 guérisons relatives, 25.200 améliorations.
Dans son numéro du 20 juillet 1901, la « Revue Universelle » a donné un article publiant les impressions d’un malade sur la vie dans un sanatorium. M. Félix Le Dantec écrit :
« Que faire sur une chaise longue pendant six heures ? Quelques-uns lisent, d’autres jouent aux dames ou aux échecs ; mais le repos absolu vaut mieux et l’on s’y fait très vite ; on arrive à ne plus s’ennuyer, à jouir de ce farniente obligatoire comme d’une chose agréable ...
En dehors des heures de repos forcé, chacun peut se promener à sa guise. C’est que les tuberculeux ne sont pas des malades ordinaires : sauf quand des poussées aiguës les forcent à garder le lit, ils ont tout à fait l’allure de gens bien portants ; plusieurs même ne toussent pas ...
Souvent ils s’amusent comme de grands enfants ; ils se lancent des boules de neige, ils jouent à la main chaude et les francs éclats de rire accompagnent les bons coups, étonnent le visiteur qui croyait entrer dans le temple de la douleur et de la mort.....
Pour qu’un malade que l’on met à l’engrais profite de son traitement, il faut qu’il soit gai, et l’administration s’occupe d’égayer les malades. Pas une occasion n’est manquée : chaque fête est marquée d’une réjouissance, d’une distraction ayant un caractère familial...
Je n’aurais jamais cru qu’il fût si facile d’apprendre l’hygiène à des gens dépourvus pour la plupart d’éducation bourgeoise. Il est naturellement défendu de cracher par terre, à cause des bacilles des crachats, et chacun a intérêt à ce que les autres se conforment au règlement ; c’est peut-être pour cela que tous s’y soumettent si facilement. »
Il y a, généralement, trois variétés de sanatoria :
Celui d’altitude élevée, au-dessus de 1.000 mètres ; celui de moyenne altitude, de 500 à 800 mètres ; celui de basse altitude ou sanatorium de plaine.
Enfin, existent encore les sanatoria des colonies. Ces derniers doivent toujours être placés sur des hauteurs. Les principaux sont, pour Madagascar et l’île de la Réunion même, Salazie (872 mètres), dans cette dernière île ; pour l’Indo-Chine, le cap Saint-Jacques ; le camp Jacob à la Guadeloupe ; les camps de Balara, de Chazeau et des Prêcheurs à la Martinique.
Examinons, pour finir, à quoi servent les sanatoria.
À peu de chose, attendu qu’ils sont impuissants à assurer la guérison des tuberculeux ; la minorité de ces derniers arrive à avoir la vie prolongée dans une existence de misère morale et de dépression physique, mais les établissements payants ou gratuits sont absolument inopérants pour combattre la tuberculose.
Il faudra trouver d’autres remèdes et, seule, la transformation de la société actuelle, en donnant à chacun la faculté et la possibilité de consommer, d’améliorer l’existence des individus par tous les moyens de confort et d’hygiène, parviendra à vaincre le fléau social de la tuberculose.
Déjà, à côté des sanatoria, s’instituent des préventoria qui ont pour but de prévenir la maladie.
Peu à peu, lorsque, dans la société, s’élaboreront les lois inéluctables attribuant à chacun le travail librement consenti au lieu des travaux forcés des usines capitalistes actuelles, lorsque les individus cesseront de vivre dans les taudis des vieilles maisons empuanties d’odeurs nauséabondes et remplies des microbes les plus malsains, lorsque le soleil de l’aisance aura remplacé les ténèbres de la misère ; alors, peu à peu, les sanatoria qui coûtent des prix fabuleux de construction, d’installation et d’exploitation pour ne rendre que des services insignifiants, disparaîtront pour faire place à des édifices appropriés à la vie intense, à la joie et à la beauté : palais artistiques qui laisseront loin derrière eux, ce que notre pauvre société actuelle a cru utile d’édifier à grands frais et sans grande utilité : les actuels sanatoria.
— Pierre COMONT.
SANTÉ
n. f. (du latin sanitas)
Equilibre psycho-physiologique des organismes vivants, se traduisant par un fonctionnement normal, régulier, parfait de tous leurs organes.
Si nous observons autour de nous les représentants de l’espèce humaine, nous constatons qu’un nombre très restreint jouit de cet équilibre intégral malgré, parfois, de rassurantes apparences. Cependant, en raison de leur avance intellectuelle, de l’énorme acquisition philosophique qu’ils ont réalisée, les peuples dits civilisés devraient, semble-t-il, jouir d’une intégrité physico-mentale inconnue aux races moins évoluées et, à plus forte raison, aux espèces animales qui n’ont, à travers le labyrinthe de la vie, pour guide que leur instinct. Mais, au contraire, il apparaît que plus la civilisation s’amplifie, mieux l’esprit humain triomphe des énigmes les plus diverses, plus, en un mot, l’intellectualité domine l’espèce, et plus décroît en même temps son immunité pathogénique générale. Progrès — ou ce que l’on a coutume d’appeler de ce nom — et santé suivraient ainsi des courbes inverses ...
Sans doute, certains fléaux qui, aux siècles passés, faisaient peser sur l’humanité leur menace endémique et frappaient périodiquement et avec violence presque toutes les races — tels le choléra, la peste, la variole — ont régressé sous les assauts de la science et sont, en Europe du moins, virtuellement jugulés. Propreté, hygiène générale croissante de l’individu et de son habitat en espacent et localisent l’éclosion, d’une part et, d’autre part, des mesures rapides de prophylaxie, le développement des services sanitaires et de voierie triomphent aisément des foyers isolés.
Mais si les épidémies, les maladies catastrophiques pourrait-on dire, ont été vaincues, par contre — paradoxe macabre et ironique — nombre d’affections à caractère infectieux, et de portée collective plus qu’on ne le croit généralement, se sont implantées victorieusement, ou même ont fait une récente apparition dans nos sociétés raffinées, mais aussi hypertendues, jouisseuses et surmenées. C’est ainsi que le diabète, le cancer, la tuberculose, la syphilis, le rhumatisme, l’urémie, l’albuminurie, l’hépatisme, les néphrites, l’appendicite, etc..., qui, dans un passé tout proche encore, étaient numériquement insignifiantes au point que certaines (maladies d’excès) avaient reçu, dans le langage populaire le qualificatif de « maladies de riches », atteignent aujourd’hui indistinctement toutes les classes de la société.
Une morbidité générale, latente, s’est installée, sournoise et redoutable. Il en est résulté, depuis nombre d’années, une mortalité accrue que n’ont pu réduire, malgré leur amplitude, les moyens de défense mis en oeuvre, et qui inquiète les pouvoirs publics. C’est ainsi qu’au cours de l’année 1932, M. Legros, rapporteur de la commission parlementaire d’hygiène, poussait un cri d’alarme en déclarant à la tribune du Parlement que la France était le pays d’Europe possédant le triste privilège de la plus forte mortalité « puisqu’elle dépasse le chiffre impressionnant de 17 pour 1.000 habitants ».
Cette précarité sanitaire, qui atteint particulièrement ce pays, non seulement n’épargne pas les autres états européens, mais elle est aussi le lot des autres continents. Dans son livre « Restez jeunes », le Docteur Pauchet nous conte qu’un industriel des Etats-Unis prit la curieuse initiative de soumettre à un rigoureux examen médical, confié à des spécialistes, tous les postulants aux emplois vacants de son établissement. Cette investigation révéla que 97 p. 100 des solliciteurs étaient affligés de tares insoupçonnées de la plupart des intéressés.
Cet état morbide engendre une mortalité de beaucoup plus élevée que la normale et particulièrement prématurée. C’est ainsi que, pour la France, la longévité moyenne est de 43 ans. Octogénaires, nonagénaires et surtout centenaires deviennent d’une excessive rareté. Combien disparaissent avant l’âge adulte, fauchés en pleine adolescence ? Combien meurent avant la trentaine ?
Cependant, si nous nous en référons aux enseignements de l’anatomie et de la physiologie comparées, les hommes, pour accomplir le cycle normal de leur existence, devraient atteindre au moins 125 à 150 ans. En effet, tous les animaux vivent environ 5 à 6 fois le laps de temps que leur squelette met à s’ossifier. C’est ainsi que le chien, lorsqu’il est convenablement traité, vit de 15 à 20 ans, réalise en 3 ans son ossification complète. Le cheval qui atteint 25 à 30 ans voit son armature squelettique s’ossifier définitivement à 5 ans, etc... Et encore avons-nous affaire ici à des animaux relativement dégénérés en raison de la domesticité qui leur est imposée ... Par conséquent, l’homme qui accomplit la soudure de son épiphyse claviculaire (la dernière) aux abords de la 25ème année, devrait logiquement atteindre et dépasser le cap des 125 et même 150 ans. Mais ce phénomène de longévité ne se rencontre plus guère que dans certaines parties du monde où les mœoeurs simples, faites de sobriété et de frugalité, subsistent encore ; les régions turco-balkaniques, par exemple, où abondent encore de robustes centenaires et plus-que-centenaires. Ce sont toutes ces observations qui ont amené Metchnikoff à cette conclusion que la vieillesse précoce affectant les peuples civilisés n’est autre qu’une décrépitude pathogénique résultant de causes évitables et correctives.
Quelles sont donc les causes mystérieuses de ces déchéances anticipées qui font de l’homme contemporain un valétudinaire avant l’âge, un moribond précoce, soldant, bien avant l’heure qui lui est assignée au cadran de la Nature, son tribut à la Parque symbolique ? Dès l’antiquité la plus reculée, depuis que l’humanité connaît la maladie, ce problème tourmenta les chercheurs. Docteurs, savants, philosophes, tentèrent de déchiffrer l’énigme. Les plus avisés, les mieux inspirés opinèrent pour une réconciliation de l’homme avec la Nature, pour une observation scrupuleuse des lois tutélaires et intangibles qui régissent tous les êtres vivants. Mais la simplicité, l’esprit de clairvoyance ne sont pas des apanages humains. Accoutumé à marcher dans la voie, absurde ici, de l’insubordination, l’orgueilleux roi de la création, plus raisonneur que raisonnable, estima davantage profitable de souscrire aux suggestions de mauvais conseillers, habiles manœoeuvriers, retors de l’empirisme, mais aussi profiteurs habiles d’une science fourvoyée. Une médecine officielle, orthodoxe, souvent puérile et inepte, s’édifia, dédaignant les causes, ne s’attaquant qu’aux effets. C’est cependant — malgré d’universels et retentissants échecs — ses dogmatiques méthodes qui prévalent encore et rallient tous les suffrages. Ses pontifes officient toujours devant le même public, indécrottablement crédule et borné, qui, répudiant tout effort critique et régénérateur, continue à accorder ses préférences aux pilules et aux onguents, aux potions souveraines et aux remèdes « guéris-tout », plutôt qu’aux pratiques d’hygiène préventives et curatives, les seules allant à la source du mal et visant à en prévenir tout retour offensif.
Cette impuissance d’une médecine égarée fut mise en évidence non seulement par de scrupuleux savants n’ayant aucune attache avec elle, mais aussi et surtout par des praticiens ayant grandi sous son aile, et qui se sont abreuvés à ses sources.
Autour de 1929, le Docteur Rist a publié (Masson, éditeur), un ouvrage intitulé : « Qu’est-ce que la Médecine ? », dans lequel il analyse et souligne l’inaptitude de la médecine à soulager l’humanité de ses maux.
« Les maladies que nous sommes en état de guérir, au sens propre du mot, dit-il, on pourrait presque les compter sur les doigts et les médicaments exerçant une action curative spécifique tiendraient dans une pharmacie de poche. »
Voilà qui est catégorique et peut se passer de commentaires.
Sir John Forbes, médecin de la reine Victoria, disait, un jour :
« Certains malades guérissent grâce aux médicaments ; il en est davantage qui guérissent sans médicaments, et il y en a un plus grand nombre qui guérissent malgré les médicaments. »
N’est-ce pas là la condamnation d’un système ? Mais continuons à énumérer d’autres sentences.
Dans une lettre adressée au Docteur Tissot, voici ce que lui écrivait son confrère, le Docteur Trouchein :
« Je gémis du désordre du plus beau et du plus dangereux des arts. Le temps et les Arabes ont fait moins de mal à Palmyre que l’ignorance des médecins ont fait à la médecine. »
Sénac, auteur de l’anatomie d’Heister, racontait que Charles II reprochait au médecin Willis de lui avoir enlevé « plus de sujets que n’aurait pu faire une armée ennemie ».
Le médecin hollandais Boerhave disait :
« Si l’on vient à peser mûrement le bien qu’a procuré aux hommes une poignée de fils d’Esculape, et le mal que l’immense quantité de médecins a fait au genre humain, depuis l’origine de l’art jusqu’à nos jours, on pensera sans doute qu’il serait plus avantageux qu’il n’y eut jamais eu de médecins dans le monde. »
Dans une séance de l’Académie de Médecine, le 8 janvier 1856, le professeur Malgaigne prononçait ces paroles :
« Absence complète de doctrine scientifique en médecine et de principes dans l’application de l’art, empirisme partout, voilà l’état de la Médecine. »
Magendie, le célèbre physiologiste, enseignait au Collège de France, en 1846 :
« Sachez-le bien, la maladie suit le plus habituellement sa marche sans être influencée par la médication dirigée contre elle. Si même je disais toute ma pensée, j’ajouterais que c’est surtout dans les services où la Médecine est la plus active que la mortalité est la plus considérable. »
Et ces paroles de l’illustre Guy Patin :
« Je le dirai à la honte de mon art, si les médecins n’étaient payés que du bien qu’ils font eux-mêmes, ils ne gagneraient pas tant. »
Soyons assurés que si Molière renaissait, sa verve pourrait, avec les mêmes raisons qu’à son époque, s’exercer aux dépens des innombrables Diafoirus et Purgon qui n’ont fait que croître et se multiplier depuis.
On pourrait objecter qu’avec les découvertes de Raspail, de Béchamp, de Pasteur, la Faculté est armée de nouvelles méthodes et que si la chimie purement médicale a fait faillite, l’opothérapie, la vaccinothérapie, la sérothérapie lui ont ramené assez de gloire pour redorer son blason. Nous allons voir que ces louanges sont loin d’être justifiées.
D’abord, quel crédit pouvons-nous accorder au fameux traitement anti-rabique de Pasteur ? Le Docteur Henri Boucher, dans une brève étude, parue sous le titre : « Les méfaits de la Science des vivisecteurs » se charge de nous répondre.
Avant la découverte et l’application de la méthode pasteurienne, il résulte, de statistiques officielles établies par Tardieu et Boulay, tous deux membres de l’Académie de Médecine, qu’il mourait annuellement, en moyenne, en France, depuis de nombreuses années, une trentaine de personnes atteintes de la rage. Depuis qu’elle est appliquée, la mortalité s’est élevée à quarante décès pour cause d’hydrophobie.
En Italie, mêmes constatations. Le Professeur Carlo Ruata, ému des nombreux décès survenant après que le traitement anti-rabique fut appliqué sur des gens ayant été mordus par des chiens suspects, entreprit des recherches. Il aboutit à ce résultat que, alors qu’il mourait, en Italie, une moyenne de 60 personnes avant l’adoption de la thérapeutique pasteurienne, il en décédait ultérieurement 85.
Le Docteur Rubinoff fit, en Russie, semblables constatations : de nombreux individus mordus par des chiens supposés enragés et cependant immédiatement traités par la dite méthode, étaient frappés de mort après que les effroyables symptômes caractéristiques de la rage se fussent manifestés.
La « Revue Médicale de l’Afrique du Nord » relatait, il y a quelques années, que de nombreux cas de rage paralytique suivis de mort avaient été constatés chez des indigènes à qui on avait cependant inoculé le fameux sérum.
A Paris, des cas typiques furent signalés. Entre autres, celui d’un garçon d’amphitbéâtre, nommé Rendu, qui s’était coupé en pratiquant l’autopsie d’un sujet mort de la rage. Il subit trois inoculations successives par mesure de précaution et mourut ensuite de rage paralytique.
Celui de Mme Robina n’est pas moins troublant. Mordue par son chien qui ne présentait cependant aucun symptôme morbide mais, malgré tout, inquiète et redoutant le pire, elle se fit traiter à l’Institut Pasteur et mourut quelque temps après, des suites de la terrible maladie, alors que son chien indûment suspecté, mourait longtemps après, de mort naturelle.
Ce sont ces faits associés à cent autres de même nature qui amenèrent le Professeur Péter à prononcer en pleine Académie de Médecine ces sentencieuses paroles :
« M. Pasteur ne guérit pas la rage, il la donne. »
Les sphères médicales, le public même, semblent pénétrés de « l’immunité » que confère la vaccination anti-varioleuse. L’Angleterre étant en quelque sorte le berceau de la vaccine décréta, l’une des premières, le traitement vaccinal obligatoire. Au cours de la période de contrainte, on enregistra 41 décès d’origine variolique par million d’habitants. La proportion tomba à 7 lorsque la vaccination fut redevenue libre.
En France, pendant l’année 1907, toute la population fut soumise au traitement préventif de la variole : 2.679 succombèrent cependant des méfaits de cette maladie. De 1910 à 1912, période où il y eut un relâchement dans l’application de la méthode, dans soixante départements, la mortalité générale pour infection variolique fléchit à 172.
Récemment, la presse publiait une statistique hollandaise relatant qu’au cours de 1929, 18 individus des deux sexes étaient morts des suites de la variole cependant que 21 autres avaient succombé à l’encéphalite et à la méningo-myélo-encéphalite d’origine vaccinale. Si bien que, à la suite de ces faits, s’inspirant des conseils de médecins définitivement fixés, le ministre de l’instruction publique néerlandais a, par une circulaire, formellement interdit la vaccination des éléments scolaires et du personnel enseignant.
Que devons-nous penser du fameux sérum anti-tuberculeux du Docteur Calmette, à la suite de l’hécatombe des 73 malheureux nourrissons de Lübeck qui trouvèrent la mort quelques jours après son application ?
Et quelle attitude observerons-nous à l’égard du sérum anti-diphtérique dont le passé n’est pas plus encourageant ? Mentionnons, entre cent autres, les mortels accidents survenus aux deux fils du Professeur Laugerhaus de Berlin.
A Berlin, au cours d’une épidémie de croup, l’un des deux fils contracta une angine simple. Redoutant qu’elle ne dégénérât en angine diphtérique, le père inquiet fit appeler le Docteur Behering — l’inventeur du sérum spécifique allemand — qui vaccina préventivement le petit malade. Une fièvre violente se déclara immédiatement, accompagnée de frissons, et la mort survint rapidement. Behering, par sa magie verbale, réussit à convaincre le malheureux père que sa mirifique invention était étrangère à la mort de son fils. Si bien que, l’année suivante, une nouvelle épidémie diphtérique s’étant déclenchée dans la capitale allemande, le père infortuné n’attendit pas que quelque symptôme du mal se manifestât chez son dernier enfant ; sans plus de délibération, il lui fit inoculer le fatal vaccin. Quelques jours après, la mort, à nouveau, emportait le garçonnet, après qu’on eut observé le même processus pathogénique que dans le premier cas.
La presse du 27 janvier 1933 enregistra, par une indiscrétion vivement réprimée, les accidents morbides ayant affecté 172 enfants venant d’être soumis au traitement préventif de l’anatoxine du Docteur Ramon. Un enfant décéda même des suites de cette intoxication. Le lendemain de cette nouvelle, un adroit communiqué réduisait le nombre des victimes, en laissant toutefois subsister le décès, et mettant sur le compte de souillures vaccinales intempestives la cause de ces troubles.
En conclusion de ce qui précède, nous estimerons donc, en accord parfait avec les Docteurs Boucher, Durville, Carton, et tous les médecins, savants et hygiénistes hostiles à cette thérapeutique d’inoculation que l’introduction dans l’organisme de virus, même à virulence atténuée, est une hérésie si l’on considère quelles substances morbides ils tiennent en suspension. Poisons chimiques, opothérapiques ou sérothérapiques, ne peuvent remédier ni s’opposer aux situations déficientes en apportant avec eux des éléments corrupteurs et perturbateurs. Ils contribuent, au contraire, à précipiter l’effondrement des résistances organiques en faussant par surcroît le jeu des automatismes de défense. Les statistiques truquées des mythomanes cyniques, avides de gains et d’honneurs, susceptibles de fausser le jugement de gens mal informés ne peuvent abuser les esprits avisés ni les chercheurs préoccupés de faits. Et ceux-ci sont là, irrécusables : une mortalité effrénée et affirmant un crescendo inquiétant.
Si, parmi l’élément médical, les ânes bâtés du doctorat persistent sincèrement dans de regrettables et funestes errements et contribuent par ignorance ou négligence, aussi par incompréhension des phénomènes naturels, à envoyer au trépas une humanité toujours soumise au bouillon de culture de la bêtise, c’est en toute conscience que les affairistes de la corporation — mercantis diplômés — cultivent, dans le public crédule, le magnifique et productif jardin des préjugés. N’oublions pas que les intérêts du médecin et du malade présumé sont antagoniques. Que les maladies disparaissent parce qu’on aura vaincu leurs causes, et c’en est fait de ces honoraires princiers qu’il soutire au patient. Eclairer la masse des profanes sur les raisons profondes de ses souffrances et mettre à sa portée les moyens — simples en eux-mêmes — propres à y remédier, ce serait tarir les sources d’une réjouissante fortune. Aussi, tant que l’aisance — et les appétits de richesse — du morticole dépendra de la maladie... et des malades, nous ne pouvons guère espérer en sa sincérité, ni en son désintéressement. Nous devons même reconnaître, pour être équitable, que les modalités d’un état social, sur lequel pèsent l’intérêt et le lucre, le contraignent souvent à oeuvrer dans ce sens immoral. Ce n’est pas lui seul, mais toute la collectivité qui est responsable des maux causés par les fils d’Esculape.
Dans une société intelligente, les honoraires médicaux devraient, au moins, non pas croître au prorata des maladies, mais, au contraire, accompagner la santé conservée. L’intérêt du médecin aurait ainsi un stimulant profitable au bien-être général....
Mais, sans attendre ces temps peut-être utopiques, il faut nous garder avec soin des manoeuvres de praticiens « à la page », et nous tourner vers les enseignements des vrais apôtres de la médecine qui, de tous temps, se sont efforcés d’éclairer l’objectif à atteindre ...
* * *
D’ailleurs, sont-ce véritablement et uniquement les microbes et bactéries qu’il faut incriminer dans la genèse et la diffusion de la plupart des maladies ? Ou n’est-ce pas plutôt l’effondrement de nos immunités naturelles, par suite d’erreurs répétées qui nous exposent à l’emprise maléfique des infiniments petits ? ..
La cuti-réaction démontre que, la race nègre exceptée, tous les humains hébergent le bacille de Koch à partir de la première quinzaine ou du premier mois de la naissance. Le colibacille est le commensal habituel, permanent et inoffensif de notre intestin. Le pneumocoque, le streptocoque, le staphylocoque, etc., sont les hôtes coutumiers de notre bouche, de notre épiderme. Le vibrion cholérique se réfugie parfois dans le tube digestif de certains individus sans occasionner de dommage, etc., etc. Tous ces parasites microscopiques vivent habituellement en saprophytes inoffensifs, à l’état de symbiose, en parfaite harmonie avec les organismes porteurs et sustentateurs, tant que l’aptitude défensive de ceux-ci demeure intacte. Nous sommes donc contraints d’admettre que ce ne peut être qu’à la faveur d’une réduction de notre système de défense, de l’affaiblissement du « terrain », que l’offensive microbienne, qui se traduit par des affections polymorphes, peut être déclenchée... Il importe donc de connaître les raisons profondes de cette décadence vitale qui nous livre, pieds et poings liés, à nos redoutables et minuscules adversaires.
Demandons-nous d’abord pour quelles raisons les animaux sauvages, qui sont exposés nuit et jour et en toutes saisons, aux douloureuses intempéries jouissent d’une magnifique santé. Parce que, à l’encontre de l’homme, ils obéissent passivement aux lois naturelles qui les régissent. L’herbivore n’ira pas emprunter au régime carné tout ou partie de son indispensable ration. Et c’est à l’abreuvoir fluvial qu’il ira étancher sa soif. Constitué pour la vie au grand air, il ignore les désastreux effets du calfeutrement. La satisfaction de ses besoins, le souci de sa sécurité l’astreignent à une activité constante qui met en jeu la totalité de son appareil musculaire interne et externe et le soustrait à cette redoutable inertie dans laquelle se complaisent la plupart des humains, particulièrement les civilisés.
Certes ! il n’est nullement question de restituer à notre bipède, la dure et pénible existence ancestrale propre à l’ancêtre des cavernes ; il est cependant urgent qu’il connaisse et pratique au moins les rudiments d’un comportement très différent de celui qu’il a, de longue date, cultivé. L’alcoolisme gradué et polychrome est, au premier chef, préjudiciable à sa santé. On ne sait en vertu de quelle aberration, de quelle altération du goût, il abandonna l’eau pure des sources pour les aigres et corrosifs breuvages qualifiés — ô ironie ! — d’hygiéniques. Il est certain qu’à elle seule, cette malfaisante habitude doit être tenue pour comptable de bien des catastrophes. La proportion des décès, en général, et l’énorme mortalité tuberculeuse, en particulier, sont rigoureusement liées à l’importance de la consommation des boissons alcooliques. La France, par exemple, qui s’est approprié l’effarant record de cette consommation avec 24 litres d’alcool absolu par an et par individu (chiffre qui laisse de côté les « suppléments » clandestins des bouilleurs de cru) détient, non seulement le record de la mortalité, mais aussi celui des décès d’origine tuberculeuse, avec le chiffre annuel de 150.000. La Hollande, au contraire, qui a vu décroître la consommation nationale du meurtrier breuvage (elle n’est plus, aujourd’hui, que de 2 litres, annuellement, par tête d’habitant), est le pays d’Europe où la mortalité est la plus faible. L’Angleterre qui a entrepris une lutte systématique contre l’alcoolisme et qui a vu la consommation de l’alcool passer de 10 litres à 7 litres par unité et par an, a bénéficié non seulement d’une amélioration générale de la santé, mais a enregistré une diminution du chiffre des décès, pour cause de tuberculose, qui, de 50.000 par an, a fléchi jusqu’à 35.000.
Voici quelques documents puisés dans le livre des Docteurs Sérieux et Mathieu : « L’Alcool » (édition Coste), établissant à quels dangers expose l’alcoolisme, même modéré, représenté par exemple, par une consommation d’un verre de vin par repas. Ils sont extraits de bilans obtenus par certaines sociétés « d’assurances sur la vie » anglaises, pour l’obtention de bases sérieuses ayant trait à leurs opérations financières. Leur impartialité ne fait, par conséquent, aucun doute.
| Morts calculées | Morts effectives | Pourcentage | |
|---|---|---|---|
| Section des abstinents | 249 | 143 | 52,42 % |
| Section générale, tempérants et buveurs | 569 | 434 | 76,27 % |
Il est à noter que le « Sceptre » assure surtout des personnes religieuses et que, par conséquent, la section générale contient presque exclusivement des tempérants.
| Morts calculées | Morts effectives | Pourcentage | |
|---|---|---|---|
| Section générale | 4.080 | 4.014 | 99 % |
| Section des abstinents | 2.418 | 1.704 | 70 % |
Donc 29 p. 100 de cas de mort de moins chez les abstinents. Aussi certaines compagnies anglaises, américaines et canadiennes accordent-elles des réductions sur les primes à payer par les clients abstinents, qui atteignent jusqu’à 25 p. 100 et elles trouvent encore un bénéfice dans cette initiative.
Ces constatations sont corroborées par ce qui suit. Le Docteur Meller a comparé les opérations, durant cinq années consécutives, de deux sociétés de secours mutuels, l’une n’admettant que des abstinents, l’autre comprenant abstinents et non abstinents, mais refusant les alcooliques fieffés. Les abstinents ne donnaient que 17 jours 12 heures de maladie ; dans la seconde, la moyenne atteignait 65 jours 15 heures.
Ci-dessous, également, une statistique anglaise publiant les chiffres proportionnels de la mortalité sur mille habitants. Elle date de 20 à 30 ans environ. Membres du clergé : 8,05 ; agriculteurs : 9,78 ; brasseurs : 21,09 ; cabaretiers : 23,57 ; domestiques de cafés et d’hôtel : 34,15.
Voici donc, par quelques aperçus, établi le rôle néfaste joué dans l’économie organique par l’insidieux alcool, même consommé modérément. Malgré son rôle prépondérant, il trouve dans d’autres breuvages tels que le café, le thé, le chocolat qui contiennent chacun un excitant toxique, des auxiliaires précieux de dégénérescence. L’alimentation carnée (voir nourriture, végétalisme, végétarisme) génératrice de toxines, de fermentations intestinales putrides, d’acide urique, etc., contribue elle aussi puissamment à faire, de l’homme frugivore, une proie facile pour la secte bactérienne. Mais il est un autre facteur de morbidité ignoré de nombre de personnes et qui cependant intervient activement dans l’affaiblissement progressif de nos défenses, si nous n’avons le souci d’y remédier : l’air confiné. Peu de gens soupçonnent l’influence capitale exercée par l’oxygène dans le jeu vital. L’homme qui en serait cependant totalement privé pendant quelques minutes seulement serait irrémédiablement condamné. C’est grâce à ce précieux comburant (qui pénètre par osmose au travers des parois pulmonaires et qui se trouve charrié par les globules rouges du sang) que l’organisme entier est copieusement ravitaillé. Combiné au carbone d’origine alimentaire, il pourvoit l’immense réseau nerveux et musculaire en énergie thermo-dynamique, intellectuelle et physique. Il assure, par surcroît, par combustion, la destruction de certains déchets organiques dont l’accumulation constituerait un danger redoutable pour les fonctions normales. Il importe donc au plus haut point, de ne pas limiter ses apports et, pour cela, de renouveler le plus possible, jour et nuit, l’air des appartements. C’est d’ailleurs au cours de la portion nocturne de la journée que l’aération des locaux habités est le plus facile à réaliser (et ce, l’hiver comme l’été : il suffit de se couvrir en conséquence). C’est d’ailleurs grâce à cette louable pratique de l’aération continue que préventoria et sanatoria obtiennent une amélioration notable de maints hospitalisés. Il sera d’ailleurs facile de s’imaginer à quels dangers on s’expose à respirer constamment un air pollué par la respiration, lorsque l’on saura que l’eau de condensation provenant de l’expiration pulmonaire tue infailliblement l’animal auquel elle est injectée.
L’hydrothérapie fait partie intégrante des mesures préventives et curatives d’hygiène susceptibles de maintenir intactes ou de les renforcer en cas d’affaiblissement, nos immunités naturelles. Sachons nous rappeler que notre épiderme fait partie de notre système respiratoire et qu’un quart environ de la somme totale d’oxygène absorbé pénètre dans l’organisme par voie cutanée. En revanche, de nombreux déchets toxiques provenant de la désassimilation sont expulsés par les conduits épidermiques qui parviendraient, en cas de malpropreté systématique, soit à être partiellement résorbés, soit à obstruer l’orifice des pores par où se font ces intéressants échanges. Tous les animaux à qui l’on supprime la respiration de la peau, par l’application d’un enduit obturant tel que le goudron, par exemple, périssent par asphyxie et par intoxication. Les ablutions générales fréquentes, quotidiennes même, constitueront donc une excellente mesure complémentaire au service de la santé, en débarrassant l’épiderme des sédiments qui l’enduisent et chatouillent désagréablement l’odorat.
Une gymnastique (voir : culture physique) rationnelle s’imposera donc, afin de pallier au danger du sédentarisme actuel, rendu de plus en plus fréquent et plus complet du fait du développement du machinisme, des moyens de locomotion mécaniques, par suite aussi de la spécialisation du travail, de l’existence de professions où l’effort musculaire est réduit à zéro (employé de bureau, écrivain, etc.). Si l’on peut compléter cette mesure par la pratique d’un ou plusieurs sports dépourvus de brutalité, tels que : marche, course, natation, saut, gymnastique d’agrès, la réception microbienne sera virtuellement vaincue. Les malingres, les chétifs, les tarés congénitaux dotés d’une désastreuse hérédité pourront briguer, à bien des titres, une rassurante santé.
L’exposition à l’air libre de la peau, pratiquée le plus fréquemment possible (voir nudisme), agrémentée d’un convenable et judicieux ensoleillement, lorsque les conditions atmosphériques et climatériques le permettent, complèteront admirablement cette cure d’ensemble. Les enfants surtout, au cours de leur développement physique, seront les bénéficiaires particulièrement privilégiés de l’influence solaire. D’incroyables cures de régénération infantile ont été obtenues sur des sujets atteints de rachitisme, d’anémie, de prétuberculose, etc.., par le nudisme et l’héliothérapie combinés. Une prudente progressivité présidera à l’adaptation ainsi, d’ailleurs, que pour chaque méthode innovatrice en matière d’hygiène. Il est nécessaire de tenir compte d’une foule de considérations dans l’application de chacune d’elles : des idiosyncrasies personnelles, de l’hérédité, des tares congénitales ou acquises qui influent diversement selon les possibilités de réaction et d’adaptation individuelles. C’est au médecin, au conseiller hygiéniste, à toute personne chargée de cette complexe réalisation, à faire intervenir souplesse éclairée et mesure dans leur appel aux nouveaux agents régénérateurs. Mais tous ont à gagner à l’introduction d’une sage méthode naturiste. Quelques faits suggestifs, entre mille, contribueront, mieux que les plus brillantes dissertations, à souligner l’importance du respect de certaines règles hygiéniques.
Mme Boussard, la mère de l’auteur du « Tour du Monde d’un Gamin de Paris », fut atteinte, à l’âge de 36 ans, d’une très grave maladie du foie qui faillit l’emporter. Sur les conseils de Lamartine, elle adopta le régime végétarien et mourut, sans récidive et sans autre accident, à l’âge de 106 ans. Elle attribuait, d’ailleurs, sa longévité au régime qu’elle avait adopté.
L’anecdote suivante n’est pas moins curieusement caractéristique : le Docteur Huchard était parvenu, grâce à la diète végétarienne, à sauver un homme fort mal en point. Il se portait admirablement bien depuis dix-huit mois, lorsqu’un beau jour, il eut la fâcheuse idée, étant entré dans un restaurant, de commander de la langouste et du gibier. Le jour même, il dut réintégrer l’hôpital, atteint de troubles caractéristiques d’intoxication d’origine alimentaire et il mourut quelques jours après, des suites de son imprudence.
Evidemment, tous les faits ne sont pas identiques, tous les cas n’ont pas le même processus et chaque erreur, chaque imprudence ne comporte pas semblables sanctions pathogéniques. Mais les petits ruisseaux font les grands fleuves ; les plus minimes écarts, les plus insignifiants manquements parviennent, totalisés, à une somme imposante susceptible, à la longue, d’influer fâcheusement sur la santé. D’autre part, il serait absurde d’imaginer que chacun est en droit de briguer le centenariat, sous le puéril prétexte d’un rigoureux et permanent respect de toutes les prescriptions d’hygiène. Mais leur judicieuse observation permet à celui que le destin a fait hériter d’une hérédité déficitaire d’en soulever assez le redoutable poids pour assurer à son existence, le gain de nombreuses années sereines. Au contraire, l’inconscient qui dilapide son capital-santé par une conduite absurde s’acheminera inéluctablement au tombeau, dès cet âge chanté par le poète et où la vie magnifique ne devrait lui prodiguer que des sourires .... Combien de bambins, d’adolescents, d’adultes enfin, tués prématurément qui eussent pu ou qui pourraient jouir d’une longue et paisible existence, s’ils avaient été soumis à une judicieuse et supportable discipline, s’ils avaient connu et observé les principes essentiels qui constituent une règle intelligente de vie ! « L’homme ne meurt pas, il se tue », affirmait Sénèque, au lointain des siècles, dénonçant dans sa clairvoyance attristée, les énormes bévues de l’humanité. Aujourd’hui, comme au temps de Néron, la sentence a conservé sa dure exactitude.
Ah certes ! nous ne l’ignorons pas, ce n’est pas sans efforts, sans lutter contre soi-même, contre les mille tentations quotidiennes que l’homme parvient à triompher de l’atavisme, de l’éducation, des habitudes tenaces. Mais la volonté s’acquiert, se développe au cours de ces multiples combats et permet bien d’orgueilleux retours sur soi-même. A son aide viendra aussi l’autosuggestion, si secourable lorsqu’elle est invoquée opportunément. Il faut bien se pénétrer qu’à la base de toute réalisation individuelle, qu’elle soit d’ordre physiologique ou social, le principe du refoulement est acquis. L’individu ne peut espérer instaurer des harmonies sans réagir contre l’ancestrale bestialité qui somnole en chacun de nous. Il n’est pas d’autonomie personnelle qui se conçoive sans que la poigne souveraine de la volonté ne maîtrise les sourds élans de l’instinct, les soubresauts du subconscient. Il importe par dessus tout que chacun soit son propre législateur, l’ordonnateur de sa loi. Mais si l’être humain, véritable cellule sociale, est impuissant à commander à ses comportements passionnels, si ses instincts étroits — individuels ou sociaux — dominent ses décisions, c’en est fait du doux rêve poétique du bonheur par l’entr’aide, d’une existence sérieuse faite du respect mutuel des droits de chacun.
Celui qui a conscience de ces conditions, qui est pénétré de la nécessité d’une forte personnalité sociale ne peut donc — dans le domaine de la santé comme ailleurs — délibérément récuser la valeur de cette méthode de contrôle averti et volontaire sans laquelle rien ne peut subsister d’objectif et de durable. Et, à l’introduire dans son existence, il goûtera cette satisfaction délicieuse de jouir de la plénitude de ses moyens physiques et intellectuels ; et il s’assurera à la fois l’équilibre qui garantit la durée du bonheur et la longévité qui le couronne.
— J. MÉLINE.
BIBLIOGRAPHIE. — La Cure naturiste (Dr Durville) ; Rajeunir (Phusis) ; Le Naturisme intégral (J. Demarquette) ; Le Décalogue de la Santé (Dr Carton) ; Enseignement et traitement naturiste pratique : 1ère, 2ème et 3ème séries (Dr Carton) ; L’éducation physique ou l’entraînement complet par la méthode naturelle (G. Hébert), ainsi que les ouvrages mentionnés aux bibliographies de « nourriture, culture physique, végétarisme, végétalisme, etc... ». Revues à consulter : Naturisme, Régénération, Vivre, Rajeunir, etc...
SATIRE
Le mot satire (substantif féminin) ne doit pas être confondu avec satyre (substantif des deux genres). Ils sont d’origine et de sens différents.
Les Grecs, puis les Romains, appelèrent Satyre — Satyrus, en latin — un demi-dieu, homme de la nature, habitant des bois, dont les jambes et les pieds étaient ceux d’un bouc. Un sens malveillant ayant été attaché à ce nom, on l’emploie aujourd’hui pour qualifier un homme débauché, brutal, cyniquement entreprenant auprès des femmes. On l’a donné aussi à certains singes, à des insectes et au champignon appelé « phallus ». En Grèce, puis à Rome, on appela satyre, au féminin, une pièce de théâtre dont les personnages étaient des satyres et dont le caractère était simplement amusant, contrastant avec celui de la tragédie et différent de celui de la comédie. (Voir Théâtre.)
Le mot satire, dont nous nous occuperons particulièrement ici, vient du latin satira, ou satura, qui désignait un mélange bariolé, un plat composé de différents mets, la réunion des fruits variés de l’offrande à Cérès. Ce sens primitif se retrouve dans lanx satura, nom donné à un compotier de fruits divers. Par extension, on appela, à Rome, satira, des farces imitées des satyres grecques, de plus en plus mêlées de fantaisie et de raillerie, qui firent de véritables pots pourris scéniques et poétiques. Ainsi fut formé le genre littéraire de la satire, le seul qui soit originalement latin. Quintilien disait :
Satira tota nostra est. (« La satire nous appartient toute. »)
Lucilius l’inaugura au IIème siècle avant J.-C. ; elle s’est continuée depuis, soit entièrement en vers, soit mêlée de vers et de prose, soit encore entièrement en prose. Ce fut la satire classique de Terrentius Varron, auteur des célèbres satires ménippées, en souvenir du philosophe Ménippe, celle d’Horace, de Sénèque, de Perse, de Lucain, de Martial (inventeur, dit-on, de l’épigramme), de Juvénal, de Pétrone, de Suétone dont la Vie des douze Césars constitue l’envers du plutarquisme dévoué à ces personnages, de Lucien, le seul grec dans cette énumération, et le plus grand rieur de tous, le plus véritablement satirique. Car il faut le constater : la satire ne fut si brillante à Rome que parce que l’esprit romain était incapable de s’illustrer dans un autre genre. La satire fut à Rome la revanche de l’esclavage et non la manifestation de libres esprits. C’est de cette satire romaine à laquelle les puissants laissaient la liberté de s’exprimer, qu’E. Despois a dit assez durement :
« La liberté de la satire n’a rien que de très compatible avec la servitude ; c’est la liberté des limiers au moment où on les découple et où on les lâche sur le gibier. »
Il y a, de la satire grecque à la satire romaine, la distance qu’il y a de la liberté à l’esclavage.
La véritable satire s’était exprimée bien avant que les Romains en eussent fait un genre littéraire. Elle avait emprunté toutes les formes de l’art, et s’était même exprimée sans art, pour :
« Censurer, tourner en ridicule, les vices, les passions déréglées, les sottises des hommes. » (Littré)
Pour intervenir dans tous les événements et prendre la défense de la liberté de l’esprit contre l’autorité, de la libre humanité contre l’asservissement social. Dès les premiers conflits humains, la satire, c’est-à-dire la raillerie, la moquerie, l’ironie cinglante, le rire vengeur, a dû être l’arme du faible contre le puissant. Elle a été la fronde de David, le glaive de Siegfried, la flèche de Guillaume Tell. Elle est l’aiguille qui pique et fait se dégonfler les outres énormes de la sottise. Elle est le « chétif insecte » qui déclare la guerre au lion. Elle est l’esprit contre la matière ; Ariel contre Caliban. Elle cloue au pilori les faux grands hommes, les pitres malfaisants qui empoisonnent le monde de leur imposture, l’accablent de leurs dogmes et tiennent sous leur puissance les foules fanatiques et abruties. Elle arrache leur masque aux Jupiters de théâtre, aux Mercures de tripot, aux Jurions de lupanar, aux Césars de carton. Elle met à nu leur viduité intellectuelle, leur indigence sentimentale, leur laideur physique, leur saleté morale. Elle révèle les tares secrètes des Hercules et des Apollons de tréteaux, la lâcheté de leur héroïsme statufié, l’infamie de leur gloire perpétuée par les « Patries reconnaissantes », l’aliénation de leur jugement. Elle montre le gâtisme maître du monde, la débauche législatrice de la vertu, la friponnerie dirigeant les affaires, la forfaiture distribuant la justice, le proxénétisme patronnant les bonnes moeœurs. Elle sème le rire, vengeur de la solennelle imbécillité pontifiante. C’est elle qui souffle dans les roseaux que Midas a des oreilles d’âne. Elle est nécessaire à l’humanité contre les fausses « élites » qui ne doivent leur prééminence qu’à leur insanité. Elle est la justice immanente qui remet en place le monde à l’envers où le coquin triomphe. Le malheur est que cette justice immanente vient trop souvent trop tard, quand le coquin est mort dans la gloire et le profit de ses turpitudes.
M. Brunetière (Grande Encyclopédie) nous paraît avoir exactement caractérisé la satire lorsque, la séparant de la comédie, il a dit qu’elle est une forme du lyrisme, c’est-à-dire de la façon de sentir et de l’expression particulières à l’individu. Elle est la forme indignée ou ironique de ce lyrisme, comme l’ode est celle de son enthousiasme et l’élégie celle de sa tristesse. Tous les genres de l’art et de la littérature qui ont pour but de représenter la vie, les moeœurs, les caractères, peuvent être satiriques ; mais ils ne le sont que si l’auteur ne se borne pas à une représentation impersonnelle de son sujet, qu’il y mêle une attaque, une critique, une raillerie, une intention morale, réformatrice. L’auteur comique montre la société et les hommes sans même chercher, parfois, à provoquer le rire et sans intention morale ou sociale. Il n’est qu’un artiste. Le satiriste, au contraire, prend parti, avant toute chose ; la raison de son œoeuvre, son but, est d’exprimer son indignation ou sa raillerie, de réformer le monde, de corriger les hommes. Il n’est pas toujours un artiste ; il est toujours un partisan, un militant, un moraliste. Il se jette dans la bataille que l’auteur comique se borne à observer et à dépeindre. Il arrive cependant que sans avoir d’intention sociale ou morale l’artiste fait œoeuvre satirique par la simple peinture d’une réalité haïssable, honteuse, blâmable par elle-même. C’est par là que la satire trouve un appui très important dans l’art naturaliste. Les artistes et les poètes les plus grands ne sont pas ceux qui ont édifié les chefs-d’œoeuvre de « l’art pour l’art », se contentant, en tant qu’hommes, de paître dans le gras pâturage du mensonge social où les « mauvais bergers » et les chiens de l’Ordre contiennent les moutons dociles ; ce sont ceux qui ont brandi le fouet de la satire pour cingler les « mauvais bergers », les chiens et les moutons eux-mêmes. Il n’est pas d’époque où l’esprit vigilant de la satire n’ait dressé contre le crime sa protestation indignée et, contre la sottise, son ironie vengeresse. Taine a dit :
« La satire combat contre les oppresseurs. »
Le rire moqueur est l’antidote de l’imbécillité pontifiante.
La fable du Lion et le Moucheron, comme toutes les fables auxquelles les La Fontaine ont donné la forme classique moderne, les contes, les légendes satiriques, remontent, avec toute la littérature, dans la nuit des temps, aux premiers vagissements de la pensée humaine. (Voir Littérature.) Ils nous viennent des époques préhistoriques où hommes et bêtes s’identifiaient, et les bêtes ont probablement appris aux hommes à railler comme elles leur ont appris tant d’autres choses. La satire est peinte sur les parois des cavernes, elle est gravée dans la pierre et le bronze millénaires avec tout ce dont ils ont voulu conserver la mémoire.
Bien avant que le romain Lucilius fit de la satire un genre littéraire académique, Archiloque de Paros lui avait donné son expression la plus véhémente et inventé, pour cela le « vers iambique » qu’Horace appelait « l’arme de la rage ». Le nom d’Archiloque fit l’adjectif archiloquien qui qualifia pour les Grecs ce qui était furieux et mordant. Trois siècles après Archiloque, cinq siècles avant J.-C., Aristophane, créateur dramatique qui fut l’Homère du théâtre antique, apporta à la scène la satire universelle, rugueuse, cynique, cinglante, avant que la satyre l’eût réduite à un amusement rassurant pour les gens « comme il faut », respectueux des maîtres et des dieux. Et Lucien vint, à la fin des temps académiques, jeter le rire vengeur de la pensée grecque, de sa lumière, de sa splendeur, bannies du monde par le triomphe de la lourde soldatesque romaine, avant-garde de la sombre et sanglante tyrannie de la Croix abrutisseuse du genre humain.
La vie publique avait fourni son aliment à la satire dans l’antiquité. Dès les premiers temps chrétiens, ce fut l’Eglise, dominatrice de plus en plus indigne, qui lui procura son élément le plus important et le plus inépuisable. Contre cette satire qui l’avait assaillie dès sa fondation, l’Eglise n’eut et ne put avoir jamais d’autre recours que ceux de la fourberie et de la violence. L’Eglise n’avait que quelques années d’existence lorsque l’apôtre Barnabé écrivait déjà, prophétiquement :
« Elle entrera dans la voie oblique, dans le sentier de la mort éternelle et des supplices ; les maux qui perdent les âmes apparaîtront ; l’idolâtrie, l’audace, l’orgueil, l’hypocrisie, la duplicité du cœoeur, l’adultère, l’inceste, le vol, l’apostasie, la magie, l’avarice, le meurtre, seront le partage de ses ministres ; ils deviendront des corrupteurs de l’ouvrage de Dieu, les courtisans des rois, les adorateurs des riches et les oppresseurs des pauvres. »
Les « hérésies », si nombreuses dans les premiers siècles, furent le résultat de la critique exercée par une satire plus ou moins grave ou gouailleuse contre les insanités annoncées par Barnabé. Il n’est pas de Pères de l’Eglise qui n’ait dénoncé avec plus ou moins d’indignation et de véhémence les agissements des boutiquiers ecclésiastiques. Saint Jérôme, le plus remarquable des écrivains du christianisme, fut aussi le censeur le plus énergique des vices des chrétiens de son temps. Il fut un terrible satirique. Lorsque les mœoeurs dépravées du clergé obligèrent les empereurs romains à édicter l’interdiction pour les prêtres d’aller dans les maisons des veuves ou des filles seules et de recevoir, à titre de donation ou par testament, les biens de leurs pénitentes, Jérôme disait :
« Je n’ose pas me plaindre de la loi, car mon âme est profondément attristée d’être obligé de convenir que nous l’avons méritée et que la religion, perdue par la convoitise insatiable de nos prêtres, a forcé les princes à nous appliquer un remède aussi violent. »
Jérôme écrivait à Eustochie contre « les hypocrites qui briguent la prêtrise ou le diaconat pour voir les femmes plus librement ». Il ajoutait :
« Des évêques mêmes, sous prétexte de donner leur bénédiction, étendent la main pour recevoir de l’argent, deviennent esclaves de celles qui les paient, et leur rendent avec assiduité les services les plus bas et les plus indignes, pour s’emparer de leurs héritages. »
Naturellement Jérôme, comme Jean Chrysostome et nombre d’autres, fut calomnié et persécuté par ceux qu’il dénonça, et il dut quitter Rome.
On ferait une immense bibliothèque de tous les écrits satiriques contre l’Eglise, depuis ceux des Pères jusqu’à ceux des journaux anticléricaux d’aujourd’hui. Et ce ne serait pas ces derniers qui seraient les plus violents. Depuis longtemps, l’Eglise a été jugée et flétrie, bien jugée et bien flétrie, par les siens eux-mêmes : papes, princes, clercs et bedeaux de tous les degrés qui, nourris dans le sérail, en connaissaient les détours mieux que personne. L’indignation et la colère de Dante et de Pétrarque n’ont pas été plus accusatrices et plus flétrissantes que celles de Jérôme dont, malgré ce, l’Eglise a fait un saint en se l’annexant astucieusement.
La littérature du moyen âge, qui fut didactique au point que certains contestent encore son esprit satirique, trouva l’élément principal de sa satire dans le monde religieux. Avant que l’imprimerie répandît la satire écrite, l’orale s’exprima surtout dans la prédication religieuse dont la forme changea complètement lorsque, à partir du XIIème siècle, les Abélard apportèrent en chaire ces critiques des moeœurs ecclésiastiques que les saint Bernard n’exprimaient que par écrit. Au XIIIème siècle, les sermons furent envahis par le langage macaronique, mélange de latin et de langue vulgaire, que Folengo colporterait en Italie et, qu’après Gilles d’Orléans, les Olivier Maillard emploieraient pour se faire comprendre du peuple de France. Avec ce langage, la plus audacieuse satire envahit les églises. Dante protestait, indigné ; mais Boccace en prenait son parti ironiquement et écrivait dans la conclusion du Décaméron :
« Considérant que les sermons faits par les prédicateurs pour reprendre le peuple de ses péchés sont le plus souvent aujourd’hui pleins de gausseries, de railleries et de brocards, j’ai cru que les mêmes choses ne seraient pas mal séantes en mes contes que j’ai écrits pour chasser la mélancolie des dames. »
Dante était le dernier représentant de cette satire enflammée, vengeresse, inspirée du premier christianisme implacable dans sa foi. Boccace préludait au scepticisme ironique, joyeux, des papes eux-mêmes qui écrivaient contre l’existence de Dieu, scepticisme qui se gausserait de l’Inquisition et de Tartufe et s’exercerait avec une verve aussi éclatante que dépourvue de frein. En même temps, la chaire serait la tribune la plus furieuse. Plus violents que personne, les moines y prêcheraient même le tyrannicide. Gens d’église, ils étaient les « oiseaux sacrés » même contre l’Eglise. Les rois eux-mêmes n’osaient les toucher, et Maillard répondait hardiment à un messager de Louis XI qui le menaçait de le faire jeter à la rivière :
« Va dire à ton maître que j’irai plus vite en paradis par eau que lui avec ses chevaux de poste. »
On ne touche pas davantage aujourd’hui, dans la République laïque, aux « oiseaux sacrés » qui prêchent l’assassinat. Le 25 mars 1912, le Père Janvier, à l’église Notre-Dame, appela ses ouailles au « massacre des hérétiques ». Il le fit impunément. Qu’un laïque parle ou écrive contre l’Eglise et sa séquelle, même sans montrer un aussi sauvage fanatisme ; la République et ses « lois scélérates » ne le rateront pas. Un récent procès de l’Emancipation de La Mayenne l’a démontré, parmi tant d’autres. Le crime de lèse-religion se retrouve inscrit dans la jurisprudence républicaine laïque, en attendant qu’il le soit de nouveau dans le code.
La simonie (voir ce mot) et le commerce des indulgences, les mœoeurs dépravées de la cour et du clergé paillardant avec le Diable, excitèrent particulièrement la faconde des Menot, des Messier, des Maillard, des Jacques Legrand, des Guillaume Pépin, des Jehan Petit, tous gens d’église. Rabelais n’aurait pu être aussi violent impunément ; Des Périers, Servet et d’autres payèrent de leur vie une audace bien moins grande. Cet esprit satirique anticlérical produisit, parmi des milliers d’ouvrages : en France, les Sérées, de Bouchet, le Cymbalum Mundi, de Des Périers, le Moyen de parvenir, de Béroalde de Verville ; en Allemagne, la Nef des fous, de Brandt, l’Eloge de la folie, d’Erasme, les Epistoloeœ obscurorum vivorum, d’Ulrich de Hutten, les prédications de Murner contre tous les clergés catholiques ou protestants, les productions des « moines bouffons » et des « espiègles » allemands. Tous, avec d’innombrables pamphlets, préparèrent et firent triompher la Réforme. Cet esprit atteignit jusqu’au sombre Savonarole qui le mit au service de la révolution démocratique qu’il prêchait en Italie. Même chez ceux qui réprouvaient les licences du langage macaronique, chez les saint Bonaventure, saint Bernard, Nicolas de Clémangis, Gerson, Pierre d’Ailly, graves docteurs qui voulaient réformer noblement l’Eglise, la satire était terriblement accusatrice contre le monde clérical. Clémangis écrivit le De Corrupto Ecclesia statu ; on a dit qu’un pape en mourut de douleur !
Pour la plupart des oeœuvres du moyen âge, la question a été posée, avons-nous dit, à savoir si elles appartiennent à la satire. La réponse n’est pas douteuse pour les oeœuvres qui ne sont pas purement didactiques. Il est d’ailleurs à remarquer que, pendant longtemps, les genres ne furent pas nettement tranchés entre ce qu’on a appelé la littérature chevaleresque et la littérature bourgeoise. La séparation vint de la distinction grandissante des classes sociales. La satire dut aider puissamment à la réforme des moeœurs dites « chevaleresques », à la réprobation de l’inhumaine hostilité de l’Eglise contre la femme et à la formation de l’amour courtois. De même, aux protestations contre les seigneurs, les moines, les sergents, toutes les engeances de rafle-pécune et de perce-boyaux qui pillaient et maltraitaient le pauvre monde. Le Roman de la Rose, dont on conteste l’esprit satirique, est à ce sujet caractéristique. Pour le Roman de Renard, « épopée des animaux », son esprit satirique est encore moins contestable. Il est de la fable, dit-on. Oui, mais de la fable étonnamment proche de la vérité humaine, d’une vérité si crue, si peu reluisante, qu’on l’a mise sur le compte des animaux pour pouvoir critiquer avec plus de liberté. Peut-on nier la satire des Fables de La Fontaine et leur intention sociale et morale ?
Une remarque est à faire ici. C’est que l’esprit satirique a un caractère particulier chez chaque peuple. Il est essentiellement son expression foncière, demeurée à l’abri des influences étrangères. Les peuples peuvent subir, successivement ou alternativement, les influences les plus diverses ainsi qu’on l’a vu si souvent en littérature ; leur esprit critique, né de leur façon particulière de sentir, leur rire, le ton de leur raillerie leur demeurent strictement personnels. C’est ainsi qu’on discute toujours sur l’intention satirique de Cervantès écrivant Don Quichotte. La satire de Shakespeare, toute dans la forme de « l’humour » anglais, échappe encore plus aux étrangers, alors qu’ils éprouvent toute la puissance dramatique et poétique de son œoeuvre. C’est le caractère populaire de l’esprit satirique qui l’a fait si vivant sous la croûte scolastique du moyen âge. Il a débordé dans toutes les formes, littéraires et artistiques, religieuses et politiques, pour se mêler, bien plus étroitement qu’aujourd’hui, à la vie sociale. Il est monté de la terre dans le fableau, du pavé des villes dans le roman et le théâtre ; il semble descendu du ciel par les flèches et les tours des cathédrales et des beffrois, par les voix de la chaire. Au-dessous d’un certain degré de la hiérarchie ecclésiastique, le clerc était plus du peuple que d’église. Il n’était pas encore sous la tutelle de la discipline perende de cadaver ; il avait femme, enfants, famille, il dansait avec eux jusque dans l’église où il participait aux joyeusetés populaires les moins édifiantes, comme les Fêtes des fous, la Messe de l’Âne, parodies du culte, dont il était le principal animateur.
La satire, au moyen âge, forme une immense littérature dans celle de ce temps-là. Elle la domine et il est nécessaire de la connaître pour savoir ce que fut réellement l’esprit de cette époque. La place nous faisant défaut, nous ne pouvons mieux faire que de renvoyer pour cette connaissance à l’ouvrage de C. Lenient : La satire en France au moyen âge. Trouvères et troubadours dénonçaient l’avidité du clergé, la sodomie qu’il pratiquait. Jean de Vitry constatait, devant les scandales de la sodomie monacale, que celui qui entretenait publiquement une ou plusieurs concubines était un homme exemplaire. Le pape Innocent III lui-même disait de ses cardinaux, évêques et autres pieux personnages :
« Ils ne connaissent d’autre Dieu que l’argent, ils ont une bourse à la place du coeœur. »
Dans sa Bible, Guyot de Provins s’exprimait violemment contre la fourberie, la paresse, la gloutonnerie, les débauches cléricales. Les sirventes des troubadours furent une protestation véhémente contre la Guerre des Albigeois. L’oeœuvre la plus remarquable de la satire de la société féodale et religieuse est le Roman de la Rose, dans la seconde partie dont Jean de Meung est l’auteur. Des esprits « distingués » affectent de nos jours de dédaigner cette Œoeuvre « incompréhensible et ennuyeuse ». Avec juste raison, R. de Gourmont a observé que le Roman de la Rose connut pendant deux siècles un succès ininterrompu auprès d’un « large parti d’esprits libres, amoureux de la vie et de la beauté », et d’un « public singulièrement intelligent et délicat ». On retrouverait difficilement un tel parti et un tel public aujourd’hui. Rutebeuf, dans sa défense de l’Université contre les moines, le roi et le pape, Villon, dans ses Testaments, Olivier Basselin et ses compagnons, dans leurs chansons contre les « goddams » du temps de la Guerre de Cent ans qui venaient bousculer les tables autour desquelles ils buvaient joyeusement, firent aussi Œoeuvre satirique.
Entre le moyen âge et les temps modernes, deux oeœuvres dominent de très haut cette époque de formation de l’esprit critique et mettent la satire au-dessus de toute autre littérature. Ce sont l’Enfer, de Dante, et le Gargantua et Pantagruel, de Rabelais. L’une a apporté, au crépuscule du moyen âge, la condamnation hautaine, impitoyable, formulée avec une puissance d’accent qui n’a d’égale que la passion magnifique de son inspiration, de la société féodale et de son oeœuvre d’écrasement de la vie, d’étouffement de la pensée. L’autre a fait entendre à l’aurore des temps modernes les aspirations d’un monde nouveau, la voix fraternelle de la sagesse, appuyée sur la science « nourricière du monde » et la conscience, contre l’ignorance, la superstition et la violence. Sous la forme joyeuse de la raillerie énorme, truculente, parfois scatologique que la prudence imposait à qui ne voulait pas être brûlé vif, Rabelais a exprimé la protestation anticipée, et non moins énergique, de la nouvelle espérance humaine contre toutes les forces qui cherchaient à entraver sa marche vers la vie, la lumière et la liberté. Et Rabelais est allé si loin au fond des choses et dans le lointain de l’avenir que depuis quatre cents ans sa satire est toujours actuelle, qu’elle est toujours redoutée, et qu’on ne cesse pas d’amoindrir la portée de son Œoeuvre au lieu de la mettre en évidence. Dernièrement, encore, la plus récente critique affectait de ne voir dans la « dive bouteille » en quoi « toute science est enclose », que le flacon des joyeux buveurs. (Larousse mensuel, mai 1933.) Qui donc dira aujourd’hui, dans une presse de plus en plus farcie d’imposture, que la « dive bouteille » de Rabelais est celle de cette sagesse que les hommes n’ont toujours pas su trouver ? « Science sans conscience est la perte de l’âme », disait-il. Après quatre cents ans de progrès scientifique et de développement intellectuel, le savant Langevin fait aujourd’hui cette constatation :
« Le problème actuel est, en réalité, un problème de justice et non pas de technique. Il vient de ce que les nouveaux moyens d’action se sont développés trop vite dans un monde mal préparé pour les recevoir, et parce qu’au lieu de profiter à tous les hommes, ils ont été exploités surtout par des égoïsmes, individuels ou collectifs, et cela par suite d’un développement insuffisant de la justice sociale, d’une part, et de la justice internationale d’autre part. » (Vu, 1er mars 1933.)
Là où Rabelais disait : conscience. le savant Langevin dit : justice. Or, c’est la même chose. Là où il y a conscience, il y a justice, et là où il y a justice, il y a conscience. Mais il n’y a pas plus justice aujourd’hui qu’il n’y avait conscience au temps de Rabelais, et la satire gargantuine et pantagruéline est toujours d’actualité. Car le monde est toujours la proie des va-t-en-guerre, des chats fourrés, des papimanes, des sorbonistes, des taupetiers, des gourmandeurs, des apedeftes, et l’on a vu se multiplier la malfaisance des Picrochole, des Toucquedillon, des Trinquamelle, des Grippeminaud, des Bridoye, des Papegaut, des Holoferme, des Janotus, tous odieux ou ridicules, « oiseaux sacrés » dévorateurs sinistres de la substance du monde, « vieux tousseux » abrutisseurs qui « abâtardissent les bons et nobles esprits et corrompent toute fleur de jeunesse ».
C’est ainsi que du bouillonnement des esprits étouffés durant douze siècles, sortirent d’abord les deux œoeuvres les plus considérables de la satire, celle de Dante et celle de Rabelais, et que commença la formidable éruption des trois autres siècles qui firent la Réforme, la Révolution française et le XIXème siècle.
Si l’on ignore trop, dans la littérature française, Jean de Meung et Rabelais, on oublie trop aussi, dans la littérature allemande, les « espiègleries » de l’époque appelée « sensualiste » au XVIème siècle. On voit généralement la littérature allemande dans l’idéale poésie des Minnesänger, dans leur solennité et dans leur formalisme trop souvent ridicule. On refuserait volontiers à la « lourdeur » allemande la possibilité du rire satirique comme on refuse la grâce et la légèreté à sa musique. « L’honneur national » français est, paraît-il, engagé dans ce débat ! On ne voit pas assez ce que l’esprit allemand a apporté, dans son interprétation de la réalité, de vérité et de vie, et dans la satire, de fantaisie, de gaieté, de vivacité, de raillerie et d’imagination. Le mot français espiègle vient de l’allemand Eulenspiegel (le miroir des hiboux, l’Espiègle), qui est le type le plus populaire dans la littérature d’Allemagne. Il a Panurge pour frère français. C’est lui qui a porté les plus rudes coups aux romans chevaleresques en montrant dans leurs héros de véritables chevaliers d’industrie, des « gentilshommes fripons » ne craignant pas de se compromettre dans des aventures dignes des vulgaires escrocs d’aujourd’hui. Jamais satire ne cingla plus profondément, parce qu’elle fut vraie, la superbe seigneuriale que dans les narrations de Hans de Schweinichen. Jamais aussi satire ne fut plus agressive et violente, jamais farce ne fut plus amusante, contre les gens d’église que celles de ces « espiègles » qui créèrent les types du moine Rush, du curé du Calemberg dont le nom semble avoir produit les mots français : calembour et calembredaine, et du curé Ameis. Cette satire, moins savante, était plus à la portée du peuple que celle des Brandt, Erasme, Reuchlin, Ulrich de Hutten. Luther portait à l’Eglise des coups non moins profonds que ceux des savants occupés à la grande querelle née des exploits de Pfeffercorn (Grain de Poivre), grotesque juif converti parce qu’il n’avait pas réussi à se faire prendre pour le messie par ses coreligionnaires, et qui avait entrepris de faire brûler les livres des juifs et ceux-ci en même temps ! C’est dans cette querelle, pour la défense de Reuchlin, qu’Ulrich de Hutten lança ses Epistoloe. Aujourd’hui on voit l’odieux Hitler renouveler les sottises de Grain de Poivre ! L’esprit satirique allemand fut étouffé par la terreur et les misères des deux siècles qui suivirent la sinistre Guerre de Trente ans. L’esprit de Till Eulenspiegel se transmit timidement au XVIIème siècle à ce Simplicissimus, dont le descendant vient de capituler devant Hitler. Il fut plus hardi dans le pré-romantisme et le romantisme, dans Jean-Paul Richter en particulier.
Le temps de la Renaissance vit refleurir la satire littéraire avec Clément Marot, inventeur du coq à l’âne, Du Bellay, auteur du Poète courtisan, Ronsard qui écrivit les Discours sur les misères de ce temps. Ils firent intentionnellement Œoeuvre satirique, mais la littérature fut dominante chez eux. Avec D’Aubigné, la satire fut plus ardente et combative. Dans ses Tragiques, il mit au pilori le règne d’Henri III , et dans la Confession de Sancy, il voua au mépris public les consciences élastiques d’Henri IV et de ses amis qui changeaient de religion suivant leurs intérêts. A cette satire littéraire et combative, Henri Estienne apporta son Apologie pour Hérodote, Pasquier, le Livre des recherches, Régnier de la Planche, le Livre des marchands et l’Etat de la France sous François II. Pierre Viret avait préludé aux pamphlets des guerres de religion par ses Satyres chrétiennes de la cuisine papale. Ces pamphlets se multiplièrent, s’élevant aux hauteurs lyriques de la Satire Ménippée ou s’abaissant jusqu’aux libelles les plus fangeux et les plus violents. Auprès de ces derniers, les homélies pâteuses et trop richement rimées d’un Duverdier, seigneur de Vauprivas, contre la corruption du siècle, n’étaient que de la guimauve.
Il fallait alors plus de courage pour dire la vérité dans la satire littéraire que pour provoquer à l’assassinat dans le libelle ordurier. Les grands redoutaient la première ; ils s’amusaient du second, même quand il levait le poignard sur un Henri de Guise ou un Henri III. Marot écrivait :
Je la dirais ... mais garde les fagots !
Et des abus dont l’Eglise est fourrée
J’en parlerais ... mais garde la bourrée ! »
Marot dut s’exiler pour échapper aux moines et cagots. Etienne Dolet, auteur du Second enfer, fut brùlé vif. Berquin fut étranglé puis brûlé. Bonnaventure Des Périers dut se percer de son épée pour échapper au bûcher. Ramus fut assassiné. Rabelais faillit plusieurs fois être victime des papimanes enragés contre lui. François Ier, dit le « protecteur des lettres », alla même jusqu’à faire fouetter un pauvre diable d’abbé Couche « qui gagnait sa vie à jouer de cabaret en cabaret de petites farces contre la cour qu’avait tolérées le bon Louis XII ». Michelet a raconté cela en ajoutant ironiquement :
« Paris comprit alors ce qu’était un roi gentilhomme. »
Paris le comprit encore mieux lorsque le roi gentilhomme s’entoura du parti des « honnêtes gens », le parti des tartufes, des ruffians des affaires que soutinrent les Diane de Poitiers, puis les Catherine de Médicis, « maquerelles royales ».
La satire de combat, où la violence ne bannissait pas toujours l’esprit, se continua par les Mazarinades de la Fronde. Elle ne se manifesta plus, ensuite, que par des pièces isolées, pamphlets ou libelles, comme les pièces satiriques réunies sous le titre : Tableau du gouvernement de Richelieu, Mazarin, Fouquet et Colbert, où on lit entre autres :
Nous avons de quoi l’employer.
Colbert, Mazarin, Berrier, Sainte Hélène, Pussort, Poncet, le chancelier ;
Voilà bien des voleurs à pendre,
Voilà bien des fous à lier. »
La satire philosophique et religieuse, inspirée par la Réforme, eut ses derniers échos dans les Provinciales de Pascal, et divers écrits jansénistes. La polémique religieuse devenant plus calme, perdit de plus en plus l’esprit satirique pour prendre le ton académique et soporifique des Bossuet et des Fléchier.
Les traditions de la satire littéraire antique, ressuscitées par la Pléiade, furent reprises par Mathurin Régnier qui fut un des plus grands poètes français. Estimant que « souvent la colère engendre de bon vers », il usa de la satire en lui donnant un caractère épicurien et libertin. Se vantant de ne pas « sucrer sa moutarde », il dit leur fait aux courtisans, aux poètes galants, à tous les sots qui estimaient plus qu’un honnête homme « un gros âne pourvu de mille écus de rentes ».
Il fut dédaigné de l’académisme naissant et aussi de Boileau qui lui fut souvent inférieur. Boileau, plus grave, plus circonspect et plus académique en sa qualité de « législateur du Parnasse », commença cette satire des moeœurs et des hommes à laquelle Molière, La Fontaine, puis La Bruyère donnèrent toute sa profondeur. Ecrite dans une prose admirablement sobre et précise, la satire de La Bruyère (Les Caractères), dépouillée de toutes fioritures littéraires, atteignit plus directement son but. Elle commença admirablement, à côté de toutes les protestations contre les misères indicibles d’un temps que des flagorneurs ont appelé le « Grand Siècle », l’œoeuvre critique du XVIIIème siècle qui fit à la satire une si grande place.
La satire du XVIIIème siècle fut burlesque avec le Diable boiteux, de Le Sage, politique en même temps que mondaine avec les Lettres persanes, de Montesquieu, philosophique avec les Contes, de Diderot, et l’oeŒuvre nombreuse de Voltaire. Dans tous les genres, elle atteignit profondément les institutions et les moeœurs. Parny, à la fin du siècle, parodia la Bible dans sa Guerre des Dieux. La satire qui porta le plus fut celle de Beaumarchais au théâtre. On prête à Louis XVI ce mot prononcé après la représentation du Mariage de Figaro : « Mais, c’est la révolution ! ». C’était, en effet, la révolution du serviteur qui avait plus de vertus que le maître, mais qui avait toujours tort parce qu’il n’était pas le maître. La satire n’était plus ardente et fanatique comme au XVIème siècle ; elle était raisonneuse et sceptique. Elle n’en frappait que plus fort les esprits nonchalants qui semblaient prendre leur parti de l’écroulement du monde. La Régence avait eu sa Ménippée avec les Philippiques de Lagrange-Chancel. Le prince Philippe d’Orléans en était demeuré définitivement flétri devant l’histoire, plus que les Jésuites qui firent la Saint Barthélémy.
A côté de la grande satire, la multitude des faiseurs de libelles et d’épigrammes poursuivait sa besogne de termite, creusant ses sapes souterraines dans l’édifice social devenu le sépulcre blanchi d’une royauté épuisée par sa stupidité et d’une noblesse pourrie par ses vices. Les lettres de cachet, qui occupaient tout un ministère, ne pouvaient faire taire les satiristes et les empêcher de montrer, avec une véhémence toujours accrue, « les vertus allant à pied et le vice à cheval ». La satire classique ne fut plus représentée, à la fin de cette époque, et bien faiblement, que par Gilbert, auteur du Siècle et du Dix-huitième siècle, où l’invective dépasse la valeur poétique. Il est fâcheux pour l’œoeuvre de Gilbert qu’elle ait été trop personnelle et subventionnée par la cour et l’archevêque de Paris contre les Encyclopédistes.
En Angleterre, la satire de Shakespeare eut la fantaisie, sinon la portée sociale, de celle de Rabelais. Son Falstaff est le type de l’humour anglais comme Don Quichotte est celui de la chevalerie espagnole. Hall, qui avait revendiqué à la fin du XVIème siècle le titre de premier poète satirique anglais, avait été une sorte de Juvénal, mais plus par la forme que par le fond. Les temps difficiles de la tyrannie des Stuarts, qui avaient supprimé la liberté de la presse vers la fin du XVIIème siècle, virent les Satires de Rochester, violentes et d’une grande crudité de langage contre les princes, leurs maîtresses et leurs courtisans. Moins violente et plus littéraire fut à la même époque l’oeuvre de Druden, entre autres son Absalon et Achitophel contre les partisans de Monmouth. Le même siècle avait vu le grave Milton se faire satiriste dans sa Défense du peuple anglais (1651). L’Angleterre eut son grand écrivain satirique dans Swift (1667–1745). Son œoeuvre très variée est généralement d’un esprit pessimiste. L’invective y est féroce et d’une ironie parfois désespérée, comme dans la Proposition pour empêcher les enfants des pauvres d’être à charge en en faisant un article d’alimentation. Les ouvrages de Swift les plus connus sont le Conte du tonneau et les Voyages de Gulliver. Par le premier, il se rattacha aux polémistes religieux allemands de la Réforme, et il devança les romantiques dans la satire du faux savoir et de la cuistrerie pontifiante. Il eut une grande influence sur les romantiques anglais et allemands. Dans le même siècle, Pope, auteur de diverses satires, parmi lesquelles la Dunciade ou Guerre des sots, fut trop préoccupé par ses querelles particulières. Son oeuvre a souvent le caractère du libelle. Au XIXème siècle, Byron fut un satirique brillant en politique et en art. Il écrivit Bardes anglais et critiques écossais pour défendre son Œoeuvre poétique, la Vision du jugement, contre Southey, la Valse, contre cette danse. L’esprit satirique est répandu dans toute son oeœuvre, notamment dans Don Juan qui le brouilla définitivement avec la haute société anglaise, « fille de l’intérêt qui ne peut être corrigée par la raison » (Stendhal). Il est regrettable que les propres préjugés aristocratiques de Byron et l’affectation de son dandysme aient si souvent contredit et diminué la portée de sa satire.
En Allemagne, après la grande période de combat philosophique et social du XVIème siècle, Joachim Rachel fut, au XVIIème, le premier satirique classique. Il fut un Régnier allemand par sa franchise et la vigueur de son style. La satire fut continuée, au XVIIIème siècle, par Hagedorn, par Liscow qui s’attaqua plus aux personnes qu’aux moeurs, par Rabener qui s’en prit aux petits hobereaux, aux bourgeois, aux pédants, et par Wieland, pâle imitateur d’Horace. Signalons encore, dans la période romantique allemande, la satire de Jean-Paul Richter, vrai rabelaisien qui railla avec une verve étincelante les Jonatus, cuistres applicateurs de la scolastique gothique, notamment dans le Voyage du professeur Fülbel et dans la Vie de Maria Wutz. On lit, entre autres, dans ce deuxième ouvrage, ceci :
« Dans les anciens couvents, la science était une punition ; seuls les coupables devaient apprendre les psaumes latins ou copier les auteurs ; dans les bonnes écoles un peu indigentes, on ne néglige pas cette punition, et un peu de science, à faible dose, y passe pour un moyen inoffensif de corriger et de mortifier les pauvres élèves. »
Jean-Paul fit aussi de la satire anti-militariste et anti-guerrière, renouvelant la vieille satire paysanne du Métayer Helmbrecht contre le parasitisme de la soldatesque grossière et pillarde. Citons encore les Xénies, épigrammes à la façon de Martial, que Goeœthe et Schiller écrivirent contre les littérateurs de leur temps et qui jetèrent une perturbation que Goeœthe compara à celle causée par « les renards en feu lancés dans le camp des Philistins ». De la satire allemande au XIXème siècle, mentionnons celle de Louis Bœoerne, traducteur des Paroles d’un croyant, de Lamennais, qui dut se réfugier en France à cause de ses idées libérales ; il écrivit les Tableaux de Paris et les Lettres de Paris. Enfin, Henri Heine, réfugié aussi en France à la suite de la publication de ses Reisebilder, de 1826 à 1830. Aristocrate et romantique d’esprit, en même temps poète de la Révolution, Heine attaqua toutes les formes d’asservissement social, mais il recula devant les conséquences populaires de la liberté. Son ironie aiguë s’exerça contre les hommes et les moeurs, avec une sorte de mécontentement de lui-même. Il vécut à Paris de 1831 à 1856, année de sa mort.
En Italie, Dante et Boccace paraissent avoir épuisé la sève satirique. Il semble que cette sève eût dû être plus vivace dans ce pays où les luttes politiques furent plus ardentes que partout ailleurs. Elle se résorba au théâtre, dans la comédie dont les personnages qui ont illustré les tréteaux de la Foire, furent à la fois des flagorneurs et des pitres. Le pays qui produisit les Concini, les Mazarin, les Alberoni fut fécond en faquins de toutes sortes qui fournirent les types d’Arlequin, Scapin, Pantalon, Cassandre, etc... (voir Théâtre). Plus sérieusement, la comédie satirique avait inauguré le théâtre italien avec la Calandria, de Bibbiena, puis la Mandragore, de Machiavel. L’Arioste, au début du XVIème siècle, cultiva la satire en poète-artiste. Son Roland furieux est burlesque plus que satirique. Alamanni, Bentivoglio, dans le même siècle, puis Alfieri au XVIIIème, suivirent les voies de l’Arioste. Alfieri, écrivain classique, manquait trop de combativité pour que la satire fût pour lui autre chose qu’un passe-temps littéraire. Salvator Rosa lui donna plus de vigueur en attaquant les mauvais artistes, les méchants poètes, les despotes et le pape. La satire la plus violente et qui eut souvent le caractère de l’assassinat, fut celle de l’Aretin. Véritable « faisan », ruffian de plume et d’épée, superbe d’arrogance mais aussi lâchement plat devant qui lui résistait, ou le payait, il fut exactement le produit de son époque de corruption.
En Espagne, la satire a eu pour auteurs Jean Ruiz et Lopez de Ayala, au XIVème siècle, Juan de Mena, imitateur de Dante, au XVème. Durant la grande période littéraire espagnole (XVIème et XVIIème siècles) et après Cervantès, elle a été à peu près abandonnée littérairement pour la peinture des moeurs picaresques. Le gongorisme et l’hypocrisie pieuse la refoulèrent dans la production populaire. Citons comme caractéristique de cette production, en raison des circonstances politiques qui l’accompagnèrent, la chanson Tragâla, que le peuple chanta à l’occasion des évènements de 1812 obligeant la royauté espagnole à accepter une Constitution libérale :
Cette Constitution que tu n’aimes pas !
....
Il est passé le temps
Où l’on grillait comme le saumon
La chair humaine ! »
Mais, deux ans après, grâce au concours de l’armée française et après sa « glorieuse victoire » du Trocadéro, la Révolution était vaincue en Espagne, comme elle l’avait été en France, et l’Inquisition recommençait à griller comme du saumon la chair humaine !
Terminons ces rapides indications sur la satire à l’étranger en citant, pour la Russie, Nicolas Gogol, ses Ames mortes et son Revizor.
En France, au XIXème siècle, l’œoeuvre de la satire a été considérable dans tous les genres. Il est peu de penseurs, de réformateurs sociaux, de poètes et d’artistes, qui ne l’aient employée. Elle va des lettres de B. Constant à celles de Proudhon, de Bakounine, de Marx, des pamphlets de P. L. Courier, de Cormenin, de Tillier, de Veuillot, à ceux de Vallès, de Zo d’Axa, de Tailhade, des Epitres et Satires de M. J. Chénier, de Viennet, aux Jambes d’A. Barbier, aux Chansons de Béranger, à la Némésis de Barthélémy et Méry, aux Châtiments de Victor Hugo, des comédies d’E. Augier à celles de Becque, de Mirbeau, de Courteline, de Tristan Bernard, des vaudevilles de Désaugiers aux farces chatnoiresques, des opérettes d’Offenbach à celles de Claude Terrasse, du feu Figaro de la Restauration, accaparé depuis par les affairistes et les Jésuites (voir Presse), au si vivant et si libre Canard Enchaîné, de la caricature des « Girouettes » de Œ1815 à celle des « Gavés » de la République en 1933. Ses personnages sont Tête de lard (Louis XVIII), Mercadet, Vautour, Giboyer, Pipelet, Mayeux, Gavroche, Vireloque, Rodin, Robert Macaire et Bertrand, Monsieur Prudhomme, Badinguet, Foutriquet, Gamelle, Lechat, et Monsieur Leygues, dont « l’élégance progressiste », suivant le mot d’O. Mirbeau, incarne si bien, depuis cinquante ans, la sénilité républicaine. Puis les Tout-en-Or de la curée de 1914, les « pots de viniers », les « requins », les « topazes », les « nervis », les « resquilleurs », les « flaougnards », les « ruffians, les « trublions ». les « mercantis », les « grues », les « poules », les « barbones » et tous les « barbeaux », tous les squales, tous les barbillons qui nagent dans les « milieux » spéciaux du marécage social : politiciens, boursicotiers, banqueroutiers, maîtres-chanteurs, mouchards, « l’élite du rebut et le rebut de l’élite », a dit M. Michel-Georges Michel. Et, planant sur tout cela, le synthétisant, l’indécente bedaine, le crâne en pain de sucre du Père Ubu, incarnation solaire, symbolique, funambulesque, malodorante, du Muflisme Souverain. Flaubert n’avait pas seulement annoncé le muflisme ; il avait vu ses personnages dans ces petits bourgeois aux ventres de crapauds enflés et aux cervelles étroites d’électeurs à qui il a fait chanter :
Nos pères l’ont été plus,
Nous le sommes davantage,
Nos enfants le seront encore plus. »
Encore plus que le pamphlet et le libelle, la caricature est, par les arts du dessin, la forme militante, agressive de la satire. Sa portée est supérieure en ce qu’elle s’incruste dans l’esprit par l’image, le trait, la couleur qui frappent instantanément et forcent à la réflexion. Relativement peu répandue jusqu’au XIXème siècle, à cause des difficultés de reproduction, elle a pris, avec le développement des arts graphiques, une importance et une influence considérables qui ont dépassé celles de la satire littéraire. Elle a abondé cependant au moyen âge, et depuis, comme illustration de cette satire dans les monuments de l’architecture, notamment les cathédrales. L’image satirique est dans la pierre sculptée, dans le bois taillé, dans les enluminures des vitraux, des livres d’heures, des manuscrits. Elle y a des traits particulièrement incisifs, et telles images de papes, de rois, ont flétri encore plus puissamment ces personnages que la véhémence d’un Dante. Aucun grand du monde n’échappa à la caricature des Danses des morts, notamment de celle d’Holbein qui illustra aussi l’Eloge de la folie, d’Erasme. Breughel le Vieux avait, avant Holbein, caricaturé dans sa peinture les mœoeurs et les types de son temps. Les Songes drôlatiques furent les premières illustrations de l’Œoeuvre de Rabelais. Callot et Puget ont buriné et sculpté des aspects caractéristiques de la misère de leur temps, des mendiants et des bagnards. Ils sont, par les types qu’ils ont représentés et par leur puissance, des précurseurs de Daumier. Dans le même esprit, l’Angleterre a eu Hogarth. Goya a été, en Espagne, aussi puissant mais plus romantique et fantastique. G. Doré montra la plus grande fantaisie et non moins de force dans ses illustrations de l’Enfer, de Gargantua et de Don Quichotte.
P.-L. Courier a signalé l’usage de la caricature qui était fait contre le peuple au temps de la Restauration. Avec cette délicatesse spéciale aux aristocraties de parvenus, les anciens valets d’écuries devenus princes et barons de l’Empire, associés à leurs anciens maîtres émigrés revenus comme des rats affamés dans les fourgons des Alliés, faisaient railler par de bas mercenaires de la plume et du crayon le peuple qu’ils avaient dupé. Mais l’esprit populaire prenait d’éclatantes revanches qui vengeaient la vérité et la justice bafouées, si elles ne les établissaient pas. La caricature satirique, qui ne se borne pas à amuser par la déformation des images et l’exagération des défauts, mais qui a une intention critique et morale, poursuivant la vilaine conscience sous le vilain visage, montrant les travers des mœurs dans les « gueules de travers », cette caricature fut magnifique d’audace et de génie au XIXème siècle. Elle eut à la fois son Dante, son Cervantès et son Rabelais dans Daumier. Autour de lui, une foule d’artistes exercèrent leur verve satirique, moqueuse, vengeresse. Louis-Philippe, qui inspira à Daumier son Gargantua, le « roi-parapluie », le roi à la tête en poire répandu par la Caricature de Ch. Philippon et qui fit la joie du monde entier, ce roi, « symbole de la royauté juste-milieu » (Larousse), fut le plus bafoué de tous les polichinelles souverains, ainsi que son digne acolyte, le « bourgeois », qui demeure sous les traits impérissables du Joseph Prudhomme d’Henri Monnier. Traviès, Grandville, Gavarni, Cham, Charlet, Devéria, André Gill et cent autres furent intarissables durant de longues années. André Gill s’en prit spécialement à Courbet, puis à Gambetta et aux premiers ventres solaires de la IIIème République. Cham fut particulièrement odieux contre la Commune, parmi toute une bande de chacals de la plume et du crayon. Faustin s’attaqua surtout aux Trochu, Ducrot et autres badernes aussi peu reluisantes du siège de Paris. Nous recommandons la lecture, dans le Dictionnaire Larousse, de l’article sur la Caricature, le journal de Philippon. Avec lui, une centaine de journaux, depuis la Silhouette, de Balzac, (1829) jusqu’au Canard Enchaîné d’aujourd’hui, représentent un siècle de caricature, vivante, hardie, émouvante, et qui, plus d’une fois, aida à soulever les pavés des rues. Les « charlatans », marchands de pâte à rasoir et de coricide, que Frison et Jacques avaient montrés faisant leurs boniments sur les places publiques, étaient de bien innocents banquistes auprès des charlatans politiciens dont Daumier a étalé la sinistre lèpre dans son Ventre législatif. Dans les trente dernières années du XIXème siècle, et depuis, la caricature satiriste a été brillamment représentée par Caran d’Ache, Toulouse Lautrec, Léandre, Willette, Steinlen, Hermann-Paul, et tous les dessinateurs de l’Assiette au beurre, au début du XXème siècle. Puis Forain, spirituel avant qu’à l’occasion de l’affaire Dreyfus il fût passé, suivant son expression, « au parti des c ... » ! Depaquit, à la fois tendre et féroce, Grandjouan et Delannoy dont les condamnations demeureront une flétrissure pour les gouvernements Clémenceau, Laforgue, H-P. Gassier dont les Empapahoutés sont l’illustration la plus spirituelle des imbécillités de la guerre de 1914.
La parodie est une forme du burlesque. Tous deux sont de la satire, quand leur but est de critiquer, pour attirer l’attention sur une erreur, un travers quelconque, en soulignant ce qu’ils ont de ridicule. Mais le plus souvent, le but de la parodie n’est que d’amuser par une imitation bouffonne, un grossissement caricatural, et celui du burlesque, de faire rire par un comique exagéré et trivial. Il faut une tournure d’esprit particulière pour pratiquer le burlesque, et ses auteurs sont peu nombreux. Scarron, auteur de l’Enéide travestie, est le plus remarquable, avec certains de ses contemporains, comme Cyrano de Bergerac dont le burlesque se mêle à des conceptions philosophiques audacieuses et à des anticipations scientifiques curieuses, telle celle de l’invention du gramophone. Le burlesque fut la première forme de la comédie italienne (voir Théâtre). La parodie est plus ancienne et plus répandue. Les Grecs s’en servirent dans le genre appelé aujourd’hui héroï-comique qui exprime, dans un langage pompeux, des sentiments vulgaires et montre comme des héros des personnages ridicules. On n’a pas cessé de la voir au théâtre, depuis Aristophane, et en France, depuis la formation du théâtre classique, au XVIIème siècle. Le Chapelain décoiffé, parodie du Cid par Racine et Boileau, vengea Corneille de Chapelain et de ses autres détracteurs. La parodie trouva un élément inépuisable dans les invraisemblances et le ton trop souvent héroï-comique du théâtre classique, de même que dans les exagérations fougueuses du romantisme ; elle montra leurs ridicules. Quand elle n’a pas un but de critique, de véritable satire, la parodie est le plus souvent d’esprit bas, envieux, jaloux, comme celui du mauvais pamphlet et du libelle. Elle contribue à faire perdre le goût du beau, à faire confondre ce dernier avec le vulgaire, l’art avec ses imitations et toutes les camelotes de ses contrefaçons. Ainsi, le cinéma est la parodie du théâtre (voir Spectacle) et le public y apprend à ne connaître les chefs-d’œoeuvre littéraires et dramatiques que par d’infâmes adaptations opérées par de malpropres tripatouilleurs (voir Tripatouillage). La parodie avilit d’abord le goût, puis le caractère de celui qui s’y plaît. C’est un amusement d’eunuque incapable d’avoir une pensée forte, et d’esclave indifférent devant la dégradation de l’esprit.
L’épigramme est une petite pièce de vers où l’intention satirique est exprimée par un trait d’esprit qui la domine. Boileau en a dit :
N’est souvent qu’un bon mot de deux rimes orné. »
Il en est resté de piquantes de l’antiquité, mais pour nous, son époque fut surtout le XVIIIème siècle où toutes les préoccupations trouvaient en elle leur forme et leur exutoire. On en écrivait à tout propos. Elles composaient entre autres ce répertoire « d’agréables ordures qui plaisaient infiniment à la cour » (Bachaumont) et que Voisenon, en particulier, alimentait de ses « petits vers polissons ». Mais nombreuses étaient les épigrammes qui atteignaient à la vraie satire, faisaient réfléchir et préparaient la Révolution autant que les traités philosophiques. Plus d’un auteur d’épigrammes alla méditer à la Bastille sur l’inconvénient d’avoir trop d’esprit.
Tant que les hommes penseront — ce à quoi ils semblent de plus en plus renoncer — la satire existera. Si elle est parfois une plante vénéneuse poussée sur le fumier social, elle est surtout le souffle pur qui vient du large de la pensée pour assainir l’air empuanti par le mensonge et répandre la vérité, la justice et la révolte. Sans elle, l’esprit critique, impuissant devant le lourd monument de la sottise, aurait été depuis longtemps écrasé. A cette sottise brutale, stupide de l’enivrement d’une force qui ne veut pas raisonner, la satire dit avec un sourire ironique le mot de Thémistocle :
« Frappe, mais écoute ! »
Elle est la réaction de l’intelligence irritée par la cuistrerie, de la sensibilité violentée par la goujaterie, de la bonté mise en fureur par la méchanceté. C’est la satire de Flaubert, de Baudelaire, de Villiers de l’Isle Adam, de Mirbeau, de Tailhade, contre la sottise « au front de taureau ».
« Frappe, mais écoute ! » Nous sommes au temps où la satire doit le crier plus que jamais, alors que la brutalité sportive, la sauvagerie militariste, la duplicité politicienne emportent de plus en plus les hommes pour les empêcher de penser et les conduire aux dictatures. Les cavernes ont de nouveau lâché leurs fauves sur le monde : que l’esprit se réveille.
— Edouard ROTHEN.
SAVANTS (LES) ET LA FOI
Leur argument.
Souvent, il nous a été donné, de la part de nos adversaires, d’entendre ce raisonnement :
« Ce qu’il y a de plus impressionnant c’est que tous les grands esprits qui sont la gloire de l’Humanité ont été convaincus de l’existence de Dieu. Platon, Aristote, Kant, Descartes, Saint Thomas, Lamartine, V. Hugo, etc ... ont employé les ressources de leur génie à glorifier le Créateur, et cette idée leur a inspiré leurs plus belles pages. Les encyclopédistes même ont combattu l’athéisme et Voltaire a cru en Dieu. Il n’est pas jusqu’aux grands révolutionnaires de 1789 qui n’aient été des déistes convaincus : Robespierre, lui qui voulait qu’on inscrivît sur tous les monuments : « Le peuple français croit à Dieu et à l’immortalité de l’âme », a glorifié l’Être Suprême. Et personne n’ignore que les plus grands savants contemporains, les Pasteur, les Roux, ont été des croyants sincères. Enfin, il a été constaté, après enquête rigoureuse, que, sur 100 savants, 85 se proclament déistes. L’infime minorité restante se classe parmi les indifférents et les athées. Eh bien , Messieurs, ces simples constatations vous montrent qu’entre la science et la foi, il n’y a nulle opposition, au contraire, et nous sommes fiers de nous ranger résolument du côté des savants ! »
Que vaut une telle affirmation ? Tout de suite, on peut répondre : l’argument du nombre, ou de la majorité, n’a jamais prouvé la véracité d’un raisonnement. Ce n’est pas parce que tous les chrétiens croient ou feignent de croire et affirment que 1 + 1 + 1 = 1, que je suis obligé de les suivre. Ce n’est pas parce que tous les hommes ont cru jadis que la terre était immobile et plate que la chose était vraie. 85 %, ou même 100 % des savants en faveur de l’existence de Dieu, qu’est-ce que cela prouve si un seul être humain nie Dieu ? Et, si l’universalité de la croyance était reconnue aujourd’hui, pourrait-on être assuré que, demain, un homme ne se lèverait pas pour crier l’erreur ? Devant tout ce qui n’est pas rigoureusement démontré par l’expérience, la seule attitude raisonnable est le doute ; mais peut-on demander à des croyants de rester dans une position dubitative ? Leur disposition d’esprit s’y oppose.
Et cette réplique suffirait à détruire l’argument exposé plus haut. Cependant nous allons pousser plus avant notre examen afin de montrer irréfutablement comment on peut tromper les esprits superficiels avec des arguments spécieux.
Les savants.
Tout d’abord, il n’est pas niable qu’on se fait, en général, illusion sur le mot : savant. L’esprit humain, à peine dégagé de la gangue des siècles d’ignorance, attribue à ce mot — plus ou moins inconsciemment — la valeur mystérieuse nuancée de respect déléguée jadis aux mots : devin, prophète, thaumaturge ou sorcier. Qu’est-ce qu’un savant ? Le Larousse dit :
« Celui, celle qui a de la science. »
Qu’est-ce qu’un homme savant ? L’homme « qui a la science de quelque chose » (être savant en mathématiques). Qui a des connaissances étendues : un savant professeur. Qui est bien informé de quelque chose : « parler d’une chose en homme savant ». Il résulte de ces définitions qu’un savant n’est savant que pour une partiede la science. Avoir la science de quelque chose, avoir desconnaissances étendues, être bien informé de quelque chose, cela n’a jamais voulu dire : avoir la science de tout, connaître tout ; être bien informé de tout. Il fut peut-être une époque où un savant pouvait être considéré comme un être possédant un savoir universel ; les connaissances humaines étaient relativement peu étendues ; un individu d’intelligence supérieure pouvait les embrasser toutes. Il ne peut en être de même aujourd’hui. Le champ des explorations scientifiques est tellement vaste qu’il est impossible à un seul individu de le parcourir en entier. La vie humaine n’y suffirait pas. Force a été de se spécialiser. Et, d’ailleurs, rares seraient les hommes aptes à avoir « des clartés de tout ». Celui-ci limitera ses recherches à une branche de la chimie, cet autre passera son existence à se pencher sur les infîniment petits, ce troisième enfin sera un mathématicien hors pair ; mais il n’y en aura aucun qui touchera, avec un égal succès, à tous les arts et à toutes les sciences. C’est tellement vrai que les œoeuvres encyclopédiques nécessitent la collaboration d’un nombre imposant de savants, tous spécialisés dans l’étude de quelques questions très précises. Tel savant en paléontologie, par exemple, peut être un parfait ignorant en musique ; tel physicien de valeur peut ne rien connaître en sociologie. H. Fabre, le célèbre entomologiste, raconte, dans ses souvenirs, que Pasteur ignorait les métamorphoses du ver à soie lorsqu’on le chargea de combattre une maladie microbienne qui, tuant ce ver, ruinait les sériciculteurs du Midi, et comment il se fit expliquer ces notions tout élémentaires.
D’ailleurs combien de vrais savants, en dehors des officiels, qui n’ont jamais été consacrés par la Faculté ! Le petit inventeur, le chercheur, l’homme persévérant qui approfondit au-delà des limites connues la technique de son métier, le rêveur qui, à la suite de longues méditations et d’expériences multiples, aboutit à savoir davantage que tous ceux qui l’ont précédé, ne sont-ils pas des savants ? Des savants parfois raillés par les officiels, mais dont les découvertes bouleverseront le monde plus que ne le feront jamais les élucubrations de quelques dizaines de membres de l’Institut. Est-ce que Forest, l’inventeur du moteur à explosion, simple forgeron, n’était pas un savant ? Dire maintenant : tel savant grammairien croyait en Dieu ; tel autre, botaniste distingué, était déiste, de même ce troisième, dont la valeur en ichtyologie n’est contestée par personne ; est-ce que cela prouve l’existence de Dieu ? Cela prouve tout simplement que le grammairien, le botaniste, l’ichtyologue, n’ont probablement jamais apporté à l’étude du problème de Dieu la méthode rigoureuse qu’ils ont employée à leurs autres recherches et qu’ils sont restés, à ce point de vue, des produits du milieu, soumis, comme la majorité des humains, aux croyances, aux préjugés, aux opinions communes de leur entourage. Victor Ernest, répondant sur ce sujet à l’abbé Desgranges, disait : « La raison profonde qui enlève toute valeur à la preuve invoquée consiste dans l’indépendance des manifestations diverses de l’intelligence ; un savant de valeur peut n’avoir pas d’aptitudes philosophiques, comme être dépourvu d’aptitudes artistiques. Victor Hugo, un des plus grands génies poétiques, a fait montre d’une philosophie souvent puérile. Sainte Thérèse, mystique et hallucinaire, témoigne d’un esprit d’organisation remarquable dans la fondation de plusieurs couvents de femmes. Lamartine était réfractaire aux mathématiques. La Fontaine n’avait pas le sens des affaires. Et Rockefeller n’a pas celui de la poésie. Les croyances métaphysiques ou religieuses de Pasteur ne l’empêchaient pas de procéder d’une façon rigoureuse et avec un esprit positif à ses expériences. Mais c’est à cette méthode rigoureuse, non à ses croyances, que Pasteur devait ses succès. Et rien ne démontre qu’il ait soumis ses croyances à cette méthode. »
La Science et la Foi.
« La raison et la foi sont de nature contraire. » (Voltaire, Dict. phil., art. âme.)
Nous affirmons qu’il y a opposition absolue entre la Science et la Foi dans tous les domaines qui touchent de près ou de loin la question de Dieu. Et cela s’explique. Comment procèdent et la Science et la Foi dans la recherche de la vérité ? La Science part de zéro, tout terrain déblayé, net. Le savant se pose l’éternelle et féconde question : que sais-je ? Et, pour savoir, il expérimente. C’est par l’expérimentation, c’est-à-dire « l’emploi systématique de l’expérience », qu’il fait pas à pas son chemin.
« L’expérimentation, préparée par les recherches des alchimistes, a fait la puissance et le développement rapide des sciences de la nature ... La valeur et la puissance de l’expérimentation viennent d’abord de ce qu’elle réalise des conditions meilleures d’observation, en mettant le phénomène à l’échelle de nos moyens, en le produisant au moment voulu, et, autant de fois qu’il est nécessaire, ensuite et surtout de ce qu’elle a créé des séries de phénomènes, dans lesquelles la variation continue d’un élément donne des éléments très sûrs de comparaison ; par suite, en raison de ces variations, et aussi grâce aux déterminations très précises que permet la technique des expériences, aidée de toute la science acquise, elle réalise une analyse de plus en plus poussée du phénomène. » (Larousse.)
Décomposer le phénomène, comparer de multiples réactions, regrouper les éléments dispersés, en deux mots faire l’analyse et la synthèse, voilà comment procède la Science. Elle n’admet donc pour vérité démontrée que ce que chacun, employant ses procédés, doit retrouver nécessairement. Certes, elle avance ainsi lentement ; mais le terrain est solide et sûr. Ce qu’elle gagne sur l’inconnu est définitivement gagné. On lui doit le merveilleux essor de l’esprit humain dans la période contemporaine. L’homme doit avoir, par la Science, la connaissance totale de l’Univers.
« La grande épopée, à côté de laquelle toutes les autres pâlissent, c’est l’histoire de l’esprit humain s’élançant, de siècle en siècle, à la poursuite du vrai, atteignant un jour l’atome, un autre jour la galaxie, et dominant la matière par l’image intelligible qu’il en donne. » (Albert Bayet.)
Et la Foi ? Disons tout de suite que la Foi ne recherche pas la vérité ; elle la possède tout entière — ou plutôt elle croit la posséder. Nous lisons ceci dans l’Encyclopédie :
« Les philosophes et les logiciens peuvent bien faire des distinctions entre la certitude et la foi. Ceux qui ont la foi n’accorderont jamais qu’ils ne sont pas certains que leur foi n’enveloppe pas la certitude. Il semble cependant que tout le monde peut admettre que, si la foi atteint la certitude, elle y arrive par d’autres chemins que la science proprement dite ou la raison. Avoir foi en un homme, en une institution, en une idée, en un système ; avoir foi dans l’avenir ; avoir une foi politique ou religieuse, toutes ces expressions supposent et impliquent que l’esprit fait usage d’autre chose que de la raison pour atteindre la vérité, qu’il est éclairé d’une autre lumière que celle qui brille pour la seule intelligence. »
Cette « autre lumière » n’atteignant que quelques humains, vague à souhait, imprécise, indéfinissable, produit de l’imagination plus ou moins maladive et non de la raison, cette « grâce », c’est elle qui révèle la vérité ! Et, ici, comment ne pas s’étonner que cette « vérité », atteinte depuis si longtemps, repose sur des bases si peu sûres qu’il suffit du raisonnement méthodique d’un logicien pour la mettre en échec ; qu’il ait fallu, aux époques de foi profonde, dresser des bûchers pour la défendre, et que toute la chrétienté s’alarme sans cesse des progrès incessants de l’athéisme ? Mais le monde ne peut revenir en arrière, et comme on ne peut arrêter l’essor de la science, le déiste est bien obligé de composer en proclamant qu’il n’y a nulle opposition entre la raison et la foi. Il faut voir « en quels termes galants ces choses là sont dites », c’est-à-dire avec quelle impudence et quelle perfidie.
« La foi et la raison, non seulement ne peuvent jamais se contredire, mais elles se prêtent une aide réciproque, parce que la droite raison établit les bases de la foi et, éclairée par sa lumière, cultive la science des choses divines, tandis que la foi, de son côté, la libère ou la préserve de l’erreur et l’enrichit de connaissances diverses. C’est pourquoi l’Eglise, bien loin de s’opposer à la culture des arts et des sciences humaines, l’aide et la favorise de beaucoup de manières. Car elle n’ignore ni ne méprise les avantages qui en résultent pour la vie de l’humanité ; elle répète même que ces sciences issues de Dieu, qui est le Maître des Sciences, doivent, avec sa grâce, si elles sont traitées comme il faut, conduire à Dieu. Et elle ne s’oppose en aucune manière à ce que ces sciences, chacune dans leur champ d’action, usent de principes et de méthodes qui leur soient propres ; mais, tout en reconnaissant cette juste liberté, elle veille avec soin pour empêcher que, par hasard, se mettant en contradiction avec la doctrine chrétienne, elles ne tombent dans l’erreur, ou bien qu’en sortant de leurs frontières elles n’envahissent pour le bouleverser le terrain de la foi. » (Con. Vat., sess. 3, C. 4.)
Et encore :
« Dire que l’Eglise voit de mauvais oeœil les formes plus modernes des systèmes politiques et repousse en bloc toutes les découvertes du génie contemporain, c’est une calomnie vaine et sans fondement. Sans doute, elle répudie les opinions malsaines, elle réprouve le pernicieux penchant à la révolte, et tout particulièrement cette prédisposition des esprits où perce déjà la volonté de s’éloigner de Dieu ; mais comme tout ce qui est vrai ne peut procéder que de Dieu, en tout ce que les recherches de l’esprit humain découvrent de vérité, l’Eglise reconnaît comme une trace de l’intelligence divine ; et comme il n’y a aucune vérité naturelle qui infirme la foi aux vérités divinement révélées, que beaucoup la confirment, et que toute découverte de la vérité peut porter à connaître et à louer Dieu lui-même, l’Eglise accueillera toujours volontiers et avec joie tout ce qui contribuera à élargir la sphère des sciences ; et ainsi qu’elle l’a toujours fait pour les autres sciences, elle favorisera et encouragera celles qui ont pour objet l’étude de la nature. » (Encyc. Immortale Dei Léon XIII, 1er nov. 1885.)
En somme, c’est toujours l’antique :
« Hors de l’Eglise, point de salut ! »
Dieu dit aux savants :
« Touchez à tout ce que vous voudrez ; étudiez les moeœurs des escargots, des oursins et des bélugas ; inventez des troncs inviolables pour que le denier du culte ne soit plus en danger ; et puis des mitrailleuses, des tanks et des gaz asphyxiants pour la prochaine ; intéressez-vous à « l’influence des queues de poissons sur les ondulations de la mer » ; bref, débrouillez-vous à rendre votre Terre, que j’ai laissée en plant, jadis, plus habitable que du temps d’Adam, plus sanguinaire que du temps de Caïn, cela tant que vous voudrez ; je vous donne pleine liberté. Mais je vous préviens : traitez les choses comme il faut, n’ayez pas d’opinions malsaines ; et si, par hasard, vous vous mettiez « en contradiction avec la doctrine chrétienne », si vous « bouleversiez le terrain de la foi », d’abord vous ne seriez point des savants, mais de vulgaires bafouilleurs hérétiques et suppôts de Satan, et ensuite malédiction sur votre enveloppe terrestre, si le bras séculier obéit à nos saintes sentences et malédiction sur votre âme, lorsque vous comparaîtrez devant Moi... »
Non, il n’y a pas contradiction entre la Science et la Foi si celle-là se fait l’humble servante de celle-ci ; c’est-à-dire si elle se renie elle-même. Dans ce cas, elle n’est plus qu’une science étriquée, diminuée, châtrée ; elle n’est plus la Science tout court pour laquelle rien n’est inviolable, rien n’est sacré, tout étant sujet à expériences, tout étant soumis au jugement de la raison, même l’Eglise, même les dogmes, même Dieu !
Les Savants selon l’Église.
Car il y a eu des savants selon l’Eglise. Ou alors, comment appeler ces lumières (!) qui ont osé expliquer la nature sans que l’ombre d’un doute assombrît leurs pensées ; tranchant souverainement, avec l’aide de la grâce divine ? Certainement le pape Zacharie (741) était de ceux-là. Il faut être un Voltaire pour écrire sur son compte qu’ « il anathémisa ceux qui démontraient qu’il y a des antipodes : l’ignorance de cet homme infaillible était au point qu’il affirmait que, pour qu’il y eût des antipodes, il fallait nécessairement deux soleils et deux lunes. » (Annales de l’Empire.)
Et citons :
-
Nider, dominicain, une des lumières du concile de Bâle, qui expliqua, vers 1431, dans son Formicarius, « comment les sorciers s’y prenaient pour soulever des tempêtes, faire tomber la grêle, transporter chez eux la moisson de leurs voisins, rendre les femmes stériles ».
-
Hollen, moine (1481), écrivant le Praceptorium, raconte « l’histoire d’une femme de Norvège qui vendait le vent dans un sac fermé par une corde à trois nœoeuds. Un vent doux s’élevait quand le premier nœoeud était défait. Le vent devenait violent après la disparition du second noeœud. Enfin, une tempête furieuse s’élevait quand le troisième noeœud était dénoué ». (Janssen, 8.525.)
-
Sprenger, dominicain — dans le Maillet des sorcières (1486), qui fut le manuel des inquisiteurs, couvert par le patronage du pape Innocent VIII — nous apprend (2-1-15) « que pour produire de la grêle, les sorcières font un trou, y versent de l’eau, et remuent avec le doigt ». (Turmel, Histoire du Diable, p. 196.)
N’est-ce pas aussi Origène, qui disait :
« À parler rigoureusement, si les démons jouent ici quelque rôle, ce qu’il faut leur attribuer, c’est la famine, la stérilité des arbres et des vignes, les excès de chaleur, la corruption de l’air qui détruit les fruits, tue les animaux et amène sur les hommes le fléau de la peste. Les auteurs de ces maux sont les démons dont la justice divine se sert comme de bourreaux ... » (Turmel, op cit., p. 139.)
Et voilà ! Ce n’est pas plus difficile que ça. Quand Dieu daigne vous éclairer d’une si éclatante façon, on se demande pourquoi certains s’obstinent encore à inventer, par exemple, des liquides pour tuer mouches et moustiques. Que n’adoptent-ils la méthode du grand Saint Bernard, de celui qui avouait ingénument, à propos de la Vierge Marie, qu’ « il est grand d’être vierge ; mais être vierge et mère en même temps, c’est ce qui dépasse toute mesure » ? Qu’ils sachent donc comment opérait le saint homme :
« A Foigny, près de Laon, lieu infesté de mouches, Saint Bernard s’écrie : Je les excommunie. Les mouches, immédiatement, passèrent de vie à trépas, et on les enleva à la pelle. » (Première vie de Saint Bernard, I 52.)
Voici également, à titre documentaire, un autre procédé employé par les « savants » selon l’Eglise dans le même but que plus haut : C’est une « lettre adressée au clergé de Langres, en 1552, par le Vicaire général » :
« De l’autorité du Révérend Père en Dieu, Monseigneur Claude de Lougni, par la miséricorde de Dieu, cardinal prêtre de la sainte Eglise romaine, du nom de Givry, évêque, duc de Langres et pair de France, moi, son vicaire général au spirituel et temporel, par l’autorité de la sainte et indivisible Trinité confiant en la miséricorde divine et plein de pitié, je somme, en vertu de la sainte croix, armé du bouclier de la foi, j’ordonne et je conjure, une première, une deuxième, et une troisième fois, toutes les mouches, vulgairement appelées urébires ou uribères, et toutes les autres bestioles nuisant aux fruits des vignes, qu’elles aient à cesser immédiatement de ravager, de ronger, de détruire et d’anéantir les branches, les bourgeons et les fruits ; de ne plus avoir ce pouvoir dans l’avenir ; de se retirer dans les endroits les plus reculés des forêts, de sorte qu’elles ne puissent plus nuire aux fidèles, et de sortir du territoire. Et si, par les conseils de Satan, elles n’obéissent pas à ces avertissements et continuent leurs ravages, au nom du Seigneur Dieu, et en vertu des pouvoirs ci-dessus indiqués, par l’Eglise, je maudis et lance la sentence de malédiction et d’anathème sur ces mouches urébires et leur postérité. »
Turmel ajoute :
« La malédiction, il va sans dire, c’était la peine de mort. » (Hist. du Diable, p. 204)
Savants ? Certes oui, à l’époque, l’opinion de ces hommes-là faisait autorité dans toute la chrétienté. Ah ! ils ne possédaient pas ce « pernicieux penchant à la révolte » ; ils n’avaient pas de ces « opinions malsaines » que d’aucuns possédaient déjà. Ils ne méritaient que la bénédiction de Dieu. Mais si les connaissances humaines ont progressé, on ne doit rien à ces moines, à ces prêtres, à ces saints. L’évolution s’est faite malgré eux, contre eux. On doit tout, au contraire, aux hérétiques, non-conformistes, qui n’ont pas craint de « bouleverser le terrain de la foi », de « s’allier à Satan », et de braver les rigueurs de l’Inquisition, car ils voyaient poindre à travers les flammes des bûchers l’image ardente de la vérité.
Les savants contre l’Église
Toutes les fois qu’un esprit curieux, chercheur, hardi, arrive, par la logique de son raisonnement, à formuler des propositions qui s’opposent à l’Écriture, il trouve l’Église devant lui qui met tout en œuvre pour lui barrer la route. Aujourd’hui, la Bête est, en général, impuissante, et le savant se rit de sa ridicule sentence d’excommunication. Il n’en a pas toujours été ainsi. Il n’en serait pas de même si l’Eglise pouvait recouvrer son antique puissance. Les leçons du passé et les paroles des pontifes ne laissent aucun doute à ce sujet. C’est le cardinal Lépicier qui écrit dans son livre « De la stabilité et du progrès du dogme » (p. 194) :
« Si les hérétiques professent publiquement leur hérésie et excitent les autres, par leur exemple et par leurs raisons à embrasser les mêmes erreurs, personne ne peut douter qu’ils ne méritent d’être séparés de l’Eglise par l’excommunication et d’être enlevés par la mort du milieu des vivants ; en effet, un homme mauvais est pire qu’une bête féroce et nuit davantage, comme dit Aristote ; et comme il faut tuer une bête sauvage, ainsi il faut tuer les hérétiques. »
C’est la même idée qu’exprimait Saint Augustin :
« Qui de nous ne loue les lois rendues par les empereurs contre les sacrifices païens ? De telles impiétés ne méritent-elles pas le sacrifice capital ? » (Epistola, 93.)
Le pape Célestin Ier, dans sa lettre aux évêques de Calabre et de la Pouille, déclarait aussi :
« Le peuple doit être enseigné et non pas écouté ; nous seuls avons le droit de lui apprendre ce qui est licite ou non. S’il se trouvait quelqu’un d’assez audacieux pour juger par lui-même les choses défendues par nous, il sentirait ce que peut la censure épiscopale : car si nos admonitions sont impuissantes, nous devons employer la sévérité et la rigueur. »
Ainsi, l’esprit de l’Eglise, au long des siècles, n’a pas varié. L’Inquisition — qui a sa source dans la Bible — est en puissance dans la pensée des Pères de l’Eglise ; comme elle vit encore dans celle des évêques, cardinaux et papes. Elle est une conséquence logique du fanatisme de ces sectaires, hommes de foi, persuadés de posséder la vérité totale. Ah ! qu’on veuille faire un retour vers ce passé, où toute lumière semblait venir de la flamme tremblante des cierges brûlant dans les sanctuaires ! Qu’on se reporte, par la pensée, à ces époques de misère, où les âmes simples croyaient entrevoir dans leurs prières les joies éternelles du paradis, en compensation à leur existence toute de souffrance et de malheur ! Qu’on se représente la chrétienté à genoux, s’humiliant avec ferveur devant le Christ-Roi ; et qu’on suppose alors, en face des chefs tout-puissants, une frêle conscience humaine venant tout à coup formuler l’ombre d’un doute, ou même énoncer une certitude qui ébranle le dogme ; et on comprendra la terrible colère du Dieu pressentant sa fin, on comprendra la sauvage agression contre la pensée libre naissante, on comprendra le Saint-Office, la question du feu, la corde, les garrots, le supplice de l’eau, les pinces ardentes, l’emmuraillement ; on comprendra tout ! Il fallait bien peu de chose alors pour que l’audacieux pérît dans les plus affreux tourments. Quelques exemples, entre tant !
Le célèbre Pierre d’Abano enseignait (1250), à Padoue, la médecine et l’alchimie. Il fut dénoncé à l’Inquisition comme magicien et accusé de travailler de concert avec le diable. Il mourut avant la fin de son procès et, d’après quelques auteurs, son cadavre fut exhumé et brûlé par ordre de l’Inquisition (1316).
François Stabili Cecco, professeur à Bologne « par l’audace de sa science, sondait les choses défendues ». Il fut accusé d’attaquer la religion. Condamné à la peine du feu, il fut brûlé vif à Bologne.
Mais le procès le plus typique et que tout le monde connaît fut celui de Galilée. Né en 1554, à Pise, Galilée occupa, à 25 ans, la chaire de mathématiques à l’université de Padoue. Admirateur de Copernic, en 1597, il écrit à Képler :
« J’ai recueilli beaucoup d’arguments et de preuves que je n’ose publier, car je redoute le sort échu à notre maître Copernic. »
Il est l’auteur de nombreuses découvertes. Avec le télescope « sa vue plongeait dans l’infini ». On le surnomma « Le Christophe Colomb de l’empyrée ». L’Église romaine fut épouvantée. Quoi : cet homme osait saper les bases de la sainte religion ? L’Inquisition va « analyser et juger ces théories absurdes et impies ». C’est le cardinal Bellarmin qui parle :
« Nous vous ordonnons de ne plus défendre et soutenir une théorie que la Bible condamne. »
Après un silence de seize ans, il publie un nouvel ouvrage : « Quatre dialogues ». Dénoncé à l’Inquisition (10 fév. 1633), il est soumis à de nombreux interrogatoires et jeté dans les cachots du Saint-Office, puis condamné. Il faut connaître cette condamnation, ce monument de sottise et d’iniquité :
« Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit ! Nous tous rassemblés en ce lieu, sous l’inspiration de l’Esprit Saint, éclairés par les lumières du souverain pontife, nous décidons qu’aucun fidèle ne doit croire ni soutenir que le soleil est placé immobile au centre du monde ; nous décidons que cette opinion est fausse et absurde en théologie, aussi bien qu’hérétique, parce qu’elle est expressément contraire aux paroles de l’Ecriture, et impliquerait une accusation d’ignorance envers Dieu, la source de toute science et le révélateur des livres saints. Nous défendons également d’enseigner que la terre n’est point placée au centre de l’univers, qu’elle n’est pas immobile et qu’elle a un mouvement journalier de rotation, parce que cette seconde proposition est, pour les mêmes motifs, fausse, absurde, même en philosophie, autant qu’erronée en matière de foi. »
Galilée s’agenouille et abjure ; il avait 70 ans !
« Et pourtant, elle tourne ! »
Cri de la conscience, cri de la vérité qui, s’il n’a pas été prononcé par l’illustre savant, est la protestation de l’humanité pensante contre le dogme étouffant et absurde.
En prison, Galilée est obligé de réciter les psaumes de la pénitence. Puis, interné dans sa villa, toujours sous la surveillance de l’Inquisition, il écrit :
« Ici, je suis vaincu par la tristesse et par une mélancolie immense. »
Il meurt, aveugle, à 78 ans, surveillé par ses bourreaux jusqu’à son dernier souffle.
Voilà ce que fait l’Eglise des savants qui ne savent pas retrouver, dans le calme de leur laboratoire ou dans la profondeur des cieux, les traces de la main divine ; ou plutôt voilà ce qu’elle en ferait si elle pouvait redevenir souveraine. Car le savant, ici et là , se heurte nécessairement au dogme ; il démolit, sans que ce soit précisément son but, mais en passant, par surcroît, l’erreur embusquée derrière le psaume ou la prière. Mallet du Pan, écrivain genevois et protestant, écrit en 1784 :
« Galilée ne fut point persécuté comme bon astronome, mais en qualité de mauvais théologien. On l’aurait laissé tranquillement faire marcher la terre s’il ne se fût point mêlé d’expliquer la Bible. »
Malheureusement, Galilée ne pouvait point être bon astronome sans que, en conséquence, il se révélât mauvais théologien.
L’autorité toujours contestable des savants. Savants officiels et autres. Leurs bévues. Leur doute.
D’une façon générale, il n’est pas de vérité absolue. Ce qui a été reconnu pendant des années et parfois des siècles comme l’expression même de la vérité est mis un jour en doute, et bientôt ne résiste plus aux investigations nouvelles. L’hypothèse ancienne, avec toutes ses conséquences fécondes, est désormais périmée ; un coin de l’inconnu est éclairé ; mais, à côté, c’est encore la nuit. Alors on découvre des routes parallèles inexplorées et, placé dans de nouvelles conditions de vie, on se rend compte que ce qui paraissait hier comme un roc indestructible présente de profondes lézardes, qu’il faut aller plus loin, regarder ailleurs et de façon différente. Il ne reste de l’antique créance qu’une poussière de vérité, brillante, précieuse, certes, mais si légère, si ténue ! Et l’on est surpris que si peu de chose ait suffi à alimenter pendant si longtemps les passions humaines.
Qu’on se représente seulement le chemin parcouru depuis Ptolémée jusqu’à Einstein. Avant Copernic et Galilée, toute l’antiquité a considéré la terre comme le centre immobile de l’univers. Einstein modifie, à son tour, la théorie newtonienne de la gravitation universelle. Ici, pourtant, le savant raisonne devant des réalités ; il peut vérifier ses hypothèses, constater l’exactitude ou la fausseté de ses calculs : l’univers entier est à la portée de son regard, ou le sera au fur et à mesure de la perfection des instruments d’optique. Mais que dire du Dieu-Esprit, insaisissable, impondérable, du Dieu éternellement caché ? Cela n’empêche pas certains savants d’affirmer qu’il existe. Il y aurait là, en vérité, de quoi troubler les âmes inquiètes, si l’on ne savait depuis longtemps ce qu’il faut penser de la science pontifiante plus ou moins officielle. Qu’on en juge par ces quelques faits :
Baumé, à l’Académie des Sciences, s’élève contre les théories « subversives » de Lavoisier. Celui-ci prétendait, en effet, que l’air est composé de deux éléments. Ne savait-on pas, depuis deux mille ans, qu’il était intangible, au même titre que l’eau et le feu ? Voltaire était allé encore plus loin :
« J’ose regarder l’existence de l’air comme une chose peu probable. » (Dict. phil. Air.)
Et il a démontré cette inexistence en sept points bien développés. Il est vrai qu’il dit ailleurs (art. Amour de Dieu) :
« Si chaque ergoteur voulait bien se dire à soi-même : Dans quelques années, personne ne se souciera de mes ergotismes, on ergoterait beaucoup moins. »
On ne peut se condamner avec plus d’humour. Il semble que la docte Académie des Sciences (déjà nommée) a le monopole des bévues colossales et des hilarantes méprises. C’est elle qui s’opposa obstinément aux idées de Boucher de Perthes (1788–1868) et de ses précurseurs qui proclamaient l’existence de l’Homme fossile. Rien ne put la convaincre, ni les découvertes de Tournal, d’Emilien Dumas, de Christol, de Marcel de Serres, de Schmerling, ni l’obstination et les preuves qu’apportait Boucher de Perthes. Et cependant :
« Les innombrables découvertes faites depuis ont démontré l’exactitude de ses conclusions. » (Larousse)
En somme, on pourrait presque affirmer qu’il n’est pas de savant plus hâté qu’un membre de l’Institut. Qui ne connaît aussi la fameuse séance où Du Moncel, le physicien, présenta le phonographe à cette même assemblée ? C’était le 11 mars 1878. M. Brouillaud se jeta sur l’opérateur, représentant d’Edison et s’écria en le saisissant à la gorge :
« Misérable, nous ne serons pas dupes d’un ventriloque ! »
Le dit Brouillaud, qui avait de la constance dans ses idées, déclara six mois plus tard, avec le sérieux de M. Homais :
« Il n’y avait là que de la ventriloquie, car on ne pouvait admettre qu’un vil métal puisse remplacer le noble appareil de la phonation humaine. »
On pourrait citer encore M. Thiers, ministre des Travaux publics en 1832, disant que les chemins de fer ne seraient jamais que des jouets pour amuser les Parisiens ; Arago, qui déclarait que la basse température des tunnels, avec le passage subit du chaud au froid, procurerait aux voyageurs des fluxions de poitrine ; d’autres encore qui prédisaient qu’au croisement de deux trains, l’air serait tellement comprimé que les voyageurs périraient asphyxiés ! Est-ce que la déclaration de l’Abbé Moreux, parue dans le Petit Journal du 8 avril 1918, prouve une grande élévation morale, digne d’un savant ?
« Mais je gage que, lors de la ruée boche sur Amiens, nos artilleurs préféreraient encore « taper dans le tas » avec nos élégants obus de 75, qui n’empoisonnent pas à la façon des vitrioleurs, mais anéantissent proprement des bataillons entiers. »
Faut-il rappeler enfin, plus près de nous, l’affaire dite « de Glozel ». On pouvait lire, dans les journaux du 9 mars 1931, le compte rendu de l’audience de la 12ème Chambre correctionnelle, dans lequel nous trouvons ces phrases :
« M. Dussaud, membre de la Société de Préhistoire de France, a expliqué comment, étant conservateur du Louvre, il a cru de son devoir d’étudier les objets de Glozel qui pouvaient être proposés aux collections nationales. Il a trouvé que c’étaient indiscutablement des faux et il l’a publiquement déclaré. Puis c’est un défilé à la barre de savants convaincus de l’authenticité des objets glozéliens : le docteur Gorlet , de Vichy, MM. Salomon Reinach, Romand, etc ... Avec une conviction égale, les savants cités par la défense et qui sont notamment : MM. Vaison, Champion, Randoin, Maheu, sont venus affirmer que les objets trouvés à Glozel n’étaient que des faux grossiers. »
Nous ne citerons pas les cas, très nombreux, où des savants renommés furent mystifiés par des prestidigitateurs, spirites, et autres charlatans.
Même lorsque le savant affirme qu’il croit, il se garde bien de baser sa croyance sur une démonstration rigoureuse, scientifique, de l’existence de Dieu. Au contraire, il dit :
« Je crois en Dieu, parce que je crois en Dieu. »
Proposition inverse de celle de Le Dantec :
« Je suis athée, parce que je suis athée ! »
Mais avec la différence qu’à celui-ci on ne peut pas demander de fournir des preuves d’une chose qu’il méconnaît, alors qu’on serait en droit d’être beaucoup plus sévère envers celui qui affirme l’existence de cette chose. Quoi qu’il en soit, c’est ici l’impasse qui coupe court à toute discussion. Pascal, qui fut sans doute le plus tourmenté des humains parce qu’il cherchait à se convaincre de la véracité des Ecritures, malgré la tyrannie implacable de sa raison, nous a laissé dans ses Pensées le reflet de son doute et du terrible combat qui se livra dans son coeœur. Chercher Dieu, en effet, et ne pas le trouver, quelle torture pour un croyant ! Il disait :
« Je n’entreprendrai pas de prouver par des raisons naturelles l’existence de Dieu ou l’immortalité de l’âme, parce que je ne me sentirais pas assez fort pour trouver dans la nature de quoi convaincre les athées. »
Et aussi :
« S’il y a un Dieu, il est infiniment incompréhensible, puisque n’ayant ni parties, ni bornes, il n’a nul rapport à nous : nous sommes donc incapables de connaître ni ce qu’il est, ni s’il est. » (Section III-233.)
Puis :
« C’est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Voilà ce que c’est que la foi : Dieu sensible au coeur, non à la raison. » (Section IV-278.)
Encore :
« La foi est un don de Dieu. Ne croyez pas que nous disions que c’est un don de raisonnement. Les autres religions ne disent pas cela de leur foi ; elles ne donnaient que le raisonnement pour y arriver, qui n’y mène pas néanmoins. » (IV-279)
Etc...
Enfin, Pasteur, tant de fois mis en avant par les déistes, s’exprimait ainsi :
« En chacun de nous il y a deux hommes : le savant, celui qui a fait table rase, qui, par l’observation, l’expérimentation et le raisonnement veut s’élever à la connaissance de la nature, et puis l’homme sensible ; l’homme de tradition, de foi ou de doute, l’homme qui pleure ses enfants qui ne sont plus, qui ne peut, hélas ! prouver qu’il les reverra, mais qui le croit et l’espère, qui ne veut pas mourir comme meurt un vibrion, qui se dit que la force qui est en lui se transformera. Les deux domaines sont distincts et malheur à celui qui veut les faire empiéter l’un sur l’autre, dans l’état si imparfait des connaissances humaines. » (Discours à l’Académie de Médecine).
Les croyants ne font donc pas preuve de beaucoup de sérieux lorsqu’ils s’appuient sur l’autorité des savants pour prouver Dieu.
Les savants athées.
Et puis enfin, quand on cite les savants croyants — avec toute la série de leurs découvertes, comme si le fait d’avoir résolu un problème devait donner par surcroît un éclat nouveau aux antiques preuves (!) de l’existence de Dieu, — on ne nous montre qu’un seul côté de la barricade. Car il y a eu, et il y a, des savants athées. Sans nous arrêter à Descartes, Mallebranche, Arnauld, Nicole et Pascal, considérés comme athées d’après le Père Hardouin (Volt., dict. phil.) nous pourrions citer un nombre imposant d’esprits de valeur qui ont vécu sans Dieu. A titre purement documentaire nous nommerons :
-
Hobbes (1588–1679), qui, nous dit Voltaire, passa pour athée ;
-
Spinoza (1632–1677), était non seulement athée, mais il enseigna l’athéisme (Volt.) ;
-
Lalande (1732–1807), astronome, disait :
« On a beau fouiller le ciel dans toutes les directions, avec les meilleurs télescopes, on n’y a jamais vu trace de Dieu » ;
-
Laplace (1749–1827), mathématicien et astronome, inventeur du système cosmogonique qui porte son nom, s’occupa de la mécanique céleste. Pour lui, Dieu était « une hypothèse inutile » ;
-
Pigault-Lebrun (1753–1835), écrivain, auteur du célèbre Citateur ;
-
Berthelot (1827–1902), chimiste, qui reproduisit artificiellement (1855) un certain nombre d’espèces chimiques existant dans les êtres vivants ;
-
Vogt Karl (1817–1895), naturaliste et anthropologiste allemand, défenseur du transformisme ;
-
Paul Bert (1833–1886) , physiologiste, membre de l’Académie des Sciences ;
-
Giard Alfred (1846–1908), biologiste, partisan convaincu de la théorie transformiste ;
-
Virchow (1821–1902), médecin, fondateur de la pathologie cellulaire, disait notamment :
« On ne peut avoir de discussion scientifique au sujet de la foi, car la science et la foi s’excluent » ;
-
Loeb, (1859–1924), physiologiste américain, chef de la section de physiologie à l’Institut Rockefeller ;
-
Delage Yves (1854–1920), zoologiste-biologiste dont l’influence fut si grande sur la science moderne ;
-
Curie Pierre (1859–1906), physicien, Prix Nobel 1904, dont la renommée est mondiale par suite de ses découvertes du polonium et du radium ;
-
Metchnikoff Elie (1845–1916), chef de laboratoire des recherches à l’Institut Pasteur ;
-
Herrera, directeur de l’Institut biologique des Sciences de Mexico, qui atteste être parvenu à créer des cellules vivantes douées de mouvement ;
-
Littré Emile (1801–1881), érudit, philosophe et philologue , de l’Académie Française (son élection provoqua la démission de Mgr Dupanloup), auteur du merveilleux « Dictionnaire de la Langue française ». Il s’est exprimé ainsi :
« Quelque recherche qu’on ait faite, jamais aucun miracle ne s’est produit là où il pouvait être observé et constaté » ;
-
Elisée Reclus (1830–1905), savant géographe, auteur de la « Géographie Universelle », de l’ « Homme et la Terre », anarchiste, révolutionnaire, révolté permanent contre la société capitaliste et les dogmes sur lesquels elle repose ;
-
Perrin Jean, de l’Institut, écrit :
« En face d’un Univers si prodigieusement riche et dont rien ne nous annonce encore la limite, comment peut-il se faire que nous ne nous sentions pas écrasés ? Sans doute, c’est d’abord parce que nous sommes affranchis de l’oppression que nous faisions peser sur nous-mêmes, au nom de fantômes nés de notre seule ignorance, et c’est parce que nous acceptons un monde qui nous ignore, plus volontiers qu’une tyrannie qui nous étouffe. » (Préface au livre de Paul Couderc : l’Architecture de l’Univers).
-
Félix Le Dantec (1869–1917), biologiste, transformiste convaincu, auteur, entre tant d’ouvrages de haute valeur, de l’Athéisme (1906), écrivait :
« Je ne dis pas que la Science vous donnera une démonstration de la non-existence de Dieu ; elle vous démontrera seulement que tout se passe exactement comme si Dieu n’existait pas, et puisque Dieu n’explique aucun mystère sans le remplacer par le mystère encore plus grand de sa propre existence, peut-être renoncerons-nous à cette notion qui nous vient de nos ancêtres plus ignorants. » (Le Conflit, Ch. I).
Pour finir — car il faut se limiter — citons encore Joseph Turmel, le vieux prêtre excommunié, qui, sous une quinzaine de pseudonymes (Delafosse, Coulange, Dulac, Herzog, Dupin, Lagarde, Perrin, Gallerand, Lawson, Michel , Letourneur, etc.), a, par la méthode historique, détruit le Dogme, sapé la foi, et cela, de la façon la plus sûre et la plus complète. De l’aveu même de l’abbé J. Rivière (Le Modernisme dans l’Eglise) :
« Il comptait parmi les illustrations du clergé de France dans l’ordre scientifique. »
Mais pénétré de l’imposture religieuse, il a voué à l’Eglise une haine acharnée, disant :
« Je déteste l’Église ; j’exècre la bête ... »
Puis :
« J’ai prononcé le serment d’Annibal, le serment de faire sans trêve ni relâche la guerre à la bête. »
Les savants et Dieu.
Il nous reste un dernier point à élucider, c’est celui de savoir quel est le Dieu dont se réclament les savants déistes. Nos adversaires, en général, n’insistent pas outre mesure sur le Dieu anthropomorphe de la Bible. Cela se comprend. Le Dieu philosophique, pur esprit, paraît beaucoup moins vulnérable. Cependant, ni catholiques, ni protestants, ni juifs, ne peuvent renier le premier. Pour leur confusion, il ne résiste pas à l’examen. Ignorant, jaloux, faillible, malhonnête, brigand, plaisantin, lutteur, cruel et sanguinaire par dessus tout, voilà ses principaux attributs. Ce Dieu, répondant à la mentalité grossière d’un petit peuple ignorant d’Asie Mineure vivant il y a 4 ou 5000 ans, est rejeté aujourd’hui par tous les esprits réfléchis et sérieux et les soutiens des diverses religions le bannissent de leur cœur lorsqu’ils sont intelligents.
Il reste le Dieu « pur esprit », créateur, gouverneur et justicier. Nous n’entreprendrons pas de démontrer ici l’impossibilité d’existence d’un tel Dieu. Cela a été fait ailleurs et magistralement. (Voir par exemple : Sébastien Faure, Douze preuves de l’inexistence de Dieu.) Nous dirons seulement que le problème du mal restera toujours insoluble pour les croyants. L’existence de ce mal condamne le Dieu puissant, gouverneur et justicier. Voltaire n’admet que le Dieu créateur, mais ...
« Où est l’éternel géomètre ! Est-il en un lieu ou en tout lieu, sans occuper d’espace ? Je n’en sais rien. Est-ce de sa propre substance qu’il a arrangé toutes choses ? Je n’en sais rien. Est-il immense sans quantité et sans qualité ? Je n’en sais rien. Tout ce que je sais, c’est qu’il faut l’adorer et être juste. » (Dict. Phil. Athéisme)
Cela frise de bien près l’incrédulité totale. Voltaire était suffisamment averti pour sentir en lui-même le point faible de son raisonnement sur « l’horloger ». Un horloger a des ascendants et Dieu n’en aurait pas ? Mais Voltaire était aussi d’esprit assez pratique — car il était riche — pour affirmer la nécessité d’un Dieu pour ... autrui !
« On demande ensuite si un peuple d’athées peut subsister ; il me semble qu’il faut distinguer entre le peuple proprement dit et une société de philosophes au-dessus du peuple. Il est vrai que, par tout le pays, la populace a besoin du plus grand frein, et que si Bayle avait eu seulement cinq ou six cents paysans à gouverner, il n’aurait pas manqué de leur annoncer un Dieu rémunérateur et vengeur. »
Et encore :
« Et je vous demanderai toujours si, quand vous avez prêté votre argent à quelqu’un de votre société, vous voudriez que ni votre débiteur, ni votre procureur, ni votre notaire, ni votre juge ne crussent en Dieu. » (Dict. Phil. Athéisme)
Toujours ce leit motiv en maints endroits de son œuvre :
« Il est clair que la sainteté des serments est nécessaire, et qu’on doit se fier davantage à ceux qui pensent qu’un faux serment sera puni qu’à ceux qui pensent qu’ils peuvent faire un faux serment avec impunité. Il est indubitable que, dans une ville policée, il est infiniment plus utile d’avoir une religion, même mauvaise, que de n’en avoir point du tout. »
Il est donc absolument nécessaire, pour les princes et pour les peuples, que l’idée d’un être suprême créateur, gouverneur, rémunérateur et vengeur, soit profondément gravée dans les esprits. (Dict. Phil. Athéisme).
Mais Voltaire n’était pas dupe lui-même de son raisonnement « pour la populace », car il a écrit ailleurs :
« L’intérêt que j’ai à croire une chose n’est pas une preuve de l’existence de cette chose. » (Remarques sur les Pensées de M. Pascal)
Alors, pas de Dieu Justicier ? Pas de Dieu gouverneur ? Pas de Dieu créateur ? Eh bien, vous pouvez croire à « quelque chose qui est au-dessus de nous », à l’X mystérieux, indéfinissable ; cela ne gêne pas les athées, du moment que cet X n’a plus la prétention de s’immiscer dans la conduite de leur vie. Mais alors athées et croyants seront bien près de s’entendre ; il est vrai que ceux-ci sentiront certainement le fagot.
Conclusion.
À la base de la croyance en Dieu il n’y a, au fond, qu’un désir d’implorante justice. Justice contre les hommes par renonciation à la révolte contre la société inique, par manque de virilité pour l’établissement de rapports plus fraternels entre les individus. Justice aussi contre la vie par peur de la mort. (Voir ce mot). Car la mort, sans survie de « l’âme », reste incomprise de la part des croyants. Cicéron envisageait la chose avec plus de sérénité :
« Quel mal lui fait la mort ? Nous rejetons toutes les fables ineptes des enfers, qu’est-ce donc que la mort lui a ôté ? Rien, que le sentiment des douleurs ? »
Epicure pensait aussi que :
« La mort en elle-même n’est pas un mal, puisque tant que nous sommes elle n’est pas, et que lorsqu’elle est, nous ne sommes plus. »
L’athée, en être conscient, débarrassé des vains espoirs et des vaines fumées, dont l’origine remonte aux paniques ancestrales, transformiste et matérialiste par raison, méconnaît Dieu.
Ce n’est pas l’opinion imprécise et sujette à caution de quelques savants qui sera assez forte pour le détourner de sa voie.
— Ch. BOUSSINOT.
SAVOIR
Lorsqu’on essaie de préciser la nature intime du savoir et celle de son mécanisme, on éprouve une très grande difficulté par le fait évident que l’on se sert du savoir lui-même pour cette fin et qu’il est, ainsi, peu aisé de saisir les premiers éléments conscients, bases de toute connaissance. C’est alors que se précisent ces questions ardues : l’homme qui sait, que sait-il exactement ? Qu’est-ce que la connaissance, qu’est-ce que la réalité ? Que saisissons-nous de l’existence des choses ? Qu’est-ce que la conscience ? Comment se fait-il que nous sentons que la réalité est autre chose qu’une spéculation de l’esprit ; que nous distinguons la différence absolue entre le moi et le non moi, entre le souvenir et le fait actuel, entre le passé et le présent, entre l’inconscient et le conscient ?
Le fait que la conscience ne sait rien d’elle-même nous démontre tout d’abord que cette conscience ne peut être la cause réelle de la connaissance, mais plutôt qu’elle n’en est que l’effet puisqu’elle apparaît ou disparaît selon des circonstances particulières. C’est donc seulement par l’analyse de quelques faits psychiques que nous saisirons le mécanisme délicat et complexe de la connaissance et de la conscience.
Prenons le cas le plus clair d’un état conscient : la vue d’un livre. Ce fait paraît absolument inanalysable au premier abord. Je sais que je vois un livre. Et c’est tout. J’en ai une conscience nette, inattaquable. Mais qui est-ce ce « je » ? Si j’essaie de penser à ce même fait, mais en supprimant mentalement le « je », j’éprouve déjà une première difficulté et je m’aperçois que mon état conscient est moins net. Si j’essaie de réaliser la même pensée, mais en supprimant tout langage, toute phrase se rapportant à cet acte visuel, alors cette pensée se résout insensiblement à une simple sensation. Le fait conscient s’atténue ainsi graduellement. Mais ce n’est pas tout ; la sensation elle-même peut perdre sa signification consciente et se réduire à une totale incompréhension. Lorsque nous voyons un objet connu, avant toute pensée nous le reconnaissons et nos réflexions peuvent ensuite s’exercer sur son usage. Si l’objet est totalement inconnu le fait conscient s’arrête aussitôt et se limite à la simple sensation, visuelle ou autre. Mais si la sensation elle-même est absolument nouvelle, alors le fait conscient disparaît pour faire place à un état d’inconscience, sans repère dans l’espace et dans le temps.
Ces cas paraissent extraordinaires, mais on connaît quelques cas d’aveugles de naissance qui, ayant acquis ultérieurement l’usage de la vue, n’ont absolument rien compris à ce qu’ils « voyaient ». Encore avaient-ils d’autres éléments pour coordonner leurs sensations et leurs pensées. Que serait l’état d’un être privé de toutes sensations, n’ayant aucun souvenir sensoriel ?
Si donc la conscience est fonction de l’importance des documents sensoriels, nous sommes amenés à penser qu’elle est nulle chez le nouveau-né. Mais alors, dira-t-on, d’où vient elle et qu’est-elle réellement ?
Nous répondrons : elle est le résultat des réactions de notre sensibilité contre le milieu ; elle n’apparaît qu’avec la complexité de ces réactions. C’est donc la nature de celles-ci qui nous indiquera ce qu’est réellement la conscience. Remarquons que nous délaissons momentanément l’idée de savoir si la connaissance est la représentation exacte des objets dans l’espace et dans le temps. Nous nous contenterons de considérer la connaissance comme une réaction de notre sensibilité contre le milieu.
Ces réactions nous sont particulièrement connues sous la forme de réflexes se produisant dans les divers étages du système nerveux et déterminant soit un acte moteur, soit un fonctionnement organique interne, soit enfin une simple dispersion de l’influx nerveux sans conséquence motrice ou organique immédiate.
L’observation de l’enfance nous démontre le caractère automatique des premiers réflexes, liés aux seules fonctions organiques. L’enfant saisit et suce n’importe quoi. Mais les sensations se précisent, se coordonnent assez vite ; les réflexes conditionnels enrichissent et compliquent le fonctionnement nerveux de telle sorte que la vie organique se trouve alors étroitement liée aux diverses variations du milieu. C’est ici que commence la connaissance réelle, non pas une connaissance formée de la pénétration de tous les secrets du monde environnant, mais une connaissance faite de la relation de divers états de l’organisme avec les influences du milieu. C’est ainsi que l’eau sera perçue et connue tout d’abord comme une chose agréable ou désagréable ; il en sera de même pour tout ; pour les aliments, les bruits, les odeurs, les sons ; pour la pluie, le vent, la chaleur, le froid, etc.... A chaque réflexe organique s’adjoindront quelques réflexes conditionnels, formés eux-mêmes, pour la plupart, par l’influence directe du milieu sur la sensibilité de l’enfant.
Nous voyons donc qu’ici la connaissance n’est qu’une incessante relation d’influence entre le milieu et l’enfant. Si toute l’énergie déclenchée par la réaction nerveuse du sujet était utilisée dans cette réaction, il ne resterait pas grand chose pour le souvenir et la pensée. Mais il est rare qu’il en soit ainsi. Une partie de l’influx nerveux se disperse dans les zones supérieures du système nerveux, laissant des traces, des liaisons, des constructions, lesquelles influeront ultérieurement sur les actes moteurs de l’organisme entier. Ce qu’il importe surtout de démontrer, c’est que la connaissance initiale n’est qu’une réponse de l’être au milieu, une adaptation de son organisme et non, comme veulent le faire croire les spiritualistes, une divination de l’état nouménal des choses. L’être agit comme un automate prodigieux sous la double action des phénomènes objectifs et des phénomènes organiques. Toute action, toute pensée, toute méditation est une réponse automatique aux variations du milieu et non pas un fait de conscience pure, devinant les secrets de la chose en soi. Il suffit de suivre une pensée pour saisir l’absence de conscience pure, pour s’apercevoir que ce n’est qu’un prodigieux mécanisme de réflexes se traduisant par du mouvement. L’homme reçoit, transforme et transmet du mouvement.
Prenons par exemple le spectacle d’une rue. J’ai conscience de tout ce que j’y vois et entends, mais cet état conscient total, je puis le diviser en un très grand nombre de faits sensoriels créés antérieurement par le mouvement et décomposable en dernière analyse, soit en mouvements musculaires, soit en modifications organiques diverses. Et ces états de conscience de sensations internes, je puis encore les dissocier jusqu’au simple réflexe automatique sans conscience.
Nous savons également, par l’observation des cas pathologiques, par l’étrangeté des sommeils et des rêves, par les oublis, par la perte graduelle de la conscience dans l’habitude ; enfin par la certitude que nous avons que tout notre savoir gît inconsciemment en nous et ne se révèle qu’au fur et à mesure de l’action présente, que le « moi » indivisible n’existe pas et que cette impression d’unité vient précisément de ce que la conscience n’étant que le heurt de notre sensibilité avec le milieu dans le présent, nous ne pouvons vivre et être que dans une seule situation, un seul état à la fois. Nous sommes « un » dans l’espace, mais non dans le temps puisque nous changeons et vieillissons.
Pouvons-nous alors préciser ce qu’est la réalité, ce qu’est le présent, le passé, l’identique, le dissemblable ? Y a-t-il une vérité sur l’existence des choses ? Pouvons-nous démontrer des erreurs ?
En prenant comme base de la connaissance les réflexes, nous voyons qu’il s’établit nécessairement une relation entre l’être et le milieu, et cette relation, dans sa forme la plus simple, est une vérité. Mais les associations de réflexes ne sont pas toujours des vérités et les réflexes conditionnels peuvent orienter l’être vers des faits inexistants ou dangereux. C’est le cas pour le chien électrisé pendant ou avant le repas et qui, réagissant tout d’abord douloureusement sous l’influence du courant, finit par éprouver du plaisir, parce que l’excitation anormale est liée au repas. On pourrait aller ainsi jusqu’au suicide. Ce qui est d’ailleurs le cas pour les ivrognes, les morphinomanes, etc...
Nous pouvons considérer le patriotisme, le nationalisme, la religiosité et les mysticismes divers comme des réflexes conditionnels nuisibles et dangereux, conduisant à des faits inexistants ou désavantageux.
Ceci nous amène à rechercher ce qu’est la réalité et comment nous la différencions du souvenir et de l’imagination.
La réalité est essentiellement sensuelle, consciente et par conséquent uniquement applicable au présent. Le mécanisme cérébral qui la différencie du souvenir peut se comprendre ainsi : dans le présent l’être est soumis à une multitude de sensations, d’excitations créant des réflexes qui l’adaptent étroitement au monde extérieur et qu’il ne peut supprimer d’aucune façon (sauf dans le dérangement cérébral). Dans le souvenir il se présente deux cas : ou le souvenir est pur, simple, dégagé de toute relation (homme, maison, chaise, etc....) et par son abstraction même il se situe immédiatement comme un souvenir pur ; ou bien il est lié à un ensemble de réflexes complexes reproduisant des parties de la vie passée. En ce cas, les divers éléments le composant ne correspondent point aux éléments présents perçus par les sens. D’où différenciation immédiate aidée par l’inégalité d’intensité nerveuse entre le souvenir et le fait présent. Autrement dit, les faits présents sont plus intenses que les faits passés. Remarquons qu’en réalité il n’y a pas de passé, car le fait d’être ne se conçoit que d’une seule façon : au présent. Si donc il existe en nous quelque chose, ce quelque chose est toujours dans le présent. Seulement ce quelque chose est comme un livre fermé ne s’ouvrant que sous les nécessités vitales du présent.
Toute la connaissance humaine étant réduite à des associations hasardeuses de sensations et à des liaisons nerveuses dénommées pensées et imagination pouvons-nous accorder une valeur réelle à cette connaissance et que vaut-elle exactement !
Examinons le cas de la théorie atomistique. Ici, il semble, au premier abord, que la pensée a dépassé le cadre du subjectif pour pénétrer le secret de l’objectif. Pourtant il n’en est rien. Pour que les idées de mouvement, de masse, de rayonnement, d’ondes, de rotations, etc., aient un sens, il est nécessaire qu’un minimum de sensations fixent le point de départ des raisonnements ; sinon, la chose dont on s’occuperait aurait aussi peu de réalité que l’âme des spiritualistes. Et les raisonnements eux-mêmes ne représenteront que des possibilités d’actions de la substance, actions connues antérieurement par des expériences et constituant la base essentielle mais sensorielle de la science. Et lorsqu’une théorie sera imaginée, c’est encore par l’intermédiaire des sens que s’en effectuera la vérification. Nous voyons que la certitude est toujours d’origine expérimentale et que l’expérience s’effectuant nécessairement au présent constitue par la force des choses la seule réalité.
Mais avons-nous pénétré les secrets de la substance et du mouvement ? Pas le moins du monde !
Nous ignorons totalement ce qu’est la substance en elle-même et le mouvement en soi. Nous n’avons saisi que des modalités d’un monde microscopique, mais toujours sensoriel. Nous n’avons saisi que des relations.
Mais cela n’empêche que ces relations soient exactes et que notre représentation du fonctionnement des choses soit conforme à la réalité. Connaître la vérité c’est donc connaître une succession de réalités perçues dans l’espace et dans le temps. La vérité est une sorte de collection illimitée de faits présents. Enseigner une ou des vérités, c’est affirmer qu’une succession de faits à venir répèteront identiquement des réalités passées.
Il est pourtant des vérités, objectera-t-on, que l’expérience ne peut aucunement vérifier et qui ont cependant un caractère de certitude absolue. Par exemple la certitude de notre propre mort. Nous pouvons répondre que précisément cette vérité est une des plus riches collections de réalités que l’homme ait jamais expérimentées. Car nul n’a jamais connu d’homme immortel. La répétition à travers les siècles des mêmes phénomènes, sans aucune exception, crée en nous le caractère de la certitude absolue, sans qu’il soit nécessaire pour cela d’épuiser tous les cas, parce que précisément tous les cas possibles n’ont aucune chance d’échapper à la règle commune.
C’est donc l’identité des cas, des faits, des circonstances qui, par leur répétition, crée en nous la connaissance applicable aux faits à venir.
Ou peut encore ajouter qu’une vérité peut être déduite du passé, sans ressembler à ce passé et annoncer une réalité nouvelle. Cela est certain. L’imagination peut construire des concepts semblables aux modifications ultérieures et plus ou moins rapides du milieu ? C’est là une des plus remarquables caractéristiques de l’intelligence et spécialement du génie. C’est aussi la forme la plus intéressante du savoir, car la connaissance, qui ne s’applique qu’à des répétitions de faits identiques, ne constitue qu’une faible partie de l’activité intellectuelle des êtres pensants. Mais le monde étant en perpétuel changement, l’être ne se trouve jamais devant des situations absolument identiques. Il lui faut donc improviser des adaptations, inventer, prévoir le futur, jouer l’avenir pour ainsi dire et se préparer aux faits éventuels.
Dans mon étude sur la raison, j’ai décrit le mécanisme subtil de l’invention, produit des liaisons nerveuses, créées sous l’influence des centres affectifs. Nous savons que les émotions violentes sont anti-intellectuelles par le fait connu que l’influx nerveux libéré en excès, s’écoule violemment vers les mécanismes moteurs les plus faciles, déclenchant par les voies réflexes les plus anciennes et les plus immédiates des mouvements plus ou moins adaptés aux événements. La pensée est, au contraire, le produit d’un lent cheminement de l’influx nerveux se dispersant dans des voies multiples dont aucune n’est assez importante pour déclencher l’acte moteur.
Des réseaux peuvent alors fusionner, créant des liaisons nouvelles dont l’effet objectif se traduira par une modification plus ou moins avantageuse de l’être vis-à-vis des faits nouveaux.
C’est ainsi que la vengeance, acte émotif par excellence, peut faire place, chez l’homme de raison, à la compréhension de l’inutilité totale de cet acte, puisque sans effet rétrospectif sur les faits passés ; tandis qu’il trouvera peut-être les moyens efficaces pour modifier, à l’avenir, les causes créant la malfaisance d’autrui.
L’invention et l’imagination sont donc bien parmi les éléments essentiels du vrai savoir. Mais au cours des siècles, les hommes ont ainsi annoncé des milliers de vérités ; les prophètes, les devins, les messies de toutes les croyances ou de tous les partis, tout comme les vulgaires tireuses de cartes, ont proclamé des vérités plus ou moins pharamineuses. Seule l’impitoyable réalité, l’expérience, a réduit à néant ces affirmations erronées.
Cette manière d’envisager la connaissance n’est nullement pessimiste. Elle sépare le savoir véritable du faux savoir. Elle nous fait voir que le monde est en perpétuel mouvement ; que tout évolue et se transforme ; et que, parmi ces mouvements, il en est dont le rythme et la répétition se prêtent à la prévision. Ce qui constitue le savoir. Il en est d’autres dont les irrégularités s’opposent à toute classification définitive.
L’astronomie, la physique, la chimie, se prêtent en partie à nos prévisions et nous permettent d’établir des vérités.
La météorologie, la biologie, la psychologie, la sociologie s’y prêtent beaucoup moins bien, quoique la psychologie, purement objective et physiologique (méthode de Pavlov), ait fait d’énormes progrès.
C’est par la collaboration de tous les efforts humains, par la coordination de toutes les réalités et de toutes les vérités que le savoir se fondera progressivement, hors des inventions et des révélations des sorciers laïques et religieux.
Une dernière question se pose. Nous avons dit que le savoir était fait de répétitions, d’identités, d’invariabilités. Or, le monde étant en perpétuelle transformation, quelle peut être la valeur exacte de notre savoir vis-à-vis des lois naturelles ? Ne dit-on pas excellemment qu’il n’y a de science que du général. Quelles peuvent être les généralités permanentes dans un monde mouvant ?
Nous pouvons considérer l’univers comme une horloge colossale dont tous les rouages seraient étroitement solidaires les uns des autres. Si cette horloge possédait des cadrans et des aiguilles marquant depuis les millièmes de seconde jusqu’à des durées dépassant des milliards de siècles, nous considérerions les diverses rotations d’aiguilles comme autant de variations évidentes. Pourtant certaines aiguilles nous paraîtraient absolument immobiles, quelle que soit la durée de nos observations Nous appellerions alors vérités ces immobilités apparentes, bien que soumises à une lente évolution.
Il en est probablement ainsi des lois naturelles. Elles nous paraissent fixes actuellement et notre courte durée, adaptée à cette stabilité relative de notre univers, établit des lois et invente une certaine harmonie qui n’est, en fait, qu’un lent désordre qui dure indéfiniment plus que notre humanité, mais n’est, au regard de l’infinité du temps, qu’un éclair fugitif dans la profondeur de l’éternité.
En résumé, nous pouvons préciser les points suivants :
-
La connaissance n’étant qu’une modification atomique de notre substance nerveuse par la substance objective dont elle ne diffère pas essentiellement, il s’ensuit que notre substance ne sachant rien d’elle-même ne peut pas savoir davantage quelque chose de l’autre. La substance ne sait rien d’elle-même.
-
La conscience n’est donc pas à la base du savoir ; elle est un effet, une conséquence du heurt de notre sensibilité avec les phénomènes objectifs. La sensibilité est antérieure à la conscience.
-
Nous appelons présent le moment précis de ce heurt et réalité l’ensemble des perceptions subies à ce moment-là.
-
Tous les souvenirs sont dans l’espace, donc présents, mais inutilisés et inconscients.
-
Le fait actuel se différencie du fait passé par la qualité et la quantité des éléments sensoriels associés soit au fait passé, soit au fait présent et surtout par la plus grande intensité des perceptions présentes.
-
Le savoir ne nous fait pas connaître l’essence des choses, mais le rapport de notre sensibilité avec le milieu.
-
Le savoir véritable est donc une adaptation de notre être aux influences du milieu. Savoir, c’est agir en s’adaptant aux réalités.
-
L’erreur est une mauvaise association de réflexes conditionnels créant des concepts différents de la réalité. Elle est toujours démontrable dans le domaine expérimental.
-
La vérité est l’ensemble des réalités dont est formé un concept. Ne peuvent prendre le nom de vérité que les concepts soumis au contrôle de l’expérience.
-
Il n’y a pas de vérité a priori. Toute connaissance est essentiellement acquise sensoriellement.
-
Il y a trois degrés dans la connaissance : les réalités strictement personnelles ; les réalités générales ; les concepts généraux.
-
L’accord des humains ne peut s’effectuer que sur les réalités générales ou sur les concepts généraux appuyés par des démonstrations expérimentales. La connaissance réelle est impersonnelle. Elle tend à l’universel. C’est-à-dire à l’élaboration de vérités spécifiques et non individuelles.
-
La principale cause de division entre les hommes consiste dans le fait de donner comme vérité, ou comme un fait général et impersonnel, ce qui n’est qu’un fait particulier ou indémontrable expérimentalement.
-
La méthode scientifique est la seule méthode pour former la connaissance réelle et le savoir. Elle utilise les réalités générales et crée des concepts généraux susceptibles de s’adapter aux variations du milieu. Mais toute utilisation de ces concepts ne peut s’effectuer sans un coefficient personnel d’appréciation qui ôte précisément à cette adaptation tout le caractère rigoureux de causalité ou de convenance infaillible de cause à effet.
-
Il y a donc la méthode scientifique et il y a les hommes l’utilisant. Il est nécessaire de se servir de la méthode. Il est prudent de se méfier des hommes et de leurs affirmations.
-
Le savoir peut être considéré comme un moyen ou comme un but. Les techniciens en font un moyen. Les savants et les philosophes en font un but. L’homme de raison doit être harmonieux ; c’est-à-dire : technicien, savant et philosophe.
— IXIGREC.
SCANDALE
n. m.
L’étymologie du mot scandale est un terme grec qui signifie piège. Les théologiens désignent par ce nom les discours, les actes, les mauvais exemples qui sont pour l’homme une occasion de tomber dans l’erreur, une incitation à commettre des fautes. Plus communément on considère comme scandaleux les faits qui froissent les sentiments professés — sinon toujours éprouvés — par la généralité des membres d’une société, faits qui provoquent des démonstrations d’inquiétude, de répulsion, d’indignation.
Ceux qui, avec Durkheim, admettent que « l’ensemble des croyances et des sentiments communs à la moyenne des membres d’une même société forme un système déterminé qui a sa vie propre » que l’on peut appeler « conscience collective ou commune », possédant « des caractères spécifiques qui en font une réalité distincte », ceux-là diront que le scandale est une atteinte à la conscience collective. Toutefois, cette conscience commune, qui n’est l’attribut d’aucun sujet réel, est un concept trop vague, pour que nous l’admettions sans réserve, autrement que comme une expression permettant d’abréger le discours. Plutôt qu’aux sentiments de la moyenne des citoyens, cette expression correspond au maximum de discipline morale qu’une minorité dirigeante peut leur faire accepter sans provoquer de leur part de trop vives réactions.
Le scandale se produit d’autant plus couramment, il est d’autant plus intense, que la cohésion du groupe humain repose davantage sur l’instinct grégaire que sur l’adhésion conditionnée d’individus jaloux de leur autonomie. Ce n’est pas à dire que la personnalité gagne à s’abstraire du milieu social. Bien au contraire, une puissante individualité est particulièrement sensible à l’évolution de ce milieu. Novatrice elle-même, les idées neuves ne la scandalisent pas ; la raison les lui fait accepter ou rejeter sans susciter chez elle des mouvements passionnels. L’homme est donc d’autant plus enclin à se scandaliser qu’il a aliéné aux mains d’une collectivité une plus grande part de sa personnalité. S’il ne lui cède rien, il est lui-même objet de scandale. Comme l’a dit un philosophe contemporain, G. Belot : « Le scandale dernier, le scandale limite, c’est l’existence même, en face de la collectivité, de l’irréductible ferment de différenciation qu’est l’individu ». L’individu indépendant est un être d’exception. Celui que nous coudoyons tous les jours n’est libre ni de ses actes, ni même de ses pensées, qui doivent rester en harmonie avec les coutumes et les préjugés du groupe. Conscience et réactions d’une collectivité n’ont, nous l’avons dit, qu’un caractère symbolique ; sentiments, émotions, mouvements sont des impressions et des manières d’être personnelles. Si la faculté de les éprouver est inégalement départie aux membres de la société, elle ne s’exerce que par l’intermédiaire de personnes concrètes qui traduisent l’opinion dominante. Etudier les conséquences du phénomène scandaleux revient, en définitive, à examiner ce qu’elles sont chez un sujet individuel dont la mentalité est façonnée par le groupe auquel il est incorporé.
Les effets du scandale rentrent dans la catégorie des émotions. Les excitations physiques ou psychiques qui lui donnent naissance doivent être au-dessus d’un minimum qui correspond à la perception. Une fois ce seuil de la perception franchi, l’émotion qui résulte du scandale, qui en donne la mesure, s’étend sur une vaste plage qui se refuse aux délimitations précises. Superficielle au début, l’émotion n’a le plus souvent que des effets passagers ; dans la zone moyenne elle agit énergiquement sur la personnalité qu’elle finit par ébranler et désagréger lorsqu’elle la secoue dans ses profondeurs.
Il faut encore distinguer, parmi les atteintes aux opinions régnantes, celles qui sont accidentelles, de celles qui sont persistantes ou souvent répétées. Le premier effet de la contradiction est de consolider l’opinion combattue.
« Il arrive parfois qu’en disputant contre les infidèles, on les induit de nouveau en péché, loin de les convertir. C’est pourquoi ceux qui possèdent la vérité doivent la répandre avec prudence. » (A. France.)
Quand elle s’adresse à un certain nombre d’individus, imbus des mêmes principes, la contradiction inopinée « tourne en scandale ». L’opposition de chacun se renforce de celle de ses compagnons et motive des protestations véhémentes qui attestent la solidarité du groupe et affermissent les croyances dont l’autorité est récusée.
Le renforcement de l’esprit de conservation est encore plus accentué lorsque, dépassant la simple contradiction au sein d’un cercle étroit, l’atteinte subite aux règles traditionnelles prend d’emblée les proportions du scandale d’intensité moyenne. Parce que les sentiments offensés... :
« ...se retrouvent dans toutes les consciences, l’infraction commise soulève chez tous ceux qui en sont témoins ou qui en savent l’existence, une même indignation. Tout le monde est atteint, par conséquent tout le monde se raidit contre l’attaque ... Il n’y a qu’à voir ce qui se produit, surtout dans une petite ville, quand quelque scandale moral vient d’être commis. On s’arrête dans la rue, on se retrouve aux endroits convenus pour parler de l’événement et on s’indigne en commun. De toutes ces impressions similaires qui s’échangent, de toutes les colères qui s’expriment, se dégage une colère unique, plus ou moins déterminée, suivant les cas, qui est celle de tout le monde sans être celle de personne en particulier. C’est la colère publique. » (Durkheim)
Puis bientôt l’émotion se calme, la vie habituelle reprend son cours, les vieux errements sortent de l’épreuve confirmés.
Il en est tout autrement lorsqu’il s’agit d’atteintes moyennes et même minimes, prolongées, multipliées, ou fréquemment répétées. Au lieu de provoquer la répulsion, le scandale finit alors par prendre un attrait particulier.
« Ici, il ne s’agit plus de l’attrait directement exercé par ce que l’on considère comme mauvais ou comme défendu, il s’agit du plaisir que l’on prend au fait même du scandale, de l’intérêt que l’on ressent à constater cet accroc à la conscience sociale, à assister au débat dramatique, tantôt plutôt comique, tantôt vraiment tragique, entre ceux qui ont transgressé la règle et ceux qui la défendent. » (G. Belot)
Si nous nous rapportons à l’une des définitions du scandale qui l’envisage comme cause de diminution de foi, nous apercevons un paradoxe dans cette attirance du fait scandaleux. Alors que :
« Toute foi cherche ce qui peut la confirmer, évite ou méconnaît tout ce qui la contredirait ou l’infirmerait ... , dans la recherche du scandale, il semble que nous allons au-devant du risque, que nous nous exposons plus ou moins volontairement au danger ... pour nous croire en droit d’affirmer, nous essayons d’abord de nier et presque de nous renier nous-mêmes. » (G. B.)
Il arrive que l’épreuve tourne contre celui qui la tente qui souvent finit par perdre ses anciennes convictions, sans trouver une base suffisante pour en asseoir de nouvelles. Et si l’on considère l’effet d’ensemble, il n’y a plus seulement fléchissement de la personnalité, mais désagrégation de la société, corruption des moeurs. Pourquoi n’agirais-je pas aussi comme ceux qui ont donné l’exemple du mépris des conventions, surtout s’ils en ont tiré quelque profit matériel ? Et cela principalement lorsqu’il s’agit de médiocres délits, de légères dérogations à la morale, dont la répétition accoutume à la licence sans trop compromettre le lien social. Une suggestion lente, progressive, consciente cependant, diminue la confiance dans les normes usuelles, dérègle le comportement individuel et rend d’abord plus indécises les réactions collectives.
Dès que, sans devenir excessive, la violence du scandale s’accroît, ces réactions tendent à retrouver leur vigueur. Ceux qui sont fortement et obstinément scandalisés cherchent à détruire les causes, et souvent même les responsables, des attentats à la légalité. Mais :
« Même vainqueurs, peuvent-ils sortir indemnes du conflit ? A être témoins, et témoins irrités, donc attentifs et « esveillés » de façons de sentir, de croire et d’agir opposées aux leurs, n’auront-ils pas vu leur esprit envahi par une foule de représentations qui tendront à l’acte à leur tour ? Ne seront-ils pas, dans quelque mesure, devenus autres, et semblables à ceux qu’ils ont d’abord réprouvés ?.. Voilà le second aspect du scandale et peut-être le plus important et le plus intéressant au point de vue moral et social. » (G. B)
« Un conflit peut surgir, et il existe toujours virtuellement, entre l’affirmation spontanée et la négation réfléchie. Celle-ci « loge son ennemi avec elle », puisqu’elle exige en principe, la présence de son objet dans l’esprit. » (G. B.)
Et l’ennemi poursuit son cheminement à l’insu même de ceux qui le logent dans leur cerveau, dont l’attention est distraite, la défiance écartée par les besognes de la vie quotidienne. Dans les périodes de détente il reparaît sous la forme de suggestion, d’obsession même. Chose remarquable, chaque fois que le fait scandaleux initial se reproduit, ils résistent d’autant plus énergiquement que l’ennemi a un caractère plus agressif et qu’eux-mêmes sont plus atteints dans leur moral et plus près de rendre les armes. Ils affectent d’être d’autant plus fermes que leur volonté est plus chancelante.
Qu’un acte délictueux soit commis dans la rue : vol, voies de fait, qui s’attroupe ? Qui se passionne ? Qui injurie et frappe le coupable présumé ? Le riche bourgeois qui passe ? Non. C’est le pauvre hère mal assuré du lendemain. Est-ce à des sentiments généreux, à la pitié qu’obéit le premier ? Bien plutôt à l’indifférence : il ne se sent pas menacé dans ses biens ; sa fortune le garantit de la déchéance. Le second cède-t-il à quelque penchant cruel, à une sauvagerie native ? Non, il a peur, et l’origine de sa peur, c’est l’instabilité de sa condition, la perspective de la détresse qui le menace et le portera peut-être, un jour, aux actes qui le scandalisent maintenant. C’est au cauchemar qui l’obsède, au spectre de l’être déchu latent en lui qu’il montre le poing.
Nul n’a mieux mis en relief l’emprise et la progression du scandale qu’Anatole France, dans « Thaïs ». Après une jeunesse dissipée, Paphnuce s’est converti au christianisme. « Depuis dix ans qu’il s’était retiré loin des hommes, il ne bouillait plus dans la chaudière des délices charnelles, mais il macérait dans les baumes de la pénitence ». Or, un jour, dans sa retraite :
« il lui souvint d’avoir vu jadis au théâtre d’Alexandrie une comédienne d’une grande beauté, nommée Thaïs. Cette femme se montrait dans les jeux, et ne craignait pas de se livrer à des danses dont les mouvements, réglés avec trop d’habileté, rappelaient ceux des passions les plus horribles ... Après quelques heures de méditation, l’image de Thaïs lui apparut avec une extrême netteté. »
« Pénétré de douleur à la pensée qu’il y a dans Alexandrie une courtisane nommée Thaïs qui vit dans le péché et demeure pour le peuple un objet de scandale », il dit :
« J’irai trouver cette femme dans Alexandrie, et, avec le secours de Dieu, je la convertirai. »
Chacun sait que la pensée de ce scandale ne cesse plus de hanter l’esprit du moine et comment il parvient à réaliser son dessein, comment il résiste à toutes les tentations, et que les violences des débauchés ou des marchands exploitant le vice, les objurgations ou les railleries de ses anciens amis ne font que renforcer sa volonté.
Cependant, si le scandale a pris fin, son souvenir continue à obséder Paphnuce, l’interprétation de ses manifestations subit seule quelques changements.
« L’image de Thaïs ne le quittait ni le jour ni la nuit. Il ne la chassait point parce qu’il pensait encore qu’elle venait de Dieu et que c’était l’image d’une sainte. »
Mais cette transfiguration n’est que passagère et bientôt c’est le fantôme lubrique de la courtisane qui occupe les rêveries et les songes du possédé.
« Il ne lui restait plus de doutes : l’image de Thaïs était une image impure. »
Dès lors, malgré les macérations, les dures épreuves auxquelles se soumet le malheureux, il ne tarde pas à succomber :
« Fou, fou que j’étais de n’avoir pas possédé Thaïs quand il en était temps encore ! Fou d’avoir cru qu’il y avait au monde autre chose qu’elle ! O démence ! J’ai songé à Dieu, au salut de mon âme, à la vie éternelle, comme si tout cela comptait pour quelque chose quand on a vu Thaïs. »
Et le scandale produit des effets analogues lorsque au lieu d’exploiter le domaine de l’instinct, il s’attaque à la pensée religieuse. Lorsqu’au banquet de Cotta vient s’asseoir Marcus l’arien, Paphnuce pâlit d’épouvante. Mais aussitôt il se reprend, si choquants que soient les propos de l’hérétique, ils n’ébranlent pas sa foi, il n’y répond même pas, il persévère « dans son silence sublime ». Pourtant, les affirmations scandaleuses qui, tout d’abord, n’ont fait que consolider 1’orthodoxie de l’anachorète, poursuivent obscurément leur travail dans son esprit et, plus tard, lorsque, dans sa détresse, il invoque le Sauveur, sa prière est une profession d’arianisme et une voix intérieure lui crie :
« Voilà une oraison digne du bréviaire de Marcus l’hérétique. Paphnuce est arien. »
Nous verrons tout à l’heure l’explication de cette chute et de ce reniement.
Si tels sont les effets du scandale, on peut se demander s’il ne peut être un puissant auxiliaire de la propagande, un moyen à employer pour retourner l’opinion d’une société. Dans une certaine mesure, sans doute ; mais moins étendue qu’on ne le supposerait. Nos tendances sont innées. Jusqu’à quel point peuvent-elles subir l’influence des événements dont le milieu social est le théâtre ?
« Le milieu n’est pas un agent de formation à proprement parler, mais bien de réalisation : il permet aux localisations germinales de déployer leurs propriétés morphogénétiques propres, mais il ne leur en confère pas de nouvelles. Néanmoins, bien que réduit à ces proportions modestes, son influence ne doit pas être sous-évaluée. » (Brachet)
À la naissance, l’être est doté des caractères généraux de l’espèce et de ceux de la lignée à laquelle il appartient.
« Mais l’épanouissement de ces caractères dépend, lui aussi, des conditions extérieures du développement, qui n’atteignent jamais l’idéal complet. »
« L’éducation sera donc capable de faire donner aux potentialités psychiques et morales du cerveau d’un individu tout ce qu’elles peuvent, mais elle pourra aussi leur faire donner moins, les enrayer et laisser dans l’ombre des défauts et des qualités, qui autrement dirigés se seraient peut-être mis à l’avant-plan. » (Brachet)
L’homme, au cours de son existence, est incorporé à différents groupes qui lui imposent leur discipline, qui favorisent certaines de ses dispositions, en refrènent d’autres, sans pourtant les abolir. De là ces combats intérieurs, ces renversements d’attitude. Penchants érotiques et penchants mystiques coexistent dans l’âme de Paphnuce. Vivant dans une société dissolue, les premiers gouvernent sa jeunesse. Après sa conversion, les seconds prennent le dessus. Mais lorsqu’il fait un retour sur lui-même, revit son passé, non pas même un scandale présent, mais le rappel d’un scandale ravive en lui la passion assoupie. Avant d’être chrétien, il a été païen, élève des philosophes, et les propos de Marcus « qu’on nommait le Platon des chrétiens » trouvent en lui des voies toutes tracées pour réveiller des idées qui sommeillaient. Sa vie reflète à la fois l’opposition de deux civilisations et celle des deux tendances qui coexistent en lui.
Durant les périodes de stabilité, la loi ou la coutume réprime toutes les tendances qui pourraient compromettre l’équilibre social.
« Mais la tendance, les aspirations ainsi réprimées n’en sont pas moins vivaces au fond de la personnalité ou de la collectivité, et prêtes à se manifester à la première occasion. »
L’homme :
« Se sent arrêté par il ne sait quoi.... C’est souvent un incident fortuit qui vient lui dénoncer ce véritable sentiment, son désir, sa tendance, son aspiration, masquées jusque-là par une répression latente, inconsciente... Mais que surviennent des circonstances qui se prêtent à la réalisation de ces tendances cachées, et, à partir de ce moment, elles se renforcent, leur répression devient consciente, et il cherche lui-même les moyens de s’en libérer. » (Dr P. Sollier)
Le scandale est précisément un de ces incidents qui fournissent l’occasion de cette libération subite ou progressive d’une tendance chez ceux qui en sont déjà imbus. Le scandale produit l’effet d’un révélateur. Dans une société qui se croyait homogène il se produit une disjonction des éléments. La révélation d’aspirations jusqu’alors contenues produit un effet de surprise chez ceux mêmes qui ne les ressentent pas ; ils en mesurent la puissance et leur foi est ébranlée ; si le groupe adverse est entreprenant, ils sont prêts à capituler. Ils réfrèneront à leur tour leurs tendances particulières, jusqu’au jour où quelque circonstance favorable permettra à celle-ci un nouvel essor. Ainsi se succèdent réformes et réactions.
Il arrive pourtant que la réaction soit immédiate ; c’est le cas du scandale extrême que nous avons laissé de côté. Ce ne sont plus seulement quelques privilèges injustifiables, quelques coutumes désuètes qui sont attaquées mais tout l’ensemble des institutions qui est menacé d’un bouleversement. Si les bases d’un nouvel ordre social ne sont pas immédiatement proposées, si l’avenir est abandonné aux fluctuations d’opinions insuffisamment éclairées, l’instinct individuel de conservation domine tout autre sentiment, l’affolement général fait obstacle à l’instauration d’un ordre nouveau.
Cependant :
« Comme la religion l’ordre aura ses fanatiques. Les sociétés modernes offrent cette particularité, qu’elles sont d’une grande douceur quand leur principe n’est pas en danger, mais qu’elles deviennent impitoyables si on leur inspire des doutes sur les conditions de leur durée. La société qui a eu peur est comme l’homme qui a eu peur : elle n’a plus toute sa valeur morale. Les moyens qu’employa la société catholique au XIIIème et au XVIème siècle pour défendre son existence menacée, la société moderne les emploiera, sous des formes plus expéditives et moins cruelles, mais non moins terribles. » (E. Renan)
« Des dictateurs d’aventure » se chargeront d’une telle besogne, si les gouvernements traditionnels la jugent indigne d’eux. Ainsi le scandale, dont l’efficacité comme moyen de propagande est indiscutable, est, par contre, un instrument d’un maniement délicat, dangereux même lorsqu’il est porté à l’extrême. Il est plus prudent de ne pas le provoquer, mais de mettre uniquement en relief ceux qui se produisent spontanément dans nos sociétés modernes. Ils sont assez fréquents pour fournir l’occasion de combattre toutes les routines, tous les préjugés, tous les abus, pour inspirer à tous ceux qui en souffrent et voudraient édifier une société meilleure le désir de mettre de l’ordre dans leurs idées et d’unir leurs forces.
Si c’est le sentiment qui provoque la critique des institutions et la révolte contre elles, c’est à la raison, plutôt qu’à la passion qu’il faut faire appel pour leur faire produire des effets durables. L’émotion consécutive au scandale, comme nous l’avons signalé, n’imprime une nouvelle orientation spirituelle qu’à ceux que leur innéité prédisposait à l’adopter. Chez les réfractaires dont la mentalité n’est pas modifiée, les arguments logiques sans les convaincre, rabattent l’assurance et, à un antagonisme actif, substituent de simples regrets du passé.
La recherche du scandale présente d’autres dangers. Des professionnels sans conviction peuvent la choisir comme carrière, et, ce qui est plus néfaste encore, des gens de bonne foi peuvent en abuser. Il est inutile d’insister sur l’effet démoralisant des manoeuvres des provocateurs ou des beaux gestes des fantaisistes. La réprobation qui devait ne s’attaquer qu’à leur personne, finit par rejaillir sur les idées dont ils se faisaient les propagandistes.
Ceux qui, sans arrière pensée, sont portés à l’outrance, sortent, en général des rangs de la jeunesse bourgeoise. Jusqu’à une époque assez rapprochée et, dans une certaine mesure encore maintenant, l’éducation bourgeoise est basée sur la contrainte : contrainte dans la tenue, dans le langage et même dans les distractions. L’établissement d’instruction, surtout s’il s’agit d’un internat, impose une discipline assez rigoureuse. Aussi, lorsque l’adolescent accède à l’enseignement supérieur, qui souvent l’éloigne de sa famille, et toujours lui laisse une certaine liberté, il s’empresse d’en user et même d’en abuser. Suivant ses tendances propres, souvent au hasard des camaraderies, il s’agrège à un groupe, et la générosité du caractère, la fougue naturelle à cet âge le conduisent à adopter de confiance les principes qui ont présidé à la formation du groupe, à en observer les rites, à les exagérer. Si le clan est révolutionnaire, il sera au nombre des plus ardents, des plus audacieux dans l’action (sans qu’il se l’avoue à lui-même, il sent bien qu’il a une position de repli).
Une fois en possession d’une situation, dans l’administration, dans l’industrie ou toute autre profession libérale, le jeune bourgeois en voie d’émancipation est arrêté par de nombreux obstacles. Les uns viennent du dehors, réglementations administratives ou patronales, esprit de corps, action des parents directs ou par alliance.
« D’autres viennent de notre constitution même, qui comporte des tendances contradictoires. Nous puisons alors dans les règles constituant les obstacles du premier ordre les raisons de favoriser tantôt les unes, tantôt les autres. » (Sollier)
La plupart subissent passivement ces nouvelles contraintes et deviennent indifférents à toute action sociale. D’autres, surtout des littérateurs en quête de renommée ou d’honneurs académiques, se rangent de nouveau sous la houlette de leurs anciens pasteurs, et sont les adversaires les plus acharnés des doctrines qui les avaient séduits un instant. Ces déviations doivent nous mettre en garde contre les excès de parole, les manifestations tapageuses qui tendent à provoquer le scandale et aboutissent à détourner la classe ouvrière de l’oeuvre indispensable d’organisation syndicale, coopérative et également civique.
L’idée fait lentement son chemin, mais elle tient solidement le terrain conquis. Pour qu’elle s’implante dans le cerveau, il faut à la fois l’aide patiente d’un initiateur et un effort personnel, ce qui tient à l’écart les versatiles et les impulsifs, qui portent le désordre dans le mouvement social.
— G. GOUJON.
SCEPTICISME
n. m.
Tirés du verbe grec qui signifie examiner, les mots scepticisme et sceptique sont relativement récents. Le plus grand des sceptiques français, Montaigne, les ignore. Pascal aussi. Pourtant le célèbre suisse François de Bonivard (1493–1570), un peu plus ancien que Montaigne, avait déjà employé exceptionnellement le mot « sceptique ». Mais on disait d’ordinaire, et Bayle dit encore, pyrrhonien et pyrrhonisme.
Ce que l’on appelait le pyrrhonisme, ce que nous appelons le scepticisme, s’oppose au dogmatisme et Pyrrhon est peut-être, en effet, le premier qui ait, si l’on ose dire, professé un antidogmatisme universel et absolu. Il ne faut pourtant pas oublier qu’il avait été précédé par Protagoras et par tout le mouvement de la sophistique. La raison — disent à peu près Pyrrhon dans Diogène Laërce et son disciple Sextus Empiricus dans son livre Contre les mathématiciens — est souvent trompeuse. Nous ne pouvons nous fier à elle que si elle établit les titres de sa véracité. Où les chercherait-elle, sinon en elle-même ? Accepter la raison conme garant de la raison, c’est consentir à un cercle vicieux. Et Montaigne, sous une forme plus piquante (Essais, liv. II, ch. 12) :
« Pour juger des apparences que nous recevons des sujets (sujetest, à cette époque, à peu près synonyme d’objet dans la philosophie moderne) il nous faudrait un instrument judicatoire ; pour vérifier cet instrument, il nous faut de la démonstration ; pour vérifier la démonstration, un instrument : nous voilà au rouet. Puisque les sens ne peuvent arrêter notre dispute, étant pleins eux-mêmes d’incertitude, il faut que ce soit la raison ; aucune raison ne s’établira sans une autre raison : nous voilà à reculons jusques à l’infini. »
Descartes, si dogmatique à l’ordinaire, mais qui appuie naïvement son dogmatisme sur la véracité de Dieu, soupçonne, quelque part, que ce Dieu pourrait être un mauvais génie « qui emploie toute son industrie à tromper les hommes ». À dégager sa pensée de toute gangue théologique, il se demande si la raison n’est pas le jouet d’une illusion perpétuelle. Qui répondra, sinon la raison ? Ainsi ma raison ne peut établir sa véracité qu’à condition que je consente à supposer sa véracité. Le cercle vicieux est bien fermé. Aussi Bayle (Dictionnaire historique et critique, art. Pyrrhon), constate :
« Il est impossible, je ne dirai pas de convaincre un sceptique, mais de raisonner juste contre lui, n’étant pas possible de lui opposer aucune preuve qui ne soit un sophisme, le plus grossier de tous, je veux dire la pétition de principe. En effet, il n’y a point de preuve qui puisse conclure, qu’en supposant que tout ce qui est évident est véritable, c’est-à-dire qu’en supposant ce qui est en question. »
Kant remarque que, dès que, franchissant les limites de l’expérience, je veux savoir, sur l’univers, quoi que ce soit d’absolu, ou je ne trouve rien d’absolu, ou je dépasse les limites de mon intelligence qui ne sait atteindre que les phénomènes. Je puis, par des arguments également forts ou plutôt également faibles, soutenir, par exemple, que l’univers a commencé ou qu’il est éternel ; qu’il est infini ou qu’il est limité. Je dis ces arguments d’une faiblesse égale, car on ne démontre la thèse qu’en réfutant l’antithèse ou l’antithèse qu’en réfutant la thèse. Travail également facile, car non seulement l’une s’oppose à l’autre, mais la thèse comme l’antithèse contiennent une contradiction interne. Notre raison semble exiger que nous choisissons entre le oui et le non ; mais, que nous examinions critiquement le oui ou le non, nous les trouvons impossibles l’un et l’autre.
Refuges : le positivisme, le refus d’étudier des questions insolubles ; ou la poésie, le consentement souriant à une ou plusieurs métaphysiques désarmées du venin de l’affirmation. Dès que je veux du solide, je m’écarte de toute métaphysique et je répète avec Montaigne :
« Ni comme ceci, ni comme cela, ni autrement. »
Mais, si j’ai du goût pour les métaphysiques, je les purge les unes et les autres de toutes affirmations et, consentant dans un rire à la pétition de principe sur quoi s’appuie chaque philosophie, je rêve joyeusement :
« Comme ceci, comme cela et de mille autres façons encore. »
— HAN RYNER
SCEPTICISME
n. m.
On donne parfois le nom de scepticisme à la négation de certains dogmes religieux et de certaines doctrines morales ou philosophiques. C’est une confusion de mots et d’idées. Nier positivement, être fermement persuadé par exemple que dieu n’existe point, ce n’est pas douter ; c’est affirmer, au contraire, et d’une façon très catégorique. Au sens rigoureux du terme, le scepticisme est l’opposé du dogmatisme. L’esprit humain, dans sa naïveté première, donne à ses concepts une valeur absolue ; spontanément il s’élance vers les choses, persuadé qu’il peut les saisir en elles-mêmes et les expliquer aisément. Puis il constate qu’il est sujet à des erreurs et à des contradictions fréquentes ; il s’interroge sur leur origine, fait un retour sur lui-même et se prend à douter que la raison soit capable de nous mettre en possession de la vérité. A la confiance absolue du début succède une défiance universelle et systématique ; un doute illimité remplace le dogmatisme originel. Non que le doute du sceptique porte sur les apparences sensibles ou qu’il ne reconnaisse pas les idées comme certaines en tant que faits mentaux. Sans peine, il déclare que la gentiane lui semble amère et que le monde physique paraît soumis à des lois inflexibles. Mais sensations et concepts répondent-ils à la réalité ? Pouvons-nous, dépassant les apparences, porter des jugements sur les choses elles mêmes ? Parce qu’il s’estime incapable de sortir hors du cercle des phénomènes de conscience, pour poser l’être, le sceptique refuse de se prononcer sur la valeur objective de nos connaissances. Il n’affirme rien, il ne nie rien ; son attitude est le doute, un doute complet, définitif. Et, comme le jugement implique la prétention de sortir de soi-même, il s’abstient de juger. De même il se refuse à énoncer aucune définition, car définir c’est déterminer l’être, en reproduire l’essence : chose manifestement absurde.
Ce scepticisme philosophique, qui échappe entièrement aux critiques que les esprits superficiels ont coutume de lui adresser, fut enseigné chez les Grecs par Pyrrhon d’Élis : d’où le nom de pyrrhonisme qu’on lui donne assez souvent. Dans le doute, Pyrrhon (qui florissait vers 340 avant notre ère, mais dont la vie est fort mal connue) voyait un moyen commode de parvenir à la tranquillité et au bonheur. Sa doctrine fut reprise et développée par Oenésidème, Agrippa, Sextus Empiricus, chez les anciens, et, à une époque plus récente, par Montaigne, La Mothe le Vayer, Hume. Ce dernier estime toute science vaine et toute induction impossible, car notre certitude s’arrête aux impressions et aux idées : les relations associatives établies entre ces éléments n’ont qu’une nécessité subjective ; elles contraignent l’esprit sans s’imposer aux choses. Des croyants, comme Pascal et l’évêque Huet, ont utilisé le scepticisme pour rabaisser la raison, mais dans le but avoué d’exalter la foi. Quant aux philosophes et aux savants qui, à la suite de Descartes et de Claude Bernard, pratiquent le doute méthodique, on aurait tort de les ranger parmi les sceptiques. Leur doute est provisoire ; ils ont confiance en la raison et veulent seulement écarter de leur route préjugés ou erreurs capables de les égarer.
En faveur de leur doctrine, les sceptiques invoquent le fait de l’erreur. Sens, conscience, mémoire, sentiment, imagination, raisonnement, toutes nos facultés, sans en excepter une seule, nous trompent. Et les croyances de la foule ignorante et moutonnière ne sont guère plus extravagantes que celles des philosophes qui prétendent n’écouter que la raison. L’homme ne dispose, en effet, d’aucun critérium lui permettant de distinguer le vrai du faux. Nos certitudes sont souvent mensongères, nos évidences illusoires, et, parce que tout homme est faillible, l’affirmation d’un savant, si grand soit-il, ne suffit pas à garantir la vérité d’une proposition. Or, en l’absence d’un moyen sûr de discerner les cas où la pensée reste d’accord avec son objet de ceux où elle ne l’est pas, rien ne prouve que nous ne sommes point le jouet de continuelles erreurs. De plus les hommes se contredisent sans cesse ; la variété des opinions est infinie ; sur la même chose, les appréciations diffèrent selon l’époque et le milieu. L’erreur d’hier est la vérité d’aujourd’hui ; ce qu’on approuve en France, on le condamne en Italie ; maintes de nos croyances actuelles seront rejetées par les générations futures. Et le même homme se contredit aux divers âges de son existence : adulte, il n’aura plus les idées qu’il avait dans son enfance ; vieillard, il adoptera souvent des opinions autres que celles qu’il professait à l’âge mûr. Comment choisir entre ces croyances opposées ; comment sortir de cet imbroglio de perpétuelles contradictions ? Si de tels faits n’autorisent pas à dire que l’intelligence nous trompe toujours, ils la rendent du moins très suspecte et ébranlent singulièrement la confiance que nous pouvions avoir en elle.
Ajoutons, et c’est le principal argument des sceptiques, qu’il est impossible de justifier la raison. Car les preuves invoquées en sa faveur reposent sur elle nécessairement, et elle ne peut, sans commettre une pétition de principe, témoigner en faveur de sa propre véracité. Sextus Empiricus disait :
« La raison est un témoin souvent trompeur. Si elle veut qu’on se fie à ses dépositions, il faut qu’elle établisse les titres de sa véracité ; mais il faudrait pour cela que la raison cessât d’être suspecte, c’est-à-dire qu’elle cessât d’être elle-même. Ainsi, ou bien on admet aveuglément toutes les représentations de la raison, et alors on se condamne à la contradiction ; ou bien on fait un choix, et dans ce cas on tourne dans un cercle vicieux, ou l’on se perd dans un progrès à l’infini. »
Cet argument a été, depuis, répété par de nombreux auteurs, sans qu’on ait rien ajouté d’essentiel. Dans un passage célèbre de ses Essais, Montaigne le présente sous cette forme :
« Pour juger des apparences que nous recevons des sujets, il nous faudrait un instrument judicatoire ; pour vérifier cet instrument, il nous faut de la démonstration ; pour vérifier la démonstration, un instrument : nous voilà au rouet. Puisque les sens ne peuvent arrêter notre dispute, étant pleins eux-mêmes d’incertitude, il faut que ce soit la raison ; aucune raison ne s’établira sans une autre raison : nous voilà à reculons jusques à l’infini. »
Sous une forme piquante et dans un style excellent, nous retrouvons ici l’argument du cercle vicieux cher à l’école pyrrhonienne.
Incontestablement, la position du scepticisme est très forte, lorsqu’on le considère du point de vue théorique, car il part de constatations difficilement réfutables. Il n’existe pas de critérium infaillible de la vérité ; et, parce que le faux ne se distingue pas du vrai, psychologiquement, nous lui donnons parfois une adhésion entière, sans soupçonner aucunement notre erreur. En outre, il est évident que la raison ne peut se justifier elle-même ; toute tentative pour démontrer sa valeur enveloppe une pétition de principe. Les arguments qu’elle apporte en sa faveur ne sont recevables que si elle possède une vraie valeur, ce dont on discute justement. Néanmoins, le scepticisme absolu ne compte plus guère de partisans ; depuis que la science positive est parvenue à énoncer des propositions qui s’imposent à tous les esprits indistinctement, il s’est vu remplacé par un probabilisme et par un relativisme dont les formes sont d’ailleurs fort variables. Pour triompher définitivement, le pyrrhonisme aurait dû démontrer que l’erreur est essentielle à l’intelligence, qu’elle découle d’une organisation radicalement vicieuse de l’esprit. Il n’a pu le faire ; et, en déclarant que l’homme se trompe, il a posé par là-même l’existence de la vérité, puisque le faux ne saurait exister que par rapport au vrai. D’autre part, bien des contradictions, survenues dans les appréciations humaines, découlent uniquement des méthodes défectueuses utilisées par les savants ou le vulgaire ; dans certains domaines, leur nombre a sensiblement diminué : résultat qui doit faire naître de grands espoirs pour l’avenir. Enfin, si la raison n’est pas en mesure de se justifier, elle est pareillement incapable de se détruire. Pour démontrer son impuissance, il faut invoquer des arguments qui supposent, au préalable, la croyance en la valeur de la raison. Aussi, bien qu’elle soit chose relativement récente et que ses imperfections, son insuffisance, l’instabilité de ses conclusions paraissent scandaleuses à de nombreux contemporains, la science positive a-t-elle porté un coup mortel au pyrrhonisme, aujourd’hui relégué au rang des faits historiques. Mais il a joué un rôle important et rendu de grands services, car il a mis l’esprit humain en garde contre des erreurs très répandues, contre le prestige trompeur des systèmes philosophiques, contre les écueils que doit redouter la raison. Il a indiqué en outre les difficultés que soulève le problème de la perception intuitive et montré les limites que la pensée ne saurait franchir.
A égale distance du scepticisme et du dogmatisme se place une autre doctrine qui nous déclare incapables de savoir s’il existe une correspondance parfaite entre notre représentation et son objet, mais affirme que certaines représentations sont vraisemblables, probables ; elles possèdent en conséquence une réelle valeur pratique et peuvent nous servir de guides pour l’action. Ce système était déjà celui d’Arcésilas. Entre le vrai et le faux, déclarait-il, on ne trouve pas de différence absolue ; mais, si la spéculation pure parvient à se passer de critérium, il en faut un pour vivre et agir : ce critérium, c’est la vraisemblance. Carnéade développa la même idée d’une façon originale et donna une analyse pénétrante de la probabilité, de ses degrés et de ses signes. Les adversaires de cette conception firent remarquer que la vraisemblance suppose la vérité puisqu’elle se mesure sur elle. Chassée de l’entendement, la certitude y rentre donc à la suite de la probabilité. Cette objection, que beaucoup jugent définitive, n’apparaît cependant pas concluante à plusieurs : ils estiment qu’elle ne serait valable que si nous pouvions atteindre la vérité pleine et entière. Or nos certitudes sont trop souvent illusoires pour que, parfois, ne subsiste absolument aucune crainte d’erreur. En fait le probabilisme répond à l’état véritable de nos connaissances, même en matière de science expérimentale. Nos concepts atteignent en certains cas un très haut degré de vraisemblance ; ils sont parfaitement logiques et s’accordent avec tout ce que nous savons par ailleurs. Ce serait trop s’avancer, néanmoins, de prétendre qu’ils ne subiront jamais aucune retouche, aucun remaniement.
— L. BARBEDETTE.
SCHISME
n. m.
D’un mot grec qui désigne ce qui est fendu, séparé. Étymologiquement, le même sens que scission, qui vient du latin. Mais schisme ne s’emploie qu’en matière religieuse.
Il se produit des schismes dans toutes les religions qui comptent de nombreux fidèles. Le plus ancien schisme que nous connaissions est le Boudhisme. Le second est celui des Samaritains. Le troisième grand schisme est le christianisme détaché du judaïsme. Simple schisme d’abord, le christianisme commença, avec Saint Paul, à devenir la plus vaste des hérésies. (Le schisme est une séparation de la communion, mais non de l’essentiel de la doctrine. L’hérésie porte sur la doctrine. Toute hérésie s’accompagne de schisme. Le schisme peut ne pas s’accompagner d’hérésie.)
On m’assure que le schisme des Samaritains existe toujours. Les Samaritains sont, paraît-il, plus sévères que les autres Juifs dans l’observation des fêtes. Ils rejettent toute l’Écriture moins le Pentateuque. Ils s’obstinent à l’écrire en caractères archaïques et refusent d’employer les points voyelles.
Le fameux schisme des Grecs, commencé sous le patriarche Photius, devenu définitif sous Cérulaire, n’eut guère d’autre cause que les ambitions rivales des évêques de Rome et de Constantinople. Le romain, sous le titre de pape, prétendait gouverner toute l’Église chrétienne ; le byzantin, sous le titre de Patriarche œcuménique et universel, avait la même prétention.
L’Église d’Occident était d’ailleurs devenue hérétique en faisant, par une addition sournoise, procéder le Saint-Esprit du Père et du Fils, contrairement à la doctrine du Concile de Nicée, qui le fait procéder du Père seul. Comme celui qui procède est exactement aussi éternel que celui ou ceux dont il procède les mots n’ont aucun sens et, dans de tels cas, les divisions deviennent irréparables. En outre, l’Église latine consacre du pain sans levain et l’Église grecque du pain ordinaire. Il y a là de quoi se haïr éternellement.
Les Arméniens sont-ils hérétiques ou schismatiques ? Rome leur donne ordinairement ce dernier titre quoiqu’ils rejettent le Concile de Chalcédoine et ces deux natures qui en Jésus font, pour les orthodoxes, une seule personne. Pour l’Arménien, unité de nature comme de personne, ce qui est proprement l’hérésie des Eutychiens ou Monophysites. Mais le grand crime des Arméniens, c’est que leurs prêtres, pour affirmer la nature unique de Jésus-Christ, ne mettent pas, au moment de la consécration, quelques gouttes d’eau dans leur vin.
Par la dogmatique, la religion anglicane se sépare si peu de la secte romaine qu’on parle plutôt du schisme d’Angleterre que d’une hérésie.
Le Grand Schisme d’Occident établit des papes concurrents à Avignon, à Rome et même quelque temps à Perpignan. On n’en sortit, et difficilement, et après beaucoup de salive, d’encre et de sang répandus, que parce que le Concile était alors supérieur au pape. Si les papes avaient déjà été supérieurs, le concile de Constance n’aurait pu déposer l’infaillible Jean XXIII[1] et l’infaillible Benoît XIII, pour les remplacer par son élu Martin V.
Nous jouirions toujours de deux ou trois papes et, au lieu de faire la guerre au nom des Patries, nous aurions le plaisir, sans doute, de nous entretuer au nom des Obédiences.
— Han RYNER.
SCIENCE
n. f. (du latin : scientia ; de scire, savoir)
On donne communément le nom de science à tout ensemble de connaissances humaines, vraies ou supposées. J’insiste sur ces deux mots, qui terminent ma définition : « ou supposées ». En effet, il est courant encore, au XXème siècle, de désigner, sous le nom de « sciences occultes » : l’alchimie, la chiromancie, l’astrologie, la cabale ; de croire à la réalité de la « science infuse », qui nous viendrait directement de Dieu, par inspiration ; de déclarer, enfin, que la métaphysique est la « science des abstractions », comme la théologie est la « science des choses divines », alors qu’il s’agit de données fort douteuses, contestables et contestées. Honorer du nom de « science » des choses aussi peu certaines, c’est faire un abus du mot. Si l’on ne veut pas rompre délibérément avec de très vieilles coutumes installées dans la langue, encore y aurait-il lieu de distinguer, très nettement, entre les sciences et la Science, celle-ci étant considérée comme le savoir humain par excellence, sans confusion possible avec ses soeurs inférieures.
La Science se compose exclusivement des connaissances qui, étant fondées sur l’expérience positive, et, par cela même, évidentes pour tout le monde, ne sont plus contestables par personne. Un fait est d’ordre scientifique lorsque sa réalité ne souffre plus aucun doute, c’est-à-dire lorsque quiconque peut contrôler son existence à volonté, à la seule condition de se placer dans les conditions requises pour cette constatation.
Il y a lieu de distinguer entre les faits scientifiques d’observation et les faits scientifiques d’expérimentation. Ces derniers sont ceux dont nous connaissons si bien les conditions déterminantes, et dont celles-ci sont tellement aisées à réunir, qu’il nous est loisible d’en opérer, chaque fois que nous le voulons, la démonstration. A cette catégorie appartiennent les expériences de physique et de chimie, journellement présentées dans des laboratoires, devant des élèves, par les professeurs chargés de leur enseignement, et qui ont cette haute conscience de n’affirmer rien qui ne soit de suite prouvable, par la production du phénomène confirmant la théorie. Les faits scientifiques d’observation sont ceux qui, en raison de leur nature, ne peuvent être produits à volonté, mais dont l’apparition régulière, enregistrable, et souvent prévisible, ne laisse prise à aucune contestation à l’égard de leur authenticité. Tel est le cas des éclipses de soleil et des aurores boréales, pour ne citer que des exemples bien connus.
Alors que les raisonnements de la philosophie abstraite n’ont donné lieu qu’à des systèmes incertains et contradictoires, tous plus ou moins discutables, selon le point de vue auquel on se place, le fait scientifiquement démontré, et démontrable, a ceci de particulier qu’il s’impose à tous par la force de l’évidence, et réduit à néant la possibilité des controverses.
Il a été dit de la Science qu’elle avançait parmi des ruines, la vérité du jour étant l’erreur du lendemain. Cette affirmation n’est pas conforme à l’exactitude. La réalité d’un fait scientifiquement prouvé est définitivement acquise, toujours. Ce qui change parfois, c’est l’interprétation du fait quant à sa nature exacte, et les hypothèses, c’est-à-dire les suppositions, auxquelles, de le constater avait donné lieu. Ce n’est point la même chose.
A mesure qu’un aviateur s’élève au-dessus du sol, le paysage apparaît pour lui beaucoup plus vaste qu’au moment du départ, et avec des aspects nombreux qu’il ne soupçonnait pas, mais ceci n’infirme point l’existence, et le souvenir, du terrain d’aviation dont il a pris son vol, et qui continue, quoique dans des proportions plus modestes pour l’oeil de l’observateur, à faire partie du paysage. Ainsi en est-il pour l’homme de science, sans cesse avide de nouvelles découvertes.
Si ce que nous connaissons de l’univers, grâce aux méthodes scientifiques d’observation et d’expérimentation, ne fournit pas à tous les problèmes qui se posent devant notre conscience, une solution, il n’en demeure pas moins que la somme de nos connaissances positives s’accroît chaque jour, donnant aux humains des certitudes qui, pour être relatives, n’en sont pas moins autrement dignes d’intérêt que les données, imprécises ou suspectes, du mysticisme et de la raison pure.
Le rationalisme scientifique n’est pas une doctrine philosophique, mais une attitude intellectuelle, qui s’offre comme préférable à toute autre, jusqu’à nouvel ordre, en raison de l’excellence de ses résultats acquis. Alors que la raison pure s’efforce d’imposer à la réalité des faits, coûte que coûte, l’arbitraire de ses concepts, le rationalisme scientifique fait dépendre constamment la théorie de l’expérience et n’hésite pas à sacrifier les données de la théorie à celles de l’expérience, chaque fois qu’il existe entre elles deux un conflit. Le rationalisme scientifique ne condamne point la théorie, indispensable à l’explication des faits, et qui est d’une aide très précieuse pour faciliter les recherches, mais il n’accorde à la théorie que la valeur d’une supposition — disons : d’une donnée contestable et provisoire — tant que la théorie n’a pas reçu de la pratique une indiscutable confirmation.
— Jean MARESTAN
SCOLASTIQUE
adj. et n. f. (du latin schola, école)
Beaucoup s’imaginent que la philosophique scolastique constitua un tout homogène, un système unique et que ses partisans adoptèrent les mêmes principes et les mêmes conclusions. En réalité elle comprit une nombreuse collection de doctrines contradictoires, enseignées dans les écoles d’Occident depuis Charlemagne jusqu’à la diffusion de l’imprimerie. Historiquement, Scot Erigène, Amaury de Chartres, David de Dinan sont à ranger parmi les scolastiques, malgré leur panthéisme hétérodoxe. Néanmoins, de cet amas confus d’idées adverses et de disputes quintessenciées un système général s’est dégagé, que l’on s’est remis à enseigner dans les séminaires, et qui réduit la philosophie à n’être que l’auxiliaire très humble, la servante de l’orgueilleuse théologie catholique, ancilla theologiae.
Au moyen âge, l’Eglise fut souveraine maîtresse en matière d’enseignement. Commenter l’Ecriture Sainte et les Pères, telle était la préoccupation essentielle des savants d’alors. Avant d’aborder les spéculations théologiques, les étudiants devaient toutefois subir une formation préalable, et d’ailleurs longtemps très rudimentaire, assurée par la connaissance du trivium (grammaire, logique, rhétorique) et du quadrivium (arithmétique, musique, géométrie, astronomie). C’est sous le couvert de la logique que la philosophie reparut ; elle fut appelée scolastique ou philosophie de l’école. Comme pour la grammaire et la rhétorique, on utilisait la méthode herméneutique ou interprétative ; les professeurs se bornaient à lire à leurs élèves l’Isagoge de Porphyre puis les Catégories et l’Hermeneia d’Aristote, accompagnant leur lecture d’explications et de commentaires. Aussi toute question philosophique était-elle pour eux d’ordre logique ; ce qui explique leur goût pour les querelles de mots, les distinctions d’une subtilité outrancière, toutes les arguties d’une dialectique formaliste et purement verbale. C’est au début du XIIIème siècle seulement, et grâce aux écrits des savants arabes, que les philosophes scolastiques connaîtront les autres ouvrages d’Aristote. D’où les confusions et les erreurs prodigieuses qu’ils ont commises concernant la doctrine du Stagirite.
De plus, l’Eglise apportait des solutions toutes faites aux principaux problèmes et ne laissait qu’un champ fort limité aux discussions. Sous peine d’excommunication, et l’on sait que cette dernière aboutissait normalement à la prison ou au bûcher, il était interdit d’attaquer les dogmes ou d’y rien changer. Démontrer que foi et raison se concilient, apporter des arguments en faveur du credo catholique, fabriquer une fausse philosophie pour donner plus de vraisemblance aux grotesques assertions des théologiens, voilà le travail préféré des scolastiques. Mais on leur permit, dans le domaine restreint qu’on leur abandonnait, de se livrer à d’extravagantes acrobaties de langage, à des querelles de mots, à des disputes aussi bornées que celle qui mit aux prises les réalistes et les nominalistes. Constatons pourtant que les plus célèbres logiciens du XIIème siècle ne conservèrent qu’un médiocre crédit au siècle suivant, après l’introduction dans les écoles de la Physique, de la Métaphysique et du Traité de l’Ame d’Aristote. La diversité des sujets étudiés apparaît grande selon les époques ; la terminologie en usage et la forme du langage ont aussi beaucoup varié.
Parmi les premiers scolastiques, citons Alcuin, Raban Maur, Scot Erigine qui vécurent sous Charlemagne et ses successeurs, puis Gerbert au Xème siècle. Au XIème siècle commence la querelle des universaux ; elle dura pendant tout le moyen âge et mit aux prises nominalistes et réalistes. Roscelin affirma que les idées générales étaient de purs mots, flatus vocis, dénués de toute valeur objective. Pour Guillaume de Champeaux, son adversaire, les universaux ou concepts universels possèdent seuls, au contraire, une réalité véritable ; ce sont les individus qui ne sont que des noms, des apparences. Saint Anselme s’attacha surtout à l’étude de la théodicée ; il est l’inventeur de l’argument ontologique qui, pensait-il, fournissait une preuve irréfutable de l’existence de dieu. Mais les croyants eux-mêmes ont reconnu depuis qu’il s’agissait là d’un pur sophisme.
Abélard, 1079–1142, substitua aux doctrines opposées de Guillaume de Champeaux et de Roscelin un système intermédiaire, le conceptualisme, qui accorde une réalité, mais d’ordre purement subjectif, aux universaux : les idées ne sont pas de simples mots, elles répondent à des représentations mentales. On sait quel roman tragique troubla la vie d’Abélard. Ses hardiesses théologiques lui valurent, en outre, la haine tenace de saint Bernard et plusieurs condamnations par les autorités ecclésiastiques. Rappelons le nom de l’évêque Gilbert de la Porrée, qui mourut vers 1154 et fut, lui aussi, accusé d’hérésie par saint Bernard, ainsi que celui de Pierre Lombard, plus théologien que philosophe, dont le Livre des Sentences devint un manuel presque obligatoire dans les écoles du XIIIème siècle : il sut courtiser Philippe-Auguste et fut nommé évêque de Paris. Amaury de Chartres et David de Dinan, qui furent condamnés en 1209, au concile de Paris, parce qu’ils professaient un panthéisme non déguisé, avaient subi l’influence de la philosophie arabe, propagée en France par des juifs venus d’Espagne.
Déjà, au IXème siècle, l’arabe Alkindi, auteur de très nombreux ouvrages, tous perdus, avait écrit plusieurs traités sur Aristote. Al-Farabi, au Xème siècle, et plus tard Avempace, le maître d’Averroès, le célèbre Avicenne, Ibn-Thofait (l’Abubacer des scolastiques), Gazali se sont inspirés, à des degrés divers, de la doctrine du Stagirite ; ils aboutirent parfois à un audacieux mélange de mysticisme panthéistique et de rationalisme qui les rendit suspects aux musulmans. Le plus célèbre des philosophes arabes fut Averroès, qui naquit à Cordoue dans le premier quart du XIIème siècle et mourut en 1198. Condamné à l’exil pour crime d’impiété, il fut rappelé, par la suite, dans sa ville natale, mais demeura toujours antipathique aux pieux disciples de Mahomet qui le soupçonnaient d’être mécréant. Son érudition encyclopédique est attestée par d’innombrables ouvrages. Grand admirateur d’Aristote, dont les écrits avaient été traduits en arabe par les savants de Cordoue, il donna des commentaires de tous ses livres : commentaires où des réminiscences néo-platoniciennes altèrent souvent la pure doctrine péripatéticienne. Parmi les partisans d’Averroès, signalons deux israélites, Avicébron et Maimonide, qui tempérèrent la virile hardiesse de son enseignement rationaliste par des idées empruntées à la Bible. De l’arabe, les ouvrages d’Aristote furent peu à peu traduits en latin, et des horizons nouveaux furent ainsi découverts aux philosophes du moyen âge. Par contre, ils continueront d’ignorer les livres les plus essentiels de Platon.
Dans le péripatétisme, l’Eglise vit d’abord un cadeau des pires ennemis de la foi catholique, les musulmans et les juifs. En outre, les théologiens estimaient cette philosophie incompatible avec certains dogmes chrétiens. La Physique d’Aristote fut solennellement condamnée en 1209, sa Métaphysique en 1215 et en 1230. Puis un revirement s’opéra dans l’esprit des dirigeants ecclésiastiques ; ils estimèrent qu’il valait mieux se faire un allié du Stagirite que de l’avoir pour adversaire. Adorant ce qu’ils avaient brûlé, ils finirent par adopter officiellement le péripatétisme et par faire d’Aristote un précurseur du Christ dans l’ordre de la nature, proeœcursor Christi in rebus naturalibus. Si l’Eglise y gagna en tranquillité, la philosophie y perdit toute indépendance et toute originalité. Bien que les écrivains catholiques assurent le contraire, le XIIIème siècle fut une pauvre époque au point de vue philosophique. Il faut l’aveuglement ou la mauvaise foi d’un Maritain, d’un Massis et des autres candidats aux récompenses de l’Académie française, pour affirmer le contraire.
Parmi les scolastiques qui ne brillèrent qu’au second rang, rappelons sans insister Alexandre de Halès, anglais d’origine, qui enseigna à l’Université de Paris, le dominicain Vincent de Beauvais, lecteur de saint Louis, l’évêque de Paris Guillaume d’Auvergne, Henri de Gand, que l’on surnomma le docteur solennel. Albert le Grand, saint Thomas d’Aquin, saint Bonaventure, Duns Scot, Raymond Lulle méritent, à des titres divers, de retenir plus longuement notre attention. Albert le Grand, né en Souabe, en 1193 ou 1205, se fit dominicain, enseigna la théologie avec éclat, puis fut nommé évêque de Ratisbonne. Mais il résigna bientôt cette charge pour s’adonner plus librement à l’étude. Son érudition lui valut une durable réputation de sorcier ; et les œoeuvres qu’il a laissées remplissent 21 volumes in-folio. Il manque d’originalité et se borne généralement à accommoder à sa façon les emprunts qu’il fait aux autres. Sous sa plume, les erreurs, les inexactitudes, les redites abondent. Sa philosophie est celle d’Aristote, à qui il attribue quelquefois les idées de Platon ; ses arguments sont en général très peu probants, car sa pensée n’a aucune profondeur. Il mourut vers 1280. L’Eglise lui fut reconnaissante d’avoir été le maître de saint Thomas d’Aquin et le mit au nombre des bienheureux.
Thomas d’Aquin est aux yeux des catholiques le philosophe chrétien par excellence, celui dont la doctrine inspire une confiance entière aux plus rigides gardiens de l’orthodoxie. « Il a fait autant de miracles qu’il a composé d’articles, déclarait Jean XXII qui le mit au nombre des saints ; à lui seul il a donné plus de lumières à l’Eglise que tous les autres docteurs, et l’on profite plus en une année seulement dans ses livres que pendant une vie tout entière dans les écrits des autres. » Nombreux sont les papes et les dignitaires ecclésiastiques qui ont tenu à son égard un langage aussi flatteur. Peu intéressante en elle-même, sa doctrine a exercé une influence considérable parce qu’elle est devenue, en quelque sorte, partie intégrante du catholicisme. Thomas naquit dans la ville d’Aquino, vers 1227 ; il entra chez les dominicains, étudia sous la direction d’Albert-le-Grand et se fit recevoir docteur à Paris. Son embonpoint devint tel qu’on dut faire une entaille à la table où il mangeait, pour y loger son ventre. Il écrivit beaucoup et enseigna dans les principales écoles d’Italie, ainsi qu’à Paris. La mort le surprit près de Terracine, en 1274, alors qu’il se rendait au concile de Lyon. Son système philosophique n’a rien d’original ; il n’ouvre pas à la pensée des horizons nouveaux ; il se contente d’accommoder Aristote à une sauce orthodoxe pour le rendre agréable aux gosiers chrétiens. Ajoutons que l’Ange de l’Ecole, c’est le titre que les catholiques donnent à Thomas, se trompe parfois singulièrement sur la vraie pensée du Stagirite. Les preuves qu’il donne de l’existence de dieu (en particulier celle du mouvement, dont les auteurs chrétiens font si grand cas et qui est empruntée à la doctrine péripatéticienne) ne supportent pas un examen approfondi. En psychologie, il reproduit le Traité de l’Ame, mais en jargon scolastique et en faisant une place aux querelles des réalistes et des nominalistes. A la suite d’Aristote, il distingue dans tout être la forme et la matière ; et c’est dans la matière qu’il place le principe d’individuation. En morale, Thomas d’Aquin affirme l’existence d’un souverain bien qui est dieu ; il accorde à l’homme une liberté plus grande que la doctrine augustinienne de la grâce ne le permettait. D’où de nombreuses disputes entre ses disciples et ceux de Duns Scot. Toutes les sottises, tous les préjugés, toutes les erreurs qui fourmillent dans la philosophie spiritualiste se retrouvent chez l’Ange de l’Ecole. Aussi ne peut-on s’empêcher de sourire lorsqu’un Gonzague Truc ose écrire : « Le thomisme est une restauration des valeurs philosophiques. Nulle doctrine n’apporte plus de satisfaction à l’esprit. Nulle pensée n’est si complète ni ne joint à tant de hardiesse une si subtile prudence. Elle paraît naturellement ou providentiellement appelée à corriger l’erreur moderne, à nous réapprendre que le sensible n’épuise pas l’être ... Que faut-il penser de la valeur dernière du thomisme ? Ce serait la vérité, si la vérité pouvait appartenir à ce monde. » De telles flagorneries à l’adresse d’un système dépourvu de vues géniales, toujours terne, souvent grotesque, montrent jusqu’où va le servilisme des contemporains lorsqu’ils veulent gagner les bonnes grâces des bourgeois bien-pensants et du clergé.
Jean de Fidanza (1221–1274), plus connu sous le nom de Bonaventure, ne jouit pas, dans l’Eglise, d’une vogue comparable à celle de Thomas, bien qu’il soit inscrit, lui aussi, parmi les saints. Il entra chez les Franciscains à 21 ans, enseigna, devint supérieur général de l’ordre et finalement cardinal-évêque d’Albano. Foncièrement mystique, il préfère saint Augustin à Aristote, sacrifîe la raison au sentiment et s’égare avec délices dans les chimériques régions de l’absolu. C’est moins, à son avis, grâce à la culture intellectuelle que par la pureté du coeŒur et la pratique des vertus qu’on parvient à la connaissance du vrai. Il s’attarde longuement à décrire les phases d’un prétendu retour de l’âme à dieu qui répond aux divagations imaginaires d’un cerveau surexcité :
« Pour parvenir au principe premier, esprit suprême et éternel, placé au-dessus de nous, il faut que nous prenions pour guides les vestiges de Dieu, vestiges temporels, corporels et hors de nous ; cet acte s’appelle être introduit dans la voie de Dieu. Il faut ensuite que nous entrions dans notre âme, image de Dieu, éternelle, spirituelle et en nous : c’est là entrer dans la vérité de Dieu ; mais il faut encore qu’au-delà de ce degré, nous atteignions l’Eternel, le spirituel suprême, au-dessus de nous, contemplant le principe premier ; c’est là se réjouir dans la connaissance de Dieu et l’adoration de sa majesté. »
Dans ces phrases alambiquées, qui pourtant ne sont point choisies parmi les plus obscures, nous retrouvons le pathos mystique cher à Bonaventure. Mais, sauf chez les franciscains, l’influence de ses écrits est aujourd’hui presque nulle dans les milieux catholiques.
On peut en dire autant concernant Duns Scot, un franciscain lui aussi, mais de tendances très différentes. Il naquit en Écosse probablement, en 1274, se fit moine de bonne heure, enseigna à l’Université d’Oxford, vint à Paris, puis alla professer à Cologne, où il mourut, à l’âge de trente-quatre ans, d’une attaque d’apoplexie. Plus original, plus vigoureux, plus hardi que Thomas d’Aquin, il est resté cher aux membres de son ordre, mais d’ordinaire les auteurs catholiques lui reprochent ses témérités doctrinales et ses critiques à l’adresse de l’Ange de l’École, qu’il a contredit fort souvent. Son réalisme très net aurait sans doute abouti au panthéisme, s’il n’avait redouté les conséquences théologiques d’une pareille doctrine. Pour lui, l’universel est un être réel, il est même le seul être réel. Quant au principe d’individuation, il ne réside ni dans la matière, ni dans la forme, ni dans l’union de ces deux éléments, mais dans une entité positive dont le philosophe n’a pas parlé d’une façon claire et que l’on peut assimiler à l’idée platonicienne. Duns Scot affirme que la raison d’être du bien et du mal se trouve dans la volonté divine dont rien ne limite la liberté. Les discussions qui survinrent entre les partisans de Thomas d’Aquin et les partisans de Duns Scot firent beaucoup de bruit au moyen âge. Elles continuent de nos jours entre les dominicains, qui soutiennent le premier, et les franciscains, restés fidèles au second, mais ne présentent plus qu’un intérêt historique pour la majorité des croyants.
Les modernes apologistes de la scolastique évitent habituellement d’exposer le système de Raymond Lulle. C’est à peine s’ils consacrent quelques lignes à cet auteur pourtant béatifié par l’Eglise. Nous comprenons leur embarras. Ce personnage excentrique construisit une méthode, le Grand Art (Ars Magna), analogue pour le principe à nos machines à compter. Elle permettait d’obtenir des raisonnements tout faits à l’aide de tableaux mobiles et superposables. Le but avoué de Lulle était l’assimilation complète de la philosophie et de la théologie ; il voulait démontrer rigoureusement les dogmes catholiques et faire comprendre, d’autre part, que la philosophie dans ce qu’elle a d’essentiel est partie intégrante du christianisme. Sa méthode découle logiquement des procédés chers aux docteurs scolastiques ; et, pendant deux siècles, elle fut enseignée dans une partie de l’Espagne, ainsi que dans plusieurs collèges de France et d’Italie. Mais ses extravagances, justement parce qu’elles révèlent trop clairement les vices profonds de la scolastique, sont odieuses aux écrivains catholiques de notre époque. Raymond Lulle, né à Palma, vers 1235, fut mis à mort en 1315 par les musulmans de Tunis qu’il voulait convertir ; il avait écrit un nombre prodigieux d’ouvrages ; et, en cherchant la pierre philosophale, il avait reconnu l’importance de la distillation pour obtenir des produits volatils.
Après le XIIIème siècle, la scolastique tombe dans une complète décadence, de l’avis des catholiques eux-mêmes. On continue de l’enseigner dans les Universités, les écoles ecclésiastiques et les monastères, mais l’on ne rencontre plus, parmi ses partisans, que les philosophes de cinquième ordre. Il suffira de citer Guillaume d’Occam, Durand de Saint-Pourcain, Buridan, Pierre d’Ailly et, plus tard, le jésuite Suarez, 1548–1617, qui interpréta le thomisme d’une façon personnelle. Les grands esprits de la Renaissance n’eurent que mépris pour la scolastique. Au XVIIème siècle, des hommes tels que Descartes, Gassendi, Arnauld, Nicole, Malebranche, Fénelon, Huet, qui acceptent le credo catholique, la raillent ou la dédaignent. Elle a, comme dans le passé, des chaires à la Sorbonne, à Rome, à Salamanque, à Coïmbre, etc..., mais les laïques et même une grande partie du clergé échappent à son influence. La pensée scientifique et rationaliste progresse au détriment du thomisme que l’on relègue parmi les systèmes surannés. Aux XVIIIème et XIXème siècles, on enseigna dans les séminaires français un cartésianisme adapté à la foi catholique et connu sous le nom de Philosophie de Lyon. À Rome, au Collège romain, l’Université officielle du pape, on se moquait ouvertement de la scolastique. Le jésuite Curci assure :
« On aurait dit que, de Rome, les professeurs du Collège romain voulaient faire disparaître du monde la doctrine de saint Thomas. »
Cousin, le chef de l’école éclectique, qui souhaitait, à la fin de sa vie, devenir un fidèle collaborateur de l’Eglise catholique, ramena l’attention sur les philosophies médiévales. Lamennais contribua aussi, pour une large part, à la résurrection du thomisme que les dominicains n’avaient d’ailleurs jamais abandonné. Sanseverino fut approuvé par Pie IX quand il publia ses ouvrages en faveur de la scolastique ; le même pape refusa néanmoins de rendre cette doctrine obligatoire dans les écoles de Rome. Mais le cardinal Pecci, devenu pape en 1878 sous le nom de Léon XIII, publiait le 4 août de l’année suivante, l’encyclique Aeterni Patris où le thomisme était proclamé la meilleure philosophie. Les professeurs hostiles à ce système durent quitter l’Université romaine ; dans les séminaires, maîtres et élèves furent contraints d’obéir aux volontés du pape. Bientôt ce fut la mode, dans le monde ecclésiastique, de proclamer l’incomparable supériorité du thomisme et de ne voir dans les systèmes philosophiques modernes que de simples aberrations. Les gens du monde, les écrivains, les hommes politiques désireux de plaire au clergé durent se décider eux aussi à témoigner d’un enthousiasme délirant pour l’Ange de l’Ecole. Une bruyante équipe, composée des Maritain, des Massis, des Gonzague Truc et de bien d’autres, encadrés par un bataillon de jésuites et de dominicains, ne cesse, depuis plusieurs années, de manier l’encensoir et d’entonner des hymnes en l’honneur de la nouvelle idole. Car les successeurs de Léon XIII ont tous donné un mot d’ordre identique au sien, concernant le thomisme. Même en Sorbonne, la scolastique est redevenue, avec Gilson, l’objet d’un enseignement favorable, en définitive, aux prétentions cléricales ; et un Brunschvig vigilant chien de garde de la bourgeoisie, favorise secrètement de tout son pouvoir ceux qu’il juge animés d’un esprit nettement réactionnaire. Malheur aux mauvaises têtes qui se dressent contre les traditions et les croyances que nous légua le passé ! Certes tous nos pontifes de la philosophie officielle ne prétendent pas, comme le thomiste Gillet, que pour résoudre le problème de la connaissance, il n’était pas nécessaire... :
« ...d’opposer l’un à l’autre la pensée et l’être ; mais, qu’au contraire, la pensée appelait l’être comme la matière sa forme, et plus généralement la puissance son acte, en vertu d’une loi mystérieuse d’attraction à laquelle paraît soumis l’Univers. »
À l’être cher aux scolastiques, et objet final de toutes leurs recherches, beaucoup de sorbonnards actuels préfèrent le devenir entendu à la manière fumeuse de Bergson. Comme les scolastiques, ce sont des verbomanes dont la préoccupation essentielle est de maintenir un spiritualisme désuet et les vieux préjugés bourgeois.
— L. BARBEDETTE.
SCULPTURE
n. f.
La sculpture a été un des premiers moyens d’expression employés par l’homme ; elle constitue les traces les plus anciennes de son séjour dans tous les pays, des témoins de civilisations antiques qu’on retrouve enfouis dans les sables ou sous les végétations des forêts.
C’est l’art de représenter dans une matière durable les êtres vivants, de leur donner ainsi l’immortalité : voyez au Louvre, la tête de basalte de l’époque saïte, quelle vie intense se dégage de ce morceau de pierre. Et de même ce chien qui, assis, les oreilles dressées, a vu défiler les siècles, n’est-il pas devenu immortel au même titre que les dieux et les pharaons de la vieille Egypte ?
La figure humaine peut être représentée en pied, nue, drapée ou habillée ; c’est une statue ; deux ou plusieurs statues forment un groupe ; un buste est la représentation de la tête avec une partie plus ou moins grande du cou et des épaules. Lorsque la sculpture est traitée sur un fond, l’oeil ne peut en faire le tour comme dans une ronde-bosse ; elle peut avoir plus ou moins de relief, ce sera un haut-relief, un bas-relief ou une médaille ; en architecture, on emploie le haut et le bas-relief pour décorer les surfaces, les frontons, etc., au moyen de figures d’hommes ou d’animaux ou d’ornements tirés de la flore, de la faune ou de la géométrie.
En général, le sculpteur qui veut monter une figure commence par la modeler en terre glaise, puis, ayant procédé à son moulage, il obtient un modèle en plâtre qui peut être coulé en bronze ou reproduit en marbre, en pierre ou en bois. Il n’y a guère que des génies, comme Michel Ange, qui attaquent directement le marbre sans passer par la terre et le plâtre !
C’est toute l’histoire humaine que raconte la sculpture. Gustave Geffroy écrit :
« Une histoire de la sculpture est la réunion dans le même temple, de tous les Dieux opposés, de toutes les divinités ennemies, de toutes les races réconciliées. »
Les périodes d’apogée de l’art que les monuments et les sculptures retrouvés ont pu nous faire connaître, se placent dès l’an 4000 avant l’ère chrétienne en Babylonie et en Egypte, dès l’an 2.500 dans l’Archipel, et dès l’an 1000, en Grèce ; cette dernière période qui vit des artistes merveilleux, comme Phidias et Praxitèle, eut une influence immense sur la Renaissance italienne. C’est seulement depuis l’an 1000 de notre ère que l’art put se développer dans l’Europe occidentale.
La sculpture égyptienne révèle une habileté technique parfaite, mais des conventions archaïques qui l’ont empêchée de s’élever librement. Dans toutes les oeuvres, des plus monumentales, comme le Grand Sphinx, aux plus petites statues de bois, de bronze ou d’or, on reconnaît la parenté, le même style, ce caractère vertical de durée, cette sérénité. Quand on songe aux moyens primitifs dont disposaient les artistes égyptiens, les chefs-d’oeuvre conservés au Louvre évoquent à nos yeux la longue suite des siècles où des milliers d’esclaves taillaient et polissaient ces géants de granit, y usaient leurs forces et mouraient à la peine ... mais leurs oeuvres vivent encore !
En Assyrie, en Perse, la pierre manquant, c’est la brique émaillée qui servait à composer les bas-reliefs décorant les palais ; cette fragile matière est parvenue jusqu’à nous, témoin la prise des Archers, au Louvre.
Si l’Egypte donne une idée de force, la Grèce a cherché à représenter la beauté. Dans les îles de l’Archipel, en Crète, notamment, se développa un art, prélude de l’art grec, dégagé des entraves de la tradition et du despotisme. Les Grecs, épris de liberté, aimant le beau et le progrès, surent très vite exprimer la vie intérieure, leurs déesses commencèrent à sourire, les frontons de leurs temples se couvrirent de puissantes compositions où les mouvements des corps racontent les événements. Polyclète est l’auteur du Doryphore qui a donné le canon, c’est-à-dire les proportions idéales du corps humain ; il fut, avec Myron (auteur du Discobole) contemporain du Grand Phidias, (431 av. J.-C.), auquel on doit la décoration du Parthénon, magnifiques hauts-reliefs, frontons, métopes, et la frise en bas-relief des panathénées qui restent, malgré les mutilations, les merveilleux chefs-d’oeuvre qu’on n’a jamais surpassés. On attribue à l’Ecole de Phidias la forte et sereine Vénus de Milo. Après lui, Praxitèle, Scopas et Lysippe maintinrent la beauté et la Grâce en accentuant l’expression des sentiments. De nombreuses stèles funéraires avec de délicats bas-reliefs font revivre l’esprit modéré des Athéniens, leur vie active, le charme de leur intimité.
Plus tard, l’art grec se répandit dans tout l’Orient et se figea dans l’art bizantin. Après la conquête de la Grèce, par Rome, il s’implanta en Italie, où il prit de plus en plus un caractère individuel, de sorte que la sculpture romaine est surtout remarquable par les portraits.
Au moyen âge, l’unique prédominance de l’église donna une direction unique à l’art. Les sculpteurs romans, souvent des moines, ornaient les églises de bas-reliefs toujours conventionnels, d’ornements géométriques compliqués. Au XIIIème siècle, l’épanouissement de l’art gothique se lit encore sur les grandes cathédrales, c’est un retour à l’étude de la nature, la flore du pays recouvre les chapiteaux, les allégories morales, les saisons, les travaux agricoles, les arts, les métiers tout est matière à de vivantes statues. Les vierges sont des mères tendres et souriantes ; mais, si elles ont la sérénité des statues grecques, elles sont toujours habillées.
En Italie, l’art gothique fut tempéré par l’exemple des monuments de l’art antique et l’on voit les bas-reliefs du baptistère de Pise sculptés par Nicolas de Pise comme un sarcophage romain. Cette influence de l’antique continua à se faire sentir ; la tribune des chanteurs de Lucca delle Roblia à Florence, merveille de vie et d’expression, réalité vivante directement observée. Donatillo à Florence ; Verrochio à Venise ; Ghiberti avec ses portes du Baptistère ; puis, au XVIème siècle, Michel-Ange, Jean de Bologne, Benvenuto Cellini, firent, dans une merveilleuse Renaissance, refleurir l’art antique animé d’une vie nouvelle.
Le même mouvement se retrouve en France, au XVIème siècle, avec Germain Pilon et Jean Goujon ; au XVIIème, avec Guillain, Girardon, Coysevox, Couston et Puget ; au XVIIIème, avec Falconet, Houdon, Canova, Clodion, Pigalle. Enfin, au XIXème, Rude, avec son entraînante Marseillaise à l’Etoile, Barye l’animalier, Chapu, Mercier, Saint-Marceau, P. Dubois, Barrias, Carpeaux, avec sa vivante « danse » à l’Opéra, Bartholomé, avec son impressionnant monument aux Morts du Père-Lachaise, Meunier le scupteur des ouvriers ; Rodin, enfin, rejetant toute influence, s’attache à la vie avant tout et ouvre la voie aux recherches les plus osées.
Actuellement, l’architecture tient bien peu compte de la sculpture : où trouverait-elle sa place dans les cubes de béton armé qui constituent les maisons modernes ?
Les sculpteurs n’en produisent pas moins des oeuvres intéressantes ; les « salons » de chaque année en sont la preuve. Que deviennent toutes ces statues modelées avec amour, travaillées avec foi et enthousiasme ?
— E. GROSS-FULPIUS.
SECTAIRE
adj.
« Qui fait partie d’une secte. » Qui suit avec une ardeur excessive les opinions d’une secte religieuse, politique ou philosophique.
SECTATEUR
n. m.
« Partisan déclaré d’une secte, d’une opinion, d’un système. »
SECTE
n. f. lat. secta, de sectari, suivre
« Ensemble de personnes qui poursuivent un même but et professent une même doctrine : la secte d’Epicure ; ensemble de ceux qui se sont détachés d’une communion religieuse : la secte des luthériens, des anabaptistes. »
Telle est simple et sommaire, l’explication de ces trois mots par le Petit Dictionnaire Larousse. Et le Grand d’abord à produire n’en dit guère plus.
Pour nous, il y a lieu, sur ce sujet, de s’étendre davantage.
Nous comprenons par sectaire le qualificatif d’un individu qui ne supporte pas facilement la contradiction.
Il en est de même des intolérants n’admettant aucune critique à leurs idées, aucune attaque à leurs dogmes.
Ordinairement acariâtres ou pédants, il ne fait pas bon de discuter avec eux. Rancuniers, ils ne pardonnent pas qu’on ose toucher à ce qu’ils ont une fois établi comme article de foi. C’est le dogme admis, soutenu, proclamé, indiscutable, imposé.
Qui de nous n’a eu devant lui, dans les groupes sociaux divers, philosophiques ou politiques, voire même au syndicat ou à la coopérative, de ces maniaques et maladifs auxquels tous et chacun sont aliment à leur âpre critique, à leur impitoyable jugement, quoi qu’ils disent, écrivent ou fassent ?
Souvent, avec une mentalité de concierge ou de bedeau, ils ont tendance à pontifier, à jouer aux chefs de groupes, aux donneurs de conseils et ne sont en réalité que des pions insipides ne manquant peut-être pas d’intelligence, mais l’employant à médire, calomnier tousceux qui ne sont pas de leur secte.
Leur influence est parfois redoutable, car ils insinuent avec une telle opiniâtreté ou accusent avec une telle hypocrisie, en sachant feindre la sincérité, qu’ils établissent de fausses réputations en s’appuyant sur des ragots ou des exagérations de leur imagination. Au besoin, ils n’affirment jamais, mais ils font planer ou sèment le soupçon.
Quant à prendre la responsabilité de l’acceptation d’un poste en vue, ils préfèrent s’abriter derrière une fausse modestie et continuer de jeter dans les rangs qui marchent vers un but quelconque d’affranchissement, partiel ou total, le découragement par la défiance, l’impuissance par la division. De tous les éléments qui composent un groupe, ce sont les plus dissolvants.
Avec le temps, et suivant les circonstances, la plupart de ces tristes individus, un beau jour, disparaissent, quand le dégoût qu’ils ont inspiré leur rend la vie impossible ou dangereuse et si leurs intérêts semblent compromis.
Le ratelier garni et garanti leur est-il enfin offert ? Ils ne s’y refusent point ; ils s’y installent. Mais, alors, ils se posent en victimes désabusées de leur dévouement à la cause ; en militants trop désintéressés et trop longtemps méconnus ; en clairvoyants impuissants, devant l’ignorance éternelle des masses ! Voilà dépeinte une secte néfaste chez nous.
En vérité, le sectarisme n’a pas existé seulement parmi les religieux, mais aussi parmi les autres groupements et même les groupements révolutionnaires. Il y eut les sectaires de la Terreur.
Mais, nous ne devons pas confondre le sectarisme et l’hérésie ; car l’hérésie était toute doctrine non conforme à l’enseignement même de l’Eglise et l’hérétique ne devenait sectaire qu’au moment où il persistait dans sa doctrine et se séparait de l’Eglise.
Aujourd’hui, le sectaire, heureusement, n’est pas toujours l’individu antipathique présenté plus haut. Ce peut être un individu, au contraire, très sympathique, ayant des idées particulières, une vie spéciale, une originalité enfin, qui le met en dehors de la généralité de ceux qui ont sur les principaux points de vue d’une certaine philosophie, une opinion semblable, une mentalité pareille, un idéal commun, une doctrine identique ; en un mot il n’est pas un adversaire : il est lui-même et n’accepte pas la manière de voir, de comprendre et de vivre de tous les autres, tout en conservant la prise de contact, en une philosophie qui est et qui reste la sienne, au moins dans son but comme dans son origine négative. Exemple : Parmi les anarchistes, n’y a-t-il pas les groupes différents depuis les libertaires syndicalistes jusqu’aux individualistes anarchistes ? Ni les uns ni les autres, parmi eux, ne prétendent posséder l’indiscutable vérité. Mais chacun cherche à acquérir, selon ses moyens sociaux, intellectuels et moraux, le plus possible de vérités le rapprochant de l’idée qu’il se fait de la perfection de l’individu dans la vie.
Nul ne peut dire qu’il possède la Vérité absolue, et c’est pourquoi chacun la recherche. C’est aussi pourquoi le sectarisme anarchiste n’existe pas, malgré les sectaires que paraissent être les individualistes quand ils font bande à part et recrutent, par la propagande écrite, parlée, vécue, des adhérents à leurs doctrines, des partisans à leur secte.
Il y eut des sectateurs en tous temps, c’est-à-dire des partisans enthousiastes, déclarés d’un système, d’une opinion, d’une secte. Il y en a aujourd’hui, dans tous les genres de groupements.
Il importe pour notre point de vue, qu’il n’y ait point confusion entre l’individu libre de lui-même et de ses idées, les propageant de son mieux surtout par son exemple et par sa conviction et l’individu de tempérament spécial se complaisant maladivement à désunir ce qui est uni, à mésallier ce qui est allié, tendant toujours à jeter le trouble où il y a l’entente et la haine où il y a l’accord. Traiter le premier de sectaire puisqu’il fait secte est le mot juste, presque l’éloge. Mais traiter le second du même qualificatif, c’est alors, pour nous, l’injurier selon son mérite.
— Georges Yvetot
SÉCURITÉ
n. f. (du lat. securitas ; rad. securus, sûr)
Signifie confiance intérieure, tranquillité d’esprit, bien ou mal fondée, dans une occasion où il pourrait y avoir sujet à craindre ; c’est en quoi ce mot diffère de sûreté, qui marque un état dans lequel il n’y a rien à craindre.
Le mot « sécurité » assez inusité et quelconque jadis, jouit depuis quelques années d’une faveur particulière. Il constitue l’un des termes essentiels de la fameuse trilogie boncourienne : arbitrage, sécurité, désarmement.
Ceci nous amène naturellement à étudier ce mot en fonction du problème de la paix.
I. HISTORIQUE.
Le problème de la sécurité des États s’est posé de tous temps. Les efforts de l’Église catholique au moyen âge s’essayant à créer une sorte de communauté chrétienne internationale dont elle prétendait, par son chef, assumer la direction spirituelle ; la création du Saint-Empire romain germanique, première tentative d’organisation européenne généralisée, double effort deux fois brisé par le Grand Schisme et la Réforme ; la Sainte-Alliance de 1815, franc-maçonnerie de princes dressés contre l’esprit de la Révolution, qui se garantissaient mutuellement leur pouvoir politique et leurs acquisitions territoriales ; — et nous passons, à regret, sous silence les généreuses rêveries individuelles d’un Sully, d’un Bernardin de Saint Pierre ou d’un Hugo — les multiples conférences de La Haye qui, faute de pouvoir organiser la paix, se sont contentées d’humaniser, de légaliser en quelque sorte la guerre ; ce sont là autant d’efforts convergents et divers qui tendaient à l’organisation de la sécurité permanente par la consécration d’un statu quo politique et territorial.
Après la grande guerre, il fallut reprendre cet effort. Ne l’avait-on pas promis ? C’est la raison des grands actes internationaux de 1919 : traité de Versailles et Pacte de la Société des Nations. Le traité de Versailles apparaissait surtout comme la consécration des vieilles idées politiques d’avant-guerre : démembrement territorial des vaincus, affaiblissement de l’adversaire par le désarmement, système d’alliances combinées, et le Pacte constituant, à l’inverse, sous l’impulsion du président Wilson, un incontestable effort tendant à l’organisation juridique et morale de la paix.
Il convient alors de rappeler ici, pour mémoire et pour éclairer ce qui suit, l’obligation de désarmer contenue précisément dans l’un des articles de ce Pacte.
ARTICLE 8. — Les membres de la société reconnaissent que le maintien de la paix exige la réduction des armements nationaux au minimum compatible avec la sécurité nationale et avec l’exécution des obligations internationales imposées par une action commune.
L’engagement pris à Versailles en 1919, par les nations signataires du Pacte est donc inconditionnel, absolu.
M. Henri Rollin, délégué de la Belgique à la S. D. N., commentant cet article 8, écrivait récemment pour répondre à ceux qui prétendent — c’est là l’argument des milieux officiels français — qu’avant de songer à l’application de cet article il faut d’abord réaliser la sécurité :
« Eh bien non ! la sécurité n’est pas une condition de la réduction. Comme l’a dit mon collègue italien M. Scialoja : la sécurité n’est pas la condition, c’en est la mesure. Dans ce Pacte, les membres de la S. D. N. ont pris un engagement d’honneur inconditionnel : A Versailles, à Saint-Germain, au Trianon, on a exigé au comptant la réduction des armements pour certains pays, (l’Allemagne, l’Autriche, etc.) mais on a promis à terme celle de tous les membres de la S. D. N. L’heure est venue d’acquitter cette dette. »
Cette promesse a même été aggravée.
Après le Pacte où figurent cet engagement d’honneur inconditionnel et cette promesse à terme, la partie V du Traité de Versailles imposé à l’Allemagne (clauses militaires, navales et aériennes) débute ainsi :
« En vue de rendre possible la préparation d’une limitation générale des armements de toutes les nations, l’Allemagne s’engage à observer strictement les clauses militaires, navales et aériennes ci-après stipulées ... »
Que signifie ce texte encore qui figure également et dans les mêmes termes, dans les traités de Saint-Germain, du Trianon et de Neuilly imposés aux alliés de l’Allemagne ? Il signifie, contre toute autre exégèse, que la limitation des armements de l’Allemagne et de ses alliés, avait pour but de rendre possible et immédiate dès que constatée, la limitation générale des armements dans le monde.
C’est ainsi que l’Allemagne l’entendit et M. Clémenceau lui-même, dans sa lettre aux puissances centrales, qui fait autorité en ces matières, du 16 juin 1919. Ajoutons encore : c’est toujours ainsi que l’Allemagne l’entend. Et, par ailleurs, rappelons que le désarmement de cette Allemagne a été constaté par le maréchal Foch lui-même, dans un rapport, resté célèbre, de 1927. Dans ce rapport, le maréchal Foch a reconnu, le 27 février 1927, que, au 1er janvier 1927, l’Allemagne était effectivement désarmée.
Mais, nous l’avons vu, à cette idée claire, dynamique, populaire du désarmement, succède, dès 1923, une idée obscure dont nous nous proposons de juger le contenu : l’idée de sécurité. Le désarmement, même limité, c’est un peu simple et cela trouble trop de calculs. On ne pourra désarmer qu’après avoir fondé la sécurité. Alors, derrière ce paravent, viennent s’abriter tous les adversaires résolus ou sournois du désarmement ; militaires, marchands d’obus et politiciens sans vergogne, que rassemble le même sordide intérêt, écrivains et journalistes au service du profit menacé. Aucun ne manque à l’appel.
Ni les accords de Locarno, de 1925, garantis par l’Angleterre, et par lesquels l’Allemagne renonçait à l’Alsace-Lorraine — librement cette fois ! — ni le pacte Briand-Kellogg de renonciation à la guerre, rien ne peut les satisfaire. Il leur manquera toujours un engagement supplémentaire qu’on jugera dérisoire et insuffisant dès qu’obtenu.
Nous résumerons notre pensée en disant qu’on a ainsi dressé la sécurité contre le désarmement.
II. LA SÉCURITÉ PAR LES ARMEMENTS.
Il nous faut donc suivre nos adversaires sur ce terrain où ils s’engagent. Est-il besoin de démontrer que la guerre classique, la guerre telle qu’elle a été faite jusqu’à ce jour, c’est-à-dire avec des armées en campagne s’étendant et se stabilisant sur des fronts interminables jusqu’à ce qu’intervienne, par lassitude ou par usure, la décision militaire finale ; la guerre avec un avant et un arrière, des combattants menacés et des non-combattants protégés par les premiers ; la guerre avec ses innombrables légions de sacrifiés et ses quelques cohortes de profiteurs, cette guerre-là a vécu.
Méthodes d’hier !
Aujourd’hui, demain, la science et la technique industrielle aidant, la guerre aéro-chimique menacera toute l’humanité. Cités populeuses, fortes agglomérations industrielles seront plus particulièrement menacées, sévissant sur tout et partout à la fois, elle emportera dans une sorte de rage folle ce qui peut subsister encore de civilisation !
En présence de telles perspectives, que valent ces mots : sécurité, défense nationale ? Il est indéniable que ces notions acquièrent un nouvel aspect, qu’elles ne sont plus ce qu’elles étaient au temps où les moyens des hommes s’avéraient plus restreints ou différents.
D’autant que nos moyens de défense contre cette guerre monstrueuse sont tragiquement limités. La guerre aéro-chimique et bactériologique ne peut pas plus être exactement prévue qu’empêchée, soit par des moyens de défense appropriés, soit par des réglementations internationales.
Méditez les citations suivantes (extraites du rapport final de la Conférence de Genève, 1925) :
« La mise en exécution d’une interdiction ou d’une limitation de fabrication des gaz toxiques est impossible en raison de leur emploi en temps de paix. »
Et cette autre :
« En raison des résultats effectifs inouïs de la guerre des gaz, aucune nation ne saurait encourir le risque d’une convention qu’un adversaire sans scrupule pourrait violer. »
Voilà la conclusion (extraite des « Règlements militaires français ») :
« Respectueux des engagements internationaux auxquels la France a souscrit, le Gouvernement français s’efforcera, au début d’une guerre, d’obtenir du Gouvernement ennemi de ne pas user de ces armes de guerre ; si ces engagements ne sont pas observés, il se réserve d’agir suivant les circonstances. »
Que faut-il conclure ? La vérité : à savoir qu’en raison des formidables progrès d’une science sans conscience, d’un machinisme broyeur d’intelligence et d’âme, d’une technique démoniaque, il n’y a plus aujourd’hui de sécurité ni pour nous, ni pour personne. De sécurité, lorsqu’il est possible que nos femmes et nos enfants soient brusquement emportés dans une vague de gaz mortels ? Sinistre plaisanterie !
Nous contre-attaquerons, me dira-t-on. Soit, je l’accorde. Nous répondrons à la destruction de Paris, de Marseille ou de Lyon par la destruction de Berlin ou de Londres ou de Rome, que sais-je ! Mais en quoi la destruction de ces villes garantit-elle la sécurité des nôtres ? Tout le problème est là !
En conséquence, c’est se moquer du monde que de prendre précisément pour pivot de toute politique extérieure une idée qui, dans l’état présent des choses ne correspond plus à rien. Exactement.
La sécurité par les armements est une dangereuse illusion qu’il nous faut dissiper sans délai. Les armements ne garantissent plus aux peuples la sécurité. Les canons sont impuissants à barrer le passage à toute une escadrille d’avions porteurs d’explosifs et de bombes incendiaires. Et que peuvent fusils, canons, tanks et mitrailleuses contre une nappe de gaz ? Rien.
D’ailleurs, même militairement vaincue, envahie, la guerre se développant sur son territoire, une nation peut encore frapper dangereusement, sinon anéantir son adversaire victorieux, avec son aviation de bombardement pratiquement insaisissable.
Les armements ne nous défendent plus.
D’ailleurs, si les armements créent la sécurité, l’Allemagne — soyons attentifs à ceci — peut légitimement réclamer le droit de réarmer pour assurer sa propre sécurité. D’autre part, enfin, si les armements créent la sécurité, comment la guerre a-t-elle pu éclater dans l’Europe surarmée de 1914 ?
Par contre, l’histoire toute récente nous enseigne, d’expérience, qu’à des armements donnés répondent des armements rivaux qui rétablissent l’équilibre et cette concurrence contient en elle-même le pire danger de guerre qui soit. Notre sécurité réside ailleurs nous le verrons. Le désarmement n’est pas sa conséquence, il est sa condition.
III. SÉCURITÉ PAR LE DÉSARMEMENT.
Henderson disait, dans son discours inaugural (Conférence du désarmement, Genève, février 1932) :
« L’histoire moderne fournit une preuve incontestable et accablante de la fausseté de ce principe selon lequel la sécurité d’une nation est en proportion de la puissance de ses armements. »
Ce n’était là qu’un commentaire éloquent de l’article 8 du Pacte de la S. D. N. :
« Les membres de la Société reconnaissent que le maintien de la paix exige la réduction des armements nationaux ... »
En outre, l’arbitrage obligatoire implique, exige même, un désarmement suffisant à écarter la menace d’une guerre brusquée venant paralyser, par son développement rapide de violence les centres vitaux d’un pays et, partant, sa défense possible. D’autre part, cet arbitrage semble une dérision au peuple sûr de sa force qu’on ne contraindra que difficilement à s’y soumettre. C’est toute l’histoire du conflit sino-japonais !
Abandonnons résolument cette thèse longtemps classique : un pays doit être fort pour être en sécurité. La sécurité par les armements n’est d’ailleurs pas absolue, constante, mais relative et précaire. Nous le constatons : l’armement de l’un appelle le surarmement de l’autre. L’équilibre ou le déséquilibre des forces n’est pas en rapport constant. Il se déplace continuellement. Ainsi, le déséquilibre subsiste, en définitive. Prétendre fonder l’édifice de la Paix en déposant à sa base une masse d’explosifs, quel paradoxe extravagant ! Disons mieux : Quelle redoutable antinomie ! Quelle absurdité !
Il faut le dire et le répéter inlassablement, la course aux armements que fait prévoir l’échec définitif de la Conférence de Genève — dont on admet, par coupable légèreté, la possibilité dans certains milieux officiels français — accélérerait tout aussitôt cette course aux armements, ce serait la course fatale vers un universel suicide.
Un nouveau conflit serait tel qu’il constituerait, pour tous, un désastre sans précédent. Cette guerre plongerait l’univers civilisé dans un abîme de dévastation. Ce n’est pas l’habituel traité de paix consacrant, orgueilleusement, la gloire des uns et le misérable écrasement des autres qui en serait la conclusion, mais la révolution brutale, effroyable déchaînement d’appétits exaspérés par la misère et par la peur.
D’idées généreuses, constructives, aucune en de telles heures ! Ce que la guerre, dans son délire sanglant, aurait épargné peut-être, la bestialité l’emporterait. Il faut désarmer !
IV. LES ÉLÉMENTS DE LA SÉCURITÉ FRANÇAISE.
Serrons le problème de plus près. Quels sont les éléments constitutifs, essentiels de la sécurité française ? Ce sont les suivants :
-
Notre armée ;
-
Le désarmement de l’Allemagne ;
-
Les accords internationaux.
Apprécions-les sommairement.
-
Notre armée ? Une natalité décroissante réduit nos effectifs d’année en année. Relativement au potentiel démographique, nous serons bientôt, vis-à-vis de l’Allemagne seule, dans le rapport de 1 à 2. Ce serait une grave imprudence que de compter sur nos alliances pour rétablir la situation à cet égard. Reste, il est vrai, pour quelque temps encore, nos ressources coloniales. Elles ne sont pas d’un maniement facile. Nous ajoutons que pour ce qui est du potentiel industriel et chimique, le rapport de l’Allemagne à nous est de 5 à 1 ! Concluez.
-
Désarmement de l’Allemagne. — Nous nous rassurons en disant : l’Allemagne est militairement désarmée. Pour combien de temps encore ? Nous l’avons démontré : le désarmement de l’Allemagne n’était que la préface du désarmement général. Les peuples vaincus ont été désarmés il y a quatorze ans ; mais, ne l’oublions pas, en vertu d’un engagement solennel réciproque.
Nous savons comment cet engagement a été respecté.
Et, si Genève échoue en fin de compte, Hitler est fondé en droit à réclamer, pour son pays, la liberté des armements. La menace est claire. Nous sommes hors d’état d’y parer. C’est la guerre avant 10 ans ! En conclusion, caractère transitoire du désarmement allemand.
Dans ces deux cas, si la course aux armements reprend, nous serons rapidement distancés et finalement vaincus par notre voisine mieux outillée et plus industrialisée que nous.
De telles vérités ne peuvent être cachées.
-
Quant aux accords internationaux que nous ne pouvons, ici, analyser en détail, disons brièvement que leur caractère d’imprécision d’une part et l’indétermination des sanctions éventuelles contre l’agresseur d’autre part, suffisent à en paralyser l’essor sinon à en ruiner l’efficacité.
V. LE CARACTÈRE VÉRITABLE DE LA SÉCURITÉ.
Qu’il nous soit permis, au terme de notre démonstration, de dénoncer l’erreur que constitue la recherche de la sécurité sur le plan de la force militaire. Matérialisme aussi décevant que vain ! La sécurité — étymologiquement d’ailleurs — est essentiellement un état de fait moral. La sécurité est fonction d’éléments psychologiques ou intellectuels. La sécurité sera acquise le jour où chaque individu, dans chaque nation, possèdera la certitude confiante qu’aucun pas ne veut ni ne peut l’attaquer brusquement. Or, les armements menacent cette sécurité intérieure précisément parce qu’ils sont la cause déterminante de la méfiance. Armer, c’est diviser les peuples. Armer, c’est surexciter leur inquiétude. Armer, c’est les dresser, demain, les uns contre les autres.
Car l’angoisse présente du monde réside, en dernière analyse, dans le sentiment de l’existence d’un redoutable armement universel et dans la crainte douloureuse qu’il inspire. Seule, sa disparition permettra la sécurité qui, dans le même temps, désarmera les coeurs comme elle aura désarmé les bras. C’est là que réside le problème de la véritable sécurité.
En conclusion, à la vieille conception latine et juridique de la paix — la justice portant un glaive, — nous opposons, sur ce plan particulier, notre conception éthique de la paix et l’action incoercible de la conscience humaine ; aux armées nationales ou internationales, survivances brutales du passé, la pression des forces intérieures, symbole d’un radieux avenir.
Notre sécurité ne repose pas sur des armements ou des sanctions extérieures, mais sur un état psychologique générateur de confiance. Et c’est dans la révolte de la conscience individuelle que réside notre suprême espoir !
Arbitrage, Sécurité, Désarmement, dit M. Paul-Boncour ? Allons donc ! Il faut réaliser le désarmement d’abord qui engendre la sécurité et permet seul un fonctionnement harmonieux de l’arbitrage.
Le reste est indigence coupable ou habileté politicienne.
— R. JOSPIN.
SÉISME
n. m. (du grec séismos)
Un séisme est un tremblement de terre ; c’est le nom donné à toute secousse imprimée au sol par un effort interne. C’est un épisode violent qui se produit dans le phénomène des contractions lentes de l’écorce terrestre.
Les séismes plus ou moins brusques, sont généralement de très courte durée (40 à 50 secondes) mais les secousses peuvent se renouveler à intervalles très rapprochés et cela pendant des jours, des semaines et même des mois. Aux îles Sandwich, il a été enregistré en 1868, deux mille secousses durant le mois de mars. L’intensité des séismes est très variable. Parfois ils sont si faibles que seuls, des appareils spéciaux peuvent les déceler. Par contre, ils peuvent être si violents qu’ils bouleversent en quelques secondes des régions entières, détruisant des villes, faisant surgir des îles, des montagnes.
Les mouvements sont de trois genres : horizontaux, verticaux et ondulatoires. Les derniers sont les plus fréquents. La nature des secousses dépend de la position du centre de poussée par rapport au point qui subit le séisme. Des observations récentes tendent à démontrer que ce centre de poussée se situerait entre cinq et vingt kilomètres au-dessous de la surface du sol. Les poussées horizontales et verticales sont moins dangereuses que les poussées ondulatoires. Les premières se caractérisent par la projection à une hauteur plus ou moins grande, des objets, des personnes et parfois des habitations. Les secondes renversent tout de côté. Les dernières impriment à la surface du sol un mouvement analogue à celui de la vague et disloquent puissamment l’écorce terrestre.
Quelle que soit la nature des secousses, elles amènent volontiers la production de crevasses qui affectent la forme de longues lézardes ou qui ont une disposition étoilée. Ces crevasses atteignent parfois plusieurs kilomètres de longueur. Les unes se referment, les autres restent béantes jusqu’à ce qu’elles soient comblées par des éboulements.... Parfois les tremblements de terre s’accompagnent de dénivellations ou rejets qui s’établissent toujours entre des assises géologiques différentes. Le séisme de 1891, au Japon, fit naître une dénivellation brusque de 6 mètres sur une longueur de 112 kilomètres, au milieu de terrains auparavant de plain-pied.
Les tremblements de terre, produisent quelquefois de véritables effondrements. En 1819, dans le delta de l’Indus, le district du Grand-Rhünn s’abîma dans la mer d’Oman, formant un golfe immense de 5 mètres de profondeur. Ailleurs, les séismes amènent des soulèvements désastreux, tel celui du port de Népou, en 1855, qui s’est entièrement vidé.
Les secousses sismiques sont peu sensibles en mer. Mais la translation des ondes sismiques donne lieu à la production des raz de marée. Les eaux de l’océan après s’être retirées, sous l’influence de la secousse, durant un laps de temps qui peut atteindre 24 heures, en découvrant une partie plus ou moins vaste des fonds sous-marins, reviennent violemment en une vague gigantesque, haute parfois de 30 mètres, qui, montant à l’assaut des côtes, balaye des pays entiers en détruisant tout sur son passage.
La portion d’un pays secoué par un tremblement de terre, peut comprendre une vaste étendue. Certains séismes ont secoué des portions de pays couvrant près de 400.000 kilomètres-carrés.
Les secousses sont dites « linéaires » quand elles se propagent sur une ligne bien nette, en ne perturbant qu’un espace très étroit. Elles sont dites « centrales » lorsqu’elles rayonnent autour d’un centre nommé « épicentre » et qu’elles vont en s’atténuant à mesure qu’elles s’en écartent. Les ondes sismiques se propagent avec une grande rapidité. Le maximum enregistré donne comme vitesse de déplacement 5.200 mètres par seconde. Cette vitesse paraît être exceptionnelle. Aujourd’hui, les séismographes, appareils très sensibles, mis à l’abri des vibrations extérieures dans des sous-sols profonds, inscrivent en blanc sur un fond noir les vibrations qu’ils ressentent. Enregistrant instantanément les tremblements de terre, quel que soit l’endroit où ils se produisent, ils permettent de situer immédiatement le lieu et l’importance du séisme.
En général, les tremblements de terre sont accompagnés d’un bruit qui rappelle le roulement du tonnerre. Il arrive cependant que la secousse sismique est insensible et qu’on en perçoit seulement le bruit. Les séismes résultent autant de l’affaissement de la croûte terrestre sur le noyau central que des poussées volcaniques. Ils sont plus fréquents en certaines régions que dans d’autres. Mais il est impossible d’affirmer qu’il existe une région du globe, terrestre ou marine, qui soit à l’abri d’un tremblement de terre. Ces actions souterraines se font sentir dans les contrées les plus différentes, parmi les terrains géologiques les plus divers, sous les climats les plus opposés. Pourtant, certaines formations sont rebelles à la propagation des ondes sismiques. Ce sont les couches épaisses d’alluvions et de terrains meubles. Alors que la transmission se produit avec violence dans les roches compactes et surtout à la jonction de terrains géologiques différents, elle perd toute violence dans ces terrains meubles. Nonobstant cela, il n’est pas de contrées qui n’aient été éprouvées par ce fléau.... De puissantes actions internes se font sentir aussi bien sur les hauts plateaux des Alpes et des Andes, dans les prairies du Mississipi ou les steppes de la Sibérie, que dans les sables de la Syrie, dans les vallées des Alpes où les collines bordant le cours du Rhin.
On admet que le voisinage de la mer joue un grand rôle dans la production des séismes. Mais ceux-ci se produisent de préférence le long de deux zones nettement limitées, qui correspondent à des plissements brusques de l’écorce terrestre.
L’une part du Portugal méridional, passe par l’Andalousie, l’Algérie, les Pyrénées, les Alpes, l’Italie, l’Asie-Mineure, l’Himalaya et les îles de la Sonde. L’autre comprend les rives du Pacifique, le Kamtchatka, le Japon, les Philippines, la Nouvelle Guinée, la côte occidentale des deux Amériques, depuis le cap Horn jusqu’aux îles Aléoutiennes.
Malgré que la violence des séismes soit superficielle, l’effort interne ne rencontrant pas à la surface du sol la résistance qu’il éprouve plus bas de la part des formations géologiques, on a malheureusement enregistré de véritables catastrophes ayant produit un nombre important de dégâts et fait de nombreuses victimes. Citons, parmi ces séismes désastreux : 1693, en Sicile : 93.000 victimes. En 1755, Lisbonne : 30.000 victimes ; en 1783, Calabre : 90.000 victimes ; en 1906, San-Francisco ; en 1908, Messine : 100.000 victimes et récemment, en 1930, au Japon : près de 300.000 victimes. Et pourtant les tremblements de terre sont des phénomènes excessivement fréquents, la terre est en état de mobilité perpétuelle. Seulement la majorité des séismes passent inaperçus, car ils se produisent soit en mer soit dans des régions inhabitées. Seuls ceux ayant ébranlé des régions habitées et ayant eu des résultats désastreux se gravent dans l’éphémère mémoire des hommes.
— Charles ALEXANDRE.
SEIZE (le manifeste des)
Sous cette appellation, on a désigné, dans le mouvement anarchiste, une déclaration datée du 28 février 1916, qui fut publiée pour la première fois dans le quotidien syndicaliste La Bataille, le 14 avril 1916. Le n°16 des publications de La Révolte et des Temps Nouveaux, du 15 octobre 1922, a reproduit in-extenso la dite déclaration, signée de quinze noms seulement ; cela provient de ce que Husseindey, le seizième signataire supposé, n’était, en réalité, que la localité (Algérie) habitée par l’un des signataires : Orfila. Ainsi, le trop fameux Manifeste des Seize aurait du se dénommer, à plus juste titre, le Manifeste des Quinze. Mais ce serait commettre une nouvelle erreur de ne voir, en cette déclaration, qu’une adhésion de quinze anarchistes. Les événements de l’époque firent que, lorsque cette déclaration fut communiquée à la presse française et étrangère, quinze camarades seulement approuvèrent le texte, pressé que l’on était de le publier ; dans le numéro du 14 avril 1916 de La Libre Fédération, périodique communiste-anarchiste, paraissant à Lausanne, une bonne centaine d’adhésions nouvelles venaient s’ajouter aux précédentes ; elles émanaient de camarades français, italiens (les plus nombreux), quelques-uns de Suisse, d’Angleterre, de Belgique et du Portugal. Certaines étaient suivies de ces deux mots curieux : « Aux Armées » ; une même, dont l’adresse était : 7, rue de la Halle, au Havre, était illisible.
Telle est l’histoire de cette déclaration appelée à soulever des polémiques violentes et à faire surgir des antagonismes qui, en 1933, persistent. Pour mieux situer ce Manifeste dans le cadre de l’évolution sociale du début du XXè siècle, on peut s’autoriser à le comparer, sur des plans différents, au Manifeste des 93 intellectuels allemands, qui, lui aussi, donna naissance à de nombreux commentaires, et dire que le premier fut au mouvement anarchiste ce que le second fut au monde « intellectuel ».
Le Manifeste des Seize — nous continuerons à le désigner ainsi — eut une répercussion considérable, qui se manifesta d’une façon véhémente dans toute l’action du mouvement anarchiste d’après-guerre. L’oubli est loin de s’en être emparé, pour l’envelopper d’indifférence, ou le remiser au musée des erreurs de doctrine ou de tactique envers un idéal. J’ignore si les générations de demain lui attribueront encore la même importance ; quoi qu’il en soit, et on le contestera difficilement, ce fut pour le mouvement anarchiste, une manifestation fort regrettable. Elle fut cause de divisions et de fractionnements dont le mouvement tout entier dut subir les contre-coups.
Le mouvement anarchiste, avant 1914-, était loin de rallier des masses organisées et disciplinées comme celles des partis politiques et des organisations ouvrières. Si des défections se produisirent parmi les adeptes de l’idéal anarchiste, on doit reconnaître en toute bonne foi que, proportionnellement, elles furent cependant minimes. Et l’on peut affirmer, sans prétention aucune, que l’idéal anarchiste reste ce qu’il n’a cessé d’être, sans être affaibli par des compétitions dont la variabilité est incompatible, et pour le moins contestable, avec la défense de son idéologie et de ses principes.
Dès le début de la guerre, quelques militants anarchistes, réfugiés en Angleterre, poursuivaient leur propagande dans Freedom, le journal anarchiste-communiste de Londres, fondé en 1886 par Kropotkine et Charlotte M. Wilson. Les trente-neuf années d’existence de ce journal en faisaient le doyen de la presse anarchiste du monde entier. Dans les numéros d’octobre, de novembre et de décembre 1914, une controverse animée s’engagea au sujet de la guerre. On y trouva une contribution pro-guerriste de Kropotkine, Tcherkesoff et Jean Grave d’une part, et celle des anti-guerristes : Malatesta et une grande partie des anarchistes anglais d’autre part. Kropotkine n’admettait guère que l’on pût avoir une idée opposée à celle défendue par les pro-guerristes et, logique avec lui-même, il mettait en exécution un point de vue jadis exprimé : qu’en cas de conflit entre la France et l’Allemagne, il prendrait position pour la France, qu’il trouvait plus évoluée et dont il craignait que la défaite n’entraînât une réaction internationale.
A quelques amis, lors d’un passage à Paris, en 1913, je pense, Kropotkine avait déclaré :
« Et la guerre ? J’ai dit, lors d’un précédent passage à Paris, à un moment où il était, question de guerre aussi, que je regrettais d’avoir 62 ans et de ne pouvoir prendre un fusil pour défendre la France dans le cas où elle serait envahie ou menacée d’invasion par l’Allemagne. Je n’ai pas changé d’opinion sur ce point. Je n’admets pas qu’un pays soit violenté par un autre, et je défendrai la France contre n’importe quel pays d’ailleurs : Russie, Angleterre, Japon, aussi bien que contre l’Allemagne. »
C’était là une profession de foi francophile doublée d’un romantisme révolutionnaire qui, si elle cadrait peu avec les écrits de l’auteur de « La Conquête du Pain » et des « Paroles d’un Révolté », pouvait s’harmoniser avec celui de « La Grande Révolution ». Mais, en ce cas, que devenait la fameuse « insurrection en cas de guerre », prônée par le mouvement anarchiste révolutionnaire ? Cette polémique entre les interventionnistes et les anti-guerristes provoqua bientôt une rupture dans le groupe de Freedom. Et, dépassant la mesure que se doit de garder une controverse courtoise, Tcherkesoff... :
« ...alla même jusqu’à injurier grossièrement Keell en personne, parce que ce militant refusait de céder aux injonctions de la demi-douzaine (tout au plus) de Kropotkiniens qui voulaient mettre le journal au service de la guerre. »
Pour dissiper la mauvaise impression produite par cette rupture violente, les anarchistes réfugiés à Londres, à cette époque, et, les camarades anglais éditèrent en langue anglaise, française et allemande, un manifeste signé par trente-six camarades, intitulé : « L’Internationale Anarchiste et la Guerre ».
Voici le texte de ce Manifeste :
« L’Europe en feu, une dizaine de millions d’hommes aux prises, dans la plus effroyable boucherie qu’ait jamais enregistrée l’histoire, des millions de femmes et d’enfants en larmes, la vie économique, intellectuelle et morale de sept grands peuples, brutalement suspendue, la menace, chaque jour plus grave, de complications nouvelles, tel est, depuis sept mois, le pénible, angoissant et odieux spectacle que nous offre le monde civilisé. Mais, spectacle attendu, au moins par les anarchistes, car pour eux, il n’a jamais fait et il ne fait aucun doute — les terribles événements d’aujourd’hui fortifient cette assurance, — que la guerre est en permanente gestation dans l’organisme social actuel et que le conflit armé restreint ou généralisé, colonial ou européen est la conséquence naturelle et l’aboutissement nécessaire et fatal d’un régime qui a pour base l’inégalité économique des citoyens, repose sur l’antagonisme sauvage des intérêts et place le monde du travail sous l’étroite et douloureuse dépendance d’une minorité de parasites, détenteurs à la fois du pouvoir politique et de la puissance économique.
La guerre était inévitable ; d’où qu’elle vînt, elle devait éclater. Ce n’est pas en vain que depuis un demi-siècle, on prépare fiévreusement les plus formidables armements et que l’on accroît tous les jours davantage les budget de la mort. A perfectionner constamment le matériel de guerre, à tendre continûment tous les esprits et toutes les volontés vers la meilleure organisation de la machine militaire, on ne travaille pas à la paix. Aussi est-il naïf et puéril, après avoir multiplié les causes et les occasions de conflits, de chercher à établir les responsabilités de tel ou tel gouvernement. Il n’y a pas de distinction possible entre les guerres offensives et les guerres défensives. Dans le conflit actuel, les gouvernements de Berlin et de Vienne se sont justifiés avec des documents non moins authentiques que les gouvernements de Paris, de Londres, de Pétrograd ; c’est à qui de ceux-ci ou de ceux-là produira les documents les plus indiscutables et les plus décisifs pour établir sa bonne foi, et se présenter comme l’immaculé défenseur du droit et de la liberté, le champion de la civilisation.
La civilisation ? Qui donc la représente, en ce moment ? Est-ce l’État allemand, avec son militarisme formidable et si puissant, qu’il a étouffé toute velléité de révolte ? Est-ce l’État russe, dont le knout, le gibet et la Sibérie sont les seuls moyens de persuasion ? Est-ce l’État français, avec Biribi, les sanglantes conquêtes du Tonkin, de Madagascar, du Maroc, avec le recrutement forcé des troupes noires ? La France qui retient dans ses prisons, depuis des années, des camarades coupables seulement d’avoir parlé et écrit contre la guerre ? Est-ce l’Angleterre qui exploite, divise, affame et opprime les populations de son immense empire colonial ? Non. Aucun des belligérants n’a le droit de se réclamer de la civilisation, comme aucun n’a le droit de se déclarer en état de légitime défense.
La vérité, c’est que la cause des guerres, de celle qui ensanglante actuellement les plaines de l’Europe, comme de toutes celles qui l’ont précédée, réside uniquement dans l’existence de l’État, qui est la forme politique du privilège. L’État est né de la force militaire ; il s’est développé en se servant de la force militaire ; et c’est encore sur la force militaire qu’il doit logiquement s’appuyer pour maintenir sa toute puissance. Quelle que soit la forme qu’il revête, l’État n’est que l’oppression organisée au profit d’une minorité de privilégiés. Le conflit actuel illustre cela de façon frappante : toutes les formes de l’État se trouvent engagées dans la guerre présente : l’absolutisme avec la Russie, l’absolutisme mitigé de parlementarisme avec l’Allemagne, l’État régnant sur des peuples de races bien différentes avec l’Autriche, le régime démocratique constitutionnel avec l’Angleterre, et le régime démocratique républicain avec la France.
Le malheur des peuples qui, pourtant, étaient tous profondément attachés à la paix, est d’avoir eu confiance en l’État, avec ses diplomates intrigants, en la démocratie et les partis politiques (même d’opposition, comme le socialisme parlementaire) pour éviter la guerre. Cette confiance a été trompée à dessein, et elle continue à l’être, lorsque les gouvernements, avec l’aide de toute leur presse, persuadent leurs peuples respectifs que cette guerre est une guerre de libération.
Nous sommes résolument contre toute guerre entre peuples ; et, dans les pays neutres, comme l’Italie, où les gouvernants prétendent jeter encore de nouveaux peuples dans la fournaise guerrière, nos camarades se sont opposés, s’opposent, et s’opposeront toujours à la guerre, avec la dernière énergie. Le rôle des anarchistes, quels que soient l’endroit ou la situation dans lesquels ils se trouvent, dans la tragédie actuelle, est de continuer à proclamer qu’il n’y a qu’une seule guerre de libération : celle qui, dans tous les pays, est menée par les opprimés contre les oppresseurs, par les exploités contre les exploiteurs. Notre rôle, c’est d’appeler les esclaves à la révolte, contre leurs maîtres. La propagande et l’action anarchistes doivent s’appliquer avec persévérance à affaiblir et à désagréger les divers États, à cultiver l’esprit de révolte, et à faire naître le mécontentement dans les peuples et dans les armées.
À tous les soldats de tous les pays, qui ont la foi de combattre pour la justice et la liberté, nous devons expliquer que leur héroïsme et leur vaillance ne serviront qu’à perpétuer la haine, la tyrannie et la misère. Aux ouvriers de l’usine, il. faut rappeler que les fusils qu’ils ont maintenant entre les mains, ont été employés contre eux dans les jours de grève et de légitime révolte et qu’ensuite, ils serviront encore contre eux, pour les obliger à subir l’exploitation patronale. Aux paysans, montrer qu’après la guerre, il faudra encore une fois se courber sous le joug, continuer à cultiver la terre de leurs seigneurs et nourrir les riches. A tous les parias, qu’ils ne doivent pas lâcher leurs armes avant d’avoir réglé leurs comptes avec leurs oppresseurs, avant d’avoir pris la terre et l’usine pour eux. Aux mères, compagnes et filles, victimes d’un surcroît de misère et de privations, montrons quels sont les vrais responsables de leurs douleurs et du massacre de leurs pères, fils et maris.
Nous devons profiter de tous les mouvements de révolte, de tous les mécontentements, pour fomenter l’insurrection, pour organiser 1a révolution, de laquelle nous attendons la fin de toutes les iniquités sociales. Pas de découragement — même devant une calamité comme la guerre actuelle. C’est dans des périodes aussi troublées où des milliers d’hommes donnent héroïquement leur vie pour une idée, qu’il faut que nous montrions à ces hommes la générosité, la grandeur et la, beauté de l’idéal anarchiste ; la justice sociale réalisée par l’organisation libre des producteurs ; la guerre et le militarisme à jamais supprimés ; la liberté entière conquise par la destruction totale de l’État et de ses organismes de coercition. Vive l’Anarchie ! »
Londres, février 1915. — Léonard d’Abbot, Alexandre Berckman, L. Bertoni, L. Bersani, G. Bernard, A. Bernado, G. Barrett, E. Boudot, A. Gazitta, Joseph J. Cohen, Henri Combes, Nestor Ciek van Diepen, F.-W. Dunn, Ch. Frigerio, Emma Goldman, V. Garcia, Hippolyte Havel, T.-H. Keell, Harry Kelly, J. Lemarie, E. Malatesta, A. Marquez, F. Domela-Nieuwenhuis, Noël Paravich, E. Recchioni, G. Rijnders, I. Rochtchine, A. Savioli, A. Schapiro, William Shatoff, V.-J.-C. Schermerhorn, G. Trombetti, P. Vallina, G. Vignati, L.-G. Wolf, S. Yanovsky.
Tandis que se déroulaient les douloureux événements qui, depuis août 1914, ensanglantaient le monde entier, faisant de lui un immense et horrifiant charnier, vers le début de l’année 1916, au moment même où il était question de paix, certains anarchistes éprouvèrent le besoin urgent d’affirmer leur position dans le conflit guerrier qui mettait aux prises tous les peuples d’Europe et d’Amérique.
De là est née cette déclaration qui, dans les milieux révolutionnaires et plus particulièrement chez les anarchistes, devait prendre le nom de « Manifeste des Seize ». Son promoteur était Jean Grave, théoricien anarchiste-communiste bien connu, auteur d’ouvrages doctrinaux, dont les principaux sont « La Société Mourante et l’Anarchie », « Réformes et Révolution », « La Société future », etc...
Voici le texte de la déclaration des Seize :
« De divers côtés, des voix s’élèvent, pour demander la paix immédiate. « Assez de sang- versé, assez de destruction », dit-on, « il est temps d’en finir d’une façon ou d’une autre ». Plus que personne, et depuis bien longtemps, nous avons été, dans nos journaux, contre toute guerre d’agression entre les peuples et contre le militarisme, de quelque casque impérial ou républicain il s’affuble. Aussi serions-nous enchantés de voir les conditions de paix discutées — si cela se pouvait — par les travailleurs européens, réunis en un congrès international. D’autant plus que le peuple allemand s’est laissé tromper en août 1914, et s’il a cru réellement qu’on le mobilisait pour la défense de son territoire, il a eu le temps de s’apercevoir qu’on l’avait trompé pour le lancer dans une guerre de conquêtes.
En effet, les travailleurs allemands, du moins dans leurs groupements plus ou moins avancés, doivent comprendre maintenant que les plans d’invasion de la France, de la Belgique, de la Russie, avaient été préparés de longue date et que, si cette guerre n’a pas éclaté en 1875, en 1880, en 1911, ou en 1913, c’est que les rapports internationaux ne se présentaient pas alors sous un aspect aussi favorable et que les préparatifs militaires n’étaient pas assez complets pour promettre la victoire à l’Allemagne (lignes stratégiques à compléter, canal de Kiel à élargir, les grands canons de siège à perfectionner). Et maintenant, après vingt mois de guerre et de pertes effroyables, ils devraient bien s’apercevoir que les conquêtes faites par l’armée allemande ne pourront être maintenues. D’autant plus qu’il faudra reconnaître ce principe (déjà reconnu par la France en 1859, après la défaite de l’Autriche) que c’est la population de chaque territoire qui doit exprimer si elle consent ou non à être annexée.
Si les travailleurs allemands commencent à comprendre la situation comme nous la comprenons, et comme la comprend déjà une faible minorité de leurs sociaux-démocrates, — et s’ils peuvent se faire écouter par leurs gouvernants — il pourrait y avoir un terrain d’entente pour un commencement de discussion concernant la paix. Mais alors ils devraient déclarer qu’ils se refusent absolument à faire des annexions, ou à les approuver ; qu’ils renoncent à la prétention de prélever des « contributions » sur les nations envahies, qu’ils reconnaissent le devoir de l’État allemand de réparer, autant que possible, les dégâts matériels causés par les envahisseurs chez leurs voisins, et qu’ils ne prétendent pas leur imposer des conditions de sujétion économique, sous le nom. de traités commerciaux. Malheureusement, on ne voit pas, jusqu’à présent, des symptômes du réveil, dans ce sens, du peuple allemand.
On a parlé de la conférence de Zimmerwald, mais il a manqué à cette conférence l’essentiel : la représentation des travailleurs allemands. On a aussi fait beaucoup de cas de quelques rixes qui ont eu lieu en Allemagne, à la suite de la cherté des vivres. Mais on oublie que de pareilles rixes ont toujours eu lieu pendant les grandes guerres, sans en influencer la durée. Aussi, toutes les dispositions prises, en ce moment, par le gouvernement allemand, prouvent-elles qu’il se prépare à de nouvelles agressions au retour du printemps. Mais comme il sait aussi qu’au printemps les Alliée lui opposeront de nouvelles armées, équipées d’un nouvel outillage, et d’une artillerie bien plus puissante qu’auparavant, il travaille aussi à semer la discorde au sein des populations alliées. Et il emploie, dans ce but, un moyen aussi vieux que la guerre elle-même : celui de répandre le bruit d’une paix prochaine, à laquelle il n’y aurait, chez les adversaires, que les militaires et les fournisseurs des armées pour s’y opposer. C’est à quoi s’est appliqué Bülow, avec ses secrétaires, pendant son dernier séjour en Suisse.
Mais à quelles conditions suggère-t-il de conclure la paix ?
La Neue Zuercher Zeitung croit savoir et le journal officiel, la Norddeutsche Zeitung, ne la contredit pas — que la plupart de la Belgique serait évacuée, rnais à condition de donner des gages de ne pas répéter ce qu’elle a. fait en août 1914, lorsqu’elle s’opposa au passage des troupes allemandes. Quels seraient ces gages ? Les mines de charbon belges ? Le Congo ? On ne le dit pas. Mais on demande déjà une forte contribution annuelle. Le territoire conquis en France serait restitué, ainsi que la partie de la Lorraine où on parle français. Mais, en échange, la France transférerait à l’État allemand tous les emprunts russes, dont la valeur se monte à dix-huit milliards. Autrement dit, une contribution de dix-huit milliards, qu’auraient à rembourser les travailleurs agricoles et industriels français, puisque ce sont eux qui paient les impôts. Dix-huit milliards, pour racheter dix départements, que, par leur travail, ils avaient rendus si riches et si opulents, et qu’on leur rendra ruinés et dévastés...
Quant à savoir ce que l’on pense en Allemagne des conditions de la paix, un fait est certain : la presse bourgeoise prépare la nation à l’idée de l’annexion pure et simple de la Belgique et des départements du Nord de la France. Et, il n’y a pas, en Allemagne, de force capable de s’y opposer. Les travailleurs, qui auraient dû élever leur voix contre les conquêtes, ne le font pas. Les ouvriers syndiqués, se laissent entraîner par la fièvre impérialiste, et le parti social-démocrate, trop faible pour influencer les décisions du gouvernement concernant la paix, même s’il représentait une masse compacte — se trouve divisé, sur cette question, en deux partis hostiles, et la majorité du parti marche avec le gouvernement. L’Empire allemand, sachant que ses armées sont, depuis dix-huit mois, à 90 kilomètres de Paris, et soutenu par le peuple allemand dans ses rêves de conquêtes nouvelles, ne voit pas pourquoi il ne profiterait pas des conquêtes déjà faites. Il se croit capable de dicter des conditions de paix qui lui permettraient d’employer les nouveaux milliards de contribution à de nouveaux armements, afin d’attaquer la France quand bon lui semblera, lui enlever ses colonies, ainsi que d’autres provinces, et de ne plus avoir à craindre sa résistance.
Parler de paix en ce moment, c’est faire précisément le jeu du parti ministériel allemand, de Bülow et de ses agents.
Pour notre part, nous nous refusons absolument à partager les illusions de quelques-uns de nos camarades, concernant les dispositions pacifiques de ceux qui dirigent les destinées de l’Allemagne. Nous préférons regarder le danger en face et chercher ce qu’il y a à faire pour y parer. Ignorer ce danger, serait l’augmenter.
En notre profonde conscience, l’agression allemande était une menace — mise à exécution — non seulement contre nos espoirs d’émancipation, mais contre toute l’évolution humaine. C’est pourquoi nous, anarchistes, nous antimilitaristes, nous, ennemis de la guerre, nous, partisans passionnés de la paix et de la fraternité des peuples, nous nous sommes rangés du côté de la résistance et nous n’avons pas cru devoir séparer notre sort de celui du reste de la population. Nous ne croyons pas nécessaire d’insister que nous aurions préféré voir cette population prendre, en ses propres mains, le soin de sa défense. Ceci ayant été impossible, il n’y avait qu’à subir ce qui ne pouvait être changé. Et, avec ceux qui luttent, nous estimons que, à moins que la population allemande, revenant à de plus saines notions de la justice et du droit, renonce enfin à servir plus longtemps d’instrument aux projets de domination politique pangermaniste, il ne peut être question de paix. Sans doute, malgré la guerre, malgré les meurtres, nous n’oublions pas que nous sommes internationalistes, que nous voulons l’union des peuples, la disparition des frontières. Et c’est parce que nous voulons la réconciliation des peuples, y compris le peuple allemand, que nous pensons qu’il faut résister à un agresseur qui représente l’anéantissement de tous nos espoirs d’affranchissement.
Parler de paix tant que le parti qui, pendant quarante-cinq ans, a fait de l’Europe un vaste camp retranché, est à même de dicter ses conditions, serait l’erreur la plus désastreuse que l’on puisse commettre. Résister et faire échouer ses plans, c’est préparer la voie à la population allemande restée saine et lui donner les moyens de se débarrasser de ce parti. Que nos camarades allemands comprennent que c’est la seule issue avantageuse aux deux côtés et nous sommes prêts à collaborer avec eux. » — 28 février 1916
Pressés par les événements de publier cette déclaration, lorsqu’elle fut communiquée à la presse française et étrangère, quinze camarades seulement, dont les noms suivent, en avaient approuvé le texte : Christian Cornelissen, Henri Fuss, Jean Grave, Jacques Guérin, Pierre Kropotkine, A. Laisant, F. Le Lève (Lorient), Charles Malato, Jules Moineau (Liège), Ant. Orfila (Husseindey, Algérie), M. Pierrot, Paul Reclus, Richard (Algérie), Ichikawa (Japon), W. Tcherkesoff.
Dès le mois d’avril 1916, afin de contrecarrer l’impression que venait de produire cette déclaration dans les milieux d’avant-garde et pour se situer vis-à-vis de ceux qui venaient d’adhérer à la Guerre du Droit en signant la déclaration dite des Seize, des militants réfugiés à Londres publièrent une protestation intitulée : « Déclaration anarchiste » et signée par le Groupe International Anarchiste, désavouant les Seize.
Cette déclaration était la suivante :
« Voici bientôt deux ans que s’est abattu sur l’Europe le plus terrible fléau qu’ait enregistré l’histoire, sans qu’aucune action efficace soit venue entraver sa marche. Oublieux des déclarations de naguère, la plupart des chefs des partis les plus avancés, y compris la plupart-des dirigeants des organisations ouvrières — les uns par lâcheté, les autres par manque de conviction, d’autres encore par intérêt — se sont laissé absorber par la propagande patriotique, militariste et guerriste, qui, dans chaque nation belligérante, s’est développée avec une intensité que suffisent à expliquer la situation et la nature de la période que nous traversons. Quant au peuple, dans sa grande masse, dont la mentalité est faite par l’école, l’église, le régiment, la presse, c’est-à-dire ignorant et crédule, dépourvu d’initiative, dressé à l’obéissance et résigné à subir la volonté des maîtres qu’il se donne, depuis celle du législateur, jusqu’à celle du secrétaire de syndicat, il a, sous la poussée des bergers d’en haut et d’en bas réconciliés dans la plus sinistre des besognes, marché sans rébellion à l’abattoir, entraînant, par la force de son inertie même les meilleurs parmi lui, qui n’évitaient la mort au poteau d’exécution qu’en risquant la mort sur le champ de carnage.
Toutefois, dès les premiers jours, dès avant la déclaration de guerre même, les anarchistes de tous les pays, belligérants ou neutres, sauf quelques rares exceptions, en nombre si infime, qu’on pouvait les considérer comme négligeables, prenaient nettement parti contre la guerre. Dès le début, certains des nôtres, héros et martyrs qu’on connaîtra plus tard, ont choisi d’être fusillés, plutôt que de participer à la tuerie ; d’autres expient dans les geôles impérialistes ou républicaines, le crime d’avoir protesté et tenté d’éveiller l’esprit du peuple.
Avant la fin de l’année 1914, les anarchistes lançaient un manifeste qui avait recueilli l’adhésion de camarades du monde entier, et que reproduisirent nos organes dans les pays où ils existaient encore. Ce manifeste montrait que la responsabilité de l’actuelle tragédie incombait à tous les gouvernants sans exception, et aux grands capitalistes, dont ils sont les mandataires, et que l’organisation capitaliste et la base autoritaire de la société sont les causes déterminantes de toute guerre. Et il venait dissiper l’équivoque créé par l’attitude de ces quelques « anarchistes guerristes », plus bruyants que nombreux, d’autant plus bruyants que, servant la cause du plus fort, leur ennemi d’hier, notre ennemi de toujours, l’État, il leur était permis, à, eux seuls, de s’exprimer ouvertement, librement.
Des mois passèrent, une année et demie s’écoula et ces renégats continuaient paisiblement, loin des tranchées, à exciter au meurtre stupide, et répugnant, lorsque, le mois dernier, un mouvement en faveur de la paix commençant à se préciser, les plus notoires d’entre eux, jugèrent devoir accomplir un acte retentissant, à la fois dans le dessein de contrecarrer cette tendance à imposer aux gouvernants la cessation des hostilités, et pour que l’on pût croire, et faire croire, que les anarchistes s’étaient ralliés à l’idée et au fait de la guerre.
Nous voulons parler de cette Déclaration publiée à Paris, dans La Bataille du 14 mars, signée de Christian Cornelissen, Henri Fuss, Jean Grave, Jacques Guérin, Hussein Bey, Pierre Kropotkine, A. Laisant, F. Le Levé, Charles Malato, Jules Moineaux, Ant. Orfila, M. Pierrot, Paul Reclus, Richard, S. Shikawa, W. Tcherkesoff, et à laquelle a applaudi, naturellement, la presse réactionnaire.
Il nous serait facile d’ironiser à propos de ces camarades d’hier, voire de nous indigner du rôle joué par eux, que l’âge, ou leur situation particulière, ou encore leur résidence, met à l’abri du fléau, et qui, cependant, avec une inconscience ou une cruauté que même certains conservateurs de l’ordre social actuel n’ont pas, osent écrire, alors que de tous côtés se sent la lassitude et pointe l’aspiration vers la paix, osent écrire, disons-nous, que « parler de paix à l’heure présente, serait l’erreur la plus désastreuse que l’on puisse commettre » et qui tranchent : « Avec ceux qui luttent, nous estimons qu’il ne peut être question de paix ». Or, nous savons, et ils n’ignorent pas non plus, ce que pensent « ceux qui luttent ». Nous savons ce que désirent « ceux qui vont mourir » pour mieux dire ; tout en ne nous dissimulant pas que les causes qui engendrent leur faiblesse, les entraîneront peut-être à mourir sans qu’ils aient tenté le geste qui les sauverait. Nous, nous laissons ces camarades d’hier à leurs nouvelles amours.
Mais, ce que nous voulons, ce à quoi nous tenons essentiellement, c’est protester contre la tentative qu’ils font, d’englober, dans l’orbite de leurs pauvres spéculations néo-étatistes, le mouvement anarchiste mondial et la philosophie anarchiste elle-même ; c’est protester contre leur essai de solidariser avec leur geste, aux yeux du public non éclairé, l’ensemble des anarchistes restée fidèles à un passé qu’ils n’ont aucune raison de renier, et qui croient, plus que jamais, à la vérité de leurs idées.
Les anarchistes n’ont pas de leaders, c’est-à-dire pas de meneurs. Au surplus, ce que nous venons affirmer ici, ce n’est pas seulement que ces seize signataires sont l’exception, et que nous sommes le nombre, ce qui n’a qu’une importance relative, mais bien que leur geste et leurs affirmations ne peuvent en rien se rattacher à notre doctrine dont ils sont, au contraire, la. négation absolue.
Ce n’est pas ici le lieu de détailler, phrase par-phrase, cette Déclaration, pour analyser et critiquer chacune de ses affirmations. D’ailleurs elle est connue.
Qu’y trouve-t-on ? Toutes les niaiseries nationalistes que noue lisons, depuis près de deux années, dans une presse prostituée, toutes les naïvetés patriotiques dont ils se gaussaient jadis, tous les clichés de politique extérieure avec lesquels les gouvernements endorment les peuples. Les voila dénonçant un impérialisme qu’ils ne découvrent maintenant que chez leurs adversaires. Comme s’ils étaient dans le secret des ministères, des chancelleries et, des états-majors, ils jonglent avec les chiffres d’indemnité, évaluent les forces militaires et refont, eux aussi, ces ex-contempteurs de l’idée de patrie, la carte du monde sur la base du « droit des peuples », et du « principe des nationalités »... Puis, ayant jugé dangereux de parler de paix, tant qu’on n’a pas, pour employer la formule d’usage, écrasé le seul militarisme prussien, ils préfèrent regarder le danger en face, loin des balles. Si nous considérons synthétiquement, plutôt, les idées qu’exprime leur Déclaration, nous constatons qu’il n’y a aucune différence entre la thèse qui y est soutenue, et le thème habituel des partis d’autorité groupés, dans chaque nation belligérante, en « Union Sacrée ». Eux aussi, ces anarchistes repentis, sont entrés dans 1’ « Union Sacrée », pour la défense des fameuses « libertés acquises », et ils ne trouvent rien de mieux, pour sauvegarder cette prétendue liberté des peuples, dont ils se font les champions, que d’obliger l’individu à se faire assassin et à se faire assassiner pour le compte et au bénéfice de l’État. En réalité, cette Déclaration n’est pas l’oeuvre d’anarchistes. Elle fut écrite, par des étatistes qui l’ignorent, mais par des étatistes. Et rien, par cette œuvre inutilement opportuniste, ne différencie plus ces ex-camarades des politiciens, des moralistes et des philosophes de gouvernement, à la lutte contre lesquels ils avaient voué leur vie.
Collaborer avec un État, avec un gouvernement, dans sa lutte, fût-elle même dépourvue de violence sanguinaire, contre un autre État, contre un autre gouvernement, choisir entre deux modes d’esclavage, qui ne sont que superficiellement différents, cette différence superficielle étant le résultat de l’adaptation des moyens de gouvernement à l’état d’Evolution auquel est parvenu le peuple qui y est soumis, voilà, certes, qui n’est pas anarchiste. A plus forte raison, lorsque cette lutte revêt l’aspect particulièrement ignoble de la guerre. Ce qui a toujours différencié l’anarchiste des autres éléments sociaux dispersés dans les divers partis politiques, dans les diverses écoles philosophiques ou sociologiques, c’est la répudiation de l’État, faisceau de tous les instruments de domination, centre de toute tyrannie ; l’État qui est, par sa destination, l’ennemi de l’individu,, pour le triomphe de qui l’anarchisme a toujours combattu, et dont il est fait si bon marché dans la période actuelle, par les défenseurs du « Droit » également situés, ne l’oublions pas, de chaque côté de la frontière. En s’incorporant à lui, volontairement, les signataires de la Déclaration ont, en même temps, renié l’anarchisme.
Nous autres, qui avons conscience d’être demeurés dans la ligne droite d’un anarchisme dont la vérité ne peut avoir changé du fait de cette guerre, guerre prévue depuis longtemps, et qui n’est que la manifestation suprême de ces maux que sont l’État et le Capitalisme, nous tenons à nous désolidariser d’avec ces ex-camarades, qui ont abandonné leurs idées, nos idées, dans une circonstance où, plus que jamais, il était nécessaire de les proclamer haut et ferme.
Producteurs de la richesse sociale, prolétaires manuels et intellectuels, hommes de mentalité affranchie, nous sommes, de fait et de volonté, des « sans patrie ». D’ailleurs, patrie, n’est que le nom poétique de l’État. N’ayant rien a défendre, pas même des « libertés acquises » que ne saurait nous donner l’État, nous répudions l’hypocrite distinguo des guerres offensives et des guerres défensives. Nous ne connaissons que des guerres faites entre gouvernants, entre capitalistes, au prix de la vie, de la douleur et de la misère de leurs sujets. La guerre actuelle en est l’exemple frappant. Tant que les peuples ne voudront pas procéder à l’instauration d’une société libertaire et communiste, la paix ne sera que la trêve employée a préparer la guerre suivante, la guerre entre peuples étant en puissance dans les principes d’autorité et de propriété. Le seul moyen de mettre fin à la guerre, de prévenir toute guerre, c’est la révolution expropriatrice, la guerre sociale, la seule à laquelle nous puissions, anarchistes, donner notre vie. Et ce que n’ont pu dire les seize à la fin de leur Déclaration, nous le crions : Vive l’Anarchie !... — le groupe anarchiste international de londres. (Avril 1916.) »
D’autre part, dans un numéro de Freedom (avril 1916), Malatesta protesta personnellement contre les affirmations des Seize. Voici son article, intitulé « Anarchistes partisans du Gouvernement » :
« Un manifeste vient de paraître, signé par Kropotkine, Grave, Malato et une douzaine d’autres vieux camarades, dans lequel, se faisant l’écho des gouvernements de l’Entente, qui demandent la lutte à outrance et jusqu’à l’écrasement de l’Allemagne, ils ont pris position contre l’idée d’une « paix prématurée ». La presse capitaliste publie, avec une naturelle satisfaction, des extraits du manifeste, et annonce que c’est le travail des « dirigeants du mouvement anarchiste international ». Les anarchistes, presque tous restés fidèles à leurs convictions, se doivent de protester contre l’essai d’impliquer l’anarchisme dans la continuation d’une féroce boucherie, qui n’a jamais promis de bénéfice à la cause de la Justice et de la Liberté et qui, maintenant, se montre absolument stérile et sans résultat, même du point de vue des gouvernants, quel que soit le côté de la barricade qu’ils occupent.
La bonne foi et les bonnes intentions de ceux qui ont signé le Manifeste sont en dehors de toute question. Mais, si pénible qu’il soit d’incommoder de vieux amis qui ont rendu tant de services à la cause qui, dans le passé, nous fut commune, on ne peut, — au point de vue de la sincérité, et dans l’intérêt de notre mouvement d’émancipation — omettre de se séparer de camarades qui se considèrent capables de réconcilier les idées anarchistes et la collaboration avec les gouvernements et la classe capitaliste de certains pays, dans leur lutte contre les capitalistes et les gouvernants de certains autres pays.
Durant la guerre actuelle, nous avons vu des républicains se plaçant au service des rois, des socialistes faisant cause commune avec la classe dirigeante, des travaillistes servant les intérêts des capitalistes ; mais, en réalité, tous ces gens sont, a des degrés variables, des conservateurs, croyant en la mission de l’État, et leur hésitation peut se comprendre quand l’unique remède réside dans la destruction de chaque entrave gouvernementale et le déchaînement de la Révolution Sociale. Mais cette hésitation est incompréhensible dans le cas des anarchistes. Nous prétendons que l’État est incapable de tout bien. Tant au point de vue international qu’au point de vue des relations individuelles, il ne peut combattre l’agression qu’en se faisant lui-même l’agresseur ; il ne peut empêcher le crime qu’en organisant et en commettant de plus grands crimes encore. Même dans l’hypothèse — qui est loin d’être la vérité — que l’Allemagne serait seule responsable de la présente guerre, il est prouvé que si l’on s’en tient aux méthodes gouvernementales, on ne peut résister a l’Allemagne, qu’en supprimant toute liberté et. en ressuscitant la, puissance de toute les forces de la réaction.
Sauf la Révolution populaire, il n’y a pas d’autre voie de résistance à la menace d’une armée disciplinée, qu’en ayant une armée plus forte et plus disciplinée, de sorte que les plus rigides antimilitaristes, s’ils ne sont anarchistes, et s’ils sont effrayés de la destruction de l’État, sont inévitablement, conduits a devenir d’ardents militaristes. En fait, dans l’espoir problématique d’écraser le militarisme prussien, ils ont renoncé à tout l’esprit et, à toutes les traditions de la liberté, ils ont prussianisé l’Angleterre et la France ; ils se sont soumis au tsarisme ; ils ont restauré le prestige du trône chancelant d’Italie.
Des anarchistes peuvent-ils, un seul instant, accepter cet état de choses, sans renoncer a tout droit de s’intituler anarchistes ? Quant à moi, même la domination étrangère imposée par la force et menant à la révolte, est préférable a l’oppression intérieure acceptée humblement, presque avec reconnaissance, dans l’espoir que, par ce moyen, nous serons préservés d’un plus grand mal. I1 est vain de prétendre, comme le font les rédacteurs et signataires du Manifeste en question, que leur position est déterminée par des événements exceptionnels et que, la guerre une fois terminée, chacun retournera, dans son camp et combattra pour son propre idéal. Car, s’il est nécessaire, actuellement de travailler en harmonie avec le gouvernement et le capitalisme, pour se défendre contre « la menace germanique », ceci sera aussi nécessaire après que pendant la guerre. Quelque grande que puisse être la défaite de l’armée allemande — s’il est vrai qu’elle sera battue — il ne sera jamais possible d’empêcher les patriotes allemands de songer à la revanche et de la préparer ; et les patriotes des autres contrées, très raisonnablement, de leur propre point de vue, désireront se tenir prêts, de façon à ne plus être pris au dépourvu. Ceci signifie que le militarisme prussien deviendra une institution permanente et régulière dans tous les pays. Que diront alors les prétendus anarchistes qui, actuellement, désirent la victoire d’une des alliances en guerre ? S’intitulant antimilitaristes, iront-ils prêcher le désarmement, le refus du service militaire, et le sabotage de la défense nationale, uniquement pour devenir, au premier soupçon de guerre, des sergents recruteurs pour les gouvernements qu’ils auront essayé de désarmer et de paralyser ?
On dit que ces choses prendront fin, quand le peuple allemand se sera débarrassé de ses tyrans et aura cessé d’être une menace pour l’Europe, par la destruction du militarisme dans sa patrie. Mais si cela est, les allemands qui pensent, à bon droit, que la domination anglaise et française (pour ne pas parler de la Russie tsariste) ne sera pas plus agréable aux allemands que la domination germanique aux français et aux anglais, désireront d’abord attendre que les russes et les autres détruisent leur propre militarisme et voudront, entre temps, continuer à accroître leur armée. Et alors ? Pendant combien de temps faudra-t-il ajourner la Révolution ? Et l’Anarchie ? Devons-nous attendre éternellement que les autres commencent ?
La ligne de conduite des anarchistes est clairement indiquée par l’implacable logique de leurs aspirations.
La guerre aurait dû être empêchée par la Révolution, ou, du moins, en la faisant craindre par les gouvernements. La. force ou l’habileté nécessaires ont fait défaut. La paix doit être imposée par la Révolution, ou, du moins, en essayant de la faire. Actuellement, la force et l’habileté manquent.
Eh bien ! Il n’y a qu’un remède : faire mieux a l’avenir. Plus que jamais nous devons éviter tout compromis, approfondir l’abîme entre les capitalistes et les esclaves salariés, entre les gouvernants et les gouvernés ; prêcher l’expropriation de la propriété privée, et la destruction de l’État, qui sont les seuls moyens pour garantir la fraternité entre les peuples, et la Justice et la Liberté pour tous. Et nous devons nous préparer à accomplir ces choses. Entre temps, il me semble criminel de faire quoi que ce soit qui tende a prolonger la guerre qui assassine des hommes, détruit les richesses et, empêche la résurrection de la lutte pour l’émancipation. I1 me semble que prêcher « la guerre jusqu’au bout », c’est faire, en vérité, le jeu des gouvernants allemands qui trompent leurs sujets et enflamment leur ardeur à la lutte en les persuadant que leurs adversaires désirent écraser et asservir le peuple germanique.
Actuellement, comme toujours, que ceci soit notre devise : « À bas les capitalistes et les gouvernements, tous les capitalistes et tous les gouvernements ! ». Et, vivent les peuples, tous les peuples !...
Errico Malatesta. »
Un peu partout, c’est-à-dire dans les pays où le mouvement anarchiste comptait un certain nombre de militants, des protestations — la plupart indignées et violentes, — s’élevèrent contre la position prise par les signataires du Manifeste des Seize. En France, dès le mois d’octobre 1914, Sébastien Faure prit nettement, et sans attendre, position contre la guerre. Il publia un manifeste ayant pour titre : « Vers la Paix ». Il en publia un autre, intitulé : « La trêve des Peuples », en juillet 1915. Tirés à un grand nombre d’exemplaires, ces tracts antiguerriers furent répandus et distribués jusque sur le front des armées. En mars 1916, c’est par Sébastien Faure et quelques autres anarchistes que fut fondé le premier journal qui, en pleine guerre, se prononça ouvertement contre la continuation des hostilités et réclama énergiquement la cessation immédiate de l’état de guerre. Ce journal, hebdomadaire : « Ce qu’il faut dire » (tel était son titre), était administré, dirigé et rédigé par Sébastien Faure, secondé par un grand nombre de collaborateurs et d’amis, entre autres Trivier, Mauricius et Génold. Dès le premier numéro de « Ce qu’il faut dire », Sébastien Faure tenta de publier une réplique vigoureuse et véhémente au Manifeste des Seize. Mais la censure en empêcha la publication sous la menace de l’interdiction définitive du journal. Pas une ligne de cette réplique, — sorte de contre-manifeste revêtu d’un nombre respectable de signatures — ne put être publiée. Il va de soi que, tandis que la presse tout entière avait offert l’hospitalité de ses colonnes au Manifeste des Seize, aucun journal n’avait voulu accueillir cette réplique, ni même en souffler mot. De leur côté, Pierre Martin, Lecoin, Ruff et quelques autres compagnons publièrent clandestinement des numéros spéciaux du journal Le Libertaire, ainsi que des tracts, dans lesquels ces anarchistes, restés irréductiblement fidèles à la pensée et à l’action libertaires, vitupéraient la guerre et s’élevaient avec violence contre l’attitude des anarchistes auteurs ou signataires dit Manifeste des Seize.
Ce qui s’est passé en France s’est produit — plus ou moins fortement — dans les autres pays. Mais, ici comme là, Gouvernement, chefs militaires, censeurs et journalistes firent leur possible — et ce possible fut presque illimité — pour étouffer la voix anarchiste clamant, seule ou a peu près seule, sa haine de la guerre et exigeant le retour à la Paix.
Ces choses doivent être consignées ici, non seulement parce qu’elles sont conformes a la vérité, mais encore parce qu’elles infligent un démenti catégorique aux partis politique et aux organisations ouvrières qui se disent d’avant-garde, révolutionnaires et pacifistes, et qui, lors de la guerre infâme de 1914–1918, ayant failli — tel le parti socialiste et le syndicalisme — au mandat dont ils étaient investis, s’essaient a justifier leur trahison par l’attitude des rédacteurs duManifeste des Seize, qu’ils étendent collectivement, bien à tort on le voit, aux milieux anarchistes.
La guerre prit fin, et il semblait qu’une fois le conflit terminé, les choses se seraient tassées comme on dit, que la reconnaissance d’une erreur momentanée aurait mis un terme aux animosités nées à la suite d’articles et de mises au point publiées dès la parution de la Déclaration. Mais il y a des vanités et des entêtements que ne peut désarmer aucune considération.
En effet, Jean Grave, dans La Bataille Syndicaliste, où il publiait assez régulièrement ses papiers, écrivait, dans le numéro 358, dans un article intitulé : « De quel côté se trouve l’incohérence ? » :
« Si les anarchistes avaient été en nombre suffisant dans le refus de se laisser mobiliser, pour troubler la défense, c’est contre eux que se serait tournée la colère populaire ; la population, ne voulant voir en eux que des agents de l’agresseur, aurait applaudi à leur exécution. Et, dans le conflit, de l’issue duquel dépend le sort de l’humanité, je suis, en ma profonde conscience, forcé de dire qu’ils n’auraient eu que le traitement qu’ils méritaient. »
Avouez qu’il y a là un abîme entre ces pensées et celles qu’il écrivit jadis dans « La Société Mourante et l’Anarchie », où il s’exprimait de la sorte :
« Mais, pourtant, si vous avez commis l’imprudence de revêtir l’uniforme et qu’un jour vous vous trouviez dans cette situation de ne pouvoir vous contenir sous l’indignation... n’insultez ni ne frappez vos supérieurs... crevez-leur la peau, vous n’en paierez pas davantage. »
Et encore :
« Il n’y a pas de patrie pour l’homme vraiment digne de ce nom ou, du moins, il n’y en a qu’une ; c’est celle où il lutte pour le bon droit, celle où il vit, où il a ses affections, mais elle peut s’étendre à toute la terre... Quant à vos patries de convention, les travailleurs n’y ont aucun intérêt, ils n’ont rien a y défendre. »
De quel côté se trouve l’incohérence ? Le lecteur en jugera.
Sans doute, la guerre terminée, il valait mieux s’expliquer une bonne fois, prendre chacun ses responsabilités, se situer, ce qui fut fait, et ainsi rebondissait le problème de l’attitude des anarchistes en cas de guerre, qu’avait soulevé le Manifeste des Seize. Si, encore, cette polémique s’était déroulée en toute loyauté et à l’ombre de la tolérance réciproque, elle aurait pu aider à reconstruire l’entente. Mais chacun s’en donna à cœur joie, et l’on assista à un beau lavage de linge sale, le tout agrémenté d’épithètes plus ou moins désobligeantes, voire même parfois perfides. L’abîme s’ouvrait sans espoir de réconciliation, séparant à tout jamais des camarades, qui avaient donné, les uns comme les autres, dans des sphères différentes, avec leur tempérament, leurs connaissances et leur travail, toute une vie à un idéal commun.
Les signataires du Manifeste des Seize, tenus moralement à se situer, voulurent « remettre ça » et jusqu’au bout défendre ce que des circonstances exceptionnelles les avaient déterminés à signer.
Jean Grave, le promoteur de la Déclaration fut le premier à en reparler et, défendant son point de vue, il récidiva dans sa façon de voir, en un exposé précis et net, qui ne permettait point de se faire la moindre illusion, sur la façon dont il concevait cette question. Voici un écrit de Jean Grave, daté de Robinson, du 26 septembre 1922, où, répondant à un blessé de guerre qui lui reprochait, d’après ouï-dire, d’avoir renié ses convictions, il s’explique et tente de justifier son attitude :
« Vous me demandez de vous donner les raisons qui ont motivé mon attitude pendant la guerre ? Pendant les cinq ans qu’elle a duré, je n’ai fait que celà dans « La Bataille ». Vous devez comprendre que je ne puis passer mon temps à recommencer. J’ai bien d’autres chiens à peigner. « À mes camarades » n’est pas un essai de justification de ma conduite comme vous le traduisez, mais une réponse à certains imbéciles qui s’étaient fait l’écho de calomnies contre moi. Il y a là, une différence.
« D’autre part, j’ai la conviction que, contrairement à ce que vous affirmez si arbitrairement, je n’ai jamais donné de démenti à aucune de mes convictions, de n’avoir jamais agi autrement qu’en anarchiste. Jusqu’à la déclaration de la guerre, moi et mes camarades, nous avons combattu le militarisme, les armements absurdes, les mesures imbéciles qui ne pouvaient avoir qu’une issue : la guerre monstrueuse qu’il fallait éviter à tout prix. Oui, jusqu’au bout nous avons essayé de faire comprendre à la population qu’elle n’avait rien à gagner à la guerre, mais, au contraire tout à y perdre. Sans aucune vanité, mes camarades et moi, nous pouvons nous vanter d’avoir mené cette campagne mieux que qui ce soit, même de ceux qui ont tant l’air de faire les dégoûtés aujourd’hui.
Si nous avions été écoutés, la guerre aurait été rendue impossible. Le seul tort que nous eûmes fut de toujours discuter au point de vue abstrait, de ne pas avoir su envisager les cas particuliers, et, aussi d’avoir raisonné comme si les anarchistes devaient être maîtres des événements. Or, ce qui est vrai. au point de vue abstrait, ne l’est pas toujours en certains cas particuliers. C’est ce que vinrent nous démontrer les faits, lorsque nous nous trouvâmes en face d’eux. La victoire du militarisme aurait été, pour un siècle au moins, la mort de toute idée d’émancipation par toute l’Europe, un recul certain de l’évolution humaine, Cela, pour moi et mes co-signataires, était indéniable. Que pour justifier leur façon de voir, d’aucuns le nient ne supprime pas le fait.
Au point de vue abstrait, on peut encore affirmer, sans beaucoup se tromper que, au point de vue de la liberté absolue, un gouvernement vaut l’autre. Dans la pratique cependant, il faut bien admettre que sous certains gouvernements, au prix de quelques mois de prison, de quelques tracasseries, la propagande de nos idées est possible, tandis qu’elle est peut-être rendue impossible sous d’autres. Sous prétexte que nous ne voulons aucun gouvernement, faut-il en conclure que s’il se présentait une tentative de nous imposer un régime comme celui du tsarisme par exemple, les anarchistes devraient se croiser les bras et laisser faire ?
Certains extrémistes seront pour l’affirmative. Mais leur opinion ne prouvera qu’une chose : qu’ils sont des imbéciles. On ne parvient à augmenter la somme de liberté dont on jouit, qu’à condition de savoir défendre celles qu’on possède déjà. C’était ce que signifiait la victoire du pangermanisme. C’est très bien de ne pas vouloir se battre ; mais si un butor vous tombe dessus, allez-vous tendre le dos ? Cela est bon pour un Tolstoïen, mais les révolutionnaires, que je sache, n’ont jamais prêché la non-résistance au mal.
Nous avions tenté de rendre la guerre impossible. Nous n’avions pas été écoutés. La guerre avait fondu sur nous. Des régions entières étaient livrées a l’envahisseur, qui fusillait, pillait, volait, maltraitait les populations ; j’aurais voulu y voir ces partisans de la non-résistance... S’ils persistent à me dire qu’en agissant ainsi, ils agissaient en anarchistes, en révolutionnaires, je leur réponds qu’ils agissaient en Jean-foutre.
Il serait temps d’en finir avec ces façons aristocratiques de certains anarchistes, de se croire bien au-dessus du reste de la population. I1 est faux que l’on puisse se détacher d’elle, se désintéresser de ce qui lui arrive. Ce qui la frappe nous frappe, ce qui. l’avilit nous avilit. Et si tout l’égoïsme des non-résistants ne frappe pas tout d’abord, c’est que ce raisonnement — resté, du reste, purement théorique — était tenu loin des régions ou les populations étaient molestées par l’envahisseur.
.................................................................................................................
Vous me demandez quelle serait ma conduite, si une nouvelle guerre se produisait ? Et vous, quelle serait la vôtre ? Vous n’en savez rien, ni moi non plus. En principe, avant comme après, je suis contre tous les militarismes, contre toutes les guerres ; si elle était encore possible, je suis convaincu que nos tristes gouvernants s’emploient de leur mieux à l’amener. Heureusement, a mon avis du moins, la dernière a été assez atroce pour que les peuples en soient purgés une bonne fois pour toutes, et que, malgré l’imbécillité des gouvernants, elle soit impossible. Mais si la menace plane encore une fois sur nos têtes, si nos gouvernants agissent si criminellement, à qui la faute ?Au lendemain de la guerre, si quelqu’un avait le droit de parler et avait, quelque chance d’être écouté, s’ils avaient su parler fermement, c’étaient ceux qui avaient combattu, qui avaient risqué leur vie, leur santé. On leur avait dit que c’était pour la fin des militarismes, pour la fin des guerres qu’ils se battaient. Pourquoi n’ont-ils pas su exiger la réalisation des promesses faites, alors que la foule était encore pleine de leurs louanges ?
Qu’ont-ils fait pour que la somme d’efforts qu’ils avaient dépensée, ne le fût pas en pure perte ? Rien. Une fois la guerre finie, chacun est rentré chez soi, et n’a pensé qu’à rester tranquille. Ah si ! On a formé des associations d’anciens combattants. Les uns sont nationalistes, réactionnaires, n’en parlons pas. D’autres sont « avancées », on a fait de la déclamation, du socialisme littéraire, du révolutionnarisme verbal, rien de pratique. Pendant cela, le monde politique tripote, vole, ruine, affame la population, pour le plus grand profit des mercantis. Qui s’en préoccupe ? Qu’il y ait des excuses, qui en doute ? Il y a l’ignorance, il y a la fatigue, les chefs de familles, les difficultés de l’existence. Il y a, surtout, que la guerre a accompli son œuvre de démoralisation. Seulement, tout cela ne justifie pas ceux qui ne surent pas mieux faire que de venir aboyer aux talons de ceux qui ne firent qu’agir selon leur conscience, et surtout voir plus clair que ceux qui ferment les yeux devant les faits, pour s’enfermer dans les formules et les dogmes. »
A côté de Jean Grave, quatorze principaux signataires avaient à se prononcer, vu que la question venait d’être soulevée à nouveau. Parmi eux, plusieurs étaient morts : Kropotkine, Guérin, Laisant, Tcherkesoff. Voici ce qu’écrivait Paul Reclus, l’un des signataires de la Déclaration, en juillet 1928, sous le titre : « Dans la Mêlée » :
« C’est en février 1916 que parut une déclaration, au bas de laquelle figurait mon nom, parmi quinze signataires, alors dispersés en France, en Algérie et en Angleterre. Les circonstances ne se prêtaient guère à un échange de vues sur les termes qu’il convenait d’employer. Ma signature voulait simplement dire : « En juillet 1914, j’ai pris parti sans hésitation ; Je suis entré dans la « mêlée ». C’est une façon de parler ; j’avais alors 56 ans ; chassé de Belgique par l’invasion, j’ai trouvé du travail n’importe où, et finalement dans l’industrie travaillant pour la guerre. Et il est délicat, les pieds sur les chenêts, de parler à ceux qui ont les pieds dans le sang. J’avais de chers amis au premier rang. Entre eux, ma pensée se porte toujours sur R. L., bon parmi les bons, courageux parmi les courageux, clairvoyant parmi, les clairvoyants. Il fut tué au début de 1918. Je n’ai jamais rien écrit, ni pensé que je ne lui eusse dit : « J’ai confiance que des dévouements surgiront et lutteront partout et toujours ».
La guerre, par sa prolongation, a déclenché la révolution russe puis, ultérieurement, a provoqué la disparition de deux empereurs de la scène du monde ; en exposant mes sentiments de juillet 1914, je n’ai pourtant pas à faire entrer ces événements en ligne de compte. Alors, c’est inconditionnellement que ma décision fut prise et je n’ai pas à me glorifier de ses conséquences heureuses que je n’avais pas espérées. Mon sentiment dominant a été, l’insurrection contre le militarisme ; toutes les vingt nations de l’Europe étaient, armées jusqu’aux dents, mais c’est un fait que l’armée allemande donnait le ton. Elle était la perfection des perfections, et les vingt, armées des alentours obéissaient implicitement au grand état-major de Berlin ; toutes les initiatives prises par De Molkte se répercutaient immédiatement dans vingt sens. La propagande antimilitariste, faite ça et là, en France, en Italie, en Suisse, n’éveillait aucun écho en Allemagne et ne pesait pas un fétu, comparée au colosse qui grandissait, sans cesse. Non seulement l’armée perfectionnait son organisation scientifique, mais partout, dans l’industrie, dans le commerce, dans la science, se plaçait un caporal auprès de quatre hommes, et cette hiérarchisation trouvait des admirateurs de plus en plus nombreux, aux quatre coins du globe. C’est contre cette caporalisation générale que je me suis insurgé.
Évidemment, nous nous sommes trouvés du même côté de la barricade que les patriotes et que le tzar... et après ? Dans quelles circonstances antérieures les révolutionnaires « purs » ont-ils marché sans l’aide des gens d’idées toutes différentes ? J’ai vu la Commune. Combien nombreux étaient ceux que guidait un idéal social à côté de ceux qui avaient pris les armes par indignation patriotique contre le gouvernement de la « défense nationale » ? Combien de Varlin pour combien de Rossel ? Et, trente ans plus tard, pourquoi les anarchistes se sont-ils exposés aux coups, pour prêter main forte aux Scheurer-Kestner, aux Clemenceau et aux Zola, en faveur d’un bourgeois emprisonné ? Jamais, avant 1914, je n’avais entendu dire qu’il fallait réserver son action au cas où nous, anarchistes, serions les seuls à vouloir arracher une concession aux adversaires ; et même, au moment critique, aucun camarade, que je sache, n’a fait entendre sa voix dans ce sens. Mon sentiment est exactement contraire ; un conflit quelconque surgit-il, la moindre idée humaine est-elle en jeu ; y a-t-il une infime chance qu’il en jaillisse un atome de progrès, il n’y a pas à reculer devant l’énormité de la tâche. Il faut se jeter de toutes ses forces au secours de la fraction qui représente la conception la plus élevée. Je m’élève contre la prétention que sans nous, les forces en jeu feront jaillir le Bien de l’excès du Mal, autrement dit qu’inéluctablement le bien viendra tout seul. Naturellement, tout dépend de l’idée que l’on se fait du progrès ; j’admets parfaitement que, vu de Sirius, un peu plus ou un peu moins de souffrance sur terre importe fort peu, qu’il est indifférent que tel peuple vive sous une dictature, tel autre sous une oligarchie de capitalistes, et tel autre sous la botte de militaires parlant une autre langue ; que les prisons soient plus ou moins pleines, que la misère soit plus ou moins profonde. Mais moi, je suis d’un autre avis, je crois au bénéfice des petites améliorations arrachées aux dirigeants, en attendant les grands progrès. Et, de 1914 à 1928, je vois un changement heureux dans la situation générale.
Qu’avons-nous donc gagné ? Que c’est nous, la France, qui, maintenant, sommes la nation militariste de l’Europe : le militarisme est entre nos mains. Ce n’est plus une idole lointaine et inaccessible, elle dépend aujourd’hui de notre action directe. Certes, le sentiment public ne s’est pas encore mis en mouvement à cet égard, mais reconnaissons du moins que l’opinion n’est pas militariste par principe ; ce n’est plus qu’une question d’opportunité pour la majorité des français. Je n’accorde pas aux militaristes une génération de survivance. C’est un signe des temps que les nations Scandinaves discutent de la suppression pure et simple de leur armée.
..................................................................................................................
Revenons à la guerre de 1914. La responsabilité de son déclenchement ne repose pas sur les épaules d’un seul homme, ni d’un demi-quarteron de gouvernants, ni sur le capitalisme seul qui s’accommodait fort bien d’une paix armée. La responsabilité de la guerre repose sur 1a notion mystique de l’honneur de l’armée, et ceci est bien mort maintenant. Les empereurs y croyaient et cela ne leur a pas porté bonheur ; les militaires français en étaient moins imbus (après l’affaire Dreyfus) et les événements leur ont enseigné une modestie supplémentaire. Oui, les signataires de la Déclaration de 1916 se sont trouvés avoir d’étranges alliés ; mais, regardant en moi-même, je puis dire que les sentiments « patriotiques » ne jouèrent aucun rôle dans ma détermination. Je ne discute pas la légitimité de ces sentiments, mais ayant vécu plus de 25 ans de ma vie en divers pays étrangers, et cela sans souffrances particulières, je puis dire que ma patrie est partout où se trouvent des hommes de cœur et d’intelligence, des camarades et des amis.
En opposition aux idées exprimées ici, celles des Tolstoïens sont absolument logiques et aucune critique ne peut leur être adressée non plus qu’aux bourgeois pacifistes, qui ignorent ou nient la question sociale. Comme eux, je sais que la violence n’est jamais une solution ; la violence contre les personnes, s’entend, car le renversement brutal des institutions, que tout le inonde reconnaît être surannées n’en sera pas moins indispensable, et il n’y a pas deux genres de violence, une violence hideuse, la guerre, une violence joyeuse, la révolution. Elles ne se séparent point, toujours hideuses, parfois inévitables. Elles se confondent souvent : 1789–92 a amené 1793–94 ; au contraire, 1870 a eu la Commune pour suite ; 1914 a eu pour conséquence 1917 en Russie et les situations révolutionnaires de 1920, en différente pays.
Frapper pour se défendre, c’est tout de même frapper. L’évolution consiste à savoir pourquoi on se bat, à savoir où il faut frapper et ce qu’il faut faire après avoir frappé. »
Philippe Richard, ne voulant point user trop sa plume ou noircir trop de papier, se contentait d’écrire :
« D’accord avec les déclarations ci-dessus exprimées. »
(Il s’agissait des déclarations de Paul Reclus.) Tandis que Charles Malato, dans une courte lettre adressée à Paul Reclus, déclarait toujours siennes les idées exprimées dans l’article de son correspondant. Profitant en quelque sorte d’un compte rendu resté sur le marbre, d’un ouvrage de l’écrivain français Julien Benda, « La Trahison des Clercs », M. Pierrot trouva le moyen de montrer pourquoi il a été un des signataires du Manifeste des Seize :
« ...Il ne s’agit pas de rester neutres. Mais la lutte sociale ne doit pas nous aveugler et nous faire perdre de vue le but, qui est la suppression des classes, et la libération de l’humanité tout entière. Les anarchistes reprochent aux bolchevistes, non d’avoir abattu l’autorité, mais de l’avoir restaurée à leur profit. Toute dictature est intolérable.
Pendant la guerre de 1914, le point de vue vraiment humain n’avait rien de commun avec le point de vue de Romain Rolland, car le point de vue humain est non pas de rester neutres, mais de savoir prendre parti. Ce n’était pas non plus le point de vue marxiste, qui fut de nier la valeur morale et de s’enfermer dans le fanatisme étroit des intérêts matériels. Bon nombre d’anarchistes ont rejoint les marxistes, oubliant que le plus humain est le point de vue moral et que le progrès humain est dans le sens de la liberté.
..................................................................................................................
L’esprit de corps, l’esprit de classe, le nationalisme naissent d’une réaction contre le sentiment d’infériorité qui apparaît aux hommes comme un sentiment insupportable. Ceux-ci reportent la supériorité qui leur manque individuellement, sur le groupe dont ils font partie ; le nationalisme consiste à considérer sa propre patrie comme beaucoup au-dessus des autres, même quand elle a tort. Si une morale semblable scelle et cimente les intérêts du groupe, c’est au dépend de l’évolution humaine, car elle aboutit à l’égoïsme et à l’esprit de domination. Toute atteinte à la supériorité de l’individu ou du groupe, autrement dit : toute mise en état d’infériorité est considérée comme un crime, comme un sacrilège. L’offense ne saurait se compenser par l’équité. Elle réclame la mise en infériorité de l’adversaire, autrement dit : son humiliation. La vengeance est un sentiment de satisfaction, qui s’exerce par des représailles. Même en dehors de toute réaction à une offense quelconque, en dehors de tout esprit de vengeance, un parti, quel qu’il soit, tend vers la domination. S’il a des intérêts à défendre, il aspire à la dictature. Peu à peu, l’idéal passe au second plan. Le parti n’agit plus que pour le triomphe, c’est-à-dire pour hisser ses chefs au pouvoir, et pour caser ses parasites.
Certains anarchistes s’imaginent détenir la vérité. Ils l’enchâssent dans une formule simpliste, et ils prétendent l’imposer aux autres. Ils deviennent les propres esclaves de leurs formules fossilisées, et font figure de fanatiques... L’amélioration morale sera de refouler l’esprit de vengeance, et la passion de domination. Domination exprime mieux que le mot « autorité » le principe contre lequel s’élève toute la morale anarchiste.
La réponse de Christian Cornélissen devait soulever cette question plus précise et plus nette : les devoirs des révolutionnaires et la guerre de 1914–1918. C’est sous ce titre, d’ailleurs, que, en août 1928, il s’expliquait :
« ...Comme révolutionnaires et internationalistes, nous n’avions pas le droit de croiser nos bras, et de laisser écraser la République Française, et la Démocratie occidentale, par les hobereaux prussiens. Nous noue sommes appelés des révolutionnaires, et comme tels nous avions le devoir, non seulement de défendre l’Avenir contre le Présent, mais aussi de défendre les acquisitions du Présent contre le Passé. Il n’y avait doute chez aucun de nous, internationalistes, que la civilisation européenne et mondiale subirait une régression de plus d’un siècle, et reviendrait à l’ancien régime de 1789, si l’Allemagne remportait la victoire. La France écrasée, l’Allemagne impérialiste aurait commencé la guerre sous-marine contre l’Angleterre. Puis c’eût été le tour des États-Unis : les Américaine l’ont bien compris. Ce n’était même pas l’empereur Guillaume II qui dirigeait la guerre déclenchée par lui : c’était la caste des hobereaux militaristes, qui rêvait d’une hégémonie allemande dans l’Europe et dans le monde entier.
Certes, nous assistons maintenant aussi à une réaction sociale. Notamment dans les pays vainqueurs. Comment aurait-il pu en être autrement, après une guerre mondiale, qui dura quatre ans ? Cependant, vingt-six dynasties balayées d’un seul coup en Allemagne, l’Autriche délivrée de son empereur, de même que la Russie de son régime autocratique, constituent autant de progrès indéniables pour l’humanité. A ces progrès politiques, il faut ajouter les réformes agraires, le morcellement des grandes propriétés seigneuriales, dans tous les pays de l’Europe centrale et orientale, aussi bien en Allemagne et en Autriche, que dans les Balkans et en Russie. La guerre mondiale a même eu ses répercussions jusque sur la révolution chinoise.
D’autre part, la réaction politique et sociale en Angleterre, en France et aux États-Unis, est certainement moins forte qu’elle aurait été dans le monde entier, après une victoire de l’ancien régime. Cette réaction est la plus efficace en Italie. Dans tous les cas, même si une nouvelle guerre éclatait, l’extrême gauche du mouvement ouvrier ne pourrait pas, à mon avis, agir autrement que les révolutionnaires internationalistes ont agi en 1916. Ils devront avoir, devant les yeux, les grandes voies de la civilisation humaine et ne pourront pas rester dans l’inactivité.
« Mais cette guerre n’est pas la nôtre, c’est une guerre capitaliste », m’a-t-on objecté dans les réunions houleuses en Hollande, et un de mes contradicteurs ajoutait : « Si c’était la révolution sociale, ou si l’issue de la guerre pouvait servir à la révolution sociale, nous prendrions naturellement parti. »
D’abord, on ne saurait se débarrasser d’un fléau mondial comme la guerre de 1914–1918, avec quelques mots sur le « capitalisme ». Cette guerre pour la, domination des peuples et des races a eu d’autres racines encore que la seule rapacité des industriels et des financiers, de tous ceux qui ont fait fortune avec le malheur des autres. On pourrait douter, ai-je répondu a, mes contradicteurs, que des camarades qui n’auraient pas su défendre les acquisitions de la grande révolution, de 1789 et de celles de 1830 et de 1848, défendront mieux, dans l’avenir, la révolution sociale, contre les forces du capitalisme actuel. Dans une période de révolution mondiale, les faibles pourront aussi chausser leurs « pantoufles » en se déclarant « contre toute violence ».
Je ne formulerais aucun reproche contre nos camarades, non-interventionnistes, si nous étions des partisans de la non-résistance, des Tolstoïens. Mais notre antimilitarisme n’est pas qu’un seul parmi les principes de l’extrême-gauche des pays occidentaux. C’est un principe secondaire, et si, demain, ce principe se heurte à un autre prédominant ; si, demain, tout le progrès de la civilisation se trouve en jeu — comme il l’a été en 1914–1918, — il est bien possible que les camarades, alors, devront oublier leur haine de la guerre, devant la nécessité de défendre les acquisitions de la civilisation. Car, en somme, les peuples, de même que les classes sociales ont la civilisation qu’ils méritent, et ceux qui ne savent pas se défendre, déclinent inévitablement. C’est une loi de la Nature que l’homme ne peut se permettre d’oublier. »
Loin d’apaiser le conflit, ces mises au point soulevèrent, dans la presse anarchiste internationale, de vives polémiques, dont certaines dégénérèrent en véritables pugilats épistolaires.
Descarsins, prenant part au débat, adressait à la revue mensuelle « Plus Loin », n° 43, d’octobre 1928, une lettre dans laquelle il situe le problème sur un plan plus général :
« ...Allons-nous admettre, comme un point de tactique anarchiste, que nous devions, dans toute guerre, intervenir en nous rangeant sous la bannière de l’un des belligérants ? En suivant les camarades de Plus Loin dans leur raisonnement, telle devrait pourtant être notre attitude, puisque, inévitablement, il se présentera dans tout conflit de gouvernement à gouvernement l’un de ceux-ci qui aura moins tort que l’autre, qui sera moins impérialiste, ou plus révolutionnaire, etc., etc. Il reste à savoir, alors, quel bénéfice les peuples peuvent tirer d’une guerre quelconque — et j’entends par la le peuple qui crève de la guerre — ou même quel bien peut en tirer le mouvement ouvrier et révolutionnaire mondial, ou encore quel profit en acquiert la, civilisation. Non pas la civilisation mythique, mais la civilisation qui se traduit par un bien-être des masses dépossédées, et un progrès moral chez les individus.
Je pense, plus fortement que jamais, que les Seize se sont trompés, et que, non seulement tout anarchiste, mais tout homme pensant, ne peut donner son assentiment, et moins encore sa collaboration, à un conflit de gouvernement a gouvernement... La cause essentielle de la régression du mouvement anarchiste, de la perte sensible d’influence de nos idées, réside dans la signature du manifeste, qui, en quelque sorte, séparait les adeptes des maîtres, décapitait le mouvement de ses chefs spirituels, qui ont eu, en 1914, une attitude qui contredisait leur vie, leurs actes, leur propagande, leurs écrits, toute leur œuvre anarchiste d’antan. Et, sans conducteurs spirituels, la propagation de nos idées ira de plus en plus vers la décadence ; la démagogie se fera une place de plus en plus grande..., et, au bout de cela, il y a le néant. Un résultat que n’avaient point prévu les signataires du manifeste. Et une régression des idées de liberté n’est point précisément un progrès de la civilisation.
En posant la question du Manifeste, c’est dans ce sens que j’espérais la voir résoudre... Expliquer une attitude, ce n’est déjà plus la revendiquer. Et si l’on ne revendique pas le Manifeste, n’est-ce pas parce qu’il est « irrevendicable », parce que l’on s’est trompé ? Si ce grand pas était franchi dans les faits, comme je suis persuadé qu’il l’est dans les esprits, nous pourrions assister à un essor nouveau, à une régénération du principe anarchiste... et anti-guerrier. »
Pierrot répondit à Descarsins par une longue explication qui mérite de retenir toute l’attention des anarchistes, car elle combat la thèse de l’égoïsme sacré :
« ...Nous prenons le droit de nous intéresser à tout déni de justice, à tout acte de violence exercé contre un faible — pour crier notre protestation et pour agir, si nous pouvons. Nous prenons le droit d’agir contre l’iniquité commise envers un traîneur de sabre, un officier de l’armée bourgeoise. Nous avons été dreyfusards et le serions encore, si c’était à refaire. Alors, si nous avons pris le droit d’intervenir autrefois, dans un conflit entre galonnés, sans en être autrement diminués, — au contraire — pourquoi n’aurions-nous pas le droit de prendre parti dans un conflit entre gouvernements, mais où le progrès humain, les notions de justice et les acquisitions dans le domaine de la liberté morale sont en cause ? Lorsque progrès moral, justice et liberté sont en jeu, il n’y a plus de classe ni d’entité gouvernementale qui tiennent, l’intérêt de l’idéal humain domine tout. Tant pis pour ceux qui ont trop peur d’être dupes et qui se confinent dans la méfiance. La méfiance est un sentiment assez bas qui ne peut aboutir qu’à l’impuissance et à la stérilité. En fait, il est l’apanage de ceux qui se sentent trop faibles ou trop peureux pour agir.
.................................................................................................................
Descarsins dit que notre attitude en 1914 a été en contradiction avec notre vie, etc... Sans doute, l’étonnerai-je beaucoup en répondant qu’il n’y a pas eu de contradiction, et que nous avons été anti-patriotes et anti-militaristes, avant, pendant et après la guerre. Mais il faut entendre que nous avons pris parti contre la menace du militarisme prussien tout-puissant, dont le triomphe eût renforcé, dans la France vaincue, un militarisme réactionnaire, et que notre adhésion à la défense commune n’a jamais eu en vue ni exaltation du militarisme français, ni impérialisme, ni domination, ni orgueil national, ni représailles à exercer, ni humiliation à imposer. Avant la guerre, nous avons fait, en France, la propagande la plus active contre les incendiaires nationalistes, contre les préjugés patriotiques, contre la mascarade des retraites militaires. Nous savions qu’en Allemagne et ailleurs, nos camarades, moins nombreux, mais aussi actifs, faisaient la même propagande antimilitariste. Nous nous rendions compte que, dans l’Empire allemand, les idées démocratiques et révolutionnaires faisaient du progrès, malgré la gêne venant de l’armature féodale de l’État. Nous espérions qu’avec le temps, la poussée démocratique et révolutionnaire, encore bien faible, deviendrait assez forte pour empêcher les militaires de pouvoir a leur gré, déclencher la guerre.
Notre résistance à l’invasion menée par le clan féodal et militaire allemand n’a jamais comporté la haine du peuple allemand, ni le dessein de son asservissement. Je n’ai jamais eu, personnellement, l’idée d’aller éventrer Nettlau sur l’autel de la patrie. J’ai continué, pendant la guerre, a répandre autour de moi des idées de fraternité universelle, et de compréhension des adversaires, fondées sur le simple bon sens. Le danger passé, nous reprenons, sans aucune honte, sans remords, notre propagande qui me semble, à moi, sans hiatus, parce que ma pensée n’a subi aucune déviation.
J’avoue, dus-je indigner Descarsins, que je reprendrai la même attitude contre une invasion conduite par Mussolini, sans haine aucune contre les Italiens. Mais, puisque je suis hostile aux royalistes français, pourquoi accepterais-je la loi des fascistes, simplement parce que les fascistes sont des étrangers ? Et pourtant le fascisme est beaucoup moins dangereux, beaucoup moins puissant que le grand état-major allemand. Sa victoire aurait des effets bien moindres ; à tout le moins, elle provoquerait, en France, le retour triomphal de l’esprit chauvin et réactionnaire. Mais, moi, je ne prétends pas imposer mon opinion à Descarsins.
Pourrais-je dire que je respire mieux depuis la guerre, que j’ai davantage confiance dans une évolution pacifique des peuples, depuis que l’Europe ne traîne plus comme un boulet, les empires d’Allemagne, d’Autriche et de Russie ? I1 y a bien le fascisme et quelques autres dictatures. Ils sont d’importance secondaire, ils sont surtout désagréables pour leurs propres peuples. Le plus fort, le fascisme italien, n’a pas d’argent, et il ne peut donc rien faire , il va à la faillite financière. Toutefois, les voisins devront se garder des soubresauts de la bête au moment de son agonie.
Qu’importe que le mouvement anarchiste actuel retourne au néant... Les idées d’émancipation et de liberté reprendront sous une autre forme et sous une autre appellation. Avec les tenants actuels du mouvement, ces idées sont en train de se fossiliser dans des formules négatives : à bas la morale, à bas la famille (il existait même, avant la guerre, une secte d’anarchistes scientifiques, composée de demi-fous qui niaient les sentiments et proclamaient : à bas l’amour, a bas la guerre, à bas la politique, à bas la propriété, à bas la société ! etc...), tout cela en bloc, sans considérer aucune contingence, de peur de se tromper ou d’être trompé. En réalité, les anarchistes soi-disant affranchis, sont esclaves de principes absolus. Ils ont fini par enfermer la doctrine dans un petit cercle d’idées simplistes, qui donnent, à quelques-uns d’entre eux, l’illusion de tout savoir et le sentiment d’une immense supériorité. »
Ichikava (Japon), dans une lettre adressée a la rédaction de « Plus Loin », marque son re-acquiescement au Manifeste, en ces termes :
« Je suis tout à fait d’accord avec vous. Je trouve surtout la mentalité du militariste japonais tout à fait changée depuis la guerre européenne, c’est-à-dire depuis la débâcle du militarisme allemand. Oui, le Japon militariste est démocratisé, parce qu’il a senti que le militarisme ancien ne peut plus résister contre le grand mouvement populaire démocratique. »
Les événements récents qui ont mis aux prises la Chine et le Japon ont montré combien l’absence de jugement était grande, chez ce signataire. Et l’on s’étonne de le voir donner à un mouvement ou à des individualités des directives sinon des conseils.
Parmi les camarades qui se mêlèrent aux débats rouverts sur le Manifeste des Seize, Luigi Fabbri, théoricien anarchiste italien, auteur de « Dictature et Révolution », publia, dans « La Protesta », quotidien anarchiste de Buenos-Ayres, une série d’articles dans lesquels il exposait l’attitude des anarchistes devant un nouveau danger de conflagration.
En voici les principaux passages :
« Au début de la guerre précédente, et pendant sa durée, il nous fut donné d’assister, non seulement à la déroute, dans tous les paye, de la IIè Internationale, de la social-démocratie, mais encore au spectacle triste, douloureux et avilissant, d’anarchistes, en petit nombre, mais parmi les plus connus, qui perdirent la tête au point d’oublier leurs propres principes d’internationalisme et de liberté. Et, parmi ceux-ci, le plus essentiel : celui qui est la négation de l’État et qui refuse à l’État l’horrible faculté de supprimer le droit à la vie pour les individus et pour les peuples. Nous eûmes ainsi, criantes et abominables contradictions des termes, des « anarchistes d’État » qui se rangèrent aux côtés de quelques gouvernements, se solidarisèrent avec eux, se portant caution pour eux, devant les peuples, et prenant parti contre l’immense majorité de leurs camarades. Et tout cela dans la naïve et anti-anarchiste illusion de sauver quelques atomes de liberté, de cette liberté démocratique dont ils avaient, pendant cinquante ans, dénoncé le mensonge et l’insuffisance, voire l’inexistence, pour la majorité du prolétariat le plus pauvre et le plus déshérité.
Les fruits de la guerre « démocratique », pour le salut des petits peuples, pour la fin de toutes les guerres, nous les avons vus. Bien plus, nous en avons éprouvé l’amertume, nous avons souffert, dans notre chair, des plaies les plus douloureuses. Les populations opprimées par les États étrangers sont, aujourd’hui, plus nombreuses qu’avant la guerre, les petits peuples davantage asservis, les irrédentismes multipliés, les libertés démocratiques diminuées et plus dérisoires encore. Les motifs de guerre sont devenus innombrables ; aujourd’hui, la guerre est un danger réel, mille fois plus grand qu’à la veille de 1914. De la guerre qui devait être libératrice et pacificatrice, a surgi un monstre : le fascisme qui, comme une tache d’huile, se répand sur le monde et menace les sources même les plus antiques de la civilisation.
Le seul fruit de la guerre dont on puisse dire qu’il n’a pas été perdu, et qu’il n’est pas inutile, c’est que, grâce à elle, les illusions sur la démocratie bourgeoise sont définitivement tombées. Si les empires centraux avaient vaincu, après une égale durée de la guerre, certainement, nous ne serions pas mieux que nous ne sommes. Au lieu de certains désastres, nous en aurions eu d’autres, peut-être moins terribles ; mais les interventionnistes d’alors pourraient encore conserver leurs anciennes illusions, et diraient à coup sûr : « Ah ! si les Alliés eussent vaincu, aujourd’hui, nous serions heureux... ». Et il faudrait refaire tout un travail pour combattre 1a vieille erreur demeurée debout ; la Victoire des États dits démocratiques qui ne nous laisse pas moins malheureux que nous ne l’aurions été avec une Victoire du parti opposé, a démontré que c’est nous qui avions raison, et détruit jusque dans sa racine la maléfique illusion ; mais à quel prix et avec quel amoindrissement de ceux qui la caressèrent de nouveau, après l’avoir dénoncée et anathématisée pendant cinquante ans...
..................................................................................................................
Les anarchistes sont contre la guerre, contre toutes les guerres. Ils sont antimilitaristes, parce que la guerre est la fin logique, inéluctable du militarisme. Quelles que soient les circonstances, quelles que puissent être les conséquences d’un conflit armé entre États capitalistes, les anarchistes, à quelque nation qu’ils appartiennent, ne doivent pas collaborer à la défense nationale. S’ils y sont contraints et forcés, ils ne doivent pas, du moins, lui donner l’appui de leur consentement volontaire, ni se déclarer solidaires de leurs concitoyens, pour s’opposer à l’invasion du territoire ou pour le libérer s’il est envahi. Ils ne doivent, pas davantage prendre parti pour l’un ou l’autre des belligérants, ni rechercher si la victoire ou la défaite de l’un ou de l’autre peut être dommageable ou non aux idées de liberté et d’émancipation politique, économique et sociale, étant admis, une fois pour toutes, que les guerres sont des querelles de gouvernements capitalistes, et que le sort des peuples y est toujours également sacrifié, quelle qu’en soit l’issue.
Gardons-nous de nous laisser abuser par 1e mirage du moindre mal, de nous laisser entraîner par les contingences, pour nous souvenir uniquement que le moindre mal sera toujours aussi néfaste pour les peuples, pour le prolétariat, pour la liberté, et gros des mêmes horribles conséquences pour l’avenir ; et, aussi pour laisser toute leur responsabilité aux gouvernements et aux classes dominantes, évitant tout acte de complicité, avec ceux-là ou celles-ci, et tâchant, au contraire, de nous préparer et d’être en situation de tirer le meilleur parti des événements pour notre cause révolutionnaire. »
Quoiqu’il n’y ait pas eu, dans l’esprit de Fabbri, la moindre animosité, voire même d’hostilité préconçue contre les signataires de la Déclaration des Seize, il n’en reste pas moins vrai qu’avec netteté et précision, L. Fabbri situait le problème dans ses termes exacts et précis, dans le cadre qui lui est propre.
Pour écarter les éléments inutiles et erronés qui pouvaient surgir à la suite de la publication des articles de Fabbri, parus dans « La Protesta » de Buenos-Ayres, l’auteur avait tenu, dans une lettre, à signaler la double traduction italien-espagnol, espagnol-français, qui pouvait créer quelque équivoque avec son texte premier.
Auguste Bertrand, dans le n° 39 de « Plus Loin » (juin 1928), commentait le point de vue de Fabbri en ces termes :
« Au regard des anarchistes croyants, j’appartiens à une catégorie de réprouvés, qu’il n’est pas possible de convertir, mais je ne suis pas voltairien ; je veuxdire que, n’ayant pas la foi, je ne cherche pas à la. détruire chez ceux qui l’ont. D’ailleurs, ces disputes ne sont d’aucune utilité, elles n’aboutissent qu’à chagriner sans entamer les convictions. Je ne ferai donc pas, mécréant, grief à Fabbri de son absolutisme doctrinaire, qui prétend enfermer la conscience anarchiste dans quelques formules très simples, hors desquelles il n’y a pas de salut. Je n’essayerai pas de lui démontrer que, dans le cas d’une coalition européenne, contre la Russie Soviétique, la place de combat des anarchistes serait dans les rangs de l’armée rouge. »
Signalant à Fabbri l’étiquette anarchiste-d’État dont il gratifie les signataires, afin de mieux concrétiser sa pensée, Bertrand essaie de montrer l’impropreté de cette désignation :
« Les interventionnistes, comme il les appelle, ne se sont pas solidarisés avec quelques gouvernements, ils ne se sont pas portés caution pour eux, devant les peuples ; ils ont fait exactement l’opposé. Ils se sont solidarisés avec les peuples et, loin de se porter caution pour quelques États, ils ont, au contraire, éveillé la suspicion des peuples contre ces États ; quant à leur illusion de sauver quelques atomes de cette liberté démocratique, qui fait encore terriblement défaut à tant de peuples, à laquelle ils ont la faiblesse de tenir, tout en on dénonçant le mensonge et l’insuffisance, voire l’inexistence pour 1a majorité du prolétariat le plus pauvre et le plus déshérité, que Fabbri ne s’y trompe pas : cette illusion, ils l’ont toujours, naïve si l’on veut, mais non anti-anarchiste. »
Bertrand tient à mettre en lumière un second point de la thèse de Fabbri et, pour cela, il dit :
« L’idéal communiste-anarchiste est, à la fois, la plus orgueilleuse revendication de la personnalité et la plus entière expression de la solidarité des individus. Je dis : à la fois, le choix n’est pas permis entre les termes jumelés, de cette double définition. Or, l’anarchie n’est pas une abstraction, ce n’est pas un système. Elle n’est pas née, toute de noir et de rouge vêtue, dans le cerveau d’un homme de génie. C’est un phénomène social qui se dégage et se précise peu à peu des efforts instinctifs d’abord, irraisonnés de la communauté humaine, tendant à assurer à la totalité des individus, les meilleures possibilités d’existence matérielle, intellectuelle et morale....Je n’affirmerai pas que tous les anarchistes partagent cette conception, mais ce qui lui donne une certaine force, c’est le caractère profond des idées libertaires et l’impossibilité de les dissocier de ce que Fabbri appelle les « contingences ». Cette aspiration universelle vers un meilleur devenir, les anarchistes ont précisément le mérite de l’avoir libérée des formules et des systèmes, et de montrer le but final auquel elle tend. C’est parce qu’ils le distinguent clairement qu’ils sont à l’avant-garde de l’humanité, en marche vers ce but ; et lorsqu’un obstacle imprévu se dresse en travers du chemin, il ne leur est pas loisible de s’asseoir sur le revers du talus et d’attendre que le gros des troupes ait écarté l’obstacle et déblayé la route. Aux anarchistes, plus impérieusement qu’à tous autres, s’imposait le devoir de résister au coup de force du militarisme allemand. »
En conclusion de son intervention dans le débat relatif au Manifeste des Seize, Aug. Bertrand écrit :
« Le seul fruit de la guerre dont on puisse dire qu’il n’a pas été perdu, c’est que la victoire des Alliés a porté un coup mortel au militarisme allemand. Quant au militarisme français, nous le combattons comme tous les militarismes ; mais, depuis 1870, il n’a jamais été assez puissant pour constituer un danger pour la paix du monde ; s’il venait à en être autrement, je doute que ce pays refasse l’unité spontanée qu’il a faite, en août 1914, contre l’envahisseur allemand, et avec laquelle en mon âme et conscience d’anarchiste, ma qualité de citoyen de la nation envahie me dictait le devoir de me solidariser. »
Ces paroles d’Aug. Bertrand nous laissent rêveurs, car elles montrent jusqu’à quel point certains éléments se réclamant de l’anarchie ont, de la situation internationale, une conception erronée et partiale. La question des responsabilités envisagée sous l’angle purement bourgeois, contredit même cette façon, de voir ; car, pour ceux qui ont étudié les documents exhumés des archives secrètes de certains régimes abolis, la part de complicité de chaque État dans le conflit de 1914–1918 est désormais établie. C’est un non-sens, alors, de se laisser prendre au mirage sentimental de la nation envahie et du devoir de se solidariser avec elle. Les anarchistes ne doivent pas se laisser égarer par de telles erreurs, qui ne peuvent que se retourner un jour contre eux et détruire la confiance que la classe ouvrière peut accorder à l’idéal anarchiste.
L. Fabbri, revenant à la charge, répondait aux articles parus dans la revue « Plus Loin », sur la question de la guerre, du Manifeste des Seize, et de l’attitude des anarchistes en cas de conflit guerrier, par un nouvel article, qui situait le sujet en s’efforçant de retrouver l’idée maîtresse, qui, dans le labyrinthe des discussions, avait été abandonnée :
« Au fond de cela, il y a souvent une incomplète compréhension de l’anarchisme ; on le voit comme séparé de la réalité actuelle et quotidienne, inapplicable, en pratique, aux problèmes de la vie réelle, ne répondant pas aux nécessités immédiates de la défense de la liberté et des droits de l’individu et du prolétariat. D’où l’accusation adressée à ceux qui, dans la vie et dans la lutte, veulent rester en accord avec leurs principes, de se séparer des réalités, de négliger les intérêts pressants de la civilisation humaine et de les sacrifier à une aride formule abstraite. C’est l’accusation que les partisans de l’intervention nous faisaient à nous, anarchistes, restés en présence du grand conflit sur le terrain révolutionnaire, prolétaire et libertaire. Leur erreur était, une fondamentale erreur d’évaluation. L’anarchie n’est pas seulement un idéal de lointaine société future, ou une abstraction de l’esprit au-dessus des contingences humaines, elle est bien tout cela, mais elle est aussi autre chose, et davantage : une pratique de la vie et de la lutte, une méthode d’évolution consciente, de préparation et de révolution, une conception de mouvement et d’action, un idéal en voie de continuelle réalisation. En restant fidèles dans la pratique à la conception anarchiste, en nous y conformant le plus possible, lorsque nous combattons, nous contribuons à résoudre les problèmes de la liberté et de la civilisation humaine Beaucoup plus, beaucoup mieux et beaucoup plus vite qu’en nous mettant en contradiction avec elle. Agir dans un sens opposé à cette conception, c’est faire tort à la civilisation et à la liberté et à toute cause bonne que l’on voudrait servir.
L’idée anarchiste et le mouvement anarchiste étant envisagés de cette manière, il me semble que l’attitude que nous avons prise pendant la guerre 1914–1918 — adversaires de tous les États, solidarisés avec tous les peuples, — ne pouvait guère être autre qu’elle ne fut. Attitude, non de renoncement, mais de combat, qui ne nous réservait pas moins de souffrances, de risques et de sacrifices que toute autre ; attitude qui ne nous mettait pas au-dessus ou hors de la mêlée, mais au plus épais, et nous faisait les interprètes des aspirations les plus ardentes et des sentiments les plus profonds des grandes masses de combattants, partout envoyés au massacre, contre leur volonté. Une telle attitude ne fut ni individualiste, ni pacifiste, ni neutraliste, mais « solidariste » anarchiste, révolutionnaire ; elle fut la plus humaine de toutes et celle qui s’accordait le mieux à la cause de la civilisation. Dans tous les pays, humanité et civilisation étaient, jour après jour, écrasées, piétinées, par la guerre, ruinées matériellement et moralement et menacées d’anéantissement, beaucoup plus par la durée de la guerre que par l’issue qu’elle pourrait avoir. Le désastre, dans chaque camp, était tel qu’il ne pouvait y avoir aucune raison, à quelque moment que ce fût, pour le faire durer une seule minute de plus, quel que dût être l’éventuel vainqueur, aucune, sinon les intérêts du capitalisme et des divers impérialismes. Et le devoir des anarchistes, non seulement pour rester cohérents avec leurs principes, mais plus encore par solidarité humaine, et dans l’intérêt de la civilisation, était de faire tout leur possible, d’employer tous les moyens et à tout prix, pour que l’on mît fin au massacre.
Ce devoir, les anarchistes restés fidèles à leurs principes ont cherché à l’accomplir comme ils ont pu. Ils n’ont pu l’accomplir que trop peu, hélas, pour obtenir un résultat appréciable. Cela est vrai. Mais ce n’est pas là une bonne raison pour soutenir qu’ont mieux fait ceux... qui ont fait le contraire, avec les résultats que l’on sait. » (« Réveil Anarchiste », de Genève, 26 janvier 1929.)
Cette longue polémique, si elle a provoqué, dans les milieux anarchistes, des scissions et peut-être amené quelques bons camarades à devoir rompre toutes relations entre eux, n’aura pas manqué d’être fructueuse en enseignements, car elle aura démontré comment un accord parfait, établi par près d’un demi-siècle de propagande pour un idéal commun, s’est trouvé brusquement rompu devant un événement d’une exceptionnelle gravité.
Nous avons tenu à placer sous les yeux du lecteur, aussi équitablement que possible, les documents essentiels se rattachant à cette controverse. Nous avons le sentiment que l’étude attentive de ces documents où s’affirment avec vigueur les deux thèses opposées, aura une triple utilité :
-
Permettre à chacun d’apprécier, judicieusement et en connaissance de cause, la position prise par les signataires du trop fameux Manifeste des Seize ;
-
Faire savoir à tous que, dans l’ensemble, le mouvement anarchiste fut nettement hostile à cette position ;
-
Mettre en garde les éléments libertaires, surtout les jeunes, contre la tentation de se laisser entraîner dans une nouvelle guerre, sous le fallacieux prétexte de combattre le Fascisme italien ou allemand pour sauver la Démocratie, ou de défendre la Russie bolcheviste pour sauver la Révolution.
— Hem Day.
SÉLECTION
n. f. (du radical latin : seligo, selectus, choisir, trier)
Sélection naturelle, eugénisme, sélection sociale, voilà le triple point de vue qui retiendra notre attention dans le présent article.
Trompés par le récit biblique de la création, des naturalistes comme Linné, Cuvier, Agassiz ont faussement supposé que toutes les espèces végétales ou animales, et l’humanité elle-même, demeuraient immuables et fixes parce qu’elles résultaient du tout-puissant vouloir divin. Si la faune et la flore ont changé au cours des âges, ainsi qu’en témoigne la paléontologie, ce n’est pas, disait Cuvier au début du XIXème siècle, en raison de la transformation des espèces, mais par suite de « révolutions » du globe, de « catastrophes subites, se produisant périodiquement et détruisant des populations entières ». A la même époque, Lamarck enseignait que les espèces évoluent. « Si cette vérité n’est pas généralement admise, déclarait-il, c’est parce que la chétive durée de l’Homme lui permet difficilement d’apercevoir les mutations considérables qui ont lieu à la suite de beaucoup de temps ». Mais Lamarck fut tourné en ridicule et Cuvier, qui cumulait tous les honneurs officiels, triompha bruyamment.
Avec Darwin, qui publia en 1859 son livre De l’Origine des Espèces, la théorie fixiste reçut un coup dont elle ne s’est point relevée. La prodigieuse documentation du naturaliste anglais, le nombre et la variété des faits qu’il apportait en faveur de la mutabilité des espèces, finirent par convaincre tous les esprits impartiaux. Sur les facteurs essentiels de l’évolution, Lamarck et Darwin sont loin, d’ailleurs, d’être d’accord. Le premier invoque surtout l’adaptation au milieu, les effets héréditaires du besoin qui crée l’organe et de l’usage qui le fortifie, ainsi que l’action opposée du défaut d’usage qui engendre l’atrophie, puis la disparition des organes inutiles. De préférence, le second explique les transformations observées par la lutte pour la vie et la sélection naturelle. Chez Darwin, cette dernière notion acquiert une importance de premier ordre.
Variabilité des espèces et concurrence vitale, telles sont, d’après lui, les causes principales de l’évolution biologique. Dans une même espèce, tous les individus présentent des différences plus ou moins accentuées qui sont en relation avec les modifications survenues dans le mode d’existence. Par ailleurs, la progression rapide selon laquelle les êtres organisés tendent à s’accroître, dans une région donnée, engendre une lutte fatale de chaque individu avec ses semblables et avec ses ennemis de tous ordres, pour la place à prendre ou la nourriture à obtenir. En conséquence, les variations nuisibles seront une cause de destruction pour les êtres qu’elles affligent ; les variations utiles auront un effet inverse, elles assureront la survivance des individus les plus aptes et se transmettront à leurs descendants. Une meilleure adaptation aux conditions d’existence et une lente amélioration de l’espèce suivront, si les variations heureuses persistent et si le même processus se répète pendant longtemps.
Darwin écrit :
« Supposons une espèce de Loup, se nourrissant de divers animaux, s’emparant des uns par ruse, des autres par force et des autres par agilité ; supposons encore que sa proie la plus agile, le Daim par exemple, par suite de quelques changements dans la contrée, se soit accrue en nombre ou que ses autres proies aient, au contraire, diminué pendant la saison de l’année où les Loups sont le plus pressés par la faim. En de pareilles circonstances, les Loups les plus rapides et les plus agiles auront plus de chance que les autres de pouvoir vivre. Ils seront ainsi protégés, élus, pourvu toutefois qu’avec leur agilité nouvellement acquise ils conservent assez de force pour terrasser leur proie et s’en rendre maîtres, à cette époque de l’année ou à toute autre, lorsqu’ils seront mis en demeure de se nourrir d’autres animaux. Nous n’avons pas plus de raisons pour douter de ce résultat que de celui que nous obtenons nous-mêmes sur nos Lévriers, dont nous accroissons la vitesse par une soigneuse sélection méthodique ou par une sélection inconsciente, provenant de ce que chacun s’efforce de posséder les meilleurs Chiens sans avoir aucune intention de modifier la race. Sans même supposer aucun changement dans les nombres proportionnels des animaux dont notre Loup fait sa proie, un louveteau peut naître avec une tendance innée à poursuivre de préférence certaines espèces. Une telle supposition n’a rien d’improbable, car on observe fréquemment de grandes différences dans les tendances innées de nos animaux domestiques : certains Chats, par exemple, s’adonnent à la chasse des Rats, d’autres à celle des Souris. D’après M. Saint-John, il en est qui rapportent au logis du gibier ailé, d’autres des Lièvres ou des Lapins, d’autres chassent au marais et, presque chaque nuit, attrapent des Bécasses ou des Bécassines. On sait enfin que la tendance à chasser les Rats plutôt que les Souris est héréditaire. Si donc quelque légère modification d’habitudes innées ou de structure est individuellement avantageuse à quelque Loup, il aura chance de survivre et de laisser une nombreuse postérité. Quelques-uns de ses descendants hériteront probablement des mêmes habitudes ou de la même conformation, et, par l’action répétée de ce procédé naturel, une nouvelle variété peut se former et supplanter l’espèce mère ou coexister avec elle. »
Ainsi Darwin accorde à la mort une grande valeur sélective : elle élimine les moins aptes à la manière de l’éleveur qui, dans un troupeau, ne garde que les meilleurs individus. Il estime que la sélection sexuelle exerce aussi une action qui n’est pas négligeable. Les mâles plus énergiques ou mieux armés écartent leurs rivaux moins vigoureux. Parfois, chez les oiseaux en particulier, ce sont les mâles les plus beaux ou ceux dont la voix est la plus mélodieuse qui sont choisis de préférence par les femelles :
« Des voyageurs nous ont raconté des combats d’Alligators mâles au temps du rut. Ils nous les représentent poussant des mugissements et tournant en cercle avec une rapidité croissante, comme font les Indiens dans leurs danses guerrières. On a vu des Saumons combattre pendant des jours entiers. Les Cerfs-Volants portent quelque fois la trace des blessures que leur ont faites les larges mandibules d’autres mâles. M. Fabre, cet observateur inimitable, a vu fréquemment les mâles de certains insectes Hyménoptères combattre pour une certaine femelle qui restait spectatrice en apparence indifférente du combat, mais qui, ensuite, suivait le vainqueur. La guerre est plus terrible encore entre les mâles des animaux polygames ... Chez les oiseaux, la lutte offre souvent un caractère plus paisible. Tous ceux qui se sont occupés de ce sujet ont constaté une ardente rivalité entre les mâles de beaucoup d’espèces pour attirer les femelles par leurs chants. Les Merles de roche de la Guyane, les Oiseaux de Paradis et quelques autres espèces encore s’assemblent en troupe ; et, tour à tour, les mâles étalent leur magnifique plumage et prennent les poses les plus étranges devant les femelles qui assistent comme spectatrices et juges de ce tournoi ; puis, à la fin, choisissent le compagnon qui a su leur plaire. Tous les amateurs de volières savent bien que les oiseaux sont très susceptibles de préférences et d’antipathies individuelles. Sir B. Héron a remarqué un Paon tacheté qui était tout particulièrement préféré par toutes les femelles de son espèce. »
Certes, malgré ses mérites, la conception de Darwin soulève de nombreuses difficultés. Si le transformisme est un fait qu’aucun naturaliste sérieux ne songe à nier, la façon dont on l’explique a singulièrement varié. Les doctrines néo-lamarkistes, weismaniennes, mutationnistes, etc... se sont éloignées des idées darwiniennes sur des points parfois très importants. De préférence, ce sont les individus moyens, non les individus supérieurs, que l’action sélective préserve de la mort ; et, très souvent, aucune différence ne distingue les éliminés des survivants. Dans toutes les espèces, les phases d’intense mortalité s’observent pendant les jeunes stades ; mais, parmi les animaux adultes restés sauvages, il n’est pas rare de rencontrer des individus diminués par des malformations naturelles ou des mutilations accidentelles. Au dire des biologistes contemporains, qui ont confronté de près la théorie darwinienne avec la réalité, il n’y a pas de « survival of the fittest » ; sauf au début, la mortalité intraspécifique n’a aucun caractère sélectif. Et ainsi tombe l’argument principal des bellicistes qui prétendent légitimer la guerre en l’assimilant, d’une façon d’ailleurs très fausse, à la lutte pour la vie et en lui faisant jouer un rôle sélectif comparable à celui que l’on a prêté à la nature.
Si la sélection naturelle n’a pas l’importance que Darwin lui attribue, la sélection artificielle, intentionnellement pratiquée par l’homme, peut aboutir à de merveilleux résultats. On sait quels miracles réalise l’horticulture ! Des chercheurs patients ont précisé et codifié les règles à suivre pour obtenir des formes végétales inconnues ou pour renforcer les caractères que nous désirons voir s’accroître dans une espèce donnée. Des variations surviennent brusquement, même parmi 186 plantes issues d’un producteur commun ; et l’on obtient des races stables, lorsqu’on marie ensemble les individus qui présentent des variations identiques. Pour conduire une espèce au degré de perfectionnement souhaité, 1’on peut choisir comme reproducteurs, dans chaque semis, les sujets qui présentent à un très haut degré les caractères que l’on désire voir se développer. En procédant de la sorte assez longtemps, d’étonnantes variétés apparaissent, conformes aux modèles que nous avions imaginés. A ces modifications il y a néanmoins des limites ; la rose bleue, par exemple, n’a encore été obtenue par aucun horticulteur. Le croisement des races permet aussi de produire des types inédits, qu’il s’agisse de fleurs, de céréales, d’arbres fruitiers, de plantes industrielles quelconques. C’est ainsi que l’on a sélectionné des variétés de betteraves, de blé, de pommes de terre, dont les qualités augmentent singulièrement la valeur Edmond Perrier écrit :
« La rose du Bengale a été importée chez nous vers 1800, la rose multiflore en 1837, la rose de l’île Bourbon en 1820 ; elles ont fourni, depuis, de nombreuses variétés : c’est en les croisant les unes et les autres avec nos roses anciennes, fleurissant au printemps, qu’on a obtenu les roses hybrides remontantes, qui fleurissent deux fois par an. »
Dans leur ensemble, ces procédés sont imités de ceux que l’homme utilise, depuis les temps les plus anciens, pour l’amélioration des races d’animaux domestiques ou pour la production de races nouvelles. Nous ne savons rien de précis concernant l’origine et l’histoire de la majorité des grandes races domestiques, soit qu’elles remontent à des époques sur lesquelles nous sommes très mal renseignés, soit qu’elles résultent d’une sélection lente, variable, intermittente et qui n’eut rien de méthodique. C’est à des mutations ou des combinaisons qui parurent intéressantes que sont dus chiens et chats sans queue, moutons et boeufs sans cornes, de nombreuses races de poules, de pigeons, de chevaux, de chiens, etc ... Quoi qu’il en soit, la sélection, intentionnellement appliquée par l’homme, dans l’ordre végétal ou animal, apparaît merveilleusement utile et féconde. Non seulement, disait Youatt, elle permet à l’éleveur de modifier le caractère de son troupeau, mais elle lui fournit le moyen de le transformer complètement :
« C’est la baguette magique, à l’aide de laquelle il appelle à la vie quelque forme ou moule qui lui plaise. »
L’éleveur de pigeons John Sebright affirmait :
« Qu’il répondait de produire quelque plumage que ce fùt en trois ans ; mais qu’il lui en fallait six pour obtenir la tête et le bec. »
Et l’on sait quels prix énormes valent les beaux reproducteurs dont la généalogie est irréprochable. Grâce aux lois de Mendel, il est d’ailleurs possible de calculer les résultats des croisements entre individus de caractères différents. Ajoutons que les méthodes à suivre, pour obtenir deux individus capables d’être la souche d’une race stable, varient selon la nature dominante ou dominée de la qualité que l’on désire. Facile dans le second cas, l’isolement est long et incertain dans le premier ; beaucoup d’individus, que les éleveurs déclarent de race pure, n’en ont que l’apparence : la disjonction mendélienne, qui survient lorsqu’on les croise entre eux, le démontre.
Puisque la sélection artificielle, appliquée aux animaux domestiques, conduit à d’heureux résultats, l’homme gagnerait sans aucun doute à user de procédés analogues, quand il s’agit de sa propre reproduction. Malheureusement, la religion chrétienne en général et plus particulièrement la branche catholique exercent une influence très néfaste en matière de procréation humaine. Asservis à des dogmes absurdes, les catholiques continuent d’obéir à l’ordre donné par Jahveh à Adam et à Ève :
« Multipliez-vous ! »
Dans une encyclique de décembre 1930, le pape a rappelé que la doctrine traditionnelle ne devait subir aucune atténuation. Le jésuite J. Keating écrit :
« En considération du bonheur éternel qui est normalement à leur portée, il est mieux que des enfants naissent estropiés ou tarés, que de ne pas être nés du tout. »
Le pitre Jean Guiraud, dont j’ai pu apprécier la sottise et la mauvaise foi lorsqu’il enseignait à l’Université de Besançon, résume les explications des théologiens catholiques en assurant que la restriction volontaire de la natalité est une faute d’une gravité exceptionnelle.
Moins déraisonnables, les protestants ont adopté de nos jours une attitude différente, du moins dans certains pays. Le député Sixte-Quenin le constate dans son intéressant rapport sur le Problème de la Natalité :
« Le nombre considérable des chômeurs anglais, écrit-il, a montré à des membres de la Chambre des Lords et à de hautes personnalités de l’Église anglicane, que la propagande néo-malthusienne devenait, en Angleterre, une mesure de salut public. On sait quel éclatant démenti a été donné, par les colonies anglaises, à la thèse qui prétendait que les colonies pourraient toujours, le cas échéant, recevoir un excédent possible de population de la métropole. Les gouvernants anglais ont essayé de se débarrasser, en les envoyant dans leurs colonies, d’une partie au moins de leurs chômeurs qui représentent une si lourde charge pour le budget anglais. Cette entreprise a lamentablement échoué ... Ainsi s’explique-t-on que des lords et des évêques en soient venus à penser que l’Angleterre est trop peuplée, que les chômeurs qui y sont en excédent et à la charge de ceux qui travaillent, peut-être eût-il mieux valu qu’ils ne naquissent point et qu’en tout cas il serait sage d’éviter que leur nombre s’augmentât par une procréation exagérée. En Amérique, il faut bien croire que ce sentiment est encore plus répandu, car on a pu lire, dans Paris-Midi, ce télégramme de New-York du 9 décembre 1932 :
« Le Conseil fédéral des églises du Christ en Amérique a tenu hier, à Indianapolis, son congrès annuel, à l’issue duquel des résolutions sensationnelles ont été adoptées. Disons d’abord que cette association groupe 135.000 églises protestantes et que ses adhérents sont au nombre de 22 millions. En ce qui concerne les problèmes sociologiques, le Conseil fédéral insiste sur la nécessité du contrôle des naissances dans « l’intérêt de la morale et de la protection de la vie humaine ». Il estime que c’est là le seul moyen de maintenir le standard de vie désirable et n’hésite pas à préconiser la création d’écoles du mariage, dont les élèves seraient initiés, par des médecins et professeurs qualifiés, aux mystères de l’eugénisme. »
C’est que l’Amérique, qui compte pourtant encore de vastes étendues peu peuplées, non seulement elle aussi, après avoir fermé ses portes aux Asiatiques, les ferme aux Européens, mais elle doit reconnaître son impuissance à utiliser son territoire soi-disant insuffisamment peuplé pour donner du travail à ses millions de chômeurs. »
En France, en Italie, les prêtres s’associent par contre au pouvoir civil pour condamner la restriction volontaire de la natalité. D’une façon générale, le désir de disposer d’un « matériel humain » abondant, pour les guerres en perspective, pousse les nationalistes du continent européen à réclamer une procréation toujours amplifiée.
Malgré leur parenté évidente, le problème de la limitation des naissances et celui de la sélection eugénique ne sont point rigoureusement identiques. Le premier, d’ordre surtout quantitatif, se préoccupe d’établir un heureux équilibre entre les ressources du globe et l’effectif de la population qui s’agite à sa surface. Le second, d’ordre qualitatif, porte sur les moyens d’éviter un amoindrissement de notre espèce, et même d’assurer son amélioration autant qu’il est possible. Il faut, déclarent avec raison les partisans de l’eugénisme, que la procréation cesse d’être le résultat d’un instinct aveugle et du hasard, pour devenir l’oeuvre volontaire et réfléchie de parents sains de corps et d’esprit. Un enfant vigoureux, robuste, bien doué intellectuellement, ne vaut-il pas mieux que cent enfants malingres et tarés ? Favoriser la procréation d’une manière aveugle, sans tenir compte des maladies héréditaires, des aptitudes familiales, des conditions favorables au perfectionnement de l’espèce, c’est précipiter la déchéance de la race humaine. Ils commettent un crime, les parents alcooliques, tuberculeux, syphilitiques, ou tarés à d’autres points de vue, qui jettent dans la lutte pour l’existence un être chétif, mal conformé, dont la destinée sera de souffrir constamment. S’il peut disposer librement de sa vie et chercher son plaisir où il le trouve, l’homme n’a pas le droit d’engager l’avenir d’un enfant condamné d’avance à une irrémédiable dégradation physique ou mentale. La stérilisation des anormaux se pratique déjà dans certains pays, et la nécessité d’un examen prénuptial est admise par les meilleurs esprits. L’américain Lothrop Stoddart rapporte l’histoire d’une famille de 1.200 individus qui eurent pour ancêtres un couple de deux dégénérés : 300 moururent prématurément, 310 furent des mendiants professionnels, 440 furent minés par la syphilis, 130 devinrent des criminels et, parmi ces derniers, 7 commirent des assassinats. Quoi qu’en pensent les catholiques, de tels exemples démontrent qu’une sélection s’impose en matière de procréation.
L’eugénisme comporte tout un ensemble de procédés dont nous ne parlerons pas ici. Dans certains pays comme l’Angleterre, les Etats-Unis, l’Allemagne, la Hollande, la Suisse, il a inspiré des mesures dont les effets bienfaisants se feront sentir dans un avenir prochain. Russie et Suisse ont même permis l’avortement, quand il a lieu dans certaines conditions. En France, par contre, la loi du 31 juillet 1920 punit d’un emprisonnement de six mois à trois ans, et d’une amende de cent à cinq mille francs, quiconque :
« Se sera livré à une propagande anticonceptionnelle ou contre la natalité. »
Le simple exposé des doctrines eugéniques peut donner lieu à des poursuites qui aboutissent d’ordinaire à de sévères condamnations. Des apôtres ont cependant bravé les foudres de la loi pour les faire connaître chez nous. Concernant l’hérédité des aptitudes intellectuelles et morales, nous sommes encore très mal renseignés, malheureusement. Mais de merveilleuses perspectives s’ouvriront pour notre espèce, le jour où l’on pourra sélectionner des races supérieures par le coeur et le cerveau. Les plus audacieuses conceptions sociales, des espoirs que beaucoup déclarent utopiques, seront alors d’une réalisation aisée ; à condition, bien entendu, que cette science nouvelle ne passe point au service des oppresseurs du genre humain.
En attendant ces jours heureux, le problème de la sélection intellectuelle et morale s’impose dans nos actuelles collectivités. C’est en instituant l’École Unique que radicaux et socialistes prétendent dégager de la masse les cerveaux supérieurs. L’un de ses apologistes écrit :
« L’accès du second degré serait réservé exclusivement aux enfants qui auraient été jugés dignes de le recevoir, aux environs de la onzième année. La sélection est une grave détermination qu’on espère réaliser assez exactement au moyen de trois séries d’épreuves, savoir :
-
l’examen attentif des résultats de l’ensemble de la scolarité élémentaire, qui doivent être obligatoirement consignés dans un livret scolaire ;
-
des épreuves écrites et orales ayant pour but de déceler des aptitudes ou des inaptitudes plutôt que de contrôler des connaissances ;
-
des épreuves psychologiques. Ces épreuves donneront lieu à des notes et permettront ainsi de conclure à l’admission ou à l’ajournement d’un enfant à l’enseignement du deuxième degré.
Nous espérons du reste voir établir une corrélation étroite entre l’enseignement primaire complémentaire et les deux premières années de cet enseignement de choix, afin qu’un esprit à évolution plus lente puisse reprendre sans dommage la place qui lui est due. Les jurys conscients de leur véritable rôle ne manqueront pas d’être aussi larges que possible dans le recrutement de l’élite de demain. Les éléments ne manqueront évidemment pas et permettront de puiser dans la masse les cadres futurs de la démocratie. Au troisième degré, on a l’enseignement supérieur proprement dit (Grandes Ecoles, Facultés, etc...). Il se propose la formation technique et professionnelle supérieure, l’initiation à la recherche scientifique en vue de la formation de savants, l’enseignement théorique et pratique de la méthode scientifique, la formation du personnel enseignant, etc... »
Afin de permettre aux riches, même très mal doués, de poursuivre leurs études secondaires ou supérieures, on laissera les écoles congréganistes fonctionner comme par le passé. Qualités de coeur et de volonté n’entreront pas en ligne de compte pour le recrutement de la nouvelle élite sociale.
Ligue des Droits de l’Homme, parti radical, loges maçonniques, etc... collaborèrent à la confection de ce projet. Même s’il s’agit de dégager les esprits vraiment supérieurs, les mesures qu’ils préconisent sont notoirement insuffisantes. Ils confondent faussement valeur et précocité ; aux examens et concours ils prêtent des mérites dont ils sont dépourvus. Désireux de sauver la société capitaliste, ils veulent amoindrir l’énergie révolutionnaire du prolétariat, en privant la masse de ses animateurs les plus intelligents. Mais le comble, c’est qu’ils confondent naïvement l’élite scolaire avec la véritable élite sociale. Ils oublient qu’on peut être un grand esprit et un aboulique ou un fieffé gredin ; leur ignorance est telle, en matière de psychologie, qu’ils identifient savoir et moralité. Vainement, j’ai multiplié les rapports et les études pour éclairer les pontifes sur ce point : il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Dans leur pensée, l’école unique est, avant tout, un magnifique tremplin électoral, aussi m’ont-ils considéré comme un « gêneur ». Une sélection sérieuse devrait pourtant tenir compte des sentiments, de la volonté, des habitudes, des désirs, de tout l’ensemble des éléments psychologiques qui constituent la vie mentale ; à côté des aptitudes intellectuelles, il existe des dispositions morales dont l’importance est prodigieuse. J’ai traité ce problème dans Ethique Nouvelle ; et j’ai montré, par des expériences pratiques, qu’il était possible d’arriver à découvrir les tendances essentielles du moi profond. Sans l’avouer, certaines associations, certains pontifes de l’Université et même des organisations très officielles s’inspirent des idées que j’émis sur ce sujet voici dix ans. Plusieurs reconnaissent qu’une sélection morale serait indispensable dans une société rationnellement organisée. Mais financiers et politiciens sont d’irréductibles adversaires d’une méthode qui mettrait fin à leurs hypocrites et criminels agissements.
— L. BARBEDETTE.
SENS (ESTHÉTIQUE)
Le sens esthétique, que nous appellerons plus volontiers, pour éviter des interprétations alambiquées, le sens de la beauté et le sens de l’art (voir Beauté et Art), est, à notre avis, un sixième sens chez l’homme. Il est inné en lui, comme le sont toutes les « facultés d’éprouver des impressions par l’intermédiaire de ses organes », facultés qui sont celles de ses autres sens. Seul l’homme incomplet, anormal, ne possède pas ce sixième sens, comme il lui arrive d’être dépourvu de ceux de la vue, de l’ouïe, de l’odorat, du goût ou du toucher. Le sens de la beauté et de l’art est, comme les autres sens, susceptible d’augmentation, de diminution, voire d’extinction suivant que son usage est plus ou moins exercé et fréquent.
L’homme primitif est, tout naturellement, sculpteur, peintre, poète, musicien. Il taille ou peint des images, il harmonise sa pensée par le vers ou par le chant, sans avoir appris, tout comme il respire, comme il dort, comme il mange, tant que ses rapports avec la nature ne sont pas interrompus ou faussés par des conventions plus ou moins arbitraires. Ce sont ces conventions toujours plus compliquées qui ont rompu, pour l’homme civilisé, la continuité de ses rapports avec la nature, comme elles ont modifié les facultés de ses sens et les ont diminuées au point de les supprimer parfois totalement. Une sorte d’atavisme s’est formé dans l’espèce humaine qui a, peu à peu, produit et transmis en elle un lent dénaturement, une insensibilité progressive, notamment du sens de la beauté et de l’art, rendant nécessaire, chez la plupart des hommes, une nouvelle création de ce sens par une éducation appropriée.
Il est des êtres qui possèdent intensément le sens de la beauté et de l’art, mais chez qui il ne se découvre que par une sorte de révélation naturelle ou cultivée, quand ils se trouvent, pour la première fois, devant certains spectacles de la nature ou certaines manifestations de l’art. Ils éprouvent alors une émotion nouvelle pour eux, et la répétition de ces spectacles ou de ces manifestations, l’observation critique qu’elle suscite, multiplient, varient, amplifient leur émotion et en font un sens de plus en plus éclairé. D’autres sont, au contraire, entièrement dépourvus du sens de la beauté et de l’art ; ils cherchent vainement à l’acquérir ou à donner l’illusion qu’ils le possèdent. Ils sont les pédants et les sots qui admirent sur la foi des autres. Les premiers sont naturellement des artistes, comme le primitif sculptant un morceau de bois ou soufflant dans un roseau. Eux seuls sont créateurs de pensée, d’art, d’harmonie. Les autres sont des snobs qui font toutes les grimaces esthétiques sans jamais en recevoir une véritable émotion ni leur donner une expression originale.
On a prétendu, bien à tort, que le sens de la beauté et de l’art est l’apanage de l’humanité et de la civilisation. Non seulement il est possédé plus sûrement par l’homme primitif que par le civilisé, mais il a été constaté d’une façon aussi certaine chez l’animal dont l’état de primitivité est, ou du moins semble être, encore plus grand. Ce sens est d’autant plus répandu dans toute la nature qu’il est, comme les autres sens, physiologiquement plus exercé et, psychologiquement, moins déformé par des conventions arbitraires. Il n’y a aucune raison pour que ce sens soit en infériorité chez les animaux, alors que les autres sont, chez eux, si éminemment supérieurs par leurs organes plus nombreux et surtout plus perfectionnés que chez l’homme. Ainsi, l’ouïe est incomparablement mieux servie par la mobilité du pavillon de l’oreille externe chez tous les animaux qui possèdent cet organe, et par l’appareil vibratoire de ceux, les poissons en particulier, qui n’ont pas d’oreille externe. De même pour la vue dont l’organe est, pour certains, sur toute la surface du corps. Parmi ceux qui ont des yeux, il en est qui sont pourvus de plusieurs paires. Les yeux pédonculés de nombreuses espèces leur permettent de changer la direction de leur vue. Les yeux rétiniens des insectes sont enrichis de facettes qui vont jusqu’au nombre de 24.058 chez la mordelle. La mouche commune en a 4.600 à chaque oeil, et le papillon 17.355. Un grand nombre de mammifères voient de nuit comme de jour. Pour le tact, il atteint une subtilité infinie grâce à la multiplicité de ses organes distribués sur tout le corps, notamment aux poils et aux plumes. L’odorat n’est pas moins subtil, servi aussi par des organes nombreux. Enfin le goût, demeuré naturel et qui n’est pas perverti comme chez l’homme par toutes les drogues et les falsifications de la chimie alimentaire, permet toujours à l’animal de discerner l’aliment utile et le nuisible. On peut faire d’un animal un gourmand et même un gourmet ; on ne réussira à l’empoisonner que par une ruse qui mettra son flair en défaut. Le Docteur Ph. Maréchal, dans son ouvrage : Supériorité des animaux sur l’homme, a abondamment démontré cette supériorité en ce qui concerne les sens, et exposé, en même temps, ses répercussions esthétiques et morales chez nos frères appelés « inférieurs ».
Par un phénomène dû à l’excitation factice et toujours plus grande des centres nerveux de l’homme, ses sensations, localisées dans ces centres, sont plus vives mais aussi moins durables que celles de l’animal. Elles sont condensées plus promptement, mais moins profondément, dans sa masse encéphalique nerveuse, alors qu’elles sont disséminées dans les organes des animaux. L’acuité de la sensibilité humaine, artificiellement provoquée et surexcitée, a remplacé de plus en plus la lente expérience et la mémoire qui en conservait les leçons. L’homme, de moins en moins réfléchi, a été de moins en moins capable d’établir pour lui et autour de lui une vie harmonieuse. Il est devenu ainsi, pour le monde entier comme pour sa propre espèce, une véritable terreur. Il a entre autres bouleversé toutes ses notions esthétiques instinctives pour détruire, au lieu de les entretenir, avec les sources de la vie, les joies qui sont ses seules raisons de vivre. Quelle joie plus ardente, plus enivrante, peut-il être que de sentir la féerie de la nature, d’écouter, dans le calme de la nuit, les frissons des feuillages, le chant solitaire du rossignol, du grillon, du crapaud, d’entendre le cri de l’alouette saluant le lever du jour ? .. Il y a des gens qui tuent, pour le plaisir, le rossignol, le grillon, le crapaud, l’alouette, ou qui font taire leur chant par les gargouillades de la T. S. F. ! Déjà insuffisamment doué, dans bien des cas, pour « la lutte pour la vie » et ayant, plus que bien des animaux, besoin de réaliser « l’entente pour la vie », l’homme s’est appliqué à aggraver ses déficiences naturelles devant les forces hostiles et les obstacles à vaincre, en composant une civilisation de plus en plus anti-naturelle et anti-sociale.
Les particularités du sens de la beauté et de l’art dans ses rapports avec la civilisation ont fait naître les théories les plus abracadabrantes, soutenues par de pontifiants imbéciles, de faux artistes, et traduites dans des oeuvres qui ne sont que des monuments de la sottise humaine au lieu de représenter le génie humain, C’est au nom de la science esthétique que ces théories ont été enfantées et qu’on s’est appliqué à les justifier. Ce fut le philosophe Baumgarten qui eut, au XVIIIème siècle, l’idée de formuler une science du Beau à laquelle il donna le nom d’Esthétique. Pour cela, il sépara, dans sa théorie, la « connaissance sensorielle » ou « connaissance sensible », de la haute philosophie ou « connaissance intellectuelle ». L’esthétique était une « gnoséologie inférieure » qui ne dépassait pas l’entendement des sens alors que la « Gnose », ou science supérieure, régnait dans les plus grandes hauteurs de l’esprit. Le Beau, perfection sensible, était inférieur au Bien, perfection rationnelle. Le Beau était dans la nature, à la portée des facultés humaines ordinaires. Le Bien était au-dessus de la nature et des facultés ordinaires, dans le domaine de la morale, c’est-à-dire de la pure spéculation spirituelle. C’était là une nouvelle façon d’appliquer la métaphysique du divin élevé au-dessus de la nature. On laissait à celle-ci le Beau, notion inférieure qu’on séparait du Bien, notion de la divinité. L’esthétique, perfection matérielle et sensible, n’était plus associée à l’éthique, perfection spirituelle et imaginative, comme dans l’antiquité païenne. Celle-ci, dans son enivrement panthéiste, avait confondu les hommes et les dieux, le Beau et le Bien dans la même perfection matérielle et spirituelle. Elle n’avait pas distingué entre la beauté des êtres et des choses et la beauté morale, entre le bien sensible et le bien rationnel. La philosophie d’inspiration chrétienne sépara le Beau-nature et matière du Bien-divinité et esprit.
Cette distinction métaphysique fut le point de départ de toute une logomachie où la notion du Beau fut noyée dans des théories qui ne furent pas plus sensibles que rationnelles. Il fut bon de s’en garder pour conserver la fraîcheur de ses sensations et des émotions du Beau, et ce fut de plus en plus nécessaire. Sans repousser toute culture esthétique, car ce serait refuser la multiplication, la variété et l’intensité des sensations et des émotions d’art, nous devons nous garder des abstractions qui ne sont que de la sottise. Il vaut mieux posséder la primitive et naïve fraîcheur d’âme de Margot qui pleure au mélodrame, que d’être un de ces prétentieux et vides imbéciles applaudissant, pour se donner un air intelligent, à ce qui les fait bailler (voir Snobisme). Le snobisme, qui veut régenter le goût, ignore le mot de Vauvenargues : « Il faut avoir de l’âme pour avoir du goût » : il faut avoir du sentiment, de la sensibilité. Aussi, convient-il de faire des réserves sur une esthétique qui sépare le Beau du Bien, la nature du divin, la matière de l’esprit. La véritable science, comme le véritable instinct du Beau et du Bien, ont fait justice de ces phantasmes qui n’eurent jamais d’autre but que de favoriser la prédominance et le parasitisme des prétendues « élites » sociales. Ils tendent, aujourd’hui, à s’imposer plus que jamais grâce à la veulerie et à la complicité de ceux qui se posent en représentants de l’esprit.
La véritable esthétique est celle qui est à la fois sensible et intellectuelle dans le but de réaliser la véritable perfection rationnelle. Elle ne sépare pas l’esprit de la matière ; au contraire. Comme l’a écrit Elie Faure :
« L’esprit n’atteint l’esprit que si la matière s’y prête. Non pas uniquement la matière visible, mais la matière sensible, le son, le mot, le symbole mathématique. »
Et il a ajouté :
« L’esprit n’est que rapports entre des éléments solides, organisation de ces éléments solides dans une harmonie continue dont l’amour est le mobile et l’intelligence le moyen. Il y a un échange constant, quels que soient l’objet et la forme de notre action, entre la matière du monde que nous transformons immédiatement en esprit dès qu’elle nous touche, et l’esprit que nous nous représentons immédiatement en matière dès que nous en sommes touchés ... La nourriture spirituelle, comme l’autre, devient l’homme intérieur même, qui prête au produit de l’échange les qualités qu’il en reçoit. »
Le véritable sens esthétique, le seul auquel nous devons nous arrêter si nous ne voulons pas nous égarer, est celui qui donne la sensation, en le faisant comprendre, de ce « poème de la matière » qui... :
« ...sature à tel point notre chair, détermine à tel point notre intelligence qu’il faudrait, pour en suivre le déploiement dans l’oeuvre d’art, partir de l’allaitement maternel où une matière liquide modèle notre forme propre, pour aboutir à l’étreinte amoureuse où se révèlent, dans les échanges indéfiniment prolongés de la volupté et de la souffrance, les plus subtiles recherches de l’imagination et de l’esprit, en passant par tous les contacts que l’éducation de nos sens, l’aliment, le vêtement, l’habitat, le jeu nous infligent avec elle. » Le sens esthétique est celui que forme en nous cette « éducation subtile et continue que la matière exerce sur nos facultés de comparer, d’éliminer, d’ordonner et de choisir, même et peut-être surtout quand nous nous imaginons que notre esprit joue dans un espace abstrait dont elle a cependant, à elle seule, déterminé les dimensions. » (Elie Faure : Le Clavier.)
Hors de ces conceptions, qui établissent la profonde communion de l’homme et de la nature, on ne peut que perdre pied, soit pour s’égarer dans les nuages d’une esthétique stratosphérique, soit pour s’enfoncer dans le marécage d’un utilitarisme grossier qui est le bannissement de tout esprit et le renoncement aux splendeurs de l’intelligence. Ce sont ces deux esthétiques : stratosphérique et marécageuse, que la civilisation a développées pour faire perdre aux hommes le véritable sens du Beau en même temps que du Bien, le sens de leur harmonie personnelle et de l’harmonie collective et universelle. Car il n’y a pas de Beau sans le Bien et il n’y a pas de Bien sans le Beau. Ce qui est beau est bien et ce qui est bien est beau. Ils sont les deux conditions de la sagesse humaine. Le Bien en est la substance ; le Beau en est la splendeur. Et pour conclure sur ce sujet, nous disons ceci :
Pour être vraiment humain et remplir entièrement les conditions de sa nature, l’art doit rechercher à la fois le Bien et le Beau. S’il ne s’occupe que du Bien, il ne s’occupe que d’une pure abstraction productive socialement de la tartuferie et du bégueulisme. S’il n’envisage que le Beau, il tombe dans les formes desséchantes et stériles de « l’art pour l’art » (voir Romantisme). Le sculpteur Jean Baffier, qui disait : « l’Art, c’est la Vie », disait aussi que l’art est « l’exaltation de la morale ... la résultante de la morale dont il représente l’exaltation ». Il le voyait dans le positif, dans l’utile, opposé à l’industrie qui « évoque le luxe, le superflu, le faste, la superfétation », et il ajoutait :
« L’Art noble, qui doit être en tous ouvrages, a créé chez nous de la richesse, de la splendeur, de la gloire, tout en conservant pieusement la source de la richesse, de la splendeur et de la gloire. Au contraire, le luxe industrialiste bancaire, avec son système d’exploitation insensé, sa production désordonnée pour satisfaire des concurrences folles, des ambitions démesurées, a conduit aux spéculations les plus extravagantes que l’on voit à cette heure, en oeuvres inqualifiables sur les champs de l’Europe et de l’Asie, même de l’Afrique. »
C’est l’harmonie du Beau et du Bien dans l’art exaltation de la morale qui constitue chez l’homme le sens esthétique, c’est-à-dire le sens d’une vie qui lui sera belle et bonne avec d’autant plus d’intensité que ce sens excitera en lui plus de volonté de réalisation. On comprend dès lors comment une civilisation établie sur la violence et le mensonge, sur l’exploitation de l’homme par l’homme, ne pouvait et ne peut toujours pas réaliser le Bien et le Beau pour tous les hommes. On comprend comment une telle civilisation devait s’efforcer, par la dégradation et l’avilissement de l’individu, de dénaturer, de dévoyer et de détruire si c’était possible son sens esthétique, pour le rendre de plus en plus incapable d’aspirer au Beau et au Bien, de revendiquer avec toute l’énergie nécessaire une vie belle et bonne pour tous. « Qui travaillerait pour nous s’il n’y avait plus de pauvres ! » demandait insolemment Metternich à Robert Owen au lendemain de l’avortement de la Révolution Française tuée par Napoléon et ensevelie par la Sainte Alliance. Ce mot cynique est la plus implacable condamnation des boutiquiers de la morale et des pontifes de « l’art pour l’art » installés dans le parasitisme social.
Mais on ne joue pas sans risque avec le feu. Les corrupteurs ont été les premiers corrompus. Les avilisseurs de l’âme populaire, celle des pauvres qu’ils faisaient travailler pour eux, ont été les premiers avilis. Ce sens esthétique qu’ils veulent achever de détruire chez leurs exploités, ils l’ont perdu depuis longtemps. Leur avidité, leur cruauté, leur vanité publicitaire, tout ce qui a produit leur mégalomanie, leur besoin de paraître et qui en a fait ces mufles intégraux dont nous avons constaté les agissements (voir Muflisme), leur a fait perdre à tel point le sens du Beau et du Bien qu’ils sont devenus eux-mêmes, aujourd’hui, les plus sûrs artisans de leur propre destruction. Car leurs victimes, hélas ! paraissent de plus en plus incapables du « geste » libérateur dans l’effondrement parallèle de leur propre sens esthétique.
Impuissantes à réagir contre les moyens de coercition matérielle qui les accablent, ces victimes sont encore plus impuissantes devant les moyens qui scellent moralement leur esclavage. Misère matérielle, abrutissement moral ; les deux sont complémentaires, et la conséquence de l’extinction du sens esthétique inspirateur de volonté sociale. La double méthode poursuit son office. Côté du Bien c’est l’obéissance perende ac cadaver à une morale civique, religieuse ou laïque, de renoncement, de soumission, à toutes les disciplines de l’usine et de la caserne ; le prolétaire — qui forme les neuf dixièmes de la population du globe — de plus en plus rationalisé, retravaillera bientôt chargé de chaînes et sous la trique comme l’esclave antique, comme les forçats, comme les noirs et les jaunes conquis par la « civilisation ». Côté du Beau, c’est l’abrutissement systématique, méthodiquement poursuivi, par tous les moyens qui « empêchent de penser », qui emportent la vie dans le tourbillon de la vitesse, du bruit, des éclairages violents, des intoxications, qui transportent dans les « paradis artificiels » ; c’est le débordement de folie sanglante, de mégalomanie grotesque, de saleté physique et morale, de muflisme en un mot qui constitue la vie actuelle.
Dans le dénaturement des sens physiques soumis à ce régime permanent de surexcitation et de désagrégation, que peut devenir le sens esthétique qui est en quelque sorte le produit, la synthèse à la fois spontanée et réfléchie de leurs sensations ? Il n’est, pour en juger, qu’à voir la laideur, l’inintelligence, l’inconscience des formes de la vie sociale et des milieux où elles se manifestent pour la plupart des hommes ; il n’est qu’à voir surtout les spectacles (voir ce mot) où ils se plaisent et où ils vont puiser leurs sensations esthétiques. Ces spectacles sont caractéristiques de la place prise dans la société par la brute civilisée mille fois plus obtuse, perverse et dangereuse que celle des cavernes. Les raffinements de sa perversion ont fait du monde entier un immense domaine du docteur Goudron et du professeur Plume.
De même que les excès imposés aux sens physiques finissent par annihiler en eux toutes sensations, le baratage grossier des facultés de l’esprit et du coeur finissent par détruire en eux toute intelligence et toute émotion quelque peu nuancée, délicate. Leur sensibilité subit le sort de la vue chez celui qui ne travaille qu’à la lumière artificielle, de l’ouïe chez le chaudronnier qui frappe sans cesse sur le métal, du toucher que les callus font perdre aux mains des terrassiers, de l’odorat pour les travailleurs des égouts, du goût pour les intoxiqués du tabac, de l’alcool et les amateurs de viandes faisandées. Quelle espèce de sens du beau et de l’art peut avoir, par exemple, une foule de deux ou trois mille personnes assistant à un concert de musique de chambre, dans une salle immense où aucun véritable silence n’est possible ? Alors que cette musique est toute de précision, de nuances, d’échos intimes, de profondeur qui demande un repliement de l’âme sur elle-même, un recueillement qui prolonge la sensation et l’émotion quelques minutes au moins après que les dernières notes se sont éteintes : on voit cette foule éclater en bravos bruyants avant même les dernières notes, trépigner, hurler comme si elle venait d’assister à l’écroulement d’un « poids lourd » ou à l’étripement d’un cheval de « corrida » ! Et que penser, aussi, du sens et de la conscience artistiques des virtuoses — des Cortot, des Thibaud — qui livrent ainsi aux bêtes Mozart, Beethoven, Chopin ou Debussy ?
Au défaut de sens esthétique individuel correspond celui du sens esthétique collectif dans les villes livrées à toutes les hideurs utilitaires et industrielles imaginées par le muflisme des tripoteurs d’affaires. La chanson du travail s’est tue dans les rues des villes ; elle est morte avec le petit artisan et elle est interdite à l’ouvrier rationalisé et taylorisé. Une morne indifférence marque l’ataxie esthétique des foules devant les modes grotesques dont on les affuble, devant les odieux navets qui sont une injure à leurs morts de la guerre qu’elles ont voulu honorer, devant les criminelles entreprises des « topazes » qui font abattre des arbres centenaires, dernière beauté des boulevards, pour faire de la place à des tables de bars, ou qui détruisent des beautés naturelles uniques, menacent des populations entières d’empoisonnement, pour les profits scandaleux d’entrepreneurs de carrières et de fabricants de ciment (Calanques et terroir de Cassis).
Il est d’une nécessité impérieuse pour tous les travailleurs, pour tous ceux qui veulent vivre une autre vie que celle d’un ilote abruti, de retrouver et de cultiver en eux le véritable sens esthétique, celui qui ne sépare pas le Bien et le Beau, l’éthique sociale qui est la justice dispensatrice du bien de tous, de l’esthétique individuelle et collective qui est la beauté et la joie à l’esprit et au coeur de tous.
— Edouard ROTHEN.
SENSATION
n. f.
Élément fondamental de la connaissance, la sensation est l’état psychologique immédiat que provoque l’excitation d’un ou de plusieurs nerfs sensitifs. Plaisirs de l’odorat ou du goût, douleur d’une brûlure sont appelés sensations tout comme les impressions tactiles, les couleurs, les sons : car ce terme s’applique indifféremment à des états affectifs ou à des états représentatifs. En fait, point de connaissance, même d’ordre spéculatif, qui ne s’accompagne d’une tonalité affective, parfois très minime il est vrai. Mais c’est exclusivement le caractère représentatif de la sensation que nous étudierons ici.
Dans les rangs inférieurs du monde organisé, chez les amibes par exemple, le protoplasma se présente sous une forme indifférenciée et les diverses fonctions biologiques paraissent s’exécuter au moyen d’une partie quelconque de cette substance uniforme : indifférence structurale et indifférence fonctionnelle sont intimement liées l’une à l’autre. Par contre, si nous négligeons les transitions pour arriver aux animaux supérieurs et à l’homme, nous constatons que la spécialisation des éléments anatomiques s’accompagne d’une division parallèle du travail physiologique. Grâce à une différenciation très accentuée du système nerveux, phénomènes de sensibilité et de motilité acquièrent une très haute importance. Le rôle de ce système est grand dans la vie organique, puisqu’il règle les mouvements des poumons, du cœoeur et de l’appareil circulatoire, les sécrétions, les mouvements de l’appareil digestif et ceux qui commandent les diverses excrétions. D’autre part, c’est lui qui permet au vivant d’entretenir d’étroites relations avec le milieu extérieur, d’en ressentir les multiples influences et d’y répondre d’une façon appropriée. Mais, alors que les nerfs affectés à la vie organique se rattachent dans l’ensemble au système du grand sympathique, ceux qui sont préposés à la vie de relation se rattachent au système encéphalo-rachidien. Collecteurs des impulsions venues du dehors, les appareils sensoriels, qui font partie intégrante de ce dernier système, se composent essentiellement d’organes récepteurs de l’excitation, d’organes de transmission et d’organes centraux de perception situés dans une partie déterminée de l’écorce cérébrale. Notons, en outre, que l’exercice de chaque sens s’accompagne, dans le champ de sa partie périphérique, de réactions musculaires, indispensables à son jeu régulier et complet. Dans les divers appareils sensoriels, les voies longues conduisent les impressions excitatrices jusqu’à la sphère corticale du cerveau, alors que les voies courtes s’arrêtent dans les centres infra-corticaux. Les neurones sensitifs périphériques ont leur corps cellulaire en dehors de l’axe encéphalo-rachidien : c’est dans la rétine elle-même que les fibres du nerf optique ont leurs cellules d’origine ; c’est dans les ganglions de Corti ou de Scarpa que l’on trouve celles du nerf acoustique.
Adaptés à un genre d’impression bien déterminée, les organes des sens doivent recevoir une excitation qui ne soit ni trop faible ni trop forte, pour donner naissance à une sensation. Au-dessous de 16 vibrations par seconde et au-dessus de 34.000, l’oreille ne perçoit aucun son ; pour les autres sens, il est, de même, possible de déterminer un minimum et un maximum, variables dans une certaine limite. Quel que soit le mode d’excitation, un organe perceptif répond toujours par des sensations d’aspect analogue : électricité, lumière, choc, ingrédients chimiques, etc... produisent une impression lumineuse, quand on les applique au nerf optique, Par contre, la même excitation produit des phénomènes très différents, selon le sens qu’elle impressionne : le courant électrique qui, appliqué à l’œoeil, détermine une sensation de lumière, provoquera une sensation de choc s’il agit sur le bras, une sensation d’odeur s’il ébranle le nerf olfactif. Aussi, plusieurs physiologistes pensent-ils que la différence spécifique, constatée entre les impressions sensorielles, ne résulte pas de la réalité extérieure, mais du seul système nerveux. C’est une action chimique que l’énergie excitatrice détermine dans les organes des sens ; et c’est la présence des produits de désassimilation qui engendre le sentiment de fatigue, consécutif à des ébranlements trop forts ou trop souvent répétés.
L’excitation est transmise au cerveau grâce à une modification chimique qui, de proche en proche, gagne les éléments encéphaliques. Plusieurs admettent un influx nerveux, analogue au courant électrique. Mais notons qu’il est beaucoup plus lent : sa vitesse, chez l’homme, est de 60 mètres par seconde dans les nerfs centrifuges, de 130 mètres dans les nerfs centripètes. Concernant le travail qui s’accomplit dans l’intimité du cerveau, nous savons fort peu de chose ; toutefois l’on est parvenu à localiser certains centres sensoriels. Un chien devient complètement aveugle, si l’on dénude ses deux lobes occipitaux ; si l’on enlève l’écorce grise du lobe droit seulement, il est partiellement aveugle et de l’oeœil gauche et de l’œoeil droit. Pour provoquer la cécité de points limités du champ visuel, il suffit d’enlever des parties déterminées des mêmes lobes. A la suite de lésions occipitales, on a constaté, chez l’homme, des troubles analogues. Chez le chien, l’oreille droite a son centre sensoriel dans la troisième circonvolution occipitale gauche, l’oreille gauche dans la même circonvolution du côté droit. Même si les organes périphériques ne subissent aucune excitation, des sensations apparaissent quand les centres encéphaliques sont ébranlés ; on l’observe dans maints rêves et dans toutes les hallucinations.
Au point de vue psychologique, la sensation subit l’influence et des états qui l’ont précédée et de ceux qui l’accompagnent. Après un bruit étourdissant, l’on ne perçoit pas les nuances de faibles sonorités ; une couleur obtient son maximum de netteté, quand l’accompagnent ses couleurs complémentaires. Harmonie des sons, accord des nuances visuelles sont fondamentales, la première en musique, le second en peinture. De plus, les impressions des divers sens s’entravent ou se renforcent : une sensation lumineuse intense augmente habituellement la finesse de l’ouïe ; des sensations sonores très vives obscurcissent d’abord les perceptions visuelles, puis les stimulent. Un contraste plus ou moins accentué semble nécessaire pour mettre en relief les sensations. Si la température se modifie brusquement, dans la chambre où je me trouve, je le remarque aussitôt ; mais je ne m’en aperçois point, si elle varie lentement. On peut cuire ou congeler des grenouilles, sans qu’aucun mouvement trahisse une douleur quelconque, lorsqu’on élève ou diminue peu à peu la chaleur. En effet, ce que l’on perçoit surtout, c’est le changement, l’opposition. La saveur sucrée d’une solution, trop faible pour être sentie normalement, le sera, et d’une façon très nette, après une application de chlorure de sodium.
Outre sa qualité spécifique et sa nuance individuelle, chaque sensation offre une certaine intensité. Bergson s’est vainement efforcé de montrer que cette dernière se réduisait à un aspect qualitatif. « Une expérience de tous les instants, écrit-il, qui a commencé avec les premières lueurs de la conscience et qui se poursuit pendant notre existence entière, nous montre une nuance déterminée de la sensation répondant à une valeur déterminée de l’excitation. Nous associons alors à une certaine qualité de l’effet l’idée d’une certaine quantité de la cause ; et finalement, comme il arrive pour toute perception acquise, nous mettons l’idée dans la sensation, la quantité de la cause dans la qualité de l’effet. A ce moment précis, l’intensité, qui n’était qu’une certaine nuance ou qualité de la sensation, devient une grandeur. » Mais les analyses psychologiques de Bergson ne peuvent rendre compte de l’aspect quantitatif de maints états de conscience ; et l’ingéniosité de son langage, capable de merveilleux tours de prestidigitation, ne parvient pas à escamoter ce que, dans un sentiment ou une sensation, l’on dénomme intensité. Par contre, de nombreux auteurs font remarquer, avec justesse, qu’élément affectif et élément représentatif se nuisent dans nos sensations : l’intensité de l’émotion ne favorise pas la netteté de la perception, et les sensations olfactives, gustatives, cénesthésiques, qui présentent un caractère affectif très marqué, ne nous donnent, au point de vue de la connaissance, que des notions imprécises et vagues.
La sensation ne se produit que si l’impression initiale possède une durée suffisante ; et elle persiste après l’excitation, dans une mesure qui varie avec la force de cette dernière. Pour l’oeœil, cette persistance va de 1/15 à 1/3 de seconde. Aussi l’impression produite est-elle continue, quand les excitations lumineuses se succèdent à des intervalles rapprochés : c’est le principe du cinématographe, et l’enfant sait qu’il peut décrire cercles ou rubans de feu en agitant assez vite un tison enflammé. Les chocs électriques cessent d’être discernables dès que leur nombre dépasse 35 à la seconde sur le corps, 60 sur le front. Des observations analogues ont été faites concernant les autres sens. Au point de vue psychologique, nous sommes conscients de la durée des sensations : durée plus ou moins longue et qui présente un aspect différent selon les sens affectés. Notre notion du temps provient, sans doute, d’une assimilation de ces diverses durées faite, ultérieurement au profit des sensations musculaires et auditives.
Certaines sensations sont manifestement extensives, c’est-à-dire étalées dans l’espace ; tel est le cas des couleurs et des impressions tactiles. Beaucoup de psychologues accordent ce caractère à toutes les données des sens. James affirme :
« La voluminosité est une qualité commune à toutes les sensations, tout comme l’intensité. Nous disons fort bien des grondements du tonnerre qu’ils ont un autre volume de sonorité que le grincement d’un crayon sur une ardoise ... Une légère douleur névralgique du visage, fine comme une toile d’araignée, paraît moins profonde que la douleur pesante d’un furoncle, ou la souffrance massive d’une colique ou d’un lumbago ... Les sensations musculaires ont également leur volume, ainsi que les sensations dues aux canaux semi-circulaires, voire même les odeurs et les saveurs. Les sécrétions internes surtout sont remarquables à ce point de vue ; témoin les sensations de plénitude et de vide, d’étouffement, les palpitations, les maux de tête, ou encore cette conscience très spatiale que nous donnent de notre état organique la nausée, la fièvre, la fatigue, les lourdes somnolences. »
Les anciens psychologues admettaient cinq sens : la vue, l’ouïe, le toucher, le goût et l’odorat ; mais les savants contemporains ont allongé la liste traditionnelle. C’est à la vue que nous devons les sensations de lumière et de couleur. Dans les sensations de lumière, la rétine est actionnée par un mélange complexe des diverses couleurs du spectre, c’est-à-dire par une association de vibrations d’amplitude et de longueur d’onde fort différentes. Dans les sensations de couleur, les rayons excitateurs sont les composants dissociés de la lumière blanche. Violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé, rouge constituent les notes principales de la gamme colorée ; mais trois d’entre elles, le vert, le jaune et le rouge, sont dites couleurs fondamentales, parce qu’elles permettent, quand on les associe en proportions variables, de reproduire toutes les autres. On pourrait distinguer six à sept cents qualités d’impressions lumineuses, au dire de certains ; et l’on a parlé d’un million de nuances colorées, en tenant compte du ton, de l’intensité et de la saturation. D’autres évaluent le nombre des sensations visuelles possibles à 35.000 ; dans chacune des couleurs du prisme, un ouvrier tapissier des gobelins ou d’Aubusson arrive, assure-t-on, à distinguer 1.500 nuances en moyenne, parfois plus, parfois moins.
A l’ouïe nous devons de connaître les bruits, résultats d’ébranlements irréguliers, instables et confus, ainsi que les sons, dûs à des vibrations périodiques et régulières. Ces derniers diffèrent entre eux par la hauteur, l’intensité, le timbre ; et une oreille exercée arrive à distinguer un nombre prodigieux de sons.
« Des notes les plus basses jusqu’aux plus hautes, écrit Ebbinghaus, nous pouvons percevoir, dans des conditions favorables, plusieurs milliers de notes et dans les hauteurs moyennes, à l’intérieur d’une seule octave, plus de mille. Si, dans l’emploi pratique des sons dans la musique, nous nous contentons d’un nombre plus faible (dans les instruments à notes fixes 12 à l’octave), cela tient en partie à des raisons techniques comme le maniement incommode d’instruments à notes trop nombreuses. Mais cela vient surtout de ce que relativement peu de notes s’accordent bien avec une note prise au hasard. »
On distingue, aujourd’hui, les sensations kinesthésiques et thermiques des sensations tactiles ; aussi n’accordons-nous plus au toucher l’importance exceptionnelle que les anciens psychologues lui attribuaient. Nous devons à ce sens les impressions de contact, de poli ou de rugueux, de chatouillement. Expansions nerveuses peu différenciées, ses organes récepteurs sont répandus sur toute la surface du corps. Néanmoins la sensibilité tactile n’est pas égale dans les diverses régions de la peau ; l’écartement minimum, requis pour que l’on sente séparément les deux pointes d’un compas, permet d’apprécier son degré d’acuité. Pour la langue, les lèvres et le bout des doigts, cet écartement va de 1 à 5 millimètres ; il dépasse 3 centimètres sur le dos de la main et 5 centimètres sur la région dorsale du corps. Quant à la persistance des impressions tactiles, elle est très faible, et si l’on touche une roue dentée, animée d’un mouvement rotatoire, la sensation n’apparaît continue qu’au delà de 40 impressions par seconde.
Le goût, qui a son siège dans la bouche, nous renseigne sur les saveurs ; mais les sensations qu’il nous donne sont habituellement mélangées à des sensations de contact, de chaleur, d’odeur, de mouvement. Parfois même les secondes sont prédominantes : les saveurs astringentes sont d’origine tactile, celles de la menthe poivrée ou de la moutarde s’avèrent surtout calorifiques, et l’on arrive difficilement à distinguer un oignon d’une pomme, lorsque le sens olfactif est détruit. C’est d’ailleurs à des terminaisons nerveuses spéciales que répondent les sensations gustatives fondamentales : sucré, acide, amer, salé. Plusieurs sels métalliques paraissent acides, en effet, quand on les pose à la pointe de la langue, et amers quand on les place dans la région postérieure ; c’est le cas de l’acétate de plomb.
Localisé dans la partie supérieure des fosses nasales, l’odorat joue un rôle prépondérant chez certains animaux. Bien que très réduit chez l’homme, par défaut d’exercice, il demeure capable, en certains cas, de déceler la présence de substances chimiques qui n’existent qu’à dose infînitésimale : on peut sentir un deux millionième de milligramme de musc et un vingt-cinq millionième de milligramme de mercaptan. Le chien, dont les lobes et les organes récepteurs olfactifs sont beaucoup plus développés que dans l’espèce humaine, retrouve, après plusieurs heures, l’odeur laissée par le passage d’un lièvre ou de son maître. Souvent les sensations olfactives s’associent à des saveurs ou à des sensations thermiques. On arrive même à confondre odeurs et saveurs : lorsqu’il agit sur la muqueuse nasale, le chloroforme semble avoir un goût sucré. Et, quoi qu’on pense, l’ammoniaque n’excite pas les fibres olfactives mais uniquement les organes tactiles du nez. Dans les conditions normales, les effluves odorants sont recueillis à l’état gazeux seulement.
A côté des cinq sens classiques, il convient de faire une place à des sens nouvellement découverts : la cénesthésie, le sens kinesthésique, le sens thermique, celui de l’orientation. Et, sans parler des sens particuliers que l’on rencontre chez certaines espèces animales, nul ne saurait affirmer que l’on n’en découvrira pas d’autres, encore insoupçonnés, même chez l’homme. La cénesthésie ou sensibilité de l’ensemble des organes est liée au fonctionnement des appareils de la respiration, de la digestion, etc..., à celui des glandes, des nerfs, peut-être du cerveau. Habituellement vague et peu claire, lorsque les organes sont en bon état, elle devient très vive dans certaines maladies. Nous lui devons les sensations générales de bien-être, de lassitude, de surexcitation, d’abattement, etc..., ainsi que des sensations de caractère périodique comme celle de la faim. Dans la cénesthésie, l’élément affectif est tout à fait prédominant ; l’élément représentatif ne comporte que des indications vagues et facilement illusoires. Une concentration excessive de l’attention sur les sensations organiques engendre la neurasthénie et la nosophobie ou crainte d’être atteint de toutes les maladies dont on entend parler ; parfois elle aboutit aux phénomènes si curieux de l’autoscopie interne. Le malade parvient à décrire l’état d’organes tels que le coeœur, le foie, les poumons. Des personnes, ignorantes des notions même élémentaires de l’anatomie, ont pu donner des indications sur le jeu de leurs valvules cardiaques ou préciser la place, dans l’intestin, d’une épingle avalée par mégarde.
Le sens kinesthésique, nettement distingué du toucher par les psychologues contemporains, nous renseigne sur l’état de nos muscles, sur les mouvements et la situation de nos membres. Que je remue mon bras ou qu’on le déplace sans aucun effort de ma part, j’en suis averti, dans les deux cas, même si je n’éprouve aucune sensation tactile et si j’ai les yeux fermés. En effet, les sensations kinesthésiques ne viennent pas seulement des muscles, mais aussi des articulations et des tendons. Quant au sentiment de l’effort, auquel Maine de Biran fait jouer un rôle primordial dans sa philosophie, il ne précède pas la contraction musculaire et n’accompagne pas l’innervation centrale. Comme toutes les autres sensations, celle de l’effort résulte d’une impression centripète. Lorsqu’ils cherchent à soulever leurs membres paralysés, certains hémiplégiques ont conscience de l’effort déployé, mais l’on constate qu’ils contractent alors soit les membres correspondants, soit d’autres muscles. Fréquemment, les sensations kinesthésiques se mêlent à d’autres sensations, en particulier à celles du toucher ; toutefois il faut ranger la sensation de pression dans la seconde catégorie et celle de poids dans la première.
Longtemps confondu avec le sens tactile, le sens thermique possède pourtant des organes spéciaux, de qui dépendent nos impressions de froid et de chaud. Les points de notre épiderme qui sentent le froid ne sont, d’ailleurs, pas les mêmes que ceux qui sentent le chaud. Si l’on promène lentement et légèrement une plume d’acier ou une tige pointue sur le dos de la main, l’on perçoit, par intervalles, une sensation de froid liée à certains points. Pour découvrir les points sensibles à la chaleur, il faut maintenir chaude l’extrémité de la plume ou de la tige dont on se sert. Ce n’est pas à un refroidissement de la peau, mais à une hyperesthésie des nerfs du froid qu’est due l’action des crayons de menthol. Le sens thermique ne nous renseigne, en définitive, que sur les variations de température des objets extérieurs, considérées dans leur rapport avec celle de notre propre corps. On attribue à un mélange d’excitations thermiques et tactiles la sensation d’humidité.
Au sens de l’équilibre, ou sens statique, nous devons les sensations de mouvement rectiligne ou curviligne, de verticalité, d’inclinaison, de vertige, d’étourdissement. Il nous renseigne, en effet, sur la position de la tête au cours des divers mouvements accomplis et, par là même, d’une façon indirecte, sur l’attitude générale du corps. Les canaux semi-circulaires de l’oreille interne constituent les organes spéciaux du sens statique, ainsi que de multiples expériences l’ont démontré ; au nombre de trois chez l’homme, ils semblent correspondre aux trois dimensions de l’espace. Déjà, Flourens constatait :
« Que la section des canaux semi-circulaires provoque chez les animaux des mouvements dont la direction correspond au plan du canal opéré. »
La grenouille, dont on a sectionné les canaux horizontaux, ne nage plus en ligne droite, mais en cercle ; elle se balance autour de son axe longitudinal. Si l’on coupe ses canaux verticaux, elle saute en ligne droite au contraire. Des expériences analogues, faites sur des lapins et des pigeons, aboutissent à des résultats identiques. De plus, on observe que les animaux qui, comme les lamproies et les souris japonaises, ne possèdent qu’une ou deux paires de canaux semi-circulaires donnent, par leurs mouvements, l’impression de ne connaître qu’une ou deux dimensions de l’espace. Les souris japonaises, par exemple, tournent fréquemment sur elles-mêmes durant des heures entières ; elles n’avancent que par trajets circulaires et en diagonale. Chez l’homme, les lésions des organes du sens statique provoquent le manque d’équilibre et le vertige. Ebbinghaus remarque :
« Si l’on tourne, les yeux fermés, plusieurs fois de suite sur le talon et si l’on s’arrête subitement, on a l’impression sensible, la plus vive, de tourner dans le sens contraire au précédent ; c’est une sensation des canaux semi-circulaires. Elle provient de ce qu’un anneau de liquide dans le canal horizontal, qui au début de la rotation du corps était resté un peu collé aux parois de celui-ci, tourne encore un moment lorsqu’on s’arrête brusquement et produit, sur les organes terminaux d’un nerf qui pénètrent dans ce liquide, une excitation contraire à la précédente. »
Certains animaux possèdent des sens dont nous comprenons très mal la nature : sens électrique, sens hygrométrique, sens de l’orientation, etc... On a beaucoup écrit, sans parvenir à formuler une explication satisfaisante, sur la faculté que possède le pigeon voyageur de regagner son gîte, même lorsqu’on le transporte à des centaines de kilomètres. Concernant les insectes, bien des choses restent à découvrir, non moins mystérieuses que celles qu’on connaît déjà. Mais, lentement, de patients chercheurs défrichent ces coins obscurs où rien n’échappe, pas plus qu’ailleurs, à la loi du déterminisme universel.
C’est dans l’étude des sensations que les psychologues se sont efforcés, pour la première fois, d’utiliser les procédés de mesure et de calcul chers aux physiciens et aux chimistes. Toute une école de psychophysiciens s’est donnée pour mission de préciser les relations qui unissent le monde physique au monde mental. Ils ont déterminé le sens de l’excitation, c’est-à-dire le minimum d’excitation requis pour qu’il y ait sensation, et surtout ils ont voulu exprimer en langage mathématique les rapports des impressions physiques et des sensations. Mais de telles recherches sont délicates. Pour la sensation de pression, on pose sur le point de la peau que l’on veut explorer de petites balles de liège, afin de parvenir à déterminer le poids minimum perceptible. Ribot écrit :
« Un grand nombre de recherches faites de cette manière, ont prouvé que la peau possède une sensibilité très variable suivant les régions explorées. Les régions les plus sensibles sont le front, les tempes, les paupières, le dos de la main ; elles peuvent sentir jusqu’à 1/500 de gramme. Le plat de la main, le ventre, les jambes sont des régions très peu sensibles, puisque le minimum perceptible tombe à 1/20 de gramme. Enfin, sur les ongles et au talon, il descend jusqu’à 19 grammes. Pour ce qui concerne l’effort musculaire, le minimum perceptible serait représenté, suivant Wundt, par le raccourcissement de 4/100 de millimètre du muscle droit interne de l’oeœil. »
Lorsque la main est à 18°C environ, il faut une élévation de 1/8 de degré pour éprouver une sensation thermique. D’après Volkmann, la plus petite sensation lumineuse perceptible serait égale à l’éclairage d’un velours noir par une bougie placée à une distance de 7,7 pieds. Pour l’ouïe, le bruit le plus faible qui puisse franchir le seuil de la conscience est l’équivalent du son produit par une boule de liège de 1 milligramme, tombant de 1 millimètre de haut, l’oreille étant à 91 millimètres de distance.
Mais c’est à détenniner les rapports de l’excitation à la sensation que se sont particulièrement attachés les psychophysiciens. Déjà Weber constatait que la sensation croît d’une manière discontinue, même quand l’excitation croît d’une manière continue, et qu’une excitation nouvelle, pour être sentie, doit être d’autant plus faible que l’excitation à laquelle elle s’ajoute est plus faible, d’autant plus forte que l’excitation à laquelle elle s’ajoute est plus forte. D’où la loi suivante, appelée loi de Weber :
« L’accroissement de l’excitant nécessaire pour produire un accroissement perceptible de la sensation est une fraction constante de cet excitant. »
Fechner essaya de préciser la loi de Weber et de trouver une formule exprimant le rapport de toute excitation à toute sensation. Il utilisa trois méthodes ingénieuses : celle des plus petites différences perceptibles, celle des cas vrais et faux, celle des erreurs moyennes, et multiplia les expériences. Finalement, il parvint à énoncer la loi psychophysique qui porte son nom :
« La sensation croît comme le logarithme de l’excitation. »
En d’autres termes, lorsque les excitations croissent en progression géométrique, les sensations croissent en progression arithmétique. Les mesures opérées par Fechner n’étaient pas irréprochables ; on a dû les modifier. De plus, sa formule ne tenait pas assez compte de la complexité des faits. Néanmoins, malgré les critiques acerbes qu’on a coutume de lui adresser, il n’est pas vrai que sa tentative ait complètement échoué. Nous savons maintenant, de la façon la plus certaine, qu’il n’y a ni égalité, ni équivalence entre les variations d’intensité de l’excitation et les variations d’intensité de la sensation. En outre, nous constatons que la sensation n’est pas un état simple et irréductible, comme le prétendent les spiritualistes, mais qu’elle est une synthèse, le résultat d’un travail organique préalable.
Taine, penseur généralement soucieux de ne point déplaire aux bien-pensants, estimait dans son livre L’Intelligence que les sensations n’ont pas le caractère de simplicité qu’on leur attribue :
« La psychologie est aujourd’hui en face des sensations prétendues simples, comme la chimie, à son début, était devant les corps prétendus simples. En effet, intérieure ou extérieure, l’observation, à son premier stade, ne saisit que des composés ; son affaire est de les décomposer en leurs éléments, de montrer les divers groupements dont les mêmes éléments sont capables, et de construire avec eux les divers composés. Le chimiste prouve qu’en combinant, avec une molécule d’azote, une, deux, trois, quatre, cinq molécules d’oxygène, on construit le protoxyde d’azote, l’acide azoteux, l’acide hypo-azotique, l’acide azotique, cinq substances qui, pour l’observation brute, n’ont rien de commun et qui pourtant ne diffèrent que par le nombre de molécules d’oxygène comprises dans chacune de leurs parcelles. Le psychologue doit chercher si, en joignant telle sensation élémentaire avec une, deux, trois autres sensations élémentaires, en les rapprochant dans le temps, en leur donnant une durée plus longue ou plus courte, en leur communiquant une intensité moindre ou plus grande, il ne parvient pas à construire ces blocs de sensations que saisit la conscience brute et qui, irréductibles pour elle, ne diffèrent cependant que par la durée, la proximité, la grandeur et le nombre de leurs éléments. »
Et Taine trouve la preuve de ce qu’il avance dans des expériences effectuées en acoustique, et qui démontrent que les différences qualitatives des sons proviennent, en réalité, de différences quantitatives. Spencer déclare, lui aussi, que « la substance de l’âme est résoluble en chocs nerveux », et que toute sensation se ramène à un nombre fixe de ces chocs produits par les mouvements ondulatoires de l’excitation. De l’élément primordial, constitutif de toutes les perceptions des sens, le philosophe anglais estime même possible de donner une idée. Il déclare :
« L’effet subjectif, produit par un craquement ou un bruit qui n’a pas de durée appréciable, n’est guère autre chose qu’un choc nerveux. Quoique nous distinguons un pareil choc nerveux comme appartenant à ce que nous appelons sons, cependant il ne diffère pas beaucoup de chocs nerveux d’autres espèces. Une décharge électrique, qui traverse le corps, cause une sensation analogue à celle d’un bruit fort et soudain. »
Bien entendu, les spiritualistes ont poussé des cris d’orfraie, tant ils redoutent l’introduction de la mesure et de l’analyse quantitative en psychologie. Certes, nous estimons que Spencer et Taine se trompent sur bien des points, mais il nous semble évident que la sensation s’explique par ses antécédents physiologiques. Contrairement à la thèse épiphénoméniste de Le Dantec, qui est une absurdité scientifique, nous admettons l’existence d’une énergie mentale capable d’avoir une action très efficace ; mais cette énergie mentale n’a rien de spirituel au sens traditionnel du mot, elle s’avère de même nature que les énergies les plus matérielles et n’est qu’une transformation des forces corporelles, une qualité nouvelle conditionnée par le système nerveux. De même que le travail mécanique peut engendrer l’énergie électrique qui, à son tour, donnera de la lumière, de la chaleur, etc..., de même le cerveau engendre la pensée, une pensée vraiment efficace, dont les effets sur l’organisme sont indéniables, mais qui, fatalement, cesse d’être lorsque le cerveau disparaît. Manifestation première de l’énergie mentale, la sensation nous renseigne sur les rapports qui relient notre corps au milieu environnant.
— L. BARBEDETTE.
SENSIBILITÉ
n. f. (du latin : sensibilitas, même signification)
Ce mot désigne la faculté d’éprouver ou de ressentir des impressions physiques ou morales : c’est cette propriété dévolue à certaines parties du système nerveux, par laquelle tout être vivant perçoit les impressions faites soit par des objets du dehors, soit produites à l’intérieur. En langage psychologique, le terme est des plus vagues et des plus défectueux ; aussi est-il employé sous de multiples significations. Physiologiquement, il désigne des phénomènes purement physiques ou mécaniques. Claude Bernard écrivait :
« Les philosophes ne connaissent et n’admettent, en général, que la sensibilité consciente, celle que leur atteste la douleur, déterminée par des modifications externes ... Les physiologistes se placent nécessairement à un autre point de vue. Ils doivent étudier le phénomène objectivement, sous toutes les formes qu’il revêt. Ils observent que, au moment où un agent modificateur agit sur l’homme, il ne provoque pas seulement le plaisir et la douleur, il n’affecte pas seulement l’âme : il affecte le corps, il détermine d’autres réactions que les réactions psychiques, et ces réactions automatiques, loin d’être la partie accessoire du phénomène, en sont, au contraire, l’élément essentiel. »
Pour tenter de faire cesser ce que certaines écoles philosophiques supposent être une confusion, on chercha à désigner, sous le nom d’irritabilité et d’excitabilité, les phénomènes dans lesquels n’entre pas la conscience ou ceux où la conscience n’intervient qu’à un faible degré. Cette façon de voir semble s’appuyer surtout sur certains dogmes religieux, entre autres celui qui prétend que, seul, l’homme possède une âme, que les animaux et les plantes n’en ont pas. Les découvertes modernes de la science sont venues renforcer la signification entière qu’on se doit de donner au mot sensibilité, sans exclure aucun règne : animal, végétal, voire minéral. Il est heureux, d’ailleurs, que des savants ne se soient pas inclinés devant l’absurde conception dogmatique des phénomènes de la vie et qu’ils n’aient point accepté, comme vérité éternelle, l’affirmation stupide qui alla jusqu’à prétendre que la femme même n’a pas d’âme ...
Dans un livre sur « L’instinct et l’intelligence des animaux », Romanes avait démontré, péremptoirement, que les singes, les éléphants, les chiens, etc... sont intelligents ; Claude Bernard, dans un mémoire « La sensibilité dans le règne animal et le règne végétal », avait écrit :
« Il y a, même chez les plantes, une faculté de sensibilité, chargée de recevoir les excitations externes et de réagir à la suite de ces excitations. »
Félix Le Dantec fut quelque peu désillusionné à la suite de la lecture des oeuvres de Claude Bernard, de qui il attendait l’explication de la physiologie et que l’auteur du « Conflit » considérait comme un géant. Félix Le Dantec trouva l’ouvrage de Claude Bernard « plein d’obscurités et de contradictions ». Dans un de ses livres, « Le Conflit », Le Dantec consacre un chapitre entier à l’intelligence des animaux ». Sous forme de dialogue, il discourt avec un abbé, à savoir si les bêtes ont une âme, tout comme ce merveilleux et prétentieux bipède, intelligent et raisonnable ...
L’instinct, au fond, pour beaucoup, est l’expression qui s’emploie pour des actes accomplis par des animaux autres que l’homme, ce qui faisait dire à Le Dantec :
« Les animaux n’ont pas droit à l’intelligence, puisque le mot intelligence nous est réservé ; l’intelligence animale s’appelle instinct, cela est infiniment simple et le tour est joué ; il serait absurde, après tout cela, de parler de l’intelligence des animaux, il n’y a pas de différence essentielle entre l’intelligence de l’homme et celle du chien, pas plus qu’il n’y a de différence essentielle dans l’odorat de ces deux espèces animales. »
Verlaine, professeur à l’Université de Liège, a démontré, dans un livre d’une remarquable valeur : « l’Ame des Bêtes », combien nos pensées étaient restées primaires à ce sujet. Après une série d’expériences dont on se doit de louer l’effort de persévérance qu’elles demandèrent, le Professeur Verlaine en est arrivé à confirmer ces conclusions qui ne sont pas sans bouleverser nos conceptions antiques, enracinées en nos cerveaux trop longtemps comprimés par des enseignements dogmatiques.
Voici ce qu’écrit le Professeur Verlaine, au dernier chapitre de son livre, plein d’enseignement, et qui forme une synthèse des connaissances de la psychologie comparée, une louange en faveur de la renaissance de la philosophie de la nature :
« Aujourd’hui, comme au temps des Védas, les gens sans grande instruction ne font guère ou pas de distinction entre les pouvoirs mentaux, des bêtes et leurs propres facultés psychiques. Certes, une éducation presque exclusivement littéraire, digne héritière de l’enseignement scolaire médiéval, et toute une littérature en retard d’un bon siècle sur les découvertes biologiques modernes, les a profondément convaincus des merveilles des instincts, leur a inculqué de ceux-ci une notion conforme aux préceptes de l’Église, qui satisfait pleinement leur ignorance, et les met à l’abri du doute. Les progrès réalisés en zootechnie, leur ont appris à parler avec un certain bon sens de l’hérédité, du mendélisme, de la sélection ; mais, quand il s’agit de Médor, de Minet ou de Coco, c’est une autre affaire ; il ne manque au brave animal que la parole pour exprimer son incomparable intelligence, ses bons sentiments, ou les ruses extraordinaires et les accès de méchanceté, absolument analogues à ceux que déploie journellement le narrateur de ses exploits, à l’égard de ses semblables. »
On confond trop souvent la sentimentalité avec la sensibilité ; la première semble être le reflet d’une nature tendre ou celui d’une pitié excessive ; la sensibilité, elle, nous apparaît être plus significative et se révèle être l’attitude d’un individu non dépourvu de connaissances, qui ressent, au contact de ses semblables et des choses, des sentiments émotifs de nature parfois bien différente.
Tout le monde est plus ou moins sentimental, témoin ces braves gens qui s’apitoient sur un toutou qui grelotte, sur un gosse qui mendie, ou sur de pauvres bougres sans travail ; leur sentimentalité les conduit à faire la charité, et là s’arrêtent leurs réflexions. Le « sensible », lui, raisonne et tâche de trouver les causes de la souffrance d’autrui ; souvent, il en souffre parce qu’il se rend compte de l’impuissance dans laquelle il se trouve de remédier à l’état de choses dont il est témoin, mais sa logique peut le conduire à s’intéresser davantage au sort de ses semblables. Il ne tarde pas à entrer dans la lutte et à venir grossir les rangs de ceux qui travaillent en vue d’améliorer la vie présente.
C’est ainsi que Aug. Spies, dans sa déclaration au tribunal, lors de sa comparution pour l’agitation faite en 1887, et que l’histoire du mouvement anarchiste connaît sous le nom de « Martyrs de Chicago » déclara :
« C’est à cause de notre sensibilité que nous sommes entrés dans ce mouvement, pour l’émancipation des opprimés et des souffrants. »
Si tout le monde semble être plus ou moins sentimental, tout le monde n’est pas sensible. Comment a-t-on défini la sensibilité ? Heule, dans son livre sur les recherches pathologiques, donnait, en 1840, la définition suivante de la sensibilité générale :
« Le tonus des nerfs sensibles, ou perception de l’état d’activité moyenne dans lequel les nerfs se trouvent constamment, même dans les moments, où aucune impression extérieure ne les sollicite. » Ribot, dans les « Maladies de la Personnalité », cite du même, le passage suivant : « C’est la somme, le chaos non débrouillé des sensations qui, de tous les points du corps, sont sans cesse transmises au sensorium ». E. H. Weber la définit : « Sensibilité interne, toucher intérieur qui fournit au sensorium des renseignements sur l’état mécanique et chimico-organique de la peau, des muqueuses et séreuses, des viscères, des muscles, des articulations ». Dans une étude inédite : « Amoralité et Sensibilité », G. Dumoulin, parlant de la sensibilité, écrit : « Nous comprendrons encore mieux ce qu’est la sensibilité en examinant les causes de son équilibre, c’est-à-dire l’état dans lequel est plongé l’individu, lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité de coordonner les éléments de ses sensations et de les synthétiser. Les causes en sont nombreuses, et je me borne à énumérer celles qui éclairent le sujet que nous traitons. Il y a des causes qui sont dues au mauvais fonctionnement des organes : ce sont les tares héréditaires, les vices, les mauvaises conditions de milieu. Vous les connaissez tous. Mais je veux surtout appuyer sur les deux grandes causes : la première, c’est la perception trop rapide des connaissances extérieures. La synthèse de nos sensations ne se produit que suivant un certain rythme qu’il ne faut pas dépasser, sans compromettre l’équilibre. C’est le cas des autodidactes. La synthèse ne se produit pas sans l’aide de la mémoire. Les connaissances doivent être emmagasinées par l’expérience répétée ; elles doivent être assimilées, faire partie intégrante de notre personnalité. C’est le pianiste débutant, qui veut exécuter un trait, et le trouve difficultueux parce qu’il n’a pas suffisamment exercé son doigté. Il place la synthèse avant l’exercice. La seconde cause, c’est le déséquilibre provoqué par le milieu social, la nécessité, pour ceux qui accordent une valeur absolue à la morale des groupes, de vivre en conformité avec elle, contrairement aux besoins de leur être intime. Cette dernière cause est la plus grave de toutes, provoque des conflits intérieurs dont les résultats sont souvent effroyables. Ce sont les amours, les amitiés brisées par la morale sociale. »
En philosophie, on a appelé sensibilité, la faculté générale d’avoir des sensations ou celle, également, d’éprouver soit du plaisir, soit de la douleur. Si nous envisageons le premier sens, nous nous trouvons en présence d’une fonction de connaissances. Pour étudier cette fonction, il sera donc nécessaire d’examiner les organes mêmes des sens ; ce sera là une étude physiologique doublée d’examen psychologique, car il est difficile, sinon impossible, de séparer les deux choses, lorsqu’on aborde l’étude des données propres de ces sens.
C’est ici qu’entre en ligne de compte ce qu’on a appelé « les écoles » et, suivant celle dont on se revendique, l’observation intérieure et l’expérimentation externe se combinent plus ou moins. Ces recherches forment, actuellement, la partie la plus importante de la psychologie-physiologie et de la psycho-physique.
Certains philosophes, et parmi eux Condillac, ont donné à cette théorie qui montre que les idées proviennent des sensations, le nom de « sensualisme ».
Ces différents systèmes dits sensualistes, ou avec beaucoup plus d’exactitude « sensationnistes », montrent donc l’origine unique des idées dans des sensations qui sont transformées ou combinées. Condillac, dans son « Traité des Sensations », s’est efforcé de montrer comment toutes nos connaissances et toutes nos facultés viennent des sens, c’est-à-dire proviennent des sensations. Pour Condillac, l’attention est l’appel d’une sensation plus vive que les autres ; la mémoire, la sensation conservée ; la comparaison, une double attention dont le jugement résulterait ; l’abstraction, une attention portée sur la qualité d’un objet ; l’imagination, la combinaison des images.
Selon l’auteur du « Traité des Sensations », qu’il s’agisse de la volonté produisant les plaisirs ou les peines, qu’il soit question de désir ou de haine, d’espérance ou de crainte, la sensation qui engendre ces facultés se réduit, pour le sensualiste, au pouvoir de liberté de rechercher ce qu’on désire, et de fuir ce qu’on redoute.
Cette thèse, Emmanuel Kant, dans « La critique de la Raison Pure », en a fait l’analyse qui l’a conduit à critiquer la sensibilité. Selon Kant, il s’agirait de savoir si l’expérience sensible ne suppose pas, elle aussi, des formes qui seraient antérieures et supérieures aux données des sens. C’est ce que prétendait Kant pour échaffauder sa théorie, qui signifie, en réalité, cette faculté de distinguer le vrai du faux, car selon les défenseurs de cette façon de voir, la vérité serait indépendante de l’esprit qui la connaît, et serait la même pour tous les esprits. La raison est donc ce fond commun à toute intelligence, par quoi il y a une vérité et une science, cela implique qu’il y a quelque chose de commun à tous les esprits, qui jugent d’après les mêmes lois.
Mais, alors, fallait-il dire en quoi consistait la raison ; pour cela, on établit la théorie de la connaissance, et partant de là, toute une philosophie. Que devenait, alors, la raison ? D’après ces théoriciens : l’ensemble des principes qui dirigent le raisonnement, et non pas toute l’intelligence ou la faculté de raisonner.
Kant distingua, lui, la Raison de l’Entendement pur, c’est-à-dire que, selon lui, l’ensemble des concepts et des principes a priori, sans lesquels la pensée est impossible, forme l’entendement pur :
« La raison est une faculté active, qui, à l’aide de ces concepts et de ces principes, ordonne les objets de la connaissance. »
Il distingue aussi la Raison spéculative, c’est-à-dire la Raison en tant qu’elle a pour fin le vrai et la Raison pratique, c’est-à-dire la Raison en tant qu’elle a pour fin le Bien et la Moralité ».
L’origine de ces idées ne fut pas sans éveiller de longues controverses, et Leibniz parla du principe de raison suffisante, c’est-à-dire qu’il maria le principe de causalité à celui du meilleur ; si bien que, selon lui, une chose ne peut être qu’à condition d’être possible, et pour autant qu’elle fasse partie du système de possibles, qui ne peut être que le meilleur entre tous.
Le sensualisme nia donc ces formes antérieures et supérieures aux données des sens, tandis que ses adversaires, avec des nuances de doctrines parfois importantes, l’affirmèrent.
Mais la sensibilité, prise dans son second sens, est la capacité de jouir ou de souffrir. Aussi, afin de la connaître, est-on amené à étudier les émotions, ces dernières étant en rapport évident avec les inclinations, parce qu’elles en dérivent, ou en sont les produits ; il ressort de là, qu’on est amené à étudier les tendances de toutes sortes, leurs transformations, leurs relations, soit avec le plaisir, soit avec la douleur, si l’on veut connaître la sensibilité.
C’est là le domaine de la psychologie générale qui recherchera les conditions anatomiques et physiologiques de la douleur physique. Pour cela, il sera nécessaire d’examiner les modifications de l’organisme qui succèdent aux douleurs physiques, les phénomènes de circulation, respiration, nutrition, mouvement ; il faudra établir si ce sont des effets de la douleur, ou si celle-ci n’est qu’un signe, examiner la nature de la douleur, si c’est une sensation ou une qualité de la sensation, car la douleur peut tout aussi bien résulter de la qualité de l’intensité, de l’excitation, comme elle peut être tributaire d’une forme de mouvement, d’une modification chimique. Les mêmes recherches seront faites en ce qui concerne le plaisir, à savoir si nous sommes en face de sensations ou de qualité, en rechercher les concomittants physiques ; et là ne s’arrêteront pas nos investigations, puisqu’on ne peut négliger les plaisirs ou les douleurs morbides, la psychologie normale comme la pathologie entreront comme apports. Nous voici devant les formes embryonnaires des tendances au suicide, devant les types mélancoliques, et enfin, il y a les états neutres.
Th. Ribot, dans son ouvrage : « La Psychologie des Sentiments » a consacré le chapitre VII à la nature de l’émotion. Après avoir recherché les éléments constitutifs d’émotion, il applique sa théorie aux émotions supérieures, religieuses, morales, esthétiques, intellectuelles. Son livre, copieux et formidablement documenté, nécessiterait une longue analyse, qu’il ne m’est pas permis de faire dans cette étude forcément condensée et incomplète. Les conditions intérieures, à savoir le rôle du cerveau, comme centre de vie psychique, celui du coeur comme centre de vie végétative, les interprétations physiologiques, comme les conditions extérieures, de l’émotion sont, chez Ribot, l’objet d’un examen approfondi, et en d’autres chapitres, il a parlé de la mémoire affective, des sentiments et de l’association des idées, de l’abstraction des émotions ; ainsi, il en est arrivé à ce qu’il appelle la psychologie spéciale qui aura pour objet l’étude de l’instinct de la conservation sous sa forme physiologique défensive, la peur offensive, la colère, la sympathie et l’émotion tendre, le moi et les manifestations affectives, l’instinct sexuel, le passage des émotions simples aux émotions complexes. Mais, à côté de la sensibilité physique, qui se marque par les émotions qui ont leur cause unique dans les impressions organiques, il y a encore toute une psychologie des sentiments sociaux, moraux et religieux, esthétiques et intellectuels, la sensibilité morale, c’est-à-dire les émotions qui ont pour condition une idée. Dans un ouvrage qui porte comme titre « La Sensibilité individualiste », G. Palante a étudié quelques aspects de cette sensibilité individualiste. Il essaye, sans préoccupations dogmatiques, de formuler une définition de cette sensibilité individualiste :
« La sensibilité individualiste est le contraire de la sensibilité sociale. Elle est une volonté d’isolement, et presque de misanthropie. »
C’était donner à une définition un caractère purement négatif. Pour ceux qui s’imagineraient par là, ne trouver qu’égoïsme vulgaire, il n’est pas inutile, je pense, de faire ressortir ce qui sépare la sensibilité individualiste de l’arrivisme plat et banal :
« La sensibilité individualiste suppose un vif besoin d’indépendance, de sincérité avec soi et avec autrui, qui n’est qu’une forme de l’indépendance d’esprit ; un besoin de discrétion et de délicatesse, qui procède d’un vif sentiment de la barrière qui sépare les « moi », qui les rend incommunicables et intangibles ; elle suppose aussi souvent, du moins dans la jeunesse, cet enthousiasme pour l’honneur et l’héroïsme, que Stendhal appelle « espagnolisme », et cette élévation de sentiments qui attirait au même Stendhal, ce reproche d’un de ses amis, « Vous tendez vos filets trop haut ». »
Si l’homme ne se contente pas de penser, de méditer ; si essayer de comprendre l’univers ne le satisfait pas entièrement, tout en cherchant à modifier l’état existant dans lequel il vit, c’est qu’il est déterminé à cette action par le sentiment de ses besoins et de ses souffrances ; la sensibilité joue ici le rôle primordial. Il serait puéril de le contester.
L’anarchiste connaît, lui aussi, des affections intimes, des tendresses et des amitiés ; c’est au travers de ce rayonnement de vie sentimentale qu’il acquiert plus de vigueur et que son action devient plus forte. Un être aussi sensitif ne peut se résigner à accepter l’état de choses actuel ; il devient combatif, et se révolte contre l’iniquité existante.
Aug. Hamon, dans son livre sur la Psychologie de l’anarchiste-socialiste, après avoir questionné toute une série d’individus sur l’influence de l’esprit sensitif dans une résolution d’activité, a écrit :
« Il se décèle aussi, en ces cérébralités anarchistes-socialistes, une grande sensibilité morale. L’adepte du socialisme-anarchiste est un sensitif développé et, par suite, un être éminemment sensible. Cette sensibilité étant jointe à l’esprit de révolte, s’exacerbe toujours, parce que l’individu constate son impuissance à modifier immédiatement ce qu’il qualifie de « mal social ». »
Voici, d’autre part, ce que lui répondaient des individus interrogés :
« L’idée libertaire avait pour moi un attrait majeur, parce qu’elle incarnait le principe d’harmonie sociale dans la liberté, la justice et l’amour ... Et, bien que les misères de l’ambiance sociale ne m’aient pas inspiré directement, je suis bien persuadé qu’il était fatal que je devinsse libertaire, tôt ou tard, de par l’acuité des sensations douloureuses qu’eut, sur mon jugement, le spectacle romain de la putréfaction bourgeoise moderne. » (A. Veidaux.)
« Nature impressionnable ... , je vis que le nombre de ceux qui étaient victimes de la société était immense, j’en souffris ... » (A. Nicolet.)
« Ce m’est, aujourd’hui, un sujet d’étonnement profond de songer que j’aie pu voir souffrir et souffrir moi-même, tant que cela, sans avoir eu la haine immédiate du monde bourgeois, sans maudire et combattre la société crapuleuse qui nous opprime ... » (E. D. H.)
« Enfant, je souffrais pour ceux qui sont opprimés et souffrent ... » (A. Agresti.)
Ces quelques exemples montrent bien l’exaspération de sensibilité qui s’accroît et détermine soit à rester simple spectateurs, comme le font ceux qui épousent la sensibilité individualiste de G. Palante, soit à oeuvrer dans un sens combatif individualiste ou communiste, quel que soit le tempérament optimiste ou pessimiste : ce sont des révoltés. Cet amour d’autrui, qui les conduit à l’action individuelle ou collective, pousse donc certains individus à tenter de modifier l’état de choses présent, à chercher à améliorer le sort qui est fait aux miséreux ; mais, comme ce « mal » qu’il perçoit est loin de se modifier immédiatement, malgré ses désirs ardents et impétueux, le sensible souffre de cette impuissance et cela n’est pas sans avoir des réactions profondes sur son individu. Il sent les souffrances personnelles et d’autrui ; il sent qu’il ne peut pas les soulager, et il veut leur disparition ; il sent que les moyens dont il dispose pour l’amélioration sociale ne donnent aucun résultat — au moins appréciable. Les sensations diverses peu à peu s’exaspèrent et provoquent l’exacerbation de la fonction cérébrale « sensibilité ».
L’examen attentif de la doctrine anarchiste, que ce soit chez un Tolstoï, un Most, un Sébastien Faure, un Reclus, un Kropotkine ou un Malatesta, confirme le caractère sensible de sa philosophie, et ce n’est, certes, pas la chose la moins belle ni la moins noble de cet idéal.
Cela nous réjouit pleinement, car elle conduit à cette révolte saine et loyale, qui caractérise d’une façon remarquable la lutte que les anarchistes livrent aux formes autoritaires et dogmatiques des manifestations sociales.
— HEM DAY.
BIBLIOGRAPHIE — Aug. Hamon : La Psychologie de l’Anarchiste-Socialiste ; Kant Emmanuel : Critique de la Raison pure ; Le Dantec Fél. : Le Conflit ; G. Palante : La sensibilité individualiste ; Th. Ribot : La Psychologie des sentiments ; Verlaine L. : L’âme des Bêtes. — H. D.
SENSUALISME
n. m.
Dans son sens philosophique, le sensualisme peut encore se dénommer sensationisme, c’est-à-dire explication de tous les processus de la pensée par le jeu infiniment varié des sensations.
L’objection que les spiritualistes opposent à cette façon, c’est qu’une quantité quelconque de sensations ne forme point une pensée et ne peut rien donner de plus, en fait de connaissance, que ce que toute collection d’images donnera : c’est-à-dire la connaissance d’une succession de faits statiques, et non pas une connaissance synthétique et dynamique de ces divers états. Autrement dit, vingt sensations successives ne formeront une pensée que si une sorte de vingt-et-unième sensation intérieure les lie et les synthétise en un tout compréhensif, qui est précisément la connaissance réelle ou conscience.
Cette critique, un peu surannée, du sensualisme oublie deux faits extrêmement importants dans l’étude de la pensée. Le premier, c’est que toute introspection n’est pratiquée que par des adultes chez qui tous les processus psychiques sont déjà organisés et ne se trouvent plus à l’état de formation ; ce qui en rend l’analyse extrêmement difficile. La deuxième, c’est que l’on considère, à tort, comme étant très connue la nature de l’image sensuelle conservée par la mémoire, et qu’on lui délimite ainsi son rôle, réduit au simple état de document statique et passif. Les sensations étant exclues de la formation même de la pensée, on peut demander ce qu’est cette pensée, qui n’est pas sensation mais qui n’est rien sans elle.
Pour affirmer que toute sensation est dépourvue d’elle-même de facultés de rapport avec d’autres sensations, et que toute pensée est exempte de sensations, il faudrait d’abord démontrer cela expérimentalement ; et ensuite prouver, par de multiples observations sur des êtres de tous âges, que les sensations se fixent en eux sous forme de collection d’étiquettes, plus ou moins disparates, sans aucun lien entre elles.
Les expériences de Pavlov réduisent à néant cette vieille conception psychologique et nous savons que toutes les sensations (bien que nous en ignorions encore la nature intime) s’irradient dans les centres nerveux et s’interpénètrent perpétuellement. Comme le jeune être est soumis, depuis sa naissance, à des milliards de vibrations objectives qui se succèdent incessamment ; comme ces vibrations créent en lui des courants nerveux innombrables en qualités et en quantités et que ces courants sont liés plus ou moins intimement à son propre fonctionnement physiologique, il est aisé de comprendre que, avant d’atteindre les hautes spéculations de la pensée, l’être vit, sent, réagit et agit, démontrant ainsi que l’action, l’accommodement, l’adaptation sont les formes les plus réelles de la connaissance.
Il est certain que cette réaction de l’être n’est point donnée par la sensation pure. Le geste de l’enfant qui se gratte après une piqûre n’est pas contenu dans la sensation de la piqûre, mais ce geste est le résultat de nombreuses réactions antérieures, beaucoup moins adaptées et plus ou moins absurdes ou maladroites, ainsi qu’on peut le constater par l’observation des jeunes enfants. La sélection des actes s’opère dans le sens du meilleur écoulement de l’influx nerveux. De même que l’eau d’un torrent nouvellement formé s’écoule selon les lois de la moindre résistance, de même l’influx nerveux s’écoule par des voies quelque peu favorables au fonctionnement biologique et héréditaire de l’individu, sous peine de disparition de l’individu et de la race inadaptée.
Chaque sensation ultérieure n’est donc jamais une image totalement neuve et inconnue, une étiquette nouvelle. Elle est un composé complexe dont le connu s’irradie dans les voies habituelles et l’inconnu dans la substance cérébrale, où il prépare de futures liaisons nerveuses.
La pensée c’est donc du mouvement, de l’action. Si le Moi est la somme latente de toutes nos expériences passées, le Il paraît être le contact d’une partie de ce moi avec les excitations sensorielles dans le présent. Il suffit d’analyser profondément toute pensée pour s’apercevoir que cette connaissance, si mystérieuse pour les spiritualistes, n’a rien d’une connaissance absolue des choses ; qu’elle n’est qu’une façon de sentir, c’est-à-dire de relier des perceptions présentes à des perceptions passées. Comme nous savons que toute sensation est en liaison avec une infinité d’autres sensations simultanées ou successives, nous voyons que ces sensations ne forment point une mosaïque, une tapisserie figée et immobile, mais qu’elles créent une activité permanente par leurs variations incessantes, leur tension continuelle, leur intensité perpétuellement changeante.
La théorie des réflexes a l’avantage d’expliquer tous les processus de l’action des êtres vivants. Elle n’a pas besoin de connaître la nature exacte de l’image ; il lui suffit de constater qu’une modification de la substance nerveuse existe après chaque variation du milieu, perçue par l’être vivant et qu’une réaction plus ou moins appropriée de cet être est l’effet de cette excitation.
En ramenant toutes les manifestations de la pensée à des réflexes et en dernière analyse à du mouvement, on relie ainsi les états mentaux aux autres états physiologiques des êtres pensants. La pensée n’est plus alors un pouvoir mystérieux de divination du monde extérieur ; elle n’est qu’une réponse aux excitations de ce monde. Quelle que soit l’extraordinaire subtilité d’une pensée, on peut toujours, à l’analyse, remonter aux éléments sensoriels qui la composent, unis à l’activité organique de l’individu. Les sentiments, même les plus complexes, sont des produits de la répétition et de l’organisation d’une certaine sorte de sensations liées à des fonctions organiques excessivement importantes, telles que : sexualité, nutrition, activité, etc ...
Il suffit, d’ailleurs, de constater tous les mauvais fonctionnements psychologiques de l’humanité pour comprendre que ce n’est pas là le fait d’une puissance indépendante des phénomènes physico-chimiques de l’Univers. Même chez les êtres normaux, le minimum d’harmonie que l’on serait en droit de voir se réaliser : c’est-à-dire un peu de fraternité déterminant les hommes, sinon à s’aimer, tout au moins à se respecter mutuellement, n’existe pas. L’homme se conduit comme une bête exploiteuse et massacreuse. Il a des rages économiques, patriotiques, nationales, religieuses, artistiques et même scientifiques qui l’apparentent plus à l’animal grognant, rongeant, déchirant et dévorant sa proie, qu’à un spectateur intelligent de l’Univers.
L’impression que donne l’activité de l’humanité est celle d’une lutte, d’un heurt, d’un choc de forces se détruisant les unes les autres, sans but et sans fin, comme d’ailleurs tout le reste de l’univers.
Le sensualisme ne fait donc que trouver le point de contact entre les forces objectives et les forces subjectives que nous connaissons.
Prises sur une certaine durée, quelques unes de ces forces ou de ces mouvements paraissent stables et coexister avec d’autres mouvements également stables. Nous appelons cela de l’harmonie en opposition avec d’autres mouvements qui se détruisent beaucoup plus rapidement et d’une moindre durée. L’harmonie est un désordre qui ne se voit pas et qui dure plus que notre observation.
Nous-mêmes, nous sommes le fait d’un semblable désordre qui ne se voit pas et que nous appelons : harmonie des fonctions organiques, harmonie de la pensée, etc ... ; et lorsque celà se voit, lorsque nous devenons cadavre et pourriture, alors l’évidence d’un certain désordre, d’un certain chaos cellulaire paraît incompatiblement avec une réelle harmonie.
Le terme sensualisme est encore entendu comme un mode de jouissance de la vie, basé sur les plaisirs des sens. L’ignorance et l’hypocrisie des moeurs actuelles en réprouve, bien entendu, les manifestations tout en ne faisant pas autre chose que de l’hyper-sensualisme, et du plus dangereux.
Les religions n’existent que grâce à une exploitation habile de la sensualité, et les religions d’état ne font pas mieux, pour des fins exploiteuses et meurtrières.
A chaque glorification, célébration ou autre fait public, tout est mis en oeuvre pour capter l’asservissement des citoyens ou des fidèles par des émotions visuelles, auditives, gustatives, olfactives, etc ...
En réalité, la sensualité est une des bonnes raisons de vivre. C’est elle qui donne de l’éclat et de l’intensité à nos désirs et transforme nos besoins physiologiques en réalisations esthétiques, en nous éloignant de la bête obtuse et limitée. L’art n’est rien sans la sensualité, et le rôle de l’imagination dans ce domaine de notre activité est évident. La sensualité, inséparable de l’intelligence se raffine parallèlement à la culture des individus.
Comme toutes les manifestations psychiques, elle est une source de plaisir et de joie chez l’homme équilibré, alors qu’elle n’est qu’une cause d’abrutissement chez le faible, le malade ou le passionné.
Les curieux de la vie, les amoureux de l’heure qui passe aiment trop les plaisirs sensuels pour se laisser déborder par un seul d’entre eux. Ils les cultivent tous pour en jouir pleinement, intensément, mais avec intelligence et pour les faire durer.
Et quand bien même un humain s’userait d’un seul coup dans une jouissance inouïe, s’il ne fait de tort à personne, que peut-on lui reprocher ?
Sa vie lui appartient ; il fait de la place aux autres et la terre continuera de tourner.
— IXIGREC.
SERVAGE
Le servage, état de servitude du serf, le servus, l’esclave antique, est la forme d’exploitation humaine particulière aux sociétés féodales (voir Féodalité). Il se constitua avec elles lorsque le conquérant barbare se fut fixé dans 10 pays conquis. L’esclave fut alors attaché à la terre et devint un bien immeuble comme elle, ne pouvant être légué, vendu, échangé, qu’avec le domaine sur lequel il vivait.
Le colonat, établi dans les derniers temps de l’Empire romain pour fixer à la terre les travailleurs qui l’abandonnaient, avait été une première forme du servage. Celui-ci ne trouva sa véritable application sociale que dans la société féodale dont il constitua la base économique. Les premiers serfs furent les esclaves que les Barbares amenèrent avec eux. Leurs enfants firent de plus en plus partie intégrante du domaine à mesure que se fortifia la société féodale. A l’encontre de l’esclave, le serf avait la capacité juridique lui permettant de se créer un foyer et de posséder ; mais son maître avait droit de vie et de mort sans aucun contrôle, sur lui et sur les siens serfs comme lui. Il était de plus main-mortable, ce qui permettait à son maître d’hériter de lui aux dépens de sa famille. Telle est l’origine du servage, système féodal qui régit la condition paysanne jusqu’à la Révolution de 1789 en France, et encore après dans d’autres pays. Il en est où le servage n’a pas encore disparu, de même que l’esclavage dans d’autres.
Les formes du servage ont varié suivant les lieux et les époques, de même que celles des sociétés féodales ; mais il est à remarquer que si ces dernières ont été de plus en plus diminuées dans leur puissance politique, elles ont maintenu, malgré vents et marées, la structure économique basée sur le servage jusqu’au jour où elles ont elles-mêmes disparu.
Jusqu’au XIIème siècle, les formes du servage furent généralement très dures. Le serf, ou vilain, ne pouvait pas plus disposer de ses biens mobiliers que de sa personne. Il ne pouvait se marier en dehors du domaine auquel il appartenait. Il devait son travail au seigneur en toutes circonstances, sous forme de corvées de tous genres. Le maître avait le droit exclusif de chasse, de garenne, de colombier, de vente de la vendange ou du vin. Le serf payait la capitation ou chevage, taxe personnelle annuelle, et la taille, impôt mobilier ; le seigneur fixait le taux de ces impôts comme il lui plaisait. Il payait, en outre, toutes sortes de redevances, en argent ou en nature, pour moudre son blé, cuire son pain, faire son vin, au moulin, au four, au pressoir seigneuriaux. Il payait aussi des taxes supplémentaires pour les fêtes du manoir, pour les expéditions guerrières, les voyages du seigneur et de sa suite. Il devait le service militaire et ne pouvait s’en faire dispenser que contre argent. Il payait encore pour pouvoir circuler sur les routes, aller aux marchés, aux halles, aux foires, aux ports. Il payait toujours et pour tout, sans avoir le droit de se faire rendre justice ; il ne pouvait ni comparaître ni témoigner devant des juges, et ceux-ci, qui étaient les seigneurs eux-mêmes ou leurs affidés, lui faisaient payer des amendes ou le frappaient de confiscations. Toute la vermine seigneuriale qui détenait les emplois : intendants, maires, prévôts, bailes, rafle-pécune et coupe-jarrets, avait les mêmes droits de le pressurer. Il devait au bétail plus de soins qu’à lui-même, à sa femme et à ses enfants. Au XIème siècle, un cheval valait cent sous en France ; un serf n’était estimé qu’à trente huit sous quand on le vendait avec la terre et le bétail !....
Par la suite, le servage prit des formes plus douces ou plus arbitraires encore, suivant les lieux et les nécessités politiques et économiques. A aucun moment elles ne furent le produit de ce prétendu progrès moral que les imposteurs religieux ont attribué au christianisme. Des distinctions se firent entre les serfs. Il y eut les serfs de corps et de poursuite qui ne pouvaient sortir du domaine ; les serfs de servitude personnelle pouvant s’établir hors du domaine moyennant le paiement de certaines redevances ; les serfs de servitude réelle qui avaient une tenure, ou service spécial, et pouvaient échapper au servage en abandonnant ce service. Mais l’amélioration capitale de la condition du serf fut dans la possibilité de s’affranchir en achetant sa liberté.
Le besoin d’argent étant toujours plus pressant pour les rois et les seigneurs, les affranchissements de serfs furent de plus en plus nombreux à partir du XIVème siècle. Les nobles et les clercs en retirèrent un profit autrement considérable que celui des taxes, si excessives fussent-elles, qu’ils faisaient payer à leurs serfs, car ceux-ci, stimulés par l’idée de leur affranchissement, travaillaient et produisaient mieux et plus que dans leur ancienne condition pour réunir la somme fixée. L’affranchissement des serfs n’eut pas d’autre cause que le profit qu’en tirèrent les féodaux. Les ordonnances de 1315 et 1318 disant que « la liberté des serfs est un droit naturel », ne furent que des manifestations hypocrites de la prétendue bienveillance royale. Si la liberté des serfs était un droit naturel, pourquoi la leur faisait-on payer ?
Lorsque, quelques années avant la Révolution française, les Turgot voulurent procéder à des réformes qui auraient pu empêcher cette Révolution et sauver la royauté, ce fut la féroce résistance des bénéficiaires des droits féodaux établis en violation du droit naturel de leurs victimes qui fit avorter les réformes, souleva l’exaspération paysanne et fut la cause directe de la Terreur qu’on reprocha tant à la Révolution. Et ce fut aussi cette résistance qui, après avoir fait se prolonger la Révolution, fit échouer ses promesses de liberté pour tous les hommes. Certes, les droits féodaux et le servage furent supprimés dans leurs formes moyen-âgeuses ; mais ils se rétablirent sous d’autres formes plus modernes, plus en rapport avec le temps. Girardin disait, un demi-siècle après la Révolution :
« Le servage intellectuel a persisté. »
Ce servage intellectuel n’était pas le seul qui avait persisté, car il n’était que la conséquence du servage économique. Les droits féodaux s’étaient changés en droits des riches ; à la féodalité de caste avait succédé une féodalité de l’argent encore plus implacable qui avait mis sur le servage l’étiquette fallacieuse de la « liberté du travail » et fait du serf le prolétaire non moins durement exploité. Mais on lui faisait ironiquement l’honneur de l’appeler « citoyen », et le pauvre imbécile était convaincu qu’il exerçait sa « souveraineté » quand on lui laissait le soin de choisir lui-même les commissaires à terrier qui réglementeraient son servage et s’en engraisseraient en le malmenant.
L’histoire officielle, dont le rôle calamiteux consiste, même dans les écoles de la République, à préparer les fils des prolétaires à leur futur servage, a érigé en dogmes de grossières falsifications dont il est nécessaire de faire justice. C’est d’abord celle dont Chateaubriand s’est fait le trop zélé propagateur, qui attribue à l’Église l’abolition de l’esclavage, son remplacement par le servage, puis l’adoucissement progressif du servage jusqu’à sa suppression. Or, l’Église n’a rien aboli ni rien fait supprimer. Elle a été solidaire jusqu’au bout de la noblesse avec qui elle partageait les privilèges des droits féodaux, comme elle est toujours solidaire des esclavagistes démocrates qui travaillent pour elle en même temps que pour eux-mêmes, lorsqu’ils sont arrivés au pouvoir par leur anticléricalisme. Elle a levé la croix comme la noblesse a tiré l’épée contre la Révolution, pour la défense des droits féodaux qu’elle appelait effrontément les droits de Dieu ; et elle la lève toujours à la tête de toutes les armées, sans distinction, qui vont piller et asservir les peuples coloniaux. (Voir la Guerre de Chine, 1900, par Urbain Gohier.)
La substitution du servage à l’esclavage fut uniquement le résultat des nécessités de la société nouvelle créée par la féodalité. L’Église n’apporta qu’une idéologie très secondaire, et d’ailleurs complice, dans cette organisation que seules régissaient des raisons politiques et économiques. Elle s’adapta entièrement au système, car il lui donnait la part du lion. Elle ne fut nullement la médiatrice généreuse qu’elle prétend avoir été en faveur des faibles et surtout des serfs qui n’étaient, pour elle comme pour les seigneurs, que du vil bétail. Le serf était exclu du clergé comme de la noblesse. Il n’était, pour l’homme d’église comme pour l’homme de la chevalerie, « qu’un être puant sorti du pet d’un âne ». Il n’était bon que pour servir, comme une bête, et il servait l’église comme le château. Il travaillait pour eux, disait Etienne de Fougères au XIIème siècle :
Vivent de ce qui travaille.
Il y avait des serfs d’église, et ils n’étaient pas toujours les mieux partagés. C’est ainsi qu’en Auvergne, en 1665, il n’y avait plus de serfs que ceux du pays de Combrailles, « sujets esclaves et dépendant en toutes manières » des chanoines réguliers de Saint Augustin. Ces serfs ayant réclamé leur liberté, les États des Grands Jours d’Auvergne les maintinrent dans leur servage. Il dura jusqu’en 1779 et ne prit fin que grâce à un édit de Louis XVI abolissant la servitude personnelle dans la France entière. (Mémoires, de Fléchier.) Les derniers serfs que la Révolution eut à libérer furent d’église ; ce furent ceux des moines de Saint Claude, dans le Jura.
Non seulement l’Église n’abolit pas l’esclavage, mais elle ne cessa jamais de le justifier par sa doctrine et de le soutenir par ses actes. Elle l’a fait approuver dans les Évangiles et dans les épîtres des apôtres, de Paul en particulier (Épitre aux Éphésiens). Les saints Cyprien, Grégoire le Grand, Ignace, déclarèrent que l’esclavage était voulu par Dieu. Dès la fondation de l’Église, le clergé, depuis les moines jusqu’aux papes, et les églises elles-mêmes, eurent des esclaves. Le premier concile d’Orange, en 441, excommunia ceux qui enlevaient les esclaves des ecclésiastiques. Le concile d’Epaone, en 517, fit défense aux abbés d’affranchir les esclaves des moines. Celui de Tolède, en 655, décida que les enfants d’écclésiastiques seraient esclaves de l’Église. Il édicta des mesures restrictives contre l’affranchissement des esclaves et défendit, même aux affranchis et à leurs descendants de se marier avec des Romains ou des Goths de naissance libre. En 1050, le concile de Rome condamna à l’esclavage les femmes qui se prostituaient aux prêtres. Cette mesure était d’autant plus odieuse que nombreux étaient les prêtres, et surtout les papes et les grands dignitaires de l’Église, qui tiraient profit de la prostitution. Comme le constatait Edgar, roi d’Angleterre au Xème siècle :
« Les maisons des prêtres étaient devenues les retraites honteuses des prostituées. »
Une d’elles, Marozie, fut tout ensemble la soeur, la concubine, la mère et l’aïeule de deux générations de papes. Au XVIème siècle :
« Rome, qui allait consacrer l’esclavage des noirs, patentait, sous Sixte IV, la prostitution. Chaque fille fut taxée un jules d’or. Cet impôt, dit Corneille Agrippa, rapportait plus de vingt mille ducats par année. Les prostituées étaient placées dans ces repaires par les prélats de la cour apostolique qui prélevaient encore un droit fixe sur leur produit. C’était un usage si universellement admis que j’ai entendu des évêques faire le compte de leur ressources et dire : J’ai deux bénéfices qui me valent trois mille ducats par an, une cure qui m’en donne cinq cents, un prieuré qui m’en vaut trois cents, et cinq filles dans les lupanars du pape, qui m’en rapportent trois cent cinquante. » (Albert Castelnau : La Renaissance italienne.)
Saint Augustin, qui fut le plus terrible ennemi des circoncellions, esclaves du Nord de l’Afrique, dans leur révolte contre les colonisateurs romains, justifiait leur esclavage par l’histoire biblique du châtiment de Cham, fils de Noé, qui est la plus abominable fable inventée pour légitimer la prétendue supériorité des blancs sur les noirs et les crimes commis en son nom. Saint Augustin prépara ainsi les arguments de l’esclavagisme colonial que l’Église consacrerait au XVème siècle. Bossuet rappela que l’apôtre Paul avait commandé aux esclaves d’obéir à leurs maîtres, et il justifia l’esclavage par le « droit de la guerre » et par le « droit des gens » en ajoutant ceci :
« C’est un bienfait et un acte de clémence de la part du vainqueur, que de réduire le vaincu à l’esclavage !.... »
L’hypocrisie protestante qui égale, si elle ne la dépasse, la tartufferie catholique, ne fut pas en retard pour employer des arguments semblables lorsque, en 1620, elle consacra à son tour l’organisation de la traite des noirs qu’on enlevait de Guinée pour fournir des esclaves aux Anglais établis en Amérique. On disait que les noirs devaient être esclaves toute leur vie « grâce à une heureuse disposition de la Providence » ! Les pieuses crapules qui s’enrichissaient de ce trafic rassuraient leurs consciences puritaines en déclarant qu’elles n’avaient d’autres vues que celles de :
« Rassembler sur les têtes africaines les bénédictions du Dieu des chrétiens avec les bénéfices de la civilisation blanche !... »
En 1859, les « philanthropes » américains qui firent la loi de bannissement des affranchis, disaient :
« Notre devoir est de moraliser le nègre ; c’est par charité que nous le faisons esclave !... »
Un nommé Callonn déclarait :
« L’esclavage est la base la plus sûre et la plus stable des institutions libres (sic) dans le monde. »
Un autre, Mac Duffie, renchérissait :
« L’esclavage est la pierre angulaire de notre édifice républicain. »
Et des savants, des pasteurs, arrivaient pour affirmer, au nom de la Science et de Dieu, « la noblesse et la divinité de l’institution de l’esclavage », sa nécessité « au bien-être et au développement de la race noire » !... Les noirs « ne pouvaient être heureux qu’en esclavage ; un abolitionniste ne pouvait être que Satan conspirant contre leur bonheur » !... Depuis, les anglo-américains ont aboli l’esclavage légal, mais ils n’ont pas cessé de « moraliser » les noirs et de faire leur « bonheur » en leur appliquant la loi de Lynch. On comprend qu’avec de tels principes l’Amérique pouvait dresser, face au Vieux-Monde, une statue de la « Liberté » pour « l’éclairer » !...
Malgré les abolitions décidées par la Convention en 1794, par la France et l’Angleterre en 1831 et 1833, par une entente internationale en 1848 et par l’Amérique en 1865, la traite des noirs et l’esclavage n’ont pas cessé d’être pratiqués plus ou moins ouvertement et cyniquement. La Commission temporaire de l’esclavage, qui siège à Genève à la Société des Nations, a constaté en 1931 que, malgré la convention internationale conclue en 1926 contre l’esclavage, il y avait encore dans le monde « au moins cinq millions d’esclaves » ! Combien de millions faudrait-il ajouter à ce nombre si l’on comptait toutes les victimes de la déportation clandestine opérée aux colonies, et de cet esclavage déguisé sous les formes odieuses du « travail forcé » que l’hypocrisie « civilisatrice », approuvée par la Société des Nations, impose aux indigènes coloniaux ?
Dans son roman, l’Évadé, Rochefort a dénoncé le trafic des indigènes d’Océanie qui se pratiquait en 1873, pendant qu’il était déporté en Nouvelle Calédonie. Le même trafic a été constaté par l’auteur anonyme des Lettres des Iles Paradis, parues en 1926, et M. Paul Monet a montré dans ses Jauniers dans quelles conditions particulièrement odieuses la République radicale-socialiste de M. M. Sarraut et Cie laisse continuer, aujourd’hui plus que jamais, en Indo-Chine, le commerce de la chair humaine et le travail forcé des indigènes. En Rhodésie méridionale, pour ne parler que de cette colonie, les Anglais ont établi un véritable régime d’esclavage contre les enfants qu’on fait travailler sans limite d’âge dans les mines et dans les champs, et que leurs exploiteurs peuvent flageller sans jugement sous un quelconque prétexte de désobéissance ou pour une simple négligence.
Esclavage et servage se confondent sous toutes leurs formes dans les déportations et le travail forcé ; et l’Internationale Ouvrière elle-même les approuve lorsqu’elle dit, par la voix de M. Jouhaux, son délégué à la Société des Nations :
« Pour être juste, il faut reconnaître que le travail forcé des indigènes peut se couvrir de quelques bonnes raisons. Dans les pays arriérés on ne saurait guère compter sur le travail librement consenti par les indigènes. »
Cette opinion d’un personnage qui parle ou prétend parler au nom de la « classe ouvrière », n’est-elle pas digne de celle de l’Église et des « philanthropes » esclavagistes ?
Voilà comment l’Église travailla, de concert avec toutes les puissances et tous les organismes profiteurs de l’exploitation humaine, à la suppression de l’esclavage et du servage. Il n’est pas certain que malgré toutes les abolitions officielles, elle n’use pas encore aujourd’hui, aux colonies, du catéchisme publié en 1835 par l’abbé Fourdinier, disant que l’esclavage est « une institution chrétienne » !..... Elle n’a jamais cessé de soutenir, dans le monde entier, les entreprises d’asservissement humain sous toutes leurs formes. Églises orientales ou occidentales, orthodoxes, catholiques ou protestantes, toutes se sont faites les instigatrices des pires persécutions contre les Bagaudes, les Bogomiles, les Vaudois, les Jacques, les Anabaptistes, les Camisards, contre tous ceux qu’a soulevés la révolte depuis vingt siècles (voir Révoltes). Luther et l’Église réformée ont participé sauvagement à l’écrasement et à l’asservissement des paysans allemands au XVIème siècle. Ivan le Terrible et Boris Godunov ont travaillé pour l’église russe en organisant la colonisation et le servage dans leur pays. Les conquistadores espagnols firent de même en Amérique pour le profit de l’église catholique. Celle-ci a soutenu toutes les contre-révolutions et elle est aujourd’hui avec Mussolini et Hitler, comme elle fut de tout temps avec tous les aventuriers qui ensanglantèrent le monde et étouffèrent la pensée et la liberté.
Une autre falsification historique non moins grossière est le récit de la fameuse nuit du 4 août 1789 où, dit-on, les nobles et les prêtres firent dans un généreux élan d’enthousiasme civique l’abandon de leurs privilèges féodaux, alors qu’ils n’abandonnèrent rien du tout. Effrayés par les révoltes des paysans qui mettaient le feu aux châteaux et aux abbayes et n’épargnaient même pas leurs personnes, ils eurent un geste d’apparente générosité comme ils en avaient eu de tout temps dans l’histoire, chaque fois qu’ils s’étaient sentis menacés. Mais ils eurent soin de rendre leur abandon inopérant en faisant adopter par l’Assemblée Nationale la condition du rachat. Il fallut alors quatre ans de luttes législatives, de protestations et d’insurrections populaires pour que l’abolition des droits féodaux, et avec eux du servage, devint effective. On comprend que les privilégiés défendirent avec une fureur désespérée leur « droit » de vivre du travail des autres ; ils n’avaient jamais vécu autrement. Il y avait chez eux une sorte de sincérité venant d’un état de choses très ancien, dont ils étaient les bénéficiaires mais dont ils n’avaient pas été les auteurs. Ce qui se comprend moins, c’est qu’ils trouvèrent tant d’appuis dans la nouvelle classe dominante, la bourgeoisie, qui n’était rien et allait être tout, suivant le mot de Sieyès, grâce à la Révolution. Mais le Tiers État qui ne cherchait qu’à dominer la mêlée, fut indifférent à la condition du rachat. Composé, dans sa plus grande partie, de citadins bourgeois, il ignorait généralement ce qu’étaient les droits seigneuriaux et le sort de la population rurale ; il ne comprenait pas davantage l’état de révolte de ces paysans qu’on l’incitait à considérer comme des voleurs et des brigands. Il ne comprit ces choses que lorsqu’il vit le principe de la propriété, de sa propriété, menacé et il devint alors contre-révolutionnaire aussi férocement que les autres ordres.
Alors que le paysan-serf n’arrivait pas à payer chaque année toutes les redevances dont on l’accablait, l’Assemblée Nationale fixait le rachat au denier 30, c’est-à-dire à trente fois les redevances annuelles ! C’était rendre le rachat impossible et maintenir indéfiniment les droits seigneuriaux. Le 10 août 1789, l’Assemblée Nationale prenait des mesures contre les paysans qui refusaient de payer les dîmes, abandonnées en principe six jours avant. Il fallut toute la ténacité révolutionnaire des paysans et l’état d’insurrection permanente où ils se tinrent, malgré les plus sauvages répressions, pour qu’ils ne payassent plus ces dîmes à partir du 1er janvier 1791 et que, par la suite, les droits féodaux fussent complètement abolis. Comme l’a dit Kropotkine, les paysans furent « la grande force de la Révolution ». Sans eux, qui avaient un but positif à atteindre, la « conquête de la terre », et que la démagogie politicienne ne dévoyait pas comme les citadins par une logomachie fumeuse, la Révolution aurait peut-être fait complètement faillite. En attendant le résultat final, « le servage devint constitutionnel », suivant le mot de Marat. La Déclaration des Droits de l’Homme, en proclamant « la propriété inviolable et sacrée », justifiait la résistance féodale et les exigences du rachat. Malgré tous les principes qui l’animaient, elle maintenait en fait la servitude contre tous ceux qui n’avaient pas la faculté de devenir propriétaires. C’est ainsi que la Révolution ne supprima pas le servage ; elle en changea seulement les formes. Elle fit l’homme libre en droit, elle le maintint serf en fait. (Voir Propriété et Liberté).
Le servage proprement dit, le servage féodal, subsista légalement jusqu’en septembre 1791, lorsque l’Assemblée Nationale abolit irrévocablement « les institutions qui blessaient la liberté et l’égalité des droits », parmi lesquelles étaient toutes les formes du régime féodal. Mais une autre forme de servage n’établissait pas la distinction des citoyens « actifs », les propriétaires-électeurs qui faisaient les lois, d’avec les citoyens « passifs », les prolétaires-muets qui les subissaient. Le paysan, entre autres, n’eut plus ce droit, qu’il possédait avant la Révolution, de discuter des affaires communales. Mais il n’était plus un « serf », il était un « homme libre » !.... Il ne fut libre que dans la mesure, encore très aléatoire, où, bravant l’anathème de l’Église et les violences aristocratiques, il put acheter des biens du clergé ou des émigrés devenus « biens nationaux », et être à son tour propriétaire. Seulement, sa petite propriété demeura en échec devant les grands domaines maintenus ou reconstitués sur lesquels s’établit le nouveau servage paysan du fermier, du métayer, du valet de ferme et du journalier, quand l’Empire, puis la Restauration, eurent définitivement assuré la sécurité de la grande propriété bourgeoise. Seule la loi agraire donnant sans condition la terre à tous ceux qui pouvaient la travailler, aurait rempli les véritables buts de la Révolution : mais il eût fallu supprimer la propriété, instaurer le communisme terrien, et Robespierre lui-même disait de cette loi proposée par les révolutionnaires avancés, qu’elle était « un absurde épouvantail présenté à des hommes stupides par des hommes pervers ».
Ce ne fut que par la loi du 11 juin 1793 que les communes purent reprendre aux nobles les terres communales qu’ils s’étaient appropriées frauduleusement. Un décret du 17 juillet 1793 abolit définitivement les droits féodaux, sans rachat. Mais ces mesures tardives, dictées par la peur de nouvelles insurrections paysannes, n’eurent que des demi-résultats. Un an après, le 27 juillet 1794, ce fut le 9 thermidor, c’est-à-dire la réaction. Le 20 mai 1795, la Convention abrogeait la loi du 11 juin 1793, et les communes qui n’avaient pas encore repris possession de leurs terres en furent définitivement dépossédées. La noblesse avait perdu ses droits féodaux ; il lui restait la propriété qu’elle partageait avec la bourgeoisie. Non seulement elle s’était assuré la conservation de la plus grande partie de ses domaines, mais encore, lorsque les circonstances le permirent, elle eut la possibilité de réclamer ce qui n’avait pas été vendu comme « biens nationaux ». C’est ainsi que le 5 décembre 1814 fut votée la loi sur les biens des émigrés, et qu’aujourd’hui encore on voit la République soucieuse de rendre à leurs descendants les biens qui ne furent pas vendus. Il existe pour cela une commission spéciale dont un décret tout récent, du 11 février 1933, a complété la composition par la nomination de deux membres. La République a plus d’égards pour les fils de ceux de Coblentz qui mirent la « Patrie en danger » en 1792, que pour nombre de ceux qui la défendirent en 1914 et revinrent mutilés.
La grande propriété, demeurée bourgeoisement intangible, permit, avec le développement industriel et commercial, la création d’une nouvelle féodalité, celle des comptoirs, des usines et des banques. Parallèlement se forma un nouveau servage qui pesa sur tous les prolétaires, ceux de la campagne et ceux de la ville. Oh ! Certes, l’homme est libre, comme le dit la Déclaration des Droits de l’Homme. Tous les hommes sont libres, comme ils sont tous frères suivant les préceptes évangéliques. L’homme peut, en principe, aller et venir, changer de domicile, de pays, de profession, se marier, avoir une famille, économiser, réaliser une fortune et, fut-il le plus chétif, aspirer aux plus hautes destinées. Il n’est plus « taillable et corvéable à merci » ; il n’y a plus personne qui ait sur lui droit de vie et de mort. Il vit dans une République « qui peut se permettre d’élever au plus haut degré de la hiérarchie sociale le plus humble de ses enfants » , comme dit lyriquement M. Alexandre Varenne devenu satrape colonial. Mais il n’a, en fait, d’autre liberté que de mourir de faim ou de se faire emprisonner ou mitrailler s’il a la prétention, étant pauvre, de choisir librement son travail, de discuter librement de ses conditions d’existence, de ne pas se soumettre à la « rationalisation » industrielle, à l’exploitation de l’atelier, à l’insolence du patronat, à la grossièreté de ses chiens de garde, et s’il ose participer à un refus collectif de travail, à une grève, à une manifestation. La faim impose à l’homme libre d’aujourd’hui un servage aussi lamentable que les droits féodaux au serf d’autrefois. Et, dans son inconscience, le prolétaire se gargarise le plus souvent de cette liberté démagogique au nom de laquelle il est le « peuple souverain ». Il n’est plus un esclave et plus un serf. Hélas !..... Si l’esclave, qui travaillait sous le fouet et qu’on mettait en croix, si le serf, qui était « taillable et corvéable à merci », si tous ceux qui n’étaient que du « bétail humain » revenaient et voyaient ces hommes libres dont on fait une mécanique sans âme, un « matériel humain » auquel on enlève même la faculté de penser, ils seraient épouvantés.
La Rome antique trouvait parmi ses esclaves des poètes et des philosophes tels les Térence, Cécilius, Plaute, etc.., qui lui faisaient plus de véritable honneur que tous ses grands chefs militaires réunis. Elle voyait avec terreur se dresser des Spartacus qui ébranlaient sa puissance et maintenaient, au-dessus de tous les avilissements, l’éternelle et magnifique revendication de la dignité humaine. On voit mal les « fleurs d’humanité » qui pourraient s’épanouir sous le régime de la « rationalisation », sauf des boxeurs, des policiers, des soldats et... des électeurs !
— Edouard ROTHEN.
SEXOLOGIE
n. f. (du latin sexus : sexe et du grec logos : discours ou traité)
Néologisme non encore admis aux dictionnaires en usage courant, employé fort probablement pour la première fois en France par Eugène Lericolais et Eugène Humbert en juillet 1912, dans la fondation de leur « Bibliothèque de Sexologie Sociale ». La sexologie est la science qui comprend l’ensemble de nos connaissances anatomiques, physiologiques, biologiques, psychologiques et sociales se rapportant à toutes les manifestations de la sexualité sur les êtres vivants. Elle se divise en quatre grandes branches :
-
La sexologie générale, normale ou biosexologie : Différenciation des sexes. Anatomie et physiologie des organes génitaux, fonctions, morphologie. Ovulation. Spermatogénèse. Fécondation, Embryogénèse, Gonocritie. Endocrinologie et neurologie sexuelles. Impuissance. Stérilité.
-
Sexopsychologie : Manifestations internes et externes de la sexualité dans ses relations de causes à effets. Psychologie sexuelle générale. Besoin génital. L’amour. Erotologie. Virilité et féminité psychiques. Psychanalyse.
-
Sexopathologie : Anomalies et malformations. Hygiène et névrose sexuelles. Onanisme et masturbation. Pédérastie et saphisme. Pédophilie. Zoophilie. Fétichisme. Sadisme et Masochisme. Maladies vénériennes.
-
Sexologie sociale : Nubilité, virginité, célibat et chasteté. Mariage et union libre. Polygamie et polyandrie. Maraichinage. Natalité et fécondité. Loi de population. Prolétariat. Prophylaxie anticonceptionnelle et vénérienne. Stérilisation. Avortement et infanticide. Filles-mères et enfants naturels. Prostitution. Dégénérescence et eugénisme. Éducation sexuelle. Lois et morales régissant les actes et les rapports sexuels.
En dépit de l’interdit méprisant jeté par les religions, particulièrement la religion judéo-chrétienne, sur les organes génitaux et sur les rapports sexuels — parties honteuses, maladies honteuses — l’importance de ceux-ci dans la formation des individus, dans leurs relations, éclate chaque jour davantage aux yeux des penseurs éclairés comme à ceux des hommes libérés des dogmes désuets. On se demande par suite de quelle aberration d’esprit, par crainte de quel « tabou » les générations passées ont pu négliger l’étude franche et rationnelle des organes et des fonctions qui président à la transmission de la vie, à la chose la plus grave qui forme, avec la conservation de l’individu, les deux pôles autour desquels gravite toute matière animée ? Sans doute, la notion de « péché » que les moralistes religieux ont attaché aux relations amoureuses, surtout à l’acte de la copulation, a été pour beaucoup dans le maintien de l’ignorance voulue et peureuse où se sont complus nos ancêtres.
On trouve bien, par ci par là, quelques oeuvres : Les Kama-Soutra de Vatsyayana, El Ktab, L’art d’aimer d’Ovide, les Traités secrets à l’usage des confesseurs où les questions sexuelles, les rapports conjugaux, les lois de l’amour ont été exposés, examinés même avec assez de pénétration intuitive, principalement dans l’oeuvre des jésuites ; mais, c’était surtout du point de vue des manifestations extérieures, si l’on peut dire, et d’une manière plutôt psychologique, morale, et le plus souvent pour condamner et non pour instruire. Ce qui faisait déjà dire à Montaigne, au seizième siècle :
« Qu’a donc fait aux hommes l’action génitale, si naturelle et si nécessaire, pour la proscrire et la fuir, pour n’oser en parler sans vergogne, et pour l’exclure des conversations ? On prononce hardiment les mots tuer, voler, trahir, commettre un adultère, etc ... et l’acte qui donne la vie à un être on n’ose le prononcer ? O fausse chasteté ! Honteuse hypocrisie !... ne sont-ils pas bien brutes ceux qui nomment brutal l’acte qui leur a donné le jour ? »
Il faut venir jusqu’au dix-huitième siècle pour voir apparaître les premières études vraiment scientifiques de l’instinct sexuel et de la génération, mais c’est aux dix-neuvième et vingtième siècles qu’il appartiendra d’avoir fait le pas décisif en posant les bases solides de la science de la vie et de sa perpétuation. Parmi les précurseurs citons au hasard : de Graaf, Hunter, Jacob, Spallanzani, Buffon, Malthus avec sa découverte de la « loi de population », Darwin « l’Origine des espèces », H. Spencer ; plus près de nous, Mendel avec les « lois d’hérédité », Raciborski et ses travaux sur l’ovulation, Krafft-Ebing dont la « Psychopathia sexualis » fait toujours autorité en la matière, Garnier avec ses dix volumes bourrés d’observations, le célèbre entomologiste H. Fabre qui nous a laissé de si remarquables révélations sur les moeurs sexuelles des insectes, Joanny Roux « L’Instinct d’amour » , qui portait en exergue : « Aimer, comprendre », Steinach, Francillon, Mantegazza, Rémy de Gourmont avec son admirable essai « Physique de l’amour », Camille Mauclair et ses deux ouvrages : La Magie de l’amour et De l’amour physique, Anton Nystom et son courageux livre : La Vie sexuelle et ses lois, G. Hardy La Question de population (le problème sexuel : moyens d’éviter la grossesse, l’avortement), ouvrage poursuivi, condamné et interdit, René Guyon l’audacieux écrivain de La légitimité des actes sexuels, Binet-Sanglé avec Le haras humain, Camille Spiess, le créateur de la psychosynthèse érotique, Gobineau et les pansexualistes ; les vulgarisateurs aussi : Jean Marestan, dont l’Éducation sexuelle a atteint le chiffre formidable de deux-cent-deux mille exemplaires, Eugène Lericolais avec Peu d’Enfants. Pourquoi ? Comment ? (la gonocritie ou procréation volontaire des sexes) et tant d’autres dont la liste serait trop longue.
Cependant, nous devons une mention toute spéciale aux six sexologues suivants qui sont, à nos yeux, les véritables fondateurs du mouvement actuel :
-
Auguste Forel, professeur à l’Université de Zurich, psychiatre et naturaliste éminent, dont le très important ouvrage La Question sexuelle fut traduit en seize langues.
-
Sigmund Freud, le créateur de la psychanalyse, qui contribua surtout à mettre en relief l’influence du fait sexuel sur un grand nombre de manifestations de la vie courante demeurées jusqu’ici inexpliquées.
-
Gregorio Maranon, professeur à Madrid, dont les admirables travaux sur l’endocrinologie ont ouvert des horizons immenses et à qui nous empruntons la conclusion de son volume sur « l’Évolution de la sexualité et les états intersexuels » : « Pour que chacun fasse correctement son devoir, il faut que l’homme et que la femme prennent conscience de ce qu’ils doivent être. Et pour cela, il faut qu’ils le sachent d’avance. Nous arrivons donc, comme à la clé de voûte d’un arc, à cette conclusion : « Il faut savoir » ; il faut remplacer le mystère du sexe par la vérité du sexe ; la chasteté dangereuse de l’ignorance — qui ne sachant rien invente tout — par la chasteté sereine de la science. Et la morale ? nous dira-t-on. Pour la morale, répondons-nous : il ne faut pas s’en préoccuper. La morale — l’éternelle et divine morale et non celle qu’ont inventée les hypocrites — est toujours du côté de la lumière. »
-
Serge Voronoff, universellement connu pour ses travaux sur l’endocrinologie sexuelle et la greffe humaine, et dont la doctrine se trouve résumée dans son livre Les Sources de la vie.
-
Magnus Hirschfeld, fondateur et directeur de l’Institut de sexualité de Berlin, fondateur et un des présidents de la « Ligue Mondiale pour la réforme sexuelle sur une base scientifique » (voir au mot : Régénération), auteur de nombreux ouvrages sur l’instinct et les perversions sexuelles, créateur de l’ethnographie sexuelle.
-
Havelock Ellis est sans doute l’écrivain qui a le plus contribué par ses nombreux travaux à jeter les fondements rationnels de la Sexologie. La liste de ses oeuvres est longue. Donnons-là ici pour l’édification du lecteur : La pudeur, la périodicité sexuelle, l’auto-érotisme ; L’Inversion sexuelle ; L’impulsion sexuelle ; La sélection sexuelle chez l’homme ; Le symbolisme érotique ; L’état psychique pendant la grossesse ; L’éducation sexuelle ; L’évaluation de l’amour, la chasteté, l’abstinence sexuelle ; La prostitution, ses causes, ses remèdes ; La déroute des maladies vénériennes ; Le mariage ; La femme dans la société ; Le monde des rêves ; L’art de l’amour, la science de la procréation ; L’Ondinisme. Tous ces sujets ont été traités avec le plus vif souci de sincérité et de vérité objective et la conclusion qui s’en dégage s’inspire d’une sereine et très humaine philosophie.
La sexologie est à présent fondée ; ses desseins sont vastes du point de vue de la connaissance de la vie et de sa continuation, de la situation même de l’homme dans la nature. D’ores et déjà, les résultats acquis sont merveilleux. Des horizons nouveaux s’élargissent : amélioration, rajeunissement des individus, arrêt de la décrépitude, prolongation de l’existence. Par la stérilisation des tarés et des anormaux, par l’application des méthodes eugénétiques, l’espèce humaine ira de perfectionnements en perfectionnements jusqu’à un stade d’évolution que nous ne pouvons et n’oserions peut-être pas prévoir. Le Docteur A. Hesnards a parfaitement exposé, dans son magnifique Traité de Sexologie, le plan de la nouvelle science ; il en a fait admirablement ressortir toute l’importance. Nous ne saurions mieux faire que de reproduire la fin de l’ « Avertissement » qu’il place en tête de son livre : « Nous terminons ce préambule par le voeu de ne jamais nous laisser émouvoir, dans notre entreprise de connaissance, par les malveillantes protestations de ceux que choquent, dans leurs préjugés d’un autre âge, toute considération sexuelle et jusqu’à l’idée même d’une science de la sexualité. Et répétons des sexologues, adeptes de la science positive, ce qu’un pessimiste illustre écrivait (non pas en vertu de son pessimisme métaphysique, mais avec la sérénité de l’homme de science) des philosophes :
« La connaissance de la sévère nécessité des actes humains est la ligne qui sépare les cerveaux philosophiques des autres. »
Pour être aussi complet que possible, nous devons encore signaler qu’à la suite de tous ces travaux de médecins, de savants, de philosophes et de sociologues, des groupements se sont formés dans tous les pays pour répandre les idées nouvelles et répondre aux critiques le plus souvent désobligeantes qu’elles suscitent. Nous avons déjà parlé de la « Ligue Mondiale pour la réforme sexuelle sur une base scientifique », notons à présent l’heureuse fondation, en août 1931, de l’ « Association d’Études Sexologiques », par le Docteur Toulouse. Là, entouré de médecins, de sociologues, d’hommes politiques même, l’éminent directeur de l’hôpital psychiatrique Henri Rousselle, mène une action des plus utiles. Le but et l’effort de cette association sont définis par les articles premier et 2 de ses statuts :
« ARTICLE PREMIER. — L’association, dite « Association d’Etudes Sexologiques », fondée en 1931, a pour but l’étude des problèmes de la sexologie et de leurs rapports avec la vie sociale.
ARTICLE 2. — Les moyens d’action de l’association sont : la propagande par la presse, par la parole et par l’image, tracts, cinématographe, publication d’un bulletin périodique, consultations médicales, fondation de dispensaires et de sections et, éventuellement, la création d’un Institut de sexologie. »
Souhaitons de toute notre confiance que cette Association ne se laisse pas détourner, par les mauvais esprits et par les contempteurs de la pensée libre, de son but vraiment humain. Tant de préjugés et de fausse pudeur, tant d’hypocrisie pèsent toujours sur nous, que tout effort vers la lumière est aussitôt paralysé, combattu. Il n’est pas jusqu’aux lois, celles qui consacrent l’injustice et l’iniquité, ou qui sont l’expression de moeurs révolues ou bien encore des instruments de défense d’intérêts de castes que l’on devra modifier, amender ou mieux : abroger. De toute façon, la route est tracée ; l’émancipation sexuelle de l’homme et de la femme préparera sans aucun doute leur émancipation totale, c’est-à-dire aussi l’affranchissement de tous les peuples et leur fusion dans la plus haute réalisation de l’humanisme intégral.
— Eugène HUMBERT.
SEXUALISME
n. m.
On se demande pourquoi certains individualistes, dont je suis, se préoccupent de la question sexuelle, insistent sur la libre discussion de tout ce qui a trait au sexualisme. Notre réponse sera brève : Un nombre élevé d’individualistes et moi-même, nous estimons qu’il y a une question sexuelle, comme il y a une question économique ou une question religieuse, etc... N’étant pas marxistes, nous ne pensons pas qu’une transformation économique suffirait à débarrasser l’individu, l’unité sociale, de ses préjugés sociaux. Nous ne pensons pas que l’histoire ou le déplacement évolutif de l’humanité soit uniquement conditionné par les circonstances économiques. Pour nous, l’histoire est ce que la font les individus, avec leurs préjugés, leurs traditions, leur science ou leur ignorance, etc... D’ailleurs, nous sommes en pleine sympathie avec les camarades qui se confinent à n’envisager que le côté économique du problème humain, chaque propagandiste, selon nous, obéissant à son déterminisme personnel.
Ceci entendu, nous ne pensons pas qu’un milieu humain ou un individu puisse se dire anarchiste, tant qu’il n’a pas fait table rase des préjugés d’ordre religieux et sexuel, préjugés qui sont, dans une égale mesure, générateurs d’autoritarisme.
Si, pour les préjugés d’ordre religieux, ce point de vue est admis, il en est tout autrement pour ceux d’ordre sexuel. C’est rarement que les hommes qui passent pour être des réformateurs ou des émancipateurs sociaux ou individuels osent aborder sans détours la question des relations sexuelles. Demeure impur, selon le terme biblique, pour une masse de révolutionnaires de toutes nuances, tout ce qui touche à la sexualité. Toutes les revendications qu’on voudra, mais non celles qui sont d’ordre sexuel. Nombre de libres penseurs, d’athées déclarés n’ont pas dépassé comme mentalité sexuelle ces trois commandements de l’Eglise :
De corps ni de consentement.
Désirs impurs rejetteras
Pour garder ton corps chastement.
L’oeuvre de chair désireras
En mariage seulement.
Et ce n’est pas une des moindres anomalies du temps présent que le pied conservé par la morale sexuelle religieuse dans des groupements qui se targuent de rejeter toute morale qui n’est pas fondée sur la biologie.
La question sexuelle se solutionne chez la plupart des humains qui se prétendent à l’avant-garde du mouvement social par la cohabitation entre un homme et une femme impulsés sexuellement l’un vers l’autre, cohabitation dont le résultat est que chaque partenaire considère l’autre comme sa propriété. En général, l’élément masculin dominant, c’est lui qui se considère comme le possesseur du corps de sa cohabitante, le propriétaire de ses sentiments et de ses désirs, le contrôleur de ses besoins de changement, tout cela en exigeant qu’elle se plie aux conséquences de la vie qu’il lui a faite, souvent en lui imposant la charge de la maternité. Nous maintenons que cette attitude de l’homme à l’égard de la femme n’a rien d’anarchiste et qu’aucun argument ne peut la justifier.
Nos idées en matière de sexualisme ont été fort peu comprises. Trop souvent on les a présentées — quand on a consenti à les examiner — avec une mauvaise foi insigne. Nous pouvons nous tromper, mais il faut nous démontrer que nous avons tort et ne pas nous attribuer des idées que nous n’avons pas. D’ailleurs nous proposons nos solutions, nous ne les imposons pas et nous nous réservons de les vivre à nos risques et périls sans obliger à participer à nos expériences qui que ce soit qui n’est pas disposé à le faire de son plein gré.
Nous disons par exemple :
-
Il n’y a pas de domaine où règne une hypocrisie plus grande qu’en matière sexuelle.
-
La morale laïque, en matière sexuelle, est la servante ou le reflet de la morale religieuse sexuelle, qui considère comme un péché de retirer de la volupté des rapports sexuels.
-
L’institution de la famille, avec l’obéissance obligatoire au père ou à la mère, est une image en petit de la société archiste. Le père y représente le législateur et la mère l’éducateur officiel.
-
Le désir de la satisfaction sexuelle est la manifestation d’un besoin naturel, d’une demande plus ou moins impérieuse de l’organisme, l’effet d’un stimulant imaginatif. Il n’a rien à voir avec le désir d’avoir des enfants, qui dépend de la réflexion et n’est donc ni un besoin ni un instinct.
-
Si on ne donne pas d’importance au fait sexuel dans l’histoire officielle, la vérité est qu’il occupe une place de premier plan dans l’histoire de chaque individu, du plus humble au plus puissant, et qu’il a déterminé maints événements politiques.
-
Aucune considération tirée de la biologie ou de la physiologie n’explique qu’on ne parle ou n’écrive pas aussi librement de ce qui a trait au sexualisme que de ce qui a trait aux autres fonctions de relation.
-
Le sentiment est un des produits physico-chimiques de l’organisme humain, comme la mémoire, le raisonnement, le jugement, l’aperception, etc... : il est éducable et amplifiable comme les autres produits de l’organisme humain.
-
La première éducation sexuelle à donner à la femme est de lui enseigner à n’être mère qu’à son gré. — La chasteté est un expédient contre nature. L’abstinence sexuelle n’est justifiée ni biologiquement, ni physiologiquement.
-
Le couple est destructeur d’autonomie individuelle et implique toujours, et dans les meilleures conditions, sacrifice d’un des éléments à l’autre. Le couple comporte toujours abstention, restriction, refoulement, résignation : il est donc opposé au développement de l’individu.
-
La jalousie est une monopolisation maladive des organes sexuels, tactiles, de la peau et du sentiment d’un être humain au profit d’un autre. Elle contient en germe l’étatisme, le patriotisme, le capitalisme.
-
La femme n’est ni plus ni moins polyandre ou monoandre que l’homme n’est monogame ou polygame. La femme et l’homme sont déterminés artificiellement par la morale conventionnelle à paraître ce qu’ils ne sont pas.
-
Il n’y a pas, actuellement, de différence essentielle entre le mariage bourgeois et la prostitution. Le mariage est de la prostitution de très longue durée et la prostitution est un mariage de courte durée
-
L’obscénité n’existe pas dans l’objet, mais dans le sujet.
-
Les anomalies sexuelles ne peuvent donner lieu à aucun dégoût ou répugnance. La science reconnaît aujourd’hui l’existence de ces anomalies congénitales, et on ne peut pas dire que chez les anormaux connus on ait remarqué déchéance de la production cérébrale ou altération des fonctions organiques. Je rappelle en passant cet aphorisme de l’anarchiste Mécislas Goldberg :
« Les perversités sexuelles sont à l’amour ce que l’anarchie est au conformisme bourgeois. »
Au lieu de nous attribuer des pensées qui n’ont jamais été nôtres, la plus élémentaire loyauté prescrivait d’examiner et de débattre courtoisement les propositions énoncées ci-dessus.
Nous avons dit : nous ne concevons la cohabitation à 2, 3, 4, ou un plus grand nombre d’individus d’un ou des deux sexes que si elle a pour base des affinités idéologiques. Ou encore, dans la société actuelle, pour raisons économiques. Nous ne la concevons pas au point de vue sexuel, ou sentimental, l’expérience montrant que la cohabitation basée sur le sexuel ou le sentimental entraîne, sauf rares exceptions, exclusivisme et jalousie. Nous avons ajouté : la logique anarchiste veut que le corps personnel appartienne à l’ego, au moi, à l’unique. Il n’est ni à la loi, ni à Dieu, ni à l’Église, ni à l’État, ni au milieu social, ni à l’ambiance sociétaire. Mon corps est à moi, pour en disposer, m’en servir, l’utiliser, en tirer le plus de plaisir ou de volupté possible, tout entier ou en partie. Et nous avons conclu en souhaitant, en revendiquant que le geste sexuel sentimental ou érotique demeure un geste de camaraderie : un geste susceptible de servir de base à des associations composées d’individus des deux sexes parfaitement éduqués au point de vue sexuel et organisées pour parer aux incidents ou accidents possibles (maternités, maladies, etc...).
Nous maintenons que le fait de se procurer mutuellement du plaisir favorise les rapports fraternels et amicaux et que « la camaraderie amoureuse » développée sur une grande échelle non seulement tendrait à supprimer la jalousie, le propriétarisme sexuel, l’exclusivisme amoureux, mais réduirait au minimum les chances de désaccords internationaux pour aboutir à l’abolition des frontières. On n’a pas plus le droit de taxer d’utopie cette aspiration que la possibilité pour les hommes de vivre sans autorité gouvernementale.
Properce, au siècle d’Auguste, avait déjà dit dans une ode (II, 15) :
« Ah ! si nous avions tous désir de vivre, étendus, à mener l’amour ... on ne verrait aucun acte cruel ; ni glaives égorgeurs, ni navires de guerre : les flots d’Actium ne rouleraient pas nos os et Rome garderait ses chevaux en repos, lasse du deuil des victoires amères. » (traduction Marcel Coulon)
En attendant, nous affirmons que là où elle est pratiquée consciemment et efficacement, la camaraderie amoureuse constitue un facteur de camaraderie plus ample et plus complète entre les individus des deux sexes qui la pratiquent.
C’est cet ensemble de propositions et de considérations que nous avons dénommé sexualisme révolutionnaire, et non autre chose. Par l’hostilité qu’elles ont soulevée, nous pensons que ce terme « révolutionnaire » leur convient à merveille.
Nous renvoyons aux mots : Amour libre, amour en liberté, camaraderie amoureuse, chasteté, cohabitation, inversion sexuelle, malthusianisme, néo-malthusianisme, mariage, monoandrie, monogamie, obscénité, onanisme, pudeur, prostitution, symbolisme érotique, etc..., pour le développement des thèses esquissées ci-dessus.
Certains camarades nous ont opposé qu’il est à redouter que la libre discussion de la question sexuelle, la réduction des relations sexuelles à un pur geste de camaraderie conduise à la prostitution (?). Ils prenaient prétexte d’une carte postale ou d’un papillon souvent réédité par la tendance individualiste anarchiste, sur laquelle on lit cette maxime :
« Qu’on prostitue son cerveau, son bras, ou son bas-ventre, c’est toujours la prostitution et l’esclavage. »
Mais ce n’est pas une apologie de la prostitution sexuelle. Ces quelques lignes veulent, au contraire, dire que l’ouvrier, adversaire de l’exploitation, qui se fait exploiter cérébralement ou musculairement, commettrait une grossière erreur s’il s’imaginait « moralement » supérieur à la pierreuse qui raccroche les passants sur le trottoir. Car l’on est favorable ou hostile à l’exploitation. Que ce soient ses facultés cérébrales ou sa force musculaire ou ses organes sexuels que l’on fasse exploiter, ce n’est qu’une question de détail. Un exploité est toujours un exploité et tout adversaire de l’exploitation qui se fait exploiter se prostitue. Je ne vois pas en quoi est supérieur à la radeuse ou à la femme entretenue, l’humain qui, adversaire de l’exploitation, accomplit toute la journée derrière une machine, un geste d’automate ou s’en va soutirer à une clientèle de petits mercantis des commandes pour son patron. Ce qui constitue l’état de prostitution, ce n’est pas le genre de métier, c’est le fait qu’on gagne sa vie par des moyens contraires à ses opinions ou renforçant le régime qu’on professe combattre.
Jamais je n’en ai été aussi convaincu qu’en assistant un jour à une « sortie » de l’Arsenal, à Toulon. Dans ce troupeau d’ouvriers se bousculant pour sortir le plus rapidement possible de leur « bagne », il se trouvait un grand nombre d’hommes qui s’affirment non seulement hostiles au système d’exploitation de l’homme par l’homme ou le milieu, mais encore irréconciliables adversaires de la guerre. S’ils sont sincères, s’ils éprouvent une horreur véritable et raisonnée de ce mode brutal et bestial de solutionner les conflits internationaux, ils conviendront eux-mêmes qu’ils se prostituent en accomplissant une tâche quotidienne qui est en contradiction flagrante avec leurs convictions les plus intimes. Ne serait-il pas du plus haut comique d’entendre ces malheureux stigmatiser la femme qui gagne son pain en jouant « la comédie de l’amour » ? Ils jouent, eux, une comédie sinistre, une comédie dont le dernier acte se déroule sur des ruines et des cadavres. Je songeais, en les voyant s’éparpiller dans les rues de cette ville, que jamais la prostitution n’a mené, en cinq ans, vingt millions d’hommes à une mort cruelle, stupide et le plus souvent ignominieuse. Il se peut qu’ici et là quelque décati, abusant de ses dernières forces, succombe entre les bras d’une prostituée ; toutes choses considérées, cela vaut autant que d’agoniser des jours durant accroché à des fils de fer barbelés.... A la vérité toute exploitation a pour réponse ou pour contrepoids une prostitution, même quand il s’agit de l’exploitation en vue d’obtenir les utilités les plus nécessaires à la vie.
Donc nous n’établissons pas de différence entre les diverses prostitutions : celle de l’intellectuel, celle du manuel, celle de l’ouvrière ès-joies sensuelles. Cependant, il est une maxime insérée également sur papillon ou carte postale, diffusée également par les individualistes et qui éclaire notre attitude sur la question de la prostitution sexuelle :
« Le mariage et la prostitution sont les deux termes d’une même opération. Seule est raisonnable la liberté sexuelle, seul est logique l’amour libre. »
Nous mettons sur le même pied le mariage bourgeois et la prostitution. Et c’est justement parce que nous proposons et exposons des thèses se rattachant aux conceptions de la liberté sexuelle et de l’amour libre que nous n’admettons pas la prostitution sexuelle comme « moyen de débrouillage ». Nous sommes adversaires de la « prostitution » au même titre que nous sommes adversaires du « mariage » — selon la conception bourgeoise — ce sont des opérations entachées de vénalité. Comme nous sommes adversaires de la prostitution de la pensée, d’ailleurs. Nous ne saurions par exemple considérer comme l’un des nôtres, comme un compagnon, quelqu’un qui écrirait ou parlerait ou se conduirait « en individualiste anarchiste » parce qu’il y trouverait occasion de gagner de l’argent, alors qu’en son for intérieur, il considérerait l’anarchisme comme une erreur, une sottise ou une chimère. Dans le milieu social actuel où tout est objet de vente et d’achat — où c’est la possession des signes monétaires qui commande obéissance, respect, estime, dignités, possibilités de jouissances de toutes sortes, nous voulons — tout au moins en ce qui concerne les produits de la sensibilité amoureuse — rester en dehors de la corruption et du mercantilisme ambiants.
Il est suffisant que la plupart de nos camarades soient forcés de vendre, de louer ou de sous-louer leur intelligence et leurs bras, de s’employer au bureau, au magasin, à l’atelier, au chantier ou ailleurs — il est amplement suffisant qu’ils s’abaissent, pour gagner leur croûte quotidienne, à servir d’instruments et d’outils aux dirigeants et aux exploiteurs, — nous ne voulons pas aller plus loin dans la voie des concessions et des pis-aller. Aucun idéalisme, aucun spiritualisme ne nous fait mouvoir. C’est assez concéder et voilà tout ! En matière de sexualisme pratique, — qu’il s’agisse de l’amour envisagé « sexuellement » ou « sentimentalement » — notre individualisme anarchiste refuse de se laisser contaminer par l’infection de l’arrivisme ambiant.
Il y a des prostitutions auxquelles nous ne pouvons pas échapper sans risquer de mourir de faim, c’est vrai. Mais, tout de même, nous pouvons renoncer à celle-là sans risquer l’absolue misère : elle n’est pas indispensable à notre conservation. D’autant plus, nous y revenons, que si nous voulons faire des manifestations amoureuses ou érotiques un procédé ou une méthode qui nous rende meilleurs camarades les uns à l’égard des autres, nous n’admettons pas, par contre, qu’on en fasse un objet de vénalité que le premier des archistes venu peut se procurer dès qu’il y met le prix, Et qu’on ne vienne pas nous dire que la compagne individualiste-anarchiste à notre façon fera de la propagande auprès du bourgeois qui paiera bon prix le sentiment (?) qu’elle feindra d’avoir pour lui. Allons donc ! Ce bourgeois poli et aimable, libéral et sympathique, en déduira que, chez les anarchistes comme ailleurs, on vend tout ce que l’on peut vendre ... l’amour comme le reste. Ah ! la jolie propagande !
Je vais plus loin : les raisons qui précèdent impliquent que l’individualiste à notre façon qui se liera à une prostituée, cela peut arriver, fera tous ses efforts pour l’arracher à la prostitution. En vain m’objectera-t-on les tempéraments spéciaux qui se prostituent « par goût ». Dans un milieu où la camaraderie amoureuse, franche, vraie, est la coutume, ils rencontreront toutes les occasions de satisfaire les dits goûts, physiquement ou sentimentalement parlant, sous tous leurs aspects.
Ceci dit, je suis prêt à reconnaître que l’absence de « camaraderie amoureuse » dans nos milieux, ou sa mécompréhension, ou sa falsification a pu ou peut justement conduire certains hommes au mariage, certaines femmes à la prostitution. Mais ces exceptions ne font que confirmer ou renforcer nos thèses. Donc, en matière de sexualisme, notre ligne de conduite est la suivante : nous ne considérons à aucun titre les manifestations de la sexualité comme objets de vénalité. Nous ne saurions nous préoccuper des moyens de subsistance de n’importe qui, mais, en aucun cas, nous n’admettons la prostitution comme « moyen de débrouillage ».
Cette déclaration était essentielle pour nous faire bien comprendre.
— E. ARMAND.
SEXUELLE (MORALE)
On ne parle point, ou si peu, ou si mal, à mots couverts, et avec toutes sortes de précautions, dans l’enseignement de la morale, qu’il s’agisse pour les pédagogues de préparer les fils et les filles de la bourgeoisie aux examens qui, selon la formule consacrée, ouvrent toutes les carrières, ou d’initier, non plus des écoliers, mais des adultes à des questions qu’ils ne soupçonnent même pas, — on ne parle point de la question sexuelle, alors qu’elle devrait accompagner toute éducation, et la parfaire pour ainsi dire. Les philosophes s’en désintéressent, laissant ce soin aux médicastres. On se heurte ici à la mauvaise volonté des moralistes d’Institut, des sénateurs et des pères de famille qui n’admettent pas qu’on mette leur nez dans leurs atributions... dont ils s’acquittent si mal. Une bonne éducation comporte des leçons de danse et de maintien, de boxe, d’escrime, de violon, etc..., elle ne saurait envisager à un point de vue élevé, philosophique et pratique en même temps la question des rapports physiques et moraux de l’homme et de la femme.
Pour tout ce qui a trait aux rapports sexuels des individus, la morale ne plaisante pas : ici, l’incohérence est à son comble, la bêtise est souveraine. Le point de départ, comme le point d’arrivée de la morale, a nom hypocrisie. L’hypocrisie joue un rôle en matière sexuelle, plus que partout ailleurs. La pudeur des bourgeois s’effarouche à la vue de la nudité (elle préfère l’habillé, tolère le déshabillé, c’est plus excitant). C’est cette pudeur sournoise — commencement de toutes les impudeurs — qui a créé l’outrage public à la pudeur et l’attentat aux moeurs et qui multiplie les affaires dites de moeurs, affaires qui permettent aux agents des moeurs de toucher une prime pour arrestations arbitraires, et aux politiciens de se venger de leurs ennemis.
L’acte sexuel est considéré par les religions et les morales comme quelque chose de honteux. Il faut qu’il s’accomplisse dans certaines conditions pour qu’on le tolère. Tout ce qui intéresse ce côté de l’individu doit être passé sous silence. On n’en parle qu’à mots couverts. Que de mystères ne fait-on pas à propos de l’acte de la génération ! C’est le secret de polichinelle, mais il est de bon ton de n’y point faire allusion. Chacun sait de quoi il retourne ; cependant, sur ce chapitre spécial, le bon sens le plus élémentaire fait défaut et, bien que les individus soient renseignés, ils sont d’une ignorance crasse en fait d’éducation sexuelle. L’éducation sexuelle est la plus négligée des éducations. Il paraît qu’il est indélicat d’apprendre à la jeunesse ce qu’elle est censée ignorer. Ce n’est pas seulement l’éducation des nouveaux venus qui doit être faite sur ce point, mais celle des anciens qui n’ont rien appris, et pour lesquels l’acte sexuel, pratiqué bestialement, constitue toute la morale. Quand on a parlé d’instituer dans les écoles des cours d’enseignement sexuel, ça a été une levée de boucliers dans le camp de la bourgeoisie honnête et bien pensante. On apprend tout aux gens, à faire la cuisine, à dessiner, à coudre, à lire et à écrire, mais de l’amour il n’est pas question. C’est trop délicat.....
Parlant de l’éducation sexuelle, Renée Dunan écrit (l’en dehors, 31 mai 1924) :
« Qu’il y ait des gens de bonne foi pour s’inscrire contre une telle idée apparaît d’un comique fastueux. »
En cette matière, décidément, les gens ne veulent pas s’instruire. Certes, la jeunesse se charge bien de s’instruire elle-même, n’en doutons pas, mais la véritable éducation sexuelle, de celle-ci nul ne veut entendre parler. Les gens s’instruisent à rebours. L’auto-éducation sexuelle est pleine d’embûches et réserve aux individus de cruels lendemains. Cette absence d’éducation est déplorable. De là vient que les mariages bourgeois sont des viols, de véritables meurtres ; que les maladies vénériennes, dites honteuses, font les pires ravages ; que les crimes passionnels se multiplient ... L’ignorance de la femme en fait d’éducation sexuelle provient de l’égoïsme de l’homme qui profite et abuse de cette ignorance. Il ne saurait être question d’éducation sexuelle dans une société où le mensonge est dieu. Nos vertueux moralistes admettent tout, excepté ça (comme les demi-vierges de Marcel Prévost). L’éducation sexuelle est leur cauchemar. Ils ne veulent à aucun prix en entendre parler. C’est pour eux pire que le bolchevisme. S’il est une chose cependant sur laquelle on doive attirer l’attention, c’est bien l’éducation sexuelle — sous tous ses aspects — la plus négligée de toutes, ou plutôt qui n’a pu être négligée, n’existant même pas. On tolère les pires saletés dans le monde bourgeois, mais on ne tolère pas l’éducation sexuelle. Pour les garçons, ils la font tout seuls, et comment ! Pour les filles, elles sont ignares, ce qui ne veut pas dire qu’elles soient vertueuses. Leur perversité n’a d’égale que leur ignorance de l’amour, qu’elles prodiguent sans en comprendre la beauté. Que de coïts ignobles provoquent cette méconnaissance des lois de l’amour. Il y a là une profanation du geste sacré qui équivaut à un assassinat. Combien d’imbéciles font l’amour sans savoir ce qu’ils font. Jeune fille ou mariée, la femme ignore tout du mécanisme sexuel. Mais la morale est sauvée. Idiots ! — S’il y a dans la vie une chose importante, c’est bien celle de l’amour physique. Celui-ci n’est que le reflet de l’amour moral. Au moral comme au physique, c’est l’absence d’amour qui domine. L’intérêt prime l’amour. Le mensonge s’installe dans l’amour pour le transformer en prostitution. Quant à l’hygiène sexuelle elle est inexistante : il est défendu de procéder à des ablutions intimes, c’est un péché. Les « parties honteuses » doivent être malpropres si l’on veut rester en odeur de sainteté. Les injections sont interdites comme contraires à la morale. Dans les ménages bien pensants, on utilise pour la procréation des chemises spéciales, évitant tout contact entre les épidermes, qui ont pour tout ornement un trou dans le milieu. Introduire du mystère autour de l’acte sexuel, c’est le rendre plus attrayant. En fait de cochonneries les bourgeois s’y connaissent. Celui qui a inventé la « feuille de vigne » était un fameux lapin. — Voilà à quoi aboutit cette morale « immorale » que nous vantent sur tous les tons les gens bien élevés, qui ne plaisantent pas avec les moeurs. Faire un cours de « sexologie » à ces enkylosés, ce serait perdre son temps, et, comme disaient les anciens, ce serait jeter des perles devant des pourceaux : margaritas ante porcos.
La question de l’amour est vite résolue par les souteneurs de la morale laïque ou religieuse. Elle est résolue dans le sens de l’esclavage pour les deux sexes. Ils ont fait de l’amour une prostitution masculine et féminine, où l’intérêt et l’argent interviennent seuls, d’où le sentiment et la sincérité sont absents. L’amour tel que le conçoivent les bourgeois est une anomalie et une monstruosité. C’est ce qu’il y a de plus immoral. Les bourgeois n’admettent pas qu’à leur conception de l’amour-esclave on oppose la conception de l’amour-libre. Si on essaie d’aborder ce sujet vous les voyez pâlir. Ne leur parlez ni de l’union libre, ni des enfants naturels, ni de la fille-mère, ni de toutes les questions qui gravitent autour de la question sexuelle. Ils n’ont pas l’esprit assez large — eux qui, cependant, font chaque jour de nombreux accrocs à leur morale — pour vous suivre sur ce terrain. En parler, c’est trop dangereux. Dire la vérité là-dessus, ce serait ébranler la société sur ses bases : toucher à la famille, au mariage, etc .. , ce serait la fin de tout. Continuons à rabâcher les mêmes âneries et à faire les mêmes gestes. La société ne s’en portera que mieux.
C’est dans le domaine sexuel que la morale est le plus immorale. C’est là surtout qu’elle manifeste sa mauvaise humeur, car ayant la vie en horreur la source de la vie lui est insupportable. Elle décrète impérativement que ce qui est naturel est immoral. Aussi aboutit-elle à des incohérences sans nombre. Elle est obligée de découvrir des faux-fuyants, des détours, des compromis, pour paraître logique. Elle ne fait que démontrer par là son illogisme.
En fait de « morale sexuelle », l’humanité retarde. Elle ne sait ce qu’elle veut. Elle se débat dans un tissu de contradictions. Elle se renie sans cesse. Elle ne paraît pas soupçonner qu’il existe une question sexuelle, plus importante que toutes les questions qui l’accaparent. De cette question, en effet, dépend le bonheur des individus. Sous aucun prétexte, elle ne veut en entendre parler : ce serait la fin de tout. A plus forte raison d’une esthétique sexuelle, considérant l’oeuvre de chair comme une oeuvre d’art. O bêtise éternelle, tu règnes dans ce domaine souverainement !
Jamais certains esprits ne se décidèrent à regarder la vérité en face. L’humanité ne diffère pas de l’animalité : elle a, comme elle, un sexe. Elle est soumise aux mêmes lois. L’homme n’est pas une entité : il possède un corps. C’est de l’hypocrisie que de ne pas en convenir. Il faut donc se résoudre à admettre certaines fonctions, certains gestes, n’en déplaise aux esprits bien pensants. Esprits pauvres, et pauvres esprits, qui ne parlent qu’à mots couverts des organes sexuels, comme d’une chose innommable, ils ne sont pas mûrs pour le « sexualisme révolutionnaire », qui est la révolte de la chair contre toutes les contraintes. Une éthique sexuelle, ayant pour corollaire une esthétique sexuelle, n’est guère possible dans une société qui ne s’intéresse qu’à des combats de boxe ou des prouesses d’aviateur.
Que de crimes provoque cette morale immorale dans les questions de sentiment : jeunes gens se donnant la mort, parce que leur « famille » s’oppose à leur mariage ; mari trompé abattant d’un coup de revolver sa femme et son complice ; épouse trahie usant du vitriol, etc., etc. Chaque jour, on lit dans les feuilles journalistiques le récit de drames « passionnels » du même genre. C’est lamentable ! La jalousie et le propriétarisme en amour empoisonnent l’existence des individus.
Cette morale a donné naissance aux pires calamités ; on lui doit la prostitution et les maladies vénériennes. La femme est ici sacrifiée : l’homme a tous les droits, la femme n’en a aucun. L’égoïsme du mâle se permet toutes les fantaisies mais n’admet pas la réciprocité de la part de sa compagne.
Que de préjugés dans ce domaine de l’amour aussi nuancé que l’arc-en-ciel. De tous les préjugés qui enlaidissent les hommes, ce sont les plus stupides. En fait de « sexologie », les bourgeois ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils sont affreusement myopes. Ne leur parlez pas d’éducation sexuelle. Elle leur fait l’effet d’un épouvantail. L’effleurer seulement, c’est se placer en dehors de toutes les normes. Ils sont grotesques, avec leurs scrupules (ils n’en ont guère en d’autres cas). Leur pudeur s’effarouche dès qu’on aborde la question sexuelle. Cette question ne sera pas posée. Et pourtant, chaque jour, de vertueux sénateurs et d’honnêtes pères de famille se font prendre en flagrant délit d’attentat aux moeurs. Ils ne sont pas précisément fidèles à leurs épouses. L’adultère est dans leurs habitudes. Ils cherchent des « excitations », se font pendre ou fouetter, pour tirer de leur sexe un peu de jouissance.
Leur progéniture a de quoi tenir. Leurs filles ont un « flirt ». Leurs fils ont des maîtresses, qu’ils lâchent, ou qui les lâchent à la première occasion. En attendant, ils ont des habitudes qu’il leur est difficile de surmonter. Quelle conception peut avoir de l’amour un jeune homme abruti par la masturbation ? Celle-ci est le fruit d’une éducation à rebours, qui vise à refouler ce qui est naturel dans l’individu et à le remplacer par quelque chose d’artificiel.
Cette morale, les bourgeois savent s’en passer quand elle contrarie leurs intérêts. Ils ferment alors les yeux sur les pires saletés. Ils tolèrent de graves manquements au dogmatisme sexuel. Du moment que ça leur rapporte, il n’y a plus de pudeur.
Le mariage est une « affaire » entre gens « comme il faut ». Autant dire une prostitution, légale et déguisée. C’est un trompe-l’oeil et une façade. Le mariage est la base de la société, disent les moralistes. C’est une base peu intéressante. Pour « arriver », des gens se marient. Ils arrivent... à se séparer. Se marier est bien vu. Il faut se marier, coûte que coûte, pour obtenir un brevet d’honnêteté. Alors, on peut tout se permettre. Honte à celui qui n’est pas marié. C’est le bouc émissaire ! Il a tous les vices. C’est ce qui faisait dire à Ibsen que « le mariage dans notre société est une cause de dégradation et de démoralisation ». « Au nom de la loi, je vous unis », l’individu muni d’une sous-ventrière qui prononce cette formule est aussi grotesque que les conjoints qui viennent lui demander la permission de coucher ensemble.
L’amour intervient rarement dans le mariage. C’est un détail. Ce qui intervient, ce sont toutes sortes de considérations accessoires. La mère, qui cherche à « caser sa fille » (sic), la met en contact avec n’importe quel individu, qui l’épousera si elle possède une jolie dot. Dans le cas contraire, il n’en veut pas. La mère, qui cherche à « caser sa fille » ne se préoccupe guère de savoir si son futur gendre a la syphilis ou toute autre tare. L’essentiel, c’est qu’il ait de l’argent. Cela seul compte. Le reste ne compte pas. Initier sa fille à la vie sexuelle, à ce qui l’attend pendant le mariage, ce ne serait pas convenable. L’initiation sera faite par le mari, à la va-comme-je-te-pousse. Balzac, qui connaissait le coeur humain, disait :
« Ne commencez jamais le mariage par un viol. »
Or la plupart des « maris » commencent le mariage par un viol. Vendre la chair de sa chair au plus offrant, telle est l’unique préoccupation de beaucoup de mères de famille. Livrer sa fille au premier venu, contre bonnes espèces sonnantes, c’est faire preuve d’une sollicitude toute maternelle. Rien ne distingue, sur ce point, les civilisés des « sauvages ». On peut même dire que ces derniers agissent plus proprement, quand ils vendent leurs filles ou qu’ils achètent celles des autres.
L’intérêt, la vanité, les relations, « le rang », interviennent dans la question sacro-sainte du mariage. L’union des sexes n’est pas une petite affaire. Il y a là des questions de race, de nationalité, de religion, qui dressent les familles les unes contre les autres. Elles redoutent des « mésalliances ». A côté de cela, on voit des princesses épouser leur chauffeur. Revanche de la chair contre toutes les étiquettes.
On assiste à des unions grotesques, dans lesquelles l’harmonie est loin de régner. Elle n’est qu’apparente, pour la galerie. Quant aux fruits nés de ces unions, ce sont des fruits véreux. Les enfants valent les parents. Tristes familles que ces familles de bourgeois, respectueux de toutes les traditions, et cependant pourris de vices. La famille bourgeoise est au-dessous de tout. Elle se croit pourtant au-dessus de tout. Jean Rostand a forgé une épithète pour désigner les père, mère et fils de famille mégalomanes : il les appelle des familiotes. Le mot est bien trouvé. Leur familiotisme vaut leur patriotisme.
Les bourgeois ignorent l’eugénisme. Qu’est-ce que c’est que ça ? Ils substituent à la procréation consciente la procréation inconsciente. Ils font des enfants malingres et idiots. Ils sont pour cela dispensés d’une partie de l’impôt et d’une foule de corvées. C’est le célibataire qui prend tout et paie pour les enfants des autres. C’est logique, dans une société illogique.
Il y a, dans le domaine sexuel, qui joue un si grand rôle dans la vie humaine, plus d’une réforme à accomplir. Pourquoi les moralistes veulent-ils imposer à tous les hommes une manière de voir uniforme ? Ils se trompent grossièrement et sont en désaccord avec les lois de la vie. Comment se plier aux commandements de la morale lorsqu’elle-même n’est pas stable ? Chez tel peuple règne la monogamie ; chez tel autre la polygamie, considérée comme un crime chez le premier. Tantôt le nu est proscrit, tantôt il est toléré. Ce qui est pudeur ici est impudeur plus loin. La morale sexuelle change avec le milieu.
« Il est bien vrai que la morale est une affaire de goût », affirme le sceptique Anatole France, voulant dire par là que la morale n’est ni stable ni universelle. L’homme moral, partout le même, sous toutes les latitudes, possédant mêmes besoins et mêmes goûts, quels besoins et quels goûts ! est une anomalie et une monstruosité. Le comte de Gobineau, précurseur de Nietzsche, voyait juste quand il écrivait, dans l’Introduction de ses Nouvelles Asiatiques :
« Au rebours de ce que nous enseignent les moralistes, les hommes ne sont nulle part les mêmes. »
La question sexuelle est une question personnelle. La liberté, dans ce domaine, est absolue ; chaque être use de son corps comme il l’entend ; chacun a le droit d’agir à sa guise. Il n’y a pas de morale sexuelle universelle. La morale sexuelle est individuelle. Il est ridicule de chercher à imposer aux sujets les plus différents un monisme amoureux. De même que nous ne pensons pas tous la même chose, nous aimons diversement. Si l’individu est la mesure de toute chose, comme le croyaient les sages antiques, n’est-ce pas surtout en amour ?
Au sujet de cette question sexuelle, comme au sujet de tant d’autres questions, renonçons à penser comme tout le monde. Ne craignons pas d’aller de l’avant. Notre morale sexuelle n’est pas celle de quantité d’individus pourris de préjugés. Si elle n’est pas conforme à la tradition, elle correspond à la réalité.
On en veut beaucoup à Freud d’avoir dévoilé que toute notre vie, intellectuelle et morale, prend sa source dans la sexualité. C’est une constatation que les moralistes ne lui pardonnent pas. Havelock Ellis est encore de ces sexologues dangereux, à ne pas lire. Ses révélations pourraient troubler l’âme innocente des petites oies blanches qui fréquentent les salons mondains.
Concluons, avec ce dernier, que :
« Toute personne qui soutient que l’impulsion sexuelle est mauvaise, ou même basse et vulgaire, est une absurdité et une anomalie dans l’univers. »
— GÉRARD DE LACAZE-DUTHIERS.
SILLON — SILLONISME
n. m.
En 1885, un journal, dont la vie fut extrêmement éphémère, se fondait, rue de Rennes, à Paris, sous le titre « Dieu et Patrie », dont les directeurs : Marc Sangnier et Paul Renaudin, devaient être plus tard les fondateurs du Sillon. Autour d’eux se formèrent des amitiés et, en 1894, alors que Marc Sangnier terminait, au Collège Stanislas, les études qui devaient le conduire à Polytechnique, la doctrine (?) du Sillon — le Sillonisme — était définitivement élaborée. Dans les quelques années qui suivirent, deux organes : la revue « Le Sillon » et le journal « L’Éveil Démocratique » étaient créés aux fins de diffusion des théories sillonistes dans le grand public.
Le programme du Sillon ? Le voici tel qu’il ressort des multiples déclarations, infiniment plus pompeuses que sincères, de ses chefs et théoriciens : émancipation politique, économique, intellectuelle du peuple, pour arriver à l’égalité qui est la vraie justice humaine. La démocratie étant l’organisation politique et sociale fondée sur l’égalité et la liberté des individus, en même temps que la participation de chacun au gouvernement de la chose publique dans le triple domaine moral, politique et économique, le Sillon entend réaliser, en faisant appel aux forces morales du Christianisme, l’éducation démocratique du peuple, c’est-à-dire porter à son maximum la conscience et la responsabilité civiques de chacun, d’où découleront la démocratie économique et politique et le règne de la justice, de la liberté, de l’égalité et de la fraternité ...
A la question qui était posée au silloniste Cousin, l’un des plus ardents apologistes de la Doctrine, auteur d’un livre où le mouvement silloniste est exposé en détail et avec éloge : « Vie et Doctrine du Sillon », à la question : « Dites-nous une bonne fois si le Catholicisme est pour vous une fin ou un moyen, car vous le rabaissez en prétendant vous en servir pour réaliser la démocratie », l’apologiste répondait :
« Il n’y a qu’une seule fin, c’est Dieu ; tout doit nous servir de moyen pour atteindre cette fin, et, parmi les moyens d’aller à Dieu, c’est-à-dire de réaliser sa volonté ici-bas, la religion est le premier de tous. La religion est donc pour nous le moyen de remplir les devoirs du culte divin, comme aussi de faire une démocratie conforme aux desseins de Dieu sur l’homme et la société. Elle est pour nous le moyen de remplir notre devoir social ; seule, elle peut nous le faire accomplir d’une façon qui nous mène vers Dieu comme tout ce que nous faisons doit nous y mener. »
Dieu, démocratie, deux termes absolument inconciliables dira un peu plus tard Pie X, lorsque, se voyant contraint de prononcer la condamnation du Sillon, mais fidèle, sur ce point, à l’opinion invariable et nullement ambiguë formulée plus particulièrement depuis la Révolution française par tous les pontifes de Rome, il rappelle les sillonistes « ses ouailles égarées » à l’observance des principes sacrés et immuables de l’Église catholique.
Dans sa lettre, en date du 25 août 1910, à l’Épiscopat français, Pie X déclare que le Sillon bâtit sa Cité sur une théorie contraire à la vérité catholique. Il dit :
« Le Sillon place l’autorité publique dans le peuple, de qui elle dérive ensuite aux gouvernants. Or Léon XIII a formellement condamné cette doctrine. Sans doute le Sillon fait descendre de Dieu le principe d’autorité qu’il place d’abord dans le peuple mais de telle sorte qu’elle remonte d’en bas pour aller en haut, tandis que, dans l’organisation de l’Église, le pouvoir descend d’en haut pour aller en bas. D’autre part, le Sillon se fait une fausse idée de la dignité humaine. D’après lui, l’homme ne serait vraiment digne de ce nom que du jour où il aura acquis une conscience éclairée, forte et indépendante, ne s’obéissant qu’à elle-même. Or, à moins de changer la nature humaine, ce grand jour ne viendra jamais ! Et les humbles de la terre qui ne peuvent monter si haut, quoique remplissant énergiquement leurs devoirs dans l’humilité, l’obéissance et la résignation chrétienne, ne seraient donc pas dignes du nom d’hommes ! »
Il nous a paru du plus haut intérêt d’opposer les déclamations des fondateurs du Sillon aux affirmations péremptoires du chef le plus autorisé du catholicisme. Car il y a surtout lieu de considérer que le Sillon était une organisation composée exclusivement de catholiques. Dans la secrète pensée de Marc Sangnier, de même que dans celle de ses collaborateurs et disciples, l’Église dont ils n’ignoraient certes pas l’histoire ni la politique constante suivie rigoureusement à travers les âges, l’Église qu’ils n’avaient sûrement pas l’intention de combattre mais dont ils entendaient, au contraire, servir les ambitions, l’Église, misant habilement sur les deux tableaux, ne pouvait pas ne pas favoriser la diversion et la manoeuvre tentée par ceux de ses fils qui, tout en restant fidèlement soumis à son autorité, estimaient pouvoir, en même temps, se parer du titre séduisant mais faux de démocrate, voire de socialiste !
Connaissant la crédulité, la naïveté d’un trop grand nombre de militants d’avant-garde, toujours enclins à se laisser piper par les déclamations d’insidieux bateleurs ; sachant aussi l’empressement que met le peuple à suivre ceux qui lui promettent l’impossible, nos Sillonistes jouaient le double jeu d’être tout à la fois les défenseurs d’une Église conservatrice et monarchiste et partisans de l’avènement d’une société égalitaire !
Oh ! ils n’en faisaient point ouvertement l’aveu ; mais, néanmoins, on se rendait suffisamment compte de leur dessein de situer leur Église sur le terrain social, dans l’unique but de lui faire conquérir, sur ce terrain, l’influence dominatrice dont elle avait si longtemps joui sur le terrain religieux.
La grande majorité des anarchistes et syndicalistes de l’époque finirent par saisir tout ce qu’il y avait de captieux et de contradictoire dans une aussi étrange attitude. Ce bloc enfariné ne nous dit rien qui vaille pensaient-ils.
Les Sillonistes, en effet, se flattaient de résoudre la question sociale à l’aide de la foi et de la morale catholiques. Or, durant cinq siècles au moins, en France, en Italie, en Espagne, le catholicisme tout-puissant n’avait rien tenté, rien fait dans ce sens. Il avait été, au contraire, le plus ferme soutien de tous les abus, de toutes les iniquités. S’il n’avait rien fait quand il pouvait tout, quelle serait son action maintenant qu’il avait perdu sa toute-puissance ?... Les Sillonistes prétendaient être en mesure, par la religion — et quelle religion ! — de fonder une société meilleure en amenant les individus à une vie morale plus haute et plus digne. Or cette prétention de la morale chrétienne se trouvait réduite à néant par dix-neuf siècles d’expérience. N’était-il point sage d’y renoncer et n’eût-il pas été insensé d’y persister ?
Au fait, qu’était-ce que cette parodie de démocratie dont l’instauration devenait subitement le rêve des réactionnaires catholiques constituant le Sillon ? Pour tous les rationalistes et libertaires, pour tous les êtres de bon sens et de jugement sain, la démocratie n’a véritablement de sens que si elle se propose avant tout l’émancipation économique, matérielle des hommes. La satisfaction des besoins physiques d’abord, le droit absolu à la vie. « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits », c’est-à-dire que, désormais, ce ne sera plus Dieu — ce Dieu qui est la consécration suprême de toutes les inégalités ! — qui dirigera les affaires des humains. L’idéal des grands révolutionnaires du XVIIIème siècle ne pouvait être que la Nation évoluant rationnellement sans maîtres célestes ou terrestres. C’est bien ainsi qu’ils conçurent la démocratie française. Or, si la tactique de l’Église changeait, s’efforçant de s’adapter aux circonstances du moment, ses dogmes, son but ne pouvaient varier.
« Anathème à qui dira que l’Église peut se réconcilier avec la civilisation moderne, avec la science moderne ! Et, surtout, anathème à quiconque osera dire que l’Église peut évoluer ! » ...
Oui, l’Église est immuable ! Tous les successeurs de saint Pierre, depuis Pie VI jusqu’au Pontife actuel, tous ont condamné sans appel la Société moderne, tous ont déclaré, en de multiples encycliques, qu’il ne saurait y avoir entente ou simplement rapprochement entre l’Église et une Société à tendances égalitaires.
L’hypocrisie, l’imposture des Sangnier et autres démocrates-chrétiens était donc flagrante ! On ne tarda point à s’en apercevoir. Si certains membres un peu naïfs de la Confédération Générale du Travail poussaient la candeur jusqu’à fraterniser avec Marc Sangnier dans les meetings, en revanche il suffisait de parcourir, de temps en temps, l’« Éveil démocratique », l’organe officiel du parti, pour savoir ce que pensait, des militants syndicalistes les plus en vue, le chef du Sillon. On s’aperçut du « truc » dont usait et abusait le révolutionnaire papelard. Perfidie et duplicité de langage, toute l’habileté du leader silloniste était là. Il s’agissait, on le conçoit, de brouiller les cartes, de se muer en chauve-souris :
« Je suis souris ; vivent les rats ! »
Effectivement, suivant les lieux et les auditoires ce champion de la « Grande Doctrine Sociale » — doctrine que, d’ailleurs, il se garda toujours — et pour cause — de définir exactement — variait son programme et ses déclarations. Pardi ! il le fallait bien puisqu’on s’était donné pour tâche de concilier les inconciliables ! Malheureusement, le « truc » finit par s’user et... le tricheur apparut tel qu’il était vraiment : un jésuite accompli ! ...
Désireux à tout prix de s’attirer la sympathie des auditoires ouvriers, il lui fallait évidemment faire des concessions, concessions parfois compromettantes et même dangereuses. Il lui arrivait de « parler rouge », de feindre la rupture avec certaines disciplines imposées par l’Église, de dénoncer avec quelque imprudence, comme étant incompatibles, les théories subversives qu’il déclarait professer et la politique inflexible d’une Église dont il ne cessait pourtant de s’affirmer le fils très respectueusement soumis ! Cette comédie ne pouvait s’éterniser.
Se rendant tout à coup compte que le prestidigitateur social sur lequel, sans aucun doute, elle avait tout d’abord fondé certaines espérances, était brûlé bel et bien et que le petit jeu, assez ingénieux, auquel il s’était jusqu’alors livré pourrait dorénavant devenir un danger pour elle, l’Église jugea de bonne politique de condamner une Doctrine qui avait certainement fait du bruit un peu partout, un peu de mal aussi dans les milieux avancés, mais qui, par contre, avait aidé à démontrer, une fois de plus, et de la façon la plus éclatante, toute la duplicité, tout le machiavélisme de l’Église et des catholiques prétendument « libéraux » ou « sociaux », en même temps qu’elle donnait la preuve la meilleure de leur radicale impuissance à résoudre, sur le plan humain, le grand problème social ! Est-il besoin d’ajouter qu’en bon et loyal fils, très humblement soumis, de l’Église catholique, le farouche démocrate Marc Sangnier, imité de tous ses disciples, s’inclina, avec empressement et une touchante sollicitude, devant la décision de son chef bien-aimé ? Le Sillon était mort ! ...
— A. BLICQ.
SIMONIE
Le mot ne date que du christianisme, mais la chose est plus ancienne. Dès qu’il y eut des religions, des hommes, soi-disant choisis par leurs dieux, s’en servirent pour exploiter les masses ignorantes et craintives. Tous les clergés, dans tous les temps, vécurent du commerce du divin. Dans l’ancienne Grèce, les orphéotélesques, parmi tant d’autres, vendaient le moyen de se soustraire aux peines infernales. Leur dieu, Orphée, n’était-il pas revenu des enfers ? Les prêtres persans firent du Zend Avesta un manuel de simonie pour justifier leur despotisme. De même, les Védas des Hindous et la Bible des Hébreux servirent surtout à faire des prêtres une caste privilégiée.
L’origine du mot simonie est dans le nom de Simon, dit le magicien, qui, d’après ce que racontent les Actes des Apôtres (VIII, 18–23) :
« Voyant que l’imposition des mains des apôtres conférait l’Esprit, leur offrit de l’argent en disant : « Donnez-moi ce pouvoir, à moi aussi, afin que ceux à qui j’imposerai les mains reçoivent l’Esprit saint. »
Mais Pierre lui répondit :
« Périsse ton argent avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s’achète ! »
Et il ajouta :
« Tu es tout rempli de venin, tu es esclave de l’iniquité. »
On a dit, en faisant un jeu de mots, que Pierre avait été la pierre sur laquelle l’Église avait été bâtie, et on en a fait le premier pape. Il serait plus exact de dire que cette pierre et ce premier pape furent Simon, car l’Église fut comme lui, et elle est toujours remplie de venin et esclave de l’iniquité depuis qu’elle tient elle-même boutique de ce don de Dieu qu’il avait vainement tenté d’acheter aux apôtres. Mais cette Église, qui devint pratiquement simoniaque pour assurer sa durée et sa puissance temporelle, ne pouvait, moralement, désavouer son apôtre fondateur, et c’est ainsi que, repoussant l’argent de la main qu’elle élevait vers l’Esprit, et le recevant de l’autre main abaissée vers la Matière, elle a défini la simonie et a tiré sur elle ses canons de la façon suivante.
La simonie est :
« La volonté déterminée, valunta studiosa, le désir, d’acheter ou de vendre des choses spirituelles, comme les sacrements, ou des choses tenant aux spirituelles, comme les bénéfices et les vases sacrés. »
La Grande Encyclopédie, qui reproduit cette définition, dit aussi :
« La plupart des anciens canonistes constate que dès que l’Église eut des revenus, la simonie s’y introduisit, d’abord par l’ordination, parce que, étant faite uniquement en vue d’un office déterminé, elle procurait alors les biens et les hommes qui furent attachés plus tard aux bénéfices ; ensuite par la collation des bénéfices. »
Le pape Grégoire Ier, dit le Grand, qui régna au VIème siècle et qui fut surtout un grand simoniaque, distingua trois formes principales de la simonie : celle munus a manu, remise ou promesse expresse ou tacite d’argent ou de tout autre objet faisant partie du domaine et du commerce des hommes ; celle munus ab obsequio, récompense ou attente d’un service ; celle munus a lingua, qui fait conférer un bénéfice non à cause du mérite du sujet, mais par la recommandation d’un tiers. Le crime de simonie est si grave aux yeux de l’Église, que tous ceux qui le commettent, quel que soit leur rang dans la hiérarchie ecclésiastique ou laïque, sont excommuniés ipso-facto, c’est-à-dire retranchés, chassés de l’Église par l’excommunication latae sententiae qui est portée d’avance, sans jugement ni sentence, et ils ne peuvent plus avoir de rapports avec les chrétiens quand ils ont été dénoncés. Personne ne doit alors prier pour eux, ils ne peuvent recevoir les sacrements ni être enterrés en terre bénite. Leurs élections ou provisions sont nulles ; ils perdent tous leurs titres et fonctions ; les bénéfices qu’ils en tiraient deviennent vacants et peuvent être accordés à d’autres.
Ces précisions ne sont pas inutiles pour bien montrer toute la gravité de la simonie, au point de vue de l’Église, et pour permettre à des mécréants comme nous de constater et de s’étonner que cette Église, après une condamnation aussi formelle et aussi farouche, se soit accommodée et s’accommode toujours de ce crime au point d’en avoir fait la base de sa constitution matérielle. Car on peut dire que sans la simonie l’Église n’aurait jamais existé comme puissance temporelle. Toute son activité sociale en est le produit. Comme disait Catherine de Sienne, elle a résumé les dix commandements en un seul : Da pecuniam, donne de l’argent !
L’Église est comme les gouvernements qui condamnent ce « crime », la guerre, et le mettent « hors la loi », mais qui ne se sont jamais occupés que de faire la guerre et de préparer, par les fourberies les plus odieuses, la prochaine « dernière » après la précédente. L’Église n’existe que par et pour la pratique de ce « crime » la simonie. Il n’est pas une grâce que ses ouailles puissent demander au ciel sans qu’elles aient à payer tribut. Jésus disait à ceux qui l’écoutaient de s’adresser directement à Dieu, en priant dans leur chambre. Les premiers chrétiens se réunissaient simplement chez l’un d’eux pour commenter la parole de Dieu et prier en commun. Mais comment se serait constitué le parasitisme de la grasse vermine des prébendiers du divin, des postulatori di santi, si ces pratiques évangéliques avaient continué ? La simonie fit leur fortune. Le chroniqueur Commynes gémissait sur les générosités de Louis XI pour l’Église, « prenant ainsi aux pauvres pour donner à ceux qui n’en avaient nul besoin ». Rabelais s’indignait en voyant combien Rome savait subtilement tirer l’or de France par la vertu des décrétales, et comment les « papimanes » savaient s’engraisser de la sottise universelle. P. L. Courier disait :
« Pagare ! pagare ! — Payez ! payez ! chantent les cloches. »
C’est ce que ne cessent pas de chanter les cloches de l’Ile Sonnante (Rome) et du monde entier.
L’Église, pour qui la simonie est un crime absolu et sans rémission, a su se tirer cyniquement de la contradiction où elle se mettait en la pratiquant. Il n’est pas un de ses conciles, pas un de ses papes, pas un de ses bedeaux qui ne l’ait condamnée ... chez les autres, chez celui qu’on ne frappera jamais, ou qui, si on le frappe parce qu’il faut de temps en temps un bouc émissaire, sera un pauvre diable sans importance et trop niais pour savoir s’élever à ces hauteurs où la simonie devient une vertu. C’est ainsi que l’Église a fait des saints de tant de personnages qui étaient, de par ses canons, excommuniés ipso facto.
Il n’y a pas plus lieu de s’étonner de l’attitude de l’Église quant à la simonie qu’à propos de ses autres turpitudes, et pas davantage de voir tant de pauvres d’esprit acheter aux mercantis du divin leurs prières, leurs miracles, leur eau bénite, leurs places dans le chemin de fer ou l’avion du paradis, leurs grigris, leurs fromages, leurs liqueurs, leurs orviétans contre les douleurs, la teigne, la colique, les chancres, les petits vers intestinaux, le pipi au lit et cent autres agréments dont Dieu, « qui aime tant les hommes », les a comblés pour leur prouver sa bonté infinie. Mais ce qui doit nous étonner, c’est que tant de gens qui ne sont pas des imbéciles ou des coquins, qui composent même une élite intellectuelle possédant personnellement une foi véritable et une conscience insoupçonnable, puissent toujours considérer l’Église comme une force spirituelle et une autorité morale inattaquables. Ce qui doit nous étonner, c’est que ces gens puissent se taire, ne pas crier de honte et de dégoût, et se faire ainsi les complices passifs de la corruption de cette Église appelée « infaillible », sans doute parce qu’elle a depuis longtemps consommé toutes les faillites.
Ils sont tout de même nombreux ceux qui ont crié leur honte et leur dégoût, depuis l’apôtre Barnabé dont une lettre, que l’Église tient bien inutilement pour apocryphe, dénonça prophétiquement, dès le Ier siècle, les turpitudes dont elle se souillerait. Sont-ils apocryphes aussi les écrits des premiers Pères, particulièrement de Jérôme, reprochant aux gens d’église leurs façons de s’enrichir par leurs manoeuvres auprès des riches veuves ou héritières dont ils recueillaient donations et héritages ? Jérôme appelait Rome « Babylone, courtisane empourprée », et son clergé « le Sénat des pharisiens ». Grégoire de Tours a écrit que le roi Chilpéric tenta de s’opposer à ces pratiques. Ce fut en vain. Elles se développèrent tellement que le clergé eut bientôt l’audace d’exiger des moribonds que la part de l’Église, appelée « part des pauvres », fût faite dans les testaments. Pour cela les testaments ne purent être écrits qu’en présence d’un prêtre, sous peine pour le mourant d’être traité comme coupable de suicide et d’être privé de la sépulture en terre bénite. On vit même s’établir une taxe fixe, un véritable impôt sur les successions que l’Église exigea avec l’approbation de plusieurs conciles. Non seulement les prêtres s’emparaient des biens des morts, mais ils jugeaient inutile de payer les dettes que ces morts avaient laissées !.... La question de ce qu’on a appelé « les testaments des âmes » serait grosse de discussions et de compétitions dans tous les siècles à venir, car le débat dure encore, le clergé n’ayant jamais cessé de circonvenir les esprits faibles que lui livre l’approche de la mort. Les tribunaux ont toujours à s’en occuper.
L’ambition, la cupidité et la paresse avaient vite rattaché aux biens de la terre les prétendus représentants d’un Dieu qui n’avait pas une pierre pour reposer sa tête, et dont l’organisation en une caste élue par ce Dieu était la première des simonies. Dès le IVème siècle, pour commencer, le concubinage des prêtres rapportait de gros revenus aux évêques qui le frappaient d’impôts. D’après Corneille Agrippa, un de ces évêques déclarait que 11.000 prêtres lui payaient chacun un écu d’or par an. De même, les religieuses étaient déliées du voeu de chasteté moyennant impôt payé au pape.
La simonie la plus criminelle, parce qu’il en sortit, pour tous les peuples, des atrocités sans nom, fut dans les collusions entre les papes et les princes. Elles commencèrent officiellement lorsque l’Église accepta de donner à l’empereur romain Constantin une absolution que les prêtres païens lui refusaient ; l’Église, de plus, fit un saint de cet indigne personnage. Depuis, les rapports simoniaques entre princes et papes furent d’un profit extraordinaire pour l’Église qui, de plus en plus comblée, ne chercha plus qu’à s’imposer comme première puissance temporelle au-dessus de tous les princes du monde.
Au Vème siècle, Clovis, premier roi de France, acheta l’amitié et l’appui d’Anastase par de riches présents. L’Église le soutint dans ses guerres et, malgré les crimes de sa femme, Clotilde, elle en fit une sainte.
Au VIème siècle, le fameux Grégoire Ier pratiqua toutes les simonies dont il avait donné les définitions. Ricarède, roi des Goths, qui maintenait des lois cruelles contre les Juifs, lui ayant envoyé des présents, il le remercia en l’approuvant par la déclaration suivante, combien chrétienne !.... « Quand la raison est maîtresse des actions d’un roi, elle sait faire passer pour justice la cruauté la plus implacable, pour louables les actions les plus coupables, et elle maintient les peuples dans l’asservissement » !... Le même Grégoire combla de louanges emphatiques, et des plus odieux encouragements à la crauté, la sanglante reine Brunehaut qui trouva toutes les complicités ecclésiastiques qu’elle désira grâce à ses largesses à l’Église. C’est encore ce Grégoire qui, pour se faire un allié contre l’Église d’Orient, félicita Phocas de son avènement au trône de Byzance dont il s’était emparé en faisant assassiner l’empereur Maurice et ses enfants. Ce pape, n’était-il pas bien digne d’être appelé « le Grand » et de faire un saint ? ...
Au VIIème siècle, Léon II légitima, contre argent, le crime d’Eviga qui avait assassiné son père Wamba, roi des Wisigoths, pour prendre sa place.
Au VIIIème siècle, Jean VI approuva, contre argent, l’usurpation du trône de France par Pépin le Bref. Le même siècle vit les rapports les plus cordialement simoniaques de Charlemagne et de la papauté. Il en résulta les guerres contre les Lombards, les Arabes d’Espagne et les Saxons, dont 30.000 furent massacrés pour leur apprendre les douceurs du christianisme.
De plus en plus l’Église absolvait de leurs crimes ceux qui payaient pour cela et, en 1027, le synode de Limoges protesta inutilement contre la cour de Rome qui vendait l’absolution à des excommuniés à l’insu des évêques. C’est ainsi que, grandissant de plus en plus comme puissance temporelle, par ses tractations infâmes avec les monarques, l’Église se vit bientôt assez forte pour leur tenir tête et chercher à prendre la première place. La question de la nomination aux offices ecclésiastiques et des investitures, qui soulevait des convoitises de plus en plus ardentes et des appétits de plus en plus féroces, fut la torche qui mit le feu aux poudres. Dans l’église même, ce furent les violences, les fraudes, les crimes les plus inouïs, commis pour les élections des papes. Entre l’Église et les princes ce furent, pendant des siècles, des rivalités et des guerres qui mirent l’Europe à feu et à sang. De ce qu’on a appelé la Querelle des investitures sortit la longue guerre entre la papauté et l’empire d’Allemagne. « Cette guerre, dans laquelle la papauté et ses champions, incitant la félonie des sujets et l’ingratitude des enfants, montrèrent, plus encore que les empereurs, un audacieux mépris de toutes les lois qui sont la sauvegarde des sociétés humaines, eut pour cause réelle la prétention de Grégoire VII et de ses successeurs de soumettre toutes les Églises et tous les États de l’Occident à la domination absolue du pape, tant au temporel qu’au spirituel » (E. H. Vollet : La Grande Encyclopédie.) Quand les princes ne donnaient pas bénévolement des territoires et des richesses à l’Église, celle-ci les leur réclamait insolemment en criant qu’elle avait été dépossédée. Les moines du Mont-Cassin, célèbres par leur vandalisme et leurs tripatouillages, fabriquaient à cet usage de faux actes pour s’attribuer des domaines et des villes. Ils sortirent entre-autres une lettre apocryphe du pape Vitalien pour légitimer leurs possessions de Sicile. Tous les crimes de l’histoire ont à leur base les collusions simoniaques de l’Église et des princes : massacres d’hérétiques, Croisades, Guerre des Albigeois, Guerres de religion, révocation de l’Édit de Nantes, Guerre d’Espagne en 1822, expédition de Rome en 1849, pour nous en tenir à la France.
C’est là l’histoire sanglante, le drame de la simonie de l’Église. Ils mettent en cause les grands protagonistes, ces papes que leur insolence mégalomane poussait à se considérer comme supérieurs aux princes et égaux à Dieu. A côté, il y a ce qu’on peut appeler l’histoire comique et grotesque, la farce, la pitrerie à laquelle participa toute la hiérarchie ecclésiastique, mais surtout la vermine moinillante et séminariste, les marmitons, les laveurs de vaisselle, les videurs de bouteilles des cuisines épiscopales, qui font les queues-rouges, les paillasses et dépouillent les populations abruties avec une invention et une verve impayables, pour le compte du grand Papegaut et de toute sa volière d’oiseaux sacrés. Car l’ingéniosité des fripons d’Église n’a d’égale que la sottise de leurs victimes.
Ce fut d’abord le culte des reliques, invention mirifique qui prit les aspects les plus ahurissants et, peut-être à cause de sa grossièreté répugnante, rapporta les profits les plus inimaginables aux charlatans sans vergogne qui l’exploitèrent. Ce fut une exploitation cynique, sans discrétion et sans pudeur, du respect des foules pour les morts et, particulièrement, de leur vénération pour ceux que l’Église présentait comme des saints. Le concile de Trente, recommandant ce respect et cette vénération, ajouta insidieusement à son texte que « Dieu même faisait aux hommes beaucoup de bien par le moyen des corps des saints », et que « ce ne serait pas en vain que les fidèles fréquenteraient les lieux consacrés à leur mémoire ». C’était inviter les fidèles à rechercher les faveurs célestes par le moyen des reliques, et à pratiquer leur culte en allant en pélerinage aux lieux où elles étaient déposées. De cette institution sont sorties des pratiques du fétichisme le plus déconcertant, et parfois le plus dégoûtant. Les truquages les plus éhontés ont multiplié dans le monde ces corps vénérés et leurs débris au point que, s’ils ressuscitaient, certains se retrouveraient avec des centaines de crânes, de bras, de jambes, de prépuces, tous de l’authenticité la plus indiscutable, certifiée par les plus graves et les plus éminentissimes docteurs, et qui arriveraient des quatre points cardinaux où ils achalandent les boutiques simoniaques. Et l’on prétend que l’Église ne fait pas de miracles !... Si elle n’a jamais été capable de faire celui de la multiplication des pains et des poissons pour donner à manger à tous ceux qui ont faim, elle multiplie tous les jours les corpi santi et leurs attributs pour satisfaire son insatiable simonie.
Il y a plusieurs catégories de reliques. Comme dans tous les commerces bien organisés, il en faut pour toutes les bourses. Il y a les reliques insignes qui comportent le corps ou un membre entier du saint. Les notables sont une partie moindre du corps. Les minimes ne sont que de petits fragments qui peuvent être contenus dans des reliquaires, des médaillons, des agnus-dei, que les personnes favorisées de leur propriété peuvent porter sur elles comme les nègres portent leurs gris-gris. Les reliques sont aussi des objets ayant appartenu à de saints personnages. On a ainsi, à côté de débris macabres, tout un bric à brac aussi hétéroclite qu’imprévu. Les premiers fournissent, indépendamment des ossements, des prépuces, des cordons ombilicaux, du sang, des larmes, du poil, des rognures d’ongles ! On a toutes ces choses de Jésus Christ en même temps que sa braguette d’enfant, de la paille de la crèche, sa robe, ses chaussures et tous les attributs de la Passion : morceaux de la croix (la vraie, bien entendu), épines de la couronne, lance, marteau, clous, inscription de la croix, et jusqu’à l’éponge qui demeure éternellement trempée de vinaigre et de fiel ! De la Vierge on ne possède pas moins d’objets multipliés et l’on a jusqu’à des gouttes de son lait et de ses menstrues !... De Marie Madeleine, ce sont des objets semblables et de ses parfums pas du tout éventés !... On a aussi les reliques les plus bizarres de plusieurs milliers de saints, et elles remontent même au temps du déluge car on possède des poils de la barbe de Noé ! .. Des prêtres français, jaloux de la concurrence italienne, trouvèrent le moyen de mettre en flacon un éternuement de Jésus, de la sueur de saint Michel et, en boîtes, du souffle de Jésus et les cornes invisibles de Moïse ! ... C’est de plus fort en plus fort, « unique, vraiment unique ! » comme disent eux-mêmes les charlatans sacrés dans leurs prospectus. Au XIXème siècle, on vit se répandre des lettres autographes, écrites en français par Jésus, et sa photographie authentique !... Attendons-nous à entendre prochainement sa voix non moins authentique sortant d’un disque de gramophone et disant :
« Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font ! »
Citons encore les trois têtes de Jean-Baptiste dont l’authenticité ne fait aucun doute pour les vrais fidèles, et qui nous font penser à l’histoire comique des Trois Bossus d’Arras. La légende n’a pas encore dit que Salomé avait eu trois têtes du Baptiste à faire couper... Il y aurait, à Cologne, les reliques non moins certaines des rois Mages. Mais la plus productive pour les charlatans sacrés est certainement la Casa Santa (la maison de la Vierge) que des anges auraient transportée de Palestine en Italie, en 1291. Objet de convoitise et de brigandage en raison de l’argent qu’elle rapportait par les pélerinages, elle changea plusieurs fois de propriétaire et de lieu. L’infaillibilité papale affirme que, depuis le XVème siècle, elle est sur son emplacement actuel, à Loreto, enfermée dans un somptueux recouvrement de marbre. Paul III constitua pour sa garde, et celle des trésors qu’elle rapportait au pape, la chevalerie de Notre Dame de Lorette qui fut supprimée au XVIIIème siècle. Des centaines de mille pélerins affluent toujours chaque année à Loreto qui est le centre de fabrication le plus important de la bondieuserie catholique.
Toutes ces choses se vendaient très cher aux princes et aux riches particuliers qui en faisaient l’acquisition pour les églises de leur pays, et elles faisaient se déverser un véritable pactole dans les caisses simoniaques. Un vaste commerce de reliques s’organisa. Les papes Eugène, Sergius, Jean VI, firent transporter d’Italie des ossements qu’ils vendirent en France et en Angleterre. Ce trafic prit tout son développement avec Pascal Ier qui avait des reliques pour toutes les bourses, et l’hagiographie s’enrichit de milliers de saints locaux dont le populaire put acheter les reliques pour quelques sous. Les cheveux et les poils de Jean Baptiste, de la Vierge, de Joseph qui se vendirent alors auraient fait une crinière à toute la chaîne des Alpes. L’exemple de ce fétichisme venait de haut. Tous les rois le favorisaient. Après Louis IX qui acheta la couronne d’épines pour laquelle il fit construire la Sainte Chapelle, son frère le duc d’Anjou se rendit acquéreur du prépuce de Jésus que les foules vinrent adorer. Un morceau de la Croix fut vendu au roi d’Angleterre, Alfred le Grand, par le pape Martin II. Depuis, cette industrie de charognards n’a pas cessé malgré les protestations de nombreux personnages autorisés, tels Guibert de Nogent au XIIIème siècle, Mariana et Mabillon au XVIIIème, de Buck au XIXème. Peut-on s’étonner de cette persistance quand on voit tant d’imbéciles attendre leur fortune d’un morceau de corde de pendu !... Que ne doit-on pas espérer d’un osselet de saint Labre ou de sa crasse mise en pilules ? ... Ce ne fut que vers 1860 que le vicariat de Rome cessa de vendre des corpi santi provenant des catacombes ; mais après 1870, le trafic recommença. Depuis que Thérèse de Lisieux, la nouvelle idole, a été érigée à la sainteté, on a commencé à débiter sa dépouille. Le pape Pie XI y préside en personne. Il a fait cadeau à l’ex-roi d’Espagne, Alphonse XIII, sans doute pour l’aider à recouvrer son royaume, d’une touffe de cheveux, d’un fragment d’os et d’un morceau de la robe de cette sainte. Le pape a aussi envoyé au Mexique un « fragment du corps » de Thérèse, on n’a pas dit lequel, pour être l’objet de pélerinages perpétuels. On vient de canoniser Bernadette de Lourdes. Attendons-nous au débitage prochain de ses hauts et bas morceaux.
Au commerce des reliques se rattache celui non moins simoniaque des images, eaux miraculeuses, chapelets, scapulaires, médailles, plâtreries et ferblanteries de toutes sortes, tous objets bénis, dont le bazar est installé autour des églises et sur les lieux de pélerinage. Les plus spéciaux de ces objets sont les agnus-dei, « sortes de fétiches faits en principe avec de la cire bénite du cierge pascal mélangée au saint-chrême et consacrés par le pape ». L’agnus-dei fut de tout temps un objet de la boutique particulière des papes ; il est fabriqué par les Cisterciens de Sainte-Croix de Jérusalem. Ces conditions supérieures de fabrication et de vente lui confèrent des vertus aussi nombreuses que spéciales. C’est le « porte-bonheur » type contre les démons, la tentation, l’enfer, la mort subite, les terreurs. Il protège contre l’adversité, le malheur. Il donne la victoire et la prospérité. Il est un préservatif contre le poison, l’épilepsie, la peste et autres maladies contagieuses — les rois de France qui pincèrent la vérole ignorèrent sans doute ses vertus -. Il apaise les tempêtes, sauve des naufrages, éteint les incendies, arrête les inondations et, enfin, mène à bon terme les grossesses en calmant les douleurs de l’enfantement. On a tout cela pour vingt cinq francs. C’est plus cher que de la corde de pendu, il n’est pas sûr que ce soit plus efficace.
Mais le vaste commerce des reliques et des gris-gris n’est rien auprès de celui des indulgences, simonie majeure dans laquelle le représentant de Dieu, se substituant à lui, tient boutique de sa volonté, de sa justice, et nous allons voir pour quels usages !
L’indulgence est la « rémission totale ou partielle de la peine temporelle due aux péchés pardonnés, que l’Église accorde en vertu des mérites surabondants de Jésus et des saints ». Il faut que ces mérites soient réellement surabondants pour qu’il en reste encore après avoir servi à couvrir tant d’infamie simoniaque. Qu’on en juge.
Dès le VIème siècle, le pape Vigile recommandait à l’évêque Césaire, d’Arles, d’accorder l’indulgence au pénitent « selon sa componction et la somme qu’il paiera à l’Eglise » !
Raymond VIII acheta au pape Grégoire IX la rémission de ses péchés moyennant 13.000 marcs d’argent payés au légat et à des abbayes.
Clément V vendit des indulgences aux croisés contre le droit de délivrer des âmes du Purgatoire. Il ne s’agissait plus seulement de peines temporelles ; on disposait de celles de l’au-delà et on empiétait effrontément sur le domaine réservé à Dieu.
Jean XXII amassa 25 millions de florins produits par la vente des indulgences et le vol des bénéfices d’église. Il envoya au bûcher de prétendus hérétiques pour s’emparer de leurs biens, et il vendit publiquement l’absolution du parricide, du meurtre, du vol, de l’inceste, de l’adultère, de la sodomie, de la bestialité. Il établit lui-même la taxe de la chancellerie apostolique qui encaissa le prix de ces absolutions. Moyennant 17 livres 15 sous, on pouvait tuer son père, sa mère, son frère, sa soeur, sans perdre ses droits au paradis. Naturellement, il en coûtait plus cher — 131 livres, 14 sous et 6 deniers — pour tuer un évêque ou un prélat supérieur. Ces messieurs savaient apprécier leur « guenille » terrestre qu’ils prétendent tant mépriser ; ils n’étaient pas pressés de la laisser disperser en reliques. Pour 131 livres 15 sous, on pouvait manquer à son serment, être garanti de toute poursuite et de toute infamie ... et même faire un saint ! La merveille, dans tout cela, n’était pas de payer l’absolution du crime, mais de pouvoir acheter le droit d’être criminel !
La « taxe des crimes » fut confirmée au XVIème siècle par Léon X qui la fit publier dans toute l’Europe. Des commissaires pontificaux présidèrent à l’administration simoniaque. Les bandits pouvaient s’entendre avec eux pour jouir en paix des fruits de leurs rapines. Olivier Maillard disait alors de ces commissaires pontificaux : « Ces hâbleurs, ces courtiers d’absolutions, de reliques et de rogations ; ces cafards, qui exploitent les visages des saints et les images de l’Agneau ; ces fripons qui flattent les dupes pour voler les bourses et qui dépouillent les simples jusqu’à la chemise, je les ai entendus se vanter d’avoir tiré des plus mauvais bourgs jusqu’à mille écus pour les indulgences, sans compter cent écus de pot-de-vin qu’ils avaient payés au curé. » Frère Thomas, autre prédicateur, ajoutait :
« Regardez ces voleurs envoyés par le pape, voyez comme ils pipent le pauvre peuple ; ils vont par monts et par vaux dépouillant les simples de leur dernière obole, et afin de les écorcher à leur aise, ils pactisent avec les prêtres ... Et ces prêtres infâmes, ces curés concubinaires, ivrognes et mercenaires, pour mieux remplir leur ventre et pour nourrir leurs ribaudes, s’entendent avec ces porteurs de bulles, extorquent, pillent et volent les idiots qui ouvrent leurs bourses pour les âmes du purgatoire. »
Ces bandits avaient d’ailleurs la haute protection de l’Inquisition. Au moyen des bulles papales, ils pouvaient se permettre de piller même les biens d’Église, ceux du pape exceptés ! Une de ces bulles, celle de la composition, permettait de garder le bien d’autrui, moyennant le paiement d’un pourcentage aux moines. Un des moines qui prêchaient cette bulle, le père Labat, disait à ses auditeurs :
« N’est-il pas bien gracieux d’en être quitte à un prix si raisonnable, sauf à en voler davantage quand on aura besoin d’une plus grosse somme !..... »
Le 4 septembre 1691, le Conseil du roi de France fixait le tarif qu’on paierait dans le royaume, à la cour de Rome, pour les bulles, dispenses, absolutions, etc. Sous Benoit XIV, en 1744, parut à Rome une nouvelle édition des « taxes de la chancellerie romaine » pour l’absolution des crimes et délits divers. Le premier article faisait observer que :
« Ces sortes de grâces et de dispenses ne s’accordaient point aux pauvres qui, ne pouvant payer, ne pouvaient y participer !.... »
L’intention simoniaque ne pouvait être plus cyniquement affirmée ; il n’y avait pas de faveurs divines pour ceux qui n’étaient pas en état de les payer.
Alexandre VII fut, au XVIIème siècle, le plus complet des simoniaques, ce qui n’empêcha pas, au contraire, le jésuite Oliva de prêcher que toutes ses actions étaient saintes et méritoires et n’empêche pas le Nouveau Larousse de nous dire qu’il fut un pape vertueux ! Alexandre aimait le faste. Oliva disait que s’il se résignait à être riche, c’était pour que l’Église eût :
« Deux mamelles rebondies pour que les princes et les évêques pussent téter un lait abondant !.... »
Une image satirique représenta Alexandre VII avec ses maîtresses, ses mignons, ses cardinaux, aux pieds d’un Christ qui, au lieu de sang laissait échapper de son sein des pièces d’or et d’argent que le pape recevait dans sa tiare en disant :
« Il a été crucifié seulement pour nous !..... »
On doit à Boniface VIII l’idée géniale des jubilés, pour exciter davantage le zèle des fidèles et donner encore plus d’ampleur aux opérations simoniaques. Le premier eut lieu en 1300. A cette occasion, indulgence plénière fut accordée à tous ceux qui visitèrent à Rome les églises saint Pierre et saint Paul au cours de l’année. De toute la chrétienté accoururent les fidèles ; ce fut une affluence et une recette comme jamais l’Église n’en avait encore vues. Aussi, le jubilé qui ne devait se faire que tous les cent ans, fut-il renouvelé dès 1349 par Clément VI. Ce pape, qui siégeait à Avignon, vendit aussi l’indulgence plénière à ceux qui ne purent pas se rendre à Rome. 600.000 pélerins allèrent dans cette ville. Le légat du pape ramena à Avignon cinquante charriots chargés d’or et d’argent. Boniface IX fit alors un troisième jubilé, dès 1389, puis Paul II décida qu’il y en aurait quatre par siècle. Ensuite, on en fit à toutes les occasions favorables. L’Église ne pouvait manquer d’exploiter le plus possible ce moyen de traire la vache à lait cagote et de manoeuvrer la pompe à « phynance ». Les jubilés devinrent les grandes foires pontificales, les expositions universelles du catholicisme.
Les indulgences accordées aux jubilés sont particulièrement larges puisqu’elles font remise de « toutes sortes de péchés, même les plus énormes, réservés ou non réservés ». Il s’agit d’y mettre le prix. Les charlatans du divin ne sont plus des intercesseurs comme les saints, la Vierge et Jésus lui-même ; ils sont plus qu’eux, ils sont Dieu et ils escamotent son jugement dernier puisqu’ils disposent du paradis ! Sous les formes plus académiques, plus onctueuses des Jésuites qui apprenaient les belles manières aux « honnêtes gens » et faisaient dire à Helvétius : « Le clergé est une compagnie qui a le privilège exclusif de voler par séduction », c’était le même puffisme que traduisait le langage rude et grossier du moine Jean Tetzel disant, au XVIème siècle, aux rustres paysans :
« Oui mes frères, Sa Sainteté m’a conféré un pouvoir si grand que les portes du ciel s’ouvriraient à ma voix, même devant un pécheur qui aurait violé la sainte Vierge et l’aurait rendue mère !..... »
Les théologiens, et en particulier Thomas d’Aquin et Alexandre de Hales, ont dénié aux indulgences le pouvoir de remettre les péchés. Les papes, prétendus « infaillibles », n’osèrent pas les traiter en hérétiques, mais ils passèrent outre, secondés par la cupidité du clergé et la stupidité des fidèles. Il n’y eut de véritable conflit entre théologiens et papes que lorsque Luther osa tenir tête à Léon X. Il en sortit la Réforme.
Les annates semblent avoir été la première forme du négoce des emplois de l’Église. Elles consistaient en une redevance que payaient à leur nomination ceux qui étaient pourvus d’un bénéfice. Elles rapportaient de gros revenus à la papauté. Boniface IX fut particulièrement expert à les faire produire. Il alla jusqu’à les tripler, favorisant ainsi, dans l’obtention des bénéfices, des aventuriers qui s’étaient enrichis sans scrupules, aux dépens des clercs pauvres et scrupuleux. Il alla même jusqu’à supprimer le noviciat d’épreuve pour pouvoir nommer évêques et abbés des gens qu’il allait chercher dans les cabarets et les lupanars. Les annates, plusieurs fois supprimées par les rois sur les plaintes du clergé, furent toujours rétablies sur l’intervention des papes. Elles demeurèrent en France jusqu’à la Révolution. L’Assemblée Constituante les abolit les 2 et 4 novembre 1789.
Au IXème siècle, le pape Sergius II, surnommé Groin de cochon, inaugura la vente publique des sacrements et des charges de l’Église, bénéfices, évêchés, abbayes, monastères. Baronius, malgré tout son zèle ecclésiastique, a écrit ce tableau de la cour de Rome au IXème siècle :
« Des monstres s’installèrent sur le trône du Christ, par la simonie et par le meurtre. L’Église romaine était transformée en courtisane éhontée, couverte de soie et de pierreries, qui se prostituait publiquement pour de l’or. Le palais de Latran était devenu une ignoble taverne où les ecclésiastiques de toutes les nations allaient disputer aux filles d’amour le prix de la débauche. Jamais les prêtres, et surtout les papes, ne commirent tant d’adultères, de viols, d’incestes, de vols et de meurtres ; jamais l’ignorance du clergé ne fut aussi grande que pendant cette déplorable époque. »
Par la suite, si le clergé ne fut plus ignorant et compta de véritables savants durant la Renaissance qui le décroûta de la crasse médiévale, il n’eut pas de plus belles moeurs. Le crime et la débauche, moins grossièrement perpétrés, prirent des formes artistes. Elles n’en furent pas moins accablantes pour ceux qui étaient réduits à téter les mamelles plates et arides de la misère, pendant que les gens d’église se « résignaient » à boire à celles rebondies de la fortune. Innocent VIII mit toutes les charges de l’Église à l’encan. Alexandre VI, le fameux Borgia, les reprenait après les avoir vendues pour les vendre une seconde fois. Il tirait le plus d’argent possible des promotions des cardinaux puis, il faisait disparaître ceux-ci pour hériter de leurs biens !.....
En 1049, un concile s’était réuni à Rome pour annuler les ordinations simoniaques. Elles étaient si nombreuses qu’on dut y renoncer pour ne pas empêcher l’exercice religieux dans les églises. De même, Nicolas II dut absoudre les simoniaques ; il y en avait tant que « presque toutes les églises seraient restées sans prêtres » !
Guifroy de Cerdagne acheta l’évêché de Narbonne et le siège d’Urgel pour son frère Guillaume. Il paya le siège d’Urgel en vendant aux Juifs les objets du culte. Le pape Étienne X acheta l’abbaye du Mont Cassin et la revendit. Un concile de Reims excommunia Henri IV d’Allemagne parce qu’il voulait enlever au pape le droit de vendre des évêchés et des abbayes. Clément V, au XIVème siècle, acquit des biens immenses par le trafic des dignités ecclésiastiques. Il s’entendit avec Philippe le Bel pour faire le procès des Templiers et s’emparer de leurs biens. Paul II ne fut élu qu’après avoir prêté serment aux cardinaux de continuer l’exploitation des décimes et d’en partager le montant avec eux. Sixte IV et Innocent VIII pratiquèrent largement toutes les formes de la simonie pour enrichir leurs bâtards. Innocent VIII en avait seize quand il devint pape. Clément VI vendit 100.000 florins d’or l’investiture de Bologne à Jean Visconti. Louis XIV paya à la papauté la canonisation de François de Sales. Léopold II d’Autriche envoya des sommes considérables à titre d’honoraires pour des dispenses.
On emplirait des volumes de l’énumération de toutes les simonies dont les représentants de l’Église l’ont souillée dans tous les siècles. On en emplirait aussi avec toutes les protestations, les satires, les pamphlets qui ont dénoncé et flétri de tout temps les hontes de l’Église, particulièrement sa simonie. Les conciles eux-mêmes s’en mêlèrent ; aussi, après celui de Trente qu’au XVIème siècle la papauté eut l’habileté de faire durer dix-huit ans pour qu’il n’aboutît à rien, cette papauté les supprima comme les rois supprimèrent les États Généraux.
Guyot de Provins, au XIIème siècle, attaqua violemment les simoniaques. L’abbé Guibert de Nogent dénonça les truquages littéraires des Vies des Saints et autres romans pieux composés pour encourager le culte des reliques et favoriser la simonie qu’il entretenait. Le troubadour Peire Cardinal écrivit une satire véhémente et indignée contre les clercs qui organisèrent la Croisade des Albigeois. Il disait :
« Ils se vêtent en bergers, mais ce sont des loups qui tuent et dévorent les brebis ... Ni milan, ni vautour ne sentent de plus loin la chair pourrie qu’eux ne sentent la richesse. Aussi, sont-ils plus volontiers au chevet des riches moribonds que dans la cabane des pauvres. »
Jean de Meung, auteur du Roman de la Rose, avait une haine particulière des deux ordres mendiants, dominicains et franciscains, qui s’attribuaient les richesses de ceux qu’ils faisaient tester en leur faveur. Il disait :
« Leur doctrine est la plus haute de toutes les doctrines, car ils ont su transformer en voeu d’opulence leur voeu de pauvreté. »
Ce poète dénonça longuement l’hypocrite cupidité des gens d’église, leur fainéantise et leurs vices sous les traits allégoriques de Faux Semblant :
Sans jamais des mains travailler ...
De l’Antechrist valet parjure,
C’est de moi que dit l’Écriture :
Il a l’habit de sainteté
Mais ne vit que d’iniquité. »
Rutebeuf fit aussi ce dernier reproche aux prêtres qui « faisaient Dieu de leur panse » pendant que le pauvre mourait de faim. Ulrich de Hutten composa tout un volume d’épigrammes contre Rome, la ville « où l’on fait commerce de Dieu, où Simon le magicien donne la chasse à l’apôtre Pierre, où les Caton, les Curius, ont pour successeurs des Romaines ; je ne dis pas des Romains. » Calvin lança un pamphlet contre les reliques et ceux qui en vivent :
« Porteurs de rogatons qui exercent foire vilaine et déshonnête. »
Luther et une foule d’autres ne furent pas moins ardents dans leurs protestations. La Réforme fut celle des consciences contre la simonie de Rome plus que la conséquence de désaccords dogmatiques. Le trafic des indulgences fut la grande affaire des élections impériales au XVIème siècle. Les Fugger, banquiers de Charles Quint et du pape Léon X, furent les intermédiaires de ce dernier pour leur vente en Allemagne.
La satire populaire ne fut pas moins vive que celle des écrivains. Le conte du curé Amis, exhibant le crâne de Saint Brandan et quêtant pour construire une église à ce saint, est particulièrement amusant. Le malin curé, pour mieux exciter la générosité de ceux qui l’écoutaient, disait qu’il refusait l’argent de tous ceux ayant péché en secret contre les lois de la sainteté et de la vertu ! Tous les imbéciles lui apportaient leur tribu, ne voulant pas avoir péché.
Une histoire non moins amusante est celle du curé de Gonfaron, dans le Var. Il vendait des places pour le paradis. Pour cinq cents francs on avait un fauteuil, pour cent francs une stalle, pour vingt francs un strapontin. A chaque place vendue, il faisait s’envoler un âne qui allait au ciel retenir la place du client. C’est ainsi qu’au pays de Gonfaron on fait voler les ânes !....
Flaubert a décrit le saint Sépulcre :
« Agglomération de toutes les malédictions possibles. Dans un si petit espace il y a une église arménienne, une grecque, une latine, une copte. Tout cela s’injuriant, se maudissant du fond de l’âme et empiétant sur le voisin à propos de chandeliers, de tapis et de tableaux !... On a fait tout ce qu’on a pu pour rendre les saints lieux ridicules. C’est putain en diable : l’hypocrisie, la cupidité, la falsification et l’impudence, oui, mais de sainteté aucune trace. J’en veux à ces drôles de n’avoir pas été émus ... »
Louis Bouilhet, comme Victor Hugo dans les Châtiments, a montré l’indignité des marchands du temple :
Qui vont tirant au sort et lambeau par lambeau
Se partagent, Seigneur, ta robe et ton manteau ;
Charlatans du saint lieu, qui vendent, ô merveille,
Ton coeur en amulette et ton sang en bouteille !
Relevons parmi les formes innombrables de la simonie que l’ingéniosité ecclésiastique ne cesse pas d’inventer et qui sont de véritables escroqueries protégées par la loi et les tribunaux, les obligations hypothécaires émises par l’École apostolique de Bethléem qui sont « payables ici-bas au comptant et remboursables au ciel, à la caisse de Saint Antoine » !... Pour permettre aux clients d’aller se faire rembourser, d’autres filous pieux leur vendent des billets de chemin de fer pour le paradis. L’aviation leur permettra bientôt d’arriver plus vite aux guichets de saint Antoine. Le développement de l’automobile a produit d’autre part une magnifique floraison de saints protecteurs contre les accidents. Saint Christophe en est le plus bel ornement. Avec lui, il n’est plus nécessaire de s’assurer et sa médaille fait « boire l’obstacle » plus sûrement que les meilleurs pneumatiques.
Enfin, avant d’en terminer avec les formes de la simonie, n’oublions pas le commerce des messes qui se fait sur une échelle inimaginable. Les messes sont les rogatons dont se nourrit le prolétariat ecclésiastique qui n’a pas le privilège, comme les princes et les évêques, de téter les « mamelles rebondies » de l’Église. Aussi, la concurrence est-elle acharnée. Chamfort a raconté l’histoire d’un abbé Raynal, jeune et pauvre, qui accepta de dire une messe tous les jours pour vingt sous. Devenu riche, il la céda à l’abbé de la Porte pour douze sous, en en gardant huit pour lui. L’abbé de la Porte la passa ensuite à quatre sous à un abbé Dénouart. C’est ainsi qu’une messe de vingt sous put nourrir trois parasites. Toutes les Croix, tous les Pèlerins, toutes les Semaines religieuses contiennent les annonces les plus alléchantes. On ne sait jusqu’où ira l’avilissement du prix des messes lorsqu’on lit ce boniment du Bulletin Salésien :
« UNIQUE ! VRAIMENT UNIQUE ! Six messes célébrées chaque jour à la Basilique du Sacré-Coeur à Rome. Six messes quotidiennes assurées à tous ceux qui, moyennant une humble obole, UN FRANC par tête, s’aggrègeront à l’Oeuvre Pie du Sacré-Coeur, destinée à la diffusion de la Foi en pays infidèles et à l’éducation de la jeunesse pauvre. »
Dieu doit être médiocrement flatté de se voir sacrifié six fois par jour pour un franc-quat’sous ! ... Les messes sont ainsi une sorte de prime que les boutiques de « bonnes oeuvres » offrent pour entraîner la clientèle hésitante. Celle des cordicoles de Brugelette, qui s’occupe de l’adoption des « pauvres noirs », inonde le monde de ses prospectus offrant des messes à perpétuité pour ses bienfaiteurs, ses zélateurs et « leurs chers défunts ».
Il est inimaginable qu’à notre époque où l’observation et les progrès scientifiques ont apporté tant de lumières dans les connaissances humaines, la superstition religieuse puisse entretenir encore tant de turpitudes. Certes, il ne faut pas s’exagérer l’étendue de cette superstition, mais elle permet d’autant mieux à l’Église de se maintenir dans sa puissance que d’autre part le calcul et la lâcheté de ceux qui savent mais se taisent, par intérêt ou par peur, lui assurent la plus redoutable impunité. Ne voit-on pas les prétendues démocraties favoriser par tous les moyens les entreprises cléricales contre la laïcité, et les politiciens « mangeurs de curé » ne sont-ils pas aussi fourbes et menteurs que les autres quand ils vont à la messe ? L’Église demeure ainsi un des rouages de l’oppression, répandant son venin et faisant des esclaves de l’iniquité ; elle ne représente plus depuis longtemps aucune spiritualité et aucune moralité. Mais tout se tient dans le système d’exploitation de l’homme par l’homme : clergé, armée, magistrature, police, patronat, s’épaulent mutuellement pour soutenir la bâtisse d’infamie sociale. Les hommes doivent la mettre à bas s’ils veulent devenir libres et heureux. En attendant, dans l’état de crise qui menace le Catoplébas capitaliste enfoncé dans son ordure, seuls prospèrent ses deux plus maléfiques soutiens : la religion et la guerre. Les boutiques simoniaques sont aussi brillamment achalandées que celles des marchands de canons ; le doux coeur de Jésus préside à la fabricatîon des bombes et des gaz asphyxiants de la prochaine « dernière », et ses évêques sonnent le ralliement patriotique au nom de l’Église universelle comme les politiciens au nom du socialisme international !.....
La peste simoniaque se multiplie dans un monde de plus en plus composé d’illettrés, de mégalomanes, de brutes et de cagots. Les foules se ruent sur les lieux des miracles et il n’y en a pas assez. Après La Salette et Lourdes, on a vu Lisieux. Aujourd’hui c’est Beauraing. Les porte-crosses mis en rut par les perspectives simoniaques défendent chacun sa boutique avec la fureur la plus véhémente, s’accusant et s’injuriant entre-eux. Les procédés publicitaires les plus ingénieux et les plus grossiers mêlent la charlatanerie sacrée aux plus douteux négoces. Le pape lui-même « tourne » au cinéma comme un vulgaire cabotin. Ce n’est que contre les idées sociales, les idées de progrès et de libération humains que l’Église est antimoderniste. Elle devance toutes les initiatives quand il s’agit d’abrutir l’humanité.
C’est aux travailleurs, à tous ceux qui conservent un esprit sain — et non saint — à balayer cette peste. Elle sera vite emportée le jour où ils diront à tous les simoniaques ce que ceux-ci leur disent ironiquement au nom de leur Dieu :
« Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front !.... »
— Edouard ROTHEN.
SINCERE
adj. (du latin sincerus, qui se disait au propre, du miel « sans cire »)
Qui s’exprime sans intention de déguiser sa pensée :
« Tous les hommes naissent SINCÈRES et meurent trompeurs. » (Vauvenargue)
Qui est éprouvé, dit ou fait d’une manière franche.
La définition du mot sincère est bien celle que donne Vauvenargue. C’est en naissant que les hommes sont sincères. L’enfant est sincère autant que son éducation lui permet de le rester car, dans la vie, de son début à sa fin, l’homme est victime de ce qui l’entoure. Et tout y est fausseté, tromperie, mensonge. Dès sa naissance, la mère, par ignorance, par amour, ne sait que mentir à son petit. A la maladroite éducation de la famille succède celle de l’école ; c’est alors l’enseignement néfaste, l’éducation novice qui forment l’intelligence, le caractère de l’enfant et c’est vraiment miracle qu’il y ait quand même des êtres sincères parmi les hommes après une telle éducation. La famille, l’instituteur, le prêtre, à l’unisson, chantent faux aux oreilles de l’enfant qui, par lui-même, se rend compte qu’il n’y a rien de sincère autour de lui. Alors, selon le caractère, selon le tempérament que lui ont donné les auteurs de ses jours, il deviendra fourbe ou sincère comme eux.
Puis, pour arracher à l’adolescent tout ce que la nature a pu quand même lui incruster de sincérité, c’est la caserne qui parachèvera l’oeuvre infâme pour faire de cet enfant, de ce jeune homme un soldat ... Un soldat ! ... La sincérité, alors, n’a plus de moyen d’existence ; car pour rester un homme, il ne faut pas être un soldat. Aussi, ce qui se passe est affreux, car la sincérité serait la désobéissance, l’insoumission dont la conséquence serait l’emprisonnement, la souffrance, le martyre, la mort !
Et pourtant, malgré tout, il y a des hommes sincères ! N’est-ce pas une raison de ne jamais désespérer de l’humanité ? Et n’est-ce pas la preuve que nous aurions tort de nous décourager dans notre propagande toute de sincérité, de fraternité, de raison envers nos semblables, pour leur bonheur et pour le nôtre, pour le bien-être et pour la liberté de tous par l’entente sincère et la solidarité cordiale et franche entre nous tous.
Mais la sincérité n’est pas forcément la brutalité dans l’expression de nos meilleurs sentiments, en opposition aux mauvais sentiments des autres. Il y a, aussi, dans la sincérité la manière fraternelle de la faire comprendre à nos compagnons de misère. Elle s’allie là au sentiment de solidarité. Il est beau d’être sincère avec soi-même et avec les autres, mais il est bon de l’être, selon les milieux et les circonstances, avec tact, intelligence et camaraderie. Pour cela, il suffit d’être naturel en tout et partout, sans forcer son talent, sans gonfler sa vertu, c’est-à-dire modestement. Il suffit d’être sincère sincèrement, si je puis m’exprimer ainsi.
Être sincère, c’est pouvoir dire en face, à quiconque, ce qu’on pense ... À condition de ne pas être soi-même ce que l’on reproche à autrui. Être sincère, c’est oser dire, à qui le mérite, ce que la plupart pensent sans le dire ... À condition de ne pas ajouter en soi-même :
« À sa place, je ferais comme lui. »
Enfin, être sincère, c’est savoir en toutes occasions opposer la vérité au mensonge ; la franchise à l’hypocrisie ; la dignité à la bassesse ; la fierté à la platitude et vivre assez bien pour ne craindre ni critique ni calomnie des cuistres et des tartufes dont le monde est si abondamment fourni.
Une sincérité consciente et sûre permet de passer partout la tête haute et de ne jamais baisser les yeux devant qui que ce soit. C’est une telle sincérité qui fait la force de l’apôtre, du militant, qui fait honte aux timides, aux fourbes, aux valets et qui fait peur aux chiens de garde de l’Ordre, de la Propriété, de la Morale.
— G. YVETOT.
SIONISME
n. m.
Le rêve millénaire des Israélites de reconstituer leur patrie ne cessa jamais d’être. Cependant, la Palestine ne comptait, au XIXème siècle encore, qu’un nombre restreint de Juifs, occupée qu’elle était par les Arabes. En 1825, il n’y résidait que dix mille descendants d’Abraham. Aujourd’hui, il se trouve en Palestine une foison de colonies représentant toutes sortes de tendances : de l’individualisme au communisme en passant par la coopération.
En 1882, fut fondée la première colonie agricole, nullement communiste, située près du port de Jaffa. Elle fut tirée de la détresse par le baron Edmond de Rotschild qui, intéressé par cette tentative, créa d’autres colonies pour permettre à ses coreligionnaires de s’installer dans leur pays d’origine. Son programme, qui n’avait rien de communiste, consistait à acheter un terrain, et à y faire venir des Juifs qui s’adaptaient au métier d’agriculteur ; puis, ceux-ci étant devenus expérimentés, il partageait entre eux la terre. Chacun devenait propriétaire et indépendant. Il s’était ainsi formé une trentaine de colonies, toutes prospères, mais guère intéressantes au point de vue social. On y employait la main-d’oeuvre salariée, de préférence aux Juifs, les Arabes.
Par suite de la grande guerre, il se produisit un changement considérable dans l’histoire des colonies sionistes. Les armées anglaises entraient à Jérusalem, sous la conduite du général Allenby, le 9 décembre 1917. Le 2 novembre de la même année, Lord Balfour, alors ministre britannique, dans une lettre au baron de Rotschild, avait déclaré officiellement que l’Angleterre :
« Envisageait avec bienveillance l’établissement en Palestine du Foyer national juif et ferait tous ses efforts pour le faciliter. »
Cette déclaration causa aux Juifs, toujours dans l’attente de la restauration de Sion, une vive exaltation, et donna une plus forte impulsion au mouvement sioniste. Des Juifs arrivèrent de tous pays et ce fut la naissance de colonies, selon le type des communautés agraires.
Il fut créé deux fonds nationaux, l’un pour la colonisation générale, le Keren Hayesod, l’autre de l’achat des terres, le Keren Kayemeth. Le Keren Kayemeth acheta des terres, mais contrairement à ce qui s’était passé dans les colonies du baron de Rotschild, ces domaines ne furent jamais aliénés. Les colons ne purent devenir que concessionnaires, et non pas propriétaires. Et cela pour diverses raisons : raison d’ordre religieux. Selon la Bible, « les terres ne se vendront pas à perpétuité, car la terre est à moi, dit l’Éternel », la terre doit rester commune « à tous les enfants de Dieu », elle ne peut être ni objet de vente ni objet d’achat. Elle devait donc rester entre les mains d’une même famille. Les récoltes seules pouvaient être vendues et seulement dans la période s’écoulant entre deux jubilés, c’est-à-dire tous les quarante-huit ans, époque à laquelle les terres devaient revenir à leur propriétaire. L’idée de la terre inaliénable est commune à toutes les civilisations primitives. Elle se retrouvait encore dans le système du mir russe. Mais si toutes les terres sont constituées en propriété nationale, c’est dans le but que toute la Palestine revienne un jour aux Israélites et que soit reconstitué le Royaume d’Israël.
Il y a encore une raison d’ordre économique. Le fond national juif bénéficiera de la plus-value de la terre qui est générale dans tous les pays où s’accroît la population (et non les propriétaires). Son revenu augmentera à chaque révision des baux et ce sera un budget suffisant pour l’État. Par ce système, le Keren Kayemeth conserve un droit de contrôle perpétuel sur la colonie pour les questions de salubrité et d’aménagement. Enfin cela évite au colon, pauvre à son arrivée, de débourser la somme nécessaire à l’achat d’une terre. Il n’a qu’un fermage peu élevé à payer. Le lieu d’élection des colonies juives est la vallée qui s’étend du lac de Tibériade au golfe de Haïffa (Jaffa), la plaine de Jézrael. Il s’en trouve également dans la plaine de Saron.
Le fonds national groupe les colons de façon qu’ils puissent exploiter un domaine assez vaste. Chaque famille cultive son lot sans employer de main-d’oeuvre salariée. Au moment de presse, les colons se prêtent mutuellement leur concours. La liberté d’organisation est absolue. Aussi trouve-t-on des colonies de type individualiste (celles fondées par Rotschild), des colonies de type communiste, et celles de type coopératif.
Comme colonie coopérative, citons Nahalai : elle est disposée de telle façon que les familles ont recours à des services collectifs, entre autres pour se procurer l’eau nécessaire. Il y a des associations pour la vente du tabac qui est un des grands produits de la Palestine, pour l’exécution de nombreux travaux : travaux de plantation, de drainage, d’irrigation, de construction de routes, etc.
Comme colonie où l’on pratique le communisme, la plus connue est Nuris. Tout s’y trouve en commun : travail des hommes et des femmes, habitation, table, enfants qui sont élevés par les soins de la colonie. La colonie pourvoit à tous les besoins. Sa production suffit presque à sa consommation et elle consomme tout ce qu’elle produit ; elle représente le type de la colonie à économie fermée qui se suffit à elle-même. Quand elle a besoin de l’extérieur, un de ses délégués se rend dans une succursale de la grande société coopérative de consommation de Palestine : « Hamashbir », y porte le produit de sa récolte, qu’on lui inscrit au crédit de la colonie, et on marque à son débit le montant des achats. A la fin de l’année, on envoie à la colonie un relevé de son compte-courant. Il existe une colonie où les vêtements même sont en commun. Les enfants y sont absolument en commun et n’appartiennent, en aucune façon, à leurs parents.
La colonisation juive présente des exemples d’énergie qui méritent d’attirer l’attention. On peut citer, entre autres, le défrichement de la vallée de Jezraë, lieu si malsain que toutes les tentatives de défrichement avaient échoué, et qu’il n’offrait, en 1920, qu’une perspective de tombes. De 1922 à 1923, de hardis pionniers accomplirent cette oeuvre considérable d’assèchement des marais au prix de travaux pénibles.
Autre exemple d’énergie et de réalisation : l’édification de Tel Aviv — sur une plage aride — aujourd’hui, ville florissante, détenant quelques industries, une plage qui possède un sérieux avenir.
Contrairement à l’antique usage israélite qui maintient la femme dans une condition dépendante, les Sionistes ont voulu associer la femme à leurs travaux, lui assigner un rôle égal à celui de l’homme, dans l’oeuvre de la reconstruction de la patrie. Pour rendre la femme, jusqu’alors maintenue dans l’ignorance, apte à ces fonctions nouvelles pour elle, il s’est créé une association universelle des femmes sionistes : Women’s International Zionist Organization, connue sous le nom de Wiso. Son but a été de former la femme juive à devenir une compagne, une mère, une valeur sociale.
On a créé à Nahalal, en 1926, une école d’agriculture pour jeunes filles, qui est en plein développement. D’autres écoles ont été fondées, parmi lesquelles des écoles d’art ménager.
Si le mouvement sioniste représente un élan enthousiaste pour la résurrection d’une nation détruite depuis des milliers d’années, au point de vue économique, il s’élève bien des obstacles à sa réussite. Les Juifs eux-mêmes, craignant qu’on ne les rejette des autres pays, s’il y a une terre proprement juive, opposent des résistances. Les Arabes ne sont pas disposés à céder leur place, d’où des heurts, qui peuvent dégénérer parfois en massacre entre Juifs et arabes (et même chrétiens indigènes). D’autre part, la superficie restreinte de la Palestine empêche l’expansion des colonies. Enfin, les colons ne se soutiennent que grâce aux subsides que leur fournissent les Juifs du monde entier. Ils manquent, par suite, d’indépendance.
On a trouvé récemment le moyen d’ouvrir de nouveaux débouchés aux colonies sionistes par l’exploitation des produits chimiques de la Mer Morte, et l’utilisation du Jourdain comme force motrice. Aussi, en examinant le pour et le contre, ne peut-on en rien se prononcer quant à l’avenir du Sionisme qui vient d’entrer dans une phase nouvelle par suite des persécutions moyenâgeuses dont les Israélites sont l’objet, actuellement, en Allemagne (1933).
— E. A.
SNOBISME
On appelle ainsi la pose, l’affectation ridicule, « l’admiration factice et sotte pour tout ce qui est en vogue ». Le snob est celui « qui juge tout sans connaître rien ». Ces définitions résultent de la double origine attribuée aux mots snobisme et snob. Elles sont anglaises. D’une part, snobisme qui s’écrivait plus exactement snobbisme il y a cent ans, viendrait de snobbish qui qualifie la vulgarité prétentieuse. Un snob, en anglais, est au sens propre un savetier, et au figuré un homme vulgaire et prétentieux. Le cordonnier qui critiquait systématiquement le peintre Apelle, et à qui celui-ci disait : « Pas plus haut que la chaussure », était un snob dans les deux sens du mot. D’autre part, snobisme et snob seraient les produits de filius nobilis dont l’abréviation a fait fil-nob et nobs, appellations données dans les collèges anglais aux fils des nobles. Ceux qui voulaient les imiter étaient les quasi-nobs ou snobs. Le snobisme est ainsi, comme conséquence des deux origines, l’affectation de connaître ce qu’on ignore et celle du genre noble. Celui qui prend le Pirée pour un homme en se donnant les airs d’un Richelieu est un snob. Il étale la double stupidité aristocratique qui consiste à se croire supérieur à tout et à prétendre tout savoir par droit de naissance.
Snobisme et snob sont entrés dans la littérature anglaise vers 1830. C’est Tackeray qui les a présentés dans sa revue humoristique intitulée The Snob, puis dans son Livre des Snobs où il a raillé la sottise aristocratique et surtout le cant, forme particulièrement anglaise de l’hypocrisie politique, religieuse et mondaine.
Le snobisme est la forme aristocratique, esthétique de la sottise en ce qu’il prétend non seulement régir la mode mais aussi le goût. Il n’est pas spécial aux monarchies. Il sévit aussi, avec encore plus de ridicule, dans les démocraties qui singent les monarchies, dont le gouvernement et « l’élite » ne sont pas composés des « meilleurs » mais, au contraire, des plus audacieux, des plus fourbes, des plus avilis. Le snobisme aristocratique a encore une certaine tenue en ce qu’il entretient la prééminence de valeurs intellectuelles et morales parfois respectables, mais le snobisme démocratique n’en a plus aucune. Il est le luxe des parvenus pour qui toute qualité n’est à considérer que suivant sa valeur argent. Le goût lui importe peu ; il ne voit que ce qui est cher. Aussi ne méprise-t-il la mode vulgaire, celle du bazar, du grand magasin, que parce qu’elle est à bon marché, à la portée de toutes les bourses. Sa vanité exhibitionniste ne trouve sa pleine satisfaction que dans le luxe coûteux. Il est sûr qu’il a du goût lorsqu’il a payé cher, de même qu’il est convaincu d’être honorable quand il peut fleurir sa boutonnière d’un machin rouge. M. Lechat ne douta plus qu’il fut un grand homme quand il eut payé 35.000 francs son portrait peint par Bonnat, et qu’ayant fait son légataire universel d’un ministre des Beaux-Arts, il eut l’assurance que ce portrait entrerait au Louvre, dut-on pour cela lui donner la place d’un Delacroix ou d’un Courbet.
Sous des formes diverses, des aspects différents, le snobisme est toujours la manifestation du besoin de paraître avec le plus d’éclat et le plus avantageusement possible par des apparences supérieures à celles de la simple mode. Le snobisme est l’aristocratie de la mode, la serviette qu’il ne faut pas mêler aux torchons. C’est lui que La Bruyère dépeignait, lorsqu’il écrivait dans ses Caractères, au chapitre des « Grands », ceci :
« C’est déjà trop d’avoir avec le peuple une même religion et un même dieu ; quel moyen encore de s’appeler Pierre, Jean, Jacques, comme le marchand ou le laboureur ? Évitons d’avoir rien de commun avec la multitude ; affectons au contraire toutes les distinctions qui nous en séparent. »
Les « Grands » prenaient les noms d’Achille, d’Hercule, d’Annibal, si mal fichus ou si foireux qu’ils fussent. Le snobisme démocratique a répandu cette sottise chez les femmes d’aujourd’hui qui troquent leurs prénoms roturiers, Marie, Louise, Catherine, contre ceux plus distingués de Mary, Loyse, Ketty. Le snobisme féminin cherche ses élégances non dans le sentiment et la grâce, mais dans les takolonneries dont il se farde des pieds à la tête. Il se fait griller la peau au soleil, ou se la fait peindre et tatouer pour des exhibitions grotesques. Le sentiment et la grâce ne sont pour lui qu’une question de « sexappeal » et il justifie ainsi le mot de Flaubert disant que « les femmes prennent leur cul pour leur coeur ».
Le snobisme a été dans tous les temps le décor, l’ornement des convenances sociales, ces convenances « si utiles pour faire tenir debout les pourritures », a dit encore Flaubert. Toutes les affectations aristocratiques grossièrement singées par les imbéciles ont été du snobisme. Le nom de Pétrone est demeuré pour représenter, en le « plutarquisant », celui d’une époque, celle de l’empire romain, qui fut aussi méprisable que la nôtre par ses moeurs. Le snobisme eut une grande allure et un véritable éclat au temps de la Renaissance italienne, lorsqu’il reçut ses directions d’hommes qui furent, malgré leurs crimes, des artistes et des savants. Mais il déchut singulièrement quand il devint, sous l’inspiration des Jésuites, le snobisme des honnêtes gens, titre que se donnèrent les aventuriers de sac et de corde composant « l’élite » des cours de France et d’Espagne au XVIème siècle. Ce fut le snobisme des âmes noires et des pieds sales. Il y eut, au XVIIème, celui des précieux aussi crasseux physiquement et moralement, mais plus léger et ridicule dans des formes littéraires. On trouve le précieux dans ce portrait de La Bruyère qui l’apparente dans tous les temps au snobisme intellectuel :
« Arsène du plus haut de son esprit contemple les hommes ; et dans l’éloignement d’où il les voit, il est comme effrayé de leur petitesse. Loué, exalté et porté jusqu’aux cieux par de certaines gens qui se sont promis de s’admirer réciproquement, il croit, avec quelque mérite qu’il a, posséder tout celui qu’on peut avoir et qu’il n’aura jamais. »
La Régence de Philippe d’Orléans, au XVIIIème siècle, vit les roués ; ils donnèrent le ton aux agioteurs de la rue Quincampoix et aux débauchés du Palais Royal et des « folies », petites maisons où ils se livraient à ce qu’on appelle aujourd’hui les « partouzes ». Le même siècle vit les merveilleux, sous Louis XV, les mirliflores, sous Louis XVI, les incroyables, sous le Directoire, tous se multipliant, comme la vermine dans les époques de décomposition sociale, dans des formes de snobisme de plus en plus excentriques et dépourvues de véritable élégance, d’esprit et de goût. Le premier Empire eut les agréables qui firent peu de tapage tout en étant fort ridicules.
La forme la plus curieuse du snobisme a été dans le dandysme, né en Angleterre au commencement du XIXème siècle. Il fut l’aspect supérieur du snobisme anglais. Le snob, d’après la peinture de Tackeray, était le gentleman hypocrite conservant, grâce au cant, les apparences d’un honnête homme ; c’était le noble étalant une façade de richesse alors que chez lui maîtres et valets ne mangeaient pas tous les jours ; cétait le prêtre cachant sous une charité ostentatoire une cupidité et des moeurs inavouables ; c’était le militaire dissimulant sous sa vantardise, et sous une poitrine rembourrée par l’uniforme, sa couardise et une anatomie délabrée ; c’était enfin tous les pantins sinistres ou grotesques faisant une insanité publicitaire du conformisme dirigeant. Le dandy fut le gentleman supérieur, le snob aristocrate qui donna le ton à la société anglaise la plus élevée en fortune, sinon en intelligence.
Balzac a dit que le dandy ne fut jamais un être pensant. Il représenta, en tout cas, une forme très particulière de l’esprit anglais : le dédain de tout ce qu’il juge inférieur à lui-même, dissimulé sous une impertinence polie. Ce fut la manifestation esthétique du cant. Le fâcheux, pour le dandysme, fut qu’il eut des préoccupations trop vestimentaires qui le conduisirent à l’excentricité ; mais même excentrique, il garda une certaine tenue, le rendant inabordable à ceux qui n’étaient pas de « race », comme les chevaux de leurs écuries. Le dandysme ne fut jamais le snobisme des gens « trop bien habillés » dont il faut se garder aujourd’hui plus que du rôdeur patibulaire et classique. Le snobisme du vêtement fut la fashion, ou « mode anglaise », contrefaçon du dandysme. Elle se répandit hors d’Angleterre, particulièrement en France où elle retrousse toujours ses bas de pantalon parce qu’il pleut à Londres ! Brummel fut l’incarnation du dandysme. Il fut l’esprit le plus britanniquement froid et calculateur ; il fut en même temps un fou.
Baudelaire, en qui les moralistes hypocrites ont vu un dandy, a écrit sur le dandysme des pages où il l’a mis certainement trop haut. Mais Baudelaire, à qui il manquait l’essentiel, c’est-à-dire la fortune, pour être un véritable dandy, voyait dans celui-ci « un homme blasé, un homme souffrant qui sourit comme le Lacédémonien sous la morsure du renard ». Ce dandysme devenait du stoïcisme. C’était celui de Leconte de Lisle dans la Mort du Loup ; c’était l’indépendance morale de Stendhal, s’excluant du « bégueulisme » de son temps et dénonçant le snobisme de ceux qui ne sentent point et dont le goût est simplement d’être sensibles à l’argent et aux dindes truffées ; c’était le don-quichottisme de Barbey d’Aurevilly s’escrimant contre les moulins à vent démocratiques ; c’était la noble et ironique impassibilité de Villiers de l’Isle-Adam, cygne tombé des hauteurs du Graal dans la basse-cour de la gendelettrerie ; c’était la protestation hautaine du fier et légitime orgueil humain contre les croupissantes et fétides promiscuités du muflisme. Baudelaire voyait apparaître le dandysme « surtout aux époques transitoires où la démocratie n’est pas encore toute puissante, où l’aristocratie n’est que partiellement chancelante et avilie. » Il le voyait fondé par « quelques hommes déclassés, dégoûtés, désoeuvrés, mais tous riches de force native », et qui lui donnaient pour base « les facultés les plus précieuses, les plus indestructibles, et les dons célestes que le travail et l’argent ne peuvent conférer ».
Un tel dandysme était bien loin, même de celui de Brummel dévoué au cant anglais et à toutes les pourritures des convenances sociales. Il était encore plus loin de cette bourgeoisie qui « pense bassement », autant qu’elle agit, et dont les « philistins » fournirent au snobisme les fashionables et les lions. Le « Jockey Club » lui-même, qu’Eugène Sue fonda en 1834 avec les gens les plus riches de Paris, et qui est aujourd’hui le cercle aristocratique le plus fermé de France fut fashionable et non dandy. Il n’a jamais représenté, comme son nom l’indique, qu’un snobisme de grande écurie.
La France eut dans le lion le contraire du dandy glacial, distant, dédaigneux, inébranlablement décidé à ne pas s’émouvoir. Le lion fut excité, galant, empressé, cherchant à plaire et à séduire par ses cravates, ses bottes, et par un débordement de sentimentalité. D’Orsay fut le premier et le plus magnifique des lions ; il fut leur Brummel. Ils sortirent des salons de la grande bourgeoisie balzacienne pour pulluler comme des rats et se répandre dans tous les trous de province. Il ne fut pas de boutique en France où ne trôna au comptoir un lion et à la caisse une lionne. Les deux furent des personnages essentiellement romantiques ; quand ils n’arrivaient pas à se faire admirer par leur costume ils recouraient au suicide. Ils ne sortaient pas du domaine des excentricités. La littérature et le théâtre romantiques empruntèrent largement à cette humanité délirante ; on eut le Lion amoureux de Frédéric Soulié, un autre Lion amoureux de Ponsard, le Lion empaillé de Cozlan, les Lionnes pauvres, d’E. Augier et E. Fournier, et nombre d’autres. Tous les artistes et les littérateurs qui ne se tinrent pas à l’écart du « monde » et connurent le succès, furent plus ou moins des lions, de 1830 à la fin du second Empire.
A côté des lions « par calcul et par spéculation » de la littérature balzacienne, il y eut les lions par vanité, par sentimentalisme, et surtout par snobisme, parce qu’ils se seraient cru déshonorés s’ils n’avaient pas été aussi sots que tout le monde. Flaubert a dit du lion A. de Musset :
« Le Parisien chez lui entrave le poète, le dandysme y corrompt l’élégance, ses genoux sont raides de ses sous-pieds .. »
Eugène Sue, qui affectait de mépriser la royauté de 1830 mais sollicitait une invitation aux chasses du duc d’Orléans, disait :
« C’est à sa meute que je me rallie ... »
L’espèce dégénéra de plus en plus pour passer au gandin, au petit crevé, au gommeux, au smarteux, qui firent du snobisme une véritable cour des miracles, en attendant que la Guerre « régénératrice » de 1914 lui fît prendre des aspects encore plus calamiteux.
Avant de voir les aspects d’aujourd’hui du snobisme, constatons qu’il ne persévère, comme toutes les formes de la sottise, que parce qu’il a, d’une part ses convaincus, ses fanatiques, ses badauds, ses dupes, ses héros, ses martyrs, et, d’autre part, ses farceurs et ses parasites. Marcel Boulenger a écrit sur le « snobisme des gens du monde », ceci :
« Le snobisme n’est point du tout, dans le monde, une sorte de manie légère, gentille, aimable, mais au contraire une passion sérieuse, violente, dévorante, secrète et perpétuelle, un feu caché qui couve chez les plus fins, alors qu’il gronde et fulgure chez les plus naïfs, une fureur qui les mènerait à tuer père et mère pour être familièrement reçus dans tel ou tel salon, ou afin d’entrer au Jockey. Il se pourrait que le snobisme fût dans le « monde » la seule passion vraiment profonde, irrésistible, et d’ailleurs assez pure — car que veut atteindre un snob, sinon un véritable idéal, et que huit fois sur dix il s’est formé lui-même ? »
Soulignons que ces lignes sont tirées du journal de l’ « élite mondaine », le Figaro (19 mai 1928), car malgré l’atténuation de la dernière phrase, on pourrait dire que nous calomnions le « monde ».
Cet « idéal » que le snob se forge ainsi, sans être bien difficile sur sa qualité, et encore moins sur ses moyens, est habilement reforgé pour le faire produire à l’infini par des exploiteurs qui « se paient la tête de l’humanité », n’ayant d’autre idéal, eux, que de téter avidement les mamelles gonflées de la sottise. Les circonstances ont permis d’étendre cette exploitation à toutes les classes sociales. A défaut d’autres réalisations démocratiques, la Guerre a indiscutablement apporté celle-là. Si on est prêt chez les « gens du monde », à tuer père et mère pour être reçu par les douairières du « noble faubourg », ou entrer au Jockey-Club, on y est encore mieux prêt dans les « milieux » où se recrute « l’aristocratie républicaine » et où l’exercice du revolver est devenu un sport aussi officiel et national que familial et moralisateur.
Constatons encore, pour faire exacte mesure au snobisme, qu’il peut être bon quand il s’attache — oh ! sans le faire exprès ! — à quelque chose de bien. Cela lui arrive sans effort d’intelligence, puisque sa nature est de ne rien comprendre ; il y a là un hasard heureux, comme lorsque la pluie arrive quand les cultures sont menacées par la sécheresse. Ainsi, le snobisme a imposé de grands artistes que la routine académique, et l’ignorance qui la suit, auraient accablés. Le cas le plus typique est celui de Wagner en France. Le snobisme nationaliste, hérissé d’aveuglement et de haine, se dressa une première fois contre lui, à l’occasion de Tanhauser, en 1861. Les snobs du Jockey-Club réussirent à le proscrire sans vouloir l’entendre. Ils voulurent recommencer en 1891 contre les représentations de Lohengrin. Malgré la mobilisation des marmitons de M. Déroulède, ils échouèrent cette fois devant le bon sens public. Le snobisme devint alors wagnérien. (Voir Symbolisme). Il le demeura jusqu’en 1914 où il exhala ce cri du coeur par la voix d’un ministre des Beaux-Arts : « Enfin, je vais pouvoir dire que Wagner m’em ... ! » Depuis, le snobisme wagnérien est à la dérive, comme les intelligences ministérielles.
Dans un autre ordre d’idée, le snobisme a adopté de nos jours, le Nudisme. N’aurait-il pour résultat que d’obliger les gens à se laver pour ne pas montrer à nu un épiderme crasseux, que ce serait une bonne chose. Mais le snobisme fait du nudisme une exhibition pas toujours décrassée et souvent dangereuse pour la santé des simples « piqués » de la mode qui s’exposent aux troubles organiques les plus graves. Chez ses protagonistes, le snobisme nudiste entretient le luxe poissonneux et la prostitution esthétique des « têtes de phoques » et des « peaux rouges », équivoques cabotins des plages où ils s’étalent sans beauté et sans pudeur.
Il n’y a que l’insanité qui n’em ... jamais le snobisme même ministériel. Il y est dans son élément, aussi est-il de plus en plus la forme exhibitionniste du muflisme grandissant. De la minorité aristocratique, il est passé à la majorité ochlocratique et il est curieux de le voir à travers des journaux qui en publient des Éloges. On a écrit entre-autres :
« Aucune hypocrisie ne lui semble négligeable (au snob) ; aucun mensonge blâmable, aucune ostentation ridicule. Il s’agit de paraître et encore plus de se défendre. »
Paraître et se défendre non seulement excusent tout le reste, mais ils font du snobisme une vertu et une discipline sociales que « tout le monde » doit suivre. On voit que snobisme mondain et snobisme populaire sont dignes l’un de l’autre.
Dans ses précédents avatars intellectuels, le snobisme avait été successivement byronien, baudelairien, nietzschéen, ibsénien, barrésien, mallarméen, bergsonien, etc... En art, il fut décadent, cubiste, futuriste, dadaïste, etc ... En tout, il fut fumiste, poseur et gobeur, sous des prétentions à la supériorité de l’esprit. Le snobisme actuel a fini de s’embarrasser d’esprit et d’intellectualité. Il est protéiste en ce qu’il adopte toutes les idées lui permettant de tirer parti de la situation. Il prend tous les visages, celui de Mussolini et d’Hitler, aujourd’hui ; demain, s’il le faut, il sera bolcheviste, comme il fut cosaque en 1815 et en 1894. Il s’intoxique de cocktails, de morphine, de cocaïne ; il fait de la pédérastie un perfectionnement social et un moyen d’arriver dans un monde où il n’y a plus que des bas-ventres. Il est devenu aussi superstitieux que les Négritos africains, mêlant par un amusant éclectisme la Vierge, Saint-Christophe, Nénette et Rintintin. Il fait bénir ses chiens et ses automobiles. Il mettra bientôt la corde de pendu à un prix inabordable pour les petites bourses.
Mais le snobisme actuel est par dessus tout admirateur de la « belle brute » militaire et sportive. M. Reinach écrivait dans le Figaro, en 1916, que « la guerre est un art noble ». Le snobisme, adoptant la formule à la faveur des circonstances, a appliqué cette noblesse à toutes les formes d’assassinat, de brutalité et d’abrutissement. L’aviation est « noble » qui permet de mitrailler des vieillards, des femmes, des enfants, des bestiaux sans défense. La boxe est « noble » qui offre le spectacle de brutes humaines s’assommant. La tauromachie est « noble » qui permet de voir étriper en musique et au grand soleil des chevaux et des taureaux. L’alcoolisme est « noble » grâce auquel, à force de cocktails, on ne peut plus monter son escalier que sur les genoux et on « pique » des crises de delirium tremens dans des établissements « distingués ».
Ces choses-là qui ont leur dénouement dans des asiles d’aliénés ou qui provoquent ces « drames mondains » dont la police n’arrive pas à étouffer les échos crapuleux tant ils sont nombreux, soulevaient le dégoût public quand un Coupeau, ouvrier zingueur, ou des « mecs » du « Sébasto » et leurs « dames » en étaient les héros ; mais elles sont « nobles » quand elles se passent dans la « haute société » !....
Le snobisme s’est démocratisé par la dissolution des classes et des principes, de la morale et des scrupules. Les « purotins » engraissés de la misère publique ont fait le snobisme « nouveau riche » ; les riches « décavés » ont adopté le « snobisme de la purée », lancé par M. de Fouquières, grand ordonnateur des élégances républicaines, et font étalage de leur bon goût dans des bals « de la misère noire », etc ... Les deux snobismes s’épaulent mutuellement, le premier entretenant le second, le second apprenant les « belles manières » au premier, les deux composant « l’élite » de la racaille souveraine dans les hautes sphères comme dans les bas-fonds.
Dans ce snobisme, l’ancien rôdeur et le souteneur, passés nettoyeurs de tranchées, munitionnaires, millionnaires et milliardaires, aventuriers politiciens, députés, sénateurs et ministres, se confondent avec la « vieille noblesse » qui met ses titres et ses parchemins au service des sociétés d’escroqueries financières, et fournit de barbeaux aristocratiques les riches héritières du cochon et du pétrole. Tous étalent des élégances trop ostentatoires pour être honnêtes et ne pas cacher de sales pièges, dans tous les « milieux » où se rencontrent les « gentilshommes » et les « nervis », les « politiciens » et les « faisans », les proxénètes et les mouchards, tous les fripons, les marlous et les assassins que la « justice » ne punit pas, que les gouvernants décorent et que les journaux soutiennent, tout au moins d’un silence complice quand ils sont « allés trop fort » !... Dans un monde aussi exemplaire, la chevalerie de « l’honneur » ne peut que faire bon ménage avec celle du surin, de la pince-monseigneur et du trottoir. Les « nervis » qui, entre un cambriolage et l’assassinat d’un garçon de recettes, mettent leurs talents au service des grands de la terre, sont dignes de partager leurs honneurs.
Le snobisme a fait riches et pauvres égaux en sottise, en cruauté, en sadisme ; mais les pauvres, qui fournissent le plus souvent les victimes, sont les plus stupides quand ils s’appliquent à copier les turpitudes de leurs maîtres. On voit encore, dans la République radicale-socialiste, les « manants » participant à la curée du cerf que des centaines de « gentilshommes », de « nobles dames », de piqueurs, de chiens, ont pourchassé, traqué, torturé pendant des heures, le plus longtemps possible, pour « faire durer le plaisir » !.... On retrouve aux spectacles de la guillotine et du cirque les mêmes foules sadiques de buveurs de sang, de hurleurs à la mort qui s’amusaient aux supplices des Damiens, qui frappaient à coups d’ombrelles les Communards prisonniers et leur crachaient aristocratiquement à la face. Il y avait, il n’y a pas longtemps, il y a peut-être toujours, dans des prisons roumaines des séances de gala où les « dames de la ville » pouvaient assister aux punitions corporelles infligées aux femmes délinquantes !... Il y a toujours en Amérique des pendaisons populaires de noirs. Elles font oublier à huit millions de chômeurs, abrutis par leur « supériorité de citoyens américains », les martyrs de Chicago, Sacco et Vanzetti, les noirs de Scottsborg, Mooney et Billings, les mineurs de Harlan. Aristocrates et démocrates sont confondus dans un snobisme qui n’est plus que de la crapule et de la lâcheté.
Nous n’insisterons pas davantage sur le snobisme produit raffiné de cette putréfaction sociale que nous avons déjà observée aux mots : Élite, Muflisme, Paraître, et dont nous verrons la psychologie aux mots Sottise et Vanité. L’aristocrate, le mufle, le mégalomane, réunis dans le snobisme, sont les éléments « spirituels » de cette putréfaction à quoi le coup de balai révolutionnaire est de plus en plus indispensable pour faire place aux forces vitales, saines et vigoureuses, qui auront à refaire le monde.
— Édouard ROTHEN.
SOCIABILITÉ
n. f.
Les sociétés existent. C’est un fait. Que ces sociétés réalisent des conditions d’existence pas toujours avantageuses à l’individu, c’est encore un autre fait. Que, malgré cela, l’individu présente cette particularité que nous appelons sociabilité, c’est-à-dire aptitude à vivre avec d’autres individus plutôt que seul, cela nécessite une recherche sur l’origine et le développement de cette particularité, à seule fin de nous expliquer son pourquoi, après son comment.
La sociabilité, comme toute chose, reste inexplicable en dehors du temps. Pour en saisir toute l’évolution, il nous faut donc remonter jusqu’à ses éléments les plus primitifs, dans le plus lointain des passés.
La vie, la substance organisée étant formée de substances inorganisées, c’est donc dans celles-ci que nous devons trouver les premiers éléments fondamentaux de la sociabilité. En fait, les constructions atomiques et moléculaires nous donnent déjà des systèmes coordonnant des éléments plus individuels : noyaux, électrons, etc.., dont les différents arrangements forment les divers corps simples connus. Ceux-ci, à leur tour, s’allient entre eux pour former tous les corps composés en nombre illimité. Des ébauches d’organisation se constatent dans les cristaux, mais ce sont les organismes vivants qui présentent à leur plus haut degré, non seulement la cohésion et l’harmonie de leurs éléments chimiques, mais encore une propriété nouvelle : le pouvoir de transformer et de coordonner les éléments inorganiques en substance organique. La matière vivante est donc conquérante.
Cette assimilation a pour conséquence deux faits importants :
-
elle augmente la quantité de la matière vivante au détriment de toutes substances, vivantes ou non, mais assimilables ;
-
cette matière ne se développe point en masse continue, informe et illimitée, mais par petites masses discontinues, distinctes, formant pour ainsi dire autant d’unités, de cellules, d’individus.
Ces deux faits ne sont certes point des éléments de sociabilité, car si les éléments de chaque individu s’ordonnent selon une certaine coordination, un certain équilibre, présentant les caractères de la sociabilité, les individus, entre eux, ne forment point un tout harmonieux. Au contraire, chacun d’eux lutte souvent contre les autres et les mouvements vitaux se détruisent ainsi mutuellement.
Cette activité n’est point créatrice de sociabilité. Pourtant chez les êtres inférieurs, tandis que la reproduction de la plupart d’entre eux donne des êtres isolés, quelques infusoires, tels les Flagellès et les Ciliès, restent fixés ensemble sur un même pied, formant ainsi des colonies variables, se dissolvant suivant les ressources alimentaires du milieu. Nous avons là une ébauche de la sociabilité. Mais il y a mieux, au bout d’un certain nombre de divisions, si le milieu n’est pas suffisamment renouvelé, la dégénérescence des infusoires ne peut être arrêtée que par une sorte de fusionnement des animacules s’effectuant deux par deux, fusionnement confondant les deux êtres en un seul et se terminant par une nouvelle bipartition donnant naissance à deux êtres nouveaux régénérés.
Parmi ceux-ci, les verticelles présentent même un fait sexuel intéressant ; car, tandis que les autres infusoires se reproduisent sans caractères sexuels apparents, chaque quart va se fixer sur un individu normal et se conjugue totalement avec lui. Le nouvel être se détache alors et va former ailleurs une autre colonie. Nous avons ici quelques vagues essais de vie collective.
Chez les êtres pluricellulaires, les phénomènes sont beaucoup plus complexes ; les Hydraires, les Polypes, les Méduses forment des colonies variables, avec organes différenciés, tantôt fixes et tantôt libres. Quelle que soit la cause de la formation des métazoaires (que l’agglutination cellulaire soit une conséquence de la formation d’un squelette formé par les déchets de l’assimilation ; ou que ce soit par suite d’un phénomène de cohésion particulier), il est certain que l’ensemble des cellules ainsi coordonnées vit en parfaite sociabilité. La raison en est dans ce fait que toutes ces cellules filles et soeurs sont issues, par bipartitions successives, d’une seule et même cellule mère et qu’elles sont, par conséquent, animées d’un même rythme qui les met en état d’équilibre mutuel.
Quoi qu’il en soit, avec les organismes plus évolués, un troisième fait vient s’ajouter aux deux examinés plus haut ; c’est le fait sexuel, le rapprochement nécessaire des êtres plus ou moins nettement différenciés. Ce rapprochement prend un caractère beaucoup plus compliqué avec l’évolution du système nerveux (intelligence) dont le fonctionnement élémentaire consiste en une sorte de coordination entre le mouvement vital de l’animal et les divers états du milieu ; coordination créée par la persistance, dans l’animal, des influences qui l’ont avantagé ou désavantagé.
Si nous étudions cette coordination chez les diverses espèces animales, nous constatons que si le fait sexuel est bien le seul créateur de la sociabilité, c’est l’évolution du système nerveux qui permet seulement l’apparition de la sociabilité économique et morale. Ce fait est évident chez les insectes sociaux, tels les fourmis et les abeilles, dont les travailleurs asexués, et par conséquent non-déterminés sexuellement, pratiquent pourtant une solidarité rigoureuse entre eux.
D’autres espèces à périodes sexuelles espacées ne se dispersent point en dehors de ces périodes ; les individus restent groupés entre eux, soit que cela constitue un avantage pour attaquer ou pour se défendre, soit que la présence de plusieurs animaux de la même espèce et de mêmes moeurs forme une sorte de sécurité par leur réciproque neutralité.
Cette évolution de l’intelligence ne s’effectue point sans heurt et sans absurdité, car si la sexualité rapproche les êtres et engendre les groupements, l’imagination crée des rivalités totalement inutiles. L’abondance des femelles indique bien que les mâles ne luttent point entre eux pour satisfaire un besoin exigeant la disparition de la plupart d’entre eux, puisqu’un plus grand nombre de mâles pourrait être satisfait. Il y a là un des méfaits de l’imagination, méfaits bien plus nombreux dans l’espèce humaine plus riche d’imagination.
Les darwinistes expliquent ce fait comme une nécessité pour améliorer les espèces. Ceci est absurde. Outre qu’il est déraisonnable d’inventer une Nature voulant l’amélioration des individus à seule fin de compliquer le jeu de massacre des espèces entre elles (ce qui est le but final), il n’est pas du tout prouvé que c’est le meilleur mâle qui est toujours le vainqueur, car il n’y a pas que la pugnacité comme valeur biologique ; et, d’autre part, cette sélection naturelle n’a point empêché la création de différences énormes entre animaux partis d’ancêtres peu différenciés, tel l’éléphant et le rat, et le meilleur des lapins est inférieur au plus mauvais lévrier.
Si nous résumons ici le comportement général des animaux, nous voyons qu’ils sont déterminés par quelques fonctions primordiales, telles que : nutrition, sensibilité, motilité et sexualité ; mais, parmi ces fonctions, la sensibilité est celle qui différencie le plus profondément les êtres entre eux. Chez les mammifères supérieurs, cette sensibilité, par le développement excessif du système nerveux, et principalement du cerveau, complique extraordinairement leur activité. Non seulement certaines réactions nécessaires à leur vie laissent des traces dans leur mémoire mais encore certaines représentations du monde extérieur, plus ou moins utiles, mais liées à ces réactions sont également conservées, créant ainsi des centres d’action extrêmement divers. On conçoit que l’infinité des faits objectifs liés (par réflexes) aux fonctions nutritives, sexuelles ou motrices, crée, subjectivement, des possibilités de réactions très variées. Certains de ces faits, ne se renouvelant jamais ou ne coïncidant pas régulièrement avec les fonctions vitales, ne se fixent point dans l’hérédité ; mais il en est d’autres, déterminant des réflexes identiques, qui parviennent à laisser des traces permanentes que nous appelons instincts. On conçoit qu’entre les réflexes étroitement liés aux fonctions organiques, utilisant une forte énergie nerveuse pour l’action immédiate et les réflexes de la connaissance pure, il y a tous les degrés possibles de l’émotivité, celle-ci étant entendue comme une libération d’énergie sous l’influence d’une excitation objective ou subjective. C’est ainsi que les réflexes en rapport avec la nutrition forment un groupe de réflexes liés à d’autres groupes également très nombreux concernant d’innombrables faits simultanés ou successifs, s’enchaînant dans l’espace ou dans le temps : faim, confection d’armes ou d’outillage, chasse, attente, poursuite, fuite, fatigue, etc. Chacun de ces états est plus ou moins déterminé violemment par les circonstances, libérant ainsi des quantités variables d’influx nerveux (émotions) lequel, se dispersant dans les groupes de réflexes, crée, selon l’écoulement normal ou anormal du dit influx, son abondance, son épuisement, son inutilisation ou sa surabondance, ces états d’âme appelés : joie, déception, colère, espoir, amitié, dégoût, haine, etc. La réussite de soi ou des autres dans la lutte détermine d’autres états affectifs : envie, admiration, orgueil, vanité, etc. De même la sexualité détermine l’amour, la bonté, la générosité, l’amitié aussi bien que la jalousie ou la haine. L’attachement aux choses et aux êtres est un état émotionnel créé par la simultanéité d’excitation favorable à notre activité (images avantageuses, réflexes conditionnels).
Comme notre émotivité est liée à notre potentiel d’influx nerveux ; comme celui-ci paraît être sous la dépendance de certaines glandes, nous voyons que la locution : être de bonne ou de mauvaise humeur est assez exacte. L’activité glandulaire détermine donc notre état humoral, autrement dit notre caractère.
Si la complexité du système nerveux rend difficile l’établissement de lois biologiques concernant le développement des sociétés humaines et particulièrement de la sociabilité, les faits examinés antérieurement nous permettent pourtant de préciser ceci :
-
La vie étant conquérante, tout être vivant est un danger pour les autres ;
-
La sexualité rapproche les individus ;
-
L’évolution psychique aggrave ou adoucit les deux faits précédents.
Ceci est évident ; l’homme civilisé qui tue une femme et son amant par jalousie sexuelle est plus malfaisant que le bouc qui se contente d’assommer son rival. Le lion qui mange une gazelle est moins dangereux que le financier qui exploite et tue, par l’usure et la guerre, des millions d’hommes.
Nous avons vu que deux autres faits favorisent la vie sociale : l’identité des rythmes vitaux, la réunion d’êtres semblables. Ce dernier fait est essentiellement dépendant des ressources du milieu et de la coordination bonne ou mauvaise des individus. Il y a une limite de groupement au dessous de laquelle l’homme trop isolé ne peut plus lutter avantageusement contre la nature ; mais il y a également une limite au delà de laquelle l’organisation devient déficiente par difficulté de coordination, excès de population.
L’identité des rythmes est produit par l’éducation utilisant la faculté d’imitation de l’homme. Elle conserve et amplifie les acquisitions des générations successives et forme un tout complexe : la tradition, s’opposant ou favorisant plus ou moins les instincts et les sentiments des individus.
Nous avons donc à considérer si la sociabilité est un fait naturel, instinctif, plus ou moins contrarié par l’éducation et la tradition, ou si, au contraire, la sociabilité est un fait acquis, créé par l’éducation, luttant contre l’instinct et l’hérédité. En réalité, la sociabilité est un de ces états affectifs complexes que nous avons étudiés précédemment ; elle est formée par l’instinct sexuel, des sentiments altruistes et généreux, le tout favorisé ou refoulé par l’éducation.
Nous nous trouvons donc en présence de deux sortes d’éléments déterminants : les éléments sociaux ou traditionnels ; les éléments individuels et héréditaires. Les premiers sont conservateurs, stables, coordonnateurs, mais absolument artificiels. Leur rôle essentiel est de créer une sorte d’unité disciplinant les variations héréditaires ; ainsi agissent les opinions, les croyances, les morales, le savoir, les moeurs et tout l’acquis matériel et psychique que l’individu trouve en naissant dans le milieu humain. Il est compréhensible que la tradition a d’autant plus de chance de durer et de s’enrichir qu’elle favorise davantage les instincts et les sentiments les plus vivaces et les plus vigoureux existant chez tous les participants du groupe. Formée d’ailleurs par l’imagination, sous la nécessité impérieuse des instincts et des sentiments, elle suit une évolution parallèle à l’évolution intellectuelle et morale du groupement, mais cet acquis n’étant qu’une connaissance imitative ne se transmet point héréditairement et disparaît avec la dispersion du groupement.
Il n’en est pas de même avec les éléments individuels héréditaires. Ceux-ci, bien que plus variés, plus divergents et s’opposant quelque peu à l’unité de rythme nécessaire à toute sociabilité collective, ont tout de même une base indestructible dans la physiologie même de l’individu, un acquis héréditaire persistant, quelle que soit l’importance, la prospérité ou la dispersion du groupement.
De grands empires se sont écroulés, entraînant la disparition totale de leurs civilisations et de leurs traditions, ne laissant que des ruines et des graphismes indéchiffrables, mais, au coeur des survivants épars, les mêmes instincts et les mêmes sentiments se sont perpétués, poussant l’individu vers son semblable pour la reproduction, la faim, l’entr’aide ou la lutte.
Ceci nous explique pourquoi l’homme actuel recherche la compagnie de l’homme, bien que cette compagnie ne lui soit pas toujours favorable. Il y est déterminé par ses instincts sociaux plus puissants que ses intincts anti-sociaux.
Nous pouvons conclure ainsi :
-
L’instinct de conquête est la conséquence de la vie et n’est jamais vaincu. Il peut dresser l’homme contre l’homme, ou l’homme contre la nature, mais ne peut cesser d’être ;
-
La sociabilité est un instinct héréditaire secondaire, à base sexuelle, s’opposant à l’instinct de conquête primordial ;
-
Elle crée les groupements humains, les sentiments sociaux et la tradition ;
-
Les groupements humains obéissent à des lois d’équilibre économique, des lois de coordination et des lois d’imitation ;
-
Les lois d’équilibre économique nous font connaître le rapport entre la production et la consommation ; entre la population et les ressources alimentaires ;
-
Les lois de coordination nous indiquent les avantages des rythmes unificateurs et les difficultés croissantes d’organisation des groupements étendus, les nécessités d’harmonisation des individus sous peine de chaos et de désagrégation ;
-
L’imitation est bienfaisante ou dangereuse suivant que les moeurs imitées sont avantageuses ou malfaisantes pour les groupements. Elle explique l’existence des fonctionnements sociaux, sexuels ou moraux les plus différents, les plus opposés et les plus dissemblables par le seul fait que l’imagination humaine est illimitée et que, seules, les impossibilités biologiques lui servent de frein ;
-
Selon que ces lois bio-sociologiques sont plus ou moins contrariées ou favorisées par la tradition, l’instinct de sociabilité ou de conquête est également plus ou moins entravé ou développé. La surpopulation, une mauvaise coordination, des moeurs belliqueuses peuvent intensifier l’instinct de conquête. L’aisance, une bonne organisation, une morale équitable peuvent, au contraire, favoriser l’instinct de sociabilité ;
-
Toute sociologie véritable doit tendre, par conséquent, à développer l’instinct de sociabilité par la réalisation rationnelle des lois bio-sociologiques favorisant la vie de tous les individus ;
-
L’évolution des sociétés humaines ne s’effectue pas fatalement vers l’ordre et l’harmonie, pas plus d’ailleurs que vers le désordre et la dissolution. Rien n’est écrit d’avance. Si l’instinct de sociabilité détermine une sage utilisation des lois bio-sociologiques, l’imitation assurera le triomphe des coordinations équitables. Si l’instinct de conquête l’emporte, ces lois seront méconnues, l’imitation en aggravera les conséquences et le déséquilibre social se perpétuera indéfiniment dans la souffrance et le chaos.
— IXIGREC.
SOCIALISATION
n. f.
Action de socialiser, de mettre en société. (Peu usité). — Extension, par lois ou décrets, d’avantages particuliers à la société entière. « Résultat de cette action » ...
Voilà, sur le mot Socialisation tout ce que dit le Dictionnaire Larousse. Il faut nous reporter dans cet ouvrage au mot socialiser, qui n’en dit guère davantage :
« Socialiser, v. a. Rendre social, réunir en société. — Placer sous le régime de l’association : socialiser la propriété. — Se socialiser, v. pr. Devenir sociable. »
Par contre, le Dictionnaire Larousse s’étend assez sur le mot Socialisme qu’il définit ainsi :
« Toute conception qui, en opposition avec la doctrine individualiste, voit dans la socialisation immédiate ou progressive, volontaire ou forcée, la condition sine qua non de tout progrès. — Socialisme d’État, V. Étatisme ; Socialisme chrétien ; Socialisme agraire ; Socialisme de la chaire, V. la partie encycl. Socialisme collectiviste. V. Collectivisme :
Encycl. Pour les socialistes, ce qui constitue un progrès, ce n’est proprement ni une richesse ni une invention, ni une maxime, mais l’utilisation sociale qui est faite de ces choses ou, en d’autres termes, l’incorporation à la communauté des avantages qu’elles représentent.
En France, de 1750 à 1789, le socialisme s’élabore par les théories de la parcelle ; il se manifeste après la Révolution par la doctrine de Babeuf et la « conspiration » des Égaux ; il se retrouve au fond des doctrines de Saint-Simon (sans communisme, mais avec de l’étatisme), et de Fourier, (sans étatisme et, avec lui, appel à la coopération et aux syndicats). Puis il se fortifie, de 1830 à 1848, dans les sociétés secrètes et avec l’appui de Louis Blanc, Pecqueur, Cabet et Proudhon ; il se formule avec Karl Marx et le Manifeste des communistes, inspire l’Internationale ; enfin, il devient, à partir de 1870, l’objet des plus vives discussions au sein même du parti socialiste ... etc., etc ... »
En ce qui concerne le socialisme collectiviste, ces mêmes lignes, tirées de la même source, à titre documentaire :
« Le socialisme collectiviste a été fréquemment en opposition avec le mutuellisme proudhonien, dont participent les syndicats et les entreprises coopératives. Cependant, les Bourses du Travail, qui caractérisent l’organisation ouvrière en France — comme les trade-unions en Angleterre et les coopératives en Belgique, comme la Confédération du Travail aux États-Unis — ont été considérées, après bien des conflits entre socialistes purs et syndiqués, comme pouvant devenir d’excellents moyens d’organisation socialiste et même de lutte de classes ; toutefois le mouvement syndicaliste et le mouvement socialiste sont loin de pouvoir être confondus. » (Dict. Larousse) (Voir et comparer avec ce que publie sur ces mots notre Encyclopédie Anarchiste.)
Il semble indispensable de reproduire ici encore presque tout l’exposé du Dictionnaire Larousse sur la question qui détermine d’elle-même la théorie de la Socialisation ; car il est nécessaire de savoir d’abord comment les socialistes et tous nos adversaires bourgeois la conçoivent ou la comprennent.
D’après le Dictionnaire Larousse, le Communisme (mis au passé) était une « théorie sociale qui se proposait d’assurer le bonheur du genre humain par l’égale répartition des biens et des maux ». Et dans son Encyclopédie, le Larousse donne encore sur le mot communisme la définition que voici :
« Tandis que le communisme moderne poursuit la transformation de toute propriété privée en propriété sociale, comme corollaire du collectivisme (voir ce mot), lequel vise la socialisation des moyens de production, de circulation, d’échange et de crédit, le communisme ancien voulait étendre ce principe aux objets, même de consommation (vêtements, meubles, aliments, etc.). Ainsi, du premier pas, apparaît son caractère utopique. Aussi bien ne compte-t-il plus que de rares adhérents, et il ne saurait avoir désormais qu’un intérêt historique, purement rétrospectif.
Quant à sa doctrine, la République de Platon dans l’antiquité, l’Utopie de Thomas Morus à l’aurore des temps modernes, la résument tout entière. Mais la première commence par proclamer la nécessité de l’esclavage, admis déjà et maintenu par Lycurgue comme base de sa république aristocratique et l’autre y conduit fatalement. En conséquence, toujours dans ses applications comme dans sa théorie, le communisme se heurte à des contradictions irréductibles, inhérentes tant à la nature des choses qu’à celle de l’humanité. » (etc., etc...)
Suivent des appréciations sur différentes expériences de communisme.
Le Dictionnaire Larousse s’étend sur le mot collectivisme, comme il s’étend sur le mot Socialisme :
« Système philosophique et politique, qui voit la solution de la question sociale dans la mise en commun, aux mains et au profit de la collectivité, de tous les moyens de production : On peut dire que le COLLECTIVISME est le socialisme extrême. » (G. Platon)
Plusieurs disent aussi COMMUNISME (voir ce mot et SOCIALISME. Dict. Larousse).
« Encycl. Politique et Philos. Ce qui, pour les adeptes du collectivisme, caractérise la période capitaliste, c’est la concentration de plus en plus grande des moyens de production en un nombre de mains de plus en plus réduit. Le jour, donc, disent-ils, où, parallèlement à la concentration industrielle, commerciale et financière, actuellement sur le point d’être un fait accompli, se serait reconstituée la féodalité terrienne abolie par la Révolution, ce serait pour les spoliés, le retour au servage et même à l’esclavage antique. Cependant, le remède n’est pas, comme le voudraient plusieurs, dans l’intervention de l’État pour mettre ces moyens, fragmentés à l’infini, à la disposition des travailleurs. C’est un axiome d’économie politique qu’en « produisant peu on produit mal et chèrement, que plus les opérations se font en grand, plus il y a de valeur dans les objets d’utilité, et moins ils coûtent » (A. Franck). Dès lors, en pleine période de production coopérative, avec tendance vers une centralisation toujours croissante des facteurs, vouloir ramener l’industrie moderne à la production isolée, serait faire un pur anachronisme. Et tel est, pourtant, le dilemme en présence duquel on se trouve : soit, pour sauver la liberté, maintenir ou préparer par des lois spéciales le morcellement de la propriété, et cela au profit de quelques citoyens peut-être, mais sûrement au préjudice de la nation, mise ainsi en état d’infériorité vis-à-vis des puissances rivales ; soit laisser s’accomplir la concentration en cours, et par là acheminer les masses à un asservissement définitif.
Dans ces conditions, disent, après Karl Marx, les collectivistes, il n’y a qu’une manière de concilier tous les intérêts : c’est, en conservant à la propriété le caractère désormais collectif qu’elle a d’elle-même revêtu, d’étendre à tous les citoyens, à mesure des possibilités toutefois, et en les proclamant tous co-propriétaires par indivis, les avantages que comporte cet état de choses. Cela, d’ailleurs, à l’instar soit des services publics déjà organisés, soit des sociétés par actions où, de nos jours, chaque participant tire d’une propriété collective les bienfaits de la propriété individuelle. Et là seulement, suivant la doctrine qui nous occupe, est la solution à l’irréductible antinomie que de tout temps on a voulu voir entre l’individu et la société. Deux faits antagonistes dominent la politique humaine et la résument tout entière : les exigences sociales et les besoins individuels. Si donc, ces deux faits sont par leur opposition, la source de tous les bouleversements, il est clair que, de leur harmonie résulterait la pacification désirée. Mais là-aussi, par cela même qu’il est une synthèse, est la raison du double reproche — ses partisans disent « l’éloge » — adressé au collectivisme, tantôt de n’être, philosophiquement, que la forme extrême de l’individualisme, tantôt de sacrifier l’individu à la collectivité.
Toutefois, si rigide paraisse-t-il, le principe ne laisse pas que d’admettre quelques exceptions. C’est ainsi qu’échappe à la socialisation collective la propriété véritablement individuelle, c’est-à-dire celle qui, mise en valeur directement par son détenteur, ne saurait mériter le nom de « capital », la caractéristique de celui-ci, dans la conception marxiste, étant l’exploitation du travail des autres. Lui échappent également les objets dit de « consommation » (aliments, meubles, vêtements, etc.), sur lesquels, dans la mesure où ils sont indispensables à son existence et dans celle surtout où il a rempli le devoir social, tout être humain a un droit imprescriptible, y compris la faculté de les transmettre par héritage. Seule l’appropriation privée des instruments de production (mines, domaines agricoles, usines, etc.) constitue un péril pour la liberté, le citoyen qui en est dépourvu dépendant forcément de celui qui les possède ; seule, par conséquent, elle doit être proscrite.
Quant aux voies et moyens préconisés par les collectivistes, ils découlent spontanément, toujours selon eux, de la nature des choses. D’abord, le capital, cosmopolite par son essence même ayant, grâce à son élasticité, à sa fluidité extrême, fait de la question sociale une question désormais « mondiale », c’est sur le terrain par lui-même choisi qu’il importe de le suivre, si l’on veut le combattre avec efficacité. Autrement, à chaque tentative faite dans un pays donné, par les déshérités pour obtenir plus de justice, il suffirait à ses détenteurs de lui faire passer la frontière pour rendre illusoire toute sanction véritable. D’où nécessité d’une entente internationale des travailleurs ... etc...
Enfin, la conquête des pouvoirs publics par le bulletin de vote ... ou autrement et la révolution, même violente, est la phase terminale de révolution. Elle est inévitable. »
Voilà, en quelques mots, tout le système collectiviste selon les socialistes, tels qu’ils sont compris par le Dict. Larousse.
Tout d’abord, émettons de façon simple et claire, que nous concevons une nouvelle organisation sociale dans le sens absolu de notre idéal libertaire, c’est-à-dire sans contrainte des uns sur les autres, sans dictature aucune et, s’il est possible, sans aucune violence, tout au moins, sans autre violence que celle de la défensive populaire s’opposant naturellement à la violence réactionnaire.
Nous ne nous dissimulons point que la réalisation de nos idées sociales ne peut s’obtenir autrement qu’à la faveur d’un mouvement révolutionnaire. Celui-ci n’est peut-être plus bien loin de s’accomplir. Un vent de mécontentement général souffle sur le vieux système social de l’exploitation de l’homme. Des circonstances économiques toutes particulières nous font percevoir comme une oscillation des choses. On parle de paix et tout le monde croit à la guerre très proche. Cette horreur est sujet de crainte bien justifiée pour beaucoup et sujet d’espoir malsain pour quelques-uns. Qui vivra verra. Mais, en tout état de cause, la Révolution est inévitable. Il importe pour nous qu’elle éclate, cette Révolution, mais nous la voulons sociale et non politique, afin qu’ainsi elle nous épargne la guerre.
A tout prendre, si le sang doit couler encore, il coulera toujours moins dans l’effort immense d’un grand renouvellement du monde, par la formidable révolte des peuples pour une heureuse transformation sociale, que par le choc stupide et criminel des nations s’ingéniant à s’anéantir mutuellement au nom d’immondes entités, au profit d’infâmes intérêts de castes et de classes.
Donc, à l’heure actuelle, bien des gens de divers tempéraments, de diverses origines et de situations sociales opposées songent à la Révolution possible. Les uns l’attendent avec espoir, les autres la redoutent. Tous ont, dans chaque pays, de sérieuses raisons pour cela. En tout cas, que ce soit la guerre qui nous menace ou que ce soit la Révolution, la situation est grave. D’ailleurs, c’est peut-être l’une et l’autre qui s’approchent et c’est sans doute de l’énergie, de la conscience des peuples qu’il dépendra que la Révolution éclate d’abord et fasse avorter la guerre, pour le triomphe du Progrès et de l’Humanité ... Tout dépend de la mentalité populaire.
Le grand souci, le seul raisonnable, pour un révolutionnaire n’est-il pas d’être prêt à toute éventualité et de savoir ce qu’il veut ?
Les anarchistes, les libertaires, les syndicalistes sont d’ores et déjà fixés. S’inspirant du plus horrifiant et du plus récent passé que fut l’expérience de 1914–1918 ils sauront s’efforcer de montrer au Peuple le chemin qui n’est pas celui où les voudront mener encore, par d’ignobles mensonges, leurs seuls ennemis : les politiciens, les gouvernants, les exploiteurs, les profiteurs, les criminels, les bandits et tous les prostitués de la Presse, de l’Armée, du Clergé, de la Bourgeoisie au service du Capitalisme. La première besogne révolutionnaire sera de triompher rapidement, par tous les moyens, des forces d’oppression de l’État et de l’État lui-même. Bien vouloir une Révolution, c’est dèjà la faire. On l’a bien vu ailleurs. Il est donc possible, avec du courage, de l’énergie, de la conviction, du sang-froid et de la volonté, de barrer la route à la guerre par la Révolution. C’est la phase d’action la plus urgente, peut-être la plus dangereuse, on le sait ; mais ce n’est pas la plus longue.
Le moment critique est celui où l’on bouleverse tout un monde déséquilibré dans sa base pour lui substituer, avec intelligence et sûreté, un système social nouveau. Nous avons le nôtre ... Inutile de l’exposer une fois de plus. Essayons plutôt de le réaliser ici de façon théorique, nous réservant de l’appliquer avec toute la foi qui nous anime et l’enthousiasme dont nous sommes capables dans nos efforts d’apostolat et de réalisation, en nous adaptant aux circonstances qui favoriseront notre but.
Nous savons bien pourquoi tout va mal. Nous savons bien pourquoi cela dure depuis si longtemps et comment cela peut finir. Ne serions-nous pas coupables, envers nous-mêmes d’abord, et envers tout le Prolétariat qui gémit, si nous négligions de nous associer à tout effort individuel et collectif susceptible de déclencher la Révolution et de l’orienter vers l’idéal le plus humain, le plus généreux, réalisant pour tous la vraie justice, la vraie concorde, la réelle égalité par l’entente définitive des humains pour instaurer leur bonheur et leur liberté, par l’anéantissement de toute exploitation, de toute tyrannie, de toute autorité ?
Nous ne croyons pas à l’émancipation des Peuples par la Dictature, fut-elle celle du peuple lui-même. Nous voulons l’affranchissement par la Liberté.
Les groupements prolétariens, s’ils ont su prendre la place qui leur revient dans le mouvement révolutionnaire et surtout dans la Révolution sociale que je suppose accomplie, ne devront pas se faire la moindre illusion sur le nombre et l’ampleur des difficultés qui surgiront alors. La tâche sera rude et longue. La dépense d’énergie, de ténacité, de bon sens devant toutes les circonstances qui se présenteront sera énorme. Et les responsabilités à assumer seront évidemment redoutables pour les groupes et pour les individus. Certes, militants, animateurs, conseillers et hommes d’action surgiront avec la même cadence que se succèderont les difficultés. Les succès ou les échecs susciteront la vaillance et le dévouement pour la cause en jeu.
Ce sont les événements qui font éclore les actes d’héroïsme et se multiplier les prouesses. Une Révolution n’est faite que de cela en sa période la plus active. Il n’y a plus place alors pour les timides. L’atmosphère révolutionnaire devient alors irrespirable aux théoriciens défaillants, aux bavards sans conviction, aux orateurs vaniteux, aux bourreurs de crânes, aux conseilleurs équivoques, aux vantards, aux esbrouffeurs, aux critiques pédants, aux pions donneurs de leçons, aux intellectuels manqués, aux savantasses qui s’évanouissent d’eux-mêmes quand l’heure est à l’action. En revanche, des braves, des modestes viendront les initiatives hardies ; les actes de courage, individuels ou collectifs, donneront un élan, une allure, un entrain qui ne seront pas la conséquence d’une folle témérité ou d’un optimisme exagéré, mais simplement d’une mâle assurance devant le danger, d’une confiance sereine dans le succès, d’un sang-froid émanant d’une force intelligemment conduite. Les beaux gestes feront émulation. Ils ne dispenseront pas du soin méticuleux à préparer leur réussite, à calculer leurs chances favorables, leurs effets salutaires. Au contraire, ils seront le fruit de l’étude calme et consciente qui font les décisions sûres et promptes pour chaque entreprise grave dont les risques auront été envisagés et prévus. Les Révolutions précédentes étant, pour les révolutionnaires sincères, un fécond enseignement, ils puiseront dans les plus récentes pour éviter les fautes et les pièges. Ils sauront alors ce qu’il faut juger néfaste à une révolution qui ne doit aboutir ni à un nouvel État ni à une autre dictature. Il faudra bien prouver qu’on peut se passer de la dictature prolétarienne pour garantir l’existence du mécanisme utile à l’activité productrice, aux échanges et à la répartition de toutes les consommations pour tous les consommateurs. Ce n’est ni pour l’État ni par l’État que devra se faire la Révolution.
Sans application de dictature, le Prolétariat s’appuiera sur la conscience collective des masses pour la bonne administration des choses et, certainement, d’instinct, les majorités mettront à la place voulue les individus de capacité reconnue qui assumeront, sans autorité, sans intérêt, par dévouement et compétence, les responsabilités durables ou éphémères aux postes où les placeront la confiance et le jugement des majorités, que ce soit pour la production, l’administration, la répartition, l’organisation. Il n’y aura plus de distinction de fortune ni de privilèges, mais seulement des capacités reconnues, des dévouements, des compétences sollicitées de s’exercer dans l’intérêt général. Le travail indispensable s’accomplira en toute satisfaction par le besoin généreux de se rendre utile à tous et à chacun.
Ainsi s’exercera la Solidarité !
Trop heureux seront ceux qui le pourront, de se rendre auxiliaires précieux de l’émancipation du Peuple, non par orgueil ou vanité, mais par conscience révolutionnaire, par devoir de camaraderie, par dignité humaine. Ainsi, les fonctionnaires feront peut-être le même travail, mais ce sera par zèle intelligent, par bonheur de contribuer à la bonne marche administrative des rouages indispensables à la vitalité de la société ou du groupe.
Le personnel sachant avant la Révolution manier les rouages de l’État bourgeois, sauront également s’appliquer, et de meilleur coeur, à perfectionner le maniement de la société prolétarienne, c’est-à-dire, selon les forces et les besoins de chacun des membres, mis à contribution selon l’âge, la santé, la vigueur, les aptitudes physiques, intellectuelles et morales. C’est dire que le travail, devenu obligatoire par nécessité, s’accomplira sans récompence ni sanction, mais par raison et par plaisir.
Les enfants et les mères, les incapables, les faibles, les malades, les vieillards n’auront aucune difficulté à être reconnus parmi ceux que la société nouvelle se fera gloire et devoir de soigner, de choyer, d’entretenir. Les premiers et les seuls, ils jouiront du repos absolu, des loisirs qu’en toute justice, en toute fraternité leur octroiera la collectivité rénovée par une salutaire et intelligente socialisation.
Imaginons, maintenant, la contre-révolution réduite à l’impuissance, puis, subjuguée, gagnée à la cause révolutionnaire, par la propagande des événements révolutionnaires eux-mêmes ; la contre-révolution jugeant et comparant, se rendant d’elle-même à l’évidence et renonçant alors à tout ce qui fut le Passé. Devant la nouveauté splendide des faits accomplis, devant la générosité des rapports sociaux et devant la perfection relative de l’administration des choses sous le régime triomphant du Bien-Être et de la Liberté institué pour tous, rien de plus naturel que la transformation des idées les plus adverses à la Révolution. Cela se produisit à chaque époque de transformation, au lendemain de chaque secousse révolutionnaire et dans tous les pays.
Il est tout à fait compréhensible qu’il y ait à mesure des transformations sociales tant désirées du Peuple, des transformations d’idées, des changements de mentalité, susceptibles d’affermir la Révolution.
Il ne restera plus au régime révolutionnaire qu’à assurer la continuité de la production et à ne pas manquer de satisfaire un seul instant aux besoins de la consommation. C’est dès le début que se jouera le sort de la Révolution. Lorsqu’elle aura fait la preuve de sa puissance indiscutable dans le domaine économique (et par cela même matériel et sentimental), c’est-à-dire dans l’organisation parfaite de la production et de l’échange, de la répartition et de la consommation, tout le reste s’organisera comme par enchantement ; car la masse, heureuse et satisfaite, n’aspirera plus qu’à consolider son bonheur et assurer son avenir.
C’est d’ailleurs, ce qu’il faudra de toute urgence ; car, inexorable, se posera pour la Révolution et pour les révolutionnaires, le dilemme :
« Vivre ou mourir ! »
La SOCIALISATION, certes, est tâche complexe, ardue, délicate. Pour l’accomplir, en accord avec notre idéal libertaire et nos conceptions du communisme, en tenant compte des théories sociales émises, des expériences faites, il faut savoir réfléchir pour savoir agir.
La Révolution, aujourd’hui comme hier et demain, n’a pas varié dans son but comme elle a pu varier et comme elle pourra varier encore dans ses moyens. Elle se propose toujours comme but : l’affranchissement du prolétariat par la socialisation des moyens de production et d’échange. C’est lorsque sera accomplie réellement cette socialisation intégrale que sera atteint le but de la Révolution. Il ne s’agit pas pour le prolétariat de se rendre maître de la puissance publique après avoir brisé, par la force, les résistances de la bourgeoisie ; il s’agit d’anéantir cette puissance publique et de rendre à jamais impossible le retour au régime actuel de propriété en supprimant la propriété ; de rendre pour toujours impossible le régime d’exploitation de l’homme par l’homme en faisant prendre, en une révolte immédiate, l’usine et la machine par l’ouvrier, et la terre par le paysan qui la cultive. Cela doit se réaliser d’abord et parallèlement — avant même d’en arriver aussitôt à la socialisation des Entreprises et Monopoles.
Tout ce qui est entre les mains de l’État ou entre les mains de particuliers sous forme de compagnies, associations, sociétés, et toutes combinaisons d’exploitation capitaliste, formant actuellement les véritables associations de malfaiteurs encouragées, subventionnées, secourues, protégées, tolérées par l’État, doivent être prises par les travailleurs et pour les travailleurs, selon leur utilité et surtout leur indispensabilité à l’intérêt général de la société nouvelle issue de la Révolution.
Telle est la première étape de socialisation. Et, pour cela, ne pas perdre un temps précieux à faire une politique révolutionnaire, consistant à nommer des comités, sous-comités, commissions, sous-commissions, caricatures de Parlement, de ministères et autres groupes d’atermoiements qui ne valent pas le moindre groupe d’action sachant prendre possession partout de ce qui appartient au Peuple, c’est-à-dire tout simplement au travailleur pour travailler, au producteur pour produire. L’usine et son machinisme, l’atelier et son outillage remis à qui de droit au nom de la collectivité, la voilà vraiment la socialisation que nous voulons opérer en gros et en détail, comme dit la chanson :
Dans son discours inaugural du parti communiste allemand, en décembre 1918, Rosa Luxembourg rappelait les mesures immédiates que préconisait, soixante-dix ans plus tôt, le Manifeste Communiste de Marx et d’Engels :
-
Expropriation de la propriété foncière ;
-
Impôt fortement progressif ;
-
Abolition de l’héritage ;
-
Confiscation de la propriété des émigrés et des rebelles ;
-
Centralisation du crédit entre les mains de l’État, au moyen d’une banque nationale, dont le capital appartiendra à l’État ;
-
Centralisation, dans les mains de l’État, de tous les moyens de transport ;
-
Multiplication des manufactures nationales ;
-
Travail obligatoire ;
-
Combinaison du travail agricole et du travail industriel ; mesures tendant à faire graduellement disparaître la distinction entre la ville et la campagne ;
-
Éducation publique et gratuite, etc ... Tout cela changeait l’État, le fortifiait.
Mais, dès 1872, Marx et Engels reconnaissaient que cette nomenclature avait vieilli et le faisaient remarquer dans la première préface du Manifeste. L’État dont il est question dans le Manifeste ne pouvait être, dans l’idée des auteurs, que l’État prolétarien. Mais il faut tenir compte qu’à cette époque, l’industrialisme n’était pas ce qu’il devint et Rosa Luxembourg avait raison de dire que, depuis 1848, le capitalisme avait pris un développement nouveau.
D’après Grinko, dans son travail : Le Plan quinquennal (Paris, 1930), nous pouvons prendre les pivots sur lesquels repose l’économie soviétique :
« 1° La dictature du prolétariat ; 2° La nationalisation du sol et du sous-sol, des usines, des voies ferrées, des banques, etc. ; 3° Le monopole du commerce extérieur ; 4° La limitation et l’éviction des éléments capitalistes des campagnes. »
Dans un livre récent de Paul-Louis : la Révolution Sociale, pp. 231–232, nous lisons :
« L’idée de la socialisation étant à la base de la Révolution, il suffit de rechercher comment on la réalisera, et il nous paraît superflu de la justifier en insistant sur la fécondité de ses conséquences et sur le bouleversement des rapports sociaux qu’elle impliqua.
La socialisation s’appliquera d’abord à la grande industrie. Pourquoi ? Parce que celle-ci, d’un côté, se prêtera mieux à l’opération et, ensuite, parce qu’en tenant les industries-clés, l’État prolétarien dominera toutes les autres.
Dans les sociétés pourvues de moyens puissants de production, toute une série d’entreprises, par la concentration même qu’elles réalisent, attendent leur confiscation. Rien de plus facile que de faire passer sous la tutelle du pouvoir central les chemins de fer, les hauts fourneaux, les fabriques de produits chimiques, les mines, les services de navigation, etc., et, sous celle du pouvoir municipal, les industries du gaz, de l’électricité, des transports en commun. Il suffira de substituer aux actionnaires et aux conseils d’administration les représentants de l’office d’État ou de l’office municipal. »
C’est aussi l’avis d’Otto Bauer, qui a été, en Autriche, secrétaire d’État au lendemain de la Révolution, puis président du comité de socialisation de l’assemblée nationale. Il indique, dans sa Marche au socialisme (1919) qu’on doit socialiser tout de suite les industries maîtresses, tandis que les industries secondaires ou qui s’exercent sur une surface déterminée seront affermées aux départements et aux communes. Celles qui ne seront pas socialisées immédiatement subiront le même sort par la suite et l’on verra à créer des unions industrielles afin de faciliter la transition. Otto Bauer était, en cela, d’accord avec Kautsky, qui a donné les mêmes définitions et établi la même nomenclature.
Mais il est évident que telle industrie, qui paraîtra moyenne dans un pays, sera grande aux yeux d’un autre. Varga, tout en insistant sur ce point qu’il faut cheminer le plus vite possible, pour briser le pouvoir économique de la bourgeoisie, rappelle qu’en Russie on a socialisé d’abord les entreprises de plus de 70 ouvriers et en Hongrie celles de plus de 20 ouvriers. Ce qui s’explique par l’importance des établissements qui fonctionnaient dans l’État russe en 1919. Il est entendu qu’en cas de révolution, on socialiserait, dans les Balkans, des usines qu’on considérerait insignifiantes aux États-Unis. Plus une industrie sera importante et plus il sera facile de la socialiser, car sa gestion dépendra, non de ceux qui la possèdent, mais de tout un personnel technique qui, en se ralliant à la révolution, lui apportera les moyens d’administrer. Quant aux ouvriers, aucune résistance ne sera à redouter de leur part, en admettant même qu’ils n’aient pas pris, le premier jour, fait et cause pour la révolution. Il n’est pas un pays au monde où ils aient protesté contre le passage de la direction privée à la direction d’État, alors même que cet État était d’essence bourgeoise et, par suite, leur offrait le maximum de garanties.
Mais la socialisation ne devra pas avoir pour effet de transférer une industrie aux mains d’une corporation ouvrière en pleine propriété. L’industrie, quelle qu’en soit la matière, devra revenir à la collectivité des travailleurs. Autrement, on pourrait voir telle ou telle corporation s’arroger des privilèges, dominer la communauté salariée et prélever sur elle des dîmes inacceptables. Il ne s’agit pas de faire don des mines aux mineurs, des chemins de fer aux cheminots, des hauts-fourneaux aux métallurgistes. Nous verrons quel rôle énorme la société nouvelle réservera aux syndicats, et dans la phase d’organisation et dans le fonctionnement normal de son activité, mais elle n’abdiquera pas une parcelle de ses droits. C’est sous son contrôle et au profit de tous que les syndicats géreront les parties du domaine socialisé qui leur seront confiées. »
..........................................................................................................
L’auteur de Révolution Sociale demande :
« Devra-t-on ou non verser une indemnité aux personnes que la socialisation dépossédera ? »
Paul Louis ne s’étonnera point que la question ne se pose pas pour nous, car nous croyons que le volé ne devient pas le débiteur de son voleur quand il reprend ce qui est à lui. Elle ne se pose surtout pas à nous, qui n’entrevoyons nullement une socialisation se bornant à substituer aux exploiteurs capitalistes l’État-Patron, maintenant le salariat et certains privilèges, parmi lesquels l’indemnisation des dépossédés prétendues victimes de la socialisation.
Cela suffit à démontrer l’abîme qui sépare le système de la socialisation des socialistes de celui des communistes libertaires ; ceux-ci estimeront très justement ne rien devoir à d’anciens accapareurs du bien de tous si ce n’est de les loger, de les vêtir, de les nourrir décemment, selon leurs besoins, comme tout individu de la collectivité.
Les socialistes qui ne veulent être révolutionnaires qu’à demi s’embarrassent ainsi dans bien des complications et, par des demi-mesures, arrivent à socialiser sans socialiser tout en socialisant et, considérant les possédants dépossédés comme victimes de la socialisation, ils arriveront à rétablir partiellement la propriété, les privilèges, etc ...
Pour la socialisation du sol, la question sera encore plus ardue si l’on fait entrer la propriété dans la question de socialisation. Que le paysan se loge dans 1e village ou sur la terre qu’il cultive, libre à lui. Le principal est que la terre soit cultivée et qu’elle ne le soit pas pour un, mais pour tous ; ni par un, mais par tous. C’est, là, affaire d’administration communale.
L’accord, l’entente entre travailleurs de la terre fera tout ce qui met en harmonie l’intérêt et le bien-être de chacun avec l’intérêt et le bien-être de tous. Cela est affaire de compréhension de la situation, ainsi que de bonne volonté et de conscience droite. Les libertaires auront leur mot à dire.
En terminant le chapitre « SOCIALISATION » de son livre Révolution Sociale, Paul Louis écrit :
« Lorsque la SOCIALISATION sera achevée, lorsque l’action individuelle sera, à tous les degrés, subordonnée à l’action collective et qu’aucune parcelle de la société ne pourra plus se dresser, par ses convoitises ou son ascendant contre les autres, la révolution sociale sera réelle et totale. Son oeuvre économique, qui commandera toutes les autres en les alimentant, apparaîtra complète. Le monde prolétarien aura remplacé le monde bourgeois, comme celui-ci aura remplacé le monde féodal, mais à la différence de ceux-ci, il aura anéanti la lutte des classes en abolissant l’exploitation des hommes par les hommes. »
Cela paraît très bien, au point de vue socialiste de l’auteur, Paul Louis, dont nous ne suspectons pas la sincérité, mais nous ne croyons pas que la Révolution sociale, réalisant ainsi la SOCIALISATION, aboutisse à cette heureuse conclusion de son chapitre sur la question qui nous occupe.
Il nous est donc nécessaire d’ajouter à cela comment nous concevons la SOCIALISATION LIBERTAIRE, puisque nous savons comment les socialistes conçoivent la leur, aboutissant à la dictature prolétarienne, ainsi que l’accomplit, de nos jours, la mise en pratique du marxisme par la Révolution russe.
Il est bien entendu que la socialisation ne se conçoit possible que par une Révolution sociale, dont elle serait le lendemain, ou la conséquence naturelle. En effet, si humanitaire qu’on puisse être, on ne peut imaginer que la société actuelle puisse ainsi se transformer du tout au tout, autrement que par une plus ou moins forte secousse révolutionnaire. Surtout que la transformation voulue ne consiste pas à maintenir ou solidifier l’État, mais à l’anéantir pour toujours. Donc, pas d’illusion sentimentale : la violence sera une nécessité.
Le caractère que nous désirons voir prendre à la Révolution prochaine est un caractère tout négatif, destructif pour éviter qu’elle ne retombe dans les errements du passé et soit à recommencer un jour. Eh ! oui. Il faut donc qu’elle soit le « premier acte de transformation sociale » ou, si l’on préfère, « le prologue indispensable de la rénovation sociale », laquelle sera aussi profonde et juste que seront justes et profondes les idées et les intentions des travailleurs en leur oeuvre d’émancipation totale.
Ainsi, pas d’équivoque. Il ne s’agit nullement d’améliorer certaines institutions du passé pour les adapter à une société nouvelle, mais il s’agit de les supprimer. Donc, suppression radicale du gouvernement, de l’armée, des tribunaux, de l’église, du commerce, de la banque, et de tout ce qui s’y rattache. Le côté positif de la Révolution consiste en la prise de possession des instruments de travail et de tout le capital par les travailleurs. Expliquons-nous : par un insigne mensonge, les ennemis du peuple ont fait croire aux paysans que la révolution voulait leur prendre leurs terres. C’est le contraire : la révolution veut prendre aux bourgeois, aux nobles, aux prêtres les terres que les paysans cultivent, pour les remettre aux paysans qui n’en ont pas. Si une terre appartient à un paysan, qu’il la cultive lui-même, la révolution n’y touchera pas et lui en garantira la possession, l’affranchissant de toute charge et lui attribuera une autre parcelle si la terre qu’il possède lui est insuffisante. Plus d’impôts ! Plus d’hypothèques sur le possesseur de la terre qui la cultive. Le paysan libre et affranchi par la révolution ... et la terre aussi ! Voilà notre SOCIALISATION.
Sans décrets, sans jugements, sans force de police, sans écrits sur papiers timbrés, la révolution prendra à tous les parasites de la société les terres qu’ils possèdent et les remettra aux paysans qui les cultivent ou leur conseillera de s’en emparer, de s’établir dessus et de les considérer comme leurs propres biens. Aux paysans de s’organiser, de s’associer pour les cultiver et s’en partager les produits. Les paysans russes, à la nouvelle de la révolution et de la déclaration de leur affranchissement, n’ont pas attendu d’ordres pour s’emparer de la terre. Ils ont compris qu’il y avait quelque chose de changé et que l’ordre vrai devait régner pour eux, dans la campagne, comme il régnait, pour les ouvriers, dans les villes où ceux-ci avaient d’abord pris possession des usines.
Le paysan travaillant alors pour lui et n’étant plus exploité, c’est la chose essentielle pour qu’il comprenne la révolution. Cette grande conquête accomplie, le reste s’accomplira normalement par le perfectionnement de la SOCIALISATION, c’est-à-dire par l’étude en commun des paysans pour mettre en valeur de production les terres qui leur sont acquises soit individuellement, soit en association, soit par la mise en commun. Ce sont là questions de détails que, déjà, dans leurs congrès corporatifs, les fédérations agricoles, horticoles, viticoles, etc., ont depuis longtemps étudiées. Les rapports de ces groupements présentés à leurs congrès périodiques par des ouvriers de la terre, de toutes les régions, sont une preuve que l’organisation des paysans ne sera pas plus en retard au lendemain de la révolution que ne le sera celle des exploités de nos cités industrielles, pour mettre en marche, au profit de la collectivité, les usines, les ateliers et les chantiers où s’opéraient tous les genres d’exploitation capitaliste, sous le régime autoritaire et humiliant du patronat et du salariat.
Les unions locales et régionales, départementales et interdépartementales de syndicats divers nous donnent, actuellement, une idée bien claire de ce que l’on peut appeler les communes de producteurs. Le comité de ces unions de syndicats divers n’est pas autre chose, pour nous, en France, que nos unions fédérées.
C’est ce groupement qui donna l’Idée (nous le croyons fortement) à Lénine de l’organisation des soviets.
Lorsqu’éclata la Révolution russe, les masses ouvrières et paysannes n’y étaient pas préparées comme elles le sont en d’autres pays par le syndicalisme et la coopération ; les producteurs et les consommateurs, sous l’Empire des tsars, s’ignoraient mutuellement bien plus que partout ailleurs où il y a aussi des ouvriers et des paysans. Et cependant, animés par des socialistes habiles et des révolutionnaires ardents, sachant mettre à profit les événements formidables de l’époque, on vit alors les masses s’adapter à un idéal social de rénovation grandiose relativement à la situation où se trouvait le prolétariat russe du régime impérial. La dictature du prolétariat a pu s’établir en Russie. Ce n’est pas une raison pour qu’une Révolution sociale ne serve qu’à l’établir en d’autres pays : la France, par exemple, pour qui la révolution peut avoir d’autres buts, plus adéquats à ce que nous entendons, en tant qu’émancipation des travailleurs par les travailleurs eux-mêmes.
Imbus d’idées sociales de justice et d’égalité ; ayant introduit dans nos organisations le principe de la solidarité ; ayant conscience de la dignité humaine, nous ne croyons pas qu’il soit désirable comme but révolutionnaire d’aboutir à une dictature quelconque.
C’est pourquoi nous sommes contre l’État quel qu’il soit ; contre l’Autorité d’où qu’elle vienne ; contre toute Dictature, y compris celle du prolétariat. Cela est clair.
Notre système de SOCIALISATION ne peut donc pas concorder en tous points avec celui des socialistes d’État. Notre doctrine libertaire n’est pas celle qui se conforme à l’évangile marxiste : elle en est le contraire en ce qu’elle n’admet ni l’État, ni l’Autorité.
Telle que nous la concevons, la commune fédérale sera, pour la SOCIALISATION, formée de l’ensemble des travailleurs. Ceux-ci appartenant, avant la révolution, à leurs groupements divers : corporatifs, comme producteurs, ainsi qu’à leurs groupes coopératifs, comme consommateurs et autres groupes sociaux d’idées et de solidarité, savent déjà ce qu’ils veulent et, à cause de cela, ils sont, par la logique des choses, à la tête du mouvement révolutionnaire. Ce sont les événements qui aident, d’eux-mêmes, la propagande (la propagande par les faits, c’est le cas de le dire). L’effervescence du moment fait, par elle-même, le recrutement.
Tout naturellement, chacun de ces groupes a, au comité général d’action révolutionnaire, son délégué. C’est ce qu’en Russie on a appelé « le soviet ». Chaque localité importante a le sien. Ce sont, en somme, des fédérations de producteurs ; fédérations locales, départementales, régionales.
La Fédération des Bourses du Travail voyait déjà, sous l’impulsion fédéraliste que lui donna son secrétaire Fernand Pelloutier, dans chaque Bourse du Travail, l’embryon de la Commune libre des Producteurs au lendemain de la révolution. Plus tard, le successeur de Fernand Pelloutier fit adopter, par un Congrès des Bourses du Travail, la substitution des Unions locales de syndicats aux Bourses du Travail. Celles-ci devenues dangereuses à l’indépendance de l’organisation syndicale ne furent plus qu’un immeuble, une Maison du Peuple, de plus ou moins d’importance ; ainsi fut sauvegardée l’autonomie des syndicats et unions de syndicats. Le principe fédéraliste triomphait ainsi de la main-mise de l’État et des municipalités qui tendaient à enchaîner le Prolétariat. (A ce propos, sont intéressants les rapports fournis aux congrès et conférences des Bourses du Travail ou Unions de syndicats, 1901 à 1912)
Notre union de syndicats, ou fédération, ou soviet, (c’est en somme notre commune fédérale), est constituée afin de pourvoir à tout : production, répartition, échange, consommation, etc. Bien que n’étant pas du domaine exclusif de telle ou telle corporation, mais les intéressant toutes, sont également du ressort de l’administration communale ce qu’on est convenu d’appeler les services publics. Il y a les services publics locaux, départementaux et les services publics d’une portée plus générale, plus étendue, intéressant plusieurs communes et pouvant peut-être un jour les intéresser toutes, comme, par exemple : les Travaux publics, l’Échange, l’Alimentation, la Statistique, l’Éducation, l’Assistance, la Sécurité, l’Hygiène, les Transports, etc. Tenons bien compte qu’il n’y a plus, depuis la révolution, ni gouvernement, ni État.
La SOCIALISATION que nous voulons n’est pas l’application du collectivisme d’État. Notre communisme libertaire ne peut cependant être une sorte de caricature d’un gouvernement local, ni celui d’un groupe autoritaire prétendant agir au nom de tous pour défendre ceci, ordonner cela avec absolutisme et menace, fabriquer des décrets, etc ...
La commune prolétarienne doit administrer, de par la force morale d’un pacte de solidarité conclu entre tous les habitants de chaque localité, égaux en devoirs comme producteurs et, bien entendu, égaux en droits comme consommateurs. C’est la mise en pratique du droit de tous à tout par une sorte d’association de mutualité garantissant le nécessaire d’abord et l’abondance raisonnable à chacun, pour tous les besoins matériels, intellectuels et autres de la vie.
Tel se conçoit le nouveau Contrat social envisagé par le communisme libertaire. En tenant compte des richesses accumulées et non employées par tous et pour tous, par ignorance et mauvaise, injuste, stupide administration des choses, par l’abus et le gaspillage de certains produits et l’ignoble organisation sociale actuelle du régime capitaliste de la société bourgeoise, le Peuple est lésé de son bien-être. Il faut mettre ordre à tout cela administrativement.
Prenons de suite les chapitres qu’il y a urgence de mettre au point pour rendre le Peuple matériellement heureux par une SOCIALISATION intelligente et intégrale.
Travaux publics.
Tous les immeubles d’habitation sont la propriété communale.
Dès le lendemain de la révolution, chacun continue d’habiter, provisoirement, le logement qu’il occupe, à moins qu’il ne soit reconnu (par une commission spéciale), inhabitable et désigné pour la démolition d’urgence. En ce cas, les occupants des taudis et logements insalubres ou incommodes sont installés dans les logements libres dont les occupants opulents ont fui la révolution.
Aussitôt, la fédération du bâtiment, par ses syndicats rayonnant sur tout le territoire, entreprend, au nom de la communauté nationale, la construction d’immeubles ne contenant que logements sains, spacieux, confortables, pour recevoir au plus tôt les familles entassées misérablement dans les taudis infects dont les propriétaires touchaient les revenus.
Chaque commune s’occupera avec ardeur de donner satisfaction en ce sens. Les architectes de la bourgeoisie seront heureux de faire oublier les services rendus par eux aux propriétaires rapaces du régime disparu et mettront au service de la commune leurs capacités techniques, en visant au luxe collectif des immeubles nouveaux et au dernier confort modernisé, selon l’hygiène, pour chaque logement ou appartement. Chaque immeuble aura ses cours et ses jardins, l’air et la lumière, le soleil et la chaleur partout et pour tous.
Avec la construction des maisons et leur entretien, s’activeront la construction des chemins, des rues, des canalisations, des égouts, leur perfectionnement, leur propreté, leur aération, leur arrosage. De l’eau, encore de l’eau, toujours de l’eau ! De l’eau claire, saine en abondance pour la boisson, la cuisine, la propreté.
La SOCIALISATION que nous voulons n’admet pas la demi-mesure en ce qui concerne les choses essentielles à la vie. Ce ne sont pas de dérisoires réformes, de ridicules améliorations d’hygiène, d’intéressées institutions de bienfaisance servant de réclame à des candidats de toutes nuances. Non, c’est un minimum superbe et durable de bien-être pour tous, dans l’habitation aussi bien que dans la ville. De l’eau, de l’électricité partout et pour tous les citoyens égaux. Ce n’est pas la charité qui doit opérer, mais la solidarité pour la satisfaction entière des besoins essentiels de l’existence. Que de choses il y aurait à dire encore ! Mais espérons qu’on saura faire plus qu’on ne pourrait dire. Volonté, ténacité, telles seront les qualités dominantes des révolutionnaires en oeuvre de rénovation et d’intelligente SOCIALISATION.
Échange.
Peut-être sera-t-il nécessaire, pour suppléer à ce que l’on connaît aujourd’hui sous le nom de commerce et pour s’appliquer à réaliser dans un sens salutaire ce qui fut glorifié par la bourgeoisie dans son sens odieux et néfaste (le mercantilisme, l’accaparement, l’agio) d’établir, dans chaque commune, un comptoir d’échange. Cela fait partie du rouage économique. Il serait trop long d’expliquer en détail le mécanisme de l’échange, qui sera certainement une simplification honnête et claire du commerce actuel.
Par exemple, les associations de travailleurs, ainsi que les producteurs individuels (d’ailleurs très rares) déposeront leurs produits au comptoir d’échange établi dans chaque commune fédérée. Fixée d’avance par une convention entre fédérations corporatives régionales et les différentes communes, la valeur de ces divers produits aura été évaluée au moyen des données que fournira la statistique. Le comptoir d’échange remettra aux producteurs des bons d’échange représentant la valeur de leurs produits. Ces bons d’échange auront la faculté de circuler dans toute l’étendue du territoire de la fédération des communes.
C’est au comptoir d’échange que les travailleurs qui produisent, par leur travail, des choses non transportables, comme des édifices d’habitation, de plaisance ou d’utilité dans les rues, places, jardins, squares, parcs, etc., feront enregistrer leurs divers travaux estimés d’avance et ils en recevront la valeur en bons d’échange. Les travaux qui consistent en services rendus, en entretiens de choses diverses, en ornementations ou réparations de choses publiques seront également tarifiés d’avance et payés en bons d’échange.
Le comptoir d’échange a aussi pour fonction de recevoir des produits, de les échanger contre d’autres produits avec d’autres communes. (Ce ne sont, positivement, que des hypothèses).
Enfin, nos coopératives actuelles sont toutes désignées pour établir facilement le bon ordre dans cette branche de vitalité sociale. Et ceci rentre dans les rouages de l’harmonie qui existera entre la production, la consommation, la répartition, l’échange. Les grands magasins sont un exemple de possibilités de circulation des marchandises avec, en moins, la complication de faire des bénéfices malhonnêtes dont le producteur est d’abord la victime et le devient encore une fois comme consommateur, puisque, de toutes les façons, sous le régime actuel, reste terriblement vrai le jugement approfondi, mais irréfutable de Proudhon : « Le commerce, c’est le vol ». Le système d’échange ainsi compris n’est qu’une opinion émise sur ce qui se pourra faire après la Révolution pour la répartition des produits et l’évaluation du travail et sa rémunération par le comptoir d’échange. Mais il y a, sans doute, d’autres méthodes plus neuves et plus pratiques dont la société actuelle nous donne l’enseignement par ce qu’il faut imiter d’elle et surtout par ce qu’il faut ne pas imiter. La SOCIALISATION fera mieux.
Alimentation.
Ce que nous venons de dire de l’organisation du comptoir d’échange s’applique à tous les produits et particulièrement à ceux de l’alimentation. Mais, là encore, c’est la coopérative de consommation qui nous servira d’indication. On y est « à la page », dans la société actuelle, pour remédier à bien des choses scandaleuses inhérentes au petit et au gros commerce. A plus forte raison, l’action coopérative s’exercera-t-elle dans le milieu social transformé.
Si tous les producteurs avaient compris l’utilité, pour eux, d’être coopérateurs, comme ils ont à peu près compris la nécessité d’être syndicalistes, la coopération eût pu faire beaucoup plus et beaucoup mieux qu’elle n’a fait. Mais, les uns par négligence, par veulerie, ne se donnent pas la peine d’adhérer à ce qui est de leur intérêt immédiat. Ils dédaignent les arguments du militant coopérateur qui sollicite leur concours, leur initiative, leur solidarité et leur responsabilité ! C’est trop de faire par soi-même et pour soi-même. Il est plus facile de protester contre la vie chère et de compter sur ses candidats et sur ses élus, que de faire ses affaires soi-même. Cependant, il était de toute logique sociale de se défendre de l’exploiteur et de préparer sa disparition au syndicat et de s’affranchir des mercantis et des saboteurs d’aliments en devenant coopérateur. Le salariat est la dernière forme de l’esclavage, mais la mentalité d’esclave de beaucoup de travailleurs est bien la cause de sa durée. Le voleur commerçant peut continuer son métier, il est considéré, protégé et ceux qu’il vole et empoisonne continuent d’augmenter quand même sa clientèle plutôt que de s’associer avec d’autres volés pour faire venir directement du producteur la marchandise indispensable à sa vie et participer ainsi à la répartition à meilleur prix, à meilleure qualité, au contrôle et à l’avantage du consommateur coopérateur. De plus, c’est à la coopérative que se fait aussi l’enseignement et que s’acquiert l’expérience de l’administration des choses, si imparfaite que puisse être la coopérative de consommation. D’ailleurs, on est toujours mal venu de dire qu’une institution d’essence prolétarienne est mauvaise, quand, stupidement, on la dédaigne et qu’on ne fait rien pour contribuer à sa bonne marche, à son amélioration. Ce ne sont pas ceux-là qui favoriseront la révolution. Ils la subiront et en profiteront.
Toutes les denrées alimentaires : boulangerie, boucherie, fruits, légumes, boissons, denrées coloniales sont abandonnées à l’industrie privée et à la spéculation qui, par des fraudes et falsifications, s’enrichissent sans vergogne aux dépens du consommateur. La société nouvelle aura pour devoir de substituer à pareil état de choses le service communal public pour tout ce qui concerne la distribution des produits alimentaires de première nécessité, ou de laisser aux coopératives de consommation composées de travailleurs, sous une forme adéquate aux idées nouvelles, le soin d’organiser, selon les besoins sociaux nouveaux, la répartition équitable des marchandises en très bon état, en parfaite qualité, à tous les consommateurs, suivant la méthode admise par la commune.
Il est probable que la commune se dispensera de l’acquisition de certaines branches de la production proprement dite qu’il sera peut-être utile de laisser entre les mains de producteurs associés. En ce qui concerne le pain, la production consiste en la culture et la récolte du blé. Le laboureur qui a semé et récolté le grain l’apporte au comptoir d’échange : là s’arrête la fonction du producteur. Mais la réduction du blé en farine, puis la transformation de la farine en pain, ce n’est plus de la production : c’est un travail, c’est un métier, mais c’est un emploi, analogue à beaucoup d’autres, consistant à mettre un produit alimentaire : le blé, à la portée des consommateurs. Il en est de même pour la viande : le paysan élève et nourrit le bétail, puis, quand il l’a rendu propre à la consommation, il l’amène au comptoir d’échange. Le boucher fait le reste. Sa fonction est aussi analogue à celle, non pas d’un producteur, mais d’un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. De même, encore pour le vin : le producteur est le vigneron qui l’apporte au comptoir d’échange, ensuite, ce ne sont plus des producteurs, mais des intermédiaires qui le préparent et le distribuent aux consommateurs.
Aussi, est-il logique de faire entrer ces diverses branches de l’alimentation dans les attributions de la commune. En conséquence, le blé, dans les magasins communaux, sera réduit en farine au moulin communal ou intercommunal, la farine transformée en pain dans les boulangeries communales et le pain livré par la commune aux consommateurs. De même pour la boucherie : abattoirs et boucheries de la commune. Pour les vins : caves communales, etc. Les autres denrées alimentaires seront conservées dans les magasins, prêtes à être livrées par la commune aux consommateurs qui viendront les chercher ou qui en commanderont livraison.
Ce ne sont encore que des hypothèses, car il y aura des perfectionnements que le progrès et la nécessité commanderont et que n’entraveront ni la concurrence, ni les privilèges.
Une fois de plus, les coopératives seront utiles à la parfaite SOCIALISATION en tout et pour tout.
Statistique.
Inutile d’insister ici sur les avantages d’une organisation socialisée de la statistique, qui fournira à tous et sur tout les renseignements utiles donnés par la commission communale de statistique. Elle sera copieusement alimentée par les diverses corporations et associations de producteurs sur le nombre de travailleurs occupés dans chaque branche de l’industrie, sur la production accomplie et sur les hausses et les baisses de produits, selon la quantité de matières premières fournies. Ce sera le baromètre de toute la production générale ou partielle, mise en balance avec les besoins de la consommation. On saura s’il y a lieu d’augmenter ou d’abaisser la production. On saura qu’il faut l’accroître ici et la réduire là. De cette façon, pour ne pas augmenter la fatigue des ouvriers de telle localité, on adjoindra à ceux-ci les ouvriers disponibles de telle autre localité où se peut diminuer la production. C’est avec la statistique que se pourra parfaire, au mieux des intérêts de la commune, la SOCIALISATION toujours en cours jusqu’à l’harmonie complète des communes fédérales, constituant le nouveau régime de bien-être et de liberté des travailleurs émancipés par la Révolution sociale également toujours en cours de perfection, visant au mieux-être définitif.
La statistique suppléera à toutes les paperasseries, multiples jusqu’à l’extravagance, qu’accumulaient les archives bourgeoises. L’état civil ne fonctionnera plus solennellement et bêtement comme autrefois : naissances et décès seront seuls enregistrés ; mais les mariages n’existeront plus, car, dans une société libre, l’union volontaire de l’homme et de la femme ne sera plus acte officiel mais acte absolument privé entre amants : cela ne regardera qu’eux ; seuls, les enfants nouveau-nés seront enregistrés, si cela est nécessaire, avec les noms de leur père et mère, à moins que la société nouvelle ne prenne soin d’eux dans des conditions tout à fait louables et dignes d’une société de travailleurs heureux, libres, fiers et pacifistes n’aimant que le travail et la vie rendue belle et bonne.
La statistique s’occupera de la santé publique et consignera toutes les observations scientifiques utiles à tous.
Éducation.
Sur un tel sujet, la SOCIALISATION devra d’abord considérer l’entretien des enfants. Leur nourriture et leur éducation sont abusivement, et par préjugé, à la charge des parents qui ne sont pas toujours à même de remplir une telle charge. C’est, d’ailleurs, en s’appuyant sur un principe faux — qui a toujours fait considérer l’enfant comme une propriété, — la propriété des parents. Il y eut le patriarcat où le père avait droit de vie ou de mort sur chacun de ses enfants. Vienne le matriarcat et la mère sera propriétaire, seule, de ses enfants. Or, l’enfant ne doit être la propriété de personne : il s’appartient à lui-même et, ne pouvant d’abord se protéger lui-même, cela paraît juste qu’il soit laissé à l’amour de ses parents quand ceux-ci peuvent pourvoir entièrement à ses soins. Mais il est inique de voir l’enfant laissé à des parents malheureux et augmentant leur misère et devenir lui-même malheureux dès sa naissance parce que la loi le veut ainsi.
La SOCIALISATION a pour premier devoir de protéger l’enfant et de lui assurer la garantie de ne rien manquer de ce qui est nécessaire matériellement et moralement à son libre développement.
La société doit pourvoir à tout pour l’enfant : son entretien, son éducation, son apprentissage, son instruction ; même son épanouissement de jeunesse doit être un sujet de soins et de sollicitude pour la société qui tient à faire de lui un homme fier et digne, un travailleur intelligent et consciencieux, redevable à la communauté sociale de ce qu’il aura été et de ce qu’il peut devenir.
Voilà ce que la SOCIALISATION doit faire.
Il y a toute une méthode d’éducation de l’enfant qu’il serait trop long de développer ici, d’autant qu’on peut se reporter à chaque mot intéressant, contenu en cette Encyclopédie, comportant l’étude et le développement qu’il convient. (Voir École, Éducation, Ruche, etc ... ).
Mettre l’entretien matériel, intellectuel et moral de l’enfant à la charge de la société, ce n’est pas comme l’ont prétendu certains réactionnaires « détruire la famille », c’est au contraire l’améliorer et fortifier la société et garantir la personnalité de l’enfant. Avant tout, l’enfant ne doit pas être une chose, mais quelqu’un qui n’appartienne qu’à lui-même. L’éducation doit être ainsi comprise par la SOCIALISATION.
Assistance.
Il ne s’agit pas, on le pense bien, d’oeuvres de charité publique ou privée, mais d’institutions au moyen desquelles la société nouvelle s’acquittera des dettes de la société ancienne, réparera ses fautes envers les indigents, les malheureux, les tarés moraux et physiques, les infirmes, les mutilés, les estropiés, en un mot, tous les êtres victimes de la société bourgeoise, hypocrite, égoïste et brutale. Assurer l’existence, le bien-être, l’entretien des enfants, des malades, des vieillards. Rendre à tous la vie douce et supportable en faisant à tout jamais disparaître les causes de ces mauvais effets. Il va de soi que pour l’établissement de ces institutions, les communes ne négligeront ni leurs initiatives, ni leur activité. Elles se prêteront mutuellement appui pour réaliser partout le mieux possible.
De même que l’enfance a droit au soutien permanent, à l’éducation, à la sollicitude éclairée de la commune, de même ont droit aux soins, à tous les soins, les incapables de tout travail, les malades et les vieillards des deux sexes.
Il est certain qu’en cette rénovation sociale, le sort de la femme de tout âge réalisera la conception la plus haute, la plus fraternelle de la solidarité, magnifiera la femme et lui assurera pour toute la vie en toutes circonstances son droit au bonheur, comme son droit à l’amour en toute liberté ! La société, d’ailleurs en retirera tout le bénéfice, puisque la femme sera la cause même du plein épanouissement du bonheur et de la liberté pour tous. Elle sera le symbole vivant de l’apaisement social, de la félicité humaine.
Hygiène.
Le bon fonctionnement des services publics étant indispensable au maintien de la santé de tous les membres de la commune, celle-ci s’appliquera à ce que tous les citoyens libres de la commune puissent facilement participer à tous les avantages des services mis à leur disposition, sans aucune autre obligation de leur part que de veiller à leur entretien et à leur bon fonctionnement, en toute intelligence et en toute conscience. Pour des hommes libres, cela va de soi. Mais il se peut qu’il y ait, par ci, par là, des négligences, des gamineries individuelles portant préjudice à la collectivité. Une aimable observation doit alors suffire, car les sanctions sont abolies. On fait appel à la raison en tout et pour tout, dans une société libre qui doit ignorer la crainte ; les châtiments, les menaces et même les humiliations n’ont plus cours.
La fonction principale de l’hygiène est de prévenir la maladie, d’éviter ses causes aussi bien au point de vue personnel qu’au point de vue collectif.
Cette question d’hygiène a une grande importance dans la SOCIALISATION. Bien souvent, elle se greffera sur les questions de travaux publics et d’éducation. Les habitudes de propreté font partie de l’éducation. Les buanderies communales, les piscines communales s’y enchaînent également. La natation fait partie de l’éducation comme le blanchissage fait partie des travaux publics. Car ce n’est pas au siècle où nous sommes qu’on ne profiterait pas des avantages merveilleux du progrès, dans le machinisme et l’outillage, pour cesser de nettoyer, laver, cuisiner, jardiner de façon primitive.
Avec la SOCIALISATION, ce qu’une commune n’aurait pas, sa voisine l’aurait et les services intercommunaux seraient habituels et preuves de sympathie mutuelle dans les communes fédérales.
En dehors de tous préjugés, la commission d’hygiène de concert avec celle des travaux publics, nous l’avons dit, s’occupera de la distribution équitable, abondante si possible, de l’eau potable assainie par les stérilisateurs les plus salutairement perfectionnés.
Cette commission d’hygiène s’occupera (toujours avec la commission des travaux publics), des abattoirs, des égouts, de l’incinération (qui, peu à peu, se généralisera) et des cimetières qui resteront encore en certaines communes (où les préjugés n’auront pas complètement disparu), car on laissera la liberté sur ce point là, en attendant que se meure d’elle-même la religion des morts... En vérité, tout cela est réalisable et l’avenir est radieux.
Sécurité.
La commune assurant à tous ses habitants la sécurité de leur personne, des mesures seront prises pour les protéger comme le sont les bâtiments, édifices, parcs, jardins, squares, etc., contre toutes déprédations possibles et tous accidents. Les causes de violence contre les personnes et les meubles et immeubles n’existant plus, s’il surgissait, par hasard, quelque fou, le plus accéléré des secours aurait vite paré au danger en maîtrisant doucement, mais sûrement, le malade et le confiant, inoffensif, aux bons soins, dévoués et expérimentés de médecins spécialistes dans un asile modèle de confort et d’humanité.
Police et tribunaux seront transférés au grenier communal des antiquités sociales. Les chômeurs de cette catégorie se rallieront à la révolution.
Transports.
Pour l’utile et l’agréable, ce que la commune ne pourra pas instituer, débordée par l’urgence d’institutions nouvelles et le perfectionnement incessant des oeuvres d’utilité sociale, des groupements spéciaux, de libres initiatives y suppléeront avec plaisir et entrain. Comme des champignons délicieux poussent autour d’un tronc d’arbre superbe et puissant, on verra naître de multiples groupements de jeunes gens et jeunes filles ayant comme but de se distraire, de s’instruire, de s’entr’aider, de s’aimer et de s’entraîner, en une belle émulation, à rendre leur vie plus belle par les arts et les sciences, les études, les excursions, les conférences. Les uns, selon l’âge, apportant leur expérience, les autres leur enthousiasme, leur désir de plaire, portant partout et en tout fraîcheur et jeunesse. Les moyens de transport seront mis à leur disposition quand il y aura du matériel disponible et ils se déplaceront très souvent pour échanger partout leurs sentiments de sociabilité, de gaîté, d’amour du beau et du bien. En quelque sorte, les moyens de transport seront utilisés à porter vers les coins les plus retirés les bienfaits obtenus par la socialisation. Ils enseigneront partout les beautés du communisme libertaire et susciteront le désir de le connaître et de l’appliquer chez ceux qui l’ignoreront.
C’est un sentiment de progrès qui règnera dans le monde. La commune mettra à la disposition des groupes d’initiatives non seulement les moyens de transport mais encore des locaux, des moyens de publicité, des matériaux et tout l’outillage nécessaire pour les plus sérieuses expériences, pour les plus vastes entreprises. Ainsi, en marge de la vie collective, en dehors des quelques heures quotidiennes consacrées au travail commun, voilà ouvertes, aux jeunes surtout, les grandes voies du progrès matériel, intellectuel, artistique, scientifique d’un avenir longtemps cherché, désiré.
On ne parle plus de propriétaires ni de propriétés. La propriété est sociale. On ne parle plus de patronat ni de salariat : les associations ouvrières, librement, ont organisé le travail. Elles l’ont rendu agréable, délassant, salutaire, d’accomplissement aisé, attrayant, nécessaire. Nul ne s’y soustrait. Pour la production et pour la consommation, toutes les formes de coopération sont utilisées, après discussion, par le groupe de socialisation qui est vraiment le groupe de la coopération des Idées.
Et la révolution est faite ! Et sans exagération optimiste, car la SOCIALISATION est accomplie.
Toutefois, on ne cesse de faire encore, dans toutes les communes fédérées, une guerre à mort aux préjugés dont l’ancienne organisation sociale a infecté le monde ! Mais il n’y a, parmi les humains, ni morts ni blessés. Une à une, s’effondrent sous le raisonnement, par l’éloquence des sincères et leurs arguments persuasifs, toutes les stupidités, toutes les idées néfastes, conservatrices de traditions mauvaises et d’institutions dangereuses et surannées !
C’est vers l’avenir, c’est vers la vie que tendent les volontés, les cerveaux et les coeurs. On sait maintenant que le Bien-Être et la Liberté ne sont acquis que par l’énergie des conquérants, par leur union dans l’action, par leur entente et leur solidarité !
Nous avons suffisamment exposé notre façon de comprendre la révolution au moment précis de la SOCIALISATION.
Revenons à nous. L’avenir entrevu sera peut-être beaucoup mieux encore dans la réalité. Ce que nous voulons, nous le savons. C’est pourquoi il nous faut maintenant revenir au présent et travailler en conséquence pour notre Idéal de société communiste, fédérale, libertaire. Continuons notre lutte en faveur de toute idée, de toute action où se trouvent des promesses d’avenir. Disons-le et prouvons-le : une société libertaire peut s’établir dans le monde et vivre sans exploitation, sans autorité, sans gouvernement, sans État, sans dictature, par l’entente libre des producteurs-consommateurs. C’est peut-être demain la révolution et, après-demain, la socialisation et notre idéal réalisé.
— Georges YVETOT.
SOCIALISME, COLLECTIVISME, COMMUNISME
n. m.
Il n’y a pas de mot plus internationalement répandu que celui de socialisme : il n’y en a guère dont l’origine soit moins certaine, et peut-être ne saura-t-on jamais bien où, quand et par qui le mot fut introduit dans la circulation verbale. Est-il sorti en 1833 — « néologisme nécessaire pour faire opposition à l’individualisme » — du cerveau fumeux de Pierre Leroux ? A-t-il été « emprunté à l’Angleterre » par Louis Reybaud ? A-t-il été forgé, comme l’énonce, sans preuves, Ch. Verecque, par Robert Owen vers 1820, pour définir « l’arrangement social rationnel », puis importé en France par les saints-simoniens ? Des minutieuses recherches de Gabriel Deville, publiées en 1908, il résulte : a) que le mot socialisme aurait fait son apparition dans le Semeur, du protestant vaudois Rod-Vinet (n° du 23 novembre 1831) ; b) que le mot socialiste aurait paru pour la première fois dans la Réforme industrielle de Fourier (n° du 12 avril 1833) ; c) que le mot socialisation se rencontre dans le Globe saint-simonien (29 juin 1831), et dans le Journal des Sciences morales de Bauchez (7 octobre 1831).
La question en est là, mais ce dont on est sûr, c’est que le mot socialisme est, dès le début, appliqué à la doctrine de ceux qui, à partir de 1831, s’efforcent de substituer à la notion d’une réforme politique, d’un changement des formes gouvernementales, la notion d’une réforme sociale, affectant les bases mêmes de la société. Cependant son immense fortune ne date que du jour où Louis Reybaud publia ses bruyantes Études sur les réformateurs ou socialistes modernes, — c’est-à-dire sur Saint-Simon, Fourier et Owen.
Ces réformateurs, Reybaud aurait pu les nommer communistes. Il ne l’a pas fait. Les mots communisme, communistes, s’appliquant aux systèmes et aux hommes qui nient le droit de propriété, existaient depuis des siècles. Mais ni Saint-Simon, ni Fourier, ni Owen ne voulaient abolir la propriété privée. Ils n’étaient pas communistes. Individualistes moins encore. La qualification de socialistes tranchait en quelque sorte la difficulté.
Longtemps on distingua le socialisme, pris dans cette acception restreinte, du communisme. Le premier ne faisait peur à personne ; le second était subversif et farouche. Aux environs de 1848, on appelait socialistes d’abord les sectateurs des divers systèmes utopiques, ensuite tous les marchands de panacées sociales qui voulaient supprimer la misère « sans faire le moindre mal au capital et au profit ». Tandis que les communistes réclamaient, au nom de la classe ouvrière, un bouleversement profond des conditions sociales : icariens en France, weitlingiens en Allemagne et en Suisse.
« Le socialisme signifiait, en 1847, un mouvement bourgeois, le communisme un mouvement ouvrier. »
Puis les acceptions se brouillèrent. Les sectes disparues, le mot socialisme perdit son sens initial : on l’appliqua indifféremment à toute doctrine, tout mouvement, tendant à transformer l’ordre social. Toutefois, le socialisme comportait bien des variétés : il avait ses opportunistes et ses radicaux. Au sein de la première Internationale, les partisans du socialisme anti-autoritaire et fédéraliste de Bakounine, voulant se distinguer des communistes marxistes, prirent, un jour, le nom de collectivistes.
Mais le collectivisme, à son tour, devait changer de sens. Lorsque Guesde, vers 1880, l’adopta, ce fut pour en faire l’équivalent exact de communisme. Ce que voyant, les derniers collectivistes de l’Internationale, qui allaient devenir les premiers anarchistes (les Kropotkine, les Reclus), cessèrent de s’appeler collectivistes : ils prirent l’étiquette de communistes-anarchistes.
Dès lors, jusqu’à la Révolution russe, socialisme, communisme, collectivisme confondent pratiquement leurs acceptions. Socialisme prévaut dans la langue courante. La plupart des partis ouvriers qui se forment, après 1875, sur les ruines de l’Internationale s’intitulent socialistes ou démocrates-socialistes (social-démocrates). Communisme et collectivisme désignaient plutôt la forme de société à la réalisation de laquelle travaillaient les partis ouvriers. Socialisme s’entendait de préférence du mouvement, communisme et collectivisme du but final. Le pacte d’unité du 13 janvier 1905 disait, par exemple :
« Le P.S., est un parti de classe qui a pour but de transformer la société capitaliste en une société collectiviste ou communiste. »
Mais quand, en mars 1919, les bolcheviks fondèrent la IIIe Internationale, ils lui donnèrent le nom d’Internationale communiste, et tous les partis affiliés durent s’intituler partis communistes. De nouveau, comme aux abords de 1848, communisme et socialisme s’opposent, l’un avec une acception révolutionnaire, l’autre avec une acception plus ou moins teintée de réformisme.
Disons que noue n’acceptons pas cette acception purement formelle. Le socialisme, tel que nous l’entendons ici, est, comme le « communisme » lui-même à la fois révolutionnaire et réformiste. Révolutionnaire par le but et, à l’occasion, par les moyens ; réformiste parce qu’il voit dans la conquête d’un certain nombre de réformes à tendance socialiste un prétexte excellent pour agiter les esprits et mobiliser les masses. Le socialisme, tel que nous l’entendons, repousse donc bien haut les flétrissures dont le néo-communisme — qu’il serait plus séant d’appeler bolchevisme — ne cesse pas de le couvrir. Il est et restera, comme le Temps l’en accuse chaque jour avec la clairvoyance de la haine, un parti « essentiellement marxiste » de lutte de classe et de révolution. Les fautes et les erreurs que peuvent commettre tels ou tels socialistes en délicatesse avec leur parti, ne sauraient prévaloir contre la force de ce fait. Le socialisme, ce n’est ni « Montagnon » ni « Marquet » ; c’est une classe en marche vers le bien-être et vers la liberté. Montagnon et Marquet passeront ; le socialisme ne passera pas et sa réalisation, exigée par le développement historique, peut être considérée comme certaine.
Socialisme et Marxisme.
Ce qui précède indique que nous laisserons de côté tous les pseudo-socialismes qui ont paru depuis bientôt un siècle. Tous les doctrinaires qui, depuis 1848, ont critiqué le laisser faire et ses abus, ou fait appel à l’intervention de l’État. ou conclu à l’urgence de réformes sociales plus ou moins radicales, ont été qualifiés de socialistes. On a vu naître ainsi les socialismes les plus divers : les uns essentiellement conservateurs, comme le socialisme de la chaire, également dénommé socialisme d’État ; les autres à préoccupations religieuses, comme les socialismes chrétiens ; d’autres, enfin, comme le socialisme agraire, le socialisme municipal, le socialisme coopératif, n’étaient guère que des démembrements du socialisme traditionnel. Nous étudierons le socialisme sous la forme achevée — classique — que lui ont donnée, entre 1871 et 1914, les partis de la Ile Internationale et dont le bolchevisme lui-même n’a pas sensiblement modifié les grandes lignes. Nous passerons très vite sur les fondements théoriques du socialisme. Nous les avons étudiés, plus haut, au mot Marxisme. Le marxisme est constitué, avons-nous vu, par trois théories essentielles superposées :
-
Théorie matérialiste de l’histoire. — Elle peut se résumer ainsi :
-
ce ne sont pas les idées que l’homme porte en lui qui « mènent le monde », mais des nécessités, d’abord économiques, auxquelles l’individu ni la société ne peuvent se soustraire, et qui le contraignent à produire incessamment pour vivre et à s’organiser pour produire davantage et mieux ;
-
les « modes de production » déterminent la structure matérielle (entre autres la division en classes) et le développement intellectuel des sociétés : « Les lois de l’économie politique, dit de son côté Proudhon, sont les lois de l’histoire », (Création de l’Ordre, p. 308) ;
-
l’antagonisme des classes joue, dans l’évolution historique, un rôle prépondérant : « L’histoire de toute société jusqu’à nos jours n’a été que l’histoire de luttes de classes » (Marx et Engels) ;
-
-
Théorie de la révolution prolétarienne. — Le socialisme ne se réalisera pas nécessairement parce qu’il est juste, mais :
-
parce que le mode de production capitaliste le contient pour ainsi dire en puissance ;
-
parce qu’il est conforme à l’intérêt général des prolétaires, que la socialisation des moyens de production, seule, peut arracher à l’infériorité du salariat. La lutte du prolétariat contre le régime capitaliste a donc le socialisme pour terme. Prolétariat et socialisme, s’appuyant l’un à l’autre, triompheront l’un par l’autre de la bourgeoisie et du capitalisme ;
-
-
Théorie de la production capitaliste. — Elle éclaire les dessous économiques de la société actuelle. Partant d’une notion de la valeur qui fonde celle-ci sur le travail, elle explique comment la bourgeoisie, détentrice des moyens de production et d’échange, s’enrichit du travail non payé (surtravail, plus-value, profit) qu’elle impose à la classe salariée ; comment l’accumulation du capital, c’est-à-dire de la plus-value, dans les mains de la minorité possédante creuse entre celle-ci et la majorité non-possédants un fossé de plus en plus infranchissable ; et comment, enfin, le Capital, qui est sorti de l’expropriation brutale ou lente de la masse des petits producteurs propriétaires, sera à son tour exproprié, non pas au profit de quelques-uns, mais au profit de la collectivité tout entière.
Par sa supériorité théorique évidente, le marxisme s’est peu à peu imposé au mouvement ouvrier dans tous les pays. Il a éliminé les théories plus ou moins utopiques qui prévalaient avant lui. Il a appris aux travailleurs la nécessité de l’organisation, la nécessité de la solidarité internationale, la nécessité de la. révolution, de cette révolution dont la conquête du pouvoir politique par le prolétariat sera la condition et le prélude.
Le socialisme est donc comme le prolongement pratique du marxisme doctrinal. Il est à ce dernier ce que l’action est à l’idée, ce que l’industrie est à la science.
I. — APERÇU HISTORIQUE.
Origine du Socialisme moderne.
De tout temps, la propriété privée a été discutée et de hardis penseurs, posant et résolvant le problème social dans l’abstrait, ont conclu à la supériorité du communisme. Rappelons Platon, Th. Morus, Campanella et, au XVIIIe siècle, les Mably, Morelly, Meslier, Godwin, etc .... Le socialisme moderne ne provient pas de là. Il est sorti, par élaboration progressive, de la révolution industrielle et de la révolution politique qui se sont produites en Angleterre et en France, entre 1760 et 1848 (ces dates sont approximatives) et qui ont introduit un nouveau mode de production et de propriété (le capitalisme), ainsi qu’un nouveau mode de gouvernement (la démocratie) En même temps, elles donnaient le pouvoir à la classe capitaliste (bourgeoisie) et faisaient surgir une classe nouvelle, celle des ouvriers salariés (prolétariat).
Le prolétariat commence à s’affirmer en France dès la Révolution : il est de toutes les grandes « journées » ; avec les Enragés, il revendique l’égalité, c’est-à-dire l’abolition des classes, le droit des sans-propriété à la vie. Ce sont surtout ses revendications (et celles de la petite bourgeoisie) que Babeuf (1796–97) tentera d’exprimer.
La tradition babouviste se transmet, par Buonarroti, à Blanqui et aux sociétés secrètes d’avant 1848. Elle n’imprègne d’ailleurs qu’une mince couche de prolétaires. Le prolétariat, qui s’augmente sans cesse d’éléments nouveaux venus des campagnes, s’éveille à peine à la conscience. C’est (comme en Angleterre) dans les sociétés corporatives (d’ailleurs illégales) qu’il a tendance à se grouper ; c’est par des coalitions (durement réprimées) qu’il résiste, sans souci d’idéologie, aux empiètements de l’exploitation capitaliste.
Cependant les désordres issus de la grande industrie, les méfaits de la concurrence frappent l’attention de certains penseurs (Sismondi), dont quelques-uns vont s’élever jusqu’à la critique de l’ordre social nouveau (Saint-Simon, Fourier, en France ; R. Owen en Angleterre). Ils édifient dans le silence du cabinet des systèmes sociaux complets et forment des disciples enthousiastes. Leurs plans de reconstruction sont aujourd’hui oubliés, mais une partie de leurs observations critiques et de leurs matériaux a passé dans le socialisme moderne (origine saint-simonienne de l’idée d’antagonisme des classe).
Dans le parti républicain d’après 1830, le régime capitaliste a de nombreux détracteurs qui, sachant parler au peuple, ont sur lui une grosse influence. Louis Blanc prêche l’organisation du travail (associations de production commanditées par l’État) ; Cabet va du républicanisme au communisme, qu’il entend réaliser par des colonies du genre de celle qu’il a décrite dans son fameux roman d’Icarie : communisme purement sentimental, idéaliste, pacifique. En Allemagne, le tailleur Weitling se rapproche des icariens français. En Angleterre, les chartistes réclament le suffrage universel, condition, selon eux, de la réforme sociale.
Enfin, il y a Proudhon. Ce fils d’ouvrier, cet ancien compagnon typographe a de hautes prétentions à la science. C’est surtout un pamphlétaire de haute allure, animé d’un puissant idéal moral, et souvent un magnifique écrivain. Il abhorre les utopistes, mais n’arrive pas à leur opposer un système et patauge dans des contradictions déconcertantes. Il est, avant tout, anti-capitaliste et anarchiste. Il flotte entre des audaces de révolutionnaire et des timidités de conservateur, entre l’individualisme et le socialisme, entre la classe ouvrière et la paysannerie, entre la politique et la morale. Son mutuellisme prétend aplanir les antagonismes sociaux, à concilier tous les intérêts, ceux de l’ouvrier et du patron, du vendeur et de l’acheteur, du créancier et. du débiteur. Cependant, peu avant de mourir, il annonce l’émancipation des travailleurs par les travailleurs eux-mêmes, tout en persistant d’ailleurs à ne pas vouloir entendre parler de la conquête du pouvoir et en continuant d’aiguiller les travailleurs vers le corporatisme et la coopération a-politique.
A la veille de 1848, rien n’est encore au point. Les systèmes s’opposent aux systèmes, les écoles aux écoles. L’exploitation ouvrière est effrénée, le travail est à peine protégé. La masse travailleuse se défend comme elle peut, réclamant en vain le droit au travail, le droit syndical, le droit de grève. Parfois elle prend les armes, comme à Lyon (1831 et 1834). Les ouvriers les plus avancés forment l’aile gauche du parti républicain ou s’enfoncent dans les sociétés secrètes sans prise sur la masse. En Angleterre se développe un double mouvement : syndical (trade-unionisme) et politique (chartisme) : ce dernier s’éteindra bientôt.
Le « Manifeste Communiste » et l’Internationale.
La mise au point, la synthèse, c’est Marx et Engels qui les réaliseront avec le Manifeste communiste. Tous deux ont passé par la philosophie allemande, à laquelle ils doivent en partie leur conception de l’histoire, mais surtout ils ont étudié en détail la révolution industrielle anglaise, ainsi que l’économie politique, et ils se sont imprégnés de socialisme français. Le marxisme est le fruit de cette triple action.
Le Manifeste est, en quelque sorte, la déclaration de guerre du prolétariat à la bourgeoisie. Il décrit d’abord le mode de production capitaliste et en énumère les principaux effets : création d’un marché mondial, soumission des campagnes aux villes, colonisation des pays arriérés aux pays avancés, etc. ; mais le mode de production finit par entrer en conflit avec les formes de propriété trop étroites qui l’enserrent, d’où s’ensuivent la surproduction, les crises, le chômage, etc.
Vient ensuite l’exposé des conditions de travail et de vie faites aux prolétaires sous le régime capitaliste : salaires le plus bas possible, longues journées de travail, organisation quasi militaire de l’industrie, travail des femmes et des enfants. Le Manifeste évoque les premiers épisodes de la résistance ouvrière, les « coalitions » (grèves), où se façonne la solidarité prolétarienne : peu à peu les grèves s’élargissent, se centralisent. Alors naît la lutte politique, — lutte de classe pour la conquête du pouvoir et le renversement de la bourgeoisie.
Comment le mouvement de la classe ouvrière tend au communisme, tend à réaliser l’idéal communiste d’une société sans classes, c’est le sujet qu’aborde alors le Manifeste. Le communisme, qui n’est que l’expression idéologique la plus avancée du mouvement ouvrier, abolira non pas « la propriété », qui n’est qu’une abstraction, mais une forme historiquement donnée de la propriété, à savoir la propriété capitaliste qui sépare de plus en plus le travailleur de son instrument de travail. Le Manifeste s’attaque aux notions chères à la bourgeoisie : liberté, civilisation, droit, famille, patrie ; il délimite l’action des idées dans le développement historique et déclare avec force que le communisme rompra avec toutes les « idées » dont s’est nourri le passé. En fin de compte, les prolétaires doivent s’unir pour conquérir le pouvoir politique, liquider la propriété capitaliste et transformer la société.
Après avoir critiqué sévèrement tous les vieux systèmes socialistes, le Manifeste convie les communistes à s’unir à la classe ouvrière et à combattre pour ses buts. Puis il termine sur le mot d’ordre inoubliable : Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !
Le Manifeste avait été rédigé au nom d’une société internationale de prolétaires (allemands pour la plupart) : la Ligue des Communistes. Peu après, la révolution embrasait l’Europe (1848–49). Partout où les travailleurs tentèrent de s’emparer du pouvoir, ils furent écrasés. Louis Reybaud put écrire sa phrase célèbre :
« Le socialisme est mort ; en parler, c’est prononcer son oraison funèbre. »
Quinze ans plus tard (1864), l’Internationale était fondée à Londres pour tâcher d’unir les prolétaires de tous les pays, Marx était l’un des fondateurs. Il en rédigea les statuts ; il en fut, d’un bout à l’autre, le cerveau.
La gloire de l’Association, ce sera d’avoir créé le mouvement socialiste moderne et d’en avoir fait un mouvement international. Elle ne put toutefois se maintenir que neuf ou dix ans. Il était sans doute quelque peu prématuré de vouloir aligner, sur un même front de lutte et de pensée, des classes ouvrières qui n’étaient pas soumises encore aux mêmes conditions de vie et d’exploitation.
Derrière le conflit Marx-Bakounine, il y avait le conflit entre ouvriers de la grande industrie et ouvriers de la petite. L’Internationale en fut très affaiblie. La défaite de la Commune, aux côtés de qui elle s’était rangée avec éclat, précipita sa disparition. Elle avait préparé le terrain pour les partis socialistes nationaux, dont le premier en date fut celui d’Allemagne (1875).
De l’union des partis socialistes sortira, en 1889, à Paris, la IIe Internationale.
Le Socialisme en France.
Après la Commune, le prolétariat, privé de ses chefs, fusillés, déportés ou proscrits, ne put que « se terrer dans ses syndicats » (le mot est de Vaillant). Il y subit l’influence des petits-bourgeois positivistes ou proudhoniens qui le confinèrent soigneusement dans les revendications professionnelles. Profitant de l’ébranlement de l’Ordre moral, il tient un premier Congrès à Paris (1876), puis un second à Lyon (1878). Le premier est purement corporatif et flétrit même la Commune ! Au second, quelques socialistes viennent affirmer la lutte de classe. Entre les deux, un homme était rentré d’exil. Il s’appelait Jules Guesde : il sera le levain qui fait lever la pâte. Son journal, l’Égalité, se proclame « collectiviste ».
A Marseille (octobre 1879), troisième congrès. Les collectivistes, unis aux anarchistes, écrasent les « syndicaux » et les coopérateurs. On glorifie la Commune et le drapeau ronge. Et, dépassant l’étape où s’était arrêtée l’Internationale, on vote non seulement la socialisation du sol, mais celle de tous les moyens de production : sous-sol, machines, matières premières.
Du congrès de Marseille sortit le parti socialiste, sous le nom de Parti ouvrier. Il était formé de six fédérations régionales, dont les deux plus actives furent celle du Centre (Paris), où dominaient les collectivistes modérés (Paul Brousse et ses amis du Prolétaire), et celle de l’Est (Lyon) aux mains des anarchistes (dont l’organe est le Révolté).
Le « Nouveau Parti », comme l’appelait Malon, fut en proie à des luttes intestines et dut subir, en deux ans, trois scissions (1880–82). Ces scissions eurent pour cause, toutes les trois, le programme électoral minimum élaboré par Guesde, Lafargue et Deville, et dont Marx avait rédigé lui-même les considérant collectivistes (« chef-d’œuvre, a dit Engels, d’argumentation saisissante ») :
-
Scission des syndicaux, qui trouvent le programme trop rouge ;
-
Scission des anarchistes, qui le trouvent trop pâle ;
-
Scission entre collectivistes révolutionnaires (guesdistes) et collectivistes modérés (possibilistes ou broussistes) : ces derniers voulaient rendre le programme facultatif ; les autres le voulaient obligatoire.
La tentative d’un parti ouvrier unique avait échoué. Syndicaux et anarchistes étaient partis. Les possibilistes prirent le nom de Fédération des Travailleurs socialistes, les guesdistes gardant jalousement celui de Parti ouvrier (« Parti ouvrier français »).
Quant aux anciens communards, rentrés après l’amnistie (1880), ils se tinrent en général à l’écart du Parti ouvrier. Les blanquistes (Vaillant, Eudes) créèrent le Comité révolutionnaire central (organe : Ni Dieu, ni Maître) ; les autres (Ch. Longuet, V. Jaclard, Theisz) l’éphémère Alliance républicaine socialiste, en coquetterie avec l’extrême-gauche radicale.
De 1882 à 1893, onze années d’intensif défrichement socialiste. Guesde parcourt la France. Le Parti ouvrier s’implante particulièrement dans les régions industrielles ; il se lie au mouvement syndical (Fédération nationale des syndicats, 1886). Le mot d’ordre des Trois-Huit (huit heures de travail, huit heures de loisir, huit heures de sommeil) est de lui ; de lui, la première ébauche des manifestations du Premier Mai. Il entretient des rapports cordiaux avec Engels, à Londres, et avec la social-démocratie allemande.
Si le Parti ouvrier progresse, la Fédération des travailleurs socialistes est, au contraire, en recul. Elle incline vers un socialisme municipal de plus en plus réformiste. En 1890, ses éléments de gauche (Allemane, Chabert, J.-B. Clément, Groussier, Dejeante) abandonnent Brousse pour fonder le Parti ouvrier socialiste révolutionnaire. Le Parti allemaniste est nettement ouvrier et même ouvriériste ; il préconise le syndicalisme et la grève générale. Il se querelle souvent avec ses élus, auxquels il impose le mandat impératif.
Le Comité révolutionnaire central n’existe guère qu’à Paris, dans le Cher et l’Allier. Il sort du boulangisme épuré de ses éléments nationalistes. L’influence de Vaillant devient alors prépondérante. En 1898, le Comité prend le nom de Parti socialiste révolutionnaire.
Les élections de 1893 sont une victoire pour le socialisme. Un groupe d’union socialiste se forme à la Chambre. Plus de 50 élus, dont beaucoup ne relèvent d’aucun des partis précités, s’y font inscrire : seuls les allemanistes refusent d’y adhérer. En de retentissants discours, Guesde et Jaurès affirment l’idée socialiste. En 1896, à Saint-Mandé, discours de Millerand, énonçant un programme minimum, qui écarte aussitôt de l’Union socialiste (c’est là son unique mérite) nombre d’indésirables.
Vers l’Unité Socialiste.
À ce moment, le mouvement syndical échappe aux partis socialistes. A la Fédération des syndicats, qui obéissait aux guesdistes, succède la Confédération générale du travail, en face de laquelle se dresse l’ambitieuse Fédération des Bourses, où Pelloutier attire anarchistes et allemanistes. Le mouvement syndical devient anti-politique, il oppose délibérément la grève générale à la conquête du pouvoir.
L’heure approchait où toutes les organisations socialistes allaient travailler à s’unir Pendant l’affaire Dreyfus, craignant un coup d’État réactionnaire, elles formèrent un Comité de vigilance, qui devint, peu après, un Comité d’entente (1898). Guesdistes, blanquistes, possibilistes et allemanistes y retrouvaient les indépendants (Jaurès. Viviani, Millerand, Rouanet, Gérault-Richard, Fournière). Mais quand, en juin 1899, Millerand entre inopinément dans le ministère Waldeck Rousseau, aux côtés de Galliffet, bourreau des communards, il ouvre, dans le socialisme français, une crise qui durera cinq ans. Le groupe parlementaire se coupe en deux : tandis qu’avec Jaurès, les uns défendent Millerand, les autres, avec Guesde et Vaillant, le condamnent. Dans un manifeste à la France socialiste, ces derniers qualifient de trahison l’acte de Millerand. Le Comité d’entente, pour trancher le débat, convoque un congrès général des organisations.
Ce congrès a lieu à Paris (salle Japy) du 7 au 8 décembre. Il condamne le ministérialisme, mais reconnaît que des « circonstances exceptionnelles » peuvent le rendre licite : les deux tendances adverses restent donc sur leurs positions. En même temps, le congrès parvient à établir une sorte de lien fédéral entre les cinq organisations nationales (celle des indépendants comprise) et les fédérations autonomes de province. A la tête du Parti est mis un comité général.
Mais Millerand restant au ministère, l’entente n’était pas possible. En 1900, les guesdistes se retirent. Après quoi (1901), c’est le tour des blanquistes. Guesdistes et blanquistes s’unissent alors entre eux : ainsi naît le Parti socialiste de France, opposé à toute participation ministérielle, à toute alliance avec un parti bourgeois.
En face, indépendants, allemanistes et broussistes se serrent au sein du Parti socialiste français, où bientôt se formera une gauche (Renaudel, J. Longuet, G. Hervé) qui réclamera, elle aussi, l’exclusion de Millerand et le contrôle des élus.
Entre les deux partis, la lutte est très acerbe. Cependant le mouvement syndical (C. G. T. et Fédération des Bourses) réalise son unité organique (1902) et dresse le « syndicalisme révolutionnaire » contre le « syndicalisme parlementaire ».
Malgré tout, l’unité couvait sous la cendre. L’expérience millerandiste ayant pris fin et son triste héros ayant été exclu par sa. Fédération (celle de la Seine), l’unité se refit à la suite du congrès international d’Amsterdam, grâce aux interventions pressantes des socialistes étrangers. Elle se refit à Paris, salle du Globe (23–25 avril 1906), après que les deux partis eurent signé une déclaration « d’opposition fondamentale et irréductible à l’ensemble de la classe bourgeoise et à l’État qui en est l’instrument ».
Le Parti Socialiste S. F. I. O.
Le parti ainsi unifié — section française de l’Internationale ouvrière : S. F. I. O. — se développa lentement, mais sûrement. Les Briand, Viviani, Gérault-Richard, Augagneur, l’avaient quitté, mais les travailleurs y entrèrent en grand nombre : de 1905 à la guerre, les effectifs passèrent de 34.000 à 93.000 membres. Son journal, l’Humanité, touchait les masses. La lutte contre le clémencisme, le briandisme, le poincarisme, instruments successifs de la politique bourgeoise, les ardents réquisitoires de Jaurès — son chef de moins en moins contesté — contre la guerre du Maroc, grosse de la guerre mondiale, contre les armements et le militarisme, l’admirable campagne de 1913 contre la loi de trois ans, tout cela valut au Parti Socialiste un crédit sans cesse grandissant. L’Europe avait les yeux fixés sur lui. A l’intérieur, son influence gagnait en profondeur. Aux élections de 1906, il obtenait 878.000 voix (52 élus) ; à celles de 1910, 1.106.000 voix (76 élus) ; à celles de 1914, 1.398.000 voix (103 élus).
De 1905 à 1914, le Parti tint 14 congrès, dont 2 extraordinaires. En voici l’énumération :
-
I. Paris (23–25 avril 1905) : Réalisation de l’unité.
-
II. Chalon (oct.-nov. 1905) : Tactique électorale.
-
III. Limoges (nov. ID05) : Parti et syndicats ; le militarisme et la guerre.
-
IV. Nancy (août 1907) : Militarisme et conflits internationaux ; et, de nouveau, Parti et Syndicats.
-
V. Toulouse (oct. 1908) : Vote de la motion Jaurès sur l’action générale du Parti.
-
VI. Saint-Étienne (avril 1909) : Élections de 1910 question agraire.
-
VII. Nîmes (février 11910) : Retraites ouvrières tactique électorale.
-
VII bis. Paris (juillet 1910) : Ordre du jour du congrès international de Copenhague (socialisme et coopération, etc.).
-
VIII. Saint-Quentin (avril 1911) : Régies municipales ; tactique électorale.
-
VIII bis. Paris (nov. 1911) : Révision des statuts.
-
IX. Lyon (février 1912) : Action syndicale ; franc-maçonnerie.
-
X. Brest (mars 1913) : Lutte contre les trois ans.
-
XI. Amiens (janvier 1914) : Programme et tactique électorale.
-
XI bis. Paris (juillet 1914) : Ordre du jour du congrès international de Vienne (qui devait avoir lieu en août et que la guerre empêcha) ; chômage ; impérialisme et conflits internationaux.
L’Internationale Socialiste.
Complétons cette nomenclature par celle des congrès internationaux de 1889 à la guerre :
-
— Paris (juillet 1889) : Deux congrès eurent lieu en même e temps, l’un convoqué par les broussistes, salle Lancry, qui ne fît rien, l’autre par les guesdistes, salle Pétrelle, qui décida la manifestation internationale du Premier Mai.
-
— Bruxelles (1891) : Législation protectrice du travail ; antisémitisme militarisme et conflits internationaux.
-
— Zurich. (1893) Question de l’admission des anarchistes (rejetée) ; journée de 8 heures ; militarisme et conflits internationaux ; travail des femmes ; action électorale et parlementaire.
-
— Londres (11896) : Exclusion définitive des anarchistes ; action politique ; question agraire ; grève générale et action syndicale.
-
— Paris (1900) : Action politique ; ministérialisme (cas Millerand) ; alliances avec la bourgeoisie ; action municipale ; trusts ; création d’un comité permanent siégeant à Bruxelles.
-
— Amsterdam (1904) : Unité socialiste en France ; condamnation du ministérialisme ; assurances sociales ; grève générale.
-
— Stuttgart (1907) :.Militarisme et conflits internationaux (vote de la motion fameuse : « Si la guerre éclatait néanmoins ... » ) ; Partis et syndicats.
-
— Copenhague (1910) : Socialisme et coopération ; renvoi au congrès suivant de la motion Keir Hardie-Vaillant sur la lutte contre la guerre.
Le congrès suivant (Vienne, août 1914) n’eut pas lieu. La classe ouvrière se trouva précipitée dans la guerre avant d’avoir eu le temps d’engager la grande action décidée à Bruxelles, fin juillet, par les représentants de l’Internationale. Devant le fait accompli, presque tous les partis s’inclinèrent ; les crédits de guerre furent votés. Cependant le socialisme ne devait pas tarder à relever la tête. En Allemagne, les futurs spartakistes et les « indépendants » rompirent avec le « socialisme de guerre ». En France, les « minoritaires » ne parvinrent qu’un mois avant l’armistice à conquérir la majorité.
On crut un moment que l’Internationale réussirait à se reconstituer en pleine guerre (1917), mais le congrès de Stockholm fut mis dans l’impossibilité de siéger. Les conférences de Zimmerwald et de Kienthal (1915–1916) ne réunirent que des minorités. En mars 1917, la Révolution russe éclata soudain, d’abord bourgeoise, puis socialisante, enfin (7 novembre) bolchevique. Maîtres de la Russie, les bolcheviks proclament la dictature du prolétariat (en fait, celle de leur propre parti), signent la paix avec l’Allemagne et s’efforcent de fomenter, en créant l’ « Internationale communiste », une révolution sociale universelle. Cet effort audacieux, malgré la complicité des circonstances, n’aboutit qu’à une série d’échecs sanglants. L’unique résultat fut la création, dans tous les pays de partis communistes dont l’activité désordonnée est, aujourd’hui, presque uniquement tournée contre les partis socialistes et les vieux syndicats .
La scission laissa les partis socialistes très affaiblis, vidés de leurs militants de gauche et de leurs éléments jeunes. Ce n’est que lentement et, surtout, grâce aux fautes accumulées comme à plaisir par le bolchevisme que les partis socialistes reconquirent leur influence. Il y eut, un moment, deux Internationales socialistes, l’une de droite, l’autre de gauche (cette dernière dénommée « centriste » par les bolcheviks) : elles fusionnèrent à Hambourg, en 1923, et la IIe Internationale se trouva ainsi reconstituée.
Elle a tenu, depuis lors, des congrès à Marseille (1925), à Bruxelles (1928), à Vienne (1931) ; elle vient d’avoir une conférence à Paris où ont été examinés les grands problèmes de l’heure : guerre, fascisme, unité, pouvoir. Alors qu’en 1914, elle groupait 3.400.000 membres, elle en groupe, aujourd’hui, trois fois plus, répartis entre une cinquantaine de partis.
Dans l’intervalle des congrès, instance souveraine, qui ne se réunissent que tous les trois ans, l’Internationale est régie par un comité exécutif (deux ou trois sessions par an) dans lequel chaque parti est représenté au prorata de sa force (la France a trois représentants). Le bureau tient des réunions plus fréquentes. Le secrétariat, dirigé par Fr. Adler, à Zurich, assure la permanence.
Organisation du Parti en France.
Chaque parti socialiste a sa figure propre. Le Labour Party comprend, à côté de ses sections locales, de nombreux syndicats, des partis et des associations socialistes. Le parti ouvrier belge se compose de sections politiques, de syndicats, de coopératives, de mutualités et de sociétés ouvrières de toute sorte. Partout ailleurs, partis et syndicats sont indépendants, mais, sauf en France, entretiennent entre eux des rapports organiques étroits. En France, l’indépendance organique est complète : Parti socialiste et C. G. T. ne collaborent qu’exceptionnellement ; les coopératives pratiquent une neutralité absolue.
Le Parti socialiste français se compose, actuellement, de 4.400 sections locales, réparties entre 96 fédérations. Sections et fédérations s’administrent elles-mêmes.
La direction du Parti appartient au Parti lui-même, c’est-à-dire au congrès national annuel, dont les délégués sont élus par les fédérations. Chaque fédération y dispose d’un mandat de droit et d’un mandat supplémentaire par 25 cotisants.
Le congrès fixe souverainement la politique du Parti. Il se prononce sur les rapports que lui soumettent les « organismes centraux » et renouvelle ces derniers (dont le plus important est la « C. A. P. ») sur la base de la représentation proportionnelle.
Dans l’intervalle des congrès, le Parti est administré par le conseil national, sorte de congrès restreint constitué par les fédérations, à raison d’un délégué chacune, élu pour un an. Le conseil national se réunit en session ordinaire environ deux fois l’an.
La commission administrative permanente (C. A. P.), dont le nom indique suffisamment le rôle, comprend 33 membres élus par le congrès à la proportionnelle. Elle se réunit environ deux fois par mois et se décharge d’une partie de ses tâches sur un bureau de quelques membres (secrétaire général, trésorier du Parti, etc.). La C. A. P. exécute les décisions des congrès et des conseils nationaux et organise la propagande (confiée à quelques délégués permanents).
Les autres commissions centrales sont celle de contrôle (qui surveille la gestion financière) et celle des conflits, qui juge les « demandes de contrôle » dont tout membre peut être l’objet et peut prononcer des peines allant de l’avertissement simple à l’exclusion.
Une part importante de l’action du Parti étant électorale, il possède des élus dans tous les corps délibérants : conseils municipaux, d’arrondissement, généraux, Chambre et Sénat.
Les élus parlementaires (actuellement 16 sénateurs et 129 députés), (la récente scission des néo-socialistes a fait perdre au Parti 31 députés et plusieurs sénateurs), forment « un groupe distinct de toutes les fractions politiques bourgeoises ». Ils sont tenus à l’unité de vote et doivent repousser l’ensemble du budget, « liste civile de la bourgeoisie ». Tout élu relève du contrôle de sa fédération et doit verser au Parti une fraction de son indemnité.
La liberté de discussion est entière dans la presse socialiste (ainsi que dans les assemblées intérieures du Parti), mais pour l’action, la presse doit se conformer aux décisions des congrès.
L’organe central est le Populaire, fondé en 1927, dont le directeur (Léon Blum) est élu par le congrès national. Le Populaire a 43.000 abonnés et environ 75.000 acheteurs au numéro. Les fédérations et sections disposent, pour leur compte d’environ 80 journaux.
Les jeunes socialistes sont unis dans la Fédération nationale des jeunesses (12.000 membres), au sein de laquelle le Parti a ses représentants (de même qu’au Comité national des femmes socialistes fondé en 1931).
Ajoutons que le Parti compte actuellement, 137.000 membres (dont 14.600 dans le Nord et 9.200 dans la Seine), (la scission néo-socialiste a fait perdre au Parti de 8 à 10.000 membres), et que son budget s’élève à 1.658.000 francs.
II. — LE PROGRAMME : BUTS ET MOYENS.
La Société capitaliste.
Le capitalisme, c’est le point de départ. Le communisme, c’est le point d’arrivée. Entre les deux, le mouvement socialiste s’intercale : empruntant ses méthodes au marxisme — c’est-à-dire à une connaissance scientifique de l’état social et du devenir historique — il s’assigne, pour but final, le renversement de la société capitaliste et la réalisation du communisme.
Capitalisme, socialisme, communisme : les trois anneaux de la chaîne, les trois étapes du voyage.
Voyons d’abord ce qu’est le capitalisme.
Le capitalisme est récent dans l’histoire. Il apparaît avec la Renaissance, lorsque commencent à se dissoudre les biens féodaux et à se constituer les monarchies absolues. Son prodigieux essor ne date que du XIXe siècle : il a fallu pour cela que, grâce à la vapeur et aux machines, la fabrique succède à la manufacture et que, sur les ruines du régime corporatif, la grande industrie conquière sa pleine liberté de mouvements (laisser faire, laisser passer).
Le capitalisme est caractérisé par la prédominance d’un mode de production, dit capitaliste, lequel exige, pour des rendements de plus en plus massifs, la réunion de capitaux considérables (matières premières, machines, argent liquide).
Le mode de production capitaliste exige autre chose aussi : l’existence d’un prolétariat nombreux, dénué d’instruments de production et réduit, pour ne pas périr, à vendre aux capitalistes sa « force de travail ».
L’essor du capitalisme eut pour conséquence l’affaiblissement rapide et le recul de la petite entreprise indépendante qui, de règle, est devenue l’exception. Ce phénomène, très apparent dans l’industrie, l’est moins dans l’agriculture, surtout en France où la petite exploitation, fortement protégée par l’Etat, a, jusqu’ici, résisté : mais, si elle subsiste, elle dépend de plus en plus du marché et des capitalistes qui y font la loi. Toute l’histoire de l’artisanerie et de la paysannerie, depuis cent ans, est celle de leur prolétarisation. « L’évolution économique de la société bourgeoise conduit, avec la nécessité des lois de la nature, à la ruine de la petite exploitation, fondée sur l’appropriation privée, par le travailleur, de ses moyens de production. Elle sépare le travailleur de ses moyens de production et le transforme en un prolétaire ne possédant rien. Elle transforme, en d’autres termes, le travailleur propriétaire en travailleur salarié. Les moyens de production deviennent le monopole d’un nombre relativement restreint de capitalistes et de grands propriétaires fonciers » (Ancien programme de la social-démocratie allemande, dit d’Erfurt, 1891).
Le résultat de cet écrasement de la propriété individuelle par la propriété capitaliste et de la petite exploitation par la grande a été un accroissement gigantesque de la productivité du travail. Mais les avantages de cet accroissement ont été accaparés par les détenteurs privés des moyens de production, capitalistes et grands propriétaires. Les prolétaires, ce matériel humain de l’industrie moderne, en ont été exclus, et non seulement les prolétaires, mais encore la classe moyenne ou petite bourgeoisie (artisans, paysans propriétaires, intellectuels), dont la situation est devenue, depuis la guerre, presque aussi incertaine que celle des prolétaires proprement dit, là où cette classe n’a pas été entièrement paupérisée.
L’évolution du régime capitaliste en a modifié profondément la structure, sinon l’essence. La concurrence entre capitalistes a amené une concentration de plus en plus dense des moyens de production dans les mains d’une oligarchie de plus en plus restreinte et omnipotente. Au capitalisme de concurrence, a succédé le capitalisme de monopole, qui n’a gardé de l’ancien que l’appétit du profit. Le libre échange a fait place au nationalisme économique. Le néo-capitalisme tend de plus en plus vers un régime d’autarcie (marché intérieur fermé), complété, à l’extérieur, par la pratique systématisée du dumping. Le néo-capitalisme, cessant d’être libéral et pacifique, est devenu résolument interventionniste à son profit. Capitalistes et financiers ont trouvé dans l’État, asservi par eux, un exécuteur docile. Protectionnisme, militarisme, impérialisme, colonialisme sont les traits dominants de l’évolution du capitalisme, parti de la liberté pour arriver au monopole.
Le néo-capitalisme a tenté d’organiser l’économie sous l’hégémonie des banques représentant le capital financier. Elle n’a réussi qu’à multiplier le désordre du monde. Tant qu’elle n’aura pour base que la propriété privée et pour régulateur que le profit, l’économie dirigée sera une utopie. La production restera livrée à son anarchie traditionnelle, dont la manifestation la plus topique est dans les crises.
Les crises économiques sont inhérentes à la nature du régime capitaliste, incapable d’ajuster sa production aux besoins des consommateurs solvables (les consommateurs insolvables n’existant pas pour lui). Avec l’industrialisation croissante du monde, qui amène la saturation des marchés et le rétrécissement des débouchés lointains, les crises deviennent « toujours plus étendues et plus dévastatrices » (programme d’Erfurt) et leurs retours périodiques entraînent, pour les États, des dérèglements financiers, monétaires, politiques et sociaux qui menacent la vieille société de subversion totale.
Le mode de production capitaliste est devenu anti-économique. Mais que dire de ses conséquences anti-humaines ? Il représente de plus en plus, non seulement pour les prolétaires qu’il exploite, mais pour la très grande majorité des hommes, un avilissement certain de leurs conditions d’existence. En même temps, s’élargit l’abîme qui sépare les classes, et s’aggravent les antagonismes qui mettent aux prises, en une véritable guerre civile (la lutte des classes) bourgeois, petits bourgeois et prolétaires.
L’inhumanité profonde du capitalisme se révèle surtout dans les crises. Alors les usines se ferment, les faillites se multiplient, les ouvriers sont jetés sur le pavé. A l’heure actuelle, dans le monde, trente millions d’ouvriers, d’employés, d’intellectuels sont ainsi la proie du chômage. Que vaut une société qui, suffisamment outillée pour satisfaire à tous les besoins, n’arrive pas à écouler sa production surabondante ? Que vaut une société qui n’arrive pas à assurer du travail à ceux qui n’ont, pour vivre, que leur force de travail ?
Le capitalisme, qui aggrave les antagonismes entre les classes, les exaspère entre nations. Dans son besoin d’expansion, il est essentiellement impérialiste. Ce qu’il lui faut, ce sont des débouchés, dût-il se les faire ouvrir à coups de canon. La préparation de la guerre est pour lui une nécessité primordiale : les guerres modernes sont des règlements de compte à main armée entre capitalismes rivaux aspirant à la suprématie commerciale.
Les guerres, Jaurès l’a dit, sont la honte et la condamnation du régime. Les guerres et les crises : les guerres sur le terrain de la politique, les crises sur celui de l’économie. Elles accusent jusqu’au paroxysme l’impuissance de la vieille société à discipliner ses forces productives surexcitées par l’appât du profit, en même temps qu’à assurer aux peuples le bien-être et la liberté dans le travail et dans la paix. Abaissement du niveau d’existence des masses, écroulement des classes moyennes, aggravation des inégalités sociales, exaspération des antagonismes de classes et des concurrences nationales, ces conséquences sont là sous nos yeux. Dernière conséquence : la bourgeoisie, sentant son règne menacé, recourt, pour se sauver, aux méthodes dictatoriales. Avec l’ancien capitalisme libéral s’en va la démocratie ; avec le capitalisme nouveau, à tendances protectionnistes et impérialistes, s’installe le fascisme, foulant aux pieds le suffrage universel et livrant le pouvoir à des bandits : armés.
Guerres, crises, fascismes ne font qu’attester l’agonie convulsive de la société capitaliste et la nécessité du communisme libérateur.
Qu’est-ce que le Communisme ? — C’est la « mise en commun », la reprise par la société, la « socialisation » des moyens de production et d’échange : sol et sous-sol, matières premières, usines, banques, moyens de transport. C’est la production capitaliste, par et pour les particuliers, transformée en production sociale, par et pour la société : celle-là ne travaillait qu’en vue du marché, c’est-à-dire de la seule consommation solvable, détentrice de moyens de paiement ; celle-ci travaillera pour satisfaire des besoins ; celle-là n’avait pour fin que le plus grand profit, celle-ci aura pour fin le plus grand bien-être.
La propriété sociale proscrira la notion de surtravail et de profit. Elle réalisera, pour la première fois, la synergie sociale, en coordonnant, d’après un plan, et en harmonisant la production et la distribution des richesses. Elle n’éliminera pas seulement les déséquilibres et les crises provenant de la surproduction et de la sous-consommation ; elle abolira pour toujours la division de la société en classes et, avec les classes tant exploiteuses qu’exploitées, les antagonismes et les luttes qu’elles engendrent mécaniquement. L’État, dans cette société d’égaux, perdra sa raison d’être. Au « gouvernement des hommes » sera substituée « l’administration des choses ». A la place des États armés et des patries hostiles, s’organiseront, par dessus les frontières, de libres fédérations de producteurs, d’échangistes et de consommateurs. Ainsi sera fermée l’ère des révolutions violentes. Ainsi la société sera, de fond en comble, transformée. Ainsi s’achèvera le cycle commencé par le capitalisme lui-même, qui, en socialisant le mode de production, a frayé la voie à la socialisation de la propriété. [Le mode de production est social — mais dans une certaine mesure seulement — parce qu’il implique des combinaisons de capitaux et de capitalistes (sociétés par actions, trusts, cartels), ainsi qu’une organisation de travail faisant coopérer des centaines et parfois des milliers de travailleurs.]
Voies et moyens.
Tel est le but final que vise le socialisme. Il reste à dire par quel moyen il se propose d’atteindre ce but essentiellement révolutionnaire.
La socialisation de la propriété capitaliste n’est pas plus, en effet, une « réforme » sociale, que le passage de la forme monarchique à la forme républicaine n’est une « réforme » politique. C’est un énorme transfert de propriété ; c’est une expropriation colossale qui lèsera les « droits » de toute une classe, et justement de la classe la plus puissante, sinon la plus nombreuse. Même s’il était possible d’y procéder sans coup férir, cette expropriation de la classe possédante n’en serait pas moins un acte révolutionnaire, impliquant une rupture décisive avec la légalité qui ne prévoit nullement l’expropriation de toute une classe.
Mais rien, ni l’expérience du passé, ni ce qu’on sait des dispositions de la bourgeoisie, ne permet de supposer que celle-ci se laissera exproprier sans coup férir. Il faudra, avant de la priver de ses biens, la réduire à l’impuissance, et pour cela la chasser du pouvoir, s’emparer de celui-ci et, délibérément, le tourner contre elle.
« La conquête du pouvoir politique est devenue — Marx le disait dès 1864 — le premier devoir de la classe ouvrière. »
La question est de savoir comment conquérir le pouvoir ? Guesde avait coutume de répondre : Par tous les moyens, y compris la légalité.
L’insurrection armée est un moyen. La grève générale en est un autre. Le bulletin de vote un troisième.
Quelque moyen qu’on préconise, tous supposent une sorte de mobilisation de la classe exploitée contre la classe exploiteuse, et par conséquent l’organisation politique et économique du prolétariat en parti de classe. Tous supposent l’existence de syndicats — ces « écoles primaires du socialisme » (Marx) — et de partis groupant les travailleurs les plus conscients du but final, les plus actifs, les plus résolus.
Partis et syndicats sont les instruments essentiels de la conquête socialiste du pouvoir. Tous les socialistes sont d’accord là-dessus. Où les opinions diffèrent, c’est sur le point de savoir si la conquête du pouvoir s’opérera par la force ou dans la légalité, par l’action révolutionnaire ou par l’action électorale.
Une discussion sur ce point de tactique nous entraînerait trop loin. Bornons-nous à signaler que l’action révolutionnaire (sous la forme d’une insurrection armée, précédée ou accompagnée d’une grève générale) n’apparaît possible que lorsque la situation est elle-même devenue révolutionnaire et qu’elle n’a d’ailleurs des chances de triompher que si la défection des forces régulières qui lui sont opposées laisse le gouvernement désarmé.
D’autre part, la tactique légalitaire, préconisée par les réformistes et qui consiste à conquérir siège à siège la majorité dans l’une des Chambres, celle du suffrage universel, est terriblement lente et décevante. A supposer qu’un gouvernement socialiste parvienne jamais à se former dans ces conditions, il aurait contre lui tous les corps constitués : Sénat, « bureaux », diplomatie, magistrature, Église, armée ; il aurait contre lui la presse ; il aurait surtout contre lui grande industrie, grande propriété, haute banque, tous les pouvoirs réels de la vieille société. Comment briser cette coalition formidable sans sortir de la légalité, sans faire appel à l’action directe des masses, c’est-à-dire, qu’on le veuille ou non, à la révolution ? Aucun des gouvernements socialistes qui ont paru depuis la guerre n’a osé cela ; tous se sont évertués à éviter le conflit, en rassurant la bourgeoisie. Mais aussi, aucune grande réalisation socialiste — ni en Angleterre [« Si vous entendez que je vais détruire notre situation économique par une législation radicale, non ! Je veillerai à protéger les droits du travail, mais, d’un autre côté, les droits du capital seront également protégés » (Interview de Mac Donald, Colliers’s Weelrly, New-York, avril 1924)], ni en Suède, ni au Danemark — ne s’est attachée à leur nom. Ils n’ont fait que démontrer, une fois de plus, que la démocratie n’est pas le socialisme. Le socialisme ne commence qu’avec la socialisation.
Ainsi donc, l’action révolutionnaire n’est possible que si la « situation » est elle-même révolutionnaire. Quant à la tactique légalitaire, elle peut bien conduire, théoriquement, jusqu’à « l’exercice du pouvoir » (selon le mot de Blum) ; elle ne conduira au socialisme qu’à la condition de sortir de la légalité pour entrer dans la révolution.
Quelque détour que l’on prenne, on en revient toujours à la nécessité révolutionnaire.
Mais la révolution — c’est-à-dire la conquête révolutionnaire du pouvoir — n’est pas à tout moment possible et le prolétariat socialiste doit savoir choisir l’heure où la bourgeoisie est en état de plus grand désarroi et de moindre résistance. Elle le fut au lendemain de la guerre ; elle peut le redevenir demain. La vieille société est, aujourd’hui, en pleine crise. En vain le fascisme essaie-t-il de surmonter par la violence les contradictions qui la minent. Il ne pourra que retarder l’effondrement final. La crise, en l’atteignant à son tour, précipitera sa chute. Au surplus, la lutte contre le fascisme, là où il a triomphé, ne peut-elle être qu’une lutte révolutionnaire dont le pouvoir est l’enjeu. Fascisme ou socialisme, bourgeoisie ou prolétariat, tel est le dilemme. Car le fascisme abattu et le pouvoir conquis, le prolétariat ne se bornera pas à rétablir les libertés démocratiques : il ira jusqu’au bout, jusqu’au socialisme.
La lutte contre le fascisme, dernier rempart de la bourgeoisie, vise bien au-delà du fascisme : elle ne peut avoir pour terme que la conquête du pouvoir et la réalisation du socialisme.
Voilà donc le pouvoir conquis. La révolution ne fait que commencer. — Maître des leviers de commande, le prolétariat en usera d’abord pour prévenir la contre-révolution. Le pouvoir n’a servi, jusqu’ici, qu’à maintenir dans l’exploitation les classes non capitalistes ; il servira à empêcher le retour offensif des anciens exploiteurs. Il les mettra, jusqu’à nouvel ordre, hors de la démocratie. Cette mise hors de la démocratie des anciens exploiteurs et, d’une façon plus générale, de tous les ennemis de la révolution prolétarienne, est ce qu’on appelle la dictature du prolétariat. En vertu de celle-ci, seuls les prolétaires jouiront du droit de former des partis ou des ligues, du droit de tenir des réunions publiques, du droit de publier des journaux, du droit d’être électeurs et éligibles. Bien entendu, la confiscation des biens des contre-révolutionnaires sera l’une des armes, et non la moins redoutable, de la dictature collective du prolétariat.
Mais, surtout, le prolétariat se servira du pouvoir pour réaliser les grandes socialisations qui sont l’essence de son programme.
Commencera-t-il par faire passer sous son contrôle les grands monopoles privés ou les socialisera-t-il immédiatement ? Il est probable qu’on procédera par étapes et que le contrôle — contrôle gouvernemental et contrôle ouvrier — préparera la socialisation. Sauf pour les mines, les chemins de fer, les assurances, les transports maritimes, les banques, le commerce extérieur, on ne procédera pas, vraisemblablement, à la socialisation d’industries entières. On se contentera, dans chaque industrie (électricité , métallurgie, textile, produits chimiques, minoterie, etc.), de socialiser les grandes entreprises et de contrôler les autres. La grande exploitation rurale sera socialisée ; la moyenne exploitation sera contrôlée ; la petite restera libre, mais sera entraînée au travail collectif. Ce sont là, au surplus, des problèmes techniques plus que politiques. (Nous laisserons de côté la question — politique et non technique — de savoir si les anciens propriétaires expropriés seront indemnisés et dans quelle mesure. Peut-être y aura-t-il intérêt politique à leur servir, leur vie durant, une rente annuelle.)
Le pouvoir socialiste organisera des trusts régionaux et nationaux autonomes, dont la gestion sera confiée à des conseils composés de représentants des pouvoirs publics, du personnel salarié (ingénieurs, employés, ouvriers) et des usagers. Des plans à long terme seront dressés pour chaque industrie et pour l’ensemble de la production nationale, qui permettront d’ajuster le rendement annuel au montant des besoins, préalablement recensés, de la collectivité sociale.
Que fera-t-on du bénéfice ? Une partie sera consacrée au perfectionnement de l’outillage et des conditions du travail ; l’autre sera partagée entre l’État socialiste et les travailleurs des entreprises socialisées.
La Révolution prolétarienne, commencée par l’expropriation de la bourgeoisie, continuée par son expropriation économique, n’aura achevé son œuvre que lorsqu’elle aura éliminé tous les vestiges des antagonismes de classes et des antagonismes nationaux, que lorsqu’elle aura définitivement balayé tous les vestiges des antagonismes sociaux et des antagonismes nationaux De l’abolition des classes impliquée dans l’expropriation de la bourgeoisie, toute une série de révolutions sortira.
L’école sera affranchie de toute servitude de classe. Le droit de tous les enfants à l’instruction intégrale — à la fois littéraire et humaine, scientifique et technique — sera organisé. L’école deviendra non seulement pour les enfants, mais pour les adultes, un centre de vie intellectuelle et sociale intense.
La justice perdra, elle aussi, son caractère de justice de classe. Plus de juges professionnels. Des juges populaires, des jurés. Généralisation de l’arbitrage pour les conflits privés. On préviendra le crime pour n’avoir pas à le réprimer. Les anormaux, les anti-sociaux, les pervers seront soignés. Les prisons, s’il doit en rester, seront transformées : de lieux d’expiation, de tourment et de honte, elles deviendront des lieux de rééducation et de relèvement.
Les antagonismes nationaux, les impérialismes sont une des formes de la concurrence universelle. Ils disparaîtront peu à peu et la guerre avec eux. La Société des nations (c’est-à-dire des peuples) deviendra une réalité. « En même temps que l’antagonisme des classes, à l’intérieur de la nation, l’hostilité des nations entre elles disparaîtra ». (Manifeste communiste.)
Avec l’extinction des antagonismes sociaux et des antagonismes nationaux, l’État enfin perdra sa raison d’être. Bien que les socialistes de la IIe Internationale aient trop souvent abandonné aux anarchistes, adversaires du « principe d’autorité », le monopole de la lutte contre l’État, l’idée que la notion d’État est liée aux notions de Classe et de Nation, que l’État nait, grandit, décline et meurt avec l’antagonisme des classes et des nations, est une idée profondément marxiste et socialiste. L’État n’a jamais été, pour les classes dirigeantes d’un pays que le moyen de tenir en respect les masses et de se défendre, en même temps, contre la concurrence des classes dirigeantes des autres pays. Dans la sphère de la politique intérieure, comme dans celle de la politique extérieure, l’État a pour but spécifique le maintien par la force de l’ordre établi, dont il constitue en quelque sorte l’armature et qui, sans lui, s’écroulerait.
« À la place de l’ancienne société bourgeoise, avec ses classes et ses antagonismes de classes, surgira une association où le libre développement de chacun sera la condition de libre développement de tous. » (Manifeste communiste)
La réalisation du socialisme ne sera pas l’œuvre d’un jour. Pour arriver au socialisme intégral, une longue évolution sera nécessaire, « qui transformera les circonstances et les hommes ». Mais cette évolution devra commencer dès l’avènement du prolétariat au pouvoir. Un gouvernement socialiste, qui, dès le premier jour, ne porterait pas la hache dans la forêt des privilèges capitalistes, commettrait une trahison.
Ce que seront les premières mesures à prendre ne peut qu’être indiqué ici. Le Manifeste communiste, dès 1848, en a énuméré un certain nombre, dont il attendait la centralisation, dans les mains du prolétariat dirigeant, de tous les grands moyens de production et d’échange, en même temps qu’une augmentation de la quantité des forces productives, donc de la masse des produits partageables. Ces mesures consistaient notamment dans : l’expropriation de la propriété foncière, un impôt fortement progressif sur les fortunes, l’abolition de l’héritage, le monopole des banques et des moyens de transport, la multiplication des manufactures nationales, c’est-à-dire la socialisation des grandes entreprises, etc ...
Ces mesures ont un trait commun : elles transfèrent à la société une partie notable de la propriété capitaliste. Elles s’imposeront à tout gouvernement socialiste qui voudra vivre.
Non pas qu’il sera nécessaire de les prendre toutes d’un seul coup. La Révolution russe a montré qu’on ne fait pas sans péril table rase du passé et que, dans la liquidation de l’ordre ancien comme dans la construction de l’ordre nouveau, des transitions doivent être ménagées. Il ne sera pas indispensable de déclarer abolie du jour au lendemain la totalité de la propriété capitaliste. Il suffira de socialiser tout ce qui pourra l’être sans danger pour la production, qui ne doit pas s’interrompre un seul jour. L’évolution vers le socialisme commencera donc par une période d’économie mixte, mi-capitaliste mi-socialiste, où le prolétariat, maître du pouvoir politique, « détiendra les leviers essentiels après avoir socialisé les principales branches économiques, mais où un large secteur demeurera entre les mains du Capital, de l’initiative privée » (Lucien Laurat : Le Socialisme à l’ordre du jour, brochure). Au secteur socialiste appartiendront toutes les industries-clés et, bien entendu, les banques ; au secteur capitaliste les industries dépendant économiquement des premières.
La tâche la plus urgente qu’ait à remplir actuellement le socialisme, c’est d’établir le programme des socialisations qu’il juge nécessaires :
-
pour résoudre la crise interminable qui, déchaînée par le capitalisme, ne peut être surmontée par lui ;
-
pour affranchir la classe ouvrière du joug du Capital. [C’est ce que vient de faire (décembre 1933) le Parti ouvrier belge.]
Ce programme établi, le socialisme posera sa candidature au pouvoir et il appellera les masses à le lui donner.
Ce qui vient d’être dit laisse, on le voit, très peu de place au « réformisme ». Les temps du programme minimum sont passés. Celui-ci a pu avoir, aux débuts du mouvement et jusqu’avant la guerre, une efficacité pour le rassemblement des masses. Il a, aujourd’hui, perdu sa raison d’être. Avec la crise et la décomposition du capitalisme, les réformes sont devenues à peu près aussi irréalisables que l’était la Révolution elle-même quand le Capitalisme était tout puissant et prospère. Au point où en sont les choses, on ne réforme pas la société capitaliste ; elle tombe en morceaux, il n’y a plus qu’à la démolir.
Mais que faire jusqu’au jour — plus proche qu’on ne pense — où, légalement ou non, le prolétariat se saisira du pouvoir ?
Que faire ? Mais continuer ce qu’on a toujours fait ! Lutter pied à pied contre la bourgeoisie et le capitalisme, profiter de toutes les libertés, de presse, de parole, d’ association, de suffrage, pour organiser et instruire le prolétariat, déloger les partis bourgeois de leurs positions politiques, battre en brèche l’oppression et l’exploitation patronales, combattre sans merci le militarisme, le colonialisme et la guerre, tant offensive que défensive. Ce n’est pas le travail qui manque au socialisme.
La lutte électorale, la lutte parlementaire ne sont que des moyens pour le socialisme : elles constituent sur le terrain politique, le prolongement de la lutte de classe ; une forme dérivée de l’action directe du prolétariat. Sinon, elles ne sont rien. Elles doivent se garder de toute compromission. C’est pourquoi l’alliance avec les partis bourgeois, la participation au pouvoir bourgeois ont été condamnées, comme des déviations mortelles, par tous les Congrès nationaux et internationaux du Parti.
Le mot d’ordre de celui-ci est, aujourd’hui, plus que jamais : Tout le pouvoir au Socialisme ! En attendant, opposition irréductible au pouvoir de la bourgeoisie !
Napoléon, ce grand entraîneur d’hommes, a dit un jour : « On ne conduit un peuple qu’en lui montrant un avenir ; un chef est un marchand d’espérance ».
Dans le déclin de tout ce à quoi les hommes ont cru, de tout ce pourquoi i1s ont vécu, le socialisme, seul aujourd’hui, montre au peuple un avenir : le Bien-Être et la Liberté. Seul, il lui dit d’avoir confiance dans l’énergie créatrice qui est en lui. Et l’espérance dont il est plein, il la lui donne. C’est pourquoi, en dépit des défaites passagères, sa victoire finale est certaine.
— Amédée DUNOIS.
SOCIÉTÉ DES NATIONS
Le principe d’un état de société entre les nations avait déjà été proclamé avant la guerre. On lit dans les conventions de la Haye de 1907 :
« Les Nations civilisées constituent une Société. Les membres de cette société sont solidaires, soumis à l’Empire du Droit et de la Justice Internationale. »
Certains pacifistes désignèrent, à ce moment, sous le terme « Société des Nations » l’organisation juridique internationale, assurant la paix, par le respect du droit, à laquelle ils aspiraient.
Ce fut pendant la guerre de 1914–1918 que se développa, principalement sous l’influence du président Wilson, un mouvement d’opinion en faveur d’une association générale des Nations civilisées, destinée à empêcher le retour de conflits sanglants. La formule « Société des Nations » devint populaire. Mais la forme de cette institution était conçue de manières très diverses. La conception anglaise était rebelle à l’idée de contrainte, rebelle aussi à une limitation trop accentuée de la souveraineté de l’Empire. Confiante en la puissance de l’opinion publique, la tendance anglaise envisageait des liens contractuels librement acceptés par les États, un organisme destiné à faciliter la coopération des peuples et le règlement amiable de leurs conflits, une ligue dont les adhérents auraient à tout moment le pouvoir de se retirer.
Selon la conception du pacifisme officieux de France, représentée surtout par Léon Bourgeois, la société des nations ne devait pas non plus avoir le caractère d’un sur-État ni porter atteinte à la souveraineté des États. Mais pour assurer le respect du droit et le maintien de la Paix, les nations associées devaient s’engager à mettre à la disposition de l’organisme à créer leur puissance économique et militaire contre le pays violant le pacte social.
Enfin, certains doctrinaires plus hardis du pacifisme constructif appelaient « Société des Nations » une autorité politique internationale dominant les États, munie des trois pouvoirs : législatif, exécutif, judiciaire, disposant d’une puissance suffisante pour limiter effectivement la souveraineté des nations et les mettre dans l’impossibilité de se faire justice elles-mêmes.
Plusieurs projets envisageaient soit la représentation directe des peuples, soit la participation au parlement mondial, à côté des délégués des États, de mandataires des grandes forces internationales comme le Syndicalisme et l’Église. Il s’agissait donc, non d’une Société des nations souveraines et armées, mais d’une société souveraine des nations désarmées.
La Société des nations existante, celle qu’institua le traité de Versailles, ne réalise sous aucun aspect la troisième conception.
Elle n’est pas une vraie fédération, sa constitution n’est pas démocratique, elle n’organise pas le règlement de tous les conflits sans exception, elle n’interdit pas dans tous les cas le recours à la guerre.
Elle a été le produit d’un compromis entre la conception française et la conception anglaise. Elle est, principalement, un organisme diplomatique.
Ses principaux organes sont : l’Assemblée des délégués, le Conseil et le Secrétariat.
La cour de justice internationale est rattachée à l’institution de Genève. L’Assemblée n’est pas un Parlement. Elle n’a pas le pouvoir de voter des lois à la majorité des voix ; ses décisions doivent être prises à l’unanimité et n’engagent les États qu’après leur ratification. Son mode de désignation n’est pas démocratique. Ses membres sont nommés par les gouvernements. Mais tandis que chaque pays dispose d’une voix à l’Assemblée, le Conseil est fondé sur une base oligarchique. Seuls les États puissants y ont un siège permanent. Le Conseil et l’Assemblée « connaissent de toute question qui rentre dans la sphère d’activité de la Société et intéressent la Paix du Monde ». Le Conseil n’est pas un pouvoir exécutif ; l’exécution des décisions de la S.D.N. et la mise en oeuvre des sanctions dépendent des États membres.
Le Conseil et l’Assemblée ont certaines attributions communes, notamment, la compétence pour la solutions des différends entre membres de la société. Parmi les attributions spéciales de l’Assemblée figure la désignation des membres nouveaux, en statuant à la majorité des deux tiers. Parmi les tâches réservées au Conseil, citons la préparation du plan de réduction des armements, la réception des rapports annuels des puissances disposant d’un mandat colonial.
La cour de justice internationale, dont le siège est à La Haye, est un corps de magistrats indépendants élus sans considération de leur nationalité par l’Assemblée et le Conseil. Sa compétence s’étend à toutes affaires que les parties lui soumettront aussi bien qu’à tous les cas prévus par les conventions en vigueur.
Signalons comme autre organe : le secrétariat, dont le siège est à Genève. C’est le seul organe permanent de la société.
L’examen des principaux articles du pacte nous montrera qu’aucune des revendications fondamentales du pacifisme n’est réalisée.
Sur le désarmement, l’article 8 proclame, non pas qu’il faut tendre au désarmement total, mais que :
« Le maintien de la paix exige la réduction des armements nationaux au minimum compatible avec la sécurité nationale et avec l’exécution des obligations internationales prévues pour une action commune. »
Le principe formulé est certes un progrès sur la vieille formule « Si vis pacem para bellum » mais l’engagement moral n’a pas été tenu.
Tandis que les pacifistes les plus modérés, tout en admettant la guerre défensive, condamnent la guerre d’agression, le pacte permet la guerre offensive dans certains cas.
Signalons les articles 12 et 13 :
« ARTICLE 12. — Paragraphe 1. — Tous les membres de la Société conviennent que s’il s’élève entre eux un différend susceptible d’entraîner une rupture, ils le soumettront, soit à la procédure de l’arbitrage ou à un réglement judiciaire, soit à l’examen du Conseil. Ils conviennent encore qu’en aucun cas ils ne doivent recourir à la guerre avant l’expiration d’un délai de trois mois après la décision arbitrale ou judiciaire ou le rapport du Conseil. »
« ARTICLE 13. — Paragraphe 4. — Les membres de la Société s’engagent à exécuter de bonne foi les sentences rendues et à ne pas recourir à la guerre contre tout membre de la Société qui s’y conformera. Faute d’exécution de la sentence, le Conseil propose les mesures qui doivent en assurer l’effet. »
Enfin le paragraphe 6 de l’article 15 dit :
« Si le rapport du Conseil est accepté à l’unanimité, le vote des représentants des parties ne comptant pas dans le calcul de cette unanimité, les membres de la Société s’engagent à ne recourir à la guerre contre aucune partie qui se conforme aux conclusions du rapport. »
« Paragraphe 7. — Dans le cas où le Conseil ne réussit pas à faire accepter son rapport par tous les membres autres que les représentants de toute partie au différend, les membres de la Société se réservent le droit d’agir comme ils le jugeront nécessaire pour le maintien du droit et de la justice. »
La portée des paragraphes les plus monstrueux, qui prévoient le recours à la guerre licite et légale, se trouve certes diminuée depuis la signature du pacte Kellog, condamnant la guerre en tant qu’instrument de politique nationale. Mais jusqu’alors les membres de la S. D. N. n’ont pu se mettre d’accord pour un amendement mettant en harmonie les deux pactes de Paris. On voit aussi dans ces deux articles que certains conflits restent sans solution lorsqu’il n’y a pas un rapport adopté à l’unanimité par le Conseil. Ajoutons aussi (paragraphe 8 de l’article 15) que le Conseil ne recommande aucune solution lorsqu’il reconnaît que le conflit porte sur un problème que le droit international laisse à la compétence exclusive d’un État. Figurent dans cette catégorie les principaux problèmes économiques, immigration, douanes, etc ...
Enfin, dans leurs sentences, le conseil ou la cour de justice doivent tenir compte des traités existants, dont certains furent imposés par la violence. Or, c’est surtout la question de la révision des traités qui divise aujourd’hui les peuples. Le président Wilson avait proposé que l’Assemblée puisse procéder aux deux tiers des voix, à la modification d’un traité. La suggestion fut repoussée. Le fameux article 19 dit seulement :
« L’Assemblée peut, de temps en temps, inviter les membres de la Société à procéder à un nouvel examen des traités devenus inapplicables, ainsi que des situations internationales dont le maintien pourrait mettre en péril la paix du monde. »
Si insuffisant que soit cet article, l’intervention de la S. D. N. pourrait être précieuse, pour aider à régler les différends insolubles par la voie diplomatique ordinaire. Mais, jusqu’alors, en ce qui concerne le traité de Versailles, il n’a pas été utilisé. Venons ensuite au problème des sanctions.
Dans une fédération d’États désarmés, le pouvoir fédéral disposera de moyens de sanctions d’autant plus justes qu’elles s’exerceront directement sur les individus coupables d’attentat à la paix. De plus, une partie de l’organisation économique étant internationalisée, des mesures de pression économique ne dépendront plus du bon vouloir des gouvernements. Enfin, certains envisagent une force de police préventive.
De toute manière, une part importante de la puissance politique sera transférée à la communauté internationale.
La S. D. N. actuelle ne peut agir par elle-même. Ses sanctions dépendent du bon vouloir des États.
« ARTICLE 10. — Les membres de la Société s’engagent à respecter et à maintenir contre toute agression extérieure l’intégrité territoriale et l’indépendance politique présente de tous les membres de la Société. En cas d’agression, de menace ou de danger d’agression le Conseil avise aux moyens d’assurer l’exécution de cette obligation. »
« ARTICLE 16. — Paragraphe 1. — Si un membre de la Société recourt à la guerre contrairement aux engagements pris aux articles 12, 13 ou 15, il est ipso facto considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les membres de la Société. Ceux-ci s’engagent à rompre immédiatement avec lui toutes relations commerciales ou financières, à interdire tous rapports entre leurs nationaux et ceux de l’État en rupture de pacte et à faire cesser toutes communications financières, commerciales ou personnelles entre les nationaux de cet État et ceux de tout autre État ou non de la Société. »
« Paragraphe 2. — En ce cas, le Conseil a le devoir de recommander aux divers Gouvernements intéressés, les effectifs militaires navals ou aériens, par lesquels les Membres de la Société contribueront respectivement aux forces armées destinées à faire respecter les engagements de la Société. »
« Paragraphe 4. — Peut être exclu de la Société tout membre qui s’est rendu coupable de la violation d’un des engagements résultant du Pacte. L’exclusion est prononcée par le vote de tous les autres membres de la Société représentés au Conseil. »
On a vu, dans le cas du Japon que la seule sanction effectivement appliquée a été l’exclusion, alors qu’une grande fraction de l’opinion mondiale voulait des sanctions économiques.
Cet examen nous fait voir qu’il n’y a rien de commun entre le régime fédératif tel que nous l’envisageons à nos articles Guerre et Pacifisme et la S. D. N. actuelle. Nous savons tous les arguments que les libertaires, partisans pourtant de l’idée de fédération, peuvent opposer à l’idée d’un sur-État. On peut d’ailleurs concevoir une organisation de la solidarité des peuples qui ait pour objet et résultat de faire disparaître les principaux conflits plutôt que de les régler par voie d’autorité. Mais, en tous cas, l’expérience sur laquelle on doit se baser pour établir ses convictions sur l’efficacité d’un régime fédéral est celle des nations à forme fédérative, comme l’Amérique du Nord et la Suisse, mais nullement celle de la Ligue de Genève. Le problème reste entier.
Les revendications immédiates des pacifistes : désarmement, arbitrage généralisé, révision des traités, abaissement des barrières douanières doivent être les mêmes que si la S. D. N. n’existait pas. La S. D. N. ne doit pas être le centre de nos préoccupations. Le problème essentiel de l’internationalisme constructif n’est pas là.
Un de ses articles prévoit, certes, des amendements aux pactes, pour lesquels la majorité des voix suffisent. Mais il n’est nullement prouvé que le futur régime juridique ou politique international sortira de la transformation du pacte actuel. Déjà, certaines de ses lacunes ont été comblées par des pactes distincts, comme l’acte général d’arbitrage. On peut prévoir d’autres conventions auxquelles participeraient la Russie et les États-Unis, sans adhérer à la S. D. N. Enfin, avant la fédération mondiale, nous aurons peut-être la fédération européenne. Pour réaliser n’importe quelle forme hardie de progrès, nous comptons moins sur l’initiative des gouvernants ou de leurs délégués que sur l’action vigoureuse des peuples. Toutefois, une S. D. N. vraiment démocratique et où le principe de l’unanimité ferait place au principe de la majorité, aurait un autre caractère.
L’expérience a donc infirmé la confiance excessive que certains mettaient dans cet organisme. Mais si nous savons nettement que la Ligue de Genève ne peut assurer par elle-même la paix, cela ne veut pas dire qu’elle ne puisse être utilisée pour le règlement de certains conflits. Il y a des cas où les peuples devraient imposer le recours à son intervention, par exemple celui de la révision des traités.
Elle est un des instruments dont on peut se servir. Confiance et utilisation sont deux notions très différentes. Parfois il est bon qu’un problème soit posé sur un plan largement international. Parfois, la diplomatie publique vaut mieux que la diplomatie privée. Et, en tous cas, toute méthode de règlement pacifique est bonne, si elle diminue les chances de guerre.
Mais, ni par les principes qu’elle proclame, ni par le caractère de sa constitution, ni par l’oeuvre qu’elle a réalisée, ni par les possibilités qu’elle contient, la S. D. N. ne mérite de symboliser les aspirations populaires en faveur d’une paix complète, d’une sécurité réelle, d’une solidarité effective, d’un désarmement total.
— René VALFORT.
SOCIÉTÉ FUTURE (la)
Les individualistes n’aiment guère à s’entretenir d’une Société future. Cette idée a été exploitée et peut nourrir son homme tout comme l’exploitation du paradis nourrit le prêtre, mais elle présente cette ressemblance avec le paradis que la description de ses merveilles exerce une influence soporifique engourdissante sur qui en entend la description ; elle fait oublier l’oppression, la tyrannie, le servage présent ; elle affaiblit l’énergie, elle émascule l’initiative. L’individualiste ne met pas son espoir dans la société future. Il vit dans le moment présent et il veut tirer de ce moment présent le maximum de résultats. L’activité individualiste est une besogne, une réalisation essentiellement présente. L’individualiste sait bien que le présent est l’héritier du passé et qu’il est gros de l’avenir. Ce n’est pas demain qu’il veut voir cesser l’empiètement du social sur l’individuel, l’envahissement, la compression de celui-ci par celui-là. C’est aujourd’hui, dans ses circonstances et conditions actuelles d’existence, que l’individualiste veut conquérir son indépendance.
Certes, l’individualiste échoue dans nombre de ses tentatives d’affranchissement du joug de la maîtrise ambiante. C’est tout naturel quand on considère à quelles forces d’opposition et d’oppression il lui faut se heurter. Mais l’avenir profitera automatiquement de ce qu’il conquiert pour lui-même. L’individualiste sait bien qu’il n’exploitera pas la forêt tout entière, mais le sentier qu’il aura frayé demeurera et si ceux qui lui succèderont le veulent, ils le maintiendront en bon état de conservation et l’élargiront.
L’individualiste est incapable, il est vrai, de dessiner tous les détails de la carte d’une « humanité future », telle qu’elle existerait si ses revendications étaient acquises. Il lui est donc impossible de faire oeuvre topographique, mais il pourra en revanche prévoir avec certitude et la nature du terrain, et la qualité du liquide qui emplira les fleuves et le genre de culture possible. « L’humanité nouvelle » n’est pas absolument pour lui terra incognita.
L’individualiste peut donc dès maintenant se rendre compte de ce que sera une « humanité future ». Il sait qu’elle ne ressemblera en rien au monde actuel, moins dans des changements de détail que par la complète transformation de la mentalité générale, la manière différente de concevoir les rapports entre les hommes, le changement de l’état d’esprit particulier et universel qui rendront impossibles l’existence de certaines méthodes, le fonctionnement de certaines institutions.
Ainsi, l’individualiste peut affirmer avec certitude que dans la société future la méthode d’autorité ne subsistera en aucun cas. Imaginer un « monde à venir » où il y aurait encore trace de domination, de coercition, d’obligation est un non-sens.
L’individualiste est sûr qu’il n’y aura pas de place pour l’intervention de l’État, d’une institution ou d’une administration gouvernementale ou sociale-législative, pénale, disciplinaire, dans les modalités de la pensée, de la conduite, de l’activité des unités humaines isolées ou associées.
L’individualiste sait que les rapports entre les humains et les accords qu’ils pourraient conclure seront établis volontairement, que les ententes et les contrats qu’ils pourront passer le seront pour un objet et un temps déterminés et non obligatoirement, que toujours ils seront sujets à résiliation selon préavis, qu’il n’y aura pas une clause ou un article d’un accord ou d’un contrat qui n’ait été pesé et discuté avant d’être souscrit par les co-contractants ; qu’il ne pourra exister de contrat « unilatéral », c’est-à-dire obligeant quiconque à remplir un engagement qu’il n’a pas accepté personnellement et à bon escient. L’individualiste sait qu’aucune majorité économique, politique, religieuse ou autre, qu’aucun ensemble social, quel qu’il soit, ne pourra contraindre une minorité ou une seule unité humaine à se conformer contre son gré à ses décisions ou à ses arrêts.
Voilà toute une série de certitudes sur lesquelles il n’y a pas à ergoter.
« L’humanité future », telle que la conçoit l’individualiste se « déroule » sans gare terminus, sans point d’arrivée. Elle est en éternel devenir, évoluant indéfiniment sous l’impulsion des conceptions et des réalisations multiples qui s’y feraient jour. Une humanité du type dynamique, si l’on peut s’exprimer ainsi, ignore l’arrêt en cours de route, ou, s’il y a arrêt aux stations, entend que ce soit le temps strictement nécessaire pour y déposer ceux qui veulent tenter une expérience qui n’engage jamais qu’eux-mêmes.
L’humanité future, « l’humanité nouvelle » comme la comprennent les individualistes, constitue une gigantesque arène où, tant au point de vue de la pensée, de la coutume que de la technique, lutteront et se concurrenceront entre eux tous les projets, les plans, les associations, les pratiques de vie imaginables. Et cela, quels que soient le moment, le stade de l’évolution du globe.
C’est à cause de ces caractéristiques bien tranchées que « l’humanité nouvelle » n’a aucun point de ressemblance, ne peut avoir aucun point de rencontre avec « la vieille humanité », la nôtre. Elle sera polydynamique, polymorphique, multilatérale.
Quand on demande comment, dans « l’humanité future », telle que la veulent les individualistes, l’on solutionnera exactement tel point litigieux, il est clair que le questionné n’en sait rien. Mais ce que l’on peut répondre avec certitude c’est qu’il ne sera jamais résolu par la méthode autoritaire, qu’on n’aura jamais recours à la violence, à la contrainte, à la force, pour régler le différend.
Bon nombre d’individualistes pensent que l’avènement de « l’humanité future », telle que nous l’avons ébauchée, dépend d’une attaque, d’une propagande sérieuse, rationnelle et suivie, contre l’emploi de l’argument d’autorité dans toutes les sphères de l’activité humaine, que ce soit en économie politique ou sociale, dans les moeurs, en art, en science, en littérature. Voici quelques-uns des points d’où, arguant du fait d’être né, d’avoir été jeté dans la société organisée sans qu’il ait été donné à l’unité humaine d’y consentir ou de s’y refuser, sans qu’il lui ait été possible de s’en défendre ou de s’y opposer, ils déduisent que ce fait primordial confère à celui qui en est victime le droit à la vie, sans restrictions ni réserves.
C’est-à-dire le droit à la consommation indépendamment de toute politique économique ; au choix individuel de la façon de produire et du moyen de production ; au choix du mode d’échange de sa production ; au choix des consommateurs qu’il veut faire bénéficier de ses échanges ; à la faculté de s’associer ou non et, s’il refuse de s’associer, au droit au moyen de production lui permettant de consommer suffisamment pour s’entretenir, tout isolé qu’il demeure ; au choix de ses associés et au choix des buts d’association.
C’est-à-dire, le droit à la faculté de se comporter comme il le trouve le plus avantageux, à ses risques et périls, sans autre limite que l’empiètement sur le comportement d’autrui (autrement dit : l’emploi de la violence ou de la contrainte ou de la coercition à l’égard de qui se comporte autrement que vous).
Le droit à la garantie qu’il ne sera pas forcé de faire ce qu’il considère comme lui étant personnellement désagréable ou désavantageux, ni empêché de faire ce qu’il envisage comme lui étant personnellement agréable ou profitable à charge de revanche à l’égard d’autrui ; et, dès lors, que, pour conquérir ce qui lui paraît utile, avantageux ou agréable, il n’aura recours ni à la force physique, ni au dol, ni à la fraude ; le droit qu’il lui sera loisible de circuler partout, de se déplacer dans toutes les directions, de répandre à titre isolé ou collectif les doctrines, les opinions, les propositions, les thèses qu’il se sent poussées à propager, sous réserve de ne point se servir de la violence sous n’importe quelle forme pour en réaliser la pratique ; le droit à l’expérimentation dans tous les domaines et sous toutes les formes, à la publicité des expériences, au recrutement des associés que leur réalisation rend nécessaire, à condition que n’y participent que ceux qui le veulent bien et que puissent cesser d’y prendre part ceux qui ne le veulent plus ; le droit à la consommation et au moyen de production, alors même que l’individu se refuserait à participer au fonctionnement de tout système ou à la mise en pratique de toute méthode ou de toute institution qui lui semblerait désavantageuse, personnellement ou pluralement parlant.
Le droit à la vie, c’est-à-dire le droit de faire son bonheur soi-même comme il se sent poussé à le faire, seul ou en s’associant avec plusieurs de ses semblables vers qui il se sent plus particulièrement attiré, sans qu’il ait à redouter l’intervention ou l’immixtion de personnalités ou d’organisations extérieuses à son ego ou à l’association dont il fait momentanément partie.
Les individualistes dont il s’agit estiment que la garantie du droit à la vie, envisagée de cette façon, est le minimum de ce que peut revendiquer l’unité humaine lorsqu’elle a compris quel acte d’autorité et d’arbitraire on commet à son égard en l’engendrant. Ils estiment de même que toute propagande faite en faveur de ces revendications favorise l’avènement de la mentalité transformée, fonction de toute humanité nouvelle.
La lutte pour l’abolition du monopole de l’État ou de toute autre forme exécutive le remplaçant, c’est-à-dire contre son intervention à titre centralisateur, administrateur, régulateur, modérateur, organisateur ou autre dans les rapports entre les individus, dans n’importe quelle sphère que ce soit, peut également favoriser, estiment ces individualistes, l’éclosion de la mentalité en question.
Peut-on voir dans le bolchevisme, c’est-à-dire dans la mise en pratique de la doctrine socialiste, telle que l’a accomplie la fraction socialiste qui, en Russie, s’est emparée, par voie révolutionnaire, de l’administration des choses, peut-on voir dans le bolchevisme une annonciation de « l’humanité nouvelle » ? La question est intéressante à solutionner, puisqu’il s’est rencontré des individualistes pour faire montre de sympathie à l’égard du gouvernement qui préside actuellement aux destinées de l’Europe Orientale.
Les faits sont là. Suspension et suppression continues de la liberté de la presse et de la liberté de réunion, poursuites et procès pour délits d’opinion, discipline civile et militaire, réquisitions individuelles et collectives, tribunaux d’exception et condamnations extraordinaires, emprisonnements, déportations, expulsions politiques, demandes d’extradition, organisation policière, répressions sanglantes ... force est de reconnaître que le gouvernement de Moscou n’a fait que continuer la tradition des gouvernements qui se sont succédé depuis qu’il existe des gouvernements. Il n’a rien innové.
On peut justifier l’indispensabilité des mesures exceptionnelles par la crainte d’un retour offensif de la réaction, ou barrer la route à l’opportunisme d’une république bourgeoise.
Mais il y a loin de là à la qualification de contre-révolutionnaires que le gouvernement de la république fédérative des Soviets décerne avec tant de générosité à ses critiques.
Terrorisme blanc ou terrorisme rouge, c’est toujours du terrorisme. Dictature du clergé, dictature de la bourgeoisie ou dictature du prolétariat, c’est toujours de la dictature.
Dictature d’une élite ? Qu’est-ce que l’élite du prolétariat ? Qu’est-ce que l’élite de la bourgeoisie ? Est-ce ce petit nombre de personnes que la culture ou la perfection « morale » distinguent du reste de la classe ou de la catégorie sociale à laquelle ils appartiennent ? Est-ce ce petit nombre de privilégiés auxquels les circonstances ou l’adresse ont permis de se placer à la tête de leur milieu ? Est-ce la réunion des plus éminents d’un groupe ou la troupe coalisée des arrivistes et des faiseurs d’un clan politique ? Leur situation exceptionnelle est-elle acquise grâce à leur valeur personnelle, à leur énergie ou seulement à la faveur de leur éloquence ou encore de leur brutalité ? Il est si difficile parfois de distinguer entre l’ardeur qui émane d’une conviction sincère et le fanatisme que laisse percer le désir d’exercer la domination, ou de faire ses affaires à soi en prétendant faire celles d’autrui et de la collectivité ! L’individualiste se méfie des élites qui se donnent la mission d’élever les masses à un degré supérieur de culture ou de bien-être. Son instinct le met en garde contre les « bons bergers ». Aussi sa propagande a-t-elle pour but d’amener chacun à se passer de bergers et à s’associer entre individus jouissant d’une liberté égale afin de résister, de faire pièce à ceux qui ne conçoivent l’association que soumise à une directive extérieure centralisatrice, pompant, suçant à son profit toutes les forces, toutes les facultés des associés.
Il est inconcevable que le terrorisme ou la dictature puissent constituer un facteur d’évolution ou de développement de la personnalité humaine. Il se peut que sous de pareils régimes nombre d’individus se courbent, que la masse se résigne à n’avoir plus que la mentalité de la servitude — si tant est qu’elle ait jamais aspiré à une mentalité autre — tous et chacun même peuvent faire fi des libertés relativement essentielles, soucieux seulement qu’il soit donné à la question économique une solution heureuse pour tous. Mais l’acquiescement de l’immense majorité à un système de gouvernement tel que la dictature économique et politique du « prolétariat » , le silence forcé des quelques éléments minoritaires ne prouveraient rien en faveur de l’avènement d’une « humanité nouvelle ».
Pas plus d’ailleurs que certaines réalisations d’ordre civil ou civique proclamant l’égalité absolue des sexes ou l’accession de la femme à toutes les fonctions administratives ou politiques possibles.
Pas davantage que prouverait en faveur de « l’humanité future » l’ingérence obligatoire des syndicats dans toutes les tractations d’ordre économique et leur accession au rôle de conseillers écoutés, sinon prépondérants, d’un gouvernement quelconque.
Si l’on examine attentivement l’oeuvre de ces réformateurs — pétulants et virulents — on s’aperçoit sans tarder qu’il y a eu changement de dirigeants au lieu d’apport d’une tactique ou d’une mise en pratique inédite. Dès que s’est apaisé le tumulte qui a accompagné le passage au pouvoir dans de nouvelles mains, l’hypnotisé se réveille de son délire passager, et il se rend compte qu’il est aux prises avec les mêmes difficultés, les mêmes interdictions, les mêmes traditions, le même fonctionnarisme que sous le régime précédent. Il n’a rien gagné non plus en indépendance ou en autonomie.
Ce qu’il voulait, c’était « vivre sa vie, la vivre à son gré, à son goût ». Ce qu’il a obtenu c’est que l’attelage change de cocher, il se demande s’il rêve et, devant l’évidence, il courbe tristement la tête et reprend son collier de misère et de malheur.
Je n’ignore pas que bon nombre d’individualistes anarchistes se désintéressent de « l’humanité future ». Pour eux, « sans risquer d’errer beaucoup, il est permis de présumer :
-
Qu’il n’existera point de vie générale en collectivité d’où l’autorité serait absolument exclue ;
-
Que dans toutes les sociétés, on rencontrera isolés ou groupés, des protestataires, des mécontents, des critiques et des négateurs.
Sans doute, on assistera à des transformations, à des améliorations, à des modifications, à des bouleversements même. Le système de production selon le mode capitaliste pourra finir par s’évanouir, ou graduellement, ou par un coup de force. Peu à peu, on travaillera moins, on gagnera davantage, les réformes se feront menaçantes, inéluctables. On pourra connaître un régime économique dissemblable du nôtre. Mais quel que soit le système de société qui englobera les humains, le bon sens indique que sa permanence est liée à l’existence d’une réglementation adaptée à la mentalité moyenne des composants du milieu. Bon gré, mal gré, ceux placés à droite ou à gauche de cette réglementation moyenne devront y conformer leurs actes, et peu importe sa base : exclusivement économique ou biologique, on morale.
L’expérience indique encore qu’à l’égard des réfractaires, on emploiera les seuls arguments dont puissent disposer les hommes : la politique ou la violence, la persuasion ou la contrainte, les marchandages ou l’arbitraire.
La foule va toujours vers qui parle bien et porte beau. Ses colères ne durent pas plus que ses admirations. Elle est toujours aussi facile à tromper et à séduire. On ne peut pas davantage faire fond sur elle qu’il y a un siècle ou mille ans. La masse est acquise au plus fort, au plus superficiel, au plus chanceux. Dans pareil état de choses que font, que feront les individualistes anarchistes ?
-
Les uns, répondent-ils, demeurent dans le milieu et y luttent pour s’affirmer. Sans se préoccuper trop du choix des moyens ; car leur grande affaire — l’affaire de leur vie — c’est, coûte que coûte, de réagir contre le déterminisme extérieur. C’est s’affirmer, sinon diminuer l’emprise du milieu sur soi ? Ils sont réagisseurs, réfractaires, propagandistes, révolutionnaires, ayant recours à tous les moyens de bataille possibles : éducation, violence, ruse, illégalisme. Ils saisissent les occasions où le Pouvoir exagère pour susciter le sentiment de rebellion chez ceux qui en sont victimes. Mais c’est par plaisir qu’ils agissent et non pour le profit des souffrants ou en les abusant par de vaines paroles. Ils vont, ils viennent, se mêlant à un mouvement ou s’en retirant, selon que leur initiative court ou non le risque d’être entamée, faussant compagnie à ceux qu’ils ont appelés à la révolte, dès que ceux-ci font mine de les suivre, de les acclamer ou de se constituer en parti. Peut-être font-ils plus qu’ils ne sont.
-
Les autres se situent en marge du milieu. Le moyen de production conquis ou acquis, ils se préoccupent de faire de leur séparation de l’ambiance une réalité, en s’essayant à produire suffisamment pour leur propre consommation, en supprimant de leur consommation le factice et le superflu.
Parce que les hommes, pris en général, ne leur semblent guère valoir la peine qu’on s’intéresse à eux, ils n’entretiennent que le moins de rapports possibles avec les institutions et les êtres humains et c’est à la fréquentation de quelques « camarades d’idées », sélectionnés, que se borne leur vie sociale. Ils se groupent parfois, mais temporairement et, étant entendu qu’ils se réservent la faculté de ne jamais déléguer à l’association restreinte dont ils font partie la disposition de leur produit. Le reste du monde n’existe que peu ou prou pour eux, c’est-à-dire dans la mesure où ils en ont besoin. Peut-être sont-ils plus qu’ils ne font.
C’est entre ces deux conceptions de la vie individualiste que s’échelonnent les divers tempéraments individualistes anarchistes ».
Pour les camarades dont je viens de transcrire l’opinion, toute ébauche « d’humanité future », toute hypothèse de milieu individualiste est oeuvre d’imagination, pure fantaisie littéraire. Ils maintiennent que, pour que la mentalité, la volonté générale se transforment en réalité, il faudrait que :
« Les espèces en voie de dégénérescence, les catégories dirigées aient délivré le globe de leur présence ; or, cela ne peut sortir du domaine des probabilités. »
Il n’était que justice de faire connaître ce point de vue que n’oublie aucun individualiste, même quand il parle de devenir social.
D’ailleurs, ce n’est pas parce que nous avons dépeint à larges traits un tableau de « l’humanité nouvelle » où nous voudrions évoluer, qu’on nous taxerait de « société futuriste ». L’individualiste anarchiste n’est pas un société futuriste ; présentéiste, il ne saurait rien sacrifier de son être ou de son avoir pour l’avènement d’un état de choses dont il ne jouira pas sur-le-champ, sans inconséquence ou illogisme. La pensée individualiste ne souffre aucune équivoque sur ce point. C’est au sein de la vieille humanité, de l’humanité des dominateurs et dictateurs de toute espèce qu’apparaît, que se forme, que devient « l’humanité nouvelle ». Les individualistes sont des révolutionnaires permanents et personnels ; ils s’efforcent de pratiquer en eux-mêmes, en leur entourage, dans leurs rapports avec leurs camarades d’idées et en leur compagnie, les conceptions particulières qu’ils se font de la vie, sous un aspect individuel, sous son aspect plural. Chaque fois qu’une des caractéristiques qui distinguent « l’humanité nouvelle » parvient à s’implanter dans les moeurs, chaque fois qu’à leurs risques et périls, un ou plusieurs êtres humains les anticipent par leurs dits ou par leurs gestes, « l’humanité nouvelle se réalise ».
Dans le domaine des arts, des lettres, de la science, de l’éthique, par leur conduite personnelle, dans la sphère économique même, on trouve des unités humaines qui pensent et agissent contrairement aux coutumes, aux usages, aux routines, aux préjugés et aux conventions de la « vieille société » et les battent en brèche. Ils représentent, eux aussi, dans leur genre d’activité, l’humanité nouvelle. D’ores et déjà, les individualistes en font partie, par leur manière de se comporter à l’égard du vieux monde, parce qu’elle révèle à chacun de leurs mouvements leur intention, leur volonté, leur espoir de voir l’individu se libérer de la contrainte du grégaire, de la mentalité du troupeau.
Peut-on espérer qu’après maints flux et reflux, maints essais douloureux, les humains en viendront quelque jour à la pratique consciencieuse de la réciprocité, à la solution individualiste anti-autoritaire — individualiste-anarchiste -, la solution de l’égale liberté ?
Peut-on anticiper que, mieux éclairés, plus instruits, informés davantage, les habitants de notre planète en viennent à comprendre enfin que ni la coercition, ni la domination du plus grand nombre ou de l’élite ou de la dictature d’un autocrate, d’une classe, d’une caste ne sont capables d’assurer le bonheur, c’est-à-dire de réduire toujours plus la souffrance évitable ? C’est le secret de l’avenir.
Mais optimiste ou pessimiste à cet égard, l’individualiste-anarchiste n’en continuera pas moins à dénoncer le préjugé qui donne sa force à l’autorité étatiste : la superstition du gouvernement nécessaire, et à vivre de façon publique ou occulte, comme si les préjugés et cette superstition n’existaient pas.
— E. ARMAND.
SOCIETES SECRETES
Les Sociétés secrètes ont existé de tout temps et chez tous les peuples ; on les trouve même dans les pays de civilisation rudimentaire. Religieuses, philosophiques ou politiques, elles ont généralement pour but de systématiser leurs conceptions et de les imposer au pays où elles vivent.
Presque partout, elles comportent une initiation impressionnante, avec des épreuves dans lesquelles on simule un danger. Le but est de lier le récipiendaire par la crainte. Certaines sociétés secrètes du Thibet liaient le postulant à un cadavre et l’abandonnaient ainsi pendant plusieurs jours. Avec l’évolution des moeurs, les initiations s’adoucissent, mais partout et toujours demeure l’idée de contraindre à la discrétion, au dévouement et à la fidélité par une réception redoutable, parfois même répugnante, comme dans certains compagnonnages ouvriers où on obligeait, paraît-il , le candidat à avaler des excréments.
Certaines sociétés secrètes ont joué un grand rôle dans l’histoire. Le nom de la Sainte Wehme, société secrète de Bohême, qui contraignait par la teneur d’un assassinat les dirigeants à entrer dans ses vues est parvenu jusqu’à nous.
Les partis d’extrême droite d’Allemagne auraient, paraît-il, ressuscité, aujourd’hui, la terrible Sainte Wehme.
L’ordre des Illuminés a été fondé, en Allemagne, au dix-huitième siècle par Weishaupt, professeur à l’Université d’Ingolstadt. Weishaupt ne se proposait rien moins que de transformer le monde et de le diriger au moyen d’une société secrète dont les agents du pouvoir politique de l’État ne seraient que les membres dévoués et obéissants. Son idée n’était pas tout à fait originale. Weishaupt avait appartenu, dans sa jeunesse, à l’ordre des Jésuites, et il avait voulu fonder une sorte de congrégation de jésuites de gauche qui gouvernerait le monde, non pour y maintenir les conceptions du passé, mais pour l’aiguiller, au contraire, dans la voie du progrès.
Ce progrès catholique, à la merci du hasard, il s’agissait d’en régulariser la marche, selon un plan établi à l’avance, dans une vaste association inconnue des masses et d’autant plus puissante.
Weishaupt réussit à grouper plusieurs milliers de personnes, appartenant à toutes les classes de la société. Le recrutement était assuré par les « frères insinuants », qui choisissaient eux-mêmes ceux des hommes de leur entourage qu’ils croyaient pouvoir être utiles à l’ordre et, pendant un temps très long, le nouvel adhérent ne connaissait de l’ordre qu’une personne : celle qui l’y avait fait entrer. Il devait lui remettre périodiquement des rapports sur lui, sa famille et son entourage. Ces rapports devaient être rigoureusement véridiques. Le nouveau membre devait se présenter et présenter les autres tels qu’ils étaient, avec leurs qualités et leurs défauts.
Une fois admis définitivement, l’illuminé avait à gravir une hiérarchie très compliquée : minerval, illuminé mineur, illuminé majeur, etc ... Au sommet, était un conseil que dirigeaient Weishaupt et son principal disciple Khnigge.
Pour donner un caractère mystérieux et, par cela même, accroître la force de ses directives, Weishaupt avait fait croire à ses associés qu’il n’était pas le chef, mais ne faisait que transmettre les ordres des « supérieurs inconnus ».
L’ordre des Illuminés ne dura pas ; Weishaupt et Khnigge se disputèrent, il y eut la scission et la société aux ambitions magnifiques s’écroula comme s’écroulent toutes les associations.
L’Illuminisme aurait grandement influencé la Révolution Française. Cela est plus que probable. Beaucoup d’hommes qui ont joué un rôle dans la révolution avaient fait partie de l’ordre ; ils y avaient certainement puisé des idées, mais prétendre, comme l’abbé Samuel que les événements de la révolution avaient été concertés d’avance dans cette société, cela ne peut être que faux, parce qu’impossible.
D’ailleurs, l’abbé Samuel, qui publia son livre au commencement du dix-neuvième siècle, est un ennemi des Illuminés.
Il est très difficile d’établir avec vérité le rôle exact d’une société secrète dans les événements historiques. La société secrète écrit peu ; tout s’y passe oralement, ce qui fait que, l’association disparue, plus rien ne reste d’elle.
On attribue de même à la Franc-Maçonnerie un rôle important dans la révolution française. Indirectement, le fait est certain. Toute l’agitation idéologique qui a précédé la révolution a été l’oeuvre d’hommes dont beaucoup appartenaient à la Franc-Maçonnerie. Mais, que la préparation des journées révolutionnaires, émeutes, procès de Louis XVI, etc ... , se soit élaborée dans les loges, cela est plus difficile à établir. D’ailleurs, des auteurs maçonniques, comme Lantoine, nient cette action directe de la Franc-Maçonnerie sur la révolution.
Le dix-neuvième siècle, surtout dans sa première moitié, vit fleurir nombre de sociétés secrètes. Outre la Franc-Maçonnerie, le carbonarisme italien se propagea dans toute l’Europe. Il réunissait des hommes d’opinions diverses : des bonapartistes qui regrettaient Napoléon et des républicains qui avaient vécu la révolution et en avaient gardé les doctrines.
Les idées des carbonari nous paraissent assez anodines. Dans la tour de la Lanterne, à la Rochelle, on peut voir une inscription gravée dans la muraille d’un cachot par l’un des quatre sergents guillotinés en 1820 :
« Ici, quatre carbonari ont été enfermés pour avoir défendu ... Dieu et la Liberté ! »
Partout où le gouvernement est despotique, l’opposition s’abrite dans les sociétés secrètes, seul lieu où elle peut s’exprimer, faire sa propagande, formuler ses espoirs.
En Russie, sous le tsarisme, tous les partis, des simples monarchistes constitutionnels juqu’aux socialistes et aux anarchistes, étaient obligés de s’organiser en sociétés secrètes. Souvent, le comité directeur siégeait à l’étranger. On rédigeait des journaux que l’on imprimait ou même dactylographiait sur du papier pelure, et on les envoyait clandestinement dans des ballots de marchandises. Des émissaires les portaient eux-mêmes, dissimulés dans la doublure de leurs vêtements, etc ...
En dépit du caractère impressionnant des initiations, de la menace de châtiments terribles pour les traîtres... :
Qui respectât les rois et qui voulût un maître,
Saisi par nous, qu’il meure au milieu des tourments
Et que ses cendres soient abandonnées au vent.
...les sociétés secrètes sont, on peut dire, presque toujours trahies. Andrieux, préfet de police, dit avec humour dans ses mémoires :
« Dès que vous serez trois, je serai au milieu de vous. »
C’est-à-dire : dès que vous serez trois, il y aura parmi vous un de mes espions.
Une grande société secrète russe terroriste fut, pendant de longues années, dirigée par un espion : Azew, qui appartenait à la police tsariste où il était très maigrement rétribué.
Azew, assez versé dans la doctrine du parti pour tenir le rôle de chef, dirigeait des attentats ; les hauts fonctionnaires du tsar se servaient de lui pour faire assassiner un confrère dont ils voulaient se venger.
Indispensables en régime autoritaire, les sociétés secrètes ont, en régime de liberté, le très gros inconvénient d’une action limitée. Elles ne sauraient jamais, si florissantes soient-elles, réunir les centaines de mille adhérents d’un parti politique. D’ailleurs on n’a aucun intérêt à s’enfermer dans une cave pour dire ce qui peut, sans inconvénient, être dit au grand jour.
Quant à vouloir, comme Weishaupt, faire diriger le monde par une société secrète, c’est un rêve. Les hommes sont trop fuyants, trop peu fidèles à un idéal pour qu’on puisse espérer les y faire travailler toute une vie sous une contrainte extérieure. Les intérêts, les passions, les ambitions personnelles ont vite fait de mettre la zizanie entre les supérieurs connus ou inconnus et la société disparaît comme disparaissent les organisations de toutes sortes.
Comme les hommes eux-mêmes, les sociétés n’ont qu’un temps et c’est se faire illusion que de vouloir bâtir d’avance pour les siècles futurs.
— Doctoresse PELLETIER.
SOCIOLOGIE
n. f.
La sociologie conspire avec la morale contre la liberté de l’individu ; elles s’associent pour étouffer l’indépendance et la vie. La sociologie a pris, ces dernières années, une place considérable dans les études philosophiques. La mode, car il existe, en philosophie, des modes comme dans la couture, est aujourd’hui à la sociologie objective, qui sacrifie l’individu à la collectivité. On n’aurait pas de peine à démontrer combien ce communisme fait d’obéissance passive, de résignation et d’insincérité est nuisible à la collectivité même. La sociologie élève au-dessus de tout la Société qui est le Dieu suprême devant lequel doivent s’incliner les individus. L’individu n’existe pas : c’est une entité. Mais la société existe. La société est une réalité en dehors de l’individu.
Certains problèmes appartiennent à la fois à la sociologie et à la morale. Parmi ceux-ci figurent celui que j’appellerai le problème des idoles : Dieu, Patrie, État, Autorité, etc ... Les idoles sont si nombreuses que je renonce à les énumérer. Pour qui réfléchit tant soit peu, ce sont là des idoles qui ne reposent que sur l’imbécillité et l’ignorance. L’homme forge ses chaînes, mais quand elles sont trop lourdes, il n’a pas le courage de s’en débarrasser. Il feint de les rejeter, mais c’est pour en prendre de nouvelles, qui portent d’autres noms : l’esclavage continue.
La sociologie se trouve en face de problèmes qu’elle résout toujours dans l’intérêt de la société, au détriment de l’individu. C’est lui qui est sacrifié. Il y a une sociologie de « classe » dont la partialité est révoltante. Sociologues de droite ou de gauche font preuve du même entêtement : ils sont aveugles et sourds. Chacun veut avoir raison et tout le monde a tort.
La sociologie ne vaut guère mieux que la morale. Elle a, comme elle, ses anomalies. Elle cherche aujourd’hui sa voie dans un fondement « objectif », après avoir fait cent fois fausse route, mais malgré les allures scientifiques qu’elle se donne, elle ne progresse guère. Elle n’a pas secoué ses chaînes : les sociologues sont les soutiens de l’ordre et de l’autorité. Ils sont à la remorque de l’État. L’étude des « faits sociaux » est pour eux l’occasion d’affirmer leur obéissance aux puissances établies. Ils ne visent qu’à humilier l’individu. L’objectivité des sociologues n’est qu’un déguisement de leur subjectivité. Les sociologues sont les dignes frères des moralistes : ils mentent comme eux, mais ils essaient, comme eux, d’étayer leurs mensonges sur des semblants de preuves. Ils essaient de faire passer leurs mensonges pour des vérités.
Certaines personnes croient que « sociologie » est synonyme de socialisme et le mot les effraye. Il n’a pourtant rien de terrible. Socialiste ou non, la sociologie vise à démontrer que la collectivité a des droits sur l’originalité et le talent, et que, hors de la collectivité, il n’y a point de salut. Sociologues de droite ou de gauche aboutissent aux mêmes conclusions : l’individu est fait pour la société et non la société pour l’individu. C’est le triomphe du communisme intégral. Il est stupide de soutenir que l’individu est fait pour la société, celle-ci ne pouvant subsister sans lui, n’ayant d’existence que par la somme des individus qui la composent. L’individu est fait pour l’individu. Il ne s’associe aux autres individus que dans la mesure où ceux-ci le comprennent, ont la même conception de la vie que lui. Les vivants ne peuvent s’associer aux morts. Une société d’individus libres n’aura rien de commun avec la nôtre : l’individu en sera la base et le sommet. Il pourra s’y développer sans contrainte. Au-dessus de l’individu, MM. les sociologues, attardés ou avancés, placent cette abstraction : la Société, avec une majuscule, à laquelle on doit tout sacrifier. Mais alors, si les individus, sans lesquels il n’y a point de société, se sacrifient à la société, ils se sacrifient eux-mêmes. C’est un non-sens. Ils s’immolent les uns aux autres et passent leur temps à se nuire. Ce sophisme me paraît tellement idiot que je ne veux point m’attarder à le discuter.
Guyau s’illusionnait lorsqu’il considérait, bien avant Durkheim, la sociologie comme la « science de l’avenir ». Il a tenté d’expliquer l’art, la religion et la morale au point de vue sociologique. Guyau a la naïveté de croire que l’on peut concilier la vie individuelle et la vie sociale. Il semble parfois avoir raison, mais il a fini toujours par aboutir à un compromis, où c’est l’individu qui est sacrifié.
« Le tas de sociologues », comme les appelle Han Ryner, valent le tas des moralistes. La science des sociétés et la science des mœurs vont ensemble. Elles s’unissent pour conspirer contre la vie de l’individu. « Les disciples de Durkheim, écrit Han Ryner, adorent servilement, comme leur maître, les fantômes créés par la naïveté des peuples et la ruse inconsciente des détenteurs du pouvoir et de la richesse. Leurs paroles comme sacerdotales sacrifient à tous les molochs la seule réalité, l’individu ». Les sociologues sont loin d’être des artistes : pensant mal, ils écrivent mal, nous ne pouvons digérer la lourdeur, la pesanteur des sociologues officiels.
« La sociologie est à la mode, écrit Bouglé. Tout le monde en parle. Peu de gens savent ce que c’est ». Il y a sociologie et sociologie. Si on entend par sociologie, l’observation des mœurs sociales, la critique des institutions et des lois, il est évident que nous faisons de la sociologie, nous ne faisons même que cela. Nous consentons à être sociologues de cette façon, et à ce qu’on trouve dans nos travaux une part de sociologie. Cependant, je proposerai d’appeler socio-critique, pour qu’on cesse de la confondre avec la sociologie ordinaire, notre méthode de critique appliquée à la société que nous jugeons belle ou laide, bonne ou mauvaise, utile ou nuisible, selon qu’elle réalise ou non l’idéal esthétique.
Georges Palante est un des rares philosophes qui considère la sociologie à un point de vue individualiste. Pour lui :
« La sociologie n’est autre chose que la Psychologie sociale. Et nous entendons par psychologie sociale, la science qui étudie la mentalité des unités rapprochées par la vie sociale. » (Précis de Sociologie, p. 3)
Il faut toujours en revenir à la psychologie individuelle. La sociologie ainsi entendue a deux objets : rechercher l’influence de l’individu sur la société ; rechercher l’influence de la société sur l’individu. Psychologue social, tel est le sociologue. Il envisage les phénomènes sociaux sous leur aspect subjectif. Les lois sociologiques se déduisent des lois psychologiques.
La sociologie ou « Science des sociétés », ainsi nommée par Auguste Comte, a pris depuis son fondateur des proportions inquiétantes. Ses prétentions sont illimitées. Elle n’a d’autre ambition que de tenir en tutelle toutes les autres sciences : celles-ci seront sociologiques ou elles ne seront pas. La méthode sociologique a tout envahi. Morale, Esthétique, etc ... ne sont, désormais, que des compartiments de la Sociologie. Il y a maintenant une cosmosociologie, une anthroposociologie, une psychosociologie, etc ...
La sociologie n’étudie plus les sociétés telles qu’elles devraient être, mais telles qu’elles ont été. Le sociologue n’est plus qu’un savant qui s’efforce de connaître les sociétés, de dégager les lois qui les régissent. C’est tout. Il ne conclut pas. Ce n’est pas son affaire.
L’avenir des sociétés, le sociologue s’en désintéresse. Étant objective, la sociologie se proclame impartiale et scientifique. Elle n’est ni l’une ni l’autre. Évidemment, il était nécessaire, en face de leurs exagérations, de ramener certains sociologues à l’étude des faits : ils ne peuvent pas n’être que des rêveurs. Mais sous prétexte de combattre chez eux l’absence de méthode, ou des méthodes défectueuses, la littérature nuageuse à laquelle nous devons tant de fabricants d’Icaries, de constructeurs de cités futures, de prophètes, d’annonciateurs des temps nouveaux, et beaucoup d’autres pontifes demi-anarchisants, on est tombé dans l’excès contraire. Pour les sociologues modern-style, les faits concrets seuls sont intéressants. C’est le cas de répéter après les anciens : in medio stat virtus. Cependant, ce in medio, ne l’appelons pas juste-milieu, appelons-le harmonie. Or, la sociologie est loin d’être une harmonie. Désormais, le sociologue ne se préoccupe plus de l’avenir des sociétés, de leur transformation en sociétés meilleures. Ce n’est pas objet de science. Ainsi en ont décidé les pontifes. Il y a, d’une part, les sociologues qui sont les seuls savants et, d’autre part, les non-sociologues qui sont des ignorants. La sur-sociologie explique tout, ouvre des horizons insoupçonnés à l’esprit humain : il faut avoir recours à la sociologie, si on veut avoir la clef de tous les problèmes. Tout le monde doit devenir sociologue, pour que la société continue de fonctionner à merveille et de distribuer ses bienfaits aux individus agenouillés devant son omnipotence.
On veut tout expliquer par la sociologie. Religion, art, morale, économie politique, histoire, etc ... sont des « branches de la sociologie ». Il y a une sociologie religieuse, morale, esthétique, etc .. , dont la prétention est de tout expliquer « objectivement ». Depuis que le fondateur du positivisme a placé dans la sociologie le salut de l’humanité, celle-ci est devenue la plus compliquée de toutes les sciences. Ne nions pas l’intérêt que peut présenter la sociologie ainsi entendue. Elle nous oblige à descendre sur la terre et à observer de près les réalités. La méthode analytique de la sociologie et des sciences sociales qui s’y rattachent peut rendre des services, mais ne les exagérons point. Ne demandons pas à la sociologie plus qu’elle ne peut donner : restituons-lui sa place dans l’ensemble des sciences, non au-dessus d’elles, mais humblement à côté d’elles. Chaque savant a une tendance à voir dans la science qu’il cultive la science unique, oubliant que, près de lui, d’autres savants travaillent dans d’autres directions. C’est une erreur, les sciences convergent au même but : la vérité. La spécialité à outrance est nuisible : le savant doit posséder avant tout une culture générale, dans l’intérêt même de la science dans laquelle il s’est spécialisé.
Durkheim et ses disciples appliquent à l’étude de la vie morale la méthode des sciences positives. Les « faits moraux » sont pour Durkheim des phénomènes comme les autres. Il ne s’agit pas de tirer la morale de la science, mais de faire la science de la morale. C’est l’ambition de Durkheim.
Les sociologues affirment bien que le fait d’étudier la réalité n’implique pas celui de renoncer à son amélioration et ils conservent à la morale son caractère de « science normative », en ce sens que les lois qu’elle découvre sont autant de devoirs qu’elle nous impose. La morale sociologique est équivoque et manque d’harmonie. Il ne reste plus, avec elle, que le dieu Société, qui entretient dans son sein tous les dieux et tous les cultes. L’école sociologique se vante, d’ailleurs, de posséder cet esprit « sagement conservateur » (Préface de La Division du Travail social), et de mettre, à la place de l’initiative individuelle, le conformisme social. Cette morale faite par et pour le social interdit à l’individu de penser et d’agir librement : elle tue dans les cerveaux l’esprit critique. Que peut bien être le progrès pour les sociologues ? Diviniser la société, tel est, en fin de compte, pour Durkheim et ses disciples, le but de la sociologie.
Les « sociologues bourreurs de crâne » sont un produit de notre temps, où l’égalité est conçue à rebours, où le suffrage universel exerce ses ravages, où les majorités l’emportent sur les « individualités », où l’incohérence et l’équivoque dominent. La manie de tout niveler est une des caractéristiques de notre temps.
Les sociologues à la Durkheim rêvent de faire de la société une caserne où chacun pensera la même chose, agira aux mêmes heures de la même manière, exécutant le même exercice et portant le même uniforme. Drôle de société, en vérité, que la société rêvée par les sociologues ! On s’y ennuiera à mourir, car elle sera d’une monotonie désespérante, La méthode communiste y sera appliquée rigoureusement. Ce serait un communisme à rebours, à l’usage des bourgeois, où nul n’aurait le droit d’être lui-même, d’aller et venir à sa guise. Ce serait le caporalisme dans toute son horreur, le conformisme intégral. Vouloir des êtres faits sur ce modèle, pratiquant la même morale et servant les mêmes dieux, c’est quelque chose de monstrueux qui ne peut germer que dans l’esprit d’un dictateur. Une telle société, où règnerait l’automatisme absolu, ne comporterait aucune initiative, aucune originalité, aucun progrès. Ce serait la mort de l’individu, sans phrases. Certes, convenons que, dès notre naissance, nous sommes happés par la société et que, si nous voulons vivre, il ne nous reste plus qu’à lutter pour nous « ressaisir » et nous dégager de son emprise, rongeant les mailles du social qui nous enserre comme dans un étau. Impossible de nier la main-mise de la société sur les individus. Elle exerce sur eux une sorte de chantage pendant toute leur vie. Mais les sociologues n’expliquent pas — ou expriment mal — comment des êtres nés à la même époque, dans le même pays, élevés dans le même milieu et selon les mêmes méthodes, n’ont ni les mêmes idées, ni la même morale. Comment expliquent-ils qu’il y ait des réfractaires ? Et pas seulement chez les pauvres, chez les déshérités du sort, les sacrifiés, les exploités ?
Ce ne sont pas les sociologues qui approuveront Jean-Jacques Rousseau disant :
« L’homme est né bon, mais la société le déprave. »
Il est difficile à l’homme de naître bon, car il est déjà social dans le ventre de sa mère, il est déjà le prisonnier de l’hérédité, mais à mesure qu’il deviendra social, il deviendra « immoral ». On dit des écoliers :
« Pris individuellement, ils ne sont pas mauvais, mais ensemble ils ne valent rien. »
C’est ce qui arrive pour les hommes réunis quelque part : ils sont lâches et cruels. Enrégimentés, les hommes sont des brutes : ils perdent aussitôt ce qu’ils pouvaient avoir de supportable comme individus. Milton écrivait, il y a trois siècles :
« Troupeau confus ; tourbe mêlée qui élève ce qui est vulgaire et vain ... La plus grande louange est dans leur blâme, à part celui qui va seul et meilleur. D’intelligents, parmi eux et de sages, il n’y en a point. »
Paroles plus vraies aujourd’hui qu’hier.
On comprend que les sociologues anti-individualistes aient un faible pour la pédagogie. C’est, en effet, par l’éducation et l’instruction, que l’on fabrique, dès l’enfance, des citoyens dociles et des âmes d’eunuques, c’est dès l’enfance que l’on déforme les cerveaux et que l’on commence le « dressage » des individus. Il importe, dès le plus bas âge, d’inculquer de saines notions sociales et morales aux futurs soutiens de l’ordre et de l’autorité. La pédagogie telle que la conçoivent les sociologues est le meilleur instrument d’asservissement qui soit entre les mains des dirigeants.
La pédagogie occupe une place importante dans la sociologie durkheimienne. L’auteur d’Éducation et Pédagogie a essayé de renouveler par sa méthode l’ancienne pédagogie. L’éducation telle qu’il la conçoit est l’action exercée par le milieu et la société sur l’enfant. Durkheim et ses disciples comptent beaucoup sur l’École pour faire des citoyens dociles et identiques. Le dogmatisme pédagogique des sociologues n’a qu’un but : détourner l’individu de lui-même pour le livrer corps et âme au social. L’individu devient la chose du social qui, par l’éducation, en fait un citoyen selon ses rêves. La société s’agrippe à l’individu, le suit partout, essaie de l’étouffer au moyen de sa pédagogie anti-individualiste. Elle vise à socialiser l’individu, à l’arracher à son individualité pour l’incorporer au groupe dont il fait partie. C’est exactement l’inverse que fait la véritable pédagogie, qui arrache l’individu à la société pour le restituer à lui-même. Dans l’éducation des sociologues-pédagogues ou des pédagogues-sociologues, l’individu se nie lui-même au profit du groupe auquel il appartient. La fin de toute éducation, pour les sociologues, c’est de faire de chaque homme un être social. Tous les individus doivent se ressembler. Violer ce commandement est un crime. L’être social renonce à toutes les joies, à toutes les noblesses, à toutes les beautés. C’est un être déchu, happé par l’engrenage dont il est prisonnier, incapable de se « ressaisir ». La société se livre sur sa personne à une sorte de chantage, dénaturant ce qui est réel en lui, déformant ses sentiments, atrophiant son intelligence, bourrant son crâne d’absurdités. Sa mémoire devient un capharnaüm sous l’influence des sur-pédagogues qui ont fait de lui une machine. Pas d’originalité, telle est la formule que la pédagogie officielle applique à quiconque a le malheur de tomber entre ses mains. Faire des automates est le but poursuivi par toute éducation sociale. Il est défendu d’être artiste dans les moindres détails de l’existence quotidienne : répéter machinalement ce que les autres ont dit, tel est l’idéal.
L’État ne peut rien pour la liberté individuelle ; il peut tout contre elle. Confier à l’État le soin d’affranchir l’individu par l’éducation, c’est lui confier le soin de l’étouffer.
Auguste Comte exagère lorsqu’il formule du haut de son dogmatisme positiviste ce précepte extravagant :
« Nous naissons chargés d’obligations de toutes sortes envers la société. »
C’est plutôt la société qui nous paraît chargée d’obligations envers l’individu qu’elle a fait naître, sans lui demander son avis. N’est-ce pas étrange de voir émettre un tel paradoxe ? C’est ce que les élèves de Durkheim soutiennent avec autant d’autoritarisme que leur maître. La sociologie durkheimienne s’applique à une société dans laquelle il n’y a point d’individus. L’individu est inexistant. Il ne compte pas. On l’ignore. La société est, pour Durkheim, la seule réalité : c’est une réalité supra-individuelle.
« La méthode sociologique repose tout entière sur ce principe fondamental : que les faits sociaux doivent être étudiés comme des choses, c’est-à-dire comme des réalités extérieures à l’individu. » (Durkheim, Le Suicide)
L’individu est dominé par une réalité morale qui le dépasse : la réalité collective.
Les sociologues en arrivent à ce paradoxe que plus un individu ressemble aux autres, plus il est lui-même. Plus il se confond avec le troupeau, moins il se confond avec lui. Plus l’individu dépend de la société, plus il est autonome. L’individu n’est jamais plus indépendant que lorsqu’il cesse d’être indépendant. C’est se moquer de nous. Qui veut trop prouver ne prouve rien. Les sociologues « plus royalistes que le roi », en arrivent à nous rendre odieuse la société : c’est un résultat appréciable. C’est la seule utilité de la sociologie. Il sied de réagir contre ce machinisme intellectuel, de mettre un frein à l’automatisme en morale, à tout ce sociétisme ou sociétarisme qui sévit et broie l’individu. L’égoïsme égotiste de ce dernier refuse de se courber devant l’égoïsme social : il est harmonie alors que ce dernier est désordre.
Tout ce sociologisme se détruit de lui-même. Il substitue aux dogmes d’une morale non scientifique les nouveaux dogmes d’une morale scientifique. Or, celle-ci est aussi peu scientifique que possible. On abuse trop du mot « science » chez certains philosophes. La morale sociologique prend place au rang des « méta-morales » auxquelles elle essaie de se substituer. Elle remplace une idole par une autre : Dieu s’appelle la société. Ne soyons pas dupes de cette nouvelle « cratie » que constitue la sociocratie. Son libéralisme est équivoque.
Le sociologue anti-individualiste va à l’encontre même des recherches qu’il poursuit, et s’interdit de comprendre quoi que ce soit aux « faits sociaux » puisque, pour lui, ces derniers mots seuls existent et ne s’expliquent que par eux-mêmes. La sociologie simplifie la réalité, qui est complexe, fait œuvre anti-scientifique ou pseudo-scientifique en rationalisant le réel. La sociologie objective pourrait bien n’avoir été qu’un « bluff ».
La métaphysique durkheimienne perd tout contact avec la réalité sur laquelle elle prétend s’appuyer. Rien de moins scientifique. C’est une pure construction de l’esprit. Le Dieu-Société est une abstraction devant laquelle Durkheim qui, nous dit-on, est de bonne foi, exige que les individus s’agenouillent, absorbés dans une contemplation mystique, où s’évanouit toute personnalité. Cette mode, espérons-le, n’aura qu’un temps.
Durkheim est à ce point obsédé par l’idée fixe de faire de la sociologie une science autonome, comme la biologie, indépendante de la philosophie, qu’il ne voit rien en dehors d’elle et croit, par elle, tout expliquer.
Durkheim voit dans la division du travail social une panacée. En elle réside le bonheur de tous les êtres.
La sociologie durkheimienne veut expliquer par une seule science la complexité des phénomènes. A force de se vouloir scientifique, la sociologie cesse de l’être, car elle n’admet d’autre explication de la réalité qu’une explication sociale. Il n’est pas possible, croyons-nous, de pousser plus loin l’autoritarisme et le dogmatisme scientifiques. Rien de moins scientifique que cette méthode. Elle perd de vue la réalité qu’elle déforme. Admettre la réalité de l’individu, c’est, pour Durkheim, faire œuvre anti-scientifique, mais n’admettre que la réalité sociale, à l’exclusion de toute autre, c’est pareillement faire œuvre anti-scientifique. C’est aboutir au même résultat. La sociologie peut prêter son concours aux autres sciences, mais rien ne justifie sa prétention à les remplacer. Elle n’est pas l’histoire : elle conserve, en face de l’histoire, sa fonction propre, sans empiéter sur elle.
Il en est de même pour toutes les disciplines. Écarter les solutions qu’elles nous offrent quand nous envisageons les problèmes sociaux, c’est ne voir qu’une face de ces problèmes, c’est se priver des moyens qui permettraient de les résoudre. L’explication sociologique des faits sociaux n’a de valeur que reliée et associée à leur explication psychologique.
Qu’il y ait des « lois » que le sociologue constate, nous ne le nions pas. Mais qu’il se borne à les constater, ce n’est là, croyons-nous qu’une partie de sa tâche. Sans ce travail préliminaire, la sociologie serait incomplète : réduite à lui seul, elle est tout aussi incomplète. Une sociologie uniquement inductive ne vaut pas mieux qu’une sociologie uniquement déductive. L’une et l’autre sont stériles.
Le déterminisme est une explication, mais il n’est pas l’unique explication des faits. On ne saurait s’en contenter. La sociologie conçoit la vie comme un mécanisme où le hasard et l’imprévu n’interviennent pas, où tout se passe automatiquement. C’est un monde sans originalité que celui des sociologues. C’est un monde aussi peu vivant que celui des logiciens. Les sociologues sont des logiciens peu recommandables, on se compromet en leur compagnie. Ces gens, qui ne veulent tenir compte que des faits, ne voient pas les vrais faits, dont l’action est certaine. Ils négligent les réalités pour des abstractions. Ils appliquent aux faits les lois de leur esprit. Ne mettons pas en doute la valeur de la science, à propos de la méthode sociologique : c’est un problème d’ordre métaphysique, nous y reviendrons. Mais protestons dès maintenant contre cet autoritarisme scientifique qui prétend tout régenter, tout expliquer, sous prétexte que tout obéit à des lois. Un dogmatisme en remplace un autre. Le dogmatisme sociologique rejoint les autres dogmatismes en ce qu’il n’admet qu’une explication des phénomènes, et qu’il ramène tout à cette explication. Il est tout aussi étroit et peu scientifique. La volonté des individus, dans cette conception de la sociologie, est singulièrement atténuée, pour ne pas dire supprimée. Il n’en est tenu aucun compte. La sociologie est science pure. On sait que Taine a appliqué à l’art la méthode sociologique. Il n’a abouti qu’à une construction a priori, niant les faits, les déformant : l’esthétique de Taine est un tissu de contradictions. Qui veut trop prouver ne prouve rien. La méthode sociologique devient la méthode logique, combien illogique en la circonstance : c’est la déduction mathématique, en une matière où elle n’a que faire. La sociologie rétablit ce qu’elle croit détruire. Ses lois sont des constructions de l’esprit. Il n’y a rien de plus subjectif que la méthode objective des sociologues. Ils essaient d’atténuer leur fatalisme en disant que la connaissance des « lois » permettra à la « science sociale » de modifier la réalité. Ils soutiennent que la sociologie devient ainsi la plus libérale des sciences, car elle admet que les sociétés peuvent évoluer sous la poussée des aspirations individuelles et collectives. Constatons-le, en passant, mais ne nous faisons aucune illusion sur le libéralisme des sociologues.
Les sociologues sont bien forcés de convenir que la sociologie conserve des rapports avec la psychologie individuelle, — ils ne peuvent le nier. Quoi qu’ils fassent et quoi qu’ils disent, il faut bien qu’ils tiennent compte de l’individu. Ils en tiennent compte, certes, mais c’est pour l’étouffer. Si on leur dit que la société n’existe que par et pour les individus qui la composent, et qu’il faut compter avec leur psychologie, ils répondent que l’association des individus constitue une vie différente de celle de chaque individu considéré isolément, et que c’est cette vie du groupe, cette vie collective qui donne naissance à des institutions dont l’ensemble constitue la civilisation. Nous savons cependant quel rôle ont joué, dans l’histoire, les individus : ce sont les isolés, les indépendants, les indisciplinés qui, seuls, ont créé quelque chose. Pendant que le troupeau stagnait, ils sortaient de ses rangs pour rompre avec sa morale et sa tradition. Ce sont les hommes de génie qui conduisent le monde. Et j’entends par eux les penseurs et les artistes. Les guerriers n’ont pas de génie, car ils n’ont qu’un génie destructeur. Le génie est essentiellement créateur. Le troupeau n’a fait que combattre et déformer la pensée des hommes de génie, — de ceux qu’il appelle des fous, — la société s’est opposée par tous les moyens, y compris l’assassinat, à la sincérité des individus, se dressant en face de ses préjugés en accusateurs. Pensant en groupe, agissant en groupe, les gens pensent et agissent mal. C’est alors qu’ils créent ces « institutions » que la sociologie appelle pompeusement la Civilisation. Concédons, en effet, aux sociologues, que la vie sociale est bien différente de la vie individuelle, qu’elle en est tout le contraire : elle oppose au courage la lâcheté, à la vérité le mensonge, à la nature l’artifice, à tous les sentiments humains leur contrefaçon et leur caricature. Ils ont raison, puisque nous voyons les individus agir en groupe d’une manière autre que pris en particulier : les ravages de l’esprit grégaire, pendant la guerre, en sont une preuve éclatante. Nous avons vu à l’œuvre cette fameuse mentalité collective : elle a bien mérité de la patrie. Les sociologues, au lieu de déplorer cela, le constatent avec un plaisir évident. Pour eux, la société est établie pour des siècles sur des principes sacro-saints. La sociologie positive a raison sur ce point : nous ne faisons aucune difficulté pour reconnaître que les individus, à peu près supportables séparés les uns des autres, deviennent, associés et groupés, unis par des intérêts quelconques, absolument idiots, sanguinaires, capables de tout. Dès que l’esprit de corps ou l’esprit de parti s’empare d’eux, ils perdent la tête, deviennent de simples brutes. Tout ce qu’il y a de boue au fond d’eux-mêmes se réveille. Ils n’ont plus de conscience, plus de sentiments, plus rien. Il suffit que quelques hommes se réunissent pour qu’ils disent ou fassent des bêtises. Certes, quelquefois, les individus vibrent ensemble pour une noble cause, mais c’est chose rare. La foule est bien différente des molécules, des cellules qui entrent dans sa composition : leur agrégat donne naissance à un corps nouveau où n’entrent que les laideurs des individus, d’où sont exclues toutes leurs qualités : d’intelligents, ils deviennent stupides, de pacifiques, guerriers. La vie sociale est le dépotoir où viennent échouer tous les égoïsmes, tous les reniements. Il semble que les hommes ne cherchent à se réunir qu’afin de mettre en commun leur bêtise. On m’objectera que si les individus n’étaient pas eux-mêmes tarés, la société ne serait pas tarée : je conviens qu’il y a des individus — la majorité — qui sont faits pour vivre en société : ils ont tout ce qu’il faut pour cela, hypocrisie, dissimulation, autoritarisme, sauvagerie. Ce sont des individus peu individualistes. C’est parce qu’il y a dans la société de ces faux individualistes, en nombre considérable, qu’elle est si imparfaite. La société leur permet de développer tout leur talent, de donner libre cours à toutes leurs passions. D’autres, moins barbares, finissent par le devenir, à leur contact, par faiblesse ou inexpérience. Ils suivent et font comme tout le monde. Évidemment, ces individus sont peu intéressants, et si la société est mauvaise, ils y sont bien pour quelque chose. Cependant, répétons-le, celle-ci ne fait que développer et porter à leur maximum leurs mauvais instincts ; elle les multiplie : la société est le terrain où germent tous les égoïsmes. Bien peu d’individus ont l’héroïsme de combattre les milieux dont ils font partie. Ils s’en évadent, comme d’une galère. Ce sont des rescapés. Individus et sociétés sont au fond également coupables : une somme de lâchetés individuelles, rendues plus nuisibles par leur association, telle est la société, dans sa triste réalité. Ces lâchetés individuelles s’additionnent pour former une force redoutable. Quiconque essaie de la briser est lui-même brisé. La société exerce une telle sujétion sur les individus que, même dans les « milieux libres », elle continue d’exercer ses ravages, ces fameux milieux libres qui devaient révolutionner le monde, et qui n’ont rien révolutionné du tout. Les colonies libertaires n’ont point réussi à réaliser cette société idéale que nous rêvons. Elles en sont même fort loin. Les individus qui en font partie n’ont point laissé à la porte leurs habitudes sociales. Peu à peu, ces milieux deviennent pareils aux autres : ils sont, ces milieux, de plus en plus réduits, les individus n’ayant pas fait l’effort nécessaire pour se réformer. Il importe de rendre inutile, par notre organisation intérieure, toute organisation extérieure dont le rôle consiste à brimer les individus qui sont assez eux-mêmes pour se révolter contre ses lois.
— Gérard de LACAZE-DUTHIERS.
SOL
n. m.
Dans le concert économique des nations, habilement organisé, pour entretenir une illusoire harmonie qui cache, plus ou moins bien, l’exploitation des masses laborieuses, la question du sol joue un rôle prépondérant. Cette question, si importante soit-elle, est toujours grignotée sous divers aspects par les élites ... qui laissent le monde travailleur dans l’ignorance sur ce sujet capital. Les politiciens de toutes nuances évitent soigneusement d’exposer aux travailleurs que la propriété individuelle représentant le fruit du travail et de l’intelligence, est conditionnée par le mode d’appropriation du sol.
Nous allons essayer d’expliquer que la question du sol ou foncière, rationnellement définie, permet de se rendre compte de la liberté ou de l’esclavage du travail.
L’organisation rationnelle de la propriété immobilière est, non seulement d’ordre économique mais aussi d’ordre moral, c’est-à-dire de justice sociale. Sans nous étendre, comme on pourrait le faire dans un livre, nous pensons que le lecteur comprendra qu’il serait vain d’émettre l’idée de laisser à chacun le produit intégral de ses efforts, tant que le sol (ou richesse foncière immobilière) ne sera pas entré au domaine social ou commun. Nous nous résumerons en disant que l’entrée du sol à la propriété collective est la condition sine qua non de l’établissement de la souveraineté du travail. Ce que nous dirons par la suite aura pour but de mieux aider à comprendre la portée de justice sociale qui s’attache à la question du sol.
Il y a, de par le monde, des faits et des vérités qui, par eux-mêmes, paraissent, dans leur ensemble, si évidents à tous, qu’il semble inutile d’en fournir quelques explications. Parmi les nombreux phénomènes sur lesquels on paraît renseigné, celui du sol n’est pas le mieux déterminé dans le domaine de l’opinion. Nous allons essayer de le démontrer en tenant compte de l’expérience, de l’observation et du raisonnement qui se rapportent à la question foncière dans le cycle des époques parcourues du début de l’histoire à ce jour.
En sociologie, qui est le point de vue sur lequel nous nous plaçons, le mot sol représente la richesse foncière immobilière sous ses divers aspects. C’est une des deux principales espèces de richesse : les capitaux, la richesse mobilière étant l’autre. De l’utilisation plus ou moins rationnelle de ces richesses, la société vit en harmonie ou dans le désordre.
Le sol qui est, comme nous le verrons, essentiellement distinct du capital, de la richesse mobilière, représente une force productrice mécanique comme source passive des richesses. D’autre part, le travail, qui est le raisonnement en action et devient force productrice consciente, représente la source active des capitaux, de la richesse mobilière.
De l’organisation des richesses que nous venons de définir, et tout particulièrement de la richesse foncière (sol), dépendent l’ordre social et le bonheur domestique ou l’esclavage des masses laborieuses.
Sans le sol, l’homme n’existerait pas ; et, socialement parlant, sans l’homme, le sol serait comme s’il n’existait pas. L’histoire sociale n’existe que pour l’homme et ne saurait intéresser les autres êtres qui, sous ce rapport, n’apportent directement aucune contribution. L’homme seul sait qu’il existe, il en a conscience. Dès lors, il examine, compare, apprécie ; de sorte que le raisonnement lui explique que, dans l’Univers, il y a des choses nécessaires à la vie et au développement social, comme il sait qu’il y en a d’autres qui sont, suivant les cas, et les circonstances, plus ou moins utiles au développement des sociétés. Cette remarque amène à comprendre que : confondre ces deux espèces de richesses — sol et capitaux — sous le seul nom de propriété dans l’attribution des richesses aux individus, c’est employer un langage inexact et dangereux qui conduit aux abus de l’organisation sociale actuelle.
Dans l’étude du Problème Social, si l’on veut éviter les équivoques, toujours dangereuses et souvent nuisibles, il convient de situer scientifiquement les rôles respectifs du sol et du capital dans la formation des richesses.
Se refuser de connaître la différence essentielle qu’il y a, dans l’ordre des richesses, entre l’indispensable et l’utile, c’est, le sachant ou l’ignorant, faire le jeu de la bourgeoisie et retarder d’autant l’heure de la libération du travail.
Afin de bien comprendre les données du Problème social , remarquons que l’homme, le travailleur, au moyen de l’usage de la richesse foncière, du sol, crée, par ses efforts, des richesses, des produits, enfin des capitaux selon les besoins qu’il en a ; alors que ce même travailleur reste impuissant pour créer le sol. N’oublions pas que la richesse foncière a des limites que les sciences au service du travail ne permettent pas de dépasser, et nous comprendrons que l’homme qui n’a pas droit à l’usage du sol se trouve placé dans le vide des richesses, comme dit Colins.
Des vérités qui précèdent, il résulte qu’il est de toute impossibilité de pouvoir ajouter la moindre étendue à la surface ou à la profondeur du sol. Par contre, la possession de la richesse foncière confère, à celui qui la détient, un véritable monopole présidant à l’attribution du travail aux individus puisque le travail ne peut s’exercer que sur ou dans le sol. Inévitablement, ceux qui détiennent le sol commandent ceux qui en sont privés. Dès lors, logiquement, l’entrée du sol au domaine commun apparaît comme une nécessité sociale pour l’instauration d’un régime de liberté individuelle et de bien-être social. En n’attachant pas au sol toute la valeur sociale qu’il comporte, permettant de mettre chaque chose à sa place et à la place qui lui convient, on consacre, dans l’équivoque, la contradiction des intérêts à l’avantage de la féodalité financière.
C’est l’ignorance de la valeur sociale qui s’attache au sol qui permet, pendant les périodes électorales où les ... élites ... de la politique sont en rapport plus ou moins direct avec les masses laborieuses, de camoufler la question foncière dans ses rapports avec l’attribution des produits du travail aux individus. Si, en 1930, nous lisons les programmes politiques des candidats, qui vont du rose pâle au rouge vif, nous remarquerons un silence volontaire sur la question du sol ; ce qui prouve que c’est en dehors des politiciens de toutes nuances que la question du sol peut et doit être étudiée sérieusement.
Les militants devraient enseigner, s’ils n’étaient des ignorants ... , que l’entrée du sol à la propriété collective est créatrice de bien-être général, génératrice de liberté et dispensatrice de la souveraineté du travail.
L’entrée du sol au domaine commun répond aux idées de justice, de liberté et de bien-être que les travailleurs désirent appliquer dans les rapports des hommes entre eux. Aussi, tant que le sol est aliénable, il est logiquement impossible de libérer le travail de l’emprise du capital, et, quelles que soient les réformes plus ou moins tapageuses de l’époque d’ignorance, les résultats ne tardent pas à devenir, avec le développement des intelligences et des nouveaux besoins qui en naissent, moins supportables que par le passé.
Tout retard, volontaire ou non, à la solution de la question du sol, qui dépasse et domine toute question agraire, minière, forestière, etc ... retarde d’autant la libération des opprimés et des travailleurs. La tactique du silence sur la question du sol compromet l’avenir du socialisme et de la liberté.
D’une manière générale, le socialisme souffre d’une crise d’indétermination qui place le futur régime sous le signe de l’équivoque en donnant à certains termes d’économie sociale un sens plus ou moins rationnel. Pour les uns, le socialisme paraît être le bien-être qu’une production intensifiée peut procurer à la collectivité à des conditions définies. Pour d’autres, dont nous sommes, le socialisme est l’application de la justice à la société. Par l’application de la justice, chacun devient l’artisan de sa fortune et de sa destinée que l’égalité du point de départ permet de réaliser. De nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice règnera seront le domaine social sur lequel chacun recevra selon ses œuvres. Une éducation morale généralisée et une organisation rationnelle de la propriété faciliteront la jouissance d’un pareil régime qu’une phraséologie trop élastique ne saurait définir.
C’est, parce que certains mots comme le mot sol et certaines expressions comme instruments de travail et moyens de production sont mal déterminés qu’il y a, selon les besoins politiques, des propositions confuses, parfois contradictoires, dans la confection des programmes plus ou moins teintés de socialisme. Comment se reconnaître dans ces labyrinthes de la cacophonie, que l’on dirait établis à dessein ? ...
Ainsi, à propos du mot sol qui nous préoccupe, certains économistes, et même des socialistes, croient nécessaire d’ajouter au mot sol celui de sous-sol. Ces personnes se sont-elles demandé s’il était possible d’établir une limite réelle entre ce qu’on appelle sol et sous-sol ? Poser la question c’est la résoudre par la négative. D’autres prétendent que les récoltes, les engrais, etc., tant qu’ils font corps avec la richesse foncière ne font pas partie du sol ; d’autres enfin n’admettent pas la richesse immobilière comme étant du sol amélioré par construction, tout comme l’est un champ de blé, ou de fourrage par le travail se rapportant à la production du champ. Socialement, c’est inutile, même dangereux de s’en remettre à des détails d’exposition.
A notre époque d’industrialisme intensif, tout le sol a été, à divers degrés, plus ou moins amélioré et, socialement, il est impossible d’établir une règle pour indiquer le degré d’amélioration qui classe le champ dans une catégorie quelconque et qui, finalement doit entrer au domaine commun. L’entrée du sol à la propriété collective est indispensable à notre époque de nécessité sociale, pour établir le socialisme à l’avantage de tous. Il est inutile et superflu d’épiloguer sur des apparences et des illusions.
En nous intéressant à la question du sol qui représente le point cardinal de l’ordre socialiste, retenons que le sol n’est pas à proprement parler, un moyen de production, un instrument de travail ; il est plus et mieux socialement parlant. Le sol est la matière absolument première, il est le fonds d’où le travail extrait, avec ou sans instrument, toutes les richesses nécessaires à l’entretien et au développement de l’Humanité.
Des explications qui précèdent il résulte que le sol se manifeste à l’intelligence que les préjugés n’ont pas atrophiée, sous le caractère de l’indispensabilité. De son organisation, dans le domaine des propriétés, dépendent la liberté ou l’esclavage du travail, le bien-être ou la misère des travailleurs. Ainsi, la confusion de la richesse foncière — sol — avec la richesse mobilière — capitaux — est, dit Colins, une escobarderie de l’Économie Politique destinée à confondre l’illusion et la réalité, l’utile et le nécessaire, afin de maintenir l’esclavage du travail et la domination du capital. C’est un tour d’escamotage économique habilement exécuté au profit du capital. A notre époque, s’intéresser à la question sociale, œuvrer en faveur du socialisme, et confondre le sol avec richesse naturelle, incréée par le travail, avec le capital, richesse mobilière, qui n’est et ne peut être que le résultat du travail, c’est vouloir, le sachant ou non, que le paupérisme reste indestructible, c’est vouloir perpétuer les révolutions, c’est vouloir la mort de la société par le désordre. La nécessité sociale forcera bien un jour, plus ou moins prochain, notre pauvre humanité à ouvrir les yeux et à s’orienter vers la connaissance du bien avec la volonté de le réaliser.
Si l’humanité réfléchissait à la question de l’appartenance des richesses, elle verrait que celles-ci s’approprient par le travail, soit au critérium de la force, soit au critérium de la raison. Remarquons, dans cet ordre d’appropriation des richesses, que l’appropriation individuelle du sol est possible tant que le droit de la force est le seul connu socialement. Alors cette appropriation est de nécessité sociale puisqu’elle est la seule qui offre une sécurité relative à l’ignorance économique de l’époque. Mais pour cette période, et quelle qu’en soit la durée, la privation du sol, pour la plus grande partie des travailleurs, fait que l’offre du travail, malgré tous les progrès possibles, est toujours au minimum des circonstances et tient les travailleurs en état d’esclavage économique. Ceux-ci ne reçoivent pas le produit intégral de leur travail, mais simplement ce que les détenteurs des moyens de production consentent à leur donner. Ajoutons aux droits des propriétaires, imposés aux travailleurs déshérités, la perception de l’impôt ou revenu social retombant exclusivement sur le travail et nous comprendrons pourquoi en époque d’aliénation du sol aux individus, la plupart des travailleurs ne consomment pas selon leurs besoins, alors que les produits agricoles et manufacturés restent inutilisés et se détériorent. Dans le régime bourgeois, l’abondance des biens nuit quelquefois et même bien souvent. Ainsi l’aliénation du sol, et par suite la monopolisation de cette richesse indispensable, canalisée chez quelques individus, créa les castes et les classes, les maîtres et les esclaves, la richesse pour quelques-uns, la misère pour le plus grand nombre.
Si nous passons à l’époque où le sol appartiendra à tous et qui sera l’époque de connaissance sociale, nous verrons que, par l’entrée du sol au domaine commun, le paupérisme se trouve anéanti, du fait que les travailleurs, c’est-à-dire tous et chacun, seront, au même titre, des propriétaires indépendants plus ou moins capitalistes.
A ce moment, contrairement à ce qui se passe en période d’aliénation du sol, les capitaux abonderont, offerts par la Société et les individus qui ne consommeront qu’une partie de leurs productions. Bien plus, les capitaux des particuliers devront concurrencer ceux de la société.
De ce fait, les capitaux animeront toujours la demande du travail et leur utilisation contribuera à l’augmentation du bien-être général. En résumé, le salaire, compris comme rémunération du travail, qui est éternel, par rapport à l’homme, sera constamment au maximum des circonstances, du minimum où il se trouve en époque d’aliénation du sol aux individus. Il n’est pas téméraire d’affirmer que l’entrée du sol au domaine social a pour but et résultat inévitable la disparition du paupérisme matériel dans une atmosphère de justice et de moralité générale.
A ce moment, mais pas avant, l’homme naît sous un régime d’égalité sociale relative et peut, en toute liberté, exercer ses facultés pour obtenir par son travail — et sans nuire à son prochain qui jouira des mêmes droits — la satisfaction des besoins ressentis.
Contrairement à ce qui se passe à notre époque, et toujours du fait de l’entrée du sol à la propriété collective inaliénable, chaque membre aura à sa disposition, selon ses goûts et son tempérament, pour exercer son activité dans le domaine qui lui plaira, d’incontestables garanties de sécurité, d’indépendance réelle et de bien-être permanent. Relativement au passé, au présent et à l’avenir, l’organisation de la propriété du sol représente une clé merveilleuse qui, dans le passé, a ouvert la serrure sociale à l’avantage des nobles, comme, actuellement, elle l’ouvre à la bourgeoisie et comme elle l’ouvrira à l’avantage de tous quand le sol fera partie du domaine commun.
C’est de sa possession individuelle ou de sa possession commune que dépend la liberté ou l’esclavage du travail. Pour notre époque, la possession commune de la richesse foncière-immobilière est de nécessité sociale, mais, en France, tous les partis font la conspiration du silence sur cette importante question qui est, sous divers aspects et dans différentes nations, dans l’ordre de mise en pratique. Un avenir relativement prochain démontrera, expérimentalement, les avantages généraux de l’entrée du sol au domaine social par rapport à l’entreprise de certaines mobilisations anti-scientifiques du sol. Nos parlementaires socialistes s’apercevront alors que le socialisme ne signifie pas, le moins du monde, que la terre agricole, qui est une partie du sol à socialiser doit appartenir à celui qui la cultive, mais à tous.
De l’exposition de la question du sol ou foncière que nous venons de faire il résulte :
-
que le socialisme ne peut se réaliser que par l’entrée intégrale du sol au domaine social aussi bien que de la richesse mobilière ou capitaux provenant de générations passées ;
-
que, de ce fait, le travail sera libre au lieu d’être esclave comme de nos jours, ou forcé comme l’enseigne et le veut le marxisme ;
-
que l’appropriation sociale des richesses indiquées n’implique pas forcément l’exploitation du domaine commun par l’État ;
-
que cette exploitation peut et doit être faite, généralement, par des associations de travailleurs libres ou par des travailleurs isolés et indépendants afin que, sous ses divers aspects, la liberté individuelle soit sauvegardée ;
-
que le produit du Travail sera, alors seulement la propriété de celui qui l’aura créé ;
-
que tous et chacun jouiront, au même titre, des avantages qui précèdent, dans une atmosphère sociale et morale d’égalité relative suffisante pour la satisfaction des besoins ressentis ;
-
que le travail sera souverain et la domination du capital anéantie.
Ces conditions de vie générale prendraient rationnellement corps, pour ainsi dire automatiquement, sous l’impulsion du principe rationnel de l’intérêt qui guide l’Humanité. L’homme libre sur la Terre libre sera l’œuvre du socialisme rationnel qui ne saurait équitablement admettre avec Engels et les marxistes, le travail obligatoire et égal d’une administration à étiquette socialiste qui paraît oublier que la liberté est le plus grand de tous les biens. Le rythme du travail et de la production sera déterminée par les besoins ressentis équitablement par tous et par chacun.
— Élie SOUBEYRAN.
SOLDAT
n. m. (de l’italien soldato)
Milit. Militaire qui touche une solde payée régulièrement par le prince ou par le pays qu’il sert. Simple soldat. Militaire non gradé : c’est un militaire de 3° catégorie, puisqu’il y a : officiers, sous-officiers et soldats pour composer une armée.
Plus un officier a de galons, plus il s’éloigne du soldat, ayant sur lui d’autant plus d’autorité et de solde importante avec plus d’honneur et moins de risques. Le soldat touche une solde ridicule, mais il est abrité, vêtu, nourri et couché. Tout cela pour une besogne stupide dans son exercice, criminelle dans ses intentions, infâme par son accomplissement et son but.
N’est pas soldat qui veut : un infirme, un idiot, un malingre, un trop faible d’esprit ou de corps est exempté définitivement. Il faut convenir que les majors peu scrupuleux examinent, auscultent, palpent la chair des hommes de vingt ans, obligatoirement tenus de se présenter à jour et à heure fixes, pour ce qu’on appelle le conseil de révision. Tous les conscrits ont de fortes chances d’être reconnus bons pour le service, surtout s’il y a nécessité de chair à canon pour défendre des intérêts qui ne les touchent aucunement s’ils ne sont capitalistes ou fils de capitalistes. S’il a la naïveté, le pauvre soldat, de croire qu’il est appelé à se battre pour un idéal ou pour une raison plus ou moins admissible, à moins d’être un crétin, il verra vite qu’il n’en est rien et qu’il est tragiquement dupe. Mais s’il est soldat, il n’est plus un homme ; il est un numéro matricule, une machine à obéir, une machine à tuer son semblable. Un moment, il voit, en face de lui, ayant subi le même ignoble dressage que lui, un autre homme ; cet homme qu’il ne connaît pas, qu’il n’a jamais vu ni connu, c’est l’ennemi. Il lui ressemble, pourtant, comme un frère, c’est un homme comme lui ; non, c’est un soldat comme lui. Et c’est à qui, dans ce face à face des deux soldats, tuera l’autre ! C’est pour cela que l’un et l’autre ont été faits soldats. Ce n’est. même pas aussi simple ; le duel ainsi décrit, n’existe que par le hasard de la guerre. Les circonstances qui mettent en présence un homme contre un autre homme, sont très rares. En effet, ce serait dangereux, peut-être, si ces deux hommes n’étaient pas aussi complètement soldats que le veulent ceux qui, à l’abri, les ont envoyés l’un contre l’autre ; il se pourrait que ces deux soldats se reconnussent comme hommes, victimes tous deux d’une machination atroce et qu’ils fraternisassent, comme cela s’est vu plus souvent qu’on ne croit, malgré le soin pris pour étouffer de si mauvais exemples, susceptibles d’être contagieux. Aussi, la guerre, ce n’est pas la lutte corps à corps et c’est tout à fait rarement le duel d’homme à homme ; c’est, au contraire, la tuerie aveugle, en groupe ; c’est le massacre acharné, sauvage de brutes affolées, en furie comme des bêtes, ce sont des fous en bandes excitées, entraînées, ivres de haine et ivres d’alcool. Il faut cela, parait-il, pour être de parfaits assassins, stupides, féroces, lâches, cruels et surtout inconscients ; en un mot, pour être de bons soldats, des héros, tuant ou se faisant tuer glorieusement ainsi que le proclament les profiteurs de toutes sortes auxquelles les guerres entre nations et les guerres coloniales procurent avancement, décorations et bénéfices.
Il n’y a, pour nous, qu’une guerre admissible, c’est la guerre civile. Là, il ne faut pas des soldats, mais des hommes. C’est indispensable pour accoucher par le fer une société grosse de transformation sociale. Quant aux malheureux enfants du peuple qui, par hasard, sont soldats de force à un tel moment, ils ont l’occasion de redevenir subitement des hommes en aidant leurs frères civils à faire la Révolution.
C’est d’ailleurs ainsi que peut réussir une Révolution ; les événements sociaux nous le prouvent ; les faits historiques de toute nation et de toute époque qui se sont produits en vue d’une transformation politique et sociale ne l’ont pas été autrement, on le sait. La Bourgeoisie qui a tout à perdre veut tout conserver. Pour cela, elle est prête à tout.
Enfin, chacun selon la loi, doit, en France, servir la patrie, et, s’il est besoin, mourir pour elle. Autrefois, le soldat de métier, changeait facilement de patrie, suivant la solde qui lui était offerte. Les chefs se ménageaient de leur mieux, et en avaient pour l’argent qu’ils consacraient à former et à payer des soldats qu’ils remplaçaient par d’autres quand ils disparaissaient, changeaient de camp ou se faisaient tuer. Le chef ou seigneur en avait pour ce qu’il payait. Il en usait selon ses moyens, pour Dieu, pour la Patrie, pour le Roi !.. et aussi pour lui-même.
Depuis la Révolution française, on a changé tout cela. Puis, est venu un vrai de vrai, parmi les soldats Napoléon, le Corse aux cheveux plats. Il mit sous sa botte le peuple qui avait pris la Bastille et renversé la Monarchie. Il conduisit par le sabre des soldats en haillons auxquels il fit voir du pays et qu’il gorgea de gloire et de sang. Ce fut le soldat triomphant de l’épopée impériale auquel nous devons la funeste prospérité du Militarisme et la renommée du soldat.
Les guerres ont, depuis, pris leur large place dans le monde. C’est une vaste et bonne affaire internationale, dont les Peuples font tous les frais. Inutile d’en parler encore ici. Nous sortons d’en prendre. La guerre mondiale fut, de 1914 à 1918, une hécatombe horrible de soldats. La prochaine ne se contentera pas de soldats : elle voudra tout ce qui vit.
Si l’on peut entendre par soldat, celui qui embrasse la défense de quelqu’un ou de quelque chose : les soldats de l’idée, on peut dire que les insoumis, les déserteurs, les réfractaires au métier de soldat sont de rudes et valeureux soldats quand on songe à ce qu’ils risquent en tout temps, de souffrances physiques et morales pour échapper à l’exécrable obligation du service militaire.
Mais que dire de l’admirable énergie des objecteurs de conscience qui refusent de se plier à tout ce qui leur est commandé par l’usage, par la loi, par ce que les intéressés appellent le devoir. Ceux là qui, consciemment, énergiquement, stoïquement, refusent de toucher une arme, sont de véritable héros. Ceux-là sont des soldats de l’Idée. (Voir Conscience, Objection, Paix).
Ces soldats de résistance au Mal, ces convaincus, ces héros, ces martyrs sont des hommes !
Ils ne veulent tuer personne : ils veulent tuer la guerre !
— Georges Yvetot.
SOLEIL
n. m.
Le Soleil, Phébus, la divinité des Anciens, l’Astre du jour qui fait mûrir le blé, la vigne, les fruits, le dispensateur de la Vie et du Bonheur sur les mondes qu’il éclaire et réchauffe de ses rayons est, non pas la boule de feu qu’il semble être, mais un globe qui n’est ni solide, ni liquide ni gazeux dans le sens que nous attribuons généralement à ces mots, car les gaz qui le composent sont condensés dans une condition de physique absolument inconnue par nous, leurs poids n’étant, en moyenne, à volume égal, que 4 fois moins lourd que les substances terrestres et la pesanteur à sa surface solaire 27 fois 1/2 plus forte qu’à la surface de notre planète.
Le bolomètre nous a permis de mesurer la température qui règne à la surface de l’astre du jour. Elle est de 6.000 degrés et celle au centre du globe de 40 millions de degrés.
Il en est également ainsi des autres soleils de l’espace. On estime leur température centrale à 40 millions de degrés. A la surface, la température des étoiles blanches-bleuâtres comme Sirius et Véga, est de 12.000, des jaunes, type Capella, Arcturus, notre Soleil, 6.000 degrés et les rouges 3.000 degrés.
Le Soleil tourne de l’Ouest à l’Est, autour de son axe, en 25 jours 4 heures, en entraînant avec lui, à raison d’une vitesse de 20 kilomètres par seconde tout notre système planétaire, sept cents fois plus léger que lui, vers Véga dans la direction de l’amas stellaire, qui est situé dans la constellation d’Hercule. Selon toutes les probabilités, notre Soleil, ainsi que la plupart des étoiles de première grandeur, ses voisines, graviteraient dans des périodes de plusieurs millions d’années autour de cet amas stellaire.
Les proportions du Soleil sont colossales. Son diamètre est environ 109 fois aussi long que le diamètre équatorial de la Terre, qui mesure 12.742 kilomètres. La superficie de l’astre du jour est 12.000 fois plus grande, son volume près de 1.300.000 plus gros et son poids 324.439 fois plus lourd que ceux de notre planète. Le poids de notre Terre étant de 5 septillions 875 sextillions de kilogrammes, celui du Soleil est conséquemment de 1 nonillion 900 octillions de kilogrammes, ce qui s’écrit par trente-un chiffres.
Comme proportion, notre Terre est à la planète Jupiter ce que cette dernière est au Soleil.
Pour faciliter le calcul et l’orientation de nos lecteurs à travers les astres, nous nous permettrons de leur donner l’indication suivante :
Le rapport de la circonférence au diamètre est : 3,145.
La surface de la sphère est égale à son diamètre multiplié par la circonférence d’un grand cercle.
Le volume total de la sphère s’obtient en multipliant la surface par le tiers du rayon.
Les surfaces des sphères sont entre elles comme les carrés de leurs rayons.
Leurs volumes sont entre eux comme les cubes de ce même rayon.
-
Surface de la Terre : 510.082.700 kilomètres carré.
-
Volume de la Terre : 1.083.250.000.000 kilomètres cubes.
-
Rayon de la Terre : 6.371 kil. 107 mètres.
-
Diamètre de la Terre : 12.742 kil. 214 mètres.
La distance moyenne qui nous sépare du Soleil est de 149.500.000 kilomètres. On peut facilement calculer cette distance depuis que Olaf Roenner découvrit, en 1675, la rapidité du rayon lumineux qui est de 300.000 kilomètres par seconde et qui fut découverte par le célèbre Danois en examinant les éclipses des satellites de Jupiter. Il constata qu’il y a 16’ 26 » de différence entre les moments où elles arrivent selon que Jupiter se trouve du même côté du Soleil que la Terre ou qu’il se trouve du côté opposé. Il suit de cette constatation que la lumière emploie 16’ 26 » pour traverser le diamètre de l’orbite terrestre et conséquemment 8’ 13 » pour venir du Soleil.
Notre Soleil, qui ne nous envoie que la deux-milliardième partie de la lumière et de la chaleur rayonnées par lui dans l’espace et dont la force dépensée par lui, sur la surface de notre planète, équivaut à 218 trillions de chevaux-vapeur, appartient, avec Capella, Acturnus, Procyon, et la plupart des étoiles de deuxième grandeur, aux astres qui traversent la troisième période de la vie stellaire ascendante.
Ces astres se font remarquer par l’altération que subit l’intensité de leur lumière, due à un commencement de refroidissement de leur surface,
Ce refroidissement est caractérisé par la formation de taches ou cavités remplies de vapeurs transparentes, qui parviennent de grands bouleversements que produisent des soulèvements et des dépressions de la photosphère. Ces taches sont généralement environnées de facules ou régions très brillantes, qui forment autour d’elles une sorte de bourrelet saillant et ultra lumineux.
Les taches solaires qui font partie intégrante de l’astre du jour et dont la température inférieure à celle de la surface lumineuse ou photosphère, voyagent autour du Soleil dans le même sens que la révolution annuelle de la Terre et que le cours de toutes les planètes. Leur rotation s’effectue auprès de l’équateur solaire environ en 25 jours et en 28 entre le 45 et 50ème parallèle boréal et austral. Aux pôles elles ne se voient jamais.
Ces taches se forment lentement ou assez subitement et sont toujours précédées par une grande agitation dans la photosphère, qui se manifeste par des facules très brillantes donnant naissance à un ou plusieurs pores qui se transforment en une large ouverture. Les taches peuvent durer de quelques jours à plusieurs mois et atteindre plus de 100.000 kilomètres de diamètre. Elles nous envoient environ 54 % moins de chaleur qu’une partie d’égale grandeur de la photosphère sans tache.
Le nombre des taches, des éruptions et des tempêtes solaires arrive environ tous les 11 ans à son maximum ; puis, ce nombre diminue pendant 7 ans 1/2 et emploie ensuite 3,6 ans pour remonter de nouveau à son maximum. Mais cette période de 11,1 ans varie elle-même et peut se raccourcir à 9 et s’étendre parfois au delà de 12 ans. Tous les 34 et 35 ans, il y a une période maxima pour les taches.
N’y aurait-il pas des éruptions énormes dans le Soleil tous les cent ou deux cent mille ans et qui auraient occasionné les périodes glacières encore inexpliquées ?
II est à noter que la période de décroissance des taches est plus longue que la période d’accroissement et que la même chose arrive également pour le reflux et le flux de la mer.
Ces périodes undécennales dues probablement à l’influence des planètes correspondent avec les aurores boréales et avec les oscillations de la boussole et cela, fait digne d’attention, de telle façon que le maximum d’oscillations coïncide avec le maximum de taches, et le minimum avec le minimum.
Une grande partie de la surface du Soleil est granulée, véritables vagues ou montagnes de gaz incandescents qui peuvent atteindre et dépasser mille kilomètres de diamètre.
De cette photosphère s’élève l’atmosphère solaire ou sa chromosphère, qui n’est visible, comme la Couronne, que pendant les éclipses totales du Soleil.
La chromosphère est une nappe de « feu » de 10 à 15.000 kilomètres d’épaisseur, qui se projette en protubérances, sorte de flammes roses, à plus de 300 à 400.000 kilomètres vers les cieux.
Au dessus de la chromosphère, il y a la Couronne, qui environne le Soleil à une hauteur de 500.000 kilomètres, et qui n’est probablement qu’un simple phénomène électrique de l’astre radieux ...
La spectroscopie ou l’analyse spectrale n’a pas seulement permis de déterminer la composition chimique du Soleil, mais elle est encore la grande révélation scientifique du XIXème siècle, qui a prouvé l’unité constitutive de l’Univers.
Les étoiles ou soleils naissent tous de condensations de nébuleuses, dont l’origine doit être cherchée dans l’éther intersidéral, berceau et tombe des mondes et des univers.
Le grand mérite de Flammarion, malgré sa faiblesse spirite, a été dans la vulgarisation précise, nette, des données scientifiques. Le défaut des astronomes anglais de la nouvelle école, tels Eddington et Cie, est, grâce à leur spiritualisme, le manque de clarté.
Ils brossent un tableau, qui rend confuse la discussion sur les étoiles dites géantes et naines.
Il n’y a, à vrai dire, pas d’étoiles géantes, et d’étoiles naines. Ce sont les mêmes étoiles, alternativement énormes ou petites, diffuses ou condensées, selon leur âge.
Les étoiles jeunes sont grandes et diffuses, telle Bételgueuse, dans la constellation de l’Orion. Elle pèse 1.000 fois moins que l’air et son volume égale 50 millions de fois celui de notre soleil, tandis que sa masse ne vaudrait que 35 fois celle de l’astre du jour. Dans quelques centaines de millions d’années, Bételgueuse sera égale à 35 fois la dimension de notre Soleil actuel.
A stade égal d’évolution, les étoiles, entre elles, varient, en moyenne, dans la proportion de 1 à 5 et leur vie autonome, depuis qu’elles se sont dégagées de leur primitive nébuleuse — le brouillard stellaire du grand Herschel — jusqu’à leur mort ou dissolution dans l’éther, ce prétendu vide entre les mondes — ne saurait dépasser 15 trillions d’années et ne doit généralement guère atteindre plus que quelques centaines de milliards d’années.
Dans cette hypothèse plausible, notre habitat terrestre vivrait, depuis sa sortie des entrailles ignées du Soleil jusqu’à son émiettement dans l’espace, à peine quelques milliards d’années terrestres.
Le monde Einsteinien, dans lequel on perd souvent pied, comme dans la trop profonde philosophie allemande, est, malgré ses apparences, un diminutif de l’Univers, parce que limité à une sphère dont le diamètre est de 300 millions et la périphérie de un milliard d’années de lumière. Ce monde serait composé d’un million de voies lactées analogues à la nôtre, dont le diamètre est de 220.000 années de lumière.
Il y aurait dans notre Voie lactée trois milliards de soleils et, dans l’Univers d’Einstein, avec ses 2 millions de voies lactées, quelques quatrillions d’étoiles composées d’un nombre d’atomes avec leurs électrons, ces systèmes solaires en miniature, s’inscrivant par près de cent chiffres — l’atome est à l’homme dans la proportion de l’homme au Soleil. — Néanmoins, l’univers d’Einstein est un diminutif de l’Univers parce que calculable.
Nier la pluralité infinie des mondes habités et dire, avec les astronomes à tendance spiritualiste de nos jours, que la vie consciente dans l’Univers serait une exception est un anthropomorphisme aussi grossier qu’était, jadis, l’affirmation enfantine que notre Terre était le centre de l’Univers et l’homme le roi d’une création inexistante parce que la matière, avec l’énergie qui lui est inhérente, est exempte de finalité, demeure éternelle, cause et effet en même temps.
Les quatrillions d’étoiles des voies lactées formant notre archipel, où nos îles stellaires qui émergent de l’éther sont toutes, d’après les révélations spectroscopiques, d’égalité constitutive et les « terres du ciel », nous font voir dans la planète géante Jupiter ce que notre Terre était dans un passé éloigné de quelques centaines de millions d’années, à l’époque de sa formation.
Avec Mars, nous avons l’image de ce que nous serons dans une dizaine de millions d’années, lorsque les océans se dessécheront et que l’atmosphère se sera raréfiée.
Avec la Lune, enfin, sans atmosphère et sans bruits, c’est le règne du silence et de la mort.
Les torches du ciel que sont les étoiles ou les soleils, deux expressions pour dire la même chose, inscrivent en lettres de feu pour celui qui sait les lire et comprendre leur langage : La Vie, si elle n’est pas nécessairement simultanée sur les mondes d’un même système solaire, est, a été et sera la parure de toutes les planètes qui peuplent l’éternité de l’Univers stellaire
— Frédéric STACKELBERG.
SOLIDARISME (biocosmique)
Il n’y a pas d’ « essence individuelle » ; tous les éléments dynamico-matériels de l’être humain sont puisés dans un fonds alimentant au même titre tous les êtres et toutes les choses, et auquel ils retournent après la dissociation des architectures éphémères, minérales, végétales, animales, où ils se sont trouvés engagés. Cette communauté de nature, d’origine et de destinée entraîne un corollaire important : chacune de ces associations d’éléments irréductibles dites à tort « individuelles », ne cesse pas un instant d’être en communication avec toutes les autres associations dynamico-matérielles, qui réagissent « ad infinitum » les unes sur les autres. La vie de chaque objet, de chaque être, est donc étroitement solidaire de la « Vie Universelle ». En outre, l’interdépendance des êtres de même espèce est absolument indiscutable, et c’est se boucher volontairement les yeux, que de se refuser à admettre les actions mutuelles des êtres humains.
Le plein développement de chacun n’est possible qu’au milieu du développement équivalent des autres. Le bonheur, l’intelligence, ne peuvent procéder de considérations égoïstes ; la sottise, l’injustice, la méchanceté, la souffrance ambiante ont leur retentissement inévitable sur chacun de nous. Et de même, solidaires aussi dans le bien, nous jouissons, directement ou indirectement, du rayonnement de beauté ou de bonté répandu dans la collectivité, même par nous-mêmes. L’homme est un foyer vers lequel comme autant de miroirs, les autres hommes réfléchissent le bien ou le mal qui en est irradié.
Impuissants donc à nous soustraire aux mille liens qui nous rattachent les uns aux autres et à la nature entière, il nous appartient de déterminer et de pratiquer consciemment les actes les plus propres à faire bénéficier notre être et les autres d’une harmonisation des activités et des modes transitoires d’existence dans le tout. C’est la diffusion de ces notions, l’étude systématique de ces actes, leur introduction progressive dans la vie humaine individuelle et collective que poursuit l’« Association internationale biocosmique », dont il a été question déjà dans cette encyclopédie.
Fondée par Félix Monier, l’auteur des Lettres sur la vie, secourue par des savants et des penseurs tels que les Herrera, les Zucca, les Albert Mary, l’A.I.B. s’attache à mettre en évidence — dans le dessein d’en tirer des attitudes conséquentes — la Solidarité qui unit étroitement, des infimes aux plus vastes et aux plus compliquées, toutes les portions de l’univers. Dégagée de toute religiosité, préoccupée d’observation et d’expérience, elle n’entend pas édifier un nouveau dogme et soustraire à toute révision les bases de son activité. Ses principes demeurent soumis au contrôle de telles découvertes ultérieures qui pourraient infirmer les multiples constatations déjà recueillies, lesquelles attestent qu’il existe, dans une vie générale aux caractères encore obscurs et souvent diversifiés, une parenté essentielle et des liens indestructibles entre tous les éléments du cosmos.
Une telle théorie, en même temps qu’elle situe l’homme à sa place modeste dans l’immensité animée, est de nature à faciliter l’établissement d’une organisation sociale où compte serait enfin tenu de cette interdépendance vitale, pour une balance à la fois rationnelle, scientifique et fraternelle des rapports humains.
— L.
SOLIDARITÉ
n. f. (du lat. solidaris, solidaire).
Etat de plusieurs personnes obligées les unes pour les autres. Philos. Dépendance mutuelle entre plusieurs personnes ou entre les hommes, qui fait : que les uns ne peuvent être heureux, se développer que si les autres le peuvent aussi, d’où résulte l’obligation de s’entraider.
Dr. franç. :
“ Quand plusieurs personnes s’obligent simultanément envers une autre, les dettes sont en principe simplement conjointes, et le créancier ne peut réclamer à chacun qu’une partie de la dette totale. Il en est autrement quand il y a solidarité. La loi reconnaît l’existence de la solidarité soit entre créanciers, ce qui permet à chaque créancier de réclamer au débiteur toute la dette, sans que celui-ci puisse jamais payer plusieurs fois la totalité (cette solidarité n‘est plus d’ailleurs, aujourd’hui, usitée en pratique), soit entre débiteurs, ce qui permet au créancier de demander le tout à chacun d’eux, sans d’ailleurs toucher plus d’une fois le montant de la dette. La solidarité doit avoir été stipulée expressément ou résulter d’un texte comme l’article 55 du Code pénal entre les auteurs d’un même crime ou délit. Le payement, la dation en payement, la novation faite par un débiteur libèrent tous les autres. II en est de même pour la remise de dette, à moins que le créancier n’ait entendu faire une remise ne profitant qu’à un seul. L’obligation solidaire une fois payée, les débiteurs procèdent entre eux à une répartition pour que chacun supporte une part proportionnelle à son intérêt dans la dette. ”
« Solidarité républicaine, association politique fondée en octobre 1848, à Paris et dans les départements, à l’instigation de Ledru-Rollin, Delescluze, Gambon, Sarrut, etc. Elle avait pour objet de résister par tous les moyens légaux aux tentatives des légitimistes et des bonapartistes pour s’emparer du gouvernement ; Administrée par un conseil général de soixante-dix membres, la Solidarité républicaine avait un comité central à Paris, des comités de département, d’arrondissement et de canton. La Cour de cassation déclara illégale cette association comme société secrète, par arrêt Du 3 décembre 1849. »
« SOLIDARISTE (synonyme de solidaire) n. Partisan de la solidarité. »
Les syndicalistes qui savent vivre en pratiquant l’entraide pour rendre plus agréable et moins fatigant le travail sont des solidaristes en action. Quand ils se soutiennent également dans la lutte contre toutes les formes de l’exploitation, ils sont solidaires, et c’est ainsi que souvent ils triomphent de leurs exploiteurs et imposent leurs revendications.
Il en est de même des coopérateurs de production ou de consommation. Ils sont également des solidaristes en action, des solidaires effectifs puisqu’ils pratiquent la solidarité.
Il n’est pas une grève, en France et ailleurs, c’est-à-dire partout où il y a des hommes assujettis à l’exploitation, où la solidarité ne soit mise en action : solidarité des grévistes entre eux ; solidarité des travailleurs de toute la corporation, de toute la localité et même de toutes les corporations et de toutes les localités et, parfois, de tous les travailleurs organisés d’une nation. Souvent aussi la solidarité internationale s’exerce en faveur de grévistes, même avant que ceux-ci y aient fait appel. Des secours arrivent de partout et les grévistes obtiennent gain de cause par leur courage, leur endurance dans la lutte et surtout par la solidarité de tous travailleurs. On n’en finirait pas de citer des exemples ou des souvenirs de solidarité en action. Toute l’histoire de la classe ouvrière en est parsemée. Il n’est pas un militant syndicaliste qui ne puisse narrer les miracles accomplis par la solidarité des ouvriers entre eux.
Qui ne se souvient des grèves de Fougères ?
Les ouvriers de la chaussure, en 1906, se révoltèrent collectivement contre les exigences des gros patrons Fougères. Ceux-ci n’avaient pas voulu accorder, aux ouvriers qui travaillaient à certaines machines, les salaires équitablement établis par le syndicat. Ils les menacèrent d’un lock-out... Car les patrons étaient fortement organisés ; les plus riches imposaient aux autres, moins puissants et moins exigeants, leur arbitraire volonté.
Ce fut donc la grève. Elle éclata naturellement au début de l’hiver (5 novembre). Les patrons savent toujours choisir la saison pour entrer en guerre contre ceux qui les entretiennent et les enrichissent. La misère fut grande. Les commerçants, au début, firent crédit à cette population ouvrière. Mais cela dura peu. La grève continuait et les secours arrivaient de partout, mais les grévistes étaient nombreux. La solidarité en action s’exerça de façon touchante dans toutes les organisations ouvrières du pays. Les appels de la Confédération Générale du Travail furent compris du prolétariat pour la grève de Fougères, comme ils l’avaient été pour d’autres grèves aussi importantes. De leur côté, les grévistes organisaient la résistance, les militants se prodiguaient, les encouragements ne manquaient pas, ni les magnifiques initiatives. Les grévistes, par milliers, défilaient chaque jour dans les rues de Fougères avec leurs drapeaux rouges, en chantant l’Internationale et d’autres refrains comme celui-ci :
Défendons noire dignité ;
Car, en défendant nos salaires,
Nous défendons la Liberté !
Hommes, femmes, enfants se soulageaient ainsi, se donnaient mutuellement confiance en clamant leurs espoirs à la face des gendarmes à pied et à cheval protégeant les usines et les propriétés, rassurant les exploiteurs. Mais les soldats entendaient et voyaient, eux, qui n’avaient pas fait serment de massacrer père et mère, si on le leur commandait. Peut-être des idées de solidarité germaient en leur cerveau... De malheureux garçons de vingt ans apprenaient, faisaient leur éducation sociale en pleine lutte de classes, malgré eux.
Les enfants n’apprenaient pas seulement les chansons des grévistes, qu’ils entendaient de l’école : ils apprenaient la vie, la vie des travailleurs autrement que celle qu’on leur apprend dans les livres de lecture de l’enseignement de l’école religieuse ou laïque. Ils profitaient aussi de l’enseignement et de la propagande par le fait qu’était la belle initiative de l’organisation des soupes communistes, ce rayon actif de solidarité collective et pratique dans les grèves.
Sous un grand baraquement édifié gracieusement par les ouvriers du bâtiment, aidés des grévistes, des marmites immenses furent installées. On y ajouta des plats, des ustensiles de cuisine, et les femmes, courageusement, se mirent à l’oeuvre avec entrain. Des équipes furent formées rapidement pour recueillir ce qu’il fallait pour mettre dans les marmites et faire cuire la soupe et le boeuf, les pommes de terre, les haricots, le riz, etc... que des donateurs aidaient à acheter ou à fournir. Car elle était sympathique à tous la lutte des ouvriers cordonniers de Fougères. Quelques débrouillards parmi les grévistes s’improvisaient cuistots et faisaient d’excellente cuisine. Les femmes s’enthousiasmaient et s’ingéniaient à être utiles. Il y avait pour tous, deux repas par jour : de 10 h. à 11 h. 15 le matin, et de 5 à 6 heures le soir. On comptait, chaque jour, 4.200 soupes ou portions. Avec cela, les grévistes ne mourraient pas de faim. Ce n’était pas l’abondance, mais plutôt la privation. Hommes et femmes savaient supporter sans plainte toutes les rigueurs de la situation. Ils ne souffraient que pour les enfants. On mangeait bien et on mangeait bon, et surtout on mangeait chaud. Tout cela était appréciable pour tenir jusqu’au bout. Pourtant, ce n’était pas suffisant. Les enfants pâtissaient : il faisait froid, très froid dans la rue et chez soi on grelottait dans la pièce sans feu, sans rien à prendre avant de se coucher... elle était loin la soupe de cinq heures du soir !.. Heureusement, l’initiative des travailleurs n’est pas à court pour manifester son précieux concours dans le rayon de son inépuisable solidarité.
Un soir, les grévistes portèrent chez eux une chaude et réconfortante nouvelle : Rennes et Paris ont décidé de prendre les enfants des grévistes de Fougères, et de les distribuer dans de bonnes familles ouvrières qui les garderont jusqu’à la fin de la grève. Ce fut un départ des enfants vraiment émotionnant, un des plus beaux épisodes, certes, de la grande grève de Fougères.
Remarquons, ici, que cet exode des enfants de grévistes, recueillis par des travailleurs d’une autre localité n’est pas unique. Il y eut d’autres exodes semblables, en Belgique notamment, bien avant cette époque ; à Marseille, en 1910, à la grève des inscrits maritimes, qui dura plusieurs mois, et d’autres encore. Elle est universelle, la solidarité dans le monde des travailleurs !
Ah ! ces départs d’enfants de grévistes ! Ces pauvres petits partant pour l’inconnu, quittant leur famille pour se fondre en d’autres familles de la grande famille ouvrière ; pleurant et riant à la fois, chagrins de quitter momentanément le papa, la maman, mais heureux, au fond, de voir d’autres pères et mères et d’autres frères et sœurs, dans d’autres villes éloignées ; c’est une époque de leur vie, cela.
“ C’est le 10 janvier 1907, qu’eut lieu le départ. Toutes les mères étaient à la gare, bavardant, plaisantant même, pour s’encourager l’une l’autre, mais bien émues, toutes, au fond. Elles faisaient aux petits mille recommandations. Mais comme ils étaient tous ensemble et tous hantés de leurs rêves, les petits n’écoutaient déjà plus. La grosse locomotive du train entrait en gare. Baisers, pleurs, mouchoirs agités : quelques minutes plus tard, le train filait à travers les landes bretonnes, vers la grande ville. Pierre regarda longtemps se dérouler les campagnes dénudées par l’hiver. Mais bientôt il se lassa et s’endormit, la petite Jeanne dormant déjà sur ses genoux. Il faisait nuit quand ils arrivèrent à Paris. Ils étaient une centaine environ. Sur le quai inondé de lumière par les lampes électriques, les personnes qui les avaient amenés, de grands camarades parisiens qu’ils avaient vus déjà les jours passés à Fougères, les firent ranger en cortège. “ Allons, les petits, dit l’un ! Tous ensemble l’Internationale. ” Et ils se mirent en marche en entonnant le chant qu’ils savaient tous. La petite Jeanne était bien un peu émue, et serrait la main de son frère. Pierre était fier ; il chantait fort, comme les manifestants dans les rues. Mais quand ils arrivèrent dans la cour, une immense acclamation s’éleva, étourdissante : “ Vive Fougères ! Vive la grève ! ”. Il y avait bien là 4 à 5.000 ouvriers de Paris qui étaient venus les chercher. Les enfants, surpris, un peu troublés de tout ce bruit, du tumulte des voitures, de l’agitation de la foule dans la nuit lumineuse de la grande ville se turent. Mais des amis les emmenaient, les plaçaient dans de grandes voitures. Pierre et sa soeur étaient rassurés. Et ils chantaient à tue-tête quand ils arrivèrent à la Bourse du Travail. Dans la grande salle des fêtes, il y avait bien encore 3.000 personnes qui attendaient les petits Fougerais. Au milieu des acclamations, ils furent conduits sur la tribune. Ils mangèrent des biscuits, burent un peu de vin chaud. Des orateurs parlèrent aux personnes qui étaient là. Ils s’adressèrent même à eux, les enfants. Pierre comprit qu’ils leur disaient d’être courageux comme leurs pères et leurs mères. Et Pierre songea aux siens qui étaient restés là-bas dans la maisonnette sombre. Enfin, après des chants, commença l’appel des personnes qui voulaient bien se charger d’eux. Pierre fut remis à un ouvrier mécanicien. La petite soeur devait être donnée à un ébéniste. Mais elle pleura tellement quand on voulut la séparer de son frère, que le mécanicien, ému, déclara avec sa femme qu’il se chargeait des deux. Je ne vous dirai pas, car ce serait trop long, combien Pierre fut heureux à Paris, ce qu’il vit, ce qu’il apprit. Qu’il vous suffise de savoir que pendant tout le temps de la grève ce fut un réconfort pour les parents de les savoir, lui et Jeanne, bien soignés, alors que la misère faisait rage au pays, et sachez aussi que leurs parents adoptifs pleurèrent de les voir partir, quand la grève eut triomphé. ” — Albert Thomas (Extrait des Lectures Historiques, 33ème lecture.)
Que voilà bien une image de la solidarité effective dans la classe ouvrière, qu’on voudrait voir répandre dans les écoles communales, si ces écoles étaient ce que les prétendent les politiciens de gauche, c’est-à-dire si l’on osait apprendre aux enfants du Peuple l’histoire du Peuple, leur Histoire.
De la même source, du même petit livre, du même auteur, voulez-vous une autre belle image de la solidarité ouvrière, celle que j’extrais, en l’abrégeant, du chapitre : la Verrerie ouvrière.
“ En août 1895, dans la petite ville de Carmaux, une grande grève éclata. Un ouvrier verrier, Baudot avait été délégué par ses camarades au Congrès que tient tous les ans la Fédération des verriers de France, et auquel les syndicats de chaque ville envoient un représentant. Baudot s’était fait remplacer à l’ouvrage par un camarade, comme cela est d’usage dans la verrerie. Mais le patron n’aimait pas les syndicats : il disait que lorsqu’un syndicat se forme dans une usine, un patron n’est plus maître chez lui ; et il voulait rester maître chez lui. Il avait décidé d’engager la lutte contre l’union ouvrière et de la briser. Il renvoya Baudot. Il le considérait, en effet, comme, un meneur. C’est ainsi que les patrons appellent les ouvriers qui s’efforcent d’unir leurs camarades, de les syndiquer pour la défense ou le relèvement des salaires. Mais les verriers de Carmaux se déclarèrent tous solidaires de Baudot. Si le patron ne voulait pas reprendre leur camarade, ils étaient décidés à cesser le travail. Le patron refusa de reprendre Baudot. — Alors, ce fut la grève, une grève longue et dure. Les verriers en subirent toutes les misères. Leurs femmes se plaignaient, les petits pleuraient. Dans les rues, des gendarmes, appelés en nombre, constamment passaient et repassaient, donnaient l’ordre de circuler. Le député de Carmaux, Jaurès, des députés socialistes, des envoyés des organisations ouvrières, étaient venus de Paris pour soutenir les grévistes. Ces députés étaient surveillés par les agents du gouvernement, qui était alors un gouvernement conservateur et qui s’inquiétait fort des grèves. Un soir, même, ils furent enfermés, tenus à vue par les gendarmes. Les préfet, sous-préfet et magistrats se montraient d’une sévérité inouïe. “Un gréviste fut condamné à 24 heures de prison “ pour avoir regardé un gendarme ”. Un muet fut arrêté pour tapage nocturne. Mais ces mesures arbitraires ne réussirent point à décourager les grévistes. ”
Cette grève, dont beaucoup se souviennent encore, fut connue de tout le pays. On lança, pour les grévistes, des listes de souscription. II y avait 850 personnes à nourrir chaque jour. Chaque quinzaine, les chefs de famille touchaient 20 francs, plus 3 francs pour chaque enfant. C’était peu pour les grévistes, mais cela faisait une somme aux soins du Comité de grève. Aussi fallait-il la défendre contre le gouvernement qui tentait de la saisir pour mettre fin à la grève en faveur du patron, le fameux Resseguier, qui résistait toujours, dur à tout, à tous, insensible â la misère des femmes et à la souffrance des enfants. Peu lui importait l’opinion publique, la presse, le gouvernement lui-même mis en minorité sur interpellation des députés de gauche. Rien ne pouvait l’émouvoir. Toutes négociations échouaient devant son orgueil patronal. La grève durait grâce aux secours que fournissait la solidarité ouvrière.
L’obstination patronale fut sans borne.
Les grévistes, à mesure que se prolongeait la lutte voulue par le patron, devenaient sympathiques à tout le monde. Eugénie Buffet, pour les grévistes, chantait dans les cours de la capitale et petite et gros sous tombaient à ses pieds et même des pièces blanches ; sa chanson disait :
Pour qui j’ai si souvent chanté...
Et la foule était, bonne. Cela donna le temps aux grévistes de réfléchir, de discuter et de décider de monter une association de production. Telle fut l’idée de la Verrerie ouvrière d’Albi. Coopératives, syndicats, groupements sociaux divers, souscrivirent des actions. Une loterie fut organisée sous forme de tombola. Enfin, une dame généreuse (Mme Dembourg) confia, pour les grévistes de Carmaux, une somme de 100.000 francs qu’elle mit entre les mains d’Henri Rochefort.
Celui-ci voulait que les grévistes de Carreaux édifiassent “ la Verrerie aux verriers ”. Or, cette forme d’association n’était pas celle que voulaient les verriers. Ils ne voulaient pas qu’une seule pensée égoïste pût entraver ou troubler le développement de leur oeuvre : la Verrerie serait la propriété de tous ; les verriers seraient, au travail, les mandataires de leurs camarades. Des militants audacieux, confiants et sincères se mirent à parcourir villes et villages ; les conférences et meetings furent organisées en faveur de la Verrerie ouvrière et non pas de la Verrerie aux Verriers, comme l’eût voulu Rochefort. Quand une organisation avait vendu pour 100 francs de tickets à quatre sous, elle devenait actionnaire de la Verrerie Ouvrière. Il y eut bientôt des milliers de francs recueillis. Alors, Rochefort commença de verser les 100.000 francs de Mme Dembourg.
Le 13 janvier 1896, fut donné le premier coup de pioche, à Albi, où devait être construite la Verrerie Ouvrière d’Albi.
La grève se termina par la rentrée des ouvriers, que voulut bien reprendre M. Resseguier et ceux qu’il désigna pour ne jamais plus rentrer dans son usine, furent indiqués pour être les ouvriers de la Verrerie ouvrière d’Albi.
Mais avant de travailler à l’usine du Prolétariat, il fallait construire cette usine. Après six mois d’un chômage dû à leur acte de solidarité avec le camarade Baudot, les verriers se firent terrassiers pour édifier eux-mêmes leur usine avec l’aide fraternelle de quelques ouvriers maçons et, guidés par un ingénieur ami, se mirent à l’oeuvre. Les hommes payés 0 fr. 30 (à l’heure) ; les jeunes gens, 0 fr. 25 et les petits (pour les courses), 0 fr. 15, ils travaillèrent, sans se plaindre, “ pour la cause ”. Pour tout cela, l’argent ramassé avait suffi. Mais ce n’était pas tout : il fallait achever construction, installer les ateliers, se procurer l’outillage, raccorder l’usine au chemin de fer du Midi et les souscriptions, les achats de billets à quatre sous n’arrivaient pas assez vite pour les échéances. La solidarité continuait à se manifester, mais très lentement, trop lentement. Cependant, en octobre, les fours avaient été allumés ; en décembre, l’usine était prête ; le verre était en fusion, attendant les travailleurs : mais l’argent manquait encore. Comment faire face aux premières dépenses ? Le notaire, conseiller des verriers lorsqu’ils rédigèrent les statuts de leur Association, essaya d’emprunter pour eux au sous-comptoir entrepreneurs. Cette société ne refusa pas, mais demanda du temps. Or, attendre, c’était risquer la faillite après tant d’efforts, après tant d’espoirs !
II y avait à Paris le Comité d’action de la Verrerie ouvrière, composé de militants délégués de Syndicats, Coopératives et de divers groupements socialistes. Ce comité, activement, s’occupait de recueillir les fonds, de susciter les initiatives, de développer la propagande faveur de l’oeuvre.
Le représentant de la Société à Paris alla trouver Jaurès à la Chambre et fit prévenir un des plus zélés partisans de l’entreprise, un solide militant socialiste, syndiqué, coopérateur, délégué de la Fédération du Livre (Hamelin) qui s’était tout dévoué à la Verrerie Ouvrière. Celui-ci s’en alla déjeuner en hâte à sa petite gargote habituelle. Deux amis qui mangeaient là, avec lui, tous deux coopérateurs, l’un de l’Avenir de Plaisance et l’autre de l’Egalitaire, voyant son air bouleversé, lui demandèrent ce qui le tourmentait. Hamelin dit :
“ Il nous faut 100.000 francs d’ici trois jours pour sauver la verrerie. ”
Ils discutèrent, ayant tout trois la foi au coeur. A deux heures, Hamelin se rendit à son tour à la Chambre, voyait, à son tour, Jaurès et l’agent de la Verrerie. Mais était-il possible à député socialiste de trouver un capitaliste capable de prêter 100.000 francs, pour une oeuvre ouvrière comme celle-là ? La réalité était cruelle : la faillite était certaine. Hamelin ne pouvait s’y résigner. Il dit :
“ Ce que vous ne pouvez faire, citoyen Jaurès, moi, simple travailleur, je vais essayer d’y réussir. Je vous demande trois jours pour vous répondre oui ou non. ”
A neuf heures le lendemain, les trois amis, Hamelin, Bellier et Rémond se retrouvaient. Ils firent le compte de l’argent qu’ils avaient en poche. A eux trois, ils possédaient 4 fr. 90, juste deux heures de fiacre. Et ils étaient à la recherche de 100.000 francs dans les rues de Paris. L’un d’eux avait suggéré qu’on pouvait s’adresser à quelques gros fournisseurs des coopératives. Un courtier en vins, socialiste, ancien combattant de la Commune, pourrait servir d’intermédiaire. Ils se rendirent chez lui. Hamelin lui dit :
“ Nous venons te chercher ; faut que tu nous aides à trouver 100.000 francs. ”
Le courtier le crut devenu soudainement fou. Mais Hamelin lui parla si chaleureusement qu’il le convainquit. Ils partirent tous quatre chez le patron du courtier qui se chargea de négocier. L’ardeur de ses trois compagnons l’avait gagné. Mais à peine fut-il en face de son patron, que sa fièvre tomba : il ne sut plus par où commencer.
“ Qu’est-ce qu’il y a donc ? Que voulez-vous ?... ”
“ Il y a que...que.... je viens vous demander 100.000 francs. ”
Ce fut son tour d’être regardé comme un fou. Mais le plus fort était dit. Il répéta tout le discours, tous les arguments d’Hamelin. Le commerçant résistait. A bout d’arguments, se sentant à demi-vaincu, le courtier demanda audience pour Hamelin. Une heure après, les trois amis étaient là. Hamelin parlait de nouveau, disait la misère, mais aussi la noblesse et la grandeur de leur entreprise. L’autre n’osait plus refuser, remettait au lendemain sa réponse. Hamelin était revenu joyeux. Le lendemain, donc, il se rendit tout confiant chez le commerçant en vins ; mais, hélas ! contrairement à son attente, il lui était répondu que le prêt n’était pas possible. Le vaillant typographe se sentit pris de désespoir ; mais, se ressaisissant, il parla de nouveau, passionnément, douloureusement, jusqu’à ce qu’enfin le négociant, impatienté et ébranlé tout à la fois, lui dit :
“ Personnellement, non, encore une fois, je ne puis rien, mais l’Avenir de Plaisance et l’Egalitaire, les deux grandes coopératives me doivent, pour la fin du mois, environ 100.000 francs. Eh bien ! que ces sociétés vous les avancent, et je m’engage alors à renouveler leur créance de mois en mois jusqu’à ce vous ayez pu les rembourser avec l’argent que vous espérez toucher du sous-comptoir des entrepreneurs. Arrangez-vous avec elles. ”
L’Avenir de Plaisance donnerait, sans nul doute sa contribution, soit 35.000 francs, mais l’Egalitaire inspirait quelque inquiétude à Hamelin. Le soir, cependant, après une brève discussion, le Conseil d’Administration de cette coopérative accordait le prêt : Hamelin pouvait télégraphier la victoire à Carmaux.
Mais les coopératives ne contiennent pas que des ouvriers soucieux de trouver dans la coopération un moyen de solidarité envers les oeuvres d’émancipation ouvrière. Il y a coopérateurs et coopérateurs comme il y a fagots et fagots. Parmi les hommes, il y a des adversaires de parti ; parmi les femmes, il y a des ignorantes du socialisme et de la, coopération.
“ On veut nous prendre notre argent, criaient-elles ; on veut nous voler 65.000 francs ! ”
Et elles signaient et faisaient signer des listes de protestation. On demandait d’urgence une assemblée générale. EIle eut lieu le dimanche, pour entendre les explications du Conseil. Il y avait 4.000 sociétaires environ, (dont 500 femmes décidées. Hamelin se rendit à cette assemblée. Des camarades socialistes lui dirent, à son entrée :
“ Vous n’obtiendrez pas un sous. ”
Il répondit :
“ Je garde confiance, si on me laisse parler, j’aurai l’emprunt. ”
Les partisans de l’emprunt furent d’abord hués ; les adversaires applaudis par toute la salle. La situation semblait mauvaise. Après d’autres, Hamelin eut la parole et les murmures s’amplifiaient du côté des ménagères qui ne pensaient qu’à leur argent sortant de la caisse de leur coopérative. Il s’expliqua, laissant de côté la question d’argent, se bornant, pour l’instant, à raconter la lutte des ouvriers de Carmaux, les persécutions subies, la dureté irréductible du patron, l’affreuse misère des familles de verriers, l’idée de construire l’usine, la collecte magnifique des gros sous dans tout le prolétariat, le courage, la ténacité. Le dévouement des verriers et de tous ceux qui les soutenaient. En cinq minutes, il avait conquis l’attention générale : on l’écouta. Et les adversaires les plus acharnés étaient rappelés au silence un quart d’heure après. Alors, Hamelin s’adressa aux femmes. Il leur dit :
“ Voulez-vous que tous ces efforts soient perdus ? Voulez-vous, mères, qui aimez tarit vos enfants, voulez-vous que, par ce froid glacial de décembre, les mères et les enfants d’Albi retombent dans la misère ? ”
“ Non ! Non ! ” crièrent des femmes.
“ Alors, vous ferez ce que je vous demande, vous voterez l’emprunt. Et d’autant plus que cela ne vous coûtera aucun sacrifice réel, puisque je prends la responsabilité de rembourser dans quelques mois. ”
“Oui ! Oui ! S’écrièrent de nouveau les femmes, nous les voterons ”. Et elles étaient levées ; elles agitaient leurs mouchoirs qu’elles avaient tirées pour essuyer leurs larmes. — Et vous, camarades, vous avez permis aux verriers d’édifier leur usine, cette usine dont chaque pierre fut arrosée de leurs sueurs. Voulez-vous donc que, dans cette usine montée par la classe ouvrière tout entière, un nouveau patron exploite encore vos frères ? — Non, non ! — Alors, comme les citoyennes, vous voterez l’emprunt, et les verriers ne seront exploités par personne. — Oui, oui ! S’écrièrent les hommes...
La partie était gagnée. Depuis le début de la séance, les militants faisaient circuler une liste où ils s’engageaient à abandonner leur action de 100 francs si la Verrerie ouvrière ne pouvait plus rembourser. Trois cents déjà avaient signé. La solidarité se manifestait.
Après Hamelin, des adversaires voulurent parler. — Signez la liste, criaient les femmes. — Engagez-vous ! Vous aurez ainsi une garantie ! Et s’ils ne signaient pas, elles les traitaient d’affameurs.
Au vote, il n’y eut que 50 opposants.
Une dépêche, envoyée à Albi, annonça la bonne nouvelle. Puis, Hamelin partit lui-même. Il dit, en arrivant, au verrier :
“ Courage, courage ! Je vous apporte les étrennes des travailleurs parisiens ! Au travail ! ”
Et, quand la première masse de verre en fusion sortit du four, les verriers tendirent leur canne à Hamelin :
“ A vous l’honneur, camarade Hamelin ! ”
Il souffla la première bouteille au milieu des vivats, car si cette bouteille ne fut pas parfaitement soufflée par cet ouvrier typographe, c’est l’artisan de la solidarité que l’on honorait.
J’ai parlé des cordonniers de Fougères, des verriers d’Albi, mais je n’ai point parlé des mineurs. Dans la vie tragique des travailleurs, ceux-là, comme les pêcheurs et les marins, sont en perpétuel danger.
Parlons de l’épouvantable catastrophe de Courrières, dont les détails terrifiants sont encore dans toutes les mémoires. On ne s’intéresse à ces malheureux que dans les époques, trop nombreuses, hélas ! où, pour gagner leur vie, ils subissent une catastrophe qui les tue par centaines. On pense encore à eux quand ils réclament un meilleur sort, quand ils menacent de se mettre en grève. Les causes de leur agitation ne sont jamais bien connues du public. Une presse bien stylée par les arguments persuasifs du gros patronat minier sait mettre les choses au point pour exaspérer les lecteurs qui, stupidement, jugent, comme le leur dit le journal qu’ils lisent et sont d’accord pour trouver exagérées, abusives, les incessantes revendications des mineurs. Pour un peu, le public, au crâne inlassablement bourré, s’apitoierait sur les patrons, les compagnies minières, les actionnaires de ces compagnies, victimes des exigences répétées des ouvriers mineurs. II n’y pas ici, à mettre les lecteurs au courant de la vie infernale du mineur. On connaît le travail ingrat, pénible qu’est celui d’extraire du charbon des profondeurs de la terre, pour un salaire qui est mesuré savamment de façon à entretenir la misère et l’abrutissement du malheur.
Pour rester dans la question qui nous occupe ici, ne parlons que de la fameuse catastrophe, qui ne fui pas la première, ni la dernière dans le martyrologe des exploités, et qui va nous fournir un exemple encore de la solidarité ouvrière qui n’a rien de semblable à celle dont l’histoire nous a fourni les détails lors de la catastrophe du Bazar de la Charité, quelques années avant, à Paris, dans la belle société où les hommes, autant affolés que les femmes, assommaient celles-ci à coups de poing, à coups de canne pour sauver leur vie d’inutiles parasites. Les actes de courage accomplis en cette catastrophe du Bazar de la Charité en flammes furent accomplis par des ouvriers du voisinage, par des pompiers et autres modestes sauveteurs professionnels ou de hasard. La solidarité est une chose inconnue aux âmes charitables qui se font une fête de donner libre cours à leur orgueil et à leur vanité, en faisant périodiquement du bien aux pauvres pour mériter le ciel.
Donc, c’est le 10 mars 1905, un samedi, dans la matinée, qu’arriva aux oreilles de tous les habitants des cités ouvrières. De la région de Lens, une affolante nouvelle, clamée par une voix mystérieuse comme celle du destin et terrorisante comme les grondements du Vésuve, de l’Etna ou du Stromboli :
“ Le grisou vient d’éclater à la fosse N°4 des mines de Courrières, la mine est en feu, il y a des centaines de victimes ! ”
En un instant, court comme la durée d’un éclair, des femmes affolées, hurlantes, s’échappèrent de leurs demeures et coururent jusqu’à la fosse, traînant après elles des enfants en bas âge qui pleuraient d’instinct, parce qu’ils voyaient pleurer leurs mères, tout à l’heure encore pleines d’insouciante gaîté ! Chacune se sentait frappée par le fléau, bien qu’elle en ignorât l’étendue et, dans chaque famille, on se demandait si le père, le fils ou le frère n’était pas parmi les victimes. Plus on s’approchait du sinistre lieu, plus le désespoir et le deuil éclataient violemment. Des épouses, des mères se roulaient, eu proie à des attaques de nerfs. D’autres étaient emportées, évanouies, dans les cabarets voisins. D’autres, enfin, laissaient échapper des paroles incohérentes entrecoupées d’un de ces éclats rte rire stridents, signes précurseurs de la folie !
Pendant ce temps, les médecins de la compagnie et ceux des environs, arrivés à la première alerte, attendaient les victimes à l’orifice du puits pour leur prodiguer leurs soins. En effet, les secours avaient été organisés de suite : toutes les autorités de la mine et celles des municipalités rivalisaient de zèle avec les houilleurs des autres fosses pour essayer d’arracher, à la mort leurs compagnons de travail. Instinctivement, chacun d’eux se sentait menacé d’un pareil sort et que, le lendemain peut-être, il aurait, à son tour, besoin d’un même dévouement ! Aussi tous se disputaient le périlleux honneur de descendre dans la mine en feu, tandis que, autour d’eux, sur le carreau de la fosse, petit à petit, la masse des curieux s’en venait, grossissant de plus en plus. Imaginez une foule have, aux traits contractés, les yeux baignés de larmes, ne parlant pas, ou seulement très bas, comme on le fait dans la chambre d’un mourant... Imaginez cette foule de 2.000 personnes au moins, massée à deux pas des barrages formés par des gendarmes à cheval en faction devant le puits, sous le ciel gris, dans la boue noire !... Il y avait là, beaucoup de femmes, des vieilles courbées par l’âge et les privations, des jeunes, portant un, quelquefois deux bébés, presque des nouveaux-nés et déjà graves ; des hommes, casqués de cuir, au visage terreux, impassibles, comme pétrifiés, semblant avoir perdu toute notion des choses existantes. Le carreau, avec son trou béant, noir comme un four, d’où il paraissait s’échapper des odeurs de cadavres, les hypnotisait. Et toute la nuit ils restèrent là, avec des alternatives d’espoir et de désillusion. En parcourant les salles où, dans les toiles blanches gisaient des morts, voire même des lambeaux de mort, on pouvait remarquer ici un vaillant sauveteur, blême, inerte sur un matelas, qui était descendu à l’annonce du sinistre, à la recherche des victimes et qu’on avait remonté peu à peu, asphyxié aux trois-quarts. Là, un galibot, c’est-à-dire un gamin de 14 ans, à prendre place à côté de ces camarades, frappés comme lui, pour dormir à jamais, dans les ténèbres. A tout moment, on apportait de nouveaux corps en lambeaux, des troncs noircis et déformés, des membres brisés, des crânes défoncés, des visages tuméfiés, sur lesquels la mémoire la plus fidèle ne pouvait mettre aucun nom. Quelques-uns avaient la position dans laquelle la mort implacable les avait surpris. Repliés sur eux-mêmes, les bras en avant pour se couvrir dans un dernier geste de défense, tels des damnés échappés d’un enfer que Dante, même, n’eût point su imaginer. Amenés sur des civières et enveloppés d’un linceul, on les déposait sur la galerie, remettant à plus tard la quasi impossible identification des moins abîmés. Le dimanche soir, on remonté 23 corps et le lundi, à midi, 7 de la n° 4. Il en restait 100 à l’accrochage. A la fosse N° 2,on en avait remonté 32 dans la nuit du samedi dimanche ; à la fosse N° 10, il y avait eu 100 ouvriers sauvés ; à la fosse N° 3, il y avait eu 10 cadavres. Au dire d’un ingénieur, à la fosse N° 4, dans la nuit qui suivit la catastrophe, étant de service, il vit un spectacle dépassant toute imagination. C’était celui de la buvette, à 380 mètres : la voie, sur un parcours de 100 mètres, était totalement obstruée, les boisages arrachés leurs appuis, d’énormes blocs de roches couvrant le sol de leurs mille fragments. A chaque pas, on rencontrait des cadavres momifiés, absolument méconnaissables. Tout un train de berlines avait été littéralement aplati ; les corps du conducteur et du cheval gisaient à plusieurs mètres de distance, et ce n’était qu’à plat ventre qu’on pouvait avancer dans les éboulis, exposé à chaque instant à être écrasé sous un nouvel éboulement. A la fosse N° 10, 9 autres corps étaient étendus sur la paille de l’écurie ; l’un était celui d’un père de cinq enfants ; tout près, ceux du père et des deux frères, dont un de 17 ans. Ce fut ensuite le tableau des reconnaissances. On avait déjà remis à leurs proches les corps de ceux qu’on avait reconnus au début de l’organisation des secours. Les autres, ceux qu’il s’agissait d’identifier, déposés dans des cercueils provisoires, aussitôt remontés étaient alignés eu deux rangées, laissant entre elles un espace de deux mètres. Des sapeurs du génie arrosaient le sol d’eau phéniquée, tandis que d’autres soldats, munis de gants, enlevaient les couvercles et écartaient les linceuls, de manière à découvrir les défunts qu’on aspergeait ensuite de phénol.
Par groupes de 20 à 25, les visiteurs étaient alors introduits, et des scènes à fendre l’âme se produisaient. Ici, c’était une femme sanglotant éperdument et s’affaissant, inerte, en apercevant son homme. Là, c’était lui deux père, cherchant son fils, et qui avait cru le reconnaître à sa chaussure. Plus loin, une mère retrouvant, dans des restes informes, celui que, deux jours auparavant, elle avait embrassé en l’appelant son fils, tombait évanouie sur la neige boueuse du carreau. Près d’elle, muet d’horreur, se tenait un ancien mineur, dont trente et un des siens, frères, beaux-frères, neveux et cousins, étaient restés an fond de la mine. Trente et un !... Quant au jour des funérailles, ce fut une journée d’atroce désespoir. Rien ne pourrait exprimer la poignante tristesse de ce spectacle dans la mine noire, sous un ciel bas et gris, tandis que la neige, tombant inlassablement, ajoutait encore à la mélancolie du paysage morne et nu...
Ne mentionnons pas les délégations, venues de toutes parts, apporter, au nom des groupements corporatifs qu’elles représentaient, le dernier et suprême adieu à ces obscurs martyrs du travail, victimes de l’exploitation, faisant contraste avec les personnages officiels des pouvoirs publics et des compagnies...
A quiconque l’a vu, ce spectacle des funérailles des victimes de la catastrophe de Courrières restera le souvenir de ce défilé gigantesque et funèbre du 13 mars 1906, sous la neige tombant en flocons serrés, de cercueils, de cercueils et encore de cercueils... Dans la rue de Billy-Montigny, l’une des communes les plus éprouvées, en face la fosse N° 3, ce fut un départ pour la nécropole, si grandement tragique, si impérieusement impressionnant, qu’il était impossible de ne point pleurer. Pendant que, aux pas lent des porteurs dévoués, Ies humbles bières s’en allaient, des gémissements de femme s’échappaient de chacune des maisons qui bordaient la rue, par les portes et les fenêtres. Et, en avançant d’habitation en habitation, on allait de râle en râle, car à chaque croisée, il y avait une voix déchirée de larmes, qui appelait un nom de disparu...
Tout cela n’incite-t-il pas à des pensées profondes et fortes sur la nécessaire, l’indispensable et consolante solidarité des malheureux entre eux ?
Mais, revenons à la catastrophe. Voici continent un rescapé raconta sa terrible odyssée :
“ J’étais à 304 mètres, dans les travaux du fond de la fosse N° 2, lorsque la catastrophe se produisit. Avec quatre de mes camarades, je conduisais un train de vingt berlines pleines de houille ; tout à cour, les lampes s’éteignirent brusquement sous l’action d’un courant d’air tellement violent que je fus renversé avec le cheval que je tenais à la bride ; les longes furent brisées net, et les vingt berlines refoulées à près de trente mètres en arrière...
On se rend compte (et on se l’explique aisément) de cette pression formidable du gaz accumulé pour que l’air respirable ait été refoulé avec une telle force, et l’on comprend que les travailleurs un peu éloignés des accrochages des fosses 2 et 10, aient été asphyxiés avant de les atteindre. Et l’on conçoit la difficulté des tentatives de sauvetage. Il fallut procéder à des travaux de déblaiement pour arriver dans les chantiers du N° 4. Ces travaux commencèrent dès que le dernier des blessé, trouvés à l’accrochage de 397 mètres fut remonté. Ils se poursuivirent toute la nuit avec une activité fiévreuse ; après une équipe, c’était une autre. Ce fut avec un dévouement, un mépris de la mort qui allait jusqu’à la témérité, que les volontaires sauveteurs se présentèrent pour tenter d’arracher à la mort leurs frères malheureux. Des traits de courage inouïs furent accomplis ; citons-en un entre cent : un porion, le nommé Grandame, dont le nom mérite de figurer au tableau d’honneur des victimes du devoir, se trouvait au fond lors de l’explosion ; à l’accrochage 300, après avoir ramené dix-huit camarades sains et saufs, il replongea dans la fournaise pour n’en plus sortir ! Les énumérer tous, d’ailleurs, serait impossible. Il convient pourtant de signaler aussi le magnifique élan de générosité des pompiers de Paris, et surtout celui des “ Feuerman ” ou soldats du feu qui, au premier appel du Syndicat des Houillères françaises, avaient accepté de franchir les 400 kilomètres qui séparent la Westphalie de notre région, pour tenter, au péril de leur vie, d’arracher, s’il en était temps encore, aux griffes de la mort, ceux de leurs camarades de la mine ensevelis depuis 72 heures dans l’inextricable réseau souterrain de Courrières. Ils s’étaient, pour cela, munis d’un appareil spécial, en usage clans les fosses de l’Allemagne, qu’ils avaient apporté. Cet appareil permet de rester deux heures dans une atmosphère irrespirable...
Hélas ! Cette suprême tentative fut inutile ; après une longue attente, où l’angoisse de la foule atteignit son apogée, les courageux sauveteurs remontèrent, maudissant, les larmes aux yeux, leur impuissance contre l’effroyable étendue de la catastrophe. Bien plus, devant le danger croissant d’exposer de nouvelles existences humaines, sans espoir sérieux d’opérer des sauvetages, les ingénieurs décidèrent d’arrêter complètement les travaux et de renverser le sens du courant d’air, puis de bouclier de puits, afin d’éviter une nouvelle explosion, le principe étant admis que tout espoir de retrouver âme qui vive était perdu.
Quant au bilan de cette hécatombe sociale qui suscita un si magnifique élan de solidarité ouvrière dans le monde prolétarien tout entier et un esprit de sacrifies international si exemplaire de la part des sauveteurs si courageux de Westphalie, le voici à titre documentaire :
Il y eut 638 cadavres au puits N° 4 sur 852 mineurs descendus ; 451 sur 453 au puits N° 3 et 123 au puits N° 3 ; soit un total de 1.212. Que de maisons ouvrières en deuil ! Que de villes tristes et lugubres ! Que de femmes éplorées ! Deux femmes : une mère et une soeur, réclamaient, à elles seules, aux autorités, les sept cadavres de leurs fils et frères !
Tous comprirent, à ce moment tragique, devant ce monstrueux amoncellement de cadavres, que les frontières politiques et naturelles séparant les peuples devaient disparaître et que toutes les mains devaient se tendre dans une oeuvre d’union des travailleurs de toutes les nations. La fraternité sociale se manifesta, certes, par une horreur sentimentale unanime et par des souscriptions. Ce fut merveilleux. Mais cela n’empêcha point les patrons et les actionnaires de demeurer féroces et rapaces, ainsi que le prouva une grève éclatant quelques jours après dans les bassins du Nord et du Pas-de-Calais, qui dura jusqu’en mai de la même année et vint, dans les familles ouvrières si éprouvées, ajouter aux douleurs si vives de la catastrophe de Courrières les tortures de la faim...
C’est au cours de cette grève qu’un journaliste impudique, un cynique politicien, osa se montrer aux mineurs, comme ministre sympathisant des grévistes qui réclamaient l’application tant promise de la journée de huit heures immédiate et intégrale. Le chapeau sur l’oreille, Georges Clémenceau se déclara d’accord avec les grévistes et leur promit l’appui du gouvernement. En effet, les grévistes ont pu constater aussitôt l’augmentation des forces militaires et policières, en attendant l’application indéfinie de la journée de huit heures ! Tout cela ne doit pas être oublié.
En présence de tels événements, qui donnent lieu à de telles marques de générosité et de véritable solidarité, on arrive à en oublier le terrible et collectif égoïsme des guerres. C’est un profond adoucissement à la douleur que ces preuves de sympathie et ces témoignages de réconfort, venus des quatre coins de l’univers... A la rigueur, ceci montrerait que l’humanité est peut-être meilleure que nombre de pessimistes le prétendent, et que la fraternité des peuples, leur solidarité dans le malheur ne sont pas toujours de vains mots. Oui, cela semblait ainsi, en l’armée 1906... Mais huit années plus tard, d’autres hécatombes, cherchées, voulues et obtenues par d’infernaux moyens de politique, de diplomatie, d’intérêts infâmes, firent des millions et des taillions de victimes en ce massacre affreux de 1914 à 1918.
Ces millions de morts de la guerre ont fait oublier les 1.200 mineurs, massacrés par un coup de grisou, dont la Compagnie de Courrières fut responsable, d’après les rapports, car elle viola manifestement l’article 74 de l’arrêté préfectoral de 1905 qui prescrit l’emploi des lampes de sûreté. Il y a bien d’autres infractions aux lois, décrets et règlements sur les mines, dont la Compagnie de Courrières s’est rendue coupable. Mais la justice bourgeoise est dure aux travailleurs et douce à leurs exploiteurs. La Compagnie de Courrières a continué de prospérer et les actionnaires, de père en fils, continuent de toucher des dividendes. Les mineurs de Courrières, comme leurs autre frères de misère, continuent de revendiquer, de végéter et de mourir comme des gueux.
Cela, c’est toute la solidarité sociale en plein épanouissement. Elle ne cessera qu’avec la disparition totale de ce qui l’engendre : l’exploitation, l’autorité des uns, l’ignorance et la soumission des autres.
Cette Révolution sociale ne s’accomplira peut-être pas sans violence, car, à la solidarité malfaisante des profiteurs d’un régime odieux qui se défendra, s’opposera la solidarité des exploités, des asservis en révolte dans un mouvement de force et de cohésion pour établir la justice et l’Égalité sociales des hommes aptes à vivre en travaillant dans l’entente et la liberté, par la fraternité et l’amour des uns envers les autres ! Ô Solidarité, nos idées d’avenir meilleur, nos espoirs sont en toi ! ” (Extraits d’un livre de lecture intitulé : La Vie du Mineur, par O. Delabasse)
Le savant Paul Langevin, interrogé en 1933, par un journaliste, fit des déclarations intéressantes qui répondaient à une opinion assez justifiée de Jules Romains sur les savants, où celui-ci affirmait :
“ Tous les savants, sans exception, sont serviles. Ce sont des employés. On l’a bien vu pendant la guerre. Eux ne s’opposeront à rien. Pas de danger qu’ils fassent grève, fût-ce pour sauver l’Humanité... ”
Une telle condamnation en bloc, un arrêt aussi impitoyable rendu par l’un des esprits les plus profonds de l’époque, ne peut laisser insensible. Il n’y a pas de règle sans exception. Et les déclarations suivantes le prouvent. Elles sont faites par un homme doux, modeste, dont l’inflexible volonté, affirmée partout, de ne point servir les oeuvres de mort, est en train de convertir par sa force exemplaire, des milliers de savants. Voici ce que dit le professeur Langevin :
“L’état actuel de la science, qui rend de plus en plus solidaires toutes les portions du monde, exigerait l’organisation internationale de la collectivité. Nous en sommes loin... [...] ”
“ Il faut convaincre que le paradis est dans ce monde, devant nous et qu’il dépend de nous. Nous sommes tous solidaires, perdus clans l’infini des espaces et du temps : solidaires de nos contemporains, solidaires de nos ancêtres aussi, et de nos descendants. Nous formons un tout, qui doit évoluer sans cesse. Et si la justice se montre défaillante, que la science vienne à son secours, et l’aide à organiser l’harmonie du monde ! [...] ”
“ J’ai remarqué, il y a une dizaine d’années, disait le professeur Langevin, que le cerveau et le coeur humains palpitaient dans l’ensemble de l’espèce. Et j’ai compris à ce moment-là qu’il était du devoir de ceux qui sont à l’avant-garde de s’occuper un peu de l’éducation des autres.
Et je ne crois plus maintenant, qu’un savant puisse dissocier son travail de l’amour du prochain. ”
Que de belles choses ont été dites ou écrites sur la solidarité !
Mais rien de tout cela ne vaut les actes. Et c’est surtout dans le Peuple, parmi les travailleurs, qu’on pourrait moissonner abondamment des exemples fameux, des traits admirables de solidarité individuelle et de solidarité collective. Mais il y en a trop, vraiment, pour entreprendre seulement une simple énumération dans la seule Histoire du Travail et des Travailleurs.
Tout le monde connaît les faits sociaux. On sait que nombre de grèves très importantes ont eu lieu avant la guerre... et depuis, sans autre raison que la solidarité. Il y en eut, également, pour des raisons de dignité. Mais celles qui eurent lieu pour empêcher une injustice ou une représaille du Patronat vis-à-vis d’un ouvrier ou d’une ouvrière seraient à signaler si l’on pouvait disposer de la place nécessaire à leur énumération et à leurs résultats. Il y eut grève générale de diverses corporations et grève générale de diverses localités pour soutenir un camarade frappé pour ses opinions, ou pour sa propagande, ou pour son dévouement à la cause ouvrière. Les Arsenaux de France ont, maintes fois, suspendu le travail pour obtenir la réintégration d’un militant congédié. Les manufactures de tabac l’ont fait aussi, la grève générale, jadis, avant 1910, pour obtenir que soit maintenue à son rang, à sa place, selon son droit, son mérite et son ancienneté, une camarade déjà âgée supplantée par une jeune protégée de l’autorité administrative. Ce fut toujours avec de tels succès que l’idée de solidarité se maintint dans le syndicalisme ouvrier, quelles que soient les corporations : fonctionnaires d’Etat ou charpentiers ; employés de magasins ou terrassiers ; couturières ou cordonniers, etc., etc...
Les actes de solidarité ont été poussés jusqu’à l’héroïsme. Le “ Un pour Tous, Tous pour Un ” s’est manifesté par de fréquentes grèves de la faim. Les libertaires, surtout, ont subi volontairement des supplices qui confondent les plus sceptiques ayant coutume de dénigrer tour, les actes de révolte ou de solidarité. Nul militant syndicaliste qui ne connaisse particulièrement des faits stoïques d’action directe individuelle ou collective accomplis par solidarité. Parfois, ce fut la mort et, toujours, le risque pour les héros, anonymes ou connus, auteurs de tels faits de solidarité effective.
On a vu obtenir, par ce moyen extrême, des résultats incontestables de capitulation des autorités gouvernementales ou judiciaires, comme on a vu, par d’autres moyens, violents, des compagnies ou des patrons accorder spontanément satisfaction entière à leurs exploités.
La solidarité des malheureux entre eux, si elle était mieux organisée, serait d’un effet formidable pour leur bien-être et pour leur liberté. C’est elle qui est appelée â vaincre l’iniquité sociale, malgré toutes les forces de préjugés, d’ignorance, de résignation entretenues parmi les Peuples. Ceux-ci s’affranchiront par leur Solidarité.
Conçue et pratiquée en vue de la libération humaine, la solidarité a exigé et exigera de nombreux sacrifices, elle a fait et elle est appelée à faire encore d’innombrables victimes. Toute libération met aux prises et dresse plus ou moins violemment les unes contre les autres les forces qui luttent pour elle et celles qui luttent contre elle ; et, comme tout état de guerre, la bataille sociale comporte des victimes.
Mais, la délivrance une fois accomplie, sous l’influence déterminante du bien-être et de la liberté dont tous bénéficieront, la solidarité, s’exerçant entre égaux, prendra rapidement la forme qui lui est propre et se traduira en toutes circonstances par l’Entraide. Alors, il ne sera plus nécessaire d’adjurer, au nom de la religion ou de la morale, de s’aimer, de se secourir, les uns les autres. Tous s’entr’aimeront et s’entraideront tout naturellement, parce que, d’une part, ils n’auront plus aucune raison de se haïr ou de se concurrencer et parce que, d’autre part, l’intérêt de chacun se confondra avec celui de tous.
— G. YVETOT.
SOLITUDE
n. f. (lat. solitudo)
La solitude (magnifiée par Ibsen), cette solitude où se forge la force et s’affirme l’originalité, ne peut être le « splendide et stérile isolement » dans lequel l’individu épuise un foyer jamais renouvelé, enchaîne la pensée — ce Prométhée — au rocher d’un moi aride. Un abîme la sépare, cette solitude, de l’absolu de glace où se fige la suffisance. Être seul, c’est réaliser son soi-même aux limites du possible et ne pas le laisser entamer par un adverse obstiné, c’est dégager de la gangue sa personnalité. Du type édifié profitera l’environ. Si nous radions, notre clarté repoussera, dans autrui, l’obscurité et il fera, tourné vers nous, saisi par notre exemple, un pas vers sa propre lumière. Et nous aurons satisfait, en dons rayonnants, à la solidarité qui nous lie au social pour tous les biens dont nous jouissons ...
Compatir aux maux du prochain, sentir dans sa chair et jusqu’au vif de nous-mêmes sa détresse et son pitoyable agenouillement ne peut, sans une descente vers l’inconscience, impliquer que nous devons accepter de nous écraser à son niveau. Mais, au contraire, que nous devons — tenant libre et fraternel le chemin de lui à nous — nous élever dans notre dignité et la notion avertie de notre plan, et l’inciter — ce prochain prostré — à secouer la rouille de ses chaînes, à briser la coque des préjugés agglutinés pour s’ouvrir à la liberté personnelle.
La solitude intelligente et bonne n’est pas la retraite dédaigneuse en marge et au dessus de l’humanité. Elle est toute chaleur, sympathie, rayonnement, attraction aussi vers les cimes. Et menace seulement pour les prêtres, pour les maîtres, les tyrans qui tiennent en bas, éloignés d’eux-mêmes et petits sous le joug ou dans l’ombre, nos frères qui sont aussi des hommes. Les médiocres, les durs, les fats, les ambitieux, les chefs, les ventres, tous les faux individualistes (aristocrates, ouvriers ou bourgeois : les classes, ici, ne sont que des étages provisoires ou des paliers d’accès) méprisent et redoutent cette solitude de flamme, de résolution, de solidarité et d’expansion ...
Vivre seul, c’est se tenir hors du sillage des foules, agréger autour de soi les éléments d’une solide et vivante unité, à la fois attentive et mouvante, c’est se refuser à demeurer complice des passivités où les majorités s’enlisent, à faire nombre parmi les multitudes, à consentir aux multiples abdications en la misère desquelles se traîne, en troupeau, le peuple ilote. Mais c’est tourner sa volonté lucide et recueillie contre les règnes accroupis sur cette torpeur et cette acceptation , contre les vampires agrippés au flanc des masses douloureuses et faisant de cette souffrance immense un insolent, cruel et grossier « bonheur » ...
L’homme fort et seul que nous comprenons et que nous aimons manie sans défaillance une investigation ardemment dénonciatrice. Il porte — aigus — le regard et le scalpel au coeur des conventions, des morales et des institutions échafaudées sur le non-sens d’une puissance d’étranglement. Il tente d’arracher — lambeaux précieux, bribes sacrées qui s’agglomèrent — un peu de cet humain qu’elles atrophient, réduisent et broient. Il se dresse, ici : flambeau, appel, main tendue, mais là : répudiation, combat, barrière résolue. Il se lève comme une espérance et un vouloir. L’homme seul et fort repousse l’isolement des tombeaux et des ruines. Sa solitude est un exemple d’énergie et elle ne cesse d’être active et féconde : elle est foncièrement généreuse ...
— S. M. S.
SOPHISME
n. m. (du grec sophisma, artifice, expédient)
Raisonnement qui pêche soit dans les termes, soit dans la forme, le sophisme est un argument captieux qui donne à l’erreur une apparence de vérité. « Il est d’usage, dans les ouvrages de logique, écrit Rabier, de traiter séparément des erreurs et des sophismes. Cette division semble peu justifiée. On appelle sophisme une erreur de raisonnement. Mais toute erreur est, au fond, une erreur de raisonnement. En effet, il n’y a d’erreur possible ni dans le fait de se représenter telle ou telle chose, ni dans le fait de croire à cette représentation elle-même. L’erreur consiste à juger d’un objet par le moyen d’une représentation, à interpréter une représentation comme signe ou image d’un objet. Or, juger d’une chose par une autre, interpréter une représentation comme signe ou comme image, c’est faire une inférence. Donc toute erreur est une inférence vicieuse ou un sophisme. » Dans l’ensemble, les philosophes contemporains adoptent cette manière de voir. Aussi l’étude des sophismes, confondue avec celle de l’erreur, a-t-elle cessé de retenir l’attention des logiciens. Rappelons cependant qu’une classification courante distingue des sophismes d’induction et des sophismes de déduction.
Parmi les premiers, citons le dénombrement imparfait, l’ignorance de la cause, le sophisme de l’accident. Déclarer qu’il y aura toujours des guerres parce qu’il y en a toujours eu, nous fournit un exemple de dénombrement imparfait. Croire que l’apparition d’une comète sera la raison d’être de meurtres ou d’épidémies dénote une complète ignorance de la cause. Déclarer que la religion est bonne parce que le sentiment religieux ne tue pas la générosité chez certaines personnes, c’est confondre une coexistence accidentelle avec une relation nécessaire. Les principaux sophismes de déduction sont l’ignorance du sujet, la pétition de principe, le cercle vicieux. On tombe dans l’ignorance du sujet, lorsqu’on déplace la question dont on s’occupe et que l’on prouve autre chose que ce dont il s’agit. C’est un procédé cher aux apologistes de la religion et aux politiciens, qui évitent ainsi de répondre aux interrogations embarrassantes et parlent indéfiniment sans jamais fournir les explications qu’ils redoutent. Dans la pétition de principe, on considère comme vraie la chose qui est en question. Ce sophisme est à la base de la majorité des arguments que servent, aux imbéciles, les partisans d’un pouvoir fort. Le cercle vicieux consiste à prouver une proposition par une autre proposition qui s’appuie sur elle. Ajoutons que la violation des huit règles du syllogisme, ou des règles concernant l’opposition et la conversion des propositions, donne naissance à des sophismes qui furent longuement étudiés par les logiciens du moyen âge, mais dont le formalisme désuet et la creuse subtilité n’intéressent plus les penseurs contemporains.
Certains déclarent même que le syllogisme, si cher aux scolastiques, est toujours un sophisme. Stuart Mill, en particulier, estime qu’il constitue une stérile tautologie ou un véritable cercle vicieux. Soit par exemple le syllogisme suivant, très correct au dire des logiciens :
« Tous les hommes sont mortels ; or le duc de Wellington est un homme ; donc le duc de Wellington est mortel. »
Pour affirmer que tous les hommes sont mortels, nous devons savoir au préalable que le duc de Wellington est mortel ; dans ce cas, le syllogisme ne nous apprend rien, c’est une pure tautologie. Et, si nous ne savons pas au préalable que le duc de Wellington est mortel, nous n’avons aucunement droit d’affirmer que tous les hommes sont mortels. Le cercle vicieux serait, en effet, manifeste, puisque la vérité de la majeure, qui sert dit-on à démontrer la vérité de la conclusion, dépendrait elle-même de la vérité de cette conclusion. Poussant la critique du syllogisme encore plus loin, Herbert Spencer estime qu’il constitue un raisonnement par analogie et qu’il suppose quatre termes, non trois seulement comme on le croit d’ordinaire. Ceux qui ne partagent pas le point de vue de Stuart Mill ou de Spencer doivent au moins reconnaître que le syllogisme déductif n’est pas un instrument de découverte, un procédé d’invention, mais qu’il vaut uniquement comme moyen d’analyse et d’exposition. Ainsi s’effondrent les prétentions de la scolastique, ce vain château de cartes que les écrivains catholiques vantent à tout propos.
Lorsque, délaissant les subtilités baroques de la logique formelle, nous examinons la question des sophismes d’un point de vue moins artificiel et plus conforme aux exigences de la réalité concrète, nous constatons que les démonstrations fallacieuses, la duperie verbale, les erreurs de raisonnement constituent la règle générale en matière de politique, de religion, de métaphysique, de sociologie. Le prêtre, le parlementaire, le haut fonctionnaire, le chef d’État sont toujours des menteurs professionnels qui colorent de prétextes humains et raisonnables leurs projets les plus injustes, les moins réfléchis. Sophistes un Poincaré, un Mussolini, un Hitler et tous leurs larbins de la presse qui abritent leurs mensonges sous l’égide d’un patriotisme pointilleux ! Sophistes les savants officiels qui, pour plaire aux maîtres de l’heure, falsifient les faits et dénaturent la vérité ! Sophistes les professeurs de philosophie qui estiment qu’une chaire en Sorbonne ou au Collège de France vaut qu’on s’aplatisse devant les pontifes en vogue et les autorités académiques ! Sophistes de bas étage les membres du clergé ou les éducateurs laïcs qui entretiennent chez les simples des préjugés ineptes, qui déforment et corrompent la mentalité des enfants ! Et ces modernes sophistes sont autrement redoutables que les rhéteurs habiles qui, dans l’ancienne Grèce, soutenaient le pour et le contre avec une égale intrépidité. En s’interrogeant sur les rapports du réel et de la pensée, les sophistes grecs ont favorisé le développement du scepticisme et de l’esprit critique. Ou peut leur adresser des reproches nombreux et fondés, mais ils n’entraînèrent pas des millions d’hommes dans une mort atroce, ils n’eurent pas l’hypocrisie de se proclamer d’incorruptibles soutiens de la vertu. Les rhéteurs qui trônent dans nos Grandes Écoles et nos Instituts, qui pontifient dans les Églises, qui président aux destinées des États modernes se donnent pour mission de réduire les peuples en servitude et de préparer d’ignobles tueries pour un avenir qu’ils espèrent proche. Et ces serviteurs du Capitalisme, nantis de grasses prébendes, pourvus de tous les avantages que procurent le pouvoir et l’argent, n’ont à la bouche que les mots de sacrifice, d’héroïsme, de désintéressement.
— L. BARBEDETTE.
SORCELLERIE, SORCIERS
La sorcellerie est une croyance antique qui veut que certains hommes puissent accomplir des actes surnaturels, généralement avec le concours d’esprits mauvais. Ainsi, le sorcier se targue de commander aux éléments et de guérir les maladies : mais il a aussi, le plus souvent, la réputation de servir les démons et de jeter des sorts.
Une telle croyance est des plus anciennes. Les sociétés les plus primitives en font foi. Les textes cunéiformes de la Chaldée, qui semble être le berceau de la tradition occultiste, montrent déjà que « le sorcier envoyait le mal par les charmes, les sortilèges, le mauvais œil, les objets ensorcelés appelés fardeaux de peine, ainsi que par le souffle, la salive, le contact direct ou indirect avec une victime déjà ensorcelée ... Il fabriquait avec certaines herbes des philtres maléfiques et déchaînait les mauvais esprits par l’imprécation magique, livrait ses ennemis au pouvoir des démons ou causait leur mort à distance par blessures ou maladies. » (R. Le Forestier, L’occultisme et la F. M. écossaise, 1928, Perrin). Dans l’Assyrie, ce pouvoir est attribué de préférence aux femmes. La sorcière habite les endroits écartés, les ruines ou l’intérieur des murs ; elle est d’une extraordinaire agilité ; elle pénètre le corps de l’homme, qu’il faut alors exorciser ; elle secoue la mer comme le vent du sud ; c’est la chasseresse nocturne, à qui on attribue la fièvre, la consomption , la folie, les troubles cardiaques, la stérilité des femmes, l’impuissance des hommes, la mort. Certains ont tous ces pouvoirs sans s’en rendre compte : ils ont le mauvais œil (Fossey, La magie assyrienne, 1902). Tout cet ensemble de superstitions se transmettra intégralement à travers les âges pour s’épanouir au moyen âge.
À toutes les époques de l’antiquité, il est possible de retrouver des preuves de la croyance à la sorcellerie. La bible en fait foi, aussi bien que les inscriptions tumulaires romaines, dont beaucoup attribuent la mort à un maléfice.
Mais c’est surtout au moyen âge et dans les temps modernes que cette croyance s’est particulièrement répandue. Des milliers de malheureux, soupçonnés de se livrer à de telles pratiques, furent brûlés ou torturés par le pouvoir religieux et par le pouvoir laïque.
Parmi ces martyrs, dont la plupart étaient des femmes, quelques-uns étaient des sorciers véritables, se réunissant secrètement pour pratiquer des orgies et des saturnales nocturnes ; mais leur nombre est évidemment très réduit. D’autres ont fait de la sorcellerie un métier : c’étaient d’obscurs charlatans qui vendaient des charmes ou des remèdes, ou se faisaient fort de faire intervenir les démons en faveur des paysans crédules, moyennant espèces sonnantes ; cette forme de la sorcellerie a trouvé son épanouissement sous le règne de Louis XIV, au moment du drame des poisons ; cette cause célèbre démontra la crédulité inouïe des grands personnages de la Cour qui se compromirent en achetant des poudres de succession destinées à hâter la mort de ceux dont ils convoitaient l’héritage ; pour conquérir la faveur entière du roi, la favorite, Mme de Montespan, n’était-elle pas allée jusqu’à servir d’autel à un prêtre diseur de messes noires, qui consacra une hostie sur son ventre nu ? Dans les campagnes, les sorciers de cette catégorie guérissaient les maladies en mêlant à des pratiques magiques quelques recettes empiriques. Mais la grande majorité de ceux qui furent condamnés comme sorciers au cours du moyen âge et des temps modernes étaient des malheureux plus dignes de pitié : quelques hallucinés, intoxiqués par l’usage de stupéfiants tels que le datura et le stramoine, des hystériques, des veuves mal vues par leur voisinage et qu’une dénonciation accueillie à la légère envoyait à la mort, voire enfin des savants ou des personnages plus ou moins frondeurs que le pouvoir de ces temps avait intérêt à faire disparaître ; c’est ainsi que des accusations de sorcellerie pesèrent injustement sur Bacon, le Docteur Agrippa, Urbain Grandier, Jeanne d’Arc, Léonora Galigaï veuve du maréchal d’Ancre, Gaufridi, Melchior de la Vallée, et bien d’autres.
Les sorciers relevaient généralement de l’official, de l’inquisition, enfin, des juridictions laïques et des parlements. Les motifs qui permettaient d’inculper ce genre de criminels étaient particulièrement odieux et constituent une lourde charge contre l’Église catholique. Il suffisait d’avoir commis des extravagances, de ne pas croire à la sorcellerie, de négliger de dénoncer les magiciens, d’être accusé d’avoir jeté des sorts. Or le paysan médiéval, crédule à l’excès, n’hésitait pas à attribuer au diable les maladies, les orages, les fléaux de la nature encore si mal connus. Les juges avaient leur conviction faite d’avance ; ils obtenaient généralement l’aveu par l’emploi de la torture, par l’ensemble des témoignages acceptés avec une absence totale d’esprit critique, enfin par la recherche de la marque du démon, constituée par un point du corps insensible, et que le chirurgien découvrait à l’aide d’une longue aiguille qu’il enfonçait sur toutes les parties du corps. Là encore, la marque était facile à trouver chez les hystériques, si nombreux à l’époque, et qui présentent très souvent des zones d’anesthésie. La condamnation était suivie généralement du supplice du bûcher. Les biens étaient confisqués.
En France, un nombre incalculable de personnes soupçonnées d’avoir été au sabbat, d’avoir pris part à des festins diaboliques et d’être liées à Satan par un pacte, furent brûlées vives. En Lorraine, plus de neuf cents sorciers furent exécutés en quinze ans par un certain Nicolas Rémy, qui encourageait ses pareils par des épîtres en vers :
Un érudit a trouvé la trace de plus de six cents procès dans le seul arrondissement de Saint-Dié. En Alsace, des autodafés monstrueux furent exécutés par la justice religieuse. On alluma des bûchers, dans le cours du XIVème, du XVème, du XVIème, du XVIIème siècles, dans presque toutes les villes et tous les villages de l’Est et du Midi.
En Italie, 139 sorciers furent mis à mort le même jour, à Milan.
En Allemagne, deux moines délégués par le Saint-Père exécutèrent, en quelques années, 6.500 sorciers dans la principauté de Trèves !
Au Congo belge, les missionnaires catholiques firent périr de nombreux prêtres indigènes sous cette inculpation. Au Mexique, un alcade fit encore brûler vifs quatre sorciers en 1874 et, tout récemment encore, les Hindous d’un village des environs de Bombay firent mourir dans les flammes une vieille femme qu’ils accusaient de répandre le choléra par ses maléfices.
Bref, dans tous les pays du monde, la même épidémie fit les mêmes victimes.
Cette croyance particulièrement néfaste a encore survécu dans la tradition populaire. Il y a aujourd’hui, dans le Toulousain, dans le Morvan, en Bretagne et ailleurs, de vieilles gens qu’on accuse de jeter des sorts, et aussi des malins qui vendent des secrets magiques ou qui remettent les entorses avec tout un cérémonial bizarre. Il suffit pour s’en rendre compte de consulter les ouvrages de folklore. On trouve aussi, dans le commerce, des recueils assez anciens qui donnent le moyen de trouver des trésors cachés ou d’invoquer le diable. De temps à autre, une histoire de sorciers a son épilogue devant les tribunaux : on voit des malheureux martyrisés par la foule superstitieuse, comme à Méry et à Laval en 1836, etc. ; on voit aussi des tireuses de cartes surveillées par la police, qui exerce sur elles un contrôle analogue à celui des maisons spéciales ; bref, il reste encore bien des preuves de la bêtise humaine au XXème siècle.
La sorcellerie est pratiquée, à l’heure actuelle, par des millions de sauvages. Les sorcières de la Côte d’Ivoire se mettent en transes médiumniques par la contemplation d’une corne d’antilope-fétiche ornée d’une fourrure de singe ; les mandingues de l’A. O. F. sont organisés en confréries de « contre-sorciers » qui recherchent les gens atteints du mauvais œil et les mettent à mort. Chez les Massaï de l’Afrique orientale anglaise, les laïbou détournent les maladies, conjurent les éléments, et sont dirigés par un Grand Sorcier qui doit être obligatoirement l’homme le plus gras de la tribu. Au Sénégal, une sorcière fut brûlée vive en 1896. Les sorciers Zoulous, du Natal, vendent des remèdes magiques et des philtres amoureux, lisent l’avenir dans l’arrangement de vieux os magiques, et jettent de mauvais sorts à leurs ennemis ; les missionnaires catholiques y ont ajouté leurs croyances non moins fétichistes, de sorte qu’en 1906 on a pu voir une jeune Cafre des missions catholiques frappée de possession démoniaque et accablée d’exorcismes.
En Sibérie, le chamanisme, qui est la seule religion ou à peu près, repose sur l’art de modifier les éléments avec l’aide des esprits ; le sorcier est en grand honneur chez les Sibériens de Tobolsk, chez les Koriaks du Kamtchatka, chez les Bouriates ; le chaman du clan du groupe des Aurochs de l’Oussouri chasse les diables du corps des malades et donne par son art magique l’abondance du poisson (V. le curieux film de Maurice Rouhier, Les Hommes de la forêt). Les bonnes gens de la République socialiste soviétique du Tadjikistan ne font appel aux remèdes européens qu’après l’intervention de la sorcière qui, par ses incantations, chasse les mauvais esprits du corps du patient pour les envoyer vers les déserts et les lacs. Même influence despotique des sorciers de la République soviétique de Tanu-Tuva , qui sont les véritables maîtres du pays. Au Thibet , tous les ministres du culte tantrique sont guérisseurs et sorciers, fabricants en exclusivité d’amulettes thibétaines, petits coffrets renfermant des préceptes de la loi tantrique écrits sur le papier magique thujapatri ; dans un récent conflit avec le Népal, les Tibétains ont demandé une trêve de six mois parce que leurs sorciers croyaient que la planète Mars ne leur était pas favorable ... Les mêmes superstitions se retrouvent en Amérique.
L’étude de la sorcellerie est des plus profitables aux antireligieux parce qu’elle leur permet de mesurer toute la profondeur de la crédulité humaine, en même temps qu’elle dévoile le passé d’intolérance et de stupidité des grandes religions qui, l’Église en tête, ont persécuté mille et mille sorciers pour des crimes imaginaires.
— Jean BOSSU.
BIBLIOGRAPHIE. — Parmi les milliers d’ouvrages traitant de ce sujet, on lira, parmi les plus récents : Garçon et Vinchen, Le Diable, Paris, Gallimard, 1926. Turmel, Histoire du Diable, Rieder. J. Bossu, L’Église et la Sorcellerie, une brochure à l’Idée Libre, 1932, etc.
SORT
n.m.
Le mot sort est quelquefois synonyme de hasard, de destin ; dans d’autres cas, il désigne l’état, la condition. Nous retiendrons ces deux sens seulement, délaissant les autres qui ne présenteraient, pour nous, qu’un intérêt des plus médiocres.
Dans toute existence, elles jouent un rôle essentiel parfois ces mystérieuses puissances qu’on appelle hasard, destin, fatalité. Comme l’orage anéantit brusquement les moissons, comme l’éclair frappe un arbre parmi bien d’autres, sans que l’on sache pourquoi, ainsi misères de toutes sortes, maladies, mort, terrassent, sans qu’il s’y attende, celui dont on enviait l’heur et la situation. Une balle perdue, une artère qui se brise, et c’en est fait de la vie ! De pauvre, quelqu’un deviendra richissime, s’il découvre une mine d’or ou les fabuleux trésors d’un pharaon ; un coup de bourse et, de deux voisins, l’un sera désormais mendiant, l’autre millionnaire ; en politique, c’est une ruelle étroite qui sépare la prison du ministère. Sans cause apparente, l’un réussit où d’autres échouaient inévitablement. Caprices du sort, destins tragiques surtout, ont frappé les hommes d’un prodigieux étonnement ; dieux souffrants, héros, martyrs, lui doivent une auréole que la toute-puissance ne parvient pas à donner ….
L’exil de Sainte-Hélène contribua pour une grosse part à la gloire de Napoléon ; Socrate, Jean Huss, Jeanne d’Arc doivent à leur supplice injuste d’être restés populaires ; un Sacco, un Vanzetti furent pleurés, même par des adversaires ; et sa croix infamante permit à Jésus de supplanter Jupiter et ses trop joyeux compagnons. Tyrans comme sujets ne sont-ils pas guettés par des malheurs imprévisibles, par d’inéluctables nécessités ? S’ils ignorent l’échéance, les hommes n’en sont pas moins, sans rémission possible, tous condamnés à mort. Maladies effroyables, brusques accidents remplaceront tortionnaires et bourreaux absents ; en pleurant sur autrui, nous pleurons sur nous-même. Un destin nous attend, terrible peut-être ; chercher à le prévoir, à le rendre meilleur, s’avère naturel !
Au fatum mystérieux et sombre qui, malgré leur vouloir, conduisait les hommes vers un but fixé d’avance, les religions antiques prêtèrent un pouvoir souverain. L’invincible divinité des athéniens fut remplacée par le livre d’Allah, chez les musulmans. Croire à la liberté fut un dogme pour les théologiens catholiques ; mais ils rétablirent la fatalité par la doctrine contraire de la prescience divine. Et, dans les maux qui l’accablent, dans les joies qui surviennent, dans des faits même insignifiants, le chrétien voit la main de la Providence. Sa résignation, inférieure à celle du musulman, lui fait supporter, néanmoins, toutes les oppressions sociales. Pas un cheveu ne tombe de votre tête, assurait l’Évangile, si votre Père Céleste ne le permet ; l’homme s’agite et dieu le mène, ont répété depuis, sous mille formes, ecclésiastiques et dévots. Mais l’efficacité des prières, admise par les docteurs de Rome, contraignit le vieux fatum païen à changer de vêtements. Drapé dans le manteau d’une Providence impénétrable, couvert d’oripeaux chrétiens, il exauce, aujourd’hui, les demandes transmises par voie sacerdotale ; par contre, il se pose en gardien farouche de l’antique distinction entre esclaves et maîtres, travailleurs et parasites. Grâce à d’adroites supercheries, liberté et déterminisme se trouvent ainsi conciliés ; pour encourager le croyant à l’action, on insiste sur la première ; si l’on souhaite qu’il se résigne, on parle d’obéissance à la volonté divine. Duplicité fort utile, que de savants apologistes ont recouverte, naturellement, du voile opaque des mystères.
Des formes sécularisées du destin s’offrent, à côté des formes théologiques ; hasard, sort, chance sont du nombre, ces mots ayant même sens ou presque d’ordinaire. Pour la majorité de nos contemporains, fatalité, destin ne résultent plus d’un vouloir tout puissant, mais ils s’entourent encore d’un halo de mystère ; autant ces termes sont d’un emploi fréquent, autant leur contenu reste incertain. Que des faits se produisent sans préalables antécédents, qu’une cause ne soit point requise pour que surgisse tel ou tel événement, seuls des ignorants le croient ! Le principe d’universel déterminisme paraît bien établi par les recherches scientifiques ; sans lui aucune prévision possible, aucune loi qui garantisse que, demain, des phénomènes identiques se dérouleront dans le même ordre qu’aujourd’hui. Si de rien quelque chose peut naître, si le néant n’est pas dépourvu d’action, connaissance rationnelle, pensée réfléchie croulent irrémédiablement. Comment admettre que ce qui n’est pas soit efficace néanmoins ? Dire du hasard qu’il est l’imprévisible vaudrait beaucoup mieux déjà, malgré l’imprécision d’une telle formule. Point de volontés extra-terrestres qui interviennent ici-bas, point de faits rebelles à toute loi ; mais de nombreux événements les causes nous échappent. Quant au destin, symbole de notre impuissance, c’est avant tout l’inéluctable, qu’il soit prévisible ou qu’il ne le soit pas.
S’il est vrai que savoir c’est pouvoir, hasard, destin, résultent, en définitive, de notre ignorance seulement ; ni l’un ni l’autre n’existeraient, pour qui connaîtrait les lois de tous les phénomènes. Dans la mesure où nos recherches progressent, leur domaine diminue ; grâce aux découvertes des physiciens, des chimistes, des médecins, chaque jour d’antiques fatalités sont vaincues. Converser avec un ami quand nous séparent des centaines de kilomètres, en quelques heures voler de Londres à Paris, préserver du tétanos ou de la typhoïde furent longtemps des impossibilités. Quitter la terre pour la lune, produire la vie, modifier sérieusement les phénomènes atmosphériques restent encore de l’irréalisé ; pourtant, déjà il est à prévoir que ce seront choses faisables pour nos successeurs. Pas de fatalités irréductibles si, dépassant le cadre des existences individuelles, nous considérons l’œuvre collective d’une humanité qui dure indéfiniment.
Même dans ce canton par excellence de l’imprévisible que l’on appelle jeux de hasard et cas fortuits, des lois rigoureuses commandent ; la probabilité mathématique le démontre. D’où la possibilité, pour le calculateur habile, d’établir d’avance, au moins de façon approchante, le bilan des pertes et des gains. Notre chance sera de moitié au jeu de pile ou face, elle sera bien moindre dans d’autres jeux. Et, si nos calculs portent sur des chiffres suffisamment élevés, la vérification expérimentale de la probabilité théorique apparaîtra concluante. Ils la confirment absolument, les résultats enregistrés dans les maisons de jeu, à Monaco en particulier. Par des procédés de même ordre et grâce à des statistiques établies avec soin, les compagnies d’assurance prévoient le nombre approximatif de décès, d’accidents, etc., pour une période et un nombre donné d’habitants. Courses, loteries, spéculations financières obéissent à un déterminisme que l’on a parfaitement mis en lumière. Notre ignorance des causes, leur complexité, la tangence de phénomènes qui ne semblaient point destinés à se rencontrer, voilà d’où provient la fatalité. Faiblesse de notre esprit, bornes étroites d’une science trop jeune expliquent notre impuissance, une impuissance toute provisoire d’ailleurs.
Ainsi l’homme doit souvent à son ignorance d’avoir un sort pitoyable et d’être vaincu dans sa lutte contre le destin. Mais souvent aussi il est victime des trahisons de sa volonté. Et nous ne parlons point de ces mentalités incohérentes, dépourvues soit de frein soit de force impulsive, qui ne constituent pas une personnalité au sens véritable ; nous parlons des individus sainement équilibrés. Parfois, c’est de courage qu’ils manquent. Combien de malheureux sombrent finalement, qui n’avaient point toujours été pusillanimes ! Ne maudissons pas trop la peur de souffrir, elle est à la base de mille inventions utiles et de l’ensemble du progrès ; aux époques favorables, elle incite à prévoir les jours mauvais pour en atténuer les rigueurs. Mais il arrive, et maintes fois hélas ! que la perspective de douleurs, d’avance et faussement jugées insupportables, fasse déserter l’arène sans avoir engagé le combat. Beaucoup s’avèrent les artisans de leur propre défaite ; pareils aux naufragés que l’espoir abandonne, d’eux-mêmes ils desserrent l’étreinte qui les retient à la bouée de sauvetage. Que de belles actions ne furent point faites, que d’œœuvres remarquables ne virent jamais le jour, parce qu’une crainte excessive paralysa les muscles, engourdit les cerveaux. Le vrai, le seul vaincu, c’est l’homme qui croit l’être, même dans les fers ; il ne l’est pas, celui qui ignore le découragement.
En effet, la volonté est une force agissante. Insérée dans la trame de nos représentations et de nos désirs, elle les oriente dans un sens que, d’eux-mêmes, ils n’auraient pas. Comme toute cause relative, seule espèce que nous connaissions, elle est dénuée de puissance créatrice et suppose des antécédents : à la règle suprême « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », elle est soumise à coup sûr. Comme toute cause aussi, elle a des conséquents et se prolonge en effets qui, sans elle, ne seraient pas : effets d’ordinaire imprévisibles, tant sont multiples et variables les éléments impondérables qui entrent dans une volition. Sur l’efficacité pratique de notre activité réfléchie, aucun doute n’est possible si, délaissant le vain domaine des abstractions métaphysiques, nous situons le problème dans le plan des données positives. La volonté s’avère facteur primordial dans le déterminisme de la vie : voilà qui suffit pour proclamer sa valeur essentielle, sans recourir à un libre-arbitre inintelligible même pour ses partisans. Et c’est la condamnation d’un épiphénoménisme qui creuse un abîme entre la matière et la pensée, qui, de plus, oublie qu’aucune force ne disparaît si toutes se transforment. Moyen d’action du vouloir sur notre vie mentale, l’attention maintient, au foyer de la conscience claire, les seuls états qui lui agréent. Images, sensations, idées font alors l’objet d’un examen minutieux ; d’où les arts, les sciences, les techniques multiples engendrées par la réflexion. Puis au monde extérieur, tant matériel qu’organique, nous apportons, grâce au mouvement, des modifications conformes à nos désirs. Sur l’univers nous avons prise ; dans les séries causales, il nous est loisible d’introduire des facteurs nouveaux. Ainsi, l’homme peut devenir, du moins en partie, l’artisan de son propre destin.
— L. BARBEDETTE.
SOTTISE
La plupart des dictionnaires donnent, comme celui de l’Académie Française, la même signification ou à peu près, aux mots bêtise et sottise.
Bêtise. — « Défaut d’intelligence, de jugement, de bon sens, ou des notions les plus communes. » (Académie Française.)
Sottise. — « Défaut d’esprit et de jugement. » (id.)
C’est à peine si certains des dictionnaires font une distinction entre la bêtise, produit de l’ignorance, et la sottise, produit d’un jugement faux. Littré est un peu plus précis quand, définissant la sottise « défaut de jugement », et la bêtise « défaut d’intelligence et de jugement », il ajoute :
« La bête est dans bêtise, tandis qu’elle n’est pas dans sottise ; c’est ce qui distingue ces deux mots. »
Cette distinction n’est pas suffisante à nos yeux ; elle laisse trop subsister une confusion volontairement créée et continuellement entretenue dans les esprits, au point que les plus avertis d’entre eux se laissent prendre par une habitude de langage qu’ils n’ont pas assez vérifiée. Or, il est essentiel pour nous, pour tous ceux qui recherchent la vérité et ne veulent pas suivre les directions malfaisantes, de mettre exactement la bêtise et la sottise chacune à sa place, et de ne pas imputer à la première ce qui n’appartient qu’à la seconde.
Tout d’abord, il convient de ne pas confondre l’esprit qui est une façon vive, légère, ingénieuse, de voir les choses et de les exprimer, et le jugement, qui est la faculté de discerner suivant la raison. Très souvent, dans son sens le moins spirituel, celui qui « court les rues », l’esprit manque complètement de jugement. Il en résulte qu’on peut être un sot, tout en ayant beaucoup d’esprit, et qu’on peut n’être pas un sot tout en n’ayant que peu ou pas d’esprit. C’était l’avis de La Rochefoucauld. Quand A. France disait : « Les hommes d’esprit sont des sots. Ils n’arrivent à rien », il pensait aux hommes de véritable esprit, aux hommes d’intelligence, de jugement, de bon sens, qui se heurtent à la sottise, laquelle permet d’arriver à tout. Les bêtes ne sont pas sottes, bien qu’elles soient ignorantes, du moins de la science humaine, et qu’elles n’aient ou paraissent n’avoir que peu d’esprit et de jugement. Aussi, n’est-ce pas chez elles qu’on trouve des ministres et des académiciens. Ceux-ci, de même que les hommes savants, ne sont pas bêtes, mais ils sont souvent des sots parce que, s’ils ont parfois de l’esprit, ils ont plus souvent un jugement faux. Pascal disait qu’entre les sots, ceux qui se sont occupés de philosophie et de science sont les plus sots de la bande parce qu’ils le sont avec connaissance. Molière ajoutait, dans les Femmes savantes :
La bêtise est ignorante, modeste, naïve, passive, sans portée, et ses dégâts sont limités. La sottise se prétend savante ; elle érige son ignorance en dogmes infaillibles et en lois tyranniques. Elle s’impose bruyamment, s’étale, s’admire et veut être admirée. Elle envahit le monde avec la violence d’un fléau pour le flétrir et le saccager, pour y répandre l’imposture et le crime. La bêtise n’a qu’un bonnet d’âne, la sottise a une tiare, une couronne, une mitre, un bonnet carré ou pointu, un képi, un casque, un sabre, des diplômes, des décorations, des uniformes, un tricorne d’académicien ou de garde champêtre. La sottise justifie, en le dépassant, cet autre mot d’A. France :
« Les gestes de l’humanité ne furent jamais que des bouffonneries lugubres. »
La bêtise n’appartient qu’aux bêtes et aux hommes simples, demeurés primitifs, qui ne savent pas et ne demanderaient qu’à savoir pour n’être plus bêtes. La sottise n’appartient qu’aux hommes, elle est leur propriété exclusive et indivise, elle est particulière aux gens compliqués et tortueux qui ne savent pas toujours trop, mais savent trop mal et trop perfidement pour porter des jugements sains et faire un bon usage de leur savoir. La bêtise se borne à ignorer, la sottise affirme qu’elle sait tout quand elle ne sait rien. Elle est le produit artificiel, vénéneux, méchant de la civilisation arbitraire et fausse qui a établi son autorité sur le monde entier. Flaubert a dépeint, dans sa Tentation de Saint-Antoine, le Catoblépas qui « reste perpétuellement à sentir contre son ventre la chaleur de la boue, en abritant sous son aisselle des pourritures infinies », et qui se dévore lui-même sans s’en apercevoir. Il a montré aussi le Presteros « qui rend imbécile par son contact ». Ces deux monstres, dignes représentations du « bourgeois » et du prêtre, sont les symboles de la sottise. Ils sont l’image de la sénilité et de la stupidité qu’elle a répandues dans le monde.
Balzac, dont l’œuvre a si souvent percé et montré les profondeurs de la sottise humaine, a dit :
« La nature n’a fait que des bêtes, nous devons les sots à l’état social. »
Mme de Staël avait déjà constaté, dans la fréquentation des gens dits « d’esprit » , que « la bêtise et la sottise différent essentiellement en ceci, que les bêtes se soumettent volontiers à la nature, et que les sots se flattent toujours de dominer la société ». Goethe a fait dire à Méphistophélès :
« L’homme emploie sa raison à se gouverner plus bêtement que les bêtes. »
Ce que Anatole France a commenté ainsi :
« La bêtise empêche souvent de faire des bêtises ... Ce ne sont pas les plus bêtes qui agissent le plus bêtement. »
Bernard Shaw a complété ces vérités majeures en portant ce jugement :
« Il y a beaucoup de sagesse dans la simplicité d’une bête, et parfois beaucoup de sottise dans la sagesse des savants. »
Sottise religieuse d’abord, née de l’ignorance et de la peur de l’inconnu, puis toutes celles qui en sont issues : sottise gouvernementale, sottise militaire, sottise judiciaire, sottise académique, sottise mondaine, tout cela est humain, uniquement humain. Les fabulistes auraient calomnié les animaux si, dans les fictions de leurs apologues, ils avaient visé autre chose que la sottise humaine. L’âne n’eut jamais l’idée de porter des reliques et de faire de sa peau un tambour ; il laissa cela aux prêtres, aux guerriers, aux juges, aux académiciens, à tous les solennels imbéciles. Les grenouilles ne demandèrent jamais un roi, si jacassantes fussent-elles ; elles vécurent toujours en république libre, ce que ne connaîtront jamais les électeurs si radicaux, si socialistes, si communistes qu’ils soient. L’animal reste bête suivant sa nature. L’homme, animal « spiritualisé », est devenu sot en voulant s’élever au-dessus de la nature, en se découvrant pour cela une âme que la bête n’avait pas, que la femme n’avait pas non plus avant qu’elle fut, elle aussi, « spiritualisée » par « l’Immaculée Conception », et que peut-être la bête aura à son tour, maintenant que M. Baudrillart, épiscope-académicien, a bien voulu lui en reconnaître une de « deuxième zone » ! .. L’homme a voulu ainsi faire l’ange en méprisant la bête ; il est tombé plus bas que la bête, dans la sottise. Schiller disait :
« Contre la bêtise, les dieux luttent en vain. »
Schiller entendait par les dieux les hommes vraiment supérieurs qui voudraient que le monde fut conduit par le savoir et la raison et non par l’ignorance et le fanatisme. Lui aussi employait bêtise pour sottise.
On a attribué à Stendhal ce mot :
« La seule excuse de Dieu, c’est qu’il n’existe pas. »
Mais ce n’est pas une excuse pour la sottise humaine qui a fabriqué ce Dieu. Au contraire. La sottise religieuse, base de toutes les autres, leur a fourni leur élément spirituel quand elle a donné à l’homme le coup de marteau qui l’a fait divaguer sur le divin. Et après avoir inventé Dieu, l’homme s’est identifié à lui et a pris sa place. Il a consacré sa sottise, l’a faite souveraine et pontifiante lorsqu’il a prétendu et voulu expliquer qu’à l’image de Dieu, maître de l’Univers, il était, lui, le maître d’une terre, centre de cet univers, et que l’Être Suprême n’avait, en somme, créé l’Univers et la Terre que pour le service et les commodités de l’homme. Ce fut l’aboutissement des religions dans 1e monothéisme ; leurs dogmes et leurs institutions ne sont que le couronnement de cette transcendante imbécillité qui permit à l’homme de pratiquer la plus sauvage autolâtrie.
La raison, appuyée sur la science, a démontré de plus en plus la sottise de telles conceptions ; mais le propre de la sottise étant surtout de persévérer dans ses erreurs, les religions sont demeurées contre toute évidence. Il y a toujours, de par le monde, des ignorantins qui enseignent que le soleil tourne autour de la terre, s’il n’y en a plus pour dire que la terre repose sur la mer ; et il y a toujours de grands personnages académiques pour déclarer qu’il faut croire aux « mystères », bien qu’ils connaissent mieux que personne la fourberie de la fabrication de ces insanités. Il y a toujours des gens qui croient, comme Bernardin de Saint-Pierre, que, si les arbres fruitiers sont bas, c’est pour que les hommes puissent cueillir plus facilement leurs fruits, et que si le melon a des tranches, c’est pour qu’on le mange en famille. Il y a aussi tous ceux pour qui les animaux n’existent que pour leur fournir des jambons et des côtelettes, des chaussures et des fourrures. Dieu ne les a pas créés pour autre chose et Mme de Coulevain devient lyrique à la vue d’un troupeau de vaches, bonnes bêtes chargées de brouter à la place de l’homme pour que s’accomplisse le « miracle de la crème » mousseuse et veloutée que réclame sa gourmandise. Cyrano de Bergerac a ri, bien avant nous, de ces billevesées quand il a écrit :
« De dire que Dieu a plus aimé l’homme que le chou, c’est que nous nous chatouillons pour nous faire rire. »
Et il a conclu ironiquement, devant tant de sottise, que si Dieu avait fait l’Arbre de Science et non l’Homme de Science, c’est :
« Qu’il voulait, sans doute, nous montrer sous cette énigme que les plantes possèdent privativement à nous la Philosophie parfaite. » (Les États de la Lune)
Henri Heine ayant fait la rencontre d’un homme qui lui dit que les arbres sont verts parce que cette couleur est bonne pour les yeux, répondit sur le même ton que :
« Le Bon Dieu avait créé le gros bétail parce que le bouillon de viande fortifie l’homme, et mis les ânes sur la terre pour servir aux hommes de terme de comparaison. »
Il y a ainsi la sottise primaire de ces faux pourceaux d’Épicure qui disent : « Vivons bien, nous mourrons gras », se préoccupant plus de la quantité de substance qu’ils laisseront aux vers que de la qualité de la pensée qu’ils pourraient laisser à l’humanité. Et il y a la sottise supérieure des purs esprits qui prétendent sécréter et distiller une pensée sublime, mais qui ne donne rien à manger à personne, pas même aux vers.
Les hommes ont ainsi mis au compte de la bêtise des bêtes leur propre bêtise perfectionnée et spiritualisée dans la sottise. L’usage demeure courant de dire bêtise pour sottise, même chez les plus clairvoyants, les plus désenchantés par la sottise et les plus révoltés contre elle. On dit toujours « sale comme un cochon », tout en sachant que le cochon n’est sale que lorsqu’il est tenu par l’homme dans la saleté. On continue à charger les vaches d’une stupidité policière dont elles sont bien innocentes. On remplirait des volumes d’exemples semblables montrant l’emploi, simplement irréfléchi chez les uns, mais hypocritement volontaire chez les autres, du mot bêtise à la place de sottise. La bêtise est le bouc émissaire de la sottise.
Quand Voltaire parlait de la bêtise des gens qui se confessent à certains prêtres, c’était leur sottise qu’il avait en vue. Les animaux ignorent le péché et n’ont aucun besoin de se confesser, surtout à des gens qui ne valent pas mieux qu’eux et, souvent, valent moins. Quand La Fouchardière dit que la guerre est « le choc de deux monstrueuses bêtises qui se heurtent », quand il salue ironiquement « la Bêtise souveraine, maîtresse des hommes et des dieux », quand il mesure la puissance de Dieu à l’étendue de la bêtise et de la méchanceté des hommes, quand il montre la bêtise précise, scientifique, mécanique, standardisée, monumentale comme les gratte-ciel, universalisée comme ce « yo-yo » qui a trouvé quarante millions d’acheteurs rien qu’en France, La Fouchardière parle de la sottise et non de la bêtise. Toutes ces choses sont de l’homme et non de la bête.
Les bêtes ne se font la guerre que par nécessité de conservation. Elles n’ont jamais imaginé de détruire dix millions d’entre elles pour conserver ou conquérir le crâne de Makaoua. Elles n’ont jamais entrepris d’anéantir leur propre espèce par l’invention de la poudre, des canons, des gaz asphyxiants, et fabriqué les sophismes qui cherchent à justifier l’emploi de ces belles choses. Les bêtes n’ont jamais prétendu être des anges, mais elles n’ont jamais expliqué non plus que l’assassinat collectif était la plus noble des actions. Elles n’ont jamais élevé des temples aux Sésostris, aux Darius, aux Napoléon, qui font, depuis quarante siècles, s’entr’égorger les hommes, et elles n’ont jamais écrit en lettres d’or, sur des plaques de marbre, que les Poincaré et les Clémenceau ont bien mérité de la Patrie !... ». Les caverneux imbéciles qui célèbrent « l’héroïsme » des « animaux de la guerre », prêtent aux bêtes un peu trop de leur sottise, de celle particulièrement nauséabonde qui se « spiritualise » avec des mouvements de menton et des poses académiques dans le sang des autres. Elles ont le droit d’être dégoûtées, comme le chien de l’ivrogne qui, voyant son maître vautré dans le ruisseau, renonce à le conduire et rentre seul à la maison. Les dix millions de chevaux, autant que d’hommes, immolés dans l’innommable saleté de la Guerre de 1914, n’y allèrent pas d’eux-mêmes. Ils y furent conduits sous le fouet, sans savoir, avec leur résignation ordinaire de bêtes pliées à la servitude. Ils ne crièrent pas : « À Berlin !.. » ou « Nach Paris !.. » comme les hommes crétinisés par la sottise patriotique. Et de même que les chevaux, les Boulot « chiens-héros », les « pigeons de Verdun », les « perroquets patriotes », toutes les bêtes martyrisées et si grotesquement célébrées par leurs bourreaux, sont bien innocentes de tant d’insanité.
A. France a fait dire à M. Bergeret :
« Il y a une férocité particulière aux peuples civilisés, qui passe en cruauté l’imagination des barbares. Un criminaliste est bien plus méchant qu’un sauvage. Un philanthrope invente des supplices inconnus à la Perse et à la Chine. »
Un criminaliste et un philanthrope sont encore plus méchants que la bête et surtout plus hypocrites. M. Bergeret a dit aussi :
« Du moins, avant qu’il y eut des philanthropes, ne torturait-on les hommes que par un simple sentiment de haine et de vengeance et non dans l’intérêt de leurs mœurs. »
C’est aux « purs esprits », aux docteurs appelés « angéliques » et devant qui les bêtes n’étaient que la plus méprisable matière, qu’il appartenait de torturer et de brûler les hommes pour en faire des « bienheureux » !..
Flaubert, parmi tant d’autres, a trop souvent appelé bêtise ce qui était la sottise de ces « bourgeois » qui prenaient « leur pot de chambre pour l’océan » ! Les bêtes sont incapables d’une aussi monumentale sottise.
La platitude des divagations bourgeoises sur le temps qu’il fait et l’état des affaires, faisait écrire à Guy de Maupassant :
Ma raison saurait bien le choix qu’il faudrait faire,
Car je ne comprends pas, ô cuistres, qu’on préfère
La bêtise qui parle à celle qui se tait. »
La bêtise qui parle cesse d’être de la bêtise ; elle devient de la sottise. Quelle bête serait capable de débiter, même en ne se prenant pas au sérieux, les stupidités himalayennes de la rhétorique religieuse, académique, militaire et politique ? Quelle bête viendrait affirmer la réalité de la Trinité, composer un discours sur les « prix de vertu », réciter la théorie militaire et parler sans s’esclaffer de la conscience d’un candidat à un mandat électoral ? Boileau a formulé la plus indiscutable des vérités lorsqu’il a dit, en paraissant émettre un paradoxe :
Qui marchent sur la terre, ou nagent dans la mer,
De Paris au Pérou, du Japon jusqu’à Rome,
Le plus sot animal, à mon avis, c’est l’homme. »
Voltaire, en défendant si bien les bêtes contre la théorie cartésienne faisant d’elles des mécaniques privées de sensibilité, de connaissance et de sentiment, a raillé supérieurement la sottise des hommes. Il s’est bien gardé de la mettre au compte des animaux. Il s’était fait un Petit mémoire instructif des belles choses qui ont partagé les esprits de nos aïeux. Parmi ces belles choses, il y en avait, comme la dispute des stercoristes, solennelle, longue et vive sur « ce qui arrivait à la garde-robe, quand on avait rempli un devoir sacré, dont il ne faut parler qu’avec le plus profond respect » ! ... Il y avait aussi la dispute des cordeliers, qui entraîna tout le monde chrétien, « pour savoir si leur potage leur appartenait en propre, ou s’ils n’en étaient que simples usufruitiers » !... Les mêmes cordeliers disputèrent avec non moins d’ardeur sur la forme de leur capuchon et la largeur de leurs manches !... Heureux était le monde lorsque ces loufoqueries d’inspiration divine n’avaient pas pour effet de faire décerveler, écarteler ou brûler quelques milliers de pauvres diables fermés, comme les bêtes, à la compréhension de tant de merveilles spirituelles !
Flaubert, suivant la voie de Voltaire, rêvait de composer un Dictionnaire des idées reçues. On y aurait trouvé « par ordre alphabétique, sur tous les sujets possibles, tout ce qu’il faut dire en société pour être un homme convenable et aimable ». Le nombre et la qualité des traits dont il a criblé la sottise dans son œuvre permettent d’imaginer combien aurait été « HÉNAURME », comme il disait lui-même, un tel dictionnaire, et quel monument il aurait formé. On en aura une idée en lisant seulement, dans cette farce véritablement rabelaisienne intitulée le Château des cœurs, le discours aux épiciers qui se termine ainsi :
« A vous d’abord, colonnes de la patrie, exemples du commerce, base de la moralité, protecteurs des arts, rois de l’humanité, dominateurs universels ! ... »
Et, ce qui est le plus remarquable, c’est que cette fusée de bouffonneries qui semble échappée de l’imagination d’un Cabrion en délire devant les têtes de turcs de la fantaisie romantique, est encore au-dessous de la sottise réelle, applaudie par des milliers d’auditeurs, répandue par les milliers de voix de la presse, et qui s’étale dans des discours officiels et ministériels. M. Fernand David, ministre du Commerce, a dit un jour aux « bistros » et « mastroquets », empoisonneurs du monde :
« Vous êtes les remparts de la dignité et de la prospérité nationales ! »
Un autre ministre du Commerce, M. Édouard Herriot, a dit aux débitants de tabac, autres empoisonneurs du monde :
« Vous êtes les collaborateurs dévoués de l’État et les excellents serviteurs du public ! »
Sans doute, le gouvernement doit bien cela à l’alcool et au tabac qui rapportent à l’État environ huit milliards par an ! « Réjouissantes recettes », disent, de leur côté les journaux. Elles sont réjouissantes, en effet, pour eux qui remplissent leurs colonnes des récits des crimes engendrés tous les jours par l’abrutissement alcoolique et tabagique.
Il est à noter qu’un M. Herriot se pique d’être un artiste et qu’il flagorne ainsi les débitants de tabac entre une conférence sur Mozart et une autre sur Beethoven ! On n’a pas dit s’il les a célébrés comme musiciens ou comme fumeurs.
Les gouvernants pratiquent l’éclectisme de la sottise ; ils se disent qu’il faut de tout pour faire une majorité compacte de sots. Dans le domaine de l’art, si la sottise gouvernementale est moins directement criminelle, elle n’en est pas moins ahurissante. M. Jules Grévy, président de la République, disait, à l’inauguration d’un salon de peinture :
« Pas de chefs-d’œuvre, mais une bonne moyenne ; c’est ce qui convient à notre démocratie. »
M. Georges Leygues, qui promena pendant quarante ans son « élégance progressiste », comme disait O. Mirbeau, dans tous les ministères avant qu’elle fut nationalement embaumée, déclarait que :
« L’État ne peut autoriser qu’un certain degré d’art !… »
Devant les électeurs abrutis et les académiciens décatis pour qui ces insanités sont paroles d’évangile, on pense au mot du cocher de Bernier, rapporté par Voltaire, et disant à son maître étonné de le voir vendant de l’orviétan à la population de Dehli :
« Tel peuple, tel charlatan ! »
Ces charlatans n’auraient aucun succès auprès des animaux.
En 1853, Flaubert écrivait :
« On deviendra si bête, d’ici à quelques années que dans vingt ans, je suppose, les bourgeois du temps de Louis-Philippe sembleront élégants et talons rouges. On vantera la liberté, l’art et les manières de cette époque, car ils réhabiliteront l’immonde à force de le dépasser. »
Là, encore, les bêtes n’y seraient pour rien ; ce serait l’œuvre de la sottise.
Henri Heine, dans son Tambour Legrand, a écrit d’amusantes pages sur la sottise pour montrer qu’ « il y a dans le monde plus de sots que d’hommes », et se réjouir de ce que les sots étaient pour lui une source inépuisable d’inspiration. Un grand nombre d’autres ont su railler de même la pontifiante imbécillité de cette sottise qui représentait aux yeux de Renan l’image la plus parfaite de l’infini. Rabelais disait plus crûment que Heine :
« Amis, vous noterez que par le monde il y a beaucoup plus de couillons que d’hommes. »
Il en avait repéré 306 espèces dans ses pérégrinations. Car nous avons heureusement, à côté de la sottise, le rire qui est autant qu’elle « le propre de l’homme ». Il en est l’antidote quand il est celui de l’ironie. Il venge l’intelligence et la raison des « bouffonneries lugubres ». Rabelais nous l’a particulièrement recommandé quand il a fait faire à Gargantua « grande irrigation d’ellébore » pour se décroûter la cervelle de toutes les sottises que les Holoferne et les Bridé, théologiens, sophistes, scoliastes, sorbonnards et sorbonicoles, tous « vieux tousseux » et « trop diteux » de coquecigrues, y avaient emmagasinées. Mais nous avons surtout la saine et souveraine ironie sur laquelle la reptilienne sottise use vainement sa bave et ses dents, l’ironie qui « nait du spectacle de l’injustice » et qui est « la vengeance du vaincu » (Baudelaire), l’ironie qui est « la joie de la sagesse » (A. France), l’ironie qui semblait à Flaubert « dominer la vie » et qui la domine, en effet, de toute la puissance de ce solide optimisme que la sottise, si « infinie » soit elle, n’est pas encore parvenue à abattre, malgré la mobilisation de tout son personnel de cuistres et de malfaiteurs.
Oscar Wilde, que la sottise la plus hypocrite prétendait marquer d’infamie, montrait sa hautaine et inébranlable sérénité lorsqu’il écrivait, dans son De Profundis :
« Le vrai sot, celui que les dieux bafouent ou molestent, est celui qui ne se connaît pas soi-même. »
Car celui-là est victime de ses propres passions encore plus que des autres. Ne sachant pas se diriger, il se laisse diriger. C’est lui qui dit avec la sottise religieuse : « je crois parce que c’est absurde », et avec la sottise scientiste : « je crois parce que je n’y comprends rien ». Pour la même raison, il obéit à tous les maléfices autoritaires et, convaincu qu’il n’agit que d’après son jugement, il se croit supérieur à l’âne qui n’obéit que sous la crainte du bâton.
Pour se défendre contre la sottise, ne plus être bafoué ou molesté par les dieux, l’homme doit non seulement se connaître lui-même mais connaître aussi ce qui l’entoure sur la terre et non dans le ciel. Il lui faut reprendre pied sur le vieux plancher des vaches s’il ne veut pas se voir, comme Antée, étouffé dans les bras d’Hercule. Sa sottise est le produit du double dogmatisme religieux et scientifique auquel il s’est soumis par ignorance et par vanité. Le premier lui a fait perdre le contact de l’âme du monde, du Weltseele, de Schelling, et le sens de la solidarité de tous les êtres qui sont dans la nature comme la nature est en eux. Le second lui a fait croire qu’avec la science il pouvait se passer de conscience et qu’il pourrait être heureux sans être juste et sans être bon. Quand Bernardin de Saint-Pierre disait que « l’existence de l’homme est la seule qui paraisse superflue dans l’ordre établi sur la terre », il ne démontrait nullement une supériorité de l’homme et sa divinité ; il constatait simplement le parasitisme où il s’était installé quand sa sottise lui avait fait croire à des prédestinations messianiques qu’accomplirait soit la divinité, soit la science, et qu’il n’avait plus qu’à attendre en contemplant son nombril. Il faut que l’homme comprenne que le progrès, pas plus que la venue du Messie, n’est une « loi fatale », comme voudraient nous le faire dire des sots furieux de notre résistance à leurs falsifications spirituelles. Il n’y a de progrès que là où il y a volonté et action de progrès, c’est-à-dire activité intelligente, et cela comporte essentiellement, pour l’individu comme pour la collectivité, une connaissance de soi-même comme de tout l’environnement. Par cette double connaissance, l’homme pourra redevenir « la nature prenant conscience d’elle-même » (E. Reclus). Il ne sera plus pour elle un parasite et un fléau, il sera un associé, un compagnon, solidaire de tous les êtres. Il sera alors indulgent à la bêtise des bêtes parce qu’il aura su se dépouiller de sa propre bêtise, de cette bêtise souveraine, criminelle et grotesque : la sottise des hommes qui se sont faits dieux ! ...
— Édouard ROTHEN.
SOVIET
n. m.
Substantif russe dont la signification correspond exactement à celle du mot français : conseil. Naturellement, ce n’est pas la philologie du mot nous intéresse ici. Ce n’est pas, non plus, son sens général. Mais il est utile de préciser que, d’une façon générale, ce terme est employé, en russe, dans les mêmes cas où les Français recourent au mot « conseil ». Ainsi, davat(donner) soviet signifie : donner un conseil ; gossoudarstvenny soviet veut dire : conseil d’État ; soviet ministrov — conseil des ministres ; voïveny soviet- conseil de guerre, et ainsi de suite. Le lecteur voit que soviet (comme « conseil ») désigne couramment une institution politique, administrative ou (souvent aussi une direction collective dans l’industrie, le commerce, l’enseignement, etc.) dont les membres se réunissent pour délibérer. Ce qui nous intéresse c’est le sens politique et social spécifique acquis universellement par le mot soviet depuis la révolution russe de 1905–1917. Or, dans ce sens, le mot est employé surtout au pluriel : les Soviets.
SOVIETS (LES) : Leur naissance. Leur vie. Leur mort.
Nombre de gens à l’étranger, je veux dire hors la Russie — parlent, quelque peu à la manière du perroquet, des Soviets, de la Russie des Soviets, du gouvernement des Soviets, sans avoir la moindre idée sur la signification réelle de ces combinaisons de mots. On a inventé même adjectif : « soviétique », un verbe : « soviétiser », d’autres termes encore que les Académies de tous les pays seront obligés bientôt d’introduire dans leurs Dictionnaires, d’autant plus que plusieurs de ces pays sont en train d’imiter le « soviétisme » russe en partie ou en entier, en gros et en détail (Mussolini, Hitler, Roosevelt, etc.... ). Le capitalisme privé étant prêt à entrer dans le coma, des « hommes d’État », des gens appartenant à des classes privilégiées ou intermédiaires, et aussi beaucoup de leurs serviteurs fidèles parmi les « intellectuels », espèrent pouvoir sauver, une fois de plus, l’ordre établi sur l’exploitation des masses, au moyen d’un néo-capitalisme d’État, modèle U. R. S. S. Ces gens ne nous intéressent pas énormément... Mais, ils ne sont pas les seuls à se ranger à côté « des Soviets ». Une foule de sincères, de naïfs — de « poires », pour dire le mot, — prenant des vessies pour des lanternes, prêtent foi au décorum « socialiste » et « révolutionnaire » des nouveaux imposteurs. Des milliers de travailleurs s’y laissent prendre, inconscients de la duperie dont ils seront les premières victimes. On est « pour les Soviets ». On est « ami des Soviets ». On croit, chacun à sa manière, que le « soviétisme », voilà le salut. On crie, à propos de tout et de rien « Vivent les Soviets !... ». Mais allez donc demander à tout ce monde ce que c’est, les Soviets : quelle fut leur origine, quelle a été leur évolution, quels sont leur rôle et leur situation actuels ? Je doute fort qu’il y ait un homme sur mille qui soit capable de vous donner une réponse intelligible...
Les travailleurs étrangers acclament « les Soviets » uniquement parce qu’ils ne les connaissent pas. Cette ignorance, par rapport au sort de l’un des éléments fondamentaux de la révolution, est déplorable. Elle aboutit à des erreurs et à des confusions fatales. C’est pourquoi tout propagandiste ou militant libertaire doit obligatoirement avoir une idée exacte des Soviets, doit connaître leur histoire. Et c’est pourquoi nous croyons indispensable de lui fournir ici ces connaissances.
La naissance du premier Soviet.
Le lecteur m’excusera d’avoir à parler, dans ce premier chapitre, de ma propre personne. Involontairement, je fus mêlé de près à la naissance du premier « Soviet des délégués ouvriers » russe, celui de Saint-Pétersbourg, en janvier -février 1905. Aujourd’hui, je dois être à peu près le seul qui puisse relater et fixer cet épisode historique (à moins que l’un, des ouvriers qui prirent alors part à l’action soit encore en vie et le fasse un jour). Plusieurs fois déjà, le désir m’a pris de raconter les faits. En parcourant la presse — même russe, et a fortiori étrangère — avant trait aux événements de 1905 ou aux Soviets, j’y constatais toujours la même lacune, notamment : aucun auteur n’était à même de dire exactement où, quand et comment surgit le premier Soviet ouvrier en Russie. Tout ce qu’on savait, jusqu’à présent, c’est que ce Soviet naquit à Saint Pétersbourg, en 1905, et que son premier président fut un avocat pétersbourgeois, Nossar, sous le nom d’emprunt de Khroustaleff. Mais d’où et comment vint l’idée de ce Soviet, par qui fut-elle lancée, dans quelles circonstances fut-elle adoptée et réalisée, comment et pourquoi Nossar devint président, d’où venait-il, quelle a été la composition et aussi la première fonction du premier Soviet ? Toutes ces questions, historiquement assez intéressantes, restent encore sans réponse. Cette lacune est compréhensible. La naissance du premier Soviet fut un événement d’ordre tout à fait privé. Elle eut lieu dans une ambiance très intime, à l’abri de toute publicité, en dehors de toute campagne ou action électorale d’envergure.
Ce qui m’empêcha, jusqu’à présent, de raconter les faits, ce fut, avant tout, un sentiment de gêne d’avoir à parler, inévitablement, de moi-même. Ensuite, je n’ai jamais encore eu l’occasion de toucher spécialement aux Soviets dans la presse libertaire. Et quant à la bourgeoise, — j’entends par « bourgeoise » aussi la presse « socialiste » et « communiste », — je n’ai aucune envie d’y collaborer, à quelque titre que ce soit. Le temps passait ainsi sans que je me décidasse à rompre le silence sur l’origine des Soviets. Une fois, pourtant, vivement impressionné par la même lacune dans une publication assez importante et, d’autre part, par des allusions prétentieuses et mensongères dans quelques articles de journaux, je suis allé voir l’éditeur d’une revue historique russe à Paris. Je lui ai proposé de faire, dans sa revue, à titre purement documentaire le récit exact de la naissance du premier Soviet ouvrier à Saint-Pétersbourg, en 1905. La proposition n’eut pas de suite : d’abord, parce que l’éditeur n’a pas voulu accepter, a priori, ma condition de ne rien changer dans la copie ; et, ensuite, parce que j’ai compris dès les premiers mots, que sa revue était loin d’être une publication impartialement historique et documentaire.
Aujourd’hui, obligé de parler des Soviets — ici et aussi dans mon article précédent sur la Révolution russe — je révèle les faits tels qu’ils ont eu lieu. Et si la presse bourgeoise — historique ou autre — s’y intéresse, elle n’a qu’à puiser la vérité chez nous.
Je ne vais pas repeindre ici l’ambiance générale de l’époque de 1900–1905 : je renvoie le lecteur à la Révolution Russe. Allons droit aux faits immédiats.
L’année 1904 me trouva absorbé par un intense travail de culture et d’enseignement parmi les ouvriers de Saint-Pétersbourg. Je poursuivais ma tâche tout seul et d’une façon strictement privée, absolument personnelle. J’avais établi moi-même la méthode de mon travail. Je n’appartenais à aucun parti politique, tout en étant intuitivement révolutionnaire. (Je n’avais, d’ailleurs, que 22 ans, et je venais de quitter l’Université.) Vers la fin de l’année, le nombre d’ouvriers en train de se perfectionner intellectuellement sous ma conduite, dépassa la centaine.
Parmi mes élèves, se trouvait une jeune femme qui, de même que son mari, adhérait à l’une des « Sections ouvrières », créées par Gapone (voir Révolution Russe ). Un soir, elle m’emmena à la Section de notre arrondissement, voulant m’intéresser à cette oeuvre et, surtout, à la personne de son animateur lequel, ce soir-là, devait justement, y assister à une réunion. Fin 1904, on n’était pas encore fixé sur le véritable rôle de Gapone. Les ouvriers avancés, tout en se méfiant parfois de son oeuvre, — vu qu’elle était légale et qu’elle émanait du gouvernement, — cherchaient à la comprendre à leur façon. La conduite assez mystérieuse de Gapone paraissait confirmer leur version. Ils étaient d’avis, notamment, que, sous la cuirasse protectrice de la légalité, Gapone préparait en réalité un vaste mouvement révolutionnaire. (Là est une des raisons pour lesquels les ouvriers se refusèrent longtemps à croire au rôle policier de Gapone. On sait que, ce rôle étant définitivement dévoilé, quelques ouvriers, amis intimes de Gapone, se suicidèrent, ne pouvant pas survivre à leurs illusions brisées.)
Au dit soir, je fis, en effet, connaissance avec Gapone. Sa personnalité m’intéressa vivement. De son côté, il parut — ou, plutôt, voulut paraître — s’intéresser à mon oeuvre d’éducation. Il a été entendu que nous allions nous revoir prochainement pour en reparler d’une façon plus approfondie, et, dans ce but, Gapone me remit sa carte de visite avec son adresse.
A peine quelques jours plus tard, commença la fameuse grève des usines Poutiloff. Et, après quelques jours encore, exactement le 6 janvier 1905 au soir, mon élève vint me voir tout émue pour me dire que les événements allaient prendre une tournure exceptionnellement grave ; que Gapone venait de déclencher un mouvement formidable des masses ouvrières de la capitale et de sa banlieue ; qu’il parcourait toutes les Sections en haranguant la foule, en l’appelant à se rendre le 9 janvier, dimanche, au matin, devant le Palais d’Hiver, pour remettre une pétition au tsar ; qu’il avait déjà rédigé le texte de la pétition, et qu’enfin, il allait lire et commenter celle-ci dans notre Section le lendemain, 7 janvier, au soir. La nouvelle me parut à peine vraisemblable. Les autres élèves, n’appartenant pas aux Sections gaponistes, ne m’en avaient pas encore parlé. Je décidai de me rendre, le lendemain soir, à la Section afin de me rendre compte, moi-même, de la véritable situation.
Le lendemain, 7 janvier, j’ai entendu Gapone lire et commenter sa pétition. C’était déjà la pétition définitive, travaillée par quelques membres des partis politiques, d’allure nettement révolutionnaire. (Voir, pour les détails du mouvement de Gapone, Révolution Russe .) Je compris tout de suite que mon élève disait vrai : un mouvement des masses formidable, d’une gravité exceptionnelle, était imminent. Le jour suivant, 8 janvier, au soir, je me suis rendu de nouveau à la Section. Je voulais voir ce qui s’y passait. Et, surtout, je cherchais à prendre contact avec les masses, à me mêler de leur action, à déterminer nia conduite personnelle. Plusieurs de mes élèves m’accompagnèrent. Ce que je trouvai à la Section me dicta vite mon devoir. La nouvelle des événements s’étant répandue en traînée de poudre parmi la population de la capitale, je vis, avant tout, une foule énorme et grave stationner aux abords de la Section, malgré le froid intense de cette soirée d’hiver. J’appris qu’à l’intérieur un membre de la Section était en train de lire et de commenter la pétition de Gapone à ceux qui purent y pénétrer. Les autres attendaient leur tour. En effet, quelques instants après, la porte s’ouvrit bruyamment. Un millier de personnes sortit dans la rue. Un autre millier se précipita à l’intérieur. Je réussis à y pénétrer aussi. La porte claqua derrière nous. Aussitôt, un ouvrier gaponiste, assis sur l’estrade, commença à donner connaissance de la pétition. Hélas ! C’était lamentable. D’une voix faible et monotone, sans entrain, sans précision, l’homme lisait le document (une copie, bien entendu), devant une masse attentive et anxieuse. Dix minutes lui suffirent pour terminer la lecture, sans commentaires explicites, sans conclusions concrètes. Ensuite, la salle fut vidée pour recevoir un nouveau millier d’hommes. Rapidement, je consultai mes amis. Notre décision fut prise. Je me précipitai vers l’estrade. Jusqu’à ce jour, je n’avais jamais encore parlé devant les masses. Mais je n’hésitai pas. Je sentis en moi une force irrésistible qui me poussait. Il fallait à tout prix changer la façon de renseigner et de soulever le peuple.
Je m’approchai de l’ouvrier qui s’apprêtait à reprendre sa lecture endormante. Je lui dis :
« Vous devez être joliment fatigué : Laissez-moi lire la pétition... »
L’homme me regarda surpris, interloqué. Il me voyait pour la première fois. Je continuai :
« N’ayez pas peur : Je suis un ami de Gapone. En voici la preuve... »
Et je lui tendis la carte de visite de ce dernier. Quelques élèves qui se trouvaient à mes côtés, appuyèrent mon offre. L’homme finit par acquiescer. Il se leva, me remit la pétition et se retira. Aussitôt, je commençai la lecture et l’interprétation du document, en soulignant surtout les passages d’allure révolutionnaire, en insistant tout particulièrement sur la certitude d’un refus de la part du tzar. J’ai lu ainsi la pétition six ou sept fois, toujours à une nouvelle foule qu’on laissait entrer, après avoir vidé la salle, jusqu’à une heure très avancée de la nuit. Et je restai coucher à la Section, avec des amis, sur des tables rapprochées les unes des autres.
Le lendemain matin — le fameux 9 janvier — j’ai dû lire la pétition une ou deux fois encore. Ensuite, nous sortîmes dans la rue. Une foule immense nous y attendait. Vers 9 heures, mes amis et moi, ayant formé — bras dessus, bras dessous — les premiers trois rangs, nous invitâmes la foule à nous suivre et nous nous dirigeâmes vers le Palais d’Hiver. Toute la foule — jusqu’à 12.000 personnes — s’ébranla et nous suivit en rangs serrés. Inutile de dire que nous ne parvînmes pas à la place du Palais. Aux abords du pont dit « Troïtzky », sur la Néva, nous nous heurtâmes contre un barrage de troupes, lesquelles, après les sommations d’usage restées sans effets, nous accueillirent par des salves nourries. A la deuxième salve, la foule s’arrêta et se dispersa, laissant sur place une trentaine de morts et une soixantaine de blessés. Il faut dire, cependant, que beaucoup de soldats tirèrent en l’air : pas mal de vitres aux étages supérieurs des maisons avoisinantes volèrent en éclats, sous le choc des balles. Par miracle, je ne fus pas touché. (Mon voisin de gauche, un forgeron de l’usine Langensippen, grand et beau gaillard, fut tué net par une balle en plein front.)
Quelques jours passèrent. La grève des usines de la capitale était générale. La misère se faisait déjà sentir dans les rangs des grévistes. Tous les jours, des réunions d’urne trentaine ou quarantaine d’ouvriers de mon quartier avaient lieu chez moi. La police, momentanément, nous laissait tranquilles. Depuis les derniers événements, elle gardait une neutralité mystérieuse. Nous mettions cette neutralité à profit. Nous cherchions des moyens d’agir. Nous étions à la veille de prendre certaines décisions. Mes élèves décidèrent, d’accord avec moi, de liquider notre organisation d’études, d’adhérer, individuellement, à des partis révolutionnaires, de passer à l’action. Car tous, nous considérions les événements comme les prémisses d’une révolution décisive.
Un soir, — une huitaine de jours après le 9 janvier, — on frappa à la porte de ma chambre. J’étais seul. Un homme entra, de grande taille, d’allure franche et sympathique.
— Vous êtes un tel ?... Je vous cherche depuis quelque temps déjà. Enfin, hier, j’ai appris votre adresse... Moi, je suis Georges Nossar, avocat. Voici de quoi il s’agit. J’ai assisté, le 8 janvier, à votre lecture de la pétition. J’ai vu que vous aviez beaucoup d’amis, beaucoup de relations dans les milieux ouvriers... Et il me semble que vous n’appartenez à aucun parti politique...
— C’est exact...
— Alors, voici. Je n’adhère, moi non plus, à aucun parti politique, car je me méfie... Mais, personnellement, je sympathise au mouvement ouvrier révolutionnaire... Or, jusqu’à présent, je n’ai pas une seule connaissance parmi les ouvriers. Par contre, j’ai de très vastes relations dans les milieux bourgeois libéraux. Alors, j’ai une idée... Je sais que des milliers d’ouvriers, avec leurs femmes et enfants, subissent déjà de privations terribles par suite de la grève. Et, d’autre part, je connais de riches bourgeois qui ne demanderaient pas mieux que de porter secours à ces malheureux. Bref, je pourrais ramasser, pour les grévistes des fonds considérables. Il s’agit de les distribuer d’une façon organisée, juste, utile. Pour cela, il faut avoir des relations dans la masse ouvrière... J’ai pensé à vous... Ne pourriez-vous pas, d’accord avec moi et avec vos meilleurs amis ouvriers, vous charger de recevoir de moi et de distribuer ensuite, parmi les gréviste, les sommes importantes que je pourrais vous procurer !
J’ai accepté. Parmi mes amis, se trouvait un ouvrier qui pouvait disposer d’une camionnette automobile de son patron pour visiter les grévistes et distribuer les secours. Le lendemain soir, j’ai réuni mes amis. Nossar était là. Il nous apporta déjà quelques milliers de roubles. Notre action commença tout de suite.
Pendant quelque temps, nos journées furent entièrement absorbées par cette besogne. Le soir, je recevais des mains de Nossar, contre un reçu, les fonds nécessaires. Et, le lendemain, aidé par mes amis ouvriers, je les distribuais, contre des reçus également, à des grévistes. Je remettais ensuite les reçus à Nossar.
Naturellement, ce dernier lia amitié avec les ouvriers qui venaient me voir. Cependant, la grève tirait à fin. En même temps, les fonds s’épuisaient. Alors surgit de nouveau la grave question : Que faire ? Comment poursuivre l’action ? La perspective de nous séparer à jamais, sans tenter de continuer une activité commune nous paraissait absurde. C’est alors qu’un soir, quelques ouvriers réunis ma chambre — Nossar était des nôtres — exprimèrent l’idée de créer un organisme permanent : une sorte comité ou, plutôt, de conseil (le mot Soviet fut prononcé pour la première fois dans ce sens spécifique) qui veillerait sur la suite des événements et pourraient le cas échéant, rallier autour de lui les forces ou révolutionnaires. En somme, il s’agissait dans cette première ébauche, d’une sorte de permanence ouvrière sociale.
L’idée fut adoptée. Séance tenante, on essaya de fixer les bases d’organisation et les perspectives de fonctionnement de ce soviet. On décida de mettre les ouvriers de toutes les grandes usines au courant de la nouvelle création et de procéder, dans l’intimité, à des élections des membres de cet organisme qu’on appela déjà — pour la première fois — Conseil (soviet) des délégués ouvriers. En même temps, on posa une autre question : Qui dirigera les travaux du Soviet ? Qui sera placé à sa tête pour le guider ? Les ouvriers présents, sans hésitation, m’offrirent ce poste. Très touché par leur confiance, j’ai, néanmoins, décliné catégoriquement l’offre. Je dis à mes amis :
« Vous êtes des ouvriers. Vous voulez créer un organisme qui devra s’occuper de vos intérêts ouvriers. Apprenez donc, dès le début, à mener vos affaires vous-mêmes. Ne confiez pas vos destins à ceux qui ne sont pas des vôtres. Ne vous imposez pas de nouveaux maîtres : ils finiront par vous dominer. Je suis persuadé qu’en matière de vos luttes et de votre émancipation, personne, en dehors de vous-mêmes, ne pourra jamais aboutir à un vrai résultat... Pour vous, au-dessus de vous, à la place de vous-mêmes, personne ne fera jamais rien... Vous devez trouver votre secrétaire, votre président, ou les membres de votre commission administrative, dans vos propres rangs... Si vous avez besoin de renseignements, d’éclaircissements, de certaines connaissances spéciales, de conseils, bref, d’une aide intellectuelle et morale qui relève d’une instruction approfondie, vous pouvez vous adresser à des intellectuels, à des gens instruits qui devront être heureux, non pas de vous mener en maîtres, mais de vous apporter leur concours sans se mêler de vos organisations. Il est de leur devoir de vous prêter ce concours, car ce n’est pas de votre faute si l’instruction indispensable vous fait défaut... Ces amis intellectuels pourront même assister à vos réunions, avec voix consultative, mais pas plus... Et puis, comment voulez-vous que je sois membre de votre organisation, puisque je ne suis pas ouvrier ? De quelle façon pourrais-je y pénétrer ?... »
A cette dernière question, les ouvriers me répondirent que rien ne serait plus facile : on me procurerait la carte d’un ouvrier quelconque et je ferais partie de l’organisation sous son nom. Inutile de dire que j’ai décliné l’emploi d’un tel procédé de truquage et de tromperie. Je l’ai jugé non seulement indigne, aussi bien de moi-même que des ouvriers, mais surtout malfaisant, dangereux, néfaste. Je disais :
« Dans le mouvement ouvrier, tout doit être franc, droit, sincère... »
Malgré mes suggestions, les ouvriers ne se sentirent pas assez forts pour pouvoir se passer d’un « guide ». Ils offrirent donc ce poste à Nossar. Celui-ci, n’ayant pas les mêmes scrupules que moi, accepta. Quelques jours plus tard, on lui procura une carte ouvrière au nom de Khroustaleff, délégué d’une usine quelconque. Et, après quelques jours encore, les délégués ouvriers de plusieurs usines de Saint-Pétersbourg tinrent leur première réunion. Nossar-Khroustaleff en fut nommé président, poste qu’il conserva par la suite, jusqu’à son arrestation. Le premier Soviet était né.
La vie, la maladie et la mort des Soviets.
J’ai raconté la naissance du premier Soviet avec force détails, car cet épisode historique était resté, jusqu’à maintenant, complètement dans l’ombre. Quant au sort ultérieur des Soviets en Russie, il peut être conté en peu de mots.
L’exemple donné par les ouvriers de Saint-Péterstourg fut suivi par plusieurs autres villes. Des Soviets ouvriers y surgirent, à l’instar de celui de la capitale. Toutefois, leur existence — à l’époque dont nous parlons — fut éphémère. Ils furent vite repérés et supprimés par les autorités locales. Par contre, le Soviet de Saint-Pétersbourg se maintint pendant quelques semaines, le gouvernement central, en très mauvaise posture à la suite des revers dans la guerre avec le Japon, n’osant pas y toucher. Obligé, par la suite, de réduire son activité, ce Soviet ressuscita — toujours sous la présidence de Nossar-Khroustaleff — en octobre de la même année (1905), aux jours de la grève générale. Il continua, ensuite, à fonctionner jusqu’à la fin de l’année, malgré l’arrestation de Nossar, aussitôt remplacé par Trotzky. (Ce dernier pénétra d’abord au Soviet comme membre du parti social-démocrate. Il y remplit par la suite, avant de remplacer Nossar à la présidence, les fonctions de secrétaire.) Supprimé définitivement à la fin de l’année (à ce moment, le gouvernement tsariste reprit pied, « liquida » les derniers vestiges de la révolution de 1905, arrêta Trotzky ainsi que des centaines de révolutionnaires et brisa toutes les organisations politiques de gauche), le Soviet de Saint-Pétersbourg réapparut lors de la révolution de février 1917, en même temps que se créèrent les Soviets dans toutes les villes et localités importantes du pays.
Le Soviet ouvrier de 1905, à Saint-Pétersbourg, s’occupa du sort des travailleurs de la capitale et, surtout, s’employa à la propagande révolutionnaire. Il siégeait assez régulièrement. Il défendait les intérêts des masses ouvrières. Il coordonnait leur action. Il discutait les problèmes qui les passionnaient. Il restait en contact étroit avec elles. Il leur transmettait ses décisions et ses instructions par l’intermédiaire des délégués d’usines. De plus, il publiait un journal d’information et de propagande : les « Izvestia (Nouvelles) du Soviet des délégués ouvriers, qui, naturellement, exerçait une grande influence sur les masses.
Cependant, à cette époque déjà, le Soviet souffrait de quelques tares organiques très graves qui déterminèrent, plus tard, la « maladie » et la « mort » des Soviets en général.
Le défaut organique fondamental des Soviets fut leur soumission — finalement complète — aux partis politiques. Dès le début, ces derniers cherchèrent et réussirent à pénétrer dans le Soviet, à s’en emparer. D’ailleurs, — nous l’avons vu. — à la naissance même du premier Soviet, le manque d’assurance, le doute, la peur d’une vraie indépendance, l’empressement d’être guidés par des éléments prétendus plus « calés » quoique étrangers à la classe ouvrière, poussèrent les travailleurs à introduire ces éléments dans leurs organismes de classe. Le recours à Nossar — épisode paraissant sans grande importance — eut, en réalité, une signification de principe très grave. A ce moment déjà, c’en était fait de l’indépendance des Soviets : le germe de la maladie future fut inoculé à l’organisme créé. Car ce fut un précédent lourd de conséquences. Une fois le principe d’intervention dirigeante des éléments non-ouvriers admis, les partis politiques ne devaient plus tarder à l’exploiter dans leurs intérêts. L’ambiance favorable à l’ingérence des politiciens dans l’oeuvre d’émancipation ouvrière fut ainsi créée. L’avenir immédiat accentua l’évolution du germe morbide et affirma son rôle néfaste. L’hégémonie des partis politiques, le renoncement à une activité vraiment indépendante, ouvrière et sociale des travailleurs, tels furent bientôt les résultats logiques de l’erreur initiale.
Déjà, en 1905, le parti social-démocrate réussit à imposer au Soviet de Saint-Pétersbourg son hégémonie politique. Trotzky mena le Soviet à sa guise. Toutefois, le champ d’action de ce premier Soviet étant très restreint, son oeuvre ne put encore en souffrir beaucoup. Et, d’ailleurs, le temps lui manqua aussi bien de souffrir que d’agir. Mais, en 1917, l’état des choses fut tout autre.
Les Soviets de 1917 furent immédiatement appelés à remplir une importante tâche révolutionnaire et sociale, à déployer une grande activité réelle.
Les Soviets de 1917 durent s’occuper de tout. Chaque Soviet local se divisait en « sections », et chaque section avait son champ d’activité. Ainsi, par exemple, tout Soviet possédait une « section financière », une « section agraire », une « section ouvrière », une « section d’approvisionnements », une « section des transports », une « section de l’instruction publique », d’hygiène, etc., etc. Dirigés, dominés, menés par des partis politiques (au lieu d’être guidés par les besoins réels de la population travailleuse et par des hommes simples, mais capables d’y faire face), les Soviets, au lieu de se consacrer à une oeuvre vraiment ouvrière et sociale, durent justement « faire de la politique », en perdant ainsi leur temps et leurs forces en des discussions et des luttes intestinales interminables, pour arriver finalement à une impuissance totale. Le parti bolcheviste en profita, en fin de compte, pour soumettre les Soviets entièrement à sa terrible dictature, pour en faire des instruments absolument dociles, pour mettre décidément fin à toute ombre de leur indépendance.
Depuis 1919, les Soviets « ouvriers » russes devinrent définitivement de simples filiales du parti bolcheviste, simples organes administratifs du gouvernement. Ils perdirent toute initiative, toute faculté d’agir librement, toute allure sociale et révolutionnaire. Les Soviets comme tels étaient morts.
D’aucuns se demanderont comment une telle imposture est possible, du moment que le Soviet est une institution locale qui s’occupe des intérêts de la localité donnée ; du moment que les Soviets sont, au moins théoriquement, souverains, et qu’enfin, leurs membres sont élus par les travailleurs. Pour bien comprendre la vraie situation, il faut tâcher de se représenter le plus exactement possible cet État omnipotent, maître unique et absolu qui tient tout, qui fait tout, qui est tout. Ce ne sont nullement les Soviets qui sont souverains, mais le parti au pouvoir, donc le gouvernement composé uniquement de membres de ce parti et soutenu :
-
par une force armée et policière formidable ;
-
par une classe bureaucratique et privilégiée nombreuse.
Ce gouvernement surveille, contrôle, organise et dirige absolument tout dans le pays. Rien ne peut se faire contre lui ou en dehors de lui. Théoriquement, — c’est-à-dire, d’après la constitution « soviétique » écrite, — le pouvoir suprême appartient au Congrès Panrusse des Soviets, convoqué périodiquement, et ayant, en principe, le droit de renverser et de remplacer le gouvernement. Mais tout cela n’est que pure apparence. En réalité, c’est le gouvernement — le Conseil des Commissaires du Peuples — qui tient la force et le pouvoir suprême ; c’est le gouvernement qui peut écraser le Congrès des Soviets aussi bien que tout Soviet pris séparément ou tout membre d’un Soviet, en cas d’opposition ou de non-obéissance. Mieux encore : Le véritable gouvernement du pays, ce n’est pas même le Conseil des Commissaires, c’est le soi-disant Politbureau (Comité politique), qui comprend quelques sommités du Parti, ou — plutôt — son chef : Staline, le dictateur. C’est Staline en personne qui est soutenu par l’Aréopage (le « Politbureau »), — par le Conseil des Commissaires, par les couches privilégiées, la bureaucratie, l’« appareil », l’armée, la police. Par conséquent, c’est Staline qui a le pouvoir réel et suprême. C’est lui et, partant, le Politbureau et le Conseil des Commissaires du Peuple qui imposent leur volonté aux Soviets et non inversement. Et voici pourquoi les Soviets ne sont, en réalité, que des filiales politiques du gouvernement.
D’autre part, depuis 1917, le mécanisme électoral des Soviets s’est joliment modifié. Si, au début, les élections aux Soviets étaient libres et plus ou moins discrètes, de nos jours — et depuis assez longtemps déjà — ni cette liberté, ni cette discrétion n’existent plus. Petit à petit, tous ces « préjugés bourgeois », furent extirpés. Aujourd’hui, les élections sont organisées, menées et surveillées de près par les agents du même gouvernement omnipotent. Les « cellules » et les organisations bolchevistes sur place suggèrent aux électeurs leurs « idées » et leur imposent leurs candidats. Dans les conditions présentes, personne n’ose, personne songe même à s’y opposer. Les candidats sont acceptés automatiquement, et les « élections » ne sont qu’une formalité de décor. De cette façon, la composition voulue des Soviets ainsi que leur soumission complète au gouvernement sont garanties d’avance. A part la maladie mortelle des Soviets que je viens de mettre en lumière, ces institutions souffraient de deux autres défauts, de moindre portée, certes, qui ne doivent pas pour cela être passés sous silence.
Le premier de ces défauts fut l’envergure et l’importance exagérée des Soviets. En effet, appelés à s’occuper de tout, ils finirent par ne plus pouvoir s’occuper de quoi que ce soit. Leurs fonctions furent — je parle de l’époque 1917 à 1919 — trop vastes et partant vagues. La répartition des fonctions entre les Soviets et les autres organismes ouvriers (syndicats, coopératives, comités d’usines) n’a jamais été dûment établie. Les anarchistes, dans leur presse, et aussi dans leur propagande verbale, se préoccupaient beaucoup de ce problème. Ils n’eurent pas le temps de poursuivre cette tâche jusqu’au bout : d’une part, ils furent attaqués et écrasés par le gouvernement bolchéviste ; et, d’autre part, ce dernier trancha la question à sa façon en accaparant toutes les organisations ouvrières quelles qu’elles fussent, en les soumettant à sa dictature et en « répartissant » leurs fonctions selon ses desseins politiques. Il est certain que le « vague » des organisations ouvrières — des Soviets surtout — fit parfaitement le jeu des bolcheviks.
Le second défaut des Soviets ne fut pas que leur défaut à eux : il est inhérent à toutes les organisations ouvrières bien assises, permanentes, solides. C’est une certaine lourdeur, une immobilité, une tendance au fonctionnarisme, au bureaucratisme, et aussi à une idée exagérée de leur importance, de leur puissance, de leur éminence. Ironie cruelle : c’est précisément cet ensemble de qualités qui les rend, finalement, presque impuissantes. Pour parer à ce vice assez important, j’ai préconisé, au cours de la révolution russe, la création, par les masses agissantes, des organismes ouvriers spontanés, vivants, « mobiles », formés ad hoc pour résoudre tel ou tel autre « problème du jour », telle ou telle autre « tâche de l’heure », et disparaître une fois la tâche accomplie. De tels organismes pourraient, à mon avis, apporter un correctif sérieux à l’attitude figée des organisations « permanentes » (Soviets ou autres). Ces dernières conserveraient alors, finalement, juste les fonctions qui exigeraient une action lente, solide, permanente. Il me semble que seul ce principe : de multiples organisations ouvrières « mobiles », constamment créées ou liquidées selon les besoins, permettrait aux masses travailleuses tout entières d’agir, de créer, de « vivre », de participer de fait à l’œuvre de la construction. Et, d’autre part, cette situation déplorable où les travailleurs se voient obligés de faire à leurs propres organisations le reproche — combien mérité ! — de s’être « détachées » des masses, cette situation anormale et pénible prendrait fin. (Une résolution dans ce sens fut adoptée unanimement par le premier congrès de la Confédération des organisations anarchistes de l’Ukraine « Nabat », à Elisabethgrad, en avril 1919.)
L’attitude des anarchistes.
Tout ce qui précède explique suffisamment l’attitude des anarchistes russes vis-à-vis des Soviets, lors de la révolution de 1917 (voir aussi Révolution Russe ). Favorable au début où les Soviets avaient encore l’allure d’organismes ouvriers, et où l’on pouvait voir dans la révolution elle-même un facteur puissant qui allait les rendre tels définitivement, bons à remplir certaines fonctions utiles, cette attitude se modifia, par la suite, en sceptique et, enfin, nettement négative, au fur et à mesure que les Soviets devenaient des organismes purement politiques, maniés par le gouvernement.
Les anarchistes, dans leur majorité, accomplirent donc, face aux soviets, toute une évolution qui suivit celle des soviets eux-mêmes : ils commencèrent par ne pas s’opposer à ce que des camarades se laissassent élire membres de ces institutions ; ils passèrent ensuite à la critique et à l’abstention ; et ils finirent par se prononcer « catégoriquement et définitivement contre toute participation aux Soviets devenus des organismes purement politiques érigés sur une base autoritaire, centraliste et étatiste » (Résolution du Congrès d’Elisabethgrad.) Sans doute, cette attitude des anarchistes vis-à-vis des Soviets fut pleinement justifiée par la marche des événements. Je voudrais pouvoir étudier, ici-même, l’important problème du rôle éventuel des organisations ouvrières du genre « Soviets » dans les révolutions à venir. Mais, ce sujet m’entraînerait trop loin, car il suppose une analyse concrète, très détaillée et très complète, aussi bien de la Révolution Sociale en son entier, que des tâches et des rôles combinés et synthétisés de tout un ensemble d’organismes ouvriers lors de cette révolution. Un tel sujet exigerait, évidemment, un ouvrage spécial et volumineux. Et, d’ailleurs, le problème pourrait être résolu d’une façon assez différente pour divers pays. Dans un ouvrage général, on ne pourrait que tâcher d’en tracer les grandes lignes. Ici, je me bornerai à dire qu’à mon avis, l’enthousiasme actuel pour les « Soviets », comme formes d’organisation de la classe ouvrière en train d’accomplir la Révolution Sociale et de créer la société nouvelle, est très exagéré. J’estime que le rôle principal, fondamental dans cette œuvre future incombera à d’autres formes d’organisation ouvrière, et que, dans tout l’ensemble de cette nouvelle charpente sociale, la tâche des institutions du genre « Soviets » sera assez restreinte, limitée, modeste. Je pense, notamment, que ces institutions ne pourront accomplirutilement que quelques besognes de second plan et d’ordre auxiliaire : administratif. régulateur, calculateur.
— Voline.
SPECTACLE
Un spectacle est, dans le sens général du mot, « ce qui attire le regard, l’attention, arrête la vue » (Littré). C’était le spectaculum (aspect, vue, théâtre) des Romains, né de spectare (regarder). En grec, theatron (théâtre), synonyme de spectaculum, venait de thedsthai (voir, contempler). A Rome, on appelait spécialement « spectacle » les jeux et les combats du cirque. Ce titre fut donné ensuite aux représentations théâtrales, et particulièrement à leur mise en scène. Une pièce à « grand spectacle » était, comme aujourd’hui, une pièce présentée dans des décors et une figuration nombreux et fastueux. Nous y reviendrons au mot Théâtre.
Parmi les spectacles autres que ceux du théâtre, il y a d’abord ceux de la rue, d’autant plus nombreux et variés pour le spectateur, le badaud le plus souvent, celui qui baye au vent, qu’il lui faut peu de choses pour arrêter son attention, l’émouvoir ou l’amuser. L’observateur prend dans la rue des leçons de choses ; le badaud y trouve toutes les distractions à la vue des étalages, des images publicitaires, de leurs illuminations et de leurs couleurs, dans le hourvari de la foule et les incidents de la circulation. Il a ses grands spectacles avec les défilés militaires, les cérémonies officielles, les funérailles des personnages illustres, les réjouissances populaires aux jours de fêtes nationales et carnavalesques. Moins spectaculeuses, mais plus excitantes sont les simples scènes où il est pris parfois comme témoin et participe ainsi à l’action : le défilé d’une noce, une bataille de dames ou de chiens, les déambulations hasardeuses d’un pochard, un échange de propos homériques entre marchandes et leurs clientes, les débats de Crainquebille et de l’agent 64, l’écrasement d’un piéton, le repêchage d’un noyé, un incendie, etc ... Une sorte d’imprévu fantastique, carambolesque, fait du spectacle de la rue quelque chose d’irréel, un voyage dans l’illusion, par le mouvement et le bruit, par le contraste permanent entre la misère et le luxe, la privation et le gaspillage.
Le spectacle de la rue est gratuit, du moins en ce qu’il s’offre sans qu’on ait à payer un tribut à des guichets. Par contre, il coûte terriblement cher aux pauvres gens qui paient de leur misère sa pompeuse magnificence. Quand on pense à tout l’argent gaspillé pour des défilés et des cérémonies, pour des coups de canon destinés à exciter les fureurs guerrières ou pour déifier des gens qui furent des malfaiteurs publics, quand on voit les exhibitions carnavalesques des « reines de beauté » organisées par des proxénètes pourvoyeurs de la prostitution officielle, quand on réfléchit à tout ce que cela comporte de servitude, de privation et de dégradation pour les victimes, mutilés, veuves et orphelins de guerre, serfs des usines et des bureaux, chômeurs errants sans abri et sans pain, mendiants et claque-patins de toutes sortes, femmes d’ateliers qui ne peuvent vivre de leur salaire et femmes de trottoir : on se demande comment le spectacle de ces odieuses pitreries peut se dérouler sans que, de cette foule, ne montent les protestations et n’éclatent les gestes qui « troublent la fête » !.... Mais il est d’autres spectacles qui détournent sa colère et endorment sa révolte sous leurs soporifiques.
La foule est inconsciente et stupide. Tournant comme une girouette suivant le vent qui passe, elle a toujours été docile quand on a su l’amuser et satisfaire sa badauderie. Ce n’est que dans les jours où elle s’ennuie que les insurrections éclatent. Panem et circenses ! disait l’antiquité romaine. Avec du pain et des jeux, on menait la populace du cirque acclamant les sénateurs, les consuls, les empereurs qui entretenaient sa dégradation. On pouvait même rogner sur le pain si les jeux étaient largement distribués. Au « bon vieux temps » de la dîme et des galères, il suffisait d’un cortège royal, d’une fête seigneuriale pour faire oublier au non moins « bon peuple » toutes les exactions dont il était victime et lui faire crier :
« Vive notre bon roi ! Vivent nos bons seigneurs ! »
Il en est de même aujourd’hui avec la foule du peuple appelé « souverain » ; quoique toujours trompé, volé et battu, de plus en plus matraqué par la police, il est toujours content quand on l’amuse. On n’est pas plus sot chez les Empapahoutas que des sorciers abusent par le spectacle de leurs prestidigitations.
Actuellement, les spectacles proprement dits sont : le théâtre (voir ce mot), les attractions foraines, le cirque, les courses de taureaux, les exhibitions sportives et le cinéma.
ATTRACTIONS FORAINES.
Elles sont le plus ancien des spectacles, et tous ceux que nous connaissons sont sortis d’elles. Elles sont les spectacles des foires où des étrangers ambulants, marchands, petits fabricants, bateleurs, ont apporté de tout temps les produits de leur commerce, de leur industrie, de leur invention divertissante. Derniers nomades, ils passent toujours, s’adaptant plus ou moins, dans une civilisation qui a planté sa tente depuis longtemps dans les villages, les villes et les groupements nationaux. Les bateleurs forains ont été à l’origine du théâtre où ils ont trouvé eux aussi leur stabilité. Leurs derniers représentants demeurés à l’état primitif, presque sauvage, sont les bohémiens qui ne cessent pas de parcourir le monde et perpétuent des mœurs et des industries aussi anachroniques que variées. Ces bohémiens étaient partis de l’Inde où ils avaient existé dès la plus lointaine antiquité. Ils étaient les colporteurs du merveilleux, jongleurs, musiciens, danseurs, acrobates, charmeurs et dresseurs d’animaux, sorciers, thaumaturges, diseurs de bonne aventure, guérisseurs, etc…. Leurs traditions, transmises en Chaldée, en Égypte, dans tout l’Orient, étaient passées en Grèce, puis à Rome où ils avaient été les circulatores auxquels s’étaient mêlés les prêtres mendiants. En France, ils furent les premiers comédiens, les chanteurs des temps carolingiens d’où sortirent les écoles de ménestrandies, des trouvères et des troubadours. Quand le théâtre se fut formé, ils demeurèrent l’attraction des foires.
Les Bohémiens proprement dits, originaires de la Bohème, appelés de nos jours romanichels et qui continuent les traditions les plus périmées de la sorcellerie populaire, se répandirent en Occident dans le premier tiers du XVème siècle. Ils vinrent à Paris pour la première fois en 1427, et la population, fort curieuse de les voir, se porta en foule à La Chapelle où, disait la chronique du Bourgeois de Paris :
« Par entreject d’habileté, ils faisaient vider les bourses aux gens et les mettaient en leurs bourses. »
Il en demeura un grand nombre dans la ville où ils ajoutèrent leur pittoresque à celui de la Cour des Miracles. Ils attiraient les curieux, surtout par les danses de leurs femmes et, sous Louis XIII, ce fut une des formes du snobisme des gens de cour d’aller voir danser, sur les places publiques, les bohémiennes dont Gombaud disait :
Qui n’est ni blanche, ni blonde,
Qui nous va tous consumer,
Qui ne vit que de rapine,
Qui n’use pour nous charmer
Que du fard de Proserpine. »
Victor Hugo a fait de la bohémienne Esméralda, dans Notre Dame de Paris, une de ses plus intéressantes héroïnes.
Le centre permanent des attractions foraines à Paris fut, au XVIIème et XVIIIème siècles, sur le Pont-Neuf. Mais elles se répandirent partout dans les foires, notamment à Paris dans celles de Saint-Germain et de Saint-Laurent puis, à partir de 1764, celle de Saint-Ovide. Les spectacles forains étaient alors plus variés et plus brillants qu’aujourd’hui. Ils réunissaient le cirque à peu près tel qu’on l’entend actuellement, et le théâtre qui devait en sortir pour aller vers de plus hautes destinées. Le cirque y trouva ses écuyers, ses gymnasiarques, ses acrobates, ses clowns, ses prestidigitateurs, ses animaux savants. Le théâtre y puisa une extraordinaire variété dans les différents genres dramatiques et y fut représenté par des acteurs remarquables. Ces spectacles comportaient aussi des exercices dits athlétiques, la lutte en particulier, qui font partie, aujourd’hui, des exhibitions sportives. Tout cela était dominé par la parade faite à grand bruit sur le devant de la baraque par toute la troupe étincelante sous ses oripeaux et la lumière de ses lampes fumineuses. Cette parade était l’amusement gratuit de ceux qui ne pouvaient se payer le spectacle de l’intérieur. Il y avait aussi, pour l’ébahissement des badauds et la fortune des coupeurs de bourses qui exploraient leurs poches pendant qu’ils avaient le nez en l’air, les charlatans vendeurs de drogues miraculeuses qui menaient grand tapage de boniments et de grosse caisse et dont les magnifiques équipages attiraient particulièrement le public. Ils étaient à la fois médecins, apothicaires, arracheurs de dents et amuseurs. Ces guérisseurs, dignes des farces de Molière, ont disparu aujourd’hui, remplacés par les chimistes qui fabriquent, dans des officines, sous les auspices de tous les saints du paradis, des pilules et des emplâtres dont ils font attester la merveille dans les journaux. Les charlatans de jadis avaient au moins l’avantage sur ceux d’aujourd’hui d’amuser les gens qu’ils ne guérissaient pas. Un autre spectacle de la foire était celui des ménageries, dont nous parlerons plus loin.
Les attractions foraines, de plus en plus dépouillées de leur intérêt spectaculeux, se meurent dans leur pauvreté primitive avec leur matériel usé, leurs phénomènes préhistoriques et efflanqués. Aussi, leur clientèle se fait-elle de plus en plus rare. Elles persistent inutilement, sans gloire et sans profit, à exhiber en images les pauvres séductions d’une Cythère qui cavalcadait vers 1830, à montrer des avaleurs de sabres, des briseurs de chaînes, des hommes sauvages mangeurs de verre pilé et buveurs de pétrole enflammé, des fakirs s’enfonçant des clous dans la tête, des femmes torpille, des veaux à deux têtes et des pieuvres géantes ; tout cela a perdu son dernier attrait depuis que le cinéma et les sports ont conquis les populations les plus éloignées de la civilisation. Bientôt, le dernier Peau Rouge n’aura plus d’autre ressource que de dévorer le dernier mouton à cinq pattes, et la dernière femme à barbe que de se faire « star » de cinéma.
LE CIRQUE.
Le sens de ce mot était plus étendu dans l’antiquité qu’aujourd’hui, surtout chez les Romains où le cirque l’emportait sur le théâtre. Chez les Grecs, il était le stade et l’hippodrome où se célébraient les jeux, particulièrement à Olympie, d’où le nom des jeux olympiques.
Chez les Romains, le cirque fut à la fois le circus, cirque proprement dit, et l’amphithéâtre. On a distingué entre le cirque, construction réservée aux courses de chevaux et de chars avec sa spina qui divisait la piste en deux parties, et l’amphithéâtre dont l’arène était spécialement aménagée pour les jeux particuliers aux Romains et qui étaient surtout le spectacle des combats de gladiateurs et d’animaux, les chasses et les exploits des bestiaires, les naumachies (simulacres de batailles navales), etc ... Mais les spectacles de l’un et de l’autre se confondaient sous la dénomination générale de circenses (jeux du cirque). Jusqu’à la conquête romaine, la Grèce ne connut pas l’amphithéâtre et ses spectacles sanglants. C’est un roi de Syrie, nommé Épiphan, qui fit venir de Rome les premiers gladiateurs qu’on vit en Grèce. Adrien chercha vainement à acclimater à Athènes leurs combats. Par contre, ils jouissaient, à Rome, d’une faveur inimaginable et ils y furent la manifestation la plus caractéristique de cette grossièreté et de cette cruauté que Sénèque reprocha si souvent aux Romains à qui il disait :
« Circi nobis magno consensu vitia commendant. » (Les cirques sont unanimes à nous recommander les crimes.)
Cette faveur se manifesta surtout durant la décadence impériale, époque où la démagogie des tyrans appuyait son pouvoir sur une populace déchue de tout ce qui avait fait les qualités du peuple romain. La formule panem et circenses, donne la mesure de la moralité de ces spectacles qui eurent vite fait de reléguer dans les gymnases les jeux olympiques harmonieusement composés de force, d’adresse, d’intelligence et de beauté, tels que les avaient conçus et que les pratiquaient les Athéniens. Des mœurs romaines, ils n’offraient que la vue d’une pompeuse et sauvage barbarie à laquelle présidaient des fous mégalomanes, prétoriens et dictateurs. Rome avait, à elle seule, une douzaine de cirques ou d’amphithéâtres.
Les spectacles étaient d’abord les courses de chars où, le plus souvent, hommes et chevaux s’écrasaient dans une mêlée sanglante. L’engouement était tel pour cette hippomanie, comme l’appelait Lucien en la raillant, qu’au temps de Néron il y avait vingt-quatre courses par jour. Elles duraient toute la journée. Le public était divisé en factions qui soutenaient les cochers rivaux. Quatre factions principales provoquaient souvent des émeutes à Rome. On en vit une, en 532, à Constantinople, qui fit 30.000 victimes !... La fureur du cirque était encore plus grande dans l’empire de Byzance qu’à Rome. Le cirque était à Constantinople le centre de la vie publique. Les empereurs byzantins dépassaient en folie mégalomane leurs confrères de Rome et le cirque fut le théâtre des tragédies et des comédies les plus sanglantes. Celui de Constantinople vit entre autres spectacles sensationnels la mutilation de Justinien II, la lapidation de Michel Calaphate, les tortures d’Andronic Commène et nombre d’exécutions capitales, à côté des triomphes des tyrans populaires.
Les combats de gladiateurs n’étaient pas moins en faveur que les courses de chars. Avant la fondation de Rome, c’était une coutume chez les Étrusques et les Campaniens de célébrer les personnages illustres par des combats d’esclaves, de prisonniers, de condamnés à mort ou de lutteurs de profession. La coutume venait des sacrifices humains pour apaiser les divinités. On en fit un divertissement populaire que les puissants favorisèrent pour gagner l’amitié du peuple. Les mots ludus (gladiateur) et tanista (maître d’une école de gladiateurs), sont d’origine étrusque. Rome hérita de cette coutume et elle eut ses gladiatores, esclaves, condamnés ou volontaires dont on faisait l’élevage et le dressage. Les gladiateurs appartenaient soit à de riches particuliers, soit à des entrepreneurs de spectacles, soit à l’État lui-même. Ils combattaient en chars (essédaires) ou à cheval (cavaliers). Les rétiaires luttaient deux par deux, les caternaires se battaient par groupes, les bestiaires combattaient des animaux. Ils donnaient aussi aux foules le spectacle de grandes batailles. A la fin de la représentation, des nègres enlevaient les cadavres et les blessés. Ces derniers étaient achevés ou servaient à des expériences de vivisection des chirurgiens quand ils ne pouvaient être remis utilement sur pied pour de nouveaux combats. César ne disposait que de 320 couples de gladiateurs, mais Trajan en eut 10.000. Quand les gladiateurs de l’empereur triomphaient, son pouvoir était plus sûrement affermi à Rome que par de grandes victoires sur les ennemis de l’Empire. Tous les peuples vaincus fournissaient leurs contingents de combattants pour les boucheries du cirque. Mais les hommes ainsi voués à la mort pour amuser une populace aussi ignoble que ses empereurs, n’étaient pas toujours disposés à ces entrégorgements. Si certains mettaient de la fureur dans les combats et devenaient des professionnels endurcis, d’autres préféraient le suicide ou combattaient mollement. On les grisait pour les exciter et, si cela ne suffisait pas, on les faisait marcher à coups de fouets et de verges rougies au feu. Les spectateurs insultaient les malhabiles et les hésitants, réclamant eux-mêmes le fouet et le fer contre eux, décidant de leur mort ou du répit qui leur serait accordé par une grâce momentanée.
Les gladiatores devinrent si nombreux à Rome que leur révolte, sous la direction de Spartacus, en 71 avant Jésus-Christ, mit l’existence de l’État en danger. Mais ils ne furent pas supprimés pour cela. Au contraire. La démagogie impériale leur fit une situation qu’aucune autre profession ne connut à Rome. Le citoyen romain méprisait le gladiateur qu’il mettait au rang du bourreau. Par snobisme, il se mit à l’admirer, à lui rendre des hommages de plus en plus éclatants. Ce fut le culte de la « belle brute » tel qu’on le voit renouvelé aujourd’hui. Des poètes chantaient les exploits des gladiateurs ; leurs portraits étaient partout encadrés des insignes du triomphe. Les femmes les plus considérables perdaient toute dignité patricienne pour suivre ces héros, même les plus minables, tel ce Sergius :
« Ni jeune, ni beau, qui avait le nez déformé, les yeux suintants d’humeur et était manchot par surcroît. »
Mais il était un Adonis aux yeux d’une dame Hippia qui quitta pour lui son sénateur de mari, ses enfants et sa patrie. On vit des chevaliers et des sénateurs gladiateurs, et même des femmes. II y en eut tant que César et Auguste durent leur défendre l’arène. Mais il y en eut plus que jamais sous l’Empire. Les empereurs eux-mêmes briguèrent la gloire des assassinats du cirque où ne se présentaient contre eux que des victimes complaisantes, résignées à être égorgées. Ces fous sadiques s’enivraient des triomphes de l’amphithéâtre. Commode tua de sa main plus de mille de ses prétendus adversaires, réclamant chaque fois son salaire, comme un simple gladiateur. Et les adulateurs des tyrans n’échappaient pas eux-mêmes aux fêtes du sang. Caracalla, pour le seul plaisir du meurtre, faisait massacrer des foules entières. On tuait par dilettantisme. Les empereurs et tous les personnages publics dont la vie était de plus en plus menacée dans un monde de plus en plus corrompu et criminel, trouvaient dans les gladiateurs les spadassins, les « bravi » qui leur servaient de gardes du corps, assuraient leur sécurité et les débarrassaient de leurs ennemis.
« La nation, que son impuissance même avait fini par désintéresser complètement de ses propres destinées politiques, n’avait plus de passion que pour les jeux sanglants du cirque. L’art dans le meurtre, tel était devenu le raffinement par excellence, et la tourbe romaine, avide de spectacles, en discourait savamment... Le besoin de voir souffrir était devenu tel que tout drame devait être non pas figuré mais réalisé matériellement. Pour rendre quelque intérêt au vieux personnage d’Hercule sur le mont Ata, il fallait aux Romains blasés que l’on brûlât un condamné à mort sur un bûcher véritable. » (Élisée Reclus.)
Les ignobles spectacles des gladiateurs disparurent peu à peu avec l’esclavage. En 404, Honorius les interdit à Rome. L’empire, repu de sang, se coucha à son tour pour mourir.
A côté des combats des gladiateurs, le cirque offrait le spectacle des belluaires ou bestiaires qui combattaient des animaux sauvages. Comme les gladiateurs, ils étaient des esclaves, des condamnés à mort, des gens de métier ou encore des amateurs. La profession de bestiaire était encore plus méprisée que celle des gladiateurs, ce qui n’empêcha pas le succès des spectacles qu’ils donnèrent après qu’on eut vu les premiers à Rome, en 186 avant Jésus-Christ. Les bestiaires donnaient la chasse aux animaux lâchés dans les arènes. Cette chasse (venatio) devenait vite un corps à corps où l’homme combattant un lion, un tigre, un ours, devait montrer une très grande adresse et n’avait pas toujours le dessus. Elle était pratiquée à coups de flèches par les sagittarii, généralement des Parthes, et avec des épieux ou des épées par les autres. Certains ne combattaient que des taureaux, soit à pied, soit à cheval ; ils étaient les tauraii, ancêtres des toréadors dont nous parlerons plus loin. La populace romaine avait le plus grand goût pour ces spectacles qui ne la passionnaient pourtant pas autant que les luttes des gladiateurs. Les empereurs, Claude en particulier, y prenaient un vif plaisir.
Enfin, pour renchérir encore sur la barbarie de ces spectacles et l’ignominie de ceux qui s’y plaisaient, des condamnés à mort étaient livrés, attachés, aux bêtes sauvages qu’on avait fait jeûner préalablement et qui les dévoraient aux applaudissements de l’assistance. Parfois, pour faire durer le plaisir, on donnait une arme au condamné pour pouvoir se défendre. Son sort n’en était pas moins réglé, sauf si la bête se montrait moins féroce que les spectateurs, comme dans l’histoire d’Androclès. Les exercices des bestiaires se prolongèrent après ceux des gladiateurs jusqu’au VIème siècle. Ils ne disparurent pas complètement et laissèrent au monde moderne le dégoûtant héritage de la ménagerie et de la tauromachie.
Il n’y a que peu de choses à dire sur le spectacle des ménageries. Jadis, les montreurs de bêtes exhibaient des animaux dits « féroces » apprivoisés ; lions, tigres, ours, rhinocéros, etc ... qu’ils menaient en laisse, leur faisant exécuter d’aimables exercices. Ce spectacle attestait combien l’entente cordiale est facile entre l’homme et la bête même la plus dangereuse, quand elle s’est philosophiquement résignée à la domesticité, pourvu qu’elle ait sa pâtée quotidienne. Aujourd’hui, les baladins primitifs se sont changés en prétendus belluaires, en ridicules « dompteurs », affublés comme les hussards d’opérettes de brandebourgs et de médailles, qui livrent, dans des cages, des simulacres de combats contre de misérables bêtes abruties par la captivité et les mauvais traitements. A force de coups, ils arrivent à faire hurler et bondir leurs fauves poussifs, parfois même à les réveiller assez pour qu’ils se jettent sur eux, ce qui leur permet de prendre des poses héroïques devant l’objectif. L’Anglais qui suivait une ménagerie pour voir, un jour, dévorer le dompteur, était un naïf ou un figurant publicitaire. Il n’est pas un couvreur, un mineur, un marin, un terrassier, un infirmier, un radiologue qui ne courent des dangers plus grands et plus certains que ces belluaires à la « noix de coco ». Mais comme leur profession a une utilité sociale que celle des « dompteurs » n’a aucunement, personne n’en a cure. La foule ne s’intéresse qu’aux cabotins qui exploitent sa badauderie.
Nous parlerons plus loin de la tauromachie.
LE CIRQUE MODERNE.
Nous arrivons à quelque chose d’aimable, à une oasis fleurie dans le désert de la sauvagerie et de la sottise humaines. Arrêtons-nous y un moment avant de reprendre le sombre voyage.
La fin des combats sanglants et la formation d’une société nouvelle dont les goûts devinrent très grands pour le théâtre, firent délaisser le cirque antique, et ce qui resta de ses spectacles passa à la foire. Le cirque devint alors le spectacle spécial qu’il est encore aujourd’hui. Comme construction, un amphithéâtre formé de banquettes en gradins autour d’une piste circulaire, le tout recouvert et fermé par une tente soutenue par un ou plusieurs mâts suivant la grandeur de la construction. Facilement démontable, celle-ci peut être posée et enlevée en quelques heures. Elle sert aux forains faisant de courts séjours dans les lieux où ils s’arrêtent. Parfois, la construction est moins primitive, de dimensions plus grandes, toute en charpente et recouverte d’un toit de zinc, quand le séjour doit être d’une certaine durée. Vers la fin du XVIIIème siècle, on commença à construire, pour demeurer, des cirques en maçonnerie. Le premier fut, à Londres, en 1770, celui des écuyers Astley. Les mêmes firent élever, en 1774, à Paris, au faubourg du Temple, une salle qui, très agrandie par de nombreuses dépendances : écuries, loges d’acteurs, foyer du public, café, etc ... , devint le cirque Franconi au commencement du XIXème siècle. Le cirque du Palais Royal, bâti en 1787, servit surtout à des représentations de théâtre musical. Il fut détruit par un incendie en 1798. Depuis, on a construit à Paris le Cirque d’Été , aux Champs-Élysées, le Cirque d’Hiver, boulevard des Filles-du-Calvaire, et le Nouveau Cirque, rue Saint-Honoré. Dès 1861, le Cirque d’Hiver abrita les concerts Pasdeloup et, quelques années plus tard, Lamoureux donna les siens au Cirque d’Été. Depuis, d’autres cirques ont été construits à Paris, entre autres l’Hippodrome de la place Clichy, devenu une salle de cinéma, et le Cirque Médrano qui a gardé sa destination première. De nombreuses villes de province ont aussi leurs cirques.
Les cirques sont plus ou moins vastes pour contenir un nombre plus ou moins grand de spectateurs ; mais leur caractéristique principale est qu’ils ont tous, invariablement et dans le monde entier, une piste de treize mètres de diamètre entourée d’une palissade pleine, toujours de la même hauteur, et percée de deux portes se faisant face pour l’entrée et la sortie. Ces dispositions du cirque sont essentielles pour le travail des acteurs et surtout des chevaux, troupes nomades à qui il est indispensable d’assurer une certitude rigoureuse dans la précision mathématique de leurs exercices, partout où elles travaillent.
Les spectacles du cirque sont caractérisés par les exercices équestres ; ils en sont le fond essentiel. Les acrobaties, exhibitions d’animaux savants, ballets, pantomimes comme les mimodrames militaires qui furent en vogue vers 1830, ne leur appartiennent pas en propre. De l’antiquité, le cirque moderne a hérité des exercices de voltige à cheval qu’exécutaient les desultores (sauteurs) et qui sont le travail des écuyers d’aujourd’hui. Ceux des gymnasiarques et des acrobates se sont ajoutés an fond équestre dans le cirque moderne plus approprié que tout autre milieu à leur exécution. Le jongleur, l’équilibriste, le trapéziste, le danseur de corde, qui se produisaient modestement sur les places publiques, prirent plus d’assurance et d’importance au cirque. Les tours augmentèrent en nombre et en variété et il en sortit le clown. Il n’est plus aujourd’hui de troupe de cirque qui puisse se passer d’une compagnie plus ou moins nombreuse de clowns.
On considère trop souvent le cirque comme un spectacle inférieur et ses protagonistes comme des amuseurs quelconques. C’est sans doute parce qu’il n’est pas de travail plus sérieux, plus difficultueux et, partant, moins cabotin que le leur, sous les apparences de l’aisance facile dans le geste et de la niaiserie dans les propos. L’acteur du cirque est un véritable artiste. Il n’est pas, non seulement d’emploi au théâtre, mais de profession dont l’apprentissage soit plus long, plus difficile, et dont l’exercice exige plus de qualités ; endurance, patience, souplesse, adresse du corps, contrôle et maîtrise absolue de soi-même. Grâce à ces qualités, les tours de force les plus compliqués et les plus périlleux de l’acrobatie semblent jeux d’enfant et sans danger. N’ont-ils pas toujours un sourire aimable et gracieux ce trapéziste et cette écuyère qui risquent à tout instant de se rompre le cou ? Mais le type le plus remarquable du cirque, et on peut dire de tout le théâtre, c’est le clown. Il doit avoir non seulement les qualités des meilleurs acrobates, mais aussi celles des meilleurs comédiens, de ceux qui inventent eux-mêmes leur texte et peuvent seuls l’inventer, parce qu’il doit être rigoureusement adapté à leurs gestes, à leurs tours, qui leur sont aussi rigoureusement personnels. Sous les peinturlurages excessifs du maquillage, dans les trémolos cocasses d’une voix qui semble sortir d’un ventre d’éléphant, d’une serrure sans huile ou d’un violon désaccordé, dans un jargon auprès duquel le « petit nègre » et le « bich la mar » sont du langage académique, dans ses cabrioles, ses grimaces, ses hurlements, ses aboiements, ses sanglots, ses facéties, ses grosses bourdes, ses coq à l’âne, ses calembours, le clown, léger et balourd, spirituel et niais, doit savoir exprimer toute la joie et toute la douleur humaine mieux et plus complètement que ne sauront jamais le faire les plus illustres déclamateurs et chanteurs. On a dit que dans chaque siècle on compte cent politiciens célèbres et seulement un clown de génie. On compte aussi des milliers de cabotins plus illustres les uns que les autres pour s’être livrés aux exhibitions les plus variées et les plus vaines ; on ne peut être cabotin au cirque, on y risque trop sa vie. C’est d’Angleterre qu’est venu le clown ; il ne pouvait être que shakespearien, bien qu’il eût été avant le gracioso du théâtre espagnol et que Shakespeare lui-même l’eût condamné dans Hamlet. Quel autre qu’un véritable clown pourrait réaliser le formidable Falstaff ? Parmi les clowns célèbres, citons Grimaldi, les Hamlon Lees, les Lauri-Lauris dont certaines pantomimes étaient des prodiges d’acrobatie et d’émotion dramatique. Toutes les comédiennes savent mourir comme la Dame aux Camélias ; seul, un Lauris savait mourir comme un grand singe frappé d’une balle de fusil. Il y eut aussi Mazurier, Auriol, Chocolat, Footit et, actuellement, les Fratellini et Grock. Faisons à Charlie Chaplin (Charlot) l’honneur de le classer parmi les clowns et non parmi les cabotins du cinéma.
Les artistes du cirque sont des « enfants de la balle », ils sont des gens simples et travailleurs qui n’ont pas le temps de faire parler d’eux. Ils ne sont pas des produits des conservatoires où l’on cultive surtout les « m’as-tu vu ? », et des « studios » où l’on pratique les exercices du « sex-appeal » pour la séduction des vieux messieurs et vieilles dames libidineux. Ils ne remplissent pas les gazettes des histoires de leurs coucheries, de leurs crises de nerfs, de leurs filouteries, de toutes les manifestations d’une plus ou moins crasseuse vanité. On ne les décore pas. Leur art est sain et réconfortant, il n’est pas intellectuel, métaphysique et noceur. Parmi tous ceux qui dispensent la joie populaire, ils sont les plus nobles et les plus désintéressés et, dernier éloge qui dépasse tous les autres qu’on peut leur faire : on peut conduire les enfants à leurs spectacles sans craindre de souiller leur âme, d’en faire des brutes et des mufles comme aux spectacles des sports, de la tauromachie, du café-concert et du cinéma.
La seule chose qui souille et déshonore le cirque, celle qui jette une ombre pénible sur le sourire de ses écuyères, les pailleteries de ses clowns, et sur son incomparable exemple de discipline du corps humain soumis à la précision intelligente des mouvements, c’est le spectacle des animaux savants présentés par des baladins qui, eux, sont le plus souvent des cabotins. C’est un spectacle pénible, parce que tout à fait étranger à l’intelligence animale que celui de ces bêtes ayant pris des habitudes précises d’obéissance mécanique sous la terreur constante des mauvais traitements.
Car ce n’est que par de mauvais traitements qu’on obtient ces éléphants, ces phoques, ces chiens et ces oies savants qui font l’admiration des badauds. On ne sait pas assez par quels procédés cruels on inculque les notions de la science humaine aux animaux calculateurs, danseurs, jongleurs, boxeurs, et aux singes imitateurs de leurs descendants « supérieurs » jusqu’à représenter un gentleman buveur de cocktails, fumeur de pipes et conducteur d’automobile. On ne sait pas assez comment on apprend aux éléphants et aux chevaux à lever la jambe en enfonçant dans leur pied un coin de fer rendant douloureux l’appui sur le sol, ni comment on dresse les chiens en les faisant danser sur des plaques de fer chauffées parfois jusqu’au rouge. On ignore trop dans le public les cent procédés de ce genre par lesquels on fabrique ces animaux phénomènes si « mignons » aux yeux des spectateurs superficiels. Lorsqu’on sait, on est plus douloureusement frappé et indigné qu’émerveillé par leur spectacle.
LES COURSES DE TAUREAUX. — LA TAUROMACHIE.
Les courses de taureaux, telles qu’elles sont pratiquées dans le sud de la France suivant de vieilles coutumes gasconnes, languedociennes et provençales, sont un jeu qui a la gracieuseté des acrobaties du cirque et n’est nullement odieux quand la cruauté espagnole ne s’y mêle pas. Elles comportent des sauts par-dessus le taureau, des écarts ou feintes habiles, des razets, des poses et enlèvements de cocardes, etc ... Ce spectacle se déroule, dans les villages, dans des arènes rustiquement improvisées au moyen de charrettes, de tombereaux, de camions sur lesquels les spectateurs sont installés. Il est sain, stimulant, plein de mouvement, de gaieté, de couleur, bien dans le caractère des populations qui y font valoir leur robustesse et leur adresse. C’est aussi la ferrade où les bouviers vaillants luttent de leurs bras et de leur agilité avec le jeune taureau pour le coucher à terre et le marquer du fer de la manade. Alors, a écrit Mistral, dans la belle langue du pays d’Oc que nous traduisons ici :
« Un vol de filles d’Arles, en selle, le sein vivement agité, empourprées au galop de leurs cavales blanches, apportent (au bouvier vainqueur) une grande corne rase de vin. » (Mireille, chant IV.)
Les Provençaux ont méconnu et renié Mistral quand ils ont voulu lui faire approuver l’ignominie de la « corrida » espagnole.
Car il ne faut pas confondre les jeux français du taureau avec la « corrida » qui est le spectacle de la plus répugnante et hypocrite lâcheté humaine, le spectacle de « l’étiquette sauvage et bigote de l’ancienne Espagne » (P. de Saint-Victor), qui ne pouvait naître et prospérer que dans le pays de l’Inquisition, comme dérivatif aux autodafés. Sous des influences pernicieuses, politiciennes et mercantiles, les provinces françaises avaient déjà laissé ensanglanter leurs jeux du taureau par des « banderilles » et par le « simulacre de la mort », qui consistent à enfoncer dans les chairs de l’animal des dards y produisant des blessures dont la douleur est prolongée par la lenteur de la guérison. Elles eurent le tort plus grave de laisser importer chez elles la « corrida intégrale » avec ses tortureurs et ses bouchers sortis des cavernes de Torquemada, picadors, toreros, matadors et, les plus répugnants de tous, monosabios (hommes-singes), valets du cirque, balayeurs des tripes arrachées aux chevaux, du sang et de toutes les déjections qui fument au soleil de l’arène. Les populations françaises eurent le tort encore plus grave de prendre goût aux « corridas » et d’adopter les sophismes dont on entretient leur turbulence naturelle. Elles ne surent pas discerner les buts malproprement intéressés des mercantis qui leur apportaient ces spectacles, et des politiciens qui faisaient échec à la loi pour les favoriser. Car la loi interdit les « corridas de toros » en France (loi Gramont pour la protection des animaux), mais elle est inexistante quand il plait de la violer aux présidents de la République, ministres, sénateurs, députés et autres grands personnages qui président, avec des airs d’imperatores, les fêtes du sang ; ils sont acclamés par les foules actuelles redescendues à la mentalité de la populace romaine.
Montaigne disait :
« Les naturels sanguinaires à l’endroit des bêtes témoignent une propension naturelle à la cruauté. Après qu’on se fut apprivoisé à Rome aux spectacles des meurtres des animaux, on vint aux hommes et aux gladiateurs. »
On ne sait si on reviendra un jour aux combats de gladiateurs, mais, à voir ce qui se passe dans les arènes et aux spectacles sportifs, il n’y aurait pas lieu d’en être surpris. C’est sans alarme que les peuples considèrent les perspectives de la « prochaine » où on les fera gladiateurs malgré eux, et ce n’est pas l’attitude des « aficionados » arlésiens, qui ont accepté sans murmure le nom de Clémenceau pour un de leurs boulevards, mais ont protesté contre celui de Séverine pour une de leurs rues, qui est rassurante à ce sujet.
Voyons ce que sont les sophismes par lesquels on prétend justifier ce spectacle de décadence perpétué dans le monde civilisé par la plus monstrueuse de ses organisations : l’Inquisition. Ne pouvant décemment expliquer le goût de la tauromachie par le goût du sang et par ses véritables origines qui sont dans le cirque romain, on en a fait un symbole et on lui a trouvé des lettres de noblesse en prétendant qu’elle était la survivance respectable, pour ne pas dire sacrée, du culte de Mithra et de ses taurobolies, cérémonies de l’expiation par le sacrifice du taureau. De la même façon, on pourrait voir dans le spectacle des victimes humaines livrées aux bêtes ou mises en croix une coutume respectable et sacrée en disant, comme les Jésuites au XVIIIème siècle, que :
« Le Christ s’était donné à manger au peuple dans l’amphithéâtre de Titus. »
Pourquoi ne le fait-on pas, d’autant plus que l’idée du sacrifice humain n’est pas morte puisqu’elle persiste dans la communion chrétienne qui fait avaler au fidèle la chair et le sang de son Dieu sous les espèces de l’hostie ? Ce spectacle serait certainement moins « hérétique » que celui des « corridas », symbole d’un culte païen, aux yeux des catholiques intégraux et fleurdelysés qui font l’union sacrée avec les mécréants libres-penseurs pour le maintien des coutumes de la tauromachie. Mais la vérité est plus basse et plus sale. Elle est uniquement dans ce goût du sang dont la bête humaine aime toujours à se repaître, qui lui fait prendre du plaisir à la chasse à courre aristocratique comme à l’étripement des chevaux et à l’égorgement des taureaux dans les arènes démocratiques. Le maquillage civilisé de la bête humaine est vite effacé lorsqu’un prétexte d’apparence « légitime » ouvre les écluses à sa bestialité.
M. J.-L. Vaudoyer, qui voit dans les courses de taureaux « la survivance millénaire du culte de Mithra », a écrit lyriquement :
« Quand, dans les arènes d’Arles (et de Nîmes), une foule fervente acclame l’adresse et le courage de l’homme devant la bête, le spectacle n’a pas seulement un attrait pittoresque, mais une signification profonde : l’un des plus vieux peuples d’Europe, sous les espèces du sang, communie dans son passé. »
Tout cela est imaginé, faux et du plus ténébreux romantisme littéraire. Mais cela serait-il exact, ne croit-on pas que le peuple, « l’un des plus vieux peuples d’Europe », devrait trouver pour communier dans son passé des objets plus dignes et plus nobles que la « corrida » dont les protagonistes ne relevaient déjà dans la Rome antique que du mépris le plus profond ? Il fallut l’avilissement de la chevalerie dans la noblesse de cour pour qu’on vît des seigneurs espagnols se faire saigneurs de taureaux dans des arènes, comme ils se faisaient porte-coton de leurs rois. Le dernier roi d’Espagne, M. Alfonso, a élevé le courage jusqu’à saigner des veaux dans les arènes de Madrid, aux applaudissements des plus hauts dignitaires de sa cour et de son peuple !
Le « courage » tauromachique est un sophisme de plus ajouté à tous les autres. C’est un sophisme que de voir dans la « corrida » une « victoire de l’intelligence humaine sur la brute ». Il n’y a que la témérité d’un cabotinage mettant au contraire l’homme au-dessous de la bête qui ne l’a nullement provoqué et ne cherche, bien inutilement, qu’à se défendre. Quand on connaît toutes les supercheries, la dégoûtante cuisine de la « corrida », et qu’on ne se laisse pas éblouir par son décor, on fait vite justice de sa sophistication. On sait alors comment la « brute », qui n’a jamais rêvé qu’à des douceurs de pâturage, est métamorphosée en animal de combat par un séjour dans une casemate obscure où elle éprouve toutes les inquiétudes et les irritations d’une captivité succédant à la libre vie champêtre ; on sait comment cette « brute » est préparée, excitée par de l’avoine arrosée d’alcool, voire, au dernier moment, par des morceaux d’amadou enflammé qu’on lui introduit dans les oreilles, et par des coups de trident, toutes excitations et souffrances qui rendraient furieux même les veaux qu’osait affronter M. Alfonso. Or, cette fureur de la brute, provoquée artificiellement et qui pourrait la rendre dangereuse pour ses bouchers, on la fait s’épuiser sur des chevaux qu’on lui donne à éventrer pendant que les « peones » se tiennent prudemment en arrière. M. André Billy a fort justement répondu à M. de Montherlant, le plus pompeux et le plus vide de tous les sophistes justificateurs de la légende mithriate : « Et les chevaux ? Montherlant a oublié de nous parler des chevaux, des pitoyables chevaux sacrifiés à Mithra, buveur de sang et mangeur de tripes ». Le hiérophante mithriate ne recevait pas sur la tête les tripes et les déjections d’un cheval en même temps que le sang du taureau sacrifié.
Quand la « brute » a épuisé sa fureur, quand elle est redevenue un bœuf qui voudrait retrouver sa manade en beuglant désespérément devant une férocité inconnue de lui et qu’il ne comprend pas, lui qui n’a pas reçu « l’étincelle divine », le torero, le cabotin grotesque, retrouve alors ce qu’on appelle son « courage ». La « brute » est si abattue, si « aplomado », qu’il faut réveiller en elle une nouvelle excitation par des banderilles qui sont parfois de feu. Puis, quand perdant son sang par vingt blessures, elle est bien abrutie, bien finie, vidée de tout instinct de défendre sa vie, alors le matador, le saigneur suprême arrive pour la larder de son épée. Voilà ce qu’on appelle la « victoire de l’intelligence humaine sur la brute » ; voilà ce que des milliers de spectateurs prennent plaisir à voir !....
N’y aurait-il pas là de quoi justifier le douloureux pessimisme de Flaubert qui disait, à propos d’une foule accourue pour voir une exécution capitale : « 0 suffrage universel ! Sophistes ! ô charlatans ! déclamez donc contre les gladiateurs et parlez-moi du progrès ! ». Il y a, heureusement, autre chose que des exécutions capitales et des « corridas » pour démontrer l’existence du progrès humain.
Concluons au sujet des « corridas » par cette double réfutation des sophismes qui cherchent à les justifier, écrite par Henri Barbusse en 1926 : « Non, il y a une différence énorme entre tuer pour se défendre ou pour subsister, détruire le parasite et le serpent, ou le mouton ou le gibier, et déchiqueter publiquement un animal pour la joie du sang, le tressaillement des nerfs, les œillades et la gloriole (et sans grand risque, quoiqu’on dise). L’homme pris individuellement ou pris dans son émouvant ensemble, doit avoir, avant tout, le respect de la vie ... On peut voir, par le fait lamentable et dramatique de l’Espagne d’aujourd’hui — désert où Barcelone est une île ensanglantée -, ce que les corridas et le christianisme ont fait d’un grand peuple, et à quelle besogne travaillent ceux qui voudraient renforcer dans ses racines de superstition le vieux régime abject, en redonnant de l’éclat à des pratiques d’un autre âge, avec de la littérature, de la mythologie et des jeux de mots ».
EXHIBITIONS SPORTIVES.
Nous ne parlerons ici du sport que dans les formes collectives qu’il a prises comme spectacle depuis une cinquantaine d’années, et qui ont complètement dénaturé son caractère. Nous ne nous occuperons donc pas du sport véritable, c’est-à-dire, suivant le vieux mot français desport dont les Anglais ont fait sport adopté ensuite par le snobisme français, « l’exercice » de plein air, individuel ou en groupe, dans l’unique but de développer les qualités de l’homme pour réaliser en lui un harmonieux équilibre de ses forces physiques, intellectuelles et morales. Nous ne verrons que le sport spectaculeux, exhibitionniste, dont le but est dans l’exaltation de la plus ou moins « belle brute » et qui est la négation même du sport, tout comme le cirque romain était celle du gymnase. Nous n’envisagerons que l’exploitation du sport dont les fins sont tellement monstrueuses que le mercantilisme dont il est la proie n’est certainement pas le plus coupable. Car il s’agit de rien moins que d’arriver par le sport, à ceci : empêcher l’homme de penser, en faire une mécanique passive pour le travail et pour la guerre, une brute sourde et incompréhensive à tout appel de l’intelligence, sauf à quelques formules imposées à son cerveau par une sorte d’enregistrement automatique pour faire croire qu’il agira par lui-même alors qu’il obéira perende ac cadaver. On veut arriver par le sport à ce que l’éducation et l’instruction officielles n’ont pu suffisamment obtenir : vider les cervelles de toute substance véritablement humaine. Voilà ce que l’exhibitionnisme sportif tend à réaliser suivant des mots d’ordre criminels, et réalisera, si l’homme qui possède encore quelque faculté de penser ne réagit pas énergiquement contre cette maléfique mécanisation pour devenir un être bien équilibré, dans l’épanouissement de toutes ses forces, et ne plus être un badaud, un esclave.
L’utilisation maléfique du sport a commencé à la fin du XIXème siècle. Favorisée par le développement de la locomotion mécanique, bicyclette et automobile, elle a été méditée, cherchée, longuement et patiemment conduite par les criminels qui voulaient aboutir à 1914 ! ... Une période de snobisme anarcho-humanitaire s’était déroulée pendant dix ans et avait lassé les esprits par sa stérilité. On avait exploité jusqu’à l’écœurement toutes les formules pseudo-libertaires du « vivre sa vie » que des primaires illettrés, ridiculement frottés de Darwin, de Nietzsche, de Stirner, d’Ibsen, voulaient réaliser par le cambriolage, la fausse-monnaie et le vagabondage spécial, encouragés en cela par « l’élite » des sans scrupules qui sévissaient en haut lieu. Des cénacles de jeunes imbéciles avaient multiplié les mystifications du décadentisme (voir Symbolisme). L’affaire Dreyfus avait montré d’autre part à tous les repus, à tous les satisfaits de l’ordre social, combien il était dangereux, pour leurs intérêts, de réveiller la pensée des foules, d’exalter leurs sentiments au nom de la Justice, du Droit, de l’Humanité, et de provoquer, comme on l’a dit en manigançant les traités d’après 1914, le « déchaînement d’un idéalisme sans fin » ! Il était temps de revenir aux vieilles disciplines sociales par le mensonge idéologique et par le culte de la force. Il fallait ranimer ce que M. Barrès, le sophiste le plus astucieux de ce temps, appelait « l’énergie nationale » ! Il fallait préparer les nouveaux « soldats de l’an II », qui, même dans les milieux syndicalistes, socialistes et anarchistes, renieraient l’Internationale ouvrière, la Justice et la Fraternité universelle pour se laisser mobiliser et défendre la Civilisation des prétoriens, des prêtres, des financiers et des politiciens ! On répandait le mépris de l’intellectualité en raillant « l’intellectuel ». On complétait le mufle par la brute en enseignant qu’il valait mieux savoir donner un coup de poing que de savoir lire. M. Jules Lemaître écrivait dans ses Opinions à répandre :
« Moins d’études, moins de bouquins, moins de bohèmes, moins d’artistes, plus d’enfants, plus de sports, plus d’industries, plus d’affaires. L’avenir de la France est dans ses coffres-forts. »
Les combats de boxe, tenus jusque là pour un spectacle barbare, devenaient en faveur. On excitait les « énergies » en les dirigeant vers ce « noble sport » ! On disait avec M. Frondaie :
« Pour ma part, je ne suis pas éloigné de croire que si, aujourd’hui un jeune, à vingt ans, révélait soudain du génie, s’affirmait grand écrivain, grand musicien, grand philosophe, il serait socialement moins utile que ne l’est actuellement le grand gamin que vous savez (Georges Carpentier), devenu grand boxeur par le don, la discipline et la volonté !.... »
Voilà comment on a abouti à 1914 ; voilà comment on prépare encore plus intensivement la « prochaine » !....
Dans un monde farci d’imposture et de crime, où l’on ne travaille plus que pour la GUERRE, pour le déchaînement de la barbarie sans fin, parce qu’on ne veut pas d’un DÉSARMEMENT qui serait le déchaînement d’un idéalisme sans fin, il ne s’agit plus d’avoir raison ; il s’agit d’être le plus fort, comme lorsque deux « gangsters » rivaux se trouvent face à face. Devant les rêves de dictature, qui embrument de plus en plus les cerveaux de millions d’hommes et finissent par crever comme des pourritures trop mûres dans des aventures mussoliniennes et hitlériennes, toute notion de raison disparaît. On n’a plus besoin de vérité, de justice, de bonté ; on n’a plus besoin de penser, d’apprendre, de savoir ; on a uniquement besoin du poing le plus lourd, du canon le plus puissant, du gaz le plus asphyxiant. L’homme des cavernes se retrouve aux délibérations de la Société des Nations, plus loquace et moins crasseux car il a, depuis mille siècles, inventé la rhétorique et le savon, mais bien décidé à rejeter par dessus bord tout l’effort de ses penseurs, de ses savants, de ses artistes et de l’immense foule de ses martyrs qui ont voulu en faire le frère de l’homme ; cet homme veut retourner à sa caverne et rester un loup pour l’homme.
C’est ainsi que le sport, qui devait faire l’homme complet en forces physiques, intellectuelles et morales, a produit surtout, par son exploitation exhibitionniste, ce qu’on appelle « l’as », le « champion », le « pugiliste », véritable monstre aux muscles énormes et à la cervelle de crétin, qui est l’idole des foules, mais dont la gloire sans fondement s’écroule encore plus vite qu’elle ne s’est dressée. Car ce colosse aux pieds d’argile est promptement « vidé » par l’excès de sa puissance, blessé, mutilé, quand il n’est pas tué par un métier qui devait en faire un Apollon et n’en fait qu’une loque humaine, aussi méprisée qu’elle fut adulée par ceux qui n’aiment que les vainqueurs !.... On a pu lire les confessions lamentables de ces « professionnels » du sport, de ces « mastodontes du ring », de ces « centaures » de vélodrome, de ces « géants » de la route, de ces « olympiens » de la piste, qui composent ce qu’un des malfaiteurs vivant de leur exploitation a appelé : « la glorieuse phalange des porteurs de la Torche Sacrée !.... ». On a pu voir comment ils deviennent aveugles, sourds, estropiés, fous, incapables de gagner leur vie par un travail quelconque, et finissent parfois comme un Battling Siki dans la vulgaire crapule, après avoir stupidement gaspillé des millions non moins stupidement gagnés. On a pu connaître comment, de l’exploitation de ces tristes « héros » tout un monde de sangsues, messieurs importants et décorés, propriétaires d’ « écuries d’hommes », imprésarios, managers, entraîneurs, arbitres, directeurs et rédacteurs de journaux sportifs, s’engraissent cyniquement en même temps qu’ils exploitent l’imbécillité publique.
Lisez ce compte rendu d’un match de boxe, écrit par le Docteur Legrain :
« Ils étaient là 30.000 dans un immense vaisseau, 30.000 hommes et femmes et même enfants en bas âge, haletants, fascinés par les évolutions, les pirouettes, les coups d’adresse des malheureux athlètes, voués par nature ou par intérêt à des combats hideux, où le peuple, redevenu animal féroce, trouve de sadiques plaisirs.
Ils étaient là étrangement mélangés, bourgeoises très décolletées (car ces réunions sont snobs), demi ou quart de mondaines, panachées de types à physionomie de souteneurs en casquette. Ces spectacles confondent les classes de façon touchante ! Quelle fraternisation !
Mais ce qui est indescriptible et inconcevable même, c’est la physionomie de tout ce peuple, ses manifestations délirantes, cependant que les coups pleuvaient, meurtrissant les chairs, faisant couler le sang, sauter quelques dents, pochant les yeux. La participation du spectateur au combat se lisait sur toutes ces faces, dont les émotions débordaient ; les yeux s’écarquillaient, des vociférations sauvages sortaient des bouches convulsées : Tue-le ; tue-le ; la brute ayant un vague souvenir des ruées humaines où le sang coule au nom de la Patrie ! »
Les autres sports, le « rugby » entre-autres, ne causent pas de moindres « dégâts » et une moindre aberration. Des femmes deviennent folles subitement en dansant pendant des centaines d’heures consécutives. Mais voici ce qui dépasse tout en horreur significative de la psychose créée chez l’individu et dans la foule par l’exhibitionnisme sportif. C’est le récit de la mort d’une « ondine », une « championne » de natation, dont voici l’essentiel pris dans un article de l’Œuvre (29 août 1933). Ruth Litzig, âgée de dix-neuf ans, avait entrepris de « battre le record du monde » de natation. Il lui fallait rester plus de 79 heures dans l’eau, sans interruption. Pendant trois jours et trois nuits, elle persista. Des gens, dans des embarcations, lui faisaient passer des nourritures, ils chantaient pour la tenir éveillée. Cela ne suffisant pas, on se mit à frapper l’eau à coup de rames à côté d’elle, des « hauts-parleurs » hurlaient, les spectateurs tiraient des coups de revolver et jetaient des grenades à main, des faisceaux de lumière étaient projetés sur le visage de la nageuse pour l’empêcher de fermer les yeux. Après 70 heures, complètement épuisée, elle voulut s’arrêter et sortir de l’eau. Sa mère, qui avait jusque-là paradé dans une loge, lui commanda de continuer en lui disant :
« Nous sommes fiers de toi, Ruth. Le mois prochain, nous allons te faire traverser la Manche ! »
Ruth n’entendit pas ; elle coula à pic et vingt mille personnes la conduisirent, deux jours après, au cimetière ... Que dire de cette « championne », de cette mère et des spectateurs ? — Corneille lui-même n’aurait jamais trouvé ça.
C’est avec cette sorte de mystique qu’on a abouti à 1914, et « régénéré » le monde en faisant 10 millions de morts, 30 millions de mutilés, 5 millions de veuves, 10 millions d’orphelins, et préparé un siècle de misère et de haine. C’est avec cette mystique que l’on veut arriver encore à la « prochaine » , la « régénération » n’étant, paraît-il, pas suffisante. Et cette mystique a tellement empoisonné les cerveaux qu’on lui trouve même des qualités révolutionnaires !.... Eh bien, non ! Nous refusons de croire à une révolution pour laquelle l’exhibitionnisme sportif est une préparation utile. On ne fait pas plus de combattants révolutionnaires avec cet exhibitionnisme qu’on n’en fait avec les jeux du cirque. L’homme qui est devenu assez peu capable de penser et de réfléchir pour prendre du plaisir, ne pas avoir d’écœurement aux lamentables « virées » du « Bol d’Or », des « Six jours », du « Tour de France », du « Marathon de la danse », aux brutalités de la piste, à la sauvagerie du « football-rugby », du « pancrace », du « catch as catch can » et à la barbarie de la « corrida », cet homme-là est mûr pour faire une parfaite brute de caserne, un « nettoyeur de tranchées » supérieur, un patriote ombrageux et xénophobe, un défenseur de « l’Ordre » : il ne fera jamais un soldat de la révolution. Les gouvernants, les patrons, les curés savent ce qu’ils font lorsqu’ils encouragent l’exhibitionnisme sportif qui empêche de penser. Ce n’est pas pour la révolution qu’ils travaillent, pas même pour cette liberté républicaine, cette entente du travail et du capital, cette fraternité chrétienne dont ils alimentent toujours leur blagologie. C’est uniquement pour faire de bons troupeaux d’ilotes, d’esclaves suffisamment « rationalisés » pour marcher sans conscience aux urnes, à l’usine, aux champs de batailles et, — suprême espoir de la justice bafouée s’il ne peut plus en être d’autre pour elle, — à la crevaison de l’humanité !.....
LE CINÉMA.
La cinématographie, dont le nom a été fabriqué des mots grecs kiné ou kinéma (mouvement), et graphein (écriture), est, au sens littéral, l’écriture du mouvement. Le cinématographe est un appareil permettant de projeter sur un écran des images animées.
Le principe de l’invention du cinématographe est dans la persistance pendant un certain temps, sur la rétine, d’images se succédant rapidement, donnant ainsi une vision sans interruption et l’impression d’un mouvement réel. Ce principe de physique physiologique avait été observé déjà dans l’antiquité, puis par Léonard de Vinci, Newton, l’abbé Nollet ; mais il ne trouva ses premières applications mécaniques qu’au XIXème siècle, dans le zootrope de Plateau puis, dans le praxinoscope de Raynaud et les perfectionnements de Marey et Démeny. La véritable invention du cinématographe fut d’abord dans l’appareil d’Édison qui trouva la bande pelliculaire pouvant reproduire des mouvements d’une certaine durée, et surtout dans celui des frères Lumière qui permit de projeter sur l’écran les images fixées sur la pellicule ou film, en anglais. Du mot film adopté en France, on a fait filmer pour dire qu’on compose un film. On a dit aussi tourner un film, du geste de l’opérateur qui enroule le film pendant la prise de vue. En 1895, les frères Lumière firent les premières projections de film et le premier spectacle cinématographique fut donné le 28 décembre de la même année dans le sous-sol du Grand Café, au boulevard des Capucines, à Paris. De ce sous-sol, le cinéma se répandit dans le monde entier.
Nous ne nous occuperons pas ici de la technique de la cinématographie, mais seulement de son application comme spectacle. Nous constaterons cependant que, malgré tous les contre-sens et les vices de cette application, elle est une des plus grandes et plus belles découvertes du XIXème siècle, une des plus fécondes comme moyen d’observation et de réalisation scientifiques et, par conséquent, un des instruments de progrès dont le génie humain a le plus le droit de s’enorgueillir. Notre hommage à la cinématographie est d’autant plus profond et admiratif quant aux réalisations qu’on peut attendre d’elle que nous avons davantage à flétrir les spectacles auxquels elle a servi jusqu’ici. Elle a ainsi subi le sort de toutes les découvertes de la science ; l’invention qui devait servir pour le bien des hommes a été employée contre eux.
Le cinématographe est devenu le cinéma dans son application spectaculeuse et, plus brièvement encore, le ciné dans l’appellation populaire. De ciné on a fait cinéaste pour désigner ceux qui font du cinéma, et tout un jargon a été composé par des spécialistes : studio, caméra, sunlight, soundman, etc ... , sans lequel le snobisme ne pourrait parler décemment de cinéma, et cette formule idiote : cent pour cent ! Mais ce ne sont pas des scrupules de linguistique, pas plus que d’autres, qui peuvent arrêter les trafiquants du « cinéma du tiroir caisse » ; la seule chose qui importe est qu’ils gagnent de l’argent, beaucoup d’argent !
Le cinéma a à sa disposition tous les truquages imagés que la photographie rend possibles. C’est ce qui lui a permis, entre-autres, de produire le dessin animé d’une fantaisie aussi curieuse qu’illimitée, surtout lorsqu’il est bien accompagné de musique. Mais tous les truquages du cinéma sont loin d’être de cette qualité, et ils sont d’autant plus déplorables que, quittant le domaine de la fantaisie, ils envahissent celui du document, de la vérité scientifique qui devrait, semble-t-il, en être épargnée. Ils ont ainsi rendu suspecte une documentation que les précisions de l’enregistrement photographique devraient au contraire faire insoupçonnable. Le cinéma anecdotique et romanesque de reconstitution du passé produit les anachronismes les plus cocasses, lorsqu’on n’a pas eu le soin de vérifier exactement tous les détails. On voit ainsi, dans des films « antiques », des réverbères ou des plaques de compagnies d’assurances sur les murs d’un palais d’Agamemnon ou d’un temple de Diane, et des rails de tramways dans une rue de Carthage !... Des films de guerre, notamment de la guerre russo-japonaise, ont été tournés dans des conditions si primitives qu’on croirait voir la reproduction d’une pantomime militaire de cirque. On n’en finirait pas de relever les négligences et les inexactitudes grossières qui fourmillent dans les films dits « historiques » et y détruisent toute illusion.
A côté de cela, un truquage plus odieux est celui de la propagande tendancieuse des mensonges sociaux, propagande encore plus redoutable au cinéma que dans le journal parce qu’elle se fait par l’image vivante et parlante qui l’incruste encore plus profondément dans les cerveaux. On eut ainsi de nombreux films, fabriqués dans la banlieue parisienne représentant de prétendues « atrocités bolchevistes » ! On a toujours le film dit d’actualité où les faits divers quotidiens sont arrangés, maquillés de façon à ne pas éveiller de pensées non conformistes et à prouver aux bons citoyens qu’ils vivent dans le meilleur des mondes possibles et sous le plus aimable des gouvernements. Il suffit, a-t-on remarqué, de passer une heure devant les actualités du cinéma pour se rendre compte de la stupidité de la foule réduite à la condition de « matériel humain ». C’est quand elle se voit dans les défilés militaires, qu’ils soient rouges, verts, noirs ou bleu horizon, bolchevistes, nazistes, fascistes ou poincaristes, qu’elle est le plus parfaitement heureuse. Les aventures policières où pâture avidement la jeunesse, et la littérature roman-feuilleton où la naïveté populaire est si bassement exploitée, ne pouvaient manquer de servir, par leurs truquages, à un abêtissement de plus en plus intensif de la « matière gouvernée ».
D’abord, le cinéma, mêlé à d’autres spectacles, fut de plein air, avec un caractère seulement documentaire. Il montrait des pays lointains et inconnus, les mœurs de leurs populations, leur faune et leur flore. Puis ce furent, toujours dans le genre documentaire, les « actualités » avec leurs défilés, leurs parades, tout le spectacle de la rue, le plat du jour, que l’observateur et le badaud retrouvaient sur l’écran, plus ou moins déformé par la censure. L’erreur du cinéma commença lorsqu’il entreprit de devenir du théâtre et de représenter, en dehors de son « documentaire » plus ou moins exact ou fantaisiste, de véritables pièces dramatiques ou comiques. Cependant, composées spécialement pour le cinéma et jouées en plein air ou dans le décor vrai et non en toile peinte d’un château, d’un palace, d’un casino, d’un navire, d’une usine, etc .. , ces choses pouvaient être intéressantes par un rapport plus direct avec la vie que celui du théâtre. L’erreur plus grave, l’erreur définitive, fut de vouloir transporter le théâtre au cinéma, de lui prendre ses œuvres et ses décors déjà conventionnels pour les enfermer dans une deuxième convention où les acteurs, l’action et les sentiments ne seraient plus que des ombres d’acteurs, d’action et de sentiments. On fabriqua ces choses-là dans ce qu’on appela les studios, mot ressemblant au latin studeo (application à l’étude) et semblant désigner un endroit où l’on étudie. Ce furent d’immenses salles où l’on reproduisait le théâtre avec toutes ses machineries, décors, mise en scène et acteurs maquillés et costumés jouant comme devant le public.
Le cinéma théâtral peut parfaitement se comprendre avec des pièces spécialement composées pour lui, exactement adaptées à sa technique et à ses possibilités matérielles. Or, ces possibilités sont essentiellement visuelles alors qu’au contraire celles du théâtre, en dehors de la danse et de la pantomime, sont avant tout auditives. Qu’on ferme les yeux devant l’écran ; le cinéma n’existe plus. Il faut au cinéma, où la lumière remplace la couleur, des décors vrais de nature et d’intérieurs, avec le mouvement, le relief plastique de la forme, les proportions des différents plans de la perspective. Il ne peut se contenter des toiles plates et peintes, de l’illusion approximative du décor de théâtre, secondaire dans un spectacle où l’on écoute plus qu’on ne regarde. Et il faut des interprètes sachant traduire par la mimique et par l’expression du visage des sentiments qui doivent être fortement extériorisés, pas seulement nuancés comme au théâtre où le geste est aussi conventionnel que le décor, quel que soit son réalisme. Un homme qui marche sur une route est, au cinéma, un homme qui marche sur une route. Il n’est là que pour ça. Au théâtre, il est un homme qui cherche à donner l’illusion, la moins ridicule possible, qu’il marche sur une route. Il est là, non pour marcher, mais pour exprimer ses sentiments de marcheur. Au cinéma, la foule marche, elle ne reste pas sur place en chantant : « Marchons ! », comme à l’Opéra. Tous les artifices de la machinerie théâtrale ne donneront jamais que de bien pauvres réalisations de la « Chevauchée des Valkyries », des « Murmures de la Forêt », de la « Course à l’Abîme » de Faust, de la montée au Mont-Salvat de Parsifal, et de tous autres tableaux fantastiques ou réels où le mouvement est nécessaire. Au contraire, on en verra peut-être un jour de grandioses au cinéma.
Le cinéma théâtral, du moins celui présenté jusqu’ici, ne peut se passer du commentaire écrit ou parlé. Les apparitions de textes écrits qu’interrompent à tout instant l’image et l’action sont exaspérantes. Le cinéma « parlant » l’est encore plus, si « cent pour cent » qu’il soit, en distrayant de la communication entre l’image et le spectateur, en rompant le charme qui ne peut se produire dans toute sa plénitude que dans un profond silence ou avec le concours de sons exactement appropriés et que seule la musique peut donner. L’image a son éloquence propre et exclusive, encore plus complète que la parole, car le geste, le mouvement, disent souvent ce que le mot, figé dans sa forme abstraite, ne peut pas dire. Il y a antinomie entre l’image et la parole comme si deux langages différents s’exprimaient en même temps, tirant l’attention de l’auditeur à hue et à dia et le mettant finalement dans l’impossibilité d’en entendre aucun. Seule la musique peut être complémentaire de l’image, se fondre avec elle. Quel est, dans un théâtre, le spectacle durant lequel le spectateur est le plus attentif et observe le silence le plus absolu ? Ce n’est pas celui qui sollicite son oreille, c’est celui qui s’offre à sa vue, le ballet ou la pantomime. Aux spectacles d’opéra, l’ouverture musicale se déroule généralement dans le brouhaha d’une salle inattentive. On ne fait le silence que lorsque le rideau se lève. Cette antinomie se manifeste dans toutes les réalisations du cinéma parlant, même les mieux réussies. A plus forte raison dans celles, presque toutes, où le « parlant » n’est que grognements, borborygmes qui sortent d’une mécanique ahurissante appelée « haut parleur ».
Par une technique appropriée, le cinéma peut donc être du théâtre, mais un théâtre spécial n’ayant de commun avec le vrai que l’expression des sentiments et aussi séparée de lui, dans ses moyens matériels, qu’ils le sont tous deux de la littérature pure, de la peinture ou de la sculpture. Aussi, la pire hérésie est-elle dans le théâtre cinématographique qui prétend interpréter les œuvres des littératures romanesques et dramatiques. Il ne peut être qu’une parodie ridicule ou sinistre et, ce qui le démontre, c’est que l’opération ne peut se faire que par une transformation, un « tripatouillage » de ces œuvres qui est un acte de véritable piraterie. Il était déjà bien difficile de faire d’une œuvre littéraire une œuvre théâtrale sans, le plus souvent, la dénaturer. Il est impossible de faire d’une œuvre littéraire ou théâtrale une œuvre de cinéma sans se livrer à cette sorte de piraterie, qui relève de tout ce qu’on voudra sauf de l’art et de la plus élémentaire probité intellectuelle et morale ….
Le film « parlant » et « sonore », lancé par les Américains qui l’appellent le « talkie » et que le Vieux Monde s’est empressé d’adopter comme tous les guanos venus d’Outre-Océan, a permis cette hérésie du théâtre transporté au cinéma, de l’œuvre dramatique reproduite photographiquement par l’image animée et par le phonographe. « Le film parlant actuel tire dans le sens du théâtre le film muet qui s’en éloignait de plus en plus ». (Gance). Or, si le dialogue est l’antipode du cinéma, le cinéma est encore plus l’antipode du théâtre. Ils ne peuvent que se heurter et se nuire réciproquement, le cinéma étant l’extériorisation par la multiplication de l’image et du mouvement, tandis que le théâtre vise à l’intériorité par la concentration d’une action fictive réduite au minimum d’image et de mouvement. Il est déjà presque impossible de représenter, sans de graves altérations, le théâtre de Shakespeare ou des œuvres comme Faust, Peer Gynt, etc ... Les « tourner » au cinéma et faire hurler ou nasiller par un « haut parleur » les monologues d’Hamlet, les suavités mystiques qui accompagnent la rédemption de Marguerite, la mort d’Ase, même dépouillée de tout son fantastique par la musique de Grieg, serait la fin de tout. L’Enfant de l’Amour, d’H. Bataille a eu l’infortune de fournir la matière du « premier film français cent pour cent parlant ». Depuis, ça a été une curée innommable, et l’on n’a pas cessé de saccager le domaine de la littérature dramatique. Le mal serait relatif s’il ne s’agissait que d’œuvres d’auteurs vivants, qui peuvent se défendre et défendre leur pensée. Mais il s’agit trop souvent d’œuvres dont les auteurs ne sont plus là et qui, malgré parfois des défenses posthumes, sont trahies et vendues par des héritiers indignes. Nous verrons, au mot Tripatouillage, l’extension inimaginable que le cinéma a fait prendre à la piraterie littéraire. On pourrait écrire à l’entrée des cinémas encore plus que partout ailleurs : « Ici, on assassine les grands hommes ! », et ce n’est pas la honteuse complicité de la corporation des « gens de lettres » qui doit justifier la chose ; au contraire !.....
De même que pour la parole, le cinéma « pure musique de l’œil » (Altmann), et la musique, pure vision de l’âme, se heurtent inévitablement, comme les vers et la musique quand ils n’ont pas été composés pour se compléter dans une étroite intimité. Que de mariages grotesques, de stupides accouplements n’a-t-on pas vus entre cinéma et musique, suivant la fantaisie obtuse du « pianiste-accompagnateur » ? Il y a de quoi hurler de rage et tout casser autour de soi, il y a de quoi « tirer sur le pianiste » et aussi sur l’écran, quand on voit les conjugaisons monstrueuses imposées à Beethoven, à Mozart, à Berlioz, à tous ceux qui ont parlé avec leur âme et qu’on fait dialoguer avec la sottise exhibitionniste du cinéma ! N’y a-t-il pas une complète aberration du sens esthétique chez ceux qui supportent cela sans être indignés ? Reconnaissons toutefois que le cinéma n’a pas l’exclusivité de ce genre d’infamie. On a vu par exemple, aux Folies Bergères, des athlètes jonglant avec des femmes nues qu’ils déposaient ensuite sur « l’autel de l’amour » ! cela avec accompagnement musical de Shérazade de Rimsky-Korsakov !.....
Mais on se soucie bien d’art et de probité chez les « gangsters » qui ont fait leur proie du cinéma, c’est-à-dire la plus écœurante exhibition de la sottise, du cabotinage et de la pornographie ! La foule, qui va toujours au médiocre quand ce n’est pas au pire, dans sa fringale incessante d’illusions nouvelles, s’est d’autant plus engouée de ce cinéma qu’il lui demandait moins de penser et se bornait à l’amuser par l’image. Ce n’était pas elle qui réclamait du cinéma des réalisations d’art qu’elle dédaignait au théâtre où il lui fallait parfois réfléchir pour comprendre. Aussi le cinéma fut-il très vite, on peut dire immédiatement, le système idéal d’abrutissement des foules suivant les voies dirigeantes. Il acheva l’œuvre des sports chez l’homme, il la remplaça pour la femme et l’enfant. On fut immédiatement submergé par des productions « d’une désespérante banalité, qui n’ont souvent pas même le mérite de l’originalité, inspirées qu’elles sont uniquement par le désir de flatter les bas instincts de la multitude pour en battre monnaie, et qui donnent aux spectateurs de tout âge de pernicieuses et de funestes leçons ». (J. Auvernier, Le Larousse Mensuel, 1910).
Depuis 1910, si le cinéma s’est perfectionné dans sa technique, il n’a guère amélioré son niveau artistique, intellectuel et moral. Au contraire.
| 10% | nature, paysages genre carte postale. |
| 10% | revolvers et police. |
| 10% | poursuites diverses et autos de luxe. |
| 20% | bals, dancings, banquets du grand monde, music-halls. |
| 20% | intérieurs de familles morales et sentimentales. |
| 30% | baisers, cuisses de girls, canapés, « sex-appeal », amour. |
Quant au peuple, a ajouté Altmann :
« Il ouvre les portières, il porte les bagages, il dit : « Madame est servie », il dit : « Merci » aux pourboires, il fait la foule et crie dans les actualités : « Vive la France ! ». »
Dans tout cela, il n’y a que :
-
1° de la niaiserie sentimentale ;
-
2° de la sauvagerie ;
-
3° et 4° du muflisme nouveau style ;
-
5° de la tartuferie ;
-
6° de la pornographie.
Il y a des riches qui ne sont que des mufles, et des pauvres qui ne sont que des larbins. Il n’y a aucune place pour le travail et pour la pensée, pour la vie libre et pour l’esprit indépendant. Le cinéma glorifie ainsi l’impérialisme du parasite, du malfaiteur, du cabotin, surtout du cabotin en qui la foule adore ses propres turpitudes. Les hommes les plus célèbres, les comédiennes les plus favorisées, ne connurent jamais cette admiration, cette popularité qui entourent les vedettes du cinéma. C’est qu’elles sont elles-mêmes de la foule ayant été, pour la plupart, promues sans études, sans travail, à une célébrité « mondiale » par le scandale, le bluff et le puffisme. Quelle est la jeune fille qui ne rêve aux splendeurs d’Hollywood pour peu qu’elle ait la cuisse bien faite ? Ont-elles besoin d’autre talent ces « stars » qui s’essaient si ridiculement à jouer des personnages et à interpréter des choses auxquelles elles ne comprendront jamais rien ? Aucune véritable artiste ne gagna jamais les millions dont elles sont payées, même lorsqu’elle se prêta au tapage publicitaire spécial qui les accompagne.
Nous ne sommes pas ici pour faire de la morale suivant ce qu’on appelle les « bonnes mœurs », et notre conception de l’éthique n’a rien à voir avec le « bégueulisme » des pharisiens ; mais nous demandons pourquoi on interdit le commerce des cartes transparentes et on poursuit leurs vendeurs, pourquoi on exige une « tenue décente » des malheureuses femmes condamnées au trottoir, alors qu’on laisse s’étaler avec une si triomphante impudeur certaine publicité de cinéma qui relève plus de la prostitution que de l’art ? La carte transparente et la pauvre putain sont discrètes et se dissimulent ; ne les voit que qui veut les voir. Elles ne raccrochent pas ostensiblement et ne sont pas licencieuses comme certaines affiches et certains placards de journaux. Mais, comme toutes les turpitudes, la pornographie devient un art et une vertu au-dessus d’un certain niveau social. Un marchand de cartes transparentes, généralement miteux quand il n’est pas fournisseur de magistrats et de sénateurs, est un « saligaud » ; mais les riches proxénètes du cinéma sont des « artistes », comme leur cheptel qui est de choix et ne doit pas plus être confondu avec la « fille » Élisa ou la « femme » Trumeau qu’ils ne peuvent l’être eux-mêmes avec M. Philibert. Une dame qui joue du serre-croupière avec des milliardaires et des ministres est en droit d’exiger l’admiration du « peuple souverain » pour son « sex-appeal », sinon comme artiste. On lit souvent, à l’entrée des salles de cinéma, des avis de ce genre :
« Vu le haut degré de sensualité du film X ... , la direction invite les familles à s’abstenir d’amener des jeunes gens de moins de 15 ans ! »
On trouve cela très digne et très bien ; mais pourquoi, en même temps, jette-t-on l’anathème sur la maison de tolérance ? Est-ce parce qu’elle ne reçoit jamais les jeunes gens de moins de quinze ans et que l’on n’y va pas « en famille » ? .. L’immoralité, la pornographie, ce sont l’intention sale d’éveiller le « cochon qui sommeille », d’exciter les sens non pour les joies saines et propres de l’amour, mais pour les dégoûtantes promiscuités de la prostitution et pour ses répugnants salaires. Les « 30% de cuisses et de sex-appeal » du cinéma ne sont pas plus des amoureuses que des artistes ; ce sont des « allumeuses » et c’est pourquoi la publicité qui les entoure est, comme leurs exhibitions, de la pornographie.
C’est ainsi que le cinéma est devenu un « instrument du bien public », suivant la formule d’un « doktor » allemand ; qu’il est employé à toutes les propagandes bourgeoises, conservatrices, patriotiques, religieuses, politiques, financières, et qu’il fait gagner beaucoup d’argent à tous les souteneurs de « l’Ordre social ». Il est même, aujourd’hui, le principal instrument de ce « bien public » en ce qu’il exerce plus directement que tout autre son influence sur la foule. Aussi, les organismes les plus ankylosés dans la momification sociale, les plus rétrogrades, les plus réfractaires au progrès, font-ils du cinéma leur moyen de rayonnement. L’Église, qui voudrait ramener la société aux temps du moyen âge, y a recours tout comme la Russie bolcheviste, et la vieille momie papale se revigore en faisant concurrence à Rigadin. Tous les curés qui font la guerre au modernisme, ont installé le cinéma catholique en face du cinéma des Amis de l’Instruction laïque qu’ils combattent avec succès.
C’est ainsi que le cinéma n’a que trop justifié les jugements sévères exprimés sur son compte, notamment ceux de G. Duhamel, disant :
« C’est un divertissement d’ilotes, un passe-temps d’illettrés, de créatures misérables, ahuries par leur besogne et leurs soucis ... Un spectacle qui ne demande aucun effort, qui ne suppose aucune suite dans les idées, ne soulève aucune question, n’aborde sérieusement aucun problème, n’allume aucune passion, n’éveille, au fond des cœurs, aucune lumière, n’excite aucune espérance, sinon celle, ridicule, d’être un jour « star » à Los Angeles ... »
Et, dernièrement, Duhamel a ajouté :
« Il est certain que si le cinéma continue dans la voie, dans l’impasse où il s’est engagé, il est certain qu’il sera bientôt un chancre, un cancer, le chancre monstrueux de toute la civilisation contemporaine. »
Par contre, le cinéma a des zélateurs enthousiastes, lyriques et grandiloquents, comme Élie Faure qui, formulant une Mystique du cinéma, a écrit :
« C’est la première fois que la science fait sourdre de l’inconnu indéfini et infini qui nous environne, par l’action de son propre mécanisme, des harmonies nouvelles et cependant solitaires de celles qui nous consolaient autrefois et dont la puissance de construction n’est qu’à l’aube de ses possibilités. En présence de cette collaboration spontanée de la science et de la poésie, de cette union intime de l’univers matériel et de l’univers spirituel, de cet appel que lance à la durée l’espace pour qu’elle se précipite et se concentre du plus lointain passé et du plus immanent avenir sur une étroite étendue dynamique qu’elle définit sans arrêt et qui la situe sans défaillance, ne sommes-nous pas autorisés à croire qu’une métaphysique nouvelle, ou mieux, un monde nouveau apparaît ? »
Et E. Faure dit aussi :
« Ce n’est pas le moindre miracle apporté par le cinéma, qu’on puisse invoquer tour à tour à son propos tous les arts qui, jusqu’ici, avaient organisé nos sensations. Il ne dépend d’aucun, mais il les contient, les ordonne et les accorde tous en multipliant par la sienne propre leur puissance. »
Une autre mystique du cinéma est celle d’Eisenstein qui veut faire le Cinéma de l’avenir par le cinéma marxiste, en réalisant le film du Capital. Eisenstein veut créer « le langage de la cinédialectique » en ne brouillant plus ensemble le « langage de la logique » et le « langage des images ». Il veut équilibrer la science et l’art par la quantité et non la qualité pour produire « la forme nouvelle du facteur d’effet social » dans « le nouveau film concret de l’intellect ». D’autre part, M. Eisenstein voit dans le cinéma « l’art complet réalisant la synthèse de l’image, du son, de la couleur et du relief ». M. Gance rêve de voir le cinéma sonore et parlant s’harmonisant par les sons et le dialogue avec les bruits de la nature et de la vie pour faire le langage nouveau de vérités nouvelles. M. Lherbier veut que la musique soit « une véritable orchestration » de ce langage nouveau, et Mme Germaine Dulac déclare indispensable pour cela de savoir « doser et choisir les éléments sonores et parlants susceptibles d’accompagner l’image ».
Nous ne doutons pas que tout cela soit possible pour le cinéma ; il a évidemment devant lui des perspectives illimitées. Mais, pour qu’il puisse se lancer librement dans ce vaste inconnu, il faut qu’il commence par s’assainir, par extirper de son organisme le « chancre monstrueux » des exhibitionnistes du « sex-appeal », des « cinéastes » tripatouilleurs de la matière littéraire, de toute la vermine qui vit de lui comme des poux dans la crinière d’un lion. Après quoi il pourra, sinon remplacer tous les arts, ce que nous ne croyons guère, mais devenir à côté d’eux un élément de véritable intelligence et de pure joie humaine.
— Édouard ROTHEN.
SPECTATEUR
n. m.
Les progrès de la physiologie nous permettent d’avancer lentement mais avec quelque certitude dans la connaissance de notre propre psychologie. Cette connaissance ne s’effectue point sans rencontrer de sérieux obstacles, même chez les penseurs les plus profonds, lesquels, déterminés par une éducation ou une influence particulièrement idéaliste, ramènent toute chose à une sorte de vie de l’esprit indépendante des conditions physiologiques d’existence bonnes ou mauvaises. C’est en ce sens que la sensibilité spectaculaire de Jules de Gaultier, qui a le plus profondément traité cette question en de multiples ouvrages, peut être comprise. Ce n’est pas que, dans le passé, plus ou moins lointain ou récent, les penseurs n’aient découvert et apprécié consciemment cette faculté de l’intelligence de jouir des choses sans les posséder, mais ce philosophe, avec un esprit de suite remarquable, a précisé le sens de cette sensibilité spectaculaire et son rôle unique de justification de la pensée elle-même.
La vie étant conditionnée par les sensations et celles-ci pouvant se diviser en sensations de plaisir et en sensations de douleur, il en résulte, pour ce philosophe, qu’aucune morale ne peut atteindre son but, qui est la suppression de la souffrance, car la réalisation du bonheur universel implique une harmonie absolue supprimant les différences et aboutissant au néant. D’autre part, chacun voulant augmenter, à son profit, la somme des sensations de plaisir et réduire celle des sensations douloureuses, il en résulte une lutte inévitable entre individus désirant tous les mêmes objets. Comme il n’y a ni plaisir, ni douleur absolue, la morale qui veut supprimer la douleur ne peut parvenir à cet état de sensation unique qui serait le néant. Ainsi, aucune morale ne peut parvenir à ses fins et, poursuivant dans l’avenir une réalisation impossible, elle néglige la seule réalité : le présent.
Ainsi, Jules de Gaultier pense que la souffrance et le plaisir étant inséparables dans le domaine sensoriel, l’éthique poursuit un rêve chimérique en voulant améliorer les conditions humaines et supprimer le mal. A cette poursuite stérile et vaine il oppose la sensibilité spectaculaire qui fait de la sensation, bonne ou mauvaise, un objet de spectacle et de joie. Cette sensibilité a ceci de particulier que, contrairement au domaine moral, qui ne peut exister dans ses deux pôles : plaisir et douleur, elle ne laisse subsister que le plaisir. Le plaisir et la souffrance ne sont plus alors que des éléments de contemplation engendrant la joie spectaculaire.
Dans le domaine scientifique, ce philosophe, constatant que la science n’a pas réussi à ramener la diversité des phénomènes à une source commune, à réduire l’hétérogène à l’homogène, alors que toute la connaissance scientifique a pour but la recherche et la démonstration de l’identité des processus physico-chimiques que nous percevons, en déduit que la science a échoué dans son essai d’explication synthétique de l’univers, mais que, précisément, cet échec, cette réduction du divers à l’Un étant impossible, parce que l’uniformité détruit toute connaissance, que toute connaissance suppose un sujet et un objet et que l’Un ne peut se manifester à sa propre vue qu’en se situant spectateur de lui-même, ce qui détruit l’unité, le rôle de la science n’est plus alors la recherche d’une explication définitive de l’univers, mais un spectacle de curiosité pure du fonctionnement de cet univers. Spectacle qui ne doit pas prendre fin par une explication totale des choses, mais doit se continuer indéfiniment, autant que la vie même des spectateurs.
Jules de Gaultier va même plus loin ; il nie le rôle utilitaire de la science. Elle n’est pas, dit-il, dans son essence, un moyen d’augmenter notre pouvoir sur les choses, mais un organe de pure vision, un moyen d’atteindre la fin immédiate impliquée dans tout mouvement de division de l’existence avec elle-même, c’est-à-dire la connaissance, la contemplation de l’univers. Si la science crée, augmente la puissance de l’homme, c’est uniquement pour augmenter la connaissance, étendre le spectacle, varier indéfiniment la contemplation.
Dans cette conception spectaculaire de la vie, il y a certainement quelque chose d’exact et de profitable pour l’individu. La course incessante vers un mieux-être à venir, toujours fuyant, toujours inaccessible est évidemment un legs religieux, un sacrifice de la réalité présenté à un hypothétique futur. L’examen logique de l’existence nous démontre, d’autre part, que tout est inutile dans l’univers, puisque rien ne dure, que tout s’y détruit et se transforme sans but et sans fin. Quel que soit l’avenir des mondes, si merveilleusement organisés soient-ils, ils disparaîtront sans laisser plus de traces dans l’infini qu’un grain de sel dans l’océan. Il est donc erroné de s’imaginer construire et œuvrer pour l’éternité. Et il est profondément absurde de reporter sur des temps à venir une joie de vivre actuelle, car le présent actuel auquel on refuse cette joie a été, au passé, un présent auquel, précisément, on refusait une joie qui nous était réservée et que nous n’avons pas. Il n’y a aucune raison pour que chaque génération ne se sacrifie pas perpétuellement à la suivante ; de telle sorte que toutes les générations humaines se seront sacrifiées sans joie à la dernière, laquelle ne fera rien de mieux, en fin de compte, que mourir dans quelques cataclysmes plus ou moins terrifiants.
C’est une sorte de course à la mort, un suicide grandiose, d’une telle envergure qu’il échappe au peu d’esprit critique des foules sacrifiées. Cette incohérence s’accorde également avec l’impression de stérilité de toute l’activité trépidante du monde moderne où l’action frénétique s’oppose à toute évolution esthétique de la durée, où la fuite des temps détruit toute contemplation désintéressée, où les visions se succèdent en des tourbillonnements précipités, sans jamais permettre de saisir, de voir, de stabiliser une réalité reposante, dans une sorte de poursuite vertigineuse d’on ne sait quel but ou quelle fin ; tels ces joueurs hallucinés, entassant désastres sur désastres pour d’illusoires revanches sur un insaisissable destin.
Si donc vivre ne correspond à rien de compréhensif, il nous reste une seule certitude, une seule joie : faire de notre vie un spectacle esthétique.
La morale courante est par conséquent à rejeter puisqu’elle nous entraîne vers des fins matérielles ou mystiques inutiles à notre bonheur. Et, d’autre part, la possession des choses est forcément une source de conflit parce que l’imagination sensuelle est insatiable et que l’élimination du déplaisir est impossible dans ce domaine d’hostilité et de lutte pour la conquête d’objets ou d’espace forcément limités.
Il est également certain que le but réel de la science n’est pas uniquement la puissance dominatrice de l’homme, puisque cette puissance, au service de l’imagination sensuelle et conquérante, ne parviendra jamais à ses fins, ne satisfera jamais l’imagination, n’atteindra, en aucun temps, un but définitif et sera inévitablement vaincue par les forces éternelles de l’univers. Un des buts actuels de la science est donc bien une recherche esthétique, la recherche d’une émotion spectaculaire, la satisfaction d’une curiosité pure, la contemplation du spectacle mondial.
Nous pourrions donc adhérer en partie à ce sens spectaculaire de la vie ; mais il y a, dans cette conception de l’activité humaine, quelque chose de mystique, d’irréel, qu’il est nécessaire de préciser et d’écarter pour donner à cette conception un caractère objectif et réalisable. Ce quelque chose, c’est l’affirmation que toute sensation, bonne ou mauvaise, peut être indifféremment une source de spectacle et de joie. C’est également l’affirmation que le but de la connaissance est essentiellement la contemplation. Il semble, d’après ces concepts, que l’esprit seul a une réalité, qu’il existe par lui-même, que, n’étant pas acteur, tous les actes lui sont indifférents pourvu qu’il y ait des actes et des acteurs dont il jouit. C’est là un des points faibles du concept idéaliste. Certes, le philosophe admet bien qu’il doit y avoir, même chez lui, une réalité sensuelle et cette réalité, bonne ou mauvaise, il l’accepte comme spectacle ; il est à lui-même, à sa sensibilité son propre spectateur, mais il néglige la base nécessaire et fondamentale de tout spectacle, c’est-à-dire la vie, base hors de laquelle aucune contemplation n’est possible.
La vie est un phénomène qui ne peut exister que dans certaines conditions. Négliger ces conditions, c’est compromettre la vie et, du même coup, le spectateur. Et ces conditions sont inséparables du bien et du mal. C’est pourquoi Nietzsche n’avait pas à se situer par delà le bien et le mal, car, par delà ces notions, il n’y a plus de vie humaine et, par conséquent, plus de spectateur. Le bien, c’est tout ce qui est nécessaire à la vie et l’intensifie ; le mal c’est tout ce qui s’oppose à cette activité et la détruit.
Jules de Gaultier approuve forcément ce minimum d’éthique, mais il ne paraît pas en avoir tiré les conclusions logiques qui semblent s’imposer nécessairement, car si nous admettons qu’il y a un mal qui détruit la vie, et conséquemment le spectateur, il y a contradiction et impossibilité absolue à faire de la souffrance et de la douleur, qui sont des éléments destructeurs de la vie, une source de spectacles.
Concevoir l’existence d’une activité et son épanouissement dans sa propre disparition, me parait être d’une parfaite absurdité. Nous retrouvons ici les expériences si concluantes de Pavlov, déterminant un chien affamé à frétiller de joie sans les secousses, primitivement douloureuses, des décharges électriques, transformées peu à peu, par association, en signes précurseurs de plaisirs nutritifs. Ainsi se conduisent les ivrognes, les morphinomanes, les héros sanguinaires et autres spectateurs, plus ou moins purs, de même qualité.
Ainsi donc, chronologiquement, la vie est antérieure à l’éthique et celle-ci à l’esthétique. Et la connaissance, loin d’être le but exclusif de la vie, n’est que la conséquence de la vie. L’esthétique n’est qu’un effet du chaos. Faire du spectacle des choses la raison d’être de l’existence, c’est tomber dans le finalisme, c’est admettre une sorte d’harmonie préétablie, une justification de l’univers. C’est admettre, avec l’alpiniste tombé dans une crevasse, que le tas de neige qui l’a sauvé, n’avait d’autre raison d’être que d’éviter son écrasement.
Il n’y a pas de fin dans l’infini.
L’homme peut faire, contre mauvaise fortune, bon cœur ; l’homme peut, faute de mieux, être un spectateur ; mais, contrairement à Jules de Gaultier, j’estime que la connaissance est, d’abord et avant toute chose, action, et qu’elle ne devient spectacle qu’ensuite, par simple fonctionnement cérébral, par une utilisation totale de l’influx nerveux. Celui-ci utilisé tout d’abord dans les centres affectifs les plus puissants parvient finalement dans les centres intellectuels toujours sous la dépendance des centres affectifs. Physiologiquement, toute la vie n’est qu’une suite de réactions de la substance vivante contre les excitations du milieu. Ces réactions n’utilisent pas totalement l’énergie nerveuse déclenchée par les excitations ; une partie de cette énergie inutilisée modifie la substance cérébrale, préparant d’autres actions plus complexes lors des futures excitations. La pensée, étant un effet de ces excitations, ne peut donc être une cause initiale, créatrice, indépendante de spectacles. Elle subit tous les avatars des chocs et des heurts d’un univers instable et chaotique. La vie existe d’ailleurs en grande partie sans conscience et sans apparence spirituelle.
La pensée est donc bien un luxe, c’est-à-dire un surplus et l’homme, c’est-à-dire l’enfant, et philogénétiquement le pré-humain, a d’abord senti, puis réagi et enfin pensé.
L’homme est acteur vivant avant d’être spectateur. Il n’y a pas de connaissance sans sensations. L’espace, le temps sont des concepts issus du mouvement. Pour vivre, il faut agir, lutter, conquérir, connaître, prévoir, penser. Penser, c’est jouer mentalement le drame de la vie, de l’univers. C’est commencer des actes qui n’aboutissent pas. La pensée est un acte différé ou un acte avorté. Elle n’a de valeur que celle que lui donnent notre activité, notre énergie, notre expérience, notre vie. Le plus pur des savants agit, crée, utilise des instruments, des appareils parfois extrêmement coûteux et compliqués, fait des expériences, plie la matière à ses calculs et à ses caprices et ressent, quoi qu’on en dise, un sentiment de joie et de puissance à en pénétrer les secrets et à la dominer, car en lui le conquérant, antérieur ou curieux, est toujours vivant.
Nous ne pouvons donc séparer la pensée de l’action et de la morale. L’homme est à la fois acteur, parce qu’il est vivant et par conséquent conquérant et qu’il lui est absolument impossible d’exister autrement ; il est en même temps spectateur, non pas parce que tout l’univers s’est coordonné pour cette fin, ou que son esprit s’est donné volontairement ce but, mais parce que tel est le fonctionnement nerveux chez lui qu’une partie inutilisée de l’influx nerveux ne peut faire autrement que s’éparpiller en de multiples ramifications appelées pensées, contemplation, sensibilité spectaculaire.
Et, conséquemment, la morale est l’ensemble des actes qui, basés sur une réelle et profonde connaissance du fonctionnement biologique de l’être humain, lui assure le meilleur fonctionnement de cette sensibilité.
L’éthique et l’esthétique sont indissolublement liées l’une à l’autre et nous pouvons conclure qu’elles permettent à l’homme, acteur et spectateur, de vivre, de jouir et de durer.
— IXIGREC.
SPECTRALE (ANALYSE)
On donne ce nom à la méthode qui permet d’analyser toute source lumineuse à travers un prisme ou par sa réflexion sur un réseau.
Newton, en 1702, avait établi que la lumière du soleil, qui nous apparaît blanche est, en réalité, composée de sept couleurs principales qui sont : violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Ces sensations colorées nous sont fournies par des vibrations différentes, en nombre extrêmement élevé. Les plus rapides parmi ces vibrations (750 trillions par seconde) et qui sont les plus divisées par la réfraction engendrent le violet ; les plus lentes (450 trillions par seconde) et les moins réfractées nous donnent le rouge. D’un bout à l’autre du spectre, c’est une gamme régulièrement décroissante.
On connaît la propriété que possède le prisme de verre de réfracter un rayon lumineux qui le traverse et de l’étaler en une nappe diversement colorée : le spectre ou la succession des couleurs est invariable. En faisant passer un rayon de soleil ou de toute autre source lumineuse, à travers un prisme, l’image colorée ainsi formée s’étalera sous la forme d’une bande colorée qui sera striée de raies fines, obscures ou brillantes, dont chacune caractérisera un corps simple et dont la présence permet d’affirmer que ce corps existe dans la source lumineuse que l’on étudie. Quand la lumière est émise par un corps incandescent, le spectre est continu. Mais quand elle traverse un espace contenant des corps en vapeur, eau ou vapeur de métaux (sodium, plomb, mercure, etc…), le spectre continu est strié de raies noires dont chacune ou chaque groupe est caractéristique du corps dont elle émane et occupe toujours la même place dans le spectre, appelé alors spectre d’absorption. On distingue ainsi les spectres de lignes à raies lumineuses qui sont produits par les gaz portés à l’incandescence et le spectre de bande qui comprennent des portions de spectres se résolvant en lignes fines qui proviennent de gaz incandescent à l’état de combinaisons chimiques.
Cette décomposition de la lumière ou analyse spectrale permet d’étudier la nature chimique des corps. Celle-ci s’opère à l’aide du spectroscope dont voici la description : imaginez un appareil muni d’une fente mince dans laquelle est concentrée la lumière à analyser et située au foyer d’une lentille ou collimateur. Ce collimateur rend parallèles les rayons du faisceau lumineux issus de la fente. Ces rayons traversent ensuite un prisme qui les disperse. Le faisceau ainsi obtenu est recueilli par une seconde lentille qui fournit à son foyer une image nette de chacune des images de la fente se succédant pour former un spectre continu. Ce spectre continu est donné par tout corps incandescent solide ou liquide. Quand ce corps incandescent est à l’état gazeux, le spectre se réduit à quelques lignes brillantes correspondant à des vibrations déterminées dont elles ont précisément la coloration. Ainsi le spectre du lithium montre seulement une raie rouge. Chaque corps possède donc son spectre particulier, formé de raies, toujours les mêmes, et dont l’emplacement mesurable permet de les identifier. Maintenant si, derrière ce gaz, se trouve une source incandescente liquide ou solide et d’une lumière obligatoirement plus éclatante, on constate le phénomène suivant : les raies du spectre observé se dessinent en noir sur le fond brillant du spectre continu issu de la source incandescente. L’emplacement des raies noires nous fournit donc un second moyen d’analyse aussi précis que le premier.
Cette méthode d’analyse est si merveilleuse, si sensible qu’elle révèle l’existence de substance en quantité infiniment petite. La présence d’un millionième de milligramme se décèle dans la flamme d’une bougie !
L’Astronomie a su tirer un prodigieux parti de l’emploi du spectroscope. Grâce à lui, nous pouvons connaître la constitution, la température, l’âge des astres du ciel : étoiles et nébuleuses. Le spectroscope s’adaptant au foyer des lunettes et des télescopes, de façon que l’on puisse concentrer sur sa fente, l’image fournie par l’objectif des astres que l’on veut analyser, on est ainsi parvenu à reconnaître dans le soleil la présence du fer, du nickel, du zinc, du cuivre, du carbone, du calcium, de l’hydrogène, etc... Dans bon nombre d’étoiles, la grande majorité, nous avons pu retrouver des éléments analogues aux substances solaires et terrestres. C’est toujours grâce au spectroscope que l’on a pu classer les soleils de l’infini en quatre types fondamentaux, selon la diversité plus ou moins grande de leur constitution intime, résultant du stade de leur évolution. D’autres applications permettent, par des variations de l’emplacement des raies, de déterminer la vitesse dans l’espace de l’astre observé, cela en dehors de notre perception directe. Aujourd’hui, on remplace l’observation directe du spectre par sa photographie : l’image du spectre est reçu sur une plaque sensible et ainsi, le spectroscope devient un spectrographe.
L’analyse spectrale, dont l’initiateur fut Frauenhofer, puis, plus tard, Kirchoff et Bunsen, a créé l’Astrophysique, branche nouvelle et merveilleuse de l’astronomie, qui, au cours des dernières années, a conduit les savants aux découvertes les plus troublantes, les plus curieuses relativement à la nature des étoiles et des nébuleuses en particulier. Cet instrument prodigieux d’investigation justifie le lyrisme de l’illustre Janssen quand il s’écriait :
« Étoile ! envoie-moi un de tes rayons et je te dirai de quoi tu es faite ! »
— Charles ALEXANDRE.
SPIRITISME
n. m.
L’homme se résigne mal à la mort. Il se consolerait aisément de ne rien comprendre aux problèmes généraux de l’univers, mais l’idée de sa disparition complète l’épouvante. Il ne faut pas chercher ailleurs la raison du succès de toutes les religions et en particulier du Spiritisme. Le spiritisme s’est, à certains égards, mis en harmonie avec les idées modernes. On resterait sceptique à notre époque devant un homme qui prétendrait avoir bénéficié de révélations spéciales. Moïse, s’il revenait raconter aujourd’hui que Dieu en personne lui a donné audience sur une montagne, aurait bien des chances de ne pas être cru ; les montagnes, mystérieuses autrefois parce que difficilement accessibles, ne le sont plus aujourd’hui. Notre temps veut des faits, des expériences ; c’est ce qu’apporte le spiritisme, ou du moins, ce qu’il prétend apporter. Il a ses laboratoires dans les instituts métapsychiques, ses sujets, ses médiums, ses savants, des savants officiels même, qui, avec beaucoup de sérieux, s’adonnent à son étude.
Le spiritisme a pris naissance en Amérique vers 1848. Dans un village perdu loin de toute grande agglomération, des jeunes filles prétendirent entendre des voix et des coups frappés par un être invisible. Plus tard il fut reconnu qu’il n’y avait que supercherie dans ces prétendus phénomènes ; mais, qu’à cela ne tienne, le spiritisme fit quand même son chemin.
La religion spirite a été développée par Allan Kardec dans ses deux ouvrages célèbres : le Livre des Médiums et le Livre des Esprits. L’homme comporte trois parties : le corps périssable, le périsprit ou corps astral, fait de matière plus sublimée et l’esprit ou l’âme. Après la mort, l’esprit et le périsprit sont libérés ; ils vivent des vies successives, toujours de plus en plus parfaites.
Les hommes, en se soumettant à certaines conditions, peuvent communiquer avec les esprits ; ces communications sont de diverses espèces : la typtologie permet de converser avec les esprits par le moyen de la table. La table se soulève et retombe, frappant de son pied des coups dont le nombre correspond aux lettres de l’alphabet ; un coup pour A, deux coups pour B, etc ... Ces communications sont très difficiles. Des gens désœuvrés se réunissent, le soir de préférence, pour se livrer à ce petit jeu. Très souvent, sentant qu’il s’agit d’une lettre avancée dans l’alphabet et craignant un grand nombre de coups, il y a doute ; il faut recommencer et on n’aboutit à rien. Aussi, beaucoup de spirites préfèrent employer la planchette à médium. C’est une petite planche de forme triangulaire et pourvue de trois roulettes. Sur une table on place une bande de papier où sont figurées les lettres de l’alphabet. Le médium s’assoit devant la table, pose la main sur la planchette ; si l’esprit évoqué est présent, la planchette roule vers la lettre qu’il indique. Il n’y a plus qu’à former les mots et les phrases. Plus faciles encore sont les communications lorsqu’on dispose d’un médium écrivain. Il n’a qu’à prendre un crayon, du papier et à attendre l’inspiration.
D’autres médiums sont parlants, L’esprit évoqué prend, pour un temps, possession de leur corps et s’en sert pour communiquer avec les vivants. Le consultant qui a perdu un être cher et qui espère communiquer avec lui va trouver le médium ; celui-ci entre en transe, sa voix change, prend le timbre de la voix du mort et le consultant est persuadé que c’est le mort qui parle. Il ne dit, et pour cause, que des choses très vagues et il ne manque pas de consoler son parent, de lui dire qu’il est heureux dans l’au-delà. Le client s’en va un peu consolé, je dis un peu, car, malgré sa naïveté, le consultant ne peut pas ne pas voir qu’il n’a eu affaire qu’au médium et nullement au mort qu’il regrette.
Il est enfin des médiums à matérialisations ; ce sont les plus recherchés. Certains font apparaître des formes ectoplasmiques. De leur bouche s’échappe une matière ténue et lumineuse qui, d’abord en forme de sphères, prend peu à peu l’aspect d’un corps humain. D’autres font apparaître des fantômes vêtus de voiles blancs, d’autres des membres humains qui consentent même à se laisser prendre un moulage, pour bien prouver leur réalité. Ces phénomènes ne se produisent jamais simplement. Il faut au médium tout un appareillage qui évoque le théâtre, qu’il est en réalité. La salle doit être obscure. Le médium est en outre caché derrière un rideau noir. Le fantôme surgit de derrière le rideau, il est interdit d’en approcher, de le toucher et aussi de faire la lumière pour se rendre compte de ce qu’on voit au juste. Les séances de matérialisations sont toujours soigneusement préparées. Les assistants sont mis en état de réceptivité par des chants, de la musique, etc ... Lorsque l’Esprit est bien disposé, il nous laisse un souvenir apporté de l’au-delà. Ce sont des objets tout à fait terrestres : fleurs artificielles, morceaux de papier coloré ; on les trouve facilement dans le commerce.
Nous n’avons guère jusqu’ici parlé que des médiums. C’est parce que le médium est indispensable ; tous les spirites vous le diront ; sans médium, pas de phénomènes. Ces médiums sont des personnes ayant reçu des dons spéciaux, leur permettant de communiquer avec l’au-delà. Leur système nerveux ultra-sensible fait d’eux des malades, une maladie enviable à bien des égards, car, pour peu que les circonstances soient favorables, elle fera leur fortune. Le médium sera couvert d’or, reçu par les rois ; il pourra même, parti de l’isba d’un moujik, gouverner l’État, tel Raspoutine.
Qu’y a-t-il de vrai dans les affirmations des spirites ?
Rien ! Et c’est bien à désespérer de l’humanité de la voir aussi stupide, en dépit de la T. S. F., de l’automobile et de l’aviation.
Tous les médiums ont été pris en flagrant délit de supercherie. Lié de corde et surveillé par une commission de professeurs, le médium parvient à libérer un membre et s’en sert pour déplacer un objet qui devrait se déplacer tout seul. La carrière d’un médium a trois phases : l’ascension, l’apogée et la catastrophe. Après un temps plus ou moins long pendant lequel le médium connaît tous les triomphes, on découvre la supercherie et il tombe à plat.
Mais, si l’individu disparaît, l’espèce subsiste. Un autre médium monte à son tour au ciel de la célébrité. La mésaventure du médium précédent est tout à fait oubliée. De nouveau, les journaux publient des articles sensationnels ; les revues scientifiques vantent les expériences ; la Sorbonne ouvre ses laboratoires, etc .. , etc ... Plein d’honneurs et d’argent, le médium est appelé dans le monde entier. Petit paysan, jeune ouvrier, ils ne connaissaient jadis que quelques kilomètres carrés de terrain ou le quartier pauvre d’une ville ; maintenant, le monde leur est familier. Avec un peu d’habileté et de truc, ils obtiennent beaucoup plus que tel savant ou tel artiste après toute une vie de travail ; ainsi va notre société, plus près de la barbarie qu’on ne pense.
La catastrophe, il est vrai, finit par survenir ; quelqu’un découvre la tromperie. Le médium est disqualifié ; adieu réceptions et voyages. Mais les prudents ont amassé leur magot et puis la disqualification n’est pas éternelle ; le médium trouvera toujours des consciences qui voudront bien le croire et le faire vivre.
Naturellement, les médiums tâchent de faire durer leur vogue le plus longtemps possible. Ils sont pleins de défiance et s’entourent de précautions. Un contrôleur leur paraît-il dangereux ? Ils le récusent, invoquent un prétexte quelconque pour ne pas opérer en sa présence ; le fluide contraire est un bon moyen d’éloigner les gêneurs. On déclare qu’un tel a un fluide qui contrarie les phénomènes ; la personne désignée n’a qu’à s’en aller.
A ceux qui voudraient voir, on répond que l’obscurité est indispensable ; si quelqu’un veut saisir le fantôme, immédiatement les compères l’en empêchent, alléguant un grave danger.
Malgré tout, nous l’avons dit, la supercherie est découverte tôt ou tard. On a trouvé le cheveu dont Euxapia Paladina se servait pour élever le plateau de la balance, abaissant ainsi l’autre plateau soi-disant chargé de fluide. Dans la célèbre villa Carmen, à Alger, le fantôme était une longue chemise blanche surmontée d’une tête de mannequin en carton. Les moulages soi-disant laissés par les corps astraux sont fabriqués par des magasins spéciaux, tel celui de M. Caroly, boulevard St-Germain. Il y a deux ans environ, les matérialisations de Nantes ont défrayé pendant plusieurs mois la presse. En fin de compte, c’était le jardinier qui assumait le rôle du fantôme ... un fantôme de jeune fille et plusieurs assistants ont pu saisir ses ... bretelles !
De grands savants ont cru au spiritisme. C’est cela que les spirites ne manquent pas d’objecter à leurs contradicteurs, laissant entendre à l’adversaire que lui, petit personnage, est bien osé, de se mettre au travers de gens célèbres qui se sont fait un nom dans leur spécialité. C’est là un argument d’autorité de valeur contestable. La fameuse preuve de l’existence de Dieu par Napoléon Ier qui, dit-on, y croyait, n’en est pas une. (Voir Savants (Les) et la Foi.)
On veut faire passer pour valeur réelle ce qui n’est la plupart du temps que le résultat d’une imposture sociale. Le savant est un bourgeois qui a été aiguillé, dès la jeunesse, dans une spécialité où il s’est fait connaître par ses travaux ; parfois il s’est illustré par une découverte due au hasard. Mais on répand partout le mensonge afin que le peuple soit persuadé que ses dirigeants : hommes d’État, généraux, savants, etc ... sont tous des êtres d’intelligence supérieure. Il faudrait écrire le « Plutarque a menti » des savants comme on l’a fait pour les militaires. Certes, le savant peut être un homme supérieurement intelligent, mais il ne l’est pas nécessairement ; la plupart sont des gens d’esprit moyen. Ils peuvent donc, tout comme les autres hommes, être les dupes d’un charlatan.
Parfois, le savant n’est pas dupe, mais il feint volontiers de l’être. Connu dans un cercle restreint de spécialistes, il est enchanté du médium qui fera parler de lui dans la grande presse. Si le médium se casse les reins, il en sera quitte pour déclarer bien haut qu’il n’y avait jamais cru. Enfin, tel savant, esprit puissant dans l’âge mûr, peut faiblir dans la vieillesse. Cela, joint à la hantise de la mort qui approche peut expliquer une adhésion au spiritisme.
Le spiritisme a beaucoup recruté durant les années qui ont suivi immédiatement la guerre. L’état de siège intellectuel avait abêti les gens et nombre de familles ayant perdu un fils dans l’hécatombe recherchaient des consolations dans cette doctrine illusoire.
Les journaux spirites, les livres sur « l’au delà » abondaient. La réincarnation était mise à la scène, des temples s’installaient dans une boutique qui ouvrait le soir ses volets et des gens s’y glissaient mystérieusement non pour tenter de renverser un gouvernement agressif, mais pour entendre un monsieur en jaquette débiter un fatras où il y avait du catholicisme, de la théosophie, une vague morale de bonté formelle et une politique réactionnaire. On chantait un cantique bébête et on s’en allait. Ceux qui avaient le temps revenaient dans la journée développer en des travaux pratiques leurs médiumnités latentes. Avec les années, le souvenir de la guerre s’est affaibli et les morts, tout à fait morts cette fois, ont cessé de faire marcher les tables.
Le spiritisme conserve cependant des effectifs assez nombreux.
Des religieux, que les religions officielles ont déçus, des malheureux qui viennent se consoler de la mort d’êtres chers et surtout une foule de déséquilibrés, demi-fous ou quart de fous. Car le nombre est beaucoup plus grand qu’on ne pense de gens qui, tout en étant capables de se tenir suffisamment bien dans la société, sont cependant des aliénés partiels. Dans le spiritisme, ils se sentent compris, alors que dans le monde ils n’osent parler de leurs ... phénomènes, craignant la moquerie.
Malheureusement, si le spiritisme satisfait les demi-fous, il ne les guérit pas, bien au contraire. Les pratiques spirites, à la longue, conduisent à la folie : à force de s’introspecter, de se dédoubler, d’être plusieurs en un seul, on finit par devenir tout à fait aliéné, surtout quand on l’est déjà un peu.
Est-ce à dire que la mort soit réellement ce que nous en savons ; on ne pourrait l’affirmer. Peut-être, dans un avenir qu’il n’est pas possible de déterminer trouvera-t-on que quelque chose survit de nous après la mort du corps. Mais ce qui est certain c’est que jusqu’ici, en dépit d’études et d’expériences multiples, jamais personne n’a eu connaissance d’un phénomène spirite bien constaté.
— Doctoresse PELLETIER.
SPIRITUALISME
n. m. (du latin spiritus, souffle, haleine)
Dissipons d’abord une confusion volontairement entretenue par les défenseurs des croyances traditionnelles entre le spiritualisme théorique et ce que l’on appelle, d’une façon bien peu heureuse à mon avis, le spiritualisme pratique. Le premier n’est qu’un ensemble incohérent de rêveries métaphysiques ; le second consiste à placer les joies de l’esprit et du cœur au-dessus des plaisirs sensuels, dans le comportement ordinaire de l’existence. En fait, ce furent des matérialistes les stoïciens qui, dans l’antiquité, pratiquèrent la morale la plus austère ; de nos jours, maints savants mécanistes et athées poussèrent le renoncement plus loin que les personnages cités en exemple par les écrivains catholiques. Et nombre de spiritualistes convaincus, de pieux croyants se vautrent dans des orgies qui n’intéressent que les organes sexuels ou le gosier ! Un matérialisme sain et bien compris devient normalement générateur de nobles rêves, de sympathie à l’égard de tous les hommes et d’une très haute moralité. Par contre, les élans d’un spiritualisme échevelé, les amoureuses aspirations des grands mystiques aboutissent fréquemment à un prurit sexuel qui passe, dans l’esprit des chrétiens naïfs, pour une tentation de Satan. Mais, en attribuant au spiritualisme le monopole de l’héroïsme et de la générosité, les bien-pensants cherchent à tromper les âmes éprises d’idéal et de poésie. Ils n’y réussissent que trop, grâce à la complicité de romanciers et de journalistes qui n’hésitent jamais à mentir pour aider au maintien des plus iniques préjugés.
Au point de vue théorique, l’histoire des doctrines spiritualistes est assez édifiante pour que nous la rappelions. Même lorsqu’ils admirent l’existence d’une âme, les anciens ne la conçurent pas comme une substance immatérielle. Le mot grec pneuma et le mot latin spiritus, qui servaient à la désigner, signifiaient primitivement le souffle, l’haleine. La même remarque s’applique d’ailleurs à tous les autres mots des anciennes langues hellénique et latine employés dans le sens d’esprit, d’âme. Preuve qu’aucune distinction radicale n’existait, selon les créateurs de ces langues, entre la matière et la pensée. A l’origine, l’expression hébraïque correspondant au pneuma des grecs signifiait, elle aussi, air, vent ; et le Lévitique affirme encore que « l’âme de la chair est dans le sang ». Le double des Égyptiens était pareillement de nature matérielle. Chez les peuples inférieurs actuels, on retrouve des conceptions très voisines. Frazer écrit :
« L’âme, comme le corps, peut être grasse ou maigre, grande ou petite ... On suppose en général que l’âme s’échappe par les ouvertures naturelles du corps, spécialement par la bouche et les narines. A Célèbes, on fixe quelquefois des hameçons au nez d’un malade, à son nombril, à ses pieds, afin que si l’âme veut s’échapper, elle soit accrochée et retenue ... Quand on baille devant eux, les Hindous font claquer leurs doigts pour empêcher l’âme de sortir. Les habitants des Marquises tiennent fermés le nez et la bouche des mourants pour prolonger leur vie en empêchant l’âme de sortir. »
Les premiers philosophes grecs restèrent fidèles à cette croyance en la matérialité de l’âme. On le constate sans peine chez les penseurs ioniens du VIème siècle. Selon Diogène d’Appolonie, l’esprit naît de l’air qui coule dans les veines avec le sang. D’après Héraclite, l’âme se nourrit d’air, grâce à la respiration. La majorité des médecins grecs continueront à faire du pneuma, non seulement la force animatrice du corps, mais l’âme elle-même. A l’inverse, Platon et Aristote conçurent l’esprit comme immatériel et partiellement indépendant de l’organisme. Principe de mouvement et de connaissance, l’âme, d’après Platon, est incorporelle, mais elle comporte plusieurs parties. L’une d’elles, l’intelligence, siège dans la tête ; c’est la partie raisonnable, divine et immortelle de l’esprit. Cœur et désir sont des parties dépendantes du corps et périssables comme lui ; la première est située dans la poitrine, la seconde « dans l’intervalle qui sépare le diaphragme et le nombril ». Selon Aristote, « l’âme est en nous le premier principe de la vie, de la sensation et de la pensée ». Elle n’est point substance mais forme ; c’est l’unité simple qui donne au corps l’action. Aristote déclare :
« L’âme ne saurait être sans le corps ; elle n’est pas un corps ; mais elle est quelque chose du corps. »
À chaque fonction du corps, il fait correspondre une puissance différente, et il arrive ainsi à distinguer l’âme nutritive, l’âme sensitive, l’âme motrice et l’âme intellectuelle. Cette dernière est elle- même composée de l’intellect passif, qui disparaît avec l’organisme auquel il est lié, et de l’intellect actif séparable du corps et immortel. Comme l’intellect actif est impersonnel et commun à tous les hommes, cette immortalité n’est d’ailleurs pas individuelle.
Chez les Pères de l’Église, la croyance à l’immatérialité de l’âme est loin d’être universellement admise. Tertullien déclare expressément que l’âme est corporelle ; il lui attribue une couleur, une figure et des dimensions déterminées. Dieu lui-même, pense-t-il, ne saurait être un pur esprit. Ce Docteur déclare :
« Qui niera que Dieu soit corps, quoique Dieu soit esprit ? Car l’esprit est un corps sui generis, avec des formes qui lui sont propres. Les êtres visibles, quels qu’ils soient, ont en Dieu leur corps et leur forme. »
Au IVème siècle de notre ère, l’évêque de Poitiers, saint Hilaire, défendait avec ardeur la thèse de la matérialité de l’âme. Origène lui-même, que l’on donne souvent comme le représentant type du spiritualisme chrétien, estimait que, Dieu excepté, tout esprit, soit céleste, soit humain, se trouve nécessairement uni à un corps subtil mais matériel. Faustus, qui fut nommé abbé de Lérins en 433 et évêque de Riez en 462, affirmait encore que, non seulement l’esprit de l’homme, mais les anges aussi sont composés d’une substance matérielle.
D’après les scolastiques, l’âme serait spirituelle, mais dépendrait néanmoins partiellement du corps. Thomas d’Aquin écrit :
« L’être de l’âme humaine dépasse la matière corporelle, il n’est pas complètement absorbé par elle, et cependant il est atteint par elle en quelque manière. En tant que l’âme dépasse la matière et qu’elle peut subsister et agir par elle-même, elle est une substance spirituelle. Mais, en tant qu’elle est atteinte par la matière et qu’elle lui communique son être, elle est la forme du corps. Or elle est atteinte par la matière, parce que toujours, comme l’enseigne saint Denys, l’être le plus parfait de l’espèce inférieure atteint l’être le moins parfait de l’espèce supérieure. »
Dès le début, déclare Thomas d’Aquin, l’embryon humain possède une âme végétative ; elle sera remplacée plus tard par une âme à la fois végétative et sensitive ; finalement surviendra une âme intellectuelle qui comprendra les deux autres en puissance et les absorbera.
« L’homme n’est ni l’âme ni le corps, mais une troisième chose qui résulte de leur union. »
Avec Descartes, la dualité entre l’esprit et le corps devient absolue. Le corps n’est qu’un pur automate ; ce qui constitue essentiellement et exclusivement l’homme c’est l’âme pensante :
« Partant de cela même que je connais avec certitude que j’existe et que cependant je ne remarque point qu’il appartienne nécessairement aucune autre chose à ma nature ou à mon essence, sinon que je suis une chose qui pense, je conclus fort bien que mon essence consiste en cela seul que je suis une chose qui pense. »
Je suis, avait-il déclaré ailleurs, d’une façon encore plus nette :
« Une substance dont toute l’essence ou la nature n’est que de penser et qui, pour être, n’a besoin d’aucun lien ni ne dépend d’aucune chose matérielle. »
De cette absurde conception cartésienne, terme final des élucubrations métaphysiques enfantées par le cerveau de philosophes doués de plus d’imagination que de bon sens, devait résulter les folies du spiritualisme moderne. Le bref exposé que nous avons fait des thèses soutenues au cours des siècles, sur la nature de l’âme, suffit d’ailleurs à montrer que ces doctrines s’apparentent aux mythes que chaque génération complique et modifie selon ses goûts, mais qui manquent absolument de toute base objective et ne valent qu’à titre de poèmes ou de romans.
Le dualisme continue d’être enseigné dans les écoles ; il constitue le fond du spiritualisme officiel. Pour lui, l’âme et le corps sont deux substances réelles mais hétérogènes ; unies dans l’homme, elles sont néanmoins irréductibles l’une à l’autre. Par malheur une pareille conception, de l’aveu des spiritualistes eux-mêmes, rend incompréhensibles les rapports de l’âme et du corps. L’oratorien Malebranche écrit :
« Comment comprendre que le corps qui n’est que de l’étendue puisse agir sur un esprit ? Comment comprendre que ma seule volonté suffise même à me faire lever le bras, puisque, pour cela, il me faudrait connaître le jeu des esprits animaux dans tous mes nerfs et muscles, alors que l’homme le plus ignorant en anatomie est capable d’exécuter ce mouvement sans difficulté ? »
Bien vainement Malebranche s’efforcera de trouver une solution à ce problème ; sa théorie des causes occasionnelles fit sourire même les plus dévots de ses contemporains. Tous ceux qui ont maintenu une séparation absolue entre l’âme et le corps ont abouti à un échec complet dans leurs tentatives d’explication. Aussi plusieurs ont-ils voulu supprimer le corps au profit de l’âme.
Spinoza estime que la pensée et l’étendue sont deux attributs d’une même substance :
« L’âme et le corps sont une seule et même chose qui est conçue tantôt sous l’attribut de la pensée, tantôt sous celui de l’étendue. »
Le corps demeure aussi réel que l’esprit, puisque chacun d’eux traduit la substance dans son langage particulier. Nous sommes conduit à un panthéisme qui équivaut à l’abandon du spiritualisme. Par contre, Leibniz sacrifie nettement la matière à l’esprit. Pour lui, la réalité se compose de monades, d’âmes plus ou moins analogues à la nôtre ; et ces monades inétendues tirent toutes leurs perceptions d’elles-mêmes, non de l’extérieur. La matière représente seulement le stade inférieur du développement de l’esprit ; entre elle et la monade la plus parfaite, il n’existe aucune différence de nature, aucune solution de continuité. Chez le minéral, la monade ne possède encore que des perceptions extrêmement confuses ; chez l’homme, elle demeure imparfaite et limitée, mais parvient déjà à des connaissances claires et distinctes. Au sommet se trouve la monade suprême, Dieu, dont les virtualités ont atteint un complet développement. Tout est esprit ; mais l’évolution de l’esprit n’est pas égale chez tous les êtres, et ce que nous appelons matière n’est qu’une dégradation de l’esprit.
Certains idéalistes vont plus loin et ne voient dans la matière qu’une illusoire apparence, une création subjective de l’activité mentale. Elle se réduit à une collection d’états de conscience et ne répond à rien de positif. Berkley affirme :
« La table sur laquelle j’écris, je dis qu’elle existe : c’est-à-dire je la vois, je la sens ; et si j’étais dans mon cabinet je pourrais la percevoir, ou quelque autre esprit la percevrait réellement. Il y a eu une odeur, cela veut dire : une odeur a été perçue ... Car pour ce qu’on dit de l’existence absolue des choses qui ne pensent point, existence qui serait sans relation avec ce fait qu’elles sont perçues, c’est ce qui me paraît parfaitement inintelligible. Leur esse consiste dans leur percipi, et il n’est pas possible qu’elles aient une existence quelconque, hors des esprits ou choses pensantes qui les perçoivent. »
L’évêque Berkley croyait porter un coup mortel à l’irréligion en niant l’existence de la matière et en attribuant à Dieu la charge de provoquer nos perceptions extérieures et de les coordonner entre elles. Mais les idéalistes du XIXème siècle ont jugé ridicule le rôle que Berkley prêtait à Dieu ; dans la matière ils ont vu de préférence une production de notre esprit, un symbole qu’il élabore pour ses besoins pratiques.
Incontestablement, nous sommes en plein roman métaphysique ; un feu d’artifice verbal, de nébuleuses rêveries que ne justifient ni l’expérience ni la raison, voilà où aboutit l’effort des penseurs spiritualistes. Dunan, un spiritualiste, a reconnu, dans un moment de sincérité, que tous ces systèmes jonglaient avec des mots vides d’idées. Il écrit :
« Il est clair que définir l’âme par le caractère de l’immatérialité ou, comme on dit encore, de la spiritualité, sans rien de plus, c’est n’en donner aucune notion positive ... C’est un mot nous donnant l’illusion d’une idée, non une idée véritable. Penser l’âme comme nous venons de le dire, c’est donc, à proprement parler, ne rien penser du tout. »
Et, pour conserver néanmoins le spiritualisme cher aux prêtres et aux gouvernants, Dunan déclare qu’il est :
« Un besoin de l’esprit plutôt qu’une doctrine définie, une pensée latente faisant effort pour s’exprimer en des conceptions claires systématiquement ordonnées sans espérance d’y parvenir jamais d’une manière parfaite. »
Peut-on imaginer échappatoire plus piteuse ! C’est un refus pur et simple de fournir aucune explication et d’apporter des arguments capables de convaincre un chercheur de bonne foi. Quel tollé, si un matérialiste tenait un langage pareil ! Ajoutons qu’appliqués à Dieu, les adjectifs immatériel et spirituel demeurent aussi creux, aussi vides de sens que lorsqu’on les applique à l’âme.
Bien qu’ils accumulent les sophismes avec une inconcevable légèreté, les spiritualistes ne parviennent d’ailleurs point à démontrer que le cerveau est incapable de rendre compte de la pensée. Ils déclarent :
« La pensée est toujours une unité dans une multiplicité ; à l’opposé le corps est une multiplicité pure. »
Or il est indéniable que l’organisme implique l’unité dans la multiplicité des mouvements ; inutile donc d’expliquer l’unité de la pensée au moyen d’une substance immatérielle. Ils disent encore :
« Tous les phénomènes psychologiques exigent un principe qui demeure identique ; et le corps ne saurait être ce principe puisqu’il paraît soumis à un devenir incessant. »
Ils oublient que, dans le corps et le système nerveux, les éléments nouveaux remplacent les éléments anciens en prenant leurs formes et leurs dimensions. Ainsi se trouve assurée une identité organique que l’on peut aisément constater. Enfin, les spiritualistes affirment que :
« L’esprit est essentiellement actif, tandis que le corps est passivité pure. »
Or il appert de plus en plus que, non seulement les organismes vivants, mais les corps bruts eux-mêmes sont doués de mouvements. La passivité de la matière a été reléguée au rang des opinions surannées par les physiciens modernes.
C’est en vain que Maine de Biran, Ravaisson, Lachelier, Boutroux s’efforcèrent de rajeunir le spiritualisme rationaliste en s’appuyant sur l’analyse psychologique et la réflexion intérieure. Maine de Biran assure :
« Sans doute, l’âme, considérée dans sa substance est un X insaisissable, mais par la réflexion sur soi le sujet se connaît comme cause et se distingue de tous ses phénomènes. Dans l’effort, ce fait primitif, le moi se saisit dans son opposition au non-moi, et par suite se pose lui-même en s’opposant à ce qui n’est pas lui. »
Dans la pensée, Lachelier voit :
« L’être idéal qui contient ou pose a priori les conditions de toute existence. »
Pour Boutroux, la conscience humaine est :
« L’acte par lequel une multiplicité et une diversité d’états sont rattachés à un moi, l’appropriation des phénomènes à un sujet permanent. »
Aussi :
« Plus que tous les autres êtres, la pensée humaine a une existence propre, est à elle-même un monde. »
La logomachie prétentieuse de ces pontifes, leur verbiage ébouriffant, l’aide qu’ils reçurent des pouvoirs publics ne suffirent pas à terrasser le matérialisme, considéré comme indésirable par les autorités universitaires aussi bien que par les prélats catholiques. Aussi, Bergson fut-il accueilli avec enthousiasme, lorsqu’il vint jouer de la guitare irrationaliste. C’est du dedans que chacun peut saisir la réalité de l’esprit, grâce à une mystérieuse intuition. Alors, prétend Bergson, la vie intérieure apparaît comme un progrès, une force créatrice, le prolongement de l’élan vital qui est « la conscience lancée à travers la matière ». Cet élan passe :
« Traversant les générations humaines, se subdivisant en individus : cette subdivision était dessinée en lui vaguement, mais elle ne se fût pas accusée sans la matière. Ainsi se créent sans cesse des âmes, qui cependant, en un certain sens, préexistaient. Elles ne sont pas autre chose que les ruisselets entre lesquels se partage le grand fleuve de la vie, coulant à travers le corps de l’humanité. Le mouvement d’un courant est distinct de ce qu’il traverse, bien qu’il en adopte nécessairement les sinuosités. La conscience est distincte de l’organisme qu’elle anime, bien qu’elle en subisse certaines vicissitudes. »
Selon sa coutume, notre académicien n’apporte aucune preuve à l’appui de ses dires ; son hostilité systématique à l’égard de l’intelligence le dispense de fournir des arguments d’ordre rationnel ; des comparaisons, de grands mots, de belles phrases lui semblent suffisants pour engendrer la conviction. Son imagination enfante des mythes qui n’ont même pas, dans l’ensemble, le mérite de l’originalité ; et son intuition fut une de ces fumisteries qui suffisent à condamner les causes qu’elles s’efforcent de servir. Aujourd’hui, le spiritualisme n’est pris au sérieux que par les arrivistes, les snobs et les ignorants ; malgré la Sorbonne, malgré les ministres républicains, malgré tous les docteurs de l’Institut, il n’inspire aucune confiance à celui qui prend la peine de réfléchir.
— L. BARBEDETTE.
SPORT
n. m. (mot anglais)
Vient de l’ancien français : desport qui signifie : amusement. Il est employé pour désigner tout exercice en plein air : course de chevaux, pêche, chasse, canotage, tir, escrime, gymnastique, football, bicyclette, etc. Le sport « est la pratique méthodique des exercices physiques, non seulement en vue du perfectionnement du corps humain, mais encore de l’éducation de l’esprit » (Larousse). On voit que, d’après cette définition, le domaine du sport est très vaste. Il englobe non seulement les jeux, mais tous les exercices d’entraînement, physiques et intellectuels. Toutefois, dans l’acception courante du mot sport, entre une idée de compétition qui ramène la chose aux exploits athlétiques. C’est le point de vue étriqué de la question, nous l’étudierons plus loin. D’une façon générale, le sport étant pratiqué en vue du développement harmonieux de la personne, il en résulte qu’est sport tout effort méthodique accompli dans ce but. Nous pourrons dire, en élargissant la chose jusqu’à son ultime limite : le sport, c’est la lutte même et c’est la vie.
« Être, c’est lutter ; vivre, c’est vaincre. » (Le Dantec)
Il est évident que l’homme, dont l’origine remonte à une époque très reculée, n’a pu s’adapter aux diverses périodes préhistoriques qu’en luttant sans cesse contre les conditions changeantes de vie. Il a été pour lui d’une nécessité impérieuse d’habituer son corps à résister aux variations atmosphériques, aux maladies, au milieu ennemi. Il a fallu qu’il s’ingénie à dominer ce milieu, sinon c’était la fin de l’espèce, comme ça l’a été pour certaines espèces animales (mammouth, bison). Il a fallu qu’il éduque son corps à la course, à la natation, à la lutte. Il a fallu que, dans son cerveau, jaillisse la première lueur d’intelligence qui, justement pour combattre les forces mauvaises acharnées à sa perte, lui a permis d’ajouter à sa force et à son agilité, son ingéniosité, son adresse, sa ruse. Tout cela a demandé des expériences sans nombre, tout cela a coûté d’innombrables vies. Mais l’homme a triomphé grâce à cet entraînement incessant. Si maintenant nous considérons l’individu en lui-même, nous voyons que, depuis le jour où il a été conçu jusqu’à celui de sa mort, c’est encore par la pratique incessante de la lutte contre le milieu hostile qu’il est parvenu à vivre. Il lui faut sa place au soleil, coûte que coûte. Si on la lui dispute, il se rebelle ; et s’il est le moins fort, il succombe. La vie est le triomphe du muscle allié au cerveau.
Le fœtus se développe au détriment de sa mère ; l’enfant fait la connaissance de tout ce qui l’entoure pour mieux éviter les embûches, pour mieux s’imposer plus tard. Et plus cette connaissance sera poussée, plus l’espèce de carapace qui l’emprisonne sera disloquée, plus il acquerra de maîtrise et de confiance en soi. Il en est de même pour tout être vivant. Nous pouvons dire que le sport date des origines de la vie. Mais au fur et à mesure que l’homme s’est élevé, il a cultivé son intelligence au détriment de ses muscles. Cette intelligence lui a permis, en effet, de ménager ses efforts et d’atteindre des buts bien plus étendus. La massue fut supérieure aux poings de l’anthropoïde. La hache, l’arc, l’arbalète, le fusil, le revolver, la mitrailleuse, marquent dans l’art de la défense et de la destruction les étapes de ce progrès. Aujourd’hui, l’intellectuel tendrait à n’être plus qu’un cerveau. D’où cette anomalie : une tête bien faite sur un corps débile. En réaction : revenons au culte du muscle ; allons aux exercices physiques ; allons aux sports ! La vérité est dans la conciliation des extrêmes :
« Le corps d’un athlète et l’âme d’un sage, disait Voltaire, voilà ce qu’il faut pour être heureux. »
Et il pensait sans doute à Eschyle, à Sophocle, vainqueurs aux jeux olympiques, ou à Platon, « l’homme aux larges épaules ». Un corps d’athlète ne s’acquiert que par un méthodique entraînement. Le corps humain est une machine dans laquelle les combustions organiques doivent être actives pour ne laisser aucun déchet ; mais il faut, pour assurer son bon fonctionnement, que tous ses organes soient harmonieusement développés. D’où la nécessité de pratiquer des exercices rationnels et progressifs. Ces exercices sont utiles à l’enfant qui se développe chaque jour ; ils sont utiles à l’adolescent et à l’homme mûr pour entretenir la souplesse des organes ; ils sont indispensables dans certains cas (arthritisme, obésité) pour redonner au corps sa capacité de résistance et de rendement. Les méfaits de la sédentarité — cette plaie de la « civilisation » — sont connus. Voici, à ce sujet, l’opinion du Docteur G. Durville :
« … en collaboration avec l’alimentation mal comprise, elle crée deux types opposés de malades : les gras et les maigres. Les gras sont des déchus à la première période : leur organisme résiste à la sédentarité en entassant de la graisse dans les tissus, en congestionnant le foie et les viscères, en hypertendant la circulation sanguine ; de temps en temps, quand l’organisme est par trop plein, une soupape s’ouvre, qui déverse le trop plein : c’est la crise d’eczéma, de furoncles, d’entérite, de saignements hémorroïdaire, utérin, nasal, etc., la crise de gravelle, de rhume, de toux, etc. Par cette crise de nettoyage toujours considérée comme une mauvaise chose, alors qu’elle est un sauveur, le gras retrouve, pour un temps, des conditions plus normales de vie ; il a puisé en lui l’énergie de réagir. Comme il va récidiver à la même existence, une nouvelle crise reviendra un jour, mais sans doute serat-elle moins efficace, car l’organisme prend de l’âge et s’use ; il arrivera même, peut-être, que l’organisme laisse ouvrir la soupape là où il ne faut pas. Au lieu des veines hémorroïdaires, si une artère cérébrale s’ouvre, parce que devenue durcie, cassante, artério-sclérieuse, ce sera l’apoplexie, mortelle peut-être. Les maigres sont des types plus déchus de sédentarisés. Ce sont souvent des fils de sédentaires et de dyspeptiques. Leur organisme débilité n’a plus la force de faire de la graisse. Même s’ils mangent « bien », c’est-à-dire « trop », « rien ne leur profite plus », car leur nutrition est trop tarée. S’il leur arrive de prendre, par hasard, du poids, leur embonpoint est fugace ; en quelques semaines, ils l’ont reperdu ; ils sont redevenus ces êtres jaunes, faibles, à ventre flasque et vide, gastritiques et entériteux, sans muscle et sans ressort. La sédentarité a fait cela. La sédentarité détruit la forme de l’être. Or, quand l’être perd sa forme, il devient non seulement laid, mais malade. » Et, plus loin : « D’où provient cette déchéance ? Il se passe que le muscle s’en va, et avec lui la forme du corps. Il n’est pas douteux qu’aux yeux de bien des gens, le muscle a une mauvaise réputation. Combien d’intellectuels, aujourd’hui encore, regardent le muscle comme un instrument pour imbéciles et pour brutes ! Pourtant, pendant plus de mille ans, la Grèce sut imposer au monde sa suprématie, grâce à sa splendide conception de l’éducation musculaire. L’idéal de beauté, c’était alors le discobole ou le gladiateur, admirables de vigueur et d’optimisme. Il est navrant qu’à la saine conception de la beauté grecque ait succédé celle qui donnait en modèle un Christ amaigri, crucifié et renonçant. Si le christianisme avait pris au paganisme son amour de la beauté naturelle, le eût été une époque de lumière. Il y a parallélisme entre la vigueur d’un muscle et la beauté de sa ligne, car la nature est essentiellement logique. Beauté et santé sont les deux faces d’une même médaille ou, plus exactement, la beauté est l’extérieur de celle-ci et la santé l’intérieur. Et la splendide cage thoracique des statues de l’ancienne Grèce signifie maximum de force et de résistance des poumons et du cœur. Socrate et Platon ne furent pas seulement des génies de la pensée, ils furent aussi des athlètes s’exerçant nus sous le soleil. En sédentarisant son corps, on abaisse ses résistances. Les atrophiés du muscle donnent naissance à des enfants débiles, insuffisants des glandes, arthritités à l’avance et délicats. Les sédentaires trahissent leur descendance... Il faut savoir qu’à presque toutes les maladies de la nutrition, à presque toutes les asthénies, à toutes les affections chroniques, correspond un appareil musculaire insuffisant ou inactif. Toute déchéance de la forme normale, c’est-à-dire athlétique, du corps humain, va de pair avec une vitalité diminuée. » (La Cure Naturiste.)
Comment réagir ? Par les exercices physiques. Ils s’effectueront autant que possible en plein air, sous les rayons régénérateurs du soleil, le corps nu (voir : Nudisme) et se composeront de mouvements simples, capables de développer l’harmonie des formes. L’équilibre des fonctions ne s’obtiendra qu’à la condition de ne pas surmener certains groupes d’organes au détriment d’autres groupes, et en restant toujours dans la limite de résistance physiologique de l’individu. Suivrat-on la méthode analytique ? (méthode suédoise de Ling), ou synthétique ? (méthode « naturelle » d’Hébert). Celle-ci connaît la plus grande vogue. Elle repose sur la pratique des exercices naturels : marche, course, saut, grimper (appuis, suspensions, équilibres et escalades), lancer (avec le jonglage), lever, défense (lutte et boxe), natation. Elle comprend aussi les bains de soleil et d’air pur, ainsi que des séances de repos. Toutes choses d’ailleurs que pratiquaient les Grecs. Le sport ainsi compris, débarrassé des vanités de la compétition et des prouesses des recordmen augmentera la force, la souplesse et la résistance du corps et deviendra le premier élément de la santé et du bonheur. « L’âme d’un sage » s’acquerra par la pratique parallèle du sport intellectuel, par cette gymnastique de l’esprit qui développe au plus haut degré le désir de savoir, par l’éducation méthodique de la volonté qui rend l’homme vraiment maître de lui, dominant ses instincts, et capable de s’élever à cette sérénité suprême où le corps est l’instrument d’exécution des décisions mûrement pesées par la raison. C’est alors que sera atteint l’idéal antique : une âme saine dans un corps sain.
Les Romains, et davantage encore les Grecs, ont été amoureux de la beauté des formes humaines. Mais la pratique des exercices gymniques remonte à des temps très anciens. Il y a 3600 ans, le Cong-fou chinois traite d’éducation physique rationnelle avec façons profitables de bien tenir son corps et de bien respirer. Cette gymnastique curative fut connue aussi dans l’Inde et en Egypte. Les mêmes exercices furent pratiqués par les asiatiques occidentaux dans leurs rites funéraires, leurs cérémonies religieuses et dans l’agonistique guerrière. Les Grecs arrivèrent à la perfection de la beauté physique par la pratique de la gymnastique ; leur merveilleuse statuaire, qui en est le témoignage, fera toujours l’admiration des hommes. À Sparte :
« L’Etat s’occupe de l’enfant dès sa naissance : mal constitué, est exposé sur le Taygète ; solide, il reste aux mains des femmes jusqu’à sept ans, âge où commence son éducation publique, militaire. Un pédonome réunit en groupes les enfants de la même année ; eux-mêmes élisent, parmi des camarades plus âgés, des moniteurs qui dirigent les exercices, assistés de « fouettards ». Exercices violents : gymnastique, lutte, jeu de balle ; à côté de cela, une culture de I’esprit très élémentaire ; on admet la musique, pour accompagner les chants guerriers. Et l’éducation des filles est à peu près semblable. » (Maxime Petit : Histoire Générale des Peuples.)
Du même ouvrage :
« L’Athénien était un bon soldat, intelligent, courageux, manquant parfois de discipline, très supérieur aux Spartiates dans la guerre de sièges. L’éducation du militaire se confondait avec celle du citoyen, elle avait pour bases le patriotisme et l’entraînement physique. Ce dernier trait distinguait l’Hellène du barbare, qui ne s’entraînait pas méthodiquement et s’étonnait des exercices que les Hellènes exécutaient dans un état de nudité complète, d’où le nom de gymnastique. À cette éducation, on s’accoutumait déjà, à douze ans, dans des palestres privés ; à dix-huit ans commençait l’apprentissage des armes, lors de l’entrée dans l’éphébie. »
Et lorsque l’éphèbe est citoyen :
« Pendant un an, il fréquente un des trois grands gymnases, l’Académie, le Lycée, le Cynosarge, y pratique le saut, la course, la lutte, l’équitation, le maniement des armes, la manœuvre en peloton. » (pp. 58 et 67)
Cette faveur dont jouissaient les exercices physiques a son écho dans les œuvres littéraires. Nous cueillons, dans l’Odyssée, ce récit « sportif » des exploits d’Ulysse (Chant VIII) :
« Il dit, et, sans se dépouiller de son manteau, il se précipite du siège, saisit une pierre deux fois plus grande et plus lourde que le disque lancé par les Phéaciens ; et, la tournant en l’air avec rapidité, il la jette d’un bras vigoureux ; la pierre vole et tombe au loin avec un bruit grondant et terrible. Ce peuple de hardis nautoniers, ces fameux rameurs qui brisent les flots, se croient frappés et s’inclinent jusqu’à terre. »
Et ces paroles d’Alcinoüs :
« Nous ne prétendons point nous illustrer au pugilat ni à la lutte, mais nos pas atteignent en un moment le bout de la lice, et rien n’égale le vol de nos vaisseaux. Toujours brillants d’une nouvelle parure, nous coulons nos jours dans les festins, le chant et la danse ; les bains tièdes font nos délices ; le sommeil a pour nous des charmes. »
Enfin, cette description d’un match de football (si l’on peut dire !) :
« Ils prennent un ballon d’une pourpre éclatante, sorti des mains de l’industrieux Polybe ; tandis que, tour à tour, l’un, se pliant en arrière, jette ce ballon jusques aux sombres nuées ; l’autre, s’élevant d’un vol impétueux, le reçoit avec aisance et grâce, et le renvoie à son compagnon avant de frapper la plaine de ses pas cadencés. Quand ce ballon lancé a montré leur force et leur adresse, ils voltigent sur la terre avec des mouvements variés et une prompte symétrie. La nombreuse jeunesse, debout autour du cirque, faisait retentir l’air des battements de leurs mains, et tous éclataient en tumultueux applaudissements. »
Il y avait diverses catégories d’athlètes, mais tous devaient être de condition libre et Grecs de naissance. On distinguait les lutteurs, les coureurs, les pugilistes, les lanceurs de javelots et de disques, les pancratiastes. Suivant leur âge, on les classait en trois groupes : enfants (12 à 16 ans), adolescents (16 à 20 ans) et adultes. Les athlètes rivalisaient dans les grandes fêtes sportives ou grands jeux, dont la plus renommée était les Jeux Olympiques, célébrés à Olympie, en l’honneur de Zeus. Le premier jour était consacré aux cérémonies religieuses, puis on assistait aux fêtes du stade qui comprenaient les épreuves de courses à pied, de lutte et de pugilat. Les lutteurs combattaient le corps nu, enduit de sable et d’huile. Dans la course, on distinguait la. course simple (stade), le double stade (diaule), la course longue (dolique), la course en armes et la course aux flambeaux (larnpadédromies). Dans le pugilat, les adversaires se portaient de terribles coups avec leurs poings garnis de plomb. Le pancrace qui combinait la lutte et la boxe était plus sauvage encore puisque tous les moyens étaient permis pour terrasser l’adversaire. Les fêtes se continuaient à l’hippodrome par des courses de chevaux et de chars, parfois par des chasses, des combats d’animaux féroces, des naumachies ; elles se terminaient au stade par le pentathle (saut, lancement du disque, du javelot, course et lutte) et par la course en armes (bouclier et casque). La course était un exercice très en honneur ; on organisa partout des courses de jeunes gens, mais il y eut aussi des courses de jeunes filles à Cyrène et à Sparte. Des coureurs, en se relayant, remplirent l’office de courriers, et l’on connaît l’exploit de celui qui expira après avoir annoncé à Athènes la victoire de Marathon. Aux Jeux Olympiques, le vainqueur recevait simplement une couronne d’olivier sauvage et c’était un honneur très grand pour lui d’avoir triomphé. Mais à la fin du Vème siècle, les jeux se commercialisèrent : le métier nourrit son homme. On vit Pindare chanter les exploits du stade. Le vainqueur obtint de nombreux privilèges dont les plus substantiels furent les exemptions d’impôts et la nourriture au prytanée. Il reçut en récompense des sommes d’argent, des couronnes, des objets précieux et des statues (Discobole, Diadumène, Apoxyomène, etc.) À Rome, les athlètes apparurent un siècle avant notre ère. Plus tard, les jeux dégénérèrent en luttes de factions, le peuple prenant parti pour l’une ou pour l’autre de ces factions reconnaissables suivant la couleur des casaques des cochers, Mais ce n’était plus de la gymnastique, ni de l’éducation physique, c’était presque le... sport dans ce qu’il a de plus mauvais. On vit ainsi, à Byzance, tout le peuple divisé en bleus et en verts. Chaque corporation avait ses chefs élus (démarques) avec ses milices. Leur rivalité déborda l’enceinte du cirque, envahit la ville et s’étendit à tout l’empire. La vie publique fut profondément troublée par ces luttes aux VIème et VIIème siècles.
Avec le christianisme, le corps humain devint l’enveloppe méprisable. Il disparut sous les draperies.
« ... On vit alors se déchaîner cette rage bien connue des fanatiques contre la chair, considérée comme le principal obstacle à toute impulsion intellectuelle et morale. La terre devint une vallée de larmes ; la nature fut l’objet de la malédiction divine, le corps parut méprisable, et l’on s’ingénia à l’outrager et le martyriser. L’apôtre Paul, le vrai fondateur de la nouvelle religion avait dit :
« Ceux que le Christ a conquis, ont crucifié leur chair avec leurs passions et leurs désirs. »
« Au Moyen Âge, durant cette époque grossière d’arbitraire féodal et de fanatisme théocratique, de soi-disant serviteurs de Dieu avaient poussé les choses à ce point qu’on en vint à mépriser la matière et que des hommes clouèrent au pilori leur propre corps, ce noble ouvrage de la nature. Les uns se crucifiaient, d’autres se torturaient ; des troupes de flagellants parcouraient le pays en tous sens, exposant aux regards leurs corps qu’ils avaient eux-mêmes lacérés ; on cherchait à détruire la force et la santé par les moyens les plus raffinés, afin de laisser à l’esprit, indépendant de la matière et surnaturel, la prépondérance sur son misérable substratum. » (Louis Büchner, Force et Matière, Ch. V.)
Le Moyen Âge fut une époque de crasse intellectuelle et physique. Nous sortons à peine de cette époque à ce sujet. Si quelque actrice, pour exciter le bourgeois, peut s’exhiber aujourd’hui toute nue sur la scène, les nudistes intégraux sont obligés de rechercher des endroits isolés pour livrer leur corps à la caresse bienfaisante de l’air et du soleil. Il n’y a pas encore si longtemps, dans les peintures et les sculptures, la feuille de vigne émasculait l’individu. La race des cuistres qui insultaient ainsi à la beauté humaine n’est point disparue ; l’attentat à la pudeur est toujours inscrit dans l’arsenal de nos lois. Cependant, la réprobation qui frappait le corps d’anathème s’est estompée au fur et à mesure que s’écroulaient les dogmes. Mais aussi une réaction suscitée par le capitalisme dans un but de défense (abrutissement des esprits et préparation à la guerre) a poussé les foules à pratiquer ou à admirer le sport tel que nous le connaissons aujourd’hui. Actuellement, nous pouvons classer les individus en trois catégories :
-
Les pratiquants du sport rationnel ;
-
Les professionnels du sport ;
-
Les foules passionnées pour les exploits athlétiques accomplis par les professionnels.
Les pratiquants du sport rationnel, relativement peu nombreux, sont gens de saine raison qui, d’une façon souvent discrète, s’exercent à vivre harmonieusement. Amoureux d’hygiène, d’air pur, de soleil ; amis des divertissements profitables à leur santé, ils cherchent avant tout à atteindre ce sommet où ils peuvent se considérer comme des « êtres complets » et ils tâchent de s’y maintenir. Ce sont, souvent, des contempteurs de notre infecte « civilisation » qui a créé ces monstruosités : les villes modernes avec leurs bagnes d’usines et de bureaux, avec leurs taudis, foyers de misère et de tuberculose. Aux moments de loisirs, ils fuient la ville qui tue, pour la campagne, pour la mer, pour la montagne, qui vivifient. Et là, sans désir d’exhibition malsaine, tout naturellement comme font les bêtes dites sauvages livrées à elles-mêmes dans la nature, ils s’ébattent pour le plus grand plaisir de leurs sens, pour le plus grand profit de leurs muscles. C’est comme s’ils remontaient le cours des siècles ... Et, se débarrassant de toutes les entraves imposées par le milieu « civilisé » (faux-col, chaussures, chemise même) ils redeviennent l’animal primitif qui court, saute, grimpe, joue, nage librement comme aux époques où la « morale » n’existait pas ! Le mouvement nudiste est une des plus belles résurrections des époques antiques où les hommes étaient fiers de la beauté de leurs formes. Mais dans le canotage, dans la pêche, dans la chasse, et aussi dans les sports d’application comme le hockey, le tennis, le basket-ball, quelle belle gymnastique des muscles pour la coordination des mouvements, quel développement des réflexes mentaux qui accoutument à prendre de rapides décisions, quel profit pour le corps et pour l’esprit ! Ici, le sport est ce qu’il y a de plus pur, de plus socialement désintéressé, de plus profitable individuellement. Le sport est la vie intense et belle.
Avec les professionnels du sport, nous passons dans le mercantilisme du siècle. Avec les passionnés — physiquement inertes — qui se repaissent des gestes de ces professionnels, nous touchons à la question sociale. Mais ici, il faut prendre la chose de plus loin. L’homme garde en lui-même un vieux fonds d’ancestrale brutalité. Lorsqu’il n’a pas été longuement habitué à réfléchir, à raisonner, à faire la critique scientifique des faits dont il est témoin, il s’abandonne à ses impulsions premières, et l’on aperçoit très vite alors, sous le léger vernis des convenances, l’être primitif avide de sensations violentes, de spectacles où la force domine, et même où le sang coule. Le panem et circenses n’est pas seulement la formule de mépris de Juvénal pour les Romains de la décadence, il exprime le besoin profond des hommes encore voisins de l’animalité. Il faut des tempéraments artistes pour goûter pleinement les plaisirs de l’esprit. Aujourd’hui, comme autrefois, Aristophane, Molière, Hugo, ont moins d’admirateurs que tel boxeur réputé ; et le nom du savant qui aura fait de merveilleuses découvertes restera ignoré des foules tandis que la biographie d’un quelconque saltimbanque des sports sera connue des bambins de l’école ! Or, tout individu ou tout groupe d’Individus qui dispose de l’autorité demande des foules dociles. Ces foules le seront d’autant plus qu’on leur masquera les causes de leur misère. La religion a été longtemps le dérivatif nécessaire : on pensait selon une certaine morale éminemment profitable aux puissants. La religion s’écroulant comme s’écroulent toutes choses qui ont trop duré, on a trouvé de nouveaux opiums pour endormir les foules ; ces poisons ont nom : politique, alcool, presse, cinéma, sports ... Par l’instruction distribuée au comptegouttes, par I’éducation dirigée dans un sens contraire aux intérêts du prolétariat, le capitalisme a réussi à créer des « citoyens » sachant tout juste lire les décrets et les lois et aptes à s’agenouiller devant les idoles du jour. Par la presse, il a complété l’abrutissement commencé dès l’enfance la plus tendre. Le service militaire vient à point pour couronner le chef-d’œuvre. L’individu est mûr alors pour l’exploitation intensive en temps de paix et pour enrichir les marchands de canon l’heure venue. Encore faut-il qu’il soit de constitution assez robuste pour tenir sa place à I’usine et à l’ost. De là, la nécessité de créer et d’entretenir une mentalité sportive. De là, le sport plus ou moins officiel et subventionné. Déjà, les Anciens, nous 1’avons vu, (Assyriens, Grecs), par les exercices physiques se préparaient à la guerre. Lorsque le corps était un objet de mépris, Rabelais, Montaigne et Rousseau préconisaient l’éducation physique ; la gent militaire sentait confusément tout ce qu’elle pouvait tirer de ces indications. Cela commença en Prusse, après Iéna : le pays avait besoin de vigoureux soldats. Le professeur Iahn conçut une méthode très complète d’entraînement physique. À Stockholm, Ling créa, en 1815, une méthode nouvelle. Des gymnases furent construits au Danemark, en Suisse, en Belgique. En France, un institut de gymnastique, sous l’impulsion du colonel Amoros, fut installé dans la plaine de Grenelle ; il devait devenir plus tard l’Ecole Normale Militaire (Joinville).
« C’est au ministre V. Duruy que revient le mérite d’avoir, en 1868, introduit ce genre d’enseignement dans les lycées et les collèges. Enfin, après la guerre de 1870, se produisit, dans une pensée patriotique, une renaissance véritable de l’éducation physique. » (Larousse)
Aujourd’hui, ça commence avec les multiples sociétés de scoutisme qui se disputent l’enfance. Une des plus laïques de ces associations écrit dans sa « loi scoute » :
« .... L’Eclaireur sait obéir ... L’Eclaireur est travailleur, économe et respectueux du bien d’autrui... »
Et, au chapitre discipline :
« La discipline, chez les Eclaireurs, est une discipline librement consentie, non une discipline imposée. Elle repose sur l’adhésion complète à la loi, dont ils sont habitués eux-mêmes à être les gardiens. »
Il sera si facile, par la suite, lorsque le scout sera devenu un homme, de lui. faire croire à des « disciplines librement consenties », et de le rendre obéissant aux lois, même à celles qui lui demanderont sa vie pour que « la Patrie ne meure pas » (!). Quoi qu’il en soit, l’enfant, tout de suite, devient un matricule sous un uniforme ; il est respectueux de ses « chefs », prêt à se plier aux ordres reçus sans discussion ni murmure. Le refrain dit :
« La discipline faisant la force principale des armées. »
On aperçoit aussitôt le but poursuivi par ces sociétés. Comme on comprend qu’une « Médaille d’Honneur de l’Education Physique » vienne récompenser les bons valets qui ont rendu des services au sport, à la préparation militaire et à l’éducation physique ! (Décret du 4 mai 1929). D’ailleurs, les personnalités officielles ne cachent pas leur jeu :
« Le maréchal Pétain, lisons-nous dans la revue l’Animateur des Temps Nouveaux, assistant un jour à une réunion sportive, paraissait médiocrement intéressé : – Que pensez-vous des joueurs, M. le Maréchal ? lui demanda un officiel. – J’aimerais mieux, répondit le Maréchal, voir ces vingt-deux joueurs sur les gradins et ces milliers de spectateurs dans l’arène. »
Evidemment, l’ogre sentait la chair fraîche ; il la voulait à point pour la prochaine « heure H ». Voici, du Soldat de Demain, un écho non moins officiel :
« M. Adolphe Chéron, président de l’Union des Sociétés d’éducation physique, interviewé par M. Ménard, rédacteur au journal l’Auto sur ce que pourraient être les progrès du sport au cours de l’année 1933, a fait les déclarations suivantes :
« Au début de la nouvelle année, je continue à demander des terrains de jeux et des pelouses pour les écoles et les clubs. Où sont ceux dont l’aménagement avait été prévu sur la zone dès le lendemain de la guerre et dont le regretté Frantz-Reichel et moi-même rappelions la nécessité devant la Commission départementale de la Seine ? Oui, des terrains de jeux nombreux à la portée de la jeunesse, dans la banlieue immédiate des villes comme dans les campagnes et aussi des locaux dignes de l’activité des Fédérations. Sur le plan de la formation des maîtres : d’une part, la reconstruction de I’Ecole Supérieure d’éducation physique de Joinville et, d’autre part, l’ouverture de l’Ecole Normale d’application des professeurs de l’Université, constituant chacune sur son terrain, les deux éléments essentiels et inséparables de l’Institut national, seul capable d’assurer à la méthode française des progrès renouvelés et fondés à la fois sur la science de la vie, sur l’expérience, sur le contrôle des résultats. »
Citons aussi cette riposte (qui en dit long) de l’Union des Sociétés d’éducation physique et de préparation au service militaire, présidée par M. Chéron (un périodique sportif accusait une Fédération d’avoir « touché un million pour construire un siège social » :
« L’Union, pour les besoins de ses sociétés, a participé, dès le lendemain de la guerre, à la campagne des stades. On peut même dire qu’elle fut des premières, sinon même la première, à ouvrir cette campagne par ses créations du Parc Saint-Maur. À ce premier stade, d’autres, par la suite, s’ajoutèrent : à Saint-Maur, un deuxième stade et une école de natation ; au Perreux, un stade complet : à Romainville, un terrain d’entraînement avec école de mécaniciens d’aviation. Soit 5 établissements d’éducation physique et sportive, toujours en service, pour l’aménagement et l’entretien desquels on est bien loin des millions que la Fédération mise en cause aurait touchés. Et les stades du Parc SaintMaur, complets dans leur installation jusqu’à comprendre un stand pour le tir, chose rare dans les organisations similaires, mais que l’Union considère comme indispensable, connaissent, de la part des Sociétés, une faveur qu’il est facile de contrôler. Le rédacteur du périodique sportif avait d’ailleurs, à la direction de son propre journal, le moyen de recueillir des témoignages probants. Des exemples malheureux de stades créés à coups de millions, et dont la vie ne fut qu’éphémère, sont connus. Les conditions mises par le sous-secrétaire d’Etat de l’Education physique à l’attribution des subventions éviteront à l’avenir, nous en avons l’espoir, le retour des erreurs commises par d’autres et assureront aux Sociétés de préparation au service militaire et à leur Union l’aide dont elles ont besoin pour rendre des services dont la portée dépasse le cadre par trop étroit des matches à recettes de l’amateurisme marron, qui, au lieu de préparer des citoyens pour le pays, fournit trop souvent au corps social des déclassés, au corps médical des malades, aux corps de troupes des ajournés, voire des réformés. » (Le Soldat de demain, janvier 1933.)
La préparation à la guerre est donc le but nettement poursuivi par l’Etat. « L’intérêt » qu’il apporte aux sports est, en définitive, celui des magnats qui sont dans la coulisse et qui représentent la finance internationale. Aussi, se leurrent ceux qui croient voir un jour le sport au service de la paix. Le général Chanzy disait :
« Faites-nous des hommes, nous ferons des soldats. »
Exaltant au contraire le patriotisme (dans l’intérieur du pays même un patriotisme de clocher : voir certains matches de football), le sport, comme la presse, comme le cinéma, comme la langue internationale, comme la T.S.F., comme tout projet détourné du but de libération des hommes vers lequel il devrait tendre normalement, est canalisé vers des fins de division et d’extermination des peuples. Le sport sera simplement au service de l’homme lorsque le régime capitaliste aura disparu. Pour le moment, nous voyons de multiples sociétés sportives, fédérées et riches. Elles sont organisées pour exploiter commercialement et les aptitudes athlétiques des joueurs et la sottise des foules. Parfois, elles servent à flatter la vanité d’un roi de 1a coiffure ou de la chaussure. Les mécènes d’autrefois préféraient protéger les artistes ; ceux d’aujourd’hui s’attachent à des équipes de sportsmen. C’est le progrès ! ... La mentalité du professionnel est en harmonie avec celle de ses chefs et avec celle du public. À de rares exceptions près, l’athlète est — comme dit la chanson — un individu « grand, fort et bête ». Nous pourrions ajouter, souvent brutal et presque toujours vendu au plus offrant. On voit tel joueur radié à vie pour « s’être livré à des voies de fait sur la personne de l’arbitre », tel autre « pour insultes à l’arbitre et brutalités ». Combien en est-il qui luttent simplement pour des questions de gros sous ! Nous copions dans nos notes prises au hasard des lectures :
« On se demande, avec quelque naïveté, dans les milieux sportifs, pourquoi certains athlètes, et non des moindres, se sentent tout à coup attirés vers un sport qui n’est pas le leur. Je crois qu’il faut chercher la raison de ces décisions subites dans la crise qui pèse actuellement sur la France et sur le monde. Quand (mettons X … ) veut devenir boxeur, il est évident que ce sont les lauriers dorés de la boxe qui l’intéressent ; quand (Z ... ), à son tour, veut lâcher la course à pied pour le football, il est évident qu’il songe aux deux mille francs par mois des joueurs professionnels de la balle ronde... etc. »
Pourquoi maintenant cet athlète est-il attaché à cette équipe, alors que naguère on le voyait ailleurs ? Beau joueur, on l’a « eu » en lui faisant cadeau, par exemple, d’un fonds de commerce. Ne devait-il pas profiter de la chance, cette garce qui tourne si rapidement ? Et le « commerce » n’est-il pas partout ? À propos de la radiation à vie du coureur Ladoumègue, nous avons recueilli, dans la France de Bordeaux (7 mars 1932), un article de C. A. Gonnet, dans lequel nous lisons :
« ... Entendons-nous bien. Je ne crois pas Ladoumègue absolument innocent ... Je suppose qu’il a dû, quelquefois, pour courir, passer à la caisse. Mais — on connaît notre sentiment — j’estime que ce garçon, sans fortune, sans famille, marié, père d’un enfant, a fichtrement raison, si ses jambes de lévrier peuvent lui rapporter quelques billets de mille, de les prendre.... On sait trop ce que c’est que le sport. Le jour où Ladoumègue n’avancera plus (et la course à pied, à ce régime-là, ne dure pas quinze ans !), il perdra et sa place — due au sport uniquement — et la foule d’amis qui l’entoure et toutes ses illusions. Il se retrouvera, comme bien d’autres, sur le pavé, avec sa gloire passée pour tout potage ... Or, la gloire n’a jamais nourri personne. Qu’un universitaire, nanti de solides rentes, coure en pur amateur, bravo ! Mais un pauvre bougre a plus que le droit : le devoir de se débrouiller dans la vie. L’intelligence est un capital, la beauté en est un autre ; la « classe » sportive peut en être un troisième. Une réunion d’athlétisme à Paris sans Ladoumègue « fait » cinq mille francs. Avec « sa » présence, cent mille ! Et vous voudriez que de tout cet argent gagné dans la foulée de Ladoumègue, il n’eût même pas les miettes ? Allons donc ! Un boxeur montant sur un ring et qui attire la foule, exige 30 % de la recette. Tout le monde trouve cela naturel. Mais d’un Ladoumègue, c’est un crime. On me dira : « Les dirigeants sont bénévoles ... ». Ce n’est pas vrai ! Ils ont pour eux les banquets, les voyages, les relations, les honneurs. L’un de ceux qui se sont acharnés le plus sur Ladoumègue criait à qui voulait l’entendre : « Les décorations, je les méprise ! » Mais il s’est tu ... du jour où on lui a donné la Légion d’honneur. Ce qui prouve d’ailleurs combien les dirigeants « bénévoles et dévoués » tiennent à leur fromage, c’est l’acharnement avec lequel ils le conservent, s’y accrochent — tout tremblants ... Edifiant exemple que nous procure, entre autres, comme une triste leçon humaine, le rugby ! Ladoumègue pouvait être radié, mais après les Jeux Olympiques. La Fédération d’Athlétisme, quand elle autorisa les tournées Nuami, Peltzer, Paddock Sholz and Co, savait bien que ses athlètes étrangers ne faisaient pas de voyages d’études ... Pourquoi a-t-elle accepté cela ? Pour faire de l’argent ! Il lui était égal que des étrangers vinssent en France avec un pourcentage sur les réunions auxquelles ils participaient, parce qu’elle, Fédération, en avait un autre ... etc. »
N’est-ce pas édifiant ? Le même écrivain sportif nous renseigne, presque un an plus tard (La France du 11 janvier 1933) sur les progrès du fléau :
« Gare à la commercialisation ! : ... J’avoue être inquiet un peu de l’orientation actuelle du sport. Le sport, qui fut pur et naturel, est en train de se commercialiser de façon effrayante et excessive. Ce n’est pas la faute des pratiquants qui, à peu de chose près, suivent la même ligne de conduite que leurs prédécesseurs et, quoi qu’on en dise, courent et jouent surtout pour leur plaisir. Mais les dirigeants — et ceci dans toutes les branches de l’activité physique actuelle — sont dominés par des questions de trésorerie qui, peu à peu, les conduisent à l’ « exploitation en règle » du capital-argent que sont leurs hommes. Que font ceux-ci ? Ils ne réagissent point, ou faiblement. Je ne sais qu’un exemple : celui d’un quinze de rugby qui s’est constitué en société anonyme (ô combien !) et réclame des comptes après chaque match. Pourquoi ? On le devine ... Mais, en dehors de cette préoccupation, somme toute morale ou normale, de dirigeants heureux de « faire des recettes », il y a autre chose. Des requins sont nés, qui « font » dans le sport, comme d’autres dans la politique, les fonds secrets, le chantage ou la coco. Ces nouveaux adeptes de la « traite des blancs » ont l’ambition avouée d’accaparer le sport pour des fins commerciales et de réaliser ce que New-York, par exemple, a déjà admis : « Tout effort est un spectacle, tout spectacle se paie ». Quand on a admis ce principe, ça vous mène loin. Vous ne faites plus du sport pour vous, mais pour le compte d’un autre. Puis, à un moment donné, vous affranchissant de cette tutelle, vous vous produisez vous-même. Paddock et Weissmüller, quand ils gagnaient le record du monde, songeaient déjà au cinéma et aux dollars. Désagrégation de l’idée originelle, avènement du Gladiateur. Gare ! ... »
C’est, évidemment, un capital, ces athlètes susceptibles de faire entrer de fructueuses recettes dans les caisses des organisateurs. (On connaît l’exemple de matches truqués pour doubler la recette dans une revanche profitable.) Mais sont-ils, du moins, des hommes « complets », de merveilleux spécimens de la race ? Hélas ! Là aussi, il faut déchanter. Les méfaits du sport ainsi compris ont, depuis longtemps, été dénoncés. Voici, par exemple, ce qu’écrit Marcel Berger, dans Mondes et Voyages, du 15 juillet 1932 :
« Votre sport ? Nous lui reprocherons d’abord d’être un vrai péril pour la race. Un péril physique. Que voyons-nous ? Notre belle jeunesse et, pis, notre adolescence des deux sexes, entraînées par l’amour-propre — et par le bourrage de crâne — aux chemins de la compétition : courses à pied, cyclisme, football, rugby, boxe, natation et le reste ! Le résultat, ce sont ces organismes surmenés, ces écœurés « claqués » que vient dénoncer le conseil de révision. Par l’abus du sport, chaque année des milliers de tuberculeux de plus, des milliers de futurs cardiaques. Consultez les médecins. La plupart se déclarent opposés aux excès journaliers commis sous cette dangereuse égide. En dehors d’eux, le plus grand nombre des « culturiste » « préparatistes », « naturistes », voire des hommes aussi qualifiés — et d’ailleurs en désaccord entre eux — que le professeur Latarget et le lieutenant de vaisseau Hébert, passent leur vie à dénoncer les excès nocifs du sport. »
Plus loin :
« … Rien de plus triste, parfois, au point de vue esthétique, qu’un champion spécialisé ! Nous connaissons des « as » de la course dont l’apparence est celle des gnomes ! Par ailleurs, il est fréquent nous dirons presque qu’il est admis — qu’un sauteur ne sache pas nager, qu’un leveur de poids ne sache pas courir, qu’un coureur soit incapable de se hisser au long d’une corde. La carence de nombreux sportifs pendant la guerre — et nous ne parlons que de carence physique — restera sujet de dérision. »
Les progrès du sport se font au détriment de ceux de l’intellectualité :
« ... Tout ce temps consacré désormais par la jeunesse — et par l’âge mûr — soit à la pratique soit à la badauderie athlétiques, tout ce temps apparaît volé aux autres distractions hygiéniques et, surtout, aux spéculations et divertissements de l’esprit. Partout, les études régressent, l’intellectualité s’avilit. Le théâtre voit baisser ses recettes au profit de celles des vélodromes. À chaque club sportif qui s’ouvre correspond quelque philharmonique, quelque foyer spirituel ou artistique qui se ferme. »
Les athlètes sont, en général, comparables à ces animaux dont on force le régime pour leur faire produire, en un temps relativement court, ce qu’ils produiraient normalement à des intervalles échelonnés. Ce sont les coureurs du Tour de France, par exemple, « dopés » comme chevaux en carrière et obligés, après l’épreuve, de se reposer ... à l’hôpital. Que devient l’homme après cela ? ... Une baudruche dégonflée. Nous trouvons ceci dans nos notes :
« Allez donc vous fier à la forme montrée par un athlète dans une seule manifestation. Elle dure ce que durent les roses, surtout lorsqu’elle n’est pas appuyée d’une robuste santé. Il y a huit jours, nous exprimions une crainte au sujet des efforts surhumains que venait de faire le trop courageux stayer dans le fameux match des champions du monde. Nous redoutions pour lui qu’il ait mis son organisme, à peine rétabli d’une longue dépression, à trop rude épreuve, qu’il ait exagéré la défense d’un capital musculaire et nerveux à peine reconstitué et insuffisamment consolidé. Cette crainte n’était pas vaine. Comme un prodigue qui ne sait pas compter, P ... puisa à pleines mains dans ses réserves, le 5 mars. Malheureusement pour lui, il eut à faire face à une nouvelle échéance, au moins aussi lourde que la première, le 12 de ce mois. En huit jours, P ... n’eut pas le temps de rattraper ses pertes et il ne put, dimanche dernier, faire face à toutes ses obligations. À peine remis d’un long état de déficience, P ... est reparti à fond trop tôt. Il peut redouter, maintenant, les conséquences de son imprudence pour la bonne tenue de sa saison d’été, à moins que le grand air et le bon soleil ne le retapent miraculeusement à leurs premiers contacts ... »
Passons aux foules, gobeuses de spectacles sportifs. Dans :
« L’atmosphère des rencontres internationales, le chauvinisme le plus étroit, le plus obtus s’y donne carrière. Sur le terrain, les équipiers — surtout ceux des quinze de rugby — n’ont qu’un but : gagner à tout prix. A tout prix, cela veut dire au prix, souvent, des pires brutalités, des pires déloyautés. Que l’arbitre, excédé, sévisse, et ce sont les 30 000 spectateurs d’un France-Ecosse qui sifflent, l’invectivent, menacent de lui faire un mauvais parti. À Colombes, des grilles acérées les en empêchent. Mais on a vu à Béziers ou à Lézignan, des arbitres roués de coups, menacés de malemort. » (Marcel Berger)
On a vu la France entière vibrer d’une façon inepte lorsque son champion de boxe partit en Amérique pour se faire battre. On assiste souvent à des échanges d’injures et de coups dans certains matches où le public prend parti pour l’une ou l’autre équipe. Et lorsque de graves questions internationales sont susceptibles de précipiter ces troupeaux vers les charniers de la guerre, on voit les foules se ruer vers les haut-parleurs des halls de journaux pour apprendre les derniers résultats sportifs. Vous croyez que l’angoissant problème passionne le public que vous voyez affairé et soucieux ; prêtez l’oreille à la rumeur qui monte : hosanna ! l’équipe de France a vaincu par x points à zéro ! Pauvres êtres qui maudissez parfois le sort qui vous accable, comme vous faites le jeu de vos maîtres en dirigeant votre pensée vers ces futilités ! On ne se doute guère combien est basse la mentalité de certaines foules, tant elles sont avides d’actes de violence et de bestialité ! Les « Annales Anti-alcooliques » (déc. 1932) ont publié la description d’un match de boxe, dont nous reproduisons le passage suivant :
« … Ils étaient là 30 000 dans un immense vaisseau, 30 000 hommes et femmes et même enfants en bas âge, haletants, fascinés par les évolutions, les pirouettes, les coups d’adresse des malheureux athlètes, voués par la nature ou par l’intérêt à des combats hideux, où le peuple, redevenu animal féroce, trouve de sadiques plaisirs. Ils étaient là, étrangement mélangés, bourgeoises très décolletées (car ces réunions sont snobs), demi ou quart de mondaines, panachées de types à physionomie de souteneurs en casquette. Ces spectacles confondent les classes de façon touchante ! Quelle fraternisation ! Mais ce qui est indescriptible et inconcevable même, c’est la physionomie de tout ce peuple, ses manifestations délirantes, cependant que les coups pleuvaient, meurtrissant les chairs, faisant couler le sang, sauter quelques dents, pochant les yeux. La participation du spectateur au combat se lisait sur toutes ces faces dont les émotions débordaient ; les yeux s’écarquillaient, des vociférations sauvages sortaient des bouches convulsées : « Tue-le ! tue-le ; tape plus fort, vas-y Thill ! » On sentait vibrer le super-patriotisme de la brute ayant un vague souvenir des ruées humaines où le sang coule au nom de la Patrie. C’était grandiose de hideur, et l’on se serait cru en pleine corrida, où l’humain ne songe plus à cacher ses instincts sanguinaires. Des femmes pleuraient, surtout derrière moi la femme fluette de l’adversaire de Thill qui encaissait les plus savantes bourrades et qui finit par tomber épuisé. Pourquoi cette petite femme était-elle là ? Sans doute pour cueillir les lauriers sanguinolents de son brutal époux ? Il Y a des femmes que de pareils triomphes mettent en liesse. Elles sont fort nombreuses, et il était visible que l’exaltation passionnée des femmes dépassait de beaucoup celle des hommes. »
Et le docteur Legrain ajoute avec raison :
« Quand on voit cela, on conçoit les boucheries de la guillotine, on s’explique la férocité de ce peuple qui demande la tête de Gorgulof, un fou ! Il lui faut du sang, à cet ours des cavernes, qui n’a du civilisé que le faux-col et la pipe. »
Le sport ? A ce mot, combien de camarades se détournent avec une sorte de répulsion ! C’est comme lorsqu’on leur parle du bistrot ou du cinéma... Ils sentent l’exploitation savante, l’abrutissement intellectuel, l’appât empoisonné. Et ils se détournent du piège. Ils s’en détournent pour aller vers leurs livres, vers leurs chères études, vers les hautes joies de l’esprit. Aux moments du délassement, ils prennent leur ligne et vont vers la rivière proche pêcher l’ablette... ou rêver. Et lorsque le cœur leur en dit, ils se dévêtent, plongent dans l’eau riante et fraîche, pour ensuite offrir leur corps aux baisers du soleil... Le sport ? certes, ils détestent celui qui s’apparente aux « véhicules du crime », selon la vigoureuse expression de Mac-Say ; mais ils aiment celui qui est un bienfait pour leur corps. Pourtant, l’autre a tant fait de ravages, qu’il leur semble que ce serait avilir celui-ci que de le dénommer sport.
— Ch. BOUSSINOT.
STÉRILITÉ
(n. f.) du latin Sterilitas, même sens
Le fait de ne pas se reproduire, de ne pas porter de fruit : un terrain stérile, un esprit stérile. Chez les animaux et chez l’homme, le fait de ne pas enfanter.
« La métaphysique est comme une vierge consacrée à Dieu ; elle n’enfante rien. » (Bacon)
La stérilité peut être pathologique ; chez l’homme, ses causes sont la criptorchidie, arrêt du développement des testicules, la tuberculose et le cancer du testicule. Les blennorragies répétées suivies d’épidydimites et d’orchites amènent la stérilité. Chez la femme, le vaginisme, état nerveux qui empêche tout rapport sexuel, les métrites et salpingites, certains fibromes qui, remplissant la cavité utérine, ne laissent pas de place pour l’œuf, l’insuffisance odonienne, caractérisée par des règles peu abondantes, les kystes et tumeurs de l’ovaire. La stérilité pathologique est peu fréquente. C’est une erreur de croire, comme le feignent certains auteurs, à un abâtardissement de la race qui amènerait la stérilité. La grande cause de dénatalité d’un pays est la stérilité volontaire.
La stérilité volontaire est une conquête de la civilisation. L’homme primitif subit la nature, les peuples civilisés l’adaptent à leur commodité. Néanmoins, les peuples sauvages savent provoquer la stérilité. Des négresses pratiquent l’avortement au moyen d’une tige de bambou introduite dans la matrice. Dans la Russie tsariste, les paysans faisaient avorter les filles qui avaient fauté en les frappant violemment au ventre. Le plus souvent, ils tuaient la mère en même temps que le fœtus.
La civilisation a trouvé des moyens moins brutaux. Les préjugés religieux, qui empêchaient les peuples de regarder en face les choses sexuelles, disparaissent peu à peu et l’avortement, en dépit d’une légalité anachronique, s’étend de plus en plus. II y en aurait, paraît-il, un million par an pour la France.
Plus générale que l’avortement est la restriction volontaire des naissances ; ce que les Anglais appellent le bearth control. On empêche, par des moyens divers, le spermatozoïde de rencontrer l’ovule. L’homme pratique l’acte bref ; la liqueur spermatique est émise au dehors, ou bien il recouvre la verge d’un condom. La femme s’efforce d’obturer par divers procédés : éponges, pessaires, etc. l’orifice utérin. Certaines se contentent d’uriner après l’acte ; la liqueur spermatique, accumulée dans le vagin, tombe par l’effet de la pesanteur. Un autre moyen consiste à faire de grands lavages de la cavité vaginale avec une eau additionnée de produits spermaticides.
Un médecin allemand a trouvé, récemment, le moyen de produire la stérilité en introduisant dans l’utérus un anneau en argent flexible. Replié pour franchir le col, l’anneau reprend sa forme dans la cavité utérine. L’utérus se contracte pour l’expulser mais n’y parvient pas et ces contractions continuelles rendent impossible à l’œuf fécondé de se fixer à la paroi. Lorsque la femme désire un enfant, elle fait enlever l’anneau ; la grossesse redevient possible.
Tous les moyens de stérilisation sont aléatoires. On n’arrive au succès qu’à force d’attention et de soins. C’est pourquoi la bourgeoisie réussit mieux que la classe ouvrière à limiter sa fécondité. Chez les ouvriers, le logement exigu et sans confort, l’indolence, l’ignorance rendent la stérilité difficile à obtenir. Seul l’anneau d’argent serait efficace, mais ce moyen n’est pas il la portée de la classe ouvrière, II faut un médecin pour placer l’anneau ; c’est une opération illégale et naturellement, ceux qui la font demandent très cher.
La stérilité, tout au moins la stérilité partielle, peut permettre à la femme une vie intéressante. La fécondité excessive fatigue le corps et l’intelligence s’en ressent. Le ventre se flétrit, la. peau affaissée tombe devant les cuisses comme un tablier : les seins se fanent et tombent sur le ventre, les jambes se couvrent de varices qui rendent la marche difficile : l’utérus, fatigué de porter constamment des grossesses, se relâche, il fait issue hors du vagin et pend entre les jambes, faisant de la femme une véritable infirme. Les préjugés sont encore tels, même en médecine, que les chirurgiens hésitent à enlever ce misérable organe qui ne fait que gêner et ne servira plus à rien, si ce n’est à tuer la femme par un cancer qui a les plus grandes chances de survenir.
Toutes les religions ont proscrit la stérilité. Chez la plupart des primitifs, la femme est esclave, sa seule raison d’être est la procréation de l’homme. Aussi la femme stérile est-elle considérée comme un être inutile. L’homme la tue ; tout au moins il la répudie et en prend une autre. Dans l’Islam, la mère d’un garçon porte orgueilleusement un croissant à sa coiffure ; elle croit avoir fait son devoir et son entourage pense comme elle. Ces mœurs barbares n’ont pas disparu. Pendant des siècles, la femme stérile était considérée comme abandonnée de Dieu ; la famille la persécutait. Aussi allait-elle dans les sanctuaires à miracles demander à Dieu la grâce de devenir féconde. L’orgueil de caste et de famille s’ajoute au préjugé religieux pour proscrire la stérilité. Pour continuer le titre, le nom, il faut un enfant, surtout un garçon.
Il ne faut pas croire que nous fassions la peinture d’une mentalité révolue. Elle subsiste encore aujourd’hui, même chez des gens prétendus avancés. Dans Fécondité, de Zola, l’épouse stérile n’est pas répudiée : mais le mari lui adjoint une concubine qui, elle, a des enfants. Tout le monde approuve ce polygame par nécessité ; la femme légitime elle-même fait taire sa jalousie.
II est à noter que, le plus souvent, la stérilité de la femme a l’homme pour cause. La blennorragie, relativement bénigne pour lui, est grave pour elle ; elle provoque la métrite et la salpingite qui entraînent la stérilité. La vasectomie, sorte d’avortement masculin est une opération qui consiste à couper le canal déférent qui conduit la liqueur spermatique. Les rapports sexuels demeurent possibles, mais ils sont inféconds et le testicule, soustrait à la fonction spermatique, n’en acquiert que plus de valeur comme glande endocrine : il répand dans tout l’organisme ses principes dynamogènes.
La vasectomie serait un moyen très commode de stérilisation. La préservation féminine est difficile : l’avortement peut être dangereux ; seule la section du canal déférent permet l’amour sans inquiétude. Mais elle n’est pas encore entrée dans les mœurs. Son seul inconvénient est d’être irréparable. Plusieurs pays : les Etats-Unis, la Suisse ont pratiqué la vasectomie sur les aliénés et les criminels. Pour les aliénés, cela peut s’admettre. D’abord ils sont inconscients et ensuite il est bon de les empêcher de procréer des malheureux qui, fous ou demi-fous, traîneront une existence misérable.
En ce qui concerne les criminels, il y a abus de pouvoir. Et la raison d’Etat n’est pas à invoquer, car le crime n’est pas héréditaire. Sa cause la plus fréquente est non pas une hérédité morbide, mais les difficultés de la vie dans une société mal organisée.
— Doctoresse PELLETIER.
STIRNÉRISME (LE)
C’est à Bayreuth, le 25 octobre 1806, que Max Stirner vint au monde. Ce ne fut pas un écrivain d’une fécondité extraordinaire, les soucis de l’existence l’accaparèrent trop. De ses écrits, un seul a surnagé, un volume où il s’est livré tout entier, où il a exprimé toute sa pensée et a essayé d’indiquer une voie d’issue aux hommes de son temps : L’Unique et sa Propriété.
Il y a Stirner et son œuvre, il y a L’Unique et sa Propriété et le « stirnérisme », Il est arrivé qu’en s’adressant aux hommes de son temps, Max Stirner s’est adressé aux hommes de tous les temps, mais sans assumer l’allure de prophète tonnant théâtralement du fond de sa caverne que Nietzsche savait si bien prendre. Stirner ne se présente pas non plus à nous comme un professeur enseignant ses élèves : il parle à tous ceux qui viennent l’entendre, tel un conférencier ou un causeur qui a rassemblé autour de lui un auditoire de toutes les catégories, manuelles comme intellectuelles.
Aussi, pour comprendre la portée du stirnérisme, faut-il retrancher de L’Unique et sa Propriété tout ce qui est relatif à l’époque où ce livre a été écrit. Sans ce travail préparatoire, la tentation risque de venir au lecteur qu’il se trouve en présence d’une confession ou d’un testament philosophique. Cet étayage fait, on a devant soi un arbre robuste et bien planté, une doctrine parfaitement cohérente et on ne s’étonne plus qu’elle ait donné naissance à tout un mouvement.
Le stirnérisme considère que l’unité humaine est la base et l’explication de l’humanité ; sans l’humain pas d’humanité, la totalité ne se comprend que par l’unité. Autant s’arrêter tout de suite si l’on ne s’assimile pas ces prémisses. Cette unité sociologique n’est pas un être en devenir ni un surhomme, mais un homme comme vous et moi que son déterminisme pousse à être comme il doit être, comme il peut être — rien de plus ni de moins que ce qu’il a la force ou le pouvoir d’être. Mais l’homme que nous connaissons est-il bien ce que son déterminisme le voulait, en d’autres termes : est-il ce qu’il devait, ce qu’il pouvait être ? Cet homme que nous côtoyons dans les lieux de plaisir ou de travail, est-il un produit naturel ou une confection artificielle, est-il volontairement l’exécuteur du contrat social ou ne s’y conforme-t-il que parce qu’éducation, préjugés et conventions de toute espèce lui bourrent le crâne ? C’est ce problème que le stirnérisme va s’appliquer à résoudre. Premier temps !
Pour replacer l’individu dans son déterminisme naturel, le stirnérisme se met à ébranler tous les piliers sur lesquels l’homme de notre temps a édifié sa masure de membre de la société : Dieu, Etat, Eglise, religion, cause, morale, moralité, liberté, justice, bien public, abnégation, dévouement, loi, droit divin, droit du peuple, piété, honneur, patriotisme, justice, hiérarchie, vérité ; bref les idéaux de toute espèce. Ces idéaux, ceux du passé, comme ceux du présent, ces idéaux sont des fantômes embusqués dans « tous les coins » de sa mentalité, qui se sont emparé de son cerveau, s’y sont installés et empêchent l’homme de suivre son déterminisme égoïste.
Les préjugés-fantômes battant en retraite les uns après les autres, les piliers de sa foi et de ses croyances croulant successivement, l’individu se retrouve seul. Enfin, il est lui, son Moi est dégagé de toute la gangue qui le comprimait et l’empêchait de se montrer tel que. La table rase a été faite, les nuages qui obscurcissaient l’horizon ont disparu, le soleil brille de tout son éclat et la route est libre. L’individu ne connaît plus qu’une cause : la sienne, et cette cause, il ne la base sur rien d’extérieur, sur aucune de ces valeurs fantômales dont, auparavant, son cerveau était farci. Il est l’égoïste dans le sens absolu du mot : sa puissance est désormais sa seule ressource. Toutes les règles extérieures sont tombées ; il est délivré de la contrainte intérieure, bien pire que l’impératif extérieur ; force lui est maintenant de chercher en lui seul et sa règle et sa loi. Il est l’Unique et il s’appartient, en toute propriété. Il n’est pour lui qu’un droit supérieur à tous les droits : le droit à son bien-être.
« La peine doit disparaître pour faire place à la satisfaction. »
Pensez donc où l’Unique en est arrivé ! Pas une vérité n’existe en dehors de lui. Il ne fait rien pour l’amour de Dieu ou des hommes, mais pour l’amour de soi. Il n’y a entre son prochain et lui qu’un rapport : celui de l’utilité ou du profit. C’est de lui seul que dérivent tout droit et toute justice. Ce qu’il veut, c’est ce qui est juste. Foin donc de toute cause qui n’est pas la sienne ! Il est lui-même sa cause et n’est ni « bon », ni « mauvais » (ce sont là des mots). Il se déclare l’ennemi mortel de l’Etat et l’irrespectueux adversaire de la propriété légale.
Quelques citations tirées de L’Unique et sa Propriété feront comprendre que Stirner n’a rien épargné et qu’aucune idole n’a trouvé grâce à ses yeux :
« Toujours un nouveau maître est mis à la place de l’ancien, on ne démolit que pour reconstruire et toute révolution est une restauration. C’est toujours la différence entre le jeune et le vieux philistin. La révolution a commencé en petite-bourgeoise par l’élévation du Tiers-Etat, de la classe moyenne, et elle monte en graine sans être sortie de son arrière-boutique. »
« S’il vous arrivait, ne fut-ce qu’une fois, de voir clairement que le Dieu, la loi, etc., ne font que vous nuire, qu’ils vous amoindrissent et vous corrompent, il est certain que vous les rejetteriez loin de vous, comme les chrétiens renversèrent, jadis, les images de l’Apollon et de la Minerve et la morale païenne. »
« Tant qu’il reste debout une seule institution qu’il n’est pas permis à l’individu d’abolir, le Moi est encore bien loin d’être sa propriété et d’être autonome. »
« La culture m’a rendu PUISSANT, cela ne souffre non plus aucun doute. Elle m’a donné un pouvoir sur tout ce qui est force, aussi bien sur les impulsions de ma nature que sur les assauts et les violences du monde extérieur. Je sais que rien ne m’oblige à me laisser contraindre par mes désirs, mes appétits et mes passions, et la culture m’a donné de les vaincre : je suis leur ‘MAÎTRE’. »
« Celui qui renverse une de ses BARRIÈRES peut avoir par là montré aux autres la route et le procédé à suivre ; mais renverser leurs BARRIÈRES reste leur affaire.
« On se contenta pendant longtemps de l’illusion de posséder la vérité, sans qu’il vînt à l’esprit de se demander sérieusement s’il ne serait pas nécessaire, avant de posséder la vérité, d’être soi-même vrai. »
« Celui qui doit, pour exister, compter sur le manque de volonté des autres, est tout bonnement un produit de ces autres, comme le maître est un produit du serviteur. Si la soumission venait à cesser, c’en serait fini de la domination. »
« Pour l’homme qui pense, la famille n’est pas une puissance naturelle, et il doit faire abstraction des parents, des frères, des sœurs, etc. »
Sur quels rivages son déterminisme poussera-t-il l’égoïste chez lequel il a été fait table rase des préjugés-fantômes ? Et voici le deuxième temps du stirnérisme.
Tout bonnement vers les rivages de l’union, de l’association ... Mais une union contractée volontairement, une association d’égoïstes que ne hanteront pas les fantômes du désintéressement, du dévouement, du sacrifice, de l’abnégation, etc. Une association d’égoïstes où notre force individuelle s’accroîtra de toutes les forces individuelles de nos co-associés, où l’on se consommera, où l’on se servira mutuellement de nourriture. Une union dont on se servira pour ses propres fins, sans que vous trouble l’obsession « des devoirs sociaux ». Une association que vous considérerez comme votre propriété, votre arme, votre outil et que vous quitterez quand elle ne vous sera plus utile.
Mais qu’on ne s’imagine pas que l’association, si elle permet à l’individu de se réaliser par elle, n’exige rien en échange.
Certes, l’association stirnérienne ne se présente pas comme une puissance spirituelle supérieure à l’esprit de l’associé — l’association n’existe que par les associés, elle est leur création ; mais voici : pour qu’elle remplisse son but, pour qu’on y échappe « à la contrainte inséparable de la vie dans l’Etat ou la société » il faut bien comprendre que n’y manqueront pas « les restrictions à la liberté et les obstacles à la volonté », « Donnant, donnant ». Egoïste, mon ami, tu consommeras les autres égoïstes, mais à condition d’accepter de leur servir de nourriture. Dans l’association stirnérienne, on peut même se sacrifier à autrui, mais non en invoquant le caractère sacré de l’Association ; tout bonnement parce qu’il peut vous être agréable et naturel de vous sacrifier.
Le stirnérisme reconnaît que l’Etat repose sur l’esclavage du travail ; que le travail soit libre et l’Etat est aussitôt détruit. (Der Staat beruht auf der Sklaverei der Arbeit. Wird der Arbeit frei, so ist der Staat verloren) : voilà pourquoi l’effort du travailleur doit tendre à détruire l’Etat, ou à s’en passer, ce qui revient au même.
Troisième temps. Reste la façon dont l’égoïste ou l’Association des égoïstes réagira contre les habiles et les rusés qui usent à des fins de domination et d’exploitation des fantômes qui ont pris possession des cerveaux des hommes, Le stirnérisme n’entend pas jouer le rôle de l’Etat après l’avoir détruit ou avoir clamé son inutilité, forcer ceux qui ne le veulent ou ne le peuvent à former des associations d’égoïstes. Le stirnérisme ne préconise pas la révolution. Le stirnérisme n’est pas synonyme de messianisme. Contre ceux qui possèdent et exploitent au point de ne laisser aux exploités ni pain à manger, ni lieu où reposer leur tête, ni de leur payer le salaire intégral de leur effort, l’insurrection est de mise, la rébellion convient. Il y a des biens improductifs au soleil, des coffres-forts pleins à déborder, que diable ! Et pas de sentimentalisme quand il s’agit d’affirmer son droit individuel ou associé au bien-être. L’ego guidé par la conscience de soi, ne saurait s’embarrasser de scrupules qui pouvaient hanter les hommes aux cerveaux habités par des fantômes.
« La révolution ordonne d’instituer, d’instaurer, l’insurrection veut qu’on se soulève ou qu’on s’élève. »
« Je tourne un rocher qui barre ma route jusqu’à ce que j’aie assez de poudre pour le faire sauter ; je tourne les lois de mon pays tant que je n’ai pas la force de les détruire. »
« Un peuple ne saurait être libre qu’aux dépens de l’individu, car sa liberté ne touche que lui et n’est pas l’affranchissement de l’individu ; plus le peuple est libre, plus l’individu est lié. C’est à l’époque de la plus grande liberté que le peuple grec établit l’ostracisme, bannit les athées, et fit boire la ciguë au plus probe de ses penseurs. »
« Adressez-vous donc à vous-mêmes, plutôt qu’à vos dieux ou à vos idoles : découvrez en vous ce qui est caché, amenez-le à la lumière et révélez-le. »
Telle est l’essence du message que Max Stirner, en le délivrant aux hommes de son temps, adresse aux hommes de tous les temps.
Nous avons dit qu’en Stirner il y avait l’homme et l’oeuvre. Après avoir parlé de la doctrine, parlons de son fondateur. Stirner n’est que le nom de plume de Johann Caspar Schmidt et ce surnom n’est qu’un sobriquet dû au front (Stirn en allemand) développé de l’auteur de L’Unique et sa Propriété et qu’il a conservé pour ses écrits.
Un des épisodes de la vie de Stirner qui retient le plus notre attention est sa fréquentation, dix ans durant, du club des « Affranchis » groupement d’intellectuels animés des idées libérales des esprits avancés d’avant 48. Ils se réunissaient dans une brasserie et dans l’atmosphère enfumée des longues pipes de faïence, discutaient sur toutes sortes de sujets : théologie (le livre de Strauss sur Jésus venait alors de paraître), littérature, politique (la révolution de 48 était proche). Ce fut en 1843 que Max Stirner, l’homme d’aspect impassible, d’un caractère fort et concentré en soi, épousa en secondes noces une Mecklembourgeoise, rêveuse et sentimentale, assidue elle aussi du club des « Affranchis », Marie Daehnhardt. Pourtant, leur union ne fut pas heureuse. L’incompréhension mutuelle des deux époux et les calomnies insinuant que Stirner cherchait un profit dans ce mariage par la dot de sa femme, amenèrent la rupture en 1845.
Stirner continua à produire. L’Unique et sa Propriété date de la fin de 1844. Il a successivement publié de 1845 à 47 une traduction allemande des maîtres-ouvrages de J.-B. Say et d’Adam Smith avec notes et remarques en 8 volumes ; en 1852, une
« Histoire de la Réaction » en deux volumes, toute de sa plume ; en 1852 encore, la traduction d’un essai de J.-B. Say sur le capital et l’intérêt, avec des remarques ... Puis, il ne publia. plus rien. Ses dernières années furent miséreuses. Réduit à gagner son pain comme il le pouvait, isolé, emprisonné deux fois pour dettes, il succomba en 1856 à une infection charbonneuse dans un garni. De nouvelles recherches de mon ami John-Henry Mackay, mort en mai 1933, semblent attester que la fin de son existence ne fut ni si misérable ni si dépourvue d’amitié qu’on l’a cru tout d’abord.
Revenons à l’œuvre de Stirner. Un des passages les plus remarquables de L’Unique et sa Propriété est celui où il définit la bourgeoisie par rapport aux déclassés. Cette citation est la meilleure réponse à faire à ceux qui voient dans Stimer et ses continuateurs des individualistes bourgeois :
« La bourgeoisie se reconnaît à ce qu’elle pratique une morale étroitement liée à son essence. Ce qu’elle exige avant tout, c’est qu’on ait une occupation sérieuse, une profession honorable, une conduite morale. Le chevalier d’industrie, la fille de joie, le voleur, le brigand, et l’assassin, le joueur, le bohème sont immoraux, et le brave bourgeois éprouve à l’égard de ces ‘gens sans mœurs’ la plus vive répulsion. Ce qui leur manque à tous, c’est cette espèce de droit de domicile dans la vie que donnent un commerce solide, des moyens d’existence assurés, des revenus stables, etc. ; comme leur vie ne repose pas sur une base sûre, ils appartiennent au clan des ‘individus’ dangereux, au dangereux prolétariat ; ce sont des « particuliers » qui n’offrent aucune garantie et n’ont ‘rien à perdre’ et rien à risquer. »
« Tout vagabondage déplaît d’ailleurs au bourgeois, et il existe des vagabonds de l’esprit, qui, étouffant sous le toit qui abritait leurs pères, s’en vont chercher au loin plus d’air et plus d’espace. Au lieu de rester au coin de l’âtre familial à remuer les cendres d’une opinion modérée, au lieu de tenir pour des vérités indiscutables ce qui a consolé et apaisé tant de générations avant eux, ils franchissent la barrière qui clôt le champ paternel, et s’en vont par les chemins audacieux de la critique, où les mène leur indomptable curiosité de douter. Ces extravagants vagabonds rentrent eux aussi dans la classe des gens inquiets, instables et sans repos que sont les prolétaires, et quand ils laissent soupçonner leur manque de domicile moral, on les appelle des ‘brouilIons’, des ‘têtes chaudes’ et des ‘exaltés’. »
« On pourrait réunir sous le nom de ‘vagabonds conscients’ tous ceux que les bourgeois tiennent pour suspects, hostiles ou dangereux. »
Stirner n’est pas descendu vers le peuple, comme les Bakounine, les Kropotkine, les Tolstoï, par exemple. Ce n’est pas un producteur massif comme Proudhon aux préjugés de bourgeois moyens et généreux ; ce n’est pas un savant comme Reclus, doublé d’un esprit de bonté évangéliste ; ni un aristocrate comme Nietzsche ; c’est l’un de nous. C’est un homme qui ne se trouva jamais nanti d’une position sûre et profitable ou rentée. Il connut la nécessité de pratiquer les métiers les plus divers pour se subvenir. La gloire qui entoure les proscrits célèbres, les militants révolutionnaires ou les chefs d’école, lui fut inconnue. Il dut se débrouiller comme il le pouvait et au lieu des marques de considération que la bourgeoisie décerne, malgré tout, à certains illustres révolutionnaires, il n’en reçut que les rebuffades dont elle accable les individus sans situation et sans garantie.
Instruit par ses propres expériences, Stirner a donc tracé du bourgeois un portrait beaucoup plus frappant que ne le fit plus tard Flaubert qui se plaçait uniquement au point de vue esthétique.
Pour Stirner, la caractéristique du monde bourgeois c’est de posséder une occupation sérieuse, une profession honorable, de la moralité, bref ce qui constitue un droit de domicile dans la vie. Le bourgeois peut être ouvrier ou rentier, se dire républicain, radical, socialiste, syndicaliste, communiste, voire anarchiste ; il peut appartenir à une Loge, à la Ligue des Droits de l’Homme, à un Comité électoral socialiste, à une cellule communiste ; il peut même payer sa cotisation à un parti révolutionnaire. Tant que sa vie repose sur une base sûre, tant qu’il offre des garanties morales, bourgeois il est et bourgeois il reste.
En Allemagne même, ce ne fut qu’au bout de cinquante ans que parut une seconde édition de L’Unique et sa Propriété (1882). En 1893, la grande maison d’éditions Reclam, de Leipzig, éditait ce livre dans sa Bibliothèque Populaire. C’était le rendre accessible à tous. En 1897, John-Henry Mackay, qui s’est donné tant de mal pour retrouver des traces de Stirner et dissiper le mystère qui couvre sa vie, publiait la première édition de Max Stirner, sein Leben. und sein Werl.
En France, L’Unique et sa Propriété paraissait en 1900 en deux traductions, celle de Robert L. Reclaire, chez Stock ; celle de Henri Lasvigne à la Revue Blanche. (En 1894, Henri Albert avait traduit une partie de l’ouvrage au Mercure de France ; un peu plus tard, Théodore Randal avait fait de même dans les Entretiens Politiques et Littéraires et dans le Magazine International).
En 1902, il était traduit en danois (avec préface de Georges Brandes) et en italien (avec préface d’Ettore Zoccoli) ; une deuxième édition italienne a paru en 1911 et a été réimprimée en 1920. En 1907, précédé d’une préface de l’auteur de la philosophie de l’Egoïsme, James Walker, il en paraissait une traduction anglaise par Steven T. Byington, éditée par Benjamin R.Tucker (sous le titre The Ego and his own). En 1912, L’Unique et sa Propriété avait, de plus, été traduit en russe (on compte huit éditions de cet ouvrage en cette langue, la septième traduite par Léo Kasarnowski, la dernière datant de 1920), en espagnol, en hollandais et en suédois. En 1930, ont paru deux traductions japonaises dont une bon marché par J. Tsuji. Je pense qu’il existe des traductions de L’Unique en d’autres langues. (J’ai entendu parler de la traduction de L’Unique en dix-huit langues, mais je n’ai pu vérifier).
Sous le titre de Kleinere Schriften — Petits Écrits — John-Henry Mackay a réuni les études, articles, comptes rendus et réponses de Stirner à ses critiques, parus de 1842 à 1848. Je connais une édition italienne de cet ouvrage, intitulée Scritii minori. J’ai traduit dans L’En dehors la critique très intéressante que Stirner a faite des Mystères de Paris d’Eugène Sue et un extrait du Faux principe de notre éducation.
— E. ARMAND.
STOÏCISME
n. m. (Du grec stoa, portique, parce que Zénon de Cittium, fondateur de la philosophie stoïcienne, enseignait sous un portique.)
Ce substantif correspond à deux adjectifs : stoïcien et stoïque. Le stoïcien est celui qui appartient à l’école de Zénon ; le stoïque est celui qui a la fermeté recommandée par Zénon. On pourrait dire d’Epictète, plus fervent de la pratique que des dogmes, qu’il était encore plus stoïque que stoïcien.
Si j’osais mêler les vocabulaires, je constaterais qu’il y a une façon pharisaïque (et d’ailleurs vulgaire) de comprendre le stoïcisme. C’est celle que blâme La Fontaine (Le philosophe scythe) quand il nous montre « un indiscret stoïcien » qui :
Désirs et passions, le bon et le mauvais,
Jusqu’aux plus innocents souhaits.
Le fabuliste ajoute que « de telles gens »
... Ôtent à nos cœurs le principal ressort
Ils font cesser de vivre avant que l’on soit mort.
Ce que condamne La Fontaine est une caricature, non le véritable stoïcisme. Il est vrai que beaucoup de professionnels de la philosophie s’y sont trompés, depuis Plutarque, ce pauvre prêtre, jusqu’à Paul Janet, membre de l’Institut, qui donna au Dictionnaire des Sciences philosophiques de Franck un article « Stoïcisme » d’une injustice et d’une ignorance émerveillables. Nul stoïcien n’a jamais élagué avec une telle indiscrétion. Ils ont seulement établi entre nos puissances une hiérarchie trop sévère et donné trop absolument l’empire à la raison. S’ils semblent condamner sans réserve les « passions », c’est question de vocabulaire : ils blâment sous ce nom les agitations folles et excessives, mais ils consentent aux « affections », mouvements beaux et eurythmés. Ils distinguent quatre « passions » dont la laideur s’efforce vers les faux biens ou se désole de ne les point posséder ; ils appellent ces quatre passions : tristesse, plaisir, désir, crainte. Le sage, par une méthode que j’indiquerai plus loin, s’affranchit de toute tristesse. Au lieu du plaisir et de ses petites secousses inquiètes, il se donne la joie continue : ascension dans la clarté ou, suivant la définition de Spinoza, émouvant voyage et « passage d’une perfection moindre à une perfection plus grande ». Au lieu de la crainte et de ses affolements, il connaît la souriante prudence qui veille toujours sur le trésor intérieur. Enfin, comme son effort n’exige jamais l’impossible ou l’aléatoire, comme ce qu’il réalise c’est toujours, dans I’indifférente victoire ou l’indifférente défaite extérieure, la beauté même de son effort et son propre perfectionnement par cette beauté, le sage ne dit pas qu’il désire, mais qu’il veut.
Bien loin que le stoïcien détruise aucune de ses puissances internes, ce qui domine en lui, c’est le sentiment de l’unité de son être et de son accord avec lui-même. Les mauvais instincts, pour employer un vocabulaire plus nouveau et plus clair que le sien, il ne les supprime pas en lui, il les rend indifférents par la platonisation, ou utiles par la sublimation. Connaître l’harmonie que je suis, la réaliser de plus en plus et, à mesure que je la perfectionne, en prendre une conscience de plus en plus nette et de plus en plus large : voilà l’essence de l’éthique stoïcienne. Monter en quelque sorte sur chacune de mes connaissances pour agir plus haut, sur chacune de mes actions pour voir plus vaste.
La grande méthode morale du stoïcisme s’appuie sur la fameuse doctrine des choses indifférentes. Le stoïcien appelle indifférent tout ce qui ne dépend pas de lui. Cette définition, d’abord âprement volontaire, il en fait peu à peu une réalité subjective. Quand il a donné tout l’effort qui dépend de lui, il devient indifférent au résultat.
J’ai montré, dans La Sagesse qui rit, que le stoïcisme est essentiellement « un positivisme du vouloir ». Le savant positiviste, pour se donner tout entier à la recherche scientifique, se désintéresse de tout le domaine inconnaissable et métaphysique. Le stoïcien, pour ne perdre à des regrets et des découragements aucune parcelle de sa force et de sa volonté, se rend indifférent tout ce qui ne dépend pas de sa volonté et de sa force.
Mais, parmi les choses qu’il déclare indifférentes dès qu’il les compare au bien unique, la beauté de sa vie, il en reconnaît de préférables : il les recherche dès que cette recherche ne nuit pas au souverain bien ; il évite, quand il le peut sans laideur, les choses contraires aux préférables. Il y a plus : rechercher le préférable et éviter son contraire est un effort naturel, raisonnable, sans lequel on ne serait pas stoïcien.
Je ne parle que de ce qu’on appelle improprement la morale stoïcienne et qui est sagesse non morale. Quant à la logique et à la métaphysique de la secte, ce sont curiosités historiques qui n’intéressent plus que l’érudition.
— HAN RYNER.
STRATÉGIE
n. f. (du grec stratos, armée ; agô, je conduis)
Sur la stratégie, considérée comme une partie de l’art militaire, nous dirons peu de chose. Elle a pour but essentiel de faciliter l’assassinat collectif de milliers d’êtres humains. Elle fut toujours une source de destructions inutiles et de monstrueuses douleurs Si les peuples étaient moins stupides, ils rangeraient les généraux fameux dans la catégorie des bandits les plus pervers. Mais, au lieu de m’arrêter à des considérations longuement développées par les meilleurs écrivains pacifistes, je préfère montrer aux adversaires de l’autorité que le pouvoir militaire n’échappe pas plus que le pouvoir patronal, administratif etc., à une décomposition qui devrait faire réfléchir les adorateurs de l’Etat.
« Même dans l’armée, institution où l’esprit de barbarie subsiste à un très haut degré, le commandement se ramène, au sommet de la hiérarchie, à une affaire de calcul et d’organisation. Un chef militaire n’a plus besoin de faire preuve de courage, ni de s’exposer personnellement au danger ; et maints haut gradés se comportèrent en pleutres durant la guerre de 1914 — 1918. Endurance, bravoure, audace, force de caractère, ces qualités impérieusement requises des anciens conducteurs de troupe, sont bonnes seulement pour le simple soldat et, quelquefois, pour les officiers subalternes. Installés loin des balles, des obus et des gaz asphyxiants, dans de confortables et luxueux châteaux, avec un nombreux personnel de cuisiniers et de valets, les grands généraux, ou plus exactement ceux qui travaillent pour leur compte, n’ont besoin que du téléphone, de cartes et des menus objets nécessaires pour écrire ou calculer. On les renseigne sur la position des armées antagonistes, sur l’importance et la qualité des éléments dont eux-mêmes disposent, sur la force de l’adversaire et sur ses intentions présumées. D’après les facteurs en présence, et nullement d’après leur fantaisie s’ils jouissent encore de leur bon sens, nos stratèges résoudront les problèmes qui se posent. La guerre se conduit comme une affaire industrielle ou commerciale ; à son stade supérieur, le pouvoir militaire ressemble de moins en moins à ce que nos pères appelaient le commandement. Organiser d’une façon adéquate et rationnelle, voilà quel est, dans l’armée comme ailleurs, le vrai travail de direction. Et si nous avons pris cet exemple, c’est qu’aux yeux des naïfs, le chef militaire demeure l’incarnation la plus typique de l’autorité entendue au sens des anciens. » (En Marge de l’Action)
On voit combien profonde est l’erreur de ceux qui attribuent une mystérieuse vertu à l’Autorité, qui prêtent à la volonté des chefs une mirobolante efficacité. L’histoire de la stratégie le démontre : cela est faux, même lorsqu’il s’agit des bravaches galonnés qui plastronnent dans les cérémonies patriotiques et les défilés officiels.
Comme il existe une stratégie militaire, il existe aussi une stratégie électorale, fasciste, communiste, cléricale, maçonnique, etc. Sectes et partis s’efforcent de détenir les leviers de commande et de procurer des places enviables à leurs adhérents. Quelle que soit l’étiquette dont ils se parent, toujours il s’agit d’assurer la domination d’un groupe restreint de privilégiés sur une masse d’imbéciles. A l’occasion, et pour mieux tromper le public, l’on adopte un programme (lui, en apparence, donne satisfaction aux plus ardentes aspirations égalitaires. En réalité, le but secret des divers groupements politiques, c’est d’obtenir la meilleure part du gâteau gouvernemental, Se faire la courte échelle pour grimper toujours plus haut, telle est la loi primordiale de ceux qui s’associent pour exploiter la sottise humaine. Une réciprocité de bas services, voilà en quoi consiste la camaraderie qui règne entre les membres de maintes organisations, dont les allures magnanimes et désintéressées imposent le respect à ceux qui n’ont pu les observer de très près.
Pour nous, quels que soient les symboles sous lesquels se développe l’exploitation des pauvres et des ignorants : croix, triangle, faucille et marteau, etc., nous restons du côté des victimes. Certes, nous conseillons la prudence : mouchards et provocateurs manquent rarement dans les milieux d’avant-garde ; et nous savons les gouvernants capables de tout pour perdre ceux qui les font trembler. Pourquoi fournir à l’administration et à la police des renseignements qui leur permettront de nous mater ? Or, des manifestations mal calculées, des déclarations courageuses mais dépourvues d’efficacité pratique, peuvent aboutir à ce résultat. Soyons prudents ; toutefois gardons-nous d’avilir la cause que nous voulons servir, en maniant le mensonge et la calomnie comme le font nos adversaires. Laissons à d’autres ces armes empoisonnées ; c’est sur la vérité seulement que doit s’appuyer la stratégie de ceux qui luttent pour le triomphe de la raison et de l’amour.
— L. BARBEDETTE.
STUPÉFIANT
-
adj. : qui frappe de stupeur ;
-
nom masc. : un stupéfiant, des stupéfiants, se dit des médicaments qui produisent une sorte d’inhibition des centres nerveux, d’où résulte un état d’inertie physique et morale qui ne va pas jusqu’à la narcose, mais produit une anesthésie partielle. (Larousse)
Cette définition ou n’est pas très exacte, ou est incomplète, car cette inhibition des centres nerveux, c’est-à-dire ce choc qui les met en état d’inertie, est soit précédée, soit suivie d’une période d’excitation telle qu’on a volontiers tendance à considérer comme stupéfiants des médicaments qui, en réalité, sont juste l’opposé.
Nous poserons donc de suite, en principe, qu’il n’y a que deux corps répondant exactement à l’idée moderne des stupéfiants :
-
la cocaïne ;
-
l’opium et ses dérivés.
A côté de ces deux médicaments, nous trouvons d’autres substances dont la pharmacodynamie est voisine des stupéfiants.
Nous les classifierons en :
-
Hypnotiques (chloral, sulfonal, bromure de potassium, et tous les dérivés de la série barbiturique : véronal, gardénal, somnifène, allonal, etc ... ) ;
-
Anesthésiques (éther, chloroforme, chlorure d’éthyle, protoxyde d’azote).
Deux autres corps existent qui, à tort, ont été souvent considérés comme stupéfiants, alors qu’en réalité ce sont des excitants : ce sont le hachisch et l’alcool. Un dernier venu, le Peyotl est intéressant à citer pour les phénomènes bizarres que procure son ingestion. Nous en dirons quelques mots.
Historique.
Dormir, ne plus souffrir ... car le sommeil est bien le réparateur souverain de tous les maux. L’insomnie est le pire des supplices : se tourner et se retourner sur sa couche, ressasser dans son cerveau tous les problèmes qui vous tracassent durant la veille et qui, dans le noir, prennent des proportions formidables ! Tout plutôt que cela... Et le stupéfiant vient qui va donner quelques heures d’accalmie.
Aussi, comme la douleur a été de tous les temps, le stupéfiant a une origine vieille comme le monde. L’Humanité souffrante a toujours cherché un procédé pour rendre la vie plus supportable. Les Incas, les Chinois, les Égyptiens trouvaient un bien-être physiologique dans l’emploi de certaines plantes dont ils avaient découvert les propriétés. C’est ainsi que l’opium et la coca furent utilisés chez ces peuples bien des siècles avant qu’on en entendit parler en Europe.
Homère ne parle-t-il pas, dans l’odyssée du « Nepeuthès » : Hélène, dit-il, tenait de l’Égyptienne Polydamna ce médicament propre à « calmer la douleur et à dissiper les chagrins ». Opium ou jusquiame ? Les commentateurs ne sont pas très d’accord.
Plus tard, en 932, Alexandre le Grand fonda, en même temps que la ville d’Alexandrie, la première école de pharmacie qui eut la gloire de lancer le fameux Thériaque, qui, par l’opium qu’elle contenait, parcourut tout le cycle des années, puisqu’elle figurait encore dans le « Codex » de 1883. Bref, à toutes les époques de l’histoire, nous trouvons des médicaments qu’il serait trop long de citer ici et qui, tous, ont eu pour but de supprimer la douleur. Nous sommes donc en bonne compagnie pour parler des stupéfiants, et d’abord du premier de tous, l’opium.
Opium.
Tout le monde sait comment on obtient l’opium : une incision sur le fruit du pavot avant sa complète maturité : un suc blanc, laiteux, poisseux par le caoutchouc qu’il contient, sourd, qui, abandonné à lui-même, se dessèche et donne un produit brunâtre : l’opium. L’on a dit longtemps que la vertu principale de l’opium était de faire dormir. Non : l’opium n’est pas somnifère, mais il facilite le sommeil, parce qu’il calme la douleur en permettant à l’organisme de ne plus sentir l’irritabilité de son système nerveux. Que l’on fume l’opium ou qu’on se pique à la morphine, la douleur cesse d’abord et la sensation d’euphorie s’installe.
Malheureusement, quand l’action de l’opium diminue, une irritabilité spéciale remplace l’insensibilité. Ce sont d’abord des démangeaisons insupportables. Puis, si l’on se lève, des sensations pénibles, allant jusqu’à la nausée et aux vomissements.
Alors, pour retrouver le bien-être évanoui, le fumeur, le morphinomane recourront de nouveau au poison, augmentant fatalement les doses, pour obtenir l’effet cherché. C’est le « cercle vicieux » de Gilles de la Tourrette.
Voilà la rançon de tous les stupéfiants. Car nous retrouverons ce même phénomène en étudiant tous ces produits ; c’est une véritable mithridatisation qui permettra à l’intoxiqué d’absorber des grammes de poison alors que quelques milligrammes pourront tuer un non initié.
L’opium agit par les différentes substances qui le composent, et dont la principale est la morphine. Une piqûre à la morphine, seule, est plus active et dangereuse que l’emploi de l’opium total avec tous ses alcaloïdes, comme le fait le fumeur. Ces alcaloïdes, dont les six principaux sont : morphine, narcotine, papavérine, codéine, thébaïne et narcéine, atténuent la valeur d’intoxication de l’opium brut. L’héroïne, trop connue de certains intoxiqués, est un dérivatif de la morphine.
Tous les fumeurs d’opium ont traité sur le mode dithyrambique les jouissances psychiques que procure la « bonne drogue ». Voici Claude Farrère qui chante l’hymne à la Fumée d’opium : « Oh ! se sentir de seconde en seconde moins charnel, moins humain, moins terrestre !... Admirer la multiplication mystérieuse des facultés nobles ; devenir, en quelques pipées, l’égal véritable des héros, des apôtres, des Dieux ... ». Farrère et les fumeurs ont raison : une des caractéristiques de l’opium est d’abolir tout désir sexuel en exaltant, au contraire, les « facultés nobles » : intelligence, mémoire, sens du beau. « Ainsi, dit toujours cet auteur, les nerfs féminins sont troublés amoureusement par l’opium mais l’opium apaise et maîtrise les virilités. Et regardez se jouer l’opium capricieux : aux femmes, créatures d’amour, il exaspère et multiplie l’ardeur amoureuse ; aux hommes, créatures de pensées, il supprime le sixième sens qui s’oppose grossièrement aux spéculations cérébrales. Il est certain que les choses sont bien ainsi et que l’opium a raison. » (Cl. Farrère, Fumées d’opium.)
Trois stades bien caractérisés marquent la carrière d’un opiomane. Les voici résumés d’après Jarland. (L’opium au Yunnam, 1925) :
-
Sensation d’euphorie dès les premières pipes. On ne sent plus son corps. Les idées surgissent. Exacerbation de l’intelligence, de la mémoire, des sentiments de beauté et de bonté.
-
Le fumeur est imprégné. Pour avoir « ses » sensations, il double, triple même le nombre de pipes. La paresse s’installe et l’activité motrice diminue.
-
L’Euphorie devient de plus en plus lointaine. L’organisme ne réagit plus : anorexie, constipation, dyspepsie, troubles de la circulation.
Bref, l’opiomane a perdu le rythme de la vie. Et, au point de vue psychique, c’est la déchéance qui commence. Ah ! les poètes ont chanté tout à l’heure l’hymne à l’opium avec ses joies et ses sensations qui font du fumeur un surhomme. Écoutez les maintenant :
« … C’est une pipe meurtrière ... dix poisons, tous féroces, s’embusquent dans son cylindre noir, pareil au tronc d’un cobra venimeux ... Il n’est plus qu’une sensation humaine qui me soit restée ... si, une chose, un verbe : souffrir ! »
« Une heure sans opium, voilà l’horrible, l’indicible chose, le mal dont on ne guérit pas, parce que cette soif là, la satiété même ne l’éteint pas... et je suis le damné qui, pour se délasser de la braise ardente, trouve seulement le plomb fondu. » (Claude Farrère, loc. cit.).
Telle est la grande caractéristique de la psychologie des stupéfiants. A côté de la joie intense que procure le poison tant que dure son effet, se trouve la désespérance épouvantable pour l’intoxiqué devenu l’esclave de sa passion.
ALCALOÏDES DE L’OPIUM.
Morphine.
C’est le dérivé de l’opium le plus employé ; et c’est le meilleur aide que possède le médecin dans tout son arsenal thérapeutique pour soulager toute douleur de quelque nature qu’elle soit. Il est même dommage que la phobie de l’accoutumance empêche beaucoup de médecins de l’employer quand ils devraient le faire, car chez des incurables, c’est un acte de charité que d’adoucir leurs derniers moments avec des injections de morphine, même à haute dose.
Chez les morphinomanes avancés, l’emploi de ce stupéfiant est redoutable, car ils ne peuvent vivre la vie à peu près normale qu’avec leur dose d’entretien. Rien n’est d’ailleurs plus triste et plus répugnant que de voir l’intoxiqué au faciès hébété, sortir de sa poche ou de son sac (car hélas ! les femmes sont en plus grand nombre que les hommes), sans nul souci d’antisepsie, la seringue toujours prête, et se larder, même en public, dans un coin retiré. (c. f. un reportage de « Gringoire », janvier 1933).
Aussi faut-il voir dans quel état se trouve la peau des jambes, des cuisses, du ventre, des bras, absolument tatoués de mille coups d’aiguille, sans compter les cicatrices d’abcès qu’on s’étonne de ne pas voir apparaître à chaque piqûre.
Héroïne.
Un dérivé de la morphine, devenu très à la mode chez les toxicomanes, c’est l’héroïne.
La sensation d’euphorie est, en effet, plus grande, plus subtile, plus spécialisée dans son raffinement, qu’avec la morphine ou l’opium. Évidemment, comme avec tout stupéfiant, elle s’atténue à la longue et finit par disparaître même en augmentant les doses.
Cette euphorie s’accompagne d’un état d’hyperactivité psychique avec facilité d’association d’idées et de paroles extraordinaires. Cela dure deux heures environ.
C’est le meilleur médicament conseillé pour la toux et la dyspnée, ainsi que pour l’état dépressif de la mélancolie, mais son emploi doit être très surveillé, car la « faim » de l’héroïne est plus impérieuse que celle de la morphine et de l’opium, surtout la sensation de « paradis » disparaissant très rapidement à l’usage.
Les autres succédanés de l’opium n’ont rien d’intéressant au point de vue « stupéfiant ».
Nous allons donc étudier le grand poison à la mode, la « coco », la « neige », qui fait tant de ravages dans un monde spécial de viveurs ou de faibles qui se laissent prendre à ses appâts.
Cocaïne.
Nous savons tous que c’est l’alcaloïde, principe actif, que contiennent les feuilles de l’Érythroxyloncoca. Les Incas, de temps immémorial chiquaient ces feuilles, remède souverain contre la faim, la soif, la fatigue.
La cocaïne fut isolée en 1859 par Niemann. Elle est employée sous la forme de chlorhydrate, sel qui se présente sous la forme de paillettes blanches, brillantes, ce qui lui a acquis très rapidement chez les cocaïnomanes la dénomination de « neige ».
On l’utilisa d’abord en chirurgie, sa propriété anesthésique étant remarquable. Reclus en formula les lois. En art dentaire, et en petite chirurgie, il rendit de grands services grâce à l’absence de toute douleur qu’on obtenait pendant les opérations.
Ce n’est que depuis quelques années qu’on s’aperçut que, prise en inhalation nasale, il se produisait des phénomènes d’euphorie, d’ivresse spéciale, et d’excitation agréable.
Et comme malheureusement, là comme partout, et encore plus que partout, l’habitude naît de la première réalisation, l’intoxication progressive abolit toute volonté de réagir, et la cocaïnomanie est installée.
La cocaïne, plus que tout autre stupéfiant, a gagné un certain public, grâce à sa facilité d’absorption. La « prise » est simple et facile. Pas de solution ou d’ampoule, ni de seringue comme pour la morphine. Pas de mise en scène ni de matériel comme pour la fumerie d’opium.
« Point de cachoterie gênante et humiliante : une boîte, une poudre blanche qui n’a pas d’odeur, qui ne tache pas, un geste rapide et discret, bref tous les avantages d’une habitude élégante et de bon ton. » (Dupré et Logre)
Les effets psychologiques de la cocaïne sont variables selon les individus. Ils ne sont pas les mêmes, non plus, selon que le terrain est neuf ou déjà imprégné.
L’initiation se fait, soit par curiosité, soit par l’entraînement d’un camarade, car il est à noter que les toxicomanes cherchent toujours à enrôler le plus possible d’adeptes.
Après la prise de cocaïne, le sujet ressent d’abord une anesthésie complète de la muqueuse nasale ; puis il éprouve sur la face, autour du nez et de la bouche une impression de froid et quelques phénomènes désagréables tels que nausées, défaillances, palpitations, changement de la voix, trismus et prognathisme du maxillaire inférieur. Chez ceux qui sont un peu entraînés, cette phase n’existe pas, et la cocaïne provoque d’emblée son euphorie spéciale : contentement profond, sentiment de force et d’intelligence, oubli des chagrins, qui n’apparaissent plus à la conscience rassérénée, que comme des contingences négligeables. C’est une ivresse forte et joyeuse. Dans son visage épanoui, l’œil vif et humide, troué par une large mydriase offre un éclat singulier, mais combien de temps cela dure-t-il ?
Fugace, ce rêve s’estompe dans un lointain, laissant un désir de recommencement inextinguible. Alors arrive un sentiment pénible de lassitude et de tristesse avec anxiété et énervement. Le malade n’est plus qu’une loque incapable du moindre effort. Et pour échapper à cette dépression angoissante, pénible comme un supplice, il ne voit plus qu’un moyen : recourir à une nouvelle dose de cocaïne. Les prises succèdent aux prises jusqu’à ce que l’on sente physiquement que l’on a son plein. Ce seuil, après quelques entraînements, peut atteindre facilement deux grammes et chez les grands cocaïnomanes, dix et vingt grammes.
Alors pendant quelques instants, c’est un vrai coma, avec cœur battant la chamade par son arythmie. C’est la période vraiment stupéfiante et tellement redoutée, que beaucoup préfèrent continuer leurs doses jusqu’au jour pour que les occupations de la vie courante les arrachent à leur cauchemar.
En effet, après ce cycle de perte absolue de toute conscience, celle-ci revient peu à peu, et c’est alors l’insomnie avec tout son bagage d’excitation cérébrale. Il y en a pour, à peu près, cinq heures. Après, la vie reprend, et quand le toxique est digéré et en partie éliminé, c’est une impression d’apaisement, avec une vitalité plutôt exacerbée. La faim, même boulimique, revient, car sous l’influence de la cocaïne, il y a presque impossibilité de manger ou de boire. Nulles aussi les fonctions urinaires et génésiques.
Ce n’est que lorsque l’organisme s’est libéré du poison par des mictions copieuses, que ces deux fonctions reprennent leur activité avec même un peu d’exagération.
Nous pouvons donc dire, d’après l’étude de ces phénomènes, qu’il y a une grande différence entre l’intoxication de la cocaïne et celle de l’opium. Dans la cocaïne, la phase d’excitation, toujours consécutive à l’état primitif et essentiel de stupéfaction, est plus développée que dans celle de l’opium. L’opiomane est en général muet, le cocaïnomane parle énormément et avec jugement et facilité.
Mais, en résumé, cocaïne comme opium suppriment les malaises de la fatigue plutôt qu’ils ne donnent de la force.
L’illusion ne se prolonge pas et l’oubli momentané de la fatigue sera compensé par une dépression plus grande du système nerveux, réclamant fatalement une nouvelle dose de poison, et amenant l’accoutumance.
Hachisch.
Nous ne devrions pas, en vérité, parler du hachisch dans cette étude, car, nous l’avons dit au début, quoique considéré comme stupéfiant, ce n’est en réalité qu’un excitant, comme l’alcool et le café.
Extrait du chanvre, (cannibis indica), il est en grand honneur chez les populations arabes, au même titre que l’opium en Chine et Indo-Chine. La préparation la plus connue est le Dawamesk qui renferme en plus de l’extrait gras du chanvre, du sucre, des aromates : musc, cantharide, noix vomique, etc ...
Il était très snob de manger le hachisch au temps des romantiques, comme il le fut plus tard pour l’éther, comme il l’est aujourd’hui pour la cocaïne, et de tout temps pour l’opium.
Théophile Gautier, Baudelaire, Moreau de Tours, Charles Richet même, notre grand maître de la physiologie, nous ont laissé des observations extrêmement fouillées sur l’ivresse hachischienne.
L’euphorie du mangeur de hachisch est causée par l’illusion d’une activité débordante. On trouve une grande analogie avec l’alcool dans cette superexcitation. Les impressions qui viennent du dehors déclenchent des actes. Une musique, même banale, provoquera des exubérances de cris, de rires ou de larmes. Nous avons vu tout le contraire chez l’opiomane ou le cocaïnomane, la passivité étant leur état habituel, et le moindre bruit pendant l’état de stupéfaction, devenant une vraie souffrance.
La plus belle observation que nous ayons de l’ivresse hachischienne est celle que Théophile Gautier publia dans un journal (La Presse) et que Moreau de Tours a reproduite dans son livre « Du Hachisch et de l’aliénation mentale ». Nous y renvoyons le lecteur.
Alcool.
C’est franchement un excitant, et l’action stupéfiante n’arrive que comme réaction intense. Alors, c’est le sommeil de brute, prélude d’une attaque possible de delirium tremens.
Peyotl.
Disons un mot de cette petite plante originaire du Mexique, le peyotl, dont A. Rouhier nous a fait connaître les sensations bizarres qu’elle provoque lorsqu’on l’absorbe en infusion.
L’ivresse du peyotl est essentiellement visuelle, et consiste en un défilé d’images vivement colorées et animées d’un mouvement continu.
Le peyotl se rapprocherait donc du hachisch mais n’a rien d’un stupéfiant. (c. f. l’auto-observation de A. Rouhier dans son livre Le Peyotl, G. Douin, Paris, p. 233.)
Hypnotiques.
Toute une série de nouveaux médicaments provenant en partie de l’acide barbiturique ont envahi la pharmacopée moderne. Énervés, excités par la frénésie et la trépidance de la vie actuelle, les gens des grandes villes ont le sommeil difficile, et l’usage des hypnogènes leur semble un appoint bienfaisant au repos qu’ils désirent.
Véronal, gardénal, allonal et combien d’autres font partie aujourd’hui du matériel de la table de chevet.... (avec peut-être le revolver dans le tiroir !.... ). Et quoi d’étonnant, alors, que l’on enregistre à chaque instant des suicides par le plus connu de ces produits, je veux dire le Véronal, puisque le pharmacien peut le délivrer tout comme un vulgaire tube d’aspirine, sans ordonnance ?
Anesthésiques.
Ceux-ci ne sont pas aussi facilement employés par le public. Le chloroforme, le chlorure d’éthyle, le protoxyde d’azote, restent l’apanage des chirurgiens. Quant à l’éther, je crois qu’il n’est guère plus de mode ; ceux d’il y a cinquante ans qui se vantaient de son ivresse et dégustaient avec délice (?) des fraises à l’éther (cf. le livre de Willy : L’Éther), ne sont plus guère en état de l’employer, et leurs petits-fils préfèrent de beaucoup la cocaïne ...
Dupré et Logre ont décrit l’élément d’excitation de l’éther, qui manque dans l’effet de l’opium. Mais la plus belle observation est celle de Guy de Maupassant, qui respirait l’éther lorsqu’il avait la migraine, et qui en recevait ensuite une excitation intellectuelle admirable : « C’était, dit-il, une acuité prodigieuse de raisonnement, une manière nouvelle de voir, de juger, d’apprécier les choses et la vie avec la certitude, la conscience absolue que cette manière était la vraie. Et la vieille image de l’Écriture m’est revenue soudain à la pensée : Il me semblait que j’avais goûté à l’Arbre de Science ... J’étais un être supérieur, d’une intelligence invincible, et je goûtais une jouissance prodigieuse à la constatation de ma puissance ...
Puis des bruits vinrent, sons indistincts, et je reconnus que ce n’étaient que bourdonnements d’oreille.
Je respirais toujours le flacon — soudain je m’aperçus qu’il était vide, et la douleur recommença ».
Nous voyons bien, qu’il s’agisse d’opium, de morphine, de cocaïne ou d’éther, que le rythme est toujours le même. Exaltation avec la sensation de beauté et de bonté et réaction de souffrance — avec l’impression que tout est fini. — On recommence alors ... jusqu’où ?
Conclusion.
Lorsque Tolstoï a demandé : pourquoi les hommes usent-ils de stupéfiants, il a répondu :
« C’est pour étouffer leur conscience et altérer le sens de leur responsabilité. »
Je ne crois pas que ceux qui s’adonnent aux stupéfiants voient aussi loin dans leurs réactions sentimentales, mais il semble que, malgré eux, ce but soit atteint.
En réalité, on crie à la déperdition de la race, à l’abrutissement des individus, à la dégénérescence de la nation parce que quelques imbéciles se livrent à la fumée d’opium ou à la prise de « coco ». C’est profondément ridicule. Qu’on les laisse donc s’abêtir, tous ces inutiles, ces snobs qui peuplent les dancings, ou les bars plus ou moins interlopes !.... Et ces fameuses fumeries d’opium des environs de l’Étoile ... et ces maisons, où tous les vices sont couverts par une respectable matrone souvent au service de la préfecture de police !.... Quelle perte voulez-vous que ce soit pour la nation de les voir se tuer ou peupler les maisons de santé ? La cure de désintoxication ? Oui, elle peut donner quelques bons résultats, mais elle coûte cher et ne nous intéresse pas.
Voit-on la classe ouvrière se livrer à ce geste stupide de se mettre une prise de cocaïne dans le nez ? Elle en rirait si on le lui proposait. Non, elle n’a que faire de tous ces poisons, et a pour elle des joies autrement saines.
Faut-il écouter les pessimistes, qui pensent que notre planète est destinée à une dégénérescence universelle : l’Extrême-Orient paralysé par l’opium, le monde musulman par le hachisch, l’Amérique par la cocaïne et la vieille Europe usée par l’abus de l’alcool ? .. (Dr Legrain.)
Non, je ne veux pas croire cela. A côté de ces fossiles, se trouvent des éléments jeunes et sains qui, loin des poisons et des stupéfiants, régénéreront la race.
Laissons aux demi-fous leurs intoxications. La société se défend contre eux le mieux possible, en créant des difficultés d’approvisionnement. La cocaïne et tous les dérivés de l’opium sont inscrits au fameux tableau B et leur délivrance par le pharmacien est de plus en plus rigoureuse. La Société des Nations s’occupe, de temps en temps, de légiférer les fournitures mondiales de ces produits. Quant aux trafiquants, la police spéciale sait leur donner la chasse et le tableau est souvent fructueux.
Mais, encore un coup, le poison n’atteint que quelques éléments peu intéressants de la société et laisse indemne la vraie fleur de la population ; et c’est le principal.
— Louis IZAMBARD.
SUBJECTIF, SUBJECTIVISME, SUBJECTIVITÉ
Ces mots s’opposent directement à objectif, objectivisme, objectivité. Le sens des mots sujet et objet et de leurs composés a tellement varié en philosophie, que leur histoire sémantique serait longue à exposer ou peu intelligible. La seule explication du sens que donne Descartes au mot objet demanderait des pages. Un philosophe presque contemporain, Charles Renouvier, mort en 1903, employait encore objet et sujet dans un sens à peu près contraire à l’usage généralement adopté aujourd’hui.
L’acception moderne a son origine dans la terminologie de Kant. Mme de Staël dit excellemment (De l’Allemagne, III, 6) :
« On appelle, dans la philosophie allemande, idées subjectives celles qui naissent de la nature de notre intelligence, et idées objectives toutes celles qui sont excitées par les sensations. »
D’une façon plus générale encore et pour parler le langage substantialiste coutumier, le subjectif est tout ce qui a rapport au Moi et à la vie intérieure ; l’objectif, tout ce qui a rapport au Non-Moi.
Page 1817 de cette Encyclopédie, Ixigrec a exposé clairement le point de vue scientifique et condamné toute méthode subjective. Il a absolument raison dans le domaine de l’affirmation générale. Ce qui est subjectif doit rester individuel et ne jamais tenter de s’imposer à autrui. Je ne propose même pas ma métaphysique ou mon éthique, je les expose. Et ce n’est pas pour que d’autres rêvent mon rêve ou agissent selon ma conscience. Ceux qui ont, comme moi, le goût de cette poésie particulière qu’on appelle métaphysique ne doivent ni se laisser imposer un seul poème, je veux dire un seul système, ni prétendre que d’autres adoptent leur rêve et leur système. Si, élargissant peut-être le sens actuel du mot, j’ai intitulé Le Subjectivisme un exposé de mon éthique, c’est pour plusieurs raisons. J’indique ainsi que, méprisant toutes les morales qui se veulent universelles et qui osent ordonner, je m’efforce de styliser ma vie selon les conseils d’une « sagesse qui rit » et qui n’a pas la prétention de pouvoir servir à tous. Qu’elle m’encourage stoïquement ou qu’elle me berce épicuriennement, la sagesse que j’écoute m’enseigne toujours que le dehors, l’objectif, la matière de ma vie, a moins d’importance que la façon dont je l’accueille : il est peu de circonstances auxquelles je ne puisse donner en moi, si je suis un artiste suffisant, la forme du bonheur. Enfin le premier conseil de toute sagesse me paraît le fameux « Connais-toi toi-même » et la partie intellectuelle de la sagesse n’est qu’une critique de mes pouvoirs et de mes vouloirs.
En métaphysique, ce que j’appelle subjectivisme n’est que le refus de toute autorité pour autrui comme pour moi ou, si l’on préfère, une affirmation de libre-pensée et d’individualisme. Mais, en éthique, aurai-je l’immodestie de croire que mon subjectivisme est un approfondissement de l’individualisme ordinaire ?
— HAN RYNER.
SUBORDINATION
n. f. (du latin sub, sous, ordo, ordre)
Euphémisme destiné à cacher la réalité, le mot subordination est l’équivalent du mot servitude, dans la majorité des cas. Et l’on sait qu’aujourd’hui la servitude est à la mode, même chez nous, où maintes grenouilles radicales et marxistes réclament un pouvoir fort.
Acquisitions tardives de notre espèce, le besoin d’indépendance, le goût de la liberté sont fréquemment tenus en échec par l’instinct servile, hérité de nos aïeux. Pendant d’innombrables siècles, les hommes furent esclaves et de corps et de pensée. Absorbé par le groupe, privé de toute personnalité véritable, l’individu n’a pris que tardivement conscience de sa valeur et de ses droits. Même à notre époque, beaucoup n’arrivent pas à comprendre que la qualité de membre de telle ou telle collectivité, famille ou association, compte bien peu comparée aux mérites intrinsèques et personnels du moi profond. Tout savant ou tout artiste dont la puissance créatrice s’avère exceptionnelle peut, à bon droit, se dire citoyen du monde, et les honneurs qu’on lui accorde ou lui retire ne modifient aucunement ses qualités. Le génie n’a point de patrie, concèdent des penseurs pourtant bien timides. Ce qui est vrai des hommes illustres, l’est aussi des individualités obscures qui, malgré une pression sociale incessante, conservent leur originalité. Un torse splendide garde sa valeur intrinsèque, même s’il est recouvert d’un veston rapiécé, et, pour faire disparaître les tares d’un corps affaibli, il ne suffit pas d’endosser des habits magnifiques ; pareillement, diplômes, titres et décorations n’ajoutent rien aux aptitudes mentales de l’individu ; si éclatants soient-ils, on leur demande vainement de donner de l’esprit aux jeunes aristocrates qui en sont dépourvus. Qu’il habite dans l’Inde, en Autriche ou au Venezuela, qu’on l’honore ou qu’on l’emprisonne, l’homme de bien sème autour de lui espérance et bonheur ; peu lui importe les mœurs, les coutumes et le qu’en-dira-t-on ; de l’opinion des autres il n’a cure, c’est de son propre cœur que jaillissent compassion et générosité. A la nature, non aux accessoires que la collectivité ajoute, chacun doit d’être une personnalité uanique, incapable de jamais se reproduire absolument identique. Tant qu’elle ne lèse point les droits légitimes d’autrui, il faut qu’elle puisse développer librement ses virtualités mentales et physiques.
Malheureusement, les chefs, loin de favoriser le goût de l’indépendance, s’appliquent à maintenir celui de la servitude, afin d’asseoir leur domination sur une base indestructible. Eglise, école, police, administrations diverses, tout le formidable appareil de la machine gouvernementale est orienté dans un sens contraire à celui de la liberté. Aussi l’évolution normale qui conduit à rejeter tradition et conformisme, pour permettre à la personne humaine d’atteindre à son développement complet, se trouve-t-elle entravée fâcheusement. A certaines époques surtout, les partisans d’une autorité tyrannique triomphent avec impudeur. Hélas ! nous vivons une de ces époques-là. La vogue est aux dictatures ; partout l’on prône les gouvernements forts, qui remplacent la raison par la trique et réduisent le citoyen vulgaire à n’être qu’un numéro. Sous prétexte de restaurer la puissance de l’Etat, qu’ils estiment amoindrie, partis rétrogrades et partis avancés songent pareillement, mais pour des fins contraires, à priver l’individu du peu d’indépendance que lui concède encore la loi. Et l’idéal qu’on nous propose à grand renfort de réclame, c’est celui de la caserne, du pensionnat ou du couvent. Tous se lèveront au même instant, porteront les mêmes habits, travailleront à des besognes équivalentes un nombre d’heures égal, mangeront au même moment une soupe et un fricot identiques ; couchés à la même heure, ils devront tous dormir ou du moins s’ennuyer au lit jusqu’à telle minute fixée d’avance ; distractions ou promenades n’échapperont pas davantage à une étouffante réglementation. Décrétées par des chefs qui penseront pour le troupeau, ces mesures seront appliquées sous la rude mais juste surveillance de contrôleurs incorruptibles.
Maintes causes expliquent cette poussée vers la servitude à laquelle trop de peuples n’ont pas su résister. Elle provient d’abord de la désastreuse influence exercée par de nombreux journaux. S’élever jusqu’à la dictature fut toujours la suprême hantise des politiciens mégalomanes et des grands ambitieux. En outre Lénine, Mussolini, Hitler ont montré qu’à notre époque les espoirs les plus incroyables étaient permis à l’homme qui exploite adroitement une situation révolutionnaire. Même dans des pays où la démocratie est installée depuis longtemps, ils sont moins rares qu’on ne le suppose, les apprentis dictateurs. Mais très peu l’avouent ; pour mieux piper la confiance des masses, ils se disent habituellement grands amis des prolétaires. Toutefois, ils alimentent, d’une façon occulte, des campagnes de presse pour la restauration d’un pouvoir fort. Un chœur savamment orchestré de journaux, allant de l’extrême droite à l’extrême gauche, proclame que la cause de nos maux réside dans l’affaiblissement du principe d’autorité. Et chaque jour, avec des variantes opportunes dans l’accompagnement, il entonne la même antienne, sous n’importe quel prétexte. C’est la condition imposée par l’invisible chef de jazz aux exécutants qui veulent avoir part aux libéralités des fins de mois. Par tous les moyens, au prix des plus honteux mensonges, il faut persuader au peuple que la situation deviendrait rapidement merveilleuse s’il avait à sa tête un maître omnipotent. Lorsque le candidat dictateur est l’homme lige des manitous de la banque, du commerce et de l’industrie, ses largesses royales engendrent à son égard un enthousiasme qui, finalement, tient du délire. Comme il dispose de ressources illimitées, la foule des gens à vendre se presse à ses guichets ; sans peine il se ménage des complicités, même parmi ceux qui se disent ses adversaires. De simples mégalomanes, Coty le parfumeur par exemple, trouvent des valets de plume assez vils pour chanter leurs louanges sur un mode dithyrambique capable d’égayer tout lecteur qui a conservé son bon sens.
En aidant à la diffusion de doctrines qui ne parlent que d’obéissance et confèrent à qui commande la dignité de demi-dieu, l’Université a contribué, elle aussi, à faire naître le mouvement réactionnaire actuel. Un Durkheim, dont l’influence fut si néfaste, prônait la soumission aux autorités sociales, même si elles détenaient le premier rang par brigue et par corruption. Sous prétexte d’ordre et de discipline, il sacrifiait l’individu à l’Etat. Avec des théories pareilles, on ne forme pas des hommes, on fabrique des pantins ; mais la tâche devient si facile, et pour les gouvernants et pour les chefs de parti, qu’ils cherchent tous en pratique à inculquer ces idées néfastes dans le cerveau de leurs ressortissants. Après les étudiants de Sorbonne et des Facultés provinciales, les élèves des lycées et des écoles normales, puis ceux de nos plus pauvres écoles primaires durent ingurgiter un Durkheim adapté à la capacité de leur cerveau. Aux adultes rendus dociles, partis, Eglises, coteries fournissent ensuite des idées toutes faites sur des problèmes qu’ils n’ont jamais étudiés. Réflexion, examen critique sont remplacés par un acquiescement aveugle aux directives des chefs de file.
Si peu de gens, même parmi les intellectuels, possèdent une vraie personnalité, que longtemps encore les fournisseurs de credo et de programmes verront leur commerce prospérer. Instinct d’imitation, esprit grégaire sont les solides bases psychologiques qui permettent aux plus sots mouvements religieux, littéraires, politiques, etc., de grandir et de durer. Par manque d’effort intellectuel, beaucoup deviennent incapables d’avoir des concepts bien à eux ; c’est d’autrui qu’ils reçoivent toutes leurs idées et, quand ils déclarent une solution adéquate et parfaite, c’est que leur guide favori l’a chaudement préconisée. Des multiples notions qui peuplent leur cerveau, pas une ne leur appartient en propre, pas une n’est une création de leur intellect ou n’a jailli spontanément du tréfonds de leur individualité. Nous rencontrons aussi des hommes, par ailleurs fort actifs, mais dont la mentalité revêt un aspect mécanique. Entourés de téléphones, de machines à parler, dicter, calculer, etc., certains brasseurs d’affaires finissent par n’avoir qu’une pensée automatique, dont le mouvement toujours pareil est commandé par les manettes et les leviers de l’intérêt personnel. Indéfiniment leur esprit tourne dans le même cercle de préoccupations mesquines et d’idées sans élévation ; ce sont des machines à gagner des dollars ou des francs. Ils jonglent avec les millions, connaissent à fond les règles du jeu commercial ou financier ; hors de l’étroit damier où s’alignent leurs pions, ils se montrent incapables de rien comprendre.
Dans le monde du travail, le développement d’un syndicalisme privé de sa première et généreuse sève, la formation de groupements professionnels peu soucieux d’éveiller le goût de la réflexion chez leurs adhérents, ont conduit certains ouvriers à penser d’une façon impersonnelle et grégaire. Bien compris, le syndicalisme aboutit à des résultats tout différents : il permet au salarié de se documenter sur les problèmes qui l’intéressent, il l’oblige à peser mûrement les décisions qu’il doit prendre et qui, parfois, mettent en cause son gagne-pain. Ce double but fut clairement exposé par les héroïques fondateurs des premiers syndicats ouvriers ; et, parmi leurs successeurs, ceux-là ne l’oublient point qui sont restés fidèles à la cause du prolétariat. Hélas ! maintes associations, qui furent à l’origine de merveilleux instruments de libération, ne sont plus aujourd’hui que des entreprises administratives, secrètement chargées par les pouvoirs publics de ralentir ou d’arrêter la marche en avant des travailleurs devenus moins dociles. Dans trop de centrales ouvrières, l’esprit bureaucratique règne en souverain maître, et ceux que la confiance des salariés plaça aux postes de direction adoptent les méthodes des fonctionnaires gouvernementaux. Ils oublient que leur emploi n’est pas une sinécure, qu’ils doivent donner l’exemple du courage, du désintéressement, de l’abnégation ; et, pour assurer indéfiniment leur réélection, ils s’efforcent, non d’éclairer la masse, mais de l’habituer à l’obéissance passive. Foin des discussions approfondies avant l’action et, après, d’une critique impartiale des résultats obtenus ; il suffit de croire à l’infaillibilité des chefs et de les suivre aveuglément. Aussi, avec la complicité des hauts fonctionnaires du syndicalisme, Mussolini et Hitler ont-ils pu se rendre maîtres des organisations ouvrières, sans rencontrer l’ombre d’une résistance. Dépourvus d’esprit critique, incapables d’initiative personnelle et ne sachant qu’obéir, les travailleurs restèrent inertes devant la dictature, parce que la trahison de leurs dirigeants les priva du mot d’ordre qui pouvait galvaniser leur énergie. Il est promis aux plus honteuses servitudes, l’homme qui, sous prétexte de discipline, se borne à n’être qu’un instrument docile aux mains d’arrivistes rouges, jaunes ou blancs.
— L. BARBEDETTE.
SUBSISTANCES
Ensemble de choses nécessaires à l’entretien de la vie. Le sujet, à le considérer sous tous ses aspects, est des plus vastes. Je ne l’examine ici qu’au point de vue du rapport de la population humaine aux subsistances.
La question, qui n’a pas retenu outre mesure l’attention des sociologues et des réformateurs sociaux, est celle-ci : la terre, exploitée par la science, l’ingéniosité et le travail humains, donne-t-elle assez de denrées de toute sorte pour satisfaire largement aux besoins primordiaux de chacun ?
Couramment, on répond par l’affirmative. On dit :
« Il y a, à tout moment, quel que soit l’accroissement de la population, trop de tout. »
Point de démonstration d’ailleurs, aucun chiffre, aucune preuve.
Elisée Reclus a bien tenté, il y a une cinquantaine d’années, de justifier la croyance générale, mais, négligeant pour les grains, les réserves (semences, alimentation du bétail, utilisations industrielles), attribuant aux hommes, pour la viande, tout le poids de toutes les bêtes vivantes, il enlisait facilement l’humanité dans des amoncellements formidables de nourriture.
La thèse de l’abondance a été aussi défendue éloquemment par Pierre Kropotkine, dans la Conquête du pain notamment et dans Champs, Usines, Ateliers. Ses vues, très en vogue parmi les anarchistes, ont eu, sur le développement général de la pensée économique conservatrice, leur influence. Elles appartiennent cependant au domaine des possibilités. Elles rejoignent les prédictions chimiques de Berthelot sur les pastilles azotées dont se nourriront nos descendants. Elles restent vaines pour les temps présents. Exposées pour ruiner la thèse malthusienne, elles la laissent absolument inatteinte. C’est que Kropotkine montrait les possibilités d’accroissement des subsistances plus en romancier qu’en physicien, c’est qu’il passait sous silence la loi de productivité diminuante du sol, c’est que, ébloui par de brillantes expériences sur de petits champs de culture, il tenait pour négligeable la rareté des matières fertilisantes et les difficultés de leur application aux grandes étendues, c’est enfin et surtout qu’il n’opposait point, aux possibilités d’accroissement de la production, les possibilités d’accroissement de la population.
Paul Robin qui avait, je crois bien, exposé déjà à Bakounine et à Marx ses doutes sur la valeur du dogme abondance, qui, maintes fois, en avait fait part à Pierre Kropotkine, aux Reclus, à ses camarades de I’Internationale, proposa, en 1901, par un tableau circulaire, des recherches sur cette question. C’est à sa suggestion que je fis paraître en 1904, un opuscule Population et Subsistances qui donnait, à titre d’indication, pour les nations civilisées, les résultats de l’enquête à laquelle je m’étais livré.
Le plan de cet ouvrage comportait cinq parties :
-
Détermination d’une ration-type, c’est-à-dire de la quantité de substance nutritive nécessaire à la vie de l’individu homme moyen actif ;
-
Statistique de la population à nourrir (ou population totale ramenée à un nombre d’adultes hommes). Selon le système que j’adoptais, la population totale était réduite du quart ;
-
Statistique de la production alimentaire (céréales, viandes, légumes, etc.). La production brute alimentaire n’est pas exclusivement consacrée à la nourriture des hommes. Il faut en déduire les semences, la consommation animale et industrielle pour obtenir la production nette, effective ;
-
Répartition égale de la production entre les individus. La division du chiffre de la production nette par celui des hommes, donne la ration réelle ;
-
Comparaison de la ration réelle à la ration type. Je ne puis m’étendre ici sur le détail. Il suffira de dire que je faisais à l’optimisme la part la plus large, que je favorisais, dans tous les sens, la croyance à l’abondance.
Ma conclusion, contraire au dogme courant, était que l’humanité civilisée ne disposait que de récoltes insuffisantes et que, à l’époque étudiée, la planète ne fournissait, aux plus industrieux de ses habitants, que les deux tiers environ de la nourriture requise pour leur aisance.
M. Yves Guyot, l’année suivante (1905), sur un plan un peu différent, s’inspirant en partie de mon travail, publiait, à la Société d’Anthropologie et à la Société de Statistique, les recherches qui l’amenaient à déclarer que :
« La production du froment et de la viande, dans le monde, est de beaucoup inférieure à la ration nécessaire... »
L’agronome Daniel Zolla, dans ses ouvrages et conférences sur la productivité du sol, sur le blé et les céréales, concluait aussi, vers 1908, approuvé par Paul Leroy- Beaulieu, à l’insuffisance de la production agricole comparée à la population.
Je me garde de présenter ces travaux comme définitifs. Mais l’étude de cette question poursuivie attentivement durant des années m’assure dans la conviction que la surabondance tant invoquée toujours — et plus que jamais au moment où j’écris — par les socialistes, les communistes, les anarchistes, aussi bien que par les économistes ou politiciens « bourgeois », est loin d’être démontrée.
L’étude, sur le plan que j’ai adopté ou sur tout autre, devrait, certes, être reprise par un comité de chercheurs désintéressés, d’experts aux opinions sociales divergentes, statisticiens, physiologistes, hygiénistes, agronomes, zootechniciens, agriculteurs, horticulteurs, chefs d’industrie, etc., capables de fournir les éléments les plus précis pour la solution de la question. J’ai suggéré, à ce point de vue une enquête permanente et la publication d’un annuaire offrant une indication autorisée sur les ressources dont l’humanité dispose, non seulement au point de vue alimentaire, mais sous le rapport vestimentaire, immobilier, du confort physique et intellectuel, de l’aisance générale, individuelle et communautaire, privée et publique. Une telle œuvre serait, par exemple, de la compétence de la S. D. N.
Quoi qu’il en soit, si les travaux d’Yves Guyot, ceux de Daniel Zolla et les miens doivent être pris en considération, il y a, dans les pays civilisés, de nos jours, comme il y a trente ans, et comme toujours selon moi, pénurie de produits agricoles. Les chiffres suivants le montrent.
Voici d’abord la production du froment dans les pays gros producteurs, aux périodes 1901–10 et 1921–30, la première étant celle précisément où MM. Yves Guyot, Zolla et Leroy-Beaulieu constataient l’insuffisance des récoltes.
| 1901–10 | 1921–30 | |
|---|---|---|
| Europe | 51 500 | 52 500 |
| Etats-Unis | 18 000 | 22 500 |
| Canada | 3 000 | 11 000 |
| Argentine | 3 500 | 6 000 |
| Australie | 1 500 | 4 000 |
| TOTAUX | 77 500 | 96 000 |
La population de ces seuls pays, durant les mêmes périodes, est passée de 530 millions d’habitants à 630 millions. Mais nous réduirons le nombre de ces consommateurs enfants, femmes, vieillards, pour l’assimiler à un nombre d’hommes adultes travailleurs. Pour ce faire, le mathématicien Lagrange diminuait d’un cinquième la population totale. Nous la réduirons d’un quart. Ce sera 400 millions d’habitants environ pour la période de 1901 à 1910, et 475 millions pour celle de 1921 à 1930. Nous leur attribuerons tout le froment récolté, sans réserves ni pour la semence, ni pour les animaux et l’industrie, nous ne tiendrons compte ni des pertes inévitables même en régime idéal, ni des pertes par gâchage.
La part annuelle d’un adulte, en froment, en pain (car poids de froment égale poids de pain) et en produits similaires, ressort à environ 195 kilogrammes en 1901–10 et à 200 en 1921–30.
M. Yves Guyot estime qu’il faut compter pour un adulte homme 360 kilogrammes de pain par an. Pour n’être point taxé d’exagération, j’attribue 750 grammes de pain par jour à un travailleur homme, soit 260 kilogrammes par an.
On voit que ce poids n’est pas atteint, bien que nous n’ayons distribué les récoltes qu’entre les habitants relativement privilégiés des pays qui les produisent. Si, dans de semblables recherches sur le monde, nous comprenions populations et récoltes des contrées dont l’agriculture intensive ou extensive est inférieure en quantité, nous diminuerions la part effective déjà insuffisante.
On voit aussi que, d’une période à l’autre, cette part n’a guère augmenté, malgré l’ampleur extraordinaire prise, après la guerre, par la production du froment, au Canada surtout, et bien que les obstacles préventifs et répressifs se soient fait sentir plus violemment qu’à aucune autre époque.
Il y a d’autres aliments, Mais, insuffisance en blé indique, d’une façon générale, insuffisance en tout. Dans une étude à larges traits, il est d’ailleurs difficile de s’étendre sur chaque espèce de produits.
| 1901–10 | 1921–30 | |
|---|---|---|
| Europe | 121 700 | 116 000 |
| Etats-Unis | 8 000 | 10 500 |
| Canada | 1 200 | 2 300 |
| Argentine | 1 100 | 800 |
| Australie | 300 | 400 |
| TOTAUX | 132 300 | 130 000 |
La récolte d’après guerre est légèrement inférieure à celle d’avant guerre. Et si nous défalquons la part prise par la semence, la distillerie, la nourriture animale, celle surtout des 80 millions de porcs qu’élève la seule Europe, consommant chacun au minimum 2 kilos de pommes de terre par jour, nous trouverions probablement assez maigre la ration de pommes de terre octroyée à chaque homme par la culture.
Il y a la viande. On peut assez facilement donner une idée de la part qui peut être attribuée à chaque adulte homme.
| 1901–10 | 1921–30 | |
|---|---|---|
| Bovins | 243 | 277 |
| Ovins | 400 | 385 |
| Porcs | 127 | 153 |
En admettant que tous ces animaux aient en moyenne, le poids moyen des races fournissant le plus de viande, on aura pour le poids de viande retirée d’un bœuf 225 kg, d’un mouton 22 kg, d’un porc 50 kg.
| 1901–10 | 1921–30 | |
|---|---|---|
| Bœuf | 54 700 | 69 250 |
| Mouton | 8 800 | 8 470 |
| Porc | 6 350 | 7 650 |
Mais ces quantités ne sont pas disponibles annuellement. Suivant l‘Aide mémoire de l’ingénieur agricole (Vermorel), on n’abat chaque année que le cinquième environ des bêtes à cornes, le quart des moutons, la moitié des porcs.
| 1901–10 | 1921–30 | |
|---|---|---|
| Bœuf | 10 940 | 13 850 |
| Mouton | 2 200 | 2 100 |
| Porc | 3 185 | 3 825 |
| TOTAUX | 16 325 | 19 775 |
| Part annuelle (kilogrammes) | Part journalière (grammes) | |
|---|---|---|
| 1901–10 | 40,8 | 115 |
| 1921–30 | 41 | 115 |
La ration réglementaire du soldat français, en viande, désossée et crue, est de 300 grammes par jour d’après M. Yves Guyot. Dans le tableau ici, les 115 grammes comprennent os et petits déchets.
Nous sommes loin de l’abondance. Et nous n’avons pas fait entrer en ligne de compte les pays qui, par leur élevage, provoqueraient certainement une diminution de la maigre part attribuable à chaque humain civilisé.
Et le poisson, et les lapins, et la volaille, et le gibier ? dira-t-on.
Réunies, toutes ces nourritures n’accroîtraient pas du dixième la part de viande.
Non, nous n’avons pas trop de tout. Au contraire, tout nous manque. Tout nous manque dans les pays dits civilisés et c’est la grande cause qui fournit les prétextes à concurrences douanières, à incidents diplomatiques, à rivalités nationales et déchaînements guerriers.
Que nous y joignions les foules d’Asie, affamées malgré leur minutieuse agriculture, affamées à cause de leur reproduction bestiale, et nous verrions si le monde vit dans l’abondance, regorge de tout, ou bien végète par sous-alimentation, insuffisance, manque de toutes subsistances.
Je répète que je n’ai nullement la prétention de trancher définitivement, et d’une façon précise, la question. Je fournis des chiffres, j’offre une méthode, j’en tire une conclusion.
Que ceux qui croient à la surabondance donnent leurs chiffres, s’appuient sur du solide ! Jusqu’à preuves du contraire, je regarde comme une erreur l’affirmation que la production agricole fournit amplement de quoi nourrir l’humanité.
Beaucoup de militants politiques, sociaux verront le remède dans un accroissement de la production. Solution qui a été adoptée par les hommes dès le début de leur existence et qui a fait ses preuves comme impuissance. Produire davantage ne devient excellent que si, à la natalité désordonnée, hasardeuse, exubérante, se substitue une reproduction en nombre limité, mesuré, raisonnable, proportionnelle aux ressources générales.
Mais c’est non seulement de denrées alimentaires que nous manquons, c’est aussi, à n’en pas douter, de confort vestimentaire, mobilier et immobilier.
Il n’est que de connaître les intérieurs prolétariens, de savoir la vie des salariés pour s’en rendre compte, Il n’est que de comparer leur confort à un type de confort désirable pour tous les humains.
Pourrait-il y avoir, par une répartition équitable, dans tout logement, assez de locaux pour y faire vivre à l’aise, en lumière et aération, chaque membre du groupe qui l’habite ? Et dans ces chambres assez de meubles commodes, confortables, jolis, pour satisfaire aux nécessités personnelles ou communautaires ?
Chacun pourrait-il, en partageant fraternellement, avoir assez de vêtements d’hiver, de demi-saison, d’été, de sortie, de travail, assez de chaussures diverses, de linge, etc. ?
Chacun dans les locaux isolés ou communautaires, pourrait-il user facilement de salles de bain, de douches, de piscines, gymnases, bibliothèques, musées, laboratoires, observatoires, ateliers, salles de réunion, de conversation, etc. ?
Chacun pourrait-il jouir d’un jardin, pourrait-il voyager, faire voyager ses idées, transporter ses objets, etc. ?
Autant de problèmes qui, aujourd’hui, à les résoudre par le côté financier, monétaire, montreraient, à n’en pas douter, la pauvreté de la richesse sociale.
Autre question encore qui peut aider à éclairer les opinions sur ce point : quel peut être, à une époque donnée, le coût de l’élevage et de l’instruction d’un enfant, de la naissance à l’âge moyen où il devient producteur capable ? Instruction, éducation sans luxe, mais confortable dans des logis clairs, aérés, propres, sains. Aucune différence entre les enfants, bien entendu. Egalité au point de départ. Tous les jeunes mis à même de réaliser les promesses de leur personnalité. Dans de telles conditions, quelque taux raisonnable que l’on prenne, quelque époque que l’on considère, on constate que la pauvreté des nations ne permet nulle part l’élevage convenable des enfants au point de vue matériel.
Il n’est, du reste, pas un homme d’Etat, pas un ministre, pas un administrateur, pas un gérant, à un titre quelconque du capital social, qui ne sache l’impossibilité dans laquelle se trouve tout gouvernement de bonne volonté de satisfaire efficacement, pleinement, aux premiers besoins des hommes. L’accroissement rapide des charges sociales improductives des Etats, des collectivités, la multiplication des fonctionnaires, des agents de la force publique, des secours aux incapables, etc., ne sont-ils pas d’autres indices de misère publique, de surpopulation ?
Ces questions sont des plus importantes, des plus graves. Ce n’est pas uniquement en supprimant les budgets de la guerre qu’on les résoudra. Les réformateurs sociaux, quel que soient leur but, s’ils tendent sincèrement à rendre les hommes moins malheureux, ont tort de ne pas s’en préoccuper. Ils les rencontreront alors qu’il sera trop tard pour les résoudre. S’ils triomphent, dans les révolutions prochaines, ils se trouveront en face d’une telle misère sociale, qu’elle sera un obstacle formidable à tous les efforts de libération humaine.
Dire qu’on s’occupera de tout cela au lendemain du « grand soir », c’est compter sur une marge de surproduction qui n’existe pas, c’est retarder la libération qu’on poursuit, c’est se leurrer et leurrer les foules. Qu’on suive Bakounine ou qu’on suive Marx, ou tout autre, c’est une erreur de délaisser Malthus et Paul Robin.
— GABRIEL HARDY.
BIBLIOGRAPHIE. — Elisée Reclus : Les produits de la terre (1892). — Paul Robin : Tableau de la production et de la consommation (1901). Type de confort pour tous les humains (1904). — Yves Giroud : Population et subsistance (1904). — Yves Guyot : Le Rapport de la population et des subsistances (1905). — Daniel Zolla : Le Blé et les céréales (1909). — Dr Ch. V. Drysdale : Y a-t-il assez de subsistances ? Traduction Manuel Devaldès. (1915).
SUBSTANCE
n. f. (du latin sub, sous, stan, se tenir)
Le problème philosophique de la substance revêt un double aspect aux yeux du penseur moderne. D’une part, il concerne la perception du monde extérieur, la nature intime et profonde des objets que nous révèle l’expérience sensible ; d’autre part, il se préoccupe du fond invariable de l’être humain, de son moi, jugé distinct des phénomènes psychologiques que l’introspection fait connaître. Négligeant les creuses subtilités des scolastiques, touchant le problème de la substance, nous parlerons successivement de la perception des réalités extérieures et de celle du sujet pensant.
Pour l’ignorant, le monde extérieur existe bien tel que nous le percevons. Couleur, odeur, saveur, froid, chaud, et toutes les autres qualités sensibles sont des propriétés des choses elles-mêmes et, par conséquent, indépendantes de notre conscience. C’est avec des haussements d’épaules et un sourire dédaigneux ou compatissant, que maintes personnes, même non dépourvues d’instruction, écoutent l’homme qui se prend à douter de la valeur objective du témoignage de ses sens. En peuplant le monde de formes ou de qualités occultes, qui constitueraient les éléments des choses, Aristote et les scolastiques, ses admirateurs, sont restés proches de cette conception simpliste. Ils érigent en entités réelles des propriétés de nature subjective. Mais la physique a détruit radicalement cette croyance instinctive à l’objectivité de nos perceptions. Elle a ramené la lumière à un rayonnement d’énergie, le son, la chaleur, etc. à des vibrations de la matière. Dans l’univers qu’elle nous découvre, tout résulte, en définitive, d’ondes et de mouvements corpusculaires. De leur côté, physiologie et psychologie ont montré que nos perceptions sensibles dépendent, dans une large mesure, de la structure et de l’état des organismes nerveux, soit périphériques, soit centraux, et que la mémoire, l’association des idées, l’habitude et les autres facultés mentales jouent aussi un rôle des plus importants. De bonne heure, la simple réflexion philosophique avait conduit des penseurs, comme Héraclite et Parménide, à distinguer l’être réel et permanent des apparences variables et changeantes. L’opposition entre l’idée immuable, toujours identique à elle-même, et les données sensibles, dépourvues de stabilité, constitue la base essentielle de la philosophie platonicienne. Beaucoup d’autres philosophes rationalistes, pleins de défiance à l’égard de nos perceptions externes, ont demandé à l’intelligence de nous renseigner sur les qualités durables et constitutives des objets.
Raffinant à l’extrême la terminologie d’Aristote, les scolastiques distinguaient l’essence de la substance. Le premier terme désigna les qualités contenues dans la définition, les idées qui constituaient la compréhension du genre et de l’espèce ; le second s’appliqua à l’abstraite notion de matière indéterminée, notion que l’on érigea bien à tort en entité incompréhensible. Mille arguties, mille querelles extravagantes découlèrent de cette logomachie et firent les délices des philosophes du Moyen Âge. Elles intéressent encore les lecteurs d’un Maritain, mais ne méritent pas de retenir l’attention d’un homme sensé. Pour Descartes, ce qu’il y a de réel dans l’univers qui nous entoure, c’est ce que notre entendement conçoit d’une façon claire et distincte, non ce que nos sens perçoivent. L’étendue, voilà l’unique propriété vraiment constitutive des objets matériels. Un morceau de cire change de couleur, d’odeur, de forme, etc., lorsqu’on le fait fondre en le plaçant sur le feu ; mais, liquide ou solide, nous savons « par une inspection de l’esprit » que la cire est toujours étendue. Aussi l’espace, selon Descartes, ne diffère-t-il « de la substance que par cela seul que nous considérons quelquefois l’étendue sans faire réflexion sur la chose même qui est étendue ». S’inspirant d’idées semblables, Locke distinguera dans les corps les qualités premières, étendue, figure, solidité, etc., sans lesquelles on ne saurait les concevoir, et les qualités secondes, couleur, son, odeur, etc., qui peuvent être supprimées, au moins abstraitement, sans que disparaisse la notion de corps. « Les qualités premières sont dans les corps, soit que nous les y apercevions ou non », alors que « les secondes sont jugées y être et n’y sont point ». Mais il n’a pas été difficile de démontrer que l’étendue de Descartes et les qualités premières de Locke étaient aussi dépourvues d’objectivité que la couleur, le son ou la saveur. En conséquence le problème de la substance constitutive des réalités perçues par nos sens s’offre au penseur moderne sous un angle assez différent.
Voici devant moi un objet quelconque, une orange par exemple. Sa perception se réduit. en dernière analyse, au groupement d’un ensemble de sensations actuelles, d’images, de souvenirs, d’idées, d’habitudes mentales diverses. L’orange possède une couleur et une forme bien caractéristiques ; au contact, elle donne une impression de froid et de légères inégalités ; à la pression des doigts, elle oppose une résistance ; elle a de plus une odeur et une saveur très particulières. Et chacune de ces sensations peut être donnée séparément ; il existe une orange visuelle, une orange tactile et thermique, une orange olfactive, une orange gustative. Un aveugle de naissance, brusquement guéri de sa cécité, ne reconnaîtrait pas de prime abord, et par la seule vue, 1’orange qu’il distingue si facilement grâce à l’odorat ou au toucher. Une simple image, un souvenir des perceptions antérieures remplacent d’ailleurs fréquemment la sensation actuelle ; la vue d’une orange placée derrière la vitrine d’un magasin suffira, par exemple, à évoquer en moi le souvenir très précis de l’orange tactile, de l’orange olfactive, de l’orange gustative. Quand je perçois l’orange visuelle, je crois la saisir avec I’ensemble des qualités qu’elle présente d’ordinaire.
Mais ces propriétés de l’orange, que l’analyse psychologique nous montre nettement distinctes, nous leur supposons un substratum commun, la substance, qui se dissimule sous la couleur, qui engendre la forme et la résistance, qui provoque l’odeur et la saveur. Cette substance, nous ne la percevons pas directement ; néanmoins, nous ne pouvons douter de son existence, car toutes les fois que nos sens s’exercent ensemble, et sur le même objet, ils nous donnent les mêmes sensations. C’est simultanément que je saisis l’orange visuelle, l’orange tactile, l’orange olfactive et l’orange gustative, si mes divers sens s’appliquent en même temps à la percevoir. D’où la synthèse de ces images différentes, qui s’agrègent entre elles et donnent finalement un objet unique. Ajoutons que le déplacement de cet objet entraînera celui de toutes ses qualités : preuve nouvelle de l’existence d’un substratum soutenant ces dernières. Ce substratum, c’est la matière dont les combinaisons infiniment variées engendrent tout ce qui existe. Substance universelle, d’où jaillissent le mouvement et la vie, la matière n’est d’ailleurs point l’entité inerte et passive que les spiritualistes ont sottement imaginée. Inséparable de la force, elle répond à une prodigieuse condensation d’énergie, à un équilibre dont le dynamisme ne peut s’accommoder d’une stabilité définitive.
Considérons maintenant le problème de la substance du point de vue psychologique, en d’autres termes recherchons la nature du moi profond. Un flux incessant de faits hétérogènes qui se succèdent et se pénètrent, un tourbillon de sensations, d’idées, de jugements, d’émotions, de volitions, voilà ce que l’individu découvre quand il rentre en lui-même pour observer sa vie mentale. Pourtant au sein de cette multiplicité de phénomènes transitoires, de ce fluidique écoulement de faits instables, il croit atteindre une réalité qui dure, un centre permanent d’où émanent ces modifications si changeantes et si variables. A ce noyau solide il rattache les événements antérieurs de son existence, ainsi que ses états présents et quelquefois, par anticipation, certains états futurs. C’est le même moi, aujourd’hui occupé à réfléchir, qui accomplit telle action il y a dix ans et qui se dispose à partir en voyage demain. D’où la croyance à un support, à une substance qui demeure et ne disparaît pas avec chaque état, pour renaître avec l’état suivant. Ce substratum nous ne le saisissons jamais, il est vrai, comme une réalité distincte des phénomènes psychologiques, mais le raisonnement nous oblige à l’admettre ; car, seul, il parvient à rendre compte des caractères d’unité et d’identité que présente le moi profond.
Avec une belle impudence et un manque complet de logique, les spiritualistes affirment que ce support ne saurait être qu’un esprit simple et immatériel. Multiplicité et changement, ces deux caractères essentiels de la vie psychologique, seraient pourtant inexplicables si les états de conscience découlaient d’un principe indivisible, ne pouvant s’éparpiller en une poussière d’états. Wundt, philosophe bien peu révolutionnaire pourtant, reconnaît combien est faux l’argument spiritualiste qui s’appuie sur l’unité de la pensée.
Il écrit :
« Où puise-t-on la conviction que l’âme serait un être simple ? On remplace le concept d’unité par celui de simplicité Mais un être un n’est pas pour cela un être simple. L’organisme corporel est un, et cependant il se compose d’une pluralité d’organes. Dans la conscience, nous rencontrons de même, aussi bien successivement que simultanément, une multiplicité qui témoigne d’une pluralité de sa base fondamentale. »
Le cerveau, organe à la fois un et complexe, rend parfaitement, compte du double caractère d’unité et de multiplicité que présente la vie mentale. Et c’est à la mémoire, aux souvenirs emmagasinés dans son encéphale, que l’homme doit de se reconnaître identique aux diverses époques de son existence. Comment expliquer les dédoublements de la personnalité, si cette dernière avait pour substratum un âme simple et spirituelle ? Ce genre de maladie s’explique très bien, au contraire, lorsqu’on a compris que la substance pensante, c’est tout simplement la substance cérébrale.
— L. BARBEDETTE.
SUGGESTION
n. f. (du latin subqerere), placer au dessous, entasser des arguments.
Insinuer pour faire accepter ce qu’on désire, en agissant sur l’esprit de la personne.
L’étude de la suggestion est extrêmement délicate, car on côtoie, par les phénomènes que l’on découvre, tout un terrain où la science officielle n’ose pas encore s’aventurer.
Les faits sont indéniables mais leur interprétation est difficile à analyser.
Dès la plus haute antiquité, les phénomènes de suggestion ont été employés dans des buts plus ou moins avouables, car il est évident que tous les miracles, les mystères, les expériences des fakirs, les prédictions des pythonisses ou des augures n’avaient d’autres causes que des suggestions soit personnelles, soit collectives.
Un exemple de ces dernières est le « baquet de Mesmer ». On sait que ce médecin allemand, fondateur de la théorie du magnétisme animal sous le nom de mesmérisme, avait réalisé, à Paris, des expériences de chaîne magnétique, comme nous en avons tous vu sur différentes scènes par des magnétiseurs fameux, il y a trente ans. Ceci est de l’hétérosuggestion, c’est-à-dire produite par des éléments extérieurs à la personnalité du sujet, en principe la volonté d’une autre personne.
L’autosuggestion, elle, se manifeste par un travail du subconscient, et peut agir d’une façon merveilleuse sur tout notre organisme, même en dehors de notre volonté.
On se rappelle qu’en 1923, Coué et sa méthode firent beaucoup de bruit par la simplicité même de l’application de la suggestion et les résultats probants qu’il obtenait chez beaucoup de malades. Cette méthode consistait à dire soir et matin à haute voix, machinalement, sans faire effort de volonté :
« Tous les jours, à tous points de vue, je vais de mieux en mieux. »
Ou, si l’on a une crise névralgique aiguë ou une secousse morale très déprimante, on dit très vite comme dans un bourdonnement :
« Ça passe ... ça passe ... »
Et les maladies physiques et les ennuis moraux, tout cela disparaît comme par enchantement.
Nous reviendrons tout à l’heure sur la méthode Coué et montrerons combien elle a été en progrès sur les anciennes écoles où toute la psychothérapie avait également la suggestion à sa base.
Il y avait, en ce temps-là, deux écoles rivales : l’École de la Salpêtrière et l’École de Nancy.
Rivales, elles l’étaient, et férocement, par des différenciations qui, disons-le tout de suite, ont disparu totalement aujourd’hui : car on ne voit plus dans les grandes névroses de la Salpêtrière, que des maladies mentales susceptibles de guérison par des soins normaux : suggestion, psychothérapie, électrothérapie, etc.
L’École de la Salpêtrière, illustrée par Charcot, Richet, Féré et beaucoup d’autres, voyait en tout névrosé un hystérique.
L’hystérie était une maladie aux manifestations diverses, dont le phénomène le plus frappant était l’attaque convulsive et dont la caractéristique était d’être sans lésions anatomiques. Angoissant et théâtral était le tableau de la grande attaque : au début, l’aura, c’est-à-dire cette boule qui remontait de l’épigastre au pharynx ; puis, la phase tonique, avec sa raideur de tout le corps ; la phase clonique, avec ses convulsions ; enfin la résolution, suivie souvent d’une crise de larmes. Au retour de la conscience, aucun souvenir.
A cette grande hystérie, Charcot adapta le grand hypnotisme avec ses lois immuables : léthargie, catalepsie, somnambulisme, dans leurs phases toujours semblables et parfaitement réglées. Il n’est pas un médecin de cette époque qui ne les ait reproduites expérimentalement et ne s’en soit même servi comme anesthésie naturelle pour les petites opérations.
C’est avec de semblables sujets que Charcot faisait la gloire de l’École de la Salpêtrière. A côté d’elle, comme une parente pauvre, vivait doucement, tranquillement, modestement, l’École de Nancy où Bernheim et Liebault dans cette ville même, Edgar Bérillon à Paris, Burot et Bourru à Rochefort, et beaucoup d’autres disciples un peu partout, soignaient également les psychoses de toutes sortes par une seule thérapie : la suggestion à différents degrés. Admettant avec tous les philosophes que nous avons deux états en nous, un conscient et un subconscient, le premier agissant par la volonté, le deuxième par l’automatisme, c’est par une action directe sur ce subconscient qu’ils purent obtenir toutes les modifications psychiques nécessaires aux guérisons. Mais c’est par l’hétérosuggestion qu’ils agissaient, c’est-à-dire par une volonté étrangère à celle de l’individu. Nous verrons tout à l’heure que les méthodes modernes et celle de Coué entre autres, consistent à substituer à cette volonté étrangère, non pas même la propre volonté du malade, mais la seule imagination, seul élément capable d’agir automatiquement sur son subconscient, de lui-même, sans aucun facteur étranger.
Charcot mourut. Des années encore ses disciples purent croire à la véracité des phénomènes qu’ils observaient chaque jour ; mais peu à peu, la désagrégation se fit : on s’aperçut que les hystériques étaient capables, suivant certaines modalités de leur caractère ou de leur état social, de reproduire les symptômes les plus multiples. Consciemment ou non, par suggestion ou supercherie, l’hystérique présentait toutes les manifestations morbides constatées si souvent, et d’autant plus facilement qu’il y était encouragé par des examens médicaux répétés ou mal conduits, qui leur ont enseigné en quelque sorte la symptomatologie de leur maladie.
C’est pourtant un fidèle disciple du maître qui démolit ainsi le monument si durable, paraissait-il, de la Salpêtrière : c’est son ancien chef de clinique devenu à son tour un maître incontesté par l’éclat de sa science, j’ai nommé le professeur Babinski.
Pour Babinski, l’hystérie qu’il nomme de préférence Pithiatisme (du grec : persuasion guérissable) est un état pathologique se manifestant par des troubles qu’il est possible de reproduire par suggestion, chez certains sujets, avec une exactitude parfaite, et sont susceptibles de disparaître sous l’influence de la persuasion seule.
Donc, par la persuasion seule, une personne, ayant l’autorité nécessaire pour cela, arrivera facilement à créer dans un malade un état d’esprit tel qu’il croira fermement que sa guérison dépend entièrement de lui même.
Et c’est ce qu’enseignait Coué :
« Je ne vous guéris pas, disait-il en substance, c’est vous qui vous guérissez vous-même : je vous montre seulement le pouvoir que vous avez en vous pour cela, et la façon de vous en servir. »
Sa méthode était expliquée dans un petit livre : « La maîtrise de soi-même par l’autosuggestion consciente ». Entendez bien qu’il ne s’agit pas d’un de ces livres plus ou moins américains enseignant la façon de cultiver sa volonté pour renverser tous les obstacles de la vie. Coué, au contraire, supprime tout effort volontaire : c’est l’imagination seule qui agit, et quand il y a conflit entre la volonté et l’imagination, c’est toujours l’imagination qui l’emporte. Exemples : voulons-nous dormir ? Le sommeil ne vient pas. Voulons-nous trouver le nom d’une personne ? Le nom vous fuit. Voulons-nous nous empêcher de rire ? Le rire éclate de plus belle, etc.
Il est certain qu’aujourd’hui, des maîtres de la psychothérapie, les professeurs Bérillon, Pierre Vachet et Marcel Viard, pour citer trois des principaux, ne soignent pas autrement leurs malades. Le docteur Viard fait suivre souvent ses conférences d’exercices de suggestion collective, et il ne dit pas autre chose :
« Soyez calmes, laissez vos muscles en résolution, ne pensez à rien, et vous sentirez une euphorie parfaite vous pénétrer, vos soucis s’atténueront, votre santé sera meilleure ... »
Le professeur Louis Bénon a dit aussi :
« Pour aider à guérir, l’influence morale a une valeur considérable. C’est un facteur de premier ordre qu’on aurait grand tort de négliger, puisqu’en médecine, comme dans toutes les branches de l’activité humaine, ce sont les forces morales qui mènent le monde.
» Le bon médecin suggestionnera donc ses malades, mais à leur insu. Il devra créer en eux une autosuggestion, en leur persuadant qu’avec le temps et la patience, la guérison viendra. Il leur dira la façon de prendre leurs médicaments et l’action qu’ils auront sur leur organisme : cette action sera décuplée par I’assurance qu’ils auront de leur bon effet. »
Et les médecins de villes d’eau le savent bien qui prescrivent à leurs clients des dosages et une exactitude peut-être exagérés, mais qui rentrent pour une bonne part dans la réussite du traitement.
Je ne parlerai pas des miracles de Lourdes, ni de la part énorme que prend la suggestion dans les guérisons de malades nerveux subissant un doping formidable par le cadre et la mise en scène. Car là, comme en toute chose, il n’y a que ceci : la foi qui sauve !
— LOUIS IZAMBARD.
SUICIDE
n. m. du latin : sui, de soi et cœdere, tuer
Si nous voulons tenter de définir ce qu’est le suicide, nous nous reporterons à la définition que E. Durkheim donne dans son introduction à son étude de sociologie sur le suicide.
« On appelle suicide tout cas de mort qui résulte directement ou indirectement d’un acte positif ou négatif accompli par la victime elle-même et qu’elle savait devoir produire ce résultat. »
Parmi les problèmes de la vie morale dont l’explication reste laborieuse, le suicide, en tant qu’acte psychologique, est certainement le plus malaisé à expliquer.
Que des êtres préfèrent, en certaines circonstances, la mort à la douleur, cela semble à première vue normal à concevoir ; mais, dès que l’on se penche sur l’impérieux attachement qui enchaîne l’individu aux manifestations de sa propre vie, on doit se rendre à l’évidence et constater que ce déséquilibre entre ces forces de vie et de mort, est plus compliqué que l’on pourrait se l’imaginer de prime abord.
Dans les asiles et les hospices, le fait de voir des malheureux sans famille, sans ami, sans argent, traînant des maladies incurables, supplier les médecins de leur prolonger la vie, montre que l’acceptation de la mort ne trouve guère d’adhésion. Cependant, nous enregistrons d’autre part, des êtres qui se refusent à supporter la moindre contrariété, ils se donnent la mort pour des motifs futiles, sinon dérisoires : les journaux sont riches d’anecdotes tant originales que douloureuses.
Ces réactions contre la mort, comme ces attraits pour la mort, s’enregistrent souvent sans que nous puissions en tirer les moindres conclusions ; tout au plus pouvons-nous, envisageant les motifs qui déterminent l’individu à se supprimer, tenter d’en déduire quelques généralisations, quelques constatations, voire esquisser quelques faibles explications, le problème reste en son entier énigmatique et, aujourd’hui encore, dans ce domaine, la spéculation et l’hypothèse se donnent libre cours.
Edmond Jaloux a noté, sur la psychologie du suicidé, quelques observations qui méritent d’être citées :
« Brusquement, la communication avec le monde extérieur est interrompue ; il ne se fait plus entre la sensibilité et lui cet échange distrayant qui nous permet de nous renouveler sans cesse et de ne pas nous épuiser. Une pensée unique fonctionne dans un cerveau à peu près obturé et se répète jusqu’à la satiété, créant une sorte d’exaltation qui supprime peu à peu tout contrôle. Tous les suicidés connaissent ces états d’exaltation qui se sont renouvelés souvent avant d’aboutir à la crise finale. Celle-ci est due à une saturation de l’esprit par lui-même. Le désespéré cherche à mourir, non plus pour échapper à la déception initiale qu’il lui arrive de perdre de vue, mais pour fuir ce délire conscient qui ne lui laisse aucun repos. Il ne voit plus la disproportion qu’il y a entre ce délire et sa cause ; il s’intoxique de ses propres réflexions au point de ne plus pouvoir se tolérer. Il faut admettre qu’en se tuant, le suicidé n’a pas une conscience exacte de sa fin totale ; tout se passe comme s’il se tuait sans croire à sa mort ; il ne la réalise à aucun moment et il se supprime avec l’intime persuasion qu’il ne supprime en lui que cet état de malaise. À ce moment, le suicide est conçu comme la seule délivrance possible, parce qu’il libère l’homme de son obsession destructrice. »
Le suicide, acte individuel, semble se rattacher par certains points aux manifestations de l’activité sociale ; par ce fait, il s’est vu étudier comme phénomène social — ce qui explique cette autre définition donnée par H. Denis :
« Le suicide est un acte volontaire qui s’accomplit suivant un processus psychique, un conflit plus ou moins complexe, long, douloureux, de motifs qui échappent à l’observation externe : l’observateur ne surprend que les manifestations intrinsèques d’un phénomène de conscience. »
Le suicide, dans l’état présent des choses, est une des formes par lesquelles se traduit l’affection collective dont les humains souffrent. Pour comprendre cet état nous devrions en étudier les formes et les aspects divers.
Certes, la question a été longuement examinée et certains auteurs ont éclairé le problème par de lumineuses recherches qui sont d’un apport incontestable.
Examiner les différents aspects sous lesquels se présente l’étude du suicide serait, sans doute, d’une utilité réelle, mais cela demanderait un exposé et un développement trop longs. Il faut se résoudre à renvoyer ceux qui s’intéressent à la chose, aux ouvrages cités dans la bibliographie, à la fin de cette étude.
H. Denis a classé les influences qui s’exercent sur le suicide, estimant que :
« Le phénomène du suicide, comme phénomène social, doit être considéré dans toute sa relativité, c’est-à-dire qu’il doit être mis en rapport :
avec les autres phénomènes moraux étudiés par la statistique ;
avec toutes les conditions générales qui peuvent exercer une influence sur ce phénomène, en tant que phénomène social.
» La classification générale de ces facteurs reproduit, à mes yeux, la classification hiérarchique des sciences, exprimant l’ordre de complexité et de dépendance des phénomènes de l’univers, de l’homme et de la société humaine. C’est la grande lumière qui éclaire aussi bien les phénomènes de pathologie sociale, comme le suicide, que les phénomènes de la vie collective. »
-
Facteurs mésologiques ou cosmiques du suicide : conditions telluriques, climat, température saisonnière, mois, heures du jour et de la nuit.
-
Facteurs biologiques : caractères anthropologiques et ethnologiques, hérédité, sexe, âge.
-
Facteurs sociologiques :
-
société domestique : état civil, célibat, mariage, veuvage, divorce ;
-
état social général.
-
D’autres auteurs ont groupé les suicides en différents types :
-
Le suicide maniaque qui détermine l’individu à se soustraire à un danger ou à une hantise imaginaire ou en vue d’obéir à un appel mystérieux qu’il a reçu de l’au-delà ;
-
Le suicide mélancolique qu’un état général d’extrême dépression conduit sur les chemins de la mort ; il prépare avec calme ses engins d’exécution, sa tristesse exagérée le pousse à voir tout en noir ;
-
Le suicide obsessif : dans ce cas, l’individu, hanté, parfois sans motif, de l’idée fixe de la mort, est en proie à l’obsession de ce désir impérieux ;
-
Le suicide impulsif et automatique qui, sans raison, conduit l’être, par une impulsion brusque, à attenter à sa propre vie.
Tout ceci ne peut cependant nous autoriser à voir, dans tout suicidé, un fou. L’histoire nous rapporte des cas d’individus qui prirent la résolution d’en finir avec la vie et donnèrent au monde de rudes leçons de volonté, de courage et de stoïcisme.
Le droit que prenaient certains individus de se supprimer devait provoquer des réactions violentes dans les sociétés policées qui, aidées des morales, des philosophies et des religions, ne manquèrent point de juger le suicide comme immoral, impie et ridicule et en qualifier l’acte de lâcheté.
Il importe peu que l’opinion publique oppose un veto impératif au droit au suicide ; à l’encontre des morales et des philosophies religieuses ou rationalistes, on peut non sans raisons, admettre le suicide.
Cela a amené certains esprits libres à se demander si le suicide ne se trouvait pas justifié par les souffrances physiques, morales ou éthiques.
Le Docteur Hotz écrivait :
« Quand une société guillotine et amnistie les crimes passionnels, il est inadmissible qu’elle refuse de laisser les incurables se tuer ou de les tuer elle-même par un moyen qui présenterait toutes les garanties désirables de respect, de liberté individuelle. » Et, déjà en 1909, le professeur G. Dumas déclarait à la Sorbonne : « Pourquoi refuserait-on la mort à un incurable ou à un homme qui la réclame, lorsque la mort est pour lui l’affranchissement de douleurs intolérables ? Rien n’est plus absurde que la souffrance inutile et rien n’est plus légitime que de chercher à s’en débarrasser. »
Le Docteur Binet-Sanglé, depuis, a écrit un petit traité : Art de mourir, afin d’aider de ses conseils ceux qui veulent se détruire.
Pour la plupart des moralistes — ceux qui soumettent au public une opinion — le suicide est une faute, voire un crime et se tuer est faire tort à Dieu ou à la société et certains vont jusqu’à affirmer qu’en agissant ainsi l’individu est un ingrat puisque, prétendent-ils, la société rend de tels services qu’il a une obligation de vivre pour payer sa dette envers elle. Sur 47 auteurs contemporains consultés : Bayer, dans son ouvrage Le Suicide et la Morale, en trouve 38 se prononçant contre le suicide.
Quoique la bible nous offre quelques spécimens de suicidés : Samson, Architophel, Eléazar, Razias, Zambri, Abimelech, Hircan, le roi Saül, Ptolémée Macron, il n’en reste pas moins vrai que c’est en se basant sur les saints évangiles que les Eglises condamnèrent le suicide en invoquant tout particulièrement le « Tu ne tueras point ».
Akiba écrit :
« Si quelqu’un s’est tué, ne l’honore pas, ne le maudis pas. »
Mais, jusqu’ici, signale le répertoire de Schwab, les rabbins interprètent les textes talmudiques en se prononçant pour l’indulgence ou la sévérité.
A. Legayt, dans son étude sur le Suicide ancien et moderne, rapporte :
« En 1320, cinq cents juifs assiégés dans une forteresse par les Pastoureaux, choisissent l’un d’entre eux, comme le plus fort ou le plus résolu, pour les soustraire à la cruauté de leurs impitoyables ennemis, et se font tous égorger de sa main. »
Dans l’Univers israélite du 4 octobre 1912, on lisait :
« La loi juive, si elle réprouve le suicide, se montre extrêmement large en faveur des suicidés. Le moindre indice favorable suffit pour incliner à l’indulgence. C’est une règle générale qu’en matière de foi funéraire on doit suivre l’opinion la moins sévère. »
La morale catholique, elle, plus rigide, condamne le suicide comme une atteinte non seulement aux droits de Dieu, mais comme étant un acte de désespoir injurieux à la bonté divine et, sauf le cas où Dieu en inspire le dessein — pour excuser Samson, sainte Pélagie et les martyrs volontaires — l’Eglise a considéré le suicide comme un crime affreux, comme le triomphe du démon sur l’homme. Le concile d’Arles, en 452, celui de Bragues en 563, et celui d’Auxerre en 576, condamnèrent le suicide comme un crime qui serait dû à l’effet d’une fureur diabolique, défendaient de faire mémoire des suicidés au saint sacrifice de la messe et interdisaient le chant des psaumes aux enterrements. À travers les siècles, l’Eglise catholique ne cessera de se montrer intolérante à ce sujet, sa législation fut véhémente, elle justifia parfois les plus sanguinaires répressions, telles celles d’Abbeville, où les corps des suicidés étaient traînés sur une claie à travers les rues. Le droit coutumier emprunta au droit canonique sa législation avec quelques variantes et, aujourd’hui, si celles-ci absolvent le suicide, la jurisprudence punit toujours la complicité.
Quant à la morale protestante, elle condamne le suicide sans le punir ; car, s’il est interdit de mettre fin à sa vie, on peut la sacrifier pour l’accomplissement du devoir :
« Il nous est permis d’exposer notre vie pour la gloire de Dieu. »
Certes, il serait attachant d’aborder cette question du suicide et de l’examiner à la lumière de la philosophie et de la littérature ; force m’est de renvoyer mes lecteurs à un autre ouvrage riche de documentation : Le Suicide et la Morale, par A. Bayet. Voici les deux impressions laissées à l’auteur de ce volumineux travail qui, parlant du suicide par rapport à la morale, écrit :
-
« Il n’y a pas, dans la morale contemporaine, comme on le dit trop souvent, une doctrine qui condamne le suicide et une doctrine qui l’approuve : il y a une morale simple qui condamne tous les suicides, en principe et dans tous les cas, et une morale nuancée qui, plus souple, distingue entre les cas et va de l’horreur au blâme et à la désapprobation, de la désapprobation à la pitié, de la pitié à l’excuse, à l’approbation, à l’admiration. »
-
« Le conflit de ces deux morales ne se ramène pas, au moins dans les formules, à un conflit entre la pensée catholique et ses adversaires. Les deux doctrines opposées se disputent et divisent le monde de la pensée, l’enseignement neutre, la presse neutre, sans qu’on puisse ranger leurs partisans en deux camps bien définis au point de vue religieux, philosophique ou politique. Et l’impression générale, lorsqu’on étudie la morale formulée, n’est pas une impression de lutte franche, mais d’incertitude et de désarroi. »
Répondant, jadis, à une enquête posée dans le journal l’En dehors, par G. de Lacaze-Duthiers, à l’époque de la mort de G. Palante, j’écrivais, à ce sujet :
« Le pouvoir de disposer de soi est et restera toujours l’affirmation la plus haute de l’individualité qui, n’ayant pas demandé à vivre, se libère des contraintes que la société ne cesse de lui imposer. Pour ma part, je ne conçois aucune « morale » qui m’obligerait à prolonger une existence dans un milieu où la libre expansion de ma personnalité ne cesse d’être entravée. La pensée de Marc Aurèle s’harmonise pleinement avec ma façon d’envisager le droit au suicide :
« Es-tu réduit à l’indignité ? Sors de la vie avec calme. »
Il serait superflu et vain, je pense, que je m’attarde à montrer l’illogisme du jugement que porte la société vouant au mépris le plus profond ceux qui s’échappent ade cette vie. Cette condamnation préconçue est des plus arbitraires et ne repose d’ailleurs que sur une foule de préjugés que nous lèguent une éducation et une morale mensongères. Pourquoi condamner des « irresponsables » qu’un état physique ou moral détermine au suicide ? Quant aux « moralistes » qu’est-ce que cette haute vertu dont ils détiennent jalousement (il faut le croire) le monopole, qui les autorise à émettre cette insidieuse prétention de jeter l’anathème sur celui qui quitte l’horrible enfer dans lequel, résigné bien souvent, il a consenti à se consumer petit à petit ? L’odieuse imposture de « leur morale », la cynique comédie que joue « leur société » ne me paraissent nullement qualifiées pour qu’en leur nom ils se posent en censeurs ; car, non contente de laisser mourir de faim ceux qu’elle a pour mission de protéger, cette monstrueuse société se plaît à envoyer s’entrégorger, au nom des entités les plus diverses et des plus stupides, ceux qu’elle devrait élever. Pères et mères, c’est vers vous que ma pensée se porte ensuite pour condamner l’absurde et odieuse autorité qui conduisit votre ou vos enfants sur le chemin du suicide. Votre conscience est-elle exempte de reproches ? Vous êtes-vous rappelé les réprimandes monstrueuses que vous décochiez à ces cœurs sensibles à qui vous refusiez votre assentiment dans le choix qu’ils s’étaient fait de leurs amours ? Et vous, potentats corrompus, détenteurs de pouvoirs usurpés, qui feignez de ne pas apercevoir la misère criante qu’engendre l’inégalité sociale du régime présent, ne sentez-vous pas peser sur vous le poids de toutes ces fins tragiques de miséreux s’échappant de « votre société », afin de fuir les affres de la faim ? Morale hautaine et vile, personnification perfide et fourbe dont sont victimes les naïfs de ce monde qui croient en votre sublimité, vous êtes la grande responsable. Suicidés : filles mères abandonnées, amoureux éconduits, détenus qu’une fatalité conduisit sur la route interdite par « nos codes », vous tous, victimes d’un milieu à plat ventre devant d’insensées idolâtries, que ne pouvez-vous ressusciter et vomir vos imprécations contre « notre » lâcheté, « notre » résignation en présence des devoirs mystificateurs ? Habile diplomate autant que perfide institution, afin de sauvegarder son « honneur et sa dignité », la société pousse la fourberie jusqu’à réprouver l’attentat contre soi-même, parce que le suicide la condamne. Mais il est un suicide qui, surplombant tous les autres, se dresse en accusateur devant notre société de tartufes, c’est le « suicide philosophique ». Maintes fois soulevée, la question du suicide philosophique a donné lieu aux plus contradictoires opinions.
« Que celui qui ne veut pas vivre plus longtemps expose ses raisons au Sénat et, après en avoir obtenu congé, quitte la vie. Si l’existence t’est devenue odieuse, meurs ; si tu es accablé par la douleur, abandonne la vie. Que le malheureux raconte son infortune et que le magistrat lui fournisse le remède, sa misère prendra fin. »
Tel était le décret par lequel Athènes avait reconnu « le suicide légal ». Cette autorisation première est certes superflue, mais c’était là une « liberté codifiée » que nous sommes loin de retrouver dans les codes actuels et même dans les préceptes moraux chrétiens et rationalistes. Sénèque écrivait :
« S’il te plaît de vivre, vis ; s’il te déplaît, libre à toi de retourner d’où tu viens. »
D’Holbach, dans son Système de la Nature, a fait l’apologie de la mort volontaire, et Littré s’exprimait de la sorte :
« Quand un homme expose clairement les raisons qui l’empêchent de vivre et quand ces raisons sont réelles et non pas imaginaires, quel motif y a-t-il de lui dénier la liberté morale telle que nous la concevons, chez chacun de nous ? »
Quant à P. Robin, il soutenait que l’homme incapable d’être utile à la société doit disparaître. Le. suicide de M. et Mme Lafargue inspirait à Marcel Sembat ces quelques lignes : « Quelle belle mort : en pleine vigueur, à l’heure choisie pour partir ensemble avant le déclin ! Cette fin me paraît fière et magnifique comme un splendide coucher de soleil. Je ne sais rien de plus noble en ce genre depuis la mort des deux Berthelot. Paul Lafargue n’est mort ni en saint, ni en martyr, ni en héros, ni en désespéré ; il est mort en sage. »
Mes citations pourraient s’allonger encore et je pourrais invoquer des noms tels que Socrate, Condorcet, E. Hureau, L. Prouvost, le lord-maire de Cork, etc., mais je veux conclure. Le suicide philosophique prête à de nombreuses critiques. Je conviens, pour ma part, qu’il n’est pas une solution et que, bien souvent, il est le résultat d’un affaiblissement moral et physique chez l’individu qui s’y détermine ; mais à quel titre condamner ceux qui ne peuvent supporter la médiocrité de la vie et la veulerie de la foule ?
Mon ami Bailly, répondant également à cette enquête, s’exprimait :
« Il est souvent très pénible de gravir les durs chemins de la vie et l’héroïsme n’est pas l’apanage de tous. Quand un être, dès sa prime jeunesse, offre — avec candeur — toute l’ardeur de son âme, la noblesse de ses sentiments et sa puissante générosité, et que les autres lui servent, en revanche, de la traîtrise et de la férocité, il se peut que les ans viennent user son enthousiasme et il lui est permis de douter de la bonté des humains. Le doute ! Quand il s’empare de vous, il vous donne quelquefois des apparences de joie, mais plus souvent il vous terrasse. Lutter, c’est vivre (selon le dicton) ... Oui, c’est vrai. Tenter sans relâche d’affirmer sa puissance par des actes de grandeur et d’intelligence, c’est se montrer quelqu’un au milieu des quelques choses. Lancer un défi aux puissants et aux flagorneurs en s’insurgeant sans cesse contre les lois qui oppriment l’individu et contre les hommes qui les érigent, c’est se montrer de grande taille. Mais, hélas ! Il y a des différences de taille. Néo-stoïcien, j’aime celui qui, fièrement et courageusement, mène (sans haine) le combat pour son indépendance. J’aime le « fort » qui toujours espère dans son désespoir (je suis de ceux qui croient que, même les plus hardis, sont parfois désespérés). J’aime celui qui, sans arrêt, dénonce la nocivité de l’autorité et de son succédané, la contrainte. J’aime par-dessus tout celui qui va « jusqu’au bout ». Mais, encore une fois, je dis, hélas ! que les héros sont rares (même au temps des héros sans héroïsme) et il nous faut reconnaître que, même dans le domaine de la bonté et de l’intelligence, il y a des faiblesses qui sont humaines. »
» Oui, vivre ! ... c’est très bien, mais mourir ! c’est parfois beau. Quand vivre veut dire : être indompté et indomptable, posséder une solide santé, trouver sur son chemin des âmes qui vibrent à I’unisson de la sienne et qui, dans les passages difficiles, vous tendent, sans arrière-pensée, fraternellement la main, je crie : « Vive la Vie !... ». Mais (malgré mon ferme désir d’aller jusqu’au bout, vu mes conceptions et quoique atteint d’une maladie incurable), quand la sensibilité est trop forte, la dignité trop élevée, l’intelligence trop éveillée pour le cadre et le composant d’une société rapace et criminelle ; quand les armes que possédait le combattant — santé, énergie et volonté — ne sont pas assez fortes, mieux vaut — c’est mon idée — qu’il accomplisse l’action qui le précipite, au lieu de se laisser choir dans la vile indifférence de ceux « d’en bas » ou dans la fameuse crapulerie de ceux « d’en haut »... »
L’individualiste souffre davantage de la laideur de notre société. De quel droit l’empêcherions-nous de se libérer ? C’est pourquoi je revendique pour l’individu la libre disposition de sa personnalité, m’insouciant peu de la prétention de la collectivité qui veut, par je ne sais quel devoir social, la retenir malgré lui !
— HEM DAY.
BIBLIOGRAPHIE. — Bayet Albert ; Le Suicide et la Morale, éd. Alcan ; Durkeirn Emile ; Le suicide, étude de sociologie, éd. Alcan ; Legoyt A. : Le suicide ancien et moderne, éd. A. Drouin, ; Sur le suicide (enquête, « Le Disque vert », Bruxelles) ; Rizzardi Luca : Le suicide, éd. « La Société Nouvelle » ; Denis H. : Le suicide et la corrélation. des phénomènes moraux en Belgique, (Académie Royale de Belgique) ; Jacquart : Essais de Statistique morale. Le Suicide, éd. Dewit ; Dr BinetSanglé : L’Art de Mourir ; « Clarté », n° 72 Le Suicide est-il une solution ? ; « L’En dehors », n° 64-66-67-68, 4è année : Enquête, Un individualiste a-t-il le droit de se suicider ?
SUPERSTITION
On connaît le mot de Voltaire :
« La superstition est à la religion ce que l’astrologie est à l’astronomie ; la fille très folle d’une mère très sage. »
Si la comparaison est juste en ce qui concerne l’astrologie et l’astronomie, la première n’étant — on le sait — qu’une science purement empirique, consistant en l’art de prédire (?) l’avenir par l’inspection (?) des astres et qui n’a jamais pu passionner que des esprits prévenus et plus ou moins teintés de religiosité, alors que I’astronornie est une science positive, basée tout entière sur l’observation méticuleuse, patiente, délicate des astres, dont il s’agit de rechercher la constitution, les positions relatives, les diverses lois qui président à leurs mouvements, observation renouvelée mille fois et dont les résultats sont toujours sujets à révision, science qui, entre toutes les siences naturelles, est, aux dires du grand Laplace, celle qui présente le plus long enchaînement de découvertes ; si, nous le répétons, la comparaison est juste dans ce prernier cas, nous estimons qu’elle est foncièrement inexacte lorsqu’elle s’applique à la superstition et à la religion, ces deux vocables pouvant indifféremment servir à exprimer les sentiments, à traduire les diverses manifestations d’une même mentalité qui, dans l’un et l’autre cas, ne peut que s’accommoder des principes, base de toute foi : Credo quia absurdum, quia ineptum, ce qui se traduit par ceci :
« Je crois parce que c’est absurde, parce que c’est inepte, et je crois d’autant plus que c’est absurde, d’autant plus que c’est inepte !... »
Le Dieu des religions dites révélées, ne se révèle-t-il pas, en effet, par la négation même du naturel, et le mystère n’est-il point le seul, l’unique moyen de preuve ? Toutes les « vérités » enseignées, imposées par les religions ne procèdent-elles pas de conceptions, d’opinions, d’appréciations, d’idées a priori qui toutes sont du domaine de l’incontrôlable et même de l’inobservable ? Ces « vérités éternelles et nécessaires » dont la puérile métaphysique a gâté, empâté nos esprits, que sont-elles, au fait, si ce n’est I’antithèse même des éternelles et inflexibles lois de la nature ? La foi ne découle-t-elle pas des affirmations — et non des démonstrations faites par les maîtres (parents et éducateurs) et acceptées par des esprits forcément dociles, où le sentiment joue le plus grand rôle ?
« Le cœur bien souvent affirme, alors que l’esprit nie. »
La religion, on le sait, n’est vraiment facile à définir que pour l’adepte d’une religion particulière. Celui-ci ne saurait admettre comme conforme à la vérité que sa religion propre, toutes les autres croyances étant délibérément, sans examen, rangées dans la catégorie des superstitions grossières. Pour lui évidemment — mais pour lui seul — la religion c’est sa religion, type absolu, indiscutable, à l’égard duquel les autres cultes ne sont que des formations fausses, imparfaites, indignes de la moindre considération !
Qu’on ne nous oppose pas certains croyants dont les connaissances, dont le savoir, dont l’acquis scientifique seraient considérables et indéniable la rectitude de jugement. Nous répondrions que s’ils admettent le mystère, les faits invérifiés et indémontrables, ils font tout simplement bon marché de leur intelligence et de leur esprit critique ; que d’ailleurs, c’est aller à l’encontre même de l’affirmation invariable des autorités ecclésiastiques de tous les temps, que c’est nier l’enseignement archiséculaire de toutes les Eglises en prétendant pouvoir s’acheminer vers la croyance, vers la religion par la raison ! Non, la foi, c’est-à-dire cette adhésion irraisonnée du sentiment à ce qu’on croit reconnaître comme la vérité, la foi seule peut animer ces « savants religieux » !
En vain objectera-t-on qu’il y a religion et religion et que celle de certains prêtres et de quelques savants, tel Pasteur par exemple, que nos catholiques se plaisent tant à nous opposer comme le modèle associant la foi à la science, que cette religion des prêtres et savants est une religion épurée, qu’elle est une doctrine ésotérique à laquelle on ne saurait décemment assimiler les superstitions des peuples fétichistes.
Encore une fois, nous répondrons que, seule, la foi du charbonnier étant digne d’un certain respect, du fait qu’elle repousse tout compromis de quelque nature qu’il soit, il ne saurait y avoir d’autre religion que celle qui, tous les jours et depuis des siècles, est enseignée par des milliers de prêtres à des millions d’enfants ; d’autre religion que celle du peuple, qui n’est qu’un ramassis de bourdes, d’invraisemblances, d’inepties, de contresens, d’absurdités pour tout dire, de superstitions et que nul par conséquent, ne peut prétendre, au regard de l’intraitable orthodoxie, revendiquer le droit de choisir ses croyances !
Il n’existe donc pas de distinction appréciable entre ces deux formes de la croyance : la religion et la superstition et les quelques faits, parmi les milliers que nous pourrions citer, empruntés aux cultes abolis ou toujours en vigueur et que nous allons très succinctement exposer ci-dessous, corroboreront notre assertion.
Dans le langage courant d’autrefois, nous dit Elie Reclus, dans son admirable ouvrage : « Les croyances populaires », les esprits des morts étaient dénommés génies ou démons. Ces génies et démons composent toute la substance des religions. En mourant, croyaient nos lointains ancêtres, les hommes passaient génies ; les génies passaient divinités — tantôt bonnes, tantôt mauvaises — mais dans leur immense majorité, mauvaises, il faut bien l’avouer. Rappelez-vous l’empereur romain qui, sentant venir la mort, dit aux amis qui s’empressaient à son chevet : « Je me sens passer Dieu ». Les mauvais démons étaient certainement en majorité, pusqu’ils avaient été des hommes comme nous. Néanmoins, les bons n’étaient pas rares. Chacun avait son bon démon et son mauvais. Qui n’entendit parler du « démon de Socrate », du « démon de justice », « de morale », « de bon sens et de bonté » ?
Le christianisme naît et se développe dans cette partie de notre planète qui, précisément, avait vu se former tant de « génies ». Et l’Eglise catholique, à la faveur de ce formidable mouvement religieux, s’édifie à son tour. Quel sera son premier souci, son premier soin ? De proscrire « tous les démons de l’ancien régime », de les « mettre hors la loi », de les traiter en diables et de les considérer comme autant de manifestations saugrenues de la superstition la plus coupable !
Allons chez les mahométans. Ils sont, eux aussi, en possession du seul vrai Dieu ! Aucune concurrence n’est tolérée !
Non loin de Tunis, on trouve un tombeau célèbre, celui de Sidi Fethallah. Situé à une lieue environ de la capitale, dans un site charmant, près d’un rocher haut de cinquante pieds, abrupt et très glissant, ce tombeau est toujours l’objet de la profonde vénération, de l’idolâtrie de nombreux musulmans résidant en ‘I’unisie. Tombeau et rocher sont devenus un lieu de pélerinage et, chaque samedi, qui est le jour saint, on peut assister à ce spectacle assez réjouissant — à moins qu’il ne soit attristant — qu’offre un grand nombre de femmes qui, tour à tour, ayant une pierre plate appliquée sur le ventre, descendent le rocher sacré au risque de se rompre le cou. Il arrive même qu’elles renouvellent deux et trois fois ce pieux et périlleux exercice, dans l’unique espoir d’acquérir une fécondité que la nature leur a refusée jusqu’alors !
Il faut entendre les catholiques du Protectorat faire des gorges chaudes à la vue de pratiques qui ne sauraient relever que de la ... superstition la plus répugnante et du magisme le plus primitif !
Faisons à présent — car il faut être équitable — une incursion dans le domaine sacré de la religion catholique, cette religion si pure, si éthérée, qui se flatte d’avoir impitoyablement écarté tous les rites, toutes les formules, toutes les pratiques et tous les sacrifices qui faisaient la honte et l’horreur des cultes antiques. Prenons, au hasard, le mystère de l’eucharistie.
La religion catholique professe, avec une imperturbable assurance, qu’un miracle d’ordre matériel s’accomplit ; que le changement réel bien qu’invérifiable (toujours !) de la substance du pain et du vin en la substance du corps et du sang du Christ (lequel, d’ailleurs, en tant que glorifié, n’a ni corps, ni sang qui ressemblent à ceux des êtres vivant sur la Terre), que ce changement s’opère par la simple répétition des paroles qui sont attribuées, par saint Paul et par les évangélistes, à Jésus instituant le rite. Et notez bien que ces paroles n’expriment pas une intention de Jésus, ni une intention du consécrateur qui les répète. Elles sont efficaces par elles-mêmes. Il suffit qu’elles soient prononcées, dans les conditions rituelles voulues, et par une personne qualifiée pour que le miracle invisible s’opère aussitôt !...
Que le lecteur veuille, à présent, conclure. Mais peutêtre sera-t-il plus convaincu encore de l’identification profonde, indéniable, de la superstition — forme originelle de la religion — et de la religion — dont le fond même n’est fait que de superstitions — s’il a le loisir de se rendre à Beauraing où il assistera, consterné, à l’indigne et burlesque comédie si magistralement jouée depuis plusieurs mois par le clergé belge et où des milliers et des milliers d’adeptes de la religion du vrai Dieu (elle aussi !) attendent patiemment, sans se décourager, I’apparition, pour le moins problématique, d’une Vierge, faite comme vous et moi, de chair et d’os, qui, il y a quelque dix-neuf siècles, accoucha d’un Dieu, conçu pourtant de toute éternité bien qu’immatériel, et dont la fonction obligatoire fut de créer l’univers !
— A. BLICQ.
SURVIE
n. f.
Il n’est pas de mensonge plus cher aux nations occidentales que celui d’une survie pour la personne humaine, d’une existence individuelle continuée après la mort. Rien n’est épargné pour faire croire aux humbles qu’un sort meilleur les attend par-delà la tombe, s’ils obéissent docilement ici-bas à tous leurs maîtres, petits et grands. Fortement soutenus par les autorités civiles, seuls chargés d’instruire la jeunesse et de façonner l’opinion, les prêtres réussirent longtemps, chez nous, à maintenir la croyance à un enfer et à un ciel dont ils donnaient, sans rire, les descriptions minutieuses. Mais ces gendarmes spirituels ont beaucoup perdu de leur prestige, depuis que les peuples devenus plus défiants refusent de les prendre au sérieux. Aussi, les pouvoirs civils leur ont-ils adjoint des équipes de philosophes, d’écrivains, voire de farceurs ou de malades, qui, sans admettre les dogmes absurdes de la théologie chrétienne, déclarent que l’âme humaine demeure vivante, même après la disparition du corps. Comme la Royauté et l’Empire, la Troisième République réserve à des philosophes spiritualistes les principales chaires de ses grandes écoles. Un Paul Janet, un Caro, phraseurs aujourd’hui universellement méprisés, furent les oracles du monde universitaire à la fin du XIXème siècle. Ils cédèrent la place à l’insignifiant Boutroux et à Bergson, la fine mouche, dont l’alchimie verbale devait éblouir les bourgeois du XXème siècle commençant. Un Brunschvicg, leur digne successeur, s’imagine qu’il a dit des choses profondes quand il a pondu une phrase obscure et alambiquée ; il trône en Sorbonne à notre époque, soucieux avant tout de plaire aux maîtres de l’heure quels qu’ils soient. Aidé par d’autres pontifes, il endoctrine une jeunesse avide de parchemins. Les romanciers gâteux de l’Académie diluent les formules du nouveau spiritualisme dans de fades volumes destinés au grand public. De leur côté, spirites, théosophes, médiums et sorciers divers se jettent sur le troupeau des gens crédules en quête d’un nouveau messie. Thaumaturges, voyants, mages, instructeurs se multiplient d’une façon invraisemblable ; et la variété de leurs doctrines, leurs chicanes, les injures et les reproches qu’ils s’adressent mutuellement ne les empêchent pas de tomber d’accord pour affirmer, conformément aux directives des chefs de la police bourgeoise, que l’âme survit après la mort. A cette condition seulement, ils ont droit d’ouvrir boutique et de monnayer les mystérieux pouvoirs qui les élèvent au-dessus de l’humanité ordinaire. C’est en 1877 qu’une obédience maçonnique, celle du Grand Orient de France, cessa de rendre obligatoire pour ses membres la croyance au Grand Architecte de l’Univers et à l’immortalité de l’âme. Mais les obédiences étrangères, en particulier la Grande Loge d’Angleterre, rompirent immédiatement toute relation avec le Grand Orient. L’immense majorité de la maçonnerie universelle est restée fidèle aux vieilles sornettes de la philosophie spiritualiste ; et, en France même, les loges du rite écossais continuent d’invoquer le Grand Architecte de l’Univers. Quelques membres courageux et clairvoyants réclament toutefois l’élimination des plaisanteries théologiques qui déparent les rituels de la Grande Loge de France. En voyant quelles puissantes institutions s’intéressent au maintien de la croyance à l’immortalité de l’âme, l’on s’étonne moins de la persistance d’une doctrine si contraire à toutes les données de la science expérimentale.
Pour l’individu infatué de sa personne et persuadé de l’importance essentielle de son moi, il est en outre fort pénible de songer qu’un jour il ne restera de lui qu’un peu de cendre ou de terre. Contre cet anéantissement, son orgueil et sa vanité se révoltent ; après sa mort, il veut continuer d’entendre les éloges dont il se gargarisa de son vivant ; il veut savourer les larmes que verseront, du moins il le suppose, ses proches et ses amis. S’il n’a pu étancher son besoin de plaisir, sa soif de jouissances multiples et renouvelées, il rêvera de délectations infinies, de bonheur ineffable, d’amours inextinguibles, de délices enivrantes pour les sens comme pour l’esprit. Et, parce que l’on croit sans peine ce que l’on désire, il se persuadera aisément que ces suppositions illusoires répondent à de solides et consolantes réalités. En concrétisant les plus nébuleux espoirs des hommes dans un ciel que les artistes ont rendu tangible en quelque sorte, et leurs craintes dans un enfer et un purgatoire dont les hagiographes nous ont fait des descriptions horrifiques, en s’attribuant de plus le droit d’expédier au ciel les âmes que Dieu condamna d’abord au purgatoire, les prêtres catholiques ont fait preuve d’un génie commercial hors ligne. S’ils avaient conservé la messe et les indulgences, les pasteurs protestants jouiraient de revenus supplémentaires qui ne sont point négligeables. Sans avoir l’esprit mercantile des fonctionnaires du Pape, les disciples d’Allan Kardec ont compris qu’il fallait faire intervenir les morts pour mieux capter l’attention des vivants. Les âmes des défunts réclamaient invariablement des messes, lorsqu’elles apparaissaient aux moines ou aux saintes du Moyen Âge ; aujourd’hui, elles se bornent à faire tourner des tables, à remuer des chaises ou des crayons, fournissant ainsi gratis de spirituelles distractions aux personnes du meilleur monde. Et l’émotion des assistants est profonde, lorsque chacun croit reconnaître dans le défunt secouant le mobilier, qui son parent, qui son ami. Beaucoup, en effet, n’arrivent pas à se persuader qu’ils sont à jamais disparus, les morts qu’ils ont tendrement aimés. En spéculant sur l’égoïsme individuel et sur le désir de revoir ceux que l’on a chéris, moines et spirites furent incontestablement bien inspirés. Feu de l’enfer et feu du purgatoire ont suffi, durant de longs siècles, à faire bouillir la marmite des premiers ; et, parmi les seconds, d’ingénieux escrocs réussissent fréquemment des coups très peu surnaturels mais des plus fructueux. La survie s’est révélée utile au moins pour ceux qui l’ont inventée.
Quant aux arguments invoqués par les penseurs spiritualistes en faveur d’une existence personnelle continuée après la mort, ils sont extrêmement piteux. Bergson avoue :
« Certes, l’immortalité elle-même ne peut pas être prouvée expérimentalement ; toute expérience porte sur une durée limitée, et quand la religion parle d’immortalité, elle fait appel à la révélation. Mais ce serait quelque chose, ce serait beaucoup que de pouvoir établir, sur le terrain de l’expérience, la possibilité et même la probabilité de la survivance pour un temps x. »
Cette survivance, Bergson n’a pu en fournir la preuve, malgré ses outrecuidantes prétentions ct malgré l’aide que lui apportèrent avec empressement les spirites, les mystiques, les faiseurs de prodiges de toutes les religions. Il n’a aucunement démontré que la pensée humaine déborde la capacité du cerveau et que ce dernier est un simple instrument utilisé par l’âme, non la source productrice de la vie consciente. Nous ne reviendrons pas sur la puissance médianimique, les visions, les pressentiments, les guérisons soudaines, les conversions religieuses et les autres faits de ce genre dont il a été longuement parlé dans d’autres articles de cet ouvrage. Des recherches méthodiques et consciencieuses ont démontré qu’il s’agit ou de simples fumisteries, de vulgaires tours de prestidigitation (quand ce ne sont pas le résultat d’inconscientes simulations), ou de phénomènes nerveux, rares, et souvent pathologiques mais toujours parfaitement naturels. L’étude impartiale des prétendues manifestations de l’au-delà rapportées par W. James, Bergson et leurs disciples, oblige à rejeter complètement l’intervention d’entités surnaturelles et d’esprits désincarnés. La tentative de ces adversaires de la raison et de la science pour constituer une métaphysique expérimentale a échoué radicalement. Et avec elle disparaît la dernière planche de salut laissée au spiritualisme philosophique.
Ajoutons qu’aucune preuve rationnelle de la survie n’a pu être apportée par les métaphysiciens. De lyriques mais creuses déclamations, où l’on ne précise rien, où l’on reste dans de vagues généralités, capables d’être interprétées dans les sens les plus divers, voilà ce que l’on trouve sous la plume des penseurs les plus vantés. Ravaisson écrit :
« Non seulement ce qui a pensé une fois éternellement pensera, mais chacune de nos pensées contient quelque chose de tout ce que nous pensâmes jamais, quelque chose de tout ce que jamais nous penserons. Comme, en effet, il n’est point de mouvement qui ne dépende de tous les mouvements qui se sont jamais accomplis, et qui ne doive contribuer à tous ceux qui jamais s’accompliront, il n’est point de pensée en laquelle ne retentisse plus ou moins obscurément tout ce qui fut, et qui ne doive subsister et se propager elle-même sans s’éteindre jamais, comme en vibrations éternelles. Chaque âme est un foyer où se réfléchit de toutes parts, sous mille angles différents, l’universelle lumière, et non seulement chaque âme, mais chacune des pensées, chacun des sentiments par lesquels se produit sans cesse, du fond de l’infini, son immortelle personnalité. »
Comme tous les métaphysiciens professionnels, Ravaisson savait faire cascader les grands mots qui ne recouvrent aucune idée. Il connaissait l’art de parler pour ne rien dire, ainsi qu’en témoigne le passage cité. C’est d’ailleurs un reproche que l’on doit adresser à tous les philosophes spiritualistes ; ils prennent la paille des mots pour le grain des choses et s’imaginent qu’ils sont profonds lorsqu’ils s’expriment dans un jargon que très peu de personnes comprennent. L’art des grandes constructions métaphysiques, c’est avant tout l’art de berner le lecteur avec des termes prétentieux et des phrases compliquées. Les imbéciles admireront d’autant plus qu’ils saisiront moins le sens des pages qu’on les invite à méditer.
Notre instinctive horreur du néant, nos aspirations vers plus de justice et de bonheur ne démontrent pas davantage l’immortalité de l’âme. Elles répondent à des tendances parfaitement naturelles, mais s’égarent lorsqu’elles situent leur objet, loin du monde présent, dans un chimérique au-delà. L’intérêt et le désir sont les plus dangereux des guides, quand on recherche la simple et nue vérité. Un spiritualiste sincère avouait récemment :
« Touchant l’immortalité de l’âme, je demeure dans une tragique, dans une déchirante incertitude. En effet, le spectacle du monde tend à nous convaincre de notre individualité passagère et du sacrifice de l’individu à l’espèce. »
On insiste beaucoup sur les consolations qu’apporte la foi en une survie ; il conviendrait aussi de rappeler les angoisses et les tourments qu’elle procure aux esprits restés naïfs. Renan affirme, il est vrai, que l’incertitude où nous sommes concernant l’immortalité de l’âme constitue une preuve de cette immortalité. Il assure :
« On peut dire sans paradoxe que si les doutes qui planent sur les vérités de la religion naturelle étaient levés, les vérités auxquelles ils s’attaquent disparaîtraient du même coup. Supposons, en effet, une preuve directe, positive, évidente pour tous des peines et des récompenses futures ; où sera le mérite de faire le bien ? Il n’y aurait que des fous qui, de gaîté de cœur, courraient à leur damnation. Une foule d’âmes basses feraient leur salut, cartes sur table ; elles forceraient en quelque sorte la. main de la divinité. Dans l’ordre moral et religieux, il est indispensable de croire sans démonstration ; il ne s’agit pas de certitude, mais de foi. Des croyances trop précises sur la destinée humaine enlèveraient tout le mérite moral. Qu’avons-nous besoin de ces preuves brutales qui gêneraient notre liberté ? Nous craindrions d’être assimilés à ces spéculateurs de vertu ou à ces peureux vulgaires, qui portent dans les choses de l’âme le grossier égoïsme de la vie pratique. »
Sans l’avouer franchement, Renan admet, avec raison, que la croyance très ferme au ciel et à l’enfer aboutit toujours à un honteux marchandage, que la différence est minime entre l ‘avare qui entasse des richesses périssables dans un coffre-fort et le pieux chrétien qui multiplie les orémus afin de grossir le trésor de ses biens célestes. Mais il a tort de supposer que le risque, né de l’incertitude, ennoblit ce marchandage. Spéculateurs de la Bourse, chevaliers d’industrie, aventuriers qui, dans tous les domaines, exploitent la crédulité des gogos, vivent aussi dans l’incertitude et courent des risques parfois terribles. Ceux qui spéculent sur l’au-delà sont à ranger parmi les usuriers les plus rapaces ; ne les plaignons pas s’ils sont tourmentés par la crainte d’effectuer un mauvais placement.
La science n’admet qu’une survie, celle des composants ultimes qui constituent l’individu. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Synthèse transitoire et passagère, notre moi s’évanouira pour ne jamais renaître ; comme les animaux, comme les plantes, comme les corps bruts eux-mêmes, l’homme doit faire retour aux grandes forces cosmiques qui, seules, possèdent l’éternité. Peut-être notre espèce sera-t-elle un jour mieux armée contre la mort ; à ce moment elle sourira de la survie que prêtres et métaphysiciens promirent longtemps en guise de consolation. Certains morts continuent, d’ailleurs, de vivre dans le souvenir de nombreuses générations. Et cette survie subjective peut adoucir le chagrin de ceux qui, bien à tort croyons-nous, se désolent de savoir qu’ils ne seront un jour qu’une poussière d’atomes, agglomérés dans des synthèses nouvelles.
— L. BARBEDETTE
SURVIE
n. f.
La survie est un terme de jurisprudence qui exprime l’état de celui qui survit à un autre. Au figuré, c’est le prolongement de l’existence et, par extension, c’est le fait de demeurer en vie après la mort.
En Droit, les gains de survie sont les avantages qui sont promis, sur les biens de la communauté, soit à celui des deux époux qui survivra à l’autre, soit à un seul d’entre eux, s’il survit à l’autre.
Albert Wahl, dans sa présomption de survie, explique que lorsque deux personnes meurent dans le même événement et qu’elles sont appelées à la succession l’une de l’autre, il est important de déterminer laquelle est morte la première, puisque celle d’entre elles qui a survécu à l’autre, ne fût-ce que d’un instant, a succédé à cette dernière. La preuve de l’ordre des décès peut être administrée par tous les moyens, même par témoins et par présomptions de faits ; par exemple, on peut décider qu’un incendie s’étant déclaré au second étage d’une maison, la personne qui habitait cet étage est présumée être morte avant celle qui habitait à un étage supérieur ou inférieur. Lorsque toute preuve ou présomption de fait manque, les deux défunts sont réputés être morts au même instant, car, pour que l’un pût succéder à l’autre, la preuve devait être apportée qu’il est décédé après lui, ce qui, par hypothèse, est impossible.
Cependant les articles 720 à 722 du Code civil ont émis certaines présomptions légales connues sous le nom de « théorie des comourants ou des commorientes ». Ils divisent la vie humaine en trois périodes :
-
de la naissance à l’âge de 15 ans ;
-
de 15 ans à 60 ans ;
-
à partir de 60 ans.
Les solutions données par la loi se rattachent à l’idée que, dans la première période, les forces croissent avec les années, qu’elles restent stationnaires dans la seconde et qu’elles diminuent dans la troisième. En conséquence, lorsque les deux défunts appartiennent à la première catégorie, le plus âgé, qui est réputé avoir offert la plus grande force de résistance, est présumé avoir survécu si les circonstances du fait ne permettent pas de déterminer l’ordre du décès. Dans la seconde période, la loi présume que les décès se sont produits dans l’ordre naturel de l’âge, c’est-à-dire que le plus jeune est présumé avoir survécu ; toutefois si les deux défunts n’étaient pas du même sexe, et si, en outre, ils étaient du même âge ou qu’il y eût entre eux une différence d’âge n’excédant pas un an, le mâle est présumé avoir survécu. Enfin, dans la troisième période, la force de résistance décroissant avec l’âge, le moins vieux est présumé avoir survécu.
Mais il peut arriver que les deux comourants appartiennent à deux périodes différentes. L’article 721 dit seulement que si l’un d’eux avait moins de 15 ans et l’autre plus de 60, le premier est réputé avoir survécu. Il néglige les hypothèses, soit ou l’un a moins de 15 ans et l’autre de 15 à 60 ans, soit ou l’un a de 15 à 60 ans et l’autre plus de 60 ans. L’opinion commune veut que, dans le premier cas, le plus âgé et, dans le second cas, le plus jeune, soient réputés avoir survécus. Mais, comme les présomptions légales sont de droit étroit, il y a des doutes sur ce point.
Que si les deux défunts sont du même âge — (et en dehors du cas indiqué plus haut, où ils appartiennent à la seconde période et sont de sexes différents) — ils sont, à défaut de présomptions légales, réputés être décédés en même temps ; la succession de chacun d’eux est donc dévolue comme s’il avait survécu à l’autre. Mais des jumeaux ne sont pas considérés comme étant du même âge. On admet généralement que le premier qui est sorti du sein de la mère est le plus âgé au point de vue de l’application des articles 720 à 722.
Ces questions de survie se posent fréquemment lorsque la mère et l’enfant succombent ensemble pendant le travail de l’accouchement. Si les circonstances de fait ne peuvent donner la solution, on admet que la mère a survécu.
L’application des présomptions fournies par ces textes n’est pas aussi large qu’on pourrait le supposer. Elle est limitée à deux points de vue. En premier lieu, la loi suppose le décès de « plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l’une de l’autre ».
Si donc un seul des comourants était héritier présomptif de l’autre, sans réciprocité (par exemple s’il s’agit de deux frères dont l’un a des enfants), les présomptions ne s’appliquent plus. Elles ne s’appliquent pas davantage si les deux défunts étaient appelés à se succéder réciproquement, non pas comme héritiers légitimes, mais comme légataires ou donataires. Ils sont alors réputés être décédés au même instant. D’autre part, la loi suppose que les deux défunts sont considérés comme étant morts en même temps, si les événements dans lesquels ils sont décédés sont différents. L’incendie d’une maison est un événement unique ; il en est de même du naufrage d’un bâtiment. L’assassinat de plusieurs personnes est, au contraire, un événement multiple, alors même qu’il a été commis par une même personne dans un même local ; c’est ce qui a été décidé à propos des assassinats de Pranzini.
Toutefois, une loi spéciale, du 20 prairial an IV, a décidé que si plusieurs personnes appelées à se succéder réciproquement sont condamnées à mort et exécutées, le plus jeune est présumé avoir survécu, lorsque le moment exact de leur décès respectif ne peut être fixé. Ce texte, qui est toujours en vigueur, mais dont la jurisprudence n’a jamais eu à faire l’application, établit une présomption légale dans une hypothèse où les événements ayant occasionné le décès n’est pas unique. La loi de prairial diffère encore du Code civil, en ce qu’elle établit une présomption invariable, quel que soit l’âge respectif des défunts.
En ce qui concerne le prolongement de l’existence, au sens propre, après la mort, la survie n’existe pas ... ou si peu. L’expérience en fut faite il y a une cinquantaine d’années sur des condamnés à mort à qui, avant la décapitation, on avait demandé d’ouvrir et de fermer régulièrement les paupières après la décollation. Les décapités se livrèrent à cette expérience, ouvrirent et fermèrent leurs paupières deux ou trois fois et ce fut tout. La survie avait à peine duré quelques secondes.
Philosophiquement, la survie existe et se perpétue. Toutes les religions se perpétuent et continuent à exister grâce à ce moyen. La chrétienté a connu son succès et se continue par la survie de son Christ qu’elle fait succomber et ressusciter si miraculeusement.
Les penseurs et les savants se survivent par les travaux accomplis leur vie durant et qu’ils ont laissés après leur mort, à l’humanité tout entière, et, pour que le nom de la plupart de ceux-ci ne soit pas ignoré par les générations qui se succèdent, on les statufie et on donne leurs noms à des places ou à des voies publiques. C’est de cette façon seule que la survie peut être considérée au figuré.
Il est incontestable que les philosophes et les savants de l’antiquité et les hommes remarquables de tous temps : de Démosthène à Caton, de Phidéas à Pline, de Vercingétorix à Napoléon, d’Ambroise Paré à Pasteur, etc., se sont survécu par la trace qu’ils ont laissée dans leur existence, sur leur passage dans la vie et dans les souvenirs qu’ils ont imprimés.
Et que la modestie de notre ami Sébastien Faure m’excuse de le citer en exemple : pionnier et vulgarisateur de l’anarchie, il se survivra par l’exemple de son existence apostolique et par le monument impérissable qu’il laissera aux générations futures : L’Encyclopédie Anarchiste.
— Pierre COMONT
SUSPECT
Adjectif employé pour qualifier tout ce qui est ou mérite d’être l’objet de quelque soupçon évidemment défavorable : un homme suspect ; un document suspect ; une intervention suspecte. On dit également d’une chose qu’elle est suspecte, lorsqu’on la soupçonne d’être fausse, de ne pas exister, ou encore d’une chose dont les qualités sont plus ou moins douteuses : une boisson suspecte.
Ce vocable fut employé comme substantif une fois dans l’histoire. Il s’agissait de la Loi des suspects, loi que promulgua la Convention, le 17 septembre 1793. En vertu de cette loi, tous les suspects, c’est-à-dire tous ceux qui ne manifestaient pas assez ouvertement, ou avec un enthousiasme jugé suffisant, leur attachement à la Révolution, pouvaient être arrêtés. Les comités révolutionnaires chargés d’arrêter les suspects étaient soumis à un Comité de Sûreté générale à qui ils envoyaient « leurs motifs », ainsi que tous les papiers et documents saisis. Les suspects étaient enfermés dans les prisons nationales et devaient supporter tous les frais de leur détention. Le 9 thermidor, la liberté était rendue à tous les suspects et, abolis, le 4 octobre 1795, la loi ainsi que les divers décrets qui s’y rapportaient.
Les « suspects » n’ont point disparu de notre planète. Il n’est même pas exagéré de dire que, à la faveur du régime capitaliste dont la grande vertu est de corrompre les individus et d’adultérer les consciences, à la faveur aussi de l’après-guerre qui a rendu les « situations » de plus en plus difficiles, le genre n’a fait que se développer !
Les suspects ? Mais ils sont légion ceux qui véritablement le sont, en tous cas devraient l’être. Suspect, l’homme d’Etat (qu’il soit blanc, noir, brun, rouge ou tricolore, peu importe) qui, à toute occasion, proteste solennellement et avec des gestes calculés, de la pureté et de la sincérité de ses intentions qui le portent à tout sacrifier, même son propre bien-être, à la grandeur et à la prospérité du pays dont il a la délicate et noble tâche, l’insigne honneur de diriger les destinées ... alors qu’il est tout simplement, ou le pantin dont on tire adroitement les ficelles, ou, le plus souvent, si pas toujours, le valet, d’ailleurs grassement rémunéré, des oligarchies financières ou industrielles qui, en fait, sont les véritables maîtres des Etats.
Suspect, le prêtre — le prêtre de toutes les Religions — qui, pour justifier sa raison d’être, c’est-à-dire son parasitisme, et perpétuer le maintien des privilèges dont il vit et s’engraisse, va partout clamant, et la légitimité des biens honnêtement acquis (s’abstenant bien de préciser la limite des richesses honnêtes !), et la sainteté de la résignation, ce qui permet à tous les exploiteurs de ne rien restituer de leurs exactions, tout en confirmant les exploités dans cette idée qu’ils feraient œuvre sacrilège en songeant à la reprise des biens dont on les a dépossédés !
Suspect, le franc-maçon, le rationaliste, le libre-penseur, en un mot le citoyen affranchi qui pousse l’inconséquence, l’impudeur, l’inconscience jusqu’à livrer ce qu’il a de plus cher : ses enfants, aux abrutisseurs des religions, soucieux qu’il est, paraîtil, de ne point déplaire à Madame son épouse qui se souvient, en certaines circonstances de sa vie, d’avoir jadis été plus ou moins pratiquante, épouse dont il sait pourtant bien, en d’autres occasions, transgresser les lois !
Suspect, le gouvernement dit prolétarien, qui entretient de cordiales relations avec les Etats fascistes, mais qui, traîtreusement, abandonne ses « frères en communisme » aux pires violences des tortionnaires hitlériens ou mussoliniens !
Suspect, le politicien — ce caméléon de toujours et de partout — qui, partisan farouche, quoique en principe seulement, d’une transformation sociale, de la destruction de l’ordre établi, de la libération de l’individu, toutes choses qui ne se conçoivent même pas sans le préalable accomplissement d’une révolution totale et profonde, rêve, en même temps, « d’aller porter la lutte de classes ... dans les ministères bourgeois » où, — ses emportements factices subitement évanouis — il n’aura cure que de collaborer fraternellement avec les défenseurs du Régime tant exécré ... en principe !
Suspects également, et au degré le plus élevé, le catholique libéral, le prêtre moderniste, le démocratechrétien, le socialiste-chrétien, le syndicaliste-chrétien, tous vocables jurant d’être accouplés, qui n’expriment que des antinomies, des incompatibilités, tout homme avisé sachant pertinemment que voila bien longtemps que le Christianisme, en général, et l’Eglise catholique, en particulier, ont impitoyablement condamné Libéralisme, Modernisme, Démocratie, Socialisme, Syndicalisme, qu’ils considèrent comme de « funestes erreurs », des « pestes mortelles » !
Et enfin, suspect le militant, le propagandiste qui apporte, dans « ses fonctions », dans ce qu’il ose appeler « son apostolat », un zèle par trop ardent. Qui ne saurait souffrir qu’une action soit engagée sans lui, qui est de tous les groupements, de toutes les associations et généralement aux postes de commande, qui se dépense sans compter, qui crie très fort et estime que l’action n’est jamais assez révolutionnaire, mais qui serait, par contre, fortement embarrassé si on l’obligeait — ce qui serait prudent et salutaire — à prouver l’origine de ses « moyens » d’existence !...
— A. BLICQ.
SYLLABUS (LE)
Syllabus, mot latin signifiant sommaire. En droit canonique, il est employé comme synonyme d’énumération succincte des points décidés dans un ou plusieurs actes de l’autorité ecclésiastique.
Le Syllabus qui fut publié, en décembre 1864, par le Pape Pie IX, à la suite de l’Encyclique Quanta Cura, est un recueil de quatre-vingts propositions latines. Résumé de toutes les allocutions consistoriales, lettres et encycliques prononcées et écrites par ce Pontife depuis 1846, il reprend, sans y ajouter le moindre commentaire, toutes les condamnations formulées contre les doctrines et les sociétés modernes. Le texte latin peut se traduire ainsi :
« Résumé des principales erreurs de notre temps qui sont signalées dans les allocutions consistoriales, encycliques et autres lettres apostoliques de Notre Très Saint Père le Pape Pie IX. »
Ce document qui montre, dans une forme indirecte et négative, mais extrêmement claire, la doctrine politique et sociale de l’Église catholique, mériterait d’être reproduit en entier. Mais comme il ne sied point d’abuser de l’hospitalité qui nous est accordée, nous nous bornerons à donner, de ce document, les passages essentiels que nous ferons précéder d’un extrait de l’encyclique qui l’accompagnait.
a) Extrait de l’Encyclique Quanta Cura
« ... Il vous est parfaitement connu qu’aujourd’hui il ne manque pas d’hommes qui appliquent à la société civile l’impie et absurde principe du Naturalisme, comme ils l’appellent : ils osent enseigner que « la perfection des gouvernements et le progrès civil exigent absolument que la société humaine soit constituée et gouvernée sans plus tenir compte de la religion que si elle n’existait pas, ou du moins sans faire aucune différence entre la vraie religion et les fausses. » De plus, contrairement à la doctrine de l’Écriture, de l’Église et des saints Pères, ils ne craignent pas d’affirmer que « le meilleur gouvernement est celui où l’on ne reconnaît pas au pouvoir l’obligation de réprimer, par la sanction des peines, les violateurs de la religion catholique, si ce n’est lorsque la tranquillité publique le demande ». En conséquence de cette idée absolument fausse du gouvernement social, ils n’hésitent pas à favoriser cette opinion erronée, on ne peut plus fatale à l’Église catholique et au salut des âmes, et que notre prédécesseur d’heureuse mémoire, Grégoire XVI, appelait un délire, savoir que « la liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme, qu’il doit être proclamé et assuré dans tout État bien constitué ; et que les citoyens ont droit à la pleine liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu’elles soient, par la parole, par l’impression ou autrement, sans que l’autorité ecclésiastique ou civile puisse limiter ce droit. »
« Quand la religion est bannie de la société civile, quand la doctrine et l’autorité de la révélation divine sont rejetées, la vraie justice ou plutôt la vraie notion de la justice et du droit humain s’obscurcit, se perd, et la force matérielle prend la place de la justice et du vrai droit. Qui ne voit, qui ne sent très bien qu’une société soustraite aux lois de la religion et de la vraie justice ne peut avoir d’autre but que d’amasser, d’accumuler des richesses et, dans tous ses actes, d’autre loi que l’indomptable désir de satisfaire ses passions et de se procurer des jouissances ? Voilà pourquoi les hommes de ce caractère poursuivent d’une haine cruelle les ordres religieux, sans avoir égard aux immenses services rendus par eux à la religion, à la société et aux lettres. Non contents de bannir la religion de la société, ils veulent l’exclure de la famille. Enseignant et professant la funeste erreur du Communisme et du Socialisme, ils affirment que « la société domestique ou la famille emprunte toute sa raison d’être du droit purement civil et, en conséquence, que de la loi civile découlent et dépendent tous les droits des parents sur les enfants, même le droit d’instruction et d’éducation ». Tous ceux qui ont entrepris de bouleverser l’ordre religieux et l’ordre social, et d’anéantir toutes les lois divines et humaines, ont toujours fait conspirer leurs conseils coupables, leur activité et leurs efforts à tromper et à dépraver surtout la jeunesse. Voilà pourquoi le clergé régulier et séculier, malgré les plus indubitables et les plus illustres témoignages rendus par l’histoire à ses immenses services est, de leur part, l’objet d’atroces et incessantes persécutions, et pourquoi ils disent que « le clergé étant ennemi du véritable et utile progrès dans la science et la civilisation, il faut lui ôter l’instruction et l’éducation de la jeunesse … »
b) SYLLABUS.
Des principales erreurs de notre temps, signalées dans les allocutions consistoriales, encycliques et autres lettres apostoliques de Notre Très Saint Père le Pape Pie IX.
-
I. — Panthéisme, naturalisme et rationalisme. — On doit nier toute action de Dieu sur les hommes et sur le monde. — Toutes les vérités de la religion découlent de la force native de la raison humaine ; d’où il suit que la raison est la règle souveraine d’après laquelle l’homme peut et doit acquérir la connaissance de toutes les vérités de toute espèce. — La foi du Christ est en opposition avec la raison humaine, et la révélation divine non seulement ne sert de rien, mais elle nuit à la perfection de l’homme. — L’Église non seulement ne doit, dans aucun cas, sévir contre la philosophie, mais elle doit tolérer les erreurs de la philosophie et lui abandonner le soin de se corriger elle-même.
..........................................................................................................
-
III. — Indifférentisme, latitudinarisme. — Le protestantisme n’est pas autre chose qu’une forme diverse de la même vraie religion chrétienne, forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu, aussi bien que dans l’Église catholique.
-
IV. — Socialisme, communisme, sociétés secrètes, sociétés bibliques, sociétés clérico-libérales. — Disons, pour nous résumer, que ces sortes de pestes sont fréquemment frappées de sentences formulées dans les termes les plus graves, par exemple dans l’Encyclique Qui pluribus du 9 novembre 1846, dans l’allocution Quibus quantisque, du 20 avril 1849, dans l’Encyclique Quanto conficiamur mocrore, du 17 août 1863.
-
V. — Erreurs relatives à l’Église et à ses droits. — L’Église n’est pas une vraie et parfaite société pleinement libre ; elle ne jouit pas de ses droits propres et constants que lui a conférés son divin Fondateur ; mais il appartient au pouvoir civil de définir quels sont les droits de l’Église et les limites dans lesquelles elle peut les exercer. — L’Église n’a pas le pouvoir de définir dogmatiquement que la religion de l’Église catholique est uniquement la vraie religion. — L’Église n’a pas le droit d’employer la force ; elle n’a aucun pouvoir temporel direct ou indirect. — L’Église n’a pas le droit naturel et légitime d’acquérir et de posséder.
-
VI. — Erreurs relatives à la Société civile, considérée soit en elle-même, soit dans ses rapports avec l’Église. — La doctrine de l’Église catholique est opposée au bien et aux intérêts de la société humaine. — En cas de conflit légal entre les deux pouvoirs, le droit civil prévaut. — L’Église doit être séparée de l’État, et l’État séparé de l’Église.
-
VII. — Erreurs concernant la moralité naturelle et chrétienne. — Les lois de la morale n’ont pas besoin de sanction divine, et il n’est pas du tout nécessaire que les lois humaines se conforment au droit naturel ou reçoivent de Dieu le pouvoir d’obliger. — Il est même permis de refuser l’obéissance aux princes légitimes et même de se révolter contre eux.
..........................................................................................................
-
X. — Erreurs qui se rapportent au libéralisme moderne. — A notre époque, il n’est plus utile que la religion catholique soit considérée comme l’unique religion de l’État à l’exclusion de tous les autres cultes. — Le Pontife romain peut et doit se réconcilier avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne.
Empressons-nous de dire que ce document eut, à l’époque de sa publication, un retentissement si considérable que le gouvernement impérial interdit aux évêques de le publier par voie de mandements. Bon nombre d’écrivains catholiques — et non des moins réputés — n’hésitèrent pas à ranger le « Syllabus » parmi les documents ex-cathedra, c’est-à-dire revêtus de l’autorité infaillible conférée aux décisions souveraines des pontifes de Rome. Faut-il souligner également combien il aggravait encore l’opposition que l’on savait déjà flagrante, irréductible, entre l’Église catholique et la société moderne ?
Remontons, en effet, à la Révolution française et voyons, par exemple, en quels termes le pontife de l’époque, Pie VI, appréciait cet événement si considérable.
Dès le 29 mars 1790, Pie VI, dans une allocution consistoriale, condamne ouvertement la Révolution française, ainsi que les principes de la Déclaration des Droits de l’Homme. Ne qualifie-t-il point de « décrets sacrilèges » la suppression des dîmes, la nationalisation des biens ecclésiastiques, l’admission des non-catholiques à toutes les fonctions civiles et militaires ? « N’est-ce pas, dit-il, faire œuvre satanique que de reconnaître à l’homme le droit de manifester librement sa pensée ? » Ne proteste-t-il pas, avec véhémence, contre un « vain fantôme de liberté », en déclarant que le gage de la félicité publique est « dans le lien d’une obéissance aux rois universellement consentie, car les rois sont les ministres de Dieu pour le bien et les défenseurs de l’Église » ? Et, le 10 mars 1791, s’élevant, à nouveau, contre le « droit chimérique » que constitue la liberté de pensée, il affirme, avec plus de force encore, « qu’il est insensé d’établir parmi les hommes l’égalité et cette liberté effrénée qui n’aboutissent qu’à renverser la religion catholique ».
Le 17 juin 1793, Pie VI, toujours, brandit, une fois de plus, ses foudres vengeurs pour blâmer la Convention d’avoir aboli la royauté « le meilleur de tous les gouvernements » et déclare qu’il est insensé d’avoir transporté l’autorité publique dans les mains du Peuple, absolument incapable, dit-il, de suivre aucun plan de conduite sage et raisonnable. La devise : Liberté, Égalité ? Il la condamne sans rémission. La liberté, « qui ne tend qu’à corrompre les âmes et à dépraver les mœurs » ; l’égalité, nom non moins illusoire, propre tout au plus à détruire l’harmonie sociale en détruisant le principe d’autorité !
Est-il permis de supposer, un instant, que ce langage fut particulier à Pie VI ? Entendez ses successeurs.
Pie VII, en 1800, réclame, dès son avènement, la suppression de la « licence effrénée de pensée, de paroles, d’écrits et de lectures ». Léon XII, à son tour, en mars 1826, anathématise francs-maçons et jeunesse universitaire, coupables de tendre au renversement « des pouvoirs légitimes ». Grégoire XVI, au lendemain de la Révolution de 1830, s’élève contre la doctrine du libéralisme, condamne les catholiques libéraux, leur reproche amèrement d’adhérer à cette « maxime fausse et absurde de la liberté de conscience, de la liberté des opinions, de la liberté de la presse surtout (la plus funeste, la plus exécrable de toutes) ». On le voit : tous ces illustres représentants de Dieu sur terre n’ont eu d’autre souci, d’autre préoccupation que de s’opposer au développement des principes humains énoncés par les grands révolutionnaires du XVIIIème siècle. Pie IX, par son « Syllabus », ne faisait que suivre la politique fidèlement observée par ses prédécesseurs et, s’inspirant de ce fait historique, on peut hardiment avancer que le « Syllabus » n’est point la doctrine d’un pape, d’un seul, mais bien la doctrine de toute la papauté, avant et après Pie VI ! Pourrait-on, en effet, nous citer un Pape qui ait désavoué le « Syllabus » ? Si quelques évêques, à l’époque où il parut, lui furent hostiles, tous, de nos jours, sont unanimes à l’approuver sans réserves. Lisez ce curieux Manifeste publié, par l’Épiscopat français, le 10 mars 1925, contre les lois laïques, et vous constaterez qu’il n’est qu’une adaptation du texte de 1864 aux circonstances et aux nécessités du moment.
Arrivons à Léon XIII — « le pape libéral, ami des ouvriers » ! — N’a-t-il point formulé un corps de doctrine où, avec une souplesse et une habileté qu’on rencontre rarement, il condamne les principes de 1789 ainsi que la démocratie telle que la conçoivent la Société moderne et tous les hommes qui ne se paient point de mots ? Le Socialisme ? « Peste mortelle qui conduit la société humaine à sa perte » ; « doctrine diabolique qui tire son origine des conceptions empoisonnées des novateurs du XVIème siècle ». — La propriété ? « Invention divine et inviolable » qui, pour détourner le fléau du socialisme, possède une vertu qui ne se trouve ni dans les lois humaines, ni dans la répression, mais dans ... la salutaire influence de l’Église !
Dans Humanum genus, encyclique publiée le 20 avril 1884, ce pape libéral déclare « qu’il ne peut admettre que le pouvoir vienne du peuple, pas plus qu’il ne croit à l’amélioration des hommes par les institutions ». Et enfin, dans Immortale Dei, parue le 1er novembre 1885, il présente Le Syllabus comme de nature à fournir une direction sûre au milieu des erreurs contemporaines et, une fois de plus, il condamne les libertés modernes, la liberté de conscience et de la presse, l’instruction laïque, le mariage civil, la séparation des Églises et de l’État.
Nous voici à l’aurore du XXème siècle. Le même pontife occupe toujours le trône de Saint-Pierre. Parvenu à la vingt-cinquième année de son pontificat, Léon XIII publie une sorte de testament où il précise sa doctrine en lui donnant une forme définitive. Que nous apporte ce testament qui n’ait été déjà proclamé, ressassé cent fois par les devanciers de l’auteur ? Condamnation de la Réforme et de la philosophie du XVIIIème siècle d’où découlent le Rationalisme et le Matérialisme. Réprobation véhémente du laïcisme, de l’esprit d’insoumission et de révolte des classes populaires. Anathématisation des sectes socialistes. L’Église dépositaire exclusive de la Vérité, de toutes les vérités et qui ne peut que flétrir la liberté accordée indifféremment à la vérité et à l’erreur, au bien et au mal. — Rien, on le voit, qui n’ait été dit déjà !
Et Pie X ? Interrogeons, sur ce point, le « grand démocrate-chrétien », le Silloniste Marc Sangnier. Il avait feint la réconciliation de son Église (car il est catholique avant tout !) avec le libéralisme, mieux : avec le socialisme ! Pie X eut tôt fait de l’exécuter, lui et ses disciples. Ils ne firent d’ailleurs aucune difficulté pour se soumettre et se démettre !....
Benoît XV continue la tradition sacrée ! Il s’élève contre les pauvres qui ont l’audace de s’attaquer aux riches ; il déplore la fréquence des grèves, condamne les « erreurs socialistes » et reprend les séculaires attaques contre « l’appétit désordonné des biens périssables », « la lutte des classes », « le laïcisme », « l’absence de hiérarchie entre les hommes », « le culte de la science », etc…, etc ….
Et pour finir, parlons un peu de Pie XI, notre Saint-Père. Depuis qu’il occupe le trône de St-Pierre, toute occasion lui fut bonne pour parler au monde.
Après ses encycliques sur l’Éducation et sur le Mariage, il a donné, le 3 mai 1932 (Caritate christi compulsi) son opinion sur les épreuves présentes du genre humain, en même temps qu’il nous proposait son remède à la crise.
L’opinion du Pontife ? Le monde retrouvera sa quiétude, les peuples leur prospérité, la crise économique sera révolue, la paix régnera entre les nations ... dès que les gouvernants et les sujets seront redevenus les fils soumis de l’Église catholique et romaine. Voilà la trouvaille !
Il met, ce brave pape, dans le même sac, les gouvernements laïcs, les écoles populaires, les universités, les sociétés secrètes, les factions socialistes et communistes. Il préconise même contre celles-ci, « un front unique et solide » !
Son remède à la crise ? Prières et pénitences !
L’Église, par l’organe de son porte-parole le plus éminent, ne se penche sur les humbles, sur les travailleurs, que pour les exhorter à la résignation, que pour les inciter à se soumettre docilement à l’autorité de leurs détrousseurs !
Et lui aussi déclare sentencieusement, que :
« La liberté, la solidarité, l’amour de l’humanité et de la science, en un mot, toutes les plus nobles affirmations de la conscience moderne, ne sont que des idoles. Il proclame que « les individus, les familles, les nations, doivent à Dieu un culte officiel, une soumission de l’intelligence. Que l’église catholique laisse à chacun la liberté d’être républicain (Il ne dit pas toutefois si c’est à la manière de Combes ou de Castelnau !), royaliste, impérialiste, mais elle ne laisse pas la liberté d’être socialiste, communiste, anarchiste, ces trois sectes étant condamnées par l’Église ... »
Donc, aucune objection, aucune contestation n’est permise. De 1789 à nos jours — pour ne s’en tenir qu’aux temps modernes — la permanence de la doctrine politique de l’Église apparaît évidente. Pie XI, en lançant son Syllabus au monde en une sorte de défi, n’a fait que s’inspirer des immuables principes qui constituent toute la structure de cette formidable et malfaisante organisation qu’est l’Église catholique. Le Syllabus condamne radicalement la conception moderne des droits de la conscience. C’est, selon lui, une maligne erreur que d’admettre les protestants aux mêmes droits politiques que les catholiques. Est-ce que les pères de la Compagnie de Jésus — les jésuites — à qui l’on attribue d’ailleurs la paternité des principales propositions de ce fameux document, ne persistent pas à enseigner que la coercition et la répression sont un devoir sacré, dès qu’on en a la puissance ou qu’on l’acquiert ?
Pie XI rejoint Saint-Paul, l’auteur de l’Épitre aux Romains, où l’on trouve cette formule célèbre du droit divin des puissances de la terre :
« Que toute âme soit soumise aux pouvoirs supérieurs. Car il n’y a point de pouvoir qui ne vienne de Dieu, et ceux qui existent ont été établis par lui, de sorte que celui qui s’oppose au pouvoir résiste à l’ordre de Dieu. »
Il rejoint Bossuet, qu’on n’accusera pas d’ignorer la doctrine chrétienne, qui, invoquant également l’autorité du fondateur du Christianisme, déclare :
« Que quiconque condamne la servitude, condamne en même temps le Saint-Esprit qui ordonne aux esclaves, par la bouche de Saint-Paul, de demeurer en leur état et n’oblige point leurs maîtres à les affranchir. »
L’Église qui n’a point condamné en principe l’esclavage, pas plus qu’elle ne l’a aboli en fait, est bien dans son rôle historique en prêtant tout son appui aux Régimes d’oppression et en s’opposant, par voie de conséquence, au développement des doctrines de libération et de rédemption humaines. Les adulateurs et les complices des Constantin, des Napoléon, des Mussolini, des Hitler et de tous les tortionnaires des peuples ne sauraient, en même temps, favoriser l’affranchissement de l’individu !
Le mot est d’une justesse profonde :
« Le Catholicisme peut être considéré comme une théorie de direction sociale greffée sur une doctrine de renoncement individuel. »
L’homme est ainsi détourné des choses, des biens de la terre et livré, pieds et poings liés, à la domination de l’Église. Toute l’œuvre de la papauté a été fondée sur ce calcul on ne peut plus logique.
Avec des alternatives d’audace insolente, d’acharnement impitoyable, de soumission et de temporisation calculée, la papauté a marché vers l’objet de ses rêves et de ses convoitises : le gouvernement universel et, en dépit des multiples et cuisants échecs qu’elle a subis au cours des siècles, elle n’a point renoncé à ses espérances scélérates d’asservir, un jour, hommes et choses à sa sanglante et implacable tyrannie !
— A. BLICQ.
SYMBOLISME
Le mot symbolisme est né du verbe symboliser, exprimer par symboles. Le symbolisme est la représentation par des symboles des abstractions, idées, personnes ou choses qui n’ont pas une existence ou une apparence réelle. Le symbole (du latin symbolum) est :
« Une figure ou une image employée comme signe d’une autre chose. » (Littré)
Il est l’aspect concret de la représentation symbolique. La parole, l’écriture, tous les arts sont des symboles de la pensée ; ils donnent un corps aux idées, ils les traduisent plastiquement pour les rendre compréhensibles et communicables à l’intelligence et aux sens. On a symbolisé ainsi la conception toute abstraite de la fidélité dans l’image du chien. De même, l’agneau est le symbole de la douceur, le lis celui de la pureté, le serpent celui de l’éternité, le lion et le soleil ceux de la force et de la souveraineté, l’épée celui de la guerre, la croix celui de la foi chrétienne, le croissant celui de la foi musulmane, le sceptre celui de la royauté, le bonnet rouge celui de la liberté, le marteau et la faucille ceux de la dictature du prolétariat, etc ... Flaubert admirait Buffon mettant des manchettes pour écrire. Il voyait là un symbole, celui de la méthode de travail de cet écrivain.
Tout est symbole dans le monde, et le domaine symbolique, aussi vaste que l’univers, n’est pas moins conventionnel, arbitraire et contradictoire suivant les interprétations, même lorsqu’elles ne sont pas seulement des images de rhétorique et sont présentées sous une forme précise et un sens généralement reconnu. Ainsi, il semble admis par tout le monde qu’un glaive est un instrument de meurtre et symbolise le combat, que la guerre est le meurtre collectif et que le but des armées est d’accomplir ce meurtre. Mais grâce à la rhétorique théologique et à son symbolisme spécial, le « Dieu des armées » qui commande à ses fidèles de massacrer, suivant les circonstances, les hérétiques, les Chinois, les Français, les Allemands, est le même Dieu qui dit d’autre part à tous les hommes sans distinction :
« Tu ne tueras pas ! …. Aimez-vous les uns les autres ! .... Qui se sert de l’épée périra par l’épée ! ... etc ... »
De même il y a une « Armée du Salut » avec un état-major, des soldats, une devise : « Sang et Feu » et un emblème composé de deux épées entrecroisées. Mais il paraît que cette armée ne veut le Salut que par la paix et, lorsqu’elle chante, avec accompagnement de grosse caisse : « Debout, saintes cohortes, soldats du Roi des rois ! », ce n’est pas dans l’intention de faire couler « un sang impur », c’est seulement « pour exciter les forces spirituelles des balayeurs du monde moral voués au nettoyage des égouts de la civilisation » !.....
Pourquoi alors des épées quand il ne faut que des balais ? Et comment s’y reconnaître, si l’on n’est pas pétri de sophistications théologiques ?
C’est par le symbole, image matérielle de sa pensée, c’est par la métaphore, image littéraire de ses états de conscience, que l’homme s’exprime et se fait comprendre. Le symbole remplit le monde, il est né avec lui. L’homme en eut immédiatement besoin. Il le trouva autour de lui, répandu dans la nature, mais livré à toutes les subtilités des interprétations. Il fut clair quand la pensée fut claire ; il fut ténébreux quand la pensée fut ténébreuse. Le symbole scientifique fut précis : avec lui, trois fois un firent trois. Le symbole théologique fut absurde (Credo quia absurdum) ; avec lui, trois fois un ne firent qu’un ! Le symbole artistique et littéraire fut livré à toutes les fantaisies de l’imagination. Le réalisme l’éclaira des rayons de la vérité, l’idéalisme l’obscurcit de métaphysique. Le symbolisme shakespearien fit d’un nuage une belette, un chameau, une baleine. Le symbolisme dadaïste fit d’un tuyau de poêle une femme, un ver solitaire, un orgue de barbarie, etc ... Les symboles eurent ainsi les significations les plus diverses, et parfois les plus ahurissantes, suivant leur emploi.
Pour les anciens, qui intégraient le divin dans la nature, le symbolisme était plus familier qu’aux hommes d’aujourd’hui. Les interprétations religieuses le firent de plus en plus mystérieux et impénétrable. La préhistoire eut ses manifestations symboliques dans l’architecture, dans les matières taillées, l’écriture, le dessin, la peinture des cavernes, dans les traditions orales devenues légendaires, transmises par les générations successives. Ce sont ces légendes qui ont fourni à Frédéric Creuzer les éléments de sa Symbolique, où il a expliqué le symbolisme primitif et sa place dans l’origine des religions antiques, principalement de la mythologie grecque. L’ouvrage de Creuzer a été complété par celui de Guigniant : Religions de l’antiquité.
Tous les deux établissent que les développements du symbolisme, dans les formes scientifiques les plus précises comme dans celles les plus vagues de l’art et de la littérature, ont eu leur naissance dans l’observation et l’interprétation des phénomènes naturels. Tant qu’il se confondit avec la nature, ne recevant que d’elle ses instincts, ses forces et les aspirations de sa conscience, l’homme rechercha des symboles naturistes. En s’écartant de la nature pour découvrir et atteindre un divin de plus en plus incertain et inaccessible, il perdit la clef des symboles. Malgré leur multiplication, et peut-être à cause d’elle, l’homme devint impuissant à représenter la diversité de la nature par la leur. A. France, en faisant cette constatation, y a vu la raison du peuple juif de se faire un dieu unique au milieu des peuples polythéistes « d’une imagination plus savante et d’une pensée plus philosophique ». Déjà l’observation et l’interprétation de la nature, de plus en plus obscurcies chez l’homme, ne s’étaient retrouvées que vaguement dans la mythologie grecque à partir d’Homère et d’Hésiode. Chez les latins, elles furent complètement éteintes après Lucrèce. Le christianisme fut l’aboutissement moderne de l’impuissance humaine devant les symboles de la nature.
Les bouddhistes voulant « se perdre dans l’infini des choses » plutôt que dans un incompréhensible divin, recherchèrent la sagesse d’abord chez les animaux. Toute une représentation symbolique d’un admirable esprit et accessible à tous, résulta de la considération déférente et affectueuse de l’homme pour l’animal. Le serpent enroulé en cercle symbolisera l’éternité et l’éléphant fut le type de la sagesse. Le divin fut pour eux dans la nature sensible. Dieu était le soleil qui avait, par sa puissance, fait sortir l’homme et l’animal du limon de la terre comme il en faisait sortir les plantes. La pureté de cette naissance eut pour symbole, chez les Égyptiens, le bœuf Apis, né d’une génisse vierge fécondée par un rayon de soleil. Le même symbole fut encore plus poétiquement représenté dans la mythologie grecque par les amours de Jupiter, principe de l’air qui féconde le monde dans ses rapports naturels avec les choses. Du même principe de la nature fécondante se forma la légende de la Vénus Génitrix, déesse de la volupté et de la maternité, mère du monde, la « bonne mère » que la ferveur populaire continua d’adorer dans la Vierge Marie, sans souci de cette Immaculée Conception dont le dogme ténébreux est souillé par les odieuses mystifications du péché originel et de la nécessité de la rédemption. C’est ainsi que les :
« Symboles sont indéfiniment extensibles ; d’abord simple fantaisie de l’esprit, puis dogmes religieux que le fidèle confesse sur le bûcher, — d’abord germes à peine perceptibles, puis végétations immenses, — ils obéissent à l’imagination qui les créa, qui les nourrit et qui peut, s’il lui plaît, leur faire envahir le ciel et la terre. » (E. Reclus)
Les dieux eurent toutes les formes naturelles avant de prendre celle de l’homme, quand son aberration mégalomane lui fit imaginer un Dieu à son image ! Le soleil symbole universel de la vie féconde, fut réduit aux figurations locales des Osiris, Jupiter, Bouddha, et de mille autres plus ou moins monstrueux, avant d’aboutir au Christ, vulgaire thaumaturge dont la charlatanerie religieuse annonce un prochain retour pour purifier le monde en jugeant les vivants et les morts ! Plus bas encore, la sottise humaine ravala le symbole solaire au point de le réduire à un Alexandre, un Justinien, un Louis XIV !....
Tant que la théologie, théorie spirituelle de l’asservissement de l’homme par l’homme, ne s’imposa pas, le symbolisme fut le langage universel des êtres et des choses, et c’est en remontant à cette source pure que Baudelaire a écrit :
« La Nature est un temple où de vivants piliers Laissent parfois sortir de confuses paroles ; L’homme y passe à travers des forêts de symboles Qui l’observent avec des regards familiers. »
Ce symbolisme naturiste a fait que dans toutes les grandes œuvres, comme celle d’Ibsen qui en est particulièrement inspirée, — l’idéal et la réalité se fondent, et que les principes et les passions se heurtent avec tant de véhémence par la transposition, dans l’humain, des forces naturelles et de leurs lois morales en lutte entre les courants arbitraires de la civilisation. Ce sont les symboles créés par les courants arbitraires qui nous font accepter, en nous les rendant familières, une foule de manières de faire et de penser que notre raison repousserait si nous les discutions. Nous sommes saturés de symboles, mais plus ou moins adultérés d’idéologie mystique, poétique, héroïque, ne correspondant plus que très relativement aux sentiments et aux sensations générales ou particulières de notre individu. C’est par les symboles que l’art exerce sa puissance, mais ce n’est qu’en dépassant la vie conventionnelle qu’il éveille en chacun de nous cette sensibilité si profondément cachée que parfois nous ne la soupçonnons pas (voir Sens esthétique).
Le symbolisme a suivi rigoureusement l’évolution humaine à travers les temps, les milieux et les mœurs. La préhistoire a eu ainsi des évolutions symboliques. Les temps historiques nous ont fait connaître des symbolismes védique, égyptien, hébraïque, hellénique, gréco-latin, scandinave, germanique, etc... Ils ont été étroitement mêlés à la formation des mythes et les ont propagés parmi les peuples. Le symbolisme est devenu anthropomorphique avec les religions qui donnèrent aux dieux la forme humaine. Il s’éloigna de plus en plus de la nature quand ces religions passèrent du polythéisme au monothéisme. L’incomparable grandeur du symbolisme grec vint de l’humanité de son polythéisme. Il libéra l’homme de la terreur des forces naturelles et de sa soumission passive à ces forces, lui faisant prendre ainsi conscience de lui-même, de sa vraie place dans la vie, non comme conquérant et dominateur de la nature et des autres hommes, mais comme individu libre, pouvant librement s’associer à eux selon son choix. « Connais-toi toi même » disait alors Socrate, et Diogène lançait son : « Ote-toi de mon soleil ! » à l’Alexandre-Soleil, maître du monde qui l’importunait de sa présence et de sa puissance. La splendeur du symbolisme grec éleva le mythe hellénique au-dessus de tous les autres. Ceux du Nord, par exemple, le scandinave et le germanique, gardèrent leur rudesse primitive et sauvage malgré ce que certains, un Goethe par exemple, voulurent leur communiquer de la sagesse grecque. Sans les Socrate, les Platon et leurs continuateurs latins, les Lucrèce et les Sénèque, le monde serait peut-être encore plongé dans la barbarie préhistorique à laquelle la brute fasciste cherche à le faire retourner.
Le mysticisme, produit de l’onanisme métaphysique, obscurcit de plus en plus le symbolisme par les mystères, les fantasmagories ésotériques, dionysiaques et orphiques qui passèrent d’Éleusis dans le christianisme par la voie du néo-platonisme. Le premier christianisme s’adapta au néo-platonisme pour se faire admettre, en attendant que sa puissance fut assise. C’était d’ailleurs une nécessité pour lui. De même que la cathédrale ne pourrait avoir, sous peine de s’écrouler, d’autre principe architectural que celui de la basilique antique, le dogmatisme chrétien, si « spiritualisé » qu’il prétendrait être, ne pourrait ne pas plagier le symbolisme païen sans demeurer indifférent à l’esprit humain. Il s’adapta, mais en truquant, en s’efforçant avec toujours plus d’audace d’extirper le naturel et la vie de ce symbolisme, de le livrer aux déchéances mortifères du mysticisme.
On ne peut pas constater sans ironie qu’une religion appliquée avec tant de fureur à maudire et à détruire le paganisme, n’ait pu s’établir et se maintenir qu’en s’appropriant ses symboles, en les maquillant, en se livrant en somme à cette farce grossière consistant à baptiser carpe ce qui est volaille ! Les symboles que Hugues de Saint-Victor appela « la représentation allégorique d’un principe chrétien sous une forme sensible », et qu’effrontément l’Église déclara être de source et de vérité chrétiennes, ne furent que ceux du principe païen adaptés par l’industrie cléricale, avec parfois une incohérence inimaginable. La symbolique chrétienne s’est elle-même retrouvée, de l’aveu de ses auteurs, dans les légendes orphiques, dans les Métamorphoses d’Ovide, dans Virgile, dans cent autres qu’elle s’est annexés. Les dogmes et les symboles furent essentiellement platoniciens, tant que l’Église fut à la recherche de cette dogmatique qu’elle prétend lui avoir été « révélé » et sur laquelle elle disputa malgré cependant des siècles ! Ses premiers livres, Évangiles et autres, ne devinrent définitifs qu’après de multiples interpolations. Elle ne rejeta le néo-platonisme et ne brûla ce qu’elle avait adoré que lorsque, assurée de sa puissance, elle eut transformé les symboles d’indépendance de l’esprit en symboles de soumission, mais les ailes que ses anges portèrent dans le dos n’en demeurèrent pas moins à l’image de celles que l’enthousiasme platonicien donnait aux âmes pour les entraîner dans les cieux. A l’exemple des platoniciens, les Gnostiques avaient vu dans l’amour corporel et humain un symbole mystique de l’amour spirituel et divin. Ce symbole était devenu chrétien au point que les mouvements des sens et la volupté physique avaient été admis comme moyens d’épuration de l’âme et d’ascension vers le ciel ! Le Cantique des Cantiques était le symbole du mariage de Jésus avec l’Église. On n’avait pas encore fabriqué l’Immaculée Conception, et l’obscénité de la chasteté ecclésiastique, derrière laquelle Tartufe dissimulerait sa lubricité n’était pas encore un article de foi. Les cérémonies, les processions, les fêtes chrétiennes, continuaient celles de l’antiquité. Les cabiries, en l’honneur de divinités aussi nombreuses que mystérieuses, se retrouvaient dans les fêtes des « saints ». Le corybantisme, pratiqué par les païens dévots de Cybèle, survivait au point de produire aux XVIème et XVIIème siècles de véritables épidémies d’hallucinations démoniaques chez les mystiques. La procession des cierges allumés, à la Chandeleur, perpétuait celle des Romains célébrant Proserpine le même jour de février. Le Carnaval, imité des bacchanales, des lupercales, des saturnales, se déroulait dans l’Église. L’office des ténèbres, dans la Semaine Sainte, rappelait celui des païens lamentant la mort de leurs dieux. A Vénus et à Cybèle pleurant sur les corps de leurs amants Adonis et Atys, on avait substitué Marie pleurant sur celui de son fils Jésus. La Fête-Dieu renouvelait les solennités à la gloire de Jupiter et d’Isis. Les Rogations répétaient les fêtes de Cérès. La Noël était la réjouissance de la naissance du Soleil dont Jésus n’était, après tant d’autres, qu’une incarnation.
« Ainsi, le christianisme allait se chargeant sur son passage de toutes les fantaisies qui avaient précédé son avènement. » (Ph. Chasles)
Pour donner le change sur tout cela, on a inventé la symbolique chrétienne. Elle est le système de la forgerie catholique afin de dénaturer le symbolisme, de faire chrétien ce qui était païen. Cette symbolique est tellement compliquée que même ses initiés, ou prétendus tels, disputent à l’infini à son sujet sans pouvoir s’entendre. Huysmans, dans sa Cathédrale, en a donné une explication qu’on peut appeler rationnelle, parce qu’il l’a vue en artiste, en homme chez qui la mystique n’avait pas obnubilé le sens véritable de l’art, et non en théologien. Et il a constaté que l’explication théologique était parfois « bien tirée par les cheveux » et « bien obscure ». Lorsqu’il a dit que l’architecture romane énonce le « repliement » de l’âme, tandis que le gothique en est le « déploiement », il a fort bien compris la contrainte des forces naturelles dans le roman, alors qu’elles débordent au contraire dans le gothique avec le flot de la vie populaire échappée à la mystique pour faire de la cathédrale la maison du peuple plus que la maison de Dieu, le symbole de la prospérité communale dans l’épanouissement d’une nouvelle vie sociale, et non celui de la foi chrétienne. C’est ainsi qu’au fronton de la cathédrale de Chartres fut sculptée la figure de la Liberté. Huysmans n’a pas vu cette figure qu’avait reconnue Michelet mais il était trop averti par tout le naturisme débordant de la cathédrale pour ne pas savoir que son symbolisme était plus populaire que religieux, plus humain que mystique, et qu’il représentait par toutes les merveilles de son « microcosme » de pierres bâties et sculptées, de clochers, de flèches et de vitraux, toutes les espérances humaines refoulées pendant mille ans.
Il n’a pas davantage échappé à Huysmans que l’art appelé « chrétien » n’eut jamais de véritable beauté que par l’inspiration naturiste et humaine, et il a été amené ainsi à dénoncer la « démence » du symbolisme chrétien. Personne n’a protesté avec plus d’indignation contre les tartufes destructeurs des images « indécentes » dans la cathédrale, contre les stupides cagots colleurs de papier sur le ventre du petit Jésus pour voiler son « obscénité », contre l’art de « bedon et de bidet », qui fit, au XVIIIème siècle, « d’un bénitier une cuvette ». Personne n’a, avec plus de verve courroucée, accusé « l’ignominie » et la « honte » de la « cohue des déicoles » appartenant à la catégorie dite « article de Munich » qui se débite dans les boutiques « d’art pieux » , et cette « mascarade la plus vile que l’on ait encore osé entreprendre des Écritures », que représente ce qu’on a appelé de nos jours le « nouveau » de l’art chrétien, avec ses Christ « montrant d’un air aimable un cœur mal cuit, saignant dans des ruisseaux de sauce jaune », et ses tableaux religieux, peints avec « de la fiente, de la sauce madère, du macadam » par des gens, « blêmes haridelles attelées à des sujets de commande pieux », qui peignent des Vierges comme ils peignent des Junons, décorant des chapelles comme ils décorent des cabarets. Il en est ainsi des arts plastiques comme de la musique (voir ce mot), dans leurs rapports avec la religion. A côté, la littérature pieuse est à l’avenant. Flaubert, qui la connaissait tout particulièrement, la trouvait « stupidifiante » par l’immensité de sa sottise, et il ajoutait :
« Mes pieuses lectures rendraient impie un saint. »
On comprend ce que peut être le symbolisme d’une telle « christolâtrie » ; il dégoûterait les plus arriérés Bassoutos. Aussi bien, comme l’a encore constaté Huysmans, la Renaissance a fait sombrer ensemble la symbolique et l’art religieux. Le naïf symbolisme des époques de foi n’est plus que la niaise symbolique des roublards exploiteurs de la foi, et d’une sottise aussi inesthétique qu’immorale. Les seules inspirations que la religion catholique a su apporter dans le symbolisme ont été celles des disputes théologiques sur la nature de Dieu et celle du Diable, et de la démonologie sortie, vers l’an mil, des monastères pour répandre la sorcellerie parmi les foules.
Un autre domaine où la symbolique est non moins pernicieuse que dans la religion, parce qu’elle y sert les mêmes buts et les mêmes intérêts, est celui des distinctions sociales, des castes et des classes où les individus sont parqués. Les préjugés nobiliaires y tiennent la plus grande place, tant il importait, jadis, pour chacun, de faire figure au-dessus des manants « sortis du pet d’un âne », et qu’il importe encore, aujourd’hui, de dominer les « espèces inférieures » méprisées des « gangsters » occupant les hautes sphères démocratiques. Rabelais a ri puissamment des faiseurs et des porteurs de blasons de son temps, « glorieux de cours et transporteurs de noms », avec leurs devises (symboles) qui n’étaient que des « paroles gelées ». Il leur opposait les vigoureux « mots de gueule » des « bons et joyeux pantagruélistes ». Il n’aurait pas moins ri des harnachements symboliques de tous ordres par lesquels le monde actuel s’accroche encore aux simulacres d’une dignité et d’un honneur perdus depuis longtemps, en admettant qu’ils aient jamais existé, et de la vaseuse rhétorique dont il accompagne sa fourberie.
Mais si le symbolisme a fourni abondamment de fétiches, de drapeaux, de déguisements, de catéchismes, de codes, le carnaval et la farce des turpitudes conventionnelles, s’il a alimenté de sophistications rhétoriciennes les entreprises de mensonge et d’exploitation humaine, il a aussi donné ses armes de défense à l’Esprit par les moyens de l’apologue, de la parabole, de l’allégorie, sous lesquels se sont couvertes toutes les ingéniosités et les audaces de la satire ou du simple bon sens en éveil contre les maléfiques influences. L’apologue a fleuri dès les premiers balbutiements humains. Tous les prophètes ont parlé par paraboles, tous les philosophes par maximes. Les paraboles des Évangiles sont bien connues. Les Maximes d’un Pythagore sont éternellement vivantes et actuelles ; notre prétendue civilisation a encore à apprendre d’elles à « ne pas attirer le feu avec une épée », à « ne pas mettre la lampe sous le boisseau », et à « s’abstenir des fèves », c’est-à-dire des suffrages des majorités qui font régner la démagogie. De même, depuis 2.000 ans, les insanités accumulées par les théologiens sur la divinité ont été d’avance balayées par cette image de Timée de Locre, identifiant Dieu avec l’univers tout entier :
« Un cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part. »
Comme l’a remarqué Voltaire :
« En métaphysique, en morale (c’est-à-dire dans le domaine symbolique), les anciens ont tout dit. »
L’allégorie abonde dans la multiplicité des symboles dont l’antiquité grecque a pourvu l’humanité en répandant la sagesse de sa philosophie. La littérature du moyen âge a été en grande partie allégorique. Les symboles étaient alors nécessaires pour rendre claire l’expression d’un langage encore trop imparfait, mais l’allégorie l’était davantage pour faire entendre la pensée considérée comme subversive. Il l’a fallu à Érasme, à Rabelais, à Descartes, à tous ceux que l’Inquisition menaçait. Érasme trouvait ses symboles dans le monde des animaux et dans celui des fous pour attaquer les puissants, les rois qu’il comparait à « des aigles carnassiers, pillards, destructeurs, batailleurs, haïs de tous », et à des fous de carnaval qui, « dépouillés de leur couronne, apparaissent des faquins ». L’œuvre de Rabelais est d’une richesse allégorique inépuisable. Sa science comme sa conscience seront toujours bons à consulter tant que les hommes seront des moutons de Panurge.
Il serait intéressant d’examiner dans les arts et la littérature, plus que dans la religion, la place et le rôle du symbolisme. Si, dans la religion, son emploi a été régressif et funeste, il a été, en art et en littérature, progressif et bienfaisant. C’est par lui que le néo-platonisme est demeuré dans la littérature quand il a été rejeté par l’Église. Chez les poètes provençaux, puis chez les Italiens du moyen âge, ce néo-platonisme a été l’élément défensif de l’Esprit, le principe de la liberté de la pensée dressé contre les dogmatismes menaçants. C’est lui qui a inspiré le symbolisme de Dante sur lequel les scoliastes discutent toujours dans l’intention obstinée de concilier son esprit de vérité, de justice et de liberté, avec l’imposture papaline et l’Inquisition. Les symboles du néo-platonisme s’opposèrent de plus en plus à ceux du catholicisme médiéval grâce à la Renaissance. Celle-ci les fit passer dans Shakespeare et chez tous les esprits indépendants qui résistèrent au classicisme subordonné au pouvoir absolu. Ils sont dans le pré-romantisme. Ils se sont dressés contre le néo-catholicisme durant tout le XIXème siècle, et nous les retrouvons dans cette période appelée du Symbolisme qui a occupé les vingt dernières années de ce siècle et qui est née de la faillite romantique.
LE SYMBOLISME ET SON ÉCOLE. (Fin du XIXème siècle).
Nous n’en parlerons que d’une façon très sommaire, mais en les situant aussi exactement que possible.
De ce qui précède, on peut déduire que le mouvement symboliste, d’où est sortie l’école de ce nom, n’a nullement été le produit d’une fantaisie artistique et littéraire. Obéissant à de lointaines et constantes affinités, il a été une nécessité de l’esprit, une réaction contre l’enlisement romantique dans un conformisme de plus en plus asservi aux grossièretés des appétits bourgeois. Ce mouvement avait commencé avec le décadentisme, dans lequel on a affecté de ne voir que « la perversion de la sensibilité dans des raffinements morbides ». Certes, il y a eu beaucoup de cela dans le cas d’une foule de décadents, depuis Alfred de Musset qui :
« Chante la Syphilis sous les feuilles d’un saule ! » (L. Bouilhet.)
jusqu’aux plus actuels futuristes, dadaïstes et surréalistes dont les manifestations ont conduit le décadentisme à la déliquescence, sans autre effet que « d’épater » les primates du snobisme. Mais le décadentisme a été, dans son principe, tout autre chose, et en particulier chez Baudelaire qui en a été promu le « théoricien » par l’hypocrisie académique et bourgeoise.
Le décadentisme a été la protestation d’une aristocratie véritable et légitime de l’esprit contre l’avilissement où il était entraîné sous prétexte de démocratisation. Il a été l’expression de la plus généreuse conception individualiste dans des rapports vraiment supérieurs entre les hommes, et d’une volonté d’opposition idéaliste, intellectuelle et morale, à l’encanaillement général aboutissant au muflisme. Avant Baudelaire, il avait été dans l’indignation de Michelet contre les « laideurs », la « brutalité grossière », l’ « emportement voulu de matérialité stérile » introduits dans l’art et la littérature, en même temps que dans les mœurs après 1830, lorsqu’eut été signée l’entente fraternelle de la religion catholique et de la religion de la banque. (Voir Romantisme.) Il avait été aussi dans les ripostes de Th. Gautier à l’hypocrisie des cafards moralistes, dans celles de Stendhal dénonçant le « bégueulisme » de ces mêmes cafards. Le décadentisme a été le labarum de tous les « poètes maudits » par la tartuferie bourgeoise contre les « poètes vendus » à cette tartuferie. Il a été dans Bouilhet, flétrissant chez A. de Musset :
« ..... l’homme grec dont les strophes serviles ont encensé Xerxès le soir des Thermopyles. »
Il a été dans Gérard de Nerval, dans Barbey d’Aurevilly, dans Villiers de l’Isle-Adam, dans tous ceux qui furent de véritables artistes, malgré des conceptions d’art différentes. Il a été dans Flaubert, définissant le bourgeois « celui qui pense bassement », faisant retentir les échos de sa véhémence contre le muflisme, troisième évolution de l’humanité après le paganisme et le christianisme, et contre la bassesse des boutiquiers des lettres qui faisaient de leur plume « un alambic à ordures pour gagner de l’argent ».
Le décadentisme a été dans le dégoût profond soulevé chez tous les esprits généreux par la carence révolutionnaire qui laissait établir par la bourgeoisie un état social aussi arbitraire et corrompu que celui de l’ancien régime. En 1848, il a participé aux barricades. Durant les trente années de digestion bourgeoise qui ont suivi l’écrasement de la Révolution dans toute l’Europe, il a été dans la propagation des idées et des œuvres des Stirner, Darwin, Buchner, Hoeckel , Herbert Spencer, Marx, Bakounine, Proudhon, Nietzsche, Wagner, Dostoïevski, Ibsen, Tolstoï, E. Reclus, Kropotkine, qui entretinrent l’esprit révolutionnaire dans la pensée universelle, et en renouvelèrent et transformèrent les conceptions. Il en est sorti cet état d’anarchisme individualiste, philosophique et artistique qui commença, après 1880, la période dite du Symbolisme, période féconde en manifestations audacieuses et originales, mais trop intellectuelle, trop spéciale, qui ne pénétra pas suffisamment la masse sociale et fut emportée dans la débâcle des consciences lors de l’affaire Dreyfus. C’est alors que sévit le décadentisme pervers avec toutes les loufoqueries dont s’engoua un snobisme imbécile à l’instigation du muflisme déchaîné.
Dans le décadentisme, le « réprouvé » Baudelaire a apporté, non des « théories », mais, ce qui valait mieux, l’œuvre poétique la plus neuve, la plus riche de symboles, la plus émouvante par son humanité et la plus parfaitement belle par son art. Il a été l’esprit le plus ouvert, le plus compréhensif, le plus clairvoyant lorsque, presque seul, il a osé affronter « la Bêtise au front de taureau », déclarer la guerre à la sottise bourgeoise, à sa haine de l’intelligence, à sa xénophobie mesquine et sauvage. Sa critique d’art et de littérature a été la plus libre et la plus lucide contre tous les poncifs des écoles et les admirations serviles. Presque seul, il a défendu Wagner qu’on sifflait à Paris, en 1860, comme on avait sifflé Shakespeare et Shéridan en 1822, uniquement au nom de « l’honneur national » !.... Il a soutenu Delacroix encore contesté par un public qui était, « relativement au génie, une horloge qui retarde ». Il a compris Daumier, alors que si peu le comprenaient, et il a vu en lui :
« Un des hommes les plus importants, non seulement de la caricature, mais de l’art moderne. »
Il a traduit Edgar Poe, autre « réprouvé » comme lui, déterminant un courant de curiosité de la pensée étrangère novatrice et indépendante des asservissements académiques. Baudelaire a été de toutes les écoles et il les a dépassées toutes. Il a été non seulement une voix nouvelle, mais aussi un monde nouveau par son étendue et sa complexité. Aussi, n’est-il pas un poète français, fût-ce Ronsard ou Hugo, dont l’œuvre ait, aujourd’hui, le rayonnement de la sienne dans le monde entier. Cela seul peut dispenser de répondre aux derniers cuistres qui crachent bourgeoisement sur lui et lui reprochent, à la suite de M. Lanson, son insensibilité et sa « volonté d’être malsain » !... Il est, comme a dit Paul Valéry, « au comble de la gloire ». Baudelaire, ironique et désespéré, implacable, est descendu dans la bassesse des âmes comme son Don Juan « vers l’onde souterraine ». Il a prospecté la charogne humaine qui ne lui pardonne pas de lui avoir arraché les oripeaux de ses sordides convenances et jeté sur ses vertueuses grimaces la plus profonde malédiction de la douleur humaine. Ce « maudit » a réhabilité Caïn, ce que ne fit jamais la bénignité infinie d’aucun « élu », en montrant dans l’ « abélisme » l’ange descendu au-dessous de la bête.
Il a crié dans sa révolte :
« Race de Caïn, au ciel monte Et sur la terre jette Dieu ! »
Baudelaire a été à la fois classique et romantique, il a été l’inspirateur du Symbolisme qu’il a détourné de « l’art pour l’art », et il a été encore plus que cela. Nul mieux que lui n’a réalisé cette « haute poésie » que composent, d’après Maeterlinck, ces trois éléments principaux :
« D’abord la beauté verbale, ensuite la contemplation et la peinture passionnées de ce qui existe réellement autour de nous et en nous-mêmes, c’est-à-dire la nature et nos sentiments, et enfin, enveloppant l’œuvre entière et créant son atmosphère propre, l’idée que le poète se fait de l’inconnu dans lequel flottent les êtres et les choses qu’il évoque, du mystère qui les domine et les juge et qui préside à leurs destinées. »
En donnant au décadentisme sa plus exacte expression esthétique et éthique, Baudelaire a engendré le Symbolisme. Celui-ci a groupé, dans ce qu’on peut appeler son unité de pensée et d’action, les hommes les plus divers de caractère, de tempérament, de conceptions philosophiques et sociales et de talent, cela parce qu’il n’a pas été une formule conventionnelle propre à certains, mais qu’il les a tous incités à rechercher profondément, en eux et autour d’eux, l’âme de toute chose. Aussi, rencontre-t-on dans les pages de l’anthologie symboliste, athées et croyants, hérétiques et orthodoxes, aristocrates et démocrates, autoritaires et libertaires, individualistes et communistes, ascètes et épicuriens, mais tous cherchant l’homme dans sa conscience et son destin, la vie dans son mystère ou dans ses certitudes, l’âme dans ses contemplations ou ses prurits d’activité. Maeterlinck a exactement montré, dans un parallèle entre la Puissance des Ténèbres de Tolstoï, et les Revenants d’Ibsen, la complexité symboliste devant « l’angoisse de l’inintelligible », et l’intervention des « puissances supérieures » pesant sur l’impuissance humaine : action d’un Dieu, comme dans la pièce de Tolstoï, ou loi de l’hérédité, comme dans celle d’Ibsen. Du caractère aristocratique de la réaction décadentiste, le Symbolisme hérita un détachement complet de la foule, voire de la nature, pour ne voir que l’individu évoluant dans des « paysages d’âmes ». Huysmans faisait dire à son Des Esseintes :
« À n’en pas douter, cette sempiternelle radoteuse (la nature) a maintenant usé la débonnaire admiration des vrais artistes, et le moment est venu où il s’agit de la remplacer, autant que faire se pourra, par l’artifice. »
Le Symbolisme n’épousa pas cette formule exagérée et stérile, mais il fit rentrer l’individu en lui-même pour rechercher et exprimer ses attractions mystérieuses, et cela, sans vouloir :
« La gloire ni la moindre consécration, mais simplement la joie divine d’avoir accompli strictement ce qu’il voulait accomplir. » (Stuart Merrill)
Flaubert et Baudelaire lui avaient transmis cette indifférence totale du public qui leur avait fait composer leur œuvre comme elle devait être, sans aucun souci de plaire à qui que ce fût, d’épouser la querelle de quelque parti ou de quelque école que ce fût. Flaubert s’était pour cela renfermé dans l’impersonnalité la plus complète, disant :
« L’auteur, dans son œuvre, doit être comme Dieu dans l’univers, présent partout et visible nulle part. »
Nous ne pouvons, ici, que parler très brièvement de l’école symboliste et de ceux, venus de tous les côtés de la pensée, qui l’ont représentée avec une variété extrême. Après Baudelaire et ces deux grands visionnaires, Gérard de Nerval et Villiers de l’Isle-Adam, ses inspirateurs principaux furent Mallarmé, Rimbaud et Lautréamont. Tous trois, sans se connaître, lui apportèrent des tendances lointaines et dispersées qui allaient des solitaires lakistes anglais aux légendes d’où Wagner faisait jaillir tant de symboles humains, et au farouche idéalisme de l’individualisme ibsénien. Une autre influence fut celle de Verlaine, poussé par son impulsivité et sa nature à la fois subtile et naïve hors du cadre parnassien, et de la froideur impassible de « l’art pour l’art ». Concentration intérieure et expression ésotérique chez Mallarmé. Virtuosité et éclat évocateur des images chez Rimbaud. Héritage du mysticisme swedenborgien et hostilité à toute règle hors celle de l’intuition individuelle, chez Lautréamont qui a fait le pont entre le symbolisme libertaire de William Blake et le symbolisme mystiquement religieux, artistique et social de 1885. Langage libre de l’âme et de l’instinct chez Verlaine.
Sous ces influences plus ou moins directes et non nettement définies, se formèrent, après 1880, des groupements littéraires et se fondèrent une infinité de petites revues. A côté de Villiers de l’Isle-Adam, de Mallarmé et de Verlaine, s’y révélèrent et s’affirmèrent tous ceux qui apporteraient une illustration quelconque au Symbolisme. Dès 1881, le mouvement avait commencé avec le groupe de la Jeune Belgique, dont faisaient partie Max Waller, A. Giraud, Ivan Gilkin, C. Lemonnier, G. Eckhoud. Les écrivains belges devaient tenir une belle place dans le Symbolisme avec G. Rodenbach, Maeterlinck, A. Mockel, A. Fontainas, Van Lerberghe et d’autres. Leurs revues seraient : la Jeune Belgique, la Wallonie d’A. Mockel, la Revue wallone de Wilmotte, le Coq rouge de Demolder, l’Art moderne, d’E. Picard, le Réveil, etc ….
En France, ce mouvement se forma des individualités les plus diverses, mais toutes évoluant dans le décadentisme qui répondait au besoin d’échapper au milieu ambiant où l’art était souillé « par le vomissement de la « Bêtise » (Fontainas), de sortir de ce que Flaubert avait appelé « les fanges bourgeoises et démocratiques ». Il serait beaucoup plus que du « dandysme intellectuel » puisqu’il rassemblerait « les mainteneurs de la civilisation » (J.-R. Bloch). Un cénacle de l’impasse du Doyenné fit la Nouvelle Rive Gauche, revue que dirigea Léo Trezenick, où débuta Moréas en 1882, et qui devint, en 1885, Lutèce, où Tailhade, H. de Régnier, Vielé-Griffin, publièrent leurs premiers vers. Les dîners de Lutèce inaugurèrent sous le nom de « Dîner des Têtes de pipe », ces soirées littéraires bruyantes et pittoresques qui furent aussi celles de la « Rose-Croix », des « Hydropathes », des « Hirsutes », du « Chat Noir », de « La Plume », et d’autres où se réunissait cette bohème mélangée et curieuse, sinon toujours sympathique, dépeinte par C. Mendès dans la Maison de la Vieille, et par Ch. Merki et J. Court dans l’Éléphant. En 1885, Ed. Dujardin fonda la Revue wagnérienne, qui fut l’organe du symbolisme musical, puis, avec Fénéon, la Revue indépendante qui eut pour principaux rédacteurs : Villiers de l’Isle-Adam, Mallarmé et Huysmans, ce dernier détaché du Naturalisme après la publication d’A. Rebours. « L’école décadente » prit le titre de « symboliste » à la suite d’un manifeste de Moréas, paru au Figaro, le 18 septembre 1886. Elle réunit E. Mikhaël , Fontainas, Darzens, Vanor, Lefèvre, Guillaumet, Bonnin, etc ... Son but précis fut de réagir, comme l’avait proposé Moréas, contre les Parnassiens et l’école de Zola. Des revues nombreuses parurent successivement : les deux Vogue, celle d’Orfer puis celle de G. Kahn, le Symboliste de Kahn et Moréas, les Taches d’encre de M. Barrès, le Chat Noir de Salis, la Pléiade de Mikhaël, Saint-Pol Roux et P. Quillard, l’Ermitage de Mazel et de Ducoté, le Décadent de l’instituteur Baju qui l’imprimait lui-même et avait comme collaborateurs : Tailhade, M. du Plessys, J. Renard, E. Reynaud, les Entretiens politiques et littéraires de Vielé-Griffin, P. Adam et Bernard Lazare, la Revue septentrionale de Roinard, l’Humanité nouvelle et Psyché de V. E. Michelet. Toutes ces revues, que nous citons sans ordre chronologique, et bien d’autres, eurent une existence plus ou moins éphémère. Les plus importantes furent La Plume, fondée par L. Deschamps (1889–1904), la Revue Blanche de Natanson (1889–1903), et le Mercure de France, ressuscité par A. Vallette, en 1890, et qui paraît toujours.
Verlaine donna, en 1884, au Symbolisme un Art poétique qui serait surtout l’art des synesthésies (voir ce mot). Mais le genre trouva son sens et sa forme définitifs dans Mallarmé qui réalisa cette gageure de faire un art de l’obscurité en la rendant lumineuse et vivante. Beaucoup ont voulu imiter sa recherche de l’image à la fois précise et splendide et sa forme elliptique, s’approprier sa faculté de transmutation de toutes choses en symboles magnifiques, dans la préoccupation farouche de ne jamais laisser ternir l’intimité et la pureté de son rêve par une intervention extérieure ; ils ne sont arrivés qu’à ne pas se faire comprendre en ne se comprenant plus eux-mêmes. Ils ont alors tenu cela pour la fin suprême de l’art ! Seul un Mallarmé aussi profondément artiste, aussi complètement désintéressé, hostile à tout bruit et indifférent à toute gloire, pouvait, comme un César Franck en musique, réaliser une telle œuvre. Son meilleur continuateur a été Paul Valéry qui, à vingt ans de distance, a apporté dans la poésie, depuis 1917, un symbolisme mûri de toutes les expériences et de toutes les observations de la pensée contemporaine.
La préoccupation du rythme plus que du nombre conduisit les poètes symbolistes à l’emploi du vers libre. G. Kahn paraît en avoir été le novateur dans La Vogue, en 1886. Il en a été le théoricien. Il fut suivi par J. Laforgue, Moréas, Mockel, Vielé-Griffin, R. de Souza, etc ...
La virtuosité plus ou moins excentrique, qui vient d’un besoin de pensée et d’expression neuves particulières à des formes spéciales de l’esprit, et qui demande des dons au-dessus de la moyenne pour ne pas tomber dans les procédés du banquisme, avait commencé dans le Symbolisme avec Rimbaud. Presque tous les symbolistes en usèrent, mais avec des réussites inégales. Parmi les plus originaux furent Rollinat qui semble hanté de Poe et de Lautréamont, Laforgue, froid railleur d’une vie trop « quotidienne », Tailhade, contempteur du « mufle » et cravacheur des « groins ». D’autres furent des humoristes plus ou moins macabres auprès de qui, comme dit Verlaine, « le seul rire encore logique est celui des têtes de morts ». La fantaisie symboliste prit avec le « surmâle » A. Jarry et son Ubu-Roi le ton de la satire la plus funambulesque. Virtuosité et fantaisie tombèrent dans la mystification et le maboulisme avec les futuristes et les dadaïstes, les Marinetti, Apollinaire, Max Jacob, Cendrars, Tzara. Ce dernier voulut « tuer l’art » après qu’on eut tué les hommes. Le surréalisme, qui participe d’un « freudisme » avalé de travers, est le dernier aspect de ces loufoqueries devenues académiques au pays du fascisme.
Le symbolisme produisit, avec René Ghil, la « poésie scientifique » basée sur des synesthésies de couleurs et de musique. Il fut grandiloquent avec deux provençaux, le marseillais Paul Roux, qui prit le nom de Saint-Pol-Roux-le-Magnifique, et répandit des métaphores plus pétaradantes que précises, et le lançonnais Emmanuel Signoret qu’une exubérante admiration de son propre génie consola de son impécuniosité. Enfin, le comte de Montesquiou-Fezensac fut le prototype du Des Esseintes d’A Rebours de Huysmans. Ce gentilhomme, quelque peu « piqué », promena, dans les salons aristocratiques, le « décadentisme pervers », ce qui, malgré le ridicule, fut plus honorable pour lui que s’il avait traîné sa noblesse, comme tant de ses congénères à particules, dans les conseils d’administration des sociétés Oustric et Stavisky.
L’occultisme, les sciences magiques devaient inévitablement avoir leur place dans le Symbolisme. Ils eurent leur représentant le plus tapageur dans Péladan, le Sâr de la Rose-Croix. D’autres furent plus réservés, tels Stanislas de Guaita, dont l’influence fut plus profonde, A. Jounet, E. Schuré, J. Bois et V. E. Michelet. Dans Là-Bas, Huysmans a écrit le roman de l’occultisme de ce temps. Un mystique plus humble fut Germain Nouveau qui se fit mendiant pour imiter saint Labre. Péladan, artiste véritablement supérieur malgré ses excentricités, et l’un des prosateurs les plus remarquables de la période symboliste, avait conçu une mystique de l’art qui, dépouillée de ses hallucinations, aurait ravi Flaubert. Il disait, dans son Appel du Grœaal :
« Artiste ... sais-tu que l’art descend du ciel, comme la vie nous coule du soleil ? Qu’il n’est pas de chef-d’œuvre qui ne soit le reflet d’une idée éternelle ? ... Apprends que si tu crées une forme parfaite, une âme viendra l’habiter ... Apprends encore ceci : au croulement du monde, Dieu sauvera l’âme des œuvres, comme l’âme des justes. Le ciel aura son Louvre et le cœur des chefs-d’œœuvre adorera pendant l’éternité son Créateur, l’artiste comme nous-mêmes, Dieu ... Prends garde ... si tu aimes le laid, tu n’as droit qu’à l’enfer. »
A côté de cette mystique de l’art, il appartenait au Symbolisme de produire celle de l’anarchisme. Elle découla tout naturellement de l’idéalisme individualiste, elle inspira de nobles esprits et des actes héroïques. L’esprit et la cause libertaires eurent de véritables militants parmi les symbolistes et, à côté d’eux, des artistes et des poètes que leurs conceptions sociales influencèrent. Laurent Tailhade fut le plus ardent et le plus constant dans la bataille libertaire. Son œuvre, même poétique, fut toute de polémique, tant sociale qu’artistique, et elle lui valut la prison avec toutes les malédictions bien pensantes et bourgeoises. Adolphe Retté fut aussi un libertaire fougueux mais inconstant. Poète, il débuta dans le symbolisme le plus hermétique, puis il passa au naturisme le plus agressif contre Mallarmé et ses disciples. Polémiste, il fut l’anticlérical le plus farouche, jusqu’au jour où ayant rencontré la « grâce » il se fit moine et passa, suivant son expression, « du Diable à Dieu ». Paul-Napoléon Roinard collabora assez longtemps aux journaux anarchistes. Il avait de la société future une conception pleine de jovialité, disant :
« Je voudrais que, sans peur, sans fatigue et sans trêve, On s’aimât d’un amour toujours renouvelé, Si j’avais créé le Rêve. »
D’autres, sympathisants, donnèrent à l’anarchisme des collaborations moins soutenues et plus timides. Les « lois scélérates » de 1893–94 leur firent abandonner une cause qui n’apportait pas assez vite les résultats espérés et devenait trop dangereuse pour leur tranquillité. Ils restèrent estimables lorsque, après avoir fait l’apologie de Ravachol, ils n’embouchèrent pas le clairon de Déroulède, ne devinrent pas patriotes avec la peau des autres, et ne firent pas des magistrats déclarant que « le passage à tabac est une nécessité sociale » !....
Parmi les écrivains favorables à l’anarchisme, Rémy de Gourmont, révoqué de son emploi de fonctionnaire pour antipatriotisme manifesté lors d’une enquête du Mercure de France sur l’idée de patrie, occupa dans le Symbolisme une place particulière et supérieure comme critique. Ses Livres des Masques et ses Promenades littéraires réunissent les études les plus remarquables qui ont été écrites sur le mouvement symboliste et ses protagonistes.
Dans l’époque symboliste, Verhaeren a été à part, prolongeant à la fois le romantisme et le naturalisme. Il fut, avec Zola, l’un des maîtres choisis par le falot Saint Georges de Bouhélier et son éphémère « école naturiste ». Verhaeren a apporté dans l’art symboliste, fait surtout de mystère, de nuances, d’imprécisions, la vigueur réaliste de sa vision des choses et sa puissance lyrique. A côté des êtres irréels, glissant comme des ombres silencieuses dans la forêt enchantée du rêve, il a été le Nibelung farouche forgeant la nouvelle humanité dans le tumulte des villes modernes.
En marge de l’école symboliste, on vit « l’école romane », fondée en 1891 par Moréas, lorsqu’il désavoua le Symbolisme. M. du Plessys, R. de la Tailhède, E. Raynaud et Ch. Maurras en firent partie. Moréas ne fut pas seulement en marge du Symbolisme par son art, il le fut par sa personnalité. Bien loin de posséder ce superbe détachement du public et du succès qui fut celui des symbolistes, il fut au contraire constamment à la recherche de la gloire, et cela explique peut-être ses variations. Il a dit son amertume dans des vers des Stances :
« Les morts m’écoutent seuls, j’habite les tombeaux. Jusqu’au bout je serai l’ennemi de moi-même. Ma gloire est aux ingrats, mon grain est aux corbeaux ; Sans récolter jamais je laboure et je sème. »
Par sa recherche des synesthésies, le Symbolisme a fait de l’art non plus une chose verbale et plastique, trop souvent isolée de la vie ou figée dans des formes conventionnelles, mais il a révélé les rapports étroits et complémentaires de tous les arts et de toutes les sensations, il a composé une harmonieuse synthèse de tout ce qui est intuition plus que raison, il a donné sa place au rêve qui murmure silencieusement au fond des êtres ses « romances sans paroles » (Verlaine). C’est ainsi qu’en particulier le Symbolisme a trouvé son âme dans la musique, dans le rythme de la poésie et celui des sons, et qu’il en a répandu et développé le goût. Les romantiques avaient à peu près ignoré la musique, en dehors des gargouillades mélodramatiques des Donizetti, Meyerbeer, Gounod, et de leurs disciples. Les symbolistes ont fait connaître la communion qu’elle établit entre le moi profond et l’univers, entre l’individu et le social. Ils ont, par exemple, initié le public au symbolisme si puissamment révolutionnaire de la Tétralogie conçue par Wagner dans le bouillonnement de 1848. A côté de Wotan, l’homme du présent conservateur de la société actuelle dont l’image est dans le Walhall, c’est Siegfried, « le rédempteur socialiste venu sur terre pour abolir le règne du capital », a écrit Wagner lui-même. Il est « l’homme attendu, voulu par nous, l’homme de l’avenir, qui ne peut être fait par nous, qui doit se faire lui-même par notre anéantissement ». Siegfried est :
« L’incarnation héroïque de l’homme libre et sain, de l’homme primitif, sorti directement de la Nature. » (R. Rolland)
Siegfried et Brunehild sont « l’ humanité future, les temps nouveaux qui s’accompliront quand la terre sera délivrée du joug de l’or », et le Crépuscule des Dieux, c’est :
« Le Walhall qui s’écroule avec la société présente pour faire place à l’humanité régénérée. » (R. R.)
Dans la pensée de Wagner l’ensemble de la Tétralogie devait être un spectacle d’ « après la grande Révolution » ! En faisant comprendre Wagner les symbolistes ont fait comprendre aussi Beethoven, Schuman et Schubert. Par leurs musiciens et leurs œuvres, de Debussy à Stravinski, de l’hiératique Pelléas à la tourbillonnante Pétrouchka, ils ont préparé la compréhension de la pure musique, jaillissement direct de l’âme, de Mozart et de Berlioz.
L’œuvre qu’on peut appeler de vulgarisation supérieure accomplie par le Symbolisme pour la musique fut aussi la sienne pour les autres arts. Le courant symboliste avait fait le succès des grands concerts ; il fit aussi celui des récitations poétiques organisées un peu partout à l’exemple de celles de l’Odéon dont G. Kahn fut le promoteur, et il soutint d’autre part, s’il ne les fit naître, les expositions d’art hors-cadres officiels comme celle des Indépendants, dont on vient de célébrer le cinquantenaire. Il aida à la création de « théâtres d’art », à l’organisation de spectacles de pensée. (Voir Théâtre). Enfin, ses principes philosophiques et sociaux eurent une application militante à l’occasion de l’affaire Dreyfus, dans le mouvement des Universités populaires, dans la compréhension mutuelle de ces « intellectuels » et de ces « manuels » accordés, un moment, pour défendre une vérité et une justice supérieures.
En résumé, nous devons être reconnaissants au Symbolisme et à son école du développement général de la pensée qu’ils ont déterminé beaucoup plus que le Naturalisme, et de leur influence sociale et artistique. S’ils ont trop souvent favorisé les outrances d’un snobisme ridicule et méprisable, ils ont éveillé dans les esprits sérieux et délicats, quelles que fussent leurs origines bourgeoises ou prolétariennes, une préoccupation de recherche intellectuelle, un souci de dignité personnelle, un sentiment de la véritable liberté de l’individu par la conduite de soi-même, et un profond dégoût des formes collectives d’abrutissement. Ils ont semé l’esprit de révolte, ils ont aidé les « hommes de bonne volonté » à sortir des basses-fosses de la sottise générale. S’ils ont constaté avec Ibsen que « l’homme le plus fort est celui qui est le plus seul », et avec Flaubert que « le nombre domine l’esprit » et que « la masse est toujours idiote », ils ont reconnu aussi, avec le même Flaubert, que cette masse « si inepte soit-elle, contient des germes d’une fécondité incalculable », et ils ont cherché à faire produire ces germes. Pour ceux qui les portaient, ils ont dit avec Beethoven :
« O homme ! aide-toi toi-même ! »
Et avec Tolstoï :
« Le salut est en vous ! »
Ils n’ont pas fait la Révolution, mais ils ont montré la voie de la seule Révolution qui ne sera pas illusoire, lorsque « l’esprit » ne sera plus dominé par le « nombre », lorsque la masse n’acceptera plus d’être soumise à des dictatures.
C’est dans cette période d’affirmation individualiste révolutionnaire, celle du Symbolisme, que l’anarchisme a été le plus fécond en manifestations diverses. Si cet anarchisme est enlisé aujourd’hui, d’une part dans le marécage du syndicalisme ouvriériste et politicien qui l’a happé, sous prétexte d’action révolutionnaire, pour le vider de ses consciences et de ses énergies, d’autre part dans un individualisme étroit et sordide dont le non conformisme ne vaut pas mieux que le conformisme bourgeois : il a gardé encore quelques belles attitudes du temps où Tailhade proférait :
Chasse la nuit ! Écrase la vermine !
Et dresse au ciel, fût-ce avec nos tombeaux,
La claire Tour qui sur les flots domine. »
Les flambeaux ne sont pas tous éteints. Sur les tombeaux des Sacco, des Vanzetti et de mille autres martyrs, sur ceux de nos frères d’Italie, d’Espagne, d’Allemagne et du monde entier, tués dans les insurrections de la Liberté, sur les prisons de tous les pays où, plus que jamais, les objecteurs de conscience multiplient ce « grain de blé » du refus d’obéissance au crime de la guerre que des Goutaudier semèrent il y a trente-cinq ans : toujours, la claire Tour domine, celle qui dresse la volonté des hommes vers la Justice, vers la Liberté, vers la Fraternité universelle.
— Édouard ROTHEN.
SYMBOLISME (fétichisme ou fantaisisme) SEXUEL
La fin du siècle dernier et le début du XXème siècle ont vu se transformer la mentalité des savants et celle du public éclairé en ce qui concerne ce qu’on appelle « les anomalies sexuelles ». Jadis accusés d’être des possédés, des suppôts de l’enfer, les « anormaux sexuels » ont vu des psychiatres, des sexologues, des spécialistes éminents s’intéresser à leur cas et examiner sans parti pris les causes profondes de leurs anomalies, anormalités ou fantaisies. Mettant à part l’inversion sexuelle (ou homosexualité) et l’onanisme (ou autoérotisme) — voir ces mots à leur ordre respectif -, on désigne sous le nom général de symbolisme ou fétichisme sexuel ou érotique tout objet ou acte destiné à procurer à l’individu l’émotion, l’excitation ou la jouissance sexuelle par des représentations évocatrices et provocatrices de l’instinct érotique.
Les psychiatres divisent le symbolisme ou fétichisme sexuel ou érotique en : normal ou acceptable et anormal ou morbide, selon que l’émotion sexuelle érotique est produite par une personne — et dans ce cas les objets lui appartenant ne sont qu’un accessoire — ou qu’elle est amenée par un objet, la personne ne devenant qu’un accessoire. Cette différenciation ne porte que sur des objets et non sur des actes ; mais lesdits psychiatres sont bien obligés de l’établir, sinon il leur faudrait attribuer, comme le remarque A. Moll, dans son ouvrage sur l’inversion sexuelle, une perversion sexuelle accidentelle ou chronique à presque tous les hommes.
Dans ses études de Psychologie expérimentale, A. Binet explique que l’amour normal apparaît comme le résultat d’un fétichisme compliqué — « polythéiste » :
« Non pas d’une excitation unique, mais d’une myriade d’excitations, c’est une symphonie. Où commence la pathologie ? — c’est au moment où l’amour d’un détail quelconque devient prépondérant au point d’effacer tous les autres. »
Tout cela ne paraît pas absolument clair. Nous trouvons autour de nous une foule de gens réputés normaux qui préfèrent que leurs partenaires soient blonds plutôt que bruns, maigres plutôt que gras et vice-versa, et à qui il serait impossible d’expliquer pourquoi, et c’est ce trait dominant qui décide de leur choix amoureux ou érotique.
À la vérité, l’on est tous plus ou moins fétichistes. Comme l’a écrit le Dr Emile Laurent (Fétichistes et Erotomanes, 1905) dans la femme aimée :
« Certains détails ont particulièrement le don de nous plaire : une fine oreille rosée, un pied menu, une taille souple et légère, de longs cheveux noirs, des seins fermes et rebondis, une croupe opulente, des yeux de pervenche, une peau satinée, des dents blanches sous des lèvres purpurines. »
Le littérateur belge G. Rodenbach écrivait :
« On aime toujours pour un détail, pour une nuance ; c’est un point de repère qu’on se crée dans le désarroi, dans l’infini de l’amour. Les plus grandes passions tiennent à de si petites causes ! Pourquoi aime-t-on ? A cause d’une couleur de cheveux, d’une intonation de la voix, d’un grain de beauté qui trouble et en suggère d’autres, d’une expression des yeux, d’un dessin des mains, d’une certaine palpitation du nez qui frémit comme s’il était toujours devant la mer. »
Faut-il conclure de cela que le délicat écrivain que fut Rodenbach était un fétichiste « morbide » ? Nous verrons par la suite que sont légion ceux chez lesquels l’émotion sexuelle est provoquée par un détail.
Havelock Ellis déclare, de son côté, que la tendance à collectionner les reliques d’une personne aimée et surtout des vêtements est la base la plus commune et la plus simple du symbolisme érotique.
« Elle est parfaitement normale. Il est inévitable que des objets qui ont été en contact direct avec le corps de la personne aimée et qui sont intimement associés à cette personne dans l’esprit de l’amant participent plus ou moins de la même vertu et de la même puissance émotionnelles. »
Partant de ce fait qu’il n’était pas rare au Moyen Age que les amants fissent échange de leur chemise et de leurs vêtements, on citera, pour étayer l’observation qui précède, des cas devenus classiques, tel celui du châtelain de Coucy, retenu en Orient, qui envoyait sa chemise de toile à la dame de Fayal qui la mit dans son lit la nuit et la pressa contre sa chair afin de soulager ses ardeurs :
la met delez moi couchier
toute la nuit à ma char nue
por mesmalz asso lagier.
Un auteur anglais du XVIIème siècle, l’un de ceux qui ont recueilli le plus de documents populaires sur l’amour, R. Burton, dans son Anatomie de la Mélancolie, ne mettait pas en doute le caractère entièrement normal du symboliste érotique :
« Il n’y en a pas un sur mille qui devient amoureux : mais il y a toujours une partie spéciale ou une autre qui plaît davantage et l’enflamme sur le reste ... S’il obtient quelque chose qui lui ait appartenu, un busc, une plume de son éventail, un cordon de soulier, un ruban, un anneau, une bague, un bracelet de cheveux, il le porte sur soi comme une faveur sur son bras, sur son chapeau, sur son doigt ou près de son cœur ; comme fit Laodamie lorsque Protésilès partit à la guerre (de Troie) et qu’elle demeura assise, son portrait devant elle ; de même une jarretière ou un bracelet de celle qu’on aime est plus précieux qu’une relique de saint ; il la met sur son casque, et chaque jour la baise et s’il est en sa présence, il n’en détourne pas les yeux, et veut boire où elle a bu, et si possible exactement au même endroit. »
Un contemporain de Robert Burton, James Howell raconte dans ses Familiar Letters qu’en dépouillant les gentilshommes français tués dans les combats livrés pour chasser les Anglais de l’Ile de Ré, ceux-ci trouvèrent qu’un grand nombre de cadavres avaient les parties génitales ornées de faveurs offertes par leurs maîtresses.
Dans les Mémoires du comte de Grammont, Hamilton, écrivain de l’époque de Louis XIV, raconte que Mrs Price, l’une des beautés de la cour de Charles II, et Dorgan étaient tendrement attachés l’un à l’autre ; quand il mourut, on découvrit une cassette pleine de toutes sortes de faveurs de sa maîtresse, y compris, entre autres choses, différentes sortes de cheveux et de poils.
Un article de Mme Jane Landré, dans 1’Œuvre du 8 août 1933, indique que, durant la guerre de 1914–1918, les mêmes phénomènes de fétichisme se manifestèrent :
« Combien de combattants entre 1914 et1918, eurent un fétiche, un ruban, un bout de valenciennes, arrachés aux « dessous » de l’amie chérie ? Même il en fut qui gardèrent, contre leur cœur un bas de soie, une chemise de fin linon volée à leur divine maîtresse. »
« Le dévouement et l’amour — écrivait à la fin du XVIIIème siècle, Mary Wollstonescraft, la compagne de celui qu’on a surnommé le père de l’anarchisme,William Godwin — peuvent s’attacher autant aux vêtements qu’à la personne, et il manque vraiment d’imagination l’amant qui n’éprouve pas une sorte de respect pour le gant ou la pantoufle de sa maîtresse ; il ne les confondra jamais avec les autres objets de la même catégorie. »
De tout cela, il résulte que la frontière entre les manifestations normales et morbides du symbolisme ou fétichisme sexuel ou érotique n’est pas marquée de façon certaine.
« D’ailleurs, c’est dans la Nature entière que l’on rencontre des symboles sexuels d’autant moins viables qu’ils n’exigent aucune imagination morbide. Le langage est plein de métaphores sexuelles qui tendent peu à peu à perdre leur symbolisme pratique pour tomber au rang de lieux communs. Le semen est la semence et, pour les latins surtout, le processus sexuel ainsi que les organes males et femelles s’exprimaient en images empruntées il la vie agricole et horticole. Les testicules étaient des fèves (fabae), des pommes (poma, mela) ; le pénis un arbre (arbor), une baguette (thyrsus), une racine (radix), une faux (falx), un soc (vomer) ; la semence était aussi de la rosée (ros) ; les grandes et les petites lèvres étaient des ailes (alae) ; la vulve et le vagin un champ (ager, campus) ou un sillon (suleus), ou un vignoble (vinea), une fontaine (fons), tandis que les poils du pubis étaient des herbes (plantaria) ».
Tout le monde sait que dans le fruit du myrte, consacré à Vénus, les Grecs voyaient une image du clitoris et dans la rose, celle des petites et grandes lèvres. La poésie érotique de nombreux peuples fait, d’ailleurs, usage de la rose dans le même sens.
Le Talmud dit des petites lèvres qu’elles sont la porte dont les grosses lèvres sont les montants et le clitoris la clé. Les livres hindous énumèrent complaisamment toutes les qualités physiques de la « padmini », ou femme-lotus, autrement dit, la femme parfaite. Sa démarche est celle du cygne ; son odeur celle du santal ; sa peau est lisse et tendre comme celle d’un jeune éléphant ; sa voix est semblable au chant du kokila mâle captivant sa femelle ; sa sueur a l’odeur du musc ; ses yeux sont comme ceux de la gazelle ; son nez est pareil au bouton de sésame ; ses lèvres sont roses comme un bouton de fleur qui s’épanouit ou rouges comme le corail ou le fruit du bimba : ses dents sont blanches comme le jasmin d’Arabie, elles ont le poli de l’ivoire ; son cou arrondi ressemble à une tour d’or ; ses seins ressemblent aux fruits du vilva ; ils se dressent comme deux coupes d’or renversées et surmontées de la fleur du bouton de grenadier.
Toutes les parties du corps de la femme peuvent devenir autant de symboles ou de fétiches pourvu que chacune d’elles corresponde à un certain idéal esthétique de l’amant.
Krafft Ebbing dans sa Psychopatia sexualis, a prétendu que la sélection sexuelle tout entière n’est pas autre chose qu’une sorte de fétichisme, c’est-à-dire de symbolisme érotique de l’objet. De même le célèbre pathologiste G. Tarde considérait l’amour normal comme un genre de fétichisme :
« Il nous faut longtemps avant de tomber amoureux d’une femme ; nous devons attendre pour voir le détail qui nous frappe et nous plaît, et nous fait dédaigner ce qui nous déplaît ; ce n’est que dans l’amour normal que les détails sont nombreux et toujours changeants. La constance en amour est rarement autre chose qu’un voyage autour de la personne aimée, un voyage d’exploration et de découvertes toujours nouvelles. L’amant le plus fidèle n’aime pas la même femme deux jours de suite de la même manière. » (Traité de L’Amour morbide.)
Toutes ces déclarations, toutes ces formules vaudraient la peine d’être examinées, vérifiées et analysées de près. Elles font montre de trop d’arbitraire ; elles sont trop péremptoires. Ceux qui ont étudié la question hors de toute déformation professionnelle concluent qu’un très grand nombre d’objets ou d’actes peuvent présenter par hasard la valeur de symboles érotiques. Les objets et les actes qui deviennent fréquemment de véritables symboles sont en nombre relativement restreint.
Sans attacher plus d’importance qu’il ne faut aux qualifications normales ou anormales, on peut, dans un but mnémotechnique, adapter la classification qu’a dressée Havelock Ellis des phénomènes de l’ordre qui nous occupe, classification relative aux objets et aux actes qui ont fait naître ces manifestations.
-
Parties du corps.
-
NORMALES : la main, le pied, les seins, le bout des seins, les cheveux, les sécrétions et les excrétions, etc.
-
– ANORMALES : la claudication, le strabisme, les marques de variole, etc. : la pédophilie ou amour des enfants, la presbophylie ou amour des vieillards, la nécrophilie ou attraction pour les cadavres, la zoophilie ou excitation par les animaux.
-
-
Objets inanimés.
-
VETEMENTS : gants, souliers, bas, jarretières, chapeaux, mouchoirs, tabliers, dessous, etc.
-
OBJETS IMPERSONNELS, comprenant tous les objets, si divers qu’ils soient, pouvant accidentellement acquérir le pouvoir d’exciter le sentiment sexuel (y compris le pygmalionisme ou excitation par les statues).
-
-
Actes et attitudes.
-
ACTIFS : flagellation, cruauté, exhibitionnisme.
-
PASSIFS : être fouetté, subir des cruautés. On peut y comprendre les odeurs personnelles et le son de la voix.
-
MIXOCOSPIQUES : vision des actes de grimper, de se balancer, etc., des actes d’émulsion, de défécation, du coït des animaux.
-
On comprendra que, faute de place, nous ne puissions nous étendre en détail sur les différentes manifestations du symbolisme sexuel ou les diverses formes qu’il revêt. Nous nous contenterons d’un coup d’œil d’ensemble.
Le fétichisme du pied et du soulier compte parmi les formes les plus fréquentes du symbolisme sexuel. On se souvient de l’importance que Restif de la Bretonne accordait à la chaussure comme fétiche d’émotion sexuelle. Il l’a raconté tout au long dans Monsieur Nicolas, son chef-d’œuvre, dans Le pied de Fanchette, et on sait qu’il a exprimé le désir qu’on enterrât avec lui la pantoufle de la femme qu’il aima le plus passionnément de toute sa vie, Mme Parangon. Mais sa prédilection pour les souliers de sa gracieuse amante ne l’empêchait pas de se jeter avec avidité sur le linge qui avait touché certaines parties de son corps.
On connaît la fascination sexuelle exercée par le pied sur les Chinois du Sud, les Mongols et, en général, tous les peuples appartenant à la race jaune, à ce point que c’est dans le pied que, pour les femmes, réside la pudeur ; la révolution chinoise a eu beaucoup de peine à abolir — et elle a rencontré maints échecs — la compression du pied de la Chinoise du Sud, compression qui semble avoir fait du pied l’un des foyers de l’attraction sexuelle, comme en Occident ce fut le corsetage de la poitrine féminine.
Ce n’est pas seulement chez les Chinois qu’il y a relation étroite entre les pieds et le désir sexuel, on l’a signalé chez les Egyptiens, les Arabes, les Allemands, les Espagnols modernes. En ce qui est les Anciens, Ovide a insisté souvent sur le charme sexuel du pied féminin, insistance telle qu’on dirait, écrit le Dr Paul Jacoby, dans sa Contribution à l’étude des folies dégénératives, que la psychologie des Romains était bien proche de celle des Chinois. Le poète latin Tibulle a décrit avec amour le pied menu de sa maîtresse « comprimé » par la bandelette qui l’entourait.
Le fétichisme du pied et de la chaussure revêt une foule d’aspects, qui se résument en ceci : que la jouissance sexuelle n’est obtenue qu’à condition que, objet ou image, le pied ou la chaussure intervienne. Et cela va de l’homme qui suit dans la rue une femme dont le pied ou la chaussure l’aura séduit à celui auquel la caresse d’un pied féminin procure le plaisir sexuel, au collectionneur de bottes, de souliers ou de pantoufles qu’une nouvelle acquisition conduit, par associations d’idées, à la masturbation — ou encore à celui qui n’éprouve de jouissance que s’il est foulé aux pieds. L’élément féminin non plus n’est pas exempt de ce fétichisme ; il y a des exemples de femmes auxquelles l’acquisition de souliers neufs ou la marche sur certains objets ou dans de certaines circonstances procure l’orgasme.
Le fétichisme du sein est également très répandu et est tellement classique qu’il est reconnu et avoué depuis la plus haute Antiquité. On peut dire que la poésie, la peinture, la sculpture, la gravure, le dessin l’ont immortalisé.
L’auteur du Cantique des Cantiques (IV, 5) déclare :
« Tes deux seins sont comme deux faons, comme les jumeaux d’une gazelle qui paissent au milieu des lys. »
Et l’anecdote de Phryné dont l’acquittement a été obtenu grâce au dévoilement de sa gorge de déesse, indique que les Grecs partageaient, au sujet de cette partie du corps de la femme, l’enthousiasme du chantre des beautés de la Sulamite. Remarquons en passant que le Cantique des Cantiques est saturé de symbolisme sexuel et rivalise, sous ce rapport, avec le Kamasoutra.
Faut-il citer Clément Marot :
Tétin de satin blanc tout neuf,
Tétin qui fait honte à la rose.
Benserade :
Caour Lormian :
N’égalent pas l’albâtre de son sein.
Voltaire :
Est au milieu de deux pommes d’albâtre.
M. Rollinat :
Monts blancs où vont brouter mes caresses peureuses.
Beaudelaire, dans ses Fleurs du Mal, symbolisant l’attraction sexuelle du sein, fait dire à la femme :
Et fais rire le vieux du rire des enfants.
On peut apprécier I’influence de ces attributs en considérant la conception différente qu’en ont les maîtres de la peinture. Les seins de la Diane au bain de Boucher, de La source d’Ingres, de la Léda du Corrège, de la Galathée de l’Albane n’ont rien de commun avec ceux des femmes de Rubens dans sa Kermesse flamande ou dans sa Bacchanale ou dans son Départ d’Adonis, par exemple. Et ce n’est pas une question de peuple ou de mode, c’est une affaire de goût personnel. Qu’on compare la Fornarina de Raphaël ou la femme de l’Education de l’Amour du Titien avec l’Europe ou la Suzanne de Paul Véronèse ou les modèles du Tintoret, on verra combien tous ces artistes diffèrent quant à la conception de ce détail du corps humain.
Le fétichisme du sein est tellement ancré dans les mœurs qu’on ne le voit pas figurer dans les livres médicaux à titre pathologique. Et pourtant le nombre est élevé des hommes et des femmes chez lesquels la vue ou le toucher des seins produit une excitation ou une émotion sexuelle érotique à l’exclusion des autres parties du corps.
Il est une forme répandue du symbolisme érotique, forme très définie et nettement distincte de toutes les autres où la jouissance sexuelle est obtenue en exposant les organes sexuels aux regards d’un individu de sexe différent, assez souvent jeune et innocent, parfois un enfant : c’est l’exhibitionnisme. Dans I’exhibitionnisme en plein air, dans l’exhibitionnisme à l’église — faut-il voir une émergence de l’ancien culte phallique, d’un instinct ancestral, rappelant un procédé d’invitation à l’amour dont le décolleté des femmes serait un aspect
« civilisé » ? Toujours est-il que cette « passion » — qui se relie au fétichisme du pénis et à celui de la vulve coûte à ses pratiquants plus que cela ne mérite quand les défenseurs de la morale officielle parviennent à les surprendre. Il est évident que dans un milieu où l’anudation ne serait pas réprouvée comme immorale, l’exhibitionnisme serait à peine remarqué ou, en tous les cas, proscrit avec beaucoup moins de rigueur ; s’il est aussi sévèrement puni, c’est à cause de l’anathème jeté par l’église sur les organes de la génération, puisque c’est sous son influence qu’on les a qualifiés de « parties honteuses ». Les mœurs des peuples païens étaient beaucoup plus tolérantes pour l’exhibitionnisme et se souciaient même fort peu de l’accouplement en public.
Le docteur P. Garnier voyait dans l’exhibitionnisme sous sa forme typique, un acte systématique équivalent ou se substituant à l’union sexuelle. Toujours est-il que parmi les exhibitionnistes on compte des gens instruits, éduqués, docteurs, écrivains, artistes, etc. et qu’il n’est pas rare de rencontrer des femmes dans le nombre. Cela nous fait souvenir que chez certains peuples primitifs et même chez quelques populations plus ou moins arriérées de l’Europe, l’exhibition de la nudité féminine est un spectacle ou une opération magicoreligieuse (Ploss Bartels : Das Weib ; Havelock Ellis : Man and Woman).
Jean-Jacques Rousseau, dans ses Confessions, raconte comment il montra parfois son derrière à de jeunes femmes, mais on sait que sa vie émotionnelle fut profondément affectée par les fessées qu’il reçut pendant son enfance de Mlle Lemercier.
Rappelons que dans l’Oraison du Soir, Arthur Rimbaud a exalté l’exhibitionnisme dans des vers qui sont présents à la mémoire de tous ses admirateurs :
Je pisse vers les cieux bruns très haut et très loin
Avec l’assentiment des grands héliotropes.
Un autre aspect du symbolisme sexuel qui a des racines très profondes est le symbolisme scatologique qui se subdivise en urolagnie et en coprolagnie, autrement dit excitation sexuelle produite soit par les fonctions urinaires, soit pas les fonctions excrétoires, fonctions si proches du foyer sexuel anatomique. Le fait est qu’il existe une certaine quantité d’hommes et de femmes chez qui la projection de l’urine, l’attitude nécessaire à cette projection, l’odeur d’un objet imprégné d’urine, la défécation produisent une émotion ou une jouissance sexuelle. Havelock Ellis écrit :
« On connaît des faits innombrables, qui prouvent que l’impulsion à attribuer aux actes d’uriner et d’excréter une valeur symbolique sexuelle, pourvu qu’ils soient exécutés par la personne aimée, est fort près du normal ; on l’a rencontré chez des individus de haute valeur intellectuelle ; cela se discerne aussi bien chez les femmes que chez les hommes ; et, tant que cette impulsion ne se manifeste qu’à un faible degré, il faut la ranger dans la sphère naturelle de l’amour. »
Dans presque tous les pays, on constate la croyance aux qualités sacrées et mythiques de l’urine. Chez les Peaux-Rouges de la côte ouest de l’Amérique du Nord, en Australie, chez les anciens Tasmaniens, chez les Tamans de la Birmanie, au Maroc, chez les Juifs, chez les Slaves du Sud, on attribuait et on attribue encore une vertu spéciale et magique à l’urine.
Le fétichisme urolagnique remonte encore plus loin, puisque selon Kind, l’excitation sexuelle produite par le spectacle d’une femme urinant n’est pas spéciale à l’homme, mais est générale chez tous les mammifères.
Ce même Kind, dans Die Weibherrschaft in der Geschichte des Menscheit reconnaît que la proximité du méat urinaire et du clitoris détermine une zone érogène, de sorte qu’uriner est un acte agréable chez les femmes. Dans les actes du Congrès de Médecine de Moscou, t. IV, Pitres et Regis considèrent que le désir d’uriner accompagne toujours l’excitation sexuelle spontanée des femmes, le plaisir éprouvé par l’homme dans le spectacle ou la représentation de la miction féminine s’expliquerait par la connaissance intuitive ou subconsciente de ce fait physiologique.
Les animaux sont également une source de symbolisme érotique. La vue du coït des animaux, certains produits animaux, la cour que se font les animaux peuvent produire l’excitation sexuelle chez l’homme. C’est ce que Havelock Ellis appelle un symbolisme fondé sur une association par similarité :
« L’acte sexuel animal rappelle l’acte sexuel humain et ainsi l’animal devient le symbole de son frère supérieur. »
C’est ainsi que l’accouplement des grands animaux — chevaux et autres — a vivement intéressé des personnes de haute culture. On se souvient que François Ier conduisait les dames de la cour dans la forêt de Saint-Germain pour leur rnontrer les cerfs faisant l’amour avec les biches, pendant la saison du rut.
Mais la zoophilie tourne à la « zooérastie » ou bestialité quand il s’agit de l’impulsion à obtenir la jouissance sexuelle par le coït ou tout autre contact intime avec les animaux. Il est évident, quand on songe aux totems qui sont principalement des animaux, aux jeux, aux fêtes, aux cérémonies, aux danses religieuses si communes chez les peuples primitifs et dont les acteurs portent des déguisements animaux, qu’il dût exister une époque où les hommes ne voyaient rien d’amoral ou de mal à s’accoupler avec les animaux.
C’est pourquoi les peintures de vases ou les marbres antiques représentant des satyres s’accouplant avec des chèvres ne suscitaient pas plus de réprobation que les représentations, sculptées sur les temples de l’Inde, de copulation entre humains et animaux. D’ailleurs les légendes mythologiques d’Io et du taureau, de Léda et du cygne, d’Europe, de Pasiphaé, etc., indiquent la persistance de souvenirs d’accouplements de ce genre qui avaient fini par être sanctionnés par la religion.
L’homme et la femme se sont accouplés avec des chiens, des chiennes, des vaches, des truies, des rennes, voire des chats et des lapins. Si les dames romaines manifestaient de l’attraction pour les serpents et plus rarement pour les ours et les crocodiles (bien que leur préférence pour l’âne soit bien connue), en Extrême-Orient, on utilise les poules, les canards, les oies, juste revanche de la gent volatile.
Quant à l’accouplement de la femme avec le singe, il ne semble pas, malgré les documents à ce sujet, qu’il en existe de bien véridiques, bien que Moll prétende que ce semble être le signe anormal d’un intérêt pour ces bêtes que la tendance des femmes à observer les singes dans les jardins zoologiques.
Notons ici la tentative faite par le Docteur Ellie Ivanoff, pour croiser, par la méthode connue sous le nom d’imprégnation artificielle, le singe et l’homme. Subsidié par le gouvernement des Soviets, Ivanoff emmena neuf chimpanzés femelles dans une vaste forêt du Turkestan russe où il avait établi son laboratoire. Le Docteur Alfonso L. Herrera a parlé longuement de cette tentative dans le cahier 82 des Cuadernos de Cultura, intitulé El Librido del Hombre y del mons (Valencia, 1933).
Il semblerait que les guenons n’ont pu supporter leur captivité. Le docteur Ivanoff n’est pas un inconnu en France et il avait tenu le Docteur Calmettes au courant de ce qu’il voulait réaliser.
Les lois condamnant la bestialité étaient très sévères chez les Juifs, qui assimilaient la bestialité à la sodomie. L’Exode (XXII, 19) et le Lévitique (XX, 15) prescrivent la mise à mort de l’humain et de l’animal. Au Moyen Âge, la bestialité était très répandue et par le Pénitentiel d’Egbert (IXème-Xème siècles) nous voyons qu’évêques, prêtres et moines n’en étaient pas exempts.
En général, les idées de ce temps étant influencées par la morale judéo-chrétienne, la bestialité était passible de longues pénitences et souvent de mort. En France, on brûla ensemble des hommes et des truies, des hommes et des vaches, des hommes et des ânesses. Au XVIIème siècle il se trouvait encore un jurisconsulte, Lebrun de La Rochette, pour justifier ces assassinats !
Une autre forme encore assez fréquente du symbolisme sexuel est la cleptolagnie ou vol associé à l’excitation sexuelle dont l’étude des manifestations est toute récente. La cleptolagnie est la jouissance sexuelle obtenue grâce « à l’énergie émotionnelle déterminée par l’excitation du vol ». Certaines femmes, surtout proche la période menstruelle, volent des étoffes, généralement de la soie et ressentent, leur action commise, une jouissance voluptueuse, « accompagnée d’une sensation délicieuse comme elle n’en éprouvait jamais pendant le coït ou autrement » a raconté l’une d’elles (Annales médico-psychologiques, mars 1921). Les hommes sont également sujets à ce genre de symbolisme.
Il me faudrait des volumes pour décrire les différentes manifestations du symbolisme ou fétichisme sexuel. Fétichisme de la bouche : dans Le Carillonneur, G. Rodenbach a décrit un personnage devenant amoureux d’une jeune fille uniquement à cause de sa bouche, ne voyant plus « que cette bouche tentante et haletante, comme une fleur isolée qu’il eût voulu cueillir dans le jardin de sa chair ... L’amour était dans cette bouche, comme Dieu dans l’hostie. » — Fétichisme de la voix — fétichisme du nez — fétichisme des yeux tout autant classique que le fétichisme des cheveux, tous deux chantés avec enthousiasme par les poètes. Le rôle des boucles de cheveux (à quoi il faut rattacher celui des poils de l’aisselle ou du bas ventre) comme excitant sexuel est bien connu. Du temps où l’on portait de longues chevelures, les coupeurs de tresses occupaient assez souvent la chronique des tribunaux et on n’ignore plus qu’une fois la tresse dans leurs mains, ils se trouvaient au comble de la jouissance. Fétichisme du bras, de la main. Fétichisme des fesses, normal chez certaines peuplades sud africaines et reconnu par les Grecs qui lui avaient consacré leur Vénus Callipyge. Fétichisme des odeurs, phénomène qui mériterait une longue étude étant donné son importance. Fétichisme des enfants impubères dont la femme n’est pas plus exempte que l’homme et au sujet duquel il faut rappeler que chez certains peuples, dont les Scythes, les mœurs autorisaient les relations sexuelles avec les fillettes. Fétichisme du costume, dont le gant, les dessous, le mouchoir, le tablier blanc, le bonnet de nuit, les bas, les fourrures, les éventails sont des subdivisions. Stanley Hall dans le Journal américain de Psychologie (vol. VIII) explique l’amour pour les fourrures par le souvenir d’une époque où les relations avec les animaux étaient beaucoup plus intimes que maintenant ou par celui des âges où nos ancêtres étaient velus. Une autre subdivision du fétichisme du costume est l’excitation produite par la femme en costume religieux, mais la recherche des origines (vestales, etc.), m’entraînerait trop loin. On a connu un juge d’instruction (Dr Emile Laurent, dans l’Amour morbide) qui éprouvait un attrait presque irrésistible pour le costume des prisonnières. Fétichisme des travestis. Fétichisme des monstruosités ou difformités.
On me reprochera peut-être de n’avoir parlé ni du sadisme ni du masochisme. Mais ni le sadisme ni le masochisme ne peuvent, selon moi, être englobés dans le symbolisme sexuel ou érotique. Le sadisme consiste à se procurer de la jouissance sexuelle en faisant souffrir autrui ou en étant témoin de ses souffrances, alors que le masochisme est le moyen de se procurer cette même jouissance en se faisant infliger de la souffrance par autrui. Cela n’a rien à faire avec le véritable symbolisme ou fétichisme sexuel physiologique qui n’associe nullement la douleur à l’amour. Ainsi, le vampirisme ou la recherche de la jouissance sexuelle par la profanation des cadavres n’a rien à faire avec le sadisme ou le masochisme ; aucun désir d’infliger ou de subir une souffrance quelconque n’existe en effet dans la nécrophilie. Pas plus qu’il n’en existe dans l’excitation par les statues. L’exhibitionniste, le fétichiste qui s’empare d’un gant, d’un mouchoir, d’une mèche de cheveux, etc., pour se procurer une excitation sexuelle ne cherche aucunement à infliger de la souffrance et n’établit aucun rapport entre la douleur et la volupté.
De Sade, qui a donné son nom au sadisme, est un précurseur en fait de psychopathie sexuelle, dont quelques esprits avertis commencent à reconnaître le talent. Il a combattu toutes les valeurs morales de son époque et s’est efforcé de démontrer dans ses romans que ce sont ceux qui sont les gardiens de la moralité qui en font le plus fi. Rappelons qu’on peut établir des parallèles profitables entre de Sade (qui florissait à la fin du XVIIIème siècle), Schopenhauer, Stirner et Nietzsche. On peut même se demander s’il n’a pas influencé le solitaire de Sils Maria.
De Sade était malthusien. Dans la Philosophie dans le boudoir, Mme de Saint-Ange parle comme les néomalthusiens actuels. Il était contre le respect des propriétés. Alcide Bonneau a fait remarquer, dans la Curiosité littéraire et philosophique, que, dans son premier mémoire sur la Propriété (1840) « La Propriété c’est le vol », Proudhon développe exactement les mêmes idées que Dorval, un autre héros de la Philosophie dans le Boudoir.
Lorsqu’au Vème Congrès de la Ligue mondiale pour la Réforme sexuelle, le Dr Magnus Hirschfeld déclare qu’il n’est pas une des formes prises par l’instinct sexuel « si anormale qu’elle nous paraisse » qui ne soit au fond « normale, justifiée, en tout cas irrésistible », ceux qui ont étudié le problème ne peuvent qu’être d’accord avec lui. Le grand malheur cependant pour l’anormal, pour le symboliste, le fétichiste sexuel, c’est qu’en dépit de toute la littérature savante ou profane (lue par une infime minorité d’ailleurs), il n’est compris par presque personne. L’amant normal a derrière lui la foule des autres êtres humains qui agissent comme lui, son espèce, son sexe, sa nation. Même l’amant inverti rencontre des individus dont les aspirations sont semblables aux siennes et auxquels il peut s’associer. Mais l’anormal sexuel, moyen, équilibré, du fait de son éducation, s’imagine qu’il est seul au monde. Son désir le plus sacré, pour ainsi dire, ceux qui l’entourent le considèrent comme une obscénité dégoûtante ou un enfantillage absurde, sinon comme un vice exigeant l’intervention de la police.
Ses contemporains ont oublié que l’adoration du pied, le respect pour les actes et les produits de l’excrétion, la cohabitation avec des animaux, la solennité de l’exhibition des organes de la reproduction, tout cela :
« C’étaient pour des ancêtres qui ne sont pas très lointains, le support des conceptions les plus élevées et des ardeurs religieuses les plus profondes. »
Le voilà seul. Rien d’étonnant à ce que cet isolement influe sur son moral. Et ce n’est pas le châtiment qui le sortira de cette situation, s’il n’est pas assez « habile » ou « perspicace » pour y échapper.
Si on s’occupe de l’inverti sexuel, personne ne s’occupe du symboliste, du fantaisiste sexuel. C’est qu’il n’a pas à présenter une lignée de grands ascendants intellectuels, lui. Les grands intellectuels fétichistes se gardent bien de se proclamer tels : ils sont encore trop esclaves de l’opinion publique, de l’opinion de leur milieu. Malgré la fréquence des symptômes de morbidité congénitale (comme s’il n’y en avait pas parmi les normaux) de :
« Toutes les manifestations de la psychologie sexuelle les phénomènes relevant du fétichisme sexuel sont ceux qui sont le plus spécifiquement humains. »
Plus que tous les autres, ils présupposent une force plastique très développée de l’imagination. Ils nous montrent à nu l’homme individuel, non seulement séparé de ses contemporains, mais en opposition avec eux, et forcé de créer tout seul son propre paradis. Ils constituent le triomphe suprême de l’idéalisme humain (Havelock Ellis : Le symbolisme érotique).
Dans son Précis de Psychologie sexuelle (Alcan 1934), Havelock Ellis reste fidèle à lui-même, déclare à nouveau :
« J’ai toujours cherché à montrer qu’il n’y a pas de limites tranchées entre le normal et l’anormal. Toutes les personnes normales sont anormales à tel ou tel point de vue, et les anormaux sont toujours menés par des impulsions fondamentales semblables à celles qu’éprouvent les normaux. »
On comprend que dès lors qu’il n’y a ni violence, ni fraude, ni cruauté, ni dol, « L’anomalie sexuelle » ait paru, à maint esprit dépouillé de préjugés, tout autant fondée que les autres propriétés de l’homme à revendiquer sa place au soleil. Il ne faut pas oublier ici cette phrase de Nietzsche :
« Sans une certaine exaspération du système sexuel, nous n’aurions pas eu Raphaël. »
L’attitude des individualistes anarchistes à l’égard des fantaisistes sexuels (titre sous lequel j’englobe les anormaux, les pervers, les déviés, les symbolistes, les fétichistes, etc.) n’est pas plus dictée par la répulsion que leurs actes inspirent aux moralistes que par la classification arbitraire en sains ou morbides. Ils ne se demandent pas non plus si les fantaisies dont il est question sont congénitales ou acquises, guérissables ou irrémédiables, etc. Ils acceptent tout simplement leur existence.
Deux conditions se présentent :
-
Ou les fantaisistes sexuels sont des autoritaires, c’est à-dire entendent, pour la réalisation de leurs fantaisies, — dont la plupart ne peuvent s’accomplir qu’en compagnie — user de violence ou de contrainte à l’égard d’autrui ; et, dans ce cas, il n’y a pas à hésiter, il faut se défendre contre eux, comme il importe de se garer de tous ceux qui, dans un domaine quelconque, politico-économique, éthique ou intellectuel, s’arrogent d’utiliser la contrainte ou la violence à l’égard d’autrui ; et il ne faut pas faire de distinction. Quiconque, groupe ou personnalité, pour arriver à ses fins, se sert de la violence ou de la contrainte, est dangereux pour l’individu comme pour le milieu.
-
Ou bien les fantaisistes sexuels n’usent ni de violence ni de contrainte, c’est-à-dire que, pour trouver des compagnons de pratique, ils ne recourent qu’à l’invite ou à la publicité, qu’à la persuasion ou au graphisme verbal ou figuré, et ne s’adressent qu’à des personnes en état de les comprendre : autrement dit font tout ce qu’accomplissent les associationnistes de toute espèce pour se gagner des amis ou des adhérents.
Intervenir alors — selon les individualistes anarchistes — est du domaine de la persécution, quel que soit le prétexte invoqué ou inventé. Est persécution toute action légale ou administrative ou autre ayant pour but d’empêcher une personne parvenue à l’âge où elle est capable de passer contrat, de disposer (dans des buts sexuels ou érotiques) comme il lui plaît de tout ou partie de son corps.
À vrai dire, quand on y regarde d’un peu près, on s’aperçoit vite que les plus acharnés persécuteurs des fantaisistes sexuels ou érotiques sont, dans leur genre, eux aussi, des fantaisistes : mais excessivement dangereux. Je parle des sincères comme des hypocrites.
Je conclus en disant que les ruines et les désastres accumulés par les « fantaisistes » religieux ou moraux, pour ne citer que ces deux catégories — ceux-là par le dogme (dont la naissance miraculeuse du Christ est un type caractéristique) — ceux-ci par la morale, qui vise à faire le bonheur de tous ceux qu’elle s’assujettit par une réglementation écrite qui ne satisfait peut-être pas le dixième des hommes — ne peuvent être mis en parallèle, comparativement parlant, avec les quelques accidents auxquels a pu donner lieu l’exagération de certaines fantaisies sexuelles. De temps à autre, la chronique judiciaire attire l’attention publique sur un cas d’anomalie sexuelle ou érotique dont le danger est très souvent et à dessein amplifié et qui n’aurait eu aucune répercussion s’il était resté secret : mais que sont ces cas isolés et assez rares par rapport aux crimes innombrables qu’ont perpétrés les perversions et les fanatismes politico-économiques, religieux ou moraux ? Il est dans le rôle des individualistes anarchistes de proclamer, de défendre le droit du fantaisiste sexuel (dès lors, je le répète, qu’il n’entend user ni de violence, ni de contrainte) à s’associer à autrui, à faire comme tout autre associationniste, de la publicité pour entrer en relations avec d’autres fantaisistes de son genre et de protester chaque fois qu’on le persécute et qu’à l’encontre de ce qui se fait pour les entrepreneurs de distractions et d’amusements de toute espèce, on lui interdit de publier des journaux, des tracts ou des brochures, etc., traitant des variétés sexuelles qui lui tiennent à cœur. Réclamer, revendiquer la liberté d’expression, de réunion et de publicité s’entend pour les individualistes dans tous les domaines, ce qui est d’ordre sexuel ou érotique inclus.
— E. ARMAND.
SYNDICALISME
n. m.
Le syndicalisme dont je vais parler ci-dessous est révolutionnaire, social et non corporatif seulement. Il est, aussi, fédéraliste et anti-étatiste.
Il prend sa source doctrinale dans Proudhon et a retenu les enseignements de Bakounine, de Kropotkine, de James Guillaume ; et Malatesta, malgré son point de vue particulier, ne l’a pas traité en indifférent. Voilà pour le passé.
Pour le présent, il s’est efforcé, par son observation des faits sociaux contemporains, de renforcer sa doctrine et de dégager les tactiques les mieux appropriées à son action et à ses buts.
J’ai déjà dit tant de choses sur ce mouvement particulier des travailleurs, notamment dans l’étude historique que j’ai consacrée à la Confédération Générale du Travail qu’il me paraît inutile de me livrer à de longs développements qui ne seraient que la répétition de mon ouvrage : Les Syndicats ouvriers et la Révolution Sociale.
La présente étude n’aura donc pour but que d’exposer certains aspects du syndicalisme, après l’avoir défini, et d’examiner quelques points actuellement controversés dans le monde anarchiste.
Définition.
Le syndicalisme est un mouvement naturel qui groupe, sous des formes diverses, des hommes qui ont des intérêts communs et des aspirations identiques ; des hommes chez lesquels la concordance des intérêts et l’identité des buts déterminent normalement et logiquement le choix de moyens d’action semblables pour atteindre le but qui est commun à leurs efforts.
On trouverait trace de telles associations, de tels groupements, quelle qu’en soit la forme, dans les temps les plus reculés de l’Histoire.
Sans doute, à ces époques lointaines, n’était-il pas question de syndicalisme. Le mot était inconnu, mais la chose existait sous des aspects divers et variés.
A mon avis, il n’est pas exagéré d’affirmer que le syndicalisme, sous des formes rudimentaires, a existé dès que la vie en société s’est imposée aux hommes comme une nécessité.
Dès ces jours reculés, qui se perdent dans la nuit des temps, la solidarité, l’entraide, l’alliance, qui constituent les bases morales fondamentales du syndicalisme moderne, sont devenues, pour les hommes appelés à vivre en commun ou en rapport, les principes vitaux dont la pratique et l’application étaient indispensables pour assurer leur sauvegarde, défendre leur vie, acquérir une tranquillité relative ; produire, échanger et consommer.
En effet, c’est en pratiquant la solidarité et l’entraide que les hommes ont pu conquérir la première place dans le règne animal. S’ils ne s’étaient pas unis, bien qu’ils fussent doués d’intelligence, ils eussent été les victimes, dans la lutte pour la vie, des races d’animaux supérieurement armés pour cette lutte, plus vigoureux et plus forts.
Or, le contraire s’est produit ; non seulement l’homme, groupé avec ses semblables, a défendu victorieusement sa vie, assuré sa subsistance, propagé son espèce, mais encore il a détruit ou domestiqué presque tous les animaux qui lui disputaient le droit à l’existence et asservi les forces naturelles.
C’est également par la vie en commun, par la pratique de l’entraide, que les inventions ont pu être réalisées, véhiculées, appliquées et que, de proche en proche, la civilisation, si contrariée qu’elle ait pu être dans son essor, a pu, néanmoins, se développer, modifier et, parfois, bouleverser les conditions de vie des hommes à des périodes déterminées.
Il est infiniment probable que le syndicalisme préhistorique n’avait pas d’autre but que d’assurer à l’homme la sécurité de la vie et les moyens d’existence.
Et si la vie avait suivi son cours normal ; si les hommes n’avaient jamais connu l’ambition, la haine, la domination, l’autorité, la propriété, la jouissance et le lucre, le syndicalisme aurait sans doute connu un développement continu et sans histoire et le but que nous poursuivons encore — que d’autres poursuivront peut-être — serait atteint depuis longtemps.
La naissance, chez les hommes, des sentiments ci-dessus indiqués, devait fatalement les séparer, les diviser, les dresser les uns contre les autres, faire naître des groupes dont les intérêts concordaient.
C’est ainsi que s’explique l’origine des classes sociales antagonistes dont il serait vain de vouloir nier l’existence.
La lutte entre les classes, dont l’une est privilégiée et l’autre déshéritée, exigea, de part et d’autre, la constitution de groupements pour défendre les intérêts et les aspirations des forces en lutte.
Ainsi naquirent successivement l’Etat, puis les syndicats ouvriers et patronaux, dont l’opposition demeurera constante, sur tous les plans, aussi longtemps que les causes et raisons de cette opposition : propriété, privilèges, autorité, subsisteront.
En ce moment, deux grands mouvements de classe : le syndicalisme patronal et le syndicalisme ouvrier sont face à face.
Chaque jour, l’un et l’autre englobent de nouveaux éléments de vie et d’action, agrandissent le champ de leur activité et se substituent, en fait, aux partis politiques qui, de plus en plus, perdent leur caractère originel et deviennent, dans des Parlements condamnés, les exécuteurs des volontés des grands groupements qui s’affrontent sur tous les terrains. Lorsque les Congrégations économiques imposent leur volonté au Parlement et aux Parlementaires, c’est le syndicalisme patronal qui parle et agit ; lorsque le Cartel des fonctionnaires et la C.G.T. obligent les socialistes à renverser, malgré leur désir, un gouvernement, puis plusieurs, c’est, indiscutablement, le syndicalisme ouvrier qui se manifeste contre l’Etat-patron. Bien que cette action indirecte, par pression, n’ait, à mes yeux, qu’une valeur relative, il n’est pas douteux que les éléments révolutionnaires ne sauraient, en la circonstance, la condamner.
Qu’il soit patronal ou ouvrier, le syndicalisme a toujours essayé et, en général, réussi à grouper toutes les forces vives et actions encore éparses. Cette idée de synthèse s’est ancrée avec toujours plus de force, mais elle a pris des formes diverses dans les deux camps.
Elle eut, en effet — et elle a encore — des partisans convaincus et acharnés ici et là.
Tandis que, de part et d’autre, certains hommes sont partisans d’une synthèse générale, qui permettrait de réunir tous les individus sur le plan d’un grand intérêt général, d’autres, moins ambitieux sans doute, mais plus pratiques et actuels désirent seulement réunir, sur un même plan, les individus dont les intérêts sont réellement concordants.
De ces idées de synthèse sont issues : la collaboration des classes et la lutte de classes, sous leur forme moderne.
La première a pour but de développer et de défendre, par voie d’ententes entre les classes antagonistes, l’intérêt général — ou plutôt ce qu’on qualifie de tel ; l’autre vise à défendre l’intérêt de classe, à le faire triompher, à donner naissance ensuite au véritable intérêt général dont elle nie actuellement l’existence.
De toute évidence, parce que la logique le veut ainsi, c’est la seconde conception qui finira par s’imposer et nous reviendrons ainsi à la source du syndicalisme ... après la disparition des classes.
Après avoir réalisé sa mission de libération humaine et la construction sociale, le syndicalisme n’aura plus pour but que de permettre à l’homme de lutter contre les éléments hostiles, de les vaincre, de les asservir pour le bien et le bonheur collectifs ; de poursuivre les recherches incessantes qui refouleront l’Inconnaissable et développeront la Connaissance ; d’appliquer, pour le plus grand bien de tous, les découvertes scientifiques aux œuvres pacifiques et laborieuses.
Ce rôle est assez noble et assez vaste pour attirer tous les hommes et les retenir à la tâche jusqu’à ce que celle-ci soit complètement accomplie.
Il est pourtant discuté et, précisément, par certains de ceux qui devraient l’accepter et le remplir les premiers. Et ici se pose cette question : les syndicats doivent-ils subsister après la révolution ?
L’existence des Syndicats après la Révolution.
Si, chez les anarchistes révolutionnaires, nul ne conteste la nécessité de l’existence des syndicats avant la révolution — il en est, très peu nombreux il est vrai, qui nient volontiers et avec force — plus de force que d’arguments — que les syndicats soient nécessaires après la Révolution.
Pour ma part, je ne déclare pas seulement qu’ils sont nécessaires, mais je ne crains pas d’affirmer qu’ils seront indispensables.
Que proposent donc, pour les remplacer, les anarchistes, adversaires des syndicats après la révolution ?
De vagues groupements de producteurs, essaimés, sans liens véritables entre eux, échangeant quelques statistiques ; produisant à la diable, sans savoir pourquoi ni comment, n’ayant aucune idée des besoins collectifs dans tous les domaines.
Si ces hommes croient vraiment que c’est avec une telle organisation qu’on peut assurer la vie économique et sociale d’une collectivité quelconque, ils commettent une erreur grave.
Ils ne se rendent certainement pas compte :
-
Que l’économie et l’administration de la production, son échange, sa répartition doivent être organisées ;
-
Que cette organisation, reposant sur des bases libertaires, doit donner, sous peine de faillite et de catastrophe, des résultats supérieurs à ceux qui étaient obtenus auparavant par une organisation autoritaire et despotique.
Comment peuvent-ils croire que la société communiste libertaire ne sera pas organisée ?
Est-ce que, du fait même qu’on indique qu’elle sera : d’une part, communiste et, d’autre part, libertaire, cela ne suffit pas à faire comprendre qu’elle sera organisée, comme le veut le communisme, et selon les principes de la plus grande liberté possible comme l’implique le mot libertaire qui signifie littéralement : tendance à être libre.
Il y aura donc, après la révolution, une société organisée sur des bases communistes libertaires, et cela aussi longtemps que l’anarchie ne sera pas totalement réalisée.
Et cette organisation, pour porter ses fruits, devra être homogène, c’est-à-dire fonctionner aussi identiquement que possible sur les trois plans suivants : économique, administratif et social.
De toute évidence, cette organisation devra être conçue de façon telle que les rouages correspondants, sur les trois plans, agissent de concert, en accord.
En effet l’économique sera la base, l’administratif l’expression et le social la conséquence. S’il n’y a pas homogénéité et concordance ce sera le chaos et quel chaos : celui que les détracteurs bourgeois appellent l’anarchie, c’est-à-dire le désordre !
Nous prétendons, nous, que c’est le capitalisme qui est le désordre et nous voulons que l’anarchie soit l’ordre, l’ordre sans autorité ni contrainte, mais l’ordre tout de même, l’ordre qui découlera des actes conscients et réfléchis de tous.
Cette conscience éclairée devra être collective et le premier terrain sur lequel elle devra se manifester sera le plan économique.
Il ne suffira pas de substituer la notion du besoin à celle du profit ; il faudra connaître réellement l’étendue et la diversité de ce besoin, le chiffrer, par conséquent.
Et ceci fait, il faudra examiner l’autre face du problème : rechercher, apprécier, connaître aussi exactement que possible les possibilités de satisfaire tous les besoins.
En un mot, il faudra établir le rapport convenable entre la somme des besoins et celle des possibilités.
Et ce rapport devra être tel que les moyens de production permettent aussi largement que possible la satisfaction des besoins.
Les uns et les autres devront donc être connus et chiffrés au préalable et, si les moyens apparaissent insuffisants au début, il faudra les augmenter et, bon gré, mal gré, en attendant qu’ils soient suffisants, restreindre la consommation.
Cette constatation suffit à elle seule à indiquer parmi les trois grands facteurs économiques : production, échange, consommation quel est celui qui est essentiel et à classer les deux autres dans leur ordre.
CONSOMMER, c’est-à-dire assurer la continuité de la vie physique de l’être, est certainement l’acte le plus important, l’acte vital qui permet, à la fois, de produire et d’échanger. Mais PRODUIRE et ÉCHANGER, c’est donner aux hommes la possibilité de consommer, donc de vivre,
Dans ces conditions, il apparaît clairement que la tâche essentielle consiste d’abord à produire, à produire pour satisfaire les besoins de la consommation.
Et qui, mieux que les syndicats, sera qualifié pour extraire, transformer et mettre à la disposition du consommateur tout ce qui est nécessaire à la vie ?
Est-ce que, en régime capitaliste, ce ne sont pas, déjà, les producteurs, par leur force-travail, mal utilisée, mal rétribuée, qui assurent, en fait, cette tâche ?
Qui oserait soutenir que les banquiers, les détenteurs de l’argent et des instruments de travail y sont pour quelque chose ?
Qui nierait que les producteurs, groupés dans leurs syndicats, représentent la force essentielle de lutte et de construction révolutionnaire ?
Quel organisme peut-on, en vérité, essayer de substituer aux syndicats qui luttent et se préparent, chaque jour, à cette tâche constructive ?
Poser toutes ces questions, c’est les résoudre.
Lorsque, dans sa charte fameuse, toujours confirmée sur ce point précis, le syndicalisme en même temps qu’il exprimait à Amiens, en 1906, sa volonté d’exproprier le capitalisme et de transformer la société, proclamait que : « le Syndicat, aujourd’hui groupement de résistance serait, demain, le groupement de production base de la réorganisation sociale », il énonçait une vérité profonde.
Qu’il revête un caractère nettement coopérateur, c’est incontestable. C’est même évident. Mais il est nécessaire aussi qu’il conserve son caractère originel afin d’être apte, le cas échéant, à s’opposer à certaines entreprises qui pourraient être tentées contre la Révolution elle-même.
Maîtres de l’appareil de production et d’échange, les syndicats de producteurs seraient tout qualifiés, s’il le fallait, pour réduire rapidement à néant les prétentions d’une coterie ou d’un clan qui pourrait menacer à un moment quelconque les conquêtes et l’ordre social révolutionnaires, en dépit de toutes les précautions prises sur le plan administratif.
S’il y a péril, les syndicats seront là pour le vaincre. Ce n’est pas à dédaigner.
Ils sont donc indispensables avant, pendant et, surtout, après la Révolution.
-
Avant, pour préparer les cadres de lutte et de réalisation ; pour lutter contre le capitalisme et réduire sa puissance dès maintenant.
-
Pendant, pour abattre définitivement le capitalisme, s’emparer des moyens de production et d’échange et les remettre en marche au profit de la collectivité et pour son compte.
-
Après, pour assurer la vie économique collective, en accord avec les offices d’échange et de répartition locaux, régionaux, nationaux et internationaux qui indiqueront les besoins à satisfaire.
Contrairement à ce que pensent et déclarent certains hommes, qui n’examinent la question que sous l’angle politique et non sous son jour véritable, c’est-à-dire social, les syndicats de producteurs ne seront jamais ni une gêne ni un danger pour l’ordre nouveau issu de la révolution sociale.
Partie intégrante de celle-ci, ils entendent, certes, en défendre l’intégrité, mais ils ne visent ni ne prétendent à aucune dictature.
Adversaires de la dictature et de l’Etat, sous toutes leurs formes, composés d’éléments qui discutent, exécutent et contrôlent, par leurs divers organes, tout ce qui se réfère à la vie économique, ils limitent à ce domaine leur effort et leur activité.
Ils laissent aux individus le soin d’administrer la chose collective, par le jeu normal des organismes de tous ordres qu’ils se donneront.
Ils n’entendent être que la base — parce que c’est l’évidence même — de la Société nouvelle, une base solide sur laquelle cette société s’appuiera avec sûreté. Ils n’entendent pas davantage accaparer la vie tout entière. Ils demandent seulement que la vie économique, administrative et sociale repose sur des bases solides, que le système social soit homogène dans toutes ses parties ; que chacun, sur son plan, accomplisse sa tâche, toute sa tâche. Ils ne veulent ni subordination, ni préséance. Ils entendent que l’égalité sociale devienne une réalité, pour les hommes et les groupements.
Leur ambition, leur unique ambition consiste à vouloir être les fondements solides de l’ordre social nouveau ; à évoluer techniquement et socialement avec cet ordre, pacifiquement ; à développer sans cesse leurs connaissances pour intensifier le bien-être de tous ; à réduire au minimum la peine des hommes, tout en satisfaisant aux besoins de tous.
Qui peut s’élever contre une ambition aussi raisonnable, aussi légitime ?
Aux communes libres, fédérées et confédérées d’administrer les choses et de donner aux hommes les institutions sociales correspondantes et susceptibles de traduire dans la vie de chaque jour les désirs et les aspirations des individus.
À chacun sa tâche. Celle du syndicalisme est assez vaste pour qu’il n’ambitionne que de la remplir tout entière, sans vouloir en accaparer d’autres qui ne lui reviennent pas.
Substitution de la notion de classe à la notion de parti.
Ayant proclamé la nocivité et l’inutilité de l’Etat et démontré la faillite irrémédiable de tous les partis politiques, le syndicalisme se doit d’en tirer la conséquence logique.
Il affirme donc la nécessité, pour les travailleurs, en raison de la concordance permanente de leurs intérêts, de substituer la notion de classe à la notion de parti.
Il est, en effet, prouvé que les partis ne sont que des groupements artificiels, dont les éléments s’opposent les uns aux autres, en raison de la discordance de leurs intérêts.
Qu’attendre d’un parti qui contient dans son sein des patrons et des travailleurs, des exploiteurs et des exploités ?
Qu’y a-t-il de commun entre l’intérêt d’un patron socialiste ou communiste — et même anarchiste — et celui de son ouvrier ?
D’accord au siège de la section — théoriquement s’entend — leur opposition deviendra irréductible dès qu’ils se trouveront face à face à l’atelier, au chantier, au bureau, etc., c’est-à-dire pratiquement.
Et quelle que soit, de part et d’autre, leur bonne volonté, ils ne pourront jamais résoudre ce différend qui restera, entre eux, permanent.
Ceci implique naturellement que le patron et l’ouvrier socialistes, communistes ou anarchistes n’ont, entre eux, rien de commun ; que leur intérêt de patron et d’ouvrier s’oppose fondamentalement et les empêche d’agir pour un but qui ne leur est commun que par l’esprit. L’impuissance des partis, de tous les partis, n’a pas d’autre raison.
Et cette raison suffit à condamner la notion de parti et à lui substituer la notion de classe.
Là, sur le plan de classe, la délimitation est nette. Pas d’éléments hétérogènes aux intérêts divergents.
Au contraire, et en dépit de certaines différences habilement exploitées et maintenues par le capitalisme, les intérêts sont concordants, les aspirations sont identiques, les buts sont communs.
Rien ne s’oppose donc à ce que de tels éléments s’unissent et agissent de concert.
L’expérience renouvelée a, d’ailleurs, démontré que seuls les groupements de classe, par leur caractère homogène, pouvaient mener des luttes fécondes, qu’il s’agisse de forces ouvrières ou de forces patronales.
Je demande donc, sans hésitation, aux travailleurs, de substituer la notion de classe à celle de parti et, en conséquence, d’abandonner les partis et de rallier les syndicats révolutionnaires.
Le syndicalisme ne peut être neutre.
Le fait de proclamer la faillite des partis et de leur substituer les groupements naturels de classe que sont les syndicats, implique la nécessité absolue, pour le syndicalisme, de combattre tous les partis politiques sans exception.
La neutralité des syndicats proclamée à Amiens en 1906, a été dénoncée, en novembre 1926, par le congrès constitutif de la C. G. T. S. R.
Cette décision, très controversée à l’époque, même dans nos milieux, n’était pourtant que la conséquence logique de la substitution de la notion de classe à la notion de parti.
Il est à peine besoin d’affirmer que les événements actuels, qui démontrent avec une force accrue la carence totale des partis, nous font une obligation indiscutable, non seulement de rompre la neutralité à l’égard des partis, mais encore d’engager ouvertement la lutte contre eux.
S’il en était autrement, il serait inutile d’avoir prononcé la condamnation de l’Etat, démontré l’incapacité des partis à résoudre les problèmes dont le salut de notre espèce dépend. La neutralité a donc vécu. On ne manquera pas, certes, d’affirmer encore que c’est une erreur de l’avoir dénoncée.
Il se trouvera encore, même dans nos rangs anarchistes, des camarades pour prétendre que cette attitude nous contraint à n’être jamais qu’un mouvement de secte.
J’ose leur dire que c’est le contraire qui est vrai.
Ce ne sont pas des chrétiens, des radicaux, des socialistes, des communistes qu’il s’agit de réunir dans un mouvement de classe, mais des travailleurs en tant que tels.
Nous leur demandons donc de cesser d’être des chrétiens, des radicaux, des socialistes, des communistes, réunis dans un groupement voué d’avance à l’impuissance, en raison de la diversité des idées de ses composants — ce qui est bien le cas actuellement — pour devenir des travailleurs, exclusivement des travailleurs aux intérêts concordants.
Nous les prions, en somme, d’abandonner les luttes politiques stériles pour les luttes sociales pratiques et fécondes ; de passer de la constatation de fait à l’action nécessaire ; de s’unir, sur un terrain solide au lieu de se diviser pour des fictions.
Pour ma part, je considère qu’une telle union, dont la fécondité est certaine, est une chose beaucoup plus facile à réaliser que de choisir le « bon parti », le vrai parti prolétarien, parmi tant d’autres.
Si les travailleurs avaient abandonné les partis à leur sort, s’ils les avaient combattus, ils ne seraient plus les esclaves du capitalisme.
Depuis longtemps, ils seraient libres et s’ils veulent réellement le devenir, il importe qu’ils cessent de croire aux vertus des partis dits « prolétariens » qui comptent tant de bons et solides bourgeois dans leur sein et n’aspirent qu’à étrangler une révolution qu’ils n’appellent que dans la mesure où ils la savent inévitable.
Tels sont les quelques points, importants à mon avis, qu’il m’a paru nécessaire de traiter dans cette étude volontairement restreinte.
Je n’ai abordé ni les bases ni les principes du fédéralisme, ni le rôle des syndicats pendant la lutte violente, dans la défense de la révolution, ni les problèmes des échanges et du moyen d’échange, ni celui de la synthèse de classe, ni la question agraire.
Toutes ces questions ont déjà été traitées dans L’ « Encyclopédie Anarchiste » par d’autres collaborateurs. Je n’y reviendrai donc pas et je borne là cet exposé.
— Pierre BESNARD.
SYNDICALISME ET ANARCHISME
Au Congrès anarchiste d’Amsterdam (1907), Malatesta, examinant dans leurs rapports le syndicalisme et l’anarchisme, prononça un discours dont voici le fidèle résumé :
Le syndicalisme, ou plus exactement le mouvement ouvrier (le mouvement ouvrier est un fait que personne ne peut ignorer, tandis que le syndicalisme est une doctrine, un système, et nous devons éviter de les confondre) le mouvement ouvrier, dis-je, a toujours trouvé en moi un défenseur résolu, mais non aveugle. C’est que je voyais en lui un terrain particulièrement propice à notre propagande révolutionnaire, en même temps qu’un point de contact entre les masses et nous. Je n’ai pas besoin d’insister là-dessus. On me doit cette justice que je n’ai jamais été de ces anarchistes intellectuels qui, lorsque la vieille Internationale a été dissoute, se sont bénévolement enfermés dans la tour d’ivoire de la pure spéculation ; que je n’ai cessé de combattre, partout où je la rencontrais, en Italie, en France, en Angleterre et ailleurs, cette attitude d’isolement hautain, ni de pousser de nouveau les compagnons dans cette voie que les syndicalistes, oubliant un passé glorieux, appellent nouvelle, mais qu’avaient déjà entrevue et suivie, dans l’Internationale, les premiers anarchistes.
Je veux, aujourd’hui comme hier, que les anarchistes entrent dans le mouvement ouvrier. Je suis, aujourd’hui comme hier, un syndicaliste, en ce sens que je suis partisan des syndicats. Je ne demande pas des syndicats anarchistes qui légitimeraient, tout aussitôt des syndicats sociaux-démocratiques, républicains, royalistes ou autres et seraient, tout au plus, bons à diviser plus que jamais la classe ouvrière contre elle-même. Je ne veux pas même de syndicats dits rouges, parce que je ne veux pas de syndicats dits jaunes. Je veux, au contraire, des syndicats largement ouverts à tous les travailleurs sans distinction d’opinions, des syndicats absolument neutres.
Donc je suis pour la participation la plus active possible au mouvement ouvrier. Mais je le suis avant tout dans l’intérêt de notre propagande, dont le champ se trouverait ainsi considérablement élargi. Seulement cette participation ne peut équivaloir en rien à une renonciation à nos plus chères idées. Au syndicat, nous devons rester des anarchistes, dans toute la force et toute l’ampleur de ce terme. Le mouvement ouvrier n’est pour moi qu’un moyen — le meilleur évidemment de tous les moyens qui nous sont offerts. Ce moyen, je me refuse à le prendre pour un but, et même je n’en voudrais plus s’il devait nous faire perdre de vue l’ensemble de nos conceptions anarchistes ou, plus simplement, nos autres moyens de propagande et d’agitation.
Les syndicalistes, au rebours, tendent à faire du moyen une fin, à prendre la partie pour le tout. Et c’est ainsi que, dans l’esprit de quelques-uns de nos camarades, le syndicalisme est en train de devenir une doctrine nouvelle et de menacer l’anarchisme dans son existence même.
Or, même s’il se corse de l’épithète bien inutile de révolutionnaire, le syndicalisme n’est et ne sera jamais qu’un mouvement légalitaire et conservateur, sans autre but accessible — et encore ! — que l’amélioration des conditions de travail. Je n’en chercherai d’autre preuve que celle qui nous est offerte par les grandes unions nord-américaines. Après s’être montrées d’un révolutionnarisme radical, aux temps où elles étaient encore faibles, ces unions sont devenues, à mesure qu’elles croissaient en force et en richesse, des organisations nettement conservatrices, uniquement préoccupées à faire de leurs membres des privilégiés dans l’usine, l’atelier ou la mine et beaucoup moins hostiles au capitalisme patronal qu’aux ouvriers non organisés, à ce prolétariat en haillons flétri par la socialdémocratie ! Or ce prolétariat toujours croissant de sans-travail, qui ne compte pas pour le syndicalisme, ou plutôt qui ne compte pour lui que comme obstacle, nous ne pouvons pas l’oublier, nous autres anarchistes, et nous devons le défendre parce qu’il est le pire des souffrants.
Je le répète : il faut que les anarchistes aillent dans les unions ouvrières. D’abord pour y faire de la propagande anarchiste ; ensuite parce que c’est le seul moyen pour nous d’avoir à notre disposition, le jour voulu, des groupes capables de prendre en main la direction de la production ; nous devons y aller enfin pour réagir énergiquement contre cet état d’esprit détestable qui incline les syndicats à ne défendre que des intérêts particuliers.
L’erreur fondamentale de tous les syndicalistes révolutionnaires provient, selon moi, d’une conception beaucoup trop simpliste de la lutte de classe. C’est la conception selon laquelle les intérêts économiques de tous les ouvriers — de la classe ouvrière — seraient solidaires, la conception selon laquelle il suffit que des travailleurs prennent en main la défense de leurs intérêts propres pour défendre du même coup les intérêts de tout le prolétariat contre le patronat.
La réalité est, selon moi, bien différente. Les ouvriers comme les bourgeois, comme tout le monde, subissent cette loi de concurrence universelle qui dérive du régime de la propriété privée et qui ne s’éteindra qu’avec celui-ci. Il n’y a donc pas de classes, au sens propre du mot, puisqu’il n’y a pas d’intérêt de classes. Au sein de la « classe » ouvrière elle-même, existent, comme chez les bourgeois, la compétition et la lutte. Les intérêts économiques de telle catégorie ouvrière sont irréductiblement en opposition avec ceux d’une autre catégorie. Et l’on voit parfois qu’économiquement et moralement certains ouvriers sont beaucoup plus près de la bourgeoisie que du prolétariat. Cornélissen nous a fourni des exemples de ce fait pris en Hollande même. Il y en a d’autres. Je n’ai pas besoin de vous rappeler que, très souvent, dans les grèves, les ouvriers emploient la violence, non contre la police ou les patrons, mais contre les kroumirs qui, pourtant, sont des exploités comme eux et même plus disgraciés encore, tandis que les véritables ennemis de l’ouvrier, les seuls obstacles à l’égalité sociale, ce sont les policiers et les patrons.
Cependant, parmi les prolétaires, la solidarité morale est possible, à défaut de la solidarité économique. Les ouvriers qui se cantonnent dans la défense de leurs intérêts corporatifs ne la connaîtront pas, mais elle naîtra du jour où une volonté commune de transformation sociale aura fait d’eux des hommes nouveaux. La solidarité, dans la société actuelle, ne peut être que le résultat de la communion au sein d’un même idéal. Or, c’est le rôle des anarchistes d’éveiller les syndicats à l’idéal, en les orientant peu à peu vers la révolution sociale au risque de nuire à ces « avantages immédiats » dont nous les voyons aujourd’hui si friands.
Que l’action syndicale comporte des dangers, c’est ce qu’il ne faut pas songer à nier. Le plus grand de ces dangers est certainement dans l’acceptation, par le militant, de fonctions syndicales, surtout quand celles-ci sont rémunérées. Règle générale : l’anarchiste qui accepte d’être le fonctionnaire permanent et salarié d’un syndicat est perdu pour la propagande, perdu pour l’anarchisme ! Il devient désormais l’obligé de ceux qui le rétribuent et, comme ceux-ci ne sont pas anarchistes, le fonctionnaire salarié, placé désormais entre sa conscience et son intérêt, ou bien suivra sa conscience et perdra son poste, ou bien suivra son intérêt et alors, adieu l’anarchisme !
Le fonctionnaire est dans le mouvement ouvrier un danger qui n’est comparable qu’au parlementarisme : l’un et l’autre mènent à la corruption et de la corruption à la mort, il n’y a pas loin !
Et maintenant, passons à la grève générale. Pour moi, j’en accepte le principe, que je propage tant depuis des années. La grève générale m’a toujours paru un excellent moyen pour ouvrir la révolution sociale. Toutefois, gardons-nous bien de tomber dans l’illusion néfaste qu’avec la grève générale, l’insurrection armée devient une superfétation.
On prétend qu’en arrêtant brutalement la production, les ouvriers, en quelques jours, affameront la bourgeoisie, qui, crevant de faim, sera bien obligée de capituler. Je ne puis concevoir absurdité plus grande. Les premiers à crever de faim, en temps de grève générale, ce ne seraient pas les bourgeois qui disposent de tous les produits accumulés, mais les ouvriers qui n’ont que leur travail pour vivre.
La grève générale telle qu’on nous la décrit d’avance, est une pure utopie. Ou bien l’ouvrier, crevant de faim après trois jours de grève, rentrera à l’atelier, la tête basse, et nous compterons une défaite de plus. Ou bien il voudra s’emparer des produits de vive force. Qui trouvera-t-il devant lui pour l’en empêcher ? Des soldats, des gendarmes, sinon des bourgeois eux-mêmes et alors il faudra bien que la question se résolve à coups de fusils et de bombes. Ce sera l’insurrection, et la victoire restera au plus fort.
Préparons-nous donc à cette insurrection inévitable, au lieu de nous borner à préconiser la grève générale comme une panacée s’appliquant à tous les maux. Qu’on n’objecte pas que le gouvernement est armé jusqu’aux dents et sera toujours plus fort que les révoltés. À Barcelone, en 1902, la troupe n’était pas nombreuse. Mais on n’était pas préparé à la lutte armée et les ouvriers ne comprenant pas que le pouvoir politique était le véritable adversaire, envoyaient des délégués au gouverneur pour lui demander de faire céder les patrons.
D’ailleurs, la grève générale, même réduite à ce qu’elle est réellement, est encore une de ces armes à double tranchant qu’il ne faut employer qu’avec beaucoup de prudence. Le service des subsistances ne saurait admettre de suspension prolongée. Il faudra donc s’emparer par la force des moyens d’approvisionnement, et cela tout de suite, sans attendre que la grève se soit développée en insurrection.
Ce n’est donc pas tant à cesser le travail qu’il faut inviter les ouvriers ; c’est bien plutôt à le continuer pour leur propre compte. Faute de quoi, la grève générale se transformerait vite en famine générale, même si l’on avait été assez énergique pour s’emparer dès l’abord de tous les produits accumulés dans les magasins. Au fond, l’idée de grève générale a sa source dans une croyance entre toutes erronée : c’est la croyance qu’avec les produits accumulés par la bourgeoisie, l’humanité pourrait consommer sans produire, pendant je ne sais combien de mois ou d’années. Cette croyance a inspiré les auteurs de deux brochures de propagande publiées il y a une vingtaine d’années : Les Produits de la Terre et les Produits de l’Industrie, et ces brochures ont fait, à mon avis, plus de mal que de bien. La société actuelle n’est pas aussi riche qu’on le croit. Kropotkine a montré quelque part qu’à supposer un brusque arrêt de production, l’Angleterre n’aurait que pour un mois de vivres ; Londres n’en aurait que pour trois jours. Je sais bien qu’il y a le phénomène bien connu de surproduction. Mais toute surproduction a son correctif immédiat dans la crise qui ramène bientôt l’ordre dans l’industrie ; la surproduction n’est jamais que temporaire et relative.
Il faut maintenant conclure. Je déplorais jadis que les compagnons s’isolassent du mouvement ouvrier. Aujourd’hui je déplore que beaucoup d’entre nous, tombant dans l’excès contraire, se laissent absorber par ce même mouvement. Encore une fois, l’organisation ouvrière, la grève, la grève générale, l’action directe, le boycottage, le sabotage et l’insurrection armée elle-même, ce ne sont là que des moyens. L’anarchie est le but. La révolution anarchiste que nous voulons dépasse de beaucoup les intérêts d’une classe : elle se propose la libération complète de l’humanité actuellement asservie, au triple point de vue économique, politique et moral. Gardons-nous donc de tout moyen d’action unilatéral et simpliste ; le syndicalisme, moyen d’action excellent en raison des forces ouvrières qu’il met à notre disposition, ne peut pas être notre unique moyen. Encore moins doit-il nous faire perdre de vue le seul but qui vaille un effort : l’Anarchie.
— E. MALATESTA.
SYNESTHÉSIE
Ce mot est une création du Symbolisme. Antérieurement, la langue française possédait l’adjectif synesthétique, néologisme admis par Littré comme terme de physiologie applicable à un organe « qui éprouve une sensation simultanément avec un autre organe ». Les symbolistes ont appelé synesthésie la double sensation éprouvée pour une impression unique portant sur une région sensible définie. C’est l’explication que donne le Nouveau Larousse de la synesthésie en disant que ce mot désigne un « trouble dans la perception des sensations ». Nous croyons que, dans la synesthésie, il y a une faculté complémentaire de sentir plutôt qu’un trouble, et qu’elle est, comme l’a dit Victor Ségalen, symptôme de progrès plutôt que de dégénérescence. Tout cela est en marge du Dictionnaire de l’Académie Française qui ne connaît ni l’adjectif synesthétique, ni le substantif synesthésie.
La sensation unique éprouvée à la fois par les deux yeux ou les deux oreilles est synesthétique. Les sensations doubles, appelées aussi « sensations associées », éprouvées par une région sensible définie, celle de l’ouïe dans le cas de « l’audition colorée », sont des synesthésies. Mais, en fait, la double sensation de la synesthésie est un fait synesthétique, car elle affecte également deux organes. Dans « l’audition colorée », si l’impression porte directement sur la région sensible définie de l’ouïe, elle atteint indirectement, par communication intérieure, celle de la vue.
Bien que les bases scientifiques du phénomène synesthétique et de la synesthésie soient assez vagues, on les a observés depuis longtemps et ils ont souvent donné lieu à des essais de théories, surtout en art et en littérature. On a souvent comparé une belle ligne à de la musique et parlé de l’architecture et de la couleur musicales. Une œuvre d’art n’est parfaite que lorsqu’elle atteint tous les sens à la fois. L’admirable harmonie de l’art grec n’est faite que de synesthésies, c’est-à-dire d’associations des sensations produites par les rythmes divers des lignes, des formes, des couleurs, des pensées, de l’atmosphère dans laquelle cet art a été réalisé, et de l’accord parfait de tous ces éléments. Les effets sensoriels de l’art, en particulier de la musique, sont extrêmement variés et non moins complexes.
Les poètes védiques usaient des synesthésies. L’ésotérisme hébraïque donnait une couleur aux sons. La théorie de « l’audition colorée » a été souvent appliquée et l’on a imaginé en parallèle la « vision sonore ». Au XVIIIème siècle, un jésuite, le P. Castel, entreprit de construire un « clavecin oculaire » sur lequel les sons seraient représentés par des verres de couleurs, et qui permettrait aux sourds d’entendre la musique. On a eu, avec certains, comme Hoffmann, « l’olfaction sonore », et la lecture que permet aux aveugles l’invention de Braille peut être appelée de la « vision tactile ».
L’imprécision scientifique des synesthésies, qui sont surtout objets de sensations personnelles, a laissé le champ libre à toutes les fantaisies. Il n’y a que virtuosité dans Rimbaud composant son fameux sonnet des Voyelles :
Je dirai quelque jour vos naissances latentes ... »
Mais il y a pas mal de divagations par ailleurs. Il en est pour qui les vibrations d’une corde de guitare s’accompagne d’une image coloriée. Pour d’autres, les jours ont tous une couleur appropriée, ce qui doit faire une polychromie curieusement variée suivant les individus. Les locataires sans pécune, pour qui le jour du terme est si noir, ne se doutent pas qu’ils font de la synesthésie... Il y a des synesthésies mystico-mobilières comme les « prières en forme de canapé », à l’usage, sans doute, des dévots fatigués. D’autres sont géographiques ou géométriques. Huysmans a écrit des pages d’un lyrisme débordant sur les synesthésies du goût par lesquelles son Des Esseintes, jouant de « l’orgue à bouche » et faisant de « l’harmonie et du contrepoint gustatifs », agrémentait de musique les sensations préliminaires du « mal aux cheveux » et de la « gueule de bois » familières aux esthètes de « l’artificiel ». Des synesthésies de même sorte, musicales, colorées, avec des visions voluptueuses, sont aussi produites par l’usage de l’opium, du hachisch et autres drogues qui créent les « paradis artificiels ». Le noble comte Robert de Montesquiou-Fezensac a gagné le titre de « chef des odeurs suaves » par les synesthésies olfactives dont il a parfumé ses œuvres. Elles ont inspiré à des humoristes l’idée de quintessencier la suavité odorante dans le « gendarmure de potassium », et la conjonction harmonieuse de la couleur, du goût et de l’odeur dans la « symphonie des fromages » !.... Un esthéticien, M. Paul Roux, devenu par la grâce symboliste Saint-Pol-Roux-le-Magnifique, qui a vu des anges « vidant leurs joues de neige en des trompettes de soleil », a résumé ainsi ce matagrabolisme à la fois transcendant et chatnoiresque :
Le maximum d’art en littérature ne peut être acquis que par un contingent relevant de tous les sens fédérés et finalement contrôlés par ce que je dénommais jadis le « Vatican des sensations » ! ...
Évidemment, il ne faut pas moins qu’un pape pour éclaircir et diriger une telle affaire.
En dehors de toutes les loufoqueries qu’elles ont favorisées, les synesthésies, nous devons le constater, sont des phénomènes naturels qui ont trouvé un vaste emploi dans l’art et la littérature, en attendant d’être appuyées de théories sérieuses. Leur subjectivité quelque peu occulte et essentiellement personnelle devait séduire tout particulièrement les symbolistes. Avant eux, elles avaient déjà attiré l’attention des poètes, entre autres de Goethe. La poésie de Th. Gautier abonde en tableaux symboliques où l’on relève des synesthésies comme celles de ces titres : Les yeux bleus de la montagne, Symphonie en blanc majeur, etc …. V. Hugo a écrit dans Booz endormi :
Mais autrement sensible aux communications d’émouvantes synesthésies, devait être Baudelaire dont l’œuvre est pleine de ces Correspondances qu’il révéla au Symbolisme dans les magnifiques vers suivants :
Laissent parfois sortir de confuses paroles ;
L’homme y passe, à travers des forêts de symboles
Qui l’observent avec des regards familiers.
Comme de longs échos qui de loin se confondent
En une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
Il est des parfums frais comme des chairs d’enfants,
Doux comme le hautbois, verts comme les prairies,
Et d’autres, corrompus, riches et triomphants,
Ayant l’expansion des choses infinies
Comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens,
Qui chantent les transports de l’esprit et des sens.
On ne pouvait faire un emploi plus admirable des synesthésies et les faire mieux comprendre. Et c’est à un tel poète que les académiciens, ceux qui, a dit Tailhade reprochent d’être « insensible » et « volontairement malsain » !.... :
Tailhade a écrit :
Vert comme un chant de hautbois. »
Le « vert » du hautbois nous paraît bien acide auprès de la douceur baudelairienne.
Maupassant a dit :
« Je ne sais vraiment si je respirais de la musique, ou si j’entendais des parfums ou si je dormais dans les étoiles. »
L’œuvre de Verlaine abonde en synesthésies. Elles sont l’élément essentiel de son Art poétique où il a demandé :
Préconisant le rythme de l’Impair :
Et :
Il ajoutait :
Pas la Couleur, rien que la nuance !
Oh ! la nuance seule fiance
Le rêve au rêve et la flûte au cor. »
Ce sont aussi des images comme celles-ci que l’on rencontre dans Verlaine : « Votre âme est un paysage choisi » — sanglots d’extase des jets d’eau — pourpre des âmes — vagues langueurs des pins et des arbousiers — « Ta voix, étrange vision » — « l’arôme insigne de ta pâleur de cygne » — « la candeur de ton odeur » — et enfin :
De mon cœur mirant son tronc plié d’aune
Au tain violet de l’eau des Regrets. »
Toute l’œuvre des symbolistes abonde en synesthésies plus ou moins hardies. Elles correspondent aux sensations profondes de l’être et elles en sont le commentaire plus ou moins lucide et précis, calme ou tumultueux.
Victor Ségalen a écrit sur Les Synesthésies et l’école symboliste, dans le Mercure de France (avril 1902), un article très intéressant qu’on peut utilement consulter.
— Édouard ROTHEN.
SYNTHÈSE (ANARCHISTE)
On désigne par « synthèse anarchiste » une tendance qui se fait actuellement jour au sein du mouvement libertaire, cherchant à réconcilier et ensuite à « synthétiser » les différents courants d’idée qui divisent ce mouvement en plusieurs fractions plus ou moins hostiles les unes aux autres. Il s’agit, au fond, d’unifier, dans une certaine mesure, la théorie et aussi le mouvement anarchistes en un ensemble harmonieux, ordonné, fini. Je dis : dans une certaine mesure car, naturellement, la conception anarchiste ne pourrait, ne devrait jamais devenir rigide, immuable, stagnante. Elle doit rester souple, vivante, riche d’idées et de tendances variées. Mais souplesse ne doit pas signifier confusion. Et, d’autre part, entre immobilité et flottement il existe un état intermédiaire. C’est précisément cet état intermédiaire que la « synthèse anarchiste » cherche à préciser, à fixer et à atteindre.
Ce fut surtout en Russie, lors de la révolution de 1917, que la nécessité d’une telle unification, d’une telle « synthèse », se fit sentir. Déjà très faible matériellement (peu de militants, pas de bons moyens de propagande, etc. ) par rapport à d’autres courants politiques et sociaux, l’anarchisme se vit affaibli encore plus, lors de la révolution russe, par suite des querelles intestines qui le déchiraient. Les anarcho-syndicalistes ne voulaient pas s’entendre avec les anarchistes-communistes et, en même temps, les uns et les autres se disputaient avec les individualistes (sans parler d’autres tendances). Cet état de choses impressionna douloureusement plusieurs camarades de diverses tendances. Persécutés et finalement chassés de la grande Russie par le gouvernement bolcheviste, quelques-uns de ces camarades s’en allèrent militer en Ukraine où l’ambiance politique était plus favorable, et où, d’accord avec quelques camarades ukrainiens, ils décidèrent de créer un mouvement anarchiste unifié, recrutant des militants sérieux et actifs partout où ils se trouvaient, sans distinction de tendance. Le mouvement acquit tout de suite une ampleur et une vigueur exceptionnelles. Pour prendre pied et s’imposer définitivement, il ne lui manquait qu’une chose : une certaine base théorique.
Me sachant un adversaire résolu des querelles néfastes parmi les divers courants de l’anarchisme, sachant aussi que je songeais, comme eux, à la nécessité de les réconcilier, quelques camarades vinrent me chercher dans une petite ville de la Russie centrale où je séjournais, et me proposèrent de partir en Ukraine, de prendre part à la création d’un mouvement unifié, de lui fournir un fond théorique et de développer la thèse dans la presse libertaire.
J’acceptai la proposition. En novembre 1918, le mouvement anarchiste unifié en Ukraine fut définitivement mis en route. Plusieurs groupements se formèrent et envoyèrent leurs délégués à la première conférence constitutive qui créa la « Confédération anarchiste de l’Ukraine Nabat (Tocsin) ». Cette conférence élabora et adopta à l’unanimité une Déclaration proclamant les principes fondamentaux du nouvel organisme. Il fut décidé que très prochainement cette brève déclaration de principes serait amplifiée, complétée et commentée dans la presse libertaire. Les événements tempétueux empêchèrent ce travail théorique. La confédération du Nabat dut mener des luttes ininterrompues et acharnées. Bientôt elle fut, à son tour, « liquidée » par les autorités bolchevistes qui s’installèrent en Ukraine. A part quelques articles de journaux, la Déclaration de la première conférence du Nabat fut et restera le seul exposé de la tendance unifiante (ou « synthétisante ») dans le mouvement anarchiste russe.
Les trois idées maîtresses qui, d’après la Déclaration, devraient être acceptées par tous les anarchistes sérieux afin d’unifier le mouvement, sont les suivantes :
-
Admission définitive du principe syndicaliste, lequel indique la vraie méthode de la révolution sociale ;
-
Admission définitive du principe communiste (libertaire), lequel établit la base d’organisation de la nouvelle société en formation ;
-
Admission définitive du principe individualiste, l’émancipation totale et le bonheur de l’individu étant le vrai but de la révolution sociale et de la société nouvelle.
Tout en développant ces idées, la Déclaration tâche de définir nettement la notion de la « révolution sociale » et de détruire la tendance de certains libertaires cherchant à adapter l’anarchisme à la soi-disant « période transitoire ».
Cela dit, nous préférons, au lieu de reprendre les arguments de la Déclaration, développer nous-mêmes l’argumentation théorique de la synthèse.
La première question à résoudre est celle-ci :
-
L’existence de divers courants anarchistes ennemis, se disputant entre eux, est-ce un fait positif ou négatif ? La décomposition de l’idée et du mouvement libertaires en plusieurs tendances s’opposant les unes aux autres, favorise-t-elle ou, au contraire, entrave-t-elle les succès de la conception anarchiste ? Si elle est reconnue favorable, toute discussion est inutile. Si, au contraire, elle est considérée comme nuisible, il faut tirer de cet aveu toutes les conclusions nécessaires.
À cette première question, nous répondons ceci :
-
Au début, lorsque l’idée anarchiste était encore peu développée, confuse, il fut naturel et utile de l’analyser sous tous ses aspects, de la décomposer, d’examiner à fond chacun de ses éléments, de les confronter, de les opposer les uns aux autres, etc. C’est ce qui a été fait. L’anarchisme fut décomposé en plusieurs éléments (ou courants). Ainsi l’ensemble, trop général et vague, fut disséqué, ce qui aida à approfondir, à étudier à fond aussi bien cet ensemble que ces éléments. A cette époque, le démembrement de la conception anarchiste fut donc un fait positif. Diverses personnes s’intéressant à divers courants de l’anarchisme, les détails et l’ensemble y gagnèrent en profondeur et en précision. Mais, par la suite, une fois cette première œuvre accomplie, après que les éléments de la pensée anarchiste (communisme, individualisme, syndicalisme) furent tournés et retournés en tous sens, il fallait penser à reconstituer, avec ces éléments bien travaillés, l’ensemble organique d’où ils provenaient. Après une analyse fondamentale, il fallait retourner (sciemment) à la bienfaisante synthèse.
Fait bizarre : on ne pensa plus à cette nécessité. Les personnes qui s’intéressaient à tel élément donné de l’anarchisme, finirent par le substituer à l’ensemble. Naturellement, elles se trouvèrent bientôt en désaccord et, finalement, en conflit avec ceux qui traitaient de la même manière d’autres parcelles de la vérité entière. Ainsi, au lieu d’aborder l’idée de fusionnement des éléments épars (qui, pris séparément, ne pouvaient plus servir à grand chose) en un ensemble organique, les anarchistes entreprirent pour de longues années la tâche stérile d’opposer haineusement leurs « courants » les uns aux autres. Chacun considérait « son » courant, « sa » parcelle pour l’unique vérité et combattait avec acharnement les partisans des autres courants. Ainsi commença, dans les rangs libertaires, ce piétinement sur place, caractérisé par l’aveuglement et l’animosité mutuelle, qui continue jusqu’à nos jours et qui doit être considéré comme nuisible au développement normal de la conception anarchiste.
Notre conclusion est claire. Le démembrement de l’idée anarchiste en plusieurs courants a rempli son rôle. Il n’a plus aucune utilité. Rien ne peut plus le justifier. Il entraîne maintenant le mouvement dans une impasse, il lui cause des préjudices énormes, il n’offre plus — ni ne peut offrir — rien de positif. La première période — celle où l’anarchisme se cherchait, se précisait et se fractionnait fatalement à cette besogne — est terminée. Elle appartient au passé. Il est grand temps d’aller plus loin.
Si l’éparpillement de l’anarchisme est actuellement un fait négatif, préjudiciable, il faut chercher à y mettre fin. Il s’agit de se rappeler l’ensemble entier, de recoller les éléments épars, de retrouver, de reconstruire sciemment la synthèse abandonnée.
Une autre question surgit alors : cette synthèse, est-elle possible actuellement ? Ne serait-elle pas une utopie ? Pourrait-on lui fournir une certaine base théorique ?
Nous répondons : oui, une synthèse de l’anarchisme (ou, si l’on veut, un anarchisme « synthétique ») est parfaitement possible. Elle n’est nullement utopique. D’assez fortes raisons d’ordre théorique parlent en sa faveur. Notons brièvement quelques-unes de ces raisons, les plus importantes, dans leur suite logique :
-
Si l’anarchisme aspire à la vie, s’il escompte un triomphe futur, s’il cherche à devenir un élément organique et permanent de la vie, une de ses forces actives, fécondantes, créatrices, alors il doit chercher à se trouver le plus près possible de la vie, de son essence, de son ultime vérité. Ses bases idéologiques doivent concorder le plus possible avec les éléments fondamentaux de la vie. Il est clair, en effet, que si les idées primordiales de l’anarchisme se trouvaient en contradiction avec les vrais éléments de la vie et de l’évolution, l’anarchisme ne pourrait être vital. Or, qu’est-ce que la vie ? Pourrait-on, en quelque sorte, définir et formuler son essence, saisir et fixer ses traits caractéristiques ? Oui, on peut le faire. Il s’agit, certes, non pas d’une formule scientifique de la vie — formule qui n’existe pas — mais d’une définition plus ou moins nette et juste de son essence visible, palpable, concevable. Dans cet ordre d’idée, la vie est, avant tout, une grande synthèse : un ensemble immense et compliqué, ensemble organique et original, de multiples éléments variés.
-
La vie est une synthèse. Quelles sont donc l’essence et l’originalité de cette synthèse ? L’essentiel de la vie est que la plus grande variété de ses éléments — qui se trouvent de plus en un mouvement perpétuel réalise en même temps, et aussi perpétuellement, une certaine unité ou, plutôt, un certain équilibre. L’essence de la vie, l’essence de sa synthèse sublime, est la tendance constante vers l’équilibre, voire la réalisation constante d’un certain équilibre, dans la plus grande diversité et dans un mouvement perpétuel. (Notons que l’idée d’un équilibre de certains éléments comme étant l’essence bio-physique de la vie se confirme par des expériences scientifiques physico-chimiques.)
-
La vie est une synthèse. La vie (l’univers, la nature) est un équilibre (une sorte d’unité) dans la diversité et dans le mouvement (ou, si l’on veut, une diversité et un mouvement en équilibre). Par conséquent, si l’anarchisme désire marcher de pair avec la vie, s’il cherche à être un de ses éléments organiques, s’il aspire à concorder avec elle et aboutir à un vrai résultat, au lieu de se trouver en opposition avec elle pour être finalement rejeté, il doit, lui aussi, sans renoncer à la diversité ni au mouvement, réaliser aussi, et toujours, l’équilibre, la synthèse, l’unité.
Mais il ne suffit pas d’affirmer que l’anarchisme peut être synthétique : il doit l’être. La synthèse de l’anarchisme n’est pas seulement possible, pas seulement souhaitable : elle est indispensable. Tout en conservant la diversité vivante de ses éléments, tout en évitant la stagnation, tout en acceptant le mouvement — conditions essentielles de sa vitalité — l’anarchisme doit chercher, en même temps, l’équilibre dans cette diversité et ce mouvement même.
La diversité et le mouvement sans équilibre, c’est le chaos. L’équilibre sans diversité ni mouvement, c’est la stagnation, la mort. La diversité et le mouvement en équilibre, telle est la synthèse de la vie. L’anarchisme doit être varié, mouvant et, en même temps, équilibré, synthétique, uni. Dans le cas contraire, il ne sera pas vital.
-
Notons, enfin, que le vrai fond de la diversité et du mouvement de la vie (et partant de la synthèse) est la création, c’est-à-dire la production constante de nouveaux éléments, de nouvelles combinaisons, de nouveaux mouvements, d’un nouvel équilibre. La vie est une diversité créatrice. La vie est un équilibre dans une création ininterrompue. Par conséquent, aucun anarchiste ne pourrait prétendre que « son » courant est la vérité unique et constante, et que toutes les autres tendances dans l’anarchisme sont des absurdités. Il est, au contraire, absurde qu’un anarchiste se laisse engager dans l’impasse d’une seule petite « vérité », la sienne, et qu’il oublie ainsi la grande vérité réelle de la vie : la création perpétuelle de formes nouvelles, de combinaisons nouvelles, d’une synthèse constamment renouvelée.
La synthèse de la vie n’est pas stationnaire : elle crée, elle modifie constamment ses éléments et leurs rapports mutuels.
L’anarchisme cherche à participer, dans les domaines qui lui sont accessibles, aux actes créateurs de la vie. Par conséquent, il doit être, dans les limites de sa conception, large, tolérant, synthétique, tout en se trouvant en mouvement créateur.
L’anarchiste doit observer attentivement, avec perspicacité, tous les éléments sérieux de la pensée et du mouvement libertaires. Loin de s’engouffrer dans un seul élément quelconque, il doit chercher l’équilibre et la synthèse de tous ces éléments donnés. Il doit, de plus, analyser et contrôler constamment sa synthèse, en la comparant avec les éléments de la vie elle-même, afin d’être toujours en harmonie parfaite avec cette dernière. En effet, la vie ne reste pas sur place, elle change. Et, par conséquent, le rôle et les rapports mutuels de divers éléments de la synthèse anarchiste ne resteront pas toujours les mêmes : dans divers cas, ce sera tantôt l’un, tantôt l’autre de ces éléments qui devra être souligné, appuyé, mis en action.
Quelques mots sur la réalisation concrète de la synthèse.
-
Il ne faut jamais oublier que la réalisation de la révolution, que la création des formes nouvelles de la vie incomberont non pas à nous, anarchistes isolés ou groupés idéologiquement, mais aux vastes masses populaires qui, seules, seront à même d’accomplir cette immense tâche destructive et créatrice. Notre rôle, dans cette réalisation, se bornera à celui d’un ferment, d’un élément de concours, de conseil, d’exemple. Quant aux formes dans lesquelles ce processus s’accomplira, nous ne pouvons que les entrevoir très approximativement. Il est d’autant plus déplacé de nous quereller pour des détails, au lieu de nous préparer, d’un élan commun, à l’avenir.
-
Il n’est pas moins déplacé de réduire toute l’immensité de la vie, de la révolution, de la création future, à de petites idées de détail et à des disputes mesquines. Face aux grandes tâches qui nous attendent, il est ridicule, il est honteux de nous occuper de ces mesquineries. Les libertaires devront s’unir sur la base de la synthèse anarchiste. Ils devront créer un mouvement anarchiste uni, entier, vigoureux. Tant qu’ils ne l’auront pas créé, ils resteront en dehors de la vie.
Dans quelles formes concrètes pourrions-nous prévoir la réconciliation, l’unification des anarchistes et, ensuite, la création d’un mouvement libertaire unifié ?
Nous devons souligner, avant tout, que nous ne nous représentons pas cette unification comme un assemblage « mécanique » des anarchistes de diverses tendances en une sorte de camp bigarré où chacun resterait sur sa position intransigeante. Une telle unification serait non pas une synthèse mais un chaos. Certes, un simple rapprochement amical des anarchistes de diverses tendances et une plus grande tolérance dans leurs rapports mutuels (cessation d’une polémique violente, collaboration dans des publications anarchistes, participation aux mêmes organismes actifs, etc.) seraient un grand pas en avant par rapport à ce qui se passe actuellement dans les rangs libertaires. Mais nous considérons ce rapprochement et cette tolérance comme, seulement, le premier pas vers la création de la vraie synthèse anarchiste et d’un mouvement libertaire unifié. Notre idée de la synthèse et de l’unification va beaucoup plus loin. Elle prévoit quelque chose de plus fondamental, de plus « organique ».
Nous croyons que l’unification des anarchistes et du mouvement libertaire devra se poursuivre, parallèlement, en deux sens, notamment :
-
Il faut commencer immédiatement un travail théorique cherchant à concilier, à combiner, à synthétiser nos diverses idées paraissant, à première vue, hétérogènes. Il est nécessaire de trouver et de formuler dans les divers courants de l’anarchisme, d’une part, tout ce qui doit être considéré comme faux, ne coïncidant pas avec la vérité de la vie et devant être rejeté ; et, d’autre part, tout ce qui doit être constaté comme étant juste, appréciable, admis. Il faut, ensuite, combiner tous ces éléments justes et de valeur, en créant avec eux un ensemble synthétique. (C’est surtout dans ce premier travail préparatoire que le rapprochement des anarchistes de diverses tendances et leur tolérance mutuelle pourraient avoir la grande importance d’un premier pas décisif.) Et, enfin, cet ensemble devra être accepté par tous les militants sérieux et actifs de l’anarchisme comme base de la formation d’un organisme libertaire uni, dont les membres seront ainsi d’accord sur un ensemble de thèses fondamentales acceptées par tous.
Nous avons déjà cité l’exemple concret d’un tel organisme : la confédération Nabat, en Ukraine. Ajoutons ici à ce que nous avons déjà dit plus haut que l’acceptation par tous les membres du Nabat de certaines thèses communes n’empêchaient nullement les camarades de diverses tendances d’appuyer surtout, dans leur activité et leur propagande, les idées qui leur étaient chères. Ainsi, les uns (les syndicalistes) s’occupaient surtout des problèmes concernant la méthode et l’organisation de la révolution ; les autres (communistes) s’intéressaient de préférence à la base économique de la nouvelle société ; les troisièmes (individualistes) faisaient ressortir spécialement les besoins, la valeur réelle et les aspirations de l’individu. Mais la condition obligatoire pour être accepté au Nabat était l’admission de tous les trois éléments comme parties indispensables de l’ensemble et le renoncement à l’état d’hostilité entre les diverses tendances. Les militants étaient donc unis d’une façon « organique », car, tous, ils acceptaient un certain ensemble de thèses fondamentales. C’est ainsi que nous nous représentons l’unification concrète des anarchistes sur la base d’une synthèse des idées libertaires théoriquement établie.
-
Simultanément et parallèlement audit travail théorique, devra se créer l’organisation unifiée sur la base de l’anarchisme compris synthétiquement.
Pour terminer, soulignons encore une fois que nous ne renonçons nullement à la diversité des idées et des courants au sein de l’anarchisme. Mais il y a diversité et diversité. Celle, notamment, qui existe dans nos rangs aujourd’hui est un mal, est un chaos. Nous considérons son maintien comme une très lourde faute. Nous sommes d’avis que la variété de nos idées ne pourra être et ne sera un élément progressif et fécond qu’au sein d’un mouvement commun, d’un organisme uni, édifié sur la base de certaines thèses générales admises par tous les membres et sur l’aspiration à une synthèse.
Ce n’est que dans l’ambiance d’un élan commun, ce n’est que dans les conditions de recherches de thèses justes et de leur acceptation, que nos aspirations, nos discussions et même nos disputes auront de la valeur, seront utiles et fécondes. (C’était précisément ainsi au Nabat.) Quant aux disputes et aux polémiques entre de petites chapelles prêchant chacune « sa » vérité unique, elles ne pourront aboutir qu’à la continuation du chaos actuel, des querelles intestines interminables et de la stagnation du mouvement.
Il faut discuter en s’efforçant de trouver l’unité féconde, et non pas d’imposer à tout prix « sa » vérité contre celle d’autrui. Ce n’est que la discussion du premier genre qui mène à la vérité. Quant à l’autre discussion, elle ne mène qu’à l’hostilité, aux vaines querelles et à la faillite.
— VOLINE.
SYPHILIS
n. f.
Les maladies vénériennes se multiplient de façon ridicule. On a raison de s’en indigner quand on songe qu’il s’agit de maladies évitables et qu’il est stupide d’être malade quand on peut faire autrement. Il suffit de savoir et d’ouvrir l’œil. Trois fléaux sociaux absorbent l’attention : l’alcoolisme, la tuberculose, la syphilis.
De l’alcoolisme, maladie évitable, on a tout dit. Il est clair que l’homme, qui absorbe de la vinasse ou de l’eau de vie n’ignore pas qu’il s’empoisonne. S’il continue, c’est qu’il est sans énergie ou qu’il a du goût pour le suicide. Voilà donc une maladie formidable qui demain doit disparaître, si on le veut.
On n’en saurait dire autant de la tuberculose. Tout le monde la respire sans s’en douter. Si l’on peut, à la rigueur, éviter les contacts des poitrinaires, il est fort difficile de résister il la contagion qui dérive des crachats pulvérulents que les cracheurs malpropres, inconscients, mais malfaisants, répandent autour d’eux.
La syphilis, enfin, comme la blennorragie, est une maladie dont l’homme peut jouir à sa guise ou qu’il peut se refuser, s’il a quelque respect de sa santé. Il suffit de ne pas s’y exposer. Elle sera plus facile à guérir même que l’alcoolisme, que soutiennent encore quelques vieux préjugés sur l’alcool-aliment, sans compter les honteux intérêts capitalistes qui le soutiennent. Rien ne justifie ni n’excuse la vérole.
D’où vient que seules parmi les maladies visiblement contagieuses, les affections vénériennes soient arrivées à un tel degré de développement ?
Malgré toute leur notoriété, elles sont pourtant encore inconnues d’une foule de gens qui s’y exposent ingénument. Car on ne saurait trop rappeler qu’il existe une syphilis des innocents.
J’entends bien que beaucoup de citoyens sont si insouciants qu’ils restent indifférents aux maux dont ils peuvent être victimes. Ces gens dangereux ne m’intéressent point.
Bien plus intéressants sont les ignorants. Et l’on en compte une foule non pas seulement parmi les gens du peuple qui sont excusables, mais dans la classe dite cultivée, ayant reçu une instruction compliquée dans les hautes écoles. Le nombre de petits collégiens qui sont syphilisés les jours où ils sortent en permission, hors des chiourmes officielles où l’on est censé en faire des citoyens modèles, est énorme. Quand, à 18 ans, j’ai quitté le lycée pour apprendre la médecine, j’étais aussi ignorant des choses de la sexualité et de la vérole que le jour où j’ai quitté ma nourrice. Que de camarades sont contaminés en arrivant à la caserne où leur naïveté est l’objet de classiques railleries !
Duclaux, dans son Hygiène sociale, écrit :
« Je demande seulement qu’on me dise, quand un jeune homme ou une jeune fille s’abandonnent à une caresse dangereuse, si la société a fait ce qu’elle a pu pour les en détourner. Ses intentions étaient peut-être bonnes, mais quand il a fallu en venir au fait à préciser, une sotte pudeur l’a retenue et elle a laissé ses enfants sans viatique. »
C’est là qu’est tout le mal : une fausse pudeur qu’il ne faut pas confondre avec la vraie pudeur ni la décence, qualité sociale d’ordre esthétique et défensif, que je me garderai bien d’attaquer. Cette fausse pudeur est encore telle à l’heure présente, qu’il faut quelque courage pour placarder sur les murs d’une ville, l’annonce d’une conférence sur les maladies vénériennes. Le médecin qui s’y expose risque un lambeau de sa réputation. N’est-il point des sujets qu’on ne devrait aborder qu’en rougissant ? …
Laissons la rougeur de la honte au front des exploiteurs de la bêtise humaine à qui nous devons exclusivement l’essor toujours croissant de l’endémie vénérienne. Laissons-la aux Tartufes que la contemplation d’un atome de peau humaine fait frétiller et qui ne sauraient s’instruire sur les dangers de la syphilis sans entrer en rut.
L’Antiquité n’a point connu ce désordre moral qu’on appelle la pudibonderie. A juste titre, les antiques, aussi admirateurs que respectueux de la Nature et de la Beauté, ont parlé et écrit sur les choses de l’Amour, sans songer à mal, parce que, s’il est une fonction dont l’homme doive être le serviteur, c’est celle de la reproduction, chargée d’assurer la perpétuité et la défense de l’espèce. Les organes sexuels n’ont aucune raison sérieuse d’être mis à l’écart des autres organes utiles à l’être vivant. L’Antiquité érigea même un culte pour les organes qui symbolisaient la reproduction. Et si elle a quelque peu dégénéré, si elle s’est livrée à la débauche tout comme nous, ce n’est pas à ce culte que ce malheur a été dû.
La décence sexuelle des Anciens n’a pas eu à résister aux exhibitions pornographiques de notre littérature et de notre imagerie, nées de notre immorale pudibonderie. L’idée d’une telle pourriture ne leur serait pas venue à I’esprit, car les choses de la sexualité ne pouvaient être pour eux l’objet d’une curiosité malsaine.
Je n’hésiterai pas à faire l’hommage de notre luxure contemporaine aux inventeurs maudits des parties dites honteuses, par suite des maladies honteuses, dont l’origine n’est pas ailleurs que dans les pratiques de l’Amour sexuel, pratiques que certaines morales religieuses ont réprouvées.
Le jour où naquit le mythe du Péché originel a vu naître les soi-disant hontes de l’Amour sexuel et la notion scandaleuse de l’impureté. La syphilis sociale était au bout. Car si, dans nos mœurs, l’Amour ne saurait être pratiqué honorablement en dehors de certains rites conventionnels et officiels ; si les inconvénients dérivant de cette pratique ne sauraient être avoués qu’en rougissant ou sans se frapper la poitrine, il devait s’ensuivre qu’il était de bon ton de tenir la jeunesse dans l’ignorance crasse des dangers qui la menacent. Cacher, refouler le malheur dont on a été victime par ignorance voulue, c’est aggraver le mal ; c’est en préparer la multiplication, c’est aboutir en fin de compte à une catastrophe sociale à laquelle il n’est que temps de remédier. Un homme averti en vaut deux ; avertissons donc.
Mais d’abord, établissons que la vérole est bien un grandissime fléau social. Que de gens, même instruits, y voient encore un petit malheur individuel, alors qu’elle nous déborde, particulièrement depuis la guerre, dont une des principales insanités a été d’aggraver la plupart des endémies, morales autant que physiques. Nous buvons comme des pourceaux depuis la guerre ; nous fumons comme des locomotives depuis la guerre, histoire d’enrichir le capital ; mais la guerre par elle-même a été pourvoyeuse de syphilitiques autant que de victimes de la sauvagerie humaine. Le directeur du service de santé de l’armée du Rhin écrit :
« Du fait de la guerre, les maladies vénériennes se sont terriblement multipliées. Le danger qui menace notre jeunesse est plus grand qu’autrefois. Le seul moyen de lutter est d’instruire les jeunes gens. »
En 1922, le Dr Helme, un publiciste averti, écrivait :
« Les ravages de l’avarie sont tels, qu’elle coûte chaque année au pays des centaines de millions. Maladie du cerveau et de la moelle, tabées, paralysie générale, fausses couches, enfants mal venus, enfants morts nés, demi-fous, stérilité des ménages : on ne se doute pas des maux qu’entraîne la redoutable infection. »
En 1914, le Dr Terraza écrivait :
« La syphilis frappe aujourd’hui un cinquième de notre population et elle tue dans d’effrayantes proportions ceux qui en sont atteints. Comme un héritage, la syphilis se transmet à l’enfant ; elle décime notre race dès le berceau. C’est elle qui est la grande pourvoyeuse de petits dégénérés. »
D’après le Dr Leredde, spécialiste réputé, la syphilis tue chaque année, en France, 40.000 enfants avant leur naissance et 40.000 autres entre un jour et 5 ans.
Le Dr Mourier, directeur de l’Assistance publique, a constaté qu’en dix ans la syphilis nous a coûté un million cinq cent mille vies humaines, autant que la guerre ! Syphilis et guerre, deux abattoirs humains.
La mortalité annuelle par les maladies infectieuses dessine une courbe au sommet de laquelle trône l’avarie avec 140.000 morts, et autant par tuberculose (seul le joyeux alcool rivalise avec elle) ; puis, très loin, par derrière, on trouve la diphtérie avec 2.500 morts, la typhoïde avec 2.100 morts, la coqueluche avec 1.500 morts, la rougeole avec 1.300 morts, la scarlatine avec 600 morts. On ne meurt pas, on se tue. Si les animaux savaient parler, comme ils nous diraient qu’ils sont plus sages que l’homme !
J’indiquerai, maintenant, deux causes essentielles des dangers de la syphilis :
-
son épouvantable contagiosité ;
-
son hypocrisie.
La syphilis est presque tout de suite une maladie chronique aux manifestations les plus variées, les plus inattendues et dont le plus grand nombre, à l’âge de la plus entreprenante virilité, sont porteuses des germes de la contagion. Le syphilitique traîne sa hideuse maladie contagieuse pendant de longs mois, de longues années, sans qu’apparemment sa santé générale en souffre. C’est un promeneur de microbes dont personne ne se méfie, pas même lui ; il n’abandonne pas ses occupations professionnelles ; les plus intimes font crédit et confiance à la graine qu’il sème à tous les coins. On ne se lasse point de se soigner d’une typhoïde : il faut que, rapidement, on en guérisse ou que l’on en meure. Mais de la vérole, c’est différent. On en mourra peut-être dans 15 ou 20 ans ; mais aujourd’hui le mal est tellement sournois que l’on oublie bien vite les prescriptions du médecin.
Partout la contagion nous guette. Quand, au retour de sa campagne d’Italie, au XVIème siècle, Charles VIII rapporta, comme rançon de sa victoire, la syphilis en France, cachée sous la livrée de ses soldats, ce fut comme une explosion de syphilis collective. On en connut de véritables épidémies. On en constate encore de nos jours quand un revenant du service militaire, où il a appris à tuer, réapparaît au village, porteur de la vérole, syphilise les fillettes, lesquelles syphilisent leur fiancé, leurs parents, leur époux, leurs enfants. Tout cela fait du bel ouvrage, tout comme les gaz asphyxiants.
Mais on a connu des épidémies bien plus stupéfiantes. A Brive, en 1874, on connut cent contaminations, produit d’une sage-femme, porteuse au bout du doigt d’une lésion syphilitique.
Mais, en 1862, à Bergame, on avait connu une terrible épidémie partie d’une fillette syphilitique insoupçonnée, qui servit à vacciner dix enfants dont cinq devinrent syphilitiques. Voyez maintenant les ricochets. Appelons ces cinq enfants A, B, C, D, E.
L’enfant A meurt de syphilis en 1863, après avoir infecté :
-
sa mère qui le nourrissait (chancre du sein) ;
-
sa soeur, âgée de 20 ans, par l’intermédiaire d’une cuiller ;
-
une tante qui, venant d’accoucher et ayant trop de lait, lui donna accidentellement le sein. Cette tante infecta :
-
son enfant nouveau-né qui succomba à la syphilis ;
-
un de ses neveux également nouveau-né, à qui elle donna accidentellement le sein.
Ce dernier infecta sa mère.
-
Total : 6 cas et 2 morts. L’enfant B et l’enfant C infectent leur mère qui les nourrit et celles-ci leur mari. L’enfant C meurt de syphilis en 1862. L’enfant D meurt après avoir contagionné son petit frère par l’intermédiaire d’une cuiller commune, et sa mère qui infecte le père. Enfin, l’enfant E infecte d’abord sa nourrice, puis son frère de lait par une cuiller, puis sa mère qui, venant d’accoucher, donnait le sein à son premier né pour favoriser la montée du lait ; cette mère donne à son tour la syphilis à son dernier né et à son mari. Total final : cinq contaminations vaccinales, 18 contaminations par ricochet et quatre morts du fait de ce transmetteur syphilitique.
On a remarqué le rôle étrange de la cuiller. Ce petit instrument est vraiment le symbole de la contagiosité. Tout est bon au microbe pour se multiplier : la pipe, le porte-cigarette, la sucette, le biberon, le simple baiser innocent ou sensuel, qui met en contact deux muqueuses. En vérité, c’est plus varié que pour la tuberculose, dont cependant la syphilis partage aussi la. contagiosité par l’air, grâce à l’infernal tabac. Celui-ci produit des lésions et des irritations buccales qui deviennent un parfait bouillon de culture pour le microbe de la syphilis qui se promène autour de nous tout aussi bien que le bacille de Koch. Syphilis et tabac vont aussi bien ensemble que syphilis et alcool.
Mais j’en viens à l’hypocrisie de la vérole. C’est bien à elle que devrait s’appliquer l’épithète de honteuse. L’hypocrisie est l’arme des faibles et des lâches. On connaît, socialement, cette arme dont font un si bel usage tant de citoyens éduqués dans les officines de la tartuferie, officielle ou privée, où l’on acquiert la phobie des choses si respectables de l’amour normal.
La première manifestation de l’hypocrisie pour la syphilis, forme particulièrement redoutable, est d’être une maladie indolente (sans douleur). L’homme a peur de la douleur et ne croit qu’à la douleur. Voyez-le pris d’une rage de dent et voyez sa course chez le dentiste. Le syphilisé ne souffre pas ; s’il ne souffre pas, il ne peut se croire malade. J’ai entendu de nombreux syphilisés cette terrifiante déclaration :
« Comment croire qu’on est mortellement atteint et qu’on est un danger public quand on a l’illusion de se bien porter ? »
Sauf en de rares complications, la syphilis ne fait pas de bruit. Quelle belle leçon de l’infiniment petit à l’homme qui se croit infiniment fort ! Le petit microbe en forme de vrille (son nom médical est tréponème) semble raisonner ainsi : j’ai besoin de la chair humaine pour vivre ; si je me démasque, c’en est fait de moi ; l’homme est plus malin, mieux outillé, procédons à l’aveuglette ! Dévorons en silence. Tel cet autre microbe malfaisant qui dévore le sucre du raisin pour en faire de l’alcool et déverse à l’homme l’unique déchet de sa vie, le poison adoré que nous mettons en bouteille. Nous en mourrons, mais sans nous douter de la cause de notre mort. Tous les microbes de la création font un peu comme cela, mais c’est à celui de la syphilis que revient la palme.
La porte d’entrée de la syphilis est toujours un petit bobo insignifiant que l’on porte à la peau ou surtout à une muqueuse, cette fine peau satinée et fragile qui recouvre les organes internes ou les orifices (bouche, nez, organes sexuels, ce qu’on appelle les parties secrètes, car nous sommes toujours au sein du mystère redoutable).
Une peau intacte, une muqueuse intacte se défendent assez bien. Mais à la moindre éraflure, voilà le microbe tout à son aise. Il s’installe et vite se met à pulluler comme les sables de la mer. Il lui faut trois semaines environ pour déposer sur notre malencontreuse éraflure toute une colonie d’enfants. Il y en a des millions (car le tréponème est un être microscopique).
Mais que l’on songe à ce qui se passe pendant ces trois semaines où l’on attend le chancre en formation, c’est-à-dire la première manifestation visible de la maladie. On est, hélas, déjà contagieux ! Et ils sont bien penauds les pauvres amoureux qui, dans ce laps de temps, se risquent aux amours vénales des maisons de prostitution avec de tristes professionnelles du trottoir, sous le vain prétexte que les femmes à plaisir (pauvres esclaves !) sont visitées régulièrement par des médecins et mises à l’index quand elles sont trouvées malades ! Quelle erreur, quelle duperie, quelle sinistre plaisanterie que ces mesures de soi-disant précautions publiques que l’on baptise d’un nom : la prostitution réglementée ! On traque la femme et on laisse l’homme errer en liberté, semer sa graine où il lui semble bon. Mais on ne traque pas le microbe qui voyage de sujet à sujet, tout comme les totos célèbres des tranchées. En attendant son chancre, que peut-être même il ignore, le syphilisé offre son microbe, et même une heure après la visite médicale, à supposer qu’à cette visite, l’infâme chancre trouve le moyen de se cacher dans un tout petit pli de la muqueuse d’où personne n’ira le déloger. La contagion syphilitique est un exemple de grande perfidie. Et quand on pense que la Police en est encore la complice, répandant dans la foule la fausse notion de la sécurité !
Qui s’y frotte s’y pique ! ne l’oublions pas. Et alors on voit apparaître la première lésion, le chancre primitif, dans le lieu même du contact malheureux : l’œil, si l’on a promené ses lèvres syphilisées sur l’œil de l’aimée, les lèvres si le baiser sur la bouche, si fréquent, a été empoisonné ; ailleurs enfin si les imprudentes caresses n’ont pas suffi à l’agresseur.
Et tout cela, sans douleur, ne l’oublions pas. « J’ai un bouton, j’ai une écorchure », dit le contaminé, si même il le dit car le syphilisé au début s’ignore lui-même un grand nombre de fois. Que l’on juge alors les cas si fréquents de gens qui n’ont aucun souci de leur toilette intime (car les organes sexuels sont dangereux à regarder !), de braves paysans ignorants les éléments de l’hygiène et de la propreté. Ah ! les microbes s’en donnent à cœur joie ! Combien la douleur serait précieuse ici pour obliger le malade à se soigner !
A partir de ce temps, l’affaire devient grave, car le chancre qui mettra plusieurs semaines à guérir n’est que la première lettre d’un long alphabet morbide dont les lettres vont s’égrener au fil des années.
Voici déjà, au bout de quelques semaines, l’apparition des accidents dénommés secondaires, les seconds en date ; nous abordons alors la période la plus redoutable au point de vue de la contagion. Habile colon, le tréponème parti du chancre est allé installer ses comptoirs de tous côtés, mais tout particulièrement au niveau des muqueuses : parties sexuelles, bouche, langue, anus. Dans ces lieux, le tréponème multiplie à foison, formant de petites plaques dites muqueuses, hélas ! encore indolores, mais qui, pourtant, constituent une assez grande gêne pour attirer l’attention.
Mais aussi, gare les contacts ! Nous sommes à l’ère de la syphilis des innocents. Syphilisés, vous déposez votre venin sur le bord de votre verre, sur la cuiller ou la fourchette dont vous vous servez, sur le bout de votre doigt que vous humectez de votre salive. Et dame, à moins que vous n’y preniez garde constamment (il faut de la patience, car la plaque muqueuse dure des mois et se reproduit sur place), il y a bien quelque mauvaise chance pour que votre femme, votre bébé, votre maîtresse reçoive de vous, sans s’en douter, un triste cadeau ! Que de misères, que de drames sont contenus dans cette petite plaquette légèrement blanche que j’aperçois sur vos lèvres, au bout de votre langue, sur les parois de votre bouche, dans le fond de votre gorge. Gardez-vous de prêter votre pipe à un copain, si vous êtes assez imprudent pour fumer. Car le résultat ne saurait manquer.
Maintenant, un temps de repos apparent. Encore une duperie, Encore une hypocrisie. La période secondaire est terminée, il n’y paraît plus, à moins que vous n’ayez laissé tout ou partie de vos cheveux, par plaques, sur le champ de bataille.
Le mal semble disparaître, il ne fait que couver et préparer la plus redoutable des offensives, celle qu’on appellera la période tertiaire. Le tréponème a fait le plongeon. De la surface du corps, il va gagner les profondeurs ; ce sont les organes essentiels de la vie qui vont payer leur tribut. Votre contagiosité va diminuer, mais vos chances d’infirmités ou de mort vont augmenter.
A cette période, nous allons faire une ample moisson de maladies sur lesquelles on met les noms les plus variés sans qu’on se doute encore de leur origine syphilitique. Dernière hypocrisie. La science médicale a dû attendre longtemps avant de reconnaître la nature syphilitique d’une foule de maladies, telles que l’ataxie, la paralysie générale, l’idiotie, l’épilepsie, etc.
La statistique du professeur Fournier va porter sur 5 749 cas et il va noter 1 451 lésions de la peau (je ne citerai que les gros chiffres) ; les lésions tertiaires des organes génitaux, 271 cas, celles de la langue, 272 ; les lésions des os, 519 ; celles du palais et du nez, 229 ; celles des testicules 245 ; la syphilis du cerveau, 758 cas ; celle de la moelle (tabès, ataxie locomotrice), 766 ; paralysie générale, 83 ; paralysie des yeux, 110.
Remarquez dans quelle proportion énorme le système nerveux, le cerveau, cet organe noble dont nous sommes si fiers, paie son tribut à la syphilis : infirmités, déchéance intellectuelle, folie, paralysies, infirmités incurables, etc.
Le professeur Fournier a pu suivre 354 cas de syphilis cérébrale. Voici quel en fut le sort : 79 ont guéri ; 66 sont morts : 209 ont survécu mais avec des infirmités équivalant à une mort partielle (surdité, cécité, impuissance, crises épileptiques, incontinence d’urine, etc.). C’est payer bien cher une fantaisie de rencontre.
Nous ne sommes pas au bout de l’infernal calvaire. Le syphilisé a tort de se croire guéri ; sa confiance est engourdie et empoisonnée. Le microbe toujours aux aguets n’attend qu’une de nos faiblesses pour se rappeler à notre souvenir.
Un jour, je reçus dans mon hôpital un pauvre médecin, dont l’histoire lamentable se reproduit chaque jour. Etudiant, il avait contracté la vérole (on devrait montrer à la foire les étudiants en médecine assez sots pour se laisser contaminer !) Trois ans de suite il s’était soigné consciencieusement. Devenu médecin et sur le point de s’installer, il songea au mariage, vint trouver le professeur Fournier pour avoir son conseil. Tout se présentait dans un ordre parfait. Le professeur donna l’autorisation du mariage. Et, ce qui prouve qu’il n’avait pas tout à fait tort, c’est que deux beaux enfants, parfaitement sains, naquirent de cette union. Comment ne pas se croire guéri ?
Or, voici que, le temps des 28 jours arrivé, notre homme s’en acquitte. Mais cette période est aussi période de bombance. On reprend un peu sa vie de garçon, Pour servir la Patrie, ne faut-il pas soutenir son principal serviteur, le Bistro ? Et notre homme n’y manqua pas. En 28 jours on absorbe d’innombrables bouteilles de vin, des apéritifs ; on se fatigue, on gaspille ses forces.
Ce fut le cas du pauvre médecin. Mal lui en prit, car, de retour au bercail, ne soupçonnant point que le microbe, ami de l’alcool, avait, pu se réveiller, il offre à sa femme un troisième enfant, son cadeau de retour qui, neuf mois après, vint au monde idiot, hydrocéphale, marqué au coin de la syphilis héréditaire. Et pendant ce temps le pauvre père, saisi à son tour de syphilis tertiaire ranimée, venait mourir dans mon service de paralysie générale. Je n’ai jamais vu effondrement plus poignant que celui de la sympathique veuve.
La vérole, installée au foyer, mettant sa griffe sur la future famille, telle est bien la plus affreuse rançon d’un mal contre lequel la société pudibonde n’a ni voulu ni su nous
armer ! On finit par avoir quelque rancœur contre la vertu de convention, quand on voit de tels désastres.
On a bien le droit de porter des regards de compassion vers celle qui, la plupart du temps, est la dolente victime de notre mal de jeunesse. La pauvre femme, amie ou épouse, paie bien cher la faute commise par notre mère Ève en mangeant le fruit défendu, ce que l’Eglise lui reprochera de toute éternité, si les hommes de raison ne viennent pas à son secours. Ce n’est pas seulement une question de justice et de réparation, c’est une question de sentiment et de sécurité pour tous. Car la femme, innocemment porteuse de germe, deviendra la transmetteuse d’un mal qui tuera ses enfants aussi innocents qu’elle-même et ruinera la paix du foyer, la tendresse et l’affection légitimes, qui sont la garantie du bonheur domestique. Il n’y pense guère, l’Homme, dont « il faut que jeunesse se passe ». Il n’y pense guère quand, dans la rue, il s’accointe à quelque pauvre femme que la misère aura acculée à toutes les hontes. Il ne pense point que cette esclave moderne n’existe qu’à cause de ses besoins physiques, auxquels il se croira tenu de satisfaire à tous les coins de rue, sans penser que la Femme pourrait tenir le même langage que lui et lui crier : « Moi aussi, j’ai une jeunesse avec des besoins, et toi, Homme, tu réclames de moi la chasteté. Je ne serai pas bonne pour I’égout, si tu découvres, le jour de nos noces, que j’ai déjà aimé et donné mon corps, alors que je n’aurai pas fait autre chose que ce que tu as fait toi-même. »
Ah ! si le microbe de la syphilis pouvait rendre l’homme sage et plus juste, parce que plus prudent, je sais pas mal d’innocentes victimes qui pardonneraient encore, pour prix du bonheur récupéré, à tous les vilains microbes du passé !
Que l’on ne voie point dans ces propos rapides quelque fantaisie de moraliste sévère ! C’est un vrai ami du peuple qui parle et qui écrit. Car la question capitale en l’espèce est que, suivant la déclaration célèbre de Fournier :
« La femme mariée est souvent contaminée dans le mariage. »
Fournier en a trouvé 20% des femmes syphilitiques qu’il a traitées. Vingt femmes syphilisées par leur mari ! Quelle moyenne inattendue ! Le terrible mal ne sera donc point l’apanage des coureurs, des viveurs, des libertins, des filles dites de joie. Faire du mal sans le vouloir, sans le savoir, tel est le lot réservé à nombre de braves camarades qui paieront bien cher une erreur de jeunesse.
Le divorce, suite de syphilis communiquée, n’est pas rare de nos jours, sans compter toutes les dislocations de ménages qui se passent hors la loi. Il faut savoir que, sur 5 767 accidents tertiaires, Fournier en a trouvé 2 814 qui n’ont fait leur apparition qu’à dater de la 10ème année. De sorte que, suivant l’expression pittoresque de ce maître « c’est l’homme mûr qui expie les péchés du jeune homme, c’est le mari qui paie la dette du garçon », c’est la femme, ajouterai-je, qui paiera la dette du mari ; c’est l’enfant qui paiera la dette du ménage. Dernière et inexcusable lâcheté.
Ce sera la fin de mon réquisitoire. La syphilis tue les petits le plus souvent dès les premiers mois de la conception. L’avortement syphilitique à répétition fait le désespoir de nombre de ménages qui n’y comprennent rien. Puis, un peu plus tard, ce sont les accouchements prématurés ; enfin, c’est le meurtre à la naissance. L’enfant naît pour ne vivre que quelques heures. Chiffre officiel : 458 enfants morts sur 996 naissances issues de femmes syphilitiques, venues pour accoucher dans les hôpitaux de Paris, de 1880 à 1885 (40 %).
Puis il y a la syphilis héréditaire tardive dans la première et la seconde enfance.
« C’est par milliers qu’on dénombre les cas où la syphilis a tué deux, trois, quatre, cinq enfants dans une même famille, parfois tous les enfants, remède héroïque employé par la nature elle-même pour arracher un rameau pourri d’un arbre malade. N’oublions pas cette vérité sociale : la multimortalité des jeunes est un signe usuel de l’hérédo-syphilis. Voulez-vous un chiffre écrasant ? Je l’emprunte encore au vieux maître Fournier :
« J’ai vu de mes yeux, ceci : 90 femmes contagionnées par leur mari sont devenues enceintes dans la première année de leur syphilis. Or, voici le résultat : 50 des grossesses se sont terminées par avortement ou mort à la naissance, 38 par mort rapide après la naissance et 2 seulement ont survécu » ! »
Mais ce n’est pas fini. Le microbe malin ne lâche pas sa proie volontiers. C’est un gros mangeur d’hommes !
Quelle effroyable collection d’infirmes et de dégénérés parmi les survivants ! Voici le groupe des éclopés partiels : on y trouve des déformations des dents, du squelette de la face (le bec de lièvre), du crâne (grosse tête bosselée), l’hydrocéphalie, la microcéphalie avec l’imbécillité en partage. On y voit des déformations du nez, des oreilles, des yeux. On y voit des membres géants ou des membres nains, des doigts supplémentaires, des pieds bots, la surdimutité, des testicules frappés de stérilité, des ovaires incapables de reproduire.
Dans un autre groupe mettons le petit avorton syphilitique, pauvre être rabougri, décrépi avant le temps qui, s’il ne meurt pas, est voué à toutes les maladies, graine d’hôpital toute sa vie. Le rachitisme est étroitement lié à l’hérédo-syphilis. La plupart des monstruosités congénitales ont cette origine.
Et puis, quand par malheur ces pauvres êtres procréent, c’est pour reproduire des déchets humains comme eux-mêmes.
Les grosses poussées de contamination syphilitique se produisent : pour l’homme, entre 20 et 26 ans ; pour la femme, entre 18 et 21 ans, périodes de la floraison amoureuse. Telles sont les années néfastes de la contagion. Allons, les amateurs, qui en veut ?
Personne, entends-je dire ! D’accord. Alors, défendons-nous. Et pour nous défendre, allons à l’école. Ouvrons nos oreilles et apprenons à voir ! Garantissons notre santé : morale et physique. Il n’a pas tout à fait tort le député paralytique et incapable quand il nous répond :
« Le public réclame des lois, des règlements pour le protéger contre la syphilis, mais qu’il commence par se protéger lui-même. La syphilis ne tombe pas du ciel. Celui qui la contracte sait fort bien qu’il s’y est exposé. »
Alors, c’est la fin de l’amour ! dira-t-on. Quelle erreur ! C’est la fin des amours malpropres, mais au profit de la pureté morale et physique. C’est la fin de la bestialité, de la chiennerie. C’est la fin des galvaudages des coins de rue, des flirts animaux dans le métro, dans tous les lieux de débauche, où toutes les séductions sont si fortement intensifiées par l’alcool et le tabac abrutissants. C’est la fin des devantures excitantes et corruptrices des libraires vivant de la débauche, devant lesquelles défile, avide des choses « secrètes et honteuses » qu’on lui cache, toute notre jeunesse, mâle et femelle.
C’est la fin du mercantilisme de l’amour, au profit d’un peu plus de dignité et du respect de la femme, notre égale depuis les Droits de I’Homme. C’est la fin des éducations ratées qui font le malheur public et privé. C’est le renouveau de la belle responsabilité du citoyen conscient de sa vraie valeur, de la beauté, de la grandeur d’âme, de tout ce qui élève et fait de l’Homme quelque chose d’un peu mieux que la bête. C’est enfin la naissance de la vraie liberté, celle qui affranchit l’homme de ses passions matérielles au profit de sa culture, celle qui lui fait prendre en mépris sa servitude vis-à-vis des entraves légales. L’homme qui a une conscience et veut vivre une vie épanouie n’a pas besoin d’autre loi. La terreur du gendarme et de l’oppression avilit. L’homme qui sait s’affranchir tout seul est vraiment seul digne de vivre.
La syphilis, les maladies vénériennes, la prostitution, toutes les lèpres sociales sont le plus éloquent des réquisitoires contre le passé d’obscurantisme où la société artificielle a laissé croupir l’individu, contre les régimes humiliants et les hypocrisies, contre les fétidités de l’Argent égoïste.
Quel soupir d’aise poussera l’Homme qui aura dû à lui-même sa libération et purifié la vie de tous en commençant par sa propre purification !
C’est une noblesse que de s’affirmer libre. Et noblesse oblige !
— Docteur LEGRAIN.
SYSTÈME
n. m. (du grec sun, avec, istemi, être placé)
Ce mot peut s’appliquer soit aux objets de nos connaissances, soit à nos connaissances elles-mêmes. On parlera par exemple du système solaire, du système digestif, du système capitaliste, voulant désigner des réalités dont l’existence ne dépend pas de notre bon vouloir. On parlera aussi de système philosophique, religieux, scientifique, etc. pour désigner un ensemble de principes et d’idées que notre esprit lie entre eux et organise en un tout cohérent. Dans les deux cas, le mot système implique les notions d’assemblage, de coordination, de rapports plus ou moins heureux ; en conséquence, il garde un sens identique. N’en soyons pas surpris. Si l’intelligence humaine introduit un ordre déterminé dans ses concepts, c’est qu’elle suppose, à tort ou à bon droit, qu’un ordre semblable existe dans les choses. L’idéal serait que notre esprit introduisît, entre ses représentations, des rapports correspondant exactement à ceux que la nature impose aux êtres et aux objets. Mais, substituant une contrainte artificielle à l’harmonieux accord engendré par les lois naturelles, la société consacre l’existence de relations absolument anormales entre les humains. On le constate dans le système capitaliste, qui permet à des fainéants de dépouiller à leur profit les travailleurs des champs ou de l’usine. De même il arrive qu’en organisant ses idées et ses principes, l’intelligence se trompe complètement. D’où la multitude des faux systèmes religieux, philosophiques, politiques, etc. ; d’où tant d’hypothèses scientifiques, incapables de résister au contrôle de l’expérience et du calcul.
Inventer un nouveau système, étonner le public par l’énoncé d’une doctrine que nul n’avait encore formulée jusque-là, telle fut longtemps la grande préoccupation des intellectuels en mal de célébrité. Elle anime encore, malheureusement, de trop nombreux contemporains. Nous lui devons ces thèses aussi brillantes qu’éphémères, ces audacieuses affirmations, ces ébouriffantes synthèses qui, après une vogue imméritée, retombent dans un oubli définitif et complet. Préoccupés surtout de rajeunir des préjugés anciens ou de produire des concepts inédits, beaucoup oublient qu’en matière de connaissance spéculative le plus constant de leurs soucis doit être d’aboutir à la vérité. Jeune ou vieille, il n’importe, cette dernière reste l’unique préoccupation du chercheur impartial et consciencieux. Si l’histoire de la philosophie nous offre un spectacle particulièrement lamentable, si elle apparaît comme un champ clos où gisent les cadavres des multiples systèmes imaginés, au cours des siècles, par des esprits ingénieux, c’est que le désir d’une renommée bruyante l’emporta chez plusieurs sur l’amour de la vérité, c’est aussi que beaucoup furent incapables de dépasser le stade des constructions individuelles pour atteindre à l’objective réalité. Aussi ne soyons pas surpris de tout ce qu’on a dit contre l’esprit de système. Ces critiques sont loin de tomber à faux dans la majorité des cas. Mais il serait dangereux de réduire la connaissance humaine à une collection de faits dépourvue d’ordre et d’unité.
La science positive nous apprend dans quelle mesure l’idée et le fait doivent collaborer, lorsqu’on veut aboutir à un savoir objectif, valable pour toutes les personnes et pour tous les temps. On s’égare loin du réel, lorsqu’on accorde une valeur absolue à des concepts a priori et qu’on néglige l’expérience, pour s’en tenir aux conclusions d’une logique abstraite et formaliste. Mais les faits ne valent que par l’idée qui en dérive, par la loi qu’ils permettent de formuler.
« Quand un fait prouve, écrit Claude Bernard, ce n’est pas le fait lui-même qui donne la preuve, mais seulement le rapport rationnel qu’il établit entre le phénomène et sa cause. »
Sans l’hypothèse féconde, qui jaillit dans l’esprit, on se borne à entasser des observations stériles. Et non seulement le chercheur doit anticiper sur l’expérience, risquer une explication provisoire, une hypothèse particulière, quand il veut découvrir la loi de faits déterminés, mais il est encore utile qu’il systématise de larges catégories de faits et de lois dans des hypothèses générales ou grandes théories.
Ces grandes théories ont l’avantage de condenser d’innombrables observations dans quelques propositions générales. Elles coordonnent des phénomènes que l’on supposait épars et sans lien ; elles rattachent à une même formule des lois que l’on croyait disparates ou isolées. Les sciences expérimentales et inductives leur doivent de s’organiser en une synthèse déductive, lorsqu’elles atteignent un stade suffisamment élevé. Dépassant les recherches descriptives ou classificatrices, les théories satisfont ce besoin de comprendre et d’expliquer que Meyerson considère, avec raison, comme fondamental dans la science. De plus, elles constituent un précieux instrument de découverte, grâce aux hypothèses qu’elles suggèrent ou aux analogies qu’elles dévoilent. Fresnel constatait déjà :
« Quand une hypothèse est vraie, elle doit conduire à la découverte des rapports numériques qui lient entre eux les faits les plus éloignés ; lorsqu’elle est fausse, elle peut représenter à la rigueur les phénomènes pour lesquels elle a été imaginée, mais elle ne saurait dévoiler les grands secrets qui unissent ces phénomènes à ceux d’une autre classe. »
Ajoutons que le savant rejette comme vaine et dangereuse toute théorie qui ne s’accommode d’aucune vérification expérimentale ou qui est contredite par les faits.
Avec des variantes, imposées par la nature des phénomènes étudiés, les remarques concernant les grandes hypothèses scientifiques s’appliquent aux larges synthèses, tentées dans l’ordre philosophique, social, moral, économique. Si attrayant qu’il paraisse, un système doit être écarté lorsqu’il n’a pas l’expérience pour point d’appui. Et le degré d’intelligibilité d’une explication, comme aussi la fécondité de ses conséquences, permettent de distinguer la théorie utile de celle qui n’est qu’une creuse fantaisie de l’imagination. Ainsi se trouvent condamnées les délirantes suppositions admises en théologie ou en métaphysique, les systèmes à la Bergson ou à la saint Thomas, simples jeux d’esprit dépourvus de toute valeur objective. Fallacieuse logomachie des amateurs d’au-delà, spéculations sur dieu, l’âme et les autres entités chimériques sont à écarter inflexiblement ; elles ont leur place près des contes de nourrice et des récits imaginaires. On s’étonnera un jour que les hommes aient pu prendre au sérieux les sornettes que l’on étudie, dans les écoles, sous le nom de systèmes métaphysiques. Seules ont droit de cité les théories suggérées par les faits et capables d’être, au moins dans l’avenir, expérimentalement vérifiées. Désirables dans le domaine de la création artistique, les fantaisies individuelles sont dangereuses en matière de connaissance spéculative.
Même contenue dans les limites fixées par la raison, une théorie n’obtient jamais qu’une valeur relative. Des systèmes jugés longtemps solides se révèlent caducs et fragiles, lorsque des découvertes nouvelles permettent de pénétrer plus profondément dans l’intimité des phénomènes. D’autres, au contraire, qui seront très féconds par la suite, semblent d’abord contradictoires et impossibles. E. Geoffroy Saint-Hilaire disait du système de Lamarck :
« Une conception fantastique, un écart, une folie de plus. »
Pour avoir bouleversé la théorie linnéenne des espèces végétales, Jordan fut considéré comme un fou tranquille. Et l’on n’a pas oublié avec quelle ardeur l’hypothèse du mouvement de la terre fut combattue par les contemporains de Copernic et de Galilée. C’est à l’observation qu’il faut demander, en dernier ressort, de confirmer ou d’infirmer un système, quel qu’il soit. Celui qui ne peut supporter l’épreuve de la vérification doit être abandonné.
Quant au scandale qui, au dire de certains, résulterait du caractère éphémère et transitoire des théories scientifiques, il ne trouble guère les esprits capables de réfléchir. Des systèmes disparus quelque chose subsiste en effet ; chacun d’eux ajoute à l’acquis du savoir définitif. Souvent même ils ne se détruisent pas mais se complètent seulement et s’unissent dans des synthèses plus vastes. Loin d’être un signe de faiblesse, la mobilité devient pour la science une preuve de fécondité ; plus nos connaissances progressent, plus les théories se transforment rapidement. Et ce ne sont pas uniquement des rapports, comme le croyait Henri Poincaré, que la science nous permet de connaître, c’est la réalité qu’elle découvre, la nature intime des choses qu’elle fait entrevoir. Pareillement, dans d’autres domaines, l’enrichissement progressif dont bénéficie la pensée ne doit pas se confondre avec une destruction pure et simple des systèmes précédents.
— L. BARBEDETTE.
[1] Note du numériseur : il n’est pas impossible que ce texte comporte une erreur quant au nom des papes, car Han Ryner ne peut pas parler du Jean XXIII que nous avons connu dans les années soixante, et il est peu probable que deux papes aient pu porter le même numéro.