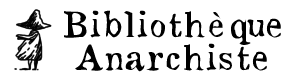L’Encyclopédie Anarchiste — R
R
RAISON, RAISONNEMENT, RAISONNABLE
RÉFORME ou RÉFORMATION (HISTOIRE RELIGIEUSE)
ÉVOLUTION DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE.
RÉFORME FONCIÈRE ET RÉFORME DOUANIÈRE.
LA RÉPRESSION NE BRISE PAS LA RÉVOLTE.
I. — La responsabilité individuelle.
II. — La responsabilité individuelle.
III. — La responsabilité collective.
IV. — La responsabilité professionnelle et sociale de l’homme.
RÉVOLTES (OUVRIÈRES ET PAYSANNES)
RÉVOLUTION (MORALE) (point de vue du socialisme rationnel)
L’erreur des révolutions passées.
Le mot révolution est galvaudé.
Ce que sera la Révolution sociale.
La Révolution sociale devra en finir avec le capitalisme et l’État.
Aucun parti politique n’est révolutionnaire.
Les anarchistes prennent part à tous les soulèvements populaires de tendance révolutionnaire.
À propos du fatalisme historique de certaine école marxiste.
On peut, théoriquement, admettre l’idée de la révolution non violente.
Si la révolution est violente, les maîtres en seront seuls responsables.
La révolution sociale exige une préparation sérieuse.
La période transitoire. — La dictature.
La fameuse période transitoire n’est autre chose que la période préparatoire.
LES GRANDES SECOUSSES RÉVOLUTIONNAIRES, DE L’ANTIQUITÉ À LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
LA RUSSIE AU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE.
LA FIN DU XIXe SIÈCLE (1881–1900).
LES DÉBUTS DU XXe SIÈCLE (1900–1905).
VERS LA GRANDE EXPLOSION (1905–1917).
RACE (RACES)
n. f. (du latin ratio ; puis l’italien razza)
Le mot race paraît tirer son étymologie de l’italien razza. En français, il représente la lignée d’une même famille, d’un peuple ou d’une région plus ou moins étendue. Pour faciliter les recherches d’ordre physique, on applique le mot race aux animaux aussi bien qu’aux hommes. Tout particulièrement, nous nous intéresserons au mot race relativement aux diverses variétés de l’espèce humaine, telles que races blanche, jaune, rouge et noire, sans oublier qu’il existe une infinité de races de couleurs intermédiaires. Au figuré, l’on parle quelquefois de race quand il s’agit de désigner certaines catégories d’hommes ayant une profession ou une inclination commune. Ces définitions ont pour but de simplifier le sens à accorder au mot race dans les divers emplois que l’on en fait. Le mot race nous intéresse sérieusement au point de vue socialiste ; et c’est la raison qui nous incite à entrer dans un développement de notre pensée sur ce sujet. S’il ne s’agit, par le mot race, que d’exprimer le caractère distinctif d’un peuple, caractère dérivant de ses dispositions organiques et dû au climat où ce peuple vit, aussi bien qu’à des habitudes que les siècles ont consacrées et qui le portent à concevoir les choses et à raisonner sur elles dans un sens particulier, le terme race a une valeur admissible. En présentant la valeur du mot race d’après ce qui précède, nous verrons qu’il y a des peuples et des races plus ou moins lents ou vifs d’allure, d’autres graves ou badins, constants ou légers, économes ou prodigues, guerriers ou pacifiques ; d’autres conquérants ; d’autres pacificateurs, organisateurs ; enfin, d’autres chasseurs, bergers, nomades, cultivateurs, industriels, etc. Le même raisonnement nous montrera qu’il y a des races d’hommes de toute nuance, à cheveux plus ou moins foncés, plats, crépus ou frisés, et des parties de l’organisme plus ou moins améliorées dans le sens de la civilisation. Si, quittant ces considérations qui se rapportent davantage à l’ordre social, nous voulons donner au mot race la signification de peuple essentiellement différent des autres peuples physiquement, organiquement destiné à être trompeur ou trompé, méchant ou bon, maître ou esclave, nous verrons que ce mot n’offre à l’esprit qu’une absurdité.
Nous ne rechercherons pas, ici, si l’homme a paru sur le globe par un seul couple ou par plusieurs à la fois et en différents lieux ; cela nous mènerait trop loin, et ce n’est pas nécessaire pour le bien-fondé de notre thèse. Nous ne voulons voir dans l’homme que l’être raisonnable qui se manifeste à son prochain par le sentiment qu’il a de son existence, qui préside à son intelligence et en permet la manifestation pour son usage exclusif. Il en est ainsi parce qu’il n’y a, pour l’homme, qu’un raisonnement, comme il n’y a qu’une raison pour l’orienter vers le progrès, le bien et la pratique de la justice vis-à-vis de tous et de chacun. Sans doute, selon les races, certains organismes diffèrent, mais cette circonstance et celles qui, du dehors, facilitent ou contrarient son action font que l’homme raisonne plus où moins facilement sur un certain nombre de questions. Ainsi, il peut conserver, plus ou moins longtemps, à travers les générations et les événements, l’impression et le souvenir des idées qu’il a acquises. L’empirisme, comme développement intellectuel, aboutit à ce résultat. S’il en était autrement, si l’homme caractérisé par les races n’était qu’une machine agencée par la nature, représentant l’unique matière combinée, fatalement, pour le mouvement particulier qui s’appelle vie et pour le fonctionnement spécial qu’on nomme raisonnement, tout serait déterminé, par avance, et l’action individuelle ne serait qu’un résultat mécanique inévitable, même non modifiable. C’est pour cette raison que la morale n’est pas une sottise seule profitable aux puissants, aux déterminés supérieurs. L’homme moral ne dépend plus de l’influence de sa race, que l’on pourrait prétendre son essence supérieure et différente de celle des autres races. En nous reportant toujours au mot race, et par suite à celui d’homme, nous verrons qu’il ne peut y avoir de conscience, au sens exact du mot, sans idées, point d’idées sans travail intellectuel de comparaison et de déduction rationnelle. En définitive, pour les hommes, rien n’existerait, socialement parlant, sans le raisonnement, comme c’est le cas pour les autres êtres. Or, l’expérience qu’on aime à mettre à contribution dans les milieux avancés nous prouve que l’homme ne naît pas avec des raisonnements tout faits ni avec le mécanisme d’où jailliront des raisonnements déterminés. Ainsi, l’expérience, le raisonnement et l’intelligence s’accordent pour nous prouver qu’on naît simplement avec son organisme et la faculté de sentir et de raisonner. Les races, et par voie de conséquence tous les hommes qui les composent, sont susceptibles de bien raisonner et de s’élever aux connaissances que l’harmonie sociale nécessite pour fonder une société rationnelle.
— Élie SOUBEYRAN.
RACES
Les hommes appartiennent-ils à une ou à plusieurs espèces originelles ? On discute beaucoup sur ce sujet : pour les polygénistes, les hommes descendraient de plusieurs espèces apparues sur divers points du globe ; pour les monogénistes, au contraire, ils proviendraient tous d’un type unique. Couleur de la peau, aspect des cheveux, forme du crâne, des yeux, du nez permettent de distinguer aisément les grandes races humaines ; mais il a fallu de longues et pénibles recherches pour établir scientifiquement les principaux groupes et sous-groupes qu’elles comportent. L’antagonisme des races, dont parlent si souvent les écrivains patriotes, n’a d’autre raison d’être que la volonté des chefs et l’intérêt des marchands de canons. Parce qu’ils diffèrent par leurs aptitudes, leurs goûts et maintes particularités physiques, les hommes n’ont pas besoin de se quereller et de se battre. « Vigne et blé noir ne poussent pas dans les mêmes terres : un laboureur habile diversifie les cultures selon le sol et le climat. Mais c’est l’accord harmonieux des peuples, non la lutte de chacun contre tous, qui s’impose au degré d’évolution où nous sommes. » (L’Ère du Cœur.) Dans l’explication de l’histoire, certains penseurs attribuent une importance capitale à la question des races. Selon Taine, race, milieu, moment suffisent à rendre compte des œuvres d’art, de la littérature, de l’histoire. Gobineau, au XIXème siècle, a émis des idées sur les races qui furent plutôt mal accueillies en France, mais qui lui ont valu une réputation durable. Il croit à la supériorité des races nordiques et à la décadence des races latines. Très aristocrate, adversaire des théories démocratiques, ayant une haute idée des peuples germaniques, Gobineau, qui était diplomate de carrière, trouva de bonne heure des partisans en Allemagne. Chez nous, ses ouvrages obtinrent un succès d’estime dans un cercle très restreint. Durant la guerre de 1914–1918, on a parfois rappelé sa mémoire, mais en condamnant ses conceptions. Quelques penseurs continuent néanmoins d’avoir pour lui une estime profonde.
RADICAL, RADICALISME
adj. et n. m. (du latin radix, racine)
Si l’on se fiait à l’étymologie du mot, il faudrait admettre que le radicalisme politique demande une complète refonte de l’ancien système de gouvernement. Rien n’est plus faux. Qu’il s’agisse de l’Angleterre, où ce terme fut appliqué pour la première fois, semble-t-il, à un parti politique, ou de la France qui devait être longtemps sa terre d’élection, le radicalisme ne réclama jamais que des réformes partielles, ne pouvant porter une sérieuse atteinte à l’omnipotence du Capital et de l’État. En Angleterre, il a eu un chef célèbre en la personne de Lloyd George, méthodiste ardent qui flagella les riches dans ses discours, mais ne prit contre eux que des mesures anodines quand il fut au pouvoir. Chez nous, l’histoire du radicalisme comporte une suite ininterrompue de renoncements et de trahisons. Sous l’Empire, Gambetta, qui se rangeait parmi les démocrates avancés, aurait mérité d’en faire partie. Candidat dans le quartier de Belleville, à Paris, en 1869, il développa un programme qui, plus tard, fut repris par les radicaux. Il réclamait la sauvegarde de la liberté individuelle, une application « radicale » du suffrage universel, la séparation de l’Église et de l’État, l’instruction primaire laïque, gratuite et obligatoire, une complète liberté d’écrire, de se réunir et de s’associer, l’élection des fonctionnaires publics, la suppression des armées permanentes. Sous le gouvernement de Thiers, le même Gambetta s’efforcera de présenter le nouveau parti radical comme un parti d’ordre. Il s’écriait à Grenoble :
« Oui, le 26 septembre 1872, je pressens, je sens, j’annonce la venue d’une couche sociale nouvelle qui est loin, à coup sûr, d’être inférieure à ses devancières... Les partis coalisés de la monarchie ont crié que le radicalisme était aux portes avec le cortège de spectres, de malheurs et de catastrophes. Car la peur est la maladie chronique de la France... Il faut que le parti radical se donne la mission de guérir la France de cette maladie de la peur. Le remède ? Toujours le même... C’est la sagesse. »
Pour sa part, Gambetta, alléché par l’appât du pouvoir, s’assagissait beaucoup ; en fait de réformes positives, il se bornait désormais à réclamer « l’instruction primaire universelle et laïque », que le clergé combattait avec acharnement. Devenu chef des opportunistes, il déclarera en 1878 :
« Que nous faut-il ? Ah ! Il nous faut toucher à bien des choses. Mais je ne suis pas pour y toucher comme des enfants ou comme des violents ou comme des utopistes. Je suis l’ennemi de la table rase, mais aussi des abus ; mais je veux qu’on tienne compte du temps, de la tradition et même des préjugés. »
Les radicaux se dressèrent alors contre Gambetta et les opportunistes. Ils réclamaient une révision de la Constitution, en particulier la suppression de la présidence et du Sénat ; ils proposaient la séparation des Églises et de l’État, un impôt progressif sur les revenus et héritages, la réduction du service militaire rendu obligatoire pour tous. À leur tête, ils avaient Clémenceau. Ce politicien déclarait alors :
« Nous nous réclamons de la liberté... Nous voulons maintenir au-dessus de tout la liberté de l’initiative individuelle... Mais, en même temps que la liberté, nous proclamons l’égalité, la solidarité humaine. Et c’est la justice que nous appelons à concilier le droit de l’un avec le droit de l’autre... Nous prétendons que la société a par-dessus tout le devoir, c’est même sa seule raison d’être, de soutenir, de fortifier le faible. »
Ces beaux discours n’empêcheront pas Clémenceau d’envoyer de nombreux innocents au bagne ou au poteau d’exécution, lorsqu’il détiendra le pouvoir en 1917 et dans les années suivantes. Nul n’a montré un plus complet mépris de la justice, de la liberté individuelle, de la vie humaine ; nul n’a abusé davantage de l’autorité remise entre ses mains par des politiciens apeurés. Hier, avant la guerre, cet homme agressif et hargneux avait montré que ses discours de jeunesse n’étaient désormais, pour lui, que vaine littérature. Nommé ministre de l’Intérieur en mars 1906, puis président du Conseil en octobre de la même année, il envoya des troupes contre les grévistes du Nord, puis contre les viticulteurs du Languedoc, révoqua les fonctionnaires récalcitrants et, sous prétexte de maintenir l’ordre, se montra impitoyable pour les déshérités du sort. Ce fut l’abandon complet du programme radical ! Et les traîtres de ce genre (certains encore plus écœurants et plus ignobles) ont toujours été nombreux parmi les radicaux ; de ce point de vue, ils n’ont rien à envier, on le voit, aux socialistes, leurs anciens adversaires devenus, depuis, leurs alliés.
Sans approuver toutes ses idées, sans applaudir aux procédés dont il usa, je tiens cependant à rendre justice au radical Émile Combes. Cet honnête homme, qui avait vécu loin des salons et des compromis, resta fidèle à ses convictions lorsqu’il devint ministre, puis président du Conseil. Aussi, les historiens officiels ou soi-disant neutres couvrent-ils d’outrages ce libre-penseur sincère, alors qu’ils encensent à tour de bras les fripons qui, parvenus au pouvoir, déchirèrent cyniquement le programme qui leur avait servi de tremplin électoral.
Bien avant 1914, les radicaux avaient oublié les revendications qu’ils déclaraient autrefois essentielles. Manœuvrés par le sinistre Poincaré, ils n’hésitèrent pas à envoyer des millions d’hommes à la mort ; pour complaire à Barrès, à Clémenceau, à toute la clique des patriotes de l’arrière, ils applaudirent à la condamnation de ceux qui commettaient l’impardonnable crime de garder un peu de bon sens, au milieu de la folie générale, et de vouloir la paix. Aujourd’hui, c’est le triomphe complet d’un honteux opportunisme parmi les partisans de la rue de Valois. Feu Lucien Victor Meunier le constatait avec franchise, en 1927 :
« J’étais encore, certes, un tout jeune homme, lorsque commença à prendre corps ce parti radical fondé expressément pour réagir contre les funestes tendances préconisées par Gambetta ; l’expérience politique me manquait totalement, c’est entendu, mais je comprenais déjà les dangers que faisaient courir à la République les théories soutenues par l’homme qui avait si superbement incarné les espérances républicaines. Se contenter d’à-peu-près, renoncer momentanément aux grandes velléités pour obtenir peut-être des succès partiels, attendre le moment propice, patienter, guetter les occasions, c’était le fond de la politique opportuniste, et cela équivalait à émietter le programme républicain, à l’ajourner indéfiniment, disons le mot juste : à le renier... À ce moment, le programme radical rédigé par les Auguste Vacquerie, les Camille Pelletan, les Henry Maret, les Sigismond Lacroix, et surtout – ne retranchons rien, sous aucun prétexte, de la vérité – par Clémenceau, portait en tête comme première revendication, la plus urgente : révision de la Constitution, suppression du Sénat, souveraineté absolue du suffrage universel. Cherchez cette révision de la Constitution dans l’actuel programme radical et radical-socialiste ; elle en a disparu ; elle a été effacée, petit à petit. Voilà encore quelques années, ce programme « prévoyait » la révision de la Constitution monarchique de 1875. Il ne la réclamait plus ; il se contentait peureusement de la prévoir ; à présent, il la passe sous silence. Alors, je ne vois plus la différence avec l’opportunisme... Ah ! Ceux d’autrefois qui marchaient intrépidement, le front levé vers l’idéal, sans se préoccuper des contingences ! Et ne me dites pas que c’étaient des utopistes, que ceux de maintenant sont – le mot est souvent employé – des réalisateurs. Je voudrais bien savoir ce qu’ils ont réalisé, nos opportunistes. »
Cette condamnation du parti radical, portée par un de ses membres resté fidèle à son premier idéal, semble plus vraie encore aujourd’hui qu’en 1927.
L’anticléricalisme lui-même n’est qu’un vieux souvenir ; et les ministres radicaux s’efforcent de le faire oublier en protestant de leur respect pour les croyances religieuses, de leur désir d’être agréables au clergé. Rien n’est plus drôle que de voir Herriot faisant des courbettes aux prélats qui peuvent favoriser son élection à l’Académie française. Protecteurs des mercantis, des banquiers, de tous ceux qui grugent le peuple et organisent la vie chère, les parlementaires valoisiens passent, comme ceux de droite et du centre, aux guichets des grandes entreprises financières commerciales, industrielles, pour toucher la sportule due aux bons serviteurs du Veau d’Or. Simple boutique électorale, le parti radical offre, en abondance, à la veille de chaque scrutin, des formules creuses, des proses hypocrites, des discours sans sincérité. Mais quand il a voté, le citoyen peut attendre la réalisation des promesses faites par ses élus. Orateurs et journalistes lui expliqueront, avec force détails, que les réformes attendues, les transformations souhaitées ne s’accompliront que plus tard, dans un avenir encore lointain. Dans le présent, il faut patienter, se taire ou même trouver la situation excellente, puisqu’un quarteron de ministres républicains dispose de l’assiette au beurre. Sans surprise, j’ai constaté, en 1932, que l’avènement au pouvoir d’un ministère radical coïncidait, en ce qui me concerne, avec un redoublement de persécutions. Mon attitude, lors des fêtes militaires franco-américaines de Luxeuil, en fut sans doute partiellement cause ; mais, surtout, on ne me pardonnait pas de dire tout haut ce que beaucoup de membres de l’enseignement pensaient tout bas, à savoir que des ministres qui se proclamaient amis de la laïcité, en parole, se comportaient, en fait, comme les pires réactionnaires.
— L. BARBEDETTE.
RADIOGRAPHIE, RADIOSCOPIE
n. f.
En 1895, Rœntgen observa que les rayons émanés d’un tube de Crookes, relié aux deux pôles d’une bobine d’induction, illuminaient un cristal de platinocyanure de baryum, même quand ce tube était enfermé dans une boîte de carton enveloppée de feuilles d’étain ou de minces feuilles d’aluminium. Et l’illumination ne disparaissait point, lorsqu’il plaçait sur le trajet des rayons une planche de sapin, une plaque d’aluminium épaisse de 15 millimètres ou un livre de mille pages. Ce fait conduisit Rœntgen à fabriquer un écran avec une lame de verre enduite d’une pâte de platinocyanure de baryum. Placée entre le tube de Crookes et l’écran, sa main fut projetée sur ce dernier sous l’aspect d’une main squelettique. La radioscopie était née ; la radiographie suivit de près, le savant bavarois ayant, de bonne heure, substitué une plaque sensible à l’écran. Il donna à ce nouvel agent, qui se propageait en ligne droite, le nom de rayons X, pour indiquer qu’il en ignorait la nature. Bien qu’ils partent de la région du tube de Crookes, où les rayons cathodiques frappent le verre, les rayons X ne peuvent se confondre avec eux. Ils se propagent d’une façon rigoureusement rectiligne et traversent des corps non transparents pour la lumière ; par contre, ils sont arrêtés par des substances que traversent les rayons ordinaires. Bois, papier, cire, charbon, etc., se laissent pénétrer, ainsi que, d’une façon générale, les matières d’origine organique. Eau, os, spath, fer, cuivre, mercure, plomb et beaucoup d’autres corps, surtout d’origine minérale, opposent un obstacle plus ou moins infranchissable.
On sait maintenant que, dans le spectre solaire, les rayons X font suite aux radiations ultraviolettes. Ce sont des rayons dont la longueur d’onde, très courte, est comprise entre 500 unités Angström et 0,06 unité. L’unité Angström est égale à un dix millionième de millimètre. Ils constituent d’ailleurs toute une gamme qui va des rayons mous, les moins pénétrants, aux rayons durs, les plus pénétrants, et diffèrent entre eux autant que les couleurs qui, par leur réunion, donnent la lumière blanche. Sans avoir encore la place qu’elles mériteraient d’occuper en médecine pour le diagnostic de nombreuses maladies, radioscopie et radiographie sont devenues d’un emploi courant : du moins dans les hôpitaux, car elles exigent la présence d’appareils coûteux, compliqués et d’un maniement délicat. On apporte sans cesse de nouveaux perfectionnements au matériel radiologique. Ce sont les ombres, les silhouettes données par les rayons X que l’on utilise. La propriété qu’ont ces derniers d’être complètement ou partiellement absorbés par certains corps, ainsi que celle de provoquer la luminescence de diverses substances, sont mises à profit. Comme leur propagation est rectiligne, les ombres sont produites de la même façon qu’avec la lumière ordinaire. Dans la radioscopie, on observe celles qui résultent du corps ou de l’organe placé sur le trajet d’un faisceau de rayons X et qui se détachent sur un écran, rendu luminescent grâce au platinocyanure de baryum. L’adaptation visuelle joue alors un grand rôle, car l’œil de l’observateur ne doit pas recevoir d’autre lumière que celle de l’écran ; l’examen demande l’obscurité la plus complète. Dans la radiographie, on remplace l’écran par une plaque photographique entourée de papier noir. Si on la développe et la fixe, après une durée d’exposition suffisante, on possède une reproduction de l’ombre radioscopique.
C’est l’énorme avantage de la radiographie de permettre un examen plus minutieux et plus détaillé des ombres ; seule, elle rend possible la découverte de certaines lésions : celles des os, par exemple ; elle fournit des éléments de comparaison fort instructifs. Mais quand il s’agit d’organes animés de mouvements rythmiques ou qui participent à l’élévation et à l’abaissement du diaphragme, la radioscopie se révèle préférable. Habituellement, la radiographie est d’ailleurs précédée d’un examen radioscopique, afin d’obtenir des indications sur la meilleure manière de photographier la région du corps malade. Suffisante lorsqu’il s’agit d’apprécier une fracture nette des os ou la place exacte d’un corps étranger opaque, d’une balle par exemple, la radiologie a généralement besoin, pour fournir des renseignements sûrs, d’être associée aux autres procédés cliniques et aux procédés de laboratoire. N’oublions pas, en effet, qu’elle dispose seulement d’ombres, agrandies dans un faible rapport, d’ordinaire, mais le plus souvent déformées ; et la superposition des silhouettes, l’inégalité des agrandissements et des déformations qui résultent de la diversité des plans traversés par les rayons, rendent particulièrement difficile l’interprétation des images radioscopiques. Un long apprentissage est nécessaire au médecin, avant qu’il parvienne à établir de bons radiodiagnostics. Lorsqu’il s’agit des rayons X, transparence et opacité dépendent du poids atomique des éléments constitutifs des corps, et aussi du nombre d’atomes contenus par unité de volume. C’est parce qu’elles ne renferment guère que des éléments de poids atomiques faibles : hydrogène (1), carbone (12), azote (14), oxygène (16), que les chairs se laissent facilement pénétrer. Dans les os, on trouve, en outre, du phosphore (31) et du calcium (40) ; le poids atomique élevé de ces corps explique l’opacité du système osseux. En raison du petit nombre d’atomes qu’il renferme, l’air contenu dans les poumons rend plus facile l’examen radioscopique des organes intrathoraciques. À cause de sa composition chimiquement identique, la région intra-abdominable offre une teinte grise presque uniforme, sauf dans les parties osseuses. Mais on peut accroître ou diminuer la transparence des organes creux ; c’est ainsi qu’en injectant du carbonate de bismuth ou du sulfate de baryum dans certains segments du tube digestif, on augmente leur opacité. Foie et vésicule biliaire, reins et vessie peuvent aussi faire l’objet d’un examen fort délicat, mais parfois très utile. Ce n’est pas seulement à nous révéler la vraie cause des maladies que servent les radiations, on leur reconnaît encore une action curative contre certains troubles organiques. D’où la radiothérapie, une branche intéressante de la médecine moderne.
« Ce qui a fait la solidité des premiers hommes, déclare le docteur Nogier, c’est assurément le contact perpétuel de leur corps avec les rayons du soleil ; ils étaient imprégnés de lumière. Combien nous leur ressemblons peu, nous dont la préoccupation constante semble être de soustraire à la lumière tout notre être, jusqu’au visage, n’en déplaise au sexe aussi aimable que gracieux. Dès que l’enfant est né, c’est le maillot, c’est l’obscurité pour ses membres qui auraient tant besoin de lumière, qui réclament à toutes les énergies extérieures le moyen de grandir et de se développer. Et l’on s’étonnera après cela qu’il y ait tant de morts parmi les nourrissons, tant de rachitiques et de scrofuleux parmi ceux qui arrivent à la vie, malgré toutes les précautions qu’on prend pour paralyser leur croissance ! » Si l’on admet que la lumière exerce sur l’organisme humain une bienfaisante influence, ajoutons que l’on ne sait presque rien sur le mécanisme de son action. Au point de vue thérapeutique, les rayons X, qui, ne l’oublions pas, prennent place dans le spectre après l’ultraviolet, sont employés pour détruire les néoformations cellulaires anormales, pour modérer le fonctionnement des glandes en état d’hyperactivité pathologique, ou même normalement actives, pour lutter contre les infections locales, soit en supprimant le lieu d’élection du mal, soit en excitant la sclérose de défense. Toutes les affections de la peau sont améliorées par les rayons X, beaucoup sont même guéries ; ils rendent de grands services dans les troubles caractérisés par une multiplication excessive du nombre des globules blancs ; on les emploie avec succès contre les diverses formes de la tuberculose de la peau ou des muqueuses, contre les tumeurs, dans les affections des glandes à sécrétion interne, contre certains cancers. Malheureusement, les rayons X, manipulés sans précaution, provoquent aussi des accidents, parfois très graves. Nombreux au début, parce qu’on négligeait de se protéger, ils deviennent de plus en plus rares. Les radiodermites, c’est le nom donné à ces accidents, n’ont pas de conséquences pernicieuses lorsqu’on supprime l’action des rayons X dès l’apparition des premiers symptômes. Mais le radiologiste qui néglige ces avertissements s’expose à une radiodermite très grave, capable même d’entraîner la mort, après d’atroces souffrances. Chez les anciens opérateurs, c’était surtout au mains, plus exposées à l’action du rayonnement, que le mal se déclarait de préférence. Successivement, il fallait amputer les doigts, la main, le bras, rongés par la gangrène et le cancer ; quelquefois, sans parvenir à conserver la vie à la malheureuse victime. Aujourd’hui, les radiologues, instruits par les douloureuses expériences de leurs prédécesseurs, parviennent à éviter ces troubles redoutables.
— L. BARBEDETTE.
RADIUM
n. m.
Les physiciens modernes considèrent la matière comme formée d’atomes, et les atomes eux-mêmes comme constitués par un noyau autour duquel gravitent les électrons. On a calculé la grandeur de ces éléments nucléaires et planétaires ; ainsi le noyau de l’atome d’hydrogène aurait 15 trillionièmes de millimètre de diamètre. On sait, de plus, que le nombre des électrons varie avec la complexité des atomes. À l’état normal, la charge positive du noyau est contrebalancée par la charge négative des électrons : l’atome est alors neutre, au point de vue électrique ; mais il suffira, pour le rendre négatif, de fixer sur lui un électron ; pour le rendre positif, d’en ôter un. Le frottement provoque des mouvements électroniques à l’intérieur des atomes, de même les réactions chimiques des piles. Certains corps, appelés radioactifs, voient leurs atomes exploser spontanément et fournir des rayons dits « alpha », formés de particules positives, des rayons dits « béta », formés d’électrons négatifs, et un rayonnement ondulatoire analogue à celui des rayons X. Toutes les substances sont un peu radioactives ; néanmoins, ce qualificatif est réservé de préférence aux corps lourds (c’est-à-dire dont le poids atomique est élevé), qui possèdent cette propriété à un degré éminent. Parmi les corps radioactifs, il convient de citer le thorium, l’actinium, le radium, dont l’atome possède 88 électrons planétaires et qui est présentement le plus connu de tous.
C’est de la découverte des rayons X qu’est issue celle du radium. Henri Becquerel, mis en présence des premières radiographies de Rœntgen, se demanda quel était le lieu d’émission des rayons X, dans l’ampoule productrice. Il apprit que le point d’émission était la tache lumineuse visible à l’endroit de la paroi qui recevait les rayons cathodiques. Mais, ayant supposé que tous les corps phosphorescents émettaient peut-être un rayonnement semblable, son hypothèse fut reconnue fausse après de nombreux essais de vérification. À son tour, Henri Poincaré se demanda si tous les corps dont la fluorescence est assez intense ne produisaient pas des rayons de Rœntgen. Cette hypothèse suscita de nombreuses et intéressantes recherches. Finalement, l’étude des substances fluorescentes conduisit Becquerel à une découverte des plus importantes. Un heureux hasard, comme il arrive souvent pour des inventions que l’on attribue ensuite au génie de l’auteur, lui fit remarquer que les sels d’uranium émettaient des radiations capables d’impressionner une plaque sensible, sans avoir été au préalable soumis à l’excitation de la lumière. Des sels maintenus pendant sept ans dans l’obscurité, et qui continuaient de produire des effets aussi nets, lui permirent de démontrer qu’il s’agissait d’une propriété quasi permanente de ces corps ; il observa, de plus, que les mêmes radiations déchargeaient les substances électrisées. En 1898, M. Schmidt et Mme Curie, travaillant chacun de son côté, prouvèrent que le thorium et ses composés étaient doués de qualités identiques à celles de l’uranium et de ses composés. Ce fut Mme Curie qui proposa d’appeler radioactifs les corps qui émettaient le rayonnement Becquerel. On sait que de la pechblende, Curie et sa femme purent extraire, en 1898, le polonium d’abord, puis le radium ; un troisième corps, l’actinium, en fut tiré par Debierne. Seul, le radium a été présenté à l’état de sel pur, le bromure de radium. On obtient ce corps en traitant une tonne de minerai par cinq tonnes de produits chimiques et cinquante tonnes d’eau. De pareilles manipulations exigent plusieurs mois.
La chaleur dégagée par une parcelle de radium est suffisante pour faire fondre un morceau de glace, de poids égal, en l’espace d’une heure. Elle donne une lumière semblable à celle d’un ver luisant et qui peut être réfléchie, réfractée, polarisée. Chaleur et lumière se continuent ainsi durant des milliers d’années, sans faire appel à une énergie extérieure. Sous son influence, l’air devient bon conducteur de l’électricité, et certaines substances, par exemple le platinocyanure de baryum, se révèlent luminescentes. Au point de vue chimique, son action transforme le phosphore blanc en phosphore rouge, colore les sels alcalins en jaune, bleu ou vert, jaunit puis détruit le papier. Le radium émet un triple rayonnement invisible, mais très intense, formé de trois parties, auxquelles Rutherford a donné les noms respectifs de rayons alpha, rayons béta, rayons gamma. Les premiers sont formés par des atomes chargés d’électricité positive ; ils ont une vitesse de 15 000 à 30 000 km à la seconde et constituent 90 % du rayonnement total. Une couche d’air de 7 cm ou une épaisseur de 5/100 d’aluminium suffisent pour les arrêter, car leur pénétration est faible. Les rayons béta, chargés d’électricité négative, paraissent analogues aux rayons cathodiques mais sont 500 fois plus pénétrants. Ils constituent 9 % du rayonnement global et se divisent en rayons mous, dont la vitesse de propagation est de 30 000 km à la seconde, et en rayons durs qui atteignent une vitesse variant de 200 000 à 300 000 km à la seconde ; les premiers sont arrêtés sans peine, les seconds difficilement. Les rayons gamma se propagent en ligne droite et ne sont pas électrisés ; ils entrent pour 1/100 seulement dans l’ensemble du rayonnement. Comparables aux rayons X, ils ont toutefois un pouvoir de pénétration très supérieur ; ils traversent plus de 100 mm de plomb, alors que 1 ou 2 mm du même corps suffisent presque pour absorber les rayons X.
Ajoutons qu’une substance mystérieuse se dégage, d’une façon permanente et continue, des divers sels de radium. Répandue dans l’air, cette émanation provoque la luminescence du sulfure de zinc, du verre et de plusieurs autres corps ; elle se condense d’une manière très brusque à la température de 150° au-dessous de zéro, ainsi que l’ont montré Rutherford et Soddy. Elle se place chimiquement dans la même catégorie que l’argon, l’hélium et les divers gaz qu’aucun réactif n’absorbe et qui n’entrent dans aucune combinaison ; on la place au 4ème rang parmi les corps ayant les plus hauts poids atomiques. Lorsqu’elle se détruit, cette émanation engendre un peu d’hélium, le gaz le plus léger après l’hydrogène. Sur l’organisme humain, le radium provoque des lésions soit aiguës, soit chroniques ; il possède une action bactéricide, mais encore trop mal connue pour qu’on puisse en tirer parti pratiquement ; sur les formes élémentaires de la vie, il exerce une influence profondément perturbatrice. Au point de vue médical, on l’utilise contre le cancer. « La plupart des cancers de la peau, écrit le docteur Niewenglowski, sont guéris ; sur les cancers des muqueuses, les résultats sont variables : bons pour le cancer de la lèvre, mauvais pour le cancer de la langue. Les cancers du sein inopérables peuvent parfois devenir opérables à la suite d’irradiations en sens divers ; dans les cas rebelles, le radium peut diminuer les douleurs et prolonger l’existence des malades. La guérison est rare, mais l’amélioration est la règle dans le cancer de l’œsophage, du pylore, du rectum, de la prostate et, parfois, une tumeur inopérable devient opérable après les irradiations. Pour nombre d’affections de la peau, le radium a une réelle valeur curative. » Les applications thérapeutiques du radium sont pour beaucoup dans la curiosité universelle dont il est l’objet présentement.
— L. BARBEDETTE.
RAISON
n. f. (du latin : ratio)
Les sens du mot raison sont nombreux. On l’oppose à instinct, quand on déclare que la raison sépare l’homme de l’animal : il signifie, dans ce cas, que nous pouvons saisir l’enchaînement des faits, comprendre leurs raisons d’être, prévoir leurs conséquences. On l’oppose à folie, quand il désigne un comportement logique, réfléchi, bien adapté au milieu et à la situation. Beaucoup confondent la raison avec l’intelligence, ce terme étant pris dans son acception la plus générale ; ou avec le sens commun, qui se ramène à un ensemble d’idées banales et souvent fausses, admises à une époque et dans une région données ; ou avec le bon sens qui consisterait dans une façon de juger qualifiée saine et droite par ceux qui prétendent maintenir l’entendement humain dans les bornes étroites d’une rigide orthodoxie. En réalité, la raison c’est le pouvoir de mettre de l’ordre dans les faits que nous présente l’expérience, c’est la faculté de relier les divers phénomènes observés, de les comprendre. Elle implique donc un ensemble de principes et de notions qui rendent possible une organisation systématique de nos connaissances. De ces principes, on a dressé des listes plus ou moins longues ; mais il est facile de les ramener à deux : celui d’identité et celui d’universelle causalité, qui constituent les lois générales de notre esprit. Nous avons, dans un précédent article, parlé longuement des principes (voir ce mot). La raison comprendrait, de plus, certaines idées primitives, universelles, irréductibles, d’après la théorie classique. Mais leur nombre varie beaucoup selon les auteurs, une analyse un peu profonde ayant tôt fait de montrer qu’elles résultent, non d’une intuition originale, mais d’un travail de réflexion, d’une interprétation des données sensibles par l’entendement humain.
Trois de ces idées nous intéressent particulièrement, à cause des conséquences métaphysiques et religieuses qu’on a voulu en tirer : celles d’infini, de parfait, d’absolu. L’infini serait ce qui n’a aucune limite dans aucun sens ; il s’opposerait au fini, qui a des limites, et à l’indéfini, capable de croître ou de diminuer sans limites assignables. Et les croyants ajoutent que l’infini est le terme nécessaire des aspirations de l’âme humaine, que nous tendons vers lui par toutes les puissances de notre être, et qu’une telle aspiration, de nature essentiellement religieuse, démontre l’existence de dieu. L’idée de parfait, c’est l’idée de ce qui est complet, achevé ; elle s’applique aux qualités qui ne laissent rien à désirer, auxquelles rien ne manque. On a également prétendu qu’elle réclamait l’existence, hors de nous, d’un être parfait. Quant à l’absolu, il se conçoit par opposition au relatif : c’est l’inconditionnel, ce qui possède en soi sa raison d’être. Hamilton estimant que toute pensée établit des relations, qu’elle conditionne, déclarait en conséquence que, si nous devons croire à l’absolu, nous ne pouvons le penser ; cette idée ne serait qu’une pseudo idée.
Quoi qu’il en soit, les idées d’infini, de parfait, d’absolu sont de simples constructions de l’esprit, d’une valeur purement subjective, et qui résultent d’un travail de l’entendement sur les données expérimentales. Pour les obtenir, nous n’avons qu’à penser par contraste, à concevoir des êtres dont les caractères sont directement opposés à ceux des objets qu’offre l’univers observable. Ainsi, nous ne percevons que des étendues et des durées finies, mais notre imagination, dont l’activité est inépuisable, peut ajouter constamment des étendues ou des durées finies à d’autres étendues ou à d’autres durées finies ; d’où l’idée d’infini. Par ailleurs, notre intelligence, notre puissance, nos qualités, nos joies, etc., sont loin d’être telles que nous voudrions qu’elles soient ; et cette imperfection, nous la constatons pareillement chez les êtres et les choses qui nous entourent. Enlevons les bornes, supprimons les limites et nous aboutissons à l’idée de parfait. Enfin, concevons un être qui, à l’inverse de ce que nous présente l’expérience ordinaire, ne dépende ni de nous, ni d’aucune autre chose, qui existe en lui-même et par lui-même, nous arrivons à l’idée d’absolu. Il est donc inutile de faire intervenir une intuition spéciale pour expliquer les concepts de la raison qui, de prime abord, semblent des plus mystérieux. Pas davantage il n’est besoin de recourir à l’innéité ; l’activité mentale ordinaire, guidée par les principes d’identité et d’universelle causalité, suffit. Mais, le problème du contenu de la raison ainsi résolu, reste celui de son origine, de sa nature, de sa valeur.
D’une façon générale, l’innéisme, appelé aussi apriorisme, oppose la raison à l’expérience et soutient que les principes directeurs de la connaissance ne proviennent pas des données sensibles. L’empirisme, au contraire, affirme que rien n’est dans l’entendement qui ne vienne de l’expérience, et que les lois de la pensée se ramènent à des habitudes acquises par l’individu ou par l’espèce. Chacune de ces grandes doctrines a donné naissance à de nombreux systèmes. Déjà, l’innéisme est en germe chez les sophistes et chez Socrate ; Platon, qui sépare radicalement la raison de l’expérience, explique l’existence des idées par l’hypothèse de la réminiscence. Pour lui, le monde sensible et le monde intelligible diffèrent essentiellement : dans le premier, tout est individuel et changeant, c’est le monde des apparences ; dans le second subsistent les idées, types éternels, modèles permanents d’après lesquels toutes choses ont été conçues et réalisées, c’est le monde intelligible, celui des concepts et des principes généraux. Entre ces deux mondes, il y a une participation continuelle : les objets sensibles sont le reflet, la copie des idées. Ces dernières, hiérarchisées entre elles, ont à leur tête l’idée du bien. Or, avant de vivre ici-bas, notre âme a existé dans un monde supérieur où elle contemplait les archétypes de toutes choses. Précipitée dans le corps, sa prison terrestre, elle se souvient de ce qu’elle a vu autrefois, en observant les réalités sensibles, pâles ombres des idées du monde intelligible.
L’innéisme d’Aristote, adversaire déclaré de la réminiscence platonicienne, reste beaucoup plus proche de l’expérience. Celui de Descartes le sera encore davantage. Ce philosophe distingue des idées adventices, qui nous viennent du dehors par les sens, des idées factices, résultat d’un travail mental, des idées innées qui ne découlent ni de l’expérience, ni d’une opération de l’entendement. Mais, par innéité, il entend la puissance de produire, non une connaissance actuelle. Il affirme :
« Quand je dis que quelque idée est née avec nous, j’entends seulement que nous avons en nous-mêmes la faculté de les produire. »
Pour Leibniz, toutes nos idées supposent des perceptions sensibles ; néanmoins, l’activité de l’esprit ne s’explique point par l’expérience puisqu’elle en est la condition essentielle. Il n’y a rien dans l’intelligence qui n’ait d’abord été dans les sens, si ce n’est l’intelligence même. Nos principes sont préformés, comme une statue d’Hercule serait préformée dans un bloc de marbre, si des veines convenablement disposées la dessinaient intérieurement. Pour la mettre au jour, il suffirait ensuite de dégrossir le marbre, comme il suffit de recourir à l’expérience pour dégager les principes rationnels. Selon Kant, notre esprit renferme trois sortes de principes, à priori, capables d’organiser les données expérimentales et de relier les phénomènes entre eux :
-
l’espace et le temps, sortes de cadres où se rangent nos perceptions, sont les formes a priori de notre sensibilité tant externe qu’interne ;
-
les catégories de l’entendement, au nombre de douze, permettent d’associer les phénomènes dans des jugements ; en elles se moule la matière de la connaissance sensible ; mais nous n’avons nullement le droit d’affirmer qu’elles répondent à la réalité objective, pas plus d’ailleurs que l’espace et le temps ;
-
la raison conçoit trois idées transcendantes, celles de l’âme, du monde et de dieu, autour desquelles se groupent toutes nos connaissances et qui élèvent la pensée à la plus haute unité possible. Comme ces idées sont des formes purement subjectives, nous ne saurions néanmoins affirmer qu’elles répondent à des réalités effectives, sans nous exposer à des antinomies insolubles ou sans faire des paralogismes. Kant s’est, d’ailleurs, borné à mettre en plein relief les éléments subjectifs et a priori que la science requiert ; il ne s’est pas préoccupé de chercher leur origine. Dérivent-ils en définitive de l’expérience, le philosophe de Kœnigsberg ne l’affirme ni ne le nie, ouvrant ainsi là porte à une conciliation avec l’empirisme.
Sous sa forme la plus ancienne, l’empirisme se ramène au sensualisme, que professaient déjà l’école atomistique d’Abdère et les épicuriens. Condillac et les matérialistes du XVIIIème siècle ont adopté la même doctrine, sans lui faire subir de modifications essentielles. Mais avec Locke, Stuart Mill, puis Spencer, l’empirisme donnera naissance à trois systèmes d’un très haut intérêt. Locke, s’opposant à la conception cartésienne des idées innées, affirme que tout ce qui est dans l’entendement a d’abord passé par les sens. L’âme, au début, est comparable à une tablette de cire ne portant aucun caractère ; elle reçoit ensuite les sensations, et c’est de leur accumulation passive que sortent les principes de la raison. D’après Stuart Mill, les sensations ne restent pas isolées dans la conscience, elles s’unissent par des liens qui peuvent finalement devenir indissolubles. Et les principes directeurs de la connaissance se ramènent, justement, à des associations d’idées contractées par l’individu : associations qui acquièrent une force irrésistible par la répétition. Ainsi, la loi d’universelle causalité dérive de l’habitude d’associer les phénomènes que l’expérience nous présente toujours l’un après l’autre ; la prétendue nécessité qui fait suivre la cause de son effet n’a rien d’objectif, elle est de nature purement subjective. Le principe de contradiction découle de la constatation répétée du fait qu’affirmation et négation sont deux actes de l’esprit qui s’excluent. Spencer admet que la raison est aujourd’hui innée dans l’individu ; mais c’est une acquisition de l’espèce qui résulte d’expériences ancestrales, d’associations transmises héréditairement. Comme tout ce qui est vivant, l’intelligence doit s’adapter à son milieu ; et des associations stables, répondant à des relations fixes de la nature, se forment dans l’esprit ; grâce à l’hérédité, elles s’incrustent dans le cerveau humain. De la sorte, Spencer réconcilie partiellement l’empirisme et l’innéisme.
Sans nier l’ingéniosité de ces diverses théories, sans méconnaître que plusieurs, surtout parmi les doctrines empiristes, mettent en lumière d’incontestables vérités, nous donnons au problème de l’origine et de la valeur de la raison une solution différente. Et, d’abord, nous constatons que les animaux supérieurs, sans avoir une notion claire des principes directeurs de la connaissance, agissent néanmoins en conformité avec les directives qu’ils imposent. C’est par l’absence de langage conventionnel et par la faible puissance de son imagination créatrice que l’animal supérieur diffère de l’homme, beaucoup plus que par l’absence de raison. « Aux animaux les plus évolués, ai-je écrit dans L’incomparable guide, nous ne refusons ni une intelligence élémentaire, ni une aptitude quelquefois remarquable à parer le danger actuel. Dès qu’il s’agit, non plus du présent immédiat, mais d’un avenir un peu lointain, ils cessent de prévoir. Et leurs réactions, bien adaptées au but, tant qu’elles se réduisent à des mouvements habituels et simples, manquent d’équilibre et de coordination lorsqu’elles réclament un ensemble de gestes combinés par la réflexion. Sans peine, le chien esquive un coup, le cheval se gare d’une auto. Dans un incendie, lors d’une inondation, l’affolement des animaux domestiques est une cause ordinaire de dégâts. Par contre, l’homme se tire d’affaire dans des conditions très compliquées et, pour lui, entièrement nouvelles. En vue de la fin souhaitée, son esprit conçoit des moyens adéquats, invente des procédés qui concordent avec les exigences du moment. Fixé d’avance sur les conséquences futures de ses actes, grâce aux suprêmes principes dont le faisceau constitue la raison, il s’oriente aisément dans le dédale des faits expérimentaux. Si les données des sens, base première de toute élaboration intellectuelle, gardent le caractère de notations personnelles et passagères, valables seulement pour un individu et pour un instant, la connaissance vulgaire, transmissible par le langage, suppose déjà un effort d’analyse et de généralisation qui permet à chacun de profiter des remarques d’autrui. Pour communiquer, il faut des signes compris par l’ensemble des membres d’une collectivité ; et ces signes supposent l’existence d’idées abstraites, résultat d’un travail effectué sur les impressions sensibles. Comme nous, l’animal attend les mêmes effets dans les mêmes conditions, il reconnaît les objets et agit en conséquence ; mais sa pensée conceptuelle reste à l’état d’ébauche et ne parvient pas à s’exprimer au moyen de signes intentionnellement fabriqués ; il s’arrête au stade des manifestations émotionnelles et spontanées du langage purement naturel. D’où la faible portée de ses prévisions et son impuissance à comprendre les situations un peu embrouillées. » Empirisme et rationalisme ont un tort commun, celui de ne pas descendre jusqu’à la réalité vécue. Avant d’être clairement conçus par la conscience, les principes existent sous forme de besoins vitaux. Ce sont des règles pratiques que l’on utilise, même sans en avoir une connaissance réfléchie, comme l’animal et l’entant utilisent les muscles de leur corps, malgré une complète ignorance des données les plus élémentaires de l’anatomie. Ils ont une base organique et répondent à des dispositions durables du système nerveux. Et, parce que notre cerveau résulte d’une longue adaptation au milieu extérieur, parce qu’il a été modelé par la nature ambiante au cours de nombreux millénaires, ces lois de l’esprit n’ont rien d’arbitraire ; elles concordent avec les lois des choses. Mais, chez l’animal et même chez certains sauvages, ces principes ne s’intellectualisent pas : ils ne passent point du domaine de l’action dans celui de la théorie. Avant de parvenir à les formuler d’une façon précise, nos ancêtres les conçurent d’abord sous un angle théologique, puis métaphysique.
En définitive, la raison, telle que la conçoivent les penseurs actuels, n’est que la conscience des suprêmes règles et de la vie et du milieu où elle puise ses éléments primordiaux. Si elle se révèle pratiquement d’une efficacité merveilleuse, c’est parce que ses lois répondent à celles du monde et des choses. Ainsi apparaît clairement la fausseté des doctrines bergsoniennes qui lui dénient toute valeur représentative, toute valeur de connaissance. Cette conception d’une raison ayant de profondes bases physiologiques peut surprendre. Lorsqu’on rejette délibérément les chimères métaphysiques, elle s’impose pourtant.
Mais les biologistes contemporains connaissent encore si mal les fonctions du cerveau que l’on ne saurait donner de précisions anatomiques ou physiologiques sur ce sujet. Attendons, sans impatience, les futures découvertes des savants. Et soyons assurés que suivre la raison, c’est demeurer fidèle aux exigences de la vie et de la nature ; que la répudier, c’est oublier les primordiales nécessités que l’existence impose. Elle est devenue, pour nous, la grande faculté d’adaptation. « Dans les faits successifs, le cerveau humain s’arrête de préférence à ce qui se répète ; de l’enchevêtrement d’expériences multiples, il dégage, par une série de comparaisons, les traits communs et permanents ; puis il généralise et applique aux événements semblables les relations découvertes dans les cas déjà observés. Sous les diversités trompeuses recherchant toujours l’identique, il trouve dans ce qui fut les lois de ce qui sera, il devine le futur à l’aide du présent. Ses prévisions acquièrent une valeur prodigieuse et son pouvoir d’adaptation s’avère capable d’un développement illimité. » Malheureusement, nos contemporains, dans l’ensemble, se détournent volontairement de la raison pour demander aux mythes religieux, ou aux vaines promesses de charlatans prétentieux, d’illusoires et dangereuses espérances, qui les fascinent mais ne les sauvent pas.
— L. BARBEDETTE.
RAISON
Faculté supérieure de l’esprit par laquelle nous percevons les rapports des choses, ou plutôt de ce que nous pouvons savoir d’elles. On oppose, d’ordinaire, la raison au sentiment, à la passion et aussi aux préjugés.
La Révolution française rendait un culte à la raison. C’était évidemment puéril ; la raison n’est pas une personne, mais une abstraction qui, n’existant pas hors de l’esprit humain, ne saurait être sensible à une manifestation quelconque. Ce que voulaient les hommes de 93, c’était, avant tout, frapper les masses encore barbares, leur apprendre à rejeter la religion et à n’admettre que ce qui est rationnel.
La raison est loin de gouverner les hommes. Depuis la guerre, tous les mysticismes ont pris un nouvel essor. Le vieux catholicisme trône aux cérémonies publiques, les églises se remplissent. Toutes les superstitions : spiritisme, occultisme, nécromancie, astrologie, envoûtement, ont leurs clients. Des intellectuels même officiels croient, aujourd’hui, qu’il existe des relations entre les astres et la destinée de chacun. Les guérisseurs qui chassent les maladies par l’imposition des mains ouvrent publiquement boutique, et les clients affluent ; on peut se croire revenu au Moyen Âge.
C’est que la raison est décevante. Rémy de Gourmont a dit :
« Ce qu’il y a de plus malheureux dans la recherche de la vérité, c’est qu’on la trouve. »
Découverte triste : on découvre qu’il n’y a rien ; que notre vie, comme celle des animaux, a son temps, plus ou moins long, et qu’après c’est fini. Le vice comme la vertu, le travail comme la paresse auront le même sort, le fossé où tout disparaît. L’humanité ne veut pas admettre cette destinée misérable, et elle va aux aigrefins ou aux demi fous qui lui parlent de survie, de récompenses dans l’au-delà aux efforts de cette vie ; les malades, déçus par la médecine scientifique, vont aux charlatans qui les encouragent, leur assurent la guérison par un fluide spécial dont ils ont reçu le privilège. La réalité n’est pas modifiée. Le malade, s’il est vraiment tel, mourra en dépit des marchands d’illusions ; le mort ne se réveillera pas.
On peut soutenir que l’illusion, calmant moral, si elle n’a pas le pouvoir de modifier la réalité, n’en console pas moins pour quelque temps ceux qui vont vers elle. Mais, dans l’ensemble, la superstition fait infiniment plus de mal que de bien. Elle abêtit les hommes, elle les rend réfractaires au progrès et elle confère une autorité morale à des gens malhonnêtes prêts à tous les mensonges pour gagner de l’argent. L’humanité ne peut fonder d’espoirs qu’en la raison. C’est par la science que les conditions de la vie s’améliorent, que l’univers se révèle à nous, que les forces de la nature sont disciplinées pour le service des hommes. La science prolonge la vie ; elle arrivera – qui sait – à vaincre la mort, tout au moins à l’éloigner de plus en plus. La science sert aussi à tuer, et des esprits superficiels le lui reprochent. Ils ne réfléchissent pas que le coupable n’est pas la science qui n’est qu’une abstraction, mais les hommes qui sont criminels en se servant d’elle pour s’entre-détruire.
— Doctoresse PELLETIER.
RAISON, RAISONNEMENT, RAISONNABLE
L’étude de la raison présente la curieuse particularité du spectacle d’une faculté humaine sur laquelle l’accord des hommes cultivés paraît s’être réalisé, quant aux méthodes conditionnant son usage, et le spectacle d’un désaccord profond quant à l’origine de cette faculté et l’attribution du qualificatif de raisonnable aux œuvres humaines.
Autrement dit, depuis la plus lointaine Antiquité jusqu’à nos jours, les hommes ont pratiqué et perfectionné l’art de raisonner juste, sans avoir jamais su exactement ce qu’était la raison, et sans avoir pu reconnaître unanimement les actes raisonnables.
Rien de plus démonstratif, en effet, que le spectacle lamentable des fonctionnements individuels et sociaux incohérents, illogiques et stupides, tandis que quelques clercs insolites enseignent, à des cerveaux depuis longtemps irrationnels, l’art des raisonnements parfaits.
Partout, l’erreur, la croyance, la superstition, le préjugé, l’illogisme, la contradiction, la mauvaise foi, la chicane, l’ergotage, le sophisme. Partout des heurts, des luttes, des oppositions, des batailles, sans que jamais les bellicistes songent à trancher leurs différends par l’expérience et par la raison.
Une question se pose alors : la raison existe-t-elle ? Si oui, qu’est-elle, quel est son pouvoir et que peut-on en attendre réellement ?
L’introspection ne nous donne aucune connaissance profonde de nous-mêmes. Nos pensées, nos jugements nous apparaissent formés d’éléments indivisibles que notre conscience groupe, compare, élimine ou choisit, sans connaître davantage la nature de ces éléments, ni le pourquoi des divergences profondes entre les diverses conclusions des raisonneurs. Chacun veut avoir raison, dit-on couramment. Et c’est tout.
L’échec de la méthode introspective vient de son impuissance à analyser les origines même de la pensée, conséquence inévitable de ce fait évident que la pensée ne peut s’analyser lorsqu’elle n’existe pas encore, et que le processus psychique ne peut s’exercer sur lui-même qu’à la condition d’être déjà de la pensée.
La méthode objective, au contraire, présente tous les avantages de l’application de la pensée à ce qui n’en est pas encore, mais en conditionne la formation et le développement. Cette méthode constate une relation entre la physiologie du système nerveux et les aptitudes psychiques. Dans l’échelle animale, les animaux à cerveau volumineux et à circonvolutions très développées sont relativement plus intelligents que ceux moins doués sous ce rapport. Ceux chez qui les localisations visuelles cérébrales se sont développées aux dépens des localisations olfactives ont également acquis une plus grande activité psychique. D’autre part, de multiples expériences anatomiques sur le système nerveux des animaux et de nombreuses observations pathologiques chez l’homme même démontrent que l’intelligence n’est qu’un fonctionnement d’un système nerveux, comme la chaleur animale est le produit d’une oxydation des aliments ingérés.
Le système nerveux se compose, dans sa combinaison la plus simple, d’une cellule sensorielle recevant les excitations extérieures, et d’une cellule motrice transmettant l’influx nerveux, créé par cette excitation, à une cellule musculaire. Les cellules nerveuses, ou neurones, sont formées d’une masse protoplasmique, entourée d’une sorte d’arborescence très compliquée, et d’un prolongement : le cylindraxe, atteignant jusqu’à un mètre de longueur, terminé également par de multiples ramifications. Dans un organisme compliqué, l’influx nerveux ne passe pas directement de la cellule sensorielle à la cellule motrice. L’ensemble du système est formé de plusieurs neurones, dont les arborescences s’enchevêtrent les unes les autres, formant autant de relais plus ou moins importants. Les cellules sensorielles aboutissent à la moelle épinière (premier relais) ; d’autres cellules nerveuses relient les divers étages de la moelle épinière entre eux, ainsi que ces divers centres nerveux avec les cellules motrices partant de la moelle. La voie ascendante sensorielle se prolonge jusqu’au bulbe rachidien, situé à la base même du cerveau, et qui constitue une sorte de centrale élémentaire du réseau nerveux. De ce centre important, d’autres neurones, ayant leurs terminaisons dans divers centres du cerveau moyen, forment également une deuxième centrale très importante d’où l’influx nerveux s’écoule plus ou moins violemment, soit dans la voie ascendante (raisonnement), soit dans la voie descendante (action).
Enfin, par l’intermédiaire de plusieurs neurones, la voie ascendante aboutit aux circonvolutions cérébrales, lesquelles forment un enchevêtrement prodigieux de cellules permettant les liaisons les plus compliquées, tandis que les cellules motrices forment un réseau se terminant aux cellules musculaires, réalisant l’action et le mouvement.
Les expériences nombreuses effectuées sur les animaux permettent, actuellement, d’affirmer que tous les organes des sens ont leur projection sur des surfaces déterminées du cerveau, y compris le sens interne, mais que ces surfaces ne sont point strictement limitées et qu’elles s’interpénètrent les unes les autres de telle sorte qu’un influx nerveux ne reste point limité à une zone particulière, mais se propage dans d’autres zones sensorielles.
Dans le fonctionnement de ce système nerveux excessivement compliqué, il faut distinguer les réflexes absolus ou innés (vies organique, instinctive, inconsciente et habituelle) qui s’établissent dès la formation du fœtus, bien avant la naissance de l’enfant, coordonnant entre eux les divers fonctionnements organiques formant la base même de toute l’existence animale de l’individu, ainsi que le mécanisme des habitudes et des tics, et les réflexes conditionnels formés ultérieurement sous l’influence d’excitations étrangères au fonctionnement strictement animal de l’être humain.
Sous l’influence des excitations extérieures, l’influx du réflexe absolu se prolonge dans la moelle et le bulbe et se transforme très rapidement en acte moteur. C’est là le réseau inférieur du système nerveux. Le réseau supérieur part des cellules sensorielles et, formant la voie ascendante, amène les excitations sensorielles en des régions particulières à chaque organe des sens. Ces régions sont qualifiées par Pavlov d’appareils analyseurs. Chaque excitation s’y diffuse, selon sa nature, et se propage par des voies créées antérieurement, ou dans des voies nouvelles, jusqu’au moment où cet influx se diffuse totalement (pensée pure, acte avorté) ou se concentre en un point quelconque du réseau central. Cette deuxième étape s’établit dans l’appareil déclencheur. Enfin, dernière phase du parcours de l’influx, celui-ci s’écoule par la voie formée dans l’appareil déclencheur, et l’appareil exécuteur (voie nerveuse descendante) transmet cet influx aux cellules motrices.
On conçoit qu’un tel parcours, une telle diffusion de l’influx nerveux à travers cette quantité prodigieuse de neurones ne s’effectuent point instantanément et que l’acte ultime, déterminé par ce travail, diffère qualitativement de l’acte déterminé par les réflexes absolus. Deux faits sont à retenir des expériences de Pavlov : la diffusion de l’influx nerveux et sa concentration. La diffusion est l’acte analyseur et discriminateur ; la concentration se traduit par l’acte moteur.
Ce qui démontre bien qu’il ne s’agit pas là d’une invention fantaisiste de physiologiste, mais bien de réalités expérimentales, c’est que, selon l’importance des ablations effectuées sur le cerveau d’un chien, son appareil analyseur ne peut plus discriminer les excitations, et l’animal, sensible au toucher, ne reconnaît plus une caresse d’une piqûre, ni un objet d’un autre, bien que percevant la masse de ces objets qu’il sait très bien éviter. De même, il différencie encore un son d’un autre son, mais pas un ensemble de sons d’un autre ensemble, et ne répond plus à son nom. Ceci nous montre que les automatismes, les réflexes inférieurs existent encore dans les centres inférieurs du système nerveux, mais que les réflexes supérieurs, créés dans les appareils analyseurs, n’existent plus.
Nous pouvons, maintenant, aborder l’étude de la formation de la pensée et, conséquemment, de la raison.
Dès la naissance, les réflexes absolus organiques s’adjoignent, progressivement, les réflexes sensoriels du réseau inférieur : réflexes cutanés, gustatifs, olfactifs, auditifs, visuels et kinesthésiques (sens des mouvements internes). Le système nerveux de l’enfant est alors constitué par des complexes de réflexes peu nombreux, mais solidement organisés, tels que réflexes alimentaires, réflexes musculaires, réflexes sensuels, etc. (tendances primitives).
On peut considérer toutes les excitations extérieures non pas comme des excitations continues, mais comme une suite innombrable d’excitations se répétant incessamment dans le temps. Chaque sensation est ainsi formée d’un nombre considérable d’excitations déterminant autant d’influx nerveux, parcourant tout d’abord les voies inférieures du réseau nerveux et se liant, par conséquent, aux réflexes organiques absolus. Mais ces influx gagnent également les voies supérieures, et, se diffusant dans les neurones encore vierges de toute impression, commencent à créer des liaisons d’autant plus solides que les mêmes excitations se répéteront plus fréquemment. Ces réflexes, particulièrement étudiés par Pavlov, se forment par coïncidence avec des réflexes absolus. Par exemple, un chien excité par un aliment (réflexe absolu) émet des gouttes de salive ; si l’on accompagne son repas d’un son, ce son suffira à lui seul, après quelques expériences, pour déterminer l’apparition des gouttes de salive. C’est là un réflexe conditionnel.
Comme l’enfant subit simultanément des myriades d’excitations par toutes ses cellules sensorielles, on conçoit que le monde extérieur, malgré ses aspects infiniment variés, fixe en lui, par le double phénomène de la diffusion des influx nerveux et des liaisons temporaires, des représentations permanentes de tous les objets. Désormais, l’activité nerveuse se décomposera en trois phases : réflexes absolus organiques, reconnaissance du monde extérieur, adaptation aux variations de ce milieu. Ce qui correspond physiologiquement aux divers étages du réseau nerveux parcouru par l’excitation ; réflexe absolu dans la moelle et le bulbe, reconnaissance dans les appareils analyseurs, adaptations dans les centres d’association et les appareils déclencheurs de mouvement.
On comprend mieux ainsi les erreurs de la vieille psychologie associationniste et la justification des reproches qu’on lui adressait. Cette psychologie supposait, en effet, que chaque sensation se groupait avec d’autres sensations, telle une collection d’images statiques, et l’on s’étonnait que d’une association de morceaux ainsi agglutinés pût sortir une pensée neuve et originale. Les choses se passent en réalité tout autrement.
Chaque influx nerveux se diffuse primitivement dans l’enchevêtrement des neurones, créant des voies multiples et préparant des voies nouvelles à d’autres influx ultérieurs. On conçoit que chaque sensation contient ainsi du connu, que l’analyseur diffuse dans les voies déjà tracées antérieurement, mais qu’elle contient aussi de l’inconnu qui trace un chemin particulier.
Or, dans ces cheminements d’influx différents, partis de zones sensorielles différentes, il se crée nécessairement des fusionnements, des liaisons, des créations incessantes, variant à tout instant sous l’influence des variations extérieures. La connaissance ainsi comprise est avant tout ACTION. Connaître, c’est agir ; c’est répondre utilement à une excitation du milieu.
La connaissance est donc essentiellement formée des modifications cérébrales créées dans le temps par des millions d’influx nerveux (réflexes conditionnels) et par des liaisons momentanées jaillies de ces modifications,
Tandis que les généralités (arbre, maison, chien, nombre, etc.) deviennent ainsi des éléments permanents de la connaissance, certains complexes de réflexes se forment, constituant autant de centres affectifs puissants, d’où l’énergie nerveuse rayonne, se diffuse plus ou moins longuement dans différentes directions, sous l’influence des excitations extérieures. Ces complexes de réflexes ou centres affectifs, probablement formés dans le cerveau moyen, comprennent la plupart des activités humaines groupées sous les noms de sexualité, ambition, orgueil, grégarisme, misanthropie, jalousie, curiosité, sportivité, esthétique, amoralisme, éthique, etc. (développement des tendances primitives).
Les excitations extérieures atteignant ces centres affectifs peuvent y libérer très lentement, ou très brusquement, leur énergie nerveuse. Dans le premier cas, cette libération est d’autant plus efficace que le centre est plus puissant, l’énergie nerveuse plus abondante, le réseau des réflexes mieux établi. Alors, l’influx nerveux gagne les centres d’associations, chemine dans diverses voies, se disperse en d’innombrables ramifications et peut, soit se résorber par une diffusion très étendue (acte manqué) ; soit se joindre finalement à d’autres influx voisins et, créant une voie nouvelle, déterminer un acte, ou une longue série d’actes adaptatifs.
Dans le deuxième cas, la brusque libération de l’influx ne permet pas à celui-ci de gagner les centres d’associations ; il passe par les voies réflexes les plus courtes, emprunte les chemins les plus ouverts et se traduit très rapidement par un acte plus ou moins approprié aux faits. Ainsi agissent la peur, la colère l’indignation, la jalousie, la haine, l’envie, les grands désirs, les fortes joies et toutes les passions.
Un exemple fera mieux comprendre la formation d’une pensée.
Supposons un enfant de quelques années laissé seul dans sa maison et ayant faim. Un centre affectif puissant existe en lui : celui de la nutrition. Ce centre, excité par la sensation de la faim, libère plus ou moins violemment de l’énergie nerveuse. Suivant le tempérament de l’enfant, cette énergie débordera les voies normales conduisant aux réseaux des réflexes conditionnels et des liaisons momentanées ; elle s’écoulera par les voies les plus anciennes et les plus faciles, utilisant les complexes de réflexes les plus primitifs : appels, cris, pleurs, accès de colère, trépignements, etc.
Si le tempérament de l’enfant est plus réfléchi, après quelques appels infructueux, il agira autrement. Il faut, en ce cas, considérer l’acquis de cet enfant à ce moment-là. Depuis sa naissance, le centre affectif de la nutrition s’est construit par additions d’innombrables réflexes conditionnels. Tout ce qui excitait ses sens, pendant le fonctionnement de ce besoin primordial, s’est lié à ce besoin : vision des locaux, meubles et ustensiles servant aux repas (tables, chaises, buffet, étagères, assiettes, pots, casseroles, verres, etc.) ; faits et gestes des personnes s’en occupant (ouverture, déplacement, utilisation des meubles, préhension des objets, etc.) ; et bruits particuliers ou odeurs précédant on accompagnant les repas.
Chez cet enfant moins emporté, l’influx nerveux se diffuse d’abord dans plusieurs directions sans issue. Je dis sans issue parce que le fait d’attendre encore un peu, d’appeler à nouveau ou de continuer à jouer, ne libère nullement l’énergie sans cesse stimulée par la faim. L’influx nerveux déclenché par ce besoin vital est beaucoup plus en relation avec le complexe des réflexes conditionnels formés par les repas qu’avec ceux du jeu.
L’énergie se diffusant plus longuement dans ce réseau complexe, plusieurs potentiels se forment, des voies nouvelles et voisines s’ouvrent, la liaison aliment-cuisine s’établit, et, l’influx nerveux s’écoulant vers les centres moteurs, l’enfant se dirige vers la cuisine. Si tout y est fermé à clef et hors d’atteinte, la vue des portes et des serrures (excitations visuelles) déclenchera d’autres reflexes conditionnels liés à l’usage de ces meubles. Il peut se faire qu’aucun de ces réflexes n’aboutisse. Aucune liaison nouvelle ne s’effectuera. L’influx nerveux se dispersera sans effet moteur. Ce sera un acte avorté. Il peut se faire, au contraire, que cet influx s’écoule dans une voie favorable ; de nouveaux potentiels se formeront, les liaisons déplacement de chaises, buffet, escalade, étagère, pot de lait s’effectueront, et, les réflexes moteurs étant excités, l’enfant grimpera sur le buffet, apercevra son pot au lait sur l’étagère mais ne pourra l’atteindre. Nouvel arrêt, nouvelle diffusion infructueuse de l’énergie nerveuse dans différentes voies ; mais une excitation nouvelle créée par la vision d’un bâton engendre une liaison immédiate entre plusieurs réflexes et détermine aussitôt l’action motrice. L’enfant descend, s’empare du bâton, remonte, pousse le pot et peut, soit parvenir à le saisir, soit le faire tomber, se privant ainsi du bénéfice de ses efforts. L’expérience, en ce cas, ne sera pas stérile ; elle l’enrichira. Une autre fois, les liaisons nerveuses seront plus complexes, l’enfant réfléchira davantage ; il prolongera, mentalement, l’expérience plus loin, prévoira les conséquences finales et agira probablement autrement. L’acte sera plus raisonné.
Ces faits successifs nous montrent toutes les transformations de l’énergie nerveuse que la psychologie courante dénomme : désir, volonté, réflexion, action
Toute pensée, dite raisonnable, est donc fonction de l’existence d’une énergie nerveuse, de la création des centres affectifs, de la formation des réflexes conditionnels, de l’abondance et de la qualité des liaisons momentanées. Comme l’influx nerveux met un certain temps à parcourir tous ces réseaux mutuellement enchevêtrés, nous appelons volonté l’écoulement plus ou moins long et régulier de cette énergie, dans toutes les voies liées à un centre affectif très important ; et nous appelons attention l’écoulement partiel de cette énergie sur une partie très limitée de ce réseau.
Nous voyons maintenant que la raison est conditionnée par quatre choses assez variables d’un homme à un autre :
-
la nature et l’importance du centre affectif ;
-
la qualité et la quantité des réflexes conditionnels ;
-
la quantité d’influx nerveux ;
-
la qualité et la quantité des liaisons momentanées.
L’énergie nerveuse n’est pas la même chez tous les humains ; libérée trop brusquement, elle s’écoule vers la motricité sans réflexions ; trop longue à se former ou insuffisante, elle n’aboutit qu’à des actes manqués, à l’hésitation, à l’indécision, à l’aboulie. Dans le premier cas, l’énergie nerveuse ne parcourt qu’une petite fraction des multiples réseaux liés à l’excitation, et l’homme n’utilise qu’une faible partie de ses expériences antérieures. Dans le deuxième cas, l’influx nerveux se diffusant sans parvenir à se concentrer sur un point, aucune liaison décisive ne se crée.
Ni l’un ni l’autre ne peuvent engendrer des actes raisonnables.
Il en est de même des liaisons momentanées, ou raisonnements. Chez certains humains, ces liaisons s’effectuent de travers, ou bizarrement, peut-être lors même de la création des réflexes conditionnels. Les faits s’emmêlent, des rapprochements absurdes se réalisent. Ce sont des esprits faux.
Mais c’est surtout la création du centre affectif (besoins organiques et psychiques) et la formation des réflexes conditionnels (sensations, expériences, souvenirs, images, etc.) qui différencient les raisonnements des individus. Les passions ou même les besoins physiologiques, bien que communs aux humains, ne se manifestent point d’identique façon chez eux. La sexualité, par exemple, variera selon les tempéraments, les influences subies et les nombreuses circonstances particulières modelant la personnalité : entourage, lectures, paroles, gestes, spectacles, etc., autant de documents sensoriels différents excitant des tempéraments dissemblables.
Il en est de même des souvenirs, des expériences, de la connaissance que les hommes ont des faits et des êtres. L’hétérogénéité du milieu crée inévitablement l’hétérogénéité des documents sensoriels et, conséquemment, des réflexes conditionnels, ou acquis intellectuels.
Tant d’éléments dissemblables ne peuvent déterminer des conclusions identiques. En fait, le spectacle des hommes raisonneurs démontre qu’ils sont rarement d’accord et se contredisent mutuellement, avec abondance d’arguments plus logiques et plus infaillibles les uns que les autres. Les philosophes, les hommes de raison par excellence, se sont disputés tout au long des siècles sans démontrer la souveraineté de la raison dans leurs propres conflits d’idées. Le célèbre ouvrage La logique, ou l’art de penser, de ces messieurs de Port-Royal, ne les a pas empêchés, tout comme Kant, de mal raisonner et d’embrouiller des fait infiniment plus compréhensibles que leurs théistes subtilités.
De nos jours, les savants ne font pas mieux. L’unanimité est loin de régner dans cette austère région où l’expérience seule devrait trancher les différents humains. En fait, la passion les égare tout autant que les autres mortels. La constatation de leurs divisions, sur des faits positifs, démontre l’hétérogénéité de leurs documents sensoriels, la divergence des éléments de leurs jugements et l’impossibilité d’une unique solution. Inutile de s’arrêter sur la lutte entre les vitalistes et les mécanistes, les monistes et les pluralistes, les atomistes et les énergétistes, etc. Pas plus qu’il ne faut s’émouvoir des désaccords entre partisans de l’émission et partisans de l’ondulation ; ni s’étonner des oppositions nombreuses au relativisme einsteinien. Quel que soit le sujet scientifique abordé, on peut être sûr d’y trouver des interprétations scientifiques différentes des mêmes phénomènes observés.
Quant aux humains sans culture philosophique ou scientifique, le spectacle de leurs dissentiments, de leurs chicanes, de leurs mésententes, disputes, procès et autres méfaits, démontre la fragilité des jugements, la divergence des raisonnements et l’impossibilité d’existence d’une unique raison pure.
Pourtant, dira-t-on, la logique est inviolable, et les mathématiques ne peuvent conduire à des contradictions. Donc, il y a des raisonnements justes, la vérité peut se démontrer, la raison n’est pas un vain mot.
Évidemment, il y a quelque chose d’invariable dans tous les raisonnements, et c’est cet invariant qui, mêlé habilement à des propos erronés, trompe et induit les gens en erreur par son apparente évidence. Ce quelque chose, c’est le rapport immuable des choses entre elles ; ce sont les évidences sensorielles tellement fixées en nous, par leur incessante répétition, qu’elles font partie de notre structure cérébrale, et que nos complexes de réflexes doivent se construire selon ces rapports mêmes. Tout le monde, sauf les détraqués, conviendra de l’emplacement d’un objet situé à droite ou à gauche d’un autre. Tout comme nul ne contestera les généralités permettant la connaissance du monde extérieur. Mais ce n’est là que le principe d’identité, duquel l’homme tire tout son savoir. C’est toujours le fameux : si A = B et si C = B, A = C. On peut varier cela de toutes les façons, ce sera toujours la recherche de l’identité. Ce sont là des éléments, des morceaux de raisonnement avec lesquels on construit toutes les démonstrations. C’est avec cela que l’on construit les mathématiques, et la logique n’est qu’une savante utilisation du principe d’identité. C’est dans ces tout petits morceaux de vérité que git la magie du verbe conquérant, la flamboyante clarté de la logique, l’enchantement des démonstrations. Savoir faire jaillir ces petits bouts de vérité, les prodiguer dans une suite ininterrompue de propos, c’est là tout l’art des trompeurs qui visent beaucoup plus à stupéfier leurs adversaires et à les dérouter, qu’à rechercher une vérité de vaste envergure.
Pourtant, il est évident que c’est uniquement dans le fameux A = B que réside toute la force, ou la faiblesse, d’une argumentation. Il faut donc, avant toute chose, démontrer l’égalité de A et de B ; il faut que cette identité s’impose comme une évidence indiscutable. Or, l’étude que nous venons de faire sur le fonctionnement cérébral nous montre qu’à part les généralités et les rapports des choses entre elles (connaissances impersonnelles), chaque humain s’est construit une conception particulière du monde ; et cette conception, ce centre affectif libèrent de l’énergie dans des voies déjà créées, négligeant d’autres voies, d’autres faits, d’autres connaissances, existant pourtant comme documentation dans l’individu, mais inutilisées lors d’un raisonnement ou d’une action trop intéressée.
De là ces entêtements extraordinaires, ces préférences, cette partialité qui surprennent chez certains êtres, même très cultivés.
À ce moment, si A = B pour Jean, B n’égale pas A pour Pierre, et aucune règle de logique ne les fera changer d’opinion. Chacun d’eux s’étonnera de l’aveuglement et de la mauvaise foi de l’autre, alors que l’un et l’autre ne sont que des mécanismes construits différemment et fonctionnant, par conséquent, différemment,
Examinons, par exemple, les deux célèbres maximes :
« Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu’il te fasse. »
Et :
« Traite autrui comme tu veux être traité. »
Il est clair que, dans les deux cas, le sujet est supposé identique à autrui. Ce qui est erroné. Si le sujet aime la solitude, il fuira la compagnie d’autrui, qui, au contraire, peut se trouver très malheureux de cette solitude. Ici, la logique négative de la première maxime est en défaut. Par contre, le sujet aimant la société peut importuner autrui qui, d’une nature méditative, souffrira de ce traitement. Ici, encore, la logique positive de la seconde maxime est nuisible et non conforme à l’intérêt réciproque des humains.
Tout cela nous montre le danger du principe d’identité, du fameux A = B, appliqué à tort et à travers, formé lui-même au hasard des formations des réflexes conditionnels. Nous voyons également le danger du rationalisme pur, car la connaissance formée en chacun de nous par ses réflexes particuliers ne peut jamais coïncider totalement avec celle des autres.
De là les méfaits de toutes les croyances, religions, morales, traditions, métaphysiques et philosophies qui, surgies des réflexes embrouillés des mécaniques cérébrales personnelles, ne peuvent en aucune façon, malgré leur rôle unificateur, s’harmoniser entre elles.
Nous pouvons même aller plus loin : non seulement il n’y a pas de raison pure, mais nous pouvons même affirmer que la logique et le raisonnement sont nettement déterminés par les centres affectifs, lesquels, loin d’être maîtrisés par une raison souveraine, utilisent au contraire cette raison pour leur fonctionnement. Ceci explique les différences considérables de raisonnement sur des mêmes sujets, selon les personnages et leurs différentes situations.
Ces divergences s’expliquent très bien après notre étude. Lorsqu’un complexe de réflexes se forme, nous savons qu’il est lié à un très grand nombre d’autres réflexes conditionnels et à d’autres complexes de réflexes, lesquels se sont construits avec un minimum d’ordre et de logique imposés par les circonstances elles-mêmes. Il est donc tout naturel qu’une excitation ayant libéré de l’énergie dans un centre affectif, celle-ci se diffuse dans tous les réseaux liés à ce centre ou complexe de réflexes. Cette diffusion s’effectuera par les voies construites antérieurement avec une certaine logique. De là cette apparence de bon sens, même dans les raisonnements vicieux. Mais cela nous montre en même temps qu’il est absurde de faire de la raison un motif déterminant primordial et absolu, un impératif catégorique. Physiologiquement, cela est totalement impossible. Il ne faut pas oublier que la vie est action et que l’action est essentiellement liée à la diffusion de l’énergie nerveuse dans les centres moteurs. Or, cette énergie n’est nullement produite par les centres associationnistes où se forment les liaisons momentanées, les hautes abstractions et les profondes spéculations intellectuelles ; elle se forme certainement dans les puissants centres affectifs, ces fameux complexes de réflexes (ambition, sexualité, haine, art, propagande, mysticisme, etc.) qui sont comme des réservoirs ou des fabriques d’énergies nerveuses. Cela explique qu’une excitation, parfois minuscule, puisse produire des effets extraordinairement violents, tel le cas d’un jaloux voyant sa femme embrasser un autre homme (excitation visuelle minuscule) et se sentant violemment ému.
C’est donc de ces centres, très liés aux réflexes moteurs, que part l’énergie nerveuse. Ce sont donc eux qui, avant toute chose, sont les propulseurs de la machine humaine. L’énergie nerveuse se diffuse ensuite, à travers le réseau des réflexes conditionnels secondaires et parvient enfin (s’il en reste et si l’acte moteur n’a pas déjà été accompli) dans les ultimes régions où, probablement, se ramifient tous les réflexes conditionnels constituant le vrai savoir, la véritable connaissance.
Il est absurde, par conséquent, de faire de la raison un motif d’action. La raison n’est et ne peut être qu’une opération de convenance d’une chose à une autre. Elle établit des rapports. Elle joue subjectivement le monde objectif. Elle est spectatrice, mais une spectatrice rarement désintéressée, car l’influx nerveux qui se diffuse d’un centre affectif parcourt des réseaux qui se sont construits progressivement, en relation étroite avec tout ce qui intéresse ce centre ; et les régions du vrai savoir se sont également construites en liaison avec lui. D’où l’aspect intéressé de tout raisonnement et sa dépendance des centres affectifs.
Que faire, alors, dira-t-on, si la raison n’est qu’une fonction hasardeuse déterminée par l’intérêt vital ? Si le raisonnement n’est qu’un outil incertain, faut-il abandonner l’espoir de voir triompher la sagesse, et faut-il se laisser guider par les passions et par les instincts ?
Que pouvons-nous, en définitive, attendre de la raison ? Voici quel peut être le rôle de cette ultime fonction du système nerveux.
Nous avons étudié jusqu’ici la formation des réflexes conditionnels. En fait, nous ne devons appeler raison que les liaisons momentanées créées par la diffusion de l’influx nerveux dans le réseau où se fusionnent tous les réflexes conditionnels.
Autrement dit, la raison est l’utilisation d’une grande documentation générale avec création de voies nouvelles prolongeant la réalité au-delà du présent, construisant mentalement du vécu pour en connaître le terme final et modifier ainsi l’action présente, en vue d’obtenir ou de modifier cette fin.
Nous savons que la connaissance réelle est formée des généralités (qui sont déjà des rapports de qualités entre elles), des rapports réciproques de ces généralités (disposition, ordre, succession, temps, espace, etc.) et des liaisons momentanées (logique, raisonnement, induction, déduction, etc.) s’appliquant à toutes les variations du milieu. C’est la connaissance expérimentale.
D’autre part, ces trois éléments de la connaissance sont communs à tous les hommes et ne se forment en nous, précisément, que par l’identité répétée des faits qui s’imposent à notre sensibilité. Nous avons donc là une possibilité d’établir le fameux A = B, seule base possible d’entente entre les hommes. Nous voyons alors que le savoir humain se divise nettement en deux parties : d’une part les connaissances objectives, satisfaisant aux trois conditions précédentes, susceptibles de démonstrations sensibles et pouvant déterminer une compréhension mutuelle des humains devant l’évidence des faits ; de l’autre les connaissances subjectives, strictement limitées au savoir individuel.
Les divergences proviennent, invariablement, du mélange ou de la substitution, consciente ou non, d’une des deux connaissances à l’autre. Les mauvais raisonneurs et les gens de mauvaise foi opèrent cette substitution et, croyant, ou affectant de croire, qu’ils sont toujours sur le terrain objectif et impersonnel, argumentent au contraire en satisfaisant largement leur logique personnelle, source de chicanes sans fin. Il ne peut y avoir rapprochement entre les hommes que sur des points communs les intéressant tous, et la raison ne peut s’exercer que sur ces points-là.
Pourtant, dira-t-on, puisqu’il a été démontré qu’il n’y avait pas de raison pure, et que seuls les centres affectifs (besoins vitaux, passions, sentiments, désirs, etc.) déterminaient la raison, celle-ci ne peut avoir aucune influence sur le comportement sensé des humains. Il est donc inutile de s’occuper d’elle. Il n’y a qu’à laisser l’énergie nerveuse se disperser selon ses propriétés physico-chimiques.
Il est évident, en effet, que si la raison était toujours entièrement déterminée par les passions violentes, il serait inutile d’en espérer un secours, quel qu’il soit, contre l’inharmonie des êtres et des choses. Mais la psychologie humaine est rarement déterminée par un seul centre affectif important assujettissant tous les autres. Ces cas-là se rencontrent pourtant quelquefois. Des hommes se passionnent pour le jeu auquel ils sacrifient tout. D’autres se livrent à la boisson ou aux stupéfiants qui les abrutissent progressivement. Il est des avides orientant toute leur existence pour agrandir une ferme ou une industrie, ou pour parvenir au sommet de la hiérarchie bureaucratique ou politique. La religion, l’art, le sport et même la science ont leurs fanatiques, sortes de monstres psychologiques, dont l’unique passion absorbe tout. Ce sont des gens dangereux, comme tous les fanatiques et les déséquilibrés, et dont les actions, aucunement équilibrées par d’autres centres affectifs régulateurs, peuvent se transformer soudainement en actes malfaisants. Comme tous les complexes de réflexes se construisent selon un certain processus logique, et que l’énergie diffusée par ces complexes les lie aux centres de la connaissance réelle, il s’ensuit que ces déséquilibrés accomplissent leurs méfaits, soit envers eux, soit envers les autres, avec une sorte de lucidité raisonnée qui surprend, mais qui nous montre l’aspect particulièrement adaptatif de la raison, c’est-à-dire la coordination des actes en vue d’atteindre une fin, quels que soient ces actes et cette fin.
On objectera que ces anormaux produisent des génies.
Cette opinion courante est erronée. Le génie n’a rien à faire avec la folie. Si par génie on entend cet esprit créateur qui formule des concepts en avance sur son époque, et trouve ou invente des formes nouvelles d’activités humaines, il est bien évident que cette nouveauté ne sera un bienfait réel que si elle correspond à une faculté humaine spécifique, saine, vitale et non morbide. Et cette faculté, loin d’exister exceptionnellement chez le génie, doit exister chez tous les humains. Ce qui, chez lui, la différencie des autres, c’est son intensité. Il y a chez le génie une forte et puissante construction de ses réflexes conditionnels ; une relation précise, poussée à un extrême degré entre tous ses complexes de réflexes ; enfin, une meilleure liaison des réflexes entre eux, peut-être parce que l’énergie nerveuse se diffusant plus longuement, dans un réseau nerveux mieux construit, peut ainsi multiplier les rapprochements des voies se construisant incessamment.
Dans la folie, c’est l’inverse qui se produit. Il y a diminution plus ou moins importante des liaisons entre les différents réseaux. Les relations entre ces réseaux et l’apport incessant des sensations présentes ne s’effectuent plus normalement. Enfin, les liaisons momentanées ne se créent plus selon l’ordre logique des faits, mais d’une manière irrationnelle et incohérente. Autrement dit, le fou ne s’adapte pas à la réalité, tandis que le génie prévoit et devine une réalité que les autres n’ont pas encore perçue.
L’homme normal est donc celui chez qui tous les centres affectifs s’équilibrent à peu près selon leur importance vitale respective. Quelques psychiatres classent ces centres ou tendances affectives innées en cinq groupes principaux : l’avidité, la bonté, la sociabilité, l’activité et l’émotivité, issus eux-mêmes des fonctions vitales primordiales qui sont la nutrition, la génération et la motilité. Enfin, une quatrième fonction, la réceptivité, se divise en mémoire, jugement, imagination. Ces trois dernières facultés correspondent aux trois éléments de la connaissance antérieurement étudiés.
Remarquons que ces tendances affectives présentent cette particularité de s’opposer presque entre elles et de s’équilibrer mutuellement. C’est ainsi que le besoin de conquête (avidité) et la combativité (émotivité) sont contrebalancés par l’amour et le désintéressement (bonté, sociabilité), tandis que l’activité en rend possible leur réalisation. Nous avons déjà là une indication précieuse pour la compréhension de l’homme raisonnable, et nous voyons que n’est pas raisonnable qui veut, mais qui peut, car l’équilibre de ces tendances innées est aussi peu dépendant de notre volonté que l’est la nature de notre sexe ou la couleur de nos cheveux.
À cette personnalité héréditaire, ou innée, s’ajoute la personnalité acquise, essentiellement formée par l’éducation (ensemble des réflexes conditionnels). C’est ici qu’il convient de faire intervenir un autre aspect du fonctionnement nerveux : l’inhibition. Cette inhibition, également bien étudiée par Pavlov dans ses effets, consiste en un arrêt, une disparition plus ou moins durable du réflexe conditionnel étudié. Elle paraît agir toutes les fois que l’excitant conditionnel agit seul, et faiblement, un certain temps (production d’un son, grattage, etc.), sans être accompagné de l’excitant absolu (repas, action de l’acide dans la gueule du chien, etc.). Voici une de ces expériences : l’excitant conditionnel étant le métronome, on lui associe l’odeur du camphre, sans faire suivre ces deux excitants d’un réflexe absolu au repas. Tout d’abord, le métronome agit et la salivation apparaît. Mais après répétition de ces excitants associés, le métronome n’agit plus, le camphre a créé l’inhibition, et il faut attendre une demi-heure pour que le métronome puisse encore provoquer, seul, la salivation. L’inhibition se propage à peu près de la même façon que l’excitation. Elle se diffuse, s’irradie autour du point excité et revient se concentrer à ce point. Le réflexe conditionnel inhibé peut disparaître momentanément ou d’une façon définitive. L’inhibition joue un rôle très important dans le déterminisme psychologique. Elle nous explique les arrêts, les changements d’idées plus ou moins soudains, la variation des décisions, la disparition des concepts ; en un mot, toutes les modifications subies par les réflexes conditionnels sous l’influence des excitations extérieures.
Ainsi, l’éducation subie par l’homme depuis sa naissance, bien que ne faisant qu’imprimer des directives dans les tendances affectives, lesquelles restent toujours les sources initiales de l’activité humaine, peut tout de même modifier, non pas sa nature affective difficilement évolutive, mais son comportement actif. Autrement dit, parmi les influences éducatives (car par éducation il faut comprendre tout ce qui a influencé l’être vivant : température, climat, aliments, vêtements, habitations, jeux, entourage vivant, etc.), celles qui intéressent plus particulièrement la connaissance ont une grande importance et peuvent faire agir les individus dans des directions très différentes. Ce rôle des idées est donc de première importance dans le comportement extérieur des humains. L’éducation sociale ayant discipliné les tendances primitives, sans les amoindrir le moins du monde, ces tendances se satisfont plus ou moins bien, selon la nocivité ou l’excellence des idées. Ces idées, ou réflexes conditionnels supérieurs, sont probablement excitées, ou inhibées, par les excitations extérieures toutes les fois que l’énergie nerveuse, divisée par la complexité de ces excitants (faits multiples, situation critique ou embrouillée, événements imprévus ou inexplicables, etc.), n’engendre pas l’action immédiate, unique et rapide, mais des ébauches multiples d’actions. Alors, l’énergie nerveuse parvient jusqu’aux centres intellectuels, et le processus habituel de la réflexion se réalise, suivi ou non d’action. Comme il est assez rare que l’homme soit sous l’empire d’une unique excitation, ou d’un unique centre affectif (ventre affamé n’a pas d’oreille, nécessité n’a pas de loi, etc.), nous voyons qu’à l’état normal les centres intellectuels sont perpétuellement excités pour adapter l’être aux réalités du moment.
Il se produit même autre chose, c’est que l’énergie nerveuse, issue de certains centres affectifs, n’est pas toujours nécessitée par une action motrice immédiate. Le système nerveux peut se comparer à une sorte de fabrique incessante d’énergie nerveuse qui, inutilisée par l’adaptation immédiate ou prochaine aux faits objectifs, parcourt les divers réseaux nerveux des centres intellectuels, soit au hasard des excitations extérieures, soit sous l’influence d’un centre affectif excité subjectivement (influence des organes, humeurs, cœnesthésie, etc.), soit enfin sous l’excitation d’un complexe de réflexes très important formé par l’éducation (problèmes éthiques et esthétiques), mais, en réalité, dépendant d’une tendance primitive innée.
Ce vagabondage de l’énergie nerveuse, à travers des réseaux prodigieusement enchevêtrés, réalise ce que nous appelons communément imagination, rêverie, méditations, réflexions, abstractions intellectuelles, raisonnement.
Le rôle de ces méditations n’est pas nul, bien au contraire. Les voies nouvelles créées par elles ne le sont pas toujours en vain. Si certaines rêveries sont stériles, il en est d’autres qui, ayant construit des possibilités d’action, ou résolu des difficultés éthiques ou esthétiques, forment des voies toutes prêtes à des excitations futures et modifieront, conséquemment, le comportement ultérieur de l’individu.
Pouvons-nous, maintenant, définir le rôle de la raison et l’attitude de l’homme raisonnable ? Je crois que oui.
Nous avons, d’un côté, les tendances affectives qui nous font ce que nous sommes : c’est notre personnalité innée ou héréditaire. De l’autre, nous avons la personnalité acquise formée par l’éducation, ou réflexes conditionnels. Nous avons vu que ces réflexes ont un rôle directeur et coordinateur, tandis que les tendances affectives ont un rôle propulseur. Nous pouvons alors saisir le mécanisme des modifications volontaires de l’homme raisonnable.
Prenons l’exemple de ce gentilhomme ayant maltraité sa femme après boire, et lui faisant serment, après un dernier verre de vin, de ne plus jamais toucher à ce breuvage. Ce qu’il fit scrupuleusement, paraît-il. Il faut, pour comprendre mécaniquement ce fait, situer la psychologie du héros. En lui existent des centres affectifs très accusés : nutrition, génération, réceptivité, etc. ; lesquels se divisent en de multiples sous-états affectifs : gourmandise, amour, imagination, goûts esthétiques et éthiques ; et, enfin, connaissances personnelles et générales. Jusqu’à cet événement, c’est le centre important de la nutrition qui, par la gourmandise, a triomphé des autres, les inhibant par son excès d’énergie nerveuse. Mais, après ce fait excessivement important, c’est le centre affectif de la génération, et les centres de l’éthique et de l’esthétique, qui réagissent sous l’impression de la douleur féminine et, à leur tour, inhibent définitivement l’état affectif de la gourmandise. L’influx nerveux, se diffusant alors (devant la complexité des faits) dans les centres de la connaissance, y détermine cette résolution énergique et définitive.
Voilà le processus volontaire d’un acte dit raisonnable.
Bien entendu, cela ne satisfera point les adorateurs de la raison pure, lesquels feront ici intervenir un impératif catégorique inconditionné, qui, sans cause, fera soudainement agir notre gentilhomme différemment. Cela ne fera pas non plus l’affaire d’une autre sorte de ratiocineur, qui voudrait que le héros se contentât de boire raisonnablement, sans passer ainsi d’un excès dans l’autre. C’est oublier qu’un homme ardent, à l’énergie nerveuse abondante, ne peut être un modéré, et que le côté éthique et éducatif, ayant été violemment excité, a réagi par le réflexe le plus efficace et le plus sûr : l’abstention définitive.
Si cette explication déterministe ne convient pas aux mystiques qui rêvent d’une parfaite indépendance de leur raison, quant aux phénomènes physico-chimiques qui la créent, elle explique, par contre, très bien le mécanisme des déterminations, raisonnables ou non.
Nous comprenons alors que l’homme raisonnable, ou l’homme de raison, est celui chez qui existe déjà un certain équilibre des tendances affectives, et qui possède une personnalité acquise fortement et diversement développée.
Ne peuvent pas être raisonnables le gastronome excessif, le sexuel pur, l’acteur à tout prix et le raisonneur exclusif ; car, concevant le monde conformément à leur nature trop spécialisée, ils s’adaptent mal aux réalités diverses du monde objectif, qu’ils déforment selon leurs spécialisations. Chez eux, les centres esthétique et éthique déterminent cette connaissance personnelle que nous supposons inconciliable avec la connaissance réelle et objective, nécessaire à toute harmonie.
L’homme de raison a donc ses centres esthétiques et éthiques équilibrés par la diversité de ses tendances affectives, et sa connaissance réelle lui permet d’orienter son activité vers des réalisations harmonieuses avec les autres êtres. C’est là une des caractéristiques de l’universalité. La grande connaissance des faits permet des synthèses de plus en plus vastes, dans lesquelles les contradictions tendent à s’éliminer par le jeu même des constructions nerveuses, s’effectuant, nous l’avons vu, selon le processus des causalités.
La volonté n’est donc que l’effet durable du fonctionnement nerveux s’effectuant sous l’influence d’une tendance effective dans le domaine de la connaissance.
Comment, dira-t-on alors, peut-on devenir raisonnable, si on ne l’est pas naturellement ?
Cette modification volontaire, intéressante au plus haut degré, comprend deux activités différentes, soit qu’il s’agisse de soi-même, soit qu’il s’agisse d’autrui. Dans ce dernier cas, notre action porte inévitablement sur un défaut que nous constatons chez ceux que nous voulons rendre raisonnables. S’il s’agit d’un enfant, nous devons étudier soigneusement sa nature et ses tendances affectives et utiliser celles qui nous paraissent avantageuses, et bien établies, pour inhiber les tendances malfaisantes, et canaliser judicieusement les autres à l’aide de solides réflexes conditionnels, créateurs de centres esthétiques et éthiques, coordonnés à leur tour par de grandes connaissances réelles et synthétiques. Le centre affectif défaillant sera ainsi équilibré par une éducation tendant à universaliser tout de même l’activité future de l’enfant. Peut-être une certaine modification de l’activité des glandes internes permettrait-elle une amélioration du caractère, puisque certaines glandes agissent comme régulateurs de croissance, d’activités musculaire ou intellectuelle, etc. C’est un problème excessivement délicat et qui exige déjà un éducateur très objectif, très bien équilibré lui-même et non déterminé par une des tendances exclusives examinées précédemment.
Ceci nous enseigne que n’est pas éducateur qui veut, et qu’engendrer un enfant est une toute autre chose que l’élever avec sagesse.
S’il s’agit d’adultes, nous pouvons encore, ici, nous trouver en présence de plusieurs cas, soit qu’il s’agisse de personnes sympathiques et de fréquentation continue ou très espacée ; soit qu’il s’agisse de personnes plus ou moins indifférentes, avec contact prolongé ou intermittent. Toutes ces distinctions nous indiquent nos possibilités d’action sur elles, car le temps, la sympathie et la connaissance sont des facteurs efficaces de toutes modifications individuelles. Si nous avons pu déceler le point défaillant (qu’il ne faut point confondre avec un caractère original et hautement personnel, pouvant même recéler du génie) se traduisant presque toujours par une déficience personnelle du sujet, nous pouvons agir, sur telle ou telle tendance affective très développée, pour inhiber les mauvais réflexes et créer d’autres complexes de réflexes éthiques ou esthétiques. Il est compréhensible que, chez ceux que nous aimons, nous agirons sur le centre génératif et émotif, et peut-être réceptif ; tandis que, pour les indifférents, nous agirons plus spécialement sur la nutrition et la motilité ; autrement dit, sur l’intérêt et l’activité vitale.
Mais il est bien évident que, comme pour l’enfant, notre action sur autrui sera d’autant plus efficace que nous serons plus équilibrés nous-mêmes, et non aussi déséquilibrés que lui. Un excité ou un lymphatique ne seront jamais de bons éducateurs, car leur nature, bien qu’acceptable pour des tempéraments s’harmonisant avec le leur, leur interdit sinon des jugements justes – car nous savons que la connaissance réelle est accessible à tous les êtres sensés –, mais certainement d’agir judicieusement. On peut penser correctement et agir très sottement.
Reste enfin le dernier cas, celui de l’amélioration de notre propre personnalité. Il peut paraître contradictoire d’établir à la fois et l’impuissance de la raison et son pouvoir créateur.
Pourtant, la difficulté se résout le plus simplement du monde, par le fait, bien évident, que celui qui veut réellement se modifier est déjà déterminé par un centre affectif énergique. Ne se modifie pas comme cela, tout d’un coup, qui veut, mais qui est antérieurement déterminé, par une cause extérieure, à se transformer. Ces causes extérieures sont nombreuses, mais, toujours, elles se traduisent nettement en nous, dans le domaine de la connaissance, par une déficience, une infériorité de notre organisme vis-à-vis d’une représentation précise que nous avons d’un meilleur fonctionnement de nous-mêmes. Que ce soit dans un combat physique, une lutte d’idées, une extériorisation affective ou intellectuelle, des tentatives de conquête ou de satisfaction organique, toujours la réalité se différencie de notre action subjective.
Nos réflexes sont toujours plus ou moins adaptés aux faits, et cela détermine en nous une réaction plus ou moins vive. L’énergie nerveuse incomplètement libérée, ou entravée dans son cheminement, ne trouve point d’issue normale et crée un état, parfois, pathologique, si une voie nouvelle ne vient utiliser cette énergie. La justification est souvent une de ces voies, et l’inadapté, réagissant, rejette sur l’objectif les causes de son insuccès. Il y a peu de chance d’amélioration avec des réflexes pareils. D’autres vont à l’autre extrémité et, d’une pusillanimité excessive, s’accusent de tous les torts, et finiraient par mourir de peur de vivre, si leurs réflexes organiques ne les propulsaient en avant.
L’homme de raison se différencie en ceci que sa connaissance du monde et de lui-même s’universalise équitablement. L’idée qu’il se fait de son moi n’inhibe pas l’idée qu’il se fait de celui des autres. Ses méditations nombreuses ont créé des voies synthétiques, harmonisant ses concepts. Qu’une inadaptation survienne, qu’une déception surgisse, qu’une contrariété le surprenne, qu’une inhibition l’indispose, et, comme tous les mortels, il en ressentira très vivement, peut-être même très violemment, les effets. Mais, par les voies nombreuses de la médication, une bonne partie de l’énergie nerveuse se dispersera et son action objective, visible, sera très différente de celle d’un homme irréfléchi.
Par contre, l’échec de sa vitalité ne s’effacera point aisément de son organisme. La complexité de ses réseaux nerveux, leur extrême sensibilité, l’abondance de l’énergie nerveuse, sans cesse sollicitée et produite par cette difficulté fonctionnelle non résolue, finiront par créer des rapprochements, des liaisons dans les centres intéressés, et de nouveaux réflexes s’organiseront, des inhibitions se créeront, et son action future sera désormais autrement orientée vis-à-vis de l’événement excitateur.
Ainsi, c’est sous l’influence des excitations extérieures que nous nous modifions ; influence qui libère en nous l’énergie d’un centre affectif, inhibant un autre centre affectif, par l’intermédiaire des centres intellectuels.
La voix de l’homme qui dit « je veux » ressemble donc aux hérauts annonçant des actes décidés sans leur consentement. C’est la trompette proclamant l’issue du tournoi. Quand la voix dit « je veux », les réflexes conditionnels ont déjà fonctionné, l’acte est en puissance, les réflexes moteurs en action.
Vouloir se modifier, c’est déjà sentir en soi un besoin d’agir autrement. C’est se déterminer selon des réflexes nouveaux, créés par le dehors. Agir raisonnablement, être un humain raisonnable, c’est avoir la chance de posséder en soi, et autour de soi, tous les éléments qui concourent à notre équilibre et à notre harmonie. Cette chance se traduit par un excédent d’énergie nerveuse, non produite par un échec, mais par un bon fonctionnement nerveux n’utilisant pas totalement cette énergie. C’est de l’épargne nerveuse, source de plaisir – lequel ne peut donc jamais être une cause d’action, mais est bien plutôt la conséquence, l’effet de l’action nerveuse –, et la durée de ce plaisir forme le bonheur, ou joie de vivre.
N’est donc pas davantage heureux qui veut, mais bien qui peut.
Cette étude ne transformera pas un anxieux en excité, ni un exclusif en équilibré. D’un pessimiste elle ne fera pas un optimiste, ni d’un esprit faux un esprit judicieux. Elle permettra simplement à ceux qui sont des équilibrés qui s’ignorent, ou des équilibrés possibles, de devenir des équilibrés vrais, s’ils ne sont pas satisfaits de leur état actuel.
La psychologie objective permettrait, peut-être, à la grande majorité des hommes de ne plus se quereller dans des domaines où tous ont tort, ou raison, suivant qu’ils se placent au point de vue personnel et subjectif, ou impersonnel et expérimental.
Employons notre connaissance à cette discrimination nécessaire. Ne molestons plus autrui pour nos divergences. Cherchons un terrain expérimental pour trancher les différends, si cela est possible ; faisons appel à ses tendances affectives, si les centres intellectuels coordonnent, ou universalisent mal sa documentation sensorielle ; et laissons-le en paix, s’il n’y a aucune action positive possible avec lui. À charge de réciprocité, bien entendu.
Ma conclusion sera donc simple. La voici :
Nous sommes formés d’un mélange de personnalité innée et de personnalité acquise. De cet ensemble, hasardeux, il résulte que notre concept de la vie ne peut coïncider totalement avec celui des autres hommes, puisque les causes déterminantes n’ont pas été les mêmes pour tous les hommes. Seules, la spécificité de la nature humaine et l’objectivité des connaissances peuvent créer des contacts avantageux et harmonieux entre les individus. Hors ces contacts, plus ou moins durables, il ne peut y avoir unanimité d’action.
La raison est l’ultime opération mentale permettant, sous l’influence des centres affectifs, particulièrement ceux de l’éthique et de l’esthétique, de synthétiser et d’universaliser les divers conflits subjectifs ou objectifs, par réduction ou élimination des contradictions s’opposant aux fins que l’être conçoit, en vue d’une meilleure adaptation de ces actes aux nécessités du milieu.
Être raisonnable, c’est donc agir convenablement vis-à-vis de ses fins personnelles et vis-à-vis des fins collectives. C’est aussi séparer nettement ce qui nous est strictement personnel de ce qui peut être identifié communément.
Enfin, se déterminer selon sa raison, c’est, sous l’influence d’une tendance affective, inhiber une autre tendance affective nuisible. C’est créer d’autres réflexes mieux adaptés à la réalité, ou exempts de contradiction. C’est avoir la chance d’être possesseur d’un système nerveux suffisamment bien construit et équilibré pour que l’influx nerveux atteignant les centres intellectuels y crée des liaisons avantageuses, ou y emprunte les voies méditatives antérieurement créées conduisant aux actes sensés.
Et c’est la vie, l’expérience qui, seules, démontrent, en dernier ressort, par l’évidence des faits, de quel côté se trouve la raison.
— IXIGREC.
RAISONNEMENT
n. m.
Le raisonnement consiste dans un enchaînement de jugements, organisés de telle façon que le dernier dépende des premiers avec plus ou moins de rigueur. Instrument de démonstration et de vérification, il assure la cohérence de la vie mentale, rend la science possible et permet de prévoir. Il engendre, écrit L. Barbedette :
« Une représentation impersonnelle du monde qui, sur des points de plus en plus nombreux, provoque un accord unanime. Ses vérités ne sont pas celles d’une race, d’une époque ou d’un individu, ce sont celles de l’humanité entière, consciente de son milieu ; d’où son évidente supériorité sur les croyances religieuses, sur les opinions commandées par l’intérêt ou le sentiment. »
Perceptions des sens, données de la conscience font l’objet d’une intuition immédiate ; mais bien des vérités ne peuvent être connues que d’une façon indirecte, grâce à la force démonstrative du raisonnement. Ce dernier, inexplicable par la seule association des idées, se ramène en définitive à une substitution de termes ; et sa rigueur sera d’autant plus grande que la similitude des termes substitués sera plus complète. En mathématiques, où la similitude atteint son plus haut degré, le raisonnement obtient une rigueur absolue. Longtemps, on considéra le syllogisme comme la forme idéale du raisonnement ; d’où l’abus qu’en firent les scolastiques au Moyen Âge. Oubliant de consulter l’expérience, ils raisonnaient à vide et n’aboutissaient qu’à de creuses abstractions, sans lien avec le réel. Dans le raisonnement inductif, l’esprit conclut du particulier au général ; il s’élève de la connaissance des faits aux lois qui les régissent. Dans le raisonnement déductif, l’esprit conclut du général au particulier ; il tire une vérité particulière d’une vérité générale. Le raisonnement par analogie, si conforme à la mentalité primitive, part de la constatation de certaines ressemblances pour en supposer d’autres.
RAISONNEMENT. — Le raisonnement est l’expression de la raison individuelle, de l’individualité, enfin de l’homme. C’est l’action de raisonner. Du reste, raisonner c’est observer, réfléchir, parler en dehors ou en dedans ; enfin, c’est calculer dans son propre intérêt, en rapportant tout à soi avec l’intention de rechercher ce que l’on croit le bien, de fuir ce que l’on croit le mal, toujours et exclusivement pour soi-même. Un raisonnement sérieux comporte l’enchaînement de diverses raisons déduites les unes des autres et aboutissant à une démonstration logique. S’il en est ainsi, c’est que la caractéristique de l’homme dans ses multiples réflexions, dans ses calculs intéressés, le porte vers l’égoïsme dont il ne se séparera jamais entièrement, lors même qu’il fasse les plus sérieux efforts dans ce sens. Est-ce à dire que, si le raisonnement nous porte vers un égoïsme rationnel, qui est la source et la condition du progrès, qui assure l’existence générale, il ne doit pas, par le pouvoir que confèrent la force et les richesses dont certains hommes disposent au détriment des masses laborieuses, dégénérer en cupide exploitation, comme la société actuelle nous en fournit l’exemple ? À cet effet, le raisonnement, de particulier à l’origine, doit devenir social, c’est-à-dire être le même pour tous devant l’évidence des faits, ce qui revient à dire qu’il doit avoir pour tous un point de départ identique, un principe commun. Tant que l’ignorance sociale sur la réalité du droit dure, il est impossible, pratiquement, d’espérer la démonstration du principe d’équité. En époque de libre examen, qui est la nôtre, non seulement la démonstration devient possible théoriquement, mais elle peut être fortifiée par les événements qui la justifient. L’on voit alors que le doute ne peut être combattu victorieusement par l’incontestabilité socialement acquise, et les conservateurs de toutes nuances continuent à évoquer l’ancienne foi, devenue impossible à restaurer. À ce moment, qui est celui de notre époque, nous remarquons que les progressistes, les matérialistes, plus ou moins déterministes, s’en remettent aux événements qui sont sans but et sans direction, et qu’à continuer ce mécanicisme de la pensée et de l’action, c’est vers sa perte que l’humanité s’oriente. Les exemples d’immoralité diverse qui se multiplient à l’infini ne peuvent laisser de doute à cet égard. Cependant, les matérialistes aiment s’appesantir sur les faits qui frappent leur imagination, leur intelligence ; ils oublient que les faits, par eux-mêmes, sont sans signification sociale. Les faits sont ce qu’ils sont et c’est au raisonnement à les déterminer. Tous les objets du raisonnement sont des faits ; et, parmi les faits, le raisonnement nous montre que les faits physiques ne sont relatifs qu’aux phénomènes, alors que les faits moraux le sont à la matière aussi bien qu’à l’intelligence, à la liberté, à la raison qui, elle-même, est un fait.
Dans le monde, il n’y a que des faits réels, éternels, et des faits apparents, physiques, temporaires. Les faits moraux, quels qu’ils soient, doivent être conformes au raisonnement sain. Ils sont une preuve surabondante de la bonté du raisonnement qui les établit. Il en est ainsi parce que ces faits sont, eux-mêmes, le résultat du raisonnement, ils ne font rien d’autre que manifester la modification éprouvée par celui qui, en raisonnant, les accepte ou les repousse. Certains nous disent : inutile de raisonner avec les faits, les faits sont entêtés, ils s’imposent en dépit de tout ce que le raisonnement pourrait leur opposer. Un pareil raisonnement, qui a quelque apparence de logique, est cependant absurde. En effet, quel est le fait qui ferait admettre que deux et deux font cinq ou sept, que un n’est pas un, que deux plus deux ne font pas quatre ? Il en est de même du fait qui serait invoqué contre l’immatérialité de la sensibilité, contre la faculté du choix, du jugement exclusive à l’homme, contre la liberté de l’homme qui n’agirait que par la volonté d’un dieu ou sous l’empire de la fatalité du mouvement et de la matière. De même, la nécessité du contact de deux ou plusieurs organismes sensibles pour développer l’intelligence et le langage, pour faire enfin qu’il y ait conscience de soi et distinction entre les idées, les faits dont la conscience se compose et imprime aux organes la connaissance de faculté qui détermine l’homme et l’action. Pour réfuter ce raisonnement logique, certains matérialistes opposent la mobilité des tables qui parleraient et répondraient aux questions posées. Nous ne nous attarderons pas à expliquer que les tables qui semblent (à la suite de certains mouvements qui ne leur sont exclusifs qu’en apparence) formuler une réponse favorable à la conscience de l’acte, ces tables sont sensées participer à cet acte. Dans les mouvements de la table, il y a un comment et un pourquoi, mais dans les actes humains il n’y a ni comment ni pourquoi, parce que c’est superflu, inutile, et qu’il est impossible de connaître le comment et le pourquoi d’un fait primitif, d’une vérité-principe. Si, dans le fait ou le principe, il y avait un pourquoi et un comment à découvrir, il y aurait par cela même, dit De Potter, un fait antérieur, un principe encore plus primitif. Le cercle est vicieux. Cherche-t-on à savoir pourquoi la violette a le parfum que nous lui connaissons, et non celui du jasmin ou de la pensée ? L’homme est envieux et voudrait même savoir ce qui reste dans l’inconnaissable, quoique sans résultat pour son action individuelle et sociale. Ce qu’il y a à faire, logiquement, c’est de constater la réalité du principe ou du fait par un bon raisonnement. Nous avons le sentiment de nous-mêmes et le raisonnement doit partir de là ; ce qui nous permettra de constater que l’ordre physique est ce qui est. Nous verrons alors que ce que nos sens perçoivent est le comment des choses, des phénomènes démontrés nécessaires dans leur enchaînement de causes et d’effets. Ce qui doit être est déterminé par leur pourquoi, et l’enchaînement de tous les pourquoi, déduits par identité d’une vérité qui n’a pas, elle-même, de pourquoi. C’est cette détermination logique qui constitue l’ordre moral.
Ainsi, le raisonnement se présente sous deux aspects et constitue soit un raisonnement simple, soit un raisonnement complexe. Le premier est la modification du soi qui n’est liée à aucune autre modification qu’elle-même ; le second est un enchaînement de deux ou plusieurs propositions qu’on peut ramener à soi et qui en sont des modifications. Ainsi, le raisonnement simple ne peut donner lieu à aucune contestation. C’est la constatation d’un fait affirmé, d’une part, et que personne ne peut contredire. Le raisonnement complexe, seul, peut être bon ou mauvais. Il est d’une manière ou d’une autre, selon que l’enchaînement des propositions se rapportant à la modification du soi est ou n’est pas conforme à la raison. Pour mieux préciser, supposons que je dise : j’entends le son d’une cloche. Si je persiste à affirmer que, réellement, j’entends le son d’une cloche, il est absolument impossible de me prouver, et même de prouver aux autres, que je ne l’entends pas. Cependant, on peut conclure et démontrer qu’il n’existe pas de cloche à la distance où on peut l’entendre régulièrement, ce qui ne prouve pas que je n’en entende pas une, ou plus exactement le son. Nous ne nous étendrons pas davantage sur des faits physiques constatés par le raisonnement simple et se rapportant à un raisonnement complexe. Nous aborderons le raisonnement métaphysique – ou plus que physique – qui, de l’ensemble des faits physiques et du fait de la conscience que le raisonnement a de son existence, au moyen des modifications que ces faits lui font subir successivement, déduit la conséquence qu’il y a, hors et au-dessus de ces faits, une vérité d’un tout autre ordre que celui dont ils font partie. De cet ordre de faits, le raisonnement en compose la nature physique, qui n’a pas d’autre valeur réelle que celle des faits mêmes dont la succession constitue la réalité de l’être qui les perçoit ; et il appartient au seul raisonnement métaphysique de déterminer la réalité qui domine le fait primordial du sentiment de soi.
Ce que nous venons de dire prouve que le raisonnement est une propriété exclusive à l’homme de comparer, de juger, de faire un choix. Dès lors, le raisonnement devient l’animateur de la conscience pour apprécier les faits, aussi bien que le guide de la volonté dans son action déterminante. Le raisonnement est personnel, mais la raison qu’il doit déterminer peut devenir raison impersonnelle en n’enchaînant entre elles que des propositions identiques et en partant du fait perçu du sentiment de l’existence. En résumé, dit Colins, c’est parce que les hommes ont mal raisonné, jusqu’à ce jour, qu’ils sont malheureux en général. Si la nécessité sociale les pousse à bien raisonner, comme nous le désirons, le chaos de nos jours fera place à l’harmonie ; et la société, dans son ensemble, sera heureuse. Puissions-nous le comprendre et en hâter l’heure !
— Élie SOUBEYRAN.
RAPACITÉ
n. f.
On appelle rapaces certains oiseaux à bec fort et recourbé, à griffes puissantes qui se repaissent avec voracité de la chair de leurs victimes. Aussi, la rapacité est-elle devenue synonyme d’avidité à se jeter sur une proie. Malgré des dehors avantageux et des manières polies, beaucoup d’hommes sont de vrais rapaces et vivent de la chair et du sang de leurs contemporains.
« Ces graves messieurs, vautours de la finance, de la politique ou de l’académie, crâne chauve et l’œil cerclé d’un monocle d’or, épient sans douceur les faiblesses de leurs partenaires : celui-ci n’est qu’une outre gonflée de vent, celui-là sert de caniche à une maîtresse acariâtre, ce troisième, d’intelligence redoutable, est à vendre au plus offrant. Et, tandis que les bouches n’ont que miel à répandre, quand de partout s’élèvent des congratulations mutuelles et générales, chacun songe au meilleur moyen de frapper celui qu’il encense. »
La guerre a montré jusqu’où pouvait descendre la rapacité des fabricants d’armes, des grands banquiers, de tous ceux qui vivent de la misère des peuples. Dans les colonies, rapines et brigandages se parent du beau nom d’action colonisatrice. Les jeunes peuvent tomber dru ; les mères peuvent pleurer. Qu’importe ! L. Barbedette écrit :
« Ce sang, ces larmes, des hommes de proie en ont besoin : à l’abri des balles, ils guettent l’heure de la curée. Honneur ou progrès sont pour eux des prétextes, armée et diplomatie des instruments ; ils veulent des concessions fructueuses et sans bourse délier, des dividendes inouïs, de l’or, toujours plus d’or. »
Au Moyen Âge, les rapaces furent les nobles ; aujourd’hui, ce sont les capitalistes. Autour des gros oiseaux de proie vole, d’ailleurs, toute une armée d’éperviers de petite taille et de noirs corbeaux qui se nourrissent des débris laissés sur les champs de carnage. Du nombre sont les prêtres aux doigts crochus et aux dents longues, les argousins de tous grades, les juges, les politiciens au plumage passant du blanc de lys au rouge écarlate. Et loin de se liguer contre ces mangeurs de cadavres, les hommes les admirent et se résignent à devenir leurs victimes quand ils jugent utile de décimer les masses moutonnières. C’est afin qu’ils ne manquent ni de viande fraîche, ni de sang vermeil que les femmes procréent sans cesse et que les pères triment pour nourrir leurs rejetons. Souhaitons qu’un jour les travailleurs finissent par comprendre que les rapaces disparaîtront quand on leur donnera la chasse et que les peuples se refuseront à leur servir de proie plus longtemps.
RATIONALISATION
n. f.
On désigne, sous le nom de rationalisation, l’ensemble des méthodes ayant pour but d’obtenir une triple réglementation :
-
des ateliers, par la standardisation et la taylorisation ;
-
des approvisionnements, par la standardisation et la normalisation ;
-
de la production, par le « fayolisme » et la formation des cartels d’écoulement.
C’est, on le voit, toute une politique économique qui s’exprime à l’aide de ce seul mot : rationalisation. Au fond, la rationalisation n’est qu’un mot nouveau employé pour désigner une très vieille chose. La rationalisation n’est pas seulement économique, elle a aussi un caractère politique et social très net, très précis, qui ne peut surprendre aucun de ceux qui savent à quel point l’économique dirige la politique et détermine le social. On peut donc dire que la rationalisation se développe parallèlement sur ces trois terrains et affirmer qu’elle est la doctrine économique des puissances d’argent, dont le but final est le fascisme.
Il m’est matériellement impossible de tenter ici l’exposé chronologique et analytique de la rationalisation. Des gros volumes n’y suffiraient pas.
Je dois donc me borner, après avoir indiqué ce que sont, suivant des auteurs divers, la standardisation et la normalisation qui sont les bases de la rationalisation, à examiner ce qu’elle est réellement et où elle risque de conduire le prolétariat, s’il ne réagit pas contre elle. J’en aurai fini lorsque j’aurai rappelé la position prise par l’Association internationale des travailleurs sur cette importante question.
La standardisation n’est pas américaine, comme on pourrait le croire ; elle est d’origine britannique. Elle consiste à unifier le travail des ateliers, de façon à ne faire créer que quelques modèles spéciaux et à réduire ainsi le nombre des éléments types de fabrication. Les modèles « normaux » deviennent, si possible, des modèles adoptés internationalement. Il en résulte une extension immédiate et considérable du champ d’expansion des produits ainsi « normalisés ». La standardisation indique surtout la création de calibres ou de formes mécaniques destinés à unifier, par exemple, le pas des vis ou des boulons, qui deviennent, de ce fait, utilisables par toutes les industries de tous les pays.
La normalisation a des objectifs beaucoup plus larges ; elle vise, en somme, à « l’organisation » moderne et scientifique de la production et des échanges, en vue de l’augmentation du rendement et de la vente.
C’est ainsi que s’exprime M. Charles d’Avron, dans un article paru dans Excelsior du 6 juin 1927. Et il ajoute : « On veut s’efforcer, en rationalisant, de mettre fin au gaspillage des énergies et des capitaux résultant de l’empirisme de l’industrie.
« On conçoit, par conséquent, que la rationalisation n’implique pas seulement des améliorations de l’outillage mécanique et la substitution de la machine automatique à la main-d’œuvre humaine, mais qu’elle suppose – et voilà tout le système – surtout le remaniement général des cadres de la production, une refonte organique et totale de l’économie nationale... et, bien entendu, internationale. »
La standardisation s’applique donc à l’exécution du travail dans l’atelier et dans l’usine ; elle donne naissance à la normalisation, et celle-ci conduit à la rationalisation. Voilà le processus.
L’organisation scientifique du travail, avec ses deux branches différentes et complémentaires : le taylorisme, qui a trait à l’exécution du travail – auquel une étude spéciale sera consacrée – et le fayolisme, c’est-à-dire l’organisation rationnelle, scientifique de l’administration des entreprises, concourt également, et en premier lieu, à réaliser ce qu’on appelle la rationalisation. Selon ses protagonistes, pour que la rationalisation puisse donner son plein effet, il faut non seulement que le produit manufacturé soit fabriqué le mieux et le plus vite possible, qu’il réponde à un type « normal », susceptible d’intéresser une vaste clientèle, mais il faut encore que, par des ententes particulières et générales, les industriels qui le fabriquent s’assurent la collaboration d’industries voisines capables de les aider à se procurer à moins cher leurs matières premières, ou à écouler leurs sous-produits.
Il faut encore que par la formation de cartels, réglés par des accords commerciaux, l’industriel et le commerçant aient la certitude de trouver, le moment venu, des débouchés capables d’absorber leur production. On voit, en effet, qu’il s’agit bien là d’une nouvelle doctrine économique, d’une refonte organique et totale de l’économie nationale et internationale.
Parlant de la « rationalisation industrielle » devant une assemblée composée de financiers, de parlementaires, d’industriels et de diplomates, le 6 décembre 1926, sous l’égide du Redressement français, à la tête duquel on trouvait, à l’époque, MM. Mercier et Romier, M. Julius Hirsch, professeur à l’université de Berlin, ancien ministre socialiste allemand de l’Économie nationale, faisait appel à la collaboration du travail, du capital, de l’intelligence et de la main-d’œuvre, et assignait comme but à la rationalisation : produire davantage, pour diminuer le prix de revient, pour assurer à la consommation des produits meilleurs et en plus grand nombre, pour appliquer le progrès, pour augmenter les salaires, pour rendre joyeux les foyers ouvriers, pour doter ceux-ci de l’hygiène, pour donner de sains loisirs aux travailleurs. Le 1er mai 1927, le Redressement français affichait ce « magnifique » programme sur les murs de Paris et, le 2 mai, M. Pierre Bertrand, rédacteur en chef du Quotidien, lui donnait une adhésion retentissante qui décidait, par la suite, la C.G.T. à « laisser se dérouler l’expérience de la rationalisation ».
On connaît, aujourd’hui, les résultats de cette expérience. Il n’est pas exagéré d’affirmer que ces résultats – voulus – ne ressemblent en rien à ceux qu’indiquait M. Julius Hirsch, les mêmes d’ailleurs que M. Dubreuil, délégué de la C.G.T. et du Bureau international du travail de Genève formulait, avec une clairvoyance (?) rare, dans son fameux livre Standards. À l’heure actuelle, on peut dire que la rationalisation a eu pour conséquences : de produire davantage pour un salaire moindre ; d’augmenter les prix, sans se préoccuper du caractère des produits ; d’appliquer le progrès mécanique, sans se soucier des conséquences de son application ; d’imposer des conditions de travail abrutissantes ; d’exténuer l’ouvrier jusqu’au point de l’empêcher de se recréer ; et, surtout, de créer un état de chômage permanent à caractère massif. Cela suffit à la juger.
Pour bien fixer l’attention du lecteur, pour l’édifier, surtout, il n’est pas mauvais de lui faire remarquer que le chômage, qui est la conséquence directe de la rationalisation, a atteint, en premier lieu et le plus durement, les pays les plus industrialisés, ceux qui ont appliqué le plus largement la rationalisation ; c’est-à-dire, dans l’ordre : l’Amérique du Nord, l’Allemagne, l’Angleterre, la France, etc. Si, aujourd’hui, plus de cent millions d’êtres humains souffrent de la faim dans tous les pays du monde, ils le doivent d’abord et avant tout à la rationalisation barbare du capitalisme ; si les hommes de 40 ans restent sans emploi ; si les « cadres » sont imbus d’un esprit féroce, de caractère nettement fasciste ; si les ouvriers subissent les vexations de l’anthropométrie, du bertillonnage, etc., c’est parce que le capitalisme a « remanié les cadres de sa production », parce qu’il a insufflé à ses techniciens et à ses chiens de garde un état d’esprit nouveau, caractérisé par un mépris total de la personnalité humaine.
On conçoit aisément que pareille situation ait incité l’A.I.T. à dire son mot sur la question. Voici comment : appelé à examiner la rationalisation, le IVe congrès de l’Association internationale des travailleurs, qui s’est tenu à Madrid, du 16 au 21 juin 1931, déclare ce qui suit :
« Considérant que, dans le développement moderne des forces industrielles, la classe ouvrière organisée doit avoir exclusivement en vue d’exploiter ce développement en faveur des travailleurs ; que l’idée du perfectionnement de la technique est en soi-même une idée à laquelle nous devons faire bon accueil ; que ce perfectionnement concerne la technique musculaire et cérébrale tout aussi bien que la technique mécanique ; que, néanmoins, ce qu’on continue à appeler présentement rationalisation ne prévoit ces perfectionnements qu’au profit du capitalisme et, par conséquent, au détriment de la classe ouvrière ; que cette rationalisation capitaliste, tout en augmentant sensiblement les profits industriels, abaisse sensiblement le niveau vital de la classe ouvrière, tant au point de vue matériel que moral et physique ; que le but fondamental d’un perfectionnement rationnel des méthodes de travail et de la technique industrielle devrait consister à réaliser, par une production plus intensive, un abaissement sensible du coût des produits fabriqués et, par conséquent, aboutir à une distribution accrue de ces produits, tout en apportant une diminution correspondante de la dépense d’énergie musculaire et nerveuse imposée aux travailleurs ; qu’une distribution plus large des richesses ainsi produites nécessiterait, par ricochet, une production plus intense et apporterait, par conséquent, une solution efficace à la crise mondiale du chômage ;
« Qu’en même temps, la course aux profits exagérés et criminels de la classe capitaliste doit être sérieusement freinée par l’organisation, plus méthodique et plus resserrée, de la classe ouvrière contre les appétits du patronat ;
« Que le prolétariat doit étudier tous les projets concernant le perfectionnement technique de la production, de la distribution et des méthodes de travail, dans le seul but de défendre les intérêts et les droits des travailleurs.
« Le IVe congrès mondial de l’Association internationale des travailleurs place devant la classe ouvrière, en général, et devant les sections nationales de l’A.I.T., en particulier, l’urgente nécessité des mesures ci-jointes :
« 1° En premier lieu, le perfectionnement des méthodes de travail du syndicalisme révolutionnaire, et la réorganisation de ses rouages, du comité d’atelier à l’Internationale elle-même, en passant par les syndicats et fédérations d’industrie.
« 2° L’institution des comités d’ateliers qui auront pour mission, en liaison avec les comités d’usines, de renseigner le bureau d’études techniques du syndicat d’industrie sur les perfectionnements et les modifications que le patronat se propose de réaliser, en vue d’en apprécier les répercussions probables et de déterminer, en toute connaissance de cause, l’action des travailleurs intéressés pour la sauvegarde de leurs conditions de salaires, de travail et de vie.
« 3° L’envoi par les bureaux d’études fédéraux d’industrie des renseignements recueillis au Comité économique national du travail et à la Fédération internationale d’industrie intéressés. Ces derniers, à leur tour, auront charge de documenter le Conseil économique international du travail, organisme de documentation économique et de préparation révolutionnaire que l’A.I.T. se doit de créer. »
Ainsi se trouve précisée, en face de la rationalisation, la position du syndicalisme révolutionnaire international, représenté dans le monde par l’Association internationale des travailleurs. S’il tient pour nécessaire le perfectionnement constant de l’outillage, des procédés de fabrication et de construction, s’il fait bon accueil à toute technique nouvelle de nature à augmenter l’importance et la qualité de la production, il entend que l’ensemble des méthodes et systèmes connus sous le nom de « rationalisation » profite, en premier lieu, aux travailleurs considérés à la fois comme producteurs et consommateurs ; par contre, il est irréductiblement opposé à toutes les mesures, quels qu’en soient le caractère et l’application, qui ne profiteraient qu’à la classe capitaliste et, par là même, menaceraient les conditions de travail et de vie du prolétariat.
Pour sauvegarder les intérêts dont il a la charge, et préparer les tâches de l’avenir, le syndicalisme révolutionnaire, représentant qualifié des travailleurs dans la société actuelle, se rend parfaitement compte qu’il doit constituer et faire fonctionner sans aucun délai les organismes techniques qui lui font encore défaut ou n’existent, çà et là, qu’à l’état embryonnaire, en même temps qu’il doit s’efforcer de développer les facultés de compréhension et la capacité d’action de la classe ouvrière, en vue de faire échec à cette « rationalisation ».
— Pierre BESNARD.
RATIONALISME
n. m.
De même que nous opposons la méthode scientifique à la croyance dogmatique, nous opposons le rationalisme à la religion. Le rationaliste est partisan de la primauté de la raison, dans tous les domaines. Le croyant n’admet cette primauté que dans les domaines étrangers à la foi religieuse. (Il serait plus exact de préciser ainsi : à SA foi religieuse personnelle. Car il admet très bien que les dogmes des autres religions soient analysés et discutés impitoyablement, passés au crible du libre examen et réfutés. Ce travail de critique lui paraît même nécessaire et bienfaisant, dans la mesure, tout au moins, où il est de nature à diminuer l’adversaire et à fortifier ses propres conceptions – auxquelles il est interdit de toucher sous aucun prétexte, bien entendu.)
Le motif de cette attitude est facile à apercevoir. En effet, les croyances ne reposent pas sur des faits démontrés, sur des connaissances acquises et toujours contrôlables. Elles sont faites de spéculations et de rêves et ne tirent leur force, quand elles sont sincères, que du seul mysticisme. En dernière analyse, c’est entre le mysticisme et le rationalisme que réside tout le conflit. Il y a une conception mystique du monde, visant à expliquer les phénomènes (ou du moins les principaux) par des interventions surnaturelles, par des pouvoirs invisibles et cachés, par des forces occultes.
En face de cette conception mystique (ou magique), la mentalité rationaliste se dresse. Le rationaliste ne veut connaître que des faits, avec leur déterminisme. Cette étude le conduit à formuler des lois, dont la connaissance lui est précieuse, puisqu’elle lui permet de régler sur elles sa conduite personnelle. Tous les progrès humains, tout ce qu’on appelle « civilisation », sont le fruit de la méthode rationaliste. C’est par cette méthode que l’homme est parvenu à surprendre quelques-uns des secrets de la nature. Dès que l’individu est parvenu à acquérir une connaissance rationnelle concernant une question quelconque, le mysticisme bat en retraite On ne peut nier que le champ du surnaturel soit allé en se rétrécissant sans cesse, dans la mesure exacte où le domaine de la raison s’était préalablement développé. La célèbre parole demeure toujours vraie : « Chaque pas de la raison en avant marque un recul du mysticisme et de la foi. »
Tous les efforts tentés, parfois avec une grande habileté, pour concilier la raison et la religion sont restés et resteront infructueux. Pourquoi ? Parce qu’aucune religion dogmatique ne résiste à l’examen. Chaque église apporte sa « révélation » plus ou moins enfantine, souvent même grotesque. La méthode rationaliste anéantit sans peine ces collections de légendes merveilleuses, ces fables insipides, ces affirmations sensationnelles et ces prodiges... La théologie ne peut vaincre et gouverner que par l’autorité. La raison ne peut, au contraire, se développer qu’en dehors de toute contrainte, par la lumière et la liberté.
Les adversaires du rationalisme nous objectent :
« Vos arguments sont excellents aussi longtemps que vous demeurez sur le terrain scientifique, mais ils ne valent rien lorsque vous vous aventurez dans le domaine de la métaphysique. Il y a des vérités qui échapperont toujours à votre raison et auxquelles il n’est possible d’arriver que par le canal de la foi. »
Certes, il nous reste beaucoup à apprendre. La science est bien loin d’avoir élucidé toutes les énigmes. Mais la religion est bien plus impuissante encore à résoudre les problèmes humains. S’il en est ainsi, les religions sont irrémédiablement condamnées. En avouant leur impuissance formelle à les fonder sur la raison, les défenseurs des croyances et des mystères religieux confirment notre thèse. Ils n’ont plus d’autre ressource que de barrer la route à l’examen, à la critique. Ne touchez pas aux « vérités surnaturelles » ! Ce sont des choses éminemment respectables et sacrées... Ne troublez pas la candide quiétude des âmes que la religion aide à vivre !
Ainsi, c’est au nom de la tolérance (?) que l’on demande au rationalisme de mettre la lumière sous le boisseau, de ne pas combattre le dogme et de laisser le champ libre à l’obscurantisme. Pendant ce temps, les gens d’église enseignent leurs calembredaines à des enfants de six ou sept ans. N’ignorant pas que l’adulte serait réfractaire à leurs fausses conceptions, ils tiennent à prendre d’abord l’enfant. La religion lui sera inculquée tyranniquement. Le prêtre usera de tout son ascendant pour dominer et faire plier la jeune conscience. Il fera même appel à la peur, et n’hésitera pas à faire intervenir le terrorisme de son dieu impitoyable, les lugubres (et cocasses, à la fois) images de l’enfer, du purgatoire et du diable.
C’est au nom de la liberté humaine que le rationalisme intervient en faveur de l’enfant. Le cerveau de celui-ci doit être préservé de toute déformation autoritaire. L’éducateur se bornera, sans faire pression sur lui, à mettre à sa disposition les éléments indispensables à sa formation harmonieuse et à son évolution normale. Le rationalisme constitue la seule méthode véritablement émancipatrice, non seulement dans le domaine religieux, mais dans tous les autres domaines politiques ou sociaux. L’homme n’aboutira à rien de grand aussi longtemps que la raison sera méconnue et sacrifiée au nom des intérêts de classe ou de caste. Comment la paix, comment la justice et la fraternité pourraient-elles être réalisées en dehors de la raison ? Travaillons donc sans répit à éduquer les hommes, à fortifier les consciences, à développer en l’individu un idéal logique, élevé, puissant. C’est seulement ainsi que l’humanité pourra se libérer et grandir.
— André LORULOT.
RATIONNEMENT
n. m. (du latin ratio, raison)
Le rationnement s’impose dans deux cas : soit par suite de sous-production, soit pour éviter les conséquences des excès de consommation (au point de vue alimentaire surtout). Le rationnement est artificiel quand il résulte de la mauvaise répartition des produits du travail. Étant donné un groupement humain dont les besoins vitaux sont connus, en société égalitaire, le rationnement ne peut s’imposer que lorsqu’il y a impossibilité de satisfaire entièrement à tous ces besoins. Il faut dire que, dans ce cas, le rationnement ne sera jamais qu’une mesure transitoire, valable pour la période de passage de la société capitaliste à la société libertaire. En très peu de temps, en effet, le travail de tous les membres de cette société suffira à donner « à chacun selon ses besoins ». L’humanité est arrivée à une époque où, par l’emploi du machinisme, l’individu peut être totalement libéré des soucis qui le hantent depuis l’âge des cavernes (nourriture, vêtement, logement, sécurité). Encore faut-il que, par la révolution (ou par des révolutions), il se débarrasse des parasites qui le dominent et l’exploitent.
En période actuelle, il y a toujours rationnement forcé pour la classe prolétarienne, qui ne peut consommer selon ses besoins par suite de la répartition défectueuse des richesses. Il n’y a jamais rationnement pour les riches. Même aux périodes de sous-production vitale (guerre), les puissants ont pu échapper aisément aux effets du rationnement (constitution de stocks, complaisances et complicités avec les maîtres de l’heure). Le chômage a pour conséquence un rationnement intensif de la classe ouvrière, mais, par le jeu des contradictions économiques que le régime porte en lui, il est facteur de la décomposition même de ce régime et il aggrave la crise sociale. Et lorsqu’un trop grand nombre d’individus souffre de misère tandis qu’une minorité de gavés détient les moyens de production, il y a déséquilibre total et, par suite, les conditions de rupture sont remplies ; l’explosion devient inévitable. L’aveuglement d’une grande partie de la masse inconsciente ne fait que retarder l’heure de cette rupture, mais bientôt cette masse est entraînée par les éléments sains et elle apporte sa pierre à la construction sociale nouvelle.
Autre chose est le rationnement volontaire de l’individu, qui a pour but de prévenir les conséquences des excès de consommation alimentaire, et le rationnement forcé qui doit réparer ces conséquences, une fois l’imprudence commise. Ce rationnement sera certainement la règle générale à observer lorsque l’individu pourra consommer à satiété. Il est, dès maintenant, la règle de santé pour tous ceux qui consomment trop. Et ceux-ci sont relativement nombreux. Viande, alcool, tabac sont nocifs et trop souvent consommés avec exagération. Il a été constaté, en Allemagne en particulier, pendant la période de blocus, au cours de la guerre de 1914–1918, la quasi disparition du diabète, de la goutte et de nombre d’affections ayant pour origine un excès d’alimentation. Ces mêmes maladies ont réapparu dès que le ravitaillement a pu redevenir normal, c’est-à-dire dès qu’il n’y a plus eu rationnement. Que l’individu soit donc bien pénétré de cette idée que si, par la révolution, il peut un jour satisfaire à tous ses besoins, il sera de son intérêt même de se limiter. Dépasser la ration indispensable au maintien du corps en bon état de santé, sacrifier à des vices – tous artificiels – qui usent prématurément la machine humaine, cela serait se forger de nouvelles chaînes, cela serait s’avilir. Le rationnement – du latin ratio, raison – procèdera alors de la raison, maîtresse souveraine des instincts et seule conductrice des hommes.
— C. B.
RÉACTION
n. f.
Employé dans le langage, soit scientifique, soit ordinaire, le mot réaction possède de nombreux sens ; nous en retiendrons un, celui d’opposition au progrès. Doivent être qualifiés réactionnaires tout mouvement, toute doctrine, toute institution qui arrêtent le genre humain dans sa marche en avant. Parce que ce terme possède un sens péjoratif, les politiciens l’emploient volontiers quand il s’agit de leurs adversaires ; et nous assistons à ce spectacle comique de conservateurs forcenés, de notoires soutiens du capital et de l’armée qui, en parole, s’affichent hommes de progrès. Des prêtres poussent l’audace jusqu’à prétendre que l’incroyant retarde. Bien que réactionnaires dans le domaine social, politique, religieux, les riches s’estiment à l’avant-garde de leur époque, quand ils suivent les caprices de la mode en matière de vêtement ou d’auto. Pourtant, la perfection ne s’identifie ni avec la nouveauté, ni avec la fantaisie, comme le supposent trop de civilisés. Ajoutons qu’un mouvement, même révolutionnaire à l’origine, et préconisant des réformes utiles, se stabilise fréquemment, par la suite, dans une attitude régressive ; le politicien avancé d’aujourd’hui peut se réveiller réactionnaire demain. Mais tout devient clair, lorsqu’on accepte pour critérium du progrès le perfectionnement de l’espèce humaine. Ce dernier, n’ayant pas de limite, comporte une marche en avant ininterrompue ; et l’on conçoit qu’il se mue en réactionnaire, l’individu qui, s’étant avancé même très loin, prétend s’arrêter de façon définitive, alors que d’autres le dépassent considérablement. Toute nouveauté, toute invention, si ingénieuses soient-elles, qui s’opposent au perfectionnement physique ou mental de l’homme, s’avèrent des régressions. Lorsqu’ils doivent aboutir à des conséquences désastreuses, plaisir et bien-être passagers ne sont plus que des appâts dangereux. Ce n’est point en raison de leur grand âge qu’une doctrine, qu’une institution, qu’un mouvement nous semblent réactionnaires ; l’harmonieux développement d’individualités libres et fraternelles, voilà le sûr indice nous permettant d’apprécier le progrès. Et nous n’hésitons pas à déclarer réactionnaires les nouveautés les plus en vogue, quand elles ajoutent d’autres chaînes à celles dont les peuples sont déjà surchargés.
Résolument tournés vers l’avenir, désireux de voir s’épanouir sans entrave toutes les virtualités de perfection que contient la nature humaine, nous ne pouvons admettre l’attitude réactionnaire, même lorsqu’il s’agit d’opérer le retour à une vie plus simple et plus saine : retour bien désirable, assurément. C’est d’une autre façon, à notre avis, que l’on doit remédier au déséquilibre du monde contemporain. Dans L’Incomparable Guide, j’ai traité ce problème : « Devant les dangers de la situation actuelle, des penseurs tournent un regard plein d’envie vers le temps où nos pères, ignorants des complications de l’existence moderne, s’enivraient d’air librement, étanchaient leur soif à l’eau claire des fontaines, demandaient exclusivement aux fruits, aux racines, au produits non frelatés de la nature de quoi satisfaire leur faim. Dans tous les domaines, ils constatent les déplorables effets des habitudes introduites par la civilisation. Que de morts dues aux excès de l’automobilisme ou de l’aviation, à l’infernale activité des monstres d’acier qu’abritent les usines, aux progrès variés d’un machinisme sans cesse plus envahissant ! Combien de fraudes alimentaires imputables à la chimie ! Et les drogues synthétiques, les médicaments artificiellement fabriqués ne donnent-ils pas des résultats décevants ? Exempts de la majorité des maladies qui nous affligent, doués d’une musculature puissante, endurcis contre les intempéries, nos sauvages et lointains ancêtres connaissaient un bonheur dont nous avons le droit de regretter la disparition. La civilisation fait œuvre régressive ; sous les guirlandes de fleurs, elle dissimule des chaînes ; ses prétendus bienfaits ont engendré d’indicibles douleurs. Élégant et policé au dehors, le moderne rejeton de l’homme préhistorique manque de vigueur physique et de ressort moral. C’est un dégénéré, dont l’ambition outrecuidante serait risible si elle n’avait pour effet de le maintenir dans son égarement ; tourné vers l’avenir, il rêve de transformations plus profondes, alors que le salut consisterait dans un retour vers le passé. Débarrassés des entraves d’une vie où l’artificiel tient une place excessive, revenons à la nature qui façonna le corps humain au cours d’innombrables siècles et qui, si nous le voulons, le régénèrera merveilleusement.
« Cette doctrine fondamentale a d’ailleurs revêtu des formes différentes ; sur la meilleure façon d’opérer pratiquement le retour à la nature, comme aussi sur l’aspect théorique du problème, les auteurs ne s’entendent pas. Plusieurs témoignent de préoccupations confessionnelles inadmissibles : ils n’ont pas compris que la religion, malsaine création de cerveaux ignorants, est encore plus nuisible que la mauvaise cuisine, que les appartements humides et sombres, que le manque d’exercice musculaire. Sourions des anathèmes contre la science que certains multiplient à profusion : indice fréquent de connaissances très superficielles ou de médiocres aptitudes pour la réflexion philosophique. Beaucoup, heureusement, ne songent point à nous ramener à l’époque où nos ancêtres habitaient des cavernes obscures, ne disposaient que d’instruments rudimentaires et disputaient aux grands fauves la pitance indispensable. Nous estimons, pour notre part, que le retour à la nature est conciliable avec les acquisitions heureuses de la civilisation. Bien plus, nous soutenons que la science est seule capable de mettre un terme au déséquilibre signalé, avec raison, par tous les hommes un peu clairvoyants.
« Le passé ne connut point une vie idéale digne de nos efforts ; demandons-lui seulement des leçons qui nous fassent éviter chutes et faux pas. Pourquoi souhaiter le maintien de l’espèce humaine, si elle devait rester éternellement stationnaire ! Arrière, les traditions désuètes qui compriment les virtualités de perfection que notre nature contient ! Inférieurs à nos ancêtres au point de vue physique, nous l’emportons sur eux, c’est indubitable, sous le rapport intellectuel. Remédions au dépérissement de notre organisme, sans renoncer aux conquêtes utiles d’une civilisation coupable d’erreurs grossières, mais détentrice des trésors que la science et l’art ont accumulés. C’est vers un futur meilleur qu’il faut tendre ; ne regrettons point un passé sinistre dans l’ensemble. Puis, combien vaines nos malédictions contre un devenir conditionné, dans une mesure importante, par des faits cosmiques inéluctables. Notre globe est le théâtre de perpétuelles modifications : température, humidité, distribution des terres et des océans, flore, faune ont changé à maintes reprises. Mais souvent la nature procède avec une lenteur extrême ; nous croyons immuable et définitif l’état sous lequel nous la voyons, parce que notre expérience individuelle n’a qu’une trop brève durée. »
Les conditions extérieures n’étant plus celles d’autrefois, il serait dangereux de vouloir imiter servilement nos ancêtres préhistoriques ; la réforme de notre manière de vivre doit être œuvre de science et de réflexion. Pour qu’il soit utile, le retour à la nature doit s’inspirer d’un désir de perfection plus haute, non de tendances réactionnaires.
Historiquement, nous constatons d’ailleurs que les partis ou les hommes, en qui s’incarna successivement l’esprit conservateur, ont exercé une déplorable influence. Tardigrades, manquant de cœur ou d’intelligence, ils ne firent preuve d’énergie que pour barrer la route au progrès. Les privilégiés, ceux à qui l’organisation sociale assure d’abondantes ressources et de continuels loisirs, rentrent habituellement dans cette catégorie. Satisfaits du présent, ils veulent que s’éternise un état de choses qui leur assure des avantages injustifiés. Aussi favorisent-ils toutes les forces oppressives, toutes les institutions réactionnaires qui s’opposent à l’émancipation des masses asservies. Prêtres, éducateurs, soldats, juges, gendarmes sont pour eux des auxiliaires indispensables. Depuis les temps les plus reculés, l’histoire est remplie par la lutte entre les partisans du statu quo et les pionniers d’un avenir moins douloureux pour la multitude des opprimés. Une sotte méchanceté : voilà, chez nous, la caractéristique la plus frappante des partis réactionnaires. Malgré la diversité des formules adoptées par eux successivement, le but constant de leurs efforts fut de retarder l’émancipation de la classe ouvrière et de maintenir au pouvoir les hommes de confiance de l’aristocratie. Royalistes à l’époque de la Restauration et sous Louis-Philippe, bonapartistes sous l’Empire, conservateurs ou opportunistes au début de la Troisième République, ils sont maintenant démocrates, républicains de gauche, radicaux, voire socialistes. Entre les démocrates populaires, dont le cléricalisme se colore en rouge pour mieux tromper les travailleurs, et les membres de l’Action française, leurs adversaires du moment, la différence est minime ; les uns et les autres sont des soldats de la cause réactionnaire. À l’égard de tous les défenseurs des négriers du genre humain, nous ne saurions nourrir que des sentiments de mépris et de dégoût.
— L. BARBEDETTE.
RÉALISTES, RÉALISATEURS
On appelle réaliste l’individu qui a le sens des réalités actuelles ; celui qui, doué d’esprit pratique et de la faculté d’adaptation et d’assimilation, poursuit le dessein de tirer le meilleur parti des circonstances du moment, de se créer une bonne situation, d’être quelqu’un au point de vue de la société ou du milieu auquel il appartient. Ne s’embarrassant ni de théories, ni de principes, ni de scrupules, sa seule ambition est de remplir une fonction, d’occuper un poste qui lui assure des avantages immédiats, le mette à l’abri des événements malheureux qui risquent de survenir, qu’il a provoqués peut-être : crise économique, guerre, etc... Le réaliste ne fait pas de sentiment, ou plutôt, si le vent est au sentiment, il se déclarera plus sentimental que n’importe qui. C’est chez lui question d’opportunité. Tout est, en effet, pour lui affaire et réalisation. Le réaliste use de la religion, de la politique, de la vertu, de l’aspiration vers plus d’équité ou vers un devenir meilleur pour parvenir à la position enviée qui lui permettra d’assouvir ses appétits ou ses ambitions. Tout cela, en considérant comme des fumisteries et des opiums pour le peuple : et le civisme, et la foi, et la moralité et la société harmonique de l’avenir.
Pour citer quelques exemples : réalistes les détacheurs de coupons et encaisseurs de dividendes, détenteurs-accapareurs des moyens de production, manieurs d’argent et brasseurs d’affaires, joueurs et spéculateurs en bourse et en banque. Ah ! certes, réalistes, ceux-là et comment ! Réalistes les monopoleurs et les privilégiés qui se disputent sur le dos de millions de victimes insensées les marchés commerciaux du monde exploitable. Réalistes, bien sûr, les capteurs de sources de pétroles et les Comités des Forges d’en deçà comme d’au delà du Rhin, réalistes les chemises noires du pseudo-César transalpin ou les rouges galonnards de la Moscovie soviétique. Réalistes aussi les copains roublards à la recherche d’une combine impérilleuse — n’importe laquelle — pourvu que ça rapporte — l’argent n’a pas d’odeur — fût-ce celle de solliciter leur inscription sur la liste des émargeurs aux guichets de publicité des emprunts de l’État qui prépare et fomente la guerre, ou de la Haute Banque qui profite de la Barbarie universelle !
Nous appelons par contre réalisateur celui qui veut faire passer dans la pratique une théorie ou une thèse qu’il ne lui suffit pas ou plus d’énoncer ou de diffuser par le verbe ou l’écrit. Pour celui-là il n’y a aucune jouissance dont il voudrait se priver, aucun raffinement auquel il voudrait renoncer, aucun appétit qu’il voudrait laisser inassouvi, mais ces réalisations, il les veut obtenir sans se prévaloir de l’archisme : domination de la société ou de l’homme sur l’unité sociale, exploitation de l’unité sociale par l’homme ou la société.
Le réalisateur, selon notre cœur, dit :
« Tous les êtres sont à moi, comme je suis à eux ; ils sont faits pour ma consommation comme je le suis pour la leur ; mais étant bien entendu que pour réaliser cette proposition je n’aurai pas recours au système dont usent et ont toujours usé les gouvernements : coercition, contrainte, obligation, etc.... »
De sorte que ce n’est pas en adapté au milieu sociétaire et à ses conditions de fonctionnement que l’individualiste à notre façon veut réaliser, s’approprier et incite autrui à s’approprier le maximum de volupté possible, compatible avec son pouvoir de jouissance.
Bien au contraire, c’est en révolté, en réfractaire, en négateur, en contempteur des valeurs économiques, intellectuelles, éthiques, consacrées par l’archisme que l’individualiste à notre façon réalise, c’est-à-dire foule aux pieds croyances, conventions, idées préconçues, restrictions et constructions de tout acabit, qu’il fera litière des impedimenta que l’autorité religieuse et la domination laïque cultivent au sein des masses. Dans le domaine de la pratique — et il n’est pas question ici d’optimisme ou de pessimisme — tout programme qui ne se réalise pas est chiffon de papier et rien de plus. Philosopher, ratiociner, couper des cheveux en quatre, discuter à perte de vue pour savoir si l’on est déterminé absolument ou partiellement est excellent quand il y a eu réalisation d’une sorte ou d’une autre — auparavant, c’est du temps gaspillé. Se tâter pour se rendre compte si l’environnement est une illusion ou un fait qui existe tel que nous le voyons, est compréhensible quand il y a eu réalisation — auparavant, c’est du temps perdu. On imagine difficilement le nombre d’heures de la vie que nous dissipons à métaphysiquer entre nous — tout en faisant la moue quand on nous parle du monde moral ou de l’état spirituel.
Notre anarchisme n’est pas une religion, une promesse de vie future, un rêve de vie meilleure ; il est vie et activité. Il est dynamisme et non hypothèse. Notre individualisme est égoïsme actuel, égoïsme de jouissance palpable, égoïsme de joie de vivre — un égoïsme capable de s’associer à d’autres égoïsmes, à un très grand nombre d’égoïsmes. La société anarchiste, le milieu individualiste anarchiste existe aujourd’hui : il est composé de tous ceux qui ne veulent ni dieu ni loi pour régler leurs affaires, passer contrat ensemble, s’associer dans un but quelconque.
Toutes les objections qu’on peut opposer à cette constatation, à ce fait, dénotent tout simplement chez les objecteurs de la paresse de compréhension ou de la déloyauté. Les premiers chrétiens avaient réalisé des associations où ils vivaient plus ou moins parfaitement leur conception de la vie, les Carpocratiens, les Frères du Libre esprit, je ne sais combien de milieux analogues ont vécu et se sont développés sans se soucier si l’ambiance leur était favorable ; les communautés religieuses vivent et se développent. Ce qu’ils ont pu faire, les individualistes anarchistes le peuvent aussi, s’ils le veulent. Toute la question est là : c’est une affaire de volonté individuelle ou collective. L’on se plaint que notre propagande ne porte pas de fruits. D’accord. Qu’il se forme des milieux fraternels, tellement différents des groupes ambiants que les nouveaux venus y seront conquis par l’atmosphère de camaraderie franche, d’intimité sincère, qui y règnera. Mais si l’on retrouve dans ces milieux les mêmes façons de juger, les mêmes préjugés, les mêmes timidités, les mêmes réticences que dans les milieux bourgeois, mieux vaut s’abstenir.
Et qu’on ne prenne pas pour une réalisation individualiste le fait de se trouver possesseur d’une petite maison, à la campagne avec un champ alentour, où finir ses vieux jours, associé à une compagne jalouse et qui s’insoucie de la propagande des idées qui vous sont chères. Et qu’on ne qualifie pas réalisation individualiste non plus le fait d’être un petit commerçant ou un négociant moyen, dont les affaires prospèrent. C’est un moyen de débrouillage, où l’honnêteté ne joue qu’un rôle secondaire et rien de plus. Je le maintiens. Dès qu’on possède, ou qu’on se décide à acquérir la volonté de réalisation, la mise en pratique de l’Une tout au moins de nos revendications devient facile. L’irréalisation est une preuve d’impuissance ou de mauvaise volonté.
— E. ARMAND.
REBELLION
n. f. (du lat. rebellio)
« Révolte, résistance ouverte aux ordres de l’autorité légitime ». Voilà, donc, d’après le Dictionnnaire Larousse, la définition du mot. Il semble clair que la rébellion soit l’acte de désobéissance, d’un ou de plusieurs individus, àl’autorité — tout simplement, sans ajouter le qualificatif : légitime — Car ce qui paraît légitime aux éducateurs plus ou moins officiels des enfants du peuple ne l’est pas pour nous, qui ne sommes ni des écoliers naïfs, ni des étudiants prétentieux, mais des individus conscients à la recherche de toutes les vérités.
Le mot Rébellion a pour synonymes : Émeute, Insurrection, Mutinerie. Mais comme tous les synonymes sont imparfaits, il nous paraît nécessaire d’analyser, ici, chacun de ces mots et d’autres encore comme : Résistance, Révolte pris dans leur vrai sens et selon les actes, les faits, les théories, les raisonnements qui se rapportent à ces différents mots ( voir ces mots ). Nous devons les examiner avec notre raison et notre mentalité qui ne sont certes pas la raison et la mentalité bourgeoises soumises à l’autorité légitime. Par le fait même, nous sommes en rébellion, en résistance ouverte contre la façon de comprendre ces mots selon l’enseignement officiel. Selon le Droit bourgeois : « Pour que la rébellion constitue une infraction punissable, il faut :
-
Qu’il y ait « attaque ou résistance avec violence et voies de fait » ;
-
que cette attaque ou résistance soit dirigée contre « les officiers ministériels, les gardes-champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire » ;
-
que les personnes ainsi déterminées agissent « pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements ».
La rébellion constitue un crime :
-
lorsqu’elle a été commise par plus de vingt personnes, soit armées, soit non armées (dans le premier cas, elle est punie des travaux forcés à temps ; dans le deuxième, de la réclusion) ;
-
lorsqu’elle a été commise par une réunion armée de trois personnes et plus, jusqu’à vingt (elle est alors punie de la réclusion).
En toutes autres circonstances, la rébellion est un simple délit, puni correctionnellement.
L’article 219 du Code pénal assimile aux réunions de rebelles les émeutes qui peuvent éclater dans les ateliers publics, les hospices ou les prisons. Celui qui fait acte de rébellion est un rebelle : il refuse d’obéir à l’autorité légitime, il se révolte.
Mais la rébellion ne peut être considérée comme un forfait que si elle est vaincue. Les rebelles victorieux sont des héros, des justiciers, des sauveurs de toutes sortes de belles entités, selon les circonstances, les lieux, les motifs et les buts de la rébellion. Selon le point de vue où l’on se place, la Rébellion est sainte, héroïque, sacrée ou elle est horrible et criminelle. Dans toutes les Révolutions, ou politiques, ou religieuses, ou sociales, sont ordinairement considérés comme rebelles ceux qui se révoltent contre un joug, une tyrannie, un régime. Que ces rebelles aient conquis le Pouvoir, ou renversé le tyran ou transformé le régime, ce sont, alors, les vaincus, s’insurgeant à leur tour, qui deviennent les rebelles.
En principe, le Rebelle a toujours tort, selon les soutiens ou les partisans de l’ordre établi. S’il réagit dans son acte de rébellion, s’il est vainqueur, alors, il n’a plus aucun tort. Il est le héros de la Justice, de l’Indépendance, du Droit, de la Liberté. Si les combattants de la Commune. n’avaient pas été vaincus par l’armée de Versailles, en mai 1871, ils eussent été les fondateurs immortels du Régime Républicain pour lequel ils sont morts.
La rébellion c’est, pour l’agent des mœurs, l’honnête femme qui résiste à l’infâme maladresse, à l’ignoble erreur de ce voyou légal qui arrête souvent, à tort et à travers, des malheureuses coupables de se trouver seules sur la voie publique. Cet individu est assermenté et quand il prétend avoir vu cette femme, non accompagnée, proposer par ses allures le commerce de son corps, il est cru sur parole, car il est assermenté. Le magistrat donne rarement tort à l’auteur d’une arrestation opérée par l’un de ces bandits des Mœurs et, s’il soutient qu’il y eut rébellion, la malheureuse n’est pas seulement flétrie de la mise en carte, c’est-à-dire inscrite et assujettie aux règlements ignominieux de filles soumises et ainsi matriculées dans le troupeau des prostituées, elle doit répondre de l’accusation d’injures et coups à agent de la force publique et se voit condamnée sans délai à plusieurs mois de prison. À la prison de Saint-Lazare, elle fait connaissance d’autres rebelles, victimes de la Police presque toujours, en tout cas, victimes de la société qui prétend que la réglementation policière de la prostitution est une institution magnifique, digne de la société bourgeoise qui règlemente ce dont elle a besoin. En effet, la Prostitution est nécessaire à la pourriture bourgeoise, au nom de sa morale hypocrite, comme le Militarisme et la Caserne lui sont indispensables au nom de son Patriotisme. Pour l’un et pour l’autre, ce sont les enfants du Peuple qui sont enrôlés et sacrifiés. S’ils osent se regimber, au moment de l’enrôlement ou après, ils sont d’inqualifiables rebelles, de monstrueux mutins et, pour ceux-là, le Code n’est pas tendre. Ne faut-il pas, au gré des profiteurs du Régime bourgeois, de la chair à plaisir et de la chair à canon ?
Il y a également rébellion dans les masses exploitées. On ne vénère pas les enrichis du travail des autres. La classe ouvrière, par moment, semble prendre conscience de sa force et de sa valeur. On a pu le constater, surtout avant la terrible guerre de 1914–1918, au temps où le Prolétariat savait s’organiser en dehors des politiciens et des intellectuels et, confiant en lui-même, croyait à son émancipation sociale par sa propre action, directement exercée contre tous ceux qui exploitent, commandent, trompent, asservissent. Il était sur la bonne voie du syndicalisme révolutionnaire, se suffisant pour affranchir les producteurs du Patronat, du Salariat et de l’Autorité sous toutes ses formes. Les travailleurs reviendront à ces efficaces méthodes. Ils répareront les dégâts de la désunion causée par la question politique et ils rattraperont le temps perdu.
Il nous faut parler ici d’un genre de rébellion particulièrement intéressant. Cela se passa pendant la guerre de 1914–1918 et l’on en a parlé depuis. Des volumes, des articles de journaux ont donné des éclaircissements sur ces faits connus maintenant et classés sous le titre de Mutineries dans l’Armée française, en ce sens, de significatives rébellions contagieuses.
C’est ainsi que, dans le journal l’Œuvre, Paul Allard a publié sous ce titre une série d’articles, d’après les Comités secretsqui se sont tenus à la Chambre des députés, sur les Mutineries de 1917.
Ces articles ont fait sensation et nous pensons que le volume qui paraîtra aura le succès de curiosité qu’il mérite. Il faut savoir ce que furent ces mutineries d’après les Comités secrets. Voici donc ce qu’annonçait Paul Allard, dans le journall’Œuvre, du 26 août 1932 :
« C’est le 29 juin 1917 que s’ouvrit — dans quelle atmosphère de fièvre et de passion ! — la deuxième série des Comités secrets : celle où furent longuement évoquées les fautes commises par le Haut Commandement dans la conception et l’exécution de la meurtrière et criminelle offensive du 16 avril 1917 et ses conséquences les plus directes et les plus douloureuses : les mutineries.
« Et c’est une des premières révélations historiques aujourd’hui incontestées des Comités secrets de juin et juillet 1917 : la révolte des « poilus » — qui s’étendit d’une manière insoupçonnée du peuple français et des combattants eux-mêmes — sur tous les fronts, même les plus lointains (Salonique, Palestine, etc.), résulte de l’inutile massacre de plus de 100.000 soldats français, victimes de l’impéritie et d’on ne sait quel délire d’orgueil et de vertige de triomphe facile du Haut Commandement, représenté par les généraux Nivelle, Mangin, Micheler et Mazer. »
Et Paul Allard continuait en promettant des révélations sensationnelles — sur les rebellions militaires.
Le samedi 27 août, paraissait le second article. Parmi d’autres choses, on y lisait :
« Ce n’est pas de la gauche ni de l’extrême gauche que partirent les réquisitoires les plus passionnés contre le haut commandement : c’est un député de la droite, le lieutenant Ybarnegaray, qui exerça sur l’assemblée un « effet foudroyant », par le récit pathétique et indigné qu’il fit, d’une voix tremblante d’émotion et les yeux encore pleins d’horreur :
« Je vois et je verrai toute ma vie, sur l’immense plateau de l’Aisne, un quart l’heure après le départ des vagues d’assaut, ces groupes errants de noirs courant au hasard, cherchant leurs chefs, se faisant massacrer par les mitrailleuses et aussi par nos propres 75 !... A six heures du matin, la bataille était commencée : à sept heures, elle était perdue !... Nous étions loin du rêve du matin ! Le rêve, c’était la marche en avant, l’offensive joyeuse, hardie, rapide !... Et alors, de tout ce désordre, de toute cette douleur, de toute cette terre sanglante, c’est une immense désillusion qui monte !... Et aussi le reproche, la colère, les mots violents, vers ceux qui, dans un geste imprudent, ont ainsi sacrifié le meilleur de nos soldats !... »
« Albert Favre, Abel Ferry, de nouveau Ybarnegaray, et enfin, le capitaine d’artillerie Albert Lebrun, apportent, ensuite, un ensemble de faits écrasants.
» M. Albert Lebrun résuma, avec son éloquence sobre, précise et dépouillée de polytechnicien, les fautes commises par les grands chefs militaires.
» Pour sortir de la situation où nous sommes — conclut le futur chef de l’État — il faut trouver autre chose ! Le gouvernement n’a pas su contraindre le haut commandement à abandonner cette sorte d’omniscience qu’il affecte (applaudissements) ni l’obliger à s’adapter aux faits, et à ne pas se laisser surprendre par eux comme nous l’avons été depuis le début de la guerre ! Ce sont ces faits que nous ne voulons plus voir se reproduire ! ” (Vifs applaudissements sur tous les bancs.)
» M. Diagne, défenseur-né des troupes noires, fit, à son tour, un récit émouvant, appuyé de menaces précises, du « massacre des noirs de l’armée Mangin. »
Il révéla qu’avant son interpellation, un officier d’ordonnance du général Mangin était venu lui demander, au nom de son chef, de retirer son interpellation. Faisant allusion aux événements du 16 avril, il lui en a donné cette explication
« Nous avons été desservis par le temps : le marronnier du 21 mars n’a pas fleuri ! C’est là notre seule faute ! » (Bruit sur tous les bancs.)
Quant aux malheureux nègres :
« Fondus par le feu, en débandade par suite de l’absence des chefs tués, obligés par le froid de mettre leur fusil sous le bras, en parapluie, incapables de se servir de leurs grenades, de mettre baïonnette au canon, voués à un véritable massacre sans utilité par l’inimaginable légèreté des généraux. »
M. Diagne conclut :
« Et c’est à ces hommes-là que vous demandez de finir la guerre pour vous ? Non, messieurs ! Je n’accepte pas cette idée. Je ne veux pas vous humilier : ce n’est pas digne de la France ! »
Le dimanche 28 août 1932, sous la signature de Paul Allard, paraissait dans l’Œuvre, un troisième article, intitulé : La parole est à M. Laval. Le député d’Aubervilliers avait signalé à la Chambre combien était mauvais l’état moral du pays en général et, plus particulièrement, celui des soldats du front.
C’était bien une révolte militaire, cette rébellion, cette mutinerie si grave, si contagieuse que ceux de l’arrière qui en avaient eu connaissance en tremblaient de frayeur ou en tressaillaient d’espoir en la Révolution possible et en la paix immédiate.
Le lundi 29 août, l’Œuvre insérait, sous le titre : Le Rapport du général Pétain, un quatrième article. Voici des extraits de ce rapport :
« Des actes d’indiscipline collectifs — écrit le général Pétain — se multiplient de façon inquiétante depuis quelques jours. Une compagnie qui doit participer aux nouvelles attaques sur le moulin de Laffaux, refuse de monter en ligne. Dans les cantonnements, partout sont posés des papillons : « À bas la guerre ! Mort aux responsables ! » Les hommes déclarent hautement qu’ils ne veulent plus se battre tandis que dans les usines, leurs camarades gagnent 15 à 20 francs par jour. »
« ...19 mai : un bataillon qui devait faire la relève se disperse dans les bois.
» 20 mai : un dépôt, divisionnaire désigné pour renforcer un régiment parcourt les rues au chant de l’Internationale, fouille la maison du commandant de dépôt, envoie trois délégués chargés de porter les réclamations.
» 26 mai : Les hommes de quatre bataillons qui doivent remonter dans le secteur se rassemblent dans le cantonnement du quartier général de la division. Les efforts du major et des officiers sont vains pour obtenir la dispersion du rassemblement.
» 27 mai : Dans la région de La Fère-en-Tardenois, un bataillon doit être embarqué en auto pour entrer en ligne. Les meneurs, excités par la boisson, parcourent le cantonnement en poussant des cris. Ils tirent des coups de fusil et empêchent l’embarquement. Au lever du jour, les mutins courent à la gare pour prendre des trains d’assaut. Un fort détachement de gendarmer !et les en empêche.
» 29 mai : Les régiments qui doivent se mettre en marche manifestent, se forment en cortège et chantent l’Internationaleen criant : « On ne montera pas ! On ne montera pas ! »
Le mardi 30 août 1932, un cinquième article sur les Mutineries dans l’Armée française, d’après les documents secrets. Cet article, dans l’Œuvre a pour titre M. Diagne à la Tribune. L’auteur montre M.Diagne plaidant avec ardeur la cause des troupes nègres particulièrement éprouvées. Il ajoute : « Les nôtres sont venus ici pour accomplir un devoir patriotique. Mais, à aucun moment, il ne saurait être question, — et si le gouvernement ne m’en donne pas l’assurance, je suis décidé à le répéter en séance publique, — en aucune circonstance, ni aujourd’hui ni demain, il ne saurait être question de demander aux nôtres d’accomplir une besogne qui n’est pas celle de soldats. »
Et le mercredi 31 août 1932, le journal l’Œuvre publie son sixième article sous le titre : Au tour de M. Dalbiez. On lit :
« Le 29 juin, c’est M. Victor Dalbiez qui, à 3 h. 35, la séance publique étant close et les tribunes évacuées, prit la parole :
— Il est indispensable que la Chambre soit mise au courant des renseignements que la Commission de l’armée a reçus du ministre de la guerre. Le pays souffre de ce régime du silence qui lui a été imposé depuis si longtemps. Le résultat de ce silence c’est que la légende — la légende qui se crée et se propage — démoralise beaucoup plus sûrement le pays que la vérité ! Si nous n’avions pas eu peur de la vérité depuis le début de la guerre, et surtout si nous n’avions pas eu peur de la dire au pays, nous ne serions pas, aujourd’hui, en proie à de vives inquiétudes au sujet de l’état moral de nos combattants !
» Non, messieurs, nous ne pouvons pas continuer la guerre les yeux fermés ! Vous savez que cela nous a conduits à deux doigts de l’abîme, car les gouvernements se laissent prendre eux-mêmes aux formules qu’ils servent au pays !
» Et nos chefs militaires s’hypnotisent, eux aussi, sur des formules ! Quand ils disent aux combattants qu’il faut passer, coûte que coûte, la formule leur suffit ! Ils ne savent pas que, lorsque les mitrailleuses sont en action, il n’y a aucune volonté humaine, aucun héroïsme qui puisse venir à bout de ces instruments-là !...
» Or l’attaque du 16 avril, cause essentielle des mutineries, a été ordonnée alors que les états-majors savaient que les ennemis étaient au courant de nos intentions. L’ennemi savait parfaitement comment elle se déclencherait, à quelle heure elle se déclencherait et comment elle serait conduite !...
» M. Victor Dalbiez montra, à l’aide de documents, que les chefs d’unités savaient — et certains pleuraient en donnant aux poilus l’ordre de sortir de la tranchée — qu’ils conduisaient leurs troupes à une mort inutile. En vingt minutes, des unités entières ont été fauchées. Ce qu’il y a de plus grave, c’est que quinze jours après, lors des attaques du 5 mai, les mêmes erreurs, les mêmes fautes, les mêmes crimes ont été commis. »
Enfin, le jeudi 1 septembre 1932, parait le septième article sous ce titre : Et M. Abel Ferry lui-même :
« Pourrons-nous passer un quatrième hiver de guerre ? demanda ensuite d’emblée M. Abel Ferry. Le pourrons-nous dans les circonstances présentes ? Chacun de vous connaît maintenant, messieurs, la crise morale, douloureuse, par laquelle passe l’armée française. Le poilu n’est pas tel que le représentent les journaux. C’est une pauvre chose héroïque qui souffre, qui souffre beaucoup et qui, actuellement, est arrivé à un degré d’usure physiologique dont, ici, vous n’avez pas idée. »
Voilà ce que disait, en pleine guerre, un député français qui devait, plus tard, être tué à l’ennemi, M. Abel Ferry. Il n’hésitait pas à demander au gouvernement, pour calmer la révolte des héros, des sanctions contre les chefs responsables des plus grandes fautes...
Après avoir ainsi exposé les causes — strictement militaires — des mutineries de l’armée, la Chambre entendit les rapports de délégués au front.
Et, d’abord, M. Aristide Jobert.
M. Jobert n’hésita pas à opposer ceux qu’elles avaient chargés, au front, de missions d’enquête.
Il fit une antithèse liminaire, l’impunité des coupables haut placés et l’impitoyable sévérité pour les véritables victimes : ceux qui se sont mutinés à la suite de ces effroyables aventures. C’est immédiatement après que, sur tout le front, se produisirent, dans l’armée, des révoltes.
Quant aux causes de la révolte, il y a, d’abord, le retard systématique des permissions ; les cantonnements défectueux ; le repos dérisoire donné à certaines unités combattantes ; les brimades...
Mais, ô surprise... après ce septième article... silence et déception. Sans prévenir, l’Œuvre avait cessé cette publication d’articles sur les Mutineries militaires de 1917. Que s’était-il donc passé ? Comment expliquer cette suspension soudaine ?
C’est le 10 septembre 1932 que parut une explication sous le titre : La Fin des Mutineries.
« Nous continuons, disait Paul Allard, de recevoir, à l’Œuvre, une très abondante correspondance dont le thème essentiel est celui-ci : « Pourquoi ne poursuivez-vous pas la publication de vos passionnantes révélations sur les mutineries dans l’armée française en 1917 ? »
» Pourquoi ?
» Pour une très simple raison. C’est que l’Œuvre est un journal qui se pique de suivre l’actualité quotidienne et ne se considère pas comme un dépôt d’archives historiques, que le sujet des mutineries est immense et qu’il fallait bien arrêter ce récit à un certain moment sous peine d’encombrer, indiscrètement, les colonnes d’un journal auquel je suis très sincèrement reconnaissant d’avoir bien voulu présenter à sa clientèle avertie les bonnes feuilles du livre que les Éditions de France vont lancer, dès octobre prochain, sur les « Dessous de la guerre » révélés par les comités secrets.
» Au surplus, mon éditeur a eu la gracieuseté de m’autoriser à faire bénéficier les lecteurs de l’Œuvre des extraits les plus importants relatifs aux mutineries. Je lui en sais gré ; mais je ne puis lui demander de pousser l’abnégation jusqu’à me permettre de publier le texte intégral de mon livre dans les colonnes de l’ Œuvre... »
Nous voici maintenant fixés sur ce que furent les rébellions pendant la guerre.
Cela nous dispense d’y ajouter d’autres arguments. Aussi bien, les mots résistance, révolte restant des synonymes de rébellion nous pouvons nous y reporter. Nous y trouverons sans doute un sens particulier qui dissipera toute confusion entre ces divers mots d’une ressemblance toute relative. Le mot Rébellion n’a de réelle parenté qu’avec le mot Mutinerie : Au point de vue militaire, il en est le frère jumeau. Au mot Mutinerie nous avons donné une documentation sur ce qui passa particulièrement dans la marine. Pour le mot Rébellion, l’occasion s’est heureusement présentée d’utiliser les précieux documents fournis par les articles de Paul Allard sur les Comités Secrets.
— G. Yvetot
RÉCIPROCITÉ
n. f.
Sur quelle base asseoir les accords entre les humains, dès lors qu’en sont exclues l’obligation et la sanction ? De quelle méthode se servir pour réaliser les rapports et les accords entre les constituants d’un quelconque milieu humain – rapports et accords qui croissent en complexité, à mesure que l’intelligence s’affine et que devient plus considérable l’acquis des connaissances humaines, que s’amplifie le rayon de leurs applications ? Quel principe poser comme fondement, comme norme des ententes et contrats de toute espèce que les êtres humains peuvent être amenés à envisager et à conclure entre eux pour leur permettre de se comporter les uns à l’égard des autres, selon leurs besoins, leurs désirs, leurs aspirations – qu’il s’agisse d’unités isolées ou associées ?
Première considération. Puisqu’on entend ignorer la coercition sous tous ses aspects – autrement dit, la réglementation légale et les sanctions pénales ou disciplinaires –, il est de toute nécessité que la méthode dont on se servira pour fonder les rapports et les accords entre les hommes implique en soi « l’équité » et l’absence totale de duperie, de tromperie, de dol.
Tout le monde sait que l’objet présumé de la loi, c’est de rendre efficaces les conditions qui déterminent ou sont censées déterminer les rapports entre les habitants d’un territoire donné. Cette efficacité s’obtient par l’application de certains châtiments à ceux qui contreviennent à la loi. On comprend que s’impose la loi, puisque les conditions qui, dans les sociétés humaines, président aux rapports et aux accords entre leurs membres sont établies sans leur consentement unanime, souvent même malgré la protestation de minorités importantes ; en tous cas, sans qu’il ait jamais été tenu compte de l’avis ou de l’opinion des transgresseurs ou des contrevenants. C’est la crainte de subir ces sanctions qui empêche un grand nombre de personnes de transgresser la loi – tout au moins ouvertement. D’ailleurs, il y a des individus qui préfèrent courir le risque d’un châtiment, quelquefois très dur, plutôt que d’observer les termes d’un contrat qui leur est imposé, ou d’accords qui les gênent ou leur répugnent, pour une raison quelconque.
Il existe une méthode dont l’application absolue garantirait à ceux qui la choisiraient comme base de leurs rapports ou de leurs accords qu’ils ne seront lésés, dupés, ni trompés – matériellement parlant –, qu’ils ne seront diminués ni même atteints au point de vue de leur dignité : c’est la réciprocité. Loyalement pratiquée, quel que soit le domaine ou la branche de l’activité humaine où elle s’appliquerait, la méthode de réciprocité implique en soi l’équité, aussi bien dans la sphère économique que dans celle des mœurs, aussi bien dans le domaine intellectuel que dans celui du sentiment. En fait, il n’y a rien qui puisse échapper à l’atteinte de la réciprocité. C’est une méthode de se comporter à l’égard d’autrui d’un rayonnement véritablement universel. Elle est très simple à exposer : puisqu’elle se résume et consiste à recevoir autant qu’on a donné, aussi bien en ce qui concerne l’isolé que l’associé.
En échange du produit de ton effort, je t’offre le mien. Tu le reçois et nous sommes quittes. Au contraire, il ne te satisfait point, tu ne le penses pas équivalent à ce que tu livres : en ce cas, gardons chacun nos produits respectifs et cherchons ailleurs si nous ne trouverons pas à mieux nous accorder. De cette façon, nul d’entre nous ne sera redevable à autrui.
On objectera qu’il est un aspect de cette conception de la réciprocité qui aboutit à dresser l’humain en face de son semblable, à la façon d’un fauve. Par exemple, tu me juges, c’est entendu ; mais moi aussi, je te juge de la même façon que toi : tu n’y échapperas pas. Tu ne m’épargnes pas ta critique, je n’aurai garde de t’épargner la mienne ! Tu m’as causé un tort, un dommage, je te causerai un tort, un dommage égal, sinon pire ; tu t’es montré cruel, impitoyable, inexorable à mon égard, j’agirai de même te concernant : c’est de cette manière que nous sommes ou serons quittes. Même pratiquée dans toute sa sécheresse, la méthode de la réciprocité aboutit pour ainsi dire automatiquement à relever, à rétablir la dignité humaine, à l’affirmer, à la sceller sur un piédestal indéracinable.
Sans doute, basés sur la réciprocité, les rapports et les accords entre les humains excluent la duperie et la tromperie. Sans doute, la méthode de la réciprocité implique, si l’on veut, l’application du talion. Mais elle n’est opérante qu’à la condition que, dans mes tractations avec autrui, nous nous situions, lui et moi, sur un plan d’équivalence par rapport à notre dignité personnelle. C’est tels que nous sommes que nous discuterons et traiterons ensemble. Mon déterminisme n’est pas le tien, c’est entendu : les mobiles qui m’incitent à agir ne sont pas ceux qui te poussent à l’action ; très souvent, là où le raisonnement te fait mouvoir, c’est le sentiment qui m’indique comment me conduire. Mais tel que je suis, sur mon propre terrain, j’estime que je te vaux ; je ne me prétends pas ton égal ; je suis peut-être moins bien musclé que toi, les capacités de ton cerveau sont peut-être plus étendues que les miennes, peut-être même es-tu plus sensible que moi à des émotions qui ne m’agitent ni ne me troublent. Mais tel que je suis – tout recours à la violence étant exclu de nos rapports –, tu ne peux m’arracher ou me saisir mon produit, si je ne trouve pas ce que tu m’offres équivalent à ce que je te demande. Donc, nous restons quittes, que nous nous accordions ou non, que nous échangions ou non le produit de notre effort. Je reste moi-même et tu demeures toi-même, aussi bien dans l’offre que dans la demande, dans le donner que dans le recevoir.
Mais ce que les individualistes anarchistes entendent par réciprocité est tout autre chose que l’aride fonctionnement d’un système d’échange consistant à recevoir en poids, en mesure, en valeur l’équivalent exact de ce qu’on a donné, ou vice-versa. Ce n’est pas non plus au point de vue éthique, l’application inexorable de la loi du talion. Je la considère, pour ma part, à un point de vue tellement individuel, tellement plastique et sujet aux variations de l’appréciation personnelle, qu’il m’est absolument nécessaire, pour en exposer les aboutissants pratiques, de me situer bien au-delà de l’idée d’une évaluation mathématique ou d’un étalon irrétrécissable. Je pose donc en première ligne que chacun a de la réciprocité la conception que lui fournit son déterminisme, tempérament ou nature, raisonnement ou sentiment. C’est donc entendu, dans mes rapports avec autrui, dans les accords que je puis conclure avec lui, je ne veux pas être lésé ; et je me sens et me sais lésé dès que je reçois moins que je donne. Et je lèse autrui dès que je donne moins que je reçois. Mais donner et recevoir sont deux rapports, deux valeurs, deux termes dont la signification et l’acception sont uniquement relatives à celui qui donne et à celui qui reçoit.
Par exemple, j’ai passé des années à me consacrer à l’éducation d’un enfant, à faire tout ce qui était en mon pouvoir afin qu’il se forme, qu’il se sculpte, qu’il devienne « soi », qu’il se dégage de la gangue des préjugés et des traditions attentatoires à l’évolution et à la constitution d’une personnalité originale. Ce fut mon don. Je me considère comme amplement payé en retour, en assistant au spectacle du développement graduel de ce jeune être, s’affirmant peu à peu ; empruntant, à mesure qu’il grandit, toujours moins à la routine et aux conventions de l’ambiance sociale. Je m’étais aperçu qu’il avait certaines dispositions pour les lettres ou pour les sciences – pour la musique –, pour les voyages. Et le voilà, parvenu à stature d’homme, un prosateur achevé, un chimiste éminent, un musicien accompli, un intrépide explorateur. Non pas un imitateur servile de ceux qui l’ont précédé dans la voie où il s’est engagé, mais en assimilant les efforts de ses devanciers, de manière à porter les siens au plus haut degré d’originalité possible. Peut-être est-ce dans un sens tout autre que je l’aurais souhaité que les dispositions que j’avais distinguées se sont développées, ou que son originalité possible s’est démontrée. J’ai cependant atteint mon but puisque, devenu adulte, l’enfant à la culture duquel je m’étais adonné n’est ni le reflet d’un homme ni le produit d’une formule.
Il se peut qu’un autre que moi eût compris autrement, dans ce cas particulier, l’application de la méthode de réciprocité. Il se pourrait qu’il se fût cru payé de retour par un peu plus de manifestations affectueuses et un peu moins d’accomplissements. Conséquence de tempérament, affaire de caractère. Mais si c’est l’affection qui semblait la plus exacte récupération des peines prises pour l’éducation de l’enfant, il eût été dès l’abord nécessaire d’insister davantage sur l’éclosion des qualités sentimentales, de développer dans ce jeune être les propensions à la sensibilité.
J’ai passé maintes nuits au chevet d’un des miens, dangereusement malade, et qui m’était cher. Pendant longtemps, sa vie n’a tenu qu’à un fil. J’osais à peine quitter la chambre où il gisait alité, tant ma crainte était grande de ne pas le retrouver vivant à mon retour. Mes soins ne sont-ils pas remboursés, aujourd’hui que j’aperçois le malade guéri arpenter la rue à grands pas, frais et dispos, prêt aux expériences et aux aventures d’une vie intense ?
Je suis payé de retour lorsque prospère une œuvre ou que réussit un de mes semblables auquel j’ai témoigné un intérêt, de quelque ordre que ce soit. Je suis payé de retour lorsque, sous condition bien entendu de le couvrir de ses frais de déplacement, j’obtiens qu’un causeur, qu’un propagandiste qui m’intéresse vienne et passe quelque temps chez moi : la jouissance que je retire de sa conversation compense amplement mon effort pécuniaire.
Je suis payé de retour lorsque je provoque ou accomplis les démarches nécessaires pour arracher quelqu’un qui m’intéresse à une souffrance, ou à une épreuve qui l’accable, et que j’y réussis. Je suis payé de retour lorsque je parviens à soulager un de mes amis, un de mes compagnons d’idées, et à alléger le fardeau matériel ou moral qui le fait ployer. Je suis payé de retour lorsque j’ai conscience que des consommateurs apprécient la confection ou l’utilité du produit que je leur livre. Je suis payé de retour chaque fois qu’ayant accompli un effort spécial à l’intention de tel ou tel de mes semblables – effort bien défini –, je suis certain que celui-ci en profite.
Voilà sous quels aspects – et je n’en ai esquissé que quelques-uns – il est nécessaire de considérer, dans sa pratique, la méthode de réciprocité, si l’on veut qu’elle soit autre chose que le conformisme à un barème accepté de part et d’autre, et qui voudrait, par exemple, lorsque j’ai échangé une paire de chaussures contre 40 ou 50 kilos de farine, que j’aie reçu autant que j’ai donné. C’est le point de vue littéral, cela, et depuis longtemps l’on sait que la lettre tue. Si je suis un artiste en cordonnerie, il se peut que 35 ou 40 kilos de pain me contentent, et que la joie que j’éprouve en sachant mon travail apprécié comme j’aime qu’il le soit par mon consommateur, compense amplement les 5 ou 10 kilos de déficit. Recevoir autant qu’on a donné, ce n’est donc pas uniquement, je le réitère, toucher l’équivalent en poids, en mesure, en qualité, en valeur de ce qu’on a remis ou livré, c’est aussi, c’est surtout être satisfait du marché qu’on a passé, c’est avoir pleine conscience que, dans « l’affaire » traitée – intellectuellement, affectivement, « récréativement », économiquement parlant –, il n’y a eu, de part et d’autre, ni trompeur, ni trompé, ni dupeur, ni dupé ; autrement dit, que chacun, au cours du contrat, a agi selon son déterminisme et s’est montré sous ses véritables couleurs.
La réciprocité est là et non ailleurs.
Je connais l’objection. Si la méthode de la réciprocité n’est pas appliquée comme il est indispensable qu’elle le soit pour remplir son but, qui en surveillera, qui en déterminera, qui en garantira l’exercice loyal ? C’est l’éternelle question qui se pose dès qu’on parle d’un système de conduite dont le fonctionnement n’exige aucune espèce de coercition ou de sanction. Et l’éternelle réponse est que les aspirations et que les revendications individualistes ne sont réalisables qu’à la condition que soit courante dans le genre humain une certaine mentalité – sans qu’une conception de la vie autre que celle qui domine actuellement ne soit devenue une habitude, un acquis, une caractéristique de l’humanité.
On m’objectera encore que l’humanité ne parviendra à ce niveau général de mentalité que lentement, très lentement ; qu’on ne sait même pas si elle s’y hissera jamais ; qu’elle n’y atteindra peut-être que la veille du jour de la disparition de la vie organisée. Je répliquerai que la mentalité, aussi bien générale que particulière – et celle-là dépend de celle-ci –, a été faussée par ceux qui ont continuellement sur les lèvres l’amour du prochain, le dévouement aux intérêts d’autrui ou de la collectivité, et qui, en pratique, visent à l’asservir et à l’exploiter par tous les moyens et de toutes les façons.
Les individualistes – on s’en est rendu compte – ne font pas des rapports et des accords entre les humains une matière, une « affaire » de pur sentiment. Baser les rapports entre les hommes sur un amour du prochain égal à celui dont on use à l’égard de soi-même ne correspond pas à une réalité. Une fois l’être humain dépouillé de son vernis, de ses habits, de ses discours, on découvre, au contraire, qu’il s’aime d’abord. Et c’est l’équité même, car c’est là l’objet, le commencement et la fin de l’instinct ou du sentiment de conservation. On aime le plus souvent son prochain moins qu’on s’aime soi-même. On peut l’aimer – et cela arrive fréquemment – autant et même plus que soi-même. Mais c’est parce qu’on y trouve son intérêt ou son plaisir – une joie, une satisfaction, un contentement d’un genre ou d’un autre – sentimental, ou éthique, si l’on veut. Quand on aime son prochain, c’est pour soi-même ; et la majorité des hommes se soucie peu de l’amour du prochain. Voilà la vérité. D’ailleurs, une satisfaction d’ordre sentimental ou intellectuel est toujours une satisfaction, il n’y a pas à ergoter. Le sentiment est un facteur aussi intéressé que le raisonnement, sinon davantage, car il porte à des extrémités qu’ignore le raisonnement.
Le genre humain pratiquera la méthode de la réciprocité pour établir ou conclure les rapports ou les accords entre les unités qui le constituent, lorsque, dans sa majorité – ou une minorité très nombreuse ou très influente –, il aura reconnu qu’il en retire intérêt. Si, au contraire, le genre humain, en général, estime que son intérêt est que la duperie ou la tromperie mutuelle soit à la base des rapports entre ses composants, s’il l’excuse, s’il le tolère, qu’on ne se fasse aucune illusion : on continuera, dans les journaux, dans les livres, ou dans les chaires, à parler d’amour du prochain et, dans la vie courante, à n’en tenir aucun compte.
Mais tout cela entendu, en quoi les individualistes anarchistes se trouvent-ils empêchés de se comporter à l’égard les uns des autres selon la méthode de la réciprocité ? Nous savons à quoi nous en tenir : les hommes, en général, se lèsent, se dupent, se trompent à qui mieux mieux, jamais ils ne donnent ou ne rendent, toutes choses étant égales, l’équivalent de ce qu’ils ont reçu ou emprunté. Dans les contrats qu’ils passent les uns avec les autres, il y a toujours quelqu’un de « roulé » ou de « refait » ou, du moins, c’est sous-entendu dans les sous-entendus des termes des accords discutés ou en discussion. Peut-être, au point de vue de l’absolue réalité, n’est-ce pas tout à fait exact et, pour ma part, là où cela se produit, je suis disposé à en placer la responsabilité sur la manie ou la tendance qui, jusqu’ici, a possédé les hommes de s’imposer leurs rapports et leurs contrats, d’en appeler à la contrainte, à la réglementation forcée, aux châtiments, pour les rendre viables et valables, pour trancher leurs différends. J’en rends également responsable le système de dissimulation qui régit toutes les transactions qui ont cours entre les hommes, système qui consiste dans tous les domaines et dans toutes les sphères à se montrer autrement que l’on est en réalité.
Mais, même alors que ce serait la règle universellement en vigueur parmi les hommes de se montrer des loups les uns à l’égard des autres ; quand bien même, pour lui rendre ce qui lui est dû, ils se situeraient à l’égard de l’ambiance humaine en état de légitime suspicion, qu’est-ce qui empêche les individualistes de se servir les uns vis-à-vis des autres de la méthode de réciprocité ? Qui les en empêche, puisqu’ils proclament que c’est l’utilité ou l’agrément qui les guide, puisqu’ils affirment s’afficher, se montrer tels qu’ils sont les uns aux autres ?
Qui peut dire si leur exemple – puisque leur tactique est, en général, de ne dissimuler rien du résultat de leurs expériences – ne parviendra pas à déterminer, sinon l’évolution de la mentalité générale, en tous cas la mentalité de milieux particuliers dans le sens de l’adoption de la réciprocité volontaire, comme base des rapports entre les unités humaines ?
La réciprocité n’est pas ignorée dans la nature, bien loin de là. Mais elle y est appliquée d’une façon qu’on a coutume de qualifier d’inconsciente, c’est-à-dire selon un degré de conscience qui échappe à notre compréhension. Tout le monde sait qu’une culture rapporte dans la mesure où on lui consacre davantage de soins ; dans la mesure où l’on débarrassera un champ de plantes parasites, ou qu’on l’épierrera, le fumera, le grain qu’on y a semé croîtra et fructifiera. Dans la nature, qui veut la fin veut les moyens. Plus un organisme développe certains organes, plus les fonctions que commandent ces organes s’accomplissent avec régularité et dans leur plénitude. Sans doute, tous les organismes ne reçoivent pas autant qu’ils donnent – mille circonstances imprévues s’interposent entre l’effort et son résultat –, mais, d’une façon générale, on peut poser comme produit acquis de l’observation que là où il n’y a aucun effort de fait, il n’y a point de résultat ; que là où il n’y a rien de donné, il n’y a rien non plus de reçu. À moins que quelqu’un de ses congénères le remplace, l’oiseau qui ne couve pas ses œufs, ne les voit pas éclore, l’être vivant qui ne s’en va pas à la recherche d’une proie végétale ou animale risque de rester l’estomac vide.
Il va sans dire que la réciprocité, telle que nous avons essayé de la définir, avec les détails et les nuances que nous avons esquissés, ne saurait être conçue que volontaire. Là comme ailleurs, nous nous tenons sur le terrain foncièrement individualiste. Solidarité volontaire, garantie volontaire, sociabilité volontaire, réciprocité volontaire. Il ne s’agit point de forcer qui que ce soit à agir de réciprocité à l’égard d’autrui, de contraindre quiconque à se demander en toute occasion s’il a bien reçu ou non l’équivalent de ce qu’il a donné ; il ne s’agit point d’imposer à la pensée, comme un dogme, qu’il est plus digne, d’abord, plus profitable, ensuite, d’user de réciprocité plutôt que de s’employer à léser, duper ou tromper son prochain. Nullement, il est question ici de l’application intégrale, loyale, de la méthode de la réciprocité dans tous les rapports et dans tous les accords entre les humains – tout au moins entre individualistes –, mais volontairement, à titre d’expérience, non comme une loi, ni comme un commandement moral. Par le libre consentement des individus isolés ou des associés qui décident de s’en servir. Comme un mode de se comporter l’un envers l’autre, les uns envers les autres,
D’ailleurs, l’individualiste véritable aura à cœur de ne point se sentir redevable à qui lui a rendu service ; le sentiment qu’il possède de sa dignité personnelle ne lui permettrait pas de rester sur cette constatation qu’il a davantage reçu que donné. Ne point se sentir diminué à ses propres yeux est un facteur qui sera toujours appelé à jouer un grand rôle dans les accords à souscrire entre individualistes.
Pour qu’un individualiste soit satisfait des résultats de l’accord qu’il a conclu avec autrui, il est nécessaire qu’il ait pleine conscience qu’il a donné tout ce qui était en son pouvoir, tout ce que lui permettait son déterminisme ; autrement dit, qu’il n’a pas reçu davantage que ce qu’il pouvait donner. Sa dignité le demande, sa fierté le réclame. Le cas peut se présenter que l’on rende service à quelqu’un, mais que les efforts accomplis n’aboutissent pas aux fins auxquelles tend ce service. Il est évident, cependant, qu’à moins de manquer à la plus élémentaire dignité, celui auquel il a été rendu service ne saurait se dérober quand la personne, qui s’est intéressée ainsi à lui, fait, à son tour, appel à son effort. La réciprocité, somme toute, c’est la tendance à compensation parfaite dans les rapports entre humains – compensation entre tout ce qui est donné, prêté, reçu, rendu, dans tous les domaines et dans toutes les sphères de la pensée et de l’activité humaines, selon les aptitudes de chacun.
Enfin, il faut tenir compte que cette compensation ne puisse être réalisée par suite d’un cas fortuit ou de force majeure : la maladie, un état d’impuissance momentané ou prolongé, etc. Il y a des circonstances où un être humain ne peut, ne pourra jamais donner autant qu’il reçoit, mais son cas peut provoquer un tel intérêt qu’il ne viendra jamais à la pensée d’aucun de ceux qui lui donnent de s’attendre à une compensation quelconque.
En résumé, la seule base équitable sur laquelle puissent se fonder les rapports entre les hommes nous semble être la réciprocité. Car là où il y a exactement réciprocité, dans les produits et dans les actions, il n’y a pas de place pour la méfiance, le doute ou la rancœur. Où la difficulté commence, c’est quand il s’agit de déterminer exactement l’équivalence des actions ou des produits, étant entendu qu’on est mû par le désir de ne pas léser autrui ni d’être lésé par lui, et non par celui de faire triompher, même par la force, un étalon d’équivalences. La notion de réciprocité n’apparaît plus alors comme une notion purement utilitaire, au sens grégaire et vulgaire du terme. Le troupeau social admet, en effet, qu’une action est compensée ou qu’un produit est rétribué lorsqu’on a « rendu la pareille » ou versé telles espèces.
L’idée de réciprocité, au point de vue individualiste, tend à instaurer une « valeur » toute différente : étant donné, dans certaines circonstances, le degré d’aptitudes et la possibilité d’efforts d’une unité humaine, quelle action pratique, quelle attitude affective, quelle production positive compenseront équitablement la somme d’efforts et la mise en jeu d’aptitudes que cette unité a dû employer pour accomplir ce geste-là ou ce labeur-là, sans qu’il puisse y avoir place pour le moindre soupçon d’exploitation ?
— E. ARMAND.
RÉCLAME
Voir l’article paraître, de E. Rothen.
RÉDEMPTEUR, RÉDEMPTION
(du latin : redimere, racheter)
D’innombrables souffrances, voilà le lot de l’homme ! Un état social contraire à la nature s’avère créateur de douleurs continuelles, surtout pour le pauvre, soumis aux incessantes vexations de chefs rapaces. Le salariat, moderne forme de l’esclavage, place le travailleur sous la dépendance des privilégiés de la fortune. Extravagante et inepte, la justice n’est, aux mains de l’État, qu’un moyen d’écraser le faible, de légitimer les rapines du fort, de permettre à l’usurpation triomphante d’asseoir sa domination de façon durable. Des législateurs, qui décorent de noms magnifiques leurs intérêts de classe ou leurs ambitions personnelles, attisent les haines, déchaînent les convoitises afin de commander plus facilement aux masses divisées. Et la guerre, suprême ressource, remédie à la surpopulation, en permettant l’extermination méthodique du jeune bétail humain. Ceux qui épargnent, en vue d’un bien-être futur, se voient dépossédés le lendemain de ce qu’ils amassèrent la veille ; grâce aux savantes combinaisons de financiers que protège le Code, leurs économies sont empochées par les tripoteurs des banques. Si haut que l’on remonte pendant la période historique, le spectacle s’avère aussi sombre, l’organisation sociale aussi cruelle pour les déshérités ; à certains moments, leur sort fut plus terrible encore qu’aujourd’hui. Dispensés de nombreuses souffrances, les privilégiés de la fortune eux-mêmes ne se déclarent presque jamais satisfaits. Constatation troublante, les statistiques démontrent que le suicide est plus fréquent parmi les riches que parmi les pauvres. Ainsi, ceux qu’on appelle les « heureux d’ici-bas » éprouvent parfois un tel dégoût de l’existence qu’ils cherchent un refuge dans la mort ; et la plupart estiment que la vie leur apporte plus d’amertume que de joie. Des ténèbres et des énigmes, voilà ce que rencontre leur intelligence ; l’incompréhension, les mesquines barrières des conventions sociales, voilà les obstacles contre lesquels butent leurs affections ; et l’envie, la haine, l’ambition déçue habitent en permanence les plus luxueux châteaux. Puis le bacille de Koch creuse aussi allègrement les poumons d’un multimillionnaire que ceux d’un paysan ; et le cancer se loge dans le ventre des duchesses comme dans celui des simples ouvrières. À tous, la nature réserve des douleurs physiques et une mort qu’accompagnent souvent des tortures effroyables. Il n’est donc point surprenant que, depuis qu’elle a pris conscience de sa situation, l’humanité rêve de rédempteur et de rédemption. Mais, comme l’a remarqué Sébastien Faure, il existe de fausses rédemptions, très dangereuses par les illusions qu’elles font naître et les directives qu’elles impriment à notre activité.
La religion, qui, pour faire oublier le présent, se montre prodigue en matière d’espérances réalisables après la mort seulement, parvient à détourner des millions d’hommes de la voie qui conduit à l’ultime libération. Constatant qu’à côté du bien le mal occupe une large place dans le monde, que les satisfactions de l’esprit et du cœur ont l’ignorance et la haine pour contreparties, qu’un rythme universel fait succéder les heures sombres aux heures ensoleillées, le mazdéisme supposa qu’il y avait un dieu bon et un dieu mauvais, toujours en lutte l’un contre l’autre. Et, pour encourager ses fidèles, il leur annonçait le triomphe final de la lumière sur les ténèbres, de la vertu sur le vice, des forces secourables sur les forces destructives. Cette mythologie symbolique ne manquait pas de grandeur. Mais le judaïsme, puis le christianisme réduisirent à de mesquines proportions ce combat du bien contre le mal. Pour eux, Satan, le principe mauvais, n’est plus qu’un ange rebelle, une simple créature, dont la chute, attribuée tantôt à la jalousie, tantôt à l’orgueil, reste en fin de compte inexplicable. Et, néanmoins, ce révolté, au prestige bien compromis, s’avère le plus précieux des auxiliaires pour les théologiens, soit protestants, soit catholiques. Véritable bouc émissaire, c’est à lui qu’ils attribuent tous les maux qui nous affligent. Nos premiers parents furent ses victimes. Placés par dieu dans un jardin de délices, ils vivaient parfaitement heureux, ignorant le travail, la souffrance, la maladie, la mort. Cet Éden était abondamment planté, et ses habitants pouvaient manger des fruits de tous les arbres, à l’exception des fruits de l’arbre de la science du bien et du mal. Ils devaient s’abstenir de toucher à ceux-ci sous peine de mort. Or, conseillée par le serpent, Ève transgressa l’ordre divin et entraîna Adam dans sa chute. L’Éternel, indigné, chassa les coupables du Paradis terrestre et les condamna, ainsi que leurs descendants, au travail, à la souffrance, à la mort. « Tout cela paraît insensé », déclare Bossuet lui-même. Aussi, les pères de l’Église, interprétant ce récit (qu’explique très bien la mentalité primitive), ont-ils cru reconnaître le diable sous la peau du serpent. Plus tard, Satan s’attaquera au Christ ; il le tentera d’abord, puis entrant « dans Juda, nommé Iscariote, qui était du nombre des Douze », il poussera ce dernier à livrer Jésus aux chefs des prêtres. Mais, par sa mort, le Christ a provoqué l’effondrement de la puissance diabolique, il a satisfait à la justice divine, irritée contre la descendance d’Adam, et racheté le genre humain. Nous n’entrerons pas dans le détail de cette folle doctrine qui, sous sa forme actuelle, ne s’est d’ailleurs constituée qu’assez tardivement. Notons cependant que, malgré la prétendue rédemption opérée par le Christ, fatigue, souffrance, maladie, mort continuèrent de régner en souveraines sur notre globe. Il y a mieux, Satan nuit toujours aux hommes, même à ceux qui ont reçu le baptême. Le pape saint Grégoire le constate avec une tristesse désabusée dans les lignes suivantes :
« Que Béhémoth (c’est ainsi qu’il appelle le diable) ait, avant l’eau du baptême, avant les sacrements célestes, avant l’incarnation du Rédempteur, englouti le fleuve du genre humain dans le gouffre de l’erreur, à cela rien d’étonnant. Ce qui surprend, ce qui est effrayant, c’est qu’il fait beaucoup de victimes même depuis que le Rédempteur est connu, c’est que l’eau du baptême ne préserve pas de sa souillure, c’est que les sacrements célestes ne l’empêchent pas d’alimenter l’enfer. »
Pas plus que les autres fondateurs de religion, Jésus n’a rien sauvé. Finalement, la fausse rédemption chrétienne devait aboutir à consolider tous les abus dans l’ordre social, à légitimer toutes les usurpations dans l’ordre politique. Puissance des ténèbres, désireuse d’égarer les esprits, non de les éclairer, l’Église s’avère la servante des tyrans.
« L’usurpateur, s’il réussit, trouve en elle une alliée : contre la dynastie mérovingienne, elle appuya Pépin, et sacra Bonaparte, après avoir sacré les Bourbons. »
Puis, en retardant le progrès scientifique, elle a empêché l’homme d’améliorer ses conditions naturelles d’existence. Médecine, chimie, physique durent rejeter le joug pesant de la théologie avant de découvrir les principales lois du monde tant organique qu’inorganique. Des dogmes insensés, des préceptes irrationnels, des rites grotesques, voilà ce que l’humanité doit aux religions de salut comme aux autres. Il faut proclamer hautement la faillite complète des tentatives effectuées par quelques-unes d’entre elles pour apporter une aide efficace à l’humanité. Anesthésiants du cœur et du cerveau, elles détournent l’esprit des réalisations heureuses et l’orientent vers des rêves malsains. Lentement, les peuples civilisés sont, d’ailleurs, parvenus à comprendre qu’ils n’avaient rien à espérer, ni à craindre de dieux inexistants. Aussi, leurs regards se détachent d’un ciel manifestement vide pour se reporter sur les réalités moins brillantes, mais tangibles, que perçoivent les sens. C’est ici-bas, non dans un au-delà chimérique, que doit s’opérer la rédemption qu’ils désirent.
Nous ne méconnaissons pas la supériorité de cette conception laïque sur la croyance à l’efficacité magique des rites et des prières. Toute tentative d’émancipation sociale, tout effort individuel ou collectif pour échapper à la tyrannie des privilégiés sont assurés de notre sympathie. Nous pardonnons même des erreurs et des défaillances ; car, seul, il ne se trompe jamais celui qui n’agit pas, et nous savons combien il est difficile de réaliser en pratique l’idéal que l’on a le plus caressé. D’où notre indulgence pour la Révolution française, pour la Révolution russe et pour quiconque travaille à l’affranchissement du prolétariat. Un examen impartial et sincère de l’œuvre, soit de Robespierre, soit de Lénine, nous contraint de penser néanmoins qu’ils ne furent pas les prophètes de la grande libération que le monde attend. Ils amorcèrent des réformes utiles ; ils ne furent point des rédempteurs infaillibles comme le crurent leurs partisans. La Révolution française aboutit, après bien des avatars, au triomphe d’une hideuse ploutocratie et à l’abominable vénalité du régime parlementaire. Lorsqu’on voit les jacobins d’aujourd’hui, les prétendus successeurs des révolutionnaires de 1789, ériger en sauveur le candidat académicien Herriot, protecteur caché des moines et des généraux réactionnaires, il est permis de conclure à la banqueroute totale des partis de gauche qui se disent démocratiques et républicains. À côté d’innovations heureuses, la Déclaration des droits de l’homme contenait des principes qui maintenaient les salariés sous le joug des patrons, et l’ensemble des citoyens sous celui de l’État. Elle conduisit au règne d’une bourgeoisie patriotarde, toujours apeurée, dont l’égoïsme mesquin s’associait à une sottise incurable ; puis à l’occulte domination des grands féodaux du capitalisme et des financiers internationaux.
Après avoir suscité de prodigieuses espérances chez les prolétaires du monde entier, le bolchevisme russe s’est égaré, lui aussi, sur une voie qui n’est point celle de l’ultime libération. À l’ancien empire des tzars, il aura donné sans doute un grand essor industriel et agricole ; il aura amélioré d’une façon sensible le sort matériel des ouvriers ; dans les domaines sexuel et religieux, souhaitons même que l’œuvre déjà accomplie se parachève et soit durable. Mais en assujettissant les esprits à des dogmes nouveaux, en faisant des améliorations économiques le nec plus ultra des préoccupations humaines, les dirigeants russes se bornent à américaniser et la vie des individus et les procédés de production, dans les immenses territoires dont ils disposent. Vue sous l’angle de l’utilité matérielle immédiate, et comparée à l’incurie des tzars, l’œuvre du gouvernement actuel peut sembler admirable ; beaucoup sont sincères, parmi les voyageurs qui reviennent de Russie émerveillés. Incapables de réfléchir en profondeur, ils ne comprennent pas que le bolchevisme a renoncé à faire besogne rédemptrice, du jour où son idéal fut limité à la transformation des conditions matérielles d’existence, du jour où il proposa comme modèle à l’ouvrier le chien bien gras mais muni d’un collier et d’une chaîne solides, du jour où il se figea dans l’imitation des procédés industriels américains, insoucieux de pousser plus loin dans la voie des conquêtes morales. Ce n’est pas en raison de l’accroissement de sa production en pétrole, en machines, etc., que j’apprécie le progrès accompli chez un peuple. Ils font bien de crier au miracle, ceux qui continuent d’admirer la civilisation des États-Unis, même après les désillusions de ces dernières années ! Pour moi, je regrette que, pour satisfaire les ventres, le bolchévisme russe ait faussement jugé indispensable de sacrifier les cœurs et les cerveaux.
Sans méconnaître le mérite de tous ceux qui, à un titre quelconque, contribuèrent à l’amélioration du sort des pauvres et firent faire un pas en avant à leurs contemporains, nous estimons que l’humanité doit encore fournir une longue marche pour atteindre à la libération définitive. De puissants obstacles, dont la lâcheté et la sottise sont peut-être les pires, retardent indéfiniment l’œuvre salvatrice de ces suprêmes rédempteurs que sont l’amour et le savoir. Aussi, l’ère de fraternité universelle, que nous appelons de nos vœux, apparaît-elle fort lointaine à beaucoup ; ils affirment que le règne de la violence ne touche pas à sa fin. Par nos actes et par nos paroles, jetons du moins, entre les hommes, des semences de concorde qui fructifieront pour le plus grand profit de nos successeurs. Et consolons-nous des maux actuels en songeant que le bonheur est, avant tout, chose individuelle et que, s’il est impossible de sauver l’ensemble de nos contemporains, nous parviendrons à nous sauver nous-mêmes en contribuant au salut de ceux qui peuvent comprendre et qui savent vouloir.
— L. BARBEDETTE.
RÉÉLIGIBILITÉ
n. f.
À l’expiration de leur mandat, parlementaires, conseillers d’arrondissement, conseillers municipaux, etc., doivent se représenter devant leurs électeurs s’ils veulent continuer à exercer leurs fonctions. La réélection est obligatoire en France, d’une façon normale, au bout de 9 ans pour les sénateurs, de 5 ans pour les députés, de 6 ans pour les conseillers généraux, d’arrondissement et municipaux. Le président de la République est rééligible au bout de 7 ans (5 ans depuis 2002) ; en 1885, Grévy fut réélu, mais, à la suite des tripotages de son gendre, il dut donner sa démission. Aux États-Unis, la constitution est muette touchant la rééligibilité du Président de la République ; toutefois, depuis Washington, il est d’usage de ne jamais investir trois fois le même candidat de cette fonction. D’une façon générale, les conditions de la rééligibilité sont les mêmes que celles de l’éligibilité. Plus la durée du mandat est longue, plus ceux qui l’exercent ont de facilité pour opérer leurs rapines et s’engraisser au dépens des naïfs qui les désignent. Aussi, l’idéal des chefs est-il d’obtenir un mandat perpétuel qui les dispense d’avoir à se représenter devant leurs électeurs. D’où les tentatives faites, ces dernières années, pour permettre aux députés de siéger plus longtemps au Palais-Bourbon. Tous les tripotages, toutes les infamies, dénoncés à propos du mode de recrutement des parlementaires, s’appliquent à la réélection. Les peuples sont d’ailleurs si sots qu’ils n’hésitent habituellement pas à réélire ceux qui les trompent et les grugent avec le plus de désinvolture. Un Poincaré, le sinistre coupable de si effroyables tueries, siège toujours au Sénat, et, s’il n’était devenu manifestement gâteux, il aurait pu se faire désigner à nouveau comme Président de la République. Voilà qui suffit à juger un régime et une époque.
RÉFÉRENDUM
n. m.
Théoriquement, le référendum apparaît comme une atténuation du système représentatif et comme un moyen d’obtenir un gouvernement populaire mixte, semi-direct ou semi-représentatif. Il suppose une assemblée élue, chargée d’élaborer les lois ; mais ces dernières ne deviennent définitives que si elles sont ratifiées par l’approbation du peuple. Le référendum peut, d’ailleurs, être appliqué dans des circonstances et avec des modalités bien différentes. En Suisse, le référendum est obligatoire pour les lois constitutionnelles fédérales et cantonales. Il est facultatif pour les lois fédérales ordinaires, votées par les deux Chambres (le Conseil National et le Conseil d’Etat). Dans ce dernier cas, la demande de référendum doit être faite, dans le délai de 90 jours après leur adoption, par 30.000 citoyens votants ou par huit cantons. Les signatures des pétitionnaires doivent être légalisées par les autorités communales et sont examinées par le conseil fédéral qui se prononce sur leur caractère régulier ou irrégulier. Les électeurs répondent par « oui » ou par « non ». Pour les lois cantonales ordinaires, le référendum est obligatoire dans certains cantons, facultatif dans d’autres. En France, on tenta vainement d’introduire cette institution au moment de la Révolution. Certains ont considéré les plébiscites, en usage sous Napoléon 1er et Napoléon III, comme une sorte de référendum. La troisième République, qui marque chez nous le triomphe complet du parlementarisme, n’a pas admis cette institution d’allure trop populaire. Appliqué selon des modalités variables, le référendum existe ailleurs qu’en Suisse, ainsi en Allemagne et aux Etats-Unis. Dans ce dernier pays, son fonctionnement est assez complexe et diffère selon les Etats. Autrefois il était préconisé par les socialistes des divers pays et prenait place parmi leurs principales revendications. Ses apologistes voient en lui un obstacle au despotisme des assemblées législatives et aux abus du parlementarisme ; il donnerait une autorité plus grande à la loi en la faisant ratifier par le peuple lui-même. Mais lorsqu’on n’admet pas que la majorité fasse la loi à la minorité, lorsqu’on refuse à quiconque le droit d’imposer sa volonté à autrui, le référendum apparaît aussi injuste dans son principe que les autres procédés servant à la confection des textes législatifs. Et le peuple n’est pas plus désintéressé que les assemblées parlementaires ; la corruption électorale a pris des proportions trop grandes à notre époque pour que quelqu’un ose le nier. Avec le référendum l’iniquité triomphe sans peine lorsque l’opinion publique est façonnée d’une façon méthodique et prolongée. Ce qui se passe dans les pays où cette institution existe démontre que les partisans du progrès ne doivent pas tourner leurs espoirs de ce côté-là.
RÉFLÉCHIR
v. (du latin reflectere, replier)
Ce verbe exprime l’action de se replier sur soi-même, de se recueillir, de faire appel à ses facultés de compréhension, de consulter la logique et la raison, d’interroger ses connaissances et l’expérience acquise, de méditer dans le but de se faire, sur un sujet déterminé, une opinion personnelle, approfondie et judicieuse. Laissant de côté les autres sens que comporte ce mot, nous ne nous arrêterons qu’à celui-ci. Au surplus, il n’a sa place dans cet ouvrage que dans la mesure où l’action de réfléchir intéresse la vie du propagandiste, du militant.
Le militant mène une vie tellement active qu’il trouve rarement le temps de se recueillir. Son parti, son syndicat, son groupement, la propagande générale l’absorbent à tel point qu’il ne lui reste plus le loisir nécessaire au travail de la méditation.
Et pourtant, il est indispensable que, le plus souvent possible, le militant s’isole, se recueille, réfléchisse mûrement. Il faut que les événements importants soient soumis par lui à l’étude, à la méditation. Sinon, il est à craindre que, d’une part, emporté dans le tourbillon et la fièvre de l’actualité, il ne se laisse égarer par certains entraînements ou certaines apparences et que, d’autre part, il ne perde la précieuse habitude de se faire, par un examen approfondi, une opinion personnelle sur les faits dont l’ensemble et le détail sollicitent et méritent de retenir son attention.
Ne peut pas, ne sait pas réfléchir qui le veut. Le sens méditatif est assez rare, et l’habitude du recueillement plus rare encore. Et pourtant ce labeur intérieur est de ceux que nul travail ne remplace. La lecture et la discussion sont d’une grande et incontestable utilité ; mais elles sont totalement insuffisantes. Par la conversation et la lecture, chacun consulte la pensée d’autrui, la confronte avec la sienne. Association ou éloignement, confusion ou opposition, accord ou conflit de deux pensées qui s’échangent, tel est le résultat de la lecture et de la discussion. Encore faut-il que celui qui lit ou qui controverse ait, au préalable, une pensée pour que celle-ci soit fortifiée ou affaiblie, corroborée ou détruite par l’entretien et la lecture. Or, pour posséder cette pensée préalable, il est nécessaire de se replier sur soi-même, de réfléchir longuement, de discuter avec soi-même, d’envisager le pour et le contre ; c’est ce qu’on appelle réfléchir, « méditer ».
Pour propager une idée, pour défendre une thèse, pour faire prévaloir une doctrine, il est indispensable de les posséder à fond. Seule la méditation (réflexion profonde et prolongée) est de nature à assurer au militant la conviction claire et solide dont il a besoin, s’il a le désir d’être un propagandiste.
Le propagandiste a le devoir de s’isoler parfois, de se recueillir souvent, de réfléchir toujours.
S’abstient-il de méditer ? Il s’accoutume, dans ce cas à chercher hors de lui les idées et les sentiments qu’il se borne à introduire ensuite en lui ; il se condamne à puiser chez les autres les ressources intellectuelles qu’il a la paresse de ne pas cultiver en lui ; il s’expose à importer en lui, sans une vérification suffisante, ce qu’y ont introduit la lecture et la conversation. Et lorsque, à son tour, il écrira ou parlera, il ne sera qu’un perroquet ou un phonographe. Il se laissera, ainsi, graduellement entraîner sur la pente dangereuse de l’adoption sans contrôle des thèses développées par les animateurs, et il ne pourra que grossir d’une unité le troupeau trop considérable déjà des suiveurs. S’il veut devenir et rester lui, le militant doit réfléchir chaque fois que surgit un événement de quelque importance, qu’éclate un conflit sérieux d’opinion, qu’il a à prendre position et à se situer dans une circonstance grave.
Je ne dis pas qu’il doive s’interdire la lecture et la discussion. Je dis seulement qu’il doit tout d’abord réfléchir et, par le seul effort de sa pensée se livrant à une profonde méditation, parvenir à se former un sentiment personnel. Qu’il ait recours, ensuite, à la discussion et à la lecture, qu’il soumette son sentiment à l’épreuve de l’étude et de la controverse, rien de mieux ; il n’est pas infaillible, et, si profondément qu’il ait réfléchi et médité, il se peut qu’il n’ait pas examiné la question dans sa totalité, qu’il ne l’ait pas observée sous son angle exact, qu’il l’ait à tort séparée des questions avec lesquelles elle s’apparente, qu’il en ait négligé certains aspects ; bref, qu’il ait fait erreur. La lecture et la discussion éclaireront les points obscurs, mettront en valeur les considérations qui lui auront échappé ; à ses lumières propres viendront s’ajouter celles des autres, et de cette association de divers centres lumineux naîtra l’éblouissante clarté. Il n’aura fait qu’apporter à ce tout sa part contributive ; mais, du moins, aura-t-il fait cet apport.
Donc, le travail de la méditation est, pour le militant, un exercice indispensable. En quoi consiste-t-il ?
Le meilleur moyen de préciser ce côté pratique au problème, c’est de prendre un exemple.
Voici quelques citations ; une douzaine :
« L’homme le plus puissant est celui qui est le plus seul. » (Ibsen)
« Déshonorons la guerre ! Non, la gloire sanglante n’existe pas. » (Victor Hugo)
« L’État ne poursuit jamais qu’un but : limiter, enchaîner, assujettir l’individu, le subordonner à une « généralité » quelconque. » (Max Stirner)
« En tout temps et en tous lieux, quel que soit le nom que prenne le gouvernement, quelles que soient son origine et son organisation, sa fonction essentielle est toujours celle d’opprimer et d’exploiter les masses. » (Malatesta)
« Les prolétaires se sont sentis, au-delà des frontières, des frères de misère qui ont comme eux le capital pour ennemi. » (Le Dantec)
« Le patron n’est jamais seul ; il a toujours avec lui, pour lui, tous les moyens de pression dont dispose sa classe : l’ensemble des forces sociales organisées, magistrature, fonctionnaires, soldats, gendarmes, policiers. » (A. Briand)
« Oui, une société qui admet la misère ; oui, une humanité qui admet la guerre me semblent une société, une humanité inférieures ; c’est vers la société d’en haut, vers l’humanité d’en haut que je tends, société sans rois, humanité sans frontières. » (Victor Hugo)
« Il est aussi difficile aux riches d’acquérir la sagesse qu’aux sages d’acquérir les richesses. » (Epictète)
« Le peuple a marché sur le corps aux rois et aux prêtres coalisés contre lui ; il en fera de même aux nouveaux tartufes politiques assis à la place des anciens. » (Condorcet)
« La guerre est le fruit de la faiblesse des peuples et de leur stupidité. » (Romain Rolland)
« En France, il meurt de misère cent quatre-vingt-quinze mille personnes chaque année. » (Bertillon)
« Ne juge pas ! Moque-toi de l’opinion des autres. » (Tolstoï)
Appliquons-nous à réfléchir sur la dernière de ces citations : « Ne juge pas ! Moque-toi de l’opinion des autres. »
Nous trouvons, ici, deux pensées. La première contient une défense : « Ne juge pas ». La seconde exprime une prescription : « Moque-toi de l’opinion des autres ». À première vue, l’homme qui réfléchit saisit sans effort le lien qui, de ces deux propositions, n’en forme en réalité qu’une seule, la seconde étant la conséquence de la première.
Toutefois, pour associer les deux parties de cette idée, il est nécessaire de les examiner successivement, puisque la seconde fait suite logiquement à la première.
« Ne juge pas ! » Qu’est-ce à dire ? Tâchons, avant tout, de pénétrer exactement le sens de ces trois mots. Est-ce à dire que, lorsque je me trouve en présence d’un écrit, d’une parole, d’une action – formes diverses sous lesquelles s’extériorise et s’affirme un de mes semblables –, je dois m’interdire d’estimer, de peser, de comparer, d’apprécier cette action, cette parole ou cet écrit ? Nullement. Le droit de critiquer, la faculté d’approuver ou de blâmer restent entiers, et il ne peut être dans la pensée de l’auteur de supprimer ce droit, de restreindre l’exercice de cette faculté. Ici, le mot juger est certainement pris pour le mot condamner, et il sied de modifier la formule « Ne juge pas » et de la remplacer par celle-ci : « Ne condamne pas ».
Est-il bien certain que je sois parvenu maintenant à comprendre la pensée de l’auteur ? C’est probable. Pourtant, il se peut que non. En tous cas, ne ferai-je pas bien de la compléter ?
Réfléchissons.
Il n’est pas déraisonnable de désapprouver un écrit, une parole, une action, ce qui équivaut à les condamner, ce qui, au surplus, entraîne le droit de combattre la parole ou l’écrit et, si on le peut, de s’opposer à l’action. Si, par ces trois mots : « Ne juge pas », Tolstoï a prétendu limiter ou abolir ma faculté d’appréciation, s’il a voulu m’interdire le droit de combattre ou de m’opposer, je cesse d’être d’accord avec lui. Mais, peut-être, a-t-il voulu me mettre seulement en garde contre la propension – hélas trop générale, parce qu’elle emprunte le plus clair de sa force à une coutume archi séculaire – de m’ériger en magistrat, en juge, et de prononcer une sentence, de rendre un arrêt et d’infliger un châtiment. S’il en est ainsi, je suis tout à fait d’accord.
Ici, je dois mûrement réfléchir, afin d’appuyer cette prohibition : « Ne juge pas ! », dont le sens exact, profond, total, est celui-ci : « Ne condamne pas ! Ne punis pas ! », même sur des motifs probants, décisifs. Ici, c’est tout le mécanisme gouvernemental, judiciaire, social que j’ai à étudier.
Commençons : mécanisme gouvernemental qui, élaborant et édictant la loi, statue souverainement sur ce qu’il est permis ou défendu de dire, d’écrire ou de faire. Je me recueille, à ce moment, avec un soin d’autant plus marqué, je donne à mes facultés méditatives une puissance d’autant plus efficiente que ce point particulier est plus délicat, plus redoutable et plus important. J’examine successivement les multiples parties du problème : d’où procède le droit du gouvernement, quels en sont les origines et les fondements ? Par quels moyens s’est-il arrogé ce droit de réglementer les discours, les écrits et les actions des individus ? Dans quelles conditions et par qui cette réglementation acquiert-elle force de loi ? Dans quel but cette législation ? Au bénéfice de quoi et au profit de qui fonctionne-t-elle ? Est-ce au bénéfice de l’équité ou des mœurs ? Est-ce au profit d’une classe de citoyens ou de tous ?... Le militant aperçoit tout de suite les vastes et nombreux horizons que ce premier point du problème ouvre devant sa pensée.
Continuons : mécanisme judiciaire. La législation est établie. Suffit-il qu’elle le soit ? Évidemment non ; les cas sont innombrables, les « espèces » abondent. Il importe que chaque cas, chaque espèce fasse l’objet d’une procédure spéciale, d’une appréciation, d’un arrêt. Donc, il faut toute une institution dont ce sera la fonction d’interpréter la loi, d’apprécier les cas, de prononcer le jugement et, le cas échéant, de fixer la peine.
Cette institution, c’est ce qu’on appelle la Justice ; institution qui, dans son ensemble, embrasse : magistrats, policiers, agents de la force publique, gardiens de prison, bourreau. Ces hommes revêtus de l’écrasant pouvoir et de la redoutable responsabilité de se prononcer sur la liberté, les biens matériels, les intérêts moraux et la vie de tous, quels sont-ils ? Comment sont-ils recrutés ? Quelles garanties offrent-ils de lucidité, d’intégrité ? Quel usage font-ils et peuvent-ils faire de l’autorité qui leur est impartie ? De quels moyens disposent-ils pour se glisser au fond des consciences, voir clair dans les arcanes obscurs de ces intimités, aussi variables que les cas et les individus ? Sur quel étalon mesurent-ils les responsabilités ? Leur est-il possible de discerner nettement, sans crainte d’erreur ou d’abus, ce qui se passe dans les régions mystérieuses de l’être humain ? L’investiture qu’ils ont reçue leur confère-t-elle de miraculeuses lumières et met-elle à leur service des moyens d’investigation infaillibles ?...
Terminons : mécanisme social. Le jugement est rendu. L’écrit, le discours, l’acte soumis à l’appréciation des magistrats ont été condamnés ; les juges ont déclaré qu’ils tombent sous le coup de la loi ; la peine a été prononcée ; le châtiment suit. L’opinion publique en est informée ; elle est, à son tour, saisie de l’affaire ; elle apprécie et, quatre-vingt dix-neuf fois sur cent, elle homologue, sans examen, automatiquement, l’arrêt rendu. Elle ajoute à la peine prononcée le mépris et la haine qui escortent le condamné sa vie durant.
Pourquoi, comment acquiesce-t-elle aussi facilement à la sentence judiciaire ? Que sait-elle de l’affaire ? Que connaît-elle du condamné, de son ascendance, de son tempérament, de son enfance, des milieux dans lesquels il a grandi, des exemples qu’il a eus sous les yeux, des entraînements qu’il a subis, des mille circonstances qui ont fait peser sur lui leurs influences, de ce rien et de ce tout qui ont, au dernier moment et en dernière analyse, déterminé son action, etc. ?
Concluons :
Arrivé à ce point de sa méditation, le militant concevra la haute sagesse, l’équité profonde et l’indiscutable exactitude de cette défense : « Ne juge pas ! », c’est-à-dire : « Ne condamne pas ; ne punis pas ! »
Le propagandiste puisera, dans les considérations et aperçus, qui l’auront peu à peu conduit à une conclusion irréfragable, une foule d’idées et de sentiments sur lesquels il campera solidement une opinion qu’il sera capable de développer et de faire triompher. Il sera bon qu’il en cause avec ses amis, qu’il en discute avec les adversaires, qu’il cherche dans la lecture ce qui est de nature à combattre ou à confirmer son propre sentiment. Et, soumise à l’épreuve de la lecture et de la discussion, loyalement confrontée avec le sentiment des autres, sa conviction reposera finalement sur des données abondantes et précises qui le mettront en mesure de la propager avec succès.
Pour la seconde partie de la citation : « Moque-toi de l’opinion des autres », il n’y aura qu’à procéder de la même manière. Ici, le travail de méditation sera rendu facile par l’examen approfondi de la première proposition, puisque la seconde vient en conséquence de la première. (Voir Qu’en dira-t-on.)
J’ai constaté fréquemment, chez un grand nombre de militants, du flottement, de l’hésitation, chaque fois qu’une situation troublante se produit et qu’un évènement grave éclate. Je comprends cette perplexité ; elle a du bon : l’attitude d’un militant doit constamment rester libre de toute chaîne, et son opinion doit demeurer, en toutes circonstances, subordonnée à une révision réfléchie et éventuelle. Dans ces conjonctures, qu’il s’empresse de s’isoler. Qu’il ait recours, avant de prendre position, à la réflexion, au recueillement, à la méditation. Cette gymnastique de la pensée est nécessaire ; il importe qu’il s’y entraîne. Pratiqué chaque jour et méthodiquement, ce sport – car c’en est un, le plus noble et le plus salutaire de tous – développera et embellira sa vie intellectuelle.
Cc sera le bain salutaire d’où il sortira purifié et fortifié. Il y puisera les forces dont il a besoin s’il veut résolument faire face à la dépense d’énergie que nécessite la lutte implacable entreprise par tous les hommes de cœur, de raison et de volonté contre le monde d’ignominie qu’il faut abattre à tout prix et le plus tôt possible.
— Sébastien FAURE.
RÉFORME
n. f.
Le changement de méthodes et de lois, considérées comme socialement mauvaises, en vue de nouvelles, que l’on considère comme meilleures, constitue une réforme. Les administrations, les États sous l’emprise de besoins nouveaux subissent des transformations et suppriment certains abus. Ces modifications constituent des réformes temporaires. Dans la vie militaire, il est parfois question de réforme. Le passage de l’activité à l’inactivité, dans l’armée, constitue pour les hommes, les bêtes et les choses un état de réforme. L’on donne aussi le nom de réforme à la révolution qui sépara de l’Église romaine une grande partie de l’Europe au XVIème siècle. C’est en 1517 que Luther proclama la Réforme. Cette réforme est la plus importante que l’humanité ait enregistrée ; elle constitue la transformation du christianisme par la libre discussion. Une pareille réformation se perçoit comme premier cri de l’intelligence plus ou moins éclairée, qui, de réforme en réforme, passe successivement de la foi religieuse au doute, pour ceux qui raisonnent, et à la foi matérialiste, pour ceux qui croient au mécanicisme général. Cette protestation religieuse amène, dit Colins, la protestation politique et crée le libéralisme, comme celui-ci amènera la protestation sociale et créera le socialisme.
Arrivée à ce point, qui est celui de notre époque, toute société est ballottée par le despotisme et l’incohérence. Elle fait appel aux réformes pour végéter entre ces deux systèmes de domination sociale. La société attend bien une réforme sérieuse et durable, mais elle ne sait de qui elle peut l’espérer ni de qui elle doit l’obtenir. Elle oublie que, tant que les abus sont possibles, socialement, c’est sur eux que son existence repose, et les réformes ne font qu’entretenir ce qu’elles paraissent combattre. Les abus et le mal qu’ils occasionnent à la société finiront, peut-être, par convaincre les bénéficiaires de l’injustice sociale des dangers qu’ils courent à persister dans le maintien de privilèges qui orientent les victimes de cet ordre social à s’instruire des moyens propres à leur libération économique et morale. Du reste, le temps et la nécessité sociale forceront les hommes à laisser tomber les cataractes qu’un faux égoïsme place devant les yeux de l’humanité. Ils verront, expérimentalement, aussi bien que par un raisonnement sain, que l’application de la justice pour tous dans les rapports sociaux est le seul moyen de rompre avec le despotisme, aussi bien qu’avec l’incohérence, et d’éviter les catastrophes sociales par l’harmonie des intérêts. Mais, en attendant que les besoins généraux obligent l’humanité à se réformer, à se débarrasser des abus et des préjugés, il est du devoir de tous ceux qui voudraient voir disparaître la période de souffrances dans laquelle vit la société générale d’essayer de bien raisonner. Cela nous amène, tout au moins théoriquement, à essayer de réformer la société, en procédant, pour ce qu’il est possible d’organiser dans la société, par le retranchement successif d’abus qui, sous le couvert réformateur, trop souvent se succèdent sous des formes différentes. Cependant, nous ne pouvons organiser, réellement, qu’après avoir assis positivement la société rationnelle sur les mines d’un protestantisme social négatif de nature à accélérer la chute de l’incohérence aussi bien que du despotisme. S’il est nécessaire qu’un ordre nouveau succède à l’ancien, il n’est pas indispensable qu’il le continue par de prétendues réformes. L’ordre nouveau doit succéder à l’ancien comme le jour succède à la nuit. Il est logique de constater que tant que la société générale ne sait pas pourquoi elle est mal, elle ne peut savoir comment elle serait bien.
Pour le bien, pour la vérité, pour la justice, il n’y a pas de degrés. Une quasi vérité est une erreur qui ne fait que prolonger l’agonie où se débat la société. Au point de vue social, il ne saurait être question de réforme véritable en maintenant les bases de l’ancienne société. Toucher à l’édifice social en maintenant certains monopoles et abus, c’est s’illusionner en illusionnant les autres et contribuer, le sachant ou l’ignorant, à l’exploitation des masses. Tant que la réalité du droit, de la justice sera ignorée socialement, il n’y aura ni réforme, ni révolution, au sens social, et les prétendues améliorations qui déplacent le mal sans le supprimer ne font qu’augmenter l’incohérence dans une agitation superficielle et stérile. À notre époque, les réformistes de toutes tendances sont, en quelque sorte, des aveugles qui croient y voir clair en poussant le char de l’État dans le chemin de l’empirisme. Aussi, comment nos sociétés sont-elles guidées ? Nous vivons au jour le jour, refaisant le lendemain ce qui a été supprimé la veille. Les abus, les scandales se multiplient à mesure que se développe l’intelligence générale. Il n’y a progrès qu’en apparence puisque la moralité générale baisse avec l’accroissement continuel des richesses. La presse bien-pensante, qui ne dit qu’une faible partie de ce qui est, ne manque pas, chaque jour, d’apporter un contingent révélateur de délits et de crimes.
Pendant que les produits du travail s’accumulent chez quelques-uns, la consommation générale, quant aux besoins ressentis, diminue chez les déshérités. Les lézardes qui fendillent le domaine social de nos jours ne sauraient être supprimées graduellement ; elles tiennent à un vice fondamental qui doit disparaître. Les réformistes politiciens pensent arriver à ce résultat tantôt sous le badigeon d’une loi de circonstance, tantôt sous l’enduit d’une constitution, aujourd’hui au moyen d’une mesure du pouvoir, demain par un acte de puissance d’une majorité où l’on ne trouve ni justice, ni solidarité. Aucune de ces combinaisons ne repose sur la science sociale, mais sur les besoins accidentels d’une politique de parti. Aussi, ce juste milieu que les éclectiques encensent ne peut mener à rien de positif dans l’ordre social.
En résumé, dans l’ordre social, pour qu’une réforme soit bienfaisante à tous, elle doit viser le côté moral aussi bien que le côté économique du problème social. Par cela même, la réforme constitue une révolution scientifique, c’est-à-dire durable.
— Élie SOUBEYRAN.
RÉFORME ou RÉFORMATION (HISTOIRE RELIGIEUSE)
Nous exposerons au mot religion les particularités doctrinales et cultuelles qui distinguent le protestantisme du catholicisme, ainsi que le mode d’organisation intérieure adopté par les principales Églises issues de la Réforme. Ici, nous étudierons les débuts du protestantisme, d’un point de vue exclusivement historique.
Le grand schisme, les prédications de Wicleff et de Jean Huss, l’engouement pour les auteurs païens de Rome et de la Grèce, la renaissance de l’esprit critique, étouffé pendant la longue nuit du Moyen Âge, sont à ranger parmi les causes lointaines de la Réforme. Mais c’est à la corruption du clergé qu’il convient d’accorder un rôle prépondérant. Évêques et abbés vivaient en grands seigneurs, préférant aux pratiques de dévotion la chasse, les bons repas et les rendez-vous galants. Dans la mesure des richesses mises à leur disposition, moines et curés imitaient leurs chefs. Quant aux papes, ils s’entouraient ouvertement de courtisanes et de mignons, se vautraient dans des orgies crapuleuses, comme Alexandre VI, ou s’adonnaient, comme Léon X, à des plaisirs raffinés. Afin de se procurer des ressources abondantes, ils vendaient aux fidèles indulgences et sacrements. Aussi, la protestation de Luther vint-elle à point et fut-elle écoutée.
Né en 1483, à Eisleben, d’une famille pauvre de mineurs, Martin Luther fut durement traité par ses parents et par ses premiers maîtres. Devenu étudiant, il connut la faim et dut, plus d’une fois, chanter dans les rues pour obtenir un morceau de pain. L’assassinat d’un de ses amis et la chute de la foudre tout près de lui, dans un bois, surexcitèrent sa ferveur religieuse et lui firent prendre l’habit des moines augustins. Sa science théologique, son éloquence fougueuse, sa foi ardente lui valurent une notoriété précoce ; dès 1508, il était nommé professeur à l’université de Wittemberg. Envoyé à Rome, vers 1510, pour défendre les intérêts de son ordre, Martin Luther fut scandalisé par les mœurs des prélats romains. De la lecture assidue des Écritures et des Pères, il tira d’ailleurs une théorie personnelle sur les conditions du salut qui devait le conduire à rompre avec le catholicisme traditionnel. Sa controverse avec Tetzel, un dominicain qui, d’accord avec la banque Fugger d’Augsbourg, avait organisé la vente des indulgences pour le compte du pape, fut le point de départ de la Réforme.
Entouré d’une brillante escorte, Tetzel parcourait l’Allemagne, affirmant qu’à « l’instant même où la pièce de monnaie retentit au fond du coffre-fort, l’âme s’envole, délivrée, dans le ciel ». Luther attaqua l’abus, puis le principe même des indulgences. Vivement applaudi par ceux qu’indignait le honteux trafic du dominicain et de sa bande, il fut rapidement suspect, par contre, aux défenseurs de l’orthodoxie. Le pape s’émut, mais son légat Caïetano ne put décider le moine augustin à se rétracter. Ce dernier en appela du pape mal informé au pape mieux informé ; puis, en 1520, il brûla solennellement, sur la grande place de Wittemberg, la bulle de Léon X qui le menaçait d’excommunication s’il ne se soumettait dans un délai de soixante jours. Vainement, la papauté tenta de sévir. Déjà, beaucoup de gens adoptaient les idées nouvelles ; les prêtres se mariaient ; moines et nonnes quittaient leurs couvents ; les étudiants se rangeaient avec enthousiasme du côté du réformateur. Cité devant la diète de Vorms, en 1521, pour y répondre de sa conduite, Luther s’y rendit, mais refusa catégoriquement de se rétracter et fut mis au ban de l’Empire. Enlevé par des cavaliers masqués de l’électeur de Saxe, Frédéric le Sage, il se tint caché quelque temps au château fort de la Wartburg, d’où il lança de nombreux pamphlets sous le nom du chevalier Georges ; c’est pendant cette retraite forcée qu’il traduisit la Bible en langue allemande. Quand il quitta la Wartburg, ses partisans étaient trop nombreux pour qu’on osât désormais s’attaquer à sa personne.
En levant le drapeau de la révolte contre Rome, Luther avait fait preuve d’un courage méritoire. Malheureusement, sa vie comporte aussi des pages qui ne lui font pas honneur. Sacramentaires et anabaptistes furent combattus sans ménagement par l’ancien professeur de Wittemberg. Les anabaptistes dédaignaient la Bible et les cérémonies cultuelles ; ils conservaient le baptême, mais exigeaient que chaque fidèle arrivé à l’âge de raison se fasse rebaptiser, étant persuadés que le baptême donné dans l’enfance ne pouvait suffire. Au point de vue social, ils prêchaient l’égalité et demandaient même la communauté des biens. Une pareille doctrine suscita de vives inquiétudes chez les possédants. Luther, désireux de conserver la protection des grands seigneurs, pourchassa ces « suppôts de Satan », assez audacieux pour critiquer l’ordre social établi. Contre les paysans insurgés, il se montra également impitoyable. Écrasés par les dîmes et les redevances féodales, réduits à une misère atroce, ces malheureux avaient cru voir l’annonce d’une ère meilleure dans les prêches de l’ancien moine augustin. Ils se soulevèrent en masse et présentèrent à leurs maîtres des réclamations d’une modération extrême. Dans une déclaration dite des douze articles, ceux de la Forêt Noire revendiquaient la liberté de choisir leurs pasteurs, le partage des biens communaux, l’abolition des droits de chasse et de pêche, de la petite dîme, du servage héréditaire. Mais ils eurent beau appuyer leurs demandes de textes des Écritures, on ne les écouta pas. Et, comme ils se révoltaient, exaspérés par les résistances seigneuriales et par la faim, Luther invita l’aristocratie à les écraser sans pitié. Il disait :
« Si vous ne mettez à mort un chien enragé, vous périrez, et tout le pays avec vous. Celui qui sera tué en combattant pour les magistrats sera un véritable martyr, s’il a combattu avec une bonne conscience. C’est pourquoi, chers seigneurs, aidez, sauvez, délivrez ; ayez pitié de ce pauvre peuple ; frappe, transperce et tue qui veut. »
Aux applaudissements du réformateur, la répression fut épouvantable ; on noya dans le sang cette rébellion tentée au nom de la doctrine évangélique.
Charles-Quint désirait vivement ramener l’Allemagne au catholicisme ; néanmoins, il fut contraint, en 1526, d’accorder la liberté du nouveau culte jusqu’au prochain concile. En 1529, comme il prétendait interdire toute innovation religieuse dans les États où le luthérianisme n’avait pas encore pénétré, princes et villes favorables à la Réforme rédigèrent une protestation contre la décision impériale. D’où le nom de protestant, donné d’abord aux luthériens, puis bientôt aux membres de toutes les sectes indistinctement. Tentée au colloque de Marbourg, l’union des diverses communions protestantes fut impossible, Luther et Zwingle n’ayant pu s’entendre au sujet de l’eucharistie.
C’est en 1530 que Mélanchton présenta à la diète d’Augsbourg une profession de foi célèbre, connue sous le nom de Confession d’Augsbourg, et qui est restée la règle doctrinale de l’Église luthérienne. Parce qu’il redoutait les violences de langage et l’emportement naturel de Luther, l’électeur de Saxe avait confié la défense de la cause protestante à Mélanchton, humaniste délicat, très modéré, très accommodant, qui était devenu le meilleur soutien de la nouvelle religion. Mais la conciliation avec les catholiques fut impossible ; et comme Charles-Quint voulait sévir durement contre les réformés, les chefs protestants se préparèrent à la lutte.
Retardée pour diverses causes, en particulier par suite des menaces turques contre l’Autriche, la guerre religieuse entre partisans et adversaires du catholicisme dura jusqu’à la paix d’Augsbourg. Dégoûté par de nombreux échecs successifs, incapable d’assurer le triomphe de l’orthodoxie romaine, l’empereur voulut, avant d’abdiquer, ramener le calme dans ses États de l’Europe centrale. Signée en 1555, la paix consacrait la victoire du protestantisme. Les princes luthériens pouvaient adopter librement la religion de leur choix ; ils conservaient la presque totalité des domaines ecclésiastiques qu’ils avaient confisqués. Luther était mort dans sa ville natale en 1546. Jusqu’à la fin, il continua de se croire providentiellement suscité par dieu. « Le monde, disait-il, est un vaste et magnifique jeu de cartes, composé d’empereurs, de rois, de princes. Le pape, pendant plusieurs siècles, a vaincu les empereurs, les princes et les rois. Ils ont plié et sont tombés sous lui. Alors, notre seigneur Dieu est venu. Il a donné les cartes ; il a pris pour lui la plus petite (Luther), et, avec elle, il a battu ce vainqueur des rois de la terre. C’est l’as de Dieu. Il a renversé de dessus leurs trônes les puissants et il a élevé les petits. » Avant de mourir, il avait pu voir sa Réforme franchir les limites de son pays natal et s’installer d’une façon durable en Prusse, où le grand maître de l’Ordre teutonique, Albert de Hohenzollern, s’était déclaré pour lui dès 1525 ; en Suède, où Gustave Vasa adopta la nouvelle religion, en 1527, et parvint à l’imposer très rapidement à son peuple en Danemark et en Norvège, où l’autorité royale favorisa d’abord la diffusion du protestantisme, puis finit par interdire l’exercice du culte catholique.
Dès 1516, un curé de Zurich, Zwingle, avait entamé la lutte contre ses supérieurs ecclésiastiques, condamné les indulgences, le culte des reliques, etc. Il appelait sa religion « évangélique », parce qu’elle n’admettait d’autre règle que l’Évangile. Montrant les blanches cimes des Alpes, dorées par les reflets du soleil couchant, il disait au peuple :
« Voilà le trône de l’Éternel : contemplez ses œuvres, adorez-le dans ses magnificences ; cela vaut mieux que les offrandes aux moines et les pèlerinages aux ossements des morts. »
L’intransigeance de Luther ne lui permit pas de s’entendre avec lui. Lors de la bataille de Cappel, Zwingle, frappé d’une pierre à la tête au moment où il assistait un blessé, expira sous les coups d’un soldat d’Unterwald, indigné par son refus d’invoquer la Vierge et les saints. Un peu plus tard, son œuvre allait être complétée par un réformateur célèbre, Jean Calvin.
Guillaume Farel, un Français originaire du Dauphiné, s’était fixé à Genève, en 1534, et sa prédication avait gagné de nombreux partisans à la Réforme ; il fit même briser les images des saints et abolir le culte catholique. Toutefois, c’est Calvin, retenu par lui à Genève, qui devait organiser définitivement la nouvelle Église. Fils du procureur fiscal de l’évêque de Noyon, ce dernier était né en 1509. Tonsuré à neuf ans, chapelain à douze, curé de Marteville à dix-huit, il fut élève au collège de Montaigu à Paris, poursuivit des études de droit aux universités d’Orléans et de Bourges, puis revint à Paris suivre les cours du Collège de France. Gagné aux idées religieuses venues d’Allemagne, il rédigea en 1533, pour son ami Nicolas Cop, recteur de l’Université, une harangue d’inspiration nettement luthérienne. Obligé de s’enfuir, il se réfugia à Nérac, près de la reine Marguerite de Navarre, puis mena une vie errante. La publication de son livre l’Institution de la religion chrétienne, paru à Bâle en 1536, le rendit célèbre. C’est à contrecœur que Calvin, cédant aux objurgations de Farel, se fixa à Genève.
Chassé en 1538, il se retira à Strasbourg. Mais rappelé en 1541, il s’installa en maître dans la ville, où il régna despotiquement jusqu’à sa mort. Les magistrats locaux ne furent plus que ses humbles serviteurs ; un consistoire, composé de douze anciens et de cinq ministres, fut chargé de diriger les consciences et de surveiller la conduite de chacun. Une première faute entraînait une réprimande ; une récidive la privation de la cène ; une nouvelle rechute était punie d’une amende, de la prison, parfois de la mort. Composition des repas, luxe des habits étaient réglés d’une façon minutieuse. Pour lui-même, Calvin ne touchait que 200 écus d’appointements ; il menait une vie austère et très occupée ; il ne prit d’autres titres que ceux de président du consistoire et de professeur de théologie. Toutefois, son orgueil était incommensurable. Il affirmait :
« Dieu m’a fait la grâce de me déclarer ce qui est bon ou mauvais. »
Un Genevois ayant mal parlé de Calvin, « ce méchant homme, ce Picard », dut venir implorer son pardon à genoux, après avoir fait le tour de la ville, tête nue, en chemise, une torche à la main. Quiconque ne le saluait pas était condamné au moins à une amende. Violent et d’humeur colérique, il ne souffrait aucune opposition. Un bourgeois fut décapité parce qu’on avait trouvé dans sa maison un livre du réformateur avec, en marge d’un passage, les mots « toute folie ». Bolsec fut arrêté, puis banni pour avoir nié la prédestination. Michel Servet, un médecin réputé, fut condamné au feu et brûlé, en 1553, parce qu’il soutenait des idées théologiques contraires à celles de Calvin.
À Genève, la vie fut extraordinairement morose. Les nouveaux mariés ne devaient ni chanter, ni danser, le jour de leurs noces ; interdiction leur était faite de porter des souliers à la mode de Berne. Même dans les plus grands festins, il était défendu d’avoir plus de trois services, comportant chacun quatre plats au maximum. Représentations théâtrales, danse, jeu de boules ou de cartes étaient proscrits. On attachait au poteau infamant l’homme surpris des cartes dans les mains. Des censeurs à qui nulle porte n’était fermée, ni de jour, ni de nuit, inspectaient les familles pour apprécier leur genre de vie et leur degré d’instruction. Calvin disposait en outre d’une armée d’espions qui le renseignaient sur les faits et gestes des habitants. De 1542 à 1546, 76 personnes furent bannies, 58 furent brûlées, pendues ou écartelées, dont 26 sorciers, hommes ou femmes, que l’on accusait d’avoir introduit la peste dans la ville.
Avec son collège, dont la direction fut confiée à l’humaniste Théodore de Bèze, Genève devint la citadelle du protestantisme. Des réfugiés accourus de partout, et qui s’instruisaient pour faire une propagande plus efficace dans leurs pays d’origine, donnaient à cette cité une allure cosmopolite. Malgré sa faible santé, Calvin déploya, jusqu’à ses derniers jours, un grand zèle pour la diffusion de sa doctrine. Quand il mourut, en 1564, il eut d’humbles funérailles, comme il l’avait demandé, mais la foule se pressait, innombrable. Son successeur, de Bèze, fut toutefois moins inhumain ; et l’on disait couramment à Genève :
« Il vaudrait mieux être en enfer avec de Bèze qu’en paradis avec Calvin. »
Le calvinisme se répandit rapidement en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Écosse. En France, il y avait plus de deux mille églises obéissant à ses directives, quand mourut le réformateur. Comme la Paix d’Augsbourg n’accordait la liberté qu’aux luthériens, la situation des partisans de Genève fut longtemps précaire en Allemagne, malgré l’appui de l’électeur palatin et, plus tard, de l’électeur de Brandebourg. À cause de son caractère démocratique, le calvinisme fut bien accueilli dans le nord des Pays-Bas, où il devint très vite la religion dominante. En Écosse, John Knox, qui s’était réfugié pendant quelque temps à Genève, organisa l’Église presbytérienne, toute inspirée des idées calvinistes. Elle n’admettait que des ministres égaux entre eux et nommés par le peuple ; l’autorité appartenait à des assemblées élues, composées d’anciens et de ministres. Officiellement reconnu en 1560 par le Parlement écossais, le presbytérianisme parvint à se répandre même en Angleterre.
Dans ce dernier pays, la Réforme fut l’œuvre d’Henri VIII. Ce roi manifesta d’abord un vif attachement pour le catholicisme ; il fit brûler les premiers livres de Luther qui parvinrent en Angleterre, et composa contre le protestantisme un pamphlet qui détermina le pape Léon X à lui décerner le titre de défenseur de la foi. Il entendait cinq messes les jours ordinaires, trois les jours de chasse. Mais c’est en vain qu’il sollicita de Clément VII la rupture de son mariage avec Catherine d’Aragon, tante de Charles-Quint ; craignant de se brouiller soit avec l’empereur, soit avec le roi d’Angleterre, le pape chercha à gagner du temps. Or, Henri VIII, talonné par son amour pour Anne Boleyn et irrité par les atermoiements et les réponses évasives de Clément VII, se décida finalement à faire casser son mariage par l’archevêque de Cantorbéry, Cranmer, après consultation des principales universités d’Europe qui lui donnèrent raison sur le fond du litige. Excommunié par le pape, il rompit complètement avec Rome, se fit reconnaître chef de l’Église anglicane par le Parlement et s’attribua les prérogatives du pouvoir spirituel. L’Acte de suprématie (1534) proclamait qu’il avait :
« Tout pouvoir d’examiner, réprimer, redresser, réformer et amender tels erreurs, hérésies, abus, offenses et irrégularités qui doivent ou peuvent être réformés par autorité ou juridiction spirituels. »
Dans le bill des six articles, paru en 1539, Henri VIII décrétait, en conséquence, que les catholiques qui refuseraient de reconnaître sa suprématie religieuse étaient coupables, mais il maintenait, sous peine du feu, la confession, la présence réelle, la communion sous une seule espèce, la messe.
Catholiques et protestants furent persécutés avec une égale férocité, les premiers comme traîtres, les seconds comme hérétiques. On compta les victimes par milliers ; les gens riches, surtout, dont les dépouilles étaient acquises aux proscripteurs, furent condamnés sans miséricorde. Le roi confisqua pour plus de sept millions de biens appartenant à des monastères dont les abbés ne siégeaient pas au Parlement ; il traduisit la Bible, et sa traduction fut la seule admise ; tous les évêques durent lui demander l’investiture. Après avoir disputé pendant cinq heures avec un maître d’école nommé Lambert, il le somma de choisir entre la rétractation ou la mort ; et comme son contradicteur préférait la mort, le monarque le fit brûler à petit feu. Sa cruauté fut inouïe, même à l’égard de sa famille. Anne de Boleyn monta sur l’échafaud en 1536 ; le lendemain de l’exécution, il se mariait avec Jeanne Seymour, qui expira en mettant Edouard VI au monde. Sur la foi d’un portrait trop flatté, il épousa alors Anne de Clèves par procuration ; mais il la renvoya bientôt à son père, estimant qu’elle était laide et qu’on l’avait trompé. Catherine Howard, sa cinquième femme, fut décapitée en 1542. La sixième, Catherine Parr, faillit avoir le même sort parce que suspectée d’hérésie ; elle survécut pourtant à son mari. Ce Barbe bleue sanguinaire et grotesque mourut en 1547. Sous son successeur, Edouard VI, on autorisa le mariage des prêtres, et une liturgie nouvelle fut instituée. Mais Marie Tudor usa des moyens les plus sanglants pour contraindre ses sujets à redevenir catholiques. C’est Elisabeth qui assura le triomphe définitif de la Réforme en Angleterre.
Nous n’entreprendrons pas de retracer, même brièvement, l’histoire du protestantisme. Notons cependant que la formation de sectes nouvelles, dont plusieurs très importantes, a continué après la disparition des principaux fondateurs de la religion réformée. Parmi beaucoup d’autres, citons les baptistes qui administrent le baptême aux adultes seulement par immersion totale. Ils n’ont pas d’évêques, mais seulement des anciens, des docteurs et des diacres ; leur esprit rappelle celui des premiers chrétiens. Les méthodistes, qui comptent plus de cinquante millions d’adhérents, reconnaissent pour fondateur le puritain anglais John Wesley, qui mourut en 1791. Cette confession protestante, qui n’était pas sans analogie avec le piétisme allemand, se proposait de réveiller la foi attiédie des fidèles ; mais elle s’adressait de préférence aux masses populaires. Divisé en plusieurs sectes, le méthodisme entretient des missions dans le monde entier. Les darbystes, ou frères de Plymouth, dont l’animateur fut John Darby, un pasteur anglican qui prêchait avec succès vers 1831, et les irvingiens, qui se rattachent au pasteur écossais Irving, mort en 1834, cultivent le prophétisme et attendent une nouvelle venue du Christ.
Dans les pays protestants, en particulier chez les Anglo-Saxons, les revivals ou réveils sont d’ailleurs fréquents ; ils tiennent parfois du délire et s’expliquent par la psychologie des foules. Le pentecôtisme, qui sévit à l’heure actuelle, doit être rangé parmi ces épidémies mentales. Voilà ce qu’écrit, à ce sujet, une protestante de mes amies, qui habite l’Ardèche : « De jeunes ambitieux mégalomanes, afin de s’affirmer eux-mêmes et d’être mis en vedette comme telle étoile de cinéma, se sont donnés pour tâche d’asservir les consciences en semant en elles le trouble, la déraison, le désir exalté du sacrifice (de tous les sacrifices, et d’abord : les pécuniaires). Ces jeunes gens – soit dit en passant, pour signaler l’incongruité de la chose – sont nantis d’une mission ecclésiastique, c’est-à-dire d’une mission d’humilité et de désintéressement, mais, débrouillards comme on l’est en mil neuf cent trente-deux, ils ont trouvé le moyen commode et rémunérateur d’incarner la finance dans le sacerdoce, jusqu’à confondre presque l’un et l’autre :
« Le don d’argent fait partie de la sanctification de la vie. L’argent doit être demandé aux chrétiens pour obéir à la parole de Dieu. La dîme doit être le minimum de l’offrande. Il faut donner sans cesse pour l’avancement de l’œuvre du Seigneur. L’argent et le réveil (celui-ci en fonction de celui-là), etc. »
Voilà leur code.
« Je n’insiste pas sur ces pieuses opérations d’une mathématique mystique et j’en arrive à l’un des procédés, en vogue dans ma contrée, d’asservissement des âmes. Ce procédé, c’est le pentecôtisme, c’est-à-dire l’annonce faite à tous les chrétiens de la révélation authentique, effective, matérialisée du Saint-Esprit, sous condition implicite, bien entendu, de la soumission préalable et complète du chrétien à celui qui lui a annoncé cette bonne nouvelle... À moins que le ridicule ne les tue très vite, ils ont souvent des séances au cours desquelles certains assistants crient, d’autres chantent, d’autres éclatent de rire, d’autres « parlent en langues », ce qui produit une cacophonie que le pasteur couvre en indiquant un cantique d’action de grâces. Moi qui, élevée par des esprits sages, n’avais jamais entendu le mot de glossolalie et qui ne croyais pas aux miracles de Lourdes, j’apprends avec stupeur que le don « de parler en langues » a été dévolu à plusieurs de mes semblables, que je tenais jusqu’ici pour des gens aussi bien équilibrés que vous et moi. J’apprends que ces mêmes personnes ont reçu l’imposition des mains d’un guérisseur et que leurs coliques ou leurs maux de dents ont cessé à ce contact (qu’ils disent). Mais comme j’ai le droit de penser que ces gens-là sont des imaginatifs, des hystériques ou des flibustiers, je ne me gêne pas pour le dire. »
Par ailleurs, des enquêtes discrètes sur les établissements charitables de l’Armée du Salut, cette institution protestante dont la presse bourgeoise dit tant de bien, montrent que, là aussi, comme dans les œuvres similaires catholiques, une hypocrite duplicité règne parmi les hauts gradés. Les employés des cadres inférieurs sont habituellement sincères ; chez ces personnes, souvent désireuses d’expier d’anciennes peccadilles, le mysticisme a étouffé la raison. Les chefs, par contre, ne méritent pas les éloges dont on les couvre. Après avoir entendu les apologistes de l’Armée du Salut vanter la charité inépuisable, A. Verdière Le Peletier fit une petite expérience. Elle écrit :
« Je me suis présentée dans un des refuges de l’Armée du Salut, mes vêtements sont misérables, je tiens un petit paquet à la main, ma voix est craintive ; l’officière qui me reçoit me toise et, sans bienveillance, me demande ce que je veux. Je sors de l’hôpital, j’ai été malade pendant deux mois, je n’ai pas de logis, pas de famille, pas d’argent ; cependant, j’ai trouvé du travail, mais ne recevrai mes appointements qu’à la fin du mois. Si je ne trouve un gîte, je ne pourrai pas travailler. — Vous n’avez pas d’argent ! Impossible de vous recevoir. Au Palais de la Femme, la chambrette coûte trente à trente-cinq francs par semaine, un lit en dortoir vingt et un francs la semaine. On doit payer d’avance. La nourriture est-elle comprise ? — Oh non ! Se récrie la salutiste, il y a le réfectoire, vous pouvez avoir un repas à trois francs cinquante-cinq. — Mais comment faire alors, puisque je n’ai pas d’argent ? — Ah ! Cela... (Elle lève les mains dans un geste qui paraît dire : « Débrouillez-vous ! ») — N’avez-vous pas des asiles qui reçoivent gratuitement ? Ne consentez-vous pas des prêts d’honneur aux personnes qui sont dans mon cas ? — Des prêts d’honneur !... Mais il nous faudrait en faire tous les jours. Dans tous nos refuges, il faut payer. — Même sur la péniche ? — Certainement ; d’ailleurs, la péniche n’est réservée qu’aux hommes. — Ne pourriez-vous me faire une faveur, je vous paierai à la fin du mois ? — Impossible, je vous dis ; d’ailleurs, il n’y a pas de place. »
Et A. Verdière Le Peletier ajoute :
« Avant de m’éloigner de cet asile inhospitalier, je lance un coup d’œil dans le vaste hall, des inscriptions bibliques ornent les murs ; sur un tableau noir, l’annonce de causeries faites par une « adjudante » ou une « capitaine » prouve que la propagande religieuse n’est pas totalement négligée. Des jeunes filles élégantes, fardées, traversent le hall et se dirigent rapidement vers la sortie. Je les suis, l’une d’elles saute légèrement dans une élégante torpédo et, sans façon, embrasse le jeune homme qui est au volant. D’antres s’éloignent, en causant gaiement. Je m’arrête un instant pour consulter le menu affiché à la porte, tout comme il le pourrait être à celle d’un restaurant. Pas de prix de faveur, puisque le pain coûte trente centimes ; mais l’alcool, le vin et la bière sont proscrits. »
Sans méconnaître les bons côtés de l’Armée du Salut, on aurait tort de fermer les yeux sur les défauts de cette puissante institution. Mais les directeurs de journaux imposent toujours silence aux reporters assez hardis pour élever quelques critiques à son sujet. De plus en plus, catholicisme et protestantisme se rejoignent et s’entendent pour exploiter la sottise humaine. La lutte contre l’incroyant, leur adversaire commun, les conduit à oublier leurs anciennes querelles et à s’associer pour maintenir sur le globe le joug abrutissant de la foi. Je reconnais cependant volontiers le mérite de certaines sectes, celles des sociniens et des unitaires, par exemple, qui accordent une large place à la raison ; et j’ai dit ailleurs combien j’avais d’estime pour les quakers, qui remontent à George Fox et restent dans l’ensemble fidèles à l’enseignement si humain de leur fondateur.
— L. BARBEDETTE.
RÉFORME FONCIÈRE
La réforme foncière est l’étude des différents régimes possibles de la propriété foncière. Comme son nom l’indique, elle se propose de dégager les réformes à apporter aux diverses modalités de possession ou de propriété du sol en vue d’harmoniser la production et la distribution des richesses. Elle part du postulat que la richesse des nations dépend du bien-être et de la liberté des individus qui les composent. Elle tend vers la libération des individus par la libre disposition des richesses naturelles, après avoir constaté, par l’histoire des peuples, que les régimes de dictature ou de domination d’une classe ont finalement, et partout, amené la misère des masses. Elle se propose, en outre, l’étude des rapports entre la société et les individus, et plus particulièrement le problème de l’impôt qui marque, dans le domaine économique, le tribut prélevé par la société sur le travail individuel.
L’enseignement officiel de l’économie politique laisse singulièrement dans l’ombre le problème de l’impôt, et si, dans la partie traitant de la « distribution », l’impôt est cité et décrit, la théorie de l’impôt est souvent totalement négligée ; il en est de même pour la question du sol. Les traités nous montrent bien les trois éléments : terre (richesses naturelles), capital et travail. Mais ce triptyque n’est, en réalité, qu’un diptyque. On ne peut, en effet, mettre sur le même plan que la terre et le travail, le capital qui n’est que le produit des deux premiers.
Les législateurs de l’Antiquité, et, à leur suite, les physiocrates et les économistes anglais, aux États-Unis, Henry George, ont mis en évidence le parallélisme entre la valeur du sol et l’accroissement de la population et des progrès humains. Il s’agit d’en tirer les déductions que des économistes timorés et effrayés par les progrès de la démocratie n’ont pas osé mettre en pleine lumière. La réforme foncière se propose donc de remettre à sa place légitime l’étude du sol et des richesses naturelles, leur valeur, et de montrer que la rente du sol résulte du travail de la collectivité, et non des individus. Cette rente foncière peut et doit être reprise par la collectivité, car elle est la seule base de l’impôt légitime, à l’exclusion de tous autres.
ÉVOLUTION DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE.
Contrairement à une opinion assez couramment répandue, la propriété individuelle généralisée du sol est de date relativement récente. À l’origine, en effet, quand les peuples étaient chasseurs ou pasteurs, il ne pouvait être question de propriété privée. Et même, dans les premières périodes de la vie agricole, il n’y avait pas lieu à appropriation individuelle du sol, puisque, quand une terre était épuisée, l’agriculteur l’abandonnait et en travaillait une autre ; mais, au fur et à mesure que la population devient plus sédentaire et plus dense, et surtout que la sécurité augmente, la terre est possédée collectivement, avec des partages périodiques entre les occupants. Elle est alors, le plus souvent, attribuée aux familles, ainsi que c’était encore, peu avant la révolution agraire d’après-guerre en Europe centrale et orientale, le cas de la Russie (avec le mir), de la Bulgarie et de la Serbie (avec la zadruga). Mais, par suite de la collectivisation forcée en Russie, le mir y est remplacé par les fermes collectives et, dans les pays balkaniques, par suite de l’individualisme grandissant, les zadrugas sont de plus en plus remplacées par les fermes individuelles, complétées d’ailleurs par des coopératives agricoles d’achats en commun, de transformation, de crédit et de vente, destinés à faciliter l’exploitation de ces fermes.
Dans la plupart des pays, la propriété foncière a passé par la phase de la conquête. Elle appartenait aux plus forts qui, une fois la terre conquise, la louaient le plus souvent à des fermiers qui payaient un loyer. C’était le régime foncier le plus courant sous la féodalité. Il était tempéré par des révoltes, dont les plus célèbres ont été celles de la Guerre des Paysans, des Hussites, etc. Là où la propriété a subi l’influence du développement de l’individualisme et de l’égalité civique, le régime féodal a été remplacé par la propriété quiritaire, semblable à celle prévue par le droit romain, et qui donnait le droit d’user et d’abuser (uti et abutendi), qui a été sanctionné par le code Napoléon. Exceptionnellement, en Europe occidentale, il se constitue des propriétés coopératives agricoles pour l’exploitation de terres. On trouve aussi, et plutôt aux colonies, des propriétés sous la forme de sociétés anonymes. Mais des propriétaires reprochent à la propriété individuelle du sol de ne pas être facilement mobilisable. Voilà pourquoi, notamment en Australie, il a été généralisé un système qui a eu son heure de célébrité, institué par l’Act Torrens. Le titre de propriété sur la terre est inscrit sur des registres ad hoc, et il peut être transmis facilement d’un individu à un autre, avec autant de facilité qu’une lettre de change.
LA RENTE FONCIÈRE.
Les premiers économistes, les physiocrates, avec Adam Smith, J.-B. Say, prétendaient que la terre produisait une rente par une vertu naturelle, comme l’arbre produit des fruits. Mais, s’il en est ainsi, certains se sont dès lors demandé pourquoi la rente n’est pas commune à tous les hommes et pourquoi, tandis que les propriétaires ont reçu la terre gratuitement de la nature, ils la font payer – et cher – à leurs semblables. D’après J.-B. Say, si la chaleur du soleil ou l’influence de l’air pouvaient être appropriées comme la terre, elles pourraient, elles aussi, donner une rente. Et il se félicite qu’il n’en soit pas ainsi. À ce sujet, la revue sociale The Commonweal, a publié les « Louanges au Seigneur » ci-dessous :
« Nous te remercions, ô Dieu, d’avoir placé le soleil au firmament, hors d’atteinte des hommes. Car, si tu l’avais placé en leur pouvoir, nous devrions payer pour chaque rayon de lumière, pour chaque atome de chaleur, comme nous devons payer pour chaque parcelle de cette terre qui, pourtant, appartient à tous. »
Au fond, quand on pousse les propriétaires actuels dans leurs derniers retranchements, au cours de discussions sur la légitimité de la propriété du sol, ils sont, dans l’ensemble, obligés de dire que, si, depuis des siècles, son appropriation est légitimée par l’achat dont elle a été successivement l’objet, à l’origine, elle a été attribuée souvent par astuce, par favoritisme, et davantage encore par la force. Le quirite, le citoyen romain, était désigné d’après son arme ordinaire : la pique.
Or, quelle que soit l’activité des propriétaires du sol, il y a un profit qui est légitime : celui qu’ils retirent de leur travail ; mais il en est un qui n’est pas légitime : celui qu’ils retirent de l’activité des autres êtres humains. Et cette vérité a été mise en lumière avec une très grande force, notamment par un économiste et sociologue américain nommé Henry George, dans son fameux livre Progrès et Pauvreté (un volume de plus de 500 pages, 12 F, chez Sam Meyer, 18, avenue de la Criolla, Suresnes, Seine). Contrairement aux physiocrates, Ricardo en tête, qui présentaient la rente foncière comme découlant de la parcimonie de la nature, de la difficulté croissante de la culture (les terres les meilleures étant cultivées les premières), Henry George a démontré, par des exemples actuellement classiques, que la rente du sol est due à toutes les causes du progrès social, et d’abord et avant tout à l’accroissement de la population, de la richesse, de la sécurité, des moyens de transports, etc., en dehors de tout travail du propriétaire du sol qui n’a qu’à s’asseoir et à se tourner les pouces en attendant une inévitable plus-value du sol qu’il a acheté bon marché.
Voici quelques exemples typiques du prix exorbitant que peuvent atteindre des terrains à population très dense : 4 hectares de terrains, situés entre la Chaussée-d’Antin et la Madeleine, à Paris, valaient 2 400 francs sous François Ier, 5 700 francs en 1552, 63 500 francs en 1646, 150 000 francs en 1767, 606 000 francs en 1775, plus de 80 millions en 1930. Des terrains qui ont été concédés à la Canadian Pacific (compagnie de chemins de fer et compagnie foncière) ont été vendus, en 1900, à 3 dollars l’acre, et, en 1910, à 15 dollars. En Égypte, aux environs du Caire, et au Maroc, aux environs de Rabat et de Casablanca, des terrains achetés à 10 000 francs l’hectare, ont été revendus, peu après, 2 000 francs le mètre carré, soit 20 millions l’hectare. Lord Snowden a cité le cas de sols agricoles qui, lorsqu’ils passaient à l’état de terrains à bâtir, du fait de l’établissement d’une voie ferrée, virent leur rente passer de 2 livres sterling 100 livres sterling et leur valeur de 300 livres sterling à 8 000 livres sterling. L’île de Manhattan, qui est le cœur de New York, fut achetée, en 1626, par Pedro Minuit, pour 24 dollars payables en perles de verre. Or, elle est estimée, aujourd’hui, sans parler des immeubles et des améliorations, à environ 5 milliards de dollars. Les quelques centaines de kilomètres carrés de la ville de New York, en dehors des constructions et des améliorations, valent environ 7 milliards de dollars, soit la vingt-cinquième partie du prix du sol nu des États-Unis, d’une superficie égale à celle de l’Europe entière. M. Pierre Bourdeix (voir Terre et Liberté, n° 5, 1932) évalue les prix du terrain dans les proportions suivantes : campagne, 0,5 ; banlieue, 33 ; ville, 650 ; Manhattan, 2 500.
On a donné plusieurs définitions de la rente foncière, mais on est d’accord, dans l’ensemble, pour appeler ainsi le loyer du sol. Ou, encore, cette partie du revenu du sol qui ne peut être considérée comme étant le résultat du travail, mais comme le produit de la terre en tant que terre, ou comme l’avantage que recueille de son monopole celui qui a le droit d’en user et d’en abuser. En ce qui concerne l’agriculture, la rente est la partie du fermage ou du loyer déterminée, notamment, par l’excès du produit sur ce que la même culture produirait dans la moins productive des terres cultivées.
M. Henri Sellier a distingué (dans la Terre n° 3, 1928) les deux formes essentielles de la rente foncière : l’agricole et l’urbaine. La terre, en effet, ne sert pas qu’à la culture. Sous le nom générique de « terrain », elle sert d’emplacement. Et il y a, entre les différents emplacements, les mêmes différences qu’entre les terres cultivées. Leur différence commerciale est variable suivant les circonstances. Elle est en voie de perpétuelle évolution. Dans les grandes agglomérations modernes, la rente foncière urbaine est en constant accroissement. Le propriétaire y perçoit une véritable rente, du même genre que celle de la rente foncière proprement dite. Elle constitue, elle aussi, un « unearned incrememt » (un revenu non gagné). « Le loyer du terrain d’emplacement d’une maison dans un petit village, a dit Stuart Mill, ne dépasse guère celui d’un terrain de même grandeur dans les champs ; mais celui d’une maison à Cheapside le dépassera de tout le montant auquel on évalue les facilités plus grandes de gagner de l’argent dans l’endroit le plus fréquenté. » La rente foncière urbaine est due essentiellement à la concentration urbaine et est accélérée par les sacrifices budgétaires que s’imposent les collectivités, et l’accroissement démographique et économique des agglomérations. Par conséquent, l’appropriation individuelle de la rente foncière non gagnée est une atteinte au droit incontestable de la collectivité qui la crée.
L’IMPÔT UNIQUE.
M. Pavlos Giannelia, un des meilleurs collaborateurs de Terre et Liberté, et fervent disciple de Henry George, insiste sur le fait que la rente foncière devrait être perçue par un impôt unique sur le sol, non point dans l’intention de brimer les propriétaires actuels, mais plutôt dans l’intention de substituer l’impôt unique sur le sol à tous les autres impôts qui briment, eux, le capital, le travail, l’initiative, l’activité. Il constate, en effet, qu’en Grande-Bretagne, par exemple, où le sol productif devrait avoir une superficie de 123 000 kilomètres carrés, les terrains cultivés ont diminué, de 1870 à 1928, de 73 000 kilomètres carrés à 49 000 kilomètres carrés, par suite des impôts (directs et indirects) que l’agriculture subit. Et, en revanche, il constate que les 303 kilomètres carrés du comté de Londres, sur lesquels se concentre la vie politique, économique, financière et intellectuelle du vaste Empire britannique, même en dehors des bâtiments qui y sont construits, ont une valeur égale, sinon supérieure, à celle de l’étendue, mille fois plus grande, du reste de la Grande-Bretagne.
Certains défenseurs de la propriété foncière estiment qu’elle n’augmente pas constamment de valeur. Il est vrai que, dans certains pays, comme la Grande-Bretagne et la France, la valeur de la terre a baissé, notamment sous l’influence de la concurrence de la colonisation et des moyens de transports ; mais, ainsi que l’a fait remarquer Charles Gide, dans son cours d’économie politique, en se basant sur les observations de M. Heckenrath, si la valeur de la terre a baissé momentanément dans les pays vieux, les mêmes causes l’ont fait monter dans les pays neufs. Et Gide a montré l’importance de l’accroissement de la population comme facteur de la hausse progressive, indéfinie et « inéluctable » de la valeur de la terre. C’est la confirmation de la thèse d’Henry George.
La rente foncière suit l’homme comme son ombre.
Tout nouveau venu dans un pays lui apporte une richesse nouvelle : ne serait-ce que de consommation Mais, par ailleurs, dans son excellent livre sur Les origines de la Révolution russe, le professeur Lescure a démontré que l’excès de la population en Russie y a provoqué, à toutes les époques, la « faim de la terre », qui y a toujours été constatée. Les États-Unis illustrent la thèse de Henry George. En 1850, la propriété agricole y était évaluée à 4 milliards de dollars ; en 1900, à 20 milliards, et, après la guerre, à 40 milliards de dollars. C’est la confirmation éclatante des prédictions que faisait à ce sujet Charles Gide, en mai 1883, dans l’article du Journal des Économistes, qui a déterminé sa rupture avec les économistes orthodoxes.
APPLICATIONS.
Cela étant, la rente foncière augmentant sans cesse, dans une société progressive, que faut-il faire ? Il faut attribuer à la collectivité la rente provenant du monopole du sol, disent Henry George et ses disciples. Comment ? En appliquant au sol nu, c’est-à-dire non comprises les constructions et les améliorations, un impôt sur la valeur de ce sol, qui sera, non pas un impôt additionnel, mais, au contraire, un impôt de substitution qui, faible au début, remplacera peu à peu, au fur et à mesure que les contribuables s’y seront habitués, tous les autres impôts qui frappent injustement et maladroitement l’activité économique.
Les thèses georgistes pénètrent de plus en plus dans les masses populaires, malgré le boycottage qu’elles ont subi en même temps de la part du pape Léon XIII et des socialistes de l’époque. Elles ont reçu un commencement d’application en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis (à Pittsburg, à New York, notamment, où l’impôt sur la valeur du sol nu est progressivement substitué à l’impôt sur les constructions) ; au Canada, notamment dans la ville de New Westminster (voir Terre et Liberté d’octobre-novembre-décembre 1931). Le pays qui s’est le mieux engagé dans cette voie est le Danemark. En 1902, sous l’énergique impulsion de Sophus Bertelsen, les petits agriculteurs danois demandèrent que fussent remplacés les impôts indirects par un impôt sur la valeur du sol nu (améliorations non comprises). Depuis, sous l’influence des idées georgistes, le Parlement danois est entré partiellement dans cette voie. Il en résulte qu’actuellement (voir Terre et Liberté de janvier-février 1933), les contribuables danois paient, certes, sensiblement les mêmes impôts qu’avant la réforme foncière, mais que les immeubles et améliorations sont sensiblement détaxés ; tandis que, par contre, le sol nu est plus fortement taxé. Ainsi, un immeuble d’une valeur marchande de 10 000 couronnes, et un terrain à bâtir de 10 000 couronnes à Copenhague auraient, avant la réforme, payé, l’un et l’autre, 100 couronnes d’impôts par an. Or, après la réforme, le premier ne paye que 8,1 couronnes et le deuxième (le sol paresseux) 81 couronnes. Le propriétaire de ce dernier est, par-là, incité à mettre son terrain en vente ou à le bâtir : nouvelle confirmation de la thèse de Henry George. De même, si les terres incultes étaient taxées, leurs propriétaires seraient, par-là même, incités à les mettre en vente ou en culture.
À Paris, par exemple (voir article de M. Jean Montigny, dans l’Information du 31 décembre 1926), le propriétaire d’un terrain nu de 1 000 mètres carrés paye, au titre de l’impôt foncier des terrains non bâtis, 400 francs par an et, avec les taxes communales, 600 francs en tout. S’il y construit un immeuble qui lui rapportera 75 000 francs de revenus nets, il payera, au titre de l’impôt foncier des propriétés bâties, environ 16 500 francs et, avec les taxes municipales, 25 000 francs environ. Dès lors, en n’acquittant que des taxes insuffisantes sur son terrain inutilisé, le propriétaire a intérêt à ce que, par suite de l’activité des autres habitants, son sol paresseux prenne de la valeur et à ce que la collectivité soit privée d’un immeuble qui lui serait utile.
IMPÔT DE REMPLACEMENT.
Nous insistons sur le fait que l’impôt sur le sol nu doit être un impôt de remplacement. Si bien que la réforme georgiste ne doit pas être uniquement la création d’un impôt sur la valeur foncière, mais plutôt l’abolition des impôts actuels et leur remplacement par un impôt sur la valeur foncière (voir article de Giannelia : Aperçu historique des impôts fonciers du Danemark, dans Terre et Liberté, janvier-février 1932).
Remarquez que l’impôt que Snowden avait fait voter, quand il était Chancelier de l’Échiquier, n’avait pas ce caractère, puisqu’il s’ajoutait aux autres. Ajoutons que la nouvelle taxe municipale sur les valeurs vénales des propriétés non bâties, prévue par M. Piétri, dans son projet de réforme des finances locales, s’inspirait de cette pensée, mais avec la différence qu’elle ne s’appliquait qu’au terrain urbain, qu’elle était facultative et qu’elle s’ajoutait aussi aux autres (voir Terre et Liberté de juillet, août, septembre 1931). Au moment où la Ligue de la république et la Ligue de la démocratie ont organisé leurs congrès pour la réforme de l’octroi, nous avons suggéré que les octrois (ces barrières douanières intérieures) fussent supprimés et leur rendement remplacé par un impôt sur le sol nu (voir Terre et Liberté de janvier-février 1932).
Toubeau, dans sa Répartition métrique des impôts, a montré la nécessité de frapper d’un impôt les terres cultivables non cultivées (voir dans le n° 2 de la Terre, 1928, notre proposition d’adapter ce système aux terres non cultivées au Maroc) et (dans la Terre, n° 4, 1927) les projets de Sun Yat Sen, qui avait connu les idées georgistes et qui voulait frapper la terre nue d’une taxe de 1 % : la valeur de la terre étant déclarée par le propriétaire. Mais si cette déclaration était estimée trop faible par le fisc, l’État pourrait la racheter au propriétaire au prix fixé par lui. Bien entendu, cet impôt devait couvrir toutes les dépenses de l’État chinois.
Rapprochons les projets de Sun Yat Sen, à ce dernier point de vue, de celui de M. Henri Mazel qui, en cas d’expropriation de terrains et de terres pour cause d’utilité publique, a demandé que les jurys d’expropriation ne soient point autorisés à estimer le sol plus haut que ne l’ont fait les propriétaires des parcelles expropriées, dans leur déclaration pour le calcul de l’impôt.
RÉFORME FONCIÈRE ET RÉFORME DOUANIÈRE.
Le remplacement des autres impôts par une taxe sur le sol nu aurait de grandes conséquences générales. Actuellement, pour ne pas imposer le sol nu, et donc pour épargner les propriétaires à la fois monopoleurs et paresseux, l’État frappe la production et les revenus au point de décourager les travailleurs. Mais comme il a des besoins budgétaires impérieux, il doit recourir, en plus des impôts directs, aux impôts indirects que le contribuable paie sans s’en douter. Mais tous ces impôts élèvent le coût de la vie, donc le coût du travail, donc le prix des productions nationales qui sont concurrencées par les marchandises étrangères sur le marché international et même national. Pour protéger ses producteurs sur le terrain national, l’État dresse alors à ses frontières des barrières douanières, établit des tarifs différentiels de transport, et des règlements « hygiéniques » entravant les importations de l’étranger. Sur le marché international, il substitue et facilite le dumping de ses producteurs, fait jouer les primes à l’exportation. En un mot, il organise la guerre douanière qui prélude à la guerre diplomatique et à la guerre tout court.
NATIONALISATION DU SOL.
Le georgisme tend donc à socialiser la rente foncière. Il veut rendre à la collectivité ce qui appartient à la collectivité ; à l’individu ce qui appartient à l’individu. Mais l’application du georgisme soulève de telles résistances, par suite même de l’incompréhension de ceux qui en seraient les bénéficiaires, que plusieurs se sont demandés s’il ne serait pas plus sage de préconiser la nationalisation du sol, grâce à quoi la réforme foncière pourrait être réalisée à pied d’œuvre, sur un terrain neuf, c’est le cas de le dire. Mais, dans ce cas, il faut adopter une méthode d’expropriation du sol qui serait nationalisé. Et c’est ici que se présentent des solutions divergentes.
S’il est vrai que la propriété du sol résulte le plus souvent de la violence, à l’origine, la propriété n’est pas respectable et, dans ce cas, il importe de la nationaliser sans indemnité. C’est ce qui a été fait, par exemple, en Russie et dans les pays de l’Europe centrale et orientale.
George, qui ne se donnait pas comme révolutionnaire, encore que le pape Léon XIII l’ait considéré comme tel, était hostile à toute indemnité aux propriétaires « actuels ». Par contre, des socialistes comme Karl Marx, Engels, Vandervelde, etc., ont envisagé l’expropriation avec indemnité.
Le champion le plus célèbre de la nationalisation du sol a été Rivadavia qui, au commencement du XIXe siècle (1826), esquissa une ébauche de nationalisation du sol. Mais, comme tous les habitants de l’Argentine pouvaient dès lors se procurer facilement de la terre, louée par des baux emphytéotiques de longue durée, la réforme souleva contre elle l’opposition d’une importante minorité de gros propriétaires. Ils renversèrent Rivadavia du pouvoir. Il fut remplacé par le tyran Rosas qui, lui, aliéna la terre et en donna de grandes surfaces à ses partisans. Ainsi, par suite de l’échec de Rivadavia, la nationalisation du sol a échoué en Argentine, qui subit encore, à l’heure actuelle, les effets de la défaite de Rivadavia.
Le baron belge Colins écrivit, en 1835, un livre, le Pacte Social, dans lequel il exposait la nécessité de la propriété collective du sol (voir dans Terre et Liberté, n° 5, 1926, l’article d’Élie Soubeyran sur Colins). D’après lui, le sol nationalisé serait loué à tout individu qui voudrait le cultiver, soit individuellement, soit en société par actions, soit en société coopérative. Tout jeune ménage devrait être pourvu, par les soins de la collectivité, d’une propriété équipée et des fonds voulus pour la gérer, dont il serait comptable vis-à-vis de la collectivité.
La thèse de la nationalisation du sol a été reprise par Gossen, né à Düren, près de Cologne. Il estimait que la société doit assurer à chaque individu le moyen de produire sur de la terre libre, non écrasée d’impôts. À cet effet, il était partisan de la nationalisation du sol et de la création d’une caisse de prêts, gérée par l’État. Mais l’intervention de l’État n’était pour lui qu’un pis aller ; car, au fond, il était avant tout partisan de la libre initiative. Il estimait que l’État peut acheter la terre des particuliers assez bon marché pour trouver dans la hausse de la rente foncière le moyen d’amortir le prix d’achat. Dans sa Théorie mathématique du prix des terres et de leur rachat par l’État, et dans sa Théorie de la propriété (contenues dans ses Études d’économie sociale), Walras a exposé les lignes essentielles de son « socialisme synthétique ». Les facultés personnelles et le travail devant être l’objet de la propriété individuelle, et les salaires devant former le revenu des individus, les terres et la rente doivent être l’objet de la propriété collective, et les fermages doivent former le revenu de l’État. Comme son contemporain Gossen, Walras admet l’intervention de l’État dans une société progressive ; mais il aspirait, en somme, à ce que, dans une société rationnelle, la vie fût organisée coopérativement. Les coopératives qui seraient créées paieraient une redevance : soit par une somme définitivement versée, soit annuelle. Ce système de rachat du sol pourrait être étendu au rachat des mines, des chemins de fer et autres monopoles économiques naturels et nécessaires.
Loria s’est prononcé en faveur de la nationalisation du sol, en collaboration avec les travailleurs de la terre.
Considérez le programme des socialistes allemands, des socialistes fabiens en Grande-Bretagne, celui de Wallace, en Angleterre, et vous constaterez la même tendance à délivrer les agriculteurs de la dépendance où ils se trouvent vis-à-vis des propriétaires monopoleurs de la terre. En France, quelques socialistes, en tête desquels Henri Sellier, maire et conseiller général de Suresnes, tendent à taxer le sol nu, notamment dans les villes, et à affecter le revenu provenant de cette taxation à décharger la propriété bâtie et l’activité ; mais, dans l’ensemble, les socialistes subordonnent la réforme foncière à la conquête des pouvoirs publics. Et, en attendant la conquête de la majorité, la plupart semble ignorer ladite réforme, qui a pourtant au moins autant d’importance (voir Daudé-Bancel, La reconstruction des cités détruites) que les activités économiques et sociales sur lesquelles le parti socialiste a porté son effort.
Un polémiste, qui était aussi un économiste, Auguste Chirac, a exposé dans sa Prochaine révolution un plan grâce auquel il prévoyait l’échange des anciens titres de propriété contre des baux emphytéotiques de 25 ans, délivrés par la nation, prise, conventionnellement, comme souveraine collective du sol du pays. Les dits baux, renouvelables de plein droit, seraient cessibles et transmissibles, sans qu’une valeur capitale puisse être attribuée au sol, « déclaré immeuble ». L’usufruitier devrait payer chaque année un impôt, après révision du cadastre. Dans sa célèbre étude sur la réforme foncière parue dans le Journal des Économistes de mai 1883, Charles Gide a suggéré une très originale formule pour le rachat des terres par l’État. L’État, décidé à procéder à la nationalisation du sol, l’achèterait, payable comptant et livrable dans 99 ans. L’avantage de l’opération serait que la terre ne coûterait point cher à l’État ; car les propriétaires actuels ne seraient dépossédés de leur titre de propriété que dans 99 ans ; mais, par contre, ils toucheraient une prime d’expropriation qui, au taux de 3 %, serait de 50 francs pour une terre estimée 10 000 francs. Mais on pourrait, en accordant une prime d’expropriation plus élevée, raccourcir la prise de possession du sol par l’État : à la mort, par exemple, du dernier enfant conçu au jour de la promulgation de la loi, c’est-à-dire en limitant la durée de l’appropriation individuelle du sol à deux ou trois générations... Dans le même ordre d’idées, Eugenio Rignano a, dans Un socialisme en harmonie avec la doctrine économique libérale, soutenu une thèse d’après laquelle le sol, le sous-sol, les maisons et les usines seraient rachetés par le produit d’impôts prélevés sur les héritages. Ce serait l’adaptation à la limitation de la propriété du système des brevets d’invention, dont l’inventeur ne jouit que pendant quinze ou vingt ans. Mais les économistes libéraux ne se sont pas déclarés satisfaits de telles suggestions. Ils en sont restés au système de la vieille propriété « quiritaire » quoique, dans la société actuelle, bien des propriétés soient collectives : les routes, les fleuves, les rivières, les océans, les canaux et de nombreuses superficies du sol.
SYNTHÈSE INDISPENSABLE.
Il faut pourtant trouver, pour l’action, une méthode qui s’impose de plus en plus, la synthèse indispensable. À cet effet, il importe d’envisager le problème du sol aussi objectivement que possible. Actuellement, le nombre des propriétaires augmente sans cesse, notamment depuis le partage des terres en Europe centrale et orientale. Certes, en Russie, la nationalisation a été théoriquement opérée ; mais, en fait, le moujik aspire actuellement, comme sous les tzars, à posséder le « papier bleu », signe de l’appropriation individuelle de la terre. Et il a subi, il subit le coopératisme des terres qui lui a été imposé sous la forme de sovkhozes ou de kolkhozes. Dans ces conditions, cette coopération n’est pas recommandable ; car elle ne devrait reposer que sur la bonne volonté des individus libres, et librement associés (voir Daudé-Bancel, La réforme agraire en Russie).
En Europe centrale, comme partout dans le monde entier, les efforts des gouvernements tendent généralement à créer et à renforcer, là où elle existe, la petite et la moyenne propriétés. C’est un fait. Or, il est impossible de nationaliser effectivement et utilement là où, à tort ou à raison, la majorité des producteurs est indéfectiblement attachée à son lopin de terre, quels que soient les inconvénients de ce genre de tenure. Par conséquent, en présence de cet état d’esprit, il est impossible, sous peine d’aboutir, comme en Russie, à un fâcheux mais réel malthusianisme de la production, de songer à la nationalisation du sol. Mais, d’autre part, sous quelque régime que ce soit, les dépenses publiques de l’État, du département et des communes doivent être couvertes par l’impôt qui existe et existera, sous n’importe quel régime d’appropriation terrienne. Le gouvernement bolchéviste lui-même a préconisé un impôt unique (comme les georgistes) sur la terre. En fait (voir Daudé-Bancel, La réforme agraire en Russie), cet impôt « unique » est multiple. Il faut tendre – que le sol soit étatisé, nationalisé ou individuellement ou collectivement approprié – à remplacer les impôts, tous les impôts, par un impôt sur le sol nu, que Toubeau et Simon (voir la Répartition métrique des impôts et la Cité chinoise), ainsi que le Congrès international pour la réforme agraire (10–11 juin 1889), auquel participèrent Basly, Antide Boyer, Camélinat, Cipriani, Daumas, Hovelacque, Longuet, Benoît Malon, Millerand, Navarre, Élie Reclus, Henry George et Toubeau, ont appelé l’impôt loyer.
Cette thèse a été soutenue aussi par Fels et Georges Darien dans la Revue de l’impôt unique. Toubeau estimait alors que, moyennant la modique cotisation (sous forme d’impôt) de 25 francs par hectare, la France pouvait abolir les octrois, les droits sur les boissons et sur le sucre, la contribution personnelle et mobilière, celle des portes et fenêtres, l’impôt foncier. Il ajoutait, contre l’immense majorité des législateurs : « Les grands domaines improductifs sont exempts d’impôt sous le vain prétexte qu’ils n’ont pas de valeur, et ils ne restent improductifs que parce qu’ils ne payent pas d’impôts. »
Sa thèse de l’impôt métrique était quelque peu simpliste. Elle a été, par certains côtés, améliorée par l’impôt sur la valeur du sol nu, à laquelle Toubeau s’est rallié.
Dès lors, si le principe de l’impôt loyer est admis (et de l’impôt loyer sur le sol nu se substituant à tous les autres impôts), la voie est ouverte pour une action féconde et synthétique. Les partisans de la réforme foncière peuvent collaborer utilement, quelles que soient leurs tendances concernant l’appropriation du sol. Dans son livre excellent, Le grand malaise (5 francs chez Sam Meyer, 18, avenue de la Criolla, à Suresnes), Paul Laffitte a, certes, préconisé la transformation de la propriété perpétuelle en concession viagère, avec prolongation de 50 ans après la mort du propriétaire ; mais il n’est point adversaire de l’impôt loyer. Étudiant le programme de Colins (dans la Terre, n° 5, 1927), tout en conservant ses idées de nationalisation du sol, Soubeyran affirmait, surtout dans les pays neufs, les avantages de l’impôt loyer, cher, d’ailleurs, à Rivadavia. Les georgistes ont reproché à l’impôt loyer de Colins et de Rivadavia de reposer sur les baux emphytéotiques (de 18 à 99 ans). Avec ces baux de très longue durée, la collectivité était privée d’une bonne partie de la rente foncière, notamment dans une société progressive ; mais ce ne sont là que d’insignifiantes nuances. La théorie georgiste est certainement la bonne.
Les georgistes reprochent aussi à Gossen et Walras d’avoir prévu une intervention abusive de l’État que, dans leur pensée, ces réformateurs subissaient. Mais, à l’époque où ils vivaient, on ne connaissait pas encore les instituts ou offices autonomes dans lesquels l’État, les départements et les communes collaborent, ou peuvent collaborer avec les collectivités et les individus (les usagers). Et ce ne sont pas des collaborations théoriques. La responsabilité des usagers est effective, monnayée. L’action de ces instituts, ou offices, ou caisses (voir Caisse nationale de crédit agricole) repose sur un louable régime fédéraliste et décentralisateur, qui n’a pas les fâcheux inconvénients de l’administration étatique – laquelle est le plus souvent centralisée, actuellement – et le fait de fonctionnaires irresponsables.
Mais, en supposant la nationalisation du sol réalisée par la volonté des électeurs, ne peut-on concevoir que les fonds ad hoc soient attribués à l’office (ou à l’institut national ou à la caisse nationale) du sol et de ses améliorations qui, à son tour, louerait le sol et ses améliorations à des offices départementaux, lesquels loueraient les superficies et les richesses, à eux attribuées, à des particuliers ou à des collectivités constituant des offices communaux ? Et si nous n’allons pas jusqu’à la nationalisation du sol, ce régime ne serait-il pas appliqué utilement aux grandes superficies du sol, actuellement national ou communal, qui, à aucun prix, ne devraient être aliénées ? En tout cas, il existe encore dans les colonies ou pays de protectorat d’énormes espaces qui sont encore propriété collective à ne pas aliéner aussi.
Terre et Liberté (mars-avril 1932) a cité le cas d’un terrain de 700 hectares de terrains dunaires que Napoléon Ier avait donné à un de ses généraux. Ce dernier le vendit pour 12 000 francs (17 francs l’hectare) à un certain M. Bortier. Aujourd’hui, ce terrain est évalué à une trentaine de millions. Arthur Wauters a rappelé, dans sa Réforme agraire en Europe, le cas d’un terrain qui, acheté en 1921 7 500 francs, à Elisabethville, par un fonctionnaire, a été revendu par lui 750 000 francs.
Walras a insisté légitimement sur la plus-value énorme qu’une administration progressive (instituts autonomes et responsables) pourrait apporter aux terres et terrains dont elle aurait la gestion, et qui enrichirait la collectivité, au lieu de profiter à des propriétaires absentéistes ou/et paresseux. Nous avons fait (dans la Terre d’avril-mai-juin 1928) une suggestion d’office autonome à propos des terres libres du Maroc, et M. Pacquier-Bronde, adjoint au maire d’Alger, a exposé dans la même revue (numéro de juillet-août-septembre 1928) un plan de colonisation nouvelle s’inspirant d’une adaptation de la production coopérative à la terre louée aux producteurs. D’autre part (dans Terre et Liberté, octobre-novembre-décembre 1932), à propos du plan Delaisi tendant à doter l’Europe agraire de moyens de transports et de fonds de roulement, Sam Meyer a proposé que les États bénéficiaires (de la Finlande à la Grèce) établissent un impôt de substitution sur la valeur du sol, semblable à celui du Danemark (voir plus haut). Quant aux larges zones qu’il y aura lieu d’exproprier pour la construction des canaux, des chemins de fer et des routes, il a suggéré que ces terrains ne soient pas vendus, mais plutôt concédés aux exploitants, à la suite d’une mise aux enchères périodique, selon les modalités en usage en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Ces terrains restant la propriété de l’État seraient gérés par des offices autonomes. De ce chef, les pays qui auraient institué chez eux cette réforme foncière bénéficieraient de ses avantages, au lieu d’une seule classe de propriétaires fonciers privilégiés.
UTOPIE ou RÉALITÉ ?
Et si certains nous reprochaient de bâtir de nouvelles sociétés « utopiques », rappelons que le district de Canberra, la nouvelle capitale de l’Australie (voir la Terre, mars 1925), de la superficie de la Belgique, vit et prospère sous le régime de l’appropriation collective du sol et de l’impôt loyer, et qu’il existe plusieurs enclaves agricoles pourvues du même régime (voir Terre et Liberté, article de Paul Passy, janvier-février-mars 1928). La colonie de réforme foncière Eden, à Oranienburg-Berlin (voir la Terre de septembre-octobre-novembre 1926, et Terre et Liberté de janvier-février 1932, article de Glemser), les colonies sionistes de Palestine (Terre et Liberté d’avril-mai-juin 1932), le territoire de Kiao Tchéou (colonie d’abord allemande puis japonaise) et la terre des colonies hollandaises reposent sur le régime de l’impôt loyer et s’en trouvent fort bien. Appliquant à l’agglomération algéroise son programme de réforme foncière, M. Pasquier-Bronde a démontré qu’il est capable de résoudre, bien plus élégamment que dans la Métropole, où la plupart des villes aliènent leur terrain, le douloureux problème des taudis (voir Daudé-Bancel, Taudis et réforme foncière, dans la Dépêche de Toulouse du 25 novembre 1932).
Nous pensons avoir prouvé que la crise agraire qui sévit aux États-Unis provient, pour une large part, de ce que la terre y a été aliénée (n° 1 de la Terre, 1928) ; et d’un article de Paul Blanchard (dans The New Freeman), il résulte que, si la colonisation avait été faite sur le principe du sol, propriété publique, loué à bail à ceux qui voulaient l’exploiter, cet affermage rapporterait aujourd’hui à l’État :
« Un revenu annuel de 11 milliards de dollars au bas mot, c’est-à-dire plusieurs fois supérieur au budget du pays tout entier. »
Dans la Terre (juillet-août-septembre 1927), P. Giannelia a démontré que, par un simple impôt sur la valeur du sol nu, en Grèce, on pourrait facilement, et avec avantage, remplacer tous les impôts qui, actuellement, entravent l’essor du pays. Les Danois progressifs poursuivent leur campagne en faveur de cette louable substitution.
En France, il faudra bien qu’on s’attelle enfin à cette indispensable besogne. Étant donné le conservatisme étroit des propriétaires et des partis de droite, aggravé par la timidité des socialistes (qui sont, pour la plupart, affligés de révolutionarisme purement verbal), il faudra aborder la réforme foncière, sous des aspects urbains de préférence.
POUR L’ACTION.
En tout cas, les partisans de la réforme foncière ont deux excellents plans d’action pratique. Ils ont été exposés : l’un, celui de V. Précy, dans un petit livre, La rente foncière (3 francs, chez Sam Meyer, avenue de la Criolla, à Suresnes), et l’autre, celui de M. H. Aronstein, président de la Ligue belge pour la réforme foncière (dans Terre et Liberté de janvier-février-mars 1929). Précy suggère que les terres actuellement libres soient, non point aliénées ou laissées en jachère, mais louées aux enchères, renouvelées tous les trois ou cinq ans, de façon que le pays touche la rente foncière qui lui revient de droit. En ce qui concerne les terres occupées, il tient compte de la timidité ambiante. Il prévoit un impôt loyer, d’abord de 0,1 % du prix du sol nu, d’où est déduit l’impôt perçu auparavant sur les constructions et améliorations. Chaque année, l’impôt loyer est augmenté de 0,1 % du prix du sol nu. Au bout de 10 ans, il atteint donc 1 %. Au bout de 28 ans, il est porté à 3 %. À ce moment, les enchères sont ouvertes, de deux ans en deux ans. La trente et unième année, les améliorations sont entièrement dégrevées et, au fur et à mesure que le budget s’équilibre, on détruit les impôts indirects les plus pernicieux pour la production, le commerce, l’activité, conformément à la doctrine georgiste.
Le plan de M. Aronstein, établi à la suite d’une étude de la loi du 16 septembre 1807 sur la plus-value foncière (mais qui n’est pas appliquée), s’inspire du plan de 1883 établi par Gide pour l’entrée du sol dans la propriété collective. Les terres seraient divisées en deux groupes :
-
Les agricoles et forestières (et qui semblent destinées à le rester longtemps encore) seraient expropriées dans 99 ans. Sur la base d’un intérêt de 6 %, la somme à payer au comptant serait de 320 francs pour chaque tranche de 100 000 francs.
-
Le terrain urbain et toutes les terres qui paraissent destinées à acquérir une plus-value rapide (terrains avoisinant les villes, les mers, les cours d’eau, les chemins de fer ou les routes de grande communication) seraient expropriés dans 50 ans.
Sur la même base, la somme à payer au comptant serait de 5 600 F, pour chaque tranche de 100 000 F. Il faudrait, en outre, prévoir la faculté pour la collectivité de racheter le droit d’occupation chaque fois qu’une mutation de ce droit viendrait à se produire, par suite de vente ou de décès. Bien entendu, MM. Aronstein et Précy prévoient aussi, et conjointement, en bon georgistes, un impôt loyer sur le sol nu.
Rappelons que si, dès 1883, quand Charles Gide a exposé son plan de nationalisation de la rente et du sol, on l’avait écouté, aujourd’hui, 50 ans après, on aurait obtenu d’intéressants résultats dans le sens de la réforme foncière. Ce n’est pas pour rien qu’un vieux et sage proverbe méridional dit très judicieusement :
« Qui gagne temps, gagne tout. »
— A. DAUDÉ-BANCEL et SAM MEYER.
RÉFORMISME, RÉFORMISTE
n. m., n. et adj.
Le « réformisme » est la doctrine de ceux qui, tout en s’affirmant en faveur d’une transformation sociale ayant pour objet d’asseoir l’organisation de la société sur des principes et fondements opposés à ceux qui existent, se proposent d’aboutir à ce résultat par une série plus ou moins considérable de réformes partielles plus ou moins importantes, réalisées dans le cadre de la légalité.
« Réformiste » est le qualificatif qui sert à désigner la personne, le groupement, l’organisation ou le parti qui considère l’ensemble de ces réformes successives et légales, comme le meilleur, voire l’unique moyen de transformer le milieu social ; disons, pour être plus précis, de substituer au monde capitaliste le monde collectiviste ou communiste.
Les partis politiques qui se disent « d’avant-garde » et se proclament révolutionnaires sont tous plus ou moins réformistes. Plus ils sont réformistes, moins ils sont révolutionnaires et – ceci est la conséquence logique de cela – moins ils sont révolutionnaires, plus ils sont réformistes.
Il est, en effet, de toute évidence :
-
que plus ils accordent de confiance à la réalisation de leur plan de réformes, moins ils en attribuent à leur plan de bouleversement révolutionnaire ;
-
que plus ils consacrent au réformisme de leur activité idéologique et tactique, moins ils réservent aux fins révolutionnaires, qu’ils prétendent s’assigner, de leurs efforts théoriques et pratiques. D’où il est permis d’inférer, par le moyen du raisonnement ainsi que par la voie de l’observation, qu’on ne peut être sérieusement et réformiste et révolutionnaire, puisque ces deux méthodes de propagande et d’action s’opposent et nécessitent l’option.
Il n’est pas malaisé de saisir pour quel motif les partis et organisations socialistes ou socialisantes ménagent, avec une attention jalouse, le chou réformiste et la chèvre révolutionnaire. Ces groupements possèdent une aile droite, un centre et une aile gauche. L’aile droite se compose des éléments peu ou prou ralliés au mouvement réformiste : les uns, parce que, désabusés de l’action strictement politique que mènent les fractions bourgeoises dites « de gauche », se sont peu à peu rapprochés du socialisme ; les autres, parce que, adeptes tout d’abord du socialisme révolutionnaire, ils se sont insensiblement lassés des vaines attentes, des espoirs déçus, des échecs subis qui sont le lot de tout parti qui en est encore à ses premiers essais de réalisation.
L’aile gauche comprend des éléments non moins disparates : d’une part, ceux que la tiédeur des organes de direction, tiédeur s’exprimant, en chaque circonstance tant soit peu grave, par l’incertitude et le flottement, a fini par éloigner des solutions équivoques et des décisions ambiguës ; d’autre part, ceux qui, par tempérament, par conviction ou par intérêt, s’orientent vers les conclusions extrémistes des conceptions dont ils ont admis le point de départ et le point d’arrivée.
Enfin, il y a le centre, dont le sort et la fonction consistent à osciller sans cesse de droite à gauche et qui, penchant, selon les événements, tantôt d’un côté, tantôt de l’autre, immobilisent le mouvement d’ensemble du groupement (organisation ou parti) tiraillé tantôt vers la gauche et tantôt vers la droite.
Quand on parvient, cette constatation faite, à discerner de quelles fractions hétérogènes se compose un parti politique, on comprend aisément qu’il soit graduellement entamé, rongé et finalement dominé par le réformisme : s’il ne veut pas se priver de ses adhérents de droite, il faut qu’il sacrifie à l’action quotidienne du réformisme tout ou partie du révolutionnarisme qui guide et actionne ses composants de gauche. Par contre, s’il entend conserver son aile gauche, il est acculé à la nécessité de sacrifier à l’action révolutionnaire tout ou partie du réformisme qui absorbe l’activité de ses adhérents de droite. Enfin, s’il ne veut pas s’exposer à perdre ce qu’on peut appeler son centre de gravité, il est dans l’obligation de s’affubler du double visage de Janus : l’un souriant à droite et l’autre à gauche. Singulière attitude !...
Toutefois, étant donné que la bataille de parti à parti et de classe à classe se poursuit sur le terrain de manœuvre des engagements quotidiens, il est fatal que, petit à petit, la poussée réformiste qui s’exerce tous les jours prenne le pas sur la poussée révolutionnaire qui ne se produit que de temps à autre, et que les préoccupations de l’ordre réformiste l’emportent à la fin sur celles de l’ordre révolutionnaire. C’est la pente, c’est l’engrenage qui amènent, tôt ou tard – et, dans la pratique, assez rapidement –, toute organisation politique ou économique ayant ouvert sa porte au réformisme à appliquer de moins en moins l’action directe qui conduit à la révolution expropriatrice, et à concentrer la totalité – ou presque – de ses ressources, de ses énergies et de ses talents dans la voie des améliorations de détail, des revendications partielles et des conquêtes fragmentaires qui constituent ce que j’appelle, ici, le réformisme.
Conclure, des considérations qui précèdent, que je suis, par principe et en toutes circonstances, l’adversaire des réformes plus ou moins appréciables que, par une pression constante, il est possible d’arracher aux résistances des pouvoirs établis, ce serait faire erreur. Non, je ne suis pas l’ennemi systématique des améliorations – si peu opérantes qu’elles soient – qu’il est possible d’obtenir.
La limitation et la réduction de la durée de la journée de travail, la réglementation du travail des femmes et des enfants, l’augmentation progressive des salaires en fonction de la cherté de la vie, l’application de la formule « à travail égal, salaire égal », la reconnaissance juridique de l’égalité des droits des deux sexes ; et, d’une façon générale, toutes les réformes, améliorations et mesures qui tendent à préserver l’enfance de l’abandon, la vieillesse du dénuement, les malchanceux et les déshérités de la misère qui est leur lot ; pour tout dire : tous les efforts, même les plus modestes, qui sont de nature à diminuer la somme des incertitudes, des souffrances, des tribulations qui accablent la classe pauvre, toutes ces mesures et tous ces efforts ont mon approbation et doivent être accueillis avec faveur. Il en est de même, dans un autre domaine, de tout ce qui peut être tenté et réalisé dans le but de restreindre ou d’abroger les abus administratifs, les oppressions qui pèsent sur la multitude, les obligations et charges dont pâtit la masse populaire, les lois et règlements qui jugulent la liberté individuelle. Il en est encore de même des dispositions qui peuvent être prises en faveur de l’instruction des travailleurs, de l’élévation du niveau intellectuel et moral de la classe ouvrière, de la lutte à engager contre les diverses formes de l’ignorance et de la crédulité qui prédisposent, je dirai même condamnent, l’immense foule à subir sans protester, souvent même à approuver les servitudes dont elle est victime.
Je suis prêt à applaudir à tout ce qui a été fait dans le passé, à tout ce qui se fait dans le présent, à tout ce qui peut être fait dans l’avenir, dans le sens d’un mieux-être quelconque : matériel, intellectuel et mental. Je ne suis donc pas l’adversaire de ce qu’on appelle couramment les réformes, modifications et changements susceptibles d’affaiblir la somme des inégalités et des injustices inscrites dans le contrat social qui nous régit ; mais je suis l’ennemi déclaré du réformisme que j’ai, au début de cet article, défini en ces termes :
« Le réformisme, c’est la doctrine de ceux qui, tout en s’affirmant en faveur d’une transformation sociale ayant pour objet d’asseoir l’organisation de la société sur des principes et fondements opposés à ceux qui existent, se proposent d’aboutir à ce résultat par une série plus ou moins considérable de réformes partielles, plus ou moins importantes, réalisées dans le cadre de la légalité. »
Et je n’ai rien de commun avec l’espèce « réformiste », qualificatif qui sert à désigner :
« La personne, le groupement, l’organisation ou le parti qui considèrent l’ensemble de ces réformes successives et légales comme le meilleur, voire le seul moyen de transformer le milieu social, disons, pour être plus précis, de substituer au monde capitaliste, le monde collectiviste ou communiste ».
Les améliorations légales et superposées que le réformisme et ses partisans parviennent à obtenir n’ont de valeur, à mes yeux, que dans la mesure ou :
-
elles allègent ou suppriment quelques souffrances ; et il serait déraisonnable que, d’une part, je veuille abolir toute la part de douleurs évitables que comporte la vie humaine, au sein de la nature et de la société ; et que, d’autre part, je me refuse à tenir pour désirables et à accueillir avec satisfaction les mesures qui ont ou peuvent avoir pour résultat de soulager – si peu que ce soit – quelques-unes de ces souffrances ;
-
elles sont une protestation, une attaque et une réalisation dirigées contre l’état de choses qu’il s’agit de renverser ;
-
elles ébranlent la solidité du régime social que j’ambitionne de démolir ; et elles préparent plus ou moins efficacement, par voie d’acheminement, la transformation sociale qui, seule, est à même de mettre fin aux institutions qui consacrent, sanctionnent et perpétuent les multiples iniquités dont le poids écrase, depuis des millénaires, l’immense majorité des humains, au profit exclusif d’une infime minorité.
On accuse fréquemment les anarchistes de professer la doctrine du « tout ou rien ». Il y a dans cette accusation une part de vérité, mais une part seulement. Car il est exact que les libertaires ne se déclareront satisfaits, et ne le seront, que lorsqu’ils auront à jamais brisé tous les obstacles d’ordre social qui s’opposent à l’application de leur devise :
« Bien-être pour tous et pour chacun ; et liberté pour chacun et pour tous ! »
De ce point de vue, il est tout à fait exact que jusqu’à ce qu’il ne reste plus pierre sur pierre de la forteresse autoritaire qu’il faut ruiner de fond en comble, ils persisteront à batailler pour qu’il n’en demeure aucun vestige. Si c’est ainsi qu’on conçoit la doctrine du « tout ou rien », il est vrai, je ne le conteste pas, que telle est la doctrine libertaire. Mais il ne s’ensuit pas le moins du monde que les anarchistes ne tiennent aucun compte des coups qui peuvent être portés, des efforts qui peuvent être accomplis dans le but d’attaquer la forteresse qu’ils entendent abattre ; encore moins s’ensuit-il qu’ils n’apprécient pas la valeur de ces efforts et de ces coups qui ont pour but et peuvent avoir pour résultat d’affaiblir la solidité et de diminuer la force de résistance de cette forteresse. Les anarchistes sont gens raisonnables et de sens pratique. Ils veulent 100, c’est le tout. Mais s’ils ne peuvent avoir que 10, ils empochent cet acompte et réclament le reste. Ils constatent que les améliorations auxquelles tendent les réformes ne sont consenties par la bourgeoisie gouvernante et capitaliste qu’à la condition qu’elles n’entament pas foncièrement le régime social sur lequel reposent l’autorité des gouvernants et les profits des capitalistes. Ils savent, par expérience, qu’après s’être plus ou moins longtemps fait tirer l’oreille – gagner du temps est une manœuvre dans laquelle les dirigeants excellent –, la classe privilégiée finit par accorder ce qu’elle n’est plus en état de refuser. Ils n’ignorent pas que lorsqu’une réforme touche aux fondements mêmes du mécanisme autoritaire : État et capitalisme, elle se heurte à la résistance désespérée des pouvoirs établis et que cette résistance ne peut être brisée que par l’élan révolutionnaire. Ils n’attachent de prix qu’aux moyens employés directement par le prolétariat en travail d’émancipation, et ils ont la certitude que, en aucun cas, en aucune conjoncture, celui-ci ne s’affranchira véritablement sans recourir à l’unique instrument de sa libération : la révolution sociale triomphante.
L’erreur du réformisme, c’est de s’imaginer que, par étapes successives, de petits profits en conquêtes secondaires, il est de force à faire l’économie d’une révolution, et que ces victoires totalisées aboutiront à la transformation sociale.
Que les groupements, organisations et partis bourgeois, même les plus avancés, placent leur confiance dans cette méthode de propagande et de combat qui se meut dans le cadre de la légalité en cours et des institutions qui agissent à l’intérieur et dans les limites de ce cadre, cela se comprend et s’explique. Ces partis croient ou feignent de croire à la pérennité de l’État et de la propriété individuelle. Ils ne conçoivent pas que celle-ci et celui-là puissent disparaître et que la vie sociale puisse être organisée sans le maintien de la propriété privée et en l’absence de l’État. Il est donc naturel qu’ils élargissent et multiplient les réformes et ne leur assignent comme limites extrêmes que les frontières tracées par les nécessités de la domination politique, l’État, et de l’exploitation économique, le capitalisme. Ils sont dans leur rôle, lorsqu’ils consentent, par les réformes, à faire la part du feu. Elle est rationnelle, elle est adroite et astucieuse, la manœuvre par laquelle, grâce à de minuscules concessions, ils parviennent à endiguer le flot qui menace de les submerger, à apaiser ou détourner les colères que suscite l’accumulation de leurs fautes et de leurs crimes. De leur part, cette tactique a sa raison d’être : elle est ruse de guerre et savante stratégie.
La sauvegarde de l’organisation sociale dont ils sont les bénéficiaires pousse les profiteurs du régime actuel dans la voie des réformes. Cette voie est pour eux, provisoirement du moins, celle du salut. Il est donc juste de reconnaître que, la mise en pratique de la méthode réformiste étant éminemment favorable à la défense de leurs intérêts de classe, les privilégiés ont cent fois raison de s’en servir. Par contre, il est évident que, nécessaire à la défense des intérêts de la bourgeoisie, le réformisme ne peut être que contraire et nuisible aux intérêts de la classe prolétarienne, et il convient de condamner sévèrement le réformisme pratiqué par les partis politiques et les organisations syndicales qui inscrivent en tête de leur programme d’action la lutte à mener, jusqu’à la victoire, contre les institutions qui servent de rempart à la classe qui gouverne et exploite.
Car le réformisme est lourd de conséquences mortelles à l’affranchissement du travail et des travailleurs. Il mène à l’abandon de toute action s’inspirant de l’esprit de classe et conduit insensiblement au collaborationnisme, c’est-à-dire à la conjugaison de plus en plus étroite des intérêts – essentiellement contradictoires, pourtant – de la classe riche et de la classe pauvre, de la classe qui gouverne et de celle qui est gouvernée. Il jette dans la position respective des organisations et des partis une confusion qui obscurcit les problèmes les plus clairs et complique les questions les plus simples. Il dérive le cours des énergies fécondes et l’enlise dans les méandres inextricables des tractations sans fin, des pourparlers sans issue et des conciliations sans résultat. Il endort le cran révolutionnaire des masses opprimées et exploitées ; il affaiblit, déconcerte et démoralise les éléments les plus ardents et les plus actifs du courant qui emporte la conscience populaire vers la conquête des points névralgiques et les réalisations ayant un sens social précis et une portée indiscutable. Il absorbe, petit à petit, au service des améliorations douteuses et des modifications à double tranchant, des efforts qui seraient autrement efficients s’ils s’employaient à des tâches sérieuses et à des buts plus élevés et plus amples.
Le réformisme détourne le regard du firmament où brille l’étoile qui indique la direction à prendre et la route à parcourir, en inclinant les petits esprits et les volontés fragiles – hélas ! C’est le plus grand nombre ! – à perdre de vue l’étoile libératrice, qu’ils accusent d’être trop haute et trop loin, et à remplacer celle-ci par les vers luisants, humbles lucioles qui parsèment l’ornière.
— Sébastien FAURE.
RÉGÉNÉRATION
n. f. (du latin regeneratio)
Reproduction d’un tissu, d’une partie qui a été détruite : la régénération des chairs ; la régénération du tissu osseux par le périoste. Au figuré, « réformation, renouvellement » : la régénération des mœurs ; la régénération d’un peuple. En termes de religion et en parlant du baptême, signifie « renaissance » : la régénération en Jésus-Christ.
En biologie, on appelle régénération la formation nouvelle d’une partie enlevée à un organisme. Elle se fait normalement, physiologiquement. Chez tous les insectes, à la suite de la mue des poils, des plumes, des écailles, ou des épithéliums ; c’est à peu près la seule que l’on constate chez les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les poissons, les mollusques et les arthropodes aériens. Mais on peut observer chez les autres animaux une régénération anormale, accidentelle ou pathologique, dans laquelle les organes entiers ou même des portions d’individu peuvent se reformer après avoir été enlevés. Chez les batraciens urodèles, par exemple, la queue, les pattes, l’œil et les branchies régénèrent. Les crabes reforment leurs pattes, les vers leur queue, les étoiles de mer leurs bras. Cette faculté surprenante de reformer un organe enlevé ou détruit expliquerait, dans bien des cas, le phénomène d’auto amputation que l’on observe chez certains animaux.
Régénération de l’espèce humaine.
On entend par-là une méthode de sélection volontaire, raisonnée, comprenant deux parties : l’une négative, l’abstention procréatrice des tarés, des dégénérés, des déficients de toute nature par l’emploi des moyens anticonceptionnels, ou par la stérilisation, consentie ou imposée, selon les cas, par l’opération chirurgicale dite vasectomie (voir ce mot) ; l’autre par l’application des méthodes eugéniques, ou science de la bonne naissance.
Dans les sociétés modernes, la sélection naturelle qui consacre généralement la survivance des plus forts, des plus beaux et des mieux doués, est plutôt renversée. Par les guerres, les jeunes, les forts, les sains, ceux qui ont les plus grandes chances de devenir les meilleurs reproducteurs sont sacrifiés. Par le privilège de la richesse, les individus les plus propres à la procréation de beaux enfants sont presque toujours supplantés à l’avantage des vieux, des tarés, des dégénérés : il est plus facile à un homme âgé, usé, laid et même infirme, mais riche, de fonder une famille qu’à un homme jeune, beau, d’intelligence droite, mais pauvre. Il s’ensuit, alors, une sélection à rebours, une véritable dégénérescence de l’espèce.
Ligue de la régénération humaine.
Hist. Fondée en 1896 par Paul Robin, section française de la Ligue universelle de la régénération humaine, dont le secrétaire général était Eugène Humbert ; elle fut dissoute en 1908, son organe mensuel avait pour titre Régénération (voir au mot Malthusianisme).
Après la promulgation de la loi scélérate du 31 juillet 1920, qui punit de prison – jusqu’à trois années – et d’amende – jusqu’à trois mille francs – la propagande néo-malthusienne et la divulgation des procédés anticonceptionnels, les buts préconisés par Paul Robin ne pouvant plus, sans danger, être exposés ni poursuivis, Eugène Humbert reforma la Ligue de la régénération humaine en 1929, sous la présidence d’honneur de Victor Margueritte, mais avec les principes et les buts de la Ligue mondiale pour la réforme sexuelle sur une base scientifique. Il fonda ensuite La Grande Réforme pour servir de lien et de moniteur aux adhérents régénérateurs. Les principes et les buts de la Ligue mondiale pour la réforme sexuelle, fondée en 1928, sous la présidence d’honneur des célèbres sexologues Auguste Forel, Havelock Ellis et Magnus Hirschfeld, se rapprochent sensiblement de ceux de Paul Robin et des néo-malthusiens d’avant 1914 ; ils comportent trois points essentiels de la régénération humaine : le contrôle des naissances, l’application des méthodes de l’eugénique et la prévention de la prostitution et des maladies vénériennes.
Voici ses dix principes directeurs :
-
Égalité politique, économique et sexuelle des hommes et des femmes.
-
Libération du mariage, et spécialement du divorce, des règles tyranniques de l’Église et de l’État.
-
Contrôle de la conception, de telle sorte que la procréation soit consentie délibérément et avec un sens exact des responsabilités.
-
Amélioration de la race par l’application des méthodes de l’eugénique et de la puériculture.
-
Protection des filles mères et des enfants illégitimes.
-
Conduite humaine et rationnelle envers les anormaux sexuels comme, par exemple, les homosexuels, hommes et femmes, les fétichistes, les exhibitionnistes, etc.
-
Prévention de la prostitution et des maladies vénériennes.
-
Incorporation des troubles dus à l’impulsion sexuelle dans la classe des phénomènes d’ordre pathologique, et non plus envisagés, ainsi qu’on l’a fait jusqu’à aujourd’hui, comme des crimes, des vices ou des péchés.
-
Seuls peuvent être considérés comme criminels les actes sexuels qui transgressent la liberté ou portent atteinte aux droits d’une autre personne. Les relations sexuelles entre adultes responsables, consenties mutuellement, doivent être respectées comme étant des actes privés qui n’engagent que leurs personnes.
-
Éducation sexuelle systématique dans le sens de la plus grande liberté, et dans le respect de soi et d’autrui.
Si l’on ajoute à ce programme l’éducation intégrale, le développement général des principes d’hygiène individuelle et sociale devant remplacer la médecine, la transformation de la société bourgeoise ou capitaliste en un milieu social qui assurerait à tous le bien-être, c’est-à-dire les possibilités pour tous les êtres humains de se développer sainement, intégralement, on voit que le titre pris par les réformateurs sexualistes de nos jours n’est point usurpé.
— Jeanne et Eugène HUMBERT.
RÉGICIDE
n. et adj. (du latin rex, roi, et caedere, tuer)
Étymologiquement, du latin fictif regiceda, regicedium, le régicide est l’« assassin » d’un roi. Il semblerait que ce nom ait été donné, lors de la restauration des Stuarts et de celle des Bourbons, aux hommes qui avaient condamné à mort Charles Ier et Louis XVI. Maurice Lachâtre écrit, dans son Dictionnaire :
« Les peuples, sous une inspiration différente, ont conclu également à la légitimité du régicide, lorsque le souverain violait le pacte fondamental de la nation ; et, en Angleterre comme en France, les têtes de Charles Ier et de Louis XVI tombèrent en vertu de ce principe. Enfin, quelques esprits ardents, sous la République, ont avancé que tout citoyen avait le droit de tuer un tyran, et ont exalté comme des héros Aristogiton et Brutus, dans l’Antiquité, Alibaud, à une époque plus rapprochée de nous. »
Il n’est pas, à ma connaissance, de page d’une tenue littéraire plus noble que celle écrite par le maître écrivain Laurent Tailhade, clamant l’apologie du régicide :
« Si la voix enflammée des poètes et des philosophes, si les accents que nous dicte une brûlante indignation tombent dans un vide sans écho ; si nous ne pouvons, désormais, tremper en un verbe de lumière le poignard de Chéréas ou le couteau des panathénées ; si la conscience magnanime de Louvel est, pour toujours, éteinte dans les hommes d’à présent, que le soleil se voile et que, devant l’inéluctable turpitude, les jeunes étoiles ferment à jamais leurs chastes yeux... Cher Harmodios, heureux Aristogiton, vous, du moins, alors que vous frappiez à l’autel de Pallas, et parmi les apprêts du sacrifice, un tyran plus beau que Diomède ou que le divin Achilleus, vous couronniez de myrte le fer libérateur. Mais, dans notre siècle de honte et de fange, pour conduire au néant la bourgeoisie implacable et stupide, la bombe même de Vaillant ou d’Orsini est une arme trop pure, un trop noble moyen. C’est dans l’excrément seul qu’elle devra périr, cette bourgeoisie odieuse, dans l’excrément dont elle ne diffère que par l’énorme puanteur. Et quand elle sera morte, râlant dans la fosse innommable, avec ses généraux, ses ministres, ses banquiers et ses magistrats, il restera pour étouffer ses prêtres, une sentine plus vénéneuse encore ; on les plongera, ces prêtres escrocs et malfaiteurs, on les plongera, pour les détruire, dans leur crasse, dans le bain, dans le premier bain de Flamidien. »
Rappelons succinctement quelques faits : Aristogiton était cet Athénien qui, de concert avec Harmodios, conspira contre Hipparque, tyran d’Athènes. Il le tua en l’an 513 avant J.-C. Les Pisistratides furent chassés d’Athènes vers cette époque, la même année que les Tarquins furent chassés de Rome, en l’an 509 avant J.-C. Les Athéniens dressèrent des statues à Harmodios et à Aristogiton, qui les avaient délivrés de la tyrannie. En 86 avant J.-C. naquit Brutus Lucius-Junius, le fondateur de la République romaine, l’un des plus grands caractères de l’Antiquité. C’est l’époque des Tarquins, Servius-Tullius et des Lucrèce ; et l’on sait que Brutus joua un rôle considérable à Rome, lorsque le peuple se retira sur les monts sacrés. Dans sa jeunesse, Brutus cultiva les lettres et la philosophie stoïcienne ; il était connu par sa grande austérité dans les mœurs et son désintéressement sans limites, il était doué d’une éloquence mâle et concise. Plus tard, il suivit son pacte contre César, qui cependant l’aimait comme un fils. On conte que César fut l’amant de sa mère. L’on connaît cette phrase restée célèbre et passée dans la conversation courante :
« Tu dors, Brutus, et Rome est dans les fers. »
À quelque temps de là, César tombait, frappé à mort, en plein Sénat, et Brutus ne fut pas le dernier à frapper. Brutus, après avoir combattu en héros, se tua comme Cassius, sur un monceau de cadavres ; et si Antoine le pleura, Octave lui fit couper la tête pour l’envoyer à Rome et la faire déposer aux pieds de la statue de César. Brutus fut appelé le dernier des Romains, et son nom a été conservé par les générations qui suivirent ; si bien que, de nos jours, on dit d’un homme à principes républicains inflexibles :
« C’est un Brutus, un vrai Brutus. »
Il ne fait aucune concession de principes à ses adversaires politiques.
Mais si le régicide, tel qu’il se manifesta dans l’Antiquité, peut, sinon s’accepter dans son entièreté, se comprendre aisément, lorsqu’il fut revendiqué ensuite par les jésuites qui l’accaparèrent pour en faire une doctrine qui les aidait puissamment à assouvir leurs haines et leurs vengeances, en vue de leur soif insatiable de domination, il devient répugnant, car ces allumeurs de crimes n’avaient « ni le cœur assez droit, ni les mains assez pures ». Ce furent des assassins, non des justiciers, et, selon une expression poétique, ils fournirent des « Brutus de collège ». Dans ses Lettres d’Argental, Voltaire écrivait, le 15 novembre... :
« J’ai le plaisir de vérifier dans Saint-Thomas, le docteur angélique, toute la doctrine du régicide. »
Les jésuites admirent donc le régicide comme principe, et s’il fut controversé souvent, il n’en reste pas moins vrai que, pour l’ordre d’Ignace de Loyola, les rois étant sous la juridiction du pape, et, de ce fait, celui-ci a le droit de les condamner ou de charger tout individu d’exécuter la sentence, le régicide s’affirmait non seulement comme autorisé, mais était exalté comme une action glorieuse et méritoire. Dans le code des jésuites, où le régicide est prêché, érigé en doctrine, l’on trouve de quoi « condamner » ces jésuites qui se disent calomniés. (Voir au mot Jésuite : Textes régicides.)
Voici ce qu’on lit dans les opuscules théologiques de Martin Bécan, jésuite célèbre :
« Tout sujet peut tuer son prince, lorsque ce dernier s’est emparé du trône comme usurpateur. Il ajoute que son assertion est si juste que, dans toutes les nations, il est à remarquer qu’on a rendu de grands honneurs à ceux qui ont tué de semblables tyrans. »
Le jésuite italien Paul Comitolo, écrit, p. 458, livre IV de ses Décisions morales :
« Il est permis de tuer un injuste agresseur, quand même il serait général, prince, roi ; que l’innocence est toujours plus utile que l’injustice, et qu’un prince qui maltraite des citoyens est une bête féroce, cruelle et pernicieuse qu’il faut détruire. »
Adam Tanner, jésuite allemand, dit :
« Il est permis à tout homme de tuer un tyran, qui est tel quant à la substance (tyrannus quoad substantiam), il est glorieux de l’exterminer (exterminare gloriosum est). »
Alp Sa, jésuite portugais, proclame que :
« Le pape peut tuer d’une seule parole (potest verbo corporalem vitam auferre) ; car en recevant le droit de faire paître les brebis, n’a-t-il pas aussi reçu celui de faire massacrer les loups ? (potestatem lupos interficiendi). »
Le jésuite Marionna, dans De Rege (lib. 1, p. 54), écrit :
« C’est une pensée salutaire à inspirer aux princes, que de leur persuader que s’ils oppriment les peuples en se rendant insupportables, par l’excès de leurs vices et l’infamie de leur conduite, ils vivent à telles conditions qu’on peut, non seulement à bon droit, les mettre à mort, mais qu’il y a de la gloire et de l’héroïsme à le faire. »
Dans Suarez, Defensio Fidei (lib. VI, ch. IV, nos 13 et 14), on trouve ces pensées :
« Si la chose publique ne peut trouver sa défense que dans la mort du tyran, il est permis au premier venu de le tuer (cuilibet de populo licet illum interficere). »
Qu’un Clément et un Ravaillac soient les praticiens de ces doctrines, personne ne le conteste, et si les Pazzi assassinèrent les Médicis, pour complaire au pape Sixte IV, si Jean Châtel tenta d’assassiner Henri IV, tous ne furent que les instruments des jésuites. Jean Guignaud, jésuite et complice de Jacques Clément, déclara :
« C’est une action méritoire devant Dieu que de tuer un roi hérétique. »
Mais les jésuites n’eurent cependant pas le monopole du régicide. Le conventionnel Grégoire jugea les souverains par cette pensée laconique :
« Les rois sont dans l’ordre politique ce que sont les monstres dans l’ordre naturel ; nous avons non seulement le droit, mais le devoir de les écraser. »
Plus tard, Mussolini reprendra ce thème dans la Lutte de Classe (9 juillet 1910) :
« J’admets sans discussion que les bombes ne peuvent constituer en temps normal un moyen d’action socialiste. Mais lorsqu’un gouvernement républicain ou monarchique vous bâillonne et vous jette en dehors de l’humanité, oh ! Alors, il ne faut pas maudire la violence qui répond à la violence, même si elle fait quelques victimes innocentes. »
C’était là justifier le régicide.
La doctrine libertaire inscrivit à son actif le régicide, et alla jusqu’à le préconiser comme un geste héroïque. Laurent Tailhade, dans le Triomphe de la domesticité, stigmatisa en une page virulente l’alliance franco-russe. Son article, d’une beauté littéraire remarquable, vibrant et plein d’images, émut le parquet qui lui fit les honneurs de la correctionnelle pour provocation au meurtre. Voici le passage incriminé :
« Quoi ! Parmi ces soldats illégalement retenus pour veiller sur la route où piaffe la couardise impériale, parmi ces gardes-barrières qui gagnent 9 francs tous les mois, parmi les chemineaux, les mendiants, les trimardeurs, les outlaws, ceux qui meurent de froid sous les ponts en hiver, d’insolation en été, de faim toute leur vie, il ne s’en trouvera pas un pour prendre un fusil, son tisonnier, pour arracher aux frênes des bois le gourdin préhistorique pour frapper jusqu’à la mort, pour frapper au visage et pour frapper au cœur la canaille triomphante, tzar, président, ministre, officiers et les clergés infâmes, tous les exploiteurs du misérable, tous ceux qui rient de sa détresse, vivent de sa moelle, courbent son échine et payent de vains mots sa tenace crédulité ! La rue de la Ferronnerie est-elle à jamais barrée ? La semence du héros est-elle inféconde pour toujours ? »
Mais si l’Église justifie un Ravaillac ou un Clément, si les conservateurs applaudissent à la fusillade des fédérés de 1871 par les Versaillais, si les républicains crient hourra pour la bombe d’Orsini, cela semble marquer leur accord pour encenser la violence et célébrer la sainteté de l’attentat. Leurs mobiles cherchent cependant des vengeances particulières, des ambitions personnelles de domination, où l’attentat n’est que l’exécution docile et souvent inconsciente instiguée par des partis et des sectes qui convoitent le pouvoir. L’on ne peut porter sur les anarchistes les mêmes accusations. S’ils jettent la mort, c’est qu’ils espèrent par des actes de violence hâter la destruction d’une société qui écrase les masses. Encore qu’il y aurait beaucoup à rétorquer sur cette façon d’envisager la propagande, il est certain cependant qu’à la lueur des bombes, les idées anarchistes qui étaient ignorées de la grande masse apparurent sous un aspect nouveau, peut-être tragique.
Cette propagande a laissé des traces profondes, des souvenirs vivaces, bons et mauvais, car chacun la jugeait différemment. Il ne s’agit pas, ici, de reparler de cette époque héroïque des attentats multiples et nombreux qui eurent lieu durant le dernier quart du XIXe siècle (je renvoie le lecteur au mot attentat). À côté de Luchini, qui tua l’impératrice d’Autriche, de Bresci, qui supprima le roi d’Italie, de Czolgosz, qui attenta à la vie du président Mac Kinley, de Ryssakoff et de Jelaboff, qui tuèrent le tsar Alexandre II, de Caserio, qui poignarda le président Carnot, viennent se joindre les diverses tentatives de meurtre sur les rois, princes et empereurs. Orsini contre Napoléon III, Hoedel-Nobilung contre Guillaume Ier, Moncasi et Gonzalès contre Alphonse XII, Passanante contre le roi d’Italie, Solovieff-Hartmann contre le tsar, De Rosa contre le prince Humberto, etc. L’attentat ne fut point toujours compris, surtout lorsqu’il était commis un peu au hasard ; mais s’il visait un responsable ou un puissant, le geste s’expliquait mieux, trouvait alors, parfois, sinon une justification, tout au moins un certain acquiescement, et certains gestes mêmes furent légitimés. S’il paraît utile de s’élever, parfois, contre de tels gestes, au point de vue de l’intérêt de la propagande, comme l’écrivait A. Lorulot, dans les Théories anarchistes :
« Il est impossible de blâmer et de juger qui que ce soit, car la lutte est souvent une nécessité douloureuse ; qu’elle soit cela, puisque l’heure n’est pas encore venue où les choses vont se modifier. Frappez, mais n’en faites pas un système, ni un principe. Frappez, quand c’est utile et quand vous ne pouvez pas l’éviter. Partisans de la vie libre et de la révolution humaine, regrettons toujours d’en venir à cette nécessité, et n’oublions pas que la haine injustifiée ne peut que contrarier l’œuvre des pionniers de l’harmonie sociale. »
— HEM DAY.
RÉGICIDE
Mot à mot : meurtre d’un roi. Terme qui s’applique non seulement au meurtre d’un roi, mais à toute suppression ou tentative de suppression criminelle d’un potentat ou d’un personnage en vedette. Mot qui peut être remplacé par celui de magnicide : meurtre d’un grand de la terre.
Le régicide est un acte fort commun dans l’histoire. On l’a noté dans tous les temps. Dans l’Antiquité, il est d’une fréquence extrême. Dirigé contre les sujets qui s’imposèrent à la foule en qualité de tyrans, il a été souvent considéré comme un acte, sinon de vengeance, du moins de justice. C’est un sentiment de simple logique, en effet, qui pousse à détruire ce qui est nuisible, plus encore celui qui use de la force ou de l’intrigue pour imposer un véritable régime de persécution. On peut dire que nombre de régicides qui ont supporté le poids de la vindicte légale et qui furent par suite des vedettes, au même titre que leur victime, ont assumé une tâche dont l’inspiration ne sortait point que d’eux-mêmes, mais qu’ils n’ont été que les instruments plus courageux d’une foule de concitoyens animés par les mêmes rancœurs.
Il est connu dans l’histoire de l’anarchisme russe, par exemple, que certains tzaricides ont été littéralement députés ou désignés par le sort pour accomplir un geste libérateur désiré par la masse. En général, ces exécuteurs ont fait preuve d’une abnégation et d’un courage qui, dans son stoïcisme même, peut être traité de fanatisme, diagnostic du reste inexact et injuste.
Mariana, dans son ouvrage De Rege et Regis institutione (Du Roi et de la Royauté), autorise le meurtre d’un roi, usurpateur ou hérétique. Il est bon de rappeler qu’après le meurtre d’Henri IV par Ravaillac, ce livre fut condamné par le Parlement et brûlé en place de grève. Il y eut toujours des flatteurs, même parmi les gens de robe et des fanatiques à rebours. Le fétichisme de ce que j’appellerai volontiers les régicoles vaut celui des régicides. Cet antagonisme de pensée et de pratique qui oppose les fervents de la liberté aux tyrans explique suffisamment l’existence du régicide. Suffirait-il à l’excuser ? C’est un point de philosophie sociale et historique que je n’ai point à traiter.
Ce que je viens de dire n’a qu’un but : établir une nuance profonde entre les vrais régicides et ceux que certains auteurs (le docteur Régis, en particulier) appellent les faux régicides, que sont les précédents. Ils opèrent en vertu d’une raison politique ou religieuse, pour le triomphe d’un principe ou d’une idée, communs à plusieurs, légitimés à tort ou à raison par la logique des faits, c’est-à-dire par un grand duel, très inégal du reste, où succombe le meurtrier. On a pu penser que le meurtrier, conscient à priori de sa faiblesse, aurait dû arrêter sa main, puisqu’il était vaincu d’avance. D’autres auront pensé à l’inverse que, malgré la prévision d’un échec, la manifestation pouvait servir l’idée qui l’a fait naître et que pour ce motif le meurtrier doit figurer plutôt dans les rangs des martyrs que des fanatiques.
On verra, du reste, que parmi ces martyrs figurent souvent aussi des fanatiques, témoins de la foi, comme furent tant de chrétiens voués au cirque, chez qui une nuance d’exaltation circonstancielle, puisée dans l’influence du milieu, développait un singulier appétit de la mort.
Les vrais régicides sont différents. Si le résultat objectif de leur geste meurtrier ne varie point, les mobiles qui l’inspirent obligent à ranger les auteurs dans une catégorie morbide, d’un intérêt captivant, parce qu’elle va mettre aux prises des illuminés, autrement dit des déséquilibrés, avec cette autre folle criminelle, fanatisée, qu’est la foule, aveuglée par un état passionnel, aberrée par une justice distributive ignorante et à la dévotion servile, trop souvent, de la loi, autrement dit de la force.
Pendant que le faux régicide est le représentant moral, spontané ou élu, d’une idée ou d’un groupe, le vrai régicide est un isolé. Le déchaînement des partis induit en général le public et la presse en de fausses directions. La méconnaissance de ce genre d’aliénés qu’est le fou raisonnant fait que la foule répugne à concevoir qu’un régicide soit autre chose que l’exécuteur des hautes œuvres d’un parti, naturellement qualifié d’extrémiste, puisque, par définition, la vertu siège au juste milieu.
Le cas récent de Gorguloff en fut une triste illustration. L’histoire montrera sans peine que l’opinion, fortement et habilement déviée dans les voies politiques, fut vraiment responsable du supplice de ce fou.
Le régicide (le vrai, il ne sera plus question que de lui) opère pour son propre compte. Sans doute, il s’inspirera pour colorer sa décision criminelle des événements du temps présent, mais il ne faut pas s’y tromper : son acte est une violence prévue par principe et par définition, quel que soit le mobile, raisonné ou délirant, qui le dirige. Ce régicide tue pour tuer ; son acte est l’aboutissant fatal d’une chaîne d’opérations mentales qui l’entraîne plus ou moins vite à une distance souvent fort éloignée de l’idée première qui a déclenché toute la série des associations mentales consécutives. C’est un bel exemple de ce qu’on appelle le délire des actes, mode habituel chez les fous raisonnants, persécuteurs, processifs, batailleurs parce que paranoïaques, actes toujours disproportionnés d’avec les mobiles allégués par l’opérateur.
Le régicide commence par être un paranoïaque. Qu’est-ce à dire ? C’est un déséquilibré congénital enclin à des jugements faux sur les personnes comme sur les choses, toujours à côté de la vérité. Ses vues constamment unilatérales s’inspirent d’une vanité, d’un orgueil primordial qui l’entraînent à croire qu’il est doué de facultés supra humaines, à se croire incapable de se tromper. Par suite, il est exposé à souffrir des moindres obstacles qui heurtent sa marche en avant, je dis marche, car aller de l’avant est tout pour lui. Il agit d’abord et réfléchit ensuite, toujours trop tard. Comme tel, il souffre perpétuellement. C’est un persécuté par l’ambiance. Il est forcément porté à la haine, à la misanthropie et enclin aux réactions. Ses réactions, puisqu’il est un super actif par principe, empruntent la forme du réflexe, du talion, de la violence. C’est pour ce motif qu’il est un persécuteur. Il s’insurgera de plano contre toute autorité, même légitime ; en matière de vie banale, nous le trouverons processif, chicanier, revendicateur. Sur le terrain des idées, il ne sera pas moins combatif, autoritaire, tyran.
C’est parce qu’il est né pour l’action que ce déséquilibré armera sa main en vue du triomphe de sa cause, si grande ou si minuscule qu’elle soit. S’il lui advient d’être aussi un rêveur, un créateur de chimère où il s’incruste comme dans son cocon naturel, tout seul, sans complice ni amis, car il n’a point d’amis et ne songe guère à en réunir, il tentera de réaliser sa chimère par un coup d’éclat. L’acte régicide est au bout, lequel régicide aurait pu être un homicide d’une autre nature : affaire d’orientation des idées. Tout paranoïaque est candidat aux actes éclatants, scandaleux ou criminels. Ses actes sont en tension perpétuelle. Les circonstances seules les font aboutir.
Si l’on a compris cette base paranoïaque du régicide, il sera facile de concevoir que le paranoïaque, orgueilleux par définition, est un mégalomane à l’occasion. L’explosion d’une folie ambitieuse sur une telle base constitue la période finale. L’apothéose du paranoïaque est souvent un épanouissement de sa personne et, chose curieuse, elle ne sera pas indépendante de l’acte catalogué criminel, à l’inverse d’autres mégalomanes qui s’exhibent tout naturellement comme des êtres généreux, philanthropes et bénisseurs.
C’est que le paranoïaque, mégalomane, va continuer à bousculer les obstacles s’ils sont de nature à compromettre l’idée, la grande et sublime idée qui le grise au point qu’il en exige la réalisation.
J’ai connu, à Ville-Évrard, un fou qui faillit m’occire parce que j’étais, à ses yeux, l’obstacle vivant à la récupération du trône d’Allemagne qui lui appartenait, pensait-il, de par sa naissance. S’il m’eût tué, ce n’eût été qu’un homicide, mais si, en liberté, il eût tué Guillaume II, qui usurpait ses droits, il eût été un régicide. Ce souvenir clinique me dispense de raisonnements théoriques plus amples.
Le dernier des régicides fut l’assassin de Paul Doumer. Il fut un prototype du genre. Trois phases dans sa vie : paranoïaque persécuté par les circonstances politiques auxquelles il a été mêlé, comme tant d’autres, et par une foule d’événements qu’il a déclenchés par son comportement maladroit et mal éclairé. Puis, développement morbide d’une personnalité mégalomaniaque où il s’est représenté comme un prophète, un messie, un néo Christ chargé d’une mission divine pour sauver le monde. Finalement, acte désordonné et absurde de tuer une vedette symbolique pour laquelle il n’avait que du respect, mais parce que la politique générale et particulière de la France était un obstacle à l’expansion de sa généreuse idée, inspirée par Dieu.
Comme tel, il devait être un martyr et féconder son idée sublime avec son sang. Ce croyant, ce mystique était hanté par le souvenir classique de Jésus, mort sur la croix pour féconder sa doctrine. Gorguloff fut un isolé, cristallisé dans sa marotte ; la guillotine a entendu ses dernières prophéties : la fin d’un monde qui n’a point voulu épouser ses idées.
Dans cette forme de régicide intervient, à côté du délire, l’obsession, la discussion consciente entre l’acteur qui ne veut point tuer et l’autre partie de son moi qui lui crie : il faut tuer ! Un rien déclenchera le meurtre comme le grain de sable qui fera sauter toute une mécanique.
Le régicide est donc un mystique. Il peut aussi être halluciné quand il est capable de vivifier sa pensée et de la réaliser en la forme d’une voix conseillère. Gorguloff était écrivain, poète, un imaginatif. Comme son sosie Ravaillac, il entendait ses voix familières qui devaient substituer peu à peu leur autorité à la sienne. Et le meurtre est au bout, conclusion logique, stupéfiante pour le profane seul, qui n’est pas initié à un mécanisme psychique particulièrement délicat.
Que l’on évoque le souvenir des grands et petits régicides de l’histoire ; s’ils ne prennent pas rang parmi les pseudo régicides que j’ai dessinés à grands traits au début, ils sont des paranoïaques dans le genre de Gorguloff, l’exemple le plus systématisé que j’ai choisi parce qu’il est encore dans toutes les mémoires.
Mais il y a des sujets qui tiennent des deux groupes. Certains régicides, animés par une idée, une thèse, un moteur qui n’a en soi rien de délirant et qui, dans une large mesure même, est soutenable, finissent, quand ils se sont bien incorporés à cette billevesée, par en être intoxiqués. Ils perdent de vue toute mesure. Et, dans leur exaltation mystique de réalisateurs, ils s’assimilent aux délirants de tout à l’heure.
Ils se persuadent aisément qu’ils peuvent jouer un rôle de libérateurs. Ils sont pris de la folie du sacrifice, et dans cette folie accidentelle, il y a bien quelque chose de l’orgueil morbide du paranoïaque : il y a une énorme vanité à se mettre en vedette et à se tenir in petto pour un personnage que l’histoire inscrira au nombre des martyrs. De là leur attitude transfigurée au sein même des pires supplices. De là l’erreur où ils succombent et qu’ils éviteraient en concevant l’inutilité de leur sacrifice.
Que devait faire la société en face des régicides ? Rien d’autre sans doute que de prononcer des sanctions aussi cruelles qu’injustifiées. Sous l’Ancien régime, tuer un roi était commettre un crime de lèse-majesté. Le roi n’est pas un homme. Sa super fonction, acceptée servilement par les peuples, lui attirait un traitement de faveur qui, dans l’histoire, porte le nom de raison d’État. Raison peu raisonnable que la République a conservée pieusement.
Le coupable subissait les horreurs d’un supplice raffiné, celui que l’on réservait aux parricides. Le roi n’était-il pas le père du peuple, comme le colonel Ramollot est le père du régiment !
Le coupable était tenaillé vif avec des pinces portées au rouge ; ses plaies étaient abreuvées de plomb fondu, puis il était écartelé par quatre chevaux, en place de grève, non sans avoir fait amende honorable en costume de parricide. Le roi héritait des biens de la victime, petit bénéfice qui sent un peu trop le flibustier ; la famille du coupable était aussi châtiée et chassée du pays. Puis le peuple était admis à se partager les morceaux du supplicié. La foule bestiale découpa Ravaillac en petits cubes que les bons et honnêtes citoyens emportèrent à domicile et firent griller.
Ainsi furent traités Pierre Barrère, en 1593 ; J. Chatel, en 1594 ; Ravaillac, en 1610 ; Damiens, en 1757, etc.
Le dernier siècle n’a point démérité des précédents, car la loi du 10 janvier 1853 a encore qualifié le régicide de crime contre la sûreté intérieure de l’État, et le coupable est puni de la peine des parricides.
Les gens qui raisonnent opinent que le XXe siècle s’honorerait en détruisant les traces de telles horreurs humaines et en traitant les régicides en malades qu’ils sont. Un homme s’est rencontré à l’époque révolutionnaire, il s’appelait Pinel. Il eut la gloire d’élever le fou à la dignité de malade. Il en est cependant encore que l’on décapite. Pinel ne serait pas content.
— Dr LEGRAIN
RÉGIE
n. f. (du radical régir)
Ce terme sert à désigner l’administration chargée de la perception des impôts indirects, administration fréquemment impopulaire car ses exigences pèsent lourdement sur la classe pauvre. Mais, pris dans un sens plus général, ce mot s’applique à un procédé d’organisation des services publics de caractère économique. La régie consiste dans l’exploitation sous la responsabilité de l’administration et par ses fonctionnaires ; mais, tantôt la direction de l’entreprise est assurée par un office autonome, tantôt elle dépend des organes mêmes de l’administration dont elle relève. Dans le premier type se rangent les régies municipales de distribution électrique qui possèdent un conseil d’administration et un directeur choisis en dehors du conseil municipal. Au second type appartiennent les régies municipales, à caractère industriel ou commercial, placées sous l’autorité du maire et du conseil municipal.
On pourrait également trouver des exemples de ces deux types parmi les entreprises économiques qui dépendent de l’État ; et c’est aux fonctionnaires qui travaillent pour le compte de ces entreprises que l’on applique le plus communément l’épithète d’ouvriers ou d’employés de la régie.
Dans un autre ordre d’idées, on déclare que l’exécution des travaux publics a lieu en régie lorsqu’elle se fait sous la direction de l’administration. Cette régie est simple lorsque le travail est exécuté sous la direction d’un fonctionnaire rétribué par un traitement fixe et qui ne spécule pas sur le travail des ouvriers qu’il embauche. Elle est intéressée quand le directeur des travaux n’est pas un agent de l’administration, et qu’il touche une indemnité proportionnelle à la dépense ou participe aux bénéfices, tout en n’assumant que des risques limités. Lorsqu’elle est intéressée, la régie ne s’arrête généralement pas à l’installation d’une entreprise, mais elle s’étend encore à son exploitation.
Il arrive qu’un entrepreneur de travaux publics n’exécute pas ses engagements ; l’administration peut alors résilier purement et simplement le marché ; elle peut aussi organiser la mise en régie. Dans ce cas, un régisseur est substitué à l’entrepreneur et, aux risques et périls de ce dernier, il continue le travail commencé avec l’ancien personnel ouvrier et les matériaux précédemment réunis. La question de la régie pose le problème de l’État patron et du fonctionnarisme. Est-il bon que l’État devienne l’entrepreneur universel et que tous les ouvriers soient des fonctionnaires ? Cette solution plaît beaucoup aux socialistes et aux communistes autoritaires.
Pour notre part, nous n’admettons pas plus l’exploitation par l’État que l’exploitation par la classe capitaliste. Nous voulons supprimer le patronat ; tyrannie individuelle ou tyrannie collective nous répugnent pareillement. Les luttes soutenues par les fonctionnaires ces derniers temps, pour le maintien de leurs salaires, prouvent d’ailleurs que l’État use des mêmes procédés que les autres patrons.
RÉGIME
n. m. (du latin regimen : conduite, gouvernement)
Les sens du mot régime sont extrêmement nombreux. D’une façon générale, il désigne la manière de se comporter, de vivre, d’agir. On parle fréquemment de régime gouvernemental, économique, monastique, un régime alimentaire et thérapeutique, de régime légal, administratif, sanitaire, des prisons, etc. En botanique, un régime est un assemblage de fruits à l’extrémité d’un rameau. Les grammaires font de ce mot le synonyme de complément. Par Ancien Régime, on entend le gouvernement qui existait avant 1789 ; le régime dotal se ramène à une convention matrimoniale. Sans nous attarder à tous ces sens particuliers et sans entrer dans des explications données dans d’autres articles, nous devons dire que les anarchistes repoussent tout régime social qui ne repose pas sur la liberté. Ils ont en abomination le régime capitaliste qui encourage l’exploitation de l’homme par l’homme. Mais ils se dressent aussi contre toute oppression d’où qu’elle vienne ; et s’ils critiquent le régime soviétique de la Russie, c’est qu’il sacrifie complètement l’individu à l’omnipotence de l’État, c’est qu’il exige une obéissance aveugle et remplace les dogmes anciens par des dogmes nouveaux. À plus forte raison méprisent-ils les régimes pseudo démocratiques et républicains où le pouvoir appartient en fait à une oligarchie financière.
Toujours plus de bien-être pour les corps, toujours plus de lumière pour les intelligences, toujours plus d’indépendance pour les volontés, voilà ce que désirent les libertaires. Qu’on les écoute et l’on s’acheminera vers une cité d’amour dont tous les habitants seront frères. C’est vers cet idéal que doivent tendre leurs efforts. Dressés contre l’injustice, ils la dénoncent, quel que soit le régime en vigueur, quel que soit le parti au pouvoir ; voilà pourquoi, considérés comme des gêneurs indésirables par la gauche de même que par la droite, ils sont mal vus sous tous les gouvernements.
RÉGIONALISME
n. m. (du mot région)
Le régionalisme ne se confond ni avec l’autonomisme, ni avec le fédéralisme, mais il implique quelque chose de plus que la simple décentralisation administrative. Il demande la création de nouvelles divisions territoriales et un développement accru de la vie régionale dans tous les domaines. Les régionalistes se défendent de vouloir ressusciter les anciennes provinces ; et beaucoup protestent de leur affection pour la nation, de leur culte pour l’État. Jean Hennessy a déclaré :
« Nous ne voulons pas et nous n’avons jamais voulu restreindre la souveraineté nationale et attribuer aux habitants d’une seule parcelle du territoire français l’autonomie. La souveraineté française appartient à la nation tout entière, Nous ne voulons pas et nous n’avons jamais voulu porter la moindre atteinte à l’unité et à l’indivisibilité de la nation. Elles sont essentielles à la prospérité, à la sécurité et à la grandeur de la France. Nous ne comprenons même pas que certains Français puissent avoir des lois différentes de celles des autres, et nous voulons les lois égales pour tous. Mais nous ne voyons pas comment des circonscriptions administratives agrandies, substituées aux départements, ayant pour centres des villes qui s’imposent par leur situation géographique, circonscriptions rationnellement et légalement délimitées, porteraient atteinte à l’unité nationale. Nous ne voyons pas non plus comment une organisation meilleure du suffrage universel, mieux adaptée aux besoins économiques de la région, aurait pour effet de diminuer les droits du citoyen au vote. Nous croyons que l’État, qui est l’expression même de la souveraineté française, doit toujours détenir les pouvoirs de décision, mais que son autorité sur toutes les questions nationales sera d’autant mieux maintenue qu’il se sera déchargé sur des collectivités restreintes du souci d’affaires trop nombreuses ou trop pressantes, auxquelles, aujourd’hui, il a peine à faire face. »
Nous sommes loin, on le voit, de l’autonomisme et du fédéralisme. Certes, tous les régionalistes ne témoignent pas d’une platitude égale à celle d’Hennessy ; beaucoup, néanmoins, sont notoirement réactionnaires. Danser la bourrée ou le rigodon, se déguiser en bergers et en bergères, allumer des feux à la Saint-Jean, voilà en quoi consiste le régionalisme de certains. D’autres ont des idées plus ouvertes. Néanmoins, après avoir passé en revue toute la gamme des régionalismes en vogue, j’ai dû en imaginer un qui donne satisfaction aux tendances fondamentales de ma pensée. Depuis, j’ai constaté qu’il avait recruté de nombreux partisans.
Admirer ce qui est ancien, sans discernement parce qu’ancien, faire fi du moderne, tel est le credo essentiel des régionalistes que nous combattons. Avec fracas, ils prêchent le retour aux mœurs antiques, aux habitudes et traditions d’autrefois. Vivre dans le passé, sans souci du présent, se contenter de souvenirs, à tout propos parler d’histoire locale, leur semble l’idéal. Ils oublient qu’il existe un devenir inéluctable, et que le changement est la suprême loi de tout ce qui est humain. Convient-il au jeune homme de s’habiller comme un baby ou au vieillard chenu de se costumer en page ? De même, l’époque moderne ne saurait être à l’aise dans la défroque des âges enfuis. Ne transformons pas la province en nécropole, ni en musée pour antiquailles. Mme de Sévigné affectionnait son lent carrosse ; avec raison, nos contemporains préfèrent l’automobile. Gardons le souvenir de ceux qui ne sont plus ; demandons des leçons à l’histoire. Mais ne sacrifions ni l’esprit d’initiative, ni les aspirations vers le mieux matériel et moral. Que l’artiste et l’écrivain de la province comme de la capitale produisent du neuf, de l’original, sans se soucier de refaire sans fin ce qu’on faisait avant, ni d’imiter les vieux modèles éternellement. L’ancienne Chine n’a tiré que déboires de son culte exclusif du passé ; que les régionalistes, instruits par l’expérience, se défient de la routine et de la tradition ! Leur but ne doit être ni de refaire un chemin déjà parcouru, ni de piétiner sur place, mais d’avancer. Complexité et changement caractérisent tout ce qui vit ; n’érigeons point en idéal le froid silence du tombeau !
Autre question et nouveau différend. Chaque régionaliste doit-il borner ses préoccupations aux limites de sa province ? Par leur façon d’agir, beaucoup le laissent croire, même s’ils ne l’affirment point. Quel tollé, lorsqu’un Auvergnat s’avise de donner des conseils aux Flamands ! Vraie muraille de Chine, un particularisme aveugle isole chaque province, bien mieux, découpe en étroits lopins jusqu’au sol d’un même département. Malgré leur voisinage, quelle distance sépare Poligny d’Arbois ! D’incroyables jalousies mettent fréquemment aux prises villes et villages limitrophes. Et malheur au profane qui, d’aventure, chasse sur ces terres gardées ! Comme au pays de Lilliput, des nains l’entourent et le garrotent. S’en tenir à des querelles de clocher, s’imposer des œillères, réduire son horizon à l’étendue d’un arrondissement sans s’inquiéter des grands problèmes humains, voilà l’aboutissant d’un régionalisme trop rétréci. Pourtant, si Paris rayonne d’une vie sans cesse rajeunie, c’est parce qu’ouvert aux courants universels de la pensée. Son cosmopolitisme reste, avec l’amour de la nouveauté, l’un des éléments qui assurent son règne. Mais, s’il est vrai qu’il faut lutter contre un défaut en cultivant la vertu contraire, c’est son particularisme outrancier que ferait bien de vaincre la province, en devenant accueillante à tout progrès. Éveiller bourgs et campagnes à la vie de l’esprit, élever progressivement leur niveau intellectuel vaudrait mieux qu’accabler la ville Lumière d’impuissantes malédictions.
Reconnaissons toutefois que les régionalistes voient se dresser contre eux le formidable appareil d’un gouvernement follement centralisateur. Dans les administrations, passer d’une ville plus petite dans une plus grande, pour aboutir à la capitale, voilà l’unique mode d’avancement. Aux Parisiens sont réservés les grasses prébendes et les suprêmes honneurs. Périodiquement, l’on écrème le reste du pays de ses éléments les meilleurs ou les plus remuants ; et, du même coup, l’on jette la défiance sur les hommes de talent qui se refusent à émigrer sur les bords de la Seine. Moyen commode de rendre les échines souples et de semer la division. Dans ce piège, le provincial donne tête basse, car, malgré son dépit fréquent, il vénère le Parisien à l’égal d’un dieu. Persuadez ce naïf qu’on peut être un sot et habiter la capitale ! À son avis, vos beaux discours prouveront que vous êtes un jaloux ou bien une tête sans cervelle. Et il admettra malaisément qu’on puisse avoir de l’esprit loin de Montmartre ou du quartier Latin. L’habitat, chez nous, en impose non moins que le diplôme ; on juge l’homme simplement d’après son plumage. « Il est des Vosges ! », redit l’écho des boutiques à papier de la Saintonge comme de la Seine, lorsqu’y parvient ma prose. Et l’on ne se gêne pas avec ce rustre des montagnes. Peut-être même la presse régionale est-elle pire, pour l’écrivain provincial, que celle de Paris. Et, s’il émerge malgré tout, quelle jalousie chez les muses départementales, quel dédain chez les notables, quels savants coups d’épingle de la part d’autorités qui toisent de haut cet administré gênant ! Et qu’il ne se rabatte pas sur les académies locales, vénérables ossuaires où des réactionnaires chenus se passionnent pour les morts, mais se désintéressent des vivants ! On s’y fige dans l’admiration du site ou des traditions provinciales ; arrière tout ce qui ne possède point la patine du temps !
La province fut toujours une pépinière d’écrivains célèbres. Elle les forma souvent, mais ne les garda presque jamais. À l’âge adulte, et sentant croître leurs ailes, ses fils ingrats la quittèrent pour le doux climat de Paris. Quoi d’étonnant, diront certains. Pour un auteur, quel silence s’il s’édite à Paimpol, quel tintamarre s’il se vend à Paris ! La capitale s’est réservée, chez nous, le monopole du bruit comme du pouvoir. Qui dira les tribulations du malheureux écrivain fidèle à son pays ? Et quel scandale, quelles clameurs s’i1 s’avise d’être audacieux ou véridique ! Ce que l’on approuve chez un Parisien devient inadmissible chez un provincial. Et l’on s’étonne que les écrivains quittent la province ! Rendons-là habitable pour qu’y puissent demeurer les artisans de la pensée. D’abord, il conviendrait d’assainir une atmosphère empoisonnée par la sottise, l’envie, la rancune et la médisance. De plus, que gagnerons-nous à substituer la toute-puissance de quelques grandes villes à celle de Paris ? Nous perdrons au change, s’il est vrai qu’un tyran éloigné vaut mieux qu’un tyran proche. Une fraternelle collaboration de tous les centres, étrangère à nos mesquines hiérarchies, et qui favorise l’ascension de tous vers plus de bien-être matériel et de dignité morale, voilà le seul régionalisme que nous approuvions.
Depuis que les autonomistes alsaciens et bretons ont encouru les foudres de nos grands patriotes, le régionalisme, autrefois fort à la mode, est devenu suspect à beaucoup. Pour moi, si je me suis intéressé à la vie provinciale, c’est dans l’espoir d’ébranler un peu la tyrannie étatiste et de contribuer à la libération intellectuelle des pauvres gens qui m’entouraient. Ayant vécu longtemps à Paris, je ne me range point parmi ses détracteurs. Partout, il est en but à la malveillance des autorités, celui qui veut rester indépendant ; et, partout, il rencontre des frères qui ont besoin d’être aidés.
— L. BARBEDETTE.
RÉGRESSION
n. f. (du radical regredior, rétrograder)
En langage biologique et pathologique, la régression désigne le retour partiel ou total de l’organisme à une phase de son existence antérieure. En sciences naturelles, les observateurs s’attachent même particulièrement à l’étude des faits de ce genre qui s’avèrent d’une grande importance pour la bonne compréhension des doctrines évolutionnistes. Lamarck, qui lui attribue un rôle capital, l’explique, d’une façon générale, par le non-usage des organes.
« Le défaut d’emploi d’un organe, écrit-il, devenu constant par les habitudes qu’on a prises, appauvrit graduellement cet organe et finit par le faire disparaître et même l’anéantir. »
À l’inverse « l’emploi fréquent d’un organe augmente les facultés de cet organe, le développe lui-même et lui fait acquérir des dimensions et une force d’action qu’il na point dans les animaux qui l’exercent moins. » Dans l’ordre psychologique, le phénomène de régression s’observe aussi couramment. Alors que la répétition rend les habitudes mentales de plus en plus fortes, l’absence prolongée de satisfaction, le manque d’activité peuvent déterminer une régression très marquée des habitudes et même provoquer leur disparition totale. Celui qui n’exerce jamais son jugement, sa mémoire, son attention est finalement victime d’une obnubilation intellectuelle qui peut le conduire à un complet abrutissement. Celui qui ne s’habitue pas à rester ferme dans ses décisions devient, à la longue, incapable de vouloir, d’une façon sérieuse et durable. Quand il s’agit des maladies mentales, les phénomènes de régression acquièrent une signification particulièrement importante ; ce sont, pour l’aliéniste, des indices capables de l’éclairer sur la marche des troubles qui suivront.
En elle-même, la régression n’est ni bonne ni mauvaise ; elle le devient seulement en fonction des conséquences qu’elle provoque, du terme où elle aboutit. La disparition d’une mauvaise habitude est excellente ; l’affaiblissement de l’attention ou de la mémoire est, par contre, indésirable. Lorsqu’on parle de régression dans l’ordre biologique ou mental, il importe donc de préciser. Même dans l’ordre social, il existe des régressions heureuses ; la disparition progressive de l’alcoolisme serait à ranger dans cette catégorie. Néanmoins, le mot régression possède généralement un sens péjoratif dans le domaine politique ou économique ; il désigne un retour à des formes d’existence inférieures et pénibles ; il est synonyme de déchéance. De ces retours vers un passé néfaste, l’histoire nous offre de nombreux exemples ; les périodes régressives arrivent même fréquemment à la suite des mouvements révolutionnaires.
« Rarement ceux qui profitent des révolutions sont ceux qui les font. En 1793, le peuple tira les marrons du feu et la bourgeoisie les croqua ; les barricades de 1830 favorisèrent surtout Louis-Philippe ; celles de 1848 Napoléon Ier. Des troubles suscités par des besoins profonds n’aboutirent qu’au changement de l’équipe gouvernementale ; l’argent prima l’hérédité, désormais la fortune, plus que la noblesse, permit l’accès du pouvoir. Mais le travailleur fut grugé par ses nouveaux comme par ses anciens maîtres ; son sort resta misérable, que l’empire succédât à la monarchie ou la république à l’empire. Toujours les aristocraties se montrent expertes dans l’art de canaliser à leur profit les mouvements révolutionnaires : les traditions païennes des nobles romains corrompirent, jusqu’à la moelle, le christianisme vainqueur, et nos modernes démocraties sont déjà confisquées par une nouvelle féodalité financière. Stratèges de l’intrigue et magiciens du verbe adaptent leur phraséologie au goût de l’heure ; avant la lutte, ils flattent les pires instincts populaires et leur main s’ouvre, prodigue de promesses insensées. Le triomphe assuré, les chefs pourvus, personne n’accepte de solder le troupier meurtri. » (Le Règne de l’Envie)
On peut assurer qu’à l’heure actuelle, en France, nous sommes en pleine régression. Prêtres, généraux, capitalistes manœuvrent à leur guise parlementaires et ministres, qu’ils soient de gauche, de droite ou du centre. De plus, journaux, revues, hebdomadaires, toute notre grande presse n’est qu’un vaste étouffoir, une vaste entreprise de mensonge. Il est presque impossible d’atteindre le peuple et de lui dire la vérité.
Dans l’ensemble du monde contemporain, l’idéal libertaire subit, d’ailleurs, une éclipse fâcheuse. Partout, on prône les dictatures et les gouvernements forts ; communistes et socialistes autoritaires sont d’accord sur ce point avec les hitlériens et les fascistes. On fait de l’obéissance aux ordres des chefs le premier devoir du citoyen. Et l’on affecte de croire que l’anarchie c’est l’incohérence et le chaos ; même dans les milieux les plus avancés, ces idées sont courantes. Aussi nos contemporains se détournent-ils de doctrines qu’ils supposent purement négatives et incapables de fournir une base constructive sérieuse. Pourtant L. Barbedette a montré que la liberté la plus complète n’implique nullement l’incohérence et l’absence d’organisation, et que la raison vaut mieux que la contrainte pour engendrer l’harmonie. La science véritable exclut rigoureusement toute intrusion du principe d’autorité ; elle ne se soumet qu’à l’expérience et à la raison. Néanmoins, elle s’avère féconde en résultats pratiques et en conséquences heureuses lorsqu’elle est bien dirigée. Des œuvres merveilleuses seront possibles quand l’amour se surajoutera à la liberté. Notre idéal peut subir une régression passagère ; finalement, il s’imposera parce qu’il répond à d’indestructibles besoins du cœur et de l’esprit.
RELATIVITÉ, RELATIF
subst. et adj.
Chasser l’idée d’absolu, si chère à la pensée théologique et métaphysique, pour lui substituer celle de relativité, voilà un travail urgent pour le philosophe et le savant contemporain. L’absolu désigne ce qui est en soi et par soi, ce qui se suffit pleinement. Le relatif, au contraire, ne peut se suffire à lui-même, qu’il s’agisse d’existence ou d’intelligibilité ; il a besoin de réalités étrangères à lui, distinctes de lui, mais avec lesquelles il supporte des rapports. Centrale dans les systèmes de Platon et d’Aristote, la notion d’absolu était déjà combattue, chez les Grecs, par Protagoras : « L’homme, déclarait-il, est la mesure des choses, de ce qu’elles sont, dans la mesure où elles sont, de ce qu’elles ne sont pas, dans la limite où elles ne sont pas. » Les pyrrhoniens s’inspirèrent également de cette idée. Au XIXe siècle, Hamilton devait adresser des critiques fameuses au concept d’absolu. Penser, déclarait-il, c’est conditionner, puisque toute pensée établit une relation ; la loi de relativité constitue l’ossature de l’intelligence. Penser l’absolu s’avère donc impossible, car ce serait conditionner l’inconditionnel et rendre relatif ce prétendu absolu. Mais c’est Kant qui, précédemment, avait donné des bases solides et durables à l’idée de relativité. Pour lui, toute connaissance est relative parce qu’elle dépend des lois de l’esprit qui l’organise. « On avait admis jusqu’ici, dit-il, que toutes nos connaissances devaient se régler sur les objets ; que l’on cherche une fois si nous ne serions pas plus heureux, en supposant que les objets se règlent sur nos connaissances. » À l’inverse des dogmatiques, qui cherchent dans des réalités extérieures la raison des lois de la pensée, il trouve dans la pensée l’explication des lois qui régissent le réel. Nous ne reviendrons pas sur ce système exposé précédemment. (Voir article Kant.)
Disons néanmoins que, transposant le subjectivisme du plan psychologique dans le plan physiologique, biologistes et physiciens ont démontré que les sensations en quoi se résout notre perception du monde extérieur, comme aussi les sensations internes, sont relatives à la constitution de notre organisme. Si nos yeux, nos oreilles étaient constitués différemment, les données visuelles et auditives perçues par nous seraient autres que celles que nous percevons. Lentement, la notion de relativité a pénétré dans toutes les branches du savoir humain ; et partout elle s’est révélée féconde en résultats heureux. En mathématiques, en physique, elle a servi de point de départ à des travaux du plus haut intérêt. Einstein s’est appliqué à étendre à la physique le principe de relativité déjà admis en mécanique. De ce qu’aucune expérience ne saurait déceler le mouvement de translation uniforme d’un système, il a conclu, dans la doctrine de relativité restreinte, que les lois des phénomènes physiques demeurent les mêmes pour différents groupes d’observateurs, en mouvement de translation uniforme les uns par rapport aux autres ; dans sa doctrine de relativité généralisée, il a étendu ce principe aux mouvements accélérés et à la gravitation. (Pour l’exposé des idées d’Einstein, voir l’article Mouvement.)
Et la notion de relativité, si féconde dans l’ordre scientifique, suffit encore, pense L. Barbedette, à expliquer une foule de phénomènes moraux, sans cela incompréhensibles. En éthique, elle doit nous guider constamment et rend parfaitement intelligibles des concepts aussi obscurs que ceux de la liberté et du bonheur. « Toujours, la causalité intellectuelle provoque le sentiment de liberté, comme, dans le monde extérieur, les ondes sonores engendrent des sensations auditives, les vibrations lumineuses des impressions colorées... Pas plus que ne sont mensongères les sensations provoquées par les objets extérieurs, le sentiment de liberté n’est illusoire ; il a, comme elles, une valeur symbolique et relative. Pour le mieux comprendre, il faut pousser plus loin, jusqu’à sa cause productrice, l’activité volontaire. Ce n’est point en dissertant sur les nuances qualitatives du rouge ou du bleu que le physicien arrive à les expliquer ; il les rattache à des vibrations quantitatives qui les engendrent sans leur ressembler. Comme les couleurs dépendent et du nerf optique et de l’excitant lumineux, la liberté, subjective apparence, s’avère un compromis entre le conscient et l’inconscient. » (Vouloir et Destin.) La liberté n’implique donc pas commencement absolu, pouvoir créateur de la volonté, comme le supposent les partisans du libre arbitre, mais elle répond à ce fait qu’en pratique l’homme parvient à modifier la trame des causes et des effets, dont le déroulement constitue et sa propre vie et le devenir de l’univers qui l’environne.
Le bonheur n’a rien d’absolu, lui non plus, il dépend de conditions multiples et variables.
« Source d’erreurs innombrables, prêtant, à tout, une nuance ou des formes illusoires, le prisme métaphysique et social fige en un bonheur abstrait nos joies fugitives et changeantes, il schématise et appauvrit nos plaisirs hétérogènes et multiformes. Pour un chimérique espoir, fruit de rêveries collectives, nous dédaignons les bonheurs passagers qui s’offrent ; pour une déesse inexistante, nous effeuillons les pétales des plus divines fleurs. Pourtant, ce bonheur solidifié, d’une immutabilité choquante, si on l’offrait aux vivants, qui d’entre eux ne s’en détournerait ? Il semble tellement fait pour les morts ; du sommeil éternel, il est une si manifeste image ! Dans l’ordre moral, comme en politique, c’est une trompeuse erreur de vouloir tout réduire à l’unité... Avec le désir et l’idéal s’individualisent, en se diversifiant, les joies suprêmes de chacun ; ne croyons pas à un bonheur unique, stéréotypé, il en existe de multiples et d’irréductibles aux formules toutes faites léguées par nos ancêtres. »
Rien d’absolu dans le bonheur humain, il est tout relatif et ne peut être que relatif.
« La nature est sans cesse en travail, et nos besoins renaissent, toujours nouveaux ; un devenir éternel préside à l’écoulement des pensées comme des choses. Ce qui charmait hier déplaît aujourd’hui ; l’adolescent ne comprend plus les passe-temps du bambin, et l’action de l’homme mûr s’accorde mal avec le calme tant chéri des vieillards. Des nuages épais suffisent à assombrir l’âme du poète, de lumineux rayons à l’ensoleiller. Et combien rare est la consonance entre aptitudes et situations : le forgeron voudrait être boulanger, le boulanger forgeron, le citadin adore la campagne et le campagnard la ville. » (À la Recherche du Bonheur)
Or, puisque l’éthique n’est que l’art de vivre heureux, il en résulte qu’elle doit s’imprégner au plus haut degré de la notion de relativité. L’erreur commise par les moralistes chrétiens, qui offraient leur céleste béatitude pour le lendemain de la mort, ne doit pas être renouvelée par les penseurs rationalistes. Dédaignant l’absolu chimérique des théologiens, ils ont à se préoccuper de la vie présente seulement.
Même en ce qui concerne les besoins physiques, il convient de bannir les affirmations trop absolues qui ne tiennent pas compte de la prodigieuse complexité du réel. « Des théoriciens, bien intentionnés, je n’en doute pas, se montrent trop absolus dans leurs conclusions. Partis d’un principe bon en lui-même, ils en tirent des conséquences extrêmes qui ne cadrent aucunement avec les nécessités pratiques. Alors que la réalité s’avère d’une complication extrême et qu’il faut, dans les sciences de la nature, demander à l’expérience de prononcer en dernier ressort, ces constructeurs de systèmes légifèrent dans l’abstrait et multiplient les déductions avec une logique dont l’apparente rigidité cache d’irrémédiables faiblesses. Trop nombreux sont les facteurs qui interviennent, trop divers les tempéraments pour qu’il ne soit pas indispensable d’individualiser le régime alimentaire, par exemple. Ce qui convient dans tel cas pathologique est contre-indiqué dans tel autre ; l’homme vigoureux et solide n’a pas les mêmes précautions à prendre que l’homme mal portant ; à celui qui fournit un gros effort physique, il faut une nourriture plus abondante qu’à celui qui travaille seulement du cerveau : l’enfant a des besoins différents de ceux de l’adulte. Défendu, quand on souffre de certains troubles, le café, dans d’autres cas, est un adjuvant utile ; selon les circonstances et les tempéraments, une totale privation de viande produira des effets opposés. Chaleur et froid excessifs ont aussi une grande influence ; impossible de se comporter d’une façon identique au Sénégal et au Groenland. Dans une contrée où l’on trouve, en toutes saisons, fruits et légumes frais, où le maintien de l’organisme à la température normale requiert peu de combustible, par suite du climat, le menu habituel ne saurait être le même que dans les régions éternellement glacées, dont la végétation n’offre que des ressources très précaires. Lorsqu’ils se querellent, les réformateurs peuvent avoir également raison, mais dans une mesure limitée : ils supposent, indûment, valable pour tous ce qui ne convient qu’à certaines personnes. Partis d’observations exactes, ils aboutissent à des conclusions trop générales. » (L’Incomparable Guide.) Dans les divers domaines où les faits dépendent du vouloir humain, le concept de relativité, pense L. Barbedette, suffit à éliminer bien des discussions accessoires et parvient même à concilier certaines doctrines, en apparence opposées. Il introduit aussi dans les discussions, et dans le comportement quotidien, plus de bienveillance à l’égard de ceux qui, sans avoir nos idées, s’efforcent néanmoins de bien agir et de voir clair.
RELIGION
n. f.
Il y a seulement un quinzaine d’années, écrire un article pour prouver l’inutilité de la religion eût semblé vouloir enfoncer une porte ouverte. Certes, il y avait encore bien des gens qui croyaient et fréquentaient les églises ; mais les gens qui lisent ne croyaient plus. La guerre qui a été pour toute l’Europe, au point de vue intellectuel, un élément de recul, a marqué un retour à la religion dans les classes cultivées. Alors qu’un savant eût rougi d’avouer qu’il pratiquait une religion, aujourd’hui nombre de professeurs de facultés se déclarent ouvertement catholiques. Les littérateurs trouvent original de mettre la religion dans leurs romans.
Dans tout cela, il y a beaucoup d’affectation. La religion, surtout la religion catholique, est, avant toute chose, un parti réactionnaire, et les intellectuels tiennent à se mettre du côté des riches, c’est-à-dire de ceux qui achètent les livres, qui peuvent créer les célébrités.
Mais, outre ce mouvement intéressé, il y a, à n’en pas douter, une religiosité sincère. Je n’en veux pour preuve que cette floraison de sectes mystiques que nous subissons : théosophie, spiritisme, occultisme, antoinisme, « christian scientisme », etc. Toutes ces religions sont aussi des partis réactionnaires ; mais cela n’apparaît pas d’emblée comme dans le catholicisme romain. Beaucoup de gens y adhèrent sans aucun souci politique, par simple besoin religieux.
L’esprit religieux est l’apanage de l’humanité. Nous ne savons pas, évidemment, ce qui se passe dans la tête des chiens, des chats, des singes et autres animaux. Peut-être croient-ils en un être supérieur et lui adressent-ils des prières ? Néanmoins, nous ne les voyons pas se grouper pour prier.
L’homme sauvage lui-même n’a pour religion qu’un rudimentaire spiritisme. La mort, c’est-à-dire la disparition de la personnalité, lui semble impossible ; il pense que les esprits des trépassés continuent à s’occuper des vivants pour leur bien ou pour leur mal. Plus tard, on adore un totem, c’est-à-dire un animal ou une plante que l’on donne comme ancêtre à un clan.
La religion grandit avec l’humanité, ce qui prouve bien que, essentiellement humaine, elle n’a rien de divin.
Les grandes religions sont, avant tout, des morales. Les dix commandements, en dehors des deux premiers qui règlent les rapports avec la divinité, sont des restrictions morales : « Tu ne tueras point », « Tu ne voleras point », « Tu ne commettras point d’adultère », etc. L’humanité primitive éprouve le besoin de tirer du ciel sa morale, afin de lui donner plus d’autorité. Ce qui vient de l’homme peut être transgressé par l’homme. La puissance humaine est limitée ; les hommes peuvent vous torturer et vous tuer si vous allez contre leur volonté ; mais on s’imagine que le pouvoir divin, plus mystérieux, doit être infiniment plus terrible. Dostoïevski, alors qu’il était au bagne, vit un jour ses compagnons se moquer de l’un d’entre eux parce qu’il était à l’agonie. « Vous n’avez donc pas peur de Dieu ! », leur dit l’écrivain russe. Et ces hommes, blasés sur les châtiments humains, cessèrent de narguer le moribond : l’évocation des peines de l’au-delà les trouvait encore sensibles.
L’humanité ne serait pas ce qu’elle est si son dieu était un dieu de justice et ne donnait des ordres que pour le bien de tous les hommes. Chacun veut prendre Dieu pour complice de son égoïsme et ce sont naturellement les puissants qui réussissent à l’avoir avec eux. Dieu ordonne d’obéir au roi et aux grands, Dieu ordonne à la femme d’obéir à l’homme. Revenant sur sa défense de l’homicide, Dieu ordonne de faire la guerre et de tuer, pour accroître la puissance d’un monarque.
Les religions reflètent les mœurs du temps et du lieu où elles se développent. Il n’en saurait être autrement car leurs fondateurs, alors même qu’ils innovent en quelque matière, restent pour l’ensemble de leur personnalité le produit de la société où ils vivent. L’islamisme, religion sensuelle, avec son paradis plein de houris dont la virginité renaît éternellement pour le plaisir du sexe mâle, convient bien à l’Oriental. Le catholicisme, avec ses statues, ses images, ses saints nombreux spécialisés dans leurs interventions, avec ses cérémonies pompeuses, convient aux peuples latins. Le protestantisme, plus froid, plus philosophique, convient aux peuples du Nord.
La religion console de la mort dans une certaine mesure. L’inquiétude humaine, au nom de laquelle le père Samson voudrait nous ramener au catholicisme, est une réalité. Tout ce que les hommes ont pu faire contre la mort, c’est de n’y pas penser, a dit Pascal. C’est ce que font, heureusement pour eux, la généralité des hommes ; seuls, les malades et les vieillards pensent à la mort.
Pour que la religion réussisse à vaincre la crainte de la mort, il faut que la foi soit très grande. Sainte Thérèse désirait la mort :
« Je me meurs de ne point mourir. »
Mais rares sont les personnes susceptibles d’une telle foi ; il faut une mentalité spéciale, qui est très rare et même anormale. Celui qui croit avec une telle force n’a pas autre chose à faire qu’à s’enfermer dans un cloître et à y attendre, dans la prière et les macérations, que la mort vienne enfin le délivrer de la prison terrestre.
Si une telle conception devenait générale, c’est la civilisation entière qui sombrerait. À quoi bon le progrès si la vie n’a aucune importance ; à quoi bon la science ; tout ce qui est terrestre n’est-il pas entaché d’erreur ? Et ainsi pensait le Moyen Âge ; ses érudits, au lieu d’observer la nature, se plongeaient, leur vie entière, dans la lecture des livres saints ; et la civilisation progressa très peu. Le progrès ne se déclencha subitement qu’au XVIIIe siècle, lorsque les esprits commencèrent à s’affranchir de la religion.
Si la religion ne détruit pas complètement la vie, c’est parce que la majorité n’y croit pas sérieusement. La vie est la plus forte, et la religion est reléguée à ses heures et à sa place ; elle ne réussit qu’à la condition de ne demander qu’une petite partie de l’existence. Le pénitent, après l’absolution, recommence son péché, et la confession n’est qu’une manière de blanchissage périodique. S’il croyait vraiment, il ne pécherait plus ; de même qu’il se garde de sauter dans un fleuve, de se laisser choir d’un lieu élevé, de même il se garderait du péché mortel, bien autrement dangereux que l’accident terrestre.
Le Moyen Âge croyait cependant. Jeanne d’Arc entendait des voix ; nombre de gens voyaient le diable dont ils avaient peur. Mais la religion n’était guère plus qu’une doctrine dont on prend et on laisse, suivant les nécessités de l’existence.
Réduite à ces proportions modestes, la religion réussit à atténuer un peu la crainte de la mort. La mort est loin, pour la plupart des hommes ; du moins, ils la croient telle et n’y pensent pas. La croyance en une vie future vient encore en atténuer le souci ; le croyant se dit que la mort n’est qu’un passage à une autre vie et que Dieu, qui est très bon, ne manquera pas de lui pardonner ses fautes.
Si la mort est proche, la religion perd de son pouvoir. La réalité, c’est-à-dire la vie qui nous quitte, s’impose avec toute sa force ; le croyant tremble comme l’incrédule ; et les consolations religieuses, tout à fait hors de proportions avec le danger, sont comme un cataplasme sur un cancer.
On vante volontiers l’influence de la religion sur la morale. Des gens vous assurent que, s’ils venaient à perdre la foi, ils se feraient immédiatement voleurs et assassins pour pouvoir jouir le plus possible de cette vie éphémère. Ce sont là paroles en l’air. N’est pas voleur et assassin qui veut ; il y a les circonstances. Celui qui est dans la société à une place stable, qui se crée une vie aisée, même en travaillant, n’a nulle envie de se mettre hors la loi en vue de l’acquisition plus que problématique de la grande fortune. C’est la société et non la morale, même basée sur la religion, qui organise la sécurité.
Au Moyen Âge, où la foi était reine, la religion n’empêchait pas la criminalité ; elle ne réussissait que dans une mesure très limitée à atténuer la violence des mœurs. Les criminels eux-mêmes croyaient ; ils allaient se confesser, et cela ne les empêchait pas de recommencer. En Italie, le bandit priait Dieu de lui faire réussir ses coups ; la prostituée suppliait la Vierge de lui envoyer beaucoup de clients.
Toutes les religions prêchent la bonté ; et, cependant, les gens religieux, loin d’être meilleurs, sont souvent pires que les athées. Le haut clergé est agité d’ambitions au même titre que les hommes politiques qui n’ont aucune croyance. Les gens dévots, loin d’appliquer les préceptes de douceur enseignés par le Christ, sont, en général, très méchants. Les habitués des églises ne se gênent pas pour médire, calomnier, nuire de toute manière au prochain, même croyant.
« Tant de fiel peut-il entrer dans l’âme des dévots ? »
Nombre de dévots sont avares, affreusement égoïstes : tous sont hypocrites, et on peut dire que les religions ont pour principal effet, non de rendre les gens meilleurs, mais d’en faire des hypocrites. L’incroyant est franchement égoïste ; le croyant se croit obligé, pour masquer son égoïsme, de ruser avec sa foi.
La religion a fait peu de bien et, en revanche, elle a fait, et fait encore, beaucoup de mal. On ne peut pas dire que le christianisme a apporté la civilisation. La civilisation gréco-romaine était beaucoup plus avancée que le féodalisme du Moyen Âge. La preuve en est que c’est dans les écrits des Grecs et des Latins que les savants du Moyen Âge puisaient leurs connaissances. En Russie, la religion orthodoxe a dominé exclusivement pendant deux mille ans, et le moujik est resté à demi sauvage, illettré, effroyablement ivrogne.
Lorsqu’une religion est puissante, son clergé, non content de rester dans son domaine spirituel, prétend au rôle de chef des peuples. Il veut imposer sa conception de la vie et, au besoin, l’imposer par la force. Le pape, au Moyen Âge, disputait à l’empereur la toute-puissance temporelle. Le bras séculier, c’est-à-dire les forces coercitives de l’État, servait à l’Église pour punir de prison et de mort les non conformistes.
La philosophie était considérée comme la servante de la théologie (ancilla theologiae), disait orgueilleusement un père de l’Église. L’esprit humain avait une entrave ; lorsque l’on émettait une théorie, il fallait se demander, non pas si elle pouvait être vraie, mais si elle ne contredisait pas le dogme. L’auteur, assez audacieux pour contredire le dogme, voyait ses ouvrages brûlés solennellement en place publique par la main du bourreau ; on confisquait ses biens ; on le mettait en prison ; parfois, on le brûlait lui-même avec ses livres.
Les demi folles coupables de sorcellerie, qui allaient, en rêve sans doute, au sabbat, à cheval sur un balai pour embrasser le diable au derrière, étaient emprisonnées et torturées. Dans les affres de la torture, on leur faisait avouer tout ce qu’on voulait ; on leur imputait la mort de gens décédés naturellement de maladies. Parfaitement innocentes, ces femmes et des hommes aussi, car il y avait des sorciers, étaient voués à une mort violente et cruelle.
Lorsque l’on reproche aux catholiques les crimes de l’Inquisition, ils s’en défendent en alléguant les mœurs violentes du temps. Le rôle de la religion avec ses préceptes de bonté et de douceur n’était-il pas de s’élever contre toute violence. Loin de le faire, elle exerçait elle-même la terreur, contredisant ainsi formellement sa doctrine.
De même que le pape se considère comme le maître du monde chrétien, le curé de campagne se considère comme le chef du village. Non content de dire ses offices, de confesser et de prier, il veut diriger la vie des habitants. Il entre dans les maisons, s’informe, donne des conseils qui sont parfois des ordres. Si une personne a mal agi à ses yeux, il expose le fait dans son prône du dimanche ; l’inculpé est voué au scandale public, et, pour ne pas être boycotté, il doit se soumettre à la volonté du prêtre. Encore aujourd’hui, la religion, reléguée dans son domaine à la ville, est toute-puissante au village. Aux grandes fêtes, la procession parcourt les rues : malheur à qui ne la suit pas ; celui qui oserait ne pas se découvrir ou s’incliner devant elle encourrait les sévices des processionnaires.
Le curé est plus instruit que ses paroissiens, et cela semblerait justifier son pouvoir. Mais sa culture toute spéciale, et en dehors des exigences de la vie moderne, fait que, loin de servir le progrès, il lui est, au contraire, un obstacle. Le curé ne donne aucun conseil d’hygiène ; là où il domine depuis des siècles, on croupit dans le purin et l’ordure. Loin de combattre la malpropreté, il la favorise, parce qu’elle est conforme à la tradition. Laver les rues, c’est déjà s’affranchir, et le prêtre ne veut pas que le villageois s’affranchisse.
Là où l’on parle patois, le curé s’oppose à la diffusion du français. « Parle la langue de ta mère ! », disait un curé de Bretagne à une paysanne qui se confessait en français.
En face du curé, la République a placé l’instituteur laïc ; c’est quelque chose, mais c’est peu. Le curé dirige ses paroissiens durant toute leur vie ; le pouvoir de l’instituteur est borné à l’enfance. Il n’ose pas entrer en conflit avec le curé ; pauvre petit fonctionnaire ; il sait que l’administration le soutiendra mal et qu’en fin de compte, c’est lui qui devra céder.
L’école n’est pas une force suffisante de progrès. Dans chaque bourg, il faudrait créer un établissement qui serait à la fois université populaire, salle de fêtes et petit hôpital. Là, deux ou trois fonctionnaires, pourvus de culture intellectuelle supérieure, seraient chargés d’aiguiller la vie locale dans les voies du progrès. Un service d’hygiène publique entretiendrait la propreté des rues. Un massif de fleurs ornerait la place des villages, avec quelques bancs autour pour permettre de se reposer en les regardant ; les fleurs affinent l’esprit. Des fêtes, des concerts fréquents attireraient la population ; des conférences théoriques et pratiques, le cinéma élèveraient son niveau intellectuel.
La religion est une entrave ; elle empêche le développement de la vie ; il faut la supprimer.
Les juifs pratiquants ont tous les instants de leur vie jugulés par la religion. Ils ne peuvent manger de viande que si l’animal a été tué de façon rituelle (kascher) ; le samedi, défense de toucher à rien, on ne peut même pas allumer une lampe, prendre un omnibus. Le baptême juif est une opération chirurgicale barbare, qui n’a aucune raison d’être. Parmi toutes les pratiques du judaïsme, certaines sont des mesures d’hygiène qui avaient leur utilité autrefois ; mais aujourd’hui, l’hygiène se fait autrement et beaucoup mieux.
Les juifs, cependant, tiennent à leur religion ; des hommes cultivés, savants, écrivains, etc., ne manqueront pas de faire circoncire leur fils sous prétexte que leurs ancêtres ont été persécutés jadis, qu’ils le sont encore dans certains pays et qu’on ne doit pas trahir les siens.
Tout cela est dénué de sens ; ce n’est pas parce qu’on se coupe un morceau de peau qu’on est solidaire avec certaines gens ; on peut parfaitement pratiquer la solidarité sans se rien couper. La circoncision pouvait avoir sa raison au temps où on ne se lavait pas ; aujourd’hui, elle n’en a aucune, et ce n’est, au fond, qu’un sacrifice humain atténué ; on se mutile pour plaire à Dieu.
Les services que rend la religion peuvent être rendus sans elle. Elle n’est qu’un ensemble de cérémonies qui marquent les époques de l’année et les dates de la vie. Noël fête l’hiver ; Pâques n’est que la résurrection du printemps. L’Église fête la naissance par le baptême, la nubilité par la première communion, le mariage, la mort…
L’humanité peut vivre sans fêtes ; mais les fêtes embellissent la vie. Tous les jours ne doivent pas se ressembler ; il faut créer, de temps à autre, des diversions qui stimulent l’esprit.
Mais les fêtes peuvent se libérer des pratiques religieuses et être très belles. On peut fêter les saisons, les âges de la vie, commémorer les grands hommes.
Pourquoi ne pas faire des cortèges d’enfants vêtus de blanc pour fêter la douzième année ? Au lieu de leur raconter une histoire baroque d’union avec le Christ par l’ingestion d’une rondelle de pain, on leur ferait une conférence sur la douzième année, l’enfance qui finit, les devoirs de la jeunesse qui va s’ouvrir. Une telle fête frapperait l’imagination des adolescents ; au lieu que de la première communion ils ne retiennent guère que l’habit neuf (surtout la robe blanche pour les petites filles), et ils s’empressent d’oublier toutes les calembredaines dont on les a saturés à cette occasion.
La commémoration des grands hommes serait d’un grand effet moral. Pourquoi des cortèges avec des fleurs, des enfants parés d’habits de fête ne parcourraient-ils pas les rues à cette occasion ? On porterait en procession le buste du savant, de l’homme d’État, etc., héros de la cérémonie ; cela vaudrait mieux que de promener la statue d’une vierge qui n’a peut-être jamais existé. Dans une allocution, on retracerait la vie du grand homme, les efforts qu’il a fait pour acquérir la valeur qui l’a élevé au-dessus des hommes de sa génération. Son exemple montre jusqu’où l’esprit humain peut atteindre ; et, à l’occasion de sa fête, nombre de jeunes gens se promettent de lui ressembler.
Si les catholiques décrient les fêtes laïques, c’est par esprit de rivalité jalouse. Une fête laïque n’est pas plus grossière qu’une fête religieuse ; on n’a pas besoin d’y mettre de beuveries.
Les pardons bretons, d’ailleurs, pour leurs ivrogneries, surpassent de beaucoup nos quatorze juillet.
La grande Révolution a établi des fêtes laïques, dont la réaction a naturellement dit beaucoup de mal. Beaucoup de ces fêtes étaient, en réalité, très belles et très dignes ; le seul tort de Robespierre a été d’y conserver l’Être suprême : vestige du passé.
L’innovation n’a pas duré parce que la Révolution elle-même a été vaincue ; et la réaction triomphante n’a rien eu de plus pressé que de rétablir les vieilles croyances, afin de replonger, au profit d’une minorité de privilégiés, les masses dans l’ignorance et la servitude.
Beaucoup de personnes qui ont rejeté les religions officielles en embrassent de nouvelles. Parmi les nouvelles religions, celle qui réunit le plus d’adeptes est la théosophie. C’est une religion supérieure. Ses temples, débarrassés de tout ornement, ne sont que de simples salles de conférences. En outre, la théosophie, contrairement aux religions officielles, admet les sciences et le progrès. Mais elle admet l’existence du corps astral qui peut se voir, prétend-elle ; elle croit aux apparitions de l’au-delà ; c’est la porte largement ouverte aux demi fous et aux charlatans.
Le spiritisme a, lui aussi, un grand nombre de sectateurs ; un congrès spirite réuni récemment en a amenés de tous les coins du monde. Il manque complètement d’intérêt : tables tournantes, coups frappés ; apport de fleurs artificielles soi-disant tombées du ciel ; spectres en carton ; membres humains en gomme. Tous les médiums, après un moment de célébrité, finissent dans le discrédit après qu’on a découvert leur truc. Ces gens ne sont, en réalité, que des artistes de prestidigitation plus ou moins habiles ; connaissant la sottise humaine, ils trompent pour gagner de l’argent. Les tables tournantes ne tournent pas ou du moins pas toutes seules ; essayez d’appuyer vos mains sur une table sans faire aucun mouvement ; vous pourrez le faire patiemment pendant une heure, rien ne se produira. Pour obtenir des mouvements, il faut plusieurs personnes et l’obscurité. Quelqu’un triche, ou bien une impulsion involontaire est donnée à la table ; le mouvement déclenché, les assistants l’aident, plus ou moins consciemment. Il est à noter que la table ne dit que des choses incohérentes ou des futilités. Nombre de personnes d’ailleurs ne font du spiritisme que pour s’amuser ; c’est un passe-temps de salon.
Ce serait une erreur de nier le besoin religieux. Il a sa source dans la crainte de la mort. On a dit avec raison que l’homme est le plus malheureux des animaux parce qu’il sait qu’il mourra. Mais il est à noter que la pensée de la mort ne hante que rarement notre esprit ; et aussi, avec une éducation bien faite, l’homme se passerait très bien de religion, ce que font déjà nombre de personnes.
On entend dire souvent qu’on ne croit pas à la religion, mais qu’on la respecte. C’est une conception fausse. La religion n’est pas plus respectable que la cartomancie, la chiromancie ou le marc de café. Respecter une idée n’a pas de sens ; ou l’idée est vraie ou elle est fausse. Si l’idée est vraie, il faut, non pas la respecter, mais l’adopter ; si elle est fausse, il faut la rejeter : pas de milieu. La position de celui qui respecte tout en ne croyant pas est une timidité tout à fait indigne d’un esprit libre. Est-ce l’antiquité de la doctrine qui inspire le respect. Elle devrait inspirer un sentiment tout contraire ; plus une fausse doctrine est vieille, plus elle a fait de mal.
Quelle attitude devrait adopter, vis-à-vis des religions, un gouvernement révolutionnaire ? Les supprimer comme nuisibles et inhibitrices du progrès ? L’attitude de la liberté serait plus clémente. On pourrait admettre que, restant dans son domaine, la religion n’est pas nuisible et que les gens qui ont besoin de cette consolation sont, après tout, libres d’y recourir. Mais l’expérience montre que la religion ne reste jamais dans son domaine. Le prêtre, surtout le prêtre catholique, est convaincu de n’être pas seulement un guide spirituel des croyants, mais un chef temporel dont le pouvoir doit s’exercer sur les athées comme sur les religieux. Si on laisse la liberté à la religion, elle en profite pour empiéter le plus qu’elle peut sur le domaine temporel. Pour amener les gens à la soumission extérieure, si ce n’est à la croyance sincère, elle emploie tous les moyens, elle prive les pauvres du travail qui les fait vivre, elle boycotte les commerçants, elle discrédite les intellectuels. Tant que le catholique ne domine pas, il se déclare persécuté. Les autres religions sont moins dangereuses que le catholicisme, mais elles ne sont pas inoffensives. Elles endorment les esprits ; elles sont toujours les alliées des partis de régression.
La Révolution russe n’a pas osé supprimer d’un coup la religion ; elle a craint de déchaîner contre elle le fanatisme des masses paysannes.
En France, l’esprit religieux est moins fort. Je ne prétends pas, cependant, qu’il faille supprimer les religions par un simple décret. On peut y mettre le temps ; mais ce temps doit être relativement court, sous peine d’échec.
Supprimer les religions ne veut pas dire tuer les religieux. Une révolution moderne doit épargner le sang. La guillotine est barbare ; la marque de la civilisation, c’est le respect de la vie humaine. Mais il faudra interdire tout culte et expulser du pays les prêtres, religieux et religieuses. Pour adoucir les rudesses d’un arrachement brusque à un pays, on pourrait leur donner une indemnité correspondant à six mois de travail ouvrier ; on pourrait même, en outre, leur accorder la libre jouissance d’une colonie lointaine.
Bien entendu, une pareille mesure ne supprimerait pas d’emblée les religions. Les cultes deviendraient clandestins, mais continueraient ; nombre de prêtres se cacheraient pour échapper à l’expulsion. Néanmoins, l’interdiction porterait un grand coup aux Églises. Les croyants tièdes, c’est-à-dire la majorité, s’habitueraient vite à se passer de religion ; surtout si on les remplace par des fêtes somptueuses ; les croyants ardents trouveront le moyen d’entendre la messe dans une chambre ; il faudra les poursuivre et les mettre hors du pays. Il n’est pas tout à fait vrai que la persécution renforce une idée. L’humanité dans sa masse est fort peu idéaliste, et le principal effet obtenu par la persécution, c’est de faire peur ; on déserte l’idée devenue dangereuse.
On pourra m’objecter que ces mesures draconiennes sont en opposition avec la liberté et la justice. Mais la liberté et la justice n’ont rien à voir ici ; entre la religion et l’irréligion, il ne peut y avoir que la guerre ; si on ne détruit pas la religion, c’est la religion qui détruit la civilisation. Si les catholiques reprenaient demain le pouvoir qu’ils avaient au Moyen Âge, ils relèveraient les bûchers.
D’ailleurs, le traitement doux du bannissement enlèverait aux religieux l’auréole du martyre ; la masse se dirait, avec juste raison, que ces gens ne sont pas tellement malheureux puisqu’on leur donne un coin de terre où ils ont la liberté d’être ce qu’ils sont.
Naturellement, la déchristianisation brusque doit être complétée par l’éducation irréligieuse des enfants. Durant les premiers temps, il ne faudra pas se contenter de passer la religion sous silence ; il faudra la combattre ouvertement. Les bolcheviks font très bien de faire chanter à leurs écoliers :
« Je ne crois pas en Dieu. »
Cela ne peut choquer que les esprits timorés qui ne peuvent s’empêcher de se raccrocher au passé. En outre, une active propagande antireligieuse devra être faite aux adultes. Il faudra montrer l’absurdité logique de la religion, renouveler l’œuvre de Voltaire où les pratiques religieuses sont tournées en dérision. Certains esprits areligieux à d’autres égards trouvent inférieurs les ouvrages où Voltaire se moque du trajet de l’hostie, soi-disant incarnation divine, à travers le tube digestif du communiant. Ils pensent que pour ne pas croire en Dieu, ils ont des raisons philosophiques beaucoup supérieures à celle-là. C’est fort possible, mais les arguments philosophiques, beaucoup trop difficiles à comprendre, ne disent rien au peuple. En revanche, le peuple comprend très bien l’absurdité qu’il y a à croire que l’on mange dieu et qu’on le digère. En réalité, on ne se tromperait pas beaucoup en accusant les adversaires de la critique voltairienne d’avoir conservé un reste de croyance. On se moque devant eux, sans qu’ils protestent, d’un tas de choses et d’un tas de gens ; eux-mêmes ne se privent pas de railler. Mais si l’on raille l’eucharistie, ils sont choqués ; donc, ils y croient.
Il y a une habitude psychologique qui nous porte à respecter inconsciemment ce que, autour du nous, nous avons toujours vu respecter et adorer. C’est une habitude néfaste ; elle fait le lit de toutes les erreurs ; ce n’est ni l’instinct ni l’habitude qui doit nous guider, mais la raison.
On peut se passer de religion. Nombre de philosophes l’ont pensé et le pensent. Certains, tout en n’ayant pour leur usage personnel aucune religion, croient qu’il en faut une pour le peuple.
Cette conception essentiellement égoïste est celle du riche qui, pour profiter en paix de sa situation privilégiée, entend qu’on abêtisse les masses déshéritées. Au fond, il n’y a pas autre chose dans le renouveau religieux d’après guerre. La bourgeoisie terrorisée par la Révolution russe se raccroche à tout ce qui lui semble être un frein social. Elle-même ne croit pas ; les jouissances terrestres la préoccupent beaucoup plus que la vie future. Mais elle voudrait amener, au besoin par la force, les masses à retourner sous la domination du clergé. Si on pouvait remplacer les syndicats par des confréries, on n’aurait plus de grèves à redouter.
Dans une société où il n’y aura plus de classe, point ne sera besoin de frein religieux.
La morale rationnelle enseignée à l’école, et qui n’est autre chose que le moyen d’assurer à chacun le bien-être dans la sécurité, sera bien autrement opérante que le fatras hétéroclite légué à travers de nombreuses générations par une humanité primitive.
Les illusions sont comme la morphine : bienfaisantes dans le moment, elles sont en réalité néfastes. Une vie future problématique ne doit pas troubler la vie présente, notre seule certitude.
C’est elle qu’il s’agit d’améliorer, de prolonger si on le peut et, pour ce faire, ce n’est pas dans les divagations du passé qu’il faut chercher, mais dans le cerveau de l’homme présent guidé par la raison et la science.
— Doctoresse PELLETIER
RELIGION
n. f.
Sur l’étymologie du mot religion, l’on discute depuis longtemps ; mais nous délaissons volontairement ces controverses d’importance secondaire. De même, nous ne chercherons point à définir la religion (chose si complexe et si variable) dès le début de cette étude ; c’est de l’examen méthodique de ses manifestations essentielles que se dégagera, progressivement, l’idée qu’on doit s’en faire. D’ailleurs, un manque complet de sincérité, une incroyable bassesse d’esprit sont, aujourd’hui, la règle commune dans ce domaine particulièrement dangereux. On finasse, on biaise, on évite de prendre une position qui puisse entraver une carrière qui s’annonce brillante, ou indisposer les critiques en renom. Vidés de leur contenu primitif, les mots finissent par ne rien garder de leur sens originel. Quiconque reconnaît la petitesse de l’homme et son impuissance devant les grandes forces cosmiques reste catalogué parmi les penseurs religieux, fût-il athée. Même si l’on réduit dieu à n’être qu’une abstraction falote, une ombre sans consistante, il est encore possible de se ranger parmi les croyants : on se borne à prétendre que l’on a du divin une conception plus élevée.
Des auteurs habiles, soucieux de ménager tous les camps, parviennent à se dire simultanément défenseurs et adversaires des religions. C’est Léon Brunschvicg déclarant que :
« Là où finissent les religions commence la religion. »
C’est un groupe d’éducateurs laïcs affirmant que :
« Pour détruire le cléricalisme, ce césarisme spirituel qui tue les âmes afin de régner facilement sur des cadavres, on a commis l’erreur absurde de le confondre avec ce qui en est tout l’opposé, avec la pure religion, qui est bien pourtant la chose du monde la plus respectable, puisqu’elle est essentiellement le culte, au fond de la conscience et du cœur, de tout ce qu’il y a de plus élevé et de meilleur dans la nature humaine. »
Comme s’il pouvait exister, en pratique, une religion distincte des religions ! Comme si le concept de religion pure n’était pas une abstraite création du cerveau, dépourvue de base historique !
Et réduire la religion à une haute culture morale, c’est méconnaître complètement la vraie nature des phénomènes religieux, c’est oublier volontairement que cultes et Églises ont approuvé des injustices notoires, et que les autorités ecclésiastiques s’opposèrent tant qu’elles purent, dans l’ensemble, au progrès moral et social. À force d’épurer le concept de religion, on le réduit finalement à n’être qu’un mot dépourvu de sens ou qui répond à des sentiments, à des idées, à un comportement qui n’ont rien de spécifiquement religieux. Mais il devient alors facile de transformer en croyants mêmes les adversaires déclarés de la religion. Paul Tissonnière déclare :
« Toute négation contient une affirmation. Quand Laurent Tailhade parle d’écraser le christianisme comme on ferait d’une vipère, de quel christianisme parle-t-il : de celui de l’Église ou de celui du Nazaréen, victime des prêtres et des chefs du peuple ? Quand Guy de Maupassant, au moment de sombrer dans la folie, fait éclater la véhémence de ses imprécations contre un dieu fabricateur de la peste, du choléra et du typhus, qu’il le représente comme affamé de la souffrance et de la mort des créatures, comme embusqué dans l’espace, pour les mutiler et les détruire dans un terrible jeu de massacre, est-ce qu’il nie absolument ? Non, il injurie. Et contre qui en a-t-il ? Contre une conception qui, mélangeant en dieu le principe du bien et le principe du mal, fait de l’être suprême une puissance monstrueuse, capricieuse, contradictoire et immorale, dont la conscience se scandalise, et dont l’intelligence demeure stupéfiée. Il fait le raisonnement de ce petit garçon à qui on avait annoncé la mort de son père, en lui disant : « Dieu l’a pris à lui », et qui n’avait rien trouvé de mieux, dans sa juvénile indignation, que de décrocher son fusil de bois et de grimper à la mansarde, dans l’espoir d’escalader le ciel et d’aller là-haut réclamer son père. La plupart de ceux qui font ainsi figure d’athées sont ceux-là, simplement, qui ne pardonnent pas aux Églises d’avoir confisqué Dieu, d’en avoir matérialisé, puérilisé la notion, de l’avoir rendu suspect en l’associant, soit au pire des conservatismes politiques, soit aux pires sottises confessionnelles. Dans l’Église, ils ne voient plus que l’organisation d’un fétichisme qu’il faut extirper, ou l’audacieuse piperie d’une crédulité populaire dont l’exploitation n’est que trop facile. »
Retenons ces aveux, qui ont leur prix dans la bouche d’un croyant convaincu, mais ne donnons pas dans le panneau qu’il nous tend.
Entité chimérique et inexistante, la religion pure est, certes, beaucoup plus facile à défendre que les religions qui, elles, existent bien et sont souillées de crimes innombrables ; quant à dieu, ne parvenant pas à concilier son infinie bonté avec les tragédies horribles dont notre globe est quotidiennement le théâtre, on espère le justifier en déclarant que les théologiens s’en font une idée fausse ou que ses qualités échappent, dans leur profondeur, à la faible portée de l’esprit humain. Lorsqu’on déclare l’Église belle et sainte, même quand ses chefs et son clergé la déshonorent, on néglige pareillement la réalité indéfendable pour ne considérer qu’une fictive abstraction. Que Brunschvicg affirme le contraire, certes, je n’en suis pas surpris ; mais, en fait, la religion ne se sépare pas des religions. De profondes transformations sont survenues, au cours des âges, dans la mentalité religieuse ; néanmoins, entre le catholique d’Europe qui adore le pain eucharistique et le sauvage d’Afrique qui se prosterne devant un morceau de bois ou un caillou, la différence est minime ; nos prêtres sont à rapprocher des fétichistes du Gabon ; la grossière amulette du nègre est l’équivalent de l’artistique crucifix du civilisé. Les plus évoluées des religions ne sont qu’un reliquat, parfois bien maquillé, de pratiques irrationnelles, de dogmes enfantins, de sentiments mal dirigés.
Dans toute religion, l’on peut distinguer un culte, des croyances, une attitude affective. Et, malgré l’extrême variété des rites, on trouve des éléments communs dans les cultes les plus divers. C’est à commémorer certains faits du passé, à en donner une sorte de représentation dramatique que servent maintes cérémonies. Le cycle annuel des fêtes, originairement de caractère naturiste et saisonnier, s’est chargé de souvenirs religieux ; dans le catholicisme, il reproduit mystiquement l’histoire du Christ. Ajoutons que ce symbolisme échappe à la majorité des assistants et même, parfois, aux prêtres. Mais l’action rituelle apparaît comme un geste magique, encore plus que comme une commémoration. Dans toutes les religions élémentaires, se rencontre la croyance à l’efficacité des cérémonies sacrées. Loisy écrit :
« Les rites des cultes primitifs sont des figurations qui sont supposées produire l’effet qu’elles représentent. Rites totémiques, rites de chasse et de pêche, rites de guerre, rites d’initiation, rites agraires, symbolisant leur objet, le mettent en scène et par cela même sont censés le réaliser. »
Le symbolisme, plus ou moins quintessencié, qu’on y ajoute n’est souvent qu’une invention postérieure ; et l’on voit quelle étroite parenté relie la religion à la magie.
Cette dernière implique la croyance à la réalisation de ce qu’on désire, grâce à la mise en œuvre de moyens mystérieux. D’heureuses coïncidences, des succès apparents entretiennent la confiance. Succès d’ailleurs presque inévitables, constate H. Delacroix :
« Lorsqu’on s’adresse, par exemple, à des rythmes naturels déjà prêts à se déclencher ; comme lorsqu’on cherche à amener la pluie vers la fin d’une période de sécheresse, ou, ce qui est encore plus aisé, lorsqu’on cherche à déclencher la venue normale des saisons ; ou bien, encore, lorsque l’opération magique est effectuée sur des hommes et qu’elle a grande force de suggestion ; tel le rite de l’envoûtement. »
Or, les cérémonies religieuses, comme les incantations magiques, procèdent du désir d’exercer une action efficace et de la croyance à la vertu de certains gestes ou de certaines paroles. Mais, parce qu’il reconnaît l’existence d’un dieu personnel et libre, le prêtre suppose, entre le rite et son effet, une liaison moins forte que celle qu’admet le sorcier.
Le caractère magique reste très net dans les sacrements qui font bénéficier les fidèles de l’efficacité assurée par les rites contraignants. D’où un matérialisme parfois très grossier, surtout en ce qui concerne l’eucharistie. H. Delacroix se voit contraint de le reconnaître :
« Le mot d’idolâtrie a été souvent prononcé et pas toujours par des incroyants. Enfin, les sacrements ont souvent ouvert la porte à l’irruption abusive des objets sacrés. Les reliques, les jugements de Dieu, les miracles, les images ont toujours témoigné du désir toujours latent, et parfois aigu dans la chrétienté, de vivre dans un monde de prodiges, de goûter le sacré par tous les sens, de recevoir de la divinité des secours magiques, d’avoir des gages tangibles du salut. Le divin et le saint, descendus dans le monde par l’incarnation, se sont ainsi créés dans l’Église un système d’objets matériels transcendants, offerts au culte des fidèles. »
Loin de refréner ces tendances à l’idolâtrie, le clergé catholique les encourage, au contraire. On observe, à l’heure actuelle, un mouvement pour la divinisation du pape, qui semble un défi an bon sens. Mgr Durand écrit :
« Oui nous croyons fermement à la présence de Dieu sous les espèces eucharistiques, en vertu du corps « transsubstantié hypostatiquement », uni à la divinité, et nous croyons aussi fermement à la présence de Dieu sous les espèces pontificales. »
Le dalaï-lama du Tibet aura peut-être, bientôt, un collègue en divinité siégeant à Rome.
Convenons que les réformateurs protestants se sont montrés moins déraisonnables, dans l’ensemble, en matière de culte. Néanmoins, s’ils ont spiritualisé davantage la notion de sacrifice, ils continuent de lui accorder une importance considérable. Le sacrifice est le moyen par excellence d’établir une communication entre le sacré et le profane, entre les hommes et les dieux. Il implique don de soi ou de quelque chose qui nous est cher ; il prétend, d’autre part, exercer une sorte d’action coercitive sur les êtres surnaturels. Ce second élément s’évanouit, dans certains cas, au point de ne laisser place qu’à la prière : pratique qui dérive de la croyance primitive à la force magique du mot. L’incantation verbale fut en honneur, à l’origine ; celui-là disposait des esprits qui connaissait leur nom secret. Puis, quand se développa la notion de liberté divine, l’invocation impérative fut remplacée par la supplication et même, plus tard, par l’effusion mystique.
Afin d’accroître son prestige, la caste sacerdotale se donna comme la gardienne des pratiques rituelles et s’attribua un rôle de premier ordre dans la manipulation du sacré. Fréquemment, d’ailleurs, le culte collectif dégénère en scènes de délire extatique, lorsque les assistants sont des convaincus et qu’ils prennent tous une part effective à l’action liturgique. Les réveils religieux, si connus en pays protestants, aboutissent à des manifestations de ce genre. Pfister note en décrivant l’une de ces séances :
« La prière confuse et simultanée devient toujours plus monotone ; on répète incessamment avec une emphase croissante : ô Jésus, viens ! C’est enfin un seul gémissement et un seul soupir à travers la salle. L’impression est atroce et au plus haut point contagieuse. La scène est interrompue de temps à autre par le chant de quelques versets. Les convulsions commencent. Quand la confusion et l’excitation sont au plus haut point, commence la glossolalie. La réunion exulte, et plus encore les baptisés en esprit. »
Parmi les premiers chrétiens, ces phénomènes convulsifs et « glossolaliques » étaient habituels ; on appela « don des langues » la faculté d’émettre ainsi des cris inarticulés, des balbutiements émotifs ou nerveux, accompagnés souvent de sanglots, de hoquets, de spasmes. On pourrait emprunter de nombreux exemples de manifestations pareilles aux cultes orgiastiques, à l’histoire des camisards ou à celle des jansénistes, aux récits concernant les moines bouddhistes ou musulmans. À Lourdes, j’ai pu observer des scènes d’agitation mystique qui supposaient un déséquilibre psychique chez les participants. Aussi, ne doit-on pas s’étonner que les fous, pour cause de religion, soient si nombreux. Bois a remarqué que, simplement pour les derniers mois de 1906, 25 % des aliénés conduits dans les asiles du pays de Galles étaient atteints de psychose mystique.
Quand le culte traditionnel ne parvient plus à satisfaire les esprits, des rites nouveaux apparaissent, mieux adaptés à la mentalité du temps. À Rome, culte de Dionysos, de Cybèle, d’Adonis, d’Attis, orphisme, mystères d’Isis et de Mithra eurent une vogue extraordinaire, lorsque le caractère légaliste et prosaïque de la vieille religion nationale rebuta la multitude de ceux qui avaient soif d’ivresse divine, de fraternité, de bonheur. Aujourd’hui que le christianisme ne répond plus aux aspirations de l’âme contemporaine, nous voyons naître de nombreuses sectes spirites, occultistes, théosophiques ; initiations et mystères reviennent à la mode. Le protestantisme arrive à s’adapter, tant bien que mal, aux nécessités de l’époque. Mais, figé dans des rites désuets, le catholicisme se borne à honorer Jésus et Marie sous des vocables inédits, à créer de nouveaux saints ou de nouveaux centres de pèlerinage. La pompe toute italienne de ses cérémonies est une vieillerie archaïque, n’ayant plus rien d’actuel, ni de vivant.
À côté du culte, et quelquefois dérivant de lui, il faut faire une place à des croyances, à des affirmations, souvent non démontrées ou même indémontrables, qui, en raison de leur simplicité, se font néanmoins accepter des masses. Pour se dire chrétien, il est nécessaire d’admettre l’existence de dieu et de voir en Jésus un personnage surnaturel. Les juifs doivent avoir confiance en Moïse ; les bouddhistes en Bouddha ; les musulmans sont obligés de croire à Allah et à la parole de Mahomet. Disputes transcendantes, complications de la théologie n’intéressent guère que le clergé et les savants. Ajoutons que le besoin de dogmatiser varie beaucoup selon les peuples. Guignebert écrit :
« Les uns se contentent parfaitement d’affirmations de foi vigoureuses, mais métaphysiquement élémentaires et qu’ils ne sentent pas la nécessité d’organiser en un système théologique cohérent ; ils raffinent sur les pratiques et les rites. D’autres sont des théologiens nés ; ils creusent les postulats premiers, les compliquent, les combinent et ne sont satisfaits que lorsqu’ils ont pu se donner l’illusion de les penser. Il y a longtemps que le rhéteur chrétien Lactance reprochait au vieux paganisme romain de tenir tout entier dans des rites et dans des gestes qui, disait-il, n’intéressaient que les doigts ; et, en effet, la religion romaine véritable, celle de l’antique cité latine, posait comme un fait l’existence de ses dieux ; elle les armait d’une grande puissance matérielle ; mais, outre qu’elle ne savait, pour ainsi dire, rien sur eux, elle ne leur prêtait presque aucune préoccupation morale et n’éprouvait aucun besoin de méditer sur leur nature, leur essence, leurs attributs, leur rôle. En un mot, elle ne philosophait pas sur eux, ni à leur propos ; elle se contentait de les honorer par des sacrifices bien réglés et les enchaînait par des prières minutieusement fixées. Dans le même temps, l’imagination des Grecs enfantait des histoires merveilleuses ou charmantes, pour en entourer des dieux dont l’origine mythique était la même que celle des divinités principales des Latins, et leurs réflexions organisaient, à côté et au-dessus des rites et de la mythologie, toute une théodicée. »
Habitudes intellectuelles et culture du milieu où la foi se développe influent également sur la plus ou moins grande complexité des dogmes. Les premiers chrétiens étaient des juifs simples et ignorants ; parmi les païens, ceux qui se convertirent à la nouvelle religion furent d’abord des esclaves, des hommes du peuple, incultes et peu enclins aux disputes métaphysiques. Ces petites gens avaient besoin d’espérance ; ils ne se souciaient aucunement des longues discussions alambiquées. Il leur suffisait de savoir que le fils d’un charpentier de Nazareth avait prêché dans les bourgs de Galilée, annonçant la prochaine venue du royaume de dieu, qu’il était mort sur une croix, victime de la rancune des prêtres et de l’impitoyable rigueur des lois romaines, mais que l’Éternel l’avait arraché à la tombe et qu’il le renverrait bientôt sur terre pour sauver ceux qui croyaient en sa mission. Des récits d’allure souvent enfantine, où le merveilleux jouait un rôle considérable, et qui reflétaient désirs et préoccupations des fidèles, tenaient lieu de théologie. Comme au début des autres cultes, on assistait à l’éclosion de mythes qui, plus tard seulement, devaient donner naissance à des commentaires exégétiques raffinés.
Lorsque la foi chrétienne fut acceptée par des hommes instruits, ayant parcouru le cycle des études grecques, elle se transforma rapidement. Examinée sous un angle métaphysique, à travers le prisme de la philosophie platonicienne, elle servit de point de départ à des spéculations théologiques. À la doctrine très simple des apôtres, fort amplifiée déjà par saint Paul, furent substituées des conceptions inspirées par l’intellectualisme hellénique. Les théories sur le Logos furent appliquées au Christ ; et la nouvelle religion dut fournir des réponses à tous les problèmes qui agitaient les écoles. D’où une floraison de dogmes, résultat de l’adaptation à l’esprit grec, mais qui auraient singulièrement scandalisé les premiers fidèles.
Malgré les dénégations de l’Église catholique, qui assure que son credo n’a jamais varié, l’évolution des croyances s’est continuée jusqu’à nos jours : la chose est évidente pour qui examine les faits avec impartialité. Illogique et « majorante », la foi cherche à grandir son objet, même si elle le dénature pour y parvenir. C’est ainsi que Jésus, considéré d’abord comme un très grand prophète, comme le messie attendu par Israël, obtint finalement une dignité encore plus haute et fut placé au rang des dieux. Marie, dont les évangélistes parlent d’une façon très brève et peu avantageuse, a vu ses prérogatives croître sans cesse au cours des siècles. Elle est devenue mère de dieu, tout en restant vierge ; son culte a pris des proportions extraordinaires : on l’a proclamée la première des créatures, la reine du ciel ; les anges auraient emporté au paradis son corps préservé de la corruption ; enfin, Pie IX déclara qu’elle fut conçue sans péché. On n’ose pas en faire une déesse, mais on lui attribue une puissance et des prérogatives supérieures à celles que les anciens concédaient habituellement aux divinités femelles.
Dans le catholicisme romain, les dogmes sont si nombreux que peu de prêtres les connaissent tous. Après avoir joui d’une vogue plus ou moins considérable, ils finissent par s’anémier, par perdre leur prestige, par ne tenir aucune place dans les préoccupations des fidèles ; ils sont morts désormais pour la foi vivante. L’autorité ecclésiastique les relègue alors au magasin des vieilleries ou les élève au-dessus de toute discussion, en proclamant qu’il s’agit de mystères inaccessibles à l’entendement humain. De la sorte, théologiens et apologistes sont dispensés de défendre des formules qu’eux-mêmes ne parviennent pas à trouver intelligibles. Pour en garantir la vérité, ils se bornent à invoquer l’infaillible autorité des papes ou des conciles. Si le prêtre n’hésite pas à recourir à des arguments rationnels, quand il espère convaincre les esprits incapables de réflexion profonde, il déclare la foi supérieure à notre entendement, lorsqu’il redoute la perspicacité de ses auditeurs.
À notre époque, la recherche scientifique conduit à l’incrédulité d’une façon presque fatale, si l’on pousse cette recherche assez loin. La pensée se détache des dogmes, même quand le cœur continue par habitude de les chérir. Loisy, qui devait quitter l’Église en pleine maturité d’esprit, l’a noté à propos de ses études de jeunesse. Autant certaines croyances, écrit-il :
« M’avaient touché comme principes d’émotions religieuses, autant leur exposé scolastique jetait mon esprit dans un indéfinissable malaise. Parce qu’il fallait maintenant penser toutes ces choses et non plus seulement les sentir, j’étais dans un état de perpétuelle angoisse. Car mon intelligence n’y mordait pas, et, de toute ma conscience d’enfant timide, je tremblais devant la question qui se posait devant moi, malgré moi, à chaque instant du jour : est-ce qu’à ces théorèmes, correspond une réalité ? »
Cette impression de vide, ces craintes devant un mensonge que je pressentais monstrueux, moi aussi, je les ai vues surgir dès mon premier contact avec les ouvrages des philosophes scolastiques et des théologiens. Les crises de doute qui secouent tant d’intellectuels, dans les pays les plus divers, prouvent d’ailleurs que toutes les religions ont à craindre l’action dissolvante de la science et de la raison. Des chimistes ou des botanistes, qui n’examinèrent jamais sérieusement les bases de leur foi, peuvent continuer à croire ; celui qui procède à l’étude impartiale et approfondie des dogmes ne saurait garder la tranquillité d’âme du vrai fidèle. Mais, chez beaucoup, le sentiment triomphe de l’intelligence ; en public, ils continuent d’approuver un culte, d’admettre un credo que leur esprit répudie secrètement.
L’élément affectif mérite d’arrêter particulièrement notre attention, car maints chercheurs estiment qu’en ses formes primitives la religion ne consista ni en mythes, ni en cérémonies, mais en émotions vagues et puissantes. Même aujourd’hui, pratiques et dogmes ne seraient que les symboles dont se revêt le sentiment. Déjà, nous trouvons le germe de cette doctrine chez Luther, et plus encore chez les piétistes, qui plaçaient la foi vivante et personnelle bien au-dessus des querelles théologiques ; des tendances de même ordre se sont fait jour, également, chez de nombreux mystiques. Mais c’est l’Allemand Schleiermacher qui, s’élevant contre l’intellectualisme, proclama avec le plus de force la royauté du sentiment, en matière religieuse. Et sa façon de voir s’est trouvée conforme à celle des psychologues qui accordent à la vie affective une primauté d’origine et de droit. Schleiermacher insistait sur le sentiment de dépendance ; d’autres partent d’angoisse devant les forces naturelles déchaînées ou devant l’énigme de la mort ; les partisans de la thèse sociologique invoquent l’exaltation collective, née de l’existence en commun. Chez les protestants, Ménégoz et Sabatier ont abouti, en s’inspirant de ces idées, à un système aujourd’hui très en vogue ; pour une notable part, le modernisme catholique découle aussi de la croyance au rôle primordial du sentiment.
En éloignant la religion de la sphère des vérités intellectuelles, on espérait la soustraire aux critiques de la raison ; devenue une affaire de cœur, elle échappait au contrôle de la science qui s’est montré désastreux en matière dogmatique. Le calcul était habile : le protestantisme s’en est trouvé rajeuni ; et, malgré les anathèmes du pape contre le modernisme, les apologistes catholiques s’efforcent maintenant de rendre la foi désirable et attrayante, plutôt que d’approfondir ses bases historiques ou rationnelles. En philosophie, les doctrines bergsoniennes et pragmatistes vinrent au secours du clergé, dans sa tentative pour discréditer la science et faire reculer l’intellectualisme. Eugène Ménégoz, étudiant le vieux dogme luthérien de la justification par la foi, déclarait que la foi, « consécration de l’âme à Dieu », reste indépendante des croyances. Elle garde sa valeur, même si les idées concernant dieu et Jésus-Christ sont erronées :
« La nécessité de la foi, nous la maintenons en face du libéralisme. Quant à la nécessité de l’adhésion aux dogmes orthodoxes, nous la nions en face de l’« orthodoxisme ». Ce qui nous sauve, c’est la foi et non l’acceptation de tel ou tel dogme, quelque vrai qu’il soit. »
De son côté, Sabatier ne voit dans les dogmes que des symboles déterminés par le milieu historique où ils sont nés :
« Toute foi religieuse et morale s’enveloppe d’une forme intellectuelle pour se manifester et se propager. Mais cette forme intellectuelle est toujours fatalement inadéquate à son objet et, partant, symbolique : elle souffre avec le temps des interprétations ou des modifications profondes. »
Les thèses de Ménégoz et celles de Sabatier s’adaptaient si bien qu’on les désigna toutes deux par un même terme : le « symbolo-fidéisme ». Libre de toute limitation intellectuelle, débarrassé de l’action restrictive et paralysante des dogmes, l’acte qui sauve est de l’ordre des sentiments. Cet acte n’aboutit d’ailleurs pas toujours à des réalisations pratiques, et il n’implique point obligatoirement la croyance précise et consciente à l’existence d’un dieu.
Volontiers, nous accordons que, ramenée à ce minimum, la religion perd une partie de sa malfaisance. Mais s’agit-il encore de religion ? Nous ne le pensons pas ; il s’agit d’affectivité seulement. De telles spéculations ont pour but de se persuader soi-même, et persuader aux autres, qu’on reste religieux alors qu’on ne l’est plus. H. Delacroix remarque :
« Les objets de croyance ne sont pas de pures figurations du sentiment, même si la croyance vient jusqu’à un certain point du sentiment. Il y a à la base de la religion, comme à la base du langage, ou de l’art, par exemple, un acte intellectuel. Le langage est d’abord, si l’on veut, l’expression naturelle d’émotions qui se dépensent en cris ou en gestes ; mais il ne devient vraiment langage que par l’imitation volontaire de soi-même, et quand on a traité ces cris et ces gestes comme l’équivalent de ces émotions, comme leurs symboles, et quand on imagine un système qui commande ces symboles. De même, l’émotion ne devient religieuse que par l’acte de l’esprit qui lui confère sa valeur, qui l’oriente et qui la situe, dût cet acte être enfermé dans cette émotion, et ne point paraître à part d’elle. La raison et la passion collaborent dans la fabrication de l’absolu. »
Si le modernisme catholique fut d’abord une école de critique des livres saints et de la doctrine scolastique, il s’efforça aussi de dégager la foi du dogmatisme théologique. Symboles passagers d’une vérité qui les déborde et qu’ils ne sauraient exprimer d’une façon adéquate, les dogmes sont modifiables ; ils doivent être pensés d’une façon différente selon les époques. Leroy écrit :
« Les pères et les conciles ont assurément dogmatisé en fonction de la philosophie alors régnante : le dogme n’est point lié pour cela à telles ou telles formes de la représentation théorique. »
D’une manière plus explicite encore, il déclare :
« La foi se pense en fonction de toutes les philosophies avec lesquelles elle se trouve en contact, soit pour s’harmoniser avec elles, soit pour s’en dégager, et elle cherche ainsi à entrer en contact avec toutes les philosophies qu’élabore successivement l’esprit humain. »
Objet d’expérience morale et non matière de science ou même d’histoire, au sens propre du mot, la foi oblige la théologie à réviser ses formules, lorsqu’elles ne répondent plus aux nécessités du temps.
Mais, contrairement aux protestants, les modernistes catholiques reconnaissaient l’autorité de l’Église romaine et voyaient dans les pratiques cultuelles et les dogmes le développement régulier de la vie chrétienne. Avec une franchise méritoire, Loisy a déclaré, depuis, qu’il était bien difficile de donner aux croyances traditionnelles un sens acceptable par les penseurs modernes :
« À vrai dire, j’aurais été moi même fort embarrassé si l’Église, au lieu de me condamner, m’avait laissé développer mes spéculations sur les dogmes et la foi, et qu’elle m’eût mis en demeure de préciser ce que décidément j’enseignerais à sa place. Tout en voyant la caducité des vieilles croyances, je me faisais l’illusion de penser que l’on pourrait continuer à se servir des antiques formulaires en les interprétant plus ou moins en symboles. Mais c’était là une complication assez superflue, et même dangereuse, quand les symboles suggèrent des idées fausses. Il m’aurait donc fallu prier l’Église de n’enseigner plus son Dieu créateur du monde, etc. »
C’est d’ailleurs une illusion commune à tous les modernistes, qu’ils soient chrétiens, bouddhistes, musulmans ou juifs, de croire que la société dont ils sont membres est assoupie seulement, et qu’elle peut sortir de sa léthargie. La condamnation par le pape de Loisy, de Tyrrell et des chercheurs qui suivaient leurs directives mit fin à tout essai de réforme dans le catholicisme. Pourtant, l’histoire constate que la religion n’a jamais eu de meilleur auxiliaire que le sentiment, lorsqu’elle fut menacée par la philosophie rationaliste, la science ou les transformations survenues dans la vie sociale. Rappelons l’influence de François d’Assise, en Occident ; celle d’Honem, qui s’exerça parmi les bouddhistes japonais presque à la même époque ; celle de Gazali chez les musulmans. Et l’on voit, durant les périodes de crise religieuse, se multiplier les manifestations d’une mysticité qui s’apparente souvent à l’érotisme.
Ni le sentiment, ni la raison n’interviennent, d’ailleurs, chez de nombreux croyants, disons même chez la plupart ; fille de la contrainte ou du conformisme, leur foi reste implicite et collective. Durkheim a bien mis en lumière cet aspect social de la religion. Il affirme :
« Les phénomènes dits religieux consistent en croyances obligatoires, connexes de pratiques définies qui se rapportent à des objets donnés dans ces croyances. Subsidiairement, on appelle également phénomènes religieux les croyances et les pratiques facultatives qui concernent des objets similaires ou assimilés aux précédents. »
Résultat d’une contrainte exercée sur ses membres par la collectivité, la foi serait une « philosophie obligatoire » associée à des pratiques obligatoires, elles aussi. Sentiments de respect, de dépendance, de crainte, d’amour qui surgissent dans les consciences individuelles proviendraient de cette suggestion sociale. Si la foi personnelle et volontairement acceptée existe à l’époque où les religions se forment, elle devient très rare par la suite. Croyances et pratiques sont imposées du dehors, par le groupe, grâce à une contrainte tantôt insinuante, tantôt impérieuse.
Il n’est aucunement nécessaire d’accepter les idées de Durkheim pour constater que la pression sociale, les habitudes traditionnelles, les mœurs, les institutions constituent les meilleurs soutiens des cultes établis. Dans les pays chrétiens, les autorités ecclésiastiques pourchassèrent avec une incroyable férocité, aussi longtemps qu’elles disposèrent des bourreaux et des juges, ceux qui s’écartaient de la foi commune. Prison, torture, galères, mort furent les sanctions ordinaires de manquements, même minimes, aux prescriptions du code religieux. Aujourd’hui, les prêtres continuent, dans la mesure du possible, à susciter mille embarras, à rendre la vie pénible à celui qui refuse de se soumettre à leurs injonctions. Le conformisme routinier, outre qu’il procure à l’individu la bienveillance des croyants, convient à la paresse intellectuelle, à l’inertie mentale du grand nombre. Étudier, réfléchir pour se faire des conceptions raisonnées, la plupart ne l’essayent pas ; imiter servilement, penser et agir sur le modèle des autres leur semble moins dangereux et moins fatigant. Absorbé par le groupe dont il n’est plus qu’un rouage, soumis d’avance à tout ce que décrète l’autorité, l’individu se borne à croire sans chercher à comprendre, à obéir aveuglément.
En Russie, la religion disparaît assez vite, depuis que les popes ne sont plus soutenus par les pouvoirs publics : preuve que le sentiment religieux n’a ni la profondeur, ni l’étendue que les thuriféraires de l’Église lui attribuent. Et nous pouvons sourire lorsqu’on objecte les conversions survenues, au cours des quarante dernières années, parmi les poètes et romanciers bourgeois. N’ayant pas besoin de travailler pour vivre, et ne trouvant pas en leur âme un amour de l’idéal assez vif pour se consacrer à la réalisation d’une belle œuvre, ces désenchantés se tournent vers le passé et prônent la tradition. Ils ferment volontairement les yeux sur les bons côtés de notre époque, se prétendent dégoûtés de la raison. Lorsqu’on s’avise d’examiner la conduite privée de ces nouveaux catholiques, on s’aperçoit qu’elle est aussi vicieuse après leur conversion qu’avant, qu’ils restent coutumiers des mêmes débauches, des mêmes orgies ; si le nom du Christ est sur leurs lèvres, ses enseignements ne sont point descendus dans leur cœur. Signalés par la presse, ouvertement ou secrètement favorable au clergé dans son ensemble, loués par les revues bien-pensantes et les critiques en renom, ils ont vu croître leur notoriété littéraire ; les grands éditeurs ont accepté leurs plus médiocres productions ; cercles mondains et salons de l’aristocratie les ont reçus à bras ouverts, même si leur nom manque de particule. Voilà l’unique résultat tangible de leur conversion !
Mais devant celui qui a l’audace de rompre avec l’Église, toutes les portes se ferment hermétiquement. Un silence glacial, discipliné, accueille ses meilleurs ouvrages. J’en ai fait personnellement l’expérience ; beaucoup d’autres l’ont faite aussi qui ont préféré la vérité à la gloire, la pauvreté libre à la servitude dorée. Perte du sens critique, complaisance marquée pour l’erreur utile, besoin de consolantes illusions, telles sont les causes profondes des conversions religieuses chez les intellectuels ; quand elles ne découlent pas des oscillations cyclothymiques, des alternatives de dépression et d’excitation, si fréquentes chez beaucoup de personnes. Avec raison, Janet observe que les convertis cités par W. James sont souvent :
« Des déprimés méconnus, qui, au cours de cérémonies religieuses, sous des influences quelconques, présentent des phénomènes d’excitation plus ou moins durables et des sentiments de joie ineffable ».
* * *
Abordons maintenant le problème si difficile de l’origine première des religions. La solution donnée par les théologiens fait sourire le chercheur impartial, tant elle s’avère naïvement enfantine. Dieu serait entré en communication avec des hommes privilégiés, pour leur enseigner les vérités qu’ils devaient croire et les préceptes qui serviraient de règle à leur conduite. Selon la Bible, Yahvé révéla à nos premiers parents qu’il était leur créateur et leur maître suprême. Plus tard, Moïse eut des rencontres avec l’Éternel sur le Sinaï, où il reçut de lui les tables de la loi. C’est de la nymphe Égérie que le roi de Rome, Numa Pompilius, apprit le secret des rites qui permettraient d’honorer dignement les dieux. Le prince babylonien Hammurabi recevait du dieu Schamach de longues recommandations. Mahomet fut investi de sa mission par l’ange Gabriel ; et cet esprit continua de l’inspirer dans la composition des maximes et des discours qui, depuis, ont constitué le Coran. Bien qu’il soit un homme et ne possède pas les attributs réservés aux dieux, le Bouddha est une incarnation passagère et renouvelable de la sagesse souveraine qui vient instruire les habitants de la terre. Pour les chrétiens, Jésus est un dieu qui a pris la forme humaine, afin que nous le comprenions mieux. Plus près de nous, Swedenborg, Allan Kardec, Hélène Blavatsky, le père Antoine et beaucoup d’autres ont fondé des sectes religieuses, à la suite de communications avec des entités spirituelles ou des esprits désincarnés.
À côté de la révélation proprement dite, les théologiens font une place à l’inspiration. Cette dernière consiste dans une intervention divine qui fait éviter toute erreur à l’écrivain sacré et lui indique ce qu’il doit dire. « Les conditions dans lesquelles elle se présente, remarque Guignebert, la rendent bien plus facile à accepter que la féerie d’une apparition divine, et elle vaut encore quand, décidément, il est devenu trop malaisé d’accepter l’intervention personnelle et en quelque sorte matérielle de Dieu. D’autre part, elle se justifie sans peine : une idée nouvelle et féconde, qui donne une forme nette à un désir ou à une aspiration de l’ambiance religieuse où elle se produit, un bon conseil, que les événements ratifient, une prévision heureuse, ou facile à accommoder avec ce qui arrive, un trait exceptionnel de sagesse ou de génie, sont toujours revêtus, au jugement des hommes de foi, des caractères de l’inspiration divine. » Si les Grecs venaient à Delphes consulter la pythie, c’est qu’ils la croyaient inspirée par Apollon, durant son délire sacré. Sibylles, devins parlaient ou écrivaient au nom des dieux, chez les anciens. Les premiers chrétiens attribuaient à l’action du Saint-Esprit les phénomènes de glossolalie qui survenaient dans leurs assemblées ; dans les sectes protestantes où ils se renouvellent, on les suppose, même aujourd’hui, d’origine surnaturelle.
Fréquent à toutes les époques, le prophétisme est une forme bien étudiée de l’inspiration. Alors que le prêtre est surtout un administrateur traditionaliste et conservateur par fonction, le prophète se fie aux certitudes intuitives et se découvre fréquemment une mission réformatrice. Le premier redoute les impulsions nouvelles : il reste fidèle à la lettre du dogme et des textes sacrés, mais finalement il sombre dans une routine insipide et un formalisme mort. Animateur enthousiaste, ne craignant pas quelquefois les attitudes révolutionnaires, le second est victime d’une excitation maladive et de troubles psychosensoriels. Nous parlons de ceux qui furent sincères, négligeant ici les fourbes, plus nombreux qu’on ne le suppose. Du sorcier vulgaire, du passionné délirant au prophète qui arrive à personnifier un moment de l’évolution religieuse, il y a d’ailleurs des degrés nombreux ; mais, toujours, l’inspiré prend pour des suggestions divines les idées qui germent dans son cerveau ; et des crises périodiques ou des excentricités, qu’on ne pardonnerait pas à un autre, témoignent de l’état anormal de son système nerveux. Mahomet, saint Paul étaient sujets à des crises d’épilepsie ; on raconte qu’Isaïe se promenait nu dans les rues de Jérusalem, pour montrer à ses compatriotes qu’ils subiraient le même sort s’ils résistaient au roi d’Assur.
Héritière du légalisme et du pouvoir solidement hiérarchisé de l’empire romain, l’Église catholique étouffa de bonne heure le prophétisme au profit de l’omnipotence sacerdotale. Néanmoins, il faudra la prodigieuse adresse des papes pour empêcher que le doux illuminé François d’Assise ne rouvre l’ère de l’inspiration personnelle. Guignebert écrit :
« L’esprit de la papauté n’avait alors rien d’idyllique ; organisée pour conduire les hommes, qu’ils le voulussent ou non, dans les voies du salut, forte de leur consentement ou de leur habitude, elle n’était disposée à tolérer aucune concurrence. On ne pouvait accuser François de mauvaise intention ; son humilité merveilleuse le gardait, non seulement de l’hérésie, mais encore du plus petit mouvement d’orgueil et d’indépendance ; il ne voyait pas lui-même le danger qu’il était ; si bien qu’il semblait impossible de l’arrêter brutalement, ou seulement d’opposer à son touchant effort un obstacle trop visible. La politique ecclésiastique, avec la complicité inconsciente de l’esprit public, fit mieux que de combattre le doux rêveur ; elle l’accabla de ses grâces et l’en paralysa ; puis, au propre, elle escamota son œuvre et la fit sienne, en la transformant jusqu’au bout. »
François d’Assise fut réduit au rôle de supérieur de couvents ! D’une façon générale, le succès d’un prophète tient aux circonstances de temps et de milieu, beaucoup plus qu’à ses qualités individuelles.
L’étude impartiale des livres sacrés de tous les peuples démontre que les fondateurs des grandes religions commirent les erreurs scientifiques familières à leurs contemporains et conservèrent maints de leurs préjugés les plus absurdes. Il suffit de lire la Bible, l’Évangile, le Coran, le Zend-Avesta, les Védas avec les yeux de la raison, et non avec ceux de la foi, pour être certain que les inspirés d’en haut furent de pauvres hommes, faillibles et bornés, dont l’ignorance en matière d’astronomie, de physique, de médecine et même d’histoire était prodigieuse. Vu la période où ils vécurent, nous pourrions excuser bien des erreurs, s’il s’agissait de mortels ordinaires. Mais, lorsqu’il s’agit de dieu ou de ses messagers, nous sommes à bon droit choqués par les affirmations saugrenues qu’ils multiplient dans leurs discours.
En outre, l’histoire enseigne que, si l’on excepte Mahomet, pourtant déjà environné de bien des légendes, nous ne savons presque rien sur les fondateurs des grandes religions. À peine pouvons-nous connaître quelques traits exacts de la vie de Bouddha ; de Zoroastre, l’existence apparaît problématique ; et beaucoup font remarquer, non sans raison, que les récits fabuleux concernant Moïse et Jésus présentent un caractère mythique très prononcé. Le professeur Alfaric écrit :
« Quand j’ai entendu parler, pour la première fois, de gens qui soutenaient que Jésus n’a peut-être vécu que dans l’imagination des croyants, je n’ai vu là qu’une de ces extravagances auxquelles l’abus de la critique peut quelquefois conduire. L’idée me semblait floue. Quand je l’ai étudiée de plus près, je ne l’ai plus trouvée tellement absurde. J’ai dû convenir qu’elle offrait quelque apparence de vérité. J’en suis bientôt venu à reconnaître qu’elle pouvait se défendre. Puis il m’a semblé qu’elle offrait bien plus de vraisemblance que la thèse contraire. »
Lorsqu’il descend sur la terre et suscite un prophète, dieu devrait laisser assez de preuves contrôlables d’un événement si merveilleux, pour que les chercheurs de bonne foi ne soient pas réduits, plus tard, à douter de la réalité de ce fait extraordinaire.
Et, dans la vie des inspirés modernes, mieux connus malgré les allures mystérieuses qu’ils affectent volontiers, on ne trouve rien qui légitime la confiance que des esprits faibles mirent en eux. Hélène Blavatsky, la fondatrice de la Société théosophique, et Mary Eddy, la fondatrice de la Christian Science, furent d’effrontées menteuses, qui ne manquèrent ni d’audace ni de persévérance, mais ne s’élevèrent pas au-dessus du niveau moral des simples charlatans. Mme de Krudener témoigna d’une sincérité plus grande ; le caractère enfantin des phénomènes qu’elle ressentait éclate, par contre, dès qu’on les examine sérieusement. C’est ainsi que les sensations pénibles qu’elle éprouvait, en s’éloignant d’une personne, étaient considérées par elle comme un ordre céleste d’aller la trouver.
Sous ses multiples formes : artistique, littéraire, scientifique, pratique, etc., l’inspiration est, d’ailleurs, un fait psychologique dont on précise bien le mécanisme. Lorsqu’elle s’exerce dans le domaine religieux, le sujet surajoute, sans aucun motif valable, la croyance à une intervention divine. Son caractère de brusquerie, de spontanéité, de force contraignante que les créateurs de belles œuvres et les inventeurs ont noté, explique cette illusion. Nietzche écrit :
« Pour peu qu’on ait gardé en soi la moindre parcelle de superstition, on ne saurait en vérité se défendre de l’idée qu’on n’est que l’incarnation, le porte-voix, le médium de puissances supérieures. Le mot de révélation – entendu dans ce sens que tout à coup quelque chose se révèle à notre vue ou à notre ouïe, avec une indicible précision, une ineffable délicatesse, quelque chose qui nous ébranle, nous bouleverse jusqu’au plus intime de notre être – est l’expression de l’exacte réalité... Telle est mon expérience de l’inspiration. »
Histoire et psychologie ont ruiné définitivement la doctrine théologique de la révélation.
Dans l’ensemble, nos contemporains n’admettent pas davantage l’explication que Voltaire a donnée de l’origine des religions. Inventions de prêtres imposteurs, croyances et pratiques cultuelles leur permirent de dominer les peuples ignorants.
« Qui fut celui qui inventa l’art de la divination ? Ce fut le premier fripon qui rencontra un imbécile. »
Et l’on rappelle souvent, pour les désapprouver, ces vers placés par Voltaire dans la bouche de Mahomet :
Il faut un nouveau culte, il faut de nouveaux fers.
Il faut un nouveau dieu pour l’aveugle univers. »
Sans parler des croyants, qui prétendent que la religion est apparue dès le tout premier âge de l’humanité, de nombreux libres-penseurs répudient cette manière de voir. Salomon Reinach écrit :
« Au fond de cette doctrine, il y a un anachronisme ridicule, que le XVIIIe siècle a commis d’autant plus volontiers que l’état du christianisme dans l’Europe occidentale semblait quelque peu l’y autoriser. Parce qu’on voyait alors des cardinaux athées, comme Dubois, Tencin et tant d’autres, et des prêtres galants qui, suivant une formule connue, « dînaient de l’autel et soupaient du théâtre », on se figurait qu’il en avait été ainsi dès l’origine. »
Certes, l’existence de la religion est antérieure à celle du sacerdoce organisé méthodiquement ; le culte des dieux ne doit pas son origine à la seule fraude de prêtres astucieux. Mais, fausse de ce point de vue, la thèse de Voltaire est vraie considérée sous un autre aspect. D’une part, c’est à l’époque moustérienne seulement qu’apparaît le culte des morts : ce qui dénote, assure-t-on, un rudiment de religion et l’idée de survie. Or, l’espèce humaine existait depuis bien des milliers d’années déjà ; et rien ne laisse supposer que l’on ait cru, avant cette période, à l’existence d’entités surnaturelles. Il s’avère donc indéniable que nos premiers pères n’avaient aucune religion. De plus, l’intérêt sacerdotal a joué, dans l’évolution des croyances et des pratiques cultuelles, un rôle énorme que les historiens modernes n’ont pas suffisamment mis en lumière, soit parce qu’ils ont craint d’encourir la colère d’un clergé puissant, soit parce que la défaveur dont jouissent les philosophes du XVIIIe siècle leur a fait négliger les remarques justifiées qui abondent sous la plume du patriarche de Ferney.
Si les mensonges de prêtres ambitieux n’ont pas fait naître le sentiment religieux, ils ont puissamment contribué à l’orienter dans un sens favorable aux prétentions des castes guerrières et sacerdotales, unies pour l’exploitation des masses stupides. De très bonne heure, la religion négligea les préoccupations spirituelles pour devenir un formidable instrument d’oppression, entre les mains de politiques habiles ; chez nombre de peuples anciens, elle resta même éternellement asservie au pouvoir civil. À Rome, constate Gaston Boissier, elle a été « soumise à l’État ou, plutôt, elle s’est confondue avec lui ». Et il ajoute :
« Les dignités religieuses n’étaient pas séparées des fonctions politiques, et il n’y avait rien d’incompatible entre elles. On devenait augure ou pontife en même temps que prêteur ou consul, et pour les mêmes motifs. Personne ne demandait à ceux qui voulaient l’être des connaissances spéciales ou des dispositions particulières ; il suffisait pour arriver à ces charges, comme aux autres, d’avoir servi son pays dans les assemblées délibérantes ou sur les champs de bataille. »
Soutien des chefs qui la favorisent, l’Église catholique est depuis très longtemps une organisation politique beaucoup plus qu’une école de spiritualité. Aussi, est-ce une grave erreur de vouloir étudier l’origine et l’histoire des religions d’un point de vue transcendant, abstraction faite des intérêts inavouables qui se cachèrent, à toutes les époques, sous le manteau sacré des dieux. Mais cette erreur était trop favorable à la cause sacerdotale pour n’être pas acceptée d’enthousiasme par les partisans des vieilles traditions. Et, comme ils détiennent les postes de direction, ils ont finalement imposé leurs préjugés, même à des esprits indépendants.
Il serait fastidieux d’énumérer toutes les hypothèses émises dans le but d’expliquer l’origine première des religions. Rappelons cependant les idées de quelques auteurs. C’est dans une terreur secrète et irréfléchie qu’il faut placer cette origine, d’après Lucrèce. Devant le spectacle des merveilles célestes, quand la foudre nous fait trembler ou que la tempête devient menaçante, nous soupçonnons l’existence d’une puissance surnaturelle et redoutable. Nous admettons, pour notre part, que cette conception n’est pas sans mérite et que la peur contribua largement à l’éclosion du sentiment religieux. Evhémère, au IVe siècle avant notre ère, assurait que les habitants de l’Olympe étaient des personnages divinisés par l’admiration des peuples ; il ramenait la mythologie à l’histoire. Beaucoup d’autres ont prétendu que la religion avait débuté par le culte des morts. Dupuis a soutenu que les dieux de la mythologie n’étaient que des constellations et qu’il fallait chercher dans leur histoire une expression allégorique du cours des astres et de leurs rapports mutuels. Nous sommes certains, affirmait Dupuis, « que l’univers et ses parties, c’est-à-dire la nature et ses agents principaux, ont non seulement dû être adorés comme dieux, mais qu’ils l’ont été effectivement, d’où il résulte une conséquence nécessaire, à savoir que c’est par la nature et ses parties, et par le jeu des causes physiques que l’on doit expliquer le système théologique de tous les anciens peuples ; que c’est sur le ciel, sur le Soleil, sur la Lune, sur les astres, sur la Terre et sur les éléments que nous devons porter nos yeux, si nous voulons retrouver les dieux de tous les peuples et les découvrir sous le voile que l’allégorie et la mysticité ont souvent jeté sur eux, soit pour piquer notre curiosité, soit pour inspirer plus de respect ».
Remarquant les liens étroits qui relient l’érotisme à la mysticité, ainsi que le caractère phallique de bien des cultes anciens, plusieurs ont pensé que la sexualité n’était pas étrangère à la naissance des phénomènes religieux. Selon son habitude, Bergson s’est efforcé de sauver d’une débâcle totale les préjugés traditionnels, en usant d’une terminologie poétique et quintessenciée. Réaction défensive de la nature contre le pouvoir dissolvant de l’intelligence, la religion exerce, d’après lui, une action compensatrice à l’égard des maux que la connaissance rationnelle provoque. Sous sa forme statique, elle aboutit à la création de mythes qui comblent le déficit de confiance dans la vie que la réflexion engendre ; son caractère social reste alors très marqué. Sous sa forme dynamique, elle ne se laisse point arrêter par la fonction fabulatrice et se pénètre de mysticisme :
« Elle soutient l’homme par le mouvement même qu’elle lui donne, en le replaçant dans l’élan créateur, et non plus par des représentations imaginaires auxquelles elle adresse son activité dans l’immobilité. »
Bergson, qui s’imagine que la pensée scientifique n’a pas progressé depuis l’époque où ses romans métaphysiques connaissaient la grande vogue, accouche de perles de ce genre :
« Le grand mystique serait une individualité qui franchirait les limites assignées à l’espèce par sa matérialité, qui continuerait et prolongerait ainsi l’action divine. »
Incontestablement, la thèse sociologique s’avère plus proche du réel que les fantaisistes élucubrations bergsoniennes. Très à la mode, elle constitue presque un article de foi pour maints universitaires. C’est dans ses formes les moins évoluées, les plus simples, celles qu’elles revêtent chez les primitifs australiens, que Durkheim et ses élèves étudient de préférence les manifestations religieuses. On leur doit d’avoir vulgarisé, chez nous, le sens des mots tabou, totem, mana. La défense d’employer ou de toucher un être ou une chose, défense non motivée mais sanctionnée par une peine d’origine surnaturelle, confère à cet être ou à cette chose la qualité de tabou. Le terme est polynésien ; toutefois, il désigne un fait que l’on retrouve chez l’ensemble des peuples de l’Antiquité, chez les sauvages actuels, et qui a même laissé des traces dans les pays civilisés.
Le « Tu ne tueras point » de la Bible ne serait qu’un tabou, valable pour les seuls membres de la nation israélite ; et les effroyables tueries fréquemment ordonnées par l’Éternel, lorsque les Hébreux furent vainqueurs, semblent confirmer cette interprétation. Certes, j’approuve les croyants qui, prenant ce précepte à la lettre, refusent d’une façon complète de répandre le sang humain ; ils ont pour eux la raison, à défaut de la Bible. Mais l’interprétation qu’ils donnent de ce précepte du décalogue ne répond pas aux véritables intentions de celui qui le rédigea. Rempart dressé contre les tendances destructives, le tabou ne serait pas inconnu des animaux supérieurs, puisque les plus carnassiers ne mangent habituellement ni leurs petits, ni leurs semblables. Par la suite, les interdictions religieuses s’inspireront de considérations raisonnées ; néanmoins, le souvenir des anciennes défenses ne disparaîtra pas totalement.
Le totémisme (du mot totem, ou mieux : otani, employé par les Indiens peaux-rouges) désigne, en gros, le culte rendu à des animaux, à des végétaux et, dans quelques cas, à des minéraux ou à des corps célestes considérés comme des protecteurs ou des ancêtres de l’homme. Il résulte d’un élargissement de l’instinct social qui, finalement, assigne une place à certains animaux ou à certains végétaux parmi les membres d’un groupe, que la communauté d’origine conduit à s’épargner les uns les autres. Universellement répandu à une époque très reculée, le culte des animaux et des végétaux, plus ou moins mêlé d’anthropomorphisme, se retrouve chez tous les anciens peuples. En Égypte, maintes espèces animales et végétales étaient sacrées : chats, ibis, crocodiles, etc., furent du nombre. Le taureau Apis et le bouc de Mendès recevaient les adorations d’innombrables fidèles. Avant de prendre une forme humaine, Horus fut un épervier ou un faucon, Osiris un taureau et Isis une génisse ; on pourrait allonger indéfiniment la liste des dieux animaux ou végétaux.
Chez les Grecs, la mythologie était pleine d’histoires de métamorphoses ; et les animaux sacrés furent maintenus à titre de symboles ou de compagnons des puissances célestes. Dans la Bible, le serpent de la Genèse, l’ânesse de Balaam, le monstre marin de Jonas, la colombe de Noé apparaissent comme les survivances de récits où les animaux jouaient un rôle divin. En Syrie, Hinterland était un dieu taureau, Atergatis une déesse à la fois colombe et poisson ; le célèbre dieu phénicien Adonis fut d’abord un sanglier, avant de devenir un jeune chasseur, cher au cœur d’Astarté.
C’est en observant les mœurs de certaines peuplades, restées à l’état primitif, que l’on a pu se faire une idée claire et précise du totémisme. Parce qu’il est le protecteur du clan, le totem ne doit être ni tué (si c’est un animal) ou détruit (si c’est une plante), ni mangé. Néanmoins, comme il s’avère un réservoir de force secrète et possède de merveilleuses vertus, on peut l’absorber dans des repas rituels, certains jours de fête ou à l’occasion d’événements d’une gravité exceptionnelle. Nombre de pratiques religieuses encore en usage découlent de là : l’agneau pascal des juifs est d’origine totémique, ainsi que l’eucharistie des catholiques. La seconde se complique, il est vrai, d’une anthropophagie qui, par bonheur, reste d’ordre purement symbolique. Beaucoup d’interdictions alimentaires – le maigre imposé par l’Église romaine, la défense de manger du porc faite aux juifs et aux musulmans, etc. – s’expliquent, non par des considérations hygiéniques, comme les écrivains modernes voudraient le faire croire, mais par le culte rendu autrefois à certains animaux et à certains végétaux.
Touchant l’idée de mana, remarquons que la magie conduit à la croyance en une force indéterminée, mi spirituelle, mi mécanique, riche de virtualités qui prendront une forme précise par la suite. Cette sorte de dieu, immanent au monde et diffus dans une multitude d’objets, mais privé d’histoire et manquant de nom, aurait donné naissance aux divers êtres sacrés. Déjà présent dans le totem qu’il remplit et déborde, il circule plus ou moins secrètement sous toutes les formules et tous les mythes religieux, il est supposé par toutes les cérémonies cultuelles ; les dieux bien individualisés sont ses descendants.
Félicitons l’école sociologique d’avoir rapproché les grossières croyances primitives des spéculations transcendantes de nos théologiens sur la divinité. Avec raison, elle a montré l’étroite parenté de doctrines que l’on supposait radicalement différentes. Mais nous ne pouvons suivre Durkheim dans sa tentative pour tout expliquer par la Société, devenue à ses yeux une entité supérieure, un Grand Être. Manifestement, il quitte la zone des recherches scientifiques pour celle des rêveries métaphysiques, quand il soutient que la religion n’est que la société sublimée et hypostasiée, et donc qu’elle est profondément nécessaire et vraie puisque la société s’avère la primordiale condition de la vie humaine. L’existence de symboles, capables de matérialiser, en quelque sorte, et de rendre accessible aux sens le véritable objet des religions, lui semble fort utile. Loin de combattre ces dernières, il prétend les aider, car il estime qu’en assurant la communion des membres d’un même groupe, elles remplissent un rôle important. Si les Églises repoussèrent les offres de service que leur faisait Durkheim, c’est que son dieu n’était guère séduisant.
Le reproche essentiel qu’il faut adresser aux grandes théories sur l’origine des religions, c’est de prendre une tendance unique ou quelques faits soigneusement choisis pour montrer que leur seule complication rend compte de tous les phénomènes enregistrés par l’histoire ou observés de nos jours. À notre avis, chacun des systèmes en présence contient une part de vérité. Dans la naissance des concepts et du sentiment religieux, il faut faire une place au besoin de comprendre, à la terreur et à l’admiration que les forces cosmiques suscitaient chez l’homme primitif, ainsi qu’à son désir de contraindre la nature à l’obéissance ; l’on ne doit pas davantage oublier l’action profonde que la société exerce sur l’individu et l’intervention intéressée des chefs ou des prêtres.
Sur l’importance d’un élément que nous n’avons pas encore signalé, l’animisme, l’accord entre chercheurs semble déjà réalisé. Inconsciemment, sans y prendre garde, le sauvage, l’enfant, l’animal prêtent aux autres vivants et aux choses inanimées les états d’âme par eux-mêmes ressentis. L’adorateur de fétiches loge des esprits dans les pierres, coquilles et objets divers qu’il honore d’un culte particulier. Dans sa colère, le bambin insulte, mord et frappe le morceau de bois ou l’instrument qui le blessa. Chez l’animal, le comportement dénote une tendance à supposer des intentions bonnes ou mauvaises, même aux objets privés de mouvement. L’homme adulte lit encore avec plaisir des fables où nos sentiments et nos idées sont attribués aux animaux ; à la nature qui l’environne, à l’air, à l’eau, le poète prête volontiers ses propres craintes et ses propres désirs. De bonne heure, nos lointains ancêtres durent peupler l’univers d’esprits pareils, ou presque, à ceux des humains. Aussi, le polythéisme précéda-t-il chez tous les peuples, même chez les Hébreux, la croyance en un seul dieu. Concevant le monde spirituel sur le type de nos sociétés terrestres, on imagina une hiérarchie de divinités plus ou moins puissantes ; on mit, plus tard, un monarque à leur tête. Le monothéisme fut le terme final d’une centralisation céleste qui se modelait, fidèlement, sur les grandes royautés d’ici-bas. Pour expliquer la naissance des religions et leurs transformations postérieures, les lois psychologiques ordinaires suffisent.
* * *
Sans nous attarder à la description des cultes disparus, nous étudierons les religions encore existantes, et particulièrement le judaïsme et le christianisme dont l’influence est prépondérante dans les pays d’Occident.
Israélites et chrétiens attribuent une importance particulière aux cinq livres : Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome, dont l’ensemble constitue le Pentateuque. L’auteur en serait Moïse, qui rapporte avec fidélité les événements de son époque et qui, pour le reste, n’a pu se tromper, puisqu’il fut inspiré et conseillé par dieu même. Or, l’examen critique du Pentateuque, commencé au XVIIe siècle par Richard Simon (pour ce motif, violemment dénoncé par Bossuet), aboutit à des conclusions très différentes. Et les exégètes du XIXe siècle, complétant l’œuvre entreprise deux siècles auparavant, ont démontré que les cinq livres, directement inspirés par Yahveh, n’étaient qu’un mélange de plusieurs textes, dont le contenu et la langue dénotent des dates de composition très différentes. De cette combinaison souvent maladroite, certains textes out pu être isolés par les critiques : ces documents sont appelés l’Elohiste, le Yahviste, le Deutéronome, le Code sacerdotal. Moïse n’est même pas l’auteur du mélange, qui fut accompli à une période bien postérieure à celle où il est supposé avoir vécu.
Si la partie historique du Pentateuque contient des passages fort anciens et qui indiquent un état de civilisation rudimentaire, on peut affirmer néanmoins que, non seulement ce livre ne remonte pas au législateur hébreux, mais que les principaux documents qui le composent ne remontent pas davantage à son époque. Salomon Reinach, enclin pourtant à considérer les éléments constitutifs du Pentateuque comme très archaïques, reconnaît que les prétentions traditionnelles sont indéfendables. Il écrit :
« Pour la publication du Deutéronome, nous avons un texte important. Sous le règne de Josias, on prétendit avoir découvert dans le temple un document très ancien, qui avait été perdu et qui fut promulgué solennellement. Ces histoires de « découvertes » de vieux manuscrits sont toujours suspectes ; il est probable que ce texte (le Deutéronome) fut non pas exhumé, mais fabriqué à cette époque, et Voltaire a supposé, non sans vraisemblance, que Jérémie avait contribué à cette fraude. On trouve, en effet, dans Jérémie plusieurs allusions au Deutéronome, notamment au passage qui concerne la libération des esclaves et la mauvaise humeur que cette mesure excita parmi les riches. Quant aux autres prophètes, ils ne citent jamais la loi écrite et l’on en peut conclure qu’ils ne la connaissaient pas. Il n’est pas moins certain que beaucoup d’épisodes de l’histoire racontée dans les livres des Juges et de Samuel sont en contradiction avec les lois dites mosaïques, qui ne pouvaient faire autorité à cette époque... La date que donne le texte cité plus haut (II Rois, 22) pour la rédaction du Deutéronome est la seule qui soit connue avec quelque certitude. Je ne puis entrer ici dans la discussion des hypothèses sur la date relative des autres couches du Pentateuque. Les savants ne sont pas d’accord à ce sujet ; mais on ne peut dire que leurs théories s’entre-détruisent, car ils sont, du moins, unanimes à nier l’homogénéité, l’origine mosaïque et la haute antiquité du Pentateuque. »
C’est à l’époque d’Esdras que fut publié le Pentateuque, sous la forme où nous le possédons ; mais l’on modifia beaucoup le texte ancien. La comparaison entre les récits de la Genèse et les mythes babyloniens, ainsi qu’entre le code d’Hammurabi et la loi mosaïque, prouve que l’on fit des emprunts à la religion chaldéenne : on avait appris à la connaître durant la captivité en Babylonie. Ainsi tombe complètement l’autorité du plus important des livres sacrés admis par les juifs ; et les légendes qui se rapportent à la création du monde, ainsi qu’aux premiers âges de l’humanité, perdent toute valeur historique.
Moïse a-t-il même existé ? On ne saurait l’affirmer avec certitude : il n’est pas l’auteur des écrits qu’on lui attribue, et les récits qui le concernent présentent un caractère mythologique indéniable. Touchant Noé, Abraham, Jacob, la captivité d’Égypte, le séjour au désert, la conquête du pays de Chanaan, nous ne savons non plus rien de positif. Il faut descendre jusqu’à Saül et à l’établissement de la monarchie, pour que l’histoire des Hébreux présente, mêlés à de nombreuses légendes, quelques faits indubitables.
Au point de vue moral, Yahvé, qui triompha de ses concurrents et devint l’unique dieu des juifs, surtout grâce à la préférence que lui accorda Salomon, se révèle un monstre sanguinaire. Pour de minimes incartades, il ordonne de massacrer même ses propres adorateurs. Pris d’une colère folle, il s’écrie :
« Ma fureur s’est allumée contre eux comme un feu. Je les accablerai de maux... La famine les consumera, et des oiseaux de carnage les déchireront par leurs morsures cruelles. J’armerai contre eux les dents des bêtes farouches. »
Plus de quatorze mille Israélites périssent à la suite d’une épidémie qu’il provoque, et des centaines meurent, piqués par des serpents. À l’égard de ses adversaires, il perd toute mesure et réclame des tueries incroyables. Les victimes propitiatoires ne lui suffisent pas, il impose souvent la destruction de tous les habitants d’une ville ou d’une contrée.
À Jéricho, il exige le massacre des hommes, des femmes, des enfants, des bœufs, des brebis. Des sept peuples cananéens qui habitent la Palestine, il promet de ne rien laisser subsister :
« Vous saurez aujourd’hui que le Seigneur votre Dieu passera lui-même devant vous comme un feu dévorant et consumant, qui réduira vos ennemis en poudre, les perdra, les exterminera en peu de temps. »
Les Nombres racontent que les Hébreux firent « la guerre à ceux de Madian, comme l’Éternel l’avait commandé, et ils en tuèrent tous les mâles ». Cette sinistre besogne accomplie, Moïse ajouta :
« Tuez donc maintenant les mâles d’entre les petits enfants et tuez toute femme qui aura eu compagnie d’homme. »
On appelait chérem ce qui devait être sacrifié. Le Lévitique dit :
« Tout chérem est sacré, soit en bétail, soit en hommes, soit en fruits de la campagne ; le chérem doit être tué. »
Or, le Deutéronome parle d’une ville chérem offerte ainsi en holocauste et dont rien ne subsista.
Saül fut vivement blâmé par Samuel, pour avoir épargné un prisonnier, alors que Yahvé ordonnait un massacre total. David obéissait mieux.
« Il prit la ville de Rabbah ; et, ayant fait sortir les habitants, il les coupa avec des scies, fit passer sur eux des charriots avec des roues de fer, les tailla en pièces avec des couteaux et les jeta dans des fours où l’on cuit la brique. C’est ainsi qu’il traita toutes les villes des Ammonites. »
Dans maints passages de la Bible, on retrouve la même ivresse homicide, inspirée par l’Éternel. Le psaume 110 affirme :
« Le Seigneur tient ses assises parmi les nations remplies de cadavres ; il écrase les têtes dans les contrées tout autour. »
Les prophètes eux-mêmes, dont l’action fut bienfaisante et qui réagirent contre les pratiques inhumaines, ont constaté l’épouvantable cruauté du dieu juif. Isaïe déclare :
« Peuples, soyez attentifs, car l’indignation du Seigneur va fondre sur toutes les nations, sa fureur sur toutes leurs armées. Ils mourront de mort sanglante, et ceux qui auront été tués seront jetés là ; une puanteur horrible s’élèvera de leurs corps, et les montagnes dégoutteront de leur sang. »
Jérémie est encore plus explicite :
« Ce jour-là est à Dieu, Yahvé Sabaoth, pour se venger de ses ennemis : le glaive dévore, se rassasie de leur chair et s’enivre de leur sang ; car c’est un festin pour Dieu, Yahvé Sabaoth. »
Certes, au point de vue authenticité, les livres des prophètes ne soutiennent guère mieux que le Pentateuque l’examen critique. Beaucoup portent les traces de remaniements postérieurs ; la prophétie d’Habacuc n’est qu’une artificielle combinaison d’autres textes : l’on doit admettre deux Isaïe ; le premier prêchait sous le règne d’Ezéchias, le second exhortait les Juifs déportés en Babylonie ; le livre de Daniel est entièrement frauduleux. Pourtant, les écrits prophétiques, ceux d’Isaïe, de Jérémie, d’Ézéchiel en particulier, témoignent de l’existence de personnalités vigoureuses qui s’élevèrent contre le formalisme cultuel et enseignèrent une morale plus haute.
Réaction heureuse contre la religion des anciens juifs, le prophétisme a préparé la voie à des idées plus modernes. Selon Amos, Osée, Michée, Isaïe, c’est dans la loi morale que réside la vraie base de la religion ; mais cette doctrine était trop nouvelle pour valoir à ceux qui la propageaient autre chose que des persécutions. Le dieu d’Amos déclare :
« Je hais vos fêtes, je les abhorre ; je ne puis souffrir vos assemblées. »
Et Osée met cette belle parole dans la bouche de l’Éternel :
« C’est la miséricorde que je veux, et non le sacrifice. »
Michée se demande :
« Qu’offrirai-je au Seigneur, qui soit digne de lui ? L’apaiserai-je en lui sacrifiant mille béliers ou des milliers de boucs engraissés ? Lui sacrifierai-je, pour mon crime, mon fils aîné et, pour mon péché, quelque autre de mes enfants ? »
De bonnes actions, voilà ce qui plaît particulièrement à Dieu, déclare le prophète, en réponse à cette question.
Isaïe fait dire à l’Éternel qu’il repousse les sacrifices d’animaux :
« Qu’ai-je à faire de cette multitude de victimes que vous m’offrez ? Tout cela m’est dégoût. Je n’aime point les holocaustes de vos béliers, ni la graisse de vos troupeaux, ni le sang des veaux... L’encens m’est en abomination ; je ne puis souffrir vos nouvelles lunes, vos sabbats et vos autres fêtes... Lorsque vous multiplierez vos prières, je ne les écouterai point, parce que vos mains sont pleines de sang. »
Jérémie s’élève, lui aussi, contre les tueries d’animaux ; il ne veut pas que le temple soit souillé par des flots de sang. Ajoutons que l’idée de la venue d’un messie, sauveur d’Israël, idée que l’on rencontre chez certains prophètes, exerça par la suite une influence considérable et favorisa l’avènement du christianisme.
Dans l’Ancien Testament, il y avait place, à côté de la loi et des prophètes, pour des poèmes, des livres historiques, des narrations édifiantes. La codification tentée par les prêtres, après leur retour de Babylonie, ne mit pas fin aux discussions concernant la liste des livres inspirés, puisqu’elles se continuaient encore pendant les premiers siècles de l’ère chrétienne. De nombreux rabbins de Palestine élevaient des objections contre le Cantique des Cantiques, les Proverbes, les livres d’Ezéchiel et d’Esther, l’Ecclésiastique. De plus, le canon alexandrin acceptait des livres exclus du canon palestinien, la Sagesse, l’Ecclésiastique, les deux livres des Macchabées, les livres de Tobie, de Judith, de Baruch. À l’heure actuelle, les catholiques donnent toujours, comme appartenant à l’Ancien Testament, des ouvrages repoussés par les juifs et les protestants.
Pendant la période qui sépare le retour de l’exil de l’apparition du christianisme, le rabbinisme, caractérisé par l’étude des textes sacrés, se développa, non seulement en Palestine, mais dans toutes les colonies juives. Les idées grecques firent des adeptes parmi les adorateurs de Yahvé ; et, dès le second siècle avant notre ère, on signalait le péril hellénique. Puis des controverses mirent aux prises des écoles de tendances opposées : les Pharisiens admettaient l’existence des anges et la résurrection des corps ; les Saducéens repoussaient l’une et l’autre de ces croyances. Jérusalem ne manqua pas de docteurs fameux : l’un des plus célèbres fut le Pharisien Hillel, qui vécut à l’époque où le christianisme prenait naissance. Ses préceptes annoncent ceux que les évangélistes attribuèrent à Jésus. Hillel disait :
« Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fit, c’est toute la loi ; le reste n’en est qu’un commentaire. »
Belles paroles qui démontrent que le christianisme n’est pas aussi original que le prétendent ses apologistes. Les Talmuds, composés durant les six premiers siècles de notre ère, contiennent de subtiles remarques et des discussions quintessenciées ; malheureusement, les détails intéressants pour un chercheur moderne n’y abondent pas.
L’apparition du christianisme pose un problème de très haute importance, et qui a fait l’objet de nombreuses publications depuis quelque temps, celui de l’existence de Jésus. Tous les exégètes sérieux s’accordent à reconnaître que les Évangiles sont des récits composés tardivement, par des hommes qui n’avaient jamais vu le Christ, et que la part des légendes est trop considérable dans ces ouvrages pour qu’il soit possible de rien affirmer avec certitude touchant la vie du fondateur de la religion chrétienne. Guignebert déclare :
« Jésus s’entrevoit si mal à travers les récits de nos Évangiles que certains critiques hardis émettent des doutes sur la réalité de sa vie ; je ne les partage pas, mais je ne puis les déclarer absurdes. »
Loisy souligne aussi le peu de confiance que l’on doit avoir dans les Évangiles :
« On fausse entièrement le caractère des plus anciens témoignages concernant l’origine des Évangiles, quand on les allègue comme certains, précis, traditionnels et historiques : ils sont, au contraire, hypothétiques, vagues, légendaires, tendancieux ; ils laissent voir que, dans le temps où l’on se préoccupa d’opposer les Évangiles de l’Église au débordement des hérésies gnostiques, on n’avait sur leur provenance que les renseignements les plus indécis. »
Salomon Reinach n’hésite pas à dire :
« Les Évangiles, abstraction faite de l’autorité de l’Église, sont des documents inutilisables pour l’histoire de la vie réelle de Jésus ; ils peuvent et doivent seulement servir à nous apprendre ce que les Églises primitives ont cru de lui. »
De pareilles conclusions suffisent déjà à ruiner, radicalement, la totalité de l’édifice dogmatique construit par les théologiens. Or, des exégètes du plus grand mérite, tels que P. L. Couchoud et P. Alfaric, professeur d’histoire des religions à l’université de Strasbourg, vont plus loin et mettent en doute l’existence même du Christ. Je dois à l’amitié de P. Alfaric, un savant courageux, qui ne voulut pas rester dans l’Église quand il eut mesuré la profondeur du mensonge catholique, d’être bien documenté sur ces questions. Tout d’abord, il paraît étrange que les historiens juifs qui furent presque contemporains de Jésus, et qui connurent ses premiers disciples, ne fassent jamais allusion au fondateur du christianisme, même lorsqu’ils racontent les événements qui se déroulèrent en Judée, à l’époque où il aurait vécu. C’est le cas pour Juste de Tibériade : le patriarche Photius lisait encore ses livres aujourd’hui perdus, et il déclare qu’il n’y a trouvé :
« Aucune mention de la venue du Christ, des événements de sa vie, ni de ses miracles. »
Quant aux deux passages de Josèphe concernant Jésus et Jacques, frère de Jésus, ce sont des interpolations ; au début du IIIe siècle, Origène ne découvrait rien de semblable dans le texte qu’il avait en sa possession. P. Alfaric note :
« Dans toute l’œuvre de Josèphe, nous ne trouvons pas un paragraphe, pas une phrase, pas un mot authentiques qui concernent Jésus. »
Le Talmud se borne à quelques phrases confuses et vagues, rédigées tardivement. Les Actes de Pilate, publiés soit par les païens, soit par les chrétiens, sont des faux, de l’avis unanime des érudits.
On rappelle volontiers la phrase où Suétone raconte que Claude :
« Chassa de Rome les juifs qui, sous l’impulsion de Chrestos, s’agitaient constamment. »
Même si Suétone fait allusion à Jésus, ce qui est loin d’être certain, il faut convenir qu’il est bien mal renseigné puisqu’il le prend pour un agitateur résidant à Rome. Ce qu’il dit prouverait tout au plus que le nom du Christ commençait à se répandre. En ce qui concerne Tacite, comme il écrivait ses Annales vers 117 seulement, il a pu se faire l’écho de légendes, fort développées déjà à ce moment.
Restent les Évangiles et les Épîtres pauliniennes. Or, nous savons que les Évangiles officiels n’offrent pas plus de garantie que les Évangiles apocryphes. Sur leurs auteurs, nous n’avons aucun renseignement ; nous ignorons même leurs noms, car ceux de Marc, de Luc, de Matthieu, de Jean semblent fictifs. Depuis longtemps, on les estimait postérieurs à l’an 70 ; par contre, beaucoup croyaient qu’ils avaient dû paraître avant la fin du premier siècle. De nouvelles recherches ont montré qu’ils furent rédigés dans la première moitié du IIe siècle.
Tous les exégètes indépendants s’accordent pour nier la valeur historique du quatrième Évangile. Loisy déclare :
« Les récits de Jean ne sont pas de l’histoire, mais une contemplation mystique de l’Évangile ; ses discours sont des méditations théologiques sur le mystère du salut. »
Écrit par un Juif hellénisant, il trace du Christ un portrait absolument contraire à celui qu’avaient donné les Synoptiques. Loisy affirme encore :
« Si Jésus a parlé et agi comme on le voit agir et parler dans les trois premiers Évangiles, il n’a pas parlé et agi comme on le voit agir et parler dans le quatrième. »
Les Synoptiques forment un groupe distinct. Matthieu s’inspire de Luc, qu’il modifie par endroits ; Luc, dans la forme que nous possédons, résulte du remaniement d’un texte plus ancien, que Marcion utilisait vers 140. Couchoud pense que Marc dépend du premier Luc ; Alfaric estime, au contraire, que Luc s’est inspiré de Marc, qui serait ainsi le plus ancien des Évangiles. Mais l’accord est complet entre ces deux auteurs pour déclarer que Marc et Luc sont pareillement dépourvus de valeur historique. Dans tous les cas, il faut conclure que les récits évangéliques présentent un caractère artificiel qui doit inspirer une extrême défiance. Et l’on s’explique que, dans un moment de franchise, saint Augustin ait écrit que, s’il ne faisait pas confiance au dire de l’Église, il ne croirait pas à l’Évangile.
Quant aux Épîtres de Paul, les critiques constatent que l’édition admise vers 140 différait beaucoup de celle qui a cours, aujourd’hui, parmi les catholiques ; et les textes frauduleusement ajoutés par l’Église sont ceux que l’on invoque de préférence pour montrer que le Christ a réellement vécu. Dans l’ancienne édition, nous ne trouvons sur Jésus que des renseignements très vagues, et l’on a l’impression de nager en plein mythe. Alfaric dit :
« Le Jésus de Paul n’offre à nos yeux qu’une image fuyante. Il demeure aussi impalpable que le « fils de l’homme » entrevu par Daniel en ses « visions nocturnes », qui venait « avec les nuées des cieux », vers « l’Ancien des jours », pour recevoir une domination éternelle sur l’ensemble des peuples, et qui symbolisait, pour le voyant, les Juifs fidèles, appelés à dominer sur toutes les nations. Son individualité n’est pas plus accusée que celle de ce « serviteur de Dieu » en qui le second Isaïe personnifiait l’Israël de l’exil, souffrant et agonisant pour les péchés d’autrui, montrant ainsi la voie aux égarés, et méritant pour lui-même un merveilleux triomphe ; pour mieux dire, il ne fait qu’un avec ces antiques figures. Il est né de leur fusion, il participe à leur nature, il appartient de même au monde idéal de la foi. »
Ainsi le Christ des Épîtres pauliniennes présente tous les caractères d’un être mythologique ; il n’a rien d’un personnage historique. Par ailleurs, Couchoud fait remarquer que, dans l’Apocalypse, on ne trouve aucun détail concernant le passé humain de Jésus ; de ces visions échevelées, l’on chercherait vainement à extraire quelque donnée positive sur l’agneau « immolé avant la fondation du monde » et qui doit, plus tard, pourchasser la Bête, héritière de l’esprit du Grand Dragon.
S’il s’agissait d’une autre religion que le christianisme, on n’hésiterait pas à conclure que Jésus est un dieu fictif, comme Osiris, Attis, Mithra, et qu’il n’eut jamais d’existence que dans l’esprit de ses adorateurs. Mais les Églises qui se réclament de lui comptent des millions d’adhérents ; elles sont puissantes, disposent d’immenses ressources et prétendent dominer finalement l’ensemble de la Terre. Devant une conclusion qui soulève la réprobation presque unanime des fidèles, et qui choque même les incroyants, beaucoup d’historiens se taisent ou ne parlent pas d’une façon claire.
C’est l’espérance d’un messie, d’un Christ, si répandue parmi les juifs, qui serait à l’origine des récits évangéliques. Tous les épisodes qu’on y rencontre répondent à d’anciennes prophéties. Alfaric constate :
« Tous exploitent, à leur manière, quelque vieux thème messianique. L’Évangile se présente, dans son ensemble, comme un décalque de l’Ancien Testament. Il ne fait qu’en transposer les oracles sous une forme plus ou moins historique. »
De bonne heure, il exista des recueils de témoignages messianiques, groupés sous certaines rubriques, et qui servaient aux prosélytes de la foi nouvelle. C’est dans ces recueils qu’il faut chercher l’ébauche de la première Vie de Jésus. Paul et les autres apôtres, doués comme lui d’une ardeur mystique agissante : voilà quels furent, en réalité, les vrais fondateurs du christianisme. Sans eux, la petite secte juive qui se réclamait de Jésus n’aurait jamais fait la conquête du monde romain. Pour obtenir ce résultat, elle dut se dégager de ses premières attaches, rompre résolument avec le judaïsme et ouvrir toutes grandes les portes de ses sanctuaires aux gentils. Parmi les premiers fidèles, le nombre fut considérable des cerveaux mal équilibrés et des gens sans aveu ; néanmoins, dans l’ensemble, ils étaient plus désintéressés, moins hypocrites que les chrétiens d’aujourd’hui.
Retracer l’histoire du christianisme sortirait du cadre de notre étude ; du moins, nous dégagerons les traits essentiels qui donnent une physionomie bien particulière aux principales Églises qu’il a produites : catholicisme, vieux tronc encore debout, puis Église orthodoxe et protestantisme, vigoureux rameaux qui s’en détachèrent, le premier au XIe siècle, le second au XVIe.
L’Église romaine se prétend la seule Église du Christ, hors de laquelle il n’est point de salut ; orthodoxes et protestants sont des schismatiques ou des hérétiques, sortis de la bergerie dont Jésus lui a confié la garde, et qu’elle entoure d’une épaisse barrière de dogmes. Dispensatrice des grâces divines, canal unique de la vérité, elle s’efforce, depuis des siècles, d’asservir et les corps et les cerveaux. Boniface déclarait :
« Dieu, en nous imposant le joug de la servitude apostolique, nous a établis au-dessus des rois, des empereurs pour arracher, détruire, anéantir, disperser, bâtir et planter en son nom. »
Tous les papes ont montré depuis, par leurs actions sinon par leurs paroles, qu’ils aspiraient à dominer souverainement. Et la Ligue apostolique se donne encore pour but, de nos jours :
« Le retour des nations et des peuples et de l’ordre social tout entier à Dieu et à son Christ par la Sainte Église. »
Dépouillé de ses privilèges dans maintes régions, obligé de compter avec de nombreux et puissants adversaires, le clergé catholique n’ose plus, chez nous, afficher devant les laïcs ses prétentions outrecuidantes d’autrefois. Mais, dans les séminaires, on continue d’enseigner aux futurs prêtres que les autorités religieuses l’emportent, en dignité, sur les pouvoirs civils ; et, dès qu’il redevient le maître, dans l’Italie fasciste par exemple, le catholicisme se fait concéder des droits exorbitants. Héritière des traditions absolutistes de l’Empire romain, désireuse d’accroître indéfiniment ses richesses, de maintenir ses ouailles dans la plus stricte obéissance et de jouer un rôle politique de premier plan, la puissance ecclésiastique a perpétué les pires abus commis par les autorités païennes.
Dès qu’elle fut l’amie des princes et disposa des tribunaux, son arme préférée fut la violence. Les apologistes, si loquaces lorsqu’il s’agit de rappeler le souvenir des premiers chrétiens qui souffrirent pour leur foi, et dont le nombre s’avère bien inférieur à ce qu’on prétendit longtemps, oublient de rappeler qu’à peine abritée sous la tutelle d’un Constantin, meurtrier de sa femme et de son fils, l’Église catholique devint persécutrice à son tour. Et elle a fait plus de martyrs, à elle seule, que toutes les religions antiques et tous les empereurs païens réunis. Théodose et Honorius fermeront les temples et, même, prononceront la peine de mort contre les partisans du vieux culte. En 385, l’évêque espagnol Priscillien et six de ses amis furent exécutés pour crime d’hérésie ; à l’instigation de saint Cyrille, la savante mathématicienne et philosophe Hypathie fut massacrée, en 414, par des croyants fanatisés.
Pour imposer leurs idées, saint Augustin et saint Jérôme invoquèrent l’aide des pouvoirs civils ; et, en 447, le pape Léon Ier affirma qu’il était juste et bon de faire mourir les hérétiques. Monstrueuse doctrine, que les canonistes et théologiens de Rome ont toujours approuvée, et qui fit d’innombrables victimes quand le clergé fut tout-puissant. Elle légitima les horreurs commises contre les Albigeois. L’un des bourreaux proclamait :
« Tuez toujours, Dieu reconnaîtra les siens. »
Et, durant une vingtaine d’années, de bons catholiques gagnèrent le paradis en détruisant des villes entières, en massacrant des milliers d’innocents. C’est encore au nom du principe énoncé par Léon Ier que furent allumés les bûchers de l’Inquisition ; que l’on remplit les geôles du Saint-Office ; que l’on sonna le tocsin de Saint-Germain-l’Auxerrois appelant les pieux catholiques au massacre de la Saint-Barthélemy ; que le duc d’Albe organisa des tueries dans les Pays-Bas, fidèle en cela aux directives de Philippe II, son maître, qui, apprenant qu’il y avait des hérétiques dans une vallée du Piémont, écrivait froidement :
« Tous au gibet. »
Nous pourrions remplir des pages et des pages avec la seule énumération des meurtres collectifs imputables au catholicisme. Le franciscain Conrad de Marbourg, persécuteur des Hussites, disait :
« Que nous importe de brûler cent innocents, pourvu qu’il y ait un seul coupable. »
Ce mépris de la vie humaine inspirera également l’Église dans sa conduite à l’égard des infidèles. Charlemagne ne laissa aux Saxons d’autre alternative que de recevoir le baptême ou de mourir ; en une seule fois, il en tua plus de 4000. La conversion des Vendes, œuvre des ducs de Pologne, celle des Prussiens, due aux chevaliers Teutoniques, celle des habitants de la Lituanie, de la Livonie et de la Courlande, dont se glorifièrent les chevaliers Porte-Glaive, furent obtenues par des procédés de même ordre. Louis XIV ranimera les persécutions contre les Vaudois ; en guise de missionnaires, il enverra des soudards inhumains chez les protestants des Cévennes ; finalement, il révoquera l’Édit de Nantes, aux applaudissements de Bossuet et des autres évêques français. Voilà comment, en plein XVIIe siècle, les autorités catholiques procédaient encore pour obtenir la conversion des hérétiques !
Et les savants furent surveillés et condamnés sans ménagement. Témoin Galilée, contraint par les inquisiteurs de proclamer fausses les découvertes astronomiques auxquelles l’avaient conduit ses recherches et son génie. Au XIXe siècle, les théologiens, ne pouvant faire emprisonner les biologistes partisans des doctrines évolutionnistes, déverseront du moins sur eux des tombereaux d’injures. Délaissant un peu la lutte contre les hérétiques, avec qui elle parvient même à s’entendre, l’Église romaine tourne sa fureur, à l’heure actuelle, surtout contre les incroyants. En Espagne, Ferrer fut sa victime ; en Amérique, Sacco et Vanzetti eurent pour bourreaux les puritains. Catholiques et protestants se réconcilient sur le dos des libres-penseurs, leurs adversaires communs.
Au besoin de dominer, à l’amour de la violence, le catholicisme joint un esprit autoritaire qui se manifeste par l’omnipotence pontificale et par le rôle essentiel que joue la hiérarchie ecclésiastique. L’organisation de l’Église fut simple, à l’origine. Des diacres et des diaconesses s’occupaient de tout ce qui concernait la charité ; par ailleurs, un évêque (du grec episcopos, surveillant) ou un prêtre (du grec presbuteros, plus âgé) présidaient les assemblées des fidèles. Ces derniers se réunissaient pour lire les livres saints et prier ; ils célébraient aussi des agapes ou repas d’amour. C’est à l’imitation de la hiérarchie en usage parmi les fonctionnaires de l’Empire que fut instaurée, ensuite, la hiérarchie ecclésiastique : dans l’ordre religieux, l’évêque devint l’équivalent du préfet.
Les évêques des grands centres possédaient une influence plus considérable ; mais la primauté de celui de Rome ne fut reconnue qu’après de longs siècles de résistance, grâce à la politique rusée de papes dépourvus de scrupule. Turmel écrit (sous le pseudonyme de Louis Coulange) :
« La primauté de saint Pierre sur l’Église universelle a été inventée pour faire échec à l’accaparement de Paul par Marcion ; elle est le produit artificiel de la polémique antimarcionite. Elle a fait son entrée dans l’Évangile de Matthieu aux environs de 150, quelques années avant le Dialogue de Justin, qui la connaît. Telle est l’origine du premier fondement de la papauté. »
Et le même auteur, dont on connaît la merveilleuse érudition, estime, comme beaucoup d’autres, que saint Pierre ne vint jamais à Rome :
« Les prétendues attestations de la venue de saint Pierre à Rome sont dénuées de toute valeur historique. Cette venue n’est pas un fait, c’est une thèse destinée à neutraliser le culte dont était l’objet le tombeau de saint Paul situé, disait-on, sur la voie Appienne. Les absents ayant toujours tort, saint Pierre, chef de l’Église, aurait été fâcheusement handicapé par le tombeau de saint Paul s’il n’avait eu lui-même son tombeau à Rome et, par conséquent, s’il n’était venu dans la ville impériale. Aux environs de 150, on enseigna que saint Pierre était venu à Rome, et l’on montra son tombeau près d’un térébinthe, au pied de la colline du Vatican, à l’endroit où, en 64, la férocité de Néron s’était acharnée sur les chrétiens. Et l’on expliqua que le grand apôtre avait été l’une des victimes du monstre impérial. Vers le même temps, aux environs de 165, parurent des textes aux termes desquels les deux apôtres Pierre et Paul avaient fondé ensemble l’Église romaine et avaient remporté le même jour la palme du martyre. »
Le soi-disant hommage rendu par Irénée à la prééminence de l’évêque de Rome repose sur une faute commise par certains traducteurs et n’est qu’une illusion. Saint Cyprien, saint Basile, saint Jérôme, saint Augustin n’ont pas cru à la primauté du siège épiscopal romain ; et c’est en termes pleins de mépris qu’ils ont parlé, à plusieurs reprises, de ceux qui l’occupaient. Le pape Libère, devenu hérétique, condamna saint Athanase et se rangea du côté des ariens. C’est l’édit de Gratien, mettant les forces policières de l’empire au service de l’évêque de Rome, qui fonda la suprématie papale. Maintenu et appliqué par les successeurs de Gratien, cet édit, qui est de 378, obligea les évêques à se soumettre aux injonctions de quelqu’un qui, jusqu’alors, était, pour eux, non un chef, mais un collègue. Grâce à des prodiges de diplomatie et à d’adroites supercheries, en particulier à la publication des fausses décrétales, vers 850, le pape vit sa puissance croître progressivement dans le domaine spirituel.
D’autres faux lui permirent de devenir souverain temporel. Turmel dit :
« En 756, l’apôtre saint Pierre écrivit du haut du ciel à Pépin une lettre éplorée pour lui signaler le danger qui menaçait son tombeau, son église et pour lui enjoindre, sous les peines les plus graves, de venir sans retard à son secours. En 774, Charlemagne reçut du pape Adrien Ier une copie de la Donation de Constantin, acte par lequel le premier empereur chrétien accordait en toute propriété à l’Église romaine d’immenses territoires. Il fut, cela va sans dire, chaleureusement invité à remettre en vigueur cette « donation » que le malheur des temps avait anéantie. Or, la première de ces impostures était l’œuvre d’Étienne II ; la seconde avait pour auteur le pape Adrien. Cette dernière fut exploitée par les papes jusqu’au jour où un chanoine de Saint-Jean-de-Latran, Laurent Valla, dévoila la supercherie, en 1450. »
On sait qu’au point de vue temporel, les évêques de Rome prétendront plus tard commander aux rois ; d’où d’interminables luttes entre le sacerdoce et le pouvoir séculier, luttes qui nuiront finalement au prestige de la papauté. L’État pontifical disparut complètement en 1870, l’administration du vicaire de Jésus-Christ étant devenue insupportable à tous, même aux bons catholiques. En excommuniant le roi d’Italie, Pie IX déclara que jamais ni lui ni ses successeurs ne pardonneraient à ses spoliateurs. Pourtant, contre une grosse somme d’argent, de nombreux privilèges et la reconnaissance de son autorité absolue sur un minuscule État, Pie XI s’est réconcilié avec le gouvernement italien.
Au point de vue religieux, l’infaillibilité du pape en matière de dogme et de morale a été proclamée, en 1870, par le concile du Vatican. En conséquence, le pontife romain possède maintenant, dans l’Église, un pouvoir absolu ; et telle est la sottise de la majorité des catholiques qu’ils applaudiraient vigoureusement s’il lui plaisait, demain, de décréter qu’il est une incarnation divine. Prêtres, évêques, archevêques, cardinaux ne sont plus que d’humbles fonctionnaires du Vatican. Étroitement surveillés par les émissaires de Rome, ils sont admonestés vertement, dès qu’on surprend chez eux la moindre velléité d’indépendance. Pour lutter contre le modernisme, une société secrète, la Sapinière, fut même organisée, avec l’approbation de Pie X et sous le haut patronage du cardinal secrétaire d’État ; elle espionnait les prélats et les autres personnages en vue du monde ecclésiastique. Conversations privées, correspondances particulières, rien n’échappait à la surveillance des délateurs. Un accident ayant révélé, en 1915, l’existence de cette mystérieuse association (et le scandale menaçant, après-guerre, de prendre de vastes proportions), le pape se décida à prononcer officiellement sa dissolution. Si elle ne subsiste pas, camouflée avec soin, c’est qu’une autre société secrète l’a remplacée, se proposant, elle aussi, de veiller à la stricte application des volontés pontificales.
Le célibat imposé aux prêtres permet, d’ailleurs, à la puissance vaticane d’obtenir un rendement maximum des fonctionnaires dont elle dispose. Déjà, le pape Sirice avait défendu aux prêtres et aux évêques de se marier, en 385 ; mais son ordonnance ne fut jamais sérieusement appliquée. Au XIe siècle, les ecclésiastiques étaient en majorité pourvus d’épouses ou de concubines, même à Rome. Parlant de cette époque, le pape Victor III déclarera :
« La masse du clergé perdit toute retenue. Les prêtres et les diacres, sans souci de la pureté de cœur et de corps requise pour toucher les sacrements du Seigneur, se marièrent, tout comme les laïcs, et transmirent par héritage leurs biens aux enfants issus de leur mariage. Des évêques eux-mêmes se rencontrèrent qui, foulant aux pieds toute pudeur, prirent des épouses. Cette exécrable coutume sévissait surtout à Rome, dans cette ville dont l’apôtre Pierre et ses successeurs avaient fait autrefois le foyer de la religion... La chaire apostolique fut occupée pendant quelques années par des hommes qui n’étaient pontifes que de nom. Après eux, un certain Benoît, grâce à l’argent distribué dans le peuple par son père, fit l’acquisition du souverain pontificat. Ce que fut alors sa vie, ce que furent les turpitudes et les abominations dont il se souilla, je rougis de le dire. »
Hildebrand, devenu pape sous le nom de Grégoire VII, obligea les prêtres à éloigner leurs femmes ; et, comme certains évêques ne voulaient pas appliquer l’ordonnance pontificale, il conseilla aux fidèles de chasser honteusement les membres du clergé qui, publiquement du moins, ne répudiaient pas leurs épouses ou leurs concubines. Avec l’aide du peuple, il réussit à imposer, dans plusieurs régions, une loi dont l’unique résultat fut d’accroître prodigieusement l’hypocrisie sacerdotale. Dès le milieu du XIIIe siècle, saint Bonaventure pourra écrire :
« La plupart des vicaires sont tellement vicieux qu’une honnête femme craint de se déshonorer en conversant secrètement avec eux... Nous constatons que la grande majorité du clergé se compose de débauchés notoires, qui ont des concubines soit chez eux, soit à l’extérieur, et qui, au su de tout le monde, ont des relations avec plusieurs femmes. »
La réforme d’Hildebrand avait produit des conséquences qu’on ne prévoyait pas.
Si déplorable était la réputation des prêtres au XVIe siècle que l’empereur Charles-Quint et son successeur Ferdinand, le roi de France Charles IX, les ducs de Bavière et de Clèves conseillaient vivement au pape d’abolir le célibat ecclésiastique. Officiellement, l’Église l’a maintenu ; d’où une incroyable floraison de vices, et de continuelles affaires de mœurs, que les tribunaux bien-pensants étouffent de leur mieux, mais que le public parvient à connaître, malgré le silence d’une presse désireuse de plaire au clergé. Le droit de se marier fut l’une des revendications qui, après la guerre de 1914–1918, conduisirent un grand nombre de prêtres tchèques à rompre avec Rome. Dans l’Amérique du Sud et dans certains pays de mission, l’autorité ecclésiastique ferme volontairement les yeux sur le concubinage des curés, qu’elle autorise ainsi d’une façon indirecte. Orthodoxes et protestants estiment, en ce qui les concerne, que le mariage est pour les ministres du culte une garantie de vertu.
Pour terminer, signalons que dans le catholicisme, comme dans l’Église grecque, les cérémonies ont gardé, dans l’ensemble, un caractère magique qui rappelle croyances et rites des peuples de l’Antiquité. C’est à l’aide des sacrements que prêtres ou évêques transmettent la grâce divine aux fidèles ; et tout sacrement requiert un signe visible, un élément naturel, eau, sel, huile, pain, vin, etc., qui exerce une action sanctifiante et devient un ferment de vie spirituelle. Par le baptême, qui simule une noyade, le profane est incorporé à l’Église et purifié du péché originel ; par l’imposition des mains et l’onction du chrême, le confirmé reçoit des grâces de force et de sagesse, le nouveau prêtre une effusion du Saint-Esprit qui le rend apte à l’exercice des fonctions sacerdotales : extrême-onction et absolution lavent la conscience du pécheur qui se soumet aux ordonnances ecclésiastiques ; enfin, le pain et le vin eucharistiques, mystérieusement transsubstantiés par l’officiant qui célèbre la messe, permettent d’ingurgiter le corps et le sang de Jésus.
À la base de ces pratiques, nous retrouvons la croyance à une force mystérieuse et vague, qui donne à certains éléments soigneusement choisis et consacrés d’une façon rituelle, une vertu toute particulière. Comme le sorcier nègre, le curé catholique croit à l’efficacité des gestes qu’il accomplit, des paroles qu’il prononce dans l’exercice de ses fonctions. Mais, parce qu’il place la liberté parmi les attributs divins, le théologien d’Enroue aboutit à des complications doctrinales que le magicien d’Afrique ignore. Néanmoins, pour qui réfléchit, le talisman du sauvage s’avère le frère jumeau du scapulaire que porte le pieux fidèle des pays latins.
* * *
Lorsque Constantinople devint la capitale d’un grand empire, l’évêque de cette ville, gratifié par l’autorité impériale du titre de patriarche œcuménique, fut investi sur les églises orientales d’une autorité qui rappelait celle que le pape exerçait en Occident. Moins favorisés par les circonstances que leurs collègues de Rome, et peut-être aussi moins ambitieux, les patriarches de Constantinople ne devaient, d’ailleurs, jamais jouer un rôle aussi brillant ; leur suprématie est restée d’ordre plutôt honorifique. Toutefois, les prétentions des papes leur semblèrent, de bonne heure, intolérables, et Photius, au IXe siècle, rejeta les innovations préconisées par Rome. Aussi, les Grecs refusèrent-ils de modifier leur credo et d’admettre que le Saint-Esprit procède, non seulement du Père, mais encore du Fils. Au milieu du XIe siècle, le pape et le patriarche s’excommunièrent mutuellement ; dès lors, la séparation entre l’Église latine et l’Église orthodoxe fut complète.
C’est vainement que l’on a tenté, depuis, d’opérer une réconciliation ; même en 1439, lorsque les Turcs menaçaient Byzance, l’accord fut impossible. En 1894, Léon XIII, qui avait écrit une lettre amicale au patriarche, reçut une réponse qui ruinait tous ses espoirs. Après la disparition du tsarisme, en 1917, le Vatican s’imagina que les Russes tourneraient facilement les yeux vers Rome, et ses diplomates cherchèrent à circonvenir le gouvernement soviétique. N’ayant pu rien obtenir et voyant l’incroyance triompher en Russie, les papes ont alors multiplié les anathèmes à l’adresse de ce dernier pays.
À l’instar du catholicisme, l’Église orthodoxe utilise le canal de la hiérarchie pour transmettre aux fidèles l’enseignement religieux et les grâces sacramentelles ; elle se glorifie de procéder d’une succession apostolique régulière et ininterrompue. Si elle accorde l’infaillibilité aux conciles œcuméniques, elle la refuse au patriarche de Constantinople aussi bien qu’au pape. Symbole vivant de l’orthodoxie, le patriarche reçoit de grands honneurs ; par contre, son pouvoir effectif est très limité. Plusieurs églises nationales écartent même toute prétention de sa part à les contrôler. En outre, les conciles reconnus œcuméniques sont au nombre de sept seulement et s’arrêtent à celui de Constantinople. Les Grecs repoussent les dogmes adoptés depuis par les catholiques, ceux du Purgatoire, de l’Immaculée Conception, de l’Infaillibilité pontificale, par exemple. Comme l’Église romaine, ils ont sept sacrements et admettent, au sujet de l’eucharistie, la doctrine de la transsubstantiation.
Les moines sont astreints au célibat ; c’est parmi eux que se recrutent les chefs ecclésiastiques. On oblige, au contraire, les popes ou prêtres séculiers à se marier avant l’ordination du diaconat ; mais on leur interdit de se remarier. La réputation d’ignorance et de vénalité faite aux popes s’avère pleinement justifiée ; de plus, beaucoup sont des ivrognes incorrigibles. À l’abri des hautes murailles de leurs monastères, les moines mènent une vie que le public suppose édifiante, mais que les initiés déclarent scandaleuse. Certains couvents, ceux du mont Athos en particulier, jouissent d’une renommée mondiale. Nulle femme, nul animal femelle n’y doivent pénétrer ; et les religieux passent leur temps à psalmodier, célébrer des offices, accomplir de petits travaux. Les confidences d’un Grec, resté croyant d’ailleurs, et qui avait longtemps séjourné sur le mont Athos m’ont appris que bien des femmes acceptent d’endosser l’habit monacal et s’en félicitent, plus tard, tant leurs compagnons masculins se montrent serviables et galants. Puis la pédérastie est, non seulement tolérée, mais encouragée par les supérieurs : pour leur usage personnel ou pour satisfaire leurs moines, quelques-uns possèdent de véritables harems de jouvenceaux, qu’ils costument en jeunes demoiselles, afin de les rendre plus appétissants. Mon confident avait assisté, en personne, à des scènes où de hauts dignitaires ecclésiastiques se livraient, en compagnie de religieux blasés, à des pratiques anormales sur des garçons impubères. En Grèce, comme chez nous, le mysticisme s’allie sans peine à l’érotisme le plus effréné.
De longues cérémonies liturgiques permettent aux moines de manifester, les jours de fêtes, une dévotion dont l’ardeur édifie les croyants. Archaïque et pompeux, le service divin est célébré dans les langues nationales anciennes, en vieux slavon, par exemple, chez les Russes ; il garde un caractère mystérieux, et la consécration eucharistique, restée un acte d’initiation, demeure cachée aux yeux des profanes. Sans être étayé par des dogmes nouveaux, le culte de la Vierge a pris, chez les orthodoxes comme chez les catholiques, un développement extraordinaire ; les saints pullulent, et les icônes sont l’objet d’une vénération universelle. Le clergé orthodoxe est trop ignorant pour qu’un mouvement moderniste sérieux ait pu le secouer, à notre époque. Concernant le pouvoir civil, il fait preuve d’une bassesse d’âme et d’une soumission répugnantes ; dans leurs États, les souverains balkaniques sont les vrais chefs de la religion ; le tsar gouvernait l’Église russe avant-guerre, par le moyen du Saint-Synode. Toutefois, les orthodoxes, bien différents en cela des catholiques, n’affichent pas un mépris transcendant à l’égard des hérétiques. L’union des Églises étant de nos jours une idée à la mode dans les pays anglo-saxons, ils s’associent volontiers aux manifestations internationales organisées par les protestants et les anglicans. Considérée comme un élément d’unité nationale, la religion orthodoxe reste forte de l’appui des gouvernements, dans les pays balkaniques. Cependant les rapides progrès que l’athéisme fait en Russie démontrent que les Églises orientales sont des institutions périmées, destinées à disparaître dans un avenir plus ou moins lointain.
L’ambition sans frein des papes, la corruption des dignitaires ecclésiastiques, la tyrannie exercée par les moines et les prêtres furent les causes profondes qui favorisèrent le développement du protestantisme, au XVIe siècle. Une querelle théologique entre l’augustin Martin Luther et le dominicain Tetzel, concernant la vente des indulgences, fut l’étincelle qui alluma l’incendie, en 1517. Ayant pu échapper à la prison et au bûcher, grâce à des protecteurs puissants, Martin Luther rompit définitivement avec le pape, et organisa une Église dont la doctrine fut précisée dans la Confession d’Augsbourg. En peu de temps, il se vit entouré de partisans nombreux ; des princes et des prélats se déclarèrent pour lui. Conservateur dans l’ordre politique et social, Luther combattit sans pitié les réformateurs anabaptistes qui troublaient la quiétude des possédants et réclamaient la communauté des biens. À côté de lui, il faut faire une place à Mélanchton, un érudit que son tempérament personnel inclinait vers la conciliation.
À Genève, se dressa l’austère figure de Calvin ; pape et roi tout ensemble, ce théologien alla beaucoup plus loin que Luther, supprima toute pompe cultuelle et ne ménagea pas les grands. Il voulait régner en maître ; et, pour l’avoir contredit, Michel Servet fut brûlé vif. Nous devrions encore parler de Zwingle, de Guillaume Farel, de John Knox et de beaucoup d’autres réformateurs et fondateurs de sectes, ainsi que de Frédéric II de Norvège, du Suédois Gustave Wasa et des divers souverains qui, au XVIe siècle, modifièrent la religion de leurs peuples, si nous entreprenions de retracer l’histoire du protestantisme. Nous voulons seulement indiquer sa situation actuelle et montrer quel esprit l’anime dans l’ensemble.
C’est à la Bible, interprétée à la lumière du Saint-Esprit et du symbole dit des apôtres, que l’autorité appartient, chez les protestants. Le fidèle entre en rapports immédiats et personnels avec la divinité par la lecture des livres saints et par la prière. Dépouillé de son caractère sacré, le prêtre n’est point l’intermédiaire indispensable entre le Christ et les croyants. Plus instruit et plus pieux, il est simplement chargé de prêcher la doctrine évangélique, d’instruire ceux qui ne peuvent étudier par eux-mêmes et de présider les assemblées du culte. Aussi n’est-il pas voué au célibat ; et l’imposition des mains, par d’autres pasteurs, ne lui confère-t-elle pas un pouvoir magique, comparable à celui dont le prêtre catholique est investi par le sacrement de l’ordre.
D’après le protestantisme orthodoxe, c’est la foi en Jésus, victime expiatoire immolée pour le salut des hommes, qui sauve le chrétien. Mais son sacrifice, accompli une fois pour toutes, ne se renouvelle pas chaque jour, à la messe, comme le prétendent les catholiques ; et les œuvres ne sont pas indispensables pour que la foi soit efficace. Quant à la prédestination des âmes au ciel ou à l’enfer, elle a été soulignée avec force par Calvin : s’appuyant sur saint Paul et sur saint Augustin, il estime que, la foi étant un don surnaturel, ceux-là seuls seront sauvés que Dieu a désignés pour recevoir cette grâce. La doctrine luthérienne est moins désespérante. Ajoutons que, par bonté d’âme, de nombreux protestants supposent qu’avant de condamner l’incroyant à l’enfer, d’une façon définitive, Dieu lui offrira de nouveau la possibilité de reconnaître Jésus pour son rédempteur. De l’Église universelle, le protestantisme n’exclut ni les orthodoxes, ni les catholiques, plus généreux en cela que les théologiens de Rome ; et la diversité des sectes, résultat nécessaire de la doctrine du libre examen, lui semble conciliable avec l’unité mystique du royaume de Dieu.
Incontestablement, il répond à une tentative de sécularisation dans le domaine religieux, car il nie que Jésus ait voulu organiser une société rigidement hiérarchisée, avec des fonctionnaires dont les pouvoirs seraient méticuleusement dosés par le Saint-Esprit. L’archevêque luthérien d’Upsal, qui dirige l’Église suédoise, possède un pouvoir administratif considérable et jouit d’une grande influence ; il ne prétend pas avoir un pouvoir d’ordre spécial et détenir ce que les catholiques appellent la plénitude du sacerdoce. Même lorsqu’on les dénomme épiscopaliennes, les Églises protestantes restent presbytériennes dans leur essence, car la puissance de l’évêque est de nature purement administrative. Dans l’Église réformée, les mesures d’intérêt général sont prises par le synode, assemblée élue de pasteurs et de laïcs ; le synode désigne un représentant ecclésiastique pour inspecter les membres du clergé. L’Église anglicane affiche des préoccupations sacramentaires et des prétentions hiérarchiques qui la différencient aussi bien du luthéranisme que du calvinisme, mais elle se situe elle-même hors du protestantisme.
Luther rejetait la transsubstantiation et n’admettait point la présence du Christ sous les espèces eucharistiques ; néanmoins, il croyait à l’existence, dans le pain et le vin, d’un élément sanctifiant. Cette présence spirituelle, Zwingle et Calvin la rejetèrent ; pour eux, c’est le Christ qui accorde une grâce spéciale au croyant dans le repas sacramentel. Les discussions sur ce sujet ne sont pas encore terminées ; luthériens, calvinistes, zwingliens s’accordent cependant pour rejeter l’opus operatum au pouvoir sanctificateur des éléments eux-mêmes ; et, dans cette question, pasteurs et fidèles jouissent de la plus grande latitude pour s’inspirer de leurs préférences personnelles.
L’austérité du culte protestant contraste avec les pompes des cultes orthodoxe et catholique. Des chaises, une table de communion sur laquelle se trouve la Bible, une chaire, un orgue ou un harmonium, voilà tout le mobilier d’un temple ; pas d’images, pas d’ornements, rien qui parle aux yeux. Lecture de l’Évangile et sermon constituent la partie centrale des offices ; les cérémonies liturgiques sont d’une grande simplicité. Dans certaines sectes, chez les quakers par exemple, le culte est même dépourvu de toutes les simagrées traditionnelles.
Dès la fin du XVIe siècle, les unitaires, auxquels se joignirent bientôt les sociniens, enseignèrent une sorte de déisme rationaliste, rejetant le mystère de la trinité, le salut par la foi et soumettant les Saintes Écritures à une sévère critique. Ils furent persécutés aussi bien par les protestants que par les catholiques. Au milieu du XIXe siècle, des théologiens rationalistes, entre autres Schérer, Réville, Colani, combattirent la doctrine paulinienne de l’expiation par le sang et ne virent plus en Jésus qu’un homme supérieur, guide et modèle du chrétien. Des luttes éclatèrent ; Pécaut, Schérer, d’autres encore, quittèrent le pastorat ; et au synode de 1872, présidé par Guizot, la fraction libérale fut vaincue par les orthodoxes. Grâce aux efforts de quelques hommes intelligents, le protestantisme libéral devait reprendre vie plus tard.
Le symbolo-fidéisme d’Eugène Ménegoz et d’Auguste Sabatier, dont nous avons précédemment exposé les idées essentielles, obtint, par la suite, un succès retentissant et durable. Moins rigide que le catholicisme, aujourd’hui momifié dans un culte et des dogmes désuets, le protestantisme est capable de transformations qui prolongeront son existence. À l’instar de l’Église romaine, il exporte, chez les infidèles, de nombreux missionnaires, qui s’occupent moins de prêcher l’Évangile que de faciliter la besogne des diplomates et des généraux d’Occident. Parce qu’on ne prétend pas les astreindre à une vie anormale, les pasteurs, qui séjournent dans les colonies européennes ou chez des peuples encore arriérés, gardent néanmoins, dans l’ensemble, une dignité personnelle que les moines, envoyés par le pape, perdent très souvent.
Bien qu’il se sépare du protestantisme, l’anglicanisme le rappelle par maints côtés. Il eut pour origine les fantaisies voluptueuses d’Henri VIII. Ce prince voulait répudier sa femme, tante de Charles-Quint, pour épouser Anne de Boleyn ; mais, afin d’être agréable à l’empereur, le pape refusa d’annuler son mariage. Rompant avec Rome, dont il avait soutenu la cause jusque là, Henri VIII se proclama chef suprême de l’Église d’Angleterre. Après de nombreuses fluctuations, dues aux caprices des souverains qui lui succédèrent, l’anglicanisme prit une forme stable sous la reine Elisabeth, qui rendit obligatoire, en 1552, un Prayer Book où l’on cherchait à concilier le dogme catholique avec la pensée protestante. Aujourd’hui, l’Église anglicane continue d’associer des doctrines opposées : elle se déclare antipapiste et anti conciliaire, mais se prétend apostolique et reste hiérarchisée ; elle croit à la présence presque matérielle du Christ dans la Cène, mais rejette le changement de substance ; elle reconnaît l’autorité de la Bible, mais s’inspire aussi des décisions prises par l’assemblée des évêques anglais. Demeurée étrangère ou presque aux recherches des exégètes rationalistes, jouissant de privilèges enviables, elle s’intéresse surtout aux questions concernant le cérémonial liturgique. On y distingue trois tendances, la Low-Church, la Broad-Church et la High-Church. Cette dernière se rapproche beaucoup du catholicisme ; c’est d’elle qu’est né le mouvement tractarien, qui devait conduire plusieurs clergymen d’Oxford, en particulier Newmann, à admettre l’autorité du pape. Un nouveau Prayer Book, où les aspirations vers le catholicisme se faisaient jour, a été rejeté par la Chambre des communes, voici quelques années. Par ailleurs, Rome a toujours refusé de reconnaître la validité des ordinations anglicanes, ce qui froisse douloureusement l’orgueil du clergé britannique. Toutes ces querelles, bien insignifiantes aux yeux d’un penseur rationaliste, montrent à quelles sottes et niaises disputes aboutissent les préoccupations confessionnelles.
* * *
Parmi les religions non chrétiennes, il en est qui possèdent des centaines de millions d’adhérents ; c’est le cas du brahmanisme, du bouddhisme, du mahométisme. Sans nous attarder à les décrire longuement, nous indiquerons de quelles croyances fondamentales s’inspirent leurs spéculations théologiques, et quels principes généraux dominent morale et culte qu’elles préconisent.
Le brahmanisme possède une abondante littérature sacrée. C’est aux Védas, formulaires liturgiques et recueils d’hymnes et de prières, que revient la première place ; le Rig-Véda est le plus ancien de ces écrits, l’Atharvéda le plus récent. Livres saints, aussi, les Brâmanas, qui sont des commentaires des textes sacrés ; les Sûtras et les Upanishads, vrais manuels théologiques ; les Purânas, recueils de légendes et de commentaires théologiques dont l’ensemble comprend 1 600 000 vers ; les grandes épopées où sont rapportés les exploits des héros et des dieux : le Râmâyana raconte les merveilles accomplies par Rama, en 48 000 vers, le Mahâbhârata a besoin de 200 000 vers pour narrer les luttes de Krichna. Le Code de Manou a été rédigé en vers depuis le début de l’ère chrétienne, mais son origine serait très ancienne, d’après les brahmanes ; on y trouve des prescriptions religieuses et sociales, inspirées de la législation du nord de l’Inde, et répondant à un idéal que les prêtres ne parvinrent jamais à réaliser intégralement. Textes inintelligibles, récits incohérents et diffus, extravagances et bizarreries de tous genres abondent dans ce fatras sacré ; on trouve aussi d’admirables maximes et des passages merveilleux de poésie.
Forces naturelles cachées sous des noms divins, les dieux védiques ont quelque chose d’impersonnel et de vague. Agni, le feu, que les auteurs des livres saints célèbrent avec enthousiasme, est le protecteur du foyer ; Ushas personnifie l’aurore ; Rudra est le père des esprits du vent ; Indra déchaîne les orages ; Varuna veille au maintien des lois physiques et morales. Sous les symboles mythologiques ou les voiles du ritualisme percent les tendances panthéistiques ; la croyance à l’efficacité magique des paroles et des gestes sacrés s’affirme avec force. Sans disparaître, les dieux védiques sont passés, depuis, au second rang.
Dans l’indouisme actuel, la trimourti ou trinité, composée de Brahma, de Vichnou et de Siva, occupe les grands rôles. Brahma, le créateur du monde, première émanation de Brahm, le dieu suprême, représente l’être descendant dans la forme, la substance se révélant dans le phénomène. Pour propager l’espèce humaine, il produisit de sa bouche le brahmane, de son bras le kchatriya, de sa cuisse le vaiçya et de son pied le soûdra ; d’où quatre castes : celle des prêtres, celle des guerriers, celle des marchands et des agriculteurs, enfin celle des ouvriers. Mais Brahma, dieu trop métaphysique, est loin d’être aussi honoré dans l’Inde que la seconde ou la troisième émanation de Brahm : Vichnou le conservateur, Siva le destructeur. Vichnou est souvent descendu sur terre, tantôt sous une forme animale, tantôt sous une forme humaine : Krichna et Rama furent deux incarnations de ce dieu. Dans son dernier avatar, il prendra l’aspect d’un cheval blanc, exterminateur de notre terre envahie par le mal. La présence de Lakchmi, l’épouse de Vichnou, a permis d’introduire un élément de mysticisme sensuel dans le culte de ce dieu.
La taille et les bras entourés de serpents, un collier de crânes autour du cou, la bouche vomissant des flammes, Siva personnifie la mort. Toutefois, ce dieu ne détruit et ne tue que pour renouveler. Il a des épouses amoureuses et sanguinaires ; l’une d’elles, Kali, est honorée par la mystérieuse association des thugs, ou étrangleurs, ainsi nommés parce qu’ils n’égorgent pas mais étranglent les victimes humaines offertes à la déesse. À côté des grands dieux, on trouve une multitude d’autres divinités ; l’origine des dieux, du monde, des hommes a donné naissance à des légendes nombreuses et contradictoires ; les plus extraordinaires superstitions trouvent dans l’Inde une terre bien préparée. On sait que la vache est l’objet d’une profonde vénération ; dans les temples, des bayadères exécutent des danses rituelles.
Deux idées expliquent et commandent les prescriptions morales du brahmanisme : celle de la migration des âmes, qui correspond à la métempsychose des Grecs, et celle de la valeur de l’ascétisme comme moyen de libération. Certes, nous trouvons des conseils d’une grande sagesse dans les livres sacrés. Le Code de Manou dit :
« Une seule bonne action vaut mieux que mille bonnes pensées, et ceux qui remplissent leurs devoirs sont supérieurs à ceux qui les connaissent. »
Nous lisons ailleurs :
« Que l’homme ne fasse pas aux autres ce qui lui serait douloureux à lui-même. »
L’auteur du Mahâbhârata place dans la bouche de Krichna, une des incarnations de Vichnou, cette magnifique justification des interventions du dieu ici-bas :
« Quand la justice languit, quand l’injustice se relève, alors je me fais moi-même créature, et je vais d’âge en âge, pour la défense des bons, pour la ruine des méchants, pour le rétablissement de la justice. »
Nous pourrions multiplier les citations de ce genre ; et nous n’avons garde d’oublier que le brahmanisme recommande d’être plein de bonté pour les animaux. Mais nous ne partageons point l’admiration témoignée à l’indouisme par maints écrivains d’Europe ; la sympathie que nous éprouvons pour la personne et l’œuvre de Gandhi ne peut nous réconcilier avec la monstrueuse organisation secrète issue de la religion nationale de l’Inde.
Sans nous arrêter aux ignobles mariages d’enfants, à la coutume, heureusement abolie, de contraindre les veuves à se brûler vivantes pour ne pas survivre à leur mari, au fanatisme des dévots se faisant écraser par les roues du char qui, chaque année, promène à travers Jagannath l’idole de Vichnou, nous rappellerons seulement les règles édictées par le Code de Manou, concernant le régime des castes. On dit :
« Que le nom d’un brahmane, par le premier des deux mots dont il se compose, exprime la faveur ; celui d’un kchatriya la puissance ; celui d’un vaiçya la richesse ; celui d’un soûdra l’abjection. »
Car :
« Le souverain maître n’assigne au soûdra qu’un seul office, celui de servir les classes précédentes sans déprécier leur mérite. »
Le brahmane est considéré presque comme un dieu :
« En venant au monde, il est placé au premier rang ; souverain seigneur de tous les êtres, il veille à la conservation des lois civiles et religieuses. »
« Un brahmane possédant le Rig-Véda tout entier ne serait souillé d’aucun crime, même s’il avait tué tous les habitants des trois mondes. »
Bien que très respecté, le guerrier n’est rien à côté du prêtre :
« Un brahmane âgé de dix ans et un kchatriya parvenu à l’âge de cent ans doivent être considérés comme le père et le fils : c’est le brahmane qui est le père. »
Le roi, lui aussi, a l’obligation de s’incliner :
« Il doit bien se garder d’irriter les brahmanes en prenant leurs biens ; car une fois irrités, ils le détruiraient sur-le-champ avec son armée et ses équipages par leurs imprécations et leurs sacrifices magiques. »
Par contre, le soûdra est, en raison de sa naissance, condamné à toutes les ignominies. Le tuer n’est qu’une peccadille ; on lui défend de s’enrichir ; pour se nourrir, il faut qu’il se contente des restes de ses maîtres ; pour se vêtir, il reçoit leurs vieux habits. S’il prétend donner des avis aux brahmanes, « que le roi lui fasse verser de l’huile bouillante dans la bouche et l’oreille » ; s’il insulte l’un d’eux, il mérite d’avoir la langue coupée ; s’il profère des outrages à l’adresse de leur caste, on enfoncera dans sa bouche un stylet rougi au feu et d’une longueur de dix doigts. Au XVIIIe siècle, les hommes des classes supérieures pouvaient encore tuer tout soûdra qui osait les regarder en face. Une religion qui aboutit à des excès pareils est indéfendable ; et cet exemple montre jusqu’où va l’outrecuidance cléricale, lorsque les prêtres commandent souverainement.
Moralement supérieur au brahmanisme d’où il est sorti, le bouddhisme rejette l’odieux système des castes. Son fondateur disait :
« La doctrine que j’enseigne ne distingue pas entre les grands et les petits, les riches et les pauvres. Il n’y a en soi ni préférence, ni aversion pour qui que ce soit. Nous devons notre amour à tous les êtres, et celui qui a de la haine pour ses semblables se hait lui-même. Si les hommes font le mal, c’est par ignorance. Il faut donc avoir compassion d’eux et les éclairer. »
Une charité qui ne distingue pas entre les hommes et qui s’étend à tous les êtres, même aux animaux, voilà ce que Gautama conseillait à ses disciples. Bien avant l’Évangile, il avait énoncé cette maxime que les chrétiens admirent :
« Aimez-vous les uns les autres. »
Forme du renoncement à soi-même, antidote de l’égoïsme comme le mépris des plaisirs sensuels, cette charité garde d’ailleurs un caractère plutôt passif.
Hostile au ritualisme brahmanique et aux prétentions des prêtres, le bouddhisme primitif n’admit ni sacerdoce, ni sacrifices ; il ne se préoccupa même pas de l’existence des dieux, et l’on a pu dire de lui qu’il fut, à l’origine, une religion athée. Comment éviter les renaissances et supprimer la douleur ? Tel était le problème que se posait Gautama, et qu’il parvint à résoudre après de longues années de méditation. Partout règnent la misère et la souffrance. Nous ne mourons que pour renaître et ne naissons que pour mourir. Nos existences découlent les unes des autres ; les événements de notre vie actuelle récompensent ou punissent les actions accomplies dans une existence antérieure ; ce qui adviendra plus tard sera la conséquence de notre manière de vivre présente. Bonheur, malheur que l’homme éprouve aujourd’hui résultent, le premier du bien qui ennoblit son âme, le second du mal qui la souilla au cours de ses vies transitoires. Atteindre au repos, arriver après l’expiation définitive au terme de nos pérégrinations, voilà le désir de nos esprits las. Et, justement, Bouddha connaît la route qui conduit au calme suprême, au bienheureux nirvâna.
Tuer le désir de vivre, non par le suicide qui n’arrête point la série des renaissances, mais par un renoncement total, par un ascétisme qui n’a pas besoin d’être inutilement cruel, c’est, assure Cakyamouni, le bon moyen d’entrer dans l’absolu repos. Ayant constaté que « la soif de l’existence » s’avère la cause primordiale de nos multiples peines, il ajoute :
« Voici la vérité sainte sur la suppression de la douleur : l’extinction de cette soif par l’anéantissement complet du désir, en bannissant le désir, en s’en délivrant, en ne lui laissant pas place. »
Sur la vraie nature du nirvâna, les érudits discutent, sans parvenir à se mettre d’accord. Pour y entrer, l’extirpation totale du désir de vivre est requise ; une extirpation partielle achemine vers la délivrance finale et permet de renaître dans le corps d’un sage. Ajoutons que le bouddhisme préfère la douceur aux austérités physiques, contrairement au jaïnisme, une autre réforme du brahmanisme prêchée par Mahâvira, qui vivait encore, probablement, à l’époque où Gautama recrutait ses premiers disciples.
Le système que nous venons d’exposer n’a rien de théologique, on en conviendra. Et le Râmâyana résumait l’opinion de beaucoup en déclarant :
« Comme apparaît un voleur, ainsi est apparu Bouddha ; sache que c’est de lui que l’athéisme est venu. »
Accusation injurieuse sous la plume de l’auteur, mais qui se transforme en magnifique éloge lorsqu’elle tombe sous les yeux du penseur indépendant. Hélas ! Comme les autres religions, le bouddhisme devait donner asile, par la suite, à d’innombrables superstitions. Son fondateur est devenu un dieu ; ses pagodes regorgent d’idoles : ses moines cupides et menteurs s’enrichissent par la vente d’amulettes et de bénédictions.
Concernant la vie de Gautama, dit le Bouddha Cakyamouni, histoire et légende se mêlent si intimement qu’il est impossible de dégager, clairement, la part de vérité contenue dans les traditions recueillies par les auteurs des livres sacrés. Il serait né vers 520 avant notre ère ; son père, roi de Kapilavastu, voyait en lui son successeur et le chérissait tendrement. Mais, à 29 ans, le prince Siddharta renonça brusquement au monde, malgré les supplications de sa famille, et résolut de se consacrer entièrement au bien des hommes. Cette décision aurait eu pour point de départ les rencontres successives d’un vieillard infirme, d’un malade laissé sur le bord de la route, d’un cadavre : rencontres qui lui suggérèrent d’amères réflexions sur la vanité de l’existence et le remplirent d’une commisération immense pour ses frères terrestres. Il se retira dans les forêts, où séjournaient des moines pénitents et des philosophes de diverses sectes. Après des recherches poursuivies durant plusieurs années, il découvrit la doctrine qui devait immortaliser son nom.
Bouddha parcourut alors le nord de l’Inde, semant partout l’espoir de la délivrance finale. Il mourut à 80 ans, sur le bord d’une rivière, après s’être couché sur le côté droit et avoir étendu ses pieds entre deux arbres. Et la légende ajoute qu’il « se releva ensuite de son cercueil pour enseigner les doctrines qu’il n’avait pas encore transmises ». On croit à l’authenticité, au moins partielle, des paroles émouvantes qu’il aurait prononcées à Bénarès et qui annoncent le sermon sur la montagne de notre Évangile.
Le christianisme doit-il quelque chose à la religion de Gautama ? Plusieurs l’ont pensé ; mais nous manquons de documents sérieux permettant de l’affirmer d’une façon catégorique. Néanmoins, nous constatons que l’Église catholique a inscrit Bouddha parmi ses bienheureux, sous le nom de saint Josaphat : la comparaison entre la vie de ce dernier et celle de Gautama, ainsi que les détails historiques et géographiques donnés par les hagiographes le démontrent péremptoirement.
Dans l’Inde, le bouddhisme se propagea très vite ; au IIIe siècle avant notre ère, le roi Açoka l’introduisit à Ceylan et envoya un peu partout des missionnaires de la nouvelle religion. Toutefois, les brahmanes persécutèrent les fidèles de ce culte rival d’une façon si sanguinaire, et avec tant de persévérance, qu’il disparut de la région où il avait pris naissance. La place considérable faite à l’ascétisme et à la magie par certaines sectes provoqua aussi des querelles, qui contribuèrent à accélérer la ruine du bouddhisme dans l’Inde. Par contre, il s’installa d’une façon durable à Ceylan, en Birmanie, au Siam, en Indochine, au Tibet, en Chine, au Japon ; il compte, à l’heure actuelle, plus de 500 millions d’adhérents. Presque toujours, il s’associe à des cultes locaux : en Chine, il vit en bonne intelligence avec le confucianisme ; au Japon, les temples du shinto sont aussi les siens, très souvent. Avec sa multitude de couvents, son culte des reliques et des nuages, son ritualisme magique, les folles cruautés de ses ascètes, les mesquines rivalités de ses nombreuses sectes, le bouddhisme n’est, depuis longtemps, qu’une grotesque caricature de la religion prêchée par Gautama.
Au Tibet, le monachisme tout-puissant a instauré une théocratie qui, pour se maintenir, interdit l’accès du pays aux étrangers et tient les habitants dans l’ignorance des progrès qui s’accomplissent sur le reste du globe. On estime à 500 000 environ le nombre des moines : 1 en moyenne pour 4 habitants. Bien garnis d’armes et de munitions, les couvents ou lamaseries sont de vraies forteresses, juchées sur des hauteurs ; il y en a au moins 3 000. Le dalaï lama, chef spirituel et temporel, vit à Lhassa ; c’est une incarnation permanente de Bouddha, un dieu vivant ; et ses fidèles l’adorent quand il daigne se montrer. Par sa hiérarchie sacerdotale, par la pompe extérieure de son culte, par ses pratiques de dévotion et même par certains de ses dogmes, le lamaïsme ressemble beaucoup au catholicisme. Rome ferait bien d’adopter les moulins à prière tibétains ; ils dispenseraient nos dévotes de marmotter, interminablement, des formules latines qu’elles ne comprennent pas.
Alors que nous sommes réduits à des conjectures touchant l’existence du Christ, et que la vie de Bouddha reste enveloppée d’impénétrables nuages, nous possédons sur Mahomet des renseignements précis et certains ; ce qui n’a pas empêché la formation de légendes pieuses dans les milieux musulmans. Né à La Mecque en 571, orphelin de très bonne heure, il fut berger, puis conducteur de chameaux, dans sa jeunesse. Son mariage avec Khadidja, à 25 ans, lui assura des loisirs et lui permit de s’occuper des questions religieuses. Très pieux, sujet à de violentes crises nerveuses, surexcité par des jeûnes fréquents et des méditations prolongées, il entendit l’ange Gabriel lui annoncer qu’Allah l’avait choisi pour son prophète et son messager. Mahomet était-il sincère, en racontant les visions dont le ciel le favorisait ? Les auteurs chrétiens répondent volontiers par la négative. Cependant, les hallucinations religieuses furent si fréquentes, au cours de l’histoire, et par tempérament le fondateur de l’islam était si prédisposé à des accidents de ce genre, que nous croyons à sa bonne foi, lorsqu’il débuta dans la carrière du prophétisme. Plus tard, il fit comme saint Paul et enjoliva ses rêves, quand il ne les inventa pas de toutes pièces ; son excuse fut d’y être contraint par les nécessités de sa profession. C’est un dur métier, parfois, que celui de messager divin ! Toutefois, la tranquille assurance dont il fit preuve, pendant les longs déboires du début et dans les moments les plus difficiles, montre qu’il crut vraiment à sa mission.
Après plusieurs années d’efforts, Mahomet parvint à convertir les membres de sa famille et quelques habitants de La Mecque : la nouvelle religion se répandait avec peine et très lentement. Néanmoins, la puissante famille des Koraïchites, qui exploitait le temple de la Kaaba, centre de pèlerinage réputé, craignit de voir diminuer ses bénéfices ; elle frappa le prophète d’ostracisme et complota sa mort. En 622, à l’âge de 51 ans, il dut s’enfuir à Yatrib, qu’on appela depuis Médine (Medinat-al-Nabi, la ville du Prophète). L’année de l’hégire (de la fuite) est le point de départ de l’ère musulmane. Très bien accueilli à Yatrib, Mahomet y recruta de nombreux partisans qui l’aidèrent dans ses expéditions contre les païens et les juifs. Vainqueur dans la vallée de Béder, puis vaincu près du mont Ohud, il obtint de nouveaux succès, et entra finalement à La Mecque en 629. Quand il mourut en 632, il avait gagné à sa foi toutes les tribus arabes.
À l’égard de ses adversaires, le prophète se montra impitoyable, massacrant les prisonniers, condamnant à l’esclavage femmes et enfants. S’il ne se vengea point lors de son entrée à La Mecque, ce fut par calcul, afin d’encourager à la soumission ceux qui refusaient encore de croire en lui. Il déclarait :
« Le paradis est à l’ombre des épées. Les fatigues de la guerre sont plus méritoires que le jeûne, la prière et les autres pratiques de la religion. Les braves tombés sur le champ de bataille montent au ciel comme des martyrs. »
Le Coran (la lecture) est le livre sacré de l’islam ; il contient les préceptes et les enseignements de Mahomet. Lui-même n’écrivait pas, mais ses auditeurs se chargeaient de transcrire ses explications sur des peaux de mouton ou des feuilles de palmier, comme c’était l’usage à cette époque, en Arabie. Ces fragments rassemblés ont donné le Coran ; une première édition parut peu après la mort du prophète ; l’édition définitive fut publiée sous le califat d’Ohtman. L’ouvrage se compose de 114 sourates (chapitres), d’étendue très inégale, qui se subdivisent en 6 000 versets environ. On n’y trouve nulle suite, nul plan chronologique ou doctrinal ; les sourates les plus longues furent mises au début, les plus courtes à la fin. Quelques-uns le proclament un chef-d’œuvre littéraire ; d’autres le jugent un pauvre livre, d’une stupidité insigne. Du moins, l’authenticité de l’ensemble n’est pas niable.
La dogmatique musulmane est simple : elle repose sur le monothéisme et le fatalisme. Il n’y a qu’un dieu, éternel et tout-puissant, dont les décrets immuables sont fixés de toute éternité.
« Tout est écrit d’avance. L’homme porte son destin suspendu à son cou. »
Dieu s’est révélé, au cours des siècles, en suscitant une série de prophètes : Adam, Moïse, Jésus. Mahomet est plus grand que ses prédécesseurs et il sera le dernier. D’où la formule chère à l’islam :
« Allah est le seul dieu et Mahomet est son prophète ! »
Après la mort, l’âme, qui est immortelle, sera jugée par Allah. Le réprouvé subira en enfer des tortures indicibles, mais qui ne seront éternelles que pour l’incroyant. Jardin délicieux où coulent le lait et le vin, où les arbres s’inclinent pour offrir des fruits aux promeneurs, le paradis est le séjour des élus. Des houris, aux beaux yeux et aux formes splendides, leur tiennent compagnie ; et l’on sert à tous les breuvages et les mets les plus délicats. En outre, les sages ont la joie « de voir la face de Dieu matin et soir ».
La prière est la principale loi du culte ; elle doit se faire cinq fois par jour. Précédée d’ablutions, elle exige que le musulman se tourne vers La Mecque, puis qu’il s’incline et se prosterne, en marmottant des phrases stéréotypées. Pendant le mois de ramadan, époque où le prophète reçut les premières visites de l’ange Gabriel, il est interdit de manger, boire et fumer, de l’aube au coucher du soleil ; mais il est permis de faire, durant la nuit, de plantureux festins. Tout musulman qui le peut doit aller à La Mecque, au moins une fois dans sa vie. La croyance aux anges et aux djinns, ainsi que le culte rendu aux nombreux saints islamiques engendrent des superstitions.
Il n’y a pas de clergé ; dans chaque mosquée, un imam, dont la présence n’est pas indispensable, dirige les prières, et un muezzin les annonce du haut du minaret. Marabouts et confréries religieuses constituent la vraie force du mahométisme. Descendant d’un personnage mort en odeur de sainteté, le marabout garde, aux yeux des fidèles, une partie de la puissance surnaturelle qu’avait son ancêtre canonisé. Certains marabouts jouissent d’un prestige considérable ; d’autres vivent péniblement des cadeaux offerts en souvenir de l’aïeul, dont chacun d’eux conserve jalousement le tombeau. Les ordres religieux ou confréries entretiennent le fanatisme ; aux préoccupations mystiques, ils associent fréquemment des visées politiques inavouées. Répartis en groupes provinciaux, les khouans ou frères sont commandés par des moqaddem ou prieurs, qui ont eux-mêmes à leur tête un supérieur général auquel tous appartiennent, corps et âme. Les plus connues de ces confréries sont celles des derviches ; ce ne sont pas les plus puissantes. Derviches tourneurs et derviches hurleurs entrent en communication avec la divinité, les premiers par le moyen de danses rapides, les seconds grâce à des mouvements de la tête et à des cris suraigus ; les uns et les autres font des miracles à la manière des fakirs de l’Inde ou des saints catholiques. Nous aurions tort cependant de rendre Mahomet responsable de toutes ces roues ; il n’en prévoyait pas l’existence. Comme les autres religions, celle qu’il fonda devait dégénérer par la suite.
Au point de vue moral, le Coran ordonne de faire l’aumône, de protéger les orphelins ; il défend de tuer les nouveaux-nés et d’enterrer les petites filles vivantes (ce que les Arabes avaient coutume de faire) ; il conseille l’affranchissement des esclaves, rien n’étant plus agréable à Dieu. Il interdit l’usure et les jeux de hasard, ne permet pas aux peintres et aux sculpteurs de représenter la figure humaine et prohibe l’usage de la viande de porc, du vin, des boissons fermentées. En ce qui concerne la guerre, Mahomet nous répugne par ses goûts sanguinaires et sa barbarie. Il fixe à quatre le nombre des femmes légitimes que peut avoir chaque croyant ; mais, par une permission spéciale de l’ange Gabriel, il eut personnellement le droit d’en avoir davantage. À l’inverse de ce qui se passe dans le catholicisme, la femme fut presque éloignée du culte. En Turquie, la situation sociale est restée un défi au bon sens, jusqu’à la réforme opérée par Mustapha Kemal, malgré l’opposition des dévots musulmans.
Dès le début, l’islam se divisa en Églises rivales. Les sunnites, qui se prétendaient seuls orthodoxes, et les chiites, qui se rattachaient à Ali, le gendre du prophète, se vouèrent une haine mortelle. Les premiers vénèrent la Sunna, recueil de commentaires donnés par les compagnons de Mahomet, sans attribuer néanmoins à ce livre une valeur comparable à celle du Coran. Mais les chiites, particulièrement nombreux dans la Perse et dans l’Inde, rejettent la Sunna et se montrent moins rigides en ce qui concerne la représentation des êtres vivants, ainsi que l’usage du vin. Et chacune de ces deux grandes branches du mahométisme a donné naissance à une multitude de sectes. Chez les orthodoxes, rappelons la réforme des motazilites et celle des wahhabites ; chez les chiites, mentionnons les ismaïliens, qui sont presque libres-penseurs, les soufistes, dont le mysticisme tend vers un panthéisme spiritualiste, les druzes. À partir de 1840, Madhi el Bâb prêcha en Perse une nouvelle doctrine ; on le fusilla en 1850, mais ses disciples continuèrent, après sa mort, de propager ses idées. Le bâbisme réclamait la suppression de la polygamie et du voile, ainsi que des réformes sociales en faveur des pauvres.
Pour moderniser la Turquie, les kemalistes ont dû rejeter délibérément un grand nombre de préceptes coraniques. La religion musulmane apparaît aussi inconciliable avec le progrès que le catholicisme romain. Ses missionnaires continuent cependant de recruter de nombreux fidèles, en Afrique et dans l’Inde ; les enseignements très simples du Coran répondent mieux aux besoins des mentalités encore naïves que les complications, inutiles et grotesques, de la théologie, soit catholique, soit protestante.
Il existe beaucoup d’autres religions, dont l’étude détaillée manque d’intérêt pour nous, soit parce qu’elles sont peu originales, soit parce que leur zone d’influence s’avère très limitée. Au Japon, le shinto n’est plus guère qu’une forme du patriotisme ; il s’attache au culte de la famille impériale, des héros nationaux, des ancêtres ; il honore aussi des génies personnifiant les forces cosmiques. Le confucianisme, cher aux lettrés chinois, n’est pas une religion au sens ordinaire du mot ; c’est une morale rationnelle, compliquée d’un culte philosophique. Confucius n’est pas à ranger parmi les inspirés d’en haut.
Fort intéressant au point de vue doctrinal et historique, le mazdéisme ne compte maintenant qu’un nombre très restreint de fidèles. Il aurait pour fondateur Zoroastre, personnage plus ou moins fabuleux, qui serait l’auteur du Zendavesta et aurait vécu vers 1100 avant notre ère. Le conflit du bien et du mal, la lutte d’Ormazd (symbole du feu et de la lumière) contre Ahrimam (l’esprit des ténèbres), voilà l’élément central des spéculations de l’Avesta. Ce dualisme prendra fin par la victoire du dieu bon. Zoroastre préfère l’activité saine au mysticisme stérile ; mais il accorde une place énorme aux formules rituelles et aux incantations magiques. À côté de maximes qui recommandent l’amour du prochain et l’humilité, on trouve des inepties qui faisaient dire à Voltaire :
« On ne peut lire deux pages de l’abominable fatras attribué à ce Zoroastre sans avoir pitié de la nature humaine. Nostradamus et le médecin des urines sont des gens raisonnables en comparaison de cet énergumène. »
On trouve, à l’heure actuelle, quelques rares mazdéens en Perse ; ceux de l’Inde sont appelés guèbres ou parsis. Le culte qu’ils rendent au feu a particulièrement frappé les voyageurs ; et tous les Européens qui séjournent à Bombay vont voir les tours du silence, où sont exposés les corps des mazdéens décédés. Si les guèbres livrent les cadavres des leurs aux animaux carnassiers, c’est pour ne souiller ni le feu en les incinérant, ni la terre en les inhumant.
L’histoire des mormons prouve que les récits les plus invraisemblables peuvent encore trouver créance dans les pays civilisés. En 1830, un Américain, Joseph Smith, expliqua à ses compatriotes qu’il avait découvert l’Évangile éternel, rédigé par le prophète Mormon, vers l’an 600 avant Jésus-Christ. Ce livre est platement imité de la Bible et d’un roman publié en 1812. Joseph Smith recruta des adeptes et fonda, en 1841, dans l’Illinois, l’Église des saints des derniers jours. Ses partisans furent persécutés, surtout parce qu’ils pratiquaient la polygamie ; lui-même fut tué en 1844. Les mormons s’installèrent ensuite sur les bords du lac Salé ; la loi américaine ne leur a pas permis de continuer à être polygames. Ils ont toute une hiérarchie sacerdotale et entretiennent des missionnaires ; ces derniers n’ont pu recruter en Europe que très peu d’adhérents.
Nous ne dirons rien du spiritisme et de la théosophie, religions écloses également au siècle dernier. Elles empruntent leurs croyances essentielles au bouddhisme, au christianisme et aux spéculations théologiques de l’Inde ; leur morale est complètement dépourvue d’originalité ; leurs pratiques cultuelles s’inspirent de procédés que n’ignoraient pas les sorciers d’autrefois. Et nous arrêterons là le tableau des aberrations humaines, qu’une étude impartiale des religions nous obligeait à faire.
— L. BARBEDETTE
BIBLIOGRAPHIE. – Il importe avant tout de consulter les recueils de livres sacrés, les encyclopédies des sciences religieuses, les collections de textes historiques ou théologiques qui permettent de suivre la marche évolutive des dogmes et des rites, les publications savantes, en particulier la Revue de l’histoire des religions, qui tiennent leurs lecteurs au courant des découvertes de l’exégèse rationaliste. Pour les religions non chrétiennes, il sera utile de consulter particulièrement le Manuel général d’histoire des religions, de Chantepie de la Saussaye ; pour le christianisme, l’Encyclopédie de théologie protestante, de Hauck. Beaucoup d’autres dictionnaires, encyclopédies ou recueils divers seraient à citer. Quoique déjà anciens, les ouvrages de Bayle, Fontenelle, Voltaire, Dupuis, Strauss, Burnouf, Darmesteter, Reuss, Renan, etc., gardent une sérieuse valeur. Voici, en outre, une liste d’ouvrages modernes qui méritent de retenir spécialement l’attention :
Alfaric : La première vie de Jésus, l’Évangile de Marc ; Pour comprendre l’Évangile de Jésus ; Le Jésus de Paul. – Bayet : Les morales de l’Évangile. – Buonaiuti : Le modernisme catholique. – Couchoud : Le mystère de Jésus ; L’Apocalypse. – Delacroix : Les grands mystiques chrétiens ; La religion et la foi. – Duchesne : Histoire ancienne de l’Église ; Origines du culte chrétien. – Durkheim : Les formes élémentaires de la vie religieuse. – Frazer : The goden Bough ; Le totémisme. – Freud : L’avenir d’une illusion. – Guignebert : L’évolution des dogmes ; Le christianisme antique. – Harnarck : Dogmengeschichte ; Wesen des Christenthums. – Henry : La magie dans l’Inde antique. – Houdras : L’islamisme. – Houtin : Courte histoire du christianisme ; Courte histoire du célibat ecclésiastique ; La critique biblique au XIXe siècle ; La critique biblique au XXe siècle. – Hubert et Mauss : Mélanges d’histoire des religions. – Pierre Janet : Les médications psychologiques. – La Vallée Poussin : Bouddhisme. – Le Roy : Dogme et critique. – Leuba : Psychologie des phénomènes religieux. – Levy-Bruhl : La mentalité primitive ; L’âme primitive. – Loisy : Mythes babyloniens et Genèse ; La religion d’Israël ; Autour d’un petit livre ; L’Évangile et l’Église ; Choses passées ; Mystères païens et mystère chrétien ; Les actes des apôtres. – Mauss : La prière. – Murisier : Les maladies du sentiment religieux. – Oldenberg : La religion du Bouddha. – Pfister : Die psychologische Enträtselung der religiosen Glossolalie. – S. Reinach : L’origine des Aryens ; Cultes, mythes et religions ; Orpheus. – Th. Reinach : Histoire des Israélites ; La fête de Pâques ; Textes d’auteurs grecs et romains relatifs au judaïsme. – A. Sabatier : Les religions d’autorité et la religion de l’esprit. – P. Sabatier : L’expérience religieuse et le protestantisme ; Les modernistes. – Sartiaux : Foi et science au Moyen Âge. – Scheel : Dokumente zu Luthers Entwickelung. – Senart : Castes dans l’Inde. – Turmel : La Vierge Marie ; La Messe ; Catéchisme pour adultes ; Le quatrième Évangile ; Les écrits de saint Paul ; Histoire du diable. – Tyrrel : Le christianisme à la croisée des chemins.
Si l’on veut avoir des appréciations courageuses sur le rôle politique et social des religions, et spécialement du christianisme, il faut lire les ouvrages de Sébastien Faure, Han Ryner, A. Lorulot, Ch. Vaudet, A. Delpeuch, J. Bossu, E. Armand, A. Lapeyre, Hem Day, E. Fournier, etc.
– L. B.
REMORDS
n. m.
Il est probable que lorsqu’une bactérie attaque la matière organique et s’en nourrit, elle n’éprouve aucune espèce de remords. A-t-on jamais vu des termites se repentir d’avoir détruit l’architecture d’un beau monument ? La mante religieuse mange dévotement son époux pendant l’acte de copulation. Il est des mères lapines qui dévorent leurs petits nouveaux-nés avec une tranquille assurance. L’abeille arrache impitoyablement les nymphes à leur berceau lorsque l’hiver s’annonce. Le loup de La Fontaine était d’une politesse excessive ; et, vraiment, il fit trop d’honneur à l’agneau en disputant avec lui avant de le croquer. On n’a jamais soupçonné qu’un hôte de la jungle – pas plus d’ailleurs qu’un animal domestique – ait souffert d’avoir « fait à autrui ce qu’il ne voudrait pas qu’on lui fit » ; ainsi, il apparaît que le remords semble être un sentiment tout à fait inconnu à nos frères dits inférieurs. Comment donc se comporte le frère « supérieur » ? Voltaire écrit :
« Locke apporte l’exemple des sauvages qui tuent et qui mangent leur prochain sans aucun remords de conscience, et des soldats chrétiens bien élevés qui, dans une ville prise d’assaut, pillent, égorgent, violent, non seulement sans remords, mais avec un plaisir charmant, avec honneur et gloire, aux applaudissements de tous leurs camarades. Il est très sûr que dans les massacres de la Saint-Barthélemy, et dans les autodafés, dans les saints actes de foi de l’Inquisition, nulle conscience de meurtrier ne se reprocha jamais d’avoir massacré hommes, femmes, enfants ; d’avoir fait crier, évanouir, mourir dans les tortures des malheureux qui n’avaient commis d’autres crimes que de faire la pâque différemment des inquisiteurs. »
Et, plus loin :
« Un petit sauvage qui aura faim, et à qui son père aura donné un morceau d’un autre sauvage à manger, en demandera autant le lendemain, sans s’imaginer qu’il ne faut pas traiter son prochain autrement qu’on ne voudrait être traité soi-même. » (Dict. Phi., article : Conscience.)
Pourtant, si le remords doit se manifester parfois, n’est-ce pas dans le crime ? Et cependant l’histoire ne nous a transmis que quelques noms de criminels torturés par le remords. Caïn appartient à la légende biblique. À côté d’un Charles IX, combien de monstres qui ont nom : Néron, Constantin Ier, Borgia, Napoléon ! Sans compter ces messieurs de l’internationale sanglante des armements. Est-ce que l’homme de « la mobilisation n’est pas la guerre » ne riait pas dans ses cimetières ? L’assassin qui vit ses derniers moments est-il assailli par le remords ? S’il a le sommeil léger, c’est surtout par peur de ce qui le menace. Mais le souverain qui, par le droit de grâce, tient la vie du misérable entre ses mains n’a nul remords de l’envoyer sous le couperet. Et, cependant, il y a crime égal.
« Faut-il tuer pour empêcher qu’il y ait des méchants ? C’est en faire deux au lieu d’un. » (Pascal)
Ainsi, nous pouvons conclure avec Voltaire que :
« Nous n’avons point d’autre conscience que celle qui nous est inspirée par le temps, par l’exemple, par notre tempérament, par nos réflexions. L’homme n’est né avec aucun principe, mais avec la faculté de les recevoir tous. »
Le remords est le produit de cette chose toute artificielle : la conscience (voir ce mot). C’est ainsi que le souverain qui aura froidement envoyé à l’échafaud ou à la chaise électrique un pauvre bougre victime des lois pourra éprouver du remords s’il se laisse entraîner, par exemple, à manger de la viande le vendredi. Mme de Sévigné écrivait :
« Vous savez comme je hais les remords ; ce m’eût été un dragon perpétuel que de n’avoir point rendu les derniers devoirs à ma pauvre tante. »
Quelles puérilités ! C’est que nous touchons ici au domaine de la morale. Il y aura remords dès qu’on aura enfreint la règle. Encore faudra-t-il qu’on soit lésé dans ses intérêts, sinon on se sentira très facilement le cœur à l’aise. J.-J. Rousseau écrit dans ses Confessions. :
« Le remords s’endort durant un destin prospère et s’aigrit dans l’adversité. »
Mais peut-il y avoir remords pour l’individu qui a éliminé en lui tout ce que les traditions ont pu apporter de grégaire ? Ses actes – outre qu’ils seront autant que possible raisonnables et sensés – ne pourront lui inspirer que du repentir, dans le cas où, par inadvertance ou par erreur, ils ne se trouveraient pas conformes à sa conception de l’éthique. Il essayera simplement d’en détruire ou d’en atténuer les effets, sans que pour cela il se croie damné à jamais, voué aux tourments éternels ou aux tortures infernales. Le remords est, lui aussi, une création du christianisme. C’est Dieu qui – en nous-mêmes – nous reproche notre « mauvaise action » (par exemple : convoiter le bien ou la femme du voisin, voler son maître, résister à l’oppression ; choses impardonnables aux gueux, comme on sait). Bourdaloue disait :
« Le remords de conscience que nous sentons après le péché est une grâce intérieure. »
Mais Boulainvilliers, ramenant la chose à de plus justes proportions, écrivait :
« Le remords qui, dans le langage de l’écriture, est appelé le ver de la conscience, n’est proprement qu’une honte portée à l’excès. »
Pour l’amoral, sensible et juste, il ne peut donc y avoir de remords, car le remords « s’adresse aux grosses offenses contre la morale » (Littré). Il y aura regret d’un acte jugé mauvais, avec résolution intérieure de ne pas le renouveler. Et cet amoral ne poursuivra que mieux l’ascension vers l’idéal qu’il se sera assigné, se perfectionnant sans cesse, sans avoir besoin de jalonner sa route de douloureux, empoisonnants et inutiles mea culpa.
Pour conclure, nous ne pouvons mieux faire que de reproduire l’admirable page du sage Meng-Tseu. Puissent s’inspirer de l’enseignement qu’elle contient tous ceux qui ont encore l’esprit peuplé de chimères et qui redoutent le remords comme sanction à leurs pauvres actes humains.
« Je suppose ici un homme qui me traite avec grossièreté et brutalité ; alors, en homme sage, je dois faire un retour sur moi-même, et me demander si je n’ai pas été inhumain, si je n’ai pas manqué d’urbanité : autrement, comment ces choses seraient-elles arrivées ?... Si, après avoir fait un retour sur moi-même, je trouve que j’ai été humain ; si, après un nouveau retour sur moi-même, je trouve que j’ai eu de l’urbanité, la brutalité et la grossièreté dont j’ai été l’objet existant toujours, en homme sage, je dois de nouveau descendre en moi-même, et me demander si je n’ai pas manqué de droiture. Si, après cet examen intérieur, je trouve que je n’ai pas manqué de droiture, la grossièreté et la brutalité dont j’ai été l’objet existant toujours, en homme sage, je me dis : cet homme qui m’a outragé n’est qu’un extravagant et rien de plus. S’il en est ainsi, en quoi diffère-t-il de la bête brute ? Pourquoi donc me tourmenterais-je à propos d’une bête brute ? C’est pour ce motif qu’un sage est toute sa vie intérieurement plein de sollicitude, sans qu’une peine l’affecte pendant la durée d’un matin. »
— Cl. BOUSSINOT.
RENAISSANCE (VUE D’ENSEMBLE)
n. f. (du radical renaître)
On désigne par ce mot le mouvement qui, au XVe et au XVIe siècle, détourna les intelligences des formes artistiques et des idées chères au Moyen Âge, pour aboutir à un l’éveil de l’esprit antique. Contre la scolastique, contre l’autorité de l’Église et des théologiens, contre les préjugés mis en honneur par le christianisme, des érudits, des écrivains, des artistes, des penseurs lèvent alors le drapeau de la révolte. Mœurs, opinion, industrie, goût littéraire et artistique, tout se transforme et se renouvelle ; saisis par la passion de l’éternelle beauté, les esprits repoussent avec dégoût les formules léguées par le Moyen Âge, et c’est à l’Antiquité grecque et romaine qu’ils demandent une conception moins mesquine de l’existence, une plus juste compréhension des harmonieuses exigences de la nature et de la raison. Simple étape dans la voie de la libération des cerveaux, la Renaissance peut sembler timide à nos contemporains, touchant maintes de ses revendications. N’oublions pas cependant qu’il fallait un courage méritoire, au XVIe siècle, pour rompre avec les traditions chrétiennes, consacrées par une longue habitude.
Parmi les causes qui favorisèrent la diffusion des chefs-d’œuvre littéraires, laissés par les plus beaux génies de la Grèce et de Rome, il faut placer l’invention de l’imprimerie. Des textes, réservés jusque-là à de rares privilégiés, devinrent d’un usage assez courant ; et les nombreux ouvrages anciens, retrouvés par les érudits de l’époque, furent connus sans peine de tous les hommes cultivés. Pétrarque et Boccace, dans la seconde moitié du XIVe siècle, avaient déjà donné l’exemple, en s’attachant à l’étude des modèles latins et grecs. Le premier se montrait plus fier de son petit poème Africa, composé en vers latins, que des stances en l’honneur de Laure de Noves, qui lui valurent la célébrité : il mettait une vraie passion à rechercher les manuscrits enfouis dans la poussière des bibliothèques ; et sa joie fut sans borne quand il découvrit, à Liège, deux discours de Cicéron, inconnus de ses contemporains. Le second apportait une ardeur égale à retrouver les textes oubliés et il les faisait traduire à grands frais, quand lui-même ne les traduisait pas ; il apprit le grec sous la direction de Léonce Pilate et parvint à lire couramment les chefs-d’œuvre de l’Hellade. Mais la brillante époque de Pétrarque et de Boccace devait être suivie d’une éclipse ; et ce furent les savants grecs, venus nombreux en Italie dès la première moitié du XVe siècle, et qui affluèrent davantage encore après la prise de Constantinople par Mahomet II, qui donnèrent une impulsion particulièrement féconde à l’étude des littératures anciennes. Citons, parmi beaucoup d’autres, Manuel Chrysoloras, Théodore Gaza, Jean Argyropoulo, Constantin et Jean Lascaris, Chalcondylas, le premier éditeur d’Homère, le cardinal Bessarion. Bien accueillis en Italie par certains princes, souvent perfides en politique et sanguinaires dans leurs mœurs, mais qui se faisaient gloire de protéger les artistes et les lettrés, ces érudits furent, dans la péninsule, les promoteurs d’une révolution intellectuelle qui s’étendra ensuite à tous les pays d’Occident. Les Médicis à Florence, les Sforza à Milan, les d’Este à Ferrare ; certains papes, comme Jules II et Léon X, ont même laissé dans l’histoire un nom assez sympathique, malgré leurs crimes et leur débauches, à cause de la protection qu’ils accordèrent aux humanistes, aux poètes, aux grands artistes des XVe et XVIe siècles.
Des érudits italiens, tels que Jean Aurispa, Guarino-Guarini, Philelfe, rivalisèrent bientôt avec leurs maîtres grecs ; alors que d’autres, en particulier Gasparin de Bergame, Laurent Valla, Pulci, Ange Politien, le Pogge, s’appliquaient plus spécialement à l’étude des auteurs latins. Pour ne pas gâter le « latin cicéronien », qu’il se vantait d’écrire, le cardinal Bembo ne voulait plus lire l’Écriture sainte. Malheureusement, trop d’humanistes renoncèrent à faire œuvre personnelle, se bornant à imiter les anciens de façon servile. Or, pastiches et copies ne sauraient prétendre à une gloire durable ; hellénistes et latinistes de la Renaissance ont laissé des ouvrages d’une grande valeur pour les érudits, mais d’un intérêt littéraire et humain généralement fort médiocre, souvent même nul. D’Italie, l’amour de l’Antiquité grecque et latine gagna, successivement, les diverses régions de l’Europe occidentale et centrale.
En France, érudits et philologues ne manquèrent pas. Le plus célèbre fut Guillaume Budé, esprit encyclopédique qui fraya la voie à l’humanisme dans notre pays. Robert et Henri Estienne furent, tout ensemble, d’excellents imprimeurs et de remarquables savants ; comme beaucoup d’autres érudits français, ils se convertirent au protestantisme et furent violemment persécutés par les catholiques. Citons encore, tant parmi les hellénistes que parmi les latinistes, Lefèvre d’Etaples, Turnèbe, Estienne Daurat, Dumoulin, Muret, Nizole, Dubois, Scaliger, Casaubon. Le Collège des trois langues, appelé plus tard Collège de France, qui fut créé en 1530 pour donner un enseignement plus moderne que celui de l’Université, contribua puissamment à développer chez nous le goût des humanités. Outre Budé, il compta parmi ses professeurs l’helléniste Pierre Danès, l’hébraïsant Vatable, l’orientaliste Guillaume Postel, le fameux Pierre Ramus, qui fut tué lors du massacre de la Saint-Barthélemy.
Dès la fin du XVe siècle, des novateurs, tels que Conrad Celtes, Peutinger, Bebel, Rhenanus, Agricola de Groningue, répandaient en Allemagne le goût des études grecques et latines. Mais, dans ce pays, la lutte entre les scolastiques, restés fidèles aux méthodes surannées du Moyen Âge, et les humanistes, qui méprisaient le latin de saint Thomas d’Aquin et préféraient Platon à Aristote, fut extrêmement vive. Reuchlin, qui demandait que la science reste indépendante de la religion, fut accusé d’hérésie par les dominicains. Quant à Mélanchton, professeur de grec à l’université de Wittenberg dès l’âge de vingt et un ans, il devait se ranger du côté de Luther et jouer un rôle très important dans l’histoire du protestantisme. Mais il était réservé aux Pays-Bas de voir naître le plus célèbre des humanistes, Erasme de Rotterdam, 1466–1536. Entré vers l’âge de vingt ans dans un cloître, il s’échappa cinq ans plus tard, dégoûté à tout jamais des habitudes monastiques. Après avoir mené très longtemps une vie errante et parcouru la France, l’Angleterre et l’Italie, il se fixa, en 1521, à Bâle, qu’il ne quitta presque plus. Recherché par tous les hommes marquants de son époque, il exerça une sorte de royauté intellectuelle qui l’a fait comparer à Voltaire. S’il a touché à toutes les questions et persiflé impitoyablement moines et théologiens, il n’osa pas cependant attaquer les dogmes comme le patriarche de Ferney le fera au XVIIIe siècle. Il a écrit :
« Tous les hommes n’ont pas le tempérament des martyrs ; et, si j’eusse été mis à l’épreuve, je crains bien que je n’eusse fait comme saint Pierre. »
Pareil à maints libres-penseurs modernes, cet écrivain sceptique ménagea toujours les autorités religieuses et civiles ; il n’osa même pas prendre parti pour la Réforme et resta finalement catholique. Ses Adages, ses Colloques, son Éloge de la folie et ses autres ouvrages obtinrent un prodigieux succès.
Toutefois, approfondissant mieux les idées des anciens et leurs procédés de composition, les meilleurs esprits comprirent que la création originale était préférable à l’imitation servile, et que, sans liberté intellectuelle, il n’était pas possible d’atteindre les cimes éclatantes du génie. Renonçant au latin, maints poètes et prosateurs écriront, en langue « vulgaire », des chefs-d’œuvre qui devront une notable partie de leur beauté à la connaissance de l’Antiquité classique, mais ne sacrifieront aux modèles grecs et latins ni les besoins de l’époque, ni le tempérament de l’auteur. Laissant à Victor Méric le soin de parler de la renaissance poétique et littéraire, je négligerai complètement ce sujet, pour me borner à dire ce que fut la renaissance philosophique, scientifique et artistique.
Sans doute, la scolastique continua de régner dans les écoles et les universités ; le thomisme trouva des défenseurs parmi les membres des ordres religieux ; et l’on dut attendre Bacon et Descartes pour assister à l’éclosion de la philosophie moderne. Cependant, une violente réaction se manifesta de bonne heure contre l’aristotélisme frelaté et mal compris des grands docteurs scolastiques. Au début du XVe siècle, le platonisme fut prêché avec enthousiasme par Gémiste Pléthon, un lettré byzantin venu en Italie ; et une académie platonicienne fut fondée à Florence. Sous la direction de Marcel Ficin, qui traduisit et commenta Platon, Plotin et d’autres philosophes alexandrins, elle devait jouir d’une brillante réputation. Nombreux, d’ailleurs, sont les écrivains de l’époque qui, par haine du Stagirique, se prennent d’enthousiasme pour l’auteur des Dialogues. Parmi ces platoniciens, qui témoignèrent souvent d’une grande indépendance de pensée, citons François Patrizzi, professeur à Ferrare et à Rome, Pic de la Mirandole, jeune prodige encore plus prétentieux que savant, Giordano Bruno, mis à mort par l’Inquisition romaine à cause de la hardiesse de ses pensées, Pierre Ramus, assassiné par des partisans fanatiques de l’ancienne philosophie, dans la nuit du 24 août 1572. Ceux qui restent fidèles à Aristote s’avèrent parfois, eux aussi, des adversaires acharnés de la scolastique ; ils lui reprochent (non sans raison) d’avoir modifié et corrompu la pensée du Stagirique. Ce fut le cas de Pomponat, que l’on persécuta parce qu’il ne croyait ni à l’immortalité de l’âme, ni à la providence. Les deux Piccolomini, Césalpini, Vanini, brûlé à Toulouse en 1619 comme impie et athée, furent également des péripatéticiens qui refusèrent d’adopter l’interprétation thomiste. Campanella, qui réclamait la communauté des femmes, du logement et des biens, n’appartient à aucune école ; Jacques Bœhm fut un mystique dont la doctrine laisse quelquefois prévoir celle de Hegel. Quant à Montaigne et à Rabelais, la place de premier plan qu’ils occupent en littérature nous dispense d’en parler ici.
Donc, nulle philosophie bien originale n’apparut à l’époque de la Renaissance ; mais à confronter les systèmes anciens, à voir combien est difficile la recherche de la vérité, les humanistes prirent l’habitude de critiquer toutes les doctrines, même religieuses. Ils comprirent la nécessité du libre examen, et s’appuyèrent, dans leurs discussions métaphysiques, non plus sur la tradition ou l’autorité, mais sur la raison. Au début, on espéra qu’une conciliation serait possible entre la philosophie grecque et le christianisme. Le pape Nicolas V recueillit, pour la Bibliothèque vaticane, les écrits des pères de l’Église, en même temps que les textes des auteurs païens ; Marcel Ficin s’efforça d’harmoniser le système de Platon avec les dogmes catholiques. Mais on comprit très vite la vanité de pareilles tentatives ; de nombreux humanistes, même parmi ceux qui, comme Pogge, étaient au service de l’Église, redevinrent païens de sentiment et de pensée. De la sorte, la Renaissance préparait la voie, non seulement à la Réforme protestante, mais à la philosophie rationaliste des Temps modernes.
Affranchies des liens étroits où les tenait la théologie, les sciences se développèrent rapidement. Refusant d’accepter les idées courantes, des chercheurs entreprirent d’observer directement la nature afin d’en mieux découvrir les lois. Un Léonard de Vinci et un Bernard Palissy s’intéressaient prodigieusement aux sciences naturelles ; dans ce domaine, ils firent même œuvre de précurseurs. En 1543, le chirurgien André Vésale publia le premier album contenant une description exacte et minutieuse des organes du corps humain. En 1553, le médecin espagnol Michel Servet, future victime de l’intolérance calviniste, découvrit l’existence de la circulation du sang entre le cœur et les poumons. Ambroise Paré, renonçant à cautériser les blessures, inventa la ligature des artères. François Viète, 1540–1603, est considéré comme le fondateur de l’algèbre. Mais c’est l’astronomie, surtout, qui brilla avec Copernic, Képler et Galilée. Le premier démontra que la Terre n’est pas le centre du monde et qu’elle tourne autour du Soleil, dans un ouvrage, De revolutionibus corporum celestium, qui parut seulement en 1543, l’année de sa mort. Ce livre sera condamné par la congrégation de l’Index comme soutenant une doctrine contraire à l’Écriture sainte ; ajoutons que Copernic fut considéré par ses contemporains comme un fou, dont les idées ne méritaient pas d’être discutées. Sa doctrine sera reprise plus tard par Képler, dont la vie fut une longue série de déboires, et par Galilée, qui fut odieusement persécuté par l’Inquisition et dut prononcer l’abjuration suivante :
« Moi, Galilée, dans la 69e année de mon âge, ayant devant les yeux les saints Évangiles que je touche de mes propres mains, j’abjure, je maudis et je déteste l’erreur et l’hérésie du mouvement de la Terre. »
Si nous applaudissons aux progrès scientifiques accomplis au XVIe siècle, nous estimons, par contre, à l’inverse de ce qu’affirment les historiens, que la connaissance plus approfondie du droit romain orienta les études juridiques dans une voie néfaste. L’engouement pour la législation romaine préparait le triomphe de l’étatisme dans ce qu’il a de plus absolu et de plus odieux. Quelques auteurs, cependant, en particulier François Hotman, Jean Bodin, le Hollandais Grotius, témoignèrent d’une indépendance et d’une originalité relatives, auxquelles il faut rendre justice. Rappelons enfin que, préludant aux revendications des anarchistes, quelqu’un osa protester contre les tyrans, quels qu’ils soient, et proclamer tous les hommes égaux et libres. Ce fut Étienne de la Boétie, l’ami de Montaigne ; son essai, la Servitude Volontaire ou le Contr’un, circula longtemps en manuscrit et ne fut publié, pour la première fois, qu’en 1576.
C’est dans les arts, en Italie surtout, que la Renaissance fut incomparable. Les premières œuvres, qui témoignent de tendances novatrices, se placent entre les années 1400 et 1450, époque que les Italiens ont appelé le Quattrocento. Quatre florentins, l’architecte Brunelleschi et les sculpteurs Ghiberti, Luca della Robbia, Donatello se dégagèrent, à des degrés différents, des traditions de l’art médiéval. En peinture, l’influence de Giotto resta longtemps encore prépondérante ; néanmoins, on découvre déjà chez Masaccio, mort en 1428, des tendances qui font présager l’évolution qui devait suivre. À partir de la seconde moitié du XVe siècle, la transformation s’accentue rapidement et les réminiscences du Moyen Âge deviennent de plus en plus rares chez les grands artistes. On trouve alors à Florence le sculpteur Verrochio et les peintres Ghirlandaio et Botticelli ; Mantoue se glorifie de posséder Andrea Mantegna ; Venise brille avec Carpaccio et les deux Bellini.
Au XVIe siècle, l’art italien atteindra, dans certaines branches, spécialement en peinture, une perfection qui, au dire de beaucoup, n’a jamais été dépassée. Conçu d’une façon toute païenne, il cesse d’être le serviteur docile de la morale et de la théologie ; s’il imite les modèles gréco-romains, c’est d’une manière originale et libre ; provoquer l’émotion esthétique, exalter la beauté sous ses formes multiples, voilà son unique but. Les progrès de la technique, l’étude très poussée du corps humain, la connaissance des lois de la perspective en peinture contribuèrent à donner aux artistes une habileté professionnelle, un savoir-faire merveilleux. De plus, jamais l’on n’avait encore vu surgir simultanément tant de génies, dont l’incessante activité se prodigua en œuvres admirables. Florence, Milan, Rome, Parme, Venise furent les principaux centres d’art ; néanmoins, une foule d’autres villes italiennes purent s’enorgueillir de monuments fameux et retinrent dans leurs murs des peintres et des sculpteurs de grand mérite.
Léonard de Vinci, Raphaël, Michel-Ange, Titien, Paul Véronèse, Corrège, Andrea del Sarto jouissent, même à notre époque, d’une prodigieuse célébrité. Génie universel, Léonard de Vinci, 1452–1519, fut à la fois peintre, sculpteur, ingénieur, poète et savant. Sa Joconde, sa Vierge aux Rochers, son Saint Jean-Baptiste, la Cène dont il décora le réfectoire du couvent de Sainte-Marie des Grâces, à Milan, sont fameux. Raphaël Sanzio, 1483–1520, mena une vie très mondaine à la cour du pape ; il mourut à 31 ans, comblé d’honneurs. Son caractère aimable lui avait fait beaucoup d’amis. Bien qu’il se soit également occupé d’architecture, c’est à la peinture exclusivement qu’il doit d’être si connu, Tous les grands musées possèdent des Madones de Raphaël ; mais c’est au Vatican que se trouvent ses œuvres les plus importantes. Michel-Ange Buonarotti, 1474–1564, était, à l’inverse du précédent, d’un caractère sauvage, ombrageux et rude, obligé de travailler pour les princes et les papes, il ne se résigna jamais au rôle de courtisan. Alors que l’œuvre de Raphaël est toute douceur, toute harmonie, celle de Michel-Ange témoigne d’une force surhumaine et d’une indomptable énergie. Comme sculpteur, il a laissé des statues allégoriques, un Moïse, un Laurent de Médicis justement célèbres ; comme peintre, on lui doit les fresques de la chapelle Sixtine ; comme architecte, il dressa les plans de la coupole de Saint-Pierre. Travailleur infatigable, il exécuta bien d’autres ouvrages, tous remarquables. Titien, 1490–1576, fut le représentant le plus complet de l’école vénitienne ; son œuvre très abondante comprend des portraits, des scènes mythologiques, des tableaux religieux. Paul Véronèse, 1528–1588, doué d’une grande facilité, exécuta des toiles d’une belle ordonnance et décora églises et palais ; il fut sans rival pour rendre le chatoiement des étoffes et la pompe de certaines cérémonies. Grâce et coloris caractérisent Corrège, 1494–1534, dont les œuvres maîtresses sont à Parme. Douceur, élégance et harmonie plaisent dans les figures peintes par Andrea del Sarto, 1488–1530.
Rappelons encore que Benvenuto Cellini, 1500–1571, dont la vie fut celle d’un aventurier, était un sculpteur et un orfèvre de génie. Son Persée, sa Nymphe de Fontainebleau sont des ouvrages délicieux. L’architecte Bramante, 1444–1514, sut joindre la force à l’élégance, la grandeur de l’ensemble à la finesse de l’exécution ; il construisit la Chartreuse de Pavie et donna le premier plan de Saint-Pierre de Rome. En musique, il convient de citer Palestrina, 1529–1594. Bien d’autres artistes, dans tous les domaines, mériteraient qu’on ne les oublie pas, tant furent nombreux à cette époque les talents qui sortaient de l’ordinaire. Mais, contrairement à ce que l’on affirme, nous estimons que le rôle des mécènes ne fut pas toujours heureux, et que l’art aurait dû s’affranchir de la tutelle encombrante des princes et des papes. Dans l’ensemble, le gain fut exclusivement pour ces potentats, qui obtinrent une gloire durable à bon compte. Quelques-uns étaient pourtant incapables de rien comprendre à la beauté. Un Pierre de Médicis, par exemple, obligeait Michel-Ange à faire des statues de neige pendant un hiver rigoureux ! Tous les mécènes ne furent pas aussi stupides ; tous se sont rendus célèbres, grâce au travail de subordonnés qu’ils payaient assez maigrement. S’il n’était mort si brusquement, Raphaël, le plus favorisé des artistes du XVIe siècle, aurait reçu de Léon X le chapeau de cardinal ; mais, assurent les contemporains, c’était en compensation de sommes considérables que lui devait le pape et qu’il ne voulait pas lui payer. Par malheur, l’histoire, habituellement au service des oppresseurs du genre humain, ne manque jamais de flatter les puissants ; elle les couvre de fleurs, même quand ils ne le méritent pas.
Hors d’Italie, la renaissance artistique aboutit également à la production d’œuvres remarquables. En France, architectes, sculpteurs, peintres resteront originaux, tout en s’inspirant des tendances rénovatrices, Sous François Ier, des maîtres italiens, Léonard de Vinci, Benvenuto Cellini, le Primatice, le Rosso, séjournèrent chez nous. Toutefois, une adaptation de l’art nouveau aux conditions particulières du milieu et du climat s’accomplit assez vite. Avec Pierre Lescot, Philibert de l’Orme, Jean Bullant, l’architecture brille d’un vif éclat. Malheureusement, elle se désintéresse de la demeure du pauvre et ne songe qu’à construire des châteaux et des palais pour les souverains, leurs maîtresses et leurs courtisans. Déplorable effet de l’asservissement de l’art au profit des lois ! En sculpture, l’influence italienne est très sensible chez Jean Goujon ; elle l’est beaucoup moins chez Pierre Bontemps et Germain Pilon, qui gardent une grande indépendance dans leurs créations. La peinture, très médiocre dans l’ensemble, n’a point laissé d’œuvres de premier ordre : François Clouet et Corneille de Lyon ne manquent pas de vigueur ; Jean Cousin ne mérite pas les éloges qu’on lui a prodigués. L’art de l’émail, qui prospérait depuis longtemps à Limoges, adopta le style et les sujets chers à la Renaissance, avec Jean Pénicaud et Léonard Limousin. Bernard Palissy, « le potier d’Agen », qui découvrit le secret des faïences émaillées et fut persécuté comme protestant, était un maître génial dans l’art de la céramique. Ajoutons que certaines œuvres musicales françaises du XVIe siècle sont appréciées avec juste raison, même aujourd’hui.
En Allemagne, l’influence italienne se fait déjà sentir chez le sculpteur Peter Vischer, 1460–1529. Elle est manifeste chez Albert Durer, 1471–1528, le plus grand artiste allemand de l’époque. Outre des toiles et des portraits, il a laissé des gravures sur bois ou sur cuivre qui jouissent d’un renom mérité. Avec Hans Holbein d’Ausbourg, 1498–1543, la Renaissance triomphe complètement. Ce peintre mena une vie errante, puis se fixa en Angleterre ; il est l’auteur de la fameuse Danse macabre de Bâle. Dans beaucoup d’autres pays encore, l’art italien trouva des imitateurs ; mais, par manque d’originalité et d’indépendance intellectuelle, ces derniers ne firent pas toujours œuvre féconde et utile. Trop souvent, ils oublièrent qu’en matière de beauté, comme de savoir, le génie requiert impérieusement la liberté.
— L. BARBEDETTE.
RENAISSANCE (POÉSIE)
La période de la Renaissance qui mérite une mention à part (voir au mot Poésie) doit être considérée comme une période de transition qui, après le Moyen Âge, prépare l’officiel XVIIe siècle où s’abreuvent les amateurs du pur classicisme. Peu d’époques ont été aussi fécondes que celle du XVIe siècle. Les guerres d’Italie, l’essor soudain des arts et de la littérature renouvelés par l’étude des anciens lui donnent un caractère nouveau.
Nous voilà assez loin des « chansons de geste », des fabliaux, d’Alain Chartier et de Villon. Les farces, moralités, soties, mystères vont faire place à la tragédie et à la comédie. La satire et l’élégie réclament leurs droits. Pierre Gringoire, d’illustre et romantique mémoire, est quelque peu démodé, encore qu’appartenant à la première moitié du siècle. Et voici Marot qui fait son apparition.
Clément Marot prodigue les ballades et les rondeaux, sans rompre complètement la tradition du passé. On lui doit aussi des églogues, des épîtres, des satires dont Boileau ne manquera pas de s’inspirer. Il a gardé l’esprit alerte, vif, enjoué de ses devanciers et il laisse prévoir La Fontaine comme Voltaire, l’un par les fables, l’autre par les épigrammes.
C’est le début de la Renaissance, et Clément Marot est incontestablement le maître. Il faut citer, autour de lui, parmi ceux qui le précédèrent et ceux qui le suivirent, Jean Bouchet, Jean Marot, Claude Chappuis, Charles Fontaine, Corrozet (qui traduit Esope), François Hubert, Victor Brodeau, Bonaventure des Périers (célèbre surtout comme conteur), Louise Labé, etc.
Mais il faut arriver à Ronsard pour voir s’épanouir la Renaissance. C’est alors le triomphe de l’Antiquité. Joachim du Bellay va lancer sa fameuse Deffense et illustration de la Langue françoyse où, pour la première fois, le mot « patriote » est employé ! Les novateurs prétendent rejeter les vieilles gauloiseries des aïeux, plus ou moins épuisées, en même temps que les mystères, dont on avait tant abusé ; Ronsard publie ses premières Odes. Une mêlée s’engage, comme elle s’engagera quelques siècles plus tard entre classiques et romantiques. Mais l’école nouvelle aura le dessus. Les amis de Ronsard se groupent dans la Pléiade. Ils ont nom : Jean Dorat, Du Bellay, Jodelle, De Baïf, Rémi Bellau, Pontus de Thyard. Autour de ces chefs d’école, combattent les Jamys, les Olivoi de Magny, les Thaureau, les Jean de la Taille, les Grévin, les Larivey, etc.
Quand Ronsard disparaîtra, vieilli et chargé de gloire, la poésie sera complètement renouvelée. Une nouvelle génération est née avec Vauquelin de la Fresnaye, Du Bartas, Desportes, Bertaud, D’Aubigné, Régnier. Mais tous s’éloignent plus ou moins du maître.
Pierre de Ronsard, qui domine son époque, a le mérite d’avoir régénéré la poésie française en puisant dans l’Antiquité, et le défaut d’avoir quelque peu troublé les sources de la vieille tradition gauloise. On lui doit quatre volumes des Odes, le Bocage royal, les Hymnes, les Élégies, Mascarades et Bergeries, etc. Sa renommée franchit les frontières. Son influence est formidable. Il ne lui a manqué qu’un peu de mesure, peut-être. Mais la poésie lui doit beaucoup. Il a innové dans bien des genres, créé des rythmes inédits. Il a surtout consacré l’alexandrin dont ses descendants useront et abuseront. Quoi qu’on puisse dire, et en dépit de la réaction qui s’est produite contre lui, Ronsard demeure un de nos plus grands poètes, et, par dessus les siècles écoulés, exerce encore une irrésistible attraction.
Un autre grand poète de cette époque inouïe, c’est Mathurin Régnier, le satiriste, féru de Juvénal et d’Horace, dont on a pu dire qu’il annonçait Molière.
La Renaissance, en définitive, a trois sommets : Marot, Ronsard, Régnier. Chose curieuse, l’enjambement pratiqué par Marot est rejeté par Ronsard, puis repris. Il règnera, de nouveau, à l’heure du romantisme. Mais le XVIIe siècle s’ouvre, et Malherbe, le terrible Malherbe, « vient », qui s’avise de mettre un peu d’ordre, supprime les rimes qu’il juge trop faciles, combat les métaphores et allégories trop excessives, fait une règle impitoyable de la césure. La poésie y gagne, sans doute, en discipline ; elle y perd en pittoresque, et c’est l’ennui morne qui, malgré l’abondance des génies officiels, va régner pour des années.
— V. M.
RENÉGAT
n. m. de l’italien rinegatto, du latin re préfixe, et de negare
Nom injurieux donné par les chrétiens à ceux qui, renonçant à la religion du Christ, en ont embrassé une autre. Par ext. : personne qui abjure ses opinions ou trahit son passé. Syn. : Apostat (Dict. Larousse). Celui qui abjure ses opinions ou trahit son passé est justement qualité de renégat. Cette flétrissure ne doit pas être appliquée à celui qui, imbu de croyances inculquées dès son enfance, réussit à s’en affranchir, à force de clairvoyance, d’esprit critique, d’intelligence et de courage. Par l’observation, la réflexion, l’étude, il parvient à découvrir des parcelles de vérité qu’il substitue aux préjugés, aux mensonges dont son entourage, sa famille, son éducation première avaient empli et empoisonné son cerveau. Celui-là est un être indépendant, de caractère fort, qui s’émancipe et marche hardiment vers la lumière, vers le vrai qu’il apprécie et qu’il constate. Il n’est ni renégat, ni apostat : il est l’individu d’esprit droit qui s’éclaire pour évoluer par la science et le libre examen. Il évolue, il se transforme selon la loi naturelle qui fait de l’homme un être pensant par lui-même, sachant voir, entendre, réfléchir et comprendre. De tels individus se rencontrent pourtant et, s’ils sont sincères avec eux-mêmes et avec leurs semblables, ce ne sont pas ceux-là qui seront des renégats ni des apostats. Le renégat renie ses croyances, son passé, non par raison, mais par intérêt ; non par sincérité, mais par lâcheté ; non par honnêteté, mais par ambition, vanité. Le renégat c’est l’arriviste, le flatteur des puissants, l’hypocrite qui, la main sur le cœur, exprime sur toutes choses et en toutes occasions de faux sentiments. Il fait étalage de vertus qu’il n’a pas pour masquer les vices qu’il a. Le renégat est donc facile à reconnaître. Il feint d’ignorer le mépris dont il est l’objet et se prétend l’apôtre de la tolérance pour tous, pensant ainsi atténuer l’effet choquant de son attitude et provoquer l’oubli ou l’indulgence de ceux qui l’ont connu tout autre. Mais le renégat trouve des adulateurs, des partisans et même des amis, s’il est prospère en ses palinodies et si sa fréquentation parait avantageuse aux créatures peu fières qui sollicitent ses bienfaits. On rencontre donc des renégats partout et surtout où il y a de l’avenir. Aussi, la politique a-t-elle son contingent de renégats. Combien d’hommes connus sont devenus d’importants personnages en reniant d’abord tout leur passé ? Combien ont affiché bruyamment des idées révolutionnaires, pour devenir les pires réactionnaires, traîtres à leurs idées, traîtres à leurs amis capables de tout pour complaire à ceux auxquels ils se sont vendus pour on ne sait jamais combien ? Le braconnier devient garde-chasse. Le théoricien de la liberté devient le traître qui la poignarde et, après avoir provoqué l’émeute sauve la société en danger en passant de l’autre côté de la barricade ! Tel autre, farouche ennemi du militarisme et du patriotisme, épouvante ou écœure par ses extravagances de provocateur et, soudain, devient le patriote incomparable qui demande à partir au front et auquel on répond qu’il est plus utile à l’arrière pour maintenir le moral du peuple. Celui-là pleure son frère tué en regrettant de n’avoir qu’un frère à immoler à la patrie ! Que d’autres ! Que d’autres encore on pourrait, d’une ligne, rendre reconnaissables, qui ont tout renié, même le bon sens, pour adorer ce qu’ils brillaient jadis ! Que de faux amants de la Liberté se sont tout à coup révélés de véhéments partisans de la dictature !... Enfin, les renégats abondent quand la lâcheté, l’ambition ou la cupidité leur font entrevoir, le plus avantageux côté de la barricade !... Ces gens-là n’ont de conviction que selon l’écuelle qui leur est offerte. Ils sont bêtes de luxe ou bêtes de somme suivant la hauteur du râtelier.
Les renégats fourmillent ; nul milieu n’en est plus abondamment peuplé que le monde de la politique (voir Politique et Politiciens). À vrai dire, on rencontre partout des spécimens de cette espèce vile et méprisable. L’anarchisme lui-même a fourni quelques-uns de ces spécimens. Qui n’a pas connu d’anciens libertaires, se flattant de l’être encore tout en reniant avec une cynique désinvolture les principes anarchistes ? Pour s’excuser — lorsqu’ils avouent leur volte-face — ils invoquent quelques mauvais clichés dont leur impudence s’accommode avec un déconcertant sans-gêne. Par exemple :
« Quel homme d’intelligence et de cœur n’a été, à vingt ans, plus ou moins anarchiste ? »
Et ils ajoutent avec suffisance :
« Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas. »
Si nous entreprenions la publication d’une liste comprenant les cas de reniement plus ou moins retentissants unis qui se sont produits en tous temps, en tous lieux et dans tous les mondes, — sans en excepter le monde ouvrier et les groupements d’avant-garde, — le lecteur serait tenté d’estimer que le « Renégat » est une des variétés les plus nombreuses dans la race humaine. Le philosophe n’en éprouve aucune surprise : l’ambition, l’amour de l’argent, la vanité, sources auxquelles s’alimentent le reniement et la trahison, sont de néfastes effets dont la cause réside dans l’immorale organisation sociale.
— Georges YVETOT
RÉPRESSION
n. f. (du latin repressio)
Action de réprimer, de sévir, dans le but d’arrêter l’effet, le développement, le progrès d’une action qu’on juge répréhensible, d’un courant, d’une doctrine, d’un mouvement que l’autorité temporelle ou spirituelle estime subversif et contraire aux intérêts religieux ou laïcs que cette autorité a la charge de défendre.
La répression sévit en raison directe de la faiblesse d’un régime et de la force de l’opposition. Les gouvernements considèrent la répression comme une manifestation de l’autorité morale dont ils jouissent et de la solidité de leur puissance. Quand la police – toujours servile – traque les militants subversifs ; quand la magistrature – toujours à plat ventre – fait pleuvoir les condamnations les plus iniques et les plus dures sur les propagandistes et les hommes d’action d’une organisation révolutionnaire ou des groupements anarchistes ; quand l’armée – toujours aux ordres des pouvoirs établis – massacre les populations insurgées ; quand les prisons regorgent de détenus et les terres d’exil de proscrits, le Gouvernement s’imagine que la sévérité qu’il déploie contre ses adversaires marque la mesure de sa force et de la faiblesse des persécutés. Il n’y a là qu’une fausse apparence, et la raison et l’histoire déposent dans un sens diamétralement opposé. Il suffit d’observer et de réfléchir quelque peu pour acquérir la conviction que la répression dont un régime fait usage, dans le but de briser l’effort de ceux qui le combattent, est, tout au contraire, la marque de l’impopularité de ce régime et, par conséquent, de sa fragilité.
Sur ce point, consultons la raison. Écoutons-la. Elle affirme qu’un gouvernement véritablement populaire – j’entends par là estimé et aimé par le peuple – n’a pas besoin de s’appuyer sur la violence : la confiance qu’il inspire aux gouvernés, le respect et la sympathie que ceux-ci ressentent pour les talents et les vertus dont ils se plaisent à combler inconsidérément ceux qui président à leurs destinées, sont, pour les institutions en cours et pour ceux qui les régissent, les assises les plus stables et le gage le plus sûr de la docilité avec laquelle les gouvernés continueront à s’incliner devant l’autorité et le prestige des chefs. Il est donc, par avance, démontré que plus un gouvernement est populaire, moins il est appelé à sévir.
Raisonnons par l’absurde : supposons un régime de liberté si positive, de si stricte équité et d’égalité si réelle qu’il serait délibérément accepté par la totalité de ceux à qui il s’applique. Il est évident qu’un tel régime reposerait sur des bases d’une solidité à toute épreuve ; et il est, en outre, évident que, ledit régime ne suscitant ni mécontentement, ni protestation, ni révolte, la répression ne trouverait pas à s’y exercer. Mais un régime de cette nature ne comporterait aucun gouvernement ; ce serait l’anarchie.
Revenons donc au régime capitaliste et autoritaire qui, par contre, ne se conçoit pas plus qu’il ne saurait exister sans la répression. En divisant les individus en riches et en pauvres, le capitalisme enfante inévitablement, et sous les formes les plus variées, l’irritation et la révolte des spoliés contre les spoliateurs. En divisant les individus en gouvernants qui commandent et en gouvernés qui sont dans la nécessité d’obéir, l’État engendre inéluctablement, et sous les formes les plus variées, la colère et l’insurrection des asservis contre les maîtres. Pauvres et gouvernés ne se dressent pas seulement contre tels exploiteurs ou tels oppresseurs, ils se dressent contre les formes mêmes de l’exploitation et de l’oppression dont ils ont à se plaindre ; ils se dressent contre les institutions qui consacrent et protègent ces formes ; ils se dressent contre le régime qui s’appuie sur ces institutions ; ils menacent directement le régime lui-même.
En fait, il en est ainsi : la révolte ne gronde, l’effervescence ne se produit, l’insurrection n’éclate que dans la mesure même où, les causes de mécontentement et l’indignation s’étant graduellement multipliées et aggravées, l’opposition – pouvant aller, alors, des éléments les plus modérés aux éléments les plus révolutionnaires, des partis les plus paisibles aux partis les plus violents, des natures les plus réfléchies aux tempéraments les plus impulsifs –, l’opposition, dis-je, se lève résolue, énergique, inflexible, contre le régime dont elle dénonce les méfaits et tente de le culbuter. Ainsi attaqué, le régime se défend et demande son salut aux forces de répression dont il dispose. La nature de ces forces de répression et la férocité avec laquelle l’autorité y fait appel étant conditionnées par l’intensité de la révolte, la gravité de la situation et l’imminence du péril.
Ce n’est donc pas quand un gouvernement est fort, mais, au contraire, lorsqu’il se trouve affaibli par l’accumulation de ses erreurs, de ses fautes et de ses crimes, qu’il a besoin de résister aux assauts qui lui sont livrés et de jeter dans la mêlée les violences, les arbitraires, les cruautés que synthétise la répression. Ce n’est donc pas de la puissance, de la solidité d’un régime ou d’un gouvernement que la répression donne la mesure. Elle donne, au contraire, celle de la force de l’opposition.
LA MARCHE D’UNE IDÉE.
Cette thèse est confirmée par une observation empruntée à des considérations d’un ordre différent et qui sont trop saisissantes pour que je ne les indique pas.
Écoutez bien ceci : une idée naît. Elle se dégage d’une multitude de faits et de circonstances qui révèlent un état social nocif et criminel. Cette idée tend à la disparition de cet état social et à la suppression des pouvoirs établis, destinés à maintenir celui-ci. Elle porte en elle, mais tout d’abord à l’état potentiel, un arsenal d’armes redoutables contre lesdits pouvoirs. Toutefois, elle est encore si faible et si menue que la menace qu’enferment ses flancs n’apparaît que fort incertaine et quasi imperceptible.
Qui sait seulement si cette idée survivra aux épreuves que comporte toute période de croissance ? Mieux vaut l’ignorer. Sévir serait une maladresse, car ce serait attirer l’attention sur l’idée naissante, lui faire une réclame inespérée et – qui sait ? –, en lui donnant une importance qu’elle n’a pas encore, la doter d’une force qui lui fait défaut. Et puis, il sera toujours temps, s’il le faut, de la combattre et de l’étouffer.
Or, voici que cette idée se propage ; elle groupe autour d’elle des intelligences, des énergies et des dévouements. Ses partisans s’agitent, mais un peu au hasard, inorganisés et sans plan concerté. La menace grandit ; mais elle reste encore trop imprécise et trop lointaine pour qu’elle soit, de la part des maîtres de l’heure qui ont à faire face à des adversaires plus pressants et mieux préparés, l’objet d’une persécution systématique et d’une répression caractérisée. Toutefois, cette menace n’est pas à dédaigner tout à fait ; les gouvernants s’en inquiètent, ils en surveillent les manifestations et, de temps en temps, le glaive de la loi s’abat sur les propagandistes qu’ils jugent trop impatients ou trop audacieux.
Mais voici que, bien loin d’être affaiblie par les coups qui lui sont portés, l’idée gagne en profondeur et en étendue. Elle se précise en formules définitives et en mots d’ordre concrets. Elle a ses théoriciens, ses écrivains, ses orateurs. Elle possède son organisation, ses journaux, ses tribunes, ses revues, ses brochures, ses livres, ses œuvres. Les mêmes tâches suscitent l’ardeur enthousiaste de centaines et de centaines de propagandistes de toutes langues et de toutes nationalités. Mêmes aspirations, même but, mêmes méthodes d’action, même idéal rassemblent peu à peu, en un faisceau de plus en plus robuste et compact, des milliers, des dizaines de milliers de militants prêts à tout, même au sacrifice de leur vie, pour le triomphe de l’idée qui leur est chère et commune. Alors, les dirigeants n’hésitent plus. L’heure de l’implacable répression a sonné. Il faut étouffer à tout prix la moisson de révolte qui lève. C’est pour eux une question de vie ou de mort. Tout leur est prétexte à justifier – apparemment, du moins – la plus sauvage persécution.
Discuter ? Opposer argument à argument, doctrine à doctrine ? Non, non ! Le feu est à la maison ; l’incendie se propage ; l’embrasement général est imminent. Il faut, toutes autres préoccupations cessantes et toute autre besogne étant reléguée au second plan, il faut, sur l’heure, perquisitionner, arrêter, condamner, châtier les rebelles, les destructeurs de l’ordre établi, les générateurs de révolte, les fomenteurs d’insurrection. Plus le régime se sent menacé, plus l’opposition est forte, mieux elle est organisée, plus redoutable est la bataille qu’elle engage, et plus le régime apporte à se défendre de rigueur et de violence.
On peut interroger l’histoire et on constatera que, depuis les temps les plus reculés, c’est ainsi, pas autrement, que les choses se sont passées. Ici, la leçon des faits se confond avec l’enseignement de la logique élémentaire, pour établir, lumineusement et sans réfutation possible, que ce n’est pas lorsqu’un gouvernement est fort et l’opposition faible que la répression sévit, mais, au contraire, quand l’opposition est forte et le gouvernement faible. De ce qui précède, je conclus à l’erreur de cette théorie courante qui mesure la stabilité et la force d’un état social au degré de répression dont il accable ses contempteurs.
LES EFFETS DE LA RÉPRESSION.
Dans la pensée des gouvernants, la répression doit avoir pour conséquence d’intimider, de disperser, de décourager et, finalement, de terrasser leurs adversaires. En fait, la répression aboutit à des résultats contraires. Rien ne peut être comparé, comme stimulant, à la persécution : c’est le coup de fouet qui, cinglant brusquement le pur sang, précipite sa course et le rend indomptable. En arrachant le militant à la vie libre, en le séparant de ceux qu’il affectionne, en l’éloignant des milieux qui lui sont familiers, la prison et l’exil avivent la haine que lui inspirait déjà l’iniquité sociale. Ils creusent en abîme le fossé déjà large et profond qui le séparait du régime oppresseur.
Un libéralisme tolérant l’eût, peut-être, à la longue, réconcilié avec celui-ci ; la répression, de caractère fatalement brutal, en fait définitivement un ennemi mortel. Par les brimades, les tracasseries et les violences exercées contre le subversif, l’autorité croit le mater. Erreur : malmené, traqué, frappé, privé de travail, celui-ci s’indigne, proteste, se rebiffe, s’exaspère et contre la répression qui se généralise et, furieuse, aveugle, s’abat sur tous les hommes qui luttent côte à côte, c’est toute une armée de militants étroitement unis et solidaires, une armée d’adversaires désormais irréductibles qui fait au régime exécré une guerre sans merci.
La persécution se flatte de disperser les rebelles : elle les rapproche. Elle espère les décourager : elle exalte leur énergie et décuple leur vaillance. Elle croit les terrasser : elle inscrit, au fond de leurs cœurs, en lettres de feu, la farouche résolution qui pousse aux prodiges d’audace et d’intrépidité. « Vaincre ou mourir ! »
Je parle, ici, bien entendu, des militants dont l’inflexible volonté s’appuie sur un tempérament énergique et persévérant et sur des convictions profondes autant qu’ardentes, conscientes autant qu’indéracinables. Exceptionnellement doués, ces natures fortes, ces cœurs fervents, ces êtres, résolus à se vouer et à se dévouer à l’apostolat vers lequel les appellent, avec une force irrésistible, leur intelligence et leur sensibilité, sont inaccessibles au découragement. Céder à la répression, se laisser abattre par la persécution leur apparaîtrait comme une lâcheté qu’ils ne se pardonneraient pas, comme une trahison dont leur conscience ne consentirait pas à les excuser, moins encore à les absoudre. Mis en demeure de choisir entre l’abandon des convictions qui les animent et la mort, c’est à celle-ci que, sans hésitation, ils se résigneraient. Oui, cent fois oui : plutôt souffrir et, s’il le faut, mourir que d’abjurer leur magnifique idéal !
LA RÉPRESSION NE BRISE PAS LA RÉVOLTE.
L’histoire le proclame : la persécution a pu entraver, parfois même paralyser momentanément la poussée d’un mouvement social ample et vigoureux ; elle a pu en retarder le triomphe ; jamais elle n’est parvenue à l’anéantir, à en avoir définitivement raison. L’histoire de l’humanité abonde en exemples de nature à illustrer cette thèse. Je n’en citerai que trois, mais ils sont typiques et suffiront :
-
Le triomphe du christianisme est le premier de ces exemples. Durant près de trois siècles, les disciples du Christ furent en butte aux plus atroces persécutions. Mis au ban de la société, pourchassés et traités comme les pires malfaiteurs, torturés comme les plus infâmes criminels, c’est par centaines de milliers qu’ils furent publiquement suppliciés et assassinés. La sauvage persécution par laquelle le monde païen espérait étouffer à jamais le christianisme naissant a indubitablement retardé le triomphe de celui-ci ; mais, par contre, elle lui a assuré, dès son avènement, une influence morale, un prestige et une puissance matérielle que le christianisme eût mis des siècles à conquérir et qu’il n’eût, probablement, jamais acquis sans la fascination exercée sur le mysticisme fanatique des populations vivant au Ve et au VIe siècle, grâce à l’évocation pathétique des martyrs marchant au supplice, extasiés, délirants.
-
Un peu plus tard, le christianisme triomphant devint persécuteur, à son tour. Durant toute la nuit du Moyen Âge, l’Église omnipotente, d’accord avec la monarchie et la noblesse, fit peser la répression la plus perfide, la plus sanguinaire et la plus impitoyable sur quiconque refusait de se courber passivement devant les absurdités de l’orthodoxie théocratique et romaine. Peu importait, en ces temps maudits, que la science fût domestiquée, que la pensée fût asservie et que, par suite, tout véritable progrès social fût rendu impossible ! Pour le clergé et la noblesse assoiffés de domination, il fallait que les cerveaux fussent plongés dans la nuit épaisse et profonde ; il fallait que, dans tous les domaines, régnât une obscurité d’encre et de plomb : vouloir projeter dans ces ténèbres quelque clarté, c’était le crime inexpiable entre tous et, contre le penseur, le savant ou l’artiste dont l’œuvre glissait dans cette nuit un rai de lumière, c’était la mort précédée d’indicibles souffrances et, après la mort, la damnation éternelle.
Ce fut en vain, pourtant, que toutes les forces de répression se coalisèrent contre l’espoir critique et de libre examen poussant irrésistiblement l’humanité pensante vers la lumière. Après avoir été travaillé et bouleversé par la lutte formidable qui mit aux prises l’aristocratie et la démocratie, le dix-huitième siècle enregistra, en dépit de toutes les persécutions par lesquelles les classes privilégiées prétendaient assurer leur salut, l’irrémédiable défaite du monde féodal (noblesse et clergé) et la victoire du monde démocratique (bourgeoisie et peuple).
-
Plus tard, encore, la bourgeoisie, devenue à son tour toute-puissante, s’arma de la plus sanglante répression contre le prolétariat en travail d’émancipation. L’histoire du XIXe siècle mentionne la colère grandissante des masses populaires cyniquement pressurées et dépouillées par une insatiable oligarchie financière, industrielle et commerciale. Écrasée d’impôts, réduite aux privations par des salaires toujours insuffisants, écœurée des palinodies et trahisons des mandataires du peuple qui violent impudemment leurs promesses, exaspérée par la rapacité patronale qui repousse hautainement les revendications les plus légitimes de leurs salariés, jetée par les rivalités et convoitises capitalistes dans d’incessantes guerres où son sang coule à flots, la classe ouvrière proteste, menace, se cabre, se soulève en grèves économiques et en insurrections politiques.
Les gouvernements sévissent. Mais l’élan est donné et les persécutions ne réussissent point à le briser. La Commune éclate. Maîtresse de Paris, elle se bat avec un courage admirable ; mais affamée, assaillie de toutes parts, isolée du monde entier, encerclée par les troupes ennemies, à bout de ressources, de munitions et de forces, elle succombe. Et l’Univers assiste à une des plus abominables répressions que l’histoire ait connues.
La bourgeoisie croyait noyer ainsi dans le sang le socialisme et la révolution. Erreur : dans le monde entier, le socialisme grandit, la révolution gronde et l’anniversaire de la Commune est commémoré par les militants de tous les pays et célébré par eux comme une étape glorieuse sur la route qui conduit à l’affranchissement international.
CONCLUSION.
Ces leçons de l’histoire sont d’une incomparable éloquence ; elles possèdent une force exceptionnelle de démonstration. Elles sont à retenir. Tenons-en compte et appliquons-les à l’époque que nous vivons.
Disqualifiées et condamnées dans le cœur et l’esprit des êtres conscients et éclairés, dont le nombre croît de jour en jour, les institutions actuelles ne disposent, comme moyen de défense, que de la répression. Elles en usent sans mesure. Aux attaques dirigées contre leur odieuse domination par les compagnons des deux hémisphères, les dictateurs et maîtres de partout ripostent par la prison, l’exil et le bourreau. Une fois de plus, l’autorité fait appel aux forces de répression dont elle est puissamment armée et met en celles-ci toute sa confiance. Sa confiance est mal placée.
La persécution, même la plus féroce, ne réussira pas à briser le mouvement formidable qui emporte l’humanité vers des formes nouvelles de vie individuelle et sociale. Elle ne parviendra pas à sauver le régime de la débâcle. C’est un duel à mort qui commence et va se poursuivre, avec un acharnement grandissant, entre l’autorité qui ne veut pas mourir et se défendra jusqu’à l’épuisement total de ses forces de résistance et la liberté qui ne peut naître et se développer que sur le cadavre de l’autorité.
Il est à prévoir que la lutte sera longue, âpre et sanglante. Il est certain qu’avant d’atteindre le but, les contempteurs de l’autorité laisseront sur la route nombre des leurs, meurtris et pantelants. C’est la fatalité de toutes les batailles que soient immolés à la victoire les meilleurs, les plus intrépides et les plus ardents. Si douloureuse que soit cette rançon de la victoire, les anarchistes sauront la payer sans défaillance. Ils savent que, juste, sublime, immortelle est la cause pour laquelle ils luttent : celle de la liberté.
Cette cause n’est pas celle d’une caste, d’une classe, d’une génération, du plus grand nombre ; elle est celle de toutes les générations et de tous les individus, sans aucune exception. Elle triomphera.
— Sébastien FAURE.
RÉPUBLIQUE [LA] (DES ENFANTS)
Parmi les réalisations tentées par les israélites dans les colonies qu’ils ont établies en Palestine (voir à Sionisme : colonies sionistes), il en est une qui ne saurait manquer de retenir l’attention de tous ceux qui s’intéressent aux méthodes nouvelles d’éducation de l’enfance, c’est la tentative connue sous le nom de « République des Enfants » et qui se déroule dans la vallée de Jézréel. Dans La Revue de Paris du 1er février 1927, J. Kessel en a parlé en des termes que nous transcrivons presque littéralement :
« Il est des faits que l’on hésite à rapporter, tellement ils heurtent les vérités admises, la routine de la vie et ce qui semble être le sens droit des choses... Comment ne pas en être sûr en abordant le récit de ma visite à Kfar-Ieladime, république enfantine, dans cette même vallée. Comment faire accepter qu’il est un endroit où 110 enfants des deux sexes, dont la majeure partie compte de douze à quinze ans, se gouvernent eux-mêmes, suffisent presque entièrement à leurs besoins, ont leur constitution, leur tribunal, leur presse, leur système électoral ? Et que cela ne tourne ni au jeu, ni au chaos ? Et que cela fonctionne pour le plus grand bien de tous ? Pourtant, Kfar-Ieladime existe et je ne suis pas le seul à l’avoir admirée. Au demeurant, voici.
« Après les effroyables massacres juifs opérés en Ukraine..., il s’y trouva un nombre incalculable d’orphelins. La puissante communauté juive d’Afrique du Sud résolut d’en prendre quelques-uns à sa charge et de les placer en Palestine. Ainsi naquit Kfar-Ieladime. D’abord, ce fut une institution pareille à tous les orphelinats. Les pupilles, apeurés, caporalisés, ne se distinguaient en rien de ces tristes gamins que l’on voit défiler en troupe morose dans n’importe quelle ville de province, un jour de fête. Près d’une année s’écoula ainsi. Alors, arriva un homme qui possède la plus noble fortune : celle d’être chéri des enfants. Il s’appelle Pougatcheff. Son portrait ? Une barbe tirant sur le roux, des lèvres épaisses, des rides profondes au front. Mais dans les yeux une infinie bonté et une candeur rayonnante.
« C’était en Russie un pédagogue connu. Il y pouvait demeurer en toute sécurité, mais il aimait d’amour la Palestine. Il y vint et fit Kfar-Ieladime.
« Les lignes essentielles de sa méthode – qu’il m’exposa dans une petite chambre claire et joyeuse – sont les suivantes : remplacer l’instruction par l’éducation. Développer l’individualité complètement, mais de telle façon qu’elle tienne compte des individualismes voisins. Employer dans sa plénitude l’heure qui passe. Abolir la préparation utilitaire à la vie, qui est une préparation mesquine et amère. Ne faire penser qu’au labeur présent, en lui-même et pour lui-même. Et, pour tout cela, faire vivre les enfants entre eux, uniquement, selon des règles qu’ils auront élaborées eux-mêmes.
« Le programme était beau. Il s’agissait de lui donner vie et chair, avec des enfants timides, transplantés, dépaysés, et qui tous avaient eu à l’aurore de leur existence de si terribles baptêmes qu’ils pouvaient en être irrémédiablement faussés. Leur nouveau guide commença par les apprivoiser. Il allait de l’un à l’autre, s’entretenant familièrement avec chacun, de sa voix sourde et gaie, tâchant de faire sentir qu’il ne venait pas en maître, mais en frère aîné. Ayant établi cette passerelle – encore fragile – de confiance réciproque, il rassembla les enfants et leur tint à peu près ce discours :
« Mes amis, je ne veux rien vous imposer. Vous devez tout comprendre et vous diriger vous-mêmes. Or, quelle est notre situation ? Où sommes-nous ? Dans l’Emek, vallée de Palestine. Ici, pour tous, commence une vie nouvelle. Vous sentez bien qu’il faut y prendre part. Mais comment ? Les villages arabes vous plaisent-ils ? Non ? Pourquoi ? Parce qu’ils sont sales. Et les villages russes où vous avez vécu ? Non plus ? Pour la même raison. Donc vous voulez vivre dans un village propre. À vous de le faire. À vous de distribuer votre travail, de le choisir, de vous entendre entre vous. Moi, je ne suis là que pour vous conseiller. Je ne reçois pas de plaintes, je ne distribue pas de punitions. Arrangez cela entre vous. »
« Ayant ainsi posé le problème, Pougatcheff laissa les enfants y réfléchir quelques jours. Puis, doucement, par insinuations et suggestions, il leur fit découvrir les rouages essentiels qui devaient les régir. Ainsi fut élaborée une constitution, charte suprême, fut institué un tribunal, seul organe de sanctions. La constitution, tous y participèrent. Elle fut le fruit de longues conversations, menées avec sérieux et foi. Sa base fut la responsabilité de chacun. Ses articles touchaient le détail de l’administration et du développement de la petite colonie. Son application devait être assurée par un comité de sept membres élus à deux degrés. Pendant un mois, Pougatcheff expliqua la valeur de la constitution qui fut votée à l’unanimité. Ensuite, il laissa deux semaines de méditation aux enfants pour choisir leurs délégués. Les élections eurent lieu avec la même gravité que celle qui avait présidé à toute cette gestation. Ainsi, se constitua le comité directeur de Kfar-Ieladime : cinq garçons, deux fillettes. Chacun avait sa charge : celui-ci devait veiller à l’ordre, celle-là à l’hygiène, un autre à ce que tout le monde allât à l’école, une autre à la tenue pendant le repas.
« Et l’autorité des directeurs que les enfants se sont donnés d’eux-mêmes est telle, me disait Pougatcheff, que (sans intervention aucune de ma part, je vous en donne ma parole) il suffit à la fillette chargée de surveiller la salle à manger de frapper quelques coups sur la table pour que le bruit le plus violent s’apaise. Il en va de même dans tous les autres domaines. Comment se soutient cette autorité ? Par quel système pénal ? Là est le point délicat de toutes les méthodes d’éducation. Les uns penchent pour la répression, les autres pour la persuasion. Fidèle au programme qui me paraît le plus conforme à la nature enfantine, je laissai les enfants – de même qu’ils se dirigeaient par leurs propres moyens – se juger entre eux. Le comité fut chargé d’élire trois juges que je présidai. Car, je vous l’avoue, les premières expériences n’allèrent point sans une véritable angoisse de ma part. J’avais peur d’ouvrir le champ aux injustices, à la cruauté que l’on prétend être le propre de cet âge. Je fus vite et pleinement rassuré. Les jugements avaient lieu en présence de tous. Or, bien que chacun eût le droit d’accuser et de défendre, je n’ai observé nulle méchanceté, nulle mesquinerie, mais un souci de l’équité, une délicatesse de cœur, une propension à l’excuse qui feraient honneur à bien des séances de tribunaux d’adultes. Ces séances sont maintenant ma plus grande joie. Mon second en tient minutieusement procès-verbal, et rarement j’ai vu un document pédagogique d’aussi haut intérêt. D’ailleurs, savez-vous combien de violations à la règle nous eûmes à juger en dix-neuf mois ? Quatorze. Songez qu’il y a ici 110 enfants et comparez à ce qu’il se distribue, en moyenne, de punitions pendant un mois dans un lycée pour des classes de 30 élèves ! Le plus grave de ces délits fut commis par deux garçons qui s’introduisirent dans la boulangerie et se confectionnèrent un gâteau avec 18 œufs. Quelles sont les sanctions qu’applique le tribunal ? demanderez-vous. Surtout la privation des droits civiques. Ne souriez pas. Vous ne savez pas combien les enfants y sont sensibles. Cela les met en dehors, en marge des autres. Ils sont accablés pendant toute la durée de leur châtiment. Tenez, je veux vous dire à ce propos une histoire qui m’a bouleversé. Nous avons ici un garçon avec une hérédité dangereuse. Son père était alcoolique et le massacre qui le rendit orphelin fut accompli d’une façon particulièrement ignoble. Il était sujet à des crises de colère sans frein, se jetait sur ses camarades, les mordait. Il fut jugé et condamné à la perte de ses droits civiques pour trois mois. Cependant, par égard pour les circonstances que je vous ai dites, les enfants résolurent que ce verdict ne serait effectif que si, pendant trois mois, il ne se contrôlait point. Dès lors, ce fut le plus émouvant des spectacles. Ce garçon se ramassa sur lui-même. Il allait, grave et muet, comme s’il portait quelque chose en lui à la fois de lourd et de précieux. Jour par jour, il fortifiait sa maîtrise. Je n’oublierai jamais avec quel accent haletant il vint un jour me dire : « Déjà sept semaines. » Cette lutte livrée à ses instincts, cette réorganisation intérieure chez un enfant de quinze ans, uniquement déterminées par la pression sociale, sont un enseignement que l’on ne peut trop méditer. Et l’anxiété générale qui accompagnait ses progrès ! Toute la colonie se passionnait pour la régénération de ce camarade. Avec quelle joie inquiète on en suivait les étapes ! Avec quelle délicatesse ingénue on y collaborait ! »
« Ayant achevé son exposé, Pougatcheff me fit visiter la colonie. Les enfants y faisaient tout. J’en vis au potager, où un professeur, en même temps qu’ils bêchaient et piochaient, leur enseignait la botanique et la chimie végétale. J’en vis à la cuisine, miraculeusement propre, qui préparaient le repas, au lavoir, à la menuiserie. J’en vis de tout petits qui poussaient les brouettes et de grands qui travaillaient aux champs. Ils étaient sains et forts, souriants et graves. Deux ou trois petites filles me frappèrent par leur beauté. Mais tous avaient dans la démarche cette noblesse qui vient d’une vieille race, d’un beau climat et d’une vie vigoureuse. En me ramenant dans sa chambre aux proportions de cellule, Pougatcheff me montra la collection d’un journal bimensuel que rédigent en hébreu les enfants de Kfar-Ieladime. Textes et illustrations étaient tracés par des mains encore malhabiles, mais si scrupuleuses !... »
— É. ARMAND.
RÉSIGNATION
La résignation consiste en l’acceptation par un individu (ou une collectivité) d’une situation que, laissé libre de se déterminer, il (ou elle) ne subirait pas. On peut sommairement diviser l’humanité en deux catégories bien distinctes, la catégorie des résignés et la catégorie des irrésignés. Les résignés comprennent tous ceux qui, par influence, éducation, intérêt, acceptent les choses telles qu’elles sont, évitables ou non, que ce soit au point de vue économique, intellectuel, ou éthique. Ils ne savent pas faire de différence entre l’évitable et l’inévitable, les faits et les circonstances contre lesquels on ne peut réagir, parce que naturels, et ceux contre lesquels on peut se dresser, parce qu’artificiels.
Il y a, en effet, certains faits d’ordre biologique contre lesquels on ne peut se rebeller. On peut trouver que le fonctionnement de l’organisme humain est loin d’être parfait ; que la façon dont s’acquiert, croît, cesse la vie est déplaisante, etc. Il n’y a rien à faire là-contre. Le mécanisme de la pensée, des secrétions, de la circulation du sang, de la marche, par exemple, sont inhérents à notre nature d’êtres appartenant à la classe des vertébrés, au genre humain. Mais on s’aperçoit bientôt que, même dans l’ordre naturel, il est des faits évitables. On peut fort bien essayer d’atténuer les effets de certains accidents météorologiques, comme le froid, la chaleur, la pluie, les inondations, la sécheresse, l’obscurité et ainsi de suite. De même on peut lutter contre la maladie. On peut tenter de réduire à un minimum la nocivité des faits naturels dans une proportion toujours plus grande. Et c’est dans ce combat conscient contre la nature que gît la différence, probablement la seule, entre l’humain et l’animal.
Si la bataille contre les forces naturelles peut donner des résultats indécis, la situation change du tout au tout quand il s’agit des faits artificiels, comme la politique, la religion, les régimes économiques, la morale, les méthodes d’enseignement, etc. Ces faits sont circonstanciels. Ils ne se relativent qu’à des situations passagères. Ils ont varié dans le temps. Ils ne sont pas immuables. Ils reposent sur des abstractions ou des fictions. Ni l’état, ni le capitalisme, ni le christianisme, ni le bouddhisme, ni le patriotisme, ni le mariage, pour ne citer que des exemples, ne sont des impératifs biologiques. On mourra si on ne mange pas ; mais on ne mourra pas parce qu’on ne croit pas en Dieu ou parce qu’on ne produit pas en série, ou parce qu’on n’utilise pas la T. S. F. ou le transport par avion. On sera un ignorant si on ne sait ni lire ni écrire, etc., mais on ne sera pas un ignorant si, au lieu de suivre l’enseignement de professeurs stipendiés par les gouvernements, on est un autodidacte.
On peut, après réflexion, après avoir étudié, comparé, analysé, etc., ne pas vouloir se résigner, dans un domaine ou un autre, à l’état de choses, artiflciel, qui constitue la société organisée.
Les dirigeants, qui sentent le danger de la réflexion, parce que tout être qui réfléchit n’est plus aussi docile que celui qui ne se pose pas de questions, assurent que le bonheur — l’aspiration de tous les hommes, pris individuellement ou en masse — est fonction de la résignation. « Résignez-vous » ont clamé et clament à l’envi les meneurs de troupeaux humains, les accapareurs du sol, de cheptel et de capital-espèces, les chefs d’armée et les capitaines d’industries.
« Résignez-vous et vous serez heureux ; ne raisonnez pas, ne demandez pas, ne souhaitez pas au delà de ce qui vous est octroyé ou concédé par Dieu ou ses représentants ; par le prince, le gouvernement, la loi, la constitution, leurs vicaires ou leurs substituts. Contraignez-vous dans vos pensées et dans vos sentiments. Mortifiez vos sens. Eteignez vos désirs. Abstenez-vous. Voilà où se trouve le bonheur. Les prêtres, les chefs et les législateurs ont planté certains poteaux-limites au dedans desquels règne officiellement le bonheur. Ne les franchissez pas. Conformez-vous à ce que vous permettent la volonté ou le caprice des Maîtres, les intérêts de caste, de parti, d’organisation ; la décision des majorités, voire la dictature des minorités ; et vous serez heureux. C’est si simple. »
On voit qu’il n’y a rien dans tout cela qui soit naturel, d’ordre biologique, qui ne puisse être évitable. On peut avoir un point de vue diamétralement opposé et vivre cependant, vivre pleinement même. Il y a donc la catégorie des résignés qui acceptent cette conception artificielle du bonheur.
Mais il y a aussi la catégorie des irrésignés : protestataires, dissidents, insoumis, réfractaires. L’histoire nous montre comment les gouvernants, les majorités, ou les minorités dominantes s’en débarrassent. Les procédés d’annihilation ou d’entrave ne varient guère dans le temps, persécutions, mauvais traitements, calomnie, exil, cachot, supplices, mort à plus où moins brève échéance. L’histoire nous montre, également, malgré ces procédés d’élimination, que l’irrésignation finit par triompher sur la résignation. Il y a des éclipses, des reculs, des marches arrière. Après avoir fait taire par la force les voix contradictoires, les meneurs de civilisations politiques, économiques ou religieuses, décrètent que tous, peuples et individus, jouissent du bonheur parfait. Plus de subversifs ni de non-conforrnistes. Le silence règne — le silence de la servitude, de la stagnation, de l’uniformité, de la peur.
Eh bien non ! Ce n’est que parce qu’ils méditent ou projettent que les irrésignés se taisent. Ce n’est qu’un silence apparent, un feu qui couve sous la cendre. Ils supportent — et supporter n’est pas se résigner. Ils subissent — et subir n’est pas accepter. Ils se contraignent — et se contraindre n’est pas obéir. Ils se savent les héritiers de ceux qui ouvertement n’ont voulu, ni accepter, ni obéir, ni se contraindre, ni se résigner. Ils se tiennent en rapport les uns avec les autres, réalisent entre eux la plus grande somme de bonheur possible. Jusqu’au jour où ils se sentent en possession de la puissance nécessaire pour se faire entendre à nouveau.
C’est ainsi que certaines oppressions, certains préjugés, certains enseignements, certains systèmes politiques ou économiques — pas tous, hélas ! — ont disparu, ne peuvent plus se reproduire sous leur forme antérieure.
Parce qu’il ne veut de bonheur autre que celui qu’il se forge lui-même — en laissant autrui se forger le sien à sa façon — l’individualiste anarchiste — isolé ou associé — est un irrésigné par essence. L’individualisme vise, en dénonçant l’artificiel de la vie en société, à réduire toujours plus les cas de résignation inévitable.
— E. ARMAND
RÉSIGNATION
n. f. du bas latin resignatio, même sens
Renonciation à un droit, à une charge, à un office en faveur de quelqu’un. (Dict. Larousse). Fig. Acte de la volonté qui accepte une situation, qui renonce à lutter contre elle ou à s’en plaindre. La résignation est la vertu du malheur (Beauchêne). Résignation de soi-même, renoncement à soi-même. (Dict. Larousse).
Il est tout à fait compréhensible que les maîtres, les puissants, les profiteurs, les spoliateurs, les exploiteurs admirent cette vertu chrétienne qu’est larésignation puisqu’elle est, par cela même, le contraire de la révolte.
La patience et la résignation, sont les principales vertus du chrétien.
Se résigner, n’est-ce pas capituler devant les plus malins, les plus fourbes ? N’est-ce pas se condamner soi-même à tout subir plutôt que de faire acte humain, fier, viril devant l’odieux, devant le mal ? Si ce n’est qu’une vertu bourgeoise, c’est une vertu aimée des bourgeois, non pour eux-mêmes, mais pour ceux dont ils profitent, contre ceux qu’ils dupent, qu’ils trompent, qu’ils exploitent, qu’ils commandent, qu’ils asservissent. Tous ceux qui vivent sans produire ; tous ceux qui sont riches de la misère de leurs semblables ; tous ceux qui vivent dans l’opulence et dans l’orgie et crèvent un jour de pléthore pendant que d’autres vivent toujours mal et meurent de froid ou de faim ; tous ces gavés, tous ces repus aiment et prêchent la résignation des pauvres.
Des prêtres qui se prétendent disciples du Christ, dodus et replets, ne craignent pas de conseiller aux pauvres la prière et la résignation. Ils recommandent aux malheureux de ne pas envier les heureux et de ne rien faire contre eux, Ne sont-ils pas sur la terre pour faire le bien, ces bons riches, et s’il n’y avait pas de pauvres, ils ne pourraient plus se rendre agréables au seigneur en faisant l’aumône. Le pauvre est l’élu de Dieu et ce qu’il souffre sur la terre lui sera compté dans le Ciel où tout se paie et se compense par un bonheur éternel. Déjà, le pauvre est assuré d’avoir sa place au Paradis, s’il sait se résigner à son sort, ne pas maudire les auteurs de ses maux et supporter ses malheurs, car Jésus l’a dit :
« Il est plus difficile à un riche de passer par la porte du Ciel qu’à un chameau de passer par le trou d’une aiguille. »
En attendant, aucun, riche, aucun prêtre, n’a poussé l’amour de la pauvreté jusqu’à sacrifier son bien-être, sa situation en se privant de tout pour le donner aux pauvres. Si quelques-uns sont allés jusque-là dans leur amour du prochain, ils ont paru tellement extraordinaires qu’on les a canonisés si l’on n’a réussi à les faire passer pour déséquilibrés et hospitalisés comme tels. Il y a eu des Vincent de Paul, sans doute. Mais qui n’a connu des êtres semblables dans le civil qui, eux, n’attendaient pas une récompense au Ciel pour l’éternité ? On ne peut, certes, pas dénigrer une personne dévouée à l’extrême, douée d’un désintéressement sans limite jusqu’à risquer tout, même sa vie, pour aider un malheureux, consoler un affligé, soigner un malade contagieux, etc. ; mais cela n’a rien à voir avec la résignation puisque ces êtres d’élite font le bien pour leur satisfaction personnelle ou dans l’intérêt de leur âme pour mériter la récompense céleste. Ils se résignent à assurer leur bonheur éternel.
La Résignation, pour nous, c’est le manque d’énergie à réagir contre le sort, contre la malchance, contre la destinée, contre tout ce que vous voudrez. C’est la lâcheté qui fait la résignation de ceux qui souffrent injustement et les empêchent ainsi de chercher les causes véritables de leurs souffrances, les auteurs impunis de leurs malheurs.
C’est parce qu’il y a de la Résignation que l’Injustice sociale se perpétue et que les méchants ; les fourbes, les cyniques vivent sans crainte d’expier leurs forfaits, ayant pour eux toute une organisation effroyable pour les protéger dans leurs exploits au nom de la Légalité, du Droit, de l’Autorité, de la Propriété, de la Justice et de la Force !
Que la Résignation, cette vertu des eunuques, des abrutis et des lâches cesse un jour de tenir dans le cœur et le cerveau des miséreux la place de la Révolte et l’on verra soudain resplendir la vraie Justice.
— G. Yvetot
RÉSIGNÉ
adj. pris comme n. m.
Les résignés sont ceux qui, malheureux, accablés, manquent de caractère, de fierté, de virilité pour se révolter contre ce qui les opprime. Les résignés sont ceux qui renoncent à la lutte ; qui abandonnent leurs droits ; qui n’ont ni le courage, ni l’énergie pour les revendiquer. Il faut bien convenir, cependant, qu’ils sont souvent les victimes, les pauvres victimes de tous les préjugés sociaux entretenus par l’atavisme, l’éducation de la famille, la religion, le dressage ignoble de l’école et de la caserne. Quand un homme est persuadé qu’il doit être soldat et tuer son semblable par ordre, pour une entité stupide, comment voulez-vous qu’un tel abruti soit autre chose qu’un résigné.
— G. Yvetot
RÉSISTANCE
n. f.
Qualité d’un corps qui réagit contre l’action d’un autre corps. (Dict. Larousse). Ce n’est pas à ce point de vue qu’il sied de parler ici du motRésistance mais plutôt dans le sens de faire résistance personnelle ou collective à tout ce qui opprime, déprime, pressure, exploite l’individu. C’est ainsi que, dans le monde des exploités, l’action collective de résistance des ouvriers de l’usine et des chantiers, de la campagne et des ports se traduit par l’action collective qui s’appelle la grève. La résistance sous toutes ses formes n’est intéressante, à notre point de vue, que si elle est la manifestation consciente d’une force humaine ou sociale qui s’affirme contre une autre force humaine ou sociale. Nous envisageons donc ainsi tous les mouvements populaires, toutes les velléités de révolte du peuple contre les tyrannies, d’où qu’elles viennent, toutes les tyrannies et aussi toutes les entités au nom desquelles on exerce : Dieu, Vérités, Patrie, Honneur, Suffrage Universel, Travail, Propriété, Eglise, Etat, Loi, Dictature, Justice, Intérêt général, Paix, Droit, Civilisation, Humanité, Progrès, etc., etc., car tous ces grands mots dans la bouche des prêtres et des politiciens, ne sont que fourberies, mensonges, duperies, bourrage de crâne. Il faut résister à leur emprise. La résistance est, avec la réflexion, le commencement de la sagesse et de l’esprit critique, de l’esprit de révolte. Une mentalité sérieuse de résistance à tout ce qui parait beau, bien, bon et cache trop souvent le contraire, dénote chez l’individu le caractère, l’esprit libre et sain et parfois l’homme d’action. Unie à d’autres individus, cette force individuelle se multiplie et se développe dans les masses qui elles, ne réfléchissent pas assez, n’étant pas alors défendues, soutenues, par une force de résistance suffisante. Au milieu d’elles, les individus désintéressés, honnêtes, dont nous parlons plus haut, sont susceptibles de prendre un ascendant tel parmi les foules, qu’ils parviennent à force de sincérité et de foi contagieuses à faire éclater pour tous des étincelles de vérités qui engendrent non plus seulement la résistance, mais la Révolte, selon les motifs, les lieux, les circonstances.
D’où la nécessité de susciter, en tout et partout, la résistance des victimes aux fléaux que créent la mauvaise organisation sociale : Vie chère, Exploitation outrée, Autorité révoltante, Inégalités sociales scandaleuses, Escroqueries et Vols légalisés, protégés par la Loi, la Magistrature, la Police. La résistance, enfin, à tout le mal social est indispensable, d’abord, et doit être permanente parmi les masses populaires lésées, meurtries, sacrifiées par tous les profiteurs du régime bourgeois.
Pour le salut de tous, la résistance doit être une façon de comprendre notre rôle, dans une société basée tout entière sur l’iniquité sociale. C’est rendre service à nos semblables que de les entraîner à la résistance. Ils savent alors, par expérience, qu’on ne peut que gagner à toujours se regimber contre les fléaux sociaux, contre leurs causes et contre leurs effets. Les travailleurs ont droit à tout pour l’unique raison qu’ils n’ont rien. Contre cet état de choses, la résistance est un devoir pour tous les producteurs nécessiteux.
C’est d’ailleurs dans cet esprit que, vers le milieu du xix siècle, les travailleurs qui n’avaient pas encore conquis le droit syndical, savaient adroitement tourna la loi et, de leurs sociétés mutuelles de secours, faisaient clandestinement des sociétés de résistance où se discutaient leurs intérêts corporatifs. La police les pourchassait et la prison les menaçait sans cesse. Société de résistance était bien le mot qui convenait à ce groupement ouvrier. Les militants se rendaient compte qu’il n’y avait que par la résistance qu’on pouvait démontrer aux exploiteurs de l’époque, qui prenaient les ouvriers pour des matériaux agissants, que ceux-ci étaient des êtres pensants.
Les sociétés de résistance sont les aïeules de nos syndicats corporatifs, lesquels ont pour devise :
« L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes. »
Et pour but constant :
« Bien-être et liberté par la suppression du Patronat et du Salariat. »
Le temps a marché, les idées ont évolué. Mais, si la résistance est toujours en honneur, le but n’est pas atteint. Il y a des crises atroces dans nos sociétés de résistance.
Les militants syndicalistes n’ont pas à se cacher dans la montagne ou la forêt, comme des bandits en complot, ou s’isoler en mer comme des naufragés pour discuter de leurs intérêts corporatifs, comme au siècle précédent, mais ils ont à déjouer les obstacles posés par les événements sur la route droite qui mène au but : c’est la corruption gouvernementale, c’est la politique et son action néfaste, c’est la vanité des uns, l’ambition des autres, qui ont laissé dévier le syndicalisme, malgré la résistance de quelques-uns. Que faire à cela, si de se maintenir dans la pure logique et l’incorruptible sincérité qui ont fait la puissance de la CGT qui précédèrent le cataclysme de 1914.
Ne pas désespérer. Croire à l’avenir et ne pas combattre la division en l’augmentant. Savoir, en toutes circonstances, résister aux tentatives de scission dans nos syndicats. La place des militants non politiciens et de conviction révolutionnaire, s’ils ont la conscience droite et s’ils ne sont pas des girouettes, n’est pas toujours où l’on pense comme eux mais, au contraire, où il y a des cerveaux à éclairer, des initiatives à encourager, des vertus à persévérance, de courage à faire éclore en actions d’unité pour l’émancipation totale des exploités. En un mot, il faut que nous soyons, au syndicat, à la coopérative, partout, en dehors de toute politique, des résistants à tout ce qui corrompt, dévie, désunit. Avec de la patience, de la volonté, du caractère, les militants, jeunes ou vieux, verront renaître le vrai syndicalisme, superbe d’enthousiasme pour l’action directe, perpétuelle et féconde résistance !
— G. Yvetot
RESPONSABILITÉ
n. f.
La responsabilité en soi n’existe pas. De même que la morale, elle est née de la vie en commun, elle est une création sociale. Imaginons des êtres pouvant vivre isolés, pouvant se satisfaire chacun du produit de leur chasse et de leur travail, ne dépendant aucunement les uns des autres, alors il n’y aurait ni morale, ni responsabilité, ni bien, ni mal. Cependant chez ceux des mammifères qui appartiennent à une espèce sociétaire, il y a un rudiment de vie morale au moment de la vie sexuelle et de l’élevage des petits.
Or, les hommes sont des animaux sociétaires. Mise à part la question philosophique de savoir si la responsabilité existe ou non, on est obligé d’admettre que pratiquement elle existe, en tant que défense des individus et de la société à l’encontre des torts qui leur sont faits par les actes, conscients ou non, commis par les autres membres de la société. La responsabilité est donc en somme, au moins primitivement, une notion extérieure à l’individu. Ce n’est que peu à peu par les sanctions et par l’éducation que cette notion pénètre dans le cerveau des hommes, au point qu’ils se tiennent sur le qui-vive pour échapper il la vengeance sociale et, qui pis est, à l’humiliation.
La responsabilité était terrible dans les tribus primitives où la moindre défaillance, même involontaire, pouvait causer ou était censée causer les plus grands malheurs à la collectivité, puisque tout malheur était considéré comme la vengeance d’un esprit ou d’un dieu, dont la colère, la méchanceté ou la jalousie devait être apaisée par le châtiment du coupable ou par le sacrifice d’êtres innocents. L’histoire légendaire et ancienne est pleine d’exemples de ces sacrifices, enfants, jeunes filles, etc., sacrifices destinés à attirer la bienveillance des dieux ou à écarter leur courroux. On retrouve de nos jours les mêmes moeurs dans certaines tribus sauvages qui ont conservé les conceptions primitives de la responsabilité.
La notion de culpabilité chez les primitifs n’est pas comparable à celle des modernes. Dans la légende d’Oedipe, la ville de Thèbes étant ravagée par la peste, on finit par s’apercevoir que le roi a, sans le savoir, tué autrefois son père et épousé sa mère, d’où le courroux des dieux qui s’exerce sur les malheureux Thébains. Jocaste se pend, Oedipe se crève les yeux et quitte la ville, l’épidémie disparaît.
Ce n’est qu’après le triomphe du principe de causalité dans la civilisation grecque que la responsabilité prend l’aspect qu’elle reprendra plus tard après la Renaissance et qui persiste jusqu’aux temps modernes. La faute dont un individu est responsable est la conséquence d’une erreur ou d’une défaillance de sa raison. Pour éviter la faute, il faut donc instruire les individus, leur apprendre à se juger eux-mêmes et à maîtriser leurs impulsions.
Pour les chrétiens du moyen-âge, l’homme étant pourvu d’une âme par Dieu, les défaillances sont dues aux tentations de la chair, c’est-à -dire au Démon. Afin de chasser « le mauvais esprit », il faut punir sévèrement le coupable dans son propre intérêt et pour le salut de son âme. Les enfants sont responsables comme les adultes et passibles des mêmes châtiments. Les animaux, coupables de méfaits graves comme mort d’homme ou trouble d’une cérémonie religieuse, sont exorcisés ou condamnés, car on suppose qu’ils sont habités par l’Esprit Malin.
Or, l’activité psychologique reste, au début de la vie, localisée au mésencéphale (tronc cérébral), sans communication avec les centres supérieurs de l’écorce cérébrale, puisque les conducteurs nerveux ne sont pas encore revêtus de leur gaîne de myéline. Les coordinations s’établissent peu à peu. Mais le sentiment de responsabilité sociale n’apparaît pas avant la puberté, c’est-à-dire avant l’apparition de la fonction sexuelle. C’est à ce moment que commence l’utilisation de véritables concepts. Et même à cette période l’adolescent n’a encore aucune expérience de la vie et des valeurs sociales.
Et pourtant, en dépit d’une observation de simple bon sens, la responsabilité des enfants a persisté jusqu’à nos jours. Il n’y a pas très longtemps, à peine quarante ans peut-être, qu’on a institué à Paris des tribunaux pour enfants. Jusque-là on ne faisait aucune distinction théorique entre eux et les adultes. L’âge légal de la responsabilité pénale était de 7 ans jusqu’en 1912 où on l’a porté à 13 ans.
C’est qu’on a toujours considéré le châtiment comme un moyen, et le meilleur, d’éducation. Les punitions ont pour objet de ramener celui qui se laisse aller aux tentations, à écouter la voix de la Sagesse. Il en est de même pour les adultes. Ils n’ont qu’à suivre les indications de la Raison. La Raison ne peut pas se tromper. N’a-t-elle pas toujours été considérée comme une parcelle du Divin ? Seuls les fous en sont dépourvus.
On a commencé à s’apercevoir dans les temps modernes qu’il y avait un grand nombre de demi-fous, terme impropre sans doute, mais sous lequel on comprenait la masse des arriérés, des instables, des déséquilibrés, etc. Cette constatation n’a pas été admise facilement, elle ne l’est encore que très incomplètement. Les profanes, y compris juges, policiers et gardes-chiourme, sont tout juste capables, et encore, de reconnaître les grands délirants. Mais les autres, ceux qui présentent des formes plus légères d’aliénation mentale, et, à plus forte raison, les simples déséquilibrés, les instables, les paranoïaques, ceux qui souffrent d’une forme cyclique et ceux qui n’ont qu’une intelligence débile, sont impénétrables pour les chats-fourrés qui méconnaissent totalement leur « irresponsabilité ». Pourquoi les gens de justice se hasarderaient-ils d’ailleurs hors du code et de leurs habitudes, et risqueraient-ils de perdre leur tranquillité ? Au surplus ils ne sont pas du tout préparés à juger les hommes de ce nouveau point de vue.
Lorsque le déterminisme scientifique commença à devenir à la mode, il y a une cinquantaine d’années, non seulement la responsabilité des déficients mentaux fut mise en question, mais celle de tous les hommes. Puisque tous nos actes sont déterminés par l’hérédité, par l’éducation, par le milieu, par les conditions économiques, par les circonstances, etc., il n’y a plus de liberté, partant plus de responsabilité. Dans les nouvelles théories l’hérédité surtout prenait un caractère fataliste. Comment les individus auraient-ils pu se déprendre du destin qui pèse sur eux ?
La question du libre arbitre revenait sur l’eau, comme au temps où les théologiens se demandaient si l’homme était dès sa naissance condamné à l’Enfer ou promis au Paradis, puisque Dieu dans sa Sagesse suprême possède entièrement la connaissance de l’avenir.
Le problème ainsi posé est d’ordre métaphysique. Il n’y a pas de liberté absolue, il n’y a pas non plus de fatalisme. Même dans l’ensemble des phénomènes naturels il n’y a pas de déterminisme uniforme, sinon il n’y aurait aucune différenciation. En tout cas le déterminisme des animaux est de moins en moins étroit, au fur et à mesure que dans l’échelle des espèces l’intelligence se développe et devient à son tour capable de réagir de différente façon. Chez l’homme en particulier, où la possibilité des coordinations cérébrales est immense, le domaine des réflexes conditionnés est extrêmement vaste, les réponses aux excitants sont multiples et variables, si bien que le fatalisme héréditaire disparaît.
L’hérédité reproduit, d’une façon imprévisible, les caractères morphologiques (traits et stature) d’un mélange d’ancêtres, elle reproduit d’une façon moins stricte leurs tendances fonctionnelles et leurs tendances affectives (sentiments) ; mais les coordinations cérébrales ne sont d’ordinaire transmises que d’une façon assez floue (aptitudes) et sont capables, sauf exceptions, de varier sous l’influence de l’éducation et du milieu, sous l’influence aussi de la propre curiosité de l’individu (goûts sensuels, esthétiques, intellectuels, moraux). Dans le domaine des goûts ceux qui sont acquis l’emportent de beaucoup sur ceux qui peuvent être hérités.
Chaque être humain a, dès la prime enfance, le désir de savoir. Savoir c’est conquérir une plus grande puissance sur les choses et sur soi-même, c’est acquérir un plus grand champ d’action, c’est arriver à mieux comprendre les conséquences de ses actes. Or nous ne sommes responsables que dans la mesure où nous nous rendons compte des conséquences de nos actes, non seulement des conséquences matérielles, mais aussi, ce dont il est plus difficile de se rendre compte, des répercussions morales et affectives. Donc savoir, en augmentant nos capacités, élargit notre responsabilité.
D’autre part l’exercice intellectuel renforce l’intelligence. Un cerveau plus développé donne à l’individu plus de pouvoir pour maîtriser les impulsions, c’est-à-dire lui donne le temps de comparer et de choisir. Celui qui se laisse aller à ses impulsions, sans prendre la peine de réfléchir, n’est qu’un esclave ; il obéit à un déterminisme grossier et automatique. A l’encontre de ces anarchistes par trop simplistes qui, il y a quelque trente ans, s’imaginaient que « vivre sa vie » — formule sommaire, variable selon la conception de la vie et faisant dépendre celle-ci, en définitive, ou des instincts ou de la fantaisie — était une formule de libération, les hommes vraiment affranchis ont plus d’ambition, ils prétendent réagir contre leur propre automatisme, ils se sentent capables de réagir aussi contre l’éducation reçue et contre le milieu, ils savent pourtant qu’ils ne sont pas libres au sens métaphysique du mot et qu’ils ne peuvent s’évader hors de la mêlée, mais ils s’efforcent d’accéder à un déterminisme plus conscient et plus affiné, et par conséquent plus varié, plus étendu.
L’intelligence augmente la liberté, une liberté toute relative. Mais cette liberté se heurte à celle d’autrui et à l’organisation sociale. Que fera l’homme intelligent ? Sera-t-il le contempteur des lois et de l’opinion, ou bien vivra-t-il dans un conformisme commode et de tout repos ? Sera-t-il bienveillant et généreux à l’égard de ses semblables, ou bien sera-t-il âpre en affaires et ira-t-il jusqu’à pratiquer l’escroquerie ? L’intelligence ouvre toutes ces voies.
Si l’on met à part l’influence de l’éducation et du milieu, l’orientation dépend plutôt de l’affectivité. L’égoïste, c’est-à-dire celui dont l’affectivité est peu développée, met son intelligence au service de ses appétits et ne s’inquiète guère d’autrui. Il s’inquiète seulement des conséquences dommageahles pour lui-même, il se gare des réactions des autres, s’ils sont plus puissants que lui, et des sanctions légales. Il pratique au besoin un conformisme religieux et nationaliste qui le range parmi les gens bien-pensants et le met à l’abri des suspicions policières.
C’est à l’égard du plus grand nombre de ces gens-là que les sanctions légales sont utiles dans le système social actuel, où le mercantilisme a hesoin d’être endigué. Elles les obligent à rester dans certaines limites, dans les limites du code. Elles ne sauraient sans doute les empêcher d’exploiter les faibles, mais elles s’opposent à la pratique habituelle et constante de l’escroquerie avérée. Pourtant dans la catégorie des escrocs elles ne peuvent pas atteindre les plus habiles et les plus chançards, comme les spéculateurs à la façon d’Ivar Kreuger. Les plus intelligents des égoïstes se gardent bien d’ailleurs de se risquer dans des aventures mesquines. Les grands ambitieux par exemple, si égoïstes, si avides, si orgueilleux qu’ils soient, savent pratiquer une affabilité de politesse, simuler le désintéressement pour les jouissances matérielles, mépriser hochets et décorations, mais n’hésitent pas à sacrifier l’amitié et l’affection à leur arrivisme et à leur désir de domination ; leur politique ne s’embarrasse d’aucun scrupule.
Quant à ceux des égoïstes, qui ne sont pourvus que d’une intelligence débile ou médiocre, ils sont les esclaves de leurs appétits immédiats. Mais ils se heurtent à chaque instant à autrui qu’ils finissent par considérer comme leur ennemi, un ennemi à qui ils ont de la joie à causer dommage et souffrance. Cependant on peut en dresser un certain nombre, grâce à une éducation stricte, qui comporte des punitions et qui les habitue à la responsabilité de leurs actes. Il n’y a qu’à observer ce que deviennent les enfants gâtés, à qui on passe tous les caprices. Ceux qui sont doués de quelque affectivité s’adaptent, après quelques heurts, à la vie sociale. Les égoïstes deviennent des adultes autoritaires, insupportables et sans scrupules.
L’avidité peut avoir pour but, soit les jouissances immédiates, soit le désir d’ostentation (vanité), soit celui de domination. C’est l’égoïsme, c’est-à-dire le manque d’affectivité et le mépris d’autrui, qui fait glisser l’avidité vers la délinquance. Il faut y ajouter souvent la paresse, le dégoût de l’effort, le désir de la vie facile, ce qui est une des causes de la glissade à la prostitution ou bien de nombre de délits commis par des fils de famille. Ne parlons pas maintenant des pauvres diables, qui sans doute peuvent être, eux aussi, égoïstes, avides, paresseux, mais pour qui la misère et l’inégalité sociale sont les causes principales de délinquance comme c’est aussi le cas pour la prostitution. En dehors des causes économiques, c’est en fait l’égoïsme qui favorise les impulsions anti-sociales, surtout lorsqu’il n’est pas accompagné d’une intelligence développée.
Les cas sont d’ailleurs plus complexes. Si l’intelligence varie avec chaque individu, l’égoïsme peut varier aussi. Il n’y a pas d’égoïsme en soi. Les gens sont tous plus ou moins pourvus d’affectivité, mais à des stades de développement divers. D’autre part l’affectivité peut être limitée à une femme, à la famille, à un ami. Enfin l’avidité n’est d’ordinaire orientée que vers tel ou tel appétit ou telle ambition ; l’égoïsme se trouve renforcé au point de devenir féroce en ce domaine, tandis que l’individu est à peu près indifférent sur tout le reste.
En tout cas les chances de délinquance augmentent avec la diminution de l’affectivité générale. Les individus sans aucune affectivité et à intelligence plus ou moins débile (ce qui n’exclut pas la ruse) sont des êtres tout-à-fait anti-sociaux et inéducables. Ce sont les véritables pervers. On ne peut s’en garer qu’en les enfermant dans les asiles pour insanité mentale.
L’affectivité diminue ou disparaît, et l’intelligence subit des éclipses dans un certain nombre de cas, surtout dans l’alcoolisme qui supprime le contrôle, tout au moins les hésitations, et laisse les impulsions brutales se donner libre cours. L’individu en état d’ivresse n’est vraiment plus responsable, et il n’est pas toujours capable de résister à sa passion, mais la collectivité a le droit de le traiter comme un être dangereux, comme un fou à accès intermittents.
D’autres causes que le manque d’affectivité peuvent intervenir dans la délinquence : par exemple, la tendance à l’imagination qu’on rencontre normalement chez les enfants et chez les primitifs, et qui les conduit à des affabulations que les adultes et les civilisés considèrent comme des mensonges. Les mythomanes, restés à ce stade de développement psychique, ont presque toujours une vanité démesurée ; ils se font passer ponr les fils ou les parents de personnages importants ou pour ces personnages eux-mêmes, et sans doute finissent-ils par le croire, promettent aux gens leur protection et d’ailleurs monts et merveilles, s’aperçoivent qu’il leur est facile de soutirer ainsi l’argent nécessaire à tenir leur rôle et glissent peu à peu à la pratique de l’escroquerie. Il y a d’autres variétés de mythomanes, beaucoup de joueurs le sont peu ou prou, et la passion du jeu explique nombre de vols et d’indélicatesses.
Parmi les autres impulsions le désir sexuel est souvent assez fort pour obnubiler l’intelligence et déformer l’affectivité. Sa puissance est peut-être davantage prédominante chez les civilisés bien nourris que chez les sauvages, les primitifs ou les misérables pour qui le problème alimentaire a certainement plus d’intérêt. L’érotisme a quelquefois une puissance telle qu’on ne peut le refouler, et l’école freudienne en a fait, avec exagération, le facteur principal du comportement des hommes et de ses déviations.
L’impulsion sexuelle paraît être la cause directe des crimes passionnels, qui ont pour caractéristique d’être commis par des individus émotifs, mais non délirants, et agissant sans préméditation. Même avec les idées actuelles sur le rôle de la justice, on comprend que le jury absolve ces meurtriers qui restent consternés de n’avoir pu réfréner sur le coup leur colère subite et d’avoir cédé, peut-on dire, à un accès de folie passagère. Ces gens-là ne récidivent pas. A quoi donc servirait un châtiment ? Même pas à faire réfléchir un passionnel se trouvant dans le même cas.
Mais y a-t-il beaucoup de passionnels purs ? A la vérité ils sont très rares. En examinant bien, on s’aperçoit que de la plupart des homicides classés dans cette catégorie le véritable mobile est non pas l’amour, mais l’amour-propre. Sentiment d’infériorité intolérable, orgueil froissé et peur du ridicule vis-à-vis de l’opinion d’autrui, et quelquefois question d’intérêt, voilà ce qu’on trouve, et aussi la préméditation, ce qui prouve qu’il y a eu temps pour la réflexion, même pour le calcul et qu’il y a responsabilité — responsabilité atténuée d’après les préjugés actuels sur le droit de propriété sexuelle.
L’amour-propre a une très grande influence sur le comportement des hommes, et qui l’emporte même sur celle de l’intérêt, quoi qu’en pensent les marxistes. Il intervient donc fréquemment dans la genèse de toute espèce de délit. Le désir de vengeance, hypertrophié chez les populations arriérées, est la conséquence d’une vanité qui masque une véritable infériorité mentale, soit individuelle, soit collective. Dans certaines peuplades ou clans l’individu est responsable de son honneur et de celui de sa famille, et si cet honneur est offensé il doit en tirer vengeance. Les hommes sont obligés ou se croient obligés de se conformer à l’opinion publique.
Nous avons dit plus haut que dans les tribus primitives le contrôle exercé sur les défaillances de l’individu était terrible et sans pitié. C’est ce contrôle incessant qui a créé peu à peu dans le cerveau humain l’amour-propre, sorte de sensibilisation à l’égard de l’opinion d’autrui. Ce sentirnent met en garde l’individu contre les défaillances et lui permet d’éviter les sanctions et les occasions d’humiliation. Il est le fondement de la morale et du sentiment de responsabilité.
Il maintient les gens dans « le droit chemin » sans doute avec plus d’efficacité que la loi. Mais si l’individu n’a d’autre frein moral que le simple amour-propre vis-à-vis d’autrui, il ne restera dans « le droit chemin », il ne respectera les règles de la morale de confiance que s’il est sous la surveillance de l’opinion publique, s’il vit dans un milieu où il est connu. Tandis que s’il mène dans une grande ville une existence ignorée ou s’il voyage à l’étranger, il y a des chances pour qu’il en prenne plus à son aise avec la morale de confiance (ne serait-ce par exemple qu’au point de vue sexuel). Le conformisme social n’est souvent que pure hypocrisie. Il suffit de garder les apparences et de ne pas être pris sur le fait. Il suffit aussi d’être assez riche ou assez puissant pour n’avoir pas à craindre l’opinion publique et même pour l’avoir pour soi, surtout si l’on respecte les préjugés dominants (religion, patrie, etc.).
Toutefois, au cours des âges, l’amour-propre s’est affiné et s’est transformé peu à peu en un sentiment plus profond. Au lieu de n’exister que vis-à-vis d’autrui, l’amour-propre est ressenti vis-à-vis de soi-même. C’est l’apparition de la conscience morale. Sans doute pas chez tous les hommes, tout au moins pas au même degré. Mais ceux qui ont vraiment le sentiment intime de leur responsabilité, prennent soin de contrôler leurs actes, car la mauvaise opinion qu’ils pourraient avoir d’eux-mêmes leur serait insupportable, fût-ce pour un acte ignoré de tous. Leur propre satisfaction leur donne plus de plaisir que l’approbation publique.
La conscience morale n’est autre chose qu’un goût, l’orientation affinée d’un plaisir sentimental, de même que les goûts sensuels ou intellectuels sont une orientation affinée de nos besoins ou de nos curiosités. Ne pas confondre les humains qui sont consciencieux par devoir (stoïciens ou puritains) et ceux qui le sont par goût (épicuriens ou anarchistes). Les premiers ont été dressés à faire leur examen de conscience pour obéir à une règle morale (extérieure à eux). Pour les seconds la conscience morale fait partie de leur affectivité profonde, et elle est non pas un devoir, mais un plaisir.
L’homme pourvu de conscience saura réfréner ses impulsions pour ne pas créer de souffrance. Il n’a pas besoin de gendarme pour rester dans « le droit chemin ». Mais son droit chemin n’est peut-être pas toujours celui du conformisme légal. Un individu affranchi, s’il est capable de se critiquer lui-même, prendra le droit de faire la critique de l’opinion publique et du conformisme. Ne supportant pas de pratiquer lui-même l’injustice, il n’acceptera pas que la société la pratique. Il ne sera donc pas forcément un bon citoyen.
D’abord il y aura souvent heurt entre sa conscience et le conformisme de l’opinion. L’opinion publique est traditionnaliste, elle a le respect des rites, de l’ordre établi, des hiérarchies. Elle est la gardienne des préjugés. Elle sait ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Elle se confond avec le conformisme des gens bien-pensants. Elle fait obstacle au progrès qui, lui, est individuel. Elle n’accepte les idées nouvelles qu’avec lenteur et après avoir persécuté les novateurs. Souvenons-nous du conformisme religieux et du conformisme sexuel et, comme simple exemple, de l’excommunication qui frappait férocement, il n’y a pas bien longtemps, les fillesmères, lesquelles d’ailleurs sont encore aujourd’hui en situation d’infériorité sociale.
Prenons ensuite la position de l’homme affranchi, ne dépendant que de sa conscience, vis-à-vis de l’organisation sociale. Il s’aperçoit que cette organisation donne force légale au conformisme de l’opinion. En France autrefois, et dans beaucoup de pays actuellement, elle condamne le sacrilège. Dans certains Etats des Etats-Unis des professeurs ont été poursuivis pour avoir enseigné le darwinisme. Dans l’Afrique du Sud un autre fut condamné par l’Eglise hollandaise pour avoir supposé que le récit d’Adam et d’Eve dans la Genèse était une allégorie inspirée ; il eut tout juste la chance d’être acquitté par la Cour Suprême du Cap en janvier 1931. Nous avons, en France, le sacrilège patriotique. Nous avons aussi le sacrilège sexuel : la propagande anti-conceptionnelle est sévèrement poursuivie, tout ce qui touche à cette question est tabou.
D’autre part, du fait de ses règlements accumulés, l’Etat a multiplié les contraventions, les condamnations à la prison, les souffrances matérielles et morales infligées au délinquant et par conséquent à sa famille. Exemples : la prohibition aux Etats-Unis, le régime douanier en tout pays et la répression de la contrebande, les règlements de police vexatoires à l’égard des prostituées, des forains, des étrangers, etc. Toutes les lois, et on en crée tous les jours, entraînent des punitions.
Enfin, l’organisation sociale est fondée sur l’inégalité et l’injustice. Il n’y a jamais eu d’égalité entre patriciens et plébéiens, noble et vilains, roi et sujets, maîtres et esclaves, riches et pauvres, patrons et ouvriers. Impôts, toujours retombant en dernière analyse sur le travail des pauvres diables, corvées, exactions, exploitation des travailleurs, misère. La plus grande somme des délits est due à l’inégalité sociale.
La société mercantile actuelle donne le spectacle d’une lutte âpre et souvent sans scrupules : d’un côté lutte pour l’existence tout court, de l’autre lutte pour l’argent et les jouissances. Dans le premier cas, insécurité matérielle se traduisant par les crises de chômage ; ignorance, alcoolisme et ses impulsions aveugles et brutales dans les milieux les plus misérables ; convoitises dues au manque des choses nécessaires à l’existence ; déséquilibre familial et incertitude sexuelle provenant de l’incertitude du lendemain, etc. Dans le second cas démoralisation, dès l’enfance, causée par la mentalité mercantile, tentations suscitées par un luxe insolent et le spectacle d’une vie facile (ciné), rôle corrupteur de l’argent, pratique courante de la réclame, du bluff, de la tromperie et de la ruse, etc. Où est la responsabilité des individus dans un milieu où il faut « se débrouiller » aux dépens d’autrui ? En particulier, où est celle des pauvres diables réduits à une situation précaire ?
Pour maintenir, coûte que coûte, les gens dans les limites du code, que fait la Justice officielle ? Elle se sert toujours des moyens de répression traditionnelle. Elle punit, elle exerce, comme les primitifs autrefois, le droit de vengeance, elle distribue de la souffrance. Nous avons dit plus haut que dans la société mercantile actuelle, où les appétits des égoïstes sont déchaînés contre autrui, l’intimidation est nécessaire pour les réfréner en partie. Et c’est la faute de la société que d’être obligée de protéger l’ordre, le sien, par de tels procédés. En outre, une personne bien équilibrée préfèrera se conformer à des règlements tracassiers et imbéciles (octroi, etc.), que de s’exposer à une punition, fût-ce à de simples désagréments. La société défend son ordre, c’est entendu, mais distribuer des souffrances infamantes augmente la délinquance sans résultats tangibles. La peur de la guillotine ne suffit pas à retenir le bras des assassins. A ce point de vue, la justice du moyen-âge avec la torture aurait dû être beaucoup plus efficace que la Justice actuelle. Or, l’assassin, qui est le plus souvent un arriéré mental, ne suppose jamais qu’il sera pris. Le voleur non plus.
On ne peut pas prétendre que la prison soit un moyen de rénovation morale, quoique des oeuvres aient été créées afin de relever la conscience des détenus et leur rendre le sentiment de la responsabilité. Prêches et sermons, même avec le plus sincère apitoiement, ne peuvent avoir d’autre résultat que de développer l’hypocrisie. Le condamné, en simulant le repentir, a quelque espoir d’obtenir une réduction de peine et, au pisaller, de menues faveurs. A la vérité la prison est un pourrissoir. Celui qui est emprisonné une première fois, après avoir commis un délit occasionnellement, peut sur le coup éprouver un sentiment de déchéance et croire sincèrement qu’il a mal fait. Mis en compagnie de chevaux de retour, il se trouve dans un milieu où le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance n’impliquent aucune honte, aucune humiliation. Il apprend que ce qu’il a fait n’est pas considéré comme une défaillance répréhensible, que cela fait partie des moyens naturels de se débrouiller, qu’il comporte même sa part de gloire ! Son tort est de s’être laissé prendre. Or, c’est l’opinion publique d’un milieu donné qui est le fondement de la morale de ce milieu. Le nouveau venu retrouve un sentiment d’équilibre. Au lieu du sentiment de responsabilité à l’égard d’une vague humanité, il s’initie à une solidarité et à une responsabilité, limitées, comme chez les primitifs, au cercle des copains, aux camarades d’un clan ou d’une bande. Il accepte avec d’autant plus de facilité l’opinion et la morale du nouveau milieu qu’il se sent rejeté du cercle des « honnêtes gens » par la tare infamante qui le marque pour toute la vie. C’est à ce point de vue que la prison est un pourrissoir, parce qu’elle entraîne les nouveaux venus vers la morale des délinquants d’habitude.
A plus forte raison ces remarques s’appliquent aux maisons de correction et de réforme morale qui mêlent quelques adolescents naïfs et influençables à d’autres malheureux, pervers ou pervertis, immoraux par débilité mentale et par éducation.
Pour que la responsabilité devînt générale entre les hommes, il faudrait que la solidarité fût, elle aussi, générale. Pour que la confiance régnât dans les rapports sociaux, il faudrait qu’il n’y eût plus d’inégalité sociale, cette inégalité dûe autrefois à la naissance, aujourd’hui à l’accaparement des richesses, et qui a pour fonction l’exploitation de la plus grande partie de la population au profit d’un certain nombre de privilégiés détenant les moyens de puissance. La société est divisée en classes antagonistes : d’un côté ceux qui travaillent pour vivre mal, dont les uns sont soumis, les autres se sentent lésés et protestent, d’autres enfin, envieux, cherchent par tous les moyens, licites ou non, à s’introduire dans les milieux de luxe ; de l’autre côté « les gens bien », ceux qui vivent aux dépens du travail d’autrui, les uns directement par une exploitation féroce ou exacte, les autres sans s’en rendre compte, les uns et les autres indifférents, méprisants ou montrant un apitoiement humiliant à l’égard des gens du commun, sans culture, sans manières, sans éducation. Où est la responsabilité de chaque individu ? Elle se confond avec celle de l’organisation sociale.
Entre ces classes en antagonisme permanent éclatent des conflits périodiques, le plus souvent aujourd’hui sous forme de grèves. Sans celles-ci il n’y aurait jamais eu de relèvement de salaire ni des conditions du travail. Elles ont dû être reconnues par la loi sous la poussée populaire, ce qui n’empêche que les grévistes sont encore traités et poursuivis comme des malfaiteurs. Les conflits sociaux ont ressuscité les délits d’opinion. On n’a pas le droit de toucher à l’ordre établi. Une simple déclaration anti-militariste suffit à entraîner une condamnation féroce.
Non, l’homme affranchi, celui qui ne dépend que de sa conscience, ne peut pas vivre en accord ni en paix avec la société actuelle. Il ne peut pas se contenter de ne pas créer de souffrance autour de lui. Il doit entrer dans la mêlée pour aider à créer un régime de justice et d’entr’aide. Celui qui n’agit pas, tout au moins par son influence morale, par ses propos et ses critiques, celui qui reste, dédaigneux et égoïste, dans sa tour d’ivoire, se rend complice et responsable des iniquités sociales.
Peut-on supposer qu’avec l’effort commun l’humanité arrivera à une organisation sociale où règnera une morale sans obligation ni sanction, fondée sur la confiance réciproque, où chacun prendra sa responsabilité en lui-même ? Il est certain qu’il y aura toujours des impulsions non réfrénées, surtout dans le domaine sexuel, des amours-propres exacerbés, c’est-à-dire des vanités, etc. Il est probable que dans une société où les conflits d’intérêt auraient en grande partie disparu, et sans doute y en aura-t-il encore, les conflits d’amour-propre seront les plus nombreux.
Le sentiment de responsabilité aura encore assez souvent des défaillances. En supposant que le monde futur soit composé, en général, d’individus ayant une intelligence et une conscience plus développées qu’aujourd’hui, il n’y en aura pas moins des divergences entre les hommes avec des intelligences et des consciences à des degrés divers de développement, avec des caractères différents, avec des réactions différentes. Tous n’arriveront jamais au même affinement dans le sentiment de responsabilité. Et l’amour-propre vis-à-vis d’autrui prendra encore souvent le dessus sur l’amour-propre vis-à-vis de soi.
On peut supposer que les conflits d’intérêt, les torts et les dédommagements seront réglés par des commissions techniques d’arbitrage et que les individus de mauvaise foi, mieux connus à l’intérieur des associations, seront devant la réprobation publique et l’antipathie générale obligés de changer de milieu, que les actes anti-sociaux (conflits sexuels, violences, déséquilibres divers, accès alcooliques, etc.) seront envoyés à une commission médicale, etc.
Il y aura toujours une société, des organismes de production et de répartition (communes agricoles ou industrielles), des associations de tout genre, des fédérations multiples. La responsabilité vis-à-vis de la collectivité existera toujours, mais elle ne donnera plus lieu à des peines infamantes. Tout devrait se réduire au dédommagement, tout au moins partiel, du tort causé, sous la garantie d’un arbitrage, et au traitement médical des individus dangereux. Encore ceux-ci devraient-ils avoir pour se défendre contre des abus possibles, l’assistance de psychiatres indépendants, remplaçant les avocats d’aujourd’hui.
Enfin, on aurait sans doute, davantage que maintenant, la préoccupation de l’hygiène et de la santé publiques. On s’intéresserait davantage à l’éducation rationnelle de l’enfant respectant son développement psychologique, sans le bourrage de crâne, destiné à l’amener au conformisme. On s’inquièterait du dépistage précoce de tous les arriérés, afin de leur donner une éducation spéciale, continuée, en cas de besoin, par une protection médicale au cours de leur existence.
Et puis, quoi qu’il arrive, il y aura toujours une opinion publique sans doute mieux éclairée, plus libérale évoluant plus facilement. Quel est le surhomme, doué du sentiment de la responsabilité le plus affiné et de quelque intelligence, qui aurait l’orgueil de prétendre pouvoir se conduire à l’égard d’autrui sans provoquer un jugement populaire parfois plus équitable que le sien ? La réaction réciproque des uns sur les autres est la garantie de la responsabilité sociale. L’équilibre de la morale, toujours instable, est la résultante de l’influence de l’opinion publique, soutien de la coutume, et de la réaction de chaque individu, défendant sa personnalité et son indépendance.
— M. PIERROT.
RESPONSABILITÉ
n. f.
La responsabilité, dit le dictionnaire, c’est l’obligation de répondre de ses actes, de ceux des autres ou d’une chose confiée. Cette définition est exacte, à mon avis. Je la fais donc mienne. La responsabilité est inséparable de l’acte lui-même. Elle implique nécessairement la liberté, en même temps qu’elle détermine celle-ci. Elle peut se présenter sous deux formes : individuelle etcollective. La responsabilité individuelle oblige à répondre uniquement de ses actes ou d’une chose confiée à la personne même. La responsabilitécollective fait obligation de répondre non seulement de ses propres actes, mais encore de ceux d’autrui, s’il s’agit d’actes délibérés, acceptés et décidéspar un groupe d’individus associés, sous une forme ou sous une autre, pour accomplir une tâche commune, pour atteindre un but commun. Dans ce cas,la chose confiée, engage la responsabilité de tous. Cette chose confiée peut être : le secret de délibérations, de décisions ou d’actes qui doivent être préparés et exécutés par les associés ou certains d’entre eux, choisis par l’ensemble. Chacun et tous sont donc, en ce cas, responsables, à la fois individuellement et collectivement, et leur liberté est déterminée par ce double caractère de la responsabilité.
Ces prémices formulées, il importe, maintenant, d’examiner les deux aspects de la responsabilité.
I. — La responsabilité individuelle.
À mon avis, l’obligation qui consiste à répondre de ses actes ou de la chose confiée personnellement, ne peut être éludée par aucun individu en possession de ses facultés mentales. Cependant, plusieurs conceptions peuvent se faire jour :
-
Celle des individualistes, adversaires de toute forme d’association ;
-
celle des individualistes partisans de l’association libre et momentanée, mais hostiles à l’organisation sous toutes ses formes ;
-
Celle des partisans de l’organisation méthodique et durable.
a.
Convaincus qu’ils se suffisent à eux-mêmes, les individualistes non-associationnistes — de moins en moins nombreux, il faut le dire — sont partisans de la liberté, sans limite, ni contrôle. Ne voulant rien avoir de commun avec le milieu, avec la société, ils n’entendent être responsables de leurs actes que vis-à-vis d’eux-mêmes et n’avoir d’obligation envers quiconque.
Cette conception est apparemment logique. Elle serait soutenable si ces individualistes pouvaient vivre en marge, s’ils n’étaient pas obligés de recevoir des services de la société et, en échange, de lui en rendre. Elle serait juste et inattaquable, s’ils considéraient que leur liberté finit au moment où leurs actes commencent à porter atteinte à la liberté des autres. Mais comme ces « individualistes » prétendent exercer leur liberté, toute leur liberté, sans se préoccuper en quoi que ce soit de la restriction apportée à celle des autres ; comme ils entendent « prendre » le plus possible à la société et ne rien lui donner, en échange, je déclare qu’une telle conception de la responsabilité est insoutenable, Elle ne peut être que celle d’« anormaux » qui n’acceptent aucune responsabilité et, en fait, sont irresponsables.
b.
Il en est autrement des anarchistes individualistes, de tendance associationniste. Ceux-ci considèrent qu’ils ne peuvent vivre que par un échange de services entre certains hommes et eux. S’ils limitent cet échange de services ; s’ils refusent, en général, de l’étendre à la société tout entière, ils conçoivent parfaitement qu’ils ne peuvent recevoir sans donner loyalement. D’une manière générale, ils respectent le contrat, écrit ou non, qui les lie à leurs associés d’un moment. Acceptant le principe de la réciprocité, ils s’interdisent — ou doivent s’interdire — de porter atteinte à la liberté de leurs associés et se considèrent responsables devant ceux-ci des obligations librement souscrites.
Ceci prouve qu’ils ont le sens de la responsabilité individuelle et un certain sens de la responsabilité collective. Toutefois, leur conception de la responsabilité : individuelle et collective, ne dépasse pas le cercle de leurs associés directs et momentanés ; ils ne se reconnaissent, en fait, aucune obligation envers les autres hommes et, moins encore, envers la société elle-même. Cette conception de la responsabilité restera donc insoutenable, aussi longtemps que le développement et l’évolution des individus, de tous les individus, ne permettront pas à l’Anarchie de devenir, partout et pour tous, une réalité. Pour que cette réalité soit enfin, il faut que les individualistes-associationnistes comprennent qu’ils doivent étendre le champ de leur association, que leur liaison avec le milieu social doit être plus complète ; que, pour réaliser ce qu’ils appellent leur revendication, il faut qu’ils cessent de proclamer que l’affranchissement de l’homme dépend uniquement de son évolution ; qu’ils admettent que cette évolution est contrariée, entravée, rendue impossible par le système capitaliste et qu’ils admettent aussi qu’il faudra au préalable, détruire ce système ; cet obstacle qui leur barre la route vers le sommet qui nous est commun, comme point d’arrivée. Lorsqu’ils auront compris tout cela, ils côtoieront la vérité. Ce temps ne paraît, malheureusement, pas prêt d’être révolu pour eux. En ce qui concerne la chose confiée, leur conception de la responsabilité est absolument identique. Ils ne se reconnaissent d’obligation de répondre de leurs actes qu’envers leurs associés momentanés. Ils sont, sur ce point, logiques avec eux-mêmes.
II. — La responsabilité individuelle.
Arrivons-en, maintenant. à la conception que professent, en matière de responsabilité individuelle, les partisans du groupement, de l’organisation, du milieu social nécessaire,
c.
Chez eux, le sens de l’obligation de répondre de ses actes et de la chose confiée, prend une signification toute différente de celles que je viens d’exposer. Considérant que la coexistence de l’individu et de la société est une nécessité indéniable, dont le fait est d’ailleurs antérieur à leur propre existence, les partisans du groupement affirment qu’il devrait y avoir solidarité complète entre tous les humains, sans distinction de race, de couleur, de lieu d’habitation. Ils constatent que cette solidarité est rendue impossible par une certaine catégorie d’individus, dont le nombre est infime et la puissance très grande. Et, convaincus que cette solidarité, cariatide sociale de l’avenir, ne pourra être pleinement réalisée que par la disparition de l’obstacle qui est au travers de leur route depuis des siècles, ils unissent leurs efforts pour détruire cette entrave à leurs désirs. Ils étendent donc le principe de la responsabilité individuelle, l’obligation de répondre de leurs actes et de la chose confiée à toute une catégorie d’hommes : à ceux qui partagent leurs conceptions et poursuivent le même but.
Liés à ceux-ci par une concordance d’intérêts de toutes sortes, ils considèrent qu’ils sont responsables devant eux dans tous les actes de leur vie ayant un caractère social, actes dont les conséquences, bonnes ou mauvaises, peuvent influer sur les conditions d’existence, de sécurité, de bien-être de leurs semblables. Ils savent qu’un acte commis à Paris, par exemple, par un individu, peut avoir sa répercussion à New York, à Pékin ou à Valparaiso. Ils se garderont donc de l’accomplir si, par sa portée et ses conséquences, il peut créer une situation fâcheuse, difficile, grave pour leurs camarades qui habitent à des milliers de lieues de Paris.
Pour prendre un exemple moins lointain, plus précis, plus accessible, plus compréhensible et, par conséquent, plus probant, examinons le fait suivant : les ouvriers d’une firme métallurgique ayant son siège à Paris et des usines à Belfort, Perpignan, Nice, Brest et Dunkerque, sont en grève à Belfort, pour une question de salaire et de durée du travail. Il est tout à fait évident que tous les ouvriers de cette firme, où qu’ils travaillent, ont le plus grand intérêt commun à ce que leurs camarades de Belfort triomphent. Ils ont, les uns vis-à-vis des autres, des obligations certaines. Que l’un des centres affiliés travaille pour exécuter les commandes qui font l’objet du litige à Belfort, les grévistes de cette localité seront battus, parce que la solidarité de l’ensemble des travailleurs de la firme leur aura fait défaut. Et, tout naturellement, leur défaite sera aussi, même avant la lettre, celle des ouvriers des autres centres.
Dans ce cas, ce n’est pas seulement la responsabilité collective des syndicats qui sera en jeu, mais encore et surtout, la responsabilité individuelle de chaque ouvrier qui devra répondre de ses actes devant chacun et tous les autres travailleurs de la firme.
On peut multiplier les exemples à l’infini, prendre encore celui-ci, si on veut : il y a menaces de guerre très graves entre la France et l’Allemagne, le moindre incident de frontière peut déclencher le conflit. Il suffit que deux sentinelles échangent des coups de feu, que deux douaniers se disputent, qu’un ressortissant français pénètre en Allemagne, ou vice-versa, qu’un avion survole la zone frontière pour que la poudre parle. J’entends bien que ce ne sera que le prétexte, que l’occasion choisie : attendue ou cherchée, pour déclencher la conflagration ; mais tout de même, si cet incident ne s’était pas produit, si le soldat, le douanier, l’aviateur avaient eu le sens de la responsabilité individuelle, s’ils avaient, avant d’agir, mesuré la portée et les conséquences de leurs actes, le prétexte n’eût pas té fourni, l’occasion n’eût pas été donnée et les dirigeants, fauteurs de guerre, eussent été dans l’obligation de chercher autre chose... qu’ils n’auraient peut-être pu trouver au moment propice. Voilà encore un aspect de la responsabilité individuelle qui oblige un homme à répondre de ses actes devant deux collectivités d’individus, situées : l’une en Allemagne et l’autre en France.
Admettons maintenant que l’incident ait produit les conséquences attendues, que la guerre apparaisse inévitable et proche. La situation sera-t-elle la même, selon qu’on acceptera la guerre ou qu’on se dressera contre elle. Affaire de responsabilité collective, me répondra-t-on ? Affaire surtout de responsabilité individuelle, répondrai-je
La résistance, la lutte pour la paix, l’utilisation psychologique des événements pour tenter une révolution sociale, dépendent d’abord et avant tout, de l’attitude que prendront ici et là les travailleurs, des moyens qu’ils mettront en œuvre, de la solidarité dont ils feront preuve des deux côtés de la frontière. Et cela est, nul ne peut le contester — et les anarchistes moins que les autres — un problème qui se posera devant la conscience de chaque individu, en Allemagne, comme en France. De même, chacun sait que l’action collective ne sera possible que si le nombre de ceux qui estimeront être personnellement responsables de leurs actes devant tous est assez grand, assez agissant, assez vigoureux dans l’emploi des moyens d’action Il est, je crois, inutile de pousser plus loin cette démonstration. La preuve parait apportée que chaque individu est responsable de ses actes, de la chose confiée : paix, succès, révolution, etc., devant tous ses semblables et, en premier lieu, devant tous ceux dont les intérêts de tous ordres sont identiques aux siens.
III. — La responsabilité collective.
Par les expo précédents, nous venons de démontrer qu’il y a trois grandes conceptions de la responsabilité individuelle. Il est aisé de conclure, dès maintenant, qu’il n’existe qu’une seule conception positive de la responsabilité collective.
Seuls, les individus qui acceptent la nécessité de l’organisation, c’est-à-dire tous les groupements à caractère communiste,qu’il s’agisse de la branche autoritaire ou de la branche libertaire, des centralistes ou des fédéralistes, doivent reconnaître comme leur le principe de la responsabilité collective et admettre celle-ci comme indispensable. L’obligation de répondre de ses actes, de ceux des autres, de la chose confiée, s’applique intégralement et avec autant de rigueur — davantage peut-être — aux groupements qu’aux individus, parce que leur responsabilité est plus grande encore au point de vue social.
En effet, cette responsabilité, qui s’étend de la décision aux conséquences de l’action, en passant par la préparation et l’action elle-même, engage le groupement tout entier vis-à-vis du reste des individus d’un pays et, souvent, de tous les pays.
Disons tout de suite qu’elle n’abolit en rien la responsabilité individuelle de tous les membres du groupement ; qu’il n’y a aucune opposition entre la responsabilité individuelle et la responsabilité collective. Elles se complètent et se confondent.
La responsabilité individuelle est la forme originelle de la responsabilité ; elle découle de la conscience elle-même. La responsabilité collective en est la forme sociale et finale. Elle élargit la responsabilité de l’individu à la collectivité : en l’étendant ainsi, selon le principe de la solidarité naturelle qui est, en même temps, une loi physique s’appliquant aussi bien aux composants sociaux qu’aux autres parties d’un corps quelconque animé ou inanimé, elle rend chaque individu responsable de ses actes devant la collectivité tout entière. Et, par réciprocité, par voie de contrôle, elle rend la collectivité responsable devant tous les individus. Comme le fédéralisme lui-même, dont elle est d’ailleurs l’un des principaux éléments, la responsabilité collective s’exerce dans deux sens : ascendant et descendant. Elle fait obligation à l’individu de répondre de ses actes devant le nombre et, à ce dernier, de répondre des siens devant l’individu.
On peut donc dire que les deux formes de la responsabilité se déterminent l’une, l’autre. La responsabilité collective consacre et précise la responsabilité individuelle. En fait, s’il réfléchit, s’il a le souci d’appliquer les principes qu’il défend, aucun communiste de tendance libertaire, anarchiste par conséquent, ne peut la lier et la rejeter. J’ajoute que s’il voulait être logique avec sa doctrine, aucun partisan de l’association, quelle que soit la nature de celle-ci, ne pourrait et ne devrait la combattre.
Ceci posé, voyons comment doit s’exercer la responsabilité collective. Prenons, par exemple, un groupement quelconque, qui a pris telle ou telle décision, après uns discussion libre entre ses membres ou leurs représentants mandatés et contrôlés. Que fera-t-il ? De toute évidence, il s’efforcera par tous les moyens en son pouvoir d’atteindre le but désigné. Cela veut dire qu’à partir de ce moment la discussion est close entre les membres du groupement ; que tous, conscients de leur responsabilité, partisans ou non de la décision prise et des mesures choisies, ont le devoir le plus strict de mettre tout en œuvre pour préparer et exécuter au mieux ce qui a été décidé.
Que l’accord ait été réalisé à l’unanimité ou à la majorité, tous ont, désormais, la même responsabilité dans la préparation, l’action et les conséquences de celle-ci. Aucun ne peut se dissocier ses autres, agir dans un sens différent ou contraire,porter atteinte à la souveraineté de la décision, prise librement, ne l’oublions pas. Par contre, si le déroulement des actions et des faits s’opérait en dehors du cadre des principes et si la décision était viciée dans sors application, tous auraient le droit, le devoir même, de s’insurger contre la déviation et de s’efforcer de ramener le groupement dans la ligne droite : celle de sa doctrine et de sa décision.
Mais, tant que l’action du groupement s’exercera dans le cadre des principes et de la décision, tous devront s’ingénier, par des initiatives intelligentes, toujours inspirées de l’intérêt commun, à atteindre le plus rapidement et le mieux possible le but visé. Il va donc de soi que tout participant, lié par une décision à caractère impératif, prise librement dans le cadre des principes et de la doctrine du groupement auquel il appartient, ne peut, à aucun moment, prendre la responsabilitéd’une initiative, d’un acte de nature à compromettre le succès commun.
Une initiative, grave par les conséquences qu’elle comporte, par la responsabilité qu’encourt son auteur vis-à-vis du groupement et, parfois, de toute la collectivité, doit donc, au préalable, avant d’être exécutée, matérialisée par l’acte, recevoir l’approbation du groupement qui est responsable de l’action et de ses conséquences. Rejetée, elle ne doit pas être exécutée. Si l’individu a le moindre sens de la responsabilité individuelle et, « a fortiori », collective.
Une telle conception de la responsabilité collective ne vise, ni ne tend à brimer la liberté individuelle, inséparable de la responsabilité collective et vice-versa. Elle lui donne, au contraire, son véritable sens : le sens social. Seuls, des fous, des forcenés, des hommes ambitieux pour eux-mêmes au suprême degré : des César, des Napoléon, des « individualistes » farouches, peuvent s’élever contre une telle conception et la rejeter. En somme, on peut dire de la responsabilité, ce qu’on dit de la liberté, inséparables l’une de l’autre, je le répète. L’individu est responsable devant le groupement ; le groupement est responsable devant l’ensemble des groupements et tous les groupements sont responsables devant tous les individus.
Pour que la responsabilité ait ce caractère, il va de soi, bien entendu, que le contrôle permanent et sévère des actes de chacun et de tous doit s’exercer de façon constante.
Ainsi se déterminent l’une l’autre, et se complètent, les deux formes de la responsabilité : individuelle et collective.
IV. — La responsabilité professionnelle et sociale de l’homme.
Après avoir étudié, défini et précisé les caractères de la responsabilité, tant au point de vue individuel que collectif, il me parait nécessaire d’examiner le problème sous sa forme professionnelle et sociale, et ce, dans le régime capitaliste et dans un régime transformé, conforme à mon idéal.
1. Dans le régime capitaliste.
Immédiatement, je remarque que cette responsabilité se présente sous un double aspect :la responsabilité de l’homme et celle de la fonction.
Ces deux formes de la responsabilité sont inséparables l’une de l’autre, la seconde est le prolongement, le complément de la première. En effet, la fonction est la consécration pratique de l’activité humaine. Et comme on ne peut juger la conscience de l’individu que sur les actes de la vie courante, on ne peut, raisonnablement séparer la fonction de l’individu et vice-versa. Qu’il l’ait choisie ou non, qu’il la subisse ou qu’il l’accepte, un homme est responsable des actes qu’il accomplit dans l’exercice de sa fonction professionnelle. Il l’est doublement : au point de vue individuel et social, en raison des répercussions et des conséquences que ses actes peuvent avoir sur l’existence des autres hommes.
Peut-on admettre, par exemple, qu’un individu, dans l’exercice de sa profession, de son métier, porte atteinte sciemment à la vie, à la santé, à la sécurité de ses semblables ? Non ! Pour ma part, je n’admettrai jamais qu’un individu, exerçant tel ou tel métier accepte délibérément d’agir ainsi, sous le prétexte trop connu qu’il faut vivre et, pour cela, composer souvent avec sa conscience.
Je n’excuse ni le boulanger qui accepte d’utiliser des produits qu’il sait nocifs, dans la fabrication du pain ; ni le charcutierqui ne se refuse pas à employer des viandes avariées ; ni l’ouvrier qui construit un bâtiment avec de mauvais matériaux et qui s’écroulera sur le dos des occupants : ni le mécanicien qui consent à partir avec une machine avariée, qui met en péril la vie des voyageurs ; ni le cordonnier qui fabrique des chaussures avec semelles en carton ; ni le garçon de restaurant qui consent à servir aux clients une nourriture malsaine, tout cela sous le prétexte qu’il faut absolument vivre.
Je préfère leur dire qu’il n’est pas nécessaire que de tels individus vivent, qu’ils sont, à proprement parler, des dangers sociaux. Je les tiens pour responsables personnellement et professionnellement des actes condamnables qu’ils commettent en transigeant ainsi avec leur conscience. De même, sont grandement responsables ceux qui acceptent de travailler aux productions de guerre et le savent. Les uns et les autres devraient se refuser à travailler dans de telles conditions, pour de telles fins. En acceptant d’exercer ainsi leur profession, leur métier — ou un tel métier — les uns et les autres se font les complices de leurs adversaires de classe lesquels n’ont qu’un but : gagner de l’argent par tous les moyens, sans se soucier de la vie de leurs semblables.
J’admets parfaitement que dans la lutte constante qui oppose les classes ; on s’en prenne aux moyens de production qui ne sont, actuellement, que des instruments de profit et d’exploitation ; qu’on s’attaque au coffre-fort par les moyens les meilleurs, mais je n’accepte pas le sabotage des produits dont tous les individus — et les ouvriers les premiers — sont consommateurs. Un tel sabotage, une telle conception de l’exercice du métier, de la profession, ne peuvent être mis en pratique que par des consciences élastiques, des inconscients ou des irresponsables. Des hommes qui les accepteraient comme valables ne vaudraient pas mieux demain, dans une société transformée, à base égalitaire. Ils sont et ils resteraient des dangers sociaux.
Prenons un autre cas, pour montrer l’intérêt qu’il y a, pour la classe ouvrière à acquérir sans cesse davantage de connaissances et de conscience. Supposons que des ouvriers sont occupés à la construction d’un pont en ciment armé. Tout leur paraît normal : les matériaux sont de bonne qualité, le travail s’effectue, techniquement, dans d’excellentes conditions ; rien ne leur parait ni singulier, ni dangereux. Et, cependant, un beau jour, soit au cours des travaux, soit à l’usage, après achèvement, le pont, en s’écroulant, fait des victimes par centaines. Pourquoi ? Tout simplement parce que les calculs de résistance des matériaux étaient faux. Dans ce cas, les ouvriers qui ont construit cet ouvrage suivant des données précises fournies par les techniciens de l’Entreprise, qui ont, les premiers, risqué leur vie, pendant l’exécution du travail, sont-ils responsables, individuellement et collectivement de l’écroulement de l’ouvrage ?
Non, s’ils ignoraient que les calculs étaient faux, s’ils n’avaient aucun moyen de les vérifier.
Oui, s’ils étaient capables de procéder à cette vérification, s’ils ne se sont pas opposés à ce que la construction se poursuive, soit par l’action de leur syndicat, soit par leur action propre. En résumé, les hommes, même en régime capitaliste, n’ont pas le droit d’être défaillants devant les obligations des fonctions qu’ils ont acceptées de remplir. Quant aux organisations, il leur appartient de rompre le silence complice observé par certains de leurs membres ; de dénoncer les procédés coupables employés ou imposés par les profiteurs, de rappeler les ouvriers défaillants à leur devoir d’humains, de dégager la responsabilité de leur classe, de souligner et démontrer celle de l’adversaire.
Ceci exposé, je déclare hautement qu’en régime capitaliste la classe ouvrière n’a aucune autre responsabilité sociale. Le fait qu’une classe commande et que l’autre exécute en conscience suffit à situer, d’une façon parfaite, la responsabilité et de celle-ci et de celle-là. Peut-on affirmer, par exemple, que dans la crise actuelle. qui est avant tout une crise d’organisation et de fonctionnement du régime capitaliste, le prolétariat — qui est tenu en tutelle, politiquement et en esclavage, économiquement — ait une responsabilité quelconque. Evidemment, non. Il est la victime de la crise. Il n’en est pas le responsable. Tout se fait en dehors de lui et contre lui ; il ne saurait donc, vis-à-vis de la société actuelle, encourir, et moins encore, endosser aucune responsabilité, à moins qu’il n’aide par son concours le capitalisme dans sa tâche, ce qui est, malheureusement, le cas pour une certaine partie de la classe ouvrière en ce moment. Mais le reste du prolétariat, ceux qui restent fidèles à leur idéal, n’ont aucune responsabilité dans tout ce qui arrive.
Leur responsabilité ? Elle se limite à n’avoir pas su trouver encore le moyen de se débarrasser du système qui les opprime et les broie ; elle consiste à trouver ce moyen le plus tôt possible. C’est tout et c’est assez. Cette responsabilité-là elle s’impose à tous les travailleurs comme un devoir impérieux ; mais elle ne s’étend pas plus loin. Elle se limite à ceux dont les aspirations sont communes, à ceux qui subissent. Que ceux qui commandent gardent la leur. Et que le prolétariat la leur laisse tout entière.
2. Dans un régime transformé à bases communistes libertaires.
Il va sans dire que dans un tel régime, le problème de la responsabilité professionnelle et sociale de l’homme et des groupements prend un tout autre caractère ; Ayant détruit toutes les formes, tous les éléments d’oppression et d’exploitation et établi l’égalité sociale, l’individu accède de plain-pied à la complète responsabilité de tous ses actes. La nécessité pour lui d’assurer la pérennité du système qu’il aura édifié lui fera une obligation absolue d’accomplir l’acte de production avec la plus rigoureuse conscience. La malfaçon voulue, le sabotage du produit, la détérioration ou la mise hors d’usage de l’instrument de travail, constitueraient autant de crimes contre lui-même et envers ses semblables : ses associés. J’ose espérer que la conscience, désormais libre, parlera assez haut et assez clair chez chacun pour que de tels actes soient à jamais bannis ; que l’erreur, si acceptable qu’elle soit, si humaine qu’elle demeure, ne trouvera pas une audience indéfinie et qu’elle sera, au contraire, salutaire pour l’avenir.
Conclusion. — Si l’époque actuelle ne m’apparaissait pas aussi décisive pour la vie de l’espèce humaine, si nous n’étions pas, à la fin d’un stade de l’évolution des sociétés ; si une ère nouvelle n’était pas à la veille de naître, si le trouble n’était pas si grand chez la plupart des hommes ; si l’anxiété n’était pas au cœur des meilleurs : si on ne confondait trop souvent : la fiction avec la réalité ; le sophisme avec la vérité, l’accessible avec l’inaccessible, le sentiment avec la raison, l’érudition. avec le savoir, la négation avec le raisonnement, j’aurais borné là ma conclusion. Elle me paraîtrait, en d’autres temps, parfaitement suffisante. Mais nous vivons dans des conditions tellement extraordinaires ; les passions et l’incompréhension sont si grandes, le sens donné aux mêmes expressions et systèmes, si différent, qu’il me semble nécessaire de motiver cette conclusion, de la renforcer, si possible, de lui donner, sa plus grande puissance de persuasion.
Quand la peur des mots, la paresse de l’effort d’induction et de déduction sont si considérables qu’elles conduisent des hommes qui ont l’habitude du mouvement des idées, à nier des choses aussi évidentes que : la nécessité de défendre par les armes une révolution, l’existence de la période transitoire, l’indispensabilité de l’instrument d’échange et la valeur de la responsabilité collective, on ne saurait être trop précis et avoir peur de chasser l’erreur de ses derniers retranchements.
Je veux prouver ici, à ceux qui nient la valeur, l’existence même, de la responsabilité collective, — qui sont, d’ailleurs les mêmes que ceux qui n’admettent pas la période transitoire parce qu’elle les effraye ; qui se refusent à défendre la révolution par tous les moyens armés, parce qu’ils sont les adversaires des forces collectives armées ; qui se refusent à accepter l’instrument d’échange, parce qu’ils sont partisans de je ne sais quelle prise au tas — qu’ils doivent capituler devant la raison, jeter le masque de la paresse et de l’incompréhension ou cesser de s’affirmer révolutionnaires. Qui peut admettre, à notre époque, alors que de formidables collectivités d’intérêts se heurtent à travers le monde ; que de leurs chocs terribles résultent à tout instant des bouleversements énormes dans tous les domaines, bouleversements qui modifient parfois en un seul jour le sort de toute une industrie et celui des millions d’hommes qu’elle occupe ; que, d’un moment à l’autre, de leur heurt, sur tel ou tel point du globe, la guerre peut éclater ; que des réactions inévitables qu’elles provoquent chez le prolétariat, et du poids de leurs fautes, peut surgir une révolution d’ordre continental, oui, qui peut admettre que la responsabilité est exclusivement, strictement d’ordre individuel ?
Est-ce que tout ne prouve pas, au contraire, avec la plus évidente clarté, que dans ces chocs titaniques ce sont des collectivités volontairement disciplinées, n’ayant qu’une seule pensée, qu’un seul but, qui s’affronteront jusqu’à la destruction de leurs rivales ? Est-ce que le capitalisme tolère que l’une de ses forces rompe sa solidarité avec l’ensemble ? Est-ce que ceux de ses membres qui veulent passer outre aux décisions arrêtées ne sont pas immédiatement brisés, écrasés ? Est-ce que chez nos adversaires l’action de l’un d’eux n’est pas examinée par tous et jugée suivant sa valeur Est-ce qu’ils tolèrent des initiatives qui engageraient la responsabilité de l’ensemble et contrarieraient son succès ? Est-ce que, chez eux, chacun n’est pas responsable devant tous ? Et l’on voudrait que dans les tragiques circonstances actuelles, alors que la révolution frappe partout à la porte des peuples, apportant avec elle le message de l’avenir, nous en restions à cette conception étriquée du « chacun pour soi », responsable devant soi ; du « franc-tireur » romantique, empanaché, gai luron et sans cervelle.
Ces temps-là sont révolus ! Celui de l’organisation, méthodique et souple à la fois, possédant le maximum de force decontraction et de détente, agissant par tous ses éléments, en pleine cohésion, est venu. La victoire sera d’autant plus rapide et plus complète que les actes seront plus mûrement délibérés, plus sûrement accomplis, plus grandement exploités, mieux ordonnés et contrôlés. Est-ce que par hasard tout cela serait incompatible avec le communisme libertaire à bases fédéralistes ? Alors, qu’on nous le dise !
Pour ma part, je dis : non. C’est, au contraire, le fédéralisme libertaire en action, en pratique.
Liés, soudés, cimentés par le sentiment de la responsabilité collective, exerçant leur liberté dans le cadre qu’ils auront eux-mêmes tracé ; attachés à ne rien faire qui puisse faire échouer leur entreprise, les hommes qui seront imbus de cet esprit de sacrifice vaincront. Les autres, ceux qui se croiront le droit d’agir à leur guise, de violer les accords conclus ; d’accomplir quand ils le veulent, et comme ils le veulent, tel ou tel acte, sans se soucier de ses conséquences, seront vaincus et feront le lit de la dictature. Et, si par un hasard heureux, ils triomphaient, on peut assurer que sous une forme ou sous une autre, ils exerceraient eux-mêmes cette dictature.
Il faut, à tout prix, que ces deux choses — aussi mauvaises l’une que l’autre — soient évitées au prolétariat. Et celui-ci ne le peut, qu’en acceptant avec la conception de l’organisation, son corollaire inévitable : le principe de la responsabilité collective. Il a le devoir d’intégrer ce principe dans le corps de doctrine du communisme libertaire.
L’évolution des sociétés, dont la marche a été si précipitée depuis vingt ans, justifie et impose cette intégration. Il s’agit de l’appliquer sans attendre davantage. Le succès est à ce prix.
Une pensée neuve, a dit Boileau, « ce n’est point, comme se le persuadent les ignorants, une pensée que personne n’a jamais eue ni dû avoir, c’est, au contraire, une pensée qui a dû venir à tout le monde et que quelqu’un s’avise d’exprimer le premier ».
Je ne me flatte pas d’avoir, le premier, exprimé l’idée de la responsabilité collective, mais il est certain qu’elle préoccupe de nombreux esprits et qu’elle ne peut être niée.
— Pierre Besnard
REVANCHE
n. f. (Étymologie re et venger)
Action de rendre la pareille pour le mal qu’on a reçu (Littré). C’est le sens le plus courant du mot. (Signalons qu’on l’emploie quelquefois en bonne part pour reconnaissance ; et que, dans le jeu, il signifie la partie que joue le perdant pour se racheter. L’expression en revanche signifie : en compensation.) Le mot revanche est donc synonyme de vengeance. Duclos disait : « La vengeance n’est plus qu’une revanche ; on la prend comme un moyen de réussir, et pour l’avantage qui en résulte. » L’avantage qui en résulte, c’est d’abord de satisfaire l’instinct de violence (bébé est content lorsqu’on feint de battre la chaise contre laquelle il s’est cogné) ; c’est ensuite d’humilier autrui et, parfois, de profiter de l’occasion pour s’emparer de ses dépouilles ; c’est réussir, c’est s’imposer, c’est dominer. Le sentiment de revanche, ainsi compris, procède du pur esprit archiste ; il est toujours condamnable.
Il semble que, d’ordinaire, on considère la revanche (vengeance) comme la façon normale et juste de régler les dommages. « Tu as brisé ma toupie, dit l’enfant, hé bien, je casse une patte à ton cheval mécanique. » « Vous avez tué, on vous tuera », dit le Code. La revanche n’était-elle pas la loi de Dieu ?
« Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera : vie pour vie. Si quelqu’un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait : fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent ; il lui sera fait la même blessure qu’il a faite à son prochain. Celui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. » (Lévitique, XXIV, 17–21.)
« Au jour de la vengeance, je visiterai et punirai ce péché qu’ils ont commis. » (Exode, XXXII, 34.)
Dieu ne s’était pas encore élevé jusqu’au pardon des offenses. Combien sont rares, encore aujourd’hui, ceux qui, à une injure, ne sont pas tentés de répondre par une injure, à un coup de poing par un coup de poing, à une guerre par une guerre ! L’esprit de revanche n’a-t-il pas été soigneusement cultivé dans notre Troisième République, après 1870, et n’est-il pas pour quelque chose dans l’explosion de 1914 ? Et combien de revanches ne se préparent-elles pas dans le monde pour réparer les défaites passées ! Malheureusement, la revanche ne répare rien ; elle est, au contraire, la source de nouvelles revanches ; et cela indéfiniment. Si l’homme était vraiment le roseau pensant de Pascal, il mettrait fin à de telles aberrations. D’autant plus que, même pour le vainqueur, la revanche n’apporte pas toujours l’apaisement souhaité.
« J’avoue que, depuis que je suis vengé, je ne me trouve pas plus heureux ; et je sens bien que l’espoir de la vengeance flatte plus que la vengeance même. » (Montesquieu)
Et Poincaré lui-même – l’homme de la revanche – n’a pas caché sa déception ; hélas, après le crime !
« Après tout ce que la France a fait pour l’Alsace, être ainsi récompensé est la plus grande douleur qu’un Français puisse éprouver. » (24 janvier 1929, déclaration à la Chambre.)
Il est cependant une sorte de revanche souhaitable pour tout être épris de justice ; c’est celle qui répare les torts commis par l’usage ou l’abus de pouvoir. Mais celle-ci ne se satisfera jamais dans les larmes, dans la douleur et dans le sang. C’est la revanche du bon sens sur les sophismes, celle de la vérité sur la sottise, celle de la raison sur le dogme, celle de la vie sur la mort. Elle est sœur, cette revanche, de la haine de Zola qui « est l’indignation des cœurs forts et puissants, le dédain militant de ceux que fâchent la médiocrité et la sottise » (Mes Haines). C’est la revanche de Voltaire qui défendit la cause des opprimés :
« Je mourrai content, quand nous aurons joint la vengeance des Sirven à celle des Calas. »
C’est la revanche que nous appelons de tout notre cœur pour placer à leur vrai rang dans l’échelle des valeurs humaines : d’un côté les César, les Napoléon, les Foch ; de l’autre les Diogène, les Estienne de la Boëtie, les Ferrer, les Sacco et Vanzetti. C’est la revanche de l’esprit libre sur les forces d’obscurantisme qui ont trop longtemps opprimé les hommes.
— Ch. B.
RÊVE
n. m.
Dans le langage ordinaire, le mot rêve est fréquemment synonyme d’espérance vaine, d’idée chimérique ; il s’applique aussi à l’idéal que l’on caresse tendrement, mais que l’on juge irréalisable. En poésie, le rêve se confond avec les constructions de l’imaginative qui se déroulent dans le cerveau de l’homme inspiré. Toute anticipation scientifique, morale, sociale peut être qualifiée de rêve ; et, pris dans cette acception, il est considéré à bon droit comme la racine première du progrès. La tendance de notre esprit à toujours dépasser le présent, à concevoir un monde supérieur à celui que perçoivent nos sens s’avère l’inspiratrice de l’art et des mille inventions utiles qui ont permis d’améliorer les conditions d’existence de l’espèce humaine. Mais c’est dans un sens plus limité que j’emploierai ce mot ici ; ne voulant pas redire ce que j’ai longuement développé dans Vers l’inaccessible et ce que d’autres ont dit dans divers articles de cette encyclopédie, je parlerai presque exclusivement du rêve examiné en tant que manifestation de l’activité mentale pendant la période de sommeil.
Longtemps on a considéré l’incohérence comme le signe distinctif du rêve. Egger écrivait :
« Il n’y a pas cohérence, il n’y a pas liaison, il n’y a pas rapports mutuels entre les rêves et l’état de veille, entre les différents rêves, entre les éléments constitutifs d’un même rêve, on pourrait ajouter entre nos rêves et les rêves de nos semblables au même moment. »
Bien avant lui, Héraclite affirmait déjà :
« Il y a un seul et même monde pour les hommes éveillés ; mais chaque homme endormi se détournant du monde commun va dans un monde qui lui est propre. »
Toutefois, Freud nous semble dans le vrai quand il établit, de ce point de vue, une distinction entre les rêves. Certains d’entre eux sont clairs, raisonnables et semblent empruntés à la vie psychique ordinaire.
« Ces rêves se produisent souvent. Ils sont brefs et ne nous intéressent guère parce qu’ils n’ont rien qui étonne, rien qui frappe l’imagination. »
D’autres apparaissent fort cohérents, mais nous surprennent, parce que rien, dans la réalité, ne leur fournit de base, ni de justification.
« C’est le cas, par exemple, quand nous rêvons qu’un parent qui nous est cher vient de mourir de la peste, alors que nous n’avons aucun motif d’appréhender cet événement ou de le croire possible. »
Enfin, il y a des rêves absurdes, incohérents, qui sortent des règles de l’intelligibilité habituelle. Ce sont les plus nombreux et, ajoute Freud :
« C’est pour cela que les médecins, qui n’attribuent aux rêves qu’une importance médiocre, refusent de voir en eux autre chose que le produit d’une activité psychique réduite. Disons, en outre, que, d’une manière générale, il est rare que des rêves un peu longs et suivis ne présentent quelques traces d’incohérence. »
Même lorsqu’il apparaît contraire aux lois de la logique rationnelle et répugne à la conscience de l’homme éveillé, le rêve est-il aussi dépourvu de sens que les notes frappées au hasard, par une main inexperte, sur le clavier d’un piano ? Cette opinion, qui fut celle de nombreux médecins, apparaît insoutenable après les minutieuses recherches de Freud. Certes, nous sommes loin d’admettre l’ensemble des conclusions formulées par ce psychiatre ; son interprétation des rêves nous paraît singulièrement caduque, pour ne pas dire absolument erronée, dans bien des cas. Mais nous admettons que maintes constructions oniriques sembleraient moins absurdes, ou même s’expliqueraient parfaitement, si nous connaissions leurs antécédents soit physiologiques soit psychologiques. Les excitations périphériques jouent un rôle que l’on a pleinement mis en lumière. Dans son ouvrage Le Sommeil et les Rêves, Maury rapporte ce fait vraiment typique :
« J’étais un peu indisposé et me trouvais couché dans ma chambre, ayant ma mère à mon chevet. Je rêve de la Terreur, j’assiste à des scènes de massacre, je comparais devant le tribunal révolutionnaire, je vois Robespierre, Marat, Fouquier-Tinville, toutes les plus vilaines figures de cette époque terrible ; je discute avec eux ; enfin, après bien des événements que je ne me rappelle qu’imparfaitement, je suis jugé, condamné à mort, conduit en charrette, au milieu d’un concours immense, sur la place de la Révolution ; je monte sur l’échafaud, l’exécuteur me lie sur la planche fatale, la fait basculer, le couperet tombe ; je sens ma tête se séparer de mon tronc, je m’éveille en proie à la plus vive angoisse et je me sens sur le cou la flèche de mon lit qui s’était subitement détachée, et était tombée sur mes vertèbres cervicales, à la façon du couteau d’une guillotine. Cela avait eu lieu à l’instant, ainsi que ma mère me le confirma, et cependant c’était cette sensation externe que j’avais prise pour point de départ d’un rêve où tant de faits s’étaient succédé. »
Chez d’autres dormeurs, le bruit d’un réveille-matin s’est traduit par l’idée d’une voiture qui roulait sur des pavés, l’aboiement d’un chien par une harangue qui provoquait les huées des auditeurs, la brusque apparition d’une lumière par la vue d’un incendie. Des expériences méthodiques, dues à une excitation intentionnelle, ont confirmé ce que l’on savait déjà. Chatouillé sur les lèvres et le bout du nez, un individu rêva :
« ...qu’on le soumettait à un horrible supplice, qu’un masque de poix lui était appliqué sur la figure, puis qu’on l’avait ensuite arraché brusquement, ce qui lui avait déchiré la peau des lèvres, du nez et du visage. »
Doucement pincé à la nuque, un dormeur imagina qu’on lui posait un vésicatoire. Le docteur Mourly Vold a constaté qu’une fatigue musculaire générale détermine fréquemment la vie de personnages en mouvement. De même, les images hypnagogiques ont pour substratum habituel des sensations effectivement éprouvées. Tous les sens externes peuvent fournir des excitations qui serviront de point de départ à des constructions oniriques.
Par ailleurs, les sensations internes, les excitations cénesthésiques jouent un rôle que Bacon signalait déjà, et que Maine de Biran estimait capable d’expliquer l’existence et la diversité des rêves. Lemoine écrivait en 1855 :
« Il suffit que nous soyons couchés dans une position incommode, par exemple sur le côté gauche, que la respiration soit oppressée, la circulation gênée tant soit peu, pour que les rêves les plus affreux, les plus horribles cauchemars inquiètent notre sommeil qui se serait prolongé sans trouble, et peut-être dans des songes agréables, si nous nous fussions endormis dans une position différente, ou si quelque mouvement instinctif, provoqué par la fatigue, eut rendu plus tôt toute leur liberté aux fonctions du cœur et des poumons. »
Faim, soif, excitation génitale, besoin d’uriner provoquent des rêves typiques ; Freud a particulièrement insisté sur l’importance du facteur sexuel dans l’activité onirique.
Ainsi qu’en témoigne l’expérience courante, l’état pathologique des organes intervient aussi. Coryza, dyspnée, affections de la gorge ou des voies respiratoires engendrent des rêves d’étouffement. Un élève de Foucault écrit :
« J’ai rêvé qu’il me fallait aller en classe, Ma mère voulait me faire prendre une pèlerine. Mais, comme cette pèlerine était trop étroite, elle me la boutonnait elle-même au cou. J’étouffais, je lui criais de ne pas continuer à boutonner cette pèlerine qui m’étranglait. En vain. Bientôt je ne pus plus parler. Je me débattis encore pendant plusieurs minutes, toujours inutilement. Enfin, je parvins à respirer un peu et je me réveillai : j’avais un fort mal de gorge. »
Par un phénomène de transfert très fréquent, certains rêvent que c’est un autre qui étouffe, un cheval par exemple dans le cas suivant :
« Une personne ayant de l’asthme depuis plusieurs années, rapporte Max Simon, et qui s’était endormie dans un état d’anxiété respiratoire, se voit en rêve dans une rue montueuse que gravit une lourde voiture : la chaleur est étouffante, les chevaux sont essoufflés, ils ont beaucoup de peine à marcher et, bientôt, l’un d’eux s’abat. La respiration du pauvre animal est haletante ; il est couvert de sueur. Le conducteur fait tous ses efforts pour relever le cheval abattu, et le dormeur vient lui prêter assistance. La personne qui fait un rêve se réveille, elle est elle-même en pleine transpiration et souffre d’une extrême oppression. »
Troubles de l’appareil digestif, du foie, des reins se traduisent par des rêves caractéristiques. Un malade qui souffre de l’estomac croit manger des serpents, un autre s’imagine qu’il ingurgite des gâteaux jusqu’au dégoût ; une irritation de l’intestin provoque chez un troisième la vue de couloirs longs, étroits et sinueux, sans doute par analogie avec l’organe atteint. C’est à des malaises digestifs, selon Delage, que seraient dues, d’ordinaire, les terreurs nocturnes des enfants. Aux diverses maladies mentales se rattachent des rêves spéciaux, bien étudiés par les aliénistes ; dans les troubles par intoxication, les constructions oniriques varient avec la nature du poison.
À côté des excitations périphériques et cénesthésiques, il faut faire une place aux facteurs psychologiques. Perceptions et idées de l’état de veille se retrouvent, pendant le sommeil, sous forme d’images souvenirs. Parfois, ce sont des impressions extrêmement fugitives, auxquelles nous n’avions prêté aucune attention, qui renaissent. Claparède dit :
« Souvent, je fais jouer un grand rôle, dans un rêve où ils n’ont rien à faire, à des personnes presque inconnues que j’ai croisées dans la rue, le jour précédent, ou dont j’ai lu le nom d’une façon distraite dans un journal. Au contraire, les images qui ont attiré mon attention pendant la journée ou la soirée, un tableau, un spectacle de théâtre ne m’apparaissent que bien rarement dans mes rêves de la nuit suivante. »
Des souvenirs très anciens, et que l’on croyait totalement disparus, revivent dans nos rêves.
Les faits d’hypermnésie onirique paraissent, en certains cas, invraisemblables. On lit dans Maury :
« Il y a quelques mois, je me trouve en rêve transporté aux jours de mon enfance et jouant dans le village de Trilport. J’aperçois un homme vêtu d’une sorte d’uniforme, auquel j’adresse la parole en lui demandant son nom. Il m’apprend qu’il s’appelle C..., qu’il est le garde du port, puis il disparaît pour laisser la place à d’autres personnes. Je me réveille avec le nom de C... dans la tête. Était-ce là une pure imagination ou y avait-il à Trilport un garde du nom de C... ? Je l’ignorais, n’ayant aucun souvenir d’un pareil nom. J’interroge, quelque temps après, une vieille domestique, jadis au service de mon père et qui me conduisait souvent à Trilport. Je lui demande si elle se rappelle un individu du nom de C... ; elle répond aussitôt que c’était un garde du port de la Marne quand mon père construisait un pont. Très certainement, je l’avais su comme elle, mais le souvenir s’en était effacé. Le rêve, en l’évoquant, m’avait révélé ce que j’ignorais. »
Désirs et craintes s’avèrent générateurs de scènes oniriques. Ce que nous avons espéré ou redouté, pendant l’état de veille, devient le thème de rêves d’une interprétation parfois facile. Freud remarque que l’enfant réalise ainsi, en songe, les souhaits que le jour a fait naître et n’a pas satisfaits.
« Une petite fille de dix-neuf mois est tenue à la diète pendant un jour parce qu’elle a vomi le matin ; au dire de sa bonne, ce sont les fraises qui lui ont fait du mal. Dans la nuit qui suit ce jour de jeûne, elle prononce en rêve son nom, d’abord, puis : « Fraise..., tartine..., bouillie… » Donc, l’enfant rêve qu’elle mange, et voit dans son menu précisément les choses dont elle s’attend à être privée. Un enfant de vingt-deux mois voit de même, en rêve, un plaisir défendu : il avait dû, la veille, offrir à son oncle un petit panier de cerises dont on ne lui avait permis de manger qu’une seule. En s’éveillant le matin, il déclara, enchanté : « Herman a mangé toutes les cerises. » Une petite fille de trois ans et trois mois avait fait une promenade en bateau, promenade trop courte à son gré, car elle s’était mise à pleurer au moment de descendre. Le lendemain, elle raconta qu’elle avait vogué sur le lac pendant la nuit ; elle avait donc continué en rêve le divertissement interrompu. La crainte se traduit non moins que le désir dans les manifestations oniriques ; de nombreuses observations, recueillies par Foucault et par d’autres auteurs, le démontrent de façon incontestable. Chez l’adulte, c’est habituellement d’une manière plus indirecte et plus complexe que se réalise en songe ce qu’il a souhaité ou redouté pendant le jour.
En certains cas, le rêve prend un aspect prophétique, lorsqu’il manifeste des aspirations dont l’individu n’a pas encore une conscience claire, mais qui joueront un rôle essentiel dans l’orientation future de son existence. On en pourrait donner de nombreux exemples, pris parmi les songes merveilleux que rapportent les hagiographes. Malheureusement, pour ne pas froisser les préjugés religieux, les auteurs les plus compétents en cette matière évitent d’aborder ce sujet. Pendant plusieurs années, j’ai pris la peine de noter mes rêves, chaque matin ; j’ai dû constater que le calcul des probabilités suffisait pleinement à rendre compte des rares coïncidences pouvant faire croire à une prémonition. Vingt fois, par exemple, j’aurai reçu en songe la visite d’un ami éloigné que je n’attendais point ; une fois sur vingt, la visite effective le lendemain aura coïncidé avec l’un de ces rêves. Prémonition, diront les esprits superficiels ; pure coïncidence, avoueront ceux qui réfléchissent. Peut-être des phénomènes de lecture de pensée et de télépathie interviennent-ils, quelquefois, le cerveau étant plus apte, durant le sommeil, à capter ondes et vibrations d’origine encéphalique. Une nuit, j’ai rêvé que l’un de mes anciens élèves, perdu de vue depuis longtemps, tirait un coup de fusil sur mon chapeau ; et, le lendemain, je recevais de lui une lettre, d’ailleurs fort amicale. Même si l’on suppose une action télépathique, le surnaturel n’a rien à voir avec les phénomènes oniriques. À l’état d’incubation, la maladie encore insoupçonnée engendre aussi des rêves prophétiques. Une enfant, qui avait rêvé qu’on broyait sa tête dans un étau, fut, peu après, atteinte de méningite. Conrad Jenner se crut piqué par un serpent dans un endroit où un anthrax apparut ensuite. Ajoutons que l’homme superstitieux, persuadé qu’un songe lui présage un accident prochain, sera, parfois inconsciemment, sous l’empire d’une terreur secrète, le véritable auteur de l’accident ; c’est le cas pour des collisions d’automobiles qu’avec plus de sang-froid l’on pourrait éviter.
L’absence de tout esprit critique, une crédulité sans borne qui accorde la même valeur à toutes les images et n’exige aucune justification rationnelle, suffisent à expliquer l’incohérence et l’illogisme de la majorité des rêves. Alors que, dans l’état de veille, rien n’arrive sans cause et que les événements sont liés entre eux d’une manière intelligible, les combinaisons les plus contraires aux lois de la nature surviennent, en songe, sans que nous en soyons surpris. Et cette absence d’esprit critique résulte probablement du fait que le dormeur reste étranger à toute considération d’intérêt, n’ayant pas besoin d’aborder effectivement le domaine de l’action. Plusieurs estiment que l’exagération de l’émotivité constitue l’un des caractères essentiels du rêve. À l’appui de cette thèse, Vaschide apporte des exemples bien choisis. Beaucoup, pourtant, ne partagent pas cette opinion. P. Brunet écrit :
« Des faits contraires semblent bien infirmer, en partie, cette théorie, puisque bien souvent dans le rêve nous restons indifférents à des scènes qui, à l’état de veille, nous auraient violemment émus. Mais il ne faut pas oublier que l’émotion éprouvée en rêve est indépendante de son substrat hallucinatoire ; si bien qu’au réveil, en présence de notre impossibilité de réunir l’émotion et le substrat, nous interprétons comme de l’indifférence ce qui n’est, en réalité, qu’une réaction affective sans rapport normal avec l’élément représentatif. »
Quant aux procédés architectoniques qui, dans le rêve, permettent la transposition des idées en images, ils sont loin d’être encore parfaitement connus et pleinement expliqués, malgré les belles recherches de Freud. Non seulement la pensée abstraite est traduite en images concrètes, de préférence en images visuelles, mais une condensation des matériaux oniriques intervient qui résulte soit de l’élimination de certains éléments, soit de leur fragmentation, soit, et c’est le cas le plus fréquent, de leur fusion. Grâce au déplacement et au transfert de l’accent psychique, un élément voit quelquefois son importance croître démesurément. De plus, il semble qu’une activité agisse après coup sur le contenu du rêve, quand ses diverses parties ont pris leur forme symbolique. Freud déclare :
« Le travail du rêve consisterait alors à disposer ces symboles pour en faire un ensemble cohérent, une représentation bien ordonnée. Le rêve acquiert ainsi une sorte de façade, insuffisante à la vérité et qui n’en masque pas également toutes les parties ; mais, moyennant quelques raccords, quelques légères modifications, il reçoit une interprétation provisoire et tout à fait approximative. En somme, nous ne trouvons là qu’un brillant travestissement des idées latentes. »
Ce travail de regroupement aurait pour but de disposer les matériaux oniriques selon leurs meilleures chances d’intelligibilité.
Mais, aux yeux de Freud et de ses disciples, le symbolisme reste le plus important des procédés qu’utilise l’activité onirique. Les exigences de la censure, les habitudes morales et sociales contractées par l’adulte, obligent certains désirs à s’entourer de voiles pour se faire accepter. À côté de symboles généraux, identiques chez tous les songeurs de même langue et de même formation intellectuelle, il en est d’autres extrêmement variables d’un individu à l’autre. Et l’étude de cette symbolique nous amène à constater, selon Freud, que presque tous les rêves des adultes sont inspirés par des désirs érotiques.
« Les symboles employés par le rêve servent le plus souvent à recouvrir des personnes, des parties de corps ou des actes qui intéressent la sexualité ; les organes génitaux, en particulier, utilisent une collection de symboles bizarres, et les objets les plus variés entrent dans la composition de ces symboles. Or, nous admettons que des armes pointues, des objets longs et rigides, troncs d’arbres ou cannes, représentent l’organe masculin, tandis que les armoires, boîtes, voitures, poêles, remplacent, dans le rêve, l’organe féminin, parce que le motif de cette substitution est facile à comprendre ; mais tous les symboles de rêve ne renferment pas des allusions aussi transparentes, et quand on nous dit que la cravate est l’organe masculin, le bois le corps féminin, et que le mouvement ascendant, l’escalier, représente les relations sexuelles, nous demandons à réfléchir, tant que la preuve de l’authenticité de ces symboles n’a pas été faite, d’autre part. Ajoutons ici que la plupart des symboles de rêve sont bisexuels et peuvent, selon les circonstances, être rapportés aux organes des deux sexes. »
Ainsi, le fondateur de la psychanalyse lui-même a jugé aventureuse et peu probante l’interprétation des symboles oniriques donnée par certains de ses disciples. Nous allons plus loin et, sans méconnaître l’importance de la sexualité en matière de rêve, nous estimons que Freud exagère considérablement cette importance. Il tombe dans l’erreur commune à tous les créateurs de système qui généralisent, indûment, des constatations vraies dans quelques cas particuliers. S’il est un domaine où la notion de relativité s’impose avec une force particulière, c’est incontestablement lorsqu’il s’agit des rêves.
Terminons en disant que l’on a rapproché l’inspiration artistique du rêve proprement dit. Freud écrit :
« Les poètes et romanciers sont de précieux alliés, et leur témoignage doit être estimé très haut, car ils connaissent entre ciel et terre, bien des choses que notre sagesse scolaire ne saurait encore rêver. Ils sont, dans la connaissance de l’âme, nos maîtres à nous, hommes vulgaires, car ils s’abreuvent à des sources que nous n’avons pas encore rendues accessibles à la science. Que le poète ne s’est-il prononcé plus nettement encore en faveur de la nature, pleine de sens, des rêves ! »
Mais d’autres estiment que l’état de sommeil, l’absence de volonté et de réflexion ne conviennent pas du tout à la création poétique. Paul Valéry déclare :
« La véritable condition du poète est ce qu’il y a de plus distinct de l’état de rêve. Je n’y vois que recherches volontaires, assouplissement de pensées, consentement à des gênes exquises. Celui-là qui veut écrire son rêve se doit d’être infiniment éveillé. Si tu veux imiter assez exactement les bizarreries, les infidélités à soi-même du faible dormeur que tu viens d’être, poursuivre dans ta profondeur cette chute passive de l’âme comme une feuille morte à travers l’immensité vague de la mémoire, ne te flatte pas d’y réussir sans une attention poussée à l’extrême, dont le chef-d’œuvre sera de surprendre ce qui n’existe qu’à ses dépens. »
Ces deux opinions contiennent, également, une part de vérité, à mon avis. Dans la rêverie de l’artiste et du poète, comme dans le rêve proprement dit, l’inconscient joue un rôle de première importance. Mais la création esthétique exige de plus l’exercice des facultés critiques, un choix conforme à la raison. Pour obtenir une œuvre belle, il faut que l’intelligibilité se surajoute aux fantaisies de l’imaginative.
— L. BARBEDETTE
RÊVE
Le cerveau emmagasine des images sensorielles. Il ne réagit pas à chacune d’elles. Il faut que l’excitant dépasse un certain seuil pour qu’il y ait une réponse motrice ; autrement dit : pour que le cerveau réagisse par un geste quelconque. Nos cellules cérébrales sont toujours en activité, comme les cellules musculaires, ou, si l’on préfère, en état de tonicité, ce qui ne veut pas dire en état de travail. La vie cérébrale au ralenti, quand elle n’est pas aiguillonnée par un excitant suffisant, se traduit par le rêve, qui en est, en somme, l’état permanent, sauf pendant les périodes d’activité. Rêve pendant le sommeil, c’est-à-dire succession d’images enregistrées dans la mémoire inconsciente et se succédant sans contrôle, sans ordre logique. Rêve à l’état de veille, où la succession des images est davantage soumise aux inhibitions cérébrales et au contrôle de la conscience. Aussi faisons-nous à l’état de veille des rêves cohérents. Les études freudiennes ont servi à montrer que chacun de nous rêve à l’état de veille : rêves héroïques, sentimentaux, aventureux, romantiques, rêves de richesse, rêves érotiques, mystiques, idéalistes, etc., où l’amour-propre, plutôt que le sexualisme, quoi qu’en pensent les freudiens, joue d’ordinaire le premier rôle. On rêve quand on ne fait rien, mais la vie moderne nous prend de toute part, et, si l’on rêve, c’est le plus souvent à ses affaires, à son travail, à des projets multiples. Pourtant, le rêve est favorisé par le besoin d’échapper à la dure réalité, à une situation d’infériorité. C’est un moyen d’évasion qui a dû surtout être employé autrefois où l’infériorité sociale était encore plus pénible qu’aujourd’hui où l’on a moins de temps à soi à cause de la rapidité et de la précision des occupations. Les rêves de bonheur dans une vie future imaginaire assurèrent le triomphe des religions mystiques parmi les femmes et les esclaves, parmi tous les pauvres gens, à une époque où personne ne pouvait plus participer d’une façon active à la vie indépendante des tribus, des cités et des nations, anéanties par l’empire. On comprend aussi la vogue des contes et des romans qui donnent un aliment à nos rêves – chansons primitives ou contes des veillées où l’imagination l’emporte sur la logique ; poésies chantées, colportées par les aèdes, les rapsodes, les troubadours, les trouvères, etc. – et le rôle important de la musique chez les populations asservies (nègres des États-Unis, moujiks de l’ancien empire des tsars) ; enfin, l’usage universel des boissons alcoolisées et le refuge des plus misérables dans l’ivrognerie.
Si l’on remonte encore plus haut, on s’aperçoit que, chez les primitifs, le rêve se mélange à la réalité, sans qu’il y ait de distinction possible, ce qui explique « la mentalité prélogique » dont parle Lévy-Bruhl, et leur goût du merveilleux. Ils sont incapables de faire la distinction, puisque incapables (et non habitués) de donner une explication rationnelle à la plupart des phénomènes et que leur explication imaginaire ne peut pas être réduite par leur propre raisonnement, ni par celui des autres membres du groupe. Le rêve est même souvent collectif et peut aller jusqu’à l’hallucination.
Chez les enfants, le rêve tient aussi une place importante. Plus l’enfant est jeune, moins il distingue entre son imagination et le réel, il prête une existence à son cheval de bois ou à sa poupée, il imagine un monde artificiel qui, peu à peu, s’évanouit à mesure que l’éducation et le développement de l’intelligence remettent le rêve à sa place et à sa valeur. Pourtant, un certain nombre d’adultes, et principalement des femmes peut-être plus émotives et peut-être à cause d’une éducation plus rudimentaire et mystique et à cause de leur infériorité sociale, restent au stade imaginatif et n’arrivent pas à séparer leurs créations imaginaires de la vie réelle. Ils se prennent à leurs propres mirages. On les appelle des mythomanes, et, comme les rêves sexuels prennent une grande place dans leur imagination, on les range sous la rubrique vague d’hystériques, y compris pithiatiques et obsédés sexuels. Les uns et les autres, comme aussi les primitifs, ont comme caractéristique un manque de développement des coordinations inhibitrices. Les mythomanes sont des primitifs attardés, ils sont mal adaptés à la civilisation moderne. Pourtant, cette adaptation peut se faire plus ou moins bien, surtout avec l’aide d’une éducation exacte qui, de bonne heure, les aide à réfréner leur vanité.
Les jeunes gens se réfugient souvent dans un monde à part créé par leurs rêves. C’est au moment de la puberté, au moment où ils abordent la vie, une vie quelquefois hostile et brutale, au moment aussi où naissent les aspirations sexuelles. Tous les adolescents sont plus ou moins schizoïdes. Les grands émotifs, timides et asthéniques, répugnent à l’action et peuvent s’enfoncer profondément dans cet état ; quelques-uns, des malades, y rester. Mais ces rêveurs font très bien la distinction entre le réel et leur rêve, tandis que les mythomanes ne le font qu’imparfaitement. Le rêveur éveillé recherche la solitude. La compagnie d’une autre personne l’oblige à revenir à la réalité, ce qui n’est le cas ni pour le primitif, ni pour le jeune enfant, ni pour le mythomane.
J’ai laissé de côté le rêve intellectuel. Ce n’est pas ce qu’il y a de moins intéressant que de laisser son esprit vagabonder en liberté sur un sujet d’étude. Les idées se succèdent par associations sans lien logique, et il arrive qu’on puisse accrocher au passage soit de multiples aspects de la question, soit une hypothèse qu’il ne reste plus qu’à contrôler, autant qu’il est possible. Des philosophes modernes ont appelé cette divagation une intuition, mais ce mot n’apporte aucune valeur nouvelle.
Le rêve, sous forme de méditation, est donc à la base du processus scientifique, comme il est à la base des réflexions philosophiques. Rêver pour réfléchir.
Mais rêver pour ne rien faire n’aboutit à rien. Se satisfaire du rêve et avoir la naïveté ou l’outrecuidance d’affirmer qu’il renferme la vraie sagesse et la connaissance de l’univers, exalter les civilisations orientales au-dessus de la civilisation occidentale et de son effort scientifique, c’est un pauvre paradoxe qui nous ramène à la mystique religieuse. Il n’en est pas moins vrai que dans le travail trépidant imposé par la société capitaliste, ce qui manque ce sont les loisirs. La crise apporte le chômage, mais ce n’est pas la même chose.
— M. PIERROT.
RÉVÉLATION
n. f.
Dans le langage ordinaire, le mot révélation désigne la découverte, souvent brusque, d’une chose tenue jusque-là cachée. À la tribune du parlement, devant les tribunaux, dans la presse, on parle volontiers de révélations sensationnelles. Parfois longtemps préparées à l’avance, et adroitement machinées par les professionnels du trompe-l’œil, ces dernières sont destinées à empêcher le public de prêter attention à des faits beaucoup plus graves, qui jetteraient un jour sinistre sur les secrets agissements des autorités. À une époque tragique, Landru rendit de fiers services à nos grands chefs aux abois ; quand la presse a pour mot d’ordre de laisser en paix le gouvernement, la police découvre toujours de sanglantes ou mystérieuses affaires, des drames d’amour ou de jalousie qui servent de pâture aux lecteurs des journaux. Ajoutons que les révélations en apparence les plus spontanées, faites à la tribune du Palais Bourbon, sont soigneusement évidées au préalable de tout ce qui ruinerait définitivement le prestige des principaux manitous de l’époque. On cite des comparses, on pourfend des ombres, et les menaces pleuvent dru sur les coupables dont l’identité reste à découvrir ; mais on ne dit rien ou presque rien des gros personnages que l’on sait effectivement compromis.
Dans l’affaire des fraudeurs de la banque commerciale de Bâle, le député socialiste qui dénonçait ce scandale s’abstint de parler du plus célèbre et du plus influent des individus inscrits sur la liste saisie. C’était l’archevêque académicien Baudrillart, grand ami de Poincaré et professionnel du patriotisme, l’un de ceux qui préparèrent l’opinion à la guerre de 1914 et qui n’ont cessé, depuis, de donner des ordres impérieux aux divers ministres réactionnaires. Le même député socialiste n’hésitait point à nommer l’évêque d’Orléans, simple brochet pourtant à côté du requin Baudrillart. Et pas un grand journal soi-disant avancé n’imprima, plus tard, le nom du recteur de l’Institut catholique de Paris ; ce n’était pas ignorance de leur part, puisque, désireux de connaître leur degré de sincérité, je fis parvenir à tous une note rétablissant la vérité. Radicaux et socialistes n’ont pas voulu entraver la brillante carrière de ce chef occulte des partis réactionnaires français. Si, par une exception rarissime, des parlementaires ont l’audace de faire des révélations réellement gênantes pour les maîtres de l’heure, la grande presse, tout entière aux mains de quelques potentats, organise le silence autour des vérités qu’ils ont pu dire. Témoin le peu de retentissement obtenu par les déclarations que Barthe fit à la Chambre, sur les accords conclus avant guerre entre Krupp et notre Comité des forges, ainsi que sur les moyens mis en œuvre par la grosse industrie française, afin d’empêcher une défaite trop rapide de l’Allemagne.
Même dans l’ordre littéraire ou artistique, c’est pour des raisons qui n’ont, d’ordinaire, rien à voir avec le talent que les critiques en renom découvrent de prétendus chefs-d’œuvre, qu’ils louent servilement dans les revues puissantes ou les journaux à grand tirage. Domestiqués par des industriels cossus, exclusivement dévoués aux prêtres de Mammon, ces larbins de la plume n’aiment et n’adorent que les idoles dorées. Ils s’agenouillent, puis brinqueballent leurs encensoirs prestement devant les vedettes dont les managers passent à la caisse. Si l’on veut des super éloges et un bruit capable d’étouffer toute note discordante, il faut y mettre le prix. On sait à quels scandales aboutissent les distributions de lauriers littéraires ou artistiques ! Simple appareil automatique, la renommée aux cent bouches reste à la disposition de quiconque est assez riche pour financer largement. Les brusques révélations de génies inconnus, faites par l’académie Goncourt, par l’Académie française, par les publications à la solde des éditeurs ou des marchands de tableaux, sont dictées par des motifs inavouables habituellement. Elles ne valent pas mieux que les révélations politiques et, comme ces dernières, se rattachent à d’occultes et louches combinaisons.
Quelques scandales récents jettent aussi une lumière assez crue sur les dessous du monde journalistique. Rappelons la mésaventure survenue, le 30 janvier 1933, au directeur du Temps, Chastenet, ainsi qu’au professeur Joseph Barthélémy, administrateur du même journal. Sous l’égide de la Nouvelle école de la paix, ces pantins faisaient une conférence sur « la presse et la formation de l’opinion publique ». Le premier, ancien directeur de banque, placé à la tête du plus grand journal de la République par la grâce de MM. de Wendel et de Peyerimoff, s’indigna contre la presse trop servile à son gré et loua l’indépendance du Temps. Mais des auditeurs bien renseignés posèrent des questions très précises sur les rapports que ce dernier journal entretient avec le Comité des forges, le Comité des houillères et le Comité des assurances. Et l’on apprit que le Temps était la propriété de ces puissantes organisations capitalistes, que l’ancien banquier Chastenet, que Barthélémy, le clown pontifiant de la faculté de droit, n’étaient que les serviteurs appointés des magnats de l’industrie. Malheureusement, bien des révélations ont déjà été faites sur la vénalité, la corruption, la servilité éhontée de la presse, sans que le public repousse les feuilles immondes et mensongères qu’on lui fournit quotidiennement. Il est vrai qu’à aucune époque l’intoxication méthodique des cerveaux n’y fut organisée sur une aussi large échelle, et d’une manière aussi savante, qu’à l’heure actuelle.
Au point de vue religieux, la révélation consiste dans la communication faite aux hommes, par dieu ou par l’un de ses envoyés, de vérités qui présentent, dès lors, un caractère de certitude absolue, si obscures qu’elles puissent paraître à notre entendement. Sur la question vitale de notre destinée, sur l’existence qui nous attend après la mort, sur l’ensemble des problèmes que la métaphysique pose sans parvenir à les résoudre, la révélation apporterait des lumières éclatantes, au dire des croyants. Elle nous renseignerait sur les incompréhensibles qualités d’un dieu dont la nature échappe à notre raison comme il nos sens, et sur les mystères d’un avenir que l’être omniscient connaît d’avance, même s’il dépend du libre vouloir humain. Un autre procédé de communication entre le tout-puissant et les hommes consiste dans l’inspiration, secours divin qui pousse l’auteur à écrire et le garantit contre toute erreur essentielle. L’assistance du Saint-Esprit, qui permet au pape d’énoncer des sentences dogmatiques où morales infaillibles, présente, d’après les théologiens catholiques, un caractère purement négatif. Révélation, inspiration, assistance du Saint-Esprit sont, à nos yeux, il n’est pas besoin de le dire, également dépourvues de valeur : de pareilles balivernes ne méritent point d’être prises au sérieux. Nous ne répéterons pas ici ce que nous avons déjà exposé à l’article Religion (voir ce mot) ; mais puisque le catholicisme admet que, de nos jours encore, Jésus, Marie ou d’autres habitants du ciel se manifestent parfois à des âmes privilégiées, nous examinerons quelques-unes des révélations célestes dont furent favorisés des dévots contemporains. Par une singulière ironie du sort, j’ai d’ailleurs rencontré sur ma route d’illustres et nombreux visionnaires.
Le 17 janvier 1871, les deux plus jeunes fils du fermier Barbedette, ainsi que d’autres enfants, virent la Vierge Marie, à Pontmain, une bourgade de la Mayenne. Vêtue d’une robe bleue parsemée d’étoiles, l’apparition se tenait en l’air au-dessus de la maison d’un débitant ; il faisait nuit, le ciel était limpide, et tous les fidèles de Pontmain se réunirent sous la conduite du curé pendant la durée du miracle. Cette vision fut reconnue divine par les autorités ecclésiastiques ; une grandiose basilique fut construite sur le lieu de l’apparition ; et les catholiques y viennent en pèlerinage de toute la région de l’Ouest. Inutile d’ajouter que nonnes et curés y pullulent, exploitant, selon leur coutume, la sottise des dévots. Les Barbedette sont nombreux dans la contrée, et j’ignore si j’étais parent avec ceux de Pontmain, mais j’étais reçu chez eux comme un membre de la famille ; j’ai connu et interrogé personnellement les visionnaires. Certes, je n’étais pas encore habitué aux recherches psychologiques ; toutefois, maints détails entendus de leur bouche m’ont, depuis, permis de conclure que, poussés aux dernières limites de l’exaltation religieuse par le curé de l’endroit, les enfants Barbedette furent victimes d’une hallucination. Dans l’intimité, ils avouaient qu’à leur avis les autorités ecclésiastiques avaient approuvé leur vision sans y croire ; et ils racontaient qu’une petite fille encore au berceau, et qui aurait contemplé la madone elle aussi, déclarait, quand elle fut grande, ne se souvenir de rien. Comme ils étaient prêtres tous deux, et que le clergé avait fait de grandes largesses à leurs parents, ils se gardaient de dire leur pensée complète à l’adolescent que j’étais. Ils auraient moins parlé encore s’ils avaient pu deviner que je deviendrais, plus tard, un incroyant notoire. À Pontmain, la Vierge annonçait la fin des hostilités : maigre prophétie, on en conviendra, puisque la défaite française était alors consommée.
Au moment où la dernière guerre battait son plein, une jeune fille de Loublande, commune des Deux-Sèvres, reçut presque quotidiennement la visite du Sacré-Cœur. Sans en avoir officiellement le titre, je remplissais, en fait, les fonctions de chef de laboratoire à la faculté des sciences de Poitiers, cette année-là. Et comme Loublande fait partie du diocèse de Poitiers, ce furent les autorités de cette ville qui s’occupèrent de la visionnaire. J’étais donc bien placé pour étudier cette nouvelle révélation, qui ne fut rejetée par la curie romaine qu’après l’intervention énergique des cardinaux allemands et autrichiens. Jésus déclarait à la voyante que la victoire des alliés serait foudroyante et irrésistible, si ministres et généraux acceptaient de mettre l’emblème du Sacré-Cœur sur le drapeau français. L’évêque de Poitiers, un prélat politicien d’une sottise insigne, se déclara convaincu de bonne heure, car la visionnaire l’assurait qu’il devait jouer un rôle de premier plan dans l’Église. À l’appui de ses dires, elle obtint même du ciel qu’Humbrech, c’était le nom de cet imbécile, assiste un jour à la transformation du vin, contenu dans un calice, en un liquide sanguinolent. Il permit de célébrer des fêtes à Loublande, d’imprimer des images et des prières en l’honneur du nouveau culte, et laissa s’installer une congrégation dirigée par la visionnaire, les Victimes du Sacré-Cœur, qui compta bientôt parmi ses membres des filles de multimillionnaires. Le cardinal archevêque de Bordeaux et l’archevêque de Tours estimèrent, eux aussi, qu’il s’agissait d’une révélation vraiment divine ; les feuilles pieuses de la contrée firent un battage insensé ; la presse de Paris s’émut, et de longs articles furent consacrés aux apparitions de Loublande par les grands quotidiens.
Sénateurs et députés réactionnaires du Poitou prirent au sérieux les divagations de cette nouvelle Jeanne d’Arc, c’était le titre que lui donnaient les familiers de l’évêché. Elle fut présentée au président de la République, Poincaré, qui lui fit don d’une épingle à chapeau, sa coiffure étant tombée par mégarde durant leur entretien. À l’armée, des insignes du Sacré-Coeur étaient distribués à profusion aux soldats, et nombre de généraux les arboraient fièrement. Mais les prélats d’Autriche et d’Allemagne firent comprendre au pape que Jésus ne pouvait nourrir de si noirs desseins contre les empires centraux, et que la France anticléricale ne méritait pas un traitement privilégié. On les crut d’autant plus facilement à Rome que le supérieur des Jésuites était germanophile et qu’il contraignit le cardinal Billot, membre de son institut, à écrire contre une révélation nettement hostile à l’Allemagne. Malgré les merveilles déjà accomplies, les apparitions de Loublande furent condamnées par le Vatican. Une enquête personnelle, faite dans l’entourage de la visionnaire, m’avait convaincu qu’il s’agissait d’une pauvre fille au cerveau troublé par des jeûnes trop fréquents et la lecture de sainte Thérèse. Son confesseur, un prêtre qui voulait se procurer beaucoup d’argent, était le principal coupable ; il pensait parvenir à ses fins en créant un centre de pèlerinage ; l’affaire de Loublande liquidée, il se trouva, d’ailleurs, suffisamment nanti pour vivre d’une façon cossue.
Voici quelques années, la Vierge apparut à Ferdrupt, dans les Vosges, à une petite fille dont les parents étaient cultivateurs. Des alentours, on venait déjà en pèlerinage, quand la voyante eut la malencontreuse idée de promettre qu’à une date, par elle indiquée, l’apparition serait visible pour l’ensemble des personnes présentes. Ce jour-là, une foule immense se pressait sur le lieu du miracle ; mais la madone ne fut aperçue par personne. Pour comble, la visionnaire expliqua que la Vierge s’était trompée en raison du changement d’heure qui s’effectuait à cette époque. Ce fut un éclat de rire général, et le clergé laissa prudemment tomber cette affaire. Une statue s’élève cependant sur le lieu de l’apparition, conformément à la demande formulée par la mère de dieu ; et la famille de la jeune fille, très pauvre auparavant, est fort à l’aise aujourd’hui. Comme Luxeuil n’est qu’à environ 25 kilomètres de Ferdrupt, j’ai pu me documenter sans peine sur ces événements. La voyante, enfant naïve et sotte, semblait prédisposée par nature aux images eidétiques ; néanmoins, le curé de l’endroit avait joué un rôle très actif, en persuadant cette petite que les visions célestes sont choses assez fréquentes.
À l’heure actuelle, on parle beaucoup des apparitions de Beauraing, en Belgique, qui eurent lieu du 29 novembre 1932 au 3 janvier 1933. Cinq enfants auraient vu la Vierge dans le jardin des sœurs de la localité ; et cette dernière leur aurait demandé de faire construire une chapelle. Je ne connais ces événements que par des comptes rendus, articles et brochures. Le travail du docteur Maistriaux, qui écrit pour se « rendre utile à l’Église et à la religion, afin d’éviter les mécomptes du ridicule », suffit pour me démontrer que les apparitions de Beauraing ont des causes très humaines, trop humaines, hélas ! Ce médecin grotesque, d’une prodigieuse ignorance concernant les recherches de psychologie expérimentale, fournit de nombreux détails qui contredisent la thèse de l’intervention surnaturelle. Les voyants avaient promis un miracle pour le 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception ; aucun miracle ne s’est produit, ni ce jour-là, ni les jours suivants. Néanmoins, par respect humain sans doute, les parents se déclarent certains de la véracité de leurs rejetons ; « il ne ferait pas bon d’avoir l’air de rire et de se moquer : l’accueil serait foudroyant ». Et le docteur Maistriaux demande aux incroyants de s’abstenir de toute plaisanterie :
« Le scepticisme absolu et surtout la raillerie ne sont plus de mise pour le moment. S’il est question d’âmes de petits enfants, on leur doit le respect le plus absolu... De grâce, respectons-les et attendons. Respectons le mystère qui plane sur ces événements dans lesquels sont mêlés des enfants sains de familles respectables. »
S’il ne s’agissait pas d’une comédie dévote ou d’hallucinations religieuses, notre auteur tiendrait un langage très différent. Il avoue, d’ailleurs, que les événements de Beauraing peuvent avoir des répercussions politiques qui l’intéressent particulièrement :
« Serait-il impossible que la sainte Vierge se soit manifestée pour approuver et intensifier cette pieuse et réconfortante croisade de notre fière jeunesse ouvrière chrétienne, de notre virile jeunesse agricole catholique, de tous nos jeunes gens et jeunes filles librement et ardemment enrôlés sous l’emblème de la croix ? Est-il déraisonnable d’espérer qu’elle ait choisi pour être témoin d’un renouveau religieux notre patrie qui fut la première à mettre son nom dans les annales de l’Action catholique ? »
Le docteur Maistriaux a raison, les manifestations surnaturelles, les révélations divines restent, d’ordinaire, incompréhensibles, tant qu’on ne fait pas intervenir les considérations politiques et l’intérêt sacerdotal. À Beauraing, comme dans maintes apparitions précédentes, la Vierge se préoccupe d’assurer aux prêtres une nouvelle source de profits et d’accroître l’influence politique du parti des sacristains.
— L. BARBEDETTE.
RÉVOLTANT
Qui révolte, qui cause de l’indignation : Des abus révoltants. Pour nous, il n’est guère facile d’énumérer ici tout ce qui est révoltant : il y en a trop. En effet, n’est-il pas révoltant de subir tout ce que l’on ne peut empêcher ? Mais n’est-il pas, peut-être, plus révoltant de voir avec quelle résignation, quelle soumission la multitude l’accepte, quand elle ne l’approuve pas ? N’est-il pas révoltant qu’il y ait toujours des riches et des pauvres ; des exploiteurs et des exploités ; des spoliateurs et des spoliés ; des maîtres et des esclaves ; des dupeurs et des dupés ; des voleurs et des volés ; des chefs et des supérieurs qui commandent et qui exigent et des simples qui obéissent et exécutent, des inférieurs qui respectent et se soumettent ; des juges qui condamnent ; des condamnés qui souffrent et se résignent ; des bourreaux et des victimes ; des législateurs élus qui font des lois et des électeurs qui élisent et qui subissent toujours les lois et leurs effets nocifs, mais ne profitent jamais des lois qui — leur avait-on promis — devaient les avantager ?
Il est trop tard quand l’électeur naïf s’aperçoit qu’il est berné et qu’il n’y a pas de bonnes lois... Y en eût-il qu’elles ne seraient ni appliquées, ni applicables. La loi n’est valable qu’autant qu’elle vient ratifier la chose acquise. Et le Peuple n’a jamais eu que ce qu’il avait su prendre. Ce qui justifie fort bien que le bulletin de vote n’est rien autre que ce que vaut l’électeur. Et celui-ci ne peut être grand-chose s’il ne sait s’organiser pour obtenir, en cohésion avec ceux qui ont les mêmes besoins, ce que nul mandataire ne peut lui apporter, avant qu’il ne l’ait lui-même arraché, imposé par la menace ou par l’action directe. En ce cas, il faut être stupidement aveugle pour ne pas voir et comprendre la vaste duperie du Suffrage Universel et la farce cynique par laquelle, en régime bourgeois, libéral et démocratique même, on escamote la Souveraineté du Peuple.
Duperie immonde et révoltante !
La possibilité, à chaque moment, pour un citoyen prétendu libre, après avoir subi la conscription, la caserne et toutes les atrocités inénarrables, atrocités morales du militarisme, d’être désigné pour faire partie des troupeaux envoyés au massacre, pour être massacreur malgré soi et massacré selon les grandes chances dont jouissent les malheureux qui sont chair à canon. C’est là, je crois, une perspective digne, admirable, héroïque pour ceux qui n’y vont pas, pour ceux à qui la guerre apporte gloire et bénéfices, mais révoltante pour tous ceux qui la subissent et qui se rendent compte de quel abrutissement et de quelle passivité ils sont nantis pour ne pas se révolter !
Révoltante pour la conscience, pour le cerveau, pour le cœur de l’homme, est l’Idée de Patrie par laquelle on obtient cet infâme assujettissement des hommes les plus jeunes, des plus beaux, des plus forts, des meilleurs producteurs et reproducteurs, tout l’avenir d’une nation, qui se laisse ainsi mener à l’abattoir sans résistance, sans remords, sans révolte !
Révoltant tout ce qui constitue, fortifie, soutient un régime ignoble basé sur l’égoïsme des uns et la résignation des autres ! Révoltante la prostitution des consciences, des talents, des caractères, des forces humaines au service de la bourgeoisie et de l’exploitation de l’homme par l’homme.
En un mot, révoltant tout ce qui est immonde sur la terre et que les préjugés respectent, entretiennent, conservent, fortifient. Révoltant il est que la Religion (c’est-à-dire l’ignorance, la soumission, la fourberie, l’hypocrisie) soit si puissante encore et que le Militarisme, le Patriotisme n’aient pas été tués par la Guerre et tout ce qu’en ont souffert ceux qui n’en ont pas profité ! Révoltante est l’Humanité que la honte n’étouffe pas. Il est révoltant de penser que c’est la Guerre, encore, que la Paix des gouvernants prépare !
— G. YVETOT.
RÉVOLTE
n. f. (du latin revolvere, retourner ; de l’italien rivolta, de re ou ri, et volta, faire volte-face, c’est-à-dire tourner la face contre)
Il semble que le sens le plus ordinaire de révolte soit de faire volte-face ; mais pour nous, anarchistes, révolte n’a pas ce sens commun. Il signifie soulèvement contre un état de choses existant, lutte contre l’ambiance, contre la stabilisation d’un régime, révolte contre la loi, contre l’autorité établie. Par là, il marque une volonté humaine, en marche vers la réalisation d’un idéal. La révolte est un acte d’intelligence, qui naît et se développe avec le sentiment de la personnalité ; elle est la concrétion de l’évolution d’une individualité qui prend conscience d’elle-même en s’insurgeant contre l’oppression collective des majorités qui veulent imposer leur façon de voir et de penser. Mais le mot révolte a également un sens social. C’est pourquoi, à certaines époques, elle devient nécessaire.
Lorsque des idées nouvelles germent et sont véhiculées un peu partout, cherchant à se faire jour de ci, de là, elles se heurtent toujours à la routine du milieu. Continuellement, elles sont arrêtées par ceux qui ont intérêt à ne point les voir se propager, et l’indifférence du plus grand nombre fait que ces idées nouvelles sont ballottées de droite à gauche, durant tout un temps, avant d’avoir droit de cité dans la conversation, les écrits, ou les diverses manifestations de la pensée humaine. Cette force d’inertie, il faut la vaincre ; ce n’est pas toujours facile ; à la révolte de l’esprit vient s’adjoindre l’action. À ce moment, la révolte s’impose comme une libération attendue et désirée ; elle éclate, et c’est heureux, car un danger plus grand guettait la société, danger que l’on peut comparer au nirvana des Hindous, qui aurait pour conséquence de conduire la société vers une dissolution de l’être. Dans leur évolution, la vie des sociétés draine avec elle des scories dont il faut se débarrasser ; manquer de prévoyance, ou tarder à le faire, opposer une barrière systématique à leur évacuation, c’est rendre cette société inhabitable. En effet, si le code de moralité en vigueur jusqu’alors est devenu caduque, si ce qui semblait équitable se révèle d’une injustice criante, l’atmosphère qui se dégage de cet état de choses ne peut durer ; une action se dessine : nous sommes au seuil d’une révolte. Des époques de crise sont propices à l’éclosion de ces sentiments de révolte ; elles créent l’état d’esprit nécessaire et préparatoire à la révolte. Ce sont des situations révolutionnaires. Alors, nous voyons les résignés d’hier, qui semblaient être à jamais courbés sous le joug oppresseur de la misère qui les terrassait, s’insurger brusquement, et se déterminer à l’action. L’audace naît en eux, et, avec elle, l’esprit de révolte. On comprend qu’il ne s’agit pas, alors, de réduire, d’atténuer cet esprit de révolte, mais de tenter l’impossible pour en améliorer les manifestations, c’est-à-dire rendre cette révolte plus efficace, plus consciente, et faire naître des sentiments de lutte pour un but précis. C’est là une tâche que se doivent de réaliser tous ceux qui se réclament de l’idéal anarchiste.
P. Kropotkine, dans Paroles d’un révolté, au chapitre intitulé « L’esprit de révolte », a analysé le processus historique de la révolte, prélude indispensable pour qu’une situation révolutionnaire aboutisse à un changement radical des engrenages de la société capitaliste actuelle :
« Aux époques de course effrénée vers l’affranchissement, de spéculations fiévreuses et de crises, de ruine subite de grandes industries, et d’épanouissement éphémère d’autres branches de la production, de fortunes scandaleuses, amassées en quelques années et dissipées de même, on conçoit que les institutions économiques, présidant à la production et l’échange, soient loin de donner à la société le bien-être qu’elles sont sensées lui garantir ; elles amènent précisément un résultat contraire : au lieu de l’ordre, elles engendrent le chaos ; au lieu du bien-être, la misère, l’insécurité du lendemain ; au lieu de l’harmonie, la guerre, une guerre perpétuelle de l’exploiteur contre le producteur, des exploiteurs et des producteurs entre eux. On voit la société se scinder de plus en plus en deux camps hostiles et se subdiviser, en même temps, en milliers de petits groupes, se faisant une guerre acharnée. Lasse de ces guerres, lasse des misères qu’elles engendrent, la société se lance à la recherche d’une nouvelle organisation ; elle demande à grands cris un remaniement complet du régime de la propriété, de la production, de l’échange, et de toutes les relations économiques qui en découlent. La machine gouvernementale, chargée de maintenir l’ordre existant, fonctionne encore, mais, à chaque tour de ses rouages détraqués, elle se bute... et s’arrête ; son fonctionnement devient de plus en plus difficile, et le mécontentement excité par ses défauts, va toujours croissant. Chaque jour fait surgir de nouvelles exigences. « Réformez ceci, réformez cela », crie-t-on de tous côtés. « Guerre, finance, impôts, tribunaux, police, tout est à remanier, à réorganiser, à établir sur de nouvelles bases », disent les réformateurs. Et, cependant, tous comprennent qu’il est impossible de refaire, de remanier quoi que ce soit, puisque tout se tient ; tout serait à refaire à la fois. Et comment refaire, lorsque la société est divisée en deux camps ouvertement hostiles ? Satisfaire des mécontents serait en créer de nouveaux. Incapables de se lancer dans la voie des réformes, puisque ce serait s’engager dans la voie de la révolution. En même temps trop impuissants pour se jeter avec franchise dans la réaction, les gouvernements s’appliquent aux demi mesures, qui ne peuvent satisfaire personne, et ne font que susciter de nouveaux mécontentements. Les médiocrités qui se chargent, à ces époques transitoires, de mener la barque gouvernementale, ne songent plus d’ailleurs qu’à une seule chose : s’enrichir, en prévision de la débâcle prochaine. Attaqués de tous côtés, ils se défendent, maladroitement ; ils louvoient, ils font sottise sur sottise, et ils réussissent bientôt à trancher la dernière corde du salut : ils noient le prestige gouvernemental dans le ridicule de leur incapacité. À ces époques, la révolution s’impose ; elle devient une nécessité sociale, la situation est une situation révolutionnaire. »
Mais il s’agit moins de parler ici de révolution que d’esprit de révolte, et de montrer le rôle important que joue cet esprit dans les grandes secousses révolutionnaires qui sont, en quelque sorte, les préludes des révolutions.
« Comment a-t-on aboli l’esclavage archique ? Par les révoltes. Comment a-t-on supprimé le servage ? Encore par les révoltes. Comment fera-t-on disparaître le salariat, qui est la dernière forme de l’esclavage ? Toujours par la révolte. La révolte est une chose fatale engendrée par l’oppression, comme l’explosion d’une chaudière est engendrée par la trop grande pression. Cependant, ce n’est ni par haine, ni par vengeance que nous nous révoltons : c’est par nécessité. La société actuelle ne nous reconnaît aucun droit au bien-être. Malgré les apparences trompeuses des libertés politiques, elle fait de nous des êtres inférieurs et misérables. Donc, nous sommes en état de légitime défense, nous accomplissons le plus sacré des devoirs en nous insurgeant contre elle. » (Brochure éditée à Genève, Les anarchistes et ce qu’ils veulent.)
Pour parer à l’absence ou à la carence de l’esprit de révolte, qui n’est pas toujours suffisamment éveillé dans les masses, lorsque se produisent des manifestations ou mouvements sociaux, un facteur entre en jeu : l’action et, suppléant à ce manquement, elle travaille à ce que ces émeutes ou ces soulèvements se développent et augmentent d’intensité. C’est ici que le rôle des minorités se précise en vue de réveiller le souffle d’audace ou le sentiment d’indépendance qui peuvent conduire les peuples à accomplir leur révolution. La valeur de la révolte a donc une importance capitale dans les périodes préparatoires à la révolution ; il serait puéril de le contester ; valeur collective en prévision d’une lutte sociale, pour une transformation du régime ; valeur individuelle dans l’état présent des choses, car, ici, comme là, nous trouvons l’affirmation d’une puissance créatrice et destructrice nécessaire à l’évolution des sociétés. La révolte a cela de sain qu’elle balaye les institutions périmées qui entravent le progrès humain. Guidée par un idéal de mieux-être et de liberté, la révolte devient créatrice de beauté, de force, d’amour. L’individu qui se révolte affirme un caractère, et ce n’est pas peu de chose, en cette époque de résignation. Cultiver cet esprit de révolte paraît fondamental, car on aidera ainsi puissamment l’individu à se ressaisir et à se reconnaître dans le tumulte de cette vie mécanisée à l’extrême, où l’être humain ressemble à un automate névrosé.
Il n’est pas téméraire alors d’avancer que plus l’élan de la pensée sera grand, plus les chances de réussite dans les luttes à livrer aux forces d’oppression seront fertiles. Mais il faut pour cela que l’individu prenne conscience de ce sentiment de révolte, il faut que cette révolte, pour qu’elle porte ses fruits, soit l’œuvre d’un long et patient travail, le résultat de profondes observations. D’autre part, il faut qu’il soit tenu compte des enseignements de l’histoire, non pour construire une théorie dogmatique aux principes immuables, et créer une orthodoxie étriquée, selon la méthode des partis politiques, et à dialectique prétentieuse, mais pour en tirer tous les profits possibles et éviter les sacrifices inutiles ou les demi triomphes qui, trop, souvent, ne sont que des défaites. Pour ce faire, il faut que l’être humain acquière une individualité.
« Ce sens de l’individualité fait donc que l’homme recherche la cause de ses actes et les discute, fait qu’il parvient à se distinguer parmi ses semblables, à se considérer lui-même dans son milieu, à prendre connaissance de ce qu’il est dans la société et dans la nature. Là où l’animal et l’homme inférieur acceptent d’être partie d’un tout, où ils agissent selon des lois inconnues, les subissant simplement, l’être supérieur se voit et s’affirme une volonté parmi les volontés qui l’environnent. Dès lors, naît la révolte, c’est-à-dire l’acte personnel, choisi, délibéré. L’individu n’accepte plus aveuglément les lois, et c’est alors qu’on le voit se tromper, errer. Ceux que l’instinct guide ne se trompent jamais. Les animaux n’aboutissent qu’à des révoltes timides, l’homme seul peut concevoir la révolte comme un devoir très net envers soi-même et envers l’espèce. Et c’est lorsqu’il arrive à se demander la raison de ce que la société et la nature exigent de lui, à discuter ce qu’il est forcé de subir lorsqu’il nie la légitimité des puissances qui s’imposent à lui. »
Improvisation, certes, soudaineté et spontanéité, autant de facteurs impondérables dont il faut tenir compte, mais cela n’exclut point la longue préparation d’une action, cela ne veut pas dire négation d’efforts persévérants, cela ne veut pas dire absence de méthode. Comme l’écrivait Gérard de Lacaze-Duthiers :
« Sommes-nous prêts, sommes-nous assez forts, aujourd’hui, pour marcher en rangs serrés contre l’armée du capital, contre l’État, contre les « autorités », et cela au nom même de l’autorité supérieure de la conscience, au nom de la loi intérieure, ennemie des lois ? Ne dissimulons à personne qu’il nous reste encore beaucoup à faire avant de nous sentir des muscles d’acier, un tempérament d’athlète. C’est par des exercices quotidiens que nous assurerons la victoire. Remportons sur nous-mêmes une victoire définitive. C’est elle qui décidera de toutes les autres. Sans cette victoire préalable, nous ne serons pas prêts pour affronter le danger. Défions-nous de nous-mêmes, de notre enthousiasme, de notre générosité. Disciplinons nos vertus. Vainqueurs de nos travers, de nos défauts, nous serons victorieux des travers et des vices des autres. N’ayons pas le triomphe insolent des vainqueurs, ce serait de la maladresse. Profitons de notre victoire avec calme et sagesse, comme si nous avions obtenu ce qui nous était dû depuis longtemps. Nous la méritons. Jusque-là, nous n’avions pas lutté pour l’obtenir. Nous n’étions pas assez disciplinés. Dès que nous l’avons méritée par l’effort, courons à de nouvelles victoires, car il y a toujours à faire contre l’iniquité qui est méprisable, il y a toujours à faire contre l’injustice et la laideur. Qu’une victoire ne nous enorgueillisse pas au point de nous faire perdre tout ce que nous avons acquis. Ne nous considérons pas comme ayant assez fait pour l’idéal. Au contraire, agissons avec la pensée que nous n’avons rien fait, et que chaque fois que nous faisons quelque chose, il reste beaucoup à faire, pour nous persuader que nous avons joué un rôle utile parmi les hommes. Là est le sens de la révolte : dans l’action qui ne se décourage pas ; dans l’effort pour être soi-même ; dans la poursuite inlassable de la justice. À quoi bon se révolter, si ce n’est pas pour le bien de l’idéal, pour l’amour de la beauté ? Toute révolte suppose une pensée libre, affranchie des lois et des dogmes, refusant de se soumettre aveuglément aux préceptes de la tradition. Les fausses révoltes des médiocres sont dirigées contre la beauté. Elles supposent la servitude. Mais la bonne révolte, qui est la revanche de la vie contre sa déformation, suppose la liberté intégrale. Elle est le plus haut affranchissement de l’être. Elle n’a qu’à se montrer pour disperser à tous vents la masse amorphe des médiocres. »
La révolte que nous, anarchistes, désirons et appelons, c’est cette révolte qui s’inspire d’un idéal, d’une éthique, et, par ce fait, devient tributaire de la raison et de la volonté dans la lutte, et ainsi, on peut lui concéder une « vertu ». Qui oserait contester la légitimité d’un tel esprit de révolte qui, en valeur, est bien supérieur à l’esprit d’obéissance qui, trop longtemps, a courbé l’humanité sous le joug le plus odieux de la servilité et de l’autoritarisme ?
« Depuis toujours, l’homme a demandé : « D’où venons-nous ? Où allons-nous ? » Les religions lui ont donné une réponse qui l’a satisfait longtemps. Maintenant, cette réponse ne le satisfait plus, et nul ne peut et ne pourra jamais lui en donner d’autre. »
La résignation, dès ce moment, est devenue impossible ; la révolte grandit, marquant la volonté humaine dans le désir de perfection, vers le beau, le juste et le vrai ; et tout ceci ne s’entend pas dans un sens abstrait ou métaphysique, mais dans un sens positif et réel. J.-F. Elslander écrit dans La vertu de la révolte :
« La conduite d’un individ qui n’accomplit que son devoir, tel qu’il est formulé par la morale, non seulement est piètre et vulgaire, mais elle est nuisible à ses semblables, en ce qu’il prend tout aux autres, à ceux qui osent et qui tentent, sans rien rendre. La vertu n’a aucune valeur ; si tous l’imitaient, ce serait, à bref délai, la fin de tout. Ce n’est pas sous cet aspect-là qu’il faut concevoir le réel devoir d’être homme, et ce n’est pas d’individus obéissants et inertes qu’on peut attendre quoi que ce soit. Au point de vue même d’où on juge généralement les faits, le devoir ne peut résulter que de l’outrance dans le sens du bien comme dans le sens du mal. Ceux qui accomplissent, dépassent, dans un sens ou dans l’autre, l’ordinaire loi ; ce sont ceux qui se jettent à l’action, ceux qu’exaltent une passion ou une idée, et qui s’y donnent de toute leur ardeur, sans se demander si c’est bien ou mal, mais rien que parce qu’ils le veulent, obéissent à l’impulsion irrésistible de la vie qui se manifeste en eux. Il n’y a rien de beau ni de grand que ce qui est hors du cours ordinaire des choses. Ce qu’on appelle le mal a lui-même sa raison d’être. Les hommes n’ont jamais réalisé une œuvre quelconque sans sortir des normes banales qu’on leur imposait. Supprimez les passions, et rien ne se tente plus ; tous ceux qui s’efforcent méconnaissent la règle. Il n’est pas possible de vivre sans pécher ; c’est ce que comprenait la religion, et c’est pourquoi, logiquement, elle était ennemie de toute vie. Les hommes, heureusement, conçoivent leur devoir autrement qu’on ne le leur assigne. Ils apprennent à braver impunément les lois de la nature et de la société ; mais ils n’agissent ainsi, pour ainsi dire, que contraints par les circonstances, et lorsqu’ils sont écrasés par l’indifférente et impérieuse nature ou par l’implacable société. Trop de préjugés les arrêtent, et ils vont jusqu’à la souffrance avant de se révolter ; il en est même qui demandent à la société qu’elle les délivre de leurs maux, ne comprenant pas qu’elle leur refusera toujours, qu’elle doit leur refuser, et que c’est de leur propre volonté qu’ils doivent attendre leur affranchissement. Il faut que l’individu acquière le pouvoir de se débarrasser des craintes puériles qu’il a gardées du passé, et juge par lui-même de la portée et de la légitimité de ses actes. Il faut qu’il se rende compte de la valeur des mobiles qu’on lui impose, et qu’il cesse de croire à la vertu des mots ; on oublie trop souvent que la conception de la société et celle de l’individu sont absolument antinomiques ou, du moins, que celle de l’individu seule est sociale, que l’autre n’a qu’une valeur conventionnelle, ne représente en somme rien. La société n’existe et ne se développe que par l’individu ; l’individu seul a une vie réelle, et c’est de sa vie à lui que celle de la société peut prendre une signification. Si on peut prouver que l’individu doit être sacrifié à la nature et à la société, la morale actuelle doit s’admettre ; sinon apparaît, dans toute son évidence, la conception individuelle du devoir. Cette conception n’est pas hostile à l’idée de société, puisque c’est par elle, par elle seule, qu’on peut expliquer l’effort humain et les conséquences sociales d’organisation qu’il doit avoir. Dès lors, il n’y a plus de raison de continuer à subir des contraintes illégitimes, et les individus s’affranchiront de ce qu’on pourrait appeler l’illusion sociale. Le bonheur qui résulte de l’observation des lois de la nature et de la société est un bonheur d’inertie ; la révolte, réprouvée par la morale ordinaire, est le principe même de la vie. Les audacieux ont une personnalité assez forte pour savoir que rien ne compte que leurs désirs et leurs volontés ; d’autres l’apprendront à leur tour, et, dans la liberté de l’action, la vie de ceux-là sera plus joyeuse et plus belle, plus intelligente et plus fière, plus féconde aussi, débarrassée des terreurs et des mensonges qui l’accablent encore. »
Il a été parlé, en maintes circonstances, du droit à la révolte, encore que c’est là émettre un non-sens, car la révolte, de par son essence même, se passe de tout droit et de toute autorisation. G. Etievant, dans Légitimation des actes de révolte, l’affirmait en ces termes :
« Vous n’avez et vous n’aurez donc jamais de titres positifs qui vous confèrent des droits supérieurs aux nôtres. Nous avons donc et nous aurons toujours le droit de nous révolter contre tous les pouvoirs qui voudront s’imposer à nous, contre l’arbitraire des volontés légales de qui que ce soit. Nous avons toujours le droit de repousser la force par la force, car nous qui respectons les droits et la liberté de chacun, nous pouvons légitimement faire respecter les nôtres par tous les moyens. C’est ce que plusieurs d’entre nous ont tenté de faire à diverses reprises, avec plus de courage que de bonheur, et c’est ce que d’autres, de plus en plus nombreux, à mesure que les lumières de la science se répandront et que la vérité sera mieux connue, tenteront certainement, à l’avenir, car nous ne reconnaissons pas, et nous ne reconnaîtrons jamais votre prétendue autorité, tant que vous ne nous aurez pas donné une démonstration claire et précise de son existence, tant que vous ne nous aurez pas dit sur quel fait précis, déterminé, scientifiquement connu, vous vous appuyez pour prétendre que vous avez le droit de nous faire la loi ? Ces actes de légitime révolte contre des prétentions qui ne reposent sur aucun droit, vous les avez, vous érigeant en juges dans votre procès, qualifiés de crimes. Si c’était votre droit de les qualifier ainsi, n’était-ce pas le nôtre de faire voir que le crime ne venait pas de nous ? Que la première atteinte aux droits imprescriptibles des individus ne venait pas de notre côté, mais du vôtre ? »
Du point de vue psychologique, on admet que l’esprit de révolte existe à l’état latent dans tout encéphale humain. Si ce n’était, l’individu ne pourrait subsister dans les divers milieux où il se voit obligé de frayer durant son existence, et cet état psychologique lui permet en quelque sorte de s’adapter aux différentes modifications des milieux. Mais du fait que la tendance à la révolte existe, il ne s’ensuit pas fatalement que tous les individus soient des révoltés ; chez les uns, ce germe a tendance à se développer ; chez les autres, il semble plutôt s’atténuer ; et chez certains, il va jusqu’à s’atrophier ou s’hypertrophier. En effet, sous l’influence de l’ambiance dans laquelle se développe l’individu, celui-ci acquiert, plus ou moins, un potentiel d’esprit de révolte, mais il semble que tout milieu social détermine plutôt l’individu à atténuer la propension à la révolte. Cette réaction contre le sentiment de révolte est due au fait que, dès son jeune âge, l’enfant subit une éducation malsaine et faussée, tant dans la famille qu’à l’école ; ici comme là, on lui prêche l’obéissance, on lui inculque le respect des choses existantes ; il accepte la religiosité de la société présente, et, nanti de ce bagage de servilité, il grandit et se fraye un chemin dans la vie ; rien d’étonnant, alors, de constater le grand nombre de résignés, et ce ne sont que les rudes épreuves de la vie qui pourront faire espérer qu’ils deviendront un jour des candidats à la révolte. En eux, rien n’a été éveillé. L’esprit d’examen comme celui de critique ont entièrement été annihilés. Rares sont ceux qui eurent le bonheur de recevoir un autre enseignement : plus rationnel et plus libertaire. Sans doute, de temps à autre, certains esprits réagissent et ces phénomènes d’obéissance passive et craintive à l’égard des institutions – famille, patrie, propriété – s’exercent d’une manière tout opposée ; c’est là un phénomène de psychologie assez curieux qui concourt à la naissance de l’esprit de révolte. Auguste Hamon, dans sa Psychologie de l’anarchiste socialiste, a tenté, en se basant sur une enquête faite auprès d’esprits révoltés, d’expliquer ces phénomènes qui revêtent des formes diverses d’inspiration :
« En examinant, en critiquant, l’individu se refuse à admettre les opinions toutes faites, les phénomènes tels qu’on les présente. Il se révolte contre les idées généralement admises, contre les dogmes religieux, moraux, scientifiques. En contredisant des théories données, en faisant opposition à des actes, l’individu se révèle un révolté. Morphologiquement, examen, critique, contradiction, opposition sont identiques. »
Et, poursuit-il :
« ...des hommes qui veulent faire table rase des actuelles organisations sociales sont fatalement doués d’une cérébralité dont une des caractéristiques doit être la tendance à la révolte contre ce qui est. »
Quiconque s’est donné la peine d’étudier la doctrine anarchiste constatera qu’elle enseigne la révolte et incite à la manifester ; il est logique que ceux qui s’en réclament approuvent cet enseignement et soient des révoltés.
Voici quelques citations empruntées à des ouvrages de théoriciens ou de militants anarchistes qui montrent l’enseignement de la révolte dans la doctrine anarchiste. P. Kropotkine, dans La morale anarchiste :
« Nous, nous sommes des révoltés et nous avons invité les autres à se révolter contre ceux qui s’arrogent le droit de traiter autrui comme ils ne voudraient nullement être traités eux-mêmes. Contre ceux qui ne voudraient être ni trompés, ni exploités, ni brutalisés, ni prostitués, mais qui le font à l’égard des autres... Jusqu’à présent, l’humanité n’a jamais manqué de ces grands cœurs qui débordaient de tendresse, d’esprit ou de volonté, et qui employaient leurs sentiments, leur intelligence, ou leur force d’action au service de la race humaine, sans rien lui demander en retour. Cette fécondité de l’esprit, de la sensibilité, ou de la volonté prend toutes les formes possibles. C’est le chercheur passionné de la vérité qui, renonçant à tous les autres plaisirs de la vie, s’adonne avec passion à la recherche de ce qu’il croit être vrai et juste, contrairement aux affirmations des ignorants qui l’entourent... C’est l’homme qui se révolte à la vue d’une iniquité, sans se demander ce qui en résultera, et, alors que tous plient l’échine, démasque l’iniquité, traque l’exploiteur, le petit tyran d’une usine, ou le grand tyran d’un empire... Nous sentons que nous n’avons pas poussé les principes égalitaires jusqu’au bout. Mais nous ne voulons pas faire de compromis avec ces conditions. Nous nous révoltons contre elles. Elles nous pèsent, elles nous rendent révolutionnaires. Nous ne nous accommodons pas de ce qui nous révolte. Nous répudions tout compromis, tout armistice même, et nous nous permettons de lutter à outrance avec ces conditions. Cette science (la morale) dira aux hommes : « Sois fort, au contraire, et une fois que tu auras vu une iniquité et que tu l’auras comprise – une iniquité dans la vie, un mensonge dans la science, ou une souffrance imposée par un autre –, révolte-toi contre l’iniquité, le mensonge et l’injustice. Lutte, la lutte c’est la vie d’autant plus intense que la nature sera plus vive. Et alors tu auras vécu et, pour quelques heures de cette vie, tu ne donneras pas des années de végétation dans la pourriture du marais... »
J. Grave, dans La Société mourante et l’Anarchie :
« ...Et dans la société actuelle, essayer de mettre des idées nouvelles en pratique, n’est-ce pas faire acte de révolte ? Heureusement, nous l’avouons, qu’il n’y a qu’un pas des aspirations au besoin de les réaliser ; et ce pas, bien des tempéraments sont enclins à le franchir, d’autant plus que la théorie anarchiste étant essentiellement d’action, plus nombreux chez ses adeptes se trouvent ces tempéraments révolutionnaires. De là, la multiplication de ces actes de révolte que déplorent les esprits timorés, mais qui, selon nous, ne sont autre chose que la preuve du progrès des idées... Ce n’est pas en se résignant ni en espérant que l’on ne change rien à sa situation, c’est en agissant. Or, la meilleure manière d’agir est de supprimer les obstacles qui entravent notre route... La mise en pratique de nos idées exige des hommes conscients d’eux-mêmes et de leur force, sachant faire respecter leur liberté, tout en ne se faisant pas le tyran des autres, en n’attendant rien de personne mais tout d’eux-mêmes, de leur initiative, de leur activité et de leur énergie ; ces hommes ne se trouveront qu’en leur enseignant la révolte, et non la résignation. Mais nous sommes convaincus aussi que les idées bien comprises doivent multiplier, dans leur marche ascendante, les actes de révolte... »
L’on pourrait trouver d’autres citations qui justifieraient, d’une façon précise, que l’esprit de révolte est exalté par les anarchistes dans leur propagande orale ou écrite ; il nous suffirait d’ouvrir les ouvrages des É. Reclus, E. Malatesta, R. Mella, Malato, Bakounine, S. Faure, pour puiser à profusion de quoi augmenter l’apport si copieux que nous ayons fait en citations. Mais ce n’est pas uniquement chez les théoriciens anarchistes que nous pourrions trouver de quoi étayer notre thèse, car cette tendance à la révolte se retrouve exprimée en maints chefs-d’œuvre de la littérature et de la musique, des œuvres d’art, chez les peintres, les dessinateurs ct les sculpteurs. Citons les P. Adam, O. Mirbeau, B. Lazare, G. Eckhout, Thaureaud, Gorki, R. Rolland, Barbusse, les Daumier, les Grosz, Beethoven, Wagner ; et l’énumération serait fastidieuse si nous la prolongions outre mesure.
Tel est le fait qu’on se doit de constater : l’esprit de révolte s’efforce à pénétrer et à s’insinuer partout. Il se développe de plus en plus, tout en subissant, à certains moments, quelques régressions ; et cet esprit de révolte, cette propension, surtout, est caractéristique chez les anarchistes, et son accentuation s’explique par le travail constant et continuel que ceux-ci ne cessent de faire, en vue de cultiver cet esprit de révolte indispensable et nécessaire à toute évolution humaine. C’est pourquoi les paroles que Pierre Kropotkine prononçait à Lyon, en répondant au juge qui l’interrogeait, au procès anarchiste du 8 janvier 1883, sont justes et réelles :
« Quand l’esprit de révolte aura bien soufflé sur le peuple, il sera prêt pour renverser le régime de la propriété individuelle et inaugurer notre idéal : le communisme anarchiste. »
Non moins vraie est cette pensée d’Oscar Wilde qui explique l’éthique de notre révolte :
« Partout où un homme exerce une autorité, il y a un homme qui résiste à l’autorité. »
Révoltons-nous contre l’iniquité, cultivons donc cet esprit de révolte, et, sans doute, verrons-nous ainsi surgir, demain, des mouvements qui aideront à construire un nouveau monde meilleur.
— HEM DAY.
RÉVOLTE
Soulèvement, rébellion contre l’autorité établie : la révolte d’un camp. Une révolte de collégiens. Souffler la révolte. — Fig. soulèvement violent. La révolte de la raison. La révolte des passions. La révolte des sens. — Syn. Émeute, insurrection, etc. Nous reportant au mot Émeute, du dictionnaire Larousse, nous ne sortons pas de notre sujet, puisqu’on y lit ceci :
« Émeute, soulèvement populaire, tumulte séditieux. »
Puis, encore cela :
« Syn. Émeute, insurrection, rébellion, révolte, sédition, soulèvement. L’émeute n’est qu’un rassemblement tumultueux de manifestants qui témoignent leur mécontentement ; elle se forme ordinairement sans avoir été préméditée, et, souvent, se dissipe d’elle-même, quoiqu’elle puisse devenir le signal d’une révolution. L’insurrection, c’est l’acte d’un grand nombre de citoyens qui s’arment pour renverser une autorité qu’ils ne veulent plus supporter. La rébellion ne tend qu’à refuser l’obéissance, tandis que la révolte tend à renverser, à détruire. Mais l’une et l’autre ne supposent pas un grand nombre de résistants. La sédition suppose des complots, des meneurs ; elle est concertée, elle a un mot d’ordre, elle pousse le peuple à prendre les armes pour soutenir un parti organisé depuis longtemps. Le soulèvement participe à la fois de l’insurrection, de la rébellion, de la révolte, mais il en marque surtout le commencement ou la formation ; on prévoit les soulèvements ou on les voit se préparer. »
« Ameuter, mettre en émeute : ameuter le peuple. » (Dictionnaire Larousse)
Ajoutons encore :
« Émeutier, émeutière : personne qui prend part à une émeute ou qui excite à l’émeute. »
Nous pouvons déplorer que la tyrannie, l’oppression, l’exploitation, n’engendrent pas toujours la révolte. Cependant, bien qu’il faille un plus ou moins grand nombre d’années d’esclavage ou d’asservissement pour provoquer une révolte, l’histoire en a noté de nombreuses et d’importantes. Pour n’en citer qu’une dans l’Antiquité, nous croyons bien faire en rappelant ici celle des esclaves de Rome, ou la révolte de Spartacus. Elle éclata en l’année 74 avant Jésus-Christ, que les Romains désignaient comme l’année 679 de leur ère (ils comptaient les années à partir de la fondation de leur ville, en 753 avant Jésus-Christ). C’était l’époque où Rome achevait de conquérir le monde méditerranéen, en brisant tous les États ou en les soumettant à sa domination. À mesure que se multipliaient les conquêtes de Rome, augmentait le nombre des esclaves. Les vaincus qu’on ne tuait pas, s’ils étaient utiles par leurs talents ou par leurs forces, devenaient des esclaves au service des Romains. Tout riche avait à lui non pas seulement quelques serviteurs, mais des armées d’esclaves qu’il employait à diverses besognes, selon leurs aptitudes ou selon son bon plaisir. Il choisissait parmi eux des domestiques de toutes sortes : cuisiniers, valets de table, coiffeurs étaient à sa disposition, pour lui, le maître, et pour ses proches et ses amis, à l’occasion. Il avait aussi médecins, musiciens, chanteurs, déclamateurs et d’autres, encore, pour lui composer un cortège dans la rue, marquant ainsi sa richesse et sa puissance. Dans les champs, il avait de nombreux laboureurs et pâtres. À la ville, il avait ses ouvriers, qu’il louait à d’autres ou dont il vendait le travail.
Il avait aussi des hommes de choix pour ses divertissements. Il les faisait former comme gladiateurs et les vouait aux jeux barbares du cirque, dont la population romaine de toutes classes raffolait.
C’était montrer son amour du peuple que de lui offrir des spectacles où les fauves luttaient entre eux jusqu’à la mort et, ensuite, les gladiateurs esclaves ou libres. Parmi ces vaincus devenus esclaves et entretenus, entraînés aux jeux brutaux et cruels pour la satisfaction et le plaisir des spectateurs, il y avait des hommes qui n’avaient pas perdu toute dignité et qui souffraient de leur humiliante situation, rêvant de liberté.
Ce furent des gladiateurs, élèves des fameux maîtres d’escrime de Capoue, qui donnèrent, en l’an 74, le signal de la révolte. Il y avait donc, parmi ces esclaves, des gladiateurs de tous pays, surtout des Thraces et des Gaulois, aussi vigoureux de corps que résolus d’esprit, souvent de caractères différents, mais tous unis par la commune haine du maître sans bienveillance à leur égard, sans pitié pour leur situation. Le traitement odieux de ces vaincus par les vainqueurs suscitait en eux des vengeances qui explosaient à la moindre occasion. Ils n’y risquaient que la mort, c’est-à-dire l’évasion d’un esclavage parfois atroce. Ils y risquaient aussi la liberté. Mais il fallait leur en faire comprendre la possibilité.
Donc, cruellement traités par leurs maîtres, les esclaves gladiateurs de Capoue se révoltèrent. Car, comme l’a écrit un historien ancien :
« Plus les maîtres sont cruels et injustes, plus les hommes rangés sous leur loi finissent par pousser leur ressentiment jusqu’à la férocité ; celui que la fortune a placé dans une condition inférieure peut consentir à céder, à ceux que le sort a mis au-dessus de lui, les honneurs et la gloire ; mais, lorsqu’il se voit privé de la bienveillance à laquelle il a de justes droits, l’esclave révolté traite ses maîtres en ennemis. »
Il y avait eu complot entre Thraces et Gaulois. Ils avaient fait une brèche au mur de leur caserne et en sortirent au nombre de 73, s’emparèrent, dans la rue des charcutiers et des rôtisseurs, des broches, des coutelas, des couperets qu’ils avaient pu saisir et, avec ces armes rudimentaires, ils avaient vaincu et désarmé les soldats ou les citoyens de Capoue qui étaient venus les attaquer. Des brigands, des pasteurs, des esclaves des champs, tous ceux dont la muette patience était lasse, s’étaient joints à eux. Dans leur premier et instinctif mouvement de révolte et pour épouvanter les maîtres, ils avaient pillé les villages, dévasté les champs, enlevé les femmes et les enfants. Puis ils s’étaient cantonnés sur une hauteur du mont Vésuve et menaçaient la plaine. Avec eux, ils avaient un véritable chef ; c’était Spartacus. Il était de cette ancienne contrée de la Grèce appelée Thrace, aujourd’hui Bulgarie. Intelligent et vigoureux, il s’était fait soldat. Il avait été pris dans une bataille, vendu à Rome, s’était évadé, s’était refait soldat, puis était retombé en esclavage : sa haute taille, sa force l’avaient désigné pour devenir gladiateur, puis professeur des autres esclaves gladiateurs. Dans la caserne, Spartacus avait souvenance vive de la liberté et de l’air pur des montagnes natales. Sa douceur de caractère, sa bonté, ses qualités morales le rendaient bien supérieur à sa condition. Il était patient, brave et prudent – vertus de chef. C’est lui qui avait indiqué l’heure de la révolte, après un apostolat actif auprès de ses compagnons esclaves chez lesquels il ranima tous les espoirs en leur parlant de la liberté, en les incitant à s’en rendre dignes par le courage et l’audace, et par le mépris de la mort.
Aussitôt qu’à Rome furent connus les exploits des esclaves en révolte, le Sénat envoya des troupes. Le préteur Clodius Pulcher était arrivé dans la plaine, et il avait disposé ses 3 000 hommes pour assiéger et réduire par la faim la petite troupe des révoltés. Le chemin d’accès à la plate-forme rocheuse où ils étaient cantonnés était bien gardé ; de l’autre côté, la pente était abrupte : un précipice. Le préteur croyait les tenir. Mais Spartacus fit couper les vignes au milieu desquelles il campait : les sarments noués et entrelacés formèrent une échelle ; un à un, tous descendirent, surprirent à l’aube les Romains et, dans leur panique, les anéantirent. Victoire !
Et après ? S’il n’avait tenu qu’à Spartacus de décider, c’est vers ses montagnes qu’il serait allé. Par terre, vers le Nord, Thraces et Gaulois seraient retournés au pays natal. Mais, ivres de leur victoire, les esclaves vainqueurs voulaient jouir comme ils avaient vu jouir leurs maîtres. Pourquoi tous les biens fabriqués pour les maîtres ne seraient-ils pas désormais pour les esclaves devenus libres par leur vaillance ? À leur tour, ils voulaient les festins, les lits merveilleux, les coupes d’or emplies de vins de Grèce. Ils voulaient la joie de voir les danseuses et d’entendre les chanteurs. Ils ne voulaient pas, comme autrefois, aux fêtes des Saturnales, quelques jours seulement de liberté ; mais ils voulaient que ce fût toute la vie une perpétuelle saturnale. Longtemps privés de liberté, aussitôt qu’ils l’eurent conquise, les esclaves ne surent pas en profiter avec mesure et prudence pour la conserver.
Cependant, leur victoire avait agité les esclaves non libérés qui vinrent alors grossir le nombre des révoltés. À l’appel de Spartacus, des esclaves de toutes nations rompirent leurs chaînes, disposés à combattre pour leur liberté. Malheureusement, ce n’était plus la liberté qu’ils défendaient, mais leur vengeance qu’ils assouvissaient. Spartacus souffrait de voir les esclaves se répandre en fléau à travers la Campanie épouvantée, ravageant, incendiant tout sur leur passage. Personne encore ne leur avait appris la douceur et la modération après la victoire. Alors, c’était la vengeance empoisonnant le triomphe et le rendant très dangereux pour les vainqueurs eux-mêmes.
Spartacus savait que la liberté conquise, c’était l’essentiel, le suprême but de la lutte. Mais il n’avait pas eu le temps de faire comprendre, admettre et partager son amour de la liberté. Il n’avait pas eu le temps de faire des hommes dignes de la liberté. Il n’avait fait que transformer les esclaves en soldats..., rien de plus ; ce n’était pas des hommes libres, c’était seulement des esclaves en révolte. Ils ne marchaient plus avec l’idée de conserver la liberté, mais avec le désir d’assouvir encore et toujours leur vengeance.
Spartacus s’efforça de créer avec eux, pour eux, une Cité nouvelle, un État nouveau, basé sur l’entente et la liberté des citoyens entre eux, pacifique et redoutable à la fois aux ennemis possibles du dehors. Plus d’esclaves, des hommes libres tels que le rêvait leur chef. Il apprit à ses compagnons de révolte à être, eux aussi, des soldats disciplinés pour se mieux défendre avec bravoure, s’il le fallait, et à mépriser l’or, l’argent et les plaisirs factices des Romains.
Un hiver ainsi passa, tandis que Rome armait et préparait une nouvelle campagne contre la révolte qu’il fallait vaincre à tout prix. Il n’était pas supportable pour elle qu’un État se formât sur le territoire de l’Italie en dehors de son autorité, contre elle. Il n’était pas admissible que Spartacus appelât à la liberté tous les esclaves et qu’il les façonnât en citoyens libres et invincibles. Des troupes furent alors envoyées à nouveau contre les révoltés. Les deux consuls furent envoyés comme chefs de ces troupes romaines, avec mission de vaincre les esclaves. Le Gaulois Crixus fut battu et tué. Spartacus marcha vers le Nord, à la rencontre des deux consuls romains et les vainquit. Rome fut dans l’épouvante. La plupart des esclaves disaient :
« Marchons sur Rome. Allons piller la cité des richesses ; allons massacrer les maîtres des maîtres ! »
Spartacus, sans rien dire, voulait entraîner ses compagnons vers le Nord, hors de l’Italie, loin de ce foyer de honte et d’oppression, vers les pâturages de la Thrace où, toujours, il rêvait de vivre libre, avec des hommes purs.
Mais avant de quitter l’Italie, lui aussi, il voulut sa vengeance solennelle et terrible. Sur les bords du Pô, il dressa un bûcher énorme en l’honneur de Crixus, son camarade, tué dans la bataille, et, pour l’agrément de l’armée des révoltés, il força les citoyens romains faits prisonniers à donner des jeux à leur tour, à lutter entre eux à la manière des gladiateurs. Pendant ce temps, le fleuve avait débordé. Il fallut attendre pour passer. Et, pendant ces jours d’attente, les esclaves – ils étaient maintenant plus de 100 000 révoltés –, fiers de leurs triomphes, exaltés, refusèrent de partir, de quitter l’Italie, résolus à châtier Rome. Spartacus fut contraint de revenir et de les suivre.
La terreur régnait dans la République romaine. Qui châtierait ces rebelles ? Qui sauverait l’État ? Un homme s’offrit : Marcus Licinius Crassus. C’était un homme très riche, ambitieux de gloire. Contre ces esclaves qui pouvaient tarir la source des richesses, ce puissant capitaliste parut l’homme désigné. Ce fut alors, pendant de longs mois, entre les révoltés et les armées de Crassus une rude guerre. Il était dur, impitoyable. Une de ses légions, prise de peur, avait reculé ; il la décima en prenant à l’alignement un soldat sur dix qu’il faisait immédiatement mettre à mort devant les autres. Puis il mena ses troupes droit contre Spartacus qui était revenu dans le sud de l’Italie, voulant aller soulever la Sicile, où les esclaves étaient nombreux et naguère révoltés. Tour à tour, les esclaves et les Romains étaient battus. Crassus tentait d’enfermer Spartacus entre la mer et le fossé creusé par ses troupes, profond et bien défendu. Une nuit de tempête, comme il neigeait à gros flocons, Spartacus fit combler le fossé sur un point et fit passer un tiers de son armée. Il semblait insaisissable.
Mais la division régnait au camp de Spartacus, trop noble, trop bon, trop supérieur à ses compagnons qui ne le comprenaient pas. En assez grand nombre, on l’abandonna. L’heure de la défaite approchait.
Crassus, une fois encore, tenta d’enfermer sur un point l’armée de Spartacus et fit commencer un fossé. Les esclaves attaquèrent les soldats romains. L’escarmouche s’échauffa : les renforts accoururent. La mêlée allait devenir générale.
Spartacus comprit que le moment du dernier effort était venu. Il exhorta les siens à lutter à outrance, sans se rendre, jusqu’au dernier soupir, à mourir en hommes libres sur les corps des ennemis qu’ils auraient immolés. Il fit crucifier les citoyens romains prisonniers de guerre, comme des esclaves, rappelant ainsi aux siens le supplice infâme qui les attendait.
Puis il rangea l’armée en bataille et, s’étant fait amener son cheval devant le front des troupes, d’un coup d’épée, il le tua :
« Si je suis défait, s’écria-t-il, je n’en aurai plus que faire ; si je suis victorieux, j’en aurai de bons et beaux que nous prendrons sur les ennemis. »
Cela dit, il fit sonner la charge.
Ce fut un choc affreux. Spartacus avait foncé dans les rangs romains, cherchant Crassus, il voulait, avec lui, avoir son suprême combat de gladiateur. Mais assailli, blessé, il succomba sous les coups. Il fut achevé, combattant à genoux. Ainsi finit Spartacus, le héros de la Révolte des esclaves.
Des quarante mille esclaves qui restaient encore, à l’armée, six mille seulement furent pris. Mais, sur le chemin de Rome à Capoue, bordure sinistre, six mille croix s’élevèrent où ils furent pendus. Rome était satisfaite.
Spartacus et ses compagnons avaient montré aux maîtres que la valeur personnelle d’un esclave pouvait être au-dessus de toute comparaison. (Extrait de l’Histoire anecdotique du travail, par Albert Thomas.)
On ne pouvait moins faire que de résumer ce récit d’une révolte mémorable d’esclaves au temps de la République romaine. Déjà, avec Marius et Sylla (88–86), des révoltes de chefs militaires, avaient commencé les guerres civiles qui devaient se terminer par la dictature de César et l’établissement de l’Empire, en 31, par Auguste. Mais cela n’a rien à voir avec la Révolte des esclaves, combattant pour la liberté.
Il y eut, avant et après, d’autres révoltes. Mais aucune n’est aussi caractéristique et aussi démonstrative que celle des esclaves de la République romaine ; révolte aussi ample que magnifique, menée par un esclave d’élite, individu superbe, révolté incomparable. Cette révolte qui fit trembler la Rome puissante et victorieuse, maîtresse du monde, cette révolte qui pouvait aussi transformer le monde par les conceptions sociales de Spartacus, s’il eût pu les réaliser, est un admirable exemple. Mais, pour une société libre, il faut des hommes libres et non des soldats, comme l’étaient devenus les esclaves en révolte.
Passons à d’autres révoltes, celles de la fin du Xe siècle de notre ère, au temps des premiers Capétiens, au moment où le jeune Richard venait de succéder à son père dans le duché de Normandie. C’est alors qu’il arriva que les serfs de Normandie eurent conscience de leur malheur. Ils ressentirent presque soudainement toute l’étendue de leur misère, toute la douleur et toute la honte de leur servitude. De plusieurs générations, la souffrance des travailleurs de la terre s’accroissait pour satisfaire aux besoins toujours croissants des seigneurs maîtres de tout. En dehors des guerres qu’ils se faisaient entre eux, les seigneurs jouissaient de tous les biens de la terre, par le travail et par la misère de leurs serfs. De leur côté, les serfs savaient qu’ils n’avaient rien à attendre des seigneurs qu’injures et mauvais traitements, après avoir tout donné de ce que leur travail faisait produire de la terre. Le sort de l’esclave antique était meilleur que celui des serfs sous le joug féodal. Voilà ce que pensaient les serfs de Normandie et de partout...
Un jour, on ne sut trop comment, à travers tout le pays souffla un vent de révolte, volant de chaumière en chaumière. Du bocage, de la plaine, serfs ou francs, tous unanimes, éprouvèrent le besoin de s’unir pour changer, coûte que coûte, la vie qu’on leur faisait mener. Par vingt, trente, et par cent, pendant les nuits sombres, loin des routes où passaient les hommes des châteaux, dans les forêts et dans les landes, connues d’eux seuls, ils s’assemblaient. Ils passaient ensemble la revue de leurs souffrances et de leurs misères. Ils exhalaient leurs rancœurs des maux endurés, des châtiments subis et, leur colère s’exaltant, ils se juraient foi réciproque. Ils se juraient que, désormais, par leur volonté, jamais plus ils ne subiraient le joug honteux du servage. Ils ne voulaient plus appartenir aux seigneurs. Ils ne voulaient plus être des serfs. Ils se révoltaient. Ils disaient :
« Mettons-nous en dehors de l’atteinte des seigneurs ; et s’ils nous rencontrent, nous sommes, comme eux, hardis et forts et capables de nous défendre ; nous sommes nombreux, soyons unis ; ils sont guerriers et braves, soyons résolus ; nous avons, comme eux, habileté, courage et force. Armons-nous et ayons du cœur. Munissons-nous d’arcs, de pieux, de haches, d’instruments de travail pouvant être des armes, et, au besoin, ramassons des pierres et combattons pour notre affranchissement. Nous voulons travailler pour nous, pour nos besoins et non pour les seigneurs. »
Dans leurs assemblées nocturnes, les paysans de Normandie renouvelèrent le serment de lutter ensemble, de rester unis. Par les femmes et les enfants des révoltés, ces messagers de confiance, ils firent connaître leurs desseins à ceux de tous les domaines. D’autres serfs vinrent se joindre aux révoltés. Il y eut des assemblées plus nombreuses. Les uns voulaient l’extermination pure et simple des seigneurs. D’autres, plus nombreux, craignant les seigneurs, voulurent que des délégués leur soient envoyés :
« Exposons-leur notre misère, peut-être nous donneront-ils quelque légère amélioration. »
Mais les seigneurs avaient peur, c’est pourquoi ils furent cruels. Ce fut l’oncle du duc de Normandie, le comte Raoul d’Ivri, qui reçut les délégués sans les entendre ; un seigneur ne discute pas avec des révoltés. Il les fit arrêter, leur fit couper les mains et les pieds et les renvoya vers leurs compagnons... Ceux-ci, effrayés, terrorisés, n’osèrent plus rien et retournèrent à la charrue. Ainsi prit fin la révolte au pays normand.
En 1382, il y eut la révolte des Maillotins contre les impôts.
Parlons maintenant de cette révolte mieux connue, appelée la Jacquerie. Cette révolte paysanne éclata dans le Beauvaisis, en 1358. Ce fut une lutte terrible contre les seigneurs, causée par les excès et les cruautés de ceux-ci envers les Jacques, surnom donné aux paysans par tous ceux qui profitaient d’eux et s’en moquaient, comme de tous temps les parasites, les malfaisants se sont moqués de ceux qui les entretenaient et ne leur ont réservé que moqueries, injures et mauvais traitements. La révolte des Jacques fut cruellement étouffée dans le sang, et les nobles triomphèrent.
Les vainqueurs ont alors abusé de leur triomphe, et cela jusqu’en 1789.
Alors, il y eut de rudes représailles, et la justice du peuple, formée de groupes de révoltés en furie, déposséda sans ménagement les ci-devant, brûlant châteaux et titres de noblesse, distribuant les terres aux acquéreurs ; enfin, ces révoltes, partout, furent la Révolution elle-même dans son action.
D’autres révoltes – dont on ne peut parler ici – se produisirent au cours des siècles, jusqu’à nos jours. Toujours, ce ne furent que des sursauts de dignité, pour le moins, mais le plus souvent des tentatives d’action directe collective pour arracher aux possédants, aux maîtres, aux exploiteurs des biens détenus par ceux qui ne les produisent pas, des bribes de mieux-être, des atténuations de misère.
Les grèves sont des révoltes de producteurs. Il se pourrait que les grèves généralisées des producteurs, jointes aux révoltes des consommateurs contre les impôts, la vie chère, en jetant la perturbation dans tous les rouages sociaux et en provoquant l’affolement des gouvernants, engendrassent une révolte qui se transformerait subitement en Révolution. Suivant l’orientation prise par l’esprit de révolte, cette révolution pourrait être celle que nous attendons, que nous espérons, à laquelle de tout cœur nous travaillons : la Révolution sociale.
C’est pourquoi toute révolte nous intéresse, nous captive, nous fait tressaillir d’espoir en l’avènement possible de la liberté.
— Georges YVETOT.
RÉVOLTES (OUVRIÈRES ET PAYSANNES)
L’histoire des révoltes ouvrières et paysannes est inséparable de celle du travail. Elle l’est aussi de celle de la pensée, car l’homme ne vit pas que de pain. Si la question économique est pour lui primordiale, une foule d’autres, plus spéculatives, viennent parallèlement déterminer ses agissements. Besoins du corps et de l’esprit ne se séparent pas, même pour le plus misérable, et ce serait rabaisser singulièrement l’homme, méconnaître ses légitimes aspirations et ses vraies nécessités que de ne le voir préoccupé que du souci alimentaire. Le pain est toujours amer quand il est mangé sans la joie de l’esprit. Si le souci de ce pain est devenu trop absorbant pour le plus grand nombre, s’il est même pour certains si exclusif qu’ils ne peuvent en avoir d’autre, c’est à l’exécrable état social créé par une exploitation de l’homme toujours plus exigeante et arbitraire que cela est dû, et cet état justifie par avance toutes les révoltes ; elles ne peuvent être plus sauvages que lui.
Par contre, les revendications les plus spirituelles ont toujours eu une base économique quand elles ont agité les foules. Toutes les luttes religieuses n’ont eu des résultats positifs qu’en se transformant en luttes sociales. Toutes les hérésies n’ont eu une véritable influence qu’appuyées sur des revendications économiques. Le christianisme n’aurait jamais existé s’il n’avait apporté, avec les promesses de la justice, celles du pain quotidien aux foules affamées et opprimées. « Esclave, tu seras égal à ton maître » a été la plus grande parole qui a soulevé ces foules contre le monde antique. En ne leur apportant que l’égalité spirituelle, le christianisme les a dupées. Élisée Reclus, écrivant L’histoire de l’Homme et de la Terre, a constaté :
« Le viol de la justice crie toujours vengeance. »
Les plus déchus, les plus désespérés qui ont crié leur faim, dans tous les temps, ont clamé aussi leur besoin de justice, de liberté, d’amour, de pensée, de rêve, de joie. C’est donc toute l’histoire de l’humanité en lutte pour son mieux-être matériel et spirituel qu’il faudrait évoquer ici. Nous nous bornerons à parler des révoltes les plus caractéristiques, parmi celles nées des conditions d’exploitation des travailleurs. Il y en a eu à toutes les époques, depuis que cette exploitation a pris des formes collectives faisant des ouvriers et des paysans les prolétaires soumis à l’esclavage, au servage, au salariat, suivant les lieux et les temps. Nous verrons aussi comment leurs révoltes ont été associées à celles de l’esprit.
La révolte a plus ou moins d’importance et de portée, suivant la profondeur de ses causes, le nombre de ses participants, l’ardeur qu’ils lui apportent. Sa forme primitive et la plus fréquente est le refus du travail ; la grève. Celle-ci, suivant les circonstances, s’accompagne parfois d’émeute, de soulèvement, de rébellion, de sédition, d’insurrection pour aboutir à la révolution.
La grève « n’est peut-être pas aussi vieille que la souffrance des travailleurs, mais elle paraît aussi vieille que l’exploitation des hommes par d’autres hommes », a dit Pierre Brisson (Histoire du travail et des travailleurs). Elle est la première forme de la résistance à l’exploitation, la mieux à la portée de l’individu désarmé devant celui qui dispose de son activité et de sa vie, et elle est, le plus souvent, le simple geste négatif des « bras croisés ». Mais dès l’Antiquité, cette forme pacifique de résistance à l’exploitation s’est révélée inopérante, la cessation du travail ne supprimant pas la nécessité de manger, et l’on a vu alors des grèves se changer en révoltes plus ou moins violentes. Les esclaves se mettaient fréquemment en grève dans l’ancienne Rome ; ils cessaient le travail pour se réunir sur le mont Aventin. Ils ne furent réellement une menace pour leurs maîtres que lorsqu’ils se soulevèrent à la voix de Spartacus. La grève, par elle-même, ne produit pas de grands résultats sociaux, mais même lorsqu’elle est un échec pour les grévistes, elle est salutaire en ce qu’elle fait réfléchir le patronat et le retient devant certains abus qu’il serait tenté de commettre. La crainte de la grève est pour le patronat le commencement de la sagesse. Pour le travailleur, elle est un exemple d’entente et de solidarité avec ses compagnons, elle lui donne le sentiment de sa force, elle est un exercice d’entraînement à des mouvements plus vastes qui ne sont plus seulement corporatifs, mais deviennent sociaux. Elle habitue le travailleur à l’idée de la grève générale révolutionnaire et le prépare pour elle.
La révolution est l’aboutissement de la révolte ; elle en est la raison et le but. Elle est le produit de toute une série de perturbations suscitées et accumulées plus ou moins lucidement par les forces de « conservation de l’énergie vitale » (R. de Gourmont), forces qui interviennent pour changer les formes sociales devenues incapables d’assurer cette conservation. La révolution est ainsi un phénomène biologique, car « ce serait une erreur grave de considérer l’évolution des sociétés humaines d’un autre œil que l’évolution des autres sociétés animales » (R. de G.). Elle est indispensable au maintien de la santé et de l’équilibre du corps social contre les éléments de désagrégation tendant à troubler son harmonie et à le détruire. Dans l’État actuel, les éléments de désagrégation sont représentés par le capitalisme, exploiteur de l’homme, et ses auxiliaires de gouvernement. Ils sont une sorte de Catoplebas, animal fantastique, vautré dans l’ordure parasitaire, et tellement stupide qu’il se dévore lui-même sans s’en apercevoir, tout en dévorant la substance sociale conservatrice de l’énergie vitale. Celle-ci ne pouvant être conservée et renouvelée que par le travail, les seules chances de salut sont dans la révolte des travailleurs contre ce Catoplebas ; elles sont dans la grève générale révolutionnaire qui expropriera le monstre et le fera crever d’inanition sur son fumier. Cette grève générale et la révolution qu’elle produira seront, après quatre-vingts siècles d’exploitation de l’homme par l’homme, l’aboutissement logique, rationnel, indispensable, du geste du premier qui jeta l’outil et se croisa les bras devant les exigences de son exploiteur.
La révolte, dans ses diverses formes, n’a jamais été que le moyen plus ou moins embryonnaire de défense et de conservation de l’énergie vitale dont tout individu est dépositaire et comptable, ce qu’oublient trop les prétendus « dirigeants ». Elle a été le geste qui a traduit en acte la pensée révolutionnaire, gardienne de l’énergie commune chez tout individu bien équilibré, et elle a fait passer cette pensée dans les faits, avec plus ou moins de réussite. Sans les émeutes des paysans contre les châteaux, les rébellions des soldats passant au peuple, les insurrections des 14 juillet, 10 août, 5 et 6 octobre, et autres, la Révolution française serait demeurée à l’état d’espérance. Sans les révolutions que la révolte a suscitées depuis dans l’Europe entière, les peuples attendraient toujours les bonnes réformes de leurs « rois philosophes », comme ils attendront encore longtemps celles de leurs « parlementaires » s’ils ne se décident pas à user, pour se faire entendre, d’un stimulant plus énergique que le bulletin de vote. La révolution, couronnement de la révolte, n’est pas seulement inévitable : elle est indispensable pour assainir et ramener à la vie le corps social qui s’écroule dans la décomposition de ses organes. Et que les timorés, ceux qui s’accommodent de cette vermine et qu’épouvante la pensée de ce qu’on appelle les « excès » révolutionnaires, méditent cet aveu récent de M. Mussolini : « Il est temps de dire une chose qui vous étonnera peut-être vous-mêmes, c’est qu’entre toutes les insurrections des temps modernes, celle qui fut la plus sanglante, ce fut la nôtre. La révolution russe n’a coûté que quelques dizaines de victimes. La nôtre, pendant trois ans, a exigé un large sacrifice de sang jeune » (discours au Grand rapport fasciste, 16 octobre 1932). Il en a toujours été ainsi. Dans tous les siècles, la défense de « l’Ordre » a fait incomparablement plus de victimes que les révolutions. Vit-on jamais l’évolution faire les dix millions de morts que la guerre de 1914 a sacrifiés pour la gloire de crapuleux mégalomanes et la fortune de non moins crapuleux mercantis ? La révolution n’épouvante tant que parce qu’elle menace des droits illégitimes, mais acquis, au profit de droits légitimes, mais à acquérir. L’égoïsme, la paresse et la lâcheté ne font que la retarder. Un jour, elle éclate, malgré toutes les résignations, sous la poussée des événements, comme une chaudière explose sous une trop forte pression de vapeur. La révolution est alors catastrophique, incohérente, aveugle. Il vaudrait mieux que les hommes apprissent à la faire intelligente ; ils n’auraient pas besoin de la recommencer si souvent.
Chez tous les peuples, la substitution monstrueuse du régime de la propriété à celui du communisme, et les abus qui en ont résulté, ont produit et entretenu un état de révolte latent, permanent, qui s’est extériorisé plus ou moins violemment, à certaines époques, par des protestations de la pensée ou par des actes. Protestations et actes furent longtemps d’origine religieuse, inspirés du vague édenisme dont les légendes avaient laissé le souvenir et l’espérance dans l’esprit humain. Aujourd’hui encore, malgré les mobiles de plus en plus positifs des révoltes, il demeure dans les masses, entretenu par leur apathie et leur ignorance, l’espoir d’une révolution qui sera l’œuvre d’un messie et non celle de leur propre effort. Si le plus grand nombre n’attend plus rien du messie Jésus, démonétisé, il a reporté sa foi sur saint Karl Marx ou saint Lénine. Il n’a fait que changer d’église, passer du ratichon au politicien, quand il ne s’est pas mis sous la coupe des deux à la fois.
Chez les Hébreux, la révolte fut surtout verbale. Elle le fut magnifiquement par la voix des prophètes proférant pour tous les peuples du monde et de l’avenir, en même temps que pour le leur, la revendication implacable et éternelle de la justice parmi les hommes.
La Grèce connut, dès le VIIIe siècle avant J.-C., la lutte des classes. Les paysans, expropriés par les nobles et les bourgeois, se révoltèrent en masse, massacrant les troupeaux, comme à Mégare, en 640. Sparte vit des soulèvements d’Ilotes, notamment en 464. À Athènes, des conspirations de paysans accablés par l’usure furent cruellement réprimées. La protestation populaire fut de plus en plus vive contre le gouvernement des riches ; mais elle fut impuissante à empêcher que leur insanité fît perdre à la Grèce son indépendance en la livrant au joug des Macédoniens d’abord, des Romains ensuite. Le serment des fonctionnaires romains contre le peuple spolié était celui-ci : « Je jure d’être toujours un ennemi du peuple et de faire tout mon possible pour lui nuire. » Isocrate a raconté que les riches auraient préféré jeter leurs richesses à la mer que d’en donner une partie aux pauvres. Ils étaient déjà aussi mufles qu’aujourd’hui.
À Rome, la lutte des classes fut plus ardente. La plèbe était de rang inférieur, mais elle était libre ; il y avait au-dessous d’elle les esclaves. C’est la plèbe qui fournit les soldats, et elle parvint à se rendre maîtresse de l’empire dont elle fit et défit les empereurs.
Au Ve siècle avant J.-C., devant les exigences de plus en plus grandes des patriciens, elle s’était mise en révolte. Elle lutta jusqu’en 287 pour obtenir l’égalité politique. La plèbe ouvrière, de plus en plus déchargée du travail dont on accablait les esclaves, devint une classe de parasites et multiplia la foule des pauvres. Ils se soulevèrent à la voix du tribun Tibérius Gracchus pour revendiquer le droit des paysans à la terre. Tibérius, puis son frère Caïus – les deux Gracques – provoquèrent d’utiles réformes au IIe siècle ; mais lorsqu’ils eurent disparu, assassinés tous deux par ceux qu’ils avaient défendus, les pauvres tombèrent à un abrutissement de plus en plus complet et furent bientôt réduits à la plèbe avinée qui acclamerait les imperators sanglants. Rome eut à faire face à de nombreux soulèvements de ces esclaves dont les rangs étaient fournis inépuisablement par les vaincus des peuples étrangers pillés, colonisés, « dévorés jusqu’aux os », a constaté Juvénal. L’Apulie vit leur première révolte, en 187 avant J.-C. De 134 à 132, ce furent les insurrections de Sicile ; les esclaves dominèrent cette province pendant deux ans, sous la direction d’Ennus et de Cléon. En Asie Mineure, ils fondèrent l’État du Soleil avec Aristonicus ; ils furent vaincus en 129. De 104 à 101, de nouveaux soulèvements furent conduits en Sicile par Salvius et Arthénion. La révolte la plus importante et la plus connue fut celle que dirigea Spartacus, de 73 à 71. Elle fit trembler la république romaine, qui la noya dans des flots de sang. Mais cette république en fut tellement affaiblie qu’elle ne vit bientôt plus de salut que dans la dictature impériale.
Les masses exploitées par l’empire romain firent la fortune du christianisme. Elles mirent en lui tous leurs espoirs. Jusque-là, leurs révoltes avaient eu des raisons uniquement politiques et économiques ; la nouvelle religion y ajouta l’élément de fermentation évangélique entretenu par la tradition sociale des pères de l’Église, adversaires de la propriété privée et du pouvoir temporel. Il naquit de nombreuses hérésies, presque toutes d’esprit communiste. Révolte et hérésie se soutinrent mutuellement, car, comme l’a écrit Doellin, toutes les doctrines hérétiques eurent un caractère politique et social. Mais très souvent – on peut dire toujours –, elles s’arrêtèrent en chemin, ne poussant pas la révolte jusqu’à la révolution, ou se retournant contre elle pour aider à son écrasement. C’est ce qu’on vit au IVe siècle, dans le soulèvement des circoncellions, ouvriers agricoles du nord de l’Afrique, contre les grands propriétaires fonciers. Les donatistes, qui avaient d’abord favorisé ce soulèvement par leur lutte contre les catholiques, s’unirent à ces derniers contre les révoltés pour les soumettre à la double autorité civile et religieuse. C’est ce qu’on vit aussi au XVIe siècle dans l’avortement révolutionnaire de la Réforme. Après avoir provoqué et soutenu la révolte populaire, ses initiateurs se rallièrent au parti de « l’ordre » et étouffèrent, au nom du dieu des protestants, la révolution qu’ils avaient soulevée contre le dieu des catholiques.
Durant tout le Moyen Âge se produisit un profond et long mouvement de révolte paysanne contre les envahisseurs « colonisateurs » romains et barbares, puis contre la féodalité qu’ils organisèrent après s’être établis sur les terres dont ils avaient réduit en esclavage les occupants précédents. Dans les pays du Nord et de l’Orient, ce mouvement de révolte entrava l’organisation féodale plus longtemps que chez les Germano-Latins. On peut dire que la lutte ne cessa pas jusqu’au XVe siècle, la révolte paysanne primitive ayant pris, avec le développement des communes, la forme artisane et bourgeoise. Elle avait commencé en Gaule, au IIIe siècle, contre les violences romaines à l’égard des paysans qu’une fiscalité excessive dépouillait de ce que leur avaient laissé les pillages de la soldatesque. Ce fut la révolte des Bagaudes, du mot celte bagad (insurgé). Elle prit, à certain moment, un caractère de véritable guerre, mais elle est mal connue. Ses aspects ont été dénaturés, comme ceux de la révolte des circoncellions, par le « plutarquisme » dévoué aux conquérants qui a toujours présenté les soulèvements populaires comme des entreprises de brigandage. N’appelle-t-on pas « brigands », aujourd’hui, les Marocains et les Chinois qui se défendent contre les envahisseurs français et japonais ? Vers 270, les Bagaudes se soulevèrent dans les campagnes gauloises et, successivement vainqueurs et vaincus, ils tinrent l’Empire en échec jusqu’au jour où ils furent écrasés, dans leur camp de Bagaudarum Castrum, par l’armée de Dioclétien. Leur mouvement ne fut pas étouffé pour cela ; il persista jusqu’au Ve siècle, se manifestant dans la résistance de plus en plus désespérée des populations gauloises aux Romains. Ils furent définitivement battus, en 440, par Aetius, général romain, avec le concours des Francs, prétendus « hommes libres », alors mercenaires à la solde de Rome.
Mais Rome reculait devant les Barbares. La résistance gauloise eut alors affaire à ces derniers. Elle se concentra dans la fédération du Tractus Armoricanus, vaste région à l’ouest de la Gaule s’étendant des rivages de la Manche et de l’Atlantique jusqu’aux pays qui ont formé depuis l’Île-de-France, l’Orléanais, le Berry et l’Auvergne. L’esprit druidique, encore vivant aujourd’hui dans le caractère breton, fut un stimulant puissant aux révoltes des Bagaudes et donna son unité intellectuelle à la fédération gauloise. Les communes naquirent de l’esprit de la « bagauderie », réfugié dans les foyers campagnards. Elles furent d’abord des associations de paysans réunis pour s’entraîner à la révolte. Les premières de ces associations furent celles de la région d’Evreux, où la féodalité sévit cruellement en 997, tuant à sa naissance un mouvement qui eût pu devenir général dans les campagnes de France et provoquer un soulèvement considérable. Cent ans après, les communes citadines, nées des communes paysannes, se multiplièrent suivant l’esprit des paysans d’Evreux :
« Il n’y a nulle garantie pour nous contre les seigneurs et leurs sergents, ils ne respectent aucun traité.
« Pourquoi nous laisser faire tout ce mal et ne pas sortir de peine ?
« Ne sommes-nous pas des hommes comme eux ?
« N’avons-nous pas comme eux un corps de chair et d’os qui sent et qui souffre ?
« Il nous faut seulement du cœur.
« Unissons-nous tous par un serment.
« Jurons de nous soutenir mutuellement. »
C’est le même esprit de la « bagauderie » qui souleva les campagnards de l’Aquitaine, du Poitou et des Marches, puis ceux de Normandie et de Bretagne, les associant avec les gens des villes dans la guerre contre la domination anglaise, au XIIe siècle. Les poètes troubadours et guerriers, dont le farouche Bertrand de Born, appelaient les populations à la révolte, « depuis la frontière où sont les monts jusqu’au golfe où gronde l’Océan ».
Quand le christianisme eut été établi, ce fut surtout en Orient que se manifesta la révolte populaire concomitante à la révolte religieuse. L’hérésie groupait facilement les foules misérables, de plus en plus trompées par l’Église. L’Orient vit ainsi l’adhésion au gnosticisme, au manichéisme, au néo-platonisme, dans leurs formes réalistes et combatives, des populations rurales attachées aux coutumes communistes, pour la résistance à l’orthodoxie des puissants féodaux et aux abus qu’ils commettaient. La lutte des Bogamiles fut la plus longue ; elle concentra la flamme de toutes les révoltes qui l’avaient précédée pour se prolonger, du XIe au XVe siècle, et ne se terminer que lors de la victoire des Turcs. Ceux-ci amenèrent à l’islamisme l’adhésion en masse des foules orientales dégoûtées du christianisme.
Dans les pays latins, l’hérésie orientale se répandit sous le nom général de catharisme, du grec kaiaros (pur). La lutte longuement poursuivie par des populations entières soulevées motiva la fondation de l’Inquisition, pour en finir avec l’hérésie et les révoltes qui menaçaient à la fois les deux pouvoirs religieux et laïque. L’Inquisition trouva tous les concours qu’elle réclamait auprès des chefs d’États désireux d’assurer leur domination sur les peuples toujours agités quoique misérables. Tous ses inspirateurs, Thomas d’Aquin entre autres, voyaient dans la garantie de l’ordre social celui de l’ordre religieux ; mais, à côté, les Joachim de Flore, Amalric de Bène, Joan de Parme, Gérard de San Dominico, Guillaume d’Occam, Marsile de Padoue, Abélard, Roger Bacon, Eckard, fournissaient l’élément intellectuel et moral des révoltes prolétariennes pour l’affranchissement du joug féodal. Si des foules entières de cathares pacifiques, simplement résolus à vivre en communisme, furent exterminées à partir de 1022, date du synode d’Orléans qui leur déclara la guerre, d’autres résistèrent et attaquèrent avec plus ou moins de violence. En Italie, ce furent les Arnoldistes, conduits par Arnold de Brescia. Puis, au XIIIe siècle, les Frères apôtres, avec Segarelli. Au commencement du XIVe siècle, Dolcino, disciple de Segarelli, et ses partisans, entretinrent une longue et vive lutte contre les troupes du pape qui furent plusieurs fois battues. En France, au XIIe siècle, Pierre Valdes, de Lyon, fut l’instigateur de l’hérésie vaudoise qui souleva les classes pauvres et s’étendit en Allemagne, en Bohème, en Italie. Contre les Vaudois du Midi de la France, appelés Albigeois, fut menée la croisade de ce nom qui fut une longue guerre où les hérétiques résistèrent héroïquement. En Flandre, les Cathares se recrutèrent parmi les tisserands et s’appelèrent les Béguards ; les femmes furent les Béguines. Ceux qui furent errants se répandirent dans le bassin du Rhin, où ils devinrent les Bollards, vers 1300. Étant passés en Angleterre, les Bollards eurent une grande part dans le mouvement social de la fin du XIVe siècle. En Allemagne, l’hérésie se développa plus facilement que dans les pays latins. L’Inquisition n’y parut qu’au XIIIe siècle et rencontra une résistance très vive. Le concile de Mayence la condamna, en 1233, et l’inquisiteur Conrad de Marburg fut tué. L’hérésie forma, en Allemagne, un vaste courant de pensée qui prépara le succès de la Réforme.
Les communes donnèrent à la révolte un caractère plus laïque et plus réaliste qui fut celui des artisans et ouvriers des villes. La formation de leur pensée avait suivi celle du travail industriel durant le Moyen Âge. Ils avaient établi les corporations d’après les distinctions des différents corps de métiers. L’artisan de la veille, devenu le maître, en se dégageant de plus en plus de son compagnon resté ouvrier, y prenait une place prépondérante. La corporation réunissait tous les individus de même profession pour assurer la production de leur métier et pour défendre leurs droits ; mais cette défense était plus de principe que de fait, se trouvant basée sur le respect d’une hiérarchie corporative tyrannique, et des conflits ne devaient pas tarder à se produire, aussi graves et aussi nombreux entre gens de même corporation qu’entre les corporations rivales. Ce furent les premiers conflits du travail moderne. Les buts de défense professionnelle, si contradictoires fussent-ils, ne faisaient pas moins de la corporation un embryon du syndicat futur, et la différenciaient de ce qu’avaient été les anciennes hétairias des Grecs, les collèges des Romains, et de ce qu’étaient les ghildes germaniques, simples sociétés de secours mutuels pour gens de même métier. Les premières chartes corporatives sont du XIe siècle. En marge de la corporation s’établit parmi les ouvriers le compagnonnage, avec ses différentes sectes plus ou moins secrètes imitées de la franc-maçonnerie. Mais ses abus devinrent aussi excessifs que ceux des corporations, et il ne répondit nullement aux véritables besoins d’association et de défense des travailleurs. Il entretint entre eux autant de divisions et de conflits que les corporations entre les patrons. Un autre organisme de défense des travailleurs était, depuis les temps antiques, la franc-maçonnerie. Elle se manifesta activement au Moyen Âge parmi les constructeurs de cathédrales et d’hôtels de ville, où maîtres et ouvriers furent généralement confondus dans un fraternel anonymat. La franc-maçonnerie, souvent opposée aux corporations et au compagnonnage, fut, dans ses loges, et particulièrement au XVIIIe siècle, l’animatrice secrète des idées politiques qui produiraient la Révolution.
Avant le mouvement communaliste qui mêla les maîtres, compagnons, apprentis des corporations citadines aux luttes politiques, la révolte ouvrière n’avait guère été que verbale. Elle était âpre, initiée, satirique. Elle s’exprimait dans la littérature populaire du temps, et même dans le roman bourgeois. La Chanson du linceul, d’Henri Heine, n’a pas des accents plus poignants que la longue plainte des jeunes filles tisseuses disant dans le roman d’Yvain, vers 1170 :
Et n’en serons pas mieux vêtues.
Toujours serons pauvres et nues
Et toujours faim et soif aurons. »
Ces tisseuses n’ignoraient pas, bien avant Karl Marx, que les employeurs les frustraient de la plus-value de leur travail :
quoique riche soit de nos gains
celui pour lequel nous peinons. »
Une autre pièce dit les doléances d’un apprenti livré aux vexations ouvrières autant que patronales :
qui soit dans son malheur plus travaillé que moi. »
Il n’y a pas si longtemps que ces doléances ne sont plus d’actualité et que, dans certaines professions, l’apprenti n’est plus, comme le cheval, le souffre-douleur de l’ouvrier et du patron.
Le seul moyen de protestation contre l’exploitation de l’ouvrier fut longtemps la révolte individuelle du refus de travailler, le chômage volontaire. Mais contre ceux qui y recouraient, comme les oiseaux (oisifs), on rédigeait et on appliquait des ordonnances de plus en plus sévères, qui les faisaient châtier cruellement. Une de ces ordonnances, de François Ier, considérait les oisifs comme des malfaiteurs « présumés », ne cherchant à vivre que de « pilleries et rançonnements ». Elle les faisait fouetter, envoyer aux galères, ou bannir. « Le peuple est un mulet qui se gâte dans l’oisiveté », disait Richelieu, et c’est surtout pour supprimer le chômage que les lois favorisaient la création des manufactures, en enlevant même leur main-d’œuvre aux entreprises privées. La manufacture devint, par son travail forcé, le remède contre la « fainéantise » ouvrière. Elle servit à plier l’ouvrier sous le joug économique définitif d’où il n’aurait plus de possibilité d’évasion par le travail. Tout le programme de la monstrueuse hégémonie capitaliste actuelle était déjà dans la cynique déclaration d’un patron lyonnais, disant au commencement de l’ère des manufactures, avec des considérations morales hypocrites, ceci :
« Pour assurer et maintenir la propriété de nos manufactures, il est nécessaire que l’ouvrier ne s’enrichisse jamais. Personne n’ignore que c’est principalement au bas prix de la main-d’œuvre que les fabriques de Lyon doivent leur étonnante prospérité. Si la nécessité cesse de contraindre l’ouvrier à recevoir de l’occupation, quelque salaire qu’on lui offre, s’il parvient à se dégager de cette espèce de servitude, si ses profits excèdent ses besoins au point qu’il puisse subsister sans le secours de ses mains, il emploiera ce temps à former une ligue... Il est donc très important aux fabricants de Lyon de retenir l’ouvrier dans un besoin continuel de travail, de ne jamais oublier que le bas prix de la main-d’œuvre leur est non seulement avantageux par lui-même, mais qu’il le devient en rendant l’ouvrier plus laborieux, plus réglé dans ses mœurs, plus soumis à ses volontés. »
C’est par ce programme, demeuré encore aujourd’hui le « credo » patronal, qu’a commencé l’exploitation méthodique du travail, appelée de nos jours « rationalisation ». On comprend que le patronat redoutait tant la formation de « ligues ouvrières » ; son système d’exploitation ne pouvait que produire un mécontentement grandissant, une fermentation révolutionnaire de plus en plus active, et une accumulation de haines farouches qui expliqueraient nombre de ces choses que les tartufes engraissés de la misère des travailleurs ont appelées les « excès de la Révolution ».
À partir du XIVe siècle, toutes les classes laborieuses de la campagne et des villes participèrent à ce qu’on a appelé les « luttes paysannes ». Les premières furent celles de Flandre. Dès que l’empire de Charlemagne avait été partagé, cette province avait entrepris de conquérir sa liberté. De bonne heure, elle fut active et prospère grâce à son industrie et à son commerce. En 1279, les tisserands de Douai firent la première grève et la première émeute ouvrière à propos d’une taxe sur les draps. Un mouvement semblable suivit à Ypres et à Provins, où les maires furent tués au cours de la bagarre. En 1302, les brasseurs et les tisserands flamands battirent, à Courtrai, les chevaliers de Philippe le Bel. Ce fut ensuite le soulèvement général de la Flandre, en 1323, qui prit un caractère nettement populaire contre tous les riches, nobles et bourgeois, et contre l’Église. La lutte armée, conduite par Nicolas Zennekin et Jacob Peyt, dura cinq ans. Finalement, les révoltés furent battus à Cassel, en 1328. La chevalerie se vengea haineusement de sa défaite de Courtrai. 9 000 paysans moururent dans cette bataille, et une répression féroce sévit contre le peuple vaincu.
Dans le même temps, se préparait, en France, la Jacquerie, dans le Beauvoisis. La guerre de Cent Ans avait commencé en 1339, entre l’Angleterre et la France, pour des questions de concurrence économique autant que dynastique ; le brigandage exercé sur l’habitant par les troupes françaises et anglaises était passé à l’état endémique. Les paysans exaspérés se mirent en insurrection sous le nom de Jacques. Ils trouvèrent des appuis dans quelques villes, principalement à Paris, où la commune faisait la révolution, dirigée par Étienne Marcel ; mais, nullement organisés, et combattus avec acharnement, ils furent rapidement vaincus. La Jacquerie fut la révolte du désespoir et ne dura que cinq semaines, du 21 mai au 24 juin 1358. Une cruauté inouïe présida à la répression qu’exercèrent les nobles. Des populations furent massacrées, jusqu’aux femmes et aux enfants, et des villages de l’Oise, de la Seine et de la Marne furent anéantis par le feu. L’un des chefs du mouvement, le paysan Guillaume Calle, fut mis à la torture puis décapité. Un demi-siècle après, le peuple de Paris fit, sous la conduite du boucher Jean Caboche, la révolte des Cabochiens. Ils avaient conçu une œuvre réformatrice qui eût pu marquer un immense progrès social si leur révolution avait été victorieuse (voir Politique).
En Angleterre, les luttes paysannes prirent une vaste ampleur au XIVe siècle, sous l’influence de Wiclef. Elles eurent leur répercussion dans les événements de Bohème, au XVe siècle, et d’Allemagne, au XVIe. Elles furent, dans les trois pays, de véritables révolutions sociales, dépassant en portée les buts politiques et religieux de leurs instigateurs qui ne pouvaient suffire aux masses populaires accablées. Wiclef était un théoricien communiste dont les idées trouvèrent, grâce à la situation économique de l’époque, un terrain favorable à cette action qui le dépassa. Tandis qu’il discutait avec l’Église, paysans et ouvriers, aidés des bollards flamands, mettaient les idées de cet hérétique en actes. John Ball, son disciple, prêcha l’insurrection paysanne contre la noblesse et le clergé, disant :
Où donc était le gentilhomme ? »
Elle éclata en 1381 et trouva immédiatement le concours des citadins misérables dressés contre les riches. Londres vit des massacres de maîtres et des pillages de maisons de banque. Le pouvoir royal menacé traita avec les insurgés. Quand ils eurent mis bas les armes, il ne tint pas ses promesses et usa d’une répression sauvage. Les chefs de la révolution, parmi lesquels John Ball, Walt Dyler, Jack Straw, furent pendus ou décapités. On s’efforça de détruire les communautés des paysans à qui le roi disait :
« Serfs vous êtes, serfs vous resterez !... »
La révolution n’en marqua pas moins le début de la disparition progressive du servage. Diverses autres insurrections y aidèrent jusqu’en 1550, notamment celle du pays de Kant dirigée par John Cade, en 1450.
En Bohême, l’état de prospérité économique avait favorisé l’enrichissement des commerçants et des hobereaux au détriment de la petite noblesse et des paysans pauvres. Dès le XIIIe siècle, l’hérésie vaudoise répandue dans les campagnes et l’esprit national soulevé contre les étrangers enrichis avaient préparé le terrain à ceux qui seraient les Hussites, disciples de Jean Huss au XVe siècle. C’est sous la triple influence religieuse, nationale et économique que la guerre des Hussites éclata en 1419, pour durer jusqu’en 1435. Il y eut rapidement division entre ceux qui ne voulaient qu’une réforme nationale ou religieuse et les paysans qui réclamaient une transformation sociale. Ceux-ci formèrent l’armée des taborites, que Jean Ziska commanda victorieusement jusqu’en 1424. Les taborites furent victorieux jusqu’en 1433 ; mais, divisés eux-mêmes et se persécutant entre eux, ils furent définitivement battus, et aucune réforme sociale ne suivit. La guerre des Hussites n’eut que des résultats politiques.
En Allemagne, les événements eurent encore plus d’ampleur. Les précurseurs de la Réforme, les avaient longuement préparés et, lorsque Luther arriva, il n’eut plus qu’à mettre le feu aux poudres, cela un peu malgré lui et sans se douter de la révolution qu’il provoquait. Comme la Bohême, l’Allemagne était un pays riche aux XVe et XVIe siècles. Ses privilégiés voulaient aussi une réforme nationale et religieuse les dégageant du joug romain et ecclésiastique. Les classes prolétariennes demandaient un État social à base communiste. L’anabaptisme représentait leur parti extrême parmi les paysans. Des publications et des prédications communistes s’étaient répandues depuis la première partie du XVe siècle. Les paysans retrouvaient leurs plaintes dans la Réforme de l’empereur Sigismond, tract d’inspiration taboriste qui leur fut distribué en 1438. En 1416, Hans Boheim annonçait dans ses discours le règne prochain de l’égalité parmi les hommes. En 1413, se forma en Alsace une association secrète, le « Bundschuch », pour le retour au droit humain contre le droit divin. Dans le Wurtemberg, c’était en 1514 l’association du « Pauvre Conrad » contre la noblesse et la bourgeoisie. Dans les villes, l’agitation communiste provoquait des soulèvements à Erfurt (1509), Ulm (1511), Brunswich (1512), Cologne (1518). Une propagande sociale intense faisait communiquer les villes et les campagnes, y semant des idées qui dépassaient et épouvantaient déjà les réformateurs nationaux et religieux. Enfin, beaucoup plus influents que les réformateurs théologiens, trop prudents, furent sur le peuple les prédicants anabaptistes qui déterminèrent un vaste mouvement de foule dans toute l’Europe centrale. L’agitation était menée surtout par Thomas Münzer, communiste-anarchiste d’action, ardent et irréductible, qui rompit violemment avec Luther, quand il le vit se dresser contre la cause populaire en déclarant, dans son aveugle fureur, des choses comme celles-ci :
« Comme les âniers, qui doivent rester tout le temps sur le dos de leurs bêtes, sans quoi elles ne marchent pas, de même le souverain doit pousser, battre, étrangler, pendre, brûler, décapiter, mettre sur la roue le peuple Herr Omnes, pour que celui-ci le craigne et soit tenu en bride. »
Ce « sot moine », comme l’appelait Münzer, avait l’allure d’un vil inquisiteur et d’un criminel frénétique. Il devait ajouter plus tard : « Moi, Martin Luther, j’ai pour ma part tué les paysans, car j’ai ordonné de les frapper à mort ; leur sang coule sur mon cou, mais je me dégage de cette responsabilité sur notre seigneur Dieu, lequel eût enjoint de parler comme je l’ai fait. Münzer prépara d’abord la lutte dans des associations secrètes et provoqua en Thuringe, où il fut aidé par Heinrich Pfeiffer, un premier soulèvement, en 1524. La révolte fut générale en Allemagne en 1525 ; ce fut la Guerre des Paysans. Elle ne dura que quelques mois, mais elle fut ardente. Divisés et trahis, les paysans furent vaincus, comme ils l’avaient été en Angleterre, mais la répression fut plus féroce, stimulée par Luther. Non seulement près de 150 000 d’entre eux furent massacrés, mais ils furent réduits au servage. On traqua ensuite les anabaptistes. Ils luttèrent jusqu’en 1536, notamment à Munster, où ils eurent pour chefs Jean de Leyde, Knipperdolling et Krechting. Tous trois, vaincus et faits prisonniers, furent exécutés en janvier 1536. Ainsi commença la régression politique et économique de l’Allemagne dont la Guerre de Trente Ans achèverait la ruine pour deux siècles.
Pour donner une idée complète et exacte de ce que furent les révoltes populaires, il faudrait parler de la part qu’elles eurent dans tous les bouleversements de l’Europe depuis cinq ou six cents ans. Ce serait d’ailleurs montrer la vérité historique de la plupart de ces événements dont le caractère exact a été faussé par le « plutarquisme ». Il n’est aucun d’eux qui n’ait eu des raisons économiques autrement profondes et graves que les motifs politiques sous lesquels on les a présentés, le plus souvent, pour servir la mémoire de quelque roi ou ministre. Mais le « plutarquisme » n’allait pas reconnaître que des événements sociaux ont été déterminés par l’intervention du peuple excédé de servitude et de misère, et non par ce qu’il appelle « l’habile » ou la « grande politique » de tel ou tel soliveau couronné. On aurait ainsi à rectifier bien des inexactitudes sur des événements dont voici quelques-uns :
La révolte des montagnards suisses, qui firent à Brunnen, en 1291, l’alliance des trois cantons de Uri, Schwyz et Unterwalden, contre le joug autrichien, et fut le commencement d’une lutte qui dura jusqu’à la formation et la reconnaissance définitive de la Confédération helvétique.
Les nombreux soulèvements populaires qui se produisirent de tout temps, en Italie, contre l’autorité papale, et notamment au XIVe siècle, la fondation d’une république romaine qui ne succomba que lorsque Rienzi l’eût trahie par sa dictature.
La part que prirent les populations italiennes dans la lutte contre la tyrannie espagnole aux XVIe et XVIIe siècles : conspiration des paysans calabrais à l’instigation de Campanella, l’auteur de la Cité du Soleil, qui, mis plusieurs fois à la torture, passa vingt-sept années en prison ; insurrection de Naples, en 1647, provoquée par des impôts excessifs appliqués à la vente sur les marchés des légumes et du poisson et conduite par le pêcheur Masaniello ; insurrection de Palerme, dirigée par l’ouvrier orfèvre Joseph d’Alessi, qui eut des motifs semblables ; insurrection de Messine, soutenue pendant un certain temps par Louis XIV, puis abandonnée aux Espagnols qui ruinèrent la ville et la province, etc.
La Russie vit de nombreuses révoltes paysannes jusqu’au XVIe siècle pour la défense des libertés municipales contre la féodalité. La cité de Nijni-Novgorod avait formé une république jusqu’à la fin du XIIIe siècle. Au XVIe, le faux ami des paysans, Boris Godounov, qui se déclarait prêt à « donner sa dernière chemise pour le peuple » (sic), livra ces paysans au servage et à la sanglante tyrannie que la dynastie des Romanov exerça durant quatre siècles, jusqu’en 1917, lorsque la Révolution nettoya la Russie de la pourriture raspoutinienne.
En Angleterre, sous le règne de Charles Ier, au XVIIe siècle, les insurrections des paysans des comtés de Northampton, Warwick et Leicester, contre les seigneurs qui les dépouillaient de leurs terres, furent un des préludes de la Révolution anglaise. Celle-ci n’aurait pu se soutenir sans le concours des classes populaires. L’Écosse et l’Irlande, traitées en colonies par les Anglais, commencèrent la grande lutte à laquelle on a affecté de ne voir que des motifs religieux et dynastiques, Elle gagna toute l’Angleterre, et c’est sous la pression du peuple que fut établie la république parlementaire que Cromwell, donnant un exemple suivi par Bonaparte cent cinquante ans plus tard, escamota à son profit et laissa livrée, après sa mort, à une restauration de la royauté. Le peuple anglais subit en ce temps-là, malgré tous ses efforts pour la liberté, toutes les formes de dictature : théocratique, autocratique et démocratique. Cela ne suffit pas ; il connut encore les horreurs d’une épidémie de peste qui fit 300 000 victimes.
En France, les événements de la Fronde eurent pour origine des révoltes paysannes contre les impôts nouveaux établis pour payer les dépenses de guerre et les emplois distribués par la royauté aux derniers féodaux résignés à devenir courtisans. Déjà, Henri IV avait payé d’une centaine de millions la soumission des chefs militaires qui auraient pu empêcher son avènement au trône. Ce « père du peuple » qui, suivant nos Plutarque, voulait que chaque paysan mît la poule au pot tous les dimanches, avait abusé, sans aucun ménagement, des tailles et de la gabelle. On vit, sous Henri IV et Louis XIII, les révoltes des Croquants, paysans du Périgord, du Limousin, du Quercy, puis, en 1639, celle des Va-nu-pieds, ouvriers et gens de métiers de Normandie. L’administration de Mazarin aggravant encore les charges populaires par toutes ses déprédations, la protestation populaire devint plus générale et fut soutenue par le Parlement, d’émanation bourgeoise. La Fronde éclata. Elle fut la guerre des appétits de cour et des intrigues des féodaux non encore entièrement domestiqués qui se battirent alternativement, mais toujours patriotiquement et glorieusement, pour et contre la France, jusqu’au jour où ils se virent suffisamment pourvus de ses dépouilles. Cela dura cinq ans, après quoi princes, bourgeois et Parlement permirent à Louis XIV de dire : « L’État, c’est moi ! » sur le dos du peuple. Celui-ci resta le dindon de la farce et paya de plus en plus la prétendue gloire du « Grand Siècle », un des plus calamiteux de ceux que la France ait connus. Le peuple des campagnes, réduit à l’état de bête de somme et de vache à lait, allait encore, pendant quatre-vingts ans, étouffer dans sa poitrine cette révolte qui le ferait un jour mettre le feu aux châteaux. La révocation de l’Édit de Nantes et les persécutions religieuses accompagnées des dragonnades déterminèrent, sous le « grand roi », la dernière insurrection paysanne, celle des Camisards, soulevés dans les Cévennes au double cri de :
« Plus d’impôts ! Liberté de conscience ! »
La révolution économique, produite au XVIe siècle par les inventions mécaniques, les découvertes maritimes, le développement industriel et commercial (voir Temps modernes), avait transformé les conditions du travail et placé plus nettement les classes sociales en face les unes des autres. De plus en plus, le paysan était séparé du propriétaire, l’ouvrier du maître, et pendant que le paysan tombait peu à peu dans un accablement passif, en attendant les revanches de 1789, l’ouvrier augmentait sa combativité contre les rigueurs de son exploitation. D’ailleurs, la campagne se dépeuplait de ses éléments les plus actifs et les plus entreprenants attirés dans les villes. Les ouvriers, malgré tous les obstacles, commençaient à employer les moyens de lutte modernes contre le patronat. On vit ainsi, à Lyon, en 1539, une grève générale de l’imprimerie. Les imprimeurs avaient formé une sorte de confrérie où ils avaient des chefs et payaient des cotisations. La grève était appelée le « tric ». On faisait le tric quand un membre de la confrérie avait à se plaindre d’un patron, et, pour assurer son succès, des compagnons armés empêchaient la continuation du travail. Les « jaunes » d’alors, les patrons, et même le guet, étaient parfois rossés par eux. Les imprimeurs de Lyon appuyèrent de cette façon les revendications dont ils avaient présenté les cahiers. Une ordonnance du roi leur fut défavorable ; ils persistèrent malgré la répression et furent aidés par les imprimeurs parisiens. Après trois ans de grève, les imprimeurs durent céder, en 1541, mais le mouvement ne s’éteignit pas, et, jusqu’en 1618, les imprimeurs ne cessèrent pas de réclamer.
Au XVIIe siècle, les coalitions ouvrières et les grèves plus ou moins agitées et sanglantes commencèrent à se multiplier. Boisguillebert les signalait vers la fin du siècle ; il en décrivait l’organisation ainsi que les causes et les conséquences. Il disait, entre autres, que des marchands considérables faisaient banqueroute parce qu’ils étaient « deux ou trois ans sans pouvoir trouver personne pour faire leurs ouvrages ». Il y eut des émeutes à Caen, où les toiliers réclamaient des augmentations de salaires. En 1697, à Darnetal, pour protester contre la main-d’œuvre étrangère, les ouvriers drapiers se mirent en grève pendant un mois, au nombre de 3 000 à 4 000, après avoir fait fermer les fabriques. Lyon et la région environnante furent de tout temps à la tête des révoltes ouvrières, la misère des travailleurs y étant plus profonde qu’ailleurs. On y vit de grandes grèves au XVIIIe siècle. En 1744, quarante mille ouvriers du textile cessèrent le travail à Saint-Etienne. Le mouvement s’étendit à Lyon. Pendant plusieurs jours, las grévistes furent maîtres de la ville, mais ne se livrèrent pas à de graves violences. On n’en pendit pas moins un ouvrier, et plusieurs autres furent envoyés aux galères. Une amnistie intervint pour ces derniers en 1745, sur la demande des patrons effrayés par l’ampleur de la protestation ouvrière. En 1779, ce fut la grève des tarifs. La révolte fut plus violente et plus sévèrement réprimée. 1786 vit une grève générale des maçons, chapeliers et tisseurs pour des motifs de salaires. Là encore, l’armée parut, et Bonaparte, alors lieutenant d’artillerie, prit part à la répression, faisant ses débuts contre le peuple. Le 27 avril 1789, ce fut à Paris le pillage de la fabrique Réveillon. Les causes et les circonstances de cette affaire sont demeurées mystérieuses. On était dans une période particulièrement effervescente où le moindre événement de la rue pouvait avoir des conséquences considérables. Pour certains, l’affaire Réveillon fut le résultat de la colère irraisonnée du peuple ; pour d’autres, elle fut le produit de la provocation policière. De tout temps, cette provocation a joué un grand rôle ; elle le joue toujours, suivant les intérêts des puissants.
Durant la Révolution, la misère et le désespoir d’Une part, la colère devant les menaces aristocratiques d’autre part, font comprendre bien des « excès révolutionnaires » du peuple. Elles sont entre autres une excuse aux Massacres de septembre, une excuse que n’auront jamais les froids et cyniques criminels, représentants de « l’ordre », qui n’ont pas cessé depuis cinquante siècles de faire de la terre entière un épouvantable charnier. Des protestations vigoureuses s’étant élevées, notamment chez les charpentiers décidés à ne plus travailler à moins de cinquante sous par jour, la commune de Paris prit parti contre eux et demanda à la Convention des armes pour faire cesser les « coalitions dangereuses » des travailleurs. C’est alors que la Convention vota la loi Le Chapelier, qui scella le servage ouvrier dans le prétendu régime de liberté de la République et supprima le droit de grève pour plus d’un demi-siècle. En 1806, Napoléon, qui avait aggravé contre les ouvriers les dispositions de la loi Le Chapelier, disait à l’Exposition industrielle de la place des Invalides :
« Le moment de la prospérité est venu ; qui oserait en fixer les limites ? »
On vit ces limites peu de temps après, dans la « crise capitaliste » de surproduction et de sous-consommation qui se produisit alors, comme aujourd’hui. La « prospérité » napoléonienne était déjà celle des Poincaré et des Tardieu.
Cette « prospérité » fut particulièrement terrible pour la classe ouvrière. En aucun temps, sa misère ne fut aussi effroyable que dans la période qui alla jusqu’en 1850. La bourgeoisie, grande et petite, établissait sa souveraineté sur des travailleurs que la faim décimait, quand ce n’était pas le choléra. On comprend que la révolte devait éclater, malgré toutes les pulsions demeurées vivaces depuis la Révolution, et se traduire par des insurrections que le romantisme appellerait « politiques », mais qui seraient surtout d’ordre économique. De 1830 à 1851, pendant vingt-et-un ans, les travailleurs mitraillés parce qu’ils demanderaient « du travail et du pain » mesureraient ce que valait pour eux le triomphe de la bourgeoisie et la blagologie qu’avait été la proclamation des Droits de l’homme et du citoyen... On comprend qu’ils demeureraient ensuite indifférents au coup d’État et à l’avènement de Badinguet. Déjà, pendant la Révolution, le journal les Quatre cris d’un patriote pouvait dire :
« Que servira une constitution sage à un peuple de squelettes qu’aura décharnés la faim ? »
Mais on n’eut pas même une constitution sage puisqu’elle fit, au profit de la nouvelle aristocratie de l’argent, vingt-cinq millions d’indigents ! Depuis le XVe siècle, la capacité d’achat des salaires des manœuvres, c’est-à-dire de la presque totalité des travailleurs parmi ces indigents, était descendue de façon presque ininterrompue de 18,40 à 4,50 pour le pain, aliment essentiel du peuple. Pour mieux affamer les ouvriers par les bas salaires, l’industrie leur prenait leurs femmes et leurs enfants. Dès le XVIIIe siècle, Pitt avait dit aux tisseurs anglais avides de main-d’œuvre à bon marché :
« Prenez les enfants !... »
La Révolution française livra les femmes et les enfants aux industriels. Michelet put crier avec indignation devant le spectacle de la femme d’atelier :
« L’ouvrière ! Mot impie, sordide, qu’aucune langue n’eut jamais, qu’aucun temps n’aurait compris avant cet âge de fer, et qui balancerait à lui seul tous nos prétendus progrès ! »
L’exploitation de l’enfant devint pire que celle de la femme. On voyait, en 1837, des enfants de six ans travaillant dans les manufactures. En 1840, à Sainte-Marie-aux-Mines, on en employait qui n’avaient que quatre à cinq ans pour dévider des trames, et qui tombaient épuisés sur les métiers. Villermé fait le tableau des enfants en haillons, pieds nus, allant travailler dans les usines de Mulhouse, n’ayant qu’un morceau de pain pour leur repas. Déjà, en 1840–1845, il y avait, dans les usines de France, 254 900 femmes et 131 000 enfants, à côté de 672 450 hommes. Des ministres avaient l’ignominie de justifier cette exploitation par des discours de ce genre :
« L’admission des enfants dans les usines est pour les parents un moyen de surveillance, pour les enfants un commencement d’apprentissage, pour la famille une ressource... L’habitude de l’ordre, de la discipline et du travail doit s’acquérir de bonne heure, et la plupart des mains-d’œuvre industrielles exigent une dextérité, une prestesse qui ne s’obtiennent que par une pratique assez longue et qui ne peut être commencée trop tôt. »
La révolte éclata, désespérée, farouche, particulièrement à Lyon, où ses plus sombres pages, avant celles de 1848, ont été écrites en 1831. Elle avait été précédée d’une longue lutte contre les machines dont le capitalisme avait fait des ennemies des ouvriers. Dès 1707, les bateliers du Weder avaient détruit le bateau de Papin, et tout le XVIIIe siècle avait vu la lutte sournoise ou violente contre le machinisme affameur. Sismondi constatait que ce machinisme « réduisait l’ouvrier à l’état mécanique, lui enlevait une partie de son salaire, favorisait le contraste scandaleux entre les riches industriels et l’indigence de leurs ouvriers ». Bastiat ajoutait cette autre constatation que la mauvaise organisation sociale, en faisant de la machine une ennemie de l’ouvrier, obligeait ce dernier à « maudire l’esprit humain ». Dès 1825, les conflits entre les travailleurs et le patronat devinrent de plus en plus nombreux, quoique contenus par les espoirs politiques dans le socialisme.
Le premier mouvement ouvrier qui eut une portée étendue et révolutionnaire fut celui d’Angleterre. Il eut ses racines dans l’action de Thomas Hardy. Dès 1791, celui-ci avait fondé, à Londres, une association ouvrière de caractère international, dont les buts étaient à la fois politiques et économiques. Cette association fit une active propagande jusqu’en 1799, année où elle disparut. Son influence se retrouva dans l’action des luddistes, ennemis des machines, qui aboutit aux mouvements insurrectionnels de 1816 à 1820. Les théories du socialiste Robert Owen, répandues de plus en plus dans les milieux ouvriers anglais, déterminèrent une longue et violente agitation qui dura de 1830 à 1834. Ce fut enfin le mouvement chartiste, qui dura de 1837 à 1848 et fut politique, mais particulièrement ouvrier. S’il ne fit pas obtenir à la classe ouvrière le suffrage universel qu’elle réclamait, il lui valut des conditions de travail et des améliorations économiques autrement intéressantes que la prétendue souveraineté du bulletin de vote qui ne lui serait accordé qu’en 1918.
En France, de 1825 à 1847, les faits de grève motivèrent environ 1 250 poursuites judiciaires. Sur 7 000 prévenus, 60 furent condamnés à plus d’un an de prison, 4 500 à moins d’un an et 700 à la seule amende. 1831 et 1834 avaient vu les insurrections de Lyon, au cri de :
« Vivre en travaillant, mourir en combattant ! »
À Caen, au Mans, à Limoges, à Paris, d’autres avaient suivi. En 1834, ce fut à Paris le massacre de la rue Transnonain, prémédité par le gouvernement. De 1831 à 1848, les travailleurs mirent un espoir fiévreux et grandissant dans le socialisme. Privés de droits politiques, ils comptaient sur leur association pour voir améliorer leur sort. Ils participèrent aux associations secrètes sur le modèle du carbonarisme, et Blanqui fut leur plus grand animateur, avec Flocon, Raspail, Marrast, Barbès, Caussidière. Avec Buonarotti, l’agitation fut plus prolétarienne. Elle fut aussi inspirée des communistes allemands et des événements de Lyon. Paris vit l’insurrection de mai 1839, qui amena la condamnation de Blanqui et de Barbès. La grève des charpentiers, en 1845, eut un grand retentissement par les discussions qu’elle souleva à propos du droit de coalition des ouvriers et de l’intervention de l’armée dans les conflits du travail. Berryer, avocat des grévistes charpentiers, avait dit aux juges :
« Si vous poursuivez si scrupuleusement le droit de coalition, pourquoi les maîtres charpentiers ne sont-ils pas assis sur les bancs des accusés ? »
Deux ans après, le droit de coalition ouvrière étant toujours en discussion, Bastiat déclarait que son refus était tout simplement la proclamation de l’esclavage, l’ouvrier étant obligé de se soumettre sans discussion et sans résistance au bon plaisir patronal. L’intervention de l’armée dans les grèves était vivement critiquée, notamment par Ledru Rollin. Protestations vainement répétées depuis, chaque fois que les « défenseurs de la patrie » ont fait couler le sang ouvrier. Le « républicain » Thiers, ministre du temps, ne considérait-il pas que les ouvriers en grève étaient des « ennemis de la patrie » ? En 1846, lors de la grève des mineurs de la Loire, la troupe tira sur les ouvriers : douze furent tués. Depuis, on ne compta plus ces interventions sanglantes que l’Empire et la IIIe République multiplièrent. Tous les régimes, même les plus démocratiques, se sont consolidés dans le sang des travailleurs.
La période de 1848 à 1864 vit 1 141 poursuites, 6 812 prévenus et 4 845 condamnés. Lyon continua à tenir la première place dans l’histoire des révoltes ouvrières par le nombre et l’importance de ses grèves, celle entre autres des chapeliers, en 1853. Les dernières années de l’Empire marquèrent une véritable « série rouge ». L’Internationale ouvrière s’était formée ; elle excitait les impatients de réalisations sociales, et les grèves éclataient de tous les côtés, réprimées d’une façon sanglante. Citons celle de Roubaix, en 1867, qui s’accompagna d’émeute. Trois usines furent dévastées, une fut incendiée ; il y eut 78 condamnations. En 1869, ce furent les événements tragiques de La Ricamarie et d’Aubin. 9 ouvriers et une femme furent tués par l’armée, en juin, à La Ricamarie ; il y eut 14 morts et 22 blessés à Aubin, en octobre. La grève du Creusot, en 1870, fut suivie d’arrestations en masses. 298 mois de prison furent distribués à 24 condamnés.
Après les massacres de la Commune, la classe ouvrière, presque anéantie dans son activité revendicatrice, ne fit guère que les grèves de 1872 chez les mineurs du Nord et du Pas-de-Calais. À cette occasion, le sinistre Thiers, encore tout dégouttant du sang des communards, fit marcher l’armée contre les grévistes, les déclarant « ennemis de la libération du territoire ». Les mineurs des mêmes départements firent par la suite les grèves de 1884, 1889, 1891, 1893, etc., jusqu’à la grève générale de 1902, où ils posèrent les conditions suivantes qui furent satisfaites partiellement : retraite, journée de huit heures, relèvement et minimum des salaires.
1886 avait vu la grève de Decazeville et l’épisode tragique de la mort du directeur d’usine Watrin. Le 1er mai 1891, ce fut Fourmies, avec le premier essai des balles Lebel, en attendant que l’armée fût pourvue de « balles de grève », sur des femmes et des enfants. En octobre 1892, ce fut Carmaux. En septembre 1899, Le Creusot, qui amena la reconnaissance du syndicat ouvrier par le gouvernement. En 1900, grève sanglante à Châlons-sur-Saône. Au Français (Martinique), 17 ouvriers furent fusillés par la troupe. En 1901, grève de Montereau. De 1900 à 1904, celles des dockers de Marseille. En 1903 et 1904, celles du textile, dans le Nord. En 1905, celles des porcelainiers de Limoges, des mineurs et métallurgistes de Meurthe-et-Moselle. Et, depuis, les grèves se sont succédé presque sans interruption, dans toutes les professions et toutes les régions, avec des répressions plus ou moins sanglantes. L’histoire de la Confédération générale du travail est surtout, jusqu’en 1911, l’histoire de ces conflits qui montrèrent en M. Clemenceau le plus farouche adversaire de la révolte. Tous les moyens utopiques du réformisme n’ont pu empêcher ces mouvements ouvriers devant les exigences de plus en plus draconiennes du patronat. Mais surtout, depuis 1914, les grèves sont devenues de plus en plus inopérantes. L’expérience a démontré définitivement, après le lamentable essai de grève générale de 1920, que seule la grève révolutionnaire, expropriatrice de la société capitaliste et bourgeoise, d’une classe ouvrière organisée et unie dans une volonté d’émancipation intégrale, au-dessus des intérêts corporatifs médiocres et contradictoires, peut apporter un véritable remède à l’exploitation des travailleurs.
Telle est, rapidement exposée, l’histoire des révoltes paysannes et ouvrières. Ses épisodes sanglants en ont fait un véritable martyrologe prolétarien. Nous n’avons nommé que quelques-uns des simples hommes qui ont guidé ces révoltes, héros obscurs mais autrement grands que les belliqueux et néfastes personnages dont le « plutarquisme » empoisonne d’une admiration malsaine les mémoires populaires. Les travailleurs devraient moins oublier les véritables héros, ceux qui, sortis de leurs rangs, humbles et souffrants comme eux, ont cherché à les conduire à leur émancipation et se sont sacrifiés pour cette tâche magnifique.
— Edouard ROTHEN.
RÉVOLUTION
(du latin : revolutio ; de revolvere : retourner)
Ce mot, qui est employé dans des acceptions très diverses, possède, en matière de sociologie, un sens très précis, en conformité, d’ailleurs, tant avec son étymologie, qu’avec la signification qui lui est communément attribuée. Une révolution, c’est une transformation considérable et soudaine, opérée dans la société, par le moyen de la violence et du renversement de l’ordre établi. Employer au propre, dans le langage sociologique, le mot révolution, en lui accordant un sens différent, c’est prêter à la confusion.
Il n’est, certes, pas interdit de s’en servir au figuré, mais à condition, si l’on veut demeurer clair, de le compléter par un terme explicatif, ne laissant subsister aucune ambiguïté, On pourra dire ainsi : une révolution dans les esprits, ou les arts, ou la mécanique, lorsqu’on voudra qualifier le changement profond, brusquement survenu, soit dans notre conscience par une révélation inattendue, soit dans nos méthodes par la vulgarisation d’une formule nouvelle. Mais il doit être bien entendu qu’il s’agit là de l’exploitation d’une analogie, qui ne doit pas servir de prétexte à l’altération du véritable sens du mot qui retient notre attention.
Prétendre que « la révolution, qui a commencé avec le premier geste de révolte d’un esclave, et ne se terminera qu’avec le trépas du dernier tyran, s’opère sous nos yeux tous les jours », c’est sans doute faire surgir, dans l’esprit de ceux qui nous écoutent, une impressionnante image, et donner à leur soif de réalisations un peu d’apaisement. Mais ceci est plus littéraire que scientifique, et constitue un abus. Il est incontestable que la société est en travail de modification permanente. Cependant, lorsque, durant de longues périodes, le progrès ne s’y effectue qu’avec lenteur, de façon presque insensible, il est excessif de présenter ceci comme un des aspects de la révolution. Il est, pour désigner de telles phases, un autre terme, qui a bien son utilité, et cet autre terme est « l’évolution ».
Affirmer que celle-ci est une révolution au ralenti, et que, par contre, cette dernière est une évolution brusque, est une thèse qui, à la rigueur, peut se soutenir, Mais il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de deux choses bien différentes, et qui ne doivent pas être confondues. La révolution est à l’évolution ce que l’accouchement est à la gestation ; ce que la rupture d’une digue est à l’accumulation des eaux ; ce que l’éclatement de son enveloppe est à l’éclosion parfaite de la fleur. Et ce n’est qu’en accordant à la définition du mot ce caractère que l’on peut, non seulement être bien compris d’autrui, dans un exposé de propagande, mais encore se soustraire personnellement aux mirages de certains concepts abstraits.
La tempête qui, de 1789 à 1793, a renversé, en France, la monarchie, détruit les privilèges de la noblesse et du clergé, et permis la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen représente bien une révolution. La multiplication des grèves corporatives et des meetings, durant une période troublée de la république bourgeoise, n’en constitue certainement pas une.
Si nous recherchons quels sont, dans l’histoire, les événements qui ont présidé à l’accomplissement des révolutions, nous découvrirons qu’il s’agit de faits se présentant d’une manière à peu près identique : des philosophes et des hommes d’action isolés ont conçu ce que pourraient être une constitution politique ou un ordre social plus justes que ceux qui existent. La grande masse du peuple demeure indifférente à l’exposé de leurs doctrines, qu’elle juge utopiques, jusqu’au jour où, surexcitée par l’extrême misère, ou l’invasion, les humiliations d’une défaite, elle perd confiance dans le gouvernement qu’elle honorait la veille, et s’insurge contre lui, non seulement par désir de vengeance, mais aussi dans l’espoir d’obtenir à son sort des améliorations, avec l’établissement d’un régime nouveau.
Si les insurgés possèdent, dans leurs rangs, des hommes de volonté tenace, de conscience droite et de culture suffisante ; si l’armée – ou, du moins, la plus grande partie de l’armée – fait avec eux cause commune, ils ont toutes chances de renverser le pouvoir. Dans le cas contraire, avec des effectifs et un armement inférieurs, des directives à peu près nulles, leur mouvement est condamné à périr à très bref délai, sous les coups d’une barbare répression. Que la victoire soit à eux, par suite de la capitulation ou de l’exode des classes dirigeantes, et la tâche n’est point pour cela terminée. Attaqués de toutes parts : à l’extérieur par les armées des nations demeurées fidèles aux règles du passé, à l’intérieur par les menées secrètes et l’espionnage de la contre-révolution, les insurgés victorieux, mais non pour cela à l’abri de tout péril, sont contraints, sous peine d’être les victimes de la terreur blanche, de prendre, sans défaillance, toutes les mesures défensives justifiées par la nécessité, de tenir en respect tous les ennemis, cependant que se réorganise, sur d’autres bases, la société.
En somme, s’inspirant des observations les plus récentes, on peut dire que toute révolution suppose trois phases pour être un fait accompli :
-
une période préparatoire, durant laquelle nombre d’esprits sont séduits par des doctrines nouvelles, et la révolte collective s’annonce par des mécontentements de plus en plus nombreux ;
-
une période insurrectionnelle, durant laquelle des combats sont livrés entre les forces révolutionnaires armées et les troupes affectées à la défense de l’ordre établi ;
-
une période consacrée à la défense des conquêtes de la révolution et à l’instauration de l’ordre nouveau lorsque, le pouvoir ayant été renversé par l’insurrection triomphante, il s’agit de conserver des positions chèrement acquises, et de réorganiser la production, la consommation, les transports, et les multiples services d’utilité publique durement éprouvés par la guerre civile.
Dans l’histoire contemporaine, deux bouleversements requièrent surtout notre attention : la Révolution française de 1789, et la Révolution russe de 1917. L’une et l’autre présentent des phases en conformité de la règle établie ci-dessus. La Révolution française est préparée par les écrits des Encyclopédistes, le mécontentement grandissant du peuple et de la bourgeoisie. Elle éclate alors que se trouve porté à son comble le scandale du dérèglement de la noblesse, contrastant avec la misère du peuple. La royauté abolie, la révolution doit faire face à l’Europe aristocratique coalisée, et prendre des mesures répressives contre les tentatives révolutionnaires des chouans. La Révolution russe est préparée, pendant plus d’un demi-siècle, par des écrivains persécutés et des terroristes. Elle éclate par suite des souffrances et de la famine, que complètent les horreurs de l’invasion, et les deuils de la grande guerre. Le pouvoir impérial renversé, presque sans lutte, grâce à la fraternisation du peuple et d’une grande partie de l’armée, les batailles les plus dures s’organisent à l’occasion des rivalités politiques, et des compétitions économiques. Menacé de sabotage et de destruction, à l’intérieur, par les menées des Russes blancs, l’État socialiste est attaqué sur tous les fronts, sans déclaration de guerre, par les nations capitalistes, et soumis à un blocus meurtrier.
Ce n’est donc que, lorsque tous ses objectifs sociaux ayant été atteints, la sécurité se trouve, par surcroît, assurée désormais, à l’intérieur et à l’extérieur, qu’il est possible de prétendre qu’une révolution est complètement victorieuse. C’est dire que, pour qu’une révolution coïncidât, sans risques de mort, dès la chute du pouvoir établi, avec le licenciement des troupes, et l’abolition de toute contrainte, comme de toute surveillance, à l’égard des citoyens, il faudrait de toute nécessité qu’elle fût, non seulement universelle, c’est-à-dire réalisée en tous pays, dans le même temps, mais encore suffisamment avantagée par les circonstances de la vie économique et de l’éducation sociale, pour qu’aucun motif de compétition grave ne pût être à redouter, par la suite, entre les hommes.
— Jean MARESTAN.
RÉVOLUTION
Bouleversement profond d’un pays tendant à remplacer un régime par un autre.
Il y a différentes sortes de révolutions, de la révolution de palais à la révolution sociale. La révolution de palais s’observait surtout autrefois dans les pays barbares. Le monarque était assassiné par une conjuration et remplacé par un autre. De nos jours, le Mexique a été troublé par des révolutions assez fréquentes de cet ordre. La révolution de palais et le pronunciamiento, chose à peu près analogue, affectent peu le pays, Tout se passe entre les dirigeants et leurs armées, qui sont des armées de métier, c’est-à-dire des bandes d’assassins à gages prêts à toutes les besognes au service de qui les paye.
Plus large est la révolution politique, par exemple la grande Révolution française. C’est à tort qu’on a distingué la révolution politique et la révolution sociale. Toute révolution, les révolutions de palais mises à part, comporte un facteur économique. Le peuple ne marcherait pas si une déficience économique ne l’y poussait pas. Un peuple qui mange à sa faim ne fait pas de révolution, du moins généralement, car il ne faut pas oublier le boulangisme qui a presque été une révolution et qui était un mouvement purement idéologique, où il y avait du patriotisme, du désir de revanche, de la colère à propos de scandales (affaire Wilson), etc.
Jamais, ni les socialistes, ni les anarchistes ne sont parvenus à susciter dans le peuple un mouvement pareil. Les socialistes ont enseigné que la révolution venait toute seule, lorsque les circonstances économiques la commandaient. C’était pour ne pas avoir à la préparer. On peut dire que la plupart des chers socialistes ont été sinon des traîtres au sens exact, du moins des profiteurs. C’est une profession que d’être un chef socialiste. Elle comporte des aléas : on peut aller en prison, mais on peut aussi devenir ministre. Le prolétariat a ainsi des avocats professionnels qui défendent sa cause, et de même qu’un avocat, même habile, ne croit pas nécessairement ce qu’il dit, de même un leader d’extrême gauche peut défendre fort bien l’intérêt des ouvriers et y être tout à fait indifférent, au fond de lui-même.
Il en va autrement des théoriciens, de ceux qui ont institué et formulé la doctrine, comme Karl Marx, Bakounine, Blanqui, Kropotkine, etc. Pour ceux-là, le socialisme et l’anarchie étaient bien la pensée véritable.
Le dogme de la révolution automatique favorise les chefs du socialisme. Si la révolution vient toute seule, point n’est besoin de la préparer, et ils s’empressent de ne pas le faire. Il est plus facile et moins dangereux de préparer des électeurs qui les porteront au Parlement que des révolutionnaires qui ne les mèneraient qu’à la prison ou à la mort.
Il est curieux d’observer que la révolution a toujours surpris ceux qui étaient censés la préparer. La révolution de 1848 surprend Proudhon qui, toute sa vie, avait écrit sur elle. Celle de 1871 surprend les militants de la Ire Internationale ; elle les surprend si bien qu’ils se révèlent incapables de l’organiser. Le socialisme, doctrine froide, hérissée de formules, n’arrive jamais à passionner le peuple. Il sait que la révolution est dans ces formules, mais elle y est contenue comme l’un des éléments d’un corps très complexe dont l’analyse ne se fait pas dans son esprit.
Aujourd’hui, en Allemagne, une grande crise industrielle, causée par la surproduction, crée une situation révolutionnaire. Le vieux parti socialiste ne sait ni ne veut en profiter ; il s’est usé au pouvoir et son idéologie est vidée de tout contenu vital. Le peuple, sous-alimenté, manquant de travail, ne va pas vers lui ; il va à Hitler, le fasciste, qui, comme Boulanger, a le don de le faire vibrer, hélas ! Avec du chauvinisme et de la réaction.
Ni dieu, ni César, ni tribun ;
Prolétaires, sauvons-nous nous-mêmes. »
etc...
Évidemment, si le prolétariat était capable de se passer de sauveurs, ce serait mieux, mais les sauveurs sont malheureusement indispensables. D’abord, un mouvement suppose une organisation, c’est-à-dire des organisateurs. La moindre réunion comporte quelqu’un qui trouvera le local, qui traitera un sujet, qui ouvrira une discussion. Les cellules communistes sont mortes, faute de leaders. On avait pensé que c’était préférable de faire réunir les ouvriers tout seuls, pensant que, mieux que les intellectuels, ils connaissent leurs souffrances. Les réunions se sont dispersées, faute d’entente. Il ne suffit pas d’être exploité et de le savoir. Sans l’excitation de l’intellectuel qui connaît les sujets, la théorie, l’ouvrier, même révolutionnaire de sentiments, retombe vite à la conversation banale sur les événements de la vie quotidienne. Le « sauveur » n’est pas forcément un intellectuel diplômé, il peut être un ouvrier intelligent. Malheureusement – je ne veux citer personne –, les événements nous ont montré que les « leaders » ouvriers ne se comportent pas mieux que les fils de la bourgeoisie. Pour se passer de « sauveurs », il faudrait un prolétariat intelligent et instruit, capable de comprendre les questions sociales. Alors, les leaders ne pourraient pas devenir dangereux, car ils seraient étroitement contrôlés. Malheureusement, il est très loin d’en être ainsi et, lorsque le prolétariat critique ses chefs, c’est, le plus souvent, à tort, il ne fait que donner cours à sa jalousie.
La bourgeoisie est, dans l’ensemble, plus intelligente. Aussi a-t-elle réussi à faire des révolutions préparées : Portugal, Turquie, Espagne. Le peuple lui a servi de tremplin. Elle l’a trompé par des promesses fallacieuses qu’elle a oubliées après sa victoire.
La Révolution russe a eu des leaders sincères, ou plutôt : ils l’étaient avant la révolution. Malgré ce qui peut nous choquer dans la conception de Lénine sur le révolutionnaire professionnel, on peut dire que si lui et les siens exerçaient un métier, c’était un métier dangereux. Ils ne pouvaient pas espérer le pouvoir, ni même un simple mandat législatif, ils risquaient la prison, parfois la mort, et contre un standard de vie plutôt faible. Mieux valait être fonctionnaire du tsarisme.
Après la révolution, les choses ont changé. Les anciens révolutionnaires sont devenus une sorte de noblesse, avec les défauts de la noblesse d’ancien régime. Les années de prison subies sous le tsarisme sont comptées comme les faits d’armes de la noblesse monarchique. Au fond, cela est juste ; ce qui l’est moins, c’est l’hérédité et le népotisme. Car si on mérite, par son travail, son dévouement et ses souffrances passées, on ne mérite nullement du fait d’être le fils, la femme ou le père d’un militant de premier plan.
La Révolution russe porte une part de mal, en ce qu’elle a découragé les militants du monde entier, en leur montrant que l’homme est partout le même et que le drapeau rouge, comme les drapeaux tricolore et blanc recouvrent la lutte éternelle de chacun contre chacun et contre tous pour la meilleure place dans le régime qui a triomphé.
Cependant, la Révolution russe, pour une part, n’est pas retombée dans les hontes de la Révolution française. Les dictateurs moscovites se sont entre évincés du pouvoir, mais aucun n’a trahi, au sens exact du terme. Pas de Directoire, pas de Bonaparte, jusqu’ici du moins. On n’a pas rappelé les anciennes classes privilégiées et, quoi qu’il soit atténué, c’est toujours le bolchevisme qui régit la Russie.
Faut-il désirer la révolution ou doit-on plutôt lui préférer l’évolution ?
La révolution est une chose barbare. La brute humaine y est lâchée et elle commet les pires excès, des excès inutiles. Des milliers de gens qui, jamais, avant les événements, n’avaient pris le moindre intérêt aux questions sociales, ne voient dans le désordre que l’occasion de piller, de tuer, de violer et de se griser. Ils font tout cela sans l’ombre d’un principe ; si la révolution est vaincue, ils passeront au vainqueur. Des gens du peuple, dit-on, lors de la répression versaillaise, urinaient sur les cadavres des fédérés morts pour une cause qui était la leur. La révolution tue des quantités de gens qui, souvent, le méritent moins que leurs bourreaux. Le créancier profite de la révolution pour faire exécuter son débiteur, le débiteur son créancier, l’homme dont un autre a pris la femme s’en venge par une dénonciation. On dénonce pour voler, pour prendre la place d’un autre, etc. Devant la mer d’injustices, de turpitudes et de crimes, les gens honnêtes et paisibles appellent l’ordre, même si cet ordre doit être un ordre réactionnaire et contraire à leurs idées.
La révolution sociale amène bien plus de trouble que la révolution purement politique. Les citoyens qui, la révolution victorieuse, font leur travail au mieux dans le nouvel ordre de choses, forment la minorité. La majorité, au contraire, tente d’échapper au travail, d’usurper les fonctions qu’elle est incapable de remplir. Il faut des années pour mettre debout un commencement d’organisation.
On compare souvent la révolution à un accouchement qui se fait dans le sang et la douleur. Il n’y a là qu’une image ; le progrès devrait se faire sans qu’il fût nécessaire de tuer des milliers de personnes.
Est-ce alors l’évolution qui est à poursuivre ? L’évolution existe-t-elle ? Rien n’est moins certain. En tout cas, elle n’est pas fatale. Pour qu’elle le fût, il faudrait qu’il y eût une volonté organisatrice extra mondiale qui ait donné un but à l’Univers. Rien de semblable n’existe. Sans parler des êtres vivants, en général, qui sont forcés de s’entre-détruire pour vivre, nous voyons dans l’humanité les choses les plus hétéroclites. Dans tel pays, on tue les vieillards ; les enfants mangent leurs parents ; les parents mangent leurs enfants encore en bas âge. Notre morale est chose bornée dans le temps et l’espace. Le progrès est aussi très relatif.
Bien des peuples dits sauvages en sont encore à une vie presque animale. Logés dans des huttes, incapables de se soustraire aux maladies, la recherche de la nourriture quotidienne est pour eux le grand problème, comme chez les animaux.
C’est à tort qu’on parle de peuples jeunes, ces primitifs existent depuis des milliers d’années ; ils sont aussi vieux que nous. On peut dire qu’il n’y a, sur la surface du globe, que des îlots de progrès, un progrès précaire. Des civilisations, après avoir progressé pendant des siècles, ont disparu. L’évolution ne se fera donc pas toute seule. D’ailleurs, les profiteurs de l’ordre de choses actuel font tout pour l’empêcher et ils y réussissent fort bien. En ce moment, une crise économique sans précédent bouleverse le monde. Il pourrait sembler que la fin du capitalisme, prédite par Karl Marx, soit enfin arrivée. Jamais les contradictions économiques du monde moderne ne sont apparues avec une plus aveuglante clarté. Les progrès du machinisme, la rationalisation ont amené la surproduction, c’est-à-dire l’abondance. Et cette abondance amène partout la misère des millions de chômeurs en Allemagne, en Amérique, en Angleterre, où le gouvernement s’astreint à les nourrir tant bien que mal, depuis dix ans, pour éviter la révolution. Cet état de choses ne peut pas être durable. Quelle fin aurait-il ? On ne peut le savoir. Il est possible que le capitalisme finisse par trouver une issue et dure encore des siècles. Il est possible aussi que le couvercle de la marmite de Papin éclate et que ce soit la révolution.
— Doctoresse PELLETIER
RÉVOLUTION (MORALE) (point de vue du socialisme rationnel)
« Si, dans l’ordre physique, tous les phénomènes obéissent aux lois de la fatalité, il en est autrement dans l’ordre social où les conséquences générales se déroulent selon le rythme de la liberté exclusive à l’homme qui en assume la responsabilité. »
Avant d’entrer dans le développement de la pensée qui nous a incité à choisir ce titre, pour exposer nos idées sur l’opération à laquelle nous faisons allusion, afin d’atteindre le but de paix morale et économique auquel nous aspirons, il convient de préciser qu’il est nécessaire que chacun de nous commence par faire sa révolution morale et spirituelle.
Cette révolution, s’opérant volontairement dans le cadre de la science et de la libre discussion, doit avoir pour mission sociale de montrer, à chacun de nous, les liens généreux d’indéfectible solidarité unissant les divers membres de l’humanité dans une œuvre morale de coopération sociale profitant également à tous et à chacun.
Après ce préambule, il pourra paraître à plusieurs que nous voulons enfoncer une porte ouverte depuis l’origine des espèces. Aussi, des deux côtés politiques de la barricade, chacun nous traitera d’intrus, disant bien haut : c’est nous qui détenons la vérité, qui la propageons et qui voulons, sous tous les rapports, la justice pour tous, pendant que, sur la crête, les profiteurs jubileront. L’évangile matérialiste de Marx, aussi bien que celui de Jésus portent à faux expérimentalement dans l’ordre social.
Il ne suffit plus de continuer à endormir le peuple, soit au nom de la fatalité d’une science plus spécieuse que réaliste, soit au nom de la grâce et de la foi. Le mysticisme, divin ou matérialiste, sombre devant l’expérience et le raisonnement qui est la source des sciences. Avec quelques variantes d’académie plastique, l’empirisme décrète, des deux côtés de la barrière, les méthodes d’un passé d’ignorance susceptibles d’entretenir une agitation sociale artificielle, aboutissant à l’ultime postulat de l’exploitation des masses par des minorités considérées comme élites et qui ne sont que les profiteurs de l’ignorance sociale.
Les uns, au nom d’un dieu de paix et de miséricorde – fort et jaloux –, s’efforcent de rançonner, le plus possible, leurs semblables et de se créer des privilèges à leur détriment ; alors que les autres, au nom d’un déterminisme mystique, se contentent, même en chantant la Carmagnole, d’obéir aux puissances du mal, à la force qui écrase la misère et qui reste sourde aux appels confus de la solidarité humaine.
Dans nos sociétés, et depuis que l’humanité a une histoire, il a été question d’un droit qui s’est toujours confondu avec la force. Quant à l’application, les droits se fondent sur la règle d’action que chacun accepte ou qu’il s’est faite. Socialement parlant, la force qui se fait appeler droit s’établit et se maintient en se cachant derrière un sophisme qui, plus ou moins bien formulé, prend le nom de loi.
Du moment que l’on vit sous l’incohérence ou sous le despotisme, ce qui signifie époque d’ignorance, comme c’est encore le cas, le droit dérive nécessairement de la loi. Si nous étions en époque de connaissance de la vérité et que la justice soit impartiale, toute loi qui ne pourrait pas être ramenée, par enchaînement de propositions identiques, au principe même du droit serait nulle. Pratiquement, équitablement, le droit est le corrélatif du devoir. Chacun a droit à ce que tous lui doivent et chacun a pour devoir de satisfaire aux droits de tous quand l’ignorance a disparu.
Ainsi, parler de droit, c’est dire qu’il existe, c’est en ressentir le besoin, c’est en exprimer la manifestation pour l’harmonie sociale, c’est l’extérioriser du chaos où il est en puissance plus ou moins contenue, c’est en faire le conducteur de la vie sociale.
Jusqu’à maintenant, la société n’a pas analysé la valeur sociale du droit. La masse n’aborde pas cette question, et ce qui constitue l’élite ne croit pas avoir un intérêt immédiat à définir ce principe social. Le droit de notre époque ressemble à une girouette tournant tantôt dans un sens, tantôt dans l’autre, alors que si le droit était le principe fondamental de la société, il serait la manifestation permanente de la justice.
De cet état de confusion des idées sur le principe d’harmonie sociale pour sortir notre humanité du chaos où elle se débat, le désordre devient la règle. Du fait d’une instruction autrement illusoire que réelle et d’une éducation qui lui fait suite, l’équivoque s’élargit dans tous les domaines, et les contradictions sociales et économiques compliquent une situation instable qui menace de nous engloutir.
Sous l’empire des contradictions multiples qui naissent mécaniquement de notre état social, l’individu et la société se meuvent « circonstanciellement » dans l’incohérence et le despotisme qui créent, pour les travailleurs plus ou moins déshérités, le paupérisme moral aussi bien que le paupérisme matériel. Et cet état dure depuis l’origine des sociétés, se perpétuant à travers le temps et l’espace, parce qu’à toute époque « les bergers » chargés d’éduquer et de diriger le troupeau de travailleurs ont enseigné une morale spéciale à leur intérêt particulier et à celui de leur entourage. La structure de la société est, pour chaque époque, l’image de ceux qui l’administrent ; et ceux-ci, prévoyant pour leurs intérêts particuliers, ont modelé la société en raison de leur appétit économique. Pour arriver à ces fins particulières, des religions et des morales ont été répandues adroitement pour expliquer qu’il y aura toujours des pauvres, cependant que le despotisme et le désordre fournissaient aux bergers et à leurs suites les privilèges qui faisaient ou font leur puissance. Ce qui s’est passé, il y a des siècles, se reproduit sous un aspect nouveau et durera éternellement, si l’humanité ne s’avise de comprendre que, comme l’écureuil dans sa cage, elle tourne dans un cercle vicieux de déisme et de matérialisme, toujours rajeunis selon les époques, pour conserver à ceux qui se réclament de ces deux morales les avantages de certaines révolutions circonstancielles, en égarant la pensée du but vers lequel elle doit logiquement et équitablement tendre, c’est-à-dire à l’harmonie sociale donnant à chacun et à tous la liberté et le bien-être par le travail. Si, dans l’état chaotique, « les bergers » tirent des événements le meilleur parti des hommes et des choses qu’ils dirigent et administrent, cet avantage n’est pas orienté vers le progrès moral et le bien-être généralisé, mais vers le profit exclusif de quelques individus, usant et abusant de leurs connaissances et de leurs richesses pour faire battre, s’entre-dévorer des hommes qui n’ont aucune bonne raison pour agir ainsi. L’immoralité suinte de tous les pores de la société. Par quelle amère ironie du destin faut-il que l’action oriente les travailleurs vers des productions nouvelles, vers des créations toujours opportunes ? Que, de ce fait, les richesses se multiplient à l’infini avec le développement du machinisme, et que la plupart des producteurs nécessaires, indispensables, se trouvent (par rapport au développement général de leur intelligence) de plus en plus privés des richesses qui s’amoncellent chez quelques individus, voilà l’immoralité du régime !
Remarquons que ces faits ne se produisent que par une fausse éducation des masses auxquelles on promet toujours… pour... demain le paradis économique, à moins qu’on enseigne aux travailleurs que le produit de leur effort se mesure à la valeur de leur apport financier et non à celui de leur activité.
En résumé, nous souffrons surtout d’une crise morale, génératrice de crises multiples. Pourquoi faut-il que l’enseignement et la pratique de la vie ne nous démontrent pas qu’il n’y a de progrès social durable et juste que par le progrès moral ? Qu’il est juste et nécessaire que l’homme ne soit pas un loup ? Qu’il doit être l’ami de son semblable, son collaborateur dans la vie pratique parce qu’il y a intérêt social aussi bien qu’avantage particulier à agir ainsi ? Telles sont les données du double problème moral et économique qui reste à résoudre.
Il faut que l’homme – tous les hommes – sache qu’il a une œuvre d’entraide à accomplir sur la Terre et qu’il se pénètre bien qu’il est intéressé ; que c’est de la pratique de son devoir que son droit peut et doit être fait et respecté. Il faut qu’il comprenne que si le dévouement est une duperie dans la période de contradiction des intérêts de notre époque, ce même dévouement serait profitable à soi aussi bien qu’à la collectivité en période d’harmonie sociale.
Dans ce monde, où, malheureusement, l’hypocrisie est le fondement de la morale courante, Paul Brulat écrit, avec infiniment d’à-propos, dans un article du Petit Méridional : un être bon, généreux, humain est un homme d’élite... Arrivons à placer ces vertus au-dessus même du génie qui peut être néfaste s’il ne rêve que de dominer, de conquérir et d’écraser, comme c’est trop souvent le cas.
Mais si l’homme n’est, comme disait Proudhon, qu’une machine construite par un créateur ou par dame nature, est-il possible que l’individu soit autre qu’il ne l’est ? N’est-il pas un automate ? Ici se pose la question du déterminisme sous ses multiples aspects, en contradiction avec la raison, impersonnelle par essence, qui nous montre les contradictions multiples auxquelles la logique se heurte dans la pratique de la vie physiologique.
L’homme peut-il, par lui-même, par son intelligence, par ses efforts, briser les liens qui l’enchaînent au social, à cette structure économique organisée uniquement pour le profit particulier de l’élite qui le façonne méthodiquement et mécaniquement vers la renonciation de son moi et l’abdication de sa volonté, comme cela se pratique par les méthodes d’appropriation, de production et de travail anglo-saxonnes ou françaises qui conduisent à la ploutocratie la plus puissante et la plus arbitraire que l’humanité ait connue ? L’expérience comme le raisonnement démontrent que oui, et nous prouvent, à l’évidence, que l’homme n’est déterminé que dans la mesure où sa volonté ne peut s’affranchir d’un état social ne lui laissant pas la liberté de son activité. Le déterminisme, dans les actions humaines, est fonction du régime qui l’abrite, mais n’a rien d’immuable. N’est-ce pas un effet de la liberté inhérente à l’homme, exclusivement, que la prise de possession de la richesse primitive ? De cette richesse qu’il n’a pas créée mais qu’il exploite – en dehors et au-dessus de ses intérêts ? Et cette liberté n’est-elle pas génératrice de responsabilité ?
Mais qu’est-ce que l’homme ? Y en a-t-il de diverses espèces ? Les hommes sont-ils, tous, doués de sensibilité réelle, d’intelligence réelle ? Pour entrer dans le développement de ces questions, il faudrait une place qui nous manque. Nous nous résumerons en disant que : seul, dans l’immense série des êtres, l’homme témoigne de sensibilité et d’intelligence réelles, et que tous les hommes, sans exception, ont la même caractéristique. Le social est leur œuvre. Sollicitée par les tendances de passion et de raison qui caractérisent l’humanité, selon qu’elle s’oriente vers le despotisme ou la liberté, l’humanité crée un social en rapport de l’une ou l’autre tendance.
Pratiquement, quand le troupeau broute l’herbe du pré où il est conduit, pour s’y alimenter selon la volonté du berger, le maître s’intéresse de trouver de nouveaux pâturages offrant plus de ressources alimentaires qu’il canalisera à son profit exclusif. Mais, socialement, appliqué à la vie humaine, qu’est-ce qu’un berger ? Qu’est-ce qu’un troupeau ? Le premier est le maître, les seconds, dans l’ordre de production générale, sont des esclaves qui ne reçoivent, pour prix de leur travail, que la part qu’il plaît au maître de leur attribuer. Le premier est libre, socialement et économiquement, les autres sont esclaves, socialement et économiquement, du seul fait de l’organisation de la propriété commandant la distribution des richesses aux individus et la constitution de monopoles de rapport. Mais la structure sociale n’est pas fatalement déterminée dans un sens plutôt que dans un autre, et l’organisation actuelle de la société, et par voie de conséquence celle de la propriété, n’est pas immuable.
À travers les âges, bien des modifications d’ordre social se sont produites. La structure économico sociale est toujours en harmonie avec l’éducation générale qui en a imposé le mécanisme. Ainsi, tout paupérisme est fruit de l’éducation. Rien de surprenant que les masses laborieuses ressemblent à des groupements d’automates. Les élites leur ont-elles expliqué et démontré que leur esclavage économique était fonction du régime de propriété ? Si l’humanité est divisée en maîtres et en esclaves c’est qu’il n’a pas encore existé d’élite réelle d’une part, et, d’autre part, c’est que les travailleurs, généralement ignorants en économie sociale, manquent d’énergie consciente, cependant que leur passivité est habilement entretenue par ceux qui les exploitent. Mais du fait que l’homme, en général, raisonne mal depuis qu’il a une histoire, s’ensuit-il qu’il doive éternellement mal raisonner ? Ne finira-t-il pas par s’apercevoir, dans un moment de claire vision des faits, qu’il est le jouet de l’empirisme où se complaisent les classes possédantes et dirigeantes qui oppriment les déshérités, sous un masque de libération sociale ? Le paupérisme matériel des masses laborieuses a son origine dans le paupérisme moral et intellectuel qui l’affecte et ne peut ni ne doit durer éternellement, ou il n’y aurait pas de justice possible. Il n’y a pas de déterminisme économique au sens propre du mot. Redisons-le, le social est ce que le législateur le fait.
Quoique présentement mal éduqué par les politiciens socialistes, un jour viendra où le dormeur s’éveillera, où il jugera les faits intelligemment et s’apercevra enfin, comme dit Marguin, que « si l’homme est beaucoup déterminé par le social, il est aussi beaucoup déterminant » par sa volonté quant aux actions présentes comme celles à venir. Il est responsable du présent comme de l’avenir et ne peut récolter que ce qu’il sème.
Le jour où l’homme aura réalisé sur lui-même, par sa capacité, la première et la plus importante des révolutions qui lui ouvrira les portes d’une rénovation sociale bienfaisante et durable, il y a aura harmonie sociale. Que l’homme apprenne qui il est, et, quand il le saura, il voudra être lui-même, c’est-à-dire libre et juste. Mais les maîtres de l’heure ne paraissent pas disposés à lui en faciliter le chemin.
— Elie SOUBEYRAN.
RÉVOLUTION (SOCIALE)
Considérations générales.
La loi de l’Évolution trouve, à peu près en tout et partout, son application. La valeur et le sens des mots n’y échappent point et la signification exacte, la portée précise d’un terme varient selon les temps et les lieux : dans le même lieu, selon le temps ; et dans le même temps, selon les lieux.
Le mot « révolution » est, à coup sûr, un de ceux qui ont le plus emprunté leur exacte signification aux circonstances de temps et d’espace. C’est ainsi que tel événement qui, à une époque déterminée et au sein de circonstances définies, eût constitué une révolution, ne saurait être tenu pour tel à toute autre époque et au sein de toutes autres circonstances.
Les études qui vont suivre et qui portent les signatures de Barbedette, Méric et Voline ne manqueront pas de faire éclater l’évidence de ces modifications plus ou moins profondes, introduites dans l’exacte définition du mot révolution, par l’époque et le milieu où se sont produits les événements historiques auxquels Barbedette, Méric et Voline conservent l’appellation courante et justifiée de révolution.
Durant des millénaires, il suffisait d’une modification tant soit peu importante dans la constitution politique d’une nation, d’un changement brusque dans le haut personnel gouvernemental, ou encore de l’introduction dans la législation d’un pays de certaines dispositions concernant les règles essentielles du droit, les assises de la morale ou les principes de la religion prédominante, pour que cette transformation, bien qu’elle ne portât pas atteinte aux fondements mêmes du régime social en cours, fût considérée comme une révolution.
Ce temps n’est plus.
L’Histoire a enregistré nombre de faits qualifiés révolution. Il n’était pas déraisonnable de les désigner ainsi, étant donné le bouleversement plus ou moins considérable qu’ils engendraient à l’heure et dans les conditions où ils éclataient. Les mêmes faits, ou des faits analogues, s’ils se produisaient à notre époque, passeraient pour de simples et peu profondes réformes subies par l’ordre social actuel.
L’erreur des révolutions passées.
L’expérience a établi que ces événements sans profondeur réelle, sans résultats positifs, n’ont été que des crises passagères provoquées par un état de fièvre momentané, et que, la fièvre étant tombée et la crise ayant pris fin, l’état de choses antérieur s’est plus on moins promptement rétabli, sans qu’il ait été sérieusement transformé. Nombreuses, dans le passé, ont été les révoltes, les insurrections, les soulèvements populaires dirigés contre les principes et les institutions régissant l’ordre existant ; mais la presque totalité de ces mouvements s’est avérée impuissante à réaliser le but visé, parce que ces révoltes, ces insurrections, ces soulèvements populaires s’en prenaient aux effets apparents et négligeaient la cause, alors ignorée, de ces effets ; en sorte que, la cause n’étant pas supprimée, les effets ne tardaient pas – et c’était inévitable – à réapparaître.
De nos jours, pour constituer une révolution, il est indispensable que la transformation vaste et profonde que comporte un tel événement ne s’attaque pas seulement au mal qu’une révolution entend atténuer ou vaincre, mais à la cause même de ce mal. Si les révolutions passées, jusques et y compris les plus considérables (Révolution française de 1789 et Révolution russe de 1917, pour ne citer que ces deux-là), n’ont abouti qu’imparfaitement et partiellement aux résultats qu’on en attendait. C’est qu’elles se sont arrêtées à mi-chemin et n’ont pas poursuivi jusqu’au bout les fins qu’elles s’étaient assignées. Il était fatal qu’il en fût ainsi, parce que, le mal se manifestant en pleine lumière, tandis que la cause de ce mal restait dans l’ombre, on croyait – de bonne foi, peut-être – avoir mis un terme à l’infection qu’il s’agissait de faire disparaître, alors que, le foyer d’infection restant intact, celle-ci ne tardait pas à renaître.
En France, les révolutionnaires de 1789 ont pensé qu’en remplaçant la monarchie par la république, et en substituant les droits de l’homme et du citoyen aux devoirs du sujet, leur tâche serait accomplie ; depuis, l’insuffisance d’un tel résultat se manifeste de plus en plus clairement et fortement. En Russie, les révolutionnaires de 1917 ont estimé que, en remplaçant la dictature des Romanov et de la noblesse russe par celle des paysans et des ouvriers, ils fonderaient, sur les ruines d’un régime social de despotisme politique et d’exploitation économique, un État géré – du moins en apparence – par le prolétariat des villes et des campagnes, et que, concentrant entre les mains de ce pouvoir dit « prolétarien » toute la puissance politique et économique, ils doteraient le peuple russe d’un régime social mettant fin aux scandales, aux abus, aux inégalités et aux iniquités du tsarisme ; or, les masses ouvrières et paysannes de la Russie restent, seize ans après les journées révolutionnaires d’octobre 1917, courbées sous un joug et soumise à une exploitation qui ne sont pas sensiblement moins durs qu’avant.
L’erreur dans laquelle sont tombées toutes les révolutions passées, c’est d’avoir limité leur effort à un objectif partiel, alors qu’il était indispensable de l’étendre à un objectif total. Exclusivement morales ont été les unes ; spécifiquement politiques ou uniquement économiques ont été les autres. Toutes ont négligé de briser, dans une organisation sociale où toutes les institutions, qu’elles procèdent de l’ordre moral, politique ou économique, sont indissolublement associées, le lien qui les unit étroitement les soude, les ajuste en un tout homogène et compact. De cette erreur, il est résulté que, affaiblie sur certains points, l’organisation sociale existante s’est trouvée dans la nécessité de se fortifier sur les autres points, afin que, plus ou moins longtemps et plus ou moins fortement rompu par l’ébranlement révolutionnaire, l’équilibre indispensable à la vie de toute société, soit rétabli.
La Révolution « sociale ».
Des constatations qui précèdent, et en appliquant ces observations aux temps actuels, il ressort que, présentement, toute révolution qui, abattît-elle une partie de la structure sociale, en laissera debout l’autre partie, ne sera qu’une demi révolution, une révolution manquée.
Ce n’est pas sans motif que, dans cet article, le mot révolution est accompagné de l’adjectif « sociale ». Cet adjectif a pour objet de qualifier en un terme précis la révolution qui est en voie de préparation, d’acheminement. Répondant aux nécessités de l’heure, s’inspirant des besoins, des aspirations et de la volonté de l’humanité parvenue au vingtième siècle, découlant d’un état social où les problèmes politiques, économiques et moraux s’enchevêtrent à tel point qu’ils ne sauraient être séparés que pour les nécessités d’une classification artificielle, destinée tout uniment à en faciliter l’étude, la révolution qui s’impose sera sociale ou elle ne sera pas. Cette révolution sociale aura pour but et devra avoir pour résultat de déchirer le contrat social qui, présentement, codifie les rapports de toute nature que la complexité de la vie individuelle et collective impose à chacun et à tous et de rédiger un contrat social entièrement nouveau, aux fondements totalement opposés à ceux du contrat actuel. Ce serait faire preuve d’une impardonnable inexpérience ou d’une inexcusable candeur que d’imaginer et d’admettre qu’il en sera autrement.
Quand je dis que cette révolution sera et qu’il faut qu’elle soit sociale, faute de quoi elle ne sera pas, j’entends affirmer par ce qualificatif qu’il faudra qu’elle soit à la fois politique, économique, intellectuelle et morale. J’entends soutenir qu’elle ne devra négliger, respecter, épargner aucune partie de l’édifice social qu’elle aura pour fin de ruiner de fond en comble, afin qu’il n’en reste pas pierre sur pierre.
Le mot révolution est galvaudé.
Je me rappelle – ô temps de ma jeunesse, comme tu es déjà loin ! – l’impression de terreur que le seul mot de révolution jetait dans le monde bourgeois, il y a une cinquantaine d’années. Ce mot avait alors une signification sur laquelle il n’était pas possible de se méprendre. « Révolution sociale », cela signifiait : confiscation pure et simple, sans indemnité d’aucune sorte, des fortunes particulières ; suppression de tous les privilèges que la naissance, l’instruction, les protections influentes, la richesse et le pouvoir confèrent injustement à une poignée d’individus ; destruction de cette armature de violence collective, de répression systématiquement organisée qui va de l’infect mouchard qui dénonce à l’ignoble bourreau qui exécute, en passant par le policier ou le gendarme qui arrêtent, le magistrat qui condamne et le gardien de prison qui enferme ; abolition de l’État et de toutes les institutions de duperie, d’oppression, de brigandage, de spoliation et d’iniquité qui en découlent et le soutiennent : gouvernement, parlementarisme, magistrature, police, armée ; anéantissement des impostures juridiques, patriotiques, familiales, religieuses, intellectuelles et morales qui paralysent l’essor et entravent le libre développement de l’individu ; disparition de toutes les tyrannies, exploitations, flibusteries, inégalités, fourberies, compétitions, haines et scélératesses sans nombre, qui portent le sceau de tout milieu social dans lequel il y a, en perpétuel et fatal conflit, des riches et des pauvres, des salariants et des salariés, des gouvernants et des sujets, des maîtres et des serviteurs, des chefs et des subordonnés. Tel était, alors, le contenu du mot révolution.
On n’abusait pas de ce mot, tant ceux qui se risquaient à le prononcer ou à l’écrire – quelques unités dans la foule immense– se sentaient faibles à la pensée des forces incalculables dont il évoquait la violente irruption, l’explosion brutale et le déchaînement tumultueux dans la vie des hommes. Ceux qui avaient l’audace de le proférer publiquement avaient conscience que ce mot est de ceux qu’on se doit de ne pas prononcer à la légère, parce qu’il synthétise tout un monde de destructions et de bouleversements destinés à ensevelir à jamais sous les décombres la misère et l’esclavage, et à faire jaillir de ces ruines nécessaires une vie nouvelle faite de bien-être de liberté et d’harmonie. Aussi, fallait-il voir le frisson d’épouvante que suscitait dans le monde des privilégiés ce mot terrifiant et lourd de catastrophes : révolution ; mais aussi, et par contre, l’émotion profonde et le tressaillement d’espérance que ce mot magique faisait descendre dans le cœur des déshérités !
Il n’en est – hélas ! – plus ainsi. Tous les écrivassiers qui déposent dans les journaux leurs petites ordures et tous les sonores et vides bavards de parlement et de réunion publique prodiguent, à plume et à bouche que veux-tu, ce mot : révolution, si riche, pourtant, de menaces contre les uns et de promesses pour les autres. Tous l’emploient ou, plus exactement, l’exploitent frauduleusement et à tout propos.
Les royalistes ne dédaignent pas d’y recourir quand ils proclament l’urgence et la nécessité d’en finir avec le régime républicain et la démocratie qu’il est censé incarner. Lorsque, pour électriser leurs éléments jeunes, pour entretenir la ferveur, qui fréquemment se décourage, de leurs partisans, pour faire cracher au bassinet de l’Action française les riches douairières, et pour calmer l’impatience des imbéciles qui sont las d’attendre sous l’orme « le retour du noble héritier des quarante rois qui ont fait la France », lorsque, dis-je, les Maurras et les Daudet déclarent, en termes rudes, violents, incendiaires, que l’heure est venue « d’étrangler la Gueuse », ils n’hésitent pas à se servir du mot révolution en déclarant que, pour arracher la France aux maîtres qui, actuellement, la déshonorent, la perdent et la poussent aux abîmes, il faudra employer les moyens violents et les méthodes illégales.
Les flagorneurs du suffrage universel qui se prétendent « radicaux-socialistes » et, par-dessus le marché, « démocrates », sont rongés d’un si violent désir et d’un si pressant besoin de capter la confiance et de piper les suffrages de tous les travailleurs, qu’ils abusent, avec une déconcertante désinvolture, du terme « révolution », dont ils torturent cyniquement le sens, à l’occasion de la moindre réforme proposée ou introduite dans la mécanique juridique, fiscale, militaire, diplomatique ou scolaire, ces charlatans présentent cette insignifiante et stérile mesure comme une sorte de révolution dans le fonctionnement des lois dans l’administration des finances publiques, dans l’organisation des armées, dans le jeu des relations diplomatiques ou dans les principes de l’enseignement et les méthodes pédagogiques. En réalité, c’est tout juste une manœuvre, à l’aide de laquelle ces politiciens sans scrupules s’ingénient à masquer la ridicule timidité de leurs programmes et la stérilité des améliorations qui y sont inscrites. Par l’audace volontairement outrée du mot « révolution » qui les pose en champions du progrès, résolus à ne reculer devant aucune mesure, dût-elle appeler, voire nécessiter, le recours aux moyens extrêmes, ils espèrent se préserver de l’accusation d’insuffisance ou de lâcheté dont les électeurs déçus sont enclins à les accabler.
Le parti socialiste (S.F.I.O.) est né, il a grandi, il vit encore à l’ombre du mot superbe de « révolution ». Il serait comique d’entendre les Blum, les Déat, les Paul Faure, les Marquet, les Renaudel, les Vincent Auriol, les Moutet, les Compère-Morel, les Varenne et les autres premiers sujets de cette troupe lyrique et dramatique s’affirmer révolutionnaires ; oui, ce spectacle serait d’un comique irrésistible, d’un grotesque hilarant, si ces cabotins n’étaient pas pris au sérieux et crus sur parole par les prolétaires naïfs, crédules, gobeurs, médusés, à qui leurs déclarations emberlificotées – ils se disent révolutionnaires, sans l’être, tout en l’étant – finissent par persuader que les discoureurs du parti socialiste sont les fourriers de la révolution sociale.
Toutefois, c’est aux incomparables bluffeurs du parti communiste (S.F.I.C.) que revient la palme dans l’art de faire subir les pires outrages au mot « révolution ». S’ils ont la plume en main, ils n’écrivent pas vingt lignes, et, s’ils tiennent le crachoir, ils n’enfilent pas cinq phrases sans que, de leur encrier ou de leur bouche ne s’échappe le mot « révolution ». Ils le glissent partout, à qui mieux mieux, à tout bout de champ. Et ils ne se contentent pas d’en user et d’en abuser à propos de tout et de rien ; ils entendent, en outre, l’accaparer à leur exclusif profit et en interdire l’emploi à tous autres. C’est comme une firme qui leur appartiendrait, comme un brevet d’invention, une marque de fabrique ou une raison sociale déposée que, seuls, ils auraient le droit d’exploiter : la Révolution est à eux, toute à eux, rien qu’à eux. Et pourtant !... Le pire est que d’assez nombreux prolétaires, à l’esprit simpliste et totalement ignorants du problème social, se laissent prendre au mirage de cette mystique grossière que les dictateurs et les roublards du parti communiste ont élevée à la hauteur d’une religion.
Ainsi : royalistes, républicains, démocrates, socialistes, communistes, les gens de toutes opinions et les partis politiques de toutes nuances trafiquent impudemment le mot « révolution », dans lequel ils incorporent des idées non seulement très différentes, mais encore contradictoires. L’ensemble d’idées et de faits que devrait signifier de nos jours le mot « révolution », et qu’il devrait sembler impossible de détacher de ce mot, s’en est, comme on le constate, plus que sensiblement éloigné.
Révolution ? — Pour les gens du Roy, c’est l’estourbissement de la Gueuse et le retour à la monarchie. Quelle absurdité !
Révolution ? — C’est, pour les radicaux et les partis de gauche démocratique, l’ensemble disparate, incohérent et inefficace des mesures de détail et des modifications de surface qu’impliquent, dans le domaine juridique, fiscal, militaire, diplomatique ou scolaire, des abus par trop révoltants et des pratiques par trop scandaleuses. Quelle sottise !
Révolution ? — Pour le parti socialiste, c’est, au prix de l’abandon du programme socialiste et au mépris des doctrines propagées par les penseurs et théoriciens socialistes eux-mêmes, la montée vers le gouvernement d’une équipe de conseillers d’État, avocats, journalistes, universitaires, médecins, vétérinaires et ex travailleurs, dans l’estomac de qui l’exemple des Mac Donald, Ebert, Noske, Scheidemann, Vandervelde, Branting, Guesde, Sembat, Albert Thomas, etc., a porté jusqu’à ses limites extrêmes la fringale du pouvoir. Quelle trahison !...
Révolution ? — Pour le parti communiste, c’est, sous des masques nouveaux et sous des formes inédites, la continuation, plutôt aggravée, de ce qui est : l’État tyran, le bureaucratisme rongeur, la police et l’armée sanguinaires, les classes antagoniques, la hiérarchie scandaleuse des traitements et salaires, la prostitution et la mendicité, la répression, le marchandage, le brigandage légal et l’assassinat ; enfin, pour couronner dignement le tout : l’accord diplomatique, financier, industriel et commercial, et, pour tout dire, l’entente gouvernementale officielle – entente cordiale, persistante et de jour en jour plus étroite – entre l’État dit « paysan et ouvrier » et les États bourgeois, entre le prolétariat dit : « communiste » et les États capitalistes. Quelle infamie !...
Révolution ? — Les ambitieux, les intrigants, les bateleurs de la politique et leurs laquais ont fait de ce mot un vocable qui ne signifie plus rien, voué aux interprétations les plus diverses et les plus opposées, dont ne s’effraient pas plus les dirigeants que ne s’enthousiasment les dirigés.
Seuls, les anarchistes – parce que, seuls, ils sont révolutionnaires – ont conservé au mot « révolution » et à l’idée fondamentale que, dans le temps et le lieu où nous sommes, il exprime, sa signification haute, pure, large, profonde, inaltérable. Salie, déshonorée, odieusement galvaudée, l’idée de révolution sociale doit être purifiée, réhabilitée et remise en pleine lumière. C’est à quoi tend, dans cette Encyclopédie, cette étude qui est consacrée à la Révolution sociale.
Ce que sera la Révolution sociale.
Revenons maintenant au sens exact du mot « révolution » et à la portée positive de l’idée qu’il exprime par rapport au milieu social contemporain : économiquement capitaliste, politiquement autoritaire. J’ai dit plus haut ce que, il y a quelque quarante il cinquante ans, on entendait par « la révolution sociale », En dépit des multiples altérations, dont j’ai cité les principales et qui sont imputables surtout aux pseudo révolutionnaires de la social-démocratie et du parti communiste, l’ensemble des faits sociaux qui se trouvent inclus et réunis dans l’idée de révolution est resté le même, et qui, peu ou prou, s’en éloigne, devient, ipso facto et quoi qu’il s’en défende, tout ce qu’on voudra, mais cesse d’être un révolutionnaire.
Il est possible de glisser dans les institutions actuelles quelques modifications de détail ; on peut même multiplier ces changements et les pousser jusqu’à l’extrême limite, ces institutions sont, quant au fond, inaméliorables ; elles engendrent inévitablement, c’est-à-dire tant qu’elles seront maintenues et sans qu’une mesure quelconque puisse écarter ce résultat fatal (fatal parce qu’il leur est inhérent] : la misère et la servitude, d’une part, l’opulence et la répression, de l’autre. On peut introduire dans le mécanisme économique, qui caractérise l’époque capitaliste que nous traversons, toutes les modifications possibles et imaginables ; aussi longtemps que le principe même qui actionne ce mécanisme sera maintenu, les inégalités et les conflits se perpétueront. C’est en vain que l’État se substituera, comme propriétaire et patron, aux patrons et aux propriétaires actuels, la gérance du premier aboutira aux mêmes conséquences que celle des seconds : faveurs et profits renaîtront inéluctablement sous des espèces et apparences nouvelles et amèneront fatalement le retour à l’existence des deux classes en lutte : celle des employeurs privilégiés, et celle des employés déshérités.
Il en est de même du mécanisme politique qui caractérise le régime d’autorité que nous subissons. On peut y faire pénétrer tous les changements que concevront l’homme d’État le plus subtil et le réformateur le plus sagace, rien, absolument rien, n’enlèvera à cette institution malfaisante – l’État – son caractère essentiel, son trait fondamental qui, dans la pratique, est de légiférer, de réglementer, d’imposer, d’interdire, de prohiber et de châtier quiconque ose entrer en lutte contre lui. Et comme, pour faire respecter la loi et observer la réglementation imposée, l’État est dans l’obligation de sévir contre les individus réfractaires ; comme, pour soumettre et faire rentrer dans l’ordre les collectivités qui s’insurgent, l’État est dans la nécessité de recourir à la force publique, il est indispensable que l’État, quel qu’il soit et puisse être, ait à sa disposition magistrats, policiers, gendarmes, soldats, gardiens de prison, fonctionnaires et employés de toutes sortes, attachés au fonctionnement de l’appareil administratif, judiciaire et répressif. C’est donc, fatalement encore, sous des espèces et des apparences nouvelles, la survivance des deux classes en opposition : celle des maîtres qui commandent et celle des sujets qui obéissent.
En conséquence, prise dans son ensemble et sans restriction ; je veux dire : envisagée dans sa plénitude réelle, dans sa totalité positive, la lutte des classes, dans ses rapports avec la révolution sociale, ne comprend pas seulement la lutte de la classe économiquement exploitée par la classe capitaliste, mais encore la lutte de la classe politiquement asservie, dominée par la classe gouvernante. Sous peine d’être mutilée et, partant, stérile, la lutte des classes, ainsi comprise – et c’est ainsi que nous la révèle une observation attentive, minutieuse, impartiale et complète –, a pour conséquence de dresser ceux qui sont exploités et opprimés contre ceux qui les exploitent et les dominent ; elle doit être à la fois politique et économique. Ils se trompent lourdement ceux qui, tels les républicains, les démocrates, les radicaux-socialistes, prétendent liquider le problème social par une solution purement politique. Ils ne tombent pas dans une erreur moins grossière ceux qui, tels les adeptes du parti socialiste et du parti communiste, comptent résoudre la question sociale par une solution purement économique. La solution uniquement politique laisserait subsister tout entière la lutte entre exploiteurs et exploités (la Révolution française en administre une preuve indéniable), et la solution uniquement économique laisserait subsister tout entière la lutte entre oppresseurs et oppressés (la Révolution russe dépose avec force en faveur de cette assertion). Au lendemain d’une demi révolution, à laquelle survivrait ou le capitalisme ou l’État, on constaterait, promptement, que, en réalité, tout resterait à faire, parce que le maintien de la propriété capitaliste, c’est-à-dire de l’exploitation économique, conduirait fatalement au retour de la domination politique et parce que la survivance de l’État, nécessairement oppresseur et répressif, conduirait fatalement à la résurrection de l’exploitation économique.
La Révolution sociale devra en finir avec le capitalisme et l’État.
Je touche, ici, à un point d’une importance capitale, d’une extrême délicatesse et d’une incomparable complexité. C’est pourquoi, au risque d’encourir le reproche de me répéter ou de paraître insister plus que de raison, je tiens à replacer, ici même, sous les yeux du lecteur, ce passage que je détache de mon article sur l’Anarchie, paru (pages 64 et suivantes) dans cette Encyclopédie :
« Les partis socialiste ou communiste de tous les pays affirment d’abord qu’une société ne peut pas vivre sans le principe d’autorité, qu’ils déclarent indispensable à l’entente et à l’organisation. La liberté de chacun, disent-ils, doit s’arrêter où commence la liberté d’autrui. Mais, en l’absence de lois, de règles qui fixent cette limité entre la liberté de chacun et celle des autres, chacun sera naturellement porté à étendre sa propre liberté aux dépens d’autrui. Ces empiètements seront autant d’abus, d’injustices, d’inégalités, qui provoqueront des conflits incessants et, à défaut d’une autorité ayant qualité pour résoudre ces conflits, c’est la force seule, la violence qui décidera. Les plus forts abuseront de leur force contre les plus faibles ; et les plus rusés, les plus coquins, abuseront de leur astuce contre les plus sincères et les plus loyaux.
« Cela posé, les socialistes et communistes autoritaires ajoutent qu’il est insensé de concevoir une organisation sociale sans lois ni sanctions. Ils s’appuient surtout sur les nécessités de la vie économique. Si chacun est libre de choisir son genre de travail, disent-ils, de travailler ou de ne rien faire, les uns travailleront beaucoup, les autres moins et d’autres pas du tout ; les paresseux seront donc avantagés au détriment des laborieux. Si chacun est libre de consommer à son gré, sans contrôle ni vérification, il y en a qui s’installeront dans les somptueux appartements, prendront les plus jolis meubles, les plus beaux vêtements et les meilleurs morceaux, et les autres seront obligés de se contenter de ce que ceux-ci leur laisseront. Ça n’ira point ; ça ne peut pas aller comme cela. Il faut des lois, des règlements qui fixent la production que chacun doit obtenir, en tout cas le nombre d’heures de travail qu’il doit accomplir et la part de produits qui lui revient. Sinon, ce seront le gâchis, la disette et la discorde.
« Les autoritaires disent enfin : si chacun est libre de faire ce qui lui plaît, tout ce qui lui plaît et rien que ce qui lui plaît, ce sera le débordement des passions sans frein, le triomphe de tous les vices et l’impunité de tous les crimes. Et ils concluent que l’autorité est nécessaire, qu’un gouvernement est indispensable, qu’il faut, de toute rigueur, des lois et des règlements, et, par conséquent, une force publique pour arrêter les coupables, des tribunaux pour les juger et des châtiments pour les punir. Toutefois, comme les anarchistes combattent cette doctrine et cette organisation, les autoritaires concèdent qu’un jour viendra où les hommes, s’étant graduellement transformés, deviendront raisonnables et fraternels et que, à ce moment-là, l’Autorité, ayant cessé d’être indispensable, disparaîtra, pour céder la place au communisme libertaire, c’est-à-dire à l’Anarchie, qui est l’idéal le plus juste et le plus élevé.
« Ils concluent : commençons par culbuter le régime capitaliste. D’abord, exproprions les bourgeois et socialisons les moyens de production, les transports et les produits. Nous verrons ensuite.
« À ce réquisitoire dirigé contre l’anarchisme, les libertaires répondent : la société capitaliste repose sut la propriété individuelle et l’État. La propriété privée serait sans force et sans valeur si l’État n’était pas là pour la défendre. C’est une grave erreur que de croire que le capitalisme est le seul agent de discorde entre les hommes vivant en société ; le pouvoir les divise tout autant. Le capitalisme les sépare en deux classes antagoniques : les possédants et les non possédants. L’État les divise aussi en deux classes ennemies : les gouvernants et les gouvernés. Les détenteurs du capital abusent de leur richesse pour exploiter les prolétaires ; les détenteurs du pouvoir abusent de leur autorité pour asservir le peuple.
« Supprimer le régime capitaliste et maintenir l’État, c’est faire la révolution à moitié, et, même, ne pas la faire du tout. Car le socialisme d’État ou le communisme autoritaire nécessiteront une armée formidable de fonctionnaires dans les services législatifs, judiciaires et exécutifs. L’organisation que préconise ce socialisme-là entraînera des dépenses incalculables dont le plus clair et le plus certain résultat sera de prélever sur la production des travailleurs des champs et des villes de quoi entretenir (assez grassement, sans doute) cette multitude de parasites et d’improductifs. Par suite, ne seront abolis ni les classes, ni les privilèges.
« La Révolution française a cru supprimer les privilèges de la noblesse ; elle n’a fait que les transmettre à la bourgeoisie. C’est ce que ferait tout système socialiste ou communiste s’inspirant du principe d’autorité ; il arracherait aux bourgeois leurs privilèges et les transmettrait aux dirigeants du nouveau régime. Ceux-ci formeraient une nouvelle classe de favorisés chargée de faire les lois, d’élaborer les règlements d’administration publique et d’en punir la violation ; la foule des fonctionnaires, dont ce serait l’occupation, formerait une caste à part ; elle ne produirait rien et vivrait aux crochets de ceux dont le travail assurerait la production. Ce serait une ruée d’insatiables appétits et de convoitises se disputant le pouvoir, les meilleures places et les plus grasses sinécures. Ce serait la curée. Quelques années après la révolution, ce seraient les mêmes désordres, les mêmes inégalités, les mêmes compétitions et, finalement, sous prétexte d’ordre, le même désordre, le même gâchis. Il n’y rien de fait et tout serait à recommencer, avec cette différence que le régime capitaliste est disqualifié, affaibli, vermoulu et à la veille de la banqueroute, tandis que le socialisme d’État ou le communisme autoritaire qui le remplacerait, aurait pour lui la jeunesse et devant lui l’avenir.
« Les anarchistes ajoutent : « Toute l’Histoire est là pour prononcer la condamnation sans appel du principe d’autorité. Sous des formes, des appellations et des étiquettes différentes, l’autorité a toujours été synonyme de tyrannie et de persécution. Non seulement elle n’a jamais protégé, défendu, garanti la liberté, mais encore elle est toujours méconnue, violée, outragée. Confier à l’autorité la charge d’assurer la liberté de chacun et de la contenir dans les limites de la pure équité, c’est une folie. »
« Et, pour finir, les libertaires disent aux partisans des régimes d’autorité : il y a entre vous et nous un abîme, non seulement en ce qui concerne la préparation et la réalisation de la révolution sociale, mais encore l’organisation de la vie individuelle et collective, au lendemain de cette révolution. Vous voulez, la révolution faite, tout imposer par la contrainte ; nous voulons tout demander à la bonne volonté et à la raison ; vous ne croyez qu’à la force, nous n’avons confiance qu’en l’entente. Vous concevez l’ordre par en haut, nous le concevons par en bas. Vous entendez que tout soit centralisé, nous voulons que tout soit fédéralisé. Votre méthode consiste à aller du composé au simple, du général au particulier, du nombre à l’unité, du tout à la partie, c’est-à-dire de la société à l’individu ; nous appliquons, nous, la méthode opposée : nous partons du simple pour aller au composé ; nous allons du particulier au général, de l’unité au nombre, de la partie au tout, c’est-à-dire de l’individu, seule réalité tangible, vivante, palpable, à la société, total des individus. Vous fondez la liberté commune sur l’asservissement de chacun ; nous fondons la liberté collective sur l’indépendance de chacun. Quand nous serons en mesure de renverser la société bourgeoise, nous détruirons du même coup le capital et l’État. Ce ne sera pas besogne plus difficile que de culbuter l’un et pas l’autre, puisqu’ils se tiennent, sont solidaires et ne forment présentement qu’un seul et même bloc, l’État n’étant, en fait, que l’expression politique de la dictature des puissances d’argent, dont le capitalisme exprime la dictature économique.
« Et, puisque vous reconnaissez que la liberté est désirable, que le communisme libertaire est l’idéal le plus noble et le plus équitable, le meilleur et le plus sûr moyen de réaliser cet idéal, c’est de combattre et de ruiner, et non de consolider et de renforcer, le principe d’autorité qui en est la négation. »
Aucun parti politique n’est révolutionnaire.
On peut reprocher à cette citation sa longueur. Elle est longue, en effet ; mais j’ai tenu à n’en rien retrancher, afin de lui conserver sa netteté, sa précision et sa force. Elle a, au surplus, le grand avantage de conduire le lecteur à une conclusion qui s’impose et qui, sans cette citation, pourrait paraitre inexacte. Cette conclusion, la voici :
Étant donné que tous les partis politiques, sans aucune exception, ont pour but non pas de briser le pouvoir, mais de l’arracher – légalement ou illégalement, pacifiquement ou par la violence – à ceux qui le détiennent, afin de l’exercer à leur tour, on peut et, logiquement, on doit affirmer qu’aucun parti politique n’est, à proprement parler, révolutionnaire et que, quels qu’ils soient, tous les partis politiques, absolument tous, sont contre-révolutionnaires, puisque tous sont opposés à une révolution qui ferait table rase de toutes les institutions procédant d’un pouvoir central ou dont la fonction serait une survivance, même affaiblie, du principe d’autorité, si un parti politique a l’impudence de se qualifier de révolutionnaire, c’est donc une flagrante imposture.
Seuls, les anarchistes déclarent que, sans un bouleversement social détruisant jusque dans leurs racines 1e capitalisme et l’État, c’est-à-dire l’autorité sur les personnes ; la propriété et l’autorité sur les personnes, le gouvernement, il n’y a pas, il ne saurait y avoir de révolution véritable. Seuls, ils enseignent, loyalement et sans peur, cette vérité capitale ; et c’est pourquoi, d’un bout du monde à l’autre bout, ils sont combattus et persécutés avec l’acharnement que l’on sait, par tous les gouvernements existants et par tous les partis qui ambitionnent de s’emparer de l’État. Le verbalisme dont se sert un parti politique et les moyens qu’il emploie ou conseille n’ont, en soi, aucune signification consistante et positive ; le but qu’il se propose, même quand il le passe sous silence, importe seul. Le prêtre réactionnaire peut utiliser la terminologie la plus violente et la plus subversive ; ce verbiage ne l’empêche pas de demeurer réactionnaire. César peut dissimuler son despotisme sous le magnifique manteau de l’ordre, de la paix et de la liberté ; il n’en reste pas moins César. Un parti de dictature peut exalter l’usage des méthodes révolutionnaires pour conquérir le pouvoir ; il n’en est pas moins un parti de dictature et, par conséquent, de despotisme et de contre-révolution. Le langage employé et les moyens d’action utilisés ou préconisés ne sont souvent que des fictions ; le but poursuivi est la seule réalité qui compte. Il y a des siècles, en voulant exprimer cette opinion, le poète latin s’est écrié :
« Sunt verba et voces ; prœtereaque nihil ! » (« Ce sont des mots, des paroles et rien de plus ! »)
Cette citation s’applique avec une sévère et rigoureuse exactitude, aux déclamations socialistes et communistes, qui dénaturent le sens actuel du mot « révolution » et mentent à l’idée fondamentale que ce mot exprime de nos jours.
Cette idée est que, à l’heure qui sonne au cadran de l’Histoire, dans les pays où le capitalisme et l’État en sont arrivés au stade actuel de leur course évolutive, il n’y a de révolution véritable, au sens exact et complet de ce mot, que lorsqu’il y a bouleversement de fond en comble, lorsqu’il est fait table rase des principes en cours et de leurs applications, lorsqu’on adopte un point de départ tout à tait nouveau, lorsqu’on opère sur une base et une pratique non seulement différente, mais encore diamétralement opposée. Or, j’ai démontré de la façon la plus irréfragable (voir le mot Anarchie) que la structure sociale repose tout entière sur le principe d’autorité et sur les institutions qui en découlent. L’idée de révolution sociale comporte donc nécessairement :
-
l’abandon total, l’effondrement définitif de toute architecture sociale ayant pour fondement le principe d’autorité ;
-
l’adoption et la mise en pratique du principe et des méthodes diamétralement opposées : le principe et les méthodes de liberté.
Les anarchistes ont l’inébranlable conviction que l’avenir leur appartient et justifiera leur doctrine. Ils ont la certitude que, tôt ou tard, après avoir épuisé, dans la douleur, toutes les méthodes et formes d’organisation sociale qui procèdent du principe d’autorité, les humains en arriveront à les repousser avec horreur et à tenter, confiants et résolus, l’essai des méthodes et formes d’organisation qu’engendre le principe diamétralement opposé. Alors, mais alors seulement, l’idée de révolution sociale, comme ils la conçoivent, triomphera et se développera sur le plan des réalités. Alors, et seulement alors, le « tout appartient à quelques-uns » de la période capitaliste, ayant fait place au « tout est à tous » des temps libertaires, et le « tous obéissent à quelques-uns » des époques autoritaires ayant été remplacé par le « personne ne commande et personne n’obéit ; ni maîtres ni serviteurs » de l’ère anarchiste, tous les individus, sans distinction de sexe et de nationalité, vivront dans le bien-être et la liberté qu’ils auront conquis par la révolution véritable.
Les anarchistes prennent part à tous les soulèvements populaires de tendance révolutionnaire.
Gardons-nous de tirer de cette affirmation la conclusion que les anarchistes restent et doivent rester indifférents aux tentatives de révolution qui – cela n’est que trop certain – précéderont la mise en route et le triomphe des multiples et grandioses réalisations qui dériveront d’une libération à la fois politique, économique, intellectuelle et morale, issue de la révolution sociale selon leurs conceptions. Si optimistes que nous puissions être, nous ne nourrissons pas l’espoir de parcourir d’un seul élan, de franchir d’un seul bond la distance qui nous sépare encore de ce magnifique résultat. Nous ne nous faisons pas d’illusions à ce sujet. Nous nous rendons compte que, entre l’ordre social – je devrais dire « le désordre social » – que nous subissons et l’ordre social que nous voulons fonder, il y a tout un monde d’idées, de sentiments, de traditions et d’habitudes qui est à transformer du tout au tout, et nous n’ignorons pas qu’une transformation aussi formidable ne peut pas être accomplie en un laps de temps très court. Il est donc hors de doute que l’humanité n’atteindra le but que je précise ci-dessus que par étapes ; il est certain que nombre de petits et moyens combats seront livrés avant que ne soit engagée ce que l’Internationale de Pottier appelle « la lutte finale » ; il n’est pas douteux que la victoire sera le couronnement d’une série de rencontres heureuses et de défaites plus ou moins cuisantes.
Eh bien ! Les anarchistes n’attendront pas, pour agir, que la bataille décisive s’engage ; ils prendront part aux escarmouches qui y conduiront. Ils se mêleront à toutes les campagnes, à toutes les agitations, aux vastes mouvements de grève, aux soulèvements populaires, dirigés contre le régime capitaliste et s’inspirant de la haine de l’autorité. Partout, ils seront au premier rang des révoltés, des insurgés, des révolutionnaires, aux postes de combats qui exigeront le plus d’intrépidité et de sang-froid ; ils seront les animateurs et les auteurs des coups de main les plus hardis, des initiatives les plus audacieuses, des actions les plus risquées, des gestes les plus téméraires, poussant l’assaut aussi loin et aussi haut que possible.
Qu’on n’en doute pas : les anarchistes seront de ceux – car j’espère qu’ils ne seront pas les seuls – qui, aux postes les plus responsables et au contact des passions les plus violemment déchaînées, garderont toute leur présence d’esprit et ne perdront pas de vue le but à atteindre. Je dis, ici, sans exagération ni romantisme, ma profonde pensée : je suis, convaincu que, toutes les fois que débutera et se dessinera une fermentation insurrectionnelle, toutes les fois que l’effervescence populaire prendra une tournure révolutionnaire, les anarchistes se jetteront au cœur même de la mêlée ; d’abord, parce qu’ils n’ignorent pas que, quand ces mouvements commencent, on ne sait jamais où ils s’arrêteront ; ensuite, parce que, fussent-elles vaincues, noyées dans le sang et suivies d’une répression féroce – rançon de la peur qui aura secoué les entrailles de la classe possédante et gouvernante –, les insurrections de cette nature laissent toujours quelque chose après elles et que le terrain conquis se mesure à l’impétuosité du flot populaire et au chemin parcouru par la vague révolutionnaire ; enfin, parce que leur tempérament et les forces intérieures qui les animent leur interdiraient toute possibilité d’assister, impassibles et les bras croisés, au duel tragique, dressant l’un contre l’autre : le présent qui ne veut pas succomber, et l’avenir, qui veut naître et vivre.
À propos du fatalisme historique de certaine école marxiste.
Le marxisme a donné naissance à une école socialiste qui, prenant à la lettre la thèse fondamentale du marxisme, prétend que la révolution se fera toute seule, automatiquement, fatalement, à la façon d’une révolution géologique, que rien ne saurait empêcher, ni même retarder, quand le travail (parfois, et le plus souvent même, imperceptible, inobservable en raison même de sa lenteur), qui prépare ce bouleversement géologique, est parvenu à son point culminant, décisif, terminus. J’ai entendu des adeptes de cette conception s’exprimer ainsi :
« Lorsque le fruit a atteint sa pleine maturité, de lui-même il se détache de l’arbre ; en tous cas, il ne reste plus qu’à l’en détacher, et il cède doucement à la main qui le cueille, ce qui ne nécessite aucun effort appréciable. »
Multipliant les comparaisons de cette nature, il en est qui disent :
« Quand les neuf mois de la gestation maternelle sont révolus, l’accouchement se produit de lui-même et, parvenu à terme, l’enfant vient au monde automatiquement, fatalement. »
Ces comparaisons sont ingénieuses et ne manquent pas de quelque justesse ; mais elles ne sont pas totalement exactes. Ce qu’il y a d’exact, c’est que, comme pour le bouleversement géologique, parvenu au point terminus de son évolution, pour le fruit mûr et pour l’enfant à terme, la transformation sociale ne s’opérera normalement, et dans des conditions favorables, que lorsque les éléments constitutifs de ladite transformation auront pris, au cœur même de la société capitaliste, un développement les acheminant de plus en plus vers la formation d’une société nouvelle et tendant de plus en plus à ruiner les fondements et les principes qui servent de base au régime capitaliste. Alors, l’édifice étant intérieurement ébranlé, lézardé, miné, rongé, ruiné, il ne restera plus qu’à provoquer l’ultime secousse qui, ayant raison des résistances toujours plus affaiblies de l’édifice, déterminera son écroulement. Mais il y a assez loin de cette prévision, rigoureusement certaine et, pour ainsi dire, scientifique, à ce fatalisme historique qui, même en l’absence de l’ultime secousse, c’est-à-dire de l’intervention brusque et violente d’une action, d’une force révolutionnaire, certifie que l’édifice croulera de lui-même, automatiquement, fatalement. Rien ne justifie une telle conception, inspirée d’un matérialisme historique poussé jusqu’à l’absolu et dégénérant en fatalisme.
La foudre n’éclate pas dans un ciel serein, l’orage est précédé d’indices précurseurs, de phénomènes annonciateurs qui ne trompent pas l’observation et renseignent celle-ci sur la violence de l’orage qui vient, sur son imminence, sur les circonstances que le déchaîneront et sur les conséquences qu’il entraînera. Il en sera de même de la révolution sociale. Pas plus que la foudre, la révolution n’éclatera dans la sérénité d’une époque paisible et sans nuages. De même que l’orage, elle sera annoncée par des symptômes révélateurs d’une fermentation inusitée, d’un trouble fonctionnel, d’une lésion organique, d’un désordre mettant en cause la vie même du corps social. Elle ne surprendra que ceux qui ferment les yeux pour ne rien voir et se bouchent les oreilles pour ne rien entendre.
J’exprime ici une certitude que tout le monde admet.
Comme il y a loin de cette certitude à l’idée d’une révolution sociale s’accomplissant d’elle-même, par la seule force des choses, automatiquement, fatalement, sans l’intervention violente et brusquée d’une action organisée, volontaire, déterminée par l’état de conscience des masses excédées !
Évolution et révolution.
On oppose souvent l’évolution à la révolution. Des protagonistes de cette opposition, les uns invoquent la raison, les autres le sentiment. Plaçant leur confiance entière dans l’évolution proprement dite, les premiers prétendent que celle-ci suffit aux transformations les plus profondes, qu’il convient de s’en remettre aux conséquences intrinsèques de l’évolution, et que, le point terminus de toute évolution se confondant avec le point initial de l’évolution qui suit, ce que nous appelons improprement « révolution » n’est pas autre chose que le passage normal et spontané d’un régime social qui s’achève à un régime social qui commence. Et ils concluent à l’inutilité de la révolution. Ils vont même jusqu’à soutenir que, ne pouvant viser qu’à précipiter imprudemment le rythme de l’évolution, parvenue presque à son terme naturel, la révolution ne peut avoir pour résultat que de ralentir ou d’entraver la marche de l’évolution, voire d’en compromettre peut-être et d’en retarder sans aucun doute la marche. À l’appui de cette affirmation, ils appellent l’exemple des insurrections, des soulèvements populaires, des révolutions avortées ou vaincues, mouvements qui ont été suivis d’une répression sauvage et d’une réaction plus ou moins longue.
Je fais tout d’abord remarquer que l’arrêt ou le recul de l’évolution en cours, dont ces adversaires de la révolution font état pour combattre l’idée même de la révolution, ne sont consécutifs qu’à des tentatives prématurées de révolution ou à des révolutions en déroute. Ces arrêts, pas plus que ces régressions, ne sauraient s’appliquer aux mouvements révolutionnaires victorieux, lesquels, s’ils n’ont pas recueilli tous les fruits de la victoire remportée, ont, tout au moins, brisé les obstacles et triomphé des résistances qui leur étaient opposées. J’écarte, ainsi, le reproche fait à toute révolution de retarder le rythme de l’évolution ou d’en compromettre, par avance, les heureux résultats. Ce reproche étant écarté, il s’agit de savoir si une évolution qui s’achève donne, spontanément et nécessairement, naissance à l’évolution souhaitable. Est-il certain que cette évolution, qui arrive a son terme naturel, sera le point de départ d’une évolution nouvelle concordant avec la nécessité d’une évolution en désaccord avec celle qui disparaît dans le gouffre du passé et en harmonie avec celle dont le besoin s’affirme et qui répond à la fois aux exigences de l’heure et aux possibilités du lendemain ? C’est le cas, ou jamais, de dire que poser la question, c’est la résoudre. J’insiste néanmoins.
Exemple : dans les profondeurs de la mer, ou dans les entrailles de la terre, un bouleversement géologique est en préparation ; il suit sa marche, lente mais régulière : des excavations se creusent, des éboulements se succèdent, des infiltrations amènent des déclivités, des affaissements, des déplacements ; des blocs s’effritent et d’autres blocs s’agglomèrent. L’ensemble de ces phénomènes conduit, à ne s’y point tromper, au cataclysme qui peut être retardé par certaines circonstances ou accéléré par d’autres, mais qui, de toutes façons, est devenu inévitable. À la minute précise où toutes les résistances sont emportées, le bouleversement prévu se produit. Rien ne peut s’y opposer, l’empêcher, pas même l’ajourner, si peu que ce soit. Dans cet exemple, la révolution géologique se confond avec la fin de l’évolution qui l’a précédée et déterminée. Mais il s’agit, ici, d’une matière s’assouplissant, sans opposition possible, aux lois de l’évolution ; cette matière n’est mue par aucun intérêt in se ; elle ne possède aucune volonté ; elle n’a, à aucun degré, le sens de la responsabilité ; elle est sans conscience.
En est-il de même quand il s’agit non plus d’une révolution géologique, aveugle, inerte, passive, irresponsable, inconsciente, mais d’une révolution sociale, où sont engagés des êtres clairvoyants, mouvementés, agissants, responsables, susceptibles de faire un choix, dont les volontés et les résistances s’opposent, en fonction même des intérêts qui les divisent et de la barricade qui s’élève entre eux et les sépare en deux camps, celui qui attaque et celui qui se défend, celui qui donne l’assaut et celui qui le repousse ? La comparaison, l’analogie par laquelle on tente d’assimiler la révolution sociale à un bouleversement géologique est-elle admissible ? Évidemment, non.
Les autres protagonistes de la conception qui oppose l’évolution à la révolution invoquent le sentiment. Ils insistent sur les atrocités de ce qu’ils nomment la guerre « civile » ; ils se complaisent dans l’évocation des luttes fratricides (qu’ils disent), qui mettent aux prises les habitants d’une même nation, d’une même région, d’une même commune ; ils assombrissent à l’envi l’aspect douloureux de ces mouvements historiques. Ils avancent que, trouvant leur application dans l’adaptation graduelle des constitutions politiques et des formes économiques aux besoins de chaque époque, aux aspirations et au tempérament de chaque peuple, à l’épanouissement progressif des civilisations, les lois de l’évolution président, seules et d’elles-mêmes, aux améliorations désirables, aux perfectionnements possibles, à l’édification, trop lente peut-être, mais certaine de la justice, de la liberté, de la paix et du bien-être pour tous. Ils concluent :
« Faisons, à tout prix, l’économie d’une révolution. »
Le sentiment qu’ils expriment part d’un bon naturel, mais il ne trouve pas sa place ici ; et nombre de considérations ruinent la solidité de l’échafaudage fragile que ce sentiment s’ingénie à édifier. Et je réponds :
« Tout beau, mes bons apôtres ! Vous prétendez vouloir faire l’économie d’une révolution. Ce désir vous honore. Mais permettez-moi de trouver contradictoire que vous ayez à ce point l’horreur du sang versé, des larmes répandues, des excès révolutionnaires, alors que vous avez à cœur de maintenir le plus longtemps possible – car c’est à ce résultat que, de toutes façons, aboutit votre manière de voir– le régime social qui, à l’heure où j’écris ces lignes, condamne au chômage plus de trente millions de sans-travail. Songez-vous, cœurs compatissants, non seulement aux privations dont ces trente millions de chômeurs pâtissent, mais encore à la détresse dans laquelle se trouvent plongés les cinquante ou soixante millions de pauvres êtres qui composent la famille de ces chômeurs : vieux parents, femmes et enfants privés des ressources que le travail des adultes leur assure à l’ordinaire ? Songez-vous, âmes sensibles, aux fleuves de sang, aux ruines, aux dévastations, aux deuils, et, pour tout dire, aux abominations de la Grande guerre qui, durant plus de quatre ans, a ensanglanté la Terre et déshonoré l’humanité ? Songez-vous au désastre incalculable et sans précédent que serait la guerre de demain, cette guerre que, dans les salons diplomatiques, dans les sphères financières, dans les officines militaires et dans les sentines parlementaires, on prépare de sang-froid, soit dans l’intention de ramasser des millions et des millions, soit dans l’espoir de faire échec à la révolution ?
« Songez-vous que, seule, la révolution peut mettre fin tant au chômage qu’aux cupidités, aux convoitises et aux ambitions des malfaiteurs qui, plutôt que de renoncer au pouvoir et à la fortune, sont prêts à précipiter leurs semblables dans l’abîme d’une nouvelle guerre ? Songez-vous à tout cela, dites, y songez-vous, et, si vous y songez, n’estimez-vous pas que la révolution n’accumulera jamais la millième partie des souffrances dont la société actuelle porte la responsabilité ? »
La guerre et la révolution.
Il est certain que si votre sensibilité s’émeut à la pensée de la révolution, elle s’accommode de la guerre, cent fois plus meurtrière et sauvage. Mais je vous entends : vous prétendez que la guerre a des excuses et que la révolution n’en a pas, parce que la guerre met aux prises des nations étrangères l’une à l’autre, tandis que la révolution – la guerre civile – dresse les unes contres les autres des personnes appartenant à la même nation, des frères. Ce qui fait que, dites-vous, la guerre et la révolution sont deux choses bien différentes et qui ne peuvent être confondues. Eh bien ! Je suis, sur ce point précis, de votre avis. Guerre et révolution portent en elles deux contenus non seulement différents, mais opposés. La guerre arrache, de gré ou de force, à son travail, à son foyer, à la paix qui lui est chère, le travailleur de France. Elle lui enjoint de s’armer et de tuer le plus possible d’Allemands, d’Italiens ou de Marocains. Ces prétendus ennemis, qu’il faut massacrer sans pitié, le travailleur de France n’a rien à leur reprocher ; ils ne lui ont fait, et ne lui font aucun mal ; il n’a à relever de leur part nul défi, il n’a aucune insulte à venger, aucune haine à assouvir, aucun intérêt personnel à défendre. Qu’il soit vainqueur ou vaincu, ce travailleur de France a tout à perdre et rien à gagner. En vain objectera-t-il qu’il ne connaît pas ceux qu’on lui fait un devoir de combattre avec frénésie ; on ne lui demande pas son avis ; on l’oblige, sous la menace des sanctions les plus sévères, à se battre contre des travailleurs comme lui, des ouvriers et des paysans victimes de la même exploitation que lui, courbés sous le même joug que lui, souffrant de la même oppression que lui : donc, ses frères de misère et de servitude.
Vient la révolution. Celle-ci dit au même travailleur :
« Te laisseras-tu toujours tromper par les imposteurs de la politique et pressurer par les capitalistes ? Ta patience n’est-elle pas à bout ? L’occasion s’offre, à toi et à tes compagnons, victimes comme toi d’une organisation sociale fondamentalement inique, de briser tes chaînes et de devenir un homme libre.
« Veux-tu ne plus être opprimé par l’État et exploité par le capitalisme ? Si oui, lève-toi, joins ton effort de libération à celui des opprimés et des exploités comme toi : tes frères ; et, tous ensemble, d’un bras robuste, d’une volonté ferme, d’un cœur fervent, affranchissez-vous par la révolution. Celle-ci t’appelle ; mais elle ne te contraint pas, à toi de décider ! »
Sans qu’il soit nécessaire que je m’étende longuement sur la différence qui existe entre la guerre et la révolution, on en distingue l’opposition. Guerre à l’intérieur ou à l’extérieur, guerre d’une ou plusieurs nations contre une ou plusieurs autres nations, ou guerre au sein de la même nation ; guerre tout court ou guerre civile, c’est toujours la guerre, me dira-t-on. Soit, je le concède à ceux à qui il plaît, afin de jeter de la confusion dans un débat pourtant si simple et si clair, d’employer le même mot pour exprimer deux choses qu’ils déclarent eux-mêmes très différentes. Différentes à tel point que, hormis le même terme qui les rapproche et les unit, tout les éloigne et les sépare. Qu’on en juge :
-
la guerre ne laisse à personne la faculté de « marcher » ou de « ne pas marcher » ; la révolution laisse à chacun l’entière liberté d’y prendre part ou de n’y point participer ;
-
la guerre oblige à se battre des hommes qui ignorent pour quels motifs ils vont tuer ou être tués, car le combattant ne sait jamais quelles sont véritablement les origines et les fins de la guerre ; il ignore toujours les véritables intérêts qui sont en jeu ; et si on demandait aux soldats pour qui et pour quoi ils font la guerre, aucun d’eux ne pourrait répondre à cette simple question. Le révolutionnaire, lui, connaît les origines du conflit et le but que vise la bataille à laquelle il participe. Il sait contre qui et pour qui, contre quoi et pour quoi il prend les armes ;
-
le travailleur qui consent à « marcher » n’a rien à reprocher à l’ennemi qu’on lui ordonne d’assassiner ; il ne le connaît pas, il ne l’a jamais vu ; en conséquence, il n’a et ne peut avoir aucune haine contre lui ; tandis que le révolutionnaire ne se décide à s’insurger contre l’État social qu’il veut détruire, que lorsqu’il est las d’être tenu en servitude par les gouvernants, lorsqu’il en a assez de subir l’exploitation des possédants ;
-
en cas de guerre, l’ensemble des déshérités d’un pays combat l’ensemble des déshérités d’un autre pays ; la voilà, la guerre fratricide, celle qui pousse à s’entrégorger des hommes unis par des liens fraternels autrement réels et puissants que ceux qui unissent mensongèrement, au nom d’une patrie commune, des hommes qui, en temps de paix, forment des castes, des catégories et des classes aux intérêts foncièrement et irréductiblement opposés. Qu’ils soient de France, d’Italie, d’Allemagne, du Maroc ou d’ailleurs, tous les déshérités communient dans la fraternité de l’oppression, du travail avili et exploité, et de la pauvreté. Or, la guerre jette ces frères les uns contre les autres et leur fait une obligation matérielle et un devoir moral de s’entretuer. Par contre, la révolution range du même côté les combattants de la même classe, les champions de la même cause, et les appelle à lutter, tous ensemble, contre les forces que leur oppose le gouvernement, défenseur de la classe ennemie ;
-
quel que soit l’enjeu de la guerre, il est nul, il est sans valeur aucune pour le combattant pauvre qui, la paix rétablie, et s’il a été épargné, retournera à l’usine ou à la terre, Grosjean comme devant ; tandis que l’enjeu de la révolution est d’une importance capitale pour le combattant révolutionnaire qui, celle-ci étant victorieuse pourra avec raison entonner l’hymne de la délivrance, parce qu’il verra la félicité remplacer la souffrance, le paradis succéder à son enfer ;
-
l’idée de patrie (voir ce mot), qui arme les peuples et les jette, dans un heurt monstrueux, les uns contre les autres, est une idée artificielle, inconsistante et criminelle ; tandis que l’idée de révolution, qui part de la volonté instinctive et profondément humaine de faire, au bénéfice des multitudes spoliées et asservies, la conquête du bien-être et de la liberté, cette idée est naturelle, positive, juste, généreuse et sainte.
En vérité, pour la révolution, même quand on l’appelle la guerre civile et qu’on l’assimile à la guerre proprement dite, prétendre que c’est toujours, qu’on le veuille ou non, la guerre, et conclure de cette assimilation erronée que si l’on condamne l’une, il faut logiquement condamner l’autre, c’est une inadmissible aberration. Je pense l’avoir, ci-dessus, très suffisamment démontré. On s’expliquerait difficilement, on ne s’expliquerait même pas du tout cette aberration, si l’on n’était pas informé des motifs qui poussent certains milieu à utiliser les affinités d’apparence qui existent entre la guerre et la révolution, pour se prononcer contre l’une et l’autre et combattre celle-ci et celle-là avec une égale énergie.
La thèse de la non-violence.
Ces milieux, quels sont-ils ? Ils sont de deux sortes et ils sont opposés. Ceux qui composent le premier de ces milieux sont de mentalité pacifico bourgeoise ; ils sont, en tant que pacifistes, contre la guerre, et, en tant que bourgeois, contre la révolution. Ceux qui composent le second milieu sont d’esprit tolstoïen ou gandhiste. Ils se déclarent irréductiblement hostiles, quelles que soient les circonstances, à l’emploi de la violence, et, pour cette raison, ils se campent en adversaires inflexibles et de la guerre et de la révolution qu’ils se plaisent, eux aussi, à qualifier de « guerre civile », parce qu’ils ne conçoivent la révolution que sous la forme d’attaques violentes et meurtrières, d’une part, et de résistances brutales et sanglantes, d’autre part.
La position que prennent les pacifico bourgeois est purement absurde : pacifistes, ils abominent la guerre et se refusent à la faire ; mais, bourgeois, ils entendent maintenir et défendre le régime capitaliste qui, comme nul ne peut le méconnaître, porte la guerre dans ses flancs ; en sorte que – inconcevable stupidité ! – ils défendent la cause de l’effet qu’ils condamnent. Je ne juge pas utile de discuter davantage cette inconséquence.
La thèse qui, au nom de la non-violence, repousse avec la même fermeté la révolution et la guerre, est plus aisément soutenable et infiniment plus séduisante. Elle est même si attirante que pas un révolutionnaire ne refuserait d’y souscrire, s’il dépendait de son vouloir que la transformation sociale, qu’il juge nécessaire et urgente, se réalisât sans violence. Rappelons-nous qu’il ne s’agit point d’un changement de détail ou de surface. Mettons-nous bien dans la tête que modification, réforme, amélioration ne sont pas synonymes de transformation. Ne perdons pas de vue qu’il ne saurait être question de replâtrage, de ravalement, de réparations, de rafistolages, de dégagements, de rafraîchissements et de décorations destinés à rajeunir, à étayer, à embellir la vieille maison et à lui donner un aspect extérieur moins repoussant ; mais qu’il s’agit de procéder d’abord à une complète démolition et de réédifier ensuite, sur des bases opposées, avec des matériaux neufs et selon un plan entièrement nouveau, un édifice vaste et confortable, élégant et solide, salubre et majestueux. Et cela étant posé et convenu, examinons, consciencieusement et sans esprit préconçu, s’il est possible de concevoir l’action révolutionnaire s’engageant, se poursuivant et atteignant son but sans l’intervention de la violence. Est-il certain que toute révolution, et, notamment, la révolution libertaire, c’est-à-dire l’affranchissement intégral, l’émancipation définitive – celle dont nous nous occupons dans cette étude – ne peut s’accomplir que dans la violence ? Cette révolution sera-t-elle accompagnée et suivie de ces attentats dirigés contre les choses (vandalisme, destruction) et contre les personnes (brutalités, assassinats), qui caractérisent la violence ? La question est là. Étudions-la attentivement.
On peut, théoriquement, admettre l’idée de la révolution non violente.
Rien n’est plus facile que de concevoir théoriquement une révolution s’effectuant sans combat brutal, sans bataille de rue, sans effusion de sang ; et, pourtant, l’idée de révolution s’accompagne, dans l’esprit de presque tous, de scènes de carnage et de meurtre. Dès que ce mot « révolution » est prononcé, il évoque, instantanément et sans réflexion, le tableau désolant du pillage, du désordre et de l’assassinat ; il projette dans l’imagination l’impression brusque et irréfléchie d’une bataille acharnée, dans laquelle font rage les haines à assouvir, les vengeances à satisfaire, les représailles à exercer. Pourquoi ? Parce que, jusqu’à ce jour, il en a été de la sorte au cours des événements que l’Histoire enregistre au chapitre des révolutions. Les annalistes et les historiens impriment à ces événements, qui ont plus ou moins fortement creusé leur empreinte dans les siècles révolus, un caractère dramatique, un aspect tragique et, parfois, horrifiant. Ils en mentionnent les origines et ils en dégagent les résultats, même quand ceux-ci ont constitué un progrès incontestable, avec moins d’insistance qu’ils n’en mettent à fixer l’attention du lecteur sur les passions déchaînées à ces époques de bouleversement et sur les débordements et les excès qui s’en sont suivis. Et la mémoire des hommes ayant gardé le souvenir de ces tragédies, leur imagination ayant conservé l’impression de ces récits dramatiques et leur sensibilité naturelle restant sous le coup des émotions suscitées en eux par ces relations de saccages et de crimes, il est naturel que, dans leur pensée, l’idée de violence reste indissolublement attachée à celle de révolution.
Toutefois, cela ne signifie pas que la révolution sociale dont il est question ici sera nécessairement, inéluctablement, violente et que la naissance du monde nouveau, dont nous pressentons la venue, se fera fatalement dans la douleur des combats, dans la brutalité des chocs, dans les larmes, le sang, les excès et les haines qui escortent la violence. Car, je le répète, on peut parfaitement admettre, du moins en principe, que la révolution sociale aura lieu pacifiquement, et les anarchistes seraient les premiers à s’en réjouir et, de tous, les plus heureux qu’il en fût ainsi. Il suffit de les connaître, de les bien connaître, pour n’en pas douter.
On se plaît à représenter les libertaires sous les traits d’êtres durs, insensibles et cruels, et, sans effort, on discerne dans quel but les dirigeants, qui nous ont en haine, ont tracé de nous un portrait aussi contraire à la réalité. La vérité est que nous sommes profondément humains, tendres, doux et pitoyables, et que, si nous exécrons l’esclavage, la servilité, la laideur, la fourberie, l’injustice et l’inégalité, nous ne connaissons pas la haine des personnes. Bien des fois, j’ai dit (et j’affirme que c’est vrai) :
« Je puis descendre dans mon cœur et je n’y trouverai aucun nom détesté. »
Sévère aux institutions, notre philosophie est, à l’égard des personnes, d’une extrême indulgence, parce que l’expérience nous prouve chaque jour que l’individu pense, sent, veut et agit en fonction de la situation qu’il occupe, du métier qu’il exerce, des influences héréditaires qui l’impulsent, de l’éducation qu’il a reçue, de la mentalité et des mœurs de l’ambiance dans laquelle il est né, il a grandi, il vit (je ne tiens pas compte, ici, des quelques exceptions qui, au surplus, ne font que confirmer la règle). Il faut qu’on sache que si nous nous tenons rigoureusement éloignés des compétitions électorales, ce n’est pas seulement parce que la politique, ce qu’on appelle couramment la politique, est malpropre et malhonnête, et parce que les Parlements sont des antres de corruption et de duplicité, mais encore parce que nous sommes des hommes, rien que des hommes, et nous savons que, sujets aux défaillances, à l’erreur, à la lâcheté, exposés comme le commun des mortels aux morsures de la cupidité et de l’ambition, si nous commettions la faute de solliciter, et si nous avions la malchance de conquérir le pouvoir, nous y serions aussi impuissants pour le bien que les autres et ne pourrions nous y conduire mieux ni autrement qu’eux.
Si la révolution est violente, les maîtres en seront seuls responsables.
J’ai indiqué plus haut ce que les anarchistes attendent de la révolution sociale, ce qu’ils lui demandent, ce qu’ils en exigent : que cette révolution clôture le régime néfaste de l’autorité et inaugure l’ère bienfaisante de la liberté, c’est, pour eux, la seule chose qui importe.
Si ce résultat peut être le fruit de la persuasion, de la douceur et de l’entente entre capitalistes et prolétaires, entre gouvernants et gouvernés, personne n’en éprouvera une joie comparable à la leur ; mais s’il est absolument indispensable de faire appel à la violence pour atteindre ce but, les libertaires n’hésiteront pas à y recourir. Eh bien ! De qui dépend-il que la transformation sociale soit pacifique ou violente ? Je n’hésite pas à dire que cela ne dépend pas de la classe ouvrière, mais de la classe capitaliste : pas des peuples, mais des gouvernements.
Supposons que la classe dirigeante ouvre enfin les yeux et, à la clarté de plus en plus vive des événements, se rende compte que ceux-ci sont faits pour lui inspirer cette crainte salutaire qu’on dit être « le commencement de la sagesse ». Supposons que les bourgeois les plus avertis et les mieux informés – il n’y a pas, chez eux, que des aveugles et des borgnes – finissent par prendre conscience du grave danger suspendu sur leurs têtes. Supposons que les plus avisés de ces représentants et porte-parole du grand capitalisme, alarmés d’une situation qui s’aggrave de jour en jour, d’un bout du monde à l’autre bout, en viennent à penser que la catastrophe est imminente. Supposons qu’ils en arrivent à grouper tout ce qui suit en un sombre tableau qui ne manquerait pas de les impressionner : irritation des masses laborieuses odieusement affamées par le manque de travail ; inquiétude des autres travailleurs que le chômage a jusqu’ici épargnés, mais qui vivent dans la navrante incertitude du lendemain ; angoisse poignante des peuples qui entendent rouler sur leurs têtes le grondement sinistre du tonnerre, qui va s’abattre sur eux sous la forme d’une guerre dont l’horreur dépassera l’imagination ; mécontentement grandissant de l’innombrable foule des contribuables sur qui pèse le poids de plus en plus écrasant des impôts ; malaise et colère suscités dans la petite et moyenne bourgeoisie par la paralysie générale des affaires, la baisse graduelle des valeurs, la débâcle bancaire, le détraquement des monnaies. Supposons que les grands capitalistes qui, présentement, règnent sur l’humanité et président à ses destinées, aient enfin la claire vision des graves dangers que l’ensemble de ces inquiétudes, irritations, mécontentements, angoisses, colères et révoltes latentes fait courir à leurs richesses et, pis encore, à leurs personnes. Ne pourrait-on pas, si improbables que soient, pratiquement, ces suppositions, en admettre la possibilité et, dans ce cas, prévoir que, cédant à la peur de se voir enlever, par la révolution, leurs biens et la vie, les détenteurs du capital et du pouvoir estiment prudent et sage de renoncer aux profits du capital et aux avantages du pouvoir, plutôt que de courir le risque d’en être dépossédés par la violence révolutionnaire ?
Le champ des hypothèses est incommensurable ; ne nous arrêtons pas sur cette voie. Poussons plus avant nos pas dans le domaine des conjectures. Nous venons d’attribuer de l’intelligence aux puissants et aux fortunés. Soyons généreux : accordons-leur aussi de l’équité, de la mansuétude, de la bonté. Les voici équitables : à comparer l’oisiveté opulente dans laquelle ils sont installés à la vie de travail et de privations à laquelle se trouve inexorablement condamnée la fraction, de beaucoup la plus nombreuse, de la population, les privilégiés finissent – supposons-le – par être frappés de cette inégalité par trop choquante. S’ils réfléchissent quelque peu, ils découvrent, non sans une certaine honte mêlée de quelques remords, que leur oisiveté et leur opulence sont faites de l’activité et de l’indigence des travailleurs. Leur cœur s’émeut, le sens de la justice s’éveille en eux. Ils tentent de soulager les infortunes qui les avoisinent. Mais ils ont tôt fait de constater que l’effort de leur charité ne parvient pas et ne saurait arriver à étouffer, même faiblement, les lamentations et les cris de détresse qu’exhale le gouffre trop large et trop profond de la douleur humaine. Sous le coup de ces désolantes constatations, leur cœur d’abord pénétré de l’amour de la justice, ouvert ensuite à la pitié, incline enfin vers la bonté. D’une part, l’esprit de justice qui gît au fond d’eux-mêmes les a conduits à reconnaître qu’il est monstrueux que certains jouissent du superflu, tandis que d’autres sont privés du nécessaire, que le droit à la vie est imprescriptible et que la vie exige que chacun mange à sa faim, soit proprement vêtu, confortablement logé, convenablement cultivé et pourvu d’une part suffisante d’affection et de tendresse ; d’autre part, les sentiments de bonté, qui sont le complément de ceux d’équité, et qui, peu à peu, envahissent leur cœur, les amènent à voir dans tous les hommes leurs frères, dans toutes les femmes leurs sœurs, dans tous les vieillards leurs parents, dans tous les petits leurs enfants, et à remplir envers eux les devoirs de solidarité que comportent les liens unissant tous les membres de la même famille. Ils s’élèvent ainsi peu à peu jusqu’au niveau de la plus haute moralité. Cette ascension les éclaire sur l’immoralité foncière d’une organisation sociale qui accorde tout aux uns et refuse tout aux autres, qui permet à une poignée de privilégiés de confisquer à leur profit tous les avantages que confèrent le pouvoir et la fortune, tandis qu’elle accable les seconds sous le fardeau des servitudes et des spoliations. Le jour, enfin, se lève où, écoutant les conseils – mieux : les ordres – de leur conscience éprise de justice et cédant aux appels de la bonté dont la douceur fait tressaillir leurs entrailles, ils abandonnent solennellement et d’un commun accord les richesses qu’ils possèdent et l’autorité dont ils sont investis. L’abdication des intelligents a été dictée par la crainte de se voir emportés, eux, leurs richesses et leur pouvoir, sous le souffle irrésistible de la tempête révolutionnaire, le renoncement des bons a été dicté par la justice et la mansuétude, le résultat est le même : c’est la transformation sociale s’accomplissant sans l’intervention de la force brutale et sanguinaire ; c’est la révolution pacifique se réalisant sans violence, en douceur, puisque tout ce qu’ils réclament leur étant bénévolement accordé, les mécontents, obtenant pleine et entière satisfaction, n’auront pas à employer la violence pour le conquérir.
Malheureusement, des hypothèses ouvrant de si magnifiques perspectives ne sont que des conjectures gratuites qui ne résistent pas deux minutes à l’épreuve de l’expérience et de la raison. L’expérience dépose contre leur vraisemblance et la raison proclame leur inadmissibilité. Aussi, ne me suis-je laissé aller à formuler ces suppositions que dans le but de faire remonter – comme il est juste de le faire – la responsabilité de la violence en cas de révolution jusqu’à ceux desquels, seuls, il dépend que celle-ci soit ou pacifique ou violente. Que les défenseurs du capital consentent à restituer à la communauté le sol, les moyens de production, de transport et d’échange qu’ils ont accaparés par la rapine, la conquête, le vol, la fraude, l’exploitation du travail d’autrui, le détroussement méthodique de l’épargne, la spéculation et les mille autres formes de la spoliation, et il ne sera pas nécessaire de recourir à la violence pour les leur arracher. Que les gouvernants, et tous ceux qui en sont les serviteurs, les soutiens et les partisans, se résignent à abandonner volontairement les postes qu’ils occupent, qu’ils renoncent aux fonctions qu’ils remplissent, qu’ils cessent de se raccrocher à l’autorité qu’ils détiennent, et point ne sera besoin, pour les en déposséder, de faire appel aux moyens violents.
Le problème si délicat et si controversé de l’emploi de la violence en période de transformation, c’est-à-dire de révolution sociale, se trouve ainsi posé dans les termes les plus simples et les plus précis, et sa position établit, de la façon la moins contestable, que sa solution tout entière se trouve, non pas, comme on est porté à le croire, entre les mains du prolétariat qui réclame le bien-être et la liberté auxquels il a droit, mais entre les mains de la bourgeoisie possédante et gouvernante qui peut, à son gré, accorder ou refuser l’exercice de ce droit au bien-être et à la liberté. Est-ce clair ? Comprend-on que si, au lieu de se faire sans effusion de sang – ce qui est désirable, mais me semble impossible – la révolution sociale s’accompagne de violence, la véritable responsabilité de cette violence sera imputable à ceux qui, par leur manque de lucidité et d’altruisme, auront rendu nécessaire le recours à celle-ci ?
La révolution sociale exige une préparation sérieuse.
Toute révolution doit être l’objet d’une préparation méthodique et de durée plus ou moins longue. Plus est considérable l’œuvre à accomplir, plus est élevé l’enjeu révolutionnaire et plus cette préparation exige de soins et de temps. Les conspirateurs qui ourdissent un complot ont le devoir de prévoir le plus et le mieux possible tout ce qui peut advenir. Cette tâche leur est rendue possible par le fait que le complot se limite ordinairement à un petit nombre de conspirateurs dont les principaux s’érigent en chefs, ont à prendre toutes décisions, dispositions et mesures propres à en assurer le succès. Le jour, l’heure, les mots d’ordre, les lieux de concentration, la répartition des forces, la distribution des postes, les mouvements à exécuter, les précautions à prendre, les modifications à prévoir, les manœuvres à contrecarrer, les résistances à briser, les complicités à s’assurer, les concours à acquérir, tous ces détails sont l’objet, de la part des promoteurs et des bénéficiaires éventuels du complot, d’une étude attentive aboutissant à un plan qui, autant que faire se peut, doit tout régler, tout prévoir, et ne rien abandonner au hasard, à l’imprévu. C’est pourquoi toute conspiration a, pour condition essentielle de la réussite, le secret scrupuleusement gardé et l’obéissance passive des troupes engagées dans le complot
Tout autre est une révolution, et notamment la révolution sociale, que nous étudions dans cet article. D’une part, impossible de tenir secrète la préparation, sous son aspect général et dans ses grandes lignes, de l’action révolutionnaire ; d’autre part, impossible d’exiger des masses insurgées une obéissance passive, une soumission aveugle qui ne sont, au surplus, aucunement désirables. Peut-on entourer de secret la propagande par la parole et l’écrit, indispensable à l’esprit de révolte qu’il faut propager au sein des masses pour espérer et obtenir d’elles qu’elles se décident à engager, l’heure venue, l’action décisive ? Peut-on organiser dans le mystère l’apprentissage de la multitude et son entraînement à ce qu’on a appelé « la gymnastique révolutionnaire ? ». Peut-il être question par avance d’une date fixe, d’une heure précise, d’un lieu de concentration déterminé, d’un plan ne varietur, de coups de main concertés, d’attaques brusquées, de manœuvres improvisées, de mouvements spontanés, etc., quand il s’agit d’une révolution qui, pour atteindre son but, doit prendre, dès le commencement et garder jusqu’à la fin, la tournure d’un formidable soulèvement populaire ?
Je n’envisage pas la révolution comme un mouvement chaotique, désordonné, partant au petit bonheur et se continuant de même ; je la conçois moins encore en dehors d’un plan étudié. Un plan discuté, conçu, tracé d’avance est utile : il est nécessaire. Mais ce plan ne doit comporter que les lignes essentielles ; il doit rester plastique et souple ; il doit être d’une grande mobilité, laisser la porte ouverte aux initiatives ; il doit s’adapter facilement et rapidement aux changements et retouches que conseillent ou ordonnent les circonstances et les conditions variables de la lutte ; car, excellente en certains cas, telle stratégie révolutionnaire peut être détestable en d’autres.
L’heure de la révolution sociale ne peut être fixée à l’avance par aucun devin ni prophète. C’est comme une traite sans échéance fixe, que le prolétariat tirera sur la bourgeoisie capitaliste et gouvernante, avec mise en demeure de payer. Cette traite ne sera utilement présentée que lorsque le porteur et bénéficiaire de cette traite sera en mesure, en cas de non-paiement, de saisir, d’expulser et d’exproprier le Capital et l’État, débiteurs associés et solidaires. Mais s’il n’est au pouvoir de personne d’assigner à l’échéance de cette traite une date précise, il n’en reste pas moins nécessaire de prévoir cette échéance et d’être en état d’exiger le paiement de cette lettre de change. C’est ainsi que je comprends la préparation de la révolution.
Cette préparation implique la réunion de trois éléments nécessaires, qui sont : l’éducation, l’organisation et l’action, et il convient d’attacher d’autant plus d’importance à chacun de ces trois éléments et à leur ensemble que le sort de la révolution sociale – sa défaite ou sa victoire – sera conditionné par la faiblesse ou la vigueur de chacun de ces éléments, et par l’insuffisance ou la force de leur réunion. Pour donner à cette préparation, gage du succès, l’importance décisive qu’elle possède, il serait donc utile de nous arrêter à chacun de ces éléments et d’établir le lien qui les rassemble, sans oublier un seul instant que la révolution sociale doit être anarchiste, sous peine d’être une révolution manquée ; que, conséquemment, anarchiste doit être l’éducation, anarchiste l’organisation et anarchiste l’action, et cela tout de suite, puisque nous sommes, d’ores et déjà, en pleine période de préparation et puisque ce travail préparatoire consiste à hâter l’éclosion de la phase révolutionnaire proprement dite et à assurer à l’anarchisme, dès son avènement, la plus puissante vitalité et les meilleures conditions de développement.
Mais, à propos de mon étude sur l’Anarchisme (voir ce mot), j’ai copieusement insisté sur le rôle de chacun de ces trois éléments et sur le total de conditions favorables que leur ensemble assure, en tant que préparation, au triomphe de la révolution sociale. Aussi, ne voulant pas me répéter, je renvoie aux pages 73 et suivantes de cette Encyclopédie le lecteur que ces multiples indications ne manqueront pas d’intéresser. Je me borne à ajouter que plus vigoureux et fécond aura été, au cours de la phase préparatoire, l’effort d’éducation, d’organisation et d’action libertaires, plus tôt éclatera la révolution elle-même, plus brève et moins violente sera l’œuvre de destruction, et plus rapide et plus sûr le travail d’édification d’un milieu social ayant pour fondement la liberté sans autres limites que l’impossible.
La période transitoire. — La dictature.
On discute, ou plutôt on ergote à perte de vue, dans les partis socialiste et communiste, sur ce que ces partis qualifient de période transitoire. Les théoriciens et leaders de ces deux courants du socialisme autoritaire entendent par là ce laps de temps indéterminé durant lequel la révolution, comme ils la conçoivent, étant un fait accompli, il s’agira : d’une part, de repousser les tentatives de retour offensif auxquelles, disent-ils, ne se feront pas faute de se livrer les forces concertées du Capital et de l’État, et, d’autre part, de procéder à la mise sur pied, au développement et à la stabilisation définitive de la nouvelle organisation sociale. Ils font partir cette période transitoire de l’époque à laquelle le mouvement insurrectionnel aura triomphé, et l’étendent jusqu’à celle où le nouveau régime, s’étant débarrassé de ses ennemis intérieurs et extérieurs, s’attellera effectivement à l’instauration d’un milieu social socialiste ou communiste. Ces deux fractions férues de la notion de l’État socialiste vont même jusqu’à préconiser, au lendemain immédiat du triomphe de leur révolution, un régime de dictature farouche et absolue, qu’ils ont l’effronterie de baptiser « dictature du prolétariat ». Cette dictature, ils ont l’hypocrite impudence d’affirmer qu’elle est indispensable à la sauvegarde de la révolution et à la défense des conquêtes révolutionnaires. Le tout est de savoir de quelle nature est la marchandise que couvre un tel pavillon.
Eh bien ! Cette marchandise n’est qu’une miteuse pacotille, et la révolution dont les bénéficiaires de la dictature prétendent sauvegarder les conquêtes, n’est qu’une piètre contrefaçon de la révolution sociale. Quelle est cette pacotille ? En quoi consistent ces conquêtes révolutionnaires ? Examinons ceci et cela froidement et du point de vue révolutionnaire qui est le nôtre, point de vue dont nul révolutionnaire conscient ne peut contester l’exactitude. Voici :
Grâce à de multiples circonstances convergentes qui ont frappé de discrédit les pouvoirs établis, fait éclater la malfaisance et l’absurdité du régime capitaliste, provoqué dans les masses populaires une fermentation exceptionnelle, mis à nu l’incapacité des dirigeants ; pour tout dire : créé et révélé publiquement une situation catastrophique, une puissante insurrection a éclaté et, par son ampleur et son extension naturelles, a atteint brusquement les proportions d’une formidable révolution. Les insurgés ont chassé du pouvoir les gouvernants militaires et civils ; la force armée a été mise en déroute et les révolutionnaires sont restés maîtres du champ de bataille. Dans ce magnifique sursaut de colère et de révolte, toutes les forces prolétariennes se sont rassemblées et elles ont mis en fuite les maîtres du jour et leurs défenseurs. Attaquée de toutes parts, prise d’assaut, la forteresse d’où, hier encore, partaient toutes les décisions de résistance et tous les ordres de massacre a dû capituler. Pris de panique, terrorisés, affolés, ceux qui l’occupaient se sont dispersés dans un sauve-qui-peut général et, faits prisonniers, pris comme otages, privés de toutes armes, ceux qui n’ont pas eu le temps de profiter de la débandade générale ont été réduits à l’impuissance.
Dans sa juste fureur, la masse révolutionnaire est résolue à mettre le feu aux quatre coins de cette forteresse maudite, centre et siège de toutes les autorités politiques, économiques ct morales. Quand cette citadelle, devenue la proie des flammes vengeresses, aura été détruite de fond en comble, quand il n’en restera plus rien, la route, si longtemps obstruée, deviendra libre et, maître enfin de ses destinées, le prolétariat, dans un élan irrésistible d’enthousiasme, confiant en l’étroite union qui lui a valu la délivrance, restant solidement uni et solidaire, organisera, en hâte, pour répondre aux nécessités qui ne peuvent attendre, la vie égalitaire et fraternelle qu’ont entrevue les libertaires et à laquelle, par leur propagande active, persévérante et passionnée, ils ont préparé les esprits et les cœurs.
Mais cette radieuse perspective ne fait pas l’affaire des chefs que les partis politiques se sont donnés. Ces messieurs ont-ils écrit tant d’articles, prononcé tant de discours, bâti des philosophies et des systèmes d’une solidité qu’ils proclamaient scientifique et qu’ils disaient à toute épreuve ; se sont-ils poussés au Parlement et installés aux postes les plus avantageux, ont-ils acquis une notoriété si brillante ; bref, se sont-ils donné tant de mal, ont-ils pris tant de peine, se sont-ils imposé de si lourds sacrifices, ont-ils travaillé si inlassablement à soustraire les travailleurs à l’influence des mauvais bergers de la bourgeoisie et à les ranger sous leur propre houlette, ont-ils fait tout cela pour que, tout d’un coup, s’écroule le rêve de domination qui les hante depuis si longtemps ? Pour que de cette victoire qu’ils ont si fervemment préparée et dont ils ont attendu l’heure avec tant d’impatience, il ne leur reste personnellement aucun profit ?
Va-t-on se passer des conseils de sagesse (ou de lâcheté) qu’ils ont si généreusement prodigués, dans les jours les plus difficiles, au troupeau de fidèles qu’ils avaient embrigadés et qui, naguère encore, les suivaient aveuglément et leur obéissaient passivement, en application de cette discipline dont ils déclaraient sentencieusement qu’elle est la principale force des partis, tout comme les militaires professionnels affirment qu’elle est celle des armées ?
Non et non ! Cela n’est pas possible.
Vite, les chefs et les sous-chefs se réunissent... pour aviser, étudier la situation et arrêter les mesures nécessaires. Ils se gardent bien de se faire les uns aux autres l’aveu des ambitions qui les rongent ; ils dissimulent de leur mieux la soif de domination qui les dévore. Tous ceux qui, au cours des années précédentes, se sont spécialisés : qui dans l’agriculture, qui dans les affaires étrangères, qui dans les finances, qui dans l’administration intérieure, qui dans l’instruction publique, qui dans la justice, qui dans la guerre, la marine ou l’aviation, qui dans les travaux publics ou les postes, qui dans les beaux-arts, le commerce et l’industrie, l’hygiène et la santé, le travail ou toute autre branche de la vie nationale, font valoir leur compétences, attirent l’attention de leurs collègues sur les services qu’ils pourraient rendre ; chacun insiste sur la gravité des circonstances, sur l’urgence et la nécessité de parer aux exigences immédiates, de rétablir l’ordre, de rassurer les camarades, d’inspirer confiance à tous. Et les grandes périodes oratoires ronflent à qui mieux mieux. Chacun estime que l’heure est venue de prendre les plus écrasantes responsabilités ; et la main sur le cœur, des trémolos dans la voix, l’œil étincelant de la flamme du plus pur dévouement, chaque spécialiste se déclare prêt à sacrifier son repos, sa santé et jusqu’à son existence, pour défendre, au poste qui lui sera imposé par la confiance de ses amis, les intérêts sacrés de cette révolution que le peuple admirable a signée de son sang !
Tous sont, en outre, pénétrés de ce sentiment profond de leur supériorité que l’habitude de parler et d’agir en chefs écoutés et obéis a introduit et graduellement développé en leurs personnes ; ils sont, au surplus, à tel point convaincus que les masses sont incapables de se diriger elles-mêmes, de discerner la voie qu’il faut suivre, d’adopter des décisions raisonnables et d’y conformer sagement leur conduite, qu’ils en viennent insensiblement à se convaincre les uns les autres qu’ils ont le devoir de se constituer en une sorte de gouvernement provisoire, investi des pouvoirs les plus étendus.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. Le gouvernement provisoire, dit « de défense révolutionnaire », se constitue par une répartition des attributions et des pouvoirs de nature à satisfaire toutes les ambitions et convoitises. Il s’agit, maintenant et sans perdre une minute, de porter cette grande nouvelle à la connaissance de tous. La nuit a suffi à l’accomplissement de tant de besognes. Le lendemain, les murs de la capitale sont tapissés d’affiches annonçant, en formes lyriques, que les hommes les plus intelligents, les plus consciencieux, les plus probes, les plus compétents, ceux qui, par toute une vie consacrée à la défense des humbles, à l’éducation et à l’entraînement des classes laborieuses, en vue de l’instauration d’une société d’hommes égaux et libres, ont su mériter la confiance du peuple, ont consenti, à la requête des organisations révolutionnaires les plus puissantes, à assumer les lourdes responsabilités et les charges écrasantes du pouvoir.
Cette proclamation ne manque pas d’affirmer que ce pouvoir sera doux à l’égard des bons, c’est-à-dire de ceux qui ont contribué à la victoire et seconderont l’effort du gouvernement, mais qu’il usera des sanctions les plus sévères contre les méchants, c’est-à-dire contre tous ceux qui tenteraient de combattre, d’entraver ou de compromettre les conquêtes révolutionnaires. Elle déclare, enfin, de la façon la plus expresse, que le gouvernement provisoire limitera strictement sa durée à celle de la période transitoire.
Des avions, des automobiles, des trains rapides, lancés dans toutes les directions, le télégraphe, le téléphone et la radio, fiévreusement utilisés, propagent cette information jusqu’aux plus modestes bourgades de la province.
Eh bien ! C’est à ce moment précis que se joue le destin de la révolution victorieuse : si la population insurgée ne réagit pas incontinent, si elle n’a pas, sur l’heure, le sentiment que la constitution de ce gouvernement provisoire équivaut à l’étouffement de la révolution, si elle n’a pas immédiatement la conviction que ce gouvernement, s’armant d’un pouvoir sans limite, va se transformer en une dictature et que cette dictature, c’est la confiscation, au profit exclusif des dictateurs et de leur parti, des conquêtes révolutionnaires, la victoire des insurgés se trouve ipso facto pratiquement annulée. Si l’indignation des éléments véritablement révolutionnaires ne se traduit pas, à l’instant même, par une reprise du soulèvement populaire insurrectionnel, si ce soulèvement n’atteint pas la puissance d’une vague de fond brisant l’autorité nouvelle, la révolution est mortellement blessée et ne tarde pas à expirer, égorgée par la perfidie, l’orgueil et l’esprit de domination de ceux-là mêmes qui se proclament ses défenseurs.
Le moindre répit accordé aux nouveaux maîtres leur permet de rétablir le fonctionnement des leviers de commande dont leurs prédécesseurs avaient été dépossédés et de s’en emparer, de remettre en action toute la mécanique gouvernementale, d’installer leurs créatures à la tête de tous les services de direction, de s’entourer d’une nuée de bureaucrates et d’une armée de fonctionnaires, de ressusciter la magistrature, l’armée et la police que la révolution avait écartelées, d’asseoir leur pouvoir sur le concours intéressé des uns, sur la servilité des autres et sur l’indifférence du plus grand nombre.
Une fois établie, la dictature se fait de plus en plus intolérante et répressive ; elle égale en abus de pouvoir, en arbitraire et en férocité les régimes les plus abhorrés. Jamais les profiteurs de la dictature – des maîtres comme les autres, et parfois pires – ne reconnaîtront leur inutilité, encore moins leur malfaisance ; jamais, ils n’avoueront que « la période transitoire » est parvenue à son terme et que, ainsi, la mission qu’ils s’étaient donnée étant accomplie, leur rôle a cessé d’être nécessaire. Comme les maîtres et les chefs de tous les temps et de tous les lieux, ils se croient toujours nécessaires, ils ne jugent jamais arrivé le moment d’abdiquer, d’abandonner le pouvoir auquel leur despotisme, leur vanité et leurs appétits se raccrochent désespérément... Et il faut une nouvelle révolution pour leur faire lâcher prise.
Le programme des partis politiques, qui s’affublent de l’étiquette socialiste ou communiste, consiste à exproprier politiquement et économiquement la classe capitaliste. Chasser la bourgeoisie du gouvernement et s’y installer en son lieu et place : voilà ce qu’ils entendent par l’expropriation politique de la classe capitaliste. S’emparer des richesses de toute nature que cette classe détient et, cette confiscation faite, étatiser la propriété, la déclarer nationale et en confier la gérance à l’État, leur État : voilà ce qu’ils entendent par l’expropriation économique de la bourgeoisie. Voilà leur révolution !
Un tel concept de la révolution conduit, par une pente naturelle, à la notion de la période dite « transitoire » ; et si on admet que, pour réduire au minimum la durée de cette « période transitoire », un gouvernement fort, une autorité intransigeante est indispensable, on est, par une pente non moins naturelle, amené à la notion de dictature.
Seulement, ce concept de la révolution n’est pas le nôtre. Il correspond à l’idée d’une révolution politico-économique, mais pas à l’idée que nous nous faisons, de ce que sera, de ce que devra être, sous peine d’aboutir à un fiasco, la révolution sociale, la nôtre, celle hors de laquelle l’Histoire n’enregistrera désormais aucune révolution véritable.
La fameuse période transitoire n’est autre chose que la période préparatoire.
Les anarchistes ne nient pas l’existence d’une période transitoire ; ils se montreraient dépourvus de tout jugement s’ils pensaient que, inopinément, sans transition, et, pour ainsi parler, du jour au lendemain, le communisme libertaire va effectivement se substituer au capitalisme et à l’État.
En matière de révolution, on prête aux anarchistes – si le proverbe est vrai, faut-il que nous soyons riches pour qu’on nous prête tant de choses ! – je ne sais quelle conception romantique, vieillotte et saugrenue. J’ai rencontré, par centaines, des gens qui, à brûle-pourpoint, m’ont posé cette ébouriffante question :
« Si la révolution éclatait du soir au lendemain, que feriez-vous ? »
Et il fallait voir sur quel air et de quel ton cette « colle » m’était poussée !
Eh bien, je ne réponds pas à une question aussi absurde. Oui, absurde est cette question, quand elle s’adresse à des anarchistes. Ah ! Je conçois qu’on la pose à des socialistes ou à des communistes. Pour eux, il suffit qu’ils s’emparent du pouvoir, qu’ils s’y installent, qu’ils y restent, et la révolution est un fait accompli : il n’y a plus qu’à instaurer la dictature pour défendre et stabiliser le nouvel État.
Mais, le lendemain, il y a, comme par le passé, des gouvernants et des gouvernés, des dictateurs en exercice, et une masse d’esclaves, des en haut et des en bas, des grassement rétribués et des maigrement payés, des fonctionnaires en foule, des bureaucrates en quantité, une multitude de « mouches du coche » qui bourdonnent et s’agitent d’autant plus qu’elles produisent moins ; il y a un État, avec ses lois, ses tribunaux et ses prisons, avec ses juges, ses gendarmes, ses diplomates, ses politiciens et ses soldats. Les bergers qui se repaissent de la chair et s’enrichissent de la laine du prolétariat troupeau ne sont pas les mêmes, c’est exact ; mais le troupeau n’en continue pas moins à être tondu et dévoré. Au fond, rien n’est changé, hormis l’étiquette et la couleur : témoins la Russie où le tsar s’appelle X..., Y... ou Z..., et les ministres commissaires du peuple, où les mouchards et les soldats sont rouges, où les agioteurs font leur beurre, où quelques-uns mangent plus qu’à leur faim, tandis que l’innombrable multitude des ouvriers et des paysans se serre la ceinture. Il n’est pas douteux qu’une révolution (?) de ce calibre peut éclater du soir au lendemain, par un simple coup de force adroitement préparé et heureusement exécuté.
Mais qu’y a-t-il de commun – qu’on nous la dise – entre ce changement d’étiquette ou de couleur et la révolution sociale ? Sur l’étiquette que porte le flacon, je lis bien :
« État ouvrier et paysan ; dictature prolétarienne ; gouvernement des soviets. »
Je vois bien encore que l’étiquette et le flacon sont de couleur rouge ; mais le liquide contenu dans le flacon n’a pas changé et c’est toujours le breuvage empoisonné de servitude, de misère et de mensonge qui en sort.
J’entends bien proclamer avec obstination que, dans ce pays immense, la dictature bolcheviste poursuit l’édification du communisme et l’affranchissement des cent cinquante millions d’ouvriers et de paysans qui peuplent ce gigantesque territoire ; mais je sais que l’abolition du régime patronal et la suppression du salariat, qui sont l’a, b, c de toute mise en pratique du communisme, y sont encore à l’état de perspective et de promesse ; je sais que la prostitution et la mendicité, négation de tout milieu social en voie de réalisation communiste, sont des maux qui n’en ont pas été chassés ; je sais que les places les plus avantageuses, les situations privilégiées et les travaux les plus agréables et les moins pénibles sont accaparés par les membres du parti communiste. Je sais que quiconque s’écarte – si peu que ce soit – de la ligne tracée par la pseudo dictature du prolétariat, est traité en criminel, en pestiféré. (Voir, plus loin, l’article de Voline sur la Révolution russe.) Je sais que les masses paysannes et ouvrières sont, là-bas, astreintes par la trique dictatoriale au travail forcé et condamnées aux privations les plus pénibles. Ce serait ça... la Révolution ?... Ça, l’édification du communisme ?...
Notre révolution à nous bouleversera de fond en comble toute l’actuelle structure politique, économique et morale, et, sur cet effondrement, elle instaurera un milieu social qui assurera à chaque individu le maximum de bien-être et de liberté. Enfoncez-vous bien cette déclaration dans la tête ; pesez-en successivement et sans vous presser chaque terme ; suivez l’enchaînement rigoureux de la pensée exprimée, et vous saisirez tout le programme libertaire.
Voilà quelque quarante ans (1894) que j’ai écrit ces lignes dans mon volume d’essai de philosophie libertaire : La Douleur universelle. « Bien-être et Liberté ! » : telle a été, hier, la devise des anarchistes ; telle est celle des libertaires d’aujourd’hui ; et, on peut hardiment le dire, telle sera celle des anarchistes de demain. Bien-être, par la suppression du capitalisme, et liberté par l’abolition de l’État.
« Bien-être et Liberté » assurés le plus largement possible à chaque individu, voilà le but constant vers lequel ont tendu et tendront, de toute leur volonté, les anarchistes de tous les temps. Une fois ouverte devant chaque individu, c’est-à-dire devant tous les êtres humains sans aucune exception, la voie qui conduit à un bien-être sans cesse accru et à une liberté toujours plus complète, la poussée se produira, la marche en avant suivra son cours aussi rapidement et aussi loin – donc toujours plus loin et sans arrêt – que le progrès indéfini.
Mais il est indispensable que, avant tout, la voie soit ouverte et, pour qu’elle le soit, il faut briser les obstacles qui l’obstruent. Ces obstacles sont, nous le savons, les obstacles de nature politique que rassemble l’État, et les obstacles de nature économique que réunit le capitalisme. Ces deux groupes d’obstacles ne peuvent être écartés que par l’effort victorieux des masses opprimées par l’État et exploitées par le capitalisme. Briser, détruire à jamais ces obstacles, c’est là, au premier chef, l’œuvre révolutionnaire ; mieux : c’est la révolution même.
Un tel résultat – imbécile qui ne le conçoit – présuppose une période préparatoire dont nul ne peut fixer la durée, mais dont il est raisonnable de prévoir qu’elle embrassera un certain temps. Quand, d’une part, le gâchis politique, l’incohérence économique et les débordements scandaleux des classes dirigeantes auront mis le comble à l’indignation populaire ; quand, d’autre part, l’éducation des travailleurs aura porté leur compréhension au point où ils auront conscience et de l’incapacité de la classe bourgeoise et de la capacité de la classe ouvrière ; quand le prolétariat aura renforcé son organisation, multiplié et fortifié ses groupements de combat ; quand, enfin, il se sera entraîné à l’action par une série de luttes : grèves, émeutes, agitations de toute nature, allant, en certains cas, jusqu’à l’insurrection ; alors, il suffira de la goutte d’eau qui fait déborder la coupe pour que la révolution éclate.
La voilà la véritable « période transitoire ». Elle n’est autre que la période préparatoire ; elle commence au moment où l’État et le capitalisme, ayant atteint, dans leur marche évolutive, leur apogée, entrent dans la phase du déclin, s’affaiblissent graduellement, non seulement par le fléchissement auquel est soumis tout mécanisme atteint par l’usure, mais encore par suite du développement progressif des germes de mort qui l’envahissent, tandis que parallèlement, synchroniquement, s’élaborent et se fortifient les formes embryonnaires du nouvel organisme social.
Qui oserait soutenir que, en ce qui concerne le capitalisme et l’État, cette phase du déclin n’est pas d’ores et déjà ouverte ? La crise sans précédent et sans égale que traverse le monde contemporain, crise politique, économique, intellectuelle et morale, crise qui atteint les sources de vie et paralyse les activités les plus nécessaires, crise qui s’étend au monde entier et frappe plus gravement que les autres les pays où le capitalisme est le plus développé et l’État le plus solidement assis ; cette crise ne porte-t-elle pas en elle la révélation d’un monde vieux, quelque peu caduc, déjà, et qui marche à grands pas vers sa fin ? De cette crise elle-même, des traits spéciaux qui la caractérisent, des ravages qu’elle exerce, des misères qu’elle engendre, des contradictions aussi absurdes que criminelles dont elle porte la marque, du renversement de la table des valeurs qu’elle détermine, des paniques qu’elle suscite, des faillites qu’elle entraîne, des ruines qu’elle provoque, de la débâcle générale qui en est la suite, que n’a-t-on pas déjà dit et que ne dira-t-on pas encore ? Les finances des États les plus puissants et justement considérés comme les plus gorgés de richesses sont sur la pente de la banqueroute, le gâchis politique est porté à son comble, les monarchies s’écroulent, les républiques chancellent, le fascisme, triomphant ici et là, promène un peu partout son masque hideux de terrorisme sanguinaire ; le régime bancaire, industriel et commercial est menacé d’effondrement ; des millions et des millions de sans-travail, spectres blêmes et amaigris, errent en bandes affamées ; partout et en tout s’avèrent, odieuses, intolérables, les conséquences d’une situation politique, économique, intellectuelle et morale de jour en jour plus catastrophique. L’humanité est aux bords du gouffre.
Telle est, actuellement, la situation que j’aurais pu, sans tomber dans l’exagération, dramatiser bien davantage ; tel est le stade auquel sont parvenus, en 1933, le capitalisme et l’État. Cette situation ne peut se prolonger bien longtemps et, dans son ensemble, elle pose, en termes sans ambages, un problème qui exige une solution à court terme. La phase dans laquelle nous nous trouvons ne peut être de longue durée. Le problème appelle, de toute urgence, une solution ; cette solution ne peut être raisonnablement et humainement qu’une transformation sociale ; cette transformation ne peut sortir que de la révolution sociale. N’ai-je pas, en conséquence, raison de dire que la période transitoire a commencé, que nous y sommes en plein, que cette période transitoire n’est, en réalité, pas autre chose que la période préparatoire ?
« La période transitoire », c’est, en fait, une habile mais malhonnête invention imaginée par les incorrigibles partisans du principe d’autorité qui ambitionnent, et pour cause, de maintenir ce principe au lendemain d’un mouvement révolutionnaire vainqueur. Placer cette période transitoire, ainsi que nous le faisons et avons raison de le faire, avant la révolution sociale, c’est enlever à ces pseudo révolutionnaires toute chance de confisquer à leur profit cette révolution. L’unique moyen de conserver cette chance consiste, pour ces escamoteurs, à situer la période mensongèrement appelée transitoire après la révolution victorieuse. Il m’a paru nécessaire de démasquer cette manœuvre. Voilà qui est fait.
Notre révolution.
La révolution sociale que les libertaires ont en vue et à la préparation de laquelle ils consacrent le meilleur d’eux-mêmes sera précédée, je l’ai déjà dit, d’une période plus ou moins longue de gestation, et son déclenchement ne se produira que lorsque les conditions suivantes seront réunies. Il faudra, avant tout, qu’un ensemble d’événements et un concours de circonstances créent une situation révolutionnaire. Je ne commettrai pas l’imprudence de prédire en quoi consisteront ce concours de circonstances et cet ensemble d’événements. Il se peut que ce soit un vaste mouvement de grève entraînant rapidement dans son orbite un nombre de plus en plus élevé de corporations et de grévistes et atteignant d’une façon effective les proportions d’une grève générale insurrectionnelle et expropriatrice jetant sur le pavé une multitude de travailleurs. Il se peut que ce soit une menace de mobilisation générale en vue d’une guerre imminente particulièrement impopulaire. Il se peut que ce soit une crise économique provoquant, de couche en couche, un malaise général, une inquiétude profonde et un mécontentement de plus en plus vif. Il se peut que ce soit un régime fiscal par trop manifestement inique, un gros scandale administratif ou judiciaire, une décision parlementaire heurtant violemment le sentiment public, un abus de pouvoir gouvernemental révoltant la conscience populaire. Toutes ces circonstances sont susceptibles d’allumer l’incendie et d’en faire, en un rien de temps, un brasier immense et ardent, pour peu que l’étincelle tombe sur une matière saturée de produits inflammables.
Il faudra, ensuite, que la situation générale soit à ce point grave et inextricable, qu’elle engage si profondément la responsabilité du régime social et qu’elle démontre si clairement l’incapacité des pouvoirs publics à rétablir l’équilibre, à remédier au mal, à conjurer la catastrophe, que le peuple finisse par perdre toute confiance dans ceux qui le gouvernent.
Il faudra, enfin, la situation étant révolutionnaire, qu’il existe, dans les masses populaires, un esprit de révolte et une fermentation révolutionnaire suffisamment prononcés pour qu’une minorité consciente, active, éclairée, et en contact avec ces masses, ait la possibilité de soulever celles-ci, à la façon du levain qui soulève la pâte.
Ajoutons à ces considérations primordiales :
-
une rupture de plus en plus marquée dans l’équilibre politique, économique et moral du régime capitaliste ;
-
une propagande active et persévérante, stimulant l’éducation révolutionnaire des travailleurs ;
-
une organisation solide, puissante, capable de relier, à l’heure fixée par la gravité des circonstances, toutes les forces de révolte constituées par des groupements nombreux et énergiques ;
-
un prolétariat entraîné à l’action décisive par une série de troubles, d’agitations, de grèves, d’émeutes, d’insurrections.
Ces conditions étant réunies, on peut être certain qu’une révolution, éclatant à la faveur d’un de ces événements qui soulèvent, entraînent, passionnent les foules et les précipitent instinctivement, en une ruée tumultueuse, contre le régime qu’elles veulent renverser, ne s’arrêtera pas à mi-chemin. Ce mouvement, dans lequel les anarchistes auront été les premiers à se jeter avec la rapidité, l’élan, la résolution et la vaillance qu’on ne saurait leur contester, et dont ils continueront à être les animateurs, ira jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’à la victoire.
Cette phase plus ou moins longue du drame révolutionnaire en sera le point culminant et décisif. Elle ne prendra fin que lorsque le souffle pur et régénérateur de la révolution libertaire aura emporté toutes les institutions de despotisme, de vol, de déchéance intellectuelle et de pourriture morale qui sont à la base de tout régime social s’inspirant du principe d’autorité.
Cette révolution portera dans ses flancs tous les germes en développement du monde nouveau, qu’elle enfantera dans l’affolement apeuré des privilégiés et dans l’allégresse et l’enthousiasme des déshérités. Les anarchistes veilleront à ce que ce ne soit pas un avortement.
Ils sauront mettre à profit les rudes enseignements que comportent les mouvements révolutionnaires enregistrés par l’histoire. Ils demeureront, aussi longtemps qu’il le faudra, en état de permanente insurrection contre les tentatives de restauration autoritaire : politique, économique ou morale. Ils ne confieront à aucun pouvoir la sauvegarde des conquêtes révolutionnaires. Ils appelleront à la défense de ces conquêtes, contre toute dictature, la foule enfin libérée des esclaves.
Toutefois, demeurant, après la tourmente révolutionnaire comme avant et pendant celle-ci, les ennemis irréductibles du principe d’autorité et de ses néfastes conséquences ; ils se borneront à être les conseillers, les animateurs et les guides de la classe ouvrière. Ils orienteront et soutiendront les premiers pas de cette multitude dans la voie définitivement ouverte de l’organisation libre de la vie sociale.
Je résume et précise brièvement ma pensée sur ce point : en période révolutionnaire, les libertaires auront à détruire, à empêcher et à reconstruire. Ils devront faire tout ce qui dépendra d’eux pour que ces trois tâches soient entreprises, se succèdent, s’enchaînent et soient accomplies dans le laps de temps le plus court. Ils consacreront le plein de leurs efforts :
-
À détruire. Détruire quoi ? — J’aime à espérer que personne ne me fera l’injure de penser que j’entends par là la destruction des immeubles, des machines, des produits de toutes sortes, des chefs-d’œuvre entassés dans les bibliothèques, des trésors artistiques qui ornent les musées, de cette fabuleuse accumulation de richesses dues au labeur opiniâtre des générations passées et présentes. La révolution sur les ruines, alors ? Tandis que notre révolution doit avoir pour résultat de restituer à la communauté humaine le magnifique patrimoine que son travail séculaire a constitué et que les tyrans et les rapaces lui ont volé. Ce serait une folie et un crime de détruire ce patrimoine. Et puis, détruire les immeubles, ce serait priver la population des habitations dont elle aura besoin pour se loger, des lits, des meubles et des ustensiles qui lui seront nécessaires. Détruire les machines, briser ces ouvriers métalliques dont la mission sera, la révolution faite, de supprimer presque totalement l’effort pénible des humains tout en multipliant à l’infini leur capacité de production, ce serait une monstrueuse stupidité. Détruire les produits de toutes espèces entassés dans les magasins et les réserves, alors que les besoins d’alimentation, de vêtement, etc. ne peuvent être satisfaits qu’à l’aide de ces innombrables produits, ce serait une inexplicable idiotie. Non. Toutes ces richesses devront être, au contraire, précieusement conservées ct, dans toute la mesure du possible, soigneusement mises à l’abri de toute destruction.
Mais détruire, et de fond en comble, sans la moindre hésitation ni restriction, toutes les abominables institutions qui, depuis des temps immémoriaux, ont fait le malheur des hommes : Propriété, État, Parlement, Armée, Magistrature, Police, Religion, Morale imposée ; toutes choses qui n’ont pris naissance et n’ont vécu qu’à la faveur du principe d’autorité, fauteur des mensonges, des erreurs, des croyances absurdes, des préjugés des lâchetés, des fourberies, des cruautés, des injustices, des inégalités, des haines qui ont fait de la Terre une planète constamment arrosée de larmes et de sang. Telle est la destruction à opérer.
-
À empêcher. Empêcher quoi ? — Empêcher, par tous les moyens et coûte que coûte, que le principe d’autorité, que la révolution sociale aura pour but d’abattre, puisse se survivre ou renaître sous une forme nouvelle, ou une appellation inédite. Malheur à toute révolution sociale qui, dans cette voie, n’irait pas jusqu’au bout de la route à parcourir ! Elle aura, dans ce cas, travaillé en vain. Aucune des révolutions du passé n’a pleinement atteint le but qu’elle se proposait, parce que (je l’ai déjà dit, mais il y a des vérités qu’on ne répète jamais trop) toutes ne se sont attaquées qu’à une partie du mal qu’il fallait tuer totalement : et, sous des formes nouvelles, insoupçonnées et imprévues, le mal a reparu. Victorieuse, s’étant assoupie à l’ombre de ses lauriers, confiante en sa victoire qu’elle avait cru définitive, la révolution s’est réveillée prisonnière et vaincue : le mal qu’elle croyait avoir tué ne l’avait pas été ; grièvement blessé, il avait pansé ses blessures et il était insensiblement revenu à la vie : arbre, dont la révolution avait coupé les branches et abattu le tronc, mais dont elle avait épargné les racines ; incendie, dont les insurgés avaient éteint les flammes, sans en éteindre complètement le foyer, sans inonder les cendres encore brûlantes ; mal, dont les révolutionnaires avaient combattu les manifestations extérieures sans en extraire le germe intérieur ; hydre de Lerne, dont le peuple-Hercule avait coupé six têtes, mais négligé de couper la septième. Les racines de l’arbre qu’on voulait abattre n’ayant pas été extirpées, l’arbre a repoussé. Le foyer de l’incendie n’ayant pas été complètement éteint, les cendres encore brûlantes n’ayant été ni dispersées, ni noyées sous des torrents d’eau, l’incendie s’est rallumé ; le mal-autorité qui rongeait le corps social n’ayant été combattu que dans ses manifestations externes et visibles, mais le virus du mal n’ayant pas été arraché, le mal a recommencé et produit les mêmes ravages. C’est l’histoire de toutes les révolutions qui ont secoué le monde et dont les résultats ont été annihilés par la suite.
La révolution sociale, quelle que soit l’époque à laquelle elle éclatera, trouvera sur sa route de redoutables adversaires. Ces ennemis seront d’autant plus dangereux qu’ils se mêleront plus ou moins à la bataille (si ce n’est dans la personne de leurs chefs, du moins dans celles des militants). La vigilance des anarchistes ne devra pas se relâcher un seul moment. Si le mouvement révolutionnaire est vaincu, rien à craindre des manœuvres des chefs socialistes ou communistes. Mais si la révolution l’emporte, attention ! L’action des anarchistes, des anarcho-syndicalistes, de tous ceux qui travaillent sincèrement et de tout cœur à la révolution sociale, sera de surveiller jalousement, dans ce cas, les agissements des dits chefs, de dénoncer hardiment leurs manigances, de combattre intrépidement leur manège, de soulever contre leurs artifices la masse des insurgés, afin d’opposer à l’accomplissement de leurs criminels desseins une barrière infranchissable et d’empêcher ainsi toute survivance autoritaire, c’est-à-dire tout gouvernement provisoire, toute résurrection de l’État.
Voilà ce que j’entends par ce terme : « empêcher ».
-
À reconstruire. Ce mot est suffisamment clair et expressif pour que je me dispense de longues explications. Reconstruire, c’est la conséquence et la suite de détruire et empêcher. L’autorité étant détruite, toute restauration du capitalisme et de l’État étant empêchée, il est évident qu’il faudra reconstruire. Et cette reconstruction devra suivre d’aussi près que possible la destruction. L’œuvre positive devra succéder pour ainsi dire sans interruption à l’œuvre négative. Reconstruire immédiatement, ce sera une nécessité parce que la vie collective ne peut, pas plus que la vie individuelle, subir d’interruption prolongée, l’organisme social ayant à toute heure des fonctions à remplir et des besoins à satisfaire au même titre et pour les mêmes raisons que l’organisme individuel.
L’ensemble de ces besoins se résume en un mot : consommer. Mais comme on ne peut consommer que ce qui a été au préalable produit, on ne peut qu’associer ces deux actions pratiquement inséparables : produire et consommer. De savantes théories, d’ingénieux systèmes se sont attachés à préciser de quelle façon, dans quelles conditions et par quels moyens la production librement organisée et obtenue s’équilibrera et même dépassera la somme des besoins à satisfaire. Extrêmement complexe en apparence, ce problème apparaît, en réalité, d’une solution simple et facile, quand on l’examine de près, la révolution ayant totalement métamorphosé l’organisation du travail. Quant à la répartition des produits, le droit de chacun à la vie étant reconnu, respecté et pratiqué, il est plus simple encore et plus aisé de l’organiser et de l’assurer : équitable et fraternelle. La mise en train d’un monde entièrement nouveau et l’établissement de rapports individuels et de relations collectives, en accord avec le principe de liberté donnant naissance à des conditions de vie opposées aux précédentes, provoqueront les tâtonnements, les essais, les échanges de vue qu’on devine. On ne rompt pas avec de vieilles coutumes et on n’en contracte pas de nouvelles sans éprouver quelques inquiétudes et difficultés. Timidité, habitude d’attendre des ordres, crainte de gaffer maladroitement et de faire rire de soi, il y aura à lutter contre bien des choses avant d’en arriver au fonctionnement régulier, méthodique, ordonné, normal d’un agencement social inaccoutumé. (Voir Anarchie, Travail.)
L’important sera de familiariser, aussi promptement que possible, les populations ayant brisé leurs chaînes avec les exigences de l’heure qui passe et les possibilités d’y faire face. Les anarchistes se dépenseront sans compter dans ce but.
Sur ce terrain, la tâche sera rendue relativement facile par les groupements et associations qui existent d’ores et déjà et qui vont se multipliant et s’élargissant de façon continue, en fonction même des besoins qui progressent. S’étendant aujourd’hui même à la plupart des manifestations de la vie en société, ces associations ont, depuis longtemps déjà, dépassé le cercle des besoins matériels ; elles embrassent la presque totalité des besoins intellectuels et moraux que ressent l’homme du XXe siècle. Elles brisent de plus en plus les limites locales, régionales et nationales et s’organisent internationalement.
Le sort de ces associations reste entre les mains de leurs membres ; le pacte sur lequel repose chacune d’elles est établi par les intéressés eux-mêmes. Leur développement se règle sur la libre volonté de leurs adhérents et n’est conditionné que par la nécessité de leur extension. L’étude impartiale et rationnelle de ce vaste mouvement associationniste nous donne un aperçu suffisant du rôle qu’il est appelé à jouer dans un milieu social libertaire qui, dès les premiers jours de son avènement, saura utiliser, pour la bonne marche de la société nouvelle, les associations existantes, telles que : les syndicats de producteurs, les coopératives de consommateurs, les sociétés nationales et internationales d’enseignement, d’hygiène, d’urbanisme, d’études scientifiques, de travaux artistiques, de tourisme, de sport, de musique, de gymnastique, etc.
Débarrassées des servitudes qui leur sont actuellement imposées par les difficultés financières, juridiques et nationales, ces associations seront tout naturellement indiquées pour jeter les bases d’une entente facile et d’une organisation pratique correspondant à la satisfaction de tous les besoins de l’individu et de la collectivité. Dans Mon Communisme (Le bonheur universel), j’ai minutieusement décrit comment je conçois, pratiquement, la reconstruction sociale dont je parle ici. J’engage le lecteur que ce problème intéresse à consulter ce volume de 400 pages uniquement consacré à cet exposé.
Conclusion.
Toute frémissante encore de la bataille à peine terminée et couronnée par la victoire, la foule ne marchandera pas sa confiance aux vaillants compagnons qui, par la hardiesse de leurs initiatives, par l’intrépidité de leur action et l’exemple de leur désintéressement, auront été les meilleurs ouvriers de cette victoire. Sachant clairement ce qu’ils veulent à tout prix, et, mieux encore, ce qu’ils ne veulent à aucun prix, les anarchistes mettront à profit cette confiance dont ils se seront montrés dignes, pour opposer à toute tentative de domination politique ou d’exploitation économique un front de bataille solide, invincible. Leur tâche ne s’arrêtera pas là. Elle consistera encore à éviter les déviations et les fausses manœuvres ; elle s’appliquera surtout à rendre immédiatement tangibles les avantages qu’une véritable révolution doit mettre à la disposition de tous.
Les anarchistes s’emploieront avec ardeur à inspirer et à seconder vigoureusement les efforts des masses travailleuses cherchant en elles-mêmes et trouvant dans leur puissance créatrice, dans leurs aptitudes naturelles alliées à leur expérience, les formes supérieures de la production fraternelle et de la répartition équitable des richesses dont le travail est la source unique. La vigilance des compagnons ne se relâchera que lorsque toutes les institutions de brigandage et d’oppression auront été totalement anéanties ; elle ne se ralentira que lorsque l’amour et la pratique de la vie libre auront si fortement saturé l’homme nouveau que tout retour offensif des conspirations autoritaires sera frappé d’impuissance.
Quand les masses ouvrières et paysannes auront pris en main leurs propres destinées, quand, en possession de leur auto-direction, elles auront acquis la maîtrise de leurs mouvements, de leurs pensées et de leurs sentiments, elles ne tarderont pas à placer en elles-mêmes cette confiance que, de tout temps, les chefs se sont évertués à leur enlever, dans le but d’exploiter à leur profit la croyance des foules abusées en la nécessité des providences et des sauveurs.
Alors, grâce à l’entente libre, grâce à l’accord fraternel que les maîtres ne pourront plus troubler, grâce enfin à l’esprit de solidarité qui surgira naturellement de la disparition des classes et de la réconciliation des intérêts individuels, s’édifiera une structure sociale toujours plus belle, plus spacieuse, plus aérée et plus lumineuse, où chacun s’installera selon ses convenances et dans laquelle tous les humains goûteront les charmes de la paix, la douceur du bien-être, les joies de la culture et les incomparables bienfaits de la liberté.
— Sébastien FAURE.
LES GRANDES SECOUSSES RÉVOLUTIONNAIRES, DE L’ANTIQUITÉ À LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
L’organisme humain est sujet à de continuelles modifications. S’il en est de lentes, il en est aussi dont l’apparente brusquerie déconcerte ; parfois, même, l’énergique et sanglante intervention du chirurgien s’avère indispensable. À l’époque de la puberté, jouvenceaux et pucelles peuvent se transformer profondément en quelques mois ; peu de jours, parfois, seront indispensables pour que la chrysalide se mue en insecte parfait. C’est dans une crise douloureuse et subite que la femme, arrivée au terme de sa grossesse, donne le jour à l’enfant contenu dans son sein ; et des opérations atroces s’imposent en certains cas. Lorsqu’un corps étranger a pénétré dans l’organisme brusquement, ou qu’un tissu parasitaire s’est développé avec lenteur, l’ultime espoir du malade réside assez souvent dans le froid bistouri du chirurgien.
Au regard impartial de l’historien soucieux de vérité seulement, il appert aussi qu’ à côté des transformations sociales progressives, il y eut toujours place pour d’utiles et brusques révolutions. Certes, la douceur serait préférable, mais laisse-t-on mourir un patient pour qu’il n’ait pas à subir les souffrances transitoires de l’opération qui le sauvera ? Plus tard, l’humanité devenue raisonnable évitera les soubresauts sanglants, rendus inévitables par la mauvaise foi des dirigeants ; le rythme des modifications sociales obéira à celui des exigences de la nature et des besoins de notre espèce. Tant que des privilégiés s’opposeront aux légitimes réclamations des individus plus évolués, tant que des serfs existeront dans l’ordre moral, économique, intellectuel, de féroces et subites révoltes viendront prouver que l’équilibre désirable n’est pas réalisé. La violence appelle la violence ; les révolutions sont les contreparties fatales de l’oppression légalement organisée. Dans l’ordre social, elles semblent l’équivalent des mutations brusques, observées par les biologistes chez les plantes et les animaux ; elles n’auraient rien de cruel si les pouvoirs établis n’entravaient pas leur libre développement. Certaines révolutions furent pacifiques, d’autres firent couler des flots de sang, parce que les chefs voulaient maintenir à tout prix des institutions périmées.
De même que les espèces végétales et animales paraissent quelquefois prises d’un besoin de mutation, de même les collectivités humaines passent par des périodes favorables à l’éclosion de tendances révolutionnaires. La présence de facteurs nouveaux, d’ordre intellectuel et moral aussi bien qu’économique, en est la cause essentielle. Sous la pression de besoins divers, et parce que le savoir a progressé, les esprits se sentent à l’étroit dans les croyances et les institutions que le passé leur légua. D’où une inquiétude génératrice de troubles et un désir de changement propice aux grandes transformations. L’influence d’une personnalité puissante, celle d’un groupe agissant et habile s’avèrent, en certains cas, d’importance primordiale. Une véritable science des révolutions, base d’une technique utilitaire et pratique, me semble possible. Grâce à une étude minutieuse de la Révolution française, Mathiez était parvenu à dégager quelques-unes des lois qui président à la naissance et au développement des mouvements révolutionnaires. C’est pour ce motif que j’aimais sa conversation. Par malheur, il s’est trop arrêté à des querelles d’intérêt médiocre concernant Robespierre et Danton ; il aurait fallu de plus qu’il étendit ses investigations à des secousses sociales d’un type différent. Dans l’étude des grandes convulsions enregistrées par l’histoire, Lénine avait puisé une science qui, pratiquement, lui fut très utile. Bien du sang serait épargné, des efforts méritoires ne seraient plus dépensés en pure perte, si les règles de la technique révolutionnaire étaient non moins soigneusement établies que celles qui permettent au chirurgien d’extraire un projectile, à la sage-femme de faciliter un accouchement. Ajoutons que l’apparente brusquerie de certaines révolutions fait trop souvent oublier le long travail préparatoire dont elles furent la résultante. Rien sans cause, pas plus dans l’ordre social que dans le domaine physique ou biologique. Un travail silencieux et préalable est requis avant qu’une mutation intellectuelle, morale ou économique s’impose ouvertement. Le rôle brillant revient aux acteurs qui paradent sur les scènes révolutionnaires ; le rôle efficace est fréquemment tenu par des individualités obscures, dont l’importance n’est devinée que beaucoup plus tard.
Quand elle se borne à changer l’équipe gouvernementale, une révolution n’est qu’une opérette insignifiante, si sanguinaire qu’elle puisse être. Que Pierre remplace Paul au pouvoir, c’est chose d’importance transitoire et médiocre ; seuls comptent les changements apportés aux institutions sociales, les transformations survenues dans la mentalité des individus. Les nombreuses révoltes prétoriennes, que connut l’Empire romain, permirent à des intrigants d’obtenir la suprême puissance ; elles ne furent pas un facteur de progrès pour l’espèce humaine. Au XIXe siècle, abondent également les insurrections qui n’aboutirent qu’à remplacer l’ancien maître par un maître nouveau, aussi détestable que celui qu’il supplanta. Hélas ! Beaucoup sont morts pour le profit d’un ambitieux ou d’une coterie qui croyaient mourir pour le triomphe d’une idée. Toujours, les aristocrates furent habiles dans l’art de détourner les révolutions du but primitivement poursuivi. Mais nous estimons, pour notre part, que des mouvements qui n’aboutirent qu’à satisfaire une poignée d’aigrefins ne méritent pas d’être appelés révolutions. Par contre, nous jugeons profondément révolutionnaires des mouvements qui n’eurent jamais recours à la violence. À l’inverse de ce que pensait Karl Marx, nous remarquons, par ailleurs, que les principales secousses qui bouleversèrent l’humanité ne furent pas toutes d’ordre économique ; plusieurs, et d’une importance essentielle, furent d’ordre exclusivement moral ou intellectuel. Pour l’émancipation humaine, la découverte de l’imprimerie eut des répercussions plus considérables que l’établissement d’un régime presque socialiste en Nouvelle-Zélande. Même aujourd’hui, le problème économique ne se pose avec une telle acuité, dans les pays d’Occident, qu’en raison des inventions multiples dues aux savants contemporains. Le progrès intellectuel est, en définitive, le facteur primordial de toutes les grandes révolutions. C’est parce qu’elles ignorent ce progrès que les espèces animales ne connaissent rien de comparable à nos bouleversements sociaux. Il faut des cerveaux qui raisonnent et conçoivent des améliorations possibles, pour que soit modifié le régime économique existant.
Si la colère des peuples éclate, parfois, avec une brusquerie qui déconcerte l’observateur superficiel, d’autres ébranlements exigent de longues années avant que se révèlent la profondeur et l’étendue de leurs effets. Toutes les révolutions ne sont pas aussi brèves que celle de 1789 en France ou celle de 1917 en Russie. Quelques-unes ont comporté de nombreux actes successifs, qui s’échelonnèrent durant plusieurs dizaines d’années. À des secousses religieuses, intellectuelles, morales, telles que le bouddhisme, le christianisme, la Renaissance, il a même fallu des siècles pour se développer pleinement. Elles comptent néanmoins parmi les plus notables que l’histoire ait enregistrées. Loin d’être calquées sur un modèle invariable et indéfiniment répété, les révolutions présentent donc des physionomies assez différentes pour qu’on hésite à les classer sous une rubrique commune. Toujours, cependant, elles supposent l’existence d’un déséquilibre ; et elles ne réussissent que dans la mesure où elles y remédient. S’il en est dont la faillite fut complète, si beaucoup n’ont réalisé qu’une minime partie du programme prévu par les animateurs, l’humanité leur doit, dans l’ensemble, les meilleures transformations sociales obtenues par les collectivités. Maintes fois, elles furent le début d’étapes glorieuses sur la route du progrès. Mais aucune n’a pu faire œuvre définitive, parce qu’elles n’apportaient que des vérités fragmentaires, parce qu’elles ne visaient qu’à un affranchissement partiel, non à la libération totale des corps et des cerveaux.
Quand nulle chaîne ne tiendra plus l’homme captif, ce jour-là seulement l’esprit de révolte aura disparu. Sachons rendre justice, néanmoins, à tous ceux qui luttèrent pour le bien de notre espèce. Ils furent souvent trahis par leurs disciples et leurs héritiers ; en leur nom, des continuateurs infidèles imposèrent de nouveaux liens aux peuples odieusement trompés ; des institutions qu’ils voulaient douces aux humbles se figèrent en instruments d’oppression. D’autres révolutionnaires eurent à démolir lois et dogmes qui se recommandaient de ces anciens révoltés. Une vue d’ensemble sur les principales secousses religieuses, morales, intellectuelles, politiques, économiques qui ébranlèrent l’humanité, depuis l’Antiquité jusqu’à la Révolution française, va d’ailleurs nous permettre de vérifier l’exactitude des diverses remarques que nous venons de faire.
De prodigieux soubresauts furent probablement ressentis à l’époque préhistorique, lorsque se répandit l’usage du feu, des premiers instruments en bois et, plus tard, des outils en pierre et en os. L’utilisation du bronze, puis du fer, l’invention des arts et de l’écriture, certaines découvertes qui modifiaient profondément le genre de vie traditionnel occasionnèrent, sans aucun doute, des bouleversements, parfois assez brusques, dans le régime individuel et l’organisation collective, alors habituellement adoptés. Mais, sur ces événements, nous sommes réduits à des hypothèses, la Préhistoire n’apportant que des lumières encore restreintes dans ce domaine spécialement obscur. Même concernant les débuts de l’époque historique, nous possédons trop peu de documents authentiques pour parler des révolutions qui furent un ferment de progrès. En règle générale, l’humanité s’enfonce alors dans un servage de plus en plus complet ; les rois sont des dieux que l’on croit sur parole, auxquels on obéit aveuglément ; et les travailleurs se résignent à devenir les bêtes de somme de quelques privilégiés. Ligoté par des chaînes religieuses, morales, économiques, familiales dont le nombre et le poids s’accroissent constamment, l’individu n’est plus qu’une chose sans droits aux mains d’un maître absolu. Loin de s’élever vers de radieux horizons, notre espèce descend vers le tréfonds de l’enfer social. Notons cependant que l’évolution humaine ne suivit point partout une marche uniforme, et que la liberté se maintint, à des degrés divers, en certaines contrées. Progrès et décadence purent aussi coexister dans des domaines différents ; le perfectionnement de l’outillage, par exemple, s’accommoda quelquefois sans peine d’une régression morale et sociale.
L’Inde, si riche en ouvrages religieux et philosophiques, manque presque complètement d’annales historiques. La Chine en possède et la tradition historique tient une place honorable dans sa littérature ; on peut en dire autant du Japon. Légendes et fables y occupent toutefois une place trop considérable, dès qu’il s’agit d’époques reculées. Grâce aux découvertes des archéologues, nous avons maintenant des données authentiques sur l’ancienne Égypte, ainsi que sur les civilisations assyrienne et babylonienne. Dans l’histoire de ces peuples, nous trouvons de fréquentes conquêtes, de nombreux changements dynastiques, des révoltes inspirées par l’intérêt personnel ou collectif, mais point de révolution, au sens élevé du mot. Certains rois, tels que Hammourabi, qui gouvernait la Babylonie vers 2100 avant notre ère, et le pharaon Aménophis IV (1380–1360), s’efforcèrent de faire triompher des idées morales ou religieuses qui constituaient un progrès sur les idées antérieures. Pas plus que Zoroastre, le législateur religieux de l’Iran, ou les philosophes chinois Lao Tsé et Confucius, ce ne furent des révolutionnaires.
Le bouddhisme, au contraire, fut, par rapport au brahmanisme, ce que la Réforme protestante devait être, plus tard, par rapport au catholicisme. En rejetant la tyrannie des prêtres et le régime des castes, Gautama, son fondateur, se posa en adversaire des autorités religieuses. Il croyait à la transmigration des âmes, mais ne parla jamais de dieu ; sa morale, toute de douceur, annonce celle de l’Évangile. Né au Ve siècle avant Jésus-Christ, le bouddhisme fut persécuté dans l’Inde, son pays d’origine ; il obtint par contre un prodigieux succès au Tibet, en Chine, au Japon, en Indochine, etc. Oublieux de la vraie doctrine de Gautama, il a versé depuis dans une monstrueuse idolâtrie et les pires superstitions.
Chez les Hébreux, la prédication des prophètes prit fréquemment un aspect révolutionnaire. Hostiles au formalisme et à l’hypocrisie, favorables aux pauvres, préoccupés de pureté morale, ces réformateurs furent suspects aux puissants de l’époque. Sur l’identité véritable des prophètes hébreux, sur l’authenticité des ouvrages qu’on leur attribue, l’on peut discuter ; dans ce domaine, bien des faussaires ont donné libre cours à leurs fantaisies. Quelle que soit la personnalité des auteurs, certains livres prophétiques font présager l’esprit moderne et témoignent d’une hostilité violente à l’égard des traditions établies.
En Grèce, plusieurs révolutions athéniennes furent inspirées par le goût de la liberté. À partir de 750 avant notre ère, il n’y eut plus de roi ; le pouvoir passa complètement aux mains de neuf magistrats, les archontes, et d’un tribunal suprême, l’Aréopage. Mais le peuple fut durement traité par ces nouveaux maîtres, recrutés uniquement dans l’aristocratie. En 624, paysans et ouvriers obtinrent que les jugements seraient fixés d’après des règles écrites et non d’après des coutumes imprécises et variables. Et, comme les lois rédigées par l’archonte Dracon étaient d’une dureté excessive, les troubles continuèrent jusqu’à la rédaction de lois moins inhumaines par Solon, en 594. Pour les fonctions gouvernementales, on accorda la préférence aux citoyens riches.
Dès 590, Pisistrate s’empara de la totalité du pouvoir ; il resta tyran, c’est-à-dire maître absolu, jusqu’à sa mort, survenue en 527. Mais ses deux fils, Hipparque et Hippias, ne purent se maintenir. Le premier fut tué par deux jeunes gens, Harmodios et Aristogiton, qui sacrifièrent leur vie pour l’amour de la liberté ; le second, chassé d’Athènes en 510, se réfugia à la cour du roi des Perses. Clisthène, le plus ardent adversaire d’Hippias, réorganisa le gouvernement dans un sens favorable au peuple.
Une nouvelle révolution éclatera en 403, à Athènes.
Profitant des malheurs endurés par la ville durant la guerre du Péloponnèse, les nobles étaient parvenus à renverser le gouvernement démocratique. Par centaines, ils avaient exilé ou condamné à mort leurs adversaires politiques. Trente tyrans firent peser un joug de fer sur tous les citoyens. Leur règne fut rapidement si odieux que Thrasybule, revenu en Attique à la tête d’une troupe d’exilés, n’eut aucun mal à les renverser. Quelques années plus tard, en 399, la démocratie athénienne se déshonorera, d’ailleurs, en condamnant Socrate à boire la ciguë.
Toutefois, c’est moins à cause de ses révolutions politiques, qu’en raison des transformations dont elle fut le théâtre dans le domaine des idées, que la Grèce antique tient une si grande place dans l’histoire de la civilisation. Non seulement tous les arts y furent cultivés avec un succès exceptionnel, non seulement ses poètes et ses prosateurs ont laissé de merveilleux chefs-d’œuvre, mais c’est là que naquit et se développa la pensée rationaliste, indépendante des dogmes religieux, d’où sortiront la science et la philosophie modernes. Certes, les plus fameux de ses philosophes s’attardèrent trop dans les chimères métaphysiques ; c’est eux, pourtant, qui montrèrent la route que prendront, par la suite, les chercheurs libres et les savants rationalistes.
À Rome, signalons la révolution de 509 avant Jésus-Christ, qui eut pour conséquence l’abolition de la royauté. Tarquin le Superbe, soupçonneux et cruel, se comportait comme les tyrans grecs. Lucius Junius Brutus, profitant de l’indignation causée par le tragique suicide de Lucrèce, souleva les Romains contre lui et fit proclamer sa déchéance. Pendant quatorze ans, Tarquin s’efforcera ensuite, mais vainement, de reprendre son ancienne capitale. Sa chute ne fut pas une victoire plébéienne, mais une victoire de l’aristocratie sénatoriale et des patriciens. En conséquence, ces derniers modifièrent la constitution en leur faveur, et la misère du peuple fut extrême au début de la république.
Une lutte, qui se poursuivit, avec de longues trêves, pendant deux cents ans, s’engagea entre la plèbe et le patriciat. Parmi les épisodes révolutionnaires, il convient de signaler la retraite sur l’Aventin. Les plébéiens désertèrent Rome en masse et, s’étant réunis autour de sanctuaires non patriciens, décidèrent de fonder une ville nouvelle. Effrayé, le Sénat admit quelques-unes des réclamations formulées par le peuple. Mais c’est plus tard, seulement, vers le milieu du Ve siècle avant notre ère, que fut réalisée l’égalité civile. Chargés de rédiger des lois écrites en 451, les Décemvirs exercèrent une tyrannie si odieuse qu’une révolte les chassa en 449 ; toutefois, les lois édictées par eux subsistèrent. Une série de mesures prises de 445 à 300 réalisèrent l’égalité politique. Par contre, l’inégalité sociale ira s’aggravant ; de plus en plus, les pauvres dépendront des riches, redevenus ainsi tout-puissants.
En 133 avant Jésus-Christ, Tibérius Gracchus, homme au grand cœur et au noble idéal, fit voter, en qualité de tribun du peuple, une loi agraire, qui attribuait aux citoyens pauvres le domaine public accaparé par les patriciens. Pour se venger, le Sénat le fit massacrer, sous prétexte qu’il aspirait à la royauté. Dix ans plus tard, en 123, le frère de Tibérius, Caïus Gracchus, devint tribun du peuple. Lui aussi fut animé de sentiments révolutionnaires. Il voulait amoindrir la puissance des nobles au profit de la plèbe, remettre en honneur la loi de Tibérius et accorder le droit de cité à tous les Italiens. Hélas ! Les patriciens parvinrent à ruiner sa popularité : abandonné par la plèbe, poursuivi par ses adversaires, Caïus se donna la mort en 121. Bientôt, d’ailleurs, les orgueilleux citoyens de Rome accepteront d’obéir à un maître absolu. Des rivalités et des insurrections militaires se succéderont pendant tous les siècles suivants ; elles sont dépourvues d’intérêt pour nous, n’ayant d’autres raisons d’être que des inimitiés ou des ambitions personnelles. C’est en vain que Marcus Junius Brutus avait poignardé César et combattu pour le maintien de la liberté.
Le sort des esclaves étant toujours resté déplorable à Rome, des révoltes serviles éclatèrent à différentes reprises. En 135 avant notre ère, il y eut des soulèvements en Sicile, en Attique, en Campanie, à Rome. De 104 à 99, nouveaux soulèvements en Sicile, à Thurium, à Capoue. Mais la plus importante des révoltes serviles fut celle que Spartacus dirigea de 73 à 71. Ce noble Thrace, condamné à l’esclavage et destiné au métier de gladiateur, s’échappa de Capoue avec quelques compagnons, puis constitua une véritable armée. Énergique et prudent, il battit le prêteur Varinius, puis les consuls Lentulus et Gellius, mais, finalement refoulé par Crassus vers le Midi, il essaya sans succès de passer en Sicile. Il périt dans une suprême bataille, sur les bords du Silarus. Pompée détruisit les dernières bandes d’esclaves qui fuyaient vers le Nord. Une fois encore, l’injustice avait triomphé.
L’introduction de l’hellénisme à Rome fut, par contre, riche de conséquences heureuses pour la pensée humaine. Parce qu’elle fit affluer en Italie les esprits façonnés par la civilisation hellénique, la conquête de la Grèce porta un coup sensible aux antiques traditions romaines. De plus en plus, la philosophie remplaça la religion dans les milieux instruits. Le grand poète Lucrèce vulgarisa la doctrine d’Épicure dans son admirable De Natura ; le système d’Evhémère, qui ne voyait dans les personnages mythologiques que des hommes divinisés, obtint un énorme succès. Une véritable rénovation des arts et de la littérature résultera de ce contact intime avec la Grèce. Et c’est vainement que Caton l’Ancien voudra s’opposer à l’influence hellénique, au nom des vieilles coutumes et de l’intérêt national.
Une formidable secousse fut, certes, donnée au monde par l’apparition du christianisme, mais elle n’eut rien de brusque, ni de violent. Pour atteindre son développement normal, elle exigea trois siècles, au moins, et ne triompha, d’une façon durable, qu’en 313, avec Constantin. Au point de vue moral, le christianisme fut peu original ; les plus belles maximes attribuées à Jésus avaient déjà été émises par des philosophes antérieurs. Toutefois, les chrétiens eurent le mérite de populariser, chez les nations méditerranéennes, des sentiments et des idées jusque-là réservés à une élite restreinte. Au point de vue intellectuel, leur influence fut extrêmement néfaste ; hostiles à la science, à la philosophie, à toutes les libres recherches de la pensée rationaliste, ils replongèrent l’Occident, pour de longs siècles, dans les ténèbres de la foi religieuse. Grâce à la duplicité des dirigeants ecclésiastiques, l’Église, prétendue gardienne de la doctrine évangélique, devait s’allier, dès le quatrième siècle, aux pouvoirs civils pour maintenir les masses dans une obéissance aveugle. C’est à tort que la disparition de l’esclavage est mise à l’actif du christianisme. Persuadés que le régime économique en vigueur à leur époque ne pouvait être modifié, les pères de l’Église, à l’exemple de saint Paul, se bornèrent à prêcher la résignation à la classe servile.
Les dogmes chrétiens étaient si absurdes que des discussions s’élevèrent de bonne heure à leur sujet ; des personnages aussi fameux qu’Origène et que Tertullien s’éloignèrent finalement de l’orthodoxie. Les hérésies furent prodigieusement nombreuses durant les premiers siècles ; il serait fastidieux d’en donner la liste. Rappelons néanmoins que la plus célèbre de toutes, l’arianisme, faillit vaincre le catholicisme. Non seulement elle obtint la protection de certains empereurs, mais le pape Libère finit par condamner Athanase, le principal adversaire d’Arius, et par adopter des formules qui s’inspiraient des doctrines soutenues par cet hérétique. Grâce à Théodose, adversaire acharné de l’arianisme, l’orthodoxie vit son prestige renaître dans l’empire romain. Quant au schisme qui sépara l’Église orientale du catholicisme, il n’eut point pour motif des querelles dogmatiques mais les prétentions outrecuidantes des papes. Dès le IXe siècle, Photius s’insurgeait contre les procédés de l’évêque de Rome. Cette séparation, rendue complète au XIe siècle, n’a d’ailleurs contribué en aucune façon au progrès de l’esprit humain.
Au VIIe siècle, le mouvement religieux suscité par Mahomet en Arabie se répandit rapidement en Égypte et dans le nord de l’Afrique, en Syrie, en Perse et même dans des pays aussi éloignés que l’Espagne. Cet ébranlement compte parmi les plus importants que l’histoire ait enregistrés. Mais bien que postérieur en date au christianisme, l’islamisme ne lui est pas supérieur au point de vue soit intellectuel, soit moral. À Bagdad et en Espagne, la civilisation musulmane fut florissante ; les accusations portées par les Occidentaux contre les disciples de Mahomet ne résistent pas, dans maints cas, à une étude impartiale. Néanmoins, le Coran parle de la guerre dans des termes qui nous répugnent profondément ; il y voit le moyen de sanctification par excellence, celui qui ouvre le ciel au croyant de la façon la plus sûre. Le sort de la femme en pays musulman ne fait pas davantage honneur à la religion du prophète arabe.
Au Moyen Âge, la dure condition faite au peuple provoqua diverses tentatives d’affranchissement ; par exemple, celle des croquants de Normandie, en 997, et celle des serfs bretons en 1024. Écrasées brutalement dans les campagnes, elles devaient réussir dans bien des villes, surtout au XIIe siècle. Les habitants des centres urbains comprirent qu’en associant leurs efforts ils résisteraient mieux à la tyrannie seigneuriale. D’où le mouvement communal, qui revêtit des formes très différentes, selon les époques et les régions. C’est au prix de combats sanglants que certaines villes secouèrent le joug féodal ; d’autres obtinrent la liberté sans recourir à l’insurrection. Malheureusement, l’accroissement de la puissance royale ruinera, par la suite, l’œuvre d’affranchissement communal, qui ne fut point favorisé par les souverains, comme des historiens mal renseignés l’ont prétendu.
La lutte du sacerdoce et de l’empire, qui du XIe au XIIIe siècle, mit aux prises les papes et les empereurs, prouve que la domination ecclésiastique ne s’étendit pas sans résistance dans les pays germaniques. En premier lieu, la querelle des investitures dressa Henri IV contre Grégoire VII ; vaincu, l’empereur dut subir l’humiliation de Canossa, en 1077. Un siècle après, Frédéric Barberousse fut tenu en échec par Alexandre III. Avec Innocent III (1198–1216), la papauté arrive à son apogée. De 1227 à 1250, nouvelle lutte entre l’empereur Frédéric II et le pape. En apparence, le pontife romain fut vainqueur ; en réalité, il avait usé ses forces dans une lutte sans profit. Dès le début du XIVe siècle, il sera obligé, par l’indiscipline de ses vassaux, de se fixer à Avignon.
Après le grand schisme, qui donna au monde chrétien le spectacle de deux et même trois papes s’excommuniant mutuellement, l’esprit d’indépendance reparut dans l’Église. Dès 1336, Wiclef, en Angleterre, dénonça la corruption des papes et du clergé. Appliquant leurs maximes religieuses à l’ordre social, plusieurs de ses disciples réclameront même l’égalité absolue de tous les hommes. En Bohême, Jean Hus (1369–1415) préconisa un ensemble de réformes qui le font considérer, à bon droit, comme un précurseur du protestantisme. Emprisonné, puis condamné à être brûlé vif, par le concile de Constance, il sut mourir en héros. Ses partisans prirent les armes ; la guerre se prolongea jusqu’en 1436, et le concile de Bâle dut se montrer conciliant pour ramener au catholicisme la majorité des hussites.
L’invention de l’imprimerie, dans la première moitié du XVe siècle, les découvertes géographiques effectuées dans la seconde moitié du même siècle ne furent point des événements d’apparence révolutionnaire. Pourtant, ils sont à l’origine de nombreuses transformations sociales, survenues par la suite. Leurs conséquences intellectuelles, morales, économiques, furent incalculables ; toutes n’ont pas été heureuses, d’ailleurs, la presse étant domestiquée par les chefs trop souvent, et les richesses de l’Amérique servant surtout à alimenter le luxe de quelques potentats.
La renaissance littéraire, scientifique, artistique et philosophique, survenue aux XVe et XVIe siècles, fut une salutaire réaction contre l’obscurantisme théologique. Elle remit en honneur les méthodes rationalistes chères à l’Antiquité, s’insurgea contre le pessimisme morose des écrivains et des artistes fidèles à la pensée catholique, se détourna d’un au-delà chimérique pour considérer avec sympathie les réalités d’ici-bas. Princes et prélats ne comprirent pas, au début, qu’elle contenait un ferment révolutionnaire ; pour acquérir le renom de mécènes, ils protégèrent artistes et poètes. Depuis, les défenseurs du trône et de l’autel ont maudit, bien des fois, l’esprit d’indépendance issu de ce retour à l’Antiquité grecque et romaine. La Renaissance eut ses martyrs parmi les philosophes et les savants : un Vanini, un Giordano Bruno furent brûlés ; Galilée fut condamné à la prison.
Luther, Calvin, Zwingle et les autres promoteurs de la Réforme protestante furent suivis par une notable partie de l’Europe, dans leur révolte contre le catholicisme. C est en 1520 que Luther rompit définitivement avec Rome ; quand il mourut, en 1546, sa réforme était solidement établie, non seulement en Allemagne, mais en Suède, au Danemark, en Norvège. De Genève, Calvin (1509–1564) exerça une prodigieuse action sur toute l’Europe. En outre, Henri VIII d’Angleterre, sans adopter soit le luthérianisme, soit le calvinisme, rompit avec la papauté. Le principe du libre examen, qui est à la hase du protestantisme, ainsi que la rébellion contre la puissance ecclésiastique, devait aboutir à des conséquences dont on ne comprit l’importance que beaucoup plus tard. Avec la Réforme, l’esprit critique et le besoin d’indépendance triomphent dans le domaine religieux.
Philippe II, qui s’était fait le champion de la cause catholique dans toute l’Europe, ne put arrêter les progrès du protestantisme dans ses provinces des Pays-Bas. Exaspérés par le despotisme politique et religieux que le roi d’Espagne faisait peser sur eux, les habitants de cette contrée se soulevèrent en 1566, sous la direction de Guillaume d’Orange, dit le Taciturne. Malgré la répression sanguinaire exercée par le duc d’Albe, malgré la défection des provinces du Sud, qui, en 1579, se soumirent à leur ancien souverain, malgré l’assassinat de Guillaume d’Orange, en 1584, la Hollande et les autres puissances du Nord continuèrent la lutte et formèrent l’État indépendant des Provinces unies. Cette république protestante, le premier pays d’Europe où la liberté (encore limitée, il est vrai) de penser et d’écrire fut laissée aux habitants, connut au siècle suivant une merveilleuse prospérité économique et une gloire intellectuelle de premier ordre.
En 1640, une révolution, provoquée par la tyrannie de Charles Ier Stuart, éclata en Angleterre. La lutte fut d’abord dirigée par le Parlement, puis le principal rôle passa à Cromwell, un chef militaire énergique et habile. Charles 1er fut condamné à la peine de mort et exécuté, le 9 février 1649 ; la république fut proclamée. Mais Cromwell substitua son despotisme à celui du roi ; en 1651, il se fit décerner le titre de Lord Protecteur et gouverna par la suite en dictateur. Faite au nom de la liberté, cette première révolution avait surtout profité à un chef ambitieux. Une seconde révolution éclata en 1688. Chassé par ses sujets, Jacques II chercha un refuge en France ; Guillaume d’Orange et sa femme furent proclamés roi et reine, après avoir promis de respecter les droits du peuple anglais, tels que le Parlement les avait définis. Cette insurrection nouvelle fit prévaloir en Angleterre le régime constitutionnel et la religion protestante. Au XVIIIe siècle, le parlementarisme s’installera en maître sous la dynastie hanovrienne, par la seule force de l’habitude.
Le développement de la philosophie et de la science modernes, aux XVIIe et XVIIIe, doit être signalé. Avec Descartes, Bacon, Spinoza, la raison s’insurge contre la tradition des écoles et la philosophie léguée par le Moyen Âge ; l’évidence remplace l’autorité d’Aristote comme critérium de la vérité ; la théologie n’est plus l’oracle toujours écouté qui décide en dernier ressort. Newton, Huygens donnent une nouvelle impulsion à la physique ; Denis Papin découvre le principe de la machine à vapeur, à la fin du XVIIe siècle ; Lavoisier, au XVIIIe, mérite le nom de créateur de la chimie moderne. On pourrait citer bien d’autres savants fameux. Ce goût pour la philosophie rationaliste et les recherches expérimentales annonce l’époque contemporaine ; il explique l’œuvre de Voltaire et des Encyclopédistes.
Nous laissons à d’autres le soin de parler de la Révolution française de 1789 et des révolutions survenues depuis. Mais rappelons, en terminant, que le soulèvement des colonies anglaises d’Amérique put dans une certaine mesure servir de modèle à la révolution qui éclata chez nous. En 1776, les États-Unis proclamèrent leur indépendance ; ils soutenaient alors contre leur métropole une guerre qui devait se prolonger jusqu’en 1783. La constitution qui, aujourd’hui encore, régit cette nation, entra en vigueur le 4 mars 1789.
Nous ne pouvions étudier en détail chacune des grandes secousses que nous avons signalées. Pourtant, de l’examen rapide que nous en avons fait, il ressort clairement que les révolutions humaines ne se produisent pas selon un type uniforme et qu’elles ne sont pas nécessairement sanglantes, mais qu’elles ont d’ordinaire le tort capital de n’envisager qu’une libération partielle de l’être humain : tantôt religieuse, tantôt politique, tantôt économique, tantôt intellectuelle ou morale. Or, pour faire œuvre vraiment rédemptrice, une révolution doit tendre à la libération complète de l’être humain tout entier. Plusieurs d’entre elles, néanmoins, furent bienfaisantes et méritent d’être louées.
— L. BARBEDETTE.
RÉVOLUTION FRANÇAISE
Nous ne tenterons pas, ici, l’histoire détaillée de ce formidable événement politique et économique que fut la Révolution française. D’innombrables volumes ont été écrits sur cette époque mouvementée. Il nous suffira de l’analyser dans ses causes et ses effets, en indiquant les incidents les plus essentiels et en marquant son caractère profond.
Nombre d’auteurs ont eu le tort très grave d’examiner la Révolution française et de la juger selon leurs conceptions philosophiques et politiques. D’autres n’ont vu qu’une sorte d’imagerie d’Épinal, s’attachant aux faits auxquels ils donnaient une interprétation romantique. C’est ainsi que nous avons des historiens de gauche – aujourd’hui dédaignés –, tels que Alphonse Esquiros (Histoire des Montagnards), ou Villiaumé qui, le premier, osa la réhabilitation de Jean Paul Marat, l’Ami du Peuple, ou, encore, Louis Blanc et Ernest Hamel, tous deux robespierristes. Mais les historiens réactionnaires, détracteurs de la Révolution, sont légion, depuis ceux de la Restauration jusqu’à M. Louis Madelin, et, plus récemment, Pierre Gaxotte. Quant à Michelet, en dépit de sa parfaite connaissance des faits, il apparaît comme le plus romantique, et bien de ses jugements ont dû être révisés.
Le véritable historien de la Révolution française est Albert Mathiez, infatigable chercheur, qui, à la lumière des documents, a su situer, dans leur pure vérité, les hommes et les événements ! En même temps, Mathiez s’attachait à la recherche des causes économiques qui, seules – en dehors des concepts philosophiques rivaux –, fournit l’explication du drame révolutionnaire.
L’économie, en effet, est à la base du mouvement qui commence à se dessiner vers les débuts de 1789. Depuis des années, ce ne sont que plaintes et récriminations, particulièrement dans les campagnes où les paysans, accablés de dîmes, connaissent la misère atroce. De plus, les caisses royales sont vides et Mirabeau crie à la banqueroute. On sent que le vieux monde monarchiste est sapé. L’État s’affaiblit. Le roi et sa cour ne comprennent absolument rien à la situation. D’autre part, le régime corporatif fait peser son oppression sur le monde ouvrier naissant, et le machinisme, venu d’Angleterre, risque son apparition. On commençait à exploiter le charbon, à fonder des usines métallurgiques (Le Creusot), des soieries (Lyon). Les industries du coton, de la laine, du fer, du sel, étaient en marche. Toute une petite bourgeoisie industrielle se créait.
Mais c’est surtout le monde paysan qui souffre. Tout un système abominable d’impôts l’accable, et les grands seigneurs, comme les hauts dignitaires de l’Église vivent sur lui, hissés sur des privilèges arrogants. Ajoutons à cela des bataillons de robins, vivant uniquement des chicanes et dépouillant le paysan.
Au-dessus, des pensions multiples allant aux maisons royales et princières, un budget mal équilibré, des dépenses exagérées, des emprunts continuels. Voilà pour les causes économiques. Mais il ne faut pas négliger l’influence des philosophes et des encyclopédistes du XVIIIe siècle. Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire agissaient profondément sur les esprits, particulièrement dans les rangs de la bourgeoisie éclairée, du petit clergé et de la petite noblesse de robe. À côté de ces trois grands destructeurs, la multitude des pamphlets, des libellés accusateurs, dévoilait la pourriture d’un régime et suscitait les colères.
Le point de départ du mouvement, c’est, au fond, la révélation du déficit, après le départ du Genevois Necker et l’entêtement du gouvernement royal à persister dans ses errements. Le parti parlementaire commence à se dresser contre la cour. En province, l’autorité se révèle, un peu partout, comme défaillante, Des manifestations bruyantes sont annoncées dans toutes les grandes villes. Des pamphlets surgissent de tous côtés. Des clubs (un mot nouveau) se fondent. Le premier en date est le club des Trente, qui se réunit chez Dupont, et où l’on rencontre Mirabeau, Sieyès, Condorcet et d’autres. Et, enfin, voici les fameux cahiers de doléances qui pleuvent. Ces cahiers, venus des campagnes, sont rédigés par des magistrats de province et des curés. Il n’est que de les consulter, d’un bout à l’autre du pays ; ils traduisent le mécontentement et les aspirations du petit peuple.
On décide alors la convocation des États généraux, et les élections ont lieu. Vers la fin avril, les députés arrivent à Versailles. La révolution fait ses débuts. Car, à Paris, c’est le triomphe des agitateurs qui se retrouvent au Palais-Royal. Les clubs, dans cette enceinte, se multiplient. Des mutineries éclatent de-ci, de-là. Les députés de la droite de l’Assemblée se sentent menacés et en appellent au roi qui ne fait rien pour les rassurer. On sent que de graves événements se préparent.
Surviennent les journées de juillet. Nous ne les conterons pas en détail, avec l’appel de Camille Desmoulins, la bagarre des Tuileries, la ruée vers les prisons et l’Arsenal. Qu’il suffise d’indiquer qu’à la vérité la Bastille n’était pas défendue, et qu’on s’explique difficilement le hasard qui conduisit le peuple armé vers cette vieille forteresse royale. La vérité, aussi, c’est qu’une armée de mendiants était descendue de Montmartre et que les brigands, comme on disait alors, avaient mis le feu aux barrières, terrorisant Paris. La petite bourgeoisie, les artisans, les ouvriers s’armaient beaucoup plus contre ces brigands et contre les mercenaires étrangers que contre le roi. Toutefois, le renvoi de Necker, alors populaire, fut l’étincelle qui mit le feu aux poudres.
Pendant trois nuits, la population parisienne fabriqua des piques. Des patrouilles de patriotes sillonnaient les rues, entraient dans les maisons, veillaient sur la sécurité de la ville. Des bandes pillaient les armuriers. Le 14, au matin, toutes ces bandes se dirigent vers la Bastille, où tenait M. de Launay, à la tête d’une petite garnison. Tout d’abord, le gouverneur semble céder aux sommations de la foule, fait retirer les canons, consent à recevoir des représentants de cette foule qui visitent la forteresse. Puis la foule essaie d’entrer ; elle tente de mettre le feu à l’une des tours, d’abattre les portes à coups de hache. La garnison prend peur et tire. Puis, de plus en plus apeurée, elle se révolte contre le gouverneur qui doit se soumettre. Ainsi tombe la Bastille. La foule se précipite. Elle trouve dans la vieille prison sept prisonniers, dont deux fous. C’est tout. Mais la Bastille était comme le symbole de l’oppression, et, pour la première fois, le peuple, ivre de joie, se sentait vainqueur de l’autorité.
Des siècles de servitude et de misère avaient fait à tous ces hommes des âmes dures. Il s’ensuivit des représailles sanglantes. On tranche la tête de de Launay. Mais de Launay était un tripoteur avare et voleur, connu comme tel dans le quartier Antoine. On abattit Flesselles, prévôt des marchands. Mais Flesselles s’était moqué de la population et était complice de de Launay. Quant à Berthier et Foulon, ils étaient tout désignés à la vindicte populaire, comme accapareurs et affameurs.
Au fond, le nombre des victimes de la vengeance du peuple n’est pas considérable et les historiens réactionnaires ont systématiquement monté en épingle ces « horribles forfaits »,
La cour, atterrée, n’eut même pas l’idée de réagir. Elle laissa Bailly s’installer, triomphant, à l’Hôtel de Ville et rejeter la cocarde blanche pour lui substituer la cocarde tricolore. Cependant, le roi demeurait sympathique. Nul ne songeait à l’attaquer. La Monarchie paraissait à tous intangible. Toutefois, la prise de la Bastille faisait naître tous les espoirs de libération. En province, quand on apprit la chute de la forteresse, ce fut une explosion de joie. Partout, on prend les armes. La révolution est en marche.
À Versailles, l’Assemblée discute sur la Constitution. Elle supprime la plupart des privilèges (Nuit du 4 Août) et acclame le roi, restaurateur de la liberté française. À Paris, les clubs s’agitent. Des hommes nouveaux apparaissent. Des journaux voient le jour. À ce moment, l’Assemblée se coupe en deux : d’un côté, les modérés ; de l’autre, les révolutionnaires. Le 30 août, une émeute éclate à Paris, que la garde nationale, commandée par La Fayette, disperse brutalement.
La cour, mal conseillée, croit alors pouvoir tenir tête. Elle fait entrer à Versailles le régiment de Flandre auquel elle ménage une réception scandaleuse, au cours de laquelle la reine, Marie-Antoinette, ne craint point de danser avec des soudards ivres, parmi les cris de :
« À bas l’Assemblée ! »
À Paris, l’impression est profonde. La révolte, de nouveau, gronde dans les rues. De plus, c’est la misère qui continue. On fait la queue aux portes des boulangeries. Et le duc d’Orléans, prétendant à la couronne, distribue l’argent, lance ses agents. Mais, selon le maire Bailly, l’autorité royale aurait organisé, elle-même, des pillages qui, empêchant le ravitaillement, conduisait le peuple de Paris à la famine. Qu’espérait la cour ?
La riposte ne se fit pas attendre. Les clubs tonnèrent. Les femmes se mirent de la partie. Formées en cortège et ayant à leur tête l’huissier Maillart, un des vainqueurs de la Bastille, elles se mirent en route pour Versailles.
Au moment où elles arrivaient à Versailles, le roi chassait dans les bois de Verrières. Il venait de repousser la Déclaration des droits de l’homme. Il avait l’âme paisible. La reine était à Trianon. Le ministre comte de Saint-Priest proposait de faire marcher la troupe sur les femmes. Necker s’y opposa. Alors, des femmes envahirent l’Assemblée et d’autres se jetèrent vers le château. À l’Assemblée, les députés se sentaient impuissants. Robespierre monta à la tribune pour défendre les femmes. Déjà, il commençait à donner sa mesure, et Mirabeau qui l’observait avec curiosité, disait :
« Cet homme ira loin, il croit ce qu’il dit. »
Finalement, le roi donna son consentement à la Déclaration. Mais le château était envahi. La Fayette, accouru de Paris et ayant tout apaisé, était allé se coucher. Mais, au matin, les portes du château sont enfoncées. Les femmes pénètrent dans les appartements de la reine, qui s’enfuit par un couloir dérobé. Des gardes du corps sont massacrés. La Fayette surgit ; il apparaît au balcon, flanqué du roi, de la reine et des enfants. Un immense cri retentit :
« Le roi à Paris ! »
Il faut s’incliner. La garde nationale fait escorte à la famille royale. Les femmes reviennent triomphantes dans la capitale – avec le boulanger, la boulangère et le petit mitron. On crie partout :
« Vive la Nation ! »
Le roi, conduit à l’Hôtel de Ville, fait triste figure.
Désormais, il va s’installer aux Tuileries. Là, il est sous l’œil et dans les mains du peuple.
Quelques jours après, l’Assemblée déclare que les biens du clergé étaient à la disposition de la Nation. C’est Talleyrand qui est l’auteur de cette proposition. Puis l’assignat est décrété. Il jouera un rôle terrible pendant toute la Révolution, sans amener une amélioration au sort des malheureux citoyens, en proie à la plus affreuse disette.
Nous avons parlé des journaux. Ils vont exercer une action de plus en plus prépondérante sur le peuple. Ce sont, d’abord, les brûlots de Camille Desmoulins : Discours à la Lanterne, La France Libre ; Camille va lancer bientôt Les Révolutions de France et de Brabant ; puis, Les Révolutions de Paris, de Prud’homme et Loustalot, L’Orateur du Peuple, de Fréron, et, surtout, L’Ami du Peuple, de Marat. Marat, c’est l’œil du peuple ; il clame furieusement ce qu’il croit être la vérité ; il dénonce les ennemis de la Nation. Tour à tour, Bailly, La Fayette, Necker sont les objets de ses accusations, d’ailleurs justifiées. Il est poursuivi, traqué par toutes les autorités, défendu par les clubs, au premier rang les Cordeliers, avec Danton. L’influence qu’il va exercer sera formidable. Ce savant, auquel on doit de nombreuses découvertes, notamment dans le domaine de l’électricité médicale, est inouï d’activité et de passion révolutionnaire. On peut affirmer que, durant ses premières années, alors que Robespierre se cherchait encore, il fut l’âme de la révolution.
Cela nous amène à la tentative de fuite de Varennes.
Le roi est arrêté, ramené à Paris. Mais l’effet produit est des plus fâcheux sur l’esprit populaire. On accuse la reine de l’avoir conseillé et de pactiser avec l’ennemi. Elle est sans cesse accusée et bafouée. On l’appelle déjà l’Autrichienne. Cette fuite avortée de Varennes a fait beaucoup contre la Monarchie.
Les événements se précipitent. Barnave fait voter le fameux décret obligeant les prêtres à prêter serment à la Constitution. Mirabeau, qui était l’idole du peuple, se rapproche de la cour ; La Fayette de même. Mais l’Ami du Peuple veille. Il dénonce les trahisons. Le roi, dans son palais des Tuileries, n’est plus qu’un prisonnier. On demande, au club des jacobins, sa déchéance ; ce club est issu, après scission, de la société fondée par les premiers constituants. Il n’allait pas tarder à devenir tout-puissant et à rallier toutes les énergies révolutionnaires. En face des jacobins, les cordeliers se montrent aptes aux coups de force et aux émeutes. Ils avaient d’ailleurs un sens aigu des besoins du peuple et ne perdaient pas de vue les nécessités économiques. C’est à eux qu’on doit, en 1791, les grèves des charpentiers, des typographes, des chapeliers, des maréchaux-ferrants, etc.
L’Assemblée s’était prononcée contre les ouvriers et elle votait la fameuse loi Le Chapelier, réprimant sévèrement toute coalition tendant à imposer un salaire aux patrons. Ainsi, l’Assemblée devenait de plus en plus réactionnaire.
De son côté, La Fayette interdisait tout cortège. Les journalistes révolutionnaires, sentant le péril, redoublaient d’attaques. Le peuple fut convié à signer une vaste pétition, au Champ de Mars, sur l’autel de la Patrie. On prit pour prétexte la pendaison de deux individus cachés sous l’autel et que la foule qualifiait de brigands, pour appliquer la loi martiale. La foule résista. Puis ce fut la fusillade. Marat, les jours suivants, estimait, dans son journal, qu’il y avait eu quatre cents morts.
Pour la première fois depuis la prise de la Bastille, la troupe tirait sur le peuple. Ce ne devait pas être la dernière.
L’épouvante règne sur Paris. Mais l’Assemblée avait reçu le coup mortel. Elle n’était plus en communion avec la révolution. Sur quoi, Robespierre fit décréter qu’aucun des constituants ne pourrait être réélu, Quant au roi, il paraissait triompher. Il était armé du veto. La révolution, abandonnée par ses journalistes, semblait bien malade. Marat jetait un cri d’alarme et se réfugiait en Angleterre. Camille Desmoulins, lui-même, cédait au désespoir. Loustalot se taisait. L’heure était tragique.
Les élections eurent lieu dans le milieu de 1790, parmi de nombreuses abstentions. Le 1er octobre, la législative se réunit. Il y avait 745 députés, pour la plupart jeunes et ardents ; presque tous inconnus, d’ailleurs. L’élément le plus agissant et remuant se composait des députés de Bordeaux : les Girondins, flanqués de Brissot et de Condorcet, élus de Paris. L’un d’entre eux va émerger et faire presque oublier Mirabeau : c’est Vergniaud.
Cependant, la vie économique est de plus en plus précaire, aussi bien à Paris qu’en province. La récolte s’annonce mal. On manque de pain et de sucre. La foule affamée assiège et pille boulangeries et épiceries. Un peu partout, on signale des bagarres, des coups de main. La jacquerie semble renaître et s’étendre, et l’inflation poursuit ses ravages.
Déjà, la bourgeoisie s’installe dans la révolution qu’elle va escamoter à son profit. Par bourgeoisie, il ne faut pas entendre une classe homogène. Les profiteurs de la révolution sont généralement des fonctionnaires, des agents de cette révolution, des miséreux d’hier, tripotant sur les fournitures, sur les assignats, touchant de tous côtés. Ce sont ceux-là qui constitueront, avec les débris de l’ancienne, la nouvelle bourgeoisie qui connaîtra la toute-puissance durant le XIXe siècle.
Quelques-uns des hommes les plus représentatifs de la révolution sont, d’ailleurs, soupçonnés de vénalité et de trahison. On accuse Danton d’avoir touché de l’argent anglais. Albert Mathiez, documents en mains, a montré de quoi ce tribun vendu était capable, et ses contradicteurs ont dû s’incliner (voir Louis Madelin). Mirabeau est également un homme d’argent et il en reçoit aussi bien de la cour que de l’Anglais. Parmi les agitateurs, combien de personnages louches, provocateurs et policiers !
À l’extérieur, la situation est tendue. Les émigrés de Mayence, de Coblence se répandent en menaces. Ils escomptent une prompte revanche. Les deux frères du roi publient un manifeste anonyme. Le roi se montre indécis. Il est conseillé par les Lameth, par Barnave, par Dupont, les auteurs de la Constitution. Et, d’autre part, la lassitude commence à gagner le peuple.
Cet état d’esprit et ces incidents ne vont pas tarder à provoquer la guerre. Cette guerre, les Girondins la désirent, l’appellent de tous leurs vœux. Ce sera un dérivatif puissant. C’est Brissot, surtout, qui, pendant des mois, s’efforcera d’habituer les esprits à l’idée de guerre. Il est soutenu par Vergniaud, par Isnard. Seul, Robespierre résiste. Mais il est impuissant devant cette sorte de psychose et ne trouve devant lui que des hommes qui rêvent d’imposer par la force l’idée révolutionnaire. Il n’est question que d’abattre les tyrans et de proclamer la guerre sainte. Mais, à la vérité, ce ne sont pas les révolutionnaires – ceux qu’on appellera plus tard les Montagnards – qui prêchent la guerre ; ce sont les hommes de droite, les têtes chaudes de la Gironde. Et la cour, un instant rebelle, finira par s’incliner. Le ministre Narbonne, du reste, s’affirme d’accord avec les Girondins. Il va si loin que Louis XVI, pour une fois clairvoyant, décide de le renvoyer.
C’est alors que Vergniaud prononce son fameux discours, dénonçant les Tuileries, et menaçant la cour du glaive de la loi. Discours sensationnel. Les rares hommes qui demeurent pacifistes sont débordés. Le ministère s’effondre. Il sera remplacé par le ministère girondin avec Roland, Clavière, Dumouriez. Et un ultimatum est adressé à l’Autriche.
Le 20 avril 1792, le roi, devant l’Assemblée, propose de déclarer la guerre au « roi de Hongrie et de Bohème ». Cette proposition est votée presque à l’unanimité, parmi les acclamations. Mais, il ne faut pas l’oublier, c’est le roi qui fait voter ce décret. D’accord, avec Marie-Antoinette, il espérait que l’ennemi serait à Paris avant peu et qu’il le rétablirait dans ses privilèges.
Les débuts, d’ailleurs, sont terribles. Biron et Dillon se font battre effroyablement. Les fuyards croient à la trahison et massacrent Dillon. Les Girondins, furieux, dénoncent les lâches et s’en prennent aux prêtres non assermentés. Puis ils licencient la garde constitutionnelle du roi et laissent se former, au Champ de Mars, un camp de 20 000 fédérés, fidèles à la révolution et venus de tous les coins des départements. Du coup, le roi se trouvait isolé, sans défenseurs. Mais, conseillé par la reine, il résiste. Les Girondins commencent à songer à une journée d’émeute.
Les faubourgs sont armés. Les agitateurs habituels font leur réapparition. Le 20 mai, la foule se dirige vers les Tuileries, où elle pénètre. Le roi est obligé d’accueillir les émeutiers. Mais la « journée » demeure sans conclusion. Vers le soir, la foule, fatiguée, se retire.
La Gironde prépare aussitôt sa revanche. De nouveaux soldats patriotes sont appelés, en grand nombre, à Paris. Les 48 sections de Paris sont décrétées en permanence. Le 11 juillet, l’Assemblée déclare « la Patrie en danger ». Un Comité d’insurrection est constitué, qui se réunit soit au Soleil d’Or, place de la Bastille, avec Santerre, Chaumette, Chabot, Fournier l’Américain ; soit chez Duplay, le menuisier de la rue Saint-Honoré, qui héberge Robespierre, C’est Robespierre qui rédige les pétitions réclamant la déchéance du roi. Danton, lui, est absent de Paris. On ne le reverra qu’à la veille de la bataille. Pétion est maire de Paris. Mais il sera débordé par la commune insurrectionnelle.
Les Tuileries étaient défendues par neuf cents Suisses et trois cents chevaliers de Saint-Louis. Les gendarmes et les gardes nationaux pactisaient avec les insurgés. Mais, dès les débuts de l’action, le roi et la reine, pris de peur, abandonnent le palais et viennent chercher refuge à l’Assemblée. Pendant ce temps, on se battait. À l’Assemblée, le roi ordonne aux Suisses de se retirer. Le château est envahi et incendié. Paris, pris d’une sorte d’ivresse, renverse les statues des rois, fait disparaître les fleurs de lys, saccage les monuments qui rappellent la monarchie. À l’Assemblée, la suspension du roi est votée, ainsi que son emprisonnement au Luxembourg. Mais la commune proteste ; elle s’empare de la famille royale et la conduit au Temple.
Un nouveau ministère est formé. Il offre cette particularité que l’agitateur Danton prend le portefeuille de la Justice. Il va très vite devenir le maître.
La commune, cependant, est encore plus maîtresse que Danton. Elle décide que la future Convention sera élue au suffrage universel, que les prisonniers condamnés pour pillage seront libérés, que les grains seront taxés, qu’un tribunal révolutionnaire jugera les traîtres et les royalistes. Tout cela, la commune l’impose à la législative ; mais elle n’agit que sous la pression populaire.
Sur le théâtre de la guerre, les nouvelles ne sont pas rassurantes. Longwy capitule. Verdun capitule. Les Prussiens s’avancent sur Chalon. La route de Paris est ouverte. Les Girondins atterrés parlent de transporter le gouvernement en province, à Bordeaux (déjà !). La commune, elle, réagit. Elle a, à sa tête, Huguenin, Rossignol, Manuel, Hébert, Panis, et derrière elle Marat, l’Ami du Peuple. Elle prétend lutter contre l’invasion par la terreur. Ce sont les massacres de Septembre en perspective.
Ces fameux massacres, presque tous les historiens les ont flétris, mais que sont-ils en regard de la Saint-Barthélemy et des guerres atroces de religion ? Les Parisiens, d’ailleurs, avaient d’excellentes raisons pour se débarrasser des nobles, des prêtres, des parents d’émigrés qui, à travers les grilles des prisons, ne cessaient d’injurier les révolutionnaires et d’appeler de tous leurs vœux l’invasion prussienne. Tous, du reste, depuis Roland et les Girondins jusqu’à Marat et Hébert, étaient d’accord pour donner la parole au peuple. Certains s’élevèrent plus tard, hypocritement, contre ces massacres. Mais ils les ont permis et même justifiés. Danton, ministre, a laissé faire. Nulle réaction contre ce lessivage sanglant.
Les prisonniers sont immolés à l’Abbaye, aux Carmes, à la Force, au Châtelet. Des tribunaux sont improvisés qui s’efforcent de respecter les formes légales. Les prisonniers sont appelés et jugés. C’est l’huissier Maillart, vainqueur de la Bastille, héros des journées d’Octobre, qui préside avec fermeté à l’Abbaye et sauve nombre de prisonniers.
Cela dure quatre jours. Des évêques, des prêtres, des anciens ministres, des courtisans sont mis à mort. Le 9 septembre, Fournier l’Américain, qui conduisait un convoi de prisonniers à Versailles, les laissa massacrer par les patriotes.
Ces événements sanglants, suivis d’autres massacres en province, ont pour résultat d’épouvanter l’ennemi et les contre-révolutionnaires. Les sans-culottes qui partent aux armées se sentent rassurés sur le sort de leurs femmes et de leurs enfants. Et, tout à coup, ce fut Valmy. Les Prussiens reculaient. Ce même jour, la Convention se réunissait. Robespierre, Marat, Collot d’Herbois, Tallien, Billaud-Varenne, Camille Desmoulins, Danton, Panis, Legendre, Sergent en faisaient partie, ainsi que les Girondins, presque tous réélus et augmentés de Buzot, Lanjuinais, Pétion, Roland, Barbaroux.
La révolution entre dans une ère nouvelle.
Le premier soin de la Convention fut de proclamer l’abdication de la royauté. Nous voici en l’an I de la République. Mais, dès les débuts, les désaccords se manifestent entre la Gironde et la Montagne. Les Girondins sont des bourgeois, lettrés et artistes, voltairiens et anticléricaux ; ils se méfient de la Commune et estiment que, du moment qu’ils ont le pouvoir, la révolution ne doit pas aller plus loin.
Les Montagnards, eux, sont plus près du peuple et, pour la plupart, se réclament de Jean-Jacques, – les dantonistes formant un groupe à part. Ils sont vaguement socialistes, encore que le mot n’existe pas et qu’on ne parle guère que de loi agraire. Ils combattent pour les pauvres. Ils sont, d’ailleurs, poussés, l’épée dans les reins, par les hommes de la Commune et par le groupe des Enragés qui s’affirment communistes et que mène Jacques Houx.
La bataille ne va pas tarder à s’engager entre les deux fractions de l’Assemblée qui se jettent à la tête les pires accusations. Les Girondins, d’abord, essaient de lutter contre la Commune et s’attaquent au trio Marat, Danton, Robespierre qu’ils accusent d’avoir voulu Septembre. Ils ont affaire à très forte partie. Danton, seul, par sa vénalité et les opérations effectuées lors de son passage au ministère, prête le flanc. Il se défend mal. La Convention le condamne moralement en lui refusant son quitus. Mais les Girondins n’osent poursuivre leurs avantages.
Vers la fin de l’année, la Commune est renouvelée et les Girondins réussissent à introduire un des leurs. Seulement, Chaumette et Hébert étaient, l’un procureur général, l’autre syndic. Au fond, la Gironde, maîtresse du pouvoir, s’avérait sans force comme sans prestige. Son impopularité augmentait tous les jours, pendant que les Jacobins apparaissaient comme les arbitres de la situation.
C’est alors que s’engage le procès du roi. Les Montagnards n’avaient qu’une idée : guillotiner le roi pour sceller l’union des véritables républicains. Quant à ceux qui refuseraient de voter la mort, on aurait le droit de les considérer comme des traîtres et des amis de la contre-révolution. Les Girondins ne surent pas voir le piège qui leur était tendu. Ils essayèrent de sauver la tête royale, mais ils reculèrent au moment de s’engager nettement, usant de procédés maladroits. L’heure n’était plus à l’indulgence ; et quand Marat réclama le vote public et l’appel nominal, il était impossible de reculer.
Le roi fut condamné, après avoir comparu deux fois : les 11 et 26 décembre, et avoir été assisté par Tronchet, De Sèze, Malesherbes. Par 683 voix, Louis Capet fut déclaré coupable de conspiration contre la sûreté générale de l’État. Le vote dura vingt-six heures, parmi les applaudissements ou les huées de la foule des spectateurs. En réalité, c’était bien le peuple qui condamnait et obligeait les Girondins à condamner. Ces derniers employèrent tous les moyens pour sauver la tête du roi. Danton, tout en hésitant, s’associa par instants à eux, fidèle à la promesse qu’il avait faite à Lameth de tenter d’épargner le roi (voir les Mémoires de Théodore Lameth). Là-dessus, on fit la découverte de la fameuse armoire de fer bourrée de documents compromettants pour la cour. Dès lors, la cause était entendue.
Autour de l’exécution de Louis, les royalistes ont établi la légende du roi martyr. En réalité, la prison du Temple lui fut assez douce. On est stupéfait aujourd’hui quand on consulte les comptes de la commune, de voir ce que ce monarque, un ogre véritable, a pu consommer de vivres – et parmi les meilleurs – à une époque où le peuple parisien était en proie à la plus affreuse disette.
Les manœuvres des Girondins, leur tentative d’appel au peuple les perdirent définitivement dans l’esprit public, cependant gue la commune de Paris, qui représentait les petites gens et les intérêts populaires, se fortifiait de jour en jour. Furieux, les Girondins s’en prirent aux Montagnards, et poussèrent la maladresse jusqu’à s’attaquer à Danton. Ils réclamaient, par la voix de Guadet, des poursuites contre les auteurs des massacres de Septembre. C’était là ouvrir un dangereux débat.
Pendant que se déroulaient ces luttes, en dépit du clairvoyant Marat, qui avait déclaré tout d’abord qu’il fallait faire confiance à la Convention, la situation financière et économique s’aggravait. Cambon déclarait un déficit de 116 millions. Les dépenses de guerre s’élevaient à 228 millions. Impossible de combler ce gouffre. Les Montagnards conseillaient de prélever les frais de la guerre sur les fortunes acquises et de voter de nouveaux impôts. Mais les Girondins ne voulaient rien entendre. Ils avaient peur de ce qu’on n’appelait pas encore le socialisme, mais la « loi agraire ». D’autre part, ils laissaient les tripotages les plus éhontés se poursuivre, avec la vente des biens du clergé, estimés à 2 milliards. Et ils faisaient « suer » les rentiers au profit des commerçants. Quant aux salariés, ils recevaient environ 20 sous par jour, alors que le pain coûtait environ 8 sous la livre, quand il y avait du pain et que le blé circulait.
D’un côté, misère des travailleurs, de l’autre côté, luxe insolent des profiteurs et nouveaux riches. Et la République était à peine à son aurore.
Les plaintes contre les fraudeurs affluaient de tous les coins de province. L’un des plus dénoncés était le fameux abbé d’Espagnac, protégé par Danton. Un autre était le juif Benjamin. Cambon s’écriait :
« Cette race dévorante est pire encore que sous l’ancien régime. »
Tous les Girondins faisaient la sourde oreille.
On comprend, dès lors, que les masses ouvrières aient chargé la Gironde de leur haine. La Montagne, du reste, ne paraissait pas comprendre davantage la situation. Les Jacobins ne bougeaient point. Il fallut l’action de la commune et des sections parisiennes pour poser le problème de la vie et réclamer la taxe. Jacques Roux, orateur populaire, meneur de la section des Gravilliers, porte-parole des pauvres, n’hésitait point à attaquer la Convention entière. Il l’engageait à réprimer l’accaparement. À ses côtés, Varlet, installé sur la terrasse des Feuillants, haranguait la foule, accusait les Jacobins. Il s’intitulait « apôtre de la Liberté ». Derrière ces deux hommes, qui représentaient les intérêts et les désirs des pauvres gens, il y avait le club des Enragés, dont l’influence se faisait de plus en plus sentir. Chose curieuse, Marat se refuse à les servir ; Hébert les soutient mollement. Toutefois, les Montagnards sont obligés de faire des concessions. Mais la vie chère persiste. Et c’est de cela que vont mourir les Girondins.
Au dehors, la guerre continuait. Les pays voisins étaient envahis. On touchait à la guerre de conquête. On annexait des territoires. Les généraux décidaient, et il fallut que Cambon s’élevât véhémentement contre ces méthodes pour que la Convention vît le péril. Cependant, elle ne tenta rien de sérieux. Là-dessus se forma la première coalition contre la France révolutionnaire. Les positions conquises en 1792 furent perdues. La Belgique fut évacuée. Les Autrichiens et les Prussiens avancèrent. Et Dumouriez passait à l’ennemi. Danton, qui se trouvait alors à l’armée, fut accusé de complicité. Il riposta en accusant Brissot et ses amis. La Montagne le soutint chaleureusement. De cette bataille sortit le comité de Salut public, où figuraient Danton et son ami Delacroix.
La disette s’aggravait. Le peuple souffrait de la faim. Des émeutes éclataient. Des épiceries étaient pillées. Des pétitions parvenaient, nombreuses, à la Convention, et Jacques Roux approuvait publiquement les pillages. La « loi agraire » et le partage des biens étaient prêchés un peu partout.
C’est alors que surgit la révolte de la Vendée, grave péril pour la République. Prêtres et Chouans donnent la main aux Anglais pendant que les émigrés suivent Autrichiens et Prussiens. Jamais la France ne fut aussi près de la mort.
À Paris, les Enragés imposent aux Montagnards, qui se rendent enfin compte du danger, des mesures radicales : cours forcé de l’assignat, maximum des grains, etc. En même temps, ils constituent des comités de surveillance pour « tenir en respect et surveiller les autocrates ». Ils amorcent, peu à peu, le redoutable tribunal révolutionnaire. Nous entrons ainsi dans la période de la Terreur.
En réalité, dès la législative, on peut dire que l’histoire de la Révolution n’est faite que des luttes, parfois sanglantes – comme à Lyon, avec Chartier –, des pauvres et des travailleurs, aux vagues aspirations communistes, et des riches, profiteurs, exploiteurs du nouveau régime. Cela durera jusqu’à Babeuf, dernier apôtre de la classe ouvrière.
Les Girondins, bourgeois lettrés et artistes, tous ou presque tous fortunés, issus de la bourgeoisie et de la petite noblesse, apeurés devant les nécessités révolutionnaires, devaient fatalement succomber. Du reste, ils accumulaient les maladresses, menaçant Paris (discours du fameux Isnard), parlant de siéger en province, etc.
Le 12 avril, Guadet, fort mal inspiré, réclamait un décret d’accusation contre Marat. L’Ami du Peuple, dans son journal, avait justifié quelques pillages de boutiques. Renvoyé devant le tribunal, il fut acquitté et triomphalement porté sur les épaules des gens du peuple à la Convention. Les Girondins furent atterrés.
Quelques jours après, les sections de Paris apportaient à la Convention une pétition contre les chefs de la Gironde. Vingt-deux d’entre eux étaient désignés. La Commune, les Jacobins, Robespierre, soutinrent les sections. Robespierre allait même jusqu’à faire sienne la politique économique des Enragés et à dénoncer la propriété qu’il subordonnait à l’intérêt social.
La Gironde résistait, malgré tout. Elle décidait de casser les autorités parisiennes. Or, la Commune était, à Paris, la seule force véritablement organisée. Elle avait en mains la garde nationale et les sections. N’importe. Les Girondins firent voter une commission des Douze, dirigée contre la Commune et qui, pour ses débuts, ordonna l’arrestation d’Hébert, de Varlet, de Dobsen, juge au tribunal révolutionnaire. La Commune, furieuse, vint protester à la barre de la Convention et s’attira une riposte d’une violence maladroite d’Isnard, menaçant sottement la capitale de la France de destruction. Cette fois, c’était bien la guerre civile.
Robespierre, aux Jacobins, appelle le peuple à l’insurrection ; Marat réclame la déchéance des Douze, Camille attaque furieusement Brissot et la Gironde. Finalement, la Convention fait remettre Hébert, Varlet, Dobsen en liberté. Aussitôt, Dobsen convoque les sections à l’Évêché, où siègent les Enragés. Un Comité insurrectionnel secret est nommé. Le 31 mai, l’insurrection est déchaînée. Hanriot est nommé chef de la garde nationale. Les Jacobins se rallient au Comité insurrectionnel. Le 31 mai, les pétitionnaires se dirigent vers l’Assemblée. Ils réclament une armée révolutionnaire, le pain à trois sous la livre, des taxes sur les riches, l’arrestation des suspects, le licenciement des nobles, officiers, etc. Ils pénètrent dans l’enceinte de la Convention. Les Girondins protestent, Robespierre intervient. Mais cette journée n’eut rien de décisif.
Ce n’était, du reste, que partie remise. Le Comité révolutionnaire agissait. Il faisait arrêter Roland. Puis, le 2 juin, il envoyait Hanriot à la tête de la force armée contre la Convention. 80 000 hommes environnèrent l’Assemblée et les Tuileries. Les pétitionnaires réclamaient l’arrestation des 22 et des 12 ; Barrère protesta contre les mesures adoptées par le Comité insurrectionnel et Danton l’appuya. Tout cela en vain. Comme la Convention se dressait pour essayer de sortir, Hanriot commanda :
« Canonniers, à vos pièces ! »
L’Assemblée rebroussa chemin. C’est alors que Cambon intervint, appuyé par Marat. Les Girondins, vaincus, furent livrés. La Montagne triomphait.
Cette journée du 2 juin est des plus importantes et des plus décisives dans l’histoire de la Révolution française. Le 10 août n’était dirigé que contre la monarchie. Le 2 juin, c’est la véritable révolution qui s’annonce et c’est une classe qui est vaincue. Mais le parlementarisme est aussi atteint. L’heure de la dictature ne va pas tarder à sonner.
Les Girondins sacrifiés – les uns envoyés à l’échafaud, les autres en fuite, traqués dans les départements –, les choses vont se précipiter. Les fractions de la Montagne entreront en lutte les unes contre les autres. Les mêmes problèmes économiques se poseront avec plus d’acuité encore. En réalité, les Girondins, pâles républicains bourgeois, étaient, pour la plupart, des hommes probes et sincères dans leurs colères et leurs haines. Du côté Montagnard, il est des profiteurs mêlés aux purs, des individus louches, principalement parmi les dantonistes. Aussi, la bataille va-t-elle se continuer. Notons aussi que Robespierre, Saint-Just et leurs amis, s’ils font alliance avec ceux qu’on appelle, déjà, des anarchistes, les Enragés ; que si Hébert, Chaumette et les gens de la Commune consentent également à ces alliances, c’est parce que les uns et les autres sont poussés par les nécessités de l’heure et qu’ils sentent leur popularité battue en brèche par le mécontentement du peuple ouvrier. Mais, chaque fois qu’ils peuvent s’évader et s’affirmer défenseurs de la propriété, ils ne manquent pas l’occasion.
C’est, pourtant, Saint-Just qui proclame que :
« L’opulence est dans les mains des ennemis de la révolution et que les besoins mettent le peuple dans la dépendance de ses ennemis. »
C’est encore lui qui affirmera qu’il fallait « appauvrir les ennemis du peuple ». Robespierre, lui-même, va assez loin dans ce sens. Ils touchent au communisme, entrevoient la révolution sociale. Mais ils s’arrêtent en chemin, indécis. L’obstacle : Propriété, est là. Il faudra tout le XIXe industriel et la croissance du prolétariat pour que le problème soit nettement posé.
Hébert et la Commune se montrent aussi perplexes que les Jacobins. Marat, l’Ami du Peuple, qui, pourtant, a prêché le pillage, se dresse contre Jacques Roux et les Enragés. Il y a, en lui, un instinct sûr qui le fait se ranger toujours du côté des petits, prendre la défense des faibles, mais il considère la propriété comme sacrée. Pour lui, la propriété conditionne la liberté. Il ne voit pas, et Robespierre, Saint-Just, Hébert, ne le voient pas davantage, que la propriété a changé de mains, qu’une nouvelle aristocratie de la richesse vient de s’installer parmi les troubles et la misère de la révolution. Cela, Babeuf, après Thermidor, le verra et le dira clairement. En 1793, il est trop tôt pour qu’on comprenne. C’est là l’excuse des Jacobins et des hébertistes. Une révolution sociale et économique leur paraissait grosse de dangers et d’imprévus et ils n’étaient pas loin de considérer les Enragés, les partisans du communisme et du partage des biens, comme des hommes suspects, manœuvrant à coups de surenchère.
Il y a aussi, à cette heure grave, des rivalités de personnes. C’est l’éternelle loi des révolutions. Quelle fraction l’emportera sur l’autre ? Quel groupe aura vraiment le pouvoir ? Il faut, d’une part, sacrifier à certaine démagogie, se tenir près des couches populaires en continuelle effervescence, et, d’autre part, demeurer les gardes vigilants de l’ordre révolutionnaire. Cela explique les tergiversations des hommes, leurs hésitations, leurs apparentes contradictions. Toujours est-il que les Girondins vaincus, les dantonistes déjà suspects et inclinant à la clémence, plusieurs courants sont aux prises : la Commune, les Jacobins, l’Évêché... Qui l’emportera ?
Il ne faut pas négliger la situation extérieure : succès des Vendéens, défaites aux frontières, trahisons militaires qui se multiplient, esprit de conquête, etc., et la situation intérieure, c’est-à-dire la famine parvenue à son plein épanouissement, parmi les désordres, les émeutes, les accaparements, les tripotages de certains révolutionnaires d’hier.
Au pouvoir, une Convention diminuée, qui vient, il est vrai, de se débarrasser de la fraction bourgeoise que représentaient les Girondins et deux comités sans grande autorité : Sûreté générale et Salut public. D’autre part, les Girondins harcèlent la province, fomentent des révoltes au nom du fédéralisme, s’allient aux royalistes, menacent Paris. L’heure est pleine de périls. Le Midi se soulève. La Corse se soulève. Bordeaux, Lyon se soulèvent. Le jeune comité de Salut Public, dont les pouvoirs sont constamment discutés à la Convention, principalement par les dantonistes, fait face à la situation. Il expédie des commissaires aux armées et en province, frappe les généraux traîtres ou maladroits. Mais il compte, malheureusement, dans son sein des modérés comme Thuriot, ami de Danton, qui s’efforcera de sauver et de ramener les Girondins. Saint-Just, Couthon, Jean-Bon-Saint-André, Prieur de la Marne forment la gauche. Robespierre n’entrera que plus tard dans le comité reconstitué.
Le 13 juillet 1793, on apprend brusquement la mort de Marat, assassiné par une virago manœuvrée par la Gironde : Charlotte Corday. L’Ami du Peuple était très populaire. Révolutionnaire ardent et prophétique, il avait subi les persécutions des La Fayette, des Bailly qu’il dénonçait justement comme traîtres. Il avait, fuyant de maison en maison, de cave en cave, pour pouvoir continuer son œuvre, sacrifié sa santé. Alors que tant de profiteurs s’enrichissaient, il mourait pauvre. Personnalité étrange et qui attire invinciblement la sympathie que celle de ce savant précurseur, rejeté par les académies et auquel on doit de précieuses découvertes en anatomie et en électricité médicale.
Le savant, chez lui, se doublait du philosophe, nourri de Jean-Jacques et qui publiait : Les chaînes de l’esclavage. Journaliste, enfin, il avait mis sa plume au service du petit peuple, dont il n’hésitait pas, cependant, à flétrir, quand il le fallait, la lâcheté et l’égoïsme. Nul plus que lui, selon Jaurès, ne fut clairvoyant et n’annonça les événements. Le peuple de Paris sentait qu’il avait en lui un défenseur indéfectible. Aussi, la consternation fut-elle formidable. On le pleura partout pendant des semaines. On suspendit son cœur sous la voûte des Cordeliers. On demanda, pour lui, le Panthéon, alors que, de son vivant, il avait assuré « qu’il aimerait mieux mourir cent fois que de finir au Panthéon ». Cet honneur, d’ailleurs, sur l’intervention de Robespierre, lui fut d’abord refusé, et l’on conduisit sa dépouille mortelle dans le jardin des Tuileries.
Le meurtre de Marat, ainsi que l’exécution de Chalier, à Lyon, marque la fin d’une ère. La révolution bouillonnante, torrentielle, tourmentée, confuse, va faire place à la révolution armée, légale, dictatoriale. Il s’agit de se détendre, de sauver les conquêtes populaires. La Terreur se dessine. Elle était, d’ailleurs, inévitable, et les événements y conduisaient secrètement.
Cependant, les meneurs des Enragés prenaient la suite de l’Ami du Peuple. Jacques Roux publiait l’Ombre de Marat. Leclerc reprenait le titre de Marat ; Hébert, lui-même, dans son Père Duchesne, réclamait la succession. La situation leur était des plus favorables.
La famine allait s’accentuant. Les queues reprenaient aux portes des boulangers. Les deux comités ne savaient où donner de la tête. Brillaud-Varenne et Collot d’Herbois, le 27 juillet, faisaient voter le décret sur l’accaparement. C’était un premier pas vers une sorte de collectivisme d’État. Les denrées de première nécessité passaient dans les mains des autorités. Les Enragés triomphaient.
C’est alors que les dantonistes commencent à s’agiter, et que se constitue la fraction des Indulgents. Le comité est sourdement attaqué et il n’échappe que grâce au concours de Robespierre, qui le défend courageusement. Le comité, en effet, est pris entre deux feux. Enragés et hébertistes d’une part ; Indulgents de l’autre. Et la crise touche à son maximum durant le mois d’août. Des mesures implacables sont prises. Les boulangers sont placés sous la surveillance des communes ; on réquisitionne leurs fours, on condamne aux travaux forcés ceux qui refusent de travailler. Le 10 août, les Fédérés accourent de tous les coins de France pour assister à la fête. On redoutait leur influence. Mais, dès les premiers jours, ils se rallièrent aux Jacobins, soutinrent le comité. Ils réclamaient la levée en masse. Tous les Français furent réquisitionnés. C’était la première fois que l’on voyait une nation entière debout pour la guerre.
Il faut noter la bienfaisante influence qu’avaient alors les hébertistes. Certes, Hébert n’était pas un esprit politique supérieur. Il prêchait la guerre à outrance. Son ami Bouchotte, le seul ministre de la Guerre de la révolution, le soutenait, expédiant des agents et des représentants aux armées pour surveiller les généraux. Hébert écrivait :
« La patrie, foutre, les négociants n’en ont point. Tant qu’ils ont cru que la révolution leur serait utile, ils l’ont soutenue, ils ont prêté la main aux sans-culottes pour délivrer la noblesse et les parlements, mais c’était pour se mettre à la place des aristocrates. »
Même langage que celui des Enragés. De plus, Hébert commence à accuser Danton et ses amis. Le tribun est parti se reposer à Arcis-sur-Aube, où il s’occupe d’achats de propriétés. Là-dessus, on apprend que Toulon est aux Anglais. Billaud-Varenne, à la Convention, dénonce la faiblesse du comité. Les sections se réunissent et siègent toute la nuit. Les ouvriers s’assemblent dans les rues, marchent sur la Commune, où Chaumette s’efforce de les calmer. Le mouvement paraît irrésistible. Alors, Convention et comités cèdent. On décrète l’arrestation des suspects, l’accélération du tribunal révolutionnaire et un certain nombre de mesures. On décide, en outre, d’adjoindre trois nouveaux membres au comité : Billaud-Varenne, Collot d’Herbois, Danton. Ce dernier refuse. Mais avec les deux premiers, c’est l’hébertisme qui prend sa part du gouvernement dictatorial.
La Terreur est, désormais, en marche. La loi des suspects est votée en septembre. Le comité de Sûreté générale est placé sous la dépendance du comité de Salut public. Le maximum, tant réclamé par les Enragés, devient une réalité.
Aux frontières, de nouveaux généraux, des jeunes sortis du peuple : Hoche, Jourdan, Pichegru repoussent l’ennemi à Hondschoodt, à Wattignies ; Carnot entre au comité, réorganise l’armée, les cadres. Le comité se sent fort. Il réclame, le 25 septembre, la dictature pour « sauver la Patrie ». En octobre, il a montré de quoi il était capable.
Mais les dantonistes ne le lâchent pas. La bagarre va s’engager. Seulement, Robespierre commencera par les hébertistes. Déjà, il s’est débarrassé des Enragés, décapités par l’exécution de Jacques Roux, et cela, avec l’aide d’Hébert. Saint-Just, de son côté, assure l’application du maximum, fait créer une sorte de tribunal spécial pour que rendent gorge les fournisseurs et tous ceux qui, depuis 1789, avaient manié les deniers publics. Les commerçants résistèrent. On les menaça d’expropriation. Ainsi, on touchait au collectivisme. L’État s’occupait de la répartition des marchandises et denrées. Il s’emparait de la production agricole et industrielle, des transports, des mines, des manufactures, de l’importation et de l’exportation. La révolution politique tournait à la révolution sociale.
Mais c’est la dictature qui vient couronner les efforts du peuple révolutionnaire. Cette dictature, il faut bien le reconnaître, est indispensable et le peuple le sent. Il y a trop de fripons, de tripoteurs, de nouveaux riches, de conspirateurs, d’agents de l’étranger qu’il faut traquer, détruire, sous peine ne voir sombrer la révolution. Aussi s’occupe-t-on, avec un soin particulier, d’organiser la justice révolutionnaire. Dures extrémités, certes, et que nous concevons fort mal aujourd’hui. Mais il faut se reporter à l’époque. C’était la bataille sans merci. La révolution contre une légion d’adversaires déclarés ou sournois. Et une révolution qui transformait la situation économique, œuvrait pour les classes populaires, se débattait parmi de terribles difficultés économiques et financières, dont elle n’était nullement responsable, puisque c’était la banqueroute monarchiste, dénoncée par Mirabeau, qui l’avait suscitée.
Le moment était singulièrement choisi pour se dresser contre le comité et parler d’indulgence. C’est ce que firent cependant les amis de Danton, pour la plupart des coquins enrichis, capables de toutes les trahisons. Ils avaient nom : Fabre d’Églantine, aventurier sans scrupules et faussaire ; Chabot, tripoteur, ami du fameux royaliste, baron de Batz ; Westermann, soudard pillard et voleur, dénoncé par Marat. Basile, Delaunay, Delacroix, le banquier Frey, etc. Tous ces gens-là étaient compromis dans les affaires les plus louches, notamment celle de la Compagnie des Indes (voir là-dessus le volume d’Albert Mathiez) ; Danton, lui-même, était convaincu de vénalité. Rendant ses comptes devant ses collègues, il avait été flétri par Cambon et s’était retiré sous le mépris général. Pas de personnage plus surfait que l’homme de l’audace, toujours de l’audace qui, au fond, n’était qu’un couard. On ne le voit participer à aucun mouvement populaire sérieux. Il n’est pas à la prise de la Bastille ; lui qui est l’oracle de sa section, on ne le voit pas au 10 août, auquel il ne participe en rien. Mais, arrivé à Paris sans un sou, il est devenu un des plus riches propriétaires de son département. C’est ce qu’Hébert ne se lasse pas d’écrire et de hurler. Quant à Camille, plus léger que coupable, il n’en a pas moins des relations suspectes.
Pourtant, Robespierre et le comité les ménagent. Ils ont besoin des Indulgents pour en finir avec les « ultras », où se glissent de singuliers révolutionnaires. Hébert, sottement, croit pouvoir entrer en lutte contre le comité. Il appelle ses fidèles des Cordeliers à la révolte, fait voiler le buste de la liberté en signe de deuil. Mais le comité était prévenu. Il charge Collot d’Herbois d’une démarche de conciliation auprès de Carrier, le « noyeur » de Nantes, âme de la révolte. Les Cordeliers font amende honorable, à l’exception du fougueux Vincent. La nuit du 23 au 24 ventôse, les chefs hébertistes sont arrêtés. Leur procès se déroule en germinal ; ils sont condamnés à mort. Malgré tout, le comité, en état de légitime défense, en épargne le plus possible. Carrier est mis en liberté. Boulanger, Pache ne sont pas poursuivis. Mai c’était déjà trop d’Hébert, de l’énergique Ronsin, de Vincent, de Cloots. La révolution s’amputait de ses meilleurs membres. Le malheur, c’est que les rivalités des hommes, les rancunes, les vanités ne pouvaient aboutir à d’autre solution.
Restaient les Indulgents. Camille Desmoulins publiait, coup sur coup, les numéros de son Vieux Cordelier qui allaient réjouir les royalistes et contre-révolutionnaires. Billaud-Varenne demande la tête de Danton à Robespierre, qui recule, épouvanté. Il ne fallut pas moins que les révélations de Fabre d’Églantine et de Chabot sur les tripotages du fournisseur d’Espagnac, de Julien de Toulouse et autres forbans pour le décider. Il y avait vraiment quelque chose de pourri dans la fraction dantoniste, et si l’on y déclamait contre l’échafaud, c’était surtout dans le but de s’y soustraire.
Saint-Just fut chargé du rapport contre les dantonistes, qu’il lut, dans un profond silence, relatant, détail par détail, les intrigues de Danton et de ses complices. Nul n’osa protester, et Legendre, qui, dès les débuts, avait élevé la voix en faveur de ses amis, balbutia des excuses. Arrêtés, les dantonistes furent renvoyés au tribunal qui, malgré les éclats de voix et les insolences du tribun, les condamna à mort. Ils furent exécutés parmi l’indifférence de la foule. Depuis longtemps, le peuple révolutionnaire était fixé ; la Convention de même. Après Thermidor, la réaction triomphante rappellera et réhabilitera les Girondins ; elle ignorera Danton et ses acolytes, à l’exception du malheureux Camille. Cela est déjà assez significatif. Il a fallu les historiens officiels, mal informés, privés de documentation, pour tenter l’apologie de Danton et de ses amis. Aujourd’hui, après les savants travaux de Mathiez, la cause est entendue. M. Madelin, lui-même, en dépit de son dantonisme, s’est incliné devant la vérité historique.
Les deux fractions, extrémistes et Indulgents, abattues, le gouvernement révolutionnaire, c’est-à-dire le comité de Salut public, s’occupe de se réorganiser. Les ministres sont supprimés et remplacés par des commissions exécutives (c’est Carnot qui fait adopter cette mesure). En même temps, la lutte s’engage contre les représentants en province qui abusaient de leurs pouvoirs. Fouché est rappelé. Jourdan-Coupe-Tête, en Avignon, est guillotiné. Les tripoteurs sont vigoureusement poursuivis. C’est le règne de la vertu, parallèlement à la terreur.
Robespierre mène le comité. Sa popularité et son autorité sont immenses. Derrière lui, Saint-Just agit. Il semble vouloir conduire, jusqu’à ses fins logiques, la révolution économique. Déjà, il avait fait voter, à la Convention, un décret disant que les biens des personnes reconnues ennemies de la révolution seraient confisqués. Puis il fit décréter l’établissement de listes de patriotes indigents. Les biens des adversaires devaient leur être distribués. Cela, après les biens du clergé et les biens des émigrés. Ainsi, Saint-Just allait encore plus loin que les hébertistes. Il arrachait ses griffes à la classe possédante et marchait à une formidable expropriation. De même, le comité s’occupe des salaires des ouvriers, qu’il relève sensiblement, sans d’ailleurs les satisfaire. Les ouvriers, en effet, réclament un salaire toujours plus haut, refusent de travailler ; Barère dut faire prendre un décret les menaçant du tribunal révolutionnaire.
Le mécontentement grandissait chaque jour. Les réquisitions pesaient sur les paysans ; les salaires demeuraient insuffisants ; le commerce était à peu près ruiné ; l’assignat exerçait ses ravages. Poursuivre la révolution devenait une besogne terrible. Le comité tenta l’impossible. Il fit distribuer de l’argent aux mendiants, aux infirmes, aux invalides. Saint-Just s’écriait : « Il ne faut ni riches, ni pauvres ! » Il avait conçu tout un plan de réformes hardies, dans le sens communiste. Mais la guerre, la terreur, l’incompréhension des foules ne lui permirent pas de l’appliquer.
La question religieuse était aussi à l’ordre du jour. C’est par là que Robespierre tombera. Déjà, il s’était élevé contre les tentatives des hébertistes de déchristianiser la France. Il se prononçait pour la liberté des cultes et s’élevait contre les fêtes organisées à la gloire de la déesse Raison. Tout ce qu’il y avait d’athées, de matérialistes, de fils de Voltaire ne pardonnèrent point à ce disciple de Rousseau. La faiblesse de Robespierre, c’est, qu’on le veuille ou non, son esprit religieux. Cela le mène à la fameuse fête de l’Être suprême où, président de la Convention, tout-puissant, redouté de chacun, il apparaît un peu comme le tyran.
Peu à peu, une coalition se forma contre Robespierre. Les représentants en province, qui se sentaient devinés et craignaient pour leur vie – les Fouché, les Tallien, les Freron –, agirent les premiers dans l’ombre. Puis, au comité même, Robespierre, tranchant et dominateur, indisposait ses collègues. On était las de voir la République gouvernée par cet homme qui incarnait la probité et voulait faire régner la vertu. Carnot s’élevait furieusement contre lui ; Billaud-Varenne le comparait au « fourbe Périclès ». Il aurait fallu un peu de doigté, quelques concessions apparentes pour revenir à l’union, car tous sentaient que cet homme était indispensable. Mais Robespierre demeurait intraitable.
Pendant ce temps, la guillotine fonctionnait à plein rendement. La Terreur parvenait à son apogée. Le 22 prairial, Couthon, inspiré par Robespierre, faisait supprimer les défenseurs, devant le tribunal révolutionnaire, ainsi que les interrogations des accusés. Les preuves morales pouvaient suffire pour obtenir la condamnation. Robespierre soutint cette loi à la Convention. On croit rêver, aujourd’hui, quand on lit les exposés des motifs de cette loi. Mais, encore une fois, c’était la bataille. Robespierre était, sans cesse, menacé d’assassinat. Un certain Admiral, qui n’avait pu le joindre, avait atteint Collot d’Herbois. Une jeune fine, Cécile Renaud, avait tenté de le tuer à domicile. On conspirait contre le comité et contre lui. La situation était tragique. Dans l’esprit des robespierristes, il ne s’agissait plus de justice, mais de défense personnelle, cette défense étant aussi celle de la République.
Cependant, sans les violentes disputes qui éclataient au comité et dont les répercussions gagnaient au dehors, les conjurés – dantonistes rescapés, Girondins épargnés, représentants en mission, enrichis et profiteurs de la révolution – n’auraient pas eu gain de cause. Le peuple était avec Robespierre, Saint-Just, Couthon... Robespierre eut le tort de ne pas voir le péril. Il fit pire. Il s’absenta du comité, à partir du 15 messidor. Pendant son absence, alors qu’il ne voyait plus rien, ne signait plus rien, ses ennemis, habilement, lui attribuèrent les mesures ultra-révolutionnaires. On répandit le bruit que Robespierre voulait guillotiner la Convention pour devenir le maître absolu. Le malheureux, à ce moment, malade, épuisé, découragé, ne s’occupait de rien.
Les prisons se vidaient et se remplissaient aussitôt. On tuait par fournées. Partout, des centaines de têtes tombaient. Le dégoût commençait à envahir la foule. Robespierre, réfugié aux Jacobins, se sentait impuissant ; mais c’était lui qu’on s’efforçait de rendre responsable.
Nous approchons du 9 Thermidor.
Saint-Just est revenu des armées, rapportant la victoire de Fleurus, Robespierre décide de sortir de sa retraite et de prendre l’offensive. Il lui faut encore épurer, débarrasser la République d’un certain nombre de coquins. Loi des révolutions ! Le 8 thermidor, Robespierre monte à la tribune de la Convention et prononce un réquisitoire sévère contre ses adversaires atterrés. Malheureusement, ils se ressaisirent promptement. Vadier essaya de ridiculiser Robespierre, avec les histoires de Catherine Théot. Cambon intervint. Billaud se prononça contre son collègue au comité. Le discours de Robespierre, dont on avait voté l’impression d’abord, fut rejeté.
Le 9, Saint-Just voulut lire son rapport, habilement préparé. Tallien l’interrompit et l’empêcha de parler. Billaud, violemment, accusa Robespierre. Celui-ci essaya de répondre. On ne le lui permit pas. Sa voix fut étouffée. Le misérable Tallien, amant de la Cabarrus, brandissait un poignard dans un geste théâtral. Finalement, Robespierre fut vaincu et décrété d’arrestation, avec Saint-Just, impassible, Couthon, Lebas, Robespierre jeune.
Mais quand Paris apprit les événements, ce fut un sursaut de colère. La Commune fait sonner la « générale », fermer les barrières. Hanriot se met à la tête de ses gendarmes, force le local du comité de Sûreté générale. Il n’a que trop peu d’hommes, par malheur, avec lui. Il est arrêté à son tour. Coffinhal ira le délivrer. Pendant ce temps, Robespierre et ses amis sont conduits en prison. Il apparaît que l’idée de Robespierre était de se présenter devant le tribunal révolutionnaire, peuplé de ses partisans. Il comptait être acquitté, comme autrefois Marat. Ses fidèles l’arrachèrent à la prison, le conduisirent à l’Hôtel de Ville où il retrouva ses amis.
Là, les robespierristes perdirent leur temps à discuter sur les moyens à employer. Ils avaient pour eux, pourtant, la majorité des sections. La Convention, apeurée, ne savait quelle décision prendre et Collot parlait de « mourir à son poste ». Les heures passèrent ainsi. À la nuit, la place de l’Hôtel de Ville était presque vide. Barras se met à la tête des troupes fidèles à la Convention et envahit brusquement l’Hôtel de Ville.
Robespierre se tira un coup de pistolet dans la tête et ne réussit qu’à se briser la mâchoire inférieure. Lebas se tua net. Robespierre jeune se jeta par la fenêtre.
Tous les survivants furent guillotinés, sur seule constatation de leur identité. Le lendemain, on exécuta 70 membres de la Convention. La tyrannie était abattue. Mais la révolution était close.
Avec Robespierre et ses amis, c’était le dernier rempart de la révolution qui s’écroulait. Ces hommes dont, malgré leurs erreurs, on ne peut nier la grandeur d’âme, le courage surhumain, la noblesse d’idées, avaient voulu conduire la révolution jusqu’à son terme, en la débarrassant des aventuriers et des forbans qui ne songeaient qu’à s’enrichir par le vol, le pillage, le chantage ; ils avaient rêvé l’égalité des droits et des fortunes ; ils se sacrifiaient pour les petits, pour les pauvres. C’étaient, en somme, des gêneurs. Trop d’honnêteté était en eux et l’on sait qu’on trouva à peine quelques assignats chez Robespierre, le tyran, le maître de la France.
Le 9 thermidor marque la fin de la révolution. Mais la terreur continue. Elle a changé d’objet, simplement. Les brigands triomphent, comme l’a dit Robespierre. Les riches respirent ; ils l’ont échappé belle. Et les prisons sont ouvertes d’où se précipitent royalistes, Girondins, contre-révolutionnaires. Les vrais révolutionnaires, tels que Collot, Billaud-Varenne, commencent à comprendre quelle sottise criminelle ils ont commise. Ils se voient, à leur tour, menacés. Plus tard, ils diront leurs remords. Barère avouera qu’on a tué la République en tuant Robespierre ; Billaud, de même.
La République égalitaire a vécu. Ce sont, désormais, les muscadins qui tiendront le haut du pavé. La réaction triomphe. Les flibustiers enrichis étalent leur arrogance. Ils seront, plus tard, fonctionnaires et préfets de l’Empire. Quant aux sans-culottes qui, par incompréhension et dépit contre les mesures de la Commune, ont laissé faire, ils sentiront la trique leur caresser les reins. Ils s’obstinaient contre le maximum ; ils le réclameront en vain par la suite.
La plupart des Montagnards, dressés contre Robespierre, bourrés de regrets, iront, dans une dernière tentative contre la république des riches et des « ventres pourris », se grouper derrière Babeuf, vaincu et immolé à son tour. De ce nombre, Amar, le plus perfide adversaire de Robespierre.
En résumé, cette révolution de cinq années, en dépit des luttes sanglantes entre frères ennemis et du sang qu’elle a dû faire verser, a accompli une besogne incalculable. Ceux qu’on n’a pas craint d’appeler des vandales ont fondé la civilisation sur les ruines d’une monarchie vermoulue. Son rayonnement s’est étendu à tout l’univers. Et le demeure, à travers les années écoulées, le guide sûr des hommes de liberté et de progrès. Elle a eu ses déchets et ses erreurs. Elle a été détournée de sa voie féconde par des adversaires sans scrupule. Elle a malheureusement abouti à l’orgie sanglante de l’Empire qui a, tout de même, fait un peu plus de victimes que la Terreur. Mais il faut la voir dans son ensemble. Aux révolutionnaires d’aujourd’hui de lui emprunter, en tenant compte de l’heure et des tâtonnements inévitables, tout ce qu’elle a comporté d’humain, de généreux, de noble, et de s’inspirer de ses inoubliables leçons.
— Victor MÉRIC.
On lira avec profit et en vue d’une documentation complète les ouvrages que voici :
Histoire des Montagnards, d’Alphonse Esquiros ; Histoire de Robespierre, d’Ernest Hamel ; Histoire socialiste de la Révolution, de Jaurès ; La Révolution française ; Danton et la paix ; Études robespierristes ; Un procès de corruption sous la Terreur (Affaire de la Compagnie des Indes) ; Autour de Robespierre, Autour de Danton, La Vie chère et le Mouvement social sous la Terreur, d’Albert Mathiez ; Histoire de la Révolution, de Villiaume ; Les orateurs de la révolution ; Histoire politique de la Révolution, par Aulard, etc.
LA RÉVOLUTION RUSSE
Quelques notes préliminaires indispensables :
-
On peut comprendre sous Révolution russe, soit le mouvement révolutionnaire entier, depuis la révolte des Dékabristes (1825) jusqu’à nos jours, soit seulement les deux révolutions consécutives de 1905 et de 1917, soit enfin, uniquement, la grande explosion de 1917. Dans l’exposé qui va suivre, Révolution russe signifiera le mouvement tout entier (première interprétation). En effet, cette méthode est la seule qui permettra au lecteur de comprendre, autant que possible, la suite des événements, et aussi la situation actuelle en U.R.S.S.
-
Il va de soi qu’une étude quelque peu complète de la Révolution russe exigerait plus d’un volume. Elle ne pourrait être qu’une œuvre de longue haleine réservée surtout aux historiens de l’avenir. Il ne s’agit ici que d’une étude sommaire dont le but sera : a) de faire comprendre l’ensemble du mouvement ; b) de mettre bien en relief ses traits saillants, ses faits essentiels et, surtout, ses éléments peu ou pas connus jusqu’à présent à l’étranger ; c) de formuler certaines conclusions ou appréciations.
-
Une difficulté considérable consiste dans le caractère très particulier de l’histoire russe en général, comparativement à celle de l’Europe occidentale. À vrai dire, l’examen de la Révolution russe devrait être précédé d’une étude historique générale du pays ou, mieux encore : encadré dans cette étude. Mais une pareille tâche dépasserait de beaucoup les limites de notre exposé. Nous essayerons donc, pour parer à ladite difficulté, d’apporter au lecteur des notions historiques d’ordre général toutes les fois que cela nous paraîtra nécessaire.
LA RUSSIE AU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE.
LES « DÉKABRISTES ». — LA LÉGENDE DU TSAR ET LE PARADOXE RUSSE.
L’immensité démesurée du pays (comme on sait, la Russie occupe seule la sixième partie du continent terrestre), une population clairsemée, désunie et d’autant plus facile à subjuguer, la domination mongole pendant plus de deux siècles, des guerres interminables, des troubles, et aussi d’autres facteurs moins importants, furent la cause d’un fort retard politique, économique, social et culturel de la Russie, par rapport à d’autres pays d’Europe. Politiquement, la Russie entra dans le XIXe siècle sous le régime d’une monarchie absolue et absurde (tsar autocrate), s’appuyant sur une aristocratie militaire et foncière, sur un clergé nombreux et dévoué, et sur une masse paysanne de plus de 100 millions d’âmes, masse illettrée, primitive, religieuse et entièrement fidèle à son « petit père », le tsar. — Économiquement, le pays se trouvait à cette époque au stade d’une sorte de féodalisme agraire. Les villes, à part les deux capitales (Saint-Pétersbourg, Moscou) et quelques autres dans le Midi, étaient peu développées. Le commerce et surtout l’industrie végétaient. La véritable base de l’économie nationale était l’agriculture, dont vivaient les 90 % de la population. Mais la terre n’appartenait pas aux producteurs directs : les paysans ; elle était la propriété soit de l’État, soit de gros propriétaires fonciers, les « pomestchiks ». Les paysans, obligatoirement attachés à la terre et à la personne du propriétaire, étaient les serfs de celui-ci. Les plus gros agrairiens possédaient de vrais fiefs hérités de leurs aïeux qui, eux-mêmes, les reçurent du souverain, premier propriétaire, en reconnaissance des services rendus (militaires, administratifs ou autres). Le « seigneur » avait le droit de vie et de mort sur ses serfs. Non seulement, il les faisait travailler en esclaves, mais il pouvait les vendre, punir, martyriser (et même tuer, presque sans inconvénient pour lui)
Ce servage, cet esclavage de 100 millions d’hommes, formait le fondement économique de « l’État ». C’est à peine s’il est possible de parler d’une organisation sociale d’une telle soi-disant « société ». En haut, les maîtres absolus : le tsar, toute sa parenté, sa cour, la haute bureaucratie, la caste militaire, le haut clergé, la noblesse foncière ou autre, etc. En bas, les esclaves : paysans serfs de la campagne, et le bas peuple des villes, n’ayant aucune notion de vie civique, aucun droit, aucune liberté. Entre les deux : quelques couches intermédiaires (marchands, fonctionnaires, employés, artisans, etc.), incolores et insignifiantes. Il est clair que le niveau de culture de cette société était peu élevé. Toutefois, pour cette époque déjà, une réserve importante s’impose : un contraste frappant dont nous aurons encore à parler – existait entre la simple population rurale ou urbaine, inculte et misérable, et les couches privilégiées dont l’éducation et l’instruction étaient assez élevées.
L’état de servage des masses paysannes était la plaie saignante du pays. Déjà, vers la fin du XVIIIe siècle, quelques hommes d’un esprit noble et élevé protestèrent contre cette horreur. Ils durent payer cher leur généreux geste. D’autre part, les paysans se révoltaient de plus en plus fréquemment contre leurs maîtres. À part les nombreuses révoltes locales, d’une allure plus ou moins individuelle, les masses paysannes esquissèrent même, au XVIIe siècle (révolte de Rasine) et au XVIIIe siècle (révolte de Pougatchoff), deux mouvements révolutionnaires d’envergure qui, tout en ayant échoué, causèrent de forts ennuis au gouvernement tsariste et faillirent ébranler tout le système. Il faut dire, cependant, que ces deux mouvements, spontanés et inconscients, furent dirigés surtout contre l’ennemi immédiat : la noblesse foncière, l’aristocratie urbaine et les administrations vénales. Aucune idée générale, cherchant à supprimer le système social entier pour le remplacer par un autre, plus juste et plus humain, ne fut formulée. Et, par la suite, le gouvernement réussit, avec l’aide du clergé et d’autres éléments réactionnaires, à subjuguer les paysans d’une façon complète, c’est-à-dire, même psychologiquement, de sorte que toute action de révolte plus ou moins vaste devint pour longtemps impossible.
Le premier mouvement sciemment révolutionnaire contre le régime – mouvement dont le programme allait, socialement, jusqu’à l’abolition du servage et, politiquement, jusqu’à la république ou, au moins jusqu’au régime constitutionnel – se produisit en 1825, au moment où, l’empereur Alexandre Ier étant mort sans laisser d’héritier direct, la couronne, repoussée par son frère Constantin, allait se poser sur la tête de l’autre frère, Nicolas.
Le mouvement sortit non pas des classes opprimées elles-mêmes, mais des milieux privilégiés. Les conspirateurs, profitant de ces hésitations dynastiques, mirent à exécution leurs projets mûris et préparés de longue date. Ils entraînèrent dans la révolte qui éclata à Saint-Pétersbourg quelques régiments de soldats. La rébellion fut brisée après un court combat entre les révolutionnaires et les troupes restées fidèles au gouvernement, sur la place du Sénat. Quelques troubles esquissés en province furent étouffés dans le germe. Les cinq principaux animateurs du mouvement périrent sur l’échafaud ; des centaines d’autres allèrent en prison, en exil ou au bagne. L’émeute ayant eu lieu au mois de décembre (en russe dékabre, les réalisateurs de ce mouvement furent nommés dékabristes (ceux de décembre). Presque tous, ils appartenaient à la noblesse ou aux classes privilégiées (il y avait à la tête du mouvement quelques officiers de l’armée impériale). Presque tous, ils avaient reçu une éducation et une instruction supérieures. Esprits élevés, cœurs nobles, ils souffraient de voir leur peuple sombrer, sous un régime d’injustice et d’arbitraire, dans l’ignorance, la misère et l’esclavage. Ils reprirent les protestations platoniques de leurs précurseurs du XVIIIe siècle et les traduisirent en actes. Ce qui, surtout, leur fournit l’élan indispensable, ce fut la visite de plusieurs d’entre eux en France, après la guerre de 1812, et la possibilité de comparer ainsi le niveau relativement élevé de la civilisation en Europe avec l’état barbare de la vie populaire russe. Ils rentrèrent dans leur pays avec la ferme décision de lutter contre le système politique et social arriéré qui opprimait leurs compatriotes. Ils gagnèrent à leur cause plusieurs esprit cultivés. L’un des leaders du mouvement, Pestel, exprima même dans son programme quelques idées vaguement socialistes. Le célèbre poète Pouchkine (né en 1799) sympathisait avec le mouvement, sans toutefois y adhérer. Restée tout à fait locale, la révolte fut vite maîtrisée, et le nouvel empereur Nicolas Ier, apeuré, poussa à l’extrême le régime despotique, bureaucratique et policier de l’État russe.
REMARQUE IMPORTANTE.
Il est indispensable de souligner ici même qu’il n’y avait aucune contradiction entre quelques mouvements de révolte des paysans contre leurs maîtres et oppresseurs, d’une part, et leur vénération aveugle et dévouée pour le « petit père le tsar », d’autre part. En effet, les mouvements paysans se dirigeaient toujours contre leurs oppresseurs immédiats : les propriétaires (« pomestchiks »), les nobles, les fonctionnaires, la police. L’idée de chercher le fond du mal plus loin, dans le régime tsariste lui-même personnifié par le tsar, l’idée de voir en ce dernier l’ennemi principal, le grand protecteur des nobles et des privilégiés, premier noble et privilégié lui-même, ne venait jamais à l’esprit des paysans. Au contraire, ils considéraient le tsar comme une sorte d’idole, d’être supérieur placé au-dessus des simples mortels, de leurs petits intérêts et faiblesses, pour mener à bon port les graves destinées de l’État. Ils étaient inébranlablement convaincus que le tsar ne leur voulait – à eux, ses « enfants » – que du bien, mais que les couches intermédiaires privilégiées, intéressées à conserver leurs droits et avantages, s’interposaient entre le monarque et son peuple, afin d’empêcher le premier de connaître exactement les misères du second, afin – surtout – de les empêcher tous les deux de venir l’un à l’autre. Ils étaient persuadés que si le peuple et le tsar parvenaient à s’aboucher directement, ce dernier, momentanément trompé par les privilégiés, se pencherait sur les misères des paysans, les libérerait et leur donnerait la terre. Aussi, tout en se révoltant, parfois – plutôt individuellement –, contre leurs maîtres immédiats les plus cruels, les paysans attendaient, avec espoir et résignation, le jour où le mur dressé entre eux et le tsar serait tombé et la justice sociale rétablie par ce dernier. Le mysticisme religieux aidant, ils considéraient la période d’attente et de souffrance comme imposée par « Dieu » en guise de châtiment et d’épreuve. Ils s’y résignaient avec une sorte de fatalisme primitif.
Cet état d’esprit des masses paysannes russes était extrêmement caractéristique. Il s’accentua encore au cours du XIXe siècle, en dépit d’un mécontentement croissant et des actes de révolte individuels ou locaux de plus en plus fréquents. Les paysans perdaient patience. Néanmoins, en leur masse, ils attendaient, avec d’autant plus de ferveur, le tsar libérateur.
Cette « légende du tsar » fut le fait essentiel de la vie populaire russe au XIXe siècle. En l’ignorant, on n’arriverait jamais à comprendre les événements qui vont suivre.
La légende du tsar nous expliquera certains phénomènes importants de la vie russe, lesquels, autrement, resteraient mystérieux. D’ores et déjà, elle nous explique, pour une bonne part, ce paradoxe essentiellement russe auquel nous venons de faire allusion, qui, jadis, frappa l’esprit de beaucoup d’Européens, et qui continuera presque jusqu’aux abords de la révolution de 1917 : d’une part, nombre de gens cultivés, instruits, avancés, qui veulent voir leur peuple libre et heureux ; gens, qui, à la page de l’époque, luttent même pour l’émancipation totale des classes laborieuses, pour la démocratie et le socialisme ; d’autre part, ce peuple lui-même qui ne fait rien pour son émancipation (à part quelques révoltes spontanées, sans envergure ni importance) ; peuple qui reste obstinément prosterné devant son idole et son rêve ; peuple qui ne comprend même pas le geste de ceux qui se sacrifient pour lui.
LES ANNÉES 1825–1860.
Aucun mouvement important n’est à signaler jusqu’aux années 1860. Toutefois, quelques traits saillants sont à noter :
-
Le renforcement progressif du régime absolutiste, de l’État bureaucratique et policier, sons Nicolas Ier (1825–1855) ;
-
Le mécontentement grandissant des masses paysannes et le nombre de plus en plus élevé d’actes de rébellion contre les « pomestchiks » ;
-
L’essor assez rapide et considérable de l’industrie et de l’enseignement (un certain progrès technique ; amélioration des voies de communication ; premier chemin de fer, reliant Saint-Pétersbourg à Moscou ; création de nombreuses écoles, etc.).
-
L’évolution rapide et importante de la couche intellectuelle. Dans un pays aussi grand que la Russie, la jeunesse était nombreuse dans toutes les classes de la population, et son nombre augmentait vite. Quelle était sa mentalité en général ? Laissant de côté la jeunesse paysanne, nous avons à constater que les jeunes générations plus ou moins éduquées professaient des idées avancées. Les jeunes du milieu du XIXe siècle admettaient difficilement l’esclavage des paysans. L’absolutisme les choquait aussi de plus en plus. L’étude du monde occidental donna l’éveil à leur pensée. L’essor des sciences naturelles et du matérialisme les impressionna fortement. D’autre part, ce fut vers la même époque que la littérature russe, s’inspirant des principes humanitaires et généreux, prit son grand élan, en exerçant une influence puissante sur la jeunesse. En même temps, économiquement, le travail des serfs ne répondait plus aux exigences de l’époque, ce dont on se rendait compte aisément. Pour toutes ces raisons, la couche intellectuelle – la jeunesse, surtout – se révéla, vers les années 1860, théoriquement émancipée. Elle se dressa contre l’absolutisme et contre le servage. Ce fut alors que naquit le fameux courant du nihilisme (voir ce mot) et, du même coup, le conflit aigu entre « les pères et les fils » – les deux générations successives – peint magistralement par Tourgueniev, dans son roman paru sous le même titre.
Le gouvernement de Nicolas Ier, réactionnaire à outrance, se refusait à tenir compte des réalités et de l’effervescence des esprits. Au contraire, il lança un défi à la société. En effet, c’est à cette époque que furent créés la police politique, le corps spécial de gendarmerie, etc., afin de mater le mouvement. Les persécutions politiques prirent libre cours ; la censure sévissait. Rappelons-nous qu’à cette époque, le jeune Dostoïevski faillit être exécuté – et alla au bagne – pour avoir adhéré au groupe d’études sociales, absolument inoffensif, de Petrachevski ; que le premier grand publiciste et critique russe, Belinski, arrivait avec grande peine à faire entendre sa voix ; qu’un autre grand publiciste, Herzen, dut s’expatrier ; et ainsi de suite, sans parler des révolutionnaires accomplis, tels que Bakounine et autres. Toute cette répression ne réussit guère à apaiser l’excitation dont les causes étaient trop profondes. Elle réussit encore moins à améliorer la situation. En guise de remède, Nicolas Ier serrait de plus en plus la vis bureaucratique. Sur ces entrefaites, la Russie fut entraînée dans la guerre de Crimée. Les péripéties de cette guerre ont démontré avec évidence la faillite du régime. Les plaies politiques et sociales furent mises à nu. Nicolas Ier mourut en 1855, parfaitement conscient de cette faillite, mais impuissant à y faire face, On peut supposer que la dépression morale qui en résulta précipita sa mort.
LES ANNÉES 1860–1881.
LES RÉFORMES. — UN NOUVEAU MOUVEMENT RÉVOLUTIONNAIRE. — LA « NARODNAÏA VOLIA ». — L’ASSASSINAT DU TSAR. — L’ABSOLUTISME, LA LÉGENDE ET LE PARADOXE SURVIVENT.
Ce fut son fils et successeur, l’empereur Alexandre II, qui dut faire face à la situation. Le mécontentement général, la pression des couches intellectuelles et avancées, la peur d’un soulèvement des masses paysannes et, enfin, les désavantages économiques du régime de servage, l’obligèrent, malgré une résistance acharnée des milieux réactionnaires, à prendre résolument la voie des réformes. Il se décida à mettre fin au régime purement bureaucratique et à l’arbitraire absolu des pouvoirs administratifs. Il entreprit une modification sérieuse de tout le système judiciaire. À partir de l’année 1860, les réformes se succédèrent d’une façon ininterrompue. Les plus importantes furent l’abolition totale du servage (1861) et la création, dans les villes et à la campagne, des unités d’auto administration locale (le gorodskoïé samooupravlénié et le zemstvo, sortes de municipalités urbaines et rurales), avec droit de self-government dans certains domaines de la vie publique (enseignement, hygiène, voies de communication, etc.).
Tout en étant importantes par l’apport à la situation de la veille, les réformes d’Alexandre II restèrent néanmoins bien timides et très incomplètes, par rapport aux aspirations des couches avancées. Elles furent loin de donner satisfaction à la société. En effet, la presse resta muselée comme auparavant ; aucune liberté civique ne fut octroyée ; la classe ouvrière naissante n’avait aucun droit civil ; la noblesse et la bourgeoisie restèrent les classes nettement dominantes ; et, surtout, l’absolutisme politique resta intact. Mais le point le plus faible des réformes fut les conditions dans lesquelles le servage a été aboli. Les gros propriétaires fonciers, après avoir vainement lutté contre toute atteinte à la loi du servage, firent leur possible pour que cette réforme fût réduite au minimum. Ils y réussirent pleinement. Les paysans obtinrent leur liberté individuelle, mais ils durent la payer cher. Ils reçurent des lots de terrain tout à fait insuffisants. De plus, ils furent astreints à payer, pendant plusieurs dizaines d’années, et à part les contributions d’État, une forte redevance aux anciens seigneurs pour les terres aliénées. Il est à noter que les 100 millions de paysans reçurent en tout à peu près le tiers du sol. L’autre tiers fut gardé par l’État. Et un tiers environ resta entre les mains des propriétaires fonciers. Une telle proportion condamnait la masse paysanne à une existence de famine et la maintenait, au fond, à la merci des « pomestchiks ».
Les insuffisances et les défauts des réformes d’Alexandre II se firent sentir déjà vers les années 1870. La vie de la vaste masse paysanne était misérable. La population laborieuse des villes restait sans défense contre l’exploitation croissante. L’absence de toute liberté de la presse et de la parole, ainsi que l’interdiction absolue de tout groupement politique ou social, rendaient impossibles toute circulation d’idées, toute critique, toute propagande, toute activité politique ou sociale, donc, au fond, tout progrès de la société. La population ne consistait qu’en des « sujets » soumis à l’arbitraire de l’absolutisme et n’ayant aucun droit de protester, de réclamer, ou de vouloir changer cet état de choses. Et quant à la masse paysanne, elle était plutôt un troupeau de bêtes de somme réduit à une existence obscure, à une ignorance totale et à la corvée de nourrir l’État.
Les meilleurs représentants de la jeunesse intellectuelle se rendirent rapidement compte de cette situation lamentable. Ceci d’autant plus que les pays occidentaux jouissaient déjà, à cette époque, d’un régime politique et social relativement avancé. Aux années 1870, l’Europe occidentale se trouvait en pleines luttes sociales, le socialisme commençait sa propagande intense, et le marxisme abordait la tâche d’organiser la classe ouvrière en un puissant parti politique.
Il est donc tout à fait naturel que, vers cette époque, des groupements clandestins se soient formés en Russie pour lutter contre le régime abject et, avant tout, pour répandre dans les classes laborieuses l’idée de l’affranchissement politique et social. Ces groupements se composaient d’une jeunesse ardente, des deux sexes, qui, éduquée par les meilleurs publicistes russes (malgré la censure, ces derniers réussissaient tout de même à propager leurs idées au moyen d’articles de revues écrits d’une manière, en quelque sorte, conventionnelle), et aussi par le mouvement d’idées à l’étranger, se consacrait entièrement, avec un esprit sublime de sacrifice, à la tâche de porter la lumière aux masses travailleuses. Ce fut alors que se forma ce vaste mouvement de la jeunesse russe intellectuelle, laquelle, en nombre considérable, abandonnant famille, confort et carrière, s’élança « vers le peuple » afin de l’éclairer. D’autre part, une certaine activité terroriste contre les principaux serviteurs du régime prit son essor. Entre 1870 et 1880, quelques attentats eurent lieu contre de hauts fonctionnaires. Il y eut aussi des attentats échoués contre le tsar.
Le mouvement aboutit à une catastrophe. Presque tous les propagandistes furent repérés par la police, arrêtés et envoyés en prison, en exil ou au bagne. Le résultat pratique de l’entreprise fut nul.
Il devint évident que le tsarisme présentait un obstacle insurmontable à l’éducation du peuple. De là, il n’y avait qu’un pas jusqu’à la conclusion logique que voici : puisque le tsarisme est un obstacle insurmontable, il faut commencer par le supprimer.
Cette conclusion poussa la jeunesse meurtrie, désespérée, à la formation d’un groupement qui se donna pour but l’assassinat du tsar. Deux éléments appuyèrent cette décision :
-
l’idée de châtier « publiquement » l’homme qui, par ses prétendues « réformes », ne fit que duper les masses ; donc, l’idée de pouvoir dévoiler la duperie devant les masses, en attirant leur attention là-dessus par un acte de châtiment violent, formidable ;
-
l’espoir de pouvoir, en même temps, démontrer au peuple, par la suppression du tsar lui-même, la fragilité, la vulnérabilité, le caractère commun, fortuit et passager du régime. En somme, on espérait pouvoir tuer ainsi, une fois pour toutes, « la légende du tsar ». Certains membres du groupement allaient même plus loin encore : ils admettaient que l’assassinat du tsar pourrait servir de point de départ à une vaste révolte, laquelle, le désarroi aidant, aboutirait à une révolution et à la chute immédiate du tsarisme.
Le groupement prit le nom de Narodnaïa Volia (Volonté du Peuple). Après une minutieuse préparation, il exécuta son projet : le 1er mars 1881, le tsar Alexandre II fut assassiné.
Le geste resta incompris. Les paysans, fascinés depuis plus d’un siècle par l’idée que le tsar ne leur voulait que du bien, et que la noblesse s’opposait par tous les moyens à ses bonnes intentions – ils en voyaient une preuve de plus dans l’obligation de payer une lourde redevance pour leurs lots de terrain, obligation qu’ils attribuaient aux intrigues de la noblesse –, accusèrent cette dernière d’avoir assassiné le tsar pour venger l’abolition du servage.
Le tsar fut assassiné, non pas la légende. Le lecteur verra plus loin par quelle sorte d’événements l’histoire s’était chargée de détruire celle-ci.
D’autre part, la cour ne manifesta pas tant de désarroi. Le jeune héritier, Alexandre (fils aîné de l’empereur assassiné), prit immédiatement le pouvoir. Les chefs du parti Narodnaïa Volia furent exécutés. Des mesures de répression très sévères réduisirent le parti entier à une impuissance complète. Le nouvel empereur, Alexandre III, vivement impressionné par l’attentat, reprit le chemin de la réaction violente. Les réformes – déjà si insuffisantes – de son prédécesseur lui parurent, au contraire, plus qu’osées : il les jugea déplacées, dangereuses. Il mit à profit le meurtre de son père pour les combattre.
Il s’employa à détériorer leur esprit, à contrecarrer leurs effets par une série de lois réactionnaires. L’État bureaucratique et policier reprit ses droits. Tout mouvement libéral fut étouffé. Les masses furent condamnées à rester dans leur situation d’obscur troupeau, bon à exploiter, privé de tous droits humains. Le « paradoxe russe » – c’est-à-dire le fossé insondable entre le niveau de culture et les aspirations des couches éduquées, d’une part, et l’existence sombre et inconsciente du peuple, d’autre part – resta intact. Dans ces conditions, l’activité révolutionnaire allait fatalement renaître. C’est ce qui arriva bientôt, en effet. Mais, cette fois, l’aspect et l’essence même de cette activité changèrent totalement.
LA FIN DU XIXe SIÈCLE (1881–1900).
LE NOUVEL ASPECT DU MOUVEMENT RÉVOLUTIONNAIRE : LE MARXISME ET LE PARTI SOCIAL-DÉMOCRATE. — LES PROGRÈS CULTURELS. — L’ESSOR INDUSTRIEL. — L’ABSOLUTISME ET LA RÉACTION S’AFFIRMENT, EN DÉPIT DE TOUTE CETTE ÉVOLUTION.
En plus de l’échec du parti Narodnaïa Volia dans sa campagne violente contre le tsarisme, d’autres événements contribuèrent surtout à la transformation fondamentale du mouvement révolutionnaire russe après 1881. Le plus important fut l’apparition du marxisme. Comme on sait, ce dernier apporta une conception nouvelle des luttes sociales, conception qui aboutit à un programme concret d’action révolutionnaire et à la formation, dans les pays de l’Europe occidentale, d’un parti politique ouvrier dit parti social-démocrate. Tout en étant interdits en Russie, les idées de Lassalle, le marxisme et ses résultats concrets y furent connus, étudiés, prêchés et appliqués clandestinement. De plus, la littérature russe trouva bientôt le moyen de s’occuper du socialisme, en employant un langage un peu camouflé. C’est à cette époque que prirent leur élan les fameuses « grosses revues » russes, où collaboraient les meilleurs journalistes et publicistes, pour y passer régulièrement en revue les problèmes sociaux, les doctrines socialistes et les moyens de les appliquer. L’importance de ces publications fut exceptionnelle. Aucune famille intellectuelle ne pouvait s’en passer. Dans les bibliothèques, il fallait se faire inscrire d’avance pour avoir à tour de rôle le numéro nouvellement paru. Plus d’une génération de jeunesse russe reçut son éducation sociale au moyen de ces revues, en la complétant par la lecture de toutes sortes de publications clandestines. Et c’est ainsi que l’idéologie marxiste, s’appuyant uniquement sur l’action organisée du prolétariat, vint remplacer les aspirations déçues des cercles conspirateurs d’autrefois.
Le second événement, d’une grande portée, fut l’évolution de plus en plus rapide de l’industrie et de la technique, avec ses conséquences fatales. Le réseau des chemins de fer, les autres voies et moyens de communication, la production minière, l’exploitation du naphte, l’industrie métallurgique, textile, mécanique, etc., tout cet ensemble d’activité productrice se développait à grands pas, rattrapant le temps perdu, Des régions industrielles surgissaient par-ci par-là, à travers le pays. Beaucoup de villes changeaient rapidement d’aspect, avec leurs usines neuves et une population ouvrière de plus en plus nombreuse. Cet essor industriel était vastement alimenté eu main-d’œuvre par des masses considérables de paysans miséreux, obligés, soit d’abandonner à jamais leurs parcelles de terre insuffisantes, soit de chercher du travail complémentaire pendant la saison d’hiver. Comme partout ailleurs, évolution industrielle signifiait, en même temps, évolution de la classe prolétarienne. Et, comme partout, celle-ci venait à point pour former les cadres principaux du mouvement révolutionnaire futur.
Ainsi, la diffusion des idées marxistes, d’une part, et la naissance du prolétariat industriel sur lequel le marxisme comptait s’appuyer, d’autre part, tels furent les éléments fondamentaux qui déterminèrent le nouvel aspect du mouvement révolutionnaire.
L’instruction publique suivait aussi une ligne ascendante. Les progrès de l’industrie, le niveau de plus en plus élevé de la vie en général exigeaient, dans tous les domaines, des hommes instruits, des professionnels, des techniciens, des ouvriers qualifiés et lettrés. Aussi, le nombre d’écoles de tous genres, officielles, municipales et privées, augmentait sans cesse, aussi bien dans les villes qu’à la campagne. Universités, écoles supérieures spéciales, lycées, collèges, écoles primaires, cours professionnels, etc., surgissaient de toutes parts.
Toute cette évolution se faisait en dehors, et même à l’encontre du régime politique absolutiste qui s’obstinait à persister, tout en formant, sur le corps vivant du pays, une carcasse rigide, absurde et gênante. Ainsi, malgré la répression cruelle, le mouvement antimonarchiste, la propagande révolutionnaire et socialiste prenaient de l’ampleur.
Vers la fin du siècle, deux forces nettement caractérisées se dressaient l’une contre l’autre en un conflit irréconciliable : l’une était la vieille force de la réaction absolutiste qui réunissait autour du trône les classes hautement privilégiées (la noblesse, les gros propriétaires fonciers, la caste militaire, le haut clergé, etc.) ; l’autre était la jeune force révolutionnaire représentée, aux années 1890–1900, surtout par la masse d’étudiants, mais qui commençait déjà à recruter aussi la jeunesse ouvrière des villes et des régions industrielles. En 1898, le courant révolutionnaire de tendance marxiste aboutit à la formation du Parti ouvrier social-démocrate russe.
Entre ces deux forces nettement opposées, se plaçait un troisième élément qui comprenait surtout des représentants de la classe moyenne et nombre d’intellectuels de marque : professeurs à l’Université, avocats, médecins, écrivains, etc. C’était le mouvement timidement libéral. Tout en soutenant – en cachette, et avec beaucoup de prudence – l’activité révolutionnaire, ses adeptes mettaient leur foi plutôt en la voie des réformes, espérant pouvoir arracher un jour à l’absolutisme des concessions importantes et aboutir à l’avènement d’un régime constitutionnel.
L’empereur Alexandre III décéda en 1894. Il céda la place à son fils Nicolas, le dernier des Romanov. Une légende absurde prétendait que ce dernier professait justement des idées libérales. On racontait qu’il était prêt à octroyer à « son peuple » une constitution qui limiterait sérieusement le pouvoir absolu des tsars. Prenant leurs désirs pour des réalités, les représentants des couches libérales, assistant, en qualité de délégués de certains corps, à la cérémonie solennelle au palais, à l’occasion de l’avènement au trône de Nicolas II, remirent à dernier une adresse où il était question de la nécessité pressante des réformes, et où l’on trouvait même une timide allusion à l’opportunité d’un régime constitutionnel. Mais, à leur grande stupéfaction, le nouveau maître, très en colère, frappa du pied le parquet, et, criant, presque comme dans une crise d’hystérie les somma de renoncer à jamais à ces « rêveries insensées ».
LES DÉBUTS DU XXe SIÈCLE (1900–1905).
L’ÉVOLUTION RAPIDE DU PAYS CONTINUE. — L’ABSOLUTISME RESTE SUR SES POSITIONS. — LE PARTI SOCIALISTE RÉVOLUTIONNAIRE. — LES ATTENTATS. — LE MOUVEMENT RÉVOLUTIONNAIRE COMMENCE À DESCENDRE DANS LA RUE. — UNE INVENTION DU GOUVERNEMENT TSARISTE POUR CANALISER LE MOUVEMENT OUVRIER VERS UNE ACTIVITÉ « LÉGALE ».
Les phénomènes et les traits caractéristiques que nous venons de signaler, s’accentuèrent encore dès le début du XXe siècle.
D’une part, l’absolutisme, loin d’aller à la rencontre des aspirations libérales de plus en plus prononcées de la société, prit, au contraire, la décision ferme de se maintenir par tous les moyens et de supprimer, par la violence ou la ruse, non seulement tout mouvement révolutionnaire, mais aussi toute manifestation d’esprit d’opposition. Ce fut à cette époque que le gouvernement tsariste, afin de faire dévier le mécontentement grandissant de la population, eut recours, entre autres, à une forte propagande antisémite et, ensuite, à l’instigation – et même à l’organisation – des pogromes (voir ce mot) juifs.
D’autre part, l’évolution économique du pays prenait une allure de plus en plus accélérée. Dans l’espace de cinq ans, de 1900 à 1905, l’industrie et le progrès technique ont fait un bond prodigieux. La production du pétrole (bassin de Bakou), celle de la houille (bassin du Donetz), des métaux précieux, etc., se rapprochaient rapidement du niveau atteint par les pays les plus industriels. Les voies et moyens de communication (chemins de fer, traction électrique, transport fluvial maritime, etc.) se multipliaient et se modernisaient. D’importantes usines de construction mécanique et autres, employant des milliers et même des dizaines de milliers d’ouvriers, surgissaient – ou s’épanouissaient – aux environs des grandes villes. Des régions industrielles entières naissaient ou prenaient de l’extension. Citons comme exemples les grandes usines Poutiloff, les importants chantiers de construction navale Nevsky, la grande usine baltique, et plusieurs autres usines d’envergure, à Saint-Pétersbourg ; les faubourgs industriels de la même capitale, avec des dizaines de milliers d’ouvriers, tels que Kolpino, Oboukhovo, Sestroretzk, et autres ; la région industrielle d’Ivanovo-Voznessensk, sous Moscou ; de nombreuses et importantes usines dans la Russie méridionale, à Kharkow, à Ekatérinoslaw, etc. Ces progrès rapides et importants restaient généralement peu connus à l’étranger. Et cependant, comme déjà dit, leur portée fut considérable, non seulement au point de vue purement industriel, mais aussi – et surtout – au point de vue social. En s’industrialisant, le pays augmentait vite ses cadres prolétariens. D’après les statistiques de l’époque, on peut évaluer le nombre total d’ouvriers industriels en Russie, vers 1905, à 3 millions.
En même temps, le pays poursuivait son évolution rapide en matière de culture générale. Depuis 1890, l’enseignement, l’instruction et l’éducation de la jeunesse ont fait de très grands progrès. Vers 1905, il existait en Russie une trentaine d’universités et d’écoles supérieures pour hommes et femmes. Presque toutes les villes, même de peu d’importance, possédaient des lycées et des collèges de garçons et de filles. L’enseignement primaire et l’instruction des adultes se trouvaient en progression constante, les « zemstvos », les municipalités et, enfin, des particuliers s’y employant avec beaucoup de zèle. Des cours du soir pour les ouvriers, des universités populaires fonctionnaient dans toutes les grandes villes. Dans nombre de ces écoles et institutions, en dehors de l’enseignement proprement dit, une propagande d’idées avancées se poursuivait assez librement, malgré la surveillance de la police. D’ailleurs, les conférenciers et le corps enseignant se recrutaient fréquemment dans les milieux plus ou moins révolutionnaires. La pression libérale exercée un peu partout par les couches intellectuelles, était telle que le gouvernement restait impuissant à supprimer ses effets. De pair avec cette activité éducative par la parole, se développait d’une façon prodigieuse l’éducation par écrit. Une quantité incalculable de brochures populaires se rapportant à toutes les sciences, et traitant les problèmes politiques et sociaux sous un jour plus que libéral, fut lancée sur le marché. La censure s’avéra impuissante à endiguer ce flot montant. Et, d’ailleurs, les éditeurs de cette littérature étaient inépuisables dans les moyens de prêter à leurs publications une forme qui trompait la vigilance de la censure. Si nous y ajoutons la diffusion assez importante, dans les milieux intellectuels et ouvriers, d’une littérature clandestine nettement révolutionnaire et socialiste, nous arriverons à une notion exacte de ce vaste mouvement d’éducation, de culture et de préparation révolutionnaire qui caractérise surtout les années 1900–1905.
Dans la campagne, l’appauvrissement des masses paysannes à la suite du morcellement grandissant de leurs parcelles de terre, déjà insuffisantes, et, partant, leur mécontentement augmentaient rapidement. Même l’exploitation des terres en commun, le fameux mir russe, n’arrivait plus à soulager le paysan. D’ailleurs, le gouvernement d’Alexandre III et celui de son successeur firent leur possible pour réduire le mir à une simple unité administrative, étroitement surveillée par l’État, bonne surtout à récolter les impôts.
La situation politique, économique et sociale de la population ouvrière resta sans changement aux années 1900. Exposés, sans aucun moyen de défense, à l’exploitation grandissante des classes bourgeoises, n’ayant aucun droit de se concerter, de faire entendre leurs revendications, de s’organiser, de se mettre en grève, les ouvriers étaient malheureux, matériellement et moralement.
Ce fut dans ces conditions que la propagande et l’activité socialistes et révolutionnaires prirent de plus en plus d’extension, depuis 1890. Comme nous l’avons déjà dit, le marxisme, propagé clandestinement, trouva beaucoup d’adeptes, d’abord parmi la jeunesse intellectuelle, et ensuite, dans les milieux ouvriers. L’influence du parti social-démocrate, fondé en 1898, augmentait vite. Naturellement, le gouvernement tsariste sévissait contre les militants socialistes. Les prisons, les lieux d’exil et les bagnes s’emplissaient. Les procès politiques ne se comptaient plus. Mais, tout en réussissant à réduire ainsi au minimum l’activité et l’influence du parti social-démocrate, les autorités n’arrivèrent cependant jamais à les étouffer. À partir de l’année 1900, le mouvement révolutionnaire, poussé en avant surtout par la jeunesse intellectuelle et, aussi, par quelques groupements ouvriers, dans les grandes villes et dans les régions industrielles, avança à grands pas. Des troubles universitaires et ouvriers devinrent bientôt des faits divers. D’ailleurs, les universités restaient souvent fermées pendant des mois, en raison justement des troubles politiques. Mais alors, à la première occasion, les étudiants appuyés par des ouvriers, organisaient des manifestations bruyantes sur les places publiques. À Saint-Pétersbourg, la place devant la cathédrale de Kazan devint l’endroit classique des manifestations populaires auxquelles les étudiants, et aussi les ouvriers, se rendaient en entonnant des chants révolutionnaires, et, parfois, porteurs de drapeaux rouges déployés. Le gouvernement y envoyait des détachements de police et de cosaques à cheval qui nettoyaient la place à coups de sabres et de fouets (« nagaïka »).
Ajoutons que ce mouvement d’aspirations politiques et sociales était doublé d’une envolée morale remarquable. La jeunesse révolutionnaire s’émancipait, en même temps, de tous les préjugés religieux, nationaux, sexuels et autres. Sur certains points, les milieux avancés russes étaient, depuis longtemps, bien en avance, même sur les pays occidentaux. Ainsi, l’égalité des races, des sexes, l’union libre, etc., devinrent pour ces milieux des vérités acquises, voire pratiquées, depuis les nihilistes. Sous ce rapport, les meilleurs publicistes russes (Bélinski, Herzen, Tchernychevski, Debroluboff, Pissareff, Mikhaïlovski) accomplirent une œuvre de grande portée. Ils éduquèrent plusieurs générations intellectuelles russes dans le sens d’affranchissement total, ceci malgré l’influence contraire exercée obligatoirement par le système d’enseignement secondaire (lycées, collèges). Tout en subissant cet enseignement officiel imposé, la jeunesse se débarrassait de sa férule, aussitôt le diplôme nécessaire en mains.
Toutefois, pour que le lecteur ait une juste notion de la situation générale, une réserve importante s’impose à nouveau.
Le tableau que je viens de peindre est exact. Mais, en se bornant à lui seul, sans y apporter des correctifs sérieux, on risquerait de tomber dans des exagérations, d’arriver à des appréciations générales erronées et, partant, de ne pas comprendre les événements ultérieurs.
N’oublions pas, en effet, que sur la masse immense de 175 millions d’âmes, les groupes touchés par le dit mouvement d’idées ne formaient qu’une couche bien mince. Il s’agissait, en somme, de quelques milliers d’intellectuels – d’étudiants, surtout – et de la fine fleur de la classe ouvrière dans les grands centres. Le reste de la population – les innombrables masses paysannes, le gros des citadins, et même le gros de la population ouvrière – restait encore étranger, indifférent, ou même hostile, à l’agitation. Certes, les milieux avancés augmentaient assez rapidement leurs effectifs. Certes, à partir des années 1900, le nombre d’ouvriers gagnés par le mouvement révolutionnaire des villes était en croissance continue, en dépit des mesures répressives. Certes, vers cette époque, l’effervescence atteignit aussi les masses paysannes, de plus en plus appauvries et miséreuses. Mais, en même temps, la masse profonde du peuple – celle dont l’agitation détermine seule les grands changements sociaux – conservait encore sa mentalité primitive.
Le « paradoxe russe » – dont il a été question plus haut – restait à peu près intact, et la « légende du tsar » éblouissait encore des millions et des millions d’hommes. Par rapport à cette masse, le mouvement en question n’était encore qu’une petite agitation de surface. Et, dans les conditions données, tout contact entre les avant-postes, poussés très en avant, et le gros des masses, resté très en arrière, était impossible. Le lecteur devra tenir rigoureusement compte de cette particularité pour pouvoir comprendre la suite des événements.
À partir de l’année 1901, l’activité révolutionnaire s’enrichit d’un élément nouveau. À côté du parti social-démocrate, naquit le parti socialiste révolutionnaire, dont la propagande fut vite couronnée d’un succès considérable.
Trois points essentiels constituaient la différence entre les deux partis :
-
philosophiquement et sociologiquement, le parti socialiste révolutionnaire était antimarxiste ;
-
en raison de son antimarxisme, ce parti apportait au problème paysan une solution différente de celle du parti social-démocrate. Tandis que ce dernier, se basant uniquement sur la clase ouvrière, ne comptait guère sur le gros de la masse paysanne (dont il escomptait, d’ailleurs, la prolétarisation rapide), et, partant, négligeait la propagande rurale, le parti socialiste révolutionnaire croyait pouvoir gagner les masses paysannes russes à la cause révolutionnaire et socialiste. Il jugeait impossible d’attendre leur prolétarisation. Il déployait, en conséquence, une forte propagande dans la campagne. Pratiquement, le parti social-démocrate n’envisageait, dans son programme agraire immédiat, qu’une augmentation des lots de terre appartenant aux paysans, tandis que le parti socialiste révolutionnaire comprenait dans son programme minimum la socialisation immédiate et complète du sol entier ;
-
en parfaite conformité avec sa doctrine, le parti social-démocrate (qui comptait essentiellement sur l’action des masses) repoussait toute action de terrorisme, tout attentat politique, comme socialement inutile. Par contre, le parti socialiste révolutionnaire attribuait une certaine utilité politique aux attentats accomplis dans certaines conditions données. Il possédait un organisme spécial (dit « organisme de combat ») chargé de préparer et d’exécuter des attentats politiques, sous le contrôle du comité central. À part ces différences, le programme politique immédiat des deux partis était sensiblement le même : une république démocratique (bourgeoise) qui ouvrirait la route à une évolution vers le socialisme.
De 1901 à 1905, le parti socialiste révolutionnaire accomplit plusieurs attentat politiques dont quelques-uns exceptionnellement retentissants, notamment : en 1902, le membre du parti Balmacheff assassina Sipiaguine, ministre de l’Intérieur ; en 1904, un autre socialiste révolutionnaire, Sazonov, tua von Plehvé, le successeur de Sipiaguine.
À part ces deux partis politiques, il existait aussi, à cette époque déjà, un certain mouvement anarchiste. Très faible, il n’était représenté que par quelques groupements d’intellectuels et d’ouvriers, sans contact stable. Il y avait un ou deux groupes anarchistes à Saint-Pétersbourg, autant à Moscou, quelques groupements dans le Midi. Leur activité se bornait à quelque propagande, très difficile d’ailleurs, à des attentats contre les serviteurs du régime, et à des actes de « reprise individuelle ». La littérature libertaire arrivait en fraude de l’étranger. On répandait surtout les brochures de Kropotkine qui, lui-même, obligé d’émigrer après la débâcle de la Narodnaïa Volia, s’était fixé en Angleterre.
Le succès croissant de la propagande révolutionnaire, à partir de l’année 1900, inquiéta fortement le gouvernement. Ce qui le troublait surtout, c’étaient les sympathies que cette propagande gagnait de plus en plus dans la population ouvrière. Malgré leur existence illégale, donc difficile, les partis socialistes possédaient dans toutes les grandes villes des comités, des cercles de propagande, des imprimeries clandestines et des groupements ouvriers. Le parti socialiste révolutionnaire réussit à réaliser des attentats politiques. Le gouvernement jugea donc ses moyens de défense – la prison, la surveillance, la provocation, les pogromes – insuffisants. Afin de soustraire les masses ouvrières à l’emprise des partis socialistes et à toute activité révolutionnaire, il conçut un plan machiavélique qui, logiquement, devait le rendre maître du mouvement ouvrier. Il se décida à mettre sur pied des organisations ouvrières légales, autorisées, dont il tiendrait lui-même les commandes. En cas de réussite, il aurait fait d’une pierre deux coups : d’une part, il aurait attiré vers lui les sympathies de la classe ouvrière, en l’arrachant ainsi aux mains des partis révolutionnaires ; d’autre part, il pourrait guider le mouvement ouvrier là où il voudrait, le surveillant de près. Sans aucun doute, la tâche était délicate. Il fallait attirer les ouvriers dans ces organismes d’État ; il fallait tromper leur méfiance, les intéresser, les flatter, les bercer, les duper ; il fallait feindre d’aller à la rencontre de leurs aspirations... Pour réussir, le gouvernement serait même obligé d’aller jusqu’à certaines concessions d’ordre économique ou social, tout en maintenant les ouvriers à sa merci, tout en les maniant à son idée. L’exécution d’un tel programme exigeait, à la tête de l’entreprise, des hommes de confiance absolue, hommes habiles et éprouvés, connaissant bien la psychologie ouvrière et la manière de s’y rendre. Le choix du gouvernement s’arrêta sur deux hommes, agents de la police secrète (l’okhrana), qui reçurent la mission d’exécuter le projet. L’un fut Zoubatov, pour Moscou ; l’autre, l’aumônier d’une des prisons de Saint-Pétersbourg, le pope Gapone. Ainsi, le gouvernement du tsar voulut jouer avec le feu. Il ne tarda pas à s’y brûler.
LA RÉVOLUTION DE 1905.
LES « SECTIONS OUVRIÈRES » ET LE MOUVEMENT DE GAPONE. — LA LÉGENDE DU TSAR TUÉE PAR LE TSAR. — LE PREMIER GRAND MOUVEMENT DES MASSES OUVRIÈRES. — LA PREMIÈRE GRANDE GRÈVE DES OUVRIERS DE SAINT-PÉTERSBOURG. — L’ORIGINE DES « SOVIETS ». — L’EFFET FOUDROYANT DES GRAVES DÉFAITES DANS LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE. — L’EFFERVESCENCE DANS TOUS LES MILIEUX DE LA SOCIÉTÉ. — LES LIBERTÉS PRISES D’ASSAUT. — L’AGITATION DANS LA FLOTTE ET DANS L’ARMÉE. — LA GRÈVE GÉNÉRALE DE TOUT LE PAYS EN OCTOBRE 1905. — LE GOUVERNEMENT PERD PIED. — LE MANIFESTE DU 17 OCTOBRE. — LE CONTACT ENTRE LES MILIEUX AVANCÉS ET LA MASSE DU PEUPLE S’ÉTABLIT. — LE « PARADOXE RUSSE » COMMENCE À S’ÉVANOUIR.
Zoubatov, à Moscou, fut démasqué assez vite. Il ne put aboutir à de grands résultats. Mais, à Saint-Pétersbourg, les affaires marchèrent mieux. Gapone, très adroit, œuvrant à l’ombre, sachant gagner la confiance et même l’affection des milieux ouvriers, doué d’un certain talent d’agitateur et d’organisateur, réussit à mettre sur pied les soi-disant « section ouvrières » qu’il guidait en personne (en contact étroit avec ses maîtres) et qu’il animait de son activité énergique. Vers la fin de 1904, ces sections étaient au nombre de onze, dans divers quartiers de la capitale, avec quelques milliers de membres.
Le soir, les ouvriers venaient assez nombreux dans leurs sections pour y parler de leurs affaires, écouter quelque conférence, parcourir les journaux, etc. L’entrée des sections étant rigoureusement contrôlée par les ouvriers gaponistes eux-mêmes, les militants révolutionnaires ne pouvaient y pénétrer qu’à grande peine. Et même s’ils y pénétraient, ils étaient vite démasqués et mis à la porte.
Les ouvriers de Saint-Pétersbourg prirent leurs sections très au sérieux. Ils avaient entière confiance en Gapone, lui parlaient de leurs malheurs et de leurs aspirations, discutaient avec lui les moyens de faire améliorer leur situation. Fils, lui-même, d’un pauvre paysan, Gapone comprenait à merveille la psychologie de ses confidents. Il savait encore mieux feindre son approbation et ses vives sympathies au mouvement ouvrier. Telle était aussi, à peu près, sa mission officielle. La thèse que le gouvernement entreprit d’imposer aux ouvriers dans leurs sections fut celle-ci : « Ouvriers, vous pouvez arriver à améliorer votre situation, en vous y appliquant méthodiquement, et dans les formes légales, au sein de vos sections. Pour aboutir, vous n’avez aucun besoin de faire de la politique. Occupez-vous de vos intérêts personnels et immédiats, et vous arriverez bientôt à une existence plus heureuse. Les partis et les luttes politiques, les recettes proposées par les mauvais bergers – les socialistes et les révolutionnaires – ne vous mèneront à rien de bon. Laissez la politique de côté et ne vous occupez que de vos intérêts économiques. Ceci vous est permis, et c’est par cette voie que vous aboutirez. » Telle fut la thèse soutenue et développée, sur l’instigation du gouvernement, par Gapone et ses aides puisés parmi les ouvriers mêmes, dans les sections.
Les ouvriers mirent l’invitation tout de suite en pratique. Ils commencèrent à préparer une action économique pour appuyer, le cas échéant, leurs revendications élaborées et formulées d’accord avec Gapone. Ce dernier, dans sa situation plus que délicate, dut faire semblant d’approuver tout. S’il ne le faisait pas, il provoquerait aussitôt un mécontentement parmi les ouvriers. Il serait même certainement accusé de trahir leurs intérêts, de tenir trop le parti patronal. Il aurait vite perdu sa popularité. De ce fait, son œuvre même serait infirmée. Dans son double jeu, Gapone devait avant tout, et à tout prix, conserver les sympathies qu’il sut gagner chez les ouvriers. Il le comprenait bien et faisait mine de soutenir entièrement leur cause, tout en espérant pouvoir, par cela même, garder la maîtrise du mouvement, pouvoir manier les masses à sa guise, pouvoir diriger, façonner et canaliser leur action.
Ce fut le contraire qui se produisit. Le mouvement prit rapidement de l’ampleur. Bientôt, il se transforma en une véritable tempête qui déborda et emporta Gapone lui-même.
Brièvement exposés, les événements se déroulèrent comme suit : de nombreux adeptes et amis décidèrent de commencer l’action. D’accord avec Gapone, ils élaborèrent et remirent à la direction une liste de revendications d’ordre économique, très modérées d’ailleurs. Vers la fin du mois, ils apprirent que la direction ne croyait pas possible d’y faire suite, et que le gouvernement était impuissant à l’y obliger.
L’indignation, la colère des ouvriers étaient sans borne : d’abord, parce que leurs longs et laborieux efforts n’aboutissaient à rien ; ensuite – et surtout – parce qu’on leur avait laissé croire que ces efforts seraient couronnés de succès. Gapone, en personne, les avait encouragés, les avait bercés d’espoir. Et voici que leur premier pas sur la bonne voie légale ne leur apportait qu’un échec cuisant, nullement justifié. Ils se sentirent « roulés ». Naturellement, leurs regards se tournèrent vers Gapone. Pour sauvegarder son prestige et son rôle, ce dernier feignit d’être indigné plus que tout autre et poussa les ouvriers de l’usine Poutiloff à réagir vigoureusement. C’est ce qu’ils ne tardèrent pas à faire. Se sentant assez à l’abri, se bornant toujours à des revendications purement économiques, couverts par les sections et par Gapone, ils décidèrent, au cours de plusieurs réunions tumultueuses, de soutenir leur cause par une grève. Le gouvernement, confiant en Gapone, n’intervenait pas. Et c’est ainsi que la grève des usines Poutiloff, la première grève ouvrière importante en Russie, fut déclenchée en décembre 1904.
Mais le mouvement ne s’arrêta pas là. Toutes les sections ouvrières s’émurent et se mirent en branle pour défendre l’action de ceux de Poutiloff. Elles apprécièrent très justement l’échec de ces derniers comme leur échec général. Naturellement, Gapone dut prendre parti pour les sections. Le soir, il les parcourait toutes, l’une après l’autre, prononçant partout des discours en faveur des grévistes de Poutiloff, invitant tous les ouvriers à les soutenir par une action efficace.
Quelques jours passèrent. Une agitation extraordinaire secouait les masses ouvrières de la capitale. Les ateliers se vidaient spontanément. Sans mot d’ordre précis, sans préparation, ni direction, la grève de Poutiloff devenait une grève quasi générale de Saint-Pétersbourg.
Ce fut alors la tempête. Les masses de grévistes se précipitèrent vers les sections, forçant tout contrôle, réclamant une action immédiate.
En effet, la grève seule ne suffisait pas. Il fallait agir, faire quelque chose. C’est alors que surgit – on ne sut jamais exactement d’où ni comment – la fantastique idée de rédiger, au nom des ouvriers et paysans malheureux de toutes les Russies, une pétition au tsar, de se rendre, pour l’appuyer, en grandes masses devant le Palais d’Hiver, de remettre la pétition, par l’intermédiaire d’une délégation, Gapone en tête, au tsar lui-même, et de demander à ce dernier de prêter l’oreille aux misères de son peuple. Toute naïve, toute paradoxale qu’elle fût, cette idée se répandit comme une traînée de poudre parmi les ouvriers de Saint-Pétersbourg. Elle les rallia. Elle les inspira. Elle apporta un sens, elle fixa un but précis à leur mouvement.
Les sections firent chorus avec les masses. Elles se décidèrent à organiser l’action. Gapone fut chargé de rédiger la pétition. De nouveau, il s’inclina. Ainsi, il devenait, par la force des choses, leader d’un important, d’un historique mouvement des masses.
Dans les premiers jours du mois de janvier 1905, la pétition était prête. Simple, émouvante, elle respirait le dévouement et la confiance. Les misères du peuple y étaient exposées avec beaucoup de sentiment et de sincérité. Ensuite, elle demandait au tsar de consentir et de faire exécuter certaines réformes. Chose étrange, mais incontestable : la pétition de Gapone était une œuvre de haute inspiration.
Il s’agissait maintenant de la faire adopter par toutes les sections, de la porter à la connaissance des vastes masses, et d’organiser la marche vers le Palais d’Hiver.
Entre temps, un fait nouveau se produisit. Des révolutionnaires appartenant aux partis politiques (ces derniers se tenaient à l’écart du mouvement) intervinrent auprès de Gapone. Ils cherchèrent, avant tout, à l’influencer, à l’obliger de donner à son attitude, à sa pétition et à toute son action une allure moins « rampante », plus digne, plus ferme, en un mot plus révolutionnaire. Les milieux ouvriers avancés exercèrent sur lui la même pression. Gapone s’y prêta d’assez bonne grâce. Des socialistes révolutionnaires, surtout, lièrent connaissance avec lui. D’accord avec eux, il remania, dans les tout derniers jours, sa pétition primitive, en l’élargissant considérablement et en atténuant de beaucoup son esprit de fidèle dévouement au tsar.
Sous sa forme définitive, la pétition fut le plus grand paradoxe historique qui ait jamais existé. On s’y adressait très loyalement au tsar, et on lui demandait ni plus ni moins que d’autoriser – même d’accomplir – une révolution fondamentale qui, en fin de compte, supprimerait son pouvoir. En effet, tout le programme minimum des partis révolutionnaires y figurait. On y exigeait, notamment, en qualité de mesures immédiates, de toute urgence : la liberté entière de la presse, de la parole, de la conscience, etc. ; la liberté absolue de toutes sortes d’associations, d’organisations, etc. ; le droit aux ouvriers de se syndiquer, de recourir à la grève, etc. ; des lois agraires tendant à l’expropriation des gros propriétaires au profit des communautés paysannes ; et, surtout, la convocation immédiate d’une assemblée constituante, élue sur la base d’une loi électorale démocratique. C’était, carrément, une invitation au suicide.
Il est à noter, toutefois, qu’en dépit de tout ce qu’il y avait de paradoxal dans la situation créée, l’action qui se préparait ainsi n’était, pour un esprit averti, qu’un aboutissement logique des tendances existantes, une synthèse naturelle des divers éléments en présence. D’une part, l’idée de la démarche collective auprès du tsar, avec la pétition, ne fut au fond que l’expression très naturelle de la foi naïve des masses populaires en la bonne volonté du tsar (ce que nous avons appelé plus haut « la légende du tsar »). Ainsi, les ouvriers qui, en Russie, ne rompaient jamais leurs liens plus ou moins étroits avec la campagne, reprirent un instant la tradition paysanne pour aller demander au « petit père » aide et protection. Profitant de l’occasion offerte et unique, soulevés par un élan spontané, irrésistible, ils cherchèrent, peut-être, surtout à mettre le doigt sur la plaie, à obtenir une précision palpable, une solution concrète, définitive. Tout en espérant, au fond de leurs âmes simples, obtenir un succès au moins partiel, ils voulaient surtout en avoir le cœur net. D’autre part, l’influence des partis révolutionnaires (forcés de se tenir à l’écart), pas assez puissante pour empêcher le mouvement ou – encore moins – pour le remplacer par un autre, plus révolutionnaire, s’avéra, néanmoins, suffisamment forte pour réussir à exercer sur Gapone une certaine pression indirecte et l’obliger de « révolutionnariser » son acte. Cet acte fut ainsi le produit bâtard, mais naturel, des forces contradictoires en action.
La conduite et la psychologie de Gapone lui-même, toutes paradoxales qu’elles puissent paraître, trouvent pourtant une explication facile. D’abord simple comédien, agent à la solde de la police, il fut, ensuite, de plus en plus entraîné par la formidable vague du mouvement populaire qui le poussait en avant. Il finit par en être emporté. Les événements le mirent, malgré lui, à la tête des foules dont il devenait l’idole. Esprit aventurier et romanesque, il dut se laisser bercer par une illusion. Percevant instinctivement l’importance historique des événements, il dut en faire une appréciation exagérée qui dépassa de beaucoup la réalité des choses. Il voyait déjà le pays entier en révolution, le trône en péril, et lui, Gapone, chef suprême du mouvement, idole du peuple, porté aux sommets de la gloire des siècles. De plus en plus fasciné par ce rêve (que les événements paraissaient de plus en plus justifier), il se donna finalement, corps et âme, au mouvement déclenché. Son rôle de policier ne l’intéressait plus. Il n’y pensait même pas, au cours de ces journées de fièvre, tout ébloui par les éclairs du formidable orage, tout absorbé par son rôle nouveau qui devait lui apparaître presque comme une mission divine. Telle était, très probablement , la psychologie de Gapone au début de janvier 1905. On peut donc supposer, avec forte raison, qu’à ce moment, et dans le sens indiqué, Gapone était sincère. Du moins, telle fut l’impression personnelle de l’auteur de ces lignes qui fit la connaissance de Gapone, quelques jours avant les événements, et le vit à l’œuvre.
Même le phénomène le plus paradoxal, parmi tant d’autres – l’abstention du gouvernement et l’absence de toute intervention policière au cours de ces journées de préparation fiévreuse –, s’explique aisément. Tout d’abord, la police ne put pénétrer dans la psychologie nouvelle de Gapone. Jusqu’au bout, elle garda confiance en son jeu. Et lorsque, enfin, elle s’aperçut du changement et du danger imminent, il était trop tard pour endiguer et arrêter les éléments déchaînés. D’abord quelque peu décontenancé, le gouvernement prit finalement le parti d’attendre le moment favorable pour écraser le mouvement d’un seul coup. Pour l’instant, ne recevant aucun ordre, la police ne bougeait pas, elle ne se montrait même pas. Ce fait incompréhensible, mystérieux, encouragea les masses, augmenta leurs espoirs.
La marche vers le Palais d’Hiver fut fixée au dimanche matin 9 janvier (vieux style). Les tout derniers jours, le 8 et le 9 surtout, furent consacrés principalement à la lecture publique de la pétition, au sein des sections. On procéda, à peu près partout, de la même façon. Au cours de la journée, mais surtout le soir, Gapone lui-même – ou un de ses amis – lisait, expliquait et commentait la pétition aux masses ouvrières qui remplissaient les locaux « par paquets », à tour de rôle. Aussitôt le local rempli, on en fermait la porte, on lisait la pétition, les assistants apposaient leurs signatures sur une feuille spéciale et évacuaient la salle. Celle-ci se remplissait à nouveau par une foule qui attendait patiemment son tour dans la rue, et la cérémonie recommençait. Cela continuait ainsi, dans toutes les sections, jusqu’à minuit et au-delà.
Ce qui apporta une note tragique à ces derniers préparatifs, ce fut, chaque fois, l’appel suprême de l’orateur et le serment solennel, farouche, de la foule, en réponse à cet appel :
« Camarades ouvriers, paysans et autres – disait à peu près l’orateur –, frères de misère ! Soyez tous fidèles à la cause générale et au rendez-vous. Dimanche matin, venez tous sur la place, devant le Palais d’Hiver. Toute défaillance de votre part serait une trahison envers notre cause qui est juste. Mais venez calmes, pacifiques, dignes de l’heure solennelle qui sonne. Le père Gapone a déjà prévenu le tsar et lui a garanti, sous sa responsabilité personnelle, la sécurité absolue. Si vous vous permettez quelque acte déplacé, c’est le père Gapone qui en répondra. D’ailleurs, vous avez entendu la pétition. Nous demandons des choses justes. Nous ne pouvons plus continuer cette existence misérable. Nous allons donc chez le tsar les bras ouverts, les cœurs remplis d’amour et d’espoir. Il n’a qu’à nous recevoir de même, et à prêter l’oreille à notre demande. Gapone lui-même lui remettra la pétition. Espérons, camarades, espérons, frères, que le tsar nous ouvrira ses bras, nous accueillera, nous écoutera, nous comprendra et fera suite à nos justes revendications. Mais si, mes frères, le tsar, au lieu de nous accueillir, au lieu de nous écouter, nous reçoit à coups de fusils et de sabres, s’il ne veut pas de nous, alors, mes frères, malheur à lui ! Alors, nous n’avons plus de tsar ! Alors, qu’ils soient maudits à jamais, lui et toute sa dynastie ! Jurez, vous tous, camarades, frères, simples citoyens, jurez qu’alors vous n’oublierez jamais la trahison. Jurez qu’alors vous chercherez à détruire le traître par tous les moyens... »
Et l’assemblée tout entière, emportée par un élan extraordinaire, répondait en levant le bras :
« Nous le jurons ! »
Là où Gapone lui-même lisait la pétition – et il la lut une fois dans toutes les sections –, il y ajoutait :
« Moi, prêtre, Georges Gapone, par la volonté de Dieu, je vous délie alors du serment prêté au tsar. Je bénis d’avance celui qui le détruira. Car alors, nous n’aurons plus de tsar ! (Blême d’émotion, il répétait deux, trois fois cette phrase devant l’auditoire silencieux et frémissant.) Jurez de me suivre, jurez-le sur la tête de vos enfants ! »
La réponse fut invariablement :
« Oui, père, nous le jurons sur la tête de nos enfants ! »
Le 8 janvier au soir, tout était prêt pour la marche.
Tout était prêt aussi du côté gouvernemental. En effet, certains cercles intellectuels et littéraires apprirent que la décision du gouvernement était arrêtée : en aucun cas ne laisser la foule s’approcher du palais ; si elle insiste, tirer dessus sans pitié. En toute hâte, une délégation fut dépêchée auprès des autorités pour tenter de prévenir l’effusion de sang. La démarche resta vaine. Toutes les dispositions étaient déjà prises. La capitale était entre les mains des troupes armées jusqu’aux dents.
On connaît la suite. Le 9 janvier, dimanche, dès le matin, une foule immense composée surtout d’ouvriers (souvent avec leurs familles) et aussi d’autres éléments très divers, se mit en mouvement vers la place du Palais d’Hiver. Des dizaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants, partant de tous les points de la capitale et de la banlieue, se ruèrent vers le but indiqué. Hélas ! Partout, ils se heurtèrent à des barrages de troupes et de police qui ouvrirent un feu nourri contre cette mer humaine. Toutefois, la pression des arrière-gardes de cette masse compacte d’hommes – pression qui augmentait de minute en minute – fut telle que, par toutes sortes de voies obliques, la foule affluait sans cesse, envahissant la place du palais et toutes les rues avoisinantes. Alors, le gouvernement ne trouva rien de mieux que de faire balayer, par des salves de feu, à intervalles réguliers, cette foule désarmée, désemparée, désespérée...
Des milliers d’hommes, femmes et enfants furent tués ce jour-là dans les rues de la capitale. Vers le soir, « l’ordre fut rétabli ». Et c’est durant toute la nuit, et par des wagons entiers, que la police emportait les cadavres hors de la capitale, pour les faire enterrer pêle-mêle dans les champs avoisinants.
Quant à Gapone lui-même, lequel conduisait, entouré de porteurs d’icones et d’images du tsar, une foule immense se dirigeant vers le Palais d’Hiver par la porte de Narva, il ne fut même pas blessé. Aux premiers coups de feu, il fut saisi par des amis, emporté hors des rangs et mis en lieu sûr. On lui coupa ses longs cheveux de pope, on l’habilla en civil et, quelques jours après, il se trouva déjà à l’étranger, hors de toute atteinte. Il lança immédiatement un bref appel aux ouvriers et paysans de toutes les Russies où, en des termes exceptionnellement éloquents et vigoureux, il maudissait, au nom du pouvoir à lui conféré par Dieu, le tsar Romanov et sa dynastie. Il y bénissait d’avance tous ceux qui arriveraient à supprimer le traître. Cet appel fut répandu en très grand nombre à travers le pays.
Quelques mots sur le sort définitif de Gapone sont nécessaires ici même pour clore le chapitre.
Sauvé par des amis, l’ex prêtre se fixa définitivement à l’étranger. Ce furent surtout les socialistes révolutionnaires qui prirent soin de lui. Son avenir ne dépendait maintenant que de lui-même. On mit à sa disposition les moyens nécessaires pour qu’il rompe définitivement avec son passé, pour qu’il complète son instruction – enfin, pour qu’il puisse devenir vraiment un homme d’action d’envergure. Mais Gapone n’était pas de cette trempe. Le feu sacré qui, par hasard, effleura une fois son âme ténébreuse, n’était pour lui qu’un feu d’ambitions et de satisfactions personnelles qui s’éteignit vite. Au lieu de se livrer à un travail d’auto éducation et de préparation à une activité sérieuse, Gapone restait dans l’inactivité, mère de l’ennui. Le lent travail de patience ne lui disait rien. Il rêvait la suite immédiate et glorieuse de son aventure. Or, en Russie, les événements traînaient. La grande révolution ne venait toujours pas. Il s’ennuyait de plus en plus. Bientôt, il chercha l’oubli dans la débauche. Le plus souvent, il passait ses soirées dans des cabarets louches où, à moitié ivre, en compagnie de femmes légères, il pleurait à chaudes larmes ses illusions brisées. La vie à l’étranger le dégoûtait. Le mal du pays le tenaillait. À tout prix, il voulait retourner en Russie. Alors, il conçut l’idée de s’adresser à son gouvernement, de lui demander le pardon et l’autorisation de revenir pour reprendre ses services. Il écrivit à la police secrète. Il renoua les relations avec elle. Ses anciens chefs accueillirent l’offre assez favorablement. Mais, avant tout, ils exigèrent de Gapone une preuve matérielle de son repentir et de sa bonne volonté. Connaissant ses accointances avec des membres influents du parti socialiste révolutionnaire, ils lui demandèrent de leur fournir des indications précises qui leur auraient permis de porter un coup dur au dit parti. Gapone accepta le marché. En attendant, un membre influent du parti et ami intime de Gapone, l’ingénieur Rutenberg, eut vent des nouvelles relations de Gapone avec la police. Il s’en référa au comité central du parti. Le comité le chargea – c’est Rutenberg lui-même qui le raconte dans ses mémoires – de faire son possible pour démasquer Gapone. Rutenberg fut obligé de jouer un rôle. Il finit par obtenir des confidences de Gapone, ce dernier ayant supposé que l’ingénieur trahirait volontiers son parti pour une forte somme d’argent. Gapone lui fit des propositions dans ce sens. Rutenberg feignit d’accepter. Il fut convenu qu’il livrerait à la police, par l’intermédiaire de Gapone, des secrets très importants du parti. On marchanda sur le prix. Ce marchandage – feint et traîné sciemment en longueur par Rutenberg, d’accord avec son parti, mené par Gapone, d’accord avec la police – se termina en Russie, où Gapone put, entre temps, se rendre, de même que Rutenberg. À Saint-Pétersbourg se joua le dernier acte du drame. Aussitôt arrivé, Rutenberg prévint quelques ouvriers, amis fidèles de Gapone – lesquels se refusaient à croire à sa trahison –, qu’il était à même de leur en fournir une preuve incontestable. Il fut convenu que les ouvriers gaponistes assisteraient en cachette au dernier entretien entre Gapone et Rutenberg, entretien où le prix de la soi-disant trahison de Rutenberg devait être définitivement fixé.
Le rendez-vous eut lieu dans une villa déserte, non loin de Saint-Pétersbourg. D’après le plan conçu, les ouvriers cachés dans la pièce contiguë à celle où se passerait l’entretien entre Gapone et Rutenberg, devaient ainsi assister, sans être vus, à cet entretien pour se convaincre du véritable rôle de Gapone et pouvoir, ensuite, le démasquer publiquement. Mais les ouvriers ne purent pas y tenir. Aussitôt convaincus de la trahison de Gapone, ils firent irruption dans la chambre où les deux hommes discutaient ; ils se précipitèrent sur Gapone, le saisirent et, malgré ses supplications, l’exécutèrent brutalement. Ensuite, ils lui passèrent une corde au cou et le suspendirent au plafond. C’est dans cette position que son cadavre fut découvert accidentellement quelque temps après.
Ainsi se termina l’épopée personnelle de Gapone. Quant à l’épopée du mouvement, elle suivit son chemin.
Les événements du 9 janvier eurent une résonance formidable dans le pays entier. Sans parler des villes et des régions industrielles, dans les recoins les plus obscurs, la population apprenait avec une stupéfaction indignée qu’au lieu de prêter l’oreille au peuple venu paisiblement devant le palais pour conter au tsar ses misères, ce dernier donna froidement l’ordre de tirer dessus. Pendant longtemps encore, des paysans délégués par leurs villages se rendaient à Saint-Pétersbourg avec la mission d’apprendre l’exacte vérité. Cette vérité fut bientôt connue partout. C’est à ce moment que la « légende du tsar » cessa de vivre. Un paradoxe historique de plus ! En 1881, les révolutionnaires assassinèrent le tsar pour tuer la légende. Elle survécut. Vingt-quatre ans après, c’est le tsar lui-même qui la tua. Moralement, le tsarisme fut détrôné le 9 janvier 1905. Mais ce qu’il y a vraiment de significatif dans ces événements, c’est qu’il fallut une expérience historique vécue, palpable et de grande envergure pour que le peuple commence à comprendre la véritable nature du tsarisme. Ni la propagande, ni le sacrifice des enthousiastes ne purent, seuls, amener ce résultat.
Quant à la ville de Saint-Pétersbourg, les événements du 9 janvier y eurent pour effet immédiat la généralisation de la grève ouvrière. Celle-ci devint complète. Le 10 janvier au matin, pas une seule usine, pas un chantier de la capitale ne s’anima. Le mouvement de sourde révolte gronda partout. La première grande grève révolutionnaire des travailleurs russes – celle des ouvriers de Saint-Pétersbourg – devint un fait accompli.
Nous touchons ici à un point très important de la Révolution russe : l’origine des soviets. Le lecteur trouvera quelques détails de plus, à ce sujet, au mot soviets. Mais l’essentiel doit être dit ici même.
Dans tout ce qui a paru jusqu’à ce jour sur la Révolution russe – je parle non seulement des études étrangères, mais aussi de la documentation russe –, il existe une lacune qui saute aux yeux d’un lecteur attentif. Personne ne peut encore jamais établir avec précision quand, où et comment fut créé le premier soviet ouvrier. Ce que le lecteur trouvera ici à ce sujet sera donc absolument inédit. (En lisant ce qui suit, on comprendra le pourquoi de cette lacune.)
De même que le mouvement précédent guidé par Gapone, la grève générale des ouvriers de Saint-Pétersbourg surgit spontanément. Elle ne fut déclenchée par aucun parti politique, voire par aucun comité de grève. De leur propre chef, et dans un élan tout à fait libre, les masses ouvrières abandonnèrent les usines et les chantiers. Les partis politiques ne surent même pas profiter de l’occasion de s’emparer du mouvement, à leur habitude. Ils restèrent complètement à l’écart. Cependant, la grave question surgit aussitôt devant les ouvriers : que faire maintenant ? Un jour, cette question fut posée concrètement dans une petite réunion privée à laquelle assistaient une quarantaine d’ouvriers de différentes usines, l’auteur de ces lignes (dont ces ouvriers étaient les élèves) et un avocat, Georges Nossar. Ni les uns ni les autres n’appartenaient à aucun parti politique.
L’auteur de ces lignes, alors un jeune homme de 22 ans, poursuivait depuis deux ans, dans les milieux ouvriers, un travail de pure culture. Et quant à Nossar, il était une connaissance de quelques jours, faite à l’une des réunions gaponistes à laquelle il vint assister. Au cours de cette petite réunion privée, on parla de la nécessité d’organiser un comité – ou plutôt un « conseil » (soviet) – qui serait composé d’ouvriers délégués par différentes usines, et qui prendrait entre ses mains aussi bien la direction de la grève que celle de la suite du mouvement. On exprima même l’idée de nommer ce comité Conseil (soviet) des délégués ouvriers. Les ouvriers décidèrent de mettre cette idée tout de suite en pratique. Dès le lendemain, ils devaient en faire part à leurs camarades d’usine, pour pouvoir désigner des délégués provisoires à ce soviet ouvrier. Mais il fallait quelqu’un qui se chargeât, séance tenante, de la direction de ce soviet. Les ouvriers présents offrirent ce poste à l’auteur de ces lignes. Ne sachant encore rien de la conception anarchiste, ce dernier en possédait néanmoins l’esprit. Il posa aux ouvriers cette question : comment pouvait-il, sans être ouvrier, adhérer à un organisme essentiellement ouvrier, le guider, le mener ? Les ouvriers répondirent que cela n’avait aucune importance, car ils pouvaient toujours introduire dans l’organisme ainsi créé un homme de confiance en lui procurant des papiers d’un ouvrier quelconque. L’auteur de ces lignes refusa catégoriquement, pour sa part, de recourir à un tel procédé, basé sur un mensonge, sur une supercherie. Il estimait, en outre, que les ouvriers devraient mener eux-mêmes leurs affaires, se bornant à être aidés ou conseillés du dehors de leurs organismes par leurs amis intellectuels, sans en faire des maîtres. Les ouvriers firent alors la même offre à Nossar qui accepta. C’est ainsi que, quelques jours après, eut lieu, à Saint-Pétersbourg, la première séance du premier soviet ouvrier russe dont Nossar, muni de faux papiers ouvriers au nom de Khroustaleff, se fit nommer président. Un peu plus tard, ce premier soviet fut complété par un nombre imposant de délégués ouvriers. Pendant quelque temps, il siégeait assez régulièrement dans le local des cours supérieurs du professeur P. Lesgaft. Il publiait périodiquement une feuille d’information ouvrière, sous le titre Les Nouvelles (Izvestia) du Soviet des délégués ouvriers. En même temps, il dirigeait le mouvement ouvrier de la capitale. Le parti social-démocrate finit, tout de même, par réussir à pénétrer dans ce soviet et à s’y emparer d’un poste important. En effet, le politicien social-démocrate Trotski (le futur commissaire bolcheviste) y entra et se fit nommer secrétaire. Plus tard, il remplaça Khroustaleff-Nossar à la présidence du soviet.
On comprend aisément pourquoi les faits cités ici restèrent dans l’ombre. Nossar (le lecteur trouvera ailleurs quelques mots sur son sort personnel) n’en a jamais soufflé mot à personne. Sur les 40 ouvriers au courant des faits, pas un n’eut jamais l’idée de les raconter. Et quant à l’auteur de ces lignes, il n’en a encore parlé nulle part jusqu’à présent.
Pendant un certain laps de temps, le gouvernement ne toucha pas au soviet. Celui-ci siégea assez régulièrement. D’ailleurs, la grève s’étant éteinte d’elle-même, à défaut d’un mouvement de plus vaste envergure, l’activité de ce premier soviet dut se borner bientôt à une œuvre de pure propagande.
Le gouvernement se vit dans l’obligation de fermer momentanément les yeux, car, sa situation devenant de plus en plus difficile, il était forcé d’agir avec la plus grande prudence. La raison principale de cette situation difficile fut l’échec cuisant que l’impérialisme japonais fit subir à l’impérialisme russe. La guerre, commencée avec beaucoup d’orgueil et, en partie, dans le but de réchauffer les sentiments nationaux et monarchistes, était irrémédiablement perdue. L’armée et la flotte furent battues à plate couture. L’opinion publique imputait la défaite ouvertement à l’incapacité, à la pourriture du régime. Non seulement les masses ouvrières, mais tous les milieux de la société furent rapidement gagnés par une colère et un esprit de révolte qui s’aggravaient de jour en jour. L’effet des défaites qui se suivaient sans arrêt fut foudroyant. Bientôt, les passions étaient déchaînées, l’indignation ne connaissait plus de bornes, l’effervescence devenait générale. Étant dans son tort, le gouvernement n’avait qu’à se taire. Les milieux libéraux et révolutionnaires en profitèrent immédiatement pour commencer une campagne violente contre le régime. Sans en demander l’autorisation, la presse et la parole devinrent libres. Ce fut une véritable prise d’assaut des libertés politiques. Les journaux de toutes tendances, même révolutionnaires, paraissaient et se vendaient sans censure, ni contrôle. Le gouvernement, le système entier y étaient vigoureusement critiqués. Les autorités furent contraintes de tolérer tout ceci, comme elles avaient déjà toléré la grève de janvier, les délibérations du soviet, etc. De plus, vers cette époque, quelques démonstrations et même quelques émeutes eurent lieu dans différentes villes, et quelques barricades firent leur apparition à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Les ennemis du gouvernement étaient trop nombreux, trop audacieux et – surtout – ils avaient raison. L’été 1905 apporta, de plus, des troubles assez graves dans l’armée et la flotte. Le pays entier se dressait de plus en plus résolument contre le tsarisme. En plus de sa mauvaise situation morale et de sa défaite dans la guerre russo-japonaise, il manquait au gouvernement le facteur le plus important pour pouvoir combattre ce mouvement : l’argent.
L’inactivité, l’impuissance avouée du gouvernement enhardirent les forces de l’opposition. Dès le début d’octobre, on parla d’une grève générale de tout le pays, comme début d’une révolution décisive. Cette grève du pays entier – grève formidable, unique dans l’histoire du monde – eut lieu vers la mi-octobre. Elle fut moins spontanée que celle de janvier. Envisagée de longue date, préparée d’avance, elle fut organisée par le soviet et surtout de nombreux comités de grève. Usines, chantiers, magasins, banques, administrations et – surtout – chemins de fer, toutes les voies de communication, postes et télégraphes, tout, absolument tout, s’arrêta net. La vie du pays fut suspendue. Le gouvernement perdit pied et céda. Le 17 octobre (1905), le tsar lança un manifeste – le fameux manifeste du 17 octobre – où il disait avoir pris la décision d’octroyer à ses chers sujets toutes les libertés politiques et, de plus, de convoquer le plus rapidement possible la Douma de l’État (genre d’états généraux) pour l’aider dans ses fonctions gouvernementales. Ce fut, enfin, une promesse de constitution. Certains milieux la prirent même au sérieux. Ainsi, un parti « octobriste » (d’octobre) fut créé aussitôt dans le but d’activer la réalisation et de surveiller l’application des réformes modérées annoncées par le manifeste.
Le but immédiat du manifeste fut atteint : la grève cessa, l’élan révolutionnaire fut brisé. Mais il va de soi que les partis révolutionnaires n’eurent aucune confiance dans les promesses. Ils ne virent dans le manifeste qu’une manœuvre politique. Ils commencèrent aussitôt à l’expliquer aux masses ouvrières. D’ailleurs, ces dernières restèrent assez indifférentes. Dix jours après le manifeste eut lieu la première grande émeute des matelots de Cronstadt, à laquelle participa l’auteur de ces lignes, et qui faillit devenir très grave.
Les libertés, prises d’assaut et promises post factum par le manifeste d’octobre, furent supprimées le jour où le gouvernement trouva de l’argent (emprunt français) et aussi la possibilité de terminer la malheureuse guerre d’une façon pas trop humiliante. Ce jour-là, le gouvernement reprit pied. Fin 1905, il interdit de nouveau toute la presse révolutionnaire, rétablit la censure, procéda à des arrestations en masse, liquida toutes les organisations ouvrières ou révolutionnaires qui lui tombèrent sous la main, supprima le soviet, jeta en prison Nossar et Trotski et dépêcha des troupes, à l’effet de châtiments sévères, dans toutes les régions où des troubles sérieux avaient eu lieu. Il ne resta qu’une chose à laquelle le gouvernement n’osa pas toucher : la Douma, dont la convocation était proche.
Ainsi, vers la fin de 1905, la révolution fut définitivement enrayée. Mais, naturellement, la tempête passée avait laissé des traces ineffaçables, aussi bien dans la vie matérielle du pays que dans la mentalité de la population.
Dans le domaine concret, il y avait, tout d’abord, comme nous venons de le dire, la Douma. Momentanément, le gouvernement se vit obligé d’élaborer, pour la Douma, une loi électorale assez large. Le peuple tout entier mettait dans cette institution les plus grands espoirs. Les élections, fixées au printemps de 1906, suscitèrent dans le pays une activité préparatoire fébrile. Tous les partis politiques y prirent part. La situation était assez paradoxale ; car, tandis que les partis de gauche déployaient leur activité ouvertement, légalement, les prisons regorgeaient des membres des mêmes partis, arrêtés lors de la liquidation du mouvement. Ce paradoxe apparent s’explique facilement. En dépit d’une certaine liberté que le gouvernement tsariste dut accorder à ses sujets en vue des élections, ce gouvernement était loin d’interpréter la Douma comme une institution appelée à se dresser contre l’absolutisme ou à le limiter. Selon lui, la Douma ne devait être qu’un organe purement consultatif, appelé simplement à aider les autorités dans leurs tâches difficiles. Tout en étant obligé de tolérer l’agitation électorale des partis de gauche, le gouvernement était décidé d’avance à réagir sans tarder contre toute tentative de la Douma de prendre une attitude frondeuse. Il était donc parfaitement logique que, la Douma n’ayant, à ses yeux, rien de commun avec la révolution, le gouvernement gardât les révolutionnaires en prison.
Un autre fait concret, entièrement nouveau dans la vie russe, fut, précisément, la formation et l’activité légale de différents partis politiques. Comme le lecteur sait, il n’y avait dans le pays, avant les événements de 1905, que deux partis politiques, tous deux clandestins ; c’étaient le parti social-démocrate et le parti socialiste révolutionnaire. Le manifeste du 17 octobre, les quelques libertés admises à sa suite et, surtout, la future campagne électorale pour la Douma, firent naître aussitôt toute une série de partis politiques légaux.
Les monarchistes créèrent l’ « Union du peuple russe ». Les éléments moins farouchement réactionnaires – hauts fonctionnaires, gros industriels, propriétaires, commerçants, agrariens, etc. – se groupèrent autour du « parti octobriste », dont nous avons déjà parlé. Le poids politique de ces deux partis de la droite était insignifiant. Tous les deux faisaient plutôt l’amusement du pays.
La grande majorité des classes aisées et moyennes, ainsi que des intellectuels de marque, s’organisèrent en un grand parti politique du centre dont la droite se rapprochait des octobristes et la gauche accusait des tendances républicaines. Le gros du parti élabora le programme d’un système constitutionnel qui, tout en conservant le monarque, mettait fin à l’absolutisme en limitant sérieusement son pouvoir. Le parti prit le nom de « parti constitutionnel démocrate » (en abrégé : parti ca-det). Ses leaders se recrutèrent surtout parmi les gros bonnets municipaux, les avocats, les personnes exerçant des professions libérales, les gros universitaires. Très influent et bien placé, ce parti déploya, dès son origine, une activité vaste et énergique.
À l’extrême gauche, se trouvaient : le parti social-démocrate, dont l’activité électorale fut à peu près ouverte et légale, malgré son programme nettement républicain et sa tactique révolutionnaire, et, enfin, le parti socialiste révolutionnaire, dont les candidats, afin de pouvoir agir sans entraves, formèrent un parti à part, sous le nom de « parti travailliste », et dont le programme et la tactique différaient peu – le problème agraire à part – de ceux du parti social-démocrate. Il va de soi que ces deux derniers partis représentaient surtout les masses ouvrières et paysannes ainsi que la vaste couche des travailleurs intellectuels.
En dehors de la question politique, le point le plus important dans les programmes de tous les partis se rapportait incontestablement au problème agraire. Une solution efficace de ce dernier s’imposait de toute urgence. En effet, l’augmentation de la population paysanne était si rapide que les lots de terrain concédés aux paysans affranchis par leurs anciens seigneurs, en 1881, déjà insuffisants, se réduisirent en un quart de siècle, par suite d’un morcellement continu, à des lots de famine. L’immense population paysanne attendait de plus en plus impatiemment une solution juste et effective de ce problème. Tous les partis se rendaient compte de son importance capitale. Pour le moment, trois solutions du problème se présentaient, notamment :
-
le parti constitutionnel démocrate proposait l’augmentation des lots par une aliénation d’une bonne partie des grandes propriétés privées ou d’État, aliénation devant être dédommagée graduellement par les paysans, avec l’aide de l’État, conformément à uns estimation officielle et « juste » ;
-
le parti social-démocrate préconisait une aliénation pure et simple des terres indispensables aux paysans, lesquelles terres constitueraient ainsi un fonds national distribuable aux paysans au fur et à mesure des besoins (nationalisation ou municipalisation des terres) ;
-
le parti socialiste révolutionnaire offrait la solution la plus radicale ; à savoir : la confiscation totale de toutes les terres faisant l’objet de propriété privée, la suppression immédiate et complète de toute propriété foncière, la mise à la disposition des collectivités paysannes de toutes les terres (socialisation des terres).
Une note importante est à ajouter à ce qui vient d’être dit. À l’époque de la Révolution de 1905, deux courants d’idées (qui allaient aboutir plus tard à une scission complète) se dessinèrent déjà nettement au sein des deux partis de gauche (socialiste démocrate et socialiste révolutionnaire) : dans l’un comme dans l’autre, se précisa, à côté du courant « officiel », une mentalité réfractaire au programme établi. D’après cette idéologie nouvelle, la révolution qui approchait avait des chances de devenir, dès à présent, une vraie révolution sociale. Les partisans de ce courant, dans les deux partis, insistaient donc sur la nécessité d’abandonner le programme minimum en cours et de le remplacer par un autre, plus révolutionnaire, plus socialiste. Dans le parti social démocrate, ce courant aboutit, déjà en 1903, à la naissance du bolchevisme (voir ce mot) et, plus tard, à la formation du parti communiste (bolcheviste). Et quant au parti socialiste révolutionnaire, il se divisa finalement aussi en deux partis distincts : celui des socialistes révolutionnaires de droite, qui défendait toujours la nécessité de passer, avant tout, par une république démocratique bourgeoise, et celui des socialistes révolutionnaires de gauche, qui prétendait, parallèlement au bolchevisme, que la prochaine révolution devrait être poussée le plus loin possible, notamment jusqu’à la suppression immédiate de l’État capitaliste et l’instauration d’une république sociale. Lors de la révolution de 1905, l’influence pratique de ces deux courants réfractaires était encore insignifiante.
Pour compléter l’exposé de divers courants d’idées, lors de la révolution de 1905, signalons que le parti socialiste révolutionnaire donna naissance, vers la même époque, à un troisième credo social, qui alla jusqu’à l’idée de devoir supprimer, dans la prochaine révolution, non seulement l’État bourgeois, mais tout État, en général, comme institution politique. Ce courant d’idées se rapprochait donc sensiblement de la conception anarchiste, sans toutefois l’adopter en entier. Il est connu en Russie sous le nom de maximalisme (voir ce mot).
Quant aux conceptions anarchistes et syndicalistes, elles étaient, à cette époque, très peu répandues en Russie. Comme déjà dit, quelques groupements libertaires existaient à Saint-Pétersbourg, à Moscou et dans le Midi. C’était tout. Cependant, un groupe anarchiste de Moscou participa très activement aux événements d’octobre et se fit remarquer dans des manifestations révolutionnaires.
Les conséquences morales, les effets psychologiques des événements de 1905 étaient plus importants encore que les réalisations concrètes immédiates. Tout d’abord, comme nous l’avons déjà signalé, la légende du tsar s’évanouit, l’absolutisme fut moralement détrôné. Ce ne fut pas tout. Car, du même coup, les masses populaires se tournèrent vers les éléments qui, depuis longtemps déjà, combattaient cet absolutisme : vers les milieux intellectuels et avancés, vers les partis politiques, vers les révolutionnaires, en général, etc. Ainsi, un contact solide et vaste s’établit, enfin, entre les milieux avancés et la masse du peuple. Désormais, ce contact ne put que se consolider et s’approfondir. Le « paradoxe russe », dont nous avons parlé plus haut, avait vécu.
Quelques mots sont à dire ici sur le sort personnel de Nossar-Khroustaleff, premier président du premier soviet ouvrier de Saint-Pétersbourg. Arrêté lors de la liquidation du mouvement, il fut condamné à être exilé en Sibérie. Il se sauva et se réfugia à l’étranger. Mais, de même que Gapone, il ne sut pas s’adapter à une nouvelle existence et encore moins se mettre au travail régulier. Certes, il ne mena pas une vie de débauche, il ne commit aucun acte de trahison... Mais il traînait à l’étranger une existence déréglée, misérable, malheureuse. Cela continua jusqu’à la Révolution de 1917. Aussitôt celle-ci éclatée, il se précipita, comme presque tous les émigrés russes, en son pays, et y participa aux luttes révolutionnaires. Ensuite, on l’a perdu de vue. D’après quelques informations, venues d’une source digne de foi, il se dressa finalement contre les bolcheviks et fut fusillé par ces derniers.
VERS LA GRANDE EXPLOSION (1905–1917).
Les douze années – exactement – qui séparèrent la véritable révolution de son ébauche n’apportèrent rien de saillant au point de vue révolutionnaire. Au contraire, c’est précisément la réaction qui triompha bientôt sur toute la ligne. Le sort de la Douma en fut la manifestation la plus éclatante.
La Douma commença à siéger en avril 1906. Un enthousiasme populaire débordant l’accueillit à sa naissance. Malgré toutes les machinations du gouvernement, elle s’avéra nettement en opposition. Le Parti constitutionnel démocrate la domina par le nombre et la qualité de ses représentants. Le professeur V. Mouromtzeff, un des membres les plus éminents de ce parti, fut élu président de l’Assemblée. Les députés de gauche – sociaux démocrates et socialistes révolutionnaires (« travaillistes ») – y formaient également un bloc imposant. La population entière suivait les travaux de la Douma avec un intérêt passionné. Tous les espoirs volaient vers elle. On en attendait au moins des réformes larges, justes, efficaces.
Mais, dès le premier contact, une hostilité – sourde d’abord, de plus en plus ouverte par la suite – s’établit entre le « parlement » et le gouvernement. Ce dernier entendait traiter la Douma du haut en bas, avec un dédain qu’il ne masquait même pas. Il la tolérait à peine. Il l’admettait difficilement, même à titre d’institution purement consultative. La Douma, elle, cherchait, au contraire, à s’imposer comme une institution législative, constitutionnelle. Les rapports entre l’un et l’autre devenaient de plus en plus tendus. Naturellement, le peuple prenait parti pour la Douma. La situation du gouvernement devenait ridicule et dangereuse. Toutefois, une révolution immédiate n’était pas à craindre. Et puis, le gouvernement comptait sur ses troupes. Il se décida donc bientôt à une mesure énergique. Un beau jour, au lendemain de quelques discussions orageuses avec les représentants du gouvernement, la Douma – la soi-disant « première Douma » – fut dissoute (en été 1906). À part quelques émeutes, dont la plus importante fut celle de Cronstadt (plus sérieuse encore que celle d’octobre 1905), le pays resta tranquille. Quant aux députés eux-mêmes, ils n’osèrent pas résister efficacement. Ils se soumirent à la dissolution et se bornèrent à lancer une note de protestation contre cet acte arbitraire. Pour élaborer cette note, les ex députés – il s’agit surtout des membres du Parti constitutionnel démocrate – se rendirent dans une ville de Finlande, la ville de Vyborg, ce qui fit appeler cette note « l’Appel de Vyborg ». Après quoi, ils se rendirent tranquillement chez eux. Malgré le caractère anodin de leur « révolte », ils furent jugés quelque temps après par un tribunal spécial et condamnés à quelques peines, d’ailleurs légères. Un seul député, jeune paysan du gouvernement de Stavropol, le « travailliste » F. Onipko, ne se résigna pas. Ce fut lui l’animateur de ce second soulèvement de Cronstadt. Saisi sur place, il faillit être passé par les armes. Finalement, il fut jugé et condamné à l’exil en Sibérie. Il se sauva et se réfugia à l’étranger. Il retourna en Russie en 1917.
Aussitôt après la dissolution de la « première Douma », le gouvernement modifia sensiblement la loi électorale et convoqua la « deuxième Douma ». Incomparablement plus modérée et plus médiocre que la première, celle-ci parut, tout de même, encore trop révolutionnaire au gouvernement. Elle fut dissoute à son tour. La loi électorale fut à nouveau remaniée. On arriva à une troisième et, enfin, à une quatrième Douma, laquelle – instrument docile entre les mains du gouvernement – put traîner une existence morne et stérile jusqu’à la révolution de 1917.
En tant que réformes, lois utiles, etc., la Douma n’aboutit à rien. Mais sa présence ne resta pas absolument sans résultats. Les discours critiques de certains députés de l’opposition, l’attitude du tsarisme face aux problèmes brûlants de l’heure, l’impuissance même du « Parlement » à les résoudre, tant que l’absolutisme s’obstinait à rester debout, tous ces faits éclairaient de plus en plus les vastes masses de la population sur la véritable nature du régime.
Deux processus parallèles caractérisent surtout la période en question : d’une part, la dégénérescence accélérée, définitive – on peut vraiment dire la pourriture – du système absolutiste ; et, d’autre part, l’évolution rapide de la conscience des masses.
Les indices incontestables de la décomposition du tsarisme étaient assez connus à l’étranger. L’attitude et le train de vie de la cour impériale étaient de ce genre classique qui, généralement, précède la chute des monarchies. L’incapacité et l’indifférence de Nicolas II, le crétinisme de ses ministres et fonctionnaires, ainsi que leur vilenie, le mysticisme vulgaire qui s’empara du monarque et de sa famille (la fameuse épopée de Raspoutine, etc.), tout cet ensemble de phénomènes n’était un secret pour personne à l’étranger.
Beaucoup moins connus étaient les changements profonds qui s’effectuaient dans la psychologie des masses populaires. Et, cependant, l’état d’âme d’un homme du peuple de l’an 1912 n’avait plus rien de commun avec sa psychologie primitive d’avant 1905. Des couches populaires, tous les jours plus vastes, devenaient nettement anti tsaristes. Seule, la réaction féroce qui interdisait toute organisation ouvrière et, aussi, toute propagande révolutionnaire, empêchait les masses de préciser, de fixer leurs idées.
En attendant, tous les problèmes vitaux restaient en suspens. Le pays se trouvait dans une impasse. Une révolution décisive devenait inévitable. Il ne manquait plus que l’impulsion et les armes. C’est dans ces conditions qu’éclata la guerre de 1914. Elle offrit bientôt aux masses l’impulsion nécessaire et les armes indispensables.
LA GRANDE EXPLOSION ET SES SUITES (1917 À NOS JOURS).
Comme cela se produit habituellement dans les cas analogues, au début de la guerre, le gouvernement russe, lui aussi, réussit à éveiller dans les masses toute la gamme de mauvais instincts, de passions dues à un atavisme animal, de sentiments périmés, aujourd’hui humainement et socialement criminels, tels que le nationalisme, le patriotisme, etc. Comme partout ailleurs, en Russie également, des millions d’hommes furent dupés, désorientés, fascinés et contraints à courir, tel un troupeau de bêtes à l’abattoir, vers les frontières. Les graves problèmes de l’heure furent abandonnés, oubliés. Les quelques premiers « succès » obtenus par les troupes russes réchauffèrent encore davantage « le grand enthousiasme du peuple ».
Mais, assez rapidement, la face des choses changea en Russie. La série des défaites commença et, avec elles, renaquirent bientôt les inquiétudes, les déceptions, le mécontentement. La guerre coûtait terriblement cher, en argent et surtout en hommes. Des millions de vies humaines durent être sacrifiées, sans aucune utilité, sans la moindre compensation. De nouveau, le régime témoigna ouvertement son incapacité, sa faillite, sa pourriture. Et, de plus, certaines défaites, qui coûtèrent, cependant, des monceaux de victimes, restèrent inexplicables, mystérieuses, suspectes. À travers tout le pays, on parla, non seulement des négligences criminelles, d’une incapacité flagrante, mais surtout d’espionnage dans le commandement suprême, de haute trahison à la cour même. On accusait, presque ouvertement, les membres de la famille impériale d’avoir des sympathies pour la cause allemande, d’avoir même des ententes avec l’ennemi. La cour s’inquiétait peu de ces bruits. Quelques mesures prises tardivement ne suffirent pas à les démentir. Dans ces conditions, « l’enthousiasme » du peuple, et aussi celui de l’armée, s’évaporèrent entièrement, déjà en 1916.
Toutefois, ce ne furent pas tant les événements d’ordre purement militaire qui déterminèrent la grande explosion de février 1917. Ce qui désespéra les masses du peuple, ce qui fit déborder la coupe de patience, ce fut surtout la désorganisation complète de la vie économique à l’intérieur du pays. C’est dans ce domaine que l’impuissance du gouvernement tsariste éclata avec une évidence immédiate, palpable. C’est là que ses effets désastreux imposèrent aux masses une action urgente et décisive.
Tous les pays belligérants éprouvèrent vers la même époque de grandes difficultés d’ordre économique et financier résultant de la nécessité de nourrir, d’approvisionner, de soutenir longuement des millions d’hommes sur l’immensité démesurée des fronts, et d’assurer, en même temps, la vie normale à l’intérieur. Partout, cette double tâche exigea une grande tension de forces. Mais, partout – même en Allemagne, où la situation était particulièrement difficile –, elle a été résolue avec plus ou moins de succès. Partout, sauf en Russie, où le gouvernement ne sut rien prévoir, rien prévenir, rien organiser. En janvier 1917, la situation devint intenable. Le chaos économique, la misère de la population travailleuse atteignirent un tel point que les ouvriers de quelques grandes villes – Petrograd, par exemple – commencèrent à manquer, non seulement de viande, de beurre, de sucre, mais même de pain. Cette situation misérable s’aggrava rapidement. Dans le courant du mois de février, en dépit des efforts déployés par la Douma, par les zemstvos, les municipalités, etc., non seulement la population des villes se vit vouée à la famine, mais aussi l’approvisionnement de l’armée devint défectueux. Et, en même temps, la débâcle militaire devenait complète.
Alors, les ouvriers de Petrograd, se sentant solidaires avec le pays entier et se trouvant en extrême agitation depuis plusieurs semaines, déjà, affamés et privés de tous moyens d’existence, ne recevant même plus de pain, descendirent en masse dans les rues de la capitale, manifestèrent et refusèrent net de se disperser. Le premier jour – 25 février 1917, vieux style – cette manifestation resta prudente et inoffensive. En masses compactes, les ouvriers, avec leurs femmes et enfants, remplissaient les rues et criaient :
« Du pain ! Du pain ! Nous n’avons rien à manger ! Qu’on nous donne du pain, ou qu’on nous fusille tous !... Nos enfants meurent de faim ! Du pain ! Du pain ! »
Le gouvernement dépêcha contre les manifestants des détachements de troupes à cheval. Or, d’abord, il y avait peu de troupes à Petrograd ; ensuite – et ce fut le point capital dans l’affaire –, les soldats, sourire aux lèvres, trottaient prudemment à travers la foule, sans sortir leurs sabres ou leurs fusils, sans écouter le commandement des officiers. Mieux encore : en maints endroits, les soldats fraternisaient avec les ouvriers et allaient même jusqu’à leur remettre leurs fusils. Naturellement, cette conduite des troupes encouragea les masses. Le 26 février au matin, la démonstration tourna nettement en mouvement révolutionnaire. Des cris – « Vive la Révolution ! À bas le tsarisme ! » – retentirent dans la foule dont la conduite devenait d’heure en heure plus menaçante, plus offensive. Bientôt apparurent les premiers drapeaux rouges. Les soldats gardaient toujours la neutralité ou même se mêlaient à la foule, de sorte que le gouvernement ne pouvait plus compter sur ses troupes. Il lança alors contre les rebelles toutes les forces policières de la capitale. Les policiers formèrent en hâte des détachements répressifs. Ils installèrent en plusieurs endroits, sur les toits des maisons, et même sur quelques églises, des mitrailleuses ; et bientôt, ils commencèrent leur offensive générale contre les masses en émeutes. La lutte fut chaude durant toute la journée du 26 février. En beaucoup d’endroits, la police fut délogée, ses agents assassinés, et les mitrailleuses réduites au silence. Mais, ailleurs, les forces policières résistaient avec acharnement. Le tsar, qui se trouvait sur le front, fut prévenu télégraphiquement de la gravité des événements.
L’action décisive se joua le 27 février au matin. Une très grande masse de manifestants, en pleine effervescence, s’étant rassemblée sur la place de la gare Nicolaïevsky, le gouvernement y dépêcha deux régiments de cavalerie, dont il pouvait encore disposer, ainsi que de forts détachements de police à pied et à cheval. Les régiments prirent position d’un côté, et la police de l’autre côté de la place, de sorte que la foule se trouvait entre deux feux. Après les sommations d’usage, l’officier de la police donna l’ordre de charger. Aussitôt, un officier, commandant les régiments de cavalerie, sortit son sabre et, aux cris de « Chargeons la police ! En avant ! », lança les deux régiments contre les forces policières. En un clin d’œil, ces dernières furent culbutées, renversées, écrasées. Entourés d’une foule en délire, les régiments se rendirent aussitôt, drapeaux déployés, au palais de Tauride, où siégeait la Douma, et se mirent entièrement à la disposition de cette dernière.
Les événements qui suivirent sont suffisamment connus. Un gouvernement provisoire, comprenant des membres de la Douma, fut formé et acclamé avec enthousiasme par la population. Le tsar, qui se rendait en hâte vers la capitale par chemin de fer, vit son train s’arrêter à Pskow et fut obligé de signer, séance tenante, son abdication, pour lui-même et son fils Alexis. Le premier acte de la révolution était accompli.
Si nous avons raconté les péripéties de cette révolution de février d’une façon assez détaillée, c’est pour en faire ressortir le point capital que voici : une fois de plus, l’action des masses fut une action spontanée qui couronna logiquement, fatalement, une longue période d’expériences vécues et de préparation morale. Cette action ne fut guidée ni organisée par aucun parti politique. Soutenue par le peuple en armes – l’armée –, elle fut victorieuse.
D’ailleurs, à cause de la répression, toutes les organisations centrales des partis politiques de gauche, ainsi que leurs leaders, se trouvaient, au moment de la révolution, loin de la Russie. Martoff (du Parti social démocrate), Tchernoff (du Parti socialiste révolutionnaire), Trotski , Lénine, Lounatcharsky, Losovsky, etc., tous ces hommes vivaient à l’étranger. Ce ne fut qu’après la révolution de février qu’ils regagnèrent leur pays.
Le « gouvernement provisoire » formé par la Douma, devenue souveraine sur les débris du tsarisme, était, bien entendu, nettement bourgeois et conservateur. Ses membres – prince Lvoff et autres – appartenaient presque tous, politiquement, au Parti constitutionnel, et, socialement, aux classes privilégiées. Pour eux, une fois l’absolutisme par terre, la révolution était virtuellement terminée. Maintenant, il s’agissait de « rétablir l’ordre », d’améliorer peu à peu la situation générale à l’intérieur du pays, ainsi que sur le front, et surtout de préparer tranquillement la convocation de l’Assemblée constituante, laquelle devrait établir les nouvelles lois fondamentales du pays, le nouveau régime politique, le nouveau mode de gouvernement, etc. D’ici là, le peuple n’aura qu’à attendre patiemment, sagement, en bon enfant, les faveurs que ses nouveaux maîtres voudront bien lui octroyer. Ces nouveaux maîtres, le gouvernement provisoire se les représentait, naturellement, comme de bons bourgeois modérés, dont le pouvoir n’aurait rien à envier aux autres pays « civilisés ». Les visées politiques du gouvernement provisoire ne dépassaient guère une bonne monarchie constitutionnelle. À la rigueur, certains de ses membres prévoyaient timidement une république bourgeoise très modérée. Le problème agraire, la question ouvrière, etc., devaient être solutionnés par le futur gouvernement définitif d’après les modèles occidentaux. En fin de compte, le gouvernement provisoire était plus ou moins sûr de pouvoir utiliser la période préparatoire, en l’allongeant au besoin, pour réduire au calme, à la discipline et à l’obéissance les masses populaires, au cas où ces dernières auraient manifesté trop violemment leur désir de dépasser les limites ainsi prévues.
Il est étonnant à quel point les hommes politiques « éprouvés », les érudits, les économistes et les sociologues savants s’étaient trompés dans leurs prévisions et leurs calculs. La réalité des choses leur échappa complètement. Je me rappelle, par exemple, avoir assisté à New York, en avril ou mai 1917, à la conférence d’un honorable professeur qui fit une longue analyse, très « scientifique », de la composition et de l’action probable de la prochaine assemblée constituante russe. J’ai posé au respectable professeur une seule question : que prévoyait-il pour le cas où la Révolution russe se passerait d’une assemblée constituante ? Assez dédaigneusement, assez ironiquement, l’honorable professeur dit, pour toute réponse, que son contradicteur était certainement un anarchiste dont l’hypothèse fantaisiste ne l’intéressait pas. L’avenir démontra bientôt que l’honorable professeur se trompait magistralement. Dans son exposé de deux heures, il n’avait omis d’analyser qu’une seule éventualité : celle, précisément, qui devint réalité quelques mois après !... Qu’il me soit permis d’exprimer, à ce propos, ici même, un avis personnel. En 1917, MM. les politiciens, les écrivains, les professeurs – russes et étrangers – ont, à de très rares exceptions près, dédaigneusement et magistralement omis de prévoir le triomphe du bolchevisme dans la Révolution russe. Aujourd’hui, ce bolchevisme triomphant étant – momentanément et pour un bref délai, historiquement parlant – un fait accompli, beaucoup de ces messieurs veulent bien l’admettre. Je suis absolument sûr qu’avec la même « clairvoyance », le même dédain d’abord, et le même « savoir-faire » ensuite, ces mêmes messieurs manqueront de prévoir à temps, pour l’accepter plus tard, le triomphe – véritable et définitif – de l’anarchisme dans la révolution sociale mondiale.
Le gouvernement provisoire ne se rendait certainement pas compte des multiples éléments qui, infailliblement, devaient se dresser devant lui en obstacles insurmontables.
L’obstacle le plus sérieux fut le caractère même des problèmes que le gouvernement provisoire avait à résoudre.
D’abord, le problème de la guerre. Physiquement et moralement, l’armée russe était à bout. L’état misérable où se trouvait le pays, d’une part, et la révolution, d’autre part, l’ébranlèrent encore plus. Deux solutions se présentaient à l’esprit du gouvernement : soit cesser la guerre, conclure une paix séparée, démobiliser l’armée et se consacrer entièrement aux problèmes intérieurs ; soit faire l’impossible pour maintenir le front, sauvegarder la discipline, faire remonter le moral de l’armée et continuer la guerre, au moins jusqu’à la convocation de l’Assemblée constituante. La première solution était, évidemment, inadmissible pour un gouvernement bourgeois, nationaliste, allié à d’autres belligérants, et considérant comme un déshonneur national la rupture éventuelle de cette alliance. De plus, en tant que gouvernement « provisoire », il était obligé de se tenir strictement à la formule : pas de changement important avant la convocation de l’Assemblée constituante qui aura pleins droits de prendre toute décision. Le gouvernement provisoire adopta donc la seconde solution. Or, dans les conditions présentes, celle-ci était irréalisable. Ce problème se trouvait ainsi fatalement voué à rester en suspens.
Le deuxième problème épineux était le problème agraire. Les paysans – 85 % de la population – aspiraient à la terre. La révolution donna à ces aspirations un nouvel élan irrésistible. Réduites à l’impuissance, exploitées et dupées depuis des siècles, les masses paysannes perdaient patience. Elles ne voulaient rien entendre, rien savoir. Il leur fallait la terre, coûte que coûte, et tout de suite, sans procédure ni cérémonie. Les paysans s’en emparaient même, un peu partout, en en chassant les propriétaires, là où ces derniers ne fuyaient pas d’eux-mêmes. Ils résolvaient ainsi le problème agraire à leur façon et de leur chef, sans attendre les délibérations, les machinations et les décisions du gouvernement ou de la Constituante. L’armée, composée surtout rie paysans, était certainement prête à soutenir cette action directe, Le gouvernement provisoire se vit acculé, soit à s’incliner devant cet état de choses et à l’accepter, soit à résister, c’est-à-dire, lutter contre les paysans en révolte et aussi, presque certainement, contre l’année. Naturellement, il adopta la tactique de la résistance. Mais, celle-ci n’avait aucune chance de succès.
Le problème ouvrier était presque aussi insoluble pour un gouvernement bourgeois que celui des paysans. Les masses ouvrières cherchaient à obtenir dans la révolution le maximum de bien-être et de droits. Or, le gouvernement bourgeois cherchait, naturellement, à réduire ces droits au minimum. Des luttes très graves étaient à prévoir sur ce champ de bataille également.
Le formidable problème économique était, lui aussi, des plus redoutables, ceci d’autant plus qu’il ne souffrirait aucun délai. En pleine guerre, et en pleine révolution, il fallait organiser à nouveau la production, la répartition, l’échange, les finances, etc., ceci dans un pays désorganisé, bouleversé, épuisé.
Il restait, enfin, le problème purement politique qui, dans les conditions données, ne présentait aucune solution plausible. Le gouvernement provisoire se chargeait, bien entendu, de convoquer le plus tôt possible l’Assemblée constituante. Mais, pour mille raisons, cette tâche ne pouvait lui réussir. Et, d’abord, il devait nécessairement redouter cette assemblée. Son désir intime était certainement de reculer autant que possible la convocation de la constituante et de chercher à installer, en attendant, par un coup de main heureux, une monarchie constitutionnelle.
Or, « en attendant », d’autres obstacles, plus redoutables encore que la complexité des problèmes à résoudre, se dressèrent devant lui.
Le principal fut la résurrection des soviets ouvriers, surtout de celui de Petrograd. Il fut remis debout dans les tout premiers jours de la révolution. Certes, à ce moment, les ouvriers y déléguèrent surtout des socialistes modérés (mencheviks et socialistes révolutionnaires de droite). Mais son idéologie et son programme étaient absolument contraires aux projets du gouvernement provisoire ; et, d’autre part, l’influence morale et l’activité du soviet de Petrograd parvinrent rapidement à rivaliser avec celles du gouvernement, au désavantage de ce dernier. Ce soviet forma dans le pays une sorte de second gouvernement avec lequel le « gouvernement provisoire » devait compter. Il va de soi que ce dernier aurait bien voulu faire la guerre au soviet. Mais, entreprendre cette action contre les ouvriers organisés, au lendemain d’une révolution qui proclama hautement la liberté absolue de la parole, de toute organisation et de toute action sociale, était chose impossible. Le gouvernement fut donc obligé de faire bonne mine à mauvais jeu, de tolérer son concurrent et même de flirter avec lui. Ceci d’autant plus qu’il sentait bien la fragilité des sympathies qui montaient vers lui de la masse travailleuse et de l’armée. Il se rendait bien compte qu’au premier conflit social sérieux, ces deux forces décisives se rangeraient infailliblement du côté du soviet. La présence de ce second gouvernement, si gênant, mais avec lequel le gouvernement provisoire était obligé de traiter, représentait, pour ce dernier, un des plus gros obstacles à surmonter.
La critique violente, la propagande vigoureuse de tous les partis socialistes et surtout des éléments d’extrême gauche (socialistes révolutionnaires de gauche, bolcheviques, maximalistes, anarchistes) rendaient cet obstacle encore plus redoutable.
En somme, seule une classe bourgeoise très puissante, fortement organisée et ayant à sa disposition une grande force matérielle (armée, argent, etc.) – et encore dans des conditions générales plus ou moins normales – aurait pu tenter, avec espoir de succès, d’imposer sa volonté et son pouvoir au pays en révolution. Or, une telle bourgeoisie faisait totalement défaut en Russie. Et quant aux conditions générales, elles étaient certainement défavorables à une pareille action.
Pour toutes ces raisons, le « gouvernement provisoire » fut fatalement et immédiatement réduit à une impuissance évidente, ridicule, mortelle. Il louvoyait, il tergiversait, il cherchait à gagner du temps... Et, en attendant, tous les problèmes brûlants restaient en panne. La critique et, ensuite, la lutte contre le gouvernement prenaient tous les jours de l’ampleur. À peine soixante jours après son installation, ce gouvernement dut, sans lutte, céder sa place à un gouvernement dit « de coalition », dont le membre le plus influent fut A. Kerenski, socialiste révolutionnaire très modéré.
Ce gouvernement « coalisé » (social bourgeois), pouvait-il espérer arriver à de meilleurs résultats ? Certes, non, car les conditions de son existence et l’impuissance de son action devaient être fatalement les mêmes que celles du premier gouvernement provisoire. Obligé de s’appuyer sur la bourgeoisie faible et désorientée, forcé de continuer la guerre, impuissant à apporter une solution réelle aux problèmes de l’heure, attaqué vigoureusement par les gauches et se débattant parmi les difficultés de toutes sortes et de toute heure, ce deuxième gouvernement périt sans gloire, de même que le premier, et à peu près dans le même délai, pour céder sa place à un troisième gouvernement, composé presque uniquement des socialistes. C’est à ce moment que A. Kerenski, maître et chef suprême de ce troisième gouvernement, devint, pour quelques mois, une sorte de duce du pays, et que le Parti socialiste révolutionnaire parut devoir l’emporter comme maître de la révolution.
Pourtant, il n’en fut rien...
Les raisons de la chute du gouvernement de Kerenski furent au fond les mêmes qui provoquèrent l’échec des gouvernements précédents. Ce furent surtout : son impuissance lamentable à résoudre les problèmes du moment, l’impossibilité pour les socialistes modérés de cesser la guerre, et leur désir d’arrêter la révolution dans les limites d’un régime bourgeois démocratique.
Mais la situation du gouvernement de Kerenski s’aggrava encore, en raison de quelques nouveaux facteurs :
-
Primo, le Parti communiste (bolcheviste), ayant rassemblé à cette époque toutes ses forces et possédant un organisme de propagande extrêmement puissant, répandait tous les jours, par mille voix, sa critique substantielle et vigoureuse, ses idées sociales nettement révolutionnaires, et surtout ses promesses de résoudre avec plein succès tous les problèmes de la révolution, s’il arrivait au pouvoir. De plus en plus écouté et suivi par les masses ouvrières et par l’armée, le Parti communiste disposait, déjà en juin, de cadres imposants d’agitateurs, de propagandistes, d’organisateurs et d’hommes d’action. De plus, il avait à sa tête un comité central puissant dirigé par Lénine. Il déploya alors une activité fébrile, farouche, foudroyante, et se sentit bientôt maître de la situation.
Rappelons ici même que la fameuse offensive échouée de Kerenski sur le front allemand en juin 1917, le soulèvement des ouvriers de Petrograd soutenus par des marins de Cronstadt en juillet (soulèvement vaincu par Kerenski, mais qui porta le coup de grâce à sa popularité) et, enfin, l’aventure du général Korniloff, lequel tenta, avec plusieurs régiments du Caucase prélevés sur le front, une marche contre-révolutionnaire sur Petrograd, et contre lequel le gouvernement de Kerenski ne réagit que très mollement et en pure apparence – rappelons que tous ces événements et leurs conséquences achevèrent de détourner les masses ouvrières et l’armée de ce gouvernement, de son chef et, en général, des partis socialistes modérés. Au début du mois d’août, le chemin fut déjà déblayé par une offensive vigoureuse du Parti communiste.
-
Secundo – et ce fait joua un rôle capital dans l’affaire –, vers la même époque, les bolcheviques réussirent à emporter une victoire écrasante aux nouvelles élections, aussi bien dans les Soviets que dans tous les autres organismes ouvriers (dont nous parlerons un peu plus loin). Les socialistes modérés (mencheviks et socialistes révolutionnaires de droite) cédèrent partout leurs places à des bolcheviques, qui s’emparèrent ainsi définitivement de toute l’action ouvrière et de toute la sympathie de l’armée. Les bonnes positions stratégiques pour l’offensive étaient maintenant entre leurs mains.
Résumons : l’impuissance absolue, évidente, de tous les gouvernements, conservateurs ou modérés, qui se suivirent de février à octobre, à résoudre, dans les conditions données, les problèmes d’une gravité et d’une acuité exceptionnelles, dressés devant le pays par la révolution – telle fut la raison principale pour laquelle ce pays jeta consécutivement par terre, dans le court espace de huit mois, le gouvernement d’allure constitutionnelle, la démocratie nettement bourgeoise, et, enfin, le régime socialiste modéré. La propagande vigoureuse de ceux d’extrême gauche pour la révolution sociale immédiate et intégrale, comme seul moyen de salut, le mot d’ordre de la révolution sociale lancé dans les masses, et aussi d’autres facteurs de moindre importance, contribuèrent à cette marche foudroyante de la révolution. Ainsi, la Révolution russe, déclenchée fin février 1917, comme conséquence naturelle de multiples facteurs variés, brûla rapidement, en raccourci, toutes les étapes d’une révolution politique bourgeoise, démocratique et socialiste modérée. En octobre, le chemin étant déblayé de toutes les entraves, la révolution se plaça, effectivement et définitivement, sur le terrain de la révolution sociale. Et il fut tout à fait logique et naturel qu’après la faillite de tous les gouvernements et partis politiques modérés, les masses laborieuses se tournent vers le dernier parti existant, le seul qui restait debout, le seul qui envisageait sans crainte la révolution sociale, le seul qui promettait, à condition d’arriver au pouvoir, la solution rapide, intégrale et heureuse de tous les problèmes : le Parti communiste (bolcheviste).
Une question s’impose aussitôt. Puisque les anarchistes, comme je l’ai dit plus haut, exerçaient, eux aussi, une influence sur les masses, quelles furent les raisons pour lesquelles ces dernières suivirent de préférence le Parti bolcheviste, au lieu de se pénétrer de l’idée libertaire et de tenter sa réalisation ? La question est, pour les anarchistes, d’une importance considérable. Elle a déjà été traitée plus d’une fois dans la presse libertaire. Mais il me semble que son examen fut toujours incomplet et partial. Jusqu’à présent, ce problème a été étudié surtout par des hommes qui cherchaient à critiquer l’idée ou le mouvement anarchistes, à imputer l’insuccès final de l’une et de l’autre, dans la Révolution russe, à l’insuffisance de l’anarchisme lui-même. C’est pourquoi il est bon de traiter ici cette question d’une façon aussi approfondie que possible.
Selon moi, les raisons fondamentales de la « victoire » du bolchevisme sur l’anarchisme, au cours de la révolution de 1917, furent les suivantes :
-
L’état d’esprit des masses populaires en général.
De même que partout ailleurs, en Russie aussi, l’État et le gouvernement apparaissaient toujours aux masses comme des éléments indispensables, naturels, historiquement donnés une fois pour toutes. Les gens ne se demandaient même pas si l’État, si le gouvernement étaient des institutions utiles, acceptables. Une pareille question ne leur venait jamais à l’esprit ; et si quelqu’un la formulait, il commençait – et, très souvent aussi, il finissait – par ne pas être compris.
-
Ce préjugé étatiste, presque inné, dû à l’ambiance séculaire, était raffermi, ensuite – surtout en Russie où la littérature anarchiste n’existait presque pas, à part quelques brochures et tracts clandestins –, par la presse tout entière, y compris celle des partis socialistes. Il ne faut pas oublier que la jeunesse russe avancée était éduquée à l’aide d’une littérature qui, invariablement, présentait le socialisme sous un jour étatiste. Les marxistes et les antimarxistes se disputaient entre eux, mais pour les uns comme pour les autres, l’État restait la base indiscutable de toute société humaine. Jamais les jeunes générations russes ne se représentaient le socialisme autrement que dans un cadre étatiste. La conception anarchiste leur resta inconnue, à part quelques rares exceptions individuelles, jusqu’aux événements de 1917.
-
Pour les raisons qui viennent d’être exposées, les partis socialistes, y compris les bolcheviques, purent disposer, au début même de la révolution de 1917, de cadres importants de militants – intellectuels et ouvriers – prêts à une vaste action. Les membres des partis socialistes modérés étaient, à ce moment déjà, assez nombreux en Russie, ce qui fut une des raisons pour lesquelles ce socialisme remporta ses succès. Les cadres bolcheviques se trouvaient alors à l’étranger. Mais tous ces hommes regagnèrent rapidement leur pays et se mirent aussitôt à l’œuvre. Par comparaison aux forces bolcheviques qui agissaient ainsi en Russie, dès le début de la révolution, sur une vaste échelle et d’une façon compacte, organisée, serrée, les anarchistes n’étaient qu’une petite poignée insignifiante. Je me souviens que, rentré de l’étranger en Russie et arrivé à Petrograd dans les premiers jours de juillet 1917, j’ai été tout de suite frappé par le nombre considérable d’affiches bolcheviques, annonçant des meetings et des conférences dans tous les coins de la capitale et de la banlieue. J’ai appris aussi que le Parti bolchevique publiait déjà, dans la capitale et ailleurs, des journaux quotidiens à gros succès, et qu’il possédait, un peu partout – dans les usines, dans les administrations, dans l’armée, etc. – des noyaux importants et très influents. Et je constatai, en même temps, avec une amère déception, l’absence totale, à Petrograd, d’un journal anarchiste, ainsi que de toute propagande verbale. Certes, il y existait quelques groupements libertaires, assez actifs, mais très primitifs. Ces « cadres » étaient absolument insuffisants pour pouvoir mener une œuvre de propagande indispensable. Au cinquième mois d’une formidable révolution, aucun journal, aucune propagande anarchiste dans la capitale du pays ! Ceci en face d’une propagande acharnée, verbale et écrite, du Parti bolchevique. Telle a été ma triste constatation. Ce n’est qu’au mois d’août, et avec de très grandes difficultés, que notre petit groupe anarcho-syndicaliste, composé surtout de camarades rentrés de l’étranger, réussit, enfin, à mettre sur pied un journal hebdomadaire : Goloss Trouda (La Voix du Travail). Et quant à la propagande verbale, on ne comptait guère à Petrograd que trois ou quatre camarades capables de la mener.
À Moscou, la situation était meilleure, car il y existait déjà un quotidien libertaire, publié par une assez vaste fédération, sous le titre : Anarchie. Mais, dans le reste du pays, les forces et la propagande libertaires étaient relativement très faibles, et il faut s’étonner que, malgré cette insuffisance, les anarchistes surent gagner, un peu partout, une certaine influence. Lorsque, à ma rentrée en Russie, des camarades voulurent connaître mes premières impressions, je leur dis ceci : « Notre retard est irréparable. C’est comme si nous avions à rattraper à pied un train express qui est à cent kilomètres devant nous, qui file à cent kilomètres à l’heure et qui se trouve en pleine possession des bolcheviques. Nous devons, non seulement rattraper ce train, mais nous y accrocher en pleine marche, y grimper, y combattre les bolcheviques, les en déloger et, enfin, non pas nous emparer du train, mais – ce qui est beaucoup plus difficile – le mettre à la disposition des masses en les aidant à le faire marcher. Il faut un miracle pour que tout cela réussisse. Notre devoir est d’espérer ce miracle et d’y travailler. » J’ajoute que ce miracle faillit se produire au moins deux fois au cours de la révolution : la première, à Cronstadt, lors du soulèvement de 1921 ; la deuxième, en Ukraine, lors du mouvement makhnoviste. Nous en reparlerons plus loin.
-
Je suis d’avis que, malgré l’insuffisance des cadres anarchistes, l’idée eût pu l’emporter si les masses ouvrières russes avaient eu à leur disposition, au moment de la révolution, leurs organismes de classe de vieille date, expérimentés, éprouvés, prêts à agir de leur chef et à mettre en pratique ladite idée. Or, la réalité était tout autre. Les organisations ouvrières ne surgirent qu’au cours de la révolution. Certes, elles prirent aussitôt, numériquement, un élan prodigieux. Rapidement, le pays entier se couvrit d’un vaste réseau de syndicats, de comités d’usines et de soviets (conseils). Mais ces organismes étaient là sans préparation ni stage d’activité préalable, sans expérience acquise, sans idéologie nette, sans initiative indépendante. Ils n’avaient jamais encore vécu des luttes d’idées ou autres. Ils n’avaient aucune tradition historique, aucun savoir-faire, aucune notion immédiate de leur rôle, de leur tâche, de leur véritable mission. L’idée libertaire leur était absolument inconnue. Et le temps était trop court pour que les faibles forces anarchistes pussent les éclairer dans la mesure nécessaire.
Les groupements libertaires comme tels ne peuvent être que des « postes émetteurs » d’idées. Pour que ces dernières soient appliquées à la vie, il faut des « postes récepteurs » : des organismes ouvriers prêts à se saisir de ces idées-ondes et à les mettre à exécution. Si de tels organismes existent, les anarchistes prennent naturellement part à ces réalisations en qualité de simples membres des dits organismes, tout en y apportant leur aide éclairée, leurs conseils, leur exemple, etc. Or, en Russie, ces « postes récepteurs » manquaient totalement, les organisations ouvrières surgies pendant la révolution ne pouvant pas tout de suite l’emplir ce rôle. Les idées anarchistes, tout en étant lancées très énergiquement par quelques « postes émetteurs » – peu nombreux, d’ailleurs – se dispersaient « dans l’air », sans être utilement « captées », donc sans résultats pratiques, voire presque sans résonance effective. Pour que, dans ces conditions, l’idée anarchiste pût se frayer un chemin et l’emporter, il aurait fallu, soit que le bolchevisme n’existât pas ou que les bolcheviques agissent en anarchistes, soit, que la révolution réservât aux libertaires le temps nécessaire qui eût permis aux organismes ouvriers de « capter » l’idée et de devenir aptes à la réaliser, avant d’être accaparés et subjugués par l’État bolchevique. La première éventualité était, évidemment, impossible. Et quant à la seconde, elle ne se produisit pas, les bolcheviques s’étant emparé des organisations ouvrières avant que celles-ci pussent se familiariser avec l’idée anarchiste, résister à leur accaparement et orienter la révolution dans le sens libertaire. Je résume : l’absence de « postes récepteurs », c’est-à-dire d’organismes ouvriers socialement prêts à saisir et à réaliser, dès le début, l’idée anarchiste, et, ensuite, le manque de temps nécessaire pour que de tels « postes récepteurs » se forment, telle fut l’une des raisons principales de la non-réussite de l’anarchisme dans la révolution de 1917.
Il existe une opinion qui jouit de quelque crédit, même parmi les anarchistes. On prétend, notamment, que, vu les conditions données, ces derniers auraient dû, renonçant momentanément à leur négation des partis, de la démagogie, du pouvoir, etc., agir « à la bolchevique », c’est-à-dire former une sorte de parti politique et tâcher de prendre provisoirement le pouvoir. Dans ce cas, dit-on, ils auraient pu « entraîner les masses », l’emporter sur les bolcheviques et saisir le pouvoir « pour organiser ensuite l’anarchie ». Une question de principe, très grave, est posée par cette façon de voir. Sans pouvoir m’y engouffrer ici, je me borne à exposer brièvement mon avis personnel. Je considère ce raisonnement comme fondamentalement et dangereusement faux. Car, même si les anarchistes, dans ce cas, avaient remporté la victoire (ce qui est fort douteux), celle-ci, achetée au prix d’abandon « momentané » du principe fondamental de l’anarchisme, n’aurait jamais pu aboutir au triomphe de ce même principe. Entraînés par la force et la logique des choses, les anarchistes au pouvoir – quel non-sens ! – n’auraient abouti qu’à une variété du bolchevisme. Si cela pouvait être autrement, c’est-à-dire, s’il était possible de tuer le pouvoir par le pouvoir, l’anarchisme n’aurait aucune raison d’être. On n’est pas anarchiste parce qu’on veut supprimer le pouvoir au moyen du pouvoir et des « masses entraînées » : on est anarchiste parce qu’on tient pour impossible de supprimer le pouvoir, l’autorité et l’État à l’aide du pouvoir, de l’autorité, de l’État et des « masses entraînées ». Dès qu’on a recours à ces moyens – ne fût-ce que « momentanément » et avec de très bonnes intentions –, on cesse d’être anarchiste, on renonce à l’anarchisme, on se rallie au principe bolchevique. Rien que cette idée de chercher à « entraîner les masses » derrière le « pouvoir » est contraire à l’anarchisme, lequel, justement, ne croit pas aboutir à l’anarchie au moyen des masses entraînées par des hommes au pouvoir.
-
Je citerai encore un fait dont la portée, sans égaler celle des raisons précitées, n’en fut pas moins considérable. Afin de frapper l’esprit des masses, afin de gagner leur confiance et leurs sympathies, le Parti bolchevique lança, par sa presse et par sa parole, des mots d’ordre qu’il emprunta aux anarchistes : « Vive la révolution sociale ! » « À bas la guerre, vive la paix immédiate ! » Et surtout : « La terre aux paysans, les usines aux ouvriers ! » Tels furent ces mots d’ordre fascinants. Les masses laborieuses s’en saisirent vite. Or, dans la bouche ou sous la plume des anarchistes, ces mots d’ordre étaient absolument sincères, car ils correspondaient à des principes adéquats ; tandis que, chez les bolcheviques, ils signifiaient des solutions tout à fait différentes de celles des libertaires.
Ainsi, « révolution sociale » signifiait pour les anarchistes une transformation qui allait se produire en dehors de toute organisation étatiste, de toute activité politique, de tout système gouvernemental, autoritaire. Pour les anarchistes, l’essence même de la révolution sociale était la construction d’une société nouvelle avec des méthodes nouvelles, c’est-à-dire non pas à l’aide de l’État, d’un gouvernement, etc., mais au moyen d’associations libres de toutes sortes, de leurs fédérations, de leur activité naturelle, saine, productive. Or, les bolcheviques prétendaient faire la révolution sociale à l’aide, justement, d’un État omnipotent, d’un gouvernement tout-puissant, d’un pouvoir dictatorial. Tant qu’une révolution n’a pas tué l’État, le gouvernement, la politique, etc., les anarchistes ne la considèrent pas comme une révolution sociale, mais, simplement, comme une révolution politique (qui, bien entendu, peut être plus ou moins assaisonnée d’éléments sociaux). Or, l’arrivée au pouvoir, l’organisation de « leur » gouvernement et de « leur » État suffisent aux « communistes » pour parler d’une révolution sociale. Pour les anarchistes, « révolution sociale » signifiait, donc, la mort de l’État (en même temps que celle du capitalisme) et la naissance d’une société basée sur un autre mode d’organisation sociale. Pour les bolcheviques, « révolution sociale » signifiait, au contraire, la résurrection de l’État, c’est-à-dire la conquête et la réorganisation de l’État appelé, selon eux, à « construire le socialisme ». Les anarchistes tenaient pour impossible de construire le socialisme par l’État. Les bolcheviques prétendaient ne pouvoir le construire autrement que par l’État.
La différence d’interprétation était, on le voit, fondamentale. (Je me rappelle encore ces grandes affiches collées aux murs, un peu partout, au moment de la Révolution d’octobre, annonçant en gros caractères des conférences de Trotski sur l’organisation du pouvoir. « Erreur typique et fatale – disais-je aux camarades : car, s’il s’agit d’une révolution sociale, il faut se préoccuper de l’organisation de la Révolution, et non pas du Pouvoir ! »
L’interprétation de l’appel à la paix immédiate était aussi très différente. Les anarchistes entendaient par là une action directe de vaste envergure exercée par les masses armées elles-mêmes, par dessus la tête des gouvernants, des politiciens, des commandants, des généraux, etc. D’après les anarchistes, ces masses devaient quitter le front et rentrer dans le pays, en proclamant hautement à travers le monde leur refus de se battre stupidement pour les intérêts des capitalistes, leur dégoût de cette boucherie inutile. Les anarchistes étaient d’avis que, précisément, un tel geste – franc, intègre, décisif – aurait produit un effet foudroyant sur les soldats des autres pays et pouvait amener, en fin de compte, la fin de la guerre, peut-être même sa transformation en une révolution mondiale. Les bolcheviques, politiciens et étatistes songeaient, eux, à une paix par la voie diplomatique et politique, en résultat de pourparlers avec les généraux allemands. Comme on le voit, les deux interprétations étaient essentiellement différentes.
La terre aux paysans, les usines aux ouvriers.
Les anarchistes entendaient par là que, sans être propriété de qui que ce soit, le sol serait à la disposition de tous ceux qui désireraient le cultiver (sans exploiter personne), de leurs associations et fédérations, et que, de même, les usines, fabriques, mines, machines, etc., devaient être à la disposition de toutes sortes d’associations ouvrières productrices et de leurs vastes fédérations. Or, les bolcheviques entendaient par le même mot d’ordre l’étatisation de tous ces éléments. Pour eux, la terre, les usines, les fabriques, les mines, les machines, les moyens de transport, etc., devaient devenir propriété de l’État, lequel, ensuite, les mettrait à la disposition des travailleurs. Encore une fois, la différence de l’interprétation était fondamentale.
Quant aux masses elles-mêmes, intuitivement, elles interprétaient tous ces mots d’ordre plutôt dans le sens libertaire. Mais, comme déjà dit, la voix anarchiste était relativement si faible que les vastes masses ne l’entendaient pas. Il leur semblait que seuls les bolcheviques osaient lancer et défendre ces beaux et justes principes. Ceci d’autant plus que le Parti bolchevique se proclamait tous les jours et à tous les coins de rue le seul parti luttant pour les intérêts des ouvriers et des paysans : le seul qui, une fois au pouvoir, saurait accomplir la révolution sociale.
« Ouvriers et paysans ! Le Parti bolchevique est le seul qui vous défend. Aucun autre parti ne saura vous guider à la victoire. Ouvriers et paysans ! Le Parti bolchevique est votre parti à vous. Il est l’unique parti qui est vraiment vôtre. Aidez-le à prendre le pouvoir, et vous triompherez. »
Ce leitmotiv de la propagande bolchevique devint finalement une véritable obsession. Même le parti des socialistes révolutionnaires de gauche –parti politique autrement fort que les petits groupements anarchistes– ne put rivaliser avec les bolcheviques. Pourtant, il était fort à un tel point que les bolcheviques durent compter avec lui et lui offrir, pour quelque temps, des sièges au gouvernement.
D’autre part, les masses ne pouvaient naturellement pas pénétrer toutes les fines différences des interprétations. Il leur était impossible de comprendre toute la portée de ces différences. Et, enfin, les travailleurs russes étaient les moins rompus aux choses de la politique, ils ne pouvaient pas se rendre compte du danger de l’interprétation bolchevique. Je me souviens que, quelque deux ou trois semaines avant la Révolution d’Octobre, prévoyant la victoire du bolchevisme, je faisais des efforts désespérés pour prévenir les travailleurs, tant que cela m’était possible, au moyen de la parole et de la plume, du danger imminent pour la vraie révolution, dans le cas où les masses auraient permis au Parti bolchevique de s’installer solidement au pouvoir. J’avais beau y insister, les masses ne saisissaient pas le danger. Combien de fois on m’objectait ceci :
« Camarade, nous te comprenons bien. D’ailleurs, nous ne sommes pas trop confiants. Nous sommes d’accord qu’il nous faut être quelque peu sur nos gardes, ne pas croire aveuglément, conserver au fond une méfiance prudente. Mais, jusqu’à présent, les bolcheviques ne nous ont jamais trahis ; ils marchent carrément avec nous, ils sont nos amis ; ils nous prêtent un bon coup de main et ils affirment qu’une fois au pouvoir, ils pourront faire triompher aisément nos aspirations. Cela nous paraît vrai. Alors, pour quelles raisons les rejetterions-nous ? Aidons-les à conquérir le pouvoir, et nous verrons après. »
J’avais beau répéter qu’une fois organisé et armé, le bolchevisme – ou plutôt l’État bolchevique – serait pour les travailleurs beaucoup plus dangereux et beaucoup plus difficile à supprimer que n’importe quel autre État. On me répondait invariablement ceci : « Camarade, c’est nous, les masses, qui avons renversé le tsarisme. C’est nous qui avons renversé le gouvernement bourgeois. C’est nous encore qui sommes prêts à renverser Kerenski. Eh bien ! Si tu as raison, si les bolcheviques ont le malheur de nous trahir, de ne pas tenir leurs promesses, nous les renverserons comme nous l’avons fait précédemment. Et alors, nous marcherons avec nos amis les anarchistes... »
J’avais beau affirmer de nouveau que, justement, et pour plusieurs raisons, l’État bolchevique serait beaucoup plus difficile à renverser, on ne voulait, on ne pouvait pas le croire. Il ne faut nullement s’en étonner, puisque même dans les pays rompus à la politique, où (comme, par exemple, en France) on en est finalement dégoûté, les masses laborieuses, et même les intellectuels, tout en appelant la révolution, n’arrivent pas à comprendre que l’installation d’un parti politique, soit-il le plus à gauche possible, au pouvoir d’un État, sous quelque étiquette que ce soit, aboutira à la mort de la révolution. Pouvait-il en être autrement dans un pays tel que la Russie, c’est-à-dire, n’ayant jamais fait aucune expérience politique ?
L’idée politique, étatiste, gouvernementale, n’était pas encore disqualifiée dans la Russie de l’an 1917. Présentement, elle ne l’est encore dans aucun autre pays. Il faudra, certainement, pas mal de temps et surtout de multiples expériences historiques pour que les masses, éclairées par notre propagande, saisissent enfin nettement le péril de cette idée. L’absence d’une telle compréhension fut, au fond, la raison primordiale pour laquelle le bolchevisme l’emporta sur l’anarchisme dans la Révolution russe.
Revenons aux faits. À partir du mois de septembre, les événements se précipitent. Les masses sont prêtes à faire une nouvelle révolution. Quelques soulèvements assez importants (à Petrograd, en juillet ; à Kalouga, à Kazan) et d’autres mouvements de masses le prouvent suffisamment.
Le Parti bolchevique se prépare fiévreusement à la grande bataille. Son agitation fait rage. Il organise les cadres ouvriers et militaires. Il organise aussi ses propres cadres et dresse, pour le cas de succès, la liste du nouveau gouvernement, Lénine en tête. Les anarchistes, de leur côté, font tout ce qu’ils peuvent pour soutenir, encourager, éclairer l’action des masses.
Rappelons à ce sujet qu’à part la grande divergence de principes qui séparait les anarchistes des bolcheviques, il existait aussi des dissentiments de détail entre les uns et les autres. Citons-en deux qui faisaient l’objet de discussions passionnées entre les militants des deux tendances.
Le premier concernait le problème ouvrier. Dans ce domaine, les bolcheviques exigeaient – et se préparaient à réaliser – le soi-disant contrôle ouvrier de la production, c’est-à-dire l’ingérence des ouvriers dans la gestion des entreprises. Les anarchistes objectaient que si ce contrôle ne devait pas rester lettre morte, si les organisations ouvrières étaient capables d’exercer un contrôle effectif, alors elles étaient capables aussi d’assurer elles-mêmes toute la production. Dans ce cas, on pourrait éliminer tout de suite l’industrie privée, en la remplaçant par l’industrie collective. En conséquence, les anarchistes rejetaient le mot d’ordre vague, douteux, de « contrôle de la production ». Ils prêchaient l’expropriation – progressive, mais immédiate – de l’industrie privée par des organismes de production collective. Ils appelaient ainsi les masses laborieuses à commencer aussitôt l’édification d’une économie sociale.
À ce propos, je dois souligner ici un point important. Il est absolument faux – j’insiste là-dessus, car cette fausse appréciation, soutenue par des gens ignorants ou de mauvaise foi, est assez répandue –, il est faux, dis-je, qu’au cours de la Révolution russe, les anarchistes ne surent que « détruire » ou « critiquer », sans pouvoir formuler la moindre idée positive, créatrice. Il est faux que les anarchistes ne possédaient pas eux-mêmes et, partant, n’avaient jamais exprimé des idées suffisamment claires sur l’application de leur propre conception. En parcourant la presse libertaire de l’époque – le Goloss Trouda, l’Anarchie, le Nabat, etc. –, on peut voir que toute cette littérature abondait d’exposés nets et pratiques sur le rôle et le fonctionnement des organismes ouvriers, ainsi que sur le mode d’action qui permettrait à ces derniers de remplacer, en liaison avec les paysans, le mécanisme capitaliste et étatiste détruit. Ce ne sont pas les idées claires et pratiques qui firent défaut à l’anarchisme dans la Révolution russe, ce sont, comme déjà dit, les institutions pouvant, dès le début, appliquer ces idées à la vie.
Le second point litigieux était celui de l’assemblée constituante. En continuant la révolution, en la transformant en une révolution sociale, les anarchistes, naturellement, ne voyaient aucune utilité à convoquer cette assemblée – institution essentiellement politique, stérile et encombrante. Les anarchistes cherchaient donc à faire comprendre aux masses travailleuses l’inutilité de la constituante, la nécessité de s’en passer et de la remplacer tout de suite par des organismes économiques et sociaux, en commençant par la révolution sociale. Les bolcheviques, en vrais politiciens, hésitaient à renoncer à la convocation de l’assemblée. Au contraire, cette convocation figurait comme un point important de leur programme. (Derrière les coulisses, ils étaient pourtant d’avis de dissoudre la constituante si, malgré leur prise éventuelle du pouvoir, celle-ci n’avait pas une bonne majorité bolchevique.)
Il est aussi très intéressant de comparer l’attitude des bolcheviques et des anarchistes, à la veille de la Révolution d’Octobre, vis-à-vis des soviets ouvriers. Le lecteur se rappellera qu’à ce moment-là les soviets fonctionnaient dans toutes les villes ou localités importantes et que, partout, les bolchevisants y formaient une majorité écrasante. Le Parti bolchevique comptait accomplir la révolution, d’une part, par l’insurrection de ces soviets qui exigeraient « tout le pouvoir pour eux », et, d’autre part, par l’insurrection militaire qui soutiendrait l’action des soviets. (Les masses ouvrières avaient la mission de soutenir l’une et l’autre.)
En parfait accord avec ce programme, le Parti bolchevique lança le mot d’ordre général de la révolution :
« Tout le pouvoir aux soviets ! »
Quant aux anarchistes, ce mot d’ordre leur était suspect, et pour cause. Ils savaient bien que cette formule ne correspondait nullement aux véritables desseins du parti. Ils savaient qu’en fin de compte, celui-ci cherchait le pouvoir politique, bien centralisé, pour lui-même (c’est-à-dire, pour son comité central et, en dernier lieu, pour son chef : Lénine. Ce dernier « dirigeait », d’ailleurs, tous les préparatifs de la prise du pouvoir, aidé par Trotski.) « Tout le pouvoir aux soviets » n’était donc, au fond, qu’une formule creuse, pouvant être remplie plus tard de n’importe quelle matière. C’est pourquoi les anarchistes, tout en étant partisans des soviets ouvriers comme d’une forme d’organisation des masses laborieuses appelée à remplir certaines fonctions dans l’édification de la nouvelle société, n’admettaient pas ladite formule sans réserve. Pour eux, le mot pouvoir rendait toute la formule ambiguë, illogique, démagogique, suspecte.
Voici comment les anarcho-syndicalistes exprimèrent leurs doutes à ce sujet, dans un article paru sous le titre : Est-ce la fin ? dans leur journal hebdomadaire de Petrograd, Goloss Trouda (numéro 11, du 20 octobre 1917), cinq jours avant la Révolution d’Octobre :
« La réalisation éventuelle de la formule Tout le pouvoir aux soviets (ou, plutôt, la prise du pouvoir politique) : est-ce la fin ? Est-ce tout ? Cet acte achèvera-t-il l’œuvre destructive de la révolution ? Déblayera-t-il définitivement la voie pour la grande construction sociale, pour l’élan créateur de la révolution ?
« La victoire des « soviets » – si elle devient un fait accompli – et, une fois de plus, l’ « organisation du pouvoir » qui la suivra, signifieront-elles, effectivement, la victoire du travail, la victoire des forces organisées des travailleurs, le début de la véritable reconstruction socialiste ? Cette victoire et ce nouveau « pouvoir » réussiront-ils à sortir la révolution de l’impasse où elle s’est engagée ? Arriveront-ils à ouvrir de nouveaux horizons créateurs à la révolution, aux masses, à l’humanité ? Vont-ils ouvrir à la révolution le vrai chemin du travail constructif, la bonne route vers la solution effective de tous les problèmes de l’époque ?
« Tout dépendra de l’interprétation que les vainqueurs prêteront au mot d’ordre « pouvoir » et à leur notion d’« organisation du pouvoir ». Tout dépendra de la façon dont la victoire sera utilisée ensuite par les éléments qui tiendront, au lendemain de la victoire, ce soi-disant « pouvoir ».
« Si, par « pouvoir », on veut dire que tout travail créateur et toute activité organisatrice, sur toute l’étendue du pays, passeront aux mains des organismes ouvriers et paysans soutenus par les masses armées ; si l’on comprend, par « pouvoir », le plein droit de ces organismes de se fédérer naturellement et librement, en exerçant cette activité, de commencer la nouvelle construction économique et sociale, de mener la révolution vers de nouveaux horizons de paix, d’égalité économique et de vraie liberté ;
« Si le mot d’ordre « pouvoir aux soviets » ne signifie pas l’installation de foyers d’un pouvoir politique, foyers subordonnés au centre politique et autoritaire principal de l’État ;
« Si, enfin, le parti politique aspirant au pouvoir et à la domination s’élimine après la victoire et cède vraiment sa place à la libre auto organisation des travailleurs ; si le « pouvoir des soviets » ne devient pas en réalité un pouvoir étatiste d’un nouveau parti politique – alors, et alors seulement, la nouvelle crise pourra devenir la dernière, pourra signifier les débuts d’une ère nouvelle.
« Mais, si l’on veut comprendre par « pouvoir » une activité de centres politiques sous l’hégémonie d’un parti politique, centres dirigés par un foyer politique principal (pouvoir central) ; si la « prise du pouvoir par les soviets » signifie en réalité l’usurpation du pouvoir par un nouveau parti politique dans le but de reconstruire, à l’aide de ce pouvoir, toute la vie économique et sociale du pays, et de résoudre ainsi tous les problèmes compliqués du moment et de l’époque, alors cette nouvelle étape de la révolution ne sera pas, elle non plus, une étape définitive.
« En effet, nous ne doutons pas un instant que ce « nouveau pouvoir » ne saura, en aucun cas, non seulement commencer la vraie « reconstruction socialiste », mais même satisfaire les besoins et les intérêts essentiels de la population...
……………………………………………………………………………………………………………………………
« Nous ne croyons pas à la possibilité d’accomplir la révolution sociale par le procédé politique qui signifierait que l’œuvre de la reconstruction sociale, que la solution des problèmes si vastes, variés et compliqués de notre temps commenceraient par un acte politique, par la prise du pouvoir, par le haut, par le centre... Qui vivra, verra... »
Le même jour, le « Groupe de propagande anarchosyndicaliste » publiait, dans le Goloss Trouda, la déclaration suivante, où il prenait nettement position vis-à-vis des événements :
« 1. En tant que nous prêtons au mot d’ordre « Tout le pouvoir aux soviets » un tout autre sens que celui qui, à notre avis, lui est prêté par le Parti social-démocrate bolchevique, appelé par les événements à diriger le mouvement ; en tant que nous ne croyons pas en de vastes perspectives d’une révolution qui débute par un acte politique, notamment par la prise du pouvoir ; en tant que nous apprécions négativement toute action de masses déclenchée pour des buts politiques et sous l’emprise d’un parti politique ; en tant, enfin, que nous concevons d’une toute autre façon, aussi bien le début que le développement ultérieur d’une vraie révolution sociale, nous apprécions le mouvement actuel négativement ;
« 2. Si, toutefois, l’action des masses se déclenche, alors, comme anarchistes, nous y participerons avec la plus grande énergie. Nous ne pouvons pas nous mettre à l’écart des masses révolutionnaires, même si elles ne suivent pas notre chemin et nos appels, même si nous prévoyons l’échec du mouvement, Nous n’oublions jamais qu’il est impossible de prévoir d’avance aussi bien la direction que l’issue d’un mouvement de masses. Par conséquent, nous considérons comme notre devoir de participer toujours à un tel mouvement, cherchant à lui communiquer notre sens, notre idée, notre vérité. »
La suite des événements est plus ou moins connue. Citons les faits, brièvement.
Le soutien de la flotte de Cronstadt et de la majorité des troupes de Petrograd assuré, la faiblesse extrême du gouvernement de Kerenski constatée, et les sympathies d’une majorité écrasante des masses travailleuses acquises, le comité central du Parti bolchevique fixa l’insurrection définitivement au 25 octobre (7 novembre, nouveau style), jour de la réunion du deuxième congrès panrusse des soviets. Cette insurrection se produisit effectivement à Petrograd, le 25 octobre au soir. Il n’y eut ni actions de masses, ni combats de rues. Abandonné par tout le monde, le « gouvernement provisoire », se cramponnant à des chimères, siégeait au Palais d’Hiver. Ce dernier était défendu par un bataillon « d’élite », un bataillon de femmes et une poignée de jeunes officiers aspirants. Des détachements de troupes acquises aux bolcheviques, soutenus par des bâtiments de la flotte baltique venus de Cronstadt et alignés sur la Neva, face au Palais d’Hiver, cernèrent ce dernier et, après une courte escarmouche, s’en emparèrent. Kerenski réussit à fuir. Les autres membres du gouvernement provisoire furent arrêtés. La circulation normale dans les rues de la capitale, ainsi que l’aspect général de la ville ne furent nullement troublés. Ainsi, à Petrograd, toute l’ « insurrection » ne fut qu’une petite opération militaire menée par le Parti bolchevique qui s’appuyait sur les sympathies de vastes masses travailleuses. Le siège du gouvernement provisoire devenu vide, le comité central du Parti bolchevique s’y installa en vainqueur.
Vers 11 heures du soir de cette fameuse journée du 25 octobre, je me trouvais dans une des rues de Petrograd. Elle était obscure et calme. Au loin, on entendait quelques coups de fusils espacés. Subitement, une auto blindée me dépassa à toute allure. De l’intérieur de la voiture, une main lança un gros paquet de feuilles de papier, lesquelles volèrent en tous sens. Je me baissai et j’en ramassai une. C’était un appel du nouveau gouvernement « aux ouvriers et paysans » russes, leur annonçant la chute du gouvernement de Kerenski et, en bas, la liste du nouveau gouvernement « des commissaires du peuple », Lénine en tête. Un sentiment compliqué de tristesse, de colère, de dégoût et, en même temps, une sorte de satisfaction ironique s’emparèrent de moi. Je pensai :
« Ces imbéciles – s’ils ne sont pas, tout simplement, des démagogues imposteurs – doivent s’imaginer qu’ils accomplissent ainsi la révolution sociale ! Eh bien ! Ils vont voir... Et les masses vont prendre une bonne leçon !... »
À Moscou et aussi dans presque toute l’étendue du pays, la prise du pouvoir par le Parti bolchevique ne s’effectua pas avec la même facilité.
Moscou vécut dix jours de combats acharnés. Il y eut beaucoup de victimes, et plusieurs quartiers de la ville furent fortement endommagés par le feu d’artillerie. Dans d’autres villes, également, la victoire fut arrachée de haute lutte. Dans certaines contrées, à l’Est et surtout au Sud, cette victoire ne fut pas définitive. Des mouvements contre-révolutionnaires importants prirent naissance, s’armèrent, se précisèrent et aboutirent à une guerre civile, qui dura jusqu’à la fin de l’année 1921. L’un de ces mouvements, dirigé par le général Denikine (1919), prit les dimensions d’un événement très dangereux pour le pouvoir bolchevique. Partie des profondeurs de l’Ukraine, à l’extrême sud de la Russie, l’armée de Denikine arriva, en été 1919, presque aux portes de Moscou. (Nous verrons plus bas de quelle façon ce danger imminent put être écarté.) Très dangereux, également, fut le mouvement déclenché par le général Wrangel, après celui de Denikine, dans le Sud. Assez menaçant a été, ensuite, le mouvement de l’amiral Koltchak, dans l’Est. Les autres mouvements contre-révolutionnaires furent de moindre importance. Presque tous ces mouvements ont été en partie soutenus et alimentés par des interventions étrangères. En somme, c’est à partir de l’année 1922 seulement que le Parti bolchevique au pouvoir put se sentir définitivement maître de la situation, et entreprendre l’œuvre qu’il a continuée depuis, jusqu’à nos jours.
Approchant de la fin de notre étude, venant de résumer la situation générale, après la victoire définitive de la révolution bolchevique, nous ne nous occuperons plus, dans la dernière partie de notre exposé, de la suite chronologique des événements. Notre tâche sera maintenant de faire ressortir et d’analyser les faits saillants de la période bolchevique de la Révolution russe, afin de pouvoir formuler nettement les appréciations et les conclusions imposées par cette analyse.
Précisons, avant tout, un fait qui n’est pas suffisamment connu. Fidèles à leurs principes, les anarchistes prirent une part très active, souvent décisive, à tous les mouvements de masses, à toutes les luttes que la révolution eut à soutenir contre la réaction. Dans les combats de Moscou, comme partout ailleurs, les anarchistes se battirent dans les premiers rangs et se sacrifièrent entièrement. J’insiste sur ce point, car très souvent, par ignorance ou par mauvaise foi, on reproche aux anarchistes russes de s’être bornés, pendant la révolution, à des discussions et de n’avoir rien fait.
Très original fut, dans la Révolution russe, le sort de l’Assemblée constituante. Comme déjà dit, les anarchistes étaient franchement opposés à la convocation de celle-ci. Les bolcheviques préférèrent faire semblant de la convoquer, décidés d’avance à la dissoudre au cas où sa majorité – chose possible dans l’ambiance générale du moment – ne serait pas bolchevique. La constituante fut donc convoquée en janvier 1918. Malgré les efforts du Parti bolchevique, au pouvoir depuis trois mois déjà, la majorité de l’assemblée s’avéra antibolchevique. Toutefois, et en dépit de l’inutilité flagrante de cette assemblée, dont les travaux se poursuivaient dans une atmosphère d’indifférence générale, le gouvernement bolchevique hésitait à la dissoudre. Il a fallu l’intervention presque fortuite d’un anarchiste pour que l’Assemblée constituante fût dissoute. Le nom de cet anarchiste, un de nos meilleurs camarades (tué par la suite à son poste de chef d’un train blindé, en lutte contre les forces de Denikine) – nom presque toujours faussé, même par les auteurs anarchistes –, est Jélezniakoff (Anatole). Ce camarade, marin de Cronstadt, fut mis par le gouvernement bolcheviste à la tête du détachement de garde au siège de l’Assemblée. Depuis plusieurs jours déjà, les discours interminables, ennuyeux et stériles des leaders des partis politiques à l’Assemblée – discours qui se prolongeaient tard dans la nuit – fatiguaient et ennuyaient le corps de garde obligé, chaque fois, d’attendre la fin et de veiller. Une nuit – les bolcheviques et les socialistes révolutionnaires de gauche ayant quitté la séance après une déclaration menaçante, et les discours allant leur petit train –, Jélezniakoff, à la tête de son détachement, s’approcha du fauteuil présidentiel et dit :
« Fermez la séance, s’il vous plaît, mes hommes sont fatigués. »
Décontenancé, indigné, le président (V. Tchernoff, socialiste révolutionnaire de droite) protesta. Jélezniakoff répéta :
« Je vous dis que le corps de garde est fatigué. Je vous prie de quitter la salle des séances. »
L’Assemblée s’exécuta. Le gouvernement bolchevique profita de cet incident pour publier le lendemain le décret de dissolution de la constituante.
Pour que le lecteur saisisse bien le vrai sens, la véritable portée de certains événements ultérieurs (entre autres, la durée, l’éventualité de succès, et l’échec final des mouvements contre-révolutionnaires), il faut que nous fassions maintenant un résumé de la situation, non plus du point de vue général, mais de celui des principes révolutionnaires et sociaux proclamés par la révolution, ainsi que de leur application pratique.
Au cours des crises et des faillites qui se suivirent jusqu’à la Révolution d’Octobre 1917, deux idées fondamentales –idées révolutionnaires allant loin au-delà du programme minimum socialiste et envisageant une véritable révolution sociale– se précisèrent dans les milieux révolutionnaires et aussi au sein des masses laborieuses.
L’une fut l’idée de construire, sur les ruines de l’État bourgeois, un nouvel « État ouvrier », de constituer un « gouvernement ouvrier et paysan », d’établir la « dictature du prolétariat ».
L’autre fut celle de modifier de fond en comble les bases économiques et sociales de la société sans avoir recours à un État, à un gouvernement, quels qu’ils soient, c’est-à-dire d’atteindre les buts de la révolution sociale et de résoudre les problèmes de l’heure par un effort naturel et libre, économique et social, des travailleurs, au sein de leurs organisations, après avoir renversé le dernier gouvernement.
Afin de coordonner l’action des travailleurs, la première idée supposait la prise du pouvoir politique, l’installation d’un gouvernement dictatorial, et l’organisation d’un nouvel État « prolétarien ». L’autre idée prévoyait l’absence de toute organisation étatique, l’entente fédérative des organismes de classe (syndicats, coopératives, toutes sortes d’associations, etc.), la cohésion naturelle partant d’en bas, la centralisation non pas politique et étatiste, mais économique et technique, selon les besoins réels.
Les deux conceptions envisageaient, entre autres choses, l’existence des soviets (conseils ouvriers), de même que celle de nombreuses autres organisations ouvrières, en tant que cellules de la société nouvelle. Mais, tandis que la première conception y voyait des cellules surtout politiques, la seconde y supposait des organismes économiques et sociaux.
La première idée fut exposée, propagée, défendue par le Parti communiste étatiste (les bolcheviques). Fort bien organisés, de plus en plus nombreux, ayant à leur tête des intellectuels qualifiés, disposant de toute une armée d’agitateurs, de propagandistes, d’écrivains, ne reculant devant aucun moyen, et sachant appliquer très habilement toutes les recettes de la démagogie, ce parti obtint auprès des masses, très rapidement, un succès de plus en plus accentué.
Quant à l’autre conception, elle ne put être défendue ou propagée que par un nombre très restreint de propagandistes libertaires.
Le courant populaire lui-même allait bien au-delà de la conception étatiste des bolcheviques. Les masses marchaient carrément vers la vraie révolution sociale. Mais, fasciné par les mots d’ordre enflammés et par l’activité vigoureuse des bolcheviques, entraînés par leurs promesses de résoudre, au moyen de leur « gouvernement de la dictature du prolétariat », les problèmes latents, le peuple travailleur leur accorda sa confiance et son concours.
La lutte entre les deux idées fut inégale.
Comme nous l’avons vu, les masses laborieuses soutinrent le Parti communiste dans sa lutte pour le pouvoir. Fin octobre 1917, ce parti attaqua le faible gouvernement de Kerenski et le renversa. Le nouveau gouvernement bolchevique s’installa immédiatement sur le trône disponible. Lénine fut son chef. C’est à ce dernier et à son parti qu’incomba désormais la tâche de faire face à tous les problèmes de la révolution.
L’idée étatiste l’emporta.
C’est elle qui allait faire ses preuves. Nous verrons tout à l’heure comment elle les a faites.
D’après la thèse libertaire, c’étaient les masses laborieuses elles-mêmes qui devaient, par leur action vaste et puissante, s’appliquer à la solution des problèmes reconstructifs de la révolution sociale. Le rôle des « élites », tel que le concevaient les libertaires, devait se borner à aider les masses, à les enseigner, à les conseiller, à les pousser vers telle ou telle autre initiative, à les soutenir dans leur action, mais surtout à ne pas les diriger gouvernementalement. L’idée fondamentale des libertaires était celle-ci : la solution heureuse des problèmes de la révolution sociale ne pourrait être que l’œuvre collective des millions d’hommes y apportant leurs initiatives, leurs forces, leurs capacités, leurs aptitudes, leurs connaissances vastes, variées et fécondes. Par l’intermédiaire de leurs organismes multiples et variés, et par la fédération de ces organismes, les masses laborieuses devaient, d’après les libertaires, pouvoir effectivement pousser en avant la révolution sociale et arriver à la solution pratique de tous ses problèmes.
La thèse bolchevique était diamétralement opposée. D’après les bolcheviques, c’était l’élite, le gouvernement (dit « ouvrier » et exerçant la soi-disant « dictature du prolétariat ») qui devait s’appliquer à pousser en avant la transformation sociale, à résoudre ses formidables problèmes. Les masses ne devaient qu’aider cette élite, en exécutant ses décisions, ses décrets, ses ordres et ses lois.
En définitive, ce fut un gouvernement d’intellectuels, de doctrinaires marxistes, qui s’installa au pouvoir et commença son action par des décrets et des actes que les masses étaient sommées d’approuver et d’appliquer.
Ce gouvernement fonctionna. L’action étatiste commença.
Tout au début, le gouvernement et son chef, Lénine, faisaient mine d’être de fidèles exécuteurs de la volonté du peuple travailleur ; en tout cas, de devoir justifier devant ce peuple leurs décisions, leurs gestes et leurs actes. (Ainsi, par exemple, Lénine crut nécessaire de justifier la dissolution de la constituante devant l’exécutive des soviets.) Cela a marché assez bien, jusqu’au jour où la volonté du « gouvernement » entra, pour la première fois, en conflit avec celle du « peuple ».
Ce fut à l’occasion de l’offensive allemande, en février 1918.
Au lendemain de la Révolution d’Octobre, l’armée allemande qui opérait contre la Russie resta quelque temps inactive. Le commandement allemand hésitait, attendait les événements, délibérait, menait des pourparlers. Mais, en février 1918, il se décida et déclencha une offensive contre la Russie révolutionnaire. Il fallait prendre position. Toute résistance était impossible, l’armée russe ne pouvant pas combattre. Il fallait trouver une solution adéquate à la situation générale des choses. Cette solution devait, en même temps, résoudre le premier problème de la révolution, celui de la guerre.
La situation ne présentait que deux solutions possibles :
-
abandonner le front ; laisser l’armée allemande s’aventurer dans l’immense pays en pleine révolution ; l’entraîner dans les profondeurs du pays ; l’y isoler, la séparer de sa base d’approvisionnement ; lui faire une guerre de partisans, la démoraliser, la décomposer, etc., en défendant ainsi la révolution sociale ;
-
entrer en pourparlers avec le commandement allemand, lui proposer la paix, traiter et accepter celle-ci, quelle qu’elle fût.
La première solution fut celle de l’immense majorité des organisations ouvrières consultées, ainsi que des socialistes révolutionnaires de gauche, des maximalistes, des anarchistes. On était d’avis que, seule, cette façon d’agir était digne de la révolution sociale ; seule, elle permettait de traiter avec le peuple allemand par dessus la tête de ses généraux ; seule, elle garantissait un élan prodigieux de la révolution en Russie et, peut-être aussi, comme conséquence, un déclenchement de la révolution en Allemagne et ailleurs.
Voici ce qu’écrivait à ce sujet le Goloss Trouda anarchosyndicaliste de Petrograd (n° 27 du 24 février 1918), dans un article intitulé : De l’esprit révolutionnaire : « Nous voici à un tournant décisif de la révolution. Une crise est là qui peut être fatale. L’heure qui sonne est d’une netteté frappante et d’un tragique exceptionnel. La situation est enfin claire. La question est à trancher séance tenante. Dans quelques heures, nous saurons si le gouvernement signe ou non la paix avec l’Allemagne. Tout l’avenir de la Révolution russe, et aussi la suite des événements mondiaux, dépendent de cette journée, de cette minute.
« Les conditions sont posées par l’Allemagne sans ambages ni réserves. D’ores et déjà, on connaît les idées de plusieurs membres « éminents » des partis politiques, et aussi celles des membres du gouvernement. Pas d’unité de vues, nulle part. Désaccord chez les bolcheviques. Désaccord chez les socialistes révolutionnaires de gauche. Désaccord au Conseil des commissaires du peuple. Désaccord au soviet de Petrograd et à l’exécutive. Désaccord dans les masses, dans les fabriques, usines et casernes. L’opinion de la province n’est pas encore suffisamment connue... (Nous l’avons dit plus haut : l’opinion des socialistes révolutionnaires de gauche, et aussi celle des masses travailleuses à Petrograd et en province se précisa par la suite, comme hostile à la signature du traité de paix avec les généraux allemands.) « Le délai de l’ultimatum allemand est de 48 heures. Dans ces conditions, qu’on le veuille ou qu’on ne le veuille pas, la question sera discutée, la décision sera prise en hâte, dans les milieux strictement gouvernementaux. Et c’est ce qui est le plus terrible ...
« Quant à notre propre opinion, nos lecteurs la connaissent. Dès le début, nous étions contre les « pourparlers de paix ». Nous nous dressons aujourd’hui contre la signature du traité. Nous sommes pour l’organisation immédiate et active d’une résistance de corps de partisans. Nous estimons que le télégramme du gouvernement demandant la paix doit être annulé ; le défi doit être accepté, et le sort de la révolution remis directement, franchement, entre les mains des prolétaires du monde entier.
« Lénine insiste sur la signature de la paix. Et, si nos informations sont exactes, une grande majorité finira par le suivre. Le traité sera signé. Seule, la conviction intime de l’invincibilité finale de cette révolution nous permet de ne pas prendre cette éventualité trop au tragique. Mais que cette façon de conclure la paix portera un coup très dur à la révolution en l’infirmant, en la déformant pour longtemps, nous en sommes absolument persuadés.
« Nous connaissons l’argumentation de Lénine, surtout d’après son article De la phase révolutionnaire (Pravda, n° 31). Cette argumentation ne nous a pas convaincus. »
L’auteur fait, ensuite, une critique serrée de cette argumentation de Lénine et lui en oppose une autre, pour terminer, comme suit :
« Nous avons la conviction ferme que l’acceptation de la paix offerte ralentira la révolution, l’abaissera, la rendra pour longtemps débile, anémique, incolore... L’acceptation de la paix fera courber la révolution, la mettra à genoux, lui enlèvera les ailes, l’obligera de ramper... Car l’esprit révolutionnaire, le grand enthousiasme de la lutte, cette envolée magnifique de la grandiose idée de l’affranchissement du monde lui seront enlevés.
« Et – pour le monde – sa lumière s’éteindra. »
La majorité du comité central du Parti communiste russe se prononça d’abord pour la première solution. Mais Lénine, en véritable dictateur, eut peur de cette solution hardie. Il invoqua, au contraire, le danger de mort pour la révolution, en cas de non-acceptation de la paix offerte. Il proclama la nécessité d’un « répit » qui permettrait de créer une armée régulière. Il brava l’opinion des masses et de ses propres camarades, il menaça ces derniers de décliner toute responsabilité et de se retirer, séance tenante, si sa volonté n’était pas exécutée. Les camarades, à leur tour, eurent peur de perdre « le grand chef de la révolution ». Ils cédèrent. La paix fut signée.
Ainsi, pour la première fois, la « dictature du prolétariat » l’emporta sur le prolétariat. Pour la première fois, le pouvoir bolchevique réussit à terroriser les masses, à substituer sa volonté à la leur, à imposer son autorité, à agir de son chef, faisant fi de l’opinion des autres...
La paix de Brest-Litovsk fut imposée au peuple laborieux par le gouvernement bolchevique, lequel réussit à briser la résistance des masses, à obtenir leur obéissance, leur passivité forcée.
Tel fut le résultat du premier différend sérieux entre le nouveau gouvernement et le peuple gouverné. Ce ne fut que le premier pas – le plus difficile. La continuation était beaucoup plus aisée. Ayant une fois enjambé impunément la volonté des masses laborieuses, s’étant une fois emparé de l’initiative de l’action, le nouveau pouvoir lança, pour ainsi dire, un lasso autour de la révolution. Dorénavant, il n’avait plus qu’à continuer de le serrer, pour obliger les masses à se traîner à sa suite, pour leur faire abandonner entre ses mains toute initiative, pour les soumettre entièrement à son autorité et, finalement, pour réduire toute la révolution aux limites d’une dictature.
C’est ce qui arriva, en effet. Car, telle est, fatalement, l’attitude de tout gouvernement. Tel est, fatalement, le chemin de toute révolution qui laisse intact le principe étatiste, politique, gouvernemental. Tôt ou tard, vient le premier désaccord entre les gouvernants et les gouvernés. Ce désaccord vient d’autant plus fatalement qu’un gouvernement, quel qu’il soit, est toujours impuissant à résoudre les problèmes d’une grande révolution et que, malgré cela, tout gouvernement, et toujours, veut avoir raison, veut avoir pour lui l’initiative, la vérité, la responsabilité, l’action... Ce désaccord tourne toujours à l’avantage des gouvernants. Et ensuite, toute initiative passe, avec la même fatalité, à ces gouvernants qui deviennent ainsi les maîtres absolus des millions de gouvernés. Ce fait acquis, les maîtres se cramponnent au pouvoir, en dépit de leur incapacité, de leur insuffisance, de leur malfaisance... Ils se croient, au contraire, seuls porteurs de la vérité. Ils se défendent contre toute opposition ; ils accaparent tout ; ils créent des privilégiés sur lesquels ils s’appuient ; ils organisent les forces capables de les soutenir ; ils répriment toute résistance ; ils persécutent tout ce qui ne veut pas se plier à leur bon plaisir ; ils mentent, ils trompent, ils sévissent, ils tuent...
C’est ce qui arriva, fatalement, à la Révolution russe.
Une fois bien assis au pouvoir, ayant organisé une armée et une police, ayant bâti un nouvel État dit « ouvrier », le gouvernement bolchevique, maître absolu, prit en mains définitivement les destinées futures de la révolution. Peu à peu – au fur et à mesure qu’augmentaient ses forces de coercition et de répression –, le gouvernement étatisa et monopolisa tout, absolument tout, jusqu’à la parole, jusqu’à la pensée.
Ce fut l’État – donc, le gouvernement – qui s’empara de tout le sol, de tout l’ensemble des terres. Il en devint le vrai propriétaire. Les paysans, dans leur masse, furent, petit à petit, transformés en des fermiers d’État.
Ce fut le gouvernement qui s’appropria les usines, les fabriques, les mines, tous les moyens de production, de consommation, de communication, etc.
Ce fut le gouvernement qui usurpa le droit d’initiative, d’organisation technique, d’administration, de direction, dans tous les domaines de l’activité humaine.
Ce fut, enfin, le gouvernement qui devint le maître unique de la presse du pays. Toutes les éditions, toutes les publications en U.R.S.S. – jusqu’aux cartes de visite – sont faites ou, au moins, rigoureusement contrôlées par l’État.
Bref, l’État, le gouvernement devint, finalement, seul détenteur de toutes les vérités ; seul propriétaire de tous les biens, matériels et spirituels ; seul initiateur, organisateur, animateur de toute la vie du pays, dans toutes ses ramifications.
Les 150 millions d’habitants se transformèrent, peu à peu, en simples exécuteurs des ordres gouvernementaux, en simples esclaves du gouvernement et de ses innombrables agents.
Tous les organismes économiques, sociaux ou autres, sans exception, en commençant par les soviets et en finissant par les plus petites cellules, devinrent de simples filiales administratives de l’entreprise étatiste, filiales subordonnées totalement au conseil d’administration central : le gouvernement ; surveillées de près par les agents de ce dernier : la police ; privées de toute ombre d’une indépendance quelconque.
L’histoire authentique et détaillée de cette évolution, achevée il y a à peine deux ou trois ans – histoire formidable, extraordinaire, unique dans le monde –, mériterait, à elle seule, un volume à part. Ici, obligés de condenser, nous n’en avons donné qu’un très bref résumé. Ajoutons-y un seul détail, car, au point de vue chronologique, notre résumé a quelque peu interverti l’ordre des faits.
Une fois au pouvoir, et en possession d’une force armée, le plus facile pour le Parti bolchevique était d’étatiser les organisations ouvrières, les moyens de transport et de communication, la production minière, la grosse industrie, le gros commerce. C’est, en effet, par ce bout que l’étatisation commença.
Le plus difficile fut de s’approprier le sol, de supprimer le fermier privé, d’étatiser l’agriculture. Cette tâche vient d’être accomplie en tout dernier lieu, après des années de luttes acharnées.
Puisque tout ce qui est indispensable pour le travail de l’homme – autrement dit, tout ce qui est capital – appartient en Russie actuelle à l’État, il s’agit, dans ce pays, d’un capitalisme d’État intégral. Le capitalisme d’État, tel est le système politique, économique, financier et social en U.R.S.S., avec toutes ses conséquences logiques dans le domaine moral, spirituel ou autre.
Pour le travailleur, l’essentiel de ce système est ceci : tout travailleur, quel qu’il soit, est, en fin de compte, un salarié de l’État. L’État est son unique patron. Si l’ouvrier rompt son contrat avec ce patron, il ne peut plus travailler nulle part. En conséquence, l’État-patron peut faire avec l’ouvrier tout ce qu’il veut. Et si, pour une raison quelconque, ce dernier est jeté dans la rue, il ne lui reste plus qu’à crever de faim, à moins qu’il ne « se débrouille » comme il peut. Ce n’est pas tout. Le système veut que l’État-patron soit, en même temps, juge, geôlier et bourreau de tout « citoyen », de tout travailleur. L’État lui fournit du travail ; l’État le raye ; l’État le surveille ; l’État l’emploie et le manie à sa fantaisie ; l’État l’éduque ; l’État le juge ; l’État le punit ; l’État l’emprisonne ; l’État le bannit ou l’exécute... Employeur, protecteur, surveillant, éducateur, juge, geôlier, bourreau – tout, absolument tout dans la même personne : celle d’un État formidable, omniprésent, omnipotent...
Comme le lecteur le voit, ce système est bien celui d’un esclavage complet, absolu, du peuple laborieux : esclavage physique et moral. Telle a été l’œuvre accomplie en Russie par le Parti bolchevique, de 1917 à nos jours. Et tel est aujourd’hui le résultat de cette œuvre.
Le Parti bolchevique chercha-t-il ce résultat ? Y mena-t-il sciemment ?
Certainement, non. Indubitablement, ses meilleurs représentants aspiraient à un système qui permettrait la construction du vrai socialisme ouvrant la route vers le communisme intégral. Je tiens à enregistrer ici-même l’aveu qui m’a été fait, il y a quelques années, par un bolchevique russe éminent et sincère, lors d’une discussion serrée, passionnée : « Certainement, dit-il, nous nous sommes égarés et engouffrés là où nous ne voulions pas aller... Mais nous tâcherons d’en sortir, et nous y réussirons... »
On peut être, au contraire, absolument certain qu’ils n’y réussiront pas, qu’ils n’en sortiront jamais. Car la force logique des choses, la psychologie humaine, l’enchaînement des faits matériels, la suite déterminée des causes et des effets sont, en fin de compte, plus puissants que les aspirations des individus.
Le Parti bolchevique chercha à construire le socialisme au moyen d’un État, d’un gouvernement, d’une action politique autoritaire. Il n’aboutit, fatalement, qu’à un capitalisme d’État monstrueux, funeste, meurtrier.
Et plus il sera démontré que les chefs du parti furent sincères, énergiques, capables, favorisés par les circonstances, suivis, aidés par les masses, mieux ressortira la conclusion historique qui se dégage de leur œuvre.
Cette conclusion, la voici : toute tentative d’accomplir la révolution sociale à l’aide d’un État, d’un gouvernement et d’une action politique aboutira fatalement à un capitalisme d’État, le pire des capitalismes.
Telle est la leçon mondiale de la formidable expérience bolchevique, leçon qui confirme pleinement la thèse anarchiste et qui, bientôt, sera à la portée de tous.
Le capitalisme d’État – auquel, d’après le propre aveu des communistes sincères, aboutit le bolchevisme en Russie – donna-t-il, au moins, des résultats appréciables ? Réalisa-t-il quelque progrès ? Pourra-t-il servir de « pont » à la véritable transformation sociale prochaine ? La pourra-t-il faciliter ?
Jusqu’à présent, les grandes prouesses définitives de l’État bolchevique ont été les suivantes :
-
Il sut créer une armée redoutable, sinon encore pour les ennemis extérieurs, du moins pour l’ennemi « intérieur », celui qui refuse de devenir esclave du nouveau capitalisme.
-
Il sut, d’autre part, militariser les propres rangs du parti dirigeant, en formant, avec la jeunesse bolchevique, des corps d’armée spéciaux – sorte de gendarmerie ou de garde nationale. C’est sur ces corps spéciaux que le nouveau gouvernement peut surtout compter. C’est à l’aide de ces corps spéciaux que le gouvernement bolchevique écrasa l’émeute révolutionnaire de Cronstadt, en 1921, et que, lorsqu’il le faut, il noie dans le sang les grèves, les révoltes et les démonstrations multiples dont la presse bolchevique ne souffle mot.
-
Il sut aussi former une police très puissante – ordinaire et surtout secrète –, police qui est, peut-être, la première du monde puisqu’elle réussit, jusqu’à ce jour, à maintenir dans l’obéissance une population subjuguée, trompée, exploitée, affamée. Il sut, surtout, élever le mouchardage à la hauteur d’une grande vertu civique. Tout membre du Parti communiste – voire tout citoyen loyal – est tenu d’aider le Guépéou, à lui signaler les cas suspects, à moucharder, à dénoncer.
-
Il réussit à faire naître et se multiplier avec une rapidité vertigineuse une bureaucratie formidable, incomparable, inégalable ; une bureaucratie qui forme, actuellement, dans le pays une caste privilégiée, « aristocratique », d’un million d’individus environ. Tout est « bureaucratisé » en U.R.S.S. : la production, la répartition, la consommation, les communications, le permis d’exister (un système de passeport sublime), la science, la littérature, l’art, etc. D’autre part, les inégalités sociales y sont prononcées plus que dans n’importe quel autre pays. Les citoyens en général, et les travailleurs en particulier, sont divisés en plusieurs catégories de salariés, de favorisés, de défavorisés, de primés, de privilégiés...
-
Enfin, nous l’avons dit, l’État bolchevique réussit à réduire à l’esclavage complet 150 millions d’hommes, dans le but de les amener un jour – par ce moyen infaillible, paraît-il – à la liberté, à la prospérité ; bref : au bonheur.
Ajoutons que cet État est passé maître hors concours dans l’œuvre de mensonge, de duperie, de mise en scène, de truquage... Sa propagande trompeuse à travers le monde est d’une habileté sans égale. Si la bourgeoisie des autres pays recourt au « bourrage de crâne », le bolchevisme, lui, fait du « super bourrage », tel que, de nos jours encore, des millions de travailleurs dans tous les pays ne savent pas la vérité sur l’U.R.S.S. Livres, brochures, journaux, revues, photos, cinéma, T.S.F., expositions – tous les moyens, les uns plus truqués que les autres, tout étant entre les mains de l’État – sont bons pour la propagande. Les « délégations ouvrières » autorisées de temps en temps à passer quelques semaines en Russie, abominablement dupées (si leurs membres sont sincères), en sont un des moyens. De même, la majorité écrasante de « touristes » ou de visiteurs isolés qui parcourent le pays, sous l’œil vigilant des mouchards, sans connaître la langue russe, sans comprendre quoi que ce soit de ce qui se passe autour d’eux.
Soulignons encore que l’État (le gouvernement) bolchevique s’est emparé, non seulement de tous les biens matériaux et moraux existants, mais – ce qui est peut-être plus grave – il s’est approprié aussi la « Vérité ». Du moins, il se croit l’unique, le vrai détenteur de la vérité tout entière, de quelque domaine qu’elle soit : vérité historique, économique, sociale, scientifique, philosophique ou autre. Dans tous les domaines, sans exception, le gouvernement bolchevique se considère comme absolument infaillible. Lui seul possède la vérité. Lui seul sait où et comment aller. Lui seul est capable de mener à bien la révolution. Et alors, logiquement, fatalement, il prétend que les 150 millions d’hommes qui peuplent le pays doivent, eux aussi, le considérer comme seul détenteur de la vérité, détenteur infaillible, inattaquable, sacré. Et alors, logiquement, inévitablement, tout homme ou tout groupement osant, non pas combattre ce gouvernement, mais simplement douter de son infaillibilité, le critiquer, le contredire, le blâmer en quoi que ce soit, est regardé comme son ennemi et, partant, comme ennemi de la vérité, ennemi de la révolution : « contre-révolutionnaire »... Il s’agit là d’un vrai monopole de l’opinion. Toute opinion autre que celle de l’élite (du gouvernement) est considérée comme hérésie, hérésie dangereuse, inadmissible, criminelle. Et alors, logiquement, immanquablement, c’est le châtiment des hérétiques qui intervient : la prison, l’exil ou le poteau d’exécution. Les syndicalistes et les anarchistes, farouchement persécutés, rien que parce qu’ils osent avoir une opinion indépendante sur la révolution, en savent quelque chose... Et si le lecteur désire avoir des détails et des précisions sur cette répression sauvage, barbare, des révolutionnaires libertaires par l’inquisition sociale bolchevique, il n’a qu’à parcourir la brochure éditée par la « Librairie sociale », en 1923, sous le titre Répression de l’anarchisme en Russie soviétique, ou lire, dans la presse périodique anarchiste, des extraits du Bulletin publié, à des intervalles réguliers, par le Fonds de secours de l’A.I.T. (Association internationale des travailleurs, anarcho-syndicaliste) aux anarchistes et anarcho-syndicalistes emprisonnés ou exilés en Russie.
D’aucuns prétendent que l’une des prouesses du bolchevisme a été l’émancipation de la femme, l’abolition du mariage légal, la reconnaissance du droit à l’avortement. Cette affirmation repose sur l’ignorance complète des faits. Comme le lecteur put le voir au début de cette étude, longtemps avant la révolution de 1917, les milieux intellectuels et ouvriers russes professaient des idées très avancées en cette matière. Dans presque tous les milieux russes, il était entendu que la femme était l’égale de l’homme et pouvait disposer librement de son amour, de son corps. De sorte que tout gouvernement issu d’une révolution était obligé de sanctionner cet état des choses. Il n’y a rien de spécifiquement bolchevique dans cette « prouesse », et le mérite des bolcheviques y est très modeste. D’autre part, le mariage légal n’est nullement supprimé en U.R.S.S. : il est simplifié ou, plutôt, il est devenu un mariage civil, tandis que, avant, le mariage légal en Russie était obligatoirement religieux. On prétend aussi que le bolchevisme a eu raison des préjugés religieux. C’est une erreur dont la source est la même que dans le cas précédent : ignorance des faits concrets. Le gouvernement bolchevique a réussi, par la terreur, à supprimer le culte public de la religion, pas plus. Quant au sentiment religieux, loin de l’avoir extirpé, le bolchevisme, avec ses méthodes et ses résultats, l’a, au contraire, soit rendu plus intense chez les uns, soit simplement transformé chez les autres. Ajoutons que, déjà avant la révolution de 1917, et surtout depuis 1905, le sentiment religieux, dans les masses populaires, se trouvait en plein déclin, ce qui ne manqua pas d’inquiéter sérieusement les popes et les autorités tsaristes. Le bolchevisme réussit plutôt à le raviver. La religion sera tuée non pas par la terreur, mais par la réussite effective de la vraie révolution sociale, avec ses conséquences heureuses.
Je laisse maintenant au lecteur lui-même le soin de répondre à la question posée plus haut, notamment :
-
Un système tel que je viens de le décrire peut-il mener et aboutir à une transformation sociale, dans le sens de l’affranchissement des travailleurs ? Peut-il favoriser cet affranchissement ? Peut-il sauver l’humanité ? Quant à nous, notre opinion est faite : nous affirmons catégoriquement que le bolchevisme, c’est-à-dire la tentative d’accomplir la révolution sociale à l’aide d’une dictature gouvernementale et d’un État, ne pourra jamais aboutir à autre chose qu’à une réaction sociale épouvantable.
Mais nous sommes obligés de constater encore un fait important : l’impuissance complète de ce système, même en tant que capitalisme d’État. Sans pouvoir entrer ici dans les détails, je dois affirmer, en effet – ceci en pleine connaissance de cause –, que la prétendue « industrialisation » du pays aboutit à quelques érections et constructions impraticables et inutiles ; que le fameux « plan quinquennal » est en train de s’effondrer dans une faillite ahurissante et que la soi-disant « collectivisation » étatiste de l’agriculture n’est autre chose qu’une immense entreprise de servage militarisé, qui ne pourra jamais donner des résultats autres que la famine et la misère générales. J’en reparlerai, d’ailleurs, dans quelques instants.
Beaucoup de gens « de gauche » – même avertis – prétendent qu’il faut se taire sur ces résultats lamentables du bolchevisme, ceci pour plusieurs raisons que voici :
1° « Les bolcheviques ont été historiquement obligés de faire leur révolution. S’ils ne l’avaient pas faite, ç’aurait été la réaction à brève échéance. Par la suite, ils ont fait ce qu’ils ont pu faire dans un pays arriéré, au milieu des difficultés sans nombre. »
Cette opinion est une simple hypothèse, pas plus. Je ne la partage nullement. À mon avis, dans les conditions données, une réaction était impossible en Russie ; et si les bolcheviques, après leur prise du pouvoir, n’avaient pas arrêté et déformé le vrai, le grand élan révolutionnaire, les masses laborieuses, aidées par les éléments intellectuels désintéressés (il y en avait), et surtout par les libertaires, auraient fini par accomplir la révolution sociale intégrale. C’est une hypothèse comme la première. Les événements vécus me la dictent. Il est impossible de savoir laquelle des deux est la juste, car il est impossible de savoir « ce qui se serait passé si les bolcheviques n’existaient pas ». Donc, passons...
2° « Les bolcheviques ont, tout de même, accompli une tâche formidable. Ils ont démontré la possibilité de vaincre le capitalisme, ils ont porté à ce dernier un coup dur, ils ont ébranlé le monde. »
Je ne partage nullement ce point de vue. Ce ne furent pas les bolcheviques, mais les masses anonymes qui accomplirent des tâches formidables. Elles ont commis, ensuite, cette erreur fondamentale de confier les destinées de la révolution au Parti bolchevique, à son gouvernement, à l’État. Les bolcheviques en ont profité – comme tant de politiciens avant eux – pour castrer la vraie révolution. Voilà la vérité. Ayant pris une part active à la révolution, d’abord dans le nord, ensuite dans le sud du pays, je pourrais remplir des centaines de pages pour démontrer, par des faits précis tirés de tous les domaines, la vaillance, la capacité, l’activité extraordinaires des masses, d’une part, et, d’autre part, la défaillance, l’incapacité des bolcheviques et, surtout, la contre activité méthodique, froide, implacable, criminelle, avec laquelle ils brisèrent l’élan des masses. L’écrasement du mouvement dit « makhnoviste » en fournit un exemple frappant, et de vaste envergure. La lecture de l’Histoire du mouvement makhnoviste (par P. Archinoff) fixerait suffisamment tout lecteur impartial. Mais, à part ce grand exemple, combien pourrait-on citer de petits faits quotidiens, banals, puisés au hasard dans les annales de la révolution, faits de moindre importance, mais dont la signification est la même !...
Ce sont les masses du peuple – et non pas les bolcheviques – qui ont prouvé la possibilité de vaincre le capitalisme.
Les bolcheviques n’ont rien « ébranlé », puisque, quinze ans après leur « révolution », c’est toujours la réaction qui règne partout. Pourtant, la Révolution russe aurait pu vraiment « ébranler le monde » si elle avait abouti à un résultat complet et concret. Les bolcheviques l’en ont justement empêché.
Les premières impressions « formidables » sur la révolution bolchevique, impressions qui donnèrent un grand espoir et un bel élan aux travailleurs du monde entier, ne furent qu’une illusion. Comme telle, elle était dangereuse, même à cette époque. Car, un jour ou l’autre, une illusion amène nécessairement non pas le succès, mais la vérité sur l’insuccès, et, ensuite, la désillusion, le découragement, l’indifférence, l’effondrement. C’est ce qui est arrivé déjà, dans une certaine mesure, un peu partout. Continuer à soutenir sciemment cette illusion aujourd’hui, serait aggraver le danger. Car, plus l’illusion dure, plus on insiste à y faire croire, plus la désillusion, le découragement, l’effondrement – qui approchent fatalement – seront désastreux. Il est grand temps, au contraire, de dire toute la vérité, de dévoiler l’illusion, de la reconnaître, de chercher à comprendre les causes de l’échec, de se consacrer – et d’aider les masses – à rechercher la vraie solution. L’attitude courageuse de l’écrivain Panaït Istrati (son œuvre : Vers l’autre flamme), attitude souvent incomprise, parfois blâmée, même flétrie par certains éléments, est pourtant la seule qui soit juste et digne d’un homme et d’un révolutionnaire.
3° « Les bolcheviques sont déjà fortement attaqués et calomniés par la bourgeoisie de tous les pays. En les attaquant à notre tour, nous avons l’air d’être de connivence avec cette dernière, ce qui prête à une confusion fâcheuse. »
Pour moi, la vérité prime tout, car c’est d’elle, c’est de son grand éclat que dépend, en premier lieu, l’issue de la gigantesque lutte engagée. Je me moque pas mal de ce que dit la bourgeoisie. Les raisons et les buts de nos attaques sont diamétralement opposés. Nous n’avons qu’à l’expliquer, au besoin. Tant pis pour ceux qui ne voudraient pas nous comprendre. Ils finiront d’ailleurs par y arriver quand même ; car, tôt ou tard, les bolcheviques se disqualifieront eux-mêmes aux yeux du monde laborieux. Nous serons bien contents, alors, de pouvoir dire que nous avions raison. Car, ce jour-là, notre attitude droite, franche et nette nous attirera des sympathies et des forces indispensables pour la victoire de la véritable révolution sociale.
D’ailleurs – en réalité –, les bolcheviques s’entendent aujourd’hui à merveille avec la bourgeoisie de tous les pays (même avec celle, fasciste, de l’Italie et de l’Allemagne). Ils pactisent avec elle ; ils passent des traités avec elle ; ils font des affaires avec elle ; ils prennent part à ses conférences ; ils lui rendent des visites de politesse ; ils font avec elle l’échange de notes de félicitations et de condoléances, etc. Il est à regretter que les prolétaires de tous les pays ne réfléchissent pas assez à des faits de ce genre. Car cette attitude des bolcheviques mérite bien la réflexion approfondie : elle est une des conséquences fatales de leur erreur et de leur révolution bâtarde. Si la bourgeoisie critique le régime bolchevique dans sa presse, c’est qu’elle ne voudrait tout de même pas de troubles bolcheviques chez elle. Et, naturellement, elle note, elle met à profit les défauts et les échecs lamentables du système. Pour cela, elle n’a même pas besoin de calomnier. Je trouve, au contraire, qu’elle le fait assez mollement, assez paresseusement – pour de multiples raisons, dont je n’ai pas à parler ici. Et quant à l’hostilité du bolchevisme pour le capitalisme, elle est de pure apparence et plutôt d’usage « domestique ». En U.R.S.S., c’est toujours une arme à effet. Au dehors, cette arme s’émousse de plus en plus. Car, en réalité, le bolchevisme n’est qu’une variété du capitalisme. Au fait, les deux capitalismes s’entendent assez bien. Les multiples déclarations des grands seigneurs bolcheviques affirmant que « les deux systèmes économiques peuvent parfaitement coexister et collaborer en étroite amitié », en font foi. Cette attitude du bolchevisme est mille fois plus suggestive, plus effective et plus significative que la coïncidence superficielle et purement accidentelle de notre critique avec celle de la bourgeoisie.
4° « La bourgeoisie cherche surtout à détrôner la Révolution russe (comme telle, en son entier) qui la gêne et lui fait peur. Cette révolution est tout de même un fait formidable. Elle reste aujourd’hui le seul grand espoir des classes exploitées de tous les pays. En l’attaquant, nous ne pouvons arriver qu’à décourager profondément les masses ouvrières, à les détourner de toute révolution. Nous faisons ainsi le jeu de la bourgeoisie, que nous le voulions ou pas. »
D’abord, nous n’attaquons pas la Révolution russe. Tout au contraire, nous attaquons ceux qui ont – momentanément, nous l’espérons – arrêté, déformé, castré cette révolution. Rien n’est plus erroné, plus faux, plus dangereux que de confondre la Révolution russe avec le bolchevisme. Je crois l’avoir suffisamment démontré au cours de mon exposé. Ensuite, si aujourd’hui la bourgeoisie peut, encore et toujours, critiquer cette révolution ; si, d’autre part, les travailleurs arrivent à en être découragés au bout des quinze années qu’elle compte, les seuls responsables en sont les bolcheviques eux-mêmes. Qu’ils s’en prennent donc aussi à eux-mêmes ! Nous n’y sommes pour rien, nous n’y pouvons rien. Enfin, en attaquant le bolchevisme en tant qu’une erreur néfaste, mortelle pour la révolution, nous ne le faisons pas à la légère, ou pour le bon plaisir de critiquer : nous indiquons le fond de l’erreur, nous analysons cette dernière en détail, et nous désignons le moyen de l’éviter à l’avenir. Nous ne poussons donc nullement les travailleurs au découragement ; tout au contraire : nous les en prémunissons. Car, lorsque les masses se seront détournées de la révolution bolchevique – non pas à la suite de nos critiques, mais en raison de son échec, qui éclatera un jour de façon retentissante et décisive –, elles trouveront dans nos idées et dans notre attitude un nouvel encouragement ; elles sauront déjà que cette révolution n’est pas la seule possible ; elles saisiront nettement le fond de l’erreur ; et elles percevront au même instant la lueur de cette « autre flamme » vers laquelle elles tendront alors leurs efforts.
En plus de ce qui vient d’être écrit, il existe une raison suprême pour laquelle toute la vérité sur le bolchevisme doit être affirmée – que dis-je ? – inlassablement, implacablement criée à travers le monde par tous ceux qui la connaissent.
Nous vivons en pleine époque révolutionnaire. Or, même au sein de telles époques, celle-ci est exceptionnelle. En effet, d’après de nombreux indices, le gigantesque bouleversement qui commence sera, cette fois, fondamental, complet, définitif. Il aboutira, en fin de compte, non pas à un simple remaniement partiel des rapports économiques et sociaux – comme ce fut le cas dans les révolutions précédentes –, mais à un changement des bases mêmes de la société humaine. Cette fois, il s’agira, vraisemblablement, non pas d’une nouvelle répartition des privilèges et des biens, laissant intacts l’exploitation des masses et le système de répression politique, mais bien de l’abolition totale de toute exploitation de l’homme par l’homme, et de toute autorité politique. Selon toute probabilité, il s’agira, cette fois, enfin, de l’émancipation intégrale de l’homme.
Cette nouvelle substance de la révolution, sans précédent, exigera de nouveaux procédés, de nouvelles méthodes, toute une nouvelle psychologie – fait qui est souvent oublié, notons-le entre parenthèses, par ceux qui analysent les événements.
Le processus de cet immense changement sera long, laborieux, pénible. Durant une bonne partie du chemin, il y aura des égarements, des erreurs, des défaillances, des culbutes, des arrêts, des reculs... Tous ces accrocs, tous ces trébuchements serviront d’expériences, de leçons. Et c’est à force de ces expériences surtout que les masses apprendront le vrai chemin menant au but.
Mais, pour que les expériences négatives soient utiles, pour qu’elles puissent servir de leçons, pour qu’elles permettent d’atteindre, dans un minimum de temps et avec le minimum de souffrances et de victimes, le succès final, il existe une condition essentielle, indispensable : il faut que tout égarement, toute faute, toute erreur d’importance puissent être rapidement repérés, signalés, reconnus, largement discutés et réparés. Une négligence, une faiblesse à cet égard pourraient avoir des conséquences très graves pour la révolution, pourraient même lui être fatales. Or, cette condition sine qua non en exige une autre, non moins indispensable. En effet, pour qu’une erreur puisse être relevée, discutée et corrigée à temps, il faut qu’elle ne soit pas voilée, cachée, étouffée. Il faut que, dès le début, et durant toute la révolution, toute erreur soit carrément avouée et la vérité hautement affirmée. C’est en partie pour cette raison que la liberté d’opinion, de parole et d’action est si précieuse, et que la dictature est impuissante. Dans la grande révolution sociale – dans cette œuvre immense et compliquée, intéressant des millions d’hommes, œuvre où les erreurs doivent être nombreuses et qui, cependant, devra aboutir non pas à un nouvel égarement, mais au vrai but, au résultat intégral, définitif –, une sincérité absolue, une franchise entière, sont de rigueur. La vérité entière – vérité de partout et de tout instant – doit constamment éclairer le chemin de la révolution sociale, pour que ses erreurs puissent être liquidées et ses expériences négatives utilisées.
Dans les conditions historiques données, dans l’ambiance sociale actuelle, l’égarement politique – État, gouvernement, etc. – est presque fatal, au début de la révolution. Il est d’une gravité extrême. Et il n’y a que nous, les anarchistes, pour le signaler, pour crier au danger.
Revenons au bolchevisme. Incontestablement, il est un fait historique et mondial d’une immense portée. Mais quel est son vrai sens historique ? Quelle est son « utilité » ? Nous affirmons que, justement, le bolchevisme n’est autre chose qu’un égarement politique survenu au début de la révolution sociale mondiale : donc, une expérience négative. Nous estimons que le seul sens historique du bolchevisme est de démontrer aux masses laborieuses de tous les pays, une fois pour toutes et d’une façon palpable, incontestable, définitive, le péril du principe politique, étatiste, gouvernemental, pour la révolution sociale. Nous considérons que la seule « utilité » du bolchevisme est d’avoir donné aux masses de tous les pays, dès les débuts de la révolution sociale, cette leçon pratique, indispensable, leçon d’une vaste envergure, d’une longue durée, et d’un fini parfait : comment il ne faut pas faire la révolution. Jadis, en Russie, la légende du tsar fut tuée, en définitive, par le tsar lui-même : par cette « expérience négative » du 9 janvier 1905 (ce qui permit, ensuite, de faire rapidement, facilement, la révolution anti-tsariste lorsque le bon moment arriva). De même, aujourd’hui, la légende étatiste, la légende de la dictature sera tuée par les étatistes, par les dictateurs eux-mêmes : par cette autre expérience impressionnante, formidable, de la Révolution russe, expérience qui, avec ses résultats négatifs évidents, palpables, déblayera le chemin et préparera le terrain à la rude révolution sociale mondiale. Ainsi, pour que les masses apprennent la bonne méthode, il leur faut une bonne leçon expérimentale. Ces sortes de leçons historiques constituent, sous certaines conditions d’ensemble, leur principale éducation.
Mais, pour que les masses des autres pays puissent, en temps opportun, tirer parti de cette leçon, il est indispensable que toute la vérité sur le bolchevisme – sur sa véritable nature, sur ses actes néfastes, sur ses résultats lamentables, et sur son échec de plus en plus net – soit affirmée sans retard ni ménagements, soit étalée au grand jour, illustrée, expliquée, commentée...
Telle est la raison suprême qui nous oblige de dire sur le bolchevisme toute la vérité, quelque cruelle qu’elle soit pour ceux qui se laissent bercer par des illusions. Nous sommes convaincus que tel est notre devoir sacré.
L’impuissance créatrice, la « trahison » (comme s’exprimèrent jadis les marins de Cronstadt) et le despotisme inouï du gouvernement bolchevique, provoquèrent-ils des réactions dans le pays ?
Certes, oui. Et ceci, dans deux sens diamétralement opposés.
D’une part, comme le lecteur sait, deux mouvements contre-révolutionnaires très vastes et très graves – mouvements qui, à un moment donné, présentèrent une menace extrêmement sérieuse pour le pouvoir bolchevique – s’étaient formés dans le sud, en 1919 et en 1920.
Les premières résistances à la révolution, en 1917 et 1918 – résistances tout à fait locales et assez anodines, malgré leur acharnement –, étaient plus ou moins naturelles : comme toujours, certains éléments purement réactionnaires se dressèrent contre la révolution et tâchèrent de la combattre. Une majorité écrasante des ouvriers, des paysans et de l’armée étant à ce moment pour le nouvel ordre, ces résistances furent rapidement et facilement brisées. Si, par la suite, la révolution avait su se montrer réellement puissante, juste, féconde, si elle avait pu résoudre convenablement ses grands problèmes, tout se serait certainement borné à ces quelques batailles éparses, et la victoire ne serait plus menacée. Mais, comme nous l’avons dit, le bolchevisme défigura et castra la révolution. Il la rendit impuissante, inutilement et stupidement violente, stérile, lugubre. Il désillusionna, il irrita, il dégoûta rapidement de vastes couches de la population. Nous avons déjà vu de quelle façon il jugula les ouvriers. Son action de violence et de terreur étatistes contre les masses paysannes (nous en reparlerons plus bas) aboutit à dresser ces dernières contre lui. N’oublions pas que, dans toutes les révolutions, le gros de la population reste, d’abord, neutre, hésite, attend les premiers résultats. Il est toujours nécessaire qu’une révolution puisse « se justifier » le plus rapidement possible. Sinon, toute cette population neutre se détourne de l’œuvre révolutionnaire, elle lui devient hostile ; elle commence à sympathiser avec les mouvements contre-révolutionnaires, elle les soutient et les rend beaucoup plus dangereux. Telle est surtout la situation lors des bouleversements de grande envergure qui touchent aux intérêts de millions d’hommes, qui modifient profondément les rapports sociaux, et qui se font au moyen de grandes promesses de satisfaction. Cette satisfaction doit venir vite. Dans le cas contraire, la révolution faiblit, et la contre-révolution reçoit des ailes. Ajoutons que beaucoup de ces éléments neutres sont indispensables pour la bonne marche de la révolution, car ils comprennent un grand nombre d’hommes d’ « élite » : des techniciens, des gens du métier, des travailleurs qualifiés de toute espèce, des spécialistes, des intellectuels, etc. Tout ce monde, qui n’est pas précisément hostile à la révolution, se tournerait entièrement vers elle et l’aiderait puissamment, avec enthousiasme, si elle arrivait à inspirer à ces gens une certaine confiance, à leur faire sentir ses capacités, ses vérités, ses perspectives et ses possibilités, ses avantages, sa force, sa justice... Dans le cas contraire, tous ces éléments deviennent franchement ennemis de la révolution, ce qui porte à cette dernière un coup très sensible. Or, il est certain que les masses laborieuses, exerçant elles-mêmes, avec l’aide libre des hommes d’élite déjà révolutionnaires, l’activité libre, sauraient entamer rapidement la vraie solution des problèmes, sauraient arriver à des résultats probants et, partant, sauraient rassurer, enthousiasmer et enrôler les dits éléments. La dictature – impuissante, hautaine, stupide et méchamment violente – n’y arrive pas et les rejette de l’autre côté de la barricade.
Le bolchevisme ne sut nullement « se justifier ». Comme nous l’avons vu, le seul grand problème qu’il réussit à résoudre, tant bien que mal (et encore sous la poussée irrésistible de l’armée elle-même, qui refusait de combattre), fut celui de la guerre. Ce succès – la paix acquise – lui valut la confiance et des sympathies durables de vastes masses populaires. Mais ce fut tout. Son impuissance économique, sociale et créatrice en général, se fit vite sentir. La stérilité de ses moyens d’action – procédés gouvernementaux, absolutisme étatiste, etc. – se révéla presque au lendemain de sa victoire. Les bolcheviques, ainsi que leurs sympathisants, aiment parler de « difficultés terribles » que le gouvernement bolchevique eut à surmonter, après la guerre et la révolution, dans un pays tel que la Russie. C’est en raison de ces difficultés que l’on cherche à justifier certains procédés bolcheviques – entre autres, la politique agraire et le soi-disant « communisme de guerre » des premières années postrévolutionnaires. Or, ayant vécu les événements, j’ai la certitude absolue :
-
que les procédés néfastes du bolchevisme provenaient non pas des difficultés rencontrées, mais de la nature même de la doctrine bolchevique ;
-
que ces difficultés avaient surgi justement parce que le gouvernement se mit, dès le début, à étouffer la libre activité des masses ;
-
que ces difficultés, si elles avaient existé quand même, auraient été liquidées mille fois plus simplement et plus facilement par la libre action des masses.
Plus les difficultés étaient grandes, plus il fallait, justement, recourir à la libre initiative, à l’activité autonome du peuple. Or, nous le savons, le gouvernement bolchevique accapara tout : l’idée, l’initiative, les moyens et l’action. Il s’installa en dictateur (« du prolétariat »). Il subjugua les masses, il étouffa leur élan. Et plus les difficultés étaient grandes, moins il permettait au « prolétariat » d’agir indépendamment. Les autorités bolcheviques ne disparaissaient, en laissant la place libre à l’action du peuple, qu’aux moments où elles étaient prises au dépourvu par une offensive contre-révolutionnaire, donc aux moments d’un danger imminent, d’une panique dans leurs rangs. Maintes fois, et en maints endroits, les masses, abandonnées ainsi à elles-mêmes, sauvèrent la situation. Aussitôt après, les bolcheviques réapparaissaient, avec leur force armée, et reprenaient fièrement leur trône et leur knout. Rien d’étonnant que le bolchevisme ne sût faire face normalement aux difficultés (provoquées en grande partie par lui-même) et qu’il fût acculé au langage des mitrailleuses (ce qui ne fit que souligner son impuissance réelle). Dans les grands bouleversements sociaux, il n’y a pas de milieu ; c’est : soit l’entière et bienfaisante liberté des masses qui, seule, peut l’emporter définitivement (et achever la révolution), soit la néfaste dictature qui s’impose (et qui l’étouffe).
Je pourrais citer nombre de cas typiques qui confirmeraient mes dires. À tout instant, et sur toute l’étendue du pays, les ouvriers des villes voulaient, par exemple, prendre de leur chef certaines mesures pour faire marcher les usines menacées d’arrêt, faute de combustibles ou de matières premières ; ou bien les ouvriers cherchaient des moyens d’assurer et d’organiser l’échange avec la campagne ; ou encore, les organisations ouvrières prenaient une initiative pour faire face à telle ou telle autre difficulté, pour améliorer un service défectueux, pour redresser une situation chancelante, pour réparer des erreurs, pour combler des lacunes, etc. Systématiquement, et partout, les autorités bolcheviques interdisaient aux masses toute action indépendante, tout en étant elles-mêmes, le plus souvent, incapables d’agir utilement et en temps opportun. J’ai cité ailleurs (voir Masses), et dans une autre suite d’idées, un cas qui eut lieu à l’usine anc. Nobel, à Petrograd, où le gouvernement préféra fermer l’usine, plutôt que de permettre aux ouvriers de se procurer les matières indispensables. Il faut multiplier ce cas au moins par mille pour se faire une idée du véritable état de choses.
Voici un autre exemple, tiré d’un domaine différent : en 1918, j’ai travaillé, pendant quelques semaines, à la section de l’instruction publique d’un soviet, dans une petite ville de province. J’étais chargé de faire marcher un organisme spécial, destiné à l’instruction des adultes, dit « culture prolétarienne ». Fidèle à mes principes, j’ai fait mon possible pour éveiller l’initiative de la population laborieuse de la localité ; me bornant à l’intéresser, à l’entraîner et à l’aider. Les résultats dépassèrent toutes mes prévisions. Des dizaines d’hommes, sortis du sein du peuple, s’enthousiasmèrent à la tâche et se mirent à travailler avec une telle ardeur, et aussi avec une telle dextérité, avec une telle richesse d’idées et de réalisations, qu’il ne me restait plus qu’à combiner et à coordonner leurs efforts. Bientôt, la population entière s’intéressa à notre œuvre. Mais... les autorités locales envoyèrent leurs rapports au Centre, à Moscou. On y comprit tout de suite que j’agissais d’après mon libre entendement ; que tous nous œuvrions librement, sans tenir compte des décrets et des ordres de Moscou. Un beau jour, je commençai à recevoir de là-bas, coup sur coup, de gros paquets bourrés de décrets, de règlements, de prescriptions, d’ordres formels... Je fus sommé de m’en tenir strictement aux textes de toute cette paperasserie stupide, à ces ordres impossibles, irréalisables, meurtriers... Après une courte résistance inutile, je dus partir, ne voulant pas me plier, sachant bien que l’exécution des ordres de Moscou allait tuer l’œuvre entreprise.
Je prie le lecteur de noter que je me tenais, très loyalement, à mes devoirs professionnels, sans faire jamais allusion à mes idées anarchistes. Il ne s’agissait là nullement d’une propagande « subversive » quelconque et il n’en fut jamais question. Tout simplement, le Centre n’admettait pas qu’on pût ne pas suivre aveuglément ses prescriptions. Mon successeur, fidèle serviteur de Moscou, appliqua à la lettre les règlements du Centre. Quelques semaines après, tout le monde déserta. L’organisme qui, récemment encore, était plein de vie, devint rapidement un cadavre et disparut. J’ajoute que, quelques mois plus tard, cette entreprise de « culture prolétarienne » échoua lamentablement, sur toute l’étendue du pays. Partout, dans tous les domaines, c’était pareil : on devait se plier aux ordres ou s’écarter. Encore un exemple : le soviet (déjà une filiale du gouvernement) d’une des villes, dans le midi du pays, s’avérant impuissant à résoudre certains problèmes économiques locaux de grande urgence, les ouvriers de quelques usines – en 1918–1919, une pareille tentative était encore possible – demandèrent à la présidence de ce soviet l’autorisation de s’occuper eux-mêmes des dits problèmes, de créer les organismes appropriés, de grouper autour d’eux tous les ouvriers de la ville, et d’agir de leur chef, sous le contrôle du soviet. En résultat, ils furent sévèrement réprimandés et menacés de poursuites pour leur geste « désorganisateur ». Comme le lecteur voit, les soviets locaux agissaient à l’instar des autorités de Moscou. À l’approche de l’hiver, plusieurs villes manquaient de combustibles, les autorités n’ayant pas fait le nécessaire pour s’en approvisionner à temps. Souvent, les ouvriers proposaient d’entrer en relations avec les paysans des environs pour que ces derniers abattent et fournissent du bois. Invariablement, les soviets interdisaient aux ouvriers de le faire en marge des établissements administratifs. Et, invariablement, ces derniers n’arrivaient pas à le faire en temps opportun. Comme résultat : ou les villes restaient sans combustible, ou ce dernier était payé fantastiquement cher, car le travail devenait très pénible et les routes impraticables à partir du mois de septembre. Parfois aussi, on obligeait les paysans à fournir du bois, tout simplement, par ordre militaire. Je pourrais couvrir des dizaines de pages d’exemples de ce genre puisés au petit hasard dans tous les domaines de l’existence. Production, répartition, transports, commerce, etc., partout c’était la même chose : les masses n’avaient aucun droit d’agir de leur propre initiative, et les administrations se trouvaient constamment en faillite. Les villes manquaient de pain, de viande, de lait, de légumes... La campagne manquait de sel, de sucre, de produits industriels... Des vêtements pourrissaient dans les stocks des grandes villes. Et la province n’avait pas de quoi s’habiller... Désordre, chaos, incurie, impuissance partout et en tout...
Le résultat psychologique d’un tel état de choses est facile à comprendre. Peu à peu, les masses se détournèrent du bolchevisme. Le mécontentement grandissait de jour en jour. Ce mécontentement servit de base à de vastes mouvements contre-révolutionnaires et les alimenta. La réaction en profita avec empressement. De grandes campagnes armées prirent pied, ourdies par les classes privilégiées vaincues, soutenues par la bourgeoisie des autres pays, dirigées par des généraux de l’ancien régime.
Le lecteur comprend maintenant pourquoi les soulèvements des années 1919 et 1920 portèrent un caractère autrement sérieux que les résistances spontanées et insignifiantes de 1917–1918. Le premier grand mouvement « blanc », dirigé militairement par le général Dénikine (1919), envahit rapidement toute l’Ukraine et une grande partie de la Russie centrale. À un certain moment, l’armée blanche, battant et refoulant les troupes rouges, atteignit la ville d’Orel, près de Moscou, de sorte que le gouvernement bolchevique s’apprêtait déjà à fuir. La durée et l’éventualité de triomphe de ce mouvement s’expliquent aisément par les sympathies d’une grande partie de la population, par la haine croissante du bolchevisme, bref, par les raisons que nous venons d’analyser. Le second mouvement, celui de Wrangel (1920), trouva une ambiance encore plus favorable et fut, à un moment donné, encore plus dangereux pour les bolcheviques que celui de Dénikine, toujours pour les mêmes raisons.
Toutefois, les deux mouvements échouèrent. Celui de Dénikine s’écroula d’un bloc. Son armée, arrivée « aux portes de Moscou », dut subitement et précipitamment battre en retraite vers le Sud. Là, elle disparut, ensuite, dans une débâcle catastrophique. Ses quelques débris, errant un peu partout, furent peu à peu liquidés par des détachements de l’armée rouge descendus du Nord sur les traces des fugitifs. Détail curieux et significatif : pendant au moins 24 heures, le gouvernement bolchevique à Moscou, pris lui-même de panique, ne voulait pas croire à la retraite des troupes denikiniennes, n’en saisissant pas la raison, ne pouvant pas s’expliquer le fait. (Il eut l’explication exacte beaucoup plus tard.) Se rendant, enfin, à l’évidence, il respira et dépêcha des régiments rouges à la poursuite des blancs. Le mouvement de Dénikine était brisé. Celui de Wrangel, surgi un an plus tard, remporta d’abord, lui aussi, quelques gros succès. Sans être parvenu à atteindre Moscou, il inquiéta, cependant, le gouvernement, peut-être plus encore que le raid de Dénikine ; car la population, de plus en plus dégoûtée du bolchevisme, n’avait nullement l’air de vouloir livrer une résistance sérieuse à ce nouveau mouvement antibolchevique ; et, d’autre part, le gouvernement ne pouvait compter beaucoup sur sa propre armée. Néanmoins, après les succès du début, le mouvement de Wrangel fut ensuite, lui aussi, rapidement liquidé.
Quelles furent donc les raisons de ces revirements presque miraculeux, de cet échec final des campagnes qui avaient commencé avec tant de succès ? Une analyse plus ou moins complète de ces mouvements demanderait des volumes. Je regrette de ne pouvoir les traiter ici autrement que grosso modo. Mais il est absolument nécessaire de leur consacrer quelques lignes, car les vraies causes et les circonstances particulièrement significatives de ces flux et reflux sont, d’une part, peu connues, et, d’autre part, sciemment défigurées par des auteurs intéressés.
En peu de mots, les raisons principales des faillites retentissantes du mouvement « blanc » furent les suivantes :
D’abord, l’attitude maladroite, cynique et provocante des autorités, des chefs et des meneurs du mouvement. À peine vainqueurs, tous ces messieurs s’installaient dans les régions conquises en véritables dictateurs. Menant, le plus souvent, une vie de débauche ; impuissants, eux aussi, à organiser une vie normale ; bouffis d’orgueil, pleins de mépris pour le peuple laborieux, ils faisaient brutalement comprendre à ce dernier qu’ils entendaient bien restaurer l’ancien régime, avec toutes ses beautés. La terreur « blanche » et les représailles sauvages commençaient partout sans délai. Les anciens propriétaires fonciers et industriels, chassés ou partis lors de la révolution, revenaient avec les armées et se hâtaient de rentrer en possession de « leurs biens ». Bref, le système absolutiste et féodal d’autrefois réapparaissait brusquement.
Une pareille attitude provoquait vite chez les masses laborieuses une réaction psychologique inverse. Un autre facteur entrait tout de suite en vigueur. En effet, les masses craignaient le retour du tsarisme et du « pomestchik » beaucoup plus que la continuation du bolchevisme. Avec ce dernier, elles pouvaient, malgré tout, espérer arriver à certaines améliorations, à des perfectionnements et, finalement, à une vie libre et heureuse. Tandis qu’il n’y avait rien à espérer d’un retour du tsarisme. Les paysans, surtout, qui, à cette époque, profitaient, au moins en principe, de l’extension des terres disponibles, s’effrayaient à l’idée de devoir rendre ces terres aux anciens propriétaires.
Ainsi, la révolte contre les « blancs » reprenait au lendemain même de leur victoire. Les masses organisaient vite une résistance acharnée. Et, en fin de compte, des détachements, et même des armées de partisans créées en hâte et soutenues par la population laborieuse tout entière, infligeaient aux « blancs » des défaites écrasantes. À cette époque, la population pouvait encore garder les armes. Plus tard, les autorités bolcheviques l’obligèrent partout à les rendre.
L’armée qui, matériellement, contribua le plus à l’écrasement des forces de Dénikine et de Wrangel fut celle connue sous le nom d’armée « makhnoviste », car elle était commandée par l’anarchiste Nestor Makhno. Combattant au nom d’une société libertaire, obligée de lutter simultanément contre toutes les forces d’oppression, les blanches et les rouges, elle arrêtera notre attention un peu plus loin, lorsque nous parlerons de l’autre résistance au bolchevisme, résistance « de gauche ». Mais, parlant de la réaction « blanche », précisons ici même que la raison qui força Dénikine de lâcher Orel et de battre précipitamment en retraite – raison que le gouvernement bolchevique apprit plus tard – fut justement la défaite décisive infligée par l’armée makhnoviste aux arrière-gardes de Dénikine, près du village Pérégonovka, dans les parages de la petite ville d’Ouman (gouvernement de Kiev). Me trouvant, à ce moment, à l’armée de Makhno, je puis témoigner que le raid fameux de son armée – raid qui suivit cette bataille – coupa en deux les forces de Dénikine, séparant ainsi leur partie avancée de leurs arrière-gardes, de leur base de ravitaillement et de leurs dépôts de munitions. Le lecteur trouvera les détails de cet épisode dans le livre déjà cité : Histoire du mouvement makhnoviste, par P. Archinoff. Quant aux forces de Wrangel, leur défaite décisive par l’armée de Makhno me fut avouée par les bolcheviques eux-mêmes, dans des circonstances assez curieuses. Lors de l’offensive, très dangereuse, de Wrangel, je séjournais en prison bolchevique, à Moscou. De même que Dénikine, Wrangel battait et refoulait l’armée rouge vers le Nord. Makhno qui, à cette époque, se trouvait en état d’hostilités avec les bolcheviques, décida, vu le danger commun, de leur offrir la paix et de leur prêter main-forte contre les blancs. Étant en mauvaise posture, les bolcheviques acceptèrent l’offre et conclurent une entente avec Makhno. Ce dernier se jeta sur l’armée de Wrangel et la battit à plate couture, près d’Orékhov (Ukraine). La bataille terminée, il envoya un télégramme à Lénine (Moscou), déclarant qu’il ne ferait plus un pas en avant si l’on ne mettait pas immédiatement en liberté son ami Tchoubenko et moi.
Ayant encore besoin de Makhno, les bolcheviques m’ont remis en liberté, en m’avouant, à cette occasion, les hautes qualités combatives de l’armée de Makhno et sa victoire brillante sur les forces de Wrangel. (Les détails sur la lutte contre Wrangel sont racontés dans le livre précité.)
Pour terminer avec les réactions de droite, je dois démentir ici même certaines légendes inventées et sciemment répandues par des gens intéressés.
La première est celle de l’intervention étrangère, laquelle, d’après la légende, serait très importante lors des offensives de Dénikine et de Wrangel. C’est surtout par l’importance de cette intervention que les auteurs bolcheviques expliquent la force et les succès des mouvements blancs. Cette affirmation ne correspond pas à la réalité. Elle est très exagérée. De fait, l’intervention étrangère, lors de la Révolution russe, n’a jamais été bien vigoureuse. Une certaine aide, assez modeste, en argent, en munitions et en équipement : ce fut tout. Quant aux détachements de troupes envoyés en Russie, ils ont été toujours de peu d’importance et ne jouèrent dans les événements presque aucun rôle. Ceci se comprend, d’ailleurs, aisément. Les chefs militaires étrangers craignaient fort la « décomposition » de leurs troupes en contact avec le peuple révolutionnaire russe. Les événements démontrèrent que ces craintes étaient assez fondées. En effet, sans parler des détachements anglais, français ou autres qui ne sont, en somme, jamais parvenus à se battre contre les révolutionnaires, même les troupes d’occupation austro-allemandes (après la paix de Brest-Litovsk), assez importantes et protégées par les forces du gouvernement ukrainien de Skoropadsky, furent vite décomposées et débordées par les forces révolutionnaires du pays. À ce propos, je me permets de souligner ici que le sort de l’occupation allemande confirme pleinement la thèse défendue par les anarchistes lors de la paix de Brest-Litovsk. Qui sait quelle serait aujourd’hui la face du monde si, à cette époque, le gouvernement bolchevique, au lieu de traiter avec les impérialistes allemands, avait laissé leurs troupes pénétrer en Russie révolutionnaire, et si les conséquences de cette pénétration avaient été les mêmes que celles qui, plus tard, firent disparaître tous les Dénikine, les Wrangel, les austro-allemands, etc. ?
Non, Lénine et ses camarades ne furent jamais des révolutionnaires. Ils ne furent que des réformistes quelque peu brutaux qui, en vrais réformistes, recoururent toujours à de vieilles méthodes bourgeoises. Ils n’avaient aucune confiance dans la vraie révolution et ne la comprenaient même pas. En confiant à ces bourgeois étatistes réformistes le sort de la révolution, les travailleurs russes révolutionnaires ont commis une erreur fondamentale. Là est une partie de l’explication exacte de tout ce qui s’est passé en Russie, depuis octobre 1917 à nos jours. Nous avons vu quelles furent les véritables raisons de la vigueur des offensives contre-révolutionnaires en Russie.
La seconde légende fort répandue est celle du rôle de l’armée rouge. D’après les « historiens » bolcheviques, ce fut elle qui battit les troupes contre-révolutionnaires, qui écrasa les offensives blanches et remporta toutes les victoires. Rien n’est plus faux. Dans toutes les offensives contre-révolutionnaires importantes, l’armée rouge était battue et fuyait. Ce fut le peuple en révolte et, partiellement, en armes qui battait les blancs. L’armée rouge revenait invariablement après coup (mais en nombre) pour prêter main-forte aux partisans victorieux, pour donner, ensemble avec ceux-ci, le coup de grâce aux armées blanches déjà en déroute, et pour se faire adjuger les lauriers de la victoire.
Je n’ai pas parlé de l’offensive assez importante de l’amiral Koltchak, en Sibérie – offensive soutenue par l’armée tchécoslovaque. En effet, je ne connais pas assez les événements de Sibérie. D’après ce que je sais, indirectement, les raisons générales des premiers succès et de l’échec final de cette offensive furent les mêmes qu’ailleurs. Mais je ne puis l’affirmer avec la même force et précision, n’ayant pas été témoin immédiat de ces événements. Je sais, cependant, d’une façon certaine, que le mouvement des partisans en armes a été aussi très important en Sibérie, et que son rôle dans la défense révolutionnaire fut considérable. Je rappelle au lecteur qu’au moment de l’offensive tchécoslovaque (juin-juillet 1918), afin d’éviter toute complication, l’exécution du tsar Nicolas II et de sa famille, déportés à Ekaterinbourg, fut décidée par le soviet régional et accomplie dans la nuit du 15 au 16 juillet.
Indépendamment de ces réactions de droite, se formèrent aussi, vers la même époque et plus tard, des mouvements allant dans le sens opposé, mouvements révolutionnaires qui combattirent le pouvoir bolchevique au nom de la vraie liberté et des vrais principes de la révolution sociale, bafoués, piétinés par le bolchevisme.
La politique générale néfaste, l’étatisme et le centralisme outrés, la « trahison » et l’impuissance flagrante des bolcheviques provoquèrent, d’abord, des mouvements de révolte et d’opposition dans les rangs mêmes du gouvernement et du parti. C’est ainsi que survinrent, en été 1918, le soulèvement – d’ailleurs purement politique – des socialistes révolutionnaires de gauche et la rupture entre eux et le Parti bolchevique. Ayant participé, jusque-là, au gouvernement, les socialistes révolutionnaires de gauche le quittent, déclarent la guerre aux bolcheviques et tombent bientôt sous les coups de la répression (en même temps que les anarchistes). C’est ainsi, également, que se forme, plus tard, au sein même du Parti bolchevique, la soi-disant « opposition ouvrière », dont les premières manifestations contraignent Lénine à publier son pamphlet connu sur la « maladie infantile du gauchisme », et qui succombe, ensuite, sous les mêmes coups d’une répression farouche. C’est ainsi, enfin, que, sur toute l’étendue du pays, se dessinent, de temps à autre, des mouvements de gauche, vite réprimés par les autorités.
Obligés de condenser, nous ne nous arrêterons ici qu’à deux de ces mouvements, tous les deux importants, significatifs, et tous les deux calomniés par les bolcheviques.
L’un fut le soulèvement de Cronstadt, en mars 1921. Les marins de Cronstadt ont tenu leur parole révolutionnaire donnée en 1917. Devant la carence totale du gouvernement bolchevique, révoltés par sa « trahison », profondément émus par la situation épouvantable du pays, sans issue tant que subsistait la politique du parti au pouvoir, soulevés d’indignation et de colère en apprenant la répression sauvage des troubles ouvriers à Moscou et à Petrograd, ils se soulevèrent, d’ailleurs pacifiquement, en protestant contre la conduite du gouvernement et en formulant des réclamations décisives au nom du salut révolutionnaire. Naturellement, le gouvernement bolchevique ne céda pas. Il attaqua Cronstadt avec des armes et noya le mouvement dans le sang. L’histoire future mettra à jour toutes les péripéties de cette lutte inégale et héroïque au cours de laquelle les bolcheviques se trouvèrent, cependant, à un cheveu du péril. Cette lutte fut terrible. Les révoltés défendirent finalement chaque maison, chaque pouce de terrain. Ils succombèrent sous la force des « junkers rouges » et payèrent cher leur noble geste. Des centaines de cadavres, d’autres centaines de prisonniers assassinés lentement dans les geôles bolcheviques, tel fut le bilan de la révolte. L’atrocité de la répression dépassa toute imagination.
Ce qui nous intéresse ici, c’est, d’abord, la façon écœurante dont cette révolte fut calomniée à travers le monde par le gouvernement bolchevique. On la qualifia effrontément de mutinerie contre-révolutionnaire. Ce fut un mensonge de plus dans tout le système mensonger des bolcheviques. Un jour, l’histoire dégagera et proclamera hautement la vérité entière sur la « Commune de Cronstadt » et sur le rôle de Trotski, le « Galliffet rouge ». Mais je voudrais fournir ici même quelques preuves du caractère révolutionnaire du soulèvement.
-
Au cours de la révolte, le comité révolutionnaire publiait un journal où l’on imprimait tous les appels, déclarations, manifestes, ou autres documents relatifs au mouvement. Il est regrettable que toute cette documentation ne soit pas encore recueillie et publiée en langues étrangères. (Elle existe pourtant en langue russe.) Les ouvriers européens devraient demander au gouvernement bolchevique de le faire. Cette publication serait édifiante. Naturellement, les bolcheviques ne la feront pas, Mais leur refus obstiné serait déjà un aveu concluant. Ayant sous la main quelques-uns de ces documents, je me permettrai de citer, ici, quelques lignes de l’un des premiers appels du comité révolutionnaire de Cronstadt, en date du 2 mars 1921 :
« À la population de la forteresse et de la ville de Cronstadt.
« Camarades et citoyens !
« Notre pays traverse une période difficile. Voici déjà trois ans que la famine, le froid et le chaos économique nous tiennent dans un étau terrible. Le Parti communiste qui gouverne le pays s’est détaché des masses et s’est révélé impuissant à sortir le pays d’un état de débâcle générale. Le parti n’a tenu aucun compte des troubles qui viennent d’avoir lieu à Petrograd et à Moscou, et qui prouvent clairement qu’il a perdu la confiance des masses ouvrières. Il n’a tenu, non plus, aucun compte des réclamations formulées par les ouvriers. Il considère ces réclamations comme des résultats des menées contre-révolutionnaires. Il se trompe profondément. Ces troubles, ces réclamations, c’est la voix du peuple entier, de tous les travailleurs. Tous les ouvriers, tous les marins, tous les soldats rouges voient nettement, aujourd’hui, que, seuls, les efforts communs, seule la volonté commune des travailleurs, pourront donner au pays du pain et du charbon, pourront vêtir et chausser le peuple, pourront sortir la république de l’impasse où elle se trouve. »
Ensuite, l’appel recommande à tous de maintenir partout l’ordre révolutionnaire, d’organiser « sur des bases justes » les nouvelles élections au soviet local et de prendre garde aux menaces du gouvernement. Préalablement, les délégués de toutes les organisations ouvrières, de marins et de soldats, réunis en une assemblée générale, créèrent ce comité révolutionnaire provisoire, chargé de gérer les affaires de la ville et de la forteresse, et de veiller sur leur sécurité.
D’autre part, dans une résolution adoptée la veille par l’assemblée générale des marins, on demandait au gouvernement, entre autres : « La liberté de la parole et de la presse pour les ouvriers et les paysans, pour les anarchistes et pour les partis socialistes de gauche » ; « la liberté des réunions et des organisations professionnelles, ouvrières et paysannes » ; « la mise en liberté de tous les détenus appartenant aux partis socialistes, ainsi que de tous les ouvriers, paysans, soldats et marins emprisonnés en liaison avec des mouvements ouvriers et paysans» ; « le choix d’une commission chargée de réviser les affaires de tous les détenus dans les prisons et les camps de concentration », etc.
-
Le journal qui paraissait à Cronstadt, pendant le mouvement, était rempli de déclarations des membres du Parti communiste, lesquels dévoilaient la faillite révolutionnaire du bolchevisme, rompaient avec le parti et se solidarisaient avec le mouvement. Ces déclarations étaient si nombreuses que, finalement, on dut les grouper, faute de place.
-
Les membres du comité révolutionnaires étaient de simples marins, ouvriers ou paysans de tendance de gauche. Le président du comité, Petritonenko, était un anarchisant.
-
J’ai encore une petite preuve personnelle, mais assez éloquente, de l’orientation révolutionnaire du mouvement de Cronstadt. Étant à ce moment en prison, j’ai su qu’une délégation du comité révolutionnaire était venue à Petrograd dans l’intention d’emmener à Cronstadt notre camarade d’alors, Iartchouk, et moi, tous les deux connus à Cronstadt. Le comité voulait que nous vinssions l’aider dans sa tâche. Il ne savait pas que, tous les deux, nous étions en prison. Il est évident qu’un mouvement contre-révolutionnaire ne songerait jamais à demander le concours des anarchistes.
J’ai cité ici au hasard quelques faits significatifs.
Mais je répète que seule une publication complète de la documentation relative au mouvement pourrait faire éclater toute la tragique vérité. Il existe une excellente brochure sur le soulèvement de Cronstadt, par Alexandre Berkman, assez documentée. Je l’ai lue en anglais. Je ne sais pas si elle existe en français.
Ce qui nous intéresse ensuite, ce sont les conséquences des événements cités.
Lénine n’a rien compris au mouvement de Cronstadt. Il eut peur et proclama, quelques jours après les événements, sa fameuse « nouvelle politique économique » (NEP). Ce dernier octroya une certaine liberté à l’activité économique de la population. Mais le sens même de cette « liberté » fut complètement faussé. Au lieu d’une libre activité créatrice des masses (ce que réclamait Cronstadt), ce fut la « liberté » pour certains individus de faire du commerce et de s’enrichir. On a souvent considéré la NEP comme un recul stratégique permettant de fortifier les positions acquises, comme un genre de « répit économique » analogue au « répit militaire » de l’époque de Brest-Litovsk. C’est possible. En tout cas, la NEP ne changea rien dans l’état général des choses. Elle trompa quelques milliers de naïfs ; elle berça de faux espoirs certaines couches de la population ; elle fit accumuler des montagnes de bêtises à l’étranger. Les quelques années de NEP permirent surtout à l’État d’augmenter, en attendant, ses forces matérielles et militaires, de créer, en silence, son appareil administratif, politique, bureaucratique et néo bourgeois, de se sentir définitivement fort pour serrer tout dans sa poigne de fer. Si l’on veut parler du « recul » dans ce sens, c’est exact. Bientôt, après la mort de Lénine (en 1924) et l’avènement – en résultat de quelques luttes intestines – de Staline, la NEP fut supprimée, les « nepmans » arrêtés, déportés ou fusillés, et l’État, définitivement armé, blindé, bureaucratisé, capitalisé, établit résolument son omnipotence. Toutes ces péripéties n’avaient plus rien de commun avec la révolution sociale et les aspirations des masses travailleuses.
Le second mouvement révolutionnaire antibolchevique, de très vaste envergure, fut celui de l’Ukraine, connu sous le nom de « mouvement makhnoviste », déjà cité au cours de notre exposé. Plusieurs départements, avec une population de 7 millions d’hommes environ, furent plus ou moins englobés dans ce mouvement qui dura de 1918 à 1921 et qui défendit crânement la révolution sociale contre tous ses ennemis, contre tous ses faussaires et fossoyeurs, y compris les bolcheviques.
Il m’est absolument impossible de faire ici une étude, même sommaire, de cette épopée vraiment exceptionnelle dans les annales révolutionnaires. Une pareille étude sommaire ne donnerait rien. Une analyse complète demanderait au moins un volume. Je ne puis que renvoyer, une fois de plus, le lecteur s’y intéressant, au livre de P. Archinoff : Histoire du mouvement makhnoviste. S’il ne l’a pas encore lu, il y trouvera un excellent exposé du mouvement, suffisamment complet. Si, au contraire, il l’a lu, il a une idée exacte des événements.
Ayant pris part personnellement, pendant quelques mois, à ce mouvement, je tiens à formuler ici certaines appréciations et conclusions que j’en ai tirées et que je considère comme importantes pour tout lecteur cherchant à se faire une idée, autant que possible juste et nette, des différentes phases et des divers aspects de la Révolution russe. Et je m’y bornerai.
Le mouvement makhnoviste fut un élan révolutionnaire sublime de vastes masses laborieuses – ouvrières et paysannes –, lesquelles, sous l’influence, d’une part, des événements ukrainiens très particuliers, et, d’autre part, de l’idéologie anarchiste propagée dans le pays par des camarades actifs (surtout par ceux de la Confédération du « Nabat ») et représentée par plusieurs guides du mouvement lui-même (dont Nestor Makhno fut le plus influent), menèrent une lutte désintéressée, héroïque et inégale pour la vraie révolution sociale intégrale, anti étatiste et antiautoritaire, contre toutes les forces qui lui étaient opposées, donc aussi contre les bolcheviques, jusqu’à l’épuisement complet.
Les constatations les plus importantes qu’on peut tirer de cette épopée extraordinaire sont les suivantes :
-
L’idée anarchiste n’est ni une utopie ou une fantaisie, ni un idéal trop lointain, inaccessible aux masses actuelles, réalisable à peine dans des centaines d’années. Quand les circonstances favorables sont là, quand les masses laborieuses ont la possibilité de faire elles-mêmes leur révolution, et quand leur activité libre et consciente est éclairée, secourue, librement guidée par l’idée anarchiste, cette dernière leur devient vite familière et chère. Elles saisissent facilement et rapidement sa profonde vérité ainsi que son essence concrète. Et alors, l’idée s’incarne en un beau mouvement réel, animé d’un élan sublime, capable de toutes les réalisations les plus audacieuses. Ainsi, sous certaines conditions données, les aspirations anarchistes deviennent normalement, naturellement, activité concrète des masses laborieuses.
-
Lorsque les masses accomplissent elles-mêmes leur révolution, elles sont parfaitement capables de résoudre tous ses problèmes, de surmonter toutes ses difficultés et de la mener à bon port. Ni les « difficultés sans nombre », ni les obstacles les plus ardus, ni même l’ « entourage capitaliste », avec ses blocus et ses menaces, ne sont pas bien redoutables pour elles. Il n’y a, alors, qu’une seule force qui peut les écraser : c’est la force brutale des armes. Mais cette force ne prouve rien. Et puis, les masses en vraie révolution vendent cher leur liberté. Et, enfin, face à une vraie révolution, la force armée est une épée à deux tranchants.
-
Pour faire leur vraie révolution, les masses n’ont aucun besoin de partis politiques, d’élites gouvernantes ou dirigeantes, etc. Par rapport à tous ceux qui possèdent de l’instruction, des connaissances techniques, économiques, sociales ou autres, de la culture intellectuelle, des aptitudes spéciales, etc., les masses laborieuses n’ont besoin que de leur aide libre, bénévole, désintéressée. Ce ne sont pas les « élites », mais les millions d’hommes qui, avec leurs intelligences, leurs connaissances, leurs aptitudes et leurs activités variées, fécondes et combinées, sont seuls à même de mener à bien la révolution sociale. Les « élites » n’ont qu’à les aider, et non pas à les gouverner.
-
Faisant leur vraie révolution, les masses laborieuses se débarrassent sans aucune difficulté, et sans aucune contrainte, de tous les préjugés : nationaux, religieux ou autres. Ce n’est pas la contrainte gouvernementale qui tue ces préjugés, mais le libre élan et le succès de la vraie révolution faite par les masses elles-mêmes.
De même que le bolchevisme a pleinement confirmé le côté critique, négatif, de la doctrine anarchiste, l’épopée makhnoviste confirma ses côtés positifs et constructifs.
On a souvent reproché au mouvement makhnoviste sa spontanéité exagérée, le manque de cohésion et, surtout, l’absence, dans son sein, d’une organisation ouvrière syndicale. Il n’y a pas de doute que si le mouvement avait eu le temps et la possibilité matérielle de s’appuyer sur une vaste organisation syndicale révolutionnaire, il aurait gagné beaucoup en ampleur, en profondeur et en vigueur. J’ai déjà dit plus haut que l’absence d’organismes ouvriers expérimentés fut, à mon avis, l’une des raisons de la non-réussite de l’idée anarchiste dans la Révolution russe.
L’existence très agitée du mouvement makhnoviste, les déplacements perpétuels de ses forces vitales, et, enfin, sa courte durée l’empêchèrent de s’occuper de près du problème syndical. D’ailleurs, le mouvement avait, incontestablement et naturellement, ses côtés faibles. Mais, en comparaison avec sa base saine et solide, ces défauts n’avaient pas une importance capitale. Et c’est pourquoi nous ne nous y arrêtons pas ici. L’analyse de ces défauts, très instructive sans aucun doute, devrait avoir sa place dans un ouvrage spécial.
Au lecteur qui voudrait faire une connaissance plus approfondie du mouvement makhnoviste, nous pouvons recommander encore les mémoires de Nestor Makhno lui-même, qu’il a récemment commencés (Mémoires et écrits – 1917–1932, éd. Ivrea, 2010).
Peut-on considérer la Révolution russe de 1917 comme terminée en tant que révolution ? Autrement dit, sa période constructive a-t-elle effectivement commencé, et son avenir, peut-il être conçu comme une évolution logique et positive des fondements jetés aujourd’hui ?
À cette question, je réponds par un non catégorique. Tout ce qui précède explique déjà cette réponse. Mais je voudrais insister, ici, sur deux points d’une importance primordiale :
-
On ne peut pas concevoir la Révolution russe (je parle toujours de la révolution de 1917) comme un événement isolé nationalement ou historiquement. Il est certain qu’elle fait partie d’un immense processus social d’envergure mondiale, quoi vient de commencer et dont elle est, pour ainsi dire, l’introduction. Elle est donc étroitement liée aux événements mondiaux. Elle exerce sur eux une certaine influence. À son tour, son avenir dépend beaucoup de ce qui se passera dans d’autres pays. Or, depuis quelque temps déjà, j’ai la conviction ferme que le monde actuel est entré dans l’époque de la grande et vraie révolution sociale, et qu’il se trouve aujourd’hui au début de la période destructive de cet immense processus. Au cours de cette période, toute la société actuelle, avec tout ce qu’elle porte en elle – économie, politique, régime social, « culture » moderne, mœurs, préjugés, etc. –, doit être détruite de fond en comble, sans quoi la construction de la société nouvelle sera impossible. Une des premières « choses à détruire » est le principe – plutôt le préjugé – politique, autoritaire, étatiste. Pour que ce principe soit détruit, la révolution sociale est historiquement obligée de passer par l’expérience concrète, c’est-à-dire par la tentative de vaincre, d’arriver à la construction nouvelle, au moyen d’un État, d’un parti politique, d’une autorité, d’une dictature. Sans cette expérience négative, l’humanité ne comprendra pas le vrai chemin. Le bolchevisme – étape de la révolution russe et de la révolution mondiale – représente cette expérience négative. Le moyen étatiste et autoritaire l’a acculé à une impasse dont il ne peut plus sortir. Si une expérience pareille s’était produite en pleine évolution florissante du capitalisme mondial, elle aurait abouti certainement à la restauration du régime bourgeois, à une contre-révolution victorieuse. Mais – et c’est là une des preuves de l’agonie du capitalisme et du caractère social-révolutionnaire de notre époque – le capitalisme en déclin est impuissant à produire en Russie la « marche en arrière ». Alors, la Russie « attend ». Maintenue, par la force des armes, dans sa terrible impasse, impuissante à faire le moindre mouvement, soit en arrière, soit en avant, elle attend : d’une part, que les événements mondiaux fassent un grand bond et, par répercussion, la « débloquent », et, d’autre part, que le monde, en faisant ce bond, prenne bonne note de l’erreur fondamentale de la Révolution russe, de son « expérience négative ».
En attendant, cette révolution, à son stade bolchevique actuel, ne peut pas créer, ne peut pas construire. Pour commencer à construire, elle doit être « débloquée » ; elle doit, ensuite, détruire le régime actuel comme un nouvel obstacle – de même qu’elle a détruit les régimes précédents –, donc, elle doit continuer en tant que révolution. Telle est une des raisons de mon « non » catégorique. Deux réserves importantes : il va de soi que, les événements mondiaux pouvant traîner en longueur ou se développer, pour assez longtemps, dans un sens ne touchant pas la Révolution russe, celle-ci pourrait arriver à briser elle-même son obstacle. Et il va de soi, également, que, dans n’importe quel cas, le « déblocage » pourrait produire, momentanément, une réaction « en arrière » en Russie. Vu le sens général de l’époque, ceci ne changerait en rien ni mes appréciations générales, ni l’évolution définitive des événements. Une telle réaction ne serait qu’un épisode passager de la période destructive de l’immense processus social-révolutionnaire, au même titre que le fascisme, l’hitlérisme, etc.
-
Quels sont les fondements sur lesquels le bolchevisme prétend pouvoir dorénavant « construire » ? Il y en a deux : la fameuse « industrialisation » du pays, et la soi-disant « collectivisation » de l’agriculture. La tâche entière devra être accomplie par des étapes régulières de 5 ans, chaque étape étant fixée d’avance par un plan spécial dit « quinquennal ». L’ensemble de ces « plans quinquennaux » est l’expression même de la prétendue « économie dirigée ». Il serait important d’analyser tout cet édifice dictatorial en détail, dans un ouvrage spécial, afin de démontrer nettement sa non-valeur. Ici, je ne puis que souligner l’appréciation donnée plus haut.
L’industrialisation d’un pays ne peut être productive que si elle provient d’une croissance générale naturelle, si elle se trouve en harmonie avec l’ensemble de la vie économique, et si, par conséquent, ses effets et ses résultats peuvent être utilement assimilés, « digérés » par la population. Dans le cas contraire, elle aboutit à des érections, peut-être impressionnantes, mais mortes, inutiles et inutilisables, semblables à ces grandes pyramides d’Égypte érigées par les pharaons. On peut ériger tout ce qu’on veut, lorsqu’on dispose de certains moyens, et surtout d’une main-d’œuvre asservie, maniable à volonté et payable par l’État-patron comme bon lui semble. Le problème ne consiste cependant pas à avoir des érections, mécaniques ou autres, mais à pouvoir en tirer profit. Or, j’affirme catégoriquement, m’appuyant sur des données précises et incontestables, que l’ « industrialisation » bolchevique en Russie aboutit précisément, dans l’écrasante majorité des cas, à toutes sortes de mécanismes, d’installations et de constructions mortes, inutiles et inutilisables. J’affirme que les 80 % de toutes ces érections restent sans vie, ne fonctionnent pas du tout ou fonctionnent très mal. J’affirme que les milliers de machines importées de l’étranger sont, pour la plupart, rapidement mises hors de service, abandonnées, perdues. J’affirme que la main-d’œuvre actuelle en Russie ne sait pas les manier, les utiliser et qu’enfin, la population n’en tire aucun profit.
L’ « industrialisation » en U.R.S.S. n’est pas une prouesse, n’est pas une « réalisation » de « l’État socialiste ». Elle est une entreprise de l’État-patron obligé, après la faillite des méthodes du « communisme de guerre » et, ensuite, de la NEP, de jouer sa dernière carte : bercer ses propres sujets, et aussi les gogos à l’étranger, par la grandeur illusoire de ses projets, dans l’espoir de pouvoir ainsi se maintenir jusqu’aux « temps meilleurs »... L’ « industrialisation » de l’U.R.S.S. n’est qu’un bluff, rien de plus.
La « collectivisation » ? Pour que le lecteur puisse saisir son vrai sens, disons en quelques mots quelle a été, exactement, la « politique paysanne » de la dictature bolchevique, depuis les débuts jusqu’à nos jours.
Comme le lecteur sait, les paysans commencèrent à s’emparer des biens fonciers, en en chassant les propriétaires, déjà avant la Révolution d’Octobre. Le gouvernement bolchevique n’eut qu’à sanctionner cet état de choses. Au début, il ne toucha pas aux paysans, et c’est pour cette raison encore que ceux-ci le soutinrent, lui laissant ainsi le temps nécessaire à consolider son État et son pouvoir. À cette époque, on disait même, surtout à l’étranger, que les paysans gagneraient le plus à la révolution, et que les bolcheviques seraient obligés de s’appuyer, plus tard, sur eux. Cependant, au fur et à mesure que l’État s’affermissait et que, d’autre part, les villes, leurs provisions épuisées, tournaient leurs regards vers la campagne, Lénine resserrait de plus en plus le cercle autour des paysans. Par une série de décrets, il somma ces derniers de remettre la plus grosse partie de leurs récoltes à l’État. Ce fut la période des réquisitions, d’impôts en nature, d’expéditions armées et du « communisme de guerre ». Bientôt, cette « politique » aboutit à des troubles sérieux. Apeuré, Lénine recula et proclama la NEP, qui permettait aux paysans de vendre leurs produits, au lieu de les voir enlevés. Mais, la NEP n’ayant tout de même pas servi à grand chose, Staline dut choisir entre deux solutions : soit élargir la NEP, c’est-à-dire marcher vers la restauration économique et politique du capitalisme privé, soit supprimer la NEP et reprendre l’offensive de l’État contre les paysans. Après avoir tout pesé, sûr de la force et de la sécurité définitive du nouvel État capitaliste, Staline prit cette dernière décision. Il entreprit l’étatisation définitive de l’agriculture, appelée sa « collectivisation ». Les « sovkhoz » (« économies soviétiques » exploitées directement par l’État) et les « kolkhoz » (« économies collectives » exploitées en commun par des paysans) devinrent tous des entreprises directes de l’État. L’État se mit à écraser, à anéantir le paysan resté propriétaire, même moyen ou petit. Par la force de la terreur et des armes, il rentra en possession effective et complète de tout le sol et transforma le paysan, non seulement en son fermier, mais en son serf. Ensuite, il groupa ces serfs en « collectivités » et les obligea à travailler pour lui. La majorité écrasante de la population paysanne se trouve aujourd’hui dans cet état de servage. Et, naturellement, une lutte à outrance, encore sourde, mais déjà effective, des paysans contre leurs nouveaux maîtres, est entamée. Il est certain que les bolcheviques maintiendront leur « politique paysanne » actuelle de plus en plus difficilement. Depuis quelque temps, ils sont déjà de nouveau obligés de recourir largement à la force militaire pour forcer les paysans à se soumettre, à ne pas « saboter », à travailler, à ne pas cacher le blé, etc.
Eh bien ! Nous affirmons qu’une telle « collectivisation » n’est nullement la vraie solution sociale du problème agraire. Nous affirmons que le paysan ne sera gagné à la cause de la révolution sociale que par des moyens n’ayant rien de commun avec ce retour au servage moyenâgeux, retour qui remplace seulement le maître féodal par le maître État.
La « collectivisation » bolchevique est loin d’être une « réalisation » socialiste. Elle est un système de violence inutile, un mécanisme sans âme, sans progrès, sans avenir.
Peut-on « construire » quoi que ce soit sur de telles bases ? Certainement non. Et les résultats du premier « plan quinquennal » le prouvent. En effet, me basant sur des données nettes, sur des faits et sur des chiffres précis, j’affirme que ce plan a fait une faillite lamentable, complète, et qu’aujourd’hui le gouvernement bolchevique se trouve devant la situation la plus tragique qu’il eût jamais à affronter. L’ « industrialisation » n’a abouti à aucun résultat appréciable. La « collectivisation » n’a amené qu’un accroissement de la misère et le retour d’une famine dont l’étendue et la gravité dépassent de beaucoup celles de 1924–1925. Le pays se débat dans une agonie épouvantable. Le pouvoir bolchevique ne se maintient qu’à l’aide d’une terreur policière, d’une tromperie, d’une démagogie inouïes, et d’une violence armée sans précédent. La dictature est acculée à un état de siège, entourée par une population épuisée, écrasée, désarmée, impuissante, mais hostile, prête à se soulever, à se révolter, à bondir sur ses oppresseurs à la moindre possibilité matérielle.
Dans ces conditions, parler d’une révolution terminée, d’une période constructive commencée, et d’une évolution positive des « fondements acquis », ce serait ne rien comprendre – ou plutôt ne rien vouloir comprendre – dans ce qui se passe en Russie actuelle.
CONCLUSIONS.
Ayant déjà tiré de nombreuses conclusions au cours même de mon exposé, je me bornerai ici à les compléter par quelques dernières réflexions qui me paraissent indispensables.
-
Tous ceux qui se demandent comment un pareil régime peut encore tenir ne doivent pas oublier que, outre les raisons que j’ai déjà exposées, il en existe une très importante que voici : le Parti bolchevique compte aujourd’hui environ un million de membres et de sympathisants, qui forment, dans le pays, une couche – on pourrait même dire une classe – privilégiée. L’écrasante majorité de ces hommes sont jeunes, ignorants (donc, faciles à manier), brutaux, fiers, avides et jaloux de leur situation privilégiée, pleins de mépris pour les masses subjuguées et exploitées ; bref, ce sont de véritables « parvenus » et profiteurs du capitalisme étatiste. S’appuyant sur toute la force réunie de l’appareil politique, économique, militaire, policier, technique, scientifique et « moral » (presse, etc.) qui se trouve entièrement entre leurs mains, profitant de l’épuisement et de l’état désorganisé des masses laborieuses, ces nouveaux maîtres pourront se maintenir au pouvoir assez longtemps (à moins de quelque choc brusque dont notre époque est si riche), jusqu’au jour où, d’une part, la « force » de l’ « appareil » tombera trop bas et, d’autre part, la puissance des masses remontera. On raconte qu’au début du bolchevisme, Trotski aurait répondu à quelqu’un qui exprimait des doutes sur la longévité du régime : « 300 000 nobles ont maintenu ce peuple en obéissance, pendant trois siècles ; pourquoi donc 300 000 bolcheviques ne pourraient-ils faire autant ? ». Ce petit colloque n’est, peut-être, qu’une légende. Mais cette légende exprime quelque chose de très concret. D’ailleurs, Mussolini et, tout dernièrement, Hitler l’ont suffisamment prouvé. Les grèves et les révoltes sont assez fréquentes en U.R.S.S. Elles sont impitoyablement réprimées, et le gouvernement n’en souffle pas mot.
-
Ceux qui excusent – et même justifient – le bolchevisme en raison des difficultés qu’il eut à surmonter, et surtout en raison de l’ « entourage capitaliste », ne doivent pas oublier que : a) justement en Russie – vu son étendue, ses richesses immenses, la faiblesse de sa bourgeoisie, etc. –, une vraie révolution, complète, belle, facilement triomphante et humanitaire, était possible malgré l’entourage capitaliste, qui, à notre époque, n’y pourrait rien ; et b) que la carence de la Révolution russe devant cet entourage capitaliste est imputable au bolchevisme lui-même.
-
Le bolchevisme n’est qu’un égarement, une erreur, une étape négative (donc, à surmonter) dans la Révolution russe et aussi dans le développement de la révolution mondiale. Il a sa place historique dans la période destructive et négative – et non pas créatrice et positive – de cette dernière. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le préciser, il y a quelques années (Choses vécues, dans la Revue anarchiste des années 1922–1924), un point important de cette période est la destruction totale de tout ce qui forme, dans la lutte décisive entre le vieux et le nouveau monde, le milieu modéré, vacillant, mou et vague (destruction du socialisme modéré) ; un autre point important est la destruction du principe politique, étatiste, dictatorial dans la révolution sociale (destruction du bolchevisme, après son expérience négative vécue). La révolution sociale ne pourra trouver son vrai chemin qu’après avoir fait table rase aussi bien du socialisme que du bolchevisme, après avoir renoncé à l’un comme à l’autre. C’est en partie le fascisme qui, historiquement, s’en charge et prépare le terrain... non pas au bolchevisme, comme d’aucuns le pensent, mais, en fin de compte, à la vraie révolution sociale. Car le fascisme contribuera puissamment à la destruction définitive du principe étatiste et dictatorial, en dépit de ses aspirations opposées. Et si le bolchevisme – c’est-à-dire le communisme autoritaire – le remplace (ce qui est possible), l’avènement de ce dernier ne sera pas, non plus, décisif ni même durable : ce sera, tout simplement, une expérience négative de plus.
-
Nous pouvons rassembler et résumer ici, en deux mots, quelques déductions de détail parsemées le long de cet exposé :
-
Ce n’est ni une « élite », ni un parti politique, ce ne sont pas Lénine ou Trotski qui ont fait la révolution (interprétation de tous les autoritaires : bourgeois, socialistes et « communistes » qui, psychologiquement, ne peuvent pas concevoir les choses d’une autre façon), mais les vastes masses armées du peuple laborieux des villes et de la campagne. Le Parti bolchevique sut en profiter pour monter an pouvoir ;
-
Après avoir commencé la révolution, les masses ont commis l’erreur fondamentale de confier ses destinées à un Parti politique, à un gouvernement, à une dictature. Cette dictature a temporairement faussé les révolutions russe et mondiale ;
-
Ce ne sont pas les « élites », les « führers » (guides), les partis, les dictateurs qui sauront mener et mèneront la révolution sociale à bon port, mais les millions d’hommes – les masses « océaniques » – acculés à la faire et à savoir la faire, par la marche historique des choses. La « légende de l’élite » devra être et sera détruite au cours de cette révolution ;
-
Les masses sont acculées à la révolution par la destruction et l’expérience historique. La destruction et l’expérience sont aussi les premières éducatrices des masses. Deux conditions doivent s’y ajouter pour que la révolution puisse prendre le bon chemin et passer à la vraie construction : l’existence d’un mouvement ouvrier révolutionnaire indépendant des partis politiques, et une intense propagande libertaire. L’absence totale de celui-là et l’insuffisance de celle-ci furent la raison principale de la non-réussite de l’idée anarchiste et de la « victoire » du bolchevisme dans la Révolution russe ;
-
Le véritable rôle des « élites » est d’aider les masses, de les éclairer, de les enseigner, d’agir dans leur sein, de leur donner l’exemple, mais non pas de les gouverner ;
-
La dictature est toujours la violence publique d’une personne, violence soutenue par une couche privilégiée et fatalement dirigée contre les masses subjuguées et exploitées ;
-
Au cours de la vraie révolution, les masses savent se débarrasser facilement, et sans contrainte, de tous les préjugés inhérents à la société actuelle.
-
-
La dernière conclusion qui se dégage des faits étudiés, la plus importante, la plus féconde et encourageante, est celle-ci : pour beaucoup de gens, le vrai sens de notre époque est la lutte décisive – la « lutte finale » – entre le capitalisme (acculé à son dernier rempart : le fascisme) et le bolchevisme (qui, pour ces gens, représente la vraie révolution et l’émancipation). C’est une erreur. Le sens historique profond de notre temps sera d’avoir posé et résolu d’une façon concrète cette question fondamentale : peut-on vaincre le capitalisme, accomplir la révolution sociale et supprimer l’exploitation des masses à l’aide d’un groupe d’hommes – ou d’un homme – qui mènera ces millions d’humains au moyen de la violence politique ? Ou, au contraire, sont-ce ces millions d’humains eux-mêmes qui, par leur action libre et librement coordonnée, pourront seuls atteindre le but ? Qui fera la révolution sociale ? Une élite, un dictateur bolchevique qui tirera « par les cheveux » les masses forcées de lui obéir ? Ou bien les masses libres, conscientes de leur tâche et agissant à l’aide de leurs organisations librement créées ?
Le vrai sens de notre époque n’est pas la lutte entre le capitalisme, d’une part, et le bolchevisme, d’autre part, mais la lutte entre le capitalisme sous toutes ses formes (le « socialisme » autoritaire, ou « bolchevisme », en est une) et le socialisme libre, antiautoritaire.
Le véritable problème de notre époque n’est pas celui d’un choix entre la dictature blanche et la dictature rouge, mais celui d’un choix entre la dictature et la liberté comme levier de la révolution sociale. Et le véritable sens de la Révolution russe est d’avoir posé concrètement, définitivement, et dans toute sa grandeur, ce problème fondamental qui, ainsi, sera résolu pour les masses d’une façon expérimentale.
Je ne doute pas un instant qu’il sera résolu, par les événements qui vont suivre, dans le sens de la liberté.
La destruction continuelle, fatale, catastrophique, acculera les masses à la révolution sociale. L’expérience durable, présente, de la Révolution russe leur permettra d’éviter, en temps opportun, l’erreur bolchevique. Elles ne voudront plus édifier un nouvel État, une nouvelle autorité, un nouveau gouvernement, sur les ruines de l’État capitaliste détruit. Alors, commencera la période vraiment constructive de la révolution sociale, dans l’ambiance d’une liberté d’action des masses laborieuses librement organisées et soutenues dans cette action par les vastes masses tout entières et par les individus. Et c’est alors que sera hautement, mondialement, concrètement et triomphalement confirmée et reconnue l’idée anarchiste. (Lire sur la révolution sociale l’ouvrage connu de Pierre Besnard : Les syndicats ouvriers et la révolution sociale.)
Tout en se rattachant à l’étude de la Révolution russe (d’ailleurs, inséparable de la révolution sociale mondiale), ces conclusions complètent dans une certaine mesure, en l’illustrant et en le concrétisant, l’intéressant aperçu général sur la révolution sociale par Sébastien Faure (voir plus haut).
— VOLINE.
BIBLIOGRAPHIE. — Au cours de mon étude, j’ai déjà cité quelques ouvrages à lire. Naturellement, ce n’est pas suffisant. Toutefois, pour le moment, je ne saurais recommander au lecteur aucune œuvre sur la Révolution russe, digne du sujet. Je lui conseille donc de lire tout ce qu’il pourra trouver, à condition, bien entendu, que le livre et l’auteur soient sérieux. Le sujet est extrêmement vaste et presque inexploré. Chaque ouvrage contiendra donc des faits intéressants et inconnus, et aussi des grains de vérité, sans aucun doute. Mais alors, encore une condition s’impose : celle d’apporter à la lecture de chaque ouvrage assez de sens critique. À cette condition, le lecteur saura, je l’espère, lui-même dégager les choses vraies, les faits définitivement acquis, des affirmations douteuses. Il saura aussi, dans la mesure du possible, formuler quelques déductions et conclusions. S’il continue ses lectures au fur et à mesure de la publication de nouveaux ouvrages, il pourra constamment comparer et contrôler aussi bien les faits que les appréciations.
À titre d’exemples, je dirai quelques mots sur deux ouvrages assez connus, notamment :
-
Les œuvres de Trotski. — Il faut les lire avec une très grande circonspection. En effet, extrêmement subjectives et partiales, pleines de polémiques, de haines et de rancunes, traitant les faits à travers une doctrine préconçue, passant sous silence certaines choses, défigurant certaines autres, ces œuvres ne méritent pas une grande confiance. Mais, en sa qualité d’un des acteurs principaux de l’épopée gouvernementale bolchevique, l’auteur fournit sur certains événements une documentation exceptionnellement intéressante, souvent inédite.
-
L’An I de la Révolution russe, par Victor Serge. — Ce livre n’est pas mauvais. Il contient beaucoup de faits exacts. Mais, en même temps, il a été écrit assez nonchalamment. Séjournant depuis longtemps en Russie, connaissant la langue, ayant été en relation, non seulement avec presque tous les bolcheviques éminents, mais aussi avec des anarchistes, lui-même ancien anarchiste (aujourd’hui trotskiste en disgrâce et déporté), l’auteur puise, néanmoins, sa documentation uniquement aux sources bolcheviques. Il ne s’est même pas donné la peine de contrôler cette documentation intéressée, partiale, souvent mensongère, de vérifier certains faits à d’autres sources. En résultat, à côté des informations et des appréciations exactes, son œuvre contient beaucoup d’erreurs, d’inexactitudes, d’omissions, et même d’interprétations complètement fausses. Naturellement, ceci diminue de beaucoup sa valeur. La lecture de cet ouvrage exige aussi la plus grande circonspection.
— V.
RHÉTORIQUE
n. f. et adj.
La rhétorique, dit l’Académie, est « l’art de bien dire ». Elle est la théorie de l’éloquence comme la grammaire est la théorie du langage.
« Tant que l’homme sait peu, il parle nécessairement beaucoup ; moins il raisonne, plus il chante ; et quand il n’a rien à dire, il amuse l’oreille par son joli babil », a dit Proudhon. L’éloquence – qui est naturelle à l’homme comme la parole, le chant et le babil – étant l’art de plaire, émouvoir ou convaincre par le discours, la rhétorique, ou art oratoire, donne les règles pour plaire, émouvoir ou convaincre par la parole, mais surtout par le « joli babil ». Comme la grammaire est née après le langage, quand il a fallu rendre celui-ci compréhensible et commun à des populations nombreuses, la rhétorique est née après l’éloquence, pour mettre en elle un ordre déduit de ses formes naturelles les plus propres à toucher l’esprit humain.
L’étude de la rhétorique est à la fois celle des discours conservés et tenus comme des modèles d’éloquence, et celle des règles que l’on a tirées de ces discours. Ce sont les Grecs qui ont découvert et formulé la rhétorique. Jusqu’à eux, chez les autres peuples, plus anciens ou leurs contemporains, l’éloquence avait été une force de la nature plus qu’un art, s’épanchant parfois avec une puissance torrentielle dans les livres sacrés orientaux comme la Bible, où les plus belles pages sont plus souvent des imprécations d’une inspiration fougueuse que de la rhétorique.
Les discours des orateurs grecs, puis romains, et les règles qu’on en a tirées pour les formuler dans des traités, sont demeurés à la base de l’enseignement classique de la rhétorique à travers les siècles. Comme au temps où Quintilien enseignait à l’école de Rome les fils des patriciens, c’est à l’ombre auguste et vénérable de Démosthène et de Cicéron que les jeunes bourgeois d’aujourd’hui « font leur rhétorique » dans les lycées de la Troisième République. La Rhétorique d’Aristote, les De Oratore et L’Oratore de Cicéron, L’institution oratoire de Quintilien sont demeurés la loi et les prophètes de cet enseignement essentiellement scolastique, conformiste et conservateur, comme le droit romain est resté le fondement de toutes les institutions, malgré tous les bouleversements politiques et sociaux qui se sont produits depuis vingt siècles. Un tel enseignement est peut-être encore très utile pour favoriser la charlatanerie philosophique, religieuse, littéraire, politique, et pour faire des histrions habiles à se pousser dans le monde de l’arrivisme ; il n’est plus que « l’art d’apprendre à écrire sans don naturel », comme a dit R. de Gourmont, et aussi de parler sans ce don. Il est incapable de faire un véritable orateur possédant l’éloquence du cœur et de la conscience, comme il est incapable de produire un penseur sincère et un grand écrivain. La rhétorique n’en distingue pas moins aujourd’hui cinq genres d’éloquences : la politique, la militaire, la religieuse, la judiciaire et l’académique. C’est dire qu’elle continue à être l’instrument de séduction des notions sociales conventionnellement établies.
Dans les temps appelés « aristocratiques », la rhétorique n’atteint guère la foule ; elle est réservée à des « élites » pour qui les « déclamateurs fleuris », comme disait Fénelon, enveloppent les lieux communs dans les papillotes de la préciosité. Le bon sens populaire pense, s’il ne dit, avec La Fontaine :
Hors de saison et qui n’ont pas de fin. »
Mais il ne s’en laisse pas moins prendre aux déclamations grossières d’une éloquence qui le flatte pour le tromper et le dominer. Quand R. de Gourmont déplorait que des jeunes gens perdissent leur temps à l’étude de la rhétorique, parce qu’elle est « une des plus grandes niaiseries qui aient abusé les hommes », il ne pensait pas au but des prétendues élites et de leurs gouvernements qui est de rendre les hommes toujours plus niais. « Quand on sait rouler une métaphore, on peut bien rouler les imbéciles », remarquait Flaubert ; et, bien avant Shakespeare, les tyrans savaient qu’après leurs coups de force « ils trouvent toujours assez de bavards pour prouver qu’ils ont bien fait ». La grande malice de la rhétorique est de flatter ceux qu’elle veut séduire, or, comme l’a dit A. Suarès : « Flatter un peuple ou une assemblée, c’est mentir. De là, qu’on pense d’autant moins, en général, qu’on parle mieux. » Mentir est, par-dessus tout, l’art de la rhétorique, pour persuader en enrobant le mensonge dans les séductions de la parole, de façon à faire croire qu’il est la vérité. Elle est ainsi l’art de déraisonner au point de faire croire à une chose « parce qu’elle est absurde » : Credo quia absurdum !... Elle est la lanterne magique qui montre toutes les merveilles du monde, à condition qu’on ne l’éclaire pas. Les sages qui la font marcher sont :
Sont d’un style pompeux et toujours admirable,
Mais que l’on n’entend point... » (FLORIAN)
Il n’y a que les dindons qui croient entendre quelque chose ; et, malheureusement, ils sont innombrables, les dindons, ils sont le « peuple souverain », ils sont la « majorité compacte » !
La première rhétorique académique et classique a été la traduction en belles phrases, en mots historiques – qui fourniraient la pâture à cinq cents générations de cuistres et feraient se pavaner des milliers de pédants –, des vociférations et des injures plutôt ordurières que s’étaient lancées à la tête les héros d’Homère. C’était de la populace hellénique qu’étaient sortis ces héros, et ils n’avaient parlé le langage des dieux que lorsque les traducteurs d’Homère les avaient frisés et pommadés. Hérodote, dans ses Histoires, fleurit de la sorte les discours des personnages qui fournirent de plus en plus à l’éloquence politique à partir du Ve siècle avant J.-C. Les Thémistocle, Aristide, Périclès, Démosthène brillèrent dans cette éloquence jusqu’au jour où Athènes perdit la liberté. Les orateurs devinrent alors les rhéteurs des temps de tyrannie et de fausse liberté, les temps des Alexandre, des Auguste, des Louis XIV, des Napoléon et des Soulouque des démocraties contemporaines.
Le rhéteur fut d’abord celui qui enseigna la rhétorique. Il prit la place de l’orateur quand l’éloquence ne fut plus libre de s’exprimer et dut cacher ses chaînes sous la déclamation. Aussi, dès l’Antiquité, le nom de rhéteur prit-il un sens péjoratif pour désigner un orateur ou un écrivain emphatique, dont l’art ne consistait que dans un alignement habile de phrases destinées à masquer une pensée vide, confuse ou fausse. Stendhal ne comprenait rien à l’art des rhéteurs lorsqu’il disait : « Ce n’est pas le tout de faire de jolies phrases, il faut avoir quelque chose à mettre dedans. » Aussi Stendhal resta-t-il toujours incompris et dédaigné des faiseurs de festons et d’astragales qui brodent sur les nuages et font de la profession des gens de lettres celle des plus vains et des plus vaniteux farceurs. Vanus et vanitas, disait Michelet. Il y eut, certes, des rhéteurs qui firent de la rhétorique une science remarquable et respectable : Isocrate, Isée, maître de Démosthène, Eschine, rival de ce dernier, Aristote, le plus grand de tous, firent la gloire de la rhétorique à Athènes. Rome eut Quintilien, et l’on vit, au IIe siècle, Plutarque et Lucien. Mais le plus grand nombre des rhéteurs formèrent alors, et depuis, une espèce trop souvent malfaisante et irresponsable. Ce sont eux, entre autres, qui introduisirent dans l’histoire ce « plutarquisme », dont le nom vient de Plutarque, mais qui n’eut chez lui que des intentions pures, alors que ses successeurs en firent le plus maléfique usage. (Voir Plutarquisme.)
De plus en plus, en constatant combien l’éloquence séduisait les hommes et les entraînait au point de leur faire perdre le contrôle de leur pensée et de leurs actes, on avait fait de la rhétorique l’art de mentir et de tromper. De plus en plus, elle servit de moyen de gouvernement et de domination. Dans toutes les sociétés, quand les orateurs, les poètes et les savants ont répandu parmi les hommes les notions claires et précises des connaissances du temps, les rhéteurs, bavards insanes, pitres et faux savants, viennent pour troubler et obscurcir ces notions, pour soutenir que le blanc est noir, en même temps qu’il n’est ni blanc ni noir, pour semer la confusion au point que, même en se tâtant bien, les gens ne sont plus sûrs qu’ils existent. Les rhéteurs conduisent ainsi les sociétés qui s’abandonnent à eux au gâtisme et à la décomposition où elles s’écroulent généralement.
Les rhéteurs ont été de tout temps des gens qui ont réussi, aussi bien auprès des prétendues « élites », dont ils sont les fleurons, que des « foules stupides ». Ils possèdent plus que quiconque « l’art de traire les hommes », comme disait Molière. Grands et petits, riches et pauvres n’ont cessé de leur payer tribut. Ils furent appelés de bonne heure – et s’appelèrent eux-mêmes – sophistes, c’est-à-dire hommes habiles à discuter ; mais ils étaient surtout des « charlatans de l’esprit » (Voltaire), soutenant de faux raisonnements avec l’intention de tromper, et enseignant, moyennant finance, l’art de composer sur n’importe quel sujet, aussi capables de démontrer le faux que le vrai, de les faire passer l’un pour l’autre, et niant d’ailleurs toute différence entre la vérité et l’erreur. C’est par les rhéteurs que :
« La philosophie donne le moyen de parler vraisemblablement de toutes choses et de se faire admirer des moins savants. » (Descartes)
Par eux, le même moyen est donné à toutes les sciences, même les plus exactes. Il y a des sophistes capables de soutenir éternellement que deux et deux ne font pas quatre, comme M. Poincaré est capable d’écrire encore vingt volumes pour affirmer que « la mobilisation n’est pas la guerre », même quand elle fait dix millions de morts !
Dans l’Antiquité, le succès des sophistes fut immense. Plus que les véritables orateurs, ils entraînaient les foules ; car, sachant défendre avec un égal talent toutes les opinions, ils étaient certains d’être d’accord avec tout le monde. Ils n’avaient pas à redouter la ciguë que but Socrate et le poignard qui frappa Cicéron. Ils pullulèrent durant la décadence athénienne qu’ils précipitèrent. Ils connurent une fortune incroyable lorsque, passant d’Athènes à Rome, ils vinrent apprendre le beau langage et la corruption civilisée aux patriciens en les décrassant de leur rusticité. Ils firent tant que Caton les fit bannir de Rome, mais ils y revinrent comme des rats, et Crassus chercha vainement à réagir contre l’enseignement d’une ignorance et d’une oisiveté élégantes qu’ils répandaient parmi les classes riches. Il y avait déjà, en ce temps-là, un snobisme qui entretenait la sottise aux dépens de l’esprit et de la raison. Cantonné d’abord dans l’enseignement, le rhéteur se mêla de plus en plus de politique. Il s’imposa dans la tragédie antique où le chœur – vox populi – fut toujours de l’avis du dernier qui avait parlé. Rome vit la domination du tribun qui faisait ou défaisait la République à coups de gueule, en attendant de faire et de défaire les empereurs.
Les temps des décadences grecque et romaine avaient produit les rhéteurs philosophes et religieux, les sophistes coupeurs de fil en quatre, abstracteurs de quintessence, chevaucheurs de chimères qui se multiplièrent avec la sorcellerie chrétienne durant tout le Moyen Âge. Quand le christianisme primitif eut cessé de s’exprimer par la rude et magnifique voix de Jérôme et des premiers pères, il descendit peu à peu de leur éloquence, par les différents degrés de la rhétorique des Salvien, Hilaire de Poitiers, Ausone, Sidoine Apollinaire, Vincent de Lérins et nombre d’autres « fanatiques de mauvaise rhétorique » (Ph. Chasles), à la métaphysique théologique et scolastique, qui ne fut plus que l’effrontée justification des turpitudes ecclésiastiques. On ressuscita la méthode hébraïque du Bœuf sur le toit, des « pilpouls », des « débats dans l’irréel, des interminables discussions dans la chimère » (Couchoud). La rhétorique était alors passée chez les Gaulois. Ils furent toujours de remarquables bavards. Marseille était devenue l’Athènes des Gaules après la conquête par Jules César, et les jeunes Romains venaient apprendre des rhéteurs de son école l’art des controversia et des suasoria. Quand la magnifique littérature du Moyen Âge eut tari ses sources populaires, elle tomba dans les niaiseries savantes et prétentieuses des « rhétoriqueurs » qui justifieraient la réforme de Malherbe.
Au XVIe siècle, la rhétorique théocratique inaugura, contre l’esprit de la Renaissance, les grands mensonges des temps modernes : guerre chrétienne, droit des gens chrétien, modération chrétienne, etc., dont Michelet a dit :
« Toutes ces locutions doucereuses ont été biffées de nos langues par le sac de Rome, de Tunis et d’Anvers, par Pizarre et Cortès, par la traite des Noirs, l’extermination des Indiens. »
Elles se sont retrouvées depuis 1789 dans la rhétorique démocratique qui a dit : guerre du droit, droits de l’homme, Liberté, Égalité, Fraternité, etc., locutions non moins doucereuses qui se trouvent elles aussi biffées des langues européennes par un siècle de démagogie politicienne, de brigandage colonial, de violations du droit des gens aboutissant à la guerre de 1914. La même imposture qui faisait parler un Bossuet « au nom de Dieu », quand il encourageait Louis XIV au massacre et à la proscription des hérétiques, a fait parler les Poincaré, les Guillaume, les Nicolas, les François-Joseph « au nom de leurs peuples » pour justifier leur crime de 1914.
Le temps de la Renaissance multiplia le type du rhéteur savantissime qui deviendrait l’académicien, et celui du rhéteur de carrefour qui exciterait les foules aux guerres de religion et aux assassinats pieux. La rhétorique des jésuites fabriqua alors la théorie du tyrannicide, qu’ils mirent hypocritement sous le couvert de la défense de la liberté. Ce fut une résurrection éphémère, mais sauvage, d’éloquence populacière qui dura jusqu’à la fin de la Fronde. Les tribuns populaires, muselés par le pouvoir royal, se réfugièrent alors au « théâtre de la foire », d’où ils étaient d’ailleurs sortis pour devenir « marmitons des jésuites » et confesseurs des rois.
Ils en ressortiraient quand la Révolution leur permettrait de ré-emboucher leur trompette et de faire régner la rhétorique politicienne qui submergerait le monde. Les rhéteurs académiques, bavards solennels mais consciences défaillantes, qui affecteraient de la mépriser, n’en feraient pas moins leur moyen de fortune auprès des « altesses » de la démocratie, en abandonnant les hauteurs sereines de la science pour descendre dans « la foire sur la place », et en laissant choir leur grande rhétorique de l’empyrée de la pensée dans les bas-fonds électoraux. On a vu ainsi, de nos jours, « le plus grand philosophe de notre époque » se faire le préfacier de M. Viviani et, dans le même temps, « les plus hautes consciences académiques » alimenter l’infecte prose du « bourrage de crâne ». La sottise sorbonique qui a dit :
« La France a spiritualisé la matière, l’Allemagne a matérialisé l’esprit. »
Et la tartuferie académique qui a opposé, avec des mouvements de menton, la « gentillesse française » à la « barbarie allemande », ne sont pas moins insanes que les cochonneries pieuses et patriotiques des bardes poussifs préposés à l’héroïsme des beuglants.
La rhétorique religieuse que le Moyen Âge avait noyée dans la vaseuse métaphysique canonique et réservée à l’usage des gens d’église, devint mondaine à partir du XVIe siècle et prit les formes de l’académisme et du « bon goût », formes artistiques de l’hypocrisie de ceux qui commencèrent alors à s’appeler les « honnêtes gens ». Cela se fit sous la direction des jésuites qui se mirent à abrutir les cerveaux pour mieux dominer les corps, à faire de l’homme une marionnette sans âme, « un cadavre qui tombe si on ne le soutient » (Loyola). Aussi, la rhétorique religieuse demeura-t-elle plus que jamais « la suivante de la théologie et de la morale évangélique », comme disait Bossuet, sauf quelques éclairs d’humanité et de vraie morale, qu’on trouve dans Massillon, et particulièrement dans Fénelon. Elle servit aux Bossuet à « enchâsser des pierres fausses dans de l’or » (Voltaire).
Au XVIIIe siècle, la société brillante s’écrasait aux séances des Sorboniques, dont l’origine venait d’un cordelier qui avait entrepris de :
« Soutenir la discussion contre tout venant et sur toutes sortes de sujets, depuis huit heures du matin jusqu’à huit heures du soir. » (Bachaumont)
Ces champions rhétoriciens ne prenaient même pas le temps de manger et de boire ; leurs auditeurs allaient se réconforter pour eux pendant qu’ils péroraient. Et ils ne se bornaient pas à soutenir la discussion sur toutes sortes de sujets ; ils défendaient aussi le pour et le contre. « L’inconnu », dans Une Nuit au Luxembourg de R. de Gourmont, dit :
« Tu sauras que j’aurais pu te dire tout le contraire, et que cela aurait été aussi la vérité. »
Car :
« Il semble que les hommes ne donnent aux mots un sens précis que pour avoir le plaisir de les employer à contresens. »
C’est le plaisir et la malice des casuistes, le but de leur rhétorique.
La rhétorique judiciaire et académique ne fut pas moins conventionnelle que la religieuse au XVIIe siècle. L’éloquence de Patru s’évertua vainement dans la cage du conformisme du temps. Les Fléchier étalaient leurs pompeuses et vides périodes pour glorifier ses turpitudes et donner la vie à son néant. Boileau a raillé « cette belle rhétorique moderne inconnue aux anciens », qui permet de dire « ce qu’il ne faut point dire ». Pourtant, les anciens connaissaient déjà cette « équivoque » par laquelle :
Et qui fait pratiquer :
Il y avait longtemps qu’on savait :
Sans blesser la justice, assassiner un homme. (Boileau, id.)
Mais jamais l’on n’avait vu une si pieuse hypocrisie, et Boileau, après Molière, flétrissait avec raison le siècle de Tartufe, ce siècle des « honnêtes gens » qui avaient commencé par brûler la Léda de Michel Ange, qui mettaient un cache-sexe aux statues, recouvraient d’un mouchoir les seins de Dorine et vengeaient ainsi contre l’art et la nature la saleté de leurs mœurs.
Quand la démagogie eut ouvert ses bondes, la rhétorique politicienne trouva immédiatement son maître et son modèle dans M. de Talleyrand. En sa double qualité de grand seigneur et de grand fripon, il lui donna une telle séduction et une telle souplesse, il présenta ses mensonges et ses palinodies avec de telles apparences de vérité et de sincérité, que les bavards subséquents n’auraient plus rien à inventer comme moyens de duperie durant le siècle d’éloquence parlementaire qui irait de l’aigre flûte de M. Thiers, son digne élève, au ronflant violoncelle de M. Briand. Il ne resterait plus aux astrologues de la démocratie que d’« éteindre les étoiles » (M. Viviani) et de leur faire remorquer « le char de la France éternelle » (M. Boncour). M. de Talleyrand apprit aux démocrates ce qu’il avait appris des aristocrates : comment « la parole a été donnée à l’homme pour déguiser sa pensée », et comment on peut « vivre de la bêtise humaine ». Louis Blanc a constaté que ce fut là « tout le génie » de M. de Talleyrand. Ce fut aussi tout le génie des politiciens qui lui succédèrent, avec beaucoup moins de savoir-vivre et d’élégance.
À côté des politiciens, il y a les rhéteurs philosophes, écrivains, artistes, qui tirent sans fin sur la guimauve conformiste et forment le bataillon des « intellectuels consolateurs », comme les appelle Gorki, de l’indécrottable sottise bourgeoise. Mais :
« Leur art, l’art du beau mensonge, leur art par excellence, n’a plus le pouvoir ni la force de cacher le cynisme malpropre de la réalité bourgeoise. » (Gorki)
L’idéalisme hypocrite dont ils parent leur rhétorique ne peut plus donner le change sur le grossier matérialisme de cette réalité. Les uns et les autres, les maîtres affairistes et les larbins intellectuels, ne sont plus que des ventres et des bas-ventres ; ils n’ont plus de cerveaux.
La sottise bourgeoise, expression d’une classe « condamnée à mort et qui le mérite entièrement, comme le mérite un bandit ou un assassin professionnel » (Gorki), a mis politiquement, depuis trente ans, sa suprême espérance dans la rhétorique « jaurésiste », dernière sophistication démocratique qu’il est nécessaire de démasquer à l’usage des prolétaires encore confiants dans le verbiage politicien. C’est une page d’histoire qui n’est pas assez connue.
La rhétorique jaurésiste est née de l’affaire Dreyfus. Elle est l’explication de la faillite socialiste, dernier épisode de la banqueroute républicaine ; car, après elle, il n’y a plus de choix qu’entre deux solutions – la dictature ou la révolution. L’opportunisme gambettiste avait commencé la banqueroute en livrant la République à la réaction sociale. Les radicaux l’avaient continuée. Ayant pris la place des gambettistes dégonflés comme revendicateurs de la République, ils avaient suivi la même voie qu’eux lorsque leur chef, M. Bourgeois, était entré dans le ministère Ribot, en 1893, entraînant son parti à liquider, « entre camarades », le scandale du Panama. Un coup d’éponge magistral laissa impunies les voleries panamistes et permit à leurs auteurs, par la solidarité politicienne, de demeurer au pouvoir et aux affaires parmi les parangons de la vertu civique ! C’est dans ces conditions particulièrement immorales que la République opportuniste et radicale, nantie d’un si fâcheux concordat, continua. Mais il restait le parti socialiste, le parti de l’Internationale ouvrière, le parti de la pureté politique, pour nettoyer les écuries d’Augias, balayer le régime qui n’avait plus de républicain que son titre, et dont les profiteurs étaient cyniquement statufiés sur les places publiques.
Lorsque l’affaire Dreyfus éclata, la voix puissante de Jaurès fit se lever les socialistes avec tous les « défenseurs de la justice ». L’heure était venue d’en finir avec une réaction et une corruption maintenues par des républicains défaillants. L’insolence des prétoriens et du Gesù était arrivée à son comble ; leur audace, encouragée par l’impunité, ne reculait même pas devant le faux et l’assassinat. L’affaire Dreyfus ne limitait pas sa portée aux réparations dues au déporté de l’île du Diable, citoyen quelconque victime d’une forfaiture comme il en était tant ; elle était un symbole, elle portait en elle toutes les revendications de la Vérité et de la Justice contre l’iniquité sociale, elle était la Révolution...
Ce fut alors au tour des socialistes de sauver la réaction. Waldeck-Rousseau, « syndic de faillite de l’affaire Dreyfus » (Rosa Luxembourg), présida à l’opération, comme Ribot avait présidé à celle du Panama. Millerand lui apporta le concours socialiste, comme Bourgeois avait apporté à Ribot le concours radical. Après des années de lutte, alors que la forfaiture était démasquée, que les faussaires, cloués au pilori de l’opinion, étaient près du châtiment, que tout l’édifice de boue et de honte de l’iniquité allait s’effondrer pour faire place à un monde nouveau, ce fut, le 19 décembre 1899, un nouveau coup d’éponge sur le crime, la loi d’amnistie graciant tout le monde, innocents et coupables, enlevant aux premiers les réparations qui leur étaient dues, soustrayant les seconds au châtiment qu’ils méritaient, bâillonnant une fois de plus la vérité, bafouant la justice, et signant une nouvelle capitulation républicaine devant les malfaiteurs triomphants ! Depuis, le parti socialiste a « vomi » Millerand, il a vomi aussi tous les renégats de son espèce ; trop tard, le coup était fait. Millerand avait pu accomplir son œuvre criminelle ; il put la poursuivre jusqu’aux cours martiales de 1914–1918, et d’autres ont continué. Les socialistes continuent aussi, qui refusent, disent-ils, de « participer » au gouvernement, mais qui y collaborent et qui collaboreront même à la dictature, quand la bourgeoisie leur en offrira la direction contre la Révolution qu’ils ont reniée.
Comment cela a-t-il été possible ? Oh ! Il n’est pas nécessaire de beaucoup de développements pour montrer l’œuvre de ce que nous appelons la « rhétorique jaurésiste » et en faire comprendre le mécanisme. Elle est sommaire et elle est nette, malgré toute la blagologie répandue après, pour la justifier quand tout était accompli, comme dans l’Évangile et dans l’éternelle histoire des peuples mystifiés.
Après les préliminaires des premiers défenseurs qui avaient dénoncé la forfaiture et indiqué les voies de la vérité, Jaurès s’était lancé dans l’affaire Dreyfus. Par sa prestigieuse influence, il l’avait imposée à son parti comme une cause sociale dont dépendait tout l’avenir du prolétariat et de la civilisation. Elle était à ses yeux « une des plus grandes batailles du siècle, une des plus grandes de l’histoire humaine » (Petite République, 12 août 1899). Il avait dit à la classe ouvrière hésitante que si elle ne se levait pas pour cette lutte, ce serait :
« La pire abdication et la pire humiliation, la négation même du grand devoir de classe du prolétariat. » (Petite République, 15 juillet 1899.)
Dans le même article, il avait ajouté, pour les guesdistes méfiants :
« Nous voulons toute la vérité !... Nous continuons la lutte, et si les juges de Rennes, abusés par les manœuvres ignobles de la réaction, devaient encore sacrifier l’innocent pour sauver les chefs militaires criminels, demain encore, malgré les manifestes d’excommunication, malgré les soi-disant appels à la falsification, à l’amoindrissement, à la déformation de la lutte de classe, nous nous lèverons de nouveau, malgré tous les dangers, pour crier aux généraux et aux juges : vous êtes des bourreaux et des criminels ! »
Jaurès avait écrit encore, pendant le procès de Rennes :
« Quoi qu’il en soit, la justice approche ! L’heure de la délivrance approche pour le martyr, l’heure du châtiment approche pour les criminels ! » (Petite République, 13 août 1899.)
Et ceci :
« Je jure que Dreyfus est innocent, que l’innocent sera réhabilité, que les criminels seront punis. » (9 août 1899.)
Il avait enfin déclaré à Lille, en novembre 1899, un mois à peine avant la loi d’amnistie :
« Pour moi, j’ai voulu continuer, j’ai voulu persévérer jusqu’à ce que la bête venimeuse ait été obligée de dégorger son venin. Oui, il fallait poursuivre tous les faussaires, tous les menteurs, tous les bourreaux, tous les traîtres ; il fallait les poursuivre à la pointe de la vérité comme à la pointe du glaive, jusqu’à ce qu’ils aient été obligés, à la face du monde entier, de confesser leurs crimes, l’ignominie de leurs crimes. »
Affirmations énergiques, engagements solennels. Ils entraînaient les socialistes, les prolétaires, tous les hommes de vérité et de justice, « intellectuels » et « manuels », internationale de la pensée et Internationale ouvrière, à la véritable lutte de classe, la véritable lutte finale d’où sortirait un monde régénéré.
Qu’arriva-t-il ? La « bête venimeuse » ne dégorgea pas son venin ; les faussaires, les menteurs, les bourreaux et les traîtres ne confessèrent nullement leurs crimes. Ils continuèrent, aussi insolents, si bien qu’aujourd’hui même, et dans les lycées de l’État, il y a encore des professeurs qui peuvent enseigner impunément aux jeunes Français que « Dreyfus fut un traître » et qu’il fut défendu par le « syndicat de la trahison » !
M. Millerand étant devenu ministre, à côté du général Gallifet, chourineur de la Commune, ce fut le vote de la loi d’amnistie, grâce au concours des socialistes. Et voici alors ce que la rhétorique jaurésiste produisit, un an à peine après la déclaration de Lille : il fallait « se débarrasser des procès ennuyeux et maintenant inutiles, pour éviter la satiété du public qui bientôt se fermerait à la vérité elle-même » (Petite République, 18 décembre 1900).
Rosa Luxembourg a écrit à ce sujet :
« Encore un pas en avant, et les anciens héros de l’affaire Dreyfus apparaîtront comme des fantômes importuns dont on ne saurait se débarrasser assez vite. »
Le pas fut vite fait. Dès le 24 décembre 1900, la Petite République exécutait Zola qui protestait contre l’amnistie. Il y avait « assez de lumière » ! Zola devait se taire.
« Surtout, pas de plaintes, pas de répétitions ! »
L’affaire Dreyfus n’était plus qu’un « cas individuel », de même que celle de Picquart. « Dans notre aspiration vers la justice (sic), nous ne pouvons nous borner à des cas individuels », écrivait Gérault-Richard, faisant écho à Jaurès (Petite République, 30 décembre 1900). La justice, ce n’était plus la vérité « qui était en marche et que rien n’arrêterait » ; ce n’était plus la lutte de classe, la Révolution ; c’était maintenant la « défense républicaine » à la sauce opportuniste ! On en arriva à plaindre les bourreaux : Esterhazy errant « déguenillé et affamé », Boisdeffre « enfui » de l’état-major, Gonse « se traînant abattu », de Pellieux « mort en disgrâce », Henry qui avait dû « se trancher la gorge », du Paty de Clam « hors de service ». Pour un peu, on les aurait tous réhabilités avec Mercier devenu sénateur... La « défense républicaine », c’est-à-dire la défense de la politicaillerie tarée qui déshonorait la République, était seule à considérer, comme elle l’avait été par l’opportunisme après le 16 mai et par le radicalisme après le Panama.
Nous ne pouvons nous étendre davantage, mais on trouvera dans l’ouvrage de Rosa Luxembourg, Réforme et Révolution, l’exposé aussi complet que démonstratif des événements par lesquels la rhétorique jaurésiste a soutenu le millerandisme et réduit le socialisme à l’impuissance révolutionnaire. La suite n’a fait que confirmer et renforcer les conclusions que Rosa Luxembourg a tirées, il y a trente ans, dans ces termes :
« Ainsi, la tactique de Jaurès, qui voulait atteindre des résultats pratiques en sacrifiant l’attitude d’opposition, s’est montrée la moins pratique du monde. Au lieu d’accroître l’influence socialiste sur le gouvernement et le parlement bourgeois, elle a fait des socialistes l’instrument sans volonté du Gouvernement et l’appendice passif de la petite bourgeoisie radicale. Au lieu de donner une nouvelle impulsion à la politique avancée à la Chambre, elle a laissé perdre, avec l’opposition des socialistes, le stimulant qui seul eût pu amener le Parlement à une politique décisive et courageuse. »
De plus en plus, les socialistes se sont enfoncés dans le marécage opportuniste. (Voir Politique.)
Le « dégonflage » socialiste dans l’affaire Dreyfus s’est complété alors de la conspiration du silence organisée contre ceux qui ne voulaient pas d’une amnistie déshonorante pour eux et pour la justice. Dans sa magnifique préface aux recueils d’écrits de Bernard Lazare, Le Fumier de Job, Charles Péguy a montré le processus de cette conspiration. C’est en vain que Bernard Lazare, Zola, Gohier, Dreyfus lui-même protestèrent. On vit se fonder l’Humanité avec l’argent des grands juifs, des « fermiers généraux de l’estomac national », comme dit aujourd’hui M. Moro-Giafferi, des « ventres dorés » engraissés de la misère publique. L’un d’eux, qui est devenu pendant et après la guerre le dictateur du blé et du pain cher, paya ainsi son élection « socialiste », que fit faire Jaurès, dans une circonscription cévenole ! La condition essentielle que les grands juifs mirent à leur apport au « journal du prolétariat » fut que les Bernard Lazare n’y écriraient pas !... Ces messieurs en avaient assez de « se battre pour la justice ». Ils préféraient s’entendre avec les faussaires, les « trublions », les « traîneurs de sabre » et les évêques qui béniraient leurs chiens, en attendant de les bénir eux-mêmes entre deux pogromes de misérables juifs. Et les choses continuèrent comme devant pour la vérité et la justice une fois de plus bafouées, pour les prolétaires une fois de plus bernés.
C’est à cette rhétorique jaurésiste qu’on dut ensuite les sinistres farces de la « démocratisation de l’armée » et de la « réforme des conseils de guerre », devenus « tribunaux militaires ». Ces conseils font plus de victimes que jamais, depuis leur suppression et celle de « Biribi », dans les colonnes des journaux de la « défense républicaine ». Les singes qui montrent la lanterne magique aux « dindons souverains » ont baptisé carpe-Painlevé la poularde-Millerand : la « double-bouche » de Lebon s’est changée en « poucettes humanitaires », et le tour a été joué. Les échos les plus douloureux peuvent venir de la terre d’Afrique ; personne ne les entend plus, puisqu’on vous dit qu’il n’y a plus de Biribi... C’est encore à cette rhétorique qu’on doit une autre farce non moins sinistre, celle du « statut des congrégations », donnant aujourd’hui à Tartufe et à Flamidien toute sécurité pour ré-encapuciner et re-moraliser le pays, sous l’édifiante protection des politiciens laïques qui vont à la messe et envoient leurs enfants dans les écoles pieuses. On a vu les plus farouches libres-penseurs aller « du diable à dieu », et des « vengeurs de Ferrer » promettre de défendre les mystères de la Vierge en recevant les insignes de l’Immaculée Conception des mains des assassins de Ferrer.
Jaurès paya cruellement les conséquences de sa rhétorique quand il fut assassiné par ceux qu’elle avait amnistiés, quinze ans auparavant. Son parti n’a pas pour cela cessé l’œuvre de capitulation opportuniste. Il l’a continuée durant la guerre de 1914 et il la continue encore plus énergiquement depuis, au nom de l’Internationale ouvrière dont il est de plus en plus séparé, comme le parti radical la continue au nom des « petits bourgeois », des « petites gens » qu’il abandonne à tous les escrocs des scandales capitalistes. Il les livre même, comme dernière ressource, depuis qu’il les a fait ratisser par les banquiers dans la récente conversion de la rente, aux consolations spirituelles que M. Bergson, le grand philosophe du régime, fait tomber sur leurs têtes des hauteur sorboniques, en disant :
« Le corps de l’homme agrandi par la science attend un supplément d’âme… »
Sans doute pour remplacer le « supplément » qu’il ne peut plus s’offrir au restaurant.
En marge des partis politiques, la Ligue des droits de l’homme, fondée à l’occasion de l’affaire Dreyfus pour la défense de la liberté et de la justice, est devenue totalement impuissante devant le flot d’iniquité, devant toutes les nouvelles affaires Dreyfus dont les dossiers font craquer ses cartons. Envahie elle aussi par les rhéteurs opportunistes et comptant parmi ses dirigeants tant d’hommes dont l’action publique est de faire échec à ses principes et à son œuvre, que peut aujourd’hui cette Ligue ?
La rhétorique démocratique, particulièrement l’actuelle, a hérité de l’Ancien Régime le goût de cette équivoque que flétrissait Boileau. Elle invente tous les jours des mots nouveaux pour qu’on ne comprenne rien à ce qu’elle veut ou ne veut pas dire. (Voir Langue, Néologisme.) Elle a fabriqué entre autre une rhétorique prolétarienne dans laquelle il est impossible de se reconnaître si l’on n’est pas un endormeur du prolétariat. Parmi les produits les plus récents de l’équivoque ainsi entretenue pour la confusion des esprits, on trouve des élucubrations comme celles-ci : « le chômage technologique » qui tend à démontrer que les causes du chômage sont dans la machine elle-même et non dans le mauvais usage, l’usage antisocial qu’en font ses possédants ; les « avantages dispensiels » pour prouver aux gens qu’ils sont d’heureux mortels quand on les dépouille, au nom de la « défense républicaine », au profit des banquiers ; les « pactes initialés », merveilles diplomatiques qui permettent de dire qu’entre deux nations un traité existe quand il n’existe pas et qu’il n’existe pas quand il existe, etc.
Proudhon constatait : « En fait de manifeste démocratique comme de programme ministériel et de discours de la couronne, l’essentiel est de parler et de ne rien dire. » On continue dans la démocratie opportuniste radicale-socialiste, comme au temps de Rome, en attendant de se réveiller un jour sous la botte d’un César.
À la rhétorique se rattachent tous les mots dérivés de logos (discours) : logographie (moyen d’écrire aussi vite qu’on parle), logogriphe (énigme, chose ou discours inintelligible), logomachie (querelle de mots), logophile (bavard), logotechnie (science des mots). et enfin... « logo diarrhée » ou logorrhée, qui indiquent l’incontinence verbale, un flux de paroles vides de sens ; c’est la véritable maladie des politiciens. Presque tous ces mots ont un sens péjoratif déduit de l’usage, le plus souvent malfaisant, de la rhétorique.
À la rhétorique, « art de bien dire », préférons l’art de bien taire... et de laisser dire. Le véritable orateur, celui qui fait un bon usage de la rhétorique, est celui qui agit bien en traduisant ses paroles en actions. Le rhéteur qui « finit par croire que la parole est le fait, et croit avoir agi quand il a fini de dire » (A. Suarès), n’est qu’un insane bavard. Il est comme le cheval dont Jules Renard a dit, dans ses Histoires naturelles : « Il pète, pète, pète. » Or, ce n’est pas de pétarades que le monde a besoin, c’est de raison, de conscience et de volonté agissante.
— Edouard ROTHEN.
RITUALISME
n. m. (du radical rit ou rite)
En un sens général, on englobe sous le nom de ritualisme tout ce qui concerne les rites, c’est-à-dire les formes et l’ordre prescrits dans les cérémonies religieuses ou même dans une cérémonie quelconque. C’est ainsi qu’on parlera de ritualisme brahmanique, catholique, maçonnique. En un sens très spécial, ce terme désigne un mouvement religieux qui se développa dans le royaume britannique vers le milieu du XIXème siècle et qui constitue l’extrême droite de l’anglicanisme.
Le goût des rites était fort vif chez les anciens. En Egypte, non seulement d’innombrables prescriptions réglaient les moindres détails du culte, mais dans la vie de chaque individu tout était prévu et fixé d’avance, de la naissance à la mort. Malgré sa toute-puissance, le pharaon lui-même subissait la tyrannie d’un cérémonial rigoureux, d’une étiquette minutieuse qui, du lever au coucher, commandait tous ses actes. Audiences, promenades, bains, accouplement sexuel devaient se faire à heure fixe. Toute autre viande que celles du veau et de l’oie lui était interdite ; pour le vin, il était parcimonieusement rationné.
Au Japon, avant 1868, le mikado était soumis aux prescriptions d’un cérémonial aussi abrutissant que pompeux. Jamais ses pieds augustes ne devaient toucher la terre nue ; c’eût été un crime abominable de lui couper la barbe et les cheveux ; il s’abstenait de manger deux fois dans le même service. Successivement et en grande pompe, il épousait douze femmes de haute naissance ; toutefois, il pouvait, de plus, entasser un nombre indéfini de concubines dans le harem impérial. Le feu, qui ne respecte rien, ayant pris au palais en 1788, le mikado fut obligé de courir et, accident non moins grave, de manger pendant deux jours, du riz qui n’avait pas été trié grain à grain ; ce fait fut consigné dans les annales de l’empire comme la plus terrible des catastrophes. Cinq fois par an, ce dieu terrestre donnait des audiences dans la troisième enceinte de son palais ; les nobles s’y rendaient pieds nus, suivis d’un serviteur qui portait leurs chaussures. Le siogoun, qui jouissait d’un prestige presque égal à celui de l’empereur, était contraint pareillement de respecter des habitudes périmées. C’est dans la seconde moitié du XIXème siècle seulement que le Japon s’est modernisé.
Dans l’Inde, le ritualisme brahmanique, souvent odieux ou cruel, s’impose obligatoirement, même aujourd’hui. Mais le pays par excellence des rites, ce fut l’ancienne Chine. Le Li-Ki, ou Livre des Rites, est l’un des cinq livres sacrés de cet immense pays. Il semble fort ancien et remonterait, croit-on, a la troisième dynastie, Tcheou. Un ministère spécial fut chargé de veiller à la stricte application des rites consacrés par l’usage ou la loi. Tout était soumis à des règles invariables, figé dans une immobilité contre nature. A Pékin, les habitants ne pouvaient sortir de leurs demeures avant 5 heures 12 minutes, le matin, ni après 9 heures 12 minutes, le soir. Construction des maisons, type des voitures, forme des vêtements, etc., étaient fixés administrativement. Si les menus détails de la vie privée n’échappaient pas à l’empire de la coutume, les grandes manifestations officielles, les cérémonies religieuses, les examens littéraires, l’étiquette de la maison impériale faisaient l’objet d’innombrables et intangibles prescriptions. Tel était l’attachement des Chinois pour les rites nationaux et le culte des ancêtres que les missionnaires Jésuites, fidèles à l’exemple donné par le Père Ricci, cherchèrent, au XVIIème siècle, non à les discréditer, mais à les concilier avec l’enseignement et les usages catholiques. Une adaptation du même genre fut tentée avec le brahmanisme, sur les côtes du Malabar, par les disciples d’Ignace de Loyola. Il fallut les condamnations expresses des papes Innocent X en 1645, Clément XI en 1715 et Benoit XIV en 1742, pour que les Jésuites d’Extrême-Orient, après avoir usé de tous les échappatoires possibles, se résignent à défendre aux chrétiens de pratiquer les rites chinois ou de rester fidèles aux coutumes du Malabar.
A l’instar du paganisme romain, formaliste et routinier, le catholicisme, son imitateur et son héritier, témoigna de bonne heure d’un goût marqué pour les cérémonies pompeuses et les rites compliqués. Pour célébrer la messe, pour administrer les sacrements, pour présider les vêpres, etc., le prêtre s’affuble de robes et de manteaux hiératiques : sacristains, chantres qui l’entourent portent des jupes ; et les jeunes garçons qui le servent à l’autel, endossent, eux aussi, des vêtements féminins. A la manière de perroquets, les assistants répètent des formules et des prières, dont ils n’omettent pas une syllabe, mais dont le sens leur échappe parfois complètement. De même, leurs divers gestes sont fixés d’avance, et c’est de façon toute machinale qu’ils se lèvent, s’agenouillent, font des génuflexions et des signes de croix. Le concile de Trente déclara anathème quiconque se permettrait d’omettre ou de changer les rites adoptés par l’Eglise. Lorsqu’il promulgua le Missel romain, Paul V ordonna aux prêtres d’en suivre les prescriptions à la lettre, en célébrant la messe ; et Benoit XIII rendit obligatoire la fidélité aux règles contenues dans le Cérémonial des Evêques. A côté du rite latin, le catholicisme accorde une place à d’autres rites, celui des grecs-unis et celui des maronites par exemple. Au Vatican, la Congrégation des Rites s’occupe de tout ce qui concerne les cérémonies liturgiques, l’administration des sacrements, la canonisation des saints ; sa création remonte à Sixte-Quint ; elle est présidée par des cardinaux.
En matière de culte, l’Eglise orthodoxe s’avère non moins amie de la routine et de la complication que le catholicisme. Par contre, le protestantisme témoigne d’une répugnance, très accentuée dans certaines sectes, pour les rites impersonnels et les formules stéréotypées. Aux cérémonies grandioses, aux manifestations théâtrales, il préfère le culte en esprit et le recueillement intérieur.
Parce qu’ils se croyaient des demi-dieux, maints souverains ont voulu qu’on rende à leur personne un culte ayant ses rites invariables et ses formes consacrées. Un cérémonial rigoureux, l’étiquette, régnait à Versailles, sous Louis XIV. Devant le lit du roi, et devant le coffret qui contenait ses serviettes, les courtisans faisaient une révérence comme les fidèles devant le tabernacle. Au lever du souverain, les assistants étaient introduits par séries dans sa chambre à coucher. Les premiers le voyaient sortir du lit et l’aidaient à mettre sa robe de chambre ; les derniers pénétraient seulement lorsqu’il s’était frotté les doigts avec une serviette trempée dans l’alcool : c’était tout le débarbouillage de ce roi crasseux. C’est un prince du sang qui présentait au monarque la chemise de jour ; pour passer sa culotte et pour l’attacher, il fallait l’intervention du maître de la garde-robe. Quand il dinait seul, un huissier, un maitre d’hôtel et trois gardes du corps, carabine à l’épaule, escortaient chacun des plats qu’apportait un gentilhomme ; trois personnes intervenaient pour lui verser à boire. Les jours de grand couvert, le cérémonial était plus pompeux encore et une trentaine de larbins, dont un aumônier, et seize hommes en armes, entouraient le potentat. Monument de sottise et de vanité, ce ritualisme trouve encore des admirateurs parmi les historiens bien pensants. A Rome, la cour pontificale continue, même de nos jours, à exiger des fidèles admis à voir le pape qu’ils se prosternent devant ce souverain costumé en princesse, et qu’ils baisent sa pantoufle avec dévotion.
Si j’en crois ce que j’ai pu lire ou entendre, la question des rites aurait une grosse importance dans la franc-maçonnerie ; mais j’en parle en profane, n’ayant jamais visité une loge. Le Grand Orient de France possède un Grand Collège des Rites, dont les membres, tous parvenus au 33ème degré, se recrutent par cooptation. Cet organisme n’a pas de pouvoirs administratifs, mais il veille à l’octroi régulier des hauts grades et au maintien du symbolisme et des traditions maçonniques. A la Grande Loge de France, Oswald Wirth et quelques autres ont conservé très vif le goût et le souci des rites. En Belgique, Goblet dAlviella s’efforça d’imprimer un caractère mahométan, bouddhique, chrétien, mithriaque à certains degrés. Albert Pike, dont l’œuvre n’est pas traduite en français, s’est appliqué à mettre en valeur les grades écossais. Chez nous, les ouvrages de Ragon, de Bédarride, d’Oswald Wirth, de Plantagenet, peuvent donner une idée du ritualisme maçonnique. Rituel et symboles auraient pour but, disent leurs défenseurs, de transformer l’esprit de l’initié et d’y introduire les principes nouveaux dont il doit s’inspirer. Occultistes et mystiques leur attribuent en outre de secrètes et puissantes vertus. Mais d’autres préfèrent le travail rationaliste ; les cérémonies ésotériques ne leur inspirent pas confiance ; ils voudraient une maçonnerie modernisée, moins indulgente pour les religions, plus pénétrée de l’esprit scientifique.
Sans nous attarder davantage à l’énumération des ritualismes qui furent pratiqués autrefois ou qui le sont encore aujourd’hui, disons que le goût des cérémonies pompeuses nous apparaît comme une survivance d’un état d’esprit qui eut sa raison d’être aux époques de barbarie, mais qui ne répond plus aux exigences de cerveaux libérés des dogmes et des croyances traditionnelles. Les rites d’origine religieuse ou magique sont à rejeter irrévocablement ; nés du mensonge, ils ont pour unique résultat d’entretenir une maladive curiosité. Mais la poésie et l’utilité s’avèrent inspiratrices de gestes et de paroles symboliques qui s’apparentent à l’art ou aux manifestations d’une activité utile. Parfois la danse semble être très proche du rite ; et l’on doit reconnaître qu’en certaines circonstances, il est bon de pouvoir découvrir sur-le-champ ses amis. Source empoisonnée où s’alimente l’hypocrisie, la politesse, cet ensemble de rites stéréotypés, contribue cependant à rendre moins pénibles les rapports que l’on a, malgré soi, avec des gens peu sympathiques. S’en tenir aux légitimes satisfactions de l’art et aux réactions pratiques exigées par la nature ou les circonstances, voilà l’unique règle de notre comportement dans ce domaine si discuté. Les mots rites et ritualisme pourraient être biffés des dictionnaires modernes sans que nous protestions, leur origine religieuse les rendant impropres à désigner gestes et paroles qui restent dans le cadre des nécessités rationnelles ou des besoins esthétiques. Dédaigneuse des attitudes hiératiques, l’humanité doit repousser mystères et rites que lui légua la tradition.
Disons maintenant quelques mots du ritualisme anglais. En 1833, certains membres de l’Université d’Oxford : Pusey, Newmann, Palmer, Oakley, Ward, Keeble, Froude, tentèrent de faire adopter par l’Eglise anglicane un grand nombre de cérémonies et de dogmes que le protestantisme avait condamnés. Keeble donna le signal du mouvement dans un sermon prêché à Sainte-Marie d’Oxford. Une série de 90 traités ou tracts, publiés dans les années qui suivirent, firent connaître partout la doctrine tractarienne (c’était le nom qu’on lui donnait à cette époque).
Nous voulons, affirmait Newman, « contribuer au réveil pratique des doctrines professées par les théologiens de notre Eglise, mais devenues lettre morte pour la majorité de ses membres ». En parole, les nouveaux réformateurs protestaient de leur attachement pour l’Eglise anglicane ; en fait, ils se rapprochaient sensiblement du catholicisme romain. « Ce sont, disait d’eux Grégoire XVI, des papistes sans pape, des catholiques sans unité et des protestants sans liberté ». Les évêques anglicans condamnèrent cette tentative et interdirent la publication des tracts en 1841. Quatre ans plus tard, Newman se convertit au catholicisme ; il fut créé cardinal en 1879 par Léon XIII. Oakley, Palmer, Manning et d’autres entrèrent également dans l’Eglise romaine. Pusey refusa d’aller jusqu’au papisme et resta le chef de ceux qui ne voulaient pas se séparer de l’Eglise d’Angleterre ; jusqu’au concile du Vatican, il crut d’ailleurs qu’il était possible de s’entendre avec Rome. S’il répugnait personnellement à adopter certaines cérémonies catholiques, ses disciples n’eurent pas les mêmes scrupules. Ils admirent les sept sacrements, la confession auriculaire, la présence réelle et le sacrifice eucharistique, le culte de la Vierge ; ornements sacerdotaux, croix, cierges reparurent dans les oratoires. Le puseyisme se transformait finalement en ritualisme. Entre ces « papistes déguisés » et les gardiens de la tradition nationale une lutte assez âpre s’est poursuivie longtemps. En 1859, les premiers avaient fondé l’English Church Union, les seconds créèrent en 1865 la Church Association qui combattit les innovations en matière de culte. Parlement et tribunaux sont intervenus à plusieurs reprises contre le ritualisme, sans arrêter ses progrès ; sur bien des points, les hauts dignitaires de l’Eglise anglicane se sont rapprochés de lui. Mais les fidèles sont restés hostiles au papisme dans l’ensemble, et la Chambre des Communes a rejeté récemment un nouveau Livre de Prières, parce qu’il faisait trop de concessions au romanisme. L’opposition à la primauté du pape demeure d’ailleurs fort vive, même au sein du mouvement ritualiste.
— L. BARBEDETTE
RIZ
n. m.
Le riz est une graminée, dont la culture réclame une surveillance toujours en éveil et une longue serre d’opérations. Semé d’abord dans un espace restreint où il germe et lève, il doit être repiqué ensuite dans les rizières, par touffes distantes de 30 à 40 centimètres. Avant le repiquage, il faut niveler le sol, le border de petits talus qui servent de chaussées, le labourer et l’égaliser avec la herse ; après, il faut inonder la rizière et maintenir l’eau à la hauteur demandée par l’état de croissance, puis opérer le vidage quand les épis son formés. Plus tard, on moissonnera à la faucille et l’on procédera au décorticage du paddy, pour extraire le grain de son enveloppe. On sème le riz au printemps ; il ne germe que planté dans la boue ; et c’est pareillement dans la boue qu’il faut le repiquer. Pendant toute sa croissance, il doit rester dans une eau qui, sans être courante, peut néanmoins se renouveler. D’où la nécessité de préparer soigneusement le terrain à l’avance, s’il n’est pas naturellement horizontal. Certaines espèces, cultivées dans les régions difficilement inondées, réclament beaucoup moins d’eau. Pour mûrir, le riz exige en outre de très fortes chaleurs. Aussi prospère-t-il dans les pays chauds et humides de la zone intertropicale, surtout dans les deltas des grands fleuves, les basses plaines littorales et les vallées submersibles. Il atteint en moyenne une hauteur allant de 70 centimètres à 1 m. 80. On compte au moins 900 variétés de riz en Indochine et 500 à Madagascar. S’il en est qui conviennent aux terrains un peu secs, d’autres, comme le riz gluant, poussent en pleine eau et peuvent atteindre 6 ou 7 mètres de hauteur.
De Chine, où elle prit naissance probablement, la culture du riz passa aux Indes, puis en Egypte, et fut importée finalement en Europe par les Arabes. On la trouve installée en Italie dès le XVème siècle ; en France, elle fut d’abord expérimentée en Auvergne, mais on l’abandonna, parce qu’au dire des médecins d’alors, le riz engendrait des épidémies. Cette céréale qui, chez nous, n’est guère utilisée qu’à titre d’aliment complémentaire, constitue le pain des races jaunes. Ce serait la plante qui nourrirait le plus d’hommes, environ 900 millions sur 2 milliards que porte le globe, d’après l’Office international de l’Agriculture. Au Japon, chaque habitant consomme une moyenne de 150 kilogrammes de riz par habitant ; à Formose et au Siam, un peu plus de 120 kilogrammes ; alors qu’en Italie, le pays d’Europe où sa culture est la plus développée, la moyenne n’atteint que 7 kilogrammes. Dans l’Inde, le brahmanisme contribue à faire du riz un élément essentiel de l’alimentation, car il proscrit l’usage de la viande. En France, il fut, pendant la guerre, l’un des succédanés employés dans la boulangerie ; mais, comme il est vendu à des prix supérieurs à celui du blé, son utilisation est redevenue très faible par la suite. Si nous ne parlons pas de la Chine, le pays qui consomme le plus de riz, c’est que l’on ne possède à son sujet aucune statistique permettant de fournir d’intéressantes précisions. On sait néanmoins qu’elle importe, annuellement, quelque 600.000 tonnes de cette céréale, par Hong-Kong, et que sa production normale laisse celle de l’Inde loin derrière elle, probablement.
Parmi les principaux pays producteurs de riz, il faut citer, outre la Chine (qui le cultive dans toute sa partie méridionale, même sur les pentes des montagnes quand l’irrigation est possible), l’Inde, la Birmanie, le Siam, l’Indochine, le Japon. La côte orientale du Dekkan les deltas du Gange et du Brahmapoutre, ceux de l’Irraouaddi et de la Salouen, du Mékong et du Sang-Koï possèdent d’immenses rizières. Dans les vastes plaines du Yunnam, on fait jusqu’à trois récoltes par an. Au Japon, la production moyenne est de 104 millions de quintaux ; elle représente 60 p. 100 de la valeur totale des produits alimentaires agricoles. On trouve aussi des rizières à Java, dans les plateaux intérieurs et sur le littoral oriental de Madagascar, dans les vallées du Nil et du Niger, dans celles du Syr-Daria et de l’Amou-Daria ; en Lombardie où la production atteint 6.500.000 quintaux, en Espagne où elle s’élève à 3 millions de quintaux ; en Amérique où elle dépasse 8 millions de tonnes ; on en trouve même en Bulgarie, en Yougoslavie, au Portugal. Avec leurs 480 millions de quintaux annuels, les Indes anglaises éclipsent, et de très loin, tous les pays non asiatiques. Si la culture du riz exige beaucoup de travail, elle est, par contre, d’un excellent rapport. Le rendement moyen, évalué à 20 hectolitres à l’hectare pour l’ensemble du globe, est bien supérieur à celui du blé ; au Japon, il atteint 26 hectolitres. Mais, lorsque les pluies arrivent en retard ou sont insuffisantes, la récolte est parfois extrêmement déficitaire. D’où les effroyables famines qui sévissent, les années de sécheresse, dans certains pays d’Extrême-Orient.
Parce qu’il est, pour une large part, consommé sur place, dans les contrées mêmes qui le produisent, le riz n’est pas l’objet d’un trafic comparable à celui du blé. Au premier rang des régions exportatrices, il faut placer : la Cochinchine, le Tonkin et le Cambodge. La Cochinchine en expédie de 15 à 16 millions de quintaux chaque année ; le Cambodge en livre plus de 300.000 tonnes à Saigon pour l’exportation ; au Tonkin, l’un obtient, à l’heure actuelle, deux récoltes par an. Saigon, la capitale du riz, rivalise avec les ports français les plus renommés, par l’ampleur de ses opérations. « Pour bien juger de l’importance de l’Indochine de comme centre de production rizière, écrit Rondet-Saint, il faut, du haut de Cholon, à Saigon, longer le canal appelé arroyo-chinois. Sur des kilomètres, les gros chalands sont l’avant à terre, dans la vase, pressés les uns contre les autres. Combien y en a-t-il ? Des centaines et des centaines. Les magasins, les piles de sacs de riz s’alignent sur chaque rive à perte de vue, coupés ça et là par quelque grosse usine de décorticage ». Sous forme de paddy, de grains blancs, etc., Saigon aurait exporté plus de 1.600.000 tonnes de riz en dix mois, certaines années. La Birmanie est aussi un centre exportateur de toute première importance ; Rangoun expédie la précieuse céréale, non seulement en Europe, mais dans les principaux pays d’Extrême-Orient. A cause de la densité de la population, Chine, Japon, etc., produisent en effet moins de riz qu’ils n’en consomment.
D’ordinaire, un mange le riz cuit à l’eau et en grain. On petit aussi le manger ou le réduire en farine ou le mélanger avec d’autres aliments. Parce qu’il renferme peu de gluten, il est moins nourrissant que le blé, mais il est très digeste s’il est préparé de façon hygiénique et très régénérateur. Pris comme base de l’alimentation, on l’accuse de donner le béribéri. Ce reproche semble fondé ; il ne vaut toutefois que contre le riz décortiqué, n’ayant plus les cuticules qui renferment les vitamines. Sous prétexte de le rendre plus appétissant et d’une présentation plus agréable, on élimine un élément indispensable. S’il est presque impossible de se procurer du riz non décortiqué chez nous, la même difficulté n’existe d’ailleurs pas en Extrême-Orient. Fruits, légumes frais, viande crue contiennent, en outre, les vitamines dont l’organisme à besoin. Aussi le béribéri n’est-il pas à craindre en France, du moins par suite de la consommation du riz, cette dernière n’étant que de 2 grammes et demi, en moyenne, par tête et par jour ; en Indochine, par exemple, où elle dépasse 500 grammes, il en va tout autrement.
| Albumine | 7,75 |
| Graisse | 0,75 |
| Hydrate de carbone | 76,50 |
| Sel | 1,50 |
| Cellulose | 0,50 |
| Eau | 13 |
Avec cette céréale, on fabrique un alcool ou un vin qu’on appelle saké au Japon. En la mêlant à l’orge, on en fait une bière qui se conserve aussi facilement que la bière commune. On en tire aussi une poudre de toilette, dont les élégantes font une grande consommation ; en une seule année, l’Angleterre eut besoin de 170 tonnes de cette poudre pour blanchir la peau de ses beautés insulaires. Pour la consommation, le riz de la Caroline, riche en phosphate, est le meilleur, puis vient celui du Piémont. Suivant l’origine et l’espèce, la valeur de cette céréale diffère d’une façon sensible. A notre époque, où l’abus de la viande s’avère désastreux pour les races d’Occident, il convient de ne négliger aucune des ressources alimentaires offertes par le monde végétal. Des recettes culinaires, fruits d’une longue expérience ou de recherches effectuées par des hommes compétents, permettent, d’ailleurs, d’apporter une très grande variété dans la confection des plats de riz. Mais les hommes, qui explorent volontiers les nébuleuses régions d’un au-delà chimérique, ignorent tout, habituellement, des qualités requises pour que la nourriture soit hygiénique.
— L. BARBEDETTE
ROMAN
L’origine du mot roman est dans le latin Romani, nom donné d’abord aux habitants de Rome, puis à tous ceux qui parlèrent la langue latine dans l’Empire appelé la Romania ou le Romanum imperium, le monde romain. De ce latin romani sont dérivés, dans la première langue française qui se distingua du latin, les mots romans, au masculin, et romance, au féminin. Romans est devenu roman et, par analogie, romance a fait romane.
On appelle aujourd’hui romanes les langues qui sont nées de la corruption du latin. Leur domaine s’étend sur tout l’occident et une partie de l’orient en Europe ; ainsi qu’en Amérique, dans les pays d’ancienne colonisation française, espagnole et portugaise. Pour Littré, les langues romanes sont les idiomes issus du latin après la chute de l’empire romain. Une interprétation plus ou moins arbitraire a fait appeler romanes les langues parlées et écrites jusqu’à la fin du XIIIème siècle. L’étude des langues romanes est d’une importance considérable pour la connaissance de la formation du langage des différents peuples européens comme conséquence, pour celle de leur histoire et de leurs mœurs. Ces langues montrent le caractère et la persistance des éléments ethniques que la conquête romaine n’a pu étouffer sous son uniformisation.
Depuis un siècle environ, on a appliqué le qualificatif roman à l’art ; l’architecture en particulier, qui, s’est dégagé le premier du classicisme néo-grec. L’étude de l’art roman n’est pas moins intéressante que celle des langues romanes, bien qu’elle révèle moins de caractères ethniques, plus d’influences étrangères. Ces influences sont barbares dans le Nord, orientales dans le Midi. Dans certaines régions rnéditérranéennes, l’art appelé roman est même uniquement d’imitation byzantine.
Nous ne nous occuperons ici que du sens spécial donné au moyen âge aux mots roman et romance. Le premier seul a conservé ce sens ; le second n’est plus employé qu’en musique. La romance est devenue la forme condensée du roman qui jadis était chanté. Il était un ouvrage de poésie ou de prose, écrit en langue romane, c’est-à-dire vulgaire, par opposition aux ouvrages écrits en latin. Son caractère était généralement profane, mais il y avait des romans religieux et il y en avait aussi d’écrits en latin. La marque essentielle du roman était, elle est encore, son genre narratif alimenté par l’invention. Il naquit de la chanson de geste, quand celle-ci, n’étant plus uniquement un chant d’entraînement guerrier, fut devenu tout un poème, une épopée, pour la distraction de la vie de château. Il ne chanta plus alors uniquement les combats et les exploits des héros qui s’y étaient distingués ; il chanta l’amour. Mais cette transformation ne se fit guère avant le XIIème siècle, lorsque le trouvère, compositeur et chanteur, introduisit l’amour courtois dans la poésie qu’il faisait entendre à ses auditeurs. Jusque-là, les romans furent des compositions épiques se rattachant aux chansons de geste : les romans de Brut et de Rom, par Wace, ceux d’Alexandre et l’Enée, par Albéric de Besançon, celui de Troie, par Benoit de Sainte More, le Tristan, de Béroul, etc. Les premiers romans où l’amour se dégagea de la geste guerrière et prit les formes de la galanterie, furent ceux de Chrétien de Troyes (La Charrette, Yvain, Tristan, Perceval, etc.), et les Lais, de Marie de France. Robert de Boron continua (Le Graal, Lancelot, etc.). Cette littérature, dite des « romans bretons », avait à son origine l’épopée celtique de la Table ronde. En même temps qu’il exprimait des sentiments de plus en plus courtois, le roman se faisait allégorique, didactique, satirique (Roman de la Rose, Roman de Renart, etc.). Toute la longue série des Contes pieux se rattache au roman par la narration, la fantaisie de l’invention et aussi le respect dont on commençait à entourer la femme après plus de mille ans de malédiction ecclésiastique. Enfin, le fabliau a été la forme populaire, « gauloise » suivant le mot qui caractérise cette forme, du roman. C’est du vieux fabliau français que sortirent les nouvelles qui firent la célébrité des conteurs Italiens depuis Boccace jusqu’au XVIIIème siècle.
Presque toutes les œuvres romanesques du moyen âge ont été écrites en vers. Lorsque la prose fut introduite dans la littérature, le roman commença à se séparer plus nettement de la poésie polir devenir ce que l’Académie française définit aujourd’hui :
« Une histoire feinte, écrite en prose, où l’auteur cherche à exciter l’intérêt, soit par le développement des passions, soit par la peinture des mœurs, soit par la singularité des aventures. » (Dictionnaire de l’A. F., 7ème édition, 1878.)
Le roman décrit la vie ou ce qui est censé être la vie. Sa première condition, en dehors de toute classification, est la vraisemblance de son invention sinon l’observation du vrai et la reproduction du réel. Il se différencie ainsi du conte dont le caractère est dans le merveilleux et l’invraisemblable. « Ceci n’est pas un conte », dit-on depuis Shakespeare, d’un récit dont on veut affirmer la vérité, tout au moins la vraisemblance. Le roman donne le tableau, l’illusion de la vie, de l’action, des sentiments, par l’adaptation habile, objective ou subjective, idéaliste ou réaliste, d’une vérité qui est, a été ou pourrait être. Il s’empare de tous les sujets : historiques, scientifiques, philosophiques, politiques, sociaux, et les anime, les spiritualise ou les matérialise dans les pensées ou dans les actes de personnages plus ou moins imaginés ou pris sur le vif, exceptionnels ou communs qui sont des caractères, des individualités, des types spéciaux ou simplement « comme tout le monde ». Le roman, par sa nécessité de personnification concrète de l’action et des sentiments, est le gente littéraire le plus voisin du théâtre. Diderot déclarait que tout bon drame devait pouvoir faire un bon roman. La réciproque est aussi vraie.
Le romanesque a toujours hanté l’esprit humain, soit par le merveilleux de la fable et l’héroïsme du mythe, soit par l’observation plus proche et plus directe de la réalité. Le roman ancien est caractérisé par l’aventure et le roman moderne par le sentiment ; mais les deux se trouvent dans les productions antiques, sources inépuisables de toutes les inventions littéraires (Voir Littérature). On s’occupait plus d’action d’éclat que de recherche psychologique aux temps de ces romans fabuleux appelés l’Iliade, l’Odyssée, l’Enéide, la Cyropédie, etc., et la fiction était la marque essentielle des Milésiennes, petits contes gracieux et voluptueux dont on ne connaît plus que ceux de Parthénius de Nicée et de Conon. Il y eut plus de vérité dans quelques productions des érotiques grecs, du IIème au Vème siècle, dans Daphnis et Chloé, le charmant récit de Longus, dans le Satyricon du satirique Pétrone, dans les Métamorphoses, d’Apulée, dont l’Ane d’Or est resté célèbre. Mais le roman ancien fut surtout le récit d’aventures, tel les Amours de Théagène et de Chariclée, d’Héliodore, qu’on imitait encore au XVIIème siècle français. A Rome, le genre tomba vite en décadence ; celle-ci fut marquée par l’adaptation de l’Apollonius de Tyr.
L’imitation de l’antique fut reprise au moyen âge. Elle aida à l’éclosion du roman chevaleresque tiré de l’épopée et elle se prolongea avec ce roman jusqu’au milieu du XVIIème siècle. De plus en plus, la poésie des chansons de geste avait été noyée dans le fatras, indéfiniment allongé, d’une invention grossière et invraisemblable dont les personnages n’étaient que des pantins. L’amour même les rendait ridicules par leur affectation galante. On était loin des Roland, des Tristan, des Lancelot et des compositions naïves de Marie de France. La chevalerie n’était plus qu’une légende héroïque. Cervantès, après Rabelais, lui avait fait de splendides et définitives funérailles avec son Don Quichotte. Le roman versait de plus en plus dans la galanterie de cour et les mœurs de la nouvelle aristocratie des « honnêtes gens » empressés à la curée des faveurs royales. Les Amadis de la littérature espagnole remplacèrent leurs armures par des pourpoints de velours et de soie, les grands coups d’épée par des madrigaux. Ils s’approvisionnèrent de plus en plus, en France, pour prendre les airs sentimentaux et hypocrites des pastorales, des bergeries, des fadasseries bucoliques du Pays de Tendre où les Céladon, les Cyrus, les Polexandre, les Phillis, les Tircis, les Alcidamie, montrèrent une innocence et des vertus d’autant plus édifiantes qu’ils pratiquèrent de plus sales mœurs. Les d’Urfé (l’Astrée), Gomberville (Polexandre, Alcidiane), La Calprenède (Cassandre, Cléopâtre), Mlle de Scudéry (Cyrus, Clélie), Hortense des Jardins (Alcidamie), et cent autres collectionneurs de scandales, écrivaient pour le monde « précieux » ces romans à clefs où la belle société du temps trouvait ses turpitudes poétisées. Les Cathos et les Madelon, « précieuses ridicules », les Philaminte et les Bélise, « femmes savantes », à qui Molière disait... :
Mais vous en faites, vous, d’étranges en conduite. »
...couraient les ruelles en compagnie d’ « abbés poudrés, musqués, égrillards, trousseurs de cottes, faiseurs de vers » (Emile Magne). Ces muses dévergondées, après avoir soupiré sentimentalement auprès des niguedouilles aussi ridicules qu’elles, se livraient à des joies plus prosaïques dans les bras de vigoureux mousquetaires qu’elles entretenaient et qui les payaient de coups. Les Jouissances chantées par la belle Hortense des Jardins, dame de Villedieu, étaient rien moins que platoniques, et Tallemant des Réaux aurait pu dire de la plupart de ces « précieuses » ce qu’il disait d’une dame de Champré :
Et par derrière et par devant. »
D’ailleurs les ébats de corps de garde s’accordaient fort bien avec les attendrissements bucoliques et même avec les amours mystiques. Les Jésuites avaient introduit le roman dans la politique et dans la religion, en même temps que celles-ci dans le roman. Ils avaient fait le roman religieux :
« La religion sortie de sa haute sphère générale pour se laisser manier et mouler au plaisir de l’individu. » (Michelet)
Ils firent de la sensation « le critérium de l’esprit ». Voisinant avec les Amadis et comme eux « éclairés du feu des bûchers » les Rosaires, romans religieux propagés dans les couvents espagnols, puis français, répandirent la galanterie ecclésiastique, particulièrement troublante par les désordres hystériques imités de ceux de Thérèse d’Avila et les « cordicoleries » subséquentes. L’Evangile était mis en romans, et Jésus en beau jeune homme, Céladon divin, comme les chromos et les plâtres de l’industrie sulpicienne n’ont pas cessé de le représenter, offrait son cœur et le reste à la frénésie des nonnes et des dévotes dont les sens, furieusement allumés, étaient appelés à témoigner des objets spirituels et d’une divinité qui n’était plus sûre que « par le tact ». On sait, par les exemples toujours actuels, jusqu’où peut aller cette sorte de « spiritualité » chez des vierges pieusement surexcitées et chez des ecclésiastiques flamidiennement disposés. Le pieux François de Sales offrait à ses belles pénitentes ses « Astrées spirituelles », Henri IV, qui s’était livré au père Cotton, y était très sensible. Il faisait ses délices des Amadis et, dans ses derniers jours, de l’Astrée. Il y puisait cette exaltation qui rendit si souvent ridicules ses aventures amoureuses et cette complaisance immorale pour les « honnêtes gens » qui, finalement, le firent assassiner.
Le XVIIème siècle, qui fut celui du roman mondain, fut celui des pires vices hérités de la pourriture physique et morale du temps des Valois, le temps où la médecine eut plus que jamais à s’occuper de la contagion syphilitique répandue par les mœurs royales. « Cent escholiers ont pris la vérole avant que d’être arrivés à leur leçon d’Aristote », écrivait Montaigne dans ses Essais. Tartufe arriva ensuite pour souiller le monde entier de sa morale. Les « honnêtes gens » — qu’il ne faut pas confondre avec « l’homme d’honneur » de Rabelais et « l’honnête homme » de Pascal, homme de mœurs franches, affable, poli, et possédant une véritable culture de l’esprit, qu’on nous présente aujourd’hui comme le type ordinaire de ces temps-là -, ces « honnêtes gens, perclus de vices, avaient besoin de ces allégories (celles de leurs romans), et pour s’illusionner sur eux-mêmes que l’on prétendait peindre, et pour témoigner de leurs inaltérables vertus devant la postérité » (E. Magne). Le roman mondain montra la psychologie du temps qui le créa. Il a continué depuis et il est à remarquer qu’il a toujours eu pour but de mettre en évidence des vertus inexistantes dans le monde qu’il a décrit. Il est le même aujourd’hui où il s’efforce de redorer le lustre d’une société bourgeoise en pleine déliquescence.
Au roman mondain du XVIIème siècle (on pourrait annexer la plupart des Mémoires, Lettres, Journaux particuliers, Historiettes, nombreux à cette époque, qui furent les premières « histoires romancées ». Jusqu’au XVIème siècle, les familles nobles, vivant dans leurs châteaux, avaient écrit leurs annales. Lorsqu’elles furent établies à la cour, leurs préoccupations familiales devinrent d’intrigue et de politique, à l’exemple de celles des princes, et l’on ne vit plus que des Mémoires plus ou moins sincères et véridiques, écrits par certains personnages, ou qu’ils faisaient écrire, sur les événements dont ils avaient été acteurs ou témoins. Il en est qui ont une véritable valeur historique, et c’est par eux que les mœurs du temps sont exactement rapportées, mais le plus grand nombre ne sont que du roman. Citons, parmi ceux auxquels on peut ajouter quelque foi, parce qu’ils ne sont pas des apologies de leur époque et qu’ils en font une critique souvent vive, les Mémoires de La Rochefoucauld, de Retz, de Mme de Motteville, de Bussy-Rabutin, de Rapin, etc. ; les Lettres de Mme de Sévigné, les Journaux particuliers de Dangeau et autres, les Historiettes de Tallemant des Réaux, et divers récits des commérages et scandales de la cour et de la ville, à l’imitation des Caquets de l’accouchée. Comme l’a dit Michelet, romans et mémoires étaient devenus :
« L’épopée non épique, l’histoire non historique, descendues l’une et l’autre de la grandeur populaire à la petitesse individuelle. »
Le véritable roman, considéré dans son sens moderne, avait eu déjà, plus ou moins indépendantes de la mode littéraire, plusieurs formes intéressantes et qui, développées, conduiraient peu à peu à celles d’aujourd’hui. Il était plus vrai, plus sincèrement inspiré de l’observation des hommes et des événements, des mœurs et des milieux. Il avait produit au XVIème siècle le Petit Jehan de Saintré, d’A. de la Salle, et les Cent Nouvelles nouvelles. Au XVIème, Rabelais, dans son Gargantua et son Pantagruel, en avait fait une « horrifique » farce, en même temps qu’une véritable somme des connaissances de son époque, une satire audacieuse et une réconfortante « pronostication » des possibilités de la sagesse humaine, si les hommes la voulaient suivre. Dans le même esprit, Despériers avait écrit ses Joyeux devis, et Du Fail ses Propos rustiques et son Eutravel. Marguerite de Navarre avait composé les contes de l’Heptaméron. Le commencement du XVIIème siècle avait vu les Aventures du baron de Feneste, d’A. d’Aubigné. Vers 1650 furent publiés les Etats et empires de la lune et du Soleil, romans d’anticipation scientifique que leur auteur, Cyrano de Bergerac, appela « histoires comiques » et qui font penser par bien des points à J. Verne et à Wells. Ces deux ouvrages étaient surtout des romans d’une hardiesse philosophique et d’un esprit naturiste tels, que toutes les éditions qu’on a tenté d’en répandre jusqu’en 1789 ont été systématiquement supprimées, à l’instigation de la congrégation de l’Index, malgré les coupures qu’y pratiquaient les éditeurs. Il en est résulté, à l’encontre de Cyrano de Bergerac, une méconnaissance de son œuvre qu’entretiennent encore les Histoires de la Littérature, celle de M. Lanson, entre-autres. Cyrano était disciple de Gassendi et ami de Campanella ; la Cité du Soleil de ce dernier paraît avoir inspiré son œuvre.
En 1651 paraissait le Roman comique, de Scarron, imité du genre « picaresque », d’après les picaros types populaires espagnols, mendiants et voleurs, dont Mendoza avait dépeint les mœurs un siècle avant dans son roman Lazarille de Tormes. Le Roman comique tranchait, par son réalisme, avec le roman mondain ; mais plus réaliste encore que Scarron furent Sorel et Furetière. Il est regrettable pour la renommée littéraire de ces deux auteurs qu’ils n’aient pas eu des qualités d’écrivains plus solides, car leurs œuvres méritaient de demeurer par leur caractère. Trente ans avant Boileau et Molière, Sorel avait apporté une réaction nécessaire contre le roman à la mode. Dans son Francion, paru en 1622, il avait montré dans toute leur vérité les bas-fonds sociaux et, en particulier, le monde déjà prostitué des gens de lettres. Dans son Berger extravagant (1627), il avait tourné en dérision la littérature du Pays de Tendre et devancé Molière dans la caricature des « précieux ». De son côté, Furetière, dans son Roman bourgeois (1666) fit une peinture exactement observée des mœurs bourgeoises, mais l’esprit d’un Molière y manquait trop pour en faire l’œuvre fortement satirique que le sujet comportait. La peinture des individus et des mœurs trouva en ce temps-là son expression la plus élevée dans les Caractères de La Bruyère, œuvre d’un véritable romancier.
Ce fut Mme de La Fayette qui donna au XVIIème siècle son chef-d’œuvre dans le roman. La Princesse de Clèves ne fut pas seulement le premier roman d’analyse ; elle apporta un ensemble de qualités qui la mit nettement au-dessus de tout le genre romanesque de l’époque. Ce roman est remarquable autant par le fond que par la forme, par la noblesse des sentiments que par son style, qualités qui sont celles du meilleur classicisme. Le XVIIème siècle vit encore le roman mythologique avec les Amours de Psyché, de La Fontaine, et le roman d’éducation avec le Télémaque, de Fénelon. Enfin, Sandras de Courtilz, auteur des Mémoires de d’Artagnan, commença le roman historique à la façon d’A. Dumas.
Le XVIIIème siècle fut plus simple, plus naturel, sinon plus sincère. Il fut moins soucieux de pompeuse et trop souvent grotesque sublimité. Mme de La Fayette et La Bruyère avaient commencé une évolution du roman de mœurs que Lesage continua par son Gil Blas de Sentillane. Dans le genre picaresque auquel il donna ainsi son chef-d’œuvre, Lesage multiplia l’observation des milieux et des individus les plus divers, vus dans toutes les classes de la société. Si l’éparpillement de l’action dans une foule d’actions secondaires fait que les personnages y sont noyés, les milieux où s’agitent ces personnages sont supérieurement dépeints et il en ressort une psychologie collective qui remplace celle de l’individu. On a reproché à l’œuvre de Lesage d’être peuplée surtout de coquins ; c’est qu’ils étaient plus nombreux que les honnêtes gens dans les milieux que Lesage décrivait, sans souci des convenances d’une hypocrisie qui mettait le masque de l’honnêteté sur le visage des coquins.
Marivaux (Vie de Marianne, le Paysan parvenu, etc.), continua la réforme du roman par une observation plus directe des mœurs. Il donna plus d’importance aux caractères, à la psychologie des individus, et moins à l’action. Il commença le roman moralisateur, mais sans y insister trop, à une époque de scepticisme et de frivolité où les derniers moralistes n’étaient que des tartufes attardés. Il faudrait attendre J.-J. Rousseau pour rendre à la morale un caractère, celui de la nature, qui la mettrait à sa vraie place dans les préoccupations humaines. L’abbé Prévost fit abstraction de toute morale conventionnelle dans sa Manon Lescaut où l’intensité de la passion, exclusive de toute considération, fait de Manon l’égale des plus humaines et des plus vivantes héroïnes de l’amour, à côté d’Yseult, fille de roi, et de la patricienne Juliette. La passion se répandait d’ailleurs dans la littérature avec une expansion qui emportait toutes les convenances, et son déchaînement de plus en plus déclamatoire serait la caractéristique du romantisme (Voir ce mot). Elle fut, en attendant, le mobile du roman philosophique, comme la nature en fut le cadre.
Les philosophes, qui employaient toutes les formes littéraires pour la propagande de leurs idées, ne pouvaient négliger le roman et l’importance qu’il avait prise dans la vie mondaine. Par des conventions nouvelles qu’ils y apportèrent, ils y firent pénétrer leurs conceptions sociales. Ils n’insistèrent pas trop sur le côté de la morale. Le ton de la volupté servit à mieux faire passer la philosophie, et l’on eut ainsi, à des degrés divers d’innocence et de perversion, de sérénité et d’orage, toute la gamme des passions, toutes les couleurs des paysages. Les Lettres persanes, de Montesquieu, commencèrent le genre du roman philosophique en apportant une sorte de détachement aristocratique un objectivisme complet, dans la satire la plus aiguë. Par contre, dans la Nouvelle Héloïse, Rousseau se mit lui-même avec un subjectivisme qui en fit le centre de toutes les passions et de toutes les sensibilités, multipliées par une imagination impétueuse et un ardent lyrisme. Rousseau fut Saint-Preux comme il fut, dans les Confessions, le « petit » de Mme de Warens. Entre le pondéré Montesquieu et le bouillant Rousseau, le sceptique Voltaire donna ses chefs-d’œuvre au roman philosophique (Zadig, Candide, l’Ingénu). Il érigea au dessus du domaine des sentiments celui de l’esprit et de la raison. De son côté, Diderot renouvela le naturalisme scientifique et philosophique de Rabelais (Jacques le Fataliste, la Religieuse, le Neveu de Rameau).
Le roman du XVIIIème siècle eut encore une assez grande variété de fond et de forme avec les fadeurs champêtres et la fausse innocence de Florian (Galatée, Estelle), les naïvetés idylliques de Bernardin de Saint-Pierre (Paul et Virginie) qui, en même temps que Marmontel (les Incas), mit l’exotisme à la mode. Ce fut aussi la froide évocation de la vie antique par l’abbé Barthélémy (Voyage du jeune Anacharsis). Les romanciers appelés « libertins » firent les peintures les plus licencieuses des mauvaises mœurs du temps. Laclos (Les Liaisons dangereuses), avait des intentions morales. Il voulait rendre service aux mœurs en dévoilant « les moyens qu’emploient ceux qui en ont de mauvaises pour corrompre ceux qui en ont de bonnes ». Crébillon fils (Lettres de la marquise de ..., les Egarements du coeur et de l’esprit, l’Ecumoire, le Sopha) et Louvet de Couvray (le Chevalier de Faublas, eurent des intentions moins édifiantes. Enfin, le cycle se ferma sur le réalisme qui fut appelé « cynique » et « monstrueux » de Restif de la Bretonne (le Pied de Fanchette, la Fille naturelle, le Paysan perverti, Monsieur Nicolas, etc.) esprit véritablement encyclopédique, producteur fécond, que les vertueux gens de plume pillèrent d’autant plus qu’ils le méprisèrent davantage, ce qu’ils appellent le « vice » perdant sa mauvaise odeur quand ils en tirent profit.
Le roman du XVIIIème siècle eut une très grande part d’influence dans l’avènement du romantisme en France. A l’étranger, le romantisme eut des sources plus considérables (Voir Romantisme). Bernardin de Saint-Pierre, disciple candide et incompréhensif de Rousseau, qu’il exagéra en faisant un système fantaisiste et arbitraire de ce qui était raisonnable et naturel chez ce dernier, fut l’inspirateur direct du Chateaubriand des Natchez, d’Atala, de René, des Martyrs et aussi du Génie du Christianisme, toutes œuvres qui terminèrent le XVIIIème siècle plus qu’elles ne commencèrent le XIXème, malgré leurs dates.
Le XIXème siècle a été la grande époque du roman français, époque qui s’est prolongée jusqu’en 1914. Elle est finie depuis la Guerre qui a bouleversé toutes les « valeurs », surtout celles de la pensée, malgré une production plus abondante que jamais. Le roman ne s’attarda pas dans le romantisme comme la peinture, la musique et surtout la poésie. Dès Balzac, dont les nombreuses œuvres composant la Comédie humaine parurent à partir de 1830, il commença à s’en dégager pour s’établir dans la vie réelle. Le roman romantique eut pour principaux auteurs Ch. Nodier, qui traduisit un des premiers le « vague à l’âme » de l’époque dans le Peintre de Salzburg « journal des émotions d’un coeur souffrant », et dans ses Contes, Senancour (0bermann) , Mme de Staël (Delphine, Corinne), B. Constant (Adolphe), A. de Vigny (Servitude et grandeur militaire, Cinq Mars, Stello, Daphné), Th. Gautier (la Jeune France, Mademoiselle de Maupin, dont la préface fut au roman ce que celle de Cromwell fut au théâtre, le Roman de la momie, le Capitaine Fracasse, etc.). George Sand exprima dans le roman le sentimentalisme outrancier de Chateaubriand (Indiana, Lélia, Leone Leon!, Jacques, Mauprat, etc.). Elle le reporta sur le monde ouvrier lorsqu’elle partagea les idées des humanitaires de 1848 (Spiridion, les Compagnons du tour de France, Consuelo, le Meunier d’Angibault, etc.). Mais ses meilleures œuvres sont celles dont elle puisa l’inspiration dans la nature (Jeanne, François le Champi, la Mare au niable, la Petite Fadette, les Maîtres sonneurs, etc.), et dans l’amour (le Marquis de Villemer, les Beaux-Messieurs de Bois-Doré, Mlle de la Quintinie, etc.). Alfred de Musset (Confession d’un enfant du siècle) se dégagea du romantisme, sinon par le fond, du moins par les formes d’un art plus libre. Il fut moins romancier que piète. De même Lamartine (Graziella) romantique dans le fond, eut plus de sérénité classique dans la forme.
Victor Hugo, étroitement romantique dans son théâtre, dépassa les limites arbitraires du genre pour faire du roman, comme de la poésie, une vaste épopée humaine (Han d’Islande, Bug Jargal, Notre-Dame de Paris, les Misérables, les Travailleurs de la mer, l’Homme qui rit, Quatre-vingt-treize). V. Hugo inaugura en France le roman historique que Walter Scott illustra en Angleterre. Le roman donna aux faits de l’histoire la couleur des mœurs du passé mais, de moins en moins scrupuleux, dans le but d’aviver et de rehausser les tons, les romanciers prendraient avec les faits historiques des libertés de plus en plus grandes, au point que le roman historique, ne serait plus que de l’histoire romancée. Avant de subir cette évolution fâcheuse, le roman historique compta de belles œuvres à côté de celles de V. Hugo, entre-autres Cinq Mars, d’A. de Vigny, la Chronique de Charles IX, de Mérimée ; les Chouans, de Balzac, etc. On peut aussi considérer comme des romans historiques, par leurs peintures des mœurs du temps passé et les cadres où elles se déroulent, la plupart des œuvres de Stendhal (le Rouge et le Noir, la Chartreuse de Parme, l’Abbesse de Castro), certaines de G. Sand (Maupras, Consuelo), puis Salammbô et Hérodias, de Flaubert, l’Agonie et Byzance, de Jean Lombard, qu’ont imités des contemporains moins scrupuleux dans l’exactitude de leur documentation. Entre temps, Alexandre Dumas était venu avec son armée de « nègres » qui se mirent à fouiller, à dépiauter, à arranger l’histoire pour lui donner la première forme, la forme supérieure si l’on peut dire, de l’histoire romancée, car ses successeurs en feraient un des plus ineptes produits du roman-feuilleton. Si Dumas accommodait l’histoire, du moins le faisait-il en y intéressant le lecteur, en lui en donnant le goût et le désir de la mieux connaitre. Aussi Dumas pouvait-il dire spirituellement que le roman faisait l’histoire moins ennuyeuse. Le succès lui donnait raison, et il était peut-être le seul, a dit un humoriste, qui n’avait pas lu les ouvrages parus sous son nom. Dans le même genre, Paul Féval (les Mystères de Londres, le Fils du Diable, le Bossu, etc.) semble avoir opéré lui-même ; aussi devint-il fou. Il avait eu cependant un secrétaire, E. Gaboriau, qui aggrava le genre en inventant le roman policier (l’Affaire Lerouge, le Crime d’Orcival, etc.).
Balzac établit le pont entre le romantisme et le naturalisme. S’il garda du romantisme une abondance touffue et une invention trop conventionnelle, souvent invraisemblable, il eut un don pénétrant d’observation et de reproduction réaliste qui lui ont fait présenter la société et les hommes de son temps avec une profonde vérité. C’est par ce réalisme que l’œuvre de Balzac demeure toujours vivante. Stendhal fut un observateur encore plus pénétrant, plus avisé, plus froidement scrutateur. Il usa dans le roman des méthodes analytiques de Taine et il y a, dans sa manière de sonder les individus, une sorte de procédé freudien gênant pour ceux chez qui la sincérité est la moindre des qualités. Il fut tenu pour cynique. Quand il fut compris, vers 1880, comme il l’avait lui-même annoncé, ce fut surtout pour servir de drapeau à des prospecteurs d’âmes aux intentions équivoques. Les dandys du décadentisme anarcho-patriotique, tel Maurice Barrès, les domestiques académisés de la faisanderie aristocratique, tel M. Paul Bourget, se prévalurent plus ou moins de Stendhal. Il eut été médiocrement flatté d’une telle descendance. Maurice Barrès (Sous l’œil des Barbares, Un homme libre, le Jardin de Bérénice, l’Ennemi des lois, le Roman de l’Energie nationale, etc.) a été, individuellement et socialement, l’esprit le plus faux de son temps. Son influence sur la prétendue « élite » intellectuelle n’est que le produit du snobisme suscité et entretenu par les bénéficiaires des sophismes immoraux et meurtriers qui mènent de plus en plus le vieux monde vers une justicière culbute. Nous parlerons plus loin de M. Paul Bourget. Aujourd’hui, la progéniture des repus de la guerre, pour qui la littérature est inférieure aux sports et à la noce, rêve d’action et de puissance avec certainement moins de scrupules qu’un Julien Sorel (le Rouge et le Noir).
Mérimée continua la transition entre le romantisme et le réalisme. Plus romantique de forme en ce qu’il fut plus artiste que Balzac et Stendhal, et plus attaché à la formule de l’art pour l’art (voir Romantisme), il fut plus réaliste de fond par la vérité de ses personnages, Colomba et Carmen sont des types de femmes toujours vrais et pas seulement ceux d’une époque ; telles scènes populaires sont, dans la Chronique de Charles IX, comme dans la Jacquerie, d’un pittoresque aussi vivant que s’il eût été noté sur place.
La théorie de l’art pour l’art fut la chaine qui lia Gustave Flaubert au romantisme. Plus romantique en cela que V. Hugo, qu’il accusait presque de démagogie parce qu’il avait écrit les Misérables, Flaubert n’admettait pas la « mission sociale » du poète. Il était d’accord avec Th. Gautier contre les « utilitaires » et il avait horreur de « l’avocasserie » productrice de la blagologie politicienne. Ses préventions à ce sujet n’étaient que trop justifiées. Par contre, lorsqu’il reprochait à V. Hugo de « peindre faussement la société », il la connaissait encore moins que lui, et il écrivait avec une belle naïveté des choses comme ceci :
« Où est la fabrique où l’on met à la porte une fille pour avoir un enfant ? »
Sa critique des Misérables descendait presque an niveau de celle d’E. de Mirecourt, sauf l’hypocrisie ; Flaubert était sincère, mais emporté par ses enthousiasmes d’artiste qui le faisaient « éclater d’intensité intellectuelle ». Il y a lieu d’ajouter, pour caractériser son romantisme, son goût de l’exotisme et celui de l’exceptionnel, de l’ignoble même dont il disait : « L’ignoble me plaît — c’est le snobisme d’en bas — quand il est vrai, il est aussi rare à trouver que celui d’en haut ». Mais il était trop intelligent, trop, sincère et trop droit pour prendre au sérieux le charlatanisme esthétique et sentimental dont tant de faux bonshommes tiraient leur fortune. Ses lettres à Mme Colet sont curieuses à ce sujet ; jamais un homme ne fut plus sincère avec les femmes. Il méprisait la vanité cabotine, car il avait le sentiment du « ridicule intrinsèque à la vie humaine elle-même », et il possédait « l’ironie philosophique » des grands et des forts, de Rabelais et de Montaigne. S’il haïssait le « bourgeois » pour sa sottise, il haïssait encore plus fortement le mauvais artiste, « le gredin qui côtoie toute sa vie le beau sans y jamais débarquer et planter son drapeau ». Ce qu’il appelait sa « déplorable manie de l’analyse » qui l’épuisait, le faisait douter de tout, « même de son doute », joint à sa scrupuleuse franchise devait amener Flaubert à dominer son enthousiasme, à faire abstraction de ses goûts personnels pour observer froidement, scientifiquement, la nature et les hommes et les montrer le plus objectivement et le plus exactement possible. De cette méthode et de sa rigoureuse continuité sortirent l’Education sentimentale et Madame Bovary, modèles du roman naturaliste et chefs-d’œuvre du roman contemporain.
En même temps que Flaubert, un attardé, Fromentin, auteur de Dominique (1863), avait clos harmonieusement la carrière du roman romantique. Il avait équilibré la passion et la raison dans une sereine atmosphère intellectuelle où l’exaltation est apaisée, et le pessimisme sans amertume. Fromentin eut intelligence de ne pas s’irriter contre un monde mal fait quand il comprit qu’il n’était pas un génie, et de se borner à exercer remarquablement des dons d’artiste qui en faisaient à la fois un peintre, un écrivain et un critique originaux. Plus sincèrement et plus véridiquement qu’A. de Musset, il aurait pu dire :
« Mon verre n’est pas grand, mais je bois dans mon verre ».
Le roman naturaliste fut, comme l’art de la même école, le produit de l’évolution sociale plus que de préoccupations esthétiques. Non seulement la Révolution avait apporté un esprit plus largement humain, mais les découvertes scientifiques, le développement du machinisme, les nouvelles conditions du travail industriel avaient engendré des volontés de réalisations qui dressaient l’économie sociale en face de la politique. La réalité s’imposait irrésistiblement au penseur comme à l’ingénieur. La science et la philosophie sociale ne descendaient plus des nuages et ne sortaient plus fumantes des cogitations scolastiques ; elles jaillissaient du fait social, du travail, de la lutte de plus en plus âpre entre les producteurs et les bénéficiaires de la richesse. Ce fait social dominait malgré toutes les résistances. G. Sand lui avait fait une place de plus en plus marquée dans ses dernières œuvres. Il avait déterminé la première forme du roman appelé « populaire », celui d’Eugène Sue (les Mystères de Paris, le Juif errant, les Misères des enfants trouvés, etc.) en concurrence avec le roman historique des A. Dumas, P. Féval, F. Soulié, dans les feuilletons des premiers journaux quotidiens dont ils avaient assuré le succès. V. Hugo avait écrit une véritable épopée populaire avec ses Misérables. Cette œuvre immense où se heurtent dans une mêlée titanesque toutes les passions, tous les rêves et toutes les réalités, les plus purs comme les plus abjects est et demeure, par son humanité, le type du véritable roman social, quelles que soient les conventions qu’on lui oppose. De ce roman social, V. Hugo a jeté l’indestructible base quand il a écrit en tête de son œuvre cette belle préface qui se termine ainsi : « tant qu’il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles ». Non seulement ils n’étaient pas inutiles, mais ils étaient nécessaires, indispensables, ces livres qui étaient une espérance pour les affamés, une accusation contre les repus.
Un Claude Bernard et un Taine cherchaient à établir scientifiquement et philosophiquement les lois de la vie ; Zola voulut les donner à la littérature et en particulier au roman. Ses théories furent plus ou moins arbitraires comme celles de C. Bernard et de Taine ; son œuvre les a heureusement dépassées et seule elle a valu, comme seule vaut la vie au dessus de tous les systèmes du monde. L’hérédité spéciale de la famille Rougon-Macquart n’est en rien déterminante des faits sociaux ; cette famille est emportée, comme toutes les autres dans le fait collectif de son temps. Zola ne pouvait pas faire, sans manquer à la vérité, que la personnalité de chacun des Rougon-Macquart ne se fondit dans l’anonymat de cette mêlée, c’est-à-dire des êtres généralement médiocres dont il se faisait l’historien, pour se transformer en types représentatifs de leur milieu et de leur temps. La besogne essentielle de Zola, comme du naturalisme, a été de transporter dans la réalité de son époque l’épopée romantique des masses humaines telles qu’elles sont, dépouillées de la déformation littéraire.
Les Goncourt se sont préoccupés davantage de l’individu mais sous son aspect on peut dire plastique. Ils ont plus recherché la précision pathologique que l’exactitude psychologique. Ils ont voulu faire de la « clinique sociale » (L. Tailhade) aussi bien dans leurs études historiques, leur Journal, que dans leurs romans plus propres à leur temps (Renée Mauperin, Germinie, Lacerteux Manette Salomon, la Fille Elisa, Charles Demailly, la Faustin, Sœur Philomène, les Frères Zemganno, etc.). Ce fut chez eux un procédé découlant de cette idée, toute conventionnelle et fausse, que l’art ne peut être réaliste qu’autant qu’il s’applique à des individus et à des milieux inférieurs, plus ou moins grossiers. Le procédé fut exagéré par Huysmans (Marthe histoire d’une fille, les Sœurs Vatard, En ménage, A vau-l’eau), avant qu’il transportât sa recherche du bizarre dans le domaine occultiste et catholique (A rebours, Là-bas ! En route, la Cathédrale, les Foules de Lourdes). Il fut encore plus exagéré par de bas producteurs dont l’œuvre ne fut que de la pornographie sans art.
Les romanciers suivants apportèrent au naturalisme les tempéraments les plus divers. Guy de Maupassant, le plus représentatif du véritable naturalisme (voir ce mot), auteur de Boule de Suif, Une vie, Bel Ami, Mont-Oriol, le Horta, Pierre et Jean, le Champ d’oliviers, la Femme de Paul, Fort comme la mort, et de très nombreux contes non moins remarquables que ses romans par la composition et parle style. Henri Céard (Une belle journée), Léon Hennique (la Dévouée, Elisabeth Couronneau, l’Accident de M. Hébert), Paul Alexis (la Fin de Lucie Pellegrin, le Besoin d’aimer, Vallobra, roman de mœurs politiciennes). Ces quatre écrivains furent avec Zola et Huysmans, les collaborateurs des Soirées de Médan. Ce furent encore, parmi les écrivains naturalistes restés attachés à l’école de Zola ou qui s’en séparèrent avec plus ou moins d’éclat : Lucien Descaves (Sous-Offs, les Emmurés, la Colonne, Philémon Vieux de la Vieille, etc.) ; Gustave Geffroy (l’Enfermé, beau livre sur Blanqui, l’Apprentie, Hermine Gilquin) ; Paul et Victor Margueritte qui écrivirent en collaboration entre-autres trois romans sur la guerre de 1870, puis se séparèrent, Paul allant vers « l’idéalisme nationaliste », Victor défendant, dans la voie contraire, les théories sociales les plus hardies et les plus généreuses pour la liberté de l’individu et pour la paix des peuples (Prostituée, la Femme en chemin, Ton corps est à toi, Non, la Patrie humaine, etc.) ; J. et H. Rosny (Nelle Horn, le Bilatéral, l’Impérieuse bonté, la Vague rouge, etc.) dont le naturalisme est, socialement, plus pondéré ; Paul Adam (Chair molle, Robes rouges, le Mystère des foules, l’Année de Clarisse, la Force, la Bataille d’Ulule, etc.) plus « nietzschéen » mondain que révolté ; Léon Frapié (la Maternelle, la Boite aux gosses, la Proscrite, etc.) ; Henry Fèvre (Galafieu, Pampouille et Dagobert, etc.) ; Michel Corday (Vénus ou les deux risques, les Embrasés, les Maternités consenties, etc.) ; Gaston Chérau (Champi Tortu, la Prison de verre, la Maison de Patrice Perrier, Valentine Pacquault, etc.) qui est un bon observateur de la vie provinciale ; Han Ryner (1e Crime d’obéir, le Sphinx rouge, les Voyages de Psychodore, Prenez-moi tous ! etc.) qui mit la philosophie individualiste dans le roman social. Enfin, ceux qui avec Zola, Maupassant et Huysmans apportèrent. au naturalisme les personnalités les plus caractéristiques : Jules Renard (Poil de Carotte, la Maitresse, Ragote, Histoires naturelles, etc.), et Georges Courteline (Boubouroche, Messieurs les ronds cuir, les Gaietés de l’escadron, etc.).
A la fois romantique et naturaliste, se dresse, magnifique, Léon Cladel qui fut le plus lyrique, le plus ardent poète de la terre et de ses hommes, de la liberté et des travailleurs. Après les Martyrs ridicules, présentes par Baudelaire, où Cladel, railla la paresseuse et vicieuse bohème, ce furent Pierre Patient, le Bouscassié, les Va-nu-pieds, Celui de la Croix aux boeufs, Ompdrailles, Crète-Rouge, Kerkadec, N’a qu’un œil, etc., tous ces types surprenants d’une vie populaire et d’une épopée qui dépasse V. Hugo en vérité réaliste et en ferveur humaine. Puis, posthume, ce fut I.N.R.I, le plus beau poème qui ait été écrit à la gloire de la Commune et de ses défenseurs. Cladel a été leur Homère.
Romantique et naturaliste, a été aussi Jules Vallès, mais plus en marge des deux écoles que Cladel, Hommes et œuvres tout différents. Si Cladel possédait foncièrement l’enthousiasme de la vie populaire, Vallès était dominé par la sainte haine de 1’injustice sociale ; elle entretenait en lui une douloureuse amertume et une ardente révolte. Il les a exprimées avec force dans la trilogie de Jacques Vingtras : l’Enfant, le Bachelier, l’Insurgé, come dans son œuvre de pamphlétaire journaliste.
Octave Mirbeau fut aussi un esprit vivement irrité contre l’injustice sociale. En marge de l’école de Médan, il apporta dans le naturalisme l’esprit individualiste-anarchiste d’une nature extrêmement sensible, en révolte contre cette injustice et contre la sottise cynique de ceux qui y président. Son œuvre, pleine d’ironie, de colère et en même temps d’humanité, est d’autant plus énergique, généreuse, émouvante, qu’il sentait avec plus d’acuité et ne voulait pas désespérer de trouver « la petite flamme de la bonté », même chez le plus corrompu des hommes. Encore plus que contre Zola et contre Anatole France, la confrérie des tartufes s’est acharnée contre lui, et elle continue contre son œuvre dans tous les milieux, même démocratiques pour ne pas dire surtout démocratiques, où l’indépendance de caractère et la générosité de coeur sont considérées comme des tares aristocratiques. Les fausses-couches de la critique dévouée à cette boueuse intellectualité n’ont pas désarmé contre Mirbeau, même après que la maladie l’eut livré sans défense à des « maquilleurs de cadavres » qui l’enterrèrent « patriotiquement », et laissèrent M. Gustave Hervé baver sur sa tombe au nom, dit-il, de :
« Tous les révoltés, de tous les gueux, de tous les traîne-misère, de tous les parias, de tous les opprimés !... »
Citons parmi les romans de Mirbeau, tous marqués de son talent profondément personnel : le Calvaire, l’Abbé Jules, Sébastien Roch, le Jardin des Supplices, le Journal d’une femme de chambre, Dingo, etc.).
On doit à des écrivains que Mirbeau influença particulièrement, et surtout à Ch.-L. Philippe, l’expression d’un sentimentalisme à la fois primitif et compliqué, qui s’exprima dans des histoires de simples êtres tout près de nous, et dont la vie et la pensée sont dépouillées des dernières conventions littéraires conservées par le naturalisme. C’est ainsi que Ch.-L. Philippe a écrit : Quatre histoires de pauvre amour, la Bonne Madeleine et la pauvre Marie, la Mère et l’Enfant, Bubu de Montparnasse, le Père Perdrix, Marie Donadieu, Croquignole. Citons dans ce groupe : Lucien Jean (Parmi les hommes) ; Léon Werth (la Maison Blanche, Claoet soldat, Clavel chez les majors, ces deux Clavel sont parmi les romans dits de la guerre les plus vrais et les plus sincères, Yvonne et Pijallet, Pijallet danse, etc.) ; Marguerite Audoux (Marie-Claire).
L’école naturaliste eut une queue dans « l’école naturiste » dont l’avortement est un épisode caractéristique du naufrage opportuniste des « intellectuels » dreyfusards. Adolphe Retté (la Seule nuit, Mémoires de Diogène, etc.), venant de l’anarcho-symbolisme, s’y arrêta quelque temps dans son voyage du Diable à Dieu. Jean Viollis en fut le meilleur romancier (Monsieur le Principal, la Flûte d’un sou, Bonne fille, etc.) quoiqu’aient insinué les boueux de la critique que sa dignité offensait. Après lui Eugène Montfort (la Chanson de Naples, Cécile, la Belle enfant, César Casteldor, etc.) fait tenir à l’école naturiste une place honorable dans le roman naturaliste. Un autre appendice du naturalisme est le « populisme ». Espérons qu’il sera la dernière formule littéraire dressée entre les hommes et la vie.
Le roman a pris un tel développement au XIXème siècle, et les écrivains qui l’ont plus ou moins illustré lui ont apporté des conceptions et donné des aspects si divers, qu’il est impossible, sans arbitraire, de classer tous ces écrivains dans un groupe déterminé. On ne peut qu’indiquer des rapports plus ou moins vagues pour le plus grand nombre d’entre eux.
Dans la première moitié du siècle, Charles de Bernard (la Femme de quarante ans, Gerfaut, l’Innocence d’un forçat, etc.), fut d’esprit et de formes balzaciens. Jules Sandeau (Mademoiselle de la Seiglière, Madeleine, Jean de Thommeray, etc.), d’abord collaborateur de George Sand qui lui prit la moitié de son nom, s’en sépara. Sa distinction académique ne pouvait s’accommoder de l’exubérance romantique de sa compagne. Emile Souvestre (les Derniers Bretons, Un Philosophe sous les toits, etc.), bon peintre des mœurs bretonnes, fut un romancier moral. Pontmartin, pamphlétaire légitimiste, fit des romans « distingués », sans plus (Mémoires d’un notaire, le Fond de la coupe, Entre chien et loup, etc.). Paul de Kock apporta, dès 1813, une verve gaiement réaliste avec l’Enfant de mm femme. Pendant cinquante ans, il alimenta le feuilleton d’une littérature innombrable, amusante, d’un esprit satirique et piquant et qui est injustement dédaignée aujourd’hui. Champfleury, qui publia en 1847 Chien-Caillou, fut appelé le « chef de l’école réaliste ». Il recherchait la réalité, disait-il, avec l’ardeur d’un bûcheron. Il en a plutôt fait un système. Ce fut sa seule gloire car ses nombreux romans sont bien oubliés. Enfin, dans ce premier demi-siècle, Claude Tillier mérite une place à part. Il y apporta une fraîcheur de pensée et un esprit satirique tout populaires qui donnèrent à Mon Oncle Benjamin et à Belle Plante et Cornélius une éternelle jeunesse.
Après 1850, Henry Murger (Scènes de la vie de Bohème, le Pays latin, etc.) mit du réalisme dans un romantisme débraillé tant par le style que par les mœurs. Personne n’écrivit plus mal que lui. Sa bohème, toute de convention, ne visait qu’à épater le bourgeois pour arriver, si possible, à épouser sa fille et ses écus et faire alors du rapin crasseux, du littérateur hyperbolique, un homme « comme il faut », marguillier de sa paroisse, « maire et père de famille » , comme a dit Verlaine. Ce type de bohème a été de tout temps. Il foisonne dans cette cour des miracles qu’on appelle « l’aristocratie républicaine », parmi tant de « pistons de la machine » à qui le bonneteau politicien permit de donner congé à l’anarchie, consolatrice des purotins. Mimi Pinson, dont les chansons entretinrent « l’héroïsme de l’arrière » de 1914 à 1918, et la Muse de G. Charpentier, que couronna l’Institut, sont des enfants de Murger. De la bohème de 1850, plus célèbre par son impécuniosité que par son talent, il faut nettement dégager Gérard de Nerval qui prouva sa sincérité par sa mort, et son talent par une œuvre de véritable artiste et d’écrivain supérieur. Dans le roman, il a écrit : le Rêve et la vie, les Filles de feu, la Bohème galante, etc. qui sont du meilleur impressionnisme romantique.
Ernest Feydeau (Fanny, le Secret du bonheur, la Comtesse de Chalis, etc.) fut un précurseur du naturalisme. Par contre, Octave Feuillet (le Roman d’un jeune homme pauvre, Julie de Trécœur, Monsieur de Camors, etc.) donna le ton de l’idéalisme sirupeux pour les familles bien pensantes. Cependant il les bouscula quelque peu pour l’immoralité de leurs mœurs. Victor Cherbuliez (le Comte Kostia, etc.) écrivit dans le même genre mondain avec quelque excentricité philosophique. Georges Ohnet (les Batailles de la vie) le continua avec des frissons héroïques, en opposant les classes aristocratique et bourgeoise, mais de façon à ce qu’elles s’entendissent toujours sur la question d’argent, et l’on arriva ainsi, dans le bocage fleuri de l’idyllisme bourgeois, à Mme de Coulevain qui croit que les vaches ont été créées pour qu’elle puisse mettre de la crème dans son café ! Les Léon de Tinseau et Zénaïde Fleuriot mirent le genre à la portée des humbles, lecteurs de l’Ouvrier et des Veillées des Chaumières, éblouis à l’idée que leurs maîtres avaient tant de vertus. André Theuriet ajouta à cet éblouissement le goût des mœurs rustiques. Ces mœurs furent d’un tout autre ton chez Eugène Le Roy (Jacquou le Croquant, le Moulin de Frau, Mademoiselle de la Ralphie, etc.), écrivain autrement vigoureux et sincèrement populaire, puis, plus tard, chez Louis Pergaud (la Guerre des Boutons, De Goupil à Margot, Mirant chien de chasse, les Rustiques, etc.).
Erckmann-Chatrian écrivirent du bon roman populaire, historique et rustique, avec un esprit nettement anti-guerrier et démocratique (l’Ami Fritz, le Juif polonais, Histoire d’un paysan, Histoire d’un conscrit de 1913, etc.). Ferdinand Fabre montra un naturalisme rude et franc dans ses peintures de mœurs campagnardes et ecclésiastiques (les Courbezon, l’Abbé Tigrane, etc.). Emille Pouvillon fut aussi un romancier des moeurs champêtres (l’Innocent, Chante-Pleure, les Antibel, etc.). Edouard Rod, d’abord naturaliste (Palmyre Veulard, la Femme de Henri Vanneau, etc.), passa à ce qu’il appela « l’intuitivisme » pour écrire des romans moraux (la Sacrifiée, la Vie de Michel Teissier, l’Inutile effort, etc.). Edmond About (Tolla, le Roi des Montagnes, l’Homme à l’oreille cassée, etc.) fit une œuvre pleine de fantaisie et d’esprit. Alphonse Daudet (Lettres de mon moulin, le Petit Chose, Jack, le Nabab, Sapho, Numa Roumestan, Tartarin, etc.) semble avoir subi l’emprise de l’école naturaliste plus qu’il n’était dans son tempérament. Peut-être se serait-il endormi sur le molleton du roman sentimental bourgeois sans la forte influence de Zola et des Goncourt. En bon Provençal qui se forçait pour être morose, il a agréablement doré de soleil et farci de « galéjade » nombre de ses œuvres. Mais le véritable esprit populaire provençal lui échappa ; on le trouve plus exact dans Maurin des Maures, de Jean Aicard, que dans les Turtarin. Pierre Loti fut un impressionniste, à la fois romantique et réaliste, de l’exotisme (Mon frère Yves, Pêcheurs d’Islande, le Spahi, Madame Chrysanthème, etc.). Il y eut enfin deux formes de romans pour la jeunesse qui eurent le plus grand succès : le roman d’aventures à la Mayne Reid, dont Gustave Aimard a été le principal auteur en France, et le roman scientifique dans lequel Jules Verne a anticipé sur des inventions dépassées depuis (navigation sous-marine et aérienne), ou qui sont encore à réaliser (communications interplanétaires et autres). Ces romans ont eu une nombreuse suite d’imitations motivée par leur vogue persistante.
Le romantisme a eu son prolongement dans deux écoles, celles des « parnassiens » et des « symbolistes » (voir Symbolisme), qui se sont quelque peu mêlées. Barbey d’Aurevilly (Une vieille maitresse, l’Ensorcelée, le Chevalier des Touches, les Diaboliques), fut un dandy du catholicisme et du satanisme. Il a influencé Léon Bloy dans la voie du catholicisme et Huysmans dans celle du satanisme. Les romans de L. Bloy (le Désespéré, la Femme pauvre) sont des pamphlets dont la langue est plus solide que les idées. On ne sait comment faire la part de la sincérité et celle de l’attitude chez ce « mendiant ingrat » si souvent en contradiction avec lui-même. Jean Lorrain (les Buveurs d’âmes, Monsieur de Bougrelon, Monsieur de Phocas, Monsieur Philibert, etc.) fut un autre dandy, celui de la pègre équivoque vivant de la haute et basse prostitution des filles du ruisseau qui s’anoblissent et deviennent des dames pieuses, et des filles nobles qui roulent dans le ruisseau. Il a le premier dépeint, avec une observation aiguë, le monde alors spécial, vers 1900, des maniaques, des intoxiqués, des sadiques, des mouchards, des marlous qui sont arrivés, depuis la guerre dite « régénératrice » de 1914, à former « l’élite dirigeante »!... Elémir Bourges (le Crépuscule des dieux, Sous la hache, les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent), fut le plus magnifique évocateur du rêve dans le roman symboliste. Péladan fut le meilleur romancier du symbolisme. Il lui donna son œuvre la plus significative dans les seize volumes de la Décadence latine. Il fut ensuite plus réaliste dans les Amants de Pise, les Dévotes d’Avignon, etc. Son style est d’un maître écrivain. Rémy de Gourmont (Sixtine, etc.) a été le plus compliqué et le plus nuageux des écrivains de la « vie cérébrale ». Le style de ses romans est étrangement artificiel à côté de celui, si aisé et si clair, de ses Promenades littéraires et philosophiques. Symbolistes et parnassiens écrivirent généralement bien, mieux que les naturalistes, en bons disciples de la forme, tels : Villiers de l’IsleAdam (Isis, Tribulat Bonhomet, l’Eve future, Contes cruels, etc.) visionnaire de génie qui promenait l’âme pure d’un Don Quichotte dans une bohème parfois fangeuse où on le pillait en l’insultant ; Pierre Louys (Aphrodite, la Femme et le Pantin, les Aventures du roi Pausole) aussi délicat et spirituel romancier que poète ; Henri de Régnier (la Double maîtresse, la Pécheresse, le Bon plaisir, etc.) qui para le libertinage mondain d’affectation académique.
Plus réalistes que romantiques ont été, ou sont encore, Catulle Mendès (la Maison de la Vieille, Zohar, Gog, etc.), François Coppée (le Coupable), Jean Richepin (la Glu, les Etapes d’un réfractaire, Miarka, etc.), Colette (les Vrilles de la vigne, Claudine, Toby-chien, etc.), Rachilde (les Hors-nature, le Meneur de louves, la Jongleuse, etc.). Entre Paul Hervieu, romancier très supérieur (Peints par eux-mêmes, l’Armature, etc.), et le très inférieur M. Henry Bordeaux, ombre falote du déjà falot M. Paul Bourget, mais que les critiques aspirant à l’Académie flagornent à l’envi, Marcel Prévost, Henri Lavedan, Abel Hermant, René Boylesve et d’autres ont continué sous des aspects divers le roman mondain.
Nous terminerons ces indications sommaires sur le roman français d’avant 1914 par Anatole France et Romain Rolland qui lui ont apporté des notes différentes mais également fortes et dignes de les faire distinguer parmi les romanciers contemporains. Anatole France (le Crime de Sylvestre Bonnard, Thaïs, la Rôtisserie de la reine Pédauque, le Lys rouge, Histoire contemporaine, l’Ile des Pingouins, la Révolte des Anges, les Dieux ont soif, etc.) à qui on peut appliquer plus qu’à tout autre le titre de « parfait magicien des lettres françaises », a donné au roman la note d’un dilettantisme supérieur, inspiré de Renan, et que la question sociale a fortement influencé, mais sans qu’il sorte d’un souriant scepticisme. Il est d’un réalisme que la finesse de l’expression rend encore plus aigu dans l’observation de ses contemporains, de leurs mœurs et de leur pensée ; c’est chez lui qu’on retrouvera la plus exacte notion de ce qu’ils ont eu d’odieux et de ridicule. Il est en même temps d’un idéalisme dont l’éloquence, nourrie de belles lettres, le rattache à la véritable famille humaniste, celle du coeur et de l’esprit. Romain Rolland (Jean Christophe, Colas Breugnon, Pierre et Luce, Clérambault, l’Ame Enchantée), également nourri d’humanisme, possède un idéalisme plus convaincu et une foi plus agissante, plus communicative. Moins parfait dans la forme — certains prétendent même qu’il écrit mal — il est plus chaleureux dans l’expression d’une pensée qui vient profondément de l’âme et non seulement du cerveau. Il est soucieux avant tout de la hauteur spirituelle qui seule fait la vraie joie de l’esprit et commande la véritable discipline sociale. Qu’il lève son verre avec son compère Colas Breugnon, qu’il chante ou pleure avec Beethoven, ou qu’il médite avec Goethe, Tolstoï et Gandhi, il est toujours un vrai fils de Rabelais, un de ces hommes « d’honneur » de la Thélème pour qui « science sans conscience est la ruine de l’âme » et de la société.
Avant de parler du roman dans le temps actuel, voici quelques indications très générales sur ce qu’il a été à l’étranger. Il y a suivi, comme en France, les différents courants littéraires (voir Littérature) et il y a produit des œuvres non moins intéressantes.
En Italie, Boccace fut le plus célèbre des premiers romanciers. Il subit l’influence française dans son Filocolo et ses Contes. L’influence espagnole fit fleurir au XVIème siècle les romans légers de Pascoli, de Caviceo, de Franco, et ceux, moraux, de Selva et de Besozzi. Au XVIIème, les Marini imitèrent d’Urfé et La Calprenède. Le XVIIIème fut sans éclat. Le romantisme, d’essence toute nordique, donna son empreinte au roman italien dans Ultime lettere di Jacopo Ortis, d’Ugo Foscolo, qui est une imitation de Werther, et dans divers romans historiques à la façon de Walter Scott, tels que Promessi Sposi, de Manzoni. Ses successeurs ont assez médiocrement illustré le genre du roman.
L’Espagne et le Portugal s’alimentèrent longtemps des conteurs français, avant de leur rendre très insuffisamment ce qu’ils leur avaient pris dans les imitations boursouflées des Amadis. Il est vrai que Cervantès paya très largement la dette de son pays avec son immortel Don Quichotte. Le genre le plus intrinsèquement espagnol est celui du roman picaresque tel que l’a créé Mendoza. Seule l’Espagne du XVIème siècle pouvait offrir au monde ces contrastes de richesse et de misère, de noblesse et de mendigoterie, d’ascétisme et de luxure. Don Quichotte vengea à la fois la vraie noblesse et la vraie morale, sans que, pour cela, l’immoralité cessa de triompher ; mais elle prit le costume de Tartufe avec la morale de Loyola. Romans galants, pieux, sentimentaux, se succédèrent ensuite dans une fadeur générale qui fut la caractéristique de la littérature espagnole depuis sa décadence, et qui n’a pas cessé bien que les Jésuites aient dû renoncer aux autodafés depuis cent ans.
Le roman anglais, après avoir été soumis aux influences françaises et espagnoles jusqu’au XVIIème siècle, prit alors un caractère original qui le classa à l’avant-garde de la littérature préromantique, à côté de la production poétique et dramatique de Shakespeare. Il inaugura dans le genre des aventures maritimes et dans celui du sentiment dont le Robinson Crusoë, de Daniel Foe et la Paméla de Richardson, furent les chefs-d’œuvre au XVIIIème siècle. Walpole ressuscita un moment le roman de chevalerie. Les caractères nationaux furent dépeints par Maria Edgeworth que continuèrent Walter Scott dans le roman historique, Goldsmith et Dickens dans le roman bourgeois. Peu influencé par le naturalisme, le roman anglais est resté national et Ruydard Kipling est de nos jours le représentant le plus exact des tendances impérialistes anglaises.
En Allemagne, le roman garda longtemps le caractère légendaire des œuvres du moyen-âge. Il resta sous les influences étrangères, chevaleresques, satiriques, picaresques, sentimentales, jusqu’au jour où Wieland, Gœthe et Jean-Paul Richter lui donnèrent un caractère national. Le Wilhelm Meisler, de Gœthe, n’a pas d’équivalent en France dans le roman sentimental et philosophique.
Le roman russe n’exista guère avant Gogol. Il prit depuis cet auteur une importance considérable avec Herzen, Tourgueniev, Dostoïevski, Tolstoï, Gorki. Il s’orienta nettement vers le naturalisme. Il est aujourd’hui l’espoir de la littérature appelée « prolétarienne ».
Enfin, il ne faut pas oublier, d’autant plus qu’ils sont des écrivains de langue française ayant enrichi le roman de plusieurs œuvres remarquables, les écrivains belges parmi lesquels nous citerons Camille Lemonnier, qui appartint au naturalisme (Happe-Chair, les Charniers, le Mâle, les Concubines, Madame Charvet, la Faute de Madame Charvet, la Légende de vie, etc.), Georges Eckhoud (Kermesses, Cycle patibulaire, Escal Vigor, la Nouvelle Carthage, etc.) et Eugène Demolder (la Route d’Emeraude, le Jardinier de la Pompadour). En Suisse, le romancier de langue française le plus célèbre fut Rodolphe Töpffer.
On dit que l’art étant indifférent à toute morale, à tout utilitarisme, l’artiste doit rester en dehors des préoccupations sociales, au-dessus des passions politiques et de la lutte des classes. On ajoute, en ce qui concerne le roman : les plus remarquables et les plus célèbres sont ceux qui ne manifestent aucun esprit de parti. Tout cela peut être vrai, mais si c’est accepté par tous les partis. Or, que voit-on ? Alors qu’on oppose ces arguments à ceux qui montrent un esprit vraiment populaire et favorable à un progrès social, on voit des hommes de régression se livrer à la plus active et à la plus sournoise propagande de mensonge et d’excitation antisociale pour la défense des intérêts privilégiés. L’art ne doit pas être humanitaire, laïque, révolutionnaire, parti de gauche, clament les bons apôtres de l’art pour l’art ; mais ils le font guerrier, clérical, patriotique, réactionnaire, parti de droite, tout en niant la souveraineté de sa fonction sociale !
Leur art s’est toujours manifesté dans cette double fonction souveraine qu’ils ont cherché à faire exclusive de tout autre : glorification des turpitudes dirigeantes, glorification de l’ignorance et de la passivité dirigées. Exaltation du crime d’en haut depuis que :
« Le crime heureux fut juste et cessa d’être crime. »
Exaltation de la vertu d’en bas dans la soumission et l’acceptation de tous les abus et toutes les iniquités. Tuer, piller, mentir, forfaire à l’honneur et à la justice, se livrer à la crapule et perdre toute dignité, est grand, héroïque, sublime, suivant les circonstances, si elles profitent aux « ventres solaires », aux « oiseaux sacrés », aux « pistons de la machine ». Ces choses sont les pires excès, les pires hontes, les pires dégradations, si elles sont commises en bas par les « gens de rien », les « espèces inférieures », les « cochons de payants ». Telles sont la morale sociale et la morale du roman sous leur double aspect militant. Ceux qui crient le plus contre le roman à tendances sociales sont ceux qui en usent le plus comme poison social.
Deux aspects, mais complémentaires, nullement opposés. L’un n’est que sot, bien qu’il soit le plus brillant ; il désarme par sa stupidité. C’est celui de la classe bourgeoise s’adorant elle-même, en extase devant son nombril, barbotant avec ivresse dans l’ordure de son ineptie. C’est le roman mondain qui offre ce spectacle. Il a comme prototype de ses auteurs M. Paul Bourget, ce « cochon triste », comme l’appelait Emile Augier, ce « gâteux précoce », comme l’a qualifié Victor Méric. Pour M. Bourget, avant 1914 l’humanité n’était intéressante qu’à partir de cent mille francs de rentes, environ un million de francs aujourd’hui ! L’autre aspect est plus dangereux, plus hypocrite, plus malfaisant. C’est celui du roman qui verse dans l’âme populaire, dans les cerveaux primaires ignorants et crédules, le poison du mensonge, de la résignation, de la soumission à l’esclavage social, celui qui met dans les esprits ces calembraines suivant lesquelles le riche vaut mieux que le pauvre, parce que la richesse est le fruit du travail, de l’honnêteté, qu’elle récompense les gens de bien, les gens bien pensants, et qu’il faut obéir à ces gens que Dieu a choisis pour commander, pour diriger le monde coupable dans les voies de la rédemption. Car Dieu est « un brave homme » ! Les impies peuvent le railler, les méchants peuvent se dresser contre ses lois, les « anarchistes » peuvent semer leur haine et leurs sarcasmes ; il vient toujours un moment où il lève sa dextre auguste et intervient, vengeur, terrible, pour punir les impies et les méchants, pulvériser les « anarchistes » et récompenser la vertu. C’est le Deus ex machina qui se manifeste vers le trois centième feuilleton, quand l’auteur ne sait plus quelle couillonnade inventer, dans les romans de ces endormeurs du populaire appelés d’Ennery, Montépin, Richebourg et toute leur séquelle.
Ah ! les faux bonshommes de l’art pour l’art, les délicats prenant un air dégoûté devant un utilitarisme qui entretient pourtant grassement leur parasitisme, savent bien que l’art, pas plus que les autres formes de la vie, ne peut être indifférent devant la morale et les conflits sociaux. Ils seraient les premiers navrés, car ils pâtiraient plus que personne, s’ils étaient réduits eux-mêmes à la neutralité qu’ils réclament. Mais ils savent bien, et ils en abusent, que, plus que n’importe quelle littérature, le roman a son influence sur les idées et sur les mœurs, qu’il ne se borne pas à observer et à dépeindre. Il n’est pour cela qu’à voir l’usage qu’on en fait auprès des masses qu’il faut tromper sans cesse pour qu’elles restent serviles ; il n’est qu’à voir à quoi il sert au cinéma ; il n’est qu’à voir la place qu’il a prise dans l’information de presse destinée au « bourrage des crânes », à faire marcher les foules moutonnières et abruties suivant les intérêts des quelques grands coquins maîtres du monde.
Et c’est pour cela que le roman actuel, le roman qui a suivi la « Grande Guerre », est une chose inepte, une chose honteuse, parce qu’il est employé, en haut et en bas, à la pire besogne de sophistication, à cette œuvre d’infection et de mort à laquelle l’ humanité se précipite parce qu’il faut, dans l’intérêt des exploiteurs de sa sottise, de son incommensurable imbécillité, « empêcher le déchaînement d’un idéalisme sans fin », comme disaient les criminels qui ont préparé le déchaînement d’une sauvagerie sans fin quand ils ont fait le Traité de Versailles et les suivants.
Emmanuel Berl a montré, dans deux pamphlets peut-être trop verbeux, pas assez en coups de trique comme ceux d’un Gorki, que la pensée et la morale bourgeoises étaient mortes. Elles sont comme le monde dont elles ont été l’expression spirituelle — si ce n’est pas offenser l’esprit que de les appeler ainsi -, elles sont en train de crever avec lui. Dans cette légion de « m’as-tu-lu », de cabotins, — qui vivent du roman actuel, lui faisant faire le trottoir, mendigotant des prix littéraires, dédicaçant leurs œuvres dans des boutiques pour le premier chaland venu, semblant dire eux-mêmes que l’homme n’en aurait pas pour son argent avec la seule matière imprimée, — dans ce monde poseur et grotesque, il y a encore de belles âmes, nous croyons même qu’il y en a beaucoup, mais épouvantées, découragées, incapables de réagir et de remonter un courant qui se déverse de plus en plus en cataractes. Ceux qui, parmi les simples hommes, ne veulent pas croire à l’extinction du l’esprit, à l’affaissement définitif des consciences devant l’argent, devant la violence, devant le fascisme, suivent avec une anxiété profonde ceux qui luttent contre le courant ; mais chaque jour c’en est un de plus, en qui on croyait, qui se laisse emporter. Un sourire d’odalisque officielle, un déjeuner avec un ministre « ami des lettres » qui vous a fait demander la décoration que vous vouliez refuser si on vous l’offrait, un bon contrat avec un libraire ou un journal, des promesses académiques ; et c’est encore un homme à la mer, la mer de la fortune et des honneurs. Ils peuvent après cela se donner l’air de mépriser la belle indépendance d’un Flaubert, d’un Villiers de l’Isle-Adam, d’un Deubel. Ceux-ci avaient une autre fierté, sans parler du talent.
La pagaille est telle, aujourd’hui, dans le monde des « dépositaires de la pensée », l’insanité bourgeoise a tellement réduit l’horizon de l’esprit, que rien ne fait prévoir quelle pourra être la part de la littérature, du roman en particulier, dans l’œuvre de transformation sociale et humaine qui doit sortir des convulsions actuelles. Il y a certes des hommes de talent et des œuvres intéressantes ; tous, qu’ils soient de « droite » ou de « gauche », sont des embaumeurs du vieux cadavre du passé, aucun n’annonce la vie nouvelle. En 1852, Flaubert écrivait : « Je crois que le roman ne fait que de naître, il attend son Homère ». Il attend toujours cet Homère qui sera celui des temps nouveaux.
— Edouard ROTHEN
ROMANTISME
Le mot romantisme vient de l’adjectif romantique, d’origine anglaise (romantic), synonyme de romanesque, et qui est passé dans la langue française vers le milieu du XVIIIème siècle. A cette époque, il fut de mode d’appeler « romantiques » les constructions et les jardins répandus par le goût anglais, et où la libre nature remplaçait l’ordonnance classique des Perrault et des Le Nôtre. Le néologisme romantique a été créé lorsqu’ii s’est agi de qualifier une forme de pensée et d’art affranchie des règles du classicisme du XVIIème siècle. Par suite, les romantiques ont été les partisans du romantisme et de son école.
Si on ne considère le romantisme que dans la doctrine de l’école qui s’est manifestée sous son nom à partir de 1830, il n’est, comme l’a défini Victor Hugo, que « le libéralisme en littérature ». Champfleury a dit que « sa doctrine avouée fut la liberté dans l’art ». C’était rétrécir le point de vue, car il n’est pas de liberté dans l’art si elle n’est partout, et on le vit bien lorsque l’on constata que les libéraux en art furent des conservateurs en politique, tandis que les libéraux en politique furent des conservateurs en art. Les romantiques furent royalistes et catholiques ; les libéraux furent les défenseurs du classicisme. Cela dura jusqu’au jour où ils s’entendirent tous pour être des bourgeois politiques et remplacer la réaction aristocratique et légitimiste par une réaction démocratique et républicaine.
Mais le véritable romantisme a des sources et un fond bien antérieurs au mouvement d’art et de littérature de l’époque de 1830 ; son importance est autrement grande que celle d’une doctrine et d’une école artistiques et littéraires. Le véritable romantisme est non seulement la « liberté dans l’art » — formule vide de sens si elle ne comporte pas aussi la liberté de l’artiste — mais il est la liberté dans la vie toute entière, dans toutes les formes de la pensée et de l’activité humaines. Il est la manifestation de l’esprit contre son asservissement et, comme tel, la protestation contre un pacte social arbitraire qui viole la liberté ; il est l’explosion des passions et des sentiments naturels à l’individu, hors des conventions d’un ordre qui prétend les faire servir contre l’individu. Il est en particulier le mouvement d’idées formé au XVIIème siècle pour retourner à l’humanisme deux fois dévoyé, par la scolastique médiévale et par le classicisme. Comme la Renaissance au XVIème siècle, il a cherché à ramener à la liberté le grand courant de la pensée humaine, ce courant formé lorsque l’homme est devenu « la nature prenant conscience d’elle-même », suivant la magnifique expression d’Elisée Reclus, lorsque la nature spirituelle s’est révélée à lui par une connaissance de plus en plus étendue, lui permettant de s’arracher aux abstractions pernicieuses du divin pour s’élever dans la lumière de l’humain. C’est ainsi que Paul Souday a pu dire très justement que le romantisme n’était pas le « vague à l’âme » qui en a été une déformation et une mode, mais qu’il était « dans un effort de la raison pour atteindre à une vaste compréhension des choses ». Comme l’humanisme, le romantisme, effort de la nature humaine pour se grandir dans la nature spirituelle, est éternel — dans la mesure où l’est l’humanité -, car il est dans celle-ci la part de la libre nature, de l’imagination, du sentiment, la revendication de la personne humaine et sa libre manifestation.
PRÉROMANTISME ET ROMANTISME.
Ce grand mouvement de pensée s’est produit avant le romantisme proprement dit. Il a été ce qu’on a appelé : le préromantisme.
Il a été l’œuvre des « philosophes » du XVIIIème siècle.
Il avait eu ses précurseurs dans Fénelon, La Bruyère, Vauban, Fontenelle et les cartésiens. Sa première manifestation avait été sur le terrain de l’art dans la « Querelle des Anciens et des Modernes ». Celle-ci avait ouvert le conflit qui aboutirait à 1789 sur le terrain social. Le préromantisme fut, dans tous les domaines de l’humain, le développement de cet esprit critique dont les premières formes littéraires avaient été dans Rabelais, La Boétie, Montaigne, et qui se transmit par Gassendi et Descartes dans la philosophie. Il bouleversa toutes les conceptions de ce que M. Cresson a appelé « le fétichisme de la révélation ». Il jeta à bas tout l’échafaudage de la philosophie scolastique, tant dans les spéculations métaphysiques que dans les sciences naturelles, et tous ses dogmes, toutes ses disciplines arbitraires. Il appartiendrait au romantisme proprement dit d’en recoller les morceaux.
Ce romantisme proprement dit ne vint qu’après la Révolution. Il devait être son couronnement, le libre épanouissement de l’humain affranchi du passé et portant tous les espoirs de l’avenir. Il fut un avortement. Non seulement il ne sut pas défendre et maintenir les courants dont il était issu, mais il les combattit, et rarement de front par les moyens obliques d’un catholicisme qu’il contribua à restaurer. Le romantisme, réduit au « libéralisme en littérature » et à la « liberté dans l’art », devint une boutique où l’art et la littérature furent de moins en moins révolutionnaires, de plus en plus bourgeois, comme le libéralisme devint de plus en plus le parti politique du conservatisme social. Il a fait de la liberté une nouvelle grue qui a rejoint au ciel métaphysique Dieu, la Patrie et la Fraternité universelle.
A quoi tient l’avortement du romantisme ? Il a deux causes principales : l’insuffisance de sa préparation scientifique devant la nouvelle situation économique créée par le machinisme, et son impuissance à opposer de nouvelles notions morales aux assauts d’un individualisme de plus en plus dépourvu de scrupules. Le préromantisme était né d’un besoin de vérité et de liberté d’autant plus impérieux qu’il ne se basait pas sur des réalités concrètes et ne savait pas où il allait, il voyait ce qu’il pouvait démolir mais non ce qu’il aurait à construire contre l’ignorance et la sottise momifiées par delà leurs formules. Les Copernic, Kepler, Galilée, Descartes, Newton, Christophe Colomb, Vasco de Gama, Magellan, avaient apporté une autre conception du monde que celle du temps d’Hérodote. Les conciles de papimanes étaient devenus impuissants à empêcher la Terre de tourner autour du Soleil. Dans le domaine sentimental on avait assez de consignes qui étouffaient toutes les tendances naturelles de l’homme et contraignaient ses mœurs au nom de l’hypocrite morale des tartufes maquillés en « honnêtes gens ». Il semblait que pour changer le monde on n’avait plus qu’à souffler sur tous les vieux phantasmes, comme il semblait au peuple qu’il n’avait qu’à brûler les châteaux pour abattre la tyrannie. On ne paraissait pas se rendre compte qu’il fallait forger tout un ordre nouveau en coordonnant les connaissances et les aspirations nouvelles.
La première manifestation de l’esprit romantique fut dans le besoin de retrouver la nature, de s’évader des conventions et de leurs réalités malpropres et tyranniques, de respirer un air plus pur et de goûter la liberté. On commençait à voyager. On désirait voir une nature plus libre, d’autres hommes dont parlaient des relations de voyageurs. Mais on craignait d’aborder l’inconnu, on était effrayé par les glaciers, les torrents, les précipices aperçus de loin, du bas des montagnes, des prés et des lacs où l’on promenait une rêverie nostalgique. Vers 1730, l’anglais John Spence disait : « J’aimerais beaucoup les Alpes s’il n’y avait pas les montagnes ». Il préludait à ce snobisme qui ne les aime aujourd’hui que parce qu’il y retrouve ses coiffeurs, ses danseurs mondains, ses gigolos de palaces et de casinos, sa T. S. F. et tous les éléments de sa vie abrutissante. Le lyrisme romantique, tout artificiel, s’exalta d’autant plus devant la montagne qu’il la connaissait moins. Elle lui parut le refuge de toutes les vertus humaines, dans les villages bienheureux de ses vallées. La pureté primitive des âmes devait y égaler celle des sommets et l’oppression devait y être inconnue des hommes fiers et hardis pour qui les cimes étaient les « forteresses de la liberté » (Schiller : Guillaume Tell).
Le paysage romanesque anglais fut le premier décor du romantisme ; il en fut aussi la première expression. Aux grands parcs, on ajouta des cascades, des rochers, des ruines, des grottes, des souterrains, des tombeaux plus ou moins truqués qui rappelèrent le moyen-âge. Dans ce milieu se développa le deuxième aspect du romantisme, la rêverie, la mélancolie, le « vague à l’âme » né de l’insatisfaction de l’être, qui deviendrait le « mal du siècle » dans le conflit de plus en plus aigu entre le rêve et la réalité. Par réaction sentimentale contre la sécheresse de l’esprit d’analyse du XVIIème siècle et son insupportable insincérité, ce fut un débordement de passion et aussi de désolation et de désespérance. Une littérature romanesque en sortit qui fut le produit d’un matagrabolisme de plus en plus morbide.
Quand Goethe publia Werther, en 1774, et introduisit le suicide romantique dans la littérature, il ne fit, comme il le dit lui-même, que « manifester les rêves pénibles d’une jeunesse malade, se faire l’écho, l’expression d’un sentiment universel ». Il n’avait très probablement pas lu Werther cet « amant inconnu » qui vint se tuer près du tombeau de Rousseau, à Ermenonville, et inaugura ainsi la longue série des suicides dont la mode ferait une véritable épidémie quand elle passerait, après 1830, chez les clercs de notaires et les garçons de boutiques provinciaux. Rabelais aurait dit que le monde était devenu « marmiteux », c’est-à-dire triste par affectation. Aussi, est-ce à tort qu’on a reproché au romantisme littéraire d’avoir provoqué les excès des mœurs de son temps. Comme toutes les modes littéraires, le romantisme n’a été que le reflet des idées et des coutumes. Remy de Gourmont a écrit fort justement qu’il « ne fut pas seulement un mode de littérature, mais encore, et surtout, un mode de sensibilité ». Ce mode de sensibilité était dans l’air, depuis le milieu du XVIIIème siècle, et il n’était pas particulier à un pays ; il était européen. Le romantisme a été européen. Il a été « un de ces vastes mouvements, ou, si l’on veut, de ces remous de profondeur, où il semble qu’il n’y ait pas un flot qui pousse l’autre, mais un ébranlement de toute la masse » (Daniel Mornet). Le romantisme fatal sembla porter le deuil de la vieille société avant qu’elle fût écroulée. N’ayant pas assez de foi, d’enthousiasme et surtout de volonté d’action révolutionnaire, crevant d’ennui, il s’abandonna au « mal de vivre », à tous ses relâchements et à toutes ses capitulations. Mais cet eunuque voulut se donner un air viril en saluant la « beauté du geste », du geste négatif ; ce déserteur de la lutte pour la liberté se posa en aristocrate en se renfermant dans « l’art pour l’art ». Le mal de vivre fut général, dans Goethe (Werther), dans Jean-Paul (Siebenkoes), dans Foscolo (Jacopo Ortiz), dans Byron (Manfred) et dans les œuvres françaises qui suivirent René et Obermann : Adolphe, de B. Constant, Chatterton, d’A. de Vigny, Joseph Delorme, de Sainte-Beuve, Lélia, de G. Sand, Arthur, d’Ulrich Guttinguer, etc...
Peu à peu, cette réaction sentimentale poussa l’individu à une introspection de plus en plus maladive, à une panique du « conscient » devant l’envahissement de « l’inconscient » à une obnubilation progressive du sens de l’humain et du collectif pour ne considérer que le « moi » et arriver à « l’état d’âme » du « héros » romantique, de l’individu centre du monde, désespéré de ne pouvoir résoudre les « énigmes de l’univers » et commander à leurs phénomènes. On maudissait la vie, la « cuisine ignoble et fade » des basses réalités qu’elle imposait à des êtres épris d’idéal. Pour rien au monde, un Chateaubriand, comblé de tous les dons, n’aurait voulu se déclarer heureux ; il se serait cru déshonoré s’il eût fait paraître une âme sereine. Le « volcanisme » grondait dans toutes les poitrines. On rugissait : « Enfer et damnation ! » On eût voulu cracher du feu, lancer des éclairs et copuler avec le diable comme dans l’opéra de Meyerbeer.
Aussi, le premier décor romantique ne suffit-il plus, bientôt, à l’imagination, même en y ajoutant les Alpes vues à distance, des rives du Léman où le snobisme faisait accourir les admirateurs de la Nouvelle Héloïse. On y ajouta toute la fantasmagorie moyenâgeuse, d’une part. D’autre part, l’exotisme apporta un décor et une forme de sensibilité nouveaux, l’engouement pour les paysages des îles lointaines, des pampas américaines, et pour le sauvage dont les qualités primitives étaient perdues pour le civilisé. C’est Lahontan qui semble avoir fourni, dans ses Dialogues rapportés d’Amérique et publiés au commencement du XVIIIème siècle, le type du « sauvage de bons sens ». Il a incontestablement inspiré l’exotisme de Marmontel, de B. de Saint-Pierre et de toute une série de romans, les Azakia et les Celario qui affadirent jusqu’à l’écœurement les images du « bon sauvage » aimant, fidèle, chevaleresque et pacifique. Chateaubriand lui-même a pris dans Lahontan son personnage d’Adario des Natchez, Il est non moins incontestable que l’œuvre de Lahontan contient la substance de tout ce qu’écrivirent sur les rapports de l’homme et de la nature en conflit avec la civilisation, Rousseau, Voltaire, Diderot, Mably, etc. L’exotisme produirait le goût de l’orientalisme qui serait le dada des romantiques de 1830. Plus exact que l’exotisme, l’orientalisme serait enrichi par l’observation directe que rapporteraient de leurs voyages Musset, G. Sand, Mérimée, Th. Gautier, Gérard de Nerval, Flaubert, pour arriver ensuite à la vérité psychologique et documentaire des romans de Mme Judith Gautier sur l’Extrême-Orient.
En fait, les préromantiques, et après eux les romantiques ne furent que très peu des « hommes de la nature ». Leurs impressions furent plus imaginées que réelles. Ils ne demandèrent à la nature qu’un brillant décor pour leur virtuosité sentimentale. L’exotisme et l’orientalisme abondèrent en clichés. Il faudrait attendre le naturalisme pour qu’on aimât et qu’on étudiât réellement la nature. Jusque là, il n’y eut guère qu’un Rousseau pour y transporter ses « rêveries d’un promeneur solitaire », un Senancour pour entretenir sa mélancolie dans « la permanence silencieuse des cimes, un Walter Scott pour en décrire la vraie poésie, et les poètes lakistes pour y puiser véritablement le réconfort de l’âme.
Si artificiel, et parfois si niais, qu’ait pu être le nouveau culte de la nature, il ne manquait pas d’avoir un motif profond dans le besoin de transformation sociale. En attendant les actes révolutionnaires, les esprits se nourrissaient d’un idéalisme de plus en plus exalté qui faisait monter la température romantique. Rousseau lui communiquait toute sa puissance explosive en niant la nécessité de la raison dans la direction des mobiles humains et en remettant cette direction à la seule loi du sentiment, guide infaillible par lequel le coeur devait commander le cerveau. C’était le renversement total de la métaphysique sociale du vieux monde. C’était l’anarchisme auquel il ne manquait que de faire une place à la raison afin d’équilibrer les facultés du coeur et du cerveau, du sentiment et de l’esprit, pour le rendre capable d’enfanter un monde nouveau où l’homme serait véritablement « la conscience de la nature ». Cette exaltation de l’homme dans la nature tendait à établir l’égalité entre les individus et non à susciter l’individualisme orgueilleux, bouffi de mégalomanie toujours insatisfaite que le romantisme produirait.
Aussi, y a-t-il un abîme entre un Rousseau et un Chateaubriand. L’un représente l’optimisme préromantique faisant confiance à la bonté foncière de l’homme. L’autre est l’image du pessimisme romantique ayant décidé que tout est mauvais dans la vie et aboutissant au suicide. L’un rêvait de liberté, d’égalité, de fraternité ; l’autre, dévoré d’aristocratisme s’abandonnerait au culte de la force. Ce fut Chateaubriand qui créa le héros romantique, le cabotin parfois génial, mais le plus souvent sot, ridicule et malfaisant, celui dont Sucy disait, à propos de Bonaparte :
« Je ne lui connais pas de point d’arrêt autre que le trône ou l’échafaud. »
Si le préromantisme avait entretenu le « mal du siècle », l’ennui, la lassitude de vivre, on doit au romantisme, depuis Chateaubriand, le besoin de « paraître » (Voir ce mot). C’est à l’auteur de René qu’on doit le type du dominateur, du dictateur, de « l’homme d’exception dont les défauts sont plus beaux que les vertus des autres, les misères plus délicieuses que tous les bonheurs de ceux qui ne sont pas lui. C’est lui (Chateaubriand) qui a donné aux romantiques ce goût tenace d’occuper le monde d’eux-mêmes, l’illusion d’être le centre de l’univers » (Daniel Mornet). Napoléon pouvait venir ; Chateaubriand préparait la drogue littéraire, le sortilège qui érigerait le bandit en héros.
Grâce à Napoléon, le romantisme a inauguré le « beau » dans le crime de la guerre. C’est ce Napoléon qui disait, devant le champ de bataille de La Moskova où 90.000 hommes étaient morts ou blessés, devant ce charnier où râlaient les mourants dans le sang, la boue et la puanteur :
« Je ne le croyais pas si beau!... »
C’est cette sorte de romantisme que M. Robert de Flers, académicien du Figaro, magnifiait quand il écrivait :
« Le sommet de l’idéal romantique ne doit-il pas être placé à l’instant où celui qui avait dominé le monde mourut sur le rocher de Sainte-Hélène ? »
C’est pour cela qu’on est toujours romantiquement « fier d’être Français quand on regarde la colonne » !... Napoléon n’en fut pas moins — lui aussi — un romantique sentimental. Ugolin ne pleurait-il pas quand il dévorait ses enfants ? Comme tous ses contemporains, Bonaparte, avant d’être Napoléon, s’était :
« Livré aux désirs et aux palpitations de son coeur sur des bancs argentés par l’astre des amours. »
Il a raconté cela dans un simili-roman intitulé Clisson et Eugénie où l’on peut lire encore ceci :
« Il est d’autres sentiments que celui de la guerre, d’autres penchants que la destruction. Le talent de nourrir les hommes, de les élever, de les rendre heureux, vaut bien celui de les détruire. »
Le sinistre cabotin n’avait pas encore découvert la « beauté » des champs de bataille.
L’abîme n’est pas moins grand entre le spiritualisme d’un Rousseau, adorateur de l’Etre Suprême, du Grand Architecte, du Grand Horloger qui a fait le monde et accroché le balancier des harmonies de la nature, et celui d’un Chateaubriand, restaurateur du catholicisme. Certes, la théorie des harmonies était bien puérile, surtout vue dans des ouvrages comme les Etudes de la nature, de B. de Saint-Pierre. La divinité qui y présidait n’était pas très subversive et Voltaire l’amendait encore en disant :
« Il faut une religion pour le peuple. »
Mirabeau ajouterait :
« Dieu est aussi nécessaire au peuple français que la liberté. »
Et Robespierre dresserait le culte de l’Être Suprême contre les athées anarchistes et communistes voulant que la nature fût bonne pour tous les hommes. Les étrangleurs de la Révolution n’auraient plus qu’à adjoindre à la religion le droit de propriété pour faire sombrer la liberté sous ses deux négations fondamentales : Dieu et l’État. Malgré ce, Rousseau demeurait un ferment de désordre, puisqu’il repoussait les disciplines catholiques. Son naturisme et son panthéisme étaient à l’antipode du Génie du Christianisme : ils étaient hérétiques aux yeux de l’Eglise et, si elle n’osait envoyer Rousseau au bûcher en même temps que La Barre, elle brûlait ses livres, le Contrat Social et l’Emile. La religion du cœur ne pouvait être confondue avec celle des dogmes, quelle que fût l’habileté des casuistes du néo-catholicisme alors naissant. Il y avait entre eux le bûcher, ce bûcher que l’Espagne rallumerait en 1823, grâce à la « glorieuse » victoire française du Trocadéro.
Le spiritualisme de Chateaubriand fut l’esprit du catholicisme rétabli dans sa malfaisance temporelle et sa puissance sociale, dans les formes concordataires de collaboration avec le pouvoir. Chateaubriand et le romantisme aidèrent à réencapuciner la France. Jusqu’en 1830, le romantisme fut monarchiste et catholique, en réaction flagrante avec la pensée et l’œuvre préromantique et révolutionnaire. Il subit cette attraction psychologique qu’Oscar Wilde a constatée ainsi :
« Partout où se produit un mouvement romantique en art, là, d’une façon et sous une forme quelconque, se trouve Christ ou l’âme du Christ. »
Par le caractère imaginatif de sa nature, le Christ est :
« Le centre palpitant du romantique. » (O. Wilde : De Profundis)
Après la Révolution de 1830, les romantiques ne devinrent frondeurs que politiquement, et Baudelaire a pu observer ceci :
« Si la Restauration s’était régulièrement développée dans la gloire, le Romantisme ne se serait pas séparé de la royauté ; et cette secte nouvelle, qui professait un égal mépris pour l’opposition politique modérée, pour la peinture de Delaroche ou la poésie de Delavigne, et pour le roi qui présidait au développement du juste milieu, n’aurait pas trouvé de raison d’exister. » (Baudelaire : l’Art romantique)
L’intérêt personnel des romantiques, qui affectaient si superbement d’autre part leur détachement de « l’utilitarisme » au nom de la doctrine de « 1’art pour l’art », leur faisait favoriser le « voltairianisme » bourgeois du « roi-parapluie ». Ce voltairianisme qui plongeait l’homme dans un bain de religiosité vague, d’humanitarisme émollient, rendrait les travailleurs incapables d’énergie et d’organisation devant les fusilleurs de l’Ordre.
En 1869, Flaubert écrivait à Michelet :
« Je crois qu’une partie de nos maux viennent du néo-catholicisme républicain. J’ai relevé dans les prétendus hommes de progrès, à commencer par Saint-Simon et à finir par Proudhon, les plus étranges citations. Tous partent de la révélation religieuse. »
Ce néo-catholicisme républicain s’était développé grâce à la bourgeoisie romantique et voltairienne arrivée au pouvoir et qui avait fait la loi Falloux sous la République de 1848. La même année 1869, Michelet avait écrit dans sa préface à son Histoire de France :
« En juillet (1830), l’Eglise se trouva désertée. Aucun libre-penseur n’aurait douté alors que la prophétie de Montesquieu sur la mort du catholicisme ne dût bientôt être accomplie. »
Mais, ajoutait-il :
« Le choléra moral qui suivit si près juillet fut le désillusionnement, la perte des hautes espérances. »
L’ART POUR L’ART.
Durant le règne de Louis Philippe, 188 romantiques s’enlisèrent dans l’égoïsme social, dans l’amoralisme béat de « l’art pour l’art » dressé contre l’ « utilitarisme » par l’artiste superbement indifférent à l’origine de la fortune assurant son « indépendance » et aux calamités publiques : guerres, choléra, banqueroutes, crises économiques ne l’atteignant pas personnellement.
« L’art pour l’art » fut le cheval de bataille des romantiques de 1830 ; ce fut leur grande faiblesse et ce fut le mal qu’ils transmirent à la littérature. Depuis, dans toutes les écoles littéraires, il a été le masque le plus hypocrite de l’égoïsme individuel et du muflisme. Il continue à stériliser l’art, à le tenir hors de la vie comme il a fait du romantisme après l’avoir vidé de tout véritable lyrisme, jaillissement spontané de l’être intime qui est celui de la nature tout entière, après l’avoir fait se recroqueviller dans cette psychologie spéciale qui entretient l’égotisme exagéré, le besoin effréné chez l’individu de « paraître », de poser pour sa statue, tels Chateaubriand sur son rocher, Th. Gautier dans son gilet rouge, G. Sand et toutes les « muses » du temps écrivant le roman de leurs amours avec de grands ou de petits hommes. Le lyrisme romantique ne fut plus que conventionnel, dépourvu de toute sincérité. Il fut un immense « chiqué ». Dès lors, il importa peu qu’au point de vue des règles, de la forme, le romantisme nous fit « repasser de l’abstraction à la poésie », puisque sa poésie était aussi fausse que l’abstraction, et que :
« Quoiqu’il ait pu sembler d’abord faciliter l’invention aux dépens de l’art, il ramène l’art à la place du mécanisme. » (Lanson)
Si cet art n’est pas plus vrai, plus sincère, plus humain que celui qu’il remplace, il ne fait que mettre un nouveau mécanisme à la place de l’ancien.
C’est chez Théophile Gautier que « l’art pour l’art » trouva sa théorie absolue, à savoir que l’art est indépendant, au-dessus de tout, qu’il est affranchi de l’utilité, de la morale, et même de la pensée et des idées ! La tonne seule importe!... Ainsi, on repoussait Racine pour remonter à Rabelais, mais on s’arrêtait avec Bridoye. De Th. Gautier sont sorties les exagérations des « épateurs de bourgeois », des exhibitionnistes de l’immoralité, des excentriques de la « couleur locale » et des techniciens de l’impersonnalité qui semblent assister des hauteurs de Sirius à la mêlée humaine. Mais il n’est pas exact que, comme a dit M. Lanson, Th. Gautier a engendré Baudelaire. Ce qui fut attitude, parti-pris, excentricité chez Gautier, fut sensibilité aiguë et profonde du coeur, noblesse de l’âme chez Baudelaire. Son immoralité n’a nullement été du cynisme ; elle a été la juste révolte, on peut dire la révolte désespérée contre la cafardise bourgeoise qui l’accabla toute sa vie et en fit un parla jusque dans ses plus proches et plus chères affections. Ses Lettres à sa mère, publiées dernièrement, en apportent un témoignage particulièrement émouvant. On est bien loin du romantisme devant une pareille douleur. Parce qu’il fut le plus douloureux des hommes, il fut, contrairement à Gautier, le plus lyrique des poètes. Si son œuvre est dans sa forme d’une beauté indépassée, si elle est aussi « coruscante » que des Emaux et Camées, elle n’est pas un étalage de pierreries pour éblouir les nouveaux riches, ni un feu d’artifices pour ébahir les badauds ; elle est pétrie de pensée, nourrie de méditation, elle jaillit et saigne d’une âme ulcérée qui porta en elle toute la douleur du monde et n’eut pas la consolation d’être celle d’un dieu, Baudelaire, penseur et précurseur, dont le génie critique eut si souvent l’intuition de vérités auxquelles les romantiques restèrent fermés, les jugeait ainsi et, avec eux, les théories de « l’art pour l’art » :
« Certainement, il y aurait injustice à nier les services qu’a rendus l’école dite romantique. Elle nous rappela à la vérité de l’image, elle détruisit les poncifs académiques, et même, au point de vue supérieur de la linguistique, elle ne mérite pas les dédains dont l’ont iniquement couverte certains pédants impuissants. Mais, par son principe même, l’insurrection romantique était condamnée à une vie courte. La puérile utopie de l’école de l’art pour l’art, en excluant la morale, et souvent même la passion, était nécessairement stérile. Elle se mettait en flagrante contravention avec le génie de l’humanité. Au nom des principes supérieurs qui constituent la vie universelle, nous avons le droit de la déclarer coupable d’hétérodoxie. » (L’Art romantique)
Il dit encore non moins nettement :
« Congédier la passion et la raison ; c’est tuer la littérature... Le goût immodéré de la forme pousse à des désordres monstrueux et inconnus. Absorbées par la passion féroce du beau, du drôle, du joli, du pittoresque, car il y a des degrés ; les notions du juste et du vrai disparaissent. La passion frénétique de l’art est un chancre qui dévore le reste et, comme l’absence nette du juste et du vrai dans l’art équivaut à l’absence d’art, l’homme entier s’évanouit ». Et, prophétiquement, il ajoutait : « Le temps n’est pas loin où l’on comprendra que toute littérature qui se refuse à marcher fraternellement entre la science et la philosophie est une littérature homicide et suicide. »
Michelet avait dit de son côté :
« Je restai à bonne distance des doctrinaires, majestueux, stériles ; et du grand torrent romantique de « l’art pour l’art », j’étais un monde à moi. »
Cette dernière phrase serait du plus parfait romantisme si l’on ne savait que ce « monde à moi » de Michelet s’étendait à toute « l’humanité qui se crée ».
Dans sa préface à Mademoiselle de Maupin, Th. Gautier s’est donné le plaisir facile de déshabiller et de fustiger comme il convenait les moralistes, espèce particulièrement malpropre de gens qui enseignent la vertu en fourrant avec délices leur groin dans toutes les ordures, et vitupèrent ceux qui rejettent toute hypocrisie pour vivre sainement et proprement. C’était ce que Stendhal appelait le bégueulisme...
« Art de s’offenser pour le compte des vertus qu’on n’a pas. »
C’était ce que représentait magistralement un Pinard qui requérait contre l’immoralité de Madame Bovary et qui était un collectionneur de cartes transparentes. Mais Th. Gautier s’est profondément fourvoyé lorsqu’il a voulu dégager l’art de toute promiscuité utilitaire, et il a apporté dans le débat plus de virtuosité que d’arguments, ne s’apercevant pas même, dans son ardeur, de ses propres contradictions. C’est ainsi qu’il écrivait :
« Rien de ce qui est beau n’est indispensable à la vie... Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien ; tout ce qui est utile est laid, car c’est l’expression de quelque besoin, et ceux de l’homme sont ignobles et dégoûtants, comme sa pauvre et intime nature. »
Mais, en même temps, il expliquait qu’une nature comme la sienne avait besoin de l’art et que, parlant, il lui était utile ! Qu’avait donc la « nature » de th. Gautier de plus que celle des autres hommes ? Cyrano de Bergerac aurait ajouté à cette question :
« Et que celle d’un chou ou d’un escargot ? »
C’était bien là l’effet de l’égotisme romantique réduisant tout à soi-même. Comment s’étonner dès lors que Th. Gautier, comme tous les romantiques, ait montré une si complète ignorance de la question sociale ? Lui, comme eux, n’ont pas vu, dans leurs ripostes contre les socialistes aussi sottes que celles des Prudhommes qu’ils vilipendaient, qu’il ne s’agissait pas de donner aux gens trop à manger, ni de les obliger à aller s’ennuyer à l’audition d’une symphonie ou à la vue d’un tableau, ni de leur faire respirer les parfums des lis et des roses quand ils préféraient l’odeur des latrines. Ces choses-là étaient trop des « goûts » de bourgeois pour qu’on ne les leur laissât pas. Ce dont il s’agissait, et qui dépassait les facultés de compréhension bourgeoise, c’était de permettre à tous les hommes de manger à leur faim, de goûter les joies de l’art quand elles les attiraient, d’échapper à l’odeur des latrines quand ils préféraient les parfums des lis et des roses. On doit aussi à Th. Gautier cette vieille facétie de « l’homme de progrès » portant une queue de quinze pieds de long avec un œil au bout, qu’il lança contre les phalanstériens et qui fait toujours la joie des vieilles nouilles conservatrices dans les Café du Commerce de France. Th, Gautier n’en savait alors pas plus que ces fossiles édentés qui usent aujourd’hui leur énergie salivaire contre un autre « œil », celui de Moscou !...
Proudhon n’eut que trop de raisons de railler les « blagues romantiques », au nom du beau du vrai de l’utile réunis, contre les écrivains « corrupteurs et corrompus », car « l’art pour l’art » n’empêcha pas qu’après 1830 :
« On se rua en bas. Le roman, le théâtre éclatèrent en laideurs hardies. Le talent abondait, mais la brutalité grossière ; non pas l’orgie féconde des vieux cultes de la nature qui ont eu sa grandeur, mais un emportement voulu de matérialité stérile. Beaucoup d’enflure, et peu dessous. »
Michelet, qui écrivit cela, salua en même temps, avec une ironie douloureuse, le retour et la fraternelle entente de la religion catholique et de la religion de la banque :
« Les capuccini revenaient banquiers et industriels. »
Il y eut peut-être de « l’art » dans cette entente toute romantique ; il y eut certainement, et surtout, du banditisme social.
Le romantisme signa sa propre déchéance en 1848, par son attitude antipopulaire. Il fit, alors, au socialisme et à la classe ouvrière la réponse cynique des rois de la Sainte Alliance à Robert Owen leur demandant de supprimer le paupérisme :
« S’il n’y avait plus de pauvres, qui travaillerait pour nous ? »
Il fut d’autant plus odieux en France qu’il était arrivé à se dire républicain ! A l’étranger, où avaient persisté les formes aristocratiques de gouvernement, il n’eut pas à se montrer hypocrite ; il n’eut qu’à continuer à servir les princes, les nobles et le clergé.
Le romantisme, héritier infidèle de l’humanisme et du préromantisme a trahi ses origines et ses parentés les plus certaines. Il a livré aux « philistins » bourgeois la pensée et l’art qu’ii devait défendre ; il a abandonné la cause révolutionnaire qui devait apporter la « liberté dans l’art » en même temps que dans l’humain. Les romantiques devaient être des réformateurs, sinon des chambardeurs ; ils n’ont été que des amuseurs. Ils voulaient être Hamlet, ils n’ont été que Polonius.
INFLUENCES ÉTRANGÈRES.
Le besoin général, européen, d’une nouvelle vie intellectuelle, morale, sociale qui se manifesta au XVIIIème siècle avait fait affluer les influences particulières aux différents pays pour la formation romantique. Les deux principales furent celles de l’Angleterre et de l’Allemagne. Celle de l’Angleterre, la plus importante, s’exerça la première et joua un grand rôle dans le préromantisme français. Ce pays avait déjà fait la moitié du chemin révolutionnaire ; son influence fut surtout politique et sociale. Celle de l’Allemagne, plus tardive, affecta le romantisme proprement dit. Elle fut plus de convention, de sentiment et d’art. L’Allemagne attendait la Révolution française pour se révéler à elle-même. Au moment où elle prit son élan, Napoléon l’arrêta comme il arrêta celui de la France et le romantisme révolutionnaire tourna au romantisme littéraire. L’Allemagne apporta à celui-ci un fond de légendes moyenâgeuses fantastiques, hallucinantes et exagérément sentimentales. L’école romantique y trouva tout son bric à brac d’opéra et s’en contenta sans chercher à percer la pensée cachée. Elle ne comprit pas plus Goethe, Schiller et Beethoven qu’elle n’avait compris Shakespeare.
La France du XVIIIème siècle fut heureuse de s’adapter aux mœurs anglaises, plus libres que celles d’une étiquette imposée depuis deux siècles par les cagots et les tartufes aux âmes et aux pieds aussi noirs que leur costume. De même, elle fit le meilleur accueil à une littérature qui échappait aux règles classiques, qui prenait plus d’aisance, en attendant que la vérité lyrique et dramatique la débarrassât des stupides conventions d’une antiquité coiffée de perruques irisées, habillée de robes à paniers et madrigalisant suivant la mode des cours. Il ne s’agissait pas encore de tomber dans le ridicule qui consisterait, au nom de la liberté dans l’art, à déclarer mauvais tout ce qui était classique, de maudire Racine au nom de Shakespeare et de remplacer l’affectation précieuse par l’affectation du vulgaire ; mais il s’agissait de faire d’Oreste un Grec et non un marquis de Mascarille ou un petit abbé, et de Camille une Romaine et non une Montespan ou une Maintenon. Dès 1750, Garrick et une troupe de comédiens anglais vinrent à Paris jouer des pièces de Shakespeare, le « barbare », comme l’appelait Voltaire resté littérairement classique. On ne le siffla pas, comme firent en 1822 les imbéciles protestataires contre l’art étranger, au nom de « l’honneur national »!... Au contraire. En 1750, si on ne comprit pas Shakespeare, on l’applaudit, on le traduisit, plutôt mal, il est vrai, et le roi souscrivit pour l’édition de la traduction de Letourneur.
Le romantisme anglais redécouvrit les vieux poètes Chaucer et Spenser, et la littérature du temps d’Elisabeth. Il retrouva les vieilles ballades d’avant la domination anglo-saxonne, que peuplaient les lutins et les fées des forêts mystérieuses et des lacs ténébreux. Les poètes des lacs, appelés lakistes, ouvrirent la voie à Byron et à Walter Scott. L’influence de la poésie romantique anglaise fut très grande. Elle est la plus lyrique du romantisme. Non seulement la personnalité de l’auteur y domine ainsi que l’émotion et la passion, l’imagination et le sentiment, mais elle est le retour à « la spontanéité naïve des âmes simples, aux grands instincts de l’humanité, que la vie mondaine et sociale n’a réussi qu’à voiler, aux joies tranquilles et douces des humbles, à l’intérêt pour les petits parce qu’ils sont si naturellement humains » (P. Berger : Les préromantiques anglais). Thomson (1700–1748), avait commencé l’évolution préromantique vers la nature avec ses Saisons (1730) qui furent traduites et répandues dans l’Europe entière, imitées en France par Saint Lambert (Les Saisons), Roucher (Les Mois), Delille (Les Géorgiques), et mises en musique par l’autrichien Jh. Haydn. Le même Thomson inaugura aussi la première forme romanesque, légendaire et allégorique dans son Château de l’Indolence où il imita Spenser. Avec Shenstone (1714–1763) et sa Maîtresse d’école, ce fut le romantisme pittoresque, fantaisiste et humoristique de la vie villageoise. Young (1681–1765), dans ses Nuits, fut le premier interprète anglais de cette mélancolie qui deviendrait le « mal du siècle ». Celui-ci, avant de conduire Werther au suicide dans la fiction littéraire, y entraîna, dans la réalité, le poète Chatterton (1752–1770), qui se tua à dix-sept ans, après avoir commencé une œuvre légendaire curieuse par ses archaïsmes. Son histoire douloureuse fournit à A. de Vigny le sujet de l’œuvre la plus sincère et la plus pathétique du théâtre romantique. La note caractéristique de la poésie anglaise de l’époque fut apportée par Gray (1716–1771), avec son Elégie dans un cimetière de campagne (1751), et ses autres poèmes où il mêla la poésie des légendes à la sienne propre. Blair et Collins le précédèrent ou le suivirent dans la même voie. Mais la trompette romantique sonna surtout sur le nom d’Ossian, sorte d’Homère irlandais dont de vagues poèmes étaient demeurés depuis des siècles et dont l’œuvre prétendue fut brusquement révélée par Macpherson (1736–1796), sous le titre Fingal qui fut le monument de la perfection romantique jamais atteinte encore. Fingal, paru en 1762, fut répandu dans le monde entier, particulièrement en Allemagne, avec le nom d’Ossian et eut encore plus d’échos que les Nuits de Young. Le goût de l archaïsme fut, après Chatterton, celui de Percy (1729–1811). Crabbe (1754–1832), fut plus réaliste et actuel. Son Village, paru en 1783, est une œuvre de révolte contre la société indifférente à la misère du peuple. Cowper (1731–1800), souffrant et sensible, fut d’un romantisme élégiaque et d’un désespoir moins théâtral que celui de Byron. Burns (1759–1791), appelé le « Shakespeare de l’Ecosse », à la fois romantique et réaliste, fut le plus humain par l’expression autant que par le sentiment. Enfin, Blake (1757–1827), « contempteur de la Raison » et « apôtre de l’Absurde », commença le vrai romantisme littéraire avec sa sensibilité et ses exagérations.
Le romantisme anglais trouva sa plus pure expression chez les poètes lakistes, Wordsworth et Coleridge, que la gloire de Byron a trop fait oublier. Wordsworth (1770–1850), possédé de bonne heure par un véritable amour de la nature et de la liberté, fut plein d’enthousiasme pour la Révolution Française, jusqu’au jour où, comme son compatriote Southey, il eut la douleur de la voir sombrer sous Bonaparte. Réfugié dans les montagnes, au bord des lacs de Cumberland et de Westmorland, guéri des héros sinon des hommes, il retrouva son optimisme humain qui se renforça dans l’amitié de Coleridge. Celui-ci (1772–1834), autre esprit enthousiaste de liberté, avait rêvé de fonder avec Southey un « refuge pour la vertu » qui aurait été appelé la Pantisocratie (pouvoir égal de tous). Il vint vivre près de Wordsworth et ils firent ensemble les Ballades lyriques, publiées en 1798. Autour d’eux se forma toute une société littéraire qui fut celle des lakistes, à laquelle appartinrent Walter Scott et Thomas de Quincey. Personne n’a montré mieux qu’eux combien la beauté est faite d’harmonie entre la nature et l’humain. Shelley (1792–1822), a été plus près d’eux que Byron.
Byron (1788–1824), fut le protagoniste le plus lyrique de l’héroïsme romantique, avec ses inquiétudes, ses aspirations idéales, ses élans fougueux, tout cela emporté, chaotique, sans équilibre de pensée et sans mesure. Il ne contribua pas peu à faire perdre la tête aux « Jeune France ». Une autre influence anglaise, bien moins heureuse, parce qu’elle n’eut pas l’excuse du génie, fut celle du roman qu’on a appelé « frénétique » et « noir », mélodramatique et fantastique, plein de récits de séductions, d’enlèvements, de substitutions d’enfants, de viols, de meurtres, d’emprisonnements, auxquels le satanisme, l’hypocrisie familiale et les vices ecclésiastiques apportèrent généralement leur mystère et leur horreur. Il se développa à côté des excentricités rabelaisiennes de Sterne (1713–1768), auteur de Tristram Shandy et du Voyage sentimental. Bien avant Walpole (1717–1797), auteur halluciné du Château d’Otrante (1767), qui est considéré comme le père du genre, Richardson (1689–1761), l’avait inauguré dans sa Clarisse Harlowe (1749), qui rencontra partout un succès inouï et ouvrit la voie d’une littérature de plus en plus indigne aux faiseurs du roman populaire. On doit à Richardson le type de Lovelace, sorte de Don Juan bourgeois. Lovelace a eu une postérité variée et monstrueuse. Lewis en a fait le personnage d’Ambrosio dans son roman Le Moine, un des plus célèbres du romantisme anglais, paru en 1797. Par Walpole et Beckford (1759–1844), celui-ci auteur de Vathek, le genre passa à Anna Radcliffe (1764–1823), auteur de la Forêt de l’abbaye de Sainte-Claire, des Mystères du château d’Udolphe, du Confessionnal des pénitents noirs, où la folie religieuse et les formes les plus imprévues du sadisme moinillant se livrent aux plus furieuses sarabandes. Il fut continué par Maturin (1782–1824), avec son Melmoth, mistress Shelley (1797–1851), avec son Frankenstein ; Lewis (1775–1818), avec Le Moine, et aboutit à Walter Scott (1771–1832), dont le talent de romancier est éclairé par un sentiment de la nature encore plus vrai que celui de Rousseau.
En France, en dehors de quelques spécimens spéciaux et mal connus, le roman frénétique sombra dans le moralisme ancillaire de Ducray-Duminil, corrigé par la polissonnerie égrillarde de Pigault-Lebrun et mis en tirades théâtrales par Pixerécourt. Ils furent les pères du roman-feuilleton et du mélodrame qui ont fourni, depuis cent-vingt ans, à un nombre incalculable de Français, leur pâtée morale et sentimentale. C’est à eux qu’on doit la réhabilitation du « bon Dieu » qui sentait un peu trop le soufre dans les romans anglais. L’influence de la littérature frénétique et noire fut telle sur les esprits que le jugement de Balzac lui-même en fut obnubilé au point qu’il admira les romans de Mme Radcliff, compara Lewis à Stendhal et plaça Maturin entre Molière et Goethe ! Il en subit une sorte d’envoûtement. Certains de ses premiers romans en sont de véritables imitations : le Centenaire, le Vicaire des Ardennes, Argow le pirate, l’Enfant maudit, etc. Il alla même jusqu’à transposer Célina, l’enfant du mystère, de Pixerécourt, dans son Héritière de Birague. De son côté, V. Hugo a fait de son Claude Frollo une pâle réplique de l’Ambrosio du Moine. Il lui est inférieur dans le dénouement, l’expiation du damné, qui est la plus belle page du roman de Lewis. Byron, Walter Scott, Fenimore Cooper, eurent des influences nombreuses et plus ou moins heureuses sur le romantisme français. Il s’écarta par contre de celles de Wordworth, de Coleridge, de Shelley, qui eussent pu être plus bienfaisantes.
En se répandant dans les mœurs, le romantisme perdait en qualité et devenait de plus en plus vulgaire pour ne pas dire bas et crapuleux. C’est ainsi qu’en 1829, la société anglaise fut occupée à la fois par Byron et un nommé Burke, qui s’était établi fournisseur de cadavres pour les amphithéâtres des hôpitaux, et qui fabriquait des macchabées par l’assassinat quand la mort ordinaire ne lui en fournissait pas assez. La langue fut enrichie du verbe burker : « étouffer une personne pour livrer son corps aux chirurgiens ». La littérature s’empara de ce réalisme macabre pour alimenter le romantisme le plus imprévu. C’est alors que Thomas de Quincey écrivit son ouvrage : De l’assassinat considéré comme un des Beaux Arts, où il mêla une ironie digne de celle de Swift à ses observations de chroniqueur judiciaire d’un journal. Les « beaux assassinats » furent alors fréquents, par contagion romantique. La France compta comme illustration dans ce genre le poète-assassin Lacenaire, qu’on appela le « Manfred du ruisseau ». Il adressa au roi une ironique Pétition d’un voleur à un roi, son voisin, qui commençait ainsi :
Je viens de sortir des galères...
Je suis voleur, vous êtes roi,
Agissons ensemble en bons frères. »
Continuant le parallèle gouailleur, le voleur demandait successivement un emploi de sergent de ville, de préfet de police, de ministre, puis finalement la place du roi :
Ladre, impitoyable, rapace ;
J’ai fait se pendre mon parent :
Sire, cédez-moi votre place ! »
Il fallait être déjà condamné à mort pour oser parler ainsi à un roi, même au roi-parapluie. Aussi cette condamnation et la guillotine ne suffirent pas à la vengeance de Louis Philippe que, de plus, la popularité de Lacenaire gênait, et il chercha à le faire passer pour encore plus criminel qu’il n’était par des récits mensongers répandus dans le public!...
En Allemagne, Hegel a défini la philosophie du romantisme. Il l’a vu dans le développement de l’esprit, dans la recherche de l’homme lui-même, et non dans les formes plus ou moins conventionnelles du monde sensible. Il l’a fait remonter ainsi à Socrate et aux stoïciens et il a, en particulier, dégagé le sentiment religieux de toutes les interprétations arbitraires de la scolastique et du classicisme qui l’a continuée, pour ne le voir que dans le panthéisme, le divin l’épandu dans l’univers tout entier. Il voyait l’individu guidé par ses passions et non plus par des conventions spirituelles et sociales qui avaient faussé sa vraie nature. C’était là la caractéristique des personnages de Shakespeare. Le romantisme se présentait ainsi comme la philosophie de l’humain harmonieusement uni par sa nature au divin universel, et pas du tout comme cette victoire du christianisme sur le paganisme dont Chateaubriand lui a donné les traits. Le même abîme qui sépare Châteaubriand du néo-christianisme de J.-J. Rousseau le sépare aussi de la philosophie de la nature d’Hegel.
L’interprétation hégélienne du romantisme avait eu son application littéraire et sociale dans le mouvement qu’on a appelé le Sturm und Drang. Ce mouvement correspondit en Allemagne au préromantisme français. Il fut la révolte de l’intelligence allemande étouffée depuis la Guerre de Trente ans sous des influences étrangères et sous des disciplines sociales oppressives. Ce fut le réveil de l’âme allemande et son effort vers le libre épanouissement de l’esprit et de l’être.
L’Allemagne possédait un lyrisme intrinsèque venu d’une âme collective qui plongeait ses racines dans la nuit des temps scandinavo-germaniques, dans les Eddas « chants ingénus qui sont l’émotion même jaillissant des profondeurs de l’humanité » (Ph. Chasles), et sont dépouillés de tout didactisme. C’est dans ces chants que Luther avait trouvé l’âme de la Réforme. Rejetés par cette dernière, devenue religion d’Etat et d’oppression, ils restèrent vivants dans les mémoires populaires demeurées primitives, avec toutes leurs légendes, leurs rêves, leur sentimentalisme et leur fantastique. C’est d’eux que sortit, encore plus émouvante et plus complète que la poésie des mots, l’expression la plus magnifique et la plus variée du lyrisme allemand dans toutes les formes de la musique, de Bach à Haydn, à Mozart, à Beethoven, à Schumann, à Schubert, à Weber, en attendant que se fût formée la langue littéraire qui serait celle de Klopstock, Lessing, Wieland, et que le préromantisme allemand trouvât ses maîtres dans Herder, Goethe, Schiller et Jean-Paul Richter, qui créèrent le vrai classicisme allemand. Herder avait dépouillé la philosophie allemande des bandelettes scolastiques et lui avait ouvert les yeux sur l’humanité. Goethe apporta à la pensée universelle le plus parfait équilibre de puissance, de grandeur et de beauté. Schiller lui communiqua les plus enthousiastes et les plus généreux élans, Jean-Paul Richter fut un Rabelais allemand par sa truculence sinon par sa philosophie déjà atteinte du « mal romantique », mal particulièrement allemand.
Durant la période d’étouffement de la pensée allemande, c’est à peine si l’esprit populaire avait pu tenter de se manifester dans le Simplicissimus de Grimmelshausen, au XVIIème siècle. Ce furent Bodmer et Breitinger qui commencèrent, dans le milieu du XVIIIème, par leur querelle contre Gottsched, l’œuvre de libération qu’on appellerait Sturm und Drang — ouragan et emportement — d’après le titre d’une pièce de Klinger, parue en 1776. Ce fut un mouvement d’esprit largement naturiste et humain, très nettement social en même temps que littéraire ; tout un groupe de jeunes poètes, parmi lesquels Klinger, Lenz, Wagner, Müller, etc., y participèrent. Mais avant, Goethe avait commencé, dès 1771, cette « période de l’assaut et de l’irruption » dans laquelle il apporta, pendant ses quatre années de Francfort, un véritable renouvellement de la littérature allemande. Ce furent Goetz de Berlichingen, Werther, la première conception de Faust, et de magnifiques Lieder, où toute la vieille poésie populaire jaillit de nouveau comme une source pure. Clavigo et Stella furent du même esprit avant que Goethe, conquis par les faveurs princières, commença sa vie « olympienne » de Weimar. Après que Klinger out donné son autre drame, les Escrocs (1780), Schiller fit un début impétueux avec les Brigands (1781). Il continua avec la Conjuration de Fiesque, dans laquelle il se montra ardent républicain, avec Intrigue et amour (1785), et ses poésies lyriques, parmi lesquelles cette Ode à la Joie, dont Beethoven fit l’admirable chant de sa Neuvième Symphonie. Après, Schiller rejoignit Goethe dans les régions olympiennes. La même année lui avait vu Intrigue et amour, parut Ardinghello ou les Iles bienheureuses, de Heinse. Ce furent les dernières manifestations du Sturm und Drang.
L’influence de ce mouvement aurait pu être beaucoup plus marquante et décisive sans la catastrophe napoléonienne qui frappa l’Allemagne encore plus que tout autre pays. Les élans généreux inspirés des sentiments de liberté et de fraternité humaine, les études philosophiques continuant l’œuvre de l’esprit critique du XVIIIème siècle, auraient pu se développer largement, avec plus d’universalité, si l’Allemagne n’avait pas été obligée de rentrer en elle-même, de se découvrir nationale et d’opposer à l’impérialisme d’un insane aventurier une résistance qui la conduirait aux plus démentes manifestations du culte de la force. Mais au temps où l’esprit du Sturm und Drang animait l’Allemagne, il faisait mériter à Schiller, comme à Anacharsis Clootz, à Campe, à Pestalozzi, à Klopstock, le titre de « citoyen français » que la Convention leur décernait le 26 août 1792. Ils étaient légion les Allemands que la Révolution Française avait enthousiasmés et qui virent leurs espoirs douloureusement brisés par la mégalomanie napoléonienne. Campe se retira dans la solitude ; Beethoven déchira avec fureur la dédicace de sa Symphonie Héroïque à Bonaparte, en qui il avait vu un héros et qui n’était « qu’un empereur » ! Fichte protesta contre « l’inexpiable crime » ; il convia l’Allemagne à recueillir l’héritage révolutionnaire renié par la France et à se faire le « héraut de la liberté ».
Le romantisme allemand se forma au milieu des troubles, des déceptions, des colères et des misères semées par Napoléon. Il ne fit pas la l’évolution allemande espérée ; il consolida la puissance princière et ecclésiastique, il fit œuvre de régression sociale comme il fit en France. Il ne sut même pas s’inspirer de la sereine harmonie de la pensée, de l’art et de la vie que Goethe avait réalisée. Le besoin de s’évader de plus en plus de la réalité lui fit prendre les formes littéraires et artistiques spéciales de l’abus du gothique, du bizarre, du fantastique, du merveilleux, de tout ce qui a fait le « mal romantique ». Jean-Paul Richter avait, un des premiers, exprimé ce mal dans ses Papiers du diable. Il en corrigea quelque peu l’expression dans ses autres œuvres : la Loge invisible, Hespérus, le Titan, Sibenkoes, et Schmelzle, sorte de Panurge ; il n’en fut pas moins le père du romantisme allemand. Ce qui ne fut qu’inquiétude et bizarrerie chez lui devint désespoir et démence chez ses successeurs. A côté de Jean-Paul Richter, Werner (1768–1823), apporta les mêmes tourments de l’esprit au théâtre. Son œuvre est agitée comme le fut sa vie, et son drame, Martin Luther (1807), est d’un romantisme caractéristique que Stendhal a fort bien analysé.
La forme du conte fut plus particulièrement favorable à la floraison du romantisme littéraire allemand, nourri des vieux conteurs millénaires adaptés d’abord par les fableaux français, puis par les Italiens et les Espagnols, de Boccace à Cervantès, jusqu’aux romans du XVIIIème siècle répandus par les « Cabinets de fées » et autres bibliothèques. L’Allemagne eut sa « Bibliothèque des romans » à partir de 1778. Les contes de Goethe eurent les heureux modèles qui favorisèrent le genre. Tieck et Novalis le continuèrent. Ils apportèrent la poésie dans la littérature narrative s’appliquant à exprimer le mystère de l’âme pénétrée de merveilleux, de puissance occulte puisée dans tout ce que la nature cache ou semble cacher pour le soustraire à la réalité perceptible. C’était là le caractère du conte défini par Goethe et par Novalis. Ils n’admettaient la réalité que dans ce qu’elle avait d’inouï, dans ce que l’imagination n’avait pas arrangé pour donner à penser que cela était arrivé. Le romantisme leur doit ce symbolisme qui le reliera par la suite à l’école symbolique. Baudelaire et Gérard de Nerval en seront particulièrement influencés. L’influence de Novalis, de son Ofterdingen en particulier, fut considérable sur le romantisme, et encore plus celle de Tieck, fantastique et terrifiant, bouleversant les événements humains.
A côté de ces conteurs, le groupe d’Heidelberg, avec Brentano (1778–1842) et Arnim (1781–1831), fut plus près de l’esprit populaire, sans abandonner le merveilleux. Brentano avait trouvé dans le monde de la fantaisie un refuge au-dessus de la « mare aux grenouilles » de la réalité souvent trop douloureuse pour lui ; il manifesta par la suite un cléricalisme effréné. Les grenouilles l’avaient pris et entraîné au fond de la mare. Arnim a fait figure de mystificateur par l’étrangeté de son mysticisme. Fouqué (1777–1843) apporta le goût des mythes et des légendes nordiques qui inspirerai eut le romantisme symbolique de Richard Wagner. La dualité de l’Ondine, de Fouqué, se trouve chez la plupart des héroïnes wagnériennes. Chamisso (1781–1838), auteur de Pierre Schlemiht, ne montra qu’une inquiétude tempérée, voulant se distraire par un récit d’une fantaisie agréable. Frédéric de Schlegel (1772–1829), développa dans son roman Lucinde (1799), la note épicurienne d’un sensualisme élevé, guidé par le culte du beau, qui a été reprise avec plus de démonstration théorique par Stuart Mill dans son livre l’Utilitarisme (1864). Schlegel, qui mit ses idées en pratique et fut imité par plusieurs romantiques, fut soutenu par le prédicateur Schleiermacher dans ses Lettres sur la Lucinde (1801).
C’est surtout à l’Allemagne qu’on doit le fantastique du romantisme. Les Aloysius Bertrand et tous les « frénétiques » français ne sont que de bien pâles illusionnistes, des démoniaques bien innocents à côté de ceux que couvèrent les « cabarets enfumés » où Brander et ses compagnons se « rougissaient la trogne », Henri Heine a remarqué à ce sujet : « Une démence française est loin d’être aussi folle qu’une démence allemande, car dans celle-ci, comme dit Polonius, il y a de la méthode ». Un Auguste Bürger (1747–1794) avait tiré un parti remarquable, dans ses célèbres Ballades, des vieilles légendes dramatiques populaires qu’il avait ranimées par la vivacité de ses propres passions. Un Eichendorff (1788–1857) réalisa un fantastique de bon ton, tout à fait moral et apaisant pour les familles, dans ses Pages de la vie d’un vaurien (1826), mais un Hoffmann (1776–1822) produisit le fantastique le plus allemand. Il fut conteur, dessinateur, musicien et eut une vie d’aventure le plus souvent semée de misère qui le poussa à l’abus des liqueurs fortes. Il en arriva à ne plus pouvoir travailler qu’en état d’ivresse. Son imagination était alors délirante, peuplée d’êtres diaboliques, en proie à la terreur, à des hallucinations, mais d’un caractère tout personnel. Le fantastique hoffmannesque montre une telle sensibilité qu’il fait participer l’humain à l’étrange, qu’il fait de celui-ci l’essence, le jaillissement de celui-là, alors qu’il n’est ailleurs qu’un procédé d’un merveilleux étranger à la nature humaine. C’est ainsi qu’Hoffmann fut parmi les romantiques un des plus véritablement lyriques. Il est le conteur qui a le mieux connu et utilisé les sciences psychiques qui transportent l’imagination dans le « monde invisible », Le succès d’Hoffmann, en France, fut très grand à partir de 1823, malgré l’insuffisance de la traduction Loève-Veimars. Des critiques revenus d’Allemagne le firent connaître. Il avait été déjà exploité par Latouche qui avait traduit et publié sa Mlle de Scudéry sous le titre d’Olivier Brusson, et par Jean Cohen, qui traduisit les Elixirs du Diable en leur donnant comme auteur un nommé Spindler. Hoffmann influença Musset, G. Sand, Balzac. Plusieurs œuvres de ces deux derniers portent la marque hoffmannesque. Celles de Th. Gautier, G. de Nerval et Mérimée encore plus. La mode fut à Hoffmann et, bien entendu, A. Dumas y trouva une mine où travaillèrent ses nombreux « nègres ».
Le succès d’Edgar Poe (1809–1849) arrêta la vogue d’Hoffmann. Mais nous arrivons à l’époque plus réfléchie, influencée par le naturalisme, du symbolisme dont Poe allait être un inspirateur, grâce à Baudelaire, qui traduisit ses œuvres et refléta son esprit. Poe fut un des plus grands artistes du romantisme littéraire. Intelligence supérieurement douée, caractère enthousiaste, généreux et révolté, il voulut, à dix-huit ans, se battre pour la Grèce, comme Byron, puis pour la Pologne. Malgré un travail acharné, il fut pauvre toute sa vie, victime des convenances anglo-américaines qui n’admettent pas l’indépendance de l’individu sans fortune, alors qu’elles sont si complaisantes à la fortune sans scrupules. Il fut poursuivi par la haine calomnieuse de cuistres impuissants comme ce Griswold qui s’acharna contre sa mémoire et fit dire à Baudelaire :
« N’y a-t-il pas, en Amérique, de loi qui interdise aux chiens l’entrée des cimetières ? »
La figure la plus caractéristique du romantisme allemand, sentimental, rêveur, inquiet, mystique, épris d’un idéal surnaturel sans aucune possibilité de composer avec le réel, avait été celle d’Heinrich de Kleist. Un Chatterton avait essayé de lutter et avait été vaincu, à dix-sept ans, par la misère plus que par le « mal du siècle ». Heinrich de Kleist vécut plus longtemps mais porta toute sa vie la nostalgie de la mort. S’il tarda à mourir, c’est qu’il lui fallait un compagnon pour « tirer le rideau » avec lui. Il ne le trouva qu’à trente-trois ans, en 1811, lorsqu’il réussit à entraîner dans la mort, avec lui, sa fiancée, Henriette Vogel. Gœthe tenait Heinrich de Kleist pour un grand poète et l’on a dit « qu’auprès d’un tel créateur, un Novalis et un Tieck s’évanouissent comme des ombres exsangues ».
Au romantisme allemand se rattachent, par la langue, mais non par l’esprit, les autrichiens Grillparzer et Lenau. Grillparzer (1791–1872) fonctionnaire viennois dont l’existence calme contrasta avec le bouillonnement romantique, fut l’interprète du véritable esprit de la capitale autrichienne. Lenau (1802–1850), d’origine aristocratique et silésienne, fut, tout au contraire, le poète d’un romantisme exalté ; il succomba dans la démence. Tous deux marquèrent par dessus tout le parti-pris de ne pas être d’esprit allemand, Ils vinrent assez tard dans le romantisme et n’en virent que les excès. Ils ne paraissent pas avoir été sensibles il son sens universel détaché de l’esprit de clocher et de caste.
LE ROMANTISME EN FRANCE.
Ce fut Senancour (17701846), qui réalisa le personnage le plus caractéristique, le plus sincère et le plus réfléchi du romantisme. Moins exalté et moins remuant que Kleist, plus indécis et plus solitaire, il trouva dans la nature le refuge de ses rêveries, sinon l’apaisement de son âme. Il fut, de son temps, un des rares hommes qui sentirent et aimèrent véritablement cette nature. Nul, plus que lui, n’éprouva ses « effets romantiques » , « l’harmonie romantique » de sa « langue primitive ». Un des premiers il chanta la forêt de Fontainebleau qui a trouvé depuis tant de poètes et de peintres. Il a vécu avec ivresse parmi :
« Ses fondrières, ses vallées obscures, ses bois épais, ses collines couvertes de bruyères, ses grés renversés, ses rocs ruineux, ses sables vastes et mobiles dont nul pas d’homme ne marquait l’aride surface... » (Obermann)
Avant Shelley, il fut le poète des splendeurs alpestres, des glaciers qui faisaient à Chateaubriand l’effet de « carrières de chaux et de plâtre » !... La mélancolie d’Obermann (1804) est aussi sincère que celle de René (1802) est affectée. Il y a, dans l’œuvre de Senancour « le romantique qui suffit seul aux âmes profondes, à la véritable sensibilité », alors que dans celle de Châteaubriand il n’y a que « le romanesque qui séduit les imaginations vives et fleuries ». Senancour, pour qui les affections de l’homme étaient « un abîme d’avidité, de regrets et d’erreurs » était trop sceptique pour trouver l’apaisement dans les soporifiques religieux. Il souffrait du mal de son époque. Chateaubriand se bornait à le mettre en roman en le délayant dans le julep du christianisme.
La véritable note française fut apportée dans la poésie romantique par Lamartine (Méditations, 1820, et Nouvelles Méditations, 1823), et Victor Hugo (Premières Odes, 1822, et Odes et Ballades, 1824). C’était une poésie nouvelle par la forme. Elle se manifesta par des œuvres, les théories n’étant pas encore formulées. Stendhal a été le premier des théoriciens romantiques. Par détestation de l’imitation classique qui n’était plus de l’époque, il s’était déclaré romanticiste et, dès 1823, il avait commencé la nouvelle bataille littéraire en posant la question :
« Pour faire des tragédies qui puissent intéresser le public, faut-il suivre les errements de Racine ou ceux de Shakespeare ? »
Toute une série d’articles pour la défense du romanticisme parurent sous sa plume et furent réunis dans le volume : Racine et Shakespeare. Mais Stendhal serait par la suite le moins romantique des romantiques. Il était trop sincère, aimait trop la vérité et détestait trop l’hypocrisie pour ne pas rompre avec le romantisme sentimental devenu une formule pour faire des dupes depuis la brutale fortune napoléonienne. Stendhal se plut à arracher leur masque sentimental aux beaux marlous, les Rastignac, les Rubempré, qui vivaient de la corruption des mœurs et que Balzac ménageait trop.
Vers 1823, Charles Nodier réunit chez lui le premier cénacle romantique. Nodier fut le romantique par excellence, par son besoin de mettre du romanesque en toute chose. Ses grandes qualités d’écrivain le firent exceller dans le conte où il ne fut pas inférieur aux Allemands. Il fut non moins romantique par la frénésie de son imagination et une remarquable insincérité le poussant à « paraître » et à étonner ses contemporains. La chose était alors plus neuve qu’aujourd’hui ; on pouvait encore en user honnêtement sans être absolument ridicule ou odieux. Le premier cénacle romantique compta les frères Deschamps, Vigny, Soumet, Chênedollé, Jules Lefèvre, etc. Hugo se réserva, à mi-chemin entre le classicisme et le romantisme, jusqu’en 1826 où il réclama la « liberté dans l’art », celle de tout dire, de tout représenter dans la réalité des sentiments humains. L’année suivante, tout en gardant une mesure que ses disciples n’observeraient pas toujours, il s’affirma avec fracas chef de l’école romantique dans la préface de Cromwell.
Le deuxième cénacle, formé en 1829, fut plus nettement romantique avec Nodier, Hugo, Vigny, Sainte-Beuve, A. Dumas, David d’Angers, etc. Les artistes entraient dans le mouvement à côté des littérateurs. Les événements politiques, avant-coureurs de juillet 1830, favorisèrent l’offensive qui fut prise audacieusement. Les représentations d’Henri III et sa cour, d’A. Dumas, à la Comédie Française, et la publication du Dernier jour d’un condamné, de V. Hugo, furent en 1829, les deux premières manifestations triomphales du romantisme. Hernani, d’Hugo, et Othello, traduit de Shakespeare par A. de Vigny, consacrèrent sa victoire définitive au théâtre (Voir ce mot). Le romantisme apporta dans la poésie française une abondance et un éclat incomparables qui se transmirent durant tout le siècle aux écoles dérivées de lui, celles des Parnassiens et des Symbolistes. Lamartine, V. Hugo, Vigny, Musset, Th. Gautier eurent de dignes continuateurs en Leconte de Lisle, Baudelaire, Banville, Verlaine. Le romantisme avait vaincu.
Sa victoire se compléta dans les arts. Le romantisme artistique sortit d’un groupe formé autour d’Hugo et que fréquentaient entre autres Corot et Rousseau. Il avait commencé par une réaction puritaine du classicisme contre la peinture mondaine du XVIIIème siècle. Les Brutus et les Gracchus de la Révolution avaient déclaré la guerre aux Boucher, Van-Loo, Fragonard, et autres « pornographes », peintres d’une « société corrompue ». Les vertus romaines devenues à la mode, en attendant de devenir les vices de la décadence du Directoire, avaient inspiré l’œuvre de David et de son école. D’une fausseté absolue dans sa conception, cette œuvre n’avait pris son importance que du très grand talent de David. De cette école même sortit la première manifestation de la peinture romantique avec les Pestiférés de Jaffa, de Gros, en 1804. Celui-ci, sur les objurgations de David, n’osa pas continuer dans cette voie. Il fut victime de sa pusillanimité au point qu’il se tua. Le Radeau de la Méduse, de Géricault, en 1819, fut plus nettement de réaction anticlassique ; on peut dire qu’il commença le réalisme dans la peinture. La guerre éclata dans le domaine de l’art comme dans celui de la littérature. Les exaltés du romantisme ne virent plus dans David qu’un copiste de l’antique et, dans l’antique, qu’une matière froide et inactive. La peinture romantique trouva dans Delacroix son Hugo. Comme lui, Delacroix dépassa l’école et s’éleva aux hauteurs humaines. Les classiques furent alors définitivement battus et les plus vastes perspectives s’ouvrirent, non pour l’art romantique, mais pour l’art naturaliste incomparablement supérieur (Voir Peinture).
L’art romantique fut dominé par la littérature ; elle l’empêcha de donner toute sa mesure. Le décor des phrases nuisit au décor de la peinture. Il en fut de même en musique. Berlioz, qui avait l’âme d’un préromantique et le génie musical d’un Mozart, voulait la liberté pour la musique comme pour les autres arts ; il fut le plus révolutionnaire des musiciens. Il fut incompris comme l’avait été Mozart, et ils continuent à l’être tous deux (Voir Musique). Le romantisme se plaisait aux truquages mélodramatiques des Meyerbeer ; l’âme profonde de la musique, celle de Berlioz, comme d’ailleurs celle de Beethoven, lui resta étrangère.
Toute une jeunesse bruyante qui mêlait les aspirations littéraires, artistiques et politiques, formait les « Jeune France » qui s’étaient ralliés autour du gilet rouge de Th. Gautier à la bataille d’Hernani. Il en sortit cette bohème parfois sublime, mais hétéroclite, qui dirait plus tard, avec Degas :
« De mon temps, on n’arrivait pas ! »
Elle produisit les excentriques, les irréguliers, les en-dehors du romantisme, quand il « arriva » de plus en plus, ayant conquis les Académies et les Salons, les prix et les décorations. On vit une foule de sous-romantiques médiocres chercher dans l’outrance l’effet qu’ils ne pouvaient produire par un vrai talent. Pour un poète délicat comme Aloysius Bertrand, auteur de Gaspard de la Nuit, on vit une quantité d’Emile et Antony Deschamps, de Rességuier, d’Hegésippe Moreau, de Briffault, de Pelloquet, de Laurent Jan, de Charles Lassailly, de Pétrus Borel, de Philothée O’Neddy, de Mac-Kent, de Destombet. Ils apportèrent dans la poésie et le roman une variété intéressante, mais surtout, ils semèrent la terreur et l’ahurissement. Baudelaire a dit :
« Sans la lycanthropie de Pétrus Borel, il y aurait eu une lacune dans le romantisme. »
Le jeune Escousse, trop louangé à sa première œuvre, ne voulut pas survivre à l’échec de la seconde et se tua. Arvers, moins exalté, vécut sur la réputation d’un sonnet et se livra modestement à la fabrication vaudevillesque. Aucune époque, sinon la nôtre qui la dépasse dans le genre, ne fut plus hyperbolique, plus riche en hommes de génie qui se dégonflaient comme des baudruches, plus comblée d’ambitieux et de ratés. Ceux-ci furent alors, beaucoup plus qu’aujourd’hui, « les tombés d’un trop haut idéal », comme disait Catulle Mendès. C’est pourquoi leur époque valut mieux que la nôtre dont l’idéal est pal’ trop plongé dans les latrines utilitaires que raillait Th. Gautier. Les excentriques, « grands dépendeurs d’andouilles », « aboyeurs à la lune », « refileurs de comètes », « avaleurs de brouillards », du romantisme, exagérèrent tout ce qu’il portait en lui de conventionnel, d’excessif, de caricatural ; et quand Ponsard arriva avec la réaction de ce qu’on a appelé le « bon sens », il n’eut pas de peine à montrer combien le décor romantique tombait en poussière. Seules demeuraient du romantisme les œuvres portant en elles la jeunesse et la beauté éternelles, celles de l’humanisme dans tous les temps.
En conclusion. Le romantisme a été une époque du grand mouvement humaniste qui se déroule à travers les siècles pour la liberté de la vie et de la pensée.
Il a eu deux périodes : celle du préromantisme, de la préparation pour l’avenir contre le passé ; celle du romantisme proprement dit d’un épanouissement artificiel, de la banqueroute, de l’incrustation dans le passé contre l’avenir.
Le romantisme était vainqueur avec la Révolution.
Il devint conservateur avec la contre-révolution et se perdit dans des questions de forme, des rivalités de boutiques. Une fois de plus, la lettre tua l’esprit. Après avoir fait atteindre à la pensée la pureté des cimes, à l’espérance humaine les « forteresses de la liberté », il a capitulé, s’est retranché dans les formules creuses de « l’art pour l’art » et a fait redescendre l’esprit dans les profondeurs caverneuses, il lui a rivé de nouvelles chaînes. Il s’est abandonné au muflisme, au sabre, à tous les dogmes destructeurs de la liberté et de la dignité humaines. Aujourd’hui, il n’en reste qu’un virus malsain dans l’organisme social. Il dresse, comme des labarums, les insignes infâmes des Mussolini et des Hitler, comme il dressa ceux des Napoléon, le « grand » et le « petit ». Il attèle à leur char de triomphe les foules imbéciles et lâches qui pâturent leur substance intellectuelle et morale dans les stades, les arènes, les dancings, au cinéma, dans les lupanars, les casernes, les sacristies, la presse, partout où l’ON NE PENSE PAS, mais qui brûlent ou sont prêtes à brûler les œuvres du génie humain qui a voulu les libérer, en faire des hommes. Le « héros romantique » est plus répandu et admiré que jamais. Mais il a de plus en plus la silhouette grotesque et les agissements calamiteux du père Ubu, avec sa « gidouille merdreuse », son « crochet à phynance » et son armée de « palotins ».
— Edouard ROTHEN
ROTATION
(du latin, rotare : tourner)
En mécanique, science des mouvements ; on appelle rotation, le mouvement circulaire d’un corps autour d’un axe invariablement fixe ou supposé tel. Le mouvement de la terre autour de son axe est un mouvement de rotation. Un mouvement de rotation peut être uniforme ou varié.
Dans le cas d’un mouvement uniforme, un point quelconque du corps décrit des arcs égaux dans des temps égaux. La petite aiguille d’une montre parcourt 30 degrés par heure ; elle parcourt donc en 6 heures, 6 fois 30 degrés ou 180 degrés.
Dans le cas d’un mouvement varié, on démontre que le rayon mené d’un point considéré, au centre du cercle qu’il décrit, fait avec sa position initiale des angles variables selon une loi quelconque. L’équation de ce mouvement se déduit du principe dit de d’Alembert qui veut qu’il y ait équilibre entre les forces extérieures appliquées au corps et les forces d’inertie nées du mouvement. Laquelle condition d’équilibre, dans le cas d’un corps assujetti à tourner autour d’un axe fixe, consiste en ce que la somme des mouvements, par rapport à cet axe, des forces appliquées au corps soit identiquement nulle.
Quand un corps solide a un mouvement de rotation par rapport à un certain système de repères et que ceux-ci participent également à un autre mouvement de rotation, le mouvement absolu du solide résultera des deux rotations. La détermination d’un pareil mouvement de rotation comprend trois cas, selon que les axes de rotation sont parallèles, concourants ou situés dans des plans différents.
Il ne nous appartient pas d’exposer ici, la détermination de pareils mouvements de rotation, celle-ci ne pouvant se faire qu’en faisant appel aux formules de l’analyse mathématique, qui ne peuvent être comprises que par les personnes possédant une culture mathématique supérieure.
Les corps célestes, planètes et soleil, possèdent généralement tous un mouvement de rotation sur eux-mêmes, mouvement qui s’accomplit en des temps différents et donnant lieu à divers phénomènes que nous allons examiner en étudiant les conséquences du mouvement de rotation de notre planète.
Notre globe est à peu près rond et, de plus, il est isolé dans l’espace ; il possède donc toutes les propriétés nécessaires pour effectuer un mouvement de rotation. Si notre globe n’effectuait pas ce mouvement que présentent toutes les planètes du système solaire, il faudrait que tous les astres du ciel, depuis le plus proche de nous, la Lune, jusqu’aux étoiles perdues aux confins de la Galaxie, tournent tous ensemble et en un seul jour autour de la terre. Il serait nécessaire, pour qu’un tel mouvement se produisit, que tous les astres fussent animés de vitesses folles, dépassant tout ce que l’imagination peut concevoir, étant donné leurs distances énormes à notre globe. L’étoile alpha du Centaure, l’une des plus proches de nous, devrait couvrir, pour accomplir ce mouvement, une circonférence de 64 trillions de lieues, à la vitesse de 740 millions de lieues par seconde (d’après Flammarion). A ces considérations militant en faveur de la rotation de notre globe, s’en ajoutent d’autres tirées de la Mécanique, que nous ne pouvons exposer ici, étant donné leurs caractères transcendants. Nous dirons simplement que la preuve de la rotation de la terre, pressentie par Galilée, a été réalisée en 1851 par Léon Foucault et renouvelée, au Panthéon, en 1902 (expérience du pendule). Le baron Eötvös, professeur à l’université de Budapest, a fait, en 1917, une nouvelle et remarquable expérience, basée sur un principe différent de celui de Foucault, pour démontrer la rotation de notre terre.
Ce pourrait être un sujet d’étonnement qu’il ait fallu attendre jusqu’au XIXème siècle pour avoir une preuve positive de la rotation de notre globe, si nous ne connaissions le pouvoir émasculateur des dogmes religieux. Les anciens se figuraient malaisément la forme de notre terre ; mille et une considérations philosophiques et surtout religieuses, faisaient de celle-ci le centre de l’univers. Notre globe, les religions l’enseignaient, était l’objet principal de la sollicitude des ou de Dieu. De plus, les livres pieux donnaient l’explication des mouvements célestes. Aussi, pendant de nombreux siècles, se soutint la théorie de la terre, centre du monde. Durant les époques de civilisation gréco-romaine, de la civilisation arabe, jusqu’à la fin du moyen-âge, la théorie en vogue voulait que notre terre fût au centre de l’univers, le restant du monde lui étant concentrique et limité par une enveloppe sphérique qui porte les étoiles déclarées fixes et immuables. De l’autre côté de cette sphère, se trouve le domaine du principe moteur de l’univers. De là aussi, parvient l’impulsion de la révolution quotidienne de la sphère étoilée ainsi que de tous les systèmes d’enveloppes sphériques qui y sont contenues. Considérées comme concentriques à la sphère terrestre et portant dans leurs ordres les sept planètes, y compris le soleil et la lune, depuis le plus éloigné Saturne (les anciens ne connaissaient ni Uranus ni Neptune) jusqu’à celui qui est le plus proche de la terre, la Lune ; chacun de ces systèmes d’enveloppes sphériques transparentes mais solidement emboîtées, accomplissait, en dehors d’une révolution quotidienne autour de la terre, encore d’autres mouvements de rotation. Il a fallu attendre, malgré les travaux d’esprits indépendants, tels Aristarque de Samos, Héraclide de Pontus, jusqu’à Copernic et Galilée pour en arriver à une plus saine représentation du système du monde. Encore ce dernier a-t-il payé sa découverte, contraire à l’enseignement des saintes écritures, d’une abjuration en règle faite en l’église de la Minerve, à Rome, le 22 juin 1633. En réalité, c’est la Terre qui tourne sur elle-même et non le ciel autour de la terre. Ce mouvement de rotation s’effectue à gauche, dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, en 23 heures, 56 minutes, 41 secondes 091.
Conséquences du mouvement de rotation de la Terre. — Tout corps en mouvement de rotation est sollicité, du fait même de cette rotation, de s’éloigner de l’axe autour duquel il tourne, par une force à laquelle ce mouvement tournant donne naissance. C’est la force centrifuge qui diminue le poids réel des corps. A l’équateur, elle est la 289ème partie de la force centripète (pesanteur). En conséquence, un corps pesant 289 grammes aux pôles, ne pèse plus que 288 grammes à l’équateur. Si la vitesse de rotation de notre planète était seulement 17 fois plus rapide, les corps ne pèseraient plus rien à l’équateur ; état de choses qui amènerait de sérieuses perturbations dans notre mode d’existence. La rotation de la terre a une autre conséquence importante pour la vie générale du globe et pour les mouvements des fluides (air et eau) qui se déplacent à sa surface. On démontre, en Mécanique (théorème de Coriolis) que tout corps en mouvement à la surface d’une sphère tournante doit être dévié de sa trajectoire du fait même de la rotation. Cette déviation se fait vers la droite dans l’hémisphère nord, vers la gauche dans l’hémisphère sud. Par conséquent, les masses d’air qui constituent les courants aériens et les vents généraux, les masses d’eau qui forment les courants marins sont déviées de leur trajectoire du seul fait de la rotation du globe. Cette cause de déviation qui s’exerce d’une façon permanente nous donne les vents alizés et les moussons, vents sur lesquels le navigateur peut toujours compter étant donné leur persistance et leur régularité. Ces mêmes vents agissant sur les masses d’eau de l’océan, leur impriment des mouvements de translation généraux connus sous le nom de courants marins ; courants qui, par leur apport de chaleur ou de froid, jouent un rôle capital sur la température des pays qu’ils baignent.
Le jour et la nuit. Rotation et mesure du temps. Aspects successifs du ciel. — Une conséquence immédiate de la rotation de la terre est la succession des jours et des nuits. La terre étant sphérique n’est, ainsi que toute sphère éclairée par une source lumineuse, qu’à moitié éclairée par le Soleil. Chaque point de sa surface passe donc alternativement dans la moitié éclairée et c’est le jour, et dans la moitié obscure et c’est la nuit.
Une autre conséquence importante est l’inégalité des heures aux différents points du globe. Le soleil paraît se lever à l’est, monte progressivement dans le ciel, atteint son point culminant à midi, et passe au méridien, puis redescend graduellement pour se coucher à l’ouest. Entre deux passages consécutifs du soleil au méridien, il s’écoule 24 heures. Cet intervalle est le jour solaire ou civil. De même, une étoile se lève à l’est passe au méridien (voir ce mot) et se couche à l’ouest. Entre deux levers consécutifs d’une même étoile, il s’écoule toujours le même nombre de secondes (86.164). Elle passe toujours au méridien à la même heure et le temps qu’une étoile met pour revenir au même méridien donne la mesure précise et constante du mouvement tournant de notre planète. Cet intervalle de temps a été appelé « jour sidéral ». Le soleil n’a pas celte constance, cette régularité. Tantôt il est en retard, tantôt il est en avance. Supposons qu’à midi, un point quelconque situé au méridien soit juste en face du soleil ; quand la terre aura accompli une rotation, le méridien se retrouvera comme il était la veille, mais le point considéré n’y sera plus. Pour qu’il revienne devant le soleil, il faut que la terre tourne sur elle-même pendant 3 minutes, 56 secondes. Et cela tous les jours de l’année. Le jour solaire qui, divisé en 24 heures, règle toute notre activité est donc plus long que le jour sidéral. Il y a, par an, 365 jours solaires 1/4, tandis qu’il y a exactement 366 rotations 1/4, soit une de plus. Cette durée du jour solaire est elle-même légèrement variable, le mouvement de translation de notre terre sur son orbite elliptique, qui lui donne naissance, n’étant pas lui-même uniforme. Cette différence entre le jour sidéral et le jour solaire détermine les aspects successifs du ciel qu’il nous est donné de contempler. Le jour sidéral étant plus court d’environ 4 minutes que le jour solaire, les étoiles, dans leur mouvement diurne, avancent donc sur le soleil. Au bout d’un mois, cette avance est de 2 heures et, après un an, de 24 heures. Les constellations que nous apercevons l’hiver sont, par suite de cette avance, voilées par le jour en été, et celles invisibles l’hiver, pour la même raison, illuminent nos nuits d’été.
Les heures.
Ceci posé, divisons la circonférence du globe à l’équateur en parties de 15 degrés chacune et considérons les méridiens passant par ces divisions qui partagent la terre en 24 tranches ou fuseaux. Quand, par exemple, en vertu de la rotation de la terre, le méridien de Paris passera devant le soleil, il sera midi à Paris. Une heure après, ce sera le tour du méridien suivant, il sera midi pour lui, tandis qu’il sera 13 heures à Paris. Les points diamétralement opposés auront alors minuit et 1 heure du matin. Jadis, chaque cité réglait les conditions de sa vie civile sur son heure locale, celle variant d’une ville à l’autre, c’est-à-dire avec le méridien. Les moyens d’interpénétration s’étant développés, il en résulta bientôt de sérieux inconvénients. Il fut décidé que chaque nation aurait une seule heure sur son territoire, celle du méridien passant par sa capitale.
Nonobstant cette amélioration, des différences d’heures persistaient quand on passait les frontières. On décida donc, en 1911, de partager la terre en 24 fuseaux horaires, contenant chacun 15 degrés de longitude, en convenant que l’heure serait la même à l’intérieur de chaque fuseau. L’avantage de cette modification est que lorsqu’on passe d’un fuseau à l’autre, le nombre des heures change exactement d’une heure et que le chiffre des minutes et des secondes ne varie pas.
Rotation des planètes.
La terre, nous l’avons dit, n’est pas la seule sphère qui gravite autour du soleil. D’autres sœurs de notre globe font cortège au soleil et, comme la terre, possèdent un mouvement de rotation. La Lune tourne sur elle- même dans le même temps qu’elle accomplit sa révolution : elle ne nous présente donc que toujours la même face. La rotation du soleil s’effectue en 25 jours, 4 heures, 29 minutes, mais elle n’est pas uniforme, les diverses zones du globe solaire, de part et d’autre de l’équateur ont des vitesses de rotation différentes, qui se ralentissent progressivement à mesure qu’il s’agit de latitudes de plus en plus rapprochées des pôles, et cela au point qu’à la latitude de 40° (N et S) la rotation est plus longue de 2 jours qu’à l’équateur. La rotation des planètes Mercure et Vénus, les plus proches du soleil, semble être de même durée que leurs translations autour du soleil ; elles présenteraient donc, comme la lune, le même hémisphère au soleil, mais cette dernière hypothèse n’est pas prouvée. La durée de leur rotation reste inconnue. Mars effectue sa rotation en 24 heures, 37 minutes, 23 secondes 65. Jupiter, la plus grosse planète du système tourne sur lui même en 9 heures, 57 minutes, 37 secondes. Saturne, la merveille du monde solaire, l’accomplit en 10 heures, 15 minutes. La durée exacte de la rotation des planètes Uranus et Neptune n’est pas déterminée, elle semble être de 10 heures, 40 minutes pour la première et de 8 heures pour la seconde. Toutes deux, cependant, effectuent leur rotation en sens rétrograde, c’est-à-dire centre de celle du soleil et des autres planètes. On n’a évidemment, aucune donnée exacte sur la durée de la rotation de la planète transneptunienne, découverte récemment.
— C. ALEXANDRE
ROUTINE
n. f. (étymologie : diminutif de route)
« Proprement, petite route qu’on prend, toujours la même, par habitude. » (Littré)
De là : façon de faire ou d’apprendre par répétition en suivant toujours le même procédé. Par routine, on entend donc l’usage, consacré par les traditions, les habitudes, les convenances, de faire une chose de la même manière sans chercher à s’évader des sentiers battus. Un esprit routinier est, en quelque sorte, pétrifié et incapable de voir autre chose que ce qu’il a toujours vu. L’innovation le déroute, il ne conçoit pas un changement à l’ordre tout provisoire des choses, et il taxe de rêveur, d’utopiste ou de fou quiconque essaie de modifier ou de détruire ce qui est. La routine est la grande ennemie de l’évolution. C’est elle qui maintient l’erreur en freinant les forces de progrès. D’où la lenteur de cette évolution. C’est par la routine, ancrée dans les intelligences moutonnières, que les religions survivent. C’est par elle que les idéologies sanguinaires se perpétuent ; c’est par la routine que la bêtise règne. Pourquoi vous habillez-vous de noir à la mort de votre parent ? Pourquoi ces fleurs sur cette tombe ? Pourquoi cette tombe même ? Pourquoi cette alliance au doigt ? Pourquoi vous découvrez-vous devant le saint sacrement, devant le drapeau, devant la Marseillaise ou l’Internationale ? Pourquoi cette ridicule concession à la mode ? Et, puisqu’il fait si chaud, pourquoi ce cache-sein et ce cache-sexe ? — Ô homme, dit libre-penseur, pourquoi cette cérémonie au monument aux morts ? — Ô camarade, pourquoi, dans ton vêtement, dans ton langage, dans tes attitudes, ce conformisme aux traditions « révolutionnaires » ?
La routine est toujours là pour faire accomplir ce qui est conforme à une des plus grandes lois naturelles : la loi du moindre effort. Mais l’individu qui raisonne se dégage vite de l’emprise de la routine, lorsqu’il a conscience de son geste routinier. Vient un moment où il est tout heureux de s’être débarrassé de la masse de préjugés, de vérités toutes faites, de faux symboles, de sentiments factices qui étaient auparavant les moteurs de ses actes. Aussi est-ce dans tous les domaines de l’activité humaine que les novateurs ont eu à lutter contre la routine. Science, philosophie, littérature, arts divers, etc., ont évolué dans l’incessant combat entre le présent et le devenir, car ce qui est ne veut pas disparaître devant ce qui sera.
Et c’est l’épopée gigantesque de la pensée ; c’est son envol, malgré la routine, vers les cimes où le ciel pur se mire dans l’eau pure de la source. C’est Christophe Colomb cherchant la route des Indes par l’ouest ; c’est Galilée faisant tourner la terre ; c’est l’esprit des Encyclopédistes détrônant les vieux dogmes ; c’est le savoir, la logique, la raison, mis à leur place souveraine. C’est le brabant remplaçant l’araire. Et c’est le tracteur remplaçant le brabant. C’est le romantisme triomphant ; et c’est, par la suite, le naturalisme s’installant au pinacle. Ce sont les diverses écoles de peinture, de sculpture, de musique, etc., qui s’imposent successivement... Mais ce sont aussi les supplices, les bûchers, les Bastilles, les haines des « cous-pelés » qui, accrochés au passé, défendent leurs situations compromises. Ce sont toutes les embûches que la routine accumule en vain pour empêcher que s’accomplisse ce qui doit être.
Tout homme qui pense doit se dresser contre la routine. Moins son emprise sera grande, et plus rapide se fera l’évolution, C’est vers l’avant que l’on doit résolument se tourner et, en évitant les sentiers tortueux, s’élancer sans œillères sur les routes neuves, vers le soleil de beauté, de justice et de fraternité.
— Ch. B.
RUCHE (LA)
Tel est le nom d’une œuvre que j’ai fondée en 1904. Dix ans après sa fondation, prévoyant que la Guerre de 1914–1918 allait entraîner la ruine de cet établissement que j’avais eu tant de peine à édifier, j’ai publié sous ce titre : « La Ruche : Une œuvre de solidarité : un essai d’éducation », une forte brochure destinée à faire connaître sous quelle forme y fut pratiquée la solidarité et dans quel esprit fut conçu et réalisé cet essai d’éducation. Il m’a paru regrettable que cette œuvre menacée de disparaître, soit exposée à tomber complètement dans l’oubli ; et j’ai cru utile d’en transmettre le souvenir à ceux qui, un jour ou l’autre, en France ou ailleurs, auront le désir de reprendre cet essai et de s’en inspirer.
Je ne saurais donc faire mieux que d’extraire de cette brochure les passages les plus susceptibles de permettre aux lecteurs de se faire une idée exacte de ce que fut « la Ruche », (La brochure en question est de 1914).
Brèves indications. — Cette œuvre de solidarité et d’éducation, sise à Rambouillet (Seine-et-Oise), a été fondée et est dirigée par Sébastien Faure. Elle élève une quarantaine d’enfants des deux sexes.
Pas de classement ; ni punitions, ni récompenses.
Son programme. — Par la vie au grand air, par un régime régulier, l’hygiène, la propreté, la promenade, les sports et le mouvement, nous formons des êtres sains, vigoureux et beaux.
Par un enseignement rationnel, par l’étude attrayante, par l’observation, la discussion et l’esprit critique, nous formons des intelligences cultivées.
Par l’exemple, par la douceur, la persuasion et la tendresse, nous formons des consciences droites, des volontés fermes et des cœurs affectueux.
« La Ruche » n’est subventionnée ni par l’Etat, ni par le Département, ni par la Commune. C’est aux hommes de cœur et d’intelligence à nous seconder, chacun dans la mesure de ses moyens.
Les trois écoles. — A l’heure où les deux écoles qui se disputent, en France, le cœur et l’esprit de nos enfants, se livrent un combat acharné, dont le plus clair résultat, jusqu’ici, est de faire éclater aux yeux des moins prévenus les tares, les imperfections et l’insuffisance de l’une et de l’autre, il est particulièrement utile que soit fondée une troisième école.
L’école chrétienne, c’est celle d’hier ; l’école laïque, c’est celle d’aujourd’hui ; « La Ruche », c’est, d’ores et déjà, l’école de demain.
L’école chrétienne, c’est l’école du passé, organisée par l’Eglise et pour elle ; l’école laïque, c’est l’école du présent, organisée par l’Etat et pour lui ; « La Ruche », c’est l’école de l’avenir, l’Ecole tout court, organisée pour l’enfant, afin que, cessant d’être le bien, la chose, la propriété de la Religion ou de l’Etat, il s’appartienne à lui-même et trouve à l’école le pain, le savoir et la tendresse dont ont besoin son corps, son cerveau et son cœur.
Dans quel but et comment j’ai fondé la Ruche. — Depuis quelque vingt-cinq ans, je fais des conférences tendant à propager les convictions qui m’animent et les sentiments qui me sont chers. Favorisé par les circonstances, j’ai eu la bonne fortune d’acquérir peu à peu une certaine notoriété. Je me suis fait, pour ainsi dire, une clientèle nombreuse d’auditeurs dans la plupart des villes que je visite périodiquement, et il n’est pas rare que, si vastes soient-elles, les salles dans lesquelles je convie le public à venir m’entendre soient encore insuffisantes. A la porte, je prélève un droit d’entrée. Mes frais (voyage, salle, publicité, etc.) payés, il me reste un bénéfice appréciable, et ces bénéfices additionnés représentent, chaque année, une somme assez ronde. Je me suis tout naturellement demandé ce qu’il convenait de faire de cet argent que me procurait ma propagande. J’aurais pu, le considérant comme très honorablement gagné, le garder par devers moi. C’est une erreur grossière et une injustice que de refuser à l’orateur le droit de vivre de ses discours ; le conférencier a le droit de vivre de ses conférences, au même titre que vivent de la tâche qu’ils accomplissent tous ceux qui travaillent : professeurs, des enseignements qu’ils donnent ; journalistes, des articles qu’ils écrivent ; médecins, des maladies qu’ils soignent ; avocats, des causes qu’ils plaident ; ouvriers, du travail qu’ils exécutent.
J’aurais donc pu, sans scrupule et en toute équité, garder pour moi les ressources que me procuraient mes conférences. Mais, constamment préoccupé de la besogne à faire par les militants auprès de la foule ignorante de notre idéal, pouvais-je conserver tout ou partie de cet argent dont, à tout instant et en toutes circonstances, il est besoin ?
Une foule de gens — c’est de beaucoup le plus grand nombre — sans conviction, sans idéal, n’ont qu’un souci : s’enrichir, en tous cas, économiser pour leurs vieux jours. On ne trouve pas un vrai militant qui ait cette préoccupation. Le militant marche, tout éveillé, dans son rêve. N’ayant de passion ardente que celle qui le mouvemente incessamment vers le but qu’il s’est volontairement assigné, il ne tient à l’argent que dans la mesure où celui-ci lui est indispensable pour la réalisation de son rêve, pour l’obtention de son but. Vingt années durant, j’ai fait comme tous mes amis : attribuant tout ce que je gagnais aux œuvres de propagande, aux campagnes d’agitation, à l’effort d’éducation, aux gestes de solidarité qui guettent et sollicitent à chaque pas l’éducateur des foules.
Toutefois, un jour vint où, au cours d’une de ces haltes qui apportent un peu de calme à la marche enfiévrée de l’apôtre et lui confèrent le repos momentané dont la nécessité s’impose, j’examinai, tranquille et de sang-froid si, des ressources mises à ma disposition par mes conférences, je faisais l’usage le meilleur, c’est-à-dire le plus fécond. De réflexion en réflexion, je fus amené à considérer qu’il serait préférable de concentrer sur une œuvre unique toutes les disponibilités que, jusqu’alors, j’avais disséminées, au hasard des circonstances, des besoins ou des sollicitations. Ce point acquis, il ne me restait plus qu’à préciser la nature et le caractère de cette œuvre unique. Or, au cours de ma carrière déjà longue de propagandiste, j’avais été amené à faire les deux constatations suivantes :
-
Première constatation : de toutes les objections qu’on oppose à l’admission d’une humanité libre et fraternelle, la plus fréquente et celle qui paraît la plus tenace, c’est que l’être humain est foncièrement et irréductiblement pervers, vicieux, méchant ; et que le développement d’un milieu libre et fraternel, impliquant la nécessité d’individus dignes, justes, actifs et solidaires, l’existence d’un tel milieu, essentiellement contraire à la nature humaine, est et restera toujours impossible.
-
Seconde constatation : quand il s’agit de personnes parvenues à la vieillesse ou simplement à l’âge mûr, il est presque impossible, et quand il s’agit d’adultes ayant atteint l’âge de 25 ou 30 ans sans éprouver le besoin de se mêler aux luttes sociales de leur époque, il est fort difficile de tenter avec succès l’œuvre désirable et nécessaire d’éducation et de conversion ; par contre, rien n’est plus aisé que de l’accomplir sur des êtres jeunes encore : les petits au cœur vierge, au cerveau neuf, à la volonté souple et malléable.
Plus d’hésitation : l’œuvre à fonder était trouvée. Il s’agissait de réunir 40 à 50 enfants en un vaste cercle familial et de créer avec eux un milieu spécial où serait vécue, dans la mesure du possible, d’ores et déjà, bien qu’enclavée dans la Société actuelle, la vie libre et fraternelle : chacun apportant au dit cercle familial, selon son âge, ses forces et ses aptitudes, son contingent d’efforts, et chacun puisant dans le tout alimenté par la contribution commune sa quote-part de satisfactions. Les grands versant dans le groupe familial ainsi constitué le produit de leur labeur, le fruit de leur expérience, l’affection de leur cœur et la noblesse de leur exemple ; les petits y versant à leur tour le faible appoint de leurs bras encore délicats, la grâce de leur sourire, la pureté de leurs yeux clairs et doux, la tendresse de leurs baisers. Les grands redevenant jeunes au contact des enfantillages et des naïvetés des petits, et les petits se faisant peu à peu sérieux et raisonnables au contact des gravités et des gestes laborieux et sensés des grands.
Entrevue de la sorte, l’œuvre unique répondait à la double préoccupation formulée ci-dessous : préparer des enfants, dès leurs premiers pas dans la vie, aux pratiques de travail, d’indépendance, de dignité et de solidarité d’une société libre et fraternelle ; prouver, par le fait, que l’individu n’étant que le reflet, l’image et la résultante du milieu dans lequel il se développe, tant vaut le milieu, tant vaut l’individu, et que, à une éducation nouvelle, à des exemples différents, à des conditions de vie active, indépendante, digne et solidaire, correspondra un être nouveau : actif, indépendant, digne, solidaire, en un mot contraire à celui dont nous avons sous les yeux le triste spectacle.
Le sort en était jeté, ma résolution était prise, j’allais fonder la Ruche. Je cherchai et finis par trouver un domaine à ma convenance : un bâtiment assez vaste, un grand jardin potager, des bois, des prairies, des terres arables, le tout embrassant une superficie totale de 25 hectares et situé à trois kilomètres de Rambouillet (Seine-et-Oise), et à 48 kilomètres de Paris. Je louai ce domaine.
Ce qu’est la Ruche.
La Ruche n’est pas, à proprement parler, une école. En tous cas, elle n’est pas une école comme les autres. Une école est un établissement fondé en vue de l’enseignement et n’ayant pas d’autre but. Les professeurs y viennent pour faire leurs cours et les élèves pour assister à ceux-ci. Les professeurs ont pour mission d’enseigner ce qu’ils savent et les élèves ont pour devoir d’y apprendre ce qu’il leur est indispensable ou utile de ne pas ignorer. Tel est, pratiquement, le but d’une école. L’école est ouverte à tous les enfants du même quartier, de la même commune ou de la même région. Elle ne doit, sans motif grave et précis, fermer ses portes à personne. Les écoliers restent dans leurs familles qui ont la charge de les loger, de les vêtir, de les alimenter, de les soigner s’ils sont malades, etc., etc. L’école qui se charge de coucher, de nourrir, de soigner l’enfant, l’école qui, pour tout dire en un mot, se substitue dans une certaine mesure à la famille de l’enfant et lui en tient lieu, est un pensionnat. Le pensionnat reçoit de la famille de l’enfant dont il assure l’instruction, l’éducation, le logement et l’alimentation, une pension représentant ces frais et ces services. La Ruche n’est pas un pensionnat et nul enfant n’y est admis et ne s’y trouve à titre « payant ». Quelques parents pouvant, grâce à leur travail, envoyer spontanément, d’une façon régulière ou de temps à autre, quelque argent à la Ruche, se font un cas de conscience de n’y pas manquer. Ces parents ont raison et ils accomplissent volontairement un devoir. Leurs versements rentrent dans la caisse de la Ruche ; leur enfant n’est ni mieux soigné, ni plus aimé que les autres ; mais ces petites sommes ont pour objet de ne pas laisser l’enfant entièrement à la charge de l’œuvre et pour résultat de diminuer mon effort personnel.
Enfin, la Ruche n’est pas un orphelinat. Nous n’avons que quelques orphelins et encore le sont-ils devenus depuis qu’ils sont avec nous. Pour être un orphelinat, il faudrait que la Ruche eût une situation régulière, prévue et réglementée par la loi ou par les statuts d’une société régulièrement constituée ; ou bien, il faudrait qu’elle eût des attaches avec l’Assistance publique qui, moyennant rétribution, lui confierait — comme elle le fait pour d’autres œuvres — les enfants qu’elle a recueillis et qui continuent à lui appartenir.
La Ruche n’est donc ni une école, ni un pensionnat, ni un orphelinat. Elle est, en même temps qu’une œuvre de solidarité, une sorte de laboratoire où s’expérimentent des méthodes nouvelles de pédagogie et d’éducation.
Direction.
Il y a un Directeur à la Ruche ; mais il l’est si peu, que, si on donne à cette expression le sens qui lui est d’ordinaire attribué, on peut dire qu’il n’y en a pas du tout. Ailleurs et, peut-être, peut-on dire partout, le Directeur est un Maître, qui donne des ordres, à qui on est tenu d’obéir, qu’on redoute, dont la volonté est souveraine, qui applique avec inflexibilité un règlement déjà redoutable et au besoin substitue son vouloir à la règle ; les uns le flattent dans l’espoir d’en obtenir des faveurs ; les autres le craignent et se cachent de lui ; les uns et les autres se mouchardent par ambition ou par cupidité, pour servir leurs intérêts ou leurs rivalités. Rien de ces abominations n’existe à la Ruche. Si le Directeur était ce despote, il serait nécessairement le point culminant d’une hiérarchie compliquée, où s’étagerait toute une série de despotismes subalternes, sous le poids desquels, tout à fait en bas, seraient écrasés les plus faibles et les plus soumis. Alors, plus de famille ; plus de milieu communiste-libertaire.
L’un de nous — c’est moi, pour le moment — a le titre de Directeur. Pour les propriétaires, dont nous ne sommes que les locataires, pour les fournisseurs, pour les familles qui nous confient leurs enfants, pour les groupes qui, par centaines, et pour les camarades qui, par milliers, suivent avec intérêt la marche de la Ruche, pour les autorités et l’administration, il faut un directeur, parce qu’il faut un responsable. S’engager, répondre, signer, se porter garant, tel est le rôle du Directeur. S’entremettre dans toutes les négociations avec l’extérieur ; écrire, parler au nom de la Ruche, telle est sa fonction. Pauvre Directeur !
Mais aussitôt que ce Directeur cesse d’être tourné vers le public et de faire face aux fournisseurs, aux propriétaires, aux banquiers, au percepteur, aux autorités constituées, aux groupes et aux camarades, il se retourne du côté de ses collaborateurs et il rentre dans le rang ; il redevient un des leurs, une unité comme chacun d’eux, pas plus, pas moins.
S’il y a une décision à prendre, il a voix au chapitre au même titre que les autres ; il exprime son avis et émet son opinion comme les autres, et son avis n’emprunte au titre qu’il porte aucune valeur particulière. On lui donne raison, si on estime qu’il a raison ; on lui donne tort, si on juge qu’il a tort ; il n’est le supérieur de personne ; il n’est l’inférieur d’aucun : il est l’égal de tous. Nous vivons dans une société tellement pourrie d’autorité, de discipline, de hiérarchie, que ce qui précède paraîtra à la plupart invraisemblable ou fortement exagéré. A mes collaborateurs et à moi, cela semble tout naturel et fort équitable. Dans un milieu communiste, libertaire, les choses ne sauraient se passer différemment.
A l’intérieur de la Ruche, le Directeur a pour fonction de centraliser tous les services et de coordonner tous les efforts, afin que chaque service, tout en restant autonome, garde avec les services voisins la cohésion nécessaire à un fonctionnement d’ensemble régulier, et aussi pour que les efforts ne se neutralisent pas les uns les autres, mais, au contraire, s’appuyant les uns sur les autres, s’entraidant, on obtienne, avec un minimum d’efforts, le maximum d’effet utile. De ce point de vue, on peut dire qu’il y a, à la Ruche, une Direction ; mais elle est tout objective ; elle n’est qu’une fonction comme les autres ; elle n’est qu’un service ; elle n’est que l’enregistrement d’ensemble, et comme le contrôle général des attributions divisées, des responsabilités éparses.
Les collaborateurs.
Nos collaborateurs ne sont ni appointés, ni salariés. Toutes les fonctions, à la Ruche, sont absolument gratuites. Salaire, traitement, avenir, avancement y sont choses totalement méconnues. Les camarades qui, à des titres divers, travaillent à la Ruche, le font de la façon la plus désintéressée. Chacun d’eux doit pourtant réunir des conditions de capacité, d’assiduité au travail, de sobriété et de moralité qui lui permettraient, à l’extérieur, de se hausser au niveau des plus favorisés de sa partie. Nos collaborateurs renoncent volontiers à ces avantages matériels pour vivre à la Ruche.
Ce n’est pas qu’ils y travaillent moins et y mènent une existence plus confortable : ils travaillent, au contraire, beaucoup plus qu’ils ne travailleraient : instituteurs dans une école, travailleurs manuels dans une usine, dans un atelier ou aux champs.
Certes, ils sont nourris, logés, chauffés, éclairés, entretenus comme le sont tous les membres d’une même famille ; mais ils se contentent, sous tous ces rapports, d’un régime fort modeste. Il leur est loisible aussi, d’avoir quelque argent de poche ; ils puisent, à cet effet, dans la caisse commune, et y prennent ce dont ils ont besoin, sans avoir à en justifier : ils sont et restent seuls juges des besoins qu’ils ressentent, et je suis heureux de dire, à la louange de tous, que depuis près de dix ans que la Ruche existe, tous nos collaborateurs y ont apporté la plus grande discrétion et la plus méritoire réserve, de façon à peser le moins lourdement possible sur notre budget. On le voit : les avantages matériels attachés au titre de collaborateur de la Ruche sont plutôt minces. Et pourtant, nul ne songe à se plaindre ; tous travaillent avec ardeur et contentement, en se consacrant à cette œuvre, parce qu’ils goûtent des satisfactions morales et des joies du cœur qui compensent largement les avantages auxquels, de propos délibéré, ils renoncent.
Plus d’une fois, il m’a été dit :
« Mais alors, c’est comme dans une Communauté religieuse ? »
Pas du tout ; la comparaison ne saurait se soutenir. D’abord, les collaborateurs de la Ruche ne sont liés par aucun vœu, ne sont tenus par aucun engagement ; libres ils sont, et à tout instant, de partir s’ils s’y déplaisent, ou s’ils espèrent être plus heureux ailleurs ; ensuite, ils ne subissent aucune autorité et n’ont a obéir à aucun supérieur ; de plus, ils choisissent eux-mêmes, en toute indépendance, leur travail et l’exécutent comme ils l’entendent ; enfin, ils sont véritablement désintéressés, car ils ne croient pas au Ciel, tandis que les membres des Communautés religieuses, s’ils renoncent à toute rétribution ici-bas, ont la conviction qu’ils recevront, plus tard, après leur mort, le salaire incomparable de leurs travaux, de leurs mortifications et de leur obéissance. Les religieux ne sont, au fond, que des usuriers : ils avancent un pour recevoir mille. Ils ne sont que d’habiles spéculateurs qui placent l’argent de leur austérité dans l’entreprise la plus avantageuse ; ils abandonnent l’intérêt de cet argent durant dix, vingt ou cinquante ans ; mais ils espèrent bien que, durant l’éternité, ils rentreront des milliers et des milliers de fois dans leur capital.
Il arrive que, à certaines époques, nous avons besoin de nous adjoindre quelques collaborateurs temporaires ; par exemple, quand il y a un grand nombre de chaussures à réparer, des travaux de maçonnerie à exécuter sans retard, ou encore, au printemps, dans les jardins ou, à l’époque des moissons et des foins, dans les champs, quand il y a un coup de collier à donner. Nous faisons appel, dans ces cas, soit à des amis particuliers de la Ruche, soit à nos camarades des syndicats parisiens, qui ne nous refusent jamais le coup de main nécessaire, et ces collaborateurs temporaires viennent, eux aussi, sans rétribution d’aucune sorte.
Tous les services sont autonomes ; chaque collaborateur connaît les attributions et les responsabilités qui s’attachent à la fonction qu’il exerce. Tous s’en remettent à la capacité et à la conscience de chaque responsable.
Une fois par semaine, plus fréquemment, si le besoin s’en fait sentir, tous les collaborateurs se réunissent le soir venu, la journée terminée, quand les enfants sont au lit. Ceux de nos grands enfants qui, âgés de 15, 16 et 17 ans, sont en apprentissage, assistent à ces réunions et y prennent part au même titre que les collaborateurs eux-mêmes. Ces réunions ont pour objet de resserrer les liens qui nous unissent et de nous entretenir de tout ce qui intéresse la Ruche. Chacun dit ce qui le préoccupe, fait part du projet qu’il a formé, de l’idée qu’il a eue et soumet cette idée, ce projet, cette préoccupation aux autres. On en parle ; on en discute ; on laisse l’idée ou le projet à l’étude si on ne possède pas encore les éléments suffisants à une détermination. Chacun a le droit de se renseigner sur le fonctionnement de tel service : enseignement, caisse, comptabilité, cuisine, etc., etc., de formuler des observations, d’émettre des conseils, de proposer des améliorations. Grâce à ces réunions fréquentes, tous nos collaborateurs et nos grands enfants (garçons et filles) sont mis et tenus au courant de tout ce qui se passe, connaissent constamment la situation de la Ruche, participent aux décisions prises et concourent à leur application. C’est la vie au grand jour ; c’est la pleine confiance ; c’est l’échange de vues, simplement, franchement, à cœur ouvert. C’est le moyen le plus sûr et le meilleur de prévenir les intrigues et la formation des coteries que favorise le silence.
L’éducation est plus particulièrement confiée à ceux de nos camarades qui, chargés de l’enseignement, sont en rapports constants avec les enfants. Ceux-là passent leur vie avec ces enfants, et il est certain que, constamment mêlés à ceux-ci, ils exercent sur eux une grosse influence. Il n’en est pas moins nécessaire que tous les collaborateurs de la Ruche soient des éducateurs. D’une part, tous sont plus ou moins appelés à initier nos enfants, au fur et à mesure qu’ils grandissent, à la technique de leur métier : cuisine, couture, lessive, lingerie, forge, menuiserie, culture, jardinage, etc., etc. ; d’autre part, ils sont souvent mêlés aux jeux, aux distractions de nos enfants. Il faut donc qu’ils soient un exemple vivant et un guide pratique, patient, doux et affectueux pour ces petits, comme, dans la famille, tous les aînés doivent être pour les plus jeunes des guides et des modèles.
Nos enfants.
La Ruche élève une quarantaine d’enfants des deux sexes. Comment ils nous viennent ? Oh ! De la façon la plus naturelle et sans qu’ii soit utile que nous les recherchions. Ce sont des situations intéressantes qui se signalent elles-mêmes ou que des organisations et des amis nous font connaître et nous recommandent. Hélas ! Ce ne sont pas les enfants qui manquent !
Le sort des travailleurs est souvent si lamentable, la famille ouvrière est si déplorablement détraquée par la maladie, le chômage, l’accident ou la mort : les querelles intestines ravagent si fréquemment le milieu familial, querelles dont l’enfant devient l’innocente victime, que cent Ruches, mille Ruches, pourraient être rapidement peuplées de petits à abriter et à éduquer. Nous en avons déjà refusé plusieurs milliers ; nous sommes dans la nécessité d’en refuser tous les jours et, la Ruche étant de plus en plus connue, nous sommes appelés à en refuser chaque jour davantage.
Que de lettres éplorées nous parviennent ! C’est la femme d’un ouvrier qui, ayant été emporté, en pleine force, par la maladie, laisse à sa veuve la charge de trois, quatre, cinq enfants en bas âge et la mère tend vers nous des bras désespérés ; c’est un travailleur qui vient de perdre la mère de ses enfants et qui nous dit : « Que voulez-vous que je fasse de ceux-ci ? Comment voulez-vous que, travaillant du matin au soir pour les nourrir, j’aie encore le temps et la force de m’occuper d’eux ? » C’est un voisin qui nous signale un de ces cas intéressants qui, à force de se répéter, sont devenus presque la règle ! C’est un camarade qui nous recommande un enfant vigoureux, intelligent, qui pourrait devenir un sujet d’élite et qui grandit, misérable et battu, entre un père qui s’enivre et une mère qui se prostitue ! C’est un ami qui nous conjure d’ouvrir la porte de la Ruche à un enfant que guette la pieuvre religieuse : sauvetage à opérer ! C’est le défilé tragique et angoissant de tous les drames silencieux ou bruyants, ignorés ou connus, dont est tissée l’existence des déshérités !
Et chaque fois que nous sommes dans la cruelle obligation de repousser les mains qui se tendent vers nous, de mentir aux espérances qu’on a fondées sur la Ruche en refusant d’y admettre un enfant qu’on se réjouissait, par avance, d’y voir accueilli, notre cœur se serre doublement : d’abord, parce que nous pensons avec tristesse aux infortunes qui nous implorent et que nous ne pouvons soulager ; ensuite, parce que nous pressentons que bon nombre de ces enfants qu’il nous est impossible de prendre sous notre protection, sont guettés par l’ adversaire ; que, vaincus par la misère, les parents céderont, que ces petits seront remis, abandonnés à l’œuvre de philanthropie ou de charité qui les convoite et que, plus tard, ils seront, presque immanquablement, des adversaires de leurs propres intérêts et de leurs frères de souffrance. Non ! Les enfants ne manquent pas ; la Ruche pourrait se vider du jeune essaim qu’elle contient ; elle pourrait se vider dix fois, cent fois ; elle ne tarderait pas à s’emplir de nouveau et quantité d’abeilles resteraient quand même à la porte.
Les petits ; les moyens ; les grands. — Nos enfants forment trois groupes : les petits, les moyens et les grands. Les petits, ce sont ceux qui, trop jeunes encore pour se livrer à un travail d’apprentissage quelconque, ne fréquentent aucun atelier et partagent leur temps entre la classe, le jeu et les menus services ménagers qu’ils peuvent rendre : propreté, balayage, éplucherie de légumes, etc. Les moyens, ce sont ceux qui sont en préapprentissage. Leur journée est consacrée moitié à l’étude, moitié au travail manuel. Les grands, ce sont ceux qui, leurs études proprement dites étant achevées et leur temps de préapprentissage terminé, entrent en apprentissage.
On pense bien qu’il n’y a pas un âge fixe, invariable séparant, de façon mathématique, les éléments qui composent ces trois groupes.
Ceux-ci sont plus précoces ; ceux-là sont moins robustes ; et c’est le développement physique et cérébral de chaque enfant qui, plus que son âge, détermine le moment où il passe des petits aux moyens et des moyens aux grands.
En fait, nos enfants restent au nombre des petits jusqu’à l’âge de douze à treize ans ; de douze, treize ans à quinze ans environ, ils font partie des moyens ; et, au-dessus de quinze ans, ils sont rangés parmi les grands.
Jusqu’à l’âge de douze ou treize ans, ils ne font qu’aller en classe ; de douze, treize ans jusqu’à quinze ans, ils vont : une partie de la journée en classe, l’autre partie à l’atelier ou aux champs ; et, à partir de quinze ans, ils cessent d’aller en classe et ne vont qu’à l’atelier ou aux champs. Néanmoins, le soir venu, comme les grands ne vont se coucher que vers dix heures, ils lisent, suivent les cours supplémentaires que nos professeurs leur font, travaillent avec ceux-ci, causent, interrogent, échangent des idées et complètent, ainsi, leur petit bagage de connaissances générales.
Le « préapprentissage ». — Dès l’âge de douze à treize ans, presque tous les enfants qui appartiennent à la classe ouvrière quittent l’école. L’enfant a son certificat d’études primaires ; sa famille estime qu’il en sait assez. En tous cas, elle pense qu’il est temps qu’il se mette au travail qui rapporte. Pour beaucoup, l’essentiel et le plus pressé, c’est que l’enfant cesse d’être une charge, qu’il se débrouille et que même il augmente de quelques sous par jour le salaire familial. Les privilégiés entrent en apprentissage. Ils y entrent tout de go et au petit bonheur. Il s’agit bien des goûts de l’enfant, de ses aptitudes, de ses forces ! Ses goûts ? Sait-il ce qui lui plaît ! Ses aptitudes ? Les connaît-il lui-même ! A-t-il eu l’occasion de les discerner ? La famille dit : « Il fera comme les autres ; c’est en apprenant un métier qu’il y acquerra et développera les aptitudes nécessaires. Ses forces ? Il a treize ans ; il doit être assez fort pour travailler, sinon, « c’est de la paresse ».
Et l’enfant devient apprenti. On sait comment il l’est, neuf fois sur dix : c’est lui qui nettoie, balaie, fait les commissions et les courses ; il est chargé de toutes les corvées ; il est plutôt domestique qu’apprenti, et ça dure jusqu’à quatorze ou quinze ans ; en réalité, ce n’est qu’à cet âge-là qu’il commence à apprendre sérieusement le métier qu’il se propose de faire. Quel métier ? Celui que le père a choisi pour lui ; celui qu’un voisin a conseillé ; celui que les circonstances — souvent les plus fortuites — ont indiqué. Le résultat est que souvent, très souvent, parvenu à l’âge de seize ou dix-sept ans, ce jeune ouvrier constate que la profession qu’il exerce ne convient ni à ses goûts, ni à ses aptitudes, ni à son tempérament. Que faire ? Quitter ce métier que, il le pressent, il ne fera jamais avec plaisir et dans lequel il sera toujours inférieur ? Il n’y faut pas songer. Il faudrait faire un nouvel apprentissage et il est trop tard.
L’adolescent se résigne ; il continue, tristement, sans ardeur, sans enthousiasme ; il devient et reste toute sa vie un ouvrier médiocre ; sorte de bagnard condamné au travail forcé à perpétuité. Triste existence ! Nous avons pensé qu’il fallait à tout prix éviter à l’enfant le désagrément et le désavantage d’être voué, dès l’âge de douze à treize ans, à un métier qui peut lui déplaire.
J’ai entendu professer couramment l’opinion que, pour un ouvrier, tous les travaux sont les mêmes, ou à peu près. Ceux qui émettent cet avis prétendent que la condition et le salaire de l’ouvrier étant, à peu de chose près, les mêmes dans toutes les industries, il importe fort peu que celui-ci travaille dans le bois, dans le cuir, dans les tissus ou dans les métaux ; que le choix d’un métier ne doit pas, en conséquence, être déterminé par les goûts, les aptitudes ou les forces de l’individu mais par le salaire et, d’une façon plus générale, les conditions de travail ; qu’au surplus, l’outillage mécanique se multipliant et se perfectionnant sans cesse, il est indifférent qu’on manipule du bois, des métaux, du tissu ou du cuir. Cette opinion est fausse, et je n’en connais pas qui aurait pour le travail manuel de plus regrettables conséquences. D’abord, il est évident que si le machinisme envahit tout et que si l’ouvrier est condamné à être de plus en plus un conducteur, un surveillant ou un auxiliaire de la machine, il n’est pas du tout indifférent que, sans faire état de ses goûts, de ses aptitudes et de ses forces, il fasse tel métier ou tel autre : tel métier est plus sale ; tel autre plus dangereux ; l’un peut, à la longue, se faire machinalement et quasi sans qu’on y pense ; l’autre exige une attention sans relâche ; le premier comporte de la minutie, de la délicatesse ; le second de la vigueur, de l’endurance ; celui-ci entraîne telle perturbation de l’organisme musculaire ; celui-là tels troubles nerveux ; dans tel métier, pas besoin d’imagination, d’initiative, d’ingéniosité ; dans tel autre, il en faut beaucoup ; on peut faire l’un sans rien connaître du dessin ni des mathématiques ; impossible de faire l’autre sans posséder des connaissances assez étendues en mathématiques et en dessin, etc., etc. Je n’en finirais pas, si je voulais énumérer ici, sans du reste m’arrêter à aucune, toutes les distinctions, toutes les différences, toutes les oppositions. Et je ne parle pas des parties du corps qui sont actionnées plus spécialement par le métier exercé ; du bruit qui se fait, des odeurs qui s’exhalent, des poussières qui sont soulevées, de l’air qui circule, etc., etc.
Est-il permis de dire, maintenant, qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des goûts, des aptitudes, des forces de l’enfant, et que le travailleur manuel peut exercer, indistinctement et indifféremment, n’importe quel métier ?
Sans doute, l’ouvrier qui va à son travail comme l’esclave à sa chaîne n’a de goût ni d’aptitude pour aucune besogne, et il lui est indifférent de travailler à ceci ou à cela ; c’est le sort qui attend le triste apprenti dont j’ai parlé plus haut. Mais il y a des travailleurs qui font leur métier avec joie, à qui l’outil manquerait autant que le pinceau manque à l’artiste peintre, qui ont l’amour de la besogne bien exécutée, du travail fini, qui se passionnent pour leur métier, pour qui vaincre une difficulté, c’est gagner une bataille sans l’horreur du sang versé et qui, toutes proportions gardées, essaient, expérimentent, travaillent dans leur atelier avec autant d’ardeur que le savant dans son laboratoire. Osera-t-on soutenir qu’il n’y a aucune différence entre ces ouvriers et les autres ?
Eh bien ! Nous désirons ardemment que nos enfants soient, plus tard, au nombre de ces travailleurs d’élite. Comment faire pour obtenir ce résultat ou, du moins, pour grouper toutes les conditions de nature à favoriser ce résultat ? Voici :
Durant deux ou trois ans, chacun de nos enfants circule dans nos divers ateliers, restant et travaillant trois, quatre, cinq ou six mois dans l’un, autant dans l’autre ; il a ainsi le temps et l’occasion d’étudier ses goûts, de préciser ses aptitudes, de mesurer ses forces. Il n’a pas, de l’âge de douze à celui de quinze ans, à se préoccuper du choix d’un métier ; il tâte de plusieurs et de chacun d’eux assez longtemps pour établir entre les uns et les autres les comparaisons nécessaires et dont il reste le centre. En même temps, il continue ses études : non seulement parce qu’il est loin d’avoir acquis la somme de connaissances générales qui, dans l’avenir, quel que soit le métier qu’il fasse, lui seront indispensables ; non seulement parce qu’il est arrivé à l’âge où, devenu plus raisonnable, il profitera mieux des enseignements qui lui seront donnés ; mais encore et surtout parce que, travaillant tour à tour, chaque jour, régulièrement, en classe et à l’atelier, il s’établira fatalement, probablement même à son insu, un rapport fort utile entre ses travaux ici et ses études là, entre la formation de son esprit et celle de son œil et de ses mains, entre sa culture générale et son apprentissage technique. Et quand, après deux ou trois ans de ce préapprentissage, il se spécialisera, son choix, bien équilibré, s’appuiera sur cette culture intellectuelle et manuelle, sans que l’une soit sacrifiée à l’autre ; bien plus, les deux se complèteront, s’ajusteront pour la plus grande satisfaction et le plus grand bien de l’adolescent.
Je ne dis pas que, dans ces conditions, le choix de l’enfant sera toujours judicieux, le meilleur, et devra être tenu pour définitif ; mais je dis que, d’une part, il y aura toutes chances pour qu’il en soit ainsi et que, d’autre part, nous aurons, nous, à l’égard de cet enfant, accompli notre devoir, tout notre devoir.
Des êtres complets.
Le rôle de l’Education, c’est de porter au maximum de développement toutes les facultés de l’enfant : physiques, intellectuelles et morales. Le devoir de l’Educateur, c’est de favoriser le plein épanouissement de cet ensemble d’énergies et d’aptitudes qu’on l’encontre chez tous. Et je dis qu’en dotant les enfants qui nous sont confiés de toute la culture générale qu’ils sont aptes à recevoir et de l’entraînement technique vers lequel les porteront le plus leurs goûts et leurs forces, nous aurons accompli à leur égard notre devoir, tout notre devoir. Car, nous aurons, ainsi, formé des êtres complets.
Des êtres complets ! De nos jours, on en trouve fort peu ; je pourrais même dire qu’on n’en trouve pas. Et c’est là une des conséquences fatales de l’organisation sociale et des méthodes éducatives qui en découlent. Ici, c’est un fils de bourgeois dont les parents ambitionnent de faire un fort en thème ou un calé en mathématiques, mais qui croiraient donner à leur rejeton une éducation indigne de leur rang et de la situation sociale à laquelle ils destinent ce rejeton, s’il apprenait à travailler de ses mains le métal, le bois ou la terre. Là, c’est un fils de prolétaire plus ou moins besogneux, que la famille arrache, dès l’âge de douze à treize ans, à l’école. Il sait tout juste lire, écrire et compter ; il est à l’âge où l’intelligence s’ouvre à la compréhension, où la mémoire commence à emmagasiner, où le jugement se forme ; n’importe ! Il faut qu’il aille à l’atelier ou aux champs ; il est temps qu’il travaille. Les parents disent :
« Et puis, est-il utile qu’il devienne un savant, pour faire un paysan ou un ouvrier ? »
Qu’advient-il ?
Le premier de ces deux garçons arrivera peut-être à un degré appréciable de culture intellectuelle : artiste, savant, littérateur, philosophe, il aura sa valeur, je ne le conteste pas ; mais il sera d’une ignorance lamentable et d’une insigne maladresse, dès qu’il s’agira de raboter une planche, de frapper un coup de marteau, de réparer ou de manier un outil, en un mot de se livrer à un travail manuel quelconque. Le second sera peut-être, dans sa partie, un travailleur suffisant : mécanicien, tailleur, maçon ; je n’en disconviens pas ; mais, en dehors de son métier, il sera d’une ignorance crasse et d’une déplorable incompréhension. L’un et l’autre se seront convenablement développés dans un sens, mais ils auront totalement négligé de se développer dans l’autre. Le premier sera un théoricien, non un praticien ; le second sera un praticien, non un théoricien. L’un saura se servir de son cerveau, pas de ses bras ; l’autre saura se servir de ses bras, pas de son cerveau.
Le fils de bourgeois sera enclin à considérer comme indigne de lui le travail manuel et comme inférieurs à lui ceux qui en vivent ; le fils de prolétaires sera porté à s’incliner devant la supériorité du travail intellectuel et à s’humilier, admiratif, respectueux et soumis, devant ceux qui l’exercent. Résultat : au point de vue individuel, aucun d’eux ne sera un être complet ; celui-ci : muscles vigoureux, cerveau débile ; celui-là : cerveau vigoureux, muscles débiles : l’un et l’autre, hommes incomplets, moitiés d’hommes, tronçons d’humanité. Au point de vue social : rivalité entre travailleurs manuels et intellectuels ; labeur intellectuel plus considéré et mieux rétribué que le labeur manuel ; celui-ci continuant indéfiniment à être infériorisé, mal rétribué et humilié.
L’Education doit avoir pour objet et pour résultat de former des êtres aussi complets que possible, capables, en dépit de leur spécialisation accoutumée, quand les circonstances le permettent ou le nécessitent : travailleurs manuels, d’aborder l’étude d’un problème scientifique, d’apprécier une œuvre d’art, de concevoir ou d’exécuter un plan, voire de participer à une discussion philosophique ; travailleurs intellectuels, de mettre la main à la pâte, de se servir avec dextérité de leurs bras, de faire, à l’usine ou aux champs, figure convenable et besogne utile. La Ruche a la haute ambition et la ferme volonté de lancer dans la circulation quelques types de celte espèce. C’est pourquoi on y mène de front l’instruction générale et l’enseignement technique et professionnel.
Nos ateliers.
Jusqu’à ce jour, nos ateliers n’ont rien produit pour l’extérieur. Seule, l’imprimerie a fait exception. Menuiserie, forge, couture, lingerie, reliure, n’ont travaillé que pour les besoins de La Ruche. En réalité, ces ateliers ont été et sont encore plutôt des services que des ateliers ; quelques-uns, vraisemblablement, garderont ce caractère ; d’autres, comme la menuiserie, la reliure et, peut-être, la couture, tout en restant des services et répondant aux besoins courants de l’Œuvre, deviendront sans doute, dans un avenir prochain, des ateliers de production en même temps que d’apprentissage.
Lorsque, arrivé à l’âge de seize ans environ, un enfant, garçon ou fille, possède une culture générale suffisante et un entraînement professionnel lui permettant de travailler à l’extérieur et, comme ouvrier ou ouvrière, de suffire à ses besoins, il peut, à sa volonté, quitter la Ruche ou y rester. Il est libre et il fait son choix en toute indépendance.
Il est probable qu’une certaine proportion de ces adultes restera à la Ruche. Ceux-là cesseront d’être au nombre de nos pupilles et prendront rang parmi nos collaborateurs. Nous en avons déjà quelques-uns qui se trouvent dans ce cas. Ils travaillent à l’atelier dans lequel ils ont fait leur apprentissage et exercent le métier qu’ils ont appris. Le temps est proche où nos couturières, nos menuisiers et nos relieuses seront à même d’exécuter proprement le travail qui leur sera confié et où, dans chaque atelier, ils seront assez nombreux pour que leur production dépasse les besoins constants de la Ruche. Nous entrevoyons donc, d’ores et déjà, la possibilité de travailler pour l’extérieur. Nous nous proposons, à la menuiserie, de faire le meuble. Dans les centres ouvriers — où nous trouverons la presque totalité de notre clientèle -, les ménages à situation modeste ont à choisir entre le meuble grossier, fruste, mal conditionné, mais relativement solide et le meuble tape-à-l’œil, c’est-à-dire élégant, gracieux, léger, mais fragile. Le premier ne flatte pas l’œil, mais résiste ; le second est agréable à la vue, mais il ne fait pas un long usage et ne résiste guère aux étourderies turbulentes de la marmaille ou aux chocs d’un déménagement. La Ruche rendrait un grand service à la classe ouvrière de Paris et des villes importantes de province en mettant à sa disposition un meuble qui éviterait ce double défaut : rusticité, fragilité, c’est-à-dire un meuble à la fois élégant et robuste, gracieux et solide.
Même observation pour la reliure : elle est de luxe ou par trop rudimentaire. De luxe, elle coûte trop cher ; trop rudimentaire, elle cède rapidement à l’usage. Pour les Bourses du Travail, les Syndicats, les Coopératives, les Bibliothèques populaires et les camarades qui sont appelés à constituer notre clientèle, il faut une reliure simplement confortable, dont le prix ne dépasse pas les ressources fort limitées de cette clientèle et dont la solidité est suffisante.
Il ne suffit pas, il est vrai, de produire bien et dans des conditions avantageuses, il faut encore s’assurer des débouchés. Pour la Ruche, cette question est résolue d’avance. Nos débouchés existent ; ce sont les Syndicats, les Coopératives, les Universités populaires, les Bourses du Travail, les Groupements d’avant-garde, tous amis de la Ruche, et aussi la multitude des camarades qui, individuellement, suivent avec intérêt le développement de celle-ci. Il suffira de faire appel à ces débouchés pour qu’ils s’ouvrent. Nous en avons l’assurance, car ce sont ces camarades et ces organisations qui, depuis sa fondation, forment la clientèle de notre imprimerie. Celle-ci fonctionne depuis un an et les commandes lui viennent de toutes parts.
Ce qui se passe pour l’imprimerie se passera pour la reliure et la menuiserie ; cela n’est pas douteux.
Notre budget.
Entre nos dépenses et nos recettes, la différence a été de 29.719 francs, du 30 juin 1913 au 30 juin 1914. Ce déficit de 30.000 francs a été comblé par le produit de mes conférences au cours du même laps de temps, soit du 30 juin 1913 au 30 juin 1914. Il est équitable de reconnaître que ce déficit est considérable et inquiétant. Je ne suis plus de première jeunesse ; j’arrive à l’âge où les forces fléchissent. Je me sens encore robuste et bien portant ; j’ai la même ardeur au travail, la même énergie, la même endurance qu’il y a vingt ans. Il faut néanmoins prévoir que je ne pourrai pas impunément prolonger, au delà de quelques années, l’effort soutenu et énorme que j’accomplis depuis plus d’un quart de siècle. La vieillesse, malgré tout, vient avec son inévitable et douloureux cortège de défaillances et d’infirmités. Il est prudent de prévoir aussi la maladie, l’accident, la mort, qui peuvent fondre sur moi et brusquement m’emporter ou me mettre hors de combat.
Et, à l’examen des chiffres ci-dessus, les amis de la Ruche peuvent concevoir sur son avenir de vives appréhensions. Ils peuvent redouter que l’apport que, depuis sa fondation, je fais, chaque année, à la Ruche venant à lui faire subitement défaut, cette œuvre ne disparaisse sous le poids de charges devenues trop lourdes. Je conçois les alarmes de nos amis et, depuis longtemps, je vis, en dépit de mon robuste optimisme, dans l’angoisse d’une de ces éventualités que j’énumère plus haut et de cette fatalité inéluctable : la vieillesse, au seuil de laquelle je me trouve.
Confiance en l’avenir.
Eh bien ! Que nos amis se rassurent. Peu de temps nous sépare de l’heure à laquelle la Ruche, cessant d’être obligée de compter sur les ressources au caractère nécessairement aléatoire qu’elle doit à mes conférences, parviendra à se suffire à elle-même et finira par substituer à ces ressources des produits ayant un caractère régulier et assuré. Très sincèrement je pense qu’il est permis de le croire, et je le crois. Quoi qu’il en soit, nos efforts tendent vers ce but et nous avons, mes collaborateurs et moi, pleine confiance que nous l’atteindrons. Le plus difficile est fait. Nous avons vaincu les premières et plus grandes difficultés ; nous avons traversé la période de tâtonnement et, si loin qu’apparaisse encore ce but si désirable et si ardemment désiré, il est certain que la route déjà parcourue est beaucoup plus longue et ardue que celle qui nous en sépare. Notre confiance est donc légitime ; elle est fondée ; elle est inébranlable.
J’arrête ici les emprunts que je fais à la brochure qui a pour titre : « La Ruche. Une œuvre de solidarité. Un essai d’éducation ». Les indications ci-dessus seraient incomplètes si je n’y ajoutais les renseignements propres à faire connaître en quoi la Ruche fut un essai d’éducation intéressant à plus d’un titre. Au moment où j’aborde la question entre toutes délicate et complexe de l’éducation et de l’enseignement, qui furent en honneur à la Ruche, j’engage le lecteur à se reporter aux études remarquables qu’il trouvera aux mots Ecole, Education, sous la signature de notre collaborateur E. Delaunay.
Idéal et réalité.
Il est à désirer que l’enseignement s’étende à des matières de plus en plus nombreuses et l’idéal serait qu’il pût embrasser tout le domaine du savoir, afin que, d’une part, tout écolier fût initié à l’ensemble des richesses intellectuelles qu’ont accumulées, au cours des siècles, tous les hommes de science et qui constituent, à l’heure actuelle, le fabuleux trésor dont il est équitable que tous soient appelés à bénéficier ; afin que, d’autre part, chacun ayant, de la sorte, l’occasion de connaître et de préciser ses aptitudes, eût le loisir et l’avantage de se spécialiser au grand profit de lui-même et de ses semblables. Mais la réalité est, hélas, peu d’accord avec cet idéal. Dès l’âge de douze à treize ans, huit enfants sur dix quittent définitivement l’école : l’apprentissage, le labeur quotidien, les âpretés de la lutte pour la vie les en tiendront éloignés à jamais. Durant les quelques années qu’ils auront passées à l’école primaire, ils n’auront pas pu apprendre grand-chose. L’essentiel, c’est qu’ils aient bien compris et qu’ils soient en mesure de bien retenir et d’utiliser au mieux ce « pas grand-chose ». Ce résultat exige qu’il ne leur soit enseigné que ce qu’il est indispensable qu’ils sachent, que les programmes ne comprennent que les connaissances pratiques dont ils feront usage dans la vie et la raison commande d’expurger de ces programmes toutes les matières qui n’ont pas un caractère incontestable d’utilité. L’important, c’est que, à l’école, l’enfant apprenne à apprendre. Ce résultat dépend moins du disciple que du maître, car c’est affaire de méthode.
L’importance de la méthode.
Il en est — ce sont à coup sûr les plus nombreux, si l’on excepte les membres du corps enseignant — qui tiennent le raisonnement suivant : « Pourvu que l’enfant apprenne, pourvu qu’il sache, qu’importe le procédé qu’il a employé pour apprendre, pour savoir ! Le résultat reste le même ». C’est là une erreur considérable et c’est se tromper grossièrement que de croire que le résultat est le même. Les procédés pédagogiques varient à l’infini et l’on peut dire que dans le détail, chaque éducateur a les siens. Toutefois, ces procédés ne sont pas seulement multiples, ils sont antagoniques et, dans la pratique, ils procèdent, vus d’ensemble, de deux méthodes opposées et aboutissent à deux résultats contradictoires.
Les deux méthodes.
L’une de ces méthodes est exclusivement déductive : elle consiste à formuler une règle, un principe, une proposition. Le Maître en donne lecture ; le livre placé entre les mains de l’enfant l’exprime. Ces règles sont presque toujours rédigées en termes brefs, peu courants, et abstraits. Il est rare que l’enfant saisisse le sens précis de ces termes, à plus forte raison qu’il saisisse l’exacte signification de la phrase. Cette formule serait en latin ou en grec, il ne la comprendrait guère moins. Puis, la règle lue, le principe énoncé, le Maitre, par déduction, donne des exemples et multiplie les applications.
Que la règle soit exacte ou erronée, que l’enfant ait ou n’ait pas compris la proposition, peu importe. La règle est imprimée dans le livre qu’on lui a remis ; le maître qu’on lui a donné affirme l’exactitude du principe. Cela suffit à l’enfant, cela doit lui suffire. Il a la sensation que son livre et son Maître ne peuvent ni ne veulent l’induire en erreur. Pour lui, la parole du Maitre « Magister dixit » remplace avantageusement la meilleure des démonstrations, la preuve la plus péremptoire.
L’autre méthode procède d’une façon diamétralement opposée. Elle place l’enfant en présence des réalités et l’incite à faire usage, pour observer les faits, de tous les moyens dont il dispose ; elle l’entraîne à observer et à multiplier les observations ; elle l’habitue à constater, à contrôler, à vérifier, à comparer, à noter les ressemblances et les oppositions ; elle l’impressionne à l’aide de tous ses sens ; puis, elle l’invite à grouper, à sérier, par similitude ou par contraste, les observations faites ; elle l’achemine graduellement vers les classifications résultant des notations innombrables ; enfin, le cercle des constatations s’élargissant toujours, elle le conduit insensiblement il la découverte de la règle, du principe.
Cette méthode est exclusivement inductive.
Dans la première méthode (déductive), le livre et le Maître jouent le rôle principal, l’élève ne tient que l’emploi secondaire. Dans la seconde (inductive), les rôles sont renversés : c’est l’élève qui joue le rôle le plus important ; puisque, au lieu que ce soit le professeur qui présente, explique et enseigne à l’enfant une règle formulée d’avance, c’est l’enfant qui cherche, fait effort, observe, note, classe, généralise sous la simple direction du professeur, dont le rôle se borne à guider l’enfant et à le préserver des erreurs que ne manqueraient pas de susciter son impatience, sa fébrilité, son inexpérience.
La méthode dogmatique.
La première méthode est, au fond, une méthode dogmatique, religieuse ; elle implique, de la part du disciple, un acte de foi envers le livre et l’éducateur ; car le disciple, en l’espèce, n’admet pas la règle parce qu’il en a lui-même contrôlé le bien-fondé ; il ne tient pas la règle pour exacte parce qu’il a pris soin d’en vérifier la justesse. Il y croit ; il la considère comme l’expression d’une certitude, parce qu’elle lui est enseignée par son livre et par son Maître, parce qu’il a confiance en l’un et en l’autre, parce qu’il a la conviction gue celui-ci et celui-là ne peuvent ni se tromper ni le tromper, parce que, pour tout dire en un mot, il croit, il a foi en ce qui est écrit et en ce qui lui est enseigné.
La méthode positive.
La seconde méthode rejette, au contraire, tout credo ; elle ne tient compte que des choses concrètes, vivantes, vues ; elle nécessite l’observation ; elle fait appel à l’esprit critique ; elle s’appuie sur l’expérimentation ; elle comporte la vérification, le contrôle ; elle exige l’exercice raisonné et constant du libre examen. En allant du composé au simple, du général au particulier, du nombre à l’unité, de l’harmonie au son, de la règle au fait, du principe à l’application, la première méthode va de l’a priori à l’a posteriori, de l’inobservé à l’observé, de l’inconnu au connu et, conséquemment, présuppose, au point de départ, un acte de foi, un geste religieux. En allant du simple au composé, du particulier au général, de l’unité au nombre, du son à l’harmonie, du fait à la règle, de l’application au principe, la seconde méthode va, au contraire, de l’observé à l’inobservé, du connu à l’inconnu et n’implique aucun acte de foi, aucun geste religieux, Qu’il le veuille ou non, qu’il le sache ou l’ignore, l’instituteur laïque qui pratique la première méthode, procède à la façon d’un croyant.
Osera-t-on soutenir, maintenant, que, quelle que soit la méthode en usage, pourvu que l’enfant apprenne, sache, soit mis en possession de la règle, le résultat est le même ? N’est-il pas de toute évidence que la première méthode, qu’on peut qualifier ad libitum de métaphysique, irrationnelle, dogmatique ou religieuse, favorise la paresse d’esprit, prédispose à la crédulité et fait appel à la mémoire plus qu’à la raison ? N’est-il pas de même évidence que la seconde méthode, qu’on peut qualifier, ad libitum de positive, rationnelle, expérimentale ou scientifique, stimule la curiosité, favorise l’activité cérébrale, éloigne de la crédulité et situe, chacune à la place qui doit être sienne, ces deux facultés : la raison et la mémoire ? Qui oserait hésiter entre ces deux méthodes dont la seconde, par le fait seul qu’elle développe beaucoup plus que l’autre la personnalité de l’enfant, est incontestablement supérieure à la première ?
Le but et le résultat de l’enseignement ne sont-ils pas réveiller chez l’enfant les curiosités qui sommeillent ; de développer les facultés intellectuelles qui se trouvent en lui à l’état potentiel ; d’actionner toutes ses énergies cérébrales, de discipliner son imagination, de fortifier son jugement, d’accroître sa mémoire, de rendre plus rapide et plus ample sa faculté de compréhension, afin que s’épanouisse de plus en plus, à la faveur d’une gymnastique méthodique et raisonnée, sa personnalité ?
La seule chose essentielle serait que fussent déposées dans son cerveau les connaissances utiles, et la méthode employée pour les y introduire serait sans importance, en tout cas d’importance tout à fait secondaire ? Pardon ! J’ose avancer que, tout au contraire, c’est la méthode, ici, qui importe le plus. Ai-je besoin de dire que, à la Ruche, c’est la méthode dont je fais, ici, l’éloge qui ne cessa jamais d’être employée ?
L’enfant doit être lui-même.
Je ne me reconnais pas le droit de vouer d’avance l’enfant aux convictions qui sont miennes et pour lesquelles je n’ai opté que dans la plénitude de mon indépendance et de ma raison. Le « petit » ne doit pas être le pâle reflet du « grand » ; le rôle du père n’est pas de se survivre, de se perpétuer, tel quel, dans sa descendance ; l’éducateur ne doit pas tendre à se prolonger dans l’éduqué, à substituer son jugement au jugement de celui-ci.
Ce n’est pas ainsi que je conçois le rôle de « Frères aînés » que nous sommes. La mission du « grand », mission de toutes la plus haute, la plus noble, la plus féconde, mais aussi la plus délicate — consiste à projeter dans le cerveau obscur du « petit » les clartés qui guident, à faire pénétrer dans sa fragile volonté les habitudes qui vivifient, à faire descendre dans son cœur les sentiments qui le mouvementent vers ce qui est juste et bon. L’éducateur doit être un exemple, un guide et un soutien : pas moins, pas plus, si l’on veut que l’enfant reste lui-même, que ses facultés s’épanouissent, que, par la suite, il devienne un être fort, digne et Libre.
Je conçois que l’Educateur et le Père aient de la joie à se refléter, à se mirer dans l’enfant qu’ils élèvent ; ce désir de façonner l’éduqué à l’image de l’éducateur est humain ; il n’en est pas moins condamnable et doit être réprouvé. Où en serions-nous du progrès, si les enfants n’avaient toujours été que la reproduction exacte, l’image fidèle des pères, si les écoliers n’avaient toujours été que la photographie scrupuleuse des Maîtres ? Chacun de nous estime que ses sentiments sont les plus nobles, ses convictions les plus saines, ses manières de voir les plus justifiées. Et c’est sans doute pour cela que chacun de nous se croit autorisé à user de tous les moyens en son pouvoir pour les faire partager et adopter par l’enfant. C’est une lourde faute.
Et puis, nous sommes encore mal accoutumés à considérer que l’enfant n’appartient ni à son père, ni à son Maître, ni à l’Eglise, ni à l’Etat ; mais qu’il s’appartient à lui-même.
A la Ruche, mes collaborateurs et moi, nous n’avons jamais perdu de vue cette vérité, de nos jours encore méconnue, mais qui est appelée à être admise sans contestation, lorsque le despotisme de l’Etat et l’autorité abusive du père de famille auront disparu.
Le système de classement.
Je suis l’adversaire déterminé du système de classement en honneur et en usage dans presque tous les établissements où l’on enseigne. Le classement passe, dans l’opinion générale, pour être un heureux stimulant et la plupart des familles s’imaginent qu’il détermine entre les écoliers une émulation nécessaire. Telle n’est pas mon opinion. L’expérience démontre que non seulement le classement ne produit aucun effet véritablement utile, mais encore qu’il aboutit à des résultats déplorables.
Les premiers — ce sont toujours les mêmes : les mieux doués, les plus studieux — deviennent, à la longue, insupportables de présomption. Il faut voir de quel œil dédaigneux d’abord, méprisant ensuite, ces gamins et ces gamines qui occupent toujours le premier rang, dévisagent les pauvres petits camarades qui se traînent lamentablement aux dernières places !
Choyés, encouragés, encensés, ces enfants, l’orgueil de leur famille et la gloire de l’établissement, finissent par croire qu’ils sont d’essence supérieure, qu’un sang plus généreux et plus pur coule dans leurs veines et que les éloges, les adulations et les récompenses leur sont dus. Ils s’habituent, petit à petit, à considérer qu’il doit y avoir à l’école deux catégories d’enfants : ceux qui sont faits pour marcher en tête et ceux qui sont faits pour se traîner en queue ; ceux qui sont destinés par leurs aptitudes et leurs mérites à être toujours en avant, les premiers et ceux qui, par leur inintelligence ou leur paresse, sont condamnés à demeurer toujours en arrière, les derniers ; ceux à qui vont, tout naturellement, les admirations et les récompenses et ceux sur qui, tout naturellement, tombent les réprimandes et les punitions. Et comme ils sont les heureux bénéficiaires d’un tel état de choses, ils sont irrésistiblement enclins à trouver qu’il est juste, avantageux, en tous cas nécessaire qu’il en soit ainsi.
Plus tard, quand ils entreront dans la circulation sociale, ces enfants, transportant dans leur milieu les sentiments acquis et les pratiques contractées à l’école, joueront des coudes pour se pousser aux meilleures places, convaincus que l’essentiel, c’est d’être au premier rang, quels que soient les moyens employés, et que le succès justifie tout. Ils n’auront qu’une ambition : parvenir. Constatant que, dans la société comme à l’école, il y a deux humanités ; celle qui marche en tête et celle qui suit en queue ; celle pour qui tout est succès et prospérité et celle pour qui tout est revers et déboires ; celle qui soulève l’admiration et celle qui provoque le mépris ; ces enfants, que l’école aura poussés vers l’arrivisme à tout prix, tenteront avant tout et uniquement de se glisser parmi ceux qui composent 1’humanité privilégiée.
Ils ne seront jamais de ces consciences hautes et probes, capables de mettre le respect de la vérité, l’amour de la justice et le culte de la loyauté au-dessus de la Fortune ou du Pouvoir ; ils ne seront jamais de ces cœurs affectueux et fraternels qui, au spectacle d’un camarade tombé dans l’infortune, s’attardent à voler à son aide et à lui tendre une main secourable ; ils ne seront jamais de ces volontés ardentes et généreuses, prêtes à sacrifier le souci de leurs intérêts immédiats et matériels à l’inexprimable joie de se faire le champion désintéressé d’une cause noble et juste. Une seule préoccupation les hantera, un seul but les tentera, vers lequel tendront tous leurs efforts : parvenir. Ils ne ressentiront que deux passions : la cupidité et l’ambition, ils ne désireront et n’aimeront que deux choses : la richesse et le pouvoir.
Quant aux derniers, quant à ceux que le classement rejette aux dernières places, ce sont aussi toujours les mêmes : les moins bien doués, les moins studieux. Ceux-là, à la longue, prennent ombrage du succès des autres et ouvrent leur cœur à l’envie. Ils rougissent et souffrent de leur humiliation constante. Stimulés par le Maître, pressés par la famille, ils voudraient bien, eux aussi, se pousser au premier rang ; mais ils manquent des aptitudes et de l’activité nécessaires. En présence de la stérilité de leurs efforts, ils se découragent insensiblement. Peu à peu le dégoût s’empare d’eux et ils prennent en grippe l’effort inutile, en haine le travail impuissant.
Et puis, ils finissent par s’accoutumer à être les derniers ; ils en prennent leur parti ; ils s’y résignent et, en fin de compte, tout en déplorant de ne pas être parmi les premiers à cause des avantages qui en résulteraient pour eux, ils trouvent qu’il est juste qu’il y ait des premiers et des derniers, que, sans doute, il est nécessaire qu’il en soit de la sorte, qu’en tous cas c’est fatal. Ainsi, ce qu’on sème, par le classement, c’est : chez les premiers, la vanité, la présomption, le mépris des inférieurs, l’arrivisme quand même ; chez les derniers, l’envie, le découragement, le dégoût de l’effort, la résignation.
Je passe sous silence ces haines, ces rivalités, ces conflits qui, trop souvent, font de l’école un champ clos où se heurtent violemment les vanités et les irritations. Pourtant, ces petits ne connaîtront-ils pas assez tôt, toujours trop tôt, les âpretés de la concurrence, les rigueurs implacables de la lutte pour la vie ? Et n’est-il pas désirable qu’on les tienne éloignés le plus longtemps possible de ces compétitions stériles et pernicieuses ?
Cas de conscience insoluble.
Chaque fois qu’un Educateur doit se livrer à la besogne du classement, se trouve en présence d’un cas de conscience dont la solution est aussi redoutable que difficile.
Voici deux enfants ; l’un a reçu de la nature les dons les plus heureux ; son intelligence est vive, sa mémoire prompte et fidèle, son imagination ardente et mesurée, son jugement sain, Il travaille peu et réussit. L’autre n’a pas été — tant s’en faut — aussi favorisé par la nature ; sa compréhension est lente, sa mémoire ingrate, son imagination paresseuse, son jugement mal équilibré. Il travaille beaucoup et réussit mal. Que va faire l’Educateur ? Que va-t-il récompenser par la meilleure place : l’aptitude ou l’effort ? A qui va-t-il, pour être équitable, attribuer le premier rang, à la nature ou au travail ?
Va-t-il donner la première place à celui qui a le moins travaillé, mais le mieux réussi ? Va-t-il, au contraire, tenant compte de l’effort accompli, ne fût-ce que pour récompenser un effort d’autant plus méritoire qu’il est plus malaisé et plus ingrat, va-t-il proclamer premier celui qui a le plus travaillé, mais le moins bien réussi ? Ce serait contraire à toutes les règles usitées dans le système de classement et cependant cela seul serait équitable. En réalité, ce système est inique et déplorable. On ne doit pas comparer l’un à l’autre et faire concourir à la même tâche deux enfants dont les forces sont aussi disproportionnées.
L’enfant ne doit se comparer qu’à lui-même, il ne peut composer qu’avec lui.
Le classement n’est pas un stimulant. Ne demandant pas assez à l’écolier intelligent, il ralentit sa marelle au lieu de la presser ; exigeant trop de l’écolier moins intelligent, il aboutit à le décourager.
L’Educateur a le devoir de comparer l’enfant d’aujourd’hui à celui d’hier, comme il comparera celui de demain à celui d’aujourd’hui et, par ses encouragements ou ses admonestations, selon le cas, il obtiendra de lui, en tablant sur une base exacte et juste, tout ce que l’élève est susceptible de donner comme effort et de produire comme résultat.
C’est ainsi que nous avons procédé à la Ruche et nous n’avons eu qu’à nous louer de la suppression du système de classement.
L’éducation morale.
L’accord existe déjà, ou à peu près, sur les meilleures conditions à réaliser pour le développement physique de l’enfant. On commence à s’entendre également sur les méthodes pédagogiques les plus aptes à favoriser son développement intellectuel. Mais le désaccord persiste et reste profond sur les procédés éducatifs à employer pour son développement moral ; pour l’entraînement méthodique de sa volonté, la formation de sa conscience et l’épanouissement de son cœur. Ici, tout est à faire, à refaire, ou peu s’en faut. Le conflit est âpre entre ces deux méthodes : sévérité ou douceur ; contrainte ou liberté ; dressage ou éducation. Examinons chacun de ces points.
Sévérité ou douceur.
Beaucoup de personnes ont le sentiment que l’enfant naît pervers et qu’il ne peut être aiguillé vers le bien que par une éducation sévère. Ces personnes professent l’opinion que, naturellement, instinctivement poussé, par de détestables prédispositions, vers les sentiments bas et les actions condamnables, il ne peut être éloigné des pratiques contraires à la morale privée et publique que grâce à un système de surveillance et de sévérité organisant perpétuellement autour de lui l’étouffement de ses aspirations, l’arrêt de ses élans. Elles affirment que tout appel à la générosité, à la justice, à la bonté, à l’amour d’autrui restera fatalement vain, s’il ne s’appuie — comme sanction de l’acte commis — sur l’idée d’une récompense à obtenir ou d’un châtiment à éviter. Ne parlez à ces gens ni de douceur ni d’indulgence envers les petits : ils vous regarderont de travers comme ils dévisageraient un esprit chimérique. Ne leur laissez pas entendre que, dans le domaine de l’éducation, comme dans les autres, vous attendez beaucoup plus de la persuasion que de la menace ; ils hausseront les épaules avec la commisération dédaigneuse que ces partisans de la « manière forte » accordent à « l’imagination maladive » d’un partisan de « la manière douce ». Railleries, sarcasmes, éclats de rire, c’est tout ce qu’ils sauront vous opposer, avec quelques clichés fortement usagés sur la nécessité de faire marcher les enfants à la baguette, de ne rien leur laisser passer, de les mener tambour battant ; faute de quoi, affirment-ils, on n’en peut rien obtenir.
Le tout est de savoir ce qu’il est désirable d’en obtenir. S’il s’agit d’obtenir d’eux qu’ils ne fassent pas un mouvement quand vous êtes là et se tiennent bien tranquilles ; s’il s’agit d’obtenir que, vous présent, ils ne fassent rien de ce que vous leur avez défendu de faite sous peine de taloches ou de privations de dessert ; s’il s’agit d’obtenir qu’ils ne prononcent pas une parole quand « il y a du monde » parce que les enfants bien élevés ne doivent pas se mêler à la conversation des grandes personnes ; oh ! oui, certes, vous pouvez, à l’aide de rigueur et à grand renfort d’attitudes menaçantes, obtenir tout cela. Mais, sachez d’une part que cette immobilité, cette obéissance passive et ce silence de commande n’ont aucun caractère de moralité ; sachez que c’est le propre de l’enfant de bouger et de parler quand il en ressent le besoin ; et n’oubliez pas, d’autre part, que, dès que vous aurez tourné les talons, l’enfant bien tranquille, bien obéissant et bien silencieux se hâtera de se dégourdir les jambes, de faire ce que vous lui aurez défendu et de bavarder à tort et à travers.
Le résultat de votre système de sévérité et de punition sera : l’hypocrisie, la pire des fautes chez l’enfant ; la seule peut-être qui soit vraiment répréhensible. Car, que l’enfant, ignorant, étourdi, turbulent, inconsidéré se laisse aller à oublier vos sages conseils, néglige de se conformer à vos recommandations, ne tienne pas un compte suffisant de vos observations, c’est certainement regrettable ; mais ce peut n’être que légèreté, inexpérience, espièglerie, inconscience ; la faute n’est pas là ; en tout cas, s’il y a faute, elle n’est pas bien grave et ne prouve en aucune façon que l’enfant ne vous aime pas, n’est pas bien intentionné, n’a pas le désir de vous être agréable et de se conformer à vos prescriptions.
La faute — faute grave — commence avec la dissimulation. Et le mensonge, la sournoiserie sont les fruits inévitables de la sévérité, de la menace
Dix gestes d’étourderie, d’irréflexion, ne sont pas grand-chose. Un seul geste d’hypocrisie est beaucoup. La sévérité fait des sournois, des craintifs et des lâches. Elle est mortelle à la franchise, à la confiance, au vrai courage. Elle élève entre l’éducateur et l’enfant les dangereuses barrières de la méfiance mutuelle ; elle aigrit le cœur des petits et les tient éloignés du cœur des grands ; elle détermine entre l’Educateur et l’enfant des rapports de Maître à Esclave et non d’ami à ami. Toutefois, ne confondons pas indulgence et laisser-faire. Je ne conseille pas à l’éducateur de fermer bénévolement les yeux sur la faute commise et de ne s’en pas soucier. Le procédé, dans ce cas, serait commode et à la portée de l’éducateur le plus paresseux comme du plus actif, du plus stupide comme du plus avisé.
Dans son inconscience, l’enfant ignore ce qu’il faut faire et ce qu’il faut éviter. L’expérience de l’éducateur lui est profitable, voire nécessaire ; le devoir du Maître est de mettre cette expérience au service de l’enfant, de le diriger, de le conseiller, de le soutenir ; s’il tombe, de le relever ; s’il se décourage, de le réconforter ; s’il pleure, de le consoler. Il faut donc, quand l’enfant a commis une faute — petite ou grande — la lui faire observer, la lui faire comprendre, lui expliquer en quoi et comment il a mal agi ; lui indiquer les suites fâcheuses de son acte, l’amener à le regretter. Il faut, ensuite, lui montrer ce qu’il aurait dû faire, afin que, le même cas se représentant, l’enfant sache comment se conduire. Il faut, somme toute, l’éloigner du chemin fâcheux dans lequel il a eu tort de s’engager et ouvrir devant lui la route où il sera bon qu’à l’avenir il dirige ses pas.
Mais il convient, quelle que soit la faute, de lui parler en termes affectueux et doux, d’une voix plus attristée que sévère, afin que, à la suite de cette tendre admonestation, l’enfant, bien loin de se sentir plus éloigné qu’avant, se sente au contraire plus rapproché de l’éducateur, plus confiant, plus aimant. Ce moyen est le plus apte à aspirer à l’enfant le regret de la faute et la résolution de ne plus recommencer.
Contrainte ou liberté ?
J’en conviens : la pratique de la liberté implique une sorte d’apprentissage. La liberté présuppose un état de conscience assez développé ; cet état de conscience nécessite un certain savoir, une certaine connaissance des choses, de l’expérience, des points de comparaison ; et, l’enfant ne possédant pas ce savoir, n’étant pas parvenu à cet état de conscience, on estime que le régime de la liberté n’est pas fait pour lui et que la contrainte lui est nécessaire. C’est aller un peu vite et je n’accepte pas cette conclusion qui n’a que l’apparence de l’exactitude. Veut-on dire que, manquant d’expérience et n’étant pas encore en possession d’un discernement suffisant, l’enfant fera parfois un usage regrettable ou périlleux, pour lui-même et pour autrui, de la liberté qui lui sera laissée ? Si c’est cela qu’on affirme, je suis prêt à le reconnaître. Mais en faut-il conclure qu’une atmosphère de liberté ne lui vaut rien et qu’il convient de ne laisser ses poumons s’emplir que de l’air de la contrainte ? Je ne le pense pas.
En matière d’éducation, le régime de la liberté comporte des risques et des inconvénients. C’est évident. Mais celui de la contrainte en entraîne de bien plus redoutables. Jetons d’abord un coup d’œil sur ces derniers.
La contrainte. Ses inconvénients.
Le régime de la contrainte a pour résultat de réglementer tous les actes de l’enfant ; il aboutit, par voie de conséquence, à la catégorisation de tous ceux-ci en prescrits et en défendus, en récompensés et en punis, car il n’y aurait pas contrainte, si l’enfant n’était pas tenu de se conformer aux prescriptions et aux défenses et si l’observation des premières et la violation des secondes n’entraînaient pas, comme sanction, selon le cas, une récompense ou un châtiment.
« Si tu fais telle chose, tu seras récompensé ».
« Si tu fais telle autre chose, tu seras puni ».
Tout le système est là. J’accorde aux partisans de ce système que leur discernement est judicieux, que leurs intentions sont pures et qu’ainsi la classification qu’ils ont établie : actes à faire et actes à ne pas faire, est sage, raisonnable et inspirée par l’intérêt de l’enfant. Comme on le voit, je mets les choses au mieux pour les défenseurs du régime que je combats. Je vais traduire ce régime et son application en un style plus familier, en un langage plus précis et en montrer le mécanisme par un exemple saisissant.
Une mère dit à ses deux enfants : « Je sors ; en mon absence, soyez bien tranquilles ; voici un livre d’images et de contes pour vous amuser ; ne touchez à rien ; ne descendez pas dans la rue ; si quelqu’un frappe, n’ouvrez pas. Si vous êtes bien sages, je vous donnerai deux sous à mon retour et, pour goûter, un beau morceau de chocolat ; ce soir, je vous mènerai au cinéma ou au cirque. Mais dans le cas contraire, si vous me désobéissez, pas de sou, pas de chocolat, pas de cirque, par de cinéma et une bonne fessée ». Et la mère s’en va.
De deux choses l’une : ou bien les enfants, à peine la mère partie, feront le diable à quatre, iront jouer dans la rue, toucheront à tout, bref, ne tiendront aucun compte des recommandations de la maman ; mais, pour ne pas avoir la fessée, pour avoir les sous et le chocolat, pour aller au cinéma ou au cirque, ils remettront tout en place, et au retour la mère les retrouvera feuilletant bien paisiblement leur livre d’images. Ou bien ces enfants se seront conformés aux ordres de la maman ; ils n’auront pas cédé au désir d’aller jouer dans la rue avec los petits voisins, dont les cris de joie parviennent jusqu’à leurs oreilles ; ils auront résisté à la tentation d’ouvrir pour savoir qui a frappé ; ils n’auront pas touché aux allumettes, quoi qu’ils eussent bien voulu en voir briller la flamme ; ils n’auront pas léché le pot de confitures quoi qu’ils en aient eu grosse envie.
Ah ! S’ils avaient été sûrs que leur désobéissance restât ignorée de la maman, ils se seraient bien contentés ! Car, il n’y a pas grand mal, après tout, à jouer dans la rue : les autres y vont bien ! La mère frotte bien des allumettes, pourquoi leur tape-t-elle sur les doigts, quand elle les voit en faire autant ? La confiture est faite pour être mangée, et elle est si appétissante ! Oui ! Mais maman s’en apercevrait et alors gare à la correction, et plus de sou, plus de chocolat, plus de cinéma, plus de cirque !
Dans le premier cas, le système de la contrainte : « Fais cela et tu seras récompensé ; fais cela et tu seras puni », n’aura pas empêché les enfants de désobéir, mais les aura poussés à un mensonge concerté dans le but d’être récompensés et de ne pas être punis. Dans le second cas, le système de la contrainte aura produit son effet ; mais en quoi la conduite de ces enfants sera-t-elle morale ? En quoi leur obéissance fait-elle honneur leur cœur ou à leur raison ?
Ici encore, on dira :
« L’important, c’est le résultat ! Et, pourvu que les enfants fassent ce qu’ils doivent faire et évitent ce qu’ils doivent éviter, c’est l’essentiel. »
On le voit, c’est dans le domaine moral la même objection que celle à laquelle j’ai répondu dans le domaine intellectuel. Eh bien ! Non ! Mille fois non ! Le résultat n’est pas tout.
La valeur morale d’un acte
Osera-t-on soutenir que les mobiles ne sont rien dans la valeur morale d’une action et que celle-ci seule importe ? L’acte qui consiste pour l’enfant en question à ne pas lécher le bout de ses doigts trempés dans le pot de confitures par crainte de recevoir une fessée ou dans l’espoir d’obtenir un gros morceau de chocolat, cet acte a-t-il un caractère de moralité quelconque ? Est-il niable que, par contre, le même acte posséderait une incontestable valeur morale s’il était dicté par l’un des mobiles suivants : ne pas prendre en cachette, parce que ce geste furtif et sournois porte en soi quelque chose d’humiliant ; ne pas aller à l’encontre du désir de la maman, parce qu’on l’aime et qu’on ne veut pas lui faire de la peine en lui désobéissant ; ne pas satisfaire tout seul sa gourmandise, même si personne ne s’en apercevait, parce que le pot de confitures est pour tous et doit figurer à la table commune ; ne pas céder à la tentation, pour la seule joie qu’il y a à se dominer, à se vaincre par un effort méritoire de la volonté ? Autant dire, alors, que, dans le domaine moral, le sens de la dignité est nul, et sans valeur aussi l’intervention du cœur et de la volonté dans les mobiles qui propulsent vers l’acte !
Et la raison ? N’a-t-elle rien à faire, non plus, dans l’appréciation de la valeur morale d’un geste ? L’enfant qui ne joue pas avec les allumettes parce qu’il n’ y en a que quatre sur la cheminée, que la mère les a peut-être comptées, et qu’il serait rossé ou puni s’il y touchait, cède-t-il à des conseils aussi moraux que ceux que lui donnerait sa raison s’il s’abstenait de jouer avec les allumettes parce qu’on lui a expliqué que c’est un jeu dangereux dont il pourrait, lui et les siens, être les premières victimes ?
Eh bien ! Le système de la contrainte n’exerce aucune des nobles facultés de l’enfant ; il ne s’adresse pas à sa raison, il ne parle pas à son cœur, il ne dit rien à sa dignité, il reste muet devant sa conscience. Il ne stimule en lui aucun sentiment élevé ; il ne met en mouvement aucun effort utile ; il n’éveille aucune noble aspiration ; il ne provoque aucune poussée généreuse ; il ne suscite aucun élan fécond. Il n’attire pas l’attention réfléchie de l’enfant sur les conséquences proches ou lointaines, directes ou indirectes, pour lui et pour les autres, de ses actes, en dehors de cette conséquence : récompense dans tel cas, punition dans le cas contraire.
Il ne laisse place à aucune initiative. Voyant s’ouvrir devant lui deux voies opposées, à l’entrée desquelles on a pris le soin de placer deux poteaux indicateurs sur l’un desquels il lit, en caractères laconiques et tranchants : « ce qu’il faut faire ; route de récompense » tandis que, sur l’autre, flamboie cette inscription : « ce qu’il ne faut pas faire ; route du châtiment », il s’évertue à déchiffrer dans l’énumération des actes à accomplir ou à éviter celui qui le sollicite, ne se détermine que d’après les indications des poteaux, sans se demander pourquoi il est bien de s’y conformer, sans éprouver dans la voie où il a engagé ses pas d’autre satisfaction que celle d’une récompense à décrocher ou d’un châtiment à fuir.
Ce système de la contrainte engendre insensiblement des êtres gris, ternes, incolores, effacés, sans volonté, sans ardeur, sans personnalité ; race servile, lâche, moutonnière, incapable des actes virils ou sublimes dont l’accomplissement présuppose et nécessite de la hauteur de vue, de la flamme, de l’indépendance, de la passion, mais parfaitement capable de cruauté et d’abjection, surtout dans les circonstances où, agissant en foule, la responsabilité individuelle disparaît.
La liberté : Ses inconvénients et ses avantages.
Le système de la liberté conduit à de tout autres résultats. Il offre des dangers, durant toute la période d’apprentissage. Aussi, convient-il que, dans les premiers temps, alors que l’enfant ignore à peu près tout des conséquences qui se trouvent au bout de ses actions, l’éducateur multiplie les avertissements, les conseils, les explications et les mille formes ingénieuses sous lesquelles peut intervenir son appui et s’exercer sa surveillance protectrice ; car s’il a le devoir de respecter la liberté de l’enfant, il a aussi celui de le protéger contre les périls de toutes sortes qui l’environnent. Petit à petit et dans la proportion où l’enfant, chaque jour mieux éclairé, se rend un compte plus exact de la portée de ses actes, cette sollicitude doit se relâcher, afin que l’enfant s’habitue à écarter lui-même de sa route les dangers qui le menacent.
Qu’on me permette une comparaison : l’enfant apprend à se bien conduire, comme il apprend à marcher. Quand il est encore tout petit et que ses jambes le portent à peine, quand il est à craindre qu’à chaque pas il ne fasse une chute ; quand il y a lieu de redouter que cette chute ne lui casse un bras ou ne lui brise une jambe, il est prudent et nécessaire de ne pas le perdre de vue, de le guider, de veiller à ce qu’il ne trébuche pas, de l’éloigner des obstacles, de soutenir sa marche chancelante, et si, malgré toutes les précautions prises, il choit, d’être là pour le relever et lui donner les premiers soins.
Il est certain qu’au début il tombera, s’abîmera peu ou prou les genoux ou les mains et poussera des cris comme si on l’écorchait vif ; mais les chutes s’espaceront ; les dégringolades se feront de plus en plus rares et de moins en moins dangereuses. Insensiblement, ses jambes s’affermiront, sa marche deviendra plus sûre. Alors, le moment sera venu de l’abandonner un peu plus à lui-même, ensuite tout à fait, le jour où il se tiendra solidement sur ses jambes, conservera fermement son centre de gravité et courra à perdre haleine sans perdre l’équilibre.
C’est à l’aide de procédés semblables que l’enfant s’habituera à marcher droit dans la vie, c’est-à-dire à se conduire sainement, clignement, noblement. S’il reste toujours en tutelle, s’il ne lui est pas permis de se mouvoir avant qu’il en ait reçu l’autorisation, si, par appréhension des chutes, des dangers, des obstacles, je veux dire : si, par crainte des fautes qu’il pourra commettre, des entraînements auxquels il sera exposé et des conséquences qui, pour lui ou pour les autres, pourront résulter de sa conduite, il reste toujours enfermé dans l’étau de la contrainte, tel le bébé dans les bras de sa mère, il ne saura jamais se conduire à travers les écueils de la vie ; il restera, adulte, cette petite chose sans personnalité et sans énergie qu’il était enfant. Et le jour où, livré à lui-même par la force de l’âge, par la mort ou l’abandon de ceux qui s’étaient donné la mission de penser et de vouloir à sa place, il devra penser, vouloir, agir de lui-même, il ne trouvera en lui ni raison pour le guider, ni cœur pour l’inspirer, ni volonté pour le mouvoir ni conscience pour le rassurer.
Sous les réserves que dicte la prudence et qu’appelle le soin de l’intérêt de l’enfant et de sa sécurité, le régime de la liberté n’enfante que d’heureux résultats.
Il entraîne l’enfant, dès l’âge de raison, vers l’exercice des plus nobles facultés ; il l’habitue à la responsabilité ; il éclaire son jugement ; il ennoblit son cœur ; il fortifie sa volonté ; il actionne en lui les efforts les plus féconds ; il stimule les poussées les plus généreuses ; il attire son attention sur les conséquences de ses actes ; il favorise son esprit d’initiative ; il multiplie ses activités ; il décuple ses énergies ; il développe merveilleusement sa personnalité. Il construit, lentement mais sûrement, un être digne sans arrogance, fier, sans morgue, épris d’indépendance pour les autres autant que pour lui, respectueux de la liberté d’autrui, comme il entend qu’autrui respecte la sienne, jaloux de ses droits et prêt à les sauvegarder.
Dressage ou éducation.
On vient de voir ce que donnent, dans la pratique, les deux systèmes en opposition : sévérité ou douceur ; contrainte ou liberté. Il est plaisant d’entendre les partisans de la sévérité et de la contrainte parler doctoralement d’éducation morale. J’en ai surpris beaucoup déjà en leur disant que, par cette méthode, on se flatte bien à tort de faire de l’éducation et que, en réalité, on ne fait que du dressage. Ce propos leur a paru de prime abord un joyeux paradoxe ; et cependant il est on ne peut plus facile de le justifier.
Supposez que je veuille obtenir d’un jeune chien qu’il fasse le beau, qu’il se tienne gracieusement sur son train de derrière, qu’il lève gentiment telle patte, qu’il exécute, sur mon ordre, au geste ou à la parole, des gambades, des sauts, des cabrioles, comment m’y prendrai-je ? Userai-je de persuasion à l’égard de ce chien ? Gaspillerai-je mon temps et ma salive à lui expliquer ce que j’attends de lui ? Ferai-je appel à ses bons sentiments pour l’amener à me satisfaire ? Non : la méthode est connue ; elle est classique : j’aurai, dans une main, un morceau de sucre et, dans l’autre, un fouet ou un bâton.
Par l’attrait de la récompense et par la menace du châtiment, j’exigerai du chien qu’il m’obéisse ; mon fouet le rappellera constamment à l’ordre ; chaque faute sera suivie d’une correction plus ou moins brutale ; coûte que coûte, le chien sera contraint de s’exécuter ; sans pitié pour le pauvre toutou, mon bâton entrera en collision sévère avec ses reins, jusqu’à ce qu’il me donne satisfaction ; alors, et alors seulement, je glisserai entre ses dents le morceau de sucre ou de viande. Viendra-t-il à l’idée d’une personne sensée de dire :
« Voilà un chien bien élevé ? »
Non ! Et tout le monde dira :
« Ce chien est bien dressé. »
Avec ce chien, je fais, en effet du dressage, pas de l’éducation. Chacun comprend, ici, que l’éducation comporte de la part de l’éduqué l’intervention de sa raison, de son cœur et de sa volonté, et chacun conçoit aussi que cette entrée en scène ne peut se produire que si la raison est éclairée, le cœur ému et la volonté entrainée.
Les fervents du morceau de sucre et du fouet diront-ils :
« Qu’importe ! Le résultat que l’on cherche est obtenu ; c’est l’essentiel. Qu’il y ait dressage ou éducation, c’est sans importance. »
En l’espèce et quand il s’agit du chien, ils ne se trompent pas. Car, voudrais-je m’adresser à la conscience du chien ? Je ne le pourrais pas ; je ne sais où elle loge. Aurais-je le désir de faire appel aux sentiments de dignité, de justice, d’affection du chien ? Je ne pourrais pas satisfaire ce désir. Je ne saurais quelle langue y employer et, tiendrais-je au toutou les plus éloquents discours, trouverais-je, pour le convaincre, les accents les plus persuasifs et les arguments les plus convaincants, il n’est pas douteux que le chien ne me comprendrait pas et resterait insensible à mon éloquence. Tandis qu’il comprend la menace du fouet et est sensible à la douceur du sucre. Ne pouvant impressionner ni la raison ni le cœur du chien, je m’adresse à sa gourmandise et à sa peur des coups. Je fais donc du dressage.
Mais, si je suis excusable de recourir à ce procédé de rigueur et de contrainte à l’égard du chien, parce que je n’en ai pas d’autre à ma disposition, je cesse d’être excusable si j’emploie le même procédé à l’égard de l’enfant. Celui-ci a un jugement et j’ai pour mission et pour devoir de le former ; il a une volonté et j’ai l’obligation de la fortifier ; il a une conscience et je dois l’éclairer ; il a un cœur et je suis tenu de tenter de l’émouvoir.
Les partisans de la « manière forte » oseront-ils soutenir qu’il n’y a pas de différence à établir entre l’enfant et le chien ? S’ils le prétendent, il est équitable et logique qu’ils appliquent à l’un et à l’autre le même système ; mais, alors qu’ils cessent de parler d’éducation et qu’ils substituent à cette expression inexacte la seule qui convient : dressage. S’ils admettent, au contraire, qu’il y a une différence entre l’enfant et le chien, il n’est ni logique, ni équitable qu’ils appliquent à l’un et à l’autre le même procédé. Qu’ils réservent au chien, à défaut d’autre moyen d’agir sur lui, la sévérité et la contrainte avec leur inévitable escorte de punitions et de récompenses ; et qu’ils recourent, pour l’enfant, à la douceur, à la persuasion, à la liberté, à la tendresse. De la sorte, ils feront : avec le chien, du dressage ; avec l’enfant, de l’éducation.
La puissance de l’exemple.
La plus grande force moralisatrice, c’est l’exemple. Le Mal est contagieux ; le Bien l’est aussi. L’exemple influe d’une façon quasi toute puissante sur l’enfant, en raison même de sa malléabilité. Il reflète si facilement et si fidèlement le milieu où il se développe qu’on pourrait, par l’enfant, connaître ce milieu et, peut-être plus aisément encore, par la connaissance du milieu, pressentir l’enfant. L’enfant baisse-t-il la tête comme si, nouvelle et moderne épée de Damoclès, une gifle allait tomber ? Vous pouvez affirmer sans hésitation qu’il reçoit souvent des coups et que ceux-ci sont généralement portés de haut en bas ; s’il recule, à l’approche de vos bras, c’est qu’il est plus accoutumé aux taloches, aux coups de poing distribués horizontalement, ou aux coups de pieds allongés de bas en haut. S’il répond à peine quand vous lui parlez, c’est, hormis le cas où il est exceptionnellement timide, la preuve qu’il a contracté l’habitude du silence imposé par les injonctions réitérées de l’entourage :
« Tais-toi ! Tu n’as pas la parole ! »
S’il tient les yeux fixés sur le sol et évite de vous regarder en face, c’est qu’il a vécu dans une atmosphère saturée d’hypocrisie. S’il jure, s’il est trivial dans son langage et grossier dans ses manières, c’est qu’il n’a pas fréquenté les salons cosmétiqués de « la haute » et qu’il n’a pas vécu dans la familiarité des messieurs de l’Institut ou de l’Académie française.
Mais que ceux qui l’entourent évitent les propos vulgaires et surveillent leurs manières, il perdra peu à peu l’habitude de parler trivialement et, pour peu qu’il ait reçu de la nature une certaine élégance, il deviendra distingué.
Qu’il soit transporté dans un milieu de franchise et il cessera de tenir les yeux hypocritement fixés vers le sol. Qu’il lui soit permis de parler quand il a quelque chose à dire et sa langue gagnera de l’aisance. Qu’il cesse d’être frappé et, se sentant à l’abri des coups, il cessera de figurer les « pauvres chiens battus ».
J’ai remarqué que les enfants batailleurs, querelleurs, violents, à la main leste, proviennent presque tous de familles où éclatent fréquemment les querelles, les batailles. Et j’ai constaté que ceux qui sont portés au bavardage, au cancanage, sortent presque tous des milieux où il est d’usage de potiner sur le pas des portes.
Si vous ne voulez pas que vos enfants vous mentent, ne les trompez jamais ; si vous ne voulez pas qu’ils se battent entre eux, ne les frappez jamais ; si vous ne voulez pas qu’ils vous parlent grossièrement, ne les insultez jamais. Si vous voulez qu’ils aient confiance en vous, prouvez que vous avez confiance en eux. Si vous voulez qu’ils vous écoutent, parlez-leur comme à des êtres capables de vous comprendre ; si vous voulez qu’ils vous aiment, ne leur marchandez pas votre affection ; si vous voulez qu’ils soient caressants et expansifs avec vous, ne leurs ménagez ni vos baisers ni vos caresses. L’exemple est tout-puissant.
C’est en application de ces données que, à « la Ruche », nous avons procédé en matière d’éducation morale.
La coéducation — Ce fut tout d’abord de l’étonnement lorsqu’on apprit que la coéducation était pratiquée à « la Ruche ». Bon nombre de personnes en furent ou en parurent scandalisées. Le coenseignement, passe encore ! Mais la coéducation!... Et j’ai dû, à maintes reprises, répondre aux critiques, aux objections, aux questions que soulevait ce problème de la coéducation.
Voici ce que je répondais :
« A la Ruche, garçons et filles vivent ensemble, comme frères et sœurs au sein des familles nombreuses. Tous concourent aux mêmes travaux et participent aux mêmes jeux. La vie est la même pour tous. Et je m’étonne que ce système de la coéducation soulève encore tant de protestations, suscite tant de craintes et déchaîne de si ardentes controverses. C’est la conséquence de quinze siècles de domination chrétienne, quinze siècles durant lesquels la mentalité publique s’est graduellement pénétrée de préjugés ridicules et d’ineptes appréhensions.
Tous ceux que n’aveugle pas le parti pris se rendent peu à peu à l’idée qu’il y a beaucoup moins de danger à faire vivre et grandir côte à côte garçons et filles, qu’à les isoler les uns des autres. La simple observation démontre que c’est de la séparation systématique de ces enfants, à l’âge où commencent à sourdre en eux les premiers tressaillements de la vie sexuelle, que rodent les curiosités malsaines et les précocités dangereuses. Peut-on s’illusionner au point de croire qu’il suffira, pour que garçons et filles se tiennent à distance les uns des autres, de défendre aux premiers de parler aux secondes et à celles-ci de jouer avec ceux-là ? L’expérience atteste que le résultat de ces défenses est diamétralement opposé à celui qu’on en attend.
Aussi longtemps que les enfants sont assez jeunes pour qu’ils ne soient pas troublés par l’approche d’un sexe différent, il ne peut être que dangereux et immoral de les prémunir contre des fautes qu’ils n’ont même pas la tentation de commettre. Et lorsque garçons et filles parviennent à l’âge où ils se sentent obscurément émus par un regard échangé, par un frôlement, par un contact furtif, par un serrement de main, par une parole, on peut élever entre eux les barrières les plus hautes, on ne réussira qu’à augmenter l’émotion, qu’à accroître le désir de renouveler la rencontre. L’indéfinissable trouble qu’eussent émoussé de nouveaux regards, l’inexprimable émotion qu’eût atténuée une conversation franche et familière, tout cet ensemble de vibrations encore mystérieuses que l’adolescence et la puberté font naître, tout cela eût été peut-être sans lendemain et n’eût pas résisté à la bonne camaraderie que ne tarde pas à engendrer l’affinité d’âge. Et voici que les exigences despotiques des usages et des convenances, les prohibitions impératives d’une morale inopportune et maladroite sont venues sottement et démesurément grossir ces « riens » encore imperceptibles ; elles ont jeté dans les veines des ardeurs insoupçonnées ; elles ont glissé dans l’imagination des rêves fantastiques et délirants ; elles ont déchaîné dans le cœur vierge hier encore de tout orage, des tempêtes formidables ; elles ont livré passage aux curiosités qui rongent l’esprit, elles ont engendré les attentes qui énervent les anxiétés qui tourmentent, les déceptions qui torturent et les langueurs qui tuent. On voudrait savoir et on ignore ; on a soif de se revoir et on est séparé ; les jours sont longs, les nuits interminables ; on souffre d’être trop jeune ; on a hâte de vieillir. Ah ! L’heureux résultat ! Et comme la morale y trouve son compte !
Des psychologues qui se croient d’observation subtile et pénétrante adressent à la coéducation le reproche de féminiser les garçons et de masculiniser les filles. Il v a du vrai dans cette observation. Mais loin qu’elle soit au détriment de la coéducation, elle est tout à son avantage. Au contact des filles, les garçons perdent un peu de leur brutalité et de leur violence, ils se font plus doux, ils apaisent leurs gestes, ils modèrent leurs mouvements, ils atténuent la rudesse de leur langage et jusqu’à l’éclat un peu cuivré de leur voix. Au contact des garçons, les filles perdent de leur mièvrerie et de leur timidité ; elles se font plus courageuses ; leurs gestes sont moins effacés, leurs mouvements plus vifs ; elles reculent moins devant le mot hardi ; leur volonté s’affirme mieux ; leur énergie croit ; leur esprit de malice et de ruse est moins aiguisé. Est-ce un mal qu’il en soit ainsi ?
Ce n’est pas mon avis, et j’estime que la vie commune, les études et les jeux partagés ébauchent au contraire une atténuation de certains contrastes que l’éducation, les mœurs, les occupations spéciales à chaque sexe, et les préjugés sociaux ont exagérés et esquissent un rapprochement qu’on peut considérer comme très heureux, puisqu’il arrache chaque sexe à certains travers qu’ont grossis des siècles de vie non seulement distincte mais opposée et même hostile, et qu’il communique à chacun d’eux une partie des qualités qui sont devenues lentement l’apanage de l’autre. Mais il n’y a là qu’un rapprochement, pas un mélange, pas une confusion ; une diminution, pas une suppression des distances et chaque sexe garde ses traits distinctifs : le garçon, la force, et la fille, la grâce ; le garçon, l’audace, et la fille, la coquetterie. »
L’éducation sexuelle.
La pratique de la coéducation pose le problème délicat de l’éducation sexuelle. Délicat ? Pourquoi le serait-il plus qu’un autre ? Pourquoi serait-il plus délicat de saisir l’enfant parvenu à l’âge et au degré de connaissance où cette question l’intéresse, des conditions dans lesquelles s’effectue la perpétuation de l’espèce humaine, que de le renseigner sur le mode de reproduction des autres espèces ? Le malaise que cause à l’éducateur une conversation ou un cours roulant sur cette question provient presque exclusivement du mystère dont le maître sent bien que l’enfant entoure ce problème ; et ce mystère lui-même a pour origine les périphrases et les réserves, les précautions oratoires et les sous-entendus avec lesquels il est d’usage d’aborder cette matière devant les enfants. Si elle était traitée avec franchise, abordée de front, étudiée au même titre que tel autre chapitre des sciences naturelles, toute gêne, tout embarras disparaîtrait.
Les hypocrites docteurs de la morale officielle qui prêchent la vertu, et qui généralement pratiquent le vice à la condition qu’on n’en sache rien, demandent pour les enfants l’ignorance de certains sujets. L’ignorance est toujours un mal, un danger.
Que de fautes, que de sottises sont commises par les enfants, uniquement par inexpérience, par ignorance ! Une mère et un père prévoyants doivent toujours éclairer leurs enfants. L’enfant finira par savoir ; pourquoi donc lui faire des cachotteries ! Serait-ce pour ménager sa pudeur ? Faire des cachotteries, c’est l’inciter à se faire, lui-même, sur des choses qui l’inquiètent, des idées fausses à propos desquelles il consultera des camarades ou des voisins. Il ne manquera pas non plus de personnes qui le renseigneront mal plus tard, alors qu’il ne sera plus temps d’agir pour l’instruire en toute franchise. Pourquoi donc lui cacher ce qu’il saura fatalement quelque jour ? C’est une imprévoyance impardonnable. Je prétends que lui dissimuler ces choses, c’est éveiller chez lui, avant l’âge que la nature assigne à son développement normal, des curiosités malsaines ; que c’est l’abandonner, confiant et ignorant, aux sollicitations de toutes les tentations qui l’entourent ; que c’est le livrer à tout hasard aux dangers des promiscuités pernicieuses ; que c’est l’exposer à l’abîme, au lieu de l’en préserver. Je prétends que les éducateurs qui agissent ainsi, au nom de la pudeur de l’enfant, sont coupables et imprévoyants. La vraie morale consiste à projeter sur ces sujets la lumière nécessaire, lumière que, quelque jour, l’enfant saura se procurer. Il vaut mieux que ce soit ceux qui l’aiment qui la lui donnent que ceux qui ne le connaissent point.
La Guerre a tué « la Ruche »
La Guerre, la Guerre infâme et maudite a tué « la Ruche » (elle a tué tant de gens et tant de choses !) Seul, le produit de mes conférences la faisait vivre et, durant les hostilités, il était ordonné aux uns de tuer ou de se faire tuer et interdit aux autres de parler. Aussi longtemps que nous l’avons pu, nous avons, mes collaborateurs, nos enfants et moi, prolongé l’existence de « la Ruche », bien que cette existence soit devenue de jour en jour plus difficile et plus précaire. Mais, dès le commencement de l’hiver 1916–1917, il parut certain que, de cette lutte obstinée, nous sortirions définitivement vaincus. Les produits de toute nature indispensables à la vie de la population, se raréfiaient de mois en mois. Paris souffrait du rationnement, encore que la capitale fût suffisamment ravitaillée, pour que les habitants de l’agglomération parisienne ne fussent pas poussés à l’insurrection. Il en était de même des grands centres de province, dont le Gouvernement pouvait appréhender le soulèvement : mais la population rurale, dont les pouvoirs publics estimaient n’avoir rien à redouter, était de plus en plus sacrifiée.
A « la Ruche », il devenait impossible de se ravitailler suffisamment, notamment en charbon, et il nous fallait réserver aux besoins de la cuisine le peu de ce produit qu’il nous était possible de nous procurer. Notre chère et familiale demeure ne pouvait plus lutter contre la rigueur d’une température hivernale et, dès que la nuit tombait, nos enfants, pour échapper an froid dont ils eussent souffert, se blottissaient sous l’épaisseur des chaudes couvertures dont, par bonheur, nous possédions un suffisant approvisionnement.
Il fallut bien se rendre à l’évidence et nous séparer d’eux. Ceux qui avaient encore une famille regagnèrent celle-ci. Je pris toutes dispositions nécessaires pour que les autres trouvent asile dans des milieux amis. Aucun d’eux ne resta à l’abandon. Un à un, nos collaborateurs se dispersèrent. Ce fut, pour tous, petits et grands, une douloureuse séparation. Mais il faut bien subir l’inévitable et la fin de « la Ruche » était devenue une fatalité, tant par suite des difficultés de ravitaillement que par suite de l’insuffisance de nos ressources. En février 1917, « la Ruche » mourut, victime, comme tant d’autres œuvres amoureusement édifiées, de la Guerre à jamais abhorrée.
Si j’étais à l’âge où il est raisonnablement permis d’envisager l’avenir avec confiance, je n’hésiterais pas à jeter les bases d’une nouvelle Ruche. J’avais 46 ans quand j’ai fondé cette œuvre de solidarité et d’éducation. Près de trente années me séparent de cette époque et ce n’est pas à mon âge qu’on s’aventure dans une telle entreprise. Mais je nourris l’espérance que d’autres, plus jeunes, un jour prochain, remuant les cendres de ces souvenirs, sur lesquelles mon vieux cœur souffle, y trouveront encore quelque chaleur, en feront jaillir quelques étincelles, en raviveront la flamme et essaieront de mettre sur pied et de mener à bien une nouvelle « Ruche ». L’expérience qu’ils tenteront leur sera facilitée par les indications qu’ils trouveront ici ; j’aime à espérer qu’Ils seront secondés par des circonstances plus favorables et que la Ruche de demain sera le creuset précieux où l’élaboreront, en petit, les formes de la société de bien-être, de liberté et d’harmonie à l’avènement de laquelle les militants libertaires consacrent le meilleur d’eux-mêmes.
— Sébastien FAURE
RUCHE
n. f.
« Demeure où les abeilles vivent et font le miel. » (Littré)
Lorsque l’essaim nouveau quitte la ruche, il va, d’ordinaire, se suspendre à une branche ou se poser contre un tronc d’arbre, à peu de distance du rucher. Aussitôt, des abeilles se détachent de cet essaim et partent en éclaireurs à la recherche d’un arbre creux, d’un trou de muraille, d’une cavité quelconque. Si l’homme cueille cet essaim, les abeilles acceptent leur demeure nouvelle quelle que soit sa forme. Si l’homme néglige l’essaim, bientôt, celui-ci partira et s’installera dans une cheminée, dans un tronc de saule, sous la toiture d’un grenier.
L’abeille s’accommode de toute espèce de refuge, et que le hasard l’ait conduite dans un vieux coffre, sous les combles du château ou dans le christ en zinc des Missions, elle se met aussitôt au travail. Car l’essaim est la colonie complète, la société organisée avec tous ses rouages, prête à fonctionner. Dans nul groupement d’activité humaine, la rationalisation ne semble poussée aussi loin que dans la ruche. Ici, chaque membre a sa fonction spéciale. La mère (improprement appelée Reine — Sultan, chez les Arabes -), unique dans la ruche, à l’abdomen volumineux, est seule à connaître les joies (si joies il y a) de l’amour sexuel. Fécondée une fois pour toutes, en plein ciel, elle passe son existence sur les rayons de cire à pondre les dizaines de milliers d’œufs qui assureront le peuplement de la ruche. Timide, peureuse, incapable même de se nourrir (elle est tributaire en cela d’ouvrières qui lui offrent la pâtée), armée d’un dard dont elle ne fait usage que dans le combat contre une rivale, elle est cependant « l’âme du nid ». Si elle disparaît à l’époque où il est impossible de pourvoir à son l’emplacement, c’est la ponte arrêtée ; par suite, l’extinction progressive des vieilles ouvrières, et c’est la mort de la ruche. Avec une reine prolifique, c’est, au contraire, la colonie puissante (20.000 individus et plus), c’est la prospérité et la richesse. On comprend qu’il y ait des apiculteurs soucieux d’avoir des reines jeunes et fécondes dans leurs ruches ; et il existe toute une méthode d’élevage et de l’emplacement des reines (Consulter, à ce sujet, l’ouvrage de Perret-Maisonneuve : « L’Apiculture intensive et l’élevage des Reines »).
Un seul mâle (on faux-bourdon) a fécondé la reine. C’est le plus fort, le plus hardi, le mieux doué pour le vol (d’après Maeterlinck). D’après d’autres auteurs, c’est le plus chanceux. Lorsque, par un beau jour d’été, la reine, encore vierge, quitte la ruche pour le vol nuptial, elle est suivie du troupeau hardi des mâles, gros bourdons trapus, velus et sans dard. L’élu, poussé par l’instinct de l’espèce, sait-il que ses noces seront suivies de sa mort, par suite de la rupture de ses organes qui restent dans l’abdomen de la reine ? Aussitôt la fécondation accomplie, les faux-bourdons deviennent inutiles. Les ouvrières les tolèrent cependant jusqu’à l’automne. (Certains auteurs prétendent qu’elles sont, par cette présence, stimulées au travail). Mais, dès que les fleurs se font rares, dès que la miellée touche à sa fin, les utilitaires abeilles ne peuvent tolérer plus longtemps ces oisifs simplement bons à consommer et à salir ; et c’est le massacre impitoyable.
Si la reine est l’âme de la ruche, les ouvrières en sont les moteurs agissants. Toutes filles d’une même mère, elles semblent intimement pénétrées de cette idée qu’elles doivent assurer, par un travail incessant, acharné (dira-t-on « librement consenti », parce qu’il ne paraît pas y avoir de paresseuses parmi elles ?), la prospérité de la colonie. Spécialisées, elles s’occupent aux multiples besognes intérieures et extérieures : soins aux larves, aux nouveau-nés ; propreté de la ruche, construction des rayons de cire (aux dimensions rigoureusement mathématiques) qui seront tour à tour berceaux des jeunes et réservoirs à miel ; ventilation ; gardiennage à l’entrée ; calfeutrage des interstices par où pourraient se glisser le froid ou la pluie ; et puis récolte du pollen, de la propolis et du nectar ! Travail de forçats qui, dans la belle saison, use une abeille en quarante jours. C’est en cette période de grande activité qu’il faut voir l’animation qui règne à la ruche, véritable usine où pas un rouage ne semble grincer et où les apports de nectar se chiffrent journalièrement par kilos ! Il faut aller près de la planche de vol pour assister à l’arrivée et à la sortie incessante des abeilles. Leurs pattes postérieures velues, aux fossettes pleines d’énormes boules de pollen, ou le corps alourdi par leur jabot garni, elles se posent, comme à bout d’effort, devant l’entrée qu’elles franchissent sans tarder, tandis que celles qui se sont déchargées de leur fardeau montrent par leur trou de vol leurs antennes, puis leur tête et à peine dehors, s’élancent d’un trait dans le soleil. Et qu’elles soient jeunes, — à l’abdomen légèrement velu comme la joue d’un éphèbe, aux ailes puissantes et neuves -, ou vieilles an corps lustré, aux ailes parfois déchirées, une seule et impitoyable loi semble les dominer : la loi d’airain du travail. Lorsque la nuit est venue, on pourrait croire que c’est le moment du repos : le travail persiste à l’intérieur et se révèle à l’observateur par un continuel bourdonnement produit par le battement des ailes, car il faut assurer la ventilation, chasser l’excès d’évaporation et concentrer le miel. Il y aura bien assez des longs mois d’hiver pour se reposer !
Pas de police entre abeilles. Le communisme intégral étant, ici, réalisé (chacun consommant selon ses besoins et. produisant selon ses forces), un organisme de commandement, un Etat (si l’on peut s’exprimer ainsi) serait une absurdité. Il n’en existe pas, en effet. Mais ce que nous constatons aussi, c’est l’absence totale de « poids morts » dans la société : malades, infirmes, consommateurs inutiles n’ont pas droit de cité dans la ruche. La pitié est un sentiment inconnu des abeilles. Le cœur semble absent ; la froide raison domine :
« Produis ou disparais ! »
L’individu n’est rien, la colonie est tout. Et, non seulement les mâles, comme nous l’avons déjà rapporté sont tués à l’entrée de l’hiver, mais les larves sont, à cette même époque impitoyablement tirées de leur berceau et transportées au dehors pour y être abandonnées (l’avortement, nécessité sociale!) ; et, en tout temps. L’abeille malade, qui traîne la patte, victime de son travail — pour que la ruche vive — est rejetée de la ruche. Nous avons vu de ces malheureuses lutter désespérément contre deux ou trois de leurs sœurs qui les traînaient vers le large. Place aux forts ! Car l’abeille est forte. Naturellement armée d’un dard (terminé par un ardillon) qui distille des gouttelettes de venin, elle fond sans hésitation sur tout être qui lui semble devoir porter atteinte à l’intégrité de la ruche. Elle a la mentalité susceptible d’un chevalier de la rapière ; mais Cyrano n’usait de son épée que poussé par de nébuleuses idées ; l’abeille, elle, ne défend ni son « honneur », ni sa personne, mais sa ruche. Son obscur instinct la pousserait-il à se sacrifier pour sa mère, la Reine, ou pour ses sœurs — sa famille -, ou encore pour sa richesse — produit de son travail -, ou pour toutes ces choses à la fois ? Sait-elle quel le doit mourir aussi après le triomphe, l’abdomen ouvert, puisqu’elle laisse le dard dans la chair de l’assaillant ? L’idée de la mort ne semble pas la retenir, et l’instinct de conservation de l’individu paraît céder la place à celui de la conservation de l’espèce. Enfin, pas plus que l’homme, l’abeille n’est délivrée de ce fléau : la guerre, ou pillage. Qu’une ruche, sous l’action du soleil, ait un gâteau de cire qui s’effondre, que le miel coule à l’extérieur ; qu’une ruche reste trop longtemps ouverte, ou bien que, dans le rucher, par une imprudence de l’apiculteur, un peu de miel ou de cire soit abandonné à terre, attirées par le profit immédiat, les abeilles se ruent sauvagement sur ces richesses et s’entretuent. Rivalités économiques ! Les ruches les plus faibles sont vidées, leur population exterminée, et la loi du plus fort domine, ici comme ailleurs.
En résumé, l’organisation sociale de la ruche nous apparaît comme une sorte de famille communiste-libertaire aux innombrables femelles incomplètes (ouvrières) sevrées d’amour, mais dominées par l’inexorable loi du travail ; à la mère (reine), seule féconde et seule capable de s’accoupler ; aux milles (faux-bourdons) Don Juan sans emploi (sauf un élu) — seraient-ils les poètes de l’association ? — Le tout cimenté par un puissant esprit de corps. Fécondité — travail — flânerie : voilà les attributs principaux de chaque groupe d’individus. Solidarité dans le travail, mais non dans le malheur. L’individu sacrifié à la communauté. Voilà les choses telles qu’elles sont dans cette société d’insectes.
Passons maintenant aux caractéristiques extérieures et intérieures des ruches. Nous avons dit que l’abeille s’accommode de toute espèce de cavité. Cependant, d’une façon générale, plus cette cavité sera volumineuse et plus la population (avec une reine prolifique) sera nombreuse, plus aussi les provisions de miel seront abondantes. D’après l’Abeille de Québec :
« La plus grande ruche du monde se trouve à Bee-Rock, en Californie. Bee-Rock est un rocher de 40 mètres de haut qui s’élève abruptement du lit du fleuve de l’Arroyo. Le monolithe granitique se perd en arrière dans une colline contiguë et présente de nombreuses crevasses. Celles-ci sont habitées par un peuple d’abeilles et leurs profondeurs regorgent de miel. On ne peut évaluer la quantité de miel contenue dans ses cavités dont on ignore le nombre et les dimensions des colonies, car si l’on en voit beaucoup, d’autres sont cachées. D’autre part, il n’y a pas à songer à pénétrer dans ces crevasses, les chasseurs d’abeilles ont déjà assez de difficultés à récolter les rayons de miel à leur entrée et c’est par centaines de kilogrammes qu’ils dépouillent chaque année les industrieux insectes. » (La Gazette Apicale, novembre 1932.)
Pour sa commodité, l’homme a créé de multiples ruches aux formes et aux dimensions diverses. Dans toutes ces ruches, l’abeille travaille selon des méthodes immuables. Jetons un regard à l’intérieur. La ruche est nue — c’est-à-dire non préparée par l’apiculteur ; on vient d’y jeter un essaim. Celui-ci se fixe au plafond et, immédiatement, les abeilles se mettent à l’ouvrage pour bâtir, de haut en bas, un rayon de cire, puis deux, trois, etc., régulièrement espacés. La reine pond au milieu du nid, dans les alvéoles et en face du trou de vol. Le miel s’emmagasine à droite, à gauche, et en haut du couvain. L’apiculteur peut donc récolter soit une partie du miel qui se trouve de chaque côté du nid, soit celui qui se trouve à la partie supérieure. Mais, en apiculture moderne, on place l’essaim dans la ruche à cadres (cadres qui contiennent une feuille de cire gaufrée que les abeilles étirent pour former un rayon). On peut ainsi, en soulevant les cadres, visiter en quelques minutes toute la ruche. On peut également effectuer la récolte avec propreté et rapidité, soit en enlevant une partie des cadres latéraux (ruches horizontales), soit en enlevant la totalité des demi-cadres (hausse) qui se superposent au corps de ruelle (ruches verticales). D’où les trois sortes de ruches :
-
Fixistes, où les rayons de cire sont collés aux parois ;
-
À cadres mobiles (Layens Dadant) ;
-
Mixtes (fixistes pour le nid à couvain et à cadres mobiles pour le grenier à miel).
Nous n’entrerons pas plus avant dans le détail de ces diverses ruches et dans les manipulations apicoles. Nous renvoyons le lecteur aux ouvrages spéciaux traitant de la question. Mais on comprendra facilement qu’il suffit de changer les dimensions d’une ruche pour en créer une nouvelle et, comme le dit excellemment Helle (Gazette Apicole, décembre 1932) :
« Les raisons de ces modifications de dimensions peuvent se justifier facilement en invoquant la région, le climat, le plus ou moins de valeur mellifère, et enfin, ce que nul ne veut avouer, l’honneur de donner son nom à une ruche, honneur fragile qui, comme la rose, ne vit que l’espace d’un matin. »
La vanité humaine se niche où elle peut.
Il est un dernier point sur lequel nous voulons dire un mot ; c’est celui concernant les rapports entre abeilles et... anarchistes. De nombreux camarades, en effet, se sont adonnés à l’apiculture. C’est une des branches les plus agréables de l’activité humaine. D’autre part, être apiculteur, cela ne sera jamais professer un « métier haïssable ». Il vaut mieux exploiter les abeilles qu’exploiter les hommes. Mais le véritable apiculteur n’exploite pas ses abeilles. Il a, au contraire, pour ces intelligentes bestioles, des soins paternels. Il les place dans des conditions idéales de travail, et les abeilles produisent, ainsi, bien au-delà de ce qui leur est nécessaire pour vivre et se multiplier. Par temps de disette, il leur vient en aide en leur restituant une partie de ce qu’il a emmagasiné aux époques de prospérité. Il est, pour elles, une véritable providence, et elles bénéficient sans s’en apercevoir de sa bienveillante, intelligente et discrète intervention. Discrète — car l’apiculteur expérimenté a appris, auprès de ses abeilles, à dominer ses réflexes, à agir toujours avec prudence et douceur ; bref, à s’élever moralement. Et ceci n’est pas un des moindres avantages de l’apiculture. (Il faut dire aussi que le dard est un merveilleux instrument d’éducation!) Et, lorsqu’on a acquis la dextérité suffisante, il faut si peu de fumée pour dominer ce petit monde, si grand par ses vertus et si précieux pour l’enseignement qu’il nous donne ! Enfin, l’idéal libertaire n’est-il pas celui qui se réalisera dans la grande ruche terrestre où, dans la paix universelle, il sera donné, comme chez les abeilles, à chacun selon ses besoins ; où tout individu aura à coeur de contribuer au bien-être de tous ; mais où il y aura place aussi pour une immense fraternité, nécessaire pour rendre la vie autant que possible douce et agréable aux déshérités, aux souffrants, aux malheureux atteints d’irrémédiable misère physiologique ? Les joies intellectuelles que nos camarades éprouvent dans la fréquentation des abeilles, et aussi les profits qu’ils tirent du commerce de leur miel sont récompenses légitimes qui les paient de bien des piqûres... sociales ; celles-ci étant, sans contredit, les plus cruelles et les plus venimeuses.
— Ch. BOUSSINOT
RURALES (ÉCOLES)
Soit dans la presse pédagogique, soit dans la presse politique, nous avons eu l’occasion de lire de nombreux articles consacrés à l’école rurale. La première constatation qui s’impose, c’est qu’il n’y a pas « l’école rurale » mais des écoles rurales, diverses comme les milieux ruraux eux-mêmes.
Pays de plaine et de grande culture où dominent les féodaux de l’agriculture, où la plupart des paysans travaillent la terre des autres et régions plus accidentées ou de petite ou moyenne culture s’opposent. Dans les premiers, le milieu n’est généralement pas favorable à l’école, à l’école laïque surtout, et c’est là, en général, que la fréquentation scolaire laisse le plus à désirer.
Différentes dans l’espace, les écoles rurales ne le sont pas moins dans le temps. Si nous nous reportons à quarante ou cinquante ans en arrière, dans un de ces milieux de petite ou moyenne culture, nous nous trouvons déjà en présence de la cause principale de l’exode rural : il ne fait pas bon vivre à la campagne pour les petits propriétaires dont de nombreuses terres sont hypothéquées, ni pour les petits fermiers qui paient difficilement leurs fermages. Les uns et les autres sont souvent les victimes de la misère des temps et de l’usure. Sans doute, les prêteurs d’argent ne peuvent dépasser un certain taux, mais les emprunteurs que le besoin presse signent volontiers un billet dont le montant majoré permet de tourner la loi.
Petit propriétaire et petit fermier voudraient, au prix de quelques peines de plus, arracher leur fille ou leur fils à cette misère. Si l’enfant présente quelques dispositions pour l’étude, « on le poussera ». L’instituteur voisin — ou l’institutrice — conseille de le faire : pour une très modique rémunération, il le gardera à l’école le soir et, trois ou quatre ans après avoir obtenu son certificat d’études, l’enfant pourra entrer à l’Ecole Normale où les études sont gratuites.
Le futur instituteur rural commence donc ses études dans un milieu rural. Ce milieu, il ne le quitte que pour passer trois ans à l’Ecole Normale primaire et un an au régiment. Encore ne le quitte-t-il pas tout à fait : il y a les vacances pendant lesquelles il abandonne l’étude pour aider aux travaux de la moisson. Des années passent, la guerre vient, la culture paie et paie bien, les petits propriétaires et les fermiers ne songent plus à « pousser » leurs enfants. Du reste, malgré les bourses, qui ne profitent pas à tous, on ne devient pas si aisément instituteur et institutrice, et ça coûte beaucoup plus cher pour le devenir. D’abord, les secrétariats de mairie demandent aux instituteurs un travail toujours croissant. Ensuite, les programmes pour le concours d’entrée à l’Ecole Normale primaire sont chargés et surchargés. Les maîtres des petites écoles rurales à une seule classe ne peuvent plus, pour ces deux raisons, continuer de préparer à l’Ecole Normale. Il faut mettre les futurs candidats en pension dans des cours complémentaires ou dans des écoles primaires supérieures, à moins que l’on n’habite la ville. En définitive, si les petits propriétaires et les petits fermiers ruraux ne veulent plus que leurs enfants deviennent des instituteurs, leurs ouvriers ne le peuvent pas encore. Pour toutes ces raisons, les Ecoles Normales primaires cessent à peu près complètement de recruter leurs élèves dans les milieux ruraux. Ces élèves, — enfants de petits commerçants d’instituteurs, d’employés -, urbains pour la plupart vont se trouver dépaysés à la campagne. La plupart ont hâte d’en partir et en attendant un nouveau poste, ils s’empressent de fuir le « trou » les jeudis et les dimanches. Pour les ruraux, ils sont des étrangers. Ils le sont d’autant plus qu’ils abandonnent les secrétariats de mairie, généralement mal payés et qui exigent de plus en plus de temps. Ces secrétariats de mairie avaient l’avantage de rapprocher les instituteurs des populations rurales, de leur permettre de rendre mille petits services dont on leur savait plus ou moins gré, suivant les milieux.
Non seulement les instituteurs des écoles rurales cessent peu à peu d’être des ruraux, mais encore ils perdent peu à peu la considération que leur valait leur savoir. Ce savoir, leurs aînés le prouvaient en rédigeant des baux, en arpentant et bornant des terrains, etc... Maintenant, ce sont là travaux secondaires, les machines ont pénétré à la campagne et, lorsqu’il s’agit de réparer ces machines, un mécanicien ou même un simple forgeron est souvent plus capable qu’un instituteur.
Il faut bien avouer aussi que le savoir que l’on acquiert à l’école n’a plus autant de valeur aux yeux des populations rurales. Le certificat d’études, plus difficile à obtenir aujourd’hui qu’autrefois, est cependant moins apprécié. Cela tient tout à la fois au peu d’utilité que présentent une partie des connaissances scolaires et à une évolution accélérée qui nécessiterait moins de connaissances, mais plus d’aptitudes à apprendre et à s’adapter.
L’école rurale d’hier — et c’est un reproche que l’on peut adresser également à l’école urbaine -, a négligé l’éducation, c’est-à-dire la formation des esprits, des cœurs et des caractères, au profit de l’enseignement. Sans doute, l’un et l’autre sont nécessaires et l’éducation est tout à la fois moins appréciée et plus difficile à donner. Il n’en est pas moins vrai qu’elle a une importance primordiale. Dans notre milieu rural, il est un fait frappant : ce ne sont pas les individus les plus instruits qui ont le mieux réussi dans la vie. S’ils n’ont pas réussi, ce n’est pas à cause de leur instruction, mais par suite de manque d’initiative, de volonté, d’alcoolisme, etc. ; et l’on ne saurait équitablement juger l’école et l’utilité de l’instruction qu’on y donne sans tenir compte du fait que ces défauts d’éducation sont, avant tout, d’origine familiale. Il n’en est pas moins vrai qu’ils jettent un certain discrédit sur l’école et il est certain aussi qu’elle l’a quelque peu mérité.
Si l’école rurale veut être plus favorablement appréciée, si elle veut jouer le rôle éducatif et social qu’elle pourrait jouer, il faut qu’elle s’adapte à son temps et à son milieu.
Lorsque je dis qu’il faut que l’école s’adapte à son temps et à son milieu, je n’en veux point faire — elle l’est déjà beaucoup trop — une force conservatrice. Ce milieu n’est pas quelque chose de statique, de mort ; c’est un organisme vivant, évoluant, progressant, parfois malgré lui.
Le rôle de l’instituteur rural consiste d’abord à donner à ses élèves un idéal, mieux encore : à les aider à se former un idéal individuel et social.
Il consiste ensuite à développer leur propre puissance. Il faut qu’il cultive en eux une certaine faculté d’adaptation et de compréhension de leur milieu social. Qu’on ne voie pas là un effort conservateur : on n’adapte les autres qu’en s’adaptant soi-même dans une certaine mesure, et cette adaptation, cette compréhension du présent ne sont que des moyens. Le but n’est ni en arrière, ni sur place, il est devant et c’est aux enfants devenus hommes qu’il appartiendra de le déterminer en tenant compte de cet élan vers le progrès, vers l’idéal que nous devrions leur donner.
Les augures officiels, et l’Union des Grands Intérêts Economiques, n’ont pas manqué de faire appel aux instituteurs ruraux pour combattre la désertion des campagnes. On s’est efforcé de leur prouver qu’ils disposaient de nombreux moyens d’action efficaces. La réalité est différente. Dans notre propre milieu, nous voyons d’un côté de gros fermiers que l’après-guerre a gâtés. Ils ont pris des habitudes de bien-être, de luxe qu’ils ne veulent pas abandonner et en des temps devenus plus difficiles, ils rognent non plus sur le superflu, mais sur les salaires de leurs ouvriers. Non seulement sur le montant du salaire journalier, mais encore sur le nombre de jours de travail : des fossés restent, de ci, de là, à nettoyer ; ailleurs, des ronces envahissent les champs, mille autres travaux utiles pourraient être faits pendant la saison mauvaise, alors que des ouvriers chôment une partie du temps.
Il n’en est point ainsi partout sans doute (les milieux ruraux sont si divers), mais là où l’égoïsme ne diminue pas le travail de l’ouvrier des champs, les machines agricoles se chargent de le faire. La désertion des campagnes a des causes économiques qui ne disparaîtront pas de sitôt.
La forte natalité qui a suivi la guerre baisse, les écoles rurales verront diminuer leurs effectifs. Sans doute, la diminution du nombre des élèves qui résultera de ce fait sera-t-elle compensée en partie par une prolongation de la scolarité. Pas suffisamment cependant pour qu’il n’en soit pas supprimé un certain nombre dont les effectifs seront devenus trop faibles.
La prolongation de la scolarité aura d’autres conséquences. Pendant la saison des foins et des récoltes, les grands élèves seront dispensés de fréquenter l’école. Il en résultera que ces élèves seront des travailleurs et des écoliers. L’école deviendra pour eux un milieu dont on est à demi sorti et dont on désire sortir tout à fait, à moins qu’elle ne sache évoluer, en rattachant son enseignement aux intérêts de ses grands élèves.
D’autres changements surviendront ; mais nous pensons que tous contribueront à une meilleure adaptation de l’école au milieu.
— C. DELAUNAY
RUSE
n. f.
On a reproché à certains théoriciens individualistes anarchistes d’admettre la ruse au nombre des quelques moyens de défense dont l’anarchiste peut encore disposer au sein de la société. Je ne puis m’empêcher de sourire quand je vois récuser l’emploi de la ruse comme arme de préservation individuelle. Mais, sans la ruse, il y a beau temps que l’autorité nous aurait annihilés et que l’ambiance nous aurait absorbés ! Pour subsister — c’est-à-dire pour conserver, prolonger, amplifier, extérioriser sa vie, l’anarchiste, l’en-dehors ne peut, sous peine de suicide, récuser aucun moyen de lutte, la ruse y compris — aucun moyen, dis-je, sauf l’emploi de l’autorité. Et cela sous peine de se trouver en état d’infériorité à l’égard du milieu social, lequel tend toujours à empiéter sur ce qu’il est et sur ce qu’il a.
Qui ne ruse pas ? L’ouvrier qui se garde bien de dévoiler ses idées à son patron ; le patron qui dérobe les siennes à son ouvrier ; l’afficheur de placards séditieux qui les colle de nuit sur les murs des édifices publics ; le distributeur de factums subversifs, qui prend bien soin qu’on ne l’aperçoive pas quand il les dépose dans les boîtes aux lettres. Et pourquoi dédaignerais-je l’usage de la ruse ? Pourquoi laisserais-je connaître le fond de ma pensée à mon adversaire ? Pourquoi me livrerais-je au premier venu ? Où ai-je dit que je vivais dans une maison de verre ? Je veux d’abord : vivre pour vivre. Je ne suis pas comptable au milieu autoritaire de mes gestes ou de mes pensées. Je ne campe pas dans ce milieu en ami. Je donne à la société capitaliste le moins possible de moi-même. Car je n’ai point demandé à naître, et en me mettant au monde, on a exercé à mon égard un acte d’autorité irréparable, qui exclut toute possibilité de contrat bilatéral.
Et qu’est-ce que la société ? J’ai déjà répondu à cette question et je me servirai des mêmes termes :
« La société si je ne m’abuse, ce sont les usines, les prisons, les casernes, les habitations ouvrières, les taudis, les maisons de prostitution, les assommoirs, les tripots, les magasins de luxe. La société ! Mais ce sont les élus, les électeurs, les juges, les gendarmes, les propriétaires, les exploiteurs, les exploités, tout ce qui peut vivre (sans produire ou créer) aux dépens d’autrui et tout ce qui laisse autrui (sans créer ou produire) vivre à ses dépens. »
Et je devrais des comptes à cette société-là ? Je devrais me placer en état d’infériorité à son égard en m’interdisant l’emploi d’une des armes qui me permettent de résister le plus efficacement à ses empiètements sur ce que je suis et sur ce que j’ai ? Et cela, au moment même où force nous est de reconnaître qu’elle a la vie plus dure que nous l’imaginions, cette bougresse de société mourante !
Mais, tout ceci exposé, pour l’individualiste anarchiste, la ruse comme tous les autres moyens de préservation individuelle, demeure un moyen de défense, non un procédé d’adaptation. La ruse lui permet de continuer à vivre au milieu de la société, non de s’y adapter. Je ne nie pas qu’il faille une volonté ferme pour user de ruse à l’égard du milieu archiste — lorsqu’il s’avère hostile et refuse tout arrangement — et pour refuser de s’y adapter. Mais si vous ne possédez pas la force de caractère nécessaire, le tempérament assez trempé pour résister à l’adaptation du milieu, vous n’êtes pas fait pour concevoir l’anarchisme comme une vie et une activité ; retournez à l’archisme que vous avez vomi : là est votre place.
— E. ARMAND
RYTHME
La véritable orthographe de ce mot est rhythme (du latin rhythmus, mouvement régulier, nombre, mesure, cadence, et du grec rhutmos, de rheórhó, je coule). Chez les Latins, la science des nombres, l’arithmétique, était la rhythmicé. La simplification de l’orthographe a fait écrire rythme. Il n’y a pas de raison de ne pas écrire encore plus simplement rytme ou ritme, le mot n’en serait pas plus mutilé dans son rythme plastique. L’essentiel serait que le rytme ou ritme ne fût pas confondu avec la rime qui est l’uniformité de son à la fin de deux mots et particulièrement de deux vers.
L’Académie, dans son Dictionnaire (1879) s’est bornée à donner du mot rythme cette définition aussi lapidaire que trinitaire : « nombre, cadence, mesure », d’après l’étymologie latine. Or, cette définition est aussi inexacte, sinon hermétique, que l’explication trinitaire de Dieu. Mais l’Académie ne se pique pas plus d’exactitude que de clarté. Elle est, comme les fabricants de dogmes, uniquement préoccupée de fournir des notions faciles et qui ne les troublent pas, les gens « comme il faut » pour en faire des imbéciles distingués, et elle laisse aux hérétiques et aux primaires le soin de rechercher la vérité des choses, quitte à l’adopter après lorsqu’elle s’est imposée.
Le nombre, la cadence, la mesure, sont trois choses distinctes ; le rythme en est une quatrième non moins distincte, et on ne saurait faire des quatre une chose unique par leur conjugaison. L’emploi des trois premières dans la musique et la poésie, les fait souvent confondre avec le rythme qui est aussi indispensable qu’elles dans ces deux genres, mais qui est tout différent. Le rythme, en musique et en poésie, est la succession régulière des mêmes temps, ou celle des mêmes nombres de pieds qui divisent les vers. Il est lui-même musique et poésie ; elles n’existent pas sans lui. Aucune chose n’est vivante sans le rythme qui lui donne son expression particulière. Il est la vie elle-même ; il n’est pas de vie sans lui.
En musique, le rythme est « l’effet produit par le rapport de durée des sons entre eux » (Larousse). Berlioz l’a appelé « la division symétrique du temps par les sons ». Il y a des interprétations très diverses sur le rythme musical, suivant les époques et l’emploi qu’on en fait. Dans la musique moderne, il a été très souvent négligé. Il en est résulté que, malgré toute sa science, cette musique est non moins souvent ennuyeuse parce que vide de véritable substance, de musique elle-même.
En poésie, la définition du rythme est la même qu’en musique. Théodore de Banville, le théoricien le plus remarquable de la réforme poétique — romantique et parnassienne — du XIXème siècle, a expliqué de la façon suivante ce qu’est le rythme et ses rapports avec la parole humaine, la poésie et la musique :
« Tout ce dont nous avons la perception obéit à une même loi d’ordre et de mesure, car, ainsi que les corps célestes se meuvent suivant une règle immuable qui proportionne leurs mouvements entre eux, de même les parties dont un corps est composé sont toujours, dans un corps de la même espèce, disposées dans le même ordre et de la même façon. Le Rythme est la proportion que les parties d’un temps, d’un mouvement, ou même d’un tout, ont les unes avec les autres. Le Son est une vibration dans l’air, qui est portée jusqu’à l’organe de l’ouïe, et qui procède d’un mouvement communiqué au corps sonore. Le son que produit la parole humaine est nécessairement rythmé, puisqu’il exprime l’ordre de nos sensations ou de nos idées. Seulement, lorsque nous parlons, notre langage est réglé par un rythme compliqué et variable, dont le dessin ne se présente pas immédiatement à l’esprit avec netteté, et qui, pour être perçu, exige une grande application ; lorsque nous chantons, au contraire, notre langage est réglé par un rythme d’un dessin net, régulier et facilement appréciable, afin de pouvoir s’unir à la Musique, dont le rythme est également précis et simple. Le Vers est la parole humaine rythmée de façon à pouvoir être chantée, et à proprement parler, il n’y a pas de poésie ni de vers en dehors du Chant. Tous les vers sont destinés à être chantés et n’existent qu’à cette condition. Ce n’est que par une fiction et par une convention des âges de décadence qu’on admet comme poèmes des ouvrages destinés à être lus et non à être chantés » (Petit traité de poésie française : Introduction).
C’est aussi par une fiction et une convention semblables qu’on a voulu faire de la musique sans rythme. Il faut lire la magnifique page de Michelet, intitulée Mélancolia, disant comment le chant rythmique jaillit de l’âme populaire, alors que l’Eglise l’avait banni de sa liturgie : « Avez-vous vu les caves misérables de Lille et de la Flandre, l’humide habitation où le pauvre tisserand, dans ce sombre climat d’éternelle pluie, envoie, ramène et renvoie le métier d’un mouvement automatique et monotone ? Cette barre, qui, lancée, revient frapper son cœur et sa poitrine pulmonique, ne fait-elle rien, je vous prie, qu’un tour de fil?... Oh ! Voici le mystère. De ce va et vient sort un rythme ; sans s’en apercevoir, le pauvre homme, à voix basse, commence un chant rythmique. A voix basse ! Il ne faudrait pas qu’on l’entendît. Ce chant n’est pas un chant d’église. C’est le chant de cet homme, à lui, sorti de sa douleur et de son sein brisé. Mais je vous assure qu’il y a plus de soleil maintenant dans cette cave que sur la place de Florence ; plus d’encens, d’or, de pourpre, que dans toutes les cathédrales de Flandre ou d’Italie.
« Et pourquoi pas un chant d’Eglise ? Est-ce révolte ? »
Point. Mais c’est que l’Eglise ne sait et ne peut chanter, et elle ne peut rien pour cet homme, il faut qu’il trouve lui-même. Elle perdit le rythme avec Grégoire le Grand, et elle ne le retrouve pas pendant mille ans. Elle en reste au plain-chant ; c’est sa condamnation » (Histoire de France : La Réforme). Et Michelet ajoute :
« La nature a mis le rythme partout. L’Eglise le supprima partout en haine de la nature. Mais, aux moments émus, la nature revient invincible ; le rythme reparaît, du moins au battement du cœur trop oppressé, ou par l’intervalle des soupirs. »
C’est ainsi que le rythme, âme libre de la nature, fait triompher la vie au-dessus de toutes les fantasmagories du divin et de leur œuvre de mort.
La prose n’a pas moins besoin du rythme que la poésie et la musique, bien qu’elle n’ait pas, comme elle, de mesure et de cadence obligatoires. Sans le rythme de la pensée et de la phrase, la prose est aussi ennuyeuse à lire et à entendre que la poésie et la musique sans rythme poétique et musical.
Lamennais a dit :
« Le rythme a sa racine dans les lois premières du mouvement. »
Le nombre, la cadence, la mesure, ne sont que la simple mécanique du mouvement. Le rythme en est l’âme, la palpitation intérieure, l’expression psychologique. C’est par lui que la musique et la poésie, le geste et la ligne, nous émeuvent, qu’ils ne sont pas seulement une interprétation matérielle perceptible à nos sens, mais qu’ils ont une expression spirituelle qui atteint toutes les profondeurs de notre sensibilité jusqu’au plus lointain subconscient. Le rythme est plastique dans les manifestations objectives de l’art ; il est spirituel par les sensations subjectives qu’il fait naître. Mais s’il est ainsi l’âme et la pensée du mouvement dont le nombre, la cadence et la mesure ne sont que la mécanique, il ne faut pas voir en lui, par une méprise contraire à celle qui le fait confondre avec eux, un subjectivisme qui en égare la notion dans la métaphysique et la livre aux abstracteurs de la quintessence divine.
Le rythme, c’est la vie entretenue par l’harmonie du mouvement. Lorsqu’il manque, le mouvement annihilé ou désordonné, chaotique, met la vie en danger. Il est dans les artères, les poumons, les centres nerveux du plus petit des êtres, comme dans la chevauchée interplanétaire des plus grands des mondes. Dans le mouvement et dans la pensée sans arrêt de l’infiniment petit comme de l’infiniment grand, il est ce que Maeterlinck appelle « l’âme irréductible de tout ce qui existe ». Hors de lui, c’est l’arythmie, et de même que l’arythmie cardiaque, pulmonaire, nerveuse, détruit l’équilibre physiologique de l’organisme humain, amène ses désordres et sa mort, l’arythmie sociale bouleverse les sociétés et l’arythmie planétaire fait un chaos de l’harmonie universelle.
Même dans les formes plastiques où il est le plus près du nombre, de la cadence, de la mesure, le rythme garde toute sa valeur animatrice de l’expression psychologique indépendante de leurs règles. Il échappe à la technique de la trinité mécanique. Il est plus d’instinct et d’inspiration que de science. Il en est tellement ainsi que dans la musique, le rythme, tout en en étant le premier élément, n’a pas suivi les progrès des autres.
Berlioz disait :
« Le rythme, de toutes les parties de la musique, nous paraît être aujourd’hui la moins avancée. »
C’est le caractère psychologique du rythme qui le tient en marge de ce progrès ; mais il fait, en même temps, qu’une mélodie du XIIIème siècle sera, dans sa nudité harmonique, aussi émouvante que la plus belle polyphonie moderne. Le rythme est comme l’éthique ; il ignore l’esthétique. Il est en lui-même la beauté et il la communique à l’œuvre d’art quelle que soit la science de l’artiste. Ce n’est que par lui que cette œuvre est ou non vivante.
Le philosophe L. Boisse a écrit :
« Le rythme est une notion essentiellement subjective... Il est l’âme de la durée, et cela partout : en psychologie, en poésie, en musique, en mathématique, et aussi en architecture, car il y a un rythme dans les lignes, mêmes droites, s’il y en a un en nous. »
Terminons par la définition suivante que M. Robert de Souza a donnée du rythme, et qui comble fort heureusement la lacune laissée par la platitude académique : « Rythme : Figure de l’espace ou du temps, déterminée selon des intervalles plus ou moins rapprochés ou compensés, réguliers ou irréguliers, par les retours, les rappels, les groupements de phénomènes quelconques, séparés, opposés ou associés. La figure d’un rythme dépend surtout de la forme que nos sens lui donnent ; elle prend d’eux, ainsi, une valeur personnelle, spécialement expressive : cette valeur est donc de qualité, non de quantité. Le rythme intéresse l’explication et l’application de toutes les sciences, naturelles, mathématiques, philosophiques, et de tous les arts, plastiques, musicaux, littéraires, mais lorsque les phénomènes sont étudiés à l’état vivant, dans leurs relations mobiles et dynamiques. Il est à la source de l’existence même ».
— Edouard ROTHEN