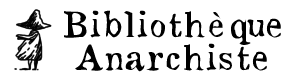L’Encyclopédie Anarchiste — P
P
PACIFISME (organisation et mouvement)
Comment empêcher la guerre et instaurer un régime stable de Paix ?
PAIX (LA PAIX PAR L’ÉDUCATION)
FIN DE LA DÉMOCRATIE CHRÉTIENNE.
PRÉTENDUE SAINTETÉ DE LA PAPAUTÉ.
TURPITUDES ET CRIMES DU VATICAN.
RICHESSE ET AVIDITÉ DES PAPES.
PARLEMENT, PARLEMENTARISME, PARLEMENTAIRE
Participation au gouvernement.
LA RENAISSANCE DE L’IDÉE DE PATRIE.
LA PATRIE CRÉATION DE LA RÉVOLUTION.
I. LE PATRIOTISME — Ce qu’il est.
PHYSICO-CHIMIE, PHYSICISME BIOLOGIQUE
PRÉCURSEURS (LES) DE L’ANARCHIE
L’ANTÉ-PRÉHISTOIRE, LES ÈRES GÈOLOGIQUES.
PHILOSOPHIE DE LA PRÉHISTOIRE.
Les coopératives de production industrielle.
Coopératives spéciales de production.
Les coopératives agricoles de production.
Les Coopératives mixtes de producteurs et de consommateurs.
VII. — Évolution de l’idée de progrès.
II. L’appareil administratif : cheiks et khalifas, caïds et contrôleurs civils, résident et bey.
III. Colons et compagnies minières. Les juifs.
II. LA PUÉRICULTURE PRÉNATALE.
PACIFISME, PACIFISTE
Le néologisme « Pacifiste » fut, lancé après 1900, par Emile Arnaud, un théoricien de la paix, président de la Ligue internationale pour la Paix et la Liberté. Le substantif « Pacifisme » existait. déjà. Il correspondait à « Pacifique ». Le Pacifisme, dit le Congrès de Munich de 1907 est : « Le groupement d’hommes et de femmes de toutes nationalités qui recherchent les moyens de supprimer la guerre, d’établir l’ère sans violences et de résoudre par le droit les différents internationaux ». Le Pacifisme, dit Sève, dans son cours d’enseignement pacifiste, n’est que l’application de la morale aux relations des peuples. Il est, comme la morale, basé sur le respect de la personne humaine.
Aujourd’hui, le mouvement pacifiste manifeste moins d’unité qu’avant la guerre. En dehors de l’union des Sociétés de la paix, sous l’égide de laquelle se réunissaient tous les anciens Congrès, nous avons l’action internationale démocratique pour la Paix, fondée par Marc Sangnier, l’Internationale des résistants à la Guerre, la ligue internationale des femmes pour !a Paix et la Liberté, l’Union des associations pour la Société des Nations. Recherchant une définition qui puisse s’appliquer à tous les mouvements et toutes les théories au moins aussi hardies dans leur opposition à la guerre que le vieux mouvement de la Paix, mais n’excluant pas ceux qui professent une condamnation de la guerre encore plus intransigeants et plus catégorique, et des méthodes de lutte plus énergiques, nous appelons Pacifisme :
« L’ensemble des doctrines condamnant le principe de la guerre, préconisant l’application de la morale aux rapports entre les peuples, poursuivant l’abolition des guerres, la solution des conflits internationaux par des moyens pacifiques, tendant à l’instauration d’un régime de paix internationale permanente. »
Tandis qu’un « Pacifique » peut se contenter de désirer la paix pour lui-même et son pays et peut croire que cette paix sera assurée par les méthodes que préconisent les Nationalistes, le « Pacifiste » condamne l’idée de violences entre États, affirme que les relations entre les Peuples doivent être soumises à des principes moraux ou à des normes juridiques, veut la paix, non pas seulement pour sa patrie, mais pour le monde entier : Paix par le respect du droit, par le développement de la solidarité ou par la fraternité et l’amour.
Cette définition englobe donc les tendances pacifistes les plus diverses ; les unes condamnant la guerre défensive, les autres admettant le droit de légitime défense pour les États ; les unes condamnant l’idée de Patrie, les autres conciliant le Patriotisme et l’esprit international ; les unes considérant comme possible l’établissement d’un régime de droit et de Paix dans l’État Social actuel, les autres tenant comme improbable l’abolition des guerres tant que le Capitalisme ne sera pas abattu, ou bien tant que la division de l’Humanité en Nations n’aura pas disparu.
On peut être Pacifiste en partant du point de vue internationaliste, sur les droits et devoirs des peuples, sur la solidarité qui les lie ou doit les lier, considérer que la Paix permanente sera le résultat de l’organisation de rapports de justice entre les nations. On peut être Pacifiste en se plaçant au point de vue individualiste. La doctrine métapolitique et supranationale de Foilin, envisage surtout une modification des rapports des individus avec les États, condamne la guerre et le service militaire comme comportant l’asservissement de l’individu au groupe, tient la méconnaissance des droits primordiaux des individus, l’excès des pouvoirs accordés aux organismes d’autorité, la croyance à la fiction des intérêts nationaux, comme les principales causes des guerres. On peut être pacifiste en partant du point de vue humanitaire et évangélique. L’anarchiste chrétien Tolstoï envisage surtout les rapports des hommes entre eux, s’oppose à la guerre parce que contraire aux principes de l’amour du prochain et au devoir absolu qui en découle : le respect de la vie. Selon Tolstoï, la violence ne cessera que lorsque les hommes refuseront d’y coopérer.
On peut enfin professer un Pacifisme synthétique à la fois individualiste et solidariste, à la fois internationaliste et humanitaire, proclamer que la justice doit dominer les rapports entre les hommes, entre les peuples et les relations de l’État et des individus. On peut préconiser à la fois la résistance populaire énergique à la guerre, le refus collectif ou individuel d’y coopérer et l’effort pour l’organisation de la Paix.
Toutes les théories pacifistes répudient la guerre en tant que moyen de règlement des différends entre les Peuples ; toutes s’opposent au bellicisme, à la politique impérialiste, au culte de la force, à la haine entre les peuples, à l’oppression des peuples faibles par les peuples forts, aux diverses formes du despotisme international. Mais il semble que nous devions mettre en évidence les idées dominantes du pacifisme moderne, celles qui rallient le plus souvent la majorité dans les Congrès de la Paix, celles qui inspirent l’effort des pacifistes constructeurs. Elles se résument en deux affirmations essentielles :
-
Les Rapports entre les Nations sont régis par les mêmes principes généraux de droit et de morale que les rapports entre individus.
-
Pour protéger la vie et la liberté des peuples, il faut étendre sur le plan international les institutions qui protègent la, vie et la liberté des hommes à l’intérieur des Nations.
Ce dernier principe ne signifie pas que l’on doive transporter dans le domaine international les iniquités et les abus que l’organisation nationale présente plus ou moins dans tous les pays mais seulement que les solutions que l’homme a réalisées ou qu’il aspire à réaliser dans la Cité doivent s’élargir et s’étendre jusqu’à l’ensemble de la Civilisation. Les Peuples ont à peu près les mêmes droits et les mêmes devoirs dans l’Internation que les individus et les familles dans la Nation. Ils ont le droit essentiel de vivre eu travaillant.
Tout différend entre Nations, non résolu à l’amiable, doit être réglé par la voie juridique. Nul n’ayant le droit de se faire justice lui-même, aucune Nation ne peut déclarer la Guerre à une autre. L’autonomie de tout pays est inviolable ; le droit de libre disposition des peuples est inaliénable et imprescriptible. Les Nations sont solidaires les unes des autres.
Sur le plan juridique, la méthode d’organisation de la Paix consiste à prévoir le règlement juridique obligatoire de tout différend non résolu a l’amiable, élaboration d’un Code international public complet réglant les obligations et droits des États, la mise hors la loi de toute guerre et de toute préparation de la Guerre, donc l’interdiction des forces militaires nationales.
Sur le plan politique, les Pacifistes avaient toujours préconisé une fédération des peuples comportant : un organe législatif, un organe judiciaire et un organe exécutif. La plupart des Pacifistes constructeurs considèrent que la Société des Nations actuelle doit être transformée. Il faut qu’elle réunisse dans son sein toute l’Humanité ; qu’elle acquière une autorité souveraine au moins sur les questions de la Paix et tous les moyens propres à imposer ses décisions (la souveraineté des États doit donc être considérablement limitée ; elle doit évoluer dans un sens plus démocratique). Le Congrès de Valence de 1926 préconisait l’établissement du suffrage populaire international ; un parlement international doit être l’émanationdirecte des peuples. La Paix ne sera instituée dans le monde que le jour où sera substitué à la souveraineté absolue et désordonnée des États la souveraineté de la loi internationale votée par un parlement international économique et politique.
Sur le plan économique, les Pacifistes préconisent le libre échange, l’établissement d’une charte internationale définissant les droits et les devoirs des Nations relativement à leurs rapports économiques, et les droits de l’Internation ; le contrôle de la répartition des matières première, l’internationalisation de certaines richesses naturelles, de certains territoires et de certaines voies de communications. La Ligue Internationale des femmes pour la Paix et la Liberté envisageait qu’aux trois pouvoirs classiques : législatif, exécutif et judiciaire, fût ajouté un pouvoir économique.
En résumé, les Pacifistes les plus hardis préconisent l’institution d’un Sur-État ; il faut que chaque Nation limite son indépendance aux questions qui n’intéressent pas l’ensemble de la communauté humaine.
Les deux problèmes sur lesquels les Pacifistes sont le plus divisés sont celui des sanctions et celui de la défense nationale. Un ancien Congrès proclamait que les sanctions exécutives des décisions arbitrales ne devaient jamais avoir le caractère d’une guerre.
Beaucoup de pacifistes modérés envisagent la nécessité de guerres de sanctions collectives contre un agresseur. D’autres condamnent tout principe de sanction. La plupart sont d’accord pour admettre les sanctions économiques et financières.
Les partisans du « Sur-État » préconisent souvent l’institution d’une force armée internationale ; de nombreux pacifistes condamnent autant une force militaire au service de la Société des Nations qu’une force armée nationale. Selon un point de vue intermédiaire, il faut distinguer entre l’armée et la police. Si l’on admet certaines mesures de police, pourquoi en laisser le monopole aux États nationaux ?... Pourquoi ne pas les internationaliser ?... Une police internationale aiderait à contrôler le maintien du désarmement ; elle devrait avoir un caractère préventif et ne prendre les armes que lorsqu’il s’agirait de protéger la vie.
En tout cas, il faut distinguer l’idée de sanctions en général et l’idée de sanctions par les armes. Les moyens coercitifs dont disposerait une autorité mondiale puissante sont très divers.
Les plus justes sanctions sont celles qui frapperaient non pas un peuple en bloc, mais les individus coupables et responsables : gouvernements rebelles, chefs de bandes irrégulières, fabricants d’armements clandestins, provocateurs à la guerre, auteurs de la publication de fausses nouvelles, etc... Selon une tendance nouvelle, l’individu doit devenir sujet de droit international. Certains droits fondamentaux des hommes doivent être proclamés et protégés ; certaines obligations du citoyen du monde envers la communauté mondiale doivent être précisées.
Sur la question de la « Défense Nationale », le point de vue des Pacifistes intégraux, gagne chaque jour du terrain. Le vieux principe « les Nations ont, comme les individus, le droit de légitime défense », est chaque jour battu en brèche. Le président du bureau international de la Paix, Henri Lafontaine, écrivait, dans un rapport destiné au Congrès d’Athènes de 1920 : « L’assimilation entre le droit de légitime défense de l’individu et celui d’une collectivité nationale est tout à fait erronée. Pour l’individu, il n’y a, le plus souvent, d’autres alternatives que de périr ou de frapper son adversaire, et encore l’individu attaqué trouve-t-il des moyens de défense au sein de la collectivité dont il fait partie. I1 n’en est pas de même pour une collectivité nationale ; en cas d’attaque directe ou suspectée, elle peut subir des dommages, mais elle n’est pas menacée de mort. Les Peuples, à de rares exceptions près, ont survécu aux aventures guerrières, même les plus tragiques.
Selon une résolution votée par ce Congrès, il faut faire disparaître du pacte de la Société des Nations toute disposition qui permet à un État ou à un groupe d’États, en vertu d’une décision prise par lui ou par eux, et fût-ce pour leur propre défense, de recourir à la force armée, toute décision de cette nature devant appartenir à une autorité internationale. Le Congrès français de Valence, réunissant des organisations pacifistes très diverses, alla plus loin et se prononça en faveur du refus de servir en cas de guerre. Il condamna totalement la légitime défense guerrière et défendit contre la loi le principe de l’objection de conscience.
Loin de nous l’idée de prétendre que tous les pacifistes ou presque condamnent toute guerre, même défensive. C’est pourquoi nous préférons réserver l’épithète de « pacifiste intégral » à ceux dont l’opposition à la guerre ne comporte aucune réserve.
Mais, tandis qu’avant la guerre de 1914, la plupart de ceux qui condamnaient le devoir de défendre son pays par les armes se plaçaient à un point de vue religieux ou à un point de vue révolutionnaire (Tolstoïsme ou Hervéisrne), sans parler du point de vue Anarchiste, aujourd’hui, nous voyons des hommes qui, sans être des Extrémistes en politique, sans s’inspirer d’aucun mysticisme religieux, professent une opposition totale à la guerre, fondée sur des principes moraux purement rationnels et sur un idéal démocratique. La majorité de ces Rationalistes ne condamnent pas la défense légitime individuelle, mais refusent d’y assimiler la défense légitime nationale, qui atteint tant d’innocents et provoque des maux plus grands que ceux qu’elle a pour but d’éviter.
Aujourd’hui, étant donné le caractère moderne des guerres, l’accroissement formidable du nombre des victimes que provoqueront les armes chimiques et microbiennes, toute défense par la guerre sera nuisible à l’intérêt public, tant de la communauté humaine que de la Communauté nationale.
La différence des points de vue sur la défense nationale entraîne une différence sur l’idée de désarmement.
L’ensemble des vrais pacifistes a comme idéal le désarmement total des Nations (sauf peut-être une minorité modérée qui se contenterait de la réduction jointe à un pacte d’assistance mutuelle). La plupart des Pacifistes considèrent, dès à présent, le désarmement comme un facteur de sécurité et d’apaisement moral. Mais les plus hardis acceptent l’idée du désarmement uni-latéral, et croient à la vertu de l’exemplarité (voir le mot Paix). Pour hâter le jour où toutes les Nations auront abandonné leur armement, condition nécessaire d’une véritable fédération du Monde, il faut qu’un ou plusieurs peuples donnent l’exemple.
Comme conclusion nous exprimerons le vœu et l’espoir que le mouvement pacifiste continue a s’orienter dans la voie d’un pacifisme intégral et synthétique, préconisant à la fois la pression populaire la plus énergique contre le déclenchement des guerres et l’effort, pour l’institution d’un régime de Paix permanente. Le seul point de vue pouvant séparer le Pacifisme internationaliste et démocratique du Pacifisme anarchiste est que, selon ce dernier, la Paix permanente exige l’abolition complète de l’État. Il nous semble qu’elle exige seulement la limitation du pouvoir des États Nationaux. Ce pouvoir doit être limité : d’une part, par les droits de la Communauté mondiale organisée ; d’autre part, par le respect de certains droits primordiaux des individus.
Les anarchistes doivent, en tous cas, se demander si toutes les critiques qu’ils dirigent contre l’État National s’appliqueraient à un État fédéral mondial. Faisons aussi remarquer qu’on ne peut appeler le mouvement pacifiste en général « Pacifisme bourgeois ». Les solutions qu’il préconise, notamment sur le plan économique, s’inspirent souvent beaucoup plus de la pensée socialiste que de la pensée libérale. La composition des Congrès comporte un élément croissant de Socialistes, de syndicalistes, de socialisants. Nous ne parlons pas de l’internationale des résistants à la guerre chez laquelle les adversaires du régime social sont en grande majorité. Le Congrès démocratique international pour la Paix, à Bruxelles, proclamait que la diminution de la puissance capitaliste, l’accroissement de l’influence des classes laborieuses sont des facteurs importants de paix.
Les mouvements internationaux nouveaux insistent beaucoup plus que le Pacifisme ancien sur les liens entre la. question Sociale et la question Internationale. Remarquons d’ailleurs que les solutions pratiques préconisées par l’internationale Socialiste se rapprochent, souvent des propositions du mouvement pacifiste proprement dit. De plus, il n’y a rien dans la Doctrine Pacifiste orthodoxe, sous sa forme hardie, s’opposant à l’idée que le triomphe de son programme sera le résultat de la victoire politique des classes ouvrières. Toutefois, il semble à la majorité des théoriciens du Pacifisme qu’un régime de Fédération mondiale doit pouvoir réunir des pays dont le système politique et Social est très différent et n’exige donc pas l’abolition complète du régime capitaliste dans le monde entier.
Mais sur de nombreuses revendications, notamment sur l’idée de désarmement et celle d’arbitrage, les Pacifistes démocrates socialisants, les pacifistes professant le Socialisme révolutionnaire et les anti-militaristes anarchistes peuvent se trouver d’accord et agir en commun, même si sur l’idéal final ou sur la solution complète leurs idées sont divergentes.
— René Valfort
PACIFISME
« Pacifiste, mais non passiviste ». Cette formule comporte, sans doute, un jeu de mots, mais elle exprime aussi, bien nettement, clairement, et sans la fatale équivoque qui embrouille toujours cette question cardinale, le point de vue qui doit être celui, de tout homme digne du nom d’homme.
C’est la formule même de la morale humaine, qui n’a rien de commun avec le passivisme prêché par Tolstoï et ses disciples, passivisme qui n’est qu’un écho lointain de l’abdication bouddhique, véhiculée en Occident par le Christianisme et la morale évangélique.
Quant à l’élimination réelle, radicale, organique, de ce fléau : la guerre, il ne faut pas perdre de vue que « le problème de la guerre et de la paix c’est la question sociale elle-même » et que « c’est seulement en supprimant l’organisation antagonique qui nous régit que nous pourrons abolir les effets nécessaires. » (Réponse à l’Enquête de la revue Cœnibiumsur la guerre, janvier 1913). Tout le reste n’est que verbiage, illusion et fumée, que palliatifs ou expédients. Si nous voulonsorganiser la paix internationale, il faut que nous organisions d’abord la paix économique ; il faut que le régime individualiste du « chacun pour soi » et du droit quiritaire ait fait place enfin au droit social, au droit réel, et a une organisation rationnelle, amicale et vraiment humaine de la vie économique, base et fondement de la vie publique. C’est dans ce sens seulement qu’une action psychologique peut être réellement d’une efficacité durable, d’une efficacitédéfinitive. Et c’est dans ce sens que nos efforts doivent s’orienter méthodiquement, si nous voulons fonder la paix.
— Paul Gille
PACIFISME (organisation et mouvement)
Nous avons cité dans notre précédent article, comme organisation pacifiste internationale : L’Union des Associations pour la Société des Nations, Le Bureau International de la Paix, organe Central de l’Union des Sociétés de la Paix, L’Action Internationale démocratique pour la Paix, La Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté, l’Internationale des Résistants à la Guerre. C’est la première de ces fédérations qui est la plus puissante numériquement ; en Angleterre, notamment, sa section nationale comprend trois millions de membres. La tendance moyenne de ce mouvement est plus modérée que celle des autres groupements internationaux pour la paix, le pacifisme qui y est exprimé est souvent le pacifisme officieux, où l’influence gouvernementale et les préoccupations politiques se font sentir. Il y a même une minorité participant aux Congrès de cette Union internationale, dont l’opposition au principe de la guerre est trop tiède pour qu’elle puisse se dire pacifiste. Mais il y a aussi, groupée dans cette association, une tendance de gauche ; et souvent des résolutions émanant de ces assises ont émis des vœux assez hardis sur le désarmement, sur l’extension des pouvoirs de la S.D.N., sur l’arbitrage obligatoire et la révision des traités, etc..., mais pourtant, dans l’ensemble, cette organisation représente le pacifisme bourgeois le plus opposé aux tendances anti-militaristes et révolutionnaires.
La doctrine permanente du Bureau international de la Paix se confond à peu près avec le programme constructif développé dans notre précédente étude. Il est impossible de préciser la puissance numérique de ce mouvement pacifiste, vu qu’il comprend, à côté des Sociétés de la Paix proprement dites, beaucoup de groupes n’ayant pas la paix pour unique but. De plus, aux Congrès qu’il organise, de nombreux militants indépendants participent aux travaux collectifs. Ces travaux sont ceux des techniciens de la paix, des vieux doctrinaires auxquels s’adjoignent, selon les pays où se tiennent les Congrès, des éléments plus jeunes et plus hardis. Ce mouvement a eu une influence dans l’évolution des idées ; il n’a pas de force directe et continue pour l’action. Pendant la guerre, il fut peu actif. La majorité de ses membres considérait qu’il ne fallait pas préconiser une paix à tout prix, mais une paix fondée sur la justice et l’organisation du droit ; ce furent des Wilsoniens seconde manière. Il serait injuste tout de même d’oublier qu’il y eut parmi les représentants du pacifisme traditionnel une minorité importante, sinon de pacifistes intégraux, du moins de Wilsoniens première manière, partisans de la paix de conciliation et traités de défaitistes. En France, notamment, ce fut l’attitude du secrétaire de la délégation permanente des Sociétés de la Paix, Lucien Le Foyer.
Selon lui, le jusqu’auboutisme internationaliste était une déviation du pacifisme traditionnel. La véritable interprétation de la doctrine pacifiste classique consistait à admettre la défense nationale mais à la réduire à la protection de l’indépendance du pays. Ce droit s’arrêtait quand l’indépendance du pays n’était plus menacée. Il fallait donc non pas prolonger la guerre en ajoutant à la défense du sol d’autres buts de guerre, mais, au contraire, être prêts à tout moment à négocier.
Quant à l’instauration d’un régime de paix organisée, il convenait de la poursuivre par des méthodes de paix et. non par la guerre et la violence. Le principe « nul n’a le droit de se faire justice soi-même » persistait, même lorsqu’une guerre était déclenchée. Sans nous rallier à cette doctrine, puisque elle admettait quand même la défense nationale guerrière, constatons la hardiesse qu’elle manifestait à ce moment-là et remarquons que plus conséquents avec leur conviction, étaient ceux qui professaient à la fois le pacifisme — but et le pacifisme — moyen. Il est incontestable, sans le moindre excès d’optimisme, que l’expérience de la dernière guerre a dessillé bien des yeux, et qu’aujourd’hui, si un nouveau conflit se déclenchait, ceux qui auraient l’attitude de Le Foyer ou de la minorité de la Ligue des Droits de l’Homme seraient plus nombreux, et que ceux qui adopteraient l’ancien point de vue majoritaires seraient moins nombreux.
L’Action Internationale Démocratique pour la Paix est le mouvement international créé après la guerre par Marc Sangnier. Si ses fondateurs sont catholiques, ses militants appartiennent à des tendances religieuses et philosophiques très diverses. On rencontre même dans ses Congrès une jeunesse étrangère socialisante et parfois anarchisante. Sur la construction de la paix, son programme s’apparente à celui de l’ancienne Union des Sociétés de la paix. Mais il insiste sur deux points particuliers : l’Importance de la Préparation Psychologique de la Paix, le Rôle des Grandes Forces Spirituelles du Monde dans cette Préparation Psychologique, d’une part ; et d’autre part le lien entre le développement de la démocratie politique et économique, au sein des divers pays et le développement de la Paix Internationale...
« L’idéal de l’action internationale démocratique pour la paix est un idéal de paix totale : Paix entre tous les individus et tous les milieux sociaux comme entre tous les peuples et toutes les races. Dans les rapports des uns comme des autres, elle exclue le recours à la violence. Estimant toutefois que la Paix est inséparable de la justice, elle affirme que la paix ne sera vraiment stable que le jour où, par des réformes appropriées, on aura remédié aux injustices politiques, sociales et internationales dont souffre l’Humanité. »
Ces formules de la Charte de l’Action internationale démocratique pour la Paix sont, certes, interprétées différemment, selon les tendances sociales de ses membres. Pour les uns, jeunes républicains, la justice sociale nécessite un ensemble de réformes très hardies. Pour d’autres, socialistes et coopérateurs, elle nécessite l’abolition complète du régime capitaliste. Remarquons aussi que condamner le principe de la guerre civile, ce n’est nullement s’opposer à la grève générale et autres méthodes pacifiques de luttes de classes. Quant à la violence révolutionnaire, ceux des pacifistes qui admettent la guerre défensive n’assimileront pas toujours la résistance par la force à un Gouvernement oppresseur, à une guerre offensive. Et, même parmi les Pacifistes intégraux, condamnant, toute guerre internationale sans réserve, beaucoup, comme Félicien Challaye, feront une distinction s’il s’agit de la lutte sociale.
« Il (le pacifiste intégral) pourra participer à la révolte contre un oppresseur, si de cette révolte peut, évidemment, résulter l’allégement de certaines souffrances. On peut, par exemple, être pacifiste, et participer à une insurrection contre des Gouvernements assez criminels pour précipiter leur peuple dans un conflit armé. La guerre civile, la guerre sociale sont essentiellement différentes de la guerre étrangère. C’est la guerre entre peuples, seulement, qu’interdit le pacifisme intégral tel qu’il est ici défini. » (Félicien Challaye : La Paix par le Droit, novembre 1931.)
Certains des Congrès du mouvement de Marc Sangnier, comme celui de Bierville ont eu un grand retentissement dans l’opinion publique. Il en fut de même parfois de l’action de la « Ligue internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté ». Ce mouvement fut fondé en pleine guerre ; et ses membres travaillèrent à la fois à hâter la fin du conflit et à préparer un régime de Paix durable. Sa doctrine de Pacifisme constructif est plus hardie, plus radicale, que celle des mouvements dont nous venons de parler. Cette ligue demande, dès à présent, le désarmement total. Elle s’oppose autant à l’armée internationale qu’au Blocus. Elle tend à un régime politique et économique mondial organisant non seulement la paix dans le sens d’absence de guerre, mais aussi une solidarité très étroite limitant l’indépendance des peuples aux questions qui ne touchent pas l’intérêt de la communauté humaine. Au point de vue social, ce mouvement proclame le bien-fondé de la plupart des revendications révolutionnaires, mais préconise l’emploi de méthodes de lutte non violentes. Une de ses déclarations condamne toute guerre offensive aussi bien que défensive.
Ce groupement international, qui vaut moins par le nombre que par la grande activité et la hardiesse dans l’action, se rapproche donc sur beaucoup de points de l’internationale des Résistants à la Guerre.
C’est parmi « les Résistants à la guerre » qu’on trouva le plus d’anarchistes. On peut dire que sa doctrine constitue une synthèse du pacifisme constructif et de l’antimilitarisme proprement dit. Nous croyons devoir citer textuellement la déclaration qui fut adoptée par la. première Conférence internationale en 1921. « La » guerre est un crime contre l’humanité. Pour cette raison, nous sommes déterminés à n’aider ni directement : en servant de quelque façon dans l’armée, la marine, ou les forces aériennes, ni indirectement : en fabriquant ou manipulant consciemment des munitions ou autre matériel de guerre, en souscrivant à des emprunts de guerre, en employant notre travail de façon à libérer d’autres en vue du service militaire. Nous sommes résolus à n’accepter aucune-espèce de guerre, agressive ou défensive, nous rappelant que les guerres modernes sont invariablement présentées par les Gouvernements comme défensives.
Les guerres pourraient se placer entre trois sortes :
-
Guerre pour la défense de l’État ;
-
Guerre pour conserver l’ordre de la Société existante ;
-
Guerre en faveur du prolétariat opprimé.
Nous sommes convaincus que la violence ne peut réellement pas conserver l’ordre, défendre notre foyer ou libérer le prolétariat. En fait, l’expérience a montré que, dans toutes les guerres, l’ordre, la sécurité, et la liberté disparaissent et que, loin d’en bénéficier, le prolétariat en souffretoujours le plus. Nous maintenons, cependant, que les Pacifistes sérieux n’ont pas le droit de prendre une attitude purement négative et doivent lutter pour la suppression de toutes les causes de guerres.
Dans d’autres motions, l’Internationale des Résistants à la Guerre demande un régime fondé sur le principe pacifiste de coopération pour le bien commun. « On remarquera que les Résistants à la guerre, ou du moins la majorité d’entre eux, condamnent la guerre civile comme la guerre étrangère. Toutefois, ne croyons pas que ce point de vue signifie la confiance exclusive dans les méthodes légalistes, démocratiques et réformistes. Beaucoup parmi eux, peut-être la plupart, veulent la révolution sociale par l’action directe du Prolétariat ; mais. ils croient à la plus grande efficacité des méthodes non violentes de lutte : grève générale, non coopération, refus de servir, boycottage. etc., etc...
Ils nient que dans les méthodes de Gandhi, rien ne soit applicable à l’Occident et rappellent que plus le Prolétariat conquiert la vraie force, moins il a besoin d’user de violence. Si certains résistants sont non-violents en partant d’un point de vue religieux ou éthique, d’autres le sont en partant d’un point de vue réaliste et pratique.
Tout en croyant au grand avenir du mouvement des résistants à la guerre, à son influence profonde sur les progrès futurs de la paix, nous lui reprochons de ne pas distinguer suffisamment, dans ses doctrines, entre la question des guerres internationales et le problème de la guerre sociale. On peut, selon nous, rendre impossibles les guerres proprement dites avant d’avoir solutionné la question sociale. On peut aussi abolir les conflits meurtriers sans avoir supprimé toutes leurs causes. Le régime le plus propice à l’établissement de la justice entre les hommes sera la Fédération mondiale politique et économique, ayant désarmé les nations militairement et économiquement.
Mais, n’oublions pas ce fait essentiel : que des hommes professant des conceptions sociales très différentes ou des idées diverses sur le problème de l’emploi de la force en période révolutionnaire, sont d’accord pour condamner sans réserve toute guerre entre peuples et préconiser la résistance active, collective, au meurtre collectif et à sa préparation.
Quant à la guerre sociale, sans vouloir nous prononcer sur le problème délicat de la défense contre la violence contre-révolutionnaire, nous croyons devoir rappeler que, même lorsqu’il y a vacance de la légalité, il ne doit jamais y avoir vacance de la morale ; et que, s’il y a une religion qui doit être respectée par les adversaires des dogmes, c’est la religion de la vie humaine, c’est le dogme du respect de la vie.
— René Valfort
PACTE
n. m. (du latin pangere, pactum, fixer)
Pacte est synonyme de contrat, d’accord, de convention ; il implique l’idée d’une association, consentie au moins de façon explicite. Dans les sociétés autoritaires, le lien d’union entre individus est d’ordre extérieur, c’est en définitive la contrainte qu’exerce l’autorité gouvernementale, c’est la peur des sanctions légales, la peur du gendarme. Ceci reste aussi vrai qu’il s’agisse de la Russie des Soviets ou de la République française que de l’Italie de Mussolini et de l’empire du Japon. La force tel est l’ultime argument dont on use contre qui se décide à désobéir. D’ailleurs l’on ne saurait parler de pacte au sens véritable, l’Etat imposant ses volontés aux individus sans préalable discussion, sans même se soucier de leur consentement tacite. Toutefois, pour rendre leur joug supportable et n’être pas victimes du mécontentement général, les autorités surajoutent, dans une certaine limite, l’intérêt à la force et se prétendent les défenseurs vigilants du bien-être commun. Les réactionnaires les plus notoires, les représentants attitrés du capitalisme et de la bourgeoisie, même les rois et les dictateurs se disent guidés par le seul intérêt du pays..Mensonge impudent, ces gens-là estimant que tout va bien lorsqu’ils sont satisfaits. Faussement ils confondent la prospérité générale avec celle de leur classe ou de leur caste ; le peuple doit se contenter du bonheur de ses maîtres. Mais les anti-autoritaires peuvent se réjouir d’une transformation qui enlève aux chefs leur auréole divine et les replonge dans la commune humanité. Elle est de date trop récente pour que les effets en soient très sensibles ; à de certains indices, l’on peut, néanmoins, juger que le prestige de l’autorité ira sans cesse diminuant. Et Lénine avait raison d’estimer la disparition de l’Etat inévitable dans l’avenir. Regrettons que ses fougueux disciples, pas plus que les autres docteurs en marxisme des différents pays, n’aient suffisamment étudié l’évolution historique du concept d’autorité. Le commandement, au sens antique du mot, n’est qu’un anachronisme ; c’est à un travail de coordination et d’adaptation que se ramène aujourd’hui le rôle du chef d’entreprise, je ne dis pas du propriétaire, parasite inutile qui souvent n’exerce pas la direction effective. Ainsi, même dans nos sociétés anarchistes, l’intérêt se substitue à la contrainte extérieure. Pourquoi dès lors l’utilité ne pourrait-elle servir de base unique aux pactes et contrats divers ? Il s’agit, pour les libertaires, d’accélérer une transformation dont le germe préexiste dans notre monde contemporain. Sans recourir à la contrainte, le lien utilitaire permet de créer des associations solides entre individus. Syndicats et groupements professionnels s’inspirent de cette idée, quand ils ne consentent pas à n’être qu’un marchepied pour de rusés politiciens. L’avantage de l’intérêt, c’est qu’il cadre avec la mentalité du grand nombre et n’exige pas une perfection exceptionnelle de la part des individus. Pierre Besnard est à consulter sur ce sujet. Mais, au-dessus du pacte qu’engendre l’intérêt, nous plaçons celui qui résulte de la communauté d’idéal ou de l’amitié. Parce qu’ils aspirent vers un but identique et qu’un rêve commun guide leurs pas, des hommes s’associent que ne rapprochaient ni le tempérament ni la profession. Nombreux furent, au cours de l’histoire, les groupements de ce genre que suscitèrent la politique et la religion. Ce fut pour le malheur du genre humain parfois et, dans l’enthousiasme de maints adhérents, l’intérêt tint une large part. Pourtant l’héroïsme de plusieurs s’avère manifeste ; et l’on pourrait utiliser, pour le bien de l’espèce, une force dont elle eut à souffrir fréquemment. Le lien associatif réside alors dans l’idée ; et nul besoin d’une autorité centrale ni de sanctions pour que le groupement puisse subsister. Les quakers sont organisés d’après ce type. Répondant à une très intéressante question posée par Marguerite Deschamps, dans la Revue Anarchiste, au sujet du respect des contrats, Madeleine Madel écrit à leur sujet :
« Lorsque, dans une réunion de cette société, on a à prendre une décision intéressant le groupe, ce n’est ni par la majorité, ni par la minorité, ni par un individu — vous entendez bien -, c’est par l’unanimité que la décision doit être prise. Voilà qui en dit long sur les méthodes de discussion approfondie et courtoise qui sont pratiquées, sur la bonne volonté et la claire raison de ceux qui y participent, car presque toujours on parvient, en effet, à cette unanimité. Lorsque le cas se produit où elle ne peut être atteinte, aucune décision intéressant la totalité du groupe n’est prise, et il appartient à chaque membre de se déterminer individuellement selon son inspiration propre. Et on ne chicane pas un membre si sa détermination ne correspond pas exactement à ce que tel autre membre désirerait. On se fait confiance réciproquement ; on fait confiance à l’idée qui anime le groupe tout entier. »
Madeleine Madel ajoute que, lorsqu’un adhérent n’est plus d’accord avec l’esprit du groupe, il s’élimine assez rapidement de lui-même, l’atmosphère étant, désormais, pour lui, irrespirable. Le milieu, cher à E. Armand, dont les membres ne songeraient pas à rompre brutalement, sans préalable avis, un contrat qui leur vaut personnellement des avantages, n’apparaît donc pas impossible. Toutefois, dans l’état présent, des associations de ce genre n’obtiendront jamais une extension bien considérable ; seules peuvent attirer les masses, celles qui se fondent sur l’intérêt. La même observation est applicable aux groupements qui se fondent sur l’amitié. A ceux-là vont mes prédilections personnelles, car j’estime que rien n’est supérieur, pour rendre la vie agréable et féconde, à de solides et durables affections. Mais la fraternité qui me plait repousse toute contrainte, toute inégalité, tout conformisme, quels qu’ils soient. Hiérarchie, obéissance, autorité sont des mots qu’elle ignore ; c’est au cœur, éclairé par la raison, qu’elle demande d’harmoniser les volontés. En fondant la Fraternité Universitaire, au début de 1921, c’est une association de ce genre que je me proposais d’établir. Voici d’ailleurs ses principes :
« Placée au-dessus des écoles et des partis, la Fraternité Universitaire demeure ouverte aux volontés droites et aux cœurs généreux sans distinction de croyance ou de position. Ignorante de toute hiérarchie comme de toute contrainte, elle ne connaît d’autres règles que celles de la confiance et de l’amitié. Les formules stéréotypées, les cadres rigides ne sauraient être son fait ; elle entend s’adapter incessamment aux conditions nouvelles du devenir social. »
Contrairement à ce que son titre semblait indiquer, elle s’adressait à tous les intellectuels, non aux seuls universitaires. Mais il fallut pratiquer une rigoureuse sélection, basée sur le caractère, le genre de vie, les dispositions du cœur et de la volonté. Onze ans de pratique m’ont persuadé qu’une sévère sélection morale peut contrebalancer l’absence de sanctions. Axel-A. Proschowsky n’a pas tort de compter sur l’eugénisme pour opérer cette sélection, plus tard ; de nouvelles découvertes d’ordre psychologique ou biologique pourront encore faciliter singulièrement la tâche de ceux qui nous suivront. Dès aujourd’hui, elle est possible quand on s’y applique sérieusement. L’absence de sanctions ne saurait d’ailleurs signifier qu’on se laisse brimer passivement, qu’on renonce au droit de légitime défense, en cas d’attaque injustifiée. Aux libertaires, à qui répugne l’emploi de la contrainte pour faire respecter pactes et contrats, il reste, en conséquence, la ressource d’appuyer ces derniers sur l’utilité, s’il s’agit du grand nombre, sur la communauté d’idéal ou sur l’amitié s’ils traitent avec des individus soigneusement choisis. Quand les trois éléments, ou deux d’entre eux au moins se trouvent réunis, le lien associatif devient particulièrement fort. Espérons qu’une transformation s’opèrera, peu à peu, dans l’ensemble des mentalités, qui permettra de donner l’amour pour base à tous les rapports entre humains.
— L. BARBEDETTE.
PAGANISME
n. m. (du latin paganus, paysan, villageois)
Quand les chrétiens commencèrent à prévaloir dans les villes, ils appelèrent païens ceux qui restaient fidèles aux anciens cultes de l’empire, voulant signifier par là que ces derniers ne se recrutaient plus qu’à la campagne. En 368, Valentinien employa ce terme dans un édit, pour la première fois. Et bientôt il servit à désigner tous ceux qui n’étaient ni chrétiens ni juifs. De païens on tira paganisme, un mot qui s’appliquait, non plus aux individus, mais à leurs croyances. Etroitement associées à l’histoire de Rome, ces croyances s’étaient modifiées au cours des siècles. Pour les anciens Italiotes, les dieux n’étaient pas des êtres vivants, unis entre eux par des mariages ou la parenté, c’étaient des abstractions vagues, dépourvues de réalité, qui personnifiaient les forces de la nature ou les phénomènes, soit terrestres, soit célestes. De bonne heure on fit des emprunts sérieux à la religion étrusque, Mais c’est l’influence hellénique qui modifia le plus profondément le vieux culte romain. On identifia les dieux nationaux avec les divinités venues de Grèce, moins rustiques et ennoblies par de poétiques aventures ; seuls les noms traditionnels furent conservés, les légendes se modifièrent, et bientôt tout l’Olympe hellénique s’installa dans la Ville Eternelle. Les fidèles ne reconnurent plus les antiques objets de leur adoration et le résultat fut un déclin rapide du sentiment religieux. Dès le début du IIème siècle avant notre ère, on traduisit en latin les écrits du philosophe grec Evehmère pour qui les dieux n’étaient que des hommes marquants, divinisés par la crédulité populaire. C’est par esprit politique, à titre de frein indispensable pour subjuguer la multitude, que les hommes éclairés continuèrent d’assister aux cérémonies religieuses ; ils sacrifiaient aux dieux, non par esprit de foi, mais afin de remplir le premier devoir de tout bon citoyen. Comme les bourgeois actuels vont à la messe, sans croire le plus souvent, pour encourager le peuple à écouter les boniments d’un clergé réactionnaire. Auguste tenta de ranimer le zèle religieux des romains : il rouvrit de nombreux temples, ressuscita des sacerdoces tombés en désuétude, remit en honneur des rites démodés. Lui-même remplissait avec conscience son rôle de grand pontife ; et c’est pour lui plaire que Virgile, dans son Eneide accorda une si large place à la mythologie. Cette restauration ne parvint pas à jeter des racines profondes ; elle développa l’hypocrisie chez ceux qui voulaient plaire au maître, mais ne ralentit point la décadence du sentiment religieux. Rome aura d’ailleurs un dieu plus vivant que Jupiter Capitolin en la personne de l’empereur. Moins original dans le fond que dans la forme, ce nouveau culte, essentiellement politique ne fut qu’une transformation de la vieille religion de l’Etat, base organique de la cité. On continua d’adorer Rome en la personne de celui qui symbolisait sa puissance. Quant au peuple, incapable de se satisfaire du culte officiel, trop sec, trop dépouillé de conviction, il se tourna vers les dieux de l’Orient, dont les prêtres apportaient l’espérance aux cœurs ulcérés par les misères d’ici-bas. En s’attribuant la destruction de la vieille religion nationale, à laquelle personne ne croyait plus, le christianisme s’est vanté d’un miracle facile. S’il dut lutter pour la conquête des cerveaux, ce fut contre des sectes orientales qui s’adressaient comme lui aux déshérités. Le culte de Cybèle fut introduit à Rome pendant la seconde guerre punique, pour obéir, croyait-on, à un oracle des livres Sibyllins ; ceux d’Isis, d’Osiris, de Mithra, d’Attis, de Sabazios etc., recrutèrent par ailleurs de nombreux fidèles. En vain le Sénat s’inquiétera-t-il de l’introduction de certaines religions étrangères et fera-t-il mettre à mort des milliers d’hommes et de femmes pour avoir participé aux Bacchanales ; en vain les cultes égyptiens seront-ils persécutés par Auguste et Tibère, l’astrologie chaldéenne proscrite par d’autres empereurs, les dieux d’Orient s’installeront à Rome en vainqueurs. Caligula permit le culte d’Isis ; Vespasien se montra favorable aux rites nouveaux ; Commode fut initié aux mystères de Mithra ; Héliogabale était grand prêtre d’une divinité orientale ; Alexandre Sévère adorait tout ensemble Jésus et Apollonius de Tyane. Les chrétiens confondront ces sectes dans une égale haine, dans un même mépris ; leurs fidèles seront tous des païens ; et la persécution sévira contre eux, sous les empereurs chrétiens, avec autant de vigueur que contre les partisans de l’ancienne religion nationale. Sur les ruines du christianisme nous voyons de même aujourd’hui se multiplier les petites Eglises et les superstitions apportées d’Orient. Spirites, occultistes, théosophes, au mysticisme souvent exacerbé, sont en passe de détrôner le dogmatisme des théologiens. Tant il est vrai que se répètent, presque pareils, les phénomènes qui président à la naissance et à la mort de toutes les religions.
Mais le paganisme ne disparut pas aussi rapidement que beaucoup le supposent ; longtemps il conserva des adhérents parmi les intellectuels, dans l’aristocratie, parmi lès habitants des campagnes. Et là encore le parallélisme apparaît saisissant entre l’agonie de l’antique religion romaine et l’agonie du christianisme dont nous sommes actuellement les témoins. En philosophie, l’école néoplatonicienne d’Alexandrie s’efforça de réconcilier 1e paganisme avec la raison. Plotin, son plus illustre représentant, passa vingt-six ans à Rome ; magistrats, sénateurs, nobles matrones se pressaient pour l’entendre. Son langage obscur, mais éloquent, son visage inspiré, ses allures de messager des dieux lui conféraient un prestige extraordinaire. Il laissa, en mourant, un nombre prodigieux de disciples qui propagèrent sa doctrine dans tous les rangs de la société : Porphyre est le plus connu d’entre eux. Chargée de subtilités grecques, la philosophie de Plotin justifiait toutes les fables mythologiques ; elle ne se détachait du paganisme que pour y revenir par une voie détournée, selon un procédé qu’ont imité depuis les apologistes chrétiens. Au faîte de toutes choses, Plotin mettait un principe indivisible et indéfinissable, l’Un ou le Bien : ce dernier engendrait l’Intelligence qui n’avait d’autre fonction que de se penser et qui contenait en elle-même les idées ou archétypes des choses ; de l’Intelligence naissait l’Ame du monde qui produisait à son tour l’espace et les êtres qui le remplissent. L’Un, l’Intelligence, l’Ame sont les trois hypostases, éternelles, infinies, mais néanmoins inégales d’un même Dieu qui sort de son unité pour penser et pour agir. La magie est utile car ses incantations et ses filtres réveillent les attractions par lesquelles l’Ame gouverne le monde ; et le sculpteur qui crée une œuvre belle fournit à cette même Ame un réceptacle où elle se repose avec prédilection. Plus tard, Jamblique enseignera comment on entre en communication directe avec les dieux par la théurgie, les sacrifices, les conjurations. Au cinquième siècle, la philosophie plotinienne brillera encore à Athènes avec Proclus. De son côté, la poésie continua de s’inspirer de la mythologie païenne. Ce sont les dieux d’Homère et de Virgile que chante Claudien, c’est à la victoire de Jupiter sur les Géants, à l’enlèvement de Proserpine qu’il s’intéresse, à une époque où le christianisme est définitivement victorieux. Aux empereurs, il tient un langage plein d’encens idolâtrique et de réminiscences païennes. Il représente Théodose prenant son vol vers l’azur céleste, comme autrefois Romulus, et allant s’installer au sommet de l’Empyrée. À Honorius qui a déjà persécuté durement le paganisme, il ne parle que des dieux antiques, sentinelles protectrices de l’empire et de son chef. Dans ses manifestations les plus importantes, la littérature était encore fidèle, en plein cinquième siècle, à la tradition mythologique ; et, dans les écoles où l’on étudiait les beaux textes de l’époque classique, les habitants de l’Olympe, aux légendes si gracieuses et si intimement mêlées à l’histoire de Rome, tenaient toujours une place de premier ordre. Philosophes, poètes, rhéteurs, grammairiens furent d’ardents défenseurs du paganisme. Il trouva aussi un appui solide dans l’aristocratie. Les familles sénatoriales étaient restées fidèles aux anciennes cérémonies et aux croyances traditionnelles. Cinq d’entre elles seulement étaient chrétiennes, quand Symmaque demanda le rétablissement de l’autel de la Victoire, enlevé du Sénat par ordre de l’empereur. Aussi la noblesse se fit-elle la protectrice des écrivains qui célébraient le vieux culte. Elle regarda avec dédain les foules qu’on entraînait au baptême et accusa les princes chrétiens d’être les auteurs de tous les maux dont souffrait l’Etat. Ses immenses domaines, ses légions d’esclaves et de clients, la richesse de ses palais, les hautes dignités que ses membres exerçaient souvent, lui assuraient un prestige considérable. Si Théodose n’osa pas appliquer en Occident les décrets qu’il avait rendus concernant la fermeture des temples et l’expulsion des pontifes, c’est qu’il redoutait ses protestations. Symmaque, l’un de ses représentants les plus illustres, est resté comme le défenseur type du paganisme expirant. Sa remarquable éloquence, ses rares qualités d’écrivain, les hautes fonctions qu’ils avait obtenues et remplies avec intégrité lui valaient la confiance du Sénat. Devenu pontife, il apportait une exactitude scrupuleuse à l’exercice de ses fonctions, multipliait les sacrifices pour apaiser la colère des dieux, ranimait le zèle de ses collègues moins ardents. Se montrant plus logique en cela que nos académiciens ou nos ministres réactionnaires actuels, qui font l’apologie du catholicisme, mais s’abstiennent d’ordinaire, d’en observer les rites et d’en pratiquer la morale. C’est pour ne point trahir les traditions romaines et la mémoire de leurs ancêtres que la majorité des patriciens continuaient de se soumettre aux prescriptions religieuses d’autrefois. Ils estimaient que la cause de Rome était indissolublement liée à celle du paganisme, comme maints patriotes de chez nous supposent que le catholicisme est un facteur essentiel de la prospérité nationale. Les gens des campagnes restèrent attachés au culte ancien pour d’autres motifs. Ignorants, grossiers, presque incapables de penser parfois, ils avaient conservé une foi entière aux dieux que leurs pères adoraient ainsi qu’à la puissance des sorciers et des magiciens. Depuis longtemps la population laborieuse des villes était chrétienne, que l’on rencontrait toujours à la campagne des temples où fumaient les charbons du sacrifice, des effigies sacrées que vénéraient les habitants ; aux arbres, aux sources, chers aux divinités champêtres, on continuait d’apporter des fleurs et d’autres présents. Bacchus et Pan n’étaient pas oubliés ; Satyres et Dryades séjournaient encore dans la profondeur des bois. Dans bien des campagnes les pratiques ancestrales furent défendues pied à pied par les paysans ; le culte nouveau ne l’emporta qu’après une lutte prolongée. Malgré l’Eglise devenue toutepuissante, le paganisme subsista en plus d’une contrée ; et, dans beaucoup d’autres, il se modifia seulement. On continua de craindre et d’invoquer les anciens dieux transformés en puissances mauvaises, en démons ; leurs noms intervenaient dans les formules magiques, les imprécations et les serments ; une vertu secrète s’attachait, croyait-on, à leurs effigies. Les imaginations se détachaient avec peine des fantômes qui les avaient émues durant des siècles. Même dans les villes, les vestiges du paganisme subsistèrent nombreux. Au grand scandale des pèlerins, Rome retentissait, à certains moments de l’année, de chants utilisés autrefois par les idolâtres. Les luttes et les courses du cirque, les spectacles du théâtre restèrent, à l’époque chrétienne, fidèles à maintes traditions léguées par les païens. Des citoyens s’entretuaient certains jours, pour le plaisir de la foule, dans plusieurs villes italiennes, à Ravenne et à Orvieto par exemple ; cela en plein moyen âge. Pétrarque raconte qu’en 1346 il vit recommencer à Naples les spectacles du Colisée. Sans les violentes persécutions dont il fut l’objet de la part des empereurs chrétiens, le paganisme aurait subsisté à l’état, non de superstition, mais de véritable culte. Dès 341, un édit prohiba les sacrifices, et cette défense fut renouvelée, avec peine de mort, en 353 et 356 ; la même peine fut portée, par Théodose, en 385 contre les aruspices, en 392 contre ceux qui pénétraient dans un temple. Un édit de 408, complété par plusieurs autres d’Honorius, marqua la fin officielle de l’antique religion nationale. Mais, au milieu du VIème siècle, ses partisans restaient assez nombreux et assez hardis, à Rome même, pour vouloir restaurer le Palladium et ouvrir le temple de Janus. Le paganisme devait d’ailleurs prendre sa revanche en fournissant de nombreux éléments au christianisme et en transformant sa physionomie première au point de la rendre méconnaissable. Au lieu de retrancher les fêtes traditionnelles, qui interrompaient la monotonie du labeur quotidien, l’Eglise les adopta, se bornant à remplacer les dieux de l’Olympe par le Christ ou les saints. Elle permit que des agapes fraternelles deviennent l’équivalent des anciens repas sacrés. La procession de la Chandeleur fut substituée aux Lupercales, celles des Rogations aux Ambarvales ; le culte de la Vierge Marie fit oublier celui des déesses, et l’on a dit qu’il avait plus fait pour le triomphe du christianisme que la main de fer des successeurs de Constantin, De nombreux temples furent transformés en églises ; on conserva souvent les anciens pèlerinages, en édifiant des chapelles ou des monastères là où se trouvaient les idoles ; la hiérarchie des dieux fut remplacée par celle non moins compliquée des saints. Nous n’en finirions pas de signaler les emprunts de toutes sortes que le christianisme fit au culte païen. Instruments liturgiques, ornements sacerdotaux, usage des cierges, de l’encens, etc., sont des legs des anciennes religions. Au moins par son aspect extérieur, le catholicisme actuel se rapproche plus du paganisme que du culte célébré par les chrétiens des temps apostoliques. Le parti pris des historiens bien-pensants est incapable, aujourd’hui, d’étouffer la vérité. Il existe à Luxeuil une collection remarquable de tombeaux gallo-romains du second et troisième siècles. Les personnages en relief qui les décorent, tiennent à la main des objets symboliques, en particulier des vases qui rappellent les emblèmes du culte eucharistique. Des prêtres avaient naturellement écrit de gros volumes pour démontrer qu’il s’agissait de tombes chrétiennes. En quelques pages, publiées par la Revue Archéologique, j’ai prouvé que les sarcophages gallo-romains de Luxeuil étaient ceux de très authentiques païens, qui n’avaient pu adopter les symboles eucharistiques, ne les connaissant pas. Tous les chercheurs sérieux m’approuvèrent, à commencer par Houtin ; pas un prêtre n’entreprit de réfuter mes arguments. Dès qu’un savant impartial s’avise de contrôler les dires du clergé, il aboutit à des conclusions désastreuses pour l’orthodoxie. C’est d’ailleurs ouvertement que le pape Grégoire le Grand conseillera aux missionnaires anglo-saxons de s’inspirer des coutumes païennes.
— L. BARBEDETTE.
PAIN
n. m. (du latin panis, même signification)
Convenons de suite qu’il y aurait trop à dire sur ce simple mot d’une syllabe en quatre lettres s’il nous fallait interpréter ici toute la signification qu’on attache à ce mot, pain. On la trouve, d’ailleurs, dans les dictionnaires, car le mot pain revient sans cesse dans la conversation de ceux qui s’en nourrissent et sous la plume des écrivains. On vit par le Pain ; on lutte pour le Pain.
Au début de la vie, ne se pose-t-elle pas déjà pour nous la question du pain ? C’est encore, à peu près partout, le premier souci des hommes pour lesquels la fameuse sentence : « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front... » n’est pas une vaine formule.
Si « l’espérance est le pain du malheureux », il ne suffit pas à le sustenter. Ce n’est pas avec ce pain là qu’il lui faut envisager l’avenir lorsque, par son travail, il doit gagner son pain et celui de la famille. Il nous paraît plus sage, pour l’homme et pour la femme, tout nouvellement unis par l’amour, d’examiner en face en pleine raison sainement, leur situation et de n’infliger la vie qu’à bon escient, c’est-à-dire de ne pas faire un malheureux à qui le pain fera peut-être manque. Nécessairement, il faut bravement affronter le problème du pain et le résoudre. Quand il y a de la misère pour deux, n’est-il pas criminel de l’augmenter pour qu’il y en ait pour trois ? Si la faim est la triste perspective des exploités, ceux-ci n’ont-ils point le devoir de s’assurer, en ne comptant que sur eux-mêmes, le pain quotidien, plutôt que de le demander en vain chaque jour, à genoux, en disant : « Notre Père qui êtes aux cieux, donnez-nous notre pain quotidien. »
Il faut du pain !... Qu’il soit de seigle ou de froment ; qu’il soit blanc on noir ; qu’il soit frais ou rassis, il est pour le plus grand nombre des humains de nos contrées le plus indispensable des aliments... Or, ce n’est pas la Terre qui le refuse à l’homme ; c’est l’Homme qui ne sait pas se le procurer... Ce n’est pas le terrain qui manque pour ensemencer où il faut le blé, le seigle, le sarrazin. Pas plus que ne manque, sous divers climats appropriés, le terrain humide tout prêt à recevoir le riz, ce pain des Asiatiques qui devient aussi celui des Africains. Enfin, le pain et nous comprimons avec lui tout ce qui est un produit de la Terre et aliment primordial à l’entretien de la vie des êtres qui l’habitent -doit et peut être en suffisance pour tous. Il appartient donc à ceux qui ne s’en peuvent passer d’exiger qu’il en soit ainsi et de s’organiser pour qu’il n’en soit pas autrement.
La terre est vaste, elle est féconde, mais il faut qu’on l’ensemence, qu’on la cultive et, suivant les climats, suivant les lieux, il faut plus ou moins de travail, plus ou moins d’efforts. Nous pouvons dire maintenant qu’il faudra toujours moins d’efforts à mesure que les hommes sauront s’entendre, s’organiser, se comprendre, s’entraider, s’adapter aux méthodes nouvelles de culture intensive : merveilleux concours apportés à leur bonne volonté, à leur coopération, par les progrès de la science, pour l’engrais nécessaire et adéquat et du machinisme, pour l’outillage centuplant le rendement en diminuant la fatigue du travailleur.
Il ne s’agira pas toujours de se conformer avec résignation aux préceptes religieux « de gagner son pain à la sueur de son front ». Tout est à transformer pour le bien de tous. Aujourd’hui, nous savons parfaitement que ce ne sont pas ceux qui ont cultivé, récolté les biens de la terre qui en ont profité. On sait aussi que le pain noir fut toujours pour le serf attaché à la glèbe, trimant dur, du lever au coucher du soleil et que le pain blanc fut pour celui qui ne travaillait pas et ne manquait de rien pour manger et boire avec son bon pain de froment.
On sait également que le citadin qui ne cultive pas la terre, mais qui produit pour satisfaire à d’autres besoins, utiles à tous, se voit mesurer sa portion de pain et n’a pas droit à la bonne qualité de ce pain parce qu’il est un salarié et que ce système d’esclavage, le salariat, consiste à lui laisser la liberté de travailler ou non pour un salaire de famine, parfois et, en tout cas, toujours insuffisant : Cela a trop duré. Cela doit avoir une fin.
Ce n’est pourtant pas qu’on ait manqué de promettre à Jacques Bonhomme d’être un jour le libre producteur jouissant de son travail. Il s’aperçoit assez que ceux-là : les prometteurs, l’ont trompé en lui faisant entrevoir qu’il aurait « plus de beurre que de pain ». Le dégoût lui vient enfin de tous les politiciens présents et futurs et l’heure viendra où il comprendra finalement que l’association libre pour la production des biens de la terre et l’entente libre avec les producteurs des villes pour le libre échange de leurs produits mutuels, succèderont au système stupide des antagonismes, au régime odieux, de l’Autorité et de la Propriété !
Nous croyons préférable de laisser de côté les innombrables dictons et proverbes se rapportant au pain.
Pourtant, quelques-uns sont à noter :
« L’homme ne vit pas seulement de pain. »
C’est juste. Il faut à l’homme de quoi apaiser sa faim qui se manifeste douloureusement et que le pain peut satisfaire, mais il faut encore qu’il puisse apaiser la faim du coeur, du cerveau, de l’esprit, des sens. La faim du coeur s’apaise par le pain de l’affection, de l’amitié, de la sympathie, de l’amour. La faim du cerveau, par le pain des connaissances, des recherches, de la réflexion, du raisonnement. La faim de l’esprit et de la pensée par le pain de l’éducation, des arts, des agréments spirituels. La faim des sens par le pain de l’exercice, des sports, le culte de la beauté, le goût des voyages, la prédilection, pour toutes les manifestations de joie, de courage, d’émotion, qui charment, réjouissent, passionnent et apaisent les sens. Evidemment tout cela sans abus du régal d’un sens aux dépens des autres. C’est ce que fit bien comprendre Octave Mirbeau, par sa pièce, les Mauvais Bergers, lorsque son héros, revendiquant pour ses camarades, réplique au patron qui semble le taxer d’exagération parce qu’il demande une bibliothèque :
« Nous ne voulons pas seulement du pain, nous avons droit, comme les riches, à de la beauté ! »
Le pain de l’esprit est aussi nécessaire que le pain du corps, à tout individu normal.
Le dicton : « Liberté et pain cuit » qui signifie : « Le bonheur consiste dans l’indépendance et l’aisance » nous convient également et nous l’avons démontré dans le monde ouvrier en adoptant la fameuse devise du syndicalisme d’avant-guerre. Bien-être et Liberté. Leur conquête mérite nos efforts associés.
Panem et circenses (du pain et des spectacles) fut une revendication facile à satisfaire à l’époque où les jouisseurs de la Rome antique avaient à si vil prix, la conscience tranquille dans l’orgie criminelle de la décadence, par l’abrutissement et les goûts cruels du Peuple.
Le pain et sa fabrication ont des origines qui remontent jusqu’aux Egyptiens. Sa fabrication fut-elle plus ancienne encore ? Cela n’est pas le plus intéressant pour nous. Nous avons mieux à savoir sur le pain.
Ce que nous aimons à constater, c’est que ce minimum de besoin pour tous ne fut pas toujours — tant s’en faut — à la disposition des êtres humains qui en avaient le plus besoin. Le pain manqua souvent à la plus intéressante partie de l’Humanité.
L’Histoire nous énumère les misères du peuple qui manquait de tout puisqu’il manquait de liberté et de pain. On se souvient que malgré les fastes et les somptuosités de Versailles, la pauvreté était grande parmi les gens du Peuple, dans la capitale du royaume de Louis XIV. Et dans les campagnes les paysans se traînaient sur les genoux pour chercher et manger certaines racines, affirme un écrivain anglais de l’époque. Les sujets du Grand Roi manquaient de pain, si l’on ne manquait de rien dans les châteaux et les palais des privilégiés. Un peu plus tard, sous l’un des règnes suivants, une princesse trouva très drôle que le Peuple manquât de pain et elle s’écria tout naturellement :
« S’il n’a pas de pain, qu’il mange de la brioche ! »
Cruelle inconscience !
Peu de temps après, une fois de plus, le Peuple manquait de pain, parce que les arrivages de grains étaient pillés avant d’atteindre la capitale ou accaparés par certains profiteurs des misères publiques ; les femmes du Peuple de Paris s’en allèrent alors à Versailles pour en ramener le Boulanger, la Boulangère et le Petit Mitron. En même temps, vite, haut et court, furent pendus par la Justice expéditive du Peuple en révolution, quelques-uns des accapareurs des blés ou farines.
C’est ainsi que débuta la Révolution Française. Qu’on ne l’oublie pas ! D’autres révolutions eurent les mêmes débuts.
Mais, depuis, l’accaparement a continué et il n’a pas pris fin. Sous forme de vie chère, les abus criminels des profiteurs se perpétuent et les misères s’accroissent parmi les travailleurs. Et cela d’autant mieux qu’une crise financière arrive toujours succédant à des opérations crapuleuses de profits et d’agio. Le pain est toujours d’un prix plus élevé le matin qu’il n’était le soir. Une presse infâme, au service des plus offrants, se charge de démontrer cyniquement que tout est pour le mieux : le prix du pain, disent les journaux, a diminué de 0 fr. 05 le kilo... C’est parfois exact. Mais il avait alors augmenté de 15 ou 20 centimes auparavant. Les scandales se suivent et les poursuites aboutissent à l’oubli.
Il y a, de plus, des combinaisons formidables qui semblent faites exprès pour engendrer des calamités, des catastrophes, en attendant mieux. Des paysans, gros propriétaires aiment mieux donner leur blé aux bestiaux que de le vendre aux minotiers. Des boutiques de boulangerie sont vendues ou revendues, chaque année, avec des bénéfices énormes. D’autres sont achalandées, restaurées de façon extraordinairement luxueuses, éblouissantes. Des dallages, des mosaïques à l’intérieur ; du marbre et des dorures à l’extérieur... Que de milliers et de milliers de francs gaspillés en poudre aux yeux ! Mais le pain est toujours plus cher et le pain est toujours plus mauvais ! On se plaint un peu, mais la Révolte dort. Le chômage, dans toutes les époques de misère, dans toutes les crises économiques s’accentue et prend des allures inquiétantes, menaçantes même. Il faut secourir les chômeurs, coûte que coûte, car la révolte gronde et la Révolution peut apparaître. Des milliers de chômeurs, c’est la rafale terrible que craignent les jouisseurs ; ils ne peuvent plus fermer les yeux ni se boucher les oreilles. Ils voient l’innombrable foule qui s’avance, ils entendent les hurlements terribles des moutons qui sont devenus des loups.
Le souvenir des canuts de Lyon au siècle dernier se dresse en leur pensée. Ils croient entendre les affamés crier : Du travail ou du pain ! et d’autres : Du plomb ou du pain !
C’est de l’Histoire cela et ce fut sans doute enseigné aux Bourgeois, fils de Bourgeois et Parvenus qui se prétendent républicains, mais non pas à la manière de ceux qui, jadis, chantaient et dansaient la Carmagnole devenue aujourd’hui, et depuis longtemps subversive en ses mâles couplets, tel celui-ci :
Du plomb, du fer et puis du pain (bis)
Du plomb pour se venger ;
Du fer pour travailler ;
Et du pain pour ses frères...
Vive le son !... Vive le son
Et du pain pour ses frères...
Vive le son
Du canon !
Et cela chatouille désagréablement le sens de l’entendement des profiteurs de toutes sortes, maîtres ou valets, qui ne vivent et ne jouissent de la misère des autres qu’autant que durent l’abrutissement et la résignation, par l’ignorance et la lâcheté de ceux qui souffrent si longtemps avant de comprendre, de s’éveiller et de se révolter. Or, tout arrive, même la Révolution sociale pour établir un régime de Justice vraie, de Liberté réelle, d’Entente fraternelle entre tous les exploités du monde, tous les gueux de l’univers : ils sont le nombre, ils sont la Force !
Le Pain pour tous, à la façon dont nous l’avons compris et dont nous nous efforçons de le faire comprendre, c’est déjà ce que conçoivent des millions de malheureux sur la terre, victimes de l’Exploitation, de l’Autorité. Ah ! s’ils s’entendaient !...
D’un peuple quand il dit : « J’ai faim ! »
Car c’est le cri de la nature :
Il faut du pain ! Il faut du pain !
Tous les pays ne sont pas aussi vastes que l’Inde et aussi peuplés de fanatiques pour subir comme eux des famines formidables et horribles. On a peine à se rendre compte que 90 % des habitants de ce pays fertile ne mangent pas à leur faim.
« Sur trois cents millions de paysans répandus à travers toute l’Inde, il y en a bien quarante millions, surtout dans les Etats des Princes, qui ne peuvent s’offrir plus d’un repas par jour. Et quel repas ! Le plus souvent de la farine de millet, délayée dans de l’eau. Car ceux qui cultivent du riz le conservent pour le vendre. C’est la famine déguisée, juste de quoi ne pas mourir. Quant à la plupart des autres, il est rare qu’ils mangent à leur faim. Cet immense peuple d’une intelligence particulièrement vive, au passé glorieux, à l’antique civilisation, ne vit guère mieux que les peuples les plus barbares du Centre de l’Afrique. Peut-être même vit-il moins bien, puisque sa religion lui interdit de tuer, il n’a pas la ressource de la chasse. » (L’Inde contre les Anglais, par Andrée Viollis.)
« La misère de l’Inde n’est pas une opinion mais un fait », écrivait, il y a quelques années, J. Ramsay Mac Donald. Si l’on n’y voit plus guère de ces terribles famines qui firent tant de victimes au dix-neuvième siècle — 2 millions en 1899 — il y a encore des disettes causées, non pas toujours par des récoltes insuffisantes, mais par la nécessité pour les paysans de vendre ces récoltes, sans garder le nécessaire, il y a toujours des privations.
Nous pouvons ajouter qu’il y en eut plus qu’il n’y en aura. Les peuples de l’Inde ont assez d’avoir faim et ce n’est pas la domination anglaise qui pourra longtemps encore maintenir la misère, étouffer la révolte dans le vaste Empire en marche vers son indépendance prochaine.
D’autres peuples d’Asie, sans doute, ne tarderont guère à vouloir aussi semer et récolter pour eux.
Et pourquoi pas ? Qui sait si la colonisation barbare par les civilisés n’ouvrira pas la voie à l’expansion grandiose des idées de Bien-Etre, de Liberté et de Fraternité des Peuples.
Le Pain et l’Indépendance pour tous, d’abord ; la fusion des races, la fin des religions, l’abolition de l’esclavage (y compris celui du salariat), l’anéantissement de toutes les dictatures (y compris celle du Prolétariat), voilà ce que nous croyons voir poindre à l’horizon des temps nouveaux, où personne ne manquera de pain.
— Georges YVETOT.
PAIN
On a vu, par l’étude qui précède, la place que tient le pain dans les préoccupations populaires. Les foules ne le réclament aux heures de crise ou d’émeute avec cette insistance, il n’est devenu l’appel symbolique de la détresse qui s’insurge, que parce qu’il est, en France notamment, l’aliment principal des masses travailleuses. Aussi, quand on considère pour quelle proportion le pain entre dans la nourriture de millions d’êtres humains, ne peut-on se désintéresser de sa substance et de sa préparation, des éléments qu’il apporte en définitive à ceux qui attendent de lui la croissance, la réparation de leurs forces, l’entretien de la vie.
Il y a quelques décades encore, le pain des campagnes, pain naturel, fait de froment normal, justifiait pour une large part les espérances fondées sur ses propriétés. Mais la civilisation est venue qui vise à tout perfectionner (et qui, mal dirigée, aboutit d’abord à dénaturer). Et l’industrie qui s’emploie, sans le contrôle de l’affairisme, à satisfaire les besoins les plus absurdes. Et la chimie, aux prétentieux ersatz… Le « progrès » s’est penché sur le pain de nos pères. Ce bon pain bis, auquel pommes de terre et fromage faisaient un frugal cortège, et qui nourrissait sainement des gens besognant dur, qu’a-t-il gagné à tant de sollicitude ? Tout simplement de devenir un coquet mais dangereux pain blanc qui trahit aujourd’hui la confiance de ceux qui persistent à juger le Pain sur les vertus du passé. Car il y a un abîme entre le pain rustique du tour familial, entre le « pain de ménage » et le magma perfide qu’est le pain blanc de nos élégantes boulangeries...
C’est au moulin qu’on fait généralement remonter les prémisses de l’œuvre d’altération (nous verrons plus loin qu’elle s’étend jusqu’à la terre elle-même). En même temps que le discrédit frappait les lourdes meules aux lentes moulures — qui laissaient à nos farines le germe substantiel et une partie du son rafraîchissant — la science el la gourmandise vouaient le blé aux cylindres destructeurs, s’ingéniaient à des blutages raffinés. Broyeurs et trieurs perfectionnés livraient au boulanger une poudre appauvrie, d’une pâleur tout aristocratique... Mars nos tables s’agrémentaient de pain blanc !
Le pain blanc : pain mort qui a perdu les vitamines et les diastases de l’embryon, pain privé des matières grasses naturelles et des albuminoïdes, des sels minéraux contenus dans le germe et l’assise protéique, des éléments cellulosiques de l’écorce, bref, dépouillé de tout ce qui vivifie le corps et reconstitue les tissus, tonifie les organes et en facilite le jeu, pain réduit à n’être plus – ou presque — qu’ « une masse d’amidon de valeur alimentaire inférieure et provoquant des fermentations acides », source de dyspepsie et de décalcification. Le pain est passé à l’état d’aliment meurtrier, au point qu’on a pu obtenir (Dr Leven, etc.) des cures de dyspepsies rebelles, de dermatoses même, par la suppression radicale du pain blanc. Certaines contrées (Angleterre, par exemple) en consomment relativement peu (100 à 150 grammes par personne et par jour). Mais les Français de toutes les classes sont restés de gros mangeurs de pain (400 à 500 grammes en moyenne), au point que cette habitude est regardée du dehors comme un trait national.
Toute une pléiade de docteurs et de savants, cependant, a lancé le cri d’alarme. Les Galippe et Barré, les Monteuis, les Lenglet, les Lumière, les Labbé, les Carton, les Durville, les Dumesnil (à qui j’emprunte ces documents et quelques citations) ont dénoncé « l’hérésie » et les méfaits du pain blanc. En France (Petit Journal, 1895), en Angleterre (pour le « standard bread » : Daily Mail, 1911), des campagnes de presse, malheureusement suivies de tentatives maladroites (farines diverses mêlées de son et d’éléments hétéroclites : pain de guerre avant la lettre) ont sombré dans le fiasco. A part quelques exceptions, et souvent par démagogie (Ami du Peuple), et des études dispersées (Quotidien, Œuvre, etc.), la grande presse d’aujourd’hui a trop de raisons pour refuser d’accueillir les arguments que les hygiénistes lui apportent. Des groupements naturistes, en France, en Suisse, etc., des publications (comme, chez nous, Naturisme, Régénération, La Revue Naturiste) ont, d’aucuns avec persévérance, poursuivi le procès nécessaire et travaillent encore à nous rendre un pain bis naturel, pain de farines de meules, débarrassées du gros son, mais conservant, avec le germe, l’énergie du grain vivant, l’assise protéique et les parties internes de l’enveloppe, un pain à la fois complet, nutritif et digeste…
Nous n’avons pu, dans ce bref aperçu, que signaler les déficiences résultant des procédés mécaniques de la minoterie moderne. Nous ne pouvons davantage exposer, dans toute leur ampleur, les maux causés dans l’organisme par l’ingestion de substances qu’une habile fabrication emprunte à la chimie (emploi de composés colorés pour le blanchiment, de bromates, de persulfates, etc., produits « améliorants » destinés à faciliter la panification, tous gaz ou sels toxiques). Nous ne ferons aussi que mentionner quelques-unes des altérations que la soif du gain, la passion des gros bénéfices, parfois aussi le désir de flatter la clientèle, n’a pas manqué d’introduire ici, comme en tant d’autres domaines (adjonction de talc pour « économiser » la poudre de blé, de sulfate de cuivre pour « régénérer » les farines vieillies ou avariées, de savon pour rendre onctueux les croissants, etc.). Ces fraudes se rattachent à la sophistication générale (voir ce mot) qui envahit toute La production, surtout industrielle, sans respect pour tout ce qui touche à l’alimentation... Nous ne ferons qu’effleurer quelques tactiques boulangères destinées à. renforcer le poids (eau en excès, cuisson incomplète et brusquée, etc.) et le mépris de l’hygiène qui préside a la fabrication (fournils en sous-sol, poussières flottantes, eaux croupies ou polluées, ouvriers expectorant, etc.), négligences qui se poursuivent jusqu’à la livraison et véhiculent les contagions tuberculeuses ou typhiques. Nous passerons sur la présence, dans les farines mal travaillées ou truquées, des nielles et des ivraies, des succédanés de toute nature sur les moisissures des grains mal soignés, exposés, par surcroît, aux déjections des rongeurs et des chats. Nous ne remonterons pas davantage jusqu’aux errements — et aux calculs — d’une culture qui sacrifie la qualité au rendement et substitue aux variétés éprouvées des variétés médiocres, mais abondantes, qui ne choisit ni ne dose à bon escient ses engrais, conceptions qui nous valent, à la base, des carences (magnésium, chaux, etc.) ou des excès (potassium) que la biologie regarde comme pernicieux...
Ceux à qui le problème apparaîtra dans son importance consulteront avec fruit les ouvrages ou les études des auteurs précités. Ils accompagneront les efforts et vulgariseront les dénonciations motivées des publications et des hommes qui ne voient pas sans inquiétude le déclin précipité des races et luttent assidûment pour l’enrayer... Ils apprendront aussi que le premier coupable de l’effondrement vital du pain à notre époque est encore le consommateur qui réclame, comme un bienfait, qu’il lui soit servi du pain blanc. Et que son éducation, d’abord, est à faire. Ils réclameront ensuite que soit obtenue, par une organisation ad hoc des moulins, et « de concert avec la minoterie (intéressée à tenir compte des goûts du public) et sous le contrôle d’hygiénistes compétents, la farine normale ». Et ils exigeront que la réforme gagne la panification elle-même (locaux manipulations, traitement de la pâte, etc.) et les transports, et les précautions ménagères. Et ils pourront alors caresser l’espérance que le pain redevienne — et sous une forme plus élevée, plus complète encore et plus saine – « notre aliment fondamental ».
— S. M. S.
PAIX
n. f. (du latin pax, même signification)
Toutes les encyclopédies définissent ainsi la Paix :
« Situation d’un peuple, d’une nation, d’un Etat, d’une société politique qui n’est point en guerre. »
Paix générale, universelle, perpétuelle, Paix solide et stable. Demander, implorer, acheter, obtenir, conquérir la Paix. Mettre la Paix entre deux Etats. Avoir la Paix. Etre en Paix. Durant la Paix. En temps de Paix. Vivre en Paix. Paix sur terre et sur mer. Jouir d’une Paix profonde. Que la Paix soit avec vous. (Pax vobiscum.) Paix aux hommes de bonne volonté. — Traité de Paix : traité qui met fin aux hostilités et fixe les conditions de la Paix. Négocier la Paix. Faire une Paix glorieuse, avantageuse, onéreuse, ruineuse, honteuse. On appelle Paix fourrée, Paix plâtrée, une Paix qui n’est qu’un simulacre, une fausse Paix, une Paix hypocrite, conclue de mauvaise foi et avec arrière-pensée par les deux parties, chacune avec l’intention de la rompre, lorsqu’elle estimera le moment favorable et les circonstances propices, ou quand elle croira utile à ses intérêts de la rompre. Paix se dit aussi, de même que Guerre, en parlant des animaux : les chiens et les chats vivent difficilement en Paix. Deux coqs vivaient en Paix ; une poule survint. Et voilà la Guerre allumée (La Fontaine). Se dit souvent de la tranquillité de l’âme, du cœur, de l’esprit, de la conscience. Il faut chercher la Paix de l’âme dans la Vérité (Voltaire). Se dit encore dans le sens de calme, repos, silence, recueillement, éloignement du bruit, de l’agitation, des affaires : La Paix des campagnes, des forêts, des déserts, des tombeaux. Les arts de la Paix : tous les arts auxquels la Paix est favorable, qui ne fleurissent que pendant la Paix, par opposition aux arts destructeurs et stériles que la guerre enfante. Paroles de Paix : qui tendent à établir l’entente, à rétablir la concorde. Faire la Paix : se dit de deux personnes qui étaient brouillées et se sont réconciliées. Laisser quelqu’un en Paix : ne plus l’importuner, ne plus le molester. Ne laisser à quelqu’un ni Paix, ni trêve : le harceler, le poursuivre, l’obséder, le tourmenter, sans lui laisser le moindre répit !...
Je pourrais citer quantité d’autres locutions courantes dans, lesquelles le mot « Paix » figure et auxquelles il confère un sens plus ou moins particulier. Ce qui précède démontre surabondamment que le mot Paix est un de ces mots dont on se sert le plus, bien que la réalité qu’il exprime soit assez rare.
Je lis dans le Grand Larousse :
« Lorsqu’ on parcourt les annales de l’humanité, on voit se dérouler devant soi une telle série de guerres sanglantes, qu’on se demande si la guerre n’est pas véritablement l’état normal de l’espèce humaine ; si la Paix, qui est la source de la richesse, de la prospérité et du développement des peuples, n’est pas au contraire son état exceptionnel. Ce phénomène étrange, qui se comprend à la rigueur à l’état de barbarie, est, pour l’homme qui pense, un sujet d’étonnement et de méditation, lorsqu’on le voit se produire dans l’état de civilisation, dans des sociétés où le meurtre individuel est considéré comme le plus grand des crimes, chez des peuples qui aspirent ardemment aux bienfaits de la Paix. »
Voici ce que je trouve dans le Grand Dictionnaire « La Chatre » :
« La Paix générale, perpétuelle a été jusqu’ici le rêve de tous les nobles cœurs, de tous les véritables amis de l’humanité. Espérons que le jour viendra bientôt où ce rêve deviendra une réalité. C’est une erreur que de croire les hommes faits pour s’entredéchirer. On ne voit pas les lions faire la guerre aux lions et les loups, dit-on avec raison, ne se mangent pas entre eux. Pourquoi en serait-il autrement des hommes ? Déjà la guerre est regardée par les peuples les plus civilisés comme un reste de barbarie, comme une regrettable extrémité, presque comme un crime. La Paix est, à vrai dire, le règne de la Liberté ; elle doit être l’état normal des sociétés qui cessent d’être divisées en maîtres et en esclaves, en oppresseurs et en opprimés, en exploiteurs et en exploités ; elle couronne l’édifice social des nations où l’intérêt individuel cesse d’être en lutte avec l’intérêt général, où règne une équitable répartition des avantages sociaux et des richesses publiques, où n’existe aucune des innombrables causes d’antagonismes qui subsistent malheureusement un peu partout. Les développements de la raison humaine, les progrès des sciences et de l’industrie, en multipliant les relations entre les peuples, en détruisant et les barrières et les préjugés nationaux qui les séparaient, préparent cet avenir que tous les bons esprits appellent de tous leurs vœux. »
C’est en ces termes magnifiques que, dans un discours à la jeunesse, prononcé à la distribution des prix du lycée d’Albi, en 1903, Jean Jaurès proclamait sa foi dans un prochain avenir de réconciliation et de Paix universelle :
« Quoi donc ? La Paix nous fuira-t-elle toujours ? Et la clameur des peuples toujours forcenés et toujours déçus montera-t-elle toujours vers les étoiles d’or des capitales modernes incendiées par les obus, comme de l’antique palais de Priam incendié par les torches ? Non, non ! Et, malgré les conseils de prudence que nous donnent ces grandioses déceptions, j’ose dire, avec des millions d’hommes, que maintenant la grande Paix humaine est possible et que, si nous le voulons, elle est prochaine. Des forces neuves y travaillent : la démocratie, la science méthodique, l’universel prolétariat solidaire. La guerre devient plus difficile, parce que, avec les gouvernements libres des sociétés modernes, elle devient à la fois le péril de tous par le service universel, le crime de tous par le suffrage universel. La guerre devient plus difficile, parce que la science enveloppe tous les peuples dans un réseau multiplié, dans un réseau plus serré tous les jours de relations, d’échanges, de conventions et, si le premier effet des découvertes qui abolissent les distances est parfois d’aggraver les froissements, elles créent à la longue une solidarité, une familiarité humaine qui font de la guerre un attentat monstrueux et une sorte de suicide collectif. Enfin, le commun Idéal qui exalte et unit les prolétaires de tous les pays les rend plus réfractaires tous les jours à l’ivresse guerrière, aux haines et aux rivalités de nations et de races. »
Le moyen d’assurer la Paix entre les nations et de mettre les peuples civilisés à l’abri des calamités que cause la guerre a dû être, depuis des temps fort reculés, l’objet des recherches persévérantes et des efforts opiniâtres de la part des esprits les meilleurs. Sully rapporte que Henri IV avait songé à établir, en Europe, une sorte de confédération (on voit que le projet des Etats-Unis d’Europe est déjà fort ancien) une République chrestienne divisée en quinze Dominations et dans laquelle tous les peuples et, aussi, toutes les religions auraient été placés sur un pied d’égalité. Les représentants des puissances européennes auraient formé un congrès dont les décisions appuyées par des armées eussent empêché toute guerre dans l’avenir. Frappé des malheurs effroyables que causaient à la France les guerres suscitées par le monstrueux orgueil et l’ambition insatiable de Louis XIV, l’abbé de Saint-Pierre, aimable et pieux philanthrope, publia, en 1713, un Projet de paix perpétuelle. Plus d’un demi-siècle après, Kant, le grand philosophe allemand, publia aussi un Essai sur la Paix perpétuelle. Saint-Simon rêva de même de mettre fin aux guerres entre les nations et, en 1814, il développa ses idées dans un ouvrage ayant pour titre : De la réorganisation de la société européenne.
Je fais remarquer, en passant, que ce fut toujours à la suite d’une série de guerres ayant le plus cruellement décimé et ruiné les peuples, que se firent jour et s’exprimèrent les plus ferventes aspirations de paix : sous Henri IV, les guerres de religions ; en 1713, les guerres presque ininterrompues sous le règne de Louis XIV ; en 1814, les guerres de Napoléon Ier. Aussi est-il naturel que les courants pacifistes qui marquent notre époque empruntent leur puissance (voir Pacifisme) à l’horrible guerre mondiale de 1914–1918.
Le monde catholique qui, par sa conception de la divinité, est dans l’obligation de considérer l’Histoire comme le déroulement sur notre planète, d’un plan conçu de toute éternité par un Dieu infiniment puissant, bon et juste, plan dont la prescience divine a tracé dans le temps les moindres détails et auquel, par conséquent, il n’est permis, ni possible à personne d’apporter la plus légère modification, le monde catholique a tenté de justifier le triste, le révoltant et odieux spectacle de l’état permanent de guerre dans l’histoire humaine, par de bien singulières considérations.
Joseph de Maistre (1753–1821), le trop célèbre écrivain et philosophe ultramondain, a osé affirmer que :
« Le sang humain doit forcément couler sans interruption sur le globe et que la Paix, pour chaque nation, n’est qu’un répit, parce que Dieu se plait à voir couler le sang de l’homme, ce sang répandu à flot étant une expiation et un moyen de purification. »
Cette thèse, au surplus, a été reprise par les représentants et porte-parole les plus qualifiés de l’Eglise catholique, apostolique et romaine, à propos de la guerre infernale dont le lecteur trouvera plus loin, au cours même de cette étude, le bilan effroyable. Dévots et bigotes furent nombreux qui crurent et croient encore que la guerre ne s’est abattue sur la France et que son territoire ne fut envahi et occupé par l’armée allemande, que pour faire expier à ce pays les lois de laïcité et de séparation des Eglises et de l’Etat. Endoctrinés par les moines et les curés, beaucoup d’esprits superstitieux et peu cultivés ont été et sont encore convaincus que, si le sang de centaines et centaines de milliers d’hommes à la fleur de l’âge a coulé durant ces cinquante et un mois de monstrueux carnages, c’est parce que la justice divine exigeait ce châtiment ; parce que la sagesse de Dieu nécessitait que ce flot de sang abreuvât le sol de la France pour le purifier et l’assainir ; parce que cette horrible épreuve pouvait, seule, ramener à Dieu le peuple français qui lentement se déchristianisait ; parce que la Volonté de Dieu, qui, parfois, se manifeste par des événements impénétrables au faible entendement des humains, avait décrété que l’atrocité de la faute commise par la nation française oubliant qu’elle est « la fille aînée de l’Eglise » appelait une expiation non moins atroce. Cette thèse abominable ne peut naître que dans des cerveaux détraqués par le fanatisme et se propager que dans des imaginations maladives. Elle tend à conclure que la guerre est un mal qui ne disparaîtra jamais, un fléau que l’effort des hommes ne peut pas vaincre, qu’il faut s’y résigner et que la Paix définitive n’est ni espérable ni possible. Par bonheur, de plus en plus considérable est la foule de ceux et de celles qui sont persuadés que la Paix, aspiration, espoir, désir présentement, est appelée à devenir de plus en plus besoin, volonté, certitude. C’est parce qu’ils sont persuadés que cette utopie d’aujourd’hui sera la réalité de demain que, dans tous les pays et surtout dans les nations où la civilisation a atteint le niveau le plus élevé, hommes et femmes ont formé des groupements, constitué des associations, organisé nationalement et internationalement des ligues qui travaillent à l’avènement de la Paix (voir le Mouvement pacifiste).
Faible encore, il y a quelques années, ce courant pacifiste devient tous les jours plus puissant et incarne une volonté de paix constamment fortifiée. Rien ne se produit fortuitement et ce n’est pas sans motif que les générations contemporaines s’imprègnent avec une ferveur sans précédent de l’idée de Paix désirable et réalisable.
Vers la Paix
Arrêtons-nous quelque peu sur les causes qui déterminent et les circonstances qui favorisent cette irrésistible poussée vers l’avènement d’une Paix définitive.
-
Il y a d’abord l’adoucissement graduel des mœurs. Il est certain que les temps ne sont pas encore venus où les humains renonceront, lorsqu’un conflit les divisera, à recourir à la force pour le trancher. La magistrature souveraine et expéditive du muscle préside trop souvent encore au règlement des différends qui dressent les uns contre les autres ; mais personne n’osera contester que l’emploi de la violence brutale est en régression sur l’époque pas bien éloignée où, sous le plus futile prétexte ou à raison de la plus insignifiante rivalité, la lutte s’engageait, farouche, mortelle, entre les adversaires. Le jour ne s’est pas encore levé où le respect de la vie humaine se sera si solidement installé dans la conscience des individus que, à l’exception de quelques brutes ou anormaux, personne n’attentera aux jours d’autrui. Toutefois, cette idée que l’existence du prochain est une chose sacrée est aujourd’hui beaucoup plus générale que dans le passé.
-
La multiplication et le perfectionnement des moyens de production, de communication et de transport, le nombre sans cesse plus important des transactions commerciales de pays à pays, la promptitude et la précision avec lesquelles sont transmises les informations qui intéressent le monde civilisé, toutes ces conditions de vie individuelle et collective ont, à ce point, resserré les distances que, malgré sa surface considérable et restée la même, notre globe, comparé à l’immense étendue qu’il était raisonnable de lui assigner il y a seulement un siècle, apparaît de nos jours infiniment moins vaste. N’étant plus enfermés, comme leurs ancêtres, dans les limites étroites de leur petite patrie, les hommes ont élargi le cercle de leurs relations jusqu’à celui d’un ou plusieurs continents et les distinctions de nationalité, les oppositions de race se sont sensiblement atténuées. Tout ce qu’il y a d’artificiel et de conventionnel dans le sentiment nationaliste (voir les mots nationalisme, patrie, patriotisme) a frappé et impressionné de plus en plus la raison des personnes aptes à réfléchir et à discerner avec clairvoyance.
-
Au sein de chaque nation, les formes de plus en plus collectives de la production capitaliste ont fait naître des agglomérations industrielles qui ont été le berceau de ces masses profondes qu’on appelle le prolétariat (voir ce mot). Ces années de travailleurs supportent avec une résignation qui va en déclinant l’exploitation dont elles sont victimes. Comprenant que, courbés sous les mêmes servitudes, subissant les mêmes dominations, ils doivent, s’ils veulent améliorer leurs conditions de travail et d’existence et finalement se libérer des jougs qu’ils subissent, communier dans la pensée et l’action, ces prolétaires se sont formés en syndicats ; ces syndicats se sont fédérés dans le cadre intercorporatif sur le terrain national d’abord, sur le plan international ensuite et, conséquence naturelle et fatale, un rapprochement s’est opéré entre tous ces exploités sans distinction de nationalité ; un sentiment et des pratiques de solidarité, de sympathie réciproque et de mutuelle confiance se substituent insensiblement aux pratiques et au sentiment de défiance et d’hostilité qui, naguère, encore, étaient le fait général. Tout permet de concevoir et tout autorise à espérer que, sous peu, il deviendra impossible aux Gouvernements de précipiter les unes contre les autres ces diverses fractions d’un prolétariat mondialement organisé et évolué, que les événements éclairent de plus en plus sur les origines et les fins des conflits armés dont il est l’éternelle victime.
Le jour — et il est proche — où les prolétaires du monde dit civilisé auront conscience que, quel que soit le coin de terre qui les a vu naître, non seulement ils n’ont aucune raison de se haïr et de se combattre, mais qu’ils ont, au contraire, tout intérêt à s’entr’aimer et à s’unir contre les Maîtres qui s’ingénient à semer entre eux la haine, ce jour-là, rien ni personne ne parviendra à les faire s’entr’égorger. Cette ascension — trop lente, beaucoup trop lente à notre gré, mais certaine — du prolétariat universel vers la constitution d’une nouvelle Internationale entraînera et guidera l’humanité sur le chemin de la Paix.
-
Est-il besoin d’attirer l’attention sur les dépenses énormes que l’état de Paix armée impose aux populations ? Qu’on en juge : le total des budgets militaires (budgets officiels) atteint, en 1931, 103 milliards 948 millions, 298.950 francs, soit en chiffres ronds cent quatre milliards, qu’on prélève annuellement sur le travail humain, sur l’épargne, sur la santé publique. Les Etats-Unis d’Amérique ouvrent la marche avec 17.685.625.000 francs. La Russie tient le deuxième rang, avec 14.473.567.615 francs. La France et la Grande-Bretagne viennent ensuite avec 11.674.000.000 francs et 11.631.375.000 francs. Mais si l’on ajoute aux dépenses de la Grande-Bretagne les dépenses des Dominions, on constate que le total arrive à un chiffre très voisin de celui des Etats-Unis. La cinquième et la sixième place appartiennent à l’Italie et au Japon. Ces six grands pays représentent les deux tiers de la dépense mondiale. Le budget officiel de l’Allemagne n’est que de 4 milliards 298 millions 076.000 francs.
Les dépenses incombant au régime ruineux de la Paix armée vont en augmentant d’une façon à peu près régulière et continue. Les dépenses militaires, inscrites au budget de la France, ont été : en 1868, de 548 millions ; en 1878, de 663 millions ; en 1888, de 727 millions ; en 1898, de 938 millions ; en 1908, de 1.165 millions ; en 1913, de 1.814 millions. En 1931, il atteint près de 12 milliards, malgré la réduction du service militaire de 7 ans à 5, puis à 3, puis a 2 ans. La Paix armée n’est-elle pas un gouffre ? Et jeter, tous les ans, dans ce gouffre, cent quatre milliards, n’est-ce pas le comble de la démence ? Peut-on sérieusement croire que les peuples sont en proie à une folie incurable et que toujours ils se laisseront bénévolement dépouiller ainsi d’une somme qui représente un effort de production considérable, et cela en vue d’entasser des engins de massacre dont ils seront eux-mêmes les victimes ? Ce serait à désespérer de la raison humaine et tout me porte à la certitude que pareille démence provient de l’héritage millénaire de férocité, de sauvagerie et d’ignorance que les hommes doivent à leur bestialité originelle, mais que, sortie des ténèbres et se dirigeant vers la lumière, la raison ne tardera pas à l’emporter et à mettre fin à cette folie.
-
Ce ne sont pas seulement des ressources matérielles incalculables que, depuis des, siècles, la guerre a englouties ; elle a été, aussi, de tous, les fléaux qui ont décimé l’humanité et de tous les crimes qui ont déshonoré l’histoire, celui qui a fait le plus grand nombre de victimes. Camille Flammarion (« Sur la Guerre ») établit les chiffres que voici : « Ce fut, depuis les Pharaons, 40 millions de morts chaque siècle (presque un par minute) ; 1.200 millions de morts en trente siècles, c’est-à-dire : dix-huit millions de mètres cubes de sang, des squelettes bout à bout sur 500.700 lieues de long (cinq fois le chemin de la Terre à la Lune), des crânes se touchant sur six fois le pourtour de la terre... » Le grand astronome français s’indignait de ces terrifiantes hécatombes. Ces chiffres sont bien de nature à faire de tout homme raisonnable et sensible un adversaire irréductible de la guerre et un partisan résolu de la paix. Mais ils remontent à une époque passablement lointaine et, pour amener à réfléchir l’homme d’aujourd’hui, il faut invoquer des événements plus rapprochés et, si possible, récents, à plus forte raison des événements qu’il a vécus et dont il a gardé le vivant souvenir.
J’ai parlé plus haut du bilan effroyable des pertes de toute nature à porter au passif de la dernière guerre mondiale. Je recommande l’exposé de ce bilan à l’attention des personnes qui liront ces lignes et je serais extrêmement surpris si, après avoir mesuré toute l’horreur qui s’en dégage, il se trouvait une seule personne, douée de quelque intelligence et de quelque sensibilité, qui pût n’en pas concevoir l’indéfectible volonté de servir de toutes ses forces la cause de la Paix. Ce bilan, le voici :
Bilan de la Guerre de 1914–1918 :
-
Pour le Monde : 51 mois de mobilisation ; 74 millions de mobilisés ; 13 millions de soldats (7 à la minute) et des millions de civils tués ; 3 millions de disparus ; 20 millions de blessés ; 10 millions de mutilés ; 3 millions de prisonniers ; 5 millions de veuves de guerre ; plus de 10 millions d’orphelins ; 10 millions de réfugiés.
-
Pour la France seulement (je ne possède pas de chiffres précis pour les autres pays belligérants) : 1.700.000 tués ; 453.500 disparus ; 2.444.000 blessés ; 708.554 mutilés (classés) : 404.606, des membres ; 235.884, des poumons ; 24. 696 des yeux ; 13.392, des oreilles ; 8.558, de la face ; 14.502, du cerveau ; 4.338 sourds ; 2.585 aveugles. Tels sont les chiffres officiels pour le matériel humain. Que de souffrances, de deuils, de larmes et de regrets, représentent ces abominables conséquences d’une guerre qui, durant plus de quatre ans, a ensanglanté la terre ! Combien d’hommes jeunes et vigoureux, intelligents et bons, l’élite, véritablement, et la fleur de l’humanité, ont été sacrifiés ignoblement à des intérêts et immolés froidement à une cause qui n’étaient pas les leurs ! Veut-on connaître, maintenant, le bilan des pertes matérielles, des ruines et dévastations que ce carnage, le plus infâme de tous ceux qu’enregistre l’Histoire, a entraînées ? La partie documentaire de cette Encyclopédie ne doit pas être fantaisiste ou approximative ; ses qualités essentielles doivent être la précision et l’authenticité. Je m’en réfère donc aux indications officielles. Ce bilan des dommages matériels, qui viennent s’ajouter à celui des pertes humaines, est le suivant et il ne s’applique qu’à la France : 4.022 communes, 632.894 maisons, 20.000 usines, 7.985 kilomètres de voies ferrées, 4.875 ponts, 12 tunnels ont été détruits ; 52.734 kilomètres de routes ont été rendus impraticables ; 3.600.000 hectares de terrain ont été rendus incultes. Les dépenses imposées au pays par la guerre ont été de 606.669.570.000 francs et 502 milliards de dettes ont été inscrites au débit de la France.
Sous ce titre : « Ce qu’a coûté la guerre de 1914–1918 », « l’Union mondiale de la femme » a publié un manifeste duquel j’extrais les tragiques données qui suivent : « Savez-vous que la guerre a coûté la vie à treize millions de soldats ? Leurs cercueils alignés côte à côte couvriraient une route de 6.450 kilomètres, soit la distance de Bordeaux à Moscou. Et ces 13 millions ne représentent que les victimes tombées sur le champ de bataille. A ce chiffre, il faut ajouter les autres 24 millions de morts, victimes du blocus terrestre et maritime, des révolutions, des navires coulés, des bombardements, des maladies et infirmités consécutives à la guerre, etc. Le chiffre de 13 millions se trouve ainsi plus que triplé. Autre tableau : les morts marchant en lignées de 10, de l’aube au coucher du soleil, à intervalle de deux secondes, ces victimes de la guerre défileraient pendant 162 jours. Tout calcul fait, la mort de chaque soldat a coûté 89.000 francs suisses (environ 445.000 francs français). La grande guerre a coûté 100.000 francs suisses, pour chaque heure, depuis la naissance du Christ jusqu’à nos jours. Les quatre ans de guerre ont coûté, par heure, plus de 45 millions de francs suisses (le franc suisse vaut actuellement 4 fr. 90). En quatre ans, l’Europe a perdu les économies d’un siècle. Evaluée en journées de travail, les pertes nettes de cette guerre représentent le labeur d’un million d’ouvriers qui travailleraient à raison de 44 heures par semaine pendant 3.000 ans ! »
J’ai tenu à citer ces chiffres, afin que, inscrits en lettres de feu dans cet ouvrage, ils m’aident à faire saisir une des raisons, et non des moindres, que les hommes d’aujourd’hui, après avoir été bercés dans la stupide glorification de la Guerre et l’admiration aveugle des Conquérants, des Grands Capitaines et des célèbres massacreurs, ont fini par s’éloigner de ces exaltations aussi insensées que malsaines et qu’ils tendent : et à mépriser et à exécrer la Guerre, autant qu’ils l’ont admirée et aimée ; et à aimer et désirer la Paix autant qu’ils l’ont, dans le passé, dédaignée et peu chérie.
-
-
Si encore il était possible, comme dans les siècles qui sont derrière nous, non pas de justifier la guerre — la guerre ne saurait être réhabilitée et, quelle qu’elle soit, elle est un crime — du moins d’établir qu’elle apporte de sérieux avantages, des bénéfices appréciables à ceux des belligérants qui sont victorieux, on pourrait, à la rigueur, en accepter les douloureux effets, en trouvant dans les profits de la victoire la compensation ou l’équivalence des sacrifices consentis. Mais il est, aujourd’hui, de notoriété publique que la guerre ne paie pas. C’est une vérité indiscutablement prouvée par Norman Angel, dans un livre qui a pour titre « La Grande Illusion », livre qui, traduit en plusieurs langues, a fait le tour du monde.
La guerre de 1914–1918, dans laquelle une foule de nations ont été engagées, a merveilleusement mis en lumière le bien fondé de cette constatation : vainqueurs et vaincus, tous les peuples qui ont pris part à cette guerre maudite en sont sortis plus ou moins épuisés et aucun ne peut se flatter que la victoire ait amélioré son sort, accru sa richesse, augmenté sa puissance proportionnellement aux dépenses qu’il y a englouties et aux jeunes hommes qu’il y a perdus. Treize ans après la conclusion de l’armistice (j’écris ces lignes en décembre 1931) qui a mis fin aux hostilités et précédé les négociations de Versailles, la situation de toutes ces nations est lamentable : débâcle financière, gâchis politique, désarroi industriel, marasme commercial, crise de chômage sans précédent, gêne et déséquilibre partout ; rien ne manque au tableau. Ces désolantes constatations, tous peuvent les faire et chacun les fait. Et elles poussent irrésistiblement tous les hommes de cœur et de raison loin des routes sanglantes de la guerre et vers les sentiers fleuris de la Paix.
Toutes les considérations que je viens d’énumérer — et chacune demanderait de plus amples développements, mais il faut savoir se limiter — expliquent et motivent l’accueil fervent que rencontrent les idées de Paix dans les milieux les plus divers, et même les plus opposés (voir le mot Pacifisme). Toutefois ces considérations et circonstances ne seraient peut-être pas suffisantes, tant le culte de la force, même sous sa forme la plus bestiale et la plus criminelle et l’esprit nationaliste et guerrier ont jeté dans la conscience des hommes des racines profondes, qu’il sera long et malaisé d’extirper à jamais.
-
Mais il me reste à indiquer le fait qui, plus que tout autre, et de beaucoup, soulève contre l’éventualité d’une nouvelle guerre l’opinion publique. Ce fait, c’est le frisson d’épouvante et de répulsion que fait passer dans le cœur de tous la certitude que, si la guerre éclatait de nouveau, elle équivaudrait à une manière de suicide général.
On trouvera au mot qui suit une étude saisissante sur les effroyables conséquences de la guerre des gaz, de cette guerre que certains ont qualifiée de guerre « scientifique » (voir l’article ci-après : La Science et la Paix). L’énumération — forcément incomplète — des gaz mortifères qui seront utilisés, les terrifiants effets que ces gaz entraîneront, tout cet amas de morts, d’incendies, d’explosions, de ruines, de dévastations, d’intoxications de tous genres que l’aviation de guerre ferait pleuvoir sur les populations civiles, y est exposé avec une précision qui exclut toute crainte d’exagération. Qu’on lise et qu’on relise cette étude nourrie d’une documentation abondante et indiscutable, et on se rendra compte qu’une telle guerre serait l’extermination de l’espèce et le retour à la barbarie par l’écroulement de la civilisation que cinquante siècles d’efforts ont lentement et péniblement édifiée.
Victor Méric, un des collaborateurs de cette Encyclopédie, a écrit ce qui suit :
« La guerre de demain n’épargnera personne ; non, personne : ni les dirigeants, ni les riches pourvus d’autos et qui fileront sur les roules, ni les militaires, ni les civils. Les enfants à la mamelle absorberont le poison, de même que les vieillards courbés vers la tombe. Plus d’embusqués, plus de filons. La mort partout ; la mort sur tous. Et l’épouvante, la démence, le déchaînement odieux des instincts les plus bas, le sauve-qui-peut général. Car la guerre, ce ne sera pas seulement l’arrosage copieux sur les cités, l’explosion des bombes, les incendies, les maisons écroulées, les rues défoncées. Ce sera, aussi, la ruée, en débandade, sur les routes ; des cohortes affolées courant sur les chemins comme ces foules du moyen âge qui fuyaient les barbares et les fléaux. Ce sera, dans les villes désertes et ravagées, dans les centres industriels et les agglomérations ouvrières, l’arrêt de toute production, l’Economie nationale frappée à sa source même, tout labeur suspendu, une sorte de formidable grève générale, déterminée par la panique. Et, au bout, le spectre hideux de la famine. Une nuit suffira, vous entendez ? une nuit... que dis-je ? quelques heures de la nuit pour que notre orgueilleuse capitale ne soit plus qu’un tas fumant de décombres. Quelques avions sur Paris, et tout sera dit. Rien à faire, rien à espérer. Les masques ? Impuissants : il en faudrait trop. Il faudrait même des vêtements complets couvrant le corps de la tête aux pieds et imperméables à tous les produits diaboliques dont on ne connaît pas la composition. Les abris ? Insuffisants. Les gaz pénètrent partout, se faufilent partout. Rien à faire, vous dit-on ; rien que de se précipiter, au hasard, vers les campagnes, dans les bois, loin des gaz, loin des poisons.
« Seulement, il faudra manger ; et les troupeaux enragés se disputeront les croûtes de pain. Car, il faut bien qu’on se le dise : il ne s’agit plus simplement de défense nationale. Il n’y a plus de victoire possible ; il y a l’Humanité qui roule sur une pente vertigineuse, vers des abîmes de sang et de folie.
« La guerre prochaine — si on ne lui barre pas le passage — c’est la fin de tout, la civilisation en échec, le bipède du vingtième siècle retournant aux cavernes, le globe couvert de ruines : la fin, comprenez-vous bien ? Le grand suicide ! »
Le savant professeur Langevin s’exprime ainsi :
« Si une nouvelle guerre devait éclater, elle se ferait dans un espace à trois dimensions, c’est-à-dire non seulement le long du front, mais en profondeur, jusqu’aux régions les plus éloignées dans chaque nation belligérante et, en hauteur, car les cieux eux-mêmes seraient sillonnés de combattants. Les effets de destruction en seraient si rapides que toute la civilisation occidentale risquerait d’être anéantie. » Le professeur Branly, le père de la T. S. F., a dit : « La prochaine guerre, au lieu de coucher seize millions d’hommes, en assassinerait, peut-être cent millions ; mais nous pouvons penser que, ce massacre se faisant de part et d’autre, les survivants continueront à s’entretuer, à moins du cas improbable où ils prendraient conscience de leur folie. »
Ce massacre futur s’effectuerait malgré tous les traités et conventions, par la voie aéro-chimique. Le fait est, hélas ! incontestable : toutes les nations s’y préparent. Beaucoup de personnalités, dans les principaux pays, en ont proclamé la légitimité.
Il est inutile que j’en dise davantage : je ne puis imaginer un homme — à moins qu’il ne soit un sadique ou un aliéné — qui envisagerait de sang-froid la perspective d’un tel désastre. Aussi, sont-ils légion — légion innombrable — ceux qui sont fermement décidés à ne reculer devant rien, afin d’éviter la guerre, afin de mettre les gouvernements en demeure de renoncer définitivement à la force armée pour régler les différends qui peuvent surgir entre eux. Il ne faut pas se dissimuler que, quelle que soit la forme du gouvernement, ce sont, dans tous les pays, les hommes au Pouvoir qui disposent souverainement de la paix des peuples. Ceux-ci se trouvent, brutalement et plus ou moins à l’improviste, devant le fait accompli ; ils n’ont point été consultés ; ordre leur est donné d’obéir au décret de mobilisation et ceux que cet ordre touche et qui refusent de s’y conformer sont frappés des peines les plus sévères, voire punis de mort, à titre d’exemple. Perdre de vue cette donnée précise du problème à résoudre, qui consiste à empêcher la guerre, à lui opposer un obstacle insurmontable, serait de la plus dangereuse, de la plus mortelle imprudence.
En 1913–1914, on sentait venir la guerre. Les personnes exactement informées sur l’état général du monde dit civilisé, averties de ce qui se préparait dans les salons diplomatiques, au courant de ce qui se tramait dans les milieux de la haute banque et de la grande industrie, renseignées sur les courants bellicistes qui agitaient les sphères gouvernementales et sur la mentalité qui régnait dans les régions officielles, ces personnes pressentaient que les grandes Puissances marchaient vers un conflit armé qui, par le jeu même des alliances et des traités en cours, allait, dès que jaillirait la première étincelle, transformer l’Europe en un immense brasier. Le prétexte importait peu : le plus futile suffirait. Cette idée d’une guerre certaine et proche était si généralement répandue et — hélas ! — si généralement acceptée, que ce qui frappa d’étonnement l’opinion publique, quand éclata la guerre, ce ne fut pas la guerre elle-même, à laquelle on s’attendait peu ou prou, mais, d’une part, l’insignifiance apparente de l’événement qui en était le point de départ et, d’autre part, la rapidité vertigineuse avec laquelle les faits se précipitèrent. Quoi qu’il en soit, la guerre était considérée par la plupart comme une sorte de fatalité, dont il n’était pas tout à fait impossible de retarder l’échéance, mais de toutes façons inéluctable. Cela est si vrai que, dans tous les milieux opposés à la guerre, on faisait effort beaucoup moins pour en écarter la redoutable éventualité, que pour étudier et arrêter l’attitude à prendre, les mesures à adopter et l’action à engager en cas de guerre. Les rédacteurs de la Guerre Sociale, organe très répandu dans les milieux d’avant-garde : antimilitaristes, antipatriotes et révolutionnaires, proposaient de saboter la mobilisation. La Confédération Générale du Travail décidait que les syndicats ouvriers et, avec eux, tous les travailleurs, répondraient à l’ordre de mobilisation par la Grève générale insurrectionnelle et expropriatrice ; enfin, le Parti socialiste unifié se prononçait en faveur de l’Insurrection ayant pour but de renverser le Gouvernement et d’annuler l’ordre de mobilisation.
Les circonstances sont loin d’être les mêmes à l’heure présente. On comprend que le caractère que, dès le début, prendront les hostilités, si l’on ne parvient pas à barrer la route à la guerre, ne permet plus de songer à l’emploi d’une de ces décisions ; il apparaît à peu près certain que la nation qui sera ou croira être prête avant les autres et mieux que les autres, attaquera la première et que l’agression se produira, sans avis préalable, sans déclaration de guerre proprement dite, sous la forme d’une invasion brusquée, par les flottilles aériennes réduisant en cendres les grands centres, les parcs d’artillerie, les réserves de munitions, les usines de guerre, les agglomérations industrielles, en un mot les points stratégiques les plus vulnérables et les plus importants. Dans ces conditions : sabotage de la mobilisation, grève générale et insurrection ; toutes choses dont l’application, en 1914, soulevait d’immenses difficultés, mais, somme toute, n’était pas irréalisable, deviendraient impossibles, vu les conditions dans lesquelles éclaterait la guerre de demain.
En vérité les termes du problème à étudier et à résoudre ont changé : il ne s’agit plus de décider ce qu’il y aura lieu de faire en cas de guerre, pour entraver, paralyser celle-ci ; il n’est que trop évident que, dans ce cas, tout sera impuissant à faire reculer le fléau. Le problème à examiner, c’est donc celui de savoir par quels moyens les pacifistes de 1931–1932 parviendront à EMPÊCHER la guerre.
Eviter la guerre, la rendre impossible, tout est là.
Comment empêcher la guerre et instaurer un régime stable de Paix ?
Les moyens en vue sont nombreux ; ils sont parfois opposés. Rien que pour les passer successivement en revue et les discuter les uns après les autres, il faudrait écrire un volume. Cette encyclopédie ne comporte pas d’aussi longs développements. Je dois donc me borner à examiner brièvement les moyens que je tiens pour inopérants et insuffisants, afin d’accorder plus de place, dans cette étude, au moyen que j’estime être le seul qui conduit au résultat désirable et nécessaire : la Paix. Je procède donc par élimination.
-
Moyens inopérants. — Je range dans cette catégorie tous ceux qui portent le sceau gouvernemental. J’ai la conviction que les protocoles, les pactes, les traités, les conventions, les accords que peuvent conclure présentement les gouvernements ne seraient, selon l’expression consacrée et authentifiée par l’Histoire, que de vulgaires « chiffons de papier » le jour où, pressée par la nécessité, cédant au besoin de conquérir par la force certains avantages, dominée par ses visées d’ambition et décidée à assouvir ses convoitises territoriales ou financières, une grande Puissance verrait dans la Guerre, et rien que dans celle-ci, la possibilité de réaliser ses desseins. La Société des Nations a été constituée dans le but de préparer l’avènement de la Paix par l’établissement et la reconnaissance d’une sorte de Juridiction suprême ayant pour mandat d’arbitrer les différends internationaux, à la lumière et en application d’une législation adoptée par l’universalité des Puissances. D’immenses espoirs ont accueilli la naissance de ce super-organisme et de ferventes et nombreuses sympathies persistent à lui faire cortège. Quand une espérance a illuminé l’esprit ou le cœur des hommes, elle s’y installe si fortement qu’elle n’y meurt que petit à petit : c’est une des forces, et peut-être la plus tenace, de toute religion. C’est ainsi que s’explique l’obstination avec laquelle nombre d’individus restent attachés, cramponnés aux généreux espoirs de Paix que l’Assemblée internationale siégeant à Genève a fait descendre dans la conscience humaine. Et pourtant ! que de lenteurs dans l’organisation de cette assemblée ! que de timidité dans ses débats ! que d’incohérences dans ses attitudes, chaque fois que les circonstances lui imposaient le devoir de se prononcer fermement ! Sans être trop sévère, on peut prétendre que, toujours défaillante lorsque certains faits de guerre nécessitaient son intervention immédiate et énergique, la Société des Nations a ruiné le crédit moral dont elle jouissait à ses débuts et jeté le découragement dans l’esprit de ceux qui lui avaient accordé toute leur confiance et qui avaient placé leurs plus fermes espérances dans l’efficacité de son action. Ses hésitations, ses faiblesses et son impuissance à l’occasion du conflit sino-japonais, alors que les deux puissances en état de guerre faisaient officiellement partie de la Société des Nations ont, une fois de plus, administré aux amis de la Paix dont les regards étaient anxieusement fixés sur Elle, la preuve qu’il n’y a pas lieu de compter sur Elle pour réaliser le but que sa constitution même lui a assigné. A aucun moment, dans aucune circonstance, les anarchistes n’ont fait confiance à la Société des Nations. Tout d’abord, ils ont constaté et n’ont cessé de faire observer que cette Société n’est pas celle des Nations, mais bien celle des Gouvernements : ce ne sont pas les peuples qui élisent leurs délégués à Genève ; ce sont les Gouvernements qui les mandatent. Les représentants ainsi désignés ne sont pas les interprètes des aspirations, des besoins et des volontés des masses nationales, celles-ci n’étant consultées ni avant, ni après.
Les personnages appelés à représenter chaque nation sont choisis par leur Gouvernement respectif ; ils sont pourvus d’instructions précises ; ils détiennent un mandat impératif auquel ils sont tenus de se conformer et, porte-parole des Gouvernements qui les ont officiellement investis, ils ne peuvent être que les interprètes de la pensée, de la volonté et des intérêts de ceux-ci. En outre, ne siègent à Genève que des Ministres, des diplomates, des parlementaires, des techniciens et des spécialistes, hommes qui, du premier au dernier, appartiennent, par leur situation, et sont liés par leurs intérêts au régime étatique ou aux milieux économiques totalement acquis aux appétits politiques et financiers de la classe gouvernante et possédante. Ce n’est pas sur de tels éléments qu’il est raisonnable de compter pour travailler avec sincérité et ferveur à l’organisation de la Paix mondiale. Les hauts personnages dont la réunion fonde la Société des Nations prononcent parfois de magnifiques discours ; à les entendre, on serait portés à prendre à la lettre les pompeuses déclarations par lesquelles ils se campent en adversaires farouches de la guerre et en partisans irréductibles de la Paix. Ce ne sont, hélas ! que mensongères déclamations et il n’est pas injuste de qualifier celles-ci aussi sévèrement, puisque l’accroissement incessant des ressources englouties par le régime de Paix armée qui impose à chaque nation des charges écrasantes, inflige à ces déclarations un sanglant démenti et en fait éclater l’odieuse fourberie. Sous le fallacieux prétexte d’assurer sa propre sécurité, chaque Puissance fortifie son appareil de guerre, en application du vieil adage « Si vis pacem, para bellum » (si tu veux la paix, prépare la guerre). En contradiction avec l’amour de la Paix dont tous les Gouvernements se proclament animés, c’est une course effrénée, une formidable ruée vers des armements de plus en plus fantastiques. Chacun sait cependant que si, naguère, c’étaient les risques de guerre qui créaient les armées et les armements, de nos jours, c’est l’existence des armées et l’accumulation des armement qui créent les risques de guerre. Les véritables ennemis de la guerre, les partisans sincères de la Paix opposent au « Si vis pacem, para bellum », dont des millénaires de batailles de plus en plus meurtrières ont démontré l’absurdité, le « Si vis pacem, para pacem » (si tu veux la Paix, prépare la Paix), dont l’exactitude et la sagesse sautent aux yeux de quiconque n’est pas aveuglé par la routine et la tradition, lesquelles conservent aux formules les plus désuètes le caractère d’une indiscutable vérité.
-
Moyens insuffisants. — Un souffle puissant de pacifisme (voir ce mot), s’est élevé un peu partout. Cette poussée vers la Paix a suscité la formation d’un nombre élevé de groupements, ayant pour but la propagande et l’action à entreprendre contre la guerre et pour la Paix. Il est hors de doute que, si l’on parvenait à dresser la liste complète de ces organisations pacifistes, on arriverait à un nombre fort impressionnant de sociétés et à un total considérable de membres adhérents. Je suis loin d’envisager ce fait comme quantité négligeable et je me garderai bien de sous-estimer le concours très réel que ces lignes peuvent apporter à la cause de la Paix et la valeur morale qu’elles lui confèrent. Je souhaite très vivement que ces associations croissent et se multiplient. Il en est qui sont internationales et celles-ci méritent les plus sincères approbations et les encouragements les plus vifs. Toutefois, je pense et très franchement je déclare que ces groupements pacifistes ne constituent qu’un élément insuffisant de lutte contre la guerre, et cette insuffisance provient des quatre causes suivantes :
-
Si nombreuses que soient ces ligues et associations, elles ne le sont pas encore assez. C’est un mouvement qui commence ; il est loin d’avoir atteint la vigueur et le développement auxquels il est appelé à parvenir. Quand on suppute les forces de guerre qu’il faut abattre, forces réelles et latentes, forces connues et masquées, forces constamment prêtes à s’unir et à taire bloc, on ne peut se défendre de l’appréhension justifiée que provoque la comparaison entre ces forces qu’il faut vaincre et celles qui les combattent. Il faut donc que ces dernières grandissent en nombre et en puissance d’influence et d’action ;
-
Les organisations pacifistes ne sont pas fédérées ; il leur manque cette cohésion qui est indispensable à tout effort d’une grande envergure. Livrées à leurs seules ressources en hommes et en argent, ces associations s’avèrent impuissantes à lutter avantageusement contre les redoutables adversaires — voilà les véritables ennemis — qui ont à leur disposition une presse abondamment arrosée par les producteurs d’armements et de fournitures militaires, par les Pouvoirs publics et les Parlements prisonniers des Puissances d’argent. Seule, la Fédération nationale et la Confédération internationale de toutes les ligues pacifistes sont capables de contrebalancer la déplorable influence que les adversaires de la Paix exercent sur l’esprit public avec la complicité des Gouvernements qui appuient leur autorité sur la force armée, des Parlements qui entretiennent astucieusement le préjugé patriotique et des journaux les plus répandus qui sont à l’entière dévotion des grandes firmes capitalistes intéressées aux industries de guerre ;
-
Si désirable, si urgente et si nécessaire que soit la réunion de toutes les ligues pacifistes en une association fédérative, on est forcé de reconnaître qu’elle est présentement irréalisable : d’abord, parce que certains de ces groupements sont étroitement liés à des partis politiques ou à des formations religieuses dont ils ne sont que le prolongement ; en sorte que les rivalités qui opposent les uns aux autres ces Partis politiques et ces formations religieuses font obstacle à leur rassemblement ; ensuite, parce que une notable proportion de ces groupements ne sont que sentimentalement, vaguement et partiellement pacifistes. En principe, tous sont contre la guerre et tous sont pour la paix. Mais, tandis que les uns, ceux qu’on peut appeler les pacifistes intégraux sont contre toutes les guerres, toujours et quand même, les autres que j’appelle les demipacifistes, établissent des différences marquées, voire des oppositions entre les guerres dites « offensives » et les guerres dites « défensives », et ils érigent en devoir de se refuser aux premières mais de s’offrir aux secondes. Je n’hésite pas à soutenir que ces étranges pacifistes — qui, en principe s’affirment contre la guerre, mais qui, le cas échéant, sont résolus à y prendre part — sont, en fait, des bellicistes qui s’ignorent. Car, de nos jours, il n’est pas un Gouvernement qui, à l’aide des moyens qui sont entre ses mains, ne soit en mesure d’imposer à ses nationaux la conviction qu’ils sont attaqués, c’est-à-dire que la guerre est une guerre « défensive » et que, s’ils prennent les armes, c’est uniquement pour se défendre contre l’agresseur. Etant donné que, dans tous les pays il en est ainsi et que, au demeurant, il ne saurait en être autrement, les demi-pacifistes dont je parle se trouveront, bien que résolument opposés à la guerre, dans l’obligation de la faire chaque fois qu’elle éclatera, puisque on leur certifiera, chaque rois, qu’il s’agit d’une guerre défensive.
-
Enfin ce qui, actuellement, rend irréalisable la fédération des groupements pacifiques, c’est qu’ils ne sont pas en possession d’une boussole leur permettant de se diriger vers le même but par la même route. Cette boussole, c’est un programme limité et précis, un but immédiat et déterminé, une plateforme d’action s’imposant à tous par sa netteté et sa consistance. Je rencontre fréquemment des hommes qui se disent contre guerre et qui sincèrement sont attachés à la Paix. Quelques minutes me suffisent pour constater le peu de fond qu’il est prudent de faire sur l’efficacité de l’aide qu’on peut attendre de leur activité. Certes, ils professent une sainte horreur de la guerre et ils sont prêts à servir de tout cœur la cause de la Paix. Mais par quels moyens lutteront-ils contre la première et de quelle façon travailleront-ils à l’instauration de la seconde ? Ils n’en savent rien, ou presque. On ne dépense utilement son activité que lorsque, d’une part, on vise un but précis et lorsque, d’autre part, on recourt à un moyen également déterminé. Sinon, les efforts qu’on accomplit, pratiqués en ordre dispersé et sans cohésion positive, perdent en grande partie leur efficacité. Ce qui est vrai pour l’effort individuel l’est encore bien davantage pour le collectif. C’est pourquoi : programme précis, but déterminé, plateforme unique et solide, quand les organisations pacifistes seront en possession de ces trois éléments, leur rassemblement s’opèrera sans trop de difficulté, leur nombre et leur activité décupleront et le courant pacifiste gagnera promptement, en profondeur et en étendue, la vigueur qui lui fait défaut.
-
-
L’unique moyen. — Comme on le voit la solution pratique du problème qui consiste à en finir avec la guerre et à organiser la paix sur des fondements solides, nécessite un effort énergique et persévérant. D’une récente lettre de Romain Rolland, je détache ce passage : « il ne suffit pas de répéter Paix ! Paix ! On dirait des troupeaux qui bêlent, leurs bêlements n’attendrissent pas le boucher... La paix n’est pas un thème à variations vocales. Elle doit être réalisée. Et pour être réalisée, il faut qu’elle soit réalisable. Une paix basée sur le statu quo politique, économique et social de l’Europe et du monde présent est une cruelle illusion et un non-sens. L’état de choses instauré par les traités de victoire en 1919, et aggravé depuis par les aberrations des politiciens, est un état de violence et d’injustice permanent, qui ne peut matériellement se prolonger sans catastrophe : car, pour les deux tiers de l’Europe, il est une cause permanente de souffrances, une plaie béante qui s’envenime ; et l’infection gagnera nécessairement tout le reste du corps, toute l’Europe, le monde entier. »
C’est fort bien dit : il ne saurait être question de pais, véritable et définitive, dans la situation politique, économique et sociale de l’Europe et du monde actuel. Cela revient à affirmer que tant que sera maintenue la structure politique, économique et sociale du monde actuel, la Paix sera impossible, qu’elle ne sera réalisable et ne sera réalisée que dans un monde dont la structure politique, économique et sociale aura été totalement transformée. J’ai cette certitude et depuis bien longtemps, je l’expose et cherche à la faire partager. Lorsque, du 17 au 22 août 1926, se tint, à Bierville (France), le Congrès « sur la Paix par la Jeunesse » qui eut un certain retentissement (5.000 délégués représentant trente nations prirent part à ce Congrès) j’adressai à ces cinq mille délégués la lettre ouverte que voici :
Messieurs,
Vous vous proposez de jeter les bases de la Paix par la Jeunesse.
Travailler pour la Paix est une des œuvres les plus nobles et les plus urgentes qu’il soit possible d’imaginer et faire appel à la Jeunesse, c’est confier sagement à l’avenir le soin de réaliser cette œuvre magnifique.
Comme l’enfer, Messieurs, vous êtes pavés d’excellentes intentions et il ne peut venir à personne l’idée de vous refuser l’hommage que méritent ces intentions admirables.
Mais permettez à un homme qui possède quelque expérience et qui, depuis de nombreuses années, se penche, fervent et angoissé, sur le problème de la Paix, de vous faire connaître, loyalement et sans ambages, le résultai de ses longues cogitations.
Et d’abord, vous apprendrai-je quelque chose en vous disant que je n’ai jamais rencontré quelqu’un — homme ou femme — se déclarant, en principe, pour la guerre ? Je ne pense pas et je ne dis pas que personne ne veut, n’appelle, ne désire la guerre ; je dis simplement que personne n’ose, en temps de paix, s’affirmer ennemi de la paix et partisan de la guerre.
Il serait, au surplus, plus que jamais prodigieux qu’il en fut autrement : la guerre maudite de 1914–1918 a laissé dans toutes les mémoires des souvenirs si horribles que, d’instinct, tous forment des vœux en faveur de la paix.
« Haine de la guerre ; amour de la paix » ; si on fouillait dans les cœurs, ce sont deux sentiments qu’on trouverait à peu près dans tous.
Il serait donc banal et inutile de vous réunir en Congrès par centaines et par milliers, si vous deviez vous borner à vous affirmer partisans de la Paix, à pousser des acclamations, à chanter des hymnes, à organiser en faveur de la Paix de solennelles et grandioses cérémonies. Je ne vous fais pas l’injure, Messieurs, de penser que ce soit là tout votre programme.
Votre programme doit avoir, il a certainement pour but d’étudier et d’arrêter les moyens pratiques propres :
A empêcher la guerre ;
A fonder un régime de paix stable et, si possible, définitif.
C’est ainsi, Messieurs, que se pose le problème de la paix : tout le reste n’est que mise en scène, décor, solennité, faconde, attitude et pose sans sincérité, sans courage, sans signification précise, et sans influence sur le cours des événements d’où sortira demain ou la guerre ou la paix.
Il s’agit donc avant tout et même uniquement d’empêcher la guerre. Un seul moyen s’offre à toute personne sensée. Ce moyen consiste à rechercher loyalement la cause véritable, profonde, essentielle, fondamentale des guerres et, cette cause étant découverte, à travailler de toutes ses forces à sa suppression.
Il est évident que tant que ne sera pas abolie la cause, l’effet persistera.
Il sera possible, en certaines circonstances, de prévenir un conflit imminent et d’en ajourner le déclenchement ; mais cette victoire, purement occasionnelle, n’aura en aucune façon fortifié la cause de la Paix, celle-ci restant à la merci du lendemain.
Il est donc tout à fait indispensable, et avant toutes choses, de découvrir la cause véritable et essentielle d’où sort la guerre, afin de dénoncer publiquement, de combattre et d’abattre cette cause.
Eh bien ! Messieurs, cette cause est aujourd’hui connue, et, depuis plus d’un demi-siècle, les Anarchistes la dénoncent sans se lasser et sans qu’il ait été possible d’en nier sérieusement l’exactitude.
Cette cause, c’est le principe d’autorité : principe qui, d’une part, fait surgir les conflits et d’autre part, les résout et, au demeurant, ne peut les résoudre que par la force, la contrainte, la violence, la guerre, indispensables corollaires de l’Autorité.
Car c’est l’Autorité, dans sa forme économique présente : le Capitalisme, qui suscite les convoitises, exaspère les cupidités, déchaîne les compétitions et dresse en bataille les impérialismes effrénés et rivaux.
Et c’est l’Autorité, dans sa forme politique actuelle : l’Etat qui, ayant partie liée avec le Capital, manœuvre diplomatiquement et agit militairement sur le plan tracé par la finance internationale ; puis, l’heure venue, prépare, chauffe, entraîne les esprits, décrète la mobilisation, déclare la guerre, ouvre les hostilités, établit la censure, réprime l’insoumission, emprisonne ou fusille les hommes courageux qui, s’étant affichés contre la guerre en temps de paix (ce qui est fréquent et sans risque) persistent à se déclarer contre la guerre… en temps de guerre (ce qui est rare et périlleux).
Je vous le répète, Messieurs, la cause de toutes les guerres, à notre époque, c’est l’Autorité dont l’Etat est l’expression politique et le Capitalisme.
Aussi, de deux choses l’une : ou bien, franchement, loyalement, vaillamment, inlassablement, vous pousserez vos recherches jusqu’à la découverte de la cause que les Anarchistes vous signalent et, dans ce cas, vous ne vous séparerez pas sans avoir pris l’engagement d’honneur de dénoncer publiquement cette cause et de la combattre par tous les moyens en votre pouvoir, jusqu’à ce qu’elle ait été totalement et définitivement anéantie.
Ou bien, reculant devant l’immensité, les difficultés, les périls et les conséquences de la lutte implacable à entreprendre contre l’Autorité, vous vous arrêterez à mi-chemin, peut-être même dès les premiers pas ; et, dans ce cas, je vous le dis tout net, Messieurs, et sans la moindre hésitation, tellement j’ai la certitude de ce que j’avance : vous quitterez Bierville sans avoir rien fait et, par la suite, vous ne ferez rien qui sera de nature à empêcher la guerre de demain et à fonder la paix sur des assises de quelque solidité.
Au surplus, Messieurs, si vous êtes réellement et sincèrement des adversaires résolus de la guerre, et des partisans irréductibles de la Paix, si vous ne l’êtes pas seulement en paroles et du bout des lèvres mais en fait et du fond du cœur, vous ne vous séparerez pas sans que chacun de vous ait fait le serment que voici :
« Je jure, en toute conscience, de consacrer désormais au triomphe de la paix le plein de mes efforts et si, pourtant, la guerre vient à éclater, je prends l’engagement sacré de répondre à l’ordre de mobilisation par un refus formel ; je jure de ne prendre, ni au front ni à l’arrière, ni directement ni indirectement, une part quelconque aux hostilités ; et je m’engage à lutter, quels que soient les risques courus, contre la continuation de la tuerie et en faveur d’une paix immédiate. »
Messieurs,
Si, de votre congrès sortait la double décision dont je viens de parler : lutte contre l’Autorité (l’Etat, le Capital), source de toutes les guerres ; et serment unanime et sacré de se refuser catégoriquement à prendre une part quelconque aux hostilités ; Ah ! Messieurs, quel retentissement auraient, aux quatre points cardinaux, vos assises de Bierville ! Et, d’ores et déjà, quel coup mortel vous porteriez à la guerre infâme et quel pas immense vous feriez faire à la cause de la Paix !
— Sébastien FAURE.
De cette sorte de manifeste, écrit il y a plus de cinq ans, je n’ai pas une ligne à retrancher ; je n’ai pas davantage une ligne à ajouter. Je conserve la certitude que le seul moyen de tuer la guerre, c’est d’en chercher et découvrir la cause et de combattre cette cause jusqu’à sa suppression. C’est, au surplus, l’évidence même. Seulement, il est à craindre que cette suppression ne demande encore beaucoup de temps et il s’agit d’aviser sans aucun retard au moyen de faire échec à la guerre et de la rendre impossible, non pas dans 20, 30 ou 50 ans, mais dans le plus bref délai. Car, si jamais la Paix ne fut plus indispensable à l’humanité qu’elle ne l’est actuellement, jamais les causes de conflit armé ne furent aussi nombreuses et aussi graves que dans le temps présent. Il faut donc aller au plus pressé et recourir d’urgence au moyen de faire reculer la guerre qui, d’un jour à l’autre, peut fondre sur nous. Ce moyen existe-t-il ? – Oui. – Quel est-il ? – Le désarmement. Est-il possible de le mettre en application dans un laps de temps relativement court ? – Je le pense.
Le désarmement.
Le désarmement est, d’ores et déjà, dans l’esprit de tous les amis sincères de la Paix. Toute personne ayant, sérieusement et sans a priori, étudié la question que j’examine ici, a été amenée à considérer le Désarmement comme la condition sine qua non de la Paix, comme la préface nécessaire, l’introduction indispensable à l’édification d’un régime de Paix durable. Une humanité qui reste l’arme au pied, qui fabrique sans interruption ni mesure, des moyens de destruction qu’elle s’ingénie à multiplier et à rendre plus meurtriers, qui engloutit, de propos délibéré, dans cette industrie de mort et de dévastation des ressources énormes, une humanité qui arrache au travail et à la vie libre des millions de jeunes gens qu’elle oblige à l’apprentissage du métier militaire, n’est pas et ne peut pas être une humanité qui s’achemine vers la Paix. Tant qu’il y aura une caserne, tant que dans cette caserne, il y aura un soldat, tant que, entre les mains de ce soldat – professionnel de la guerre – il y aura une arme de guerre quelconque, cela signifiera que l’humanité n’aura pas encore renoncé au règlement, pas la voie des armes, des conflits qui l’agitent ; cela signifiera, tout au contraire, qu’elle se dispose, comme par le passé, à confier au sort des armes le règlement des dits conflits et la menace horrible de la guerre continuera à assombrir l’horizon. Il ne sera sensé de penser que les hommes sont résolus à faire de la Paix Espérance une féconde Réalité, que lorsqu’ils auront brisé les instruments de massacre que nécessite la Guerre. Je répète que l’immense majorité des pacifistes est acquise à cette idée du désarmement, prélude indispensable de la Paix. Tous les partis politiques de gauche, même ceux dont le pacifisme est le moins catégorique, se rallient à la thèse du désarmement. Tous conviennent que M. Herriot a raison d’affirmer que « le surarmement ne peut aboutir qu’à la guerre » et M. Paul Boncour de déclarer que « la course aux armements c’est la guerre ». Traduite en langage clair et simple, cette double déclaration veut dire que « plus on arme, plus on marche vers la guerre et s’éloigne de la paix » et que « moins on arme, plus on se rapproche de la paix et s’éloigne de la guerre » ; et il est logique d’en conclure que lorsqu’on cessera la politique d’armement, on entrera de plein pied dans la politique de la paix, pas avant.
C’est un avantage immense que cet accord total sur le problème de l’armement et du désarmement ; car, pour le triomphe de la Paix, il est d’un prix inestimable que, sur ce point de capitale importance, tous les pacifistes se mettent d’accord. Et, pourtant, cet accord n’est pas suffisant ; il est nécessaire que l’entente s’établisse en outre sur les conditions mêmes de réalisation du désarmement. Et c’est ici que l’accord cesse et fait place à de graves divergences.
Deux thèses s’affrontent : l’une consiste à établir tout d’abord un régime de paix armée qui garantisse à chaque nation sa propre sécurité ; ce point acquis, on instaurerait un tribunal d’arbitrage qui, en cas de conflit, rendrait une sentence devant laquelle seraient tenus de s’incliner les parties en cause ; ce double régime de sécurité et d’arbitrage devant, au dire de ses partisans, avoir pour résultat de réduire au minimum les différends et de régler pacifiquement ceux qui se produiraient, l’éventualité de la guerre deviendrait peu à peu de plus en plus rare et le désarmement s’opérerait pour ainsi dire automatiquement, les armées et les armements devenant à la longue sans utilité.
L’autre thèse consiste à atteindre le même but : le désarmement, mais en faisant précéder la sécurité de l’arbitrage et, par conséquent, découler celle-là de celui-ci.
Sécurité, arbitrage, désarmement, tel est l’ordre chronologique déterminé par la première thèse. Arbitrage, sécurité désarmement, tel est l’ordre propose par la seconde. Mais on remarquera que, quel que soit l’ordre adopté, c’est au Désarmement que conduisent en fin de compte les deux formules. Sur ce point, pas de divergence ; ce qui démontre, sans qu’il y ait place pour le moindre doute, que le désarmement est considéré par les uns et par les autres comme la condition indispensable de la Paix. Les Hommes d’Etat, les diplomates et les techniciens selon les Gouvernements dont ils font partie donnent leur adhésion à l’une ou à l’autre de ces deux thèses. On peut en inférer qu’ils ne sont pas pressés d’aboutir. Car, soit qu’ils sachent d’avance que longues, très longues seront les négociations concernant la sécurité et l’arbitrage avant qu’elles aboutissent, soit qu’ils usent perfidement de tous les moyens dilatoires par lesquels il leur est aise de traîner en longueur ces préliminaires et pourparlers, ils n’ignorent pas que des années et des années s’écouleront avant l’adoption et la mise en service du mécanisme délicat et compliqué qu’exigent la sécurité et l’arbitrage. Il est infiniment plus simple de se demander s’il ne serait pas plus pratique et plus rationnel d’attendre du Désarmement la sécurité et l’arbitrage que d’attendre de l’arbitrage et de la sécurité le désarmement. C’est l’idée qui s’est présentée à l’esprit de ceux qui, impatients d’aboutir et comprenant la nécessité d’agir vite, voient avec terreur les années se succéder sans que, par la voie de la sécurité et de l’arbitrage, progresse effectivement la volonté de désarmement. A la réflexion, étude faite des ententes mondiales que comportent la sécurité et l’arbitrage, cette idée a tendance à prévaloir dans l’esprit public. Adoptée depuis quelque temps déjà par quelques-uns de ceux qui estiment qu’il importe avant tout d’éviter les horreurs d’une prochaine guerre, cette opinion gagne de jour en jour du terrain et je pense qu’elle est appelée à faire des progrès très sensibles. La rapidité avec laquelle elle se propage porte en elle les plus précieux encouragements et le gage de son prochain succès. Beaucoup de pacifistes, des plus ardents et des plus actifs, envisagent aujourd’hui le désarmement, non plus comme une chose vague et lointaine dont il faudra parler longtemps, bien longtemps avant d’en saluer la réalisation, mais comme un événement qui peut, qui doit se produire sans trop tarder, à la condition qu’une propagande sérieuse et continue soit faite en sa faveur.
« Désarmement, d’abord. Sécurité et arbitrage par le Désarmement », sont des mots d’ordre que font leurs, dès à présent, nombre de ligues pacifistes, de groupements ouvriers et d’organisations d’avant-garde. Dans ces milieux, on commence à comprendre que la sécurité et l’arbitrage ne peuvent être obtenus que par le désarmement. On se rend enfin compte que chercher à s’orienter vers le désarmement par la sécurité et l’arbitrage, ce n’est pas seulement prendre le chemin le plus long, mais encore faire fausse route. Les dirigeants et toute la caste que les industries de guerre enrichissent se raccrochent obstinément à la thèse de la sécurité et des garanties sur lesquelles ils la font reposer. Ils prétendent, et on comprend pourquoi, que la sécurité résulte de l’étalage de la force et de la crainte qu’un peuple puissamment armé inspire aux autres peuples ; ils disent que, quels que soient les pactes et accords destinés à maintenir la Paix internationale, la sécurité de chaque pays nécessite une force militaire de nature à décourager tout agresseur. On aperçoit tout de suite les conséquences d’une telle conception du problème de la sécurité. Au nom de la sécurité, qu’elle dit lui être indispensable, chaque Puissance sera conduite à s’armer de plus en plus. Il suffira qu’une nation augmente, transforme ou perfectionne son outillage de guerre, pour que les autres nations s’autorisent et même se proclament astreintes, malgré elles, à augmenter, transformer ou perfectionner le leur. Et ce sera, plus que jamais, la course aux armements, c’est-à-dire la guerre certaine sous le prétexte de l’éviter.
C’est cette préoccupation stupide de la sécurité qui dominera, j’en ai la certitude, l’assemblée qui va se réunir à Genève, en février 1932, sous le beau nom — beau, mais mensonger — de Conférence du désarmement. Je n’entends pas soutenir qu’on n’y parlera pas du désarmement ; on en parlera copieusement et le mot de désarmement est celui qui sera prononcé le plus fréquemment. Il y sera répété avec d’ autant plus d’insistance qu’on s’éloignera davantage du fait qu’il exprime. J’ai la certitude que l’orateur, quel qu’il soit, qui, au nom de son pays, saisirait sérieusement les délégués réunis à cette conférence, d’une proposition ferme de désarmement véritable et immédiat, serait accueilli par des huées ou des protestations indignées. De deux choses l’une : ou bien on ne prendrait pas au sérieux cette proposition et on refuserait de la discuter ; ou bien la prenant au sérieux, on se hâterait de lui faire un enterrement de première classe, sous un amoncellement de fleurs et couronnes. Cela n’est pas douteux.
La seule chose dont s’occupera cette conférence, dite improprement du désarmement, c’est de la limitation des armements. Il me paraît probable que les grandes Puissances, celles qui possèdent les armements les plus considérables et les plus modernes, après avoir affirmé que cet outillage de guerre (effectifs militaires, munitions, machines à tuer, gaz, etc.) est absolument indispensable à leur propre sécurité, se refuseront à en retrancher quoi que ce soit et que les Puissances en retard sur l’équipement militaire des précédentes formuleront et défendront avec acharnement des motions leur accordant la faculté de la mise au point qu’elles déclareront, elles aussi, absolument nécessaires à leur propre sécurité. Sans compter que tous les gouvernements, les forts comme les faibles, ne consentant pas à renoncer aux budgets votés et aux dépenses engagées en vue d’une guerre prochaine, obtiendront l’autorisation de continuer jusqu’à l’épuisement complet des budgets votés la réalisation totale des travaux prévus ou en cours d’exécution. Résultat : il faudra nous estimer très heureux si, en application des décisions prises — peut-être n’auront-elles que la valeur de simples indications — les armements restent ce qu’ils sont et ne s’en trouvent pas accrus au total. Ces brèves explications touchant le problème de la sécurité démontrent clairement que le souci de ce que les Etats appellent la sécurité de leur pays, bien loin de nous rapprocher graduellement de la Paix, nous en éloigne indéfiniment.
Quant à l’arbitrage et aux conditions dans lesquelles il est question d’en assurer pratiquement le fonctionnement et l’autorité effective, il est raisonnable de penser qu’il sera incontestablement faussé par la disproportion née de la différence d’armement entre Puissances illégales et que l’arbitrage ne remplira sa mission que dans deux cas : le premier, lorsque les Nations en conflit ne seront, ni l’une ni l’autre, décidées à faire la guerre et seront, par conséquent, disposées, l’une et l’autre, à régler à l’amiable leur litige ; le second, lorsque le différend mettant aux prises deux pays : l’un fortement et l’autre faiblement armé, l’écrasement de celui-ci par celui-là sera chose tellement certaine, que le plus faible se verra dans la nécessité de subir la sentence rendue, celle-ci fût-elle en opposition manifeste avec son droit et ses intérêts et que le plus fort se refusera à tout arbitrage, quelle que soit la netteté des engagements précis qu’il aura contractés antérieurement et en temps de paix. Ecoutez l’opinion que suggère au chef reconnu du Parti socialiste (S.F.I.O.) de France, le conflit actuel entre la Chine et le Japon :
« Pourquoi le Japon se dérobe-t-il à l’intervention de la Société des Nations, à la décision éventuelle des arbitres ? Parce qu il est armé, parce qu’il se sent le plus fort, parce que la force crée la tentation d’user de la force. Nous sommes donc fondés à affirmer que le Désarmement est la vraie garantie, la vraie caution, la vraie sanction des procédures arbitrales. Le cas japonais illustre avec éclat notre formule : sécurité par l’arbitrage et le désarmement. » (Léon Blum, journal Le Populaire, du 16 novembre 1931.)
Je me rallie à cette formule après y avoir glissé cette légère, mais nécessaire modification : sécurité et arbitrage par le Désarmement. Cette modeste retouche donne à ma pensée la précision. que je désire : avant tout, désarmement ; ensuite sécurité reposant sur le désarmement ; enfin arbitrage, quand le désarmement et la sécurité seront, comme le dit Blum, la vraie garantie, la vraie caution, la vraie sanction.
Nous voilà donc parvenus à la certitude que, en attendant la transformation sociale qui frappera de mort la cause permanente, essentielle, fondamentale de la guerre : le principe d’Autorité d’où procèdent toutes les institutions sociales actuelles, nous ne disposons que d’un seul moyen d’empêcher la guerre qui vient et que ce moyen unique, c’est le Désarmement.
Seulement, il y a désarmement et désarmement et, ici encore, nous nous trouvons en présence de deux courants très distincts, voire opposés. Il nous reste à les examiner successivement, afin de décider lequel est à écarter et lequel est à adopter.
Le désarmement général, simultané, contrôlé.
Il faut entendre par le désarmement général, le désarmement qui serait accompli par l’universalité des Nations, sans que, parmi celles qui comptent du point de vue de l’équipement et de la préparation militaire, il en soit excepté une seule. Il faut bien se mettre dans la tête que pour que le désarmement soit général, il n’est pas suffisant qu’il soit le fait de la majorité des peuples, mais qu’il soit celui de la totalité des pays qui pratiquent, actuellement, le régime de la Paix armée. Le désarmement simultané, c’est celui qui se ferait le même jour, au même moment et dans les mêmes conditions, sur un mot d’ordre convenu et en application d’un accord intervenu entre les représentants officiellement accrédités de tous les gouvernements.
Enfin, pour qu’il soit considéré comme sincère, loyal, effectif, il faut que ce désarmement général et simultané soit, au moment où il s’opère et par la suite, soumis constamment et pour une période d’assez longue durée à la surveillance d’un Comité de Contrôle, dont les membres dûment mandatés, auront pour fonction de s’associer à des intervalles rapprochés, mais sans date fixe et connue d’avance, que les conditions du désarmement sont strictement respectées et, le cas échéant, d’en signaler les violations.
À la lueur de ces précisions, apparaissent immédiatement les multiples et graves difficultés, lenteurs et résistances faisant obstacle à la réalisation d’un accord unanime dont les stipulations les plus minutieuses devront être arrêtées et consenties par tous les Etats. Il convient d’ajouter que, rien que pour entamer utilement et avec de réelles chances de succès les négociations indispensables à la conclusion d’un tel accord, il sied de supposer que l’atmosphère de défiance que les Gouvernements capitalistes et autoritaires ont intérêt à entretenir dans le but de diviser les peuples, afin de mieux régner, aura été, au préalable, dissipée et remplacée par une atmosphère de rapprochement et de confiance. Je ne pense pas qu’il soit utile que j’entre dans le détail et j’aime à croire que ceux qui se disent des pacifistes et sèment de tels obstacles sur la route du désarmement sont de faux amis de la Paix. On reconnaîtra que, s’ils étaient des adversaires avérés du désarmement et, par conséquent, de la Paix, ils ne prendraient pas une autre attitude, ils n’exigeraient pas l’adoption préalable de conditions plus difficiles à réunir. Pour s’en convaincre, il n’est que d’observer la conduite des Gouvernements et des castes qui font à l’idée de Paix l’accueil le moins empressé. Ces castes et ces gouvernements se gardent bien de se déclarer franchement hostiles au courant qui emporte les hommes d’aujourd’hui, loin des champs de carnage. Sur le plateau, ils se résignent à vilipender la guerre et à exalter la Paix ; mais, sournoisement, tortueusement, dans les coulisses, ils s’ingénient à gagner du temps en prolongeant le plus longtemps possible le statu quo dans l’espoir inavoué que le désarmement, que les pacifistes intégraux assignent comme but à leurs efforts immédiats, se fera attendre si longtemps encore, que la guerre s’abattra sur le monde avant que les partisans déterminés et sincères de la Paix aient pu réaliser leur volonté de désarmement. Je mets ceux qui lisent ces lignes au défi de découvrir un gouvernant, un seul, un diplomate, un seul, un militaire, un seul qui ait l’impudence de confesser qu’il désire, qu’il appelle, qu’il veut la guerre. « Nous voulons la Paix ; nous sommes résolus à tout faire — tout dans la limite de la dignité et des intérêts sacrés du pays auquel nous appartenons — pour éviter la guerre. Nous envisageons sympathiquement l’idée du désarmement ; mais nous nous opposerons avec la dernière énergie à la mise en pratique de cette idée, aussi longtemps que la Sécurité de notre pays restera incertaine et que les sentences arbitrales ne disposeront pas des sanctions ayant la force d’en imposer le respect ! » Tel est le langage dont ces Messieurs ne se départissent en aucune circonstance. Et à l’appui de ces déclarations qui puent à plein nez l’hypocrisie, ces tartufes continuent à garder des millions d’hommes sous les drapeaux et à jeter des milliards dans le gouffre des armements. Cette ignoble bouffonnerie ne peut être que le prologue de l’immonde tragédie que nous préparent, avec la complicité des Gouvernements à la merci de la Phynance, les aigrefins de la haute Banque et les flibustiers de la grande Industrie.
Notre génération vit une heure exceptionnellement grave : les excitations chauvines, les fanfaronnades patriotardes, les traités à réviser, la surpopulation, la course aux armements, les impérialismes déchaînés, les rivalités et convoitises qu’exaspère le besoin de conquérir le marché mondial, peuvent, d’un jour à l’autre, allumer l’incendie. La crise de chômage, crise d’une intensité exceptionnelle et d’une étendue sans précédent peut pousser les Maîtres de l’heure qui ont entre les mains les destinées humaines, vers une guerre de laquelle ils attendraient et la liquidation des stocks incalculables que le système de la rationalisation a accumulés aux quatre coins du globe et la liquidation du matériel humain qui surabonde (il est plus facile, plus expéditif et moins dispendieux, de faire tuer vingt-cinq millions de sans-travail, que de les nourrir). Folie, dira-t-on ? Sans doute ; mais cette démence criminelle ne l’emporte pas sur celle dont l’odieux, le révoltant spectacle est sous nos yeux et qui consiste à précipiter dans la mer, à détruire par le feu, à jeter dans les égouts et à laisser systématiquement pourrir des produits périssables dont on préfère priver les populations affamées plutôt que de diminuer ses profits. Pense-t-on que les bénéficiaires d’un régime social qui fatalise de telles monstruosités reculeraient devant cette autre monstruosité : la Guerre, si, pris d’affolement, saisis de panique, effrayés eux-mêmes par le cercle de feu dans lequel leur cupidité, leur imprévoyance et leur imbécillité les ont enfermés, ils n’entrevoyaient, à tort ou à raison, que ce moyen d’en sortir ? Je ne dis pas : « la guerre est à nos portes » ; mais, avec tous ceux qui ont les yeux ouverts sur les événements, en suivent le cours impétueux et gardent la maîtrise d’euxmêmes au milieu de l’aveuglement général, je donne l’alarme, je sonne le tocsin. Je dis et je redis que le temps presse, qu’il ne faut plus attendre davantage, que demain il sera peut-être trop tard, qu’il est d’extrême urgence d’agir et d’agir vigoureusement. Je m’adresse à tous les pacifistes et je leur dis : « Voulezvous, coûte que coûte, empêcher la guerre ? » Ils me répondent : « Oui ! » S’ils me demandent : « Le pouvons-nous ? » Je leur réponds : « Oui ! » De quelle façon ? Par quels moyens ? En un mot, que faire ? C’est ce qu’il me reste à exposer.
* * *
Avant d’aller plus loin, jetons un coup d’œil sur la route que nous venons de parcourir : le voyage se poursuivra et s’achèvera avec moins de fatigue.
Par des statistiques empruntées aux meilleures sources, j’ai rappelé les épouvantables conséquences de toute nature dues à l’état de guerre dans lequel les hommes ont vécu depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. J’ai attiré l’attention sur celles infiniment plus désastreuses qu’entraînerait la guerre de demain. Et, par cette succession de tableaux et de chiffres, j’espère avoir inspiré le dégoût et la haine de ce crime des crimes : la Guerre et avoir provoqué le désir fervent, l’amour passionné de la Paix.
Cela fait, j’ai démontré que la tâche qui réclame le plus impérieusement l’effort immédiat et vigoureux des pacifistes de l’heure actuelle consiste à empêcher la Guerre qui, sous la pression des circonstances que peuvent cyniquement exploiter les Puissances d’argent, peut s’abattre prochainement sur les Peuples. J’ai établi que l’unique moyen de barrer la route au fléau qui menace, c’est, par le Désarmement, la cessation aussi prompte que possible du régime de Paix armée, qui entretient entre les Peuples une atmosphère de méfiance et d’hostilité, en même temps qu’il met à la disposition des Gouvernements un appareil de force dont ils sont tentés de se servir. J’ai prouvé que le Désarmement général, simultané et contrôlé dont on parle dans les sphères officielles et dans les milieux parlementaires, exigerait un temps si long que le péril de guerre imminente qu’il faut à tout prix conjurer se transformerait presque immanquablement en réalité. Pour compléter cette étude, je n’ai plus qu’à exposer et justifier le moyen que je propose aux pacifistes de ce temps qui sont décidés à tout faire pour empêcher les fauteurs de guerre de mettre à exécution leurs sinistres desseins.
Le désarmement unilatéral et sans condition de réciprocité.
Le moyen d’empêcher les Gouvernements acculés à une impasse de tenter d’en sortir par la Guerre, c’est le Désarmement unilatéral, sans condition de réciprocité ; il n’y en a pas d’autre. Chaque Etat se déclare, en principe, prêt à désarmer... mais à la condition que tous les autres Etats en fassent autant et au même moment. La belle affaire ! Je ne sache pas qu’il y en ait un seul qui oserait dire aux autres : « Désarmez si bon vous semble ; mais ne comptez pas que je suivrai votre exemple. Quoi que vous décidiez et fassiez, moi, je reste armé ! » Au surplus, il serait impossible à un Gouvernement — quel qu’il soit et quel qu’en soit le chef : président, roi, empereur ou dictateur, de tenir un tel langage et de conformer sa conduite à une telle déclaration : ce Gouvernement ameuterait contre lui tout son peuple et susciterait la coalition, contre lui, de tous les autres. Toutefois, si tous les Etats sans exception, affirment à la face du Monde et solennellement qu’ils sont prêts à désarmer, aucun ne manifeste l’intention de joindre l’acte à la parole. Aucun ne prend sur lui de donner l’exemple ; en sorte que, dans ces conditions, un laps de temps fort long peut s’écouler avant que cette volonté de désarmement s’affirme autrement qu’en discours ; les Nations peuvent ainsi s’attendre les unes les autres pendant des dizaines d’années ; et pourtant le temps presse. L’idée s’impose, on le voit, que, en cette matière comme en toute autre, il est absolument nécessaire qu’une nation commence, qu’elle prenne l’initiative de désarmer, sans exiger des autres qu’elles fassent de même, sans attendre que les autres soient décidées et prêtes à le faire, fût-elle, cette nation, toute seule à désarmer, à assumer les responsabilités et à courir les risques que peut comporter une mesure aussi grave. Je pense que le plus élémentaire bon sens se range à cet avis et que ceux qui, sincèrement, loyalement et virilement, travaillent à prévenir le retour de l’épouvantable catastrophe estimeront avec moi que le désarmement que je propose est une nécessité.
J’insiste : s’il est acquis, en premier lieu, que le désarmement est absolument indispensable à l’établissement de la Paix — et je crois avoir surabondamment démontré cette nécessité que, au surplus, tous ceux qui ont étudié la question admettent ; — s’il est acquis, en second lieu, que le désarmement général, simultané et contrôlé ne peut se produire que dans un avenir indéterminé et, à coup sûr, encore fort éloigné — et je pense que cette affirmation ne soulève aucune contestation — la preuve est faite que, pour opposer à la guerre qui vient une digue infranchissable, il n’y a pas d’autre moyen que le désarmement hic et nunc dont une nation donnerait aux autres l’admirable exemple. Est-il besoin d’ajouter que, plus puissante sera la nation entrant résolument et volontairement dans la voie d’un désarmement immédiat, effectif et total, plus considérables seront le retentissement et la portée de cet événement et, conséquemment, la force d’attraction que cet exemple exercera sur les autres peuples ? Le désarmement qu’effectuerait une petite nation (petite par l’étendue de son territoire, par le nombre de ses composants et par la faiblesse relative de son appareil de guerre) aurait incontestablement la même valeur morale que celle du désarmement accompli par une nation plus puissante. Peut-être même pourrait-on soutenir que ce geste emprunterait à cet ensemble de circonstances une beauté particulière, une grandeur exceptionnelle. Mais il est évident qu’il ne retentirait pas dans le monde à l’égal du coup de tonnerre que serait le même geste accompli par une Puissance de premier ordre. Pour avoir toute la signification, pour produire tous les effets qu’on en peut espérer, il faut donc que ce désarmement initial soit le fait d’une grande et forte Puissance. Alors seulement, le phare ainsi allumé projettera sur les régions ténébreuses où s’agitent les brigands qui complotent coutre la paix du Monde et préparent cyniquement les atrocités désastreuses de la guerre de demain, une clarté si éblouissante et dont le rayonnement s’étendra si loin, que l’événement deviendra, d’un seul coup, le plus considérable de l’Histoire humaine.
J’imagine une nation en possession de son plein développement, auréolée d’un prestige indiscuté, disposant, sur terre, sur mer et dans les airs, d’une organisation militaire formidable. Je suppose que, cédant à la poussée devenue irrésistible de son peuple, le Gouvernement de cette nation prenne enfin conscience de la folie criminelle des armements et que, de gré ou de force, il se décide à désarmer. J’imagine que, avant d’en arriver là, il a fait tout ce qu’il était en son pouvoir de faire pour entraîner les autres Gouvernement dans la voie du désarmement. Mais il a constaté que ceux-ci s’attardent, hésitent et résistent. Et voici — pure hypothèse toujours — que, sans attendre une résolution de désarmement général qui ne vient pas, il rend sur lui de désarmer, seul et avant tous les autres. Il ne s’agit pas d’un désarmement camouflé, truqué ou partiel, mais d’un désarmement effectif, loyal et complet. Il brise les cadres de ses armées ; il licencie la totalité de ses soldats ; il dépeuple ses casernes, ses bastions et ses forts ; il vide ses manufactures d’armes, ses arsenaux maritimes et ses champs d’aviation militaire ; il vide aussi ses parcs d’artillerie, ses dépôts de munitions et ses poudrières ; il liquide tous ses stocks, approvisionnements et réserves de guerre ; il cesse toute production destinée à la guerre et transforme matières premières, machines et installations de toutes sortes en outillage et produits d’utilité sociale ; il reporte sur les œuvres d’hygiène et de vie, de culture intellectuelle et de solidarité les milliards qu’engloutissaient, hier encore, l’entretien des armées, l’équipement et les préparatifs de guerre ; il rompt tous les marchés et contrats passés avec les industriels de la mort ; il annule toutes les commandes faites à ces industriels ; bref, il ne se borne pas à déclarer qu’il désarme ; il fait de cette déclaration une réalité dont il administre la preuve jusqu’à l’évidence.
Puis, par tous les moyens que le dernier mot de la Science met à sa disposition, il lance dans le monde entier une proclamation ayant pour but de faire connaître à tous les peuples la décision qu’il a prise et le désarmement qu’il a effectué.
On peut aisément prévoie l’incroyable émotion qui s’emparerait des autres peuples à l’annonce d’un tel désarmement et à la lecture d’une telle déclaration.
Mais n’anticipons pas. Je reviens à ma démonstration, au point précis où je l’ai laissée : donc il faut qu’une grande Puissance désarme la première. Je serre de plus en plus mon argumentation et je pose cette question : « Quelle peut et quelle doit être cette Puissance ? » Ma réponse est nette ; je n’hésite pas : le choix à faire se limite à la France et à l’Allemagne et j’appuie cette indication sur l’opinion que professent unanimement ceux que tourmente le problème de la Guerre et de la Paix et qui ont sérieusement étudié ce problème. Tous reconnaissent que la paix européenne et, par extension, celle du monde est subordonnée au rapprochement franco-allemand. Ils estiment judicieusement que tant que s’élèvera entre l’Allemagne et la France la barrière de méfiance, d’hostilité, de rivalité et de revanche qui les sépare, la Paix sera en péril. Ils pensent, au contraire, que lorsque ces deux nations concluront sur la base de leurs intérêts réciproques (et ceux-ci existent) l’entente désirable, l’Europe et, par extension, le monde entier aura fait un pas décisif vers la Paix. Je partage cette opinion. Il n’est pas question d’un traité d’alliance franco-allemand (nous savons, par expérience, que ces sortes de traités qui lient deux ou plusieurs Etats sont des machines de guerre dirigées contre les autres Etats) ; il s’agit d’un accord qui amènera le rapprochement du peuple allemand et du peuple français et consacrera le caractère de sympathie mutuelle et de confiance réciproque des relations de toute nature qui peuvent et doivent exister entre les Français et les Allemands. Je ne pousse pas l’optimisme jusqu’à affirmer que le jour où ces relations existeront, la Paix sera assurée ; mais je crois et je dis que, ce jour-là, s’ouvrira une ère d’apaisement qui favorisera tous les autres rapprochements, toutes les autres réconciliations désirables et possibles ! je crois et je dis que, dans leur ensemble, ces multiples rapprochements dissiperont rapidement l’atmosphère de bataille qui, présentement, enveloppe l’humanité, qu’ils achemineront promptement les peuples, dressés aujourd’hui à se méfier les uns des autres, à se mésestimer et à se haïr, vers des rapports d’estime et de sympathie agissantes, prélude de la réconciliation et précurseurs de la Paix.
Puisque l’établissement de la Paix est subordonné au rapprochement franco-allemand, c’est de la France ou de l’Allemagne que doit partir le signal du désarmement ; c’est à l’une de ces Puissances de première grandeur que doit échoir l’honneur d’ouvrir la marche vers la Paix par le Désarmement.
De ces deux nations, quelle est celle qui doit précéder l’autre dans la voie du désarmement ? Je réponds hardiment et sans la moindre hésitation : la France. Mes raisons sont nombreuses ; voici les principales :
-
Tout d’abord, il faut tenir compte que de la guerre de 1914–1918 qui a mis l’Europe à feu et à sang, la France est sortie victorieuse et l’Allemagne vaincue. Vainement fera-t-on observer que, durant plus de quatre années, l’armée allemande, presque seule, a tenu tête, et victorieusement, et sur un front d’une immense étendue, à la coalition des armées de France, d’Angleterre, d’Italie, de Belgique, des Etats-Unis d’Amérique, etc. et que, sans cette coalition écrasante en combattants, en matériel de guerre, en ravitaillements de toute nature et en ressources de toutes sortes, la France eût été dans la cruelle nécessité de se rendre. Le fabuliste a dit :
En toutes choses il faut considérer la fin.
Cette maxime s’applique aux choses de la Guerre : le résultat seul compte. Or, la fin de cette horrible guerre, c’est le traité de Versailles, et ce traité proclame la défaite de l’Allemagne et son écrasement. Quelles que soient les conditions dans lesquelles a été conclu le traité de Versailles, celui-ci atteste — c’est le fait brutal — la défaite de l’Allemagne. Cette défaite, c’est son abaissement dans le Monde et, par un jeu de bascule facile à concevoir, l’élévation correspondante de la France victorieuse. Aux yeux de tous les Peuples et devant l’Histoire (ou, plus exactement ce qu’on appelle l’Histoire) la défaite est une marque d’infériorité et une humiliation pour la nation vaincue et la victoire est un honneur, une gloire et une marque de supériorité pour la Puissance victorieuse.
-
Les traités en vigueur ont limité à cent mille hommes les effectifs militaires de l’Allemagne ; ils ont réduit à un minimum proportionné à ces effectifs les armements de cette nation. L’Allemagne, dans ces conditions, apparaît désarmée déjà par rapport à la France et aux autres pays qui ont eu et ont encore toute licence de porter au maximum leur appareil de guerre. Etant donné cela, le désarmement officiel et total de l’Allemagne ressemblerait fort à la reconnaissance d’un état de choses existant déjà et pourrait être perfidement interprété soit comme une manifestation d’impuissance ou de découragement, soit comme une manœuvre tendant à amener les autres nations à désarmer également. Par contre, la France, avec ses six cent mille hommes sous les drapeaux, ses formidables armements et ses quatorze milliards de dépenses annuellement inscrits à son budget de guerre, en désarmant volontairement — car rien ne l’y obligerait — ne pourrait être accusée ni de faiblesse, ni de découragement, mais, tout au contraire, apporterait à tous les peuples la certitude et la preuve qu’elle renonce, à tout jamais, à l’emploi de la force, bien que, en ce qui concerne les moyens de défense et d’attaque que comporte le souci de sa propre sécurité, elle soit en mesure de rivaliser avec n’importe quel antre pays.
-
Depuis plusieurs années, le Gouvernement de la France, par la voix autorisée de son ministre des Affaires étrangères et de ses agents diplomatiques, n’a cessé de proclamer officiellement son inébranlable attachement à la Paix. Elle se flatte officiellement d’avoir fait, en toutes occasions, les concessions et de s’être imposé tous les sacrifices par lesquels il lui était possible de prouver la volonté pacifiste qui l’anime. Désarmer avant les autres nations, ce serait établir de la façon la plus éclatante, entre ses déclarations et ses actes, l’harmonie qu’exige la plus élémentaire sincérité.
-
À ces considérations d’ordre général vient s’ajouter celle-ci qui est d’ordre particulier : puisque le hasard a voulu que je sois Français de naissance, il est naturel que je travaille à répandre dans mon pays l’idée de désarmement volontaire et immédiat que je préconise et que je lui demande d’être le premier à effectuer le désarmement que j’estime être indispensable à l’instauration du régime de Paix dont je désire si profondément le prochain avènement. Il serait étrange que, vivant en France, propageant en France, par l’écrit et par la parole, l’idée que je développe au cours de cette étude sur la Paix, et le vaste problème qu’elle soulève, je m’adressasse à une autre nation que la France et que je misse tout autre Etat en demeure de désarmer, aux lieu et place de l’Etat français. Aux pacifistes d’Allemagne, d’Angleterre et de chaque pays, il appartient d’exercer chez eux l’apostolat que j’exerce chez moi. Quel que soit le pays dans lequel il vit et dont il parle la langue, tout véritable pacifiste a le devoir impérieux de préconiser le désarmement sans condition de réciprocité. Tous : Allemands ou Français, Anglais ou Italiens, Espagnols ou Yougoslaves, Polonais ou Russes, tous doivent, avec une égale activité, mener, dans leur propre pays, une campagne énergique en faveur du désarmement immédiat et pousser l’opinion publique à faire pression sur son Gouvernement respectif, afin d’imposer à celui-ci, dans le plus bref délai, sous la poussée d’un courant pacifiste devenu irrésistible, le désarmement nécessaire. Alors, quelle que soit la grande Puissance qui, la première, désarmera, elle aura l’approbation enthousiaste de tous les pacifistes des autres nations ; la tâche de ceux-ci se trouvera singulièrement facilitée ; il suffira d’un vigoureux et suprême effort pour que les autres Gouvernements soient sommés par leur peuple de suivre l’exemple et de désarmer à leur tour. Ainsi seront écartés en grande partie les dangers que le désarmement sans condition de réciprocité pourrait faire courir à la nation qui aura eu la hardiesse de désarmer avant les autres.
La meilleure preuve — et en réalité la seule — qu’il soit possible de donner de la loyauté et de la ferveur avec lesquelles on défend une Idée, c’est incontestablement de conformer sa conduite aux exigences de cette Idée, quelles que puissent être les conséquences d’une telle conduite. L’anarchiste n’attend pas, pour pratiquer l’abstention qu’il soit convenu que tous les électeurs s’éloigneront des urnes électorales : il ne vote pas. L’anarchiste qui affirme et prouve la malfaisance des Chefs et des Maîtres n’attend pas, pour refuser toute fonction qui l’obligerait à se conduire en maître ou en chef, que personne ne consente à assumer une de ces fonctions ; il ne tente rien pour en être investi et, si elle lui est offerte, il la refuse. Il y a, de même, des hommes qui, pour ne pas prendre les armes et pour se soustraire à l’obligation militaire, n’attendent pas que ce refus devienne le fait général : ils entrent en révolte immédiate contre l’impôt du sang. Ces hommes, ce sont les objecteurs de conscience. (Voir Conscience et Objection de conscience.) Ils ne cèdent à aucune pression, à aucune menace ; ils ne se rendent à aucune sommation. Ayant compris l’horreur du métier dont la jeunesse fait l’apprentissage à la caserne ; ayant saisi la criminalité de toutes les guerres, quelles qu’en soient les origines et les fins ; leur conscience leur interdisant de consentir bénévolement à être assassins ou victimes, ils se refusent, en temps de paix comme en temps de guerre, à tuer ou à être immolés au nom de la Patrie et pour la Défense dite nationale. Ils pratiquent le désarmement avant la lettre et dans l’espoir que leur exemple sera de plus en plus suivi. Ils puisent dans leur noble conscience la certitude qu’un jour viendra où le désarmement universel résultera automatiquement du refus universel de prendre les armes ; où les combats cesseront faute de combattants ; où la Guerre mourra parce que personne ne consentira à la faire. Ce geste est d’une magnifique beauté, d’une exceptionnelle noblesse et d’une vaillance digne d’admiration. Il est, en outre, d’un enseignement précis et profond. Donc, accueillons avec une chaude amitié l’exemple que donnent à tous les objecteurs de conscience et glorifions-le. Mais, il faut bien le reconnaître : cet exemple, purement individuel, est parfois passé sous silence ; il n’a qu’une portée restreinte. L’objecteur de conscience est traîné en Conseil de Guerre. Il est condamné ; il entre en prison. Au bout de quelques mois, le silence et l’oubli se font. Son acte n’a pas été inutile ; car, dans l’effort : écrit, parole ou action, rien n’est complètement vain ; mais son sacrifice n’a eu et ne pouvait avoir qu’un retentissement faible et éphémère ; son exemple ne pouvait être suivi que d’un petit nombre d’imitateurs.
Eh bien ! Le désarmement de tout un peuple, alors que les autres peuples restent armés jusqu’aux dents, c’est l’objection de conscience dépassant le cadre individuel et s’étendant jusqu’aux frontières d’une grande et puissante nation. Ce désarmement, c’est le témoignage de la conscience de toute une collectivité nationale se refusant à la Guerre, ne voulant plus recourir aux armes ni confier au sort des batailles sanglantes le triomphe de ses intérêts et l’affirmation de son Droit ; c’est l’engagement public, officiel, positif et solennellement observé de ne plus se battre, de placer l’amour de la grande famille, solide et permanente, que forme l’humanité, bien au-dessus de l’amour de cette petite famille (?) qui repose sur l’idée fragile et changeante de la Patrie.
Tel est l’aspect philosophique, moral et social du Désarmement que je propose à la conscience des hommes et des femmes de France, comme en Allemagne, en Angleterre et partout, d’autres militants de la Paix le conseillent aux hommes et aux femmes d’Angleterre, d’Allemagne et des autres pays.
* * *
Halte ! Respirons un instant ; reprenons haleine, voyons où nous en sommes de la démonstration en cours et serrons de plus en plus notre argumentation :
Il s’agit d’empêcher A TOUT PRIX la guerre qui, dans l’état actuel de trouble et d’effervescence, peut nous surprendre et qui entraînerait l’extermination de l’espèce et l’effondrement de la civilisation. Nous avons acquis la conviction que l’unique moyen de faire échec à cette abominable éventualité, c’est le désarmement. Mais il n’est pas douteux que le désarmement général, simultané et contrôlé exigera de longues années avant que soient réunies toutes les conditions indispensables à sa mise en application. Or, il faut aller vite, très vite et, par suite, il sied d’abandonner provisoirement la thèse de la sécurité et de l’arbitrage aboutissant à ce désarmement général et simultané.
Je dis PROVISOIREMENT, car, bien loin d’équivaloir à l’abandon définitif du Désarmement universel qui reste la condition sine qua non de la Paix mondiale, le désarmement unilatéral que je préconise est appelé, par la vertu d’exemplarité, dont nul ne nie la force, et par la situation nouvelle qu’il déterminera, à brûler les étapes qui conduiront infailliblement au désarmement général et simultané. La Paix internationale et permanente continue à être le but à atteindre et le désarmement général demeure le moyen d’atteindre ce but ; mais, au lieu de chercher à atteindre ce but par le moyen beaucoup trop compliqué et qui exigerait un temps infiniment trop long : la sécurité, l’arbitrage et le désarmement général, simultané et contrôlé, je propose un moyen beaucoup moins compliqué et beaucoup plus rapide : le désarmement sans condition de réciprocité, dont une Puissance de premier ordre donnerait l’exemple et je pense — et je crois avoir justifié ce sentiment — que la France doit être cette Puissance.
* * *
Plaçons-nous maintenant dans l’hypothèse de la France venant de désarmer. Elle porte ce prodigieux événement à la connaissance de tous les peuples par la voie d’un message traduit dans toutes les langues, reproduit et commenté par les journaux du monde entier, communiqué par tous les postes de T. S. F. et par toutes les agences d’information. Concis, limpide, émouvant, ce message que les mille bouches de l’information feraient retentir aux quatre points cardinaux, pourrait être à peu près celui-ci :
MESSAGE DU PEUPLE FRANÇAIS
A TOUS LES AUTRES PEUPLES
« Le régime de PAIX ARMÉE fait peser sur toutes les Nations des charges accablantes, en même temps qu’il prépare infailliblement le retour de la folie des folies, du crime des crimes : la Guerre !
La Guerre entraîne à sa suite un cortège de plus en plus effrayant de ruines, de deuils, d’inexprimables détresses. Si un conflit armé se produisait demain, ce serait l’extermination de l’espèce humaine et l’effondrement d’une civilisation que des siècles d’efforts et de sacrifices ont lentement édifiée.
A l’exception d’un nombre infime de personnes -dont aucune n’ose se prononcer ouvertement et franchement en faveur de la Guerre — tous les humains aspirent à un régime de PAIX générale et permanente.
Gouvernements et Peuples, tous reconnaissent que le Désarmement général est la condition sine qua non de l’établissement de ce Régime de Paix si fervemment désiré et si anxieusement attendu.
C’est pourquoi, au sein de toutes les nations existe un courant de plus en plus puissant contre la Guerre et pour la Paix,
Mais aucun Peuple, jusqu’à ce jour, n’a exprimé assez clair et assez haut sa volonté de Paix. Aujourd’hui, c’est chose faite : le Peuple de France a mis son Gouvernement en demeure de désarmer, sans attendre que les autres nations soient résolues et prêtes à désarmer également. Et, sous l’irrésistible pression populaire, le Désarmement, en France, est actuellement un fait accompli.
On vous dira, peut-être, que ce désarmement n’est que fictif, incomplet et provisoire. N’en croyez rien. : il est réel, total et définitif. Vous pouvez contrôler l’exactitude de cette affirmation : nos portes sont ouvertes à quiconque désirera acquérir la certitude de notre loyauté.
C’est cet événement, à jamais inoubliable, que, par ce message, le Peuple de France porte à la connaissance de tous les autres Peuples.
Devant l’Histoire et devant l’Humanité, nous déclarons : que nous ne nous connaissons plus d’ennemi ;
Que nous ne voulons plus nous battre ;
Que nous sommes irréductiblement décidés à ne jamais recourir à la force des armes pour trancher les différends, de quelque nature qu’ils soient, qui pourraient surgir entre n’importe quel peuple et nous ;
Que, désormais, nos relations avec les autres peuples, sans distinction de nationalité ni de race, seront de confiance et d’amitié.
Nous déclarons que nous avons pris au sérieux le pacte par lequel, d’accord avec un grand nombre d’autres Puissances, la France a déshonoré la Guerre, l’a jetée hors la loi et mise an ban de l’Humanité.
Oui, la France désarme. Elle désarme moralement et matériellement. Elle désarme sans que rien ne l’y oblige, volontairement et lorsqu’elle est en possession d’un potentiel de Guerre qui n’est inférieur à celui d’aucune autre nation.
Nous avons pleine confiance dans l’avenir. Nous savons que le désarmement d’un grand pays comme le nôtre fera naître partout l’admiration et l’enthousiasme et que, par la puissance de l’exemple, il sera le signal du désarmement général.
Nous ne redoutons rien : un Peuple ne peut pas songer à attaquer un autre Peuple qui, non seulement ne le menace pas, mais encore lui tend fraternellement la main. Un Gouvernement ne parviendra jamais à convaincre ses nationaux que le Peuple de France qui, le premier et le seul, a désarmé, complote contre eux une agression, une offensive quelconque.
Désarmé, ne basant plus sa sécurité sur ses Forces de guerre, le Peuple de France se place sous la protection de tous les autres Peuples, ses frères ; il confie à cette protection la garde de son inviolabilité.
Nous adjurons le Monde civilisé de suivre au plus tôt l’exemple que nous lui donnons. Trop longtemps la guerre a dévasté la Terre. L’heure est venue de mettre un terme à l’infamie et aux atrocités des rencontres sanglantes. Que, au sein de chaque nation, les multitudes qui, jusqu’à ce jour, se sont entretuées pour des Causes qui n’étaient pas les leurs, que les masses laborieuses qui, en toutes circonstances, ont toujours payé et toujours paieront de leur sang et de leur travail tous les frais des boucheries internationales ; que ces foules se dressent contre leurs Gouvernements et leur imposent le désarmement. Le sillon est tracé ; chaque peuple a le devoir de le creuser et de l’élargir, en exigeant de son Gouvernement qu’il imite la France : la volonté de Paix qui déjà emporte l’Humanité ne peut manquer d’être fortifiée et portée jusqu’à son comble, par l’annonce de l’événement que vous apprend ce Message.
Puisse cette volonté de Paix devenir rapidement irrésistible ! Alors, elle brisera tous les obstacles qui pourraient lui être opposés. Alors et alors seulement, le danger d’une guerre prochaine, dont la menace pèse sur le Monde, sera conjuré. Alors, et alors seulement, s’établira le règne indestructible de la Paix radieuse et féconde ! »
Il va de soi que les circonstances apporteront à ce texte les modifications qu’elles comporteront ; mais l’esprit de ce Manifeste pourra rester le même. Quelle émotion profonde, quelle impression sans précédent, quel frémissement inexprimable suscitera, d’un bout du monde à l’autre bout, un événement de cette nature et de cette importance !
Est-il exagéré de dire que ses répercussions seront incalculables, qu’il suscitera dans le monde entier une émotion à ce point puissante et profonde qu’elle portera un coup mortel à la mentalité de violence que des siècles de luttes guerrières ont déterminée ?
A l’étonnement, à l’admiration et à l’enthousiasme spontanés de la première heure, succèdera rapidement dans la conscience des peuples les plus fortement travaillés par la propagande pacifiste, la résolution consciente et réfléchie de suivre l’exemple. Partout les Forces de Guerre se trouveront affaiblies et partout seront raffermies et fortifiées celles de Paix. Qu’on y songe : c’est à la suite de la victoire des Prussiens sur les Autrichiens, (Sadowa, 3 juillet 1866) et quelques années plus tard, de la mise en pièces des armées françaises par les armées allemandes (1870–1871), que la puissance militaire de l’Empire d’Allemagne, se développant sans arrêt, contraignit — si l’on peut dire — les autres nations à accroître, de lustre en lustre, leurs effectifs et leurs armements. C’est l’exemple de l’Allemagne de plus en plus militarisée, appuyant son effort industriel et commerçant sur un appareil de conquête et d’extension toujours plus robuste et perfectionné. Qui a entraîné la vieille Europe et, de proche en proche, le monde capitaliste des autres continents sur la route des effectifs de plus en plus nombreux, des réserves de mieux en mieux préparées, des budgets de guerre constamment enflés, des armements toujours plus puissants et s’adaptant de mieux en mieux aux nécessités de l’offensive et de la défensive.
Oui : c’est à l’instigation de l’Empire Germanique et dans l’espoir de se garantir pour le mieux — ô mirage de la Sécurité ! — contre toute éventualité d’agression que, depuis une soixantaine d’années, chaque nation a cru devoir porter au maximum sa puissance militaire et que, chaque année, le monde qui se flatte d’être civilisé précipite follement dans l’abîme sans fond des budgets de guerre, des ressources, qui, présentement, se chiffrent par cent quatre milliards de francs. Pour ouvrir la voie à cette danse échevelée des milliards, il a suffi de l’exemple donné par une grande Puissance : l’Allemagne.
Eh bien ! J’ai la conviction, et tous ceux que n’aveugle pas le fanatisme chauvin partagent cette conviction, que l’exemple que donnerait aujourd’hui la France en se désarmant entraînerait promptement et de façon certaine toutes les autres Puissances dans la voie du même désarmement. Je suis persuadé que le Peuple de France ayant, par son attitude résolue, énergique et inflexible, imposé à son Gouvernement, sa volonté de Paix par le Désarmement immédiat et sans condition, les autres Peuples, pris d’une noble émulation, et qui ont besoin de paix autant que celui de France, exerceraient sur leurs Gouvernements respectifs la même irrésistible pression et obligeraient ceux-ci à désarmer sans plus attendre. La certitude que j’exprime ici a pu être considérée, tout d’abord, comme la manifestation d’un optimisme de commande et sans mesure ; à l’heure actuelle, cette certitude est entrée dans un certain nombre d’esprits ; elle s’y est installée et n’en sortira plus. Plusieurs groupements pacifistes : les plus avancés, et les plus actifs, ont donné leur adhésion pleine et entière à la thèse que j’expose dans cette étude et aux conclusions d’ordre pratique qui en découlent. Toute cette partie de la population française qui est socialiste et même socialisante a adopté ces conclusions ; et si, pour des raisons politiques et de tactique électorale, les chefs de la Social-Démocratie française ne se prononcent pas, publiquement et franchement, en faveur du Désarmement unilatéral, presque tous les adhérents que compte le parti Socialiste sont acquis à la nécessité d’une telle mesure ; ils sont prêts à seconder tout mouvement dans ce sens et décidés à lui apporter l’appui de leur concours. Ce courant est si marqué au sein de ce parti que son Secrétaire Général, le député Paul Faure n’hésite pas à écrire :
« Quand l’opinion publique sera convaincue que les prochains conflits ne laisseront rien à la surface du globe, tous ceux qui parleront de la Guerre seront regardés comme des fous. Sécurité d’abord, proclament de bien singuliers patriotes, avec des trémolos dans la voix qui sonnent faux comme des tambours crevés. Par la guerre, ce ne sera plus jamais la Sécurité. Qu’on se le dise ! Demandez-leur donc comment ils entendent empêcher 300 avions de venir, la même nuit, divisés en équipes, incendier Paris, Lille, Marseille, Lyon, Toulouse et Bordeaux — pour commencer — incendier les villes et anéantir tous les êtres vivants ! Sommes-nous prêts aux représailles ? demandent nos bonnets à poil. C’est à quoi on songe tout de suite, comme s’il s’agissait d’une partie de football ou d’un concours d’aviron. Nous pensons, nous, à autre chose : comment faire pour que ne soient pas détruites les capitales et les populations. Et nous avons choisi comme direction : le désarmement matériel et moral. » (Le Populaire, 20 janvier 1932)
Les organisations syndicales qui comptent actuellement plus d’un million de syndiqués sont, elles aussi, à peu près unanimement pour le Désarmement sans condition de réciprocité. Nous voici donc, dès maintenant, en présence d’une solution à laquelle se rallient, plus ou moins publiquement et explicitement, plusieurs centaines de milliers de personnes, peut-être pourrait-on dire, sans tomber dans l’exagération, deux millions de pacifistes. C’est une force ; elle n’en est qu’à ses débuts ; mais elle ne demande qu’à se développer et il dépend de ceux qui la constituent, que par leur zèle et leur activité, elle augmente promptement en étendue et en profondeur.
Quelque peu emporté par l’exaltation que soulève en moi cette espérance d’un grand pays comme la France donnant au Monde le merveilleux exemple d’un désarmement volontaire, face aux autres Puissances persistant à conserver et même à accroître leur appareil de Guerre, il m’est arrivé de m’écrier, en m’adressant parfois à d’immenses auditoires :
« Le jour où la France se désarmera, seule et avant toutes les autres Nations, elle écrira la page la plus glorieuse, la plus féconde, la plus admirable, non seulement de son Histoire, mais encore de l’Histoire Universelle ! »
Le plus souvent, cette déclaration fut accueillie par de frénétiques acclamations. Toutefois, il m’est arrivé de voir se dresser devant moi un super-patriote m’apostrophant à peu près en ces termes :
« Monsieur, votre langage est celui d’un ennemi de la France. Je ne sais pas si, en donnant l’exemple du désarmement, la France écrirait, comme vous le dites, la plus admirable page de son histoire ; mais ce que je sais, ce dont je suis absolument certain, c’est que si la France commettait l’imprudence de se désarmer, cette page de son Histoire serait la dernière, parce que, le lendemain, il n’y aurait plus de France. Songez-y, Monsieur : notre pays est de toutes parts entouré de nations avides et puissantes : l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie contournent ses frontières. Fertile et riche comme Elle l’est, la France ne saurait manquer d’exciter les convoitises de ces nations de proie. La vaillance bien connue de ses chefs militaires et de leurs soldats, le formidable matériel de guerre dont elle dispose lui servent aujourd’hui de remparts et garantissent sa sécurité. Qu’Elle se désarme ; et, ces remparts s’étant écroulés, ses frontières n’étant plus protégées, Elle serait immédiatement envahie et l’agresseur — ou les agresseurs — ne rencontrant aucune résistance, assouviraient sans coup férir et par conséquent sans risque leurs appétits d’annexion. Nouvelle Pologne, notre pays magnifique, déchiré, écartelé, tomberait sous l’écrasante domination du ou des conquérants qui se partageraient son territoire et sa population. N’ai-je pas raison, Monsieur, d’affirmer que le Désarmement que vous préconisez équivaudrait, pour la France, à un véritable suicide ? Vous n’êtes pas son ami ; vous êtes son plus mortel ennemi ! »
Ce langage, c’est celui que profèrent nos nationalistes et le peuple de France — comme d’ailleurs — est tellement et depuis si longtemps habitué à vivre sur le pied de guerre, on lui a tant et si bien dit, répété, rabâché qu’il est une sorte d’agneau entouré de loups, que, sans réfléchir, il est porté à croire que c’est une indiscutable vérité. Et pourtant !...
À l’objection soulevée contre le Désarmement unilatéral et sans condition de réciprocité, je réponds que je ne partage en aucune façon les craintes et les sinistres prévisions que traduit cette objection. Par la pensée, supposons la France s’étant totalement désarmée. Elle a avisé de cet événement considérable tous les autres peuples et leur a administré la preuve de sa parfaite loyauté, de son indiscutable sincérité. Il est entendu qu’elle a définitivement renoncé à la guerre, qu’elle ne consentira, en aucun cas, à se battre, que rien, rien ne la décidera à se départir de cette résolution. Elle l’a solennellement déclaré et personne ne l’ignore, ne peut l’ignorer. Et, maintenant, réfléchissons et argumentons.
Toute nation se compose de deux éléments : ses gouvernants (une infime minorité) et l’immense multitude qui forme le reste de la population : D’où peut surgir le danger dont on nous menace ? Il ne peut provenir que de cette multitude qu’on appelle le peuple ou de ceux qui gouvernent. Est-il permis d’imaginer qu’un peuple, pour si belliqueux qu’il soit, puisse concevoir et envisager sérieusement le projet de porter la guerre dans un pays dont il connaît l’indéfectible attachement à une Paix définitive ? Tenons compte que tous les peuples sont plus ou moins travaillés par la propagande pacifiste ; qu’il y a, chez eux, des associations dont la volonté de Paix a été portée à son comble par le désarmement volontaire de la France ; n’oublions pas que ces peuples sont édifiés sur les horreurs de la guerre et savent pertinemment que l’annexion d’une partie du territoire français ne leur rapporterait rien ; ne perdons pas de vue que le prolétariat de ces peuples a conscience que sa situation sociale le condamne à être et à rester aussi longtemps qu’il aura des capitalistes et des gouvernants, victime de l’exploitation de ses capitalistes et de la domination de ses gouvernants et que cette domination et cette exploitation se trouveront aggravées en raison directe de l’extension qu’apporteraient à cette agression et à cette spoliation un territoire plus étendu, une population plus nombreuse, et un gouvernement plus fort. J’ai la conviction que, dans ces conditions, il ne viendra à la pensée d’aucun peuple de songer à se jeter sur le seul pays qui aura affirmé et prouvé qu’il entend ne chercher querelle à personne et qu’il veut vivre en paix et en amitié avec tout le monde. Pour se battre il faut être deux, c’est aussi vrai pour deux nations que pour deux individus, et il suffit que l’un des deux refuse le combat pour que celui-ci n’ait pas lieu. Il n’est plus, le temps où la guerre se limitait aux campagnes engagées entre mercenaires, spadassins et reîtres ayant, par intérêt et par profession, embrassé la carrière des armes. Dans toutes les nations, c’est la totalité des hommes valides et adultes qui, en temps de guerre, est appelée sous les drapeaux et ce que nous savons du caractère que revêtira la guerre de demain nous persuade que, hommes et femmes, vieillards et enfants, personne ne sera épargné. Et on s’essaierait à nous faire admettre l’éventualité d’une agression voulue ou même consentie par la population paisible d’un ou plusieurs pays contre une grande nation comme la France qui se serait délibérément désarmée ? Cette éventualité est inadmissible.
Il est vrai que si la guerre n’est jamais désirée ni voulue par le peuple, celui-ci apprenant et constatant de mieux en mieux qu’il n’a rien à y gagner et tout à y perdre, elle est le fait des dirigeants qui gouvernent la nation. Ceux-ci ne sont que le petit nombre mais ils possèdent tous les leviers de commande : pouvoir, richesse, journaux, censure, toutes ces forces sont à leur discrétion et entre leurs mains. Ils excellent dans l’art de préparer les esprits à la guerre, de chauffer l’opinion, de l’affoler et de la galvaniser. Quand ils sentent venir un conflit armé, ils mettent en mouvement toutes leurs batteries ; ils ne témoignent jamais plus ostensiblement de leur volonté de paix que lorsqu’ils sont à la veille de déclencher la guerre. Ils sont à la source des renseignements. Dans les sphères gouvernementales, diplomatiques, militaires et capitalistes, on sait à quoi s’en tenir sur les événements qui se préparent ; mais jusqu’à la dernière heure, on ruse, on travestit les faits, on dénature les informations ; en un mot, on ment. Or, toutes ces manœuvres, toutes ces fraudes, tous ces mensonges ont un but, un seul, et il est le même dans tous les pays. Ce but, c’est de faire pénétrer dans le crâne de la masse la conviction que, dans chaque pays, les Pouvoirs publics ont tout mis en œuvre pour éviter la guerre : « Toutes les concessions compatibles avec la dignité et les intérêts de la Nation, nous les avons faites. Tout ce qu’il était humainement possible de faire pour épargner à notre pays les duretés, les rigueurs, les douloureuses épreuves que comporte un conflit armé, nous l’avons fait. Nous sommes allés jusqu’aux extrêmes limites de la conciliation ; nous n’avons reculé devant aucune mesure susceptible d’écarter cette terrible éventualité. Tout a été inutile. La Guerre nous est imposée ; nous la subissons ; mais, puisque nous sommes l’objet d’une agression criminelle, nous nous trouvons dans l’obligation de repousser cette agression ; sauvagement attaqués, nous avons l’impérieux devoir de nous défendre. » Tous les gouvernements s’expriment de la sorte et donnent à cette fourberie toutes les apparences de la sincérité.
Et c’est ainsi que chaque Etat parvient à faire croire à son Peuple qu’il s’agit d’une Guerre au caractère indubitablement défensif. Il n’y a pas un gouvernement, je dis : « pas un », qui, à notre époque, prendrait sur lui de reconnaître qu’il pourrait ne pas faire la guerre, que rien ne l’y oblige, mais qu’il a la volonté de la faire quand même : une telle guerre serait tellement impopulaire, elle se heurterait à de telles résistances, elle soulèverait un tel mécontentement, elle ameuterait tant de colères, qu’aucun gouvernement – à moins qu’on ne le suppose frappé de démence – ne consentirait à assumer les responsabilités écrasantes et à courir les risques certains d’une aussi périlleuse aventure. Cela ne fait pas le moindre doute.
Eh bien ! Il est facile, dans l’état actuel du monde, alors que chaque nation, bottée, casquée, armée, reste sur le qui-vive et contribue à transformer la terre en un immense camp retranché d’où peut, à tout instant, surgir, du Nord ou du Midi, du Centre, de l’Est ou de l’Ouest, le spectre hideux de la Guerre ; il est possible — et sans grand effort — de convaincre la population de chaque pays que, en acceptant de se battre, elle ne fait pas autre chose que de se défendre contre l’odieuse agression de telle nation qui a formé le dessein de détruire ses foyers, de ruiner son industrie, de s’emparer de ses biens, de conquérir son territoire et de la réduire en esclavage et qui, dans ce but, a recours à la guerre. Mais il serait tout à fait impossible d’imputer d’aussi noirs desseins, d’aussi sinistres intentions à la France désarmée ; il serait totalement impossible, quelles que soient les manœuvres employées, d’amener la population d’un pays quelconque à l’idée d’une agression ayant pour auteur le seul Peuple qui aurait pris la magnifique initiative et donné le superbe exemple du Désarmement.
Et, sur ce point, c’est-à-dire me plaçant dans l’hypothèse de la France ayant volontairement désarmée, je conclus : d’une part, aucun peuple ne songerait à ouvrir les hostilités contre une telle France ; d’autre part, aucun gouvernement n’oserait donner à sa population l’ordre de se ruer contre cette France, parce qu’il ne serait possible à aucun gouvernement de transformer une guerre dont le caractère offensif serait évident, en une guerre dont le caractère défensif serait impossible à établir avec quelque vraisemblance. Est-ce clair ? Et n’est-il pas démontré, maintenant, que le désarmement de la France n’exposerait celle-ci à aucune agression, mais tout au contraire, serait le gage, la garantie de sa complète sécurité ?
Poussons plus loin l’examen de cette menace que les ennemis de la Paix brandissent sur la tête des partisans, comme moi, du désarmement de la France. Et supposons que cette menace se réalise, bien que je vienne d’en démontrer plus que l’invraisemblance : l’impossibilité. La France est envahie. Elle l’est par une seule puissance ou par plusieurs. Examinons les deux cas :
-
Premier cas : elle est envahie par les armées d’une seule nation. Pense-t-on que les autres Puissances laisseront cette invasion se produire sans qu’elles interviennent ? Imagine-t-on qu’elles assisteront, impassibles et l’arme aux pieds, à l’occupation du territoire français par telle ou telle Puissance ? Comment ? Lorsqu’il s’agit d’une île perdue, d’un coin de terre situé au loin, qu’un Etat laisse percer l’intention de s’annexer par un des procédés connus : protectorat ou colonisation, toutes les autres Nations s’agitent, se mettent sur les rangs, réclament leur part du gâteau, font valoir des droits fictifs ou réels, interviennent sous une forme ou sous une autre ; les convoitises se manifestent, les appétits s’affirment, les rivalités entrent en jeu. On dirait autant de chiens affamés prêts à se ruer les uns sur les autres pour se disputer un os. Et on consentirait à admettre qu’une Puissance ayant jeté son dévolu sur la France sans défense, les autres laisseraient faire ? Il n’y a pas, au monde, une personne sensée qui puisse croire une minute qu’il en serait ainsi. Passons à l’autre supposition.
-
Second cas : La France est envahie de divers côtés par plusieurs Puissances, par exemple : au Nord, par l’Angleterre ; à l’Est, par l’Allemagne ; du côté des Pyrénées, par l’Espagne ; du côté des Alpes, par l’Italie. Cette hypothèse présuppose une entente préalable, un plan concerté. Je ne m’arrête pas aux difficultés qui précéderaient un tel accord et accompagneraient la mise à exécution du plan concerté. Voici donc les armées anglaises, allemandes, espagnoles et italiennes en France, supposons-le. Quelles vont être les conséquences de cet envahissement ? Gardons notre sangfroid ; faisons abstraction, comme il sied, de toutes les colères et indignations qui, dans l’état actuel des nationalismes surexcités, jailliraient de ces sources empoisonnées qui se nomment : Patrie, indépendance nationale, honneur, drapeau, défense du sol, sauvegarde du Patrimoine commun, cendres des aïeux, et autres calembredaines.
Mettons-nous bien dans la tête que, dans le cas qui nous occupe, l’invasion a eu lieu sans combat ; Anglais et Allemands, Espagnols et Italiens n’ont rencontré sur les frontières qu’ils ont franchies, sur le territoire qu’ils ont occupé, dans les villes et villages où ils se sont installés, aucune résistance armée ; les envahisseurs qui, dans l’espèce, ont pratiqué une sorte de pénétration pacifique, puisqu’ils n’ont eu à renverser aucun obstacle, à rompre aucune digue, à culbuter aucun barrage, n’ont pas à redouter la moindre attaque ni devant, ni derrière, ni sur le flanc ; à l’abri de toute surprise, leur sécurité ne court aucun risque. Cela étant, on discerne tout de suite l’extrême différence qui sépare une invasion de cette nature de celle qui se pratique en temps de guerre, c’est-à-dire lorsque l’envahisseur a dû, pour avancer, marcher sur le cadavre des siens qu’il semait derrière lui, sur le corps de ceux qui se battaient pour lui barrer la route et sur les dévastations et les ruines qu’il accumulait sur ses pas. Provoquées, justifiées, exigées même par les sauvageries et atrocités qu’entraîne l’état de guerre, les cruautés, brutalités et violences dont se rendraient coupables les envahisseurs de la France désarmée et refusant de se défendre n’auraient aucune raison d’être et seraient sans excuse puisque sans motif. En conséquence, que résulterait-il d’une telle invasion ? Annexion à l’Etat envahisseur du territoire envahi ; installation d’un nouveau personnel gouvernemental et administratif ; application à la population résidant sur le terrain annexé de la législation et du système d’impôts et contribution en vigueur dans le pays annexeur ; voilà pour le régime politique auquel seraient soumis les habitants des régions envahies. Pense-t-on qu’il y aurait grand dommage, pour nos compatriotes de France, à subir ces divers changements ? Gouvernés pour gouvernés, administrés pour administrés, le seraient-ils plus durement ou plus mal par des gestionnaires étrangers que par des gérants français ? Seraient-ils, en tant que contribuables, sensiblement plus pressurés ? Les impôts, dont rien ne permet d’entrevoir l’allègement dans le pays de France, n’ont-ils pas atteint le maximum des charges fiscales qu’il est possible de supporter, en sorte qu’il serait impossible d’aggraver ces charges ? La législation, chez nos voisins, est-elle notablement en retard sur la nôtre ? Quant au régime économique, il est probable que, à peu de chose près, il resterait le même. Tout ce qu’on peut prévoir, ce serait, au pis aller, la mainmise sur les chemins de fer, les compagnies de navigation et de transport, les compagnies d’assurances, les mines, les banques, les grandes firmes industrielles et sociétés commerciales de premier ordre, les vastes entreprises agricoles, etc. Sans doute, les richissimes capitalistes de nationalité française qui sont, actuellement, à la tête de ces grosses affaires auraient à se plaindre de ces confiscations et expropriations ; mais, à l’exception de ces personnages — dont le sort ne me cause aucune inquiétude car je suis certain qu’ils ont des intérêts ailleurs — je ne vois pas en quoi le sort de tous les autres se trouverait aggravé. Exploités et flibustés par les capitalistes de France, les travailleurs seraient flibustés et exploités par les capitalistes des autres pays et j’estime qu’ils ne perdraient rien au change : tous les exploiteurs se valent. Compte tenu de ces explications, je suis en droit d’affirmer que, si on veut bien comparer les maux relativement légers que déterminerait l’invasion de la France désarmée aux horreurs qu’entraînerait pour ses habitants une nouvelle guerre, on ne peut que se prononcer en faveur du Désarmement que je conseille, dût celui-ci ouvrir à « l’étranger » les frontières de la France. Car il est de règle et d’élémentaire sagesse, quand on est dans la nécessité de choisir entre deux maux, d’opter pour le moindre ; et, ici, le moindre est incontestablement le Désarmement, l’invasion dût-elle s’en suivre.
Le Désarmement doit être imposé par le Peuple au Gouvernement.
Cette étude touche à sa fin. Pour la compléter, je dois préciser les moyens à employer pour imposer au Gouvernement de France le désarmement dont il est appelé à donner l’exemple.
J’ai dit plus haut que ce qui manque aux nombreuses ligues et associations pacifistes existantes, pour imprimer à leur effort l’élan nécessaire à chaque groupement et apporter à l’ensemble le lien indispensable à une action commune, c’est une sorte de boussole permettant à toutes ces ligues en général et à chacune en particulier, de s’orienter vers le même but et par la même route : la plus directe et la plus sûre. Eh bien ! Cette boussole, le désarmement unilatéral et sans condition la leur apporte. Ce désarmement est un programme clair et précis ; il est un but immédiat et déterminé ; il peut et doit servir de plateforme sur laquelle se mettront d’accord tous les pacifistes immuablement décidés à ne faire la guerre en aucun cas, ni directement ni indirectement. Sur ce programme, ce but et cette plateforme, il ne sera ni très long ni très difficile d’asseoir la fédération, nationale d’abord, internationale ensuite, des associations véritablement et foncièrement pacifistes. Le jour est proche où, désabusés par les pantalonnades et défaillances de la Société des Nations, les Peuples ne se feront plus la moindre illusion et refuseront de continuer à faire crédit aux professionnels de la Politique, de la Diplomatie, de l’Armée et de « l’Affairisme mondial » qui composent l’Assemblée de Genève. Le jour est proche où les esprits les moins ouverts, je dirai même les plus obtus, se rendront compte que le régime dit, bien à tort, « de la sécurité », loin de conduire les nations vers la Paix, les accule fatalement à la Guerre. Les événements s’ajoutent les uns aux autres, qui tuent chez tous les individus animés d’une volonté loyale et ferme de Paix toutes les espérances qu’avaient fait naître les Protocoles, les Pactes et les Conventions conclus ou à conclure. Grand déjà est le nombre de ceux qui sont convaincus que la Paix ne descendra pas des hauteurs dirigeantes, des altitudes gouvernementales et qu’elle ne peut sortir que des profondeurs de la masse populaire, pour qui l’état de guerre est une calamité et l’état de paix un besoin, une nécessité.
Le désarmement volontaire de la France sera le signal d’un enthousiasme délirant au sein de la population française et, chez les autres peuples, le point de départ d’une formidable poussée vers le même désarmement. Tous ceux et toutes celles en qui brille la flamme dévorante du véritable Pacifisme accouront de toutes parts, se rechercheront et s’assembleront en une innombrable multitude sous le signe du Désarmement à tout prix. Sous les formes les plus diverses et les plus efficientes : réunions, conférences, meetings, démonstrations sur la voie publique, journaux, affiches, tracts, brochures, manifestes, appels à l’opinion, la propagande s’organisera, toujours plus active et plus féconde en faveur du Désarmement. Des lèvres des apôtres de la Paix jailliront des harangues toujours plus enflammées, des sommations sans cesse plus pressantes, des mises en demeure de plus en plus impérieuses. Et la Cause magnifique que les militants plaideront ainsi répondra si exactement à la volonté de Paix qui sommeille au fond de tous les cœurs et au tréfonds de toutes les consciences, même de celles qui s’ignorent le plus, que le courant pacifiste, de plus en plus tumultueux, frémissant et passionné, deviendra vite puissant et, enfin, irrésistible.
Je ne pousse pas la naïveté jusqu’à croire que ces combattants de la Paix ne trouveront en face d’eux aucun adversaire. Non ; je ne suis pas candide à ce point. Je prévois, je sais, je suis certain que tous les intérêts politiques et économiques auxquels la Paix armée et la Guerre sont ou paraissent être favorables mettront tout en œuvre pour s’opposer au pacifisme intégral dont je prône la croisade : leur propagande de désarmement : fausses nouvelles, informations tendancieuses, intimidations, ruses, manœuvres, chantages et perfidies, leur mauvaise foi ne reculera devant rien. Poursuites et condamnations ne seront certainement pas épargnées aux militants pacifistes les plus zélés et les plus en vue. Mais quand la répression s’abat sur un mouvement ayant atteint certaines proportions, elle ne fait qu’accroître la puissance de ce mouvement (voir Répression), elle est le coup de fouet dont le cinglement active, précipite et porte à son maximum la vitesse du coursier qui se hâte vers le but et ne se laisse abattre par aucun obstacle. Les premières difficultés que tout mouvement rencontre à sa naissance sont d’ores et déjà vaincues. Le mouvement pacifiste n’en est qu’à ses débuts ; il s’est quelque peu laissé assoupir au ronronnement des berceuses que chantonnaient autour de son berceau les hypocrites fauteurs de guerre et les faux artisans de la Paix. L’enfant a grandi ; il devient robuste et courageux, entreprenant et audacieux. Hier encore, il ignorait la voie qu’il devait suivre : on en ouvrait devant lui tant et de si attirantes ! Aujourd’hui, après de multiples tâtonnements et toute une série d’essais dont, à l’expérience, il a constaté l’erreur ou l’insuffisance, il a trouvé sa voie. Cette voie, c’est celle du Désarmement hic et nunc ; il s’y est vaillamment engagé. Impatient d’aboutir, ayant conscience du danger dont tout retard sème sa route, plaçant tous ses espoirs et toute sa confiance dans la puissance de l’exemplarité, il demande le Désarmement ; demain il l’exigera ; sous peu, s’il le veut résolument, il pourra l’imposer. Il sait qu’il ne doit avoir confiance qu’en lui-même, il sait que seul il est de taille à briser toutes les résistances ; il engage la lutte. Ce lutteur vigoureux, combatif, ardent, tenace, c’est le Peuple pacifiste ; hier encore, faible comme un enfant, aujourd’hui fort comme un adulte ; demain, athlète magnifique. Les pessimistes et les découragés estimeront que je me laisse emporter sur les ailes d’un lyrisme téméraire et sans consistance. Eh bien ! Qu’ils prennent la peine de réfléchir ; qu’ils comparent la masse incalculable de ceux et de celles qui, appelés à subir toutes les désastreuses conséquences de la Guerre, sans avoir, quelle que soit l’issue de celle-ci, le moindre espoir d’en retirer le plus mince avantage, à la dérisoire minorité de ceux et de celles qui, confiants dans la situation qu’ils occupent et les moyens dont ils disposent, ont ou croient avoir quelque chance de sauver leur carcasse et de recueillir les fruits de la victoire. Cette simple comparaison suffira largement à les édifier.
Vainement me dira-t-on que cette comparaison ne prouve rien en faveur de ma thèse, puisque la même disproportion entre les profiteurs possibles et les victimes certaines de la guerre existait hier comme elle existe aujourd’hui et qu’elle n’a pas empêché, il y a 16 à 17 ans, les masses destinées à l’immolation de se ruer vers la frontière. A mon tour de répondre que les événements ont modifié du tout au tout l’état d’esprit de la masse. Qu’on relise la partie de cette étude qui (pages 1913-14-15 et 16) a pour titre : « Vers la Paix ». Cette lecture ruinera le rapprochement qu’on serait tenté d’établir entre deux dates : 1914 et 1932 qui, bien que fort rapprochées, sont séparées par des circonstances qui ont creusé entre elles un véritable abîme. Pour ne pas triompher trop facilement, je veux bien reconnaître que si, par malheur, la guerre maudite éclatait brutalement et par surprise à l’heure où nous sommes, un certain nombre et même, probablement, beaucoup de pacifistes se laisseraient entraîner vers l’abattoir ; n’ai-je pas dit, au surplus, que cette guerre prendrait, dès la première heure, un tel caractère d’extermination et de désastre, qu’il n’y aurait possibilité de rien faire ? Mais si quelque répit nous est laissé, (et c’est toujours dans cette hypothèse qu’il faut se placer pour raisonner et agir), je pense que le courant pacifiste possède, dès à présent, une ampleur et une force appréciables et qu’il s’étend et se fortifie de jour en jour. Qu’ils apprennent à se connaître, les militants de la Paix ; qu’ils se rapprochent, qu’ils se concertent, qu’ils se placent, en dehors et au-dessus des tendances politiques, religieuses et idéologiques qui les séparent, sur le terrain solide de la Paix avant tout, de la Paix à tout prix, de la Paix par tous les moyens ; que, pénétrés de la nécessité de conjurer les menaces de guerre qui sont suspendues sur nos têtes et, toute autre affaire cessante, de marcher, non plus en ordre dispersé, mais en rangs compacts contre cette angoissante éventualité, ils prennent en commun les décisions urgentes ; que de leurs innombrables poitrines sorte, puissante, irrésistible, la clameur attendue : « Désarmement, Désarmement, Désarmement ! » Que cette clameur s’avère comme le cri discontinu d’un sentiment, d’une résolution, et d’une volonté inébranlables. Que, pareil à ces lames de fond qui, dans leur furieux élan, bouleversent et emportent tout, le soulèvement des couches profondes s’élève et monte jusqu’aux sommets qu’occupe le Gouvernement ; et celui-ci sera bien obligé de capituler, c’est-à-dire, comme on l’a proclamé naguère, de se soumettre ou de se démettre.
S’il se soumet, ce sera le Désarmement ; s’il se démet, ce sera la Révolution.
CONCLUSION.
En étudiant le problème si délicat, si complexe et si ardu de la Paix, j’ai été entraîné à des développements qu’on jugera peut-être excessifs. Mon excuse, c’est que la lutte contre la Guerre dont l’imminence plane, terrifiante, sur notre époque est, à coup sûr, celle qui réclame présentement notre attention la plus vigilante et notre effort le plus immédiat. Il est permis de dire que l’avenir de l’humanité se joue actuellement sur ce « pile ou face » : la Guerre ou la Paix.
Si la Guerre n’est pas empêchée, ce sont d’inestimables trésors anéantis ; c’est le merveilleux labeur des générations qui nous ont précédé, détruit ; c’est la vieille Europe couverte de décombres, de cendres et de cadavres. C’est, pour un temps indéterminé, la porte fermée à tous les espoirs qui s’ouvrent devant nous.
Le devoir qui s’impose à tous les amis sincères, à tous les ouvriers de la Paix, c’est de travailler avec un zèle inlassable et une activité de tous les instants à empêcher la Guerre. Un seul moyen s’offre à nous : le Désarmement. Encore faut-il qu’une Puissance de premier ordre commence et je dis que c’est à la France qu’est dévolu l’honneur de donner l’exemple.
Désarmement moral et désarmement matériel ; l’un et l’autre sont indispensables et indissolublement solidaires. Le Désarmement matériel est impossible s’il n’est pas la transposition dans le domaine des faits du Désarmement moral ; et le Désarmement moral serait vain s’il n’amenait pas le Désarmement matériel.
Je ne dis pas que le Désarmement, c’est la Paix définitive, indestructible. Seule, la suppression du régime social qui repose sur le principe d’Autorité peut enfanter et enfantera cette Paix définitive et indestructible. Je persiste à affirmer que la forme actuelle de l’Autorité politique : l’Etat et la forme actuelle de l’Autorité économique : le Capitalisme portent en elles la Guerre entre les Nations comme elles la portent, au sein de chaque nation, entre les classes qui composent celle-ci et, au sein de chaque classe, entre les individus et les groupements qui constituent chaque classe.
La Paix, la vraie Paix ne s’édifiera donc que sur les ruines du monde social actuel, sur l’effondrement du Principe d’Autorité et des Institutions qui en procèdent : le Capitalisme, autorité sur les choses et l’Etat, autorité sur les personnes.
Pas un instant, au cours de cette étude que je viens d’écrire avec tout mon cœur comme avec toute ma raison, je n’ai perdu de vue le but suprême à atteindre : la transformation sociale, transformation vaste et profonde (voir le mot Révolution) qui ne laissera rien subsister de ce qui s’opposera à cette devise anarchiste : Bien-Etre et Liberté. Allant au plus pressé, étudiant le problème dont la solution est urgente : le moyen pratique et immédiat d’empêcher la Guerre, je me suis arrêté au Désarmement. Je m’y suis arrêté avec d’autant plus d’ardeur et de confiance que ce Désarmement mène à la Révolution Sociale en même temps qu’il est l’unique moyen de faire reculer la Guerre.
Je conclus : il serait déraisonnable d’attendre d’un Gouvernement quelconque qu’il prît de lui-même l’initiative d’un Désarmement dont il donnerait l’exemple. Tout Gouvernement est dans la nécessité d’appuyer sur la force les pouvoirs qu’il détient. Se désarmer équivaudrait pour lui à un suicide à échéance plus ou moins rapprochée. Le peuple, rien que le peuple, en qui fermentent la haine de la guerre et l’amour de la Paix, peut imposer à ses Gouvernants l’obligation de désarmer. Il le peut et il le doit.
L’idée du Désarmement est en marche. Le prolétariat tient en mains la possibilité d’en commencer la réalisation. C’est lui qui, dans les manufactures d’armes, les arsenaux maritimes, les usines où on travaille pour les armements, l’équipement et les fournitures militaires, pour l’aviation de guerre et la fabrication des bombes qui incendient, stérilisent et tuent ; c’est lui qui produit tout ce qui forme l’arsenal de massacre. C’est lui, aussi, qui charge, transporte et décharge tous ces produits destinés aux œuvres de destruction et d’assassinat. Qu’il affirme son inébranlable volonté de paix et de désarmement en refusant son concours à la fabrication et au transport de tous ces produits. Exception faite des quelques opulents capitalistes qui s’enrichissent de cette fabrication et de ces transports, le concours et la solidarité agissante de tous lui seront assurés. Ce sera le premier pas, mais un pas décisif vers le Désarmement à imposer aux Pouvoirs publics ; la conscience populaire et l’agitation pacifiste feront le reste.
Et ce ne sera pas long : soutenu par ce désarmement effectif, le courant pacifiste deviendra rapidement d’une puissance telle qu’il ne tardera pas à être irrésistible. Alors, le Gouvernement se trouvera en face de ce dilemme ; de deux choses l’une : ou bien, il cédera et, dans ce cas, ce sera le Désarmement immédiat et, fort de cette victoire décisive qui attestera sa propre force et la faiblesse du Gouvernement, le peuple donnera l’assaut à celui-ci et ce sera la Révolution ; ou bien, le Gouvernement résistera et, dans ce cas, le courant pacifiste, devenu irrésistible, le culbutera. Ce sera, alors, la Révolution d’abord et ensuite le Désarmement.
C’est ainsi que tout se tient et s’enchaîne, que tout est dans tout, que le problème d’aujourd’hui : la Paix ou la Guerre, conduit logiquement à celui de demain : le Désarmement ou la Révolution sociale.
— ***Sébastien FAURE***.
PAIX (LA SCIENCE ET LA)
L’idée de Paix, à notre époque, ne rencontre plus que de rares adversaires. Peuples, gouvernements, poètes, philosophes sont pacifistes ; du moins, ils l’affirment. Il est donc permis de dire, qu’en règle générale, tout le monde est pour la Paix. Comment se fait-il, dès lors, que les guerres soient encore possibles ? D’où vient qu’en présence d’une telle unanimité le déclenchement des grandes tueries se puisse encore produire ? Devrons-nous donc nous résigner, et renoncer à jamais à l’espérance de voir enfin la Paix rayonner sur le monde ? Nous ne le croyons pas. Non que nous ayons dans la sagesse des hommes une confiance excessive, mais nous pensons que les événements (et certains, comme par exemple le progrès scientifique et industriel) peuvent avoir sur le destin et la volonté des hommes une influence considérable et parfois salutaire. C’est précisément ce que l’actualité semble devoir vérifier.
Depuis quelque temps, en effet, un élément nouveau, un facteur important s’est fait jour, qui est appelé à jouer dans les problèmes de la Guerre et de la Paix un rôle, selon nous, décisif. Et c’est la science, à qui nous devons déjà tant de progrès utiles, qui nous apporte encore, sous une forme évidemment curieuse, la solution de ce difficile problème. Cette solution, ce remède, cet instrument de Paix aussi inattendu que paradoxal, c’est l’Arme chimique, ou Guerre des Gaz. Et il ne s’agit pas là de la Guerre chimique, telle qu’elle fut pratiquée durant la guerre de 1914, encore qu’elle ait laissé de bien cruels souvenirs à des milliers de combattants, gazés incurables, qui achèvent péniblement, au milieu de continuelles souffrances, une existence plus que misérable. Nous entendons parler de la guerre telle qu’elle apparaîtrait demain, si cette calamité venait à nouveau s’abattre sur nous, de cette guerre dont la nouveauté réside en ce fait que ses victimes se recruteront surtout parmi la population civile.
Il est incontestable et incontesté que si une nouvelle guerre éclate, ce sera une guerre aéro-chimique, empoisonneuse, incendiaire, et peut-être bactériologique. Or, une telle guerre, de l’avis de toutes les compétences, serait tout simplement la fin de la civilisation. On ne peut, sans avoir examiné de près cette question, se faire une idée, même approximative, des ravages que peut faire la nouvelle arme.
Nous donnons, ci-après, quelques exemples déjà anciens, quoique récents, car la chimie fait du chemin. Des progrès considérables ont certainement été réalisés depuis la mise à jour des documents qui suivent ; mais ces indications, quoique incomplètes, pourront aider le lecteur à se former une opinion sur ce triste sujet.
* * *
L’arme chimique utilise les produits les plus toxiques qui soient connus, ceux dont l’action sur notre organisme est la plus destructrice. La méthode d’emploi consiste à gazéifier ou à réduire ces produits en fines particules, à les diviser, les pulvériser, de manière à former des sortes de nuages dans lesquels on immerge les êtres que l’on veut détruire. Ces gaz sont enclos par quantités énormes dans des bombes légères qui les libèrent au moment voulu. Ce sont généralement les avions qui sont chargés de les transporter et les faire pleuvoir sur les points choisis par l’assaillant. Naturellement, il est impossible, en l’état actuel de la science, de s’opposer à l’action terrible de ce moyen de combat. Les masques, en raison de la grande variété des gaz, sont devenus absolument illusoires, et d’ailleurs, on n’a pas toujours un masque approprié sous la main. Comme, au surplus, beaucoup de ces poisons gazeux sont incolores et inodores, que rien ne décèle leur présence, on voit la difficulté de se protéger contre de telles agressions. Si seulement il existait un moyen de parer à une attaque de ce genre, si les avions, si les porteurs de mort pouvaient être arrêtés en chemin, s’il était possible de dresser des obstacles sur leur passage ! Mais, là encore, rien à espérer. La démonstration en fut faite souvent, et notamment à Londres, lors des manoeuvres aériennes de 1927, où 250 avions figuraient les assaillants. Sur ce nombre, et malgré des précautions formidables, 16 seulement d’entre eux furent découverts ; découverts, mais non pas empêchés et les 234 autres ne furent même pas aperçus. S’il se fût agi d’une attaque véritable, c’est par centaines de mille qu’on eût compté les victimes, que rien ni personne au monde ne pouvait protéger.
Les mêmes expériences ont apporté les mêmes conclusions à Nancy, à Toulon, à Lyon, à Paris, etc. Il ne reste donc, aux populations attaquées, aucun espoir d’échapper aux atroces conséquences des gaz, et c’est la mort certaine, précédée souvent d’une épouvantable agonie ! Ajoutons que la fabrication des gaz de combat est une des plus économiques et des plus faciles qui soient. La plupart des usines où se fabriquent des produits chimiques peuvent être immédiatement transformées en vue d’une production considérable de gaz.
Les dangers de l’arme aéro-chimique ont été dénoncés par d’éminentes personnalités : MM. Michelin, les professeurs Langevin, Haller, etc. ont maintes fois attiré l’attention du public sur ce sujet. Le gouvernement français lui-même y a fait allusion, dernièrement, à l’occasion de la nomination, comme inspecteur de l’Aviation, du Maréchal Pétain. Le rapport au Président de la République signale « l’extrême danger que ferait courir au pays une forme d’agression dont l’emploi se généralisera dans les conflits futurs ». Il dit encore :
« La tâche est vaste et puissante puisqu’elle équivaut à organiser ce que l’on peut appeler la Guerre des arrières. »
Tous les Etats, sans exception, sont préoccupés de la question et ont pris des dispositions en conséquence. De toutes parts, des usines, des établissements spéciaux sont édifiés pour l’étude ou la fabrication de l’arme chimique. L’Angleterre possède, près de Salisbury, d’immenses laboratoires spécialisés dans l’arme des gaz : ces laboratoires occupent en permanence une cinquantaine d’ingénieurs-chimistes. Les Etats-Unis, de leur coté, travaillent sans relâche le problème dans leurs établissements d’Edgewod, les plus grands du monde : 400 hectares. L’Italie a organisé un service chimique de guerre, auquel s’intéresse vivement son gouvernement : c’est en mars 1926 qu’a été publié le décret royal relatif à son fonctionnement. Le service chimico-militaire compte déjà plus de 200 officiers. En Russie, l’industrie chimique est développée à un degré inimaginable, et de nombreuses usines à gaz asphyxiants ont été installées à Karkow, Kiev, Smolensk. Pour l’Allemagne, il est inutile d’appuyer. Toutes ses industries chimiques (et elles sont nombreuses !), d’accord avec le gouvernement, ont prévu la question, et peuvent se transformer immédiatement en fabriques de poisons de guerre. D’autre part, son aviation commerciale, qui est considérable, peut être, en un clin d’œil, mise en état de collaborer aux nouvelles méthodes de combat. En Pologne, il existe à Cracovie et à Varsovie, des cours spéciaux pour l’étude de gaz toxiques. En Tchécoslovaquie, les usines se multiplient et une station pour les essais de gaz existe à Bistrowa, près Olmutz. Le Japon dépense des sommes énormes pour l’étude des gaz de combat, et ses chimistes sont très renseignés sur ce que font les autres pays, où ils se sont rendus pour études, envoyés par leur gouvernement. L’Espagne elle-même possède deux établissements pour les gaz : l’un aux environs de SanFernando, l’autre dans le district de San-Marto-de-Péridas. Quant à la France, traditionnelle, elle suit le chemin que lui tracent les autres, mais elle suit, puisque notre Conseil Supérieur de la Guerre possède une commission des études chimiques de guerre.
* * *
Nous voici donc fixés : le monde entier se prépare à la guerre des gaz. Ces petits cadeaux, que de toutes parts élabore la chimie guerrière, nous viendront, doux présage ! des profondeurs du ciel. Comme nous n’avons pas pour but l’initiation à la technique des gaz, mais seulement la vulgarisation de l’arme chimique, nous désignerons sans ordre ni méthode le nom de quelques gaz. D’ailleurs les personnes qui désireraient une documentation plus complète sur ce sujet pourront avoir recours aux ouvrages spécialisés, qui sont nombreux. Nous leur recommandons le livre intitulé : « La Guerre des gaz », de Carl Endres, et « Autour de la Paix chimique », de Henri Le Wita, à la documentation desquels nous avons eu nous-mêmes recours. La liste des toxiques que nous donnons sera évidemment incomplète, car leur nombre s’accroît chaque jour. Au surplus, il n’est pas facile de les connaître tous, chaque détenteur en gardant jalousement le secret. Les suivants sont donc, en quelque sorte, officiels. Certains portent des noms évocateurs, et d’une éloquence appropriée. Ecoutez cette symphonie.
Les gaz de combat connus se divisent en : asphyxiants, lacrymogènes, cyanhydriques, moutardes, arsines, explosifs et incendiaires. Leurs subdivisions donnent : le brombenzylcyanide, le chloracétophénône, le phosgène ou oxychlorure de carbone, le palite, le nitro-chloroforme, le dichloréthysulfide, ou ypérite, la diphénylchlorarsine, la diphénylcyanarsine, la diphénylaminchlorarsine, ou adamsit, l’ethyldichlorarsine, la lewisite M. ou chlorvinyldichlorarsine.
Les moins dangereux, les gaz lacrymogènes, limitent leur action aux muqueuses humides ; ils attaquent les yeux, les bronches, les poumons, et même l’estomac. Le chlore provoque la mort en 30 minutes dans la proportion de 3 milligrammes par litre d’air. Mais le phosgène (oxychlorure de carbone) est autrement dangereux, et la quantité nécessaire pour donner la mort est encore plus minime ; il suffit d’en avoir respiré quelques traces, pour que, même beaucoup plus tard, ses effets se fassent sentir. Le cas de ce chimiste italien, le professeur Fénaroli, est typique.
« Ayant subi un commencement d’empoisonnement au cours d’une expérience, le professeur rentra chez lui. Ce n’est que dans la nuit qu’il se sentit indisposé. Le lendemain, il était mort. »
Les effets du phosgène sont atroces ; le gazé souffre d’un étouffement progressif, la respiration est saccadée ; il meurt enfin, le regard désorbité, la bave ou l’écume aux lèvres. La puissance du phosgène est telle que deux tonnes de ce gaz suffiraient à anéantir une ville comme Paris.
Le nitrochloroforme, ou vomiting-gaz des Anglais, provoque d’épouvantables nausées ; il est déjà mortel dans la proportion de 1 milligramme par litre d’air. Le gaz moutarde ou ypérite (dichloréthysulfide) est plus terrible encore. Ce gaz, emporté par le vent à plus d’un kilomètre, est encore fort dangereux. Mélangé à l’air dans la proportion de 0,07 milligrammes par litre d’air, il est mortel dans tous les cas. C’est un poison cellulaire qui tue sans résistance possible toutes les cellules qu’il touche. Quand il ne tue pas tout de suite, son contact amène des nécroses et des plaies purulentes fort profondes, ouvrant les portes à toutes les infections microbiennes. Les yeux, les poumons, le sang sont atteints, et chez les adultes, se sont les organes sexuels qui sont les premiers touchés. La diphénylaminchlorarsine a été découverte par un Américain ; c’est un poison particulièrement concentré, puisqu’une partie de ce gaz contre 30 millions de parties d’air, suffit à donner la mort. Ce gaz traverse immédiatement les masques à gaz ordinaires. La lewisite, outre son action terrible sur les yeux et sur les organes de la respiration, présente encore cette particularité d’attaquer tous les points du corps qu’elle touche. Son influence, au début, se traduit par d’irrésistibles démangeaisons. D’autre part, le major Nye parle d’un nouveau gaz (connu, paraît-il, des Russes), dont l’action serait telle que dans la proportion d’un dix-millionième, il suffit à mettre un homme hors de combat dans l’espace d’une minute.
Des expériences ont été faites, dès lors, sur des animaux, à l’aide du gaz en question ; sur un troupeau de chèvres qui avait été exposé dans un endroit clos aux effets d’un nuage extrêmement dilué, toutes les bêtes furent tuées, à l’exception de quatre qui, prenant la fuite, et devenues folles, se brisèrent le crâne contre un mur. Mille bombes de ce gaz suffiraient, dans des conditions favorables, à gazer une capitale de grande étendue. Une bombe à gaz courante pèse environ 5 livres ; un avion moderne de transport peut en transporter 600. On voit que deux avions seulement suffiraient à gazer un espace aussi grand que Londres, Paris ou Berlin.
Enfin, au sujet des bombes incendiaires, le lieutenant-colonel Wauthier écrit :
« Les avions de guerre seront chargés de bombes « Elektron », du poids de 1 kilo seulement, mais dont la température de combustion atteindra 3.000 degrés. Cent avions porteurs de ces gaz pourront allumer dixsept mille incendies. Supposons que Paris reçoive la visite de cinq seulement de ces avions ; c’est encore, pour le moins, huit cent cinquante incendies qui éclateront dans la capitale. »
Nous arrêterons là ces quelques exemples qui suffisent, croyons-nous, à donner une idée de l’efficacité des nouveaux moyens de combat. Il est à remarquer que l’arme chimique ne peut servir utilement qu’avec le concours des avions. On conçoit que sur le sol, l’assaillant risquerait, soit par suite d’un vent défavorable ou pour toute autre raison, d’être la victime de ses propres armes. Or, l’aviation a fait en tous pays des progrès énormes, et comme il n’est pas besoin d’avions spéciaux, d’avions militaires pour transporter les bombes légères, qui contiennent les gaz, n’importe quel avion de tourisme sera donc à même de fournir à la chimie une utile collaboration.
* * *
En présence des moyens de guerre si puissants et si meurtriers, chacun va se demander si on osera s’en servir. De l’avis des militaires, cela ne fait pas le moindre doute. Tous les spécialistes sont d’accord à ce sujet, et l’on rencontre partout des opinions dans le genre de celle du général Fries qui dit :
« La guerre de l’avenir sera gagnée par les généraux qui feront le plus grand usage de l’arme chimique. »
Cela se conçoit fort bien ; quand on fait la guerre, il faut la gagner ; dès lors, tous les moyens sont bons. On s’est, d’ailleurs, aperçu que les guerres modernes ne se gagnaient pas uniquement sur les champs de bataille, car la nation tout entière concourt à entretenir et à alimenter la résistance. Dès lors, les premiers objectifs à atteindre sont surtout les centres industriels et économiques, les entrepôts, les usines, les ateliers de munitions pour lesquels, jadis, « le front » constituait un rempart, mais qui sont devenus aujourd’hui parfaitement vulnérables, grâce à l’arme aéro-chimique.
Les populations civiles, travailleurs, hommes, femmes, enfants, seront donc particulièrement visées, et voici, d’après Carl Endres, quelles seraient, sous ce rapport, les conséquences d’une nouvelle guerre :
« La situation de la défense sera tellement désespérée du fait de la rapidité et des autres avantages dont disposera l’assaillant, qu’il paraît probable que l’on renoncera très vite à entretenir des forces de défense aérienne, et que tous les efforts tendront à diriger des contre-attaques sur l’intérieur du pays ennemi. Ainsi, c’est une effroyable course au massacre qui se déclenchera. Le résultat c’est que les populations civiles, des deux côtés, subiront des pertes considérables et qu’une immense quantité de biens et de trésors, représentant l’héritage de la civilisation, seront anéantis. Les usines du pays le plus faible cesseront très vite de tourner. Il n’y aura plus de direction politique centrale. Les villes qui ne seront pas encore brûlées ou gazées seront abandonnées par leur population poussée au désespoir, et qui se réfugiera en masse dans les forêts, dans les montagnes, dans les parties les plus pauvres du pays, ou même, quand ce sera possible, à l’étranger ; des famines et des épidémies terribles redoubleront les horreurs de cette guerre faite par un monde qui se qualifie de civilisé. Et sur des ruines, qu’il sera à tout jamais impossible de relever, les misérables restes des peuples belligérants concluront une Paix, qui, à coup sûr cette fois, ne sera suivie d’aucune nouvelle guerre. »
Et il conclut :
« Il se peut que l’Humanité souffrante, poussée par une colère déchaînée, lynche ceux qui, en politique, en paroles et en écrits se sont faits les prophètes du vieux système du règlement de compte par la guerre. »
* * *
Nous voici maintenant renseignés. Nous savons ce que serait une guerre en l’état actuel des armements. Or, c’est justement ce qui nous rassure. En effet, nous ne pensons pas, malgré ces horribles perspectives, qu’il y ait lieu de se frapper. Au contraire, c’est l’occasion de vérifier l’exactitude de ce vieux principe qui veut que le bien résulte très souvent de l’excès même du mal. Notre opinion est donc nettement optimiste. Aussi le lecteur est-il invité à examiner, avec attention, cette thèse, en apparence paradoxale, que le développement de l’arme aéro-chimique doit inaugurer l’ère de la Paix entre les Peuples.
En effet, les guerres n’existent, ne peuvent exister que du fait qu’une partie de la population n’y prend pas une part effective. Il saute aux yeux que ceux qui veulent la guerre, ceux qui y ont intérêt, ceux qu’elle sert, ne doivent participer d’aucune manière à ses dangers. A quoi leur servirait l’argent, même la gloire ramassés sur l’hécatombe s’ils devaient faire partie des victimes ?
Dans toute guerre, il y a inévitablement l’avant et l’arrière. A l’avant sont les héros plus ou moins volontaires. Plus en arrière sont les gendarmes dont la mission est de maintenir dans les bonnes traditions du courage militaire, ceux qui seraient tentés d’y faillir. En arrière encore, on rencontre les Etats-majors à qui est dévolue l’élaboration des magnifiques plans stratégiques et tactiques dont nous connaissons, hélas ! les effets. Puis, tout à fait à l’arrière, ceux qui assurent l’armement et la vie matérielle du pays, ouvriers et ouvrières de l’usine ou des champs. On conserve aussi à l’arrière, des hommes qui ont la charge d’entretenir en bon état le moral des Nations : Ecrivains spécialisés, poètes du genre, chanteurs, journalistes, répandent chaque jour en vers et en prose, dans une presse savamment censurée, une confiance inébranlable, annonçant les victoires des chefs, les replis des soldats, tout en magnifiant comme il convient la puissance de l’armée et le courage de ses héros.
Au centre de tout ceci, le gouvernement et les parlementaires palabrent et marquent les coups, tandis que les commerçants et industriels fabriquent et vendent, qui des armes, qui des chaussures, qui des vêtements, qui des munitions, que, en un mot, les uns et les autres font des affaires. Comme l’arrière, d’autre part, abrite aussi des étrangers qui dépensent de l’argent, d’autres qui en gagnent, qu’il y a des embusqués qui s’ennuient, des femmes libres, des travailleurs d’usines qui ont le filon, des hommes trop jeunes, des hommes trop vieux, alors... que voulez-vous, il faut bien vivre : les théâtres s’ouvrent, les lieux de plaisirs se créent petit à petit, et ceux de l’arrière, sauf exceptions rares, en arrivent à oublier que la guerre existe, que là-bas, sur le « front », pères, frères, maris, dans le froid, dans le sang, dans la neige et dans la boue, souffrent et meurent. Ils sont d’ailleurs loin, les pauvres combattants, et nul ne pourrait entendre leur râles, ni leurs gémissements !
L’énergie de l’arrière reste donc intacte ; et son courage et son civisme ne font que grandir avec les jours, et ce courage et ce civisme exigent impérieusement la victoire, non pas une victoire quelconque, mais la vraie victoire, une victoire complète. Quelque temps que cela puisse durer, il n’importe : on résistera, et l’arrière tout entier fait serment de tenir jusqu’au bout, Le gouvernement, de son côté, ne se montre jamais inférieur ; il tient ses séances régulièrement, insouciant du danger. Si pourtant, par un hasard invraisemblable, les ennemis poussaient l’indiscrétion jusqu’à s’approcher trop, il serait prêt, lui aussi, aux sacrifices utiles. Sans hésiter, malgré les ennuis d’un déménagement hâtif, il se transférerait plus loin, aussi loin qu’il serait nécessaire, pour proclamer, du haut de sa nouvelle tribune, la foi inébranlable du pays dans l’héroïsme et la ténacité des combattants.
C’est donc à l’arrière, on le voit, et à l’arrière seulement, que vibre et palpite intacte l’âme de la guerre et du courage persévérant.
Mais que va-t-il advenir de cette âme collective, de ce courage, avec l’arme aéro-chimique, quand le champ de bataille aura changé de front, ou, si l’on préfère, qu’il n’y aura plus de front, que les gaz et l’incendie, venus par avions, ne choisiront plus leurs victimes et frapperont aveuglément sans prévenir, les cités, les gouvernements même, les pauvres, les riches, les hommes, les femmes et les enfants ? Qu’adviendra-t-il de ce courage, quand l’arrière tout entier, avec ses habitations, théâtres, usines, se trouvera exposé, tout autant, sinon davantage, que les soldats du front ? C’est pourtant là ce que nous réserve la prochaine dernière !
Et que l’on n’aille pas compter sur l’ « Humanité » de l’adversaire pour épargner les « innocents ». Le seul fait que les peuples n’auraient pu s’entendre pour éviter un conflit dont ils ne pouvaient méconnaître les résultats, établirait la preuve que les hommes ne sont pas, dans leur ensemble, guéris de leur féroce imbécillité. Si des puissances font la guerre, c’est pour la gagner, dès lors (nous en avons déjà vu des exemples), les adversaires ne ménageront rien ni personne, et feront l’impossible pour obtenir, par tous les moyens, une décision rapide, afin d’imposer les conditions d’armistice qu’elles auront choisies.
Nul n’a donc plus rien, désormais, à espérer de la guerre. Pas plus l’arrière que l’avant, pas plus le riche que le pauvre, le maître que l’ouvrier. Les vautours eux-mêmes et les corbeaux n’y pourront trouver avantage, puisque les charognes dont ils se repaissent seront empoisonnées. Vivent donc les gaz, s’ils ont cette conséquence inattendue, en rendant la guerre plus atroce, de la rendre impossible ! Surtout, si par une sorte de choc en retour, ce sont les fauteurs et les bénéficiaires de guerre, principalement, qui les premiers, devront en subir la rigueur.
Ceci admis, quel gouvernement oserait déclencher une guerre, certain que la population tout entière et lui-même se trouveront sans défense possible, exposés aux coups de l’ennemi, tout autant et plus encore que le combattant en uniforme, et sachant qu’au surplus, la fuite, même jusqu’à Bordeaux, ne saurait le protéger ?
On a objecté à ce raisonnement : Pourquoi un autocrate aux abois renoncerait-il à la guerre comme dérivatif, puisque, justement en raison de l’efficacité des armes modernes, il serait certain au moyen d’une attaque-surprise d’anéantir une ville, et d’amener, par conséquent, l’adversaire à capituler ? Qu’une attaque brusquée lui permette de mettre en cendres la capitale ennemie, c’est hélas ! possible, mais il n’aura pas réduit, de ce fait, tous les centres d’aviation disséminés sur le territoire visé. Il devra donc s’attendre, en admettant même l’indifférence des Etats voisins, à des représailles impitoyables et terribles. Ayant semé l’horreur il récoltera l’horreur, mais de victoire, point !
Il ne reste donc actuellement que deux solutions : La Paix, ou la fin du monde civilisé.
Quel est, dans ces conditions, l’homme d’Etat, le chef, le dictateur qui oserait attaquer une autre nation, sachant les représailles toujours possibles, et sachant aussi que lui-même devra. subir, d’une manière ou d’une autre, l’inévitable châtiment de sa monstrueuse initiative ?
Cela, les gouvernements le savent parfaitement ; s’ils paraissent faire crédit à l’éventualité d’une guerre, c’est pour nous en faire partager la crainte, parce que cette crainte est, pour les Etats autocrates, un moyen de gouverner. Néanmoins, aucun ne la désire, et tous les gouvernements, soyons-en certains, feront l’impossible pour l’éviter. Jamais, d’ailleurs, ils ne se seront trouvés en meilleure posture qu’actuellement pour organiser la Paix, et s’en attribuer le mérite. Mais qu’ils se hâtent...
Voici donc les gaz, les plus redoutables des instruments de meurtre, devenus, par un singulier retour des choses, un argument et une arme puissante, entre les mains des pacifistes. Faites connaître autour de vous les dangers de la guerre chimique ; répandez cette vérité qu’une attaque aéro-chimique est imparable ; expliquez à tous ses effets atroces et inévitables, que surtout nul ne l’ignore. A cet instant, la guerre aura vécu, les gaz l’auront tuée.
Et que l’on n’aille pas trouver puérile cette argumentation. Nous défions les hommes, pour si courageux qu’ils soient, ainsi que les chefs, nous défions les uns et les autres de rester impassibles devant un danger qui frapperait si cruellement les leurs, leurs femmes, leurs enfants, leurs vieux. Tant qu’il ne s’agira que de leur propre existence, soit ! ils seront prêts à en faire le sacrifice pour des convictions, par intérêt, pour un peu de gloire, ou encore pour ce qu’ils croient être leur devoir. Mais cette pensée que les gaz, ce fléau égalitaire, invisible et mystérieux, pourraient frapper ceux qu’ils aiment, c’est une éventualité dont l’idée seule leur serait insupportable, et tous, tous ceux qui auront conservé quelque chose d’humain se dresseront, nous en sommes sûrs, indignés et pleins de haine, contre tous les fauteurs de guerre quels qu’ils soient, s’il en pouvait encore exister. Sébastien Faure a prononcé cette phrase lapidaire et vraie :
« On fait la guerre avec la peau des autres. »
L’arme aéro-chimique heureusement a changé tout cela ; c’est pourquoi nous avons confiance en l’avenir.
Mais il est indispensable, nous le répétons, que ces dangers soient connus davantage, qu’ils soient connus de tous. C’est à vous pacifistes de tous pays, pacifistes mes frères, qu’il appartient d’en répandre autour de vous la certitude et l’horreur.
* * *
Pourtant, il existe un autre danger. Certains gouvernements manifestent, tant est grand leur amour pour le peuple, un souci très marqué d’établir en ce qui concerne la guerre, une sorte de règle du jeu. Ils envisagent, et cela fort sérieusement, de codifier, de régulariser, de donner en quelque sorte un statut à ce vieux sport qu’est la guerre. Il y aurait comme dans tous les jeux, des coups permis et des coups défendus. On désignerait, au moyen d’un uniforme voyant, les personnes qu’on aurait autorisé à exterminer loyalement, ainsi que celles qu’il faudrait respecter (les grades et les conditions ne sont pas encore désignés, mais on peut essayer de s’en faire une idée). L’emploi des gaz serait défendu dans certaines zones, en raison des dangers qu’il pourrait faire courir aux simples spectateurs, à ceux ne portant pas la « marque », c’est-à-dire ne faisant pas, par conséquent, partie des joueurs.
La guerre chimique serait donc réglementée. On n’en pourrait faire usage qu’en certaines circonstances et avec discernement. Des endroits seraient désignés qu’on pourrait appeler ainsi qu’il a été proposé, « les Lieux de Genève ». Là, leur emploi serait interdit ; ailleurs il serait autorisé. En circonscrivant ainsi le terrain du combat, on éviterait la confusion entre les combattants, les vrais, ceux qui ont obtenu licence de mourir, et les autres, les malins et les innocents... comme si le troupeau de ceux qu’on mène de force à l’abattoir n’était pas, lui aussi, composé d’innocents !
Ces projets de réglementation qui se présentent à l’examen impartial comme une sinistre plaisanterie, sont cependant en voie de réalisation ; certains articles même sont d’ores et déjà admis par la Société des Nations. Au lieu de condamner la guerre, ces Messieurs condamnent l’emploi des armes dites inhumaines ; les autres, les armes humanitaires, telles le canon, le fusil, la mitrailleuse, le couteau à cran, les bombes, les obus, etc. restent admises.
Les résultats de pareils projets apparaissent heureusement fort problématiques. Aucun pays ne se pliera jamais à cette discipline, ne consentira à se priver de l’outil de guerre redoutable qu’est l’arme chimique, ceci dans la crainte légitime que l’adversaire revenant sur les engagements pris (cela s’est déjà vu) n’en fasse lui-même usage (bien qu’illégitimement), pour s’assurer l’avantage.
La réglementation des armements est donc une convention absurde et inopérante. Le succès d’un tel projet, dont la candeur le dispute au cynisme, nous apparaît à nous, comme un désastre. S’il réussissait, ce ne serait ni plus ni moins que le rétablissement de l’ancienne arme de combat : le Front, si bien décrit par les Barbusse, Dorgelès, Remarque, Chevalier, etc., cet enfer où, comme disaient les autres, « ce sont toujours les mêmes qui se font tuer ».
Et la guerre pourrait recommencer, fraîche et joyeuse pour ceux qui ont l’habitude d’en tirer profit. Or, la guerre n’aura vécu que si nul n’y peut trouver bénéfice, et si ses risques s’affirment rigoureusement les mêmes pour tous, pour tous sans exception, y compris les chefs et les marchands.
L’Arme chimique réalise ces conditions ; c’est pourquoi la Paix sera une Paix chimique.
— Charles MOCHET.
PAIX (LA PAIX PAR L’ÉDUCATION)
La paix n’est pas seulement l’absence de guerre. Un état social où la justice n’existe pas, où les valeurs morales sont dominées par les forces matérielles, n’est pas un état de paix. La violence en reste la règle. L’injustice attise les colères et engendre les haines. Les passions s’entrechoquent, provoquant révoltes et révolutions, querelles de parti, émeutes et bagarres. Dans ces conditions, l’absence de guerre n’est qu’une apparence de paix. La paix véritable est impossible à réaliser sans la justice. C’est ce qui explique qu’une guerre soit génératrice d’une autre guerre, les traités qui terminent un conflit étant en général des mesures de violence imposées aux vaincus par les vainqueurs. Il n’y a pas de guerres justes, a-t-on dit. On peut ajouter que tous les traités de paix sont des monuments d’injustice. Et il en sera ainsi tant que l’esprit de violence n’aura pas été répudié par les individus et les peuples, tant que l’esprit de paix ne sera pas entré dans les mœurs.
La paix est donc, avant toute chose, un état d’esprit. Certains individus sont pacifiques par nature, d’autres le sont par raisonnement ; mais ce qu’on peut affirmer, c’est qu’il n’est point possible d’être pacifique, si l’esprit n’est point pacifié. En l’état actuel des choses, tout concourt à maintenu les esprits dans la violence. L’éducation, la presse, les préjugés et la routine, sont les facteurs par excellence de cette formation de l’esprit. Disons mieux : de cette déformation, car il n’est pas exact de dire que l’homme est naturellement porté à la guerre. L’homme aspire au bonheur. Pour accepter la guerre, les souffrances et les misères qu’elle engendre, il faut qu’il y ait déformation de sa nature par la pression continue, sur son cerveau, d’un fanatisme nationaliste et d’une mystique guerrière obnubilant chez lui le simple bon sens. Ce fanatisme commence avec la première éducation donnée à l’école, par l’exaltation de la patrie, la méfiance à l’égard des étrangers, la haine même pour ceux qu’on appelle les ennemis héréditaires. Plus tard, la lecture des journaux, les fêtes et représentations patriotiques, le service militaire, l’armée, continueront l’œuvre de cette première éducation. Devenu adulte, l’individu sera le plus souvent incapable de réagir contre cette mentalité qu’on aura développée en lui pendant les vingt premières années de sa vie.
Il y a là, pour les éducateurs, matière à méditation. Si la paix est un état d’esprit, une manière de penser, il faut donc que la formation morale et intellectuelle de l’enfant tende toujours vers le principe d’harmonie. L’éducation de l’enfance devra servir la cause de la paix. Toutes les matières de l’enseignement seront soigneusement examinées. Non seulement la lecture et l’histoire peuvent servir l’esprit de violence en exaltant la guerre et les héros militaires ; mais encore une étude littéraire peut développer le nationalisme en glorifiant démesurément les écrivains d’un pays, en les déclarant supérieurs à tous les autres ; un simple devoir de grammaire peut prendre ses exemples dans les récits belliqueux.
Cependant, le rôle de l’éducateur ne se bornera pas au contrôle des livres et des matières enseignées. Il ne devra pas hésiter à condamner nettement la guerre et le recours à la violence entre les peuples. Il devra également dénoncer les injustices et les violences de la vie courante et de l’état social. S’il ne le fait pas, il risquera de rendre stériles ses efforts d’éducation pacifique par le contraste de cette éducation avec les tableaux que l’enfant pourra voir journellement autour de lui.
Tâche essentiellement délicate, car il convient de condamner le mal sans violence et sans haine, et d’attaquer l’erreur sans attaquer les hommes : les hommes se sont trompés ; leur ignorance a causé ce désordre et cette injustice que nous constatons, mais on ne peut pas condamner les hommes pour leur ignorance ; il faut les éclairer, faire appel à la raison ; c’est par l’esprit que l’humanité doit s’élever vers la vraie justice, génératrice de la véritable paix. Voilà ce que dira l’éducation rationnelle et sage.
Le premier travail de paix, dans l’école, sera la suppression des rivalités entre écoliers. Le classement, les tableaux d’honneur, les récompenses, sont des méthodes dangereuses. Ces usages, en favorisant les mieux doués intellectuellement, qui ne sont pas toujours les meilleurs et les plus courageux, développent l’orgueil et l’égoïsme des favorisés, font naître le ressentiment chez les moins bien partagés. Le sentiment d’une injustice subie, crée un état de révolte passive pernicieuse au développement moral. Qu’on se contente de comparer l’enfant à lui-même, et d’encourager ses efforts. Qu’on le stimule par le désir d’accroître sa valeur propre ; non en le comparant à tel ou tel de ses camarades, mais à ce qu’il fut le mois précédent ou l’année écoulée. Ce stimulant sera suffisant, si l’éducateur est conscient de sa tâche.
Puis enfin, l’éducateur rappellera souvent aux enfants dont il est responsable, la grande fraternité humaine à travers les âges, la solidarité naturelle qui relie l’homme à l’homme, et les peuples aux peuples. Il parlera des races dites inférieures avec bonté, les présentant comme des frères sans défense ayant droit à la protection des peuples plus cultivés et plus évolués. L’éducateur ne manquera jamais de faire appel à la sensibilité, à la générosité, au désintéressement qu on rencontre chez presque tous les enfants normaux. L’éducation donnée jusqu’alors a le plus souvent pour effet de cristalliser ces qualités qui sont cependant les sources de la vie spirituelle, et la condition du bonheur humain.
Les mères ont, naturellement, une importante part à apporter à ce travail de la paix par l’éducation. Premières éducatrices, ce sont elles qui donnent aux enfants la première orientation morale. Nous l’avons déjà dit, elles n’ont pas suffisamment compris, jusqu’à présent, ce rôle si délicat que l’humanité attend de leur mission maternelle. Le plus souvent, elles ont fait de leurs enfants des égoïstes, tout en croyant fermement travailler à leur bonheur. Ainsi faisant, elles les ont isolés de la communauté humaine.
Il faut savoir, ici encore, que la justice est à la base de l’harmonie du monde, et qu’il n’est pas possible d’assurer le bonheur de quelques-uns au milieu de la détresse générale. La mère intelligente et sage sera celle qui, sachant que son enfant n’est pas seul dans l’univers, l’élèvera dans le souci de l’humanité. Voulant son bonheur, elle voudra le bonheur de tous. Elle apportera sa contribution aux possibilités de ce bonheur commun en donnant à sa tâche maternelle une haute signification ; et son premier travail de paix sera la formation de cette âme enfantine qu’elle a pour mission d’élever vers le bien.
La première éducation de la paix consiste essentiellement à rendre l’enfant fraternel et bon. Plus tard on lui fera toucher des problèmes abstraits, où la philosophie et l’histoire entreront en jeu. Mais nous devons être persuadés qu’il ne les comprendra jamais si son âme d’enfant n’a point connu la générosité et la sensibilité. Le sentiment précède la pensée, qu’il stimule et éclaire, et nous ne pouvons penser que parce que nous sentons. Mais le sentiment, lui aussi, demande à être guidé et surveillé. Il faut aider nos petits à bien sentir, si nous voulons qu’un jour ils apprennent à bien penser.
— Madeleine VERNET.
PALÉONTOLOGIE
(du grec palaios, ancien, ontos, être, et logos, discours)
La Paléontologie est loin d’être une science morte. Elle a fait ses preuves, elle est appelée à prendre une place de plus en plus importante parmi les connaissances humaines. Elle ouvre au philosophe des horizons infinis, et peut-être nous permettra-t-elle de percer, un jour, le mystère des origines. Elle s’appuie sur les autres sciences, qui, elles-mêmes, s’appuient sur elle. Son but est de démontrer que l’homme n’est pas né d’hier, mais d’avant-hier, et qu’au lieu de sortir comme une créature parfaite des mains du créateur, il a été lentement engendré par toute la série des êtres qui l’ont précédé. C’est dire qu’il y a deux paléontologies : la paléontologie animale et la paléontologie humaine. Mais esquissons brièvement l’histoire de cette science. Nous apercevrons mieux, ensuite, son but et ses moyens.
La paléontologie se préoccupe, avant toute chose, de l’étude des fossiles, animaux et végétaux, conservés entièrement ou en partie dans les couches géologiques. C’est dire qu’elle ne peut se passer de la géologie, qu’elle s’appuie sur elle pour la dépasser. On pourrait ergoter sur le mot « fossiles », et ne l’employer que pour désigner les débris des espèces éteintes. C’est dans ce dernier sens que nous l’emploierons ici, sens qui a fait souvent donner à la paléontologie le nom de paléozoologie lorsqu’elle s’est préoccupée des animaux enfouis dans les entrailles du sol, et celui de paléobotanique, quand elle s’est appliquée à l’étude des anciens végétaux. Ces débris se sont conservés sous certaines influences, qu’il serait trop long d’énumérer ici ; d’autre part, les espèces disparues offrent plus d’un rapport avec les espèces actuelles. Elles permettent d’en mieux saisir l’évolution. L’évolution, mot qui n’a rien à voir avec les débuts de la science paléontologique, dont Cuvier peut être considéré comme le père. En remontant plus haut, on lui découvrirait des précurseurs chez les Grecs et chez deux ou trois savants des XVIe et XVIIe siècle. Ce n’est que lorsque la géologie a vraiment existé que la paléontologie a pu exister à son tour. Cuvier, dans les Ossements fossiles et son Discours sur les révolutions du globe, publiés dans la première moitié du XIXe siècle, a énoncé les grandes lois de la paléontologie. Mais Cuvier, savant officiel, respectueux de toutes les traditions, et ses disciples immédiats, prenant à la lettre son enseignement, n’avaient pas voulu entendre parler dfévolution. Et si, comme le savantasse Elie de Beaumont, ils affirmaient l’ancienneté de certains animaux fossiles, ils ne voulaient rien savoir en ce qui concernait l’ancienneté de l’homme fossile, qu’ils faisaient naître, avec la Bible, 4.000 ans avant notre ère, et ils proclamaient sur un ton qui ne souffrait point de réplique : « L’espèce humaine n’a jamais été contemporaine de l’Elephas primigenius ». Le règne animal a évolué paléontologiquement, et l’homme, bien qu’apparu le dernier sur la terre, remonte sans doute à des millions d’années ! Certains savants ont essayé d’accorder la paléontologie fondée sur la doctrine de l’évolution avec l’enseignement de l’Eglise, tel Albert Gaudry qui se fit l’ardent défenseur de l’hypothèse évolutionniste. Cette hypothèse ne s’opposerait pas, comme le croyaient Cuvier et ses disciples, aux dogmes chrétiens.
L’étude de l’anatomie comparée avait été pour Cuvier une révélation. Elle l’avait mis sur la voie d’admirables découvertes. Il compara les formes disparues aux formes vivantes. Alcide d’Orbigny, Charles Lyell, Lamarck et Darwin ont contribué, autant que lui, à jeter les fondements de la paléontologie. Albert Gaudry, dans ses Enchaînement du Règne animal, achève de donner à cette science droit de cité parmi les autres.
La paléontologie a ressuscité tout le passé de l’homme et de l’animal, dont les ossements ont été conservés dans les couches terrestres, formant comme les feuillets d’un grand livre qu’on pourrait appeler, avec Haeckel, la création naturelle. La phylogenèse nous fait assister à l’évolution de l’espèce dans le sein de la terre, elle est confirmée par l’ontogenèse ou constitution de l’être dans le sein de la mère. L’embryologie vient ainsi en aide à la paléontologie. Cette dernière a aussi d’étroits rapports avec la Préhistoire : elle est une de ses sources.
Nous ne ferons pas ici l’histoire des espèces qui se sont succédées dans les couches géologiques, ni l’étude du fœtus humain ; bornons-nous à dire que l’embryon passe, dans le sein maternel, par tous les états par où sont passés les espèces animales. C’est une récapitulation synthétique, les étapes du règne animal l’ont franchie rapidement. Ne subsiste que l’essentiel.
On sait que les terrains ont été divisés en primaires, secondaires, tertiaires et quaternaires, et que chacun d’eux comporte lui-même des divisions. La paléontologie a recueilli dans ces différents terrains des traces des animaux et de l’homme. Elle projette sur le mystère des origines humaines d’éclatantes lueurs. Alliée aux sciences connexes, elle nous met sur la voie de la vérité, de la vérité sans majuscule, qui nous dispense de recourir à l’hypothèse d’un Dieu ayant tiré le monde du néant, et fabriqué de toutes pièces, dans le Paradis terrestre, une créature parfaite. Désormais, on ne peut plus croire à ces balivernes. Elles cessent d’avoir cours. Seuls les cerveaux anémiés peuvent encore l’invoquer pour expliquer l’existence du ciel et de la terre.
— GÉRARD DE LACAZE-DUTHIERS
BIBLIOGRAPHIE sommaire (et récente) : Albert Gaudry : Les Enchaînements du Monde animal, les ancêtres de nos animaux dans les temps géologiques, Contemporanéité de l’espèce humaine et de diverses espèces animales aujourd’hui éteintes. — Boucher de Perthes : Des Arts à leur origine. — A. Nittel : Traité de Paléontologie. — Hornes : Manuel de Paléontologie. — Marcellin Boulé : Les Hommes fossiles. — Gérard de Lacaze-Duthier : Philosophie de la Préhistoire. — L. Joleaud : Eléments de paléontologie. — F. Roman : Paléontologie et Zoologie. — Binet-Sanglé : Nos ancêtres. — Goury : Origine et évolution de l’homme. — S. Blanc : Initiation à la Préhistoire. — Verneau : Les origines de l’Humanité, etc.
PALLIATIF
n. m.
On désigne par ce terme ce qui n’a qu’une efficacité incomplète ou peu durable. Dans l’ordre médical on qualifiera ainsi un remède qui peut soulager, mais non guérir ; dans l’ordre moral, le palliatif sera la demi-mesure qui masque le mal sans le faire disparaître. Notre science étant fragmentaire, nos moyens d’action limités, il faut bien se satisfaire de palliatifs, quand les procédés d’une efficacité certaine font défaut. Ainsi, lorsqu’il s’agit de souffrances intolérables ou de maladies impossibles à guérir, la morphine devient prodigieusement utile. Sous son action, la douleur se dilue, disparaît et une impression de bienêtre envahit l’organisme. De même la cocaïne est précieuse pour ses vertus anesthésiantes. Mais si elles suppriment la douleur, elles n’en font pas disparaître la cause. L’abus de ces drogues conduit aux pires conséquences. « Puisse la science découvrir un médicament qui, sans offrir de dangers sérieux, terrasse la douleur organique de façon définitive. Les stupéfiants actuels entraînent des désordres trop graves pour qu’on ne répugne pas à leur emploi quotidien » (Vers l’Inaccessible). Si le palliatif peut devenir dangereux dans l’ordre physique, c’est bien autre chose dans l’ordre moral. Le plus souvent, il n’est qu’une secrète abdication, un moyen hypocrite de détourner l’attention du seul remède efficace. « Quand l’Eglise conseille l’aumône, c’est pour prévenir une révolte des exploités : grâce au mirage d’une charité illusoire, l’injustice créatrice de misère peut subsister. L’usinier, devenu millionnaire en tournant des obus, sacrifiera de bon cœur quelque cents francs aux œuvres de mutilés. Deux ou trois billets, donnés aux pauvres ostensiblement, suffiront à blanchir le mercanti qui, un quart de siècle, rançonna ses clients. » Nous rencontrons de prétendus amis de la paix, qui, désespérant d’empêcher la guerre, à ce qu’ils assurent, se bornent à vouloir l’humaniser. Ils acceptent qu’on se tue avec la baïonnette, le fusil, le canon, etc., mais prétendent interdire l’emploi des gaz. Ils se résignent au massacre des soldats, mais souhaitent qu’on laisse indemnes les civils, ceux des grosses agglomérations en particulier. Le soi-disant anticléricalisme de certains cache un profond respect de la religion. Ce n’est pas contre les Davidées, c’est contre Barbedette et ses amis que sévissaient encore récemment des politiciens de gauche arrivés au pouvoir. On pourrait multiplier les exemples, car en politique surtout, les mesures qualifiées d’utilité publique ne sont, en général, que des palliatifs insuffisants. Heureux quand elles ne fortifient pas un mal qu’elles prétendaient guérir.
PAMPHLET
Ce mot, venu d’Angleterre et répandu en France depuis l’invention de l’imprimerie, a eu son origine dans le vieux mot composé français, palme-feuillet, dont la signification était : « feuillet qui se tient dans la paume de la main. »
A cause de sa commodité, on se servit de ce feuillet pour répandre des écrits qu’on voulait propager en grand nombre, et on prit l’habitude d’appeler pamphlets non seulement les feuillets, mais aussi les écrits qu’ils contenaient. La forme du pamphlet se prêtait remarquablement à la propagation clandestine des écrits de critique politique et sociale subversive de l’ordre établi et du conformisme du jour. Reproduit à l’infini par le moyen de l’imprimerie, pas encombrant, facile à cacher, peu coûteux et d’une lecture rapide, il devint ainsi le véhicule de la pensée indépendante et réformatrice. Son nom fut donné surtout à ces écrits subversifs parmi lesquels la satire des mœurs et des hommes occupait la plus grande place. Les pamphlets ont justifié ainsi cette définition que Paul-Louis Courier leur a donnée : « Petits écrits éphémères, d’une ou deux pages, qui vont de main en main et parlent aux gens d’à présent des faits, des choses d’aujourd’hui. » Par la suite, il arriva que le pamphlet fût composé de feuillets plus nombreux qui formèrent des brochures et même des livres.
De plus en plus le pamphlet fut spécialisé dans les écrits satiriques et il finit pal’ se confondre avec la satire en prenant de plus grands développements. Il en fut la forme militante, combative, la transportant de la littérature plus ou moins spéculative dans la politique et dans la mêlée sociale. Il fut, et il est toujours, « le livre populaire par excellence ». (P. L. Courier). Aussi, les gouvernants, les privilégiés, les « pistons de la machine » comme Balzac appelait les bouddhas de 1’ordre social, les « confréries des puissants » et des « ventrus » qui n’aiment guère la satire, redoutant d’y voir leur ombre, aiment encore moins le pamphlet. Ils le jugent diffamatoire, parce qu’il leur dit trop souvent la vérité et les dépouille, sans aucune espèce de considération, de leur dignité carnavalesque. Alors que la satire s’exerce sur des généralités qui sont de tous les temps, le pamphlet est particulier à une époque une société, des personnes. Il a une forme inférieure dans le libelle (voir ce mot) auquel on reproche plus justement d’être diffamatoire et qui s’attaque plus directement aux personnes, à leur vie privée, dans un but de scandale.
Le pamphlet est une des armes de la polémique. Quand l’argumentation de la raison est insuffisante contre la mauvaise foi qui ne veut pas se rendre, contre le préjugé qui demeure tenace, il est le coup de massue qui abat le forcené, la douche qui calme subitement l’excité. Il a le défaut de la polémique qui s’occupe plus de victoire que de vérité et avec laquelle, disait Renan, « on ne fait pas plus de bonne science que de grand art » ; mais Renan reconnaissait que la polémique est nécessaire contre l’intolérance qui fait obstacle à la science, et le pamphlet l’est aussi.
Le pamphlet ne s’embarrasse pas d’élégance académique, pas plus que d’impartialité. Il n’en sera que plus remarquable s’il possède une valeur littéraire et sert la cause d’une vérité qui n’est pas circonstancielle, relative au temps et à la mode ; il portera alors en lui la pérennité de la beauté et de la vérité éternelles. Mais il est avant tout une œuvre de passion et sa qualité essentielle est dans la netteté de sa pensée. Comme Boileau, il appelle « un chat un chat et Rolet un fripon ». A la révolution, le plus souvent lente et pacifique que la satire apporte dans les mœurs, le pamphlet donne la forme insurrectionnelle qui fait dresser des barricades et met un fusil en mains du révolté.
L’Académie Française, vieille dame qui redoute les fréquentations turbulentes, ne dit du pamphlet que ceci dans son Dictionnaire (7e édition 1878) :
« Mot emprunté de l’anglais. Brochure. Il se prend souvent en mauvaise part. »
De pamphlétaire, auteur de pamphlets, elle dit :
« Ne se prend guère qu’en mauvaise part. »
L’Académie a traduit ainsi le sentiment des gens « comme il faut » et « bien pensants » pour qui l’expression, vil pamphlétaire, est devenue un cliché. Larousse, de qui l’article pamphlet est remarquable dans son Grand Dictionnaire, a écrit au mot pamphlétaire :
« On dit un vil pamphlétaire, comme on dit un honorable député, un vénérable ecclésiastique, un magistrat austère. Il est vrai que ce sont les magistrats austères, les vénérables ecclésiastiques et les honorables députés qui emploient le plus souvent le terme de vil pamphlétaire. Les deux mots sont accouplés comme deux forçats à la même chaîne. »
Larousse a dit aussi :
« Quel homme animé du saint amour de la vérité, n’a pas été plus ou moins pamphlétaire ? »
Il y a eu des pamphlétaires même chez les magistrats austères qui condamnent les vils pamphlétaires ; depuis Montaigne jusqu’à Cormenin ils n’ont pas manqué. Il y en a encore davantage chez les vénérables ecclésiastiques qui envoient les vils pamphlétaires en enfer ; la liste en serait longue depuis l’apôtre Barnabé jusqu’a l’abbé Turmel, car c’est dans son personnel lui-même que l’Eglise a trouvé ses plus farouches et ses plus impitoyables adversaires. Nous le verrons au mot Satire. C’est une preuve de plus que les disciplines sociales, même les plus étroites, sont impuissantes à réfréner les manifestations des esprits véritablement indépendants. Elles n’enlèvent leur virilité qu’aux eunuques volontaires. Il y a même des pamphlétaires parmi les honorables députés qui projettent de faire une nouvelle « loi scélérate » contre la « diffamation » des vils pamphlétaires.
Paul-Louis Courier a raillé avec une verve étincelante, dans son Pamphlet des pamphlets, les bons apôtres de ce bloc enfariné qui condamne les vils pamphlétaires. Il avait été poursuivi en cour d’assises — les « lois scélérates » démocratiques n’existaient pas encore pour l’envoyer en correctionnelle — pour son Simple discours à l’occasion d’une souscription pour l’acquisition de Chambord, et l’épithète de « vil pamphlétaire » que le Procureur du Roi lui avait décochée avait suffi pour le faire condamner. Les jurés ne s’étaient même pas donne. la peine de lire son pamphlet ; la vérité qu’il pouvait renfermer ne pouvait qu’être criminelle, n’étant pas enveloppée de cette rhétorique qui confond le mensonge et la vérité et fait passer les coquins pour d’honnêtes gens. Ils avaient été fixés d’avance sur l’écrit comme sur son auteur par les étiquettes du pharisaïsme offensé : « pamphlet, vil pamphlétaire », car « un pamphlet ne saurait être bon, et qui dit pamphlet dit un écrit tout plein de poison ». On ne saurait, en « bonne police », laisser circuler du poison. Mais, le scandale, c’est que le monde aime bien ce poison, parce qu’avec lui « il y a aussi des sottises, des calembours, de méchantes plaisanteries », et les bons apôtres gémissent :
« Honte du siècle et de la nation, qu’il se puisse trouver des auteurs, des imprimeurs et des lecteurs de semblables impertinences ! »
Ce que ne disent pas ces bons apôtres, c’est que le pamphlet n’est pas moins goûté par eux ; ils le lisent avec délices, ils s’en gargarisent voluptueusement lorsque, au lieu de servir la vérité, il sert le mensonge et sort de l’officine de ces « Pitres dévêts, marchands d’infâmes balivernes », que V. Hugo a flétris dans ses Châtiments. La Bruyère a constaté qu’ « on n’approuve la satire que lorsqu’elle va mordre les autres ». Le pamphlet mord toujours quelqu’un et il y a toujours quelqu’un pour en rire parmi ceux qui ne sont pas mordus. De là cet amour du monde pour le poison appelé pamphlet.
Mais il y a pamphlet et pamphlet comme il y a poison et poison ; de même, il y a pamphlétaire et pamphlétaire. Que la vérité soit ou ne soit pas toujours dans le pamphlet, et de quelque parti qu’il vienne — chacun prétend détenir la vérité et la dénie à l’adversaire, — il y a plus sûrement de « vils pamphlétaires ». Ce sont ceux qui ne possèdent pas, à défaut d’une conviction absolue, un désintéressement complet au service de ce qu’ils prétendent être la vérité et tirent profit de leurs pamphlets. Le pamphlet, en raison des attaques personnelles qu’il contient et de sa vivacité, devient alors la forme la plus basse du brigandage et de la prostitution littéraires, et celui qui s’y livre est le plus bas coquin de la confrérie des lettres. Le genre fleurit particulièrement aux époques de décomposition sociale, lorsque les mœurs sont tombées à de telles turpitudes que les prétendues « élites » ont perdu tout prestige et peuvent être fouaillées, sans pouvoir trouver dans la conscience publique l’appui d’une réaction possible. L’Arétin fut, au XVI e siècle, le type romantique, brillant et redouté, du « vil pamphlétaire », condottière de plume, sorte de Don Juan du chantage, qui savait à l’occasion tenir la vie de ses victimes à la pointe de son épée. L’espèce s’est encore singulièrement avilie depuis pour arriver aux « faisans » actuels, sortis des ténébreux charniers de la guerre avec les Thénardier montés au pouvoir et dont, vampires sans dégoût, ils sucent le pus qui leur tient lieu de sang. Ces « faisans » sont de ceux à qui V. Hugo disait :
Vos oreilles n’y sont jamais ! »
Le pamphlet n’est honorable que s’il n’est pas le produit d’une plume vénale, s’il sort d’une conscience pure qui n’est à la solde de personne et sert la vérité, ou ce qu’elle croit telle, avec un complet désintéressement. S’il n’y a pas un critérium infaillible de la vérité, il y en a un du pamphlétaire dans les conséquences que son pamphlet a pour lui : les persécutions, la prison et parfois l’assassinat plus ou moins légal pour les P.-L. Courier ; les hautes protections, sinon la fortune et les honneurs, pour les L. Veuillot. Le plus souvent, les pamphlétaires qui servent la vérité doivent rester anonymes pour échapper aux persécutions.
« Ils arrosent la terre de leur sueur et de leur sang, la moisson croît, le peuple la recueille et ne songe même pas à connaître les noms de ceux qui l’ont ensemencée pour lui. » (Pierre Larousse)
Nous n’écrirons pas ici l’histoire du pamphlet. On la trouvera avec celle de la satire, à ce mot. Nous indiquerons seulement ses époques les plus brillantes et ses différents aspects.
Le pamphlet véritable, c’est-à-dire écrit et répandu à des milliers d’exemplaires, ne date que de l’invention de l’imprimerie. Il fut la raison principale de l’opposition et des interdictions faites par les différents pouvoirs à cette invention. Il fit des débuts éclatants en Allemagne, avec les Epistolœ obscurorum virorum d’Ulrich de Hutten, inspirées par la querelle de Reuchlin et des théologiens de Cologne. Ces lettres étaient d’une telle puissance et d’une telle vie, qu’elles sont demeurées inoubliées en Allemagne où des éditions successives n’ont pas cessé d’entretenir leur popularité. Elles sont moins connues en France. Laurent Tailhade, qui voyait en Ulrich de Hutten « le Lucien de la Renaissance germanique », en a publié une traduction, il y a quelques années, sous le titre : Epîtres des hommes obscurs du chevalier Ulrich von Hutten (1924). Les pamphlets de Hutten ouvrirent la voie à ceux de Luther, non moins vigoureux, qu’il appela : Propos de table, parce qu’il n’y occupa que « le temps de ses réfections corporelles ».
Le pamphlet se multiplia à cette époque si troublée du XVI e siècle, allant des hauteurs satiriques de la Satire Ménippée jusqu’à la multitude des libelles qu’on afficha sous forme de placards et n’eurent plus aucune espèce de retenue. Il fut d’une violence extrême, passant du ton de la raillerie, quand il attaqua les mœurs d’Henri III et de sa cour dans l’lsle des hermaphrodites, nouvellement découverte, avec les mœurs, loix, coustumes et ordonnances des habitants d’icelle, à la provocation à l’assassinat et au régicide. Il exprima ainsi la forme aiguë et réaliste de la satire qui attaquait la légitimité des rois et présentait la résistance à leur pouvoir comme un devoir. L’apologie d’Harmodius, d’Aristogiton, de Brutus, de Cassius, d’Aratus de Sieyone qui avaient délivré leur pays des tyrans, était répandue par des milliers de feuillets et de placards.
Devenu immédiatement l’arme des partis, le pamphlet ne cessa de se multiplier en prenant des caractères divers ; mais il fut par-dessus tout l’expression de la pensée populaire, Il gagna en esprit ce qu’il perdit en violence quand les fureurs religieuses furent calmées, et il abandonna le ton de la diatribe pour prendre celui du burlesque, de l’épigramme et de la chanson. Les Mazarinades furent aussi nombreuses au temps de la Fronde que les libelles des temps de la Ligue. On en a compté plus de cinq mille. Elles firent vivre une nuée de pamphlétaires miteux dont Mazarin lui-même payait les insolences. Il allait même jusqu’à provoquer des émeutes qu’il exploitait à son profit, selon les procédés policiers de tous les temps. Les Henri III, Henri IV et Mazarin étaient les premiers à rire des attaques des libellistes. Les deux premiers en moururent assassinés, le troisième en fit sa fortune. Il disait :
« Qu’ils crient, pourvu qu’ils paient ! »
Lui encaissait. Venu à Paris sans un rouge-liard dans la domesticité d’une reine de France, il mourut dans le lit de cette reine, laissant à ses neveux une fortune de plus de cinquante millions. Cela n’empêcha pas pourtant que certains auteurs et éditeurs de mazarinades furent pendus ou envoyés aux galères.
Sous Louis XIV, sauf à la fin du règne où les turpitudes royales soulevèrent les consciences même les plus domestiquées, le pamphlet perdit complètement son âpreté, comme si la courtisanerie en eût eu raison. Les auteurs de libelles étaient d’ailleurs de plus en plus menacés. Tartufe, s’il plaisantait avec les vices des autres, n’aimait pas qu’on raillât les siens et tenait d’autant plus à ne pas voir attaquer sa vertu qu’il n’en avait guère à revendre. De plus en plus réduit aux dimensions du libelle, le pamphlet dut dissimuler ses auteurs. Il en fut ainsi jusqu’à la Révolution et il s’en vengera par son agressivité. Chavigny paya de trente ans de cage de fer, dans la forteresse du mont Saint-Michel, son pamphlet intitulé : le Cochon mitré, contre Le Tellier, frère de Louvois (1689). Cent ans plus tard la Révolution mettait fin à la captivité de Latude emprisonné depuis trente ans pour crime de lèse-majesté, parce qu’il avait adressé à Mme de Pompadour certains « hommages » déplaisants ! Latude ne fut pas le seul qui subit les cruelles vengeances de la catin royale. Dumouriez a raconté dans ses Mémoires comment il vit un jour, à la Bastille, « un homme d’environ cinquante ans, nu comme la main, avec une barbe grise très longue, des cheveux hérissés, hurlant comme un enragé ». Cet homme, qui était devenu fou, était un nommé Eustache Farcy, gentilhomme picard, capitaine au régiment de Piémont, enfermé depuis vingt-deux ans pour avoir fait ou colporté une chanson contre la Pompadour. D’autres, nombreux, connurent un sort semblable. Les libraires, éditeurs de libelles, étaient durement frappés, aussi la plupart de leurs productions avaient elles leurs presses à l’étranger, particulièrement en Hollande. Les colporteurs les apportaient ; le monde frivole les répandait, heureux’ de ces attaques sournoises contre des puissances que d’autre part il flagornait bassement.
Voltaire, bien qu’il fut le polémiste le plus ardent de son époque, était ennemi des libelles. Il a vivement attaqué les auteurs de ces « petits livres d’injures » auxquels ceux qui les faisaient mettaient rarement leurs noms, « parce que les assassins craignent d être saisis avec des armes défendues ». Il voyait en eux des « compilateurs insolents qui, se faisant un mérite de médire, impriment et vendent des scandales comme la Voisin vendait des poisons ». Son article Du Quisquis de Ramus ou La Ramée, dans le Dictionnaire Philosophique, est un véritable pamphlet, plein d’indignation, contre les faiseurs de libelles qui prétendaient imiter Horace et Boileau. Il leur répondait qu’Horace et Boileau n’avaient pas fait de libelles et que, si on voulait les imiter, il fallait avoir un peu de leur bon sens et de leur génie ; on ne ferait alors plus de libelles. Voltaire montrait ainsi l’exacte distinction qu’il y a lieu de faire entre la véritable satire, celle d’un Horace et d’un Boileau, et cette forme la plus vile du pamphlet qu’est le libelle. Il disait encore :
« La vie d’un forçat est préférable à celle d’un faiseur de libelles ; car l’un peut avoir été condamné injustement aux galères, et l’autre les mérite. »
La Régence, parce qu’elle avait eu beaucoup à se faire pardonner, avait été d’une certaine douceur aux pamphlétaires. Le Régent oubliait les injures faites au duc d’Orléans. Le pamphlet prit une vigueur nouvelle aux approches de la Révolution. Il contribua puissamment à l’amener. Il répandit les idées des Encyclopédistes en les vulgarisant ; il exploita les querelles du régime, celles entre autres du Parlement et de la royauté ; il dressa sur la scène l’audace de Figaro dans les deux pièces de Beaumarchais, le Barbier de Séville et Le Mariage de Figaro. Necker présenta au roi son Mémoire sur l’établissement des administrations provinciales où il attaqua l’arbitraire royal. Mirabeau lança son pamphlet Sur la liberté de la presse qui fut suivi, en 1789, par son Appel à la nation française. La royauté harcelée, même par ses plus cyniques profiteurs, ne sut plus où trouver le salut et justifia de plus en plus les attaques contre elle par l’accumulation de ses fautes.
Sous la Révolution, le pamphlet se multiplia pour et contre la royauté. Il fut presque la seule littérature du temps, avec les discours civiques, et il fut aussi verbal qu’écrit, à la tribune, sur la scène et dans la presse. Il fut lu, déclamé, chanté. Il traduisit tous les événements politiques, toutes les préoccupations populaires. Successivement parurent des pamphlets de circonstance et d’autres qui eurent la périodicité du journal. Ils commencèrent avec Le Véritable ami du peuple, de Loustalot, et La France libre, de Camille Desmoulins. Relativement mesurés et traitant de questions sociales plus que de querelles de partis et de personnes, ils exprimèrent au début la joie et les espoirs du peuple qui se croyait entièrement libéré de ses chaînes. Celui de Sieyès sur le Tiers Etat fut la première manifestation d’un nouvel esprit de classe qui allait diviser la Révolution et la conduire à la Terreur. Les journaux-pamphlets se multiplièrent : Le Patriote français, de Brissot, les Révolutions de Paris, de Loustalot ; la Bouche de Fer, de Fauchet et Bormeville ; l’Ami du Peuple, de Marat ; l’Orateur du peuple, de Fréron ; les Révolutions de France et de Brabant, de Desmoulins, puis son Vieux Cordelier. Les haines anti-révolutionnaires d’une part, et les souffrances populaires d’autre part, poussèrent à la virulence. L’écossais Swinton, stipendié de police, et le royaliste Moranda qui avait dû, publiquement, se reconnaître « infâme », lancèrent des libelles forcenés. Les Effets des assignats sur le prix du pain, de Dupont de Nemours, la Criminelle Neckero-Logie, de Marat, excitèrent les fureurs contre les affameurs, et des feuilles sinistres célébrèrent les exécutions de Foulon et de Berthier. Ce furent ensuite les diatribes contre Louis XVI et le pamphlet de Marat : C’en est fait de nous ! Contre les clubs se déchaînèrent les attaques royalistes des Sabbats Jacobites, des Actes des Apôtres, du Jean Bart ; contre le clergé, celles de tous les temps prirent une violence nouvelle. Des pamphlets furent écrits contre Mirabeau, contre Bailly et La Fayette après les massacres du Champ de Mars, contre Carrier. Celui-ci fut particulièrement malmené par Babeuf. La terrible question du pain ne cessa pas d’occuper l’opinion ; elle fournit matière aux pamphlets, si elle ne nourrit pas le peuple. Et c’est elle, en définitive, qui était la grande question de la Révolution ; elle faisait se recreuser entre les classes sociales le fossé qui semblait avoir été comblé par la démolition de la Bastille. Ce ne furent pas les déclamations des « buveurs de sang » qui firent la Terreur ; ce fut la misère du peuple, ce peuple qui eut voulu garder sa confiance dans « le boulanger, la boulangère et le petit mitron », et qui la garde toujours pour les endormeurs, royalistes ou démocrates. Ce fut le Père Duchesne, sous ses différents aspects, qui refléta le mieux la colère populaire jusqu’à l’exécution d’Hébert, en 1794. Hébert lui avait donné sa formule la plus caractéristique.
Le Consulat et l’Empire firent taire les pamphlétaires. Ils furent, avec tous les écrivains mal pensants, exilés, emprisonnés, déportés ou fusillés, ainsi que leurs éditeurs. Bonaparte ne tolérait autour de lui que des flagorneurs. Le pamphlet revint avec une liberté relative de la presse sous la Restauration. Chateaubriand le ressuscita avec une certaine grandeur ; il avait combattu Napoléon, il observa la décence en se réjouissant de sa chute. Ceux qui furent sans décence furent les gens de presse et de poubelle qui avaient vécu en parasites de l’Empire, avaient été ses plus plats valets jusqu’au 31 mars 1815 ; ils se mirent à l’injurier à partir du 1er avril pour recommencer leurs flagorneries pendant les Cent Jours et se replonger enfin dans leur ordure injurieuse après Waterloo. Et cette tourbe infâme prétendait parler au nom des « honnêtes gens »... comme aujourd’hui ! Chateaubriand réussit moins auprès du pouvoir avec ses pamphlets, quand il s’opposa à l’ultra-royalisme. Sa Monarchie selon la charte le fit rayer du nombre des ministres. Un Martainville inaugura en ce temps-là, contre les libéraux, les arguments qui n’ont pas cessé d’être répétés depuis, si éculés qu’ils soient devenus, par tous les partis contre ceux qui les devançaient, les appelant « partageux » qui veulent « les nez étant égaux, se moucher tous dans le même mouchoir ». Pour Martainville et la séquelle des « bien pensants » d’alors, le libéralisme était « la religion des gens qui fréquentent les galères ». Les libéraux devenus « bien pensants » en ont dit autant des républicains, puis ceux-ci des socialistes, et ces derniers des anarchistes et des bolchevistes. En 1820, « l’homme au couteau entre les dents » s’appelait Thiers ; aujourd’hui il s’appelle Staline.
Une brillante pléiade de pamphlétaires travaillèrent à l’avancement du libéralisme de plus en plus influencé par les idées républicaines et socialistes. Les pamphlets de P.-L. Courier sont demeurés les modèles du genre dans l’esprit comme dans la forme ; il paya de sa vie l’audace de sa plume. Béranger, qui donna au pamphlet la forme de la chanson, connut la prison. Les Iambes, de Barbier, la Némésis, de Barthélémy et Méry, furent écrites en vers vigoureux. Sous LouisPhilippe, de Cormenin illustra le pamphlet politique, mais plus par sa vigueur et sa verve que par son style. Ses pièces anti-cléricales, Oui et Non (1845) et Feu ! Feu ! (1846), de même que ses Avis aux contribuables et son Livre des orateurs, celui-ci publié sous le pseudonyme de Timon, eurent un succès considérable auquel répondirent les plus vives attaques. Elles venaient des deux côtés, légitimistes et libéraux, et Cormenin pouvait dire : « J’ai été l’homme le plus honni, le plus calomnié, le plus menacé, le plus biographié, le plus déchiré, le plus défiguré, le plus flétri, le plus sali, le plus souillé de boue de la tête aux pieds... Au fond, j’ai tout lieu d’être satisfait. Lorsqu’un de mes pamphlets ne m’attire que peu d’injures, je ne suis pas content de moi et je me dis :
« C’est ma faute ! J’aurai mal attaqué cet abus là ! J’aurai mal défendu cette liberté-là ! »
Claude Tillier donna au pamphlet un accent plus populaire et défendit les idées généreusement révolutionnaires contre le libéralisme bourgeoisement opportuniste. Il fut en même temps un remarquable écrivain, profondément pénétré des sentiments du peuple et en possédant la sensibilité si incomprise, raillée et meurtrie. Il possédait aussi, comme Félix Pyat l’a dit, l’esprit de Voltaire et de Diderot. On était à la veille de 1848. Le peuple avait encore des illusions sur les dispositions de la bourgeoisie, malgré les répressions anti-ouvrières. Les journées de juin 1848 et celles de décembre 1851 ne lui avaient pas encore ouvert les yeux.
Alphonse Karr fit de ses Guêpes de véritables pamphlets ; il ramena ainsi le genre au pamphlet-journal de la Révolution. Il s’attaqua aux mœurs avec un esprit satirique souvent profond, dépassant le pamphlet mais respectueux, malgré ce, de « l’ordre ». Il disait : « Que les assassins commencent », ne voyant pas que les assassins sont faits par la société et qu’elle devrait « commencer » avant eux. Il définissait ainsi sa satire :
« Consultant à la fois la nature de mon esprit et la nature des choses et des gens que j’attaque ; considérant que beaucoup de choses humaines sont des outres gonflées de vent, — j’ai divisé et changé mon glaive en une multitude d’épingles ; quelquefois une seule piqûre suffit pour crever et aplatir l’ennemi ; alors je l’abandonne et n’en parle plus ; mais d’autres ont la peau plus épaisse et, d’épingle en épingle, il faut que le glaive y passe tout entier. »
La Révolution de 1848 fut l’occasion de nombreux pamphlets, puis le Coup d’Etat inspira à V. Hugo son Napoléon le Petit en attendant les Châtiments. Le II e Empire ne vit guère de pamphlets, jusqu’à Rochefort et sa Lanterne qui reprit le genre des Guêpes avec plus de virulence. Sous la III e République, le pamphlet s’est de plus en plus confondu avec l’article de journal. Vallès fut un ardent pamphlétaire, puis Tailhade. Tous deux connurent la prison et la misère. En Allemagne, Maximilien Harden fut un pamphlétaire de premier ordre. Nous retrouverons le pamphlet dans l’étude de la satire, manifestation plus générale, et de tous les temps, de l’esprit de liberté contre toutes les formes de l’oppression.
— Edouard ROTHEN.
PANÉGYRIQUE
n. m.
Le proverbe dit : « Menteur comme un panégyrique. » Le panégyrique est un discours consacré à la louange d’un personnage plus ou moins illustre. Il ne comporte ni critique, ni blâme, ni même la moindre réserve. C’est donc la forme la plus bassement servile dans l’art oratoire.
Ironiquement : Propos qui a l’air de louanger quelqu’un et qui le décrie par des restrictions. (Lachâtre)
Les Grecs, si avides d’éloquence, prononçaient des panégyriques en l’honneur d’hommes, vivants ou morts ; de cités glorieuses (Athènes) ou d’entités métaphysiques (la Parie). Les Romains consacraient le panégyrique exclusivement aux vivants. Ce furent des élucubrations fatigantes dans lesquelles on prodigua aux puissants de l’heure les mensonges les plus éhontés, (panégyriques de Constantin, de Julien l’Apostat, de Théodose, etc.).
Les Pères de l’Eglise, grecs et latins, cultivèrent avec succès ce qu’on nomma « le panégyrique chrétien ». L’oraison était consacrée à un personnage destiné à être canonisé. L’Eglise grecque appelle encore Panégyriques des livres disposés, selon l’ordre des mois et contenant pour chacun de ces mois des discours à la louange de Jésus et des Saints.
Longtemps, panégyrique, éloge et oraison funèbre ont pu être confondus. « L’oraison funèbre était, à vrai dire, le panégyrique des morts, et le panégyrique donnait aux vivants un avant-goût de leur oraison funèbre. » (A. Gazier. Ency.).
Ce genre, en raison même du but poursuivi, ne fut presque toujours que l’étalage d’une phraséologie pompeuse et froide, un abus de lieux communs, pleins de banalités et d’enflure. Il fallait certainement n’avoir pas le souci du pain quotidien pour consacrer son temps à écouter « ces chefs-d’œuvre de pédantisme et de mauvais goût ». Au surplus c’était bien le passetemps d’ « honnêtes gens » avides de flatter les maîtres ou d’apprendre comment on les courtise.
Le panégyriste le plus éminent, Bossuet, se spécialisa dans « le panégyrique des morts ». Il s’éleva, certes, jusqu’aux plus hauts sommets de l’éloquence, mais davantage avec le souci d’instruire, de donner des leçons (pour la plus grande gloire de Dieu) que de dire la vérité, dont il n’avait cure. « L’auteur d’une oraison funèbre dira seulement ce qui est à l’honneur de son héros ; il louera des actions qu’on puisse louer sans crainte dans la chaire de vérité, et résolument, en vertu d’un accord tacite entre lui et ceux qui l’écoutent, il passera les autres sous silence. » (Encycl.) Bossuet ne manqua pas à la règle. Panégyriste de Saint-Pierre, il se garda de parler de son reniement ; de Saint-Paul il omit de signaler que le prince des apôtres fut d’abord un persécuteur acharné des chrétiens.
« De 1.500 à 1.800 oraisons funèbres imprimées de 1621 à 1789, dix ou douze tout au plus supportent la lecture. »
Que de temps, et parfois de talents, mal employés ! Que d’oisifs se sont appliqués, dans ce genre boursouflé, insipide, à mentir avec art ! (le panégyrique d’Athènes coûta 15 ans de travail à Isocrate ; Bossuet eut 140 jours pour écrire l’oraison funèbre du prince de Condé et un an pour élaborer celle de la princesse palatine !) Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?
Les gens d’Eglise et de robe, les personnages officiels, les bonzes de toutes les académies éprouvent certainement davantage que les prolétaires le besoin de prononcer des panégyriques. Cultivant avec amour leur petite vanité, combien se complaisent à s’encenser mutuellement ! Pour un Voltaire dérogeant une fois « à l’usage fastidieux de ne remplir un discours de réception que de louanges rebattues du Cardinal de Richelieu », que de plats valets ! Panégyrique d’hommes de lettres, d’hommes politiques, d’hommes d’Etat ; panégyriques de Jeanne d’Arc, de la Patrie, de la Révolution, de la République, des morts de la guerre (ô Poincaré !) qui encombrent trop souvent les colonnes des journaux ou que vomissent les postes de T. S. F., qui donc a le triste courage de vous lire ou de vous écouter jusqu’au bout ? Fléchier, qui s’y connaissait, disait : « L’imagination a plus de part aux panégyriques que la raison ; ce sont des hyperboles perpétuelles. » « Hyperboles » est poli ; nous employons à l’occasion des termes un peu plus forts pour flétrir les discours trompeurs.
— Ch. B.
PANIQUE
n. f. et adj.
Selon les Grecs, le dieu Pan, au cours de ses randonnées nocturnes, jetait fréquemment l’effroi par de brusques apparitions. De là vient le mot panique, que l’on applique à une terreur subite et souvent collective. Quand un mouton se met à fuir, le troupeau entier prend peur. Les foules humaines aussi sont prises de paniques, car les émotions se propagent avec une incroyable rapidité. On en peut citer des exemples fameux. Préludant aux paniques qui secouent les banques modernes, la banqueroute du système de Law, en 1720 fut le signal d’une indescriptible émotion. Les spéculateurs malheureux, dont les actions et les billets ne valaient plus guère que le prix du papier, s’entassaient aux portes de la banque ; des cris et des menaces montaient à l’adresse de Law. Trois personnes furent étouffées par la foule, tant la presse était grande ; et leurs cadavres furent promenés à travers Paris par les ennemis du financier qui réclamaient vengeance. Effrayé, Law, qu’on encensait sans mesure peu auparavant, décampa secrètement et de nuit. Quand Poincaré, en 1914, s’enfuit à Bordeaux avec sa séquelle de ministres, de journalistes, de financiers et de parlementaires, ce fut sous le coup d’une panique, que l’on a vainement essayé de couvrir du manteau de prudence. Ces gens, qui épargnaient si peu le sang de l’humble soldat, craignaient pour leur propre vie, et c’est loin du danger qu’ils transportaient leurs précieuses personnes. Des armées russes, pendant la dernière guerre, furent prises d’une terreur indicible, car elles voyaient la Vierge Marie étendant la main du haut du ciel pour protéger l’adversaire. On a su depuis que des aviateurs, munis d’appareils cinématographiques, projetaient ces divines images sur les nuages qui servaient d’écran. Avec raison, ils avaient tablé sur la superstition populaire. De nombreuses paniques sont volontairement déchaînées par les financiers et les politiciens ; elles permettent de louches combinaisons, d’infâmes marchandages, impossibles à un autre moment. L’affolement provoqué en France par la chute du franc, celui qui vient de secouer l’Angleterre par suite de la baisse de la livre sterling, ont profité à certaines gens. Les gémissements officiels ne purent dissimuler complètement la joie secrète et les ambitieuses visées de ceux à qui cet affolement profitait. Réfléchir, observer, voilà ce que doit faire le sage, quand il voit ceux qui l’entourent pris d’une panique dont le motif n’est pas clair. Il ne peut oublier qu’aux yeux des chefs le peuple est un enfant qu’il est utile d’effrayer en certains cas.
PANTHÉISME
n. m. (du grec pan, tout, theos, Dieu)
C’est en 1705 seulement que le terme panthéiste fut employé, pour la première fois, par l’Anglais Toland ; mais, en fait, le panthéisme est aussi ancien que la philosophie. Tous les systèmes métaphysiques ou religieux qui réunissent Dieu et le monde, pour n’en former qu’un être unique, se rattachent à cette doctrine. Extrêmement nombreux et de formes très différentes, ces systèmes ne sauraient être ramenés à un seul type ; ils ont toutefois ceci de commun qu’ils considèrent Dieu comme identique à l’ensemble des réalités et n’admettent pas la distinction, chère au théisme traditionnel, entre Dieu et l’univers.
Déjà le panthéisme apparaît dans les antiques spéculations hindoues. Il est clairement exprimé dans certains livres :
« La cause suprême, lit-on dans le Vedanta, désira être plusieurs et féconde, et elle devint plusieurs. Cet univers est Brahma, car il en sort, il s’y plonge, il s’en nourrit ; il faut donc l’adorer. Comme l’araignée tire d’elle et retire en elle son fil, comme les plantes sortent de la terre et y retournent, comme les cheveux de la tête et les poils du corps croissent sur un homme vivant, ainsi sort l’univers de l’Inaltérable. »
Le monde n’est donc qu’apparence imaginaire, seul Brahma possède une existence vraie ; aussi, quand se termine la vie présente, l’âme, émanation de Dieu, est-elle de nouveau absorbée en lui. Dans le Bhagavad-Gita, où l’inaction complète est recommandée, Dieu est confondu avec ce qu’il y a de meilleur dans l’univers :
« Je suis la vapeur dans l’eau, la lumière dans le soleil et dans la lune, l’invocation dans les Védas, le son dans l’air, l’énergie masculine dans l’homme, le doux parfum dans la terre, l’éclat dans la flamme, la vie dans les animaux, le zèle dans le zélé, la semence éternelle de toute nature. Dans le corps, je suis l’âme et dans l’âme, l’intelligence. Quelle que soit la nature d’une chose, je la suis. Enfin, qu’est-il besoin d’accumuler tant de preuves de ma puissance ? Un seul atome émané de moi a produit l’univers, et je suis encore moi tout entier. »
Le célèbre philosophe chinois Lao-Tseu semble avoir été, lui aussi, panthéiste ; mais l’obscurité de son style permet difficilement de pénétrer sa pensée. Il admet un principe éternel, immuable, qu’on ne peut ni définir, ni comprendre ; le monde et les âmes sont des émanations de la substance divine ; après la mort, ces dernières retourneront au premier principe, si elles en sont dignes.
En Grèce, le panthéisme n’aura qu’un nombre assez limité de partisans. On a cru le trouver en germe chez Héraclite d’Ephèse, dont les idées sur l’universel changement et l’universel devenir influenceront Hegel. S’il est vrai qu’Anaximène de Milet identifiait l’air, dont il faisait le principe de toutes choses, avec la divinité, nous sommes, ici, en présence d’un panthéisme matérialiste. Quelques-uns voient un précurseur de Fichte et de Schelling dans Parménide d’Elée et même dans Xénophane. Les Stoïciens furent nettement panthéistes. Le monde est semblable à un être vivant, déclaraient-ils ; Dieu est la force qui imprime le mouvement et l’ordre ; il est inséparable de la matière, principe passif qui ne devient fécond que grâce à l’action divine. Ce que notre âme est pour notre corps, la force l’est pour le monde ; elle en pénètre les diverses parties comme un souffle ou mieux comme un feu qui porte en lui les germes et les raisons d’être de tout ce qui existe. De cette âme du monde, la partie supérieure et directrice réside à part. Force et matière ne se distinguent, d’ailleurs, que temporairement ; à des périodes déterminées, elles se résorbent dans le feu solitaire, d’où le monde sort de nouveau suivant des lois inflexibles. Indéfiniment et d’après un ordre rigoureusement déterminé, des univers pareils au nôtre apparaissent donc, puis font retour à la substance unique qui les a produits. F. Ravaison résume ainsi le panthéisme stoïcien :
« Au commencement tout est force, souffle enflammé, tout est Dieu. En vertu de la loi du rythme, qui fait succéder le repos au travail, un relâchement se produit, et un nouvel élément se forme, l’air. Nouveau relâchement, nouvel élément : c’est l’eau qui naît de l’air comme l’air est né de l’éther. En ce moment, le monde est une masse d’eau entourée d’une sphère de feu. Sous l’influence de la chaleur du ciel, une partie de l’eau s’évapore ; l’air se forme de nouveau ; une autre partie de l’eau se condense ; c’est la terre séjour de l’homme. Alors, sous l’action dirigeante de l’esprit divin, les êtres naissent. Mais peu à peu le feu divin retrouve sa tension première. De plus en plus la terre se change en eau, l’eau en air, l’air en feu. Un jour viendra où notre univers sera de nouveau absorbé dans le sein de Dieu. Tout retournera à l’unité première par la conflagration universelle. »
On sait quelle prodigieuse influence la doctrine stoïcienne exerça, non seulement en Grèce, mais à Rome. Plotin, qui entreprit de réunir et de concilier les philosophies de Platon, d’Aristote et de Zénon, supposa que, dans la nature, tout vit et tout pense d’une seule vie et d’une seule pensée (Voir Paganisme), Il admit que, par l’extase, l’homme arrive à se diviniser dès ici-bas :
« Quand l’âme est devenue semblable à Dieu par les moyens connus de ceux-là seuls qui sont initiés, lit-on dans les Ennéades, elle le voit tout à coup apparaître en elle ; plus d’intervalle, plus de dualité, tous deux ne font qu’un. Dans cet état, l’âme ne sent plus son corps, elle ne sent plus si elle vit, si elle est homme, ou quoi que ce soit au monde ; elle perd toute conscience d’elle-même, et cesse de penser, elle devient Dieu, ou plutôt elle est Dieu. »
Ce panthéisme mystique devait avoir une prodigieuse fortune. A la suite de Plotin, tous les ascètes chrétiens et musulmans rêveront de se perdre en Dieu comme la goutte d’eau disparaît dans l’océan ; ils voudront mourir à eux-mêmes, s’oublier pour ne faire qu’un avec l’objet de leur adoration. Les mystiques catholiques frémiraient d’apprendre qu’ils eurent pour prédécesseur un ardent adversaire du christianisme ; pour rester d’accord avec les dogmes imposés par Rome, ils ont soin de parler quelquefois d’un dieu personnel. Mais leur panthéisme latent se fait jour de mille manières dès qu’ils s’expriment avec sincérité.
Au moyen âge, deux professeurs de l’Université de Paris, Amaury, de Chartres, et David, de Dinan, enseignèrent un panthéisme rationnel. Ils s’inspiraient de la philosophie arabe alors très florissante et dont quelques représentants manifestaient des aspirations panthéistes. Amaury admettait que tout est un, que les idées de l’intelligence divine étant à la fois créatrices et créées, le créateur et la créature sont une même chose. D’où la conclusion que Dieu est tout et que tout est dieu, les êtres émanés du premier principe devant retourner à lui et s’absorber dans sa substance. C’était pousser le réalisme à ses dernières conséquences et renouveler le panthéisme que Scot Erigène avait professé au IXe siècle. David, de Dinan, identifiait le connu et le connaissant. Il distinguait trois formes d’existence : la matière, la pensée, dieu, qui se confondaient finalement dans une substance indéterminée, dont les évolutions engendraient toutes choses. Au XIVe siècle, le panthéisme transpire dans les écrits de plusieurs mystiques ; discret chez Tauler qui cherche à calmer les défiances des théologiens, il se dégage nettement des formules employées par son maître Eckard. « L’amour divin, écrivait ce dernier, anéantit tout ce qu’il y a d’humain dans notre âme, pour la confondre, pour la convertir en Dieu, de même que la formule sacramentelle change la substance du pain encharistique, et le fait devenir le vrai corps de Jésus-Christ. » Un mystique tout à fait hétérodoxe et qui témoigna d’une grande profondeur d’intelligence, le cordonnier de Görlitz, Jacques Boehm, déclarait, à l’époque de la Renaissance, que tout émane de Dieu. Une dualité : être et néant, tendresse et violence, bien et mal, constituerait le fond de tout ce qui existe ; mais cette dualité aboutirait à l’unité par l’identification des contraires. On trouve des conceptions panthéistes chez d’autres auteurs de la Renaissance. Giordano Bruno s’inspire des Eléates et des Alexandrins. Pour lui l’univers est la manifestation visible de Dieu ; l’infini variété des individus n’est que l’expression de son unité partout présente. Giordano Bruno fut brûlé par ordre de l’Inquisition romaine. Chez Vanini, cette autre victime de l’intolérance religieuse, on rencontre aussi des traces de panthéisme.
Avec Spinoza, au XVIIe siècle, nous arrivons à une doctrine dont l’importance est primordiale en philosophie. C’est d’une façon toute mathématique, sous forme de définitions, d’axiomes, de postulats, de corollaires rigoureusement enchaînés entre eux que le système est exposé. Inspiré de Descartes, le spinozisme aboutit, néanmoins, à des conclusions très originales ; parti de la définition de la substance, il montre qu’il n’y a qu’une seule cause, Dieu, et que notre univers sort de lui nécessairement. La troisième définition de l’Ethique nous renseigne sur la substance, la sixième sur Dieu.
« J’entends par substance ce qui est en soi et est conçu par soi, c’est-à-dire ce dont le concept peut être formé sans avoir besoin du concept d’une autre chose. »
« J’entends par Dieu un être absolument infini, c’est-à-dire une substance constituée par une infinité d’attributs, dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. »
Nous connaissons seulement deux attributs de la substance divine, la pensée et l’étendue. Ces attributs infinis s’expriment par des modes finis ; et les modes de la pensée et de l’étendue constituent l’ensemble du monde. Entre Dieu et le monde, il n’y a qu’une différence de point de vue : Dieu est la nature naturante, le monde la nature naturée. Dieu est étendu, « car tout ce qui est en Dieu, et rien ne peut être, ni être conçu sans Dieu ». Mais il n’a pas de corps et n’est pas divisible. Dieu a pour attribut la pensée ou puissance de concevoir, mais il n’a pas un esprit analogue à celui de l’homme, même toute proportion gardée. L’intelligence divine diffère absolument de l’intelligence humaine ; elles ne peuvent se ressembler « que d’une façon toute nominale, absolument comme se ressemblent entre eux le Chien, signé céleste, et le chien, animal aboyant ». Ainsi Dieu, la nature naturante, n’a rien de personnel ; l’idée de création est fausse, car elle suppose en Dieu une volonté conçue sur le type humain ; tout ce qui existe découle de la substance divine avec une inéluctable nécessité. Les corps, que nous révèle l’expérience, sont des modes de l’étendue divine ; les âmes des modes de la pensée divine. Chez l’homme nous rencontrons une double série de phénomènes d’étendue et d’idées, c’est-à-dire de modes de l’étendue et de modes de la pensée divines ; modes qui demeurent parallèles, les seconds ayant pour objet de réfléchir les premiers. Le libre arbitre est une illusion qui naît de l’ignorance où nous sommes des causes de nos actions. Dans un être fini, le principe de toute activité morale est « l’effort par lequel toute chose tend à persévérer dans son être, et qui n’est rien de plus que l’essence actuelle de cette chose ». De cette tendance fondamentale découlent nos émotions, nos sentiments, nos appétits. Pour s’identifier avec Dieu, l’homme doit s’affranchir de ses passions et oublier sa propre individualité. Il devient éternel dans la mesure où il connaît les choses comme éternelles, soit par le raisonnement, soit par l’intuition ; il se divinise dans la mesure où il prend conscience de sa vraie nature qui est identique à la nature de la pensée absolue, c’est-à-dire de Dieu. Excommunié par les juifs, ses coreligionnaires, Spinoza vécut pauvre et solitaire, polissant des verres de lunette pour gagner son pain. Mais son système devait exercer une influence prodigieuse et faire l’objet de discussions qui durent encore aujourd’hui.
Au siècle dernier, le panthéisme a connu une vogue exceptionnelle, grâce aux philosophes allemands. Fichte, Schelling, Hegel l’adoptent tous trois, mais ne le conçoivent pas de la même façon. Selon Fichte, le moi se pose lui-même, et, en développant ses virtualités, il rencontre le non-moi qui ne se distingue pas réellement du moi, qui n’est que l’idéal conçu par le moi ou mieux la partie de l’idéal que le moi n’a pas encore réalisée. Ainsi seul le moi est réel ; son activité produit tout ce qui existe ; il crée le monde qui est dû à la pensée absolue, contrainte de se limiter. Après avoir adopté la philosophie de Fichte, Schelling aboutit à une conception personnelle qui substituait un moi infini au moi relatif admis par le premier. Au commencement il place l’Absolu, principe supérieur et antérieur au moi, « principe neutre, indifférence ou identité des contraires ». L’absolu comprend en lui-même l’identité de l’objet et du sujet, de l’un et du multiple, de l’ordre réel et de l’ordre idéal, mais il évolue et se développe. Dans l’ordre réel, il engendre successivement la nature, l’animal, l’homme, « il sommeille dans la plante, rêve dans l’animal et se réveille dans l’homme ». Dans l’ordre idéal, histoire, vertu, science, bonté, etc., découlent de lui progressivement. Puis l’absolu s’élève au-dessus de ces deux ordres et enfante la philosophie, en se saisissant lui-même comme suprême identité.
Hegel, dont la renommée fut si éclatante, pose comme principe premier l’Idée, où tout le possible est contenu virtuellement, où les contradictoires sont conciliés, et qui porte en soi la nécessité de son existence. Douée d’une logique vivante, l’idée évolue : elle se pose d’abord, puis s’oppose et enfin se réconcilie ; d’où trois moments successifs, la thèse, l’antithèse, la synthèse. Pour Hegel, l’ordre idéal et l’ordre réel sont d’ailleurs identiques : « Tout ce qui est rationnel est réel » ; « Tout ce qui est réel est rationnel ». La logique, qui se confond avec la métaphysique, devient la partie essentielle de la philosophie ; mais elle repose sur la négation du principe de contradiction. L’identité des contraires n’a rien qui choque ni l’expérience, ni la raison ; c’est à tort qu’elle fut combattue par l’ancienne logique. Nous constatons par expérience que tout être est mouvement ; or tout mouvement apparaît comme le passage de la puissance à l’acte, c’est-à-dire d’un contraire à un autre contraire, par une action qui domine les deux. N’étant plus enchaîné par aucune nécessité, l’être peut se transformer et se transforme réellement en toutes choses. Un perpétuel devenir manifeste la synthèse qui contient, dans son sein, rationnel et réel, être et néant. Parti de l’être pur, ce devenir aboutit à l’homme en qui l’idée prend conscience d’elle-même ; après avoir donné le mouvement, il s’est, en effet, transformé en matière inorganique, puis en matière organique, puis en matière sensible. La doctrine hégélienne fut bien accueillie en France. Vacherot y trouvait « la vraie solution du problème de la vérité » ; Renan en a parlé avec beaucoup d’estime.
Nous pourrions rappeler d’autres systèmes et d’autres auteurs peu connus ; ce que nous avons dit suffit à donner une claire idée du panthéisme. Il est né du désir d’apporter une solution au problème des rapports de Dieu et du monde, de l’absolu et du relatif ; faux problème, à notre avis, puisque l’un des termes doit disparaître, Dieu, l’absolu n’étant que de vains mots, des entités imaginaires. Le besoin d’unité, la tendance à ramener le divers à l’identique, à simplifier l’apparent chaos du monde, si profondément enracinés dans notre esprit, ont favorisé son éclosion et son développement. Très supérieur au théisme chrétien, il est fort séduisant par sa grandeur spéculative et par son charme poétique ; il est vrai dans la mesure seulement où il se rapproche de l’athéisme. Mais, si belles qu’elles puissent être, les constructions du panthéisme restent fragiles et sans bases sérieuses. Le système des Stoïciens, celui de Plotin, de Spinoza ou d’Hegel ne sont que de beaux romans métaphysiques. Ils témoignent de la puissante imagination et du remarquable talent de leurs auteurs ; ils n’ont pas de valeur objective. Pour aboutir à de sérieux résultats en métaphysique, on devra répudier les anciennes méthodes pour adopter celles de la science expérimentale. Ce sont les astronomes, les physiciens, les chimistes, les biologistes qui élucideront les problèmes transcendants de l’origine première et de la destinée ultime de notre univers.
— L. BARBEDETTE.
PAPE, PAPAUTÉ
La Papauté incarne, dans le monde actuel, le principe d’autorité sous sa forme la plus tyrannique. Pour ce motif, tous les hommes de progrès devraient unir leurs efforts pour la combattre.
Les Papes ont toujours revendiqué, comme nous le montrerons, la direction spirituelle la plus large de la société, sachant bien que, lorsqu’on gouverne les cerveaux et les cœurs, on est également le maître des volontés et des corps.
Il y a trois ans, répondant indirectement à Mussolini dans une lettre qu’il adressait à son cardinal Gaspari, le pape Pie XI écrivait :
« Dire du Saint Siège qu’il est l’organe suprême de l’Église catholique universelle, et qu’il est, par suite, le légitime représentant de l’organisation de l’Église en Italie, c’est une formule qui ne peut être admise que dans le sens où l’on dirait que la tête est l’organe suprême du corps humain ... C’est toujours le Souverain Pontife qui intervient et qui traite dans la plénitude de la souveraineté de l’Église catholique : pour parler exactement, il ne représente pas cette souveraineté, il la personnifie ; et il l’exerce en vertu d’un direct mandat divin… » (Croix. 11-6-29)
Le Pape ne représente pas la souveraineté catholique ; il la possède, il l’incarne. Il ne parle au nom de personne. Il ne doit rendre de comptes qu’à Dieu seul. Tel est le sens de cette déclaration, qui a du moins le mérite de la franchise.
A notre époque de « liberté » et de « démocratie », un langage aussi surprenant semble ne révolter personne ; il recueille, au contraire, l’approbation pleine et entière des millions de catholiques répandus dans le monde.
On lit dans la Semaine religieuse du diocèse de Mende :
« Le Pape a parlé, nous devons obéir sans discuter ses ordres, quand même nous n’en comprendrions pas les raisons. Ses décisions valent indépendamment des raisons qui les appuient. Vouloir n’accepter que les ordres dont les raisons nous agréent, ce serait s’ériger en juge du Pape, ne vouloir obéir en définitive qu’à soi-même. »
Dans son numéro du 16 mai 1927, La Croix déclarait :
« .... Dieu, dont le Pape est ici-bas le vicaire, dont il est le vice-Dieu ... »
L’Ami du Clergé (18-6-25), revêtu de l’Imprimatur du diocèse de Langres, imprime également que :
« Le Pape, c’est donc Jésus-Christ demeuré visible parmi nous. Si vous voulez voir Jésus-Christ, allez à Rome, allez voir N. S. Père le Pape Pie XI. »
Le Pape est ainsi identifié à Dieu.
Rien d’étonnant, dans ces conditions, qu’il ait le droit de commander aux hommes :
« Il n’y a qu’une seule autorité sereine et juste : c’est l’autorité du Pape, l’autorité de l’Église ... Si elle jouissait de son plein essor, si elle était écoutée, il n’y aurait plus de question sociale, de haines nationales et de révolutions. » (Id.)
Pendant plusieurs siècles, l’autorité des Papes a prévalu et non seulement la fraternité n’a pas triomphé, mais les Pontifes ont fait régner sur les hommes la tyrannie la plus odieuse.
Il faut un certain cynisme, par conséquent, pour soutenir une thèse semblable. Mais le cynisme ne manque pas aux gens d’Église ; nous aurons plus d’une fois l’occasion de le constater.
L’Union Catholique de l’Hérault, dans son numéro du 14 avril 1929, affirme :
« Le Pape ... qu’il se nomme Benoît ou Léon, Grégoire ou Pie, c’est le Chef, le Pasteur, le Christ continué. »
Saint François de Sales n’avait-il pas dit :
« Les seules idées chrétiennes sont les idées romaines. Jésus Christ et le Pape, c’est tout un. » (Cité par La Croix. 18-1-29.)
Toujours la même tendance de faire du Pape un Dieu.
Aussi Mgr Durand, évêque d’Oran, peut-il écrire (dans son mandement contre l’Action Française) :
« Quand le Souverain Pontife intervient dans une affaire de prime abord temporelle et donne des directions impératives, il ne faut pas voir qu’un conseil, mais bien un ordre à exécuter ponctuellement, parce qu’il traite alors cette affaire temporelle non pas du côté strictement temporel, mais bien du côté spirituel qu’elle implique, complètement sous sa juridiction dont il ne doit rendre compte qu’à Dieu ...
Enfin, il est de foi catholique, proclamée par le Concile du Vatican, que la juridiction du Souverain Pontife s’étend sans aucune restriction à tout le spirituel, où qu’il se trouve. Il s’ensuit qu’il peut intervenir dans les affaires temporelles en proportion de la part spirituelle qu’elles contiennent. En le niant, l’Action Française se met donc, par voie de conséquence, en opposition avec le Concile du Vatican dont nous avons cité les deux anathèmes ; elle est encore à ce titre suspecte d’hérésie, haereticatis. »
Ce distinguo entre le temporel et le spirituel est assez subtil, mais, en dernier ressort, le Pape revendique le droit de les gouverner tous les deux. C’est ce qui ressort du texte de Mgr Durand. C’est également ce qui découle des multiples déclarations de l’épiscopat et des théologiens.
Le R. P. de La Brière (Jésuite) écrivait dernièrement que la politique n’est qu’une branche de la morale et comme le Pape est tout puissant et infaillible en matière de morale, il a par conséquent le droit d’intervenir dans le domaine de la politique. (D’autre part, le Syllabus déclare que les sciences et la philosophie doivent être soumises à l’autorité de l’Église.)
Rien n’échapperait donc à la juridiction du Pape et il serait le maître de la société.
Le Cardinal Andrieu, archevêque de Bordeaux, est allé plus loin encore : il a mis le Pape au-dessus du Christ !
Je n’invente rien. Dans son mandement publié pour le Carême 1929, on peut lire :
« Écoutez saint Fulgence et avec lui saint Cyprien, saint Augustin et tant d’autres : « Croyez fermement et sans hésitation qu’aucun hérétique ou schismatique ne peut être sauvé, s’il n’est pas en communion avec l’Église et le Pape, quelques aumônes qu’il ait pu faire pendant sa vie, alors même qu’il aurait répandu son sang pour le nom de Jésus-Christ. »
Rien ne sert de faire le bien et de pratiquer la vertu, ni même de se sacrifier à Dieu. Avant tout il faut obéir au Pape.
Cette doctrine fait du Pape le vrai Dieu, car l’autre n’est guère encombrant.
Le moine Auguste Triomphus, dont la Somme fut publiée à Rome en 1584 (cette Somme avait été écrite sur l’ordre du Pape Jean XXII lui-même) prétendait que le Pape pourrait délivrer d’un seul coup, s’il le désirait (mais il n’y a pas intérêt, bien au contraire !) toutes les âmes du Purgatoire.
« La puissance du Pape est si grande que le Pape lui-même n’en peut connaître la limite. »
Léon XIII, qu’on représente comme un pape libéral, a dit formellement :
« Puisque la fin à laquelle tend l’Église est de beaucoup la plus noble de toutes, son pouvoir aussi l’emporte sur tous les autres. »
Le Pape revendique donc tout le pouvoir. Il est bien loin de se cantonner dans une mission purement « spirituelle ».
N’a-t-il pas toujours réclamé le droit de vie et de mort sur les fidèles ? En 1862, le célèbre journaliste catholique Veuillot n’écrivait-il pas :
« Il se rencontre des hommes qui se scandalisent de voir aux mains du Père des fidèles le droit de vie et de mort. Ces mêmes hommes, toutefois, ne songent pas à contester au Pape le droit de lier et de délier les consciences, de retenir ou de remettre les péchés, d’ouvrir le ciel ou de le fermer. Pourquoi celui qui peut plus ne peut pas moins ? Pourquoi celui qui a reçu de Dieu le droit de vie et de mort éternelles ne pourrait-il pas recevoir aussi ce qui est infiniment moins, le droit de vie et de mort temporelles ? »
En 1851, le pape Pie IX avait censuré le canoniste Nuytz (de Turin) qui ne voulait accorder à l’Église qu’un pouvoir pénal spirituel et non temporel. (Lacordaire, Montalembert, etc ... , furent blâmés pour le même motif.)
En créant le féroce tribunal de l’Inquisition, en obligeant les rois (sous les menaces les plus effroyables) à exterminer les hérétiques, les Papes ont montré qu’ils entendaient soumettre l’humanité tout entière à leur ambition.
Pour acquérir et pour conserver cette puissance exorbitante, la Papauté n’a pas reculé devant le choix des moyens. Elle a imposé à ses fidèles une obéissance absolue et dégradante ; elle est allée jusqu’à se proclamer infaillible.
Le Cardinal Maurin, archevêque de Lyon, proclamait (Carême 1929) :
« Le privilège de l’Infaillibilité a été conféré à l’Église par le Christ. En vertu de cette prérogative, il est alors absolument impossible que le Pape se trompe. C’est une vérité de foi définie par le même Concile du Vatican et l’on ne pourrait la nier sans tomber dans l’hérésie et se séparer de l’Église. »
(Remarquons en passant que le Christ n’a rien conféré à l’Église et que les Évangiles ne disent pas un mot de tout cela, même en torturant les textes.)
Mgr Maurin citait ensuite des paroles du Pape Pie X lui-même, prononcées en 1910 :
« Quand on aime le Pape, on ne s’arrête pas à discuter sur ce qu’il conseille ou exige, à chercher jusqu’où va le devoir rigoureux de l’obéissance et à marquer la limite de cette obligation. Quand on aime le Pape, on n’objecte pas qu’il n’a pas parlé assez clairement, comme s’il était obligé de redire à l’oreille de chacun sa volonté clairement exprimée tant de fois, non seulement de vive voix, mais par des lettres et d’autres documents publics ; on ne met pas en doute ses ordres, sous le futile prétexte, pour qui ne veut pas obéir, qu’ils n’émanent pas effectivement de lui, mais de son entourage. On ne limite pas le champ où il peut et doit exercer sa volonté ; on n’oppose pas à l’autorité du Pape celle d’autres personnes, si doctes soient-elles, qui diffèrent d’avis avec le Pape. »
Peut-on imaginer langage plus orgueilleux de la part d’un potentat quelconque ?
Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, grand apôtre de l’obéissance (pour les autres), avait été jusqu’à dire que « si le pape décide que le blanc est noir, nous devons dire avec lui : c’est noir ! » (Exercices spirituels, édition de 1644, p. 290.)
Certains lecteurs penseront peut-être que les choses ont évolué depuis Loyola et que l’Église est moins exigeante aujourd’hui ?
Je les renvoie à nouveau au Cardinal Andrieu, archevêque de Bordeaux. Combattant l’Action Française, il définit la puissance du pape de la façon suivante :
« En faisant écho à ce refus d’obéissance, sous prétexte que le Pape était sorti de son domaine, les catholiques de l’Action Française adhérèrent à trois hérésies formelles : à l’hérésie qui conteste au Pape le droit de fixer lui-même les limites de sa compétence ; à l’hérésie qui conteste au Pape les pouvoirs de juridiction plénière tels que le Concile du Vatican les a définis ; à l’hérésie qui conteste au Pape le droit de décider souverainement et sans recours possible, même au Concile œcuménique. »
Le même cardinal publiait, le 31 juillet 1929, une lettre pour féliciter un royaliste d’avoir rompu avec l’Action Française pour faire sa soumission à l’Église. Et il signait sa lettre : « Bordeaux, le 31 Juillet 1929, en la fête de saint Ignace, le fondateur d’une illustre milice suscitée de Dieu en vue de combattre par l’obéissance au Pape, perinde ac cadaver, l’esprit de révolte contre le Pape, que Luther avait soufflé dans toute l’Europe avec son « Libre Examen » (La Croix, 8 août 1929.)
Ces quelques lignes suffisent à montrer que la mentalité cléricale n’a pas varié.
Toujours la haine de Luther et le mépris du libre examen. Toujours l’obéissance au Pape, perinde ac cadaver (comme un cadavre). Toujours le même souci de fouler aux pieds l’individu et d’en faire un automate.
En juin 1929, un pèlerinage français a été conduit à Rome par le général de Castelnau, qui a donné dans son bulletin, Le Point de Direction, le compte rendu de la cérémonie, qui s’est déroulée d’ailleurs selon les traditions courantes. Les pèlerins se sont tous agenouillés et le Pape a traversé leurs rangs en leur donnant son anneau à baiser. Lorsqu’il fut installé sur son trône, Castelnau, toujours agenouillé, prit la parole pour l’assurer « de notre soumission sans réserve », « humblement prosternés aux pieds de Votre Sainteté », etc, etc... Semblable platitude n’est assurément plus de notre époque, mais il faut convenir qu’elle est la conséquence logique des croyances catholiques en l’infaillibilité et la pseudo-divinité du Pape.
Il me serait facile de multiplier les preuves de ce genre, pour montrer combien grande est la tyrannie papale — et combien grande la servilité des croyants catholiques. Il me semble plus intéressant de rechercher les conditions dans lesquelles un despotisme aussi monstrueux a pu naître et se développer.
ORIGINE DE LA PAPAUTÉ.
S’il fallait en croire les catholiques, la Papauté aurait une origine surnaturelle et divine. Son fondateur serait le Christ en personne, sous prétexte qu’il aurait dit à son disciple Pierre (qui devait le trahir si lâchement) :
« Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. »
La prétendue divinité de l’Église ne repose donc que sur un mauvais calembour ; il ne faut pas être très exigeant pour se contenter de cette « preuve ».
Ajoutons qu’on ne sait pas grand chose sur saint Pierre, premier pape et fondateur de l’Église. L’histoire de son supplice est déclarée apocryphe par des historiens très compétents. Certains autres sont allés jusqu’à nier même son existence. En tout cas, il n’a jamais mis les pieds à Rome et n’a pu en être l’évêque, par conséquent.
Les débuts du christianisme sont entourés d’une grande obscurité et les documents sérieux sont très rares, ce qui n’empêche pas l’Église d’être très affirmative. Ainsi Pie XI, dans sa lettre du 11 juin 1929 au Cardinal Gasparri, assurait que « l’universalité se rencontre déjà de droit et de fait aux premiers débuts de l’Église et de la prédication apostolique ».
Or, ceci est absolument faux, il a fallu plusieurs siècles pour que la Papauté fût constituée. Il a fallu bien des luttes et bien des intrigues, il a fallu surtout du machiavélisme, du mensonge et nombre de faux documents, pour que l’évêque de Rome prenne le pas sur les autres évêques et leur impose son autorité.
« Les métropolitains sont restés, au moins jusque dans le IXème siècle, en possession d’instituer les évêques de leur province, sans intervention du Pape, dont ils avaient pourtant accepté depuis longtemps l’autorité sur eux-mêmes. » (Abbé de Meissas)
Même lorsqu’ils eurent accepté l’autorité du pape, les évêques et archevêques métropolitains restèrent donc les maîtres dans leurs diocèses ; l’autorité du Pape fut, au début, purement nominale, honorifique. On s’effaçait devant l’évêque de Rome (comme devant celui de Constantinople) parce qu’il représentait une capitale importante, dont la renommée était considérable. L’idée de primauté s’attachait à la ville et non à la personnalité de l’évêque.
Les évêques de Rome eux-mêmes étaient bien éloignés de manifester à ce moment de grandes ambitions ; ils n’avaient pas la moindre idée de l’omnipotence qui serait revendiquée par leurs successeurs.
Au sein des premiers groupes chrétiens, il n’y avait pas de hiérarchie. La fraternité régnait de la façon la plus complète, car on attendait la fin du monde, que Jésus (il s’est trompé sur ce point comme sur beaucoup d’autres !) avait prédite comme imminente (Dogme de la Parousie). Dans cette attente, les disciples du Christ mettaient en commun tout ce qu’ils possédaient et vivaient sur le pied d’une parfaite égalité. Prêtres, évêques et simples fidèles ne se distinguaient aucunement les uns des autres, ni par le costume, ni par l’autorité. Les premiers évêques de Rome n’ont donc laissé aucun souvenir historique tangible et sérieux, ce qui n’a pas empêché l’Église de les canoniser. De tous les premiers Papes des cinq premiers siècles sans exception, dont on ne sait rien, ou presque rien, elle a fait des saints, en effet ; probablement pour donner à leur personnalité un semblant de réalité.
Mgr Duchesne, dans son ouvrage très érudit sur l’histoire de la Papauté, a supprimé une dizaine de papes que l’Église (infaillible pourtant !) avait toujours considérés comme authentiques. Il a bien fallu s’incliner, en maugréant, devant l’érudition du savant Mgr Duchesne et l’annuaire officiel du Vatican, dès 1905, adopta la chronologie remaniée. (La Vérité sur le Vatican, par V. Charbonnel). C’est ainsi que le pape Pie XI, qui devrait être le 266ème successeur de saint Pierre, est devenu le 260ème.
Charbonnel avait fait des découvertes assez amusantes. Parmi les papes supprimés (et qui n’ont jamais existé), se trouve saint Anaclet. On l’a biffé de la liste des papes, mais il continue à figurer, en qualité de saint, sur le calendrier — entouré d’ailleurs de beaucoup d’autres « saints » forgés de toutes pièces par les exploiteurs de belles légendes.
Ces exemples montrent qu’il ne faut accorder aucun crédit aux affirmations « historiques » de l’Église.
* * *
Chacun sait que la puissance de l’Église date du règne de l’empereur Constantin, qui trouva adroit d’appuyer son autorité personnelle, pour la rendre plus forte, sur les croyances du Christianisme — religion d’esclaves.
Il conféra aux évêques des pouvoirs judiciaires (314), mais il n’accorda rien de plus à l’évêque de Rome, pseudo-pape, qu’aux autres évêques.
Grâce à l’appui des empereurs, le christianisme progressa. Il s’était jusqu’alors peu développé à Rome puisqu’en 251, les chrétiens romains n’étaient au nombre que de quelques milliers, soit environ cinq pour cent seulement de la population totale, en dépit de tous les exploits soi-disant miraculeux attribués à Paul, à Pierre, aux premiers papes et aux innombrables martyrs de la foi chrétienne. La dite foi était si stupide qu’elle ne pouvait se développer que par l’appui des pouvoirs publics, c’est-à-dire par la contrainte et par l’intérêt.
Après les troubles de l’Arianisme, qui divisèrent les chrétiens, les dits chrétiens se resserrèrent un peu autour de Rome. Le Concile de Sardique (347) fut une des premières tentatives pour renforcer l’autorité de l’évêque romain, lui conférant un droit de juridiction sur toute l’Église. Malheureusement, les canons de Sardique sont des faux, probablement fabriqués au Vème siècle pour les besoins de la cause romaine et jamais le Concile de Sardique n’avait songé à prendre les décisions qu’on lui attribua mensongèrement par la suite. (Professeur Friedrich.)
En réalité, jusqu’au milieu du VIIIème siècle, en dépit des velléités de Rome, leur influence sur les chrétiens d’Orient demeura complètement nulle et même assez faible sur ceux d’Occident. Une rivalité acharnée dressait au surplus le pape de Rome contre son concurrent, pape de Constantinople. Ce dernier tirait sa puissance de la proximité du trône impérial.
« Si Constantinople avait conservé l’empire du monde ; si le relèvement qui marqua le règne de Justinien avait eu des suites, Rome eût été probablement vaincue dans la lutte. Au lieu de la Papauté romaine, nous aurions subi sans doute une Papauté byzantine. » (De Meissas)
Ainsi, le développement de l’Église chrétienne fut conditionné bien davantage par des facteurs politiques que par des facteurs purement religieux et moraux.
Sujet de l’empereur byzantin, l’évêque de Rome le trahit et s’affranchit de sa tutelle. Puis, grâce à la naïveté des rois Francs, il s’adjuge la souveraineté d’un nouvel État (752). La puissance temporelle de la Papauté est fondée.
Les premiers papes ont su spéculer à merveille sur l’ignorance et la crédulité de leurs fidèles encore barbares et terrorisés par les dogmes de la religion. Pour les berner, on fabriqua des faux documents par centaines. Ce ne sont pas seulement les fameuses Décrétales, base essentielle de la Papauté, qui sont fausses. Tout est truqué, altéré, déformé, falsifié ou inventé de toutes pièces ! Les canons des Conciles, les lettres des empereurs et des rois, leurs prétendues donations aux papes, les bulles même et les écrits attribués aux premiers évêques de Rome, tout est l’œuvre de faussaires très pieux, travaillant obstinément à travers les siècles à donner une base inébranlable à la puissance papale. La plupart des documents invoqués par les papes pour justifier leurs prétendus droits sont apocryphes ou altérés !
Base bien immorale pour ... la plus grande puissance morale (?) du monde !
« De sorte, pourrait-on ajouter après la lecture des travaux de Doellinger et de Friedrich, que plus la critique pénètre dans les origines de l’Église chrétienne, plus on en vient à se demander s’il nous reste un seul document authentique des origines du Christianisme, et lequel ? » (Professeur Giraud-Teulon. traducteur de « La Papauté », d’Ignace de Doellinger.)
Voici ce que l’abbé de Meissas écrit de son côté, sur les fausses Décrétales :
« On sait que ce recueil contient avec d’autres pièces apocryphes de fabrication antérieure, comme la donation de Constantin (par cette fausse donation, les Papes prétendaient fournir la preuve que l’empereur leur avait donné la possession légitime de l’Italie), 94 lettres papales, allant de saint Clément (fin du Ier siècle) à Grégoire II (+731). Grâce à l’ignorance et au défaut de critique de tout le clergé au IXème siècle, les Papes, dont elles faisaient l’affaire, s’appuyèrent sur elles à partir de Nicolas I, en 865. En 1151, elles furent introduites dans le décret de Gratien, où elles devinrent définitivement la base d’un droit ecclésiastique inconnu aux premiers siècles.
L’imposture fut peut-être soupçonnée, reconnue même de bonne heure, par plus d’un savant mais il était alors trop dangereux de passer pour une personne pensant mal des choses de la sainte foi catholique (style de l’Inquisition). Les premiers qui osèrent exprimer leurs doutes furent le cardinal Nicolas de Cusa (+1464), Laurent Valla (+1465) et Jean de Torquemada (+1468). L’imposture fut définitivement démontrée par les protestants, savoir les Centuriateurs de Magdebourg en 1560 et David Blondel (+1655). L’Index a vainement essayé d’étouffer leurs voix ; tout le monde est aujourd’hui fixé. Mais le mal était fait et la Papauté est restée en possession de cette omnipotence absolue, que personne ne lui reconnaissait encore avant les fausses décrétales. »
La cause est donc entendue. Le chanoine Doellinger (« le théologien le plus illustre de l’Église catholique et l’une des gloires scientifiques de l’Allemagne au XIXème siècle ») a pu écrire : « Aucune des anciennes confessions de foi, aucun catéchisme, aucun des écrits des Pères de l’Église destinés à l’instruction religieuse du peuple, ne contiennent un mot du pape : encore moins, une allusion à l’obligation de ne chercher qu’auprès de lui la certitude en matière de foi et de doctrine. Aucun point de la doctrine, pendant le premier millier d’années de l’Église, n’a été reçu comme valablement décidé par une sentence papale ».
La Papauté est le fruit du mensonge, de l’imposture et de l’intrigue. Source empoisonnée, dont ne pouvait sortir qu’une institution malsaine, ainsi que nous allons le montrer.
FIN DE LA DÉMOCRATIE CHRÉTIENNE.
Le premier résultat de cette évolution fut que l’Église perdit le caractère semi-démocratique qu’elle avait eu à ses origines.
Prêtres et évêques étaient alors élus directement par les fidèles. Il en fut de même pour certains papes, tels que saint Ambroise, élu par le peuple, bien qu’il ne possédât aucun titre ecclésiastique.
Jusqu’alors, les questions dogmatiques avaient été librement discutées dans les synodes et les conciles. C’était l’assemblée des évêques qui les tranchait et qui décidait. Le pape ne pouvait imposer aucune idée personnelle, à moins qu’elle n’eût été approuvée et confirmée par les évêques.
Les évêques refusaient parfois de s’incliner devant les papes ; c’était ceux-ci qui devaient baisser pavillon devant les décisions des conciles.
Au VIIème siècle, ne s’est-il pas trouvé un concile pour condamner la mémoire du pape Honorius Ier, convaincu d’hérésie et dont les écrits furent livrés aux flammes ? Les légats romains assistaient à ce grand Concile, parlant au nom de l’Église tout entière. On était encore loin de la ridicule infaillibilité des Papes !
En 824, les évêques réunis au Synode de Paris blâmèrent les « absurdités » du pape Adrien, qui avait ordonné, disaient-ils, une adoration superstitieuse des images. (La chose n’a pas grande importance, puisque le Cardinal Bellarmin a prétendu qu’il fallait suivre les enseignements des papes, fussent-ils hérétiques, faute de quoi l’autorité de l’Église serait dangereusement ébranlée. Un théologien de Mayence, Erbermann, assurait qu’un pape tout à fait ignorant pouvait être quand même infaillible « puisque, autrefois, Dieu avait indiqué le bon chemin aux hommes en faisant parler même une ânesse ». (Doellinger.)
Le Pape Étienne VII fit déterrer le corps du Pape Formose, son prédécesseur. On le dépouilla de ses ornements, on lui coupa les doigts et la tête et ses débris furent jetés dans le Tibre. Les ordinations faites par Formose furent annulées par Étienne VII. Mais celui-ci fut bien vite étranglé et ses successeurs Théodose II (qui régna 20 jours !) et Jean IX le désavouèrent à leur tour — et replacèrent Formose dans son tombeau ! L’infaillibilité des représentants de Dieu était soumise à de singulières (et barbares) fluctuations.
D’autre part, les papes n’avaient aucune part à la convocation des synodes. Tous les grands synodes ont été ordonnés par les empereurs, qui ne consultaient même pas les papes. Ces derniers n’en eurent même pas toujours la présidence (Doellinger). On voit par là que leur « primauté » ne leur procurait pas des avantages bien sensibles.
Bien entendu, à ces époques, il n’y avait pas de Curie romaine. Personne ne demandait au pape de dispense, ne lui versait de taxe ni d’impôt. Tout cela a bien changé par la suite.
Il faut reconnaître que les manœuvres des évêques de Rome furent facilitées par la dissolution de l’empire romain et les invasions des barbares. A la faveur de ces désordres, ils s’emparèrent aisément du pouvoir.
Les Croisades contre les Infidèles constituent une des plus grandes hontes de la Papauté. Au cours de ces guerres stupides, on fit d’horribles hécatombes (par exemple, sur 800.000 croisés, il n’en arrivait que 50.000 aux Lieux « Saints »). Qu’importait aux Papes, désireux d’accroître leur puissance à tout prix !
Et leurs conflits avec les rois, par suite de leurs exigences ? Faut-il rappeler leur résistance à la Pragmatique Sanction ? Faut-il rappeler le crime de la condamnation des Templiers ? Il y aurait trop à dire ….
Même la condamnation des Jésuites, au XVIIIème siècle, dont on serait tenté de féliciter la Papauté (comme une de ses rares bonnes actions) ne fut décidée qu’à contre-cœur. Au fond, le Pape Clément XIV était favorable aux Jésuites ; il ne les condamna que parce qu’ils avaient soulevé contre eux une réprobation universelle par leurs méfaits — et parce qu’il craignait, en se solidarisant avec eux, de provoquer un schisme dans l’Église.
Chaque pape s’employa, à tour de rôle, à conserver et à accroître sa puissance, mais ce fut Grégoire VII, habile, énergique, sans scrupule, qui développa au plus haut point l’absolutisme papal et ses successeurs ne firent que s’inspirer des principes et de l’exemple qu’il leur avait légués.
L’ambition des papes ne connut plus de bornes. Par l’Inquisition, ils ne reculèrent devant aucune atrocité pour imposer leur joug aux populations. Les rois tremblaient devant eux, car ils excommuniaient quiconque leur résistait, allant jusqu’à délier les sujets des rois hérétiques ou excommuniés de toute obéissance à leur égard, excusant ainsi la révolte et le régicide. En d’autres circonstances, les Papes avaient la prétention de disposer des royaumes ; ils enlevaient la couronne à tel monarque indocile pour la donner à un autre roi ou à un seigneur choisi parmi leurs plus dévouées créatures. Que de conflits et de guerres sanglantes ont été produits par cette insupportable prétention de la Papauté ! Maîtres du monde, pasteurs des âmes, représentants de Dieu, n’étaient-ils pas qualifiés pour gouverner les nations, par dessus la tête des potentats éphémères, qui n’avaient reçu le glaive que pour servir Dieu et son Église ?
Alexandre VI donna au roi d’Espagne toutes les terres que l’on découvrirait à cent lieues des Açores, à la seule condition d’en faire évangéliser les habitants (et pour cause). Quel titre avait le Pape sur l’Amérique, pour la « donner » aux barbares conquistadores qui devaient exterminer les malheureux Indiens ? Il y eut une grande dispute, car le pape Eugène IV l’avait déjà donnée (l’Amérique), aux Portugais. Mais les Espagnols eurent, finalement, raison, parce qu’ils étaient les plus forts et qu’ils s’appuyaient sur un pape vivant, tandis que les Portugais ne pouvaient invoquer qu’un pape mort ! (Meissas).
En 1215, Innocent III attaqua furieusement la Magna Charta anglaise, la plus ancienne et la plus vénérable des constitutions européennes, parce qu’elle ne faisait pas une part assez grande à l’absolutisme romain.
Pie VI n’essaya-t-il pas, plus tard, de briser l’œuvre de notre Révolution française ? En opposition à la Constitution civile du clergé, n’a-t-il pas suscité le plus féroce des conflits, en poussant les Chouans à la « guerre sainte » ?
Le dernier grand concile fut le Concile de Trente. Les papes supportaient mal ces grandes assemblées, où l’on discutait trop librement à leur gré. Ils les considéraient comme des obstacles à leur autocratie.
Les Papes mirent tant d’obstacles au Concile de Trente, ils l’interrompirent et le suspendirent si souvent, qu’il se prolongea 18 ans ! (de 1545 à 1563). La Papauté craignait d’être mise en cause au cours des débats, mais elle manœuvra si habilement qu’elle finit par lasser ses adversaires et par éviter le danger.
La Papauté devint une monarchie vraiment absolue.
Ce fut, à l’intérieur même de l’Église, une atmosphère étouffante. On la respire aujourd’hui encore ... Le célibat fut imposé aux prêtres, afin de pouvoir les dominer plus aisément.
Le pape eut le pouvoir de fabriquer lui-même les lois de la Chrétienté, de les modifier ou de les supprimer à son gré et sans consulter personne. Jamais aucun monarque ne posséda une puissance aussi arbitraire.
Dans la pratique, le Pape était souvent un instrument entre les mains de son entourage. La Curie romaine s’était formidablement développée ; elle était devenue la plus forte bureaucratie qui ait jamais existé dans le monde. Le Pape était le prisonnier de la Curie, qui, de son côté, n’obéissait qu’aux appétits les plus cupides et aux ambitions les plus exagérées.
Par la suite, la Compagnie de Jésus devait s’infiltrer dans l’entourage du Pape et régner sur le Vatican. Nous voyons aujourd’hui fleurir sous nos yeux les conséquences ultimes de la politique des jésuites, devenus, par leur ingéniosité, leur patience et leur astuce, les véritables maîtres des Papes et de l’Église catholique.
La « démocratie » chrétienne reçut le coup de grâce en 1870, au Concile du Vatican, qui admit le dogme stupide de l’Infaillibilité du Pape. Il y eut cependant des résistances, puisque 451 prélats seulement, sur 700, s’inclinèrent lors du premier vote, devant la volonté de Pie IX. Voilà une infaillibilité (!) qui tenait à peu de chose.
La plupart de ces prélats était entraînés par l’appât des faveurs et des prébendes. Ils votèrent par calcul, par intérêt, plutôt que par faiblesse ou par sottise, ce qui fut pourtant le cas de quelques-uns.
Parmi les opposants se trouvaient les hommes les plus distingués, intelligents, sincères. Ils durent s’incliner, la mort dans l’âme, devant le triomphe des Jésuites, qui faisait de la religion chrétienne, un véritable fétichisme, basé sur le culte d’un homme infaillible et sacro-saint !
PRÉTENDUE SAINTETÉ DE LA PAPAUTÉ.
Plus la papauté acquérait de puissance, plus vite elle dégénérait, sombrant dans l’immoralité la plus choquante.
Les compétitions les plus ardentes ne tardèrent pas à se déchaîner autour du trône pontifical. Il ne m’est pas possible, dans cette courte étude, de multiplier les exemples, car c’est toute l’histoire de la papauté, très détaillée, qu’il faudrait faire pour montrer la bassesse et l’avidité des prétendus représentants de Jésus.
Bornons-nous à quelques exemples.
« De 883 à 955, pendant plus de 70 ans, l’Église romaine vécut dans l’humiliation et dans la servitude : la chaire apostolique était alors la proie et le jouet des factions rivales de la noblesse et fut même livrée, pendant un certain temps, aux mains de femmes ambitieuses et débauchées. » (Doellinger)
Au XIème siècle, ce fut encore pire :
« Le trône pontifical fut alors vendu et acheté comme une marchandise ; trois papes, à la fois, se disputèrent jusqu’à ce qu’enfin, l’empereur Henri III parvint à arrêter la dissolution de la papauté en plaçant des évêques allemands sur le siège de Rome. »
A l’origine, les Papes étaient sous la dépendance des Empereurs (le droit de veto, conservé par l’Empereur d’Autriche jusqu’au démembrement de son empire en 1918, n’était pas autre chose qu’un vestige de cette dépendance). Une fois élu, le Pape ne commençait à régner de façon réelle qu’après avoir reçu l’exequatur impérial. Cette vassalité cadrait assez mal avec le caractère prétendu surnaturel et sacré de la Papauté.
Lorsque les Papes se furent émancipés de cette tutelle, lorsqu’ils se sentirent assez forts pour essayer de faire trembler les empereurs et les rois, lorsque la chrétienté fut soumise à leurs caprices, leur ambition devint illimitée.
Ils poussèrent la folie jusqu’à se mettre au-dessus des principes sociaux et moraux imposés aux vulgaires mortels.
« En 1610, la Rota de Rome rappelle que les concordats entre le pape et les princes, étant un privilège accordé par le Saint Siège, celui-ci n’est jamais lié par contrat. »
Nicolarts Zallwein, Oenas Sylvins, Pirro Corrado, Roccaberti, Felino Sandei soutiennent la même thèse.
Le 14 décembre 1740, Benoît XIV renouvelle ces prescriptions et se met au-dessus de tout concordat, dans sa lettre au Chapitre de Liège. En 1893, Pezzani, théologien pontifical, déclare qu’un concordat n’est qu’une concession, toujours révocable dès qu’elle cesse d’être utile à l’Église ; il ajoute que l’obéissance est due même à un pape pervers. (Voir les remontrances de saint Bernard (1091–1153), à la Papauté et aux Grands de l’Église, qui dominent et s’enrichissent. Cité par le Docteur Mariavé.)
Dans leur orgueil, les Papes se plaçaient donc tout à fait au-dessus de la chétive humanité !
Aussi, quelles rivalités, quelles luttes haineuses vont se livrer pour la possession de la tiare ! Et que de crimes aussi... Nombreux sont les papes qui n’ont gouverné que pendant quelques mois, voire quelques semaines et qui mouraient subitement, empoisonnés par les prélats impatients de leur succéder !
L’abbé de Meissas a dressé un tableau récapitulatif des pontificats les plus courts. Je regrette que la place me fasse défaut pour le reproduire, car il est très suggestif. Contentons-nous d’y relever quelques noms.
Entre les années 235 et 1605, il a régné 212 papes. 42 n’ont pas régné une année entière. (La fin du IXème siècle vit 10 papes en 17 ans !)
Sisinnius ne gouverna que 19 jours ; Étienne I, 3 jours ; Boniface VI, 15 jours ; Théodore II, 20 jours ; Jean XV, un mois ; Damase II, 23 jours ; Célestin IV, 16 jours ; Pie III, 25 jours ; Marcel II, 2 jours (c’est un record !) ; Urbain VII, 15 jours ; Léon XI, 26 jours (le record fut battu en 1276 : 4 papes se succédèrent, en effet, au cours de cette seule année). Je n’énumère pas ceux dont le règne a duré un mois, six semaines ou trois mois au maximum, la liste en serait trop longue.
Les papes étaient terriblement puissants, mais ils soulevaient tant de jalousies et de haines que, malgré les précautions les plus prudentes, ils finissaient souvent par succomber.
Il avait fallu 35 jours de conclave pour élire Pie III — et il ne gouverna que 25 jours.
Lorsque les cardinaux ne parvenaient pas à se mettre d’accord pour l’élection du Pape, ils votaient pour le plus vieux, le plus malade (ou le plus bête), espérant ainsi se retrouver bientôt devant un siège vacant et de nouvelles élections.
L’Église ose, néanmoins, prétendre que les Papes sont élus sous l’inspiration du Saint Esprit !
Bien entendu, les femmes jouaient un rôle de premier plan dans ces intrigues et ces compétitions. Armand Dubarry a pu dire que « les femmes ont fait plus de prélats, cardinaux, papes que tous les souverains réunis » (Histoire de la Cour de Rome).
En 1281, le Conclave, réuni à Viterbe, traînait en longueur. La foule envahit alors le palais et enlève les cardinaux Matteo et Giordano Orsini, parents du défunt pape, qui entravaient l’élection, paraît-il. La nomination du nouveau pape, Martin IV, put alors se faire sans difficultés. Voilà une manifestation vigoureuse ... du Saint-Esprit !
Le Français De Brosses, qui voyageait en Italie, vers 1740, a laissé sur les Conclaves des pages inoubliables, presque aussi sévères que celles qui furent écrites, moins d’un siècle plus tard, par l’illustre écrivain catholique Chateaubriand. Écoutons De Brosses :
« Il n’y a ni petit ni grand dans Rome qui n’ait un intérêt personnel à ce que tel ou tel soit élu, à cause des liaisons et des protections, à cause des cardinaux qu’il fera et parce qu’il rend incontinent son chapeau à quelqu’autre personne appartenant à la famille du pape qui le lui a donné ; de sorte qu’il importe à beaucoup de gens que le nouveau pontife soit choisi dans le nombre des créatures de tel ou tel pape. » (Cité par Dubarry)
On cite des papes qui achetèrent à beaux écus une partie des cardinaux composant le Conclave, afin d’être élus à coup sûr ! Ce fut le cas du cardinal Rodrigue Borgia, élu pape, en dépit de sa vie scandaleuse (il avait 5 bâtards) en prodiguant l’or et les promesses.
Il leur fallait, une fois élus, récupérer leur mise de fonds en pressurant la chrétienté et en vendant aux enchères toutes les charges ecclésiastiques.
« Il n’est plus un évêché, il n’est plus une dignité ecclésiastique, il n’est plus une simple place de curé, dit l’abbé Burchard d’Ursperg, dont on ne fasse l’objet d’un procès à Rome et malheur à celui qui y arrive les mains vides. » (Doellinger)
« Tout se vendit autour du pape : la pourpre, la mitre, les bénéfices, les titres, les décorations ; car rien n’égalait l’appétit de ce beau monde clérical, couvert de dentelles, de soie, de brocart et servi par un nombreux domestique. » (Dubarry)
Que d’abus dans la nomination des cardinaux !
Leur nombre était d’abord très réduit. En 1277, le Conclave qui élit Nicolas III n’était composé que de 8 cardinaux seulement.
Il y en eut ensuite 10, puis 20, puis 40, 50 ... Sixte V décida qu’il y en aurait 70, et ce chiffre a prévalu.
C’était une source de très gros bénéfices. Aussi nous ne devons pas nous étonner d’apprendre que Léon X ait créé cardinal à l’âge de sept ans, le fils du roi du Portugal.
Alexandre VI nomme le fils du roi de Sicile, âgé de 4 ans, coadjuteur de l’évêque de Metz. Jean X nomme archevêque un enfant de 5 ans, fils du comte de Vermandois et Clément VII fait cardinal le jeune Odet de Coligny — il avait 11 ans.
En 1534, Paul III fait cardinal son neveu Nicolas (12 ans).
Sixte Quint nomme également son neveu Peretti cardinal, à l’âge de 14 ans.
Léon X avait été créé cardinal à 14 ans par Innocent VIII. (Il est vrai qu’on pouvait également être pape à 23 ans (Grégoire V), à 16 ans (l’infâme Jean XII) et même à 12 ans (Benoît IX).
Nul n’ignore que ce sont tous ces abus, cet amour effréné de l’argent, la vente des indulgences, des évêchés, des cures, le spectacle des orgies, des empoisonnements, des turpitudes de la Papauté qui ont rendu possible la révolte de Luther et le grand mouvement de réformation protestante. Le siège de saint Pierre, grisé de sa toute puissance, sombrait dans la folie et la pourriture.
Le chancelier Gerson, dont on a fêté récemment l’anniversaire, déclare :
« Par suite de l’avarice cléricale, de la simonie, de l’avidité et de l’ambition des papes, l’autorité des évêques et des chefs inférieurs des Églises a été absolument détruite et anéantie ... »
On excommuniait quantité de gens pour des bagatelles, leur laissant ensuite la faculté de se racheter de ces excommunications par le versement de sommes écrasantes. L’exploitation de la superstition fut poussée à ses extrêmes limites.
L’évêque Alvaro Pelayo raconte qu’il aperçut, chaque fois qu’il entra dans les antichambres du pape, des courtisans occupés à compter des pièces d’or, dont les monceaux s’élevaient devant eux. (Doellinger)
Jacques de Vitry (qui fut lui-même cardinal), disait :
« Les revenus de la France entière suffiraient à peine à subvenir au luxe des cardinaux. »
Et ces personnages se disputaient le Saint-Siège comme une proie.
J’ai dit plus haut que certains papes n’avaient régné que quelques semaines, voire quelques jours. Il faut ajouter qu’entre deux papes, il y avait parfois un interrègne considérable, parce que les cardinaux ne parvenaient pas (malgré la collaboration du Saint Esprit, c’est-à-dire de Dieu), à se mettre d’accord. C’est là un des plus grands scandales qui déshonorent l’histoire de la Papauté.
Célestin IV ne fut élu pape qu’après une vacance de 2 ans ; Grégoire X, après un interrègne de 3 ans ; Nicolas IV, après une année et son successeur Célestin V dut attendre 27 mois ! Après la mort de Benoît XI, il y eut une vacance de 11 mois ; après celle de Clément V une vacance de 28 mois....
Durant ces interrègnes, les gens de la Curie s’en donnaient à cœur joie. Ce n’était que procès, intrigues, vente de sauf-conduits, de dispenses, de privilèges de toutes sortes.
On réagit contre ces scandales, en soumettant les Conclaves à un règlement sévère. Les cardinaux étaient enfermés tous ensemble, dans une même chambre. Ils n’étaient autorisés à conserver qu’un seul serviteur chacun auprès d’eux et leurs aliments leur étaient apportés à travers un guichet.
Si le Saint Esprit ne les avait pas visités au bout de trois jours et s’ils n’étaient pas arrivés à se mettre d’accord sur le choix d’un pape, on diminuait leur ration alimentaire pour les obliger à se dépêcher.
Moins sévère aujourd’hui, l’organisation des Conclaves maintient cependant pour les cardinaux l’obligation d’être séquestrés jusqu’à la fin de l’élection. Excellente précaution ...
Machiavel déclare que « plus un peuple habite près de la Cour romaine, moins il possède de religion ». Et Guichardin écrit :
« On ne saurait dire de la Cour de Rome tant de mal qu’elle n’en mérite encore davantage. »
Isidore Chiari, évêque de Foligno, va jusqu’à dire que :
« Parmi les deux cent cinquante évêques de l’Italie, à peine pourrait-on en trouver quatre méritant le nom de pasteurs spirituels et administrant réellement leur charge. »
Sainte Catherine de Sienne vint trouver Grégoire XI et lui dit « qu’elle sentait dans la Curie romaine la puanteur des vices infernaux ».
Saint Bonaventure, que les Papes avaient pourtant comblé d’honneurs n’a pu s’empêcher de comparer Rome à « une prostituée qui enivrait les rois et les peuples du vin de sa débauche ».
Le peuple romain, loin d’estimer la Papauté, détestait cordialement tout ce qui touchait, de près ou de loin, au Vatican.
« On n’a pas souvenir d’un Pape dont la mort ait été un sujet de deuil pour les Romains. » (Dubarry)
La mort du Pape était, au contraire, le signal de la réjouissance populaire ou de la révolte.
Les Romains expulsèrent la Papauté de Rome à plusieurs reprises, en effet. De 1140 à 1149, par exemple, les papes ne purent rentrer dans la Ville éternelle.
A la mort de Paul IV, le peuple se souleva et délivra tous les prisonniers de l’Inquisition, puis mit le feu à la prison.
Le grand schisme d’Occident, conséquence de ces compétitions farouches, mit le coupable au scandale. Pendant 71 ans, on vit le spectacle de deux papes, l’un à Rome, l’autre à Avignon (à certain moment il y en eut même trois !) s’excommuniant et s’anathématisant réciproquement... (XIVème et XVème siècles).
Un autre exemple de ces compétitions : le pape Sergius III est élu en 898, concurremment avec Jean IX, mais celui-ci l’emporte, étant soutenu par l’empereur Lambert. A Jean IX avait succédé Benoît IV, puis Léon V (903). Moins de deux mois après, celui-ci fut renversé par Christophe, qui l’incarcéra. Mais, dès le commencement de 904, on vit revenir Sergius III avec l’appui des Francs et il envoya Christophe rejoindre Léon V en prison, jusqu’à ce qu’on les supprimât tous deux. (Abbé de Meissas.)
Moins d’un siècle plus tard, les Éphémérides de la Papauté nous fournissent un tableau analogue. Nous voyons, de 964 à 985, un premier pape assommé, un second mort captif en exil, un troisième maintenu par une répression barbare, un quatrième étranglé et un cinquième mort de faim ! Après cela, il y a des gens pour croire que le Christianisme est venu civiliser l’humanité ! Il est vrai qu’ils ont l’excuse, comme la quasi unanimité des croyants, de ne rien connaître de l’histoire de la Papauté, ou de n’en connaître qu’une version falsifiée pieusement, comme tout le reste.
Gonflée littéralement de richesses fabuleuses, Rome fut pillée et mise à sac (en 1527) par les Allemands, les Espagnols et les Italiens. Les rares chrétiens sincères y virent un châtiment de Dieu pour les hontes de la Papauté.
TURPITUDES ET CRIMES DU VATICAN.
Je ne m’arrêterai pas aux crimes de l’Inquisition, car nous avons traité ailleurs la question. Rappelons simplement que la responsabilité de ces crimes incombe entièrement au Vatican. Ce sont les Papes qui ont créé l’Inquisition et qui ont donné aux Inquisiteurs les instructions concernant la procédure à suivre contre les hérétiques. Ces instructions, dignes des bourreaux qui les mettaient en application, étaient dictées par une cruauté sans égale. Elles ont permis de torturer, de violenter (et de détrousser, car l’Église ne perd jamais une occasion de remplir ses poches) des centaines de malheureuses victimes innocentes.
Pour obliger les seigneurs et les rois à exterminer les hérétiques, on les menaçait de l’excommunication. C’est ainsi que des milliers d’Albigeois furent brûlés vifs sur l’ordre du Pape (1208) avant même que l’Inquisition eût été organisée définitivement.
Innocent VIII (1484–1492) prescrivait aux magistrats civils d’exécuter les sentences de l’Inquisition sous peine d’excommunication, « promptement, sans appel et sans le moindre coup d’œil jeté sur la procédure » (sic). (Abbé de Meissas.)
De tels exemples pourraient être multipliés mais sont-ils bien sincères ceux qui essaient de laver la Papauté de toute complicité dans les atrocités de l’Inquisition ? N’insistons pas, car le rôle sanguinaire de l’Église n’est que trop connu et, dans la circonstance, les rois et les seigneurs, si barbares et cruels qu’ils aient été, ne furent que des instruments dociles entre les mains des prêtres intolérants et fanatiques.
Nous avons parlé des Croisades et des hécatombes qu’elles ont nécessitées. Non seulement elles furent inutiles, puisqu’elles ne donnèrent même pas les résultats qu’on en attendait, mais elles entretinrent entre les races chrétiennes et islamiques les haines les plus funestes. Nous pourrions parler aussi des guerres de religion, en particulier de la répression du protestantisme, dont la responsabilité incombe aux Papes dans une très large mesure.
A part quelques rares exceptions, prêtres, évêques et moines poussèrent au massacre des huguenots. Le clergé de Paris fit des processions au lendemain de la saint Barthélémy. Le pape lui-même (Grégoire XIII) ordonna une procession d’actions de grâces, à Rome et il y assista. Il fit également frapper une médaille pour commémorer le souvenir de ce grand événement et glorifier le triomphe de la Foi sur l’Hérésie — sans parler des félicitations qu’il envoya au lamentable Charles IX.
(Ces félicitations, nous les retrouverons plus tard dans la bouche de Bossuet, l’Aigle de Meaux, adressant à Louis XIV les éloges les plus exagérés au lendemain de la révocation de l’Édit de Nantes, qui rallumait la guerre religieuse et servit de prétexte à la persécution et à l’expulsion de centaines de milliers de réformés.)
Chaque fois qu’ils y eurent intérêt, les Papes n’hésitèrent pas à provoquer des guerres et des révolutions. Grégoire VII, par ses prétentions théocratiques, mit l’Allemagne à feu et à sang (ce qui n’a pas empêché l’Église de le canoniser !). Sixte-Quint loua le zèle et le courage du dominicain Jacques Clément, qui avait assassiné le roi Henri II, auquel on reprochait de ne pas servir assez docilement la cause anti-luthérienne. Les Papes ont donné aux monstrueux rois d’Espagne les directives sanglantes que l’on connaît. Cette malheureuse nation en est restée épuisée et dégénérée pour des siècles. Les guerres de Vendée sont également l’œuvre de la Papauté, ainsi que les récentes insurrections du Mexique, sans parler du rôle machiavélique joué par elle lors du déclenchement de la guerre de 1914 — dont elle attendait un regain d’influence et le rétablissement de son pouvoir temporel, réalisé en février 1929, grâce à la complicité du trop célèbre Mussolini.
Voilà l’institution dont on nous demande d’admirer la sainteté, le caractère surnaturel et la haute vertu moralisatrice ! Et nos gouvernants, même « laïques », acceptent de congratuler ces gens-là, sachant pertinemment qu’en abrutissant le peuple, l’Église travaille à conserver leurs privilèges !
Pour édifier le lecteur sur l’œuvre moralisatrice (?) du Vatican, il me suffira de reproduire quelques documents puisés au hasard, à travers les siècles :
-
IVème SIÈCLE. — « Le frère se sépare de sa sœur qui fait profession de virginité ; la sœur dédaigne son frère qui vit dans le célibat et cherche ailleurs un autre frère ; tous deux paraissent prendre le même parti ; puis, sous prétexte de se procurer des consolations spirituelles, ils ont chez eux, avec des étrangers, un commerce charnel. » (De Custodia, p. 327.)
« Puis-je raconter sans douleur combien de vierges succombent tous les jours ; combien l’Église en voit périr dans son sein : combien, semblables à des étoiles scintillantes, deviennent les esclaves du démon ; combien de cœurs enfin, aussi durs que la pierre, s’ouvrent cependant à ce serpent qui s’y glisse comme dans une retraite ? Quelles sont celles-là qui, la tête haute, marchent à pas comptés, cachant sous une toilette simple et modeste une vie déréglée que l’on ne connaît que par leur grossesse et par les cris des enfants ? Ce sont des vierges devenues veuves avant leur mariage. Il y en a qui procurent la stérilité à leur sein, et ainsi commettent l’homicide d’un homme qui n’est pas encore né. D’autres se sentant criminellement enceintes ont recours aux poisons qui font avorter. Et comme souvent elles périssent avec leur embryon, elles descendent aux enfers chargées de trois crimes, homicides d’elles-mêmes, adultères de Jésus-Christ, parricides de leur enfant, même avant sa naissance. » (Saint Jérôme, De Custodia, p. 326.)
(Cf. saint Jean Chrysostôme, Homélies quod regulares feminoe ... et Contra eos qui subintroductas habent.)
-
Vème SIÈCLE. — « Nous appelons les femmes qui demeurent avec nous nos mères, nos sœurs et nos filles, n’ayant point de honte d’employer ces noms de piété à couvrir nos débauches. Que fait le moine dans la chambre des femmes ? Que signifient ces tête-à-tête intimes et ces yeux qui fuient les témoins ? » (Saint Jérôme, édition Martianney, t. IV, p. 287.)
-
VIème SIÈCLE. — « L’incontinence, à en juger par le grand nombre de canons qui la condamnent, paraît avoir été la grande plaie du clergé espagnol. » (Abbé Guyot, Somme des Conciles, t. I, p. 385).
-
VIIème SIÈCLE. — Le concile Quinisecte ou in Trullo, en 692, nous apprend (canon 86) qu’il était devenu urgent de réprimer un scandale courant : le proxénétisme des clercs ! Les clercs tenaient des lupanars.
-
VIIIème SIÈCLE. — Les mœurs du clergé vont en se corrompant chaque jour davantage, de l’aveu des conciles successifs de 742, 744, 787, 753, 757. Les prêtres portent les armes, se livrent aux orgies, à l’usure, à la simonie ; l’orgueil, l’avarice, la luxure et l’ambition sont leurs vices les plus communs.
-
IXème SIÈCLE. — « Les clercs n’auront absolument aucune femme chez eux, pas même leur sœur ; car il y a des prêtres qui, faisant de leurs propres sœurs leurs concubines, leur ont engendré des enfants. » (Concile de Mayence en 847 et Concile de Metz en 888.)
-
Xème SIÈCLE. — Pendant plus de cinquante ans, l’Église fut gouvernée par trois prostituées lesquelles firent trois papes.
Une patricienne de Rome, Théodora, avait deux filles, Théodora la jeune et Marouzie. Celle-ci, maîtresse du pape Sergius III eut de lui un fils, Jean (Jean XII). A la mort de ce pape, Théodora, la mère, lui donna pour successeur son amant, Jean X. Aidée de son mari, Guy, fils aîné de son amant, le marquis de Toscane, Marouzie renverse Jean X, l’amant de sa mère et le fait étouffer en prison et place sur le trône pontifical, successivement Léon VI, Étienne VII et Jean XI, un fils qu’elle avait eu de Sergius III, et qui fut Jean XII. Un mari ayant surpris ce pape dans les bras de sa femme, l’assomma d’un coup de marteau sur la tempe. (Annales ecclésiastiques, de Baronius, t. XV, etc. ; Fleury, Hist. Ecclés., liv. XIV.)
« Nous ne disons rien qui ne soit vu et avoué de tout le monde. Nous en pouvons prendre à témoin la veuve de Rénier, son vassal, dont il est si amoureux qu’il lui a confié le gouvernement de plusieurs villes, et qu’il lui a donné des croix et des calices d’or de l’église de Saint-Pierre du Vatican. Nous en prendrons encore à témoin Étiennette, une de ses maîtresses, qui mourut ces jours passés, en accouchant avant terme, d’un enfant qu’elle avait eu de lui. Mais quand ces personnes-là demeureraient dans le silence, les pierres crieraient, et le palais de Latran, qui était autrefois une retraite de personnes de vertu, et qui est devenu maintenant un lieu de débauche et de prostitution, élèverait sa voix pour lui reprocher ses amours, et pour condamner le commerce infâme qu’il entretient avec la sœur d’Étiennette ; Étiennette, concubine d’Albéric, son père. Nous prendrons encore à témoin l’absence des femmes de toutes les nations qui n’oseraient venir faire leurs prières au tombeau des Apôtres de peur d’y recevoir un traitement pareil à celui qu’ont reçu des femmes mariées, des veuves et des filles, qui ont été les victimes de son impudicité ... » (Rapport fait à l’empereur Othon par les évêques assemblés en concile, année 962, sur la conduite du pape Jean XII. Mémoires de Luitprand, évêque de Crémone, traduits par le président Cousin, t. II de l’Hist. de l’empire d’Occident, 1683.)
« Ces débauches étaient payées avec le trésor de l’Église que la simonie alimentait et que l’on n’avait garde d’employer aux usages légitimes. On parle d’un évêque consacré à l’âge de 10 ans, d’un diacre ordonné dans une écurie, de dignitaires aveuglés ou transformés en eunuques. La cruauté complétait l’orgie. Pour que rien ne manquât, on raconte que dans les festins de Latran, il arrivait au pape de boire à la santé du diable. » (Abbé Duchesne, chargé de cours à la Faculté catholique de Paris, Les commencements de l’État pontifical, Albert Fontemoing, éditeur, Paris 1898.)
-
XIème SIÈCLE. — Trois papes siègent concurremment à Rome : Sylvestre II à Saint-Pierre, Jean XX à Sainte Marie Majeure, et Benoît IV au palais de Latran.
« Les évêques en vinrent à ce point de vilenie, qu’ils se firent des rentes avec la luxure de leurs prêtres. Ils permirent, en effet, aux prêtres d’entretenir des concubines chez eux pourvu qu’ils payassent une amende à eux, évêques. » (Concile de Lillebonne, 1080, canon 5ème.)
Le concile de Pavie en 1020 dit dans son canon 3ème :
« Les fils et les filles de tous les clercs, sans exception, qui sont nés d’une femme libre, quelle qu’elle soit, et quel que soit le genre d’union de cette femme (mariage ou concubinage), tous ces fils et filles, avec tous les biens qu’ils ont reçus de n’importe quelle main, appartiendront comme serfs à l’église de leur père, et jamais ils ne pourront être affranchis du servage de l’Église. » « Les femmes qui, dans l’enceinte de Rome, se seront prostituées à des prêtres, appartiendront au palais de Latran comme esclaves. » (Décret du pape Léon IX, Concile de Rome, 1051.)
-
XIIème SIÈCLE. — Les scandales des siècles précédents atteignent de telles proportions, qu’on ne compte pas moins de onze conciles réunis pour les flétrir et provoquer des ordonnances qui resteront lettre morte. (Conciles de Londres, 1102, 1108 ; Latran, 1123 ; Londres, 1125, 1127, 1129 ; Latran, 1139 ; Londres, 1175 ; Latran, 1179 ; Rouen, 1189 ; Dalmatie, 1199. Le concile de Latran, 1179, canon 11ème, constate que les clercs sont infectés d’un vice contre nature.)
-
XIIIème SIÈCLE. — « Aucune plaie de l’Église, à l’exception de 1’incontinence, ne fut plus étendue ni plus envenimée que celle de Simonie. On compterait difficilement les évêques déposés pour ce crime par les papes ou par leurs légats ; le nombre des prêtres échappe à l’histoire, à la faveur de leur subalternité. L’Église était envahie par la concupiscence des yeux et par l’orgueil de la vie. » (Abbé Guyot, loc. cit. t. Il, p. 26.)
-
XIVème SIÈCLE. — Le grand schisme d’Occident (1378 à 1417). II y eut un Pape à Rome et un Pape à Avignon.
« Combien est grand le nombre des clercs qui attendent une place ! Mais quelle est la valeur de ces gens qui accourent de toutes parts et offrent leurs services ? Ce n’est pas de l’école ni des études libérales, mais de la charrue et des œuvres serviles qu’ils venaient pour obtenir 1’administration des paroisses et des autres bénéfices. Ils ne comprenaient guère plus le latin que l’arabe ; que dis-je ? Ils ne savaient pas lire, ô honte ! ou ils savent à peine distinguer un alpha d’un bêtha ... »
« Aujourd’hui, un homme inoccupé, ayant horreur du travail ou désirant riboter dans l’oisiveté, court-il au sacerdoce et l’acquiert-il ? Sur le champ il se joint aux autres prêtres, sectateurs de voluptés, qui, plus Épicuriens que Chrétiens, fréquentent assidûment les cabarets et consument tout leur temps à boire, manger, dîner, souper, ainsi qu’à jouer aux dés et à la paume. Plongés dans la crapule et l’ivrognerie, ils se battent, ils crient, ils font du tapage et de leurs lèvres souillées ils jurent le nom de Dieu et des saints. Quand le calme est enfin venu, ils passent des bras de leurs concubines à l’autel de Dieu. »
« Leur zèle et leurs convoitises sont pour l’argent ; ce qu’ils cherchent avec ardeur, ce n’est pas le profit des âmes, c’est celui de leur bourse. L’amour de l’argent les enflamme ; la piété consiste à gagner de l’argent ; ils ne font rien sans calculer si leur acte les aidera à récolter de l’argent en quoi que ce soit ; l’argent les jette dans les altercations, les luttes, les querelles et les procès ; ils supportent beaucoup plus philosophiquement la perte de dix mille âmes que celle de dix à douze sous. »
« Par respect, je ne dirai pas grand chose des couvents de femmes : lorsqu’on doit parler, moins d’assemblées de vierges vouées à Dieu, que de lieux infâmes, de roueries d’impudentes courtisanes, de lubricité et d’inceste, il ne convient pas de s’étendre longuement. Que sont, en effet, aujourd’hui les couvents de jeunes filles ? Hélas ! ce ne sont point des sanctuaires de Dieu, mais d’exécrables lupanars de Vénus ; ce sont des bouges où les jeunes débauchés viennent assouvir leurs impudiques passions. Aussi, aujourd’hui, faire prendre le voile à une jeune fille est-il la même chose que la vouer à la prostitution. »
« Les cardinaux, ces assesseurs du Pape, ont une telle insolence dans l’air, les paroles et les gestes, que si un artiste voulait peindre l’orgueil en personne, il ne pourrait pas choisir de meilleur modèle qu’un cardinal... Quant au Pape, il distribuait les évêchés vacants et les principales dignités de l’Église à des jeunes gens, élégants et parfumés, qui lui servaient de mignons. » (Nicolas de Clemangis, archidiacre du diocèse de Bayeux, directeur du collège de Navarre, en 1435 ; De corruptio Ecclesioe statu, édition J. Martini Lydius, Leyde, 1613. Cap. VI, XIV, XVI, XXIII, X. 1 ; XXVII, 5.)
-
XVème SIÈCLE. — « Le pape (Jean XXIII) s’est souillé d’incestes avec la femme de son frère et avec de saintes religieuses ; il a défloré des vierges, commis des adultères et des crimes odieux qui, jadis, firent descendre la colère de Dieu sur cinq villes. » (Concile général de Constance, 1414, qui articula contre ce pape soixante dix griefs.)
-
XVIème SIÈCLE. — Alexandre VI Borgia. (D’une prostituée, Vanozza, il a quatre fils et une fille, la célèbre Lucrèce Borgia.)
« Alexandre ne pouvait se délivrer des malheurs domestiques qui troublaient toute sa maison, et qui étaient accompagnés d’exemples tragiques d’amour et de cruauté qui font horreur aux nations les plus barbares ; car, comme, dès le commencement de son pontificat, il avait résolu d’élever le duc de Candie, son fils ainé, au suprême degré de grandeur temporelle, le cardinal Valentin (César Borgia, duc de Valentinois, qui avait beaucoup d’éloignement pour le sacerdoce et plus de penchant pour la guerre) ne put souffrir de voir que son frère lui fût préféré ; il était d’ailleurs chagrin de voir que son frère aîné avait plus de part que lui aux bonnes grâces et aux faveurs de leur sœur Lucrèce ; de sorte qu’animé par cet amour déréglé et par son ambition, deux passions qui entraînent également à toutes sortes de scélératesses, il fit assassiner le duc son frère, un soir que ce dernier se promenait à cheval dans les rues de Rome, et fit jeter secrètement son corps dans le Tibre. Outre cela, le bruit s’était répandu (si on peut ajouter foi à une pareille énormité) que non seulement les deux frères étaient coupables d’inceste avec leur sœur Lucrèce, mais que le père lui-même en était aussi coupable…. » Et, jaloux d’Alphonse d’Aragon, mari de Lucrèce, le pape et le cardinal César le font assassiner.
Hic jacetin tumulo Lucretia nomine, sed re Thaïs, Alexandri filia, spousa, nurus.
« Ci-gît, dans le tombeau du nom de Lucrèce, mais en réalité, Thaïs, fille, épouse et bru du pape Alexandre. » (Extraits d’Alex. Gordon (Fragments secrets de Guichardin). Vie d’Alexandre VI, t. II, p. 139–144 ; t. II, p. 83 ; t. I, p. 255. Trad. franç., Amsterdam, 1732, 2 vol. in-12. On trouvera les fragments secrets de Guichardin dans l’édition Panthéon, appendice 20.)
« Les exemples scandaleux et les crimes de la Cour de Rome ont été cause que l’Italie a perdu entièrement tous les principes de la piété et tout sentiment de religion. Nous autres Italiens, nous avons cette première obligation à l’Église et aux prêtres d’être devenus des impies et des scélérats ! » (Machiavel, Discours sur la première Décade de Tite-Live, liv. I, ch. l2.)
Pour dédommager le lecteur de cette nomenclature fastidieuse nous reproduirons cette énergique peinture que dans ses lettres sine titulo, très peu connues, Pétrarque fait de la Cour papale. (Pétrarque était tout qualifié pour stigmatiser les crimes et l’immoralité du Vatican, puisque sa propre sœur, toute jeune encore, avait été lâchement violée par le pape Benoît XII.)
« On trouve en ces lieux le terrible Nemrodh, Sémiramis armée, l’inexorable Minos, Rhadamante, Cerbère, Parsiphaë, amante du taureau, le Minotaure, monument scandaleux des plus infâmes amours, enfin tout ce qu’on peut imaginer de confusion, de ténèbres et d’horreur. C’est ici la demeure des larves et des lémures, la sentine de tous les vices et de toutes les scélératesses » (Epist. sine titulo, p. 718). « Je ne rapporte que ce que j’ai vu moi-même et non ce que j’ai entendu raconter par d’autres. Je sais, par ma propre expérience qu’il n’y a ici ni piété, ni charité, aucune foi, aucun respect, aucune crainte pour la Divinité, rien de saint, rien de juste, rien d’humain. L’amitié, la pudeur, la décence, la candeur y sont inconnues ; la vérité !... trouverait-elle un refuge dans une ville où tout est plein de fictions et de mensonges : l’air, la terre, les maisons, les places publiques, les portiques, les vestibules, les appartements les plus secrets, les temples, les tribunaux et jusqu’au palais pontifical ? » (Epist. 12, p. 273) ... « On y perd ce qu’on possède de plus précieux, la liberté d’abord, puis la paix, la joie, l’espérance, la foi, la charité, en un mot les biens de l’âme ; mais dans le domaine de l’avarice, rien n’est regretté pourvu que l’argent reste. L’espoir d’une vie future est considéré ici comme une illusion vaine, ce qu’on raconte des enfers est une fable ; la résurrection de la chair, la fin du monde et Jésus-Christ, juge suprême et absolu, sont mis au rang des inventions puériles. L’amour de la vérité y est taxé de démence, l’abstinence de rusticité, la pudeur de sottise honteuse ; la licence, au contraire, est estimée grandeur d’âme, la prostitution mène à la célébrité. Plus on accumule de vices, plus on mérite de gloire ; une bonne renommée est regardée comme ce qu’il y a de plus méprisable, la réputation comme la dernière des choses ... Ce que je dis n’est ignoré de personne ... Je passe sous silence la simonie, l’avarice, la cruauté qui ne respecte aucun sentiment humain, l’insolence qui se méconnaît elle-même, et les prétentions de la vanité.... Qui ne rirait et ne s’indignerait à la vue de ces enfants décrépits (les cardinaux et les prélats) avec leurs cheveux blancs et leurs amples toges sur lesquelles ils cachent une impudence et une lascivité que rien n’égale ? …. Des vieillards libidineux poussent l’oubli de leur âge, de l’état qu’ils ont embrassé, et de leurs forces, jusqu’à ne craindre ni déshonneur, ni opprobre : ils consument dans les festins et dans les débauches les années qu’ils devraient employer à régler leur vie sur celle du Christ. Mais bientôt ces excès sont suivis d’autres excès encore, et de tout ce qu’offrent de plus condamnable l’impudicité et le libertinage. Les indignes prélats croient arrêter ainsi le temps qui fuit devant eux, et ils ne voient d’autre avantage dans la vieillesse, si ce n’est celui qui rend licite pour eux, et dans leurs idées, ce dont les jeunes gens eux-mêmes ne seraient pas capables.... Satan, d’un air satisfait, assiste à leurs jeux, il se fait l’arbitre de leurs plaisirs ; et constamment placé entre ces vieillards et les jeunes vierges qui sont les honteux objets de leurs nauséabondes amours, il s’étonne de ce que ses tentations sont toujours au dessous de leurs coupables entreprises …. Je ne dirai rien des viols, des rapts, des incestes, des adultères ; ce ne sont plus là que des badinages pour la lubricité pontificale. Je tairai que les époux des femmes enlevées sont forcés au silence par un exil rigoureux, non seulement loin de leurs foyers domestiques, mais encore loin de leur patrie. Je ne m’appesantirai même pas sur le plus sanglant des outrages, celui par lequel on force les maris de reprendre leurs épouses prostituées, surtout lorsqu’elles portent dans leur sein le fruit du crime des autres ; outrage qu’on a bientôt l’occasion de répéter, puisque la femme doit retourner dans les bras de son premier amant dès qu’elle peut de nouveau servir à ses infâmes plaisirs ... » (16ème lettre.)
Plus connus sont ces deux sonnets où le poète traduit son indignation en vers magnifiques :
-
Sonnet CV. — Fiamma dal Ciel.... « Que la flamme pleuve du ciel sur tes tresses, ô Méchante ! toi qui, partie de l’eau et des glands, es arrivée à la richesse et à la grandeur en appauvrissant autrui ; toi qui mets la joie à mal faire. — Nid de trahisons, où se couve tout le mal qui se répand aujourd’hui par le monde ; esclave du vin, du lit et de la table ; chez toi la luxure est au comble. — A travers tes salons, jeunes filles et vieillards vont dansant, et Belzébuth au milieu avec ses soufflets, son feu et ses miroirs. — Jadis tu ne fus pas nourrie dans la plume ni à l’ombre, mais nue au vent et sans chaussure à travers les ronces. Aujourd’hui ta vie est telle que la puanteur en montera jusqu’à Dieu. »
-
Sonnet CVII. — Fontana di dolore ... « Source de douleurs, réceptacle de colère, école d’erreurs et temple d’hérésie, autrefois Rome aujourd’hui Babylone, fourbe et criminelle, où éclosent tant de plaintes et de soupirs ; officine de tromperies, ô prison barbare, où le bien meurt, où le mal croît et grandit ; enfer de vivants ! Ce sera un grand miracle si le Christ à la fin ne se courrouce contre toi. — Fondée en une humble et chaste pauvreté, tu lèves les cornes contre tes fondateurs, ô courtisane éhontée. Où donc as-tu placé ton espérance ? Est-ce dans tes adultères, dans tes richesses mal acquises ?..... »
-
Le lecteur espère sans doute que les choses se sont améliorées depuis Pétrarque ? Assurément, les gens d’Église sont devenus plus prudents, ils sont experts dans l’art de dissimuler leurs tares. Au lieu de les étaler cyniquement, à la manière de ces Papes tout puissants, qui se croyaient tout permis, ils sont obligés d’agir dans l’ombre et le secret. C’est là une des tristes nécessités de nos époques trop libres, où les yeux sont ouverts (quelquefois) et où l’esprit critique prend la parole pour proclamer la vérité.
En réalité, les mêmes causes engendrent nécessairement les mêmes effets. Un célibat obligatoire et contre nature ne peut engendrer que l’hypocrisie dans les rapports sexuels — ou les perversions les plus anormales. Comment l’ambition déréglée des gens d’Église, la facilité que possèdent les grands prélats d’amasser d’énormes richesses, de dominer à leur gré les êtres qui ont confiance en leur mission (et surtout les femmes et les filles), comment cet orgueil et cette puissance n’engendreraient-ils pas la corruption et le vice ? La turpitude et l’immoralité du clergé ne sont que les conséquences fatales d’un état de choses pernicieux. De telles institutions ne sauraient engendrer des mœurs simples, fraternelles et laborieuses.
Le Semeur reproduisait récemment (avril 1929) une page bien édifiante sur la vie du pape Pie IX. En plein XXème siècle, ce pape fut incestueux, adultère, faux-monnayeur et assassin — comme la plupart des « Saintetés » qui l’avaient précédé !
Quant à l’homosexualité, elle fleurit plus que jamais à l’ombre des sacristies et ses ravages s’étendent jusqu’aux plus hauts « sommets » de la chrétienté ! Le cardinal Merry del Val n’échappait pas à cette contagion, s’il faut en croire Victor Charbonnel, et les couloirs du Vatican sont remplis de « mignons », dont les complaisances spéciales assurent la fortune ! Nombreux sont les cardinaux qui gardent auprès d’eux un jeune « neveu » dont les services intimes leur sont précieux ....
Les fidèles catholiques n’en doivent pas moins se prosterner aux pieds de leurs saints pasteurs et vénérer les souverains pontifes, ministres et représentants de Dieu sur la terre !
Un bon croyant ne doit-il pas renoncer à tout jugement personnel et s’en rapporter aveuglément à la hiérarchie ecclésiastique ?
Le cardinal Bellarmin (dont les Jésuites sont parvenus à faire un saint) n’est-il pas allé jusqu’à prétendre « que si le pape se trompait en prescrivant des péchés et prohibant des vertus, l’Église serait obligée de tenir les péchés pour bons et les vertus pour mauvaises, si elle ne voulait pas pécher contre la conscience », (Si autem papa erraret proecipiendo vitia, vel prohibendo virtutes, teneretur Ecclesia credere vitia esse bona et virtutes mala, nisi vellet contra conscientiam peccare. De Rom. pontit., 4, 5, éd. Paris 1643, p. 456). Cité par le chanoine J. de Doellinger, La Papauté, p. 194.
RICHESSE ET AVIDITÉ DES PAPES.
Pour vivre dans la paresse et dans les jouissances, les Papes ont toujours recherché l’argent. Et ils se sont entourés de richesses, revêtus de costumes somptueux, afin de frapper l’imagination des simples et de leur imposer plus facilement leur lourde tyrannie.
Il est bon que l’on connaisse la cupidité des représentants du Christ — de ce Christ vagabond qui vivait de mendicité !
Ces représentants, pour accroître leur prestige, se parent comme des idoles. Leurs vêtements, leurs chaussures, etc..., sont d’une somptuosité inouïe.
Quelques exemples :
« J’ai vu des mules (chaussures du pape), dont les croix étaient en brillants et qu’on estimait cent mille francs (il s’agit de francs-or, bien entendu). » Armand Dubarry, Histoire de la Cour de Rome.
Le même auteur ajoute que la mitre de Boniface VIII avait coûté 9.500 florins-or, soit cent mille francs-or (cinq à six cent mille francs-papiers). Elle pesait dix livres.
Le Pape Léon X acheta à un joaillier vénitien une perle de 350.000 francs.
La tiare de Paul II (1464–71) valait 2.500 écus, soit un million 70.000 francs-or, ce qui représenterait vingt millions de francs d’aujourd’hui, en raison, non seulement de la dépréciation des monnaies, mais du renchérissement considérable de la main-d’œuvre et des matériaux.
Lors de la prise de Rome par le connétable de Bourbon, le célèbre artiste Benvenuto Cellini fut chargé de briser les tiares, afin de cacher les pierres précieuses et les joyaux plus facilement.
En 1831, Grégoire XVI, craignant l’émeute, fait enterrer sa tiare au pied d’un arbre, dans son jardin. Son successeur Pie IX fit de même en 1848. Le premier mouvement de ces bons apôtres consiste toujours à sauver la caisse !
On écrit des merveilles de leurs chaussures : Souliers de soie bordés et brodés d’or, de maroquin rouge avec talons rouges et ornements en or massif, de lin ou de laine blanche, mules avec croix d’or et pierres précieuses, etc....
Voici la description de la tiare, donnée par Mgr Battandier dans l’Annuaire pontifical :
« La tiare est formée d’un feutre très fin recouvert d’un tissu à mailles d’argent fabriqué exprès à Rome. L’intérieur est doublé en soie. C’est sur ce feutre que sont attachées les trois couronnes d’or, excessivement légères pour diminuer le poids. Chaque couronne se compose d’un bandeau d’or orné de pierreries et terminé par deux rangées de perles. Chaque rangée en contient 90, ce qui fait en tout 540 perles. Au-dessus du bandeau est la couronne ou mieux les fleurons formés d’un feuillage imitant une croix. Il est séparé de l’autre par un petit cercle d’or avec pierres précieuses, ce qui lui donne l’aspect de la couronne héraldique de duc. L’ornementation de la tiare est basée sur la forme octogone, c’est à-dire qu’il y a 8 fleurons : 4 émeraudes, 3 saphirs, 1 rubis. Les 8 pointes entre les fleurons ont 6 grenats et 2 rubis.
Deuxième couronne : 10 émeraudes, 24 rubis balais, 3 saphirs, une chrysolithe, 2 aigues-marines et 2 fils de perles.
Troisième couronne : 3 hyacinthes, 2 émeraudes, 19 rubis, 4 saphirs, 3 aigues-marines, 9 grenat, une chrysolithe et 2 fils de perles orientales.
Le sommet de la tiare est couvert d’une feuille d’or avec 8 rubis et 8 émeraudes. Sur elle s’appuie un globe d’or émaillé en bleu, surmonté d’une croix composée de 11 brillants.
Les fanons de la tiare, qui retombent sur les épaules du pape, portent 2 rubis, 4 topazes et 4 émeraudes.
En tout : 6 rangs de perles orientales, 146 pierres précieuses de couleur et 11 brillants.
Je m’excuse de cette énumération. Elle n’est pas inutile. Que de misères et de souffrances le Pape, s’il était sincère, pourrait soulager, avec la fortune qu’il porte sur la tête, comme un potentat oriental ou comme un comédien !
Le Christianisme a été fondé par des pauvres, soutenu par des misérables et il tire toute sa force morale de l’adhésion des malheureux. Et cependant, c’est au Vatican que l’on trouve les plus grandes richesses du monde, accaparées par une caste d’intrigants parasites et jouisseurs !
Doellinger fait la description de la Cour de Rome en 1518. Toutes les places d’employés de la Curie étaient vendues très cher — car elles permettaient de rafler de beaux bénéfices. Le nombre des référendaires n’était pas limité. Il y avait 101 solliciteurs, 101 maîtres des archives, 8 scribes des suppliques, 12 scribes du registre, 27 scribes de la pénitencerie, 81 scribes des Brefs, 104 collecteurs des plombs, 101 scribes apostoliques, 13 procurateurs, 60 abbreviatores de parco minori, 12 abbreviatores de parco majori, 12 avocats consistoriaux, 12 auditeurs de Rota (desquels il est dit qu’ils se contentaient des pourboires), 19 notaires, 29 secrétaires, 7 clercs de la Chambre. Environ 800 dévorants dont le principal souci consiste à rafler le plus d’argent possible, pour rentrer d’abord dans leur mise de fonds et pour s’enrichir ensuite, ainsi que leurs parents et leurs créatures.....
M. Young, (La France et Rome, cité par de Meissas), déclare qu’au XVIIème siècle, il y avait 250 fonctionnaires pontificaux, dont certains payaient leurs charges jusqu’à 180.000 francs....
Les frais d’administration du Palais du Vatican coûtaient, à eux seuls, 7 millions de francs-or par an. Il fallait donc que les Papes trouvent des ressources considérables.
Par la loi des Garanties (1871), le Gouvernement italien avait offert au Pape une subvention perpétuelle de 3.225.000 lires. La Papauté refusa.
Les accords du Latran (février 1929) sont plus généreux encore, puisque le Saint-Siège recevra 750 millions de lires en espèces et un milliard de lires en dette consolidée 5 % au porteur. On a calculé que cela représentait, au cours de la lire, plus de 4.800.000 dollars (120 millions de francs). Il faut y ajouter les revenus que le Vatican possédait déjà, soit plus de 2 millions de dollars. Au total : 170 millions de francs.
Des ressources aussi formidables (et nous ignorons le chiffre exact des sommes que le Pape reçoit, depuis la guerre surtout, des grands banquiers américains, qui le couvrent littéralement d’or), permettront à l’Église de poursuivre dans les meilleures conditions son œuvre d’évangélisation des masses, d’abrutissement de la jeunesse, de corruption des consciences par l’achat des politiciens, des journalistes, etc....
LES MARCHANDS DU TEMPLE.
La « Sainte Boutique » possède bien des moyens et des procédés pour rançonner les gogos.
« Aujourd’hui, les évêques ne payent plus leurs bulles que 4.400 francs (or), les archevêques 6.660 ... Mais le commerce des dispenses, indults, indulgences, etc..., marche toujours son train. Les papes du XIXème siècle y ont ajouté celui des titres de noblesse et des décorations. Il y a aussi les quêtes du denier de Saint-Pierre, dont les préfets violets se montrent grands zélateurs pour se faire bien voir de leur maître. Enfin, de pieux et riches imbéciles, très ignorants de la vraie origine et de la vraie histoire de la Papauté, offrent incessamment de magnifiques cadeaux à celui qu’ils croient sincèrement le représentant de Dieu sur notre petite planète. C’est bien entendu la France, cette précieuse vache à lait, qui fournit toujours le plus (30 millions environ par an, en or). » (Éphémérides de la Papauté, par l’abbé de Meissac, p. 216.)
Le trafic des Indulgences se fit d’une façon tellement cynique et exagérée qu’il souleva contre la Papauté de grandes colères et l’on sait que la révolte du moine Luther fut, dans une grande mesure, motivée par ce trafic. Mais ce que l’on sait moins, c’est que les mercantis du Vatican continuent aujourd’hui, plus que jamais, leurs lucratives entreprises.
Victor Charbonnel a reproduit les tarifs de la Sacrée Congrégation des Indulgences, tels qu’ils sont affichés à la Chancellerie du Vatican (la Congrégation des Indulgences a été supprimée en 1904, mais rattachée à la Congrégation des rites — et rien n’a été changé à la « bedide gommerce »).
Je ne reproduirai pas cette liste, car elle est longue — et fastidieuse. On y trouve les taxes pour bénédiction des chapelets, croix, crucifix, statues de Saint Pierre ; indulgence pour 4 jours de l’année, pour les sermons, pour la fin des retraites, pour les moribonds, les missions — et j’en passe plus de la moitié.
* * *
On sait que l’Église ne reconnaît pas le divorce, qu’elle vitupère, au contraire, comme une effroyable immoralité. N’empêche que la Sacrée Congrégation romaine du Concile ne consacre une bonne part de son activité aux procédures d’annulation de mariages.
Il y a 22 ou 24 cas de divorce ... pardon : d’annulation ! Il suffit de démontrer que le mariage n’a pas été consommé (par suite de l’impuissance du mari, par exemple), pour que la Papauté annule l’union et rende leur liberté aux deux époux.
Bien entendu, cela coûte très cher.
« Dans une cause de mariage, il faut compter d’abord les frais de l’enquête faite par la cour épiscopale, et ceux-ci seront plus ou moins considérables, selon le nombre des témoins, leur éloignement de la Curie épiscopale, les indemnités à leur fournir, les experts dont on invoquera le témoignage. » (Annuaire pontifical)
Que d’intermédiaires à rétribuer, de pourboires à donner, de paperasses à noircir ! Cela se prolonge pendant des mois. Il faut remettre la main à la poche, pour activer les démarches, à plusieurs reprises. Finalement, il n’est pas possible de divorcer à Rome à moins de 50.000 francs, mais nombreux sont les cas d’annulation qui ont coûté 150.000, 200.000 francs et davantage. Cette comédie religieuse n’est à la portée que des gros porte monnaie.
* * *
La vente des décorations papales fournit des ressources qui ne sont pas négligeables.
Il y a l’Ordre du Christ ; l’Ordre de Pie IX ; l’Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand ; l’Ordre de Saint-Sylvestre ; l’Ordre de l’Éperon d’Or (qui a été récemment décerné à Podieux Mussolini, pour bien marquer la réconciliation du Vatican et du Fascisme !) ; les croix Pro Eccesia et Pontifice, les médailles Bene merenti....
L’honneur d’arborer ces rubans et de faire encadrer un diplôme signé de la Sainte main du Pape ne saurait évidemment trop cher se payer.... Il faut compter de 5 à 10.000 francs, ce qui n’empêche pas les amateurs d’être nombreux.
Le titre de duc coûtait 100.000 francs, avant la guerre. Le titre de comte, 20.000 francs. Le titre de baron, 12.000 francs. Il y a aussi des comtesses, des princes, des marquis... Le Vatican ne néglige aucun profit (les Hennessy, marchands de cognac, sont comtes du Pape (cité par Charbonnel), ce qui n’empêcha pas l’un d’eux d’être ministre de la République française et propriétaire du Quotidien, journal de gauche !!)
CONCLUSION.
Étudier l’histoire de la Papauté, c’est prendre la meilleure leçon d’anticléricalisme et d’antireligion.
Cela permet de saisir sur le vif le cynisme et la tyrannie des Imposteurs d’Église, exploiteurs de la Crédulité.
La Papauté est la dernière grande monarchie de droit divin qui existe dans le monde actuel. C’est l’institution la plus antidémocratique que l’on puisse concevoir.
Deux cent cinquante millions de catholiques sont dirigés par une oligarchie d’un millier de despotes romains (dont les neuf dixièmes sont italiens, ce qui explique que M. Mussolini ait cherché, dans un but impérialiste, à utiliser le concours de la Papauté).
L’oligarchie papale n’a pas de comptes à rendre, ni d’explications à fournir. Elle est infaillible. Elle peut commander ce que bon lui semble et décider les pires absurdités. Ayant fait de l’obéissance la première des vertus, les fidèles sont tenus de s’incliner, non seulement sans murmurer, sans réfléchir, sans discuter, sans chercher à comprendre, mais encore en se prosternant dans l’humilité la plus admirative.
Rien n’est plus contraire à l’esprit critique, à la dignité humaine, au droit à la vie consciente, que la Foi catholique.
Rien n’est plus dangereux pour notre effort d’émancipation et de révolte que cette mentalité rétrograde faisant de la chrétienté un troupeau d’esclaves abêtis.
L’association conclue entre Mussolini et Pie XI (chacun d’eux espérant bien, in petto, en tirer le maximum de profits) est dirigée en premier lieu contre le mouvement mondial de rénovation et d’affranchissement social et en second lieu contre la France. Non pas, certes, la France de Tardieu, de Poincaré ou de l’abbé Bergey, mais la France populaire, laïque, ardente et généreuse, prête à reprendre la grande œuvre révolutionnaire sabotée et trahie tant de fois depuis un siècle ….
« Les coqs ne chantent plus, ils sont plumés », pouvait-on lire en 1870, dans l’Osservatore Romano, journal du Pape, dirigé par le propre filleul du Pape Pie IX. Le Vatican se réjouissait du désastre qui accablait la France. Quelle ingratitude ! Car les Français avaient soutenu Pie IX contre les Italiens ; ils s’étaient aliénés les sympathies de ces derniers et de 1’Angleterre (sympathies précieuses, qui auraient empêché le traité de Francfort) pour être agréable au Vatican en envoyant des troupes françaises monter la garde à sa porte. Et voilà comment le Pape récompensait un dévouement aussi stupide !
Pourquoi ? Parce que, derrière les gouvernements éphémères, Pie IX apercevait le visage de la vraie France, celle de Voltaire, de Diderot, de 1793, celle qui ne se renferme pas à l’intérieur de ses frontières et qui jette aux opprimés du monde entier un cri d’espérance et d’encouragement.
La Papauté est un chancre hideux qu’il faut extirper complètement, définitivement, si l’on veut en finir avec toutes les tyrannies et toutes les oppressions, basées sur le mensonge, la haine, le fanatisme et l’intolérance.
* * *
Pour compléter ce trop rapide et insuffisant exposé, voici quelques notes puisées dans la Chronologie des Papes. Il n’est pas douteux que, sur 260 papes qui ont régné — infaillibles représentants de la vertu et de Dieu ! — plus de la moitié ont été d’effroyables gredins, des tyrans sans scrupules, des débauchés, des voleurs, des assassins, des monstres avides de richesses, qui se vautraient dans les turpitudes les plus écœurantes.
Des 33 premiers évêques de Rome, nous ne dirons rien : ce sont d’illustres inconnus, dont la personnalité (pourtant canonisée !) et l’œuvre sont absolument nulles.
-
SYLVESTRE (319), associe l’Église à l’empereur Constantin, couvert de crimes.
-
LIBÉRIUS (352). Un des responsables des luttes sanglantes provoquées par l’hérésie des Ariens.
-
DAMASE (366). Compétitions et luttes sanglantes à Rome.
-
SÉRICIUS (384). S’associe au tyran Maxime pour exterminer les Manichéens.
-
INNOCENT (402). Arme l’Occident contre l’Orient et suscite partout des conflits fanatiques.
-
BONIFACE (418). Déclare indigne d’être clerc tout homme qui avait eu le malheur d’être esclave (Malgré cela, il y a des gens qui prétendent que c’est l’Église qui a supprimé l’esclavage !)
-
LÉON (440). Tyrannique persécuteur des Nestoriens, des Pélagiens, des Manichéens, bref, de tous ceux qui pensaient autrement que lui.
-
SYMMACHUS (498). Élu en même temps qu’un autre pape, Laurent. Guerres civiles. Accusé de crimes énormes, Symmachus fut déposé, mais revint au pouvoir après une lutte sanglante. Bannit les Manichéens et brûla leurs livres.
-
BONIFACE II (530). Encore deux compétiteurs : Boniface et Dioscore.
-
JEAN II (533). Achète son élection à prix d’or. Le Sénat proteste contre le corrupteur.
-
VIGILIUS (537). Pape souillé de crimes. Fut détrôné et traîné dans la ville, la corde au cou. Mourut en exil.
-
PÉLAGIUS (555). Réclame le premier la peine de mort contre les incrédules.
-
GRÉGOIRE (596). On l’appelle « le grand ». Il encense le tyran Phocas, assassin de toute la famille impériale. Développe la superstition et favorise le pullulement de la clique monacale.
-
FABINIAN (604). Voulait qu’on brûlât tous les livres.
-
HONORIUS (625). Condamné comme hérétique par un concile œcuménique.
-
THÉODORE (642). Absout Martine, femme de Constantin, qui avait empoisonné son mari pour lui succéder.
-
CONON (686). — SERGIUS (687). Nouveaux schismes et nouvelles discordes. Sergius achète son élection en donnant à l’archidiacre Pascal les couronnes d’or suspendues devant l’autel de Saint-Pierre.
-
CONSTANTIN (708). Fait crever les yeux à l’archevêque de Ravenne et condamne de nombreux citoyens rebelles à sa tyrannie.
-
GRÉGOIRE III (731). Ordonne de prier pour les morts et de donner pour eux ... à l’Église ...
-
CONSTANTIN II (767). C’était un simple laïque, qui se fit élire par violence et corruption.
-
LÉON III (795). Le peuple de Rome se soulève contre ce criminel et l’attaque en pleine procession.
-
EUGÊNE II (824). Encore un schisme. Le commerce des reliques et ossements prend une magnifique extension.
-
LÉON IV (847). Imagina qu’un évêque ne pouvait être condamné que sur les dépositions de 72 témoins (il en suffisait de deux pour condamner un laïque !).
-
PAPESSE JEANNE (854). Les cléricaux nient son existence, relatée par plusieurs chroniqueurs et historiens du temps. Enceinte d’un cardinal, elle mourut en accouchant.
-
FORMOSE (891). Chasse son concurrent Sergius par la force.
-
BONIFACE VI (896). Véritable scélérat. Condamné et supplicié pour ses nombreux forfaits.
-
ÉTIENNE VII (896). Fait déterrer, pour le juger, son prédécesseur Formose. Il fut lui-même emprisonné et étranglé.
-
JEAN X (898). Schisme entre lui et Sergius, fils de Benoît. Jean X fait un archevêque âgé de 5 ans.
-
LÉON V (903). Compétitions, dépositions, emprisonnements.
-
CHRISTOPHE (903). S’empare par la force de la Papauté. Chassé à son tour et tué par Sergius III.
-
SERGIUS III (904). Monte sur le trône pontifical dont il avait été chassé deux fois. Célèbre par ses débauches avec la courtisane Marozia, dont il eut un fils, qui fut également pape, Jean XII.
-
JEAN XI (914). Pape grâce à l’appui de Théodora, femme perdue de débauches.
-
JEAN XII (931). Incestueux, assassin. Eut d’innombrables maîtresses et commit de multiples viols. Crevait les yeux et arrachait la langue à ses rivaux. Mourut des suites d’une correction qui lui fut infligée par un mari le surprenant en flagrant délit avec sa femme.
-
JEAN XIII (956). Ce scélérat, chassé par le peuple romain, ne se maintint que par une sanguinaire répression. Était le fils de la courtisane Théodora II, fille de Théodora I et soeur de Marozia. Pendant 60 ans la « sainte Église » fut en réalité gouvernée par des ... grues.
-
LÉON VIII (963). Créature de l’empereur Othon, qui fait étrangler son rival Benoît, élu pourtant par le clergé.
-
JEAN XIV, (965). Chassé par le gouverneur de Rome, il le fit tirer par quatre chevaux et s’acharna sur son cadavre.
-
BONIFACE VII (974). Dut s’enfuir à Constantinople, volant les trésors du Vatican. Fit crever les yeux de son rival, le pape JEAN XV.
-
GRÉGOIRE V (996). Fait couper les mains, le nez et les oreilles à son concurrent Jean XVIII, qui fut ensuite pendu.
-
BENOIT VIII (1012). Violentes compétitions avec Grégoire.
-
BENOIT IX (1033). Élu pape à 12 ans. Se vautra dans les orgies. Trois papes gouvernent en même temps, s’arrachant à qui mieux mieux les richesses de l’Église.
-
CLÉMENT II (1046). — DAMASE II (1048). Tous deux meurent empoisonnés.
-
NICOLAS II (1058). Chasse et excommunie son prédécesseur BENOIT X, qui s’était d’ailleurs imposé, lui aussi, par la force.
-
GRÉGOIRE VII (1073). L’un des papes les plus redoutables. Astucieux, vindicatif et cruel, fit peser sur le monde une tyrannie effrayante.
-
URBAIN II (1088). Fit prêcher la première Croisade. Les papes sont responsables de la mort des cinq millions d’hommes qui ont péri dans ces hécatombes.
-
PASCAL (1099). Son règne fut rempli d’attentats, de scandales et d’assassinats.
-
CALISTE II (1120). Persécute l’anti-pape GRÉGOIRE VIII.
-
HONORIUS II (1124). Excite les seigneurs à exterminer les Normands incrédules.
-
LUCIUS II (1144). La Papauté était alors expulsée de Rome par la haine des Romains.
-
ADRIEN V (1154). Se fait livrer par traîtrise le moine Armand de Brescia, qui avait critiqué les turpitudes papales, et le fait brûler.
-
ALEXANDRE III (1159). Un schisme de 17 ans ... Début des persécutions contre les Vaudois, exterminés avec barbarie.
-
LUCIEN III (1181). Excommunie les Vaudois et les Albigeois.
-
GRÉGOIRE VIII (1187). — CLÉMENT III (1187). Prêchent la Croisade pour la reprise de Jérusalem.
-
INNOCENT III (1198). Il envoie le sauvage saint Dominique exterminer les Albigeois. Tout le midi de la France est dévasté. Une des pages les plus sanglantes de l’histoire des papes, qui en compte pourtant de nombreuses.
-
GRÉGOIRE IX (1227). Il met l’Allemagne à feu et à sang, par l’envoi des chevaliers teutoniques, qui réduisaient les habitants en servage.
-
INNOCENT IV (1243). Empoisonneur et assassin ; ruine l’Italie en provoquant la guerre civile. Il étend les privilèges des inquisiteurs dominicains et déclare que les hérétiques doivent être mis à mort.
-
ALEXANDRE IV (1254). Cherche à dépouiller de sa couronne le jeune Conradin, roi de Sicile. Introduit la torture dans les tribunaux de l’Inquisition.
-
NICOLAS III (1277). Remplit l’Italie de discordes et de troubles, mais enrichit sa famille et ses bâtards.
-
MARTIN IV (1281). Conduite scandaleuse. Il prend publiquement la concubine de son prédécesseur.
-
HONORIUS IV (1285). Offre l’empire à Rodolphe, à condition qu’il fasse la guerre aux Français.
-
BONIFACE VIII (1294). Célèbre par ses démêlés avec Philippe le Bel. Scélérat consommé, avait fait assassiner son prédécesseur. Simoniaque, homicide, usurier.
-
CLÉMENT V (1305). S’établit à Avignon. Responsable du supplice des malheureux Templiers. Perfide et débauché, fit massacrer 4.000 Vaudois en un même endroit.
-
JEAN XXII (1316). Ambitieux et tellement avare et voleur qu’il laissa une fortune de 25 millions de florins-or, somme inouïe pour l’époque.
-
BENOIT XII (1334). Célèbre pour avoir séduit la sœur de Pétrarque, âgée de 18 ans. Sa lubricité était invraisemblable. Il mourut couvert de plaies hideuses.
-
CLÉMENT VI (1342). Accablé de dettes, dépensait les revenus de l’Église avec des filles de joie. Provoqua la guerre en Allemagne, en Bohême, en Italie.
-
INNOCENT IV (1352). Aussi avare et exploiteur que ses prédécesseurs.
-
GRÉGOIRE XI (1370). Stimule le zèle des Inquisiteurs au Portugal.
-
URBAIN VI (1378). Des 30 schismes qui ont déchiré l’Église, voici le plus long. « On vit pendant 50 années papes contre papes ; empires contre empires, églises contre églises, enfin l’Europe contre l’Europe : son sol déchiré, souillé par tous les crimes » (Meissas). Urbain fait torturer et assassiner 6 cardinaux qu’il accusait de comploter ; il fait tuer Jeanne de Naples, etc....
-
BONIFACE IV (138!)). Ignorant, mais pillard à l’excès.
-
GRÉGOIRE XII (1406). Son règne fut un tissu de lâches fourberies. Le Concile de Pise le déposa.
-
ALEXANDRE V (1409). Ivrogne, gourmand, scandaleux ; ne dépare pas la collection.
-
JEAN XXIII (1410). Empoisonne son prédécesseur pour lui succéder. Sodomiste et forban d’envergure. Le Concile de Constance le dépose, ce qui était justice, mais fait brûler Jean Huss, crime abominable.
-
MARTIN V (1418). Fait massacrer les hussites révoltés.
-
EUGÊNE IV (1431). Déposé par un Concile comme hérétique, sanguinaire et parjure.
-
CALLIXTE III (1455). Homme d’argent et d’intolérance, confirme l’usage de la torture contre les hérétiques.
-
PAUL II (1464). Brute fanatique, multiplia les procès d’hérésie.
-
SIXTE IV (1471). S’amusait avec deux petits garçons dont il fit des cardinaux. Fit assassiner Laurent et Julien de Médicis. Les prostituées de Rome lui versaient un impôt de 20.000 ducats par an. Mourut syphilitique. (Il avait installé l’Inquisition à Séville).
-
INNOCENT VIII (1484). Il avait eu seize enfants ! Multiplie les autodafés ; augmente les pouvoirs de Torquemada.
-
ALEXANDRE VI (1492). De toute la collection de monstres qui ont régné sur les Chrétiens, celui-ci (Borgia) est peut-être le plus odieux. Ses crimes et ses empoisonnements sont trop connus pour qu’il soit utile de les rappeler.
-
JULES II (1503). Livre Venise au pillage. Met la France en interdit. Élu par les pires corruptions.
-
LÉON X (1513). S’enrichit, avec ses maîtresses, en exploitant... le Purgatoire.
-
ADRIEN VI (1522). Créature de Charles-Quint. Despote et lubrique.
-
CLÉMENT VII (1523). Met l’Europe à feu et à sang pour étouffer le protestantisme naissant.
-
PAUL III (1534). Avait livré sa sœur à Borgia pour être nommé cardinal. Fut l’amant de sa propre fille ...
-
JULES III (1550). Dépravé et homosexuel. Fulmine contre les hérétiques.
-
PAUL IV (1556). Surexcite la lutte contre les Luthériens et plonge l’Europe entière dans le deuil.
-
PIE V (1556). Ancien Inquisiteur. Défend aux médecins de soigner les hérétiques. Fournit des moyens d’action à Charles IX contre les protestants.
-
GRÉGOIRE XIII (1572). Applaudit aux massacres de la Saint-Barthélemy.
-
SIXTE V (1585). Un des plus grands fourbes de la Papauté. Voulut donner l’Angleterre protestante à Philippe II d’Espagne ! Approuve l’assassinat d’Henri III.
-
GRÉGOIRE XIV (1590). Envoie une armée et dépense 500.000 écus d’or pour déchirer la France.
-
PAUL V (1605). Assassinat de Henri IV. Partout des guerres intestines suscitées par le Vatican.
-
GRÉGOIRE XV (1621). Excite le duc de Savoie à assiéger Genève. Fait persécuter les réformés en Pologne, etc.
-
URBAIN VIII (1623). Emprisonne le vieux savant Galilée ...
-
INNOCENT X (1644). Fut le jouet de sa belle-sœur (et maîtresse), Dona Olympia, qui pille le Vatican. Condamne le traité de Westphalie, qui admettait la liberté du culte pour les protestants.
-
ALEXANDRE VII (1655). Appuie les Jésuites, stimule l’Inquisition, distribue les biens d’Église à ses parents.
-
INNOCENT XI (1676). Obtient la révocation de l’Édit de Nantes, ce qui ruina la France.
-
CLÉMENT XI (1700). Soutient la Compagnie de Jésus contre les Jansénistes.
-
CLÉMENT XIV (1769). Après tant de scélérats, il eut le mérite de condamner enfin les Jésuites, non par humanité, mais par peur. Ils se vengèrent en l’empoisonnant.
-
PIE VI (1775). Responsable du sang versé par la Chouannerie, en essayant d’abattre la Révolution Française.
-
PIE VII (1799). Se fit lâchement le complice de Napoléon Ier, qui le malmena malgré tout, pour sa duplicité.
-
PIE IX (1846). Canonisa l’Inquisiteur Arbués. Promulgua le Syllabus. Se proclama « Infaillible ». Finalement balayé par le peuple italien.
-
LÉON XIII (1878). Astucieux et subtil. Prêche le « ralliement » à la République, mais fortifie le thomisme. Par son « Rerum Novarum » et sa « Démocratie chrétienne », chercha à faire dévier et échouer le vrai socialisme.
-
PIE X (1903). La France dénonce le Concordat qui la liait à cet esprit borné. Il s’en venge en poussant l’Autriche à déclencher la guerre mondiale.
-
BENOIT XV (1914). Hypocritement inféodé aux Empires Centraux, adopta ensuite une « neutralité » peu compromettante, à l’égard de la guerre mondiale.
-
PIE XI (1922). Fasciste en Italie, en Espagne, en Pologne, en Hongrie, condamne l’Action Française en France. Joue la comédie pacifiste. Est le grand profiteur de la Guerre. Pactise avec Mussolini.... Mais le dernier mot n’est pas dit.
Dans ce rapide exposé historique, nous n’avons cité que quelques faits et quelques noms. Il ne s’ensuit nullement que les papes non cités aient été des hommes vertueux et bons (je ne prétends pas non plus que les scélérats et les avares n’ont jamais rien fait de bien). Ce qui est certain, d’une façon générale, c’est que la Papauté, qui se prétend une institution supérieure et sainte, a toujours été, au contraire, une entreprise de rapine, accumulant les crimes pour dominer l’humanité.
— André LORULOT.
BIBLIOGRAPHIE. — Indépendamment des ouvrages cités au cours de la présente étude (Doellinger, de Meissas, Charbonnel, Dubarry, etc...), voir La Vicomterie, Les Crimes des Papes.
PARADIS
n. m. (latin paradissus, du grec paradeisos, jardin)
Ce nom est donné aux séjours divers inventés par l’imagination humaine pour servir de demeures aux âmes favorisées des trépassés. Persuadés depuis toujours qu’ils possèdent une ou plusieurs âmes immortelles, les hommes ont de tout temps inventé des contrées merveilleuses pour les recevoir. D’ailleurs les visions et les songes ont renseigné les vivants sur le pays des morts ; innombrables sont les voyageurs qui ont exploré le séjour des morts. Tous les peuples ont eu, parmi leurs grands hommes que la légende magnifie, des êtres privilégiés qui sont allés visiter les lieux de délices ou de châtiments, dévolus aux esprits des défunts et, qui, au retour, ont narré avec un grand luxe de détails les délices et les épouvantes des uns et des autres. Aussi, le Peau Rouge connaît-il par avance les heureux territoires de chasse ; les indigènes de l’île Touga, l’île vaporeuse de Bolotu ; le Grec, sa prairie d’Asphodèle ; le chrétien, l’enfer et son paradis peuplé d’anges. Toutes les péripéties du départ, les dangers du chemin qui conduit au royaume, le nombre et les difficultés des obstacles à surmonter pour y parvenir, ont été dits et redits par les explorateurs d’outre-tombe et par les clergés de chaque religion.
La fantaisie de chaque peuple a diversement situé le royaume des morts. Tantôt c’est une île située au-delà des mers ou le sommet inaccessible d’une haute montagne, ou une vallée lointaine ou encore une immense plaine inconnue. Tantôt c’est le berceau légendaire de la race où l’on croit que les âmes vont reprendre celles de leurs ancêtres, ou bien le fond d’une caverne, le bord d’un fleuve ténébreux, parfois les astres, enfin le ciel, les nuages ou la voûte solide du firmament. L’idée d’un séjour souterrain ou sous-marin a donné lieu à des mythes innombrables ; idée suggérée par le mode de sépulture où la disparition régulière du soleil dans les flots ou derrière les montagnes. La grande majorité de ces distributions arbitraires sont de toutes les contrées et de tous les temps et, souvent nous les trouvons associées dans un même pays, combinées et utilisées par l’imagination d’une même tribu.
Les Algouquins envoyaient leurs morts dans une île au milieu d’un lac ; les Australiens et les naturels de toute la Polynésie, également dans une île située vers le soleil couchant ; de même Hésiode réserve aux esprits des héros les îles Fortunées, les monts Kino-Biclou à Bornéo, le mont Mérou dans l’Inde, le pic central de l’île Ceylan portent sur leurs plus hautes cimes le séjour funéraire. Les volcans du Nicaragua, de la NouvelleZélande, l’Heckla, le Vésuve, l’Etna ont été considérés comme des séjours infernaux. On connaît les enfers et les paradis des Grecs, des Latins, des Egyptiens, des Chaldéens, des Hébreux dont les similaires sont communs aux Indous, aux Chinois, aux musulmans et aux chrétiens ainsi qu’aux Kharens, aux Néo-Zélandais, aux peuples de l’Amérique centrale et de l’Amérique australe. Presque partout on admet des voyages d’âmes dans les airs et dans les astres. Les nuages, le soleil, la lune, les étoiles, la voie lactée, ont été tour à tour considérés, selon l’humeur du moment, soit comme paradis, soit comme enfer.
Mais quelles que soient les idées que les anciens et les modernes se font de l’autre monde, il n’est toujours que l’image extraordinairement amplifiée de ce monde et de l’existence journalière. Rien ne peut lui enlever ce caractère. Toutes les joies, tous les bonheurs que l’homme a connus ou désirés ; toutes les peines et les douleurs qu’il a subies ou souhaitées à ses ennemis ont été transportées soit au paradis, soit en enfer.
La pêche, la chasse, la guerre, l’ivresse, la volupté sexuelle, toutes ces joies, portées à un degré inouï de puissance et considérées comme éternelles, constituent le souverain bien du paradis de l’habitant du Kamtchatka, du Kharens, ceux du Groenlandais, de l’Araucan, du Mahométan. Le même excès de chaleur et de froid, de la faim, le travail forcé, les tortures et les supplices renaissant sans cesse, constituent l’appareil constant de tous les enfers. Le ciel des chrétiens est une assemblée de dévots exécutants des mélodies sacrées, chantant, dans une béatitude jamais lassée, des hymnes de reconnaissance au Tout-Puissant, dont le spectacle est leur plus haute félicité, comme le ciel des Bouddhistes est le lieu idéal où les adorateurs de ce Dieu continuent leurs disputes et leurs interminables discussions théologiques. Tous les paradis sont conformes à l’idéal mesquin de ceux qui les ont inventés pour leur usage ; ils copient textuellement leur vie étriquée. Ils n’ont qu’un défaut capital : celui d’être imposés dans le ciel à ceux qui ne le connaissaient pas sur la terre.
De bonne heure et presque partout, des distinctions ont été admises entre les demeures d’outre-tombe et entre les diverses catégories d’âmes. Les âmes plus méritantes — mérite souvent dû à la position sociale du mort plus qu’à ses propres qualités — jouissent chez presque tous les peuples d’une immortalité spéciale, et privilégiée, différente de celle réservée aux esprits du commun.
L’équité ne règne pas plus au royaume des morts que sur notre globe terrestre. Toutes les âmes n’ont pas la même destinée et, au ciel comme sur la terre, les plébéiens sont sacrifiés aux nobles et aux riches. La notion du vice et de la vertu, le sens de la justice sont les conquêtes les plus tardives de l’humanité, elles sont d’ailleurs encore inachevées. Et l’Eglise catholique qui prétend avoir apporté au monde la justice en est restée dans l’édification de son paradis aux conceptions les plus barbares et les plus injustes des peuples anciens et des sauvages. Elle réclame les rigueurs de l’enfer pour ses adversaires et ses prédécesseurs, c’est-à-dire la majorité des humains. Elle exclut de son paradis, non pas les assassins confessés, ni les criminels repentants, mais les gens qui n’ont pas cru à ses dogmes ; de plus elle en chasse les fidèles des autres religions, trois ou quatre fois plus répandues que le christianisme. Et parmi ses élus, elle favorise les papes, les prêtres, les moines et les ecclésiastiques de tout acabit, qui, de par leur profession même, sont assurés d’avoir meilleure part aux félicités éternelles.
La répartition des châtiments et des récompenses a toujours été adéquate à la conception morale des temps où les religions et les mythologies se sont formées, mais elle reste toujours inférieure au niveau de la moralité acquise en dehors et à l’encontre des religions. Rarement la justice d’outre-tombe a inspiré une crainte salutaire aux malfaisants, et elle a apporté un réconfort douteux, une consolation vaine aux peuples dont elle résume l’idéal. En rejetant hors de la réalité la réparation possible des maux présents, elle a opposé un obstacle incalculable au développement de l’activité humaine. De plus, la croyance aux paradis et aux enfers a surtout été utile aux exploiteurs de la faiblesse humaine, car, complice de la servitude physique et morale, arme aux mains des maîtres incapables d’élever les caractères et de diriger le progrès, elle a maintenu les humbles dans l’ignorance et la crainte, facteurs de résignation ; elle a déchaîné contre les conceptions analogues ou contraires, les persécutions et les bûchers et a ainsi inondé de sang toute la terre. Socialement, la promesse du paradis, pour les chrétiens entre autres, a eu surtout pour but — et pour effet — de faire accepter aux déshérités leurs souffrances et leurs privations, l’infériorité même de leur condition comme une épreuve bienfaisante qui leur vaudra, après la mort, une félicité compensatrice. Et, pendant que les pauvres se consolent du mieux qu’ils peuvent avec le mirage de joies problématiques, les grands de ce monde — et les princes de l’Eglise au premier rang — se hâtent de savourer les jouissances positives, certaines au moins, de la vie terrestre.
— Ch. ALEXANDRE
PARADOXE
n. m. A été formé des mots grecs para (à côté) et doxa (opinion)
Dans l’Encyclopédie de Diderot, on lit cette définition du paradoxe :
« C’est une proposition absurde en apparence, à cause qu’elle est contraire aux opinions reçues, et qui, néanmoins, est vraie au fond ou du moins peut recevoir un air de Vérité. »
Le paradoxe est l’opinion de l’homme qui préfère une vérité nouvelle, même incertaine, à l’enlisement dans les idées acquises. Il est à la recherche idéologique ce que l’hypothèse est à la recherche scientifique. Le but du paradoxe est la vérité, comme celui de l’hypothèse est la certitude. Mais pas plus que l’hypothèse ne devient toujours une certitude, le paradoxe n’est toujours la vérité de demain. De même les opinions reçues qui s’opposent aux paradoxes ne sont pas toujours des préjugés. Ces opinions ont été des paradoxes avant de devenir soit des vérités, soit des préjugés. Les paradoxes qui sont des vérités demeurent. Ceux qui sont des préjugés sont emportés par de nouveaux paradoxes. Il. ne s’agit donc pas de prendre parti, soit pour l’opinion reçue, soit pour le paradoxe ; il s’agit de choisir la vérité là où elle se trouve. C’est l’attitude de la science devant l’hypothèse ; elle l’adopte, elle lui apporte la démonstration qui en fait une certitude quand elle a découvert qu’elle est vraie. C’est le sort de l’utopie qui est une forme du paradoxe et qui devient un jour réalité. Toutes les inventions ont été des paradoxes, des utopies, tant qu’elles sont restées dans le domaine de l’imagination ; l’expérimentation les a fait passer dans celui de la vérité et de la réalité.
Proudhon disait :
« Il n’est pas une vérité qui n’ait été, au jour de sa publication, regardée comme un paradoxe. »
Il n’est pas un progrès qui n’ait été un paradoxe à un moment quelconque de l’humanité, depuis la production et les usages du feu que certains hommes ignorent encore aujourd’hui, jusqu’à ceux de la vapeur et de l’électricité. La locomotion aérienne, imaginée et recherchée par l’homme depuis qu’il a observé le vol de l’oiseau, a été un paradoxe tant que l’aérostation et l’aviation ne l’ont pas réalisée. Il y a cent ans, on aurait traité de fou celui qui aurait prédit qu’en 1931 on volerait plus longtemps, plus haut et plus vite que les oiseaux ; on l’aurait peut-être envoyé à Bicêtre, comme on avait jeté en prison Galilée lorsqu’il avait soutenu que la Terre tournait autour du Soleil. Les communications interplanétaires sont encore du domaine du paradoxe, de l’utopie ; elles ne le seront peut-être plus dans cent ans ou dans mille ans et il n’y aurait pas à traiter de fou celui qui annoncerait que l’homme pourra alors, dans la même journée, aller déjeuner dans la Lune et coucher dans Vénus ou dans Saturne. Qui sait quelles choses encore plus extraordinaires la science permettra, dans dix ou cent siècles d’ici, si l’humanité ne s’est pas exterminée elle-même avant ? Car, le paradoxe le plus impossible à soutenir aujourd’hui, devant les exemples qu’elle donne de sa folie, est qu’elle ne court pas au suicide général de tous ceux qui la composent. Rien n’est impossible. « Celui qui en dehors des mathématiques pures prononce le mot impossible manque de prudence », disait Arago, ce qui n’empêchait par le même Arago de soutenir, à propos des chemins de fer, que la basse température des tunnels, avec le passage subit du chaud au froid procurerait aux voyageurs des fluxions de poitrine !...
Le paradoxe est contraire à l’opinion, mais non à la raison. « Paradoxa », et non « paraloga », disaient les stoïciens qui émettaient les vérités éternelles de la sagesse reconnues de tout temps et toujours à reconnaître. La philosophie antique a pourvu de paradoxes toutes les philosophies de l’avenir sans qu’elles arrivent à les épuiser. La fourberie théologique a, à dessein, assombri la sérénité philosophique en introduisant dans les discussions paradoxales les affirmations stupides de ses élucubrations. Car on ne saurait admettre comme paradoxe, c’est-à-dire vérité probable soumise au contrôle de la raison et des faits, ce qu’on doit croire parce que c’est absurde. Credo quia absurdum ! Comme l’hypothèse expérimentale, le paradoxe qui sera la vérité est fondé sur une observation antérieure. Il n’y a aucune observation à la base de la métaphysique théologique ; il n’y a que les phantasmes d’imaginations en délire exploités par des imposteurs.
Il y a le paradoxe dont la vérité est reconnue implicitement par l’opinion, mais qu’elle laisse à l’état de paradoxe, parce qu’elle n’en tire pas toutes les déductions nécessaires, soit par incapacité, soit par indifférence. Tel est ce paradoxe de V. Hugo voyant dans le travail parlementaire celui de « quelques pauvres diables de gâcheurs politiques, lesquels s’imaginent qu’ils bâtissent un édifice social parce qu’ils vont tous les jours à grand peine, suant et soufflant, brouetter des tas de projets de lois des Tuileries au Palais Bourbon et du Palais Bourbon au Luxembourg ». D’ailleurs, tout ce qui constitue la vérité sociale est paradoxe dans l’état social basé sur le mensonge, ce mensonge conventionnel qui est, au dire de ses augures, une nécessité vitale des sociétés. Le pain et le bien-être pour tous, l’ « à chacun selon ses besoins », la liberté individuelle, la justice sociale, qui sont des vérités naturelles et élémentaires, sont devenus des paradoxes dans un monde constitué sur les sophistications les plus pernicieuses. En 1534, Sébastien Franck dans son livre Paradoxes, après avoir défini le paradoxe « quelque chose qui est vrai, mais que tout le monde tient pour faux », donnait le commentaire de deux cent quatre-vingts de ces vérités essentielles dont l’artificieuse casuistique sociale a fait des paradoxes.
Par contre, les sophismes les plus haïssables sont érigés en vérités sociales, tel le fameux aphorisme : Si vis pacem. para bellum — « Si tu veux la paix prépare la guerre » — qui est la loi du monde actuel, malgré toutes les expériences qui en ont démontré l’indiscutable fausseté, mais que les hommes se laissent toujours imposer par la fourberie de leurs gouvernants. Il a fallu le monstrueux impérialisme de Napoléon pour ressusciter cet exécrable sophisme en rétablissant le culte barbare de la force militaire disparu avec les Romains. Depuis ces sinistres fossoyeurs du monde antique, personne n’avait pensé à préparer la guerre pour assurer la paix. Les mégalomanes Louis XIV et Frédéric, eux-mêmes, ne levaient des armées que pour faire la guerre ; en dehors des pauvres diables et des aventuriers ramassés par les recruteurs et que poussaient la faim et des perspectives de pillages, ils auraient vainement tenté d’intéresser leurs peuples à leurs entreprises. L’ « amour sacré de la Patrie ! » ne les avait pas encore poussés à cette duperie qui leur fait confondre la patrie avec les Napoléon et avec les coffres-forts de leurs maîtres ! Malgré la « gloire » des quinze années de brigandage guerrier que fut le règne de Napoléon Ier, les peuples avaient un tel mépris de cette espèce de gloire qu’ils restaient résolument pacifistes. Par contre, ils étaient soulevés par un véritable internationalisme de l’esprit, formé et fécondé par l’enthousiasme des idées de la Révolution Française, et qui suscita dans toute l’Europe les événements de 1848. En 1859, Emile de Girardin, un des porte-parole les plus autorisés de la bourgeoisie régnante, faisait paraître un ouvrage sur le Désarmement Européen, où il écrivait :
« A quoi servent les armées ? Elles servent à créer le risque de guerre et à l’entretenir. Il n’existerait pas sans elles. »
Daumier raillait avec une verve impitoyable la « paix armée » qui dormait sur des canons et sur des pointes de baïonnettes. Un Napoléon III lui-même, qui ne voyait que dans la guerre le moyen de soutenir la légitimité de ses criminelles usurpations, sentait le besoin de sacrifier au pacifisme des idées en prenant en 1863 l’initiative d’un désarmement de tous les pays militarisés, et d’une révision des traités de 1815 qui avaient créé un état de conflit permanent. Mais la peste napoléonienne avait déposé son virus dans toute l’Europe et empoisonné les peuples. En 1870, l’abcès creva. Depuis, l’infection n’a pas cessé de se répandre, contaminant le monde entier. Le culte de la force et la haine de la pensée, l’admiration de la brute, la pratique du banditisme colonial, l’abandon de tous scrupules, le mépris de toute justice sociale, le règne du muflisme : tout cela a formé cette monstrueuse aberration qui a eu son couronnement dans la guerre de 1914. Or, cela n’a pas suffi. Une récente statistique a montré que les dépenses militaires des nations dites « civilisées » absorbent chaque année plus de cent milliards. Les cinq nations qui sont les plus « civilisées » : Etats-Unis, Russie, France, Angleterre, Allemagne, figurent dans ce chiffre pour cinquante milliards à elles seules. Inconsciemment, car la vérité sort toujours, même de la bouche de Tartufe, les journaux disent, en reproduisant cette statistique :
« Que ne ferait-on pas pour le bonheur de l’humanité avec cet argent ? »
Mais ils se reprennent vite, sous l’œil des carnassiers qui les tiennent à leur solde, pour dire que le bonheur de l’humanité consiste à avoir de nombreuses armées, des flottes puissantes, de gros canons, des avions redoutables, des gaz aussi « moutarde » que possible, et pour chanter le saint cantique :
« Si vis pacem para bellum !... »
Au moins, la paix du monde est-elle assurée moyennant toute cette préparation guerrière ? Non, le monde est plus que jamais menacé de la guerre !... Alors, on ne comprend plus et on demande : jusqu’où ira-t-on dans la voie de cette folie ?... Les exécrables malfaiteurs qui mènent la danse ne le savent pas eux-mêmes ; ils paradent, ils étalent leur incommensurable sottise, leur hideuse vanité, aux applaudissements des peuples de plus en plus trompés et abrutis.
Dans son Paradoxe sur le Comédien, Diderot a montré un autre aspect du paradoxe, celui d’une vérité qui ne cesse pas d’être à la fois démontrée et déniée dans les faits. Le paradoxe soutenu par Diderot est qu’un comédien joue d’autant mieux ses rôles qu’il y apporte moins de passion et reste maître de lui. Le débat est toujours actuel et prête toujours aux déductions les plus variées, comme celles qu’en a tirées Diderot et qui sont autant de paradoxes bâtis sur les mobiles contradictoires des individus dans leur activité sociale. Nous ne nous arrêterons que sur celui-ci :
« On ne devient point cruel parce qu’on est bourreau, mais on se fait bourreau parce qu’on est cruel. »
C’est là un paradoxe redoutable. Il renferme tout le problème de la psychologie des hommes qui, à un moment donné et dans des circonstances quelconques, tiennent en leur pouvoir la vie des autres hommes. Les gens qui sacrifient la vie des autres sont toujours des bourreaux aux yeux de leurs victimes. Eux se considèrent toujours comme des justiciers agissant dans des buts légitimes. Ils ignorent le remords qui est une fiction romantique, ils tuent « avec tranquillité » et ils conservent un « cœur léger » devant les hécatombes qu’ils commandent. La légitimité, ou ce qu’ils croient telle, de leur fonction est-elle assez puissante pour créer cette insensibilité qu’on peut appeler « professionnelle » de l’homme d’Etat, du juge, du militaire, du bourreau lui-même, ou cette insensibilité vient-elle de leur cruauté naturelle qui seule leur permet d’accepter leur sanglante fonction ? Voilà la question redoutable que pose le paradoxe de Diderot. Elle est particulièrement grave pour les révolutionnaires à qui sont proposées les solutions sociales de la violence et ils ne sauraient y répondre sans avoir de leur côté sévèrement interrogé leur conscience. Car un homme cruel ne sera jamais juste ; il sera un tyran, il ne pourra être un propagateur de la liberté, quelle que soit la légitimité de la cause qu’il aura choisi de servir et pour laquelle il se sera fait bourreau. Cet homme sera toujours plus nuisible qu’utile à cette cause, même en faisant ses « gros ouvrages », ceux de la guillotine et de la fusillade ; car la violence n’est qu’un pis aller, même employée pour la vraie justice, et le sang, quel qu’il soit, laisse toujours une tache sur celui qui l’a répandu. La force des forces est celle de l’idée ; c’est la force qui convainc, ce n’est pas celle qui frappe ; c’est la force de l’apôtre, ce n’est pas celle du bourreau ; c’est la seule force qui peut produire la véritable justice sociale et dresser une solidarité humaine vraiment pure. Avant de recourir à la violence, regardons en nous-mêmes, longuement, profondément, pour savoir si nous obéirons réellement au sentiment de la justice ou à la cruauté qui nous aveuglera et souillera nos actes, même les plus légitimes.
On n’en finirait pas de discuter sur le paradoxe, tant il est un des moyens les plus brillants et les plus féconds de la rhétorique en ce qu’il l’alimente incessamment de sujets et d’arguments imprévus. Il est très souvent une attitude de la vanité humaine, le produit d’un esprit de contradiction plus ou moins subtil et dont les opinions sont plus ou moins fausses quoique non reçues, ou le besoin « d’épater le bourgeois » par des sornettes non moins sottes que les siennes. Mais il est souvent aussi une défense de l’esprit contre l’incontinence bavarde, qui « parle comme un livre » et ne débite que de stupides lieux communs. Il y a une foule de gens qui, pour se prouver qu’ils existent, ont besoin de parler à tort et à travers. Ils se croiraient morts et se tâteraient s’il leur arrivait de rester silencieux pendant un quart d’heure. Bien entendu, ce sont ces gens qui ont tant de choses à dire qui débitent le plus d’insanités. Devant ce flot, il ne reste d’autre ressource, quand on ne peut fuir le bavard ou la société dont il fait partie, que de riposter à son « bon sens » par des paradoxes exprimant la contrepartie de ce qu’il dit. Au monsieur qui a hérité de ses grands-parents l’habitude de dire après chaque repas, en guise de poussecafé : « Encore un que les Prussiens n’auront pas ! » on peut soutenir qu’au contraire ils l’ont eu avant lui et qu’ils l’auront encore après. On peut faire, sur ce sujet, des discours qui rempliraient vingt volumes aussi copieux et aussi ennuyeux que ceux où M. Poincaré cherche toujours à justifier sa « mobilisation qui n’est pas la guerre ! ». Comme la majorité des gens sont de séniles moulins à « bon sens » et partagent les opinions de M. Poincaré, on ne tarde pas, et avantageusement, à passer pour un « piqué » qui est regardé avec pitié et qu’on finit par laisser tranquille. A mesure qu’il avance en âge, l’homme intelligent goûte de plus en plus la satisfaction de passer pour un « piqué » dans un monde où les gens « raisonnables » sont si souvent des abrutis. C’est le signe de sa bonne santé intellectuelle et morale. Il dit comme J.-J. Rousseau : « J’aime mieux être un homme à paradoxes qu’un homme à préjugés. »
— Edouard ROTHEN.
PARAÎTRE
Nous ne nous occuperons de ce mot -qui semble né du latin parere : être engendré, mis au jour — que dans le sens de se montrer, se faire remarquer sous des apparences aussi brillantes que possible et le plus souvent fausses, pour donner de soi une idée plus avantageuse que la réalité.
Certes, il est normal, nécessaire même, de faire valoir les qualités que l’on a, quand elles peuvent être utiles aux autres en même temps qu’à soi-même. Il peut être bon que l’individu cherche à attirer l’attention sur lui lorsqu’il a à offrir, en échange du bénéfice qu’il en retirera, un équivalent certain. Il est même indispensable au progrès humain, il est de l’intérêt collectif, que l’homme possédant une réelle supériorité dans une branche quelconque de l’activité, se fasse connaître et que son œuvre soit mise en évidence. Le « besoin d’être unique », dans lequel M. Valéry voit la racine de l’orgueil, manifeste un désir légitime de paraître quand il est celui du savant, de l’inventeur, de l’artiste, de l’artisan qui veulent faire participer la collectivité au bénéfice de leur savoir, de leurs découvertes, de leurs travaux, des perfectionnements et des embellissements qu’ils apportent à la pensée et aux formes de la vie. L’excès de modestie, ou — ce qui serait la même chose — l’excès d’orgueil qui les ferait se renfermer dans la retraite et cacher leur œuvre à tous les yeux, serait injustifiable et coupable. Paraître est donc, en certaines circonstances où l’individu se fait connaître par une activité novatrice et féconde, une condition de progrès, un stimulant de l’initiative personnelle contre l’indifférence collective et la stagnation sociale.
Mais trop souvent le « besoin d’être unique » n’est qu’un vulgaire besoin de paraître excité par la vanité. (Voir ce mot.) Même chez ceux qui méritent l’attention publique, trop souvent la sotte vanité l’emporte sur un orgueil justifié et fait se détourner les regards dirigés sur le savant ou l’artiste vers le cabotin qui est leur double. Combien d’hommes remarquables, légitimement admirés pour leurs travaux, ont souillé leur gloire et fait oublier leur mérite en sombrant dans les affaires ou la politique ! On peut être un génie et n’être qu’un petit caractère, voire un hurluberlu. L’exemple abonde dans l’histoire d’hommes, d’abord grands et vertueux, qui furent entraînés par la fureur de paraître à devenir des scélérats. Combien, sans s’élever si haut et descendre si bas, qui ternissent eux-mêmes la considération méritée par leur œuvre en intriguant, sans dignité, pour des salamalecs au « cher maître », des décorations, un habit vert avec plumes d’autruche et la petite épée qui a une rigole pour le sang ! Combien traînent une noire mélancolie parce qu’ils n’ont pas leur portrait dans l’album Mariani et sont négligés par l’actualité publicitaire ! Combien se laissent emporter par le vertige malsain de l’arrivisme et désertent les régions sereines de la pensée et de l’art pour congratuler des ministres, distribuer des « prix de vertu » et parfois finir en correctionnelle !...
Paraître a été une nécessité primitive de l’humanité, sa première manifestation psychologique. Cette nécessité est venue du besoin sexuel, quand il a inspiré à l’individu le désir de plaire, de séduire par des apparences flatteuses le mâle ou la femelle convoité. Paraître est dans l’instinct de la nature tout entière quand, « immense champ d’amour », a dit Buchner, elle se pare féeriquement de toutes les merveilles au temps enchanté des pariades. Ce désir de plaire a appris à l’homme, comme à l’animal, à faire valoir ses avantages personnels et à donner l’illusion de ceux qu’il ne possède pas. Pour paraître auprès de la femelle et l’emporter sur ses rivaux, le mâle fait le beau, il montre son courage, son audace, son adresse, il étale ses grâces physiques. Il fait prendre à sa voix les inflexions les plus caressantes, à son langage le ton le plus éloquent. Il se livre à toutes les violences et à toutes les douceurs. Il cherche à vaincre dans le combat furieux et sanglant, à charmer dans la paix poétiquement inspirée. Il est Hercule tuant la reine des Amazones et filant aux pieds d’Omphale. Contre la puissance de cet instinct de nature, toute résistance est impossible sans les plus graves désordres ; il sonne triomphalement la fanfare de la vie victorieuse de toutes les aberrations mortifiantes grâce aux prodiges de l’amour. Plantes, bêtes et gens y sont soumis ; mais alors que les premières lui obéissent simplement et normalement, les hommes ont voulu le « civiliser ». Ils ont ainsi créé, avec toutes les aberrations de l’amour, toutes celles du besoin de paraître. Alors que ce besoin ne dépasse pas chez les animaux la satisfaction sexuelle, il s’est compliqué chez les hommes de prolongements conventionnels, tels le mariage destiné à perpétuer une illusion qui devient ainsi contre nature et produit les pires égarements. Il s’est en outre étendu à toutes les formes de la vie civilisée au point qu’il préside à toutes les manifestations de son organisation artificieuse.
Il semble que, dans une vraie civilisation le besoin de paraître par les moyens de la violence et de la tromperie aurait dû s’atténuer de plus en plus pour s’anéantir à mesure que l’homme acquérait plus de connaissance et de raison, qu’il pouvait davantage dominer ses passions et corriger sa nature primitive. Il n’en a rien été. Plus l’homme a eu la possibilité de se développer et de grandir en valeur intellectuelle et morale, plus il a cherché à paraître sous de fausses apparences, plus il s’est ingénié à s’abaisser intellectuellement, à se souiller moralement. Plus l’homme a découvert de moyens de bien-être, de vie facile et agréable, de raisons d’entente et de cordialité avec autrui, de possibilités de rapports sincères de plus en plus étendus dans le monde entier, plus il a multiplié les difficultés, les ruses, les abus, les prétextes de conflits en se montrant faux, hypocrite, avide d’une considération de mauvais aloi et d’une puissance usurpée. Plus il a étouffé ses scrupules, plus il est devenu effrontément, cyniquement menteur, poseur, charlatan, cabotin, réclamiste, pour atteindre, au moyen du bluff et du puffisme à la frénésie d’arrivisme dont on voit aujourd’hui le débordement calamiteux. Cela suffirait à montrer la fausseté de la vie socialement organisée et à prouver que ce qu’on appelle la « civilisation » n’est que la barbarie plus policière que policée.
Dans le but de paraître, l’homme avait d’abord inventé la parure pour suppléer l’insuffisance de ses avantages naturels. Il avait commencé par se parer de plumes, se tatouer le corps, se mettre des anneaux dans le nez et aux oreilles, se pendre au cou des verroteries, se vêtir d’étoffes éclatantes ; il avait créé la mode. Celle-ci, et toutes les façons de se faire valoir, sont restées primitives chez l’homme primitif. Elles se sont compliquées à l’extrême chez le civilisé pour arriver aux raffinements de la toilette, aux maquillages savants et aux chirurgies esthétiques de l’heure présente. En même temps, le besoin de paraître s’est surexcité dans l’esprit propriétaire, thésauriseur, spoliateur, et dans le désir de domination qui s’est exercé d’abord sur le voisin de case, les compagnons du clan, pour s’étendre ensuite sur les nations et le monde entier. De l’individuel il est passé au collectif pour créer arbitrairement les suprématies de castes et de races, justifier les classes et les impérialismes. La vanité individuelle, excitée par la vanité voisine, a trouvé son appui dans la vanité du groupe de plus en plus nombreux et fait prendre au besoin de paraître un caractère vésanique et épidémique. De l’égotisme, dont la forme saine et intelligente est dans « la culture attentive des diverses facultés du moi » (Fonsegrive), elle a fait l’hypertrophie du MOI, sentiment excessif de la personnalité et exagéré au point de ne considérer que soi et de vouloir n’occuper les autres que de soi. Suivant les époques et les circonstances, ce sentiment prend les formes précieuses du narcissisme barrésien et se manifeste, individuellement, et passivement, dans une sorte d’onanisme intellectuel cultivé en un quelconque Jardin de Bérénice ; mais il est furieusement épris d’action pour les autres à qui il dit :
« Allez ! enfants de la Patrie ! »
Ou bien, il s’aiguille vers des activités collectives plus grossières et plus brutales. J.-R Bloch constatait, en 1828, que le sport français était « en train de se tourner en une sorte d’égotisme plastique et sensuel dont les effets ne sont pas moins morbides que l’égotisme cérébral de Barrès ». Encore plus exaspérée, la vanité individuelle se manifeste dans l’activité catastrophique des mégalomanes, prétendus « surhommes » auxquels les simples vaniteux ont la sottise de remettre leur destin. C’est ainsi que du primitif qui a commencé à se peindre le visage, il y a des milliers d’années, pour plaire à sa femelle, et tué son voisin pour s’emparer de sa chasse, jusqu’aux arrivistes convoitant la possession du monde et aux mégalomanes chefs d’Etats décidant « les mobilisations qui ne sont pas la guerre », se sont déroulés tous les aspects du besoin de paraître. Simplement naïf chez l’homme de la nature ne cherchant, comme la plante et comme l’animal, que sa meilleure place au soleil, ce besoin a atteint l’aliénation frénétique du dictateur jamais satisfait, jamais rassasié, toujours prêt à mettre le monde à feu et à sang, à décréter la misère et la ruine de millions d’hommes pour la satisfaction de son exécrable vanité. Un Néron incendiait Rome pour montrer qu’il était un grand artiste ; un Clemenceau a fait prolonger la Grande Tuerie pour prouver qu’il faisait la guerre. Et les peuples, intoxiqués, hallucinés par la même vanité, dressent des monuments de gloire à ces fous sanguinaires en chantant qu’ils ont « bien mérité de la Patrie !... ».
Car, au-dessous des Néron et des Clemenceau qui font ce qu’on appelle « l’histoire » et sont les Himalaya de la sottise humaine, il y a la cohue innombrable des piqués, des mythomanes — monomanes du mensonge, — des mégalomanes, des aliénés de toutes sortes, furieusement acharnés à se hisser les uns sur les autres, à s’écraser et à se dévorer entre eux pour paraître au-dessus de leur environnement. Les crabes qui s’agitent dans un panier où ils sont entassés donnent un spectacle bien innocent à côté de celui-là. Rien ne fait mieux comprendre la monstruosité de l’état social, son incapacité à se constituer sur des bases rationnelles, que ce grouillement de vanités sordides. Rien ne montre davantage le détraquement du mécanisme à l’envers qu’on appelle « civilisation » et qui annihile, broie, sacrifie tout ce qui est vrai, juste, équilibré, généreux, bienfaisant, pour le triomphe des gredins et des fous.
Il convient de distinguer entre ceux que tourmente le désir de paraître. Il y a la masse grégaire, la foule des « innocents », des « pauvres d’esprit » à qui le ciel est promis et dont, la vanité chétive se repaît de cette merveille, celle des simples imbéciles dont un besoin simiesque d’imitation satisfait la vanité puérile dans la pratique de la mode, celle des imbéciles plus compliqués qui obéissent au snobisme. Ceux-là sont plus victimes de leur sottise qu’ils ne sont bénéficiaires de leurs ambitions toujours déçues. Pris individuellement, ils sont rarement dangereux, seulement capables à l’occasion de se mettre à ruer et à mordre comme une bourrique quand elle est trop fortement étrillée. Les dégâts qu’ils peuvent produire sont limités par leur incapacité intellectuelle, leur aboulie congénitale et leur peur des coups. Mais le danger vient de leur masse. Grenouilles pullulantes dans le marais social, « majorité compacte », malgré ce déliquescente, soumise à toutes les abjections, rétive à toutes les générosités, favorable à toutes les turpitudes : ils sont le troupeau stupide qui se plante sur la tête des plumets, des cocardes, des petits drapeaux, pour suivre les tambours, tirer au sort, marcher aux urnes, se ruer aux mascarades patriotiques et courir à tous les appels du canon. Ils sont les soutiens et les dupes des malfaiteurs qui ont fait du besoin de paraître un système d’exploitation, des criminels qui entretiennent l’état social dans la frénésie de ce besoin, de tous ceux qui en sont les professionnels et par qui sévit l’arrivisme dont nous parlerons plus loin.
La possibilité de paraître avec plus ou moins d’éclat et d’influence dépend du prestige qu’on exerce. Ce prestige agit avec une sorte de fascination abolissant le jugement et la résistance de celui qui le subit. Tous les moyens de séduction, plus ou moins grossiers, des vieilles sorcelleries se retrouvent en l’occurrence, à peine changés par la terminologie moderne. Les enchantements féeriques, les apparitions merveilleuses et terrifiantes, les diableries, les philtres, les charmes, les incantations, les exorcismes, tout l’appareil des jeteurs de sorts, des rebouteux des âmes et des corps, des nécromants, des charlatans du divin et du temporel, avec les mises en scènes pompeuses des cours et des cérémonies : tout cela n’a été créé que pour exercer ce prestige en frappant les imaginations et en troublant les esprits. C’est par ces moyens qu’on provoque les états d’hypnotisme collectif qui font béer les foules admiratives aux manifestations carnavalesques des puissants de la terre, aux Te Deum chantés en l’honneur du « Dieu des armées ». C’est ainsi qu’on convainc les peuples que leur nation propre, dont les maîtres sont si grands, est au-dessus des autres ; que l’armée est une belle chose, que la guerre est d’essence divine et doit toujours exister, malgré les pactes Kellog qui la déclarent « crime » et la mettent « hors la loi » ; qu’enfin, il faut travailler, payer, s’armer et se faire tuer, pour que les maîtres soient toujours plus grands, plus insolents, plus mystificateurs et que le crime ne soit pas extirpé de la terre.
Même dans les pays démocratiques, on perpétue la mascarade des cérémonies, des uniformes, des décorations, et les fallacieuses distinctions qui séparent les hiérarchies du vulgaire demeuré nu et cru et qui n’est rien, « pas même académicien », a dit Piron. Tout cela pour maintenir le prestige, aussi anachronique que ses déguisements, d’une autorité qui n’a même pas assez le respect d’elle-même pour se manifester autrement que par des moyens de carnaval. Mais l’oripeau est nécessaire, tant il couvre souvent le plus vilain bonhomme, pour donner l’illusion d’une supériorité du dominateur sur le dominé. « Prestige acquis », a dit Le Bon dans sa Psychologie des Foules, mais non « prestige personnel ». Tout ce monde de déguisés est d’autant plus entiché de ses prérogatives, jaloux de les faire valoir et d’en tirer avantage, qu’il est moins digne de considération. Le tyran violateur des droits de « son » peuple, le ministre prévaricateur, le guerrier massacreur et pillard, le prêtre simoniaque, l’intellectuel prostitué au pouvoir, le magistrat forfaiteur, le dignitaire de la Légion d’honneur livré au péculat et à l’escroquerie, tous ces représentants de l’imposture souveraine ont besoin de leur « prestige acquis » pour paraître quelque chose. Il est du plus haut comique d’observer le spectacle de leurs jongleries, de leurs disputes, de leurs intrigues, pour se faire valoir et s’évincer réciproquement. Ceux qui ont de belles femmes sont favorisés ; ils font des cocus magnifiques. « Le mépris de l’inférieur est un grand principe d’émulation et le fondement de la hiérarchie », a dit A. France. Ce mépris soulage les petites âmes de celui que leur manifeste les malins grimpés plus haut qu’eux au mât de cocagne de la notoriété. Aussi, les questions de préséance les préoccupent plus que leurs fonctions. Depuis qu’il y a des hiérarchies, la question est posée de celui qui aura le pas sur l’autre. Au temps des Pharaons la dispute était vive pour savoir qui, des porteurs de l’ordre guerrier du Lion ou de ceux de l’ordre civil de la Mouche, marcherait le premier dans les cérémonies. Le XVIIIe siècle vit la querelle interminable du Parlement, des Pairs et de la Noblesse, chacun de ces trois corps voulant passer avant les autres et rester assis et couvert devant eux. Suivant que le roi avait besoin d’un corps ou d’un autre, il rendait des Edits contradictoires qui entretenaient la bagarre. Le snobisme et ses valets de plume, qui affectent de « savoir vivre », ont souvent cité avec admiration l’exemple de Talleyrand offrant du bœuf à ses convives suivant les degrés de la hiérarchie. Commençant par le plus haut personnage, il disait de la façon la plus respectueuse :
« Monsieur le duc me fera-t-il l’honneur d’accepter ce morceau de bœuf ? »
Il allait ainsi, en graduant sa politesse, jusqu’au dernier convive, un parent pauvre relégué au bout de la table, à qui il disait sèchement :
« Du bœuf ?... »
Le « savoir vivre » de M. de Talleyrand n’était que du muflisme supérieur.
Pour éviter les incidents dans la hiérarchie officielle et obliger ses dignitaires à conserver quelque dignité devant les badauds subjugués, on a établi des protocoles, codes de la discipline et des préséances. Même en République, on ne saurait confondre les serviettes d’en haut avec les torchons d’en bas, Chacun a sa place, sa case, son étiquette, suivant ses fonctions et son grade ; même morts, ceux d’en haut auront droit à des « funérailles » pompeuses ou des « obsèques » dignes, ceux d’en bas à un « enterrement » plus ou moins simple. Il y aura ou non cortège, musique, grand-messe, discours, voitures, couronnes, suivant que le mort aura été ambassadeur ou concierge de l’Obélisque. La tournée chez le marchand de vin, « où l’on est mieux qu’en face », n’est pas prévue.
Avec les époques et les circonstances, le prestige change d’aspect ; les façons de paraître varient comme la mode. Il s’agit pour chacun d’être de la classe dont le nombril est le plus étoilé, ou de paraître lui appartenir. Les parvenus romains devenaient patriciens ou se donnaient l’air de l’être. M. Jourdain et la comtesse d’Escarbagnas ont de plus sûrs ancêtres dans les Crispinus et les Ponticus étrillés par Juvénal que dans les grimoires des généalogistes. Dans la société féodale du moyen âge, et jusqu’à la Révolution Française, quand la noblesse l’emportait sur les autres classes, chacun voulait être noble, plus ou moins cousin du roi, au moins son bâtard si on ne pouvait être son fils légitime, son porte-coton quand on ne pouvait être son ministre. Les plus nobles étaient les plus audacieux, c’est-à-dire les plus massacreurs et les plus pillards. Les rois étalent les sur-nobles, les lions qu’imitaient les loups et les renards dévorateurs des ânes et des moutons. Pendant dix siècles, cette noblesse d’aventure s’était renouvelée ou accrue de tous les roturiers parvenus, pouvant payer un de ces titres dont les rois et les papes tenaient boutique et se faire fabriquer une hérédité aristocratique par un quelconque d’Hozier. Suivant le prix qu’il y mettait, le marmiteux, à peine décrassé par la savonnette à vilain, se découvrait des ancêtres ayant porté outrasse avec Philippe Auguste ou dansé avec Isabeau de Bavière. La querelle du Parlement, des Pairs et de la Noblesse provoqua la publication d’un document amusant sur l’origine véritable de tout le monde à particules qui menait si grand tapage au nom de ses ancêtres. Le Parlement lui-même ne pouvait dissimuler « qu’il était ouvert à la roture par la vénalité » et que, parmi les gens de robe, certaines classes étaient « abjectes ». Mais ce n’était pas le corps des Pairs, « encore bien plus défiguré », qui était en droit de lui faire reproche de sa roture. Quant aux Nobles, ils étaient à peu près tous sortis récemment de boutiquiers ou de ces valets de seigneurie qui vivaient de la noblesse, en attendant de prendre ses titres et ses places, et même « d’hommes de néant », comme ce Maximilien de Béthune, fils d’un aventurier venu d’Ecosse. Les ducs de Richelieu venaient d’un Vignerot, domestique et joueur de luth ; les ducs d’Uzès, d’un Bastet, apothicaire. Les de Luynes descendaient d’un avocat de Mornas dont les trois rejetons avaient porté tour à tour l’unique manteau de famille pour se présenter au Louvre. Les La Rochefoucault sortaient d’un George Vert, étalier-boucher ; les Neuville-Villeroy d’un marchand de poissons ; les Noailles d’un domestique anobli par un vicomte de Turenne, etc. Comme disait La Fontaine, en conclusion de sa fable La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf :
Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs,
Tout petit prince a des ambassadeurs,
Tout marquis veut avoir des pages. »
L’Intimé, dans Les Plaideurs, de Racine, se recommande en ces termes à Dandin, son juge :
Chacun cherche à paraître comme il peut.
La noblesse, pour qui travailler eût été déroger, n’en était que plus prodigue dans son désir de paraître. Elle se ruinait par ostentation, au contraire des démocrates qui mettent aujourd’hui la même ostentation à s’enrichir. La chevalerie qui avait paradé au Camp du Drap d’Or, derrière François Ier et Charles Quint, y avait laissé les trois quarts de sa fortune. Elle mangea le dernier quart pour paraître à la Cour. Les chevaliers devinrent des courtisans flagorneurs, réduits à des services dégradants que payaient des bénéfices, des pensions, des faveurs moins qu’honorables. Les blasons se redoraient par des mésalliances, par le jeu, le maquereautage et toutes les friponneries qui, pratiquées dans la manière des cours, devenaient des vertus aristocratiques. Le vrai sentiment de l’honneur, que les nobles prétendaient posséder à un si haut degré, était devenu aussi inexistant que pour la plupart de ceux qui portent aujourd’hui leur honneur à leur boutonnière.
La bourgeoisie, dans son ascension, fut conduite, non à se substituer à la noblesse dans des formes plus intelligentes et plus dignes, mais à la singer dans ses façons de paraître. Le Bourgeois Gentilhomme, de Molière, est l’image classique, multipliée à de nombreux exemplaires, du bourgeois qui se trouvait noble parce qu’il avait des maîtres de musique, de danse, de philosophie, d’armes, qu’il faisait de la prose sans le savoir et que ses valets marchaient sur ses talons pour qu’on vît bien qu’ils étaient les siens. Il n’était pas plus ridicule, mais il l’était autant, que cette duchesse de Lesdiguières commandant à son professeur de maintien de lui donner de l’esprit pour briller dans la société. M. Jourdain était trop naïf pour être bien dangereux ; mais il a pris de la férocité en se reproduisant. Le traitant Turcaret, forban de finance, annonça les loups-cerviers qui firent comprendre qu’en 1789 le peuple en eut assez. Mais quand leur tête fut promenée à bout de pique, leur valet Frontin prit leur place. La carrière fut ouverte à la ruée démocratique qui aboutit, de nos jours, à l’apothéose de Thénardier et de ses acolytes montés du bouge de la rue Blomet aux plus hauts emplois de l’Etat.
Les guillotineurs n’avaient pas encore lavé la machine à Guillotin du sang des « aristocrates » que déjà ils voulaient se parer de leurs titres ! Napoléon Ier vendit de la noblesse à toute sa valetaille. La monarchie de Juillet en pourvut les fils des « sans culottes » enrichis dans tous les tripotages et devenus bourgeois constitutionnels. Il en coûtait seulement 18.470 francs de droit d’enregistrement pour devenir duc, 7.490 francs pour être comte, la même somme pour être marquis, 5.050 francs pour une vicomté et 3.830 francs pour une baronnie. L’Annuaire de la Noblesse disait : « Lorsque la concession deviendra ancienne et que le temps aura jeté sur elle le voile de l’oubli, on revendiquera une origine féodale. » Un quelconque Drigon devint marquis de Magny, un Gaschon fit un de Molènes, un Piédevache fut fait de la Bourdelais et un Le Chat rentra ses griffes sous le nom de Saint-Hénis ! Il y en eut des centaines qui figurent encore aujourd’hui au Gotha parmi l’aristocratie du noble faubourg et de l’Action Française !
Le besoin de paraître a pris tout son développement dans l’arrivisme contemporain épaulé par le muflisme. Leur progression a été commune ; ce sont deux frères siamois engendrés et engraissés par le même fumier social. L’arrivisme a été remarquablement étudié par Ossip-Lourié dans son ouvrage : L’Arrivisme, essai de psychologie concrète. Si nous avions un reproche à faire à ce livre, ce serait de paraître plaider l’irresponsabilité de l’arrivisme en insistant trop sur sa pathologie. Le monstre cause trop de désastres et il est trop impitoyable à l’égard de ses victimes pour mériter des circonstances atténuantes.
Comme le muflisme, l’arrivisme est une vieille chose dans le monde ; comme lui, il a pris à notre époque un développement qui en a fait une maladie sociale. Il est le phénomène psychologique le plus caractéristique de notre temps. Evidemment, il y a toujours eu des arrivistes, « ambitieux sans scrupules », voulant à tout prix « parvenir, arriver aux dignités, aux honneurs, à la fortune », comme il y a toujours en des égotistes animés de la manie de parler et de faire parler d’eux, et des mégalomanes possédés du délire des grandeurs. Leurs cas ont été certainement nombreux, mais ils étaient particuliers, considérés généralement comme anormaux, anti-sociaux, et, même quand ils réussissaient, ils devaient mettre une sourdine aux trompettes de leur triomphe ; on ne leur permettait pas d’ériger en civisme leur impudent pharisaïsme. Si, au temps de Louis XV, comme en tout temps, « la vertu était à pied et le vice à cheval », du moins n’avait-on pas fait une vertu du vice et ne le tenait-on pas pour une chose socialement admirable.
On ne trouve le mot : arrivisme, dans aucun dictionnaire. Le premier, Ossip-Lourié l’a défini ainsi :
« Désir de se mettre en évidence, de s’imposer, de jouer un rôle, de dominer. Tendance pathologique irrésistible à réaliser rapidement, par tous les moyens, un but égoïste, à s’acheminer ou plutôt à s’élancer vers une situation mettant le sujet au-dessus de son état, de ses capacités, de sa valeur réelle. C’est une affection qui pousse invinciblement certaines catégories d’individus, — dont le nombre augmente de plus en plus, — à égaler ou à dépasser quelqu’un, à s’emparer d’une parcelle d’un pouvoir, d’une puissance. » Petits arrivistes qui se démènent dans leur village, auprès d’un patron, dans le salon d’une sous-préfète ou dans des comités électoraux ; grands arrivistes qui atteignent les plus hautes situations politiques et sociales au-dessus des foules et des peuples : « Chez tous on observe une floraison démesurée de la vanité et de l’audace provocante. » C’est ainsi que « des imbéciles, des idiots, des monstres arrivent socialement à des situations en vue. »
Ossip-Lourié ajoute :
« L’élément brutalement égoïste est inséparable de l’arrivisme. Les sentiments affectifs sont abolis, exaltés ou pervertis chez la plupart des arrivistes... Aucune catastrophe familiale, sociale ou universelle, souvent provoquée par eux-mêmes, ne peut les émouvoir. Tout pour eux est prétexte pour se manifester, se produire... Les arrivistes sont des stratèges de premier ordre. Leur habileté va même jusqu’à se faire des ennemis utiles. Pour réaliser leurs desseins, ils font souvent preuve d’une pittoresque ingéniosité et d’une souplesse géniale. Avec une audace morbide ils savent utiliser les infiniment petits et les hécatombes de millions d’êtres humains... Les arrivistes ne peuvent se manifester que s’ils trouvent constamment de nouveaux buts à leur activité. Le jour où ils n’ont plus de degré à monter, d’obstacle à franchir, ils se désagrègent et perdent leur raison d’être... L’un des traits caractéristiques des arrivistes, c’est la stérilité de leurs efforts. Regardez au fond de leurs œuvres : il n’y a rien. Dépouillez-les de leurs couronnes artificielles, vous vous trouverez en présence de niais. »
L’arriviste sévit dans tous les milieux et dans toutes les classes. Partout, en bas et en haut, illettré ou savant, manuel ou intellectuel, prolétaire ou capitaliste, gouverné ou gouvernant, il est un cas pathologique.
« Car tout arriviste, quel que soit le degré de son arrivisme et de l’état de son milieu, doit être toujours suspect au point de vue nerveux et mental... On est frappé de la quantité considérable de tarés qu’on rencontre (chez les arrivistes) : débiles, esprits faux, déséquilibrés de l’émotivité ou de l’humeur, hystériques, névropathes. Tous portent des stigmates, c’est-à-dire des signes permanents et flagrants pathognomoniques. »
Cette thèse est illustrée par une discussion qui s’est produite, il y a quelques années, à la Chambre des Communes d’Angleterre. Il s’agissait du trafic des décorations qui se pratique au-delà de la Manche comme en deçà. Un orateur demanda qu’on fit examiner par un médecin aliéniste toute personne désireuse d’être décorée.
Après ces définitions et observations, Ossip-Lourié a étudié « la genèse psychologique de l’arrivisme ». Les circonstances et les facilités de développement toujours plus grandes que lui a offertes l’état social, ont multiplié l’arrivisme en procurant aux monomanes ambitieux et aux mégalomanes, qui ne sont plus neutralisés dans des asiles, la possibilité de réaliser les idées de grandeur dans lesquelles ils se complaisent. Non seulement ils peuvent, aujourd’hui, s’exercer en liberté, mais ils sont aidés et admirés publiquement, jusqu’à l’assassinat inclus, qui est pour eux la meilleure des réclames et des moyens de se pousser dans le monde. Il n’y a pas longtemps, les journaux offraient complaisamment à l’admiration des foules, au lendemain d’un acquittement en cour d’assises, le sourire d’une beauté de cinéma qui avait tué son mari millionnaire pour hériter de lui. Quel encouragement à la vertu pour les jeunes filles sans fortune, ouvrières et dactylos, qui résistent aux séductions des « concours de beauté » et de la prostitution empanachée où ils conduisent ! Devant les facilités qu’ils rencontrent, l’admiration dont ils sont l’objet, comment s’étonner que les arrivistes et les cabotins du crime « finissent par se persuader qu’ils sont plus puissants, plus grands, plus nobles que tous ceux qui les entourent », que des hommes « encore sains d’esprit en apparence, chez qui le délire ambitieux n’est qu’à l’état latent, sacrifient tout à la satisfaction de leurs tendances orgueilleuses » ? Ils sont en même temps « la proie de la folie des grandeurs et des victimes de l’existence des hiérarchies sociales ».
Dans un état social normal, le mal serait vite endigué et neutralisé ; mais dans l’état de violence et d’arbitraire qui est à la base de la société « la plus faible cause suffit à déclencher la démence », pour conduire jusqu’au crime « socialement avouable et admiré ». Au lieu d’enfermer dans des maisons d’aliénés les arrivistes délinquants, « on les honore, on leur élève des statues quand ils ne se les élèvent pas eux-mêmes... Ils sont d’autant plus dangereux qu’ils ne peuplent pas les prisons, mais la vie courante, et sont parmi les dirigeants des sociétés ». Ces dirigeants sont très rarement des individus supérieurs ; ils sont des médiocres comme tous ceux qui n’arrivent que par les autres. Ils sont à la mesure de la foule qu’ils doivent flatter et tromper pour réussir. Comment pourrait-on leur opposer la vérité devant cette foule ? C’est l’histoire du Dr Stockmann, dans Un Ennemi du Peuple, d’Ibsen, l’histoire de tous ceux qui croient pouvoir demeurer libres et garder une conscience propres s’ils réussissent auprès de la « majorité compacte »...
« L’arriviste n’est jamais un homme libre, il ne peut pas l’être. Pour arriver, il est obligé de s’accrocher à un milieu, à une caste, à s’y embrigader, quitte à les lâcher, dès que son but sera atteint, pour s’embrigader ailleurs. »
La tromperie qui porte l’arriviste à se faire surestimer le porte aussi à faire sous-estimer ses adversaires. De là l’étroite collaboration de l’arrivisme et de la calomnie qui ne respecte aucune valeur intellectuelle et morale, aucune pureté. C’est ainsi que :
« Arriver est la vertu pratique que toute société enseigne et exige. On ne vous demande pas comment vous êtes arrivé, on vous dit :
« Arrivez d’abord, vous serez quelqu’un après. »
Arrivez par tous les moyens, la société vous mettra au pinacle, fera de vous un grand homme. Si vous n’arrivez pas, on vous traitera d’incapable, de médiocre, de propre à rien, de coupable, de suspect. »
Telle est la morale sociale fondée sur l’arrivisme, maladie devenue si générale que les hommes, de moins en moins nombreux, qui en sont épargnés et ont l’énergie de lui résister passent pour des anormaux et des fous à surveiller. L’arrivisme est devenu « le baromètre moral des peuples » ; il fait des idoles des bandits qui parviennent à les dominer, et il les fait s’idolâtrer eux-mêmes dans le monstrueux épanouissement de leur vanité collective.
Si l’arrivisme n’a pas été souvent étudié comme manifestation sociale collective, les arrivistes ont, par contre, fourni une matière abondante à la littérature. Celle-ci ne pouvait manquer d’observer cette passion : l’ambition, qui est, après l’amour, le mobile le plus puissant des actions humaines ; elle devait souvent présenter ses exploits dans l’histoire, le roman, le théâtre. De tout temps on a instruit les hommes sur les moyens de réussir, de parvenir, de dominer. Les princes ont suivi plus ou moins intelligemment les conseils des Machiavel ; les gardeuses d’oies ont été éveillées à des idées de grandeur par les diseurs de bonne aventure. Dès l’antiquité, l’arriviste a achalandé les boutiques des pythonisses lisant les présages de son destin dans le ventre d’un poulet comme aujourd’hui dans le marc de café ou les cartes. Depuis l’Art d’Aimer, d’Ovide, jusqu’aux enseignements des Jésuites sur la façon de se pousser dans la vie en suivant le Chemin de velours, les traités plus ou moins cyniques ou libertins se sont multipliés à son usage. Le Cortigiane (le Courtisan), de Balthazar de Castiglione, a été le modèle, depuis le XVIe siècle, de tous les ouvrages à l’usage des hommes de cour, celui de Balthazar Gracian en particulier. L œuvre de Balzac est le tableau de l’arrivisme qui enfiévra, il y a cent ans, la bourgeoisie échappée aux dangers révolutionnaires et devenue maîtresse de son sort. Toute la littérature du XIXe siècle est pleine de la montée arriviste observée d’une façon de plus en plus naturaliste par Stendhal, Flaubert, Maupassant, Zola. De Rastignac lançant son défi à la société en criant : « A nous deux, maintenant ! », à Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir et à Bel Ami, tous ses héros ont défilé dans les romans de 1830 à 1885. Bel Ami est le type complet, achevé de l’arriviste contemporain. Il ne lui manquait plus, il y a cinquante ans, que cette considération publique qui lui a permis, depuis, de se multiplier. Louis Reybaud avait constaté le besoin de gloire précoce qui tourmentait les générations de son temps et devait trouver son premier triomphe arriviste avec les gens de sac et de corde du Coup d’Etat, les aventuriers du Deuxième Empire. Il écrivait, en 1843 :
« On ne cherche pas à mériter les positions ; on veut les prendre d’assaut ; on demande à la fortune plus qu’elle ne peut donner, à l’imagination plus qu’elle ne peut produire. Le temps n’entre pour rien dans les calculs ; on ne sait ni lutter ni attendre ; partout on veut jouir vite et n’importe par quels moyens. »
Que pouvait le vieil idéalisme des révolutionnaires quarante-huitards contre cet arrivisme qui se montrait si résolument réaliste, ayant déjà fait ses preuves par les massacres ouvriers et l’enfumage des Arabes ? Dans son Jérôme Paturot, Reybaud a montré avec une ironie aiguë l’arrivisme patelin, prudhommesque, d’un marchand de bonnets de coton devenu ministre et dont les aphorismes sont de la plus exacte psychologie politicienne. (Voir Politicien).
A l’époque du Symbolisme (voir ce mot), l’individualisme anarcho-bourgeois qui découvrait Darwin, Nietzsche, Stirner, Ibsen, échafaudant la théorie de l’individu contre la société, essayait de justifier l’arrivisme dans lequel, finalement, il perdrait tout son anarchisme pour n’être plus que bourgeois. Une foule de phénomènes en composaient la ménagerie : pieds plats mal bâtis et foireux, Zarathoustra à béquilles, scientistes sans science, surhommes qui voyaient chacun « l’Unique » en se regardant dans une glace, et prétendaient bouleverser le monde en refilant de la monnaie de plomb à un épicier et la vérole à une femme. Ils bavaient d’admiration devant le mot de Tailhade :
« Qu’importent les victimes pourvu que le geste soit beau », mais ne s’inquiétait pas de la beauté du geste ; les victimes leur suffisaient. Tous chantaient l’hymne du « struggle for life ». Ils affirmaient que la vie doit appartenir au plus fort, au plus fourbe, au plus audacieux, que les scrupules ne sont que préjugé et duperie, qu’il faut savoir « vivre sa vie » et se tailler la part du lion pour ne pas être réduit à celle de l’âne. Tout cela, perfidement répandu par des farceurs et mal digéré par des imbéciles, avait créé une sorte d’héroïsme tragi-comique qui justifiait aux yeux des gobe-mouches la fortune des coquins des affaires et de la politique, — les businessmen à la Lechat, — mais finit lamentablement dans les aventures des « bandits tragiques ».
Sous l’influence de ces phantasmes, Henri Château présenta, dans son Manuel de l’Arriviste, une sorte de surhomme boiteux, à la fois génial et imbécile, dont la psychologie nous paraît tout à fait fausse. Ce personnage qui a observé jusqu’au fond le mensonge social, est arrivé au mépris le plus total de toutes ses institutions et de tous ses fantoches, au détachement le plus complet de toute solidarité sociale pour « ne songer qu’à soi-même », dans la plénitude de « l’individualisme égoïste, délivré de tous préjugés et de toute morale ». Mais en même temps, l’auteur fait de son héros le type de l’arriviste parfait. Il y a, à nos yeux, une incompatibilité majeure, une antinomie absolue, entre le personnage réalisé en lui-même et celui qu’il veut jouer dans la société. Quand un homme est réellement, et non pour paraître, arrivé à une telle attitude philosophique, quand il tire une telle sérénité de son mépris de la sottise humaine et qu’il est devenu véritablement invulnérable à cette sottise, il n’est pas concevable qu’il puisse ainsi se déboulonner lui-même de son piédestal pour se livrer aux pitreries de l’arrivisme, même par raillerie ou par vengeance. Cela nous fait penser à la statue de Henri IV qui descendrait de son cheval sur l’invitation du poivrot légendaire pour aller boire avec lui. Un homme arrivé dans le sens noble du mot, en réalisant son être moral dans une plénitude indéfectible, n’a de rapports avec la société que comme pis aller, dans les limites strictement nécessaires pour conserver sa liberté, entretenir son existence et ne pas aboutir au suicide. Comment pourrait-il se dédoubler, se contredire, se démentir au point de remplir les conditions de l’arrivisme qui sont, avant tout, l’élimination de toute personnalité et la soumission à toutes les incongruités nécessaires pour séduire la foule ? Ce prétendu individualiste, qui se ferait l’esclave de la société pour ne pas en être la dupe, serait un Gribouille qui se jetterait à l’eau pour ne pas se mouiller. Ce serait un niais ou un farceur et, s’il était sincère, on pourrait dire de lui ce que R. de Gourmont a dit de Machiavel :
« Cet homme si intelligent n’eut pas l’esprit de se méfier de l’hypocrisie universelle. »
Un arriviste ne peut être dégagé de tout préjugé moral, de tout respect social ; il doit, au contraire, les pratiquer. S’il ne les a pas tous conservés, il en possède du moins assez pour attendre encore quelque chose d’eux puisqu’il veut arriver par eux... Quelles que soient les théories qu’il émet, quels que soient ses actes préparatoires — et il ne trompe pas longtemps les clairvoyants — il n’est qu’un bourgeois, il n’agit qu’en bourgeois, et quand il affirme le contraire, il n’est qu’un bourgeois plus hypocrite que les autres. Voit-on le personnage qui viendrait dire :
« C’est parce que j’ai la haine, le dégoût, le mépris de la société et du troupeau lâche des hommes, c’est parce que je veux me venger de toutes les humiliations qu’ils ont fait subir à ma conscience d’homme libre et de révolté, que je me conduis comme le plus haïssable, le plus méprisable, le plus lâche de tous. C’est parce que je déteste le désordre social et les turpitudes bourgeoises que je participe à ce désordre et que je me vautre dans ces turpitudes » ?...
Non ! des gens qu’on appelle les « faisans », et que V. Méric a dépeints dans ses Compagnons de l’Escopette, se sont essayés à cette sorte de justification. Ils n’ont donné le change qu’à leurs pareils, arrivistes sans frein, et aux gobeurs qu’ils abusaient. Ce n’est pas dans Darwin, Nietzsche, Stirner et Ibsen qu’ils avaient fait leur éducation : c’est dans le Manuel de l’Arriviste.
On n’a que trop le spectacle des agissements des prétendus « affranchis », de ces sans-scrupules qui se disent « conscients », de ces « dessalés » évoluant dans des milieux spéciaux, mais aussi corrompus que les milieux bourgeois, qui sont encore plus timorés et plus méprisables que les « abrutis » et les « espèces inférieures » qu’ils vitupèrent. Combien qui eurent l’honneur de représenter « l’idée » à un moment quelconque de leur jeunesse impétueuse, de souffrir volontairement pour elle, de faire figure de révoltés, de réfractaires, d’en-dehors, n’avaient au fond que des instincts et des âmes de bourgeois, n’attendant que l’occasion de se montrer « parfait honnête homme », de se « réhabiliter » et jouir de la « considération publique » ! Ils l’ont montré... Avoir été braconnier et devenir garde-chasse, avoir prêché l’abstentionnisme et être un jour député, avoir été en prison pour antipatriotisme et porter la Légion d’honneur : quelle déchéance dans une telle « réhabilitation » ! Il peut y avoir là du cynisme ; il n’y a aucune grandeur morale et aucune supériorité de caractère.
Même sans posséder les grandes ambitions arrivistes, les « affranchis » illégaux, comme les « abrutis » conformistes, ont les faiblesses du besoin de paraître et en sont les victimes. La vanité les perd également. Combien d’illégaux à qui un « bon coup » pourrait assurer un avenir tranquille, dans une sécurité où ils jouiraient intelligemment de l’indépendance économique, de la liberté du corps et de l’esprit, se font prendre sottement, par vanité puérile, par besoin d’exhibitionnisme ! C’est l’histoire de ce journalier des chemins de fer qui, ayant réussi à « lever », à Marseille, un magot d’un million et demi, puis à passer en Espagne où personne ne serait allé le chercher, se signala lui-même à la police par ses excentricités et « tomba » … « honteux comme un renard qu’une poule aurait pris ». C’est l’histoire d’une foule de ces « renards » qui mettent trop de « poules » dans leurs affaires. Les « affranchis » de cette sorte, pitoyable gibier de bagne et d’échafaud, sont fabriqués en série par la société pour justifier son organisation policière et sa vindicte.
Suivant les milieux, les circonstances, les individus, l’arrivisme se manifeste par des moyens très différents. Tous ne sont pas à la portée de tout le monde. Les mêmes procédés sont favorables ou désastreux selon les cas. Tel escroc deviendra ministre, tel autre ira au bagne. Il y a la manière ; il faut avoir la « découpure », et puis, on est plus ou moins « fadé » — on a plus ou moins de chance — comme disent les spécialistes du « milieu ». Dans la démocratie qui a proclamé l’égalité devant la loi, il en est toujours comme sous l’autocratie dont les jugements distinguent les puissants des misérables. A un certain degré de puissance, de savoir faire, de protection, non seulement l’art d’arriver en friponnant peut être pratiqué sans danger, mais il constitue une vertu au point que sans lui on ne peut devenir un grand personnage. Combien d’hommes illustres, auxquels « la Patrie est reconnaissante » et que la foule acclame, n’auraient été que les épaves d’un parasitisme miteux, les « chiens crevés » de l’actualité, si leur chance ne leur avait pas fait atteindre les régions stratosphériques où planent les Jupiter de l’Olympe panamiste et oustricard ! La question, pour l’arriviste, est de franchir ce qu’on appelle en mécanique le « point mort » et en physique le « point critique ». C’est d’atteindre ce passage où la loi et ses gendarmes cessent d’être soupçonneux et hostiles pour devenir bienveillants et protecteurs. Jusque-là, si l’on n’a pas eu ce minimum de probité que Figaro constatait chez Bartholo : « tout juste autant qu’il en faut pour n’être point pendu », on risque la culbute. Arrivé à ce sommet, on peut se laisser glisser confortablement dans cet océan de délices que Satan offrait à Jésus avec le gouvernement du monde.
Suivant le milieu social auquel il appartient, son éducation, son caractère, son intelligence, le but qu’il poursuit, l’arriviste use plus ou moins délicatement ou grossièrement des moyens de la flatterie et de la tromperie. Il est le renard guettant le fromage au bec du corbeau. Il se fait flagorneur sans mesure ; aucune platitude, aucune bassesse ne le fait reculer. « Si la peste donnait des pensions, la peste trouverait encore des flatteurs et des serviteurs », constatait le poète persan Saadi. L’histoire d’un arriviste fameux, Alberoni, fils de jardinier, devenu abbé, puis cardinal et maître de l’Espagne, est particulièrement édifiante. Saint Simon l’a contée dans toute sa crudité. Chargé d’une commission du duc de Parme auprès du duc de Vendôme, bâtard royal qui mit la pédérastie à la mode dans son armée et donnait ses audiences sur sa chaise percée, Alberoni, reçu avec ce cérémonial, ne trouva rien de mieux que de tomber en extase devant le derrière du Vendôme et de le baiser en s’écriant :
« O culo di angelo ! »
De telles prémices, auxquelles il ajouta une impassibilité totale sous les coups de bâton, valurent à Alberoni les plus hautes destinées. C’est ainsi que réussirent tant de favoris de princes livrés eux-mêmes aux plus honteuses et sanglantes turpitudes. Tous les porchers devenus papes n’usèrent pas seulement de la ruse assez innocente de la béquille de Sixte-Quint ; la sodomie, l’adultère, la simonie, le poison, le poignard, leur furent plus utiles que les vertus évangéliques pour arriver au trône de Dieu. Combien de Mazarin, de Potemkine, devinrent ministres et dictateurs parce qu’ils surent se glisser dans le lit d’une reine de France ou d’une impératrice de Russie ! Combien de personnages solaires de la démocratie ont dû leur fortune, non à leur dévouement à la chose publique, mais à ce qu’ils surent s’établir greluchons des déesses de la République ou flagorneurs de ses dieux ! Henri Heine a raconté que se rendant un jour chez le baron de Rothschild, il vit un domestique galonné traversant un corridor en portant le vase de nuit de M. le baron, et « un agioteur de la Bourse, qui passait dans le même instant, tirer respectueusement son chapeau devant le puissant pot ». Henri Heine ne douta pas qu’avec le temps l’agioteur deviendrait millionnaire. Combien ne doivent leur fortune qu’à de tels coups de chapeau !...
Toutes les façons de paraître sont plus ou moins inspirées par l’arrivisme. Celle qui en semble la plus dégagée est celle de l’épateur qui cherche les effets les plus violents possibles, mais sans qu’ils fassent long feu pour procurer un profit. Quand l’épateur voit qu’il a un public dont il peut exploiter la complaisance et qu’il continue dans ce but, il devient alors un charlatan. Jusque-là, il est une sorte d’artiste, de dilettante, qui cherche surtout à se faire admirer en surprenant, en étonnant, en épatant — (faire tomber à la renverse) -par son exagération des choses. Lorsque l’épateur n’est que le blagueur qui « cherre dans les bégonias », cultive la « galéjade » et ne se livre qu’à d’inoffensives excentricités, il lui arrive d’être amusant. Mais il y a l’épateur insupportable, le poseur, qui a toujours l’air d’être devant le sculpteur de sa statue ; il se double du raseur quand il est pris d’incontinence verbale. Et il y a pire. Trop souvent, le désir d’épater la galerie fait perdre tout sens commun et fait commettre des sottises irréparables, comme celles de ces déséquilibrés pariant d’avaler d’un trait un litre d’alcool ou de planter leur couteau dans le ventre du premier « pante » qu’ils rencontreront. C’est l’exploitation ignoble, par les chantres de « Rosalie » — la baïonnette — de cette stupide gloriole à laquelle se laissent prendre tant de malheureux inconscients, qui fait les « nettoyeurs de tranchées » dans les guerres du Droit et de la Civilisation.
Le nombre des épateurs est infini, comme la variété de leurs inventions. Simples farceurs, inoffensifs maboules ou aliénés vicieux, ils se manifestent dans tous les domaines. Ils sont la foule de ceux qui :
« Pissent au bénitier afin qu’on parle d’eux. » (M. Régnier)
Depuis les Alcibiade coupant la queue de leur chien, jusqu’aux sanglants dictateurs qui sont des Soulouques déchaînés, tous, pour paraître, pour échapper aux règles communes de la vie et surtout au travail, dépensent une ingéniosité qui les rend ridicules ou odieux. Ils s’imposent des fatigues et des humiliations que souvent un galérien aurait refusé de supporter.
L’épateur professionnel est le charlatan aux différents degrés du charlatanisme (voir ce mot). On appelait jadis, « charlatans », ceux qui vendaient sur les places publiques, à grand renfort de coups de grosse caisse, des orviétans plus efficaces dans leurs « boniments », leurs « postiches », qu’à l’usage. Le mot a été appliqué ensuite, par extension, à tous les exploiteurs de la crédulité publique. L’esbroufeur est un parent du charlatan, mais d’une espèce plus inquiétante, celle de l’épateur qui ne se contente pas de surprendre par des façons exagérées et se donne des airs importants, usurpe des qualités et des titres qui ne sont pas les siens, pour intimider, en imposer, et finalement, friponner en abusant de l’ascendant qu’il a pris sur sa victime. Ce qu’on appelle le « vol à l’américaine » est une forme de l’esbroufe.
Une autre espèce de charlatan est le banquiste. C’est un bateleur, un saltimbanque, mais de plus d’envergure que ceux opérant sur les champs de foire. C’est surtout le directeur de théâtre, l’entrepreneur de concerts qui se livre à une réclame effrénée pour faire valoir des spectacles inférieurs et présenter comme des artistes de quelconques cabotins. Les moyens du banquiste comme du cabotin sont le battage et le chiqué, qui exagèrent jusqu’à l’insanité l’illusion déjà si souvent grossière du théâtre et achèvent d’en détourner les gens de goût. « Princesse du battage et reine du chiqué », disait Jean Lorrain de Sarah Bernhardt dont le talent, si grand qu’il fût, n’égala jamais la prodigieuse vanité. Encore, les Sarah Bernhardt, les comédiens chanteurs, virtuoses, ont-ils un talent certain, acquis par une étude de leur art ; mais que dire de ces dames de cinéma et de music-hall, de ces « stars », de ces « vedettes », de ces « artistes » qui n’ont jamais appris autre chose qu’à exhiber leurs fesses !... Le banquiste est aussi l’homme à promesses mensongères qui exploite la crédulité publique derrière une façade d’autant plus somptueuse et considérée que les gogos sont plus nombreux et que la filouterie boursicotière est plus active. Le mot banquisme vient d’ailleurs de banque. Depuis la « Grande Guerre », les banques ont pris des proportions de temples où la filouterie a les formes sacerdotales d’une véritable religion. Le banquiste et le banquier sont des gens qui jettent de la poudre aux yeux des badauds ; le premier pour distraire leur esprit, le second pour exciter leur cupidité, tous deux pour leur faire les poches.
L’écornifleur, qui tire de petits profits par des moyens détournés ; le tapeur, qui emprunte sans rendre ; le pique-assiette, qui dîne chez les autres mais chez qui jamais l’on ne dîne ; le resquilleur, qui use de tout sans payer : tous ces parasites, parfois si miteux qu’ils méritent l’indulgence, sont des variétés de l’esbroufeur. Le besoin de paraître a fait de leur industrie une branche des arts mondains assez semblable à la kleptomanie. Pratiquée avec élégance, elle alimente de fructueuses carrières, celles des danseurs mondains, des aviateurs de sajous et de bars, des professeurs d’esthétique, des arbitres de la mode, des jurés de concours de beauté et des gigolos des reines de ces concours, des organisateurs de kermesses de charité, des gastronomes professionnels, des rabatteurs de « maisons de conversation », des rédacteurs de la chronique des bidets, de cent autres qui champignonnent sur le fumier de l’arrivisme et en marge de la grande publicité.
En prenant plus d’envergure, le charlatan, l’esbroufeur, le banquiste sont devenus le bluffeur et le puffiste. Leur ascension et leur multiplication ont été celles de la puissance et de la domination de l’argent, surtout depuis la « Grande Guerre ». Certes, il y a eu de tout temps de grands aventuriers bluffeurs et puffistes qui furent considérables pour leur époque ; mais leur nombre fut restreint et le champ de leurs ébats fut forcément limité aux ressources financières de leur temps. Les Fermiers Généraux, qui dévoraient jadis la substance misérable du pauvre peuple, font figure de personnages d’opéra-comique à côté des ravageurs sinistres qui sévissent aujourd’hui, n’ayant même pas l’excuse, comme les autres, d’être des mécènes et des gens d’esprit. La banqueroute de Law, au XVIIIe siècle, coûta à la France deux milliards et demi que se partagèrent quelques douzaines de grands fripons. Mais que sont ces deux milliards et demi auprès de tous ceux que messire Quincampoix fait danser aujourd’hui dans ses officines ? Le système du sire n’était que du boursicotage primitif, le loto des familles, auprès de ce qu’on tire actuellement du pis de la vache-contribuable pour engraisser les féodaux du régime. Rien qu’en 1931, pendant que des centaines de mille chômeurs étaient laissés sans ressources, livrés pour tout potage aux brutalités policières, une dizaine de milliards ont été distribués aux ventres dorés des banques, des chemins de fer, des compagnies da navigation, etc., sans parler d’autres milliards aux fabricants de quincaillerie guerrière. Les cent cinquante ans de règne des « tyrans », Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, n’atteignirent pas la gabegie qu’on a vue dans la seule année « républicaine » de 1931. Ce n’en fut pas moins la culbute en 1789. Elle se fait attendre aujourd’hui. Faut-il croire que cent quarante ans d’exercice de la « liberté » ont été surtout l’apprentissage de la résignation pour les éternels tondus à qui un railleur de messire Quincampoix disait déjà au temps de Law :
Vous recherchez une couronne
De plumes de paons, de chardons :
C’est la Sottise qui la donne. »
Bluff et puffisme sont les manifestations ultra-modernes, les derniers perfectionnements de l’arrivisme, l’expression surréaliste de l’art de paraître. Ils semblent marquer le maximum de la température délirante qui ne peut être dépassée sans que la machine humaine n’éclate. Mais elle a résisté déjà à tant d’atmosphères qu’on ne peut savoir jusqu’où elle tiendra le coup.
Bluff, bluffer, bluffeur, sont des mots tout nouveaux pour désigner une vieille chose qui s’est développée vertigineusement. Ils viennent de l’anglais to bluff qui veut dire : tromper aux cartes en faisant croire à l’adversaire qu’on a en main un très beau jeu alors que l’on n’a rien. En passant dans le français, le mot bluff a pris le sens de : leurrer par de fausses apparences, des propos emphatiques qui sentent le charlatan ; chercher à intimider, à tromper les gens sur ses forces et ses ressources réelles. C’est le sens du vieux mot esbroufer, mais la chose a tellement gonflé et s’est tellement répandue qu’un nouveau mot n’était pas inutile à la langue pour la désigner plus énergiquement. Joseph Jolinon, dans son roman : Les Revenants dans la Boutique, a fait le tableau suivant du monde d’après-guerre livré à la frénésie du bluff : « Inutile d’agir. Tout allait pour le mieux. Si la France, handicapée de gloire, se remettait la dernière des suites de sa victoire, elle se remettait bien. Malgré nos trois cent milliards de dette, la stabilisation du franc à quatre sous humiliait surtout notre amour-propre. N’était-ce pas une faillite presque idyllique : perdre au change, gagner à l’exportation, maintenir les prix à l’intérieur. Rarement la monnaie avait mieux circulé. Ainsi les hauts salaires consacraient l’accord apparent du capital et du travail. On pouvait enfin tayloriser. Partout des tableaux de rendement, des graphiques, des statistiques. Un surmenage général, une discipline partout renforcée. La mentalité militaire affectait l’ordre civil. Les officines ressemblaient à des usines et les usines à des casernes. Des compagnies de spécialistes, des régiments de techniciens, dans le mélange des races et des sexes. Et tout obéissait à la multiplication réciproque des produits et des besoins, laquelle tendait vers l’infini. Toujours plus de débouchés aux fournisseurs, d’émissions aux banquiers, de malades aux médecins, de plaideurs aux avocats, de lecteurs aux littérateurs. Surproduire et surconsommer, pas d’autre loi morale. Une idée force, la vanité. De la jalousie comme volonté de puissance. Une assurance de succès, le cynisme. Au bluff, à la négation du risque, tous les espoirs permis. Triomphe de la quantité, apothéose du nombre. Arriver au plus tôt à la plus grosse fortune. Deterding. Ford, Mussolini, Genney Tunney. On en rêvait chaque nuit à chaque étage. » On continue d’en rêver, en l’an 1932, à chaque étage, malgré la « crise » qui arrête la surproduction par la sous-consommation et précipite comme des châteaux de cartes l’édifice fallacieux du bluff universel, ne maintenant debout, au-dessus des ruines qui s’accumulent et comme le seul espoir des fossoyeurs de l’humanité, que l’effroyable menace d’une nouvelle guerre.
Si La Fontaine revenait, il pourrait dire dans un langage plus moderne :
Et sont nés, pour le moins, de cuisses d’archevêques ;
Tout mercanti veut avoir son château,
Tout galapiat a son carnet de chèques. »
Le carnet de chèques n’est-il pas le « sésame » qui ouvre toutes les portes, procure toutes les joies et toutes les voluptés ? On n’a pas cent sous dans sa poche pour payer la maigre provende d’une gargote et on ne se risque pas à aller s’y attabler ; le gargotier rigide et qui a des principes sur l’honnêteté de ses clients aurait vite fait de livrer à la police, pour grivèlerie, le dîneur sans pécune. Mais on peut, muni d’un carnet de chèques, s’installer dans un palace, y mener la belle vie en agréable compagnie, emprunter au gérant tout l’argent de poche qu’on désire. La valetaille des boîtes de luxe est à plat ventre devant le « rasta » qui porte beau, est insolent à souhait, et qui disparaît après avoir payé avec un chèque... sans provision. On est indulgent pour cet « homme du monde ». D’autres paieront pour lui. La bohème barbue, échevelée et sentimentale du romantisme, rêvait toute sa vie d’un argent qui devait lui venir du Hanovre. Le gentleman rasé et cosmétiqué, technicien et réaliste, méprisant les rêveurs et se « débrouillant » dans les affaires, porte le Hanovre dans sa poche avec son carnet de chèques sans provision. Des cousins du roi d’Espagne et des ministres démocrates n’ont-ils pas donné leurs lettres de naturalisation à ces papiers précieux ?
Le puffisme est le complément « publicitaire » du bluff. Le mot vient aussi de l’anglais, de puff — bouffée de vent, chose ridicule, sans importance, peu sérieuse — qui a fait le français pouf. On fait un pouf en partant sans payer ses dettes.
Autrefois, on « levait le pied », tout simplement. Aujourd’hui, on laisse un chèque. C’est une belle chose d’avoir au moins appris à signer de son nom ou d’un nom emprunté. Pouffer, c’était poser, se donner des airs. On s’en donne de plus en plus. Mais puff et pouf s’appliquent plus spécialement à une annonce emphatique et trompeuse, à « l’art de duper avec de grands mots » (Larousse). Le puff a été défini par Scribe « le mensonge passé à l’état de spéculation, puis à la portée de tout le monde, et circulant librement pour les besoins de la société et de l’industrie. Toutes les vanteries, jongleries, sensibleries de nos poètes, de nos orateurs et de nos hommes d’Etat, autant de puffs !... » Depuis, les besoins de la société et de l’industrie sont devenus si démesurés avec les inventions nouvelles que le simple puff est devenu le puffisme, c’est-à-dire un système social, de réclame, de tromperie, supprimant toute vérité et toute sincérité dans les rapports humains. Aucune entreprise n’est plus possible si elle n’est étayée, recommandée, poussée par le mensonge du puffisme. Les plus réfractaires sont amenés, malgré eux, consciemment ou non, à ses méthodes s’ils ne veulent pas succomber.
Le puffisme a pris sa forme pratique, technique, officielle, dans la réclame et la publicité. Par elles, aucune des conditions de la vie, aussi bien spirituelle, morale, intellectuelle que matérielle, n’échappe à son mensonge. II règne sur la chaire comme à l’éventaire du camelot, il préside au commerce de la grâce divine et de la science sorbonique comme à celui de la pâte à rasoir ; il répand partout les nappes de ses gaz plus redoutables que ceux dont on usera à la « prochaine ». Par lui le « mensonge immanent des sociétés », qu’on déguisait jadis sous le nom de Providence, s’étale impudemment et cyniquement.
La réclame a pris une extension inimaginable avec le puffisme. Jadis elle était suspecte. Elle était interdite par les corporations de l’industrie et du commerce à leurs membres. On jugeait indigne de faire valoir une marchandise autrement que par sa bonne qualité. Il y avait d’ailleurs des règlements sévères contre les malfaçons et les fraudes ; une surveillance très rigoureuse était exercée. Colbert édicta des mesures draconiennes. Plus d’une fois, le fabricant et le vendeur furent mis au pilori avec leur marchandise, le carcan au cou, même pour avoir fabriqué et vendu un produit au goût de la clientèle, mais non réglementaire. Ces entraves exagérées avaient au moins l’avantage de garantir la qualité de ce que le consommateur achetait. Depuis, on a pratiqué l’exagération contraire. Sous prétexte de « liberté », on fabrique et on vend les pires camelotes, inutilisables à l’usage, et on empoisonne les gens par les falsifications des denrées alimentaires. La réclame consista d’abord dans de simples annonces faites par les crieurs de marchandises en même temps que de nouvelles. Des crieurs-jurés avaient le monopole de ces annonces. Ils faisaient un simple éloge des objets criés pour les recommander, et leur domaine était très limité. Quand l’imprimerie permit la publication de journaux et l’affichage de placards, on vit des annonces écrites auxquelles s’ajoutèrent de petits articles.
La première forme de ce qu’on appelle aujourd’hui la publicité fut, en 1619, l’invention de Théophraste Renaudot dans un prospectus où il faisait pompeusement la « description d’un médicament appelé polychreston ». Habilement, il mêla dans cette description la soixantaine de vertus de cette médecine à celles de la Faculté qui n’en avait certainement pas autant. Avec l’extension de la presse, les faiseurs de réclame s’ingénièrent à trouver des moyens nouveaux d’exciter la curiosité publique. Ce fut souvent avec esprit, et la réclame fut chose supportable, parfois amusante, tant qu’elle demeura dans le domaine particulier qui lui convenait des choses mercantiles. Mais quand le banquisme littéraire et artistique voulut lancer un livre ou un tableau, un écrivain ou un artiste comme une marque de saucisson ou un apéritif, quand il voulut présenter comme des artistes des hommes-serpents de la virtuosité acrobatique, quand la publicité prit de plus en plus les formes de la muflerie qui s’impose, pénètre et poursuit partout, ils devinrent exaspérants et insupportables
Jadis la publicité était ce qui rendait une chose publique. Aujourd’hui, elle est le système du puffisme qui perd toute mesure dans la réclame et par lequel la moitié du monde est occupée à « monter le cou » à l’autre moitié. Une armée innombrable de techniciens de toutes sortes est à son service ; aucune forme de l’activité humaine n’échappe à son industrie pour être vendue et monnayée. Déjà, en 1860, Proudhon écrivait :
« À quoi demande-t-on aujourd’hui la sécurité, le succès, le bien-être, les affaires ? À l’annonce, à l’a réclame, au prospectus, à l’étalage, à toutes les charlataneries des expositions et des tripotages. Ne faut-il pas avoir le cerveau vide et à bout de ressources pour imaginer qu’une grande ville subviendra à son industrie par un appel à la curiosité ? Généraliser et appliquer en grand, à tout un pays, les procédés et ficelles des boutiquiers du boulevard le jour du nouvel an, quelle idée !... »
C’est cependant ce qui s’est produit, grâce au puffisme et à la publicité. Ils sont venus tous deux d’Amérique et se sont répandus dans le monde entier. Rapportant tout à l’argent, ne pouvant concevoir que quelque chose ne soit pas monnayable dans le domaine de la conscience comme de la mercante, de la pensée comme de l’industrie, l’Américain était tout désigné pour trouver et répandre cette double peste, avec toutes les grossièretés dont les vieilles civilisations européennes, imbues malgré tout de certaines traditions de politesse, n’auraient pu avoir l’initiative. Mais le mélange des races provoqué par la guerre a ouvert la voie au puffisme universel en détruisant toute notion des véritables valeurs intellectuelles et morales, en faisant un salmigondis des mœurs les plus disparates et surtout en exaspérant, à tous les degrés de la hiérarchie sociale menacée dans ses éléments autochtones, les ambitions, les convoitises et les appétits arrivistes.
Le great attraction qui commença avec Barnum, banquiste de Tom Pouce et de la nourrice de Wasinghton, a envahi le vieux monde, pénétré son mécanisme tant idéologique que pratique, pour traiter l’homme « comme le plus obtus des animaux inférieurs », a écrit Duhamel. La publicité s’est appliquée à créer des besoins factices pour débiter des produits factices et une affreuse camelote dont s’est engouée la foule emportée par une hystérie collective. L’attraction exercée jadis par les charlatans est passée aux grands magasins, à leur luxe esbroufeur et à leurs produits fallacieux, Zola avait déjà observé leur formation et leur influence dans son roman : Au Bonheur des Dames. Les jours de « réclame » de tel ou tel objet de leur négoce, annonces à grand fracas par les journaux, ce sont de véritables émeutes dans les halls immenses où se débitent les camelotes des « Big Business », grands brasseurs d’affaires. Elles ne sont pas faites pour le goût du public, c’est lui qui est fait pour elles, et il n’y en a pas pour tout le monde. Mais ces fins mercantiles ne sont qu’un des aspects du puffisme et de la publicité. Ils sont allés plus loin et plus profond dans la transformation de la psychologie des foules, dans le bouleversement des mœurs, dans toutes les voies de l’arrivisme le plus interlope, les façons de paraître les plus sottes et les plus abjectes. Ils sont l’humus dans lequel fermentent, poussent, s’épanouissent toutes les végétations vénéneuses du crime et de la prostitution, de la friponnerie et du cabotinage. Ils donnent sa justification, le rendant séduisant et admirable, à tout ce qui est socialement malsain, monstrueux, hors-nature et hors-civilisation véritable. C’est ainsi qu’on ne voit plus que des rois et des reines à tous les degrés de l’échelle, une haute et basse pègre qui a envahi toutes les formes d’une activité où chacun, for ver ! veut être le premier au-dessus des autres. Si les authentiques monarques, ceux qui « firent » leur pays ou continuent à le « faire » en attendant la culbute des premiers, sont réduits aux emplois ambulatoires de la noce aristocratique, on voit des légions de rois du cochon, du cirage, du bistouri, du roman, de la carambouille, des troupeaux de reines de toutes les nations et de toutes les villes, du nougat, de la margarine, de la bouillabaisse, du bigophone, de la dactylographie, du lavoir, de l’entôlage. Tous les milliardaires sont des Louis XIV, les ministres, des Colbert, les généraux, des Turenne, les catins, des Marie-Antoinette, les dames de lettres, des Ninon de Lenclos, les épiciers, des Mercure, les quincailliers, des Vulcains, les politiciens, des Mirabeau et des SaintJust, les estampeurs, des philanthropes, les escrocs, des conseillers des familles, et les proxénètes, des défenseurs de la vertu. Tous les écrivains ont du génie avant d’avoir appris à écrire, tous les cabotins sont les premiers artistes du monde sans savoir chanter, danser et jouer, tous les serins sont des rossignols, tous les miellés sont des Adonis, toutes les femmes sont belles qui usent des takolonneries, tous les commerçants sont d’honnêtes gens quand ils sont faillis, toutes les matrones des maisons de tolérance sont de dignes rombières quand elles vont à la messe ; leurs barbeaux, assez riches pour être candidats et passer du vagabondage spécial à la députation, font l’ornement des comités électoraux, et le Bistrot, officiant inamovible de la démocratie, demeure derrière son comptoir « le rempart de la prospérité et de la dignité nationales » !... Les bienfaiteurs de l’humanité ne sont pas les Pasteur, les Edison, les Einstein ; ce sont les Knock et les Le Trouhadec. La capitale du monde n’est pas New York, Paris ou Pékin ; c’est Donogoo-Tonka où l’on a dressé le temple de l’Erreur Scientifique (Jules Romains). Bata, le roi de la chaussure dont le nom est inclus symboliquement dans battage, est le nouveau Messie ; Bataville est la Jérusalem nouvelle. L’écrivain Ilia Ehrenbourg, hérétique qui a refusé de s’agenouiller devant ce dieu de la godasse et devant ses cuirs, vient d’être condamné. La Cour des Miracles a escaladé le ciel. Qui donc prétendait qu’il n’y avait pas de rédemption pour le vieux monde terraqué ? Par le puffisme, il se divinise.
Nous avons dit plus haut qu’Ossip-Lourié nous paraissait avoir trop insisté sur la pathologie de l’arrivisme. Il n’est pas douteux que si le besoin de paraître et toutes les turpitudes qu’il engendre, sont le produit d’une maladie si profonde qu’elle élimine toute possibilité, pour la personnalité humaine, de redevenir saine et morale, l’humanité court à sa propre destruction. Souhaitons alors qu’elle soit très prochaine, pour notre goût d’équilibre et de raison. La nature purifiée de la vermine humaine aura tout loisir de recomposer une autre humanité qui n’aura pas de peine à être moins folle.
— Edouard ROTHEN.
PARALLÈLE
adj. et subst. m. ou f. (du préf. para, à côté, et d’allélos, l’un l’autre)
GÉOMÉTRIE
On appelle droites « pa.rallèles » des droites situées dans un même plan et qui ne peuvent se rencontrer, à quelque distance qu’on les prolonge. De même, on nomme plans « parallèles » deux plans également distants l’un de l’autre dans toute leur étendue.
GÉOGRAPHIE
Il a été dit déjà (voir Latitude, Longitude) que pour indiquer la situation d’un point à la surface de la terre, on a imaginé différents cercles sur le globe. L’un d’eux, l’équateur, fait le tour de la terre à égale distance des deux pôles. D’autres, qui lui sont perpendiculaires, coupent la sphère terrestre en deux parties, en passant par les pôles, ce sont les méridiens (voir ce mot). Nous appellerons cercles parallèles tout cercle qui sera déterminé par un plan parallèle à l’équateur et perpendiculaire à l’axe de la terre. Comme pour les méridiens, nous pouvons mener une infinité de parallèles à la terre ; par chaque point du globe, on peut mener un parallèle et un méridien déterminés. Seulement, pour obtenir plus de précision, on a imaginé de diviser un méridien à partir de l’équateur et de part et d’autre de celui-ci en 90 parties égales ou degrés, numérotés 0 à l’équateur et 90 aux pôles. Si, par chacun des points de division, nous faisons passer un cercle perpendiculaire à la ligne des pôles, ce cercle déterminera un parallèle affecté du même numéro que le point de division correspondant du méridien. Comme l’intervalle entre deux parallèles ainsi établis serait trop large pour fixer avec précision la position d’un point, on a à nouveau divisé ces intervalles en minutes et ces minutes en secondes. Les principaux parallèles sont les cercles polaires arctique et antarctique situés tous deux à 33° 27’ des pôles ; les deux tropiques, celui du Cancer au nord de l’Equateur et celui du Capricorne au sud ; tous deux sont distants de 23° 27 de l’Equateur. Ces importants parallèles renferment et limitent les zones de température de la Terre. La zone torride est comprise entre les deux tropiques ; la zone tempérée nord entre le tropique du Cancer et le cercle polaire boréal, la zone tempérée Sud entre le tropique du Capricorne et le cercle polaire austral, enfin les zones glaciales sont situées entre les cercles polaires et les pôles.
COSMOGRAPHIE
De même, pour obtenir la position précise d’un astre sur la voûte céleste, on a imaginé, en astronomie, des méridiens et des parallèles. Ces coordonnées célestes, qui portent le nom « d’ascension droite » et de « déclinaison », sont, comme les coordonnées terrestres, rapportées à la ligne des pôles et à l’équateur.
Nous appellerons « déclinaison » d’un astre quelconque, l’angle que fait le rayon visuel de l’observateur de l’étoile avec le plan de l’équateur. Et nous nommerons « ascension droite » l’angle que fait sur l’équateur le plan contenant l’étoile avec un point fixe, situé également sur l’équateur (point gamma). Ainsi donc, on a tracé idéalement sur la sphère céleste des cercles de latitude parallèles à l’équateur et des cercles de longitude passant par les pôles. Comme sur terre, les latitudes sont comptées à partir de l’équateur et nous obtenons alors la « déclinaison » d’un astre.
Ainsi que, sur terre, nous avons, pour déterminer la longitude d’un point, choisi un méridien initial considéré comme méridien origine, il a fallu choisir sur la voûte céleste un point unique bien déterminé pour tracer le méridien d’origine. La trajectoire apparente du soleil se confond dans l’espace avec la trace du plan suivant lequel la terre tourne autour de l’astre du jour. Comme par suite de l’inclinaison de notre globe, l’équateur céleste et le nôtre ne coïncident pas avec le plan de l’orbite, le soleil semble donc, dans sa marche annuelle, se déplacer selon un cercle orienté obliquement par rapport à la rotation quotidienne du ciel qui s’effectue parallèlement à l’équateur. Aux équinoxes seulement, le soleil est juste à l’intersection des deux plans qui se coupent dans l’espace (point vernal). Par le point d’intersection où le soleil se trouve à l’équinoxe du printemps (point gamma, passe le méridien initial à partir duquel, dans le sens du mouvement diurne, sont comptés les autres méridiens en se servant non plus de degrés de longitude, mais d’heures d’ascension droite. L’écart entre le méridien se mesure en astronomie, non pas par degrés, mais par le temps qui le sépare et qu’on détermine à l’aide d’une horloge sidérale réglée de telle façon que les aiguilles effectuent le tour complet du cadran exactement dans le temps que la terre effectue une rotation complète. Ces heures sidérales ont chacune une valeur angulaire de 15 degrés, chaque minute vaut 15 minutes d’arc, et chaque seconde 15 secondes d’arc.
La position apparente d’une étoile est déterminée en ascension droite (longitude) par l’écart du temps qui la sépare du méridien initial et sa déclinaison ou latitude par sa distance angulaire au nord ou au sud de l’équateur. Ces mesures se prennent à l’aide de la lunette méridienne, lunette invariablement orientée suivant le plan vertical du méridien et ne pouvant pointer qu’en hauteur. On y enregistre les passages successifs des astres (détermination de l’ascension droite) ; des cercles gradués dont elle est munie, indiquent d’une façon précise l’inclinaison du pointage (déclinaison). Ajoutons, pour être complet, que ces coordonnées célestes ne sont pas invariables, le mouvement de rotation de la terre ne conserve pas une direction immuable dans l’espace.
LITTÉRATURE
Parallèle, tout écrit ou discours mettant en évidence les dissemblances ou ressemblances existant entre deux personnes, deux êtres ou deux choses s’appelle aussi parallèle.
— Ch. ALEXANDRE.
PARLEMENT, PARLEMENTARISME, PARLEMENTAIRE
Dans l’ancienne France, les parlements étaient des tribunaux. Ils jouèrent un rôle politique important, sans parvenir à mettre un frein à l’absolutisme royal. Ce qui les concerne regarde surtout la justice, aussi n’en parlerons-nous pas dans cet article. Au sens actuel, les parlements sont des assemblées politiques qui détiennent le pouvoir de faire les lois ; celui de France et d’Angleterre comprend deux Chambres ; il n’en comprend qu’une dans certains pays. Quant au parlementarisme, c’est un système de gouvernement qui implique la prépondérance du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif, et contraint les ministres à démissionner lorsqu’ils n’ont plus la confiance des sénateurs ou députés. De nombreuses monarchies sont parlementaires ; plusieurs républiques ne le sont pas. Aux Etats-Unis, par exemple, les ministres dépendent du seul président de la république ; députés et sénateurs ne peuvent rien contre eux. Le titre de parlementaire ou de membre du parlement, très respecté chez nous autrefois, n’en impose plus à personne : maints hôtes du Luxembourg et du Palais Bourbon sont trop manifestement de crapuleux malfaiteurs. Dès le moyen âge, l’Angleterre posséda un parlement politique ; c’est chez elle que prit naissance le régime parlementaire. Avant de donner un successeur à Jacques II, chassé par ses sujets, le parlement britannique rédigea, en février 1689, une Déclaration des Droits qui limitait le pouvoir royal et précisait ses propres prérogatives. Guillaume III et sa femme Marie ne furent proclamés roi et reine qu’après avoir promis de la respecter. Ils tinrent parole et, sans y être obligés, choisirent quelquefois leurs ministres dans la majorité du Parlement. La reine Anne, qui succéda à Guillaume III, suivit cet exemple. A sa mort, en 1714, un hasard, l’avènement au trône de la dynastie de Hanovre, dont les deux premiers souverains, Georges Ier et Georges II furent presque des étrangers pour leurs sujets, acheva d’affermir le régime parlementaire. Georges Ier s’enivrait quotidiennement et vivait entre de vieilles favorites laides et rapaces. Comme il ne comprenait pas l’anglais et que ses ministres ne comprenaient pas l’allemand, il laissa bientôt ces derniers gouverner sous le seul contrôle des Chambres. Georges II, d’esprit presque aussi borné que son père, comprenait l’anglais mais ne le parlait pas ; il déserta lui aussi le conseil des ministres. Finalement, en vertu de la tradition, le roi ne dut appeler au pouvoir que des hommes appartenant au parti qui avait la majorité dans le parlement. Ils abandonnaient leurs fonctions lorsque cette majorité leur retirait sa confiance. Egaux en théorie, les ministres étaient dirigés en fait par l’un d’entre eux qu’on appela le Premier et qui fut souvent le leader du parti au pouvoir. Tous étaient solidaires, c’est-à-dire responsables des actes de chacun. A cette époque, le parlement britannique ne représentait d’ailleurs que l’aristocratie anglaise, surtout la classe des grands propriétaires terriens. Les réformes de 1832, puis de 1867 et de 1885 étendirent le droit de vote à un nombre de plus en plus considérable de citoyens, leur faisant croire qu’ils étaient quelque chose dans 1’Etat, alors que politiciens et capitalistes les manœuvraient comme des pantins. D’Angleterre, le parlementarisme devait, au cours des XIXe et XXe siècles, passer dans de nombreux pays. En France, il fut instauré par la monarchie de 1830 ; plus tard il disparut, mais pour revenir tout-puissant sous la troisième république. L’Assemblée nationale, élue en février 1871, pour conclure la paix avec la Prusse, comptait plus de 400 députés royalistes et seulement 250 députés républicains. Mais les monarchistes se divisaient en légitimistes et en orléanistes, les premiers voulant pour roi le comte de Chambord, petit-fils de Charles X, les seconds lui préférant le comte de Paris, petit-fils de Louis-Philippe. N’ayant pu ramener les Bourbons, l’Assemblée finit par accepter la république, en janvier 1875, à une voix de majorité. On ne créa pas une Constitution formant un corps unique, mais trois lois en tinrent lieu ; elles portaient sur l’organisation des pouvoirs publics, sur l’organisation du Sénat, sur les rapports des pouvoirs publics. Discussion et vote de ces lois remplirent l’année 1875. Elles confiaient le pouvoir législatif à deux Chambres et le pouvoir exécutif à un président irresponsable, mais qui gouvernait pat l’intermédiaire de ministres responsables devant le parlement.
« 1. — Le pouvoir législatif, déclare la loi du 25 février, s’exerce par deux assemblées : la Chambre des députés et le Sénat. La Chambre des députés est nommée par le suffrage universel, dans des conditions déterminées par la loi électorale. La composition, le mode de nomination et les attributions du Sénat seront réglés par une loi spéciale.
« 2. — Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans. Il est rééligible.
« 3. — Chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par un ministre.
« 5. — Le Président de la République peut, sur l’avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l’expiration légale de son mandat. En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois.
« 6. — Les ministres sont solidairement responsables devant les Chambres de la politique générale du gouvernement et individuellement de leurs actes personnels. Le Président de la République n’est responsable que dans le cas de haute trahison. »
Après le vote des lois organiques nécessaires au fonctionnement du nouveau régime, l’Assemblée nationale se sépara. Elle fit place à deux Chambres, le Sénat élu le 30 janvier 1876 et la Chambre des députés élue le 20 février de la même année. Par la suite, des modifications furent apportées à la Constitution ; en particulier, on décida qu’il n’y aurait plus de sénateurs inamovibles : tous devaient être élus par les départements et les colonies. L’institution d’un Sénat, œuvre des députés monarchistes qui comptaient sur lui pour jouer un rôle conservateur, fut combattue par les républicains. Mais finalement ils s’accommodèrent très bien de l’existence d’une Chambre haute. Ils devaient, d’ailleurs, s’accommoder d’un si grand nombre d’institutions et de procédés royalistes que la France républicaine ressemble beaucoup, de nos jours, à un pays monarchiste. Actuellement, le Sénat est composé d’environ 300 membres, âgés d’au moins 40 ans et nommés pour 9 ans ; il est renouvelable par tiers, tous les 3 ans. Son mode de recrutement assure la prépondérance de la campagne sur la ville, de la classe riche sur la classe pauvre. L’élection des sénateurs est faite par un collège restreint composé des députés du département, des conseillers généraux et d’arrondissement, des délégués choisis par les conseillers municipaux, suivant une proportion qui favorise singulièrement les petites communes. La Chambre des députés est élue pour une durée de 4 ans, au suffrage universel. Des lois spéciales, non prévues par la Constitution, règlent son mode d’élection. Scrutin uninominal ou scrutin d’arrondissement, scrutin de liste avec prime à la majorité, scrutin de liste avec représentation proportionnelle ont des partisans qui se disputent et luttent pour faire triompher le mode de votation qu’ils préfèrent. Les électeurs oublient qu’il serait préférable de n’accorder à personne le droit de les opprimer. Députés et sénateurs se servent largement : à titre d’indemnité parlementaire, ils reçoivent de grosses sommes, sans parler des pots-de-vin qui payent leurs complaisances à l’égard des magnats de la banque, du commerce ou de l’industrie. Pendant la durée des sessions, il faut l’assentiment de l’Assemblée dont ils sont membres pour qu’on puisse les poursuivre devant les tribunaux ; en outre, ils jouissent de l’irresponsabilité judiciaire, pour tous les actes commis dans l’exercice de leur mandat. Pas de travail sérieux, mais de longs bavardages à la tribune, pour faire croire aux électeurs qu’on ne les oublie pas, voilà l’occupation essentielle des parlementaires. Les ministres, détenteurs du pouvoir exécutif, forment le cabinet sous la direction d’un président du conseil. Ils sont nommés par le président de la république, mais ce dernier doit désigner des hommes ayant la confiance du parlement Députés et sénateurs peuvent leur poser des questions écrites ou orales et les interpeller : dans le cas d’interpellation, un vote suit, impliquant approbation ou désapprobation du gouvernement. La désapprobation oblige le cabinet à remettre sa démission collective au président de la république. Tous les ministres étant solidaires, un vote hostile contre l’un d’eux entraîne la chute des autres si la question de confiance a été posée au préalable. Qu’il s’agisse du pouvoir exécutif ou de la confection des lois, le peuple n’intervient donc jamais directement ; il se borne à expédier au Palais Bourbon des aigrefins qui le trompent et se gaussent de sa crédulité. Une poignée d’intrigants gouverne en régime parlementaire. « Le gouvernement parlementaire, écrit le professeur Hauriou, est d’origine aristocratique et bourgeoise et tend à la création d’une oligarchie parlementaire. Il semblerait que la République, forme d’Etat où la souveraineté nationale devrait être réalisée plus pleinement que dans les autres, appellerait logiquement soit des institutions de démocratie directe, soit, tout au moins, le régime représentatif et présidentiel américain. De fait, il n’y a actuellement dans le monde aucune république aussi exclusivement parlementaire que la nôtre. Dans toutes les autres, ou bien le régime parlementaire est remplacé par un régime présidentiel comme aux Etats-Unis, ou un régime directorial comme en Suisse, ou bien le régime parlementaire est combiné avec le référendum populaire (Tchécoslovaquie, Empire allemand, Prusse, Estonie, Lettonie). La raison du caractère strictement parlementaire de la République française se trouve dans les traditions du parti républicain qui n’est pas démocrate, mais conventionnel au sens de la dictature d’une Assemblée représentative unique. » Hauriou, dont l’autorité est grande en matière de droit constitutionnel, n’a pas nos idées, cela va sans dire ; mais il constate que le régime parlementaire est, par nature, fort peu démocratique. Il ajoute même :
« C’est une question de savoir si la démocratie française, à mesure qu’elle fera son éducation politique, se contentera de ce parlementarisme Conventionnel qui n’en demeure pas moins un régime oligarchique, et si elle n’exigera pas une évolution vers des institutions de gouvernement direct qui puissent lui faire contrepoids. »
Problème qui ne saurait nous retenir, le referendum populaire étant, comme le reste, à la merci des maquignons du journalisme et de la politique. Très en vogue au début du XXe siècle, le parlementarisme a subi un recul sensible dans les années qui suivirent la guerre de 1914–1918. Mais ce fut pour des raisons que nous ne partageons pas : on voulait un pouvoir exécutif fort, débarrassé de tout contrôle gênant ; la mode était alors aux dictatures. A l’inverse, nous estimons l’autorité toujours trop forte, trop oppressive ; et si le régime parlementaire ne nous satisfait en aucune façon, c’est que lui aussi s’arroge le droit de tyranniser les individus. Jamais un gouvernement ne nous semble assez faible ; c’est à ruiner l’autorité, non à la fortifier, que nous travaillons. A la contrainte nous voulons substituer l’intérêt bien compris, mieux encore l’universelle fraternité. Contre l’impuissance et la corruption du régime parlementaire on a beaucoup écrit ; certains abus sont connus de tous. Verlot écrit :
« Le député, animé des meilleures intentions, assiste impuissant à la confection de lois mal étudiées, mal préparées, sans souci de leur répercussion... Les affaires sérieuses se discutent souvent devant des banquettes vides. Quelques douzaines de députés votent pour 600 collègues... Au contraire, les séances où il peut être question d’un scandale regorgent d’auditeurs. Les manœuvriers de couloirs cherchent les moyens de renverser le gouvernement ; on conspire, on combine dans une atmosphère plus ou moins viciée qui écœure les braves gens. »
Verlot, ancien radical devenu sacristain, n’était d’ailleurs pas à compter parmi les braves gens. Et les critiques ne doivent pas s’adresser aux seuls députés de droite. Dans des souvenirs pleins de saveur, l’ancien député A. Jobert nous raconte l’histoire suivante, au sujet du vote par procuration :
« J’assistai à la première réunion du groupe socialiste parlementaire, salle de la Quatrième Commission… A la disposition géographique même des places occupées, il était facile de voir que là, comme dans tous les autres organismes, les castes sociales existaient. Alors que les ténors occupaient la table sise au milieu, les autres, les indésirables, les déshérités se tenaient loin du soleil, le long des murs, dans les encoignures et dans les embrasures des fenêtres. Il y avait les députés de première zone et ceux de deuxième zone. De suite les manitous (Sembat, Renaudel, Varenne, Compère, Delory, etc.), prirent la direction du groupe et élaborèrent son règlement. La première bataille se livra au sujet des votes au Parlement. Renaudel préconisa l’unité de vote et, pour ce faire, demanda que fussent désignés trois délégués du groupe, chargés de la fonction de boîtiers c’est-à-dire ayant seuls le pouvoir de mettre dans l’urne, lors des scrutins, les 103 bulletins socialistes. En somme, c’était la consécration, par le groupe de l’abominable pratique du vote par procuration, du vote des absents avec tous ses tripatouillages... Candidat, j’avais promis à mes camarades de la Fédération d’abord, aux électeurs ensuite que, si j’étais élu, je demanderais l’application du vote personnel… je réservai mon droit de garder par devers moi le soin de déposer mon bulletin dans l’urne et déclarai ne vouloir confier ce souci « pas même à Renaudel et à Compère-Morel ». On devine quel tollé ma déclaration souleva... »
Nous pourrions multiplier les exemples démontrant que députés de droite, du centre et de gauche s’accordent pour duper les électeurs. Aussi, malgré les injures échangées en public, entretiennent-ils, loin des regards indiscrets, d’excellentes relations. C’est, assuret-on, le cas pour Tardieu, Herriot et Blum, qui sablent le champagne de compagnie après s’être copieusement disputés à la tribune du Palais Bourbon. Une adroite distinction entre la vie publique et la vie privée, admise par les socialistes comme par les royalistes, couvre et légitime ces odieuses comédies. Contre ce mur de la vie privée, lorsqu’il s’agit d’individus qui s’arrogent le droit de commander aux autres, je me suis élevé bien des fois. Mais vainement, tous les partis étant d’accord pour continuer cette sinistre farce. Ajoutons que le choix des parlementaires fait l’objet d’un véritable commerce. De longs mois avant l’élection, le marché aux candidatures s’ouvre ; politiciens rapaces, journalistes véreux font preuve d’une activité débordante. Paris devient le centre principal où acheteurs et vendeurs se rencontrent. De là seront expédiés, aux quatre coins du pays, des centaines d’avocats sans cause, d’écrivains sans talent, de riches oisifs que la province devra renvoyer, munis de l’estampille parlementaire. A l’acheteur on servira une abondante documentation, s’il ignore tout de sa circonscription ; des électeurs influents, des militants du pays se chargeront de le faire adopter par les indigènes. Officiellement sacré candidat par un comité local, il n’aura plus qu’à payer à boire, serrer des milliers de mains, flatter tout le monde, Et la farce sera sensiblement la même s’il s’agit d’un autochtone qui, à force de bassesse et de ruse, est parvenu à capter la confiance de ses concitoyens. A la règle générale qui veut que les gouvernants soient des êtres immondes, les parlementaires n’échappent en aucune façon.
— L. BARBEDETTE
PARTAGEUX
Comme le dit lui-même le « Dictionnaire Larousse », ce nom ou adjectif, peu usité, « se dit ironiquement d’une personne qui réclame le partage général des terres et la communauté de tous les biens ». Partageux est une corruption du mot Partageur.
On voulait, par ce terme, disqualifier les hommes imbus d’idées sociales et ceux qui s’en proclamaient les partisans et les propagandistes : les plus petits propriétaires, ceux qui vivaient péniblement de leur lopin de terre, disait-on, en seraient dépossédés par les partageux.
Il fut un temps où ce pauvre argument avait prise sur l’esprit lourd de certains paysans. On s’appliquait à transformer le sens des mots pour calomnier les plus ardents apôtres de Justice et d’Egalité sociales, les plus profonds penseurs dont on ne pouvait discuter ni contredire les systèmes clairement exposés.
Evidemment, l’ironie facile avait prise sur les ignorants, incapables de raisonner et craignant toujours qu’on leur ravisse le lendemain ce qu’ils avaient difficilement acquis la veille. Si stupide que soit la calomnie il en reste toujours assez pour engendrer la haine ou augmenter le mépris. Ceux qui possédaient beaucoup craignaient fort l’expansion des idées de partage équitable des terres et ils avaient tout intérêt à mettre de leur côté les malheureux possesseurs d’une pauvre terre aride arrosée de la sueur du courageux paysan qui la cultivait. Le but à atteindre était, surtout en période électorale, de disqualifier un candidat au profit d’un autre. Nous avons dit que ce terme était peu usité ; il l’est de moins en moins et les socialistes, dans leurs discours de propagande électorale, ne sont plus traités de partageux, parce qu’on sait bien que le socialisme et les écoles qui s’y rattachent, au point de vue propriété ou répartition des richesses, ne préconisent pas le partage, mais exactement le contraire, c’est-à-dire la mise en commun.
C’est par ce mot : partageux qu’on prétendit se moquer fort des utopistes du XIX siècle qui désiraient l’application d’une juste répartition des richesses sociales et de ceux qui voulaient la mise en commun des terres et de tous les biens.
Cette épithète n’a certainement pu porter grand préjudice aux idées des penseurs sociaux ni à leurs systèmes de rénovation ou de révolution. Les partisans de la propriété, les avocats d’une si mauvaise cause (consacrée par la Révolution française), défendaient comme ils pouvaient le Propriétarisme, régime économique fondé sur la Propriété et découlant de son principe.
On ne peut, certes, pas dire que le système capitaliste, le fameux régime de l’exploitation de l’homme par l’homme, ne soit pas aussi celui du partage des richesses dues au travail. Mais c’est un partage qui se fait à l’encontre de tout bon sens et de toute équité, puisque ceux qui produisent tout ne possèdent rien, alors que ceux qui ne produisent rien possèdent tout. Ces derniers peuvent penser que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il nous appartient, ici, de démontrer que la logique et l’équité en sont absentes et que selon la juste, très juste expression de Proudhon : « La Propriété, c’est le vol ». On ne peut pas être partisan de la Propriété si l’on a le moindre respect du principe d’égalité et le moindre sentiment de justice. (Voir Propriété).
Le mot Partageux s’applique sans doute aussi, assez justement — en terme de mépris mérité — à certains faux apôtres qui dénigraient la Propriété jusqu’au jour où ils en purent jouir à leur tour par une occasion, fût-elle malpropre et par conséquent digne de leurs convictions.
Georges YVETOT.
PARTI (POLITIQUE)
Les partis politiques sont des organisations qui se donnent comme but de faire triompher leur opinion dans le pays. Cette opinion est exposée dans un programme que le parti propose à ceux dont il demande l’adhésion. En France, de droite à gauche, nous avons : les royalistes (Action Française), le parti national, la gauche démocratique, le parti radical, le parti républicain socialiste, le parti socialiste français, le parti socialiste S.F.I.O., le parti d’unité prolétarienne, le parti communiste S.F.I.C., etc, etc.
D’ordinaire, le nom d’un objet sert à désigner l’objet, mais en politique la vérité est le moindre souci (Machiavel). Aussi les noms des partis servent autant à cacher ce qu’ils veulent qu’à le faire connaître. Ainsi, la gauche démocratique n’est ni à gauche, ni démocratique. Elle siège à la Chambre au centre droit, son but est la conservation sociale, même la réaction ; recrutée dans la grande bourgeoisie, elle n’a rien de démocratique. Le parti radical, à ses origines, voulait réaliser radicalement, c’est-à-dire jusqu’à la racine, le programme de la Grande Révolution (Robespierre) : laïcisation intégrale, suppression de l’héritage, instruction gratuite à tous les degrés, liberté politique, assistance aux vieillards invalides, enfants, impôt progressif sur le revenu, etc ... Ce programme est en partie réalisé, mais dans une mesure très faible ; la laïcité est en train de faire faillite, la religion domine à nouveau partout ; l’instruction gratuite à tous les degrés n’est pas réalisée ; la liberté politique est très relative. En réalité, le 1e parti radical est le parti des petits bourgeois et des paysans aisés, c’est un parti de stagnation, il n’est nullement radical. Le parti socialiste n’est pas davantage socialiste. Son but est la suppression de la société capitaliste et l’établissement du collectivisme. En réalité, le collectivisme est sa dernière préoccupation. C’est, en fait, un parti de réformes sociales qui n’a rien de subversif.
Les partis, d’ordinaire, sont sincères au moment de leur fondation ; mais ils s’usent en vieillissant, surtout lorsqu’ils pratiquent le parlementarisme et sont portés au pouvoir. Le parti socialiste anglais, porté au pouvoir, n’a pas transformé la société, et son chef, Mac Donald, à la fin, a préféré, pour tirer son pays des difficultés économiques, s’allier aux conservateurs. Le parti socialiste allemand, vieille et lourde machine, marche par sa vitesse acquise ; lui, non plus, ne transforme pas la société. Il a toutes les peines du monde à empêcher le jeune et actif parti hitlérien de prendre le pouvoir.
Le parti radical, à ses débuts (milieu du XIX siècle), renfermait des hommes dévoués. Ils allaient en prison pour leurs idées, beaucoup perdaient une situation brillante et préféraient végéter dans une profession de misère (professeurs libres), plutôt que de renoncer à leur idéal. C’est pour cela qu’on a dit que la république était belle sous l’Empire. Le socialisme a connu, lui aussi, une belle époque : Fourier, Victor Considérant, Karl Marx. Ces hommes vivaient pour leurs idées, leurs conditions matérielles étaient précaires ; la prison, l’exil, la misère étaient leur lot. Mais dès qu’un parti approche du pouvoir, il est corrompu. Le ministre socialiste qui apprend la révérence pour se présenter devant une Majesté a oublié les ouvriers qui l’ont porté là où il est.
Pas plus que les étiquettes, les programmes ne disent la vérité. Aussi sont-ils tous acceptables à la lecture. Le pire parti de réaction n’avouera jamais que son idéal est l’aristocratisation d’une petite minorité et l’exploitation de tout le reste. A l’entendre, il veut, au contraire, le bonheur du peuple, il prétend même être le seul à le vouloir sincèrement. La réaction ne s’avoue telle que dans la frénésie de la victoire : massacre du peuple en juin 1848 et en mai 1871. Dans l’ivresse du triomphe, l’aristocratie traite le peuple de vile canaille bonne à travailler et à crever. Mais dès que les choses sont redevenues normales, elle préfère cacher ses sentiments véritables et afficher une bienveillance fallacieuse.
Le fascisme, nouveau parti issu de la guerre, ne s’avoue pas non plus réactionnaire. On y trouve du syndicalisme, des idées à apparence démocratiques puisées aux ouvrages de Sorel ; il est pour les gens qui travaillent, contre les avocats bavards du parlement. En fait, il est pour l’hégémonie du grand patronat et l’écrasement de la classe ouvrière.
C’est un bon point pour le progrès social que personne ne veuille s’avouer réactionnaire et que la droite tienne à s’appeler gauche. Cela prouve la marche des sociétés vers la démocratie, marche définitive, du moins il faut l’espérer.
— Doctoresse PELLETIER.
PARTICIPATION
n. f. (du latin : pars, partie, capere, prendre)
Ce mot, qui implique l’idée, de prendre parti, d’avoir part, est d’un usage très fréquent. Entre ses multiples applications, nous en retiendrons trois : participation aux mouvements d’avant-garde, participation au gouvernement, participation aux bénéfices.
Certes, il ne peut escompter que malveillance et persécutions, celui qui lutte contre les autorités gouvernementales, religieuses, militaires, etc., celui qui se dresse contre la féodalité d’argent et les tout-puissants rois de l’or. Et, parmi ceux dont il voudrait briser les chaînes, beaucoup ne le comprendront pas. Ingratitude calomnies voilà le salaire dont on le payera fréquemment. Ne soyons pas surpris que les arrivistes s’éloignent rapidement vers les gras pâturages de la politique. Pourtant il en est d’autres, dont la vie toute entière est une magnifique leçon. Je songe à Sébastien Faure ; et certaines de ses phrases jamais ne sortiront de ma mémoire :
« En ai-Je rencontré et semé sur ma route de ces gens qui ont marché sur leur conscience et leur cœur : les uns, pour satisfaire leur cupidité ; les autres pour assouvir leurs ambitions leur vanité, leur arrivisme ! Je ne les envie pas. Et me voici l’homme le plus heureux du monde. Je ne souffre que de la douleur qui m’avoisine et des injustices et inégalités qui me révoltent. Mais je pactise avec cette souffrance, par la conscience que j’ai de faire tout ce que je puis faire pour supprimer injustices, inégalités, servitudes et misères. »
Ce langage, mon cher Sébastien Faure, comme je le comprends ! Quand j’ai senti la mort me frôler de son aile glaciale, ce fut pour moi une joie intense de songer à ce que j’avais fait de ma vie, d’une vie que beaucoup repousseraient avec terreur pourtant. Si tous ceux qui ont entrevu la lumière, si tous ceux que la servitude révolte contribuaient à l’œuvre de rédemption humaine que nous poursuivons, notre terre deviendrait vite un éden bien supérieur à celui où, d’après la Bible, Dieu plaça nos premiers parents. Mais ils sont légions les cœurs lâches, les volontés sans énergie ; très peu osent manifester des opinions qui leur vaudraient la haine des puissants. Plusieurs ne méritent pas ces reproches ; ils témoignent, à l’occasion, d’un attachement sincère pour leurs idées ; s’ils se taisent, c’est qu’ils répugnent à faire œuvre de propagandistes. Ne les condamnons point ; faisons-leur remarquer, toutefois, qu’ils se doivent de soutenir, dans la mesure de leurs moyens, ceux qui répandent une doctrine dont la diffusion s’avère utile. Pour que nos conceptions ne restent pas ignorées du public, il faut que des orateurs, des journalistes, des écrivains acceptent de les exposer. La presse, qui ouvre largement ses colonnes aux politiciens de tout acabit, n’est pas accueillante pour nous ; les éditeurs nous éconduisent systématiquement. Des critiques et des journalistes m’ont avoué qu’ils avaient reçu des semonces en règle pour avoir parlé de mon œuvre avec bienveillance. Aucune école et aucune tribune ne nous acceptent sans arrière-pensée. C’est l’étouffement méthodique qui fait croire à beaucoup que le mouvement libertaire est mort ou du moins en voie de disparition. Quand nous déciderons-nous à leur prouver le contraire ? Chose facile, si chacun acceptait de faire quelque sacrifice en faveur de ses idées. Les socialistes sont très actifs, mais délaissant toute éducation populaire, ils versent dans le pire électoralisme et s’embourbent dans les marais nauséabonds de la politique.
Participation au gouvernement.
Le problème de la participation au gouvernement qui agite si fort les S.F.I.O., démontre avec évidence que les temps héroïques du socialisme sont révolus, qu’il n’est plus qu’un parti bien sage, aux ordres de ces suprêmes représentants du capitalisme que sont les présidents de République ou les rois. S’il était fidèle à sa doctrine et à ses traditions, le socialisme ne devrait constituer, en régime capitaliste, que des équipes parlementaires d’opposition violente et continue. C’est sur un bouleversement social, sur une révolution que comptaient les anciens marxistes qui préconisaient la lutte des classes ; ils avaient horreur des améliorations partielles, des réformes de détail qui retardaient la victoire du prolétariat ; ils voulaient l’expropriation brutale des capitalistes, détenteurs des instruments de production. Puis, leurs successeurs se laissèrent hypnotiser par l’action électorale et crurent que la l’évolution sociale s’accomplirait d’elle-même, sans recours à la violence, dès qu’ils détiendraient les portefeuilles ministériels et la majorité dans les assemblées parlementaires. Et l’on aboutit aux louches combinaisons, aux intrigues personnelles qui rabaissent aujourd’hui le socialisme au niveau des partis bourgeois, Des socialistes sont devenus ministres, en Allemagne, en Angleterre, dans bien d’autres pays ; l’un d’eux fut même président de la République allemande. Mais, nulle part, la prise du pouvoir par les socialistes ne fut suivie de la conquête de la propriété par le prolétariat. La défection de Mac Donald, en Angleterre, n’a été que la consécration en droit d’une situation de fait qui existait depuis longtemps. Jamais les ministres travaillistes ne songèrent à déposséder les gros propriétaires ; protéger le peuple contre certains excès des capitalistes, tel fut le maximum de leur action en faveur des ouvriers. En Allemagne, les sociaux-démocrates pratiquent la politique de soutien ; ils se pendent aux basques d’Hindenburg et de Brüning, dont les décrets frappent durement la classe laborieuse. Cette politique de soutien fut de même pratiquée chez nous, en 1924, à l’époque du Cartel. Mais ceux qui, tel PaulBoncour, se sentaient nés pour les grands rôles et voulaient devenir ministres, bon gré mal gré, ont réclamé davantage ; d’accord avec leurs alliés, les radicaux, ils voulaient la participation des socialistes au gouvernement, comme pendant la guerre, à l’époque bénie de l’union sacrée. Renaudel, Déat, Compère-Morel, Buisson, Marquet, Montagnon, Auriol, Bedouce, etc., sont les défenseurs attitrés, de cette tendance. Jusqu’à présent les congrès socialistes ont refusé de les suivre ; mais on la laissé entendre que des circonstances exceptionnelles pourraient conduire à modifier cette décision. Circonstances que l’on s’est abstenu de préciser, comme de juste, afin que les portes restent grandes ouvertes aux fructueuses combinaisons. Les chefs savaient, bien avant son départ, que le patriote Paul-Boncour n’était plus socialiste ; il leur répugnait toutefois que la rupture devînt publique et définitive ; aucune concession ne leur semblait excessive pour sauvegarder l’unité apparente du parti. D’ailleurs, les défenseurs d’un socialisme édulcoré, d’une politique d’entente avec les radicaux, sont très nombreux parmi les parlementaires S.F.I.O. « J’estime, écrivait Léon Blum, en 1930, quand les radicaux songeaient à reprendre le pouvoir, que nous devons assurer dès à présent le futur gouvernement de concentration radicale, non pas, certes, du soutien quasi-contractuel de 1924, non pas même de cet appui discret que nous avions donné à Chautemps et qui avait suffi à le compromettre, mais de notre bonne volonté, de notre sympathie, de notre préjugé favorable, de notre désir de le voir vivre et durer ». Avec ou sans collaboration gouvernementale, le socialisme français suit l’exemple de la social-démocratie allemande et du travaillisme anglais.
Participation aux bénéfices.
A l’époque où le socialisme, non encore émasculé, faisait trembler le patronat, ce dernier préconisa des réformes qui donnaient, un semblant de satisfaction à l’ouvrier, sans amoindrir la toute puissance du capitalisme. La participation aux bénéfices fut du nombre ; mais, pratiquement, elle fonctionna dans très peu d’entreprises. En théorie donc, on demandait qu’aucun salarié ne fût occupé dans une maison sans être assuré d’avoir part aux bénéfices. Dans ces conditions, l’ouvrier devenait un collaborateur intéressé à la bonne marche de l’établissement ; il était un associé, pour le patron, non plus un adversaire. Comme il s’agissait uniquement d’illusionner la classe laborieuse, on distribuait, en fait, des sommes dérisoires, et à ceux-là seulement dont on avait longuement éprouvé le servilisme foncier. Même ainsi comprise, la participation n’obtint pas l’assentiment de tous les défenseurs du capital. L’académicien Faguet écrivait :
« Où y a-t-il des bénéfices ? La plupart des entreprises industrielles n’en font pas. Elles font vivre leurs ouvriers et leur patron, celui-ci un peu mieux que ceux-là ; et voilà tout. Elles joignent les deux bouts. Voilà l’état normal de la plupart des entreprises, je parle de celles, qui ne font pas faillite. »
Les bénéfices étant nuls, les malheureux patrons n’avaient rien il distribuer à leurs employés, cela va sans dire. La manière forte plaisait beaucoup mieux à l’ensemble des capitalistes ; c’était un crime à leurs yeux de faire la moindre concession aux salariés. Ce charlatan de Gustave Le Bon dira :
« Pactiser avec eux, comme le font quelques riches bourgeois dans l’espoir d’attendrir ceux qu’ils considèrent comme leurs futurs vainqueurs ; est d’une pauvre psychologie. Toutes ces lâches et très honteuses faiblesses ne font qu’accroître l’audace des assaillants. De telles luttes ne comportent d’autre alternative que vaincre ou périr. Pactiser n’éviterait pas la défaite et engendrerait, outre la ruine, la honte dans le présent et le mépris de nos fils dans l’avenir. Rien ne servirait donc de continuer à masquer sa peur sous d’hypocrites discours philanthropiques auxquels ne croient plus, ni ceux qui les débitent, ni ceux qui les entendent. »
On s’empressa d’oublier la comédie de la participation aux bénéfices, qui ne peut être qu’un trompe-l’œil en régime capitaliste. Le parasitisme, qui consiste à vivre du travail d’autrui, se rencontre déjà chez les animaux : le frelon pille le miel des abeilles, le coucou pond ses œufs dans le nid des autres oiseaux, etc. Mais, dans l’espèce humaine, il acquiert une puissance et un développement extraordinaires : une multitude d’individus vivent du labeur des autres, sans rien leur donner en échange. C’est le cas de rentiers, de propriétaires d’usines ou de fermes, de commerçants innombrables : tous gens qui se classent fièrement dans l’élite de la société et que les autorités protègent. Dans le système coopératif seulement, la participation aux bénéfices cesse d’être un leurre pour devenir une réalité : elle requiert la disparition du parasitisme comme condition essentielle.
— L. BARBEDETTE.
PARVENU[E]
adj.
« Celui, celle qui a fait fortune, qui a passé de la pauvreté à l’aisance, à la richesse, à l’opulence. » (Lachâtre)
Nulle époque n’est plus favorable à l’éclosion des parvenus que celle d’un grand bouleversement social : guerre ou révolution. Cependant il y a eu de tout temps des parvenus, hommes habiles, favorisés par leur audace, par leur manque total de scrupules et par les circonstances. M. Jourdain vendait du drap ; telle famille bourgeoise doit sa fortune à l’ancêtre trafiquant d’esclaves ; telle autre à l’acquéreur de biens nationaux, telle autre encore au fournisseur de matériel de guerre. Le parvenu a nécessairement tripoté avec la sueur ou le sang du peuple. Commerçant, industriel ou gros propriétaire foncier, il a exploité autrui autant qu’il a pu. Quand il est arrivé à la richesse, son insolence n’a plus connu de limites. Et cela s’explique : Voilà un homme, né dans le prolétariat ou dans la petite bourgeoisie, auquel l’abondance et le luxe de la classe riche en ont toujours imposé. Intelligent, avide de posséder, d’être enfin lui aussi — pourquoi pas ?- un des « heureux » de la terre (il ne conçoit pas d’autre sorte de bonheur), un jour, sous une de ses multiples formes, le moyen d’acquérir la fortune se présente à lui. Sans doute, pour ce premier pas, il faut tremper dans une affaire louche, passer sur les camarades, sur un frère, ou sur des cadavres, mais qu’importe ! L’ultime but de l’agitation humaine n’est il pas de parvenir ? Et le premier geste fait, le reste vient par surcroît. Voilà notre homme riche. Dissipées les craintes et les angoisses du début. Ce qu’il possède, il le doit -il en est persuadé — à sa valeur personnelle. Où quantité d’autres ont vainement essayé, lui a réussi. Un formidable orgueil s’empare de sa personne. Il a changé de classe. Et un de ses premiers besoins est de cacher ses origines. M. Jourdain veut être un parfait gentilhomme ; il devient mamamouchi ! Il achète au pape un titre de noblesse ; il a un château, une écurie de chevaux de courses, des ancêtres ! Il pousse à outrance les manières en usage dans « le grand monde), et se montre ainsi d’un parfait ridicule. « Un sot parvenu est comme sur une montagne, d’où tout le monde lui paraît petit, comme il paraît petit à tout le monde » (Noël). Cependant tous les par venus ne se laissent point sottement griser par leur fortune. Certains, — les plus redoutables — conscients de leur force (l’argent permet tout), se retournent avec morgue vers leurs compagnons de la veille et deviennent pour eux d’impitoyables ennemis. Il semble qu’un besoin les pousse à racheter leur origine dans l’écrasement des pauvres qu’ils ont reniés. C’est l’histoire de tous les renégats. L’infâme Mussolini est un modèle de ce genre. Le parvenu est donc un être sans conscience, toujours dangereux ; et le prolétaire restera fraternel, secourable, humain, prêt aux besognes émancipatrices de demain tant qu’il s’opposera aux désirs malsains des parvenus, et tant qu’il pratiquera pour lui-même cette vertu nécessaire, définie par Albert Thierry, et qui a nom : le refus de parvenir.
— Ch. B.
PASSIF, PASSIVITÉ
(du latin pati, souffrir, endurer)
Supporter une action sans chercher à s’y soustraire, ne pas agir, c’est être passif. Et le terme passivité désigne ce mode de comportement. En pratique ils sont l’immense majorité ceux qui renoncent à juger par eux-mêmes, à vouloir par eux-mêmes. C’est à l’Académie, à l’Eglise, au journal qu’ils demandent ce qu’il faut croire ; et pour agir ils attendent un mot d’ordre des chefs de file ou des autorités. Cette mentalité servile permet aux politiciens et aux capitalistes de les exploiter sans danger ; elle fait souvent le désespoir de qui voudrait l’affranchissement des masses populaires. Mais pourquoi redire ce que d’autres ont déjà dit tant de fois ? Creusons plutôt en profondeur le problème philosophique et moral de la passivité. Faut-il agir ou rester inerte, satisfaire nos désirs ou bien les supprimer ? Ni les religions, ni les philosophies ne concordent dans leurs réponses. Les différentes sectes de l’Inde recommandent d’ordinaire l’inaction. Elle est représentée comme l’idéal de la sagesse humaine par le Sankhya de Patandjali ; et le Nyavare proclame que l’activité est fille de la faute. Le Bouddhisme, réforme religieuse du Brahmanisme, s’inspire des vieilles croyances hindoues. Pour lui, la vie n’est qu’illusion et souffrance ; de l’existence naît le désir et le désir engendre la douleur ; des existences futures nous attendent, qui seront pleines de tristesse également, si nous ne parvenons à tuer tout désir par un renoncement complet. Ceux qui auront épuisé toute volonté de vivre entreront dans le nirvâna ; ceux qui ne l’auront supprimée que partiellement renaîtront sous des formes moins matérielles qui les rapprocheront du but final. A l’inverse du Jaïnisme, sorti lui aussi du Brahmanisme et qui prêche la cruauté envers soi-même, le Bouddhisme réduit la part de l’ascétisme et recommande surtout le renoncement moral et la charité. Sur la vraie nature du nirvâna, on a beaucoup discuté ; pour certains il consiste dans l’anéantissement total et complet, mais d’autres contestent cette interprétation. Schopenhauer s’est inspiré des doctrines bouddhistes. Dans le monde, tout veut, selon lui, car tout fait effort, désire vivre et agit. Une volonté inconsciente et aveugle, mais universelle, indestructible et nécessaire, se développe dans la matière inorganique, dans le règne végétal et animal, puis arrive à prendre clairement conscience d’elle-même dans le cerveau humain. Cette volonté impersonnelle donne ainsi naissance aux individus qui en sont des déterminations particulières. Elle ne saurait périr ; mais la volonté individuelle, c’est-à-dire l’effort qui constitue notre âme, peut disparaître puisqu’elle est soumise au temps et à l’espace. Chacun de nous doit donc s’appliquer à faire retour à l’inconscience, au nirvâna. Car vouloir « c’est désirer et faire effort ; c’est donc essentiellement souffrir, et comme vivre c’est vouloir, toute vie est par essence douleur. Plus l’être est élevé, plus il souffre. Voici le résumé de cette histoire naturelle de la douleur : vouloir sans motif, toujours souffrir, toujours lutter, puis mourir, et ainsi de suite dans les siècles des siècles, jusqu’à ce que notre planète s’écaille en pièces et en morceaux ». Comme les bouddhistes, Schopenhauer recommande, non le suicide, mais la pitié pour autrui et la destruction de l’égoïsme. La volonté individuelle doit disparaître. « Alors se produit l’euthanasie de la volonté (sa béatitude dans la mort) ; cet état de parfaite indifférence, où sujet pensant et objet pensé disparaissent, où il n’y a plus ni volonté, ni représentation, ni monde. » Parce qu’il est mieux adapté à la mentalité occidentale, le christianisme conseille l’effort et, l’action. Néanmoins, c’est à procurer des moments de paix totale dans la passivité que tendent ses pratiques de dévotion. Grâce à la quiétude mystique, l’esprit, oublieux de ses instincts et de ses désirs, éprouve une détente momentanée. On connaît l’épisode de l’Evangile où Marthe, qui s’empressait aux soins du ménage, se plaint à Jésus que sa sœur Marie ne l’aide pas et la laisse servir seule. Elle s’attire cette sèche réponse : « Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas ôtée ». Au dire de tous les commentateurs catholiques, cette phrase signifie que la vie spéculative est supérieure à la vie active. Doctrine consacrée par l’Eglise, du moins en théorie. Parce qu’il faisait prédominer les Œuvres sur les vertus passives, l’américanisme, un mouvement propagé aux Etats-Unis par le père Isaac Hecker et l’archevêque Ireland, fut condamné par Léon XIII, en 1899. Quand il oppose l’Idéal chrétien el l’Idéal de passivité des orientaux, Henri Massis montre son ignorance en matière de théologie. Mais il est indubitable qu’en pratique les dignitaires ecclésiastiques préfèrent l’homme riche en dollars à l’homme pourvu seulement de divines bénédictions. Les fructueuses intrigues les intéressent beaucoup plus que les dévotes méditations. Grâce à une merveilleuse collection de sophismes et de dogmes contradictoires, tout ensemble ils prêchent la résignation au peuple et attisent la cupidité des grands. Nous méprisons la duplicité des prêtres ; nous ne pouvons admettre l’idéal des orientaux. Sans doute il est indispensable à l’homme de connaitre périodiquement le relâchement et la paix, surtout lorsque l’allure de l’existence est trop rapide, les problèmes à résoudre trop compliqués. Même après la besogne d’une journée ordinaire, un répit s’impose ; la nature y pourvoit par le sommeil de la nuit. L’homme a inventé d’autres réconforts, et qui sont parfois dangereux, contre les soucis et les tracas : jeux, excitants, narcotiques, etc. Mais, pour nous, les heures de repos ne sauraient être qu’une condition, un prélude de l’action positive ; elles constituent seulement une phase préparatoire, un moyen, non une fin en soi. C’est la plénitude de l’existence individuelle, le libre développement des virtualités du moi que nous voulons ; sans doute, chacun doit tenir compte de la présence d’autres hommes, ses frères, mais il n’a pas à s’absorber dans un tout impersonnel. Nous sommes pour l’action, contre la passivité, du moins tant qu’il est utile de réagir et de lutter. A notre avis, l’action est la suite naturelle du rêve.
« Dans le concept qui ne s’extériorise pas, il y a quelque chose d’inachevé, d’incomplet. Nous aimons croire que nos rêves ne seront pas toujours utopiques ; et la suprême griserie pour une volonté forte, c’est d’assister à leur réalisation. » (Vers l’Inaccessible)
On objecte que l’activité n’aboutit qu’au progrès mécanique, incapable de nous procurer le bonheur ; et l’on ajoute que nos pères étaient plus gais que nous, qu’ils ne vivaient ni moins bien, ni moins longtemps, que les injustices ne sont pas devenues moins nombreuses et les rapports sociaux plus faciles. De purs sophismes, mais que les partisans du statu quo répètent avec une persévérance et une audace qui les font admettre comme d’incontestables vérités. L’homme a perfectionné ses machines au point de modifier complètement les conditions économiques ; malheureusement le progrès moral n’a pas fait le bond requis pour se mettre à l’unisson du progrès scientifique. Nous l’admettons ; toutefois, nous avons l’espérance, la certitude même que des transformations s’opèreront dans l’ordre moral, si l’on ne décourage pas ceux qui s’efforcent de les provoquer. Le fruit du travail doit être réparti avec équité ; c’est à accroître le bien-être de tous, non à favoriser le luxe de quelques potentats, qu’il faut employer les procédés nouveaux de l’industrie. En dispensant d’actions pénibles, le machinisme pourrait permettre de réduire singulièrement la durée du travail quotidien. Au lieu de multiplier les engins da mort, la science parviendra à diminuer la somme des maux qui nous affligent, quand elle le voudra. Guerre, Capitalisme, Etat sont d’artificielles institutions humaines ; elles cesseront d’écraser les peuples, dès que ces derniers refuseront d’obéir servilement. Le triomphe des maîtres est fait de la passivité des esclaves. Tendre la joue gauche, si l’on vous frappe sur la joue droite, comme le conseille l’Evangile, c’est abdiquer au profit des violents, c’est confondre la sottise avec la bonté. Gandhi a soupçonné les laideurs que recouvre parfois la non-violence. Il a écrit :
« Je crois, en vérité, que s’il fallait absolument faire un choix entre la lâcheté et la violence, je conseillerais la violence. Mais je crois que la non-violence est infiniment supérieure à la violence : Pardonner est plus viril que punir. Le pardon est la parure du soldat. Mais s’abstenir n’est pardonner que s’il y a possibilité de punir ; l’abstention n’a aucun sens si elle provient de l’impuissance. On ne peut guère dire que la souris pardonne au chat lorsqu’elle se laisse croquer par lui. »
Nous admettons sans peine que, chez Gandhi et chez nombre de ses partisans, la non-violence n’est pas la lâcheté. Celui qui refuse d’obéir, au risque d’être condamné par les tribunaux, est un brave. Ce n’est pas un être passif et sans individualité, c’est un homme énergique et fort. En tant qu’elle implique désobéissance aux ordres des autorités britanniques, j’approuve donc la méthode de non-coopération. Mais, pour le reste, elle ne m’enthousiasme nullement. Peut-être Gandhi ne pouvait-il, en pratique, adopter une autre attitude, la mentalité des hindous étant corrompue par des croyances religieuses très néfastes, quoi qu’en disent les admirateurs de l’Orient. N’a-t-il pas déclaré qu’il préférait la forme violente du sinn-féinisme à cette passivité résignée que représente, par exemple, la non-résistance au mal de Tolstoï. Il a raison de placer le droit au-dessus de la force ; et lui du moins prêche la résistance au mal. Mais pourquoi qualifier violence, et dans le mauvais sens du mot, le fait de résister par la force à un injuste agresseur ? Comment estimer coupable celui qui refuse de se laisser tuer bêtement par un policier ou un militaire ? Sa vie ne vaut-elle pas la vie de celui qui l’attaque, au nom d’autorités tyranniques ? Gandhi ne parvient pas à ébranler, par des arguments rationnels, le droit de légitime défense, qui permet à chacun de s’opposer, même par la force, aux entreprises d’un assassin. Pas plus que la nature, pas plus que la science, la force n’est, en elle-même, ni morale, ni immorale ; au service d’une mauvaise cause elle devient condamnable ; elle est bonne si on l’utilise, sans léser les droits de quiconque, pour réaliser un idéal généreux. Mais, parce qu’il n’a rien renié des croyances de ses pères, parce qu’il veut rester un « bon hindou » du point de vue religieux, le Mahàtma ne parvient pas à formuler une doctrine applicable hors de sa région. Louons-le d’avoir puissamment contribué au réveil de l’Inde ; reconnaissons que sa tâche était dure et qu’il devait compter avec d’antiques et puissants préjugés ; ne prenons ses idées ni pour le dernier mot de la sagesse, ni pour l’expression définitive de l’idéal humanitaire. Avec ses intouchables, ses parias, son régime des castes, l’Inde ne saurait servir de modèle aux peules, comme voudraient le faire croire des écrivains pourtant bien intentionnés.
— L. BARBEDETTE
PASSION
n. f. (du latin pati, souffrir, endurer)
Sur le sens du mot passion, les psychologues ont discuté longuement. Il désignerait la sensibilité en général, selon certains, Descartes en particulier, l’appliquait à des états que nous appelons aujourd’hui émotions, désirs, inclinations. D’antres le réservent aux émotions violentes qui troublent profondément le corps et l’esprit. Ribot déclare que la passion doit être distinguée « de l’émotion d’une part et de la folie d’autre part : car elle est située entre les deux, à mi-chemin », La plupart rattachent maintenant la passion aux tendances ; elle consisterait dans une inclination exaltée qui domine et unifie toute la vie psychologique. Ce n’est pas un penchant nouveau, c’est un penchant antérieur développé outre mesure. Elle apparaît, quand une tendance prend le pas sur les autres, les absorbe à son profit et fait converger toutes les énergies vers sa fin particulière. Une affection unique, démesurément grossie, remplit la conscience du passionné. Sa puissance d’aimer est centralisée tout entière sur un seul objet. Son intelligence, en proie à une véritable obsession, ne pense qu’au but désiré ou aux moyens d’y parvenir. Inerte pour tout le reste, son activité devient fiévreuse dès que la passion est en jeu. Exclusive et jalouse, l’inclination, qui parvient à régner ainsi en souveraine maîtresse, ne permet plus aux autres de se développer. Ribot à raison de dire que la passion est dans l’ordre affectif ce que l’idée fixe est dans l’ordre intellectuel. Selon le milieu où il se trouve et l’objet qu’il poursuit, l’ambitieux, tourmenté par un continuel et violent besoin de s’élever au-dessus des autres, variera ses procédés. Son tempérament entrera aussi en ligne de compte ; le fourbe et le brutal useront de moyens différents. Mais qu’elle agite un conquérant fameux ou un obscur contremaître, l’ambition suppose une prodigieuse hypertrophie du moi. « J’ai couché dans le lit des rois et j’y ai gagné une terrible maladie », déclarait Napoléon, en songeant à la folie du pouvoir qui s’était emparé de lui. Déjà César, traversant un pauvre village des Alpes, disait à ses amis :
« J’aimerais mieux être le premier dans ce village que le second à Rome. »
Nos ministres et nos maréchaux n’avouent plus des désirs de cet ordre ; dans leur for intérieur, beaucoup estiment cependant que tout irait mieux s’ils étaient dictateurs. Chez les médiocres, chez ceux qui ne peuvent aspirer qu’à des situations moyennes, la passion s’attache à des objets de minime importance ; elle n’est ni moins tyrannique, ni moins envahissante. Le souci d’obtenir des promotions et des médailles occupe toute la vie de certains fonctionnaires : serviles devant leurs chefs, ils terrorisent avec délices leurs subordonnés ; dès qu’ils occupent un degré supérieur dans la hiérarchie, le copain d’hier n’est pour eux qu’un étranger. Dans les plus humbles milieux, on rencontre des individus qui, pour monter, acceptent les pires besognes, se font courtisans et délateurs, poignardent dans le dos leurs meilleurs amis. Et l’ambition n’est pas l’unique passion qui produise des effets de cet ordre. Poètes, dramaturges, romanciers nous ont amplement renseignés sur les mille aspects que l’amour revêt. L’avare s’oublie lui-même pour ne songer qu’à son argent. En face de l’or, il éprouve une joie extatique comparable à celle de l’ascète contemplant son dieu. Fursac a rencontré une femme qui couvrait d’or la surface de sa table, puis restait de longues heures à le considérer. Sur le point d’entrer en agonie, une autre déclarait :
« Je voudrais faire fondre toute ma fortune et l’avaler avant de mourir. »
Plutôt que d’entamer leur cher magot, des avares périssent de faim et de froid, se privent des remèdes qui leur permettraient de guérir. La passion du jeu était si grande dans l’Ancienne Chine qu’à défaut d’autre chose, certains livraient les doigts de leurs mains comme enjeu, acceptant qu’on les coupe si la fortune ne les favorisait pas. Un détenu politique, rapporte Descuret, se laissa mourir d’inanition : il jouait quotidiennement, bien que malade, sa ration de bouillon ou de vin. Le nombre est grand de ceux qui se suicident, après s’être ruinés à Monte-Carlo. On sait jusqu’où va quelquefois la passion des collectionneurs. Mazarin, en mourant, regrettait ses tableaux autant que le pouvoir. Pétrarque, Bertin on voulu rendre le dernier soupir dans leur bibliothèque. Un colonel, connu pour sa passion des médailles, fut pris de pneumonie et se trouvait depuis plusieurs heures dans un état comateux. « Je répétai devant lui à plusieurs fois et très haut, écrit Descuret, qu’il y aurait prochainement une vente de médailles magnifiques. Le colonel articule vaguement le mot médaille, puis recouvre peu à peu la conscience et guérit ». Mais, quelques années plus tard, le vol d’un tiroir de sa collection faillit lui être fatal :
« Une seule consolation me reste, disait-il ; les imbéciles n’ont pris que les médailles en or ; un pouce plus bas, c’était les grands bronzes, les rares. Je n’aurais pas survécu à leur perte. »
Même l’habitude de se mettre en colère peut dégénérer en besoin, en passion. Le naturaliste Virey affirme :
« J’ai connu des hommes chez qui l’irascibilité était devenue un besoin. Ils cherchaient querelle à tout le monde, principalement à leurs amis, car ils exigeaient plus d’attentions de leur part que de tout autre. Ils étaient très désappointés lors qu’on refusait de contester avec eux ; et leurs domestiques n’ignoraient pas qu’ils seraient brusqués davantage s’ils ne prêtaient pas un léger élément pour faire dégorger la mauvaise humeur habituelle de leurs maîtres. »
Chacun de nous a d’ailleurs rencontré de ces rombières insupportables, de ces vieillards toujours grincheux qui disputent constamment, et souvent sans motif, parce qu’ils éprouvent du plaisir à crier comme d’autres en éprouvent à rendre leur entourage heureux. Ces exemples suffisent à nous éclairer ; il serait facile d’en citer un plus grand nombre, car les passions s’avèrent multiples et diverses. N’étant que l’exagération des tendances, elles sont aussi nombreuses que ces dernières. On peut leur appliquer la classification utilisée pour les besoins physiques et mentaux. Les unes sont égoïstes et concernent soit le corps, soit l’esprit ; d’autres sont égo-altruistes ou purement altruistes ; d’autres enfin ont un objet impersonnel, celles qui se rapportent au vrai, au beau, au bien. D’un point de vue différent, et d’après la richesse de leur contenu psychologique, l’on distingue des passions inférieures, intermédiaires, supérieures. Dans les passions inférieures, la recherche du plaisir physique est le facteur essentiel ; intelligence et imagination jouent un rôle très réduit ; on se borne à répéter indéfiniment des gestes identiques. Ivrognerie et gourmandise rentrent dans cette catégorie ; le vin peut cependant être une source de consolation et l’art culinaire s’avère susceptible de raffinements délicats. Le besoin d’excitants, d’alcools, d’opium, de morphine, de cocaïne, etc., résulte parfois d’aspirations intellectuelles, je l’ai montré dans Vers l’Inaccessible ; et dès lors il est impossible de méconnaître l’élément esthétique qu’il contient. A l’origine des passions intermédiaires, l’amour par exemple, on trouve encore la sensation ; mais elles supposent, en outre un travail psychologique profond. Une transfiguration de l’objet s’opère, grâce à l’imagination qui ajoute, retranche, idéalise. Sans cesse l’amoureux découvre de nouveaux charmes dans la personne de sa bien-aimée ; parfois même il rêve d’héroïsme et de sacrifice, afin d’être plus digne de celle qu’il a choisie. Extrêmement riches au point de vue psychologique, les passions supérieures doivent peu à la sensation, beaucoup à l’intelligence. Elles ne comportent plus la répétition machinale de gestes analogues, mais une prodigieuse variété d’émotions et d’efforts. Sans parler des génies qui produisent des œuvres belles aussi naturellement qu’un arbre se couvre de feuilles et de fleurs, le simple dilettante n’éprouvera de joie esthétique que s’il refait, au moins dans une certaine mesure, le travail du créateur. La passion du vrai, celle du bien éveillent aussi les puissances de l’âme : les grands réformateurs furent transformés par leurs rêves, les grands inventeurs firent preuve d’une ingéniosité et d’une patience admirables. Par contre, le fanatisme, soit politique soit religieux, engendre l’étroitesse d’esprit et le désir de persécuter ceux qui professent des opinions différentes. Elle est déplorable, la mentalité du dévot qui multiplie les signes de croix, en marmottant des oraisons. Si variés que soient leur nature et leur objet, les passions ont pour effet commun de transformer la vie psychologique. Le centre de la personnalité change et une orientation commune est imprimée à toutes les facultés. Incapable de se fixer ailleurs, l’attention est retenue sur la fin poursuivie par le passionné. Appliquée à un objet unique, l’énergie mentale acquiert plus de force ; les raisons surgissent nombreuses et persuasives ; sans peine on découvre la solution des plus difficiles problèmes. Malheureusement, l’esprit devient la dupe du sentiment, car, très différente de la logique ordinaire, la logique de la passion adapte ses jugements à une conclusion posée d’avance. Simple instrument de la sensibilité, l’intelligence se borne à trouver des arguments qui légitiment les prétentions de l’intérêt ou les espérances du cœur. D’avance le prêtre admet les dogmes imposés par son Eglise ; c’est après seulement qu’il cherche à se démontrer à lui-même ou à démontrer aux autres que ses croyances ne sont pas contredites par l’expérience et la raison. Au chevet de son enfant malade, la mère, pour se convaincre qu’il guérira, songe qu’il est jeune, qu’il est robuste, que d’autres atteints de troubles semblables se sont rétablis grâce aux soins d’un docteur habile. Le médecin, au contraire, ne se prononce sur la gravité du mal qu’après avoir observé tous les symptômes, les défavorables non moins que ceux qui laissent de l’espoir. On sait combien facilement les amoureux s’illusionnent sur l’objet de leur affection, l’ornent de qualités qui n’existent, hélas, que dans leur imagination. La passion ne s’embarrasse guère du principe de contradiction, elle accumule les idées de détail, sans relations logiques entre elles, mais qui tendent toutes à la même conclusion. Elle procède aussi par gradation, comme ces orateurs qui, pour convaincre leur auditoire, apportent des arguments toujours plus forts, eu égard, non à la raison, mais au tempérament et aux préjugés de ceux qui les écoutent. De même que l’intelligence, l’activité se trouve orientée vers un but unique ; d’où la puissance extraordinaire qu’elle acquiert parfois. On connaît quelques cas célèbres, il en existe bien d’autres. Ribot écrit :
« Quand on veut donner des exemples de grands passionnés, on les prend toujours dans l’histoire politique ou religieuse, dans les expéditions guerrières ou maritimes, on cite des artistes ou des inventeurs enivrés de leur vocation. Il le faut bien, parce que ceux-là seuls sont connus. Ils ont laissé un nom parce qu’ils ont agi sur leur milieu ; leur passion a eu une répercussion forte et durable sur leurs semblables. Mais des milliers d’hommes ont vécu, possédés de passions aussi intenses, qui ne sont connus que d’un mince entourage, parce qu’ils n’ont pu s’élever faute d’appui intellectuel ou parce que leur passion (comme celle des amoureux) est limitée à deux individus dont la destinée est indifférente au reste des hommes. Malgré tout, cette passion qui n’a défrayé que des conversations locales ou des gazettes ignorées, n’en a pas été moindre comme puissance d’effort et condensation de la vie affective. »
Reconnaissons, toutefois, que l’humanité abonde, non en grandes passions, mais en passions médiocres qui manquent soit de force soit de durée. Parfois elles apparaissent brusquement, parfois elles se développent lentement, d’une façon progressive. Le coup de foudre, fréquent dans les récits imaginaires, est rare dans la vie réelle. Et l’hypothèse d’une préexistence, au sens bouddhique ou spencérien du mot, n’est pas du tout nécessaire pour l’expliquer. Quand un esprit s’est donné un idéal et que cet idéal il le découvre, brusquement réalisé dans un être qui s’est trouvé sur son chemin, alors l’amour éclate dès la première rencontre. Un travail souterrain s’est produit dans l’inconscient ; sa mise au jour soudaine explique le caractère de brusquerie qui accompagne son irruption dans le champ de la conscience claire. Toute passion exige une période d’incubation préalable, un enfantement de longueur variable ; elle n’est jamais une création ex nihilo. L’événement extérieur, dans le coup de foudre, joue le rôle de l’étincelle qui enflamme la poudre au préalable entassée. Constitution morale, physique et hérédité prédisposent, d’ailleurs, aux différentes passions ; une sensibilité vive, une imagination ardente ont une importance essentielle. Surtout l’imagination qui, se conformant au désir, embellit l’objet de notre amour, enlaidit l’objet de notre répulsion. Mélinand écrit :
« Ce qu’on aime ou ce qu’on hait passionnément, ce n’est pas l’être ou l’objet réel, mais une image de lui qu’on se forge soi-même. Le véritable objet de l’amour, ce n’est pas la personne vraie, mais la personne idéale créée par notre imagination. De même dans la haine, et dans toutes les passions. Il y a toujours création d’un fantôme, interposé entre la réalité et nous. »
Parmi mes amis, plusieurs m’ont avoué qu’avant notre rencontre ils me voyaient hautain, tel un dieu de l’Olympe, ou brandissant une arme avec colère. Le ton de mes écrits en était cause ; et leur surprise fut grande lorsqu’ils me connurent pour de bon. Milieu social, éducation, climat, nourriture exercent aussi une influence indéniable. Dans le Nord, on est en général plus gourmand, dans le Midi moins travailleur. Les mœurs qui, selon Stendhal, « changent à peu près tous les cinquante ans », engendrent des passions spéciales. Chez certains, l’homosexualité est aujourd’hui une affaire de mode plus que de tempérament ; dans quelques milieux littéraires ou mondains, l’on se fait un point d’honneur d’oublier les femmes pour les éphèbes. Parfois, elle résulte de la monosexualité du milieu. « Dans les compagnies de discipline, qui étaient composées de condamnés militaires astreints à ne jamais sortir du quartier pendant toute la durée de leur service, écrit le Docteur G. Saint-Paul, l’homosexualité, ersatz de la sexualité normale, était extrêmement répandue. C’est là que l’on voyait l’union homosexuelle figurer en réplique fidèle de l’union sexuelle : l’un des conjoints étant l’homme, le mâle, le fort de l’association, prêt à peiner, à se dépenser, à risquer, à se faire punir pour l’autre, la femme, coquette, adulée, capricieuse souvent et passant à son partenaire corvées et charges trop lourdes. A l’occasion, scènes de jalousie, rixes, batailles, coups de couteau agrémentent ces mœurs et, dans la règle, le passif demeure ou devient la proie du vainqueur ». L’absence de femmes s’avère la raison d’être de ce comportement. Mais chez des hommes libres, l’homosexualité peut résulter soit d’un défaut de conformation dans les organes sexuels, soit d’anomalies dans les sécrétions, anomalies se rattachant à des dispositions anatomiques encore indécelables par le savant. Prodigieux est, d’autre part, l’influence de l’éducation sur la genèse et le développement des passions ; beaucoup de criminels accusent, à bon droit, leurs parents, le milieu où ils ont grandi, la société, d’être responsables des actes répréhensibles qu’ils ont commis. Il arrive que la passion prenne fin par épuisement ou par satiété ; elle peul aussi se transformer ; malheureusement il n’est pas rare qu’elle ait pour terme la folie ou la mort. D’où l’idée, fréquemment soutenue, qu’elle est à l’énergie morale ce que la maladie est au corps ; d’où l’anathème lancé contre elle par les Stoïciens et, depuis, par maints autres. Kant affirme que toute inclination sensible est Pathologique et que l’on diminue son mérite en s’éprenant d’enthousiasme pour le bien. Plusieurs, en particulier Fourier, estiment par contre, que toutes les passions sont également utiles et bonnes.
« Elles nous guident comme la boussole le marin, et nous indiquent vers quel but doivent tendre nos efforts. »
Dans le phalanstère, la nouvelle organisation sociale préconisée par Fourier, les passions les plus diverses avaient complète satisfaction. En réalité, il existe des passions nocives, tant pour l’individu que pour ceux qui l’entourent, et aussi des passions capables d’assurer à l’existence plus de noblesse et d’intensité. Ceux qui firent de grandes choses, pour le bonheur comme pour le malheur de leurs semblables, furent, en général, des passionnés. C’est d’après l’objet poursuivi et les conséquences observables qu’un juge impartial arrive à se prononcer. Reconnaissons, toutefois, que la passion même bonne, l’amour excessif du beau ou du vrai par exemple, suppose un certain déséquilibre mental. Quant aux passions néfastes, nous parvenons à les dominer en détournant l’attention des objets qui les attirent et en leur refusant les satisfactions qu’elles réclament. Plus tard, la morale, devenue expérimentale et physiologique, disposera d’ingrédients capables de modifier nos sentiments. Les découvertes récentes, concernant l’influence des produits sécrétés par les glandes endocrines sur le caractère et le comportement des individus, prouvent qu’il ne s’agit point là de vues chimériques.
— L. BARBEDETTE.
PASTEURISATION
La pasteurisation est un procédé qui vise à détruire champignons et microbes, grâce à un chauffage qui va de 95 à 75°C et qui est suivi d’un refroidissement brusque. La stérilisation ainsi obtenus est incomplète, car certains microbes résistent à cette température. Par contre, elle dénature moins les liquides qu’une stérilisation obtenue par une température de 100 ou 120°C. On emploie fréquemment ce procédé pour le lait. Ce dernier est alors chauffé à 70–75°C, puis on le refroidit brusquement, afin d’éviter les températures Intermédiaires de 30 à 40, qui sont particulièrement favorables à la germination des spores ayant pu échapper à l’action de la chaleur. Les grandes sociétés laitières ont souvent recours à ce procédé. Le lait pasteurisé pouvant se conserver pendant deux jours. Mais, bien qu’à un degré moindre que le lait stérilisé, le lait pasteurisé perd une partie de ses qualités naturelles. On sait que l’usage exclusif du lait stérilisé conduit au rachitisme et à la maladie de Barlow, lorsqu’on ne compense pas la destruction des vitamines par des aliments frais. On emploie aussi la pasteurisation pour les vins, afin de les conserver et de les vieillir. Certainement, Pasteur à rendu un grand service à l’humanité en attirant l’attention sur l’énorme rôle joué par les infiniment petits. Ils sont cause d’un nombre prodigieux de maladies (voir Microbes) et l’on doit prendre contre eux de sérieuses précautions. Néanmoins, la crainte des microbes ne doit pas conduire à d’autres excès dangereux. Depuis Pasteur, la médecine a fait de grands progrès ; elle a, en particulier, mis en évidence le rôle des vitamines absolument nécessaires au développement de l’organisme et qui sont détruites par les températures élevées. La cuisson enlève à certains aliments une notable partie de leur valeur ; et, sous prétexte de tuer les microbes, il ne faut pas s’abstenir, par principe, de tout ce qui est cru. On doit même connaitre que, sur certains points de grande importance, les savants s’écartent de plus en plus des méthodes et des idées chères à Pasteur. Ce qui n’enlève rien au mérite du célèbre chimiste, mais démontre que nul n’est infaillible et que la science a pour condition primordiale, non l’idolâtrie à l’égard des grands hommes, mais la libre critique et des recherches toujours plus approfondies.
PATRIE
n.f. (du latin pater, père)
Le mot patrie, chez les anciens, signifiait la terre des pères : terra patria. Etymologiquement, il désigne le pays où on est né. Comment, de ce sens si restreint le mot patrie est-il arrivé à désigner les vastes nations d’aujourd’hui ? Par quel processus, dépassant même ce stade, arrive-t-il à désigner la terre entière, la patrie humaine, rejoignant l’internationale ? En voici succintement l’explication, donnée par A. Hamon :
« L’idée de patrie présuppose la solidarité l’union, l’association entre individus. L’idée de patrie implique l’idée de collectivité ; en effet, nous ne pouvons concevoir et nous ne pensons pas que quelqu’un puisse concevoir la patrie réduite à un individu. La patrie est donc un ensemble d’êtres, une résultante dont les composantes sont des individus. Pour que ces individus se composent entre eux et donnent naissance à la résultante patrie, il faut des caractères communs, une relation de nature quelconque unissant associant ces individus entre eux. Nous ne pouvons concevoir des êtres sans communs caractères s’agrégeant entre eux, se composant pour engendrer une association, une collectivité, une résultante patrie. Ces premiers caractères communs furent certainement le lieu de naissance ou plutôt le groupement au milieu duquel l’être naissait et se développait. La première patrie fut la horde, la tribu, le clan. La vie en commun développe une communauté — accrue encore par les liens du sang — de mœurs, de coutumes, de langue, de sensations, de sentiments qui rend solidaires les humains les uns des autres. Ils sont les membres d’un même corps, agrégat d’individus. Aussi, dans la horde, la tribu, le clan ils se sentent solidaires les uns des autres. Relativement aux tribus voisines. Ils se sentent différents, presque de nature autre, vivant éloignés, n’ayant de contact que pour la dispute, la guerre. Mœurs, coutumes, langues, sentiments et sensations sont dissemblables. Elles sont l’étranger, l’ennemi. La patrie est la horde, la tribu, le clan seul.
Peu à peu, avec le temps, l’homme passant de l’état de chasseur à l’état de pasteur et de celui-ci à, l’état d’agriculteur, la cité se forma. Alors la patrie fut cette cité. L’étranger, l’ennemi, fut celui qui n’était pas de la cité. Le nombre de gens participant de caractères communs s’est accru ; la solidarité s’étend sur une aire plus grande, mais son intensité a diminué, car des classes et des castes se sont séparées dans la cité. La patrie existe plus grande, plus ample, mais le sentiment patriotique est moins puissant, car on a moins besoin d’être solidaire. De la civilisation naissent sans cesse de nouveaux besoins ; aussi, le commerce se développe ; et, par suite, se multiplient les contacts entre cités voisines. On se connaît mieux, en se hait moins, même on s’aime. Les différenciations de mœurs s’atténuent ; les langues se pénètrent mutuellement ; les intérêts se solidarisent en quelques occasions ; l’alliance, puis l’union se fait.
Le petit Etat est né ; une nouvelle patrie en résulte, plus grande de territoire, plus nombreuse d’hommes. Dans cet Etat, les mœurs, les coutumes, les langues, les sentiments tendent à s’unifier, à devenir semblables du Nord comme au Sud, à l’Est comme à l’Ouest. La solidarité diminue d’intensité. De l’extension des connaissances humaines, du commerce, de l’industrie naissent de nouveaux besoins qui entrainent des voyages, à des rapports fréquents avec l’étranger. Des guerres résultent des contacts entre peuples ennemis, des chevauchées en des régions étrangères. Les peuples se pénètrent mutuellement, tendent à se différencier de moins en moins. Des alliances et des unions se font. Par elles, l’agrégation des petits Etats en de grands s’accomplit, et aussi par conquêtes.
Une nouvelle patrie est née. Elle est plus grande superficiellement que toutes les précédentes ; elle contient plus d’individus que toutes les précédentes. La solidarité embrasse un plus grand nombre d’êtres, mais elle est moins intense. Tous les hommes de cette patrie n’ayant pas de rapports quotidiens entre eux, ne vivant pas en un même lieu, ne se connaissent point, ne se sentent point exactement semblables entre eux, bien que les différenciations se soient considérablement atténuées. Le lien de solidarité existe, mais, embrassant plus d’êtres, il est plus lâche.
Nous en sommes actuellement à ce stade de l’évolution et déjà se dessine vigoureusement le processus qui conduira l’humanité à l’internationalité ou union des nations et ensuite vers un état tendant sans cesse à l’uniformité entre tous les humains. Actuellement, en nos grandes patries, tout tend à l’internationalité, c’est-à-dire à la solidarité entre les nations, à l’amour des hommes, quels que soient leur lieu de naissance, leurs mœurs. »
Un seul complément à ces lignes : à l’heure présente, le soi-disant lien de solidarité sociale n’existe pas entre tous les hommes d’une même « patrie ». Le prolétaire conscient nie les patries. Il ne se sent solidaire que de ses frères de misère, sur le plan international. Nous verrons cela plus loin.
LA PATRIE DANS L’ANTIQUITÉ
Pour la société antique, la patrie était un tout sacré, une réalité vivante, hors de laquelle il n’y avait pas de bonheur possible.
« On aimait la patrie parce qu’on en aimait les dieux protecteurs, parce que chez elle On trouvait un prytanée, un feu divin, des fêtes, des prières, des hymnes, et parce que, hors d’elle on n’avait plus de dieux ni de culte. »
La famille constituait la base de cette société ; la famille avec son autel pour les vivants, son tombeau pour les ancêtres, le champ qu’elle possédait et fécondait, ses dieux domestiques. La famille antique était « une association religieuse plus encore qu’une association de nature ».
Le mot patrie : terra patria résumait tout cela.
« La patrie de chaque homme était la part de soi que sa religion domestique ou nationale avait sanctifiée, la terre où étaient déposés les ossements de ses ancêtres et que leurs âmes occupaient. La petite patrie était l’enclos de la famille, avec son tombeau et son foyer. La grande patrie était la cité, avec son prytanée et ses héros, avec son enceinte sacrée et son territoire marqué par la religion. « Terre sacrée de la patrie », disaient les Grecs. Ce n’était pas un vain mot. Ce sol était véritablement sacré pour l’homme, car il était habité par ses dieux. Etat, Cité, Patrie, ces mots n’étaient pas une abstraction, comme chez les modernes, ils représentaient réellement tout un ensemble de divinités locales avec un culte de chaque jour et des croyances puissantes sur l’âme. » (Fustel de Coulanges).
L’homme prisonnier de la famille, prisonnier de ses dieux, dans le droit antique, ne croyait pas la vie digne d’être vécue en dehors de la patrie. Citons encore le même auteur pour montrer comment l’individu était enchaîné : « Tout ce que l’homme pouvait avoir de plus cher se confondait avec la patrie. En elle, il trouvait son bien, sa sécurité, son droit, sa foi, son dieu. En la perdant, il perdait tout, Il était presque impossible que l’Intérêt privé fût en désaccord avec l’intérêt public. Platon dit :
« C’est la Patrie qui nous enfante, qui nous nourrit, qui nous élève. »
Et Sophocle :
« C’est la patrie qui nous conserve. »
Une telle patrie n’est pas seulement pour l’homme un domicile. Qu’il quitte ces saintes murailles, qu’il franchisse les limites sacrées du territoire, il ne trouve plus pour lui ni religion, ni lien social d’aucune espèce. Partout ailleurs que dans sa patrie, il est en dehors de la vie régulière et du droit, partout ailleurs il est sans dieu et en dehors de la vie morale. Là seulement il a sa dignité d’homme et ses devoirs. Il ne peut être homme que là.
La patrie tient l’homme attaché par un lien sacré. Il faut l’aimer comme on aime une religion, lui obéir comme on obéit à Dieu :
« Il faut se donner à elle tout entier, mettre tout en elle, lui vouer tout. II faut l’aimer glorieuse ou obscure, prospère ou malheureuse, Il faut l’aimer dans ses bienfaits et l’aimer encore dans ses rigueurs. Socrate condamné par elle sans raison ne doit pas moins l’aimer. Il faut l’aimer comme Abraham aimait son dieu, jusqu’à lui sacrifier son fils, Il faut savoir mourir pour elle. Le Grec ou le Romain ne meurt guère par dévouement à un homme ou par point d’honneur, mais à la patrie il doit sa vie. Car, si la patrie est attaquée, c’est sa religion qu’on attaque. Il combat véritablement pour ses autels, pour ses foyers, pro aris et focis ; car, si l’ennemi s’empare de sa ville, ses autels seront renversés, ses foyers éteints, ses tombeaux profanés, ses dieux détruits, son culte effacé. L’amour de la patrie, c’est la piété des anciens. »
Rien d’étonnant, après cela, que l’exil soit la plus terrible des punitions. Les anciens l’appelaient en effet une peine capitale. Ils n’imaginaient pas de châtiment plus cruel.
« L’exilé, en laissant sa patrie derrière lut, laissait aussi ses dieux. Il ne voyait plus nulle part de religion qui pût l e consoler et le protéger ; il ne sentait plus de providence qui veillât sur lui ; le bonheur de prier lui était ôté. Tout ce qui pouvait satisfaire les besoins de son âme était éloigné de lui. Or, la religion était la source d’où découlaient les droits civils et politiques. L’exilé perdait donc tout cela en perdant la religion de la patrie. Exclu du culte de la cité, il se voyait enlever du même coup son culte domestique et il devait éteindre son foyer. Il n’avait plus le droit de propriété ; sa terre et tous ses biens étaient confisqués au profit des dieux ou de l’Etat. N’ayant plus de culte, il n’avait plus de famille. Il cessait d’être époux et père, ses fils n’étaient plus en sa puissance ; sa femme n’était plus sa femme, et elle pouvait immédiatement prendre un autre époux. Il faut ajouter que les droits à l’héritage disparaissaient aussi. Par intérêt donc, au moins autant que par devoir, l’homme était obligé de placer la patrie au-dessus de sa vie même.
Et puis, la terre tourna... Il en fut alors ce qu’il en a toujours été : ce’ qui semblait immuablement fixe ne se trouvait être qu’un moment de l’évolution. Des changements sociaux et politiques amenèrent de nouvelles manières de penser. Les antiques croyances étaient périmées ; le patriotisme changea de nature. Les dieux passant au second plan, on aima la patrie « seulement pour ses lois, pour ses institutions, pour les droits et la sécurité qu’elle accordait à ses membres ». Cette cassure entre la religion et la patrie enleva à l’antique amour rd la patrie ce qu’il avait de rigide et de dur. Une phraséologie semblable à certaine que nous sommes accoutumés de subir de nos jours eut cours alors, et l’on entendit des paroles comme celles que Thucydide met dans la bouche de Périclès, exposant qu’elles sont les raisons qui font aimer Athènes, c’est que cette ville « veut que tous soient égaux devant la loi» ; c’est « qu’elle donne aux hommes la liberté et ouvre à tous la voie des honneurs ; c’est qu’elle maintient l’ordre public, assure aux magistrats l’autorité, protège les faibles, donne à tous des spectacles et des fêtes qui sont l’éducation de l’âme ». Et l’orateur termine en disant ; « Voilà pourquoi nos guerriers sont morts héroïquement plutôt que de se laisser ravir cette patrie ; voilà pourquoi ceux qui survivent sont tout prêts à souffrir et à se dévouer pour elle. »
Lois, institutions, liberté, honneur...
Dans la société, apparaissait la notion de classe, et cette notion, plus juste, se substituait peu à peu à celle de la patrie. Aristocratie et démocratie — possédants et plèbe — riches et pauvres — division naturelle des hommes tant que ne sera pas réalisée l’anarchie !
« On ne distinguait plus, pour toute l’Italie et pour toute la Grèce, que deux groupes d’hommes : d’une part, une classe aristocratique ; de l’autre, un parti populaire. »
Sans doute, la question sociale ne se posait pas avec la même netteté que de nos jours, sans doute les prolétaires « allaient chaque matin saluer les riches et leur demander la nourriture du jour », sans doute ils s’estimaient trop souvent satisfaits avec « du pain et le cirque» ; mais la lutte des riches et des pauvres ne se vit pas moins dans toutes les cités et, les intérêts les plus immédiats étant nécessairement opposés, on oublia ce que fut la patrie à l’époque où la vieille religion enchaînait les individus.
Puis vint le christianisme. Mon « Royaume n’est pas de ce monde », — « Allez et instruisez tous les peuples », disait Jésus. Le christianisme « présenta à l’adoration de tous les hommes un Dieu unique, un Dieu qui était à tous, qui n’avait pas de peuple choisi, et qui ne distinguait ni les races, ni les familles, ni les Etats ». C’était l’unité de la race humaine présentée à tous, et c’était la négation même de la patrie terrestre. C’en était fini de l’antique notion de la patrie, de celle qui « effaçait quelquefois tous les sentiments naturels ». Elle avait accompli son entière révolution. Avec l’invasion des Barbares, elle disparut tout à fait.
LA RENAISSANCE DE L’IDÉE DE PATRIE.
Le monde vécut, durant tout le moyen âge, sans même connaître le mot de patrie. Il n’aurait correspondu alors à aucun besoin. La France romaine, féodale, royale, l’ignora.
« L’Europe dans le moment où elle commença de s’ébaucher, ne connut que des querelles de dynastie. » (Paul Reboux)
Brigandages seigneuriaux, brigandages royaux, conflits d’intérêts entre les puissants de l’heure, voilà toute l’histoire de ces temps-là. Règne de la force brutale, mœurs rudes, maîtres qui ne s’embarrassaient pas de sophismes pour voiler leurs desseins de rapine et de domination.
« La guerre de Cent ans ? Conflit entre la maison des Valois et la maison des Plantagenets. Jeanne d’Arc ? Une amazone rustique dévouée à son seigneur, une protectrice des paysans, ses frères, dépouillés par les bandes ravageuses des Anglais et des Bourguignons. Aussitôt les Anglais boutés hors du patrimoine royal, la bataille reprend, en France même, entre Français. La Gascogne, anglaise durant trois cents ans s’efforce de le rester, et Bordeaux accueille Talbot par des acclamations. » (Reboux)
Jeanne n’employa jamais le mot de patrie devant ses juges. Elle disait : pays. Ainsi, l’aventurière qui devait devenu cinq siècles plus tard « la Sainte de la Patrie. » ne sut jamais pour quelle véritable raison elle s’était battue.
C’est après qu’on le lui fit dire. Mais que ne fait-on pas dire aux morts ? Leur docilité permet de les accommoder à toutes sauces. En fait, patrie passa dans la langue française par le canal des humanistes de la Renaissance. Et, ici, qu’il nous soit permis de faire remarquer de quel poids va peser désormais sur nos sociétés modernes toute l’antique société. Pendant quatre cents ans on va s’appliquer à copier les anciens, à penser comme eux en toutes choses, à partager leurs erreurs et leurs crimes. Et, comme le dit Fustel de Coulanges, « l’une des plus grandes difficultés qui s’opposent à la marche de la société moderne est l’habitude qu’elle a prise d’avoir toujours l’antiquité grecque et romaine devant les yeux ». En ce qui nous intéresse, la néfaste idée de patrie va s’appesantir sur les cerveaux à tel point que, de nos jours, on va retrouver dans nombre d’esprits tous les errements de l’époque où régnaient en maîtres, dans les foyers, les dieux domestiques.
Un cuistre quelconque, nourri de latin, trouva donc le mot de patrie à sa convenance et introduisit le néologisme par la porte dérobée.
« C’est évidemment un mot de formation savante, c’est-à-dire non spontanée, ni populaire. On le chercherait vainement dans les monuments authentiques de notre langage au moyen âge, dans les chansons de gestes par exemple ». (Aulard)
À quel moment ce mot parut-il dans la langue ? On a prétendu qu’il fut prononcé aux Etats Généraux de 1483. L’examen attentif du journal de Masselin prouve qu’on ne le trouve nulle part dans ce document.
« Ménage dit que patrie n’était pas usité du temps de Henri II, vu que Charles Fontaine le reproche comme un néologisme à Du Bellay :
« Qui a païs, n’a que faire de patrie... »
Le nom de patrie est obliquement entré et venu en France nouvellement et les autres corruptions italiques. » (Quintil Horatian, p. 185.)
D’un autre côté, on a dit que patrie datait de François 1er. François 1er était un roi vraiment national ; c’est sous son règne, c’est au XVIe siècle que le mot patrie fut transporté de la langue latine dans la nôtre. A. de Saint Priest, Les Guises ; Revue des Deux Mondes, 1er mars 1850 (Littré). Le mot patrie ne parut donc que dans la première moitié du XVIe siècle. On le trouve :
« En 1539, dans le Songe de Scipion, traduit nouvellement du latin en français ; en 1554, dans la traduction des deux dialogues de Platon, par Etienne Dolet ; en 1545, dans Salel ; en 1546, dans Rabelais. » (Aulard)
Mais le mot ne dépassait pas un cercle restreint de lettrés. Il ne fit son chemin que peu à peu et, dans la seconde moitié du XVIe siècle seulement, il devint d’un usage courant, concurremment à pays. Il ne représentait cependant rien de précis. On n’entendait par là ni la France « unifiée » — ce qui est un vain mot — ni l’acceptation tacite par tous les Français de vivre sous le même prince — ce qui n’a jamais été. — Les luttes intérieures niaient justement la « patrie » telle qu’on se plaît à la concevoir de nos jours. « Tantôt, c’est la noblesse catholique qui fait appel aux Espagnols. Richelieu détruit La Rochelle. Turenne marche sur Paris à la tête d’une armée d’aventuriers. Condé, vainqueur de Rocroy dévaste les provinces du Nord » (Reboux). La patrie s’incarnait dans le roi. Lui seul était tout à la fois. C’était le sentiment de Bossuet qui disait que la patrie « est le prince, puisque tout l’Etat, est en la personne du Prince ». Mais la multitude miséreuse ne s’occupait pas de ces subtilités. Elle avait le souci de ne pas mourir de faim. Il faut arriver à la Révolution pour que l’idée de patrie pénètre dans le peuple et pour que celui-ci, tout vibrant de naïf enthousiasme, la fasse briller au firmament des éternelles duperies. Avec la force d’une religion nouvelle, l’idée de patrie va, en effet, d’un vigoureux élan, conquérir le monde.
LA PATRIE CRÉATION DE LA RÉVOLUTION.
La Révolution de 1789, comme toute véritable révolution, n’a été que l’aboutissement d’une longue évolution. L’ancien état de choses ne correspondant plus aux besoins nouveaux de la société, une organisation nouvelle devait s’imposer, nécessairement. Quelle allait être cette organisation ? Sur quelles bases idéologiques allait-elle s’appuyer ! Pouvait-on innover réellement ? Lorsque l’homme, pris dans le tourbillon social, est désemparé, il se tourne vers le passé pour y chercher du réconfort et des exemples. Thucydide, faisant parler Périclès (voir plus haut), n’avait-il pas demandé que « tous soient égaux devant la loi ?... etc). La cité antique fut la vieille fée qui présida à la naissance de la société nouvelle. Déjà, dès le XVIIe siècle, les mots de liberté et d’égalité avaient, auprès des cœurs justes et sensibles, une saveur particulièrement agréable ; et ceux qui souffraient d’exactions et de misère les chérirent plus que tout. Et puisqu’on parlait de patrie, on assista à l’éclosion de cette idée qu’il « n’y a de patrie que là où il y a liberté ». C’est l’époque où La Bruyère se permet d’écrire — sans grand danger, car l’autorité semblait établie sur le roc — : « Il n’y a point de patrie dans le despotisme ; d’autres choses y suppléent : l’intérêt, la gloire, le service du prince ». Et encore :
« Que me servirait, ... comme à tout le peuple, que le prince fut heureux et comblé de gloire, par lui-même et par les siens, que ma patrie fût puissante et formidable, si, triste et inquiet, j’y vivais dans l’oppression ou dans l’indigence. » (Du Souverain ou de la République, chapitre X.)
Puis vinrent les philosophes, les encyclopédistes, précurseurs des temps nouveaux. Témoins vibrants de l’injustice sociale, — nourris d’autre part des souvenirs de l’antiquité, — ils rêvaient un ordre social où dans la liberté et dans l’égalité, régnerait la « vertu » parmi les hommes. Leur idée était que « l’existence d’une patrie digne de ce nom suppose des lois, la liberté, l’abolition du despotisme » (Aulard). Ils s’emparèrent donc du mot patrie, le hissèrent au pinacle et il synthétisa toutes leurs généreuses aspirations ; après eux, le peuple l’adopta d’enthousiasme. Désormais la patrie vivait dans les cœurs comme Dieu vit dans celui des croyants. C’est Montesquieu qui écrit : « Ce que j’appelle la vertu dans la République est l’amour de la patrie, c’est-à-dire l’amour de l’égalité » (Esprit des Lois). C’est Voltaire qui dit :
« On a une patrie sous un bon roi ; on n’en a point sous un méchant. » (Diet. phil.)
Et Rousseau :
« La patrie ne peut subsister sans la liberté, ni la liberté sans la vertu ni la vertu sans les citoyens ; vous aurez tout si vous formez des citoyens ; sans cela vous n’aurez que de méchants esclaves, à commencer par les chefs de l’Etat. » (Article Economie politique dans l‘Encyclopedie)
Au fur et à mesure que se déroulèrent les événements révolutionnaires, les « patriotes », comme on disait, — c’est-à-dire la majeure partie des Français qui avaient bénéficié du changement de régime — crurent réellement que s’élaborait l’âge d’or. Les trois ordres « ces trois nations ont souvent exprimé et expriment souvent le sentiment qu’ils font partie d’une seule et même nation. La nation, la patrie, voilà leur mot de ralliement le plus fréquent » (Aulard). (Remarquer en passant la synonymie des mots : patrie, nation. Voir ce dernier mot.) Presque tous étaient persuadés de la prochaine disparition des classes sociales. La Liberté, L’Égalité, voilà la patrie nouvelle ! Les nobles de Touraine, par exemple, fiers de leur « patriotisme », déclarent dans leurs cahiers — sincèrement ou non ; mais qu’est-ce que cela leur coûtait ? — qu’ils sont « citoyens avant d’être nobles ». Le clergé aussi, dans son cahier au bailliage de Sens, proteste de son « zèle patriotique ». Le Tiers est prodigue du mot patrie qu’il identifie avec Royaume, France, Empire, Empire français, rarement pays. Le mot qui triomphe est Nation. (Aulard.) Des événements comme la nuit du 4 août contribuèrent à affermir cette idée que tous les Français, n’ayant qu’un intérêt commun, allaient vivre en frères. Et ici apparaît, pour la première fois, la notion de l’intérêt général, le puissant sophisme qui va avoir tant de prise sur les âmes et qui va être la base la plus sérieuse — en apparence — du sentiment patriotique. La Bourgeoisie, dans son triomphe, va s’en servir avec maîtrise, et longtemps la classe ouvrière se laissera berner par cette idée mensongère qu’au-dessus de son intérêt de classe il y a un intérêt suprême : celui de la patrie. A l’origine, il y avait certainement plus de naïve bonne foi que de duplicité à croire cela. On ne pouvait prévoir ni Napoléon, ni les sociétés anonymes, ni l’essor du capitalisme moderne. Aussi, un des premiers efforts de la Révolution fut-il d’« unifier » la patrie. Tous les obstacles qui s’opposèrent à cela furent brisés. « La patrie, après des vicissitudes et des contrariétés, se formera sans le roi, contre le roi, en République. » C’est l’époque des fêtes des Fédérations, des discours pompeux — à l’antique ! — des autels dressés à la Patrie déifiée. M. de Jougla, chevalier de Saint-Louis, s’écrie à la fédération de l’Aube, le 9 mai 1790 :
« Vivons comme frères !... Pensons sans cesse que nous sommes citoyens et frères, enfants et soldats de la patrie, Français en un mot. »
Certes, c’était sans rire que Faujas de Saint-Fond disait à son tour :
« La nouvelle division du royaume en départements fait disparaître ces limites féodales qui semblaient annoncer autant de peuples différents que de provinces ; elle a pour but de procurer à tous les mêmes lois, le même ordre de choses, les mêmes mœurs, et de nous réunir à jamais par le même amour de la patrie. »
Et ce brave commandant de la garde nationale de Grenoble, à Lyon, le 30 mai 1790, — M. Dolle — croit fermement que « c’est arrivé » ! :
« Amis et camarades, c’est maintenant que nous sentons avec délices combien il est doux pour des citoyens qui savent aimer la patrie de se réunir de toutes les parties de l’Empire pour ne former qu’une seule et même famille. Par l’heureuse influence de cette égalité, dont nous ressentons déjà les bienfaits, tous les départements du royaume contractent l’union la plus tendre, tous les citoyens deviennent des frères, et tous les bons Français, pénétrés des mêmes sentiments de patriotisme, n’auront bientôt qu’un seul désir : celui de chérir à jamais leurs lois et leurs rois. »
C’est l’embrassade générale ; c’est la paix perpétuelle entre les renards et les coqs, c’est le loup devenu mouton ; c’est la réalisation anticipée de la ronde de Paul Fort :
« ... Si tous les gâs du monde voulaient se donner la main ... »
À Plobsheim (Alsace), on vit les ecclésiastiques catholiques et protestants s’embrasser en public ; à Clamecy, le 27 mai 1790 « l’accolade fraternelle est reçue et rendue dans tous les rangs ». Mais le bouquet fut, sans contredit, la Fête de la Fédération au Champ de Mars à Paris : Tous les députés s’embrassèrent à l’envie. On cria : Vive le Roi ! Vive l’Assemblée Nationale ! Vive la Nation !
« La Fayette fut embrassé : les uns lui baisèrent le visage, les autres les mains ; d’autres, l’habit. Ce ne fut qu’avec beaucoup de peine qu’il parvint à remonter à cheval. Alors tout fut baisé : ses cuisses, ses bottes, les harnais du cheval et le cheval lui-même. » (Dans : Les Révolutions de Paris.)
La raison ? La Fayette venait de prêter serment sur l’autel de la Patrie !
L’illusion de la liberté et de l’égalité ; l’illusion de la démocratie par le suffrage universel ; l’illusion d’un intérêt commun unissant des hommes que le hasard a fait naître en un endroit délimité par ce qu’on appelle des « frontières », qu’on ose quelquefois qualifier de « naturelles » ; les carnages périodiques pour amalgamer le tout, et voilà la Patrie ! C’est l’héritage de la Révolution. Démocratie ? Citons encore Robespierre :
« Qu’est-ce que la Patrie — Si ce n’est le pays où l’on est citoyen et membre du souverain ? Par une conséquence du même principe, dans les Etats aristocratiques le mot patrie ne signifie quelque chose que pour les familles patriciennes qui ont envahi la souveraineté. Il n’est que la démocratie où l’Etat est véritablement la Patrie de tous les individus qui la composent, et peut compter autant de défenseurs intéressés à sa cause qu’il renferme de citoyens. » (Rapport du 18 pluviose An II.)
Défenseurs intéressés ? Aulard n’hésite pas à écrire :
« On peut dire que cette guerre (1870) a achevé la fusion des Français, l’unité morale de la France, consacré la patrie nouvelle, la patrie telle que la Révolution l’a faite. On a le sentiment que la récente guerre mondiale a cimenté à jamais cette patrie. »
Eh bien non ! Le dogme de la patrie est mortellement atteint.
La raison toute puissante l’a condamné depuis longtemps ; et l’on peut affirmer, au contraire, que la dernière guerre, par les souffrances qu’elle a semées, par les révolutions qu’elle a suscitées, par les conséquences économiques qu’elle a engendrées, a détruit l’idée de patrie en exacerbant les intérêts antagonistes qui opposent toujours les deux classes sociales : celle des possédants et celle des prolétaires.
QU’EST-CE QUE LA PATRIE ?
a) Le point de vue officiel.
En ces temps d’instruction laïque et obligatoire il n’est pas difficile de savoir ce qu’est la Patrie. Il suffit d’ouvrir un quelconque manuel « d’instruction civique et morale » à l’usage des perroquets de nos écoles primaires. Voici, par exemple, ce que dit un de ces catéchismes :
« Notre patrie, c’est la terre où sont nés nos parents, c’est le village que nous habitons, c’est la France entière avec ses grandes villes et leurs monuments, chefs-d’œuvre du génie national. Notre patrie est encore autre chose ; c’est une grande famille formée de citoyens libres, ayant la volonté de vivre ensemble librement, sans subir le joug de l’étranger. C’est l’ensemble de tous ceux qui portent le nom de Français et qu’unit la communauté de langue, de mœurs, de lois et de sentiments ; c’est l’histoire du pays avec ses gloires et ses revers, ses institutions successives et le souvenir de ses grands hommes. » (Cité par C.-A. Laisant)
Procédons méthodiquement et voyons si la patrie est bien tout ce qu’on nous dit dans l’extrait ci-dessus et dans quantité d’autres du même genre. Nous essayerons de n’omettre aucune des définitions données.
C’est la terre où nous sommes nés. — S’il en est ainsi, notre patrie se limite à bien peu de chose : un village, une ville, quelques arpents de terrain. Elle ne peut pas être à la fois Paris et Marseille, les montagnes de la Haute-Savoie et la lande bretonne. Certes, l’homme reste fidèle au petit coin de terre qui a vu ses premiers pas, mais cet amour du village natal n’expliquera jamais l’amour d’un vaste pays aux aspects divers et qui lui resteront quelquefois toujours ignorés.
C’est la terre des ancêtres. — Les ancêtres, qui est-ce ? Viennent-ils tout droit de Vercingétorix ou des Romains, des Francs, des Arabes, des Espagnols, des Autrichiens, etc... ? Etaient-ils catholiques, protestants, jansénistes, Jacques, chouans, révolutionnaires ? Les ancêtres ? J. Richepin est sans doute dans le vrai, qui dit : « On n’est fils de personne, on est fils du destin, qui mit un spermatozoïde aveugle dans l’ovaire. »
C’est le pays des gens de notre race. — Il faut être un Bazin pour affirmer des niaiseries dans le genre de celles-ci : « ...Les origines du peuple alsacien sont celtiques... Les dernières recherches accusent 70 % d’Alsaciens bruns, c’est-à-dire Celtes, contre 30 % d’Alsaciens blonds, c’est-à-dire Germains. » La race ! Ce mot n’a pas de sens. En ce qui concerne la France, nous lisons ceci dans l’Encyclopédie : « Le groupe linguistique latin ou roman qui comprend les Français du Nord, les Languedociens-Catalans, les Espagnols, les Portugais-Galego, les Italiens, les Romanches ou Latins et les Roumains, n’offre aucune unité de type physique, non seulement, dans son ensemble, mais même dans chacun des sept groupes secondaires que nous venons d’énumérer. Ainsi, parmi les « Languedociens-Catalans » on constate la présence de trois races au moins : occidentale ou cévenole, qui domine sur le Plateau Central en France ; littorale ou atlanto-méditerranéenne, prédominante en Provence et en Catalogne ; Ibéro-insulaire que l’on trouve dans l’Angoumois comme en Catalogne, etc. »
C’est la terre où l’on parle la même langue. — Cela ne tient pas. Il y a des Français qui ne parlent pas français (Alsaciens, Bretons, Provençaux, Basques, Corses, etc...). Les Suisses ont trois langues. Les Américains des Etats-Unis parlent anglais et ne portent pas toujours l’Angleterre en leur cœur ; de même les Irlandais. Voir aussi la République Argentine et l’Espagne ; le Brésil et le Portugal, etc…
C’est l’ensemble d’un territoire limité par des frontières. — Qu’est-ce qu’une frontière ? Une ligne de poteaux ne limite rien. Le Rhin unit les peuples plutôt qu’il ne les sépare. De même tout autre fleuve. De même la mer. De même une chaîne de montagnes. Paquebots, avions, tunnels, T. S. F. et l’on parle frontières ! Frontières variables avec la fortune des armes ou à la suite de marchandages diplomatiques qui font un Alsacien, Allemand ou Français ; un Polonais, Russe ou Allemand ; un Autrichien, Yougo-Slave, Tchéco-Slovaque, ou... sans-patrie ! Est-ce la frontière qui empêche que Guernesey ou Jersey soient françaises et la Corse italienne ?
C’est une sorte de communion d’idées, de sentiments, de goûts, de mœurs qui fait qu’on veut vivre ensemble. — Communion d’idées entre les catholiques et les protestants ? Mêmes sentiments les cléricaux et les libre-penseurs ? Les nationalistes et les communistes ? Mêmes goûts la cocotte de luxe et Mme Curie ? Mêmes mœurs, paysans et citadins, religieuses et prostituées, capitalistes et ouvriers ? Ah ! Plutôt mêmes idées, mêmes sentiments, mêmes goûts, mêmes mœurs, catholiques du monde entier et protestants, et communistes, et généraux, et prostituées, etc. On n’aime vivre qu’avec gens de son milieu. Qui se ressemble s’assemble.
C’est une association d’hommes formés selon les mêmes règles d’éducation. — D’abord, il y a une règle différente pour les riches (lycées, collèges, enseignement supérieur) et pour les pauvres (enseignement primaire). Il y a ensuite absence de règles pour ceux qui sont restés illettrés. Enfin, quel que soit le mode d’éducation, il y aura toujours des délicats et des mufles.
C’est un groupe d’êtres du même type avec défauts et qualités qui les caractérisent. — Le Français idéaliste, n’est-ce pas ? L’Anglais commerçant ; l’Allemand pratique, l’Italien fourbe — à moins que ce ne soit le contraire. Tout cela est bien conventionnel. Voilà un mode de penser en série qui dispense de penser. Est-ce que Tartufe n’est pas de tous les pays ? Et Harpagon ? Et M. Jourdain, et Boubourouche ? Et... ?
C’est l’héritage littéraire, scientifique, artistique légué par nos grands hommes. — Oui, la France de Montaigne, de Pascal, de Voltaire, de Hugo, de Pasteur. Sur cent Français, quatre-vingt-dix ne se sont assignés dans la vie que le profit, et se moquent de tout cela. C’est un héritage qu’ils laissent à d’autres — à des « étrangers » souvent — et puis, le génie de Montaigne, de Pascal, de Voltaire, de Hugo, etc., de même que celui d’Homère, de Socrate, de Shakespeare, de Wagner, de Tolstoï, de Marconi, etc. n’appartient-il pas à tous les temps et à tous les pays ? « L’univers est la patrie d’un grand homme » disait l’abbé Raynal. D’autre part il n’existe aucune similitude de pensée entre un Bossuet et un Proudhon, un Joseph de Maistre et un Hugo, par exemple ; il en existe, au contraire, entre Bossuet (Français) et le pape (Italien) ; entre Proudhon (Français) et Kropotkine (Russe). L’héritage littéraire, artistique, scientifique, n’est ni Français, ni Allemand, ni Anglais ; il est universel, il est humain.
C’est l’histoire du pays, avec ses gloires et ses revers. — L’histoire officielle sans doute. La belle histoire aux pages sanglantes, l’histoire des crimes. Quoi, la solidarité dans le meurtre ! La fierté de communier avec des assassins disparus ! Ah ! Quel est l’esprit sensé qui ne répudie ces « gloires » et ces « revers » ? Gloires, les victoires de Bouvines, de Marignan, de Rocroy, d’Austerlitz, de la Marne ; et revers, les défaites d’Alésia, de Waterloo, de Sedan ? Allons donc ! Est-ce que ces événements ont jamais influé sur le sort de l’individu qui n’a comme toute fortune que ses deux bras à louer au service d’autrui, autrement qu’en le privant parfois de l’usage de ces bras ? Gloire, le bien-être et la vie ; revers, la souffrance et la mort ; et c’est tout. Quant à l’histoire véritable, celle qui a opposé tout au long des siècles les riches et les pauvres ; celle qui se poursuit tous les jours dans la lutte des classes, elle est la négation même de la patrie.
C’est une association d’individus qui acceptent librement la même forme de gouvernement pour bénéficier de libertés égales. — Les faits sont en contradiction flagrante avec cette affirmation, on reconnaît là l’idée des philosophes et des révolutionnaires de 1790. On sent l’embrassade qui vient. Si tout le monde acceptait la même forme de gouvernement, la question sociale serait résolue. Quant aux libertés, on sait ce qu’il faut entendre par là : celles qui laissent le riche comme le pauvre libres « de coucher sous les ponts ou de voler du pain ». Il n’y a jamais eu d’acceptation unanime du régime. Il y a toujours eu opposition au plus grand nombre de lois faites par une minorité et au profit de cette minorité.
C’est Partout où l’on est bien. — La patrie n’est même pas cela ; car en quel lieu est-on bien ? En quel lieu n’est-on pas spolié d’une partie de son travail ? Où donc existe la justice ? « Ubi bene ibi patria ». Aphorisme hérité de l’antiquité — et sophisme — La patrie des Espagnols habitant Bordeaux par exemple n’est pas l’Espagne puisque la misère les a chassés de leur pays ; elle n’est pas la France lorsqu’ils n’y peuvent plus vivre. Devient-elle la République Argentine ou les Etats-Unis lorsqu’ils y émigrent ? Autant vaudrait demander où est la patrie du Juif errant.
C’est une grande famille où tous les membres ayant des intérêts communs, sont solidaires les uns des autres ; la patrie c’est notre mère. — Il n’y a pas d’intérêts communs dans la société actuelle. Il y a lutte, il y a bas égoïsme, il y a concurrence, il y a inégalité. Singulière famille — ou plutôt famille normale en effet — où l’on se querelle, où l’on se jalouse, où l’on désire ardemment la disparition du prochain pour jouir de sa fortune ; où l’on active autant que possible la mort du concurrent dans une lutte au couteau. Singulière famille où les uns sont rassasiés et où les autres ont faim ; où les uns travaillent et n’ont rien et où les autres ne font rien et ont tout. C. Bouglé dit cependant : « C’est de l’association que l’individu reçoit, non pas seulement le pain du corps, mais le pain de l’âme. En ce sens notre patrie est bien notre mère spirituelle ». (Encyc.). Pour le pain du corps, nous sommes fixés. Quant au « pain de l’âme », combien peu y goûtent ! Et pour ceux-ci ce « pain » est le trésor universel légué par l’humanité tout entière. G. Hervé écrivait naguère : « Les patries, des mères ? Allons donc, des marâtres cruelles que tous leurs fils déshérités ont le droit et le devoir d’exécrer. »
Nous ajouterons simplement ceci : Si toutes les vraies mères étaient comme la patrie, il y aurait longtemps que le genre humain aurait disparu de la planète.
b) Où donc est la patrie ?
Puisque nous n’avons pu trouver une définition satisfaisante de la patrie, puisque — comme pour Dieu — nous savons plutôt ce qu’elle n’est pas que ce qu’elle est, essayons de chercher ce que cache ce mot pour la majeure partie des individus.
Voltaire dit :
« Un juif a-t-il une patrie ?... Sa patrie est-elle Jérusalem ? Il a ouï dire vaguement qu’autrefois ses ancêtres, quels qu’ils fussent, ont habité, ce terrain pierreux et stérile et bordé d’un désert abominable, et que les Turcs sont maîtres aujourd’hui de ce petit pays dont ils ne retirent presque rien. Jérusalem n’est pas sa patrie. Il n’en a point ; il n’a pas sur la terre un pied carré qui lui appartienne. »
Nous trouvons aussi dans le Dictionnaire philosophique : « Les moines oseraient-ils dire qu’ils ont une patrie ? Elle est, disent-ils, dans le ciel ; à la bonne heure ; mais dans ce monde, je ne leur en connais pas. » Dans ce monde, la patrie des moines et des curés, c’est Lourdes, c’est Lisieux, c’est Rome, c’est le denier du culte, c’est le besoin de domination, c’est l’argent.
Où est la patrie du commerçant ?
« Le Banian, l’Arménien qui passent leur vie à courir dans tout l’Orient, et à faire le métier de courtiers, peuvent-ils dire, ma chère patrie, ma chère patrie ? Ils n’en ont d’autre que leur bourse et leur livre de compte. » (Voltaire)
« Le commerçant qui achète et vend des produits étrangers concurrençant ceux de sa patrie ne s’occupe point s’il nuit à des gens de même patrie que lui. Son intérêt seul le guide. Sa patrie, c’est son intérêt. » (Hamon)
Où est la patrie du soldat ? Celle du mercenaire ?
« Parmi nos nations d’Europe, tous ces meurtriers qui louent leurs services, et qui vendent leur sang au premier roi qui veut les payer, ont-ils une patrie ? Ils en ont moins qu’un oiseau de proie, qui revient tous les soirs dans le creux du rocher où sa mère fit son nid. » (Voltaire)
Où est la patrie des soldats de la Légion Etrangère ? Celle des engagés et des rengagés ? Elle est dans la solde ; elle est dans les primes, elle est dans leur intérêt.
« L’officier et le soldat qui dévasteront leur quartier d’hiver, si on les laisse faire, ont-ils un amour bien tendre pour les paysans qu’ils ruinent ? Où était la patrie du duc de Guise le balafré ? Etait-ce à Nancy, à Paris, à Madrid, à Rome ? Quelle patrie aviez-vous, cardinaux de La Balue, Duprat, Lorraine, Mazarin ? Où fut la patrie d’Attila et de cent héros de ce genre, qui, en courant toujours, n’étaient jamais hors de leur chemin ? Je voudrais bien qu’on me dît quelle était la patrie d’Abraham ? » (Voltaire)
Où est la patrie de l’industriel ?
« Il emploie des ouvriers étrangers parce qu’ils exigent un salaire moindre ; il agit conformément à son intérêt et nuit à des individus de même patrie. Sa patrie, c’est son intérêt. » (Hamon)
Où est la patrie du Comité des Forges ? Ces hommes « forment une féodalité si puissante, si ramifiée, si étendue, que les îlots féodaux de l’ancien temps ne lui sont en aucune façon comparables. Les Etats sont leur chose ; le monde entier leur proie. Magnats du Haut-Fourneau, Magnats des Charbonnages, Magnats des Grandes Compagnies de Transport, Magnats de la Banque : voilà les hommes qui règnent quelles que puissent être les formes gouvernementales que les peuples se donnent. » (Rhillon). N’allons pas parler patrie à ceux qui composent « l’internationale sanglante des armements ». Où est la patrie du financier « qui spécule à toutes les Bourses, qui agiote sur tous les fonds, préjudicie ceux de sa patrie imperturbablement, car, pour lui, la patrie est son intérêt personnel ? » (Hamon). Où est la patrie de ceux qui font voyager l’or de capitale en capitale, par avion, afin de mieux spéculer sur les monnaies nationales ? Leur patrie, c’est leur intérêt. Où est la patrie de l’agriculteur « qui fait imposer les produits étrangers, nuit aux individus de sa patrie, car il les oblige ou à se priver de ses produits ou à en réduire l’usage. Pour lui, la patrie est son intérêt personnel. » (Hamon). C’est l’intérêt de l’agriculteur qui fait la politique de la vie chère, qui hérisse le pays de barrières douanières, qui sème la misère parmi les prolétaires. Où est la patrie de l’inventeur « qui vend à l’étranger son invention utile ou nécessaire à la défense nationale, lèse les individus de la même patrie que lui. Il a pour patrie son seul intérêt. » (Hamon). Où est la patrie du politicien ? « Celui qui brûle de l’ambition d’être édile, tribun, rhéteur, consul, dictateur, crie qu’il aime sa patrie, et il n’aime que lui-même. » (Voltaire). Il n’est pas de plus ardent patriote allemand que l’aventurier autrichien Hitler. Où est, d’une façon générale, la patrie du possédant de celui qui, « directeur, administrateur, actionnaire d’une société industrielle, commerciale ou financière, vend des canons, des cuirassés, des obus, des poudres, qui prête de l’argent à des patries étrangères, n’agit pas en patriote, mais en individu soucieux de son seul intérêt ? Sa patrie, c’est son intérêt. » (Hamon)
Et maintenant, où est la patrie de ceux qui n’ont rien de ceux que nul intérêt ne pousse à s’abriter derrière ce paravent ? Nous pouvons affirmer que cette patrie n’existe pas. Nous avons, là dessus, l’aveu du plus cynique des politiciens (Clemenceau) :
« Après tout, les anarchistes ont raison ; les pauvres n’ont pas de patrie. » (Aurore, 17 janvier 1897)
G. Darien écrit dans son livre : La belle France, aujourd’hui — et, hélas ! depuis si longtemps ! — :
« La Patrie, c’est la somme des privilèges dont jouissent les richards d’un pays. Les heureux qui monopolisent la fortune ont le monopole de la patrie. Les malheureux n’ont pas de patrie. Quand on leur dit qu’il faut aimer la patrie, c’est comme si on leur disait qu’il faut aimer les prérogatives de leurs oppresseurs ; quand on leur dit qu’il faut défendre la patrie, c’est comme si on leur disait qu’il faut défendre les apanages de ceux qui les tiennent sous le joug. C’est une farce abjecte. C’est une comédie sinistre. »
Et La Mothe-le-Vayer disait déjà, en 1654, que la patrie était « une erreur utile et une tromperie nécessaire pour faire subsister les empires ou toute sorte d’autres dominations. » Pour les foules, cependant le mot et la chose existent, dira-t-on. Eh oui ! La sottise aux mille têtes grimaçantes a créé cette déité : La Patrie ; et les foules se prosternent devant elle. Elles croient à la Patrie comme elles croyaient à Jupiter, à Jéhovah, à Moloch... Mais hors de là, la patrie est inexplicable.
« Je dirai que la Patrie n’est point une division administrative et qu’il y a, dans ce qui la constitue, un élément divin, qui échappe à nos prises et déjoue nos calculs. » (René Bazin)
Voilà l’aveu. C’est aussi le sentiment de C. Bouglé, qui écrit :
« La supériorité de l’amour de la patrie c’est qu’il est irraisonné. » (Brunetiére)
Le patriotisme serait le meilleur exemple de ces « croyances » qui sont nécessaires au peuple sans qu’elles soient démontrables. Il rentrerait dans la catégorie des instincts sublimes qui dépassent et dominent l’intelligence. De ce point de vue, chercher pourquoi nous devons aimer la patrie, soumettre ce sentiment au raisonnement, ce serait peut-être une œuvre vaine et sacrilège. « Après cela il ne nous reste plus à nous, anarchistes, qui nions tous les dieux et nous gaussons des pirouettes de leurs thuriféraires, qu’à tirer l’échelle et à chanter avec Percheron :
Qu’ont inventés les égoïstes,
Que nous ont dorés les sophistes
Et dont se sont épris les sots.
(Les briseurs d’images)
IL N’Y A PAS DE PATRIE.
Depuis qu’il y a des hommes qui pensent, la patrie est jugée. Aussi, nous nous excusons, pour terminer, de citer quelques écrits résumant, à ce sujet, le sentiment des esprits indépendants de tous les temps et de tous les pays.
La Mothe-le-Vayer écrivait :
« Anaxagore montrait le ciel du bout du doigt, quand on lui demandait où était sa patrie. Diogéne répondit qu’il était cosmopolite ou citoyen du monde. Cratès le Thébain, ou le Cynique, se moqua d’Alexandre qui lui parlait de rebâtir sa patrie, lui disant qu’un autre Alexandre que lui la pourrait venir détruire pour la seconde fois. Et la maxime d’Aristippe, aussi bien que de Théodore, était qu’un homme sage ne devait jamais hasarder sa vie pour des fous, sous ce mauvais prétexte de mourir pour son pays. »
Nous lisons dans Montaigne (Essais liv. III chap. IX) :
« Non parce que Socrate l’a dit, mais parce que, en vérité, c’est mon humeur, et à l’aventure, non sans quelque tort, j’estime tous les hommes mes compatriotes et embrasse un Polonais comme un Français. »
Fénelon lui-même n’hésitait pas à proclamer que « chacun doit infiniment plus au genre humain, qui est la grande patrie, qu’à la patrie particulière dans laquelle il est né. » (Socrate et Alcibiade). Et Diderot :
« Vaut-il mieux avoir éclairé le genre humain qui durera toujours, que d’avoir ou sauvé ou bien ordonné une patrie qui doit finir ? » (Claude et Néron)
Lamartine, mieux inspiré dans sa Marseillaise de la paix que dans ses actes politiques, s’écriait :
« L’égoïsme et la haine ont seuls une patrie, la Fraternité n’en a pas. »
Et Tolstoï :
« Quand je songe à tous les maux que j’ai vus et que j’ai soufferts, provenant des haines nationales, je me dis que tout cela repose sur un grossier mensonge : l’amour de la Patrie. »
Ah ! Détestons ce mot de patrie ! Même quand il semble partir d’un bon sentiment, méfions-nous ! Derrière lui, il y a toujours l’esprit religieux qui sommeille. “Patrie des Travailleurs” disent les communistes en parlant de l’U. R. S. S. Ne sentez-vous pas l’hydre renaître dans ces quelques mots ? “Patrie Humaine” ! Proclament de bons camarades. Oui, certes, mais pas avant que soit à jamais abolie cette monstruosité sociale (au siècle où la machine est susceptible de libérer l’individu) : l’exploitation de l’homme par l’homme. Et en conclusion, nous ne pouvons mieux faire que de reproduire la belle page de Charles Albert, toujours d’actualité :
« Quand les bourgeois nos maîtres actuels s’emparèrent du pouvoir, il y a plus d’un siècle, ils savaient très bien que la religion, c’est-à-dire le fanatisme, était un excellent moyen de gouverner les hommes. Aussi s’empressèrent-ils de remplacer le fanatisme Dieu qu’ils avaient eux-mêmes à peu près ruiné par le fanatisme Patrie. Quand nous sommes encore tout petits on nous inculque avec beaucoup de soin l’amour de la patrie. Mais on a bien soin que ce mot ne corresponde à rien de précis, qu’il soit pour nous quelque chose d’indéterminé et de vague. C’est l’idole terrible et mystérieuse à laquelle on nous ordonne de tout sacrifier, sans que nous puissions comprendre pourquoi. A grand renfort de tirades enflammées, on nous rend esclaves d’un mot, d’un mot vide de sens. On pourra ensuite faire dire à ce mot tout ce que l’on voudra, abriter derrière lui tout ce qu’on aura besoin d’y abriter. On n’aura plus qu’à le prononcer pour nous conduire à toutes les aventures, pour nous faire absoudre tous les crimes. Et c’est ce qui est arrivé.
« Au moyen du mot patrie on nous berne et on nous gruge, on nous asservit et on nous abrutit, on nous malmène et on nous affame, de père en fils, depuis plus d’un siècle. Il n’y a pas d’infamie ou de cruauté, d’affaire véreuse, de programme menteur, d’institution oppressive qui n’ait eu ce mot pour devise. C’est pour la patrie qu’on nous enferme, pendant trois ans, dans une véritable prison : la caserne, quand on ne nous fait pas crever d’insolation sur un champ de manœuvre ou mitrailler sur un champ de bataille. C’est pour la patrie que tous les aigrefins avides de notre argent prétendent nous l’extorquer ; pour la patrie qu’on nous courbe, des douze et quatorze heures durant, sur un labeur de bêtes en échange d’un salaire de famine. Si des riches veulent nous prouver que nous devons éternellement rester pauvres, si des forts veulent nous démontrer qu’il faut nous résigner à demeurer faibles, c’est toujours l’intérêt de la patrie qu’ils invoquent. N’est-ce pas le mot en vedette sur les affiches où des candidats nous promettent les mêmes réformes que leurs pères promettaient déjà à nos pères, leurs grands-pères à nos grands-pères ? N’est-ce pas le mot qui ronfle dans tous les boniments où l’on a la politesse de nous expliquer comme quoi, nous autres prolétaires, sommes les éternels vaincus, les éternels sacrifiés ? Et, jusqu’ici, hélas, ce mot eut toujours raison. Raison de notre bon sens, raison de notre honnêteté. Il triompha et triomphe comme par enchantement de nos répugnances et de nos scrupules. Quelqu’un vient-il à nous au nom de la liberté, de la justice, au nom de nos intérêts immédiats et de nos besoins les plus pressants, nous gardons contre lui un fonds de méfiance. Mais nous suivons sans explication, au bout du monde, le premier aventurier venu, s’il sait se servir du mot magique. Tant que cette religion imbécile de la patrie continuera à nous en imposer, c’est-à-dire tant que nous n’aurons pas vu clair dans le jeu de ses prêtres, nous serons encore des esclaves. Voilà assez de mensonges, d’absurdités et de quiproquos. Il est temps d’en finir avec cette comédie sinistre. Aux gens qui viennent nous dire à tout propos : « la patrie exige, le pays réclame », il est temps de fermer la bouche une fois pour toutes. La patrie c’est nous-mêmes, ou bien ce n’est rien du tout. Or, personne ne peut savoir mieux que nous-mêmes ce qu’il nous faut. »
— Charles BOUSSINOT.
PATRIE
L’idée de patrie est relativement jeune dans l’histoire de l’humanité. Les Chinois de l’époque ancienne ne l’avaient pas. Leur sentiment n’allait pas au-delà du clan familial qui pouvait comporter cent personnes et plus. On trouve l’idée de patrie dans l’antiquité gréco-romaine ; à Sparte, à Rome. Il faut remarquer que ces cités sont édifiées sur l’esclavage. Le citoyen, même pauvre, ne travaille pas, il est entretenu tant bien que mal par la cité ; seuls, les esclaves travaillent. Aussi le citoyen, même plébéien, tient-il à sa patrie, c’est d’elle qu’il tire son existence ; il est donc disposé à la défendre. Mais c’est surtout l’aristocrate qui est patriote. Horace est un patricien. Aussi le vieil Horace sacrifierait volontiers la vie de ses enfants pour que Rome ne soit pas sujette d’Albe. Si Rome perd sa puissance, lui-même n’est plus rien.
La Féodalité ne connaît pas la patrie au sens que nous lui donnons. Le seigneur gouverne son domaine et il ne se fait aucun scrupule de combattre le roi. Le vassal, le serf, sont les hommes du seigneur ; sans doute ils l’aiment en quelque manière, ils le suivent à la guerre ; en échange, ils en reçoivent ce qui est nécessaire à leur subsistance.
C’est la Révolution française qui démocratise l’idée de patrie. Elle sous-entend un ensemble d’institutions et de lois supérieures à celles du reste du monde et qui rendent la qualité de français enviable. La patrie s’oppose au roi, tout au moins au roi absolu. On veut défendre en elle les conquêtes récentes de la révolution que ne manquerait pas de détruire une nation monarchiste, victorieuse de la France républicaine dans une guerre. Mais en associant le peuple à l’idée de patrie, la bourgeoisie le trompe. C’est elle qui, en fin de compte, bénéficie des conquêtes de la Révolution ; liberté de pensée, égalité devant la loi, accession du non noble aux emplois dirigeants, le peuple ne profite guère du nouvel ordre de choses. Le souci quotidien de sa nourriture et de son logement, le travail long et fatigant ne lui permettent pas de profiter de la liberté de penser. Son ignorance, son ambiance, sa fatigue ne lui permettent pas de penser, il ne peut que répéter la pensée des autres. Quant à l’égalité devant la loi, cela non plus ne veut pas dire grand’chose. S’il vole, il est sûr d’aller en prison, et la loi ne lui sera pas paternelle. Cependant le peuple de la Révolution française s’emballe pour l’idée de patrie, c’est qu’il croit que le nouvel ordre de choses apportera une amélioration à son sort. Il sera vite déçu, voyant d’autres hommes remplacer les anciens dans les situations privilégiées et sa misère rester la même. Il ira à la guerre contraint par la conscription ou poussé par la faim, mais il laissera s’établir l’Empire premier et second, convaincu que ces changements de régime sont des affaires de Grands, qui ne le concernent pas.
L’école primaire, de nos jours, a réussi à implanter l’idée de patrie au cœur du peuple. Moins profondément qu’il ne paraît. S’il n’y avait pas la crainte du gendarme, du conseil de guerre et du poteau d’exécution, bien peu de Français obéiraient à l’ordre de mobilisation. Le patriotisme se manifeste surtout par son côté agressif. L’ouvrier français déteste l’ouvrier étranger qui vient le concurrencer sur le marché du travail. Sans réfléchir, il injurie aussi le bourgeois qui parle une langue qu’il ne comprend pas, mais qui, il l’oublie, apporte son argent. La patrie reste, au fond, la chose des classes dirigeantes. C’est à elles que l’on pense lorsqu’on dit que la France s’enrichit, qu’elle a des intérêts dans telle colonie, dans tel pays étranger. Les milliards qui, en ce moment, remplissent les caves de la Banque de France, n’empêchent pas l’ouvrier d’être jeté à la rue, faute d’avoir pu payer son propriétaire.
L’idée de patrie cependant connaît, en ce moment, sa période de déclin. La dernière guerre, les ravages qu’elle a faits, les trônes renversés ou ébranlés, le bolchevisme, ont fait réfléchir une partie des classes dirigeantes et celle-ci se demande si, au lieu d’opposer les patries les unes aux autres, il ne vaudrait pas mieux les fédérer, afin d’écarter la guerre qui est un crime, mais qui est surtout un crime qui ne paie pas.
Quel sera le rôle de la Société des Nations ? On ne saurait le prédire. Certes, il y a des volontés de paix parmi les classes dirigeantes d’Europe. Mais il y a aussi bien des causes de guerre. On a dit, avec raison, qu’on a supprimé une Alsace-Lorraine pour en faire vingt autres. L’épée des vainqueurs a tranché dans la carte d’Europe, exacerbant les peuples d’être rattachés là où il ne leur plaît pas. Grisés de leur victoire, ils ont voulu fouler le vaincu, l’humilier sans vouloir réfléchir qu’une grande nation ne reste pas indéfiniment sous la botte.
Les partis d’avant-garde ont combattu avec raison le patriotisme. Il n’y a pas de quoi être fier d’être Français plutôt qu’Allemand ou Turc, puisque c’est l’effet d’un hasard qui, nous faisant naître à Paris, aurait pu nous donner le jour à Berlin ou à Constantinople. Quant à aller risquer de se faire tuer et tuer les autres pour que Guillaume ou un quelconque président aient la victoire, c’est une stupidité.
L’élite du peuple comprend cela, mais dans son ignorance elle est facilement suggestible. On l’a bien vu en 1914. Les mêmes hommes qui avaient crié ; « A bas la guerre ! » criaient, à six mois d’intervalle : « A Berlin ! »
Dans ce revirement, il n’y avait pas que de l’ignorance, il y avait de la peur. Parce que le prolétariat n’a pas compris qu’il est la force et que, s’il le voulait sérieusement, aucune guerre ne se ferait.
— Doctoresse PELLETIER.
PATRIOTISME, PATRIOTE
I. LE PATRIOTISME — Ce qu’il est.
La Châtre le définit :
« L’amour de la patrie mis en action. »
Le Larousse :
« Vertu du patriote, amour ardent de la patrie. »
Et il ajoute, citant Mme L. Collet :
« Le patriotisme est comme la foi, il aide à mourir. »
D’après ce que nous savons déjà de la patrie, nous disons : le patriotisme est la religion de la patrie — comme le christianisme est la religion du Christ. De même que chaque croyant nous présente sa religion comme la seule bonne, la seule naturelle, la seule nécessaire, la seule digne d’être embrassée, de même l’on nous montre le patriotisme comme un sentiment profond de l’être humain et comme le facteur indispensable à l’épanouissement total de l’individu. G. Bouglé (Encyclopédie) dit :
« L’amour de la patrie nous paraît à la fois naturel et nécessaire, si bien que l’antipatriotisme nous étonne encore plus qu’il nous indigne. »
Naturel, le patriotisme ne le paraît qu’autant que la patrie paraît aussi « naturelle ». Naturel, le patriotisme étroit et exclusif des Grecs et des Romains, lorsque la patrie se réduisait à la « terre des pères ». Mais inexistant lorsque le dogme de la patrie n’existe pas dans l’imagination des hommes, inexistant pendant tout le moyen âge ; inexistant aujourd’hui dans les pays non encore touchés par le virus ; mais naissant, mais se développant au fur et à mesure qu’on l’insinue dans les cœurs ; toujours artificiel :
« Le patriotisme n’est pas un instinct, mais un sentiment factice, postiche, qu’on enseigne, qu’on crée dans les esprits qui en étaient dépourvus, que l’homme n’apporte nullement avec lui, comme on osait le dire, mais dont il est merveilleusement indemne en naissant. » (Pierre Scize, Le Canard Enchaîné, nov. 1931.)
Il n’y a jamais eu de patriotisme spécifiquement algérien, congolais, sénégalais, soudanais, lapon, etc. Mais il existe cette monstruosité : un patriotisme français de la part d’Algériens de Sénégalais, de Martiniquais, de Malgaches, pauvres diables qui se disent attachés à la « mère patrie ». Mais il y a, naissant, le patriotisme indochinois, par exemple, un patriotisme sucé aux sources pures et qui se retourne contre l’autre, celui de nos maîtres, le bon. Et voici l’aveu ingénu qu’a fait récemment Mme Andrée Viollis :
« D’autre part, l’instruction que nous avons donnée aux jeunes Annamites a été beaucoup trop rapide et, pour tout dire, assez maladroite. Nous leur avons imprudemment inculqué la notion de la patrie — qu’ils ignoraient avant nous. Nous leur avons vanté la gloire de Jeanne d’Arc qui bouta l’Anglais hors de France. Ils ont immédiatement pensé qu’il serait héroïque et méritoire de chasser l’envahisseur — le Français — hors de l’Indochine. » (Le Petit Parisien)
Est-ce que l’instruction donnée aux jeunes Français ne serait pas aussi « maladroite » — ou plutôt trop adroite ? Est-ce que nos écoles, laïques et autres, n’inculqueraient pas « imprudemment la notion de la patrie » ? Est-ce que chaque nation ne procéderait pas au bourrage de crânes intensif pour dresser les jeunes esprits dans « l’amour ardent de la patrie » ? Mais, si le patriotisme n’est pas naturel, peut-être est-il nécessaire ? Et ici nous demanderons : à qui peut-il être nécessaire ? Nous avons vu que la patrie n’est rien pour la masse des prolétaires. En conséquence, le patriotisme ne peut être nécessaire qu’à la classe possédante « qui y trouve un intérêt de premier ordre, un intérêt vital ». (G. Hervé.)
Le grand mensonge de la patrie, abrité derrière l’axiome de l’intérêt général est d’une utilité impérieuse pour le capitalisme.
« Le patriotisme masque, en chaque nation, l’antagonisme de classe au profit de la classe dirigeante, par là il prolonge et facilite sa domination. » (G. Hervé)
Nécessaire pour créer l’illusion de la solidarité nationale, pour unir les pauvres aux riches, — dans l’intérêt exclusif de ceux-ci, — le patriotisme est la base de cette « union sacrée » qui s’établit au moment où il s’agit, pour le prolétaire, d’accepter les plus terribles sacrifices. Comprenez-vous toute l’immense duperie qui se cache derrière ces lignes de C. Bouglé : « L’amour de la patrie semble être aujourd’hui la seule chose capable de réduire au silence, quand il le faut, les passions les plus violentes, comme celles qui divisent les habitants d’un même pays en partis politiques. Nul autre sentiment n’est plus de taille à lui tenir tête. Lui seul est capable, quand la patrie est en danger, de séparer le fils de la mère, l’époux de l’épouse, et de mettre l’épée à la main de ceux mêmes qui ont juré de ne pas tuer. Les devoirs les plus pressants, qu’ils aient pour but la conservation de l’unité familiale ou l’observation de préceptes religieux, le cèdent ainsi au devoir envers la patrie, suprématie garantie tant par l’opinion que par les institutions publiques. Au patriotisme on reconnaîtra le droit de nous demander le sacrifice absolu de notre personnalité ; et nous devrons la sacrifier joyeusement. « Mourir pour la patrie est le sort le plus beau » ».
Nécessaire, le patriotisme l’est encore en ce sens qu’il :
« Sert de prétexte à l’entretien de formidables armées permanentes, qui sont le soutien matériel, le dernier rempart des classes privilégiées. Le prétexte, le seul but avouable et avoué de l’armée, c’est de défendre la patrie contre l’étranger ; mais une fois revêtu de la livrée de la patrie, quand le dressage de la caserne a tué en lui toute intelligence, toute conscience de ses intérêts, l’homme du peuple n’est plus qu’un gendarme au service de ses exploiteurs contre ses frères de misère ». (G. Hervé)
Nécessaire, le patriotisme l’est toujours aux industriels, à la Haute Banque, aux rapaces internationaux. Par les conflits armés qu’il suscite (guerres continentales ou brigandages coloniaux), il fait vivre cet ogre avide de chair fraîche et de profits ; le capitalisme. Ce sont les produits qui se vendent, les “ affaires ” qui marchent, Fer, pétrole, céréales, produits chimiques, canons et munitions, s’écoulent selon un rythme accéléré. Ce sont les prolétaires, ces éternels mécontents, qui succombent dans la mêlée, moutons égorgés sous le couteau du boucher. Double profit pour les bergers.
« Pour les classes dirigeantes, quelle mine d’or que le patriotisme, mais aussi quel attrape-nigaud pour les peuples ! » (G. Hervé)
Le patriotisme n’étant ni naturel, ni nécessaire à tout le monde, pour mieux le faire accepter on nous le montre aussi sous son côté mystique. Nous ne citerons qu’à titre documentaire le point de vue de ces rhéteurs — valets du pouvoir, s’ils sont complices — toqués s’ils sont sincères. « Les fins que nous pouvons nous proposer sont d’autant plus hautes qu’elles participent davantage de l’éternel », dit Boutroux, et Bouglé d’adapter cette formule au patriotisme et de parler de « dévouement accepté », de la « mission » des patries. L’une se vantera d’être la terre classique des beaux-arts, l’autre du commerce, de la libre entreprise, du self-government ; celle-ci de la pensée claire ; celle-là de la pensée profonde. Et chacune déduira de la forme déterminée du bien ou du beau qu’elle est chargée de représenter, des raisons spéciales d’être aimée et préférée. Ainsi, des raisonnements, partant de ce principe que tel ou tel idéal est supérieur aux autres, justifieront non pas seulement le patriotisme en général, mais tel patriotisme en particulier.
Ces raisonnements varieront naturellement avec les nations ; et, suivant la nature de l’idéal qu’elles auront choisi, il leur sera plus ou moins facile de concilier les sentiments qu’elles veulent inspirer avec les prescriptions de la morale universelle des temps modernes ; avec les exigences de l’individualité et de l’humanité. Pour nous, Français, il semble bien que la conciliation soit aisée, si nous nous attachons aux traditions qui, de l’aveu de tous les peuples font notre gloire. La noblesse de notre Révolution nous oblige ; nous devons être les représentants et comme les gardiens du rationalisme.
« Notre patriotisme se confond avec la raison des temps modernes. » (Lavisse)
Nous ne pouvons mettre notre gloire à subjuguer ou à exploiter les peuples, mais seulement à les libérer.
« La France est la patrie du droit. » — « La France est la patrie de l’espérance. » — « Tout homme a deux patries, la sienne et la France. »
Ces formules que les peuples ont répétées doivent nous rappeler que l’originalité de notre mission historique est l’universalité même de nos idées. Parce que notre patrie a proclamé par le monde la liberté des individus et la fraternité des peuples, l’amour de notre patrie est sans doute celui qui s’accorde le mieux avec le respect de la personne et le culte de l’humanité. Les idées rationalistes, individualistes et humanitaires, voilà l’âme de la patrie française. Et, c’est au culte de ces idées que nous devons veiller, avec un soin jaloux, si nous voulons conserver à notre nation sa tradition, sa gloire, sa raison d’être.
Que de mots ! Que d’idées conventionnelles ! Quelle accumulation de mensonges et d’âneries ! Que de sophismes pour mieux duper les individus ! Quelle est « cette morale universelle des temps modernes », celle de Pie XI, ou celle des profiteurs de la dernière ? Où sont les « gardiens du rationalisme » ; les héritiers « des quarante rois qui, en mille ans, firent la France », ou bien les partisans de « la dictature du prolétariat » ; ou encore M. Poincaré ? Quant « à subjuguer ou à exploiter les peuples », il est évident que la France répudie ces honteuses pratiques ! Et Clairvaux a justement été fait pour la plus grande « liberté des individus ». Comédiens qui dressent le décor derrière lequel s’abritent les Hauts-Fourneaux et le coffre-fort ! Et quelle tromperie pour que les foules acceptent sans protestations ni murmures, les sanglants holocaustes ! « Le patriotisme, disait G. Darien, n’est pas seulement le dernier refuge des coquins ; c’est aussi le premier piédestal des naïfs et le reposoir favori des imbéciles. »
L’ECLOSION DU PATRIOTISME FRANÇAIS.
À la suite de l’explosion révolutionnaire de 1789, alors que l’ordre nouveau se bâtissait sur les débris de l’ancien régime, on s’imagina qu’une ère de liberté et de bonheur universel allait s’ouvrir. C’est la « patrie » qui synthétise toutes les aspirations généreuses de l’époque ; et on assiste à l’éclosion du patriotisme français, à son rapide épanouissement, à sa floraison triomphale. C’est d’abord l’Assemblée Constituante qui donne la formule patriotique : la Nation, la Loi, le Roi. Puis les événements se précipitent ; l’absolutisme royal sombre avec la Bastille, les grandes propriétés nobiliaires et ecclésiastiques sont abolies, les cens, corvées, tailles, sont supprimés, les privilèges disparaissent.
Après la nuit du 4 août, « le patriotisme électrise toutes les âmes » (Barère, dans son journal Le point du jour). Les prolétaires n’avaient pas eu le temps de s’apercevoir que le plus clair des conquêtes de la révolution allait passer au bénéfice de la bourgeoisie.
Ils ne s’attachaient qu’aux apparences ; mais comme elles étaient belles ! Il semblait qu’on sortait d’une longue nuit de souffrances et d’horreur et que l’aurore se levait enfin, pleine de promesses et de vie ; l’aurore libératrice, telle qu’on l’avait entrevue en rêve… plus belle même, si possible, puisqu’elle apportait avec elle la liberté, l’égalité, la fraternité ! Jamais les hommes n’avaient vibré de tant d’espérance ; jamais l’avenir ne s’était montré si plein de magnifiques promesses ! Et voici que soudain, les forces du passé se redressent, menaçantes. Les rois se coalisent contre la révolution. Va-t-il falloir renoncer aux superbes moissons entrevues ? Va-t-il falloir reprendre les antiques chaînes du servage ? Jamais ! répond Jacques Bonhomme. Et c’est « la Patrie en Danger ».
En ces heures de vie intense, le patriotisme va se manifester sous mille formes diverses. Il faudrait se garder de croire cependant à sa spontanéité. On le cultiva jusque dans les couches les plus déshéritées de la paysannerie. On créa la psychose du patriotisme ; sans réussir partout pour cela (Vendée). Et il est piquant de constater comment l’ancienne religion (par la majeure partie de son clergé) aida la religion nouvelle à faire ses premiers pas : « Nombreux, dit Aulard, furent, dans les villages, les curés patriotes qui prêchèrent la patrie nouvelle, la patrie révolutionnaire. On se demande quelquefois par où l’esprit du siècle pénétra dans l’âme fermée et obscure des paysans ignorants : la prédication chrétienne propagea le grand mouvement philanthropique que les philosophes avaient formulé, prépara la démocratie. Ces curés éclairés rendirent les paysans patriotes. » Le patriotisme est né à l’ombre des sacristies. Il a grandi avec rapidité, il est devenu la foi nouvelle, la foi dévorante qui parfois chasse l’antique foi, comme le christianisme avait remplacé dans les cœurs païens les dieux démodés ; mais qui, parfois, la complète, la coudoie, l’étaye, dans une même complicité.
Religion, il a sa forme religieuse dès ses premières manifestations vitales. On dresse des autels de la patrie dans toutes les villes, dans tous les villages. Désormais, il y a deux cultes : le culte de la patrie et le culte catholique. Frères ennemis ? Il semblerait :
« Ce n’est point à l’église que se dresse l’autel, c’est sur une place de ville ou dans une prairie. »
Cependant, s’il pleut, on va à l’église. Et l’assistance est tout à fait édifiée. Aulard poursuit :
« Il parut à toute l’Assemblée que la divinité l’avait obligée, par le mauvais temps, à se former dans son temple pour y réunir son autel à celui de la patrie, et y rendre encore plus sacré le serment qui allait se prononcer. »
C’est bien l’union : christianisme-Patriotisme qui s’opère. Mariage de raison, comme au temps où Rome faisait une place d’honneur aux dieux étrangers qu’on lui présentait, le christianisme pour ne pas succomber accepte le partage des âmes.
« Ces deux autels ne sont pas ennemis, et les deux religions la nouvelle et l’ancienne, gardant chacune son existence distincte dans le cœur comme dans la réalité s’offrent au public en une attitude de concorde. » (Aulard)
Et c’est vraiment touchant cette célébration du culte nouveau par toute la clique ensoutanée (sauf une partie du haut clergé). À Paris, la messe est célébrée sur l’autel de la patrie. À Saint-Dié l’évêque, M. de Chauniont, participe « à la cérémonie du serment » et chante lui-même un Te Deum. À Sainte-Foy (Gironde), un moine récollet s’écrie :
« Aujourd’hui d’un bout de l’Empire à l’autre, l’union, la paix l’amour de la patrie, règnent parmi les Français », etc…
Mais voici la guerre. Guerre sainte que commande le dieu nouveau : Patrie. « La patrie est en danger », formule liturgique qui va envoyer à la mort « une Jeunesse Ardente et Vigoureuse », comme porte une estampe de l’époque. Et Hérault de Séchelles déclare à l’Assemblée :
« Enfin, Messieurs, il faut se pénétrer d’une réflexion décisive. C’est que la guerre que nous avons entreprise ne ressemble en rien à ces guerres communes qui ont tant de fois désolé et déchiré le globe : c’est la guerre de la liberté, de l’égalité, de la Constitution, contre une coalition de puissances d’autant plus acharnées à modifier la Constitution française qu’elles redoutent chez elles l’établissement de notre philosophie et les lumières de nos principes. Cette guerre est donc la dernière de toutes entre elles et nous... »
La dernière des guerres ! Déjà ! Et le Dieu a toujours soif.
S’il faut en croire Jaurès, de véritables accès de religiosité s’emparèrent des êtres, et surtout des adolescents et des femmes. On fit tout d’ailleurs pour obtenir ce résultat. Lors des enrôlements civiques, on ne négligea rien pour frapper les imaginations : coups de canon, rappels dans les quartiers, cortèges avec enseignes et couronnes civiques avec inscriptions, mises en scène théâtrales, amphithéâtres avec banderoles tricolores et couronnes de chêne, pièces de canon, musique, etc. « La jeunesse était électrisée ». Un officier qui amenait 78 adolescents de la section des Quatre-Nations s’écriait :
« Si je n’avais consulté que les apparences, la taille de quelques-uns se serait opposée à leur admission ; mais j’ai posé ma main sur leurs cœurs et non sur leurs têtes ; ils étaient tout brûlants de patriotisme. »
Ne sommes-nous pas tentés, malgré tout, de penser : pauvres gosses ! N’avons-nous pas entendu, pour notre malheur, d’autres patriotes professionnels proférer de semblables affirmations ? Il n’est pas difficile, certes, de faire s’entre-tuer les hommes lorsqu’on a réussi à leur persuader qu’une entité métaphysique quelconque l’exige, au nom d’un soi-disant intérêt supérieur. Alors, leur vie même ne compte plus. Et ce furent les offrandes à la divinité « des dons patriotiques qui affluaient, des lettres chargées d’assignats, des bijoux, des bracelets ». Ce furent aussi des réunions de femmes dans les églises pour « travailler aux effets d’équipement, aux tentes, aux habits, à la charpie ». Jaurès les trouve admirables ces femmes qui viennent « ennoblir leurs mains au service de la patrie ». Sans doute, patrie signifiait liberté, mais on se payait de mots. Economiquement, on se forgeait d’autres chaînes ; politiquement, on frayait la route à Napoléon. Car le souffle révolutionnaire était un souffle imprégné d’esprit religieux, et cela se comprend : trop longtemps les prolétaires s’étaient agenouillés devant les autels, trop longtemps ils avaient adoré, trop longtemps ils s’étaient sacrifiés, en imitation de celui qui était mort sur la croix, pour que, d’un coup, leur seule raison jugeât sainement des choses, pour qu’ils vissent, de prime abord, où était leur véritable intérêt. Les femmes se donnaient tout entières à la patrie, comme elles s’étaient données naguère au Christ-Roi. Et quand la raison abdique, nous ne trouvons pas cela si admirable. La grandiloquence du verbe ne nous cachera jamais la réalité de la vie. Jaurès écrit :
« Parfois, un homme entrait, un révolutionnaire du bourg ou du village, et il haranguait ces femmes, il les conviait à la constance contre les périls prochains, à l’héroïque courage. Mères, c’est la patrie qui est la grande mère, la patrie de la liberté !
« Parfois celui qui leur avait parlé d’abord familièrement, presque du seuil de l’église où l’avait appelé une clarté, gravissait à la demande des femmes, les degrés de la chaire. Et, pour aucune de ces femmes restées pourtant presque toutes chrétiennes, il n’y avait là ironie ou profanation. Une harmonie toute naturelle s’établissait dans leur âme entre les émotions religieuses de leur enfance et de leur jeunesse, douces encore au cœur endolori, et les hautes émotions sacrées de la liberté, de la patrie, de l’avenir. Mais celles-ci étaient plus vivantes. Si le prêtre s’insurge contre la liberté, que le prêtre soit frappé ; si la religion ancienne tente d’obscurcir la foi nouvelle, la foi à l’humanité libre, que la vieille religion s’éteigne, et que la lampe mystique soit remplacée dans l’église même par la lampe du travail sacré, celui qui vêt, abrite, protège les défenseurs de la liberté et du droit. »
N’est-ce pas là cet état d’hystérie collective qui pousse aux grandes aberrations ? Ne sont-ce pas des croyants ceux qui sont décidés à briser tout ce qui s’oppose au triomphe de leur foi ; ceux qui sacrifient tout ce qui, d’ordinaire, fait le bonheur des individus ? En ce temps-là, « les mères offraient leurs fils à la patrie « ! Ainsi Abraham sacrifiait Isaac à son dieu. Mais peut-être n’y a-t-il que les sages pour concevoir toute la monstruosité de pareilles attitudes.
Cependant le patriotisme s’étalait partout. On le trouvait jusque sur les objets les plus inattendus. Il y eut des « faïences patriotiques nivernaises », aux curieuses images. Ici, c’est un coq perché sur un canon. « Je veille pour la nation » ; et là, ce sont des drapeaux, des arbres de la liberté, des bonnets phrygiens, « le bonnet de la liberté » des instruments aratoires, des balances « la Loi et la Justice ». Partout des inscriptions où reviennent surtout les mots : La Liberté, la Nation, l’Agriculture, la Montagne, la Convention, la République Française ; mais aussi : le Père Duchêne 1792, aimons-nous tous comme frères 1793, la reproduction d’un « assignat de dix sols », et un couplet de la Carmagnole ! Il y eut des encriers patriotiques. Celui de Camille Desmoulins portait : Guerre aux tyrans, paix aux chaumières, unité et indivisibilité de la République. Il y eut même des cruchons faits pour glorifier la foi de l’heure. « Vive la Liberté ! » L’abstraction « patrie » se rendait palpable pour les âmes simples jusque dans les plus infimes détails de la vie journalière. Tout le monde, pourtant, ne sacrifiait pas jusqu’au délire au snobisme du jour. Si chacun protestait, en général, de son patriotisme, il y avait pour certains « des intérêts inquiets », qu’on ménageait. Les gens pratiques (Sancho Pança n’accompagnera-t-il pas toujours Don Quichotte ?) ne s’égaraient pas dans de vagues nuées. Il y eut les patriotismes « éclairés ». Le Tiers de Marseille écrivait, par exemple :
« Nous avons l’avantage d’être Français et Marseillais. Français, l’intérêt général de la Nation excite notre zèle. Marseillais, l’intérêt de la Patrie, qui ne peut être séparé de celui du commerce, réclame notre sollicitude. » (Fournier, Cahiers de la Sénéchaussée de Marseille, p. 362.)
Les avocats disaient aussi qu’ils étaient « Français, Marseillais et avocats ». Les maîtres perruquiers :
« Nous sommes Français, nous sommes Marseillais, nous sommes perruquiers : voilà les rapports qui nous lient à l’Etat. »
Autrement dit : Le patriotisme, c’est la bourse !
Et il fut un moment même où la « Patrie en danger » ne disait plus grand chose aux foules, parce que l’ivresse ne peut durer toujours. C’était, après le détraquement des premiers temps, le retour au bon sens et à la raison. Nous lisons dans l’Histoire de La Réole, par Octave Gauban :
« La ville avait déjà fourni des volontaires en 1791 et ouvert une souscription en leur faveur. Le corps municipal, plus préoccupé de plaire aux habitants que de remplir les devoirs que lui imposaient les dangers de la patrie, avait été effrayé du mécontentement que soulevait cette nouvelle demande de soldats et hésitait à exécuter la loi. Le passage incessant des troupes contribua aussi à refroidir l’enthousiasme des premiers temps. La municipalité relevait chaque jour de nouvelles plaintes sur le surcroît de charges que les logements militaires faisaient subir aux habitants. » (p. 314–315.)
Puis :
« La nouvelle administration essaya de donner une impulsion plus vive aux enrôlements. » (p. 316.)
Et enfin :
« Des appels si fréquents fatiguaient la population. On eut recours à l’émulation ou, plutôt à la vanité patriotique. On proclama que le service de la patrie était un honneur et que les plus dignes devaient être désignés par voie d’élection. Cet honneur était accepté comme tel par quelques-uns et rejeté par le plus grand nombre comme un fardeau. » (p. 317.)
LE PATRIOTISME ACTUEL.
On ne devient un fervent du patriotisme qu’après avoir subi un long travail de préparation ; et la croyance s’ancre d’autant plus profondément dans le cerveau qu’on a sucé de meilleure heure les soi-disant vérités que dispensent les prêtres. Allez dire, vous, catholique, à un musulman que sa religion est fausse et que Mahomet est un imposteur, bienheureux si vous vous en tirez avec vos deux yeux ; mais que le musulman vienne vous démontrer péremptoirement — ce qui n’est pas difficile — que Marie, après avoir accouché de sept enfants, ne peut plus être vierge, ou que Jésus ne se dissimule pas tout entier dans une rinçure de calice, ne sentez-vous pas aussitôt la moutarde qui vous monte au nez ? Mais serait-il musulman celui qui, au lieu d’être né aux confins du désert, aurait vu le jour dans les montagnes d’Ecosse, et seriez-vous catholique si vous aviez fait vos premiers pas dans les plaines du fleuve Amour ? De même ne serait jamais devenu patriote celui qui n’aurait de sa vie entendu parler de la patrie. L’enseignement patriotique commence dans la famille même :
« Le bambin sait à peine marcher qu’on lui donne pour ses étrennes des soldats en plomb, des canons, des forts en carton, un tambour, un clairon, un fusil, un sabre plus grand que lui. Quand les moyens le permettent, on l’affuble d’un costume de hussard, de dragon, avec un beau casque, une belle crinière. » (G. Hervé)
Aujourd’hui, les grands magasins vendent des mitrailleuses, des tanks. Et bébé fait : poum ! A trois ans, il tue déjà des hommes par la pensée. Et papa, maman, grand-père sourient. Mais aussi, comme il écoute les récits du temps de guerre où l’on évoque — non point tant que cela la boue, les poux, la merde, la souffrance et la mort ; c’est triste et sale, ça — mais les beaux faits d’armes la vie en « Bochie », les rigolades et l’aventure ma foi, presque merveilleuse ! ...
« L’enfant entend tout cela, souvent de travers. Mais son cerveau reçoit de cette éducation familiale une ineffaçable empreinte. Avant même d’être allé à l’école, le morveux a déjà dans le sang la haine de l’étranger, la vanité nationale, l’idolâtrie du sabre, l’adoration mystique de la patrie. » (G.Hervé.)
Bébé a six ans. Il va à l’école. Il sait lire (si l’on veut). Il a quatre, cinq livres et parmi ceux-ci l’Histoire de France, la criminelle Histoire de France, aux images suggestives, aux récits enflammés. Ici, ce sont les « enfants Gaulois qui se battent comme de petits sauvages » ; et là, Henri IV, enfant, une trique à la main, « gai et batailleur ». Partout c’est la France qui rallie le légendaire panache « sur le chemin de l’honneur et de la victoire » ; partout aussi c’est la mauvaise foi des « ennemis ». La France risque n +1 fois de disparaître (!) mais toujours le patriotisme de ses enfants la sauve du désastre.
Rataplan, rataplan, tire-lire...
Chante un soldat de Napoléon. Et bébé qui vient d’écouter — avec quelle ardeur ! — le récit passionné va, pendant la récréation, se battre lui aussi « comme un petit sauvage ». Il sera Vercingétorix, il sera Bayard — seul, hein, au Garigliano ! — et Bonaparte à Arcole, et le « poilu » ! Nous avons connu un gosse qui vivait si intensément le drame qu’il brandissait un couteau ! Autrefois ne se battait-on pas à la hache ? C’est si beau de s’entr’égorger ! Et puis, ce n’est pas si répréhensible que cela de jouer à la guerre. Duguesclin n’est-il pas devenu un « as » parce qu’enfant il flanquait des raclées à ses camarades et sortait du combat les habits déchirés et le nez sanglant ? De quel droit le maître voudrait-il interdire en récréation ce qui est glorifié en classe ? D’ailleurs, l’étude reprend. L’austère « morale » est là pour maintenir dans le droit chemin le petit bout d’homme qui pourrait s’égarer. Devoir envers la Patrie !
« Celui qui n’aime pas la Patrie, absolument, aveuglément, ne sera jamais que la moitié d’un homme. » (Morale et enseignement civique, par A. Saignette (livre du maître), p. 64.)
« On doit à sa patrie le sacrifice de sa vie. Il n’y a pas de gloire comparable à celle du citoyen qui meurt pour son pays. Le devoir du soldat est de défendre son drapeau jusqu’à la mort. » (La morale mise à la portée des enfants, par O. Pavette, p. 141, etc., etc.)
Mais bébé chante aussi. Ne touche-t-on pas à tous les arts, à l’école dite « primaire » ? La seule chanson que nous apprit notre premier maître — la seule qu’il sût, vraisemblablement — s’intitulait Le Soldat Français :
Tout équipé, prêt au combat,
Plein de courage et d’espérance
Où t’en vas-tu, petit soldat ?... etc.
On la braillait encore récemment dans une école d’une grande ville.
Qui ne connaît aussi Le clairon, de Dérouléde ?
Le clairon sonne la charge...
Et la Marseillaise :
Et l’Hymne, de Hugo, accommodé à nombre d’airs martiaux :
Et tant d’autres !
Naguère, G. Hervé écrivait, dans Leur Patrie :
« Il est piquant de constater qu’en tous pays la religion patriotique est introduite dans les cerveaux et dans les nerfs par les mêmes procédés que les religions proprement dites. L’une comme l’autre prend l’enfant dès le jeune âge, avant que son esprit critique n’ait commencé à se former ; les chansons patriotiques remplacent les cantiques ; les manuels d’histoire et d’instruction civique remplacent la bible et le catéchisme ; au lieu de chasubles éblouissantes d’or et de pierreries du prêtre, ce sont les costumes criards, tapageurs des soldats et des officiers, un mélange carnavalesque de bleu, de rouge, de vert, de doré, de plumes de coq, de plumes d’autruche ; les chapelets et les autres momeries catholiques sont remplacés par les exercices de chiens savants de la caserne, destinés eux aussi à étouffer toute initiative et toute réflexion ; ce n’est plus la musique troublante de l’orgue, c’est le bruit énervant des tambours, des trompettes, des musiques guerrières ; en guise de processions, des revues, des parades, des alignement ; tirés au cordeau, des défilés à grand orchestre, où l’on voit 50 000 marionnettes humaines lever la patte en cadence au commandement. Pas une fête publique, ni en Allemagne ni en France, qui ne soit accompagnée d’une exhibition solennelle de soldats sous les armes. Chaque 14 juillet, en l’honneur des grands ancêtres qui ont pris la Bastille, l’armée française est exhibée sur les places publiques de toutes les villes de garnison. Des centaines de milliers de citoyens se lèvent de bon matin, pour aller voir griller sous le soleil, en costume carnavalesque, le guignol national. Et là, tous, ils poussent des bravos frénétiques quand ils voient défiler, au milieu de nuages de poussière, des lignes interminables d’hommes, de chevaux, de canons, une masse formidable de viande de boucherie et d’instruments d’abattoir. Et quand passe devant eux, au bout d’un bâton, le morceau d’étoffe qui est l’emblème sacré de la patrie, un frisson religieux court dans leurs nerfs et ils se découvrent dévotement devant l’icône, comme leurs pères se découvraient devant le Saint-Sacrement. Arrivé à ce degré de déformation intellectuelle, le patriote est bête à tuer : il est à point pour l’abattoir. »
L’enfant a grandi. Après les « patronages », les sociétés de boy-scout ou de préparation militaire qui se sont disputé son adolescence, la caserne le prend à vingt ans. Vienne la guerre, il n’a qu’un cri :
« À Berlin ! » (de l’autre côté du Rhin : « Nach Paris ! »)
Ou bien il s’en va sauver la France en crevant sur une terre lointaine. Il faut bien porter la civilisation aux noirs ou aux jaunes en les exterminant. Car l’heure des sacrifices sanglants a sonné. Le Patriotisme demande maintenant l’immolation de ses fidèles. Le pauvre croyant se tourne vers ses saints pour leur demander courage et réconfort. Il revoit Jeanne d’Arc « la bonne Lorraine » c’est-à-dire l’Allemande (car à cette époque la Lorraine était de vassalité allemande (Paraf-javal). C’est l’Ange, c’est Dieu qui lui téléphone, c’est sa mission... Toutes les foutaises ! Parfois, pourtant, sous l’empire de la souffrance les yeux se dessillent, le voile tombe. Trop tard ! Il n’y a plus qu’une seule chose qui pousse encore cette loque à obéir : la peur. Mais le dieu farouche est là qui le guette, et, au moindre mouvement de rébellion, se jette sur sa proie. Mourir pour la patrie ! Ah ! comme Dorgelés en a dépeint toute l’horreur ! La page vaut la peine qu’on la reproduise ici :
« Non, c’est affreux, la musique ne devrait pas jouer ça...
« L’homme s’est effondré en tas, retenu au poteau par ses poings liés. Le mouchoir, en bandeau, lui fait comme une couronne. Livide, l’aumônier dit une prière, les yeux fermés pour ne plus voir. Jamais, même aux pires heures, on n’a senti la Mort présente comme aujourd’hui. On la devine, on la flaire, comme un chien qui va hurler. C’est un soldat, ce tas bleu ? Il doit être encore chaud.
« Oh ! Etre obligé de voir ça, et garder pour toujours, dans sa mémoire, son cri de bête, ce cri atroce où l’on sentait la peur, l’horreur, la prière, tout ce que peut hurler un homme qui brusquement voit la mort là devant lui. La Mort : un pieu de bois et huit hommes blêmes, l’arme au pied. Ce long cri s’est enfoncé dans notre cœur à tous, comme un clou. Et soudain, dans ce râle affreux, qu’écoutait tout un régiment horrifié on a compris des mots, une supplication d’agonie :
« Demandez pardon pour moi... Demandez pardon au colonel. »
Il s’est jeté par terre, pour mourir moins vite, et on l’a traîné au poteau par les bras, inerte, hurlant. Jusqu’au bout il a crié. On entendait :
« Mes petits enfants... Mon colonel... »
Son sanglot déchirait ce silence d’épouvante et les soldats tremblants n’avaient plus qu’une idée :
« Oh ! vite... vite... que ça finisse. Qu’on tire, qu’on ne l’entende plus... »
« Le craquement tragique d’une salve. Un autre coup de feu, tout seul, le coup de grâce. C’était fini... Il a fallu défiler devant son cadavre, après. La musique s’était mise à jouer Mourir pour la patrie, et les compagnies déboîtaient l’une après l’autre, le pas mou. Berthier serrait les dents pour qu’on ne voie pas sa mâchoire trembler. Quand il a commandé : « En avant ! », Vieublé, qui pleurait, à grands coups de poitrine, comme un gosse, a quitté les rangs en jetant son fusil, puis il est tombé, pris d’une crise de nerfs. En passant devant le poteau, on détournait la tête. Nous n’osions pas même nous regarder l’un l’autre, blafards, les yeux creux, comme si nous venions de faire un mauvais coup. Voilà la porcherie où il a passé sa dernière nuit, si basse qu’il ne pouvait s’y tenir qu’à genoux. Il a dû entendre sur la route le pas cadencé des compagnies descendant à la prise d’armes. Aura-t-il compris ? C’est devant la salle de bal du Café de la Poste qu’on l’a jugé hier soir. Il y avait encore les branches de sapin de notre dernier concert, les guirlandes tricolores en papier et, sur l’estrade, la grande pancarte peinte par les musicos :
« Ne pas s’en faire et laisser dire. »
Un petit caporal, nommé d’office, l’a défendu, gêné, piteux. Tout seul sur cette scène, les bras ballants, on aurait dit qu’il allait « en chanter une », et le commissaire du gouvernement a ri derrière sa main gantée.
« — Tu sais ce qu’il avait fait ?
— L’autre nuit, après l’attaque, on l’a désigné de patrouille. Comme il avait déjà marché la veille, il a refusé. Voilà...
— Tu le connaissais ?
— Oui, c’était un gars de Cotteville. Il avait deux gosses. Deux gosses, grands comme son poteau... »
Mais rien n’y fait... Ou plutôt, l’évolution est tellement lente que le patriotisme a toujours la faveur des foules. Cela tient à deux causes principales :
-
La sottise ;
-
l’action des prêtres.
Que dire de la sottise, sinon qu’elle est immense. Sous le choc des rudes expériences on pourrait croire parfois que c’en est fait des errements du passé ; mais non, l’homme a une cervelle de mouton. Se souvient-il qu’on le tond périodiquement et sait-il que le boucher attend qu’il soit assez gras pour l’égorger ?
« Eh ! les hommes font-ils des expériences ? Ils sont faits comme les oiseaux, qui se laissent toujours prendre dans les mêmes filets où l’on a déjà pris cent mille oiseaux de leur espèce. Il n’y a personne qui n’entre tout neuf dans la vie, et les sottises des pères sont perdues pour les enfants. » (Fontenelle, Dialogue des morts.)
Est-ce que comme avant la dernière guerre, nous ne trouvons pas des masses de jeunes gens enrôlés sous les drapeaux du nationalisme ? Est-ce que même d’anciens combattants ne sont pas groupés dans des associations bien pensantes, prêts à « remettre ça », s’il le faut ? Et parmi les ligues dites « pacifistes » combien en est-il qui n’enverront pas leurs adhérents à la frontière, lorsque la patrie sera encore en danger ? En bas, il y a de vagues aspirations à la paix, mais il y a surtout la résignation du troupeau :
La pauvre âme en deuil clame sa souffrance,
Pourquoi donc là-bas, l’ont-ils abattu ?...
Mais, tu dis pourtant, toi malheureux père...
Qu’il faut des soldats, pour faire la guerre.
Alors ! dis, gros Jean, pourquoi te plains-tu ?
(F. Mouret, Gros Jean pourquoi te plains-tu ?)
Ah ! Si l’on n’avait la certitude que, suivant la grande loi de l’évolution, le patriotisme est appelé à rejoindre dans la mort les vieilles religions disparues, si l’on se fiait seulement aux apparences, combien aurions-nous de raisons de désespérer !
Ces morts, vos pauvres bien-aimés,
Vous les avez laissé mourir,
Vous les avez laissé partir,
Vous l’aimiez donc bien, la Patrie !
S’écrie Marcel Martinet avec son grand cœur de poète désabusé. Et cependant de ci, de là, il est des actes qui nous interdisent le découragement. Il y a eu les femmes italiennes, naguère, qui se sont couchées sur les rails pour empêcher le départ de leurs enfants ; il y a l’objecteur de conscience qui se refuse à tuer.
Quant aux prêtres, ils sont légion. Prostitués à l’argent, ils pontifient en temps de paix pour les générations nouvelles qui ignorent, et en temps de guerre pour les générations sacrifiées qui meurent. Certes, il est parmi eux des hommes sans foi — signe des temps — qui pèchent souvent par omission. Un instituteur nous déclarait récemment :
« J’ai honte chaque fois que je parle de la patrie. »
Et combien parmi ses collègues savent rester objectifs, suivant, d’ailleurs, en cela, le conseil de leur grand maître J. Ferry :
« Vous ne toucherez jamais avec trop de scrupule à cette chose délicate et sacrée qui est la conscience de l’enfant. »
Mais aussi combien de comédiens n’avons-nous pas connus, depuis le chansonnier populaire jusqu’au Président de la République ! Citons deux de ces mirlitons, pour avoir une idée de leur genre. Nous allons donc nous abaisser jusqu’à Botrel ; il est le maître incontesté de la chanson célébrant la guerre fraîche et joyeuse. Pour qu’un peuple se soit avili jusqu’à admirer ses productions (!) il faut qu’il soit descendu bien bas. Prenons dans le tas (avec des pincettes). C’est Rosalie « chanson à la gloire de la terrible petite baïonnette française » dit le sous-titre :
Et du sang impur des boches
Verse à boire !
Abreuve encore nos sillons.
Buvons donc !
Et encore, dans La petite Mimi :
Quand ell’ chante à sa manière :
Ta ta ta, ta ta ta... ta... ta... ta... tère
Ah ! Que son refrain m’enchante !
Je l’appell’ la Glorieuse,
Ma p’tit’ Mimi, ma p’tit’ Mimi, ma mitrailleuse.
Rosalie me fait les doux yeux,
Mais c’est ell’ que j’aim’ le mieux !
REFRAIN
Quand les Boches,
Nous approchent,
Après un bon « démarrage »”,
Nous commençons l’ « fauchage »
Comm’ des mouches
Je vous couche
Tous les soldats du Kaiser,
Le nez dans vos fils de fer
Ou les quatre fers en l’air !
Pardon. Arrêtons-nous pour éviter la nausée, et passons au genre sublime avec l’ineffable feu Paul Deschanel. Celui-ci opérait à la Chambre. On a réuni ses discours dans un opuscule intitulé : Les commandements de la Patrie. Et voici quelques perles :
— « Jamais la France ne fut plus grande, jamais l’humanité ne monta plus haut. »
— « ...Saintes femmes, versant aux blessures leur tendresse, mères stoïques ; enfants sublimes, martyrs de dévouement ; et tout ce peuple impassible sous la tempête, brûlant de la même foi : vit-on jamais en aucun temps, en aucun pays, plus magnifique éclosion de vertus ? »
— « Ah ! C’est que la France ne défend pas seulement sa terre, ses foyers, les tombeaux de ses aïeux, les souvenirs sacrés, les œuvres idéales de l’art et de la foi, et tout ce que son génie répand de grâce, de justice et de beauté, elle défend autre chose encore : le respect des traités. »
— « Et voici que l’Angleterre, visée au cœur, affronte les nécessités nouvelles de son destin et, avec le Canada, l’Australie et les Indes, poursuit à nos côtés, dans le plus vaste drame de l’histoire, sa glorieuse mission civilisatrice. » (Séance du 22 décembre 1914).
— « Chacun de ses soldats, devant les fils de fer sanglants, redit le mot de Jeanne :
« Vous pouvez m’enchaîner, vous n’enchaînerez pas la fortune de la France. »
Et du fond de la tranchée fangeuse, il touche le sommet de la grandeur humaine. »
— « Il serait scélérat d’ôter par une parole, par un geste, la moindre parcelle de foi à ceux qui se battent avec un invincible courage. » (Séance du 5 août 1915).
Dans un discours à l’Institut, il disait aussi, le 25 octobre 1916 :
— « Les héros qui affrontent la mort savent qu’avant de s’éteindre, leur vie, flamme brève, en allume une autre, immortelle. »
— « Oui, cette sublime jeunesse va à la mort comme à une vie plus haute. »
Et à côté de ces pitres de l’estrade ou de la tribune, que d’autres sous-produits chauffant l’opinion dans la presse vénale, journellement, avec une constance d’autant plus rigoureuse qu’ils sont mieux rétribués ! Que n’en a-t-on lu des phrases dans le genre de celles-ci :
« La jeunesse sent obscurément qu’elle verra de grandes choses, que de grandes choses se feront par elle. Et son optimisme patriotique, sa confiance, elle l’a imposée à tous, avec une force invincible. Bien plus elle a réagi sur ceux-là même qu’avait séduits, jadis, l’illusion humanitaire. Avoir redonné à ses aînés le sens des réalités françaises, c’est ce qu’on pourrait appeler le miracle de la jeunesse. » (H. Massis et A. de Tarde, Le Matin, 23 janvier 1913.)
Ou encore :
« Nous ne pouvions passer sous les yeux immobiles de cette chère figure muette et voilée (la statue de Strasbourg, place de la Concorde), sans ressentir au fond de nous-mêmes une secrète humiliation de notre défaite et comme un remords persistant de notre inaction. » (Poincaré, 17 novembre 1918.)
Mais ici, rien ne nous étonne de l’homme qui se complaît « dans la jolie symétrie française de ces tombes dans le réveil de ce pays si longtemps opprimé. » (11 mai 1915). Où le cynisme des prêtres s’étale dans ce qu’il a de plus abject, c’est lorsqu’ils utilisent les morts au service de leur religion. Et avec quel art ils opèrent ! D’ailleurs, pas de danger ; ils sont si sages les disparus !
« Ils ne réclament rien, pas même la gloire qu’on leur octroie si généreusement. Pas un seul ne se plaint. Ils approuvent et sanctionnent invariablement par leur silence forcé, la cause même de leur destruction avec une unanimité aussi absolue que compréhensible. Aussi il faut voir comme on use et abuse de leur mutisme pour leur faire dire et redire ce qu’on veut. » (Lux.)
Que ne feraient-ils pas que ne diraient-ils pas en effet, ces morts si heureux, si serviables, si intéressés — au sort des vivants ! Ce serait à mourir de rire si ce n’était si bête. Voyez plutôt :
« J’imagine que des profondeurs de l’immortalité ceux qui, jadis, ont triomphé à Tolbiac, à Bouvines, à Rocroi, à Denain, à Valmy, de notre perpétuel ennemi, ceux mêmes qui, dans les temps plus anciens, à Marathon, aux Thermopyles, à Salamine, à Platées, ont lutté aussi pour la liberté et la civilisation contre la lourde et tyrannique barbarie, jettent à pleines mains des lauriers sur les héros qui ont combattu aux rives de la Marne comme sur ceux qui, avec une endurance et une abnégation sublimes, ont défendu Verdun.” (Discours à la Distribution des prix du collège de Vitry-le-François, 13 juillet 1916, Jovy).
Et Deschanel :
— « Mais non ! La France n’oubliera plus, elle ne peut plus oublier ; à l’appel héroïque, ses morts se sont levés, ils sont debout, ils la regardent. »
Et c’est le culte de la charogne :
« Partout, les « morts glorieux » sont exposés et balladés triomphalement dans les rues sur un char militaire pavoisé de drapeaux, avec un goût dont la grossièreté n’exclut pas le ridicule. On inaugure en leur honneur des monuments hideux. Et les cérémonies macabres, ayant la douleur vaniteuse des familles comme complice, la curiosité des badauds comme cortège, sanctifient, sous la présidence des assassins officiels, le grand crime de la guerre et proclament, en même temps, la gloire de la victime avec celle des bourreaux. » (Lux)
L’Arc de Triomphe est devenu le grand Temple du patriotisme, la Kasba des pèlerins.
« Comme si ce n’était pas assez, on a corsé le spectacle : « La Flamme du souvenir » s’est allumée pour remémorer éternellement le triomphe du crime uni à la sottise. « L’appel des morts » a retenti ironiquement et vainement dans le grand silence du néant. Aucun n’a répondu : Présent ! » (Lux)
Mais ils ont parlé, ces morts, par la voix de leur poète, Marc de Larreguy de Civrieux, qui les a suivis « dans le doux nirvâna de leur suprême pose ! » et voici ce qu’ils disent :
Roulés dans leurs toiles de tente...
Ou bien craignez, craignez que les Morts ne vous hantent
D’hallucinants remords et de folle épouvante,
Si vous touchez à leurs linceuls ! »
(La muse de sang.)
</quote>
Enfin, on peut considérer encore comme prêtres de la patrie tous ceux qui entretiennent cette mentalité collective qui pousse les individus vers le troupeau discipliné : Chefs de partis ou de groupes, Moïses du Nationalisme ou du Socialisme. Nous avons vu avec quelle chaleur Jaurès parlait des femmes patriotes de 1793. Et nous sommes tout à fait de l’avis de Colomer qui écrivait, avant sa conversion au bolchevisme :
« En apprenant aux jeunes hommes à se discipliner aux règles d’un Parti socialiste qui n’oubliait pas d’être français, Jean Jaurès faisait la même besogne que Ferdinand Brunetière en leur enseignant de suivre les dures leçons d’obéissance de la hiérarchique Eglise et que Maurice Barrès en les incitant à la gymnastique morale du bon patriote. A l’heure du danger, les apparentes raisons s’oublient, les fantômes d’idées s’évanouissent, mais ce qui reste chez tous identique, c’est l’habitude de la discipline, le mouvement mécanique du tassement et du rangement pour une action collective ; c’est l’oubli de la conscience individuelle, le souvenir des gestes qui font marcher en ordre pour obéir à la loi. » (A nous deux, Patrie)
Combien de prolétaires oublient qu’ « Il n’est pas de sauveur suprême ». Drieu La Rochelle proclame :
« Je ne répondrai à aucune mobilisation, ni celle des patries ni celle des partis. »
Voilà l’homme tel qu’il doit être. Que l’être s’appartienne d’abord. Qu’il soit lui-même en toute chose, il répudiera toutes les religions, et parmi celles-ci, la plus sanguinaire de toutes à l’heure présente : le patriotisme.
**** II. PATRIOTE — Évolution du mot.
Patriote, du grec patriotès, qui voulait dire : compatriote ; au sens primitif il désignait donc : celui qui est du même pays. L’équivalent serait, aujourd’hui, dans le langage familier : pays, payse.
« Le Breton (Hume), homme actif, liant, intrigant, au milieu de son pays, de ses amis, de ses parents, de ses patrons, de ses patriotes. » J.-J. Rousseau (Lettre à Guy, 2 août 1776.)
Puis le mot signifie : celui qui aime sa patrie, qui se dévoue à ses compatriotes.
« Vauban..., ce véritable grand homme pour qui le duc de Saint-Simon, cet âpre censeur, inventa et à si juste titre, le mot de patriote. » (Raudot. Mes oisivetés, p. 1, Paris 1863.)
« Patriote, comme il l’était (Vauban), il avait été toute sa vie touché de la misère du peuple et de toutes les vexations qu’il souffrait. » (Saint Simon)
L’Académie ne donne ce mot pour la première fois que dans son édition de 1762. (Littré).
Avec la Révolution, un sens nouveau est donné à ce mot : Est patriote celui qui veut organiser la patrie par la liberté. Patriote devient synonyme de révolutionnaire ; il a pour antonyme : aristocrate.
« Le titre de patriote s’applique à celui qui est l’ennemi des distinctions de castes et de privilèges. » (La Châtre)
On comprend ainsi la phrase du Prince de Ligne :
« Patriote, mot honorable qui commence à devenir odieux. » (Lettre à Joseph II)
Le patriote avait pour ennemis, à cette époque, les nobles, le clergé, les chouans. Patriotes étaient les soldats de la République.
« Les patriotes des Sables-d’Olonne écrivent, en mars 1791, aux Jacobins de Paris qu’ils sont débordés, qu’ils ne peuvent tenir tête aux forces de contre-révolution et de fanatisme. » (Jaurès)
Mus par les idées des encyclopédistes, ils « vont de village en village opposer la pensée de la Révolution à la propagande cléricale. » Cela ne se fait pas sans heurts et lorsqu’il y a massacre de patriote (à Montauban, le 10 mai 1790), le prêtre bénit le carnage, l’épée d’une main, la croix de l’autre. Estampe du musée Carnavalet. Les patriotes se vengent tantôt par les armes, tantôt par la caricature. Une autre estampe représente : le dégraisseur patriote. Le patriote, debout devant un treuil, serre de plusieurs tours de vis un prêtre qui, de gras qu’il était, devient maigre à l’extrême. Deux autres prêtres qui viennent de subir le dégraissage, s’en vont, un tantinet ahuris. Et deux aides maintiennent devant la machine un ecclésiastique gras à lard, un peu effrayé du sort qui l’attend. La légende porte :
« Patience, monseigneur, votre tour viendra. »
Des patriotes de cette venue eussent, quelques années auparavant, senti le fagot. Patriotes aussi ceux qui se battaient aux frontières, contre les émigrés et leurs alliés. Patriotes ceux de l’intérieur qui organisaient la révolution et dont les plus ardents étaient Robespierre et Marat. Patriotes tous les « extrémistes » d’alors, genre Hébert, qui s’écriait aux Jacobins, le 21 juillet 1792 :
« S’il faut un successeur à Marat, s’il faut une seconde victime, elle est toute prête et bien résignée : C’est moi ! Pourvu que j’emporte au tombeau la certitude d’avoir sauvé ma patrie, je suis trop heureux ! Mais plus de nobles ! Plus de nobles ! Les nobles nous assassinent. »
Et le mot continue son évolution, sous Louis-Philippe les républicains seuls se disent patriotes ; mais bientôt au fur et à mesure que se développe et grandit la bourgeoisie, bonapartistes, légitimistes, descendants d’émigrés ou petit-fils de « sans-culottes » tout le monde devient « Patriote », on ne donne plus à ce mot le sens de compatriote, on oublie sa synonymie avec révolutionnaire ; on lui octroie sa nouvelle signification : dévot de la Patrie. De sorte qu’on assiste au renversement des rôles : les défenseurs des principes de 1789 ne se disent plus que bien mollement « patriotes » ; les révolutionnaires sont devenus nettement antipatriotes (du moins en paroles), et les plus farouches patriotes se réclament justement des idées et des formes de gouvernement que la Révolution a combattues !
Pour nous, résumant tout ce que nous avons dit jusque-là, notre définition sera : la Patrie est la divinité ; le Patriotisme est la religion de la Patrie ; le patriote est le fidèle du patriotisme.
***** LE MODÈLE.
Comment doit se comporter le bon patriote ? Que doit-il penser ? Que doit-il faire ? Autant de questions insolubles si le patriote-type n’avait été établi depuis les origines, gabarit sur lequel chacun se modèlera ; de même qu’il existe — idéalement — le parfait chrétien, le parfait musulman, le parfait bouddhiste, etc., pour croyants des autres religions. Le vulgaire, ayant la perfection devant les yeux, fera comme le geai ; il tâchera d’égaler le paon.
En France, on peut considérer Corneille comme le créateur de génie de ce monstre-type qu’on nomme : le patriote. Corneille, nourri d’antiquité (l’Antiquité, toujours !), planant dans les sphères éthérées de l’inaccessible, en matière de psychologie, a créé des personnages dominés par l’abstraction : Devoir. Pour ceux de Polyeucte, Dieu seul compte ; pour ceux d’Horace, c’est la Patrie. Ces types sont dits « Cornéliens ». Le patriote sera donc cornélien, c’est-à-dire qu’il n’aura d’humain que sa forme extérieure. Un court examen d’Horace nous donnera les traits essentiels du bon patriote. On connaît le sujet de la tragédie : Albe et Rome sont en guerre. Rome confie son sort à Horace et ses frères ; et Albe à Curiace et ses frères. Mais Sabine, sœur de Curiace est femme d’Horace ; et Camille, sœur d’Horace est la fiancée de Curiace. Le Vieil Horace va démêler cet imbroglio, car il est le gardien de la flamme. Tous, sauf Camille, si humaine, si tendre, si femme, si « antipatriote » — malgré ses préjugés — sont des fanatiques de la patrie.
Et nous voyons que :
1° Il est glorieux de mourir pour son pays. Cela devient presque un plaisir.
Horace :
<verse>
Quoi, vous me pleureriez, mourant pour mon pays !
Pour un cœur généreux ce trépas a des charmes,
La gloire qui le suit ne souffre point de larmes ;
Et je le recevrais en bénissant mon sort,
Si Rome et tout l’Etat perdaient moins à ma mort. (II-1.)
Quand on apprend à Curiace qu’il est désigné pour se battre, surpris, il dit :
Et Horace déclare à son tour :
Qu’on briguerait en foule une si belle mort. (II-3.)
2° Mourir pour la patrie, c’est l’immortalité.
Curiace :
Dans un si beau trépas, ils sont les seuls à plaindre ;
La gloire en est pour vous, et la perte pour eux ;
Il vous fait immortel, et les rend malheureux. (II-1.)
3° Le patriote doit obéir aveuglément.
Horace :
J’accepte aveuglément cette gloire avec joie. (II-3.)
4° Lorsque la défense de la patrie l’exige, il n’y a plus ni parenté, ni amour, ni amitié qui compte.
Curiace :
Ne pourront empêcher que les trois Curiaces
Ne servent leur pays contre les trois Horaces. (II-2.)
Cela frise la folie :
Horace :
Que j’épouserai la sœur, je combattrai le frère ;
Et pour trancher enfin ces discours superflus,
Albe vous a nommé, je ne vous connais plus. (II-3.)
Dans les recommandations à sa sœur Camille, Horace dit :
Ne le recevez point en meurtrier d’un frère. (II-4.)
Ne me reprochez point la mort de votre amant. (II-4.)
Comme consolation :
Voilà, c’est simple.
Et Curiace ne prend pas de gants pour éloigner Camille :
La patriote Sabine poussant son mari et son frère à s’entre-tuer, envisageant un recul — impossible — dit :
Je le désavouerais pour frère ou pour époux, (II-6.)
Et plus loin :
Ce qui est évidemment très gentil.
Au troisième acte, elle attend l’inévitable avec une tranquillité de future veuve joyeuse :
Qu’il en faut sans frayeur attendre la nouvelle (III-1.)
Enfin, pour qu’on ne l’ignore pas, Horace, après avoir tué sa sœur, répète la formule du patriotisme triomphant :
L’amour au-dessus de la Patrie, quelle hérésie ! Horace, assassin de son beau-frère, reproche à sa sœur de penser encore à Curiace :
Le nom est dans ta bouche et l’amour dans ton cœur ! (IV-5.)
Et, pour la punir, il la tue. Les patriotes sont gens curieux qui ne parlent qu’amour, honneur, devoir, mais le crime est leur suprême ressource.
Le plus hideux personnage est certainement le vieil Horace. Il bénéficie d’ailleurs du privilège de tous ces vieillards — trop décrépits pour payer de leur personne — qui font bon marché de la peau des autres :
a) Il pousse ses fils au combat :
b) Il menace :
Si leur haute vertu ne l’eût répudiée,
Ma main bientôt sur eux m’eût vengé hautement
De l’affront que m’eût fait ce mol consentement. (III-5.)
Il eût trouvé alors assez de force pour tuer ses fils ; quant à se battre lui-même contre ses ennemis, vous ne le voudriez pas ?
c) Il est fier et heureux de la mort de ses deux fils et regrette seulement que le troisième ait réchappé.
Rome est sujette d’Albe ! Et, pour l’en garantir,
Il n’a pas employé jusqu’au dernier soupir ! (III- 6.)
Plus loin, il dit encore :
Il ne tenait qu’à lui, certes, de les suivre ; mais il préfère vivre. Ce n’est d’ailleurs pas le chagrin qui le tuera. Sans une larme, il se console en disant :
d) Il souhaite la mort de ce troisième fils lorsqu’il se figure qu’il s’est enfui :
Et c’est là qu’il dit le fameux :
« Ce trait du plus grand sublime. » (Voltaire.) Sublime comme effet théâtral, sans doute, mais qui révèle une mentalité abjecte.
e) Il deviendra criminel :
Chaque goutte épargnée à sa gloire flétrie ;
Chaque instant de sa vie, après ce lâche tour,
Met d’autant plus sa honte avec la sienne au jour,
J’en romprai bien le cours... (III-6.)
Et encore :
Laveront dans son sang la honte des Romains. (III-6.)
f) Son plus grand bonheur est lorsqu’il apprend que son fils a tué son gendre :
Du service d’un fils, et du sang des deux autres. (IV-2.)
g) Il est mufle, goujat : A sa fille qui vient de perdre son fiancé, il ne trouve à dire, comme paroles de consolation, que ces mots :
Dont la perte est aisée à réparer dans Rome. (IV-3.)
h) Il est dénaturé : Lorsque Camille, après avoir maudit Rome, succombe sous les coups de son frère, le vieux s’écrie :
5° Il est criminel d’aimer les ennemis.
Le vieil Horace :
De rage en leur trépas maudire la patrie,
Souhaiter à l’Etat un malheur infini,
C’est ce qu’on nomme crime et ce qu’il a puni. (V-3.)
Et le jeune :
Quiconque ose pleurer un ennemi romain ! (IV-6.)
6° Il est bienséant de glorifier les morts.
Le vieil Horace :
Et on ne doit pas les pleurer :
Horace :
Et nos deux frères morts dans le malheur des armes
Sont trop payés de sang pour exiger des larmes.
Quand la perte est vengée, on n’a plus rien perdu. (IV-5.)
7° Le rêve du patriote est l’impérialisme.
Le vieil Horace :
Rome se fera craindre à l’égal du tonnerre (III-5.)
La voix de la raison, du bon sens et du cœur parle par le seul truchement de Camille. Ah ! Comme nous souffrons avec elle, la douloureuse amante !
Elle est la révoltée qui maudit.
Qu’un astre injurieux nous donne pour parents. (IV-4.)
Elle est la révoltée que la folie patriotique n’aveugle pas :
Se plaindre est une honte, et soupirer un crime :
Leur brutale vertu veut qu’on s’estime heureux,
Et, si l’on n’est barbare, on n’est point généreux. (IV-4.)
Elle est la révoltée qui souhaite la destruction de Rome, l’anéantissement de la patrie, la fin du dernier patriote :
Moi seule en être cause et mourir de plaisir. (IV-5.)
III. CONCLUSION.
Nous aussi, souhaitons l’anéantissement de cette idole : la Patrie. Nous aussi renions le monstrueux patriotisme, goule assoiffée de sang. Nous aussi considérons le patriote comme un barbare, d’autant plus dangereux qu’il veut nous faire partager sa passion, nous imposer sa loi, « Il est triste que souvent, pour être bon patriote, on soit l’ennemi du genre humain », écrivait Voltaire. Pour être l’ami du genre humain, pour vouloir son émancipation totale, il faut, en effet, cesser d’être patriote ; il faut aller vers l’idéal libertaire, vers la fin des Etats et des Patries, vers l’Internationale : celle qui ne portera aucun numéro, celle qui, n’étant inféodée à aucun Parti politique, abolira les frontières, supprimera les Armées, réconciliera tous les Peuples, mettra fin à la guerre, et fera de la terre la Patrie universelle.
BIBLIOGRAPHIE. — Fustel de Coulanges : La cité antique. — A. Hamon : Patrie et internationalisme. — Paul Reboux : Les drapeaux. — A. Aulard : Le patriotisme français de la Renaissance à la Révolution. — C.-A. Laisant : La barbarie moderne. — G. Hervé : Leur patrie. — R. Bazin : Questions littéraires et sociales. — Voltaire : Dictionnaire philosophique. — Rhillon : De Briey à la Rhur. — G. Darien : La belle France. — Ch. Albert : Patrie, guerre et caserne. — A. Naquet : L’Humanité et la Patrie — J. Jaurès : Histoire socialiste de la Révolution Française. — A. Colomer : A nous deux, patrie. — O. Gauban : Histoire de la Réole. — Paraf-Javal : La légende détruite. — R. Dorgelès : Les croix de bois. — P. Deschanel : Les commandements de la patrie. — Ermenonville : Pour voir clair. — Jovy : Quelques motifs de foi dans la patrie. — Marc de Larreguy de Civrieux : La muse de sang. — Lux : Les morts glorieux. — Drieu La Rochelle : L’Europe contre les Patries. — M. Martinet : Les Temps maudits. — Th. Botrel : Chansons de batailles et de victoire. — Corneille : Horace, etc., etc.
PATRONAGE
n. m.
Protection exercée par un patron, dit le Larousse, sans autre commentaire sur cette signification.
Peut-être, cette façon de protéger existait-elle au temps du Compagnonnage lorsque le patron, le maître, s’engageait formellement à diriger un apprenti dans la meilleure voie pour bien apprendre son métier, en le surveillant, en le conseillant ou en le confiant à un bon compagnon. Ce genre de patronage s’exerce encore chez certains artisans, dans certaines corporations, chez un patron, travaillant lui-même avec quelques compagnons et pouvant ainsi former, près de lui, de bons ouvriers. Mais ce système tend à disparaître du fait de l’extension formidable de l’industrie qui, par l’extrême division du travail, conduit à une spécialisation de plus en plus exclusive. Le producteur qui travaille de nos jours dans une usine, atelier, manufacture ou chantier, appartenant à une société industrielle, ignore totalement le nombre, la qualité, la situation sociale et jusqu’au nom et à la résidence des actionnaires dont il est le salarié. Dès lors, quelle relation, entre ce travailleur et ses patrons anonymes ? Par la standardisation du travail, par l’application rigoureuse du système Taylor, par la mise en pratique du travail à la chaîne, on arrive à produire en quantité au détriment de la qualité. L’ouvrier, de plus en plus associé à l’appareil mécanique, dont il n’est plus qu’un rouage en chair et en os, se désintéresse totalement de la besogne qu’il accomplit.
C’est sous le patronage de ces criminels saboteurs de la production que sont les industriels, qu’est disparue la conscience de l’ouvrier qualifié, ayant l’amour de son métier. L’ouvrier a fait place au manœuvre, à l’homme-outil, à l’exploité dégoûté, travaillant, désormais, comme une brute et malheureusement pensant et agissant assez souvent de même, hors du Syndicalisme.
Voilà ce qu’on peut dire du Patronage dans le sens de protection de l’ouvrier par le patron.
Patronage a un autre sens encore. Il signifie le personnage influent sous la direction ou sous la protection de qui l’on est admis dans un Asile, ou dans un Refuge où au nom duquel un sans-travail, un besogneux se présente très humblement sur un chantier ou dans un atelier, sollicitant la grâce d’y être largement exploité.
Sous le couvert de la charité privée, presque toujours des établissements religieux prétendent porter secours aux malheureux faisant appel à leur Patronage. A ce propos, le Larousse dit, « Patronage : Nom donné à des associations de bienfaisance qui ont pour objet de venir en aide à l’individu pauvre, abandonné ou frappé d’une condamnation, de lui donner un appui et de lui constituer comme une nouvelle famille ». Mais on ne dit pas quelles formalités doit remplir, quels certificats doit montrer, quelles preuves de soumission, de piété, le malheureux solliciteur doit produire avec son extrait de baptême, son livret de mariage, etc., pour être admis. Enfin, ces patronages, dont les institutions charitables seraient admirables si elles s’inspiraient du véritable amour du prochain, de l’esprit évangélique, ne sont trop souvent rien autre que des exploitations hypocrites du pauvre. On y abrite des professionnels de la mendicité, des habitués utiles et résignés, dociles et pieux prêts à toutes les besognes, aptes à toutes les courbettes pour mériter leur séjour en ces asiles et y tenir la place des malheureux sans ressources ni recommandations, sortant de prison ou d’hôpital, mal vêtus, sans le sou, fatigués. Pourtant, l’on héberge plus ou moins mal, durant un laps de temps plus ou moins court, des vagabonds, des trimardeurs quand, à vue d’œil, on les juge aptes à des corvées rudes et répugnantes, ordinairement sans autre salaire que la pitance insuffisante et médiocre, et si peu réconfortante, que ces passagers préfèrent à de pieux hébergements, la misère et la liberté, sur la route, avec le risque du gendarme, dans les champs, et du mouchard dans les villes où sont toujours traqués les miséreux ayant encore assez d’audace et de fierté pour se suffire hors les lois de protection sociale et les patronages d’hypocrite charité. Les gueux préfèrent encore à ces patronages d’associations de bienfaisance les gestes de solidarité des gueux, l’entraide comme elle se pratique dans certaines corporations, où la sympathie pour les trimardeurs est de tradition. Le grand air fait aimer l’Indépendance et libère le gueux, amant de la Liberté, de bien des préjugés de respect pour l’Autorité et la Propriété.
On ne peut parler du mot Patronage sans arriver à la signification effective que lui ont donnée les cléricaux pour dominer, par la conquête de l’enfance et de l’adolescence, dans les classes pauvres, la Famille, la Cité, la Ville et le Village, puis, la Nation. C’est d’une tactique habile, exercée par des manœuvriers adroits, dans un but unique. Il y a très longtemps que les Patronages existent en France. Les lois de laïcité n’ont pu les atteindre ou leur porter préjudice que dans certains centres industriels, où les municipalités devinrent en majorité socialistes. Au point de vue laïc, c’est seulement depuis 1894, que furent créés, par des personnalités de la librepensée ou appartenant à des groupements politiques d’idées avancées, des patronages laïcs qui s’opposèrent aux patronages cléricaux. Quelques personnes de bonne volonté encouragèrent cet effort contre l’envahissement de l’éteignoir par le Patronage scolaire. Des subventions municipales aidèrent ce mouvement. Mais l’ennemi clérical avait, avec les secours quémandés aux fidèles dans les églises paroissiales, quêtés dans les réunions mondaines, parmi les cossus de la Réaction, des ressources plus élevées et des influences plus fortes que n’en pouvaient espérer les adversaires des curés, des évêques et de toute la monstrueuse armée noire, plus forte que jamais depuis la Grande Guerre. Elle s’abat victorieuse, sur la France chauvine, s’apprêtant à toutes les horreurs sanglantes que provoqueront dans le monde, tant qu’elles existeront, ces deux néfastes entités : Dieu et Patrie.
Une congrégation, les frères de Saint-Vincent-de-Paul, s’est organisée spécialement en vue de ces œuvres nouvelles, associations religieuses qui, sous le nom de patronages scolaires furent des sociétés de prétendue protection pour les jeunes gens des deux sexes sortant des écoles primaires. Primitivement, avant de s’avouer, les cléricaux firent croire que leur but était simplement de :
« Suivre les élèves après l’école, afin de perfectionner, dans des cours et des conférences, leurs études après leur sortie ou du moins d’entretenir le modeste savoir qu’ils ont acquis à l’école ; de les. aider à trouver des situations et surtout leur procurer des amusements sains : réunions, promenades, représentations théâtrales, gymnastique, sports. »
Sans aucunement vouloir les vanter, l’on peut dire qu’ils se sont attachés à cette tâche avec zèle et persévérance, à la grande satisfaction des parents eux-mêmes qui n’avaient plus d’inquiétude à voir l’enfant absent du foyer familial, le sachant à l’abri, joyeux, content de se remuer, de se distraire avec ses camarades et avec M. l’Abbé, si aimé de tous les gosses, jouant avec eux, tous les soirs, toute la journée du jeudi et du dimanche, entre les Offices religieux. Il y avait, en plus, des secours personnels aux familles intéressantes. Pourvu que les parents s’y prêtent, il y avait des relations possibles, avantageuses avec les gens d’Eglise. Le petit garçon et la petite fille, devenaient ce qu’on les faisait au Patronage, hypocrites et pieux. Les conférences étaient socialement religieuses et parfaitement combinées pour faire du Mensonge la Vérité et persuader que les plus infâmes ennemis de la Raison étaient les vrais Amis du Peuple, c’est-à-dire, du Vrai, du Bien, du Beau !
Grâce aux encouragements gouvernementaux, après le magnifique accord de la gente cléricale avec la tourbe politicienne pour l’ignoble massacre jusqu’au bout (1914–1918) et pour le prochain, les cléricaux ont la bride sur le cou et ne se gênent plus en rien. Les Patronages de jeunes gens sont des vestibules de la SainteCaserne, ils sont l’antichambre de l’Ecole du Crime. Sous l’uniforme des Boy-scouts, les enfants du Peuple, ceux qui doivent donner leur sang pour la Patrie, sont entraînés, physiquement comme moralement, à la Guerre Fraîche et Joyeuse, agréable à Sabaoth, au Dieu des Armées. Voilà ce que les Patronages au sens clérical du mot, sont en train de faire : un travail acharné, incessant pour parvenir à l’abrutissement complet du Peuple. Ils savent commencer par le commencement : par l’enfant. Pendant ce temps, dans les Loges, dans les Groupes de Libre-Pensées, on parle d’élection et l’on discute sur : Patriotisme et Religion. Les petits abbés des Patronages, eux, ne discutent pas, ils agissent ; ils recrutent ; ils forment des soldats de l’Ordre, des soldats de Dieu, des défenseurs de l’Eglise, des protecteurs du Capital, des électeurs et des lecteurs de tout ce qui est cagot, réactionnaire ; les profiteurs de guerre, les bravaches et les guerriers les plus stupides ont de beaux jours en perspective : les Patronages leur préparent des admirateurs et des victimes.
Que fait-on au Patronage ? Voici :
-
La vie au Patronage « Nazareth ». — Octobre ramène la vie au Patronage. Bien finies les vacances, les longues vacances attristées cette année de pluies et d’orages. Les oisillons de Nazareth accourent à tire d’aile des quatre coins de France et font retentir à nouveau la cour de leur bruyant ramage. Demandez-le plutôt, si vous êtes incrédules, aux locataires des immeubles voisins !
-
Le jeudi 8 octobre fut vraiment la première journée de patronage sérieuse. La matinée s’écoule vite : messe de 8 heures à l’Œuvre, puis départ des catéchismes pour la messe du Saint-Esprit à la paroisse. L’après-midi, les portes du patronage s’ouvrent à une heure.
-
Chapelet du soir. — Chaque soir, à 6 heures, rendez-vous aux pieds de la Sainte Vierge. Nous félicitons le groupe de fidèles. Que tous les enfants de Nazareth prennent au moins un rendez-vous par semaine. Que de grâces ils obtiendront pour eux, leurs familles et leur Œuvre par cette pratique !
-
Cotisation annuelle. — Elle est fixée à 10 francs. Beaucoup d’écoliers se sont déjà acquittés, au début de l’année, de ce modeste tribut. Avis aux retardataires !
-
Tableau d’honneur. — Ont amené des nouveaux au patronage dans le courant d’octobre : Jean Bardon, Paul Chevrot, Maurice Dizin, Daniel Rigal, Maurice Michaut, Henri Carbonero, André Lavaud, Guy Maulian, Robert Dupré, René Saignelonge.
-
Petit catéchisme : de 6 ans 1/2 à 8 ans : chaque jeudi, de 9 h 45 à 10 h. 30 au patronage.
-
Chaque jeudi, de 9 h 45 à 10 h 30 au patronage.
-
Messe obligatoire au patronage le jeudi et le dimanche à 8 heures moins 10. — 1re année : Répétitions au patronage, 7, rue Blomet, le mercredi à 16 h 30 et le jeudi à 10 heures. Récitation à la paroisse, 68, rue Falguière, le jeudi à 8 h 20.
-
Messe obligatoire au patronage, 7, rue Blomet, le dimanche à 8 h moins 10. — 2e année : Répétitions au patronage, 7, rue Blomet, le lundi à 16 h 30 et le jeudi à 8 h 30. Récitation à la paroisse, 68, rue Falguière, le mardi à 16 h 20 et le jeudi à 9 h 45. Messe obligatoire au patronage, 7, rue Blomet, le jeudi et le dimanche à 8 h moins 10.
-
Catéchisme de persévérance. — Réunion au patronage le jeudi, à 14 h 45. Messe obligatoire au patronage le jeudi et le dimanche à 8 h moins 10.
-
M. l’abbé Massiot, chargé des catéchismes, recevra les parents les lundi et mercredi de 16 heures à 18 heures...
Après cela, on se rend compte des résultats à espérer d’une telle semence.
— G. YVETOT.
PATRONAT
n. m.
Pour connaître l’origine et l’évolution du patronat dans le monde occidental, il faut remonter à la famille patriarcale. En principe :
« Une famille était un groupe de personnes auxquelles la religion permettait d’invoquer le même foyer et d’offrir le repas funèbre aux mêmes ancêtres. » (Fustel de Coulanges)
À Rome :
« La famille a pour objet essentiel la perpétuité du culte héréditaire. Dans la pensée des Anciens, l’homme, seul apte à transmettre la vie, est aussi seul apte à transmettre le culte. La famille se compose donc exclusivement des personnes ayant reçu du même ancêtre, de mâle en mâle, le même sang et le même culte. Ce sont les agnats... La famille est gouvernée par le père, le pater familias, maître absolu des gens et des biens... » (G. Bloch)
La famille est une unité économique pourvoyant à ses propres besoins, elle est aussi une unité politique. Elle prend alors la forme de gens.
« Nous sommes conduits à reconnaître dans la gens la famille, non pas la famille se démembrant incessamment à la mort de son chef, mais la famille maintenant son unité de génération en génération. » (G. Bloch)
Communauté de sang réelle ou fictive ?
« C’est un fait connu que, dans les plus vieilles civilisations, les liens sociaux sont toujours censés être des liens de parenté, de consanguinité. » (G. B.)
Cependant la famille s’annexe des éléments hétérogènes. La guerre de tribu (groupe de familles) à tribu, de cité à cité, procure des esclaves répartis entre les gentes. Il fallait, au cours d’une cérémonie devant le foyer, introduire le nouvel arrivant dans la famille. Celui-ci « étranger la veille, serait désormais un membre de la famille et en aurait la religion », cependant, sans pouvoir en accomplir les rites.
« Mais, par cela même que le serviteur acquérait le culte et le droit de prier, il perdait sa liberté. La religion était une chaîne qui le retenait. Il était attaché à la famille pour toute sa vie et même pour le temps qui suivait la mort. »
Dans ces temps reculés, il était difficile à l’homme de vivre isolé au milieu de groupes organisés. Ceux que les vicissitudes de l’existence avaient réduits à l’isolement sans les faire tomber dans l’esclavage cherchaient à se joindre à une famille organisée. Ils étaient admis à la suite de formalités analogues à celles que nous avons mentionnées pour les esclaves ; comme ceux-ci, ils devaient travailler pour la communauté sans avoir rien en propre. Avec les descendants d’esclaves affranchis, ils forment au sein de chaque famille ce que « l’on appelle des clients, d’un vieux mot qui signifie obéir ». Pour tous ces éléments annexés à la famille, le chef n’est pas un père, c’est un patron. Le client doit à la gens qui l’a accueilli, c’est-à-dire au patron qui la représente, toute sa force de travail, tout le produit de son labeur. En revanche, il a sa subsistance assurée et la protection. Il est membre de la communauté par l’adoption. « De là un lien étroit et une réciprocité de devoirs entre le patron et le client. Ecoutez la vieille loi romaine : « Si le patron a fait tort à son client, qu’il soit maudit, sacer esto, qu’il meure. » Considérés au point de vue économique, à l’aurore de la civilisation occidentale, esclaves, affranchis, clients, avaient une situation sensiblement équivalente : absence complète de liberté, obligation du travail, garantie de l’existence.
Avec le progrès de la civilisation, l’extension de la cité, la formation des empires, la famille patriarcale, groupement relativement secondaire, ne tarde pas à se désagréger. Les membres de la famille consanguine, tout en conservant des liens de solidarité, vivent d’une vie indépendante. Les clients, volontaires ou agrégés sous la contrainte de la misère, se transforment en parasites vivant, dans l’oisiveté, des aumônes du riche, l’appuyant de leurs suffrages aux jours d’élection. Les descendants d’affranchis sont dégagés de tous liens avec le patron à la troisième génération. Avec la masse flottante des émigrés, introduits grâce à la multiplication des relations commerciales, ils fournissent le contingent des artisans et travailleurs libres. Que vaut cette liberté pour le plus grand nombre, pour ceux qui exercent un métier manuel n’exigeant pas de talent particulier ?
Les guerres de conquête font affluer entre les mains du vainqueur une multitude d’esclaves.
« On cite telle campagne militaire à la suite de laquelle 150.000 êtres humains tombèrent en servitude. De plus, une véritable traite sévissait dans la Méditerranée orientale... Le grand marché des esclaves était l’île de Délos, où, certains jours, d’après Strabon, plus de 10.000 malheureux étaient mis à l’encan. » (Toutain)
Ces esclaves achetés comme marchandise, en grand nombre chez les riches propriétaires, n’étaient plus comme jadis incorporés à la famille. Les moins spécialisés cultivaient le domaine du patron ; les autres étaient loués comme ouvriers à des entrepreneurs ; ils percevaient des vivres ou touchaient un salaire minime. Il y avait ainsi des ateliers et des chantiers d’esclaves en Grèce, au Ve siècle av. J.-C.
« Le père de Sophocle possédait un atelier d’esclaves forgerons ; le père de Cléon, un atelier d’esclaves tanneurs, le père d’Isocrate, un atelier d’esclaves luthiers ; les fabriques d’armes de Lysias et du père de Démosthène occupaient une maind’oeuvre servile. » A Rome : « Malgré les frais que pouvaient entraîner la nourriture et l’entretien des esclaves, la main-d’œuvre servile se recommandait par son bon marché. Elle ne fit pas disparaître complètement le travail libre ; il y eut encore, aux derniers siècles de la République, des journaliers agricoles et des fermiers à part des fruits ; mais sur la plupart des domaines de quelque étendue, l’exploitation du sol était confiée à des esclaves. » (Toutain)
Quel était le sort du travailleur libre concurrencé par la main-d’œuvre servile et souvent commandé par un contremaître ou régisseur esclave ? La vie des ouvriers libres est très dure.
« Les salaires baissent ; les chômages sont fréquents. Les querelles entre ouvriers et patrons se multiplient. Les uns font grève ; les autres essaient, sous des prétextes plus ou moins spécieux, de ne pas verser les salaires promis. » (Toutain)
« On comprend que tant de travailleurs aient quitté leur patrie et changé leurs outils pour des armes, à la perspective des belles soldes offertes par les rois. Dans l’éclat de la civilisation hellénistique se dissimulent d’innombrables misères. » (G. Gloty)
Nous sommes toujours en face de la même opposition : servitude en échange de la pitance assurée ; liberté avec misère constamment menaçante.
Dans le haut moyen âge, l’économie est presque exclusivement rurale. Il y a :
« Même à l’aurore de l’époque féodale... une classe de paysans libres et non nobles. Toutefois, dans la pratique, le vilain se rapproche du serf beaucoup plus que ne semblerait le permettre ce critérium, en apparence très tranché : la liberté... Le serf est lié irrévocablement à la terre, le vilain peut la quitter, car il a le droit de déguerpir, suivant le terme consacré... Seulement la différence est plus théorique que réelle, plus juridique que pratique, attendu que le vilain ne déguerpit pas. La situation du travailleur agricole est son seul gagne-pain. Il reste donc héréditairement sur la tenue et son existence ressemble étonnamment à celle du serf quasi-libre qui cultive le lot d’à-côté. » (J. Calmette)
La situation de l’artisan, domestique du châtelain, n’est guère différente. Les uns et les autres d’ailleurs ont droit à un minimum de moyens d’existence et à quelque protection.
Ce n’est que dans les villes qui ont subsisté, très déchues d’ailleurs de leur prospérité de l’époque romaine, qu’il reste une certaine liberté. Dans la partie méridionale de notre pays, notamment :
« Il s’est maintenu dans les villes un peu d’industrie, un peu de commerce, un peu de liberté... » (Rambaud)
Les privilégiés qui en bénéficient donneront naissance à la bourgeoisie.
Cette bourgeoisie naissante fait preuve d’un véritable génie organisateur (au XIIe et XIIIe siècle surtout) dans un intérêt très égoïste d’ailleurs. Elle tire ses ressources alimentaires de la campagne environnante. L’échange est direct entre producteurs et consommateurs sur le marché local public.
« Des deux parties en présence au marché, le producteur de la campagne et le consommateur de la ville, celui-ci seul est pris en considération. L’interdiction des monopoles et des accaparements, la publicité des transactions, la suppression des intermédiaires ne sont qu’autant de moyens de garantir son approvisionnement individuel dans les conditions les plus favorables. » (Pirenne)
Le travailleur rural a deux maîtres : l’un lui impose des corvées sur son domaine, l’autre le dépouille le plus possible du fruit de son travail, libre en apparence. Il paie très cher sous cette double contrainte la garantie d’une existence famélique et la protection que lui assurent, en cas de danger, les murailles de la ville et du château.
A l’intérieur de la cité :
« Le socialisme municipal a trouvé dans l’organisation des petits métiers sa forme la plus complète, et l’œuvre qu’il a réalisée dans ce domaine doit être considérée comme un chef-d’œuvre du Moyen Age. » (Pirenne)
« Le bien commun de la bourgeoisie est, ici, comme en matière d’alimentation urbaine, le but suprême à atteindre. Procurer à la population des produits de qualité irréprochable et au meilleur marché possible, tel est l’objectif essentiel. Mais les producteurs étant eux-mêmes des membres de la bourgeoisie, il faut, de plus, adopter des mesures qui leur permettent de vivre de leur travail de façon convenable. Ainsi, le consommateur ne peut être pris seul en considération, il importe aussi de s’occuper de l’artisan. Une double réglementation se développe. » (P.)
Nombre des ateliers, qualité et quantité des produits, tout cela est systématisé pour ajuster la production aux besoins. Dans tout atelier, il y a un maître d’œuvre, des subordonnés s’initiant peu à peu aux détails et à la pratique impeccable du métier : ce sont les compagnons, enfin des apprentis. Pendant la belle période de l’institution, tous peuvent aspirer à la maîtrise. Mais les maîtres, en nombre restreint, fonctionnaires du corps municipal, peuvent facilement s’entendre pour s’assurer le monopole de la maîtrise. A l’égard de leur personnel ils deviennent des patrons. Ils pourvoient à leur subsistance, souvent à leur foyer même. Mais qu’ils les nourrissent et les logent ou qu’ils leur laissent un semblant de liberté, la servitude est sensiblement la même. Le compagnon ne doit se livrer à aucun travail personnel pour des particuliers ; il doit, à heure fixe, avoir regagné son domicile ; il doit assister avec sa corporation, aux offices religieux...
Des patrons bourgeois arrivent lentement à s’enrichir grâce à leur ladrerie et aux privations qu’ils imposent à leurs auxiliaires. Impossible de donner de l’extension à leur industrie pour dominer un marché intérieur étroitement réglementé. Mais, si la ville est sur un nœud de communication, on peut travailler en vue des marchés lointains. La création d’ateliers plus importants, exportant leurs produits, enrichit la cité sans préjudice pour l’artisanat local. D’autre part, les commerçants enrichis par le trafic des produits du dehors, créent, pour échapper aux restrictions locales, des manufactures dans les campagnes. Des paysans abandonnant un sol ingrat, une population flottante de déracinés fournissent la main-d’œuvre. Celle-ci est libre, sans lien de dépendance avec le patron nouveau genre, mais sans la protection que lui assurait encore l’artisan bourgeois. On entre dans l’ère moderne ; le patronat prend la forme capitaliste ; il exploite le travailleur soit directement, soit par l’intermédiaire d’un artisan à façon, dans tous les cas, sans avoir à sa charge la moindre obligation humanitaire.
Le travail n’est plus une obligation, il n’est plus imposé par contrainte directe, celui qui l’exerce peut changer de lieu, changer de métier. Mais ce qui est pire, le travail est devenu une marchandise, sans faire l’objet de la traite comme dans les temps antiques, il est obligé de s’offrir lui-même sur le marché. Avant Lassalle, Turgot avait énoncé la loi d’airain des salaires.
« Le simple ouvrier qui n’a que ses bras et son industrie n’a rien qu’autant qu’il parvient à vendre à d’autres sa peine... Les ouvriers sont donc obligés de baisser le prix à l’envi les uns des autres. En tout genre de travail, il doit arriver et il arrive, en effet, que le salaire de l’ouvrier se borne à ce qui lui est nécessaire pour assurer sa subsistance. » (Formation et distribution des richesses. Cité par H. Hauser.)
Il arrive même que l’exploitation commence dès l’enfance et que l’âpreté des patrons capitalistes soit capable de la pousser au point de compromettre l’existence et la reproduction du travailleur. Les Pouvoirs publics doivent intervenir comme il est arrivé au milieu du siècle dernier, après l’enquête Villermé ; ils recourent encore de nos jours à des mesures de protection, prenant à leur compte une partie des obligations que se reconnaissait le patron de jadis. Ils ont enfin concédé le droit de coalition que la bourgeoisie avait toujours refusé en fait et qu’elle avait légalement aboli aux jours de son triomphe.
L’effet de ces lois tutélaires devait être passager, car l’influence exercée par le capitalisme sur les gouvernants allait en compromettre l’application. Le droit de coalition lui-même est mis en échec par un patronat dont les membres ont plus de facilités pour conclure des accords que n’en ont les éléments innombrables et désunis de la masse ouvrière.
Néanmoins, les grèves apportent du trouble dans les entreprises, risquent de compromettre de fructueuses spéculations. Puis le capitalisme redoute toujours des revirements de l’opinion qui peuvent le dépouiller de son hégémonie dans l’Etat. Aussi a-t-il tendance aujourd’hui à revendiquer le rôle paternaliste qu’il a assumé si souvent.
Les potentats de la grande industrie multiplient les œuvres sociales : allocations familiales et caisses de compensation, services d’infirmières-visiteuses, crèches et garderies d’enfants, retraites, allocations pour maladies, dispensaires, logements, sociétés d’éducation et de distraction.
« Le temps est passé en effet, où, une fois le salaire payé, le patron était quitte envers son ouvrier. Actuellement, l’employeur a une idée plus large et plus haute de son devoir professionnel. Il offre à la personne qui travaille chez lui des avantages que, strictement, ce travailleur ne gagne pas par son labeur ; qui sont consentis à la position sociale du salarié, et non pas à son travail considéré en lui-même. » (Réveil Economique)
Le but réel ? Conquérir des âmes, d’abord :
« Dans bien des cas, les œuvres d’éducation et de distraction ne sont pas étrangères à cette sorte de conquête de l’âme : elles constituent un lien véritable, fait de mutuelle estime, entre le travailleur et son patron. »
Faire aussi échec à l’action de l’Etat.
« Le patronat a donc intérêt, croyons-nous, à intensifier l’effort commencé : en étendant et en complétant le réseau d’œuvres sociales, il sera en droit de répondre aux promoteurs des doctrines étatistes : « Voyez ce que j’ai fait ! »
Enfin, un but inavoué : dissocier la classe ouvrière, avoir à sa discrétion une poignée de privilégiés et, grâce à leur concours égoïste, dominer une masse dégradée de manœuvres, rejetés en marge de l’humanité.
Il faut souhaiter que la classe ouvrière ne tombe pas dans ce piège et que, rejetant et l’appui de l’Etat, et l’aumône du patronat, elle se donne elle-même les institutions qui, libérant le travailleur de toute tutelle despotique, lui assureront la dignité et la sécurité de l’existence.
— G. GOUJON.
PAUPÉRISME
n. m. (du latin pauper, pauvre)
L’état d’indigence où se trouve, de façon permanente, une partie plus ou moins considérable de la population, voilà ce qu’on entend par paupérisme. On évalue à plus de deux milliards le nombre des hommes qui vivent actuellement sur la terre ; ce qui donne une densité moyenne d’environ 15 habitants par kilomètre carré. Population répartie de manière très inégale, en raison des ressources plus ou moins abondantes et des conditions d’existence plus ou moins favorables rencontrées sur les divers points du globe. Sur ce nombre, combien d’individus méritent d’être appelés indigents ? On est incapable de donner un chiffre même approximatif. En effet, tel sera pauvre à Paris qui ne le serait pas dans un village perdu de la Bretagne, qui serait presque riche dans un coin reculé d’Afrique on d’Asie. Puis, nulle statistique n’est possible dans les pays non civilisés. Enfin, soit en Europe, soit en Amérique, l’on doit se contenter des chiffres donnés par les organisations charitables, officielles ou privées, chiffres que leur origine rend suspects et qui concernent seulement les pauvres secourus. Aussi n’a-t-on jamais fait d’enquête sérieuse et générale sur le paupérisme considéré dans l’ensemble de notre planète. Il existe seulement des enquêtes restreintes et d’une impartialité souvent douteuse, relatives à tel peuple ou à telle contrée. En Chine, dans l’Inde, le paupérisme fait, chaque année, des milliers de victimes ; en Angleterre, ses ravages furent grands pendant tout le XIXème siècle, ils s’accentuèrent encore après la guerre de 1914–1918. Le ministre Chamberlain déclarait en 1885 :
« L’Angleterre est le pays le plus riche du monde... Malheureusement à tout ce luxe il y a une contrepartie. Il y a parmi nous, perpétuellement, en dépit de cette richesse croissante, près d’un million de personnes qui cherchent dans la charité parcimonieuse de l’Etat un refuge contre la faim, et il y en a des millions d’autres qui sont sans espoir de pouvoir résister à quelque calamité imprévue, comme la maladie ou la vieillesse, par exemple. »
Ces aveux d’un officiel ne dévoilaient pas toute la profondeur du mal, cela va sans dire. En France, nos Démocrates prétendent que la République s’est montrée maternelle pour les déshérités. Le sénateur Delpech affirmait :
« La loi du 14 juillet 1905, sous le beau titre inscrit pour la première fois dans une loi française « service public de solidarité sociale », assure l’assistance à tout Français privé de ressources, incapable de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence et : soit âgé de plus de 70 ans, soit atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable. De facultative pour les municipalités et les conseils généraux, l’assistance devient légalement obligatoire et la dépense peut être imposée aux collectivités du domicile de secours... Non seulement les vieillards infirmes et incurables dénués de ressources et qui ont un domicile de secours bénéficient de la loi, mais aussi ceux qui n’ont point de domicile de secours. Et l’assistance ne se traduit pas seulement par l’allocation de pensions de secours à domicile, mais encore par l’hospitalisation à l’égard des bénéficiaires dépourvus de tout domicile de secours. »
En pratique, les résultats ne furent pas aussi brillants que Delpech l’avait supposé ; après la dépréciation du franc surtout, il ne resta aux vieillards qu’à mourir de faim, s’ils n’avaient d’autres ressources que le secours octroyé par les autorités. Il est vrai qu’aujourd’hui nos politiciens font mousser la loi sur les retraites ouvrières.
Pour des raisons indépendantes du bon vouloir des capitalistes, le paupérisme n’a pas sévi chez nous avec autant de rigueur qu’en Angleterre ; néanmoins les journaux fréquemment nous apprennent que des malheureux meurent de faim ou de froid.
Sur l’origine du paupérisme, aucun doute possible. Il provient d’une double cause : une injuste répartition des richesses et un excessif accroissement de la population. C’est à la première cause que l’on doit imputer la majorité des souffrances endurées actuellement par les déshérités. Mais, dans un avenir prochain, la seconde cause l’emportera en importance probablement. Une choquante inégalité, habituel résultat de la chance ou de l’hérédité, que ni le travail ni le talent ne justifient, réduit le grand nombre à la pauvreté, réservant l’opulence à quelques-uns. Au banquet de la vie les convives sont rares, les serviteurs légion : aux premiers les bons morceaux, aux seconds les reliefs, maigre salaire d’un travail sans repos, ou prix d’une chaîne et d’un collier. D’où la servitude économique du grand nombre, instaurée au profit des privilégiés. Le remède efficace consisterait à répartir les richesses au prorata du travail et des besoins. Si chacun participait d’égale façon à des biens suffisants pour tous, le paupérisme disparaîtrait. Mais point d’intermédiaires parasites, point de désœuvrés qui prélèvent une large part sur le travail d’autrui ; à l’ouvrier, au paysan l’intégral résultat de son labeur. Dans le domaine économique, le dernier mot doit appartenir à un harmonieux équilibre, conciliateur des possibilités de la production avec le droit identique qu’a chacun de satisfaire ses désirs légitimes. Même réparties avec équité, les ressources du globe deviendraient insuffisantes si la population s’accroissait indéfiniment. La terre avait 680 millions d’habitants en 1810 ; elle en a plus de deux milliards aujourd’hui ; l’augmentation est donc rapide, malgré les fléaux qui font périr les hommes par centaines de mille et même par millions. C’est sur eux que de bonnes âmes comptent pour débarrasser notre planète de son excédent de population. Tel raz de marée, remarque-t-on, tel tremblement de terre ont tué, en une nuit, cent ou deux cent mille personnes ; en 1887, le Fleuve Jaune déplaça son lit brusquement, ce qui coûta la vie a 2 millions de Chinois ; dans l’Inde, où sévissent de fréquentes famines, on a compté 19 millions de morts par la faim, de 1896 à 1900. Les bellicistes estiment, en outre, que des guerres assez fréquentes et assez meurtrières permettront toujours d’empêcher la surpopulation. C’est pour les envoyer au carnage que les mères élèveraient avec tant de soins leurs garçons ! Nous espérons, pour notre part, que les guerres disparaîtront de la surface du globe. Tous les carnages passés n’ont d’ailleurs pu arrêter l’accroissement de la population ; malgré de fréquentes guerres civiles et internationales, cette dernière a plus que doublé au cours du XIXème siècle ; et les horribles hécatombes de 1914 et des années suivantes n’ont retardé sa progression que pour très peu de temps. Sans doute de vastes espaces sont encore incultes et les progrès de la technique agricole permettront de tirer un meilleur parti du vieux sol européen. Le nombre des habitants que peut nourrir notre planète est pourtant limité ; des savants officiels estimaient, avant guerre, qu’il ne devait pas excéder trois ou quatre milliards. Qu’on le veuille ou non, le problème de la surpopulation s’imposera à l’attention de tous dans un avenir prochain. Pour nous, la question se pose d’une façon différente. Nous estimons la qualité préférable à la quantité. A notre avis, l’on doit apporter autant de soin à la procréation dans notre espèce que l’éleveur en apporte pour obtenir des poulains de bonne race, que l’horticulteur en dépense pour avoir des légumes succulents. L’eugénisme permettra de voir naître des générations moins cruelles, moins sottes et douées de qualités morales trop rares chez nos contemporains. Quant au paupérisme, il disparaîtra dès qu’à l’aveugle fécondité de l’instinct l’on substituera une prévoyance réfléchie tenant compte des ressources économiques existantes. Nous parlons d’un monde enfin libéré de la tyrannie des capitalistes et des états-majors ; car aujourd’hui il importe surtout de se débarrasser des parasites qui vivent grassement aux dépens des travailleurs. Mais n’hésitons pas à le dire, ceux qui propagent l’eugénisme sont des bienfaiteurs du genre humain.
— L. BARBEDETTE.
PAUVRETÉ
n. f.
On définit ordinairement la pauvreté : l’état de celui qui est dépourvu ou mal pourvu du nécessaire. Mais ce sens est loin d’être admis par tous unanimement. Dans un Cours de Morale qui eut son heure de célébrité, Jules Payot demande que l’on distingue soigneusement la misère de la pauvreté. D’après lui, la misère est une maladie de la volonté ; elle constitue un retour à l’état de saleté, de paresse, d’imprévoyance de l’homme primitif.
« Découragé, le gueux refuse de continuer pour sa part la lutte humaine et il renonce aux grandes conquêtes de la coopération solidaire. Il vit dans la négligence des soins du corps ; il devient pour tous un danger, parce que livré aux seuls plaisirs grossiers. »
Payot, haut fonctionnaire bien nourri, bien nippé, n’était pas tendre, on le voit, pour le malchanceux tombé au dernier degré du dénuement. Il en fait même un parasite sans scrupules, vivant aux dépens de la société, dans les asiles de nuit et les hôpitaux. Par contre, ce moraliste, grassement rétribué par l’Etat, ne tarissait pas d’éloges à l’égard de la pauvreté :
« Cette condition, qui impose l’effort persévérant, la prévoyance, la résistance aux passions, laisse intacte la santé ; elle aiguise l’intelligence ; elle trempe la volonté. Elle unit la famille dans une solidarité consentie. Avec l’instruction primaire gratuite et obligatoire, la parole de Raynal cesse d’être exacte :
« La pauvreté engendre la pauvreté, ne fut-ce que par l’impossibilité où se trouve le pauvre de donner aucune sorte d’éducation ou d’industrie à ses enfants. »
L’ignorance, cette servitude sans espoir, imposée autrefois aux enfants sans ressources a été vaincue. »
Payot se borne à dire, en langage laïc, ce que prêtres et moines expriment en jargon religieux. Le ciel disparaît pour faire place à l’école, c’est tout. Jamais les papes, ces riches entre les riches, dont les robes et les bijoux valent, à eux seuls, des fortunes princières, jamais les fastueux prélats qui vivent dans le luxe et l’oisiveté, n’oublient de faire un dithyrambique éloge de la pauvreté. Aux ouailles ils rappellent que Jésus n’avait pas une pierre pour reposer sa tête, ajoutant que pour gagner le paradis l’on doit faire des largesses à ces messieurs du clergé. Pareille duplicité fut fréquente chez les moralistes officiels de toutes les époques : à Rome, le philosophe Sénèque écrivit, dit-on, l’éloge de la pauvreté sur un pupitre d’or. Nos idées sont bien différentes : nous condamnons la pauvreté. Tout au plus admettons-nous qu’elle soit bonne, en certains cas et de façon transitoire, à titre de moyen pour aboutir à une vie plus haute ou à la réalisation d’une idée. Mais l’on ne saurait comprendre que le travail normal d’un homme ne garantisse pas largement sa subsistance. Si le monde est trop peuplé, qu’on limite les naissances ; si la répartition des biens s’accomplit sans équité, qu’on la change. Faire de la pauvreté des uns le corollaire de la richesse des autres est la pire solution ; l’extrême opulence s’avère contre nature autant que l’extrême misère. L’homme n’a droit qu’à ce dont il peut user ; accaparer d’inutiles moyens d’existence devient un attentat contre le bonheur d’autrui ; vouloir l’or pour lui-même, non pour ses avantages, est une criminelle perversion du désir. L’argent, simple instrument d’échange, n’a d’autre titre à demeurer roi des cités que l’avantage des fainéants rentés. En attendant que la justice prenne sa revanche, quels moyens s’offrent de se libérer ? Restreindre nos besoins, limiter nos charges, insoucieux des préjugés ; ou produire sans arrêt, sans relâche, se transformer en bête de somme. Accepte qui voudra la seconde solution, ce n’est pas celle du sage. Un travail, modéré, raisonnable, sera toujours nécessaire et sain ; dans une société moins chaotique, il deviendrait obligatoire pour tous ; l’âge ou la maladie seuls en dispenseraient. Mais fournir un labeur de forçat pour qu’un parasite repu daigne vous qualifier de bon citoyen, cela jamais. Aider ses frères dans la peine, oui ; entretenir des bœufs gras à l’étable, non. Faisons plutôt une large place au sentiment, à la pensée, au rêve, en éliminant les factices et ruineux plaisirs de l’alcool, du tabac, d’une cuisine raffinée ou d’une mise excentrique. Une table hygiénique et simple, pour la bourse comme pour l’estomac ne vaudrait-elle pas mieux ? Et les vêtements ridicules, fabriqués par nos grands couturiers, sont-ils donc si beaux ? Elégance et confort n’ont rien à voir avec un luxe insolent ; dans les bazars d’antiquailles nos affûtiaux compléteront bientôt des collections grotesques ; un visage sans défaut n’a pas besoin de fard et, lorsqu’on est fatigué, un lit de bois vaut un lit d’or. Certes, il est des jours où l’on souffre de n’être pas riche, en voyant autour de soi tant de misères qu’il faudrait soulager, tant d’œuvres qu’il faudrait soutenir. Une enquête menée dans le Semeur, par Barbé, sur l’utilité que l’argent peut avoir pour un militant d’avantgarde, a très bien mis en lumière certains aspects du problème. Mais comme la richesse durcit le cœur et le corrompt, sauf chez quelques hommes d’élite comme elle résulte habituellement d’une spoliation légale faite au préjudice d’autrui, elle ne fait point l’objet de nos convoitises.
— L. BARBEDETTE.
PÉDAGOGIE
n. f.
La pédagogie est, nous affirment la plupart des dictionnaires, l’art d’instruire et d’élever les enfants. D’après certains auteurs elle serait la science de l’éducation.
Pour bien comprendre cette opposition, déterminer laquelle de ces définitions est la vraie ou si elles le sont l’une et l’autre dans une certaine mesure, il faut faire appel à l’histoire. Et l’histoire nous répondra que les arts ont toujours précédé les sciences mais aussi que le progrès des sciences a été constant, que de plus en plus les arts font appel aux sciences pour déterminer les buts qu’il faut atteindre et les moyens d’y parvenir. La pédagogie a donc été tout d’abord un art. Art bien empirique et bien imparfait, que nous retrouvons non seulement chez les sauvages, mais encore chez les animaux. Le faucon exerce ses petits à la chasse. Le canard apprend peu à peu à nager aux canetons. La mère ourse donne des leçons à son ourson, le punissant et le récompensant suivant qu’il fait preuve de bonne ou de mauvaise volonté à l’étude. Les fourmis ont leurs leçons de gymnastique et de construction. Cette éducation animale basée sur l’exemple et l’imitation est une préparation à la vie par un apprentissage gradué.
Nous ne savons pas comment nos ancêtres préhistoriques élevaient leurs enfants, mais nous pouvons en avoir quelque idée par la connaissance de la pédagogie des primitifs, c’est-à-dire des sauvages actuels. Chez les plus déshérités d’entre eux, l’éducation est pour ainsi dire inexistante, mais l’allaitement dure très longtemps : trois ans ou plus. Chez des peuples moins arriérés on peut observer trois degrés dans l’éducation. Au premier degré c’est l’éducation domestique, libre de l’enfant que le père ou la mère — suivant les peuplades — ont décidé de conserver, car il est des enfants que l’on tue, soit parce qu’on les juge trop faibles — et ce sont surtout les filles, moins utiles, qui sont supprimées — soit pour toute autre cause.
A cette première période (puériculture) succède celle de l’initiation sexuelle. La mère s’occupe de la fille et lui apprend les soins du ménage. Le père s’occupe du garçon. A l’initiation sexuelle succède l’initiation sociale, réglée soigneusement par la tradition et où la magie tient une large place. Les enfants sont alors soumis à des épreuves (tatouages, dents arrachées, mutilations, initiation à des secrets magiques, etc.) accompagnées des chants et des danses rituelles. On a essayé de civiliser ces primitifs, les expériences n’ont donné que de maigres résultats : les adultes ne sont pas modifiables ; les éducateurs ont été le plus souvent des missionnaires catholiques ou protestants qui ont plus songé à évangéliser qu’à éduquer véritablement. Une véritable éducation de ces peuplades doit être tout d’abord professionnelle et adaptée au milieu. Il faut tenir compte des tendances héréditaires.
« Chateaubriand, dans le Génie du Christianisme, dit que l’amour de la patrie est un sentiment qui a été placé dans le coeur de l’homme par Dieu lui-même ; il cite des sauvages venus des endroits les plus éloignés et transplantés dans des pays civilisés, à Paris par exemple, où ils mouraient d’ennui ; il en conclut que l’amour de la patrie est un sentiment inné et divin. Il n’en est pas ainsi : il faut voir dans cet amour du milieu où le sauvage a été élevé, le fruit d’une longue adaptation de la race qui fait prendre à l’organisme des tendances telles qu’il ne peut. bien vivre que dans ce seul milieu. » (Sluys)
Qui a bien compris ceci admettra sans peine que les patriotismes iront en s’affaiblissant au profit de l’internationalisme. Sluys écrit encore :
« L’enquête sur l’éducation des primitifs montre que pendant un nombre considérable de siècles, l’évolution de l’éducation suit l’évolution sociale elle-même ; le milieu modifie, l’hérédité fixe, les croyances cristallisées sont. transmises par des initiations ; l’enfant imite les parents et s’adapte ainsi au milieu social. »
La Grèce antique a vu s’opposer deux systèmes d’éducation : l’éducation du guerrier à Sparte et du citoyen à Athènes. Sparte fut, pendant des siècles, un haras humain : ne pouvaient se marier les individus mal conformés ou qui avaient été lâches à la guerre ; les nouveaux-nés faibles, chétifs, tarés étaient jetés dans une fondrière. A partir de sept ans, les enfants enlevés à la famille étaient endurcis physiquement et moralement, habitués à la douleur, aux jeux violents, exercés à la course, au saut, à l’a nage. Cette éducation produisit une race de guerriers grossiers, inhumains et perfides, dont le nombre alla d’ailleurs en diminuant et qui finirent par être gouvernés par des femmes. Lorsque l’on parle de l’éducation à Athènes, il ne faut pas oublier que cette éducation, qui avait pour but de former des citoyens, ne s’appliquait qu’aux enfants des citoyens et qu’il y avait, à Athènes plus de dix fois plus d’esclaves et de serfs que d’hommes libres.
Le but de l’éducation, à Athènes, était de former le citoyen cultivé, fort, sain, aimant le bon et le beau. La civilisation brilla alors à Athènes tout pendant que ses habitants ne se laissèrent pas amollir par la richesse, la puissance et le voisinage du luxe oriental, Rome imita alors le système d’éducation de la Grèce sans cependant l’égaler. Parmi les caractères particuliers de l’éducation romaine, il faut en noter quelques-uns qui ont influé profondément et pendant longtempssur l’éducation française. D’abord le droit du père de famille de noyer ou d’étouffer le nouveau-né difforme et d’user de sévères punitions corporelles ; ensuite l’invention de la grammaire, de la rhétorique ; l’étude des humanités, c’est-à-dire celle du grec, à l’aide de versions, de thèmes, etc.
Puis la civilisation romaine sombra sous les invasions barbares.
Pendant le moyen âge, l’éducation fut avant tout chrétienne. L’étude se faisait d’après les textes ; l’observation était négligée ; l’enseignement. portait sur des mots, des définitions, des raisonnements appliqués à des principes que l’on considérait comme indiscutables parce qu’ils appartenaient au dogme ou avaient été formulés par Aristote. Ce fut le règne de la scolastique et l’on vit des thèses de doctorat qui ne peuvent que nous faire sourire aujourd’hui, par exemple :
« Adam et Eve avaient-ils un nombril ? »
« Quand un paysan va au marché, menant un cochon au bout d’une corde, est-ce le paysan qui conduit le cochon ou est-ce la corde ? »
Notre pédagogie a évolué depuis, mais on y retrouve encore la trace des influences grecque et romaine comme aussi du verbalisme du moyen âge.
Il y a cependant entre la pédagogie du primitif et celle du croyant une différence, et la seconde marque un réel progrès. La première est empirique, elle se suffit à elle-même et est conduite au petit bonheur ; la seconde recherche des principes directeurs. Ces principes, elle les emprunte à une philosophie métaphysique et dogmatique. L’enfant, de par la faute d’Adam et d’Eve, est un être imparfait qu’il faut corriger à l’aide de punitions ou de récompenses ; ce petit d’homme est aussi un petit homme et on le traite comme tel ; on ne conçoit pas qu’il puisse exister chez l’enfant des tendances ayant seulement une valeur fonctionnelle, c’est-à-dire uniquement propres à assurer son développement.
Mais la philosophie a évolué, elle s’est efforcée et s’efforce encore de devenir une science positive ; elle s’appuie sur la psychologie qui, de dogmatique qu’elle était en ses débuts, tend à devenir scientifique et expérimentale, en prenant appui à son tour sur ra biologie et la sociologie.
La science de l’éducation se constitue peu à peu, mais elle n’est encore qu’ébauchée. S’occupant d’un être vivant qui évolue dans un milieu social, la pédagogie scientifique ne peut exister que si la biologie et la sociologie forment des sciences positives. Actuellement, la pédagogie est encore un art qui s’efforce de devenir une science. Mais faut-il encore parler de pédagogie, alors que ce mot a un contenu tout autre que celui qu’il avait il y a moins d’un siècle ? A. Nyns dit :
« Nous n’avons pas conservé le vieux mot. de pédagogie parce que cette science est restée trop en dessous de nos conceptions modernes, parce qu’elle a des attaches trop fortes avec la métaphysique et la philosophie spiritualiste, alors qu’elle devrait être une branche des sciences naturelles.
Nous avons lancé le mot de Pédotechnie parce qu’à une conception nouvelle de l’éducation, il faut un mot nouveau. »
D’autres mots également (Pédiatrie, etc.) ont été créés ; l’ancienne pédagogie s’est modifiée, divisée ; les auteurs de ces divisions ne sont pas, d’ailleurs, toujours d’accord ; en particulier ils ne s’entendent pas sur ce qu’est ou doit être la « pédagogie expérimentale ». Ce sont là des questions qui intéressent surtout les spécialistes.
Mais il n’est pas besoin d’être spécialiste pour s’intéresser à la pédagogie et des connaissances pédagogiques plus étendues seraient utiles à tous les éducateurs. C’est un tort, pour les parents, de croire que l’amour de leurs enfants est suffisant pour leur faire trouver intuitivement ce qu’il convient de faire ou de ne pas faire ; ceci qui est évident pour tout ce qui a trait à la vie physique — combien d’enfants sont victimes des maladresses alimentaires ou hygiéniques de leurs parents ! — ne l’est pas moins en ce qui concerne la vie intellectuelle et morale. C’est un tort pour les éducateurs de profession de se fier à leur pratique, la pratique devient vite routine et d’ailleurs, pour être acquise, elle nécessite des tâtonnements que l’on eût abrégés et des erreurs que l’on eût évitées par l’étude de la pédagogie. Nous n’insistons pas sur ce sujet, il suffira à nos lecteurs de se reporter à quelques-unes des études pédagogiques que nous avons données en cet ouvrage, par exemple aux mots « éducation » et « morale », pour se rendre compte de l’utilité des études pédagogiques.
Non seulement les méthodes de la pédagogie, ces fondations, ont évolué, mais encore les buts qu’elle se propose d’atteindre ont subi quelques changements. Il semble que l’on a plus que jadis le souci de respecter la personnalité de chacun ; l’éducation tend à ne plus être un dressage, mais à favoriser l’épanouissement des tendances utiles de chaque individu ; l’instruction fait place aux exercices individuels, l’école tend à être sur mesure, c’est-à-dire à la mesure de chacun. En revanche, il est certain que la concurrence, l’émulation qui tenaient une si large place dans l’ancienne pédagogie cèdent peu à peu du terrain devant l’entraide et la coopération. En résumé, la pédagogie tend actuellement vers l’individualisme et l’entraide, c’est-à-dire vers l’anarchie, au sens que les meilleurs penseurs (Kropotkine, par exemple) ont donné à ce mot.
— J. DELAUNAY.
PÉDANT, PÉDANTISME
La société est pleine de pédants qui déguisent leur impuissance sous de grands airs austères : représentants de l’autorité, administrateurs et fonctionnaires quelconques, délégués de sociétés reconnues ou non d’utilité publique, tous se composent un visage sévère, en rapport avec leurs missions plus ou moins secrètes et leurs fonctions plus ou moins grotesques. Ils pensent nous en imposer avec leur attitude compassée. Ils nous font suer avec leurs manières. Tout chez eux est étudié. Rien ne vient troubler leur sérénité. Leur visage est un masque sous lequel s’abrite la dissimulation. L’autorité est basée sur ces gestes mécaniques et ces physionomies rébarbatives. Il faut bien, pour justifier l’utilité du métier qu’ils exercent, qu’ils embêtent les gens. Ils sont tyranniques et orgueilleux, croient tout savoir et se croient tout permis, ne souffrent pas qu’on leur parle d’égal à égal, mais toujours d’inférieur à supérieur. Le mal que font ces imbéciles est irréparable. Ils ne conviennent jamais de leurs erreurs. Ces gens qui se croient quelque chose parce qu’ils portent sous le bras une serviette bourrée de papiers font pitié. Je les méprise. Ils sont mûrs pour le professorat, qui exige des diplômes et une mine renfrognée. Décidément il y a des gens qui sont faits pour tenir certains emplois et remplir certaines fonctions : ils sont bien à leur place.
L’écueil de tout enseignement, c’est le pédantisme. A bas les pédants ! Les pédants sont une race insupportable. Quand on les rencontre, on a envie de fuir à 500 kilomètres. Ils ont une odeur spéciale. Leur ton autoritaire essaie d’en imposer. Derrière tout ce fatras d’érudition et de grands gestes, il n’y a rien. Avec eux, la vie est une chose morte. Ils en ont fait un mécanisme sans imprévu. Défense de les questionner. On doit accepter les yeux fermés la vérité qui tombe de leurs lèvres. « J’ai dit », supprime d’un seul coup toutes les objections. Pas de discussion possible avec ces tyrans. Ce sont les fascistes de l’enseignement. Avec ces pédants, on s’éloigne de la vérité. On s’éloigne de la vie. On ne pense pas, on ergote. On n’avance pas, on piétine. La science n’est plus qu’un monde décoloré et figé, qu’un fouillis inextricable de formules, où ne pénètre ni air, ni lumière ; qu’une construction aussi déplaisante qu’une prison ou une caserne. Leur science n’est qu’une pseudo-science, sans portée et sans intérêt.
Avec les pédants, tout est rétréci, amoindri, châtré. L’obscurité leur tient lieu de profondeur. Ils ne voient que les détails, au détriment de l’ensemble. La synthèse leur échappe. Ils ne saisissent aucune unité. Ils pataugent au milieu de notes, de fiches, de documents dont ils ne savent pas tirer parti. Nulle lueur dans cet enseignement. Tout avec eux devient néant. Je ne puis souffrir les gens qui ont des serviettes sous le bras (larbins ou barbacoles). J’ai horreur du type professeur. Le professeur cela me fait l’effet d’un fossile. C’est un squelette ; rien de plus. Le professeur, c’est le contraire de l’artiste. II hait par dessus tout l’originalité et la sincérité. Le professeur n’innove pas, n’invente pas. Il se borne à recueillir le fruit du travail des autres, mal digéré et qu’il déforme. Il n’a pas d’envergure, pas d’imagination. Pas de gestes larges. Tout est petit, rapetissé, mesquin. Placez-le devant une création originale, le professeur ne comprend plus : il n’a vu cela nulle part. L’élève qui a fait un bon devoir est puni : j’appelle bon devoir celui qui est personnel. Est bon devoir, pour le professeur, celui qui ne renferme aucune idée, mauvais celui qui atteste une personnalité et sort de l’ordinaire. Aucune idée subversive n’est tolérée par le professeur. Et il n’est pas difficile d’avoir une idée subversive : la moindre idée où il entre une lueur d’intelligence est subversive pour le professeur. Le professeur répète chaque jour ce qu’il a dit la veille, sur le même ton compassé et vieillot. Il épluche, il corrige. Tant de fautes contre la grammaire, contre le style, contre la tradition ! Or, le professeur ignore la grammaire, écrit mal et fausse la tradition. De quel droit apprend-il aux autres l’orthographe. Le professeur est le type du pédant. (Voir le mot Professeur).
— Gérard de Lacaze-Duthiers.
PEINTURE
n. f. (du latin pictura, même sens)
INTRODUCTION.
On peut, d’une façon générale, désigner par le mot peinture tout emploi d’une matière colorante sur une surface ou sur un modelé, dans un but de figuration symbolique ou de simple ornementation. D’une façon plus étroite, ce terme est réservé à la représentation, par la couleur, des objets, des images de la vie, et, par cette représentation ou son simulacre, à l’expression des sentiments, des passions, des comportements individuels ou collectifs de l’homme, et d’abord de celui qui s’exprime, l’artiste. Les procédés mécaniques ne peuvent donc pas entrer dans cette définition. A la suite de préoccupations et de recherches nécessitées par des perfectionnements ou des reculs de la technique, la représentation expressive et symbolique des images a pu, dans certaines circonstances, faire place, plus ou moins complètement au simple jeu des rapports de couleur et à leur prestige .sur les sens ; le but a cédé devant le moyen.
Les phases de l’évolution de la peinture oscillent, très généralement, entre deux ordres de préoccupations ou de tendances : l’expression et la décoration, plus ou moins distinctes ou mêlées selon les tendances générales d’une race, d’une époque, ou les tendances particulières des artistes ; les unes et les autres étant en partie déterminées par les conditions générales de la vie économique et sociale et de la vie spirituelle et morale, mais tout autant par la nature, la possibilité d’adaptation et la connaissance d’usage des matériaux qui servent à l’élaboration de l’œuvre d’art, c’est-à-dire par les conditions de la technique. Et les grandes époques d’art, les grandes réalisations de l’art sont celles où les deux tendances se fondent sans qu’il soit possible de les distinguer, car, à vrai dire, le souci de l’expression n’est sensible qu’au prix d’une certaine défaillance de la technique et les recherches de la technique ne deviennent apparentes qu’au prix d’une certaine défaillance de l’inspiration.
Autour de ces préoccupations maîtresses se développent, plus ou moins, les préoccupations de ligne, de couleur, de modelé ou volume, de lumière et d’espace. Ce sont les variations de rapports de ces diverses préoccupations qui permettent de différencier les styles et les écoles. Un style n’est pas autre chose que l’utilisation d’une matière aux besoins, aux tendances, aux idées et au goût d’une région, d’une époque, d’une société, ou d’un artiste, compte tenu des lois particulières à la matière employée. Aux artistes de découvrir ces lois, de pousser la découverte au delà des sentiers battus. Il n’est pas un grand artiste qui n’ait, en quelque manière, par enrichissement ou par simplification, modifié la technique de son art et entraîné, dans un certain sens, l’évolution de cet art après lui. Nous pouvons même dire que l’influence d’un artiste se mesure bien plus par les modifications qu’il a apportées à la conception technique de son métier que par les conceptions idéologiques dont semblent témoigner ses interprétations de la vie. Mais pour qui sait aller plus loin que l’apparence, c’est dans ses interprétations techniques que peut se lire le mieux sa conception de la vie.
Cette position relative des éléments constitutifs de l’œuvre d’art et la prédominance accordée à la réalisation technique sur le « sujet » montre que l’on distingue à tort le fond et la forme, l’invention et l’expression. Ils se confondent, et il n’y a pas d’art qui se contente d’inventions. Comme l’ont dit les plus anciens sages, aucune chose n’existe tant qu’elle n’a pas été nommée. La réalisation artistique c’est ce qui donne un nom à l’invention, ce qui l’appelle à l’existence.
Cette position de vue permet de comprendre que, pendant tant de siècles, un art comme la peinture ait pu vivre autour d’un nombre très restreint et indéfiniment répété de motifs. Elle explique que nous puissions considérer cent interprétations, à peu près identiques dans le fond, d’une même apparence, mais qu’une entente particulière de la densité, de la résistance, de la statique ou des vibrations de la forme et de la couleur, un sens particulier de la lumière et de l’espace suffisent à différencier. La juxtaposition de deux taches, la justesse ou la nouveauté d’un rapport, nous sont des témoignages plus probants de l’authenticité d’un peintre que des recherches ou des intentions qui n’ont à figurer que pour mémoire dans l’histoire de la peinture.
Mais la qualité de la matière ne suffit pas davantage et seule à conditionner l’œuvre d’art. Les réalisations techniques n’impliquent pas nécessairement la richesse de la matière ou le développement des procédés industriels. Certaines époques, certaines sociétés, très riches, très développées industriellement, n’ont produit que peu d’œuvres d’art ou des œuvres inférieures. Par contre, aux mêmes époques d’autres peuples, ou les mêmes peuples à d’autres époques ont, dans des conditions économiques défavorables, avec des instruments défectueux, réalisé des œuvres d’art parfaites. La perfection de la peinture n’est donc relative ni au sujet seul, ni à la seule matière ; elle est l’adaptation relative des moyens d’expression à la chose exprimée.
De ce point de vue relatif, l’histoire de la peinture doit tenir compte :
-
de la nature et de l’emploi des surfaces ou des objets sur lesquels la peinture a été appliquée ;
-
de la nature et de l’emploi des couleurs et des produits employés pour les combiner ;
-
de la nature et de l’emploi de l’instrument et de l’adaptation de la main. Car la peinture est d’abord ouvrage d’ouvrier, et l’histoire de la peinture ne peut être considérée indépendamment de l’histoire générale du travail humain.
Toutefois on ne peut l’envisager indépendamment des conditions de la vie spirituelle des civilisations, considérée sous le double aspect de révolution ou de la stagnation des institutions et de l’épanouissement ou de l’étouffement des individus. Les événements politiques, à moins qu’ils n’aient été accompagnés de vastes transformations sociales, n’ont que peu d’importance pour l’évolution de la peinture. Des événements d’ordre privé en ont souvent davantage. Dans les périodes de gouvernement personnel, une mort, un déplacement, le changement de goût, d’idées morales ou religieuses de la personnalité dirigeante peuvent avoir, dans une continuité politique parfaite, plus d’importance pour la vie de l’Art qu’une Révolution. Dans les périodes de gouvernement républicain, qui oscillent toujours entre l’oligarchie théocratique ou financière et l’ochlocratie (dite démocratique), à moins qu’elles ne les combinent profitablement, c’est aux conditions économiques qu’appartient l’influence déterminante.
Ceci posé, et toutes réserves faites sur l’interprétation de certaines formes de la peinture qui se présentent à nous en vestiges isolés, nous allons passer en revue les grandes manifestations de la peinture considérée tomme moyen d’expression et d’ornement de la vie des hommes et de leur conception caractéristique d’une « formule » universelle, logique, harmonieuse, c’est-à-dire esthétique, d’arrangement des éléments qui les entourent. Nous ne cherchons pas à donner un exposé historique sans lacunes. Ce qu’il nous importe de dégager, ce n’est pas la série complète des écoles, mais seulement les phases de la continuité artistique susceptibles de contribuer à une connaissance positive de l’homme, comme elles ont contribué au développement de l’espèce par le perfectionnement des individus.
I. LA PRÉHISTOIRE.
A) Europe.
Il est impossible, dans l’état présent des connaissances, de dresser un tableau, même approximatif, des époques voisines de l’origine de l’art et de déterminer quel est celui des arts plastiques dont l’usage est le plus ancien. Les découvertes faites en ce domaine ne constituent encore qu’une très faible collection de documents, que nous devons nous contenter d’enregistrer, sans conclure. Documents relatifs : les uns aux matériaux employés, les autes aux conceptions générales des artistes primitifs, d’autres enfin à leur style. Les premiers en date de ces documents semblent être les restes de matières colorantes trouvées aux Roches (Indre), à la grotte des Fées (Vienne) et aux Cottés (Vienne), dans des dépôts de l’industrie aurignacienne (1re période archéologique), comprenant : sanguine, terres rouges et lie de vin, grès ferrugineux, ocres rouge et jaune, pyrolusite et oxyde de manganèse. On connaît, de la même industrie, des dessins en couleur représentant des animaux : bovidés, chèvres, bouquetins, chevaux, exécutés avec une sûreté de trait et une justesse d’observation déjà remarquable, ainsi que de nombreuses représentations de mains humaines, en blanc, sur fond noir ou rouge.
Les découvertes de cette période sont, jusqu’à ce jour, localisées en Espagne et dans le Sud-ouest de la France.
Après une longue lacune pendant l’époque solutréenne, l’art de peindre renaît avec l’industrie magdalénienne, 3e et dernier des âges archéolithiques. Ce sont les mêmes régions : Espagne et Sud-ouest de la France, qui nous ont livré les documents les plus saisissants. Leurs peintures sont les plus belles de toute la Préhistoire et certaines d’entre elles comptent parmi les plus fortement expressives et les plus grandioses de tous les temps. Ce sont, en majorité, des représentations animales : Mammouths, bisons, lions, loups et renards, rhinocéros, ours, sangliers, chevaux, cerfs, élans, antilopes, bouquetins et chevreuils et le renne, surtout, dont cette période constitue l’ultime habitat dans nos régions, illustrent les parois des cavernes à Altamira, la Vieja, la Morella de la Vella (Espagne) ; à Lorthet (Hautes-Pyrénées), au Mus-d’Azil (Ariège), aux Cabrerets (Lot), aux nombreux abris de la Dordogne : Laugerie, Combarelles, Font de Gaume, les Eyzies, la Madeleine, le Moustier, et à Bruniquel (Lot-et-Garonne). Nous y trouvons aussi des représentations de phoques et de poissons. Les motifs tirés des végétaux ou des thèmes géométriques sont rares, ce qui tend à prouver que l’invention décorative est postérieure à l’expression symbolique. Enfin il faut noter que les représentations humaines, d’ailleurs rares, sont maladroites, hésitantes, presque informes, alors que l’expression des types animaux, de leurs caractères et de leurs mouvements dénote un art depuis longtemps sorti des balbutiements primitifs, arrivé à un point élevé de son évolution. Le réalisme puissant et synthétique des artistes magdaléniens, qui élimine les détails inutiles, leur compréhension des détails maintenus dans l’harmonie de l »ensemble et la forte structure de leurs figurations ne peuvent être le fait d’une humanité cérébralement arriérée. Les artistes magdaléniens nous apparaissent, au contraire, comme les détenteurs d’une savante maîtrise. Certains préhistoriens, comme Jacques de Morgan, les estiment mieux doués que les peuples : égyptiens, chaldéens, peut-être même que les Hellènes dont nous avons reçu les principes de l’art, dans la période historique. Quoi qu’il en soit, l’unité de style que nous constatons alors entre les œuvres des diverses stations, nous permet de conclure à une certaine communauté de civilisation entre des groupes géographiquement assez éloignés, et par conséquent à des échanges et à une pénétration réciproque, plus explicable par des relations pacifiques que par les guerres de clans auxquelles naguère on les attribuait. Quand nous considérons, au contraire, l’alternance entre des périodes d’activité artistique et des périodes de décadence, nous pouvons conclure que les premières ont été des périodes de paix relative entre des populations civilisées, tandis que les secondes ont été les témoins de guerres et d’invasions barbares. Et nous pourrions expliquer ainsi l’importante lacune qui s’ouvre, à la fin du quaternaire, avec la disparition des centres magdaléniens, pour ne se refermer qu’après de nombreux millénaires, avec l’apparition dans nos régions de l’industrie énéolithique, apparition de beaucoup postérieure aux premières manifestations esthétiques proto-historiques, de l’Egypte, de l’Elam et de Sumer. C’est en Orient, désormais, et pour un très long temps que nous devrons chercher des témoignages de l’activité artistique.
Mais nous devons, auparavant, nous demander comment et pour quelles raisons profondes l’homme, différencié peut-être par cela même des autres animaux, a trouvé les lois de figuration, d’expression, d’harmonie qui constituent, à proprement parler, l’art. Sans nous attarder à exposer toutes les théories émises à ce sujet, nous écarterons celles qui tendent à présenter l’invention de l’art comme ayant eu pour but l’ornement des cavernes et l’agrément des populations qui y employaient les loisirs de leurs longs hivers polaires. Il faut remarquer en effet que la plupart des peintures, et les plus importantes, se trouvent dans les parties les plus reculées des cavernes, et qu’elles ne sont visibles et n’ont, par conséquent, pu être exécutées qu’à la lumière artificielle. Et ce que nous connaissons du luminaire primitif ne laisse pas supposer qu’elles aient pu être éclairées dans leur ensemble, pour le plaisir des chasseurs. D’autre part, divers signes, comme les mains humaines, les points, les traits qui couvrent les représentations animales, et la simultanéité de figurations symboliques, vraisemblablement astrales, nous amènent à une conception de l’invention des arts qui n’est pas celle de l’agrément et de la récréation. Les observations qui ont été faites sur les peuples actuels restés aux stades primitifs et les documents écrits des premières civilisations primitives, nous permettent de formuler cette proposition : l’art est d’essence religieuse et son premier usage est une magie. Magie sympathique d’une part, qui, par la représentation d’un être, a pour but soit de s’en ménager les faveurs, soit de s’en assurer la possession ; totémisme d’autre part, c’est-à-dire, adoption par un clan d’une force, naturelle ou animale, qui serait son ancêtre et, à la fois, sa patronne, et dont les images se retrouvent sur les armes, dans les tatouages et dans les lieux consacrés. C’est ainsi que s’explique le fait de la figuration exclusive, dans certaines grottes, de certaines espèces animales, indépendamment des conditions réelles d’habitat des espèces. De ce totémisme primitif en vertu duquel l’homme s’assimile à la divinité animale de laquelle il se croit issu, dérivent toutes les assimilations animales des masques, des vêtements de sorciers et des parures ecclésiastiques. Les dieux animaux des Egyptiens, les monstres à tête humaine sur un corps animal ou à chef animal sur un corps humain, kheroubims, minotaures, centaures, etc., et les mythes de la métempsychose n’ont pas d’autre origine. Il a fallu la raison grecque pour que le culte des dieux anthropomorphes remplace celui des dieux zoomorphes et des forces naturelles. Ainsi l’art, avec la religion, est parvenu à l’humanisme auquel il est encore, généralement, fidèle.
Si nous nous sommes attardés un peu longuement à cette lointaine apparition de l’art dans l’humanité primitive, c’est que les problèmes qu’elle pose et les observations qu’elle suscite ont une portée telle qu’elle ne s’est pas encore épuisée. L’art vit toujours, comme l’humanité elle-même, sur les thèmes les plus anciens ; et les artistes les plus grands sont ceux qui, dans la représentation la plus humble, ont mis non seulement leur être, avec tout ce qu’il sait et tout ce qu’il peut, mais le trésor entier des expériences humaines, des plus obscures, des plus inconscientes, jusqu’à celles qui, peu à peu, et sans qu’il ait à renier aucun balbutiement des ancêtres, s’élèvent au-dessus des croyances et, par la raison qu’il en prend, le libèrent.
B) Orient Primitif.
Nous avons dit quelle lacune s’ouvre soudain dans nos pays, à la fin des temps quaternaires. Ni les âges mésolithiques, ni le néolithique ne nous ont laissé les traces d’une culture artistique. Et pourtant ces périodes témoignent d’un indéniable progrès industriel, la dernière même voit naître tous les perfectionnements de la vie sociale que connaît depuis, l’humanité.
En Orient, au contraire, la décoration par le dessin et la couleur dénote un art raffiné. Mais il semble que celui-ci soit le fait d’une civilisation importée. L’industrie des métaux y apparaît contemporaine des témoignages proprement néolithiques, concurremment avec l’emploi des matières précieuses, des pâtes colorées et des émaux dont la présence atteste, à défaut d’œuvres indépendantes, le sens de la couleur et du dessin qui sont à la base de l’art de peindre. C’est à la céramique que nous devons emprunter nos documents.
Les motifs de décoration proprement néolithiques : lignes brisées et figures géométriques (triangle, carré, cercle, spirale, etc.) sont appliqués au moyen d’une incision, remplie de blanc. Les Susiens primitifs y ajoutent une stylisation ingénieuse des formes animales et végétales, en rouge et en noir ; puis le style évolue vers le naturalisme. En Egypte, la technique est plus proprement picturale ; les motifs, mouchetures, spirales, rayures, fleurs, oiseaux, barque funéraire, sont, le plus souvent, posés à froid, au moyen de couleurs broyées, liées par un corps gras ou adhésif. Les îles méditerranéennes emploient les deux techniques, asiatique et égyptienne, mais introduisent dans la décoration un goût très personnel dans l’interprétation naturaliste. Dès qu’apparaît, en Europe occidentale, vers le début du premier millénaire, un art saisissable, nous le voyons marqué d’influences diverses, à la fois septentrionales (et sans doute dérivées par là de l’orient sibérien) et méditerranéennes.
II. PÉRIODES ARCHAÏQUES.
A) Egypte.
L’impression générale hiératique produite par l’art égyptien proprement dit est toute différente de celle que nous donnent les premières manifestations de cet art, aux temps prépharaoniques. Il semble qu’une nouvelle race soit ici intervenue. Quoi qu’il en soit, nous devons noter que l’art égyptien qui nous est parvenu est un art funéraire. Les Egyptiens, au dire de Diodore, considéraient leurs maisons comme des lieux de passage et leurs tombeaux seuls comme des demeures durables. Cela explique le luxe des apprêts des tombes et que nous y ayons trouvé, éternisés par l’art, ainsi que dans les temples, les aspects de la vie et les documents de l’histoire.
La peinture égyptienne funéraire est faite de tons plats, frais et vrais, sans nuances, sans artifices de lumière et d’ombre, cernés par un dessin rigoureux. Elle est, par là, éminemment décorative. Ses lois générales sont les mêmes que celles du bas-relief ; et nous ne devons pas oublier que les bas-reliefs égyptiens, et la sculpture en ronde-bosse elle-même, étaient enluminés de couleurs. La peinture ne joue donc qu’un rôle secondaire dans l’admirable unité de l’art égyptien. Elle n’en est pas moins importante pour nous, et par ses qualités décoratives et par l’abondance des documents qu’elle nous apporte sur la vie égyptienne.
Abstraction de l’illusion optique et de la perspective, souci de ce qui est et non de ce qui se voit, en même temps recherche de l’exactitude, précision scientifique du détail, choix de ce qui est essentiel, tels sont les caractères qui ont fait de l’art égyptien un modèle de vie, de vérité et de style. Au point de perfection où nous voyons, dès le troisième millénaire, le rendu de la forme et la souplesse de la main, nous ne pouvons admettre que des artistes pour qui nul obstacle de matière, nulle difficulté d’expression n’existait, aient ignoré la perspective, ou le raccourci, ou le jeu des couleurs (alors qu’ils ont créé de si chatoyants bijoux) mais plutôt qu’ils les ont jugés inutiles et par là même les ont éliminés. Les artifices qu’ils ont admis et qui composent le corpus de leurs conventions esthétiques, se défendent pour des raisons de vérité permanente, de grandeur dans le style et de nécessité symbolique, L’art égyptien est le triomphe d’une volonté raisonnée, pure de sentimentalisme, sereinement impassible, mais, en même temps — et en particulier dans la peinture -enjouée par la spiritualité. Les conventions hiératiques et la conception architecturale qui président à la peinture égyptienne n’en ont pas exclu la variété et la vie. Nous n’en voulons pour témoins que les portraits, non seulement individuels, mais collectifs, portraits de races qui accompagnent maintes scènes commémoratives ou familières, les représentations animales et l’ornementation décorative.
L’art égyptien, qui a réalisé ses données essentielles dans la période comprise entre la quatrième et la douzième dynastie (2900 à 1800) n’a, par la suite, que peu évolué. Il convient cependant de signaler une véritable mais courte révolution, sous le règne d’Aménophis IV (1372–1354 av. J.-C.) et de son gendre et successeur Toutankhamon. Parallèlement à une tentative religieuse pour remplacer tous les dieux égyptiens par le culte immatériel du dieu solaire « Aten », une rénovation artistique introduisit, avec l’école d’El Amarna, la spontanéité, la fraîcheur, le charme, en même temps qu’elle atteignit une acuité inconnue dans l’expression psychologique. Mais la réforme religieuse échoua, et, avec le pouvoir des prêtres, l’art égyptien retomba dans les conventions rituelles.
Les sujets traités par la peinture égyptienne constituent le recueil le plus complet de documents sur la vie de cette longue civilisation et de celles qui l’ont entourée : les dieux, leur culte et leurs légendes, les croyances funéraires et la vie des vivants, la maison, les jardins, les champs, la chasse et la pêche, le commerce et le travail des métiers, les jeux et les plaisirs, la vie publique, les guerres et les défilés de peuples. Par leur large participation aux préoccupations de la vie populaire, les artistes égyptiens furent les premiers, et longtemps les seuls, à ajouter aux éléments religieux de l’époque primitive un élément social.
B) Asie Occidentale.
En dehors de la céramique décorée dont la production cesse très tôt, nous n’avons aucune œuvre peinte proprement dite des hautes époques de l’Asie Occidentale. Il est probable que la peinture, qui était utilisée, comme en Egypte, sur les stucs de revêtement des palais et des temples, suivit l’évolution des autres arts, que l’on peut résumer ainsi : sur un fond commun asiatique, apparaissant dès le début du 3e millénaire et dont la forme la plus haute se présente, en Sumer, entre le XXVe et le XXIe siècles, chaque région de l’Asie Occidentale a apporté ses variantes particulières ; les périodes de domination sémitique, à partir du XXIXe siècle, sont marquées partout par un appauvrissement de l’invention et une tendance à la stylisation. Cet art, jusqu’à la pénétration hellénique, au IIIe siècle, est exclusivement religieux. Les rares peintures murales assyriennes récemment découvertes ne démentent pas les caractères généraux de stylisation hiératique et de force, révélés par la sculpture et les basreliefs. On peut rattacher à cet art les grandes décorations en brique émaillées de la Perse Achéménide. La peinture, en Asie Occidentale, reste décorative à la fois par sa conception et par son emploi, voisine du linéament sculptural et tributaire de l’architecture.
C) Pays Egéens : Crète, Chypre, Mycènes.
La civilisation égéenne, qui, du début du troisième au début du premier millénaire, couvrit les îles et les littoraux européen et asiatique de ce qu’on appela plus tard l’Ionie, apporte, dans les formules que nous connaissons par l’Egypte et l’Asie, une nouveauté singulière, ou peut-être un singulier renouvellement. Les découvertes de Mycènes, de Tirynthe, de Cnossos, ont mis à jour, non seulement des vases d’une ornementation toute particulière, mais de grandes peintures murales d’un très réel intérêt. Sur le sol où viendra, plus tard, s’installer la race hellénique, nous voyons se manifester un sentiment nouveau, issu du naturalisme, et qui semble ne plus rien devoir à l’inspiration religieuse. Les animaux, les végétaux, les figures humaines qui peuplent de leur mouvement les manifestations de cet art n’obéissent plus à aucune règle de grammaire sacrée ; leur ordonnance ne semble plus déterminée par le souci du totémisme ou de la magie mais par l’agrément et la vérité.
Certes, il n’est pas niable que l’influence égyptienne ou celle de Sumer puissent se remarquer dans les peintures, la céramique ou la gravure, crétoise ou chypriote, de la période minoenne (2.000 à 1.500 av. J.-C), mais c’est une influence transposée. L’art de la mer Egée n’en constitue pas moins un monde à part, magnifique et barbare, familier, expressif, moderne. Cet art ne semble pas avoir inspiré directement les premières manifestations du génie grec. Mais si l’on considère qu’avant les phéniciens, les navigateurs égéens ont colonisé le bassin oriental et central de la Méditerranée, on comprendra que, dès le VIIIe siècle, des formes d’art, apparentées entre elles par une discipline commune, d’un naturalisme épuré, aient pu marquer, de l’Italie du Sud à l’Ionie asiatique, la naissance de l’hellénisme.
III. ANTIQUITÉ CLASSIQUE.
A) La Grèce et l’Hellénisme.
La grande révolution accomplie par le génie grec peut être définie d’un mot : l’humanisme. Ce mot servira, à toutes les époques, à caractériser les tendances à la liberté de la pensée et à l’épanouissement des individus selon l’ordre de l’harmonie et le culte de la beauté. De fait, le Grec, inventeur des mathématiques, codificateur des connaissances antérieures à lui dans l’appareil classificateur qui constitue, à proprement parler, la Science, a trouvé aussi la raison de l’Art et lui a donné pour de longs siècles et sur toute la Terre, un certain visage que nous reconnaissons encore aujourd’hui.
La grande peinture grecque, qui fut très florissante et dont les auteurs de l’antiquité nous ont laissé des descriptions et des éloges enthousiastes, ne nous est point parvenue. Polygnote, Zeuxis, Parrhasios, Apelle, ne sont pour nous que des noms. Nous ne pouvons juger de la conception générale, de la composition, du dessin, du sentiment de la couleur et de la technique des peintres grecs que d’après les copies ou les répliques alexandrines, phéniciennes, pompéiennes et romaines. Il est possible, d’après celles-ci, de retrouver les lois générales de cet art. Les peintures qui décoraient les murailles étaient exécutées soit à la fresque, soit à l’encaustique, c’est-à-dire au moyen de couleurs liées à la cire chaude. Dans la période archaïque, celle qui précéda l’hégémonie d’Athènes, la peinture grecque garda les caractères techniques de la peinture égyptienne. Si le dessein fut plus libre, la couleur demeura plate et sans effets, donc purement décorative. Ce ne fut qu’à partir du IVe siècle que les jeux de lumière et d’ombre, le sens du modelé, du mouvement et de l’espace, introduisirent dans la peinture la vie et l’expression. La sobriété, cependant, resta la règle de cet art. La gamme des couleurs était très limitée. Polygnote, au milieu du IVe siècle, n’en employait que quatre : le blanc, le noir, le rouge et le jaune.
Devant l’absence des monuments authentiques de la grande peinture, nous devons faire une place à part aux représentations des vases peints, qui, dès le début du VIe siècle, abandonnant le style géométrique, nous apportent sur la vie hellénique la plus abondante documentation. Les vases à figures noires du VIe siècle, ceux à figures rouges sur fond noir et à figures polychromes sur fond blanc des Ve et IVe, égalent en finesse, en sensibilité, en noblesse et en charme les merveilles de la sculpture familière de Tanagra et de Myrina. Toute l’histoire légendaire, les mythes, les croyances, les occupations et les plaisirs de la vie revivent dans leurs figurations. Par elles nous sommes amplement renseignés sur les jeux de ce peuple sportif ; et c’est peut-être le culte des mouvements du corps libre, en plein air, qui libéra définitivement l’art grec de la contrainte des lois d’équilibre et de symétrie qu’il subit, à ses débuts, tout comme l’art des Egyptiens et des Asiatiques.
La diffusion de la culture hellénique, à la suite d’Alexandre, réforma l’art de tous les pays où pénétra avec elle l’esprit de mesure et le culte de l’intelligence. L’Egypte, la Syrie, l’Asie Mineure, la Mésopotamie et la Perse et les steppes de la Caspienne, aussi bien que les remparts montagneux de l’Afghanistan et Rome, reçurent, cultivèrent et transformèrent, selon leur génie propre, la semence hellénique. Il est vérifié aujourd’hui que l’art de l’Inde est né de cette influence. Les peintures bouddhiques que nous trouvons dans la péninsule même, puis sur tout le pourtour du Gobi et dont la diffusion, en ces régions, entre la période sélenecide et les premiers siècles de notre Moyen-Âge (IIIe-VIIe), coïncident avec celle du bouddhisme, sont vraisemblablement à l’origine de la peinture chinoise.
Mais l’art grec rayonna plus fortement encore dans le bassin de la Méditerranée, porté par les flottes d’Athènes jusqu’au sein des anciennes colonies phéniciennes ; et Rome, en imposant sa force militaire et son organisation administrative à la Grèce elle-même et aux pays hellénisés, apprit de ceux-ci et porta au monde occidental une formule d’art qui est une glorification pompeuse de l’hellénisme.
Ce que nous connaissons d’œuvres peintes, en Egypte (portraits), en Phénicie (fresques tombales), en Italie du Sud par exemple nous montre l’art hellénique, adapté aux traditions régionales, évoluait peu à peu vers des formules dont la fortune historique sera diverse. Dès les derniers siècles de l’ère antique, nous pouvons saisir les éléments de formation des deux grands courants qui détermineront un jour l’art des temps modernes, tel qu’il nous apparaît, un peu artificiellement, surgi de la Renaissance. Le courant italo-romain qui se prolonge dans l’art chrétien des premiers siècles est à l’origine du réalisme qu’intensifieront les barbares et qui marquera si fortement les écoles occidentales. Ce que nous voyons, au contraire, tant en Egypte qu’en Phénicie ou à Palmyre (vassale quelque temps des Perses Sassanides), c’est un retour aux tendances profondes de l’Orient : d’une part stylisation des figures, d’autre part, recherches de luxe décoratif. Sous le formulaire et l’apparat, l’humanisme grec se voile, sans toutefois disparaître ; et nous voyons dans les écoles orientales qu’il a un instant vivifiées et pour longtemps unifiées, poindre la pompe, l’artifice, et la grandeur aussi du style de Byzance. Ce style résistera longtemps, dans les écoles du Moyen Age, au réalisme occidental, conservant les fortes disciplines des traditions techniques, et les imposant, non sans bonheur, aux richesses d’invention des artistes d’Europe.
B) L’art chrétien du Moyen-Âge.
On peut ainsi distinguer trois courants issus du fond commun de civilisation unifié par le génie grec. Nous laisserons de côté les formes asiatiques qui demanderaient une étude spéciale, pour nous attacher particulièrement à celles qui intéressent l’Europe.
Le courant occidental, qui se confond à l’origine avec l’art de la Rome païenne, se continue sans changement jusqu’après Charlemagne. A part certains motifs, tirés des mythes de la religion naissante, les premières peintures chrétiennes ne se distinguent ni par le style ni par les procédés de ce que nous voyons, par exemple, à Pompéi. La seule distinction de cet art réside dans les motifs qu’il évite : la représentation de la divinité jusqu’au Xe siècle, et celle de la nudité dont l’interdiction se prolongera jusqu’au XIIIe. Les motifs de décoration végétale et florale ne sont pas particuliers au christianisme. Le plus connu de tous, celui qui mêle le pampre, l’épi et la colombe se rencontre déjà dans l’iconographie des cultes dionysiaques de la région syro-phénicienne. Il n’est pas jusqu’aux figures symboliques, telles que les anges enfants ou l’âme, qui ne soient la réplique des amours ou des génies funéraires ailés, et de la mélancolique Psyché. La seule figure nouvelle apportée par l’iconographie chrétienne, celle du Bon Pasteur, ne révèle aucun sentiment nouveau.
En Orient, l’art Byzantin semble remonter aux traditions de rigueurs théoriques et de faste des Achéménides et de l’Assyrie. Même uniformité rituelle des figures el des attitudes, même tendance au colossal, même absence de vie physique et d’émotion. Cette tendance, commune à l’Egypte, à la Chersonèse, pénétrant en Russie à la suite des missionnaires, maintenue dans les couvents de solitaires, s’y prolonge bien au-delà de la chute de Constantinople, dans les fresques du mont Athos (attribuées à Panselinos) dans les peintures du Sinaï, et dans les icônes des sanctuaires russes. Mais l’influence de Byzance rayonne aussi sur l’Occident. Elle y recouvre bientôt le courant italoromain et se marie au goût barbare. Non seulement l’Italie, dominée par les Goths, reçoit les leçons d’art des mosaïstes byzantins, et les applique dans ses églises, jusqu’à la Renaissance du XIVe siècle ; mais l’Europe occidentale elle-même subit l’influence de Byzance, en même temps qu’elle voit s’affermir les premières royautés barbares. Et plus tard, quand aux VIIIe et IXe siècles, les empereurs iconoclastes forcent les artistes à s’expatrier, c’est sur l’Occident pacifié qu’ils refluent ; ils y déterminent ce qu’on a appelé la Renaissance carolingienne. Mais jamais le sens décoratif original des Barbares ne fut étouffé, et son esprit, à la fois réaliste et fantaisiste, où se retrouve le génie des ancêtres de l’âge du fer, mêlé, dans l’Europe méridionale, d’influences syriennes, anime, à travers un appareil technique peut-être appris de Byzance, les inventions ornementales si caractéristiques, le sens plastique et les ressources expressives des décorateurs romans.
IV. LES TEMPS MODERNES.
Ce qui caractérise les époques modernes de l’histoire de la peinture, comme toutes les autres manifestations de l’esprit humain, c’est la rapidité d’évolution des formules, les forts écarts dans la transformation des styles, le diversité des écoles locales, en même temps que les rapports d’analogie entre des maîtres éloignés, la profusion des aptitudes et des génies particuliers. A partir du XIVe siècle, principalement, la vie artistique reçoit une diffusion telle qu’en six siècles à peine, elle nous apparaît plus riche d’inventions et de recherches que toute l’antiquité. Et cependant, durant cette période, aucune école ne présente ce caractère d’ensemble réussi, d’expression raciale durable que nous offrent l’époque égyptienne on l’époque grecque, Le mouvement des cathédrales, du XIIe au XVe siècle, est le seul auquel sa durée et sa dispersion territoriale confèrent une certaine universalité. Les autres mouvements sont d’oscillation courte ou d’aire localisée. Ce sont des mouvements particuliers ; et le génie des individus y a plus de part que les formules traditionnelles ou les disciplines rituelles. C’est dans la période dite « La Renaissance » (qui, en Italie, commence vers 1275) que la peinture se différencie nettement des autres arts et s’individualise ; elle échappe peu à peu au bâtiment, à l’architecture ; elle sort de son mur et vient au devant du spectateur. Toute enivrée de ce qu’elle gagne en vitalité et en émotion, elle ne sait pas ce qu’elle perd.
A) XIIIe et XIVe siècles.
À l’aurore du XIIIe siècle, l’achèvement d’un grand nombre d’édifices dans le nouveau style occidental, appelé improprement gothique, amène une modification profonde de la décoration des églises. La nécessité de tamiser, en l’utilisant à des fins mystiques et décoratives, la trop grande lumière projetée par les baies immenses, donne naissance à un art nouveau dont, par la suite, l’influence sur la peinture sera considérable. Dans toute l’Europe occidentale, le vitrail sera, avec l’enluminure, toujours pratiquée et de plus en plus assouplie, la plus riche manifestation de la couleur. Ces deux procédés expriment fortement les types et les formules issus du fonds occidental. Entre 1200 et 1300, les enlumineurs parisiens, les verriers de Noyon, de Beauvais, de Saint-Denis, de Notre-Dame et de la Sainte-Chapelle, de Reims, de Chartres et d’Amiens représentent le plus haut point de l’art de peindre. Ils complètent la réussite des sculpteurs. D’ailleurs, de même qu’à l’époque romane, l’influence de la sculpture, plus tôt et plus profondément évoluée, est visible dans l’œuvre des premiers peintres occidentaux. Les fresques de Montmorillon, de Cahors, de Clermont-Ferrand, perpétuent, dans le dernier quart du XIIIe siècle, la tradition romane. Elles rejoignent le mouvement qu’instaure dans le Sud-Est de la France, dans les premières années du XIVe, le transfert de la cour papale à Avignon (1309). Les papes amènent avec eux des fresquistes siennois qui formeront la première école provençale.
C’est à l’Italie, en effet, qu’appartient, de la fin du XIIIe siècle jusqu’en 1430, la maîtrise incontestée de la peinture. Pour si incertaines que soient les dates, nous sommes en possession d’œuvres florentines et siennoises qui se dégagent alors de l’influence des mosaïstes, et des émailleurs byzantins, qui n’ont pas cessé de former, en Italie, des élèves. La légende d’un de ceux-ci, Cimabue, qui aurait été le « premier peintre » est une jolie page d’anthologie. Il est certain que des artistes italiens s’individualisèrent dès le XIIIe siècle, et c’est à Sienne que nous trouvons la première école. Duccio (1255–1319 ?) semble avoir, le premier, dégagé des formules byzantines et miniaturistes la conception du tableau, avec le sentiment de la composition. Dans cette première école de Sienne, nous citerons encore Simone Martini, qui vint à Avignon en 1310 et y mourut en 1344, après avoir fondé l’école à laquelle on doit les fresques du Palais des Papes (1320–1364) et celles de Villeneuve. Mais dès la génération suivante, l’école de Sienne se dessèche, et retombe pour longtemps dans l’illustration allégorique. Les Lorenzetti, cependant, la maintiennent quelque temps. Les procédés techniques des Siennois tiennent encore de la miniature ; fraîcheur de coloration, suavité, poésie, n’y excluent pas la pauvreté de matières et d’effets dont triompheront les florentins des lustres suivants.
À Florence, l’école semble être née de l’enseignement d’un fresquiste romain, Pietro Cavallini, l’auteur des fresques du Transtevere ; et le maître le plus illustre, à son aurore, fut Giotto di Bondone (1260 ?-1336). Ce fut un puissant ordonnateur d’ensembles. Son art, architectural et sculptural encore, est animé d’un souffle nouveau ; la vie s’introduit dans la peinture par la recherche du modèle expressif. A part il Andrea Orcagna (1308 — 1368) et Taddeo Gaddi (1333 — 1396), les successeurs de Giotto furent en général des imitateurs ; et pour un quart de siècle l’Italie s’appauvrit.
C’est à ce moment qu’apparaissent, en Europe occidentale, les résultats de l’admirable poussée que la peinture y reçut de la sculpture et du vitrail. Il semble bien d’ailleurs que Siennois, ou Romains, et Giotto lui-même soient tributaires des imagiers français du XIIe siècle finissant et du XIIIe et que la voie de diffusion des recherches qui introduisent, dans la peinture, la vie, soit la route des pèlerinages. En France, comme en Italie, les sculpteurs précéderont les peintres. Les Gérard., d’Orléans, les Jean Bandol, de Bruges (v. 1370), Beauneveu et Jacquemart, de Hesdin, les suivent assez tardivement. Le néerlandais Claus Sluter, sculpte, en 1390 et 1395, le portail de Champmol, précédant les peintres flamands de Bourgogne : Jean Malouel (v. 1395), Broederlam, et les miniaturistes : Pol de Limbourg et ses frères.
Le mariage de Philippe de Bourgogne avec Jeanne de Flandres, en 1385, fixe à Dijon la cour de Bourgogne et y attire les artistes flamands, Une étape se crée entre la Flandre et l’Italie. Bourges en devient une autre. Vers ces deux villes, qui font figure de capitales, affluent aussi les apports rhénans. Dans les temps troublés de la Guerre de Cent ans, de vastes échanges artistiques se nouent, sur une ligne qu’on peut tracer, entre Bruges et Florence, autour de Dijon, de Bourges et d’Avignon. Mais la Bourgogne est la charnière centrale de ces échanges.
****** B) XVe siècle.
Dès lors la peinture se développe avec la plus grande rapidité et s’humanise de plus en plus. Les peintures d’autels elles-mêmes ne sont plus seulement l’illustration mystique et décorative des thèmes religieux, mais d’abord des tableaux où la technique, de plus en plus, se libère. Le perfectionnement des siccatifs et l’emploi plus adroit de la peinture à l’huile, procédé connu dès le XIVe siècle, est l’œuvre des flamands et, en particulier des frères Van Eyck.
De 1400 à 1420, environ, l’art franco-flamand domine. L’œuvre de Malouel, celle de ses neveux de Limbourg, mêlent leur influence à celle beaucoup plus forte des Van Eyck Hubert (1370 — 1426) et Jean (1384 — 1437), maîtres de l’école des Flandres, et du Valenciennois Robert Campin (1375 — 1444 ?), maître de l’école de Tournai. Les « Très riches heures du Duc de Berry », point culminant de l’art de la miniature à cette période, auxquelles tous ces artistes peuvent avoir collaboré, sont de 1416. Après 1420, l’assassinat du duc de Bourgogne et le traité de Troyes amènent un nouveau déplacement des centres artistiques. Paris, ruiné ; Dijon, délaissé, ainsi que Bourges, c’est à Gand, à Tournai, à Bruges, à Bruxelles que travaillent d’actifs ateliers. Leurs artistes apportent au sud de la France, à Aix où vient de s’installer le roi René, des leçons qui fructifieront dès la génération suivante.
Les années 1420 à 1440 sont parmi les plus fécondes de l’histoire de la peinture. Le grand rétable de l’Adoration de l’Agneau des Van Eyck, achevé en 1432, est, non seulement pour l’art des Flandres, mais pour toute l’Europe occidentale, la borne éminente des nouvelles directions. Mais les deux frères sont aussi les premiers des grands portraitistes, Désormais aux compositions religieuses s’ajoutent les œuvres qui traitent la figure humaine. Enfin, et d’abord comme fond, le paysage naît. On doit associer au nom de Campin celui du plus grand de ses élèves : Roger Van der Weyden (1400 — 1464). Au réalisme bourgeois des Van Eyck, Roger ajoute une note lyrique, un expressionnisme pathétique. Roger est en outre un des plus grands coloristes de tous les temps. L’influence de ces maîtres, diversement combinée, se retrouve dans l’école d’Aix : Le maître de l’Annonciation (v. 1445). On la retrouve aussi dans l’œuvre du Suisse Conrad Witz (né vers 1400).
L’Italie, pendant ce temps, accomplit, dans un isolement relatif, sa deuxième Renaissance. L’école d’Ombrie, formée peut-être par les Siennois, se rattache encore à ceux-ci, dans l’oeuvre charmante et fleurie de Gentile da Fabriano (1360 — 1428). Transporté à Venise, son enseignement combiné avec celui de Jacopo Bellini influence sans doute le grand peintre, graveur et sculpteur Pisanello (1397 — 1455 ?), élève d’Altichiero, détache les premiers maîtres de l’Ecole vénitienne du byzantinisme des mosaïstes.
Mais c’est à Florence surtout que l’humanisation de la peinture se précise et s’intensifie. Fra Giovanni da Fiesole, l’Angelico (1387 — 1415), contemporain du piétisme franciscain, en exprima la béatitude sentimentale, avec une émotion communicative. Par sa technique, il forme le passage entre Giotto et Masaccio. Celui-ci est un maître, analogue aux Van Eyck et à Giotto par l’orientation nouvelle qu’il a donnée à l’art de peindre. Il fut vraiment le premier italien qui exprima l’homme moderne dans son intense réalité, avec un sens du modelé vivant et du caractère profond qui ne le cède pas à Michel Ange lui-même. En même temps que dans les sculptures de Donatello, tout l’art florentin du XVe siècle puise sa source dans les fresques de ce très jeune homme (1400 — 1428). Si quelque trace de l’imagerie d’Angelico se retrouve encore longtemps dans l’œuvre ingénue et féerique de Benozzo Gozzoli (1420 — 1498), Angelico lui-même et ses contemporains Andréa del Castagno et Paolo Uccello, peintre génial, orientent l’école florentine vers la recherche des formes hautaines et un certain héroïsme plastique. Domenico Veneziano Baldonnelli et Filippo Lippi se partagent l’influence de Masaccio. Cependant les Siennois Sassetta, Neroccio, Matteo di Giovanni, ressuscitent à l’écart les imageries décoratives des maîtres du XIVe.
De 1440 à 1470, la génération née dans le premier quart du siècle arrive à la maturité ; et nous assistons, aussi bien en Italie qu’en Flandre, à une floraison magnifique. Piero della Francescha (1416 — 1462), même après Masaccio, est un précurseur. Un sentiment nouveau d’inquiétude tragique ajoute à l’intensité de son sentiment de l’espace. Mais nulle émotion ne perce cette noblesse. Les maîtres nés aux environs de 1430 à 1440, sont tourmentés visiblement, au contraire, par la passion de l’homme à laquelle ils prêtent une expression héroïque. Antonio Polajuolo (1429 + 1498) renchérit sur le culte de la force et les recherches du modelé expressif de Castagno et d’Ucello, Andrea Mantegna (1431 — 1506), inspiré par le culte de la grandeur antique qu’il ressuscite sans en être écrasé, sera l’initiateur d’un grand essor des écoles du nord de l’Italie et de celle de Venise. Verrocchio (1435 -1488), puissant sculpteur et peintre, est le maître du premier des grands artistes universels, Léonard de Vinci ; Melozzo da Forli (1435 — 1488) et Luca Signorelli (1441 — 1523) reprennent la grande leçon de leur maître Piero et l’intensifient en l’humanisant. Signorelli surtout est un grand créateur de formes libres et de mouvements. Antonello da Messina (1430 — 1479), introducteur vraisemblable à Venise de la technique perfectionnée de l’huile, est un portraitiste profond. Enfin Botticelli, Sandro Filipeppi (1444 — 1510) traduit dans la plus étonnante arabesque, avec le plus émouvant prestige, la même inquiétude humaine, la même tension intérieure et technique que ses contemporains. Mais c’est surtout vers la ligne expressive et le modelé tangible que ces maîtres portent leur effort. Ceux qui échappent à leur rigueur, qui semblent tout baignés de suavité, n’expriment pas plus qu’eux cependant la foi tranquille des Siennois ou des Florentins du XIVe. C’est l’athéisme renaissant qui circule avec la douceur de l’atmosphère dans l’œuvre de Pietro Vanucci, dit le Perugin (1446 — 1523) et de Francesco Francia (1450 — 1518).
De Mantegna et des Bellini l’art des vénitiens prendra, avec la sérénité païenne, la science et le goût des belles matières. Peut-être aussi la grandeur de la cité et l’héritage de Byzance sensible chez les frères Vivarini, de Murano, sont-ils pour quelque chose dans les déterminations si particulières de cet art. Gentile Bellini (1427 — 1507) est l’illustrateur des fastes de Venise ; Giovanni Bellini (1430 — 1516), son frère, est un génial artiste, fort complexe, dont l’activité parcourt toutes les étapes, donne ou subit toutes les influences. Carto Crivelli (1430 — 1494), artiste des plus originaux, peint dans une matière précieuse des formes magnifiques. Il faut rattacher à Mantegna et à l’art tendu des florentins les oeuvres d’un grand artiste austère, Cosimo Tura, de Ferrare (1430 + 1495), maître de toute une école qui comptera des peintres représentatifs comme Ercole de Roberti (1456 — 1495).
Ces artistes, pour la plupart de très haut rang, ont tous marqué, de façon ou d’autre, l’évolution de l’art après eux, et plusieurs des vastes génies du XVIe siècle ne font, en somme, qu’épanouir, développer et achever en l’épuisant, le mouvement reçu de leurs prédécesseurs, après y avoir imprimé leur marque de grands ouvriers.
En Flandre, les grands élèves des Van Eyck et leurs disciples, Van Ouwater, Thierry Bouts (1410 — 1475), Petrus Christus ; ceux de Robert Campin, comme Jacques Daret et de Roger Van der Weyden, emplissent de leurs œuvres les églises et les demeures. Les premiers maîtres allemands restent jusqu’en 1460 à l’abri de la forte empreinte réaliste. Le Maître de Sainte Véronique (1410), Stephan Lochner (1390 — 1451), ou Pleidenwurf (1420 — 1472) sont encore des enlumineurs plus que des peintres. Mais, en France, une école nouvelle, issue des sources flamandes, revit vers 1450. Simon Marmion (1427 — 1489) y reste disciple de Van Eyck. Mais Jean Fouquet (1415 — 1485) et Perréal (le maître de Moulins), sont de grands artistes personnels et sûrs. Fouquet, à la fois le dernier et le plus grand des miniaturistes et l’un des portraitistes les plus vivants, est un novateur dans la composition. Les Flamands, en ce temps, s’italianisent : Van der Goes (1430 — 1482). On peut trouver une synthèse des deux tendances dans l’œuvre d’un rhénan, devenu le maître de Bruges, Hans Memling (1430 — 1492), qui allia les suavités d’un génie délicat aux savantes acquisitions de l’Ecole. Son disciple, Gérard David (1450 — 1523) est tout imprégné d’italianisme.
Vers le milieu du siècle, un peintre de Bourgogne, Euguerrand Charonton (né vers 1410), s’installe à Avignon et y fonde un atelier. Il ouvre la voie aux chefs-d’œuvre d’un peintre régional, Nicolas Froment (1435–1500). Du double courant d’influences, bourguignonne et italienne, est animée l’œuvre la plus dramatique de toute la peinture française au XVe siècle, la « Pieta » d’Avignon (1470).
C’est vers ce temps que l’enseignement de Van der Weyden pénètre en Allemagne. Il nourrit les probes élans de l’Ecole de Cologne et les œuvres pathétiques des maîtres de la « Vie de Marie » (vers 1450) de la « Passion de Darmstadt » (v. 1450) de la Sainte Parenté (v. 1480) et surtout l’auteur magnifique de « L’Autel de Saint Barthélemy » (v. 1490). Mais déjà s’interpose l’œuvre d’un grand peintre, possesseur d’un génie sensible, graveur d’une expression personnelle, Martin Schongauer (1450 — 1491). En Autriche, une école influencée par les maîtres de Padoue et de la première veine vénitienne éclairée par les Ombriens, s’épanouit avec Michaël Packer (1430 — 1498) et Reichlich.
La fin du siècle, en Italie, nous montre les disciples des grands artistes de la génération de 1430, former la transition avec les grands artistes du XVIe. A Florence, Filippino Lippi (1467 — 1504) procède de Botticelli ; Verrochio forme, avec Vinci, deux maîtres considérables, Domenico Ghirlandajo (1449 — 1494) et Lorenzo di Credi (1459 — 1537) ; Mantegna et Giovanni Bellini influent, à Venise, sur Carpaccio (1460 — 1522) ; dans le nord de l’Italie, à Vicenza, sur Montagna (1450 — 1523), à Vérone sur Morone, Liberale ; Bellini sur Cima da Conegliano (1460 — 1517). De Mantegna, encore, la première école de Milan, formée par son condisciple Vincenzo Foppa, et illustrée par Borgognone, tire son éclat passager. Pérugin, maître de l’espace, formé par les Ombriens parmi lesquels se détache seul avant lui Nicolo de Foligno, enseigne à son tour Pintoricchio, et contribue à former l’idéal du jeune Raphaël. L’école bolonaise, fondée par Lorenzo Costa, issu de l’école de Ferrare, et enrichie par Francia, y contribue aussi, par le truchement d’un élève de celui-ci, Timoteo Viti, qui, émigré à Urbin en 1495, fut le premier maître du jeune Sanzio. Par ces maîtres intermédiaires nous sortons de l’ascétisme, de la tension linéaire, de l’héroïsme. Des formes rondes, des couleurs chaudes ou légères, une heureuse sensualité, voilà ce qu’ils apportent au XVIe siècle.
Mais ils furent devancés et dépassés par un initiateur plus puissant qui, non seulement fond en lui toutes les acquisitions antérieures, mais qui projette de lui-même, sur toutes choses, une lumière intérieure : Leonardo da Vinci (1452 — 1519), l’un des « hommes représentatifs » de la plus haute humanité. Génie universel, à la fois peintre et sculpteur, ingénieur et inventeur, savant et philosophe, Léonard, le premier, rompit avec la technique prudente et éprouvée des peintres du XVe siècle. Afin d’éviter la sécheresse, d’obtenir l’atmosphère, la fluidité des tons, le fondu du modelé, le clair-obscur, de s’élever de la géométrie des contours à celle des plans, de renforcer l’expression plastique par la vibration de la vie intérieure, Vinci usa de moyens compliqués, et qu’il était le premier à essayer, qui ont fait la fragilité de son œuvre. Il n’en subsiste pas moins, dans celles qui nous sont parvenues à peu près intactes, un dessin sensible et fort, d’un équilibre serein et souple qui semble la solution des recherches de Verrochio, son maître, de Botticelli, et de Mantegna, un charme qui dépasse le laisser-aller de Perugin ; et par-dessus cela qui est la conclusion d’un siècle, une sensibilité de l’espace, une alchimie de la couleur, une ambiance de vie secrète, qui posent la question personnelle que tout grand artiste apporte avec lui, et qui ouvrent le XVIe siècle.
****** C) XVIe siècle.
Libérée du cerne des lignes et de la tyrannie des murs, la peinture peut revendiquer, désormais, un rôle autonome d’incantation sensorielle. Vinci, Toscan, répandit hors de la région florentine, l’art dont il fut l’initiateur. C’est à Milan, où s’écoula une partie de sa vie, qu’une école tout entière suit sa manière. Da Predis, Solario, Beltraffio, Luini (1475–1532), artistes de talent secondaire, mais savants, amenuisent vers le joli, le charme du maître. Giovanni Bazzi, dit le Sodoma (1478–1549), fonde, à sa suite, la nouvelle école de Sienne. Mais l’influence de Vinci est encore sensible, jusqu’à l’imitation, chez de nombreux peintres du Nord, et les Flamands et Hollandais lui doivent en partie leurs recherches des effets et de la savoureuse matière. Enfin, Raphaël lui-même ajoute aux leçons indirectes de Francia, à la pratique apprise dans l’atelier de Pérugin, à la grandeur antique puisée chez Michel-Ange, quelque chose de plus secret qui vient de Léonard de Vinci.
Fra Bartolomeo (1475–1517) et, plus que lui, son disciple Andrea del Sarto (1486 — 1531) combinent cette influence avec celle naissante de Michel-Ange. Les derniers florentins sont emportés par le grand vent qui fond alors les écoles, à la fois vers le métier simple et libre de Venise, et vers l’emphase théâtrale qui achèvera lamentablement le siècle. Après eux, Pontormo et Bronzino, grand portraitiste, donnent parfois dans le maniérisme. Mais l’Ecole florentine, entre temps, a éclaté sous la poussée formidable du génie de MichelAnge.
Michel-Ange Buonarroti, florentin (1475 — 1564), remplit tout le XVIe siècle. Formé à la peinture par Ghirlandajo, à la sculpture par un disciple de Donatello, il n’a plus, à partir de 18 ans, d’autres maîtres que les antiques qu’il interprète à sa manière. Sculpteur avant tout, architecte et poète, il ne devient peintre que par force, quand le pape Jules II lui impose, en 1508, de décorer le plafond de la Sixtine. La gageure se répète, en 1535, et le Jugement dernier complète le plafond. Michel-Ange organise la surface peinte en architecte. Il n’a souci d’aucun artifice : clair-obscur, transparence, jeu des couleurs. Avec des moyens pauvres et comme méprisants de la matière, il impose à la peinture une œuvre colossale qui violente la peinture et la dépasse. Il remonte, au-delà du XIVe siècle, à la conception idéaliste de l’œuvre d’art, au point extrême où il n’y a plus rien entre l’artiste et sa création que la projection idéale de lui-même. Lui disparu, la peinture n’est plus, sur les épaules de ses suiveurs, qu’une irréelle défroque. Un seul de ses disciples, Daniel de Volterra (1510 — 1566) n’est pas toujours inférieur à ses efforts vers le sublime. Quand Michel-Ange meurt, le dernier peut-on dire, il convient de noter que récole même de Raphaël a, depuis vingt ans, disparu.
Nous avons vu de quelles influences s’est formé le grand éclectique dont le nom a longtemps passé pour le parangon de toute peinture. Rafaele Santi, ou Sanzio (1483–1520) est né à Urbin, en Ombrie. Il vient à Rome en 1508 et, jusqu’à sa mort, comblé d’honneur, de gloire et de plaisirs, il accumule une oeuvre immense, dont il abandonna trop souvent l’exécution à des élèves. Cet illustrateur génial, cet adaptateur prodigieux est peut-être le plus grand « compositeur dans l’espace » qui ait existé. Mais les symptômes de décadence qui germent dans l’art italien, Raphaël les porte déjà en lui : la virtuosité, une certaine négligence, un amollissement de la forme et la monotonie de la couleur. La force du contour et du modelé, la maîtrise du mouvement, conquises durement par les artistes volontaires du XVIe, tombent dans l’agrément de l’art facile, dans une formule de bon ton qui est la loi de l’académisme. Le meilleur élève de Rafaël, Jules Romain (1492–1546), acheva certaines de ses oeuvres.
Avant d’aborder l’Ecole de Venise, qui résistera et survivra seule à l’académisme, nous devons étudier un autre maître dont l’influence contrebalança celle de Michel-Ange et de Rafaël. Allegri, dit le Corrège (1494- 1534), peintre de Parme, formé à l’école de Ferrare, introduit dans l’art italien un élément nouveau de sensualité directe et charnelle, fait d’un clair obscur caressé de lumières, de couleurs chaudes, de formes enveloppées. Dans une atmosphère de Vinci, des formes belles et puissantes, qui semblent d’un MichelAnge heureux, exaltent la chair comme seuls purent le faire, par la suite, les Vénitiens et Rubens. Corrège fut exploité par les jésuites et la contre-réforme. On employa son œuvre et sa manière, attirantes par leur sensualité, à l’aide de l’Eglise de Rome mise en péril par les chrétiens rigides du Nord et qui revenait, avec son sens naturel de l’adaptation, dans une société paganisée, à sa source païenne. L’Ecole issue de Corrège compte un peintre secondaire, Francesco Mazolla, dit le parmesan (1503–1540).
A Venise, Giovanni Bellini relie le XVe au XVIe. Mais Giorgione (1478–1510), son élève, à qui on a attribué longtemps trop d’oeuvres et trop d’influence, induit pourtant la peinture vénitienne à des recherches d’incantation purement picturales : mythographe de la vie contemporaine, luministe et coloriste sensuel, Giorgione n’est pas sans action sur l’œuvre de ses successeurs. Tiziano Vecelli, le Titien (1488–1576), issu, comme Giorgione, de Giovanni Bellini, ne cessa, au cours de sa longue existence, d’approfondir et de libérer son génie propre. Son œuvre, immense et de la plus grande variété, donne parfois dans l’éloquence théâtrale ; mais la matière est une des plus belles qui soient. Ces qualités de matière et de couleur distinguent aussi bien les contemporains du Titien, que sa gloire ne doit pas éclipser : Palma l’Ancien (1480–1528) ; Lorenzo Lotto (1480–1547) ; Sébastiano del Piombo (1485–1547), artistes personnels et diversement savoureux.
Mais deux très grands maîtres apparaissent, dans la génération des élèves : Tintoret (1518 -1594) et Paolo Cagliari, dit le Véronèse (1528 -1588). Tintoret est de tous les peintres de Venise celui qui, par sa force, sa fécondité d’invention, sa hardiesse et sa nouveauté, rappelle le plus Michel-Ange. Véronèse s’assimile la plénitude vénitienne avec une solennité qui semble presque espagnole, mais qui n’est, à tout prendre, que la magnificence hautaine de ses prédécesseurs de l’Italie du Nord. Il n’est pas sans intérêt de rapprocher de lui le grand peintre de Brescia, Moretto (1498 -1555) et son élève G. Moroni (1520–1578). Avec Véronèse et Tintoret, Bonifazio et son élève Jacopo Bassano (1510 -1592), prolongent jusqu’à la fin du siècle le grand âge de la peinture vénitienne.
C’est aux maîtres de Venise et de l’Italie du Nord, que les Néerlandais et les Flamands du XVIe siècle demandent leur inspiration. En Quintin Matsys, d’Anvers, (1466–1530) survit pourtant une pointe de réalisme mystique à la Van der Weyden. Mais Jean Gossaert de Mabuse (1470–1541), grand technicien, Van Orley (1488 – 1541) n’évitent que dans le portrait les déviations de l’italianisme. Lucas de Leyde (1494–1533) est plus personnel et, dans son œuvre de graveur, entièrement original et grandiose.
Jérôme Bosch (1465–1516) et ses grotesques, Joachim de Patinir (1475–1524) et plus encore Pieter Brueghel (1520–1569) gardent la tradition flamande. Les figures du dernier sont un étonnant mélange de rusticité fruste et de grandeur humaine. Joos Van Cleve le Jeune (1510- 1554), Isenbrant (1510 -1580) et Willem Key (1515 -1568) suivent, au contraire, de près, l’exemple de Mabuse et de Van Orley. Anthony Mor (1512 -1576), l’un des premiers maîtres hollandais, est, dans le portrait surtout, égal aux plus grands.
Par contre, le XVIe siècle est, pour l’école allemande, la grande période d’activité. De nombreux maîtres y apparaissent : Bernard Strigel (1460 -1528) encore près des enlumineurs, Zeitblom, inspiré des sculpteurs sur bois de la Souabe, Hans Fries, et ses vierges suisses (1465–1518), Holbein le Vieux, puissant et lourd.
Tous ces maîtres sont dépassés par un homme au génie universel, Albrecht Dürer (1471–1528), de Nuremberg. Dürer, comme les Flamands de son temps, fut imprégné d’influence italienne ; mais à travers les italiens, c’est l’antiquité elle-même qu’il veut atteindre. En ce sens, il est le premier à poser et à résoudre le problème de l’humanisme allemand, comme le posera et le résoudra Goethe. En dehors de son œuvre de peintre, Dürer accumula toute sa vie, dans la gravure, des chefs-d’œuvre d’une invention, d’une beauté de forme et d’une exécution incomparables. L’influence de Dürer sur la peinture allemande fut immense, même sur ses contemporains dont plusieurs furent d’un réel mérite. Hans Von Kulmbach (1476 — 1522) reste près des tailleurs de bois franconiens ; Schaüffelein (1480–1540) annonce déjà le style baroque. Martin Schaffner (1480–1541) et Beham (1502 -1540) sont plus italianisés. Mais bien plus significatifs sont l’alsacien Hans Baldung Grien (1480 — 1545), grand maître de la forme et graveur d’un haut et pur style, et le bavarois Albrecht Alldorfer (1480–1538), poète aux rêves grandioses, génial paysagiste, étonnant romantique. Coloriste aux effets neufs, qui parfois annonce Greco, Alldorfer est le plus puissant inventeur que l’art allemand ait connu entre Dürer et Mathias Grünewald (œuvre entre 1500 et 1529). Celui-ci est un grand peintre, le plus peintre des Allemands, d’un réalisme et d’un mysticisme également saisissants, et d’une personnalité intense dans le dessin, âpre et tragique. Le courant flamand n’est pas cependant, en Allemagne, entièrement épuisé. Joos Van Cleve le Vieux (mort vers 1540) détermine à la flamande toute l’école de Cologne. Bruyn (1493–1555), son disciple direct, est le dernier artiste notable de ce milieu. En Westphalie, les frères Heinrich et Victor Dünwegge doivent aussi beaucoup à cet enseignement.
Mais en dehors de ces deux courants, flamand et italien, si bien fondus dans le grand humanisme de Dürer, Lucas Cranach (1472–1553) inaugure un art qu’on peut dire propre à la Réforme allemande. Observateur précis, peintre sec et dessinateur sans ampleur, Cranach donne l’expression la plus typique de l’art populaire à tendances nationales. Hans Holbein, le jeune (1497 — 1543) est un génie tout différent. Sans aucune trace d’influence de Dürer, il est, lui aussi, et plus que Dürer même, un humaniste. Pour ce déraciné, mêlé à la société intellectuelle de France, de Hollande et d’Angleterre, la question de l’alliance de l’âme antique et du génie allemand ne se pose pas. Portraitiste d’une acuité presque unique, Holbein dépasse son temps comme il dépasse son pays et atteint à l’humanité universelle. Dans l’art du portrait, son successeur Amberger (1500–1561) mêle à son influence celle visible des Vénitiens.
Après cette génération, dès le milieu du XVIe siècle, l’art allemand s’éteint. Muelich (1516 — 1573) n’est plus qu’un reflet de Venise.
De même l’Ecole française, naguère si vivace, se raréfie et s’amenuise, mais elle donne, en même temps, son expression la plus française dans l’œuvre de quelques artistes, néerlandais ou italiens. L’Ecole du Midi est morte après la Grande Pieta. Simon de Châlon : (1532 — 1562) y apporte la tradition néo-flamande, mais ne la ressuscite pas. Perréal prolonge jusqu’en 1516 récole du Centre. Mais les artistes marquants du XVIe siècle sont les trois Clouet. Jean I, le père venu des Flandres vers 1492, Jean II, le fils (1485 — 1540) et François (1522 — 1572). Le plus grand des trois est Jean II, dessinateur et peintre sobre et fin, d’une pureté classique, dont les portraits résistent aux plus hautes comparaisons. Ses contemporains, comme Bellegambe, ses successeurs : Quesnel et Dumonstier maintiennent la tradition du portrait habile où excellera bien plus qu’eux, dans ses petits tableaux si fouillés et si vivants, Corneille, de la Haye, dit Corneille de Lyon (1533 — 1576).
L’Ecole de Fontainebleau, fondée par les italiens Rossi et Primatice, ramenés par François Ier, fut supérieure en général à l’enseignement qu’elle reçut. Celui-ci, inspiré du poncif de Michel-Ange, apporte en France l’enflure et le goût décoratif du style baroque. La Contre-Réforme qui, après l’Italie, va conquérir la France, insinue déjà dans son art la tendance théâtrale à l’éloquence et au creux. Jean Cousin (+1590) est, à ce point de vue, très représentatif.
Que reste-t-il, en effet, à prendre, à l’Italie ? Le mauvais goût, la fadeur, l’éclectisme composent la formule académique qui pèsera sur toute l’Europe du XVIIe siècle, aux deux seules exceptions, d’autant plus glorieuses, de l’Espagne et de la Hollande. Cette formule qui parut salutaire, après l’imitation désordonnée des maîtres, est due à Louis Carrache (1555 — 1600) et à ses deux neveux, Augustin (1557 — 1602) et Annibal (1560 — 1609). C’est de Bologne, leur ville natale, que partit le mot d’ordre qui était d’allier « le dessin de l’école romaine le mouvement et les ombres des Vénitiens, le beau coloris de la Lombardie, le style terrible de MichelAnge, la vérité et le naturel de Titien, le goût pur et souverain de Corrège ». On voit à quelle confusion l’application de ces théories pouvait conduire des hommes sans génie.
Une réaction de réalisme bouleversa, vers la fin du siècle, ce formulaire des recettes de la médiocrité. Un gâcheur de plâtre, Amerighi, dit le Caravage (1569 — 1609) introduisit dans la peinture les figures de la rue. Son goût de la vie est rendu efficace par le sens profond des formes et du mouvement et l’intensité des effets. Sa manière, rude et sombre, eut sur toute la peinture, en Italie, en Espagne et en France une influence durable jusqu’au XIXe siècle. Les éclectiques eux-mêmes l’ajoutèrent à leur recueil de recettes.
D) XVIIe-XVIIIe siècles.
La décadence de la peinture résultant, si l’on peut ainsi dire, du surmenage du XVe siècle et du début du XVIe, pèse également sur tous les pays dans les premières années du XVIIe. Plus encore qu’au XVIe, les caractères généraux des écoles disparaissent devant les caractères individuels des peintres. Les exceptions elles-mêmes à la décadence générale sont individuelles et paraissent d’autant plus fortes.
Les successeurs italiens des Carrache qui ont rempli d’œuvres innombrables les musées et les collections particulières, ajoutent à l’impersonnalité de leurs maîtres la fausse grâce du style jésuite, son sentimentalisme mystico-érotique, le tarabiscotage qui a valu à l’époque le qualificatif de baroque. Albane (1578 — 1660) ; le Dominiquin (1581 — 1641) ; Guido Reni (1575 — 1642) ; Guerchin (1591 — 1660) sont des compositeurs habiles et des peintres vulgaires.
Les tendances des éclectiques mêlées à l’influence de Caravage sont manifestes dans l’œuvre des décorateurs de l’Ecole romaine : Pierre de Cortone et son fâcheux élève Luca Giordano. Le produit de ces confusions est un art grossier, tapageur, et sans conscience. Salvator Rosa (1615 — 1673), de l’école de Naples, a créé un genre de paysage théâtral, qui fut longtemps imité.
Les artistes les moins sensibles à l’influence bolonaise sont néanmoins des suiveurs ; le meilleur des romains de cette époque : Sassoferrato (1605 — 1685) emprunte à la première manière de Raphaël. Les deux florentins Alexandre et Christophe Allori, sont des académistes chez qui subsiste encore le goût et le style propres à leur région. Mais ce qui domine bientôt, à côté des airs de parade foraine des décorateurs, c’est un style dégénéré et douceâtre dont le trop célèbre Carlo Doici est le représentant.
Avec la survivance de l’école vénitienne nous touchons à la première exception dans la décadence générale, qui dépasse quelque peu les individualités honorables. Venise a échappé à l’éclectisme, parce que plus qu’ailleurs, l’esprit païen de la Renaissance s’est intégré à la vie de la cité. Ni la réforme, ni la contre-réforme n’ont eu prise sur elle. En outre et de même qu’en Hollande, le génie pictural, évolué de la représentation mythique vers le naturalisme plus vaste, trouve précisément dans la nature elle-même les qualités d’espace, de lumière, de couleur, qui vivifient la peinture. Le paysage, la vie en plein air, la vie civile sont les ressources de l’école vénitienne du XVIIe et XVIIIe, comme de l’école hollandaise.
C’est à cette veine intime et populaire que les deux fils de Jacopo Bassano, et, après eux, Pietro Longhi, Mganasco (1667 — 1749), Piazzetta (1682 — 1754) doivent de rester de vrais peintres. Canaletto (1697 — 1767) et Guardi sont des paysagistes expressifs, des interprètes émus de la lumière et de l’espace, de charmants notateurs du détail pittoresque. Mais le plus grand artiste de Venise, au XVIIIe, est Jean-Baptiste Tiepolo (1696- 1770) qui, par la grandeur à la fois de son style et la liberté de sa couleur, relie la Renaissance au romantisme, si bien qu’on a pu le définir le dernier des grands peintres anciens et le premier des grands modernes. A Rome, Panini, et surtout le grand graveur Piranesi, fondent sur l’archéologie un art qui marquera sur la fin du XVIIIe siècle.
En France, aux deux extrémités d’une époque pompeuse et pauvre, des réalistes, les Le Nain, d’une part : Antoine (1588 — 1649), Louis (1593 — 1648) et Mathieu (1607 — 1671) et Callot (1593 — 1631) ; d’autre part, Chardin (1699 — 1780) échappent à la grandiloquence et au creux par l’expression simple de la vie et de l’homme. Egalement, mais dans un autre sens, de grands maîtres de la forme et du mouvement, des passionnés du style et de l’équilibre s’opposent à la médiocrité des formules : le plus grand, Nicolas Poussin (1594–1665) et, à l’autre bout de l’époque, Louis David. Le premier, isolé dans sa noblesse intérieure, le second chef d’école, ramenant l’un et l’autre, avec des moyens différents, la peinture à des fins élevées, à la pureté ou à l’héroïsme ; celui-ci, par la rupture éclatante avec les mièvreries du XVIIIe, permettant l’éclosion admirable du XIXe siècle français. Tirons encore hors de pair, un Philippe de Champaigne (1602 + 1674), scrutateur austère du visage humain ; et tout différents, mais non moindres, ces grands poètes de l’espace, ces magiciens de la lumière : Claude Gelée (1600 — 1682), la plus haute expression, peut-être, avec Poussin, de l’art du paysage jusqu’à lui, et Antoine Watteau (1684 — 1721).
Les autres sont marqués par l’époque et secondaires, qu’ils suivent les Carrache comme Simon Vouet (1590–1649), Le Sueur (1616–1655) ; qu’ils les dépassent même, sans les égaler comme peintres, par une ampleur de style et un sens indéniable de la décoration, comme Le Brun (1619–1690) ou Jouvenet (1644–1717) ; ou qu’ils transportent leur éclectisme dans le portrait, comme Rigaud, Pierre Mignard, ou Largillière, auxquels peut s’appliquer la critique de Poussin à l’un d’eux qu’il trouvait froids et fardés. A côté de ces maîtres ennuyeux, le Valentin, Sébastien Bourdon semblent vivants et savoureux. Le débridement des instincts, qui, à la mort de Louis XIV, succède à l’oppression religieuse, ne relève pas la peinture. Jamais avec des mains plus glacées n’ont été tentées de plus chaudes parties. Ni Lancret, ni Pater, suiveurs sensuels de Watteau, ni Boucher (1704 — 1770), peintre d’un rococo si surfait, mais bon décorateur, ni les Coypel, les Van Loo, les Lagrenée, aucun de ces peintres pour désœuvrés décadents ne s’élève, par sa conception, au-dessus de l’anecdote, par son faire, au-dessus d’un petit agrément. Ce sont les portraitistes Nattier (1685–1765), malgré sa sécheresse ; Tocqué (1696–1772), qui n’est pas sans profondeur ; Aved (1702 — 1766) ; les pastellistes si subtils La Tour (1703 — 1788) et Perronneau , ou encore les provinciaux : Grimou, Subleyras, Duplessis, qui font figure de peintres. Greuze, lui-même, aux compositions si niaisement fades, se sauve par des portraits tendres ou vigoureux. Mais, par dessus tous, Chardin, le plus authentique peintre du XVIIIe siècle, rappelle les hollandais par la beauté de la matière.
À la fin du siècle et avant David auquel tout l’oppose, Honoré Fragonard (1732 — 1806) est un vrai peintre, parfois un grand peintre, au métier souple, hérité de Rubens et annonciateur des romantiques. Les noms d’Hubert Robert, de C.-J. Vernet, élève, à travers Manglard, de Lorrain, marquent la charmante faiblesse de l’art du paysage. Les décorateurs et les tapissiers, Ondry, Le Prince, rejoignent, par Desportes, le XVIIe siècle, et adaptent au luxe des intérieurs, les petites manières en vogue dans une société déliquescente.
Dans ces deux siècles, où seuls nous avons vu émerger des individus isolés, et mise à part la survivance de Venise, des écoles pourtant fortement caractérisées, naissent et s’établissent : au sud-ouest de l’Europe l’école espagnole ; au Nord-ouest, l’école hollandaise et la nouvelle école flamande de qui naîtra l’école anglaise.
Inauguré par le génial isolé, par cet opposant, cet étranger que désigne son sobriquet d’El Greco, le mouvement de la peinture espagnole se dégage, dès les premières années du XVIIe siècle, des influences napolitaine et vénitienne. Le Greco (Theotocopouli, 1550–1614) est, en réalité, un homme du XVIe siècle. Il transforme à des fins si neuves le grand enseignement de ses maîtres vénitiens, que nulle autre peinture ne peut être comparée à la sienne. La stylisation des formes humaines, l’expression, la force de la couleur y atteignent une acuité sans repos, mais inégalée. Plus directement inspiré des Italiens, et en particulier du Caravage, Ribera (1588–1652) qui vécut une partie de sa vie à Naples, reste pourtant foncièrement espagnol, par son réalisme et l’âpreté de son style. A Séville, succédant aux mystiques encore inspirés de Van des Weyden, tel que Moralès, Herrera le Vieux introduit, vers 1620, l’influence italienne, mais il transpose avec une vigueur naturaliste saisissante. Zurbaran (1598–1664) est un maître aussi expressif et tragique, mais plus peintre. Alonso Cano (1601- 1667) adoucit la manière et précède Murillo (1618- 1682) dans un idéalisme sentimental, un peu inconsistant, mais d’une couleur séduisante. Le grand peintre de l’Espagne du XVIIe siècle et l’un des plus grands artistes de tous les temps est Vélasquez (1599–1660). Rénovateur de la technique, le premier qui ait employé les couleurs à l’huile directement, le plus savant sans doute des techniciens et le plus habile, Vélasquez est en même temps le plus simple, le plus dépouillé, le plus objectif des peintres. Avec une richesse de matière égale à celle des Hollandais, un sens de la couleur égal à celui des grands Vénitiens, il rejoint la sobriété, la grandeur de style et la vérité nue des grands Italiens du XVe, la majesté d’un Piere Della Francescha.
Après une éclipse assez longue, l’art espagnol revit, à la fin du XVIIIe siècle, avec une force renouvelée, dans l’œuvre de Goya (1746–1828). Cet homme prodigieux, dessinateur et graveur d’une passion ardente, peintre dont la largeur et la sûreté égalent presque celles de Vélasquez, Goya eut une influence considérable, au XIXe siècle, sur les peintres français et anglais. Par lui, comme par Vélasquez, l’école espagnole dépasse les conditions d’une école nationale et atteint une expansion universelle.
Cependant, au nord de l’Europe Occidentale, l’école flamande surgit de la couvaison italienne en un bouquet prestigieux de flammes ardentes et charnelles. Rubens (1577–1640) qui allume ce beau feu sort de l’enseignement assez obscur de Van Noort et d’Otto Venius. Mais il puise à la source même, à Venise, et son génie est assez fort pour ressusciter, à travers le métier de ses inspirateurs, la grande verve naturaliste des premiers Flamands. Sa fécondité exceptionnelle de narrateur, son sens du modelé vivant et des couleurs expressives, sa fougue incomparable le rapprochent à la fois de Véronèse et de Michel Ange. Mais il a su, à un degré unique, rendre la vibration sensuelle de la chair et le délire sacré de la nature. Ses contemporains Frans Pourbus (1579–1622), Snyders (1579–1657), Cornelis de Voos (1585–1651), participent diversement à son entraînement. Pieter Brueghel, le jeune, collabore avec lui. Mais son émule le plus proche, Jordaens (1593–1678) qui pousse à l’extrême, semble-t-il, sa forte liesse de gas de Kermesse, a, parfois, avec un éclat égal, plus d’équilibre dans la densité et plus de solidité. Van Dyck (1599–1644) est tout autre. Disciple de Rubens dans son rôle mondain, ce peintre plein de distinction est un des maîtres les plus féconds, les plus agréables et les moins profonds. Il plut aux gentlemen de l’Angleterre raffinée et toute l’école anglaise s’est inspirée de lui. Après ces maîtres, David Téniers (1610–1690) le Jeune et plus encore Adrian Brouwer (1605–1639) doivent aux Hollandais le goût des intérieurs et de la vie quotidienne.
Les écoles de Hollande, (car elles furent aussi nombreuses que dans l’Italie du XVe siècle), se différencient, dès le XVIe, avec Lucas de Leyde, Schoorel et Van Hemskerke, dans le courant néerlandais. Mais c’est au XVIIe, alors qu’expire l’Italie artistique, qu’une grande poussée de sève fait de la Hollande le pays des peintres. La Réforme, qui partout ailleurs produit un appauvrissement artistique, aboutit, au contraire, par la séparation des provinces protestantes, à un épanouissement des vertus hollandaises. L’art naturaliste et bourgeois des Hollandais, tourné vers les satisfactions quotidiennes, diffère de tous les autres arts avant lui. L’abandon des grands sujets est compensé par la grandeur de style que confère à cette peinture la beauté de la matière et la dignité du grand métier. A ce point de vue, aucune époque ne peut être comparée au XVIIe siècle hollandais.
De Frans Hals à Hobbema, un siècle entier s’étend, aussi riche, aussi varié que les grands siècles de la Renaissance italienne, prodigieux par le nombre des habiles et, même si l’on excepte pour une gloire sans voisinage le solitaire Rembrandt, marqué par de très grands ouvriers et de singuliers génies. Des écoles naissent, à Utrecht et à Delft, avec Mierevelt et Honthorst à la Haye, avec Esaias Van de Velde, à Amsterdam, avec Eliasz et de Keyser.
Frans Hals (1580–1666), de Harlem, est un maître de la matière comparable à Vélasquez et un portraitiste qui ne le cène qu’à Rembrandt. Dans cette longue vie, le peintre évolue en simplifiant sa manière pour aboutir aux œuvres dépouillées et fortes des dernières années. Les élèves de Hals lui doivent leur prodigieuse technique : Brouwer, Adrian Van Ostade (1610–1685), Isaac Van Ostade (1621–1649), Jan Steen (1626–1679) sont plus que des conteurs pleins de verve et de mouvement Mais les générations suivantes renonceront à cet élément d’intérêt. Déjà les intérieurs de Gérard Dow (1613- 1675) et de Ter Borch (1617–1681) n’ont point d’autre sujet réel que le jeu des rapports de couleur dans la lumière. Deux grands maîtres, Pieter de Hooch (1636–1677) surtout et Jean Vermeer, de Delft (1632–1675) porteront à la hauteur des plus grandes réalisations de l’art, et par la seule magie de la peinture, le simple aspect d’un intérieur, d’un paysage urbain, de figures calmes et profondes. Le sens de l’espace, que les grands Ombriens ont cherché dans les perspectives lointaines, ils le trouvent et l’introduisent sous une fenêtre discrète, autour d’une table. La lumière est entre leurs mains l’élément d’incantation du tableau.
Mais il faut reconnaître là l’influence — qui, pour certains fut écrasante — du plus grand magicien de la peinture : Rembrandt (1606–1669). Nul peintre peut-être n’est plus complet. Il n’y a pour lui ni genres ni techniques particulières. Ce qu’il a peint, gravé ou dessiné, il l’a, pour ainsi dire, recréé. Il y a le Monde des apparences, et le Monde de Rembrandt. Qui est autre, comme il y a la lumière de Rembrandt et l’étrange vibration de sa peinture. Sa matière, au début brillante et ferme, évolue, comme celle de Frans Hals, vers une liberté, une simplicité, égales à celles de Vélasquez. Mais il y introduit un élément que ses glorieux émules ont ignoré et qui est la marque particulière de son génie. Une lumière intérieure, une atmosphère d’ombre rayonnante baignent toutes ses œuvres et leur assurent une emprise que le mot seul de magie représente sans l’exprimer.
Comparés à lui, ses disciples de l’école d’Amsterdam et ses contemporains nous paraissent ou froids ou pauvres. Isolés de lui, ils reprennent leur rang qui est encore celui d’excellents peintres. Ferdinand Bol (1616–1689), Govaert Flinck (1616–1660), Niklas Maes (1632–1693) ; et plus encore Van der Helst (1612–1670) sont des maîtres de la figure humaine.
L’école de Harlem, illustrée en premier lieu, par Frans Hals, est encore l’école des grands paysagistes : Salomon Ruijsdaël (1600–1670), Everdingen (1621–1675), Wouwerman (1619–1668) et Jacob Ruijsdaël (1629–1682), le premier, en Hollande, des compositeurs de paysage, l’un des plus saisissants interprètes, avant Corot, des transparences de l’espace. Après eux, Nicolas Berchem, Berckeyden, vulgarisent le paysage et le rendent décoratif. Amsterdam eut aussi de bon paysagistes : Asselyn, Aest Van der Neer, Philippe et Salomon de Koninck, Karel Dujardin et le grand animalier ingénu : Paul Potter (1625–1655). Mais le seul rival des Ruysdaël, en cette école, est Mindert Hobbema (1638–1709) qui, avec Albert Cuyp (1620–1691), le plus grand des animaliers, prolongent aux abords et au début du XVIIIe siècle, la grande tradition du paysage hollandais.
Mais la Hollande a produit encore d’étonnants peintres de la mer, les plus vrais, les plus saisissants avant les modernes. Le premier et le plus grand sans doute : Jan Van Goyen (1586–1657), de La Haye, est le maître des ciels mouillés et des transparences marines. Après lui, les deux Guillaume Van de Velde, Van de Capelle, Van der Meer, Backhuysen enfin, illustrent diversement un genre spécifiquement hollandais.
On pourrait en dire autant des innombrables peintres de natures mortes, dont l’habileté dégénère parfois en virtuosité, mais parmi lesquels de vrais maîtres : Kalf, Van Beyerem, Van Huijsum ont laissé des œuvres fortes ou charmantes.
Mais cette immense et savoureuse école s’éteint d’un coup dès la fin du XVIIe siècle. Au XVIIIe, il n’y a plus rien que quelques disciples glacés et mièvres de Gérard Dow et de Van Mieris, plongés dans un académisme de petit genre, de conversations galantes et d’élégances de salon, qui ne se distingue en rien, sinon par sa faiblesse plus grande, de l’esprit des petits maîtres français.
C’est pourtant en partie à la Hollande, mais plus encore à la Flandre et particulièrement à Van Dyck que l’école anglaise du XVIIIe siècle doit sa naissance et son développement. Mais ce n’est qu’avec un retard de près d’un siècle que se produit cette éclosion. Et l’art anglais apparaît aussitôt fortement caractérisé dans ses éléments de terroir auxquels il doit peut-être de rayonner, à la fin du XVIIIe siècle, sur toutes les autres écoles.
Hogarth (1697–1764), le premier de ses peintres, ennuyeux dans ses sujets moralisateurs est pourtant un bon peintre, franc et expressif. Mais c’est surtout à la génération suivante que les influences mêlées des Flandres, de Venise et d’Espagne font surgir les grands portraitistes mondains, parmi lesquels Reynolds (1723–1792) et Gainsborough (1727–1788) tiennent une place particulière, celui-ci plus complet, plus génial et l’un des premiers maîtres du paysage où l’école anglaise se distinguera. Après eux, Rneburn, Romaney, Hoppner, Opie ; et Lawrence (1769–1830) qui les égale presque en renom. En même temps le paysage, naturaliste à la manière hollandaise mais avec une originalité savoureuse, se développe à la suite de Gainsborough et de John Crome (1769–1831). Mais ses plus belles réalisations et ses directives magistrales, celles qui de Constable et de Turner viendront influencer le romantisme français, appartiennent déjà au XIXe siècle.
XIXe siècle.
La grande fermentation des esprits qui précède la Révolution française n’a pas son équivalent dans l’histoire de la peinture ; mais son pendant, s’y retrouve. Si l’on veut bien comprendre que l’œuvre de la Révolution fut moins l’explosion de passions populaires qu’une imitation de juristes épris d’héroïsme à l’antique, on ne manquera pas de noter la réaction archéologique qui se produisit en peinture, environ le milieu du XVIIIe siècle et dont Vieu, J.-B. Pierre, Regnault., Peyron et, plus que tous, David (1748–1825), furent les truchements ou les prophètes. C’est un nouvel académisme, non plus inspiré de la Renaissance, mais puisant directement à l’antique compris à la façon de Montesquieu, un paganisme sans volupté, cérébral, une conception de moralistes. Cette réaction contre les polissonneries et les manières de la peinture de boudoir, cette tendance au grandiose n’eût donné que des œuvres ennuyeuses si David n’avait été, à côté d’un théoricien pompeux, un grand peintre simple. Son exemple plus que ses leçons restituèrent à la peinture ses nobles ambitions, la conscience et le respect du beau métier. On n’accepta plus le faire facile, ni la hâte. A cette rigueur l’école française dut de s’élever au grand art qu’elle avait entrevu et manqué au XVIIe ; mais si, cette fois, elle y réussit, c’est que des éléments d’une technique forte et vivante lui vinrent, à la fois, des espagnols, des vénitiens, des flamands, des hollandais et des anglais et qu’elle sut les utiliser sans s’y asservir. C’est aussi qu’elle rencontra dès les premières années du XIXe quelques puissants génies qui l’empêchèrent de dévier.
Les débuts de cet âge, le plus grand, le plus vivant de la peinture française, ne manquent pas de confusion. Il brillera d’ailleurs plus par la profusion des génies particuliers que par l’unité de tendances. Le classicisme à la romaine de David est dominé par ses fortes réalisations. En même temps un romantisme d’inspiration, une inquiétude sentimentale, pénètrent l’école, à la suite des littérateurs. En marge P.-P. Prud’hon (1758–1823), qui n’échappe pas toujours à l’allégorie, est un séduisant coloriste, influencé tardivement par Léonard et par Corrège. Mais Guérin, Gérard et Girodet sont assez fades. Il semble que la sève appauvrie des petits maîtres du XVIIIe, s’essaie vainement, avec eux au grand art. Gros (1771–1835), au contraire, transpose dans l’exaltation des héros contemporains le fort enseignement davidien ; il y ajoute le culte de Michel-Ange et y apporte une fougue particulière et de singuliers dons de coloriste. C’est de lui que le génial Géricault (1791–1824) tient son modernisme réaliste et sa hardiesse. Mais les Anglais, qu’il connut chez eux, et Rubens renouvelèrent et libérèrent sa technique. On doit noter ici comme un élément important de l’enrichissement de la peinture au XIXe siècle, le perfectionnement par les Anglais et la diffusion de l’aquarelle.
Delacroix (1798–1863), génie inquiet et magnifique, semble l’incarnation du romantisme. Mais ce serait insuffisamment le définir. Car si par l’expansion somptueuse qu’il lui a donnée, il impose, contre la tyrannie de l’antique, le goût du moyen âge, de l’exotisme ou du moderne déjà vivaces chez Gros et Géricault, il convient de noter que du point de vue de l’invention el des sujets, Ingres, son grand rival, n’est pas moins en opposition avec les antiques ; et que si Delacroix, délaissant l’archéologie, reprend la tradition aux Vénitiens, il la cherche plus haut, chez les Florentins du XVe et chez Raphaël. Cette courte digression doit suffire à montrer la vanité des appellations et l’insuffisance du choix des sujets à distinguer entre eux les peintres. Peu importe le bric-à-brac d’accessoires historiques auquel Delacroix fit souvent appel. Où Delacroix a réussi quelques-unes des plus fortes pages de l’histoire de la peinture, Delaroche, avec les mêmes éléments, n’a rien produit que d’ennuyeuses images.
C’est de l’influence mêlée de Delacroix et des Anglais que procèdent maints petits maîtres du paysage et de l’exotisme : Paul Huet, Isabey, Decamps, et des intimistes comme Tassaert.
Ingres (1780–1867) hérite de David l’autorité sur l’école. Ce dessinateur prodigieux, interprète des « valeurs tactiles » aussi sûr que les Florentins du XVe, est un peintre sec et sans vibration. Ses portraits, ses nus s’imposent pourtant, les uns par une certaine grandeur d’expression et de composition, les autres par le sentiment très aigu de la volupté des formes. Rien, au contraire, ne rattache à la vie l’école des Nazaréens allemands : Cornelius, Schnorr, Overbeck ne sont que de tristes intentionnistes.
L’Ecole d’Ingres est en grande partie responsable de l’académisme officiel qui pesa sur tout le milieu et le troisième quart du XIXe siècle et d’où il ne fallut rien moins que le génie de Courbet d’une part et la révolution impressionniste d’autre part, pour sauver la peinture. Flandrin et Mottez, plus peintre, se sauvent par leur dignité et leur conscience. En réalité, comme au XVIIe, ce sont les éclectiques, Gleyre, Cabanel, Delaunay ou de faux romantiques Ary Scheffer, Couture et Baudry qui causent l’affaiblissement de la peinture.
Chassériau (1818–1856), qu’on a voulu prendre comme un moyen terme entre Ingres et Delacroix, est, en réalité, un maître personnel, non qu’il soit sans contacts, en particulier avec Delacroix, mais sa sensibilité et son charme le font distinct et reconnaissable.
Le début et la première moitié du siècle ont méconnu deux très grands maîtres qui, en dehors des écoles et de la mode, poursuivirent, diversement, une œuvre riche d’humanité et d’amour : Corot et Daumier, que le XXe siècle a mis à leur place réelle. J.-B. Corot (1796–1875), longtemps considéré sous son seul aspect de paysagiste, est aussi un peintre de figures d’une simple et émouvante grandeur. Mais nul n’a mieux que lui exprimé la douceur charnelle et comme intime de la nature et de l’atmosphère. Daumier (1809–1879), peintre, graveur, aquarelliste et lithographe, est un puissant témoin des mœurs et des caractères. On l’a comparé à Molière, mais s’il n’est pas moins profond, il est moins complaisant. Sa révolte a cinglé les puissants avec une grandeur tragique qui l’apparente à Goya. Celui-ci termine en 1828 une longue et puissante carrière. Après lui, l’école espagnole s’éteint dans ses initiateurs, dont le plus brillant est Lucas.
A la suite des salons où exposèrent les grands paysagistes anglais Constable (1776–1837) et Bonnington, un amour puissant de la nature souleva l’enthousiasme de jeunes artistes. Retirés dans la forêt de Fontainebleau, en contact avec la nature, Théodore Rousseau (1812–1867), Daubigny (1817–1878), Jules et Victor Dupré, Diaz, Troyon, renoncèrent au paysage composé, cherchèrent la simple grandeur de l’expression directe où ils avaient été, sans le savoir, précédés par Georges Michel. Millet (1816–1875), leur voisin de forêt, les dépasse par la grandeur qu’il sait donner au travail humain. D’autres paysagistes, partis en Orient, à l’exemple de Delacroix et de Decamps, y cherchèrent moins le pittoresque qu’une vérité un peu courte. Fromentin et, mieux que lui, Marilhat ; expriment cette tendance. Il est étrange et inexplicable qu’au temps presque où la sève de Constable et de Bonington portait ses fruits, où Turner achevait son œuvre pour l’éblouissement des générations suivantes, toute une formation d’artistes anglais se soit délibérément refusée à une emprise que recevait l’Europe, ait laissé tarir cette veine. Les pré-raphaëlites : Millais, Burne Jones, Wats, Madox Brown, Rossetti sont sortis de la vie par amour du XVe siècle ; et si quelques-uns, comme Millais et Wats ont gardé le sens de la peinture, c’est quand ils ont oublié leurs théories. Après eux, Walter Crane, Kate Grineway, Brangwyn sont des illustrateurs.
La première moitié du siècle vit naître en France des écoles provinciales : celle de Provence, avec Granet, élève de Constantin et de David, celle de Lyon avec Berjon, Grobon et les inspirés d’Ingres, comme Orsel et Jeannot.
Mais en 1850, une affirmation puissante marque une nouvelle détermination de la peinture. Courbet (1819–1877) avec « l’Enterrement à Ornans », réagit à la fois contre l’académisme et contre l’éclectisme. On ne peut se contenter de voir en lui l’aboutissement de petits maîtres, Cals ou Bonvn. Aux dernières années de Delacroix il apporte sa forte prétention de successeur légitime. Ce génie robuste et limité, l’un des plus parfaits ouvriers de la peinture, a produit, une œuvre où la sève populaire circule avec la sensualité la plus saine. La haine bourgeoise lui fit payer, de son vivant et après sa mort, sa participation à la Commune.
A la suite d’un voyage à Francfort et de son exil définitif en Suisse, Courbet peut être considéré comme l’initiateur en Europe Centrale sinon d’une école, du moins de quelques peintres, les plus vivaces et les plus vrais. Leibl, Liebermann sont des portraitistes un peu mous mais délicats. Hans Von Marées, malgré sa grandiloquence, est un peintre. L’école russe, assez tardive, produit vers le même temps, des œuvres secondaires.
En France, la libération des formules qu’inaugura Courbet ne fut pas perdue. Il convient de noter d’ailleurs l’influence bienfaisante qu’un maître de l’école, Lecocq de Boisbaudran,eut alors sur toute une génération de jeunes gens : Fantin Latour (1836–1904), Alphonse Legros, le grand Américain Whistler. Fantin est un peintre des plus sensibles et des plus fins. Il semble qu’en ce moment de 1860, l’air circule plus à l’aise dans la peinture. Les peintres sont sortis, les uns de la tension romantique, les autres de la forêt. Le grand exemple de Corot, sensible chez Lépine, celui de Delacroix, inspirent respect et admiration. Mais aux italiens, aux flamands, aux anglais, voici que, comme excitant étranger, succèdent les espagnols hautains. Cependant un Ricard (1823–1872), isolé volontairement dans son culte des maîtres, a donné quelques-unes des effigies les plus aiguës et les plus modernes. Les écoles locales, à ce moment, brillent encore avant de disparaître. L’origine provençale rapproche ici de Ricard Guigou (1833–1871), maître incomplet, mais sensible et vrai.
Manet (1832–1883) est un peintre de grande race et de grand goût. Il réagit contre les couleurs sombres de Courbet, de Théodule Ribot, d’autres encore. S’il doit aux maîtres espagnols, c’est à Vélasquez et à Goya ; mais avec un sentiment si personnel, un accent si authentique que toute la peinture après lui en est marquée. Si ceux qu’on appelle les impressionnistes l’ont devancé dans leurs recherches du plein air, ils ne sont pas moins, pour leur conception générale de l’art, ses disciples. Mais, en même temps que lui, un autre maître qui, par sa possession du mouvement des lignes s’égale aux grands, marque également, bien que diversement, sur les peintres qui le suivirent : Edgar Degas (1834–1917). Dans une veine pessimiste, apparentée, Forain, maître dessinateur, ainsi que Steinlen ont laissé des pages émouvantes.
N’est-ce pas un peu à Manet, puis au-delà de lui à Courbet et aux peintres de Fontainebleau que l’école hollandaise du milieu du siècle, l’école de la Haye doit son puissant et bref renouvellement ? Mais la vieille sève hollandaise y est aussi pour beaucoup. Bosboom (1817–1891) procède également de Bonington et de Jules Dupré. Josef Israëls (1827–1900 ?) ne semble rien devoir aux maîtres éclectiques français, avec qui il étudia, non plus qu’à Ary Scheffer. Son réalisme à la fois sombre et lyrique, son habileté manuelle et sa souplesse de matière remontent dans le temps, aux ancêtres du XVIIe, à l’émotion issue de Rembrandt. Autour de lui et après lui, les frères Maris Jacob et Wilhem, peintres de matière riche, évocateurs de paysages, puis Anton Mauve et Mesdag, portent dans le paysage la même sève et le même esprit.
L’école belge procède également des maîtres français : De Navez, élève talentueux de David, à Alfred Stevens, marqué par Courbet et Fantin, à Constantin Meunier. Vers la fin du siècle pourtant, des maîtres moindres, Laermans, Brackeleer réagissent ; mais c’est pour suivre de loin leurs ancêtres du XVe siècle ou du XVIIe.
Tandis que Manet et Degas tirent de la veine réaliste et contemporaine la matière de leur élévation picturale, un génial isolé : Puvis de Chavannes (1824–1898) construit, avec des moyens aussi modernes, ses visions de l’humanité éternelle. Puvis restera le grand décorateur de la seconde partie du XIXe, comme Delacroix fut celui de la première. S’il est moins peintre, moins vibrant, moins inventif, il a davantage le sens de la surface à décorer. Alors que tant d’écoles, depuis Ingres jusqu’aux pré-raphaëlites anglais, en passant par les Nazaréens allemands s’épuisèrent à rechercher l’esprit des italiens des XIVe et XVe siècles, en voulant imiter leur manière et leurs sujets, Puvis y atteint par des moyens modernes avec des sujets qui ne doivent rien à aucune autre mythologie que celle de l’humanité nue.
Le mouvement impressionniste, qui est à proprement parler le réalisme appliqué à l’expression des rapports de la lumière en plein air, est moins isolé qu’il ne semble. Les paysagistes anglais, et le plus grand de tous, Turner (1775–1851), visionnaire génial des brumes et du soleil, le hollandais Jongkind (1819–1891), le havrais Boudin (1824–1898), le marseillais Monticelli (1824–1886), prestigieux visionnaires ; les lyonnais Ravier, Guichard, Carrand et Vernay, peuvent, diversement et à divers moments de leur carrière, être considérés comme des précurseurs. Cela ne doit rien retirer au mérite de ceux qui codifièrent, si l’on peut dire, les recherches, et leur donnèrent leur plus forte expression : Camille Pissarro (1830–1903), l’anglais Alfred Sisley (1839–1899), Maximilien Luce (1858) et surtout Claude Monet (1840–1926), le plus sensible et le plus habile de ces maîtres de la lumière.
Alfred Renoir (1841–1920) et Cézanne (1839–1906) s’ils ont passé par l’impressionnisme, le dépassent. Renoir, par la puissance de sa vision, l’allégresse de ses nus, revient, avec des moyens renouvelés, à la grande tradition vénitienne. Cézanne est plus particulier encore. Le plus peintre des peintres, il semble qu’il réinvente la peinture. Nul plus que lui n’a su rendre la vibration tactile des volumes colorés. Tout pour lui est couleur et le modelé ne s’exprime par aucune ombre, mais par un ton opposé à un ton. Cézanne est l’initiateur de toutes les recherches de synthèse. Avec Van Gogh (1853–1890), hollandais génial et brûlé à son propre feu, avec Toulouse-Lautrec (1864–1901), évocateur d’une époque, avec Odilon Redon (1840–1916) pur et féerique, les moyens impressionnistes encore servent à la reconstruction du Monde. Seurat, que suivent Signac et Cross, inaugure les recherches d’un art plus exactement scientifique. Paul Gauguin (1848–1903) retrouve à Tahiti un nouvel exotisme et le sens de la synthèse. C’est de lui, de Cézanne et de Van Gogh que procèdent, à leurs débuts, les Fauves : Friesz, Manguin, Marquet, et le plus original, Henri Matisse, de plus en plus orienté vers les formules libres et les plus rares vérités de la couleur. Vuillard, dans des gammes fondues et sourdes, Bonnard, avec des tons nacrés et des rapports aigus ; Piot, Roussel, Puy, Dufrénoy expriment l’aboutissement précieux de cet âge. Cependant que Vlaminck, le Fauconnier et Segonzac remontent, par les Flamands, les Hollandais, ou leur tempérament propre, au réalisme de Courbet et que d’autres reviennent au classicisme par l’éclectisme.
D’ailleurs les ardentes divisions qui mirent en lutte les « partis » de la peinture, dans les premières années du XIXe siècle, disparaissent peu à peu, en même temps que disparaissent les résistances des tenants de la vieille académie. Des hommes du « centre » pourrait-on dire, Chartes Cottet, Lucien Ménard, Albert Besnard, Aman Jean participent aux mêmes expositions que les Fauves. Le Suisse Félix Valotton fut, avant la lettre, avec un souci serré de la forme et des valeurs tactiles, un rénovateur du classicisme. Les théories surtout de Maurice Denis aidèrent ce mouvement.
Le mouvement cubiste fut une réaction violente à la fois contre les tendances et contre l’esprit de l’impressionnisme et de toute la peinture antérieure. Jamais révolution plus complète d’un idéalisme plus absolu ne fut tentée contre la nature. En dépit des variétés d’aptitude de Picasso, du talent de Brague, le cubisme n’a réussi qu’à orienter, dans un sens expressif par sa simplicité même, la décoration moderne et l’art de la publicité.
Désormais, il n’y a plus, en peinture, d’écoles locales. Paris est le creuset où convergent et se fondent toutes les tendances. Seule l’école allemande, issue, à travers Corinth, des romantiques, a une vitalité propre, moins picturale que graphique, avec des artistes expressifs, Pechstein, Nolde, Grosz. Les tendances expressionnistes ne sont pas sans influence sur les Belges contemporains : Permeck ou Masereel. Mais la Belgique, l’Angleterre centrale, la Hollande et le Japon même vivent du même foyer international et à leur tour l’alimentent.
Nous n’avons rien dit, au cours de cet exposé incomplet, des écoles extrême-orientales. Leur examen, fort différent de celle des artistes de mentalité européenne, exigerait une préparation et des préambules qui excéderaient cette étude. Mais ce que nous avons dit, en débutant, des caractères généraux et du rôle de l’œuvre d’art comme expression d’une race ou d’un individu, s’applique aussi bien à ces formes d’art qu’à celles qui nous sont plus habituelles, qui, d’ailleurs, ont subi en maintes époques, et en particulier à la fin du XVIIIe, puis autour de 1880, l’influence des Asiatiques. Actuellement, il faut noter aussi l’attraction exercée sur les artistes par les styles nègres et polynésiens, attraction moins due à une pénétration profonde et fraternelle de ces races qu’à un snobisme désœuvré et maniaque.
— TIBURCE.
PENSÉE (ET ACTION)
Bien qu’elle soit rédigée en style lapidaire, la Déclaration des Droits de l’Homme est loin de définir d’une façon précise les conditions dans lesquelles pourra s’exercer la liberté de la pensée. A l’article 11, il est dit : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »
Que doit-on entendre par abus ? Plus loin, au nombre des dispositions fondamentales garanties par la Constitution, il est répété :
« La Constitution garantit pareillement comme droits naturels et civils : 5° la liberté à tout homme de parler, d’écrire, d’imprimer et publier ses pensées, sans que ses écrits puissent être soumis à aucune censure ou inspection avant leur publication... »
Et, peu après :
« Comme la liberté ne consiste qu’à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui, ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant la sécurité publique ou les droits d’autrui, seraient nuisibles à la société. »
Les droits d’autrui, quand il est faible, ont toujours été fort mal préservés par la justice. Par contre, le vague des termes, sûreté publique, société, a laissé la porte ouverte à l’arbitraire, que l’on prétendait bannir de nos institutions.
Ce n’est pas seulement, de ce fait, la possibilité d’expression de la pensée qui est mise en péril, mais la pensée même. Les préjugés spiritualistes de l’époque empêchaient de s’en rendre compte, et cette vérité est encore trop méconnue à notre époque. Ainsi, dans un récent article de Revue, nous lisons :
« Soit dit en passant, sans paradoxe, dans toutes les sociétés, sous tous les régimes politiques, la liberté de pensée a régné, aucune société n’a véritablement violé la liberté de conscience, phénomène purement intérieur ; tous les régimes se sont montrés tolérants... parce qu’ils ne pouvaient faire autrement par la nature des choses. L’on n’a jamais violé que la liberté des manifestations extérieures : discours, cris, chansons, ports d’emblèmes, écrits, cortèges. Cette liberté-là, toutes les sociétés l’ont violée, tous les régimes la violeront. »
Ces phrases expriment une erreur que l’examen des conditions du fonctionnement de l’esprit doit dissiper. Liberté de pensée et liberté de manifester sa pensée sont inséparables. Proudhon l’avait bien aperçu, lorsqu’il écrivait :
« L’idée, avec ses catégories, naît de l’action et doit revenir à l’action, à peine de déchéance pour l’agent... contrairement à ce qu’enseignent l’orgueil philosophique et le spiritualisme religieux, qui font de l’idée une révélation gratuite, arrivée on ne sait comment, et dont l’industrie n’est plus ensuite qu’une application. »
Tout être vivant est un faisceau de tendances.
« Sans arrêt, depuis sa naissance, avant cela même, dans le développement du germe, la vie consiste en ces mouvements spontanés et dirigés, que le milieu extérieur ne fait que stimuler, qui aboutissent à le modifier aussi à quelque degré, mais toujours se suscitent l’un l’autre en vertu de nécessités intérieures ; on peut les nommer indifféremment, et selon les points de vue, fonctions, instincts ou tendances. » (D. Parodi)
En nous assimilant à l’être que nous voyons vivre sous nos yeux, nous pouvons dire que l’aspect intérieur qu’ont pour lui ces mouvements spontanés répondant aux stimulations extérieures qui libèrent son énergie propre, est l’élément primordial, la substance de sa pensée. Activité et pensée sont les deux faces complémentaires du comportement de l’être, les composantes de sa vie.
« L’activité de l’esprit consiste dans la vie des idées ; les idées sont des êtres vivants, c’est-à-dire qu’elles ne s’épuisent ni dans leur apparition, ni même dans leurs transformations intérieures ; elles agissent ; même elles sont elles-mêmes une action extérieure, un mouvement. Concevoir une lettre adressée à un ami, c’est déjà commencer à lui écrire, réaliser les actes nécessaires pour faire ce qui est imaginé. L’action extérieure est la prolongation de l’idée, l’idée elle-même vue du dehors. » (L. Brunschvicg)
L’effet du stimulus extérieur est de provoquer l’attention corrélative à la sensation. Or, l’attention est la prise d’une attitude, la suspension de mouvements en cours, une nouvelle orientation de la tête et du regard, l’activation de certains muscles. À des mouvements presque imperceptibles, l’observateur exercé reconnaît l’éveil d’une pensée.
On a dit que les tendances de l’être vivant inclinaient toutes également, en dernière analyse, à conquérir l’univers à multiplier sa formule individuelle, à imposer au milieu son propre rythme. C’est sans doute là l’aspect extérieur de la vie. Au dedans, l’activité se traduit par la recherche de l’équilibre avec le milieu, absorption et assimilation quand la chose est possible, harmonisation des rapports dans le cas le plus général, harmonie constamment compromise, constamment rétablie. Dans la vie psychique, cela se traduit par la persuasion d’autrui, la propagation de son idée ou l’assimilation de la pensée des autres, en un mot, par l’échange libre des pensées.
Toute idée, aussitôt conçue, se manifeste-t-elle par un acte ? Ce qui caractérise les êtres les plus élevés en organisation, c’est la faculté de différer l’action, de freiner les mouvements instinctifs non rationnels pour les corriger en tenant compte de l’expérience passée. L’énergie activée par l’impression venue du dehors est tenue en réserve, associée à d’autres pour n’être libérée qu’au moment le plus favorable ; le geste automatique ne s’accomplit pas.
« Brusquement, l’idée de l’acte se sépare du mouvement organique et attire l’attention de l’esprit. Au lieu d’être une source d’impulsion vers le dehors, elle revient en quelque sorte sur elle-même, et devient le point de départ de la réflexion. L’action à laquelle conduit la tendance est alors une action intellectuelle ; elle consiste à coordonner par rapport à l’idée initiale d’autres idées secondaires qui sont en relation avec elle... L’intervention de la réflexion a ainsi transformé et élargi le caractère de la tendance. A l’idée initiale est suspendue maintenant une série de mouvements successifs... » (L. B. déjà cité)
Ainsi, le freinage de l’acte impulsif, lorsqu’il a son point de départ dans l’individu impressionné lui-même, loin d’être un renoncement à l’activité, est, au contraire, la préparation à une activité extérieure plus intense et plus efficace. Que va-t-il advenir si l’arrêt vient de la rencontre d’une force extérieure prépondérante abolissant la tendance individuelle ?
Ce qui réalise le mieux la suppression de l’activité de l’homme, c’est son retranchement du milieu social où il vit normalement : la réclusion. Or :
« L’homme ne peut se suffire à lui-même en plein isolement. Son intelligence est incapable de se développer pleinement si, par les messages de la parole, de l’écriture, elle n’entretient correspondance avec les intelligences contemporaines et proches... »
En cas de réclusion :
« L’expérience a montré que c’était là une insigne cruauté et que les condamnés mouraient bientôt ou sombraient dans la démence. » (Dr Desfosses)
Plus l’individu est inculte, plus la séquestration le dégrade. Chez l’homme civilisé, le geste symbolique, le geste descriptif sont l’accompagnement ordinaire de la parole. Chez le primitif, ils sont l’essentiel du langage : sans mimique pas de compréhension réciproque. Bien plus, le langage tout entier est une action dramatique évoquée par la voix et le geste, devant l’interlocuteur. Un Boschiman est bien accueilli et embauché en qualité de pâtre par un blanc qui ensuite le maltraite. Il s’enfuit et est remplacé par un autre qui se sauve à son tour. Voici, d’après Wundt, comment il raconte le fait :
« Boschiman-là-aller, ici-courir-vers-blanc, blanc-donner-tabac, Boschiman-aller-fumer, blanc-donner-viande, Boschiman-aller-manger-viande, se-lever-aller-maison, Boschiman-aller-faire-paître mouton blanc, blanc-aller-frapper-Boschiman, Boschiman-crier-fort-douleur, Boschiman-aller-courir-loin-blanc, Boschiman-ici-autre, lui-faire-paître-moutons, Boschiman-tout-à-fait-partir. »
La phrase n’est qu’une suite de simulacres d’actions, une succession d’images concrètes, de faits vécus. Une foule se comporte comme un homme primitif ; pour qu’une pensée commune naisse chez elle aussi bien que pour qu’elle s’exprime, il faut les cris, les gesticulations, les manifestations d’ensemble. Faire obstacle à l’expression tumultueuse chez celle-là, c’est stériliser la pensée. Si, au contraire, chez l’homme cultivé, l’idée non productrice d’effets immédiats se réfléchit, se multiplie, le résultat, bien que différé, finit pourtant par être le même lorsque aucune voie ne s’ouvre à l’expansion du flot d’énergie mentale qui s’est accumulé. La déchéance intellectuelle est fatale.
La suppression totale de l’activité n’est pas la seule manière de réduire la sphère intellectuelle ; c’est même la moins usitée. La coutume, la loi, l’opinion publique atteignent au même résultat, en imposant à l’homme des actes monotones, des gestes rituels qui, même s’ils ne sont pas en opposition avec ses tendances naturelles, envahissent le champ de la conscience, au détriment des autres aspirations. Religions, castes, Etats usent de ce procédé pour assurer leur empire.
Obligation d’avoir une attitude respectueuse en présence de cérémonies publiques multipliées à dessein — c’est ainsi que sous l’Ordre Moral, on courait quelque risque à ne pas se découvrir au passage d’une procession -, application apportée dès l’enfance à la répétition fréquente des gestes et paroles rituels ; attention ramenée périodiquement sur des conceptions mystiques par des appels bruyants, telles sont les contraintes que les clergés ont toujours imposées à l’élargissement de l’horizon intellectuel. En milieu confiné, la pression d’un voisinage routinier achève de comprimer toute imagination novatrice.
Tous les groupements autoritaires ont eu recours à l’exécution de manœuvres standardisées, de gestes mécaniques pour conduire la pensée dans une voie unique. La recherche de cette fixation fut le véritable motif pour lequel, contre tout bon sens, les dirigeants ont toujours réclamé la prolongation du service militaire. C’est à cet assujettissement auquel ont été soumises deux générations qu’il faut attribuer pour une large part l’affaissement intellectuel et moral des civilisés européens. Dans d’autres castes : administration, magistrature, des cérémonies mondaines au déroulement stéréotypé, détournaient leurs membres de l’étude et d’un développement original, et atteignaient le même but moins sûrement cependant.
Ce qui agit dans le même sens sur la population ouvrière, c’est la rationalisation irrationnelle en vogue aujourd’hui, mais inaugurée dès l’introduction du machinisme. Ici encore nous sommes en présence d’une répétition automatique d’actes monotones qui ne tardent pas à perdre tout intérêt pour qui les accomplit. Les défenseurs de la rationalisation prétendent que précisément cet automatisme libère l’esprit qui peut vaguer à son aise. Erreur : une succession d’images n’est qu’un simulacre de pensée lorsqu’elle envahit un cerveau astreint à ne pas détourner son attention d’un mouvement ininterrompu.
L’idée n’est nullement indépendante du jeu de l’appareil musculaire. Notons, en effet, que bon nombre de physiologistes contemporains admettent que l’énergie nerveuse, aliment de tout psychisme, s’élabore autant dans le muscle que dans le système nerveux qui serait avant tout un organe de concentration et de conduction. Même si ces vues ne représentaient pas encore toute la vérité, il reste que le fonctionnement du nerf et celui du muscle sont accordés quant à leur rythme
A la contrainte de l’opinion, de la coutume, de la caste, de la pratique industrielle, vient s’ajouter celle de l’Etat et de sa législation répressive. Nous ne mentionnerons que les lois du 16 mars 1893, 12 décembre 1893 et 28 juillet 1894, dites lois scélérates. Il suffit de préciser qu’elles punissent la manifestation la plus discrète, la plus intime de la pensée : une simple conversation, dénoncée par un seul interlocuteur sans autre appui à cette unique déclaration qu »un ensemble de charges dont la nature et le poids sont laissés à l’appréciation du juge. La loi frappe des conceptions intellectuelles, apologie de certains actes en général, sans viser quiconque, alors que les opinions exprimées ne sont traduites ni par des actes ni par des faits dommageables à autrui. Oppressives pour la pensée, ces lois ne sont pas moins dangereuses pour la société. Exprimée, discutée, contredite, l’idée, si elle est fausse, est abandonnée par son auteur qui, tout au moins, perd confiance dans la possibilité de sa réalisation. Ruminée, dans la solitude par quelqu’un qui a plus de caractère que de jugement, elle aboutit à des conséquences désastreuses pour tous. La propagande, à notre avis, ne s’est pas assez obstinément appliquée à poursuivre l’abolition de ces lois. Jusqu’ici, les gouvernants n’ont pas osé en faire une application intégrale ; mais le fascisme est là, guettant l’occasion.
Si l’action est le germe et l’accompagnement obligé de la pensée, il paraît tout aussi évident que l’action· sans la pensée est inconcevable. Cependant, cela n’a pas été aperçu de tout temps :
« Dès l’abord, l’action de l’homme s’est, pour l’essentiel, appliquée au réel. »
C’était, nous l’avons vu, la condition préalable de la manifestation de la pensée réfléchie. Mais l’erreur, à certaines époques, fut de regarder comme étrangers l’un à l’autre le domaine de la Pensée et celui de l’Action.
Tout montre que, au contraire, la pensée s’est d’abord exercée de préférence sur le fictif et l’imaginaire... Les mots, les sens que l’homme leur a forgés... ont engendré bien des pseudo-problèmes, dont certains encombrent encore de leur poids inutile, non seulement la philosophie, mais jusqu’à la science... Seule, la parole a permis à l’activité technique de se transmettre et d’assurer son progrès ; seul, le progrès des techniques a contraint la parole à abandonner ses illusions et à limiter le monde verbal à ce rôle de substitut, d’équivalent maniable du monde réel, dans lequel il est indispensable au libre et plein exercice de la pensée. » (Dr Ch. Blondel, mars 1931.)
De nos jours, l’école pragmatiste a prôné encore le primat de l’action. Elle n’arrive qu’à justifier le succès obtenu par tous les moyens, l’odieux arrivisme. Contre elle maintenons notre conception, héritée de Proudhon, à la fois réaliste et idéaliste : pas de pensée qui n’ait son point d’appui dans l’action ; pas d’action qui ne puisse trouver sa justification dans la mise en œuvre d’une pensée logique et créatrice.
C’est, d’ailleurs, d’un processus semblable que découle toute notre connaissance. Elle part d’une synthèse intuitive, perception d’un ensemble que notre esprit analyse pour reconstituer finalement l’objet, grâce à une nouvelle synthèse élaborée.
Dans le champ de la perception, l’objet est saisi comme un ensemble, et d’autre part chez tout homme, et plus visiblement chez l’enfant, la perception est accompagnée d’un désir, d’une tendance, d’un mouvement de préhension. L’esprit décompose cet ensemble, découvre des similitudes entre les parties disjointes, aussi bien qu’avec les éléments analogues issus d’analyses précédentes. Il reconstitue enfin, par une ultime synthèse, l’objet primitif, en acquiert la compréhension, c’est-à-dire l’incorpore à sa personne aux fins d’utilisation d’instrument d’un acte ou immédiat ou différé.
La contemplation que l’activité n’accompagne pas aboutit à l’anéantissement de l’être. Toutes les démarches de notre esprit peuvent se représenter par la même formule, symbole d’expansion, de mouvement et non de contrainte, d’immobilité.
— G. GOUJON.
PENSÉE (LA LIBRE)
Il existe, chez beaucoup de militants d’extrême avant-garde, une sorte de prévention contre la Libre Pensée. Non pas, certes, contre son idéal ou ses conceptions, mais contre le groupement en lui-même. On commence pourtant à s’apercevoir que l’organisation est nécessaire — et presque indispensable — dans tous les domaines de l’action. Sans organisation, il est bien difficile de coordonner les efforts, de les intensifier, de travailler avec méthode et d’obtenir des résultats durables et féconds. Pourquoi n’en serait-il pas de même pour la Libre Pensée, c’est-à-dire pour l’action anticléricale et antireligieuse ? Si le groupement a fait la preuve de son utilité sur les terrains coopératif, syndical, politique, pourquoi ne serait-il pas appelé à rendre également des services aux adversaires des Eglises ? Leur besoin de s’associer devrait être, au contraire, d’autant plus vif, qu’ils ont à combattre un adversaire très puissant, très riche et surtout très discipliné.
L’Eglise romaine, en particulier, tire les trois quarts de sa force de son organisation autoritaire et de sa hiérarchie sévère. Ses dogmes puérils et ses légendes grossières se seraient écroulés depuis longtemps, si les croyants et les prêtres n’étaient aussi savamment embrigadés. Il est un peu enfantin d’imaginer que l’on pourra venir à bout d’un tel adversaire sans se grouper et sans s’organiser.
Certains diront :
« Je n’ai pas besoin des prêtres ! J’ai perdu la Foi. Je n’éprouve nul besoin de fréquenter les églises. Cela me suffit. À quoi bon « faire de la Libre Pensée » ? Je laisse le croyant libre, puisque je suis moi-même libre de ne pas croire... »
Il faut se rappeler deux choses :
-
Nous ne prétendons nullement gêner ou amoindrir la liberté du croyant. Nous voulons le convaincre, l’éclairer et non le violenter ;
-
la liberté de l’incroyant (très relative au surplus !) restera précaire et menacée aussi longtemps que la société sera ce qu’elle est. Les incroyants ne doivent pas oublier que leur liberté est sans cesse limitée et combattue, que l’Eglise est intolérante par principe et par nécessité. Pendant des siècles, les athées et les penseurs libres n’ont-ils pas été contraints de se plier devant des dogmes et des coutumes que leur conscience avait rejetés ?
Et puis, lorsqu’on a compris que la religion est fausse, que le fanatisme est malfaisant, comment ne pas éprouver le besoin de faire du prosélytisme et de répandre les vérités que l’on a découvertes, afin de les propager et d’en faire bénéficier son semblable ?
Ce sont ces considérations qui ont conduit les librespenseurs à s’organiser. Les premières sociétés de LibrePensée ont été fondées, en France, il y a une soixantaine d’années (c’est à la fin du Second Empire que le mouvement libre-penseur et anticlérical se développa sérieusement, dans la presse indépendante et plus tard par les groupements), au moment où la liberté d’association commença à ne plus être tout à fait un vain mot. A ce moment surtout, elles étaient nécessaires. L’un de leurs premiers soucis fut d’obtenir la liberté des funérailles (sanctionnée seulement par la loi de 1887) et d’organiser, dans des conditions parfois très difficiles, les premiers enterrements civils. Les sociétaires tenaient à honneur d’assister en nombre aux obsèques de leurs collègues décédés, résistant aux manœuvres de pression, d’intimidation et quelquefois même de violence et de persécution, que les cléricaux exerçaient sur les familles, particulièrement dans les campagnes.
Les groupes de Libre Pensée ont rempli un rôle bienfaisant. Ils ont travaillé et préparé les esprits, très activement, pendant les trente années qui ont précédé la guerre. C’est, dans une large mesure, grâce à leur activité, que la superstition a perdu du terrain, que les lois laïques ont pu être votées, que la puissance de l’Eglise fut (trop légèrement, hélas !) battue en brèche.
Je ne veux pas insinuer, en parlant ainsi, que l’action des Sociétés libres-penseuses ait toujours été intégralement admirable, et irréprochable. Comme tous les autres groupements, même les plus révolutionnaires, la Libre Pensée a servi souvent de tremplin électoral. Nombre d’arrivistes l’ont utilisée comme un marchepied — et se sont empressés de l’oublier, voire de la trahir, dès qu’ils eurent décroché la timbale ! L’un des plus illustres exemples à invoquer est celui de M. Henry Bérenger, collaborateur de Victor Charbonnel aux temps héroïques de la Raison et de l’Action, vigoureux et talentueux militant anticlérical, devenu un des plus cyniques caméléons du Sénat, associé aux trafiquants de la Haute Banque et acoquiné aux représentants de la pire réaction.
Ainsi que notre regretté ami Brocher l’a exposé dans une précédente et substantielle étude, les groupes de Libre Pensée n’ont consenti que lentement, difficilement, à se rassembler dans une même fédération nationale. On se contentait de s’unir dans une localité, ou dans un canton, et l’on ne regardait guère plus loin, ni plus haut. Les réunions étaient rares, la propagande nulle. Un banquet de temps à autre, et particulièrement le vendredi dit saint, en guise de légitime protestation contre un usage inepte, quelques conférences publiques... Très peu de bibliothèques, très peu de propagande éducative par la brochure, le livre ou le tract (à part quelques exceptions).
Il faut reconnaître que, depuis la guerre, la Libre Pensée a évolué d’une façon plutôt heureuse. Au lendemain de l’armistice, elle était complètement désorganisée, désagrégée. D’abord, parce que la plupart des militants avaient été mobilisés ou dispersés par les événements. Les Sociétés avaient cessé de se réunir et de fonctionner, et, quand la tuerie eut pris fin, il fut très difficile de regrouper les éléments épars. La difficulté fut d’autant plus grande que la Libre Pensée avait à lutter contre un préjugé tenace et dangereux. La guerre avait passé, avec son « Union Sacrée ». Les querelles religieuses paraissaient périmées. Le vent était à l’apaisement, à la concorde. Nul ne consentait à réveiller le combisme, en dépit des avertissements des rares libres penseurs qui n’avaient pas oublié les leçons de l’histoire.
L’Eglise travaillait inlassablement à reconquérir ses privilèges. Elle noyautait l’enseignement avec ses infectes « Davidées ». Elle intriguait au Parlement pour la non-application des lois laïques, en attendant leur abrogation. Le rétablissement de l’ambassade au Vatican, le vote de la loi liberticide contre les néo-malthusiens, le retour des Congrégations (retour illégal, mais complaisamment toléré par les gouvernements complices), le maintien du régime concordataire et de l’enseignement confessionnel en Alsace, autant de succès pour la politique vaticanesque, laquelle s’évertuait, d’autre part, à leurrer les masses populaires et à désarmer les légitimes méfiances dont elle était l’objet, en jouant la comédie de la démocratie chrétienne, en condamnant l’Action française, en affirmant son amour de la Paix, de la Justice et de la Liberté et en créant la Jeunesse Ouvrière Chrétienne et les Syndicats Catholiques !
Malgré tout cela, la plupart des politiciens persistaient à nier l’évidence et se refusaient à reprendre le salutaire et indispensable combat contre les exploitants de la crédulité. Lisez les professions de foi et les programmes des candidats, cette année encore, et vous pourrez constater que l’anticléricalisme (ou la « défense laïque, comme on dit aujourd’hui, afin de moins effrayer les timorés, sans doute) y tient fort peu de place ! La plupart des hommes politiques qui furent, avant la guerre, des militants bruyants de la Libre Pensée n’en font à présent même plus partie. Et les jeunes débutants se garderaient bien d’y venir, craignant de compromettre leur carrière.
A quelque chose malheur est bon ! Le départ des habiles et des ambitieux a permis à la Libre Pensée de se consacrer à une œuvre plus profonde — et plus féconde. Au lendemain de la guerre, l’Union fédéraliste des Libres Penseurs de France et des Colonies (fondée en 1905) se réorganisait de son mieux, mais ne parvenait à grouper que de maigres effectifs.
En 1921, nous avions fondé, à Lyon, une Fédération Nationale de Libre Pensée et d’Action Sociale, qui devint rapidement assez forte. Sans être inféodée à aucun parti, chapelle ou système, cette Fédération estimait que la question religieuse est inséparable du problème social et que la Libre Pensée doit œuvrer à l’édification d’un monde meilleur, pour la disparition des privilèges et des exploitations. En 1925, la fusion se fit entre l’Union fédérative et notre fédération d’Action Sociale et le nouvel organisme prit le nom de « Fédération Nationale des Libres Penseurs de France et des Colonies », adhérent à l’Internationale de la Libre Pensée.
Grâce à la fusion, la Libre Pensée a pris un développement rapide. Elle possède aujourd’hui, en France, plus de 400 groupes en pleine activité et pénètre dans une soixantaine de départements. Elle publie un journal, dont je suis le rédacteur depuis la fondation, c’est-à-dire depuis douze ans (il fut intitulé d’abord, l’Antireligieux, puis l’Action Antireligieuse et enfin La Libre Pensée).
Assurément, il reste encore en dehors de la Fédération Nationale, un certain nombre de groupes autonomes. Ce ne sont pas généralement les plus actifs, tant s’en faut. Il subsiste également une fédération dissidente, la Libre Pensée prolétarienne, d’inspiration nettement communiste, qui essaie de concurrencer la Fédération Nationale, en la qualifiant avec dédain de Libre Pensée bourgeoise (?).
En réalité, notre Fédération Nationale ne veut être asservie à aucun parti, quel qu’il soit. Elle ne demande à ses adhérents que d’être sincèrement et authentiquement libres penseurs, de ne participer à aucune cérémonie religieuse, sous peine de radiation immédiate et d’assurer le respect de la conscience de leurs enfants. Hors de la Libre Pensée, chaque adhérent peut librement participer à la propagande de son choix : communiste ou radicale, socialiste ou libertaire, etc., etc.
Pour montrer que notre Fédération Nationale est loin de posséder une mentalité bourgeoise, il me suffira de reproduire la déclaration de principes qui figure en tête de nos statuts nationaux :
Les membres déclarent accepter les principes suivants :
« Les libres penseurs de France proclament la nécessité de raffermir et de réorganiser leurs groupements afin de donner un nouvel élan à la propagande antireligieuse, trop délaissée depuis la guerre. Ils tiennent à rappeler que la libre pensée n’est pas un parti, qu’elle n’apporte aucun dogme et qu’elle vise au contraire à développer chez tous les hommes l’esprit critique et l’amour du libre examen. Les religions restent le pire obstacle à l’émancipation de la pensée. Elles propagent une conception laide et étriquée de la vie : elles maintiennent l’humanité dans l’ignorance, dans la terreur abrutissante de l’au-delà, dans la résignation morale et la servitude.
« Les libres penseurs réagissent contre les tyrannies quelles qu’elles soient, contre tout ce qui vise à subordonner ou à amoindrir l’individu. L’esprit de caste, l’appétit des oligarchies et les provocations nationalistes leur semblent aussi néfastes que l’obscurantisme religieux. La libération humaine doit être réalisée dans tous les domaines pour être vraiment efficace. Privilèges politiques, ambitions capitalistes, abus et crimes du militarisme et de l’impérialisme, toutes les injustices et toutes les iniquités doivent être combattues par la Libre Pensée, pour que la liberté de conscience cesse d’être un vain mot et que le règne de la laïcité soit assuré.
« Indépendante de tous les partis et de toutes les tendances, la Libre Pensée tait appel à tous les hommes d’avant-garde sans exception. Fraternellement unis pour la lutte antireligieuse, associant leurs efforts contre les préjugés et les dogmes, contre l’alcoolisme qui dégrade et la superstition qui abêtit, ils auront surtout en vue de faire de l’éducation et de répandre une morale rationnelle, génératrice de bonheur, de dignité et de justice sociale.
« La Libre Pensée, basée sur le libre examen et sur l’esprit scientifique, est une des méthodes les plus efficaces de perfectionnement individuel et de rénovation sociale, par la recherche et l’étude, par la tolérance et la fraternité. Elle s’attache à déjouer les visées dominatrices des Eglises et fait appel à la conscience et à la raison des hommes pour réaliser un idéal élevé, nullement dogmatique, basé sur l’évolution et sur le progrès continu de l’humanité, pour l’instauration d’une société libre, sans exploitations ni tyrannies d’aucune sorte. »
Cette « déclaration » suffit à établir que le champ d’action de la Libre Pensée est illimité et que toutes les bonnes volontés peuvent y collaborer.
En terminant, je dirai deux mots de la situation internationale. Sur ce terrain, les difficultés ont été peut-être plus grandes encore que sur le terrain national. Dans beaucoup de pays, l’action de la Libre Pensée, comme en Italie, est impossible et même interdite par les Lois. Dans d’autres pays, la Libre Pensée est sacrifiée aux préoccupations politiques. Et puis, la division a fait son œuvre mauvaise, là comme ailleurs.
Il y a deux internationales. Celle de Bruxelles, à laquelle nous adhérons, et celle de Vienne (Libre Pensée prolétarienne). Mais, à Berlin, en 1931, une nouvelle organisation a été fondée, née de la fusion entre l’Internationale de Bruxelles et une très importante faction de celle de Vienne, qui s’est détachée de la Libre Pensée prolétarienne pour se joindre à la nôtre. Notre internationale a ainsi gagné de gros effectifs, en particulier en Allemagne, où la Libre Pensée groupe plusieurs centaines de milliers d’adhérents. Le président est toujours le docteur Terwagne, de Bruxelles, mais le siège du secrétariat est en Allemagne.
La vieille Eglise ne veut pas mourir. Possédant de formidables richesses, une organisation unique avec des ramifications multiples dans tous les pays, triturant les cerveaux dans ses maisons d’enseignement, intriguant dans le monde politique et parlementaire, dominant la plupart des femmes par leur inconscience et un grand nombre d’hommes par leur veulerie, elle veut essayer, avec une audace inouïe, de dominer le monde et de l’assujettir à sa loi. Ce sera la tâche admirable de la Libre Pensée, dans les années qui viendront, de réveiller l’action anticléricale pour déjouer ce funeste dessein (beaucoup plus politique que religieux !) et pour écraser, enfin, l’infâme...
— André LORULOT.
PENSIONNAT
n. f.
« Maison d’éducation qui reçoit des internes », dit le Larousse. Plus exactement : établissement où l’on débite, à doses mesurées, de l’instruction, de l’éducation et du mauvais rata. But mercantile de la part du directeur de l’établissement.
« Tant d’élèves à tant de bénéfice net par élève, égale : tant. »
Conséquence : chercher à augmenter le nombre des pensionnaires et, pour cela, vanter la pension, sa situation géographique, son exposition, la qualité de l’enseignement, la discipline « paternelle », l’absolue liberté de conscience ou l’observation rigoureuse des devoirs religieux (selon la clientèle fréquentée par l’établissement), etc. Réclame dans les journaux, envoi de prospectus ; et puis façade soignée : parloir aux murs décorés de « travaux d’élèves », de diplômes et médailles. Bureau directorial parfois luxueux. Rien n’est négligé de ce qui doit faire bonne impression sur les parents. (Ainsi, pour certains restaurants dont on doit bien se garder d’aller visiter les cuisines, si l’on veut conserver son appétit). Car trop souvent il y a un lamentable envers de décor : classes petites et mal aérées, réfectoires puants, cour minuscule, dortoirs où s’entassent un trop grand nombre de lits. L’enfant est jeté là (caserne, vie collective, promiscuité, prison), au moment où sa nature réclame impérieusement l’air, la lumière, de l’affection et la liberté. Il en est pourtant qui s’adaptent presque aussitôt ; et bientôt, sous leur uniforme maquillé « à l’ancien », ils prennent l’allure de jeunes forçats résignés à subir leur temps. Pour d’autres : les tendres, les délicats, les sensibles, — une minorité, — la vie de pension est une atroce torture. Tout les choque profondément : le coudoiement de camarades grossiers, l’autorité du « pion », parfois le parti-pris de professeurs qui les ont jugés paresseux un peu à la légère et qui ne savent pas revenir de leur erreur :
« Chez les natures d’enfant ardentes, passionnées, curieuses, ce qu’on appelle la paresse n’est le plus souvent qu’un froissement de la sensibilité, une impossibilité mentale à s’assouplir à certains devoirs absurdes, le résultat naturel de l’éducation disproportionnée, inharmonique qu’on leur donne. Cette paresse qui se résout en dégoûts invincibles est, au contraire, quelquefois, la preuve d’une supériorité intellectuelle et la condamnation du maître. » (O. Mirbeau)
Ceux-ci subissent, le plus souvent, les mystifications et les brimades des grands. Et ce genre de vie aboutit à créer, selon les tempéraments, soit des résignés, soit des rêveurs à l’intense vie intérieure, soit aussi des révoltés, poussés à la vengeance et aux évasions.
Que dire de l’éducation et de l’instruction reçues dans les pensionnats, sinon qu’elles participent du plan général de dressage de la jeunesse en vue de perpétuer le régime ? Proudhon disait : « Ce que les bourgeois veulent pour le peuple, c’est tout simplement une première initiation aux éléments des connaissances humaines, l’intelligence des signes, une sorte de sacrement de baptême intellectuel ; consistant dans la communication de la parole, de l’écriture, des nombres, des figures, plus quelques formules de religion et de morale ; — cela pour que les natures délicates puissent constater, en ces travailleurs voués à la peine, le reflet de l’âme, la dignité de la conscience, pour n’avoir pas trop à rougir de l’humanité. » (Capacité politique des classes ouvrières.) « L’école est une garderie, l’école est un guignol, l’école est un atelier, l’école est un vestiaire intellectuel, l’école est un vestiaire politique... », écrivait Albert Thierry (Nouvelles de Vosves). (Voir les mots Education, Ecole, Internat, Orphelinat, etc.).
Le pensionnat répond cependant à une nécessité... pour les parents, qui sont ainsi débarrassés de leur progéniture. Qu’y gagne l’enfant ? L’expérience précoce de la vie sociale avec toutes ses turpitudes. Dans les rapports quotidiens de maîtres à élèves et d’élèves à élèves, il apprend ce que peuvent être le travail ennuyeux et imposé, la patience, la rébellion, l’amitié, l’hypocrisie, etc., et surtout (d’élèves à élèves) les vices, inévitables à l’âge où la puberté le tourmente. L’onanisme, la pédérastie, le saphisme sont monnaie courante dans les pensionnats. O. Mirbeau, dans Sébastien Roch nous a montré ce qui se passait à l’école des Pères Jésuites Saint-François Xavier, de Vanves. Nous trouvons dans A nous deux, Patrie, une scène édifiante, vue par Colomer, en 1909, dans un dortoir du Lycée Louis le Grand, et Sylvain Bonmariage, dans La Femme Crucifiée, nous décrit les moeurs lesbiennes au couvent des Oiseaux :
« Le vice y existait et s’y prélassait comme dans son royaume. »
Est-ce à dire que l’enfant gagnerait davantage à la vie familiale ? Rarement. La solution de l’avenir est sans doute encore dans le pensionnat. Mais dans un pensionnat rénové. Et là, il faudra certainement s’inspirer des principes de F. Ferrer, de la Ruche de Sébastien Faure, sans doute aussi de l’expérience russe. Làbas, les « maisons des enfants » recueillent les enfants dont les parents sont occupés à l’oeuvre commune ; mais, parfois, l’enfant est la triste victime de cette expérience. Dacha, la militante, — nous conte Gladkov (Le Ciment) — voit sa petite Niourka fondre « comme une bougie à la flamme ». Et c’est une intolérable douleur.
« L’enfant ne vit pas que de lait maternel, l’enfant se nourrit aussi de tendresse maternelle. L’enfant se fane et se dessèche si le souffle de la mère lui est refusé, si la mère ne le réchauffe pas de son sang, ne lui parfume pas le petit lit de son odeur et de son âme. L’enfant est une fleur printanière. Niourka était une fleur arrachée à la branche et jetée sur la route. »
L’important serait justement de ne pas arracher « les fleurs à la branche », et le pensionnat futur pourrait être la vaste abbaye de Thélème que nous rêvons, la Cité nouvelle, très grande, lumineuse, gaie, pleine d’arbres et d’oiseaux où, dans un maximum de liberté, l’enfant irait, ici, cueillir la tendresse maternelle et là, développer toutes ses facultés. La mère d’un côté — quand elle mériterait son titre de mère, — les grands amis éducateurs de l’autre ; l’enfant entre eux, dans cette famille agrandie, restant soi-même toujours, mais heureux, parce que vivant dans une atmosphère de confiance et d’amour.
— Ch. BOUSSINOT.
PERSÉCUTION
n. f.
Action de persécuter. Importunité continuelle. Délire de la persécution (relève de la pathologie).
Au point de vue historique, on entend généralement par persécution les tourments, proscriptions, martyres subis par les novateurs. Lorsqu’une idée nouvelle, subversive, s’empare des foules, lorsqu’elle se propage et devient menaçante pour l’ordre établi, les vieilles forces du passé se coalisent contre elle ; la persécution naît automatiquement.
« Quel est le persécuteur ? C’est celui dont l’orgueil blessé et le fanatisme en fureur irritent le prince ou les magistrats contre des hommes innocents, qui n’ont d’autre crime que de n’être pas de leur avis. » (Voltaire)
S’il y a eu persécution de Chrétiens par les Romains, il y a eu, par la suite, persécution des hérétiques par les chrétiens ; enfin, il y a toujours persécution des non-conformistes par les orthodoxes. Le croyant, le fanatique, voudrait arrêter l’évolution du monde au moment où il est arrivé lui-même. L’amant de la Liberté, au contraire, renversant toutes les barrières et tous les dogmes, va hardiment de l’avant. Mais rares sont les individus qui comprennent que l’univers est en perpétuelle évolution ; plus rares ceux qui aident à cette évolution ; innombrables sont les timorés qui, se figurant être « le sel de la terre », prétendent intégrer la vérité totale. Ces derniers deviennent dangereux lorsqu’ils se mettent dans l’idée de vouloir faire le bonheur de ceux qui ne le leur demandent pas. Alors ils emprisonnent, ils torturent, ils brûlent, ils accomplissent des « actes de foi ».
« Celui qui a des extases, des visions, qui prend ses songes pour des réalités, et ses imaginations pour des prophéties, est un fanatique novice qui donne de grandes espérances ; il pourra bientôt tuer pour l’amour de Dieu. » (Voltaire)
« La religion — écrivait-il encore dans le dictionnaire philosophique au mot fanatisme — dans tous les temps a servi à persécuter les grands hommes. »
Et plus loin :
« Il y a des fanatiques de sang-froid ; ce sont les juges... »
On pourrait résumer l’histoire de l’Humanité dans l’opposition des idées dominantes et des persécutions qu’elles ont suscitées.
La société antique croula devant la mystique chrétienne. L’Eglise sentit passer le vent de la mort avec la Réforme et la Révolution. Le Capitalisme voit venir sa fin sous la poussée irrésistible des idées socialistes, communistes et libertaires. Et toujours l’organisme condamne, emprisonne, torture, persécute, avant de disparaître à son tour.
L’Eglise dit avoir été persécutée pendant trois siècles. En réalité il y eut, pendant les trois premiers siècles de l’ère chrétienne, « de courtes et rares périodes de persécution effective » ; et nous lisons dans l’Encyclopédie que :
« Les mesures de répression prises par l’Empire furent faibles et débonnaires, comparées aux persécutions infligées plus tard par l’Eglise aux hérétiques. »
Les historiens catholiques exagèrent à dessein le nombre des persécutions. Il n’y eut pas, comme ils l’affirment, dix persécutions générales. Voici, en un résumé succinct, les événements de ce temps-là : Sous Néron (en 66–68) un seul chrétien fut persécuté à Rome : Paul (on ne peut admettre la persécution de Pierre, pure légende pontificale). Domitien (95) :
« Jaloux de son pouvoir, prenait ombrage de tout ce qu’il ne comprenait pas. Il devint inquiet et cruel et se mit à persécuter les honnêtes gens, les citoyens qui regrettaient la liberté, les stoïciens qui prêchaient la vertu. (Tacite hist. I. 1.) Naturellement, les chrétiens étaient fort menacés par un pareil régime ; mais s’ils en souffrirent ce ne fut point spécialement à cause de leur religion. Il n’est point prouvé que Flavius Clemens et Domitilla qu’on a mis au rang des martyrs de ce règne fussent chrétiens. »
Avec Trajan (107) il n’y eut aucune ordonnance spéciale contre les chrétiens. Trajan et Antonin ne méritent pas le nom de persécuteurs (Voltaire). Le rescrit de Trajan, adressé à Pline le jeune en 112, mentionne qu’il « ne faut pas faire de recherches contre les chrétiens » et que « dans nul genre d’accusation, il ne faut recevoir de dénonciation sans signature ». Et l’on voit sous ce règne, « les magistrats, lorsqu’ils sont indulgents, absoudre les chrétiens et les condamner lorsqu’ils sont cruels ou pressés par les excitations du peuple païen ». Adrien (118–138) et Antonin le Pieux ne prirent aucune mesure nouvelle contre les chrétiens. Sous Marc-Aurèle (161–180), le peuple, alarmé par des tremblements de terre et les inondations du Tigre et du Pô, exigea la punition des chrétiens, blasphémateurs des dieux tutélaires. La persécution sévit à Smyrne, Rome, Vienne et Lyon. Septime-Sévère (191–211), punit les conversions au christianisme, mais ceux qui étaient nés sous cette religion ne furent point inquiétés. Maximin le Thrace (235–238) ne persécuta pas les chrétiens spécialement à cause de leur foi ; et avec Philippe l’Arabe (244–248) l’Eglise jouit d’une paix complète. Jusqu’à ce moment-là, « le peuple seul provoquait les persécutions par ses plaintes et ses séditions ». Le nombre des martyrs fut peu élevé. Les écrivains chrétiens :
« Quadratus, Justin, Miltiade, Athénagore, Apollinaire, Méliton, Tertullien, Origène, publièrent des Apologies et des exhortations aux martyrs, dont une seule page aurait fait condamner au feu livres et auteurs, s’ils avaient été composés par des hérétiques, au temps où l’Eglise catholique était toute puissante. »
Avec Decius (249–251) on assista à une persécution générale. Cet empereur entreprit de détruire la religion chrétienne ; il fit rechercher les chrétiens et voulut les contraindre à abjurer leur foi. Gallus (251253) continua ses méthodes. Valérien (253–260) d’abord indulgent, prit ensuite des mesures plus cruelles que ses prédécesseurs. La persécution se ralentit avec Gallien (260–268) et Aurélien (270–280), mais sous Dioclétien (284–305) en 303, et sur les instances de Galérius, fut promulgué un édit, qui ordonnait de démolir les églises, de livrer et brûler les livres sacrés, d’exclure les chrétiens des offices publics. De plus, il était interdit d’affranchir les esclaves professant la religion chrétienne. Par un second édit, on eut pouvoir d’emprisonner les évêques et de les soumettre aux tourments. Par un troisième, on étendit ces mesures à tous les fidèles. La persécution fut atroce en Orient. Elle n’épargna que la Gaule, et l’on appela le règne de Dioclétien : l’ère des martyrs. Mais on ne résout rien par la force et la cruauté, quand l’Idée s’impose aux esprits ; en 311, Galérius, par impuissance à soumettre les chrétiens, leur accorde un édit de tolérance. Avec Constantin (312), le pouvoir va composer avec cette force naissante : le catholicisme, et va essayer d’en tirer profit. Les chrétiens ne seront plus troublés. Par l’Edit de Milan (313), on leur accorde « entière et absolue liberté de professer la religion chrétienne. »
Dès ce moment, de persécutée, l’Eglise va se faire persécutrice. Force d’Etat au service de tous les maîtres, poursuivant son rêve de domination universelle, elle entassera, au cours des siècles, crimes sur crimes, horreurs sur horreurs.
« Dans le système catholique, l’hérésie, ou seulement l’indulgence envers elle est un crime énorme, un crime de lèse-majesté divine à la répression duquel tous les fidèles ont le devoir de concourir. » (Encyc.)
Et bientôt va se dresser le formidable appareil de persécution permanente : Le Saint Office de l’Inquisition (voir ce dernier mot). L’homme n’est plus libre. L’Eglise est présente à tous les actes importants de sa vie ; elle en profite pour le modeler, le diriger à son gré. Baptême, communion, mariage, maladie, mort sont des étapes où le prêtre s’impose, jette à. ses pieds la pauvre créature humaine faible ou désemparée. Par la confession, l’Eglise tiendra l’homme en perpétuel esclavage moral.
« Le confessionnal vaut à l’Eglise une inquisition cent fois plus clairvoyante que tous les délateurs de la Rome païenne. Le prêtre, quand il le veut, peut tirer de la bouche de l’enfant ou du serviteur la dénonciation du père ou du maître. » (Encyc.)
Il serait certainement fastidieux d’énumérer ici toutes les persécutions que fit subir l’Eglise à ceux qui s’opposaient (ou étaient soupçonnés s’opposer) à ses desseins.
« Depuis le supplice de Priscillien (385) jusqu’à celui de François Richette (1762) ce fut une longue série funèbre de supplices, de guerres, de massacres et d’exterminations. » (Encycl.)
Et tout cela commis au nom du Jésus de Paix et d’Amour. Marquons rapidement les grandes étapes de cette route sanglante : l’hérésie d’Arius (318) coûta la vie à environ 300.000 individus. La querelle des iconoclastes et des iconolâtres (du VIIe au IXe siècle) en fit périr 60.000. L’impératrice Théodora fit égorger 100.000 manichéens (845). Les croisades coûtèrent la vie à 2 millions de chrétiens ; et le sang des Turcs coula pendant 8 jours lors de l’entrée des Croisés à Jérusalem (1099). Et voici la croisade des Albigeois (1209) ; les Vêpres Siciliennes (1282) ; le Supplice des Templiers (1300) ; les 4.000 Fraticelles, moines, mendiants brûlés par Clément V ; Jean Huss et les guerres des hussites contre les Impériaux (XVe siècle) ; le massacre des Vaudois (1545) (22 bourgs anéantis) ; massacres approuvés par François Ier (18.000 victimes) ; le carnage de la SaintBarthélemy (1572) ; les innombrables procès contre les sorciers (400 sorcières brûlées à Toulouse en 1577) ; les Dragonnades (1685). Faut-il citer aussi toutes les exactions commises dans le Nouveau Monde ? (L’évêque Las Casas, par exemple, qui prétendit avoir immolé douze millions d’hommes à la religion chrétienne.) Faut-il citer toutes les guerres et toutes les révoltes suscitées par les Jésuites dans les pays lointains : Japon (1616), Chine (1750-1815-1839), Cochinchine et Tonkin (1837–1839) ?
Ah ! malheur à ceux qui luttent pour la vérité, à ceux qui osent la clamer à la face du Monde ! Malheur au poète, à l’inventeur, au savant, au génie, si la chanson, la trouvaille, l’idée fulgurante jaillie de son cerveau heurte par trop les préjugés établis : l’immense bêtise est là qui le guette, et l’hydre de la persécution se dresse et le broie ! C’est Socrate, c’est Phocion, buvant la ciguë ; c’est Zénon d’Elée pilé dans le mortier ; c’est Michel Servet brûlé vif à Genève, par ordre de Calvin ; c’est Galilée, torturé par l’Inquisition ; c’est Vanini, torturé et brûlé à Toulouse comme athée ; c’est notre grand Francisco Ferrer, fusillé par ordre des jésuites dans les fossés de Montjuich ; ce sont les douces figures de Sacco et de Vanzetti, ignominieusement persécutés par le capitalisme yankee. Et tous ceux-la ne sont que quelques unités parmi les plus marquantes de l’immense chaîne des martyrs de la pensée libre. A côté d’eux, combien d’obscurs sacrifiés, combien de suppliciés, d’emprisonnés par l’aveugle et impuissant et inutile Pouvoir établi ! Car la persécution va toujours à l’encontre du but qu’elle poursuit, en assurant automatiquement le triomphe de l’idée qu’elle combat. (Voir Répression.)
— Ch. BOUSSINOT.
PERSONNALITÉ
n. f.
Délaissant les autres sens du mot personnalité, rappelons seulement qu’il est synonyme d’individualité consciente : ce qui nous conduit à parler d’un problème fondamental en philosophie. Chaque homme a conscience d’être une personnalité parce qu’il se sent distinct du monde extérieur et des autres individus, parce qu’il rattache à un centre unique la totalité de ses états mentaux. Il se perçoit lui-même et ses états, non comme deux portions d’existence indépendantes, mais comme une seule réalité vue sous un double aspect : d’un côté le sujet un et identique, de l’autre ses phénomènes multiples et changeants. On a soutenu que l’enfant n’avait aucun sentiment de sa personnalité. Vers la deuxième et la troisième année, les enfants, déclare Luys :
« Parlent d’eux-mêmes à la troisième personne, comme s’il s’agissait d’une personne étrangère à eux, et manifestent leurs émotions et leurs désirs suivant cette formule simple : « Paul veut telle chose », « Paul a mal à la tête ». Ce n’est que peu à peu, et en quelque sorte par l’effet des efforts incessants d’une trituration continue, qu’on arrive à lui apprendre que l’ensemble de sa personnalité, constituée à l’état d’unité, peut revêtir une autre façon abstraite que celle d’un nom propre, et que sa formule équivalente est représentée par les mots je, moi. »
Il est bien vrai que l’enfant parle de lui-même à la troisième personne ; mais ses exigences, ses réclamations énergiques témoignent de son égoïsme foncier, de l’invincible attachement qu’il porte à son moi. Tout animal, si inférieur soit-il, manifeste sa volonté d’être, et, selon la belle expression de Lotze, le ver qu’on foule aux pieds oppose son moi douloureux au reste de l’univers. L’égoïsme du tout jeune enfant n’est qu’une forme de l’instinct de conservation : il est biologiquement indispensable. Pour qu’il se précise et devienne le sentiment clair de la personnalité, une lente évolution sera nécessaire. L’enfant prendra d’abord conscience de son propre corps comme d’une réalité distincte des autres corps qui l’entourent. Alors que les sensations concernant les objets étrangers varient beaucoup, les sensations organiques sont durables et toujours actuelles. Transporté d’un appartement dans un autre, le bébé voit des meubles différents, mais il perçoit toujours ses membres, il éprouve des sensations internes et musculaires identiques. Dans la découverte de son corps, les sensations douloureuses et la double sensation tactile jouent un rôle très important : à chaque instant, les obstacles s’opposent au libre déploiement de ses muscles et provoquent des souffrances ; s’il touche une partie quelconque de son corps, sa sensation est double, à la fois il touche et il est touché, s’il s’agit d un objet extérieur, la sensation est simple. Ajoutons que les autres corps ne nous sont connus que par l’intermédiaire du nôtre : fermons les yeux, nous ne voyons plus rien ; bouchons nos oreilles, et les sons s’évanouissent. Pour l’enfant, les limites de sa personne ce sont d’abord les limites de son corps. Rien de plus curieux que de l’observer, au début : remuant ses mains, les fixant des yeux, les mettant dans sa bouche ; avec ses pieds il procédera de même ; parfois il se mord, tire violemment sa jambe ou ses doigts. Il s’aperçoit également que sa propre activité modifie les objets qui l’entourent. Preyer écrit :
« Par exemple, au cinquième mois, l’enfant découvre, en déchirant un morceau de papier, le bruit qui en résulte. Il n’y a certes pas, à cette époque, de notion claire de causalité, mais l’enfant a vu par expérience qu’il peut être lui-même la cause d’une perception visuelle et auditive à la fois, puisque, quand il déchire le papier, i1 y a régulièrement amoindrissement des morceaux et bruit. La patience avec laquelle il continue à découper ainsi s’explique par la satisfaction qu’il éprouve à être une cause de modification, et à percevoir que la transformation si frappante d’un journal entier en de petits morceaux est due a sa propre activité. »
Plus tard, avec le développement de la vie mentale, l’idée qu’il a de sa personnalité se modifie beaucoup chez l’enfant. Elle se modifie encore chez l’adolescent et même chez l’adulte, variant ainsi au cours de toute l’existence. Ce sont nos état psychologiques : joies, tristesses, désirs, idées, jugements, etc., que nous arrivons à considérer comme formant notre moi véritable. Parce qu’inétendus, d’apparence indéterminée et perçus non du dehors, mais du dedans, ils semblent plus intimes, en effet, que les phénomènes organiques localisables dans l’espace et soumis à un déterminisme manifeste. Du point de vue physiologique, la personnalité s’avère pourtant le résultat de l’individualité organique ; elle en est la traduction consciente, la représentation mentale. Pour chaque animal, déclare Ribot, le sens vital devient :
« La base de son individualité psychique. Il est ce principe d’individuation tant recherché par les docteurs scolastiques parce que sur lui tout repose directement ou indirectement. On peut considérer comme très vraisemblable que, à mesure qu’on descend vers les animaux inférieurs, le sens du corps devient de plus en plus prépondérant jusqu au moment où il devient l’individualité psychique tout entière. »
Et, dans la mesure où l’individualité organique demeure imparfaite, la personnalité psychologique reste imprécise :
« Si deux êtres humains, dès la période fœtale sont partiellement fusionnés, les deux têtes, organes essentiels de l’individualité humaine, restant parfaitement distinctes, alors, voilà ce qui arrive : chaque organisme n’est plus complètement limité dans l’espace et distinct de tout autre ; il y a une partie indivise commune aux deux ; et si, comme nous le soutenons, l’unité et la complexité du moi ne sont que l’expression subjective de l’unité et de la complexité de l »organisme, il doit y avoir dans ce cas d’un moi à l’autre une pénétration partielle, une portion de vie psychique commune qui n’est pas à un moi, mais à un nous. C’est ce que l’expérience confirme pleinement. » Dans la série animale, le progrès de l’individualité psychologique est parallèle au progrès de la coordination organique. L’apparition d’une conscience coloniale, favorisée par la division du travail et la vie errante, dans les colonies d’individualités inférieures, est déjà un premier pas vers une organisation plus parfaite. Le développement du système nerveux, coordinateur par excellence, est d’une importance capitale. Mais, dans les espèces inférieures, il n’opère qu’une centralisation imparfaite. Chez les annélides, les ganglions cérébroïdes qui envoient des nerfs aux organes des sens, paraissent remplir les mêmes fonctions que le cerveau des vertébrés. Il est loin toutefois de les avoir centralisés complètement. L’indépendance psychologique des divers anneaux est bien évidente. Certaines eunices, qui peuvent atteindre 1 m 50 de longueur, mordent la partie postérieure de leur corps, sans paraître aucunement le ressentir. L’individualité est si peu précise qu’on voit chez certains annelés asexués, composés d’une quarantaine d’anneaux, une tête d’individu sexué se former au niveau du troisième anneau, se munir de tentacules et d’antennes, puis se détacher de l’individu primitif pour vivre à sa guise... Pour les animaux supérieurs, il est inutile d’insister : l’individualité au sens courant du mot est constituée ; le cerveau de plus en plus prépondérant la représente... A son plus haut degré, elle est nettement localisée ; elle a accaparé une partie de l’organisme qui, pour cette fonction et pour elle seule, devient le représentant de tout l’organisme. Par une longue suite de délégations successives, le cerveau des animaux supérieurs est parvenu à concentrer en lui la plus grande part de l’activité psychique de la colonie. »
Chez l’individu lui-même, le cerveau apparaît comme un coordinateur de tous les centres secondaires, et le moi conscient comme un écho psychologique de l’unité organique. Aussi les troubles de la personnalité sont-ils liés à des altérations de la cénesthésie ou de la motricité, ainsi qu’à des anesthésies cutanées. L’hystérie, qui engendre des troubles profonds de la sensibilité, détermine fréquemment le dédoublement de la personnalité. Au point de vue psychologique, la mémoire joue un rôle essentiel. Si le moi a conscience de durer, c’est parce que le passé revit dans le présent grâce au souvenir. Chacun a une histoire, faite des événements de sa vie antérieure. Dès l’âge de quatre ans, l’enfant rappelle avec complaisance certains faits passés ; il dit volontiers : « quand j’étais petit. » Et le vieillard, malgré les transformations survenues dans sa propre personne et dans le milieu qui l’entoure, se reconnaît dans le jeune écolier que choyait une mère aimante, dans l’adolescent fiévreux et tourmenté qu’il fut voici bien longtemps. Des révolutions brusques et profondes ont pu modifier complètement sa vie intellectuelle ou sentimentale, il n’y a pas eu rupture de sa personnalité pour autant ; la mémoire a enregistré étapes et changements ; elle groupe autour du nom les multiples souvenirs de ce qu’il fut. Chez certains, en particulier chez l’enfant ou chez l’ambitieux, la représentation de ce qu’ils seront plus tard, ou mieux de ce qu’ils voudraient être, constitue un élément très important de la personnalité. Mille rêves passent dans le cerveau de l’enfant, tout ce qui brille l’attire ; mais les difficultés qu’offrent les réalisations pratiques l’obligeront par la suite à diriger tous ses efforts vers un but unique ; heureux s’il parvient à exceller dans la carrière qu’il aura finalement choisie. Le moi n’apparaît donc pas comme un simple polypier d’images, ainsi que l’affirmait Taine ; il suppose une pénétration de ses éléments constitutifs ; l’association des idées ne peut suffire à l’expliquer. Stuart Mill, dont la thèse ressemble beaucoup à celle de Taine, reconnaît la faiblesse de la doctrine phénoméniste :
« Si nous regardons l’esprit comme une série de sentiments, nous sommes obligés de compléter la proposition, en l’appelant une série de sentiments qui se connaît elle-même comme passée et à venir ; et nous sommes réduits à l’alternative de croire que l’esprit, ou moi, est autre chose que les séries de sentiments, ou de possibilité de sentiments, ou bien d’admettre le paradoxe que quelque chose qui, ex hypothesi, n’est qu’une série de sentiments, peut se connaître soi-même, en tant que série. »
Mais c’est une absurdité pire d’avoir recours à un principe spirituel : l’âme, pour expliquer la personnalité humaine. Pourtant Reid affirme que le moi substantiel se distingue nettement des phénomènes qu’il observe :
« Nos plaisirs et nos peines, nos espérances et nos craintes, toutes nos sensations s’écoulent devant la conscience, comme les eaux d’un fleuve sous les yeux du spectateur immobile attaché au rivage. »
Doctrine que nous n’avons plus besoin de réfuter, puisque les philosophes actuels sont unanimes à la condamner. De nombreux spiritualistes admettent, par contre, la thèse de Paul Janet :
« Le tort de quelques défenseurs de la métaphysique substantialiste, déclare ce dernier, est de considérer l’être et la substance, partant le moi, comme des choses en soi qui vivraient dans une région séparée, mais n’auraient rien de commun avec les phénomènes. La vérité c’est que l’être est inséparable de ses manières d’être, la substance du phénomène ; la conscience les saisit ensemble dans leur intime unité, ou plutôt elle est simplement la connaissance que l’être a de lui-même à l’occasion de ses manifestations diverses. »
Déjà Maine de Biran avait soutenu que le moi est perçu directement par la conscience dans le sentiment de l’effort. Jamais, quoi qu’en disent Paul Janet et Maine de Biran, nous ne saisissons une substance spirituelle quelconque, jamais nous ne saisissons autre chose que des états mentaux. Et le support des phénomènes psychologiques doit être cherché dans le cerveau, non dans une âme spirituelle et indivisible. Comment comprendre les altérations de la personnalité, si cette dernière a pour cause un principe simple et immatériel ? Des faits indubitables établissent pourtant que le moi est sujet à de nombreuses maladies ; la plus connue est le dédoublement de la personnalité. Félida, que le Docteur Azam, de Bordeaux, put observer pendant plus de trente ans, avait son existence partagée en deux sortes d’états alternatifs. Dans les uns, elle se souvenait de toute sa vie antérieure et son caractère était vif et joyeux ; dans les autres, elle était fort triste et ne se souvenait que des états semblables. Les changements d’états s’opéraient à la suite d’un sommeil de quelques minutes. Voici, exposé par Binet, le cas de la dame américaine de Mac-Nish :
« Une jeune dame instruite, bien élevée et d’une bonne constitution, fut prise tout à coup, et sans avertissement préalable, d’un sommeil profond qui se prolongea plusieurs heures au-delà du temps ordinaire. A son réveil, elle avait oublié tout ce qu’elle savait ; sa mémoire n’avait conservé aucune notion ni des mots, ni des choses ; il fallut tout lui enseigner de nouveau ; ainsi, elle dut apprendre à lire, à écrire et à compter ; peu à peu, elle se familiarisa avec les personnes et avec les objets de son entourage, qui étaient pour elle comme si elle les voyait pour la première fois ; ses progrès furent rapides. Après un temps assez long, plusieurs mois, elle fut, sans cause connue, atteinte d’un sommeil semblable à celui qui avait précédé sa vie nouvelle. A son réveil, elle se trouva exactement dans le même état où elle était avant son premier sommeil, mais elle n’avait aucun souvenir de ce qui s’était passé dans l’intervalle ; en un mot, pendant l’état ancien, elle ignorait l’état nouveau. C’est ainsi qu’elle nommait ses deux vies, lesquelles se continuaient isolément et alternativement par le souvenir. Pendant plus de quatre ans, cette jeune dame a présenté à peu près périodiquement ces phénomènes. Dans un état ou dans l’autre, elle n’a pas plus de souvenance de son double caractère que deux personnes distinctes n’en ont de leurs natures respectives ; par exemple dans les périodes d’état ancien, elle possède toutes les connaissances qu’elle a acquises dans son enfance et sa jeunesse ; dans son état nouveau, elle ne sait que ce qu’elle a appris depuis son premier sommeil. Si une personne lui est présentée dans un de ces états, elle est obligée de l’étudier et de la reconnaître dans les deux pour en avoir la notion complète. Il en est de même de toute chose. »
Parfois des personnalités distinctes existent simultanément. Outre son moi primitif, Miss Beauchamp, qui fut observée par Morton Prince, avait trois personnalités aux aspirations et aux idées différentes. Deux d’entre elles ignoraient les autres ; la troisième les connaissait. De nombreux cas de dédoublement ont été recueillis par les psychiatres. Les altérations du moi peuvent d’ailleurs être plus ou moins profondes, plus ou moins durables ; on connaît de nombreuses formes intermédiaires entre l’état normal et le dédoublement complet. Le somnambulisme naturel, le sommeil hypnotique déterminent un dédoublement atténué ; la distraction intense en est une forme beaucoup plus élémentaire. Possessions démoniaques et médiumnité se ramènent à des maladies de la personnalité. A côté du dédoublement, il y a d’autres troubles fort nombreux : altération, substitution, etc. ; leur complexité est si grande que les psychiatres ne s’accordent pas lorsqu’il faut les classer. Ces troubles ont mis en évidence les rapports étroits qui relient l’individualité psychologique à l’individualité physiologique ; ils nous éclairent sur la nature synthétique du moi et nous contraignent à bannir définitivement la croyance en un principe spirituel et indivisible : l’âme des métaphysiciens.
— L. BARBEDETTE
PEUPLE (POPULACE, POPULAIRE)
Le grec pléthos (peuple) vient du radical pléo (remplir). Ce qui est pléthorique est ce qui ne peut être rempli davantage. De pléo sont sortis aussi les latins plebs et plebis qui ont fait plèbe, et populus qui a fait peuple.
Peuple et plèbe sont synonymes pour désigner la multitude, la foule, ce qui fait nombre dans tous les genres de la nature. On dit : un peuple d’étoiles, un peuple de fraisiers, le peuple singe (La Fontaine), comme le peuple de France ou de Paris, c’est-à-dire toute une population. On a distingué en appelant peuple la réunion de tous les hommes formant une nation, vivant dans un même pays et sous les mêmes lois, et plèbe la populace, le bas peuple, par opposition aux classes supérieures. A Rome, les patriciens étaient l’aristocratie, les plébéiens étaient le peuple. Cette division, à base toute politique, ne correspondait pas à celle d’aujourd’hui, des propriétaires et des prolétaires arbitrairement réunis sous l’appellation de peuple. Les plébéiens ne se distinguaient des patriciens que par leur origine, mais ils étaient, comme eux, des hommes libres et parfois aussi riches. Les patriciens étaient les descendants des premiers Romains ; les plébéiens, ceux de toutes les populations latines transplantées à Rome dans ses premiers temps. Les deux classes furent en lutte durant toute l’existence de la Rome antique. Quand la plèbe l’emporta, il s’établit ce qu’on a appelé la « démocratie romaine », qui n’a été que l’adaptation de la plèbe à l’aristocratie, le « collaborationnisme » des deux classes unies par leurs intérêts communs. Au-dessous d’elles étaient les prolétaires (proletarius), la basse classe des plébéiens sans fortune, mais oisifs, réduits à l’esclavage par la misère, n’ayant d’autre utilité sociale que de faire des enfants pour défendre la patrie, et les esclaves proprement dits (servus, servulus), étrangers conquis à qui le travail manuel était réservé et imposé.
Après l’antiquité, le sens du mot peuple se restreignit de plus en plus devant la progression aristocratique, et surtout devant la mystique sociale que précisa et consacra le christianisme détaché de son esprit primitif d’égalité et de communisme. Larousse a pu dire fort justement que « l’histoire du peuple, c’est l’histoire de la misère ». Elle l’est et le sera tant que la misère n’aura pas complètement disparu, même des sociétés humaines où l’on a proclamé la mystification de la souveraineté du peuple, c’est-à-dire de tous les citoyens de la nation une et indivisible. Il ne peut y avoir unité et indivisibilité là où persistent propriété et dépossession, oisiveté et labeur forcé, richesse et paupérisme, là où se perpétuent, même sous le nom de « démocratie », les abus et les inégalités des régimes aristocratiques. « Le peuple, aujourd’hui, c’est tout le monde ! », disent les démagogues qui, ayant bien dîné, n’admettent pas que quelqu’un ait faim. Non. Le peuple n’est toujours que ceux qui peinent, qui produisent, qui paient, qui souffrent et qui meurent pour les parasites. Les parasites de jadis, pour qui le peuple était « la canaille », qu’ils méprisaient et fouaillaient insolemment, avaient au moins le mérite de la franchise ; ils n’avaient pas l’hypocrisie d’appeler ce peuple « souverain », et la bassesse de le flagorner pour escroquer ses suffrages et se moquer de lui ensuite.
La mystique qui présida à l’organisation de la société chrétienne au moyen âge, a été formulée ainsi par La Chesnaye-Desbois, dans l’introduction de son Dictionnaire de la Noblesse :
« Dans le droit naturel, les hommes sont égaux ; mais la force et la vertu ont fait les distinctions de la Liberté et de l’Esclavage, de la Noblesse et de la Roture. »
Sauf la vertu qui n’a que faire dans cette histoire, la définition est exacte. Elle a été de plus en plus précisée dans les faits par l’organisation féodale de la société : en haut, la hiérarchie aristocratique de la noblesse laïque et ecclésiastique, depuis le plus petit baronnet et le simple moine mendiant jusqu’au roi et au pape ; en bas, le grouillement roturier du peuple composé des esclaves, des serfs, des croquants, des vilains, des valets, attachés à la glèbe, au métier, à la domesticité. En haut, les parasites que la force, et non la vertu, a pourvus de domaines et de revenus, la noblesse de sang, de distinction, d’origine, d’épée et de robe, dont le droit à ne rien faire était héréditaire et qui auraient dérogé, se seraient exposés à perdre les avantages de leur noblesse, s’ils avaient travaillé. En bas, toute la masse du peuple condamne à travailler pour eux, à leur obéir, à les servir. Il y avait ainsi, à la veille de la Révolution française, quatre cent mille nobles qui dévoraient la substance du peuple réduit au sort de ces :
« Animaux farouches, des mâles et des femelles, répandus par la campagne, noirs, livides et tout brûlés du soleil, attachés à la terre qu’ils fouillent et qu’ils remuent avec une opiniâtreté invincible : ils ont comme une voix articulée ; et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face humaine et, en effet, ils sont des hommes ». (La Bruyère)
La noblesse était d’autant plus méprisante pour le peuple qu’elle ne pouvait se faire d’illusion elle-même sur ses vertus. C’est toujours la peste qui se moque du choléra. Les termes de son mépris abondèrent contre les hommes qui portaient le poids de la malédiction divine du travail, alors qu’elle était érigée à l’honneur de ne rien faire. L’homme du peuple : « être puant sorti du pet d’un âne », disait-on au moyen âge, était : le manant, homme du terroir, de la cité, tenu pour grossier ; le roturier, qui fut d’abord le routier, l’homme des routes, et ensuite l’homme qui n’est pas noble, qui est sale, méchant, obtus ; le vilain, habitant de la campagne, roturier « sans honneur » qui a « moult de meschance » (E. Deschamps), et dont on disait :
Poignez vilain, il vous oindra. »
Le croquant, homme de rien, qualificatif appliqué particulièrement aux paysans, depuis la révolte de ceux de Guyenne, sous Henri IV :
Le butor, le maraud, le maroufle, le rustre, le rustaud, et cent autres soulignant la grossièreté du peuple. Tous se sont trouvés réunis dans ce terme : la canaille, venu de la chienaille (de chien), resté en usage après 1789, dans le langage aristocratique Les généraux, même sortis du peuple, disaient à leurs soldats : « Sabrez-moi cette canaille ! » dans les insurrections de février 1930, de juin 1848, de décembre 1851, où :
se ruaient à l’immortalité ! » (Aug. Barbier : « Les Iambes »)
La Bruyère, parmi nombre d’autres, a exactement situé la position du peuple en face de la noblesse et de sa prétendue « vertu » en écrivant :
« Qui dit le peuple dit plus d’une chose ; c’est une vaste expression et l’on s’étonnerait de voir ce qu’elle embrasse et jusqu’où elle s’étend. Il y a le peuple qui est opposé aux grands, c’est la populace et la multitude ; il y a le peuple qui est opposé aux sages, aux habiles et aux vertueux, ce sont les grands comme les petits. »
La Bruyère a mieux précisé encore lorsqu’il a dit :
« Si je compare ensemble les deux conditions des hommes les plus opposés, je veux dire les grands avec le peuple, ce dernier me parait content du nécessaire, et les autres sont inquiets et pauvres avec le superflu. Un homme du peuple ne saurait faire aucun mal ; un grand ne veut faire aucun bien, et est capable de grands maux ; l’un ne se forme et ne s’exerce que dans les choses qui sont utiles, l’autre y joint les pernicieuses ; là se montrent ingénument la grossièreté et la franchise, ici se cache une sève maligne et corrompue sous l’écorce de la politesse. Le peuple n’a guère d’esprit et les grands n’ont point d’âme. Celui-là a un bon fonds et n’a point de dehors ; ceux-ci n’ont que des dehors et qu’une simple superficie. Faut-il opter ? Je ne balance pas, je veux être peuple. »
Et il raillait de la façon suivante :
« Un grand s’enivre de meilleur vin que l’homme du peuple : seule différence que la crapule laisse entre les conditions les plus disproportionnées, entre le seigneur et l’estafier. »
La sagesse est en bas comme en haut ; la crapule est en haut comme en bas. Beaumarchais a dit, d’une autre façon que La Bruyère :
« Aux vertus qu’on exige d’un domestique, votre Excellence connaît-elle beaucoup de maîtres qui fussent dignes d’être des valets ? »
En principe, le mot peuple correspond à l’idée de Nation, d’Etat, au groupement de tous les habitants d’un même pays vivant sous les mêmes lois. La voix du peuple est « la voix de Dieu », c’est-à-dire la vérité, et « la loi est la volonté du peuple ». Ce sont là les affirmations de la littérature démagogique, de tous les imposteurs qui, de tout temps, se sont moqués de la vérité autant que de la volonté du peuple. En fait, le peuple est « une réunion de sujets par opposition à souverain » (Bescherelle et Littré). Or, sous le souverain, qu’on appelle toujours « le père et le pasteur du peuple » si tyrannique soit-il, sous le maître : « en politique, le seul mot de droits du peuple est un blasphème, un crime », disait Bonaparte. Avant 1789, peuple se disait en France « de l’état général de la Nation, simplement opposé à celui des grands, des nobles, du clergé » (Bescherelle), et représenté par les paysans, ouvriers, artisans, négociants, financiers, gens de loi, gens de lettres qui figuraient le tiers-état aux états généraux. Mais le tiers-état devint de plus en plus le groupement des enrichis, des bourgeois qui se rapprochèrent des nobles et pénétrèrent dans leurs rangs en attendant de les supplanter pour former une nouvelle aristocratie, celle de l’argent, et de se tourner contre le peuple pour le mépriser à leur tour.
La Révolution a proclamé, le 15 décembre 1792, la « souveraineté du peuple », remplaçant celle de la noblesse et faisant résider l’origine des pouvoirs politiques dans la Nation qui délègue ces pouvoirs à des hommes qu’elle choisit et aux conditions qu’elle leur impose. Sous cette Révolution, les orateurs et les amis du peuple étaient ceux qui parlaient pour le peuple et le défendaient devant les assemblées. On appelait ennemis du peuple ceux qu’on voulait perdre devant l’opinion et envoyer à l’échafaud. Mais lorsque la bourgeoisie eut consolidé définitivement sa puissance, la souveraineté du peuple ne fut plus que la souveraineté bourgeoise maintenue par la violence, tout comme avant 1789. Le mot droits du peuple continua à être un blasphème et un crime, tout comme les droits de l’homme et du citoyen qui ont été proclamés et ne sont pas appliqués, dans la république bourgeoise où l’on se moque de la « souveraineté du peuple » avec plus de cynisme que ne le firent jamais royauté, noblesse et clergé. Pauvre peuple souverain qui n’est capable, et n’a la possibilité, de « déléguer ses pouvoirs » qu’à des gens qui font de lui de la chair à travail, de la chair à plaisir, de la chair à canon de plus en plus « rationalisée » !...
Le vrai peuple, toujours sacrifié, est toujours la classe inférieure, la partie la moins distinguée de la population, la moins instruite, la plus portée à se laisser mener par des préjugés, à se soumettre à une abrutissante résignation, et dont on exploite toujours l’ignorance et la crédulité. L’homme du peuple reste l’homme du commun qui ne sort pas de la classe subjuguée pour parvenir à la classe souveraine, il forme la masse de ces prolétaires qui semblaient à Balzac être « les mineurs d’une nation et devoir toujours rester en tutelle ». Lamennais, dont le Livre du Peuple demeure un des plus admirables cris de révolte de l’humanité sacrifiée, ne se laissa pas prendre à la confusion démagogique des classes répandue par les rhéteurs. Il écrivit :
« La société se partage en deux classes distinctes, l’une investie de droits obstinément refusés à l’autre, l’une dominante et l’autre dominée, l’une généralement riche et l’autre généralement pauvre, et cette dernière reçoit particulièrement le nom de peuple. »
Il y a un esprit-peuple qui est né de la terre, des hommes, des animaux, du travail, de tout ce qui est de source naturelle, qui n’a pas été défiguré par des conventions plus ou moins arbitraires, et qui flambe sous le soleil, qui a la mélancolie des échos des bois à l’automne, qui souffre de l’engourdissement hivernal, qui s’émeut devant les détresses, se révolte contre l’injustice, n’avance qu’en trébuchant parmi les chausse-trapes, mais avance toujours. De cet esprit, celui appelé « populaire », inventé par les fabricants de littérature, n’est qu’une caricature. On naît peuple, on ne le devient pas comme on devient bourgeois et aristocrate par une formation intellectuelle conventionnelle. Pas plus que la rivière ne remonte à sa source, l’homme ne redevient peuple quand il a été déraciné, surtout intellectuellement, qu’il a perdu contact avec le travail de la terre, celui de l’outil, avec la simple culture humaine qui seule engendre la véritable culture de l’esprit. Un Léon Cladel portait en lui tout le lyrisme de l’esprit-peuple ; il éclate magnifiquement dans son œuvre. Son I.N.R.I. est un ecce homo autrement humain et pathétique que la victime de Pilate ; il n’est pas descendu du ciel et ne doit pas y remonter. Personne, parmi les révoltés contemporains, n’a mieux traduit que Cladel l’âme du peuple unie à celle de la terre. Un seul, avant lui, l’avait dépassé c’est Michelet.
Michelet n’a pas seulement senti et décrit, vécu dans ses nerfs et dans son sang, la douloureuse histoire du peuple, — l’histoire de la misère, — il a senti, décrit et vécu aussi l’éternité de son espérance, de sa patience, de sa ténacité à construire et à reconstruire la ruche humaine que les frelons dévastent, à relever l’œuvre de salut humain que ses ennemis s’obstinent à détruire. La véritable histoire du peuple est dans les vingt-sept volumes de l’Histoire de France de Michelet, monument de justice à la gloire de la foule anonyme, de la multitude laborieuse, exploitée, saignée, écrasée, qui seule a fait la France, de sa sueur et de sa chair, à l’encontre des prétentions grotesques de ses rois et de leurs thuriféraires, mouches du coche et parasites malfaisants. Mais le plus pur de cette histoire, son âme, est dans le volume intitulé Le Peuple. Michelet y a pu dire dans sa préface : « Ce livre est plus qu’un livre, c’est moi-même. Je l’ai fait de moi-même, de ma vie et de mon cœur », car :
« Pour connaître la vie du peuple, ses travaux, ses souffrances, il me suffisait d’interroger mes souvenirs... Moi aussi, j’ai travaillé de mes mains. Le vrai nom de l’homme moderne, celui de travailleur, je le mérite en plus d’un sens. »
Avant d’écrire des livres, Michelet en avait composé comme imprimeur ; avant d’être un maître-écrivain, il avait été un ouvrier manuel ; avant d’être censuré, suspendu, révoqué, chassé de ses emplois de savant et de professeur par les gouvernants au service des Jésuites, il avait vu les presses de son père brisées par les décrets contre l’expression de la pensée du premier Napoléon. Avant de voir la meute « bien pensante », et que sa mort n’a pas fait taire parce que son œuvre demeure plus que jamais vivante, hurler après lui, il s’était vu chômeur, il avait souffert avec les siens du froid, de la faim, de toutes les misères ouvrières. Il ne séparait pas les travailleurs les uns des autres, l’intellectuel du manuel, le savant du manœuvre, l’artiste de l’artisan : il ne divisait pas le peuple contre lui-même. Il ne craignait pas de dire qu’il voyait « parmi les ouvriers des hommes de grands mérites qui pour l’esprit valent bien les gens de lettres, et mieux pour le caractère ». Il avait dégagé la personnalité du peuple du fond des temps. Il l’avait découverte :
« Parmi les désordres de l’abandon, les vices de la misère, dans une richesse de sentiment et une bonté de cœur, très rares dans les classes riches. »
C’est dans « la faculté du dévouement, la puissance du sacrifice » qu’il avait trouvé sa « mesure pour classer les hommes » et juger du véritable héroïsme du peuple tant abusé par des maîtres égoïstes et criminels. Lorsqu’il se fut instruit par un labeur tenace, ce ne fut pas pour tirer un profit personnel d’une profession de pédant ; ce fut pour instruire les autres dans les voies de la vérité, de la liberté de l’esprit, où il s’était instruit lui-même. Il apprit ainsi que « la difficulté n’est pas de monter, mais, en montant, de rester soi ». Il resta avec les Barbares, « les voyageurs en marche vers la Rome de l’avenir » et qui, s’ils n’ont pas la culture des classes supérieures momifiées dans un conservatisme corrompu, ont bien plus de « chaleur vitale » et apportent à la terre, avec leur sueur, leur « vertu vivante ».
C’est de cette façon que Michelet travailla dans l’art à cette résurrection dont il donna une véritable formule « prolétarienne » que ne devraient pas oublier, aujourd’hui, les initiateurs d’un art prolétarien :
« Ceux qui arrivent ainsi, avec la sève du peuple, apportent dans l’art un degré nouveau de vie et de rajeunissement, tout au moins un grand effort. Ils posent ordinairement le but plus haut, plus loin, que les autres, consultent peu leurs forces, mais plutôt leur cœur. »
Et il ne craignit jamais, pour cela, de perdre des amitiés, de sortir d’une position tranquille, d’ajourner son « grand livre, le monument de sa vie », parce qu’il avait à parler et à dire ce que personne ne disait et ne dirait à sa place, à revendiquer pour ce peuple qu’il avait vu marcher, avec qui il marchait à travers la longue obscurité des siècles, le peuple de la Révolution dont l’Europe portait toujours en elle la « chaleur latente ».
On pouvait encore parler de cette « chaleur latente », et des espoirs qu’elle entretenait en 1846, avant qu’on eût vu, en France, la République des capucins de 1848, le Coup d’Etat de 1851, la Commune, la IIIème République, et, dans toute l’Europe, la Révolution écrasée sous les bottes des cosaques et des hulans, les peuples conduits par leurs empereurs, leurs kaisers et leurs tsars, aux entreprises impérialistes puis, avec le concours des dictateurs démocrates, à la Boucherie Mondiale de 1914. On pouvait encore posséder à cette époque, où toute l’Europe bouillonnait de l’effervescence qui ferait surgir des barricades dans tous ses pays, cette conception mystique du peuple qui est la gloire de Michelet dans la pureté de son élan vers la fraternité. C’est le malheur de notre temps qu’une réalité odieuse lui interdise si sauvagement cette mystique, car l’humanité devra infailliblement y revenir, si elle ne veut pas disparaître dans l’ignominie définitive. Comme l’a écrit M. Monglond, Michelet possédait « cette faculté, qui fut chez lui prodigieuse, d’amalgamer sa propre vie, ses émotions, son âme solitaire, à l’âme de la France ». Visionnaire génial qui retrouva dans le passé le véritable destin du peuple et le lui montra dans l’avenir, il a été trop attaqué et il est toujours trop détesté par les hommes qui abusent le peuple pour ne pas avoir vu et dit juste. Pourquoi faut-il qu’il fasse contre lui l’accord du nationalisme et de l’internationalisme, le premier lui reprochant d’appartenir au second, le second lui faisant grief d’être du premier ? Aveuglement de la lutte des classes vue à travers l’ignorance des partis et la fureur des appétits ; produit convergent de la double mystique bourgeoise et ouvriériste (voir Ouvriérisme) aussi fausse d’un côté que de l’autre de la barricade, et qui ne tend qu’à mettre les uns à la place des autres dans la perpétuité de la haine et de l’exploitation de l’homme. La mystique de Michelet est au-dessus des deux autres, bourgeoise et ouvriériste, parce qu’elle est celle de la vérité. Par une voie qu’on pourrait appeler celle du « spiritualisme historique », celle du cœur et des sentiments, Michelet aboutit au même but que le « matérialisme historique » qui suit la voie de la raison et de l’expérience. Tous deux se rejoignent au même point ; Michelet l’appelle : « Fraternité ! », Karl Marx et Bakounine l’appellent : « Solidarité ! »
Si Michelet a identifié les mots Peuple et Patrie, c’est en voyant dans la patrie la « grande amitié » de tous les travailleurs qui l’ont faite de leur intelligence et de leurs bras, et c’est en voyant cette « grande amitié » étendue au-delà des frontières, au-dessus des patries, dans la fraternité de tous les travailleurs de toutes les patries. Il ne lui venait pas à l’idée decomprendre dans cette « grande amitié » ceux qui avaient exploité et pressuré le peuple pour leur gloire malsaine et leurs appétits égoïstes, pas plus qu’il ne voulait y comprendre ceux qui avaient fait des idées de la Révolution un nouveau moyen de mystification du « peuple souverain ». La Patrie, et la « grande amitié » qui fait ricaner aujourd’hui tant de sots qui ne sont pas toujours des bourgeois, c’était la solidarité de tous ceux qu’unissait la volonté du bien commun opposée aux intérêts particuliers des rapaces. Solidarité admirable, si elle existait, mais utopique devant la réalité, et de plus en plus utopique depuis Michelet, la Révolution qui devait unir tous les travailleurs les ayant divisés davantage ! Car la Révolution, au lieu de supprimer les grandes classes parasites, leur a seulement fait faire peau neuve, et elle a créé au-dessous d’elles, mais « collaborationnant » avec elles, de nouvelles classes de moyens et petits privilégiés qui ont multiplié les divisions.
Aujourd’hui, malgré les théories démagogiques, le peuple ne forme plus qu’un mélange chaotique. D’une part ce sont, plus ou moins solidaires des parasites et des exploiteurs, des travailleurs qui ont accédé à la propriété et dont les intérêts ne sont plus ceux de leur classe. D’autre part, c’est une masse prolétarienne réduite à l’esclavage économique et pour qui il n’est d’égalité sociale que dans la mesure où ses composants peuvent en sortir individuellement pour devenir des travailleurs privilégiés. « Tout le monde travaille aujourd’hui ! » disent les démagogues. Mais voici : il y a les « travailleurs » milliardaires, et il y a ceux qui errent sans pain et sans abri ; il y a des « travailleurs » Citroën, Bata, Oustric, tous les nouveaux féodaux, et il y a les serfs de leurs entreprises qui demeurent les perpétuels esclaves. La réalité renverse les théories d’un démocratisme salivaire et périmé, car ce ne sont pas les théories qui font la réalité. Ce ne sont pas des théories qui ont fait les classes actuelles de ceux qui possèdent et de ceux qui n’ont rien, de ceux qui peuvent faire eux-mêmes leur destinée dans une mesure plus ou moins large et de ceux qui sont réduits à subir celle qu’on veut bien leur faire. Prétendre qu’ils font tous partie du « peuple souverain », c’est se moquer du monde.
Le mot peuple, dont la terminologie est de plus en plus vide de sens précis, est ainsi devenu une entité. Le mot patrie n’est pas moins une entité parce qu’il ne correspond pas davantage à une réalité. Il y a eu, jadis, dans une certaine mesure, le sol sacré des ancêtres où la « grande amitié » des travailleurs pouvait trouver des racines plus ou moins profondes, s’alimenter de véritables motifs sentimentaux : le coin de terre où les morts reposaient sous la protection pieuse des vivants, la vieille demeure où les générations se succédaient dans la vie et le travail familiaux, le vieux clocher, la vieille tour, les vieux arbres du bord de l’eau, tout ce qui limitait l’horizon, faisait l’univers de gens qui ne sortaient généralement pas de leur « trou », ou y revenaient pour mourir. Aujourd’hui, les derniers vieux qui restaient au village sont morts. Les jeunes s’en vont et ne reviennent plus. La vieille demeure, le vieux clocher, la vieille tour, les vieux arbres, ont été démolis, abattus, les morts eux-mêmes ont été chassés de la terre bouleversée pour construire des usines, des banques, des cinémas où viennent travailler, tripoter, s’ébattre, faire fortune, des étrangers au village, à la ville et même au pays, gens de passage ou qui font souche d’Italiens, de Polonais, d’Arabes, de Chinois, mélangeant les races, les caractères, les mœurs du monde entier.
Il n’y a plus de patries, il n’y a plus de petites ou de grandes « amitiés » de clocher et de corporation ; il y a des classes qui sont en luttes et dont les intérêts sont tels que : l’ennemi, pour le prolétaire, n’est pas le prolétaire étranger, mais le patron compatriote et, vice-versa : l’ennemi, pour le patron, n’est pas le patron étranger, mais le prolétaire compatriote. A l’encontre de toute la blagologie conservatrice, nationaliste et démocratique, il n’y a plus de nations, — ce qu’on appelle la « Société des Nations » n’est que l’assemblée du capitalisme international réunie pour discuter de l’exploitation du prolétariat international -, il y a deux Internationales dressées l’une contre l’autre. Les aventuriers de la politique, les charlatans du patriotisme et de la religion, les rapaces de la finance et des affaires, les proxénètes de l’art et de la littérature, les cabotins du snobisme, les valets de plume de la presse, entretiennent à l’envi la confusion dans le cerveau brumeux du « peuple souverain », grâce aux degrés et aux aspects infinis que prennent la propriété et le travail, grâce aux ratiocinations sur l’élasticité des ventres et leur capacité. Quand des marchands de mitraille sont prêts, pour s’enrichir, à faire tuer des millions de leurs compatriotes ; quand des hommes prétendant parler au nom du peuple n’attendent que le moment de commander la boucherie ; quand des favorisés peuvent « gagner » vingt-cinq millions par semaine en exploitant le travail de misérables qui s’exténuent sans pouvoir vivre décemment ; quand la morale civique et religieuse reconnaît qu’il est « nécessaire » aux besoins de certains de gaspiller en un jour le prix de la vie de cent familles, et quand la « charité » des philanthropes réduit des êtres humains à chercher leur subsistance dans les poubelles ; il n’y a pas de « peuple souverain », pas plus que de « grande amitié » dans la Patrie, « d’amour sacré de la Patrie » et « d’union sacrée » pour la défense de la Patrie !...
Le jour où tous les prolétaires sauront ne plus obéir à des entités favorables à leurs exploiteurs, mais toujours décevantes pour eux ; le jour où ils cesseront. de se déchirer entre eux pour le profit de leurs ennemis ; le jour où ils sauront s’entendre contre ces ennemis ; ce jour-là il pourra y avoir de nouveau le Peuple des travailleurs unis dans une « grande amitié » rayonnante. Mais, qu’on ne s’y trompe pas. Si le cœur ne collabore pas avec la raison, si la Révolution qui jaillira de cette entente ne fait pas s’accorder ensemble le « spiritualisme historique » de Michelet et le « matérialisme historique » de Karl Marx pour le succès de l’œuvre entreprise : il n’y aura rien de fait. Le Peuple, quelle que soit la nouvelle défroque idéologique qu’on mettra sur son dos, demeurera le troupeau des vaincus, et l’histoire du peuple continuera à être « l’histoire de la misère ».
POPULACE
Toutes les qualifications méprisantes données au peuple sont exprimées dans le terme collectif : populace. La populace, disent les dictionnaires, est le bas peuple, la racaille, rebut du peuple. Dans une société où certains jouissent aux dépens des autres de faveurs illégitimes, il y a inévitablement, par voie de conséquence, les disgraciés illégitimes. L’extrême puissance et l’extrême opulence sont faites de l’extrême servitude et de l’extrême misère de ceux sur qui elles règnent. La populace a été dans toutes les sociétés constituées suivant cet arbitraire, Tenue dans l’ignorance, condamnée au vice en même temps qu’à la servitude, cultivée comme l’engrais de la monstrueuse végétation parasitaire des privilégiés, elle a toujours été l’instrument des démagogues. A Rome, elle était la vox populi, la sordida pars plebis, et faisait escorte aux Nérons qui la payaient avec les spectacles ignominieux du cirque. Aujourd’hui, elle est la racaille des nervis du « milieu », souteneurs des proconsuls de bars de vigilance, des conquistadores de la flibusterie politique, qui ont les poches ouvertes à tous les profits et là conscience fermée à tous les scrupules. (Voir Politicien). Elle est la farouche légion du vice et du crime qui entraîne à l’ochlocratie les démocraties banqueroutières incapables de l’arracher à ses hontes, de l’élever en l’instruisant, de lui rendre une dignité humaine, de l’empêcher d’étendre ses turpitudes à tout l’organisme social comme un immense lupus. La populace est en haut comme en bas, plus corrompue, plus vile et plus pourrie en haut, dans l’opulence des palais, qu’en bas, dans la hideur des bouges. Toutes les essences de Coty, le parfumeur du régime, ne peuvent effacer la tache indélébile.
La populace a souvent joué un rôle dans l’histoire, parfois héroïque et noble, le plus souvent lâche et odieux. Si elle a plus d’une fois sauvé Rome, comme a dit V. Hugo, et ce n’est pas ce qu’elle a fait de mieux, car Rome ne méritait pas de vivre quand elle n’avait que ce soutien, elle l’a encore plus sûrement perdue. Elle a été le peuple soulevé contre lui-même plus que contre ses ennemis, le peuple se faisant son propre bourreau dans l’explosion aveugle de son inconscience et de sa cruauté. Si tant de révolutions ne produisirent pas ce qu’on en attendait, c’est qu’elles furent des déchaînements de la populace exaspérée par la misère ou excitée par des perspectives de pillage, mais nullement éclairée sur des buts révolutionnaires précis et préparés.
De populace on a fait l’adjectif populacier — ce qui est de la populace -, et un néologisme, populacerie, dont le besoin ne se faisait nullement sentir.
POPULAIRE
Cet adjectif désigne ce qui est du peuple, ce qui vient de lui, ce qui lui appartient, et ce qui est usité, répandu parmi le peuple. Sa signification suit celle de peuple dans toutes ses acceptions ; il est tout autant employé à faux quand on veut lui faire qualifier quelque chose de vulgaire, de bas. On appelle ainsi « art populaire » et « littérature populaire » un art et une littérature spécialement composés pour le peuple, qui affectent la vulgarité et la grossièreté populacières, et dont la niaiserie, l’infériorité, ne sont dignes que de la bassesse bourgeoise qui les produit.
L’art et la littérature véritables, comme la pensée et le travail véritables, sont avant tout populaires, c’est-à-dire propres à tous les hommes. Ils n’existent et ne demeurent que parce qu’ils viennent du véritable peuple, qu’ils expriment ce qui est véritablement humain. L’art et la littérature populaires sont de tous les temps, alors que ceux de l’aristocratie sont particuliers à des époques et périmés avec elles. (Voir Art et Littérature). Tout ce qui est humain est populaire, quelles que soient les conventions appelées « nobles » par lesquelles on veut détacher du peuple une partie de l’humain. Tout ce qu’ont produit les écoles philosophiques, artistiques, littéraires, n’a été durable, n’a mérité de fixer l’attention des hommes, que dans la mesure de ses attaches avec leur multitude, avec le peuple.
On voit de nos jours se fonder des partis de « démocratie populaire » qui sont une sorte de contrepartie à d’autres dits d’ « aristocratie républicaine » ! Cette abracadabrante terminologie politicienne, bien digne du muflisme qui y préside, ne fait que mettre en évidence les survivances des castes aristocratiques dans la prétendue démocratie où nous ne sommes pas fiers de vivre. (Voir Politique).
On emploie substantivement le mot populaire à la place de peuple. On donne ce titre : Le Populaire à des journaux et… à des apéritifs ! Populaire est plus familier que peuple. Plus familièrement encore on dit : le populo. Ce dernier mot ne vient pas de l’argot, comme on pourrait le croire. Le vieux langage français appelait populo un petit enfant gras et potelé. Dans la peinture et la sculpture allégoriques on voit fréquemment des populos portant des cornes d’abondance ou des guirlandes de fleurs.
Parmi les dérivés de peuple et de populaire on a vu populicide, néologisme que la Révolution de 1789 produisit contre les ennemis du peuple,
Popularisme — système de la popularité — est synonyme de démagogie.
Populariser — rendre populaire — est synonyme de répandre, de vulgariser.
— Edouard ROTHEN.
PHALANSTÈRE
n. m.
Dans le système de Fourier (1772–1837), la phalange représente le groupe élémentaire sur lequel repose la commune sociétaire et le phalanstère est le nom que, s’inspirant très probablement du mot « monastère », Fourier a donné à l’ensemble des constructions destinées à abriter la phalange. Ce grand penseur trace de la manière que voici le plan du phalanstère :
La phalange comprend une réunion de 1.500 à 1.800 personnes, exécutant les travaux de ménage, de culture, d’industrie, d’art, de science, d’éducation, d’administration, nécessaires à l’exploitation unitaire de 16 kilomètres carrés de terrain.
Quant au phalanstère, ce doit être un magnifique édifice, ayant une façade de plusieurs centaines de mètres, projetant, à droite et à gauche, de vastes ailes en fer à cheval et repliées sur elles-mêmes, de manière à se doubler et à former des cours intérieures spacieuses et ombragées, séparées par des couloirs, sur colonnes jetées d’un corps de bâtiments sur l’autre et servant de terrasse et de serre. Les ateliers bruyants seront établis dans une des ailes et, dans une autre, ceux où règne le silence ; au centre, se trouveront la bourse, la bibliothèque, le musée, les réfectoires, la tour d’ordre avec beffroi, horloge et télégraphe, le théâtre, le bureau de la Régence et un Temple. Une rue-galerie, à hauteur du premier étage, chauffée l’hiver, ventilée l’été, où seront exposés les produits industriels et artistiques, serpentera autour de l’édifice, établissant entre toutes ces parties, une communication facile.
Chaque famille trouvera à se loger, selon ses convenances, dans des appartements somptueux ou simples, mais dont le moins riche offrira, par sa distribution bien entendue, un degré de confort et d’élégance qu’on trouve rarement dans les habitations de la classe aisée. Elle choisira de même parmi les mets, tous sains et nutritifs, mais plus ou moins recherchés, préparés au restaurant commun, ceux qui conviendront le mieux à ses goûts ou à sa fortune.
Les plus jeunes enfants seront réunis dans des salles vastes et bien aérées, où seront établies, à hauteur d’appui, des nattes élastiques, séparées par des cordons de soie, qui soutiendront l’enfant fatigué du berceau, sans le priver du mouvement et lui permettront de se livrer à ses instincts de sociabilité, qui sont, après les besoins purement moraux, les premiers à se développer. Cette partie de la théorie reçoit une ample confirmation des salles d’asile, où plusieurs centaines d’enfants s’ébattent joyeusement, sous la garde de deux femmes qui, malgré leur aptitude spéciale, ne réussiraient pas à faire taire les cris ou à réprimer la fatigante turbulence d’un enfant isolé.
Les bâtiments affectés à l’exploitation rurale se trouveront sur l’autre côté de la route, communiquant avec 18 phalanstères par des galeries couvertes et, dans la campagne, s’élèveront des pavillons où le travailleur se reposera pendant la chaleur du jour ou à l’heure du repas.
Frappé et douloureusement ému par le spectacle des masures à la campagne et des taudis en ville, dans lesquels étaient logées les classes laborieuses et pauvres de son temps (celles de nos jours sont aussi mal abritées, meublées, installées, éclairées, ventilées), le fameux sociologue voulait, grâce à la fondation et à la multiplication des phalanstères édifiés sur le plan ci-dessus indiqué, remplacer, par chaque groupement phalanstérien, quatre cents masures rurales environ, ou quatre cents de ces infects réduits où sont entassées quatre cents familles plus ou moins indigentes qui, privées d’air, de lumière, de propreté et d’hygiène, grouillent dans les agglomérations citadines.
Pour compléter les indications que comporte le mot phalanstère, ajoutons que les travaux devaient y être rétribués en raison composée du Capital, du Travail et du Talent. Quelques essais de phalanstère ont été tentés en France, notamment à Condé-sur-Vesgre (Seine-et-Oise) et en Amérique, par Victor Considérant, un des plus illustres apôtres du Fouriérisme. Ces essais n’ont pas donné les résultats qu’on en attendait. Je suis porté à attribuer cet échec au mode de rétribution des travaux en honneur et en pratique au sein du phalanstère. Je ne prétends pas, tant s’en faut, que ce système de rétribution soit l’unique cause de l’échec en question ; mais j’estime qu’elle en est la principale. La théorie fouriériste a pour but la réalisation d’une harmonie sociale remplaçant l’état d’opposition, de méfiance, d’hostilité, de concurrence et de rivalité qui est le propre des sociétés modernes. Il est de certitude élémentaire que pour atteindre ce résultat, il est indispensable d’éliminer des rapports sociaux toutes les sources de compétition qui jaillissent du système politique, économique et moral de pratique actuelle. On imagine aisément les contestations et désaccords que devait fatalement provoquer, au sein de l’association phalanstérienne, cette triple attribution fixant la part du Capital, du Travail et du Talent. Il n’est pas douteux que, dans le dosage à établir, chacun de ces bénéficiaires : Capital, Travail et Talent, devait faire effort pour que la meilleure part lui fût accordée et il est certain que, quelle que soit la part attribuée à chacun de ces trois associés — cette part, fût-elle la même -aucun ne devait se trouver satisfait et que, par conséquent, chacun devait : d’une part, concevoir de l’injustice dont il se prétendait victime, une certaine irritation sourde ou avouée ; d’autre part, travailler à la réparation de cette injustice. On pouvait, on devait, dans ces conditions, dire adieu à l’Harmonie rêvée. Celle-ci s’avérait rapidement impossible.
Au sein d’un groupement, d’une association, d’une collectivité, bref d’une société quelconque, l’harmonie (c’est-à-dire l’entente, l’accord) ne peut être réalisée que par un régime se rapportant le plus et le mieux possible, à un principe égalitaire. Egalité dans l’effort à accomplir et égalité dans la satisfaction des besoins ressentis.
Je ne dis pas identité, je dis égalité. Il serait injuste et déraisonnable de demander à une personne de seize ans un travail aussi soigné et fini que celui d’une personne de trente-cinq ans, familiarisée avec la technique et les moindres détails d’une besogne professionnelle ; il serait déraisonnable et injuste d’exiger qu’un être plutôt faible — quoique bien portant — dépensât la même somme d’énergie physique qu’un être exceptionnellement vigoureux et endurant. Il serait tout aussi injuste et déraisonnable d’assigner la même limite aux besoins — d’alimentation, par exemple — de deux individus d’âge très différent, de constitution opposée ou de goût dissemblables.
Par contre, il est raisonnable et juste de demander à chacun qu’il collabore, dans la mesure de ses connaissances et de ses forces à la production commune, de lui reconnaître, en échange, la faculté de puiser dans le grand tout alimenté par l’effort de tous — le sien et celui des autres — de quoi satisfaire ses besoins.
Cette égalité dans l’effort à accomplir et dans la faculté de satisfaire les besoins éprouvés, c’est l’application de cette formule : « De chacun selon ses forces à chacun selon ses besoins ». Cette formule est spécifiquement et exclusivement libertaire. Sa mise en pratique est, seule, de nature à faire naître et à fortifier l’harmonie sociale.
— Sébastien FAURE.
PHALLUS
La place que tient le phallus dans l’histoire de la civilisation est immense. Tout part de lui et y revient. Il est l’alpha et l’oméga de la vie humaine. Les religions, les morales et les politiques tournent autour de lui : il en est le pivot. Le phallus, qu’est-il besoin de le dire, c’est le membre viril. Celui-ci, et sa compagne, la vulva (organes génitaux féminins), ont joué dans l’histoire un rôle primordial.
Le mot phallus viendrait d’un mot phénicien : phalou, qui signifie chose cachée, et aussi chose admirable (le verbe phala signifie, en phénicien, tenir secret). On conçoit que les premiers hommes aient vénéré leur phallus d’où sortait la vie. Ils le comparaient au Soleil, qui fécondait la terre. Dans l’art préhistorique, on trouve des phallus, associés ou non à la vulve, sur des corps humains, ou isolés d’eux, gravés et sculptés dans la pierre. L’époque aurignacienne et l’époque magdalénienne nous ont laissé de ces dessins qu’on qualifierait de nos jours de pornographiques (déesses de la fécondité, scènes de coït, phallus sur bâtons de commandement, etc.) Pendant les temps néolithiques s’élevèrent un peu partout les menhirs, symboles agraires et symboles érotiques tout ensemble.
L’histoire emprunta à la préhistoire le culte du phallus : Assyrie, Phénicie, Egypte ont adoré le phallus sous différents noms. Les Hébreux en parlent à chaque instant : la Bible est un livre obscène sous tous les rapports. Les Indous ont vénéré le lingam. Ensuite, les Grecs et les Romains ont célébré Priape. Le christianisme emprunta au paganisme ses croyances : Saint Foutin était une réincarnation de Priape. Les cathédrales reproduisent sur leurs portails des scènes phalliques. L’ethnographie nous fournit de nombreuses représentations du membre viril : ce sont des « idoles » qui sont de véritables œuvres d’art (sculpture africaine et océanienne). De nos jours, le culte phallique est en pleine décadence : il n’est plus que l’ombre de lui-même. La religion lui fait la guerre. La politique envisage les organes sexuels comme un moyen de remédier à la crise de la dépopulation et de préparer les futures hécatombes : le lapinisme intégral est soutenu et encouragé par l’Etat. La morale traque le phallus, tandis que tout, dans la vie sociale, le met, pour ainsi dire, à toutes les sauces. L’érotisme est à la fois encouragé et combattu par les Pouvoirs publics. On en arrive à une incohérence sans précédent. La plupart des maladies nerveuses proviennent d’un refoulement de la sexualité qui, dans une société renouvelée, serait considérée comme une chose normale, et, non comme un péché !
En somme, adorer le Phallus était, chez les peuples anciens, chose moins stupide que d’adorer le bon Dieu ou la Sainte Vierge. « Peut-être, écrit Voltaire, en respectant dans les temples ce qui donne la vie, était-on plus religieux que nous ne le sommes aujourd’hui en entrant dans nos églises, armés en pleine paix d’un fer qui n’est qu’un instrument d’homicide. »
Dans l’ouvrage que nous terminons sur Le Culte Phallique à travers les âges, Evolution et Signification, nous avons écrit l’histoire complète et détaillée des différents aspects sous lesquels on peut considérer le culte du phallus, et rappeler les coutumes auxquelles il a donné lieu dans l’antiquité, les temps modernes et l’époque contemporaine.
— GÉRARD DE LACAZE-DUTHIERS.
PHARE
n. m. (latin pharus, du mot grec Pharos : île située près d’Alexandrie)
On donne le nom de phare aux tours surmontées d’un fanal, établies le long des côtes pour éclairer les navigateurs pendant la nuit. Les phares ont pour but de permettre à un navire passant la nuit en vue du littoral de déterminer sa position et de tracer la route qu’il doit suivre pour arriver au lien de sa destination ; ils servent également à rendre visibles les dangers sous-marins : récifs ou hauts-fonds. Ils consistent en de puissants appareils d’éclairage, soit électriques, à pétrole ou à huile, placés à des hauteurs convenables dans des endroits judicieusement choisis, sur des tours ou des constructions élevées à cet effet.
L’humanité s’est efforcée, depuis que la navigation maritime existe, de venir en aide aux navigateurs. Déjà Pline l’Ancien, en l’année 77, mentionne les premiers phares : ceux d’Alexandrie, d’Ostie et de Ravenne. La tour de l’île de Pharos, près d’Alexandrie, a fourni, d’ailleurs, le nom générique aux langues romanes. Mais c’est seulement au premier siècle de l’ère chrétienne qu’a commencé l’éclairage régulier des côtes. Les romains dressèrent de nombreux phares un peu partout. Le moyen âge en vit s’élever d’autres, surtout sur les côtes de la mer du Nord et de la Baltique. A notre époque les phares sont nombreux, puissants et variés. Partout où la navigation est dangereuse ; à l’entrée de chaque port important, les phares lumineux, les cloches sous-marines et les phares hertziens se sont multipliés, rendant ainsi à peu près nuls les dangers de la navigation et faisant de plus en plus, de la mer, une route sûre.
Avec les moyens d’éclairage, très imparfaits, d’autrefois, il fallait beaucoup de soins, de peines et de patience pour conserver en bon état les feux battus par la tempête et la pluie, dans le brouillard et la neige. Les côtes étaient souvent peuplées de pêcheurs avides et d’écumeurs de rivages qui n’hésitaient pas à allumer des signaux trompeurs pour attirer les navires circulant de nuit, à des endroits où ils venaient immanquablement se briser sur des récifs ou sur la côte. C’est pourquoi les premiers gardiens de phares furent souvent des ermites ou des prêtres, gens sur qui l’on pouvait presque toujours compter.
Les installations destinées à donner de la lumière dans les phares furent d’un genre très simple depuis l’antiquité jusqu’au début du siècle dernier. On brûlait, dans des mannes de fer, du bois trempé dans du goudron. Les mannes étaient placées au milieu du sommet de la tour ou accrochées à de solides perches à quelque distance de la pointe extrême de la tour et en biais. Il existait aussi des bascules sur des échafauds en bois où l’on suspendait la manne de feu.
Vers le milieu du XVIe siècle, on remplaça le bois par du charbon. On obtenait ainsi une lumière plus puissante et moins susceptible d’être éteinte par la tempête. Consumé d’abord dans les mannes de fer, le charbon fut brûlé plus tard sur la plateforme des tours, dans des foyers creux et la fumée fut emmenée par une cheminée quand on sut abriter le feu par une grande lanterne de verre. Au commencement du XIXe siècle, les deux phares importants du cap Lizard étaient encore alimentés par un feu de charbon et en Suède, il y eut quelques feux du même genre qui persistèrent plus longtemps encore.
Vers 1782 apparurent les premiers phares à huile, et en 1791, Teulères et Borda inventèrent les phares à réflecteurs paraboliques, dont la portée et la clarté furent supérieures à toutes celles obtenues jusqu’alors. Quelques temps après, le physicien Fresnel parvint, grâce à une disposition particulière de lentilles et de prismes, aujourd’hui encore usitée dans tous les appareils de phare, à renforcer puissamment les feux de ceux-ci. Durant le XIXe siècle, on employa comme combustible, l’huile de colza, plus tard le pétrole et enfin la lumière électrique. Les phares les plus récents emploient principalement la lumière électrique et aussi la lumière à pétrole incandescente ou la gazoline, aux endroits où la force électrique fait défaut.
Etant donné le grand nombre de feux qui éclairent aujourd’hui les côtes, il est nécessaire de les différencier pour qu’ils ne soient pas confondus par les marins qui, de nuit, s’approchent d’un port. On distingue, d’après leurs espèces : les feux fixes où la lumière brûle continuellement, avec une clarté égale ; les feux discontinus qui disparaissent à des intervalles déterminés ; les feux changeants où les rayons blancs alternent avec des rayons rouges ou verts ; les feux brillants qui apparaissent après une assez longue obscurité et les feux éclairs qui surgissent brusquement avec des éclats d’une durée de moins de deux secondes.
Tout navire qui arrive du large, tombe d’abord dans le rayon d’action des plus grands phares, dont l’emplacement et la puissance sont déterminés de façon que le navire faisant route vers un point indiqué, ne puisse passer sans les apercevoir ; il rencontre alors les phares de second ordre qui le conduiront jusqu’au port dont ils signalent les abords immédiats ; ensuite un éclairage spécial signale au navire les jetées et les travaux du port et lui permet d’arriver sans encombre au lieu de stationnement définitif. Outre les constructions fixes établies à terre, il existe également des bateaux-phares qui sont placés aux endroits où la construction d’un feu est impossible, comme dans les parages de la mer du Nord, où les bancs de sable se déplacent continuellement. Après le bateau-phare, vient, dans l’échelle des feux flottants, la bouée lumineuse, indiquant, en général, un danger isolé à proximité d’un port. Enfin, signalons les cloches sous-marines et les phares hertziens. Les premiers sont des appareils sonores fonctionnant sous l’eau et émettant, au moyen d’un mécanisme approprié, des battements simples ou doubles, dont la combinaison permet au navire de résoudre le problème de la détermination d’un point le long des côtes. Les phares hertziens constituent la solution du même problème par la télégraphie sans fil.
C’est grâce à ces diverses combinaisons : phares lumineux, cloches sous-marine, bouée lumineuse, phares hertziens, que diminuent peu à peu les périls de la navigation nocturne aux abords des côtes. Ils assurent à une grande distance au large, la sécurité de la pêche et des transports par temps calme et réduisent considérablement les risques terribles que la tempête fait courir aux usagers de la mer.
— Ch. ALEXANDRE.
BIBLIOGRAPHIE. — Clerc Rampal : La Mer. — A. Neuburger : Utilisation des forces naturelles. — Thoulet : L’Océan. — Dr Richard : L’Océanographie.
PHILANTHROPIE
(du grec philos, ami, et anthropos, homme)
La Philanthropie est un masque trompeur sous lequel la bourgeoisie abrite ses méfaits. C’est le déguisement dont elle se sert pour faire croire aux individus qu’elle veut leur bonheur. Sous ce masque se dissimulent les pires appétits. Sous prétexte de faire le bonheur de l’humanité, les philanthropes font son malheur. Les riches, les puissants, les mercantis, les maîtres de l’heure, tous les dirigeants ont intérêt à ce que les individus ne se révoltent point, devant les crimes que leur morale, leur politique et leur administration perpétuent au sein de la société. Ils se servent d’un narcotique pour endormir les masses : ce narcotique, c’est l’altruisme. Entendez, par ce mot, une fausse bonté, une fausse pitié, qui constituent ni plus ni moins qu’une mystification. Ce palliatif, — la philanthropie -, est pire que le mal. Elle accumule misères sur misères. Elle entretient l’ignorance, et sa compagne la douleur, au sein des masses. Il faut aux philanthropes, — ces pseudo-amis des hommes, — une certains dose de pitié, une certaine dose de charité, une certaine dose de dévouement, pour leur permettre de dominer, de diriger, de légiférer ; donc, par la même occasion, pour justifier leur semblant de dévouement, il leur faut de la douleur, de la souffrance et de la misère. Ces « amis du peuple » en font les ennemis. Chaque jour nous les voyons à l’œuvre. Leur dévouement est un trompe-l’œil. Ils ne connaissent point le sacrifice vrai. Ce qu’ils servent, ce sont leurs intérêts.
De même que les pacifistes de banquet, tout en prétendant limiter les armements, ne font que les étendre, de même les philanthropes, en prétendant combattre le chômage et le paupérisme, ne font que les cultiver. Malheureusement, cette « culture de la souffrance humaine », qu’on appelle la philanthropie, s’exerce avec la complicité des sacrifiés, et leur assentiment. Les malchanceux profitent de la pitié, ils emploient mille ruses pour obtenir quelques miettes du festin philanthropique, et ils sont aussi coupables que leurs bienfaiteurs. Les individus se prêtent trop, par lucre, par calcul, par veulerie, aux « combinaisons » des bienfaiteurs, ce qui fait que les uns et les autres sont aussi peu intéressants, et qu’ils méritent autant les uns que les autres le titre de profiteurs de la bêtise humaine. Les uns exploitent ; les autres se laissent exploiter : on se trouve en présence de deux classes d’individus qui se prêtent main-forte, et font appel au sentiment pour servir leur intérêt.
Comme on prétend « humaniser » la guerre, lui donner des lois, — pour l’éterniser, — ainsi les dirigeants s’efforcent, par tous les moyens, de conserver l’état de paupérisme qui sévit, présentement, dans le monde. Leurs méfaits sont innombrables. O philanthropie, que de crimes on commet en ton nom ! Tous ces « chariteux » ne font la charité qu’à moitié. Ils la font d’ailleurs ostensiblement au vu et su de tout le monde. Combien plus « philanthrope » est celui qui, n’ayant pas le sou, aide un camarade, lui vient en aide, partage ses peines. Il y a des philanthropes ignorés, mais ce ne sont pas ceux dont nous parlons.
Les philanthropes sont de drôles de « types ». Dames patronnesses, vieux messieurs décorés qui président des conseils d’administration dans les compagnies d’assurances ou dans les grandes banques, noceurs repentis, énergumènes de la politique, âmes sentimentales qui tiennent à gagner le ciel, tous ces pantins, tous ces fantoches sont à mettre dans le même sac. Moralistes, économistes, patrons d’usine, etc., tous se disent « philanthropes », de même qu’ils se disent « pacifistes », alors qu’ils ne sont ni l’un ni l’autre.
La psychologie de « philanthrope », autant que sa physiologie (ici la déformation professionnelle est visible) est curieuse et décevante. Il a la manie de faire le bien. Pour satisfaire cette manie, il use de tous les moyens en son pouvoir, licites ou illicites : tracts, prospectus, cérémonies patriotardes, causeries, représentations au bénéfice de..., etc. « Visiteurs » et « visiteuses » vont à domicile porter du bonheur ! Le philanthrope a toujours sous le bras une serviette bourrée de papiers. Il ne s’épargne aucune démarche auprès des particuliers ou des Pouvoirs publics. Où il n’y a point d’administration, il en crée une. Le philanthrope est bureaucrate. Il faut qu’il salisse beaucoup de papier pour pouvoir faire le bien. Sa mentalité est celle du vieux militaire abruti par l’alcool ou de la vieille dame qui se voile la face devant l’éphèbe qui exhibe dans le marbre ou le plâtre une académie impeccable !
La philanthropie sert de prétexte à décorer beaucoup de gens et à décrocher quelque sinécure. Palmes académiques ou Mérite agricole, parchemins, distinctions honorifiques, tableaux d’honneur, diplômes, médailles, ornent le vestibule des home bien pensants. Ne nous étonnons pas qu’il y ait tant de philanthropes de par le monde. Si on ne mettait pas leurs noms dans les gazettes, il y en aurait beaucoup moins.
La philanthropie est un chancre qu’il faut à tout prix extirper. C’est un microbe, une lèpre, une peste... Il faut la combattre par tous les moyens. Elle est le fruit de l’incohérence et du bluff. C’est une des mille et une mystifications dont notre époque est remplie.
Que voit-on à l’heure où tant de gens prétendent faire le bonheur de leurs semblables ? La peine de mort (guillotine, électrocution, pendaison, etc.), le bagne, la justice des tribunaux (de classe), les erreurs policières, les expertises truquées, — la guerre qui menace, tandis qu’une conférence dite du désarmement se refuse à désarmer. Alors, que vient-on nous parler, avec des trémolos dans la voix, du bonheur des peuples ? Liberté, égalité, fraternité sont des mots vides de sens tant que la chose qu’ils signifient n’est point réalisée. Les politiciens nous bourrent le crâne, avec leurs promessesses et leurs boniments. C’est ce que font aussi les philanthropes, cette espèce de politiciens dont nous mourons, comme des autres. Refusons de les écouter, et combattons leur action. Méfions-nous des « aventuriers » de la philanthropie. Ils sont extrêmement dangereux. La philanthropie est une affaire, comme la guerre, ou comme la paix (dans le monde des politiciens). Les petites « combinaisons » vont leur train, en philanthropie comme en politique. Tout bon politicien doit être au moins philanthrope (en paroles, non en actes), et tout bon philanthrope doit être doublé d’un politicien avisé. Nous avons vu à l’œuvre les philanthropes, comme leurs amis les élus du suffrage universel. Ils se valent. Ils soutiennent la même cause : celle de leur porte-monnaie !
Le philanthrope respecte la morale, croit en Dieu et vénère l’autorité. En père de famille, il est à cheval sur les principes, qu’il viole chaque fois que l’occasion s’en présente. Le philanthrope redoute l’opinion et craint la critique. Il fait partie de la Ligue contre la licence des rues et commandite les maisons de prostitution. Il est plein d’illogisme et nage dans l’incohérence. Ses conversations abondent en lieux communs, en phrases toutes faites, en bourdes colossales. Il passe son temps à exprimer des banalités. Il est à la fois pour et contre ceci ou cela. Il n’ose pas prendre parti, mais il est au fond du parti la réaction intégrale en toute chose.
Les « putains » de la Haute font la charité en dansant et en couchant avec des ministres, Les représentants de l’aristocratie frayent avec ceux de la démocratie. Le clan des philanthropes va de l’extrême droite à l’extrême gauche, en passant par le centre. Tous ces gens-là s’entendent comme larrons en foire pour faire le bonheur du peuple, avec des discours et des pirouettes.
Faire l’aumône, c’est pour les gens qui sortent de la messe une agréable distraction. Avant d’aller s’empiffrer chez le pâtissier, ils jettent deux sous dans la sébile de l’aveugle ou du manchot. Ce geste leur vaut la considération de leurs pairs. Ils iront droit au ciel !
On verse aux foules l’opium de la philanthropie, comme celui de l’espérance. On fait miroiter à leurs yeux les paradis futurs, sur terre ou dans l’autre monde. C’est autant de gagné pour les bienfaiteurs. Pendant ce temps ils s’amusent, pérorent dans les académies ou les salons. Ils font leurs affaires sur le dos des pauvres.
Combien de « fondations » qui n’ont eu que la vanité pour mobile ! Celle-ci est une animatrice dangereuse. Que de bêtises leur vanité fait commettre à certains individus !
A côté de la philanthropie humanitaire, il y a la philanthropie scientifique. Les « bienfaiteurs » agissent encore ici dans un but de réclame ou pour faire oublier leurs crimes. Cependant, quels que soient les mobiles auxquels ils obéissent, ils peuvent rendre des services. On préfèrera toujours le philanthrope qui permet à un savant de poursuivre ses expériences, en mettant à sa disposition des instruments de travail et un laboratoire, au philanthrope qui fait construire un couvent ou une chapelle. Les deux ne se comparent pas. Le premier est utile ; le second est nuisible, Qu’un milliardaire mette une partie de sa fortune à la disposition d’un biologiste ou d’un physicien, c’est chose autrement intéressante qu’un dévot qui lègue à sa paroisse le contenu de son coffre-fort pour gagner le ciel.
Le véritable « philanthrope » fait le bien, non pour qu’on l’applaudisse et l’encense, non par devoir, snobisme, intérêt, égoïsme, ou toute autre considération inférieure, mais simplement parce qu’il considère que la solidarité bien comprise, l’entraide intelligente et l’union sont les meilleurs facteurs du progrès. Il se préserve du sentimentalisme à l’eau de rose, de la sensiblerie, de la fausse pitié, de la charité des mondains et de l’altruisme des impuissants. Il n’obéit qu’à sa raison. En se libérant de tous les préjugés, il libère ceux qui l’approchent. Il donne à tous l’exemple, non de la vertu, non de la résignation, non du sacrifice, ces mots dont usent et abusent les malfaiteurs déguisés en bienfaiteurs, mais de l’énergie, de la volonté, de la virilité, de la sincérité en toute chose. Le véritable philanthrope serait celui qui délivrerait l’humanité de tous ses tyrans. Il aurait fort à faire !
La philanthropie est destinée à disparaître avec notre société. Elle disparaîtra avec l’alcoolisme, le suffrage universel, la prostitution et autres tares sur lesquelles repose tout notre édifice social. D’ici là, l’Etat — ce philanthrope des philanthropes — fera tout son possible pour maintenir dans la société la misère sous toutes ses formes, tout en encourageant les philanthropes à bien faire, et les individus à s’abandonner entre leurs mains.
Avec quelle sollicitude l’Etat — cette pieuvre — vient en aide à l’individu, de sa naissance à sa mort ! On n’a jamais bien su ce que c’était que l’Etat. L’Etat, c’est moi, disait Louis XIV. L’Etat, c’est nous, disent nos modernes roitelets. Bref, l’Etat c’est tout ce que l’on voudra, Il est insaisissable, on ne le voit pas plus que Dieu. Cependant il manifeste sa présence par des maux de toute sorte. Sa sollicitude s’étend de l’enfant au vieillard. Elle prend l’enfant dans le sein de sa mère, et guide les premiers pas. L’Etat commence par combattre la limitation des naissances. Il encourage le lapinisme intégral. Il ignore l’eugénisme. Il préfère, à la qualité, la quantité, qui fera des soldats et des bulletins de vote ! C’est toujours ça de gagné. Faites des enfants ! ne cessent de dire les riches à leurs serviteurs les pauvres. Mais eux se gardent bien d’en faire. On accorde aux mères lapines et aux pères lapins des tas de passe-droits qu’on refuse aux pauvres bougres de célibataires. Il est certain que l’Etat fait beaucoup pour les déshérités de ce monde, avec l’appui des donateurs, bienfaiteurs et autres, ce qui permet à l’administration de l’Assistance publique de boucler son budget. La fille-mère, la mère qui ne peut nourrir son enfant touchent des allocations (oh ! bien minimes), de vagues secours. Il semble vraiment qu’il n’y en ait que pour elles : crèches, pouponnières, que sais-je ? Tout cela, évidemment, c’est de la poudre aux yeux. Ça fait très bien dans un salon, quand on en parle, ou en période électorale. Cela permet aux dames patronnesses, déguisées en infirmières, de tripoter, de fricoter à qui mieux mieux. Ces « foyers », stigmatisés par Octave Mirbeau dans une pièce célèbre, voient éclore plus d’un scandale, aussitôt étouffés. Tous ces messieurs et dames, avec la complicité de l’Etat, protègent les tout-petits, et leurs pères et mères. Tel directeur de grand magasin lègue à l’Etat de fortes sommes pour que son nom soit vénéré à jamais de ses employés. Les « familles nombreuses » y trouvent leur compte. Les chers petits anges, dorlotés par les sœurs et par les curés, sont l’objet des attentions les plus délicates de la part des « bienfaiteurs » mâles et femelles (notons en passant que la pitié de ceux-ci s’étend aussi à nos frères inférieurs, chiens, chats et chevaux notamment, et que beaucoup de vieilles dames s’intéressent à leur sort. Il y a une Société dite Protectrice des Animaux, qui ne protège que ses membres. L’argent ne va pas aux bêtes, mais dans la poche de ses administrateurs. Nous sommes, là-dessus, particulièrement bien documentés).
L’Etat, — avec le concours des particuliers, — ou les particuliers avec le concours de l’Etat, s’occupent du sort des adolescents, de la « jeune fille », etc. Ouvroirs et orphelinats leur évitent les pires tentations. Les sociétés de scouts, sur lesquels il y aurait tant à dire, font le reste. Patronages, laïques ou non, sociétés de tir, de gymnastique, de préparation militaire, etc. sont, avec l’appui des « pères de famille », protecteurs de la veuve et de l’orphelin, parmi les moyens dont dispose la société pour faire l’éducation de la jeunesse.
L’âge mûr possède également ses protecteurs et ses protectrices : marraines de guerre, et de paix, tuteurs et tutrices de celui-ci ou celui-là, asiles d’aliénés nouveau modèle, prisons du dernier confort, etc., s’harmonisent avec l’hygiène sociale, la salubrité publique et autres balivernes qui servent à corser les boniments électoraux. Les casernes sont bien aérées. Les classes des écoles sont très attrayantes. Quant aux hôpitaux, on a envie d’y mourir (il y aurait beaucoup à dire sur les hôpitaux).
La vieillesse est également protégée et secourue. Secours, allocations, hospices, notre République égalitaire a bien fait les choses. La mort s’exploite au grand jour, le pauvre bougre ira pourrir dans la fosse commune si sa famille n’a pas les moyens d’engraisser les entrepreneurs de pompes funèbres !
Soupes populaires, — combien appétissantes ! — retraites ouvrières, assurances sociales, etc., quelle salade, et quelle bouillabaisse ! La bourgeoisie fait présent à ses pauvres des plats les plus faisandés : moyens de communication grotesques, spectacles abrutissants, bistros, beuglants, lupanars, cinés ... J’allais oublier les sports : boxe, tour de France, traversée de Paris à la nage, ou simples courses de midinettes... Avec cela le peuple est content, le peuple est heureux. Vraiment, la philanthropie, telle que l’entendent nos contemporains, est une belle chose. Elle fait « marcher » les gens, et ils marchent bien.
La démocratie redouble d’efforts pour rendre le palais du peuple habitable. Elle a réalisé de grands progrès, quand on pense à la façon dont on pratiquait l’hygiène sous l’ancien régime. Cependant bien peu de chose a été fait, tout n’est que façade et bluff. Des paroles. D’actes, point, ou si peu !
Les quelques réalisations tentées par la République dite démocratique pour remédier aux différents maux qu’elle entretient dans son sein sont stériles. Que n’ont pas inventé les maîtres de l’heure pour se faire pardonner leurs crimes et leurs méfaits ! Les manifestations de cette philanthropie « laïque et obligatoire » se répartissent, avons-nous dit, en plusieurs groupes. On peut les classer suivant qu’elles s’adressent à l’enfant, à la femme, au vieillard, au malade, à l’infirme, etc., selon qu’elles visent telle ou telle catégorie de travailleurs, etc. Pour la jeunesse, nous avons des orphelinats ; pour la vieillesse, des asiles ; pour les nécessiteux, des soupes populaires et des asiles de nuit ; pour les malades, des hôpitaux avec ou sans curés. Pour les femmes en couches, nous avons des secours, ainsi que pour les familles nombreuses (encouragement au lapinisme intégral). Nous avons un vieux stock de lois concernant les accidents du travail, les retraites ouvrières et les assurances sociales, etc., etc. Nous avons vraiment trop de « secours », pour qu’ils soient équitablement distribués.
Ne vaudrait-il pas mieux, pour l’individu, qu’il se débarrassât de cette charité légale et administrative, pire que le mal qu’elle prétend guérir et qu’en réalité elle s’efforce d’entretenir par tous les moyens ? Les classes dirigeantes, devant la misère créée par elles, se trouvent acculées dans une impasse, et s’efforcent de l’atténuer jusqu’à un certain point (il est nécessaire, en effet, de conserver une certaine dose de misère, pour que fonctionne normalement toute la machinerie sociale). Les accapareurs de la richesse ne savent qu’inventer pour endormir les consciences et maîtriser les estomacs de ceux qui souffrent et peinent pour eux. Mais ils ne parviennent pas à enrayer la vague de paupérisme dont ils sont les auteurs, et qui les emportera, un jour, comme fétu de paille !
On prend vraiment en pitié ces pauvres philanthropes qui suent sang et eau pour nous prouver qu’ils font le bien, — leur bien. Ils dansent, mangent et forniquent en musique, pour le bonheur de leurs semblables. Ils sauvegardent la vertu... des autres. Bals de charité, des Petits Lits Blancs (ma chère !), banquets monstres, soirées de galas, mascarades, travestis, divertissements variés, orgies, soulographies, « partouzes », versent dans les caisses des philanthropes des billets de banque et des pièces d’argent pour leurs « bonnes œuvres ». Les mendiants de profession, envoyés par les confréries aux portes des églises ou sur le passage des processions, opèrent aussi pour la communauté. Il y a des troncs dans les églises, cagnottes toutes trouvées dans lesquelles ses sacristains bien pensants puisent de quoi se saouler les jours de fêtes ! Avec cet argent, les curés entretiennent des danseuses et font des repas pantagruéliques.
Il y aurait une histoire de la philanthropie à écrire depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. On y verrait que les riches, sous tous les régimes et dans tous les pays, sont partout les mêmes. On verrait, sous toutes les latitudes, de « généreux philanthropes » qui ont voulu le bonheur de leurs semblables. Pour ne parler que de l’époque contemporaine, combien de patrons d’usine, de grands industriels, de milliardaires, de partisans des trusts à outrance et du système Taylor, essaient de faire oublier leurs... humbles débuts, l’esclavage et la sueur du peuple dont ils vivent, en fondant des cantines, des lieux d’amusements et autres façades pour entretenir dans la bonne voie le peuple des travailleurs (ceux-ci leur sont reconnaissants, si l’on en juge par les « fanfares » qu’ils exhibent dans les rues, pour la fête du « patron »).
Les philanthropes sont optimistes. Du moment que leur petit commerce prospère, ils sont contents. Tout leur sourit : les femmes, la fortune, la gloire... Leur portrait orne les taudis. Leur nom vole de bouche en bouche !
Point d’argent, point de philanthropes ! Quand ils « font la charité », c’est le ventre plein et le gousset bien garni. En somme, c’est surtout aux philanthropes que profite la philanthropie. C’est le plus clair de l’histoire !
La philanthropie, ce sont les pilules Pink de la misère ! Absorbées à petite dose, elles produisent des effets excellents, de l’avis même de ceux qui les avalent. De quoi les pauvres se plaignent-ils ? Ils ont tout pour être heureux. On les dorlote, on les nourrit, on les chauffe, on les loge, on les habille, on les entretient. On leur procure du travail. Tout est bien dans le meilleur des mondes. Nous avons, à Fresnes, une prison moderne. Nos casernes sont d’une propreté exemplaire. Les infirmes et les malades sont bien soignés, les épidémies sont enrayées. On trouve des docteurs à chaque coin de rue. Les chirurgiens ne chôment pas. La vie est belle !
— Gérard de LACAZE-DUTHIERS.
PHILOSOPHIE
(du grec : philos, ami, et sophia, sagesse)
Il y a une certaine philosophie, qui n’a que de lointains rapports avec ce que l’on désigne d’habitude sous ce nom. Si la philosophie a ses détracteurs, la faute en est aux philosophes. Ils ont fait de la philosophie quelque chose de si compliqué, de si impénétrable et de si abscons, qu’ils ont découragé les meilleures volontés. Ils se sont enfermés dans leur tour d’ivoire, échafaudant des théories dans le vide, fabriquant des systèmes incohérents, avec cette singulière prétention, bien qu’isolés du reste du monde, d’imposer au monde leurs conceptions. Je ne puis croire à la philosophie telle que l’enseignent les philosophes. Les philosophes sont pour moi des abstracteurs de quintessence, des coupeurs de cheveux en quatre. Ils déraisonnent et sont terriblement ennuyeux. Ils croient se distinguer du vulgaire, avec lequel ils se confondent, en parlant le langage des apothicaires et des huissiers. La philosophie est une variété de « bourrage de crâne ». Comme la Science, comme la Morale, comme l’Art, comme tout ce qui s’enseigne en médiocratie, les classes dirigeantes l’ont confisquée à leur profit : la philosophie est devenue leur prisonnière. Il faut l’arracher à ses bourreaux et lui rendre sa liberté. Il sied de restituer au vocable philosophie son sens positif. C’est la tâche réservée aux véritables philosophes.
La philosophie « officielle », d’une prudence extrême, se tient constamment dans le juste milieu. Sa timidité lui interdit toute investigation hardie. Elle ne hasarde rien de contraire aux bonnes mœurs. Elle n’ose s’aventurer sur un terrain scabreux. Elle se contente de tourner éternellement dans le même cercle vicieux et de contempler les mêmes paysages ; le monde serait perdu si elle s’écartait tant soit peu de la route suivie : ce serait la fin de tout. Tout ce qui est nouveau, original, indépendant, lui fait peur. La pensée l’effraye. C’est une vieille radoteuse, qui ne veut pas qu’on la dérange de ses habitudes. Elle est affreusement laide, et porte un vêtement singulier, qui la fait ressembler à une folle. Elle parle un langage mesuré, pondéré, lourd et prétentieux comme sa personne. Elle marche à petits pas, en s’appuyant sur un bâton, sans rien voir autour d’elle. Jamais elle ne consentira à faire connaissance avec la vie. Si, par hasard, elle exprime un semblant d’idée, c’est sans le faire exprès et en s’excusant bien vite de son audace. Elle invoque l’autorité des philosophes antérieurs qui eux-mêmes invoquent celle de leurs prédécesseurs qui tiennent leur autorité des « anciens ». Cette pseudo philosophie a pour mission de faire respecter la tradition et d’éterniser, sous des noms différents, les vieilles idoles. Elle entretient une atmosphère de banalité dans les cerveaux. Elle veille à ce que l’esprit humain soit bien sage, et ne s’éloigne jamais du chemin qui lui a été assigné de toute éternité. Elle interdit toute originalité aux individus. Elle exige que tous les êtres se ressemblent. Elle est chargée de maintenir l’ordre dans la cité des idées et de s’opposer à ce que les gens aillent trop vite. Il faut piétiner sur place pour faire plaisir à cette vieille coquette qui ne sait qu’inventer pour abrutir les individus. Quel que soit le déguisement sous lequel elle cache son impuissance, suivant les lieux et les époques, elle sert le même idéal : celui de la médiocrité.
Ce vocable « philosophie », synonyme de néant, il sied de lui donner un sens positif qu’il n’a eu que bien rarement. A la philosophie traditionnelle, étatiste et légale, négative par excellence, opposons une philosophie d’hommes libérés, a-légale et a-sociale, jugeant les choses en toute indépendance, sans se soucier de l’opinion et de la tradition. A la pseudo philosophie ou non-philosophie « archiste », opposons une philosophie « an-archiste », éclairée par la raison et magnifiée par l’amour. Nous ne chercherons ni à plaire, ni à déplaire ; nous ne nous préoccuperons que d’être nous-mêmes. Ce qui nous guidera dans nos jugements, ce ne sera pas ce que d’autres ont pu dire avant nous, mais notre conscience. Nous ne mépriserons pas pour cela la pensée des autres, chaque fois qu’ils auront été eux-mêmes. Nous en dégagerons l’essentiel. Ce n’est qu’à la condition de ne pas imiter le passé qu’on le continue. C’est en le dépassant, c’est en s’opposant à lui qu’on le prolonge dans l’avenir. Imiter quelqu’un c’est le méconnaître. C’est faire œuvre d’incompréhension. Admirer vraiment, c’est comprendre. C’est conserver sa liberté au lieu de l’aliéner. La sympathie exige la différenciation. Il faut nous efforcer de saisir, dans une pensée qui n’est pas nôtre, un atome de vérité. Ne soyons ni intransigeants ni exclusifs, sans pour cela abdiquer notre personnalité. Il faut admettre certaines pensées que nous n’approuvons pas. Le monde serait affreusement monotone si nous pensions tous la même chose et agissions semblablement. Quel enfer ce serait ! Ce qu’il faut, c’est qu’ayant devant les yeux un idéal de beauté, nous nous efforcions d’y tendre tous par toutes les routes, que ce soit le même idéal, mais que nous le réalisions par des voies différentes. La tolérance n’est pas l’indulgence. Ne confondons pas. Elle ne nous dispense pas de dire ce que nous pensons de l’action d’autrui. L’indulgence approuve, la tolérance laisse à l’adversaire la liberté de patauger, de se montrer tel qu’il est, de se détruire lui-même. En face de l’intolérance, elle fait preuve d’une patience à toute épreuve, se gardant bien d’imiter le sectarisme et le fanatisme qui, eux, ne tolèrent rien.
Nous dégager de l’emprise des milieux, nous « ressaisir » sous les mailles du social qui nous enserrent, telle sera notre méthode. Notre philosophie sera anarchiste en ce sens qu’elle reposera sur l’esprit critique qui n’accepte rien les yeux fermés, mais tient compte de tout ce qui peut aider à la manifestation de la vérité. Par vérité, je n’entends point un dogme intangible devant lequel nous n’avons qu’à nous incliner. J’entends par « vérité » le besoin qui est en nous de vivre une vie autre que la vie que nous impose la société. C’est là notre vérité.
L’an-archiste est le véritable philosophe, parce que la sagesse guide ses actes, dans lesquels l’esprit intervient autant que le cœur pour réaliser par son accord avec lui un équilibre harmonieux.
Il y a philosophes et philosophes. C’est encore un de ces mots qui expriment tout ce que l’on veut. La langue française fourmille de vocables auxquels on prête les sens les plus fantaisistes. Le même mot a trente-six significations pour trente-six individus. Le langage philosophique lui-même aide à cette confusion, donnent aux mots un sens qu’ils n’ont point. Il est juste que les philosophes soient victimes de l’exemple qu’ils donnent. Que sont les philosophes pour le vulgaire ? Des abstracteurs de quintessence. C’est bien, au fond, ce qu’ils sont en réalité. Mais la véritable philosophie est autre chose que le langage tarabiscoté et les formules hermétiques des philosophes professionnels. Ce n’est point chez les philosophes qu’il faut chercher la véritable philosophie. Le malheur est qu’en la confondant avec sa contrefaçon on en méconnaît la réalité. La foule ne fait aucune différence entre la vraie et la fausse philosophie : elle est incapable de voir où sont les véritables philosophes. Elle a les philosophes qu’elle mérite. Au fond, si elle déteste les philosophes, ayant le vague instinct de quelque chose qui la dépasse, elle a néanmoins une secrète admiration pour tous ceux qui parlent pour ne rien dire. Elle ne comprend pas : donc, ce doit être génial ! Les pseudo-philosophes déshonoreraient la philosophie, si elle pouvait être déshonorée. Ils ont pris la place des vrais, en sorte que la philosophie n’est plus qu’une mystification et ne peut plus être prise au sérieux. Où l’on cherche des philosophes, on trouve des charlatans.
Certes, les philosophes ont de nombreux représentants à notre époque, mais quel que soit le bruit fait autour de leur nom, ils ne nous ont rien apporté de bien nouveau. Comme hommes, ils sont poltrons et timorés, suivent la foule et manquent de courage. Ce n’est pas du côté de nos soi-disant philosophes qu’on trouve des esprits libres. Ce sont des hommes sociaux, et cela veut tout dire. Arrivistes est l’épithète qui convient à ce genre d’intellectuels.
Parce que j’aime la philosophie, je n’aime guère les philosophes. Ils sont si peu philosophes ! Ils ont exactement les mêmes appétits et les mêmes besoins que les autres hommes. Ils ont mêmes vices, mêmes défauts. Ils en ont même davantage. Ils sont pourris de préjugés. Leur philosophie est un non-sens. Elle reflète leur mentalité. C’est la philosophie qui convient parfaitement à une médiocratie sans idéal. Elle est l’expression d’une élite qui, elle-même, est l’expression d’un troupeau. Suiveurs et suivis se valent. Il y a une autre philosophie, qui exige chez l’individu l’harmonie des gestes et des paroles et qui est la victoire de la vie intérieure sur la vie extérieure. Son harmonie n’est pas en surface, mais en profondeur. Elle n’est pas un semblant d’harmonie, masquant tous les désordres. Cette philosophie réelle et vivante, peu d’hommes l’enseignent et la pratiquent, ceux qui s’intitulent philosophes moins que les autres, car ils cachent leur vide de pensée sous des formules creuses et des banalités. Ils sont insincères. On les trouve toujours du côté du plus fort. Ce qui caractérise ces eunuques, c’est la crainte. La crainte d’émettre la moindre idée qui ne figure pas dans le dictionnaire des idées reçues. Ils ont peur de l’autorité. Ils flattent le pouvoir. Ils se mettent à la remorque des dirigeants. Tristes individus ! Ils sont bien de leur époque.
Tout autre est le vrai philosophe. Il ne mange pas à tous les râteliers. Il ne fréquente pas le monde et les académies. Il se tient en dehors du « mouvement ». Il n’est à la remorque d’aucun régime. Le philosophe est l’homme d’avant-garde, — écrivain, poète, artiste ou autre, — qui sème des idées sur sa route. La prison le guette, les dictateurs le pourchassent : il est libre.
Il est certain que ceux qui ont usurpé le titre de philosophes, comme d’autres celui d’artistes ou d’écrivains, ne sont pas autre chose que de vulgaires arrivistes. Comment empêcher des gens qui n’ont aucune idée dans le cerveau de nous donner le change en débitant, sous le nom d’idées, toutes sortes de lieux communs ? Ne pas penser est dans les habitudes des pseudophilosophes. A cette ombre de pensée, on donne le nom de philosophie. Cet abus d’un vocable qu’on ne devrait employer qu’à bon escient est un scandale parmi d’autres scandales dont notre époque foisonne.
On ne peut contempler sans rire les acrobaties des philosophes suspendus dans le vide par un pied. Ils sont amusants. Leurs tours de force n’arrivent pas à prouver leur force. Leur adresse et leur habileté ne servent à rien. On essaie de suivre leurs prouesses déclamatoires : au bout du chemin, on aboutit à une impasse. C’est le vide qu’on rencontre.
Il y a une « philosophie officielle », comme il y a une esthétique et une morale officielles. Elle résout tous les problèmes dans un sens autoritaire. Cette philosophie est facilement reconnaissable sous son masque de libéralisme et les différents déguisements qu’elle revêt. La véritable philosophie n’est pas là, mais dans la vie intérieure de l’individu aux prises avec la vie sociale.
Ce qui caractérise la plupart des professeurs de philosophie, c’est qu’ils ne sont point philosophes. Ils le sont « officiellement », c’est tout. S’ils l’étaient réellement, enseigneraient-ils aussi platement la philosophie ? Des professeurs non-artistes et non-écrivains enseignent sans conviction l’art et la littérature. Est-ce enseigner vraiment qu’enseigner sans originalité les « matières du programme » ? Enseigner la philosophie et la pratiquer sont deux choses différentes. Il n’y a de véritables professeurs de philosophie que celui qui vit sa philosophie. Il y a des « professeurs d’énergie » sans énergie. Pareillement, il y a des professeurs de philosophie sans philosophie. Ils font eux-mêmes partie des professeurs dits d’énergie. J’entends, ici, par professeur sans philosophie autant l’écrivassier qui pontifie dans une revue ou un journal, que le bavard qui ergote dans une chaire. Et quelle philosophie que celle qu’ils enseignent ! Une philosophie morte, une philosophie sans âme, et quand par hasard, ils côtoient la vraie philosophie, c’est pour l’étouffer.
De toutes les manies qui tyrannisent l’âme humaine, la philosophomanie est peut-être la moins curable. Nos philosophomanes ne perdent aucune occasion de montrer leurs talents. Ils font des discours à tout propos. Aussi réussissent-ils en politique et dans l’administration.
Des gens tiennent commerce de philosophie, comme ils vendraient du sucre ou des épices. La philosophie est un métier qui n’exige ni beaucoup de savoir, ni beaucoup de talent. Cette philosophie alimentaire, en harmonie, si je puis m’exprimer ainsi, avec ce qui ne comporte aucune espèce d’harmonie, — avec la critique et l’esthétique alimentaires, qui nourrissent pas mal de gens, — philosophie qui flaire d’où vient le vent et flatte les passions, — comment la prendre au sérieux
Inexistante, elle n’en existe pas moins parles ravages qu’elle exerce. C’est le contraire de toute philosophie, car sous ce nom on ne peut désigner que ce qui est libre et vivant. Ces « philosophes » sans philosophie, dépourvus d’héroïsme à tous les points de vue, n’appartiennent pas, quels que soient leurs titres et leurs chamarrures, à l’histoire de la philosophie. Rompre avec leur enseignement, ce devoir s’impose à qui ne cherche pas dans le jargon philosophique un moyen de se distinguer du vulgaire. Sous les apparences dont se revêtent les pontifes, leur vraie nature apparaît : un geste maladroit révèle leur basse mentalité. Tôt ou tard, l’insincérité des penseurs de la médiocratie se manifeste. Ils se montrent tels qu’ils sont. Que les impuissants cherchent dans « la philosophie », comme d’autres dans l’art et la littérature, un moyen de faire parler d’eux, rien de plus logique. Le contraire nous étonnerait. On ne peut cependant se résoudre à contempler ce spectacle sans protester. Philosophe sans philosophie, ôte ton masque ! Que le vide de ta pensée soit enfin révélé !
En marge des philosophies « officielles », les philosophies indépendantes font leur chemin. Elles apportent à l’humanité des directives nouvelles. Par elles, l’individu s’augmente et s’embellit. Il approcherait de la perfection, l’être qui joindrait l’harmonisme de Louis Prat au subjectivisme de Han Ryner.
Toute philosophie vraiment digne de ce nom doit commencer par une critique de l’autoritarisme sous toutes ses formes, y compris l’autoritarisme philosophique. Elle ne peut rester indifférente au triomphe du mensonge, mais dans cette lutte de chaque instant contre le mensonge, qui est sa raison d’être, elle ne se compromet point. Elle ne doit pas perdre de vue les hauteurs, si elle veut agir efficacement. Elle contribue au progrès des esprits par sa sérénité même. Sa polémique est supérieure. Ce n’est pas la petite polémique des mécontents et des aigris. Elle renonce à tout sectarisme. C’est ainsi que la philosophie, en s’élevant sur les sommets, devient cette « existence volontaire au milieu des lacs et des hautes montagnes », dont parle Nietzsche.
Le philosophe ne s’abaisse pas à la polémique vulgaire qui ne sort pas de l’insulte et de la calomnie. Il polémique à sa manière. Sa polémique est désintéressée. II n’a en vue que l’intérêt de la vérité. Il dit tout ce qu’il pense. L’indulgence du philosophe n’est pas faiblesse. Il n’épargne personne, et ne s’épargne pas lui-même.
Avec le sage Han Ryner, je dirai :
« L’équilibre philosophique consiste à éviter également de tyranniser et d’être tyrannisé. Le désir du philosophe, c’est de se sentir libre parmi des mouvements libres. »
C’est également le désir de l’artiste, du créateur de beauté sous toutes ses formes, — de quiconque n’est pas un eunuque, mais un vivant.
La véritable philosophie a nom sagesse. La sagesse d’autrui s’éveille au contact de la nôtre, comme la nôtre a son contact. Il y a entre les êtres un échange de sentiments qui peut aider à libérer les êtres. Découvrir, au contact d’autrui, notre philosophie, de même qu’autrui découvre sa philosophie au contact de la nôtre, c’est recevoir autant que donner. Chaque être se donne dans la mesure où il peut se donner, mais il y a, dans l’humanité, des êtres qui, n’ayant rien à donner, ne s’enrichiront jamais spirituellement.
La philosophie doit quitter son visage sévère pour revêtir le visage souriant de la sagesse. Elle doit se laisser facilement aborder. Quand la philosophie est sagesse, elle existe vraiment. La véritable philosophie n’est ni triste, ni follement gaie. Elle ignore les joies factices comme les pleurs hypocrites. Elle se meut dans la joie sereine comme dans la profonde douleur. Elle est une compagne qui nous soutient dans l’affliction et partage nos espérances.
La philosophie rend jeune. Elle a le privilège de conserver à l’homme la fraîcheur de ses sentiments, tout en accroissant la vigueur de son esprit. Elle en fait un être capable de vibrer et d’aimer, autant que de penser et d’agir. Le véritable philosophe est une harmonie qui se déploie librement au sein de la vie.
L’existence du philosophe a son unité. Elle est pareille à une architecture bien équilibrée, à une statue aux lignes pures, à un poème vivant et libre. On la contemple comme on contemple un beau vase aux contours harmonieux.
Que notre philosophie soit notre vie même. Faisons passer nos idées dans nos actes. Qu’est-ce qu’une philosophie qui se contente de belles paroles ? Une mystification. Ce qui caractérise le pseudo-philosophe, c’est l’écart qui existe entre sa pensée et ses actes. C’est son insincérité.
La philosophie, c’est la vie même. La vie se charge de réduire à néant toutes les pseudos-philosophies.
« Ah ! ces philosophes ! » disent, avec un petit air entendu, des gens qui ne savent même pas ce que c’est que la philosophie. Ils veulent évidemment dire par là :
« Ces fous, qui n’ont pas des idées comme tout le monde, qui ne font rien comme les autres, ces utopistes, ces rêveurs, qui vivent dans les nuages. »
Et ils les prennent en pitié, parce qu’ils méprisent l’argent et les honneurs. Sans s’en douter, ils assignent à la philosophie son véritable but : combattre, en restant sur les hauteurs, le mensonge sous toutes ses formes.
Les imbéciles ont pour les philosophes un souverain mépris. Ils affectent de ne pas les prendre au sérieux. Ils ne prennent au sérieux que les pseudo-philosophes sortis de leurs rangs, qui se chargent de les guider et de les éclairer. Mais pour l’homme qui pense par lui-même, ils n’ont que de la commisération. Le philosophe est, comme l’artiste, relégué parmi les bouches inutiles. Du moment qu’il ne fait pas de politique, c’est un être nuisible. C’est un fou dangereux, qu’il faut mettre hors d’état de nuire.
Si les philosophes sont des « fous », au dire des esprits pratiques, ils le sont à leur manière, de même que ces derniers le sont en leur genre. Ce n’est pas le même genre de « folie ». La folie du philosophe ne quitte pas les sommets ; celle des gens pratiques stagne dans les bas-fonds. La folie du premier est utile à l’humanité, celle des seconds lui est nuisible. L’idée fixe de l’artiste n’est pas celle du non-artiste. Le premier aspire à réaliser la beauté, le second se complait dans la laideur. En quoi le philosophe qui médite sur le ciel constellé d’étoiles est-il plus insensé que l’homme d’affaires courbé sur des chiffres, dont le cerveau s’affole à la pensée qu’il a fait une mauvaise spéculation, que le politicien qui se maintient au pouvoir à force d’acrobaties, que le mercanti qui cherche à voler le plus possible sa clientèle, etc. ? Tous ces gens-là sont fous, terriblement fous. Le philosophe est moins fou, assurément, que ces déchets d’humanité.
Débarbariser l’âme humaine, la philosophie n’a pas d’autre but.
Comme tout art, la philosophie suppose la science. Ses racines plongent dans la science pour en extraire la sève qui s’épanouira en fleurs et en fruits. Philosophie et science sont inséparables. Les isoler, c’est les mutiler. S’appuyant sur la science, la philosophie rejoint l’art. Elle devient esthétique. Elle affirme la nécessité de l’art dans la vie humaine, à la place de la politique et de la morale, qui sont des négations de la vie. La philosophie esthétique exige, de la part de l’individu, une vie libre, une vie vivante dégagée de toute laideur. Elle s’appuie sur la réalité pour dépasser la réalité.
Ce n’est pas toujours, chez les professeurs de philosophie, que nous trouvons la vraie philosophie. Nous trouvons, chez eux, des bavardages sur la philosophie des autres, qu’ils approuvent, si elle est amorphe, qu’ils combattent, si elle est sincère. La philosophie doit être cherchée beaucoup plus dans les ouvrages des critiques, essayistes, romanciers, poètes et dramaturges, qui ont quelque chose à nous dire, que du côté des philosophes qui ont usurpé ce titre par leur savoir-faire et leur habileté. Même dans une chaire « officielle », un penseur original peut renouveler la philosophie et se montrer sincère. Rares sont ces esprits d’avant-garde que leur métier n’a pas corrompu. Ils n’en ont que plus de mérite. Mais vraiment on les compte.
La philosophie est la recherche de l’harmonie sous toutes ses formes. Etre philosophe, c’est tenter de concilier dans sa personne l’amour et la raison, le conscient et l’inconscient. La philosophie est une esthétique et le philosophe un artiste. La vie humaine peut être une œuvre d’art, au même titre qu’un poème. Elle exige, comme l’art, indépendance et sincérité.
Des gens s’intitulent « philosophes » comme ils s’intituleraient n’importe quoi. Ils vendent de pseudo-idées Et vivent de mystifications. Ces mercantis de la pensée ont des prétentions sans bornes. Le tort qu’on a, c’est de les prendre an sérieux. De même qu’il existe une « critique alimentaire », une esthétique et une morale « alimentaires », etc., qui empêchent certains individus de mourir de faim, il existe une philosophie « alimentaire » destinée à engraisser les pseudo-penseurs. Ils exploitent un « filon » et vivent aux dépens de la bêtise humaine. Ce sont des malins qui se croient très forts. Ils le sont, en effet, en un certain sens. On les prend pour de grands esprits. La philosophie alimentaire suppose toutes sortes de compromissions. Le pseudo-philosophe se voit contraint de trahir ses amis et de flatter ses ennemis. Il fait de la politique. Il mange à tout les râteliers. C’est une espèce de « déclassé » qui arrive à ses fins. Il possède l’intelligence des affaires, plus que celle de la philosophie. Ces philosophes politiciens restent toute leur vie des « ratés » malgré leurs titres et les grades.
La philosophie est l’expression d’un cerveau affranchi qui pense par lui-même. Ne demandons pas de penser par eux-mêmes aux pseudo-philosophes. Leur pensée ne leur appartient pas. Moins ils ont d’originalité, plus ils ont de prétentions. Leur cerveau est compliqué comme leur existence. Vide, comme elle. Ils ne font rien, naturellement. Le philosophe véritable est un être simple. S’il se tient à l’écart de la foule, ce n’est point par vanité. Loin de chercher à leur en imposer par ses grands airs, il passe inaperçu au milieu des hommes. Il n’essaie pas d’attirer l’attention sur lui par des grimaces. Sa sérénité est celle du sage. Les pontifes affectent une sérénité qui ne trompe que les imbéciles. La sérénité du philosophe n’est point cette attitude équivoque qui nous fait considérer avec la même indifférence la beauté et la laideur, la vérité et le mensonge. On appelle cela planer ! Appelons cela ramper. La sérénité du philosophe n’en fait point un eunuque ; il y a dans sa sérénité une vie profonde et intense que ne connaissent point les agités. Sérénité qui n’ignore ni la souffrance, ni la joie, ni la lutte, ni le danger, et qui est faite de la volonté de rester soi-même dans tous les milieux.
Philosophie, que de bêtises on a dites en ton nom ! Je renonce à les énumérer. Par elles, ou ne peut se faire une bien belle idée de l’esprit humain. Je n’appelle pas « bêtises » des erreurs inévitables d’où peuvent naître des « vérités ». Je n’appelle pas « bêtises » des recherches non couronnées de succès, des utopies plus créatrices que de plates réalités. Qui ne cherche pas, ne s’expose pas à errer. Il y a des erreurs qui ont rendu plus de services à l’humanité que de petites vérités superficielles et transitoires. J’appelle de ce nom des divagations qui n’ont rien à voir avec la philosophie et que l’on s’obstine à confondre avec elle.
Le langage amphigourique des philosophes ne prouve point leur profondeur. Si des grands philosophes ont dit des « bêtises », de petits en ont dit bien davantage, et n’ont dit que cela. Dans leurs théories, on ne peut rien prendre. Aucune vérité ne luit dans leurs erreurs. Les autres ne se sont jamais trompés pour rien. Leur philosophie existe. La philosophie n’est pas quelque chose que l’on place au-dessus de la vie, mais qui a sa source dans la vie même. La philosophie c’est tout ce qui, dans l’art et la littérature, augmente la pensée de l’homme. Ainsi, elle est souvent hors de la philosophie.
Certaine philosophie est la négation de la philosophie. Nous arrivons à ceci, qui semble un paradoxe, que pour connaître la philosophie nous devons nous adresser à d’autres hommes qu’à des philosophes. Un philosophe devrait être un homme universel, connaissant tous les arts et pratiquant tous les métiers. Un tel homme n’existe pas. Chaque philosophe est un spécialiste : autant de sciences, autant de philosophes. Mais celui qui tente de dégager l’éternel de l’éphémère, l’unité de la variété, celui-là seul est un philosophe. Le véritable philosophe serait l’homme qui dégagerait l’harmonie des contraires. Or, je ne vois qu’une sorte de philosophes assez vivant pour réussir dans cette entreprise : l’Artiste. Et par artiste j’entends tout créateur de beauté, quel qu’il soit, le poète dans ses multiples manifestations.
Il y aurait beaucoup à dire sur la philosophie, sur ce qu’elle est et sur ce qu’elle devrait être : la philosophie devrait avoir pour but de nous apprendre à devenir meilleurs. Elle devrait consister, avant tout, dans la réforme de notre « moi ». Elle devrait avoir pour objet de nous aider à échapper à l’emprise du social, pour que nous vivions enfin notre vie. Elle devrait s’efforcer de nous faire passer de l’état de sous-hommes à celui d’hommes vivants et pensants. Nous apprendre à vivre en beauté, telle devrait être l’unique philosophie. La philosophie est un art : c’est l’art de vivre par excellence. Penser, rêver, aimer, agir, créer, il n’y a point d’autre philosophie. Appelez cela d’un autre nom, peu importe. Cela suppose une autre vie que la vie que nous vivons, cela suppose une conception de la sagesse autre que celle que l’on nous enseigne, cela suppose une humanité régénérée et embellie, autre que l’humanité que nous avons sous les yeux. Cela suppose l’affranchissement total des individus.
Il y a la philosophie morte et la philosophie vivante. La première a entretenu l’humanité dans sa laideur, elle est cette laideur même. La philosophie vivante est celle qui, dans chaque système philosophique, dans chaque œuvre d’art ou de littérature, ancienne ou moderne, représente l’idée en marche, le mouvement et l’action. La philosophie n’est point donnée une fois pour toutes : elle se fait chaque jour, mais dans ses transformations successives les mêmes éléments demeurent, dont chaque individu fait son profit pour sa libération spirituelle. A travers la philosophie qui passe s’exprime la philosophie qui demeure, et qui est faite de tous les nobles gestes, de toutes les belles pensées, de toutes les aspirations sincères, sans lesquelles l’humanité ne serait qu’un troupeau de brutes. C’est ce côté positif de la philosophie qui seul compte ; le côté négatif ne nous intéresse que comme curiosité : c’est une manifestation du néant, rien de plus. Ou ne peut vraiment donner le nom de philosophie qu’à ce qui enrichit l’esprit, l’oblige à penser, lui fait concevoir la vie d’une façon vivante, l’arrache à la servitude et à la mort sous toutes ses formes.
La philosophie devrait être une œuvre d’art et le philosophe un artiste. Au lieu de cela, la philosophie est quelque chose d’amorphe, d’où la vie est absente. C’est la plupart du temps un docte bafouillage. Ceux qui s’intitulent pompeusement philosophes, pour se distinguer du reste de l’humanité, ne sont que des farceurs ou des impuissants. La philosophie est devenue, entre les mains de la bourgeoisie, quelque chose qui n’a de nom dans aucune langue. La vraie philosophie doit être cherchée dans l’œuvre des grands artistes, et, parmi les philosophes, seuls méritent ce titre l’eux qui sont des artistes. Art et philosophie, loin de s’exclure, se confondent.
Qu’est-ce que la philosophie ? Question qui reste sans réponse, ou provoque les réponses les plus saugrenues de la part des gens. Il n’est pas facile de savoir, au juste, ce que c’est que la philosophie, quand les philosophes ne le savent pas eux-mêmes.
On dit, de certaines personnes : « C’est un philosophe », ce qui signifie :
« C’est un être qui ne s’émeut de rien, supporte tous les maux, accepte toutes les souffrances, se rit de la bêtise, et finalement renonce à l’action. »
Cependant, le véritable philosophe ne se résignera jamais à subir toutes les humiliations, toutes les privations, sous prétexte que son âme reste libre. Non, l’âme n’est pas libre qui accepte aveuglément son sort. C’est faire le jeu de la laideur que de renoncer à vivre. Cette façon d’envisager la philosophie est néfaste : celle-ci ne saurait être faite de passivité et de résignation. Le stoïcisme du philosophe n’est pas cela. La philosophie doit être la révolte la plus élevée de l’esprit humain contre toutes les iniquités.
Certes, le philosophe ne se fait aucune illusion sur la bonté de la nature et la justice des hommes. Mais il agit quand même, sans espérer quoi que ce soit, sachant que toute action n’est pas perdue, même si elle n’est pas couronnée de succès immédiat. L’action du philosophe, c’est sa pensée, et sa pensée porte toujours ses fruits.
Qu’est-ce que la philosophie ? Est-ce l’amour de la sagesse, comme l’étymologie l’indique (du grec philos, ami, et sophia, sagesse) ? C’est là son sens le plus large. Et c’est au fond son vrai sens. Mais qu’est-ce que la sagesse ? Est-ce le bon sens étroit du bourgeois, qui a peur de se compromettre s’il émet une idée ? Ce n’est point cette caricature de sagesse que la sagesse du philosophe. Dans la sagesse viennent s’épanouir les plus beaux dons de l’homme : beauté, sincérité. Etre sage n’a jamais voulu dire : reculer, avoir peur de l’inconnu, stagner. Cette conception de la sagesse est fausse. La sagesse des eunuques parodie la sagesse.
Le vocable philosophie est un vocable extrêmement complexe, qui désigne les choses les plus différentes. Elle embrasse l’univers et, dans l’univers, cet autre univers qu’est l’homme. Elle constitue une discipline supérieure, servant de trait d’union entre toutes les disciplines, différant de celles-ci tout en entretenant avec elles des rapports étroits. Elle analyse et synthétise ; elle observe et elle imagine : elle est à la fois rêve et réalité. Œuvre de science, elle est en même temps œuvre d’art : elle dégage l’harmonie de toute chose, et propose à l’homme un autre idéal que celui de manger et de boire. Sous ses multiples significations, elle est bien la science de la sagesse : tout ce que l’homme connaît n’étant pour lui qu’un moyen de s’augmenter et de s’enrichir intérieurement. Le philosophe est l’homme qui sculpte sa propre statue, la perfectionnant sans cesse, l’ennoblissant par de perpétuelles retouches, en faisant une œuvre d’art, dont la note dominante est l’harmonie.
Il y a, en dehors et au-dessus de la philosophie traditionnelle, une philosophie humaine, qui n’est enseignée nulle part, et qui est la seule qui ait un sens. Elle incarne la liberté de l’esprit dans sa plus haute expression. Elle est la forme la plus élevée du progrès.
Toute philosophie réside dans la science de la conscience et la conscience de la science. Dans le premier cas, la philosophie consiste à se connaître soi-même, afin de se diriger sans secours étranger, à perfectionner sans cesse la technique de sa vie, pour agir harmonieusement ; dans le second, elle consiste à avoir conscience du pouvoir que nous avons sur ces choses en les faisant servir à notre perfectionnement au lieu d’utiliser pour nous diminuer une science sans conscience, mise au service de la mort. Ces deux formules se complètent, ne sont que deux aspects de l’homme envisagé au double point de vue intérieur et extérieur.
A la philosophie de « classe » il ne sied point d’opposer une autre philosophie de classe, mais la philosophie tout court. La philosophie ne sert aucun parti, si chaque parti s’en sert. Elle est quelque chose d’inactuel et d’actuel à la fois, qui plane au-dessus de notre existence quotidienne et cependant se mêle constamment à elle. Ce vocable peut signifier, pour nous, autre chose que ce qu’il signifie pour la plupart des individus. Le mot « philosophie » veut dire « amour de la sagesse ». Pour ceux qui n’en comprennent pas le sens il signifie : « amour de la folie. » C’est bien, en effet, ce qu’elle est chez certains philosophes. On peut ne pas employer de formules bizarres et se garder de phrases contournées, et cependant n’être qu’un fou. La folie n’est pas qu’extravagance : elle est aussi timidité, pauvreté de fond et de forme. C’est la sagesse, et la sagesse seule, que nous recherchons, à l’aide de toutes les méthodes et sur toutes les routes. La sagesse seule nous intéresse, car en elle seule habitent la justice et la vérité. La sagesse est la forme suprême de la beauté. Hors de la sagesse, point de salut. Etre sage ne signifie pas : être timide, obéir et se résigner. Etre sage signifie vivre, mais vivre normalement, non à la façon anormale des brutes qui se prétendent normales parce qu’elles ont légalisé leurs sales instincts. Aimer la sagesse, c’est aimer la vie. Ont seuls droit au beau nom de sages ceux qui, dans l’humanité, ne piétinent pas sur place, refusent de regarder en arrière, ne s’attardent pas à répéter des lieux communs, en un mot qui ne pratiquent pas cette pseudo-sagesse en honneur dans notre société.
Il y a deux philosophies : celle du passé et celle de l’avenir. N’hésitons pas entre les deux, Cette dernière est la nôtre. A nous de la créer sur les ruines de l’ancienne. La vraie philosophie cependant ne peut être située ni en arrière, ni en avant : elle est en nous, elle réside dans notre pensée, elle est la manifestation de notre héroïsme intérieur. Elle ne connaît pas de bornes : le temps ni l’espace ne peuvent la limiter. Elle est, — ou elle n’est pas.
Notre « philosophie » n’est point une philosophie d’esclaves. Que voulons-nous ? Examiner toute chose avec nos yeux, rejeter l’esprit d’autorité, nous délivrer des chaînes qui enlisent la pensée. Quelques philosophes ont tenté ce suprême effort, mais c’était pour retomber, comme Descartes, sous le joug de l’autorité. Les uns et les autres ne semblaient rejeter les chaînes traditionnelles que pour s’en forger de nouvelles, aussi lourdes à porter. Et l’autorité était rétablie sous un autre nom, un dogme en remplaçait un autre : tout était à refaire. N’importe, même dans ces équivoques, ces compromis, il y a quelque chose à prendre. Ce qu’il y a de particulier aux systèmes philosophiques, c’est qu’on peut en tirer tout ce qu’on veut : c’est là leur point faible. C’est peut-être aussi ce qui fait leur force. Si l’on fait dire à un philosophe le contraire de ce qu’il a voulu dire, c’est quelquefois un bien. Il dit alors des paroles sensées. Il faut, d’autre part, rétablir la vérité en ce qui concerne les théories que l’on interprète à tort et à travers : combien de philosophes ont été exploités par l’ignorance ou la politique : ne les rendons pas responsables de cette exploitation. C’est une aventure qui arrive aux plus grands : on n’exploite que les forts.
Certains philosophes sont obscurs, ce qui ne veut pas dire qu’ils soient profonds. Mais, déjà obscurs par euxmêmes, ils le sont bien davantage quand leurs disciples essaient de mettre à la portée de tous leur philosophie. Les professeurs de philosophie les rendent plus incompréhensibles encore, et finalement personne n’y comprend plus rien. Evitons de leur ressembler, et ne faisons dire à tout philosophe, vrai ou faux, que ce qu’il a voulu dire. Pour discuter une doctrine, il faut la connaître. Comment la discuterons-nous si nous n’avons d’elle qu’une image tronquée ? N’obscurcissons pas à plaisir des théories suffisamment obscures par elles-mêmes, clarifions les plutôt, tâchons de les rendre compréhensibles. Sans rien abdiquer de notre liberté de pensée, faisons l’effort de nous « objectiver », en nous mettant dans la peau du personnage dont nous exposons les théories. Nous devons prendre, pour ainsi dire, à la gorge, chaque philosophe et le forcer à dire toute sa pensée, ce qu’il n’a pas dit ou ce qu’il n’a fait que balbutier. Même s’il est en désaccord avec nous, afin de mieux le combattre, nous devons nous efforcer de mieux le connaître. Un philosophe est un homme comme les autres, qui affecte de ne pas leur ressembler : montrons-le tel qu’il est, et surtout rendons-nous compte s’il n’y a point, entre sa vie et son œuvre, de contradictions, s’il a bien été sincère, et demandons-nous ce que, pour son temps, il a vraiment apporté d’utile à l’humanité. Plaçons-nous dans son milieu : alors tel philosophe qui nous apparaît en retard pour notre époque se révèlera en avance sur la sienne. Il n’a pas toujours été facile aux penseurs de dire toute leur pensée : en exprimant des demi-vérités, ils sont parvenus à dominer leur siècle et à s’imposer même aux tyrans. Voilà ce que nous ne comprenons pas toujours quand nous condamnons les philosophes du passé. Placés, comme les hommes d’aujourd’hui, entre la vie et la mort, ils ont préféré conserver leur existence, non pas au prix de reniements, mais de ruses qui leur ont permis de conserver, sinon toute leur liberté, du moins une partie de leur liberté. Chaque régime a combattu les philosophes quand ceux-ci ont fait preuve d’esprit critique en pensant par eux-mêmes. Quelques-uns ont payé de leur mort leur indépendance. Mais leur pensée leur a survécu.
Quelque ardue que soit certaine philosophie, il faut avoir le courage de s’aventurer dans ce labyrinthe : on risque d’être récompensé de sa persévérance par quelque trouvaille. La véritable philosophie ne consistet-elle pas à découvrir, même dans ce qui n’est pas vivant, même dans l’incohérence et la folie, des parcelles de vérité ? Une erreur peut être créatrice si nous la comprenons, si nous l’interprétons. Tel philosophe, qui semble loin de nous, devient ainsi pour nous un précieux collaborateur. Faisons servir la pseudo-philosophie à l’édification de la vraie, — cette philosophie profonde et humaine, où l’esprit critique domine, opposé à l’esprit de résignation et de soumission.
Même chez les philosophes les plus bourgeois, il y a quelque chose à glaner. Ils ont souvent dit des « vérités » sans le faire exprès. Ils ont été des destructeurs malgré eux. Certains ont combattu les préjugés de leur classe, la raison n’étant pas chez eux tout à fait morte. Et par là ils ont cessé d’être bourgeois. Mais quelle ironie de constater que des bourgeois élèvent des statues à des penseurs, des écrivains dont l’œuvre est la condamnation de leur vie entière. Les bourgeois n’en sont pas à une incohérence près. Cependant ni Rabelais, ni Voltaire, ni Rousseau, dans la partie vivante de leur œuvre, ne leur appartiennent : ce sont des « rescapés » qui, sortis de leurs rangs, appartiennent à une humanité qui n’offre aucune ressemblance avec celle qu’ils représentent.
Les philosophes, ce sont tous les hommes qui, dans tous les temps et dans tous les pays, ont osé penser par eux-mêmes.
Quand je dis : les philosophes, je songe surtout aux artistes. Ce sont eux surtout qui ont le privilège de penser et d’exprimer harmonieusement leur pensée.
Tous les créateurs de beauté, quels qu’ils soient, sont des philosophes. Il y a toujours, dans l’art véritable, de la pensée. Un art sans pensée est un art sans beauté. C’est un art sans vérité. C’est le faux-art. L’art est une forme de la philosophie et la philosophie est une forme de l’art. On peut remplacer ces mots l’un par l’autre, ils signifient la même réalité.
Ce qui rend les études philosophiques si ardues pour les non-initiés, ce n’est pas seulement le mystère dont elles ont été enveloppées, comme si cela pouvait leur communiquer un prestige quelconque ; c’est que, même dépouillées de cet attirail sans élégance, elles sont encore dures à digérer pour des cerveaux habitués à ne pas réfléchir. La philosophie exige un effort de pensée dont bien peu sont capables. Habitués à lire des romans d’une stupidité dont rien n’approche, à voir jouer des pièces sans idée, à ne connaître, des manifestations de l’art, que son affreuse parodie, comment les esprits pourraient-ils goûter les réflexions profondes sur la vie, les recherches désintéressées, les travaux les plus sérieux sur tel ou tel problème, que constitue la philosophie ? Il faut, pour suivre celle-ci, un effort constant, une attention soutenue. Alors que la dispersion fait son œuvre, détournant les cerveaux de la recherche de la vérité, il est difficile, même en s’y prêtant, de concentrer sa pensée, de la ramener sur un sujet qui exige de la patience, du travail et une perpétuelle tension d’esprit. Tant que les brutes seront en majorité dans le monde, seule une élite cultivera la philosophie, puisera dans son étude les plus pures joies intellectuelles.
Toute étude à laquelle on n’est pas habitué constitue, quand on l’aborde, un malaise pour l’esprit. Il y a comme une sorte de désarroi et d’hésitation dans la pensée. Ce qui est nouveau réclame de l’attention. Le cerveau doit faire un effort pour entrer en contact avec ce qu’il ne connaît pas. De là vient sans doute que tant de gens repoussent toute innovation comme dangereuse, car elle bouleverse leurs habitudes et trouble leur repos. Se contenter de ce qu’ils ont plus ou moins bien appris, et ne pas savoir autre chose, telle est l’ambition suprême de la plupart des individus. Avec la philosophie on quitte les sentiers battus et l’on s’engage sur une route peu fréquentée, aux prises avec des difficultés qui surgissent de toutes parts. On est pareil à ces explorateurs qui pénètrent pour la première fois dans un pays habité par les bêtes féroces et qui doivent défendre leur existence pied à pied. C’est pourquoi peu de gens s’intéressent à la philosophie, et par philosophie qu’il me soit permis de répéter que j’entends par là non seulement la philosophie proprement dite, mais toute réflexion profonde sur la vie, la pensée sous toutes ses formes, et en particulier, et surtout les œuvres d’art et de littérature sincères. Qui n’a pas le cerveau conformé de façon à s’intéresser à la beauté, qu’il s’en détourne, qu’il aille grossir le nombre des imbéciles et des médiocres.
Quand on aborde certaines études, il ne faut pas se laisser décourager par les difficultés du début. L’entrée du temple de la science est obscure, mais une fois qu’on en a franchi le seuil, quels merveilleux horizons se découvrent au voyageur assoiffé d’infini. Mille merveilles surgissent, et cela compense les fatigues éprouvées. Chez certains penseurs, ce qui semblait d’abord obscur devient lumière, les détails se précisent peu à peu. Ad augusta per augusta, c’est le cas de répéter à propos de la philosophie le mot que Victor Hugo prête, dans Hernani aux conjurés, mot que je traduis par ceux-ci : « On n’arrive sur les sommets qu’à force de patience, d’obstination et d’amour. »
Les arcanes de la philosophie finissent par livrer tous leurs secrets à celui qui ne se décourage pas dès les premières pages du livre qu’il vient d’ouvrir pour la première fois. Si une élite seule est capable de s’intéresser à la philosophie, cela ne signifie pas que la philosophie ne s’adresse qu’à une élite. Elle s’adresse à tous : tout homme peut être un philosophe si, dans le métier qu’il exerce, il agit librement ; si, dans son travail même gît sa libération ; s’il est artiste dans tout ce qu’il fait. Or, la société actuelle empêche les hommes d’être eux-mêmes en les contraignant aux gestes mécaniques et en bannissant l’art de leur vie. Elle leur impose des tâches absurdes et déprimantes qui en font des esclaves, des non-artistes, des semblants d’hommes. En les empêchant d’exercer un métier intelligent, elle en fait des ratés et des mécontents qui subissent leur sort sans même avoir le courage de se révolter.
Qu’on ne nous objecte point l’adage : primo vivere, deinde philosophari. « Vivre d’abord, philosopher ensuite », c’est-à-dire : discuter, spéculer, imaginer et rêver. Oui, sans doute, il faut vivre matériellement avant de songer à l’idéal. Mais ne vaudrait-il pas mieux mêler l’idéal à notre vie entière, en sorte que vivre et philosopher soit une seule et même fonction ? Dans la société capitaliste, certes, primo vivere, deinde philosophari, il faut d’abord songer à la nourriture du corps avant de songer au pain de l’esprit. Dans une société vivante, ce fossé n’existerait plus. Il n’y aurait plus, entre philosopher et vivre, de barrière. C’est qu’en effet l’idéal existerait en chacun de nos gestes, et toute besogne cesserait, par là même, d’être inférieure. On ne vivrait plus pour manger, on mangerait pour vivre de la vie de l’esprit, sans que la vie matérielle soit un obstacle au développement de cette dernière, au lieu qu’aujourd’hui il y a antagonisme entre la pensée et l’action.
Toute philosophie n’est au fond que l’esprit critique analysant chaque chose, destructeur et constructeur à la fois. En même temps qu’il manie la pioche du démolisseur, l’esprit critique pose les fondements d’un nouvel édifice à la place de l’édifice vermoulu qu’il vient d’abattre. On ne conçoit pas que la critique se contente de détruire, ce n’est là qu’une partie de sa tache ; à côté de cette besogne négative, une besogne positive s’impose à elle. C’est celle d’introduire de l’ordre dans les idées, de libérer les sentiments du mensonge, de dépouiller le vieil homme qui sévit sous le masque de l’homme civilisé. Le philosophe a deux fonctions : montrer que les « valeurs » anciennes ne correspondent plus aux besoins profonds de la conscience humaine, et leur substituer des valeurs nouvelles. Toute philosophie comporte une part de négation et une part d’affirmation. Négative, elle voit dans chaque problème son côté fragile, factice et transitoire ; affirmative, elle en considère le côté positif, durable et vivant qui constitue le meilleur de la pensée humaine. Il s’agit d’édifier, en utilisant les matériaux les plus purs, les plus solides parmi ceux que nous a légués le passé, un édifice sain, aéré et propre. Cet édifice s’élève un peu plus chaque jour, mieux équilibré et plus harmonieux, auprès duquel l’agitation des hommes vient mourir comme les flots de la mer viennent se briser sur les rochers du phare qui les domine.
A côté de l’enseignement de la philosophie, se place l’histoire de la philosophie, qui en est inséparable. On ne peut rien comprendre à la philosophie si on ne sait rien de son histoire. On est constamment obligé de faire appel à celle-ci quand on étudie les problèmes les plus variés. Sur telle ou telle question, on cite l’opinion d’un ou de plusieurs philosophes, ayant eu un système original et personnel. A chaque instant, on se trouve en présence d’une école, qu’il faut connaître, discuter, quand on examine un problème d’une façon sérieuse. C’est pourquoi il est indispensable de commencer un cours de philosophie par l’histoire de la philosophie, surtout si l’on s’adresse à des profanes qui n’ont qu’une vague idée de la philosophie. Loin de rebuter l’auditeur, elle l’intéresse. C’est une sorte d’initiation sans fatigue pour l’esprit. Pour des débutants, qui sont censés tout ignorer de la philosophie, les mettre en contact avec son histoire, les familiariser avec certains noms, c’est leur faciliter leur tâche, c’est leur rendre moins aride une étude qui exige un effort intellectuel continu ; quand ils aborderont la philosophie proprement dite, ils auront une idée de celle-ci, ils seront moins dépaysés, et en mesure de réfléchir et de discuter. L’histoire de la philosophie doit servir d’introduction à l’enseignement philosophique. Avec elle, on s’initie peu à peu à l’étude des grands problèmes que l’homme intelligent ne peut pas ne pas se poser. Il s’en dégage une leçon qui constitue pour ainsi dire la philosophie de l’histoire de la philosophie.
Histoire intéressante et vivante entre toutes, que celle de la philosophie. En étudiant les philosophes, on se rend compte de la marche de l’humanité, de ses tâtonnements, de ses illusions, de ses désillusions, de l’éternel va et vient de l’esprit humain à la recherche de l’absolu ; on voit les erreurs succédant aux erreurs, et quelquefois on découvre dans cet arsenal de systèmes un pur diamant qui resplendit, car il contient une parcelle de vérité.
— Gérard de LACAZE-DUTHIERS.
PHILOSOPHIE
Ami de la sagesse. Pour l’antiquité, le terme de sagesse doit être entendu dans le sens de connaissance. Le philosophe, celui qui connaît, qui pense, alors que les autres se contentent de vivre. De nos jours encore, le peuple appelle volontiers philosophe l’homme qui réfléchit, qui a des idées.
La philosophie antique comprend toute la connaissance, aussi bien les sciences dans leurs détails que les problèmes derniers de l’univers. Aristote, philosophe, est aussi physicien et naturaliste. Plus près de nous, Descartes, l’auteur du « Discours de la méthode », est mathématicien et physiologiste (théorie des esprits animaux). Mais les sciences se dégagent l’une après l’autre de la philosophie et il ne lui reste plus que quatre départements de la connaissance : la psychologie, la logique, la morale et la métaphysique. La psychologiedemeure dans les manuels classiques de philosophie, mais c’est seulement par l’effet de la routine. Elle est une science, la science de l’esprit humain, comme telle, elle a droit à l’indépendance au même titre, par exemple, que l’anatomie, science du corps humain.
La logique, art de bien raisonner, constitue aussi un objet autonome de connaissance.
La morale, à son tour, doit être affranchie de la philosophie. Jusqu’à l’époque contemporaine, on croyait que la connaissance du bien et du mal nous venait soit de Dieu, soit d’on ne sait où (impératif catégorique de Kant). Aujourd’hui, on sait que la morale est humaine, qu’elle est un ensemble de conventions : des bonnes et des mauvaises qui se sont développées au cours de l’évolution sociale des peuples. C’est donc à la sociologie et non à la philosophie que la morale doit être rattachée. Ainsi, il ne reste à la philosophie que la métaphysique, connaissance des problèmes les plus généraux de l’univers.
On a dénié à la métaphysique le droit à l’existence. Voltaire en faisait une manière de folie et Auguste Comte voulait qu’on la rayât de la connaissance.
La métaphysique est cependant un progrès, un progrès sur la religion. Les fondateurs de religions : Moïse, Jésus, Mahomet, etc., se prétendaient les détenteurs d’une révélation divine. Le métaphysicien, s’il croit en Dieu, ne dit pas avoir eu avec lui soit une entrevue directe, soit une inspiration quelconque. C’est avec sa raison seule qu’il veut étudier l’univers. Que vaut son étude ? Evidemment, elle est relative. Le savant, lui aussi, se sert de sa raison, mais à la base de son étude, il y a toujours les faits d’observation qu’il a constatés avec ses sens et que chacun peut constater comme lui, s’il se met dans les mêmes conditions. Le métaphysicien, enfermé dans son cabinet n’a devant lui que son papier pour écrire. S’il étudie, c’est seulement dans les livres, les pensées que les autres métaphysiciens se formaient de l’univers. Il les répète, les critique ou les combine entre elles, pour en former de nouvelles.
Est-ce là un travail inutile ? Pas complètement. La connaissance des faits ne suffit pas ; il est bon de faire des synthèses, de se demander de quoi l’univers est fait ; s’il a ou n’a pas de but, etc.
Les résultats de ces études ne sont pas il est vrai encourageants. Si la science est fertile, si, grâce à elle, on peut voler dans les airs, communiquer en quelques minutes avec toute la terre, la métaphysique est stérile. Bacon l’a comparée à une vierge consacrée à Dieu, et a dit qu’elle n’enfantait rien. La raison du métaphysicien se heurte à un mur. Il découvre que, tout étant fonction de notre esprit, nous ne pouvons rien savoir de la réalité des choses. La raison même en arrive à douter d’elle-même et l’esprit humain, en dernière analyse, se réduit à l’état de conscience présent, point psychologique, comparable au point mathématique qui n’a ni longueur, ni largeur, ni hauteur ; c’est-à-dire qui n’est rien.
Malgré ces négations, l’étude de la métaphysique n’est pas complètement inutile. Il est bon de savoir qu’en étudiant les faits, nous n’atteignons pas l’absolu, mais restons à jamais enfermés dans le relatif. La métaphysique comporte plusieurs écoles.
Le spiritualisme, comme son nom l’indigne, admet qu’au-dessus de la matière il y a l’esprit qui, tout en ayant besoin d’elle, en est indépendant. En général, le spiritualisme admet Dieu. Parfois, il le nie d’une manière honteuse. Par exemple lorsqu’il dit que Dieu est un « devoir être », qu’il n’est pas, mais qu’il sera. Autant dire que Dieu c’est le progrès et se déclarer athée.
Le matérialisme n’admet que la matière. Les religions de toute espèce se sont acharnées sur lui. On a dit qu’il était grossier, générateur de crime (les pourceaux du troupeau d’Epicure). Les charlatans religieux ne lui pardonnent pas de vouloir lui enlever leur pain et leur puissance, en portant l’humanité à se passer de leur prétendue médiation avec le divin.
Les savants officiels d’aujourd’hui, valets de la bourgeoisie, déclarent que le matérialisme est infirmé par la science, parce que la physique a découvert les ions et les électrons.
La découverte des atomes d’électricité n’infirme en rien le matérialisme. La matière, c’est ce qui est, ce que l’on peut observer, ce n’est pas nécessairement l’atome solide et insécable d’Epicure.
Le scepticisme, systèmes de Berkeley, de Hume, d’Hamilton, etc., déclare que nous ne pouvons rien savoir de la nature des choses, parce que tout est fonction de races. C’est une doctrine irréfutable mais dangereuse. Nous avons besoin de faire, à la base, un acte de foi. « Je crois au monde extérieur », mais cet acte de foi suffit ; après lui, la porte est fermée aux autres.
— Doctoresse PELLETIER
PHILOSOPHIE
Le dictionnaire désigne par le mot philosophie la science générale des êtres, des principes et des causes. Au figuré, l’art de s’élever au-dessus des incidents de la vie courante. Sous ce vocable, on désigne aussi la classe, le cours où l’on enseigne la morale, la psychologie, la logique et la métaphysique.
La philosophie ancienne était l’amour de la sagesse, même chez ceux qui n’aspiraient pas à la connaissance de la vérité qui pourrait les orienter vers la connaissance de la vraie sagesse. Au XVIIIe siècle, la philosophie est devenue la négation de l’erreur, ou plus exactement de tout ce dont la vérité ne pouvait pas être démontrée.
L’objet de la philosophie est de répondre, par de bonnes raisons, claires et péremptoires, à la question fort simple que voici : pourquoi doit-on, quoi qu’il puisse en coûter, ne jamais nuire aux autres, soit par la violence, soit par tromperie, en leur faisant du mal, ou encore en ne leur faisant pas tout le bien qu’on pourrait leur faire. Cette question résolue, la vraie science est fondée. Alors la société s’organise rationnellement, la morale existe et devient la clé de voûte de l’édifice social.
Mais pour arriver à cet état d’esprit individuel et collectif, il faut que la philosophie enseigne par des connaissances positives établies incontestablement, qu’il n’est pas indifférent, comme résultat social, de se conduire honnêtement, de pratiquer la justice dans les actes de la vie courante.
L’amour rationnel de soi, et non l’amour passionnel, rend obligatoire le dévouement à son prochain comme condition de son propre bonheur. Il n’y a pas deux études, a dit Origène ; l’une de la philosophie, l’autre de la religion. La vraie philosophie est la vraie religion et la vraie religion est la vraie philosophie. Faut-il conclure que la philosophie de l’avenir continuera la philosophie actuelle ou l’ancienne philosophie ?
La Philosophie de l’Avenir, sous peine de rester dans la même impuissance sociale, ne doit même pas continuer les philosophies précédentes ; elle leur succédera de la même manière que le jour succède à la nuit sans la continuer.
Aux ténèbres de la nuit succèdera la lumière de vérité et de justice qui démontrera à chacun et à tous les multiples avantages de l’équité dans les rapports sociaux. La philosophie doit démontrer scientifiquement que l’Humanité récolte selon qu’elle a semé.
— Elie SOUBEYRAN
PHYSICISME
n. m.
Pour expliquer les phénomènes qu’ils étudient, les biologistes et les médecins tendent de plus en plus à abandonner le terrain purement chimique. Ils font appel à la physico-chimie, à la physique, à la mécanique. Ainsi se développe progressivement la conception que, depuis des années, j’ai systématisée sous le nom de physicisme biologique.
J’insiste sur ce point. Le physicisme n’est pas une hypothèse, en vue de l’esprit. C’est une méthode de recherche positive, dont les résultats acquis conduisent à une sorte d’identification du « vivant » et du « nonvivant », des « êtres » et des « choses ». Devant ses conquêtes, disparaît l’idée d’inertie. Inversement, nulle loi d’exception ne s’applique à l’organisation. Les structures, les fonctions, les mouvements sont justiciables des mêmes procès et des mêmes énergies dans le règne biologique et dans le règne minéral. Je ne reviendrai pas ici sur ces aperçus et les faits sur lesquels ils s’appuient, les ayant largement exposés dans de nombreux articles et mémoires, et surtout dans le Dictionnaire de biologie physiciste et dans Les Horizons du Physicisme (Maloine, éditeur). Il suffira d’ajouter que chaque jour apporte à ma conception, d’ailleurs entrevue parallèlement par d’autres investigateurs, un nouvel appoint de travaux confirmatifs, dont l’ensemble permet déjà d’entrevoir l’étonnante fécondité d’une telle orientation.
C’est ainsi que le docteur Jules Regnault, dont le nom, — popularisé par l’opération qu’il pratiqua sur lui-même en 1912, — est attaché à de nombreuses recherches scientifiques poursuivies depuis près d’un tiers de siècle, vient de publier un ouvrage remarquable sur les Méthodes d’Abrams (Maloine, éditeur, 1927), qu’il a contrôlées, étendues, mises au point.
Albert Abrams, médecin américain d’origine israélite, mort à San Francisco en janvier 1924, a consacré toute sa carrière à l’étude des réflexes viscéraux, c’est-à-dire des réactions organiques inconscientes provoquées par des excitations nerveuses. Il en a tiré une première méthode thérapeutique, la spondylothérapie, qui emploie dans un but curatif les réflexes déterminés par des actions physiques variées, — froid, pression, courant de haute fréquence, percussion, — portant sur des points convenablement choisis au voisinage de la colonne vertébrale. Puis, il est arrivé à la médecine dite électronique, en constatant que les diverses maladies présentent une polarité caractéristique de leur énergie, dont certains réflexes, peuvent être utilisés comme « détecteurs ».
Abrams et Regnault considèrent l’économie comme un système vibrant formé d’une juxtaposition de champs électro-magnétiques. A chaque maladie répond une fréquence vibratoire déterminée, et l’expérience montre qu’en faisant traverser l’organisme par un courant de haute fréquence à période oscillatoire variable, certains rythmes provoquent des phénomènes de résonance dont on peut tirer parti pour agir sur les tissus et détruire l’état morbide. Abrams dit :
« Chaque objet a une certaine période naturelle de vibration. Si nous approchons d’un objet une source de vibration de même rythme vibratoire que lui, la vibration forcée de l’objet atteint une amplitude telle, qu’elle peut le briser ou le détruire entièrement. »
C’est pour cette raison, ajoute J. Regnault, qu’un chanteur puissant, après s’être rendu compte de la note donnée par un verre de cristal, le brise facilement en poussant cette note au-dessus du verre. Par les méthodes d’Abrams, on obtient le même effet destructeur sur les cellules morbides. Il y a là, sans doute, l’une des plus notables indications curatives sur les maladies néoformantes, tuberculoses et cancers. Mais c’est également une curieuse démonstration, sur le « vivant », du physicisme biologique. Et cette démonstration prend un intérêt sans précédent de l’ingéniosité des dispositifs expérimentaux que le docteur Abrams, puis le docteur J. Regnault, — plus physicien que le « physician » américain, — ont dû successivement imaginer et perfectionner.
J’ai dit ailleurs (Horizons du Physicisme) que les lois physiques sont strictement valables pour les êtres organisés, et j’en ai cité plusieurs exemples typiques. D’après Jules Regnault, la théorie des quanta serait aussi applicable aux organes. On sait que Max Planck appelle « quanta » les quantités d’énergie minima nécessaires pour produire un effet. N’importe quelle quantité faible ne suffit pas forcément à déclencher un phénomène ; et d’autre part, une quantité plus forte que le quantum n’agit pas davantage que lui. Aussi, la Nature procède-t-elle par bonds, ce qui expliquerait les mutations brusques étudiées par Hugo de Vries. Cette loi du « tout ou rien » s’applique à la posologie des extraits organiques. Si, à une poule chaponne, on greffe quelques centigrammes de testicule, elle reste chaponne. Rien n’apparaît jusqu’à ce que la dose atteigne 0 gr. 45. Alors, explosent subitement les attributs du mâle. Une dose plus forte ne donne pas plus : la dose minima est en même temps la dose optima, c’est-à-dire la plus favorable à l’accomplissement du phénomène. Pezard a obtenu les mêmes résultats quand il a injecté du suc testiculaire frais (Les méthodes d’Abrams, p. 177).
Si l’on ajoute à ces données, toutes plus ou moins nouvelles, les travaux de J. Vallot, G. Sardou et Maurice Faure relatifs à l’influence des tâches solaires sur les accidents aigus des maladies chroniques ; ceux de Faure sur les recrudescences de morts subites provoquées par la même cause ; ceux de Jules Regnault, de Maurice Roblot, de Franck-Duprat, de Al. Bécédéef, sur les influences cosmiques (Côte-d’Azur médicale, avril 1927), les miens, sur l’action du tourbillon terrestre et des vibrations telluriques sur l’organisation et la morphologie des animaux et des plantes (Côte-d’Azur médicale, 1924–1927), on se rend compte de l’importance croissante des considérations physiques dans l’élucidation des déterminismes biologiques. On s’aperçoit en outre que les êtres, les choses et les mondes, apparaissent aux yeux du physicien comme des juxtapositions de champs de force, — probablement de champs électromagnétiques. L’activité mécanique dérivée de ces champs de force constitue la Vie, et celle-ci est universelle, puisque inhérente à la nature même du Tout et de ses parties ; éternelle comme l’univers auquel nous ne pouvons assigner ni premier commencement, ni fin ultime ; et solidaire en vertu des inévitables influences mutuelles des champs de force.
Cette « grande vérité » du Physicisme peut seule servir de substruction, pour les esprits éclairés de notre époque, à un credo philosophique et à une morale objective. Sa mise à jour aura été, en dehors de toutes les vaines agitations de la fourmilière, la formidable révolution humaine du XXe siècle de notre ère. Elle a déjà sa phalange d’apôtres et de disciples groupés autour de notre ami F. Monier, le penseur des Lettres sur la Vie. Ce groupe d’esprits généreux et avertis, j’ai nommé l’Association internationale biocosmique, n’est encore qu’un jeune arbrisseau, mais gonflé de sève, en pleine croissance ; et demain, peut-être, ses rameaux élargis abriteront l’humanité d’un tutélaire ombrage.
— Albert MARY.
PHYSICO-CHIMIE, PHYSICISME BIOLOGIQUE
Longtemps, physique et chimie restèrent séparées. La première, disait-on, étudie les propriétés générales des corps, les phénomènes superficiels et passagers qui n’altèrent pas leur structure intime ; la seconde étudie les phénomènes profonds qui modifient leurs qualités constitutives et permanentes. Ainsi, la chaleur, phénomène physique, n’enlève pas aux corps leur individualité propre : leurs caractères primitifs reviennent dès qu’elle a disparu. Quand l’oxygène et l’hydrogène se combinent pour donner de l’eau, le fait s’avère d’ordre chimique, au contraire, car il suppose une durable métamorphose. Présentement, la physique est définie la science des transformations de l’énergie, la chimie celle des transformations de la matière. Mais les barrières établies entre elles disparaissent graduellement ; dans certaines branches particulières, leur fusion est un fait accompli. Une science jeune, qui déjà compte à son actif d’importantes et nombreuses découvertes : la physico-chimie, étudie les phénomènes que peuvent également revendiquer le chimiste et le physicien. Toutes les recherches chimiques effectuées par des procédés physiques, celles d’un Curie, d’un Perrin, d’un Millikan par exemple, rentrent dans son domaine. Théorie électronique de la matière, structure intime de l’atome, mouvement brownien et, d’une façon générale, ce qui concerne la dynamique intra-atomique, voilà les sujets qui, à l’heure actuelle, retiennent de préférence son attention. Et, si elle doit nous arrêter, c’est à cause de ses résultats théoriques, plus remarquables encore que les applications pratiques, pourtant prodigieuses, dont elle est la source. Dès aujourd’hui, la physico-chimie permet de répondre à ces questions, considérées par les philosophes comme essentiellement métaphysiques : qu’est-ce que la matière, d’où vient notre univers et quelle sera sa destinée, comment naissent et meurent les mondes ? En un mot, au problème longtemps énigmatique de l’origine première, elle fournit une solution. Preuves, entre bien d’autres, que l’inconnaissable des positivistes n’est tel que provisoirement et, qu’avec un peu de patience, la raison appuyée sur l’expérience déchirera les voiles dont s’entourent métaphysique et religion. Mais la presse, qui parle complaisamment des effets pratiques de la radioactivité, ne dit pas que les récentes découvertes physico-chimiques rendent absolument inutile l’hypothèse d’un dieu créateur. De plus les esprits ne sont pas habitués à concevoir les phénomènes cosmiques comme se déroulant, non en ligne droite, mais sur le modèle d’un cercle fermé. Ils ne comprennent pas que la mort de mondes vieillis provoque infailliblement la naissance de mondes nouveaux ; sans qu’on puisse parler d’origine première ou de fin ultime, car il s’agit des phases successives d’un processus circulaire qui se répète indéfiniment. Dans Face à l’Eternité, puis dans la préface du livre de G. Kharitonov, Synthanalyse, j’ai insisté sur ces idées, sachant d’ailleurs qu’elles étaient trop neuves, trop contraires aux conceptions traditionnelles, pour être comprises immédiatement.
Si, dans un tube de verre, où passe un courant électrique, on pousse le vide jusqu’à une pression comprise entre 1/100.000ème et 1/1.000.000ème d’atmosphère, toute colonne lumineuse disparaît ; par contre, la paroi opposée à la cathode s’échauffe et s’illumine d’une lueur verdâtre ou violette. Crookes, le premier, observa ces phénomènes en 1886. Des rayons sont émis par la cathode, qui semblent constitués par des particules de matière transportant de l’électricité négative et animées d’une extrême vitesse. Au voisinage de la cathode, les molécules de gaz restées dans le tube seraient décomposées en ions positifs, absorbés par la cathode, et en ions négatifs qui, projetés en ligne droite, constituent les rayons cathodiques. La vitesse des particules ainsi projetées est de 40.000 à 60.000 kilomètres par seconde ; elle varie d’après la différence de potentiel qui, dans le tube de Crookes, existe entre les deux électrodes. Ainsi le rayonnement cathodique apparaît constitué d’éléments infimes, arrachés aux atomes des corps. Ces constatations devaient conduire à la théorie électronique de la matière et au problème de la structure de l’atome. Les découvertes d’Henri Becquerel, un peu plus tard, puis de M. et Mme Curie aboutirent à des conclusions de même ordre. Après de minutieuses recherches, Henri Becquerel résumait ainsi ses observations, en 1896 :
« L’uranium et tous les sels d’uranium émettent un rayonnement invisible et pénétrant qui produit des actions chimiques, photographiques et décharge à distance les corps électrisés. Ce rayonnement paraît avoir une intensité constante, indépendante du temps et n’être influencé par aucune cause excitatrice extérieure connue. Il paraît donc spontané. Il traverse les métaux, le papier noir et les corps opaques pour la lumière. La plaque photographique et l’électroscope forment les bases des deux méthodes d’investigation pour étudier le nouveau rayonnement. La propriété radiante est liée à la présence de l’élément uranium : c’est une propriété atomique, indépendante de l’état moléculaire des composés. Les corps frappés par le rayonnement nouveau émettent eux-mêmes un rayonnement secondaire qui impressionne une plaque photographique. »
On découvrit ensuite que le thorium et ses composés provoquaient des phénomènes identiques. Puis M. et Mme Curie remarquèrent que certaines chalcolites et certaines pechblendes étaient deux à quatre fois plus actives que l’uranium. Mme Curie déclarait :
« Il devenait dès lors très probable que si la pechblende, la chalcolite, l’antunite ont une activité si forte, c’est que ces substances renferment, en petite quantité, une matière fortement radioactive, différente de l’uranium, du thorium et des corps simples actuellement connus. J’ai pensé que s’il en était effectivement ainsi, je pouvais espérer extraire cette substance du minerai par les procédés ordinaires de l’analyse chimique. »
En juillet 1898, Curie et sa femme annonçaient qu’ils avaient trouvé un corps quatre cents fois plus actif que l’uranium ; ils l’appelèrent polonium. En décembre de la même année, on apprenait qu’ils avaient extrait de la pechblende un corps neuf cents fois plus actif que l’uranium, et célèbre aujourd’hui sous le nom de radium. Depuis, on a isolé d’autres éléments radioactifs. Le radium dégage spontanément de la chaleur, de l’électricité, une lumière visible dans l’obscurité ; il produit des effets chimiques, provoque la luminescence de certaines substances, émet un triple rayonnement invisible. Tons les sels de radium dégagent une substance inconnue, qui se comporte comme un véritable gaz et produit, en se détruisant, de l’hélium, le plus léger des gaz après l’hydrogène. Dès lors, il apparut extrêmement probable que toute matière pondérable était d’origine électrique. (Voir article Matière.) Et l’on put concevoir comment naissent, meurent et renaissent les substances tangibles qui constituent l’univers observable. Bien des retouches seront apportées, sans doute, aux conceptions de G. Kharitonov. Il est même possible que l’origine et la fin des mondes soient expliquées par un processus différent. Il aura eu le mérite de démontrer, à l’aide d’arguments purement scientifiques, que les univers se succèdent sans fin, éternellement. Et je me félicite d’avoir contribué de toutes mes forces à la publication de sa Synthanalyse. Les travaux de Millikan et d’autres chercheurs célèbres conduisent, d’ailleurs, à des conclusions pareilles. « Que faut-il considérer comme commencement et comme fin ? Le cycle est fermé et pour cette raison comporte autant de commencements que de fins ; on peut dire que le commencement est une fin et la fin un commencement. » En vertu de lois inflexibles, la matière se désagrège et retourne aux éléments impondérables d’où elle était sortie, mais c’est pour renaître de ses cendres, tel le phénix dont parlaient les anciens. A l’angoissante question du premier et du dernier jour du Cosmos, nous pouvons apporter une réponse claire :
« Si l’homme pose une telle question, il est évident qu’elle est la suite de la contemplation des phénomènes qui l’entourent : il voit que chaque phénomène sur la terre a son commencement et sa fin. Ce n’est pas tout, l’astronomie lui montre que les étoiles sont aussi soumises à cette loi. Enfin, nous voyons, par tout ce qui nous entoure, qu’un corps organisé et limité dans l’espace est aussi limité dans le temps de son existence organisée. En examinant le genre humain, nous découvrons : qu’il fut un temps où il apparut sur la terre et qu’un temps viendra où il disparaîtra ; que la longévité du genre humain est déterminée par le remplacement d’une génération par l’autre. Il est évident que les hommes parurent sur notre planète lorsque les conditions correspondantes y naquirent. Quand les conditions changeront, le genre humain disparaîtra, Mais si les conditions dans lesquelles nous vivons sur la terre étaient constantes, l’existence du genre humain n’aurait pas de fin. Cela veut dire que la variété des conditions est la cause principale de l’apparition et de la disparition de la vie organique. C’est ce qui a lieu relativement au Cosmos. On peut comparer les univers séparés aux races humaines et. l’univers des univers au genre humain. Les mondes se forment, naissent et meurent ; les races apparaissent et disparaissent. Mais l’univers des univers n’a ni commencement ni fin, car les conditions dans lesquelles il existe sont invariables. L’éternité des conditions engendre la constance des formes. Voilà pourquoi l’univers des univers n’a jamais connu de naissance et ne connaîtra jamais la mort. » (Kharitonov)
Un retour éternel, qui n’a rien de commun avec celui des spirites et des théosophes, tel serait l’inflexible destin des soleils et des mondes. A mon avis, l’homme pourra le rompre, s’il arrive, grâce à la science, à dominer les forces cosmiques dont notre terre est le produit. Au jeu aveugle des énergies naturelles, se substituerait alors la finalité éclose dans son cerveau. Et notre espèce, ou une autre plus intelligente, remplacerait les dieux morts à la tête de l’univers. Le physicisme biologique se propose de répondre, lui aussi, à un problème considéré, jusqu’à présent, comme foncièrement métaphysique, celui de la vie. Nous n’insisterons pas, le lecteur devant trouver, à l’article Plasmogénie d’amples renseignements sur ce sujet. Stéphen Mac Say s’occupe, avec beaucoup de dévouement, de l’Association Biocosmique qui s’intéresse aux plus mystérieuses recherches biologiques. Ajoutons que deux savants ont cru, ces dernières années, avoir résolu le problème des origines de la vie. Le silence s’étant fait, depuis, sur leurs découvertes, nous ignorons absolument ce qu’elles valent et n’en parlons qu’à titre documentaire. Le docteur G.-W. Crile, pouvait-on lire dans le Daily Mail du 10 décembre 1930, « un savant renommé de l’Association Clinique de Cleveland, a réalisé une créature vivante dans un tube à essais, « sans aucun parent » !... Des tissus cérébraux provenant d’un animal fraîchement tué furent réduits électriquement en cendres. De ce résidu, certains sels et d’autres éléments furent obtenus. A cette substance furent ajoutés de la protéine et divers principes chimiques. Le tout fut traité électriquement et aux yeux des savants apparut une chose douée des caractères d’une cellule vivante de protozoaire. Cette « chose » possédait le pouvoir de procréation par fusion ou divisions cellulaires. » On a de même annoncé qu’avec du protoplasma extrait de divers minéraux, tels que la craie, les roches calcaires, la poussière d’éponges, l’huile de foie de morue, W. Morley Martin, un Anglais, parvenait à produire des animaux vivants. Au dire de ce savant, la substance protoplasmique serait chose éternelle, indestructible, dont ni le temps ni le feu ne peuvent avoir raison. Nous manquons de renseignements pour nous prononcer sur les recherches du docteur Crile et de W. Morley Martin. Sont-elles sérieuses, ne le sont-elles pas ? Nous l’ignorons ; et, en pareil cas, la prudence s’impose. Nous savons, toutefois, que la raison et l’expérience arriveront, un jour, à nous éclairer pleinement.
— L. BARBEDETTE.
PHYSIQUE
n. f. (du grec phusis, nature)
Alors que la mathématique a pour objet des créations abstraites de l’esprit, la physique, dont la chimie est aujourd’hui inséparable, étudie des réalités extérieures et sensibles, les phénomènes du monde inorganique. Et, comme ces réalités s’imposent à nous, il est indispensable de recourir à l’expérience pour les connaître scientifiquement. C’est Bacon qui, répudiant les conceptions finalistes chères à la physique de son temps, eut le mérite de proclamer avec force qu’il fallait renoncer à imaginer un monde conforme à nos désirs, pour observer les phénomènes avec précision et impartialité. La nature ne livre ses secrets qu’à ceux qui l’interrogent ; elle reste indéchiffrable pour quiconque s’en détourne et ne l’écoute pas. Descartes demandait, au contraire, que la méthode de la physique soit calquée sur celle des mathématiques. Persuadé que l’univers, en son fond, est quantité pure, que les données qualitatives dépendent du corps et des organes des sens, il accordait au raisonnement déductif une place de premier ordre. Toutefois, l’expérience conservait un double rôle : c’est elle qui posait les problèmes et c’est elle qui permettait de choisir entre les différentes solutions offertes par le calcul mathématique. Longtemps, la tendance expérimentale l’emporta. Si les mathématiques sont commodes pour formuler avec précision les lois découvertes, remarquait Newton, la découverte ellemême est le résultat de l’observation. Au cours des XVIIIème et XIXème siècles, beaucoup de physiciens s’attachèrent à l’étude des faits, à la découverte de phénomènes encore ignorés, se bornant à transformer, dans la mesure du possible, les lois qualitatives en lois quantitatives d’un usage plus facile pour les applications pratiques. Puis l’on s’aperçut qu’il s’agissait, en bien des cas, de mouvements et d’ondes ; à l’origine du son, comme de la lumière, comme de certains phénomènes électriques, on trouve les vibrations d’un milieu approprié. Ainsi nous arrivent du soleil, sous forme ondulatoire, lumière, chaleur, électricité et peut-être cette force mystérieuse qu’on nomme l’attraction. Tout se meut, rien n’est inerte, au sens où l’on employait autrefois ce mot. Dès lors la mesure intervient pour déterminer les fréquences, les amplitudes, etc. ; la mécanique acquiert une importance primordiale et les formules algébriques se multiplient. Certaines parties de la physique ont aujourd’hui un caractère mathématique très accentué. Mais, comme le faisait déjà remarquer Leibniz, les mathématiques comportent une multitude de combinaisons possibles, seule l’expérience permet de distinguer celle qui est réelle de celles qui ne le sont pas. Meyerson écrit :
« Les limites mêmes entre ce à quoi nous devons attribuer une existence dans le sens physique, et les concepts qui ne sont que d’essence mathématique, nous sont inconnues ; parmi ceux que nous classons, à l’heure actuelle, dans cette dernière catégorie, il peut certainement y en avoir qui demain serviront à des explications en matière de physique. Par le fait, MM. Weyl et Eddington, dans leur tentative d’élargir les cadres de la théorie formulée par M. Einstein en y englobant les phénomènes électriques, ont manifestement recouru à une telle transformation du mathématique en physique. Ces tentatives, ou des tentatives plus hardies peut-être encore dans l’avenir, sont-elles destinées à réussir, c’est-à-dire à prévaloir dans l’esprit des hommes compétents et à s’installer à demeure dans la science ? Cela dépendra de la force explicative de ces déductions et, plus encore sans doute, de la manière dont pourra s’établir l’accord entre leur aboutissement et les résultats d’expériences nouvelles. Donc, en définitive, tout dans cet ordre d’idées dépend de la marche du savoir expérimental, rien n’étant prévisible a priori. »
Ainsi l’expérience gardera toujours une place nécessaire en physique : nous avons précisé son rôle à propos de l’observation (voir ce mot). Il nous reste à montrer comment de la constatation des faits l’esprit s’élève à l’affirmation des lois. Déterminer la cause des phénomènes, c’est-à-dire leur antécédent nécessaire et suffisant, telle est la principale préoccupation des sciences physiques ; cette détermination accomplie, l’on peut exprimer les rapports qui relient antécédent et conséquent, formuler des lois. On suppose alors que chaque événement requiert des conditions précises, que, dans des circonstances identiques, les mêmes antécédents seront toujours suivis des mêmes conséquents. Le principe du déterminisme soutient l’édifice des lois physiques. Mais la découverte des causes est difficile. Nos sens ne perçoivent pas le lien causal ; ils nous présentent des successions de faits, sans nous renseigner sur la nature des rapports qui les unissent. J’attribue à la chaleur l’ébullition de l’eau, la dilatation du fer ; l’expérience me montre seulement des phénomènes qui se succèdent, en aucune façon je ne saisis l’action de la chaleur, soit sur l’eau, soit sur le fer. De plus, chaque conséquent est précédé d’une multitude de faits qui s’enchevêtrent et s’amalgament ; rien ne distingue la cause véritable noyée au sein des autres antécédents. Et nous sommes incapables de réaliser un vide complet où chaque phénomène, introduit séparément, produirait les effets qui lui sont propres. L’isolement total d’un antécédent est, pour nous, chose irréalisable en pratique ; mais grâce au raisonnement, des expériences successives permettent d’aboutir, par élimination, à la coïncidence solitaire entre le phénomène-cause et le phénomène-effet. Rabier dit :
« Or, si une coïncidence, même répétée, constante et variée, ne suffit pas à prouver rigoureusement la causalité, quand cette coïncidence se produit au milieu de coïncidences multiples, c’est-à-dire quand l’antécédent et le conséquent sont mêlés et confondus dans une pluralité d’autres phénomènes, au contraire, un seul cas de coïncidence solitaire suffit à prouver un lien de causalité. Là, en effet, où un seul antécédent est donné, on ne saurait douter que cet antécédent ne soit la condition déterminante du phénomène. L’exclusion de tous les autres antécédents a exclu la possibilité de toute autre hypothèse. »
C’est à réaliser la coïncidence solitaire que visent et les tables de Bacon et les méthodes de StuartMill. L’on aboutit à des rapports que l’esprit généralise, en vertu du principe d’universel déterminisme. Mais alors que, dans les sciences peu avancées, les lois restent, en général, d’ordre qualitatif, en physique et en chimie, elles dépassent, habituellement, ce stade pour devenir quantitatives. On ne se borne plus à décrire les phénomènes et à énoncer l’influence qu’ils exercent les uns sur les antres : à dire, par exemple, que l’aiguille aimantée dévie sous l’action d’un courant électrique ou d’un autre aimant. Grâce à une analyse quantitative minutieuse, à un dosage rigoureux des éléments en présence, le rapport causal peut s’exprimer en langage mathématique. Nous sommes alors renseignés sur ce que deviennent les facteurs mis en jeu dans les séries de faits successifs ; et les prévisions indispensables au technicien s’obtiennent avec une grande facilité. Ainsi, grâce aux formules algébriques, l’ingénieur calculera avec toute la précision désirable les résultats que l’on peut attendre d’une machine électrique ou thermique donnée. La méthode des variations concomitantes est d’un grand secours pour lier les intensités qualitatives à des rapports numériques. Repérées selon une échelle métrique, les qualités sont, à chaque instant, traduites en chiffres. Le lien causal se réduit au rapport qui unit les éléments quantitatifs de la cause aux éléments quantitatifs de l’effet. Et l’on n’a plus qu’à trouver la fonction appropriée, le mot fonction étant pris au sens mathématique, dans le nombre prodigieux de celles que renferment l’analyse et l’algèbre. Pour établir la formule de la loi, fréquemment l’on fait, d’ailleurs, abstraction d’irrégularités minimes, mais systématiques, qui croissent ou décroissent d’une façon méthodique. C’est la preuve que la loi est inexacte ; elle peut, néanmoins, être d’un grand secours dans la pratique et demeurer à titre de loi approchée. D’un emploi continuel dans l’industrie, les lois approchées se trouvent à l’origine de presque toutes les découvertes importantes. Lorsque les erreurs systématiques décroissent progressivement, en fonction de certaines circonstances, on a une loi limite. La loi de Mariotte, par exemple, devient d’autant plus exacte que l’on s’éloigne davantage de la pression et de la température critiques, c’est-à-dire de la pression et de la température requises pour la liquéfaction des gaz. Quant aux erreurs qui se distribuent sans ordre, dans des limites assez étroites et toujours les mêmes, elles ne prouvent rien contre l’expression mathématique de la loi. Elles proviennent seulement de l’imperfection de nos procédés, du manque de précision de nos expériences. Et, grâce aux formules mathématiques, surtout aux équations différentielles et aux représentations graphiques, nous saisissons mieux le passage de l’état initial à l’état final dans les transformations diverses de la causalité. Etude de toutes les formes possibles de relations, les mathématiques apparaissent à la dernière étape de la méthode des sciences physiques ; elles ne rendent pas l’expérience inutile, elles la précisent et la clarifient seulement. Aussi la déduction joue-t-elle un rôle sans cesse accru. Sans doute les principes, qui lui servent de base, ne sont pas l’expression pure et simple des données expérimentales, mais ils ne sont, en aucune façon, arbitraires ; Duhem a tort de prétendre qu’on ne saurait les dire vrais ou faux. Ils reposent sur un fond expérimental évident ; ce qui reste hypothétique, c’est l’extension universelle qu’on leur donne. Mais, considérés à leur juste valeur comme des règles que l’esprit peut transformer, les principes sont d’un grand secours en physique. Le professeur Bouasse écrit :
« Bacon nous dit qu’il ne faut point attacher des ailes à l’entendement, mais, au contraire, du plomb qui le retienne et l’empêche de s’élancer de prime saut aux principes les plus élevés. C’est qu’en effet la tentation est forte, après quelques expériences, de chercher un système a priori, duquel on pourrait ensuite déduire tous les faits par simple raisonnement... ; c’est ainsi qu’ont procédé tous les anciens, c’est la cause de l’échec piteux de théories audacieuses comme celle des tourbillons de Descartes, et de tant d’autres que nous voyons apparaître triomphalement pour s’effondrer, après quelques mois ou quelques années. Leurs auteurs ont anticipé à l’excès sur l’expérience ; ils n’ont pas su choisir, parmi l’infinité des propositions générales contenant tous les faits connus, le vrai principe, celui qui interprète exactement la nature. Mais, pour nombreuses que soient les erreurs, l’audace est parfois couronnée de succès. Après avoir étudié le levier, la poulie, les machines simples peu nombreuses alors connues, et avoir exactement énoncé les lois particulières auxquelles elles obéissent, l’on a remarqué, vers 1620, que toutes ces lois étaient des cas particuliers d’une règle plus générale, à savoir : ce qu’on perd en force, on le gagne en déplacement. Toutes les machines inventées depuis, et le plus souvent même en se laissant guider par ce principe, machines dont le nombre se chiffre par milliers, y satisfont exactement. Assurément pas plus du temps de Galilée que du nôtre, on ne saurait donner une démonstration générale et a priori du principe du travail. C’est évident, puisque la démonstration a priori de sa vérité exigerait que l’on connût ce qu’il renferme, et tous les jours nous lui trouvons des applications nouvelles. L’énoncé de ce principe a donc été une heureuse divination ; il s’applique à tant de faits, il éclaire tant de problèmes que douter actuellement de sa certitude serait folie. A la vérité, les découvertes du siècle dernier ont prouvé qu’il n’était pas assez général ; on l’a complété par une nouvelle et heureuse divination, on en a fait le principe de la conservation de l’énergie, qui, jusqu’à présent, domine la science. »
Rendue possible par l’existence de principes généraux, la déduction, qui est la forme explicative par excellence, permet de donner à la physique un caractère plus rationnel, plus cohérent. Les acquisitions inductives particulières sont rattachées les unes aux autres ; les lois sont groupées et hiérarchisées en système ; l’ensemble devient un tout organique qui se rapproche de l’unité. Excellente pour l’exposition didactique et utilisée dans l’enseignement pour ce motif, la déduction nous laisse tout ignorer par contre, des tâtonnements et des efforts qu’exige chaque découverte. Aussi se surajoute-t-elle à l’expérience et à l’induction sans les supprimer ni les reléguer au second plan.
Si l’on considère maintenant les résultats auxquels ont abouti les recherches des physiciens, ils apparaissent merveilleux. Jamais le génie inventif ne s’est montré plus fécond qu’au XIXème et XXème siècles. Ampère découvrit les lois de l’électromagnétisme ; Fresnel soutint la théorie des ondulations en optique ; Arago fit progresser l’étude des phénomènes lumineux et des phénomènes électriques ; Faraday attacha son nom a des travaux de premier ordre en électricité ; Niepce inventa la photographie ; avant Edison, Charles Cros, qu’on refusa de prendre au sérieux, imagina le phonographe ; Fulton appliqua la vapeur à la navigation ; Gramme, un simple ouvrier, a rendu pratique et facile l’utilisation, aujourd’hui considérable, des forces électromotrices ; Morse réalisa le télégraphe électromagnétique inscripteur de dépêches ; Graham Bell trouva le téléphone magnétique. Nous ne saurions donner la longue liste des inventeurs qui se sont illustrés depuis 130 ans. Néanmoins, rappelons encore qu’en 1895 Rœntgen dotait l’humanité des rayons X ; qu’en 1896 Henri Becquerel découvrait le rayonnement spontané de la matière et les faits de radioactivité ; qu’en 1898 M. et Mme Curie parvenaient, après de patientes recherches, à extraire le radium. Par ailleurs, l’Allemand Hertz démontra, en 1890, qu’il existait des ondes électriques analogues aux ondes lumineuses, et Branly, quelques années après, trouva un détecteur capable de les rendre perceptibles. De cette double découverte sortit la télégraphie sans fil. Au point de vue théorique, Maxwell, conduit par l’analogie des formules mathématiques qui les représentent, a ramené à l’unité les lois de l’optique et celles de l’électromagnétisme ; Louis de Broglie a supposé que le rayonnement de l’énergie éclairante se produisait quand l’atome libère des électrons, peut-être des électrons spéciaux, les photons, animés de mouvements vibratoires ; Einstein, qui occupe une chaire à l’université de Berlin, édifia, pendant la guerre, sa « théorie de la relativité », l’une des plus belles constructions de la pensée humaine, malgré les critiques qu’on peut lui adresser. L’histoire de la physique témoigne d’un effort continuel pour simplifier l’extrême complexité des phénomènes. Actuellement, si les chercheurs continuent à cultiver la science pour elle-même et si les découvertes s’avèrent importantes et nombreuses, le public s’arrête surtout à l’aspect pratique de la physique et de la chimie. « La période actuelle est arrivée, écrit Millikan, période extraordinaire de développement et de fécondité, période qui voit de nouveaux points de vue et même des phénomènes entièrement nouveaux se succéder si rapidement sur la scène de la physique, que les acteurs eux-mêmes savent à peine ce qui s’y passe, période pendant laquelle aussi le monde du commerce et de l’industrie adopte et adapte à ses propres besoins, avec une rapidité sans précédent, les plus récentes productions des laboratoires du physicien et du chimiste. Ainsi, le monde pratique des affaires s’empare des résultats de ces recherches d’hier qui ne se proposaient pas d’autre but que d’accroître un peu notre connaissance de la structure intime de la matière, et qui servent aujourd’hui à décupler la portée du téléphone ou à produire six fois plus de lumière qu’autrefois pour la même dépense d’énergie électrique. » Hélas, les découvertes scientifiques peuvent faire le malheur de notre espèce autant que son bonheur ! Grâce aux progrès de la physique et de la chimie, c’est par millions qu’on a tué les hommes pendant la guerre de 1914–1918 ! Aujourd’hui, c’est à la fabrication des gaz asphyxiants que s’intéressent de préférence les savants officiels. Comment ne pas maudire une science qui décuple sans arrêt la puissance des engins de mort ! Mais à qui la faute ? En elle-même la science n’est qu’un instrument ; elle ne devient bonne ou mauvaise qu’en vue des fins pour lesquelles on l’utilise. La faute incombe aux professionnels de la haine, aux prêtres, aux moralistes grassement payés par l’Etat, à tous ceux qui, de façon sournoise ou brutale, retardent l’avènement d’une ère de fraternité.
— L. BARBEDETTE.
PHYSIQUE (CULTURE PHYSIQUE)
Méthode consistant, grâce à un ensemble d’exercices physiques appropriés, à développer harmonieusement l’être humain, tout en lui assurant un meilleur équilibre physiologique. Si un doute subsistait sur l’utilité et l’opportunité de la culture physique, il suffirait, pour être édifié, de comparer l’ensemble de nos contemporains aux magnifiques spécimens que les statuaires antiques nous ont légués. Nombreux sont ceux qu’une grotesque adiposité caractérise, cependant qu’un aussi grand nombre s’efforce de dissimuler par des artifices vestimentaires, vainement correctifs, une disgrâce anatomique où la cachexie a imprimé son sceau. Quant aux rares privilégiés arborant une esthétique de bon aloi, le dénombrement en est facile…
Ces déviations morphologiques sont regrettables en ce que, d’abord, elles accusent un écart déplorable entre la monstrueuse anomalie qu’elles réalisent et ce type de beauté idéale qui, autrefois, constituait la règle générale ; ensuite, parce qu’elles sont corrélatives d’une réduction très sensible de vitalité organique. Or, le vieil adage qui enseigne qu’un corps sain abrite un esprit parfaitement équilibré atteste que la décadence physique atteignant l’humanité dans la plupart de ses membres risque fort de se vérifier par une insuffisance mentale consécutive. Il y a donc urgence, pour le sociologue soucieux et avisé, à réagir énergiquement contre les causes, nombreuses, hélas ! de cet effondrement physico-mental, s’il tient à ménager les possibilités futures d’une organisation sociale qui exige de l’ensemble de ses composants un épanouissement général de toutes leurs facultés.
Il n’est pas téméraire d’affirmer, d’après les données scientifiques actuelles, que, trônant au sommet de la hiérarchie causale, un concept erroné de l’hygiène générale, malheureusement triomphant, intervient pour une part très importante dans cette décadence. Alimentation fantaisiste et vicieuse, toxicomanie polymorphe ; hydrophobie et aérophobie associent leurs funestes interventions et concourent à poursuivre l’œuvre désagrégeante. Renforçant cette ligue malfaisante, le sédentarisme entre en scène à son tour, parachevant supérieurement ce tragique dénouement.
C’est un fait que l’homme répudie de plus en plus l’effort. L’incessant perfectionnement des moyens de locomotion mécanique le soustrait au sport si salutaire de la marche. Le développement permanent et progressif du machinisme, le réduisant ou à une passivité totale ou à une spécialisation professionnelle anormale ; l’activité exclusivement intellectuelle qu’exigent d’innombrables professions ; l’oisiveté quasi-absolue d’un nombre important de privilégiés ; le confort ennemi de l’émulation et de l’effort musculaire, etc. ; bref, de multiples facteurs conduisent à cette carence de l’activité physique générale, si utile en soi, par l’effervescence vitale qu’elle alimente.
De ce qui précède, allons-nous récuser le progrès matériel et ses contingences et aboutirons-nous à cette conclusion qu’il n’y a de salut que dans un retour à la vie ancestrale, comme seule capable de nous rendre la vigueur perdue et le bien-être physiologique si gravement compromis ? Ce serait une absurdité !
Les moyens de transport rapide, outre qu’ils permettent une liaison plus étroite entre les différents groupements humains épars sur le globe, peuvent contribuer à réduire les causes de mésintelligence qui ont suscité, au cours des siècles, tant d’antagonismes. Ils coopèrent à cette édification mutuelle sur les innombrables phénomènes d’ordres divers qui se déroulent sur chaque point de la planète et accroissent sans cesse le bagage encyclopédique. Enfin ils assurent, avec la réalisation de mille autres bienfaits, une plus intelligente répartition des richesses terrestres. Le machinisme (voir ce mot), odieux parfois, en ce qu’il est aujourd’hui un instrument d’asservissement aux mains de castes insatiables, peut et doit devenir le véritable organe de libération de l’humanité entière en réduisant pour chacun au minimum l’indispensable somme de travail fastidieux. Non, la civilisation, dans ce qu’elle a de meilleur et de plus élevé, nous apporte trop de joies pour que nous désirions remonter à la nuit primitive. Le problème de régénération corporelle comporte, heureusement, d’autres solutions, et des remèdes actuels que nous allons étudier.
La fonction étant créatrice de l’organe et son rythme commandant en définitive ses possibilités, l’intégralité de cet organe, la plénitude de ses moyens sont sous la dépendance du mouvement fonctionnel. Un parallélisme étroit contrôle et régit cette solidarité, un pendule commun règle l’amplitude de leurs oscillations. Il convient donc de restituer aux organes humains, sous peine de voir s’accentuer leur décrépitude, l’activité appropriée à leur destination première, à leur raison spécifique.
Les anciens l’avaient fort bien compris Chinois, Indous, Perses, Grecs et Romains, ces derniers et avant-derniers surtout, moins éloignés que nous cependant d’une existence naturelle, mais prévoyant le danger d’une expectative portée à la hauteur d’un principe, instituèrent des méthodes d’éducation physique, dont la valeur, si nous en jugeons par les œuvres splendides enfantées par le génie des Praxitèle, des Polyclète, des Lysippe, ne le cédait en rien aux méthodes actuelles les plus éclairées. Palestres, thermes, gymnases étaient assidûment fréquentés par une foule avide de maintenir en bonne harmonie l’élégance des formes et le bien-être physique. L’invasion des barbares pulvérisant les civilisations grecques et romaines, puis le moyen âge obscurantiste vinrent étouffer ces élans vers l’utile et le beau. Après plus de mille ans d’interruption, le XIXème siècle s’illustra par une rénovation des principes culturistes. Avec Iahn en Prusse, Ling en Suède, puis Amoros en France, réapparurent les exercices corporels. En deçà et au delà du Rhin, la gymnastique d’agrès prévalut. Mieux avisé, le Docteur Ling s’inspira des exigences anatomiques pour rationaliser l’exercice.
Puis ce furent les sports athlétiques qui, avec leur brutal esprit de compétition et leur hantise des performances, dépassèrent le but érigé par l’éducateur éclairé. Pratiqués avec modération et une intelligente progression, expurgés de leur pratique de violence, les sports sont d’excellents moyens de développement et d’entretien physique. Mais ils ne sont guère accessibles qu’à la jeunesse, parce qu’ils nécessitent généralement des endroits spécialement aménagés et fort éloignés de l’habitat de chacun. Et parce que, surtout, ils exigent une préparation physique préalable, si l’on ne veut pas qu’ils risquent d’être plus dangereux qu’utiles. Mais il est facile de pallier à ces inconvénients de l’âge et du lieu, en s’imposant quotidiennement et méthodiquement, chez soi, un nombre déterminé d’exercices variés. Le résultat tangible est une régénération partielle ou totale, selon les cas, pour ceux atteints d’insuffisances fonctionnelles. Pour les rares privilégiés pourvus d’une impeccable santé, c’est la garantie d’un rassurant statu quo.
La physiologie nous enseigne qu’une masse musculaire en action est le siège de phénomènes congestifs (afflux sanguins) consécutifs à l’effort suscité. Les parties intramusculaires témoignent d’échanges intensifs inaccoutumés. L’oxydation profuse active les combustions, et l’élimination résiduelle s’organise avec une ampleur inconnue de la masse assoupie. L’activité, lorsqu’elle est méthodiquement dosée en fréquence et en tonalité, en intensifiant le phénomène de la nutrition, accroît la section musculaire et sa puissance dynamique, laquelle se traduit par une aptitude croissante à l’effort. La graisse parasitaire qui enrobe les fibres musculaires ne résiste pas au traitement. C’est donc en soumettant alternativement ou simultanément, d’après les nécessités anatomiques et physiologiques, les différents organes à des exercices spécifiques qu’il est possible de régénérer les anormaux et de cuirasser les autres contre la déchéance.
Evidemment — nous ne saurions trop le répéter — la culture physique n’est pas une panacée. Dans bien des cas, elle serait inopérante sans le concours des autres modalités hygiéniques. Mais leur combinaison énergiquement appliquée garantit le succès de cures inespérées.
La ptose gastro-intestinale, par exemple, si fréquente aujourd’hui, résulte d’un relâchement de la paroi musculaire abdominale, agent normal de contention des viscères stomaco-intestinaux ; elle est facilement réductible par l’application d’exercices abdominaux conjugués avec un régime alimentaire rationnel. La constipation la plus rebelle est justiciable du même traitement.
L’exercice respiratoire provoque les plus heureux effets. Il soumet le diaphragme à une gymnastique très active et exerce une véritable suroxygénation du sang. Mais il faut veiller à ce que les inspirations profondes soient suivies d’expirations totales assurant une contractilité fréquente et régulière des alvéoles pulmonaires. L’alternance non respectée expose aux dangers de l’emphysème (Docteur Lewy).
D’après le Docteur Pauchet (Restez Jeunes), l’exercice respiratoire stimule vigoureusement la thyroïde qui régit le métabolisme. Elle accroît la capacité thoraço-pulmonaire considérablement. Chez le sédentaire, dont les poumons fonctionnent au ralenti, les inspirations réduites n’insufflent de l’air pur que dans les régions intermédiaires. Les alvéoles de la base et des sommets ne connaissent ainsi le contact généreux du gaz vital. Etonnons-nous de la fréquence des lésions tuberculeuses observées dans ces régions déshéritées, qu’une abondante aération préserverait.
Les flexions et rotations du tronc assouplissent le corps et renforcent les muscles thoraciques et abdominaux. Ils exercent un véritable massage de l’estomac et du foie qui remédie à bien des défaillances de ces organes. La moelle épinière, ainsi que toutes les ramifications nerveuses qui s’irradient de l’axe central, bénéficient de ces divers mouvements.
Toute une gymnastique savante s’ingénie à corriger maintes déviations du squelette, des atrophies musculaires congénitales ou acquises, qu’une thérapeutique officinale n’avait fait qu’aggraver.
L’être humain n’a donc pas de meilleur serviteur que la gymnastique. Pour l’enfant et l’adolescent, elle est génératrice de vigueur, de souplesse, de santé, de joie, de beauté. Elle est, pour l’adulte, rectificatrice de malformations imputables au professionnalisme déformant, comme aussi de mille autres tares. Elle assure au vieillard une jeunesse prolongée et recule à l’extrême les limites de la vieillesse. Elle prépare un déclin sans décrépitude, la fin normale d’une lampe qui s’éteint.
La culture physique doit être pratiquée au grand air ou dans une pièce copieusement aérée et, si possible, ensoleillée, Qu’importe la saison ! Le nudisme — que l’accoutumance rend si aisé et si agréable — est de rigueur ou, à défaut, l’appareil vestimentaire le plus restreint (caleçon, culotte courte, ample et légère). Ceci pour permettre aux pores de la peau et aux glandes sudoripares d’accomplir leur tâche respiratoire et éliminatrice. Le corps entraîné s’adapte volontiers aux basses températures, surtout lorsqu’il est animé de mouvements rapides et ininterrompus. Ablutions totales, lotions circonstanciées, douches, laits, etc., s’intercaleront ou succèderont à chaque séance pour débarrasser l’épiderme de ses sécrétions toxiques. Dans leurs intervalles, les exercices seront accompagnés, puis suivis, de vigoureuses frictions concentriques à la main nue, puis au gant de crin. Leur action stimulante procurera les plus heureux effets.
L’heure du lever est préférable pour l’accomplissement de ce programme. Il précédera le petit déjeuner pour ne pas gêner la digestion. Mais, à défaut, n’importe quel moment de la journée peut être adopté dès l’instant qu’il sera antérieur aux repas.
Un nombre respectable d’ouvrages traitant de l’éducation physique constituent, par les enseignements qu’ils renferment, une véritable encyclopédie culturiste. Ils guideront le profane vers une initiation profitable et quintessenciée. Nous citerons, au hasard parmi d’autres non moins intéressants, ceux du Professeur Demeny, de Müller, du Commandant Hebert, du Professeur Desbonnet, du Docteur Ruffier, de Sandow, du Docteur Pagès, du Docteur Chauvois, du Docteur Pescher, etc., etc.
Nous accorderons cependant une mention spéciale à « Mon Système », de Müller, dont la formule inspirée de la gymnastique de Ling, résume les enseignements gymniques tout en les émaillant de judicieux principes d’hygiène. « Mon Système » sera le vade-mecum des non initiés.
Comme tout ce qui concerne la culture du moi, la pratique de la culture physique exige du postulant une volonté constante et tendue (mais elle a, en vertu de lois déjà citées, de bienfaisantes répercussions sur cette même volonté). Elle n’offre pas l’attrait des jeux de plein air, l’agrément des sports d’équipes par exemple. Le reproche le plus sérieux qu’on puisse lui faire est de manquer de gaîté. Mais si l’on met en balance le petit inconvénient que cela comporte et les immenses avantages qu’elle procure, le grief s’évanouit. D’ailleurs quiconque s’accorde régulièrement sa séance matinale d’assouplissement finit par en ressentir l’impérieux besoin et trouve, à l’accomplir, une réelle satisfaction. Et puis « Paris vaut bien une messe », disait Henri IV, exprimant par là qu’il serait malséant de reculer devant une chose relativement désagréable si elle est une source de profits.
Il serait souhaitable que l’enseignement pédagogique, qui n’aborde qu’avec une extrême timidité les importantes questions d’hygiène, assimilât à ses programmes l’initiation gymnique. Elle s’inspirerait profitablement des préceptes de la « Méthode Müller » et surtout de la « Méthode Hébert » qui joint l’utile à l’agréable.
Lorsque l’humanité entière sera conquise aux principes culturistes et ralliée aux autres formules d’hygiène, les innombrables fléaux pathogéniques qui l’accablent ne seront plus que souvenirs historiques, errements des époques où fleurissait une civilisation encore enlisée dans la barbarie.
— J. MELINE.
OUVRAGES RECOMMANDÉS. — Mon Système (Müller). -Le Code de la force ; Guide pratique d’éducation physique ; Les sports contre l’éducation physique (G. Hébert). — L’entraînement respiratoire par la méthode spiroscopique (Dr J. Pescher). — Soyons forts (Dr Ruffier). — Les dessanglés du ventre ; La machine humaine, anatomie (Dr Chauvois). — Ma méthode ; Manuel de culture physique (Dr Pagès). — Gymnastique suédoise (André et Kimlim). — La rééducation. respiratoire et les sports respiratoires (Sandow). — Restez jeunes ; L’éducation physique de l’enfant (Dr Pauchet). — Pour rendre nos enfants souples et gracieux (Lebigot et Coquerelle), etc., etc.
PLAGIAT
n. m.
On appelle communément plagiat le fait de « s’approprier la pensée d’autrui » (Larousse). « Quand un auteur vend les pensées d’un autre pour les siennes, ce larcin s’appelle plagiat. » (Voltaire.) Le plagiat est une des supercheries de « l’industrie littéraire », et l’une des plus graves, mais il n’est pas la plus grave. Celui qui s’approprie le bien d’autrui et qu’on appelle un « voleur » est souvent excusable, par exemple lorsqu’il n’a pas d’autre moyen d’assurer sa subsistance. Il est moins excusable lorsqu’il recherche un superflu ou obéit à des nécessités qui ne sont que conventionnelles. Il ne l’est plus du tout lorsque, ne se contentant pas de s’approprier le bien d’autrui sans nécessité véritable, il cherche, en outre, à discréditer et à ridiculiser sa victime, tel Tartufe voulant mettre le bonhomme Orgon hors de chez lui.
Les plagiaires ne sont pas des voleurs ordinaires ; ils n’ont pas l’excuse de la faim, même s’ils vivent de leur plume, car ils pourraient et ils devraient vivre d’autre chose, s’ils voulaient tenir leur plume avec toute la dignité désirable. (Voir Gens de Lettres). Les nécessités de l’homme de lettres, ou de celui qui se prétend tel, sont toutes conventionnelles et de l’ordre de la vanité ou de la cupidité. C’est par vanité ou pour s’enrichir, le plus souvent pour les deux, et non parce qu’ils ont faim, que tant de geais déshonorent la profession des lettres en se parant des plumes du paon. La Fontaine a dit :
Qui se parent souvent des dépouilles d’autrui,
Et que l’on nomme plagiaires »
Dans la plupart des cas, ils sont simplement indélicats et leur faute est d’autant plus vénielle qu’elle ne tarde pas à être découverte et à leur rapporter plus de ridicule qu’ils n’en ont tiré de considération. Comme le geai de la fable, le plagiaire de cette sorte se voit :
Berné, sifflé, moqué, joué,
Et par messieurs les paons plumé d’étrange sorte. »
Ceux-là sont les simples plagiaires, trop simples pour être très malfaisants, qui se bornent à « coudre dans leurs rapsodies de longs passages d’un bon livre avec quelques petits changements » (Voltaire.) Mais il y a ceux qui ne se contentent pas de se parer des plumes du paon et se permettent de les tailler, de les arranger, de les adapter à leur façon, défigurant ainsi malignement les auteurs qu’ils ont dévalisés. Ceux-là ajoutent à l’indélicatesse la muflerie ; ils pratiquent un véritable banditisme artistique. Ce sont des tripatouilleurs et des vandales. (Voir Tripatouillage et Vandalisme.) Ils sont d’autant plus méprisables que leurs supercheries les font réussir auprès du public ignorant ou indifférent. Ils trônent parfois à l’Académie, sont des « chers maîtres » dans les revues et les journaux, pontifient dans les assemblées littéraires et artistiques. Or, il y a au bagne quantité de gens qui n’ont pas fait pire qu’eux et sont certainement plus excusables.
Le plagiat était, dans le droit romain, le crime de « celui qui débauchait ou recélait des esclaves, achetait sciemment une personne libre, ou enlevait des enfants » (Bescherelle). Le plagiaire (plagiarus, de plaga, plaie, coup) était condamné au fouet pour avoir commis le crime de plagiat. Martial, satirique romain, ayant fait un rapprochement entre le plagiaire et celui qui méritait le fouet de l’opinion publique pour s’être approprié les pensées d’autrui, il semble qu’il y ait eu là l’origine de l’application des mots plagiat et plagiaire à la friponnerie littéraire et, par extension, à celle de l’art. Car cette sorte d’industrie s’exerce aussi dans les beaux arts et les arts appliqués. Les Pierre Grassou, dont Balzac a conté la fortune, abondent dans le monde de la peinture, et il est plus facile de gagner des millions en pillant chez un musicien une quelconque Ramona qu’en s’appropriant une œuvre littéraire. Le plagiat est plus difficile à déceler en art qu’en littérature.
Michelet .a fait un des derniers emplois du mot plagiaire, suivant la définition antique, en appelant ainsi les Jésuites qui enlevaient les enfants à leurs mères. (Du prêtre et de la femme.) Le crime de plagiat, dans le sens du droit romain, a disparu de la loi moderne depuis la suppression légale de l’esclavage. Il ne subsiste que le crime d’enlèvement d’enfants, puni par les articles 354 et suivants du Code pénal français actuel. Le plagiat, dans son acception moderne, est considéré par le Code comme une atteinte à la propriété, sous le titre de « contrefaçon littéraire et artistique », et assimilé à la contrefaçon industrielle. C’est un délit qui relève des articles 425 et suivants du Code pénal. En fait, pour que le juge sévisse, il faut qu’il y ait justification d’un préjudice matériel résultant de la contrefaçon. Un plagiaire peut très bien être acquitté, bien qu’ayant commis le plagiat le plus manifeste, s’il est établi qu’il n’est pas résulté un préjudice de son larcin ; il peut même faire condamner celui qui, publiquement, lui a appliqué l’épithète de « plagiaire » bien qu’il la méritait, le mot étant un outrage, suivant la décision de la Cour de Montpellier du mois de mai 1929.
On était plus sévère, jadis, pour les voleurs littéraires. Au moyen âge, un nommé Fabre d’Uzès, qui s’était approprié les œuvres d’Albertet de Sisteron, après la mort de celui-ci, et les avait publiées sous son nom, fut pris et fustigé suivant la « loi des empereurs ». Depuis, la loi s’est faite plus indulgente. On a vu tant de personnages faire leur fortune académique par des larcins de cette espèce, qu’on est devenu beaucoup plus complaisant. Il y a à peine quelques années, on a décoré de la Légion d’honneur M. Ferdinand d’Orléans, duc de Montpensier, qui avait publié sous son nom et sous le titre : Notre France d’Extrême-Orient, avec une belle préface de M. le Myre de Vilers, député de la Cochinchine, un ouvrage pillé dans celui de deux fonctionnaires, MM. Russier et Brenier, intitulé : L’Indochine française. Sous Louis-Philippe, Eugène Bareste avait été décoré et chargé par le gouvernement d’aller « rechercher les choses homériennes », à la suite de la publication qu’il avait faite d’une traduction allemande de l’Iliade et l’Odyssée qu’il s’était appropriée. M. Arsène Houssaye fut honoré des faveurs ministérielles quand il publia une Histoire de la peinture flamande et hollandaise dont le texte et les planches étaient empruntés à d’autres. Le gouvernement de Louis-Philippe avait une excuse, il ignorait les plagiats révélés plus tard ; mais ceux qui ont décoré le duc de Montpensier n’ignoraient pas qu’il n’était qu’un plagiaire de la plus laide catégorie. Un autre plagiaire royal fut Joseph Bonaparte, ex-roi des Deux-Siciles et d’Espagne, qui fit rééditer sous son nom un poème historique d’un nommé Lorquet sur Napoléon. L’histoire fut racontée sous le titre : Le roi couvert des dépouilles du poète.
Au XVIIIe siècle, l’académicien Ripault Désormeaux devait ses travaux historiques à Dingé. Petit Radel avait fait paraître, avec sa signature, des notices de Teillac. Dupré de Saint-Maur, voulant avoir des droits à l’Académie Française, publia une traduction du Paradis Perdu, qui était de l’abbé de Boismorand. Au XIXe siècle, un prétendu orientaliste, Langlés, a fait sa réputation en plagiant de nombreux ouvrages, ceux entre autres de Galland. L’académicien Etienne a plagié une pièce de collège, Conaxa, dans la comédie Les Deux Gendres. Louis de Bacher, membre de l’Institut, prit intégralement un de ses ouvrages dans un de ceux du comte de Neny. Certaines oeuvres de Victor Cousin sont d’autres auteurs que lui. La traduction de Thomas Reid, signée de Th. Jouffroy, fut le travail de Garnier. Les éloges académiques prononcés par Dacier furent écrits par des secrétaires. Baour Lormian a publié, sous son nom, des ouvrages de Buchon et de Lamothe-Langon, celui-ci fabricant d’apocryphes et mystificateur professionnel. La vanité et le lucre, dans lesquels Quérard voyait les mobiles de ces usurpations de réputation, se sont ainsi manifestés trop souvent parmi l’engeance académique. Et la tradition persiste. De nos jours, le maréchal Foch, avec ses mots historiques, et M. Pierre Benoît, dans ses romans, l’ont brillamment continuée.
Il y a relativement peu de plagiats au sens littéral du mot, c’est-à-dire d’appropriation textuelle de la production d’autrui. Il faut être un prince, pour qui « tout ce qui est national est nôtre », pour la pratiquer avec la désinvolture d’un Bonaparte ou d’un Montpensier. Mais le plagiat qui va du simple emprunt plus ou moins déguisé jusqu’au tripatouillage le plus éhonté est innombrable.
S’il n’y a pas une unique origine à la pensée comme à l’espèce humaine, il y a une unité de la pensée des hommes. Il n’est pas douteux que son expression est limitée et que depuis longtemps elle a presque tout dit de ce qu’elle avait à dire. Elle a même tout dit, si l’on en croit La Bruyère, depuis plus de sept mille ans qu’il y a des hommes, et ils sont tous des plagiaires. Malgré ce, cette pensée, ou du moins ce qui est présenté comme tel et n’en est pas une infâme caricature, n’a pas arrêté sa production et prétend toujours apporter du nouveau. De plus en plus, l’humanité parle et écrit. Elle n’a jamais fait tant de discours, imprimé tant de livres et de journaux qu’aujourd’hui. Aussi, chaque jour découvre-t-on que l’idée, le récit, la mélodie, le tableau, la statue, le monument qu’on croyait de l’invention de tel ou tel auteur, a existé avant lui, qu’il n’a fait que recommencer mieux ou plus mal l’œuvre d’un prédécesseur, et on découvre aussi que toujours plus en arrière, ce prédécesseur en avait eu d’autres. On a ainsi établi des chaînes, des filiations d’œuvres dont les sources sont toujours plus reculées vers une origine qui semble avoir été celle d’un système de pensée commun à tous les hommes, quels qu’aient été le lieu et l’époque de leur apparition sur le globe. Comment contester cette origine quand on retrouve sur les plateaux du Tibet, parmi des populations qui n’ont jamais eu aucune relation avec le monde occidental, les fables des Contes de Perrault ? (Voir Littérature.) Est-il une seule pensée de la philosophie la plus moderne qui ne se retrouve pas dans les lointaines Védas composées il y a plus de cinq mille ans ? Les migrations ne suffisent pas à expliquer cette origine puisque, dans le monde entier, les mêmes légendes, à peine déformées par les différences de milieux et de mœurs, se répètent chez les peuples de races les plus diverses.
Mais il y a à distinguer entre ce que Corneille appelait des « concurrences », qui sont les rencontres d’idées communes à l’espèce et font qu’un La Rochefoucauld dira, cinq mille ans après un ancien brahmane : « Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement », et le plagiat que La Rochefoucauld a très probablement commis en prenant cette idée dans Cervantès, après que Cervantès lui-même l’eût prise à un de ses devanciers. Il y a entre les deux choses tout ce qui constitue ce que S. Zweig, dans son ouvrage sur Freud, a appelé : la création, « ce don de voir des choses archi-vieilles et immuables comme si jamais ne les avait illuminées l’étoile d’un œil humain, d’exprimer ce qui fut dit mille fois avec autant de fraîcheur virginale que si jamais la bouche d’un mortel ne l’avait prononcé ».
Il y a aussi à distinguer entre le plagiat consistant à prendre les idées des autres pour en faire une œuvre nouvelle, leur donner des développements plus complets, une forme plus parfaite, pour les mettre en lumière et les répandre alors qu’elles étaient perdues, cachées dans une gangue obscure, et le plagiat appropriation vulgaire de celui qui se croit très habile en déposant son nom, comme une crotte, sur le livre, le tableau ou la symphonie d’un autre. Les hommes qui disparaissent laissent à ceux qui les suivent un héritage de pensée et d’art comme ils leur laissent tous les produits, toutes les richesses de leur travail, de leur invention, de leur habileté, pour qu à leur tour ils les fassent valoir et les perfectionnent avant de les transmettre à leurs successeurs. C’est la marche du progrès. C’est par elle que nous ne vivons et que nous ne pensons plus dans les formes de notre lointain ancêtre des cavernes. Mais Descartes n’a pas plus inventé le « je pense, donc je suis », que Cicéron disant, avant lui : « vivere est cogitare », et que les constructeurs des palaces actuels n’ont inventé le ciment et le verre dont ils se servent. Piron a dit spirituellement :
Leurs écrits sont des vols qu’ils nous ont fait d’avance.
Mais le remède est simple, il faut faire comme eux :
Ils nous ont dérobés, dérobons nos neveux. »
C’est la bonne formule pour prouver que nos aïeux ne nous ont pas laissé un héritage inutile parce que nous le gaspillerons.
Il y a, dans la marche des idées, une infinité d’états, comme entre le grain d’où sortira la fleur et la fleur qui tombera en pourriture. Il y a, parmi ceux qui les utilisent, le prestidigitateur qui en tire un brillant feu d’artifices, l’artiste qui en fait jaillir une source de profonde émotion humaine, ou le lourdaud entrant dans leur domaine à la façon d’un éléphant qui s’ébattrait dans un dépôt de porcelaines et s’oublierait dans tous les coins. A. France a dit fort justement :
« Une situation appartient non pas à qui l’a trouvée le premier, mais bien à qui l’a fixée fortement dans la mémoire des hommes. »
Il y a là la justification du plagiaire prestidigitateur et artiste, et la condamnation du plagiaire lourdaud. On a prouvé que sur six mille vers attribués à Shakespeare, quatre mille ne seraient pas de lui. Qu’importe si l’emploi que Shakespeare a fait de ces quatre mille vers, empruntés un peu partout, leur vaut une mise en valeur que leurs véritables auteurs, en les noyant dans un galimatias plus ou moins informe, ne leur ont pas donnée ! Est-il un plagiaire celui qui fait un collier royal de cent pierres précieuses ramassées dans cent ruisseaux du monde ? Ce qui fait l’importance et la valeur d’une œuvre, c’est souvent moins la nouveauté de la pensée qu’elle apporte que l’expression qu’elle donne à une pensée qui est celle d’un certain nombre. Le véritable plagiat n’est pas dans la rencontre inconsciente d’idées semblables, pas plus que dans la ressemblance de gens ayant la même couleur de peau, la même taille, la même forme de nez ; il est dans l’appropriation préméditée de la production d’un autre, dans le fait de prendre le visage d’un autre, et encore comporte-t-il des nuances suivant les cas.
De tout temps il y a eu des plagiaires. Dès qu’un homme a eu émis une idée, un voisin s’en est emparé et l’a répandue parmi d’autres qui ont prétendu en être les auteurs, et cette idée s’est rencontrée un jour avec celle semblable qu’un autre avait eue dans une autre région. L’antiquité a abondé en plagiaires de toutes sortes. Ils sont pour la plupart inconnus pour toujours parce que disparus de la mémoire des hommes avec ceux qu’ils ont plagiés. Mais il reste des exemples nombreux. Le « fumier d’Ennius », dont Virgile a fait sortir de si belles fleurs, a produit d’autres floraisons. Si certaines sont allées à l’oubli, d’autres sont demeurées avec toutes leurs couleurs. La Bible, ouvrage le plus ancien du monde judéo-chrétien, n’est faite que de plagiats et a alimenté d’autres plagiats. Ses premiers livres ont été formés de toutes les légendes universelles. Les Proverbes de Salomon ne sont que la transcription des préceptes égyptiens d’Amen-em-opé. Les Psaumes et le Cantique des Cantiques sont la transposition presque littérale des hymnes religieux et des chants d’amour égyptiens. (Couchoud : Théophile.) Une des plus belles images de l’Evangile, celle du Fils de l’homme qui n’a pas une pierre pour reposer sa tête, vient directement d’un discours de Tiberius Gracchus disant : « Les bêtes sauvages de l’Italie ont un gîte, une tanière, une caverne. Les hommes qui combattent pour l’Italie ont en partage l’air et la lumière, rien de plus. Ils n’ont ni toit ni demeure ; ils errent de tous côtés avec leurs femmes et leurs enfants... On les appelle les maîtres du monde, et ils ne possèdent pas une motte de terre. » Les textes des auteurs primitifs de l’Eglise ont été pillés dans les œuvres du paganisme, avant que l’Eglise cherchât à anéantir ce paganisme. De même que les basiliques, les allégories et les hymnes païennes sont devenues les premiers temples, la première peinture, la première musique chrétiens ; tous les dogmes, tous les symboles, toute la liturgie du christianisme sont plagiés de l’antiquité et dans des formes souvent bien inférieures.
Il n’est pas d’auteur antique qui ait échappé à l’accusation de plagiat. L’ignorance générale l’a favorisé au moyen âge, en même temps que le zèle des propagandistes religieux multipliait les « pieuses jongleries » de leurs tripatouillages. Dans les temps modernes, « bien des écrivains ne se sont pas bornés à glaner, ils ont moissonné dans les champs d’autrui », a dit Mayeul Chaudon. Montaigne a pris énormément à l’antiquité, à Sénèque et à Plutarque en particulier, et il l’a déclaré honnêtement. Dante, Rabelais, Shakespeare, Corneille, Pascal, Milton, Racine, Molière, La Fontaine, Bossuet, Voltaire, Rousseau, pour ne citer que les plus illustres, ont été les plus effrontés plagiaires du monde, si l’on appelle plagiat le fait de prendre une idée ou une situation déjà connue et d’en faire un chef-d’œuvre. On attribue à Shakespeare, qui n’a peut-être jamais existé que par l’œuvre portant son nom, cette réponse au reproche d’avoir pris une scène dans une pièce d’un autre auteur :
« C’est une fille que j’ai tirée de la mauvaise société pour la faire entrer dans la bonne. »
Molière disait :
« Je prends mon bien où je le trouve. »
A. Dumas voyait dans le plagiat, avec un certain cynisme, une « conquête » de l’homme de génie faisant :
« De la province qu’il prend une annexe de son empire ; il lui impose ses lois, il la peuple de ses sujets, il étend son sceptre d’or sur elle, et nul n’ose lui dire en voyant son beau royaume : « Cette parcelle de terre ne fait point partie de ton patrimoine. »
A. Dumas, lui, étendait son propre patrimoine à toute l’histoire de la France qu’une centaine de « nègres » tripatouillaient pour son compte et dont il signait les élucubrations. Combien d’autres ont fait encore plus mal que lui ! Car le malheur est que le plagiat n’est pas toujours le fait de l’homme de génie faisant un joyau de ce qui était informe, mais qu’il est le plus souvent le fait de pillards sans talent autant que sans vergogne. Un certain Ramsay, qui avait copié mot pour mot des passages de Bossuet et avait été pris la main dans le sac par Voltaire, répondait insolemment « qu’on pouvait se rencontrer, qu’il n’était pas étonnant qu’il pensât comme Fénelon et s’exprimât comme Bossuet » !
Les pillards sont même sans politesse, poussant la muflerie jusqu’à injurier leurs victimes. Ils ne leur suffit pas de boire dans le verre des autres, ils crachent dedans. C’est ainsi que Castil Blaze, un des plus sots critiques musicaux qui aient existé, traitait Rousseau d’ignorant après avoir capté dans son Dictionnaire de la musique trois cent quarante deux articles et se les êtres attribués ! Le philologue Lefebvre de Villebrune, qui avait pillé 6.200 notes dans l’œuvre de Casaubon, injuria celui-ci dans sa traduction d’Athénée. Comme il faut de tout pour faire un monde, surtout celui des pillards littéraires, il y a aussi parmi eux des humoristes. Un Dominique de Hottinga a parlé des « longues veilles » que son travail lui a coûtées, dans une traduction de la Polygraphie de Trithème qu’il a volée à Collange. Un Lajarry ayant pillé, dans Andrieux, une pièce qu’il publia sous le titre : Saint Thomas, la présenta comme « une rêverie émanée de ses loisirs » ! Il y a enfin chez ces pillards, comme dans toutes les mauvaises compagnies, des moralistes, hypocrites raffinés, anormaux et pervertis, qui sont les plus nombreux et travaillent dans la vertu et la pornographie combinées ; les Louis de Bans et les Bacon-Tacon qui plagient la Fausseté des vertus humaines et des Discours sur les mœurs ! Le fin du fin de cette tartuferie est dans le cas de ceux qui, jugeant « infâmes » des Vénus au couvent, les écrivent et les éditent sous des noms supposés. Ainsi, sous le pseudonyme Le Cosmopolite, le duc d’Aiguillon fit imprimer un Recueil de pièces choisies parmi les plus licencieuses, entre autres le Bordel céleste d’un pauvre diable, Pierre le Petit, qui avait été pendu puis brûlé vers 1670 pour avoir commis cette impiété. Grands seigneurs et abbés de cour en faisaient leurs délices.
Le plagiat fut de mode à partir du XVIIe siècle. C’était une façon de se distinguer que de s’attribuer l’esprit des autres. Les gens du monde se faisaient passer volontiers pour les auteurs des écrits de plumitifs besogneux et anonymes qui couraient les ruelles et la Cour. Un nommé Richesource, qui avait pris le titre de « Directeur de l’Académie des orateurs philosophes », enseignait comment on pouvait devenir distingué en pratiquant le plagiarisme dont il définissait ainsi l’art : « celui de changer ou déguiser toutes sortes de discours, composés par les orateurs ou sortis d’une plume étrangère, de telle sorte qu’il devienne impossible à l’auteur lui-même de reconnaître son propre ouvrage, son propre style, et le fond de son œuvre, tant le tout aura été adroitement déguisé. » Un quatrain paru dans l’Almanach des Muses, en 1791, a jugé ainsi cette méthode
J’imite et jamais je ne pille.
— Vous avez raison., monsieur Drille,
Oui, vous imitez... les voleurs. »
Le XIXe siècle a eu, comme les précédents, ses plagiaires plus ou moins coupables, plus ou moins cyniques, parmi ses grands hommes et surtout ses moyens et petits auteurs : Chateaubriand, Lamartine, Hugo, Balzac, Alfred de Musset qui prétendait pourtant ne boire que dans son verre et avait dit sévèrement : « Voler une pensée, un mot, doit être regardé comme un crime en littérature. » Stendhal, Baudelaire, A. Dumas père et fils, Scribe, Sardou qui fit une enquête sur le plagiat « considéré comme un des beaux arts », E. About, Renan, A. France, Zola, Coppée, J. Lorrain, E. Rostand, etc. Parmi les plagiats ou rencontres d’idées et de situations que nous n’avons pas vus signalés, indiquons la parenté curieuse du sujet du Bal de Sceaux, écrit par Balzac, en 1829, et de celui de Horatio Sparkins, de Dickens, paru après. Par contre le David Copperfield, de Dickens, fut publié bien avant Jack, d’A. Daudet, qui parait en avoir été directement inspiré. II y a aussi une parenté frappante entre l’Aiglon, d’E. Rostand et certains épisodes des Mohicans de Paris, d’A. Dumas. M. Barrés semble avoir pensé au frère Calotus d’A. Rimbaud quand il a vitupéré les « accroupis de Vendôme », et M. P. Bourget paraît s’être un peu trop souvenu d’Hamlet quand il a écrit André Cornélis. M. Maurice Rostand, insupportable cabotin qui avait pillé Dickens, le plaignit quand il fut lui-même pillé ; double profit publicitaire, M. Louis Dumur a inventé un type, Un Coco de génie, qui pratique le plagiat quand il est en état de somnambulisme. C’est un aspect littéraire de la psychopathie.
Depuis 1670 que parut le premier ouvrage dévoilant les anonymes et les pseudonymes, celui de Fréd. Geisler, et depuis l’ouvrage d’Adrien Baillet, les Auteurs déguisés, le plagiat a été souvent dénoncé, ainsi que toutes les formes de supercheries littéraires. On a eu le Dictionnaire des ouvrages anonymes, par Barbier, en 1806–1808, puis les Questions de littérature légale, de Ch. Nodier, le Bulletin du bibliophile belge, de F. de Reiffenberg, et les Curiosités littéraires, de Lalanne.
L’ouvrage le plus complet sur ces questions est : Les Supercheries littéraires dévoilées, se J. M. Quérard, paru en 1847 et réédité avec de nombreux compléments en 1869. Il demeure un précieux document pour les recherches bibliographiques. Depuis Quérard, d’autres ont dénoncé des plagiats plus modernes. M. G. Maurevert, entre autres, a composé le Livre des plagiats où il en a fait connaître de nombreux d’auteurs contemporains. Car l’industrie des plagiaires ne chôme guère, pas plus que celle de toutes les autres supercheries. Nous verrons, au mot tripatouillage, que ces supercheries se sont multipliées et ont pris un caractère inouï de banditisme littéraire, grâce à la fabrication cinématographique qui a supprimé tout respect de la pensée et tout scrupule d’art, faisant du milieu spécial où cette fabrication s’exerce une véritable foire d’empoigne et un laboratoire d’horreurs.
De plus en plus, les auteurs se pillent entre eux. C’est le plus clair de leur génie puffiste et publicitaire. Ça fait du bruit dans les journaux, il y a même des procès. Tous les morts-nés de la littérature et de l’art, devenus des « chers maîtres » avant d’avoir rien produit, les fournisseurs du snobisme actuel, les directeurs de conscience et d’esthétique du muflisme, vivent et prospèrent de l’industrie du plagiarisme. Rapetasseurs de vieilles savates, rongeurs de rogatons, collecteurs d’épluchures, ils ont le nez dans toutes les poubelles de l’histoire, les yeux et les mains dans toutes les œuvres des voisins. Ils sont les chiens à qui Edgar Poe voulait interdire l’entrée des cimetières parce qu’ils grattent et fouillent partout, profanent tout, pissent sur tout. Ils le sont cyniquement, pratiquant le plagiat comme moyen de réclame, D’ailleurs, on ne les prend jamais sans vert. Stendhal, qui, sous le pseudonyme de Bombet, avait pillé l’Italien Carpini pour faire sa Vie de Haydn, s’efforça de ridiculiser sa victime quand elle eut le mauvais goût de se plaindre. Aujourd’hui. M. Pierre Benoît a déclaré, en faisant une pirouette qui lui a gagné l’Académie Française, qu’il avait voulu « appâter les imbéciles ». Les imbéciles sont ceux qui ont dénoncé ses supercheries en faisant connaître les auteurs et les textes où il avait puisé, notamment dans V. Hugo. Aussi, le plagiat, plus ou moins aggravé de tripatouillage, est-il de plus en plus dans les mœurs, et on peut s’attendre à voir l’Académie Française décerner un jour prochain un Grand prix du plagiat. Il ne sera, d’ailleurs, pas plus immoral que ses Prix de Vertu !
* * *
Au plagiat, on peut rattacher le pastiche, imitation de la manière d’un auteur, quand il n’est pas d’intention satirique dans le but évident de faire ressortir, en les grossissant, les défauts de celui qu’il imite et qu’il n’est pas alors de la parodie. En musique, le pastiche fut nettement du plagiat et du tripatouillage lorsque des entrepreneurs prirent des morceaux de compositeurs divers et les « arrangèrent » pour en faire des œuvres nouvelles. Les plus cyniques de ces entrepreneurs furent deux musicastres, Lachnith et Kalbreuner qui firent, en 1803 et 1805, deux oratorios, Saül et la Prise de Jéricho, dont la musique fut pillée dans une douzaine d’auteurs. Lachnith poussait le cynisme jusqu’à s’écrier, pendant qu’on jouait des airs de Mozart qu’il s’était attribués : « Non, je ne ferai jamais rien de plus beau ! » Chargé d’adapter la Flûte Enchantée, de Mozart, pour l’Opéra de Paris, il en fit un salmigondis, sous le titre : Les Mystères d’Isis. Son compère Kalbreuner se chargea du tripatouillage de Don Juan, dans lequel il introduisit de la musique de sa façon. Le pastiche musical est pratiqué aujourd’hui d’une façon moins grossière, plus savante ; l’emploi de la pensée et de la manière d’autrui, habilement dissimulé, n’a plus que l’aspect de réminiscences. M. Saint-Saêns a été, sans l’avouer, le plus adroit pasticheur musical. Il a fait de l’Haendel, du Mozart, du Gluck, du Berlioz, du Liszt, du Wagner, et aussi du Meyerbeer, mieux que tous ces musiciens, comme les Pierre Grassou font du Raphaël, du Rembrandt, du Watteau, du Corot, du Daumier et même du Bonnat, mieux que tous ces peintres.
En littérature, on tient le pastiche en haute estime comme étant, dit-on, le signe d’une culture étendue, d’un esprit critique aigu, d’une souplesse de pensée remarquable. Et il convient admirablement à notre époque, dit-on aussi, parce qu’il est « la forme la plus rapide et la plus portative de la critique ». (M. F. Gregh). Il n’est plus la peine de perdre son temps à lire les grands ouvrages pour se faire une opinion sur eux ; le pastiche les sert concentrés avec leurs qualités et leurs défauts comme un Liebig littéraire. II y a, nous semble-t-il, contradiction entre les qualités nécessaires aux faiseurs du pastiche, entre les connaissances étendues qu’il réclame, la préparation studieuse qu’il demande, le travail de lecture et de réflexion qu’il impose, et cette critique rapide et portative qui correspond plutôt aux formes trépidantes, bruyantes et vides de la littérature actuelle aussi pressée de n’arriver nulle part que la justice de Méphistophélès : avion, paquebot, auto, cinéma, reportage, machine à écrire, télégraphe, téléphone, tous moyens qui ne s’accordent guère avec le travail de bibliothèque et de pensée tranquille que cette littérature laisse aux « poussahs » littéraires. Le pastiche est, au contraire, de notre temps, un anachronisme. Il est de vieille formation scolastique. On dut l’enseigner au moyen âge, et même avant dans l’antiquité, pour imiter autrui. Il a été l’apocryphe qui, sous le couvert de cette imitation, a servi à répandre tant de falsifications de la pensée, comme nous allons le voir. Aujourd’hui encore, on enseigne le pastiche dans les collèges, ce qui explique sans doute que tant de professeurs excellent dans ce genre. Mais ce n’est pas une des moindres incohérences de notre époque « rationalisée » que d’apprendre à des jeunes gens dont on fera des officiers, des ingénieurs, des banquiers, des commis voyageurs, à imiter Boileau écrivant à Racine au sujet de sa lettre sur les Hérésies imaginaires, ou Maucroix déconseillant La Fontaine de continuer sa tragédie d’Achille !... Quoi qu’on en puisse dire, le pastiche n’a pas de vie originale ; il est un signe des temps de la décadence littéraire, des époques où la pensée, apeurée devant les réalités, se réfugie dans les superfluités rhétoriciennes. Notre temps s’attache au pastiche comme le XVIIe siècle s’attacha au gongorisme. Comment les littérateurs auraient-ils une pensée originale, alors qu’ils ne comprennent pas le fait social, redoutent ses conséquences, et s’efforcent d’être hostiles à la marée montante, irrésistible, d’un monde nouveau qui les emportera avec toute la vieille scolastique usée, vidée, finie, pour ouvrir devant les hommes les voies de la vie ?
Le pastiche est inoffensif tant qu’il ne se présente que comme un amusement littéraire d’une intention avouée par son auteur. Mais beaucoup de pastiches sont des apocryphes dont les auteurs ne se sont pas fait connaître, dont le but, a dit Quérard, a été de tout temps « soit le charlatanisme, soit la mystification », et qui multiplient la confusion dans l’histoire. C’est. ainsi qu’on a imputé à des poètes célèbres des poèmes qu’ils n’ont jamais écrits. La Batrachomiomachie, attribuée faussement à Homère, le Du Culex et le Du Ciris, qu’on a mis au compte de Virgile, sont des apocryphes. Des Lettres de Thémistocle, de Phalaris, d’Apollonius de Tyane, des Fables d’Esope, ont été composées par le moine Planudes. L’Eglise a fait un usage exagéré de l’apocryphe pour les besoins de son opportunisme, pour appuyer de prétendues autorités ses décisions contradictoires. Il y a ainsi de faux ouvrages des Pères de l’Eglise, de fausses décrétales des papes, de faux traités des saints Ambroise, Athanase, Augustin, Bernard, une Histoire apostolique d’Abdias, un des soixante disciples de J. C. et premier évêque de Babylone, qui ont été fabriqués aux XVe et XVIe siècles. Erasme se plaignait, au XVIe siècle, de ne posséder aucun texte des Pères de l’Eglise qui n’eût été falsifié. Les fraudes les plus grossières ont été inventées par des prélats et de simples moines. Eusèbe tenait pour authentique une lettre de J. C. à Abgar, roi d’Edesse ; en plein XIXe siècle on répandait encore, dans les campagnes françaises, de prétendues lettres de J.C.!... D’autre part, les récits mythologiques sont pleins de soi-disant écrits d’Hermès, Horus, Orphée, Daphné, Linus et autres personnages légendaires n’ayant probablement jamais existé. L’écossais Mac Pherson inventa, au XVIIIe siècle, le barde Ossian qui fut un des héros du snobisme romantique. Sigonius publia, en 1583, un faux Cicéron, le Consolatio, que certains veulent encore tenir pour authentique. Il y eut de faux Pétrone, de faux Athénagore, de faux Catulle. On a vu depuis de faux La Fontaine, Sévigné, Corneille, Molière, Fénelon, Fléchier, Diderot, Condorcet, Walter Scott, Byron, etc., qui n’étaient que des pastiches, mais non avoués par leurs auteurs. Combien de ces choses fausses sont toujours tenues pour véridiques et continuent à faire autorité dans l’histoire littéraire et dans l’histoire tout court ! Si, de temps en temps, on découvre la mystification des lettres de Cléopâtre, de Marie-Madeleine, de Vercingétorix, de Clovis, fabriquées par un Lucas Vrin, ou d’une tiare de Staïtapharnés, ou de la peinture de Boronali, combien le plutarquisme (voir ce mot) ne se nourrit-il pas toujours d’ « apocryphités » dont personne ne conteste l’authenticité, et combien de fausses œuvres représentent l’histoire de l’art dans les musées !
Le pastiche, même quand il n’a pas les conséquences dangereuses de la mystification apocryphe et n’est que la forme élégante du plagiat, ne mérite pas plus d’estime. Il est le produit d’une société qui a peur de la pensée et s’efforce de se survivre dans la pérennité d’un passé momifié et périmé.
— Edouard ROTHEN.
PLAISIR (ET PEINE)
Éléments simples et fondamentaux de la vie affective, plaisir et peine sont impossibles à définir. Il serait d’ailleurs inutile de le faire, chacun sachant par expérience à quels états mentaux ces termes répondent. Perpétuellement, ils se mêlent et se succèdent dans la conscience ; entre ces deux pôles, la vie psychologique oscille sans arrêt. Trop diverses sont nos tendances pour que toutes puissent être satisfaites ou contrariées en même temps. C’est à une proportion entre les éléments agréables et douloureux, à une prédominance des uns sur les autres que se ramènent joies et souffrances. La blessure qui permettait au soldat d’échapper à l’existence du front, sans que sa vie soit en danger, sans qu’il soit privé d’un membre, lui occasionnait des douleurs physiques quelquefois vives ; elle remplissait, par contre, son esprit d’espoir consolateur. C’est une douce peine qu’éprouvent les amants, lorsqu’ils se font de tendres reproches ou qu’ils se séparent pour peu de temps. Poussé à l’extrême ou trop prolongé, le plaisir se transforme en souffrance : si belle que soit une mélodie, il est difficile de la tolérer pendant plus de deux heures ; des saveurs même agréables provoquent la nausée lorsqu’elles reviennent trop fréquemment ; et c’est à une vraie torture qu’aboutit le chatouillement.. En sens inverse, de pénible un état peut devenir agréable : saveur et odeur des narcotiques, de l’alcool, du tabac répugnent d’abord à certains qui, par l’effet de l’habitude, les jugeront délectables plus tard ; des exercices musculaires, douloureux à l’origine, seront générateurs de joies par la suite. « Il y a une espèce de douleur, écrivait Mme de Lespinasse, qui a un tel charme qu’on est tout prêt à préférer ce mal à ce qu’on appelle plaisir. Je goûte ce bonheur ou ce poison. » On rencontre des malades qui éprouvent du plaisir à gratter leurs plaies ; l’euphorie des phtisiques, et des mourants est chose connue ; sadisme et masochisme impliquent, associé à l’impulsion sexuelle, le besoin de frapper ou d’être frappé. Certains savourent le spleen, la mélancolie ; nul événement heureux ne parvient à les dérider. De pareilles voluptés sont de nature morbides ; elles montrent du moins combien il est difficile de tracer des limites précises entre la douleur et le plaisir. Aussi plusieurs psychologues ont-ils admis que ces deux états ne sont point deux manifestations contraires, mais deux moments d’un même processus ; ils géraient la traduction, dans l’ordre affectif, du rythme fondamental de la vie, constitué par l’assimilation et la désassimilation (deux processus réciproquement dépendants et dont l’un implique l’autre). C’est la conception de Th. Ribot. D’autres affirment, au contraire, que plaisir et douleur sont aussi nettement distincts que la sensation visuelle l’est de la sensation auditive. Selon Goldscheider et von Frey, il y aurait dans la peau des points sensibles à la douleur et à la pression ; Strong et Nichols parlent de nerfs dolorifères ; à la suite de minutieuses expériences, Mmes Ioteyko et Stefanowska ont admis, elles aussi, l’existence d’un sens spécial de la douleur ; elles croient même à l’existence d’un centre cérébral dolorifère différent des centres percepteurs. Ce qui les conduit à préciser que des états désagréables peuvent n’être pas douloureux :
« L’élément désagréable est un élément qu’on doit exclure de toute théorie objective de la douleur. »
Bourdon et Georges Dumas font aussi cette dernière distinction, que n’acceptent point la majorité des psychologues. Ces doctrines ont du moins le mérite de ne pas s’écarter du domaine expérimental. Autrefois les métaphysiciens s’en tenaient à des considérations imprécises et vagues qui encombrent encore les manuels de philosophie. Aristote déclarait :
« C’est dans l’action que semble consister le bonheur, le plaisir n’est pas l’acte même, mais c’est un surcroît qui n’y manque jamais, c’est une perfection dernière qui s’y ajoute, comme à la jeunesse sa fleur. »
Toutes les fois que l’activité se déploie librement et se trouve en possession de son objet, la jouissance apparaît. Reprenant la même pensée, Hamilton ajoute que le plaisir naît d’une activité moyenne et la douleur d’une activité trop faible ou surmenée. Pour Descartes, notre bonheur réside dans le sentiment de quelque perfection. D’après Spinoza, la joie résulte du passage d’une moindre à une plus grande perfection, la tristesse du passage inverse. Adoptant une conception que l’on trouve déjà chez Epicure, Kant et d’autres penseurs, Schopenhauer par exemple, soutiennent que le fait primitif est non le plaisir, mais la douleur ; seule la seconde est positive, le premier n’est qu’un état négatif, une absence de douleur. La vie s’avère une continuelle souffrance, car elle est essentiellement volonté, et l’on ne veut que pour satisfaire des besoins pénibles et toujours renaissants, pour obtenir ce dont le manque fait souffrir. Mais une telle conception paraît inadmissible. Tous les besoins ne sont pas douloureux ; et certains plaisirs, la vue d’un beau spectacle ou l’audition d’une belle musique, par exemple, n’impliquent nullement l’existence d’une privation antérieure. Pour Wolf, un disciple de Leibniz, les états affectifs se ramènent à la contemplation d’une perfection ou d’une imperfection ; la sensibilité n’est qu’une connaissance confuse. Sans être aussi catégorique, Leibniz affirmait cependant :
« Je crois que dans le fond le plaisir est un sentiment de perfection, et la douleur un sentiment d’imperfection, pourvu qu’il soit assez notable pour qu’on s’en puisse apercevoir. »
Les stoïciens pensaient de même, lorsqu’ils faisaient dépendre bonheur et malheur de l’idée que s’en font les humains. Epictète déclare :
« Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses mais l’opinion qu’ils se font des choses. Ce n’est pas la mort qui est terrible, mais l’opinion que nous nous faisons de la mort. Lorsque nous sommes troublés ou affligés n’accusons donc jamais que nous-mêmes, c’est-à-dire nos jugements. »
Une telle maxime, il est vrai, s’applique surtout au plaisir et à la souffrance d’ordre psychologique. Mais Ribot soutient que les états affectifs les plus éthérés ne diffèrent des états affectifs d’ordre physique que par leur point de départ : les premiers sont liés à une image ou à une idée, les seconds à une sensation. Il écrit :
« Au premier abord, il semblera paradoxal et même révoltant à plus d’un de soutenir que la douleur que cause un cor au pied ou un furoncle, celle que Michel-Ange a exprimée dans ses Sonnets de ne pouvoir atteindre son idéal ou celle que ressent une conscience délicate à la vue du crime, sont identiques et de même nature. Je rapproche à dessein des cas extrêmes. Il n’y a pourtant pas lieu de s’indigner si l’on remarque qu’il s’agit de la douleur seule, non des événements qui la provoquent, qui sont, eux, des phénomènes extra-affectifs. »
De même, la distinction entre les joies spirituelles et les joies sensorielles n’a qu’une valeur pratique.
« Le plaisir, comme état affectif, reste toujours identique à lui-même ; ses nombreuses variétés ne sont déterminées que par l’état intellectuel qui le suscite. »
Herbart n’explique pas les états affectifs, ainsi que le faisait Wolf, par un jugement de valeur, mais par l’accord ou le désaccord qui existe entre nos représentations. Dissonances et harmonies musicales n’apparaissent qu’avec les notes de la gamme ; souffrances et voluptés d’ordre psychologique (Herbart s’occupait seulement de celles-là) résultent, à son avis, de la coexistence dans l’esprit d’idées qui se contredisent ou se renforcent. Loin d’être inertes, nos représentations intellectuelles sont des forces capables de se combattre ou de s’unir. C’est dans l’activité que Spencer, après bien d’autres, place la cause du plaisir. Il dit :
« S’il y a, comme on ne peut le nier, des douleurs négatives qui naissent de l’inaction, et des douleurs positives qui ont leur origine dans l’excès d’activité, il en résulte que le plaisir accompagne les actions moyennes, c’est-à-dire situées entre les deux extrêmes. »
S’appuyant sur la doctrine évolutionniste, il a montré, en outre, que les douleurs sont les corrélatifs d’actions qui nuisent à l’organisme, les plaisirs les corrélatifs d’actions qui le favorisent. L’adaptation de l’être au milieu constitue une indispensable nécessité biologique ; un vivant ne peut survivre que si les états agréables s’associent, chez lui, aux actes utiles, la souffrance aux actes nuisibles :
« Si nous substituons au mot plaisir la phrase équivalente : un état que nous cherchons à produire dans la conscience et à y retenir ; et au mot douleur, la phrase équivalente : un état que nous cherchons à ne pas produire dans la conscience ou à en exclure, nous verrons que, si les états de conscience qu’un être s’efforce de conserver sont les corrélatifs d’actions nuisibles, et que si les états de conscience qu’il s’efforce de chasser sont les corrélatifs d’actions profitables, l’être doit rapidement disparaître, s’il persiste dans ce qui est nuisible et fuit ce qui est profitable. En d’autres termes, ces races d’êtres seules ont survécu chez lesquelles, en moyenne, les états de conscience agréable ou qu’on désire accompagnent les activités utiles au maintien de la vie, tandis que les états de conscience désagréables ou qu’on fuit accompagnent les activités directement ou indirectement destructives de la vie ; par suite, toutes choses égales, parmi les diverses races, celleslà ont dû se multiplier et survivre qui possédaient les meilleurs ajustements entre leurs états de conscience et leurs actions, et tendaient toujours vers un ajustement parfait. »
Mais cette adaptation du plaisir à l’activité utile n’est jamais complète ; milieu et conditions de vie changent très rapidement ; d’où les exceptions à la règle générale que l’on constate parfois.
« Comme chaque espèce, sous la pression croissante du nombre, doit être refoulée dans les milieux voisins, chaque membre doit, de temps en temps, rencontrer des plantes, des proies, des ennemis, des actions physiques que ni eux ni leurs ancêtres n’ont encore expérimentés, et auxquels leurs états de conscience ne sont pas adaptés. »
Ces désaccords entre les inclinations héréditaires et les nécessités actuelles sont particulièrement nombreux lorsqu’il s’agit de l’homme, car les sociétés dont il est membre subissent une évolution rapide.
« D’une part, il survit encore de ces sentiments tout à fait propres à nos ancêtres éloignés, qui trouvent leur satisfaction dans l’activité destructive de la chasse et de la guerre : sentiments qui, par leur direction antisociale causent indirectement de nombreuses misères. D’autre part, la pression de la population a rendu nécessaire le travail persistant et monotone ; et quoique le travail ne répugne nullement à l’homme civilisé autant qu’au sauvage, et qu’il soit même pour quelques-uns une source de plaisirs, cependant, pour le présent, la réadaptation est loin d’avoir été assez loin pour qu’on trouve du plaisir habituellement dans la quantité de travail requise habituellement. »
Nul ne peut nier que la souffrance soit le signe ordinaire du danger, le plaisir, celui de l’utilité ; la thèse de Spencer ne manque ni de logique ni de profondeur. Néanmoins, le progrès scientifique a démontré que ces signes étaient souvent trompeurs. De pénibles opérations chirurgicales sont parfois singulièrement fécondes en conséquences heureuses ; certains poisons flattent le goût et l’odorat. Plaisir et douleur n’expriment que les effets immédiats, l’influence partielle et momentanée d’une action. Des troubles d’importance minime, tels que la carie dentaire, engendrent des souffrances hors de proportion avec les dangers courus par l’organisme ; de très graves maladies, comme le cancer du foie et la tuberculose pulmonaire, se développent sans que le sujet soupçonne le péril. D’une façon générale cependant, les sensations affectives internes deviennent d’autant moins vives que l’organisme est plus parfait ; à l’état normal, cœur et foie ne donnent naissance qu’à des sensations très vagues. Et non seulement la douleur, cette « sentinelle vigilante », ne nous informe parfois que quand le mal est irrémédiable, mais elle nous trompe très fréquemment sur le siège et la cause de la maladie : certains troubles de l’estomac se traduisent par des céphalalgies, certains désordres du foie par une douleur à l’épaule droite ; une démangeaison du nez peut être due à des vers de l’intestin. L’existence de plaisirs morbides est attestée par de nombreux faits. « J’ai connu, déclare Mantegazza, un vieillard, qui m’avouait trouver un plaisir extraordinaire et qui ne lui paraissait inférieur à nul autre, à égratigner les contours enflammés d’une plaie sénile qu’il avait depuis plusieurs années à une jambe. » Dans son autobiographie, Cardan affirme :
« Qu’il ne pouvait se passer de souffrir et quand cela lui arrivait, il sentait s’élever en lui une telle impétuosité que toute autre douleur lui semblait un soulagement. »
En conséquence, il s’infligeait à lui-même de véritables tortures. Spencer, qui constate la réalité de ce qu’on appelle le plaisir de la douleur, ne parvient pas à fournir une explication satisfaisante :
« J’avoue, que cette émotion particulière est telle que ni l’analyse ni la synthèse ne me mettent en état de la comprendre complètement. »
Ribot, qui a donné de fortes pages sur ce sujet et résumé ce que d’autres avaient dit, ne réussit pas davantage à trouver la cause de ces anomalies. Considérées en tant que guides, joie et souffrance n’ont donc qu’une valeur relative ; souvent, elles ont besoin d’être corrigées par la connaissance réfléchie. Une recherche imprudente du plaisir qui répudie l’indispensable contrôle de la raison, aboutit à des effets désastreux. Il est certain que l’exercice normal des fonctions organiques est lié à une sensation fondamentale de bonheur ; l’état normal n’est pas la douleur, comme le prétendent les pessimistes, mais le plaisir. Vivre, c’est essayer d’éviter la première et de se procurer le second ; toutefois, pour y mieux parvenir, il faut n’accorder qu’une confiance limitée aux impressions du moment et chercher une règle de conduite plus sûre : celle que la science nous propose. L’affectivité, qu’elle soit agréable ou pénible, semble un appel à l’action ; son rôle est celui d’un indicateur, mais d’un indicateur qui sacrifie volontiers l’individu à l’espèce. Témoin ces insectes chez qui le geste procréateur du mâle est suivi d’une mort immédiate.
Tout état affectif requiert-il la présence d’un élément représentatif ? La majorité des psychologues l’affirment.
« Le plaisir et la douleur, déclare Lehmann, sont toujours liés à des états intellectuels. »
Si vague, si confuse que soit la connaissance, pense Höffding, elle existe même dans des impressions agréables ou pénibles qui, de prime abord, semblent l’exclure. Ribot admet, par contre, que l’élément affectif n’est pas assujetti au rôle perpétuel d’acolyte ou de parasite et qu’il a une existence propre, indépendante, au moins quelquefois. « L’enfant ne peut avoir, au début, qu’une vie purement affective. Durant la période intra-utérine, il ne voit, ni n’entend, ni ne touche ; même après la naissance il lui faut plusieurs semaines pour apprendre à localiser ses sensations. Sa vie psychique si rudimentaire qu’elle soit, ne peut évidemment consister qu’en un vague état de plaisir et de peine, analogues aux nôtres. Il ne peut les lier à des perceptions, puisqu’il est encore incapable de percevoir... Règle générale : tout changement profond dans les sensations internes se traduit d’une façon équivalente dans la cénesthésie et modifie le ton affectif ; or, les sensations internes n’ont rien de représentatif et ce facteur, d’une importance capitale, les intellectualistes l’ont oublié... Mais la source la plus abondante où l’on pourrait puiser à volonté est certainement la période d’incubation qui précède l’éclosion des maladies mentales. Dans la plupart des cas, c’est un état de tristesse vague. Tristesse sans cause, dit-on vulgairement ; avec raison, si l’on entend qu’elle n’est suscitée ni par un accident, ni par une mauvaise nouvelle, ni par les causes ordinaires ; mais non pas sans cause, si l’on prend garde aux sensations internes dont le rôle, en pareil cas inaperçu, n’en est pas moins efficace. » On a reproché à Ribot de s’adresser de préférence à la psychologie pathologique ; en outre, on estime contestables la plupart des exemples qu’il cite. Ces critiques comportent une part de vérité. Néanmoins tous reconnaissent que l’élément affectif et l’élément représentatif, loin de suivre une marche parallèle, varient plutôt en raison inverse l’un de l’autre. Dès lors il n’apparaît pas impossible qu’ils se dissocient complètement, dans certains cas. Enfin, il est incontestable que, chronologiquement, la vie affective se développe avant la vie représentative. Concernant les rapports du plaisir et de la douleur avec l’activité, les philosophes ont affirmé de bonne heure que les premiers avaient leur source dans la seconde ; mais ils restaient dans le vague. Grâce aux progrès de la physiologie moderne, nous sommes mieux renseignés sur ce sujet. Là encore il faut bannir les préoccupations métaphysiques, pour sen tenir aux données de la science expérimentale. Nous avons déjà signalé les recherches de ceux qui admettent des nerfs dolorifères spéciaux. Beaucoup supposent que le bulbe joue un rôle essentiel en matière d’affectivité ; la couche corticale des hémisphères cérébraux, siège des facultés supérieures, n’aurait qu’une importance minime. Agréable lorsqu’elle est modérée, l’excitation des nerfs sensitifs devient douloureuse quand elle est excessive ; suppression ou diminution de l’excitation modérée provoque une impression désagréable. Dans l’analgésie, soit spontanée soit artificielle, la sensation persiste alors que l’a douleur disparaît. Hystériques, aliénés, thaumaturges des différentes religions échappent ainsi, quelquefois, à des souffrances qu’un homme normal ressentirait cruellement. Le froid intense, le chloroforme et bien d’autres substances déterminent une analgésie totale ou partielle. Dans l’hyperalgésie, au contraire, la souffrance s’amplifie outre mesure ; le moindre contact, le plus léger bruit peuvent devenir intolérables. La douleur diminue la fréquence des battements du cœur, parfois au point de provoquer une syncope ; elle rend la respiration irrégulière et réduit notablement la quantité d’acide carbonique exhalé ; elle trouble les fondions digestives et ralentit les secrétions ; dans des cas extrêmes, elle détermine une décoloration rapide des cheveux, phénomène qui résulte d’une insuffisance de nutrition. Tantôt elle provoque un arrêt des mouvements ; tantôt elle engendre une agitation convulsive qui laisse finalement l’individu très appauvri. Quant à la nature du processus intime qui produit la douleur, les uns le ramènent à une forme particulière du mouvement, d’autres l’attribuent à des modifications chimiques des tissus. D’après cette seconde hypothèse, la douleur chronique serait une véritable intoxication. Elle verserait, dans le sang, des produits d’une digestion défectueuse qui en altèrent la composition et favorisent l’éclosion, proche ou lointaine d’une maladie. La formation de toxines dans l’organisme, telle serait sa cause ultime. A l’inverse, le plaisir est favorable à la santé. Il active la circulation du sang, accélère la respiration, élève la température du corps, favorise la digestion et se traduit par une exubérance de mouvements ; en un mot, il est, selon la remarque de Ribot, essentiellement dynamogène. Mais à quelles modifications intimes de l’organisme répond le plaisir ? Quelles dispositions de l’axe cérébro-spinal, des nerfs, des terminaisons périphériques le font apparaître ? Nous l’ignorons ; la physiologie en sait moins sur ce sujet que sur les conditions de la douleur. Ajoutons que si l’absence de plaisir et l’absence de douleur vont généralement de pair, il existe néanmoins des cas où l’insensibilité au plaisir se manifeste seule. Richet écrit :
« Brown-Séquard a vu deux cas d’anesthésie spéciale de la volupté toutes les autres espèces de sensibilité, de la muqueuse urétrale et de la peau, persistant. Althaus en rapporte un autre cas. On en trouverait peut-être un plus grand nombre, sans la fausse honte qui empêche les malades d’en parler. Fonsagrives en cite un exemple très remarquable observé sur une femme. »
Esquirol rapporte le cas d’un magistrat chez qui :
« Toute affection paraissait être morte... S’il allait au théâtre (ce qu’il faisait par habitude), il ne pouvait y trouver aucun plaisir. »
Les cas d’insensibilité au plaisir sont fréquents chez ceux dont l’existence est assombrie par une mélancolie profonde. Ces faits sont d’ordre pathologique, comme aussi ceux que nous avons cités à propos de l’analgésie. Parmi les phénomènes psychologiques normaux, en existe-t-il qui soient neutres, c’est-à-dire dépourvus de toute tonalité affective ! Bain, Wundt, Sergi répondent affirmativement. Ce dernier écrit :
« Le plaisir et la douleur, étant les deux pôles de la vie affective, il doit exister entre eux une zone neutre qui réponde à un tel état de parfaite adaptation. L’indifférence est précisément l’état de conscience neutre qui manifeste une adaptation parfaite de l’organe, alors qu’il n’y a ni augmentation, ni diminution d’activité vitale. »
L’eau d’un bain tiède me procure une sensation agréable ; je passerai par un état neutre, avant de souffrir de la température trop élevée si l’on continue à chauffer l’eau de plus en plus. Ces raisonnements n’ont pu convaincre la majorité des psychologues qui nient que l’on parvienne à réaliser, en pratique, ces prétendus états indifférents. Sur les effets de l’habitude, en matière d’affectivité, il y aurait beaucoup à dire : nous renvoyons à l’article Habitude, où le lecteur trouvera des détails du plus haut intérêt. Quant au rôle moral de l’a douleur et du plaisir, il est de primordiale importance, puisque l’homme passe son existence à fuir la première, à rechercher le second. Et cette règle s’impose à tous, même à ceux qui prétendent s’y soustraire. Mais pour atteindre au bonheur durable, après lequel nous soupirons, pour éviter les embûches secrètes que ni l’instinct ni le sentiment ne parviennent à découvrir, il est indispensable de faire appel à la raison, et à la science le plus précieux de ses instruments.
— L. BARBEDETTE.
PLANÈTE
n. f.
Parler des planètes, c’est parler, pour les terriens que nous sommes, de notre système solaire qui est profondément plongé dans la Voie Lactée dont le nombre de soleils analogues au nôtre est évalué à quelques milliards et qui, d’après les données dernières, formerait, avec près d’un million d’autres voies lactées d’égale dimension moyenne, notre univers, une unité sphérique de voies lactées associées, dont le diamètre serait d’environ 300 millions et la périphérie un milliard d’années de lumière.
Cette sphère incommensurable, composée de trillions de systèmes solaires ou d’étoiles, ce qui est la même chose, n’est qu’une grande unité dans l’Univers, c’est-à-dire dans l’infini de l’espace et de l’éternité du temps, deux conceptions aussi inséparables que le sont la Matière et l’Energie qui lui est inhérente.
L’homme, étant un être conscient de son moi, ne saurait comprendre le néant. Il constate qu’il y a, avec tout ce qui l’entoure, depuis le brin d’herbe jusqu’aux mondes qui roulent dans l’espace, un commencement, qu’il traverse une période de croissance, d’apogée — de 20 à 50 ans, — de déclin, de désagrégation pour aboutir à la fin personnelle. Mais cette mort n’est qu’individuelle et la conception du substratum incréé, cause et effet, origine et fin de toute chose s’impose à notre entendement, sous peine de nous renier nous-mêmes, de ne plus nous saisir, nous comprendre et expliquer notre existence.
Ce n’est pas Dieu qui a créé les mondes, c’est la peur et l’ignorance qui ont été les fées malfaisantes qui ont présidé à la naissance des dieux et du surnaturel, cause première, après la misère physiologique, de la plupart de nos contradictions, de nos souffrances, de nos douleurs.
C’est pour cette raison aussi que nous n’acceptons pas aveuglement toute innovation et que sans rejeter les conquêtes chimiques concernant les atomes – il y en aurait des trillions dans un millimètre cube — qui sont à l’homme comme volume ce que l’homme est au Soleil, nous préférons tout de même appuyer nos raisonnements sur l’astre du jour qui est en quelque sorte palpable que sur les mondes invisibles qui nous révèleraient le monde visible,
A l’origine, y avait-il l’atome migrateur, « wandaring », disent les Anglais, ou les mondes, les étoiles qui brillent au-dessus de nos têtes se sont-ils formés par des condensations d’éther, c’est-à-dire de cette matière dite impondérable qui remplit l’Univers et permet à notre vue armée du télescope et du spectroscope d’arracher au grand Tout, dont nous faisons partie, ses secrets les plus troublants et en même temps les plus réconfortants ?
Voici ce que nous répond, à ce sujet, l’astronomie, la science la plus ancienne et la plus moderne en même temps :
Les grands corps célestes, notre soleil, ainsi que ses compagnons, qu’il nous a été possible d’étudier par le télescope et l’analyse spectrale dans les insondables abîmes de l’espace, passent tous par cinq périodes caractéristiques d’évolution ascendante. La sixième période marque le commencement de leur déclin, précédant leur dissolution dans le substratum incréé de l’Univers, d’où, phénix éternels, ils ressuscitent de la poussière cosmique sous des formes analogues mais rajeunies, pour parcourir un nouveau cycle de vie stellaire.
De ces six phases ou périodes d’évolution, les cinq premières, qui constituent la vie stellaire ascendante, peuvent être subdivisées.
Premièrement, en période de l’état gazeux incandescent.
Cet état est caractérisé par une nébulosité diffuse ne présentant aucun indice apparent de condensation et brillant d’une lueur uniforme bleuâtre qui va en s’éclaircissant légèrement vers les bords. Henchel désignait ces nébuleuses, qui donnent un spectre formé de raies brillantes et qui ne peuvent pas être résolues en étoiles, du nom de brouillard planétaire et voyait en elles des condensations de l’éther qui servent de matière première à la formation des mondes.
Deuxièmement, la période de la formation d’un noyau lumineux au milieu de la nébuleuse de plus en plus incandescente et de forme à peu près sphérique. Cette phase peut aussi être désignée par l’expression : nébuleuse stellaire.
Après une évolution qui compte des milliers de siècles et pendant laquelle la nébuleuse stellaire, devenue étoile, a brillé, tel Sirius ou Véga, d’un très vif éclat, elle a donné naissance à la troisième période, qui est celle de la formation de « taches », c’est-à-dire d’un premier commencement de refroidissement de la surface de l’astre.
La quatrième période est celle des éruptions. Elle correspond à l’état d’un astre couvert d’une écorce obscure et refroidie, mais encore trop ténue pour opposer un obstacle aux éruptions que détermine la partie centrale du globe demeurée à l’état de fusion, éruptions d’une telle violence que le soleil, déjà prêt à s’éteindre, se transforme, de temps en temps, en brasier ardent.
La cinquième période marque enfin le refroidissement complet de l’écorce extérieure de l’astre, la transformation d’une étoile en planète.
Au début de cette cinquième période, au milieu de laquelle se trouve aujourd’hui notre Terre, la mer la recouvrait probablement tout entière, et ce n’est que peu à peu que l’Himalaya, les Andes et les Alpes ont dû émerger des flots tièdes de l’Océan primordial.
Nous trouvons ACTUELLEMENT, dans le ciel, des astres qui représentent les cinq phases que nous venons de mentionner.
Ainsi, nous constatons la présence, dans la constellation de l’Orion, des Chiens de chasse et de la Lyre, des mondes en formation, à l’état purement gazeux.
Les représentants de la seconde phase d’évolution se voient dans toutes les régions du ciel.
Notre Soleil, Capella, Arcturus, Procyon, etc., etc., appartiennent à la troisième. La plupart des étoiles de cette période se font remarquer par l’altération que subit l’intensité de leur lumière.
Les représentants de la quatrième période, de la période des éruptions violentes qui brisent la surface déjà refroidie et sombre de l’astre, se rencontrent parmi les étoiles dites nouvelles. Depuis 2.000 ans, on a enregistré plus d’une trentaine d’apparitions de ce genre parmi lesquelles celle de 1572 était si brillante qu’elle était visible en plein jour.
Notre Terre certainement et toutes les planètes habitées, ses sœurs, appartiennent à la cinquième phase de leur évolution, phase qui est incontestablement à l’apogée d’une vie stellaire.
Notre nébuleuse solaire a donc dû aussi présenter à ses origines l’aspect d’un noyau lumineux enveloppé à une grande distance d’une sorte d’atmosphère gazeuse, de forme à peu près sphérique, et dont le diamètre a dû dépasser 30 milliards de kilomètres.
Les planètes, en commençant par les plus éloignées et en finissant par Mercure, se sont dégagées sous forme d’anneaux incandescents des entrailles équatoriales du Soleil, car le mouvement de rotation étant plus fort à l’équateur, la force centrifuge était naturellement prépondérante. Les anneaux se divisèrent et les débris les plus considérables, attirant et s’agrégeant les autres, formèrent de nouveaux centres ou noyaux nébuleux.
Chacun de ces noyaux a dû être animé de deux mouvements simultanés, l’un de rotation autour de son propre centre, l’autre de translation autour du centre commun, le noyau solaire. De plus, comme ces deux mouvements n’étaient que la continuation du mouvement antérieur général, le sens resta le même que celui de la rotation de tout le système ou du noyau solaire.
De la même façon, les planètes, encore à l’état d’incandescence, donnèrent naissance à de nouveaux corps, — les satellites ou lunes, — gravitant et tournant autour d’elles.
Il y a, s’il nous est permis de nous exprimer ainsi dans l’intérêt de la clarté, entre Soleil, planète et lune, en quelque sorte les mêmes rapports qu’entre mère, fille et petite-fille. Comme le Soleil, leur commun ancêtre, chaque planète et chaque lune ont commencé leur existence autonome à l’état de noyau nébuleux et, comme ces dernières également, le soleil et les étoiles, qui sont des soleils lointains, sont. tous appelés, à leur tour, à devenir des corps solides, des terres analogues à la planète que nous habitons ou à la lune qui éclaire nos nuits de la lumière réfléchie de l’astre du jour.
LE SOLEIL.
Actuellement, notre Soleil, l’astre du jour auquel nous devons la vie, occupe presque le centre de notre République planétaire. Son diamètre égale environ 109 fois, sa superficie 12.000, son volume 1.300.000 et son poids 324.439 fois celle de la Terre.
La définition usuelle du Soleil, corps gazeux incandescent à forme sphérique, est loin d’être rigoureusement exacte.
Le Soleil, dont la surface est à la température d’environ 6.000 degrés, n’est en réalité ni solide, ni liquide, ni gazeux dans le sens que nous attribuons généralement à ces mots, car les gaz qui composent son globe sont condensés dans une condition de physique absolument inconnue pour nous, leur poids n’est, en moyenne, à volume égal, que quatre fois moins lourd que les substances terrestres et la pesanteur est à la surface solaire 27 1/2 fois plus forte qu’à la surface de notre planète.
L’astre du jour tourne, de l’Ouest à l’Est, autour de son axe, en 25 jours 4 heures (la rotation des taches s’effectue entre le 45° et 50° parallèle boréal et austral en 28 jours) en entraînant avec lui, à raison d’une vitesse de 20 kilomètres par seconde tout notre système planétaire, composé de quatre planètes de moyenne grandeur, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, un millier de petites planètes situées entre les orbites de Mars et Jupiter, quatre grandes planètes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune et Pluton, dont les proportions ne sont pas encore suffisamment déterminées, ainsi qu’une quantité de comètes dans la direction de l’amas stellaire qui est situé dans la constellation d’Hercule.
Si nous quittons, par la pensée, l’astre du jour, qui se trouve presque au centre de notre système solaire, pour aller à la périphérie, la première planète, Vulcain, n’ayant jamais été découverte, est Mercure.
MERCURE.
La planète Mercure marche avec une vitesse de 46 kilomètres 811 mètres par seconde et met 87 jours, 23 heures, 15 minutes et 46 secondes pour parcourir son orbite de 356 millions de kilomètres, qui se trouve à une distance de 58 millions de kilomètres du Soleil. L’année mercurienne est par conséquent d’environ 88 jours terrestres et comme cette planète, pareille à la Lune relativement à la Terre, tourne toujours le même côté contre l’astre radieux, elle ne compte qu’un jour dans son année. Le diamètre de Mercure est de 4.800 kilomètres, son volume est 19 fois plus petit que celui de la Terre, et son poids 16 fois moindre. La pesanteur à sa surface est moitié plus faible que chez nous et la densité des matériaux environ 1/50 plus forte. L’atmosphère de Mercure est plus dense et plus élevée que la nôtre et sa topographie nous est encore entièrement inconnue.
Ces données sont incontestablement insuffisantes pour affirmer la présence actuelle d’habitants sur Mercure. Mais la question est oiseuse depuis que les sciences exactes ont démontré qu’il n’y a aucune ligne de démarcation absolue entre la nature organique et inorganique et que l’analyse spectrale a révélé, non seulement l’origine commune de toutes les planètes de notre système, mais aussi l’unité constitutive de l’Univers, qui nous donne la certitude que toutes les étoiles qui scintillent dans le ciel sont des laboratoires qui se préparent les éléments de la vie organique et que chaque planète est, a été ou peut devenir un foyer de vie.
VÉNUS.
La seconde planète que nous rencontrons en venant du Soleil pour nous diriger vers la périphérie de son système est Vénus.
L’étoile du berger ou du matin et du soir gravite autour de l’astre du jour à une distance moyenne de 108 millions de kilomètres avec une vitesse de 34 kilomètres 600 mètres par seconde et met 224,70 jours pour parcourir son orbite presque circulaire et longue de 672 millions de kilomètres. L’année de Vénus est par conséquent de 224 7/10e de jours terrestres.
Les proportions de Vénus sont presque les mêmes que celles de notre Terre ; son atmosphère est plus dense, on y voit rarement sa surface et jusqu’ici on n’a pu déterminer la longueur de son jour qui semble être, comme le nôtre, de 24 heures à peu près.
LA TERRE.
À 149.500.000 kilomètres en moyenne du Soleil, nous nous retrouvons chez nous, dans notre « home » sublunaire, âgé de 2 milliards d’années environ et dont l’humanité remonte bien à 300 mille années au moins.
La Terre tourne autour d’elle-même en 23 heures, 56 minutes, 4 secondes, et son mouvement de translation est de 365 jours, 6 heures, 9 minutes, 10 secondes, ce qui donne pour sa marche une allure moyenne de 29 kilomètres et demi par seconde pour accomplir sa révolution annuelle de 930 millions de kilomètres.
Le diamètre de notre Terre est de 12.742 kilomètres ; mais ce diamètre, qui va d’un pôle à l’autre, est plus court de 43 kilomètres que celui qu’on mènerait d’un point de l’équateur au point diamétralement opposé. Cet aplatissement — 1/292 du globe terrestre dans le sens de son axe de rotation et le renflement des parties équatoriales constituent la preuve mécanique de son état fluide primitif, la démonstration scientifique que la Terre a été un soleil.
La surface de notre planète est de 510 millions de kilomètres carrés, dont 384 millions sont recouverts par les mers et 26 millions — le quart seulement — composés de terres habitables.
Le volume de notre globe est d’un trillion 83 milliards 260 millions de kilogrammes cubes ; son poids de 5 septillons 957 sextillions, cinq cents quintillons de kilogrammes et sa densité supérieure 5 ½ fois à celle de l’eau.
Avant de décrire sommairement la lune, notre cornpagne fidèle, voici quelles sont, grâce à l’inclinai son de la Terre sur son axe de rotation, les durées des jours et des nuits, selon les latitudes sur lesquelles on se trouve. Le tableau suivant donne la longueur des jours pour les solstices d’été, 21 juin et 22 décembre, de l’hémisphère nord et sud. La longueur des jours pour les solstices d’hiver, 22 décembre et 21 juin, de l’hémisphère boréal et austral est égale à la longueur des nuits de leur solstice d’été respectif :
Longueur du jour au solstice d’été :
-
Equateur …... 12 heures — 64° 50 ...... ……... 21 heures
-
16° 44 ........... 13 — 65° 48 ……………... 22 -
-
30° 48 ........... 14 — 66° 21 ……………... 23 -
-
41° 24 ........... 15 — 66° 34 ……………... 24 -
-
49° 02 ........... 16 — 67° 23 ……………... 1 mois
-
54° 31 ........... 17 — 69° 51 ……………... 2 -
-
58° 27 ........... 18 — 73° 40 ……………... 3 -
-
61° 19 ........... 19 — 78° 11 ……………... 4 -
-
63° 25 ........... 20 — 85° 05 ……………... 5 -
-
64° 50 ........... 21 — Aux pôles ………..... 6 -
La température moyenne de la surface du globe terrestre est de 15° C., sensiblement la même que celle de Toulon. La température annuelle moyenne des régions équatoriales varie entre 26 et 30°, les maxima enregistrés sont de 52° à 56° à l’ombre. La température moyenne hivernale de Jakontsk et de Werchnojansk, latitude 62 et 67, en Sibérie Orientale, est de – 40° à — 45° avec température minima de — 63° pour Jakontsk et — 67° pour Werchnojansk. Température maxima dans l’eau : Mer Rouge, 32° ; Golf Persique, 35°.
LA LUNE.
La Lune, la muette compagne de nos nuits, qui fait avec nous le voyage autour du Soleil, n’est qu’à 384.436 kilomètres de nous, distance que la lumière franchit en une seconde un quart.
La Lune, qui réfléchit la 618.000e partie de la lumière solaire, autrement dit qui est 618.000 fois moins brillante que l’astre du jour, marche à raison de 1 kilomètre 17 mètres par seconde sur son orbite autour de notre planète en 27 jours, 7 heures, 43 minutes, 11 secondes, en lui montrant toujours la même face. Mais comme, pendant l’accomplissement de sa révolution sidérale, la Terre a continué son mouvement de translation autour du Soleil, la lunaison (révolution synodique), qui est l’intervalle entre deux nouvelles lunes, se trouve être de 29 jours 12 heures, 44 minutes, 3 secondes (pour rattraper la Terre dans sa marche autour du Soleil).
Il résulte de l’ensemble des 60 mouvements de la Lune qu’il n’y a environ que douze jours dans son année de 29 1/2 jours terrestres et que, pendant la durée du jour lunaire, la surface de notre satellite est alternativement exposée à plus de 300 heures de lumière et d’obscurité.
Les phases de la Lune sont déterminées par sa position relativement au Soleil. Lorsqu’elle passe entre lui et nous, nous ne la voyons pas, parce que son hémisphère non éclairé est tourné vers la Terre, c’est la nouvelle Lune. Lorsqu’elle forme un angle droit avec le Soleil, nous voyons la moitié de son hémisphère éclairé : c’est le premier ou dernier quartier, et lorsqu’elle est à l’opposition du Soleil, c’est la pleine Lune et nous voyons toute sa surface éclairée.
Le diamètre de la Lune est de 3.480 kilomètres, sa surface de 38 millions de kilomètres carrés, soit un peu moins que la 14e partie de celle de la Terre, mais comme elle nous montre constamment le même côté, nous ne connaissons que 21.833.000 kilomètres carrés de sa surface totale.
Le volume de la Lune est 49 fois plus petit et son poids, égal à 74 sextillions de kilogrammes, 81 fois plus léger que celui de la Terre.
Mais ce qui caractérise le plus la Lune, c’est son absence d’atmosphère, de son, d’eau, ses volcans éteints. C’est le règne du silence éternel.
Selon toute les probabilités, la Lune est une terre morte, Mars une terre qui décline, notre planète en pleine activité a encore des millions d’années devant elle et le monde géant de Jupiter l’avenir. Dans ces conditions, paix aux trépassés et encore un mot, pour prendre congé, sur les éclipses de la Lune qui intéressent les vivants que nous sommes.
La Lune offre à notre curiosité deux genres d’éclipses : sa propre éclipse, qui a toujours lieu au moment de la pleine Lune, quand elle entre dans la zone d’ombre de la Terre, et est visible au même instant physique dans tous les pays où elle se trouve au-dessus de l’horizon, et l’éclipse du Soleil qui se produit toujours à la nouvelle Lune, quand notre satellite s’interpose entre la Terre et l’astre du jour. L’éclipse totale de la Lune peut durer deux heures, l’éclipse totale du soleil ne dépasse guère 5 à 6 minutes.
MARS. — Nous voici à la planète Mars, célèbre, pour nous autres humains, par les flots d’encre que nous avons versés sur les habitants présents ou absents et sur la surface de laquelle nous avons absolument voulu voir, suggestionnés par Schiaparelli, des « canaux », sorte de travaux d’irrigation pour faire profiter les plaines de cette planète, où l’eau se ferait rare, de la fonte des neiges, constatées au printemps, de ses régions polaires.
A ce désir et rêve des chercheurs scientifiques qui, depuis Galilée jusqu’à Flammarion, ont fouillé le sol de chars dans toutes les directions par le télescope et l’analyse spectrale, afin de trouver des traces palpables de vie, l’uranographie de chars, notre sosie en miniature, répond :
Mars, la planète rouge-jaunâtre, vogue sur son orbite elliptique, longue de 1.400.000.000 de kilomètres avec une vitesse de 23 kilomètres 850 mètres par seconde, et met un an 327 jours pour accomplir sa révolution en tournant autour de son axe en 24 heures, 37 minutes, 23 secondes.
L’année de Mars est conséquemment égale à un an 322 jours, soit 687 jours terrestres — 668 2/3 jours martiens et son jour a 24 heures, 37 minutes, 23 secondes.
A sa distance moyenne, Mars est à 225.400.000 kilomètres du Soleil. De la Terre, la distance de Mars varie dans le rapport de 1 à 7, de sorte que son diamètre apparent peut aller de 4° à 30° quand l’opposition arrive vers l’aphélie de la Terre et le périhélie de Mars. Lorsque l’opposition arrive au moment du périhélie de Mars, cette planète passe à sa plus grande proximité possible de la Terre, soit à 56 millions de kilomètres. La Terre et Mars tournent dans le même sens, ne se rencontrent d’un même côté du Soleil qu’après 2 ans et 2 mois et se trouvent à leur plus grande proximité tous les 15 ans un quart. Leur prochaine distance minima aura lieu en 1938.
Le diamètre et la périphérie de Mars ne dépassent guère la moitié de ceux de la Terre et leur longueur respective est de 6.753 et 21.200 kilomètres. La superficie de l’astre est de 143.163.600 kilomètres carrés, ce qui fait un peu plus que la quatrième partie de celle du globe terrestre. Le volume de notre voisine est 6 fois et demie plus petit et son poids 9 fois et demie plus léger que le nôtre. Etant 6 fois et demie plus petit que la Terre, en volume, Mars se trouve être 7 fois et demie plus gros que la Lune et 3 fois plus gros que Mercure.
La densité des matériaux constitutifs de cette planète est égale aux 71/100 de la densité moyenne de notre Terre et la pesanteur à sa surface est presque 3 fois, 0,374, plus faible qu’ici, ce qui veut dire que 100 kilos transportés sur Mars n’y pèseraient que 37 kilos.
Nos connaissances à l’égard de Mars ne se bornent pas à son uranographie. Le télescope et l’analyse spectrale, découvert par Kirchhof et Frauenhofer, en 1860, nous ont permis d’acquérir des notions positives sur son atmosphère, ses climats, ses saisons, sa géographie.
La présence de nuages, très rares il est vrai, et de glace et de neige, qui recouvrent ses pôles, en augmentant ou en diminuant d’extension, selon qu’il fait hiver ou été sur la région circumpolaire que nous observons, attestent suffisamment l’existence d’une atmosphère.
Huggins a prouvé, à l’aide du spectroscope, la présence de vapeurs d’eau. Il a constaté que le spectre de Mars est coupé dans sa zone orangé par un groupe de raies noires qui coïncident avec les lignes qui appartiennent, dans le spectre solaire, au coucher du Soleil, quand la lumière de cet astre traverse les couches les plus denses de notre atmosphère. Si ces raies étaient causées par l’atmosphère terrestre, elles auraient dû également se montrer dans le spectre lunaire comme dans celui de Mars. Or, elles n’y sont pas perceptibles, ce qui prouve que celle du spectre martien appartiennent à l’atmosphère de Mars et que cette dernière est comme la nôtre, quoique un peu moins, chargée de vapeurs d’eau.
La surface de Mars est presque aux 3/4 composée de terres et à 1/4 de mers, contrairement à notre Terre, où cette proportion est renversée. Les montagnes sur notre voisine sont bien moins hautes qu’ici et les mers bien moins profondes que nos océans, ce que paraît indiquer leur couleur claire.
Enfin, l’obliquité de l’elliptique étant sur Mars de 24° 52’ — ici 23° 27’ — il en résulte que les saisons martiennes sont de même nature que les nôtres, quoique presque deux fois plus longues, comme le montre, pour l’hémisphère nord des deux planètes, le tableau suivant :
| Sur La Terre | |
|---|---|
| Printemps | 93 jours terrestres |
| Eté | 93 — - |
| Automne | 90 — - |
| Hiver | 89 — - |
| Sur Mars | |
|---|---|
| Printemps | 191 jours martiens |
| Eté | 181 — - |
| Automne | 149 — - |
| Hiver | 147 — - |
Il y a, sur Mars, comme sur notre Terre, trois zones : la torride, la tempérée et la glaciale, qui s’étendent respectivement de l’équateur à 24° 52 et de cette latitude jusqu’à 65.8 et de là aux pôles.
Ainsi, la longueur des jours et des nuits, leurs variations, selon le cours de l’année, leurs différences, selon les latitudes, sont autant de phénomènes semblables sur les deux planètes. La différence entre elles n’est notable qu’en ce qui concerne la lumière et la chaleur solaire, qui sont deux fois moins intenses sur Mars qu’ici, le diamètre apparent du Soleil étant, vu de Mars, 21°, de la Terre, 32° 3 ».
Ajoutons encore qu’au lieu d’un satellite, comme la Terre, Mars en a deux : Deimos qui effectue sa révolution en 30 heures 17° 54 » et Phobos en 7 heures 39° 15 », à des distances respectives de 20.325 et 6.055 kilomètres de la surface martienne.
Voilà à peu près l’essentiel de ce que nous savons de Mars. Naturellement, nous ne pouvons pas non plus affirmer que Mars soit actuellement habité par des êtres conscients et intelligents. Mais, pour nous, la question ne se pose pas ainsi : « La pluralité des mondes habités étant depuis longtemps mathématiquement tranchée par l’affirmative. » La seule question qui se pose encore pour nous est de savoir si les planètes d’un même système peuvent être simultanément habités par des « humanités évoluées », étant donné les millions d’années qui séparent probablement leurs naissances.
****** LES PETITES PLANÈTES.
La formation d’une grosse planète entre Mars et Jupiter a dû être empêchée par le voisinage du monde jovien dont l’attraction puissante, après avoir brisé l’anneau primitif en voie de devenir un globe, a mis ensuite obstacle à la réunion de toutes ces parcelles par les perturbations constantes qu’il exerce sur elles.
Dans cette zone du ciel, les mille petites planètes réunies en une seule ne dépasseraient guère le tiers de la masse de la Terre.
Etant donné l’excentricité extrême des orbites de ces planètes minuscules, quelques-unes, comme Acthra et Eros, peuvent s’approcher du Soleil plus que Mars dont elles coupent l’orbite.
Eros, qui n’est pas plus grande qu’un département français, peut s’approcher de la Terre jusqu’à 46 millions de kilomètres environ et s’éloigner jusqu’à 265 millions. Par contre, l’orbite de Hilda se rapproche de celle de Jupiter jusqu’à 184 millions de kilomètres.
Les orbites de quelques-uns de ces petits mondes s’entrelacent souvent à tel point que l’hypothèse d’une association comme planète double ou une collision éventuelle paraît admissible. La plus grande de ces petites planètes est Cérès, dont le diamètre est de 767 kilomètres, tandis que celui des petites n’atteint même pas 50 kilomètres. Néanmoins, rien ne s’oppose à admettre que ces terres lilliputiennes ne soient ou aient été le siège d’une vie intense et d’une civilisation, qui, comparée à la nôtre, l’éclipserait dans son rayonnement.
C’est notre anthropomorphisme, legs de longs siècles de religion qui ont enténébré la mentalité humaine, qui seul nous rend si difficile la compréhension de cette vérité évidente : qu’il n’y a dans la nature ni cause finale, ni grand ni petit.
LE MONDE GÉANT DE JUPITER.
En continuant par la pensée notre voyage vers la circonférence de notre République Solaire, nous voici en face du monde géant de Jupiter qui constituait, encore hier, astronomiquement parlant, avec le Soleil, une étoile double et nous offre, avec le cortège triomphal de ses belles lunes, l’image en raccourci de notre système planétaire.
Jupiter, qui est à peu près, comme taille et poids, au Soleil, ce que notre Terre est à lui, a un diamètre 11 fois plus long et un volume 1.300 fois plus grand que les nôtres et vogue sur son orbite longue de 4.830.180.000 kilomètres avec la rapidité de 12 kilomètres 800 mètres par seconde, en tournant autour de son axe en 9 h 55 et autour du Soleil en 11 ans 10 mois et 17 jours terrestres.
L’année de Jupiter égale conséquemment presque 12 de nos années, pendant que la durée de son jour n’est que de 9 heures 55’.
Tous les 399 jours, la grande planète revient en opposition relativement au Soleil, et le Soleil, la Terre et Jupiter se trouvent alors sur une même ligue. Cette date est, avec les trois mois qui la suivent, la plus favorable à l’observation.
L’orbite de Jupiter est, en moyenne, à 775 millions de kilomètres du Soleil, mais comme elle est elliptique avec une excentricité de 0,048, il y a plus de 80 millions de kilomètres de différence entre sa distance au Soleil ou à la Terre à son périhélie qu’à son aphélie.
Selon que la grande planète est à son périhélie ou à son aphélie, son diamètre apparent varie de 30° à 47°. C’est cette différence de distance qui constitue seule les saisons de Jupiter, car l’inclinaison de son axe de rotation n’est que de 3°, c’est-à-dire presque perpendiculaire à son orbite.
Le tour du globe de Jupiter et son diamètre équatorial dépassent onze fois, en longueur, ceux de la Terre. Le diamètre polaire, par contre, n’a que 132.800 kilomètres, car la rapidité du mouvement de rotation de la planète sur elle-même est si grande, qu’un point situé sur l’équateur court en raison de 12 kilomètres 450 mètres par seconde. De là, le renflement de son équateur et l’aplatissement de ses pôles qui est de 1/17°, tandis que celui des pôles terrestres n’est que de 1/292°. La surface de Jupiter est égale à celle de 114 terres.
La densité moyenne des matériaux qui composent ce grand monde, est de 0,242, c’est-à-dire d’environ 1/4 de ce qu’elle est ici, et l’intensité de la pesanteur de 2 1/4 fois plus forte que sur la Terre.
Ces chiffres prouvent que les conditions de vie sont bien différentes sur Jupiter de ce qu’elles sont sur Mars, la Terre, Vénus et Mercure.
Non seulement Jupiter offre à ses habitants présents ou futurs, des années d’une longueur de 12 ans terrestres avec 10.455 jours de 10 heures chaque, une égalité quasi absolue de climat sous toutes ses latitudes, grâce à l’inclinaison de l’équateur sur l’orbite de 3° seulement, mais ce monde, qui gravite 5,2 fois plus loin de l’astre du jour que la Terre ne reçoit qu’environ 27 fois moins de lumière et de chaleur du Soleil que nous
Recevoir 27 fois moins de lumière que la Terre, c’est encore loin d’être plongé dans une obscurité opaque. La pleine lune répand une clarté 618.000 fois plus faible que celle du Soleil et puis le nerf optique des êtres d’une planète quelconque est forcément adapté au milieu où ils sont appelés à vivre et évoluer.
Pour ce qui est de la chaleur, qui existe sur la surface de Jupiter, elle dépasse certainement et de beaucoup celle qui résulterait de la seule action solaire et il est probable que ce globe, quoique né avant la Terre, a conservé, en raison de son volume et de sa masse, une partie de sa chaleur originelle.
L’atmosphère, dense, haute, tourmentée et saturée de vapeurs qui entoure la planète géante, indique que le climat de Jupiter est plus chaud que celui de la Terre et qu’il règne sur ce monde lointain, un déchaînement des éléments comme notre Terre n’en a plus connu depuis la période primordiale des époques géologiques. Sur sa zone équatoriale, le vent souffle constamment en ouragan et la rotation des nuages de cette région s’effectue en 9 heures 50’ pendant que celle des nuages du 25° parallèle met 9 heures 55.
Nous ne voyons que très rarement la surface de la planète. Les bandes blanches et grises, souvent nuancées d’une coloration jaune et orangée, qui sillonnent ce globe principalement vers la région équatoriale, font partie de sa couche aérienne. Sur ces bandes, on remarque parfois des taches plus claires ou foncées que le bord sur lequel elles sont placées, ou encore des déchirures qui se déplacent les unes et les autres de la gauche à la droite (de l’Ouest à l’Est), si l’on observe la planète dans un télescope qui ne renverse pas les objets. Ces taches appartiennent également à l’atmosphère jovienne et font partie des nuages qui enveloppent ce monde colossal.
En général, l’équateur est marqué d’une zone blanche, il y a une bande plus sombre, nuancée d’une teinte rougeâtre foncée. Au-delà de ces deux bandes sombres, australe et boréale, on voit, ordinairement, des bandes parallèles alternativement blanches et grises. La nuance générale devient plus grise et homogène au fur et à mesure qu’on s’approche des pôles et les régions polaires elles-mêmes sont grises-bleuâtres.
Mais il n’y a aucune fixité dans ces bandes, dont l’aspect typique varie fréquemment et profondément.
Entre la 20° et la 30° latitude australe de la planète, MM. Corder et Terby ont aperçu, en 1872, pour la première fois, une grande tache rougeâtre, de forme ovale, longue de 42.000 et large de 15.000 kilomètres. Cette tache pourrait bien être un continent en formation qui serait, relativement à Jupiter, dans la même proportion que l’Australie l’est relativement à la Terre.
L’analyse spectrale montre que l’atmosphère de Jupiter, si dense dans ses couches inférieures, grâce à l’intensité de la pesanteur, est composée, sauf quelques substances qui paraissent spéciales à ce monde, de la même vapeur d’eau que celle de la Terre. Cette atmosphère est, comme nous l’avons dit, très agitée et soumise à des variations continuelles, qui, chose étrange, paraissent elles-mêmes être en relation avec les taches du Soleil et avoir aussi leur maximum tous les onze ans.
Jupiter ne vogue pas seul dans l’espace. Il marche sur son orbite accompagné de 4 grands et plusieurs petits satellites qui ne sont que des astéroïdes captivés par lui.
Io, Europe, Ganymède et Callisto, les quatre grands satellites, découverts en 1610, par Galilée, sont une des curiosités les plus attirantes du ciel, et font du monde jovien une miniature de notre système solaire.
Ces quatre lunes offrent, avec leur monde central, les principaux éléments astronomiques suivants :
| Distance de Jupiter (Durée du révol. en jours joviens) | Diamètre | |
|---|---|---|
| Io | 430.000 km (4,27) | 3.800 km |
| Europe | 682.000 km (8,58) | 3.300 km |
| Ganymède | 1.088.000 km (17,29) | 5.800 km |
| Callisto | 1.914.000 km (40,43) | 4.400 km |
Ganymède, comme importance, vaut une véritable planète. Son diamètre égale au 47/100e de celui de la Terre, surpasse de près du double le volume de Mercure, égale les deux tiers de celui de Mars et est cinq fois plus gros que notre Lune.
Comme la Lune le fait pour la Terre, tous ces satellites tournent autour de Jupiter en lui montrant constamment la même face et les différences d’éclat observées sur leurs disques prouvent que leur sol est accidenté comme le nôtre et qu’ils sont environnés d’une couche atmosphérique. Le spectroscope fait voir dans cette atmosphère la même vapeur d’eau qu’ici et quelques gaz qui n’existent pas sur la Terre, mais qui sont évidemment les mêmes que ceux constatés sur Jupiter.
Le globe jovien observé de Io présente un disque de 20° de diamètre, c’est-à-dire 1.400 fois plus vaste que celui du Soleil, vu de la Terre et le satellite Io reçoit de la planète, dont le pouvoir réflecteur égale trois fois celui de la Lune, plus de 155 fois et le dernier 8 fois plus de lumière que nous de la compagne de nos nuits.
Mais le monde colossal de Jupiter n’offre pas seulement aux habitants futurs de la planète géante un séjour incomparable à ceux présents ou passés de ses lunes, des effets grandioses de lumière et des perspectives célestes enchanteresses, il est encore pour nous une révélation permanente de la vie universel1e et un enseignement hors ligne de vérités astronomiques.
C’est à l’observation des éclipses quotidiennes que les lunes de Jupiter produisent que nous devons la connaissance de la rapidité de la lumière. L’astronome danois Olaf Roemer remarqua le premier, en 1675, que ces éclipses retardaient ou avançaient d’environ 16 minutes et demie, selon que Jupiter se trouvait en conjonction ou en opposition avec le Soleil.
Le diamètre de l’orbite terrestre étant d’environ 298 millions de kilomètres, il était, désormais, prouvé que la lumière parcourt 300.000 kilomètres par seconde, ou plus exactement 299.796 kilomètres.
C’est à l’étude télescopique et spectroscopique du disque jovien que nous puisons, à l’heure qu’il est, les renseignements les plus précieux de géologie stellaire et que la philosophie astronomique trouve le mieux à se documenter.
Monde en voie de formation, Jupiter nous fait assister, d’ici, aux périodes les plus mouvementées de la préhistoire de notre propre planète. Ce qui se passe là-haut est ce qui s’est passé ici-bas, il y a une centaine de millions d’années, et c’est notre propre passé que nous étudions en observant le déchaînement de tous les éléments qui se produisent actuellement à plus de 600 millions de kilomètres d’ici, sur le géant de notre système.
S’il est exact que le vaste Jupiter soit, aujourd’hui, — et c’est certain — au même stade de son évolution où en était la Terre, il y a cent millions d’années, il faudra à la planète géante, qui est mille fois plus grosse et trois cents fois plus lourde que notre globe, des millions de siècles pour qu’elle puisse arriver dans son évolution ascendante, au point qui correspond à celui auquel nous sommes parvenus dès maintenant. Mais si, par hypothèse, d’ici là, le foyer d’action vitale de notre système planétaire qu’est le Soleil s’était éteint — et il y a des savants, et pas des moindres, qui n’accordaient, hier encore, qu’une quarantaine de millions d’années à sa lumière et à sa chaleur — les germes de vie, qui se trouvent actuellement à l’état embryonnaire sur notre grande planète sœur, n’arriveraient jamais à leur entière éclosion, à leur plein développement, Jupiter serait mort avant d’atteindre son apogée.
Qu’on puisse compter sur des millions de siècles et toutes les îles de notre archipel solaire auront le temps de parcourir le cycle entier de leur évolution. Par contre, l’astre du jour s’étant éteint dans quarante millions d’années, Jupiter, mort avant son heure, serait condamné à faire, à son détriment, l’expérience de manque de finalité dans l’Univers, la nature, alternativement marâtre et bienfaisante, ne faisant aucune différence, qu’il s’agisse de ces atomes du ciel, que sont les soleils et les planètes, ou de nous autres, habitants fugitifs de ce monde sublunaire.
Quoiqu’il en soit, la vie vaut la recherche de la vérité désormais acquise, que la vie est partout illimitée dans le temps et l’espace.
SATURNE.
Saturne, où nous arrivons maintenant, est la plus grande merveille de notre système planétaire, dans lequel il reste, avec son anneau lumineux, comme le principal témoignage de la formation des mondes. Dieu du Temps et du Destin des anciens, son orbite était considéré, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, comme la frontière de notre République solaire.
Cette belle planète, dont l’inclinaison de l’équateur sur l’orbite est de 26° 49’, gravite à une distance moyenne de 1.400.000.000 kilomètres du Soleil, en faisant 9 kilomètres et demi par seconde sur son parcours de 8.860.000.000 kilomètres et met, en tournant autour de son axe en 10 h 14’, 29 ans et demi pour accomplir sa révolution autour du Soleil.
Le diamètre équatorial de Saturne est de 122.000 kilomètres, mais son volume n’est que 719 fois aussi gros que celui de la Terre, car l’aplatissement de ses pôles est de 1/10e, tandis qu’il n’est que de 1/17e sur Jupiter et 1/292e ici.
Quoique 719 fois plus gros que la Terre en volume, le poids de Saturne ne dépasse guère 92 fois celui de notre planète.
Le spectre de Saturne présente la plus grande similitude avec celui de Jupiter, mais il n’en est pas de même de son anneau, où la bande caractéristique dans le rouge ne se retrouve, ce qui nous fait penser qu’il ne doit pas y avoir plus d’atmosphère dans l’anneau de Saturne que dans notre Lune.
La couronne de Saturne est un système d’anneaux concentrique, composés d’un grand nombre d’astéroïdes ou lunes minuscules se présentant dans le télescope comme un immense anneau nettement partagé en deux anneaux distincts séparés l’un de l’autre par un espace noir, large de 2.800 kilomètres, dit ligne de Cassini. La distance du bord intérieur de l’anneau à la surface de Saturne n’est que de 11.600 kilomètres.
Au-dessus de ce système d’anneaux, une dizaine de lunes, dont plusieurs ne sont que des astéroïdes gravitant autour du monde Saturnien et desquelles nous ne voulons retenir que les plus grandes : Rhé et Titan, dont les diamètres semblent atteindre 1.200 et 3.000 kilomètres et qui mettent 4 et 15 jours pour contourner Saturne.
De l’ensemble de l’uranographie des satellites et de leur planète nous concluons que la vie, comme sur notre Lune, s’est depuis longtemps éteinte sur les premières et qu’elle a dû coïncider chez eux avec l’époque où Saturne était encore un soleil en pleine activité. Du reste, les avis sont partagés. Quant au globe de Saturne lui-même, dont le faible soleil n’a qu’un diamètre apparent de 3’ 22 », l’activité actuelle, à sa surface, l’atmosphère dense, chargée de vapeurs d’eau nous incite encore à penser qu’il doit encore produire de la chaleur par lui-même, grâce à son volume énorme pas encore entièrement refroidi ou parce que la constitution physique et chimique de son atmosphère et les influences cosmiques de ses anneaux s’unissent pour créer des effluves électriques et transforment certains mouvements en chaleur.
URANUS.
Avec Uranus, découvert par William Herschel, en 1781, nous arrivons aux confins de notre monde solaire, où des perturbations encore inexpliquées ont occasionné les mouvements rétrogrades des quatre satellites d’Uranus et de celui de Neptune. Au lieu de tourner de l’ouest à l’est, comme la Lune, des satellites de Mars, de Jupiter et Saturne, dans le plan de leurs équateurs respectifs de façon à ce que ce plan ne fasse pas un angle considérable avec celui de leurs orbites autour de l’astre du jour, les compagnons d’Uranus tournent, au contraire, de l’est à l’ouest et dans un plan presque perpendiculaire à celui dans lequel la planète se meut. Il résulte de cela que l’axe de rotation d’Uranus est presque couché sur le plan de son orbite et que dans le ciel uranien le Soleil tourne d’apparence d’ouest en est au lieu de l’est en ouest. L’équateur d’Uranus étant incliné sur l’orbite, le Soleil uranien doit s’éloigner pendant le cours de son année de 81 ans terrestres jusqu’à cette même latitude et les latitudes qui correspondent sur cette planète à celle de l’Europe septentrionale pour nous, ont, pendant leurs longs hivers et leurs longs étés de 21 ans, le Soleil sans interruption alternativement au-dessous et au-dessus de l’horizon.
La planète Uranus se meut lentement, à l’énorme distance de 2 milliards 864 millions de kilomètres du Soleil, en faisant 6 kilomètres 700 mètres par seconde sur sa longue orbite de 17 milliards 830 kilomètres et met, en tournant sur elle-même en 11 heures environ, 84 ans et 8 jours pour accomplir sa révolution entière.
L’année d’Uranus est donc de 84 ans 8 jours et son jour de 11 heures à peu près.
Le diamètre d’Uranus est 4 fois celui de la Terre, soit exactement 53.000 kilomètres, ce qui fait que ce monde est encore, à lui seul, plus gros que les quatre planètes intérieures, Mercure, Vénus, la Terre et Mars réunies. Sa masse, par contre, est à peine 14 fois celle de la Terre, car les matériaux qui la constituent sont très légers et ne valent, à quantité égale, qu’un cinquième, 0,1% des nôtres,
Par l’analyse spectrale nous savons que l’atmosphère d’Uranus ressemble plus à celle de Saturne et Jupiter qu’à la nôtre, qu’elle forme, comme la leur, des bandes parallèles à l’équateur et qu’elle renferme aussi des gaz inconnus ici, mais identiques ou analogues à ceux que nous avons trouvés dans les deux grandes planètes. En outre, fait à noter, l’atmosphère d’Uranus se distingue surtout par la faculté d’absorption, faculté que nous n’avons jusqu’ici rencontrée dans aucune autre planète de notre système.
Uranus a quatre lunes : Ariel, à 196.000 ; Umbriel, à 276.000 ; Titania, à 450.000 et Oberon à 600.000 kilomètres de distance et elles tournent respectivement en 2 jours 12 heures, 4 jours 3 heures et demie, 8 jours 16 heures et 13 jours et demi autour de lui.
NEPTUNE.
Depuis que le prodigieux mathématicien Le Verrier a presque doublé le rayon précédemment connu de notre République solaire en heurtant de sa plume la terre lointaine du ciel qu’est Neptune, il nous semble qu’il doit y avoir encore, dans le domaine de notre Soleil, plusieurs planètes au-delà de cette dernière.
Cette probabilité de l’existence de planètes transneptuniennes ressort surtout de ce que la troisième comète de 1862 a son aphélie à la distance 48 (48 fois celle qui sépare le Soleil de notre Terre) et que les orbites de quatre autres comètes aussi paraissent avoir leur point d’intersection à une distance de 70. Si ce calcul est exact, et il doit l’être, l’hypothèse de deux planètes voguant à environ 7 et 10 milliards et demi de kilomètres du Soleil se vérifiera réalité à condition, bien entendu, qu’elles soient assez volumineuses pour être visibles.
A défaut de ces deux planètes attendues, un visiteur inattendu, la planète Pluton, de la taille de notre Terre, vient de se présenter, mais nous ne sommes pas encore en état de l’apprécier parce qu’elle est encore sur le « chantier ».
Retournons donc à Neptune, encore gardien provisoire de la frontière de notre système.
L’orbite de Neptune, longue de presque 28 milliards de kilomètres, est tracée autour du Soleil, à la distance moyenne de 4 milliards 487 millions de kilomètres. Cette planète, qui ne fait que 5 kilomètres 370 mètres par seconde, en tournant probablement en 11 heures autour de son axe, met 164 ans 281 jours pour accomplir sa révolution autour du Soleil. L’année de Neptune est donc de presque 165 ans et son jour d’environ 11 heures.
Le diamètre de ce monde, le nôtre multiplié par 3,8, est de 48.420 kilomètres. La densité de ses matériaux n’est que le tiers des nôtres, mais la pesanteur à sa surface est à peu près égale à ce qu’elle est ici. Malgré la faiblesse de sa lumière, l’analyse spectrale a permis d’apprécier son atmosphère et nous savons qu’elle offre presque une identité complète avec celle d’Uranus et qu’elle a les mêmes facultés d’absorption que la sienne.
Nous ne connaissons qu’une lune à Neptune. Elle fut découverte par Lassel, également en 1846, et elle tourne à 400.000 kilomètres autour de Neptune en 5 jours, 21 heures. Son mouvement est rétrograde, de l’est à l’ouest, et c’est surtout par la rapidité de sa rotation que nous avons pu établir approximativement celle de Neptune, dont le disque, légèrement bleuâtre et diffus, n’offre pas de points de repère suffisant pour permettre avec précision un tel calcul.
Vu d’Uranus, qui est 19,18 et de Neptune qui est 30 fois plus éloigné de l’astre du jour que nous, la première de ces deux planètes ne reçoit plus que la 368e partie et la seconde la 900e partie de chaleur et de lumière dont il nous gratifie. La pleine Lune réfléchissant la 618.000e partie de la lumière solaire, Uranus reçoit donc tout de même du Soleil encore 1.500 fois, et Neptune 687 fois plus de lumière que nous de la pleine Lune...
Nous voici, avec un peu d’efforts, arrivés au terme de notre voyage idéologique. Uranus et Saturne exceptés, toutes les planètes de notre monde ont disparu de notre vue ; mais les quatre milliards et demi de kilomètres qui nous séparent du Soleil n’ont en rien modifié les figures des constellations qui brillent au-dessus de nos têtes. Pour changer les perspectives stellaires que nous offrent les constellations de la Grande Ourse ou de l’Orion, il nous faudrait, sur les ailes de la pensée, plus rapides que la lumière, franchir neuf mille fois la distance qui nous sépare de Neptune, pour aborder, après avoir assisté à un défilé de comètes — les trépassés du Ciel — Proxima ou Alpha du Centaure, la belle étoile double, dont le volume égale environ deux fois et demi celui de notre Soleil... Je gage que nous ne serions pas bien dépaysés, parce que partout nous retrouvons même loi fondamentale, même égalité constitutive avec des variétés infinies, mais semblables dans les formes ou manifestations de la vie éternelle.
— Frédéric STACKELBERG.
P. S. — Une poule aveugle, prétend un dicton allemand, trouve parfois un grain d’or. C’était mon cas, quant à la Bégude, près de Marseille, j’ai trouvé une étoile dite nouvelle, en glanant, sans l’aide d’un télescope, dans le ciel pendant une belle nuit d’été, en 1918, comme en fait foi le télégramme que j’ai envoyé alors à notre inoubliable Camille Flammarion et qu’il inséra dans sa Revue Astronomique.
Je n’ai pas plus de mérite aujourd’hui qu’alors, en affirmant, dans l’intérêt de la précision et de la clarté, que toutes les étoiles sont alternativement diffuses et géantes dans leur jeunesse, condensées et naines pendant leur vieillesse et qu’elles semblent varier comme poids, en moyenne, dans la même proportion que les hommes entre eux de 1 à 5 et que la longévité maxima d’un être humain qui ne dépasse guère 120 ans, trouve son pendant équivalent dans une étoile dont l’âge de la naissance à la mort (sortie et retour à l’éther intersidéral) ne doit pas dépasser 15 trillions d’années.
— F. S.
PLASMOGÉNIE
n. f.
Mot nouveau s’appliquant à une science nouvelle, celle qui s’occupe spécialement de la génération des formes modelées (Plasma-Généa) ou biologie synthétique.
Ce mot, proposé dès 1903, par le Professeur Alfonso L. Herrera, rassemble dans les mêmes études les travaux divers se rapportant à la biologie constructive, les essais de reconstitution, en laboratoire, des phénomènes de la vie organique.
La plasmogénie pure, qui comprend l’étude des phénomènes de morphogenèse, de physiogenèse et de chimiogenèse, se complète par la plasmogénie appliquée qui s’étend sur l’hygiène, la médecine, les sciences naturelles, la cosmologie, l’agriculture, l’industrie, etc. Dans sa partie abstraite, la plasmogénie appliquée touche la philosophie et la sociologie, on voit donc quel champ immense s’ouvre devant les pionniers de cette science, puisque c’est la vie universelle qui est leur terrain d’expérience.
Ceci explique également la valeur personnelle des hommes qui se sont donnés à ces délicats problèmes, car avant de devenir des reconstructeurs de formes animées, ils ont dû préalablement parcourir les sciences qui s’y rattachent : physique, chimie, astronomie, histoire naturelle, biologie, océanographie, etc.
Je ne dirai rien de la biologie purement analytique, qui précéda les premières expériences de plasmogénie (cherchant à combler l’énorme fossé qui séparait à nos yeux les éléments vivants de ceux dits : « non vivants »), qui eurent lieu il y a environ cent ans. Ducrochet et G. Rose cherchaient déjà, par divers moyens, à reproduire des cellules animées, ainsi que Linck. Vers 1855, Runge trouva la « force vitale » dans l’osmose et la capillarité, et obtint des précipités périodiques.
Ch. Brame perfectionna les expériences, obtint des cellules de soufre utriculaire, ébauche d’organisation présentant des phénomènes osmotiques et, en 1865, Bôttger prépara les premières végétations inorganiques, qui furent le point de départ des recherches postérieures sur les croissances osmotiques à base de silicates.
Jusqu’en 1880, on a remarqué les essais de Traube de Breslau, de Pfeffer et de Reincke. En 1871, Harting avait réussi son essai de production synthétique de formations calcaires, pendant que Rainey reproduisait des cristaux imparfaits en milieu colloïdal.
Ce fut en 1882 que C. Robin présenta à l’Académie des Sciences un mémoire de Vogt et D. Monnier, sur l’imitation des formes organiques obtenues par osmose et, en 1885, Garcia Diaz, de Madrid, présenta des formes de morphogenèse expérimentale, pendant que Th. Graham, en Angleterre, travaillait sur l’état colloïdal d’où allait naître la biologie micellaire des frères Mary. Vers 1890, deux noms retenaient déjà l’attention ; ce sont ceux de Bütschli, le micrographe, et de Alfonso L. Herrera, qui publièrent de remarquables études sur des expériences morphogéniques.
Dix ans après, le courageux Stéphane Leduc, de Nantes, préparait sa « Biologie synthétique » qui, malgré son éloignement, reste pour nous un monument de clarté et de probité documentaire ; il publiait ensuite sa « Théorie physico-chimique de la Vie », suivie, en 1921, de l’ « Energétique de la Vie », qui est son dernier livre sur la biophysique et la plasmogénie. Les travaux de Stéphane Leduc, rouvrant la controverse sur les générations spontanées, donnèrent lieu à de chaudes discussions. Quoi qu’on ait dit, les expériences de Pasteur n’ont pas solutionné le problème, son triomphe ne fut que momentané, mais il eut pour lui une presse puissante et l’appui tacite ou avoué de tous les officiels et du clergé. Les mêmes voulurent étouffer la voix de cet ancien tourneur sur métaux, qui se permettait de chercher à fabriquer des être artificiels et de surprendre les secrets de la Vie, jusqu’ici réservés à Dieu. Stéphane Leduc aura sa revanche, les esprits libres lui redonneront une place d’honneur parmi les précurseurs ; toutes les études de l’avenir touchant l’osmose, la biologie micellaire, etc., devront forcément se référer à ses travaux impérissables. Ah ! si Stéphane Leduc s’était soumis aux puissants du jour, et qu’il eût adapté ses résultats avec les conceptions religieuses du moment, il serait plein de gloire et fêté, au lieu de connaître le mépris non déguisé des officiels, à cause de ses ouvrages libérateurs. Non seulement ce fut un savant averti, mais il tira de ses travaux toute une philosophie, qui ne plaît point aux pontifes, et ceci explique sa retraite silencieuse. Ses conceptions évolutionnistes furent trop osées pour ses contemporains, mais les critiques malveillantes s’éteindront avant que son œuvre admirable ne subisse les assauts du Temps.
Je regrette de ne pouvoir donner, ici, de longs aperçus de la philosophie de Stéphane Leduc ; beaucoup de lecteurs de l’E. A. le connaissent déjà. Que les autres s’y réfèrent, ils verront que, sous l’écorce d’un savant positif, se cachait un cœur d’or, d’un désintéressement total, qui fait penser à Elisée Reclus.
Vers 1910, et de tous côtés, de nouvelles recherches sur la cristallisation, sur la phagocytose, sur l’osmose, sur la biologie des infiniments petits, se firent jour et constituèrent des bases solides pour la plasmogénie.
Dès 1909, les frères Mary éditaient leur ouvrage sur les « cellules artificielles » ; ils étudiaient la cristallisation imparfaite, fondaient la biologie micellaire, multipliaient les expériences, conjuguant leurs travaux avec ceux de Lehmann, de Kuckuck, de Benedikt, de Raphaël Dubois, de Gaubert, de Butler, de Quinke, de Rumbler, de Victor Delfino, etc. En 1914, les frères Mary fondaient l’Institut de Biophysique, qui devint un foyer des idées physicistes et, en 1915, ils publiaient les « Principes de Plasmogénie ».
Une pléiade d’autres chercheurs, parmi lesquels Lecha Marzo et Rodriguez Mendez, en Espagne ; Castellanos, à Cuba ; Jules Félix, à Bruxelles ; Foveau de Courmelles, à Paris, donnaient un essor nouveau à la plasmogénie, puissamment aidés en cela par d’autres savants et penseurs, comme E. Hureau, Alfred Naquet, Rocasolano, Albert Jacquemin, Tarrida del Marmol, S, Lillie, Otto von Schroën, Renaudet, Malvezin, Guinet, G. Abbott, H. Fischer, Razetti, Mirmande, Ruiz Maya, etc.
Déjà, en 1911, A.-L. Herrera avait publié, à Mexico, « Una nueva ciencia. Plasmogénia ». En 1915, les frères Mary publiaient, en Espagne, « La sintesis de la Organizacion » ; en 1919, les mêmes écrivaient le résumé de l’histoire de la Plasmogénie, et ce fut seulement en 1921 que, par souscription, put paraître, à Paris, le « Dictionnaire de Biologie Physiciste », qui restera pour tous nos amis une mine inépuisable de recherches touchant les grands problèmes de la Vie (l’hydrogéologie occupe 80 pages de cet ouvrage), puis vinrent les « Horizons du Physicisme », qui parurent en 1923.
En 1926, parut, à Barcelone cette fois, et richement illustrée, une nouvelle édition de « Una nueva ciencia : la Plasmogénia », par A.-L. Herrera.
Depuis, dans bien des journaux, revues médicales, scientifiques ou philosophiques, nous avons lu des articles sur la plasmogénie, signés : Albert Mary, Victor Delfino, A-L. Herrera, R. Dubois, Foveau de Courmelles, Jules Regnault, etc. Une revue allemande, « Protoplasma », s’occupe spécialement de cette science. Espérons que de nouvelles revues s’intéresseront à ce problème fondamental de la Vie universelle, en dehors des dogmes des religions révélées et donneront à la plasmogénie la place qu’elle mérite, parmi les sciences positives. Le petit « Bulletin de l’Association Internationale Biocosmique » (La Vie Universelle) donne toujours les compte rendus et résultats d’expériences de plasmogénie, à côté d’autres études astronomiques ou philosophiques.
En 1928, courant février, Albert Mary, qui avait perdu son frère depuis 1915, mourut à son tour, sans avoir jamais reçu la récompense de son travail acharné. Comme Stéphane Leduc et comme A-L. Herrera, il avait subi les critiques acerbes de ceux qui veulent modeler leurs conclusions scientifiques sur des métaphysiques périmées. Albert Mary, qui fut des nôtres aux Universités Populaires, et donna des chroniques aux « Temps nouveaux », fut un biologiste non officiel, un en-dehors, un chercheur indépendant, un philosophe, et un poète, et son œuvre doit être classée au tout premier rang, parmi celles des plasmogénistes.
Je visitai également, en 1928, le vieux pacifiste Raphaël Dubois ; il mourut peu de temps après, en 1929, laissant, en plus d’un long professorat, de belles études sur la lumière physiologique, le sommeil hivernal, etc. ; il fut le grand ami de Kuckuck, de Pétrograd. La mort fauche dans les rangs des chercheurs, mais rien ne se perd de leurs enseignements, et les jeunes, continuant les investigations commencées, donneront peut-être demain un essor insoupçonné aux découvertes de la biologie synthétique. Puisse notre vaillant ami A-L. Herrera qui, depuis plus de 40 années, a donné le plus grand essor à cette science, continuer encore longtemps ses expériences, pour que les jeunes générations s’orientent un peu vers la synthèse scientifique, après avoir été si longtemps portées vers les sciences analytiques. Ainsi conduits vers de nouvelles et pacifiques conquêtes, les hommes sauront mieux se situer dans l’Univers incréé, et comprendront facilement le solidarisme biocosmique qui les lie avec tout ce qui existe (avec les éléments vivants et avec les matières dites inertes, avec le passé et avec l’avenir) et deviendront plus fraternels, plus solidaires, en supprimant totalement les barrières de race, de couleur, de frontière et de langage, qui les empêchaient de collaborer pour de meilleurs devenirs.
— J. ESTOUR.
P.-S. — Pour compléter ce court exposé, je ne saurais mieux faire que de citer quelques phrases glanées un peu au hasard, mais qui situeront quand même les plasmogénistes dans l’esprit du lecteur, et de donner une petite bibliographie pour ceux qui voudraient approfondir cette question si importante. — J. E.
-
Extraits (Stéphane Leduc) :
-
La vie est indestructible, incréable, éternelle (page 22, « Biologie Synthétique »),
-
La condensation des nébuleuses, la séparation des planètes et de leurs satellites est, au point de vue mécanique, analogue aux phénomènes de cohésion et de segmentation que nous avons étudiés dans les liquides, et suggère que si, au lieu d’un champ de forces rayonnantes, nous produisions dans les liquides un champ tourbillonnaire, les analogies deviendraient plus grandes encore... (page 171, « Biologie Synthétique »).
-
Puisque on ne peut marquer la séparation entre la Vie et les autres phénomènes de la nature, on devrait conclure que cette séparation n’existe pas, ce qui est conforme à la loi de continuité entre tous les phénomènes (page 13, « Théor. Phys. Chim. ; de la Vie et Générations spontanées »).
-
L’acte élémentaire de la Vie, c’est la diffusion et l’Osmose (page 179, « Th. P. C. ; de la Vie et Gén. sp. »).
-
Ce n’est qu’en conservant intacte sa personnalité, en toute liberté, en toute indépendance que l’on peut avancer vers des horizons nouveaux... Il existe, pour les pionniers, des satisfactions inconnues des autres hommes : la conscience de l’œuvre accomplie, la volupté de l’action qui crée ce qui n’a jamais existé, de l’esprit qui contemple ce qui n’a jamais été vu, de l’intelligence qui comprend ce qui n’a jamais été compris (page 205, « Bol. Synt..»).
-
-
Extraits (Albert Mary) :
-
La Nature n’est grande et intelligible que vue de haut. On comprend alors combien il est impossible de scinder les phénomènes en compartiments nettement délimités et foncièrement différents les uns des autres, et combien l’Univers, selon le mot de d’Alembert, n’est vraiment « qu’un fait unique et une grande vérité » (« Dict. de Biologie Phys. »).
-
La seule loi idéale de l’éthique est extensive et tolérante : c’est une loi de respect égalitaire et mutuel qui se double accessoirement d’un corollaire d’entraide. Contre les fléaux et contre les difficultés naturelles d’existence, l’humanité ne sera vraiment forte que lorsque les êtres humains auront répudié définitivement toute concurrence matérielle qui infériorise et toute haine désavantageuse à l’individu et à l’espèce. Moins de codes, de castes et de frontières ; plus d’intelligence, de droiture et de bonté : voilà ce qu’il faut à l’Humanité pour devenir digne d’elle-même, pour durer et pour être plus heureuse (p. 263, « Dict. Biol. Phys. »).
-
Il n’y a pas d’ « essence individuelle », tous les éléments dynamico-matériels de l’être humain sont puisés dans un tonds alimentant au même titre tous les êtres et toutes les choses et auquel ils retournent après la dissociation des architectures éphémères, minérales, végétales, animales où ils se sont trouvés engagés. (Déclaration de l’Ass. Int. Biocosmique, sept. 1P27.)
-
-
Extraits (A.-L. Herrera) :
-
En réalité, tout est vie, et on ne saurait concevoir aucune limite entre ses diverses formes, les mêmes atomes passant des corps organisés aux inorganiques, à travers des combinaisons infinies ; et si nous envisageons la vie comme le mouvement dans l’Univers, rien n’est mort et, sous divers degrés, tout a une vie, manifeste et organique, en petit, ou comme un ensemble manifeste ou non, inorganique, en grand, enfermant toutefois les éléments des îlots d’être vivants, semés dans l’infini d’eaux profondes et agitées. (Ab Aeterno : « La Vie universelle », n° 7, page 126.)
-
L’Association Biocosmique répond à un besoin profond de nos temps. Morts et oubliés les dogmes religieux dans le cerveau des hommes libres ; détruit pour toujours l’idéal mystique, spiritualiste, chrétien ; il faut rentrer bon gré mal gré dans la nature, nous résigner à mourir pour toujours, dans le sens absolu et vulgaire du mot, mais tout à fait sûrs de notre pénétration dans l’ensemble, ou plutôt de notre vie cosmique. Par là, nous ne mourrons jamais. Notre dépouille fétide, cadavérique, si détestée des spiritualistes est, en réalité, un laboratoire merveilleux, où des réactions chimiques actives se poursuivent dans les mêmes atomes, molécules, milieux physico-chimiques de l’être vivant. Une humanité et une philosophie nouvelles se dresseront sur les ruines du Vatican. (« La Vie universelle », n° 1, page 15.)
-
L’ensemble de la Nature est vivant, et non mort, comme le disaient les partisans de saint Augustin (l’Aigle de l’Eglise), auteur de 252 volumes. Haeckel a combattu l’erreur géocentrique, mais il faut aussi combattre l’erreur biocentrique, qui consiste à limiter la vie des organismes terrestres. Kuckuck a publié, à cet égard, un livre volumineux et peu connu (« L’Univers, être vivant », 1911, Kündig, Genève). L’activité des astres est gigantesque, les éléments sont synthétisés dans les étoiles et les rayons cosmiques de Millikan constituent l’annonce de la naissance des éléments à la faveur des électrons positifs ou négatifs, produisant de la sorte les atomes. Ces cadavres bâtissent la nature. Le Ciel étoilé, envisagé comme un autel sépulcral par le fanatisme, est une vie universelle. (« La Vie universelle », n°9, page 163.)
-
La différence classique entre la matière morte et la matière vivante a été écrasée par la plasmogénie. Tout vit. Je suis heureux de donner la Vie à tout, associé à Dastre, Fouillée, Jules Félix, A. Mary, F. Monier, Zucca, Andrenko, etc. J’ai l’honneur d’octroyer le ciel étoilé aux hommes et ceux-ci à l’Infini. En effet, nous avons cette suprême consolation : nous sommes immortels, nous faisons partie de l’Univers et irons toujours d’une forme à l’autre, en menus fragments ou comme des géants, comme des poussières d’étoiles ou comme des cellules solaires. Rien ne meurt : dans l’Indifférence universelle tout se tient et tout se pénètre. Le vivant est un soupir de l’Infini. Le cadavre est un fantôme. (« La Vie universelle », n° 10, page 191.)
-
-
Extraits (Raphaël Dubois) :
-
En analysant attentivement les arguments invoqués par les philosophes spiritualistes d’une part et par les matérialistes d’autre part, je fus conduit à reconnaître qu’en réalité, on passe sans transition appréciable de la Force à la Matière et réciproquement, et que ces deux principes ne sont, en somme, que deux aspects d’une seule et même chose, d’un principe unique, à la fois Force et Matière. Pour le distinguer des conceptions dualistes, je proposai alors de baptiser le nouveau-né « Protéon », pensant que c’était aussi le meilleur moyen de faire disparaître de la Science le mot force et le mot matière qui, dans mon esprit, exprimaient des erreurs susceptibles de conduire à une impasse, comme cela arrive aux religions buttées à des dogmes immuables. (« La Vie universelle », n° 2, p. 7.)
-
BIBLIOGRAPHIE. — A.-L. Herrera : Una nueva ciencia, « La Plasmogénia » (Maucel, éditeurs, à Barcelone, 1926) — A. et A. Mary : Dictionnaire de Biologie physiciste (Maloine, 1921, Paris). — A. Mary : Les Horizons du Physicisme (Maloine, 1923, Paris). — A.-L. Herrera : Biologia y Plasmogénia (Herrero Hermanos, 1924, Mexico). — Stéphane Leduc : Théorie physico-chimique de la Vie (Poinat, éditeur, Paris, 1910). — Biologie Synthétique (Poinat, éditeur, Paris, 1912). — L’Energétique de la Vie (A. Poinat, éditeur, Paris, 1921). — Raphaël Dubois : Naissance et évolution du Protéonisme (« Vie Universelle », n° 2 à 7). — A.-L. Herrera : La Vie latente dans l’Univers (« Vie Universelle », n° 1 à 10). — Foveau de Courmelles : La Vie et la Lumière (« Vie Universelle », n° 5). — Félix Monier : Lettres sur la Vie (Vallée du Mont Ari), 1921 (à Châtenay-Malabry, Seine). — Georges Lachovsky : L’Origine de la Vie (Nilsson, Paris, 1925). — Carl Störmer : De l’Espace à l’Atome (Alcan, Paris, 1929). — Barbedette : Face à l’Eternité (Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône). — Jules Regnault : Les Méthodes d’Abrams (Maloine, Paris, 1927). — Kuckuck : L’Univers, être vivant (Kundig, éditeur, Genève, 1911). — Victor Delfino : La vida y la muerte, los origenes de la vida, los progresos de la plasmogenia, produccion de amibas artificiales, biologia universal, el error biocentrico ; El Cosmos y la vida. Nuevos horizontes de la biologia, etc., et cent traductions diverses. — Aristide Pradelle : L’Atome fluide moteur du monde (Delesalle, éditeur, Paris, 1912). — Albert Dastre : La Vie el la Mort (Paris, 1902). — Paul Kammerer : Allgemeine Biologie (Stuttgart 1920). — Israël Castellanos : Plasmogénia (Hyygia Madrid, 1918). — J. Nageotte : Organisation de la matière (Alcan, Paris). — H.-F. Osborn : The origin, and evolution of Life (New-York, 1921). H. Bechhold : Colloids in Biology and Medicine (NewYork, 1919). — Martin Fisher : Oedema and Nephritis (New-York, Willis, éditeur, 1921). — J. Alexander : Colloïd Chemistry (1922, vol. 26, New-York). — Kunstler et Prévost : La matière vivante (Masson, Paris, 1924). — Aug. Lumière : Nouvelles hypothèses (Masson, 1921). — A.-L. Herrera : La Silice et la Vie (en préparation, 1930). — A. Zucca : L’uomo e l’infinito (Voghera, 1906, Rome). — Rôle de l’Homme dans l’Univers (Paris, Schleicher).
Parmi les revues qui ont publié des articles sur la Plasmogénie, on peut citer : Protoplasma, Homo, Semana medica, La Revista Blanca, Medicina Argentina, Côte d’Azur Médicale, Intuicion, L’Idée Libre, Le Courrier Médical, Estudios, Le Semeur, L’En-dehors, La Vie Universelle (organe de l’Ass. Intern. Biocosmique), etc.
PLATINE
n. m. (espagnol : platina, de plata, argent)
Métal malléable, dont la couleur, à l’état pur, varie entre le blanc d’argent et le gris de plomb. C’est le plus lourd des corps connus, son poids spécifique allant jusqu’à 22,069 quand il a été travaillé. Mais c’est aussi le plus inaltérable ; il ne s’oxyde à aucune température, résiste à la plupart des agents chimiques et n’est fortement attaquable que par l’eau régale et plus lentement par l’acide sulfurique nitreux, la potasse, l’azote de potassium et le cyanure de potassium. Son point de fusion est de 1.800 degrés.
Ce métal, qui se trouve toujours mélangé dans la nature avec d’autres métaux ayant des propriétés analogues, comme le palladium, l’iridium, l’osmium, etc., a été découvert en Amérique méridionale, au Brésil, en Colombie. Il existe aussi dans les dépôts aurifères et diamantifères de Bornéo, et sur la pente orientale des monts Oural. L’infusibilité et l’inaltérabilité du platine donne lieu à un procédé d’extraction spécial. On attaque la mine de platine par l’eau régale et on précipite par le chlorhydrate d’ammoniaque ; le précipité calciné produit ce qu’on nomme le platine en épongé ; cette matière est réduite en poudre fille qui puisse former une boue avec de l’eau ; cette boue placée dans un moule est comprimée le plus possible. Le gâteau obtenu est alors chauffé, puis martelé sur une enclume pour en rapprocher de nouveau les parties. Après cette opération, le platine peut être forgé, comme le fer, puis laminé, étiré en fil, etc. On emploie le platine dans beaucoup de circonstances ; on en fait des chaudières, des alambics pour les usines de produits chimiques ; des creusets, des tubes, des capsules pour les laboratoires. On a essayé aussi de l’employer en bijouterie. On munit de pointes de platine les paratonnerres. On l’applique également sur la porcelaine, surtout en couverture totale, qui donne l’apparence de l’argenterie. Associé avec 10 p. 100 d’iridium, il a servi à la construction de l’étalon type du mètre international.
— Ch. ALEXANDRE.
PLOUTOCRATIE
n. f. (du grec Ploutos, richesse et Kralos, pouvoir)
Influence des riches dans un Etat. Gouvernement des riches. Carthage fut une ploutocratie (Larousse). En fait, il n’y a jamais eu que des ploutocraties. Tout Etat dit policé est l’expression de la classe dominante, et cette classe est celle qui détient la richesse (capitaux et instruments de production). Ploutocratie au moyen âge, dans le système féodal, lorsque le seigneur, propriétaire du sol, dicte sa loi aux manants. Ploutocratie dans les nations modernes, lorsque le capitaliste impose sa volonté aux travailleurs : « Le capital est un seigneur qui engloutit tous les bénéfices et le travail un esclave qu’on force à soulever des montagnes » (Pecqueur). Ploutocratie partout, car la concentration capitaliste a abouti à remettre entre les mains de quelques corsaires de haut vol toute la richesse accumulée. Et, cependant, combien de naïfs s’imaginent vivre en démocratie ! Combien ont cru à la « nuit du 4 août », à la « souveraineté du peuple », à la libre « expression de la volonté nationale » ! « Plus de privilèges, la loi égale pour tous. » Quelle duperie ! Il faut dire pourtant que ces naïfs-là sont de moins en moins nombreux : la multiplicité des scandales financiers, l’application de plus en plus fréquente de l’adage : « Selon que vous serez puissant ou misérable, Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir » ont ouvert les yeux des plus crédules de nos contemporains. Partout, il faut subir « la loi du riche ». Et, nous référant à S. Faure (La Douleur universelle), nous citerons Necker qui disait :
« Toutes les institutions civiles ont été faites par les propriétaires. »
Et Turgot :
« Partout les plus forts ont fait les lois et ont accablé les faibles. »
Lamennais écrivait aussi :
« Ce qu’il a plu aux maîtres d’ordonner, on l’a nommé Loi et les lois n’ont été, pour la plupart, que des mesures d’intérêt privé, des moyens d’augmenter et de perpétuer la domination et les abus de la domination du petit nombre sur le plus grand. » (Le Livre du Peuple), etc.
Dans le même livre, S. Faure a lumineusement démontré comment la soi-disant démocratie aboutit en réalité à une ploutocratie occulte. Et chacun sait que, derrière le « peuple souverain », derrière les quelques centaines de pantins qui disent le représenter, il y a le « mur d’argent » : une poignée de magnats de la Banque et de l’Industrie qui sont les maîtres réels des peuples. Que le gouvernement soit une royauté ou une république ; qu’un Alphonse XIII soit remplacé par une démocratie ; qu’un bloc, dit « des gauches » s’installe au pouvoir, à la place d’un autre bloc dit « des droites » ; que X... se mette là où était Z... , ou vice-versa, qu’y a-t-il de changé pour le prolétaire ? Demain, il lui faudra offrir ses bras pour vivre tout comme avant, et les politiciens rouges ou blancs qui se succèdent sur le tréteau sont là pour le berner par leurs pirouettes. Sur la vie misérable du travailleur se projette l’ombre écrasante du coffre-fort. Et, dans la coulisse, sont les ploutocrates, vrais rois de l’heure, dictateurs puissants entre les mains desquels se trouvent les vies de millions d’humains.
— C. B.
PLURALISME
n. m. (de plures, pluralis : plusieurs)
En face de la métaphysique, il y a deux positions classiques. Sceptiques, positivistes, agnostiques repoussent toute métaphysique. Mais le dogmatique adopte une doctrine et combat pour elle comme pour la vérité absolue. Aucune de ces deux positions ne me convient.
N’y a-t-il aucun moyen de subir la victoire légitime du positivisme, critique de mes pouvoirs, sans sacrifier des désirs qui me tourmentent et me réjouissent, richesses instables ? La métaphysique ne saurait devenir science. Pourquoi n’aimerais-je pas en elle le plus séduisant et le plus décevant des poèmes ?
Mais, si la métaphysique me paraît poésie, je n’ai aucune raison d’adopter un système jusqu’à condamner les autres. Je veux continuer à jouir, alternatif, de tous les poèmes métaphysiques. Un plaisir à quoi je ne renonce pas en créant mon poème, c’est celui d’aimer les poèmes différents...
Le positivisme m’a enseigné que nulle métaphysique n’a de prise sur le monde extérieur, sur le monde objectif ; mon expérience m’a appris qu’aucune ne satisfait non plus à tous mes besoins intérieurs, à tous mes besoins subjectifs... Parmi les besoins poétiques qui dominent en moi, les plus considérables appartiennent peut-être à l’ordre logique et à l’ordre sentimental. Vais-je établir entre eux une hiérarchie ?...
Ma petite logique, tu es, si j’ose dire, une grande maîtresse d’erreur. En métaphysique, je m’appuie sur toi pendant une longue marche, où chaque pas a neuf chances sur dix de m’égarer. Les raisons que la raison ne connaît pas, ces raisons du cœur que vante Pascal, sont aussi trompeuses que la logique. De n’importe quel point de départ commun, la logique et le cœur nous peuvent entraîner vers des régions singulièrement diverses...
Une métaphysique est œuvre personnelle comme un poème. L’imposer est folie sacerdotale ; la proposer, naïveté paternelle. Il faut se contenter de l’exposer... Quel genre de poésie est la métaphysique ? Dans ma jeunesse, je déclarais déjà qu’il n’y avait pas de métaphysique vraie, mais j’ajoutais que toute vraie métaphysique tendait vers un monisme. J’appelais la métaphysique « la poésie de l’unité ». Je suis moins exclusif aujourd’hui et moins injuste. A côté de la blonde poésie de l’unité, j’aime la brune poésie de la dualité et du combat ; je ne méprise pas la châtaine poésie de la conciliation. Et pourquoi repousserais-je toujours la poésie de l’infini ? Mais la métaphysique que j’embrasse le plus souvent et d’un amour plus étroit, il me semble qu’elle est sens et poésie de la diversité... Au pluriel, c’est au pluriel qu’il faut parler des monismes, des dualismes, des ternarismes, des infinitismes, des pluralismes.
Dans les doctrines historiques, on pourrait considérer en souriant comme un monisme relativement absolu, le système des Eléates. Le monisme des Eléates se résume dans la fameuse formule :
« L’Etre est ; le Non-Etre n’est pas. »
Si l’être est d’une façon absolue et si, d’une façon absolue, le non-être n’est pas, voici niées toutes les épousailles du non et du oui, toutes les limites et les choses limitées, toutes les apparences, c’est-à-dire, je le crains, toutes les réalités. Voici nié le changement et les choses changeantes, le mouvement et les moteurs et les mobiles. Admettre un tel monisme, c’est supprimer l’expérience et ses objets, c’est ne voir dans les phénomènes et dans ce que nous appelons d’ordinaire êtres ou choses que tromperies ou illusions. C’est déclarer que rien de ce qui nous est apporté par nos sens n’a aucun l’apport avec la vérité profonde et l’être unique...
Ce puissant monisme d’éternité et d’immobilité est remplacé aujourd’hui par deux pauvres monismes évolutifs dont je dirais volontiers que l’un est futuriste et l’autre passéiste. Au XIXème et au XXème siècle, nul philosophe connu n’ose nier la multiplicité actuelle. Mais on sauve l’unité en la plaçant soit à l’origine, soit à la fin des choses.
Le monisme passéiste, l’unité placée à l’origine des choses, est la métaphysique à quoi aboutit la doctrine spencérienne. Spencer voit la vie et l’univers même comme un progrès fatal. Ce progrès il le définit une différenciation de plus en plus grande, une hétérogénéisation croissante des phénomènes et des êtres. Avec lui nous remontons, dans le temps, à une époque où l’homogénéité était absolue. Pour la réfutation du monisme passéiste, qu’on me permette de renvoyer au livre capital sur la question, Le Pluralisme de J.-H. Rosny aîné.
Qu’on cherche aussi dans ce livre la réfutation du monisme contraire, le monisme futuriste qui admet la multiplicité dans tout le passé comme dans le présent, mais veut que nous marchions vers l’unité et la paralysie, vers l’équilibre des énergies et de la matière.
Comme les monismes, poésies de l’unité, les dualismes, poèmes du combat, m’enivrent parfois, ne me satisfont jamais.
Il est visible que nous vivons dans un monde de guerre. Mais le combat a-t-il la précision que lui veut Zarathoustra ? N’y a-t-il que le bien et le mal ? N’y a-t-il pas, partout ou presque, du mélange ? Si je classe les phénomènes et tous les êtres selon le critérium de mon intérêt, tout ce qui ne m’est pas hostile m’est-il nécessairement favorable ?
Beaucoup de choses me sont indifférentes, neutres, sans saveur de plaisir ou de douleur. Parmi les phénomènes qui me blessent, quelques-uns m’apportent un bien réel… Même si, sur un certain plan, il y a du bien et du mal absolus, ou à peu près, je me transporte parfois dans des régions de lumière sans douce chaleur ni brûlure, par-delà le bien et le mal…
Après la poésie de l’Unité et celle du Combat, les poèmes de la Conciliation. N’y a-t-il pas un lieu où les adversaires s’apaisent et où les contradictoires s’identifient N Les métaphysiques qui essaient ainsi de concilier, dans un troisième terme, les deux armées du dualisme, je les appelle parfois ternarismes.
Les variétés en sont nombreuses. Le plus connu des ternarismes est le système de Hegel. Toujours Hegel dresse l’antithèse en face de la thèse ; il ne prend parti ni pour l’une ni pour l’autre, mais les fait s’épouser, à ce qu’il croit du moins, dans ce qu’il appelle la synthèse. Comme sa métaphysique est un panlogisme ; comme, pour lui, le mouvement des choses et le développement des idées se correspondent : dès qu’il a réussi la synthèse de la thèse et de l’antithèse, il croit avoir expliqué le devenir créé par la coexistence de l’être et du non-être ou par ce qu’il nomme volontiers, avec des mots moins concrets, l’identité des contradictoires. Mais, à regarder de près, on s’aperçoit que la synthèse, le plus souvent, renouvelle la thèse avec des mots en apparence plus larges et escamote, dans ce vague élargi, l’antithèse…
Il n’y a pas moins de poésie dans cette doctrine que dans la plupart des autres… Et il y a des métaphysiques infinitistes qui ont, comme toutes les autres, leur poésie et leurs impossibilités logiques. Et il y a encore le pluralisme, poésie et sens de la diversité.
Dans ce Pluralisme qui sera, demain, notre « Discours de la méthode », Rosny aîné se défend à peu près victorieusement contre toute métaphysique. Il se tient fortement sur le plan scientifique, logique, méthodologique… Ce Pluralisme, néanmoins, produira de nouvelles métaphysiques. Rosny lui-même accomplira l’évolution complète des grands génies philosophiques. Nul n’échappe à la métaphysique. Auguste Comte lui-même – et cependant c’est du nom de sa doctrine que nous appelons le refus à toute métaphysique – après un effort en apparence victorieux, a été plus vaincu que tout autre : il a construit plus qu’une métaphysique : une religion. Mais il n’y a pas défaite à satisfaire un des besoins essentiels de l’homme ; il n’y a pas défaite à être poète. La défaite, c’est de s’embrouiller et se perdre parmi nos besoins divers ou de se refuser à quelques-uns d’entre eux. J’ai besoin de nourriture et j’ai besoin d’air. L’un ne remplace pas l’autre. Voilà ce qu’ignorent ceux qui condamnent métaphysique ou science, ceux qui embrouillent science et métaphysique. Impossible de formuler une loi sans fausser en quelque mesure les phénomènes. Dans la forêt de l’univers, il n’y a probablement pas deux feuilles ou deux phénomènes qui se recouvrent exactement. Pour leur donner un nom commun, les soumettre à une loi commune, il faut oublier leurs différences ; il faut traiter comme identique ce qui n’est pas identique. Pour construire la science, nous consentons à quelque chose qui n’est pas de la science, qui est de la métaphysique.
Sachons-le. Ayons toujours en quelque méfiance ce qui est scientifique, à cause de la quantité de métaphysique que cela contient nécessairement. Ayons en admiration, si nous sommes poètes, tout ce qui est scientifique, à cause de la quantité de métaphysique et de rêve que cela contient nécessairement.
J’appelle métaphysique : l’art d’apaiser les antinomies, l’art de calmer nos contradictions internes. Les antinomies sont-elles purement internes ? Ne résident-elles pas aussi dans la nature des choses ? Si je ne donne pas aux mots un sens équivoque, est-ce que je ne trouve pas toujours la nature en contradiction avec elle-même ?... Peut-être est-il absurde de dire : La nature. Peut-être n’y a-t-il que des natures ? S’il n’y avait ni l’Etre et son travail contradictoire, ni la lutte éternelle de l’Etre et du Non-Etre ? S’il n’y avait que les êtres et l’innombrable Chacun-pour-Soi ?...
En moi aussi les natures se contredisent, se querellent. Que la bataille cesse d’être méchanceté et déchirement pour devenir spectacle, et qui m’émerveille… Je porte en moi des antinomies parce que j’ai des besoins intérieurs multiples. Ces besoins divers et souvent divergents, la métaphysique de chacun les doit satisfaire en chacun de nous.
Les antinomies ? L’Un et le multiple, l’infini et le fini, l’origine et la non-origine… Autant de terrains de heurts et de malentendus qui ont aussi leurs compromis comme l’absolu et le relatif… Les êtres sont. Réalité et existence à la fois dans la multiplicité fantastique des êtres en lutte et en pénétration. Les êtres sont. Contradiction de l’être libre en proie aux libertés contraires, problème d’une âpre « liberté » intérieure en face d’un déterminisme extérieur irrésistible, instabilité de l’être unique envahi par les êtres innombrables. Les êtres sont. Mais forment-ils vraiment un nombre, et fini ? Où sont-ils en dehors du nombre et en quantité infinie ? Je rêve, j’imagine que « tout » est éternel. Et cependant, je crois que « rien » n’est éternel… Les antinomies ? Il m’arrive de les résoudre par un parti-pris qui prend un faux aspect de conciliation. Mais la conciliation véritable m’échappe et elle n’est au pouvoir de personne….
Je suis – si j’ose dire – pluralement pluraliste. Non seulement j’admets (ou je rêve) la multiplicité des êtres et leur durée éternelle. Mais à chacun de ces êtres j’accorde, comme Spinoza à sa substance, un nombre indéfini (Spinoza dit : une infinité d’attributs…). Certes, chaque attribut de chacune de mes Eternités – et chacune de mes Eternités elles-mêmes – est impuissant à créer à lui seul aucun mode, aucune réalité sensible, mais chacune collabore de toute son essence, de tous ses attributs, à produire des êtres innombrables. Dans mon rêve, aucune de ces Eternités, aucune de ces essences qu’Herbart appelle les Réalités n’a jamais existé à l’état séparé. Elle a toujours été prise dans quelque agrégat. Et elle passe d’un complexe à un autre complexe. C’est pourquoi si, en un certain sens, il est juste de remarquer que, pensé isolément, chacun d’eux, incapable de subsister isolé, équivaut au néant et que seuls les phénomènes et les choses possèdent la véritable existence. Et la véritable existence est chose qui passe.
Le pluralisme de Rosny est phénoméniste. Mon pluralisme s’avoue substantialiste. Mais mon substantialisme monadiste se complète d’un pluralisme phénoméniste. Je reconnais que les phénomènes sont hétérogènes et discontinus. L’éternité de la monade ne trouble en rien, si j’ose dire, ce trouble et cette discontinuité. La monade éternelle ne passe dans une réalité complexe qu’en se libérant d’une autre. Chaque changement détruit et crée ; chaque changement est bond et révolution.
Me voici donc pluraliste comme Rosny aîné, et à la fois comme Leibniz, et encore comme le plus avisé et le plus complexe des monistes, Spinoza. Car son monisme équilibré s’associe à un dualisme subjectif, puisque nous connaissons deux attributs de la substance et à un pluralisme subjectif, puisque les attributs inconnus sont en nombre infini. En nombre infini aussi les modes naturés par chaque attribut de l’unique, double et infiniment multiple Naturante.
* * *
Je n’essaie de rien démontrer en métaphysique. Je ne m’attarde pas non plus à rien réfuter. Je n’impose ni ne m’impose ma métaphysique. Celle que j’ai dite ici, pour toujours peut-être mais peut-être seulement pour un an ou un mois, me satisfait à peu près. Je serais désolé qu’elle me satisfît complètement... Je ne dis à personne : Adoptez ma métaphysique. Je dirais plutôt à chacun : Essayez donc si vous ne goûterez pas un grand plaisir en bâtissant une métaphysique à votre mesure.
— Han RYNER.
BIBLIOGRAPHIE. — Le Pluralisme ; Les Sciences et le Pluralisme (J.-H. Rosny aîné). — Les Synthèses suprêmes ; Songes Perdus ; Crépuscules (Han Ryner). -Les philosophies pluralistes en Angleterre et en Amérique (J. Wahl). — L’Harmonisme (Louis Prat), etc.
PLUTARQUISME
Ce mot est un des plus heureux néologismes produits par l’après-guerre. M. Jean de Pierrefeu paraît en être l’auteur. Il en a, en tout cas, justifié l’emploi et la destination mieux que personne dans ses ouvrages : G. Q. G. Secteur, et Plutarque a menti, où il a décrit l’œuvre de mensonge, de falsification des faits de la guerre de 1914, par les rédacteurs de ce qu’on a appelé le « communiqué ». Le plutarquisme a été la forme intellectuelle, élégante, aristocratique, du « bourrage de crâne », de ce mensonge ignoble, à l’usage des foules chloroformées patriotiquement, sans lequel « la guerre n’aurait pas duré trois mois », a écrit M. P. Allard qui fut préposé à la censure, autre organisme du Grand Quartier Général, chargé, avec les Conseils de guerre, d’entretenir un « moral » haineux et belliqueux.
Dépassant cette sinistre et honteuse époque de 1914–1918, le plutarquisme est l’histoire fabriquée, maquillée, vue en beauté, à la façon de Plutarque, auteur des Vies des Hommes illustres de l’antiquité. C’est la déformation des événements, l’exagération tendancieuse de ce qu’ils ont eu, très rarement, de grand, le silence, non moins tendancieux, sur ce qu’ils ont eu presque toujours de honteux ; c’est la fable, la légende, créées et imposées contre la vérité, l’embellissement systématique de l’insanité, et c’est l’apologie des pires bandits qui ont sévi sur l’humanité, l’idéalisation des pires crimes dont elle a souffert. C’est :« le héros couvert de lauriers, acclamé par la foule, l’impérator romain sur son char de triomphe », et qui ne fut pas « autre chose que le digne fils de ces brigands dégouttant de crimes, vivant du pillage et du vol, qui fondèrent la ville sur le mont Palatin. » (J. de Pierrefeu). C’est, après Plutarque, la glorification durant vingt siècles, par les annalistes, les chroniqueurs, les mémorialistes, les historiens, de tous ceux qui ont succédé à ces « héros » et ont abouti aujourd’hui au Président de la République :
« Incarnation vivante, rejeton orgueilleux des grands bandits légaux qui ont détroussé nos ancêtres par l’usure, par le monopole, par la savante mise en œuvre de tous les procédés que la loi, faite par eux, et pour eux, leur mit en main. » (M. Millerand)
Le plutarquisme accommode l’histoire, la pare à la façon des bouchers préparant leur étal. Il pique des fleurs sur le faisandage. Sur l’ignoble ordure de la guerre, il dresse le Lao labarum de Constantin, le panache Blanc d’Henri IV. Il dit à Fontenoy : « Tirez les premiers, messieurs les Anglais ! » et il crie dans les tranchées : « Debout les morts ! » Il montre les gestes héroïques des grands personnages sur des champs de bataille où ils ne furent jamais. Tel, sur les tableaux d’histoire de Versailles, Louis XIV préside à tous les combats de son règne ; il ne risqua jamais sa vie dans aucun. C’est le cas d’à peu près tous les rois et conquérants à qui on attribue de hauts faits. Suivant des clichés adoptés, on dit : « César conquit la Gaule », comme on dit : « Sainte Geneviève sauva Paris » et « le général Joffre a gagné la bataille de la Marne » !
M. Julien Benda, parlant de la Crise de la vérité, a cité ce mot d’un de ses contradicteurs :
« Qu’est-ce que le truquage d’un texte, près du salut de la France ! »
C’est ce que disaient les faussaires du temps de l’affaire Dreyfus, pour qui il y avait une vérité française qui n’était pas la vérité de tout le monde. C’est ce que le plutarquisme a dit partout, depuis toujours, dans tous les pays. Qu’était le truquage d’un texte pour l’Eglise, auprès de la domination qu’elle voulait exercer ? Qu’est ce truquage aujourd’hui, auprès de l’impérialisme qui veut dominer à tout prix ? Ce sont vingt siècles de ces truquages qui ont fait de l’histoire l’enseignement de l’immoralité. Déjà, lorsqu’elle est écrite avec une recherche honnête de la vérité, l’histoire n’est qu’une « pauvre petite science conjecturale », comme disait Renan. Mais lorsqu’elle est cyniquement adultérée, elle est l’œuvre la plus criminelle qui soit contre l’esprit humain. Or, toute la vie sociale est bâtie sur l’infaillibilité dogmatique de l’imposture traduite par le plutarquisme. Il est d’autant plus dangereux que la lettre de ses textes est exploitée par des coquins. Couchoud a remarqué que quelques mots de la Bible : « Tu ne laisseras pas vivre la sorcière, ont provoqué sans fin des massacres de femmes ». Combien ont fait encore plus de morts les mots : Dieu le veut ! et Allons, enfants de la Patrie !...
Diderot disait :
« Quand il s’agit d’accuser les dieux ou les hommes, c’est aux dieux que je donne la préférence. »
Le plutarquisme, lui, la donne aux hommes. Toutes les révoltes de l’humanité sacrifiée ont été, à ses yeux, des crimes, depuis celle de Prométhée jusqu’à celle des communards. Les Jacques étaient des bandits aux yeux du plutarquisant Froissard ; les peuples coloniaux qui se défendent contre les pillards « civilisateurs » sont des brigands, de l’avis de la valetaille plutarquisante des journaux. Le grand principe du plutarquisme a toujours été la justification de l’Ordre établi par les maîtres, si opposé qu’il eût été au véritable développement social et au progrès humain. La puissance romaine a été plus néfaste à la marche de l’humanité qu’elle ne l’a favorisée, et aujourd’hui encore le droit romain enserre l’homme comme dans un étau ; mais le plutarquisme a présenté cette puissance comme le rempart de la civilisation, même lorsqu’elle tuait la civilisation grecque, parce qu’elle représentait l’Ordre. Il a pris position pour les dieux contre les hommes, pour le Sénat contre Catilina et Spartacus et, à la façon de Mascarille, il a mis en madrigaux toute l’histoire romaine. Suivant le même principe, il a célébré et il continue à célébrer comme glorieuses les époques les plus calamiteuses de l’histoire de la France, celle de Louis XIV en particulier. Quelles que soient les preuves accumulées du malheur de cette époque, il y a toujours des Louis Bertrand pour plutarquiser sur « Louis le Grand » et écrire des insanités comme cellesci : « Il a façonné nos âmes, notre sensibilité, notre intelligence. Nos âmes sont restées héroïques et douces, comme celles de son temps, comme la sienne... » et des journalistes pour apprécier ainsi :
« Le culte de Louis Bertrand pour Louis XIV qui a déconcerté les préjugés démocratiques de notre époque d’anarchie, n’est, chez l’écrivain, que le culte de l’ordre français, incarné dans le roi le plus soucieux de l’honneur national qui fut jamais. » (Figaro, 10 mars 1928)
Gobineau a montré comment le souci « d’honneur national » de Louis XIV ne fut que la manifestation de sa mégalomanie, et comment celle-ci a engendré, en France, cette vanité nationale, mère de l’impérialisme dont Napoléon a semé le virus dans l’Europe entière contre les idées de Fraternité humaine apportées par la Révolution. Quant à « l’ordre français » incarné par le même Louis XIV, il fut la plus odieuse et la plus insolente exploitation de la misère du peuple que jamais autocratie eût pratiquée dans aucun royaume. C’est cela qu’on appelle l’Ordre devant lequel’ il n’y a qu’à s’incliner, à béer d’admiration et à se dire :
« Ah ! qu’on est fier d’être Français quand on contemple la colonne ! »
Les autres peuples ne sont pas moins fiers, car ils ont tous, pour la plus grande gloire de l’Ordre, leurs Napoléon à jucher sur des colonnes, et leurs Poincaré qui ont « bien mérité de la patrie » en contribuant à faire les dix millions de morts de la Grande Guerre. L’Impérator Auguste, après avoir révolutionné le monde pour établir sa puissance, disait « augustement » aux aventuriers devenus ses courtisans :
« S’opposer à tout changement dans l’Etat est toujours le fait d’un honnête homme et d’un bon citoyen. »
Depuis vingt siècles, en passant par Louis XIV pour aboutir à M. Tardieu, la formule de l’ordre n’a pas changé pour tous ceux dont :
« Le crime heureux fut juste et cessa d’être crime. » (Boileau).
Elle a son fondement dans ce sentiment, l’impuissance que M. Barrés réclamait des pauvres et qui est, disait-il : « une condition première de la paix sociale », c’est-à-dire de l’ordre selon le plutarquisme.
Le plutarquisme qui produit des excités, des illuminés, des fous nationalistes, des divagateurs cornéliens, des mégalomanes dictateurs et des légions de pauvres abrutis intoxiqués d’héroïsme patriotique, a été souvent dénoncé, au point qu’on en est arrivé à envisager la suppression de l’enseignement de l’histoire pour mettre fin à son perfide empoisonnement des esprits. Ce remède est impossible, car il faudrait, en même temps, supprimer dans les esprits la curiosité du passé indispensable à leur progrès autant que celle de l’avenir. Mais ce qui est possible, c’est de se défendre contre la malfaisance du plutarquisme et de le combattre énergiquement dans l’actuel, en attendant que les recherches sincèrement objectives, sans préoccupations de partis, permettent de l’éliminer peu à peu de l’histoire passée. Il faut mettre à nu et fustiger sa malfaisance d’hier ; il faut l’empêcher de faire son œuvre de demain en dénonçant par tous les moyens l’imposture qui tombe des tribunes gouvernantes, s’étale dans les journaux, falsifie la notion de toute chose, répand la confusion et rend impossible le discernement de la vérité, même pour les faits les plus récents. Involontairement, parce qu’il voit mal les événements, mais plus souvent volontairement, parce qu’il est payé pour cela et que sa conscience y est entraînée sans trouble, celui qui écrit au jour le jour le document de l’histoire future ment dans tout ce qu’il écrit ; il ment comme il respire, il plutarquise avec cynisme, sinon avec talent.
Dans sa Manière d’écrire l’histoire, Mably a dit :
« Ce n’est pas la peine d’écrire l’histoire pour n’en faire qu’un poison ... Il me semble que c’est à l’ignorance du droit naturel ou à la lâcheté avec laquelle la plupart des historiens modernes trahissent par flatterie leur conscience, qu’on doit l’insipidité dégoûtante de leurs ouvrages. »
Mably ne mâchait pas ses mots ; ils étaient justes et il ne pouvait en avoir d’assez flétrissants pour des ouvrages aussi néfastes. Leur plutarquisme a complètement travesti l’histoire en faussant les figures et les époques, en se taisant sur des faits essentiels, sur leurs véritables origines et caractères, en dissimulant ou en dépréciant l’action populaire venue des masses humaines, cela pour encenser jusque dans leurs pires turpitudes les sinistres et sanglants cabotins qui régnèrent et ne furent, à de très rares exceptions, que de calamiteux imbéciles. N’allait-on pas, au temps de Mably, jusqu’à trouver « charmantes » leurs « évacuations », (Journal de Barbier), et à se disputer l’honneur de leur torcher le derrière ! Or, on ne peut dire que le plutarquisme est spécial à une époque. Il sévit encore plus en démocratie qu’en autocratie, en raison de ce principe bien simple que la démocratie doit convaincre, tandis que l’autocratie n’a qu’à s’imposer. Quand elle ne veut pas convaincre par la vérité, la démocratie est amenée à user du mensonge plus que l’autocratie. On voit ainsi, par exemple, M. Herriot renchérir, au nom des principes des droits de l’homme, sur les louanges du plutarquisme à l’égard de Bossuet en célébrant la tolérance, le sens humain, la fraternité et l’amitié humaines de ce prélat qui fut le plus pontifiant des inquisiteurs, le plus implacable des esclavagistes, le plus pompeux des flagorneurs de la royauté et le plus étroit des casuistes. Le catholique Bordas Demoulin déclarait que « Voltaire prêchant la tolérance, la liberté et la fraternité, était plus chrétien que Bossuet défendant l’intolérance et la théocratie ». Le laïque et démocrate Herriot met Bossuet sur le même plan que Voltaire, et peut-être le trouve-t-il meilleur libre-penseur !
Voltaire pratiquait le pyrrhonisme, c’est-à-dire :
« L’esprit de doute qu’il faut porter dans l’étude de l’histoire. »
Car, si « l’histoire est le récit des faits donnés pour vrais, au contraire de la fable qui est le récit des faits donnés pour faux », il n’est nullement établi que les faits donnés pour vrais soient indiscutablement vrais et que, très souvent, leur récit n’ait pas été remplacé par celui des faits donnés pour faux. L’histoire a été inévitablement, comme toutes les autres formes de la littérature, de transmission orale tant que l’homme n’a pas su en fixer la mémoire par les signes de l’écriture. Or, comme l’a fort bien dit Voltaire :
« Avec le temps, la fable grossit et la vérité se perd. »
La transmission orale du père aux enfants a pris un caractère de plus en plus fabuleux et, lorsque l’homme a commencé à écrire l’histoire, il a écrit les fables qu’il avait apprises et non la vérité. Aussi, le pyrrhonisme est-il une attitude indispensable pour quiconque ne veut pas être dupe du plutarquisme. Il n’a pas mis Voltaire lui- même à l’abri des erreurs, personne ne pouvant y échapper complètement, mais il lui a permis d’en corriger beaucoup que les ignorants tenaient pour des vérités définitives. Voltaire a mis ainsi à leur vraie place la prétendue Histoire Universelle, de Bossuet, qui n’est que l’histoire imaginée de quatre à cinq peuples, et l’Histoire Ecclésiastique, de Fleury, « statue de boue dans laquelle l’artiste avait mêlé quelques feuilles d’or ».
Alors que Plutarque reprochait à Hérodote de n’avoir pas assez vanté Ta gloire de quelques villes grecques et d’avoir omis plusieurs faits dignes de mémoire, Voltaire a montré combien Hérodote, s’il « ne ment pas toujours », a abondamment plutarquisé. D’autres preuves ont été apportées depuis du plutarquisme d’Hérodote, notamment dans une communication récente, faite à l’Académie, et prouvant que le pharaon Moeris, et le lac artificiel qu’il aurait fait creuser, n’ont jamais existé. De même, Tite Live a « embelli ou gâté son histoire » par des prodiges. Des quantités de mauvaises actions ont été, non seulement excusées, mais encore données en exemples à suivre par l’histoire, et leurs responsables, proposés à l’admiration éternelle des foules, ont été mis au rang des dieux. Comment n’aurait-on pas chanté la gloire des rois souillés de crimes, des massacreurs dégouttant de sang, lorsqu’on faisait du Jéhovah biblique le Dieu de l’Univers ?
A l’historien occupé, avec plus ou moins d’indépendance, d’esprit et de volonté de vérité, à la recherche des événements, s’est ajouté l’historiographe, celui-ci « appointé pour écrire l’histoire » par de grands personnages dont il était le commensal et dont il ne pouvait être que le flagorneur, aux dépens de la vérité historique qu’il avait pour profession de déguiser en faveur de ses maîtres. Alain Chartier se donna le ridicule d’écrire qu’Agnès Sorel ne fut jamais la maîtresse de Charles VII, alors qu’au su de l’histoire quatre enfants étaient nés de leurs amours. Il n’est pas de monarque de qui on n’ait fait la légende dorée. Les Salomon, Cyrus, Alexandre, César, Constantin, Clovis, Charlemagne, Barberousse, François Ier, Charles Quint, Louis XIV, Pierre-le-Grand, Napoléon, ont été d’autant plus célébrés qu’ils portent la responsabilité de plus de crimes ou que les circonstances particulières à leurs temps ont permis de leur attribuer un mérite plus ou moins fabuleux. L’époque de Salomon fut la plus brillante de l’histoire du peuple juif ; on en a profité pour attribuer à ce monarque, d’ailleurs plus ou moins mythique, comme son temple qui n’aurait jamais existé, une sagesse que le Plutarque biblique est allé chercher en Egypte. La renommée la plus certaine de Salomon serait d’avoir fait à la reine de Saba des enfants dont les Ménélick éthiopiens se déclarent aujourd’hui les descendants. Le kalife Haroun-al-Rachid a, personnellement, bénéficié de l’exceptionnelle prospérité économique et de la véritable grandeur artistique de son époque ; mais il n’y fut pour rien. Son histoire politique, à laquelle il fut plus directement mêlé, est bien moins brillante. Un Henri IV, dont le plutarquisme a fait un « père du peuple », n’a laissé dans le peuple que le souvenir d’un gaillard inconstant et luxurieux, qui sentait le gousset, n’aurait pas été fâché que ses sujets puissent comme lui bien manger, mais qui n’en fut pas moins impitoyable aux braconniers et ouvrit la voie au pouvoir absolu de ses successeurs, par ses incessantes restrictions aux dernières libertés communales et nationales. Il fut le premier roi de France qui ne convoqua jamais les Etats Généraux.
Deux des mystifications du plutarquisme sont particulièrement intéressantes pour nous en ce qu’elles constituent l’armature de la société européenne et chrétienne dans laquelle nous vivons. Ce sont celles du « Siècle d’Auguste » et du « Siècle de Louis XIV». Le siècle d’Auguste : apogée et déclin de la puissance romaine et naissance de Jésus ; liaison de l’ordre antique à son crépuscule et de l’ordre chrétien à son aurore. Le Siècle de Louis XIV : constitution de l’ordre moderne sur les bases étatistes et impérialistes que la Révolution Française renforcerait, après les avoir ébranlées et avoir menacé de les démolir. Le plutarquisme a fait des deux hommes, Auguste et Louis XIV, l’incarnation des deux époques, les protagonistes inspirés, surnaturels, les deus ex machina de toute la mécanique sociale de vingt siècles d’histoire.
L’histoire romaine tout entière, le tableau et l’exaltation des vertus romaines qu’on n’a jamais cessé de présenter, ont été une mystification continue dont les plus grands poètes et les plus grands artistes se sont faits les complices avec les historiens. Il y a toujours des politiciens verbeux pour célébrer l’amour de la liberté et de la justice chez les Romains qui le possédèrent et le pratiquèrent si peu, et la prétendue démocratie romaine qui ne fut que tyrannie impérialiste et débauche ochlocratique. L’histoire romaine, telle que nous la connaissons, n’a été écrite qu’à partir du IIe siècle avant J.-C., sous l’influence d’annalistes n’ayant eu aucune connaissance certaine des faits antérieurs, toutes les archives de Rome ayant été détruites par les Gaulois lorsqu’ils avaient fait le sac de la ville en 390. On peut dire que cette histoire fut imaginée par les Grecs Polybe, Plutarque, Appien, ses premiers écrivains, puis par les latins Salluste, Tite Live, Tacite. Tout leur souci, même celui des Grecs, fut d’exalter la puissance romaine jusque dans ses pires fautes, de justifier le fait accompli si néfaste qu’eussent été ses conséquences. Le plutarquisme n’a pas changé de voie depuis ce brave homme de Plutarque qui, plein de bonnes intentions, ne se doutait pas du mal qu’il ferait au monde. Il n’a pas cessé depuis de tresser des couronnes à l’insanité, d’élever des temples à la sottise et des arcs de triomphe aux assassins.
Le plutarquisme veut que le génie des rois ait produit les grands hommes. La vérité est plutôt que la sottise des rois a étouffé le génie des grands hommes. N’importe quel imbécile couronné — et on sait s’il y en a eu dans tous les pays, même parmi les quarante rois qui, dit-on, « ont fait la France » — peut faire à son gré des princes, des ministres, des maréchaux. Luimême, ses frères et ses cousins, sont tout cela en venant au monde. Mais il lui est impossible de faire un seul homme de pensée. Napoléon aurait voulu avoir un Corneille sous son règne ; il n’eut qu’un Luce de Lancival. Auguste tua Cicéron, mais, quoiqu’en ait dit Boileau, il ne fit pas plus Virgile que Louis XIV ne fit Racine. Auguste et Louis XIV, tous deux mouches du coche, bénéficièrent de 1 a gloire de leurs siècles pour voiler des turpitudes qui furent, elles, bien à eux. N’eston pas allé jusqu’à dire que Napoléon débarquant à l’île d’Aix fit pousser des immortelles sous ses pas ? Le plutarquisme a planté des bégonias dans toute l’histoire.
Auguste, qu’on s’est efforcé de montrer vertueux, vivait dans l’inceste. Le « simple et magnanime Auguste » est un cliché fabriqué pour faire oublier le sanglant Octave qu’il fut avant de ceindre sa couronne d’empereur-démocrate. Chateaubriand a dit :
« Il avait à la fois l’habileté et la médiocrité nécessaires au maniement des affaires qui se détruisent également par l’entière sottise ou par la complète supériorité. » (Etudes historiques)
L’empire romain, en supprimant les libertés républicaines, supprima aussi la liberté des gens de lettres. Jusque-là, le théâtre leur avait permis de vivre de leur plume ; lorsque l’empire remplaça le théâtre par le cirque, les poètes furent réduits aux libéralités dégradantes des Mécènes. Le plutarquisme a chanté les prétendues largesses d’Auguste pour Horace et Virgile, et Sainte Beuve a laissé entendre que l’Enéide avait été un ouvrage « commandé » à Virgile par l’empereur. En fait, Virgile avait été dépouillé par la victoire d’Octave-Auguste, comme l’avaient été Tibulle et Properce, et Horace, ancien esclave, soldat de Brutus, avait tremblé pour sa vie. Tous deux durent se tenir pour très heureux de n’avoir pas été égorgé!’ ! comme Cicéron et Cassius de Parme, ou proscrits comme Varron. Auguste ayant bien voulu rendre à Virgile la terre qu’il lui avait volée, fut sacré grand bienfaiteur du poète par la postérité ; mais les rapports du poète et de l’empereur demeurèrent lointains, de même que ceux d’Horace. Si tous deux eurent la faiblesse de comparer l’impérator à Apollon, ce fut pour les besoins de leur sécurité.
Avec Louis XIV, le plutarquisme a été encore plus farci d’imposture. Chose curieuse, c’est au sceptique, au pyrrhonien Voltaire qu’on doit la mystification du Siècle de Louis XIV. Or, comme l’a observé E. Despois, si l’on appelle ainsi le XVIIe siècle, on ne peut ne pas remarquer que ce qu’il a eu de plus glorieux s’était déjà produit lorsque Louis XIV commença à régner par lui-même, en 1661. Le philosophe Descartes était mort en Suède en 1650 ; le peintre Lesueur n’était plus depuis 1655. Balzac, Voiture, Vaugelas, étaient également morts. Pascal allait disparaître en 1662. Poussin, exilé à Rome par les cabales, finirait sa carrière en 1665. Corneille avait achevé son œuvre depuis longtemps, mais le plutarquisme n’en ressasse pas moins le cliché venu de Racine :
« La France se souviendra avec plaisir que, sous le règne du plus grand de ses rois, a fleuri le plus grand de ses poètes. »
Molière, La Fontaine, Boileau, Racine, Bossuet, étaient en pleine maturité ; leur formation ne pouvait rien devoir au monarque qui n’arrivait que pour placer sur sa tête la couronne de leur gloire. Il semble qu’au contraire l’avènement de ce roi médiocre ait fait tarir la source du génie si abondante avant lui. Les Colbert, Louvois, Condé, Turenne, formés aussi avant son règne, ne furent pas choisis par lui ; ils furent imposés par les événements. Lorsqu’il dut faire choix des ministres et des hommes de guerre qui les remplacerait, il ne sut distinguer que des Chamillart et des Villeroy. Il sacrifia Vauban, le plus grand des ingénieurs et l’un des meilleurs hommes de l’époque, à ce Chamillart dont on dit quand il mourut
De son roi le protonotaire,
Qui fut un héros au billard,
Un zéro dans le ministère. »
A Mohère, Louis XIV préféra le bouffon Scaramouche. La troupe de Molière ne recevait que 7.000 livres de subvention ; celle de Scaramouche jouissait de 15.000 livres de pension. Ce fut Boileau qui apprit à Louis XIV que Molière « était le plus rare écrivain de son temps ». Le Grand Roi ne s’en était pas aperçu et ne le crut qu’à moitié ; il continua à préférer Scaramouche. Sur son ordre, l’Eglise fit de pompeuses funérailles à ce pitre, tandis que Molière fut enterré de nuit, presque furtivement, et faillit ne pas avoir de sépulture. Auprès de ce roi, qui ne voulait dans son entourage que des courtisans et des flagorneurs, Molière ne pouvait être à son aise, pas plus que La Fontaine, Puget, Colbert, Vauban, La Bruyère, Fénelon. Seuls Racine, La Bruyère et Fénelon sont véritablement du règne de Louis XIV, et seul Racine subit son ascendant ; il n’eut pas à s’en louer, car ce ne fut que pour voir diminuer son génie et pour arriver à une disgrâce qui le tua. La Bruyère ne connut son temps que pour en faire une profonde satire. Fénelon ne dut rien à son époque ; méprisant les conquêtes et la cour, protestant contre la misère publique, il fit figure d’hérétique. Le roi ne l’aima pas, lui préférant Bossuet qui avait salué en lui un nouveau Constantin, un nouveau Charlemagne, quand il avait commis le crime de révoquer l’Edit de Nantes, et qui avait abaissé son génie oratoire au niveau du pharisaïsme de la cour. Chez presque tous ceux qui se formèrent sous le règne et eussent pu réellement être influencés par 1ui, ce fut la stérilité ou la médiocrité des Fontenelle et des J.-B. Rousseau, allant jusqu’à la « platitude absolue » de Campistron. Le seul lustre de la fin du règne fut dans la comédie des Regnard, Dancourt, Lesage, non pour célébrer l’ordre d’une royauté décrépite qui s’effondrait dans l’hypocrisie dévote, mais pour railler ses faisandages, « valets escrocs, financiers ridicules, coquettes effrontées, gentilshommes aux gages de quelque vieille débauchée », (E Despois), et préluder ainsi à l’œuvre de critique des philosophes encyclopédistes. Le Frontin, de Turcaret, en 1709, annonçait Figaro. En même temps, le fameux « Grand Siècle », débordant sur les quinze premières années du XVIIIe, aggravait la désolation d’une France pillée, dévastée, ruinée par la guerre, l’invasion, la banqueroute, la famine, réduite à l’épouvantable misère sur laquelle les Saint Simon, Vauban, Fénelon, La Bruyère, une foule de rapports d’intendants et de gouverneurs des provinces, de pamphlets et de libelles, avaient inutilement appelé l’attention du stupide Roi Soleil.
La gloire de Louis XIV fut toute théâtrale. Gloire d’apparat d’un cabotin royal dont l’esprit était aussi noir que les pieds, des pieds qu’il ne lavait jamais !... Magnificence criminelle qui faisait construire le palais de Versailles et ruinait la France. Louis XIV ne justifia que trop la haine justicière qui se manifesta contre lui et se traduisit à sa mort par des imprécations dont des centaines de vers, parmi lesquels les suivants ne furent pas les plus féroces, donnèrent le ton :
Le partisan des usuriers,
L’esclave d’une indigne femme,
L’ennemi juré de la paix.
Ne priez point Dieu pour son âme,
Un tel monstre n’en eut jamais. »
Sa mort fut « une joie universelle », a dit Voltaire. Massillon, prononçant l’oraison funèbre du personnage, ne put s’empêcher de dire, devant toute la cour rassemblée :
« ... Triste souvenir de nos victoires, que nous rappelez-vous ? Monuments superbes, élevés au milieu de nos places publiques pour en immortaliser la mémoire, que rappellerez-vous à nos neveux ?... Vous leur rappellerez un siècle entier d’horreur et de carnage... Nos campagnes désertes, et au lieu des trésors qu’elles renferment dans leur sein, n’offrant plus que des ronces au petit nombre des laboureurs forcés de les négliger ; nos villes désolées ; nos peuples épuisés ; les arts à la fin sans émulation ; le commerce languissant. »
Non seulement Louis XIV n’avait jamais rien fait pour le peuple, mais il avait tout fait pour aggraver la servitude et la misère où il vivait depuis toujours. Les avertissements n’avaient pourtant pas manqué. En 1661, première année du règne, le médecin Guy Patin avait déjà écrit :
« On parle fort, au Louvre, de bals, de ballets et de réjouissances, mais on ne dit rien de soulager le peuple qui meurt de misère. »
Dès la même année, Bossuet qui serait le plus empressé des thuriféraires royaux, avait dit les devoirs des rois et des nobles devant la détresse populaire. De toutes les provinces les cris de cette détresse n’avaient cessé d’arriver à la cour durant cinquante ans, mais seule la brutalité de la soldatesque chargée de la police y avait répondu. La Bretagne avait eu, en 1675, la primeur des horreurs que le Palatinat devait connaître douze ans plus tard. Mme de Sévigné avait dépeint les exploits des soldats voleurs et pillards et écrit particulièrement ceci :
« Ils mirent, l’autre jour, un petit enfant à la broche ! » (Lettre du 30 octobre 1675)
Les Commissaires du Roi avaient dit dans leurs rapports, en 1687 :
« Il n’y a presque plus de laboureurs aisés… il n’y a plus que de pauvres métayers qui n’ont rien… Il y a beaucoup moins d’écoliers dans les collèges qu’il n’y en avait autrefois, parce qu’il y a beaucoup moins de gens qui aient de quoi faire étudier leurs enfants. »
Les soldats eux-mêmes, malgré le pillage, allaient « presque tout nus, sans bas, sans souliers, n’ayant qu’un mauvais jupon et haut de chausses de toile », écrivait l’Intendant de Montauban en 1693. Soldatesque digne de Callot on la chercherait vainement sur les champs de bataille peints par Vander Meulen, où le Roi Soleil et ses satellites font de l’équitation. Boisguillebert constatait, dans son Détail de la France, en 1907 :
« C’est un fait qui ne peut être contesté que plus de la moitié de la France est en friche ou mal cultivée, c’est-à-dire beaucoup moins qu’elle ne pourrait être et même qu’elle n’était autrefois... »
Après 1709, année d’un terrible hiver, la famine avait été permanente. Il n’y avait plus eu d’argent, même pour payer les appointements des officiers et ravitailler l’armée ; mais, malgré ce, Louis XIV n’avait pas cessé de faire la guerre. Il la fit jusqu’en 1713. De 1685 à 1715, la population de la France a diminué d’un million d’habitants.
Telle est l’histoire, très rapidement esquissée, de ce fameux « Grand Siècle » qui trouve toujours, pour plutarquiser a son sujet, des courtisans d’académie, de vieux croûtons universitaires et le pauvre troupeau’ des « imbibés », comme dit Mme Gyp, de doctrine maurrassienne. Ils n’ont toutefois plus guère d’arguments, en faveur de leur Roi Soleil, que la protection « éclairée et généreuse » qu’il aurait accordée à l’industrie, aux arts et aux lettres. Or, là encore le plutarquisme a trop fait des siennes. Que pouvait faire pour l’industrie ce roi qui chassait du pays ses meilleurs artisans par la révocation de l’Edit de Nantes ? Lavisse a écrit :
« Les sommes données en assistance aux manufactures sont médiocres en comparaison de celles que dévorent les bâtiments ; et elles deviennent insignifiantes les années de guerre. »
Pour les arts et les lettres, nous avons vu de quelles lumières personnelles Louis XIV avait été capable de les « éclairer ». Sa générosité fut au niveau de ses lumières. Il fit encore moins que ses prédécesseurs, si l’on tient compte que beaucoup plus qu’eux il eut besoin de flagorneurs pour célébrer sa gloire. Il les paya, comme les avaient payés les autres, non selon leur talent, mais selon leur servilité. Dès qu’ils avaient formé une cour autour d’eux, les rois avaient été obligés d’entretenir des parasites thuriféraires. Les Valois les avaient rémunérés surtout avec des abbayes. Sous Louis XIII fut établi l’usage régulier des pensions par Richelieu, ministre convaincu de son génie poétique, qui créa l’Académie Française pour s’honorer lui-même en honorant ceux qu’il prétendait égaler. Mazarin continua l’usage pour des fins moins remarquables ; il avait besoin de plumitifs pour riposter aux Mazarinades. Colbert, sous Louis XIV, voulut encourager les Lettres sans y entendre plus que lui. Il s’en remit d’abord à un grotesque M. Costar qui déclara Chapelain « premier poète du monde pour l’héroïque », titre dont Chapelain se garda bien de se découronner lorsqu’il fit lui-même la liste des pensions pour l’année 1663 et s’inscrivit pour 3.000 livres. C’était le tarif des Godefroi, Dauvrier, Rourzeis, Mézeray, aussi plats écrivains que Chapelain, alors que Corneille n’avait que 2.000 livres, Molière 1.000 et Racine 800. Louis XIV estimait moins Corneille, Molière et Racine que son « capitaine des levrettes de la chambre » qui touchait 2.400 livres. En 1673, Corneille se vit supprimer toute pension. Agé alors de soixante sept ans et chargé de famille, il vivrait jusqu’en 1684 complètement oublié du roi « protecteur des lettres ». En 1680, les pensions furent complètement supprimées. En 1669, année où elles avaient été les plus élevées, elle n’avaient pas dépassé 112.000 livres. La Convention devait, en l’an III, voter 600.000 livres pour secourir les gens de mérite abandonnés par la royauté et, parmi eux, une parente de Corneille, fille de celle que Voltaire avait dotée. Qu’on mette en balance les 100.000 livres de pensions littéraires annuelles, descendues à 57.000 en 1675, et qui ne furent distribuées que pendant seize ans, avec les centaines de millions que les sangsues de la royauté, ses favoris et ses catins, surent lui soutirer pour l’avilir et le déshonorer pendant cinquante ans.
Le plutarquisme a créé la légende du « bon tyran », ou plutôt, il n’a eu qu’à l’exploiter, l’ayant trouvée toute faite. Les peuples crédules et convaincus que les rois leur étaient envoyés par Dieu pour faire leur bonheur, étaient toujours pleins d’espérance et d’allégresse à chaque nouvel avènement. « Que de fois se renouvela l’illusion du bon tyran réalisant l’idéal de la liberté et de l’égalité des citoyens », le bon peuple ignorant que « ces trésors seront conquis, ils ne seront pas donnés » (E. Reclus). C’est ainsi qu’à la mort de Louis XIV moqué de la cour et maudit du peuple, son successeur, Louis XV, fut appelé le « Bien Aimé », jusqu’au jour où l’on s’aperçut qu’il n’était qu’un monstre d’égoïsme et de perversité. Les hommes de lettres du temps, et particulièrement Voltaire, contribuèrent au XVIIIe siècle à répandre la légende du « bon tyran », grisés qu’ils furent trop souvent par le protectorat qu’étendaient sur eux de prétendus rois-philosophes. Voltaire se décida pourtant à écrire à Frédéric II qu’il se « moquait du monde » quand il faisait étalage de son respect de la justice, dans le même temps où il s’emparait de la Silésie et la livrait au pillage. C’est ce Frédéric, « ami du genre humain », qui ne voyait dans le peuple « qu’une masse imbécile faite pour être menée par ceux qui se donnent la peine de la tromper ». Le landgrave Frédéric de Hesse-Cassel, non moins « philosophe » que Frédéric II, était un marchand d’hommes qui avait plus de soldats que de sujets et les vendait aux Etats étrangers. Il fournit ainsi 12.000 hommes à l’Angleterre pour faire la guerre d’Amérique, en 178l. Diderot, si peu courtisan qu’il fut, se laissa circonvenir par la Grande Catherine de Russie qui fut la putain royale la plus dévergondée et la plus criminelle que le monde connut jamais.
Pour les besoins de sa puissance immorale et malfaisante, le « bon tyran », si bien animé qu’il puisse être, par une intelligence et une générosité personnelles, ne peut que voir ses efforts « réduits à néant par les appétits et les caprices des parasites de la cour et des privilégiés de toute espèce qui pullulent autour des églises et des palais ! » (E. Reclus). Ce fut le cas, dans l’antiquité, pour les Marc Aurèle, les Julien, les Majorien, qui auraient pu être de « bons tyrans » sans leur entourage. Le plutarquisme d’église a fait un saint de Constantin qui fut le plus astucieux et l’un des plus criminels parmi les empereurs romains ; il l’a appelé « le Grand ». Il a, par contre, appelé « l’Apostat » ce Julien qui fut le plus digne de tous. Ce fut aussi le cas de certains papes qui étaient de vrais chrétiens, mais durent céder aux influences et aux intrigues de leur clergé sous peine d’être assassinés comme il arriva à tant d’entre-eux. Suivant les intérêts en jeu pour la défense de l’ordre, le plutarquisme a auréolé les uns, méprisé les autres, à l’encontre de toute vérité. Il a fait ainsi un Charles le Mauvais d’un prince qui n’était pas plus mauvais qu’un Jean le Bon. Titus qui détruisit Jérusalem et fit massacrer onze cent mille Juifs, fut appelé : « les délices du genre humain » ! Tacite trouva moyen d’idéaliser Tibère et Néron ! Le chef-d’œuvre du plutarquisme a été de faire magnifier par les descendants des Gaulois les Césars qui firent de la Gaule une province romaine, y tuèrent l’esprit de liberté comme ils l’avaient tué à Rome, réduisirent cette Gaule à l’impuissance devant les invasions barbares et y préparèrent l’asservissement des esprits à l’ordre chrétien succédant à l’ordre romain. Le plutarquisme peut faire sienne la formule des gladiateurs antiques :
« Ave Caesar, morituri te salutant ! » — César, ceux qui vont mourir te saluent !
En 1914–1918, ils ont été dix millions qui sont allés se faire tuer en saluant les Césars de l’impérialisme moderne maquillés en idoles du Droit et de la Civilisation.
Le plutarquisme dit, avec V. Hugo :
Et il fait de cette litanie l’inscription lapidaire de cent mille monuments aux morts de la guerre. Mais l’histoire vraie dit, avec A. France :
« On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. »
On le sait ; on ne se laisse pas moins toujours plutarquiser, tant est puissant le prestige de l’ordre que soutient le plutarquisme. L’histoire officielle refuse de découvrir les véritables responsabilités de la dernière guerre. Il faut que, même contre toute évidence, ces responsabilités appartiennent aux vaincus. « Vœ Victis ! » a-t-on dit, au nom du Droit et de la Civilisation, comme le disait Brennus, il y a deux mille ans, au nom de la Force. Vainqueurs et vaincus continuent à décréter que les pourvoyeurs de charniers ont « bien mérité de la patrie ! » On se laisse préparer pour la « prochaine », celle qu’il faudra faire une nouvelle « dernière » fois « pour que nos enfants ne connaissent plus ce crime : la guerre ». On repartira « frais et joyeux » et ceux qui en reviendront diront encore : « C’était le bon temps !... » (M. Dorgelès) en exhibant leurs « gueules cassées », leurs moignons et leurs misères, pour faire de la publicité à leurs « camarades » politiciens et académiciens. On plutarquise partout, à jet continu, nationalement et internationalement, sous les dictatures et dans les caricatures de démocraties. Bellicisme et pacifisme se confondent dans le belli-pacisme et le paci-bellisme. Les mêmes journaux qui chantent la renommée de M. Briand « pèlerin de la paix », font une large place aux manifestations contre la guerre, publient des appels des femmes contre l’éducation militaire de leurs enfants, chantent en même temps la gloire du général Mangin « broyeur de noirs », gémissent avec tous les aboyeurs de la publicité des plaques blindées et des munitions sur « l’insuffisance de notre préparation militaire », et offrent aux enfants, pour faire leur éducation pacifiste, l’histoire du petit Turenne qui, à huit ans, avait appris, dans Plutarque, l’histoire des héros grecs et romains, et à neuf ans, couchait « par un temps de neige sur l’affût d’un canon » !... Des prêtres, des savants, des poètes, exaltent les vertus, l’utilité, la beauté de la guerre ; des guerriers font des tableaux idylliques de la paix. Tous ces compères passent à la caisse des marchands de canon, de godillots et de conserves que leurs victimes, médusées par le respect de l’ordre, ne se décident toujours pas à accrocher à de justicières potences.
Le plutarquisme, qui possédait déjà dans les moyens de l’industrie publicitaire des ressources infinies, en a trouvé d’autres, plus intellectuelles et plus littéraires, si l’on peut dire, dans l’histoire romancée dont le goût s’accorde si bien avec les pétarades, le bluff, la grossièreté, la fausse distinction et l’héroïsme canaille de notre époque de mutisme. Il y a eu de tout temps de faux mémoires, des apocryphes, qui ont fait figure de documents historiques et dont l’importance correspondait à celle de leurs prétendus auteurs. On a vu ainsi de faux écrits de rois, de ministres, d’une foule de personnages plus ou moins illustres, bourrés des faits les plus imaginaires, des mystifications les plus audacieuses, qui sont devenus des vérités de l’histoire suivant les intérêts des partis. L’histoire romancée a ajouté à ces falsifications la note littéraire imaginative, sentimentale du roman pour entraîner l’esprit public à une soumission de plus en plus abrutissante aux disciplines de l’ordre militariste, religieux et policier. La lâcheté publique, qui n’a aucune réaction contre le plutarquisme de la tribune, de la chaire, du journal, n’en a pas davantage contre les « lois scélérates » et la matraque policière. On l’oblige, aujourd’hui, à saluer le drapeau ; on l’ obligera demain à saluer des processions.
A la suite de la Révolution, les premiers temps du XIXe siècle avaient vu l’engouement public pour l’histoire. Walter Scot l’avait mise dans le roman avec un vif succès. Il se créa une industrie qui mit le roman dans l’histoire et qui fabriqua à tour de bras, pour toutes les classes et tous les partis, l’histoire romancée. On eut le choix entre des mémoires de personnages de la vieille cour échappés à la guillotine, de marchandes de modes, d’anciennes catins tombées dans la dévotion, de conventionnels, etc. Les mêmes officines où se signalaient par leur activité les Max de Villemest et les Lamothe-Langon, fabriquaient, avec un égal entrain, une Correspondance du pape Clément XIV, des Mémoires de la duchesse de Berry, de Mlle Bertin, modiste de Marie-Antoinette ; de Léonard, son coiffeur, de Sophie Arnould, et de Pauline, la « veuve de la Grande Armée », ou de Bourrienne et de Brissot. L’histoire de Cagliostro avait épuisé les forces de plusieurs feuilletonnistes quand A. Dumas s’en empara et y attela une vingtaine de ses « nègres » habituels. Il prétendit alors, non sans esprit, apprendre l’histoire aux historiens et au peuple, et il déclara, non sans raison : « Les historiens passent si souvent, sans les relever, près des infamies des princes, que c’est à nous autres romanciers à faire, dans ce cas-là, leur office, au risque de voir, pendant un chapitre, le roman devenir aussi ennuyeux que l’histoire. » Le républicanisme d’A. Dumas était alors émoustillé par la loi du timbre qui menaçait son industrie feuilletonesque.
L’histoire romancée d’aujourd’hui, pas toujours moins ennuyeuse que l’histoire, est nettement du plutarquisme en ce qu’elle a un but bien déterminé de prosélytisme suivant les fins de l’ordre. Grâce au confusionnisme qui a supprimé toute distinction des valeurs, on annexe des révolutionnaires, ou tout au moins des esprits indépendants, à la réaction et au néo-catholicisme. Plus souvent on fait de conquérants, d’inquisiteurs, de dictateurs, de débauchés, des exemples d’hommes de paix, de tolérance, de liberté, de sainteté. C’est un galimatias qui fait de notre temps « une époque bénie par les farceurs, les visionnaires, les confusionnaires, illusionnistes, faiseurs de boniments, marchands d’orviétans, inventeurs de spécifiques à la graisse de chevaux de bois. » (.J.-R. Bloch). Des foules de Loriquet, clercs et laïques, de toutes les religions et de tous les partis, continuent à maquiller, fausser, plutarquiser l’histoire et la vie tout entière. Ils plutarquiseront tant qu’ils rencontreront des hommes pour croire à leur imposture et pour obéir à l’ordre criminel dont ils sont les soutiens.
— Edouard ROTHEN.
POÉSIE
Rien d’aussi vaste que ce mot qui est sujet aux interprétations les plus diverses et revêt bien des sens. D’Homère à MM. Paul Claudel et Paul Valéry, pour prendre deux pôles, il y a de la marge. L’application qu’on a pu faire de la poésie (le mot et la chose) varie à l’infini et l’on éprouve quelque embarras à rechercher une signification à peu près exacte.
Il est évident qu’au berceau des civilisations, la poésie se confond avec le chant. Le poète chante. Il chante les guerriers victorieux, l’amour, les champs, le ciel et la terre. Orphée chantait et les bêtes les plus féroces se couchaient à ses pieds. Amphion chantait et, aux accents de sa lyre, les pierres de Thèbes se rangeaient les unes sur les autres. De même, Tyrtée chantait et les guerriers se précipitaient dans la mêlée. Les premières manifestations de la poésie sont du genre lyrique et du genre héroïque. Il faut y joindre le genre bachique ou dithyrambe, en l’honneur du dieu du vin, et le genre érotique.
Ainsi, au début, on rencontre les chants de guerre, l’ode héroïque ou pindarique (du nom de Pindare), les chœurs lyriques qu’on trouve dans les tragédies, les cantates, les chansons... Au Moyen Age, ce seront les mêmes essais, les mêmes tâtonnements avec les chansons de geste. La guerre, l’amour, les rivalités des dieux et les grands de ce monde font les frais de la poésie.
Plus tard, avec l’évolution des langues, la poésie se sépare du chant, est soumise à des règles fixes que certaines révolutions d’écoles tenteront d’enfreindre et que les époques dites de décadence s’enorgueilliront de mépriser. Mais, en résumé, la poésie doit tenir compte d’un certain rythme. Chantée au commencement, elle est, par la suite, scandée, soit, comme chez les anciens, par le jeu des syllabes longues ou brèves ; soit, comme chez les classiques français, par le jeu des hémistiches, de la césure et de la rime. Chez les contemporains, le vers est torturé, disloqué, ne relève plus que de vagues assonances et d’une musique approximative. La poésie se réfugie volontiers dans l’abscons, échappe à toutes règles et rejoint la prose tant par son absence de clarté que par ses accrocs à la plus élémentaire syntaxe.
Outre les lois qui ont toujours déterminé la poésie à travers les âges, il faut considérer l’emploi de termes dits nobles, et d’images plus ou moins justifiées. Le poète se doit de prononcer coursier pour cheval, et de désigner la lune comme l’astre d’argent, pour prendre un exemple. Ou encore de prêter un char et des doigts roses à l’aurore. A la longue, l’abus de telles images a été vivement ressenti. On s’est efforcé de renouveler les vieux stocks, ce qui a conduit nos rimeurs à des fantaisies dangereuses autant que nébuleuses.
Au fond, la poésie vient du besoin qu’avaient les hommes de magnifier les choses et eux-mêmes. Non seulement ils chantaient, mais encore ils avaient recours à l’image : métaphore, allégorie, fable. On dit souvent qu’il est possible de goûter de la poésie dans une prose harmonieuse et colorée et il est certain que la poésie ne s’exprime pas fatalement sous forme de vers (si l’on prend le mot : poésie, dans son sens général). Mais, étroitement définie, la poésie a ses lois. Et il est tout aussi vrai qu’il ne suffit pas de rimer avec excellence pour s’avérer poète.
En réalité, la poésie est née du désir irrésistible qui a toujours poussé l’homme à élever son esprit, à échapper à sa basse animalité, à s’ennoblir en quelque sorte. Il est tout naturel qu’au début il ait traduit les sentiments qui l’agitaient en face du spectacle de l’univers et de l’énigme de la création. Il a chanté les dieux et les héros et, en les chantant, il les a créés. Il a chanté l’amour, qui pouvait n’être que le contact de deux épidermes et la satisfaction fugace d’un instinct brutal et il en a fait une passion redoutable, dominante, bouleversante. Il a chanté les batailles, éveillé dans les âmes l’amour du clan, de la cité, de la patrie. Durant les siècles, le poète fut un charmeur, un enchanteur, versant dans les cerveaux un redoutable opium, travestissant la vérité des choses. Tour à tour lyrique, épique, bachique, érotique, héroïque, bucolique, il a permis l’épanouissement du « divin mensonge », s’opposant à ce que le bipède humain vit clairement, nettement, la froide réalité. Mais il a aidé des millions de réprouvés à supporter la dure et fade existence, parmi des chimères et des rêves impuissants. J’oserai écrire que, toujours, le poète fut un malfaiteur social, généralement domestiqué par les maîtres, et qui, malgré lui, par la vertu de ses chants, a puissamment aidé l’homme à grandir, à sortir de lui-même. Il a pris la bête rampant dans la fange et l’a projetée vers le ciel. Un ciel vide, soit. Mais, par delà ce néant, il y a des horizons à atteindre. Le poète peut devenir, demain, le guide.
Les peuples ont toujours eu, d’ailleurs, les poètes qu’ils méritaient. Sans essayer de remonter aux origines de la civilisation, il est indispensable de noter le grand poème de l’Inde : le Ramayana. Michelet dit :
« Un immense poème, vaste comme la mer des Indes, béni, doué du soleil, livre d’harmonie divine où rien ne fait dissonance. Une aimable paix y règne... la Bible de la Bonté... la mer de lait... » Le Ramayana, c’est la sublime histoire de Rama combattant le mal et la nuit. Et c’est l’âme de toute une race de grande douceur et de longue patience pour laquelle l’esprit est tout, circule partout, dans l’animal et dans l’arbre géant, et dans les brins d’herbe. Cela sans la moindre superstition. L’intelligence ne perd pas ses droits. Dieu n’est qu’un symbole. S’il prétendait tyranniser l’homme, ce dernier lui rappellerait que c’est lui qui l’a fait et qu’il peut le faire s’évanouir en soufflant dessus. Poème d’amour, et de paix fraternelle, et de liberté. Ici le poète est vraiment le sage, et le prophète.
L’Egypte a sa poésie, qui est celle de la Mort. Rien ne dure. La vie circule d’un être à l’autre et le néant est au bout. Mais l’Amour est plus fort que tout. Isis retrouve, à Byblos, son amant, Osiris, transformé en pin, l’arbre vivant, l’arbre qui pleure. Car l’arbre a une âme, un cœur. Et aussi toute la Nature que symbolise Isis, la femme, la mère, la vie, l’amour. N’oublions pas qu’Isis-Osiris, étant deux, ne font qu’un et qu’Isis fut fécondée dans le ventre maternel, mettant au monde un fils, Horus, qui se trouve être son père. Symboles naïfs sous lesquels il est facile de découvrir les réalités. Mais nous sommes plutôt dans le mythe que dans la poésie, telle qu’on l’entend, dans l’Occident.
Si nous passons au Juif, nous découvrons la poésie de l’esclave. Un dieu cruel, implacable, règne sur un peuple avide, cupide et essentiellement religieux. Mais le Juif n’a rien imaginé. Il a emprunté aux autres et il prêtera, plus tard, au chrétien, à la petite semaine. Poésie terriblement pratique. Moïse est dictateur. Joseph est financier. Tous les grands Juifs sont plus ou moins devins, chiromanciens, faiseurs de tours. Et Jéhovah, qui connaît son peuple, agit en tyran, n’apparaissant que pour sévir. Mais le Veau d’Or est plus puissant que lui et déjà, en exil, en Chaldée ou en Egypte, les Juifs pratiquent le commerce d’argent et font fortune. Poésie de sécheresse et de stérilité.
La Perse, avec son combat éternel du Bien et du Mal — Ormuz contre Ahrimane — et sa légende de l’Aigle, son culte de la Femme et de la Mère, nous a légué le Shah Nameh de Firdousi, qui fut, par sa vie, ses infortunes, son influence, quelque chose comme son Homère. La Syrie nous a donné la poésie de l’inceste, de la prostitution, de la mutilation, avec Astarté et Moloch, la femme poisson-colombe, Belphégor le priapique, les orgues, les bacchanales... Mais, pour discerner l’origine véritable de la poésie, il faut atteindre les Grecs héritiers et dépositaires des vieilles légendes d’Orient.
Avec la Grèce, c’est le culte de la Beauté. Les Dieux n’ont pas d’autre signification. Nous nous évadons du mythe cadenassé et le poète ne se confond plus avec le prophète ou le prêtre. Les Grecs imaginent des Dieux à profusion, chacun d’eux correspondant à une nécessité de leur vie sociale. Jupiter n’a guère plus d’importance, pour les Grecs, qui savent à quoi s’en tenir, que Marianne pour les républicains français. Les dieux incarnent des besoins, des aspirations. Ils sont à l’image et à l’a mesure de ceux qui les inventent et ils n’interviennent dans les affaires des mortels que de façon humaine. Le roi, le chef de la troupe olympienne ne conquiert ses nombreuses maîtresses que par subterfuge, en se transformant en taureau, en pluie d’or ou en prenant l’apparence d’Amphitryon. Les dieux sont pleins de défauts, de vices, qui appartiennent à l’homme. Ils sont vaniteux, vindicatifs. Junon est jalouse. Apollon se venge sauvagement de son rival. Mars est un adjudant grotesque. Mercure est un voleur. Diane est une pimbêche. Les Grecs s’amusent. Ils plantent des dieux à tous les carrefours. Les hommes qui se sont imposés dans la guerre ou dans les arts, Hercule, Thésée, Esculape, Prométhée, prennent du galon et deviennent, pour le moins, demi-dieux.
Les Grecs ont trop de dieux qu’ils font, défont, accommodent aux goûts du jour et qui ne sont, au fond, que des créations fictives et représentatives. D’une bourgade à l’autre, les dieux changent, n’ont pas les mêmes attributs. C’est un jeu. Les fables les plus diverses se succèdent, se multiplient, empruntées à l’Orient, dénaturées, arrangées. En dernière analyse, les dieux sont installés chez les hommes, vivant de leurs passions, dans une familiarité constante. Les Grecs sont comme les enfants parmi les fées de leurs contes qui peuplent leurs rêves sans les absorber, pratiquement.
Dès lors, la poésie se transforme. On ne peut, ici, que résumer et il n’est pas dans notre cadre de tenter l’histoire de l’esprit humain. Considérons seulement que l’Inde, avec son culte du feu : Agni, le vrai dieu ; que l’Egypte, avec son culte de la vache nourricière et maternelle ; que la Perse, avec sa dualité du Bien et du Mal, de la Lumière et des Ténèbres ; que le Chaldéen, le Phénicien, le Juif, et tous les peuples enfants sont demeurés en arrêt devant le Mystère qu’ils ont interprété, les uns avec joie, avec l’amour, les autres dans la haine et l’épouvante. Les Grecs ne sacrifient qu’à la Beauté. Ils sont amoureux du Soleil et de la Forme, Mais leurs balbutiements poétiques, comme ceux de tous les peuples (on le verra avec nos propres chansons de gestes) vont aux héros des batailles. Les rapsodes errant de cité en cité comme, plus tard, nos jongleurs moyen-âgeux et nos trouvères, ne jouent de la lyre que pour chanter les exploits des rois, roitelets, guerriers, leurs faits d’armes, leurs victoires, leurs amours.
L’origine de la poésie doit être cherchée dans l’énigme que la nature offre à l’homme et dans le goût du merveilleux. La poésie est, d’abord, essentiellement panthéiste chez les peuples orientaux dotés, déjà, d’une métaphysique, astrologues, navigateurs ou pasteurs, voués à la contemplation. Chez les nomades épris de batailles, elle revêt un caractère de nihilisme féroce. Mais, avec les uns et les autres, elle est sœur de la musique. Les clans, les tribus, les peuples se montrent friands d’harmonie dans les sons et dans les mots.
L’aède grec, lui, chante pour le plaisir. Il se soucie peu du Mystère qui l’environne. Les symboles dont il fait choix sont clairs et, même, quand il puise dans les vieilles légendes rapportées par les voyageurs, il les accommode à son goût, sous un ciel qui demeure pur et calme, Dès lors, la poésie perd son caractère primitif d’unanisme, pour employer un mot moderne. Elle est conforme à l’âme de ce petit peuple bavard, discutailleur, frivole. J’ose m’étonner de constater l’influence (les arts plastiques mis à part) que quelques bourgades échelonnées sur les bords de la Méditerranée ont pu exercer, au cours des siècles, sur le monde européen qui persiste à s’alimenter à la source gréco-latine, alors qu’il pourrait puiser dans la richesses de ses folklores (notamment en France, où le Moyen Age est prodigieux).
Il n’est pas dans mes intentions de dresser, ici, un tableau complet de la poésie et de son évolution. Un tel tableau nécessiterait des volumes. Nous noterons que la poésie grecque a vu le jour, très probablement, sur les côtes de 1’Asie-Mineure, vers le Xe siècle avant Jésus-Christ, avec les Orphée, les Amphion, les Linos. Puis apparut la poésie épique, consacrée aux combats. Ce sont les aèdes qui la propagent par leurs chants, lesquels ont trait aux prouesses des guerriers, particulièrement des ancêtres entrés dans la légende. Les dieux se mêlent aux hommes, interviennent entre les combattants. De là, Homère, l’immortel Homère, qui n’a fait que donner son nom à une œuvre collective et lui a fourni, peut-être, l’unité de composition. On ne sait rien d’Homère, représenté généralement sous les traits d’un vieillard aveugle, sinon que sept villes prétendent lui avoir donné naissance. Il faut observer que l’Iliade et l’Odyssée furent recueillies par les soins de Pisistrate, tyran d’Athènes, au VIe siècle et que, plus tard, au IIe siècle, Aristarque revit très scrupuleusement ces deux poèmes dont il supprima nombre de vers inutiles ou fâcheux.
L’Iliade, c’est l’histoire de la guerre que les Grecs livrèrent aux Troyens. C’est une succession de chants qui finissent par devenir fatigants. L’Odyssée a plus d’intérêt. Ce poème relate les aventures du subtil Ulysse (Odyseeus) et côtoie le roman ou le conte de fées. L’influence de ces deux œuvres fut formidable en Grèce. La poésie lyrique et tragique ne cessa de s’en inspirer. Cependant, il y eut, avec Hésiode, comme une sorte de réaction. Ce poète s’efforça, dans Les Travaux et les Jours, de condenser les connaissances de son temps et d’enseigner (en grec : didasco), d’éduquer, d’instruire ses contemporains. Il créa ainsi la poésie didactique. Toute la poésie grecque sort d’Homère et Hésiode.
La poésie lyrique s’affirma avec Tyrtée (le Déroulède de Sparte), qui entraînait les guerriers à la mort ou à la victoire ; avec Sapho, prêtresse de l’amour ; avec Anacréon, poète érotique et charmant qui chantait « le divin Eros, maître des dieux, dompteur des hommes » ; avec Pindare qui composait des Odes pour les jeux olympiques, pytiques, isthmiques (c’était une manière de poète officiel). Puis, la poésie tragique, avec Eschyle, Sophocle, Euripide, triompha. Ces trois grands tragiques qui influencèrent les Latins et notre XVIIe siècle, n’eurent que de pâles imitateurs. Par contre, le génial, l’immense Aristophane, ennemi de la guerre, ennemi de la démocratie ridicule de son temps, ennemi du socratisme créateur de Dieu et marchand de morale, connut, à travers les siècles, un succès qui ne se démentit jamais. Il demeure le premier poète comique à la verve cinglante et vengeresse, père de tous les satiristes et de tous les pamphlétaires.
Après lui, on ne voit guère que Ménandre, dont on n’a conservé que quelques fragments, et qui s’attache surtout à la peinture des mœurs de son temps.
Il ne faudrait pourtant point oublier Archiloque, qu’on connaît imparfaitement et qui, dans ses iambes, donna naissance à la satire.
Les Romains surgissent ensuite. Ils se nourrissent des Grecs. L’Odyssée est traduite en latin, Naevius adapte, à la scène, les comédies d’Aristophane. Ennius (un Grec) donne des tragédies. Mais c’est la comédie, surtout, qui se développe avec Plaute et Térence, le premier s’apparentant à Aristophane, le second à Ménandre qu’il imite. Mais Plaute est le plus grand auteur romain. Il a décrit, quelquefois avec grossièreté, usant d’une liberté extrême, les mœurs de son temps, flagellant les esclaves, les femmes impudiques, les soldats, les voleurs et tripoteurs de l’époque, s’attaquant courageusement aux maîtres et aux institutions, dénonçant les vices et les lâchetés. L’influence de Plaute, comme celle d’Aristophane, s’est fait sentir sur le XVe siècle. Racine et Molière ne l’ont pas oublié et les poètes comiques contemporains pas davantage (Laurent Tailhade a adapté la Farce de la Marmite et Tristan Bernard, dans les Jumeaux de Brighton, s’est souvenu des Menechmes).
Le grand poète de Rome, c’est Lucrèce, l’auteur de « De Natura rerum ! ». S’inspirant de la philosophie à tendance matérialiste d’Épicure, il s’efforce d’expliquer l’univers sans dieux — ni Dieu. Il combat la religion et prévoit la théorie des atomes. Le premier, il professe que la terre n’est pas le centre de l’univers et que d’innombrables mondes vivent, naissent, meurent. Les Dieux n’y peuvent rien, s’ils existent. L’évolution des êtres se poursuit (Lucrèce laisse prévoir Darwin), dans la lutte pour la vie, par la force ou par la ruse. Aucun poète n’a fourni une vision aussi claire de la réalité des choses et la Science, depuis, n’a fait que confirmer, dans son ensemble, les théories — qui tiennent de la divination — du poète de De Natura rerum qui est le sommet de la poésie didactique.
Avec Catulle, d’abord ; puis Virgile, la poésie bucolique prend son essor. Mais Virgile n’est pas seulement l’auteur des Eglogues, des Georgiques. Son œuvre la plus importante est l’Enéide, poème épique, imité d’Homère, où il chante, à son tour, les exploits et les infortunes d’Enée, guerrier rescapé de la ruine d’Hion.
Horace fait triompher la poésie satirique. On sait ce que lui doivent nos auteurs les plus renommés, dont l’illustre Boileau-Despréaux qui prétendit fixer, à la prosodie et à la métrique, des règles éternelles. Tibulle continue Catulle et il est continué par Properce. Ovide met la mythologie grecque en vers latins. Puis, plus tard, Lucain tâte de l’épopée avec la Pharsale. Perse reprend le fouet de la satire qui appartiendra, sans contestation, à Juvénal, plus brutal, plus mordant, plus audacieux qu’Horace. Quant à la poésie tragique, elle a son représentant dans le médiocre Sénèque. Et c’est la fin. Les Barbares envahissent l’Empire. La Décadence s’impose. Le Monde occidental est bouleversé.
Nous entrons dans la fameuse nuit du Moyen Age. Tout est à recommencer. Nous voici, de nouveau, en présence d’un peuple enfant, qui balbutiera sa poésie, tâtonnera, créera, jusqu’au jour où, après les guerres d’Italie, et ce qu’on a appelé la Renaissance, les Grecs et les Latins s’installeront despotiquement chez nous.
Le Moyen Age, c’est un recommencement. Les guerriers du Nord se sont abattus sur la Gaule, dont les indigènes — les Celtes — ne sont, eux-mêmes, que les descendants d’autres envahisseurs. On ignore la Grèce. On ne sait pas Rome. Tout est à refaire, parmi les combats. La poésie fleurit, instinctivement. Elle débute, comme autrefois, par le chant. On va chanter les gestes (du latin : gesta, actions, prouesses), des héros. C’est le siècle de l’épopée. Ici, deux théories :
-
les peuples jeunes s’adonnent à la cantilène (ou chanson) que les soldats répètent à l’envie (voyez, à notre époque, la Madelon, cantilène). Puis, avec les jongleurs, successeurs des aèdes, les cantilènes se développent, touchent au lyrisme et à l’épopée ;
-
d’après Joseph Bédier, les chansons de geste sont composées par des clercs et récitées, ensuite, par les jongleurs.
Cette querelle n’a pas grande importance. Ce qu’il faut voir, c’est qu’à l’origine de la poésie française, on chante. Et l’on chante les gestes, les exploits des héros. L’assonance suffit. La rime n’interviendra que par la suite. Les vers sont décasyllabiques et groupés en laisses ou couplets. Le jongleur s’en va, de château en château, avec sa vielle et ses petits manuscrits. Et les féodaux écoutent. Le jongleur chante pour eux.
Aucun emprunt aux Grecs ou aux Latins. Les premiers poètes puisent dans leur propre fond. Ils disent l’héroïsme des paladins, puis des croisés. C’est ainsi que voient le jour toute une série de poèmes épiques : Berthe aux grands pieds, Huon de Bordeaux, la Chanson de Roland, Oger le Danois, les Quatre fils Aymon, etc., etc. En même temps se développe le fabliau, qui est une manière de satire et dont un recueil, rédigé au XIe siècle, le Romulus de Marie de France, nous a été légué. Mais pour bien suivre le développement de la poésie au Moyen Age, il faut tenir compte des conditions sociales, des invasions, des luttes entre féodaux, etc. C’est ainsi que la poésie épique comprend trois cycles : celui de Charlemagne, celui de Guillaume d’Orange, celui de Don de Mayence. Il ne s’agit que de gestes des chevaliers chrétiens en lutte contre le Sarrazin. Une des plus populaires de ces chansons de gestes, c’est celle qui nous est parvenue sous le titre : Les Quatre fils Aymon. D’autre part, la poésie allégorique donne naissance au fameux Roman de la Rose (de Guillaume de Lorris et Jean de Meug), et les fabliaux ou ysopets (d’Esope) aboutissent au Roman de Renart et à Rutebœuf, un des premiers poètes satiriques et l’ancêtre de Villon.
Deux langues, d’ailleurs, s’affrontent. Les troubadours triomphent dans le Midi ; les trouvères dans le Nord. Mais la poésie provençale, avec ses « saluts d’amour », ses ballades, ses « chansons courtoises » exerce une grande influence sur l’évolution du lyrisme en France.
Nous voici au XIVe siècle, avec Eustache Deschamps qui compose sa ballade sur le Trépas de Bertrand-Du-Guesclin et un certain nombre de poèmes satiriques...
Nous ne ferons que mentionner Villon, dont nous étudions l’œuvre et la vie (voir Villon, dans une autre partie de cet ouvrage). Et c’est la Renaissance avec Ronsard, la pléiade, tout un immense effort de renouvellement (voir article : Renaissance).
Cela nous mène jusqu’à Malherbe, parmi bien des résistances. Mathurin Regnier, notamment, attaque le premier des classiques avec vigueur. Mais c’est Malherbe qui a raison de réagir contre l’imitation des anciens et d’imposer la langue de son temps. Il commande la clarté, la logique, l’harmonie des vers. Mais il aboutit à une certaine sécheresse qui contraste avec la verve du satirique Mathurin Regnier, son adversaire, héritier de Villon et de Clément Marot. Son autorité devient telle qu’il écrase d’excellents poètes : le lyrique Théophile de Viau, Saint-Amant, Cyrano de Bergerac... II sera suivi par les maîtres du XVIIe siècle et Boileau s’écriera : Enfin, Malherbe vint !...
Ce XVIIe siècle, on le dit ici, sans la moindre velléité de polémique littéraire, fut plutôt odieux. Si on excepte Corneille (qui fut un romantique jeté dans le carcan classique et qui, deux siècles plus tard, aurait peutêtre écrit Ruy-Blas), les copieurs qui ont nom Racine, La Fontaine, Boileau, Molière n’ont rien apporté que ce qu’ils ont pris aux autres. Ils utilisaient les Grecs et les Latins, mais ils n’ignoraient pas le Moyen Age et la Renaissance. Ils ont bénéficié de ce fait que la langue s’est à peu près fixée sous Louis XIV (Malherbe ayant mis la poésie en cage). Ils travaillaient sur du vieux, rapetassaient ; ils puisaient partout. Le grand siècle est le siècle de la stérilité et du plagiat. La poésie est morte ; tout lyrisme est éteint, toute fantaisie absente. L’ennui règne. Molière pille ses devanciers et ses voisins. La Fontaine transpose et son inspiration manque de poumons. Boileau, pion accablant, prend son bien où il le trouve, même chez ceux qu’il fustige. Seul, Racine, par la peinture des passions (mais des passions frigorifiées dans le moule de l’alexandrin) peut prétendre à l’invention. Ce qui manque le plus au XVIIe, c’est l’originalité. Le Moyen Age est confus, barbaresque, énorme, ridicule et puéril. La Renaissance innove. Malherbe réglemente comme un préposé aux douanes poétiques. Les « grands génies » qui tournent autour du Roi Soleil, cette image de la solennité morne et pesante, écrivent, riment, officiellement, sur de vieux canevas (à quelques exceptions près) et des thèmes rabâchés.
On le verra avec les successeurs, quand tons les sujets seront épuisés et qu’un Voltaire, en dépit de son génie, devra ramasser les miettes des grands maîtres, passer de Brutus à Zaïre et à Mérope. Au fond, nul poète véritable au XVIIIe siècle si ce n’est l’abbé Delille, ancêtre du symbolisme et quelques lyriques un peu pompeux genre Millevoye et Le Franc de Pompignan. Au théâtre, parmi les comiques, brillent encore les Regnard, les Destouches, les Piron, les Gresset. Parmi les tragiques, Crébillon s’exténue et Ducis cherche sa voie, maladroitement, du côté de Shakespeare. On sent que tout est dit. Le râtelier gréco-latin est vide. Il va falloir passer à un autre genre d’exercices.
Aussi le lyrisme tant méprisé va-t-il connaître, avec un J.-B. Rousseau, un renouveau inespéré. Parny apparaît presque comme un précurseur. On cherche. Il faudra que surgisse André Chénier pour que la poésie retrouve ses ailes, encore que l’auteur des Idylles et des Jambes, mort trop jeune, sans avoir donné sa mesure, se soit complu un peu servilement à l’imitation des anciens. Mais André Chénier marque, malgré tout, un point de départ. Le romantisme s’annonce.
Le romantisme, c’est une réaction violente, une bourrasque qui s’élève contre le classicisme. On veut s’exprimer librement et tout exprimer. On secoue les règles caduques. On bouleverse le vocabulaire. Par dessus les maîtres à perruques, on saute sur le Moyen Age. On ressuscite Villon, Ronsard. La tragédie est condamnée. On s’accroche au drame, formule nouvelle, qui se réclame de Shakespeare, de Gœthe, permet de fouler aux pieds les lois de l’unité de temps et de lieu. De même le vers, ligoté, emmailloté, voué à la crapaudine de la césure, privé de la gymnastique de l’enjambement, se retrouve plus aérien, bondit vers les espaces libres. Le passé moyen-âgeux ne suffit plus. On vole vers l’Orient, un Orient conventionnel, mais plein de couleurs, rutilant et chaud, où la fantaisie ne connaît aucun bâillon. La formule du romantisme tient dans un mot : Liberté. Mais, liberté dans le cadre d’une prosodie consentie, régulatrice, permettant les bonds de l’imagination et ne présentant que des obstacles aisés à franchir ou à tourner. Ceci pour la technique. Pour l’expression, la liberté sans rivages, selon le mot que Vallès reprendra plus tard. Tout le XIXe siècle qualifié de « stupide » par un polémiste délirant, aussi bien dans l’ordre politique et social que dans l’ordre scientifique ou littéraire, s’explique par ce mot : Liberté. La Révolution a profondément agi sur les esprits et le pédantisme des siècles précédents rebute toute une jeunesse ardente, avide de mouvement, brûlée de curiosité, Il y a bien encore quelques retardataires qui s’efforcent de défendre le temple classique. Mais les jeunes iconoclastes sont trop nombreux et leurs assauts s’avèrent impétueux. Les Lemercier, les Baour-lorman reculent. Le romantisme va s’affirmer dans un ouragan.
Ses sources sont l’Orient et le Moyen Age. Ses maîtres, il va les chercher ailleurs qu’à Rome et à Athènes. Et il se dresse impétueusement contre les derniers champions de la tragédie ou de la poésie didactique représentées par un Castel qui chante la forêt et les plantes, un Boisjolin qui rime une Botanique, un Campenon, un Gudin, un Laya, un Lemercier, un Arnault, un Raynouard, un Brifaut. Tout cela sent la fin. C’est la queue sans prestige du grand siècle, sans la légèreté libertine et l’ironie aimable du XVIIIe. Il est même curieux que Jean-Jacques, Diderot, Voltaire, les Encyclopédistes aient pu bénéficier de successeurs aussi indigents. Mais il est vrai, d’autre part, qu’en dépit des apparences, la révolte romantique est provoquée par eux. L’influence d’André Chénier reste mince et, seules, des femmes élégiaques comme Mlles Desbordes-Valmore, Aimable Tastu, Sophie Gay, Delphine Gay (Mme de Girardin) se réclament de lui.
Cependant, outre l’influence des philosophes du XVIIIe, particulièrement de Rousseau, il faut noter celles de Bernardin de Saint-Pierre et de Chateaubriand, les vrais parrains du romantisme. En même temps, le théâtre anglais (Shakespeare) et le théâtre allemand (importé par Mme de Staël), influencent les jeunes écrivains. Ossian et Byron ne contribuent pas peu au renouveau du lyrisme. Gœthe exerce une attraction formidable sur tous. Bientôt la guerre est déclarée aux « vieilles perruques » et Mme de Staël baptise la nouvelle école. Hugo, qui débute, repousse le mot : romantisme ; puis, devant les railleries des héritiers de Boileau, il le reprend comme un drapeau.
C’est au théâtre surtout que les plus formidables bagarres vont se poursuivre. Hugo va lancer Cromwell et son inoubliable préface. Il piétine les règles de la tragédie avec son unité de temps et de lieu, son abus du confident — qu’il remplace d’ailleurs par le monologue — sa monotonie, son absence d’action ! Le drame du XVIIIe siècle, si timide, si pondéré, s’élargit, prétend à exprimer toute la vie humaine, à en extraire à la fois tout le sublime et tout le grotesque. Shakespeare est passé par là, grâce à Frédéric Soulié qui donne Roméo et Juliette. Les classiques protestent. Mais Alexandre Dumas donne Henri III et sa cour, et Victor Hugo livre l’inoubliable bataille d’Hernani. Le public répond à l’appel. E. Casimir Delavigne, lui-même, le dernier des classiques, se laisse gagner.
Dans la poésie pure, Lamartine triomphe, tout en demeurant à l’écart du mouvement avec ses Harmonies, ses Méditations, son Jocelyn. Et Victor Hugo va dominer son siècle, depuis les Odes et Ballades, en passant par les Orientales, les Feuilles d’Automne, les Voix intérieures, les Rayons et les Ombres, les Châtiments, les Contemplations, la Légende des siècles, jusqu’à l’Art d’être grand-père. A côté de ce géant, Alfred de Vigny, avec ses Poèmes antiques et modernes ; Alfred de Musset, considéré comme l’enfant terrible du romantisme, alors qu’il demeure sensiblement classique ! Derrière, le chansonnier Béranger, l’auteur des Iambes ; Auguste Barbier ; le chantre de Marie : Auguste Brizeux ; le lamartinien Victor de Laprade, etc., et les fantaisistes Théophile Gautier, Théodore de Banville.
Le mouvement romantique qui provoque une véritable révolution dans la poésie et au théâtre ne tarde point, cependant, à tomber dans l’excès. Une réaction se dessine avec Ponsard, l’auteur de Lucrèce et de Charlotte Corday et Emile Augier. Puis les querelles s’apaisent. D’autres écoles vont voir le jour. Charles Baudelaire, dont Hugo dit qu’il a créé un frisson nouveau, compose ses Fleurs du Mal qui sont à l’origine du symbolisme et du parnassisme. A la vérité, toute la poésie moderne est contenue dans Hugo le Père, qui a tout dit et dans Baudelaire, le maître de la forme. De ces deux sources, vont partir tous les courants.
Contre le romantisme, c’est la croisade naturaliste, d’abord avec Zola qui, malgré lui, reste imprégné de ce qu’il appelle la « sauce romantique ». Le romantisme, au fond, n’est fait que de couleurs et d’images. La réalité lui échappe. Telle est la nouvelle thèse. Mais le naturalisme lui-même, va subir de rudes assauts. Voici le symbolisme qui triomphera avec Paul Verlaine, petit musicien sans idées, et Stéphane Mallarmé le théoricien du groupe, qui verse dans l’abscons et, pourtant, apparaît aujourd’hui comme un modèle d’éblouissante clarté. Soyons juste. Tous deux sont des poètes. Verlaine a des accents auxquels il est difficile de résister. Mallarmé, pur et noble, est aussi harmonieux qu’inventif. Mais l’engouement les a situés à une place d’où la postérité les délogera. D’autres symbolistes ont exercé une influence profonde sur les générations d’aujourd’hui : l’amer, le féroce Tristan Corbière, le néantiste Jules Laforgue, le vibrant et coloré Arthur Rimbaud, l’immense et marécageux Verhaeren ; le petit-fils de l’abbé Delille, Albert Samain... Citons encore Henri de Régnier, Gustave Kahn, Maurice Maeterlinck, Stuart Meril, Francis de Viellé-Griffin, Adelphe Retté, Rodenbach, Paul Valéry... Nous sommes loin du romantisme. Le vers classique, disloqué par la bourrasque de 1830, aboutit au vers libre. On ne jure plus que par l’assonance et le rythme. Les derniers romantiques sont représentés par François Coppée, un excellent poète quoi qu’on puisse dire et qui se tient à mi-chemin entre les romantiques et les naturalistes ; Jean Richepin, truculent, argotique, baudelairien et hugolesque, et Edmond Rostand, le dernier, verveux et d’une aimable fantaisie.
Parallèlement au symbolisme, se développent le Parnasse et l’école romane. A la tête des parnassiens qui veulent imposer le culte de la beauté plastique (Verlaine, d’abord parnassien, s’écriait : Est-elle en marbre ou non, la Vénus de Milo ?), c’est d’abord Leconte de Lisle, très grand, au-dessus des chapelles ; De Heredia ; Sully Prudhomme (qui prend une place à part dans la poésie « philosophique »). L’école romane a pour chefs, le Grec Jean Moréas, qui se réclame de Ronsard, et Raymond de la Tailhède. Poésie froide, semée d’archaïsmes. A côté de ces chefs de groupements, Laurent Tailhade, poète aristophanesque, d’une verve cruelle et vengeresse, mais pauvre en sensibilité lyrique.
On comprendra aisément que nous nous voyons dans l’obligation de résumer. Les chapelles se multiplient. Les groupes « poétiques » se succèdent. Saint-Georges de Bouhelier découvre le « naturisme » qui a fait long feu. Jules Romain lance l’unanisme. De bons poètes encore : Fernand Gregh, issu de Verlaine ; Maurice Magre, René Arcos, Georges Duhamel, Jean-Paul Toulet, André Salmon, etc. Mais il semble que les recherches de ces derniers temps ont épuisé la poésie. Les manifestes, les tendances, les théories se heurtent dans un pêle-mêle déconcertant. Le symbolisme aboutit à Francis James (candide, mais poète), à l’imbuvable Paul Claudel, à l’abondant, trop abondant Paul Fort. Le romantisme est mort. Les parnassiens sont exsangues. Les « romans » sont exténués. Et, pour couronner le tout, les excentricités du jour, dont le surréalisme, déjà caduc, à base de freudisme et de communisme nuageux.
Est-ce la fin ? La poésie n’est pas forcément le vers dont la formule varie à travers les siècles, Le vers n’est qu’un exercice. La poésie, pour triompher, doit exprimer les aspirations d’une époque et ouvrir une large fenêtre sur demain. Tout ce qu’il y a de trouble, de vague, de « contenu » dans un siècle, le poète en aspire le suc dont il fera le miel qu’il nous offrira. A travers les bouleversements d’aujourd’hui, quel est le rôle du poète ? Au cours des âges, il a chanté l’amour, les lauriers, les dieux. Il s’est efforcé de violer le mystère. Le poète doit être de son temps et de tous les temps. Il lui faut traduire les aspirations profondes des hommes en proie à la douleur, à l’incertitude, à l’espérance.
Notre siècle est celui du Machinisme, du Progrès Scientifique, de l »Exploitation cynique, de la Sottise et de la Guerre. Mais il est gros de possibilités féeriques. Il contient toutes les clartés et tous les apaisements du futur. Que nous veulent tous ces bardes bardés d’incompréhension qui éjaculent péniblement leurs métaphores éculées, leurs bouts rimés et leurs proses rythmées ? Toujours le thème sempiternel : la gloire l’amour, la nature et ses feuilles desséchées et ses petits oiseaux ! Et il y a un Monde qui meurt, un Monde qui nuit, un immense effort vers l’avenir. On attend le Poète, le Vrai, qui scrutera les horizons, saura dire la peine des hommes et indiquer du doigt le chemin sur lequel l’humanité passera si elle ne veut pas mourir stupidement et ignominieusement. Point besoin d’écoles. Foin des chapelles ! La forme, pour impeccablement pure qu’elle soit, passe. Il n’en reste que l’aspect documentaire, l’expression fugitive d’un instant de la vie multiple et mouvante. Le poète est en face de l’éternité. Il lui faut s’installer sur une cime et plonger dans les perspectives. Prophète et guide, Victor Hugo était cela. C’est pourquoi il est grand parmi les grands. C’est pourquoi on lui doit tout. Poètes de demain, qui de vous va devenir un Dieu ?
Pour reprendre une formule célèbre, le poète sera anarchiste ou il ne sera pas.
Ceci ne veut pas dire que le poète doit adopter un credo politique ou social. Il est en dehors et au-dessus de nos luttes. Mais il ne peut point ne pas communier avec les vœux d’une humanité douloureuse qui cherche sa voie, à tâtons, parmi les égoïsmes déchaînés, les ambitions infécondes, les rivalités criminelles. Pour lui, pas de frontières. Il plane sur nos mêlées stériles. Il s’érige sur nos compartiments nationaux, décorés du nom de Patrie. Il est l’Homme qui se fait Verbe et vers quoi convergent tous les espoirs. A travers la confusion des idiomes, dans les malentendus immenses qu’entretiennent les préjugés, il apparaît la « claire Tour qui sur les flots domine ».
Le poète appartient à la Terre entière. Il emprunte les mots de sa tribu, veille soigneusement à la pureté de sa langue. Mais les mots ne font que vêtir l’Idée.
Le poète est Lumière, Vérité, Bonté. Qu’il use du sarcasme, du blasphème, de l’ironie, de l’amertume, il n’est que cela ou il n’est pas poète.
Le poète sait le néant de tout, et que le ciel est vide, et que les êtres sont en bataille contre les êtres. Mais il sait aussi que la vie, ce bouillonnement précaire et fugace dans le mouvement universel, a un sens — un sens unique vers la Compréhension totale et l’Harmonie — et que rien ne compte, rien ne vaut de toutes nos agitations ridicules, si l’on n’a pressenti la grande, l’éternelle Loi de la Solidarité et de la Liberté.
La légende veut qu’Amphion, la lyre en mains, fit se dresser les pierres qui venaient, à son appel, se placer les unes sur les autres. Ainsi se bâtit la cité. La légende veut aussi qu’Orphée chantant, les bêtes féroces vinssent se coucher à ses pieds. Le poète saura charmer d’autres bêtes féroces qui pullulent dans la jungle sociale et constituera la grande Cité Humaine. Mais il faut, pour cela, qu’il renonce à cette sorte de masturbation funeste où il se complait et s’abîme. Il faut qu’il se fasse entendre. Il associera ses souffrances à la grande souffrance universelle. Il mêlera ses doutes, ses négations, ses espérances à celles de ses frères. Il dira la laideur de ce monde, magnifiera la Révolte qui, seule, crée et bâtit. Il entraînera les foules rampantes, non plus vers les boucheries immondes ou vers l’esclavage, mais vers les sommet s où resplendit l’Amour, et leur montrera, du doigt, le Chanaan, toujours promis, jamais atteint ; un Chanaan non pas offert par un Dieu dérisoire, mais pressenti, rêvé, voulu par l’Homme.
— Victor MÉRIC.
P. S. — A cet exposé rapide, mais qui devait être bref, attendu que le sujet traité est immense et que des volumes compacts ne l’épuiseraient point, il faut ajouter quelques aperçus concernant la poésie chez les peuples voisins.
* * *
Poésie allemande.
L’Allemagne a débuté par l’épopée avec son Niebelungenlied qui est l’œuvre d’un grand nombre de poètes demeurés anonymes, Elle a eu, comme la Grèce, ses aèdes. Les Niebelungen s’inspirent de la mythologie scandinave, chantent les Dieux et les Héros, et les batailles. La poésie des peuples enfants est toujours la même, à quelques variantes près. Epopées, chansons de gestes. Le rapprochement, avec la Grèce, peut se poursuivre. L’Allemagne a aussi son odyssée, Gudnina, poème anonyme qui conte la vie périlleuse des aventuriers normands. Puis, dans les siècles qui viennent, l’Allemagne a ses trouvères, ses troubadours qui parcourent le pays en chantant des liéder, C’est l’ère des Minnesanger.
Au XVe siècle, une réaction se dessine. Les Meister-sänger (maîtres chanteurs) traduisent les douleurs, les joies, les espoirs du monde populaire. Le plus célèbre de tous ces poètes est Brant qui écrit la Nef des Fous, en dialecte alsacien. C’est une satire violente et puissante des mœurs de l’époque.
La Renaissance touche l’Allemagne, mais elle s’exerce, grâce à Luther, dans le monde religieux. Hans Sachs compose ses Chants du Carnaval qui inspirèrent, plus tard, Richard Wagner. En même temps, la légende de Faust prend son essor. Et l’on voit apparaître les chansons dites de société qui vont se développer (XVIIe siècle).
Au XVIIIe siècle, Klopstock compose sa Messiade, un poème épique sur le Christ. Wieland s’inspire de nos chansons de gestes. Bürger triomphe dans la ballade, Mais il faut arriver à Gœthe, le poète le plus puissant de l’Allemagne, un des pères du romantisme, pour voir s’épanouir le génie allemand. Faust, Werther, Herman et Dorothée sont immortels. Son Roi des Aunes est inoubliable. Ajoutons que Goethe était un esprit transcendant et que son influence sur le monde entier subsiste. Il se plaçait au-dessus des différences de race et de langue et se penchait sur notre Révolution. La pensée humaine doit beaucoup à ce poète grand parmi les plus grands.
Schiller, ami de Gœthe, a laissé des drames, des ballades, des romances. C’est également un grand poète lyrique. Toute son œuvre respire l’amour de la justice et de la liberté. Citons : Guillaume Tell, Les Brigands (que l’on connaît imparfaitement en France) Marie Stuart, le Fiancé de Messine, etc.
Après ces deux immenses poètes, les frères Schlegel et Tieck fondent une école nouvelle. Puis, les poètes romantiques surgissent qui prêchent la haine de Napoléon : Koerner, Ardt, Rückert, Uhland, Korner, Hebel. C’est la période patriotique, mais il faut reconnaître que ce genre de poésie a trouvé une autre expression que la nôtre, incarnée par un Déroulède. Notons, à côté de ces bardes héroïques, Chamisso et Platen, et l’école autrichienne, avec Zedlitz, Lenau, Grün, etc.
Le dernier grand poète de l’Allemagne, c’est le juif Henri Heine, qui écrivit aussi en français, très spirituellement. On lui doit des liéder, des satires comme Atta Troll où il fustige cruellement ses compatriotes. Son influence fut profonde sur la jeune poésie française, notamment sur Jules Laforgue. Depuis, l’Allemagne a vu naître bien des poètes, mais aucun d’eux n’a marqué profondément. La musique et la métaphysique demeurent les traits dominants de la culture allemande.
Poésie anglaise.
Un des plus vieux poèmes connus de langue anglaise est intitulé Beowulf. Un des premiers poètes est Chancer qui écrivit de nombreuses pièces de théâtre et traduisit le Roman de la Rose. Il faut dire que jusqu’au XIVe siècle, la langue anglaise n’exista point. Les conquérants normands parlaient un dialecte français ; les Anglo-Saxons parlaient leur dialecte à eux. La fusion de ces deux dialectes a donné l’anglais moderne, sans compter bien des apports étrangers. Il n’y a donc, dans les premiers siècles, que légendes brumeuses, venues des pays nordiques, comme la légende d’Hamlet qui, chose curieuse, se retrouve en Gascogne (voir à ce sujet la traduction et l’étude de Marcel Schwob). La véritable poésie anglaise apparaît un peu tard.
La Renaissance connaît son plein épanouissement sous le règne d’Elisabeth avec Spenser, l’auteur de la Reine des Fées (voir Taine), Christophe Marlowe, dont le Faust inspirera Gœthe. Et, enfin, voici l’immense Shakespeare, le dramaturge sans rival, dont on ne sait pas très bien s’il a existé en un seul individu, qui il était, qui il représentait. Mais ce problème déborde notre cadre. De même nous ne consacrerons pas une étude approfondie à ce poète qui veut une analyse à part. Qu’il suffise de noter la variété touffue de son œuvre, faite de comédies, de tragédies, de drames empruntés tantôt à des légendes : Roméo et Juliette, Hamlet, Othello, le Roi Lear, Macbeth ; tantôt à l’histoire et aux anciens : Jules César, Antoine et Cléopâtre, Richard III, etc. Parmi ses meilleures comédies, il faut citer : Le Marchand de Venise, Beaucoup de bruit pour rien, les Joyeuses Commères de Windsor, etc. L’influence qu’a exercée Shakespeare sur toutes les littératures, et particulièrement au XIXe siècle, est énorme. Les Anglais lui opposent Otway génial poète dramatique, mais très inégal.
Un autre grand poète anglais, Milton, est universellement connu. Son Paradis Perdu a été traduit dans toutes les langues. C’est un poète épique et plein de lyrisme, mais d’une philosophie confuse. A la même époque, Dryden triomphe dans la satire et au théâtre.
Le XVIIIe siècle voit Pope, sorte de Boileau anglais ; Macpherson, qui imagine les poèmes d’Ossian, lesquels sont à l’origine du romantisme ; Chatterton, qui devait servir de sujet à Alfred de Vigny.
Au théâtre, Sheridan brille dans la comédie. Parmi les poètes secondaires, il faut citer : Cowper, Robert Burns, Wordsworth, Shelley et, surtout, Byron. Mais, déjà, nous touchons au XIXe siècle et au romantisme. Wordsworth écrit des sonnets et des ballades lyriques ; Shelley, mort très jeune, atteint aux cimes du lyrisme et dans la Reine Mab, la Magicienne de l’Atlas, Prométhée, s’efforce d’élever les âmes et de guider l’Humanité vers des destinées de Bonté. Quant à Byron, grand lyrique lui aussi, qui agira profondément sur Lamartine, c’est le premier héros du romantisme. Mais sa personnalité encombre son œuvre. On le retrouve sans cesse, lui, toujours lui, dans Childe Harold, Manfred et même dans Don Juan.
Parmi les modernes, Tennyson, poète très pur et abondant, presqu’un classique ; Swinburne, lyrique violent, exaspéré, et dramaturge génial. Plus près de nous, Rudyard Kipling, l’immortel auteur du Livre de la Jungle, qui est aussi un poète héroïque et fougueusement nationaliste.
Poésie italienne
Dans l’Italie diverse, morcelée, en proie aux révoltes, les poètes sont nombreux. Presque tous sont de culture française. Le premier qu’on rencontre, Brunetti Latini, que Dante considérait cornme son maître, nous a laissé un recueil de tous les poèmes épars du moyen âge, qu’il a intitulé : Trésor.
Mais, dès la fin du XIIIe siècle, la Divine Comédie fait connaître partout le nom de Dante Alighieri. Ce poème se compose de trois parties : L’Enfer, le Purgatoire, le Paradis. C’est une œuvre un peu complexe, mais d’une rare puissance. Dante est accepté comme le plus grand poète d’Italie. Il a, cependant, dans un genre différent, un rival avec Pétrarque, l’immortel auteur du Canzonière, consacré à Laure. La langue de Pétrarque est extraordinairement musicale, quoiqu’un peu précieuse. Boccace, qui écrivit beaucoup en latin, compte plus comme l’auteur licencieux du Décameron que comme poète.
La Renaissance italienne se manifeste par deux poètes, l’un héroï-comique, l’Arioste, auteur du Roland furieux ; l’autre, épique, le Tasse, auteur de la Jérusalem Délivrée. Ce dernier, classé parmi les grands poètes, abuse cependant de ce qu’on appelait alors les concetti, c’est-à-dire les pointes et son style est tout d’affectation. Au siècle suivant, Maffei compose des tragédies. De même, Metastase, dont les chœurs chantés sont inoubliables. De même encore Alfieri qui vient après. Enfin Goldoni est le créateur de la comédie de caractères et mérite d’être surnommé le « Molière italien ».
Le XIXe siècle débute avec Monti, auteur tragique, et Léopardi, poète amer, néantiste, pessimiste. Puis, c’est Carducci, le grand poète national italien qui s’impose. Il fait songer, par l’abondance de ses images, par sa richesse et sa couleur, à Victor Hugo, alors que Léopardi rappelle plutôt Vigny. Antonio Pogazzaro est un poète idéaliste. Et voici Gabriele d’Annunzio qui, en dépit de ses aventures politiques, reste le poète le plus brillant et le plus pur, parmi les contemporains. Après lui, c’est une mêlée confuse. Le futurisme fait son apparition avec Marinetti, qui opère aussi en France, lance des manifestes retentissants à travers tous les pays, proclame qu’il faut mettre le feu aux bibliothèques et aux musées, renouveler l’art et la poésie, ouvrir les portes aux Barbares... Aujourd’hui, Marinetti est de l’Académie de Mussolini. Le futurisme n’est plus que du passé.
AUTRES PAYS.
L’Espagne a ses poèmes de combat, ses chansons, ses romances, avec tous ses Cid Campeador. Les poètes ne font que chanter la gloire de l’Espagne, notamment Herrera. Par contre Gongora imagine une langue qui a fait fureur en France, à certaines époques et a donné naissance au gongorisme. Dans le drame et la comédie, Lope de Vega est au premier plan. Guilhem de Castro lui succède. Mais le maître incontestable est Calderon, auteur de mille cinq cents pièces environ.
A noter encore le fabuliste Iriarte, le poète comique Moreto, qui inspira Molière et Scarron, Tyrso de Molina auquel on a emprunté Don Juan. L’époque contemporaine s’enorgueillit de Zorrilla, grand poète et auteur dramatique.
Le Portugal a surtout un grand poète épique, l’auteur des Lusiades, Camoes.
L’Amérique a produit Emerson, Longfelow, Wall Withman, tous trois grands poètes et, surtout, Edgar Poe qui devait agir si fortement sur l’esprit de notre Baudelaire.
La Belgique a connu un nombre infini de trouvères qui, pour la plupart, chantaient en français. Mais, en réalité, la poésie belge date de 1830 ; elle subit l’autorité de Hugo. Plus tard, Max Waller groupe, autour de lui, une pléiade. Cependant la poésie belge se confond avec la poésie française. Les Rodenbach, les Maeterlinck, Verhaeren sont plutôt considérés comme poètes de langue française. Les Flamands ont des maîtres, tels que Guedo Gezelle, poète élégiaque qui rappelle notre André Chénier.
Les Scandinaves ont fourni les premières légendes avec l’Edda, d’où sont partis les Niebelungen. La poésie scandinave est une source d’inspiration. Toutes les littératures y ont puisé. Mais les poètes sont très nombreux, très divers. Il nous est impossible de les énumérer tous. Citons, parmi les Suédois, et sans tenir compte de la période latine, les poètes religieux : Elisabeth Bremer, Peter Lagerloef, Columbas, etc. Puis au XVIIIe siècle, Gyllenborg, lyrique et fabuliste ; Kellgren, Oxenstierna, Anna Maria Lenngrenn, Bellman, chansonnier le plus populaire de tous. Au XIXe siècle, Erik-Gustaf Gedfer et son groupe, se réclament de Shakespeare. Franz Mikael Franzen se prétend individualiste. Puis viennent Johan Ludwig, Raneberg, Elis Malmstroem et, enfin, vers 1880, le génial Augus Strindberg. Parmi les derniers : Gustaf Frœding, Per Hallstrœm, etc.
La poésie norvégienne s’impose à l’admiration avec deux grands poètes dramatiques : Ibsen et Bjørnstjerne Bjørnson : A côté de ces maîtres : Gaspari, Randers, Diétrichson, poètes lyriques.
La poésie danoise nous offre Andersen qui est également un conteur ; Grundtvig, barde guerrier ; Johannes Hansen, autre barde guerrier ; Aarestup (l’Henri Heine danois), Paladan Meiller, Parmo Carl Ploug, auteur des chants populaires, etc.
La Russie peut être divisée en trois périodes littéraires : dans la première, les Russes écrivent le slavon, ou slave de l’Eglise ; dans la deuxième, avec Pierre le Grand, le russe apparaît. Lomonossov renouvelle la poésie et donne la première grammaire nationale. Soumarokov crée le théâtre. Dans la troisième période, Pouchkine représente le romantisme et, en même temps, les débuts de la véritable poésie russe ; c’est un des plus grands poètes russes, auquel on doit, entre autres poèmes, Le Prisonnier du Caucase et le célèbre roman en vers Eugène Onéguine. Mais ce sont surtout les romanciers qui dominent. Les poètes qui succèdent à Pouchkine ne le valent pas, sauf peut-être Lermontov. Ce sont Nekrassov, Nadson, Maïkov, Tioutchev, etc.
— Victor MÉRIC.
POGROME
n. m.
Mot russe adopté tel quel, dans un sens précis, même spécial, par d’autres langues et, en particulier, par la langue française.
Philologiquement, le mot pogrome se compose de la racine grom et du préfixe po. (Notons à ce propos que le mot progrome, employé fréquemment par la presse française au lieu et au sens de pogrome, n’est qu’une erreur, une mutilation du vrai terme. Le mot progrome n’a pas de sens, le préfixe pro ayant, en russe, une signification qui ne peut s’adapter à la racine grom. Le mot progrome est donc, tout simplement, inexistant.) Avec la racine grom, la langue russe forme le verbe gromit qui signifie dévaster, saccager, massacrer. Prenant la même racine grom et y ajoutant le préfixe po, on obtient le substantif pogrome qui signifie l’action de dévaster, de saccager, de massacrer. (En ajoutant à la même racine grom un autre préfixe russe raz, on obtient un autre substantif — razgrome — qui veut dire aussi dévastation, ruine. Mais, tandis que le mot razgrome, à part son sens spécial de débâcle militaire, signifie une dévastation ou un désordre purement matériel, provoqué plutôt par des forces naturelles ou fatales, le terme pogrome désigne nettement un acte de saccagement et de massacre conscient, volontaire, prémédité plutôt que spontané, accompli par plusieurs personnes dans le but même de dévaster, de saccager, de détruire, de piller, de violenter, d’assassiner, de massacrer.)
On entend donc par pogrome, au sens général du terme, tout acte volontaire de dévastation, de destruction, plus ou moins importante, de valeurs matérielles et aussi de vies humaines, acte insensé, sauvage, accompli par plusieurs personnes ou, plutôt, par une foule déchaînée, poussée à ce crime par un aveuglement de haine ou de colère, par une soif presque pathologique de vengeance, de violence, de sang...
Mais, si l’on n’employait ce terme que dans ce sens général, il n’y aurait pas de raison pour qu’il soit emprunté, par les langues étrangères, à la langue russe. Le mot massacre, par exemple, suffirait largement à la langue française. Et, en effet, tous les « pogromes » qui ont eu lieu, au cours de l’histoire humaine, en France et dans d’autres pays du monde — « pogromes » religieux, politiques ou autres — sont qualifiés en français massacres.
En empruntant à la langue russe le mot pogrome, on a voulu désigner par là quelque chose de tout à fait spécial, de spécifiquement russe. En effet, le mot pogrome signifie, en russe, — à part son sens général — spécialement et surtout un massacre de Juifs en masses. Des massacres de ce genre — des pogromes — ont eu lieu en Russie, périodiquement, depuis la fin du XIXe siècle, jusqu’à la chute du tzarisme, et même au-delà. Et c’est bien dans ce sens spécifique que le mot pogrome fut adopté par les langues étrangères. Frappés par la monstruosité de tels procédés en plein XXe siècle, emportés souvent par un élan de vive protestation contre de telles abominations, les peuples des autres pays prirent l’habitude de désigner ces horreurs par le ternie originel.
Le lecteur trouvera certains détails sur les pogromes, en Russie, au mot Antisémitisme (voir pages 101–102). Nous les complèterons ici.
Vers la fin du XIXème siècle, l’absolutisme tzariste commença à être de plus en plus sérieusement menacé par toutes sortes de mouvements révolutionnaires et populaires — conséquence naturelle d’une oppression politique écœurante et d’une situation misérable, tant matérielle que morale, des masses laborieuses.
Pour faire face à ces mouvements, le gouvernement ne trouva rien de mieux que de recourir à de vieilles recettes éprouvées, notamment : d’une part, à des répressions de plus en plus sévères, et, d’autre part, aux moyens de canalisation du mécontentement populaire vers des manifestations moins dangereuses pour le régime. Dans cet ordre d’idées, le gouvernement n’hésita pas à exploiter la crédulité, l’ignorance et les préjugés religieux des masses, à faire appel aussi aux instincts les plus bas de la « bête humaine », pour rejeter sur les Juifs la responsabilité de tous les malheurs et aiguiller dans ce sens la colère du peuple. Les journaux gouvernementaux et « bien pensants » menaient une propagande systématique contre les Juifs. On les accusait de trahison, de menées antinationales, de tous les crimes et de tous les vices. Et, de temps à autre, on lançait contre eux des bandes déchaînées recrutées parmi les bas-fonds de la police et les éléments désœuvrés des villes. Hâtons-nous de dire que la vraie population laborieuse restait toujours plus ou moins étrangère à ces actes de sauvagerie et que, par la suite, le prolétariat des villes organisait même, assez souvent, la défense de la population juive contre les massacreurs. Car, quant à la police, même lorsqu’elle ne dirigeait pas directement ces massacres, elle les préparait toujours dans les coulisses, elle fermait toujours les yeux sur ce qui se passait, elle n’intervenait efficacement que lorsque les événements menaçaient de dépasser les cadres prévus et de prendre des dimensions « exagérées ».
Ce qui se passait au cours des pogromes « non exagérés », dépasse en horreur toute imagination : des appartements — souvent même des maisons entières – saccagées ; des biens enlevés et emportés en tas, avec des cris sauvages de triomphe bestial ; des hommes tués en masse avec une cruauté inouïe ; des femmes violentées et ensuite éventrées au milieu des ruines ; des enfants saisis à pleins bras et embrochés sur des sabres ou écrasés contre les murs... Et l’on faisait peu de distinction entre les Juifs aisés et la malheureuse population juive ouvrière... Les descriptions détaillées de certains pogromes juifs de grande envergure — descriptions faites par des témoins oculaires — produisent une impression terrifiante, à un tel point qu’il est impossible de les lire jusqu’au bout d’un seul trait. Et quant à ceux qui ont eu le malheur d’être victimes d’un pogrome ou même seulement d’y assister, ils finissent assez souvent par en avoir la raison ébranlée. Ajoutons que la documentation certifiée exacte sur les pogromes est abondante, aussi bien en Russie qu’à l’étranger.
C’est surtout dans les premières années du XXème siècle, au fur et à mesure de la croissance du mécontentement populaire contre le système absolutiste, que les pogromes prirent une allure de périodicité et apparurent en véritables séries. En voici les principaux : à Odessa, en octobre 1905 ; à Kiew, octobre 1905 ; à Tomsk, octobre 1905 ; à Gomel, en janvier 1906 ; à Biélostock, en juin 1906 ; à Kitchinew, plusieurs pogromes en 1905 et 1906. Les victimes de ces pogromes se comptent par centaines, parfois même par milliers. Et, à part ces pogromes d’envergure, il y en a eu des dizaines de moindre importance. Après 1906, la vague des pogromes est tombée comme par enchantement, le gouvernement se sentant plus en sécurité après avoir brisé la révolution de 1905.
La révolution de 1917 et la chute du tzarisme ne mirent pas complètement fin à la pratique des pogromes, Partout où les éléments contre-révolutionnaires reprenaient momentanément le dessus (les mouvements de Petlioura, de Dénikine, de Wrangel, de, Grigorieff et autres), les pogromes juifs reprenaient de plus belle, sur l’ordre ou, en tout cas, sous l’œil bienveillant des chefs, qui cherchaient à acquérir ainsi une popularité et à flatter les instincts malsains des masses sur lesquelles ils s’appuyaient.
Peut-on dire au moins qu’actuellement les pogromes en Russie ne sont plus que des cauchemars du sombre passé, et qu’ils ne pourront plus jamais ressusciter ? Hélas, non ! On ne peut pas l’affirmer. Au risque d’étonner certains lecteurs, nous devons avouer, en toute franchise, que l’antisémitisme existe toujours en Russie, et que des pogromes sont encore fort à craindre dans l’avenir.
L’antisémitisme russe moderne n’a plus, il est vrai, les mêmes bases ni le même sens qu’autrefois. Ses bases et son sens sont devenus plus vastes, plus profonds et plus nets. Ses effets n’en pourraient être que plus désastreux. Ce ne sont plus des suggestions d’en haut qui le nourrissent, mais des appréciations qui naissent et se répandent dans les couches populaires elles-mêmes. A l’heure actuelle, il couve sous la cendre. Mais il peut éclater, un jour, en une explosion terrible.
Quel est donc l’aspect de ce nouvel antisémitisme en U.R.S.S. ?
Malgré l’opinion inverse de beaucoup de gens à l’étranger qui, dupés momentanément par la propagande intense et par la mise en scène très habile des bolcheviks, ignorent totalement la réalité russe actuelle, le régime bolcheviste n’est pas stable. Nous l’affirmons catégoriquement. On attribue à Trotski une fameuse parole qu’il n’a, peut-être, jamais prononcée, mais qui, indépendamment de son auteur, dépeint bien la vraie situation en U.R.S.S. Trotski aurait dit, un jour, au début du régime bolcheviste, répondant à quelqu’un qui doutait de la solidité de ce nouveau système étatiste : « Trois cent mille nobles ont pu gouverner ce peuple durant trois siècles. Pourquoi donc trois cent mille bolcheviks ne pourraient-ils en faire autant ? » L’analogie entre les deux « possibilités », l’ancienne et la nouvelle, dépassa, peut-être, la pensée de l’homme : elle est complète. La réalité russe actuelle y est bien exprimée : un peuple opprimé par une couche privilégiée, laquelle se maintient au pouvoir par tous les moyens. On avait pourtant bien raison d’appeler la Russie tzariste « géant aux pieds d’argile ». Car, tout l’édifice d’alors avait pour base l’oppression et l’esclavage des masses. L’histoire a bien prouvé la vérité de la formule : le géant s’est effondré. Mais, le nouveau « géant », l’U.R.S.S., a, lui aussi, des pieds d’argile, car il se maintient, exactement comme l’autre, au moyen de l’oppression et de l’esclavage des masses, Il finira donc aussi, inévitablement, par s’effondrer. Et, dans les conditions actuelles, il ne pourra jamais se maintenir, même le long d’un quart de siècle.
Eh bien ! Le jour où les événements en U.R.S.S. prendront une tournure défavorable pour les maîtres de l’heure, la colère du peuple tombera fatalement sur les têtes de ces maîtres qu’il tiendra pour responsables de toutes ses misères et de l’échec de la Révolution. Or, il y a beaucoup de Juifs dans les rangs du parti communiste russe, surtout parmi les dirigeants et les chefs. « Nous sommes opprimés par des étrangers et par des Juifs » — cette appréciation est courante en U.R.S.S. Il est possible, dès lors, que dans l’ouragan de la lutte et sous l’accès de la haine, toute la population juive devienne l’objet des violences de la foule déchaînée. Il nous reste à espérer que la masse laborieuse trouvera en elle-même, une fois de plus, assez de bon sens, de volonté et de force, pour ne pas permettre à un mouvement salutaire contre les véritables oppresseurs de dégénérer en un nouveau massacre des Innocents.
— VOLINE.
POISON
n. m.
Au sens figuré, le terme poison s’applique à tout ce qui trouble l’existence et nuit au bonheur de la vie. Au sens strict, il convient aux substances capables de provoquer, à faible dose, la mort ou la maladie. Ces substances peuvent être introduites dans l’organisme par voie respiratoire, par voie digestive, à l’aide de piqûres, etc. ; elles provoquent un empoisonnement aigu ou chronique, dont les symptômes varient suivant la nature du corps absorbé. Les poisons furent connus des anciens, non seulement par 1es accidents fortuits qu’ils provoquaient, mais par les recherches intentionnelles d’individus ou de sectes qui les utilisaient contre leurs ennemis. En Égypte, les prêtres de Toth étaient parvenus à en préparer un grand nombre ; c’est d’eux, selon Homère, que les Grecs reçurent leurs premières notions de toxicologie. La liste des empoisonneurs fameux est longue, et les femmes y tiennent une place importante. A Rome, la sinistre Locuste mit son art au service de Néron et d’Agrippine ; au XVIIème siècle, les crimes de la marquise de Brinvilliers et de la Voisin, sa complice, émurent vivement l’opinion ; quant à Mme Lafarge, condamnée en 1840 pour avoir empoisonné son mari, plusieurs inclinent à croire, même à notre époque, qu’elle fut victime d’une erreur judiciaire. Bien d’autres cas célèbres mériteraient qu’on les citât ; sans parler de la multitude des empoisonnements qui permirent de se débarrasser d’un adversaire ou d’un oncle à héritage et qui restèrent toujours ignorés. Longtemps, il fut nécessaire de constater la présence d’un toxique dans l’estomac ou les intestins, pour affirmer avec certitude que la mort était survenue par empoisonnement. Depuis Orfila, on le recherche dans les organes où il pénètre après l’absorption ; et les méthodes employées pour y parvenir se perfectionnent constamment. Aujourd’hui, dépassant la constatation des effets immédiats, habituellement d’importance secondaire, les toxicologues étudient l’action intime des substances vénéneuses sur les humeurs et les tissus. Ils savent que les poisons ne se portent pas indifféremment vers toutes les parties du corps et qu’ils manifestent d’ordinaire une préférence pour un organe déterminé : foie, poumons, système nerveux, par exemple. Les poisons furent divisés autrefois, d’après leur origine, en poisons minéraux, végétaux et animaux. Tenant compte de leur action sur l’organisme, on les a partagés, depuis, en quatre classes :
-
les poisons irritants qui corrodent les parties qu’ils touchent et provoquent leur inflammation : acides et alcalis concentrés, préparations arsenicales, mercurielles, de cuivre, d’antimoine, de plomb, d’argent, cantharides, ellébore, coloquinte, euphorbe, etc. ;
-
les stupéfiants, qui agissent sur le système nerveux sans enflammer les organes qu’ils touchent : acide prussique, eaux de laurier-cerise et d’amande amères, opium, morphine, etc. ;
-
les poisons narcotico-âcres qui paralysent le cerveau et enflamment les parties sur lesquelles on les applique : ciguë, digitale, produits des strychnées, belladone, alcool, éther, tabac, oxyde de carbone, champignons, etc. ;
-
les putréfiants qui altèrent les liquides de l’organisme : venins provenant de la piqûre d’animaux. Les virus, autrefois rangés dans cette dernière catégorie, sont maintenant du domaine de la bactériologie. Depuis que des savants, vrais criminels dignes du mépris public, s’adonnent à l’étude des gaz asphyxiants, en prévision des guerres futures, cette branche de la toxicologie prend un développement de plus en plus considérable. Parmi les poisons qui servent à donner la mort, quelques-uns méritent de retenir particulièrement notre attention. Les composés de l’arsenic, l’acide arsénieux surtout, furent très fréquemment employés autrefois, mais les empoisonneurs contemporains leur préfèrent des substances plus actives. Ces toxiques provoquent de violentes coliques, des vomissements qui s’accompagnent d’un ensemble de symptômes rappelant ceux du choléra. Parfois l’empoisonnement revêt une forme lente. Depuis que les allumettes sont universellement répandues, l’intoxication par l’es matières phosphorées n’est pas rare. Généralement la mort survient après 4, 6, 8, 10 jours et plus de souffrances. Presque toujours, l’empoisonnement par les composés cyanés résulte d’une méprise ou indique un suicide. La terminaison fatale survient en moins d’une minute si I’acide cyanhydrique est absorbé sous forme de gaz ; après quelques minutes s’il est ingéré par voie digestive ; plus tardivement si le cyanure est en solution diluée. De tous les poisons, l’oxyde de carbone est probablement celui qui fait le plus de victimes ; le gaz d’éclairage en contient de 10 à 14 pour 100. Or, il suffit d’un millième d’oxyde de carbone dans l’air pour provoquer l’asphyxie. Contrairement à ce que l’on croit, l’intoxication est habituellement douloureuse au début. Nombre d’empoisonnements criminels ou de suicides sont dus actuellement à la strychnine, que le public se procure sans trop de peine pour la destruction des animaux nuisibles. Elle provoque des phénomènes de tétanisation musculaire et entraîne la mort dans un laps de temps qui, après l’apparition des premiers symptômes, peut aller d’une demi-heure à 4 heures. L’intoxication par les champignons est presque toujours involontaire, mais sa fréquence démontre que la récolte de ces cryptogames doit se faire avec une extrême prudence.
Morphine, héroïne, cocaïne peuvent servir à obtenir une mort rapide, mais d’ordinaire l’on s’arrête à des doses qui provoquent seulement une passagère euphorie. L’usage quotidien de ces drogues conduit aux pires déchéances et physiques et morales. Stupéfiant préféré de la race jaune, l’opium cause de grands ravages en Extrême-Orient. C’est par des sentiers fleuris qu’il conduit aux suprêmes dégradations. Le plus souvent on le fume ; à quelques-uns, dix à vingt pipes suffisent, chaque jour ; il en faut de cinquante à cent aux amateurs passionnés de la drogue. Immatérielle légèreté, béatitude, clairvoyance, telles sont les impressions premières de l’intoxiqué ; les idées affluent lumineuses et dociles, l’imagination s’exalte, l’ouïe et la vue acquièrent une finesse extrême. Des scènes magnifiques se déroulent qui répondent à la mentalité de l’individu et traduisent ses désirs secrets ; il plane dans des sphères inaccessibles aux mortels ordinaires. Mais l’opiomane, victime d’une longue habitude, quitte plus tard les régions célestes pour un monde de cauchemars internaux. La volonté sombre, le caractère se modifie ; miné par la cachexie, le corps est d’une prodigieuse maigreur, les yeux sont hagards, le teint pâle ; des illusions sensorielles surviennent, parfois éclate un véritable delirium tremens opiacé. Ce qui est vrai de l’opium l’est aussi de la morphine, un alcaloïde que le premier contient dans une proportion moyenne de 10 pour 100. Utile lorsqu’il s’agit de souffrances intolérables ou de maladies impossibles à guérir, ce stupéfiant, qu’on emploie en injections sous-cutanées, provoque une ivresse à laquelle prennent goût très vite même les bien-portants. Les morphinomanes sont actuellement nombreux en Occident, mais ils payent chèrement les jouissances qu’ils se procurent. Fétidité de l’haleine, constipation opiniâtre, perte de l’appétit, maigreur extrême surviennent chez l’intoxiqué ; et, comme il se pique finalement à toute heure et n’importe où, sans précautions aseptiques, il est couvert de flegmons et d’abcès. Vouloir et moralité s’en vont ; l’intelligence s’obscurcit ; puis ce sont d’horribles et fréquentes hallucinations. L’héroïne possède les mêmes propriétés que la morphine, mais une force double : d’où un danger accrû pour qui l’utilise. Dionine, narcéine, codéine ont une nocuité réduite au contraire. A l’inverse de l’opium qui rend passif, la cocaïne exalte l’activité. On l’extrait des feuilles du coca, un arbuste dont les qualités ne furent point ignorées dans l’antique royaume des Incas. Précieuse en chirurgie pour ses vertus anesthésiantes, elle est encore l’un des excitants les plus recherchés. La cocaïne, la coco des habitués de Montmartre, est la drogue préférée des intellectuels, des aviateurs, de tous ceux qui ont besoin de décupler leur énergie à de certains moments. Au début de faibles doses suffisent ; il faut les élever très vite ; dans des cas exceptionnels, elles atteignent, dit-on, 20 grammes par jour. Sous l’influence du poison, une euphorie spéciale s’empare de l’individu ; il bavarde, remue, estime clairs les problèmes les plus ardus ; il improvise sans effort et s’exprime avec une étonnante précision ; la résistance physique augmente, la fatigue musculaire s’évanouit. Plus tard, le cocaïnisme engendrera l’irritabilité, le dégoût du travail, le besoin de contredire, la manie des longues courses en voiture ; une perforation intérieure de la cloison nasale se produit, stigmate souvent ignoré du priseur. Avec l’accroissement des doses, la déchéance s’accentue. Prédisposé aux maladies qui frappent les débilités, le patient devient sujet, en outre, à de fréquentes hallucinations. Des insectes, croit-il, grouillent sous son épiderme, ses yeux les lui montrent en certains cas et il se sert d’épingles ou de canifs pour les extraire ; des mouvements rapides animent les objets qui l’entourent, parfois les personnages des tableaux qu’il regarde ; il entend des bruits, des craquements et d’imaginaires injures provoquent chez lui de folles colères. C’est à l’asile d’aliénés que conduit l’abus de la cocaïne. Une cure méthodique permet de se déshabituer des différentes drogues dont nous venons de parler ; après guérison beaucoup reviennent à leur ancien vice. Le hachich, tiré du chanvre indien, n’a jamais eu que fort peu d’amateurs chez nous. On l’ingère sous forme de boulettes, de pastilles, de confiture surtout ; on fume aussi le chanvre indien. L’effet n’est pas instantané ; il commence par le besoin de gesticuler sans raison, suivi de crises d’hilarité interminables, irrésistibles. Puis les sens, doués d’une acuité incroyable, perçoivent mille choses qui leur échappent à l’état normal, et les extases hallucinatoires commencent. Elles varient selon le tempérament, les préoccupations, les désirs, le degré de culture des individus ; elles sont dirigeables, ce qui est plus extraordinaire. On dit du hachich qu’il est un prodigieux révélateur de l’inconscient. Mais si désastreux sont ses effets, qu’il fut interdit dès le moyen âge par certains gouvernements orientaux.
Rangeons aussi parmi les poisons des substances qui, sans introduire l’individu dans le monde des paradis artificiels, provoquent chez lui des excitations factices et l’intoxiquent plus ou moins rapidement. Le tabac et l’alcool rentrent dans cette catégorie. On dit peu de mal du tabac ; il provoque néanmoins, chez qui en abuse, des phénomènes toxiques bien caractérisés. La nicotine, qu’il contient à dose variable, est un poison violent : huit gouttes tuent un cheval en quatre minutes, dix centigrammes provoquent la mort d’un chien de taille moyenne. Les ouvriers des manufactures de tabac éprouvent, au début, des vertiges, des coliques, des nausées ; après quelques semaines ils s’habituent, mais la sécrétion urinaire devient plus abondante et le teint demeure terne. Chez les grands fumeurs, l’affaiblissement de la mémoire est fréquent, de même que les troubles de la vision appelés « mouches volantes » ; il faut y voir le résultat des légères congestions cérébrales, qui se répètent trop souvent chez l’amateur passionné de la pipe ou de la cigarette. Palpitations de cœur, carie dentaire, faux asthme, pharyngite granuleuse, perte de l’appétit, certains cancers, certaines névralgies peuvent aussi résulter du tabagisme. L’alcool produit une excitation factice qui le fait rechercher par les travailleurs ; et si trop d’artistes ou d’écrivains furent aussi ses victimes, c’est qu’il rend au début les idées plus abondantes, l’intelligence plus vive. Mais l’on pourrait difficilement exagérer la gravité de ses méfaits. Le terme « alcool » convient, d’ailleurs, à une nombreuse famille de produits distillés, dont le plus commun est l’alcool éthylique, base essentielle de l’eau de vie ordinaire. Il en existe d’autres : alcool propylique, butyrique, amylique, méthylique, etc., dont la nocuité s’avère encore plus grande et qui se retrouvent parfois, en faible quantité, dans les alcools et les liqueurs de consommation. C’est aux acides prussique, acétique, formique, etc. au furfurol, à l’aldéhyde benzoïque et à d’autres impuretés dangereuses que les eaux-de-vie de marque doivent la saveur et le parfum qui les font rechercher des gourmets. On s’est demandé si l’alcool était un véritable aliment, ou s’il traversait seulement le corps et s’éliminait sans profit pour l’organisme. Même s’il constitue un aliment, on admet aujourd’hui que c’est à dose très minime ; trop concentré, il irrite les muqueuses, trouble la sécrétion des sucs gastriques et rend plus ou moins insolubles les albuminoïdes et les féculents. Peau, reins, poumons n’échappent pas à son action désastreuse ; parfois il congestionne le foie, parfois il le resserre et le durcit ; il détermine une hypertrophie puis une dégénérescence du cœur, occasionne la rigidité des vaisseaux sanguins et favorise anévrismes ou hémorragies. Parce qu’il attire l’alcool en forte proportion, le système nerveux est particulièrement atteint ; l’intoxication du cerveau, aiguë ou chronique, aboutit à de graves désordres de l’intelligence et de la motricité. Hallucinations des sens, delirium tremens sont les ultimes conséquences de l’abus du poison. Et ce n’est pas l’individu uniquement qui souffrira, sa descendance aussi sera frappée, tant l’influence de l’alcool est profonde sur les glandes séminales et sur leurs produits. Pour satisfaire son besoin d’évasion, pour fuir les vulgarités de la vie courante ce n’est pas aux toxiques qui ruinent le corps et troublent l’esprit, que l’homme doit recourir. Comme nous l’avons montré dans « Vers l’Inaccessible », des ondes généreuses et limpides s’offrent pour apaiser les cœurs assoiffés d’idéal. Malheureusement, il existe aussi des poisons intellectuels et qui ne sont pas les moins redoutables. Religion, chauvinisme patriotard, culte de l’Autorité et de l’Argent ont fait incomparablement plus de victimes que l’arsenic ou l’oxyde de carbone. Mais nos contemporains, dans l’ensemble, ne parviennent pas encore à le comprendre.
— L. BARBEDETTE.
PÔLES
n. pl. (du grec polein : tourner)
La sphère céleste semble tourner tout entière, il est en ouest, autour d’un point du ciel voisin de l’étoile Alpha de la Petite Ourse (étoile polaire). Si nous faisons partir dans la direction du fil à plomb, une ligne imaginaire qui traverse le centre de la terre et qui va aboutir de l’autre côté de la sphère, nous obtiendrons l’axe de la terre, c’est-à-dire la ligne autour de laquelle elle semble tourner. Chacun des points où l’extrémité de l’axe terrestre perce le globe est un pôle. Celui tourné du côté de l’étoile polaire est le pôle nord, boréal ou arctique. Le pôle opposé est le pôle sud, austral ou antarctique. S’appellent zones glaciales ou régions polaires, les pays ou océans compris autour des pôles dans l’intérieur des cercles polaires, lesquels sont respectivement situé à 66° 33’ de l’équateur. Elles occupent les 8/10e de la surface totale du sphéroïde terrestre.
Les rayons solaires ne font que glisser à la surface de ces régions désolées et froides. La sphéricité du globe amène les rayons du soleil, de verticaux qu’ils sont à l’équateur à devenir de plus en plus obliques vers les pôles. Et comme la température d’un lieu dépend de l’échauffement de ce lieu par le soleil, elle décroît donc de l’équateur aux pôles ; d’autre part comme le soleil échauffe la terre, non pas par la distance à laquelle les divers points du globe se trouvent par rapport à l’astre du jour, mais proportionnellement à la perpendicularité des rayons, on conçoit que la vie végétale et animale, à plus forte raison la vie humaine, n’existe pour ainsi dire pas dans les régions polaires. Au nord, seules les côtes les plus méridionales et surtout celles de l’ouest dans la direction du détroit de Davis et de la mer de Baffin, sont habitées par une population de nomades atteignant à peine 10.000 habitants. Au cours des longs hivers, la température s’abaisse parfois jusqu’à 50 à 60 degrés sous zéro et elle ne s’élève guère pendant les courts étés à plus de 6 à 7 degrés au dessus de zéro. De plus, l’inclinaison de la terre sur son axe, produit une différence dans la durée du jour et de la nuit, suivant la latitude du pays que l’on considère. Aux cercles polaires le soleil ne se couche pas pendant le jour du solstice d’été et ne se montre pas le jour du solstice d’hiver. Depuis ce cercle jusqu’au pôle, le soleil ne se lève pas ou ne se couche pas pendant un nombre de jours qui va toujours en augmentant jusqu’au pôle même où l’on trouve six mois de jours et six mois de nuit.
On conçoit aisément que, dans ces régions qui connaissent un été très court (3 mois) et où le sol est presque toujours gelé, où l’océan est recouvert d’une banquise épaisse, la faune et la flore soient très restreintes. La faune terrestre est à peu près nulle dans les régions polaires australes, elle est plus riche dans les régions boréales. Nous y trouvons des carnassiers de petite taille : blaireaux, renards, martes ; des rongeurs : lièvres blancs, lemmings et des carnassiers de grande taille : ours blancs ; des ruminants : bœufs musqués, rennes, élans, etc. La faune aérienne et marine est assez abondante dans les deux hémisphères : palmipèdes migrateurs, échassiers, passereaux, pingouins, guillemots, goélands, plongeons, mallettes, cormorans, fous, eidus pour l’hémisphère nord ; au sud, notons : manchots, pétrels, albatros, puffins, etc. Dans les eaux vivent les cétacés et les pinnipèdes, les phoques et les morses dans les régions arctiques et, dans les régions australes, les otaries. La flore comprend dans les deux hémisphères des mousses et des lichens et dans celui du nord existent quelques espèces naines de saules et de bouleaux qui profitent des trois mois d’été pour achever en une ou deux saisons, leur complet développement. Au-delà du 70° parallèle, la faune et la flore disparaissent pour ainsi dire. Les morses, les phoques et les pingouins sont les derniers animaux qui persistent dans les solitudes, la terre s’achève au Nord et au Sud dans le froid et la nuit...
Les régions polaires n’ont pas toujours présenté le caractère qu’elles nous montrent aujourd’hui ; elles n’ont pas connu de tout temps le climat rigoureux qui les caractérise actuellement. A l’âge tertiaire, à la période néogène, le climat des pôles était voisin de celui des régions méditerranéennes actuelles. La faune et. la flore y étaient alors considérables. Notons aussi qu’aux époques géologiques antérieures, la chaleur reçue aux pôles était égale à celle que recevait l’équateur et que les formes de vie animales et végétales étaient, à peu de choses près, semblables sur toute l’étendue du globe.
On s’imagine aisément que les régions polaires n’ont que peu tenté les explorateurs. Et, de fait, les explorations entreprises dans ces pays n’ont été inspirées que par une pensée scientifique et économique : la recherche des pôles, l’espoir de trouver une route maritime plus directe pour passer de l’Europe en Asie et en Amérique. Nous devons diviser les explorations polaires en quatre groupes :
-
celles tentées pour rechercher le passage du NO ;
-
celles tentées pour découvrir le passage du NE ;
-
les expéditions tentées pour atteindre le pôle nord, et
-
les expéditions antarctiques.
1° Passage du Nord-Ouest, qui a pour but de reconnaître la route maritime la plus directe pour passer du Nord de l’Amérique septentrionale au détroit de Behring. En 1497, Sébastien Cabot aperçoit le détroit de Davis. Un peu plus tard, les frères Cortéréal aperçoivent le détroit d’Hudson. Notons les ouvrages de Martin Irobisher qui découvre la côte méridionale de la terre de Baffin. Ensuite, John Davis entreprit de 1585 à 1587, trois voyages au cours desquels il explore le détroit qui porte son nom et la terre de Baffin jusqu’au 72° latitude nord. En 1610, Hudson étudie la baie qui porte son nom. Citons les expéditions de Button et Ingram (1612), de Luke Fox et de Th. James (1631). Aucune de ces expéditions, sauf celle de Baffin et Byllot qui atteignirent le 78° de latitude nord et découvrirent, sans en reconnaître le véritable caractère, le détroit de Lancastre ne furent fructueuses. Il était réservé aux explorateurs du XIXe siècle de coordonner les découvertes de leurs devanciers et de trouver le passage tant cherché. En 1819, Edward Pany s’avança jusqu’à la terre de Melville et parvint à la terre de Banks. En 1847, après un double hivernage, Franklin mourut à la terre du roi Guillaume. Pendant ce temps, James Clark Ross et Parry reconnurent le groupe d’archipels existant à l’ouest du bassin de Melville. En 1858, Mac Clure découvrit le passage en entier, passage constitué par un ensemble de canaux conduisant d’un océan à l’autre, mais dont la navigabilité est rendue impossible par les obstacles climatériques.
2° Passage du Nord-Est, qui, à travers l’ensemble de détroits existants entre le seuil de Behring et la Nouvelle Zemble, fait communiquer, le long du littoral sibérien, le Pacifique septentrional et l’Atlantique nord. Notons d’abord, en 1554, la tentative de Willougby qui atteignit la Nouvelle Zemble et vint mourir, au retour, à l’île Nokonief, sur la côte de Laponie. Citons le voyage de Bourrough qui atteignit l’extrémité méridionale de la Nouvelle Zemble et celui de A. Pet et Ch. Jackmin en 1580, jusqu’à la mer de Kara. En 1596, Willem Barentz découvrit le Spitzberg et atteignit la côte occidentale de la Nouvelle Zemble où il mourut après un dur hivernage. Hudson, en 1607, parvint jusqu’au 80° de latitude nord. A retenir ensuite un certain nombre de petites expéditions faites au cours des 66 années suivantes, par des Danois, des Hollandais, des Anglais. Mais ce ne fut qu’au XIXe siècle que se firent les expéditions décisives. L’expédition autrichienne de Weyprecht et Payer découvrit, en 187l, la terre François-Joseph. L’archipel de la Nouvelle Sibérie, l’île Wrangel, à l’est du cap Tchéliouskine, furent reconnus par divers explorateurs russes. En 1878–79, le Suédois Nordenskjôld coordonna les découvertes antérieures en réussissant la traversée du passage du N.-E. Comme celui du N.-O., ce passage est inutilisable à cause des glaces qui l’encombrent ou l’interceptent continuellement.
3° Découverte du pôle nord. — Pendant que certains cherchaient la solution aux problèmes des passages du N.-O. et du N.-E., de hardis explorateurs s’avancèrent de plus en plus loin dans les régions polaires et tentèrent d’approcher le pôle nord. En 1861, Hayes atteignit, dans la direction du détroit de Smith, le 81 ° 35’ de latitude ; Hall le 82° 16’ ; en 1876, Markham parvint jusqu’au 83° 20’, tandis que des membres de l’expédition Greely s’avançaient au nord du Groenland jusqu’au 83°. En 1898, Peary dépassa ce dernier point de 26’. Notons l’expédition de Nansen vers le Groenland en 1888. En 1895, le même atteignit au nord de la terre François-Joseph, la latitude de 86° 4’ et, en 1900, l’Italien Cogni, membre de l’expédition du duc des Abruzzes, s’avança dans les mêmes parages jusqu’à la latitude de 86° 34’. Signalons l’expédition d’Andrée en ballon, en 1897, de Siscedrupt (1901), de Peary qui découvrit le pôle nord le 6 avril 1909. Plus près de nous, se situe l’expédition du général italien Nobile en zeppelin, et la tentative faite actuellement pour atteindre le pôle en sous-marin.
4° Régions antarctiques. — Les régions polaires antarctiques n’ont que peu sollicité les explorateurs. Seules des considérations d’ordre scientifique et l’ambition de savoir si cette immense calotte de glace recouvre un continent autonome ou un archipel, conduisirent les audacieux vers les régions australes qui s’avèrent d’une pénétration difficile et qui sont plus éloignées que les régions arctiques de tout pays civilisé.
Théodore de Gheritk et Kerguelin découvrirent l’îlot de Kerguelin. Cook découvrit les Sandwich du Sud. En 1819, Smith reconnaît le groupe important des Shetland. En 1823, le baleinier Wedel s’approche du 80° parallèle. En 1839, Dumont d’Urville découvre la terre LouisPhilippe et Bellingshausen l’archipel Pierre Ier (1821). De Wilkes et James Clark Ross découvrent, en 1844, les volcans Erebus et Tenon, sous le 78° latitude sud, et la terre de Victoria. En 1892, Scott parvint jusqu’au 82° 17’ de latitude sud. De Gerlache pousse, en 1897, jusqu’au 71° latitude et découvre de nombreuses terres australes.
Shackleton atteignit le 88°23 de latitude sud en 1909 et le 16 décembre 1911, Amundsen toucha le pôle sud. Récemment, l’expédition américaine Byrd séjourna — voyage d’études — et étudia les régions australes.
— Ch. ALEXANDRE.
BIBLIOGRAPHIE. — La surface terrestre (Ch. Weule) (L’Univers et l’Humanité, tome IV).
POLICE
s. f. (du latin : Politia, administration d’une ville)
Organisme qui a pour but de faire exécuter les lois, décrets, ordonnances édictés par le pouvoir législatif et tendant à sauvegarder la sûreté : des biens, des personnes ou de l’Etat.
Toute loi, toute règle, suppose, évidemment, une sanction. Toute sanction nécessite un mécanisme de contrainte. Aussi loin que l’on remonte dans l’histoire de l’évolution des sociétés, on constate cette préoccupation du législateur : assurer, par un ensemble de mesures, de défenses et de prescriptions, la tranquillité de l’Etat et la sécurité des citoyens : l’ordre. Tant que l’Ordre peut être basé sur la Foi, sur la croyance à un magistrat suprême, chaque croyant, c’est-à-dire chaque citoyen, participe à la police de l’Etat, et le législateur, qui est en même temps le Prince, peut facilement veiller à l’exécution de la loi, sans cet organisme spécial, distinct, qu’est la police du XXe siècle.
Encore au temps de la Grèce :
« la police se confondait avec l’ensemble des institutions qui constituaient la cité, et les écrivains anciens entendaient, par un Etat bien policé, celui dans lequel les lois en général assuraient la prospérité intérieure. »
Sous les Romains, ce ne fut que du temps d’Auguste que la police devint une institution spéciale ; encore fut-elle nécessitée par l’étendue du vaste Etat qui l’enfermait dans son sein des peuples à la foi désharmonique en un ou plusieurs « Dieux ». Elle devint d’ailleurs, tout aussitôt, une véritable police politique, épouvantablement tyrannique. Le « prœfectus urbis », ayant sous ses ordres les « curatores urbis », parsema Rome et les Provinces d’agents inférieurs, chargés de « rapporter » sur tout ce qui était susceptible de porter quelque ombrage au pouvoir d’Auguste. Cette police disparut avec les invasions des « barbares », pour ne renaître que plusieurs siècles plus tard, avec le grand mouvement de libération des Communes. En achetant le droit d’administrer les villes qu’ils habitaient, les bourgeois prirent en même temps toutes les mesures de sécurité et pour eux et pour leurs biens. Ils firent construire les « beffrois », d’où la cloche sonnait le tocsin à l’approche des indésirables, bandits de grands chemins ou hommes d’armes.
Toute la nuit, un corps de police, « le guet », armé, parcourait les rues pour prévenir les vols, les assassinats et, nous disent les chanteurs du temps, « faire peur aux amoureux ». Un service de garde veillait aux portes de la ville, fermées dès le soleil couché. Chaque ville avait sa police, ses règlements et son organisation. Souvent cette police s’opposait à celle que, peu confiants, s’étaient constituée certains corps de métier. Tantôt, donc, faisaient la police : corps de métier, maires, capitouls, consuls, jurats ; tantôt, en d’autres villes, des officiers royaux, et dans les fiefs seigneuriaux, des juges délégués par le seigneur.
A Paris, un prévôt nommé par le roi, fut chargé, vers la fin du XIIe siècle, de la police intérieure de la ville, faite d’abord, depuis des temps fort reculés par le chef de la corporation des marchands d’eau. Le Prévôt de Parts, armé et du pouvoir judiciaire et d’une grande autorité, disposa pour faire la police, d’une Compagnie de sergents, d’une Compagnie d’ordonnance et de guet. Mais l’ordre ne put jamais régner totalement, la survivance des autres polices provoquant fréquemment des heurts entre le pouvoir et les corporations des marchands. En outre, il y avait quelque danger pour le Pouvoir à laisser dans la même main l’exercice de la police et celle de la justice.
Un Edit de 1669, institua à Paris un magistrat spécial qui, sous le nom de lieutenant de prévôt pour la police, puis de lieutenant général de police, eût dans ses attributions toutes les branches de la sûreté générale et sous ses ordres : 48 commissaires de police et 20 inspecteurs. Pour la première fois, la justice et la police furent deux organismes distincts. On trouve (Larousse) dans le préambule de cet édit, une définition fort aimable des attributions de la police :
« La police consiste à assurer le repos du public et des particuliers, à purger la ville de ce qui peut causer des désordres, à procurer l’abondance et à faire vivre chacun selon sa condition. »
Dans ce but furent créés des lieutenants de police dans les principales villes du royaume et plus tard partout où existait un siège royal.
Et voici, d’après le Larousse, comme les lieutenances de police répondirent aux espérances fondées sur elles :
« Si la création de lieutenants de police dont le premier fut M. de la Reynie, eut de bons côtés, elle ne fut pas sans inconvénients graves. La police changea de caractère. Le lieutenant de police ne se borna pas à surveiller les halles et marchés, les rues et les places publiques, les réunions illicites ou tumultueuses, la librairie, l’imprimerie, le colportage des livres et des gravures, le vagabondage, la mendicité, etc., il devint surtout et avant tout un agent politique du Pouvoir dont il émanait. On le vit se prêter à tous ses intérêts, à tous ses caprices et prendre, conformément à ses ordres, les mesures les plus tyranniques. Dès lors, la liberté des citoyens put être foulée aux pieds sans rencontrer d’obstacles dans le pouvoir judiciaire. L’espionnage fut organisé sur une vaste échelle ; on accrut considérablement le nombre des agents, on en créa qui eurent pour mission de dérober les secrets des familles et de prendre tout ce qui portait ombrage à l’autorité. Aussi, malgré quelques règlements utiles, relatifs à l’éclairage de la ville, etc., la police devint extrêmement impopulaire. Dès le début de la Révolution de 1789, le lieutenant de police Thiroux de Crosne donna sa démission et l’institution disparut avec lui. »
Totalement réorganisée par la Révolution, qui nous la laissa à peu près dans l’état où elle est aujourd’hui, la police fut saluée ainsi, par les articles 16 et 17 du Code des Délits et des Peines du 3 brumaire, an IV :
« La Police est instituée pour maintenir l’ordre public, la Liberté, la propriété, la sûreté individuelle. Son caractère principal est la vigilance. La société considérée en masse est l’objet de sa sollicitude. »
Mais les révolutionnaires de 1789 ont eu d’autres illusions. En réalité, la police continua la bonne tradition des lieutenances de l’ancien régime. Faite pour exercer directement l’autorité au nom du Pouvoir établi, elle se spécialisa dans l’exercice de l’oppression, si bien que, seule, l’oppression fut sa raison d’être. Chargée de surveiller l’exécution des lois, de poursuivre toutes les insoumissions, elle est devenue l’expression même de la tyrannie. Echappant nécessairement à tout contrôle réel, elle est, au-dessus des lois, un organisme de mouchardage, de provocation, de sanie.
Les agents de la police sont recrutés dans les milieux les moins éduqués, les moins conscients, les moins susceptibles de compréhension. La misère, l’ignorance et la fainéantise sont les agents de recrutement de la police. Aussi, lorsque ces individus sont nantis d’un peu d’autorité — celle que confère le collier à pointes au chien de propriétaire — ils oublient leur classe d’origine, l’ignominie sociale et deviennent les plus fermes soutiens du régime du jour. Asexués, déclassés, décérébrés, ils sont, aux jours calmes :
« Les braves gens qui s’ baladent tout le temps. »
Vêtus du costume spécial à la valetaille : majordomes, cochers, suisses, évêques, juges, soldats, ils chassent dans les rues les camelots et les petits marchands qui trichent avec la loi qui garantit le commerce patenté, renté, doré sur glaces et devantures ; ils poursuivent les chiens errants et mal peignés ; battent la semelle devant les préfectures ; assomment les poivrots dans leurs postes sales et punais. Aux « premiers mai », aux jours noirs de la grève où la plèbe hurle sa faim aux accents d’une « Internationale » indisciplinée, armés de matraques et de coupe-coupes, ils cognent sur les femmes et les enfants, bossèlent le crâne aux vieillards. Quand la nuit étend son manteau sur les ruelles, deux par deux, ils sont l’Ordre saint et majestueux. Et lorsque des méchants attaquent le passant attardé, pour n’être pas troublé l’Ordre-Flic « se tire des pattes » et vient sur le champ de bataille, quand il n’y a plus que les morts et les blessés, dresser contravention. Ils sont parfois bêtes, souvent méchants, mais tout le monde les connaît.
Il est une catégorie de policiers qui prétendent épouser la forme bourgeoise de vêture. Le naïf seul les croit « de la secrète ». Il y a dans leur démarche, leur regard, un indéfinissable ton de vilenie qui les classifie immédiatement « animal dangereux » ou « piège à loups ». Ceux-là tendent les lacets, sinon avec science, du moins avec assez d’impudeur, pour que s’y prennent les pauvres lièvres du vol et du crime ou les buses étourdies. Les rongeurs et les grands rapaces, non plus que les fauves, ne craignent leurs rets. Vivant du voleur, de l »assassin, de la putain et du souteneur, pour nécessiter leur état, s’ils n’existaient pas, ils inventeraient le vol, le crime, la prostitution et le maquereautage.
C’est dans la catégorie des agents « en bourgeois » que se recrutent les agents politiques, de beaucoup les plus bas, les plus vils, ceux dont les moyens sont le mouchardage et la provocation. Leur but, leur unique but, c’est de garantir le Pouvoir de la critique parlée ou écrite et de l’action individuelle ou sociale ; sûrs d’être couverts en toutes circonstances par les maîtres du jour, il n’est pas d’ignominies qu’ils se refusent. Se glisser auprès de l’ennemi possible, gagner sa confiance, s’en faire un ami, afin de surprendre ses pensées et ses actes, puis le dénoncer, le vendre salement. Afficher dans un groupement où l’on a pénétré, les idées des « copains », les pousser à agir, leur en procurer les moyens, puis, quand ils sont irrémédiablement compromis, les vendre, pour gagner quelque argent ou mériter quelque galon. Qu’importent les douleurs, les désespoirs, la mort même, de ceux qui l’avaient reçu comme un frère ! Le policier fait son métier. Triste métier !
Mais a-t-il du moins quelque utilité ? Le mal qu’il fait, la laideur qu’il répand, sont-ils compensés par du bien, de la joie, de la beauté ? Sous l’œil tutélaire de la police, les beaux sentiments, les joies fécondes, peuvent-ils s’épanouir ?
Indépendamment des déformations professionnelles nécessaires, la police prétend :
-
Préserver les biens ;
-
Préserver les personnes ;
-
Assurer l’ordre.
Voyons ce qu’il en est.
-
Préserver les biens : Dans nos société policées, toutes les richesses : sol, sous-sol, instruments de travail, produits du travail, tout est la chose, le bien, la Propriété (voir ce mot) de quelques-uns ; les autres, de beaucoup la plus grande quantité, ne possèdent rien. Or, ceux qui possèdent toute la richesse sociale, ce sont ceux qui précisément n’ont jamais participé à sa production et ceux qui ne possèdent rien, ce sont ceux qui ont produit toute cette richesse. La police n’a donc pas défendu les producteurs contre les accapareurs, les profiteurs — Non pas. La loi sanctionne le fait, de cette dépossession du grand nombre des producteurs par le petit nombre des profiteurs. Et la Police veille à l’exécution de la loi. C’est-à-dire que le rôle de la Police, sous prétexte de défendre les biens, est de défendre les voleurs contre les protestations et les révoltes des volés.
Utile la Police ? Socialement utile ? Qui l’oserait soutenir ?
-
Préserver les personnes : et d’abord, qui préserve les personnes du bon plaisir de la Police ?
Pour conserver les biens qu’ils ont dérobés aux producteurs, quelques exploiteurs tuent à petit feu, par manque d’hygiène, de repos, de saine nourriture, de logements spacieux, d’air pur, les neuf dixièmes de l’humanité. Pour leurs profits, ces exploiteurs déclenchent des guerres où l’on fait souffrir, puis périr des millions de producteurs. La Police empêche-t-elle que l’on tue par privations ou par la guerre ? Défend-elle ces millions de producteurs, de personnes, contre les exploiteurs qui les tuent ? Que non pas ! Lorsque les victimes veulent se révolter contre leurs bourreaux, la police frappe les victimes, les emprisonne, les tue. La police défend la personne des quelques exploiteurs de la juste révolte des millions de producteurs spoliés.
Peut-on dire que la Police est socialement utile à la préservation des personnes ? Non pas !
-
Garantir l’ordre ! Quel ordre ? Est-ce l’harmonie sociale que nous rêvons, où tous les humains, fraternellement unis, s’aideraient à se faire une vie toujours plus belle et joyeuse ? Non, non. L’ordre (voir ce mot) que garantit la police, est l’état social actuel. Cette richesse de quelques-uns, faite de la misère de tous les autres, cette constance dans l’insécurité et dans la douleur, tel est l’ordre que la police garantit. Toute amélioration, toute modification apportée à cet ordre épouvantable, lui paraît désordre et elle sévit durement contre les « fauteurs de désordre ».
Inséparable de l’Ordre actuel, la Police est une institution qui doit disparaître avec cet ordre. Le vol disparaît avec la Propriété individuelle ; le crime avec l’intérêt ; le désordre avec l’Etat.
— A. LAPEYRE.
POLITESSE
(de l’italien : politezza)
Manière d’agir et de s’exprimer conforme aux usages reçus dans une société. Ces usages varient suivant les régions et selon les époques. Ils sont ainsi parfois contradictoires. Cependant ils sont inspirés toujours par deux sentiments très estimables : le souci de la dignité personnelle et le désir de plaire à autrui. Il ne s’agit donc nullement d’un préjugé, encore moins de coutumes condamnables, bien qu’elles puissent être, en certains cas, avantageusement modifiées et remises en discussion. La politesse est une forme de la sociabilité. Certains démagogues en ont pris ombrage, sous prétexte qu’elle est en honneur dans les milieux aristocratiques. Comme si l’esprit révolutionnaire devait consister, non à se conduire selon la raison, mais à faire, en chaque circonstance, exactement le contraire de ce que font les bourgeois !
La véritable courtoisie est faite de simplicité cordiale à l’égard de tout le monde, surtout envers les plus humbles ; et elle vise à la bonne tenue, à la grâce dans le geste, par respect pour soi-même et pour les autres. Elle n’a pas lieu d’être confondue avec l’attitude guindée, et le ton impertinent, les courbettes excessives, les propos ennuyeux à force d’être mesurés, qui furent de bon ton naguère, et qu’affectionnent encore de ridicules parvenus. Il serait injuste de la taxer d’hypocrisie. Les règles élémentaires de la solidarité, et de la déférence réciproque, dans les relations de chaque jour, n’ont rien à voir avec la duplicité. La flatterie excessive, l’obséquiosité intéressée pourraient seules mériter une telle accusation. Mais on peut être poli sans jamais recourir à d’aussi vils procédés. D’ailleurs, la franchise n’est pas plus à confondre avec la brutalité, que la modestie avec le sans-gêne ou la grossièreté.
Lorsqu’une personne est disgraciée par la nature, faut-il pousser l’amour de la vérité jusqu’à lui rappeler qu’elle est laide, ce que son miroir ne lui révèle que trop ? N’est-il pas plus charitable de prêter attention à quelque détail avantageux de son physique, tout en paraissant ne s’apercevoir point du peu d’harmonie de l’ensemble ? La sincérité ne consiste pas à dire tout ce que l’on pense, mais à penser tout ce que l’on dit. Et lorsque l’on pense des choses qui pourraient être attristantes pour autrui, sans aucune nécessité, le mieux est de se taire, de réserver son courage civique pour des occasions plus profitables.
Il n’est pas de règle de politesse puérile et honnête qui ne puisse se justifier par des raisons valables, ce qui ne signifie point qu’il faille, à l’instar des snobs, se plier aveuglément à tous les caprices de la mode. S’il est convenable qu’un homme, qui n’est ni infirme ni accablé de fatigue, cède sa place, s’il est assis, à une femme demeurée debout, ce n’est point en vertu d’une sorte de religiosité à l’égard du sexe féminin, mais parce que la femme étant, en moyenne, plus faible que l’homme et, par surcroît, sujette à des troubles physiologiques, que le sexe mâle ne connaît point, il est juste qu’elle soit l’objet d’attentions particulières. Eventuellement, d’ailleurs, il serait bien qu’une femme jeune et robuste se privât de son siège en faveur d’un mutilé ou d’un vieillard.
Se laver les mains avant de se mettre à table, manger en évitant de toucher les aliments avec ses doigts, n’est pas une question d’afféterie, mais d’hygiène et de propreté. Ne discuter qu’avec tact lorsque nous avons affaire à des personnes ayant des idées opposées aux nôtres, éviter de les froisser, tâcher plutôt d’éveiller leur curiosité, n’est ni une faiblesse ni de la dissimulation. Les invectives, l’ironie blessante, ne sont pas des arguments, et ils éloignent de nous plutôt qu’ils ne plaident en faveur de nos doctrines.
Il n’est pas indispensable de compulser de gros ouvrages spéciaux pour être de bonne éducation. Il suffit, à tout moment, d’avoir envers les personnes qui nous entourent, la conduite correcte et les prévenances dont nous serions heureux de bénéficier si nous étions à leur place.
— Jean MARESTAN.
POLITICIEN
Voir Politique.
POLITIQUE
La politique est la science ou l’art de gouverner un Etat. M. A. Lichtenberger a fait la distinction suivante : la science politique est « l’étude des phénomènes politiques en vue de la recherche des lois qui les régissent » ; l’art politique est « leur étude en vue de la recherche et de la découverte des moyens de les modifier et de les accommoder au mieux aux intérêts des citoyens ou de l’Etat ». Mais « cette distinction est pratiquement inutile » (Grande Encyclopédie). Nous ne nous en occuperons donc pas, d’autant plus que ce n’est pas de la façon académique qui fait de la politique, soit une science, soit un art, que nous l’envisagerons. Il y a, pour les travailleurs, des nécessités qui les invitent impérieusement à ne pas aller se perdre dans les régions stratosphériques où la politique sort de la pratique ; ils risqueraient de retomber un peu trop brutalement dans les réalités si souvent bourbeuses où ils sont contraints de vivre. Tenons-nous donc dans le domaine de ces réalités, celui de l’observation et de l’expérience des faits ; il est suffisamment démonstratif pour nous.
Des gens qui ont fait un usage plus ou moins cynique de la politique en ont dit les choses suivantes :
« Qui dit politique dit presque coquinerie. » (Frédéric II)
« Tout le secret de la politique consiste à mentir à propos. » (Mme de Pompadour)
« Entre la politique et la justice, toute intelligence est corruptrice, tout contact est pestilentiel. » (Guizot)
Cela n’a pas empêché ces auteurs, et bien d’autres qui n’ont pas dit moins de mal de la politique, d’en faire leur métier. D’autres, qui l’ont simplement observée, n’en ont pas mieux parlé. Ibsen disait :
« Je ne crois pas que la politique soit capable d’affranchir les esprits et je n’ai guère confiance dans le désintéressement de ceux qui ont le pouvoir entre leurs mains. »
Et M. Suarès :
« Tout système politique est un mensonge que les habiles préparent à l’usage des sots. Et la mauvaise foi ne corrige pas la sottise, loin de là, elle l’accomplit. »
Arrêtons là nos citations ; nous pourrions en reproduire un volume d’aussi caractéristiques.
La politique est, à nos yeux, la plus grave et la plus malfaisante des créations artificielles de la métaphysique sociale présidant à l’exploitation de l’homme par l’homme. Elle est la justification mensongère, le mécanisme arbitraire de l’incorporation et de l’asservissement de l’individu dans un état social qu’il n’a pas eu la liberté de choisir, et dont il n’a pas la liberté de s’abstraire. Elle est le système qui tient l’homme en tutelle permanente, soit qu’elle lui impose l’obligation d’obéir sans discussion à la volonté d’autrui — autocratie, — soit qu’elle lui fasse croire qu’en obéissant à autrui il n’obéit qu’à lui-même — démocratie. Elle est, de toutes les façons, le moyen qui enlève à l’individu le gouvernement de lui-même pour le remettre à une autorité ayant reçu, soi-disant, d’une puissance supérieure, ou des hommes eux-mêmes, la délégation du gouvernement de tous.
Gouverner, c’est user plus ou moins abusivement de l’autorité. La politique, quelle que soit sa formule, n’est jamais que « le principe de l’autorité de l’Etat » (A. Lichtenberger), c’est-à-dire la science, on l’art, d’exercer l’autorité, d’imposer à l’individu une volonté étrangère à la sienne. Elle ne pourra être autre chose tant que les hommes ne sauront pas former une société où il n’y aura plus ni gouvernants ni gouvernés, et dans laquelle ils vivront librement en n’admettant dans leurs rapports sociaux que les seules associations d’affinités et d’intérêts — anarchie.
Nous ne décrirons pas tous les aspects qu’a eus la politique ; ce serait écrire l’histoire sociale de l’humanité, depuis le jour où l’autorité s’est manifestée sous sa première forme. Nous examinerons seulement, et très rapidement, ses divers systèmes, en insistant cependant sur la formation de la politique actuelle, pour montrer que, s’ils sont souvent très différents et en opposition complète de principes, ils ne sont que des pisaller plus ou moins supportables suivant leur degré d’autorité. Comme toutes les religions, toutes les morales, toutes les philosophies, qui sont d’ailleurs de la politique quand elles passent du domaine de la spéculation individuelle dans la vie publique, tous les systèmes politiques, quand ils arrivent à dominer, aboutissent au même résultat : « Tous, quels qu’ils soient, se transforment si complètement dans la lutte, qu’après la victoire il ne leur reste d’eux-mêmes que leur nom et quelques symboles de leur pensée perdue. » (A. France)
Plus simplement, A. Karr a constaté :
« En politique, plus ça change, plus c’est la même chose. »
Après chaque changement, on peut chanter, comme la Fille de Madame Angot :
De changer de gouvernement ! »
Les formes de la politique varient avec celles de l’Etat, sa représentation et sa puissance ; mais monarchie ne comporte pas indubitablement tyrannie, pas plus que république ne comporte liberté. Il y a des monarchies libérales et des républiques dictatoriales. Il y a l’exaltation de l’idée de « l’Etat au-dessus de tout », sa prédominance exclusive sur l’individu, dans la dictature du prolétariat comme dans celle d’un Louis XIV, d’un Napoléon ou d’un Mussolini disant : « L’Etat, c’est moi ! » Il peut y avoir minimum de sujétion à l’Etat, maximum de liberté individuelle, dans des monarchies comme dans des républiques. Etatistes, fédéralistes individualistes, se manifestent également dans toutes les formes de la politique, et leurs théories arrivent très souvent à se mêler au point de se confondre pour la plus grande satisfaction des fabricants de cette logomachie qui fait la rhétorique politicienne.
On a attribué à Voltaire ce mot :
« Quand le premier coquin rencontra le premier imbécile, la religion fut fondée. »
On pourrait dire cela encore plus exactement pour la politique, car si la religion est l’art d’asservir les âmes, la politique est celui de soumettre l’individu tout entier. Les deux se complètent ; elles ont d’ailleurs la même origine dans la sorcellerie née de la crainte de l’inconnu et du désir de domination. Le principe de la politique est que les hommes ont délégué leurs pouvoirs à ceux qui les gouvernent. Les hommes n’ont rien délégué du tout ; la délégation est originelle comme ce pêché dont ils portent le poids sans l’avoir commis. En fait, le coquin s’est imposé à l’imbécile et l’a séduit en lui faisant croire qu’il avait reçu son pouvoir de lui. Aristote a constaté que :
« Le moyen d’arriver à la tyrannie est de gagner la confiance de la foule. Le tyran commence toujours par être un démagogue. »
L’antiquité appelée classique a été la grande école des tyrans-démagogues : Athènes d’abord et surtout Rome. Mais le phénomène est constant ; il est de tous les gouvernements appelés démocratiques, et aujourd’hui comme dans l’antiquité. Un gouvernement quel qu’il soit ne peut pas ne pas passer de la liberté à la dictature sans attenter à sa propre autorité, c’est-à-dire se détruire lui-même. Tout gouvernement cherche à s’incruster dans le système qui l’a produit, à le conserver, et, pour cela, à renforcer l’autorité qui le défend contre le progrès social.
Aussi, toute politique, si avancée et si hardie qu’elle se présente, n’a de véritable caractère que dans l’opposition d’avant-garde. Le jour où elle parvient au pouvoir, elle devient conservatrice, sinon tyrannique et odieuse.
La politique s’imposa à l’individu, d’abord dans les rapports de famille et de classe. Le sorcier, devenu le prêtre, fut longtemps le chef, précédant dans la communauté réduite le conquérant qui forma les Etats. Le communisme, forme primitive des sociétés, fut remplacé par le régime de la propriété qui engendra la politique autoritaire, arbitraire et immorale du plus fort, du plus avantagé, dans la double forme de la théocratie et de l’autocratie. Celles-ci furent plus ou moins corrigées par l’aristocratie et la démocratie, établies sur la prédominance de ceux appelés les « meilleurs », mais dont les choix furent arbitraires. La monarchie, produit du choix aristocratique, s’imposa par la violence, sans admettre de discussion. La république, produit du choix démocratique, se constitua par la fourberie insinuante, se glissant dans la confiance de ses victimes en les flattant et les appelant « citoyens », jusqu’au jour où, solidement établie, elle put devenir dictature. Aristocratie et démocratie, civiles ou religieuses, ont été de tout temps les deux pôles de toute politique. Toutes deux sont basées sur l’exploitation de l’homme, aucune sur sa liberté. La première est plus brutale ; la seconde est plus hypocrite.
La vie communiste n’appartient qu’aux sociétés primitives. La multiplication de la population, la diversité et la concurrence des intérêts individuels, la suppriment plus ou moins vite. Aucune politique ne lui a permis jusqu’ici de se maintenir ou de se l’établir. Le gouvernement des sociétés antiques a été presque entièrement religieux et monarchique. Le brahmanisme a fait dominer dans l’Inde une théocratie abjecte par son mépris des castes inférieures et la condition à laquelle elle les a condamnées. Les empires assyriens et babyloniens, l’Egypte, puis la Palestine, eurent des gouvernements théocratiques et monarchiques plus ou moins atténués par des notions morales variables. Il faut excepter la Chine qui, dès les temps les plus anciens, donna l’exemple d’une démocratie dirigée par les « meilleurs », les plus instruits, choisis en principe par le peuple. La morale de Confucius avait inspiré en Chine la première forme d’un gouvernement venant mes hommes et non d’un dieu ou de ses délégués.
En Grèce, le caractère religieux de la politique se mélangea d’une philosophie de plus en plus humaine, au point que ce pays fut le berceau de la pensée libertaire la plus hardie qui fut jamais. La philosophie grecque a fourni, depuis 2.000 ans, à la politique, toutes les théories qu’elle a pu échafauder. Les plus conservateurs et les plus révolutionnaires, les plus utopistes et les plus réalistes des penseurs n’ont fait que renouveler la philosophie antique et la politique qui en est sortie. A. France a écrit :
« La politique est une science incertaine qui n’a pas fait de progrès depuis Aristote. »
Elle n’en avait fait guère plus avant, depuis Confucius chez qui on trouve tant de notions du respect humain qui sont encore à mettre en pratique aujourd’hui. Opposés aux sophistes partisans du droit du plus fort, Socrate et son disciple Platon, puis Aristote, élève infidèle de Platon, établirent les fondements de la politique, science et art du gouvernement. Communisme des citoyens et soumission absolue aux lois de l’Etat souverain, furent la théorie de Platon. Respect de la propriété individuelle et de la personne humaine, dans l’Etat « association d’êtres égaux recherchant une commune existence heureuse et facile », fut celle d’Aristote. Mais Platon et Aristote ne considéraient que les droits du citoyen dans la cité ; ils faisaient de celle-ci une organisation aristocratique où dominaient les guerriers et les juges sur les travailleurs esclaves. Diogène et Epicure mirent l’homme au-dessus du citoyen, l’humanité au-dessus de l’Etat. Les stoïciens, rejoignant Confucius défenseur des droits de l’homme contre les dieux, revendiquèrent la liberté et l’égalité pour tous les hommes et mirent les droits et les institutions naturels audessus de ceux de l’Etat.
La République Romaine s’inspira des stoïciens en commandant de servir la vertu plutôt que l’Etat. Les Gracques voulurent mettre en pratique ces prescriptions ; Cicéron et Sénèque les enseignèrent. Mais le peuple fit périr les Gracques en maudissant leur nom, et les tyrans-démagogues assassinèrent Cicéron et Sénèque comme ils avaient, à Athènes, fait mourir Socrate et poussé au suicide Démosthène ne voulant pas survivre à la liberté. Les quelques principes généreux qui éclairent d’un peu d’humanité le Digeste, recueil de doctrine du droit romain, ont été puisés par Ulpien chez les stoïciens.
Le Christianisme fut d’abord un agent d’émancipation de l’individu contre la tutelle de l’Etat. Il le mit en état d’insurrection morale, mais en même temps de soumission temporelle plus complète. « Rends à César ce qui appartient à César », lui dit-il. Il ajouta : « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l’accomplir », et il compléta en disant :
« Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. »
Il remettait ainsi la justice à la discrétion des cieux. Il établissait un deuxième pouvoir à côté de celui de l’Etat, pouvoir encore plus orgueilleux et plus despotique que l’Eglise exercerait, au nom de Dieu, en l’érigeant d’abord en égal, puis en supérieur, toujours en rival de l’Etat, pour absorber ou tout au moins dominer son gouvernement. Dès le IIIème siècle, l’Eglise exerçait ses violences contre le peuple. Au Vème, elle réussissait à tenir en échec les empereurs et réclamait leur soumission, ses imposteurs déclarant, pour en faire un dogme, que Dieu les avait établis au-dessus de tous les princes et de tous les hommes. Elle n’a pas cessé d’être un agent de division de l’Etat, mais en même temps elle a été, par ses doctrines de résignation et d’obéissance perinde ac cadaver, la puissance d’asservissement la plus implacable qui ait jamais existé et la plus sûre collaboratrice de l’Etat dominateur quand celui-ci a été d’accord avec elle. C’est pourquoi, chassée par la porte, l’armée noire revient toujours par la fenêtre. En 1763, un abbé Labbat, prêchant à SaintEustache, disait :
« Tôt ou tard, la Révolution éclatera dans un royaume où le sceptre et l’encensoir s’entrechoquent sans cesse. »
Il espérait bien que la Révolution se ferait au profit de l’encensoir.
Toute la politique du moyen âge fut dans la lutte entre l’Eglise et la royauté pour l’hégémonie, et dans celle des Communes pour l’émancipation. Politique essentiellement réaliste, qui n’avait aucune doctrine véritable. Le gouvernement était uniquement une question de force, malgré le prétendu adoucissement des mœurs apporté par le christianisme. Dol, spoliation, assassinat, étaient les plus clairs arguments royaux et ecclésiastiques et les pires turpitudes n’étaient pas toujours celles des rois. Eglise et royauté vivaient, en principe, sur le droit romain adopté par les Barbares. La conception d’un droit nouveau ne s’éveillait que confusément dans la lente montée de la pensée empêtrée de théologie et terrorisée par l’inquisition. Le conflit permanent entre l’Eglise et la royauté faisait toutefois réfléchir, et les premières aspirations d’esprit laïque et libertaire se formulaient, favorisées par le développement économique des communes, centres de l’esprit populaire. La découverte d’Aristote avait ouvert le champ aux querelles scolastiques, chacun faisant dire au philosophe antique ce qui lui plaisait. Il fut particulièrement cuisiné par Thomas d’Aquin, et l’œuvre de ce dernier est devenue si définitive pour la politique de l’Eglise qu’elle la ressuscite aujourd’hui dans le néo-thomisme. Entre tant d’élucubrations forgées pendant dix siècles pour servir la politique ecclésiastique, Aristote, tripatouillé par Thomas d’Aquin, est demeuré la plus sûre béquille de son imposture. On trouve tout ce que la politique peut rêver dans le thomisme ; tous les partis, même laïques, peuvent s’y rencontrer dans le plus touchant opportunisme et s’embrasser Ad majorem Dei gloriam.
A côté des ratiocinations angéliques n’aboutissant, en fin de compte, qu’à la soumission ou au bûcher, l’esprit populaire, aidé de la raison et de la science, jetait les premiers fondements de la politique démocratique bourgeoise, réaliste et nationale, dans les groupements d’intérêts économiques et de défense contre la guerre étrangère. Des théoriciens, pas toujours assez débarbouillés de mystique religieuse, mais pleins d’ardeur pour la liberté, répandaient l’esprit de révolte. (Voir Révoltes.) Dès le XIVème siècle, la bourgeoisie appuyait sa politique sur les Etats Généraux du pays. A ceux de 1357, elle contraignait la royauté à signer cette grande ordonnance qui, a dit Michelet... :
« ...était bien plus qu’une réforme. Elle changeait d’un coup le gouvernement. Elle mettait l’administration entre les mains des états, substituait la république à la monarchie. Elle donnait le gouvernement au peuple. »
L’ordonnance de 1357 avait été, dit encore Michelet, « la charte législative et politique de la France ». Un demi-siècle après, une autre ordonnance, celle de 1413, fut son « code administratif ». La bourgeoisie ne se borna pas à apporter aux Etats Généraux un esprit révolutionnaire ; elle appuya ses revendications des deux premières révolutions parisiennes, celle dirigée par Etienne Marcel, en 1357, et celle des Cabochiens, en 1413. Malheureusement, elle n’eut pas, par la suite, la puissance de faire respecter ces ordonnances par la royauté ; mais sa politique ne serait pas plus audacieuse en 1789, quand, enrichie de plus d’expérience et de méthode, elle réussirait là où elle avait échoué quatre siècles avant. C’est au cours du XIVème siècle que fut sculptée, au fronton de la cathédrale de Chartres, la première figure de la Liberté :
« Liberté morale, sans doute, mais l’idée de la liberté politique s’y mêle et s’y ajoute peu à peu. » (Michelet)
La politique bourgeoise n’avait échoué qu’en partie dans ses premiers buts trop populaires. La bourgeoisie n’était pas alors aussi séparée du peuple qu’aujourd’hui. Favorisée dans sa sécurité et ses avantages de classe par l’appui de la royauté, elle tourna insensiblement au conservatisme en attendant des temps meilleurs où elle serait plus forte. Encore agitée durant les guerres de religion, sa dernière manifestation bruyante fut à l’occasion de la Fronde où elle soutint le Parlement contre le roi. Ensuite, elle s’effaça humblement devant la royauté absolue qui ne convoqua plus les Etats Généraux dès le règne d’Henri IV et supprima les dernières libertés communales sous celui de Louis XIV. Ayant définitivement réduit la féodalité, dominant l’Eglise et s’appuyant sur la bourgeoisie, la royauté tendit de plus en plus à l’unification et à la centralisation étatistes où se satisfît la mégalomanie orgueilleuse et guerrière des Rois-Soleil. A côté, dans son état de sécurité, la politique bourgeoise s’échappa de plus en plus de la spéculation scolastique du moyen âge et de la pensée humaniste de la Renaissance pour s’établir sur le terrain des réalités économiques où elle triompherait. Elle avait vu favorablement l’avortement révolutionnaire de la Réforme, les tendances démocratiques populaires réduites à néant, les révoltes d’esprit communiste noyées dans le sang, et les conceptions des « utopistes » bornées à de la littérature. Elle tira sa méthode du « Grand Livre » de ses comptoirs et de ses boutiques, de ses « comptes-courants » chez ses banquiers, en attendant de puiser ses théories chez les Encyclopédistes.
Pendant que la bourgeoisie marquait le pas, en France, derrière le roi disant : « L’Etat, c’est moi ! », elle faisait sa première révolution victorieuse en Angleterre. Cent cinquante ans avant la Révolution Française, les Anglais tranchaient le col à la monarchie absolue, malgré les doctrines de Hobbes sur sa légitimité. Ils établissaient le parlementarisme et votaient le bill d’habeas corpus, dont on attend encore l’équivalent en France pour la défense de la liberté individuelle toujours livrée à un arbitraire quasi-féodal quoique démocratique. Durant tout le XVIIIème siècle, la bourgeoisie française s’instruisit à l’école des politiques anglais orientés vers le libéralisme et la démocratie. Locke fut le principal représentant de cette école. Son influence détermina en France la politique encyclopédiste qui le dépassa pour aboutir à la Révolution de 1789. La bourgeoisie victorieuse de la monarchie de droit divin se serait alors fort bien accommodée, comme les Encyclopédistes, d’un « despotisme éclairé », sous un « bon tyran ». Il fallut la résistance royale attachée aveuglément au despotisme absolu pour que, les idées républicaines l’emportant, la République fût proclamée en 1792 et que Louis XVI fût décapité. Mais la République, repoussant le fédéralisme pour faire la France « Une et indivisible », ne fit que transporter la Raison d’Etat de la royauté à la Nation. La bourgeoisie vit de plus en plus sa force dans l’étatisme. C’est pour le maintenir qu’elle favorisa la dictature napoléonienne. C’est pour le consolider que, disant avec Gambetta, en 1873 : « La France n’est que trop décentralisée », elle a fait la République opportuniste. C’est pour le sauver en se sauvant elle-même qu’elle est de plus en plus fasciste, mais qu’elle sera, demain, collectiviste, voire bolcheviste, s’il le faut, contre la liberté et l’anarchisme.
Après Napoléon, la politique bourgeoise concentra ses efforts pour l’établissement de la nouvelle féodalité de l’argent, et contre la montée de l’idéologie socialiste dont les buts tendraient de plus en plus vers un étatisme appelé « prolétarien ». Ce fut la lutte du capitalisme et du prolétariat. Toute la politique n’a pas eu, depuis, d’autre base ; mais le prolétariat, après cent ans d’efforts et après avoir fait l’expérience des théories les plus diverses, en est toujours à peu près au même point. Le fait économique est arrivé à s’imposer avec un réalisme si brutal et si angoissant, qu’il est devenu une menace même pour la bourgeoisie, bien qu’elle continue à le dominer. Ce n’est pas pour rien que la démocratie créée par elle a toujours, comme fondement, les principes juridiques du droit romain qui n’admettaient pas la coexistence de la liberté politique et de la liberté civile. Les mystificateurs du « peuple souverain » lui affirment qu’il possède ces deux libertés. Le fait social répond tous les jours, avec une brutalité sans cesse accrue : « Non ! » (voir Propriété et Liberté). « Les droits de l’homme sont-ils proclamés ? Oui. Sontils appliqués ? Non », constate la Ligue des Droits de l’Homme.
La royauté de droit divin fut liquidée définitivement par la chute de la Restauration, amenée surtout par haine de l’Eglise encore plus intéressée et acharnée que la royauté à retourner au passé. Depuis, les « légitimistes » ont été réduits à l’opposition de quelques vieilles momies enroulées dans le drapeau blanc. Ralliés aux « orléanistes » depuis la mort de leur dernier « prétendant », ils ont formé, — avec les épaves de toutes les oppositions conservatrices déçues, celles, entre autres, du « bonapartisme » et de tous les cléricaux, jésuites de robe longue ou courte maquillés en libéraux, en démocrates, voire en socialistes, — le parti nationaliste, dont les manifestations ne prennent une consistance et ne présentent un danger à certains moments que grâce à la lâcheté et à la corruption des prétendus républicains. On a ainsi le spectacle particulièrement édifiant de ministres, de parlementaires, de financiers, de magistrats et de guerriers, tremblant devant des aboyeurs nationalistes qui exercent impunément sur eux un véritable chantage, celui de « l’homme à la chemise sale », et les mettent dans les plus ridicules postures.
La Révolution Française avait orienté les esprits vers une politique de plus en plus audacieuse dans les voies de la liberté ; mais la bourgeoisie sut arrêter, ou plutôt faire dévier ce mouvement pour neutraliser ses effets sociaux. Ce fut le règne de la duplicité démocratique, imitée de celle de l’Eglise, qui succéda au règne du droit divin. De même que dans les temples l’on disait : « Aimez-vous les uns les autres », en célébrant les égorgements, la bourgeoisie écrivit les grands mots : Liberté, Egalité, Fraternité, sur les bastilles conservées ou reconstruites : prisons, casernes, bagnes du travail et de la misère, où elle fit enfermer ceux qui eurent foi dans ces belles formules et revendiquèrent en leur nom. Avec une absence de plus en plus complète de morale et de scrupules, la politique bourgeoise entreprit d’exploiter à la fois la misère et la bassesse humaines, de corrompre quand elle ne put pas vaincre, de calomnier et d’affamer quand elle ne parvint pas à acheter. Elle sut prendre tous les masques, s’affubler de toutes les défroques, avoir ses hommes dans tous les partis. Quand les procès, la prison, la déportation, la proscription, la fusillade ne lui suffirent plus contre les « bandits rouges », elle se fit rouge elle-même, libérale, républicaine, radicale, socialiste. Après avoir chanté le Ça ira ! et la Marseillaise, pendant la Révolution, elle est revenue à O Richard, ô mon roi ! sous la Restauration. Elle a chanté ensuite la Parisienne pour saluer le retour des « trois couleurs ». Elle chanta la Reine Hortense, sous Napoléon III. Elle chante aujourd’hui, avec l’éclectisme d’un temps qui est à la fois oiseau et souris, l’Hymne au Sacré Cœur, conjugué avec l’Internationale. Demain, elle sera bolcheviste et tiendra entre ses dents le couteau de l’homme de Moscou. Ce ne sont pas les complices qui lui ont manqué et lui manquent encore parmi les girouettes politiciennes, les proscrits défaillants, les bavards ambitieux, les chambardeurs rêvant d’un ordre où ils seront les maîtres, toute la vermine des aventuriers et des renégats. Depuis le petit Thiers jusqu’à M. Tardieu, elle en a fait, pendant cent ans, ses avocats, ses hommes d’affaires, ses magistrats, ses policiers, ses techniciens, ses spécialistes, ses gouvernants, c’est-à-dire ses valets.
La bourgeoisie avait sauvé la propriété de la révolution. Elle établit sur elle un étatisme de l’Argent qui serait, par ses coffres-forts, plus inexpugnable que celui de la Royauté derrière les vieilles tours féodales où 1789 avait porté la torche. Elle commença par liquider le sentimentalisme et tout ce qui, dans la phraséologie révolutionnaire, représentait pratiquement trop de libéralisme. De Locke, des Encyclopédistes, des Physiocrates, tous partisans du « despotisme éclairé », de Rousseau réclamant un « contrat social » basé sur le respect de la liberté individuelle et l’égalité de tous dans un Etat fort et juste appuyé sur la souveraineté populaire, de Montesquieu préconisant une. constitution anglaise, de Morelly, favorable à une société communiste, d’Adam Smith, individualiste bourgeois, de Kant et de Fichte, individualistes à tendances libertaires, de tous, elle prit ce qui pouvait servir ses desseins, établir sa prépondérance, et elle rejeta, combattit, tout ce qui la contraria. Entichés d’aristocratisme pour eux, ses plus hauts représentants avaient pris la place, dans l’échelle sociale, des « ci-devant » royalistes. Il furent pleins de respect pour les théories des Joseph de Maistre et de Bonald défendant les droits de Dieu contre les droits de l’Homme, de Haller, champion de la légitimité, des Bentham et Burke, en Angleterre, des Savigny et Hegel, en Allemagne, qui renforçaient la souveraineté de l’Etat. Mais les acquéreurs de biens nationaux, les financiers et fournisseurs des armées, les nouveaux nobles, tous les pirates des guerres napoléoniennes qui craignaient de devoir rendre gorge, furent avec la moyenne et petite bourgeoisie et par haine de l’Eglise, libéraux et « voltairiens ».
La bourgeoisie se servit de Voltaire et de la pensée encyclopédiste comme l’Eglise s’était servie d’Aristote, en les dénaturant. Elle exagéra ce qu’ils avaient de superficiel, de sec, d’égoïste et de sceptique, pour dissimuler leur sérieux et leur profondeur révolutionnaire. Déjà, sous l’Empire, dans la presse officielle menée par Geoffroy, et à l’Institut, on avait affecté de ne connaître du XVIIIème siècle que sa littérature. A partir de la Restauration, le Constitutionnel et les « idéologues » de son entourage, plus ou moins servants de l’Eglise et jésuites honteux, poursuivirent l’incompréhension et le discrédit de Voltaire par le « voltairianisme », application prudhommesque, c’est-à-dire grotesque, des idées du XVIIIème siècle aux intérêts bourgeois.
Durant la Restauration, la bourgeoisie, pour contrebalancer la réaction politique, s’était servie du libéralisme. Il avait eu alors une certaine grandeur avec B. Constant, quand il demandait à l’Etat d’assurer « la garantie des droits de l’individu indépendants de toute autorité sociale ou politique ». Mais la bourgeoisie liquida ce libéralisme idéaliste à l’occasion de la Révolution de 1830, et il mourut avec B. Constant, l’année même où la ruée des appétits installa Louis Philippe au pouvoir. Le libéralisme se fit cyniquement réaliste avec Guizot disant à ses compères : « Enrichissez-vous ! », et surtout avec Thiers qui donna la formule du plus bas égoïsme bourgeois : « Chacun pour soi et chacun chez soi » à une société de parvenus déjà trop enrichis et trop disposés à l’écouter. Aux droits de l’individu défendus par le libéralisme généreux de B. Constant, Guizot et les doctrinaires du libéralisme bourgeois opposèrent la différence des intérêts, née de l’inégalité des individus et surtout des fortunes. On ne naissait et on ne demeurait plus roturier ou noble, mais on naissait et on demeurait riche ou pauvre. La bourgeoisie organisa le gouvernement des riches et supprima les droits des pauvres. Elle n’en prétendit pas moins rester fidèle aux « grands principes » de la « Révolution immortelle », pour lesquels « nos pères ont versé leur sang », etc. On connaît la chanson. Les « arrière petits-fils », les « héritiers des Jacobins », la chantent encore, et les prolétaires, qui continuent à crever de faim, sont toujours heureux de l’entendre. Ce salmigondis d’idéalisme verbal et de réalisme sordide produisit le libéralisme « prétexte et justification de la classe industrielle à l’aube de son règne ». (Dumont-Wilden : Benjamin Constant.) On ne reparlerait plus du libéralisme de B. Constant qu’en 1875, lorsqu’on fabriquerait ce qu’on appellerait la Constitution de la IIIème République. Dans l’intervalle, la bourgeoisie aurait eu le temps de s’immuniser contre toutes les entreprises révolutionnaires. Les Constituants de 1875, les mains encore rouges du sang des Communards et préparés aux palinodies « opportunistes », pourraient, sans courir grand risque, se donner des airs libéraux. « Les temps héroïques sont passés », dirait Gambetta lançant le coup de pied de l’âne aux morts de la Commune.
L’histoire du libéralisme, premier parti politique issu de la Révolution, devait être celle de tous les partis qui lui succèderaient. Elle a marqué la fin de l’idéologie directrice de la politique. Depuis, le fait social a dominé la théorie. Celle-ci n’a plus été viable que dans la mesure où elle a été la déduction vérifiée, contrôlée, du fait et a opposé à la métaphysique politique ce qui a été appelé le « matérialisme historique ». La science économique s’est substituée à la politique ; elle a rétabli le droit divin dans le droit capitaliste, l’esclavage populaire dans la servitude prolétarienne. Les Droits de l’Homme que la Ligue formée pour leur défense est devenue, aujourd’hui, incapable de défendre, la Liberté, l’Egalité, la Fraternité, ne sont plus que de la blagologie bourgeoise, comme le « Sermon sur la Montagne » et l’amour du prochain sont, depuis 1900 ans, de la blagologie religieuse. L’équivoque sentimentale de l’entente des classes, produite par les premières théories socialistes et que cherche à entretenir plus que jamais, aujourd’hui, la fourberie politicienne, a été balayée par la réalité toujours plus impitoyable et cruelle de la lutte des classes ; mais il a fallu toute l’évolution du socialisme pour arriver à cette constatation de fait, qui s’impose aujourd’hui contre le socialisme lui-même, passé au service de la bourgeoisie capitaliste, afin d’en atténuer les inévitables effets révolutionnaires. Malgré le bulletin de vote et le « collaborationnisme » socialosyndicaliste, il est de plus en plus impossible que le loup et l’agneau paissent ensemble.
Le socialisme (voir ce mot), avait été de tout temps en instance dans les aspirations communistes-libertaires et confondu avec elles. La Révolution leur donna l’occasion de leurs premières manifestations politiques, notamment lors de l’élaboration de la Constitution de 1793. Tenue en échec par les Jacobins, cette Constitution ne fut jamais appliquée. Dès ce moment, ceux qui représentaient socialisme, communisme et anarchisme, depuis Marat jusqu’à Babeuf, furent les indésirables de la Révolution, les « enragés » plus détestés des Jacobins défenseurs de la propriété, que les royalistes. Après l’échec de la conspiration des « Egaux » et la mort de Babeuf, socialisme et communisme furent réduits, pour un demi-siècle, aux aspirations et aux manifestations vagues et contradictoires du fouriérisme et du saint-simonisme qui fournirent au romantisme les éléments d’un snobisme engoué de la littérature d’Eugène Sue et de George Sand. Mais le socialisme se précisa. Au début du siècle, dans ses Effets de la civilisation, l’anglais Charles Hall avait commencé à expliquer scientifiquement l’antagonisme du capital et du travail ; il avait pressenti ses conséquences : révolte inévitable, militarisation de l’Etat et dictature, guerres pour enrichir davantage les riches et faire s’entretuer les pauvres, etc. D’autre part, à la faveur de l’agitation créée dans toute l’Europe par la Révolution Française, les idées d’Owen et de ses disciples amenèrent les manifestations ouvrières anglaises, véritable révolution sociale qui fit dire à Karl Marx :
« Pour la première fois, dans l’histoire, l’économie politique de la bourgeoisie avait été vaincue par l’économie politique de la classe ouvrière. »
Mais cette victoire n’eut pas les conséquences sociales qu’on en pouvait espérer.
Du babouvisme, du fouriérisme, du saint-simonisme et des idées anglaises sortit le socialisme français. Pecqueur formula la théorie de la « socialisation » collectiviste. Cabet fit de son Icarie un Etat-Providence de tous les citoyens devenus fonctionnaires. Louis Blanc souligna la division existante entre la bourgeoisie et le véritable peuple qui était le prolétariat (voir Peuple), en disant :
« J’entends par bourgeoisie l’ensemble des citoyens qui possèdent les instruments de production, ou capital, qui travaillent avec leurs propres outils et ne dépendent pas d’autrui. Le peuple est l’ensemble des citoyens qui ne possèdent aucun capital et dont l’existence dépend entièrement d’autrui. »
En conséquence, Louis Blanc réclama de l’Etat l’organisation du travail. Toutes ces théories opposaient un étatisme générateur de bonheur général, faisant participer, selon la formule de Sismondi, tous les citoyens « aux jouissances de la vie physique que la richesse représente », à l’étatisme bourgeois réservant ces jouissances pour une classe privilégiée et dominatrice. Mais leurs auteurs ne paraissaient pas apercevoir l’antinomie absolue qui existe entre le régime de la propriété et la liberté de tous les hommes. C’est ainsi qu’un socialisme, plein d’aspirations généreuses mais insuffisamment basé sur des données positives, et trop incertain sur ses moyens d’action, préparait, en collaboration plus ou moins cordiale et confiante avec le libéralisme républicain, les événements de 1848. La lutte s’organisait dans des sociétés secrètes. Des émeutes étaient provoquées. La « Société des Saisons », formée sous l’inspiration de Buonarroti, suscitait en 1839 une insurrection à la suite de laquelle Blanqui et Barbès étaient condamnés à mort. En marge du socialisme étatiste français, Proudhon formulait contre le régime de la propriété la théorie d’une société anarchiste basée sur l’entente des individus dans la liberté et l’égalité complètes. De cette dissidence sortirait la séparation du communisme libertaire du communisme étatiste, séparation que rendrait complète le marxisme, quand il aurait exprimé ses théories définitives sur la lutte des classes, aboutissant à la dictature du prolétariat.
Les progrès du socialisme apparurent à la bourgeoisie comme le « Mané, Thécel, Phares » de son horizon politique. Tant que le socialisme ne se manifesta que dans des formes littéraires, sollicitant sa philanthropie mais laissant le prolétariat sur son fumier, elle se donna des airs généreux et flirta avec cette idéologie sentimentale. Mais l’idylle tournant à l’orage, les affamés commençant à gronder, le socialisme les poussant à la révolte et annonçant une Internationale qui leur dirait : « L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! », le « spectre rouge » vint troubler le sommeil du bourgeois. Celui-ci se fit alors plus féroce. (Voir Révoltes ouvrières.) Les journées de juin 1848 inaugurèrent les grandes représailles ; elles creusèrent le fossé entre les classes et commencèrent véritablement leur lutte.
La bourgeoisie comprenait que les massacres, dans lesquels, malgré tout, elle se couvrait d’infamie et se faisait honte à elle-même, suffiraient de moins en moins à arrêter la vague populaire, même lorsqu’elle recourrait aux « guerres mondiales » faisant dix millions de morts. Il serait plus sûr pour elle de s’annexer le socialisme comme elle s’annexerait successivement tous les partis républicains. C’est ainsi qu’elle put durer et qu’elle dure encore. Certes, les antagonismes théoriques entre les différentes écoles politiques ont favorisé les desseins bourgeois. De plus, le sentimentalisme vague dont se leurraient jadis les partis populaires ne leur permettait guère de soutenir énergiquement des droits qu’ils ne voyaient qu’en rêve, et qu’ils attendaient plus d’une Providence que de la volonté des hommes. Mais depuis que la politique est devenue « l’application de la physique sociale » (A. Lichtenberger), la démonstration historique et scientifique s’est faite irréfutablement de l’impossibilité absolue de co-existence de la propriété et de la liberté, de l’entente du capitalisme et du prolétariat, de la réalisation de la justice sociale dans la société bourgeoise. Il semble, dès lors, que si proudhoniens, bakouninistes et marxistes ne purent s’entendre, il y a soixante ans, socialistes et anarchistes, collectivistes, communistes, fédéralistes et individualistes, pourraient se mettre aujourd’hui d’accord, au moins pour une action minimum sur les principes fondamentaux qui leur sont communs. Mais il faudrait pour cela que les hommes fussent à la hauteur des principes, que les partis politiques ne fussent pas menés par des politiciens prêts à toutes les palinodies et que tant de vaniteux ne mettent pas leurs petites personnes au-dessus des idées.
C’est par la corruption parlementaire que la bourgeoisie a pu faire servir à ses intérêts toutes les idéologies depuis cent ans passés, et maintenir ainsi sa puissance. Le parlementarisme (voir ce mot) est l’ossature des démocraties modernes. Qui domine au parlement domine la démocratie. Il s’agit donc d’y dominer coûte que coûte, par tous les moyens. Avec des hommes habilement dressés, circonvenus, corrompus, on fait faire au Parlement tout ce qu’on veut, quelle que soit l’indication donnée par le « suffrage universel ». La bourgeoisie a trouvé ces hommes dans tous les partis d’opposition, même les plus révolutionnaires. Il a suffi qu’ils se laissent prendre dans l’engrenage parlementaire pour que leurs partis y passent tout entiers.
Le parlementarisme fut inauguré en France par la Charte de 1814, établie pour régler les rapports de la monarchie restaurée et du peuple devenu « souverain ». Chateaubriand l’a décrit dans sa Monarchie selon la Charte qui lui valut la disgrâce royale. A la Chambre des pairs, désignés par le roi, s’opposait une Chambre des députés élus, en principe, par le peuple. Mais le jeu du régime censitaire réduisait ce peuple aux électeurs payant au moins 300 francs d’impôts, c’est-à-dire aux grands propriétaires. Ainsi, dès sa première application, le parlementarisme se révéla comme une institution fallacieuse. Ce fut une aristocratie de l’argent qui représenta le « peuple souverain » sous la Restauration.
Quand la bourgeoisie moyenne eut fait la Révolution de 1830, le cens fut abaissé. A côté des élus de la grande propriété, prirent place ceux des boutiquiers et des fonctionnaires. Jérôme Paturot, marchand de bonnets de coton, fournisseur de Louis Philippe et de la garde nationale, devint député. Au libéralisme aristocratique de la droite, celui des Say, Cousin, Royer-Collard, Guizot, fut alors opposé le libéralisme démocratique de la gauche, celui des Manuel, P.-L. Courier, Carrel, Delessert. Tout en établissant sur des bases de plus en plus solides la féodalité financière qui lui assurerait les monopoles des grandes entreprises nationales, la bourgeoisie faisait de la démagogie. Elle se dressait furieusement contre Lamartine quand il dénonçait la trahison de l’intérêt général au profit de cette féodalité, mais elle chantait sa Marseillaise de la Paix, inaugurant ainsi dans sa double fourberie ce « bellipacisme » qui livrerait le monde aux marchands de canons. En même temps, par esprit « voltairien », elle soutenait le catholicisme libéral contre l’ultramontanisme et, influencée de plus en plus par ses petits bourgeois, les futurs radicaux qui font aujourd’hui le parti des « petites gens », elle préparait la liquidation définitive de la royauté dont elle n’avait plus besoin et qui commençait à lui coûter trop cher. Mais la peur du socialisme la retenait. Le 25 février 1848, elle fit le saut malgré elle, La République fut proclamée ; en même temps, le suffrage appelé « universel » fut accordé au peuple après une journée de barricades. L’expérience de la « souveraineté » du peuple allait être de plus en plus déconcertante et tragique.
Le 23 avril 1848, le « peuple souverain » envoya, ou crut envoyer, à la Chambre des députés, ses « républicains » sur les 900 élus qui la composaient. L’Assemblée Constituante formée le 5 mai par ces prétendus « républicains » commença par faire massacrer ses électeurs cinquante jours après, quand ils se permirent de réclamer une République effective. Elle vota ensuite, le 4 novembre, une Constitution conservant toute l’organisation despotique établie par Bonaparte après le 18 brumaire, et notamment l’autorité absolue du Président de la République sur les fonctionnaires et sur l’armée. Elle prépara ainsi ce que Karl Marx a appelé : Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Ce Bonaparte ne perdit pas son temps. Bien qu’il fût soutenu par un pacte occulte des bourgeois royalistes-catholiques et des aventuriers bonapartistes, le pauvre « peuple souverain » crut voir en lui l’homme qui le vengerait des journées de juin et il le nomma, au plébiscite, président de la République par cinq millions et demi de voix ! L’ancien « carbonaro » se hâta de faire envoyer en Italie une armée française pour soutenir le pape contre les républicains, et de créer le « parti de l’ordre » pour préparer, dans l’ombre maléfique des massacres populaires, les élections de mai 1849. Elles furent nettement anti-républicaines. On vota alors la loi Fulloux, en faveur de l’enseignement congréganiste (16 mars-31 mai 1850), et les lois sur la presse (27 juillet 1849–10 juillet 1850) qui tuèrent les petits journaux démocratiques et arrachèrent à Lamennais, dont le Peuple Constituant fut supprimé, ce cri douloureux : « Silence aux pauvres ! ». Suivirent des destitutions de fonctionnaires, des saisies de journaux, des procès de presse, des accusations de complots ou de sociétés secrètes, des arrestations et de longues détentions préventives arbitraires, l’état de siège dans plusieurs départements, des attentats à toutes les libertés, une campagne de mensonge et de haine inouïe contre les « rouges », tout cela soutenu par les prétendus libéraux qui s’appelaient Thiers, Molé, Barrot, Montalembert, Falloux, etc., et la majorité parlementaire des prétendus républicains.
Car ceux-ci étaient aussi corrompus que leurs prédécesseurs, les libéraux que Guizot et Thiers avaient fait abreuver de « pots de vin » par les « loups cerviers » de la finance, et que, avant ces derniers, les Ventrus des ministères de Villèle que Béranger avait montrés, revenant « gras et fleuris » dans leurs circonscriptions, en chantant :
Les ministres m’ont donnés !
Ah ! que j’ai fait de bons dînés ! »
Le parlementarisme avait immédiatement adopté la moralité et les méthodes de participation au pouvoir des anciens sans-culottes et conventionnels passés au service de l’Empire, puis de la Restauration. Ce n’était pas pour rien qu’un Guizot — comme un Tardieu aujourd’hui — « ne comprenait pas qu’on ne fût pas servilement ministériel quand il était ministre » (Dumont-Wilden). Il savait payer la servilité, et les premiers parlementaires n’avaient pas attendu d’être les élus du « suffrage universel » pour vendre au pouvoir ce qui leur servait de conscience. Ils étaient cependant des propriétaires. Ils n’avaient pas pâti, dès leur naissance, comme les anciens claque-patins sortis, disent-ils avec ostentation, des « plus basses assises du prolétariat », qui, quoique solidement engraissés depuis, gardent toute leur vie un « boyau de vide » à faire remplir par le plus offrant.
Malgré la décevante expérience parlementaire, les idées républicaines et particulièrement socialistes se développant, des élections partielles furent favorables à la République en 1849 et 1850. La bourgeoisie voulut alors éviter à tout prix des élections populaires en 1852. Elle fit voter la loi du 31 mai 1850 portant à trois ans la résidence qui n’était que de six mois pour l’électeur. Trois millions de ceux que M. Thiers appelait « la vile multitude » furent ainsi exclus du « peuple souverain ». Cela ne suffit pas. II fallait un « sauveur » pour en finir avec les « hordes de barbares prêts à se ruer sur les familles et sur les propriétés ». Pour cette tâche, le président qui avait juré sur son « honneur » de respecter la Constitution mit son « honneur » à la violer. C’est ainsi qu’après divers événements : manifestation impérialiste de l’armée à la revue de Satory (10 octobre 1850), destitution des généraux Neumayer et Changarnier, trop républicains, appel de Bonaparte au Coup d’Etat (discours de Dijon, mai 1851), manifestations de la Société du Dix Décembre dont les malabars inculquaient à coups de matraque le goût du bonapartisme aux citoyens, brochures du royaliste Romieu réclamant l’écrasement par le « soldat », par le « sabre », par la « force » de « la foule, cette bête cruelle et stupide », on arriva au 2 décembre 1851, à ses massacres et à ses déportations. Si le député Baudin mourut sur une barricade, si quelques autres parlementaires furent emprisonnés et proscrits, le plus grand nombre s’inclina devant le Coup d’Etat et, malgré les 100.000 arrestations et les 15.000 déportations qui suivirent, le « peuple souverain » à qui le Bonaparte avait rendu le « suffrage universel » pour la circonstance, eut la lâcheté de se prononcer pour l’Empire par 7.500.000 oui contre 640.000 non et environ 1.500.000 abstentions. Les « pauvres » ne sortirent de leur silence que pour river à leur cou le boulet impérial qu’ils traîneraient pendant dix-huit ans.
Si nous nous sommes étendus sur ces faits historiques, c’est qu’ils montrent, dès le commencement du parlementarisme, son impuissance contre les dictatures de « l’Ordre », sournoises ou avouées. Et cela n’a pas changé depuis, malgré l’expérience qui aurait dû, semble-t-il, servir au « peuple souverain ». Quand l’Empire fut emporté dans la boue de la défaite et que les fusilleurs des Communards s’occupèrent de fonder une nouvelle République, ils faillirent rétablir une royauté, ce qui n’avait aucune importance aux yeux des dirigeants.
Ce qui en avait une, c’était de raffermir la puissance bourgeoise par la soumission ouvrière au capitalisme. Les sévères censeurs de l’Empire, les radicaux de 1869, donnèrent tous les apaisements (voir Opportunisme), et tous les partis les ont donnés depuis. La politique opportuniste, qui demeurera la formule de la IIIème République, a poussé les rouges vers les blancs et les blancs vers les rouges, pour se confondre de plus en plus dans le marais conservateur où se font les « bons dînés » ministériels. « Ni réaction, ni révolution », a été le principe républicain auquel les socialistes eux-mêmes se sont ralliés.
Avant qu’il devînt un « grand parlementaire », Jules Ferry disait : « le régime parlementaire, soit dans une république, soit dans une monarchie, n’a que le choix entre deux genres de mort, la putréfaction comme sous Louis-Philippe, ou l’embuscade comme sous Napoléon III. » Avant qu’il devînt ministre et président de la République, M. Millerand déclarait :
« Quelle humiliation ! Quelle honte ! La France est une démocratie, elle le croit du moins. Elle a l’illusion de diriger ellemême ses propres affaires. Pur décor ! Les ministres ne sont que les commis chargés d’exécuter les ordres des grands financiers. Pantins dont la Haute Banque tire les ficelles. »
Le comédien Got, type du « français moyen », qui avait déploré, après le 2 décembre 1851, « la plate impudence et le mépris d’elle-même avec lesquels ce qu’on appelle l’opinion publique accepte les coups de force bien menés », disait du parlementarisme :
« Je reste convaincu que le parlementarisme, comme le suffrage universel, malgré toutes les apparences de la justice et de la raison, est constamment détourné de son but par l’intrigue et les dessous de la politique, et demeure une duperie et un escamotage perpétuel. »
Le parlementarisme s’est de plus en plus corrompu, avec la politique appelée républicaine, dans les aventures du Panama, du boulangisme, du mélinisme, de l’affaire Dreyfus, pour aboutir, après la guerre de 1914, à la mainmise absolue de la finance représentée par tous les politiciens véreux qui agissent pour elle et qui dominent la situation. La Ligue des Droits de l’Homme, dont les intentions nous paraissent certainement pures ; malgré l’impuissance où la réduisent trop d’éléments politiciens qui vicient et paralysent son action, voudrait lutter contre la corruption politique et « sauver le parlement républicain » (H. Gernut, Cahiers des Droits de l’Homme, 30 septembre 1931), Il faudrait pour cela que le peuple possédât et sût exercer une autre souveraineté que celle de son esclavage. Le parlementarisme a signé le procès-verbal de sa définitive carence le 2 août 1914, lorsqu’on a décrété sans le consulter, et qu’il a approuvé après, « la mobilisation qui n’était pas la guerre » !
Le socialisme, parti de lutte de classe et d’émancipation prolétarienne, dont Karl Marx avait déjà dénoncé la déviation « social-démocrate », a passé à son tour le Rubicon, lorsque ses parlementaires et les fonctionnaires syndicaux ont livré l’Internationale Ouvrière à l’ordre bourgeois, capitaliste, militariste et policier en 1914. A la suite du Panama, Guesde et Lafargue écrivaient le 22 janvier 1893, au nom du parti ouvrier français :
« Pour en finir avec les flibusteries financières, il faut en finir avec l’exploitation patronale. C’est une transformation sociale qui s’impose. Et cette transformation appelée à faire disparaître, avec la féodalité industrielle, terrienne et bancaire, le parasitisme dont le panamisme n’est qu’une des formes, qui donc pourrait l’accomplir, sinon la classe victime, depuis les travailleurs des villes et des champs, déjà dépossédés et réduits à l’état de salariés, jusqu’à la petite bourgeoisie encore industrieuse, qui voit son lendemain de plus en plus compromis dans les krachs, laissant derrière eux l’égalité de la misère pour chacun et l’insécurité pour tous ? »
Or, durant la Grande Guerre, le parti socialiste et le syndicalisme avaient l’occasion de mettre fin, au nom de tous les prolétaires qui se battaient, à la féodalité industrielle, terrienne et bancaire, en faisant réaliser la « socialisation des moyens de production et d’échange » qui était à la base des aspirations socialistes et syndicalistes. Mais ils ont consommé la pire des trahisons à leurs principes en s’opposant à trois reprises différentes, comme l’a rappelé l’ancien député Jobert, à cette socialisation. Cette trahison majeure a entraîné toutes les autres. Aujourd’hui, le socialisme est impuissant, sinon complice, devant les flibusteries financières, et le syndicalisme, loin de travailler à la disparition du salariat qui est à la base de la charte ouvrière, « collaborationne » avec ceux qui exploitent les salariés. Le suffrage universel étant dans l’impossibilité d’ apporter au socialisme, non seulement une unanimité, mais simplement une majorité assez forte pour imposer une réforme de l’état social, les socialistes avaient à choisir entre l’œuvre d’éducation qui donnerait au prolétariat la capacité qui lui manquait, et l’action révolutionnaire immédiate. Ils ont préféré s’engager dans l’impasse du parlementarisme qui ne laissait à leurs représentants que le choix entre l’enlisement fangeux où étaient tombés tous les autres partis, et une opposition stérile, toujours menacée des violences dictatoriales de la majorité. Les événements ont alors suivi leur cours ordinaire. Le parti socialiste est devenu un parti comme les autres, c’est-à-dire une coterie d’intérêts particuliers, le plus souvent dressée contre l’intérêt général et dont les formules blagologiques sont de plus en plus incapables de masquer la corruption.
Nous ne ferons pas l’histoire de la politique socialiste parlementaire. Soulignons seulement la contradiction où elle s’est mise avec ses propres théories à propos de la « participation » au gouvernement. Elle n’a pas cessé de tourner autour de ce pot depuis qu’elle s’est faite parlementaire. Au début, elle s’est montrée nettement hostile ; le socialisme devait prendre le pouvoir et non y participer. Faut-il croire que, comme pour le renard de la fable, les raisins étaient trop verts ? Il le semble car, peu à peu, les socialistes sont venus à composition à mesure que les possibilités de collaboration se sont levées à l’horizon. « Avoir des élus dans des assemblées où ils apportent l’opposition socialiste n’est pas de la collaboration », dit-on d’abord. Mais il s’agissait de savoir à quel moment cette opposition deviendrait de la participation. On était sur la pente savonnée où les malins prétendent qu’ils sont toujours à temps pour arrêter la glissade, et où les naïfs acceptent de glisser avec eux. Or, on peut dire à ce sujet que si la casuistique ecclésiastique est tortueuse, celle de l’opportunisme politicien adapté à la politique socialiste ne l’est pas moins. L’élu : conseiller municipal, conseiller général, député, ne devait pas, dans la rigueur de son opposition, occuper des fonctions officielles. Il ne put même, pendant longtemps, devenir sénateur, en raison des tractations et des compromissions avec les autres partis, inévitables pour l’élection d’un si important personnage. C’était toujours l’histoire des raisins !... Peu à peu, le conseiller municipal put devenir adjoint et même maire ; le conseiller général put faire un président de Conseil général ; le député put entrer dans des commissions parlementaires et devenir président de la Chambre des députés. Enfin, l’homme pur, qui ne devait pas compromettre son parti, put être sénateur. Il est resté interdit, sous peine d’excommunication majeure, de devenir ministre, et chaque fois que, depuis M. Millerand, un de ces messieurs a voulu l’imiter, il a dû commencer par démissionner du parti, ce qui, entre parenthèse, ne le gênait guère, puisqu’il n’avait plus besoin de son parti. Comprenne qui pourra, parmi ceux pour qui les mots ont encore un sens. Etre le maire d’une commune, ou son adjoint, n’est ce pas participer à l’administration communale ? Etre membre d’une commission parlementaire, n’est-ce pas participer au travail du parlement ? Etre président de la Chambre des députés, n’est-ce pas participer au gouvernement en planant au-dessus des partis pour faire l’accord entre eux dans leurs débats ? Tout cela, quoi qu’on en dise, n’est-ce pas se mêler aux affaires, contribuer à la fabrication des lois bourgeoises, exercer l’autorité qui les fait appliquer, enfin, participer au gouvernement ? Quelle différence y a-t-il entre l’acte d’autorité du ministre interdisant une manifestation dans toute la France, et celui du maire qui interdit dans une commune ? Seule, une casuistique filandreuse peut faire une distinction. « L’opposition ainsi comprise devient une sinécure qui n’exclut pas les prébendes », a dit fort justement M. B. de Jouvenel. Elle ne sert qu’à dissimuler aux yeux des masses, aussi aveugles dans le parti socialiste que dans les autres partis, les turpitudes par lesquelles les politiciens adaptent les principes du parti à leurs intérêts particuliers et persuadent les sots qu’ils travaillent pour le socialisme quand ils dînent chez les ministres, qu’ils font avancer le collectivisme quand ils s’enrichissent, et qu’ils honorent leur parti quand ils portent à leur boutonnière un ruban rouge !... Aussi, les Caillaux ont-ils beau jeu pour railler le socialisme et dire des idées de Karl Marx qu’elles sont devenues « ces formules desséchées que les partis socialistes, quand ils sont parvenus au pouvoir dans nombre de pays, ont été hors d’état d’incorporer dans les réalités ». En faisant du socialisme révolutionnaire un système gouvernemental, aussi menteur et aussi malfaisant que tous les autres systèmes politiques, les partis socialistes ont réduit le socialisme à ces « formules desséchées ».
On discute, depuis deux ou trois ans, de la « crise doctrinale du socialisme ». Il y a toute une jeunesse ardente, sincère, que les pratiques de l’arrivisme politicien n’ont pas corrompue, et qui cherche la voie d’un redressement du socialisme dans sa véritable raison, sa véritable action, son véritable but. Dans son inquiétude de ne pas trouver cette voie et dans son désir d’action, cette jeunesse dit :
« Il ne suffit pas, pour être révolutionnaire, de flétrir jour par jour les forces d’oppression et ceux qui faiblissent devant elles... Il est possible que l’orage vienne ; bien des récoltes périront peut-être. Qu’aurez-vous fait pour les sauver ? »
L’observation est certainement fondée à l’égard de certains dilettanti. Mais, est-ce ne rien faire pour sauver les récoltes que de dénoncer ceux qui les exposent systématiquement à l’orage, et n’est-ce pas mieux faire que « les plumitifs des différents partis dits avancés que vous voyez suspecter, et insulter, et déchirer tout indépendant qui ne paie pas cotisation dans leurs boutique » ? (J. R. Bloch). La première chose à faire pour un redressement du socialisme serait de le faire rompre avec le parlementarisme. Mais il est déjà bien tard pour cette opération. Comme tous les autres partis, le socialisme est aujourd’hui dominé, gangrené par ses politiciens : ses états-majors de gens plus ou moins arrivés au maréchalat, ne voulant lâcher leur bâton à aucun prix, dû le parti en périr ; sa hiérarchie de chefs et de chefaillons aux dents d’autant plus aiguisées qu’ils ont déjà mordu peu ou prou à la galette du pouvoir ; son armée de tous les affamés d’autorité, fût-elle celle d’un « flic », qui seraient, comme le héron de la fable, tout heureux et tout aise de rencontrer, grâce au socialisme, un limaçon en attendant une plus abondante chère. Tout ce monde se gave, ou aspire à se gaver, de la détresse de l’immense foule des véritables affamés, à exploiter la colère des véritables prolétaires pour qui le « grand soleil rouge », toujours annoncé, ne brille jamais.
L’Eglise romaine a prétendu être une puissance populaire et démocratique parce qu’il lui est arrivé de faire papes des gardeurs de pourceaux. Napoléon, qui escamota la République dans le but de lui substituer une nouvelle dictature dynastique, déclarait que chacun de ses grenadiers portait dans sa giberne un bâton de maréchal. Voici ce que produit aujourd’hui la démagogie socialiste mise au service de la démagogie bourgeoise :
« De nos jours, le plus modeste des enfants de nos écoles peut devenir chef du gouvernement ou président de la République... Gloire donc à la Révolution qui a mis dans chaque berceau ce rayon d’espérance ! Gloire à la République qui peut se permettre d’élever au plus haut degré de la hiérarchie sociale le plus humble de ses enfants !... Oui, c’est une grande chose que les enfants du peuple puissent désormais s’élever dans l’Etat jusqu’au faîte des charges et des honneurs. » (Alexandre Varenne)
Le socialisme n’est plus, d’après Varenne, d’apprendre à tous les enfants du peuple à vouloir la justice sociale dans l’égalité de tous les hommes et dans la solidarité commune. Non. Il consiste à leur apprendre à arriver, à dominer par les compétitions et les intrigues, les mensonges et les violences qui permettent à un soliveau national de s’ériger, tous les sept ans, « au faîte des charges et des honneurs » !... Il y a, entre ce laïus de M. Varenne et certaine opinion formulée jadis par M. Millerand sur les présidents de République, tout le chemin parcouru par le socialisme parlementaire dans la voie honteuse de son adaptation au muflisme démocratique (voir Muflisme).
En décembre 1927, M. Poincaré, chef du gouvernement, donnait ce satisfecit aux socialistes du Sénat : « Je suis en face d’une opposition des plus courtoises ; vous me laissez accomplir mon œuvre. » En février 1928, il disait à ceux de la Chambre des députés :
« Vous conduisez votre opposition sans aucune hostilité, avec modération. Le parti socialiste n’a pas cherché à entraver l’action essentielle du gouvernement. »
Et dans le Populaire, journal du parti socialiste, ce parti montrait lui-même, par la plume de M. Emile Kahn, dans quelle impasse le parlementarisme l’avait engagé : « L’opposition de combat, c’est un magnifique article de journal. Cela ne répond pas à la réalité. Depuis que le ministère Tardieu est au pouvoir, notre groupe parlementaire est contraint de mener une opposition de résignation que j’appellerai une opposition de collaboration » ... A part cela, on ne « participe » pas !
En temps d’élections, la chose est pire. La politique socialiste en arrive à renier totalement la lutte de classe. L’union prolétarienne n’a plus de sens pour elle ; c’est sous cette chose vague, et qui n’a plus aucun sens depuis longtemps, appelée « alliance républicaine », qu’elle cherche à recueillir le plus de suffrages par des pactes formés, le plus souvent contre ceux qui sont plus à gauche qu’elle, avec ceux qui sont plus à droite. Comme tous les partis se réclament aujourd’hui de la République, on sait ce qu’on risque de rencontrer au coin du bois de cette alliance. Le socialisme dit qu’il défend en la circonstance les « idées démocratiques » ; mais il n’est aucun de la douzaine de « partis républicains » existant aujourd’hui qui ne prétende les défendre avec le même zèle. En 1910, les socialistes écrivaient des choses comme celles-ci : « Le public ouvrier et paysan ne voit pas très bien ce que les réactionnaires pour de bon pourraient bien faire de pire que les radicaux ... En dénonçant l’impuissance et la banqueroute du parti radical, en flétrissant son cynisme et les écœurants procédés du même parti politique, le parti socialiste ne fait le jeu d’aucune réaction... » (Paul Faure, Le Travailleur du Centre, 20 mars 1910). Aujourd’hui, ils font alliance avec les dits radicaux et ceux qui disent, et ne cessent pas de dire que tous se valent, plongés qu’ils sont dans la « pourriture parlementaire », passent pour des hargneux, des aigris, des jaloux, quand ce n’est pas pour des vendus à qui on demande aimablement combien la réaction les a payés !... Les adversaires du parlementarisme ne comprennent rien, dit-on, aux réalités. Ceux qui en vivent, les socialistes parlementaires entre autres, les comprennent, eux, les réalités. Comme le Ventru de Béranger, ils savent comment on revient « gras et fleuri » sans avoir couru les risques d’une révolution que seuls les « primaires » de leur parti réclament encore.
Pourquoi le parti socialiste jette-t-il ainsi par dessus bord, avec tant de désinvolture, la doctrine marxiste ? On pourrait croire qu’il lui a gardé la vieille dent de ces « sociaux-démocrates » que Marx dénonça et flétrit plus et mieux que personne. Mais la raison est autre. Le rapporteur de la question électorale au dernier congrès socialiste a pu l’exprimer ainsi sans soulever des huées générales :
« Afin d’obtenir le plus d’électeurs et le plus d’élus, j’ai dressé notre programme électoral comme font les grands magasiniers qui, pour attirer et allécher les clients, confectionnent des séries d’articles réclames ! »
L’aveu est ici complètement dépouillé d’artifices. Ce n’est pas avec « l’article » marxiste qu’on « attire et allèche les clients » de la boutique électorale. Aussi, le résultat est-il, et il sera tant que durera le régime parlementaire, celui-ci :
« République, dictature, royauté, empire, que signifient ces titres dont les régimes se parent, que comptent, dans les démocraties, les voix des électeurs, quand les lendemains des gouvernements et des peuples se décident dans une région où les ministres et les dictateurs n’ont pas accès et où quelques douzaines de personnages sans mandat manient l’épargne, distribuent le crédit au gré de leurs esprits faillibles, manœuvrent les cabinets travaillistes aussi aisément que les conservateurs, et n’avertissent les nations des opérations qu’ils ont faites en leur nom que par le bruit soudain de leurs faillites. » (H. de Jouvenel)
Ce qu’on appelle la « souveraineté » du peuple n’est donc que l’abandon de sa volonté et de ses droits, par le moyen du parlementarisme, au bon plaisir de ses maîtres. Proudhon a dénoncé la « confusion de la volonté sociale avec le suffrage universel et la substitution de celui-ci à celle-là » dans des termes qui devraient faire réfléchir les électeurs qui en sont capables. Il a écrit ceci :
« Que le suffrage universel, c’est-à-dire une idée individualiste adoptée par la majorité du peuple, s’exerce d’une manière tacite ou formelle, peu importe. Dès lors qu’il devient la loi de la nation, il doit arriver infailliblement que la volonté sociale soit viciée dans ses manifestations légitimes et peu à peu anéantie. C’est ce qui arrive lorsque le peuple, prenant l’action par masse pour l’action sociale, l’uniformité disciplinaire pour l’unité organique, le prestige monarchique, dictatorial, triomphal, pour la richesse, la grandeur et la gloire, finit en se donnant un dépositaire de sa pensée et de son pouvoir, par détruire son propre organisme et se réduire, suivant l’expression de Napoléon, à l’état de poussière !... »
On ne peut mieux démontrer que la théorie du « peuple souverain » est une mystification. Elle l’est encore plus dans les faits.
Il ne peut pas y avoir souveraineté du peuple quand le peuple a, au-dessus de lui, des maîtres. II n’y a de souveraineté que celle de ces maîtres qui exploitent le peuple à leur gré. Ses maîtres commencent d’abord par le faire voter suivant leurs intérêts. Tout un système de pression et de terreur est en main des patrons, des curés, de tous les dirigeants temporels et spirituels contre les électeurs soumis à leur autorité. On prive de travail ou de la communion l’ouvrier mal votant. S’il s’en moque pour lui, ce sont sa femme et ses enfants qui sont atteints. Toute une organisation de battage, de trompe l’œil, d’intimidation, de « pots de vin » et de « pots au feu », accompagne le candidat riche envahissant une circonscription avec des « nervis » solides qui lui font une garde du corps et sont pourvus de triques à l’usage des contradicteurs, d’argent pour les ivrognes dont la conscience politique a besoin d’alcools variés pour se révéler... On ne peut pas être candidat d’un parti, même socialiste, si l’on n’a pas les moyens de payer son élection. E. de Goncourt constatait :
« Dans les sociétés corrompues, on vante la probité, mais elle se morfond dans la misère. »
Elle se morfond encore plus dans l’impossibilité de l’action. Dans les partis politiques corrompus, et ils le sont tous, on ne vante même pas la probité ; on la méprise et on la combat. N’est-elle pas un reproche — pour ne pas dire un remords — pour tous les aventuriers, les « resquilleurs » et les « monte-en-l’air » de la politique enrichis par toutes sortes de rapines ? Et le silence au candidat pauvre est imposé comme à l’électeur pauvre, qui sont probes tous deux, surtout par cette presse qui se prétend « libre », mais qui ne parle que pour celui qui la paie, pour le malfaiteur qui peut payer contre l’honnête homme qui n’en a pas les moyens. Le « peuple souverain » est dominé, « mis en boîte », dans les réunions électorales où les candidats se présentent comme des Rédempteurs du monde, par une foule de braillards aussi corrompus que ceux qui les emploient, qui attendent de leur candidat dont ils ont souvent financé l’élection, des décorations, des adjudications, des bureaux de tabacs, des autorisations aussi illégales que productives, des emplois de budgétivores et cent autres choses où ils étaleront, dans le plus doux et le plus rémunéré des « farniente », la récompense de leur zèle démocratique et l’insolence de coquins qui se savent protégés auprès des tribunaux. C’est ainsi que se fait le choix des « meilleurs » dans la démocratie.
Et il y a la candidature officielle du gouvernement, soutenue par les préfets et les maires, par les fonds secrets distribués à la presse dont l’indépendance démocratique est à plat ventre devant les distributeurs de sportule. Il y a cent ans, les gouvernants envoyaient aux préfets, à l’usage des fonctionnaires, des circulaires comme celle-ci du 17 décembre 1828 :
« Sa Majesté désire que la plupart des membres de la Chambre qui a terminé ses travaux soient réélus.
« Les présidents de collèges sont les candidats.
« Tous les fonctionnaires doivent au roi le concours de leurs démarches et de leurs efforts.
« S’ils sont électeurs, ils doivent voter selon la pensée de Sa Majesté, indiquée par le choix des présidents, et faire voter de même tous les électeurs sur lesquels ils peuvent avoir de l’influence.
« S’ils ne sont pas électeurs, ils doivent, par des démarches faites avec discrétion et persévérance, chercher à déterminer les électeurs qu’ils peuvent connaître à donner leurs suffrages au président. Agir autrement ou même rester inactif, c’est refuser au gouvernement la coopération qu’on lui doit ; c’est se séparer de lui et renoncer à ses fonctions.
« Présentez ces réflexions à vos subordonnés, etc. etc. »
Aujourd’hui, les circulaires sont plus discrètes, les menaces et les sanctions plus déguisées contre les insoumis ; mais les gouvernants perdent toute discrétion, soutenant ouvertement de leurs discours, et des journaux, les candidats de leur majorité. Avec une impudence déconcertante ils battent la grosse caisse électorale comme des charlatans et poursuivent les gens jusque dans leur lit avec la T. S. F. C’est dans ces conditions que s’exerce la « souveraineté du peuple » souverainement mystifié.
Le « suffrage universel » n’est pas une moindre mystification, corollaire de la précédente en ce qui concerne le nombre, la qualité des électeurs et le compte que l’on tient de leur volonté. Qui dit « universel » dit « général, qui s’étend à tout ». Le suffrage dit « universel » devrait être celui de tous. Il commence par exclure tous ceux qui, ayant moins de vingt-et-un ans et n’étant pas encore passés par la caserne, ne sont pas suffisamment abrutis socialement pour faire de « bons électeurs ». Il exclue aussi les femmes, du moins en France. Il est de vérité élémentaire que si les femmes ne doivent pas faire de meilleurs électeurs que les hommes, elles ne peuvent en faire de pires. Au pays « le plus spirituel du monde », la femme est reine de tout ce qu’elle veut, tout autant qu’elle se prostitue ; mais une Séverine ou une Mme Curie est inférieure au premier ivrogne venu devant le « suffrage universel ». Il a fallu soixante ans à la République pour qu’elle se décidât à accorder le droit de vote aux « gens de maison » ! Il reste encore toutes sortes de « mineurs » d’autres espèces : étrangers, militaires, prisonniers, etc., ce qui exclue du « peuple souverain » environ les trois-quarts de la population. Il y a de plus à tenir compote des « abstentionnistes » qui refusent de voter pour une raison quelconque, et enfin, de ce que la majorité dont les suffrages l’emportent n’est pas l’unanimité des votants. Ainsi, sauf quelques écarts de chiffres qui ne changent rien à cette constatation générale, la statistique est à chaque élection ce qu’elle a été en 1928 :
-
Electeurs inscrits : 11.395.000.
-
Votants : 9.350.000
-
Suffrages représentés par les candidats élus : 4.800.000
Il en résulte que, dans un pays de 40 millions d’habitants, la majorité de ce qu’on appelle le « suffrage universel » est représentée par 4.800.000 électeurs, pas même le huitième de la population ! Nous ne tenons pas compte des élections aux colonies où il arrive, sans doute sous l’effet du soleil, que 10.000 votants donnent 15.000 voix à un élu !...
Tout au moins, le nombre des députés de chaque parti est-il proportionnel au nombre de voix recueillies par chacun ? Qu’on en juge par ces chiffres qui sont encore de 1928 :
-
Conservateurs et Républicains quelconques : 2.700.000 voix 265 élus
-
Radicaux et socialistes divers : 3.500.000 — 220 --
-
Socialistes S.F.I.O : 1.700.000 — 99 --
-
Communistes : 1.200.000 — 14 --
Si la proportion obtenue par les conservateurs et républicains quelconques avait été observée pour les autres partis, les radicaux auraient dû avoir 343 élus, les socialistes S.F.I.O. 166 et les communistes 114. La « droite » a eu 350 députés pour moins de quatre millions de suffrages ; la « gauche » n’en a eu que 250 pour plus de cinq millions. Voilà le fonctionnement de cette double mystification : « souveraineté du peuple » et « suffrage universel ». Le peuple peut voter à « gauche », tant qu’il lui plaira ; le gouvernement est toujours à « droite », sous peine de se supprimer lui-même.
Au moment où nous écrivons, les élections législatives de mai 1932 viennent d’avoir lieu. Il n’est aucun parti pour qui les 1er et 8 mai n’aient été de « belles journées », même pour les « conservateurs » qui auraient eu, paraît-il, zéro élu ! Car cela ne prouve rien, pas plus que la « majorité républicaine » qui s’est, dit-on, affirmée... une fois de plus ! C’est toujours la majorité républicaine qui s’affirme à chaque élection. En 1928, elle s’était tellement affirmée que L’Œuvre avait demandé ironiquement que quelques-uns de ses membres voulussent bien se dévouer pour former une opposition. On a vu comment cette demande a été satisfaite, grâce à la « bonne humeur » de M. Tardieu succédant à la « pénitence » poincaresque. Comment croire qu’il en sera différemment cette fois-ci ? Comment ne pas être certain qu’il en sera de même ? Avec un zèle suspect, des journaux qui célébrèrent le régime de la « bonne humeur » écrivent aujourd’hui sur M. Tardieu : « On frémit à la pensée qu’un homme si léger a tenu en ses mains le destin du pays et qu’il sévit encore pour quelques jours. » Mais qu’il arrive, d’ici quelque temps, à gagner à sa cause la majorité qu’on lui oppose aujourd’hui, et cet homme « si léger » redeviendra le seul ayant assez de prestige pour sauver le pays. Les Argus de la Bourse ne s’y trompent pas qui disent à leurs lecteurs financiers : « Pas d’aveugles présomptions... Pas de craintes injustifiées. » Et ils ne conseillent nullement, comme dans les véritables crises politiques, l’exportation patriotique des capitaux à l’étranger. Ils savent bien que ce n’est pas encore cette fois qu’on « prendra l’argent là où il est », malgré la « victoire des rouges » !... Au lendemain des élections, on a vu ceci : l’Eglise catholique faisant de pompeuses funérailles religieuses à M. Doumer, président de la République laïque, qui était né protestant et avait été librepenseur toute sa vie ! Un tel exemple du confusionnisme du temps, établi sur la corruption politique et l’avarie des consciences politiciennes, n’est-il pas fait pour donner confiance à tous les partis et à toutes leurs girouettes, si habiles à tourner de l’un à l’autre, à ne courir jamais qu’au secours de la victoire, à « braver les tyrans abattus et à se mettre aux gages des autres » ?...
Seul, le « peuple souverain » ne trouve jamais son compte à cette politique. Comment le trouverait-il dans l’ignorance absolue où il est tenu de ses véritables besoins individuels et collectifs ? Comment ferait-il pour voir clair et se guider dans le labyrinthe des intrigues et des tripotages internationaux et nationaux où la confusion est semée à plaisir par tous les pêcheurs en eau trouble de la politique ? Comment peut-il savoir pourquoi le Béloutchistan, par exemple, est aujourd’hui la « nation amie » et sera demain « l’ennemi héréditaire », pourquoi il doit prêter son argent au royaume du Soleil et le refuser à celui de la Lune, pourquoi la rente monte ou descend, pourquoi il doit dépenser ou économiser, pourquoi on passe de la « pénitence » à la « bonne humeur » et vice-versa, pourquoi il y a sous-consommation quand il y a surproduction, pourquoi les œufs, la morue, les bananes, sont tour à tour des nourritures excellentes ou nocives, pourquoi on met la guerre « hors la loi » et on la prépare plus que jamais, et pourquoi, demain, pour des raisons de diplomatie secrète dans lesquelles il n’a pas plus le droit, lui, le « souverain », de mettre le nez, que ne l’avaient les sujets de Nabuchodonosor ou de Louis XIV, il devra marcher de nouveau pour une « mobilisation qui ne sera pas la guerre », mais qui fera tuer, cette fois, la moitié du genre humain !...
Le peuple, si « souverain » que le déclarent ses gouvernants en se moquant de lui, demeurera « le serf taillable et corvéable à merci », la « vile multitude » que méprisent les Thiers en la faisant massacrer, le troupeau lamentable du prolétariat des usines et des casernes, des profits capitalistes et des guerres impérialistes, tant qu’il ne possèdera pas une VOLONTÉ SOCIALE, seule génératrice de la liberté sociale et de la liberté politique. Mais, pour posséder cette volonté, il lui faut acquérir un savoir, une conscience, une énergie qui ne se trouvent pas dans les bars de vigilance, en levant le coude à la santé de malfaisants politiciens,
* * *
Après ce qui précède sur la politique, avons-nous besoin d’expliquer longuement ce qu’est le politicien ? Non, mais il n’est pas inutile de montrer que si la politique ne peut pas en faire un personnage bien reluisant, malgré tout son « prestige », lui est encore moins capable de la faire reluire. Le politicien est à la fois le producteur et le produit de la politique, la cause et l’effet ; ils s’avilissent mutuellement.
L’étiquette est récente. C’est un néologisme, Littré l’a ignoré. Le Nouveau Larousse l’a défini :
« Personne qui s’occupe de politique. Ne se dit guère qu’en mauvaise part. »
Le politicien ne s’occupe pas seulement de politique ; il en vit et il en fait le plus méprisable des métiers. Dans un temps où l’on croyait encore à un parlementarisme honnête, fonctionnant avec un personnel qui mettrait ses actes en rapport avec ses discours en remplissant les fins promises au peuple, ce néologisme fut formé pour désigner et flétrir les aventuriers politiques, les trafiquants de mandats, les brebis galeuses égarées dans le bon troupeau. Les galeux sont devenus si nombreux que la qualification s’est de plus en plus répandue et généralisée dans le langage. Elle a perdu en même temps son sens exclusivement péjoratif pour prendre ce caractère de bon garçonnisme dont on s’accommode à l’égard des maux dont on ne sait se débarrasser. On en est arrivé ainsi à commettre ces pléonasmes : un « politicien sans scrupules », un « politicien louche », ou ces antithèses : un « politicien scrupuleux », un « politicien vertueux » !
Le politicien se signale et se peint suffisamment luimême par son importunité et ses turpitudes sans que des esprits malveillants aient besoin d’aller le chercher dans la solitude et de mettre à la lumière son indignité. Ses palinodies sont sans voile, sauf pour les aveugles ; les fluctuations de ses opinions et les contradictions de ses actes, si habiles qu’il les croie, le dénoncent, car elles coïncident toujours avec un changement avantageux dans sa situation personnelle. Etant en évidence dans toutes les manifestations de la vie publique, il alimente toute une littérature très souvent bouffonne et encore plus ridicule et odieuse. Il remplit l’histoire et le roman. Flaubert, dans son Candidat, et plusieurs autres auteurs qui l’ont présenté au théâtre, ont échoué en le montrant trop crûment, en ne l’enveloppant pas assez de la rhétorique, du « galoubet », de la « galéjade » qui ont fait le succès de Numa Roumestan et de Pégomas dans Cabotins de Pailleron. Le public aime, au théâtre comme à la ville, les séduisantes fripouilles, surtout celles qu’il a couvées électoralement, qui lui font les poches en l’amusant. Il les préfère à l’honnête homme froid et distant qui ne sait pas rire, même dans les cimetières. Ce qui fait faiblir l’attaque, c’est que chaque nouveau qui se présente dit : « Oui, c’est entendu, mes prédécesseurs ont pu être des fripouilles, mais moi, Moa ! je suis d’une autre trempe ; je ne suis pas de ceux qui trahissent ! » Et cela dure jusqu’au premier pot de vin qui se présente, puis on passe à un autre. Il y a plus de cent ans que cela dure.
Le politicien a son ancêtre, son prototype, dans le Ventru, chansonné par Béranger en 1818, qui chantait ses « bons dînés » chez les ministres avec une jovialité cynique dont voici quelques traits :
Je reviens gras et fleuri ...
« …Comme il faut au ministère
Des gens qui parlent toujours,
Et hurlent pour faire taire
Ceux qui font de bons discours,
J’ai parlé, parlé, parlé,
J’ai hurlé, hurlé, hurlé...
« ... Si la presse a des entraves,
C’est que je l’avais promis.
Si j’ai bien parlé des braves,
C’est qu’on me l’avait permis.
J’aurais voté dans un jour
Dix fois contre et dix fois pour…
« Au nom du roi, par mes cris,
J’ai rebanni les proscrits...
« …Des dépenses de police
J’ai prouvé l’utilité... »
Et voici les deux derniers couplets, sommet du crescendo de turpitude :
Vous paierez, sans y songer,
L’étranger et les ministres,
Les ventrus et l’étranger.
Il faut que, dans nos besoins,
Le peuple dîne un peu moins.
Quels dînés,
Quels dînés,
Les ministres m’ont donnés !
Ah ! que j’ai fait de bons dînés
Enfin, j’ai fait mes affaires :
Je suis procureur du roi ;
J’ai placé deux de mes frères,
Mes trois fils ont de l’emploi.
Pour les autres sessions
J’ai cent autres invitations.
Quels dînés ! etc. »
Daumier a peint le Ventru en troupeau délibérant, dans son Ventre législatif (1834). « Jeu de massacre d’un aspect horrifiant, qui prédispose plus au cauchemar qu’à une gaieté réconfortante ! Ce ne sont que mufles et groins, nez pulpeux, bouches sphincters, yeux caves ou bigles, etc. », en a dit Louis Nazzi. Plus amusant dans sa bonhomie prudhommesque, avec ses apophtegmes arrivistes, est le Jérôme Paturot, de L. Raybaud. L.-Ch. Bienvenu (Touchatout), dans son Trombinoscope, a fouaillé la vulgaire insanité politicienne. La caricature et la satire contemporaines l’ont vigoureusement fouettée dans nombre d’œuvres, notamment dans les numéros de l’Assiette au Beurre intitulés : Monis, marchand de cognac (n° 7 bis), Les Baudin de nos jours (n° 38), L’assiette au beurre municipal (n° 55), Pour être député (n° 56), Têtes de Turcs (n° 61), Les bonnes paroles du camarade Briand (n° 410). De même dans la première série des Hommes du Jour, par Méric et Delannoy.
Mais le politicien se peint lui-même encore mieux que n’importe quelle critique, grâce à l’ingéniosité que lui donne son besoin de paraître, de faire croire à son génie, à sa sincérité, à son dévouement, à tout ce qu’il ne possède pas. On a composé des recueils de ses discours et écrits choisis, ceux de Clemenceau et de Briand entre autres. Il manque ceux de M. Millerand, un des plus complets spécimen du genre, et c’est dommage. Il serait particulièrement édifiant de voir réuni ce que ce verbeux personnage a dit de plus caractéristique, depuis qu’il déclara la guerre au « vieux monde qui trébuche dans la boue et dans le sang », jusqu’au jour où il s’est gavé de cette boue et de ce sang comme président de la République. Comme tout ce qui bourdonne, tout ce qui piaille, tout ce qui se faufile pour être au premier rang devant le photographe, le politicien gesticule, grimace, hurle ; il est partout et l’odieux ne l’arrête pas plus que le ridicule. Il est l’arriviste, le bluffeur, le puffiste de la politique. Il préférerait être mort que de ne pas attirer l’attention sur lui, même pour recevoir des pommes cuites. Il avale toutes les couleuvres, donne dans tous les panneaux, même pour célébrer la gloire du grand poète Hégésippe Simon, ou pour délivrer de la tyrannie le noble peuple des Poldèves, qui n’ont jamais existé ! Il fait fi de tous scrupules, de toute fierté, de tous sentiments qui ne sont pas que verbaux, sauf peut-être dans l’intimité. Quant il a semé la ruine et la misère autour de lui, d’un « cœur léger », il pleure peut-être sur lui-même, comme M. Lechat.
Le politicien n’a pas d’opinion ; il a des appétits et il les promène d’un parti à l’autre dans l’espoir de mieux les satisfaire. Mais il ne sait pas sortir d’un parti « à l’anglaise », discrètement ; il faut qu’il s’en aille avec bruit et explique ce qu’il appelle « reprendre sa liberté d’action et de vote ». Il pratique ainsi l’ostentation du reniement. On n’est pas fier, généralement, d’être un renégat ; mais pour un politicien, c’est un sujet d’orgueil qui lui permet de se montrer dans les journaux sous ses aspects photogéniques les plus avantageux. La Fouchardière a raconté que la collection de M. P. Boncour comprend à cet usage 6.327 clichés aussi rares que curieux !
Le politicien prend les attitudes de dignité bouffonne du Matamore pour dire :
« Jamais nous n’accepterions un mandat impératif. Nous plaçons au-dessus de tout notre conscience et ce que nous considérons être notre devoir. »
Malheureusement, on ne sait jamais où est sa « conscience » et ce qu’est son « devoir », pas plus qu’on ne sait jusqu’où va son « dévouement » à la chose publique. Il a une si sainte horreur des responsabilités qu’il n’a pas même le courage de ses votes ! Il a inventé le « scrutin secret » pour pouvoir soutenir qu’il a voté blanc quand il a voté rouge, et tous les jours la peur de l’électeur lui fait rectifier ce que lui ont fait faire les bonnes combinaisons parlementaires. C’est ainsi que les politiciens manifestent ce que M. Jean Piot a appelé « la rigidité dans l’abandon des principes ». On comprend qu’ils ne veuillent pas de mandat impératif de leurs électeurs !... « Vieilles phrases, vieux mensonges, vieux galons », disait A. Karr, des boniments politiciens. Ils pensent tous comme certain ministre :
« Il y a trente ans, je me serais fait couper en quatre pour mes principes. Aujourd’hui, je coupe mes principes en quatre. »
A-t-on besoin d’avoir des scrupules quand on a tant d’esprit ?
Ces hommes, qui ont une si haute conscience et un si grand sentiment de leur devoir, sont surtout cramponnés au mandat qui les fait bien vivre. Aussi, comme dit La Fouchardière, « avant de voter une loi, ils ne se demandent pas : « Est-ce que c’est utile au pays ? », ils se demandent : « Est-ce que c’est avantageux pour la coterie ? ». » La coterie, c’est le parti qui les soutient, ce sont les camarades sans lesquels ils ne seraient rien. L’ex-prolétaire, l’ex-travailleur qui, dans quatre ans de haute solde municipale, départementale ou législative, à laquelle s’ajoutent tant de profits affairistes, amasse une fortune que ne lui aurait jamais rapportée son métier quel qu’il fût, se révèle un parfait bourgeois. Il n’est pas un Cincinnatus et, lorsqu’il a été blackboulé, il use de tous les moyens pour ne pas retourner à sa « mistoufle » originelle. On ne veut plus voyager et payer sa place en 3es classes dans la vie quand on a « resquillé » en 1res, et on s’accroche à ses prébendes, même si on n’y a plus de titres. Le « peuple souverain » peut avoir signifié à l’ex-député qu’il l’a assez vu. Le parti est là : c’est un syndicat de défense politicienne. Il le fait installer dans une sinécure avantageuse en attendant l’occasion de le faire réélire quelque part. C’est ainsi que d’anciens chambardeurs deviennent chefs dans l’administration, préfets, trésoriers payeurs généraux, ambassadeurs, gouverneurs de colonies, etc. en attendant de se « dévouer » de nouveau pour un mandat électoral. Si l’homme est devenu impossible auprès de ses premiers électeurs, on le patronne dans d’autres circonscriptions. Il ne connaît rien des intérêts locaux qu’il aura à représenter, mais il n’en a pas plus besoin qu’un ministre dans les choses de son ministère. Il y en a qui font ainsi le tour du pays sans trouver à se caser. On en fait alors des sénateurs par les combinaisons du suffrage restreint. Élevés à cette dignité (Senatorum ordinem adipisei, Cicéron), ils sont définitivement garés de la bagarre électorale, au-dessus du forum et du caprice de la foule qui ne les méprisera jamais autant qu’ils la méprisent. Ils planent au rang des dieux ! Il y a ainsi des familles entières pour qui le parasitisme politique est héréditaire, qui se le transmettent de père en fils comme une sorte de droit dynastique. Henry Becque n’entendait rien à la politique lorsqu’il disait :
Sans en attendre rien pour moi. »
Chaque parti politique est la pureté même. C’est toujours chez le voisin que se produisent les collusions immorales. On crie d’autant plus fort contre celles de l’adversaire qu’on fait le silence sur les siennes. « Le propre des hommes de parti est de se soutenir, même sans s’estimer, parce qu’il est moins utile de s’estimer que de se soutenir », dit la morale politicienne. Quand les intérêts des partis différents ne sont pas trop opposés, il y a alors la solidarité politicienne qui joue. M. Caillaux disait devant la Commission d’enquête informant sur l’affaire Oustric :
« J’aurais pu désavouer mon prédécesseur. Je ne l’ai pas voulu ; ce sont des choses que l’on ne fait pas. »
M. Caillaux appellerait un agent de police pour arrêter un pickpocket opérant sous ses yeux la substitution d’un portefeuille particulier, mais il ne dit rien quand le pickpocket s’attaque au portefeuille public. C’est de la morale politicienne. Toute notion d’équité est ainsi complètement faussée au profit des intérêts politiciens ; ils font de la justice une chose absolument circonstancielle. Non seulement il y a une justice de classe, instrument de la lutte de classe, qui multiplie l’illégalité et l’arbitraire contre ses ennemis de classe et pratique une perpétuelle violation de la liberté individuelle, mais il y a une justice de parti, de boutique, de caverne électorale, et elle sévit de plus en plus grâce aux moeurs politiciennes. M. E. Jaloux a écrit, un jour, ceci :
« Un convoi de forçats est parti pour la Guyane. Est-on sûr qu’aucun innocent ne s’y trouvait ? Je déplore seulement que les choses ne deviennent crucifiantes dans ce pays que lorsque la politique et les intérêts de caste s’en mêlent. »
Aux temps de l’affaire Dreyfus, on avait eu l’illusion de l’existence d’un « parti de la justice », de la justice pour tous, où se rencontraient tous ceux qui plaçaient la justice au-dessus de la politique et des intérêts de toutes les castes. La Ligue des Droits de l’Homme avait été formée pour cette défense supérieure de la justice... Elle est aujourd’hui débordée par le flot de l’iniquité toujours triomphante, qui vient de gauche comme de droite, et de tous les partis, hostiles ou indifférents, qui font la « conspiration du silence » autour de ses appels. La politique de toutes les nuances entasse ainsi scandales sur scandales. Pendant qu’un Roussenq expie au bagne, depuis vingt-cinq ans, le « crime » d’avoir brûlé un jour un pantalon militaire, des individus que la chronique judiciaire classe parmi les « malfaiteurs dangereux », échappent aux tribunaux ou ne subissent pas leurs peines parce qu’ils sont des parents, des amis, des courtiers électoraux, des gardes du corps, « nervis » et matraqueurs de réunions publiques, de politiciens influents. Ceux-ci, suivant les circonstances, exhalent le « dégoût de leur conscience » à propos de certaines affaires comme celle du professeur Moulin ; ils gardent allègrement ce dégoût en eux, et pendant des années, à propos d’autres affaires, celles du docteur Boutrois, du capitaine Moirand, du professeur Platon, et de cent autres. Dans l’affaire du professeur Platon, les plus « hautes consciences » de son propre parti se taisent systématiquement depuis huit ans, alors qu’elles savent que ce professeur a été condamné par ordre !... Derrière toutes les iniquités sociales, il y a des partis et des politiciens qui en profitent. Les partis réactionnaires ne voulaient pas, il y a trente ans, que le capitaine Dreyfus fût reconnu innocent ; les partis démocratiques ne veulent pas, aujourd’hui, que le professeur Platon soit innocenté. Et tous les politiciens de gauche ou de droite ne veulent pas qu’il existe une justice sociale à laquelle, les premiers, ils auraient à rendre des comptes !
Mais tout cela ne compte pas pour le sot électeur, tout cela est emporté dans le flot boueux du battage électoral, de la parade des tréteaux qui enlèvera ses suffrages à l’esbroufe. On voit alors « l’honnête » Bertrand dénonçant le « malhonnête » Robert Macaire et tous les « Requins » qui sont à la direction des affaires publiques, « dans la tourbe des politiciens d’affaires » — y en aurait-il qui seraient hors des affaires ? — « qui spéculent sur l’ignorance publique... dans l’armée des aventuriers au service de la classe dirigeante » ; et il fait le geste de se boucher le nez en parlant de « la bourgeoisie heureuse et payeuse qui ne regarde pas la propreté du linge de ses laquais ». La foule, d’abord méfiante, applaudit bientôt à tout rompre, d’autant plus que ça se termine par l’Internationale. « Quel brave homme ! » dit-elle, « quel candidat honnête ! Celui-là n’a certainement pas la chemise sale. Il sera mon député. » Et dans la coulisse Bertrand et Robert Macaire se congratulent, échangeant leurs chemises, puis ils vont retrouver un autre « honnête homme », le baron de Wormspire qui leur fait manger la bouillabaisse avec des princesses de théâtre. La suite, ce sera une bonne loi que présentera Robert Macaire, que Bertrand laissera voter sans rien dire, et qui permettra à Wormspire de retenir comme amendes le quart du salaire des serfs de ses usines et de ses bureaux. (Loi votée en février 1932 et contre laquelle la Confédération Générale du Travail a protesté).
Le peuple dîne un peu moins »,
chantent les « ventrus » de 1932 comme ceux de 1818 ; et si le brave électeur crie qu’il est volé par tous ces « honnêtes gens », Robert Macaire déchaîne ses « flics » contre lui pendant que Bertrand chante à la cantonade :
J’ai prouvé l’utilité. »
Léon Werth a constaté que, chez les politiciens, « rien ne s est incarné... la politique en eux n’est pas chair et sang ». En effet, elle n’est que digestion. Werth a ajouté :
« Ils se réunissent en des déjeuners corporatifs. Il y a une règle du jeu. Pas même au dessert — et pas plus qu’à la Chambre — on n’évoque la Homs Bagdad et la N’Goko Sangha. »
C’est ce qui permet d’écrire, à l’usage des bonnes poires militantes du parti, des brochures furibondes contre les « Requins », pendant que les chefs déjeunent avec ces requins ! La brochure c’est « l’indéfectible affirmation marxiste » — sans rire, — les déjeuners, c’est « l’alliance républicaine ». La veille des élections, on se souvient qu’il y a des révoqués de 1920 qu’il faudrait faire réintégrer par les Compagnies de chemins de fer. Tous les partis jurent d’exiger d’exiger cette réintégration. Le lendemain des élections, tous l’oublient. On en reparlera aux prochaines élections, et on en reparlera encore quand les derniers révoqués seront morts. C’est ainsi que les politiciens donnent la lune à leurs électeurs, comme disait le père Peinard.
Terminons en constatant que c’est à la Guerre — « régénératrice », selon M. Bourget — de 1914, que l’on doit, avec le naufrage définitif de la démocratie dans l’ochlocratie, le débordement de boue politicienne de l’heure. C’est elle qui a amené l’avènement à la politique de la bande à Thénardier échappée à ses bouges, ses ghettos, ses maquis, pour la curée des centaines de Waterloo de la « Victoire » dans le monde entier. Thénardier disait, aux temps calamiteux de la rue Blomet : « Oh ! je mangerais le monde ! » Il est en train de le manger et, avec lui, sortis comme des rats des égouts électoraux, toute la troupe des Babet, Gueulemer, Claquesous, Montparnasse, Demiliard, Mardisoir, Barrecarrosse, Poussagrive, Carmagnolet, Poussedentelle, et tous les autres dont V. Hugo a conté la vermineuse épopée. Ils s’épanouissent aujourd’hui dans des emplois de « faisans », de « gangsters », de « rufians », de « topazes », de « nervis », de « resquilleurs » politiciens, dans les assemblées politiques, dans les Conseils d’administration des sociétés industrielles et financières, dans la presse, dans tous les lieux où l’on a des invitations pour les « bons dîners » des ministres. Dans la domesticité opulente des Zaharof, des Déterling, des Rothschild, des Kreuger, des Ford, des Bata et autres « Maîtres du Monde », Gueulemer est devenu Gueule-en-Or et Demiliard s’est métamorphosé en Deux-Milliards. Thénardier, promu président du Conseil, renouvelle l’Histoire des Treize avec son état major. Il y a bien, de temps en temps, quelque accrochage. Un copain fait le plongeon pour avoir signé trop de chèques sans provision ; d’autres s’effondrent dans des aventures de Gazette du Franc ; la prison de la Santé devient trop petite pour hospitaliser tous les compères, plus truffés les uns que les autres de « Légion d’honneur », qui ont « protégé » l’épargne publique en la faisant passer dans leurs poches. Mais ces choses arrivent même aux grands patrons, aux Kreuger par exemple, qui finissent par le suicide. On a l’habitude ; ce sont les risques du métier et ils sont moins graves depuis que les caresses de la « Veuve » ne sont plus que pour les pauvres « cavés », les anormaux primaires et les vagabonds. Dieu merci ! Il n’y a plus de rois pour faire accrocher les Semblançay à la potence, et de sans-culottes pour reprendre aux antiquailles les piques de Foulon et de Berthier.
La Ligue des Droits de l’Homme perdra son temps si elle veut guérir le parlementarisme de la lèpre politicienne qui le ronge aujourd’hui jusqu’à l’os. Ils finiront ensemble, avec le régime d’imposture démocratique qui les a engendrés.
— Edouard ROTHEN.
POLYTHÉISME
n. m. (du grec : polus, nombreux ; theos, dieu)
Le polythéisme, ou culte de plusieurs dieux, est antérieur au monothéisme, ou culte d’un dieu unique, mais lui-même n’est pas apparu dès les tout premiers temps de l’humanité, ainsi qu’on le prétend d’ordinaire. Armand de Quatrefages professait que la religiosité constitue, avec la moralité, la caractéristique essentielle de la race humaine, du règne humain, comme il disait, voulant marquer par là que :
« L’homme est distinct des animaux au même titre que ceux-ci sont distincts des végétaux. »
Pourtant notre espèce n’a pas échappé à la loi d’évolution ; et de longs siècles furent nécessaires avant qu’elle puisse se poser les problèmes qui donnèrent naissance aux religions. A l’époque moustérienne, on inhumait les cadavres ; de plus, leur attitude repliée indiquerait, dit-on, l’existence d’un rite, la croyance à la vie future. Admettons-le ; mais bien des milliers d’années s’écoulèrent avant d’en arriver là. Aux époques chelléenne et acheuléenne, on ne trouve rien de pareil. Certains animaux enterrent leurs compagnons défunts ou les couvrent de branchages ; beaucoup tremblent devant la mort ; aucun indice ne permet d’affirmer que l’idée de survie hante leur cerveau. La religion apparut lorsque l’homme s’interrogea sur son origine et sa destinée, lorsqu’il chercha une explication aux phénomènes de la nature. Ce qui exigeait une évolution cérébrale déjà très avancée. Ne pouvant rien comprendre aux forces cosmiques et à l’inflexible déterminisme de leurs lois, il peupla l’univers d’esprits semblables au sien, mais plus puissants. Alors naquit le polythéisme qui, malgré les prodigieux succès du monothéisme (voir ce mot), continue de régner aujourd’hui sur une notable partie du globe. Le fétichisme des sauvages actuels témoigne d’un état d’esprit voisin de celui des hommes primitifs. Dans l’ancienne Egypte, corps célestes, plantes, animaux, etc., prenaient forme de dieux, tant l’animisme demeurait un penchant essentiel de l’âme populaire. Chats, ibis, chacals, éperviers, crocodiles, scarabées étaient sacrés ; le culte du taureau Apis, à Memphis, et celui du bouc de Mendès sont restés fameux. Le taureau Apis devait être noir, avec un triangle blanc sur le front, une marque ressemblant à un vautour les ailes étendues sur le dos et, sur la langue, un signe en forme de scarabée. Des prêtres le nourrissaient soigneusement et l’honoraient comme un dieu. Sa mort était un deuil national. Parmi les divinités à forme humaine, plusieurs avaient une tête d’animal, souvenir certain de leur nature primitive. Même des arbres, même d’humbles végétaux furent considérés comme sacrés. L’anthropomorphisme triomphera plus tard ; mais les Egyptiens juxtaposeront les divers cultes adoptés successivement par eux, sans chercher à les fondre ensemble ou à les relier par un lien logique. D’où l’inextricable chaos de leurs croyances théologiques. Une hiérarchie finit par s’établir entre les dieux ; Horus, Râ, Osiris passèrent au premier plan ; AmmonRâ jouit d’une grande vogue sous le règne d’Aménophis IV ; Sérapis devint le dieu principal à l’époque des Ptolémées. Nos pudeurs actuelles étaient inconnues de ces religions anciennes ; et le phallus, symbole de l’éternelle fécondité de la nature, faisait l’objet d’un culte qui s’étalait au grand jour. Des figures, dont l’organe viril n’était guère moins important que le reste du corps, étaient portées triomphalement dans certaines cérémonies. On faisait saillir les femmes stériles par le bouc sacré de Mendès. « Cet animal étant fort enclin aux actes de Vénus, écrit Diodore de Sicile, on jugea que son organe, qui était l’instrument de la génération, méritait d’être adoré, parce que c’est par lui que la nature donne naissance à tous les êtres. » Assemblage de cultes locaux disparates, la religion du peuple égyptien manifesta des tendances vers le monothéisme, mais n’y aboutit jamais.
Les Assyriens ont connu des dieux animaux, mais c’est dans les astres qu’ils plaçaient leurs divinités essentielles. Samas régnait dans le soleil, Sin dans la lune, Adar dans Saturne ; dans Jupiter habitait Marduk, dans Mars Nergal, dans Vénus la déesse Istar, dans Mercure Nébo ; Bin commandait aux tempêtes et aux orages. Aux environs de 860 avant notre ère, un roi assyrien comptait plus de 7.000 dieux petits ou grands. Ils étaient groupés par trois, chaque dieu ayant pour épouse une déesse qu’il fécondait. Le premier souverain de la Babylonie unifiée, Hammurabi, plaça Marduk à la tête des autres dieux. Il prétendait en avoir reçu un code de lois, que l’on a retrouvé à Suse et qui ressemble beaucoup au code mosaïque. Mais comme Hammurabi a vécu six siècles avant Moïse, c’est ce dernier qui l’a plagié. Sur bien des points, la Bible s’est d’ailleurs inspirée des traditions assyriennes ; ainsi, concernant le déluge. Furieux contre les hommes, les dieux décident qu’ils périront par l’eau, sauf Unnapishtin et les siens qui construisent une arche et s’y enferment. L’eau tombe d’une façon effrayante ; et l’arche s’arrête sur une montagne au bout de sept jours. Une colombe, puis une hirondelle lâchées par Unnapishtin, ne trouvant de terre ferme nulle part, reviennent ; un peu plus tard, un corbeau part et ne reparaît point. Le Noé assyrien quitte l’arche et offre un sacrifice aux dieux. Antérieure au récit biblique, cette fable fut admise par les juifs, qui se bornèrent à la modifier en l’adaptant au monothéisme. Au dire des prêtres babyloniens, les astres exerçaient une profonde influence sur la destinée des hommes ; leur inspection permettait en conséquence de prévoir l’avenir. D’où l’astrologie qui, de nos jours encore, compte des partisans.
Le culte phénicien, qui s’adressait à une multitude de dieux locaux, fut particulièrement cruel, On immolait des enfants les jours de fête ou pendant les épidémies, les disettes et les autres calamités publiques. Engraissés au préalable, ils étaient suppliciés sous les yeux de leur mère qui devait s’abstenir de pleurer. Afin d’accroître les douleurs des victimes, on les traînait entre deux feux à l’aide de cordes mouillées ; plus tard on les brûla dans des statues métalliques. Pour s’assurer la bienveillance divine, des parents n’hésitaient pas à faire mourir leur unique enfant ou leur premier-né dans des souffrances atroces ; les époux sans postérité achetaient les enfants de parents pauvres pour les offrir au moloch odieux. A Carthage, qui fut fondée par des phéniciens comme on le sait, un chef de révoltés fit crucifier son fils afin de se rendre la divinité favorable. Deux cents enfants, désignés par le sort et appartenant aux principales familles, furent brûlés, quand Agatocle assiégea la ville ; de plus, trois cents personnes s’offrirent en holocauste. Le Moloch carthaginois était une statue d’airain ; grâce à un mécanisme spécial, ses bras se relevaient, précipitant la victime dans une fournaise intérieure. En d’autres régions, on enfermait l’adulte ou l’enfant dans une statue d’airain chauffée au rouge. Des danses et des chants avaient lieu, avec accompagnement d’instruments de musique, pour couvrir les cris du malheureux qui agonisait. A côté des baals et des molochs, il y avait d’autres dieux moins féroces : citons Astarté, l’Aphrodite des Grecs, et Adonis, jeune et beau chasseur, que les femmes pleuraient, chaque année, le jour anniversaire de sa mort. Parmi les modernes, plusieurs refusent d’ajouter foi aux récits de Diodore et pensent que le sacrifice des enfants ne consista, de bonne heure, qu’en un simulacre, en une comédie rituelle. Espérons qu’ils disent vrai ; mais les religions ont provoqué tant de crimes que le contraire, hélas ! est loin d’être impossible.
Le panthéon brahmanique, à l’époque des Védas, était composé de dieux personnifiant les forces naturelles. Au nombre de 33, et ignorant toute hiérarchie, ils régnaient les uns au ciel, d’autres sur la terre, d’autres dans la région intermédiaire. Les grands dieux de l’Inde actuelle ne jouaient pas un rôle important. Aujourd’hui, dieux et déesses pullulent au pays de Gandhi. Vishnou et Siva sont honorés sous mille formes ; mais Brahma, la première personne de la trinité hindoue, n’est pas populaire, c’est un dieu trop métaphysique. D’incroyables superstitions, un culte désordonné, des extravagances de toutes sortes rendent l’hindouisme aussi ridicule et aussi odieux que n’importe quelle autre religion. Il faut, chez les théosophes, une forte dose d’ignorance ou d’aveuglement pour prendre au sérieux ces folies orientales. Et l’on peut douter de la bonne foi de ceux qui, ayant étudié sérieusement l’Inde brahmanique, osent nous l’offrir en modèle. De Dieu, le Bouddha Sakyamouni ne se préoccupa jamais ; peut-être n’y croyait-il point. Mais ses fidèles ont donné, de bonne heure, dans les pires extravagances du polythéisme. Relativement raisonnable en Chine, le bouddhisme a multiplié au Tibet les incarnations divines. Avec son pape, ses moines, son clergé, ses nombreuses pratiques de dévotion, le lamaïsme ressemble fort au catholicisme romain. Ces analogies ont fait croire à plusieurs que le christianisme devait beaucoup à la religion de Bouddha ; on a même parlé d’un séjour de Jésus dans l’Inde et exhumé de prétendus documents relatifs à son voyage et à son retour en Judée. Un manuscrit en langue pali aurait été découvert qui porte cette phrase sur le premier feuillet :
« Ici ont été confiés à l’écriture les rapports faits par des marchands venus d’Israël et les résultats d’une vaste enquête faite par nous, disciples de Bouddha Gauthama, sur le Saint Issa crucifié en Judée il y a quatre ans par le Gouverneur Pilate du pays des Romèles. »
La crédulité des théosophes étant inépuisable, les mystificateurs se permettent les plus bizarres fantaisies. Ces pieux mensonges rappellent ceux des premiers chrétiens ; mais nul homme réfléchi ne s’y laisse prendre. Les ressemblances constatées entre la vie de Bouddha et celle de Jésus portent seulement sur des légendes tardives ; l’on n’a pu, jusqu’à présent, en tirer des conclusions sûres.
En Gaule, le mystère qui entourait la religion et la défense faite aux druides de rien écrire sur leur doctrine et leurs cérémonies cultuelles, empêchèrent longtemps d’approfondir les croyances sacerdotales. A l’origine, les Gaulois adoraient les grandes forces naturelles : Belon, le soleil, Belisana, la lune, les montagnes, les grands arbres, les fleuves, etc. Ensuite ils peuplèrent le globe d’esprits ou de génies et imaginèrent tout un monde de nains, de fées, de korrigans. Alors apparurent les principaux dieux gaulois : Teutatès qui conduit les âmes des morts, Esus qui remplit d’horreur la profondeur des forêts, Eporia, la protectrice des chevaux, Borvo, Sirona qui président aux eaux thermales, etc. Au-dessus des divinités locales, les druides plaçaient un être suprême, dont la connaissance était réservée à un petit nombre d’initiés. On ne trouvait ni temples, ni statues ; mais l’on offrait à ces dieux irascibles les dépouilles des vaincus ou des victimes humaines. Recrutés parmi l’élite de la jeunesse, les druides faisaient, au préalable, un apprentissage d’une vingtaine d’années. Isolés du monde, ils apprenaient des milliers de vers qu’ils devaient retenir de mémoire. Le chef des druides, nommé à vie, était choisi par voie d’élection. Parmi les fêtes, celle de la cueillette du gui, qui avait lieu le sixième jour de la lune d’hiver, était particulièrement solennelle. Au-dessous des druides proprement dits venaient les eubages, sorciers qui fabriquaient des amulettes et guérissaient les maladies, puis les bardes, assez peu considérés, qui chantaient des poèmes sacrés. Les druidesses disaient la bonne aventure et entretenaient les superstitions populaires.
Comme César parlant des Gaulois, Tacite, parlant des Germains, identifie leurs dieux avec ceux de Rome. Il en cite trois : Mercure, Hercule et Mars. Mercure n’était autre que Vodan ou Odin, le plus fameux des dieux de Germanie. Les légendes lui prêtaient des mœurs guerrières et de nombreuses aventures ; chasseur féroce, c’est lui qui entraînait au Walhalla ou paradis les âmes des guerriers tués sur le champ de bataille. Là encore ils continuaient à se battre et à boire la cervoise ou l’hydromel dans le crâne de leurs victimes. Hercule se confondait avec Thor, le dieu du tonnerre, qui faisait entendre sa voix puissante au milieu des orages. Pour ce motif, Thor sera parfois confondu avec Jupiter. Le Mars germain était Tyr, fils d’Odin, qui avait pour symbole une épée plantée en terre. Parmi les déesses, citons Fraya, la Vénus du Nord, Hertha, la terre nourricière, Holda, la vigoureuse chasseresse. Le panthéon des germains était abondamment peuplé ; en outre ils supposaient la nature pleine d’esprits, elfes et trolls. Dans les montagnes habitaient des géants et des nains, dans les eaux des nixes, dans la mer un démon femelle Ran. Tout arbre avait son génie ; le culte des rivières et des fontaines était très populaire. On ne trouvait ni temples, ni caste sacerdotale ; les sacrifices étaient offerts par le chef de la famille et par le chef de la cité. Sorciers, devins, prophétesses ne manquaient pas : les femmes surtout passaient pour jouir de dons magiques. En 70, la prophétesse Velléda parvint à soulever les Bataves contre les Romains.
Les mythologies grecques et romaines sont trop connues pour que nous insistions. Très nombreuses, les divinités grecques avaient un visage et un corps humains ; elles étaient douées des vertus et des passions habituelles aux hommes. Grâce aux poètes et aux artistes, la religion primitive s’était modifiée de bonne heure, pour faire place à l’anthropomorphisme. Pourtant le totémisme laissa de nombreux vestiges, et les dieux ou déesses habitaient l’Olympe, une haute montagne du nord de la Grèce. C’étaient Zeus, le roi des hommes et des dieux, Héra, son épouse et sa sœur, Apollon, le maître du soleil, Poséidon qui commandait aux eaux et à la mer, Arès, le dieu des combats, Héphaïstos, le forgeron, Hermès, le messager céleste, Athéna, la déesse de la sagesse, Aphrodite, la reine de l’amour, Vesta, la gardienne du foyer, Déméter, la protectrice des moissons, Artémis, la déesse de la lune. Les Grecs honoraient beaucoup d’autres dieux, Hadès, le roi des enfers, Dionysos, le protecteur de la vigne, etc., ainsi que des divinités de moindre importance : muses, nymphes, faunes, néréides et tritons. Des héros ou demidieux, fils d’une mortelle et d’un dieu, étaient en outre admis dans l’Olympe : par exemple Hercule, Persée, Bellérophon, les deux frères jumeaux Castor et Pollux. Les Grecs possédaient des sanctuaires ; et quelques-uns, en particulier ceux de Delphes, d’Olympie, de Délos, jouissaient d’un renom prodigieux. Fort tolérants en matière théologique, dans l’ensemble, les hellènes persécuteront, néanmoins, Anaxagore parce qu’il doutait des dieux ; ils tueront Socrate qui les raillait. Nous avons parlé ailleurs de la religion romaine (voir Paganisme) et nous avons montré comment elle se transforma sous l’influence de la mythologie grecque.
Trois religions monothéistes, le Judaïsme, le Christianisme, le Mahométisme, triompheront plus tard des cultes polythéistes, dans maintes régions du globe. Elles n’ont pu les faire disparaître complètement ; c’est par centaines de millions que se comptent encore les partisans du Bouddhisme, du Brahmanisme, du Fétichisme. Et, si l’on examine attentivement les dogmes chrétiens, ceux du catholicisme en particulier, on y découvre de nombreux vestiges du polythéisme. Dieu est unique, mais on le suppose composé de trois personnes ; l’adoration du pain eucharistique rappelle le culte des anciennes idoles ; la communion, qui consisterait, d’après les fidèles, à manger la chair de Jésus, fut comparée, avec raison, par Saint Cyrille, à un banquet de cannibales. De son côté, Saint Augustin déclare « que dévorer cette chair paraît plus affreux que de tuer un homme ». Comme la pâque juive, qu’elle a continuée en la transformant, la pâque chrétienne découle en droite ligne des vieilles croyances totémiques. Pour leur avoir dit ce que je pensais de l’eucharistie, un jour de première communion, les prêtres espagnols, saisis de colère, ordonnèrent des prières expiatoires et me dénoncèrent aux tribunaux. Ils ne purent m’accuser d’avoir falsifié les textes des Pères de l’Eglise qui démontraient l’exactitude de ma conception.
— L. BARBEDETTE.
POPULATION
Ensemble des habitants d’une agglomération, d’une contrée, de la terre. Même si l’on ne considère que le nombre des humains, que leur répartition, leurs migrations et, en général, que les faits statistiques de l’anthropogéographie, la question de population est une des plus vastes qu’on puisse examiner.
C’est une des plus graves, et peut-être la plus grave, si on l’envisage du point de vue physiologique, psychologique, économique et social. Il s’agit alors des deux grands actes de l’existence, vivre et se reproduire. C’est alors une question biologique, la suprême question du développement de la vie humaine à la surface du globe.
A la vérité, jamais les potentats ne se sont intéressés autrement à la population que pour l’accroître d’une façon hasardeuse, sans se soucier de savoir si cet accroissement pouvait provoquer et entretenir le malheur des sujets.
Sauf chez les Grecs, on ne rencontre nulle part, à aucune époque, ni dans la littérature, ni dans l’histoire, ni chez les philosophes, encore moins, si possible, dans les codes, la moindre indication d’une règle limitant le nombre des membres d’un groupement, ni le moindre doute quant à cette idée que, pour la prospérité d’un pays, il est indispensable que s’accroisse sans arrêt le nombre de ses habitants.
Platon opine cependant que l’on doit « arrêter ou encourager la propagation » selon le besoin, « par les honneurs, la honte et les avertissements des vieillards ». Il veut même, dit Montesquieu, « que l’on règle le nombre des mariages de manière que le peuple se répare sans que la république soit surchargée » (Lois, liv. V). Il prescrit expressément que le « nombre des maisons et des lots de terre ne dépasse jamais cinq mille quarante, comme celui des guerriers » ! Quand au nombre des enfants il dit qu’en cas de surabondance, on peut « interdire la génération ou favoriser l’émigration ».
Aristote, selon Montesquieu, exprime que « si la loi du pays défend d’exposer les enfants, il faudra borner le nombre de ceux que chacun doit engendrer », que « si l’on a des enfants au-delà du nombre défini par la loi il faut faire avorter la femme avant que le fœtus ait vie » (Politique Liv. V).
Aristote dit encore :
« C’est un grand tort, quand on va jusqu’à partager les biens en parties égales de ne rien statuer sur le nombre des citoyens, et de les laisser procréer sans limite, s’en remettant au hasard pour que le nombre des unions stériles compense celui des naissances, quel qu’il soit, sous prétexte que, dans l’état actuel des choses, cette balance semble s’établir tout naturellement. Il s’en faut que le rapprochement soit le moins du monde exact… Le parti le plus sage serait de limiter la population et non la propriété, et d’assigner un maximum qu’on ne dépasserait pas, en ayant à la fois égard, pour le fixer, et à la proportion éventuelle des enfants qui meurent, et à la stérilité des mariages... S’en rapporter au hasard, comme dans la plupart des états serait une cause inévitable de misère dans la république de Socrate ; et la misère engendre les discordes civiles et les crimes... »
Aristote va jusqu’à permettre l’abandon et l’avortement.
Mais ce ne sont là que des vues théoriques. Toutes les lois anciennes et modernes cherchent à multiplier les mariages pour accroître la population. On connaît l’effort d’Auguste, par les lois Julia et Papia Poppea, en vue de combattre le célibat et la diminution du nombre des citoyens romains.
Le christianisme, un moment, réagit, en dehors de toute préoccupation économique, contre les encouragements au mariage. Partant d’un principe religieux, moral, saint Paul recommanda le célibat. Il ne resta guère des conseils d’abstinence de l’église catholique primitive que la pratique du célibat chez les prêtres, que les anathèmes dom elle frappa, notamment au concile de Trente l’opinion que l’état conjugal doit être préféré à l’état de virginité ou de célibat. En fait l’Eglise impose le célibat aux prêtres parce qu’il est une force pour sa défense et sa domination, pour La propagation de la foi. Mais elle a toujours provoqué la multitude au mariage, à la procréation et a fait une loi aux fidèles du cresette et multiplicamini. Les prêtres, les écrivains catholiques, casuistes ou non, par tous les moyens, y compris la confession ont poussé à la reproduction irréfléchie, à l’accroissement humain désordonné.
La littérature du moyen âge, la littérature moderne ne semblent pas avoir émis de profondes remarques sur la population. Les documents précis sur le nombre des hommes font défaut dans les ouvrages courants d’histoire ancienne, d’histoire du moyen âge et des temps modernes. Peut-être les érudits pourraient-ils éclairer sur ce point les chercheurs ? Sans doute trouverait-on qu’au cours des siècles les famines, les guerres, la misère permanente ont eu pour grande cause occulte et originelle un surcroît continuel de population par rapport aux produits. Si j’en crois Rambaud, par exemple, un des rares historiens qui aient eu quelque intuition de l’importance de cette question, les politiques ecclésiastiques du moyen âge semblent avoir préconisé l’idée de déverser sur d’autres pays le trop plein des populations de l’ouest européen, Les Croisades n’auraient été que la mise à exécution d’un plan d’émigration en masse. C’est au moins ce que laisse supposer un passage de la prédication du pape Urbain II au concile de Clermont où fut prêchée la première Croisade. Le pape exprima cette idée presque dans les mêmes termes que les économistes et les politiques actuels invitant les déshérités d’Europe à chercher fortune dans le nouveau monde ou aux colonies australiennes et africaines :
« La terre que vous habitez, disait Urbain II, cette terre fermée de tous côtés par des mers et des montagnes, tient à l’étroit votre trop nombreuse population ; elle est dénuée de richesses et fournit à peine la nourriture de ceux qui la cultivent. C’est pour cela que vous vous déchirez et dévorez à l’envi, que vous vous combattez, que vous vous massacrez les uns les autres. Apaisez donc vos haines et prenez la route du Saint-Sépulcre... »
Quoi qu’il en soit, il semble que la question de population n’a pris, dans les préoccupations des hommes d’état et des philosophes, une place assez importante que vers le XVIIIe siècle.
Sauf des aperçus superficiels et ingénieux chez Vauban, par exemple, au XVIIe siècle, et toujours dans le sens de l’accroissement, il faut arriver à Mirabeau le père, à Quesnay, Adam Smith, Arthur Young, Dugald Stewart, au moine vénitien Ortes, à l’anglican Townsend, à bien d’autres, pour trouver des vues fugitives, des intuitions incomplètes sur la question.
Ce fut Malthus qui étudia le plus profondément le sujet et émit, le premier, des principes dont l’importance est telle qu’aujourd’hui encore ne sont pas closes les discussions qu’ils ont suscitées. Les recherches et les conclusions de cet économiste tendaient à démontrer, et, à mon sens, démontraient, que tout accroissement dans le chiffre de la population, que ne précède pas ou n’accompagne pas un accroissement correspondant des moyens de subsistance, ne peut engendrer que la misère, la guerre, un accroissement de la mortalité. Selon lui la difficulté ne consiste jamais à mettre au monde des êtres humains, mais à les nourrir, à les vêtir, à les loger comme il faut, à les élever lorsqu’ils sont nés. Réagissant contre le fameux aphorisme de J.-J. Rousseau, adopté, prôné par de nombreux disciples : il n’est pire disette pour un état que d’hommes, Malthus démontra qu’en tout lieu l’espèce humaine s’accroît tant que la multiplication n’est pas arrêtée par la difficulté de pourvoir à sa subsistance et par la pauvreté d’une portion de la société, et que, en conséquence, au lieu de favoriser l’accroissement on doit plutôt s’efforcer de le limiter, de le régler.
Nous n’analyserons pas ici son ouvrage, pas plus que les déductions qu’en ont tirées les purs malthusiens et les néo-malthusiens. On aura des vues sur ce point aux articles Malthusisme et Néo-Malthusisme, Naissances, Natalité, Eugénisme, etc. de cette encyclopédie. Nous nous bornerons à considérer la population au point de vue statistique laissant à chacun le soin de rechercher les causes dont les faits chiffrés découlent, sans envisager davantage les conséquences. Tout au plus feronsnous quelques remarques à la fin de cet article, et suggèrerons-nous une étude méthodique, arithmétique, sur la population et les subsistances.
Ceci dit, quel est le nombre des hommes qui ont peuplé aux différentes époques, et qui peuplent aujourd’hui, notre planète ?
Dans les pays à recensements périodiques, comme la plupart des contrées européennes, quels que soient les erreurs, les omissions, les doubles emplois, le chiffre de la population est assez exactement connu. Mais partout ailleurs les évaluations remplacent les recensements et les chiffres, alors, varient quelquefois dans de fortes proportions. C’est ainsi, par exemple, qu’avant le premier recensement qui fixa la population de Madagascar à 2.500.000 habitants on l’évaluait diversement de 1 million à 6 millions d’habitants.
Pour la terre entière aux diverses époques les évaluations ont été fort différentes. En 1660, Riccioli évaluait la population de la terre à 1 milliard d’habitants. Süssmich, en 1742, indique le même chiffre. Voltaire donne 1 milliard 600 millions en 1753, et Volney cinquante ans plus tard, seulement 435 millions. C’est vers 1830–40 que l’on commence à avoir des chiffres moins fantaisistes. Bernoulli et Omalius d’Halloy évaluent à cette époque à 800 millions d’habitants la population de la terre, Kolb, en 1868, indique 1.250 millions, Bebm et Wagner, en 1882, 1.450 millions environ.
| 1880 | 1900 | 1910 | 1930 | |
|---|---|---|---|---|
| Europe | 328 | 420 | 450 | 530 |
| Asie | 800 | 850 | 800 | 1000 |
| Afrique | 110 | 130 | 140 | 145 |
| Amérique | 100 | 160 | 175 | 150 |
| Océanie | 5 | 5 | 6 | 10 |
| Monde | 1.343 | 1.565 | 1.571 | 1.935 |
On remarquera l’incertitude des chiffres pour l’Asie, notamment. C’est que, l’Inde et le Japon exceptés, les contrées de cette partie du monde sont sans recensements. Les chiffres de 1930 sont ceux, arrondis, de la Société des Nations (Annuaire Statistique 1930–31).
| HABITANTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 1930 | ||||
| Superficie en milliers de km² | En millions | Par km² | En millions | Par km² | |
| Afrique | 28.890 | 130 | 4,4 | 145 | 4,9 |
| Amérique | 40.945 | 160 | 3,9 | 250 | 6 |
| Asie | 41.970 | 850 | 20 | 1.000 | 25 |
| Europe | 11.425 | 420 | 36,6 | 530 | 46,5 |
| Océanie | 8.560 | 5 | 0,5 | 10 | 1,1 |
| Monde | 131.820 | 1.565 | 11,8 | 1.935 | 15,2 |
On voit que la population du globe s’accroît, que les lamentations sur la dépopulation sont vaines et ne peuvent en tout cas être prises en considération que par ceux qui regardent comme nécessaire la concurrence, la lutte, la guerre et toutes les misères qui s’en suivent.
À la question de population se rattache celle des subsistances. Y a-t-il assez de subsistances pour tous ? La presque unanimité des militants révolutionnaires répond affirmativement avec la plus grande assurance. Je ne suis point de cet avis. Je pense, au contraire, que les progrès agricoles, les progrès industriels, ceux des transports, etc., n’ont pas apporté à une humanité, sans cesse croissante, le bien être qu’elle attendait d’un développement prodigieux de la technique et j’avance que, dans l’hypothèse d’un partage équitable, la part individuelle serait insuffisante. Mais cette question, comme la précédente, sera sans doute traitée au mot subsistances.
— Gabriel HARDY.
POSITIVISME
n. m.
Le terme « positivisme » désigne deux choses bien différentes. Il s’applique au système particulier d’Auguste Comte, mais il convient également à une disposition d’esprit, à une méthode de recherche bien antérieures au comtisme. En ce dernier sens, le positivisme se confond avec l’esprit scientifique ; il implique le rejet des creuses spéculations, qui ne s’appuient point sur l’expérience, et un goût prononcé pour les faits observables. Ainsi compris, il s’inspire d’une tradition scientifique déjà longue, sans qu’aucun philosophe puisse se targuer d’en être l’inventeur. Nous lui devons les merveilleuses découvertes qui ont transformé le monde contemporain. Rénovateur de la mentalité humaine, trop longtemps prisonnière des [mythes religieux, ce positivisme là mérite qu’on le développe et qu’on l’encourage. Lui seul permettra à. la morale et à la métaphysique de quitter l’ornière traditionnelle, où elles pataugent, pour réaliser des progrès sérieux. Depuis des années, je le répète, sans avoir pu convaincre les pontifes officiels, cela va sans dire. Le positivisme que ces derniers acceptent, c’est celui d’Auguste Comte voulant instaurer une morale et une religion qui n’ont rien de positif, quoique l’auteur assure le contraire. Ils trouvent également fort commode la distinction établie par le philosophe et ses disciples entre les réalités connaissables et celles qui ne le sont pas : l’inconnaissable servant de refuge aux plus sottes croyances de nos pères. Ce positivisme n’est pas le nôtre ; néanmoins nous saurons reconnaître ses mérites, car il marque une étape, sans doute indispensable, vers une philosophie devenue scientifique, non plus dans sa terminologie seulement, mais pour de bon.
Dans la loi des trois états, Auguste Comte a indiqué, de façon heureuse, la marche générale de l’esprit. humain. L’homme primitif et l’enfant expliquent les phénomènes naturels par des volontés analogues à la nôtre. Ils peuplent le monde de divinités capricieuses, dont l’action engendre et les événements qui nous favorisent et ceux qui nous affligent. C’est l’époque théologique, où triomphent l’animisme et l’anthropomorphisme. Aux divinités l’on substitue plus tard des entités occultes, des forces cachées qui résident dans les choses elles-mêmes et provoquent des effets que l’on peut prévoir d’avance. La physique du moyen âge fournit un bon exemple de ce genre d’explication. C’est à sa vertu calorifique que le feu doit de l’échauffer, à sa vertu dormitive que l’opium doit de faire dormir ; et si l’eau monte dans un corps de pompe, c’est que la nature a horreur du vide. Dans cette période métaphysique, l’action des forces occultes est du moins conçue comme uniforme ; l’univers paraît soumis à des lois fixes. Enfin la cause d’un phénomène n’est plus, pour le savant, ni une volonté divine, ni une vertu cachée, mais un autre fait : elle consiste dans l’antécédent nécessaire et suffisant de ce phénomène. La loi naturelle, dont le degré de précision varie d’ailleurs singulièrement, sera l’expression du rapport qui relie la cause à l’effet. C’est la période positive, celle où sont parvenues nos sciences les plus avancées. Jusque là, Comte peut nous servir de guidé ; l’éloignement pour les entités métaphysiques, l’attrait pour les faits et les lois expérimentalement vérifiés caractérisent, de façon indubitable, la science contemporaine. Mais à cette conception de l’esprit positif, le philosophe en substitua une autre qui ne concorde plus avec les données de la tradition scientifique. Proscrivant toute recherche, même basée sur l’observation, qui n’apparaissait pas susceptible d’application pratique, il considéra comme positives 1es seules connaissances utiles. Par contre, il admit des fictions, des utopies, invérifiables expérimentalement, mais qui contribuaient à soutenir les sentiments nécessaires à la vie sociale. Dans son Système de Politique, l’esprit scientifique disparaît. pour faire place aux préoccupations utilitaires. Arrivé là, il n’hésite plus à déclarer positives toute méthode, toute idée qui lui plaisent, faisant ainsi de sa fantaisie le suprême critérium du savoir légitime. Le Cours de Philosophie Positive qui dans la pensée de Comte, n’était qu’une introduction à son œuvre politique et morale, reste heureusement plus fidèle, dans l’ensemble, au véritable esprit scientifique. Il a valu à son auteur une gloire justifiée. Groupant les sciences d’après leur ordre de complexité croissante et de généralité décroissante, le philosophe en distingue six que l’on peut qualifier de fondamentales : la mathématique, l’astronomie, la physique, la chimie, la biologie, la sociologie. L’ordre où il les énumère est celui de leur dépendance et de leur développement historique ; c’est aussi l’ordre qu’il conviendrait d’observer du point de vue pédagogique. Parce qu’elle est. la plus simple et la plus générale, la mathématique s’est développée la première, parce qu’elle est la plus complexe et qu’elle dépend de toutes les autres, la sociologie s’est constituée en dernier lieu. Les faits mentaux relèvent soit de la physiologie cérébrale, soit de la sociologie ; il n’y a pas place pour une psychologie séparée. A cette classification des sciences on a fait des reproches : elle comporte de regrettables omissions ; elle a tort de ranger l’astronomie parmi les sciences fondamentales et de séparer la physique de la chimie. Pourtant c’est d’elle que s’inspirent les classifications adoptées aujourd’hui ; son principe est encore le meilleur de ceux qu’on a proposés. Nous repoussons toutefois les conséquences pédagogiques que Comte en a tirées. Sur chacune des six sciences fondamentales, il s’étendra longuement ; mais sur la science en général il sera fort succinct. Œuvre de l’esprit positif, la science exclut la recherche des causes transcendantales et ne s’attache qu’à l’étude des faits et de leurs rapports constants. Très éloignée de l’empirisme, c’est-à-dire de la simple compilation des faits, elle vise à rendre possible la prévision rationnelle qui découle de la connaissance des lois reliant les phénomènes. Elle s’efforce aussi de hiérarchiser les lois particulières et d’en réduire le nombre, en les ramenant à des lois plus générales. Il faut tendre « à agrandir autant que possible le domaine rationnel aux dépens du domaine expérimental, en substituant de plus en plus la prévision des phénomènes à leur exploration immédiate : le progrès scientifique consiste principalement à diminuer graduellement le nombre des lois distinctes et indépendantes, en étendant sans cesse leurs « liaison. » Aussi le rôle de l’observation diminue-t-il, dans la science, au profit du rôle de la déduction. Observation et induction permettent d’énoncer les premières lois ; grâce à la déduction, l’esprit en développe les conséquences et peut indéfiniment descendre du général au particulier. Mais les sciences particulières ont l’inconvénient de morceler le réel et de n’offrir que des fragments de vérité. Notre esprit désire plus d’unité : il veut connaître les liens qui les rattachent entre elles, avoir une vue d’ensemble sur leurs suprêmes conclusions. Ainsi se crée une science des sciences qui constitue la philosophie. Le besoin s’en faisait sentir depuis que les chercheurs, renonçant à une culture encyclopédique, se sont spécialisés dans une branche particulière du savoir. Systématiser les apparences pour les ramener à l’unité d’un seul principe, tel sera, selon une formule donnée plus tard par Spencer, l’objet propre de la philosophie positive. Il est vrai que Comte conteste la possibilité d’une synthèse objective. Nos connaissances sont fragmentaires et les diverses catégories de phénomènes sont irréductibles ; ne demandons pas à la chimie d’expliquer la vie, ni à la pesanteur de rendre compte des propriétés chimiques des corps. Néanmoins, on trouve chez lui un indéniable essai de systématisation philosophique. Nous ne pouvons tout connaître, une partie du réel nous échappe ; d’où la doctrine de l’inconnaissable qui, pour beaucoup, caractérise le positivisme. Délaissant le plan métaphysique, Comte ne veut pas que l’on donne une signification transcendante à la notion de causalité et que l’on ramène les unes aux autres toutes les catégories de phénomènes. Pourtant, dans ses derniers écrits surtout, il penche vers un spiritualisme et une finalité qui ont leur source dans la vie sociale. Sachons-lui gré d’avoir cherché à faire de la sociologie une science positive. Aux explications théologiques il substitua dans l’étude de l’évolution humaine, des vues, erronées parfois, mais qui du moins ne s’écartaient pas des données expérimentales. D’autres ont poussé plus loin depuis ; il a le mérite d’avoir ouvert la voie. Par contre, en étudiant son œuvre morale, religieuse, politique, on est pris de pitié, en voyant jusqu’où un grand esprit peut déchoir. C’est tardivement qu’Auguste Comte fit de la morale une science spéciale ; encore ses idées sur ce sujet restèrent-elles confuses et vagues. Sa manière de déterminer et de justifier les règles de la vie pratique ne saurait, en aucune façon, nous satisfaire. A l’en croire, l’homme, sans la société, ne serait qu’un animal ; à cette dernière il doit pensées, sentiments, vouloir, bien-être, en un mot tout ce qui fait de lui un homme. Seule existe l’Humanité « Le Grand Etre » ; l’homme pris isolément n’est qu’un mythe. En conséquence nous devons subordonner à la société tous nos sentiments et toutes nos pensées, nous sommes moralement contraints de lui consacrer toutes nos forces. Nous n’avons pas de droits, mais seulement des devoirs. N’étant pas libre, l’individu n’a pas à décider de l’emploi de sa vie d’après ses goûts personnels ; la société dispose souverainement de toutes ses facultés, de tout son être. On ne saurait imaginer tyrannie plus complète, bien que Comte répugne à l’emploi de la force. Si nous arrivons à posséder des droits, nous les tenons exclusivement de la fonction remplie par nous dans la société. Et Comte ose confondre cet esclavage honteux avec le véritable amour d’autrui, avec le dévouement à l’humanité ! Il ramène l’altruisme au respect de l’ordre établi, à l’obéissance aux chefs ! On ne saurait pousser plus loin l’inconscience ou le cynisme. L’admiration, professée par le créateur du positivisme à l’égard du catholicisme, du moyen âge, des jésuites, n’a rien qui puisse surprendre. Poussant plus loin, il voulut instaurer une religion avec un clergé, des temples et un culte qui n’est pas sans analogie avec celui que pratiquent les partisans de Rome. L’Humanité y remplace Dieu. Elle n’est pas conçue comme la cause efficiente du monde, mais comme la souveraine puissance dont nous dépendons, comme la Providence qui, par ses bienfaisantes inventions, nous protège contre l’action brutale des forces naturelles. Ce nouveau Dieu a quelque chose de la grandeur et de la bonté du Dieu des théologiens ; il enveloppe tout ce que les ancêtres ont laissé de meilleur. L’esprit des morts nous hante ; c’est eux qui continuent de gouverner les vivants. Un triple culte, personnel, domestique, public, fut institué par Comte en l’honneur de l’Humanité. Le culte personnel comportait de nombreuses prières et s’adressait aux femmes, « nos anges gardiens », qui représentent pour nous la Providence. Destiné à sanctifier les événements essentiels de la vie, le culte domestique comportait neuf sacrements. Au culte public se rattachait l’institution d’un calendrier positiviste rappelant les principales époques de l’histoire et le souvenir des grands hommes. On prévoyait l’existence d’un sacerdoce hiérarchisé, de temples, de fêtes. Les idées sociales et politiques de Comte découlent du même besoin de systématiser à l’excès, d’établir un ordre rigide. Entre le capital et le travail ne doivent pas survenir de conflits d’intérêts. L’ouvrier est un fonctionnaire, au même titre que le capitaliste ; il a droit à une large indemnité pour son entretien. C’est aux hommes compétents qu’il appartient de prendre les mesures exigées par les circonstances. Mieux instruites, les masses renonceront à la souveraineté populaire qui n’est ni juste, ni efficace. Un double pouvoir, l’un temporel, l’autre spirituel, assurera la prospérité générale. Chaque république, d’étendue médiocre, aura pour chefs temporels des banquiers ; au-dessous d’eux viendront, par ordre d’aptitude à exercer l’autorité, les commerçants, les manufacturiers, les directeurs d’exploitations agricoles. Dans le domaine spirituel, c’est à des philosophes qu’appartiendra le souverain pontificat ; savants, artistes, poètes, prendront place dans la hiérarchie sacerdotale. Ce nouveau clergé, composé d’aspirants, de vicaires, de prêtres, de grands prêtres aura pour fonction d’enseigner, d’administrer les sacrements, de surveiller la moralité publique, d’admonester les coupables et même de les excommunier. Tous ces chefs, comme aussi les capitalistes seront désignés non par l’élection, ni héréditairement, mais par cooptation ; autant que possible chaque chef choisira son successeur. Comte, qui se réservait le souverain pontificat, se chargeait de désigner les premiers directeurs spirituels de la cité. Nous pourrions multiplier les détails grotesques ; ce qu’on vient de dire suffira pour édifier le lecteur. On ne s’étonnera pas qu’un grand nombre de positivistes, les plus sensés, les plus clairvoyants, aient repoussé cette organisation sociale et cette religion. L’Action Française, d’un côté, les socialistes, à l’opposé, ont invoqué Auguste Comte en faveur de leur doctrine ; on y trouve maintes affirmations contradictoires, en effet ; mais un partisan de la liberté sympathisera difficilement avec ce défenseur de l’Etat omnipotent. Quelques-uns de ses disciples se donnèrent le ridicule d’accepter l ‘œuvre du philosophe dans sa totalité et de pratiquer le culte positiviste. « Comme saint Paul, écrira le brésilien Miguel Lemos, nous préférons être tenus pour insensés, en suivant les leçons de notre Maitre, qu’être reconnus pour sages par la frivolité contemporaine ». Pendant plus de trente ans, Pierre Laffitte fut le chef des comtistes orthodoxes français ; en Angleterre, les grands pontifes furent successivement Richard Congreve et Fr. Harrison. La Suède, le Brésil, le Chili eurent des groupes remuants qui se bornaient à mettre servilement en pratique les préceptes du fondateur. Plus féconde fut l’action de disciples dissidents, Littré, Start Mill, Lewes, qui n’admettaient qu’une minime partie du comtisme et repoussaient absolument le Système de Politique positive. Quant à l’action diffuse de la nouvelle philosophie, on l’a exagérée singulièrement ; nous ne lui devons ni Spencer, ni Renan, comme on l’a prétendu : le premier s’est toujours défendu d’avoir subi l’influence de Comte, le second ne pouvait supporter la lecture du Cours de Philosophie Psitive. Mais certains professeurs de Sorbonne estimèrent qu’elle leur serait d’un grand secours pour instaurer une religion nouvelle, celle de l’Etat ; par ailleurs des catholiques, comme Brunetière, André Godard, etc. la jugèrent capable de rajeunir l’apologétique chrétienne. Ce fut la vraie raison de son tardif succès. Durkheim doit beaucoup à Comte, et l’on sait qu’il exerça, de son vivant, une sorte de dictature philosophique dans l’Université. Faussement, on a confondu positivisme et comtisme ; les deux ne sauraient fusionner et le second reste un épisode d’importance secondaire dans l’histoire du progrès de l’esprit scientifique. Si Comte s’inspire de tendances positivistes dans ses premiers écrits, il retourne plus tard, inconsciemment ou non, aux vomissements de la théologie.
- L. BARBEDETTE.
POSSESSION
n. f.
Il est à remarquer que la possession n’est pas toujours synonyme d’appropriation. La possession représente l’occupation d’une richesse, le fait d’avoir présentement à sa disposition tel objet, produit, etc. C’est ainsi que, bien souvent, la possession représente la jouissance actuelle d’un bien non fondée sur un titre de propriété. Par ce fait, la possession nous apparaît comme n’impliquant pas forcément la propriété. Il est à remarquer cependant que la possession prolongée assez longtemps peut faire acquérir, à celui qui la détient, la propriété. Il y a prescription en faveur du détenteur.
Par ailleurs, il arrive que la propriété et l’usager sont confondus dans la possession. La possession légale et définitive constitue la propriété. Toute possession légale est un droit. La possession du sol par les individus est nécessaire tant que la société générale ignore la cause de la puissance économique de quelques-uns, mais cette propriété individuelle disparaîtra quand la société saura et voudra le bien public généralisé. L’ordre, vie des sociétés, l’exige et la nécessité sociale l’imposera. Au figuré, être en possession signifie avoir la liberté de dire, le droit de faire, etc. Au pluriel, possessions signifie des fonds de terre, de colonies possédés par les Etats, les collectivités et même par des particuliers.
— E. S.
POTENTIEL
(adjectif et nom)
Au point de vue grammatical, l’adjectif potentiel désigne seulement la possibilité de l’action ; au point de vue philosophique, il convient à ce qui n’est qu’en puissance ; au point de vue médical, il s’applique à ce qui exige un certain temps avant de manifester son action. Mais c’est à sa signification physique que l’on s’arrête le plus souvent. Et d’abord, on oppose l »énergie potentielle à l’énergie cinétique ou actuelle. Cette énergie potentielle correspond au travail qu’accompliraient les forces intérieures d’un corps, si elles engendraient une action effectivement réalisée. Seules ses variations sont bien déterminées ; et, comme toutes les formes d’énergies, elle ne saurait augmenter spontanément, elle ne peut que diminuer. Si elle augmente, cet accroissement est compensé par la diminution d’une autre forme d’énergie. Le contrepoids d’une horloge possède, quand il est remonté, une énergie potentielle qu’il perdra pendant sa descente. Un ressort enroulé pourra de même produire un travail grâce à l’énergie que sa déformation lui confère. Un réservoir d’essence que l’on fera exploser avec de l’air, au moment voulu, constitue aussi une provision d’énergie potentielle. On pourrait multiplier les exemples. Mais c’est en matière d’électricité que le terme potentiel acquiert une importance particulièrement considérable : il cesse alors d’être employé comme adjectif pour devenir un nom. Si l’on compare un courant électrique à une chute d’eau, son intensité répondra au débit de la chute, son potentiel à la hauteur de cette même chute. D’une façon plus précise, on peut dire que la différence de potentiel entre deux conducteurs est l’équivalent de la différence de niveau entre deux réservoirs d’eau. Quand on met en rapport deux conducteurs chargés d’électricité de même nom, ils sont dits de potentiel semblable, lorsqu’aucune quantité d’électricité ne passe de l’un sur l’autre ; dans le cas contraire, ils sont dits de potentiel différent. C’est en volts que se comptent les différences de potentiel, et l’on appelle voltmètres les appareils qui permettent d’en effectuer la mesure. Mais ce qu’on mesure et calcule c’est seulement une différence de potentiel. Dans un conducteur traversé par un courant, le potentiel prend d’ailleurs une valeur invariable et diminue d’un point à un autre, dans le sens du courant, depuis la valeur la plus élevée qui règne à l’une des extrémités du conducteur jusqu’à la valeur la plus basse qui règne à l’autre. Conformément à la fameuse loi d’Ohm, la chute de potentiel le long d’un conducteur, dans lequel le courant ne produit pas autre chose qu’un dégagement de chaleur, est proportionnelle à l’intensité du courant et à la résistance ; l’unité de différence de potentiel ou volt est la différence de potentiel existant entre les extrémités d’un conducteur, dont la résistance est de un ohm, traversé par un courant invariable de un ampère. Par son aspect extérieur, le voltmètre rappelle l’ampèremètre, mais alors que le second est un galvanomètre de très faible résistance qui mesure l’intensité du courant passant dans un circuit, le premier est un galvanomètre de très grande résistance qui sert à la mesure des forces électromotrices. Remarquons que nos sens restent presque totalement insensibles et muets lorsqu’il s’agit d’électricité ou de magnétisme. Un courant électrique provoque des secousses parfois très douloureuses et même mortelles ; au moment des orages, nous éprouvons des malaises, par suite de la variation brusque de notre potentiel. D’une façon générale, nous ne ressentons que des impressions très vagues quand nous pénétrons dans un champ électrique ; nous n’en ressentons aucune s’il s’agit d’un champ magnétique. Sans doute tous les faits sont, en définitive, réductibles à des phénomènes électriques si la matière est composée d’électrons ; il reste que nos sens sont singulièrement inaptes à percevoir électricité et magnétisme dans leurs manifestations ordinaires. Aussi, la science de ces phénomènes fut-elle de longs siècles avant de faire de sérieux progrès. C’est par le raisonnement, la mesure de quelques faits soigneusement observés, le calcul mathématique, que les physiciens sont parvenus à découvrir les lois de l’électricité. Nous ignorons encore sa vraie nature. A quelles modifications de la substance du conducteur correspond le transport de l’énergie électrique, de quelles transformations intimes résulte l’aimantation du fer ? Nous n’en savons rien, pas plus que nous ne savons comment se propage la chaleur ou comment elle résulte de la disparition d’autres formes d’énergie. Pour imaginer, d’une façon concrète, les phénomènes électriques, il faut user de comparaisons, de métaphores, plus ou moins adéquates, qui risquent de donner des idées fausses si on les pousse trop loin. Il convient de les éviter dans la mesure du possible pour leur substituer des formules mathématiques ; ce qui est particulièrement facile en électricité, nos connaissances étant parvenues, dans ce domaine, à un haut degré de perfection. Ainsi, le potentiel peut se définir d’une façon rigoureuse ; et les formules qui le concernent rendent aisés tous les calculs. Il semble même que certaines branches de la science électrique ne soient plus capables de progrès essentiels mais seulement d’améliorations de détail. « Notre génération, écrit Leblanc, a vécu de l’induction et je crois que ce thème est usé. Nous avons passé notre temps à faire tourner des champs à gauche ou à droite et à combiner leurs mouvements avec ceux de collecteurs ou de balais. Ces questions ont été tellement travaillées de tout côté qu’on peut les considérer comme épuisées ; si l’on veut trouver quelque nouveauté il faut la chercher dans les tubes à vide. » Ondes hertziennes, rayons cathodiques, etc., ouvrent, aujourd’hui, de nouveaux champs d’étude à l’électricien émerveillé. Pour les générations qui montent, de vastes domaines restent à explorer, si, délaissant les préoccupations chauvines et les inventions d’ordre militaire, elles s’adonnent à des recherches vraiment utiles.
— L. Barbedette.
POUVOIR
n. m.
Ensemble des personnes qui exercent l’autorité politique. Droit ou puissance de commander. Autorité d’une personne sur d’autres personnes.
Théoriquement, le Pouvoir procède d’un contrat passé entre les citoyens et les gouvernants, ceux-là ayant délégué à ceux-ci tout « pouvoir » d’agir en leur lieu et place, de légiférer et de faire exécuter les lois au profit de tous. Toutefois, ce « pouvoir » a eu, à son origine, une autre expression que la volonté de tous. Il fut d’abord : la raison du plus fort. Le guerrier le mieux armé, le plus fort et le plus heureux, soumit à sa volonté les autres membres de la tribu. Législateur et exécuteur de la loi, qui était sa loi, le prince était : le Pouvoir.
Ce pouvoir était nécessairement instable et passait souvent d’un chef à l’autre, car la force est incessante modification ; par accident ou vieillesse, le chef cesse d’être le plus fort, et doit passer le pouvoir. Or, le prince tient à conserver son autorité. Le sorcier, ou le prêtre devient son allié et, profitant de l’ignorance du peuple, il affirme l’existence d’un être supraterrestre, un surhomme, nécessairement invisible, de qui tout procède et qui dans un colloque a « révélé » au prêtre une règle des actions, une morale, dont naturellement, le premier enseignement est : « Toute autorité vient de Dieu, désobéir à l’autorité, c’est désobéir à Dieu. » La sanction de la Loi, est dans l’au-delà du tombeau le ciel ou l’enfer. Le prince règne au nom de Dieu : Pouvoir de Droit Divin.
Tant qu’il est possible de faire accepter par le peuple la réalité de la « Règle » et de sa sanction, le Pouvoir est indiscuté, absolu, réel. L’Eglise et l’Etat mettent en œuvre tous les moyens propres à empêcher l’examen de la règle : misère, inquisition, patries, ignorance, etc. Mais les développements économiques et intellectuels, les guerres, le commerce, la découverte de l’imprimerie, ne tardent pas à rendre cet examen de la règle incompressible. Le protestantisme religieux est inséparable du protestantisme politique. Petit à petit, l’esclave devenu serf et bourgeois a pris conscience de ses droits. Il se révolte contre le pouvoir du « Droit Divin » et lui substitue le pouvoir du plus grand nombre, ou « Démocratie ». Le serf est devenu : citoyen. En principe il se dirige lui-même, tire de lui-même sa foi, sa règle des actions. Il est libre. Mais ses aspirations ne sont pas assez précises, sa conscience assez profonde ; le peuple de citoyens croit qu’un Gouvernement est indispensable, composé de quelques hommes qui règleront la vie sociale au nom de tous. Chaque citoyen leur délègue « son pouvoir ». « La loi est l’expression de la volonté générale », formulée par voie de suffrage restreint ou universel. En apparence, la majorité des citoyens exprime cette « volonté générale » en faisant élire son « délégué », mais la réalité est tout autre. Grâce au suffrage universel (voir Parlement), une poignée de « politiciens » (voir ce mot) accapare le « Pouvoir » et impose sa volonté au peuple,
Le Pouvoir ou Etat (voir ce mot) est toujours l’instrument de domination d’une catégorie d’individus (voir classe) sur une autre. L’exercice du pouvoir est essentiellement corrupteur et ce sont nécessairement les êtres les plus féroces, orgueilleux et vils qui en sont les bénéficiaires. Mais même en supposant — ce qui est profondément absurde — que ce soient les plus doux, les plus humbles, les meilleurs, que le peuple choisisse pour exercer le Pouvoir à sa place, le pouvoir n’en serait pas moins l’oppression, le privilège, la servitude et le vol. Le « Pouvoir » n’est qu’une des formes de l’Autorité, il doit disparaître pour faire place à une humanité libre. Le Pouvoir d’un seul sur tous est révolu à jamais, le pouvoir des majorités sur les minorités est sérieusement battu en brèche ; encore un pas, ou un saut, et l’Evolution ou la Révolution amèneront le pouvoir de chacun sur soi, pour soi et que nul ne reçoit en délégation.
— A. LAPEYRE.
PRAGMATISME
n. m. (du grec pragma, action, affaire)
De prime abord, l’esprit humain est dogmatique : à ses idées, à ses perceptions il accorde une valeur absolue, persuadé qu’il parvient à saisir les choses telles qu’elles sont. Plus tard, contradictions et erreurs l’amènent à s’interroger sur les motifs de sa confiance. Un doute pénètre en lui qui n’est souvent que passager, qui parfois aboutit, dans l’ordre spéculatif, au scepticisme complet. Bien qu’ils estiment l’homme incapable de connaître la vérité et, s’il la connaissait, incapable d’en posséder la certitude, les sceptiques se rencontrent avec les partisans du dogmatisme pour définir la vérité : l’accord de la pensée avec son objet.
Cette définition, les pragmatistes la repoussent, au contraire. Comme le Faust de Gœthe, ils placent à l’origine des choses, non la pensée, mais l’action. Une idée est vraie dans la mesure où elle se traduit en conséquences pratiques heureuses ; l’utilité n’est pas fonction de la vérité, c’est la vérité qui devient fonction de l’utilité. Charles Pierce employa le premier, en 1878, le terme pragmatisme et lui donna son sens actuel. Pour lui, nos croyances ne sont que des règles d’action, et le contenu d’une idée se ramène à la conduite qu’elle est propre à susciter. Une pensée, même la plus élaborée, même la plus délicate, doit se juger d’après les impressions qu’elle provoque, les réactions qu’elle suscite, les conséquences qu’elle entraîne dans l’ordre pratique. La conception de Pierce passa inaperçue. Mais reprise vingt ans plus tard par William James, qui fut son principal défenseur, elle connut un éclatant succès. Ce philosophe nous demande de détourner nos regards de tout ce qui est réalité première, premier principe, pour les tourner vers les résultats, les faits, les conséquences. Au lieu d’être la réponse à une énigme et la cessation de toute recherche, une théorie n’est plus qu’un instrument de travail. Nos idées, qui ne seraient rien en dehors de l’expérience, deviennent vraies en proportion des services qu’elles nous rendent, en nous permettant de couper au plus court, au lieu de suivre l’interminable succession des phénomènes particuliers. « Dès lors, écrit William James, qu’une idée pourra, pour ainsi dire, nous servir de monture ; dès lors que, dans l’étendue de notre expérience, elle nous transportera de n’importe quel point à n’importe quel autre ; dès lors que, par elle, seront établies entre les choses des liaisons de nature à nous contenter ; dès lors, enfin, qu’elle fonctionnera de façon à nous donner une parfaite sécurité, tout en simplifiant notre travail, tout en économisant notre effort, cette idée sera vraie dans ces limites, et seulement dans ces limites-là ; vraie à ce point de vue, et non pas à un autre ; vraie d’une vérité « instrumentale », vraie à titre d’instrument et seulement à ce titre. Telle est la théorie de la vérité « instrumentale » ou de la vérité consistant, pour nos idées, dans leur aptitude à fournir un certain travail. » Nos sciences ne sont qu’un ensemble de conventions qui ont le mérite de réussir. En physique et en biologie, les lois sont de simples approximations ; elles se ramènent à un système de signes qui, en résumant les faits déjà connus, permettent d’en prévoir d’autres. En mathématiques, définitions, axiomes, postulats sont des créations de l’esprit fort commodes Sans doute, mais conventionnelles et arbitraires dans une large mesure. Aussi, la science et les lois qu’elle formule valent-elles seulement en raison de leur utilité. Comme il n’y a pas de principes a priori, de propositions nécessaires, elles pourraient être différentes et rester aussi vraies ; c’est-à-dire aussi fécondes en tant que moyens d’action. On les a comparées à des langues, « or, les langues, tout le monde le sait, admettent une grande liberté d’expression et comportent de nombreux dialectes ». D’ailleurs la vérité n’a rien de statique ; elle dépend des événements qui la vérifient et change comme eux. Une idée, utile à une époque, pourra cesser de l’être à l’époque suivante ; des croyances qui stimulent un individu paralyseront quelquefois son voisin. Tout change, tout devient, l’univers se résout en un flux de phénomènes, et nous déclarons vraie l’affirmation qui nous donne prise sur la réalité mouvante. Malgré les réserves de Bergson et de son disciple Leroy concernant le pragmatisme, ce dernier peut être cité avec fruit sur ce sujet. Il écrit :
« Toute vérité ressemble à ce qu’on appelle parfois la vérité morale, on la reconnaît à ses oeuvres, à ses effets ... La vérité n’a rien de statique. Ce n’est pas une chose, mais une vie. C’est moins le caractère de certains résultats que celui de certains progrès. C’est moins un terme qu’une croissance... la vérité, comme la vie est suite, évolution, continuité traditionnelle. »
En conséquence, déclarent les pragmatistes, nous ne devons pas craindre de dépasser, par la croyance, les faits établis et les théories démontrées. La logique ne saurait avoir le dernier mot, puisque nous jugeons la vérité d’après l’expérience vivante, non d’après des concepts abstraits. Au cœur, aux sentiments, aux désirs, il faut faire la part très grande dans notre système de connaissance, et l’on peut tenir pour vraie toute idée qui console et fortifie. D’où la vérité des croyances religieuses et des doctrines métaphysiques qui entretiennent l’espoir en une justice posthume, en une bienheureuse survie. C’est pour aboutir là que William James avait rabaissé la pensée au profit de l’action, remplacé le vrai par l’utile, multiplié les sophismes. Mais, ce faisant, il assurait une large diffusion à ses livres et gagnait à sa cause la sotte multitude des croyants. Sous prétexte que nous baignons dans une atmosphère que traversent de grands courants spirituels, le philosophe américain affectait de prendre au sérieux les divagations mentales qui revêtent un aspect religieux. Bergson (cet israélite qui fait les délices du monde chrétien) écrivait :
« James se penchait sur l’âme mystique comme nous nous penchons dehors, un jour de printemps, pour sentir la caresse de la bise, ou comme, au bord de la mer, nous surveillons les allées et venues des barques et le gonflement de leurs voiles, pour savoir d’où souffle le vent. Les âmes que remplit l’enthousiasme religieux sont véritablement soulevées et transportées : comment ne nous feraient-elles pas prendre sur le vif, ainsi que dans une expérience scientifique, la force qui transporte et qui soulève ? Là est sans doute l’origine, là est l’idée inspiratrice du « pragmatisme » de William James. Celles des vérités qu’il nous importe le plus de connaître sont, pour lui, des vérités qui ont été senties et vécues avant d’être pensées. »
Nous sommes, en définitive, les artisans de la vérité ; elle dépend de notre sentiment et de notre volonté, autant que de notre raison. D’accord avec Bergson et Leroy lorsqu’il s’agit de critiquer la science, les pragmatistes répugnent, par contre, à construire une métaphysique systématique. Ils n’invoquent pas l’intuition, mais à côté du plan de l’action technique, ils donnent place à d’autres plans qui comportent des expériences d’un autre ordre, non moins réelles bien qu’elles restent étrangères à l’intelligence. Chez l’anglais Schiller et l’américain Devey, deux partisans notoires du pragmatisme, on trouve des nuances très personnelles de pensée ; William James, chez qui les préoccupations religieuses deviendront prédominantes, ne saurait non plus se confondre avec aucun autre. Ce dernier déclare, il est vrai, que le pragmatisme est une méthode et qu’il n’exclut aucune doctrine. Il le compare au corridor d’un hôtel sur lequel donneraient d’innombrables chambres. « Dans l’une on peut trouver un homme travaillant à un traité en faveur de l’athéisme ; dans celle d’à côté, une personne priant à genoux pour obtenir la foi et le courage ; dans la troisième, un chimiste ; dans la suivante, un philosophe élaborant un système de métaphysique idéaliste ; tandis que, dans la cinquième, quelqu’un est en train de démontrer l’impossibilité de la métaphysique. Tous ces gens utilisent quand même le corridor : tous doivent le prendre pour rentrer chacun chez soi, puis pour sortir. » En fait, ce corridor n’a servi qu’aux défenseurs des préjugés sociaux et religieux. Au nom de l’intérêt collectif, on a légitimé les plus criantes injustices ; un Maurras, un Barrès, un Le Don prêchèrent ouvertement le respect du mensonge utile. Nombreux sont les bourgeois incroyants qui jugent bon d’assister à la messe parce qu’ils voient dans l’Eglise le plus ferme soutien de l’ordre établi. Et parmi les journalistes ou les écrivains, thuriféraires attitrés de l’autel, les athées ne manquent pas. L’idée vraie étant « l’idée qui paie », ils jugent mauvaise toute cause dont les défenseurs ne sont pas rétribués grassement. Quant à William James, il édifia sa fortune philosophique en mettant le pragmatisme au service de la religion. Il semble même ne s’être intéressé à cette doctrine que dans l’unique dessein de restaurer les croyances traditionnelles. Il a affirmé :
« La méthode pragmatique est avant tout une méthode permettant de résoudre des controverses métaphysiques qui pourraient autrement rester interminables. Le monde est-il un ou multiple ? N’admet-il que la fatalité, ou admet-il la liberté ? Estil matériel ou spirituel ? Voilà des conceptions dont il peut se trouver que l’une ou l’autre n’est pas vraie ; et là-dessus les débats restent toujours ouverts. En pareil cas, la méthode pragmatique consiste à entreprendre d’interpréter chaque conception d’après ses conséquences pratiques. »
De cette interprétation il résulte, au dire de James, que l’ascétisme et la charité des âmes religieuses prouvent la réalité du surnaturel ; qu’il est bon d’avoir le sentiment de l’existence de Dieu, ce compagnon fidèle qui ne nous abandonne jamais ; que les extravagances des spirites et des mystiques sont elles-mêmes souverainement respectables. Toutes les âmes humaines plongeraient leurs racines, au delà du conscient, dans une réalité divine, pressentie plutôt que connue, d’où leur viendraient force et chaleur. On ne s’étonnera pas que les théologiens, aux abois devant les progrès destructeurs de la science, aient fait bon accueil à ce défenseur si pénétré de l’esprit pratique cher aux Américains. Mais le charme du pragmatisme est rompu, même dans son pays d’origine. Du moins près des chercheurs sérieux, car aux demi-savants et au peuple l’on continue de servir cette bien-pensante doctrine comme une curieuse nouveauté. Dans la connaissance scientifique, l’esprit se heurte à une réalité qui ne se plie nullement à ses désirs. Bien que reconstruites par l’entendement, les définitions mathématiques n’en sont pas moins, à l’origine, suggérées par l’expérience ; et les axiomes s’imposent à nous avec une autorité absolue. C’est de leur correspondance avec les lois essentielles de la pensée, non du hasard, que découle l’utilité des vérités mathématiques. Dans les sciences expérimentales, lois et faits ne sont pas d’arbitraires créations de notre pensée ; ils s’imposent à nous, au contraire. Si cette proposition : « La terre tourne autour du soleil », est commode, n’est-ce pas parce qu’elle est vraie ? Loin d’être vrai en raison de son utilité, le concept n’est habituellement utile qu’en raison de sa vérité. Mettre sentiment et intelligence sur le même plan, prétendre qu’une idée est aussi bien vérifiée si elle satisfait nos désirs et se révèle pratiquement utile, que si elle est susceptible d’être démontrée rationnellement, c’est ouvrir toute grande la porte à la fantaisie. Parodi écrit :
« Qu’un désir soit assez intense pour vaincre toutes les résistances et dominer l’âme entière et il sera par là même en état de faire une vérité de tout ce qui lui agrée ; de vaincre, dans les cas où ils lui sont contradictoires, les intérêts de la logique et de la cohérence rationnelle ; et pourquoi, par autorité, contagion ou suggestion, ne s’imposerait-il pas encore à tout un groupe, et ayant obtenu le consentement collectif, comment ne créerait-il pas à son gré la vérité et l’erreur ? »
Il importe de distinguer nettement les vérités scientifiques, qui s’imposent à tous, des croyances d’ordre sentimental qui varient d’une conscience à l’autre. Ces dernières, incapables d’aboutir à l’accord unanime des esprits, gardent un caractère subjectif si personnel qui doit éveiller la défiance de l’homme réfléchi. Les défenseurs attitrés du catholicisme ont parfaitement compris les faiblesses irrémédiables du pragmatisme. D’où l’attitude équivoque qu’ils adoptent à son égard, comme à l’égard de la philosophie bergsonienne. Apte, croient-ils, « à débarrasser certaines âmes des chaînes du scientisme et à les rendre libres pour une nouvelle vie religieuse », ils lui adressent volontiers « les superstitieux de positivisme, les esprits qui croient que le dernier mot de la vie et de la vérité est dans le plateau d’une balance ». Mais ils le déconseillent aux bons chrétiens, déjà tombés sous leurs griffes. La constatation des méfaits et des crimes, actuellement imputables aux religions, suffirait, en effet, à détourner les consciences probes de toutes les églises et de tous les temples. Peut-être furent-elles utiles à une époque de l’évolution humaine ; depuis longtemps elles entravent les progrès de l’espèce et abêtissent les individus. Au nom même du pragmatisme, William James aurait dû condamner les décalogues et les credo qui se partagent l’empire des âmes. Mais sa voix n’eut alors trouvé qu’un faible écho ; sa philosophie serait demeurée obscure ; très peu l’auraient pris au sérieux. Lui-même a signalé l’influence tyrannique que les croyances traditionnelles exercent dans les groupements humains :
« Le premier des principes est de leur rester fidèle ; et, dans la plupart des cas, c’est le seul principe qu’on observe. Comment s’y prend-on, en effet, presque toujours, avec les phénomènes tellement nouveaux qu’ils entraîneraient, pour nos croyances, toute une réorganisation ? On les tient pour non avenus, tout simplement, ou bien l’on insulte les gens qui témoignent en leur faveur !... Une opinion nouvelle entre en ligne de compte parmi les opinions « vraies » dans la mesure exactement où elle satisfait chez l’individu le besoin d’assimiler aux croyances dont il est comme approvisionné, ce que son expérience lui présente de nouveau. En même temps qu’elle s’empare d’un fait nouveau, la nouvelle opinion doit s’appuyer sur d’anciennes vérités. »
En américain pratique, William James plaça donc le pragmatisme sous l’égide de la religion, associant ainsi les préjugés traditionnels à un mode de penser nouveau. Consciemment ou non, beaucoup l’ont imité depuis, dans les domaines les plus variés, préférant leur succès personnel à celui de la vérité.
— L. BARBEDETTE.
PRÉCURSEURS (LES) DE L’ANARCHIE
Nous ne savons pas exactement quand commence l’autorité gouvernementale ou étatiste. On a donné de nombreuses raisons de l’établissement de l’autorité. Les hommes formant des groupements toujours plus nombreux, s’avéra-t-il nécessaire de confier la gestion des affaires et la solution des différends aux plus intelligents ou aux plus redoutés : les sorciers ou les prêtres ? Les groupements primitifs se montrant, en général, hostiles les uns aux autres, la nécessité s’imposa-t-elle de centraliser la défense du milieu aux mains de plusieurs ou d’un seul choisi parmi les guerriers (les guerrières) les plus courageux ou les plus vaillants ? Toujours est-il qu’il semble que l’autorité ait préexisté à la propriété individuelle. L’autorité évidemment a régné alors que les biens, les choses et dans certains cas, les enfants et les femmes étaient la propriété de l’organisation sociale. Le régime de la propriété individuelle, c’est-à-dire la possibilité pour un membre de la collectivité :
-
d’accaparer plus de sol qu’il ne lui en fallait pour subsister, lui et sa famille ;
-
de faire exploiter le surplus par autrui, n’a fait que raffiner, compliquer et rendre plus tyrannique l’autorité, qu’elle fût théocratique ou d’essence militaire.
Des primitifs se rebellèrent-ils contre l’autorité, même rudimentaire, qui sévissait dans les groupements primitifs ? Y eut-il des objecteurs, des désobéisseurs dans ces temps où les phénomènes météorologiques étaient attribués à des puissances supérieures, tantôt bonnes, tantôt défavorables, où l’on relativait à une entité surnaturelle la création de l’homme. Certains mythes montrent que l’homme n’a pas toujours accepté bénévolement d’être un jouet dans la main de la divinité et l’esclave de ses représentants, par exemple les mythes de Satan et de Prométhée, des anges rebelles et des titans. Plus tard même, lorsque l’autorité gouvernementale ou ecclésiastique fut bien assise, il y eut des manifestations qui, tout en restant dans un cadre pacifique, témoignaient cependant d’un esprit dé révolte. On peut classer sous ce chef les scènes et comédies satiriques, les saturnales romaines, le carnaval chrétien, etc. De nombreux contes circulaient parmi le peuple qui les entendait toujours avec une joie parfois puérile où le thème était le même : la victoire du faible, de l’opprimé, sur le tyran ou le riche.
L’antiquité grecque, produisit, avec Gorgias, niant tous les dogmatismes ; avec Protagoras, faisant de l’individu la mesure de toutes choses ; avec Aristippe, le fondateur de l’école hédoniste, pour lequel il n’est d’autre bien que le plaisir et le plaisir immédiat, actuel, le plaisir quel que soit son origine ; avec les cyniques (Antisthène, Diogène et Crates) ; avec les stoïques (Zénon, Chrysippe et leurs successeurs), l’antiquité grecque produisit des hommes critiquant, puis niant les valeurs reçues.
De la négation des valeurs de la culture hellénique, les cyniques en vinrent à la négation de ses institutions : mariage, patrie, propriété, Etat. Derrière le tonneau et la lanterne de Diogène, il y avait autre chose que de la raillerie et des mots d’esprit. Sans doute, Diogène transperçait de ses sarcasmes mordants les plus puissants et les plus redoutés parmi ceux qui s’arrachaient les dépouilles d’Athènes expirante. Sans doute Platon, que scandalisait la forme ultra-populaire de ses prédications, rappelait-il « un Socrate en délire » ; mais en faisant du travail manuel l’égal du travail intellectuel, en dénonçant les travaux inutiles, en se proclamant citoyens du monde, en considérant les généraux comme des « conducteurs d’ânes », en tournant en ridicule les superstitions populaires, et jusqu’au démon de Socrate, en réduisant l’objet de la vie à l’exercice et au développement de la personne morale, les cyniques pouvaient bien se prétendre comme leur maître, médecins de l’âme, hérauts de la liberté et de la vérité. Au point de vue social, les cyniques étaient communautaires et étendaient ce principe, non seulement aux choses, mais aux personnes, conception chère à maints philosophes de l’antiquité.
On a reproché aux cyniques et à Diogène en particulier, l’orgueil qu’ils tiraient de leur isolement et de se poser en modèles, leur exagération d’un genre de vie qui était comme la négation de toute société organisée. Diogène a répondu d’avance :
« Je suis comme les maîtres de chœurs, qui forcent le ton pour y amener leurs élèves. »
Le premier enseignement de Zénon, celui de la Stoa, se rapprochait beaucoup de celui des Cyniques. Zénon, dans son Traité de la République, repoussait les mœurs, les lois, les sciences, les arts, tout en demandant comme Platon la communauté de biens. Le fond du système stoïque est que le bien de l’homme est la liberté et que la liberté ne se conquiert que par la liberté. Le sage est synonyme de l’homme libre : il ne doit son bien qu’à soi-même et ne relève que de soi. A l’abri des coups du sort, insensible à toutes choses, maître de soi, n’ayant besoin que de soi, il trouve en soi une sérénité, une liberté, une félicité sans limites. Ce n’est plus un homme. C’est un dieu et plus qu’un dieu, car le bonheur des dieux est le privilège de leur nature tandis que la félicité du sage est la conquête de sa liberté ! Zénon, logiquement, niait l’omnipotence, la tutelle, le contrôle de l’Etat : l’homme devait se servir de loi à soi-même et c’est de l’harmonie individuelle que devait sortir l’harmonie collective. L’hédonisme, le cynisme et le stoïcisme opposaient le droit naturel pour l’individu de disposer de soi au droit artificiel qui en fait un instrument dans les mains de l’Etat. Zénon se servait de cette théorie pour combattre, comme l’avaient déjà fait les cyniques, le nationalisme exagéré des Grecs et admettre un instinct de société, un instinct naturel poussant l’homme à s’associer à d’autres hommes. On peut considérer cyniques et stoïciens comme les premiers internationalistes.
* * *
Cette idée du droit naturel, de la loi de nature, de la religion naturelle, sera reprise par maints philosophes. D’ailleurs le triomphe du christianisme n’est pas aussi complet que l’affirment ses thuriféraires. De nombreux hérétiques s’élèvent alors et se couvrent même du masque de la religion par prudence et dissimulent leur propagande sous une écorce religieuse.
Voici, par exemple, le gnostique Carpocratès d’Alexandrie, fondateur de la secte des Carpocratiens, dont le fils Epiphanes a réuni toute la doctrine dans son ouvrage Péri Dikaios Inés (de la justice). La justice divine, pour lui, existe en la communauté dans l’égalité (Koinonia met Isotetos). De même que le soleil n’est mesuré à personne, il doit en être de même pour toutes les choses, toutes les jouissances. Si Dieu nous a donné le désir c’est pour que nous le satisfassions, non pour nous restreindre, de même que les autres êtres vivants ne mettent pas de frein à leur appétit.
Les Carpocratiens furent parmi les premiers qui reconnurent le droit de tous sur toutes choses, jusqu’en ses extrêmes conséquences, et cherchèrent à le mettre en pratique. Ils furent apparemment exterminés. Des inscriptions indiquent pourtant qu’au VIe siècle encore, les tendances carpocratiennes subsistaient en Cyrénaïque, dans l’Afrique du Nord.
Anéantis ou non, les Carpocratiens eurent des successeurs. Nous ignorons si les initiés des sectes épousant leurs conceptions ou des idées analogues avaient rejeté à l’intérieur de leurs groupes toute autorité, s’ils n’étaient pas organisés, comme on dit aujourd’hui. Toujours est-il que le système au pouvoir avait en eux d’irréconciliables adversaires. Il y eut des internationales de sociétés secrètes en relations entre elles et dont les membres, en voyage, étaient accueillis fraternellement, par les associations correspondantes. On enseignait clandestinement et les nombreux procès de ceux qui furent découverts et tombèrent victimes de leur propagande, nous le démontrent suffisamment. Le malheur est que trop souvent leurs véritables opinions nous sont inconnues. On ne nous parle que de leurs crimes (?) ou de leurs écarts (?).
Au synode d’Orléans (1022), onze cathares (Albigeois) sont brûlés parce qu’accusés de pratiquer l’amour libre. En 1030, à Montfort, près de Turin, des hérétiques sont accusés de s’être prononcés contre les cérémonies et les rites religieux, ainsi que contre le mariage, la mise à mort des animaux et en faveur de la communauté des biens. En 1052, à Goslar, un certain nombre d’hérétiques sont brûlés pour s’être prononcés contre la mise à mort de tout être vivant, c’est-à-dire contre la guerre, le meurtre, et la mise à mort des animaux. En 1213, des Vaudois sont brûlés à Strasbourg pour avoir prêché l’amour libre et la communauté des biens. Il ne s’agit pas là de « clercs », mais de pauvres artisans : tisserands, cordonniers, maçons, menuisiers, etc.
Se basant sur un passage de l’épître de Saint-Paul aux Galates : « Si vous êtes conduits par l’esprit, vous n’êtes plus sous la loi », nombreux furent les sectaires qui placèrent l’être humain, la personnalité au-dessus de la loi. Hommes et femmes partageaient un point de vue assez semblable à celui des Carpocratiens et aboutissaient, dans la pratique, à une sorte de communisme libertaire qu’ils vivaient comme ils le pouvaient, dans des espèces de colonies plus ou moins occultes et sous la menace d’une répression impitoyable. Amaury ou Amalric de Bène, près Chartres, professait ces idées en Sorbonne au XIIe siècle. Il eut des disciples plus énergiques que lui, parmi lesquels Ortlieb de Strasbourg, qui firent connaître sa doctrine anarchico-panthéiste en Allemagne, où ils trouvèrent d’enthousiastes et convaincus partisans sous le nom de Brüder und Schwestern. des freien Geistes (Frères et Soeurs du libre esprit), que Max Beer, dans son Histoire du Socialisme, considère comme des anarchistes-individualistes, qui se situèrent en dehors de la société, de ses lois, de ses moeurs, de ses habitudes et qu’en revanche la société organisée combattait sans merci.
Pensez donc ! Pour Almaric de Bène et ses continuateurs, Dieu se trouvait en Jésus, comme dans les penseurs et les poètes païens ; il a parlé par la bouche d’Ovide comme par celle de Salut Augustin. De tels hommes n’étaient pas dignes de vivre !
Dans les hérésies, il faut distinguer entre le panthéisme anarchiste almaricien, dont les adhérents se considéraient comme des parcelles du Saint Esprit, rejetant tout ascétisme, toute contrainte morale, se situant pour ainsi dire au-delà du bien et du mal et les héritiers du gnosticisme manichéen, tels les Albigeois, ascètes dont l’aspiration vise à vaincre la matière. Encore n’est-il pas toujours facile de faire une démarcation exacte. L’historien catholique Doellinger, qui a étudié l’histoire de toutes ces sectes, n’a pas hésité à dire que si elles l’avaient emporté (et il s’agissait surtout des Vaudois et des Albigeois), « il en serait résulté un bouleversement général, un retour complet à la barbarie et à l’indiscipline païennes ».
Au premier groupe panthéiste anarchiste, nous rattachons l’hérésie anversoise de Tanchelin, celle des Kloeffers de Flandre, des Hommes de l’Intelligence, des Turlupins, des Picards ou Adamites (rayonnant jusqu’en Bohême), des loïstes, également anversois ; partout s’élèvent des hommes ou des associations qui veulent réagir contre le système dominant, représenté surtout par le catholicisme, dont les hauts dignitaires menaient une existence scandaleuse, maintenaient la prostitution, tenaient des bordels et des maisons de jeux, portaient les armes et se battaient comme des guerriers de profession.
Je partage absolument l’avis de Max Nettlau, que, dans les dernières années du moyen âge, le Midi de la France, le pays des Albigeois, une partie de l’Allemagne s’étendant jusqu’à la Bohème, les contrées arrosées par le Rhin inférieur, jusqu’en Hollande et dans les Flandres, certaines portions de l’Angleterre, de l’Italie, la Catalogne enfin, constituaient un terrain d’élection pour les sectes qui attaquaient le mariage, la famille, la propriété et s’attiraient une répression impitoyable.
Ce n’était pas seulement en Europe que se développaient des mouvements antiautoritaires. Dans l’histoire d’Arménie, de Tschamtschiang (Venise 1795), il est question d’un certain hérétique persan du nom de Mdusik qui niait « toute loi et toute autorité »... Le Supplément Littéraire des Temps Nouveaux (Paris, vol II, p. 556–57), contient un article intitulé « Un précurseur anarchiste », où le Dr. turc Abdullah Djevdet présente un poète syrien du XVe siècle : Ebr-Ala-el Muarri.
* * *
Nous voici à la Renaissance, il n’y a pas à le nier, les catholiques, aidés par l’état séculier, ont anéanti et réduit à l’impuissance les hérétiques panthéistes-anarchistes. Les protestants ne se sont pas montrés tendres à l’égard des anabaptistes, sorte de communistes autoritaires se fondant sur l’ancien Testament ; le vieux monde dut courber la tête sous l’omnipotence de l’Etat, plus fortement servi et centralisé qu’il ne l’était au Moyen Age. La découverte de l’Amérique enflamma cependant l’esprit des penseurs et des originaux, dont la mentalité n’avait pas été écrasée sous le laminoir de l’organisation politique. On parla d’îles heureuses, d’Eldorados, d’Arcadies. Dans sa Kosmographey (1544), Sébastian Münster a décrit les habitants des îles nouvelles, « où l’on vit libre de toute autorité, où l’on ne connaît ni le juste, ni l’injuste, où l’on ne punit pas les malfaiteurs, où les parents ne dominent pas leurs enfants. Pas de loi, liberté des relations sexuelles. Aucune trace d’un Dieu, ni d’un baptême, ni d’un culte ». A ses aspirations vers la liberté, il faut relier sans doute l’apparition de la Franc-maçonnerie et des différents ordres d’illuminés. L’un des génies les plus brillants de la Renaissance, François Rabelais, peut également, par son abbaye de Thélème (Gargantua 1. 54–57), être considéré comme un des précurseurs de l’anarchisme. Elisée Reclus l’a proclamé notre grand ancêtre. Sans doute, dans la description de ce milieu de liberté, il a négligé le côté économique et il tenait davantage à son siècle qu’il ne l’imaginait lui-même. Sans doute, son manoir raffiné, il l’a dépeint dans le même esprit que Thomas More son Angleterre idéalisée et Campanella, dans sa Cité du Soleil, sa république italienne et théocratique. N’empêche qu’en l’abbaye de Thélème, Rabelais s’est plu à dépeindre une vie sans autorité. On se souvient que Gargantua ne voulut bâtir « murailles au circuit ». « Voyre et non sans cause, approuva le moine, où mûr y a et davant et derrière, y a force murmure, envie et conspiration muette »... Les deux sexes ne se regardaient pas en chiens de faïence... « telle sympathie était entre les hommes et les femmes que par chacun jour, ils étaient vêtus de semblable parure... »
« Toute leur vie était employée non par lois, statuts ou règles, mais selon leur vouloir ou franc arbitre ; se levaient du lit quand bon leur semblait ; buvaient, mangeaient, travaillaient, dormaient quand le désir leur venait. Nul ne les éveillait, nul ne les parforçait ni à boire, ni à manger, ni à faire chose autre quelconque. Ainsi l’avait établi Gargantua. Et leur règle n’était que cette clause, fais ce que tu voudras, parceque gens libres, bien nés, bien instruits, conversant en compagnies honnêtes, ont par nature un instinct et un aiguillon qui toujours les pousse à faits vertueux et retire du vice, lequel ils nommaient honneur. Iceux, quand par vile sujétion et contrainte sont déprimés et asservis, détournent la noble affection par laquelle à vertus franchement tendaient à déposer et enfreindre ce joug de servitude : car nous entreprenons toujours choses défendues, et convoitons ce qui nous est dénié... Par cette liberté, entrèrent en louable émulation de faire tout ce que à un seul voyaient plaire. Si quelqu’une ou quelqu’un disait : « Buvons », tous buvaient. Si disait : « Jouons », tous jouaient. Si disait : « Allons à l’ébat ès champs », tous y allaient... »
Rabelais est plutôt un utopiste. Nous ne parlerons pas, ici, d’ailleurs, des Utopies et des Utopistes, que nous reverrons dans l’article consacré à ce sujet. Un autre précurseur de l’anarchie est sans contredit La Boétie, dans son Contr’un ou De la servitude volontaire (1577), dont l’idée maîtresse est le refus à opposer au service du tyran, dont la puissance a sa source dans la servitude volontaire des hommes. « Le feu d’une petite étincelle s’étend et toujours se renforce, brûlant du bois et d’autant plus qu’il en trouve ; sans qu’on y mette de l’eau pour l’éteindre, seulement en n’y mettant plus de bois, n’ayant plus rien à consumer, il se consume lui-même, devient sans forme et n’est plus feu. De même en est-il des tyrans : plus ils pillent, plus ils exigent, plus ils ruinent et détruisent, et plus on leur donne, plus on les sert. ; plus ils se fortifient, mieux ils sont en situation de tout détruire ou anéantir ; et si on ne leur donne rien, si on ne leur obéit point, sans combattre, sans frapper, ils demeurent nus et défaits et ne sont plus rien : ainsi, la racine qui n’ayant plus de sève ni d’aliments, devient une branche sèche et molle... Soyez résolus de ne servir plus et vous serez libres. »
La Boétie ne préconise pas une organisation sociale définie. Cependant il parle de la nature qui a fait tous les hommes de même forme et semble-t-il au même moule... « elle n’a pas envoyé les plus forts et les plus avisés comme des brigands... » pour maltraiter « les plus faibles ; plutôt faut-il croire que faisant aux uns les parts plus grandes et aux autres plus petites, elle voulait faire une place à l’affection fraternelle lui donnant occasion de s’employer, les uns ayant plus de puissance de donner aide et les autres besoin d’en recevoir... »
« Si donc cette bonne mère nous a donné à tous figure de même pâte... ; si elle nous a accordé à tous, sans distinction, ce grand présent de la voix et de la parole pour nous mettre en rapport et fraterniser davantage, pour faire, par l’habitude et le mutuel échange de nos pensées, une communion de nos volontés ; si elle a tâché par tous les moyens de serrer, d’étreindre plus fort le nœud de notre alliance en société ; si elle a montré en toutes choses qu’elle voulait à la fois nous faire unis et tous uns ; s’il en est ainsi, il ne faut pas douter que nous soyons tous compagnons ; et il ne peut tomber dans l’entendement de personne que la nature en ait mis aucun en servitude, nous ayant tous mis en compagnie. »
De cela on pourrait déduire tout un système social.
La monarchie devient de plus en plus absolue. Louis XIV réduit la moitié de l’intelligentsia à l’état de domestiques et force l’autre moitié à recourir aux presses hollandaises. Dans Les soupirs de la France esclave qui aspire à la liberté (1689–1690) et d’autres ouvrages du même genre parus à Amsterdam, on ne trouve guère d’anarchisme. Il faut aller jusqu’à Diderot pour entendre énoncer cette phrase qui contient, en elle seule, tout l’anarchisme :
« Je ne veux donner ni recevoir de lois. »
Dans son entretien d’un père avec ses enfants (Œuvres complètes, vol. V, p. 301), il avait donné l’antériorité à l’homme de la nature sur l’homme de la loi, à la raison humaine sur celle du législateur. Tout le monde se souvient de la phrase de la Maréchale, dans l’Entretien d’un Philosophe avec la Maréchale :
« Le mal, ce sera ce qui a plus d’inconvénients que d’avantages ; et le bien, au contraire, ce qui a plus d’avantages que d’inconvénients. »
Et de celle des adieux du vieillard dans le Supplément du voyage de Bougainville :
« Vous êtes deux enfants de la nature : quel droit as-tu sur lui qu’il n’ait pas sur toi ? »
Stirner, plus tard, ne dira pas mieux.
Dans la Revue Socialiste de septembre 1888, Benoît Malon consacre une dizaine de pages à Don Deschamps, bénédictin du XVIIIème siècle, précurseur de l’Hégélianisme, du Transformisme et du Communisme anarchiste.
Voici, enfin, Sylvain Maréchal, poète, écrivain, bibliothécaire (1750–1803) qui, le premier, proclama joyeusement des idées anarchistes, entachées cependant d’arcadisme. Sylvain Maréchal est un polygraphe qui a touché à toutes sortes de sujets : il débute par des Bergeries (1770) et des Chansons anacréontiques, en 1779 ; il trouve à faire paraître ses fragments d’un Poème moral sur Dieu, le Pibrac moderne, en 1781 ; en 1782, L’âge d’or, recueil de contes pastoraux ; en 1784 son Livre échappé au déluge ou Psaumes nouvellement découverts. En 1788, sous-bibliothécaire à la bibliothèque Mazarine, il public son Almanach des honnêtes gens, où il substituait aux noms des saints ceux des hommes et des femmes célèbres : il y plaçait JésusChrist entre Epicure et Ninon de Lenclos. Aussi cet almanach fut-il condamné à être brûlé de la main du bourreau, et son auteur envoyé à Saint-Lazare, où il demeura quatre mois. En 1788, ses Apologues modernes à l’usage du dauphin. C’est là que se trouve l’histoire du roi qui, à la suite d’un cataclysme, renvoie chacun de ses sujets chez lui, en prescrivant que, désormais, chaque père de famille sera roi dans son foyer. C’est là que se trouve énoncé le principe de la Grève générale, comme moyen d’instaurer une société où la Terre est propriété commune de tous ses habitants, où règnent « la liberté et l’égalité, la paix et l’innocence ». Dans le Tyran triomphateur, il imagine un peuple abandonnant les villes à la soldatesque et se réfugiant dans les montagnes, où, partagé en famines, il vivra sans autre maître que la nature, sans autre roi que leurs patriarches, abandonnant pour toujours le séjour dans les cités, bâties par eux à grands frais, dont chaque pierre a été arrosée par leurs larmes, teinte de leur sang. Les soldats envoyés pour ramener ces hommes dans leurs agglomérations se convertissent à la liberté, demeurant avec ceux qu’ils devaient ramener en servitude, renvoient leurs uniformes au tyran, qui meurt de rage et de faim en se dévorant lui-même. C’est sans contredit une réminiscence de la Servitude volontaire.
En 1790, il édite l’Almanach des honnêtes femmes, orné d’une gravure satyrique sur la duchesse de Polignac. Renchérissant sur l’Almanach des honnêtes gens, chaque saint est remplacé par une femme connue. Ces femmes célèbres sont divisées en 12 classes, selon leur « genre » (1 classe par mois) : Janvier, Fricatrices ; Février, Tractatrices, etc. Nous avons ainsi à la suite les Fellatrices, les Lesbiennes, les Corinthiennes, les Samiennes, les Phœniciennes, les Siphnassiennes, les Phicidisseuses, les Chaldisseuses, les Tribades et les Hircinnes. Très rare, cette brochure ne se trouve plus guère qu’à l’enfer de la Bibliothèque Nationale.
Sylvain Maréchal n’accepta qu’avec réserve la révolution de 1789. Le premier journal anarchiste français, L’Humanitaire, (1841) affirme qu’il disait qu’aussi longtemps qu’il y aurait des maîtres et des esclaves, des pauvres et des riches, il n’y aurait ni liberté, ni égalité.
Sylvain Maréchal continue ses publications : en 1791, Dame Nature à la barre de l’Assemblée Nationale ; en l’an II, le jugement dernier des rois ; en 1794, la fête de la raison. Il collabore aux Révolutions de Paris, à l’Ami de la Révolution, au Bulletin des Amis de la Vérité. L’hébertiste Chaumette, son ami, tombe victime de la Terreur, mais Sylvain Maréchal échappe à Robespierre comme il échappera à la réaction thermidorienne et aux persécutions du Directoire, bien qu’il eût collaboré à la rédaction du Manifeste des Egaux, du moins on l’assure.
La tourmente passée, Maréchal reprend la plume. En 1798, paraît son Culte et lois d’une société d’hommes sans Dieu. En 1799, Les voyages de Pythagore, en 6 volumes. En 1800, son grand ouvrage, Dictionnaire des athées anciens et modernes, dont l’astronome Jérôme Lalande écrivit le supplément. En 1807, enfin, De la Vertu..., ouvrage posthume, qui fut peut-être imprimé, mais qui ne parut pas, et dont Lalande se servit pour son second supplément au « Dictionnaire des Athées ». Napoléon interdit d’ailleurs à l’illustre astronome de continuer plus longtemps à écrire sur l’athéisme.
* * *
En Angleterre, on peut considérer jusqu’à un certain point Winstanley et ses niveleurs comme des précurseurs de l’anarchisme, comme on a pu le voir par l’article que nous leur avons consacré. John Lilburne, un autre niveleur, dénonçait l’autorité « sous toutes ses formes et ses aspects » ; ses condamnations à l’amende, ses années de prison, ne se comptaient plus. On l’exila en Hollande. A trois reprises différentes, le jury l’acquitta la dernière fois en 1613 (il avait enfreint son arrêté d’expulsion), Cromwell le maintint en captivité « pour le bien du pays » ; en 1656, devenu quaker, on le libéra, ce qui ne l’empêchait pas, en 1657, à 39 ans, de mourir de phtisie galopante.
Vers 1650, il est question de Roger Williams, qui débuta comme gouverneur du territoire qui forma plus tard l’Etat de Rhode Island (aux Etats-Unis) et surtout d’un de ses partisans, William Hurris, qui tonnait contre l’immoralité de tous les pouvoirs terrestres et le crime de tous les châtiments, S’agit-il d’un visionnaire mystique ou d’un anarchiste isolé ? Les premiers quakers sont également des antiétatistes décidés.
Le Hollandais Peter Cornelius Hockboy (1658), l’Anglais John Bellers (1685), l’Ecossais Robert Wallace (1761) se prononcent pour un socialisme volontaire et coopérateur. Dans ses Prospects, Robert Wallace concevait une humanité composée de nombreux districts autonomes. La protestation contre les abus gouvernementaux, contre les excès de l’autorité se fait jour dans des pamphlets, des satires de toute nature, écrits avec une virulence et une franchise dont il n’y a guère d’exemple aujourd’hui. Citer les noms de Thomas Hobbes, John Toland, John Wilkes, Swift, De Foe, suffira.
Nous arrivons à l’Irlandais Edmond Burke et à sa Vindication of Natural Society (1756) — justification de la société naturelle — dont l’idée fondamentale est celle-ci : quelle que soit la forme de gouvernement, il n’en est aucun qui soit meilleur qu’un autre :
« Les différentes espèces de gouvernement rivalisent mutuellement concernant l’absurdité de leurs constitutions et l’oppression qu’ils font endurer à leurs sujets... Même les gouvernements libres, relativement à l’étendue de leur territoire et à leur durée, ont connu plus de confusion et commis plus d’actes flagrants de tyrannie que les gouvernements les plus despotiques de l’histoire. »
Edmond Burke revint sur ses dires. Dans ses Reflexions, il s’éleva contre la Révolution française. Un Américain, Paine, député à la Convention, lui répondit par The Fights of Man (1791–92) — les droits de l’homme. S’étant opposé à l’exécution de Louis XVI, il fut jeté en prison. Il échappa de peu à la guillotine. Il profita de son emprisonnement pour écrire l’Age de Raison — The Age of Reason — (1795).
« A tous ses degrés, la société est un bienfait, mais, même sous son aspect le meilleur, le gouvernement n’est qu’un mal nécessaire ; sous son pire aspect, c’est un mal intolérable... Le métier de gouverner a toujours été monopolisé par les individus les plus ignorants et les plus fripons que compte l’humanité. »
En 1796, paraît une brochure à Oxford, intitulée : « The inherent Evils of all State Government demonstrated » — « Démonstration des maux inhérents à tout gouvernement étatiste », — attribuée à A.-C. Cuddon, fortement teintée d’anarchisme individualiste, et que Benj. R. Tucker a rééditée en 1885, à Boston,
Sous l’influence de la Révolution, il s’était créé à Londres un groupe appelé Pantisocracy, sous l’impulsion du jeune poète Southey, qui devait, plus tard, à l’exemple de Burke, renier ses rêves de jeunesse. D’après Sylvain Maréchal — confirmé en partie par Lord Byron — ce groupe épicurien voulait réaliser l’abbaye de Thélème, et entendait rendre toutes choses communes entre ses membres, les jouissances sexuelles y comprises. Toujours d’après Maréchal, les plus grands artistes, les plus grands savants, les hommes les plus célèbres de l’Angleterre auraient fait partie de ce milieu qui finit par être dissous par un Bill du Parlement (« Dict. des Athées », au mot : Thélème).
Dans ses Figures d’Angleterre, Manuel Devaldès, présente La Pantisocratie comme un projet de colonie à établir en Amérique parmi les Illinois, colonie basée sur l’égalité économique. Deux heures de travail quotidien devaient suffire à la nourriture et à l’entretien des colons. A la suite de la défection de Southey et de la mort de deux des principaux initiateurs, la Pantisocratie serait morte sans avoir vu le jour.
En Allemagne, Schiller écrivait les Brigands, dont le principal personnage, Karl Moor, s’élevait contre les conventions, la loi, qui n’a jamais créé un grand homme alors que la liberté a engendré des colosses et des horsmesure. Fichte disait que, si l’humanité était moralement accomplie, elle n’aurait pas besoin d’Etat ; Wilhelm de Humboldt, en 1792, défendait la thèse de la réduction de l’Etat à sa fonction minimum ; Alfieri, en Italie, écrivait De la Tyrannie.
De tous côtés, l’autorité, sous une forme ou sous une autre était battue en brèche. Spinoza, Comenius, Vico, Voltaire, Lessing, Herder, Condorcet ont été des libertaires par certains points, certaines formes de leur activité littéraire. En luttant contre les supplices infligés aux sorciers, contre la sévérité des châtiments des délits, contre l’esclavage — pour la libération de la femme — pour une autre éducation de l’enfant — contre la superstition religieuse et pour le matérialisme : Spee, Thomasius, Beccaria, Sonnenfelds, John Howard, Clarkson, Mary Wollstonecraft, Rousseau, Pestalozzi, La Mettrie, d’Holbach, ont sapé les piliers de l’autorité. Il faudrait un volume pour rappeler les noms de ceux qui ont, à un point de vue ou à un autre, contribué à ébranler la foi en l’Etat et en l’Eglise.
Aussi nous arrêterons-nous à William Godwin, dont nous considérons l’Enquête sur la justice politique et son influence sur la vertu et le bonheur en général (1793) comme le premier doctrinaire de l’anarchisme digne de ce nom. Il est bien vrai que Godwin est un communiste-anarchiste, mais sa négation de la loi et de l’Etat convient à toutes les nuances de l’anarchisme.
— E. ARMAND.
PRÉHISTOIRE
(du latin prœ, avant et histoire)
DÉFINITION. — La préhistoire suppose une définition de l’histoire. Elle est elle-même une histoire, — l’histoire de l’humanité en l’absence de l’écriture. L’histoire serait le récit des faits et gestes de l’humanité transmis par l’écriture. Peyrony donne de la préhistoire cette définition :
« La préhistoire est la science qui, se basant sur des faits positifs, recherche ce qui s’est passé avant que les hommes aient relaté par écrit les faits dont ils étaient témoins. »
Capitan définit ainsi la science préhistorique :
« La préhistoire cherche à reconstituer la vie des premiers hommes, alors que, sauvages tout à fait primitifs, ils vivaient comme ceux-ci, n’ayant qu’une seule préoccupation : lutter contre la mort qui de toutes parts les menaçait et parvenir à continuer de vivre. »
Nous croyons inutile de reproduire ici les nombreuses définitions qui ont été données de la Préhistoire par les savants. Toutes se ramènent à la précédente. Est-il juste cependant de définir la préhistoire comme étant l’histoire de l’humanité en l’absence de l’écriture ? L’écriture ne suffit pas à établir une démarcation entre la préhistoire et l’histoire. En effet, l’écriture ne date pas des temps historiques : nos ancêtres des cavernes avaient découvert des signes linéaires susceptibles de fixer leurs pensées sur une matière dure bien avant les phéniciens, auxquels on attribue l’invention de l’alphabet. Ne disons pas que la préhistoire est l’histoire de l’humanité en l’absence de l’écriture, mais l’histoire de l’humanité alors qu’existait une écriture dont nous ne connaissons pas la clé. Une écriture a bien existé pendant la préhistoire, mais nous ne l’avons pas encore déchiffrée. On interprète certains signes comme étant des marques de chasse ou de propriété. Il en est qui sont de véritables lettres, parmi lesquelles on en retrouve quelques-unes dont nous nous servons pour écrire ces lignes. Si nous ne sommes pas parvenus à déchiffrer l’écriture linéaire préhistorique, dont on constate l’existence 25.000 ans environ avant notre ère, pendant l’époque dite de la Madeleine, nous avons à notre disposition, pour reconstituer la vie de nos lointains ancêtres, une écriture particulière, qui est celle de l’art. Cette écriture peut être comprise de tous. Certes, on peut encore l’interpréter. Cependant le langage de l’art finit par livrer tous ses secrets à celui qui fait un effort pour les découvrir.
Plutôt que l’écriture, ce sont des conditions morales qui séparent la préhistoire de l’histoire. On peut dire qu’avec l’histoire commence une ère d’esclavage et de bluff, et que l’homme a cessé de vivre librement pour s’assujettir à des gouvernements et à des lois. Les monuments de l’histoire prouvent surabondamment cet état d’esprit que les monuments de la préhistoire sont loin de nous révéler. Déjà l’époque néolithique, avec les menhirs et les dolmens, nous fait pressentir ce que sera un monde en proie à l’autoritarisme, ayant succédé à l’anarchie, — ici le mot anarchie n’est point synonyme de désordre, mais d’harmonie -, à l’anarchie qui fut le premier état social de l’humanité.
MÉTHODE. — Pour reconstituer l’homme primitif, la science préhistorique a recours à toutes les sciences. Elle s’appuie sur toutes les connaissances humaines. Elle n’a que l’embarras du choix. Elle utilise toutes les méthodes. Ces méthodes, maniées avec prudence, nous permettent d’approcher d’une vérité approximative, relative, qui peut nous suffire. On combinera la méthode objective avec la méthode subjective. L’imagination et l’observation se prêteront main forte. Comment se passerait-on de l’observation en préhistoire ? D’autre part, l’observation toute seule ne suffit pas. Parfois, l’imagination nous met sur son chemin, ce qui nous entraîne à dire que le préhistorien idéal doit être doué d’autant de sensibilité que d’intelligence, et être savant et artiste à la fois.
En préhistoire, il faut commencer par le commencement. On partira donc du système solaire. La méthode astronomique précédera toutes les autres. Ensuite la géologie nous livrera la clé de bien des énigmes. La méthode géologique, qui en englobe elle-même d’autres, nous permettra de pousser plus avant nos investigations. Méthode astronomique, méthode géologique, ce sera là notre point de départ. La méthode stratigraphique permettra d’étudier couche par couche les débris abandonnés par les différents peuples qui se sont succédé. Le préhistorien sera tour à tour anthropologiste, archéologue, ethnographe, botaniste, zoologiste, minéralogiste, etc. L’archéologie combinée avec la paléontologie animale et la paléontologie humaine associées à la méthode esthétique et à la science de l’art permettront au préhistorien de « ressusciter » la vie des générations disparues. Nous pensons que l’étude de l’art préhistorique peut achever de recréer l’état d’âme et la mentalité des primitifs préhistoriques. On se gardera bien d’assimiler ceux-ci à des enfants, où même à des sauvages (la méthode ethnographique a du bon, à condition de ne pas en abuser).
Nous n’avons indiqué ici que très succinctement la méthode suivie par la science préhistorique. Répétons que toutes les sciences sont pour elle de précieux auxiliaires. D’autre part, le préhistorien doit être un esprit libéré de tous les préjugés, un ennemi des coteries et des formules toutes faites, et ne pas s’enfermer dans une théorie et s’y complaire, lorsque de nouvelles découvertes viennent les infirmer. C’est dire que la passion du vrai passera chez lui avant la passion tout court. Les préhistoriens n’ont pas toujours donné l’exemple de la sagesse : on assiste à de véritables pugilats oratoires qui ne nous les montrent guère sous un jour favorable. L’envie, la jalousie, l’incompréhension en font des êtres aussi laids que les moralistes et les politiciens. Le préhistorien devra donc s’affranchir des petitesses et des égoïsmes engendrés par la déformation professionnelle, l’esprit de corps, etc. Qu’il médite ces paroles d’un des siens :
« Notre préhistoire est aujourd’hui si compliquée, elle nous révèle, à chaque instant, des particularités si singulières de l’ethnographie de nos ancêtres, qu’il ne faut jamais rien nier a priori. »
Qui dit cela ? Le docteur Capitan, qui n’a pas toujours lui-même donné l’exemple du tact et de la sagesse. Et il ajoute :
« Rien n’est plus déplorable qu’une critique théorique... et à distance. »
Il condamne ainsi les procédés de ses amis. Il ne faut pas qu’une affaire comme celle de Glozel se renouvelle, dans laquelle on a vu les « officiels » essayer d’établir une sorte de trust de la préhistoire et la confisquer à leur profit. Ils refusent de voir ce qui n’entre pas dans leurs classifications, et ils en arrivent à nuire à la science qu’ils prétendent représenter.
HISTOIRE DE LA PRÉHISTOIRE.
La préhistoire a son histoire. C’est une science jeune, née d’hier, et qui possède déjà ses lettres de noblesse. Science neuve, révolutionnaire pourrait-on dire, elle a subi dès sa naissance de rudes assauts. Ne venait-elle pas démontrer que l’homme avait d’humbles origines, qu’il n’était pas sorti parfait des mains du créateur, et qu’il ne datait pas de 4.000 ans avant notre ère, comme le prétendaient les partisans du créationnisme, fanatiques de la genèse biblique, en tête desquels Bossuet qui résumait l’opinion des savants et des historiens sous le règne de Louis Le Grand ? Les hommes ne se sont aperçus que très tard qu’ils n’étaient pas nés ex nihilo, et qu’ils avaient pour ancêtres tous les animaux qui vivaient à la surface de la terre, bien avant l’apparition de la bête verticale.
Laissons de côté les cosmogonies, les théogonies les plus anciennes qui ont pressenti la vérité. Disons que Lucrèce peut-être considéré comme le précurseur des savants modernes, car le disciple d’Epicure, ennemi comme lui de tous les dieux, voyait dans l’espèce humaine une espèce qui n’échappait pas aux lois qui régissent tous les êtres. Dans son admirable poème : De la Nature, il a montré l’homme luttant pour vivre, grattant la terre avec ses ongles, se nourrissant de racines, tableau bien différent de celui qui représente le premier homme jouissant de tous les privilèges, au sein du paradis terrestre, avant la faute d’Adam.
On a cru longtemps que les instruments de silex étaient tombés du ciel, les pierres de foudre étaient considérées pour cette raison comme des talismans. Bernard Palissy, Mercati, Léonard de Vinci, ont d’abord fait justice de ces superstitions. Peu à peu la vérité s’est fait jour, avec De Jussieu, Mahudel, Goguet, Eckard, etc. Beaucoup d’autres savants, de philosophes, mériteraient d’être cités ici. Bornons-nous à rappeler que Jacques-François de Borda, né à Dax (1718–1803), naturaliste, dont personne n’a parlé, s’était intéressé particulièrement, pendant le XVIIIe siècle, aux silex taillés, que certains considéraient encore comme tombés du ciel, alors qu’ils étaient l’œuvre d’une main humaine. Dans ses Mémoires pour servir à l’histoire du règne animal des environs de Dax, en Gascogne, De Borda écrit :
« Les anciens habitants du pays, et vraisemblablement ceux qui les premiers y fixèrent leurs demeures, ont employé le silex pour en faire divers instruments... On trouve quelquefois dans les Landes des pointes de flèches faites de silex, mais grossièrement travaillées ; il paraît qu’on leur donnait la forme triangulaire en frappant la pierre. »
Le véritable fondateur de la préhistoire, le premier préhistorien, fut Boucher de Perthes (1788–1868), qui démontra que les silex taillés étaient l’œuvre de l’homme préhistorique. Naturellement on le traita de fou. Il lutta pendant un demi-siècle pour ses idées (nous avons conté, année par année, son long martyrologe, dans notre Philosophie de la Préhistoire (tome premier). Boucher de Perthes avait contre lui les savants officiels et les réactionnaires de tous clans. Depuis ses découvertes, la préhistoire a fait du chemin : on pourrait citer une centaine de préhistoriens qui ont marché sur ses traces. Lartet, Piette, Capitan, Breuil, combien d’autres ont contribué à enrichir la science préhistorique. Il y eut malheureusement des « officiels », parmi les continuateurs de Boucher de Perthes, qui n’eurent ni sa sincérité ni son indépendance. Une équipe de chercheurs exempts de préjugés scientifiques ou autres a heureusement continué l’œuvre de l’homme libre -sous tous les rapports — qu’était le fondateur de la préhistoire (tous ses écrits, science, essais, philosophie, littérature, etc., sont ceux d’un anarchiste). On peut dire qu’entre leurs mains la science préhistorique s’est ressaisie : on attend de ces « amateurs » un renouvellement de ses méthodes et de son esprit qui permettra de résoudre le problème des origines humaines.
L’ANTÉ-PRÉHISTOIRE, LES ÈRES GÈOLOGIQUES.
Pour comprendre la préhistoire et saisir le problème des origines humaines, il importe, avons-nous dit, d’interroger la géologie. Celle-ci en est la meilleure introduction.
La Terre n’a pas toujours existé. Elle est relativement jeune, par rapport aux astres qui peuplent l’immensité. Un jour, dans cette immensité, un grain de poussière apparut. Ce grain de poussière a vu naître l’espèce humaine. Peut-être, dans d’autres mondes, existe-t-il d’autres espèces, plus ou moins voisines de la nôtre. Rien ne s’oppose à cette hypothèse. La terre a son histoire, comme tous les êtres qui ont vécu et vivent à sa surface. Elle n’est qu’un point dans l’infini, et n’échappe pas aux lois qui régissent l’univers. Elle a eu son enfance et son adolescence. Elle entre à peine dans son âge mûr. Elle connaîtra la décrépitude. Un temps viendra où elle ne sera plus qu’un astre mort, errant à travers l’espace.
Détachée de la nébuleuse solaire, la terre est devenue, en se refroidissant, une sphère liquide, à la surface de laquelle s’est condensée la croûte terrestre. Globe de feu, puis atome de boue, ainsi débuta la planète qui devait donner naissance au genre humain.
La Terre a d’ abord connu une ère primitive. Pendant cette ère, elle est restée stérile. Cependant, s’élaborait lentement dans ses flancs le monde futur. Quand les conditions atmosphériques le permirent, la vie se manifesta, sous les formes les plus humbles. Puis elle se modifia, au cours de périodes d’une durée fort longue. La voir grandir et se développer, c’est assister au plus émouvant des spectacles, c’est suivre les péripéties du plus tragique des romans.
Dans les couches terrestres étudiées par les géologues, on peut suivre aussi facilement qu’en tournant les feuillets d’un livre, cette longue ascension de plantes et d’animaux vers des formes de plus en plus perfectionnées. On n’a trouvé aucune trace d’êtres vivants dans les roches cristallines fondues sous l’action de la chaleur et devenues solides par suite du refroidissement. Au contraire, dans les rochers sédimentaires, formées par la dissociation des précédentes, sous l’influence de différents agents, ces traces sont visibles : on peut les suivre sans interruption des infusoires jusqu’à l’homme.
On a donné le nom de fossiles aux restes d’espèces disparues trouvés dans les entrailles de la terre. On peut considérer les fossiles comme de véritables médailles de la création. Quelquefois des empreintes les remplacent, moules indélébiles qui ont conservé la forme des espèces.
L’histoire de la Terre a été divisée en plusieurs périodes plus ou moins longues. C’est ainsi qu’on distingue une ère archéenne (de arkhé, commencement). Pendant cette ère, le globe terrestre est vierge de toute trace d’être vivant, le milieu n’étant guère favorable à l’éclosion de la vie, ou les organismes qui ont vécu à cette époque ayant été détruits. Cette période, la plus longue des ères géologiques, a duré des millions d’années. L’océan recouvrait alors tout le globe.
Aux temps archéens succéda l’ère primaire. En cet âge primordial, vierge de tout visage humain, la plante et l’animal se confondaient. D’une cellule, formée d’éléments inorganiques, étaient sortis tous les êtres. La vie avait d’abord pris l’apparence de corpuscules gélatineux ou protoplasma. Dans cet immense laboratoire qu’était la nature, s’ébauchait un monde nouveau, dont elle n’avait pas conscience.
Au fond des mers tièdes, à des profondeurs insoupçonnées, les premiers êtres vivants, moitié plantes, moitié bêtes, en grande partie minéraux, soumis aux mêmes lois physico-chimiques, solidaires les uns des autres, inauguraient cette longue histoire qui devait aboutir à l’homme.
Tels furent les premiers habitants du globe. Ces êtres étaient muets et sans sexe. Ils se reproduisaient par fractionnement ou fissiparité. Autant de morceaux, autant d’individus différents.
L’ère primaire, d’une durée immense, comprend plusieurs terrains, auxquels on a donné les noms des localités où ils ont été étudiés, mais qui se rencontrent aussi en d’autres contrées. C’est ainsi que les géologues ont distingué le précambrien, dans lequel on trouve des traces de restes organiques, précédant, comme son nom l’indique, le cambrien ou silurien inférieur (silurien vient de Silures, anciens habitants du Pays de Galles). On trouve dans le silurien des crustacés aux formes bizarres, tels que les trilobites. Dans le dévonien (comté de Devon, Angleterre), on trouve comme fossiles des spirifers (sortes de brachiopodes) et des poissons cuirassés. Dans le terrain suivant (houiller ou carbonifère), apparaissent les insectes et les plantes cryptogames. Le Permien (de Perm, Russie), qui vient ensuite, contient des batraciens et les premiers reptiles.
Il y avait, à cette époque, des animaux intermédiaires entre les reptiles et les batraciens. C’étaient d’énormes crapauds appelés labyrinthodontes, recouverts de plaques osseuses, dont on a retrouvé les traces sur les rivages qu’ils ont parcourus.
Parmi le monde végétal dominaient les lycopodes, les prèles, les fougères, les uns et les autres de taille géante. Lépidodendrons, sigillaires, calamites, se développaient sous un climat chaud et humide, analogue à celui des tropiques. Il n’y avait à cette époque ni été ni hiver, mais une température uniforme.
L’ère primaire fut très mouvementée. Il y eut d’importantes éruptions volcaniques. Les plissements de l’écorce terrestre formèrent trois grandes chaînes de montagnes (huronienne, calédonienne et hercynienne, aujourd’hui disparues. Il y avait alors trois continents (le continent nord atlantique, le continent sino-sibérien et la terre de Gondwana (comprenant le Brésil, l’Afrique et l’Australie).
Pendant l’ère secondaire, la vie progresse et continue. L’atmosphère se nettoie, les espèces animales et végétales se multiplient La terre entre dans son adolescence...
Le monde animal, sorti des eaux, avait pris possession du globe. La vie avait fat un nouveau pas en avant, et allait s’enrichir, sans cesse.
L’ère secondaire comprend le triasique (trois formations distinctes), dans lequel on rencontre des encrines, des cérulites, et aussi des labyrinthodontes ; le jurassique, inférieur, moyen et supérieur, qui renferme des ammonites, des bélemnites, des reptiles nageurs et volants, et les premiers oiseaux ; le crétacé (craie), pendant lequel les ammonites se déroulent, les oiseaux à dents se multiplient, et les reptiles terrestres ou dinosauriens (du grec deinos, terrible, et sauros, lézard), sont les trois de la création.
Ces derniers étaient les bêtes les plus étranges que la nature ait enfantées. Ils tenaient de tous les animaux à la fois. C’étaient de véritables monstres, de dimensions colossales, de 15 à 60 mètres de long, herbivores ou carnivores, marchant les uns à quatre pattes, les autres sur leurs pattes de derrière comme des bipèdes. Ils se distinguaient par un corps énorme, surmonté d’une petite tète. Ils incarnaient la force et la stupidité. Parmi les représentants de cette faune géante, bornons-nous à citer l’atlantosaure, le gigantosaure, le brontosaure, le mégalosaure, le stégosaure, le cératosaure, l’allosaure, l’apatosaure, le titanosaure, l’hadrosaure, le mosasaure et cent autres, sans oublier le diplodocus, le zanglodon, le triceratops, l’agathomas, l’iguanodon, le trachodon, le brontozoum, le dimétrodon, auquel il convient d’ajouter cœlurus, lœlaps, thespesius, cheirotheriums et compsognathes. Ces êtres paradoxaux étaient dignes de leurs émules, les reptiles nageurs (ichtyosaures, plésiosaures, téléosaures, mosasaures, hyléosaures, etc.) ou des reptiles volants, tels que le ptérodactyle qui partageaient le royaume des airs avec l’archéoptéryx, le premier oiseau (ce dernier était de petite taille).
L’ère secondaire vit apparaître, vers sa fin, des animaux de la taille d’un rat, le corps couvert de poils et allaitant leurs petits au moyen de mamelles : c’étaient les mammifères, qui allaient remplacer, pendant l’ère tertiaire, les grands sauriens de l’âge précédent.
La flore était représentée par des cycadées, des conifères et des palmiers auxquels étaient venus se joindre de rares hêtres et des chênes.
La température, qui avait été chaude dès le début, s’abaissa vers la fin. Les saisons firent alors leur apparition, comme en témoignent les cercles concentriques dans le bois, et la présence d’arbres à feuilles caduques. Cette ère fut relativement calme. Aucune montagne ne se forma et il n’y eut point d’éruptions volcaniques.
Comme les ères précédentes, l’ère tertiaire a été divisée par les géologues en plusieurs périodes, caractérisées par la nature des différents terrains contenant des fossiles. En commençant par les plus anciens, nous trouvons d’abord l’éocène (de eos, aurore, et kainos, récent), l’oligocène (de otigos, peu récent), le miocène (de méion, moins récent), et le pliocène (plelon, plus récent).
Avec l’ère tertiaire, nous nous rapprochons des temps actuels. Le développement pris par les mammifères parmi les vertébrés a transformé l’aspect de la planète.
L’ère tertiaire marque une nouvelle étape dans l’évolution de la vie. Les invertébrés sont représentés par les nummulites, semblables à des pièces de monnaie, et les cérithes, sortes de gastéropodes en forme de cônes. Parmi les vertébrés, ce sont les mammifères qui l’emportent : leur règne commence. Depuis la fin de l’ère secondaire, ils ont fait du chemin ; ils sont devenus les rois de la création. Depuis longtemps les grands reptiles secondaires sont ensevelis dans la boue des marécages, leur organisme ayant atteint un degré de perfectionnement qui ne pouvait être dépassé.
Au tertiaire moyen, apparut un pré-éléphant, le mastodonte, possédant quatre incisives, presque droites, et des molaires énormes, faisant l’office de broyeurs. Au tertiaire supérieur, les précurseurs de l’homme, et l’homme lui-même connurent l’éléphas méridionalis, de 4 mètres 22 de hauteur, de 5 mètres 36 de longueur, et le dinothérium, qui avait deux défenses inférieures recourbées vers le bas, et qui était le plus grand des mammifères terrestres : il avait 6 mètres 50 de long et 5 mètres de haut.
On a trouvé dans les terrains tertiaires les précurseurs du cheval, parmi lesquels le phénacodus, de la taille d’un loup, possesseur de cinq doigts.
Les ruminants comprenaient l’antilope, le bœuf, le mouton, le chevreuil, la girafe et le chameau.
Le xiphodon, aux dents en forme d’épée, se rapprochait de la gazelle. D’autres mammifères à sabots possédaient un nombre pair de doigts, l’anthracotherium, rappelant le sanglier, l’anaplotherium, de la grosseur d’un âne, dont a trouvé le squelette dans le gypse de Montmartre.
Les carnassiers et les singes apparurent vers la fin du tertiaire. Parmi les premiers figuraient le terrible machairodus, fauve redoutable aux dents tranchantes en forme de poignards, plus redoutable encore que les chiens, les chats, les loups, les ours, les tigres et les lions parmi lesquels il vivait.
Les animaux de l’ère tertiaire ont, avec les nôtres, de grandes ressemblances. Poissons, reptiles, batraciens et oiseaux se rapprochent de plus en plus de ces derniers. Les oiseaux sont dépourvus de dents, alors que ceux des temps secondaires en avaient. Tortues, lézards, crocodiles, serpents, ont pris la place des grands sauriens. De vrais singes succèdent aux lémuriens du début de l’ère tertiaire. Bientôt surgira un être que la nature est en train de tisser dans ses flancs : l’homme.
La flore des temps tertiaires ressemblait beaucoup à celle d’aujourd’hui. Ce furent d’abord des plantes tropicales, telles que palmiers, lauriers, bananiers, camphriers, mais la température s’abaissant apparurent des arbres à feuilles caduques, tels que les chênes et les érables. Les plantes à fleurs se sont développées. Les graminées nourrissent de nombreux troupeaux d’herbivores. Les saisons commencent à se dessiner, le froid s’accroît, la glace recouvre les pôles et le sommet des hautes montagnes.
L’ère tertiaire a duré trois millions d’années. Elle a vu la naissance des grandes montagnes actuelles. A cette époque se sont formés les plissements alpins qui ont produit les Alpes, le Jura et les Pyrénées. L’Atlantique, la Méditerranée et la Manche se sont ouverts, tandis que s’effondraient d’immenses continents tels que l’Atlantide.
Voici maintenant l’époque quaternaire, qui est celle dans laquelle nous vivons. Elle a été divisée en pléistocène (pleistos, beaucoup plus récent) et en holocène (olos, tout à fait récent, temps actuels). Quels progrès réalisés depuis les temps primitifs ! Quel plus beau roman que celui des espèces se succédant en se perfectionnant, pour aboutir à la forme humaine.
Le quaternaire a donné naissance à plusieurs sortes d’animaux contemporains de l’homme et de son précurseur. Parmi ces animaux, il en est dont les espèces sont éteintes : le mammouth, l’ours des cavernes, le rhinocéros à narines cloisonnées qui appartenaient à la faune froide. Le glyptodon était un tatou gigantesque, sorte d’édenté mesurant trois mètres de long. Sa carapace a pu servir d’abri aux premiers hommes. Des oiseaux géants, tels que le Dinornis ou Moa, de trois mètres de haut, et l’Aepyornis, de la même taille, qui pondait des œufs d’une capacité de dix litres, ont également disparu. D’autres animaux de la faune chaude émigrèrent vers d’autres cieux : l’hippopotame, la panthère, l’éléphant et, plus tard, le renne et l’élan. Enfin, d’autres animaux de l’époque quaternaire vivent encore dans nos pays : le cheval, le bœuf, le cerf, le sanglier, le chien et le loup. La flore était celle d’aujourd’hui.
Le climat consistait en périodes froides séparées par des périodes chaudes, ces périodes coïncidant avec l’avance et le recul des glaciers. Inutile d’ajouter que la géographie pléistocène correspondait, dans ses grandes lignes, à celle d’aujourd’hui.
Avec le quaternaire, nous entrons clans la Préhistoire. Fin du tertiaire ou commencement du quaternaire, offrant les mêmes caractères, ont assisté à la naissance de l’homme. Celui-ci ne date pas de 4.000 ans, comme le prétendait Bossuet, prenant à la lettre les Saintes Ecritures. S’il est, d’après ce qui précède, le benjamin de la nature, ce benjamin date de plusieurs milliers d’années. Il a pu apparaître au pliocène, et même au miocène. La nature, d’où il est issu, a sans doute recommencé plus d’une fois son œuvre. Il y a eu des ébauches d’êtres humains. Combien d’humanités ont disparu, ayant qu’une humanité plus perfectionnée ait supplanté les autres ! Et peut-être l’être humain actuel n’est-il, au point de vue physique, et ajoutons moral, qu’une caricature qui disparaîtra, remplacée par un être plus parfait à tous les points de vue. Mais cela, c’est le secret de l’avenir, de ce que nous appellerons la Post-histoire.
C’est à la fin du tertiaire ou au début du quaternaire, — ce qui est au fond la même chose, — qu’on rencontre des êtres intermédiaires entre les espèces de singes aujourd’hui éteintes, et l’homme actuel.
Le Pithécanthrope (de pithécos, singe, et anthropos, homme), découvert à Java en 1911, que Marcellin Boule croit être un gibbon géant plutôt qu’un hominien, tient des singes anthropomorphes par la forme de son crâne et ses arcades sourcilières proéminentes, mais par la capacité de sa boite crânienne et son attitude verticale, prouvée par la forme de son fémur, il tient de l’homme.
Dans la région de Pékin, ont été récemment mis au jour les restes d’un être intermédiaire entre le Pithécanthrope de l’Île de Java et l’homme de la race de Néanderthal (voir plus loin). On lui a donné le nom de Sinanthropus pékinensis, découvert en Chine en 1829, dans les montagnes du Hopéi occidental, dans une fente fossilifère de Tchéou-kéou-tien. La visière sourcilière de cet être est très développée.
Cet hominien connaissait le feu et vivait dans les cavernes. Il a laissé des outils de pierre et d’os. Ces objets, dont les retouches sont certaines, ressemblent aux objets pré-chelléens et chelléens (voir plus loin), sauf qu’au lieu d’être en silex, ils étaient de quartz et de quartzite. L’homme de Pékin est sûrement de l’âge du pithécanthrope ou de l’éoanthrope (eos, aurore, et anthropos, homme). Il était doué d’intelligence, c’était ce qu’on appelle un homo sapiens (l’homo sapiens a été reculé à tort, selon nous, à une époque ultérieure).
Notre ancêtre est une forme éteinte de singes anthropoïdes fossiles, et non d’un singe anthropoïde de races existant encore : chimpanzé, gorille ou gibbon. Les primates comprenaient les anthropoïdes, divisés en Platyrrhinés et Catarrhinés (de ces derniers font partie les Cynomorphes, Anthropomorphes et Hommes). Vers quelle époque se produisit la séparation des hominidés d’avec les primates ? Sans doute au tertiaire le plus ancien, ou pendant le miocène moyen. Dans l’Asie Centrale, les hominidés, croit-on, auraient évolué de l’état de quadrupèdes anthropomorphes aux formes bipèdes.
Nous pouvons maintenant aborder la Préhistoire proprement dite, caractérisée par la présence de l’homme au milieu des autres espèces animales.
DIVISIONS DE LA PRÉHISTOIRE.
La Préhistoire comprend plusieurs époques, chacune étant superposée sur une époque antérieure, et recouverte elle-même par une époque postérieure. Chaque époque comprend des industries caractéristiques, une faune et une flore associées à ces industries, ainsi qu’aux ossements des différentes races humaines. Au début, ce fut l’époque éolithique (eos, aurore, et lithos, pierre, en grec), ou le début de l’industrie de la pierre (celle-ci simplement utilisée, puis retouchée). Viennent ensuite les deux grandes divisions dues à Gabriel de Mortillet : le paléolithique (époque de la pierre taillée, du grec palaios, ancien, et lithos, pierre), et le néolithique (époque de la pierre polie, du grec néos, nouveau, et lithos, pierre), entre lesquels on a intercalé depuis le mésolithique, ou moyenne industrie de la pierre (du grec mésos, moyen, et lithos, pierre).
Nous ne croyons pas devoir faire entrer dans la préhistoire l’époque des métaux qui rentre plutôt dans la protohistoire (du grec protos, premier). Le paléolithique, correspondant au pléistocène (du grec pleistos, beaucoup plus, et kainos, récent) ou quaternaire ancien, a été divisé en paléolithique inférieur, moyen et supérieur. Font partie du paléolithique inférieur et moyen le pré-chelléen, le chelléen (industrie de Chelles, Seine-et-Marne), l’acheuléen (industrie de Saint-Acheul, Somme), le Moustérien (industrie du Moustier, Dordogne). Le paléolithique supérieur débute avec l’aurignacien (industrie d’Aurignac, Haute-Garonne), se continue par le solutréen (industrie de Solutré, Saône-et-Loire}, et s’achève par le Magdalénien (industrie de la Madeleine, Dordogne).
Chacune de ces époques a été d’une durée plus ou moins longue et a eu une ère d’extension plus ou moins considérable. On peut faire remonter le chelléen à 125.000 ans environ avant notre ère, mais il est certain que l’apparition de l’homme date d’au moins 500.000 ans (certains préhistoriens disent même d’un million d’années). Ces dates sont approximatives : en préhistoire, 100.000 ans de plus ou de moins, c’est peu de chose.
Le glozélien, industrie de Glozel, près de Vichy, (Allier), de 5.000 à 10.000 ans environ avant notre ère, constitue le magdalénien terminal ou néolithique.
Les principales industries mésolithiques sont l’azilien (Mas d’Azil, Ariège), le tardenoisien (La Fère-enTardenois, Aisne), et le campignien (Campigny, SeineInférieure). Le néolithique prend le nom de Robenhausien (Robenhausen, Suisse). Entre le chelléen et l’acheuléen on a intercalé récemment le clactonien (industrie de Clacton-en-Sea, Angleterre), et, entre l’acheuléen et le moustérien, le levalloisien (industrie de Levallois, Seine), et le micoquien (La Micoque, Les Eyzies, Dordogne). Ajoutons que les hommes auxquels nous devons les industries du paléolithique étaient dolichocéphales (du grec dolikhos, long, et kephalé, tête), et les autres, brachycéphales (du grec brakhus, court, et kephalé, tête) et mésaticéphales (de mesos, milieu), mélange des deux races.
On a nié l’existence de l’homme à l’époque tertiaire pour la raison qu’on n’a point trouvé d’ossements humains à cette époque, et que les outils de silex découverts dans les terrains tertiaires pourraient bien n’avoir été que des « jeux de la nature ». Ce qui est absurde, car l’humanité n’a pu en un seul jour découvrir le feu, inventer le langage et tailler le silex (on admet tout de même que le silex d’Ipswich (Angleterre) décèle un travail intentionnel). Ils sont sans doute l’œuvre d un pithécanthrope.
On doit à l’homme qui vécut pendant l’époque chelléenne, et dont l’existence est attestée par la mâchoire trouvée à Mauer, village de Rhénanie, par le crâne de Piltdown (Angleterre), les restes de la Denise et la calotte crânienne, plus trois molaires et le fémur gauche du pithécanthrope de Trinil (Java), l’instrument dénommé « coup de poing » par G. de Mortillet, instrument amygdaloïde (en forme d’amande), à bords peu tranchants, et à talon épais, permettant qu’on le tienne bien en mains. Cet instrument serait à plusieurs fins : percuteurs, racloirs, grattoirs, perçoirs suffisaient grandement aux besoins de l’homme chelléen. Avec l’acheuléen (mâchoire de Weimar), le coup de poing s’affine ; il est plus mince et plus allongé ; taillé plus soigneusement sur les deux faces. Avec l’industrie moustérienne (l’homme de Néanderthal et de Spy), le coup de poing se raréfie et devient de petite dimension. Pointes, couteaux, racloirs, scies, bolas, complètent l’outillage. Avec l’aurignacien (race de Grimaldi), le coup de poing a disparu. De nouveaux instruments apparaissent, pics, rabots, grattoirs, palette de schiste pour la peinture, burins pour la gravure. Le travail de l’os en est a ses débuts (aiguilles sans chas, épingles, hameçons, etc). Avec le Solutréen (race de Cro-Magnon), l’industrie lithique atteint son apogée : les solutréens furent d’admirables ciseleurs de pierre (pointes a feuille de laurier, pointes à cran, véritables bijoux). L’industrie de l’os s’enrichit des aiguilles à chas. Avec le magdalénien (race de Chancelade), c’est l’apogée de l’industrie de l’os : le harpon simple ou à barbelure domine. Propulseurs, sagaies, hameçons, bâtons de commandement, poignards, etc. sont les instruments les plus fréquents. L’industrie de la pierre est en régression, et cependant il y a toute une industrie microlithique nécessitée par les arts plastiques, qui ont atteint à cette époque leur plus grand développement.
Au magdalénien terminal correspond le glozélien (néolithique 1). Le glozélien est comme un pont jeté entre l’âge de la pierre taillée et l’âge de la pierre polie. Il est situé à la fois sur le versant paléolithique et sur le versant néolithique. Les autochtones de Glozel, descendant des magdaléniens, nous ont prouvé, par leurs industries et leurs arts, qu’entre les deux âges de la pierre n’existait point d’hiatus, comme l’avaient prétendu jusque-là les préhistoriens officiels. D’après ces préhistoriens, la renne aurait fui vers le Nord à la fin de l’époque magdalénienne et l’art aurait complètement disparu. Erreur que les découvertes qui ont été faites dans le cimetière néolithique par le Docteur Morlet ont réduite à néant. Glozel peut être appelé l’âge de l’argile : cette matière, en effet, a été utilisée par les tribus glozéliennes pour graver sur des tablettes des signes alphabétiformes et fabriquer des figurines phalliques. A cette époque, la sculpture et la gravure produisent des chefs-d’œuvre, dignes de ceux des cavernes périgourdines.
L’azilien, qui inaugure les industries mésolithiques, dérive également du magdalénien. L’outillage lithique est minuscule. Cette époque a laissé des galets coloriés sur lesquels figuraient des signes (on ne croit pas qu’ils soient alphabétiformes). L’azilien a sans doute commencé après et fini avant le glozélien qui a inauguré le polissage de la pierre (les troglodytes de la Madeleine l’avaient seulement appliqué à l’os et à l’ivoire).
Autre industrie de transition : le tardenoisien, qui comprend des outils affectant des formes géométriques. Le campignien constitue la dernière des industries mésolithiques. Cette industrie comprend des pics, des tranchets en silex et des objets en os et en bois de cerf. Avec le néolithique, la pierre polie se substitue à la pierre taillée. On rencontre, à côté de l’ancien outillage lithique, de nombreuses haches polies.
Nous avons à peine effleuré les industries des deux âges de la pierre. Le néolithique inaugurait une ère nouvelle. On trouve alors toutes sortes d’instruments. L’art du blé, l’art du tissu, l’art de la navigation, et malheureusement aussi l’art de la guerre se développent d’une façon surprenante. L’habitation se transforme : à côté de l’architecture dolménique (constructions à demi-enfoncées dans le sol) s’édifient des cités lacustres (palafittes). L’âge des métaux qui, selon nous, appartient à l’histoire, comprend l’industrie du cuivre, suivie de celle du bronze, à laquelle succéda celle du fer (ces époques ont été elles-mêmes subdivisées). Notons qu’avec les néolithiques les races brachycéphales (têtes rondes) prennent de plus en plus le dessus.
Parallèlement aux industries avaient évolué l’art, la morale, et ce qu’on peut appeler la religion des hommes préhistoriques. En même temps que le climat (humide et chaud pendant l’époque chelléenne, froid pendant l’époque moustérienne, plus froid encore pendant l’époque magdalénienne, pour devenir tempéré pendant le néolithique, comme il l’est de nos jours), la faune s’était modifiée : le mastodonte, l’éléphant méridional, le rhinocéros, l’hippopotame préchelléens et chelléens avaient été remplacés à l’époque acheuléenne par le mammouth à narines cloisonnées, et les premiers rennes avaient pris possession du moustérien. On a pu grouper sous le nom d’âge du renne les civilisations du paléolithique supérieur, cet animal étant alors le plus répandu (il y avait aussi des cerfs, bouquetins, antilopes saïgas, etc.). Les animaux des époques suivantes sont les animaux actuels.
L’alimentation s’était modifiée. Frugivore pendant le chelléen l’homme était devenu carnivore avec le moustérien. Il avait abandonné sa demeure aérienne pour s’abriter au pied des falaises et loger dans des cavernes. D’arboricole, il était devenu terrestre.
Les premiers hommes inventèrent le langage et découvrirent le feu. La position verticale avait libéré la main en même temps que le cerveau. La mâchoire avait cessé de fonctionner comme instrument de préhension. La place laissée à la langue avait permis à l’homme de substituer, au langage inarticulé, un langage vraiment humain.
A quelle époque remonte la découverte du feu ? Peutêtre au préchelléen, mais sûrement au chelléen. L’homme connut le feu par les volcans, et aussi par la foudre : il s’ingénia à le conserver. Puis il le produisit lui-même, sans doute en frottant l’un contre l’autre des bâtons (Lucrèce pense que l’exemple lui en fut donné par les branches des arbres se frottant entre elles sous la poussée du vent), ou en choquant un silex — la pierre providentielle et salvatrice — contre un autre silex. L’homme préhistorique a inventé le briquet. Pendant longtemps il n’eut pas besoin de feu pour se chauffer ni cuire ses aliments (il pratiquait alors le nudisme et le crudivorisme), le froid l’obligea à allumer du feu aux abords de ses cavernes, ce qui éloigna les bêtes féroces. Pour s’éclairer dans les cavernes, il inventa la lampe !
L’invention de l’écriture remonte à l’époque magdalénienne. Sur maints objets de cette époque on rencontre des signes alphabétiformes ; on y trouve de véritables lettres, des A, des E, des I, et différents signes linéaires ou idéographiques. Les glozéliens ont ajouté une centaine de signes alphabétiformes à l’écriture magdalénienne.
La religion des premiers hommes fut seulement une sorte d’entraide qui leur permit de faire face aux difficultés de l’existence. Ils vénéraient les forces naturelles et adoraient leur phallus. Les chelléens abandonnaient leurs morts sur les arbres les plus hauts. Les moustériens les inhumaient. On a trouvé, dans les époques qui ont suivi, des fosses dans lesquelles les cadavres reposaient selon certaine orientation. Nos ancêtres croyaient-ils à l’au-delà ? Nous pensons qu’entourés de mystères ils ne se laissèrent pas pour cela gagner par la superstition. Ce n’est qu’avec l’histoire que la religion devint « une affaire ».
ART PRÉHISTORIQUE.
C’est à l’art qu’il faut demander ce que pensèrent les hommes préhistoriques, et comment ils vécurent. L’art complète sur ce point les renseignements fournis par l’archéologie et l’anthropologie. L’art est né avec l’humanité même. Du jour où la bête verticale s’est sentie saisie d’admiration devant un beau paysage, elle est devenue artiste. Quand elle a pris un silex, l’a taillé, même grossièrement, inventant ainsi les techniques, elle eut droit au titre d’être humain. La première oeuvre d’art a été le premier silex taillé. C’est par la sculpture que les arts plastiques ont débuté. L’homme chelléen a trouvé dans ses courses vagabondes des silex anthropomorphes et zoomorphes. Il en a accentué la forme et en a fait des pierres-figures. Longtemps on a cru que l’art datait de l’époque magdalénienne. D’importantes découvertes, d’abord contestées, ont prouvé qu’il existait dès l’aurignacien. Les préhistoriens officiels ne remontent pas plus haut : ils nient obstinément l’existence de pierres-figures dès l’époque chelléenne (il nous a été donné d’en examiner un certain nombre dans la collection de M. Dharvent, à Béthune. Elles ont été découvertes dans les alluvions caillouteuses du quaternaire ancien. Naturellement les « officiels » ont nié leur authenticité, mais M. Dharvent, savant indépendant, ne s’est pas laissé intimider par leurs aboiements. Sa collection est unique, et constitue un des documents les plus précieux sur les débuts de l’art préhistorique). La sculpture s’est manifestée d’abord sous la forme de la ronde bosse, puis la gravure et la peinture se développèrent à l’époque aurignacienne (grossiers dessins schématiques d’hommes et d’animaux, puis œuvres plus parfaites : Vénus de Laussel et autres). La technique s’enrichit par la suite. On a nié l’existence de l’art pendant le solutréen : or, les frises du Roc, pour ne citer que cette sculpture, ont contredit cette assertion fausse. Le magdalénien marque l’apogée de l’art quaternaire. Les troglodytes des cavernes périgourdines ont laissé des chefs-d’œuvre inimitables : ce furent d’incomparables animaliers, non surpassés depuis. Médiocres dans les figurations humaines, et cela pour des raisons qu’il ne nous appartient pas d’approfondir ici, ils sont inégalables quand ils gravent ou sculptent des rennes, des bisons, des mammouths, etc., qu’ils voient vivre sous leurs yeux. Les Combarelles, Font de Gaume, Altamira, etc., sont de véritables musées d’art préhistoriques. Art mobilier ou rupestre, les documents abondent, nous prouvant qu’à cette époque l’art et la vie se confondaient. On a essayé d’expliquer l’origine de l’art par la magie ou pouvoir que possède l’homme d’agir sur les choses d’une façon surnaturelle. Les chasseurs de rennes se seraient proposés, en dessinant des animaux, un but utilitaire, alimentaire et prophylactique : multiplication des animaux comestibles, éloignement des animaux nuisibles. On a tenté d’expliquer par la magie le réalisme de la technique quaternaire, Les cavernes seraient les sanctuaires dans lesquels opéraient les sorciers préhistoriques, sanctuaires au fond desquels peintures et dessins avaient été placés. Or, il n’est pas vrai que les figurations animales soient toujours placées au fond des cavernes. Il en est qui se trouvent à l’entrée. N’est-il pas plus raisonnable de penser qu’à côté d’œuvres pouvant avoir eu pour point de départ la magie, l’artiste préhistorique a simplement voulu occuper ses loisirs et exécuter pour son seul plaisir des œuvres d’art pariétales et mobilières destinées à orner sa demeure et les objets dont il se servait. L’homme primitif a connu la parure et les bijoux. Il a aimé s’entourer d’harmonie et de beauté. Cette tradition se retrouve chez l’homo glozeliensis, sculpteur et graveur dont les créations égalent les meilleurs dessins magdaléniens. Alors, la poterie naquit, puis les arts mineurs prirent un nouvel aspect avec les robenhausiens. La stylisation et le schématisme l’ont ensuite emporté sur l’inspiration et le lyrisme.
La découverte des œuvres d’art préhistoriques, trop nombreuses pour être énumérées ici, constitue un des chapitres récents, et des plus importants, de l’archéologie préhistorique. Ce chapitre a apporté à la science de l’esthétique un fondement réel et solide.
PHILOSOPHIE DE LA PRÉHISTOIRE.
Lamarck a dit fort justement :
« Toute science doit avoir sa philosophie : ce n’est que par cette voie qu’elle fait des progrès réels. »
Pour que la préhistoire joue un rôle dans l’évolution des idées, il faut qu’elle soit autre chose qu’un ensemble de faits sans liens entre eux, ou qu’une collection de vieilles pierres sans intérêt, d’où ne se dégage aucune vue d’ensemble.
« La Préhistoire est le véritable humanisme moderne », a écrit le préhistorien allemand Frobenius. Parole juste et profonde ! C’est, en effet, pour nos contemporains, une école de sagesse et d’humanité. Nous avons essayé de dégager de l’étude de l’anthropologie et de l’archéologie préhistoriques une philosophie : c’est ce que nous avons appelé la « philosophie de la préhistoire ». Cette philosophie est pleine d’enseignements, Elle nous rappelle nos humbles origines et nous montre l’évolution en marche vers le mieux. Elle exige que chacun de nous se dépouille de ses préjugés et de ses erreurs pour vivre une vie saine et naturelle, dégagée de tout l’artificiel qu’une pseudo-civilisation y a mêlé. Le retour à l’âge des cavernes ne serait point, comme on ne cesse de le répéter, un retour à la sauvagerie ancestrale, à la barbarie. L’âge des cavernes, si on entend par là un âge de crime et d’esclavage, serait plutôt le nôtre, véritable âge de fer en comparaison de l’âge d’or que vécurent les premiers hommes, malgré la lutte qu’ils durent livrer à la nature entière pour en devenir les maîtres. Les premiers hommes furent vraiment des créateurs, c’est-à-dire qu’ils découvrirent ce que personne n’avait découvert avant eux. Certes, ils se sont inspirés, dans leurs découvertes, de leurs frères inférieurs les animaux, mais en les dépassant. Ce furent des hommes de génie. Volonté, intelligence, sensibilité se développèrent en même temps chez ces hommes. Les savants officiels prétendent que l’homme n’a mérité le titre d’homo sapiens (homme pensant et raisonnable) qu’à partir d’une certaine période de la Préhistoire. Les hommes du paléolithique supérieur, seuls, mériteraient ce titre, ceux du paléolithique inférieur n’étant que des sous-hommes. C’est encore un préjugé, qu’il s’agit de dissiper. Dès que l’homme a inventé la technique, il n’a pas été qu’un homme faber, il a été également un homo sapiens. Cette épithète convient à l’homme de Chelles aussi bien qu’à celui de la Madeleine. Dès qu’il a tiré de la nature l’industrie et l’art, l’homme a mérité le titre d’homo sapiens. L’être qui était le plus faible de tous les êtres est devenu le plus fort et le plus habile. Il a ajouté à ses bras des outils qui ont suppléé à sa faiblesse. Il a inventé le feu et découvert le langage. Avant lui, nul être n’avait taillé le silex. Les grands anthropoïdes avaient pu ramasser des pierres et se servir de bâtons, former des familles, mais l’être vertical, lui, avait fait davantage. Mains et cerveau avaient travaillé ensemble à la même œuvre. Le redressement de la colonne vertébrale avait libéré la mâchoire qui, en cessant de fonctionner comme instrument de préhension, avait permis au cerveau de mieux penser et à la main de mieux agir. Le passage de l’animal à l’homme s’opéra par le redressement de la colonne vertébrale, allégeant l’être tout entier, et aérant son cerveau. Détaché du tronc commun des primates, qui avait donné naissance aux grands anthropoïdes, d’une part, dont l’espèce est aujourd’hui éteinte, et à l’homme, d’autre part, ce dernier évolua vers une forme toujours plus parfaite, ainsi que le prouvent les intermédiaires qui ont été découverts (pithécanthrope, sinanthrope, etc.), entre l’humanité actuelle et le précurseur hominien.
Quelles perspectives ouvre à la pensée la philosophie de la préhistoire qui nous oblige à méditer sur les origines, et à nous demander ce que nous avons fait, hommes de l’histoire, de la civilisation qui nous a été léguée par les hommes préhistoriques. L’art, les industries, les métiers, ils nous ont tout transmis. C’est pourquoi, en nous rapprochant de leur existence saine et harmonieuse, parfaitement équilibrée, pour retrouver la santé et la force dont nous avons tant besoin, nous ne devons pas rejeter tout ce que la science et l’art nous offrent d’avantages et de bien-être (seuls une fausse science et un faux art, science de mort et art de mensonge, doivent être rejetés). Limitons nos besoins, et nous cesserons d’être des sous-hommes, c’est-à-dire des dégénérés. Renonçons à l’agitation qui caractérise notre ère d’affairisme et trépidation. Telle est la leçon — il y en aurait encore bien d’autres à tirer — qui se dégage d’une philosophie de la Préhistoire. On peut dire que nos ancêtres des forêts vierges ou des cavernes, troglodytes ou non, nomades ou sédentaires, ont été les premiers penseurs, les premiers artistes, les premiers philosophes de l’humanité. Ici les mots « philosophie de la Préhistoire » revêtent un second sens, qui complète le premier. Ils signifient qu’avant la philosophie des Grecs, la seule enseignée par les historiens officiels, il y a eu une pré-philosophie : il y a eu des écoles, des systèmes philosophiques pendant les temps préhistoriques, et cela aussi bien en ce qui concerne l’esthétique que la sociologie, la morale, etc. Il y a eu, dans les forêts vierges du tertiaire ou les cavernes quaternaires, des philosophes aussi grands, plus grands même que ceux de l’histoire.
Nous avons dressé un tableau des philosophies de la Préhistoire aux différentes époques de la pierre. Ces philosophies ou pensée de l’homme sur la vie (l’action et la pensée se confondaient alors), nous sont connues par les œuvres d’art et les industries des hommes préhistoriques, associés à leurs restes. On peut reconstituer leurs philosophies mieux peut-être qu’on ne reconstitue les philosophies de l’histoire, qui nous arrivent le plus souvent à travers des documents falsifiés. Les quelques documents que nous possédons en préhistoire, sérieusement contrôlés, sont plus sûrs que tout ce fatras qui encombre l’histoire. La pénurie même de ces documents constitue un gage de leur authenticité. Il ne reste que des faits sélectionnés, ce qui écarte toute chance d’erreurs.
Nous reproduisons ici, sommairement, notre tableau des philosophies préhistoriques, dont les divisions correspondent aux arts et aux industries des différentes époques de l’âge de la pierre. Arts et industries nous révèlent la « philosophie », c’est-à-dire la vie même de nos ancêtres. Nous avons divisé les philosophies préhistoriques en trois grandes sections : la philosophie éolithique ou encore préchelléenne, datant de la fin du tertiaire, attestée par l’existence d’éolithes dus à l’homme ou à son précurseur (utilisation de la pierre, brute d’abord, ensuite avec des retouches intentionnelles). La philosophie quaternaire ou paléolithique comprend ellemême deux grandes sections : les philosophies du paléolithique inférieur ou philosophie chelléo moustérienne subdivisée en philosophies chelléenne, acheuléenne et moustérienne (ou néanderthalienne), et les philosophies du paléolithique supérieur (aurignacienne, solutréenne, magdalénienne et glozélienne). Viennent ensuite les philosophies mésolithiques, comprenant les philosophies azilienne, tardenoisienne et campignienne. La philosophie néolithique ou robenhausienne qui leur succède comprend la philosophie lacustre ou palafittique, et la philosophie dolménique ou mégalithique. Si nous faisions entrer l’âge des métaux dans la préhistoire, nous aurions une philosophie du bronze, du fer et du cuivre. Tel est le tableau, extrêmement sommaire, réduit à sa plus simple expression, des différentes philosophies de la préhistoire correspondant aux différentes « écoles » d’art et aux industries des âges de la pierre. L’homme du Moustier, de même que celui de la race de Chancelade ou de tout autre, ont eu des philosophies différentes ; malgré des points de contact qu’on ne peut nier. On suit d’époque en époque la marche du progrès. Certes, il ne s’agit pas de philosophie au sens habituel. Les documents dont nous nous inspirons pour retracer ce tableau de l’évolution des idées, sont les différents types d’industries, ainsi que les œuvres d’art mobilières ou pariétates. Une même idée directrice inspire toutes les philosophies du paléolithique : l’homme vit au grand air, au sein de la nature, parmi les forces naturelles qu’il maîtrise ; sa religion, sa morale, son esthétique, toute sa vie enfin ne peuvent ressembler à la religion, à la morale, à l’esthétique, en un mot à la conception de la vie des peuples néolithiques. Avec ces derniers, une nouvelle philosophie s’élabore, l’autorité exerce ses méfaits, la religion devient une religion d’Etat (ce dernier étant représenté par une théocratie toute puissante). Les monuments mégalithiques n’ont pu, en effet, s’élever tout seuls. Nous supposons qu’un peuple d’esclaves, sous le commandement de maîtres dont le pouvoir était illimité, a semé un peu partout les menhirs et les dolmens. Nous sommes toujours des néolithiques, nous éloignant de la nature et vivant une existence absurde, à la merci des dirigeants. Aussi la conclusion d’une philosophie de la Préhistoire ne peut être que celle-ci : le retour aux origines, à la nature, à la vie vivante, et cela sans abandonner les conquêtes de la science. Savoir nous en servir pour notre bonheur, au sein d’un milieu renouvelé, tout est là. Dans un ouvrage récent : L’Homme, Races et Coutumes, du Dr Verneau, nous lisons :
« Un jour viendra où nos successeurs considèreront avec une sorte de pitié la civilisation d’aujourd’hui, dont nous sommes si orgueilleux. »
Cette réflexion, sous la plume d’un savant officiel, n’est pas pour nous déplaire. N’est-ce pas là ce que nous ne cessons de dire et redire depuis des années ? C’est pourquoi nous ne voyons pas d’autre remède pour conjurer le suicide de l’humanité (qui, d’ailleurs, est si peu intéressante, qu’elle mériterait d’être abandonnée à son sort), qu’un retour intelligent à la nature, nous voulons dire à la vie libre et vivante que vécurent nos ancêtres, retour entendu, répétons-le, non à la façon dont le comprenait Rousseau, en renonçant aux sciences et aux arts, mais en les utilisant pour notre perfectionnement intellectuel et moral : emprunter à l’histoire ce qu’elle a conservé des civilisations préhistoriques, ce qu’elle n’a pu anéantir de celles-ci, et sur ce legs du passé, construire la cité de l’avenir au sein même de la cité présente, par notre effort à devenir meilleurs, la réaliser dès aujourd’hui en agissant sur notre moi, sur celui des autres ensuite, par la persuasion, l’éducation et l’exemple, afin de hâter le retour de l’âge d’or sur la terre.
— Gérard de LACAZE-DUTHIERS.
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE (ouvrages récents portant sur des généralités). — S. Blanc, Initiation à la Préhistoire. — Marcellin Boule, Les Hommes fossiles (2° édition). — Dr Capitan, La Préhistoire, édition revue et augmentée par Michel Faguet. — F. Déchelette, Manuel d’Archéologie préhistorique. — Furon, La Préhistoire. — René Gérin, Les hommes avant l’histoire. — Goury, Origine et évolution de l’homme. — Gérard de Lacaze-Duthiers, Philosophie de la Préhistoire (tome 1). — G.-H. Luquet, L’art et la religion des hommes fossiles. — Léon Mand, La Préhistoire. — F. de Morgan, L’humanité préhistorique. — Peyrony, Eléments de Préhistoire. — E. Pittard, Les races et l’histoire. — G. Renard, Le travail dans la Préhistoire. — A. Rio, La Préhistoire (Encyclopédie par l’image). — J. H. Rosny aîné, Les origines, Les conquérants du feu. — Dr Verneau, Les Origines de l’humanité.
PRÉJUGÉ
n. m.
La définition du préjugé paraît assez aisée lorsqu’on l’applique aux menues opinions erronées que partagent les gens simples et peu doués d’esprit critique ; mais en examinant soigneusement toutes les connaissances de l’esprit humain, on s’aperçoit que les préjugés s’étendent beaucoup plus loin que chez les gens ignorants et qu’on les rencontre également chez des êtres très cultivés et dans tous les domaines du savoir. Le préjugé n’est plus alors une simple opinion personnelle admise sans examen, c’est une manière de penser collective, imposée par la tradition et que les casuistes essaient de justifier par de mauvais raisonnements.
C’est ainsi que les croyances sont toutes des préjugés, puisque toute croyance a précisément pour but de détruire l’esprit critique et de s’établir sur des actes de foi, ôtant ainsi au croyant toute possibilité de juger sainement. Toute opinion basée sur la foi est donc un préjugé. Pour en saisir plus nettement le côté absurde et imaginatif, étudions quelque peu le mécanisme d’un jugement et l’origine des préjugés.
Tout jugement est une utilisation présente d’une série d’expériences antérieures établissant une certaine identité entre une série de faits actuels et une série de faits passés. Les travaux du grand physiologiste russe Pavlov ont permis de comprendre que toute connaissance est le résultat d’une réaction du système nerveux à une influence du milieu, ou à un fonctionnement organique inné, déterminant un certain nombre de réflexes, s’enchevêtrant les uns dans les autres, selon des lois biologiques qui commencent à être mieux observées et mieux classées qu’autrefois. Les jugements s’effectuent donc à l’aide de réflexes. Les réflexes conditionnels, étudiés par Pavlov, sont des réflexes associés à d’antres réflexes primitifs, et se substituant à eux, pour déterminer les mêmes actes, alors que, normalement, ces réflexes secondaires ne pourraient y parvenir seuls. Si, par exemple, on gratte un chien, et qu’on lui donne ensuite à manger, le seul fait de le gratter le prédisposera, ultérieurement, à manger. Mais, ce fait ne met en action qu’un réflexe conditionnel, qui ne saurait, en aucun cas, s’il n’est suivi d’alimentation, le prédisposer à un quelconque repas. Il y a pourtant, ici, jugement puisque, habituellement, le grattage est suivi du repas. Il y a donc une association légitime de sensations, succession de faits sensoriels, apparence de causalité ; mais c’est un rapport faux, puisque, en réalité, ces deux faits : le grattage et l’alimentation, ne sont point liés par un phénomène de causalité naturelle, mais rapprochés, au contraire, par l’imagination de l’expérimentateur. Jugement ne signifie donc aucunement vérité, mais fonctionnement de réflexes compliqués, déterminant une adaptation de l’organisme aux circonstances.
Le commencement de la pensée est donc, invariablement, une réaction nerveuse déterminant un mouvement musculaire ou une fonction organique interne. Il n’y a pas de pensée sans dépense d’énergie, sans travail intérieur. Il est donc probable que les premières pensées, ou plutôt les premiers éléments de la pensée (sensation, puis perception) sont des vérités premières, subies par le jeune humain dès ses premiers contacts avec le milieu. L’abstraction, l’idée générale, est l’invariant des sensations répétées, créé aux carrefours des influx nerveux, empiétant les uns sur les autres, sous l’abondance des impressions sensorielles. Le jugement, qui n’est qu’un acte secondaire, n’est que l’utilisation de réflexes antérieurs, la mise en jeu d’un complexe de réflexes, sous l’influence d’une action du milieu, ou d’un fonctionnement organique. Le jugement n’est donc jamais un acte indépendant. Il dépend de deux facteurs : tout d’abord de la faculté innée de grouper des réflexes en de nombreux complexes de réflexes (diffusion de l’influx nerveux à travers les cellules cérébrales), faculté dépendant inévitablement du tempérament personnel qui atténue ou augmente, déforme ou rectifie les complexes de réflexes sensoriels et les réflexes conditionnels dans leurs rapports entre eux ; ensuite de la nature et de l’abondance des documents sensoriels accumulés depuis la naissance (éducation, tradition, circonstance).
L’esprit critique est formé de la double faculté d’accumuler et de conserver les documents sensoriels ; et de les grouper et les coordonner, ensuite, logiquement. Tout être humain, même héréditairement doué d’un esprit critique et d’un tempérament équilibré, se trouve, dans la vie sociale, devant ces deux sortes de faits : les faits traditionnels ; les faits circonstanciels. Les faits traditionnels sont constitués par l’ensemble de toutes les connaissances transmises d’une génération à l’autre ; connaissances formées de savoir véritable et de nombreuses erreurs plus ou moins dangereuses. Les faits circonstanciels sont déterminés par la lutte de l’homme contre le milieu naturel, ou contre le milieu social, en fonction des connaissances : traditionnelles ou acquises personnellement.
Or, nous avons vu que la connaissance réelle n’est qu’un réflexe, une réponse exacte du système nerveux à une excitation, externe ou interne, se traduisant par une adaptation avantageuse de l’organisme entier aux circonstances nouvelles. Il peut se faire que la tradition enseigne une réponse utile ; il peut également se faire qu’elle l’ignore, ou qu’elle en donne une erronée et nuisible. Ce renseignement erroné c’est le préjugé.
La tradition est donc à la fois la source du vrai et du faux. Parmi ces renseignements il en est de vérifiables et d’expérimentaux, découverts par l’esprit d’observation de l’homme : c’est la connaissance objective, origine des jugements corrects et du bon sens. Il en est d’absurdes et d’incontrôlables, basés uniquement sur la terreur, la foi, l’ignorance, la stupidité et qu’imposent la partie la plus rétrograde de l’humanité, les exploiteurs laïques et religieux : ce sont les préjugés.
Le préjugé n’est donc pas une pensée primitive, un réflexe direct ; ni un complexe de réflexes sensoriels se contrôlant les uns les autres. C’est un complexe de réflexes conditionnels erronés, aussi peu utiles au bon fonctionnement de l’homme, que n’est utile à l’appétit du chien le grattage de son épiderme.
Nous avons donc une démarcation précise entre une opinion exacte et un préjugé ; la première relève de l’expérience (réflexe conditionnel contrôlé) ; le second de l’imagination (réflexe conditionnel invérifiable). Et comme conséquence l’absence de préjugé est essentiellement le fait d’un esprit indépendant, adaptant ses faits et gestes au mieux de ses intérêts vitaux, selon un critère éthique et synthétique purement objectif.
Nous pouvons maintenant passer brièvement en revue quelques-uns des plus malfaisants préjugés.
RELIGION.
Toutes les religions, toutes les croyances mystiques sont des préjugés, puisque leur admission ne peut s’effectuer que par la destruction de l’esprit critique et du bon sens. Ce sont des préjugés collectifs, admis sans examen. La foi ne raisonne pas. Imposés aux jeunes êtres, ces réflexes conditionnels invérifiables et désastreux prennent, chez certains humains, une telle importance qu’ils en restent irrémédiablement déformés. Les associations de réflexes ne s’effectuent plus désormais selon un ordre logique, et selon le processus des causalités sensorielles, mais selon un processus entièrement subjectif, embrouillant certains réflexes normaux et faussant, inévitablement, tous les jugements ultérieurs. Les conséquences malfaisantes de ces préjugés se traduisent par des haines farouches, une intolérance et un sectarisme abrutissant, un fanatisme criminel semant la discorde, la guerre et la mort.
PATRIOTISME.
Même remarque pour la religion patriotique que pour la religion déiste. Basée sur l’ignorance des ascendances et la haine des clans voisins, elle engendre cette chose cocasse : des hommes, fils de toutes les races mêlées, se réclament d’une race pure, autochtone, inexistante, et d’un patrimoine géographique ancestral, encore plus inexistant. Tout territoire fut habité et peuplé tour à tour, au cours des siècles, par de si nombreuses populations, fondues les unes dans les autres, qu’il est grotesque de vouloir lui trouver un premier occupant. Nul ne se trouve sur sa terre ancestrale ; nul ne peut se réclamer d’une race pure, car rien de cela n’existe et n’a existé. Ce préjugé entretenu et développé par les exploiteurs est un des meilleurs moyens pour diviser les peuples, créer des haines féroces, aboutissant à des massacres monstrueux, justifiant le rôle soi-disant défensif des dirigeants.
AUTORITÉ.
Le principe d’autorité, c’est-à-dire l’imposition d’un fait par la force est un des préjugés les plus répandus. Il commence dans la famille, se continue à l’école et s’épanouit dans la vie sociale, en passant par la caserne, sa plus belle manifestation. Nulle part le culte de la raison, du bon sens, de la recherche expérimentale, de la persuasion, n’est développé pour résoudre les difficultés sociales. La force, c’est-à-dire, presque toujours la violence inique, impose à l’homme la volonté d’un autre homme. Or l’homme est un imitateur et tout geste qui, imité, nuit à l’homme, est nuisible à tous les hommes. D’où la malfaisance de l’esprit d’autorité plus ou moins répandu chez les humains et leur nuisant par réciproque usage. Ce préjugé, qui ne repose que sur le romantisme des traditions, s’oppose à l’épanouissement de l’intelligence, appauvrit et avilit l’humanité et en retarde indéfiniment son harmonieuse évolution. L’autorité est l’antinomie de la raison et rien ne démontre, objectivement, qu’elle est nécessaire au bon fonctionnement social. Développer l’autorité ; éduquer, enseigner, coordonner autoritairement, c’est retourner à la brute, c’est reculer indéfiniment l’avènement de l’Age de la Raison.
JUSTICE ET CRIMINALITÉ.
Parce que les nécessités de coordination des humains les ont déterminé, selon leurs connaissances traditionnelles, à formuler des bases d’entente à formes autoritaires appelées lois, la tradition a déformé le sens provisoire, incertain et faillible de ces lois, pour en faire une sorte de chose inviolable et sacrée ; préjugé issu de l’origine soi-disant divine et magique des dites lois, car le chef et surtout le sorcier, puis le prêtre ou magicien, furent certainement les premiers législateurs des hommes terrorisés et ignorants. Ce pouvoir surnaturel, attribué à la loi, fausse actuellement le sens des réalités sociales chez de nombreux individus, qui ne qualifient de bien ou de mal que ce qui est en accord avec la loi, sans songer que celle-ci n’est qu’une invention humaine, par conséquent susceptible d’être juste ou criminelle, absurde ou sensée. La justice, d’après cette loi hasardeuse, est la personnification même du bien luttant contre le mal. Pourtant l’étude de toutes les sociétés, passées et présentes, nous montre que toujours la misère et la souffrance furent le sort du plus grand nombre des hommes et que la justice n’a jamais supprimé le mal social, précisément parce que ce mal est l’effet du même état d’esprit qui invente l’abstraction justice, sorte de puissance indépendante de l’homme, confusément divinisée par lui.
De là ce respect absurde, sacré de tout l’appareil de justice, investi par les préjugés ancestraux de l’infaillibilité des concepts absolus.
Ce préjugé déforme le jugement envers ce que l’on dénomme le criminel, c’est-à-dire celui qui désobéit aux lois, celles-ci fussent-elles criminelles ou stupides. Le criminel n’est pourtant jamais responsable puisque : criminel par manque de sensibilité, ou insuffisance de maîtrise de ses réflexes, il est tel que l’ont fait ses progéniteurs et la tradition ; il n’est qu’un effet et non cause initiale du mal ; et, s’il est criminel lucidement, il ne l’est que par la faute du milieu criminel qui l’y oblige, par nécessité défensive et vitale. Le préjugé de la responsabilité se renforce et s’aggrave ici de la férocité de l’esprit de vengeance, qui rend le mal pour le mal. Ce qui démontre bien le caractère primitif et sauvage de toute justice humaine.
Le bon sens indique que le meilleur moyen de réparer et de prévenir un mal, c’est de détruire les causes qui le créent, et non de punir ceux qui n’en sont que l’instrument.
SEXUALITÉ.
Tout est préjugé en matière de sexualité, et cela se comprend puisque le sens de la vie est faussé par les sorciers modernes, alliés aux exploiteurs internationaux. Aussi, dès le jeune âge on développe dans la mentalité des jeunes humains ces quelques absurdités : il y a quelque chose de criminel à pratiquer l’union charnelle en dehors des formes légales des sorciers laïques et religieux ; dès que les rites magiques sont prononcés par les sorciers, l’homme et la femme mariés n’ont plus ni sentiments, ni affections, ni désirs pour d’autres qu’eux deux ; en échange de quoi ils cessent d’être propriétaires de leur propre personne pour devenir la propriété de leur conjoint, sur lequel ils ont, néanmoins, droit de vie et de mort ; il y a des choses honnêtes en amour et des choses honteuses, tout comme il y a des organes honteux ; les procréations nombreuses sont sources de joies et de prospérité ; enfin, la femme n’étant point propriétaire de son corps ne peut se refuser à la maternité, ni la prévenir ou l’arrêter à son gré.
II est flagrant que tout cela est absurde, nuisible et contraire à la beauté de la vie. Tout ce qui donne de la joie, sans amoindrir notre vitalité, notre intégrité individuelle, est sain, bon, désirable et utile. Et chacun est seul juge de ce qui embellit sa vie.
Tous ces préjugés, que partagent stupidement les gens ignorants, ne sont nullement répandus chez les exploiteurs, qui ont peu d’enfants et se livrent à tous les jeux de l’amour, au mépris des rites de leurs sorciers.
C’est donc une morale pour le peuple, destinée à perpétuer sa misère, à le priver de joie, à le maintenir abruti dans le cercle familial, rétrécissant son point de vue, limitant son action à son foyer, détruisant sa solidarité avec le reste de l’humanité. Les préjugés sexuels sont donc de merveilleux auxiliaires de l’universelle exploitation.
ÉDUCATION.
Il est difficile de ne point reconnaître l’influence considérable des préjugés dans l’éducation. Les enfants sont tout d’abord séparés par sexes, comme si la peste jaillissait de leurs contacts. Ensuite la matière éducative tend à développer chez eux la même mentalité que celle de leurs progéniteurs ; c’est-à-dire tous les défauts caractérisant la présente société. Tout ce que l’enfant perçoit autour de lui concourt à détruire sa personnalité, son esprit critique, sa spontanéité, sa solidarité, ses affections, ses sympathies, son esprit inventif et créateur, pour le figer dans une attitude hypocrite, respectueuse et soumise vis-à-vis de la force, des puissants et des maîtres ; garantie certaine d’une perpétuation de tous les maux sociaux, déterminés par la bêtise et la brutalité.
L’éducation ne peut avoir qu’un seul but : créer des intelligences lucides, dans des corps sains, en dehors de toutes idées personnelles de classes, de sexes, de croyances, etc. L’éducation doit être strictement objective, développer le sens des rapports exacts et l’harmonie des sensibilités.
Un autre préjugé consiste à croire que l’enfant appartient à ses parents, et que ceux-ci sont ses meilleurs éducateurs naturels. Il n’y a aucun rapport entre le fait d’engendrer un enfant et le fait d’être doué de toutes les rares qualités que doivent posséder les vrais éducateurs. Ensuite l’enfant s’appartient à lui-même, puisqu’il n’est ni un objet inerte, ni un animal. D’autre part, la famille est le plus mauvais lieu pour l’éducation des enfants, car l »exemple pernicieux des parents et l’insuffisance des moyens éducatifs nuisent au développement rationnel de l’enfant. Tous ces préjugés sont donc à combattre énergiquement pour l’amélioration des méthodes éducatives.
HYGIÈNE.
Ici encore les préjugés règlent les coutumes, les modes, la forme des vêtements selon les sexes, les professions, les hiérarchies sociales, etc. Les femmes vont demi-nues, même en hiver ; les hommes s’entortillent dans d’épais et sombres vêtements, même en été ; tandis que la nudité totale paraît un attentat aux mœurs. Cela permet aux humains de baigner dans leur sueur, plus ou moins parfumée, de ne point observer l’hygiène conservatrice des formes et d’ignorer la belle santé qui ne doit rien aux recettes des apothicaires.
Il y a également beaucoup de préjugés à l’égard de l’alimentation. Nombreux sont ceux qui s’imaginent que la viande, le vin et autres boissons alcooliques, sont nécessaires à la santé et que seule la nourriture imposée par la tradition familiale est la meil1eure. La diversité de ces traditions, à la surface de la terre, prouve l’incohérence de leur exclusivité. Ici, comme ailleurs, l’expérience est seule concluante et nul ne s’en soucie pour établir, objectivement, des bases certaines et générales.
Enfin l’hygiène des habitations est chose nulle dans une grande partie de la population. La peur des courants d’air, et de l’air pur, tient les gens enfermés et entassés étroitement dans une atmosphère puante, privés de soleil et de ses rayons bienfaisants, tandis que leur peau ignore les bienfaits de la lumière et des douches stimulantes.
ÉCONOMIE.
Rien ne démontre le réalisme de la société capitaliste. Contrairement à l’opinion courante, elle n’est qu’une mystique, imposée par la tradition comme une réalité objective. Or toutes les formes de sociétés sont possibles en dehors d’elle, et la disparition totale d’anciennes sociétés, fortement constituées, entraînant en même temps la ruine de leurs traditions, et par conséquent toute cause subjective de durée, prouve la fragilité de toute société.
La mystique capitaliste n’est rien en dehors de sa tradition et ne repose sur aucune base biologique naturelle et indestructible. C’est donc un grossier préjugé de croire que les groupements humains ne peuvent se coordonner que selon un type unique et définitif.
CONCLUSION.
Il est impossible d’examiner tous les préjugés car ce serait faire tout le procès de la société. Le respect et le culte grotesque des morts ; le respect des dettes de jeu, dites dettes d’honneur ; l’approbation des gains aux jeux de hasard, courses de chevaux, loteries, etc., justifiant le mysticisme de la chance et le légitimant ; le culte de la supériorité économique, artistique ou scientifique, basée sur une hiérarchie arbitraire et mystique ; la peur du changement, des transformations sociales ; les cristallisations autour des formes archaïques du passé ; en résumé tout ce qui n’est pas le fruit d’une série d’expériences biologiques, d’une synthèse de faits étudiés en dehors des formules cristallisantes de la tradition ; tout ce qui est imposé comme ne se discutant pas, est préjugé.
La disparition des préjugés se réalisera par une meilleure éducation, et par la connaissance de notre propre fonctionnement cérébral, démontrant l’origine de la connaissance réelle et celle des préjugés, ou réflexes conditionnels séparés du contrôle sensoriel et objectif.
— IXIGREC.
PRÉJUGÉ
En termes de jurisprudence, se dit de tout document, ou observation, qui précède le jugement et permet de l’établir. Le plus souvent le mot préjugé sert à désigner une opinion acceptée sans contrôle ou, tout au moins, sans examen suffisant. C’est à tort que l’on emploie parfois ce mot comme synonyme d’erreur. En effet, on peut adopter sans examen des idées exprimées par autrui, et qui sont parfaitement justes. Par contre, si nous ne faisons pas état, dans notre jugement, de toutes les données du problème, ou si notre raisonnement est défectueux, il pourra nous advenir, même après mûre réflexion, de faire nôtres certaines idées fausses. Réfléchir est une bonne précaution contre l’erreur, mais ne donne pas la certitude que l’on ne se trompera jamais.
Cette encyclopédie est, en très grande partie, consacrée à la lutte contre quantité de superstitions qui, dans les domaines de l’amour et de la sexualité, des croyances religieuses et de la morale, du nationalisme et de l’économie politique, demeurent dans la mentalité populaire. Il n’est donc aucune nécessité de revenir sur maints sujets ayant donné lieu, par ailleurs, à d’abondantes démonstrations. Par contre, il ne sera pas sans utilité de soumettre à la méditation du lecteur, certains préjugés qui ont cours dans les milieux révolutionnaires, et sont, le plus souvent, les vestiges de formules ou de doctrines anciennes, qui n’ont pas été confirmées par l’expérience, ou qui, justifiées à une certaine époque, ne le sont plus aujourd’hui, les circonstances de la vie sociale étant sensiblement différente de celles de naguère.
Par exemple, pour ce qui concerne l’organisation d’un mouvement insurrectionnel, maint révolutionnaire s’exprime encore comme si, au lieu d’être au siècle des avions, des tanks, de l’artillerie lourde, et de la guerre des gaz, nous vivions encore au temps où un paysan, avec sa faux, ou son vieux fusil à pierre, pouvait tenir tête à un fantassin régulier. De nos jours, dans une guerre civile, les armes à la portée du peuple : fusils de chasse, couteaux, revolvers et bâtons, seraient de pauvres choses. Seule, la révolte de l’armée, passant au peuple, est susceptible de lui donner la victoire et de le préserver du massacre.
Préjugé encore que l’étrange association, dans les mêmes milieux, de thèses insurrectionnelles très violentes, avec, d’autre part, les déclarations d’un pacifisme sentimental allant jusqu’à proclamer l’horreur des armes, et condamner tout entraînement physique ayant un caractère militariste. Pour ne pas être, d’ordinaire, dictée par les mêmes motifs que les hostilités internationales, la guerre civile n’en est pas moins une guerre. Elle aussi fait pleurer des mères, et couler le sang des hommes. Comme les autres, elle exige une préparation, des connaissances techniques, l’usage d’engins meurtriers. Durant la Commune de Paris, les bataillons fédérés luttaient pour un noble idéal qui n’avait rien de commun avec les objectifs contre-révolutionnaires de l’armée de Versailles. Cependant, de part et d’autre, on utilisait, pour se battre, les moyens militaires de l’époque, et l’on n’aurait pu faire autrement. Tout en étant partisan de la paix entre les peuples, un révolutionnaire, qui admet le recours à l’insurrection armée, ne peut donc, sans inconséquence, répudier le militarisme sous toutes ses formes, ni se déclarer, sans aucune réserve, pacifiste. Seuls ont qualité pour se réclamer du pacifisme intégral, et condamner l’usage des armes, ceux qui, à l’exemple des Doukhobors et des disciples de Tolstoï, ou de Gandhi, sont partisans de la résistance passive et se refusent à employer, à l’égard d’autrui, la violence, en quelque circonstance et sous quelque prétexte que ce soit.
Sont encore de graves préjugés : la conception de la Nature considérée à l’égal d’une divinité tutélaire, infiniment bonne, aimable, et prévoyante envers les êtres ; la croyance en la vie édénique des peuplades primitives ; la foi en la vertu suprême de certaines collectivités d’hommes, jugées incapables absolument — parce qu’elles sont composées de travailleurs manuels, par exemple — de se comporter comme le reste de l’humanité, en des circonstances identiques.
Il en est d’autres, qui mériteraient examen. Je crois m’être assez étendu pour disposer les hommes de bonne volonté à ne jamais s’endormir sur le mol oreiller des opinions définitives, mais à passer honnêtement en revue, de temps à autre, celles qu’ils ont choisies comme étant l’expression de la vérité sans défaut.
— Jean MARESTAN.
PRÉJUGÉ
Le préjugé est une opinion préconçue, adoptée sans examen et sans recherche de sa valeur propre. L’analogie prédispose au préjugé.
Le préjugé représente une opinion contestable, mais qu’on ne conteste pas. Avec la multitude de préjugés qui ont acquis droit de cité, on peut se demander s’il faut travailler à détruire les préjugés, comme on peut se poser la question de savoir si on leur doit le respect qui aide à les conserver.
Cette double question trouve sa solution pratique selon les cas et les époques. Aussi longtemps que la Société exerce, sans obstacle, le monopole du développement de l’intelligence, il faut, socialement parlant, ne pas chercher à ébranler les préjugés utiles au maintien de l’ordre établi.
Il n’en est pas dé même, quand les moyens de comprimer l’activité des intelligences ont échappé à la société. Alors, la guerre ouverte aux préjugés est un devoir, et il s’agit de faire tous les efforts possibles pour y substituer la vérité.
A ceux qui prétendent qu’on doit dissiper peu à peu les ténèbres qui obscurcissent la raison et n’élaguer que branche à branche l’arbre des préjugés, Colins répond :
« On ne réforme pas le fanatisme, on le remplace par le réel ou on reste dans la fantasmagorie. »
Que l’on admette que, pour le passé, la foi permettait de prendre le préjugé pour la vérité et se trouvait en harmonie avec l’ordre de l’époque, rien à redire, puisque l’état général d’ignorance ne permettait pas mieux. Du reste, pour toute époque possible, tout est bien, puisque l’humanité obéit à l’ordre de nécessité.
Quand la discussion est libre, les épais nuages dont l’esprit était enveloppé sont facilement percés à jour, et alors ce n’est pas peu à peu qu’il faut répandre la lumière, mais d’un seul jet, d’une seule poussée.
Il ne faut pas qu’il existe d’erreur grave ou légère, car le préjugé — erreur — tant qu’il subsiste, empêche la vérité de se faire jour. Sous cet aspect, le préjugé est toujours dangereux.
Du reste, dit L. de Potier, il est d’essence de la vérité de ne pouvoir être saisie que tout entière ou pas du tout.
Les préjugés peuvent être classés en préjugés d’éducation et en préjugés d’instruction. L’un comme l’autre n’ont pas donné lieu à la connaissance, mais à la croyance. De la participation de l’instruction à l’œuvre d’éducation naît un renforcement du préjugé, de l’erreur.
L’ignorance, mère du préjugé, peut et doit être détruite ; mais, pour cette fin, il faut connaître la vérité et l’enseigner en substituant le savoir à la foi. A notre époque encore, l’erreur, revêtue des dehors de la science, reste tenace et les préjugés persistent. L’œuvre de régénération sociale est retardée d’autant. Avant de pouvoir remplacer le préjugé par la vérité, il faut déblayer le terrain des obstacles dont le faux l’avait embarrassé, N’oublions pas que le préjugé religieux est celui qui possède, au plus haut point, la ténacité qu’aucun autre ne partage avec lui au même degré.
La politique des catholiques est, indubitablement, le moyen le plus efficace pour maintenir, pour ainsi dire indéfiniment, le préjugé religieux qu’il exprime. Pour l’abattre, la lutte ne peut s’entreprendre que sous le sceptre de la vérité.
— Elie SOUBEYRAN.
PRESSE
Le substantif presse vient, comme le verbe presser, du latin pressus, qui signifie serrer plus ou moins fortement, étreindre, comprimer.
Le mot presse est à plusieurs usages. Les plus importants sont en mécanique, pour désigner des machines servant à exercer une pression sur un objet quelconque pour en réduire le volume, en modifier la forme, en extraire une partie liquide ou lui imprimer une marque. Parmi ces dernières sont les presses d’imprimerie qui servent à l’impression de l’écriture. L’importance prise par cette industrie lui a fait donner le nom de presse en la considérant particulièrement dans la fabrication des publications qui ont une régularité périodique et quotidienne : revues, gazettes, journaux. L’industrie de la presse se confond ainsi avec le journalisme (voir ce mot). C’est d’elle dont nous nous occuperons ici dans sa formation, son développement, dans ses rapports avec la pensée et dans son rôle social.
L’industrie de la presse, moyen de répandre les nouvelles relatives à la vie sociale, a existé bien avant l’invention des presses d’imprimerie. Elle répondait à la curiosité publique ; elle était indispensable. Sans remonter, dans l’antiquité, plus haut que les Romains, on peut dire que la première forme de la presse fut dans leurs Acta diurna, petites affiches qu’on exposait dans les endroits publics et que lisaient les amateurs de nouvelles. Suivant Juvénal, les dames romaines passaient leurs matinées à lire cette sorte de journal dont elles recevaient des copies.
Au moyen âge, les nouvelles s’échangeaient de vive voix, apportées sur les lieux d’assemblées populaires, particulièrement sur les marchés. Là, des hommes faisaient métier de les recueillir pour en écrire des copies qu’ils adressaient à des abonnés. Leurs feuilles furent l’origine du journal. Elles publièrent par la suite des nouvelles politiques. L’une d’elles, conservée à la Bibliothèque Nationale, porte ce titre :
« C’est la très noble et très excellente victoire du roi Louis XII de ce nom, qu’il a heue, moyennant l’aide de Dieu, sur les Vénitiens. »
La portée de ces feuilles manuscrites ne pouvait être que très réduite ; elle s’étendit lorsque l’imprimerie permit d’en multiplier le tirage. En Allemagne, au XVe siècle, elles s’appelaient Zeitung, qui signifie gazette. Le même siècle vit, encore en Allemagne, la naissance de l’almanach. A Venise, au XVIe siècle, les feuillets des gazetiers étaient les Fogli avvisi ou les Notizie Seville. On les appela gazettes, du mot gazzetta, pièce de monnaie qui servait à les payer, et le mot passa en France. Avec l’imprimerie, les gazettes et les almanachs se répandirent rapidement, surtout en Allemagne où le peuple apprenait à lire plus qu’en tout autre pays. D’autres publications étaient appelées courriers. A partir de 1590 furent publiées, à Francfort les Relations Semestrales, rédigées en latin et en allemand et paraissant deux fois par an, à l’époque des grandes foires. Diverses autres publications, sans être des journaux proprement dits, parurent périodiquement de façon suivie. 1615 vit naître le Journal de Francfort, premier journal européen. Parurent ensuite celui de Berlin, en 1617 et celui de Nuremberg, en 1620. La presse allemande a été de tout temps, depuis les premières gazettes, la plus importante dans tous les genres, politique, littéraire, scientifique, et celle des autres pays n’a pas cessé de suivre ses initiatives jusqu’à la création de la presse contemporaine où la publicité est arrivée à dominer toutes les autres préoccupations. Le premier journal anglais fut l’hebdomadaire Weekly News, fondé en 1622. Dès 1702, Londres eut son journal quotidien, le Daily Courani. La Révolution d’Angleterre fit prendre à la presse de ce pays un développement que les journaux français ne connurent que cent cinquante ans après, à partir de 1789. Le premier journal italien parut en 1630. Une censure religieuse rigoureuse empêcha le développement de la presse italienne comme elle retarda celui de la presse française.
Nous ne suivrons pas le mouvement de la presse dans les pays étrangers. Nous indiquerons seulement, et rapidement, ce qu’il a été en France. On cite, comme le plus ancien document, le prospectus d’une « gazette rimée », paru en 1609, et qui disait entre autres :
Contente les cervelles,
Car de tout l’univers
Elle reçoit nouvelles. »
Ces nouvelles mettaient alors des mois et même des années à arriver. Le monde n’en était pas plus malheureux qu’aujourd’hui où, en trois heures, la téléphotographie lui transmet, en texte et en images, ce qu’il y a de plus nouveau aux antipodes. Au contraire. En voyant les résultats, cette espèce de maboulisme trépidant qui n’est capable de se fixer sur rien et oublie immédiatement, pour quelque chose de plus nouveau, ce qu’il vient à peine d’apprendre, on se demande ce que ce sera lorsque, par des moyens aussi rapides, on recevra des nouvelles du Soleil et de la Lune.
Une gazette dont l’existence n’est pas plus certaine que celle de la « gazette rimée « de 1609, est celle de Troyes qui aurait paru en 1626, mais dont il ne reste aucune trace.
Ce fut le 30 mai 1631 que vit le jour la Gazette de Théophraste Renaudot, le « père du journalisme français ». Elle parut chaque semaine et Renaudot la rédigea durant vingt-deux ans. Il y apporta la ténacité qu’il mit dans toutes ses entreprises et qui fit soulever contre lui les haines de tous les pontifiants bénéficiaires de la routine. Le premier, il connut dès la création de la presse le sort de tous ceux qui voudraient en faire un instrument de vérité et tenteraient de s’en servir autrement que pour mentir, bluffer, soutenir la puissance d’un puffisme de plus en plus impudent. « En une seule chose ne cèderai-je à personne, en la recherche de la vérité », disait Renaudot. S’il revenait aujourd’hui, combien de ceux qui « honorent » en lui le premier de leur profession, réclameraient ou approuveraient contre lui l’application des « lois scélérates » ! Une allégorie naïve, mais caractéristique, représentait sur la couverture de la Gazette Renaudot refusant l’argent offert par les « cadets de la faveur ». C’est un geste que ne connaissent guère les stipendiés des Rafalovitch, les nourrissons de la Tour pointue et les cadets des fonds secrets, bien qu’ils prétendent tous qu’ils font des « journaux honnêtes pour les honnêtes gens » ! En fait, la Gazette de Renaudot ne pouvait vivre qu’avec l’appui du pouvoir, de Richelieu d’abord, de Mazarin ensuite et, profondément convaincu des services qu’il pouvait rendre à tous ses contemporains par le moyen de son journal comme de ses autres entreprises, Renaudot ne fut pas absolument rigoureux quant aux appuis qu’il accepta. Sa gloire la plus authentique, alors qu’il participa à tant de choses, fut de demeurer personnellement honnête et pauvre. « Le vieux Théophraste Renaudot est mort gueux comme un peintre », a dit son plus acharné ennemi, le riche Gui Patin.
Les haines contre Renaudot, gazetier, s’alimentèrent des haines contre Renaudot, médecin. Sa querelle avec Gui Patin, qui opposa la science nouvelle de la Faculté de Montpellier à l’empirisme de la Faculté de Paris, fut digne d’inspirer Molière. Toute l’Université fut contre Renaudot et le Parlement le condamna. Mais c’était le novateur, l’entreprenant, l’audacieux Renaudot qui avait raison, malgré la Faculté puisqu’il guérissait les gens, et le peuple chantait en l’honneur du quinquina dont il s’était fait le propagateur :
Par la vertu du quinquina : Alleluia ! »
On doit à Renaudot, indépendamment de la Gazette, la création du Bureau d’adresse et de ses Feuilles devenues ce qu’on a appelé par la suite les Petites Affiches, qui inaugurèrent les annonces et la publicité. Du Bureau d’adresse sortit encore une autre création, celle des offices de secours aux pauvres qui devinrent les monts de piété. Il n’était pas besoin de tant d’activité créatrice pour attirer sur la tête de Renaudot les vieilles haines médiévales toujours vigilantes : invidia scolastica et invidia medica.
La Gazette se doubla bientôt des Nouvelles. Les deux réunies se vendaient un sou ; on avait l’une ou l’autre pour deux liards. Renaudot les rédigea jusqu’au 23 octobre 1653, avant-veille de sa mort à la suite d’une attaque de paralysie. Loret, le plus connu des auteurs des Mazarinades et qui composait une Muse historique, chronique en vers faisant concurrence à la Gazette, lui consacra un adieu assez ému et le 1er novembre, la Gazette fit son éloge. Un dernier mot sur Renaudot. « La presse, disait-il, tient cela de la nature des torrents, qu’elle grossit par la résistance ! » Il n’avait pas encore fait l’expérience qu’elle s’avilit par la soumission. Trois siècles plus tard il aurait fait écho à la question indignée de Séverine à ses « confrères » :
« Sommes-nous des larbins ? »
Et résigné il n’aurait pu que répondre :
« Hélas !... »
La Gazette fut continuée par les fils de Renaudot jusqu’au jour où, prenant le titre de Gazette de France, en 1762, elle devint le journal officiel de la royauté, dirigé par des fonctionnaires de la Cour. Elle déclina alors au point que Grimm en dit en 1772 :
« Je ne crois pas qu’il soit possible de lire rien de plus bête. »
Peut-être est-ce pour cela qu’elle demeura, malgré vents et marées, pour soutenir jusqu’en 1915, année où elle mourut, les « droits » d’une légitimité inconsolable et obstinée qui dut renoncer à se rétablir, même à la faveur de la guerre.
La Gazette était de caractère politique. En 1665, Denis Sallo fonda le Journal des Savants, d’information littéraire, scientifique et de « critique équitable et impartiale », dit Sallo qui signait du nom plus distingué de d’Hédouville. Les jésuites firent supprimer le Journal des Savants. Il ressuscita en 1666, sous la direction de l’abbé Gallois, et il n’a plus cessé, depuis, de paraître, sous le patronage de l’Etat.
En 1762, on vit la première publication de caractère « parisien » et « boulevardier », comme on a dit plus tard. Ce fut le Mercure Galant, créé par Donneau de Vizé qui s’inspira de l’esprit gai et vivant de la Muse historique de Loret. A la fois politique, littéraire et mondain, sa formule était :
« Parler de tout, ouvrir le Mercure à tous, faire qu’il convienne à tous. »
Il eut un vif succès et devint en 1714 le Mercure de France. Après plusieurs éclipses, il disparut définitivement en 1825. Le titre fut repris en 1890 par Alfred Vallette et un groupe d’écrivains symbolistes qui le donnèrent à une revue littéraire. (Voir Symbolisme.)
D’autres gazettes eurent un sort moins heureux que celle de Renaudot. Les Lettres en vers et en prose, de Lagrète de Mayolas (1672), commencèrent à publier des romans avec « la suite au prochain numéro ». Le Journal de la Ville de Paris, de Colletet fils, inaugura en 1676 ce qu’on a appelé plus tard « l’annonce anglaise ». Elle y tint jusqu’à six pages ; mais Colletet n’y fit pas fortune, si l’on en croit Boileau dépeignant :
Allant chercher son pain de cuisine en cuisine. »
Dans une autre circonstance. Boileau célébrant Horace le voit qui :
N’attend pas pour dîner le succès d’un sonnet. »
En 1684, Bayle fonda ses Nouvelles de la République des Lettres que continuèrent Leclerc, La Roque et Bernardet.
Le XVIIIe siècle vit se développer la presse et la polémique dans tous les genres. On lui doit la propagation des idées philosophiques qui formèrent l’esprit politique de la Révolution française. La vieille société de droit divin y était sapée par les droits de l’homme. Le Pour et le Contre, de l’abbé Prévost (1723–1740), l’Année littéraire, de Desfontaines, puis de Fréron, l’Ane littéraire, opposé au précédent par Le Brun, le Journal Encyclopédique, de Pierre Rousseau (1759), et d’autres encore, entretenaient un courant d’idées de plus en plus impétueux. La Gazette des deuils, de Palissot, inaugura la chronique des décès. Durozoy y ajouta celle des naissances et des mariages. Campigneules fit le premier Journal des dames en 1759 ; il y publia des comptes rendus de livres, spectacles et « de tout ce qui, en littérature, est fait par et pour les dames ». Le Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacie fut fondé en 1754 ; celui du Commerce en 1759 ; la Gazette des Tribunaux en 1774, etc. Enfin, en 1777, parut le Journal de Paris, premier quotidien français. Des journaux se fondèrent en province, parmi lesquels existent encore le Journal du Havre qui a 175 ans, et celui de Rouen qui en est à sa 163e année. Voilà, en résumé, le tableau de la presse .avant 1789.
La Révolution française fit prendre aux journaux une importance extraordinaire. La politique y occupa alors la première place, et avec une liberté qu’elle n’a plus connue (voir plus loin). Il paraissait en France, en 1779, quarante-et-un journaux dont quatorze étrangers. De 1789 à 1793, on en compta 1.400, hebdomadaires, bi-hebdomadaires ou quotidiens, pour ou contre la Révolution, dont le prix moyen fut de deux sous. Le centre du monde de la presse parisienne était alors, sur la rive gauche de la Seine, dans les rues Hurepoix et des Poitevins où s’imprimaient et se distribuaient aux vendeurs la plupart des journaux. Quand le centre des affaires s’établit, après la Révolution, sur la rive droite, autour de la Bourse dont la construction commença en 1808, la presse se transporta dans le voisinage, au quartier du Croissant.
On n’en finirait pas d’énumérer les titres et les auteurs de toutes les feuilles plus ou moins éphémères, appartenant à tous les partis, qui parurent pendant la Révolution et qui furent presque toutes tuées lorsque le Directoire rétablit la censure. On trouvera, dans le Grand Larousse Universel, une longue liste, commentée, d’un grand nombre de journaux de la Révolution, à l’article : journal. De l’ancienne presse, il ne demeura guère que le Journal des Débats dont les propriétaires, les frères Bertin, pas assez soumis à l’arbitraire napoléonien, se virent dépossédés, et qui devint le Journal de l’Empire. Sous la Restauration, les frères Bertin rentrèrent en possession de leur journal qui a été, depuis, le Journal des Débats politiques et littéraires.
A partir de la Restauration, l’histoire de la presse a suivi les vicissitudes de la liberté d’opinion, jusqu’au jour où les journaux, cessant de représenter des opinions, ne furent plus que des prospectus de charlatans au service de l’argent. La liberté devint une chose inutile dans une profession où l’on ne cherchait plus qu’à vendre sa liberté. Au contraire : plus la liberté fut étranglée, plus la valetaille journaliste prospéra. N’est-ce pas la suprême honte de la presse d’aujourd’hui de laisser appliquer, contre la liberté de la pensée, des « lois scélérates » contre lesquelles les journalistes d’il y a cent ans firent une révolution ? Aujourd’hui, les journalistes n’ont que des « rapports d’amitié » — sportule, fonds secrets, décorations, bons dîners — avec les fabricants et les bénéficiaires des « lois scélérates » ! Tous les régimes libéraux avaient voulu que les délits de presse ne fussent passibles que de la seule cour d’assises. A différentes reprises, les rois Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe, et le plus sinistre étrangleur de liberté depuis Napoléon Ier, son neveu Napoléon III, avaient dû céder devant l’opinion indignée de leurs « lois d’exception » ; mais l’on a vu la République radicale-socialiste rétablir ces lois et les maintenir depuis trente-cinq ans ! Grâce à elles, de plus en plus, on condamne automatiquement en correctionnelle orateurs, écrivains, dessinateurs, etc., sans aucune possibilité de défense effective et avec une sévérité haineuse qu’on épargne aux pires malfaiteurs de droit commun. C’est en cour d’assises qu’un Daumier était traduit en 1832 et 1834 pour ses dessins de la Caricature. C’est en correctionnelle que le dessinateur Des Champs a été poursuivi cent ans après. Non seulement la presse qui se dit « républicaine » ne proteste pas, mais elle s’amuse des « records » de condamnations que détiennent certains, et elle perd toute pudeur au point de leur reprocher de recommencer après qu’on a bien voulu les « gracier » !... C’est cette presse qui a osé célébrer, en 1930, le centenaire des « Trois Glorieuses », et qui ose commémorer aujourd’hui Jules Vallès, emprisonné, persécuté, insulté par les valets de plume, parce qu’il réclamait pour l’expression de la pensée une « liberté sans rivages !... ».
Cette liberté sans rivages, cette liberté de l’immense Océan, est de moins en moins celle qu’il faut aux barbillons nageant dans l’aquarium journalistique ; elle leur fait peur. De plus en plus ils sont soumis au conformisme hypocrite des malfaiteurs régnants et résignent toute pensée qui résiste aux tripatouillages sportulaires. Ils se dressent contre elle, non pour la discuter et la combattre ouvertement — ils sont trop lâches pour cela — mais pour la discréditer, pour l’étouffer sous la calomnie policière ou sous la conspiration du silence. « Silence aux pauvres ! », disait douloureusement Lamennais, il y a cent ans ; il le répéterait aujourd’hui. Depuis cent ans, les journaux ont de plus en plus établi leur sécurité sur leur domestication au pouvoir. Non seulement ils se sont corrompus avec lui, mais la corruption du pouvoir n’a été possible que par la corruption de la presse, parce qu’elle a failli complètement à sa tâche qui était d’éclairer l’opinion, parce qu’elle s’est faite, a dit Albert Bayet, « la première vassale de la féodalité industrielle ». Dernièrement, le Temps, le plus important, le plus représentatif et le plus hypocrite des journaux bourgeois, celui où les Tardieu des N’Goko-Sangha et des Homs-Bagdad donnent des leçons de moralité politique avant de la pratiquer comme chefs du gouvernement, a été vendu au Comité des Forges. « Les hommes du fer ou de la houille achètent aujourd’hui l’opinion comme Oustric achète un garde des Sceaux. » (A. Bayet, Cahiers de la Ligue des D. de l’H., 20 novembre 1931.)
Entre tant d’exemples de domestication de la presse, celui du Figaro est typique. On ne parle guère de l’ancien Figaro, celui de la Restauration. Il serait aujourd’hui un homme de mauvaise compagnie pour les Bartholo et les Bazile, les flibustiers et les cafards, qui opèrent à son enseigne. Entre tous les journaux dits de « la petite presse », le Corsaire, le Pandore, la Silhouette, le Lutin et nombre d’autres feuilles d’opposition, le Fiqaro fut, de 1826 à 1830, celui qui porta les plus rudes coups au gouvernement de Charles X, à ses Villèle et à ses Polignac. Il écrivit entre autres, en 1827 :
« Dorénavant, tout écrivain qui n’aura pas 50.000 francs de rentes, sera un homme sans considération et sans talent. D’agrès cette nouvelle découverte, M. de Rothschild va se trouver le gros génie de l’époque. »
Le spirituel barbier annonçait ainsi le « gros génie » qui, cent ans après, se dirait Figaro ; nous voulons nommer M. Coty. La Fontaine qui flairait, lui aussi, les « gros génies » à la Coty, a raconté :
Etait craint partout à la ronde ;
Et bien qu’animal sans vertu,
Il faisait trembler tout le monde. »
Emile Gaboriau a composé tout un volume, sous le titre : L’Ancien Figaro, des « bigarrures », « coups de lancette », « nouvelles à la main », etc. dont Figaro cribla alors les puissances souveraines. En voici quelques-uns qui seraient encore d’actualité aujourd’hui :
-
« On parle d’établir de Paris à Bruxelles des relais en permanence à l’usage de MM. les agents de change, les financiers, les libraires, etc., qui désireraient faire banqueroute. »
-
« Un missionnaire observait très pertinemment que l’infâme Voltaire avait assez écrit pour perdre deux millions d’âmes, et pas assez pour allumer dix bûchers. »
-
« Depuis que l’abbé G ... a fait brûler Voltaire et Rousseau, on sait de quel bois les jésuites se chauffent. »
-
« Il y a un proverbe florentin conçu ainsi : Qui fait ses affaires ne se salit pas les mains. M. le comte de... doit avoir les siennes furieusement propres. »
-
« Un auteur célèbre a dit que l’existence entière des jésuites fut un grand dévouement à la religion et à l’humanité. Ajoutez : et aux petits garçons. »
-
« Il y a des gens bien élevés, en Russie : les potences ont quinze pieds de haut. »
-
« La statue de Louis XIV qui a été érigée à Lyon à coûté, tous frais faits, 537.950 francs. Que l’on dise ensuite dans vingt biographies que Louis XIV ne vaut rien. »
-
« Un juge présidant les dernières assises A certain vagabond reprochait son larcin.
Ah ! parbleu ! répond-il, dites donc des sottises, Sans les voleurs, bientôt vous crèveriez de faim. »
-
« Les valets détestent la liberté parce qu’elle ne leur permet pas de se montrer plus insolents que leurs maîtres. »
-
« La garde meurt et ne se rend pas. » M. de Villèle a retourné ce proverbe ; il ne meurt pas et ne rend rien. »
-
« Comment pense-t-on dans votre régiment ?
On ne pense pas.
A la bonne heure. »
-
« De quoi vous plaignez-vous, vous a-t-on défendu de penser ? »
-
« <em>Panem et circenses<em>. Des truffes et des cordons. »
-
« Thémis a maintenant pour attributs un bâillon et un timbre. »
-
« La liberté est trop lourde, a dit M. de Cur... Il se rappelle peut-être le temps où il traînait le char de la déesse. »
-
EPITAPHE :
J’ai vécu d’un journal par moi mis à l’encan ;
De honte j’ai vécu ; j’ai vécu de scandale ;
J’ai vécu de la croix ; j’ai vécu du turban ;
J’ai vécu, j’ai vécu, gazetier famélique,
Quatre-vingts ans passés ... Mais je voulus, enfin,
Vivre un matin de l’estime publique,
Et le soir j’étais mort de faim. »
-
« — Le mensonge déshonore.
— C’est possible, répondit M. de V..., mais ça n’ôte pas un portefeuille. »
-
« Il y a plus de honte à être debout dans certains salons qu’à tomber dans le ruisseau. »</em>
-
« La meilleure rime à ministre est sinistre. »
-
« La garde meurt et ... les ministres restent. »
-
« On vient de publier une biographie de tous les bons ministres de France. Cet ouvrage n’est pas long. »
-
« Ces messieurs conviendront au moins qu’ils ne nous gouvernent pas gratis. »
-
« M. de Cumulando est devenu très riche en visitant les pauvres. »
-
« On a beau agrandir la Chambre, elle sera toujours moins large que leur conscience. »
-
« Ils brisent les cachets des lettres pour revenir aux lettres de cachet. »
-
« Au lieu de décorer les gendarmes et de casser les boutiques, on ferait mieux de décorer les boutiques et de casser les gendarmes. »
-
« Qu’on dise que les jésuites ne se fourrent pas partout, il y en a même aux galères. »
-
« Si l’on chasse les mendiants, à quoi serviront les aumôniers ? »
-
« Séminaire vient de semen ; cela signifie mauvaise graine. »
-
« Les ministres ne sont pas comme les jours, ils se suivent et se ressemblent. »
Qui marchez le front haut, plus fiers que le sultan,
Combien fait-on d’honneur, de talent, de génie,
Avec une aune de ruban ? »
-
« Nos faiseurs de budgets ont toujours trouvé des dépenses pour augmenter la recette ; mais ils n’ont pas encore cherché la recette pour diminuer la dépense. »
-
« On cherche la liste des gens qui avalent le budget : l’Almanach royal paraîtra demain. »
-
« Tous les députés parlent contre le budget, mais le ministère ne s’en émeut pas ; il compte sur le scrutin. secret, où la plupart de ces messieurs n’ont plus alors de secret pour les ministres. »
Arrêtons-nous sur ce dernier trait ; il est encore plus actuel que tous les autres après cent ans de parlementarisme.
La politique étant devenue, au XIXe siècle, la préoccupation de toutes les classes, il se créa des journaux pour toutes les classes et toutes les opinions. Mais les « affaires » dominant de plus en plus les opinions, les journaux devinrent d’affaires plus que d’opinion. Une transformation qu’on peut appeler radicale fut conçue et réalisée dans ce sens par Girardin et Dutacq qui firent le journal à bon marché en réduisant de cinquante pour cent le prix de l’abonnement, et recoururent pour compenser aux profits de la publicité. Le but était de rendre la publicité la plus productive possible par un tirage de plus en plus important pour atteindre des lecteurs de plus en plus nombreux. Il fut obtenu quand le Petit Journal inaugura, en 1863, le journal à cinq centimes. L’opinion du journal ne comptait plus ; on la fit de plus en plus amorphe pour atteindre le plus de gens possible. Des agences d’informations et d’annonces, telle l’Havas, fondée en 1835, facilitèrent la besogne en concentrant les nouvelles apportées du monde entier par le télégraphe et en en faisant une mixture interchangeable à l’usage de tous les journaux. Ainsi fut organisé ce barattage quotidien de millions de cervelles suivant les desseins des « Maîtres du Monde » maîtres du télégraphe, des journaux et des gouvernements. Ainsi fut réalisée la plus vaste et la plus audacieuse entreprise de brigandage qui se fût jamais vue. La presse, complice de toutes les turpitudes, gagnerait à tous les coups, retirerait les bénéfices sans jamais assumer aucun risque, quelles que seraient les catastrophes. A l’enseigne du civisme, du patriotisme, de l’honneur, de la vertu, elle tiendrait boutique de friponnerie, favoriserait toutes les trahisons, toutes les prostitutions. Elle aurait toujours des leçons à donner, jamais à en recevoir ; le silence organisé confraternellement lui permettrait d’étouffer tous les scandales pouvant l’atteindre, et les plus noires fripouilles, les plus salement engraissées de rapine, tiendraient, grâce à elle, le haut du pavé. Voilà ce qu’un Armand Carrel, journaliste ardent et sincère, pressentait, avec quelques autres, devant l’entreprise de Girardin et de Dutacq. La polémique qui résulta de leurs protestations eut pour conséquence le duel dans lequel Girardin tua A. Carrel, le 22 juillet 1836. Duel symbolique : la publicité tuait la pensée et supprimait l’opinion publique !
La Presse, de Girardin, et le Siècle, de Dutacq, étaient parus le même jour, le 1er juillet 1836. Ils eurent rapidement vingt mille abonnés chacun. Le roman-feuilleton, alors à son aurore et dont le succès était extraordinaire (voir roman) facilita beaucoup cette réussite auprès du « populaire ». On dut trouver ensuite d’autres moyens de tenir le public en haleine. « De plus fort en plus fort », dirent les banquistes de la presse s’ingéniant à tirer parti d’un bluff grandissant. Après 1850, le système des « primes » parut. Divers journaux se mirent à rembourser les abonnements avec des marchandises à prendre chez des commerçants désignés par eux. On en vit qui offrirent des soins médicaux et des médicaments gratuits ; d’autres, une pension de retraite après trente ans d’abonnement !... « Le charlatanisme de la presse quotidienne était largement inauguré », comme l’a constaté Larousse. Ce furent ensuite les concours de toutes sortes, escroqueries plus ou moins déguisées qui prirent la plus grande extension quand le journal fut à cinq centimes et qui révélèrent des profondeurs désespérantes de sottise publique. Les centaines de mille citoyens qui comptèrent les grains de blé du « litre d’or » ou qui accomplirent les « marches du Matin », font comprendre combien on était mûr pour la guerre de 1914 !... En 1866, la Presse illustrée présenta le premier journal quotidien avec images, et en 1869, l’Histoire fut le premier qui parut sur huit pages. Enfin, le Matin apporta dans le journalisme français, en 1884, les procédés américains. On atteignit alors les grands tirages. Ceux du Petit Parisien, du Journal, en concurrence avec le Petit Journal et le Matin, sont chaque jour de millions d’exemplaires.
Les entreprises publicitaires ont dépouillé de plus en plus les journaux de toute pensée originale et indépendante. Il y a un gabarit d’abrutissement national auquel ils sont astreints de se tenir, s’ils ne veulent pas compromettre leur prospérité. Aussi les plus grands écrivains, plus ou moins domestiqués, n’y sont-ils que des figurants pour leur donner des apparences littéraires, artistiques, scientifiques, mais moins considérés certainement que les « démarcheurs » qui apportent de bons contrats de publicité. La critique n’est plus que de la réclame déguisée pour le marchand de tableaux, l’éditeur, le directeur de théâtre dont les produits sont vantés ni plus ni moins que les camelotes vestimentaires, comestibles ou purgatives du couturier, de l’épicier, du pharmacien. De lamentables académiciens, membres de l’Institut, professeurs de grandes écoles, sont censurés, tripatouillés, comme les derniers rédacteurs des « chiens crevés ». De « vieux hellénisants » vendent leur conscience en même temps que leur science pour découvrir sur un bouclier antique que Pâris portait des bretelles X... et que la belle Hélène fumait des cigarettes Z... Les rédacteurs en chef ont plus de mépris pour les « pattes de mouche » de ces pitoyables mercenaires que pour les prospectus écrits à la machine à écrire, nets et clairs, envoyés par l’usine A..., le laboratoire B..., ou la distillerie C... C’est comme on le dit aujourd’hui, et certainement pas sans rire, dans la presse de M. Coty : « Les correspondants télégraphistes et les photographes ont remplacé l’écrivain consciencieux qui peinait sur une idée ». Aux télégraphistes et aux photographes, la modestie si connue de M. Coty l’empêche d’ajouter les parfumeurs milliardaires qui font peiner des « nègres » sur des idées (?) qu’ils signent mais qu’ils sont incapables d’exprimer.
Cette presse publicitaire qu’aucun scrupule ne retient plus, est tombée à toutes les formes de la vénalité. Nous n’insisterons pas sur les preuves de cette vénalité ; elles ont été souvent fournies à l’opinion publique incapable dans sa veulerie de se défendre. Les révélations apportées par les documents Rafalovitch, publiés en volumes sous le titre : L’abominable vénalité de la presse, ont marqué au fer rouge le monde d’aventuriers du journalisme. Voici le plus récent témoignage, celui d’un ministre, ancien Président du Conseil, « qui le sera de nouveau », rapporté par J.-R. Bloch dans Europe du 15 juin 1932 :
« J’ai le chagrin de déclarer, après trente années de vie politique, que la presse française est tout entière vénale. Les journaux qui ne sont pas stipendiés par une ambassade, par un pays étranger, — c’est, hélas ! le cas d’un très grand nombre, et parmi les plus importants, — sont à la solde des groupements financiers, des banques, des partis. Un homme d’Etat qui n’est pas capable de déchiffrer la presse étrangère, cet homme-là est prisonnier des forces de corruption, des congrégations financières et de la propagande étrangère, dont nos journaux sont les agents serviles. »
Autant l’histoire de cette presse de bluff et de puffisme et de ses industriels proxénètes de l’opinion est honteuse et ne mérite que le mépris, autant l’histoire de la presse d’opinion, d’idée et de lutte sociales, est instructive et intéressante à connaître. Elle a toujours été, on peut dire, le véritable baromètre de la pensée publique et, s’il n’y a plus aujourd’hui de presse d’opinion en dehors de quelques journaux sans influence déterminante, c’est qu’il n’y a plus d’opinion publique.
L’effervescence de l’opinion a toujours fait se multiplier les journaux dans les périodes pré-révolutionnaires et révolutionnaires et soutenir ceux de l’opposition. En 1824, six journaux dévoués au gouvernement avaient 14.344 abonnés contre 41.330 à six autres journaux d’opposition. Ces nombres, qui devaient grossir dans la même proportion, expliquent les barricades de 1830, quand Charles X voulut supprimer les libertés de la Charte.
Sous Louis Philippe, la presse d’opposition démocratique fut représentée par la Tribune, avec Marrast, le National, avec Armand Carrel, le Globe, de Pierre Leroux, le Bon-Sens, de Cauchois-Lemaire, continué par Louis Blanc, le Monde, de Lamennais, etc. Les oppositions légitimiste et bonapartiste avaient la Révolution de 1830, la Quotidienne, la Gazette de France, etc.
La Révolution de 1848 fît éclore une foule de journaux. La République, de Bareste, parue le 24 février, fut suivie de la République Française, la République Universelle, la République démocratique et sociale, la Vraie République, de Thoré, Leroux et Barbès, la République rouge, et même la République bonapartiste, pour préparer le bonapartisme anti-républicain. Il n’y eut pas moins de Révolutions et de Tribunes. Les femmes entrèrent dans la lice avec la Voix des Femmes, la Politique des Femmes, l’Opinion des Femmes, et des farceurs firent la République des Femmes où on leur faisait chanter :
De tyrans trop longtemps debout
A la barbe faisons la guerre,
Coupons la barbe, coupons tout ! »
Une opposition sociale plus sérieuse fut représentée par le Peuple Constituant, de Lamennais, l’Ami du Peuple, de Raspail, le Représentant du Peuple, de Proudhon, qui devint le Peuple. Près de cinq cents « canards » plus ou moins fantaisistes naquirent dans la période de février à décembre 1848. Ils eurent les ailes coupées par le régime Cavaignac qui les passa « au fil du sabre africain ». (Hatin.)
Malgré l’hostilité du IIe Empire à toute presse indépendante, mais grâce aux affaires qui remplaçaient l’opinion dans les papiers imprimés, il y avait en France près de deux mille journaux en 1869. L’Empire avait vu naître, à côté du Petit Journal, le Temps, de Nefftzer, l’Evénement, qui devint bientôt le Figaro, de Villemessant, puis le Gaulois et d’autres qui se sont continués sous la IIIe République. La presse de province se formait seulement à l’évolution publicitaire. Les derniers temps de l’Empire près de s’écrouler dans la honte et que Sedan achèverait, virent se lever contre lui, sans qu’il pût les empêcher, le Courrier Français, où Vermorel fit courageusement le procès des républicains de 1848 et de « leur politique bornée, anti-socialiste, qui rendit le 2 décembre inévitable » (Lissagaray : Histoire de la Commune), la Libre pensée, d’Eudes, la Rive Gauche, de Longuet et Rogeard, la Lanterne, de Rochefort, le Ratipet qui recevait ses inspirations de V. Hugo, le Réveil, de Delescluze, et nombre d’autres menant en province une lutte ardente contre l’Empire, après vingt ans d’étouffement bonapartiste.
Sous la IIIe République, les journaux se sont multipliés, surtout en province. Les deux mille de la fin 1869 sont devenus aujourd’hui de huit à dix mille. De plus en plus, ces journaux, « d’opinion » à leur début, se sont tournés vers les affaires, emportés par les séductions de la sportule politique et publicitaire. Aucun journal quotidien ne peut y échapper. Un million ne permet plus de vivre longtemps ; même si on l’a trouvé dans les poches des « honnêtes gens » croyant naïvement qu’un journal peut être « honnête » ; il faut, à bref délai, le renouveler, et seules les puissances de corruption financière sont à même de le fournir. Une nuée de périodiques plus ou moins vaguement définis vivent de moyens semblables dans des conditions encore plus ténébreuses. Ce sont les « chevaliers de l’escopette » qui font la « guérilla » dans le maquis pendant que l’armée régulière de la « grande presse » livre les batailles rangées avec son artillerie lourde et ses mitrailleuses.
Il est inutile de parler de tous les grands journaux qui se sont créés depuis cinquante ans au service des intérêts de la bourgeoisie capitaliste. Ils ont été aussi vides de substance, sauf celle de quelques héroïques rédacteurs — une Séverine, un Tailhade — acharnés à leur en donner malgré eux, qu’ils ont été malfaisants. Plus intéressante serait à suivre l’évolution de la presse « d’avant-garde » si on ne devait faire trop souvent la triste constatation qu’elle n’a pu prendre un développement qu’au détriment des idées qu’elle devait défendre, des luttes qu’elle devait mener. Une foule de journaux socialistes, plus ardents les uns que les autres, se sont succédés depuis 1875. M. Zévaès leur a consacré une étude intéressante dans Monde (21 mai 1932 et suivants). Ces journaux, et ceux qui les ont créés, quand ils ne sont pas disparus plus ou moins tôt, ont suivi l’évolution politique du socialisme vers l’opportunisme. (Voir Politique.) Quant à la véritable presse d’opposition politique, de pensée sociale, intellectuelle, artistique, elle végète de plus en plus, semblant ne plus répondre à un besoin, alors qu’on aurait plus que jamais besoin d’une presse hardie, vaillante, combative, qui ne limiterait pas l’action sociale à des questions de boutiques. A l’atelier, au bureau, dans la rue, au restaurant, en tramway, les travailleurs en « bleu » ou en veston lisent des journaux d’information, de sport, de cinéma, des revues policières. Socialistes ou communistes, orthodoxes ou hérétiques, syndicalistes réformistes ou révolutionnaires, anarchistes communistes ou individualistes, ne lisent même pas, pour la plupart, les journaux et autres publications de leurs idées, de leurs organisations. Le « peuple souverain » fait le pied de grue pendant des heures, transpire, s’écrase, se laisse bousculer et matraquer par des policiers sans aménité, pour voir enterrer un maréchal, passer un roi nègre, couper une tête ; il se passionne à la lecture des crimes rocambolesques sans lesquels son travail serait sans entrain et son déjeuner sans saveur. Il reste indifférent à la tragique affaire du « Chaco » et de ses cent cinquante « indésirables » livrés aux gouvernements fascistes comme aux millions d’êtres humains qui meurent en Mandchourie et ailleurs, victimes des entreprises impérialistes. Ce peuple s’arrache les journaux pour savoir quel est le gagnant du Derby, le vainqueur d’un combat de boxe, pour voir la photographie de la dernière reine promue à une prostitution souveraine par les proxénètes des concours de beauté, du monsieur qui a dansé cent heures consécutives, de la dame qui a vendu le plus cher son « sex-appeal ». Ce peuple, qui connaît tous les « as » du sport, toutes les « stars » du cinéma, tous les chevaux de course, ignore les noms de Marx, de Bakounine, de Pelloutier, de Varlin, de Vallès, de Louise Michel, de Séverine, de Jaurès, comme ceux d’Hugo, de Michelet, de Darwin, de Wagner, de Pasteur, d’Edison, d’Einstein, de Freud, grâce aux journaux dont il fait sa pâture. Ils l’ont fait descendre à l’étiage de la pensée bourgeoise dont l’aliment est dans une stupidité égoïste de plus en plus aveugle et féroce, dans une haine si monstrueuse de tout ce qui est humain qu’elle est arrivée à se haïr elle-même par un juste retour de ses turpitudes.
LIBERTÉ DE LA PRESSE
Dès l’invention de l’imprimerie, la presse, moyen d’expression et de vulgarisation des idées, vit se dresser contre elle l’hostilité des pouvoirs. Elle fut suspecte comme la pensée, dangereuse comme la vérité qu’elle était susceptible d’opposer au « mensonge immanent » des sociétés. La royauté et l’Eglise lui firent la guerre ; elles ne la tolérèrent que lorsqu’elle les servit. Elle fut immédiatement sous le contrôle de l’Université, gardienne de la pensée orthodoxe. Dès 1543, la congrégation de l’Index avait été organisée spécialement contre l’imprimerie. François Ier et Henri II rendirent les premiers édits contre elle. Ils furent terribles. La Faculté de théologie eut le privilège de juger seule, sans appel, des autorisations à donner. Ce fut la peine de mort pour les auteurs, la destruction des écrits quand il n’y avait pas eu autorisation. Dès le règne de François Ier, que des flagorneurs ont appelé « le protecteur des Lettres », plusieurs libraires furent pendus, d’autres brûlés, tel Etienne Dolet en 1546. Les Estienne furent persécutés à la fois par les catholiques et les calvinistes. Michel de l’Hôpital fit amender la férocité inquisitoriale par l’ordonnance de Moulins qui enleva à la Faculté de théologie, pour le réserver au roi, le droit d’autoriser les ouvrages, et qui supprima la peine de mort contre les écrivains et les éditeurs des « mauvais livres » disant des vérités subversives. En 1586, on n’en pendit pas moins François Le Breton pour avoir écrit trois pamphlets sur la misère du peuple. D’autres furent envoyés au gibet ou rompus vifs en grève, pour des libelles et autres productions jugés indécents ou hérétiques. Richelieu, un autre « protecteur des Lettres » qui n’admettait que des écrits dont sa vanité n’avait pas à souffrir, fit rendre en 1625 un édit rétablissant la peine de mort contre tout auteur de publication non autorisée. On ne cessa pas de pendre, de brûler, de rompre vifs ou d’envoyer aux galères, auteurs, éditeurs et colporteurs jusqu’en 1728 qui vit l’abolition de la peine de mort en matière de librairie. Les galères et les prisons d’Etat n’en reçurent que plus de rameurs et de pensionnaires suivant les caprices des puissants car, si les mœurs plus accommodantes sinon plus douces que la loi s’étaient accoutumées à une pensée plus libre, elles n’en étaient pas moins abusives dans leurs haines particulières. Des milliers d’écrits subversifs, imprimés à l’étranger, étaient répandus par les personnages les plus considérables de l’Etat. On ne cessait pas pour cela de brûler des ouvrages et d’emprisonner des auteurs, mais il n’y avait plus guère que des gens d’église pour requérir des jugements contre eux. Un Voltaire, un Diderot, un J.-J. Rousseau auraient été brûlés vifs au XVIe siècle. Au XVIIIe, on brûlait encore un chevalier de La Barre, mais on ne pouvait plus envoyer au bûcher des hommes d’une telle notoriété. L’Eglise ne put que se couvrir de honte et de ridicule par ses autodafés des Lettres philosophiques, de l’Emile et de cent autres écrits dont la condamnation revient comme un leit-motiv dans les gazettes du temps. Même lorsqu’elle l’emportait, son autorité en était atteinte. On le vit lorsqu’elle voulut, par exemple, faire condamner pour hérésie Marmontel, à propos d’un passage sur la tolérance dans son roman Bélisaire. L’affaire dura près de trois ans. Tous les rieurs furent avec Marmontel contre l’archevêque de Paris et la Sorbonne, et des vers comme ceux-ci coururent dans le public :
Quand, malgré la Sorbonne, il faisait aimer Dieu ? »
Marmontel se vengea de son censeur, l’abbé Riballier, qui prétendait avoir perdu la vue en travaillant à cette censure, par l’épigramme suivante à graver sur le collier du chien de l’abbé :
Ma décadence et ma misère ;
J’étais le chien de Bélisaire,
Je suis te chien de Riballier. »
Deux siècles plus tôt, Marmontel eût subi le sort d’Etienne Dolet. Les abus de la censure ecclésiastique étaient devenus d’un autre âge comme aujourd’hui ceux de la censure républicaine. La première s’est écroulée avec l’insanité aristocratique, la seconde s’écroulera avec l’insanité démocratique.
La Révolution Française proclama avec les Droits de l’homme que :
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » (Article 11 de la Constitution de 1791.)
Chacun imprima ce qu’il voulut durant la Révolution ; ce fut la « liberté sans rivages », mais cela ne dura pas. Dès que la classe bourgeoise put le faire, elle découvrit des rivages à la liberté de la presse et, le 27 germinal an IV, elle y planta la guillotine contre quiconque parlerait de changer le gouvernement. Le 19 fructidor an V, les journaux furent placés sous la surveillance de la police. Le 9 vendémiaire an VI, la loi du timbre fut établie pour les journaux politiques. Au nom des « droits de l’homme », on rétablissait ce qui avait été de « droit divin ». Napoléon Ier alla plus loin : il supprima radicalement toute liberté pour les discours et les écrits qui ne furent pas officiels. C’est ainsi que, sous son règne « libéral », on ne vit aucune condamnation de presse : elle n’existait plus ! Sous le Consulat, il avait fait réduire à treize le nombre des journaux, sous prétexte qu’ils étaient « des instruments dans les mains des ennemis de la République ». Le 28 septembre 1811, le Journal de l’Empire — l’Officiel de I’époque — publiait cet avis : « A compter du 1er octobre prochain, il ne paraîtra plus à Paris que quatre journaux quotidiens s’occupant de nouvelles politiques, savoir : le Moniteur, le Journal de l’Empire, la Gazette de France et le Journal de Paris ».
La Charte de 1814 dut reconnaître la liberté de la presse, mais le gouvernement de la Restauration chercha toujours à la restreindre jusqu’au jour où la presse eut raison du gouvernement en le renversant (juillet 1830). Les lois des 17 et 26 mai 1819 réalisèrent pour la première fois ce qu’on peut appeler une « législation de la presse » en ce que celle-ci ne fut pas soumise uniquement au « bon plaisir » du gouvernement. On s’efforça de définir et de classer ce qu’on appela les « délits de presse » en établissant, suivant leur gravité, une échelle de peines. On innova en matière de « diffamation » en prohibant la preuve des faits dits diffamatoires admise jusque là. La seule publicité des faits, qu’ils fussent vrais ou faux, suffit pour la condamnation du « diffamateur ». On dressa ainsi le fameux « mur de la vie privée » derrière lequel on peut être un coquin tout en faisant publiquement figure d’homme exemplaire. On admit cependant la preuve des faits quand il s’agirait d’un personnage investi d’une fonction publique. La loi du 26 mai 1819 rétablit la compétence du jury pour connaître des crimes et délits de presse, sauf de la diffamation. Une troisième loi, celle du 9 juin 1819, fixa les conditions de la publication. Il n’y eut plus d’autorisation à solliciter, mais seulement une déclaration à déposer en fournissant un cautionnement, en indiquant l’éditeur responsable et en payant le timbre. Ces lois ne tardèrent pas à paraître trop libérales au gouvernement. L’assassinat du duc de Berry, le 13 février 1820, fut le prétexte de la loi du 31 mars qui put faire suspendre tout journal pendant six mois. On revint ensuite à la demande d’autorisation pour les nouveaux journaux et tous furent soumis à la censure avant toute publication. La loi du 17 mars 1822 créa le délit de tendance qui livra la presse au pouvoir discrétionnaire des magistrats. P.-L. Courier, entre autres, fut victime de ce pouvoir. Ce régime dura jusqu’au 18 juillet 1828 où l’autorisation préalable fut supprimée et le cautionnement fut réduit. Mais Charles X voulut retourner au régime napoléonien. Son ordonnance du 25 juillet 1830 amena la Révolution trois jours après.
Etabli par une révolution faite au nom de la liberté de la presse, le gouvernement de Louis Philippe devait au moins se donner l’air de respecter cette liberté. La Charte de 1830 la reconnut ; elle confirma la compétence du jury et supprima la censure. Mais diverses lois secondaires servirent à grignoter sournoisement ce régime trop libéral. Les insurrections de Lyon et de Paris furent le prétexte de la loi du 9 septembre 1835, véritable « loi scélérate » qui demeura jusqu’à la fin du règne.
La Révolution de 1848 ramena, mais pas pour longtemps, la « liberté sans rivages ». Dès le 9 août 1848, le cautionnement et le timbre furent rétablis et la loi du 27 juillet 1849 remit presque entièrement en vigueur celle de 1835. Une autre, du 16 juillet 1850, vint compléter et imposa entre autres, aux écrivains de la presse périodique, l’obligation de signer leurs articles. Ces deux dernières lois tuèrent nombre de petits journaux, dont le Peuple constituant, de Lamennais.
On comprend que le 2 décembre 1851 fut fatal à la liberté de la presse comme aux autres libertés. Un premier décret, du 31 décembre 1851, enleva au jury la connaissance des délits de presse. Un autre, du 17 février 1852, mit les journaux à la merci du pouvoir par le rétablissement de l’autorisation préalable ; les taux du cautionnement et du timbre furent encore élevés et les écrits périodiques y furent astreints à leur tour. Après trois avertissements, sous des prétextes quelconques, un journal pouvait être supprimé. Les comptes rendus des débats parlementaires devaient être publiés intégralement, ce qui était impossible dans les journaux, ou réduits à l’impression du procès-verbal des séances. Les commentaires étaient interdits. Pour les débats judiciaires, interdiction absolue de rendre compte des procès de presse et faculté donnée aux présidents des tribunaux d’interdire les comptes rendus des procès ordinaires. C’était l’étranglement pur et simple de l’opinion. La loi du 2 juillet 1861 améliora à peine ce régime quant à la suspension et à la suppression des journaux. Les protestations devenant plus nombreuses et plus énergiques, on fit alors la loi du 11 mai 1868 supprimant l’autorisation préalable et remplaçant les avertissements, suspensions et suppressions par des jugements de tribunaux correctionnels auxquels les délits furent déférés. Les partis de gauche réclamèrent inutilement pour rendre la presse au jugement du jury. C’est la caractéristique des gouvernements de dictature ; ils veulent rester maîtres de l’opinion et, pour cela, il faut qu’ils soient soutenus par des magistrats serviles. Dans tous les procès de presse jugés alors par les tribunaux correctionnels « il fut impossible de découvrir un seul exemple d’acquittement. » (Larousse). Les législateurs républicains n’auraient qu’à reprendre cette loi de 1868 pour faire leurs « lois scélérates » de 1893 et 1894. Larousse a dit encore : « Telle fut, alors, l’ardeur des parquets à poursuivre la presse de l’opposition, que l’application de la loi de 1868 se traduisit dans les six premiers mois de sa promulgation par 121.919 francs d’amende et sept ans, six mois et vingt-et-un jours de prison. » Les parquets et les tribunaux républicains font mieux depuis 1893 ; il est vrai qu’en quarante ans ils ont eu plus de temps que ceux de l’Empire. C’est par des centaines d’années de prison et des millions de francs d’amendes que leur « ardeur » s’est manifestée contre tous les délits d’opinion et de presse. Dans la seule période du 1er janvier 1928 au 31 décembre 1931, 944 années de prison et 2 millions de francs d’amendes, qui représentent 15 millions et demi avec les frais, ont été appliqués en vertu des « lois scélérates ». (Humanité, 24 juin 1932).
Au 4 septembre 1870, la liberté de la presse fut rétablie, limitée par l’état de siège. La loi du 15 avril 1871 replaça la presse sous le régime de celle du 27 juillet 1849, sauf quelques détails. Enfin, la loi du 29 juillet 1881 constitua la charte la plus libérale que la presse eût connue en France, hors les périodes de « liberté sans rivages ». Mais, sans avoir été abrogée depuis, cette loi a été tellement corrigée par une vingtaine d’autres, notamment par les « lois scélérates » de 1893, 1894 et 1920, que la liberté de la presse est placée aujourd’hui sous un régime aussi hypocrite et aussi arbitraire que sous l’Empire. Et comme si la loi n’y suffisait pas, les « caprices » de la censure, le « bon plaisir » des préfets, le « pouvoir discrétionnaire » des magistrats ajoutent encore à cette hypocrisie et à cet arbitraire par des interdictions, des saisies et des arrestations préventives. On interdit, sans jugement, une scène de théâtre parce qu’elle est désagréable à une dame bien en cour. On fait saisir, sans jugement non plus, des livres, revues, journaux, parce qu’ils ne sont pas assez respectueux des ventres solaires du régime. On boycotte même officieusement dans les organisations de la librairie et de la presse où opèrent de répugnants cafards et des gens de basse police, les publications indépendantes qui osent attaquer les malfaiteurs publics. Un Ilya Ehrenbourg, condamné à Berlin pour propos irrespectueux sur M. Bata, empereur de la « godasse universelle », voit faire le silence en France sur ses livres par toute la « grande presse » et tous les « grands critiques ». Rabelais constatait de son temps qu’il « ne fallait pas toucher aux oiseaux sacrés ». Il ne faut pas davantage toucher aujourd’hui à la basse-cour souveraine, à ses dindons et à ses oies. La censure officielle, dont nous reparlerons au mot vandalisme est exercée avec une inconscience stupéfiante, dénotant une véritable absence de sens moral, par des « écrivains » qui se sentent très « honorés » de tenir un tel emploi !...
L’histoire des procès sous les différents régimes qui ont réglementé la liberté de la presse serait longue à raconter. Bornons-nous à en citer quelques-uns parmi les principaux ; ils ont été le plus souvent reliés à des procès politiques. C’est ainsi que celui de la « Conspiration des Egaux », en 1797, fut en même temps celui du Tribun du Peuple, le journal de Babeuf.
La grande époque des procès de presse, des plus retentissants, fut dans les premières années du règne de Louis Philippe. La Tribune, dirigée par Armand Marrast, mena contre lui une lutte très dure, aussi, en quatre ans, fut-elle poursuivie cent onze fois et vingt fois condamnée, accumulant 49 années de prison et 157.000 francs d’amendes. La Révolution, la Quotidienne, la Gazette de France furent aussi plusieurs fois poursuivies. Marrast fut personnellement condamné à six mois de prison et trois mille francs d’amende pour avoir dénoncé le scandale d’une fourniture de fusils auquel furent mêlés, avec un sieur Gisquet, M. Casimir Périer et le maréchal Soult. Cette condamnation de Marrast établissait le principe de l’impunité assurée aux « potdeviniers » et aux fonctionnaires pratiquant le péculat et la concussion, en assimilant à la diffamation les dénonciations publiques contre eux.
En 1832, en même temps que le procès contre la « Société des Amis du Peuple » dans lequel Raspail, Bonnias, Gervais, Thouret et Blanqui furent condamnés, on vit d’autres procès contre la Tribune, puis celui de la Caricature, de Philippon, qui valut à Daumier ses six premiers mois de prison pour son Gargantua, et celui de la Némésis, de Barthélémy. Ce fut à l’occasion de ces procès qu’Armand Carrel écrivit dans le National ce que Louis Blanc a appelé « une intrépide déclaration ». Il s’y déclarait prêt à résister par la force aux « sbires » de M. Périer qui viendraient l’arrêter pour délit de presse et il terminait ainsi :
« Que le ministère ose risquer cet enjeu, et peut-être il ne gagnera pas la partie. Le mandat de dépôt, sous le prétexte de flagrant délit, ne peut être décerné légalement contre les écrivains de la presse périodique ; et tout écrivain, pénétré de sa dignité de citoyen, opposera la loi à l’illégalité, et la force à la force. C’est un devoir : advienne que pourra. »
Le National fut saisi, mais on n’osa pas arrêter A. Carrel.
En 1833, la Tribune ayant accusé les députés dont les relations avec le caissier des fonds secrets étaient plus profitables qu’honorables, ce journal fut cité à la barre de la Chambre. Cavaignac et Marrast y firent le procès de la corruption parlementaire telle que le régime constitutionnel l’avait produite et qui avait fait, de toutes les Chambres qui s’étaient succédées, des « prostituées », dit Marrast. Bien entendu, il y eut condamnation. MM. les députés défendaient leur « honneur » bien qu’ils l’eussent si souvent compromis. Par 204 voix sur 304, le gérant de la Tribune fut condamné à trois ans de prison et dix mille francs d’amende. Or, sur les 204 « honnêtes » députés qui condamnèrent, il y avait 122 fonctionnaires qui recevaient des traitements pour des fonctions qu’ils ne remplissaient pas ; 26 autres tripotaient avec deux ministres associés de M. Decazes dans l’exploitation des forges de l’Aveyron !
La même année 1833 vit les procès du journal lyonnais La Glaneuse. Sa condamnation ne fut pas étrangère à l’agitation qui produisit l’insurrection de 1834. Les événements de Lyon eurent leurs échos à Paris où M. Thiers, ivre de sang, préparait le massacre de la rue Transnonain. La veille, il supprima brutalement la Tribune et Marrast dut s’enfuir pour échapper à un mandat d’arrêt.
Le procès des républicains, en avril 1835, devant la Chambre des pairs, fut précédé de celui du National dans lequel A. Carrel avait publié, le 10 décembre 1834, un article violent pour nier la compétence des pairs dans ce procès. Il avait écrit entre-autres :
« Non, aux yeux de l’éternelle justice, aux yeux de la postérité, au témoignage de leur propre conscience, les vieux sénateurs de Bonaparte, ses maréchaux tarés, les procureurs-généraux, les anoblis de la Restauration, ses trois ou quatre générations de ministres tombés sous la haine ou le mépris public et couverts de notre sang, tout cela rajeuni de quelques notabilités jetées là par la royauté du 7 août, à la condition de n’y jamais parler que pour approuver, tout cet ensemble de servilités d’origines si diverses n’est pas compétent à prononcer sur la culpabilité d’hommes accusés d’avoir voulu forcer les conséquences de la révolution de juillet... »
Contre le réquisitoire, Carrel avait écrit :
« On pense bien que nous ne pouvons pas laisser ce ramas d’hérésies constitutionnelles, de violations de tous les principes de droit criminel admis chez les peuples civilisés, ces sophismes niais, ces vieilleries de Justice prévôtale, ces âneries de Bridoison, conseiller de chambre étoilée, sans les accabler de l’inexprimable dégoût que tous les cœurs honnêtes, que tous les esprits éclaires, éprouveront à une telle lecture. Il n’est pas besoin d’indiquer l’objection de sens commun, de vérité, de pudeur, qui naît à chaque phrase de cette indigne rapsodie. »
M. de Ségur requit des poursuites. La pairie, « jugeant dans sa propre cause », condamna le gérant du journal, M. Rouen, à deux ans de prison et 10.000 francs d’amende. Il y a lieu de souligner à cette occasion l’animosité particulière de M. Thiers contre A. Carrel. Il alla jusqu’à chercher à le compromettre dans une affaire d’assassinat. Le renégat se vengeait ainsi de sa honte contre son ancien compagnon de lutte républicaine resté fidèle à son passé.
La Caricature, qui avait publié le dessin vengeur de Daumier, la rue Transnonain, et son épique autant que monstrueux Ventre législatif, fut tuée avec nombre d’autres par la « loi scélérate » de septembre 1835. Daumier marqua cette fin par un dessin caractéristique représentant trois morts de juillet 1830 soulevant la pierre de leur tombeau et disant :
« C’était vraiment pas la peine de nous faire tuer ! »
Cette période héroïque de la presse, suite des combats de 1830, finit à la mort d’A. Carrel, en 1836. La presse qui avait lutté énergiquement jusque-là parut écrasée par la loi de septembre. En fait, elle évoluait vers les délices publicitaires moins aventureuses que Girardin et Dutacq lui présentaient et qui allaient « changer en un trafic vulgaire ce qui était une magistrature, et presque un sacerdoce. » (Louis Blanc). La République de 1848 et le 2e Empire n’eurent pas ainsi de procès de presse marquants. Ils avaient d’ailleurs supprimé l’opposition républicaine. Les condamnations et les déportations de 1852 y avaient mis fin en personnifiant la démocratie dans l’homme qui la menait avec le sabre et la proscription, Quand l’opposition reprit des forces vers la fin de l’Empire, on vit le procès de la souscription Baudin en novembre 1868. Les journaux qui avaient ouvert la souscription, l’Avenir national, la Revue politique, le Réveil et l’Avenir furent poursuivis avec leurs rédacteurs Peyrat, Charles Quentin, Challemel-Lacour et Delescluze. C’est dans ce procès que Gambetta, défendant Delescluze prononça son virulent réquisitoire contre les hommes du 2 décembre « chargés de hontes et de crimes ».
Il y aurait à parler des procès de presse de la IIIe République. Ils se sont multipliés contre les journaux socialistes, syndicalistes, anarchistes et aujourd’hui communistes. Ils sont connus de nos contemporains qui n’oublient pas l’histoire. On vit encore s’exercer, jusqu’en 1914, le « libéralisme » de la loi de 1881 dans les procès de la Voix du Peuple, des Hommes du Jour, de la Guerre Sociale, du Libertaire et d’autres qui se déroulèrent en cour d’assises. Quand cette loi ne suffit plus à l’arbitraire gouvernemental, il usa, avec une violence toujours accrue, des « lois scélérates » dans les procès de presse. Les journaux socialistes et syndicalistes furent de plus en plus épargnés grâce à leur « collaborationnisme » succédant à leur opposition. Aujourd’hui, anarchistes et communistes, quoique se combattant âprement, sont égaux devant une répression qui feint hypocritement de les confondre et les frappe plus que jamais.
La liberté de la presse n’est toujours que la liberté d’écrire selon les vues du gouvernement, soit pour l’approuver, soit pour manifester une opposition courtoise qui ne le menace pas dans ses fondements. On est encore loin de la « liberté sans rivages » d’un régime vraiment républicain, On ne l’a connaîtra que lorsqu’on aura conquis toutes les libertés, car elles sont inséparables les unes des autres.
— Edouard ROTHEN.
PRÊTRE
n. m. (du grec : presbuteros, plus âgé)
En bref, s’appelle prêtre, tout ministre d’un culte religieux.
A part quelques groupes humains, à l’intellect trop rudimentaire, il n’est guère de peuple qui n’ait été la dupe du voyant, du faiseur de pluie, du sorcier, c’est-à-dire du prêtre. Au cours de l’évolution du sentiment religieux, le prêtre est apparu juste à point pour capter à son profit les croyances fétichistes du moment, en s’imposant comme le médium obligé entre l’homme et les puissances surnaturelles dont il est le jouet passif.
Partout, il s’est trouvé des hommes qui, par leur finesse, ont su en imposer à leurs semblables en mettant le pouvoir soi-disant supérieur de leurs fétiches au service de leurs amis, moyennant une rétribution déterminée. Habiles à interpréter les songes et les présages, les signes du temps et les oracles de tout genre, ils surent gagner la confiance de leurs compagnons en leur inspirant, même par leur état morbide, réel ou simulé, une crainte superstitieuse. Le pouvoir sacerdotal fut d’abord représenté par l’homme médecin. Le sorcier, c’est déjà le prêtre, car c’est parmi les sorciers que, demain, se recruteront les clergés. Le plus souvent c’est un fou que sa folie même sacre sorcier aux yeux de la tribu entière, car chez les sauvages, la condition principale pour devenir sorcier, c’est d’avoir reçu de la nature ou acquis par l’exercice, une santé suffisamment mauvaise pour être aux confins de la folie. L’épilepsie et la chorée suffisent chez nombre de peuples pour accéder à la dignité de sorcier. Les pratiques imposées chez les non-civilisés, pour être initié au métier transforment d’ailleurs très vite un homme normal en un demi-fou, victime d’hallucinations répétées, qui sont considérées comme la preuve du caractère sacré de l’individu atteint. L’ivresse provoquée, les jeûnes prolongés, l’absorption renouvelée de substances excitantes, de narcotiques divers, les bains de vapeur, les cris, les hurlements et les contorsions précédant les actes du ministère, amènent rapidement chez les sorciers et les apprentis-sorciers, de graves désordres cérébraux qui se traduisent par des crises d’épilepsie qui, pour les populations ignorantes, sont la preuve du pouvoir mystérieux de l’homme-médecin. C’est pourquoi dès le commencement ce sont surtout les fous et les idiots qui, au nom de la religion et en vertu de ses enseignements, exercèrent sur la partie de l’humanité saine et intelligente, la prépondérance empruntée à leur caractère sacré. Etat de chose qui resterait incompréhensible si la religion n’était elle-même tout à fait en dehors du domaine de l’intelligence sereine et entière.
Ce serait se tromper que de supposer que les premiers prêtres étaient des imposteurs. Le plus souvent, ils furent les premières dupes de leurs propres jongleries, car l’esprit humain possède des ressources inépuisables de crédulité. La sorcellerie et son corollaire la magie n’ont pas eu leurs origines dans la fraude et ont été rarement pratiquées comme pures impostures. Le sorcier apprend de bonne foi une profession qu’il croit digne de vénération, en ajoutant plus ou moins de foi à ce qu’elle enseigne ; dupe et fourbe en même temps, il associe l’énergie d’un croyant à la ruse d’un hypocrite, Nous pouvons en dire autant d’une bonne partie des prêtres modernes.
Cependant le prestige du sorcier ne s’imposa pas tout d’un coup à l’imagination des hommes. Il fallut un long temps avant de transformer les fétiches individuels en fétiches collectifs. Les hommes ne perdirent que peu à peu l’habitude d’avoir leur gris-gris et ne s’accoutumèrent que progressivement à recourir uniquement à celui du sorcier, dans toutes les occasions, pour lui demander aide et conseils.
Mais quand ils eurent pris l’habitude de s’adresser au sorcier et à ses fétiches ; la puissance de celui-ci grandit de plus en plus, jusqu’au jour où il put prendre en mains la direction du culte et devenir le gardien et l’instructeur des croyances religieuses. Alors, le sorcier sera non seulement l’être qui inflige et guérit les maladies, qui prédit les événements futurs, provoque à son gré la pluie, la grêle et la tempête, qui évoque les ombres des morts, se met en communication avec les esprits et les divinités, mais surtout l’être supérieur doué de facultés spéciales qui lui permettent de communiquer avec les dieux. Il sera l’intermédiaire obligé entre ce monde et l’autre ; la crainte et la vénération que les dieux inspirent rejailliront sur leurs ministres et se traduiront par des bénéfices et des immunités de toutes sortes. Investi d’un caractère sacré, participant quelque peu de la divinité, le sorcier a finalement, en apparaissant comme le seul détenteur de la vérité et comme ministre de la justice divine, conquis le pouvoir et avec lui la richesse. Ces avantages ont souvent excité la jalousie des puissants et dans beaucoup de sociétés, L’autorité civile ou militaire s’est arrogée le sacerdoce (voir ce mot).
Ce que nous venons de dire du sorcier est vrai du prêtre d’aujourd’hui. A quelque religion qu’il appartienne, le prêtre moderne, tout comme ses devanciers, interprète la volonté des êtres surnaturels, parle et commande au nom des dieux. Tout comme le sorcier péruvien, le prêtre chrétien — causons de lui principalement puisque nous le subissons plus particulièrement — consacre des pâtes et des liqueurs ; comme le mage Perse, il fait descendre la divinité sur l’autel et de plus l’offre à manger à ses fidèles ; tout comme le sorcier africain, il chasse les démons qui ont pris possession du corps humain : l’exorcisme a été d’une pratique courante dans le clergé catholique. Le prêtre, c’est l’homme qui croit et fait croire aux talismans, aux amulettes (scapulaires, chapelets, etc.), aux génuflexions, aux gestes sacrés. C’est l’être qui parle, enseigne, agit, condamne, absout, promet et surtout reçoit au nom de Dieu. Mais c’est principalement le conservateur et le parasite par excellence.
Conservateur, gardien farouche des erreurs du passé, des mensonges et des fausses notions morales si novices à l’humanité, le prêtre est l’homme qui a codifié et imposé les multiples « tabous » (voir ce mot), qui depuis toujours ont pesé sur l’activité de l’homme et l’ont paralysée si souvent. C’est lui qui jalousement maintient ce réseau d’interdictions nuisibles qui restreignent la liberté et la dignité de l’homme moderne et qui portent sur la nourriture, les jours ouvrables, l’activité sexuelle, le mariage, la maternité libre, l’éducation de la masse, la liberté d’aller et de venir, de faire et de ne pas faire, etc., etc. C’est lui qui, en sanctionnant de son autorité les « tabous » hérités d’une mentalité barbare, se fait le conservateur attitré des préjugés et des erreurs morales émasculatrices d’énergie. Il les enseigne à l’homme, en même temps que ces croyances archaïques dont la moindre est en contradiction flagrante avec la vérité scientifique. Fidèle à son rôle de conservateur à outrance, il attaque violemment les tendances, les découvertes, les opinions qui menacent à un degré quelconque l’intangibilité des dogmes et la perduration d’une autorité aussi exorbitante qu’elle est artificielle. Que l’on se rappelle, à ce sujet, l’Inquisition et les persécutions subies au cours des siècles par les penseurs indépendants.
Le prêtre est celui qui ne peut vivre que d’autrui et par autrui, c’est-à-dire en parasite. Il donne des paroles, des gestes, c’est-à-dire rien, et transforme ce rien en valeurs réelles : victuailles variées, vêtements somptueux, habitations confortables, honneurs, privilèges, revenus de tous genres, capitaux importants. Aussi rien ne lui coûte pour acquérir et conserver ces avantages. Il sait habilement en agitant juste à point le fantôme de son dieu et en imposant le tabou propice, exploiter les sentiments les plus bas des puissants comme les défaillances les plus tristes des faibles. A ceux-ci il sait persuader que l’ignorance, la crainte, la douleur sont autant de vertus qui assurent à ceux qui les possèdent la meilleure part des irréelles récompenses extra-terrestres. Il apporte à l’œuvre de domination des autres un concours assuré. En stimulant adroitement l’égoïsme, la rapacité des grands, il partagera avec eux les dépouilles prélevées sur la misère humaine, quand il n’aura su se les approprier tout entières. Il connaît l’art de se rendre, en toutes circonstances, indispensable aux uns et aux autres. Il impose aux faibles son appui et aux puissants son alliance, en réprimant, par son enseignement, tout sentiment de dignité et de révolte chez les prolétaires. Pour nous en convaincre, remémorons-nous les férocités de l’Inquisition, les ambitions théocratiques de la papauté (voir ce mot), les désordres amenés, tant au moyen âge qu’à l’époque moderne, par la rivalité et la rapacité des ordres religieux. Souvenons-nous de l’enseignement de l’obéissance passive, des subtilités morales qu’enseignent et pratiquent les Jésuites, de l’immoralité et de la nocivité de la confession, moyen efficace d’espionnage universel. Evoquons un instant l’ingérence constante du prêtre dans tous les actes de l’existence de l’homme qu’il prend au berceau pour mieux le dominer. Quand l’enfant naît, il est là pour l’incorporer de force dans son église, en lui imposant sa foi ; il dirige ensuite son éducation qu’il a soin de rendre aussi antiscientifique que possible ; à son mariage, il est présent aussi pour codifier et réglementer la vie conjugale et, à sa mort, on le retrouve encore veillant jalousement à ce que le moribond meure chrétiennement et prêt à recueillir, quand il y en a, pour lui et ses pareils, la majeure partie, sinon la totalité, de l’héritage. Dominé par l’instinct de conservation, voulant durer toujours, envers et contre tous, il enseigne partout que l’homme doit se résigner à la vie au lieu d’en jouir ; il prêche constamment qu’il vaut mieux se contenter de l’injustice que de lutter pour plus d’équité, s’agenouiller devant les idoles que de se révolter, échanger le présent et ses joies pour un mythique au-delà ; comprimer ses plus nobles aspirations, ses élans les plus productifs de bonheur, pour une résignation passive, une mortification perpétuelle. Si la science et les vertus incontestables de quelques-uns des ministres d’un culte, ancien ou moderne ont pu faire, çà et là, illusion sur l’utilité du prêtre, la nocivité d’une action générale et d’un enseignement anémiants et démoralisants demeure avérée. Quoique prétendent certains, le prêtre, de par ses dires et ses actes, n’a pas cessé d’être un véritable malfaiteur social. Parasite par excellence, son activité consiste avant tout à drainer à son profit personnel et à celui des œuvres d’obscurantisme dont il est l’agent actif et stylé, le meilleur des efforts du peuple. Et détruire son prestige et ruiner son influence, arracher à son emprise les esprits qu’il subjugue nous apparaît comme une des tâches primordiales de toute campagne de libération humaine.
— Ch. ALEXANDRE.
PRIÈRE
n. f.
La prière est une supplication adressée aux puissances extra-naturelles afin d’en obtenir une grâce ou pour les honorer.
Par son apparition dans le culte, la prière marque une évolution du sentiment religieux. Dans la période du fétichisme primitif, il n’existe ni temples, ni rites, ni prières. Le fétiche étant considéré comme un dieu portatif, un porte-bonheur, il suffit donc de l’avoir constamment avec soi pour être préservé des accidents et des contrariétés.
La divinité, quelque forme qu’elle prenne, est toujours la réalisation inconsciente des sentiments mêmes de l’homme, une projection spontanée de ses conceptions et de sa propre mentalité. On conçoit que la nature brutale du primitif, à peine accessible aux sentiments altruistes (compassion, reconnaissance, bienveillance, etc.), ne le porte guère à prêter aux dieux des sentiments qu’il ne possède pas lui-même. L’idée de prier les esprits, afin de les émouvoir et de les disposer favorablement, ne saurait donc, dans le principe, se présenter à lui. Il communique naturellement aux dieux l’égoïsme féroce que lui impose la lutte pour la vie et les terribles difficultés qu’il trouve à satisfaire ses besoins. Ce n’est que plus tard, beaucoup plus tard, quand il commence à s’humaniser, qu’il devient capable de comprendre que la prière, les offrandes, les génuflexions sont susceptibles d’avoir d’heureuses répercussions sur l’esprit du fétiche protecteur. Cette extension anthropomorphique de la conception religieuse coïncide avec l’apparition de l’idolâtrie. Le même enchaînement d’idées qui donne au fétiche l’apparence humaine conduit tout naturellement à lui prêter des sentiments humains. Du jour que les hommes ont cru pouvoir, par des prières, déterminer, chez leurs semblables, une modification avantageuse pour leurs désirs, il eût été étrange qu’ils n’eussent point usé de cette ressource à l’égard d’êtres qui leur apparaissaient comme plus ou moins semblables à eux-mêmes, sauf cette différence qu’ils les croyaient plus puissants et que, par conséquent, ils avaient d’autant plus intérêt à s’assurer leur bienveillance.
Aussi la prière, comme le sacrifice religieux (voir ce mot), a-t-elle toujours présenté deux caractères significatifs, caractères dont elle n’a jamais pu, quel que soit le degré d’évolution du sentiment religieux, se débarrasser.
D’abord, elle n’a jamais d’autre but que l’obtention d’un avantage matériel déterminé ; ensuite elle suppose que l’entité à laquelle elle s’adresse ne peut être sensible qu’à un intérêt du même genre. En conséquence elle s’accompagne généralement d’une offrande qui lui donne l’apparence d’un marché. Donnant, donnant ! C’est toujours le paiement anticipé d’une grâce ou d’une protection. C’est avant tout un échange proposé par l’homme à des puissances qu’il a douées d’appétit et de volonté, de sens et de raisonnement humain. L’homme ne traite pas d’égal à égal avec les dieux qu’il s’est donnés. En les créant, il s’est acquis des maîtres redoutables, le plus souvent malveillants et susceptibles, et qu’il est aisé d’offenser. Devant eux, il est comme le serf devant le baron féodal, comme le sujet devant le maître capricieux. Il ne doit pas seulement négocier les bienfaits qu’il implore, mais alléger le joug que la divinité fait peser sur lui. Il doit éloigner de lui et des siens les catastrophes suspendues sur sa tête : famines, maladies, fléaux divers, calamités, désastres publics et privés. De plus, il doit encore implorer la remise plus ou moins coûteuse des péchés commis. C’est pourquoi la prière restera toujours, même aux époques où la conception de la divinité se sera affinée, « spiritualisée », un marché, un contrat express ou sous-entendu. La prière implique la conviction que les dieux sont obligés par l’offrande des mortels. Humble « transaction » entre l’homme et la divinité, elle s’est élevée peu à peu au rang suprême, parce qu’elle engage les dieux. Prononcée à l’heure favorable, formulée selon les rites prescrits, elle évoque et maîtrise les dieux qui ne seraient pas sans elle. Le prêtre qui les dicte, s’est fait de sa puissance un monopole ; connaissant les formules sacrées et l’art de les appliquer, il s’empare ainsi de la direction du ciel et de la terre, il domine les dieux eux-mêmes, et parvient même, miracle inespéré ! à les incarner à son gré dans un fétiche solide ou liquide, en bois, en pierre, en métal ou en farine ! ! Il les gouverne donc à sa guise et peut parler sans crainte du moindre démenti, en leur nom ! A l’influence sacerdotale, à l’ignorance soigneusement entretenue et prolongée, l’expérience semble, hélas, apporter son vivant témoignage. La prière est presque toujours exaucée des dieux, car l’homme ne leur demande que ce qu’il veut et peut se procurer lui-même !
Quand l’événement espéré ne se produit pas, de deux choses l’une : ou bien le dieu est irrité ou mécontent, ou bien il manque quelque chose au mérite, à la pitié du croyant. Un échec répété ne nuit aucunement à l’efficacité de la prière, ce n’est qu’une invitation nouvelle à plus de ferveur, de piété agissante ! La prière s’avère donc tribut et rachat, hommage forcé autant que volontaire, moyen d’expiation et de rédemption ... Ajoutons que la prière répond, pour les faibles, à un besoin de s’appuyer sur autrui (à plus forte raison si on lui accorde des pouvoirs étendus, miraculeux) de faire appel à des interventions extérieures dans les heures de désarroi et d’angoisse d’abord, puis en face de menues difficultés et de mésaventures puériles.
Tous les peuples ont prié. De l’Orient à l’Occident, en Amérique comme en Océanie ; dans les solitudes glacées du Nord comme dans les plaines torrides de l’Equateur, les hommes ont adressé des hymnes, des supplications aux puissances extra-naturelles. En des termes sinon identiques du moins similaires, en de courtes oraisons ou de longs palabres, les peuples ont demandé ce dont ils ont besoin : beau temps, bonne chasse, santé, victoires sur les ennemis, longue vie et prospérité pour eux et leurs alliés. Mieux même, certains ont porté, cousues dans leurs vêtements ou dissimulées dans de petits sacs de cuir, des formules regardées comme les plus efficaces versets de la Bible, citations du Coran, etc. Rappelons les « moulins à prières » des bouddhistes, les gestes accompagnés de paroles machinales ou saugrenues ; les litanies murmurées par des milliers d’humains égrenant des chapelets, petites boules assemblées en colliers ; les incantations des sorciers, les oraisons toujours récitées au XXe siècle, grimoires qui guérissent les brûlures, le charbon, les chancres, arrêtent l’incendie et le mal de dents ! et nous aurons alors une idée plus nette de l’universalité de la prière.
Mais, à côté de ces suggestions mesquines de l’égoïsme, se situent des inspirations plus élevées et plus larges. A mesure que se formaient les conceptions de vertu, de probité, de justice, l’illusion religieuse s’en emparait pour en faire l’attribut des dieux. Ceux-ci devinrent les dispensateurs et les juges des instincts et des actes moraux, les arbitres des infractions aux lois qui règlent les heurts résultant de l’antagonisme des intérêts. C’est pourquoi l’homme finit par demander aux dieux des qualités morales autant que des biens physiques. Et le prêtre, affermissant encore sa puissance, suggéra aux foules que les dieux s’offensaient des crimes, des fautes commises sur la terre et qu’ils pouvaient, à leur gré, les absoudre ou les punir. Ainsi les dévots s’habituèrent à demander aux dieux et à leurs interprètes des absolutions complètes qui leur permirent de recommencer indéfiniment les mêmes actes répréhensibles, ceux-ci étant assurés d’une rémission plus ou moins onéreuse. L’introduction dans la prière, des scrupules moraux et du repentir a plus contribué à l’asservissement des foules, à la puissance sacerdotale, qu’au perfectionnement des croyants.
La prière conserve toujours la faveur des masses, parce qu’elle est avant tout la résultante dune croyance invétérée à la puissance du hasard. La généralité des hommes est convaincue qu’il existe dans l’enchaînement rigoureux des phénomènes de la nature, un certain flottement, un je ne sais quoi qui permet d’échapper, dans une certaine mesure, à l’ordre des choses. Et pourtant la conception de la divinité s’oppose à la puissance de la prière. Toute oraison échoue devant un dieu omniscient, infaillible et immuable. Dès le principe, Dieu a tout ordonné, tout prévu. L’induire à changer, c’est l’outrager, car que penser d’un infaillible qui se dément ? Comment accorder sa suprême justice, son infinie bonté avec une partialité passagère ? Et que penser d’un être qui, vivant sur une des plus infimes planètes d’un univers gigantesque, peuplé de milliards de mondes, implore une divinité définie comme un cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part ? Comment se reconnaît ce dieu, parmi la clameur sans fin, les désirs contradictoires et opposés des 1.800 millions d’hommes parlant plusieurs milliers de langues ou idiomes différents ?
La prière, tard venue dans l’arsenal des conceptions mythiques, est une arme d’une efficacité surprenante entre les mains des clergés. C’est un appel renouvelé à la résignation passive, une bastille de l’initiative et de l’activité. Puisqu’il suffit de marmotter quelques paroles pour changer du destin les décrets imminents, pourquoi s’évertuer à faire preuve d’énergie et de volonté ? De plus, puisque la prière du simple croyant a déjà tant de vertu, car elle suffit souvent à déterminer chez les dieux un changement favorable à l’intéressé, quelle ne doit pas en être sa puissance quand elle passe par la bouche du prêtre ! De là, à remettre la direction de tous les actes de la vie entre les mains du prêtre, il n’y a qu’un pas qui est vite franchi (voir prêtre).
Et si la raison humaine ne s’était révoltée à temps, faisant crouler les théologies, en se rangeant du côté de la science, nous risquerions beaucoup de n’être plus que des caricatures d’hommes ne sachant plus que réciter des oremus et balbutier des pâtenôtres du lever au coucher du soleil, pour le plus grand profit des « majordomes du ciel ! ».
— Ch. ALEXANDRE.
BIBLIOGRAPHIE. — Lefebvre : La religion. — Le Clément de Saint-Marcq : Histoire générale des religions. — Véron : Histoire naturelle des religions. — Salomon Reinach : Orphéus. — Tylor : Civilisations primitives, etc.
PRIMAIRE
Adjectif qui vient de primus et de primarius (le premier dans le temps, dans le lieu). Il indique ce qui est au commencement, au premier degré. (Terrain primaire, enseignement primaire, etc.)
Nous ne nous occuperons de ce mot qu’au sens figuré qui en a fait un substantif pour dire d’un individu : « C’est un primaire ». Son usage est récent ; il est ignoré des dictionnaires. Il s’est établi dans les mêmes circonstances et le même milieu de sottise nationaliste que celui du mot « intellectuel », employé comme terme de mépris ironique contre les professeurs et écrivains « dreyfusards ». Si « intellectuel » est périmé, dans ce sens péjoratif, depuis « l’affaire », « primaire » est devenu d’emploi courant, entretenu par le snobisme de « gendelettres » pour la plupart illettrés, mais dont la vanité primaire s’exerce dans un pédantisme de façade, en admiration devant les porteurs de reliques universitaires qui « pensent bien » et dont la situation est plus souvent le résultat de l’intrigue et de l’esbroufe que du savoir.
Car le savant, celui qui sait véritablement, est modeste. Il n’étale pas sa science à la foire aux vanités. Il sait surtout qu’il a encore plus à apprendre qu’il n’a appris et, devant la qualité et les moyens de ceux qui parviennent, devant leur bourdonnante affectation, il se dit, autant pour ne pas être ridicule que pour conserver sa propre estime, le mot d’Elisée Reclus : « Gardons-nous de réussir ! » Mais le pédant s’estime trop pour ne pas se croire au-dessus du ridicule, car il sait tout, il connaît tout. Volontiers, il déclarerait que le monde a tout appris par lui et n’aura plus rien à apprendre après lui. Il est l’alpha et l’omega, le commencement et la fin, comme Dieu le Père ; mais pas plus que lui il ne compte ses sottises qu’il déifie en multipliant son besoin de paraître. Il regarde du haut de ses échasses quiconque n’est pas trois fois docteur, grand-maître ès-sciences et ès-arts ; il méprise le « primaire » qui n’est rien, ou si peu de chose, « pas même académicien », et dont les médiocres diplômes, quand il en a, ne font jamais qu’un parent pauvre dans l’illustrissime famille des dindons savantissimes et doctorissimes.
Le « primaire » c’est l’aliboron dont se gaussait feu M. Barrès, et dont s’égaient toujours les héritiers de son narcissisme d’esthète poseur et de politicien roublard. C’est l’autodidacte instruit à l’abri de la férule universitaire, ignoré de ses palmarès, dont l’indépendance indigne la confrérie des bonnets carrés ou pointus, s’il ne s’abaisse pas à solliciter leur sympathie par des platitudes. Car, s’il n’y va plus de sa vie, comme pour un Galilée obligé, afin d’échapper au bûcher, de déclarer que la Terre était immobile, il y va toujours de sa tranquillité et de sa réputation. Ce « primaire » pourra posséder à lui seul plus de science et de talent que tous les Trissotins académiques réunis ; il pourra être un de ces génies qui, en vingt ans, font parcourir au savoir humain plus de chemin que les milliers de ses professionnels diplômés ne lui en ont fait faire en vingt siècles ; il sera toujours un suspect, un indésirable dans la République des roussins d’Arcadie qui remâchent le chardon sacré. Quand il sera mort, les roussins se vêtiront de sa peau pour se donner l’air du lion et mépriser les « primaires » avec plus de superbe.
Est-il nécessaire de dire que le mépris du « primaire » est d’origine essentiellement aristocratique et réactionnaire ? II est, transporté sur le plan intellectuel, ce qu’est le mépris du roturier sur le plan social. Mais il n’y a pas toujours concordance entre les deux ; il y a souvent contradiction, l’aristocratie n’ayant pas plus l’exclusivité de l’intelligence que la roture n’a celle de la sottise, et la distinction entre aristocratie et roture étant une des pires sottises de ceux qui prétendent à l’aristocratie. Ce n’est pas la contradiction la moins bouffonne de la prétendue élite aristocratique que d’appeler « primaire » le novateur scientifique, le pionnier social qui cherche à faire avancer le monde hors des voies de la tradition routinière où elle veut le maintenir, car, sans ce novateur, ce pionnier, la civilisation serait depuis longtemps enfouie, comme les ruines des Babylone et des Ninive, sous les sables de l’oubli. Il y a une forme de gâtime totalement opposée à toute manifestation supérieure de l’esprit dans la prétention de ramener l’humanité à des temps comme ceux de Charlemagne, voire des Pharaons, et une ironie dont les anthropopithèques attelés à cette besogne ne se rendent certainement pas compte lorsqu’ils appellent « primaires » ceux qui s’y opposent. Or, ces fossiles ont le mépris du « primaire » social comme ils ont celui du « primaire » universitaire et du « primaire » politique.
Le mépris du « primaire » est d’autant plus absolu pour l’aristocrate que, politiquement, ce « primaire » ne peut être à ses yeux qu’un homme de « gauche ». On voudra bien reconnaître en lui, le cas échéant, une neutralité politique qui n’en fera plus qu’un « demiprimaire ». Tels furent, pour les Doumic de leur temps, les Balzac, Stendhal, Flaubert, Baudelaire, et nombre d’autres indépendants de l’académisme. Mais les Vallès, Zola, Mirbeau, portèrent le double anathème comme « primaires » académiques et politiques ; des badernes, tel M. F. Masson, des rinceurs de bidets armoriés, tel M. P. Bourget, des bedeaux, tel M. Bazin, des fumistes, tel M. Barrès, donnèrent contre eux le grotesque spectacle de leur mépris au nom de l’intelligence souveraine. Actuellement, M. F. Brunot, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres et professeur d’Histoire de la Langue française, ayant présenté des Observations irrévérencieuses sur une Grammaire que l’Académie Française a mis trois cents ans à enfanter, les « pets de loup » de la compagnie n’ont pas osé le traiter de « primaire » ; mais l’élégant M. Abel Hermant, qui joue les Pétrone sous le manteau quelque peu rongé des mites de Lancelot, l’a délibérément taxé de « cuistrerie » pour lui apprendre qu’un professeur n’a pas de leçons à donner aux « gens de qualité », quand ils daignent, pour un moment, s’occuper de la langue française. Car les « gens de qualité », même à l’Académie française, savent tout, sans avoir rien appris, par cette faveur héréditaire qui les faisait, jadis, rois, barons, colonels, quand ils venaient au monde, avant d’avoir mouillé leur première braguette. Ils sont ainsi à l’inverse des « primaires » qui ne savent rien, même en ayant beaucoup appris. Cet avantage, essentiellement aristocratique, crée pour les « gens de qualité », c’est-à-dire les gens de « droite », un privilège d’intelligence qui rend adorable chez eux tout ce qui est méprisable chez les autres. C’est ainsi qu’il ne peut pas y avoir de « primaires » de « droite ». Par contre, un roturier, un homme de « gauche », fût-il un Pasteur, un Curie, un Edison, est incontestablement un « primaire » malgré son savoir, sa naissance n’ayant pas été marquée par le miracle aristocratique. Il demeurera un « primaire » tant qu’il n’aura pas reçu le signe de la grâce qui en fera un homme de « droite ». Sottise, ignorance, malhonnêteté, mensonge, grossièreté, ne peuvent être que de « gauche », comme barbarie ne peut être qu’allemande. Intelligence, savoir, honnêteté, vérité, délicatesse, ne peuvent être que de « droite », comme gentillesse ne peut être que française.
Si un malheureux Bourneville s’avise de commettre un jour ce tripatouillage ridicule :
pourvu que L’ON lui prête vie... »
immédiatement, tous les cuistres d’académie, tous les bedeaux de sacristie, tous les jésuites de presse, tous les politiciens de la « droite » parlementaire, jettent feu et flamme contre ce « primaire », ce « vandale », ce « dépeceur de chefs-d’œuvre », ce « salisseur de la beauté », etc. Mais qu’un nommé Hervo se permette d’ « adapter spécialement », à l’usage des séminaires, les Plaideurs, de Racine, et en fasse une tartufiante mélasse, les mêmes cuistres, bedeaux, jésuites et politiciens de cette « droite » qui fit marcher les naïfs « primaires », en 1914, pour « la défense de Racine » (sic), lui donnent leur patronage, leur publicité et leurs encouragements, tenant Racine lui-même pour un « primaire », puisqu’il s’est mis dans le cas de se faire tripatouiller pour ne pas troubler les chastes méditations des puceaux de séminaire. Les disciples de M. Barrès, à qui on doit toujours revenir quand on requiert des exemples d’imbécillité supérieure et de tartuferie souveraine, sont dans un état de gaieté délirante lorsqu’ils réussissent à faire marcher un « primaire » parlementaire, de « gauche » bien entendu, pour la libération du noble peuple des Poldèves, habitants de la Lune ; mais ils rentrent dans les profondeurs les plus hermétiques de leur confusion lorsqu’on rappelle que leur « Maître », affamé de publicité comme le plus « primaire » des politiciens, se laissa prendre à célébrer « l’illustre » Hégésippe Simon que de joyeux lurons révélèrent à la poésie française pour mystifier le niguedouille académique et national. Un homme de « droite » peut-il être mystifié, étant un « couillon » supérieur, ou un « coïon », comme écrivent ces Messieurs de l’Académie Française qui s’y connaissent particulièrement ?
Mais voici que M. Pierre Lasserre, peu suspect, croyons-nous, de ce que nous appellerons le « primariat », aux yeux des « gens de qualité » et de « droite », a bouleversé sans aucun égard la conception aristocratique, mais trop primaire du « primaire », en situant sa véritable position universitaire et politique, dans deux articles des Nouvelles Littéraires (30 novembre 1920 et 4 janvier 1930). Il l’a d’abord défini ainsi :
« Un « primaire », c’est un livresque et un dogmatique. C’est un esprit qui a vieilli, sans dépasser, en son développement, le stade scolaire. C’est un adulte resté écolier, mais sans la fraîcheur, qui ne fait pas la différence entre les questions réelles que la vie nous donne à résoudre et les questions conventionnelles, artificiellement simplifiées, qui font l’objet des travaux de collège. »
M. Lasserre a ensuite démontré que ce « primaire » est aussi bien de « droite » que de « gauche », chez ceux dont l’esprit de parti l’emporte sur une science mal digérée ou dont la malhonnêteté intellectuelle et morale est incompatible avec le respect de la vérité. Le « primaire », a déclaré M. Lasserre, « peu pourvu de cet esprit de finesse qui fait pressentir la complexité des choses, assimile naïvement les cas concrets aux cas abstraits ». Il arrive à voir la solution de toute chose dans certains principes absolus. C’est ainsi qu’il forme, à « gauche », le troupeau des Homais « qui, comme on dit, font « dater la France de 1789 » et saluent dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen l’avènement de la vérité politique absolue ». Mais le « primaire » est aussi à « droite », dit M. Lasserre, chez celui qui voit dans les maximes des Homais « l’erreur politique absolue », les considère « comme un poison que la France s’est mis, voici déjà cent quarante ans, dans les veines », et veut « détruire méthodiquement et pièce à pièce l’œuvre de 1789 ». La haine et le mépris aristocratiques du présent sont autant des sentiments de « primaire » que la haine et le mépris démocratique du passé. Le « primaire » est « l’homme pressé qui court aux formules » ; il est celui qui a gardé l’habitude de penser que « la vie se laisse régler, bien ou mal, mais docilement, par des dogmes », et comme il y a les formules et les dogmes de « droite » et de « gauche », il y a les « primaires » de « droite » et de « gauche ». Si évidentes que soient ces choses pour tout esprit clair et indépendant, il était nécessaire qu’elles fussent précisées, et il est nécessaire qu’elles soient répétées, tant les notions les plus simples de l’intelligence et du savoir ont été bouleversées et faussées par les abstracteurs de quintessence et les alchimistes sociaux.
Non moins utilement, M. Lasserre, passant de la politique à la philosophie, a encore montré les « primaires » du néo-thomisme actuel, essentiellement de « droite », à l’origine tout au moins. Car ce néo-thomisme fait de plus en plus, parmi les « primaires » de « gauche », de singuliers progrès, grâce au ramollissement de leur « tripe laïque » par l’eau bénite où ils la trempent. Si les « primaires » de « gauche » ne virent, jadis, dans le thomisme, que la manifestation d’une époque de mort où ils englobèrent tout le moyen âge avec ses grandeurs comme avec ses hontes, ils voient de plus en plus, aujourd’hui, dans le néo-thomisme auquel ils s’adaptent opportunément, la planche de salut de leur muflisme menacé par la justice sociale. La conclusion de M. Lasserre est que « l’esprit primaire, qu’il soit de gauche ou de droite, est le fils dégénéré, pauvre et plat, de l’esprit apocalyptique ».
La question du « primariat » est ainsi honnêtement fixée mais elle ne l’est pas complètement. Il reste à juger, en dehors de la politique et de la philosophie, l’attitude de l’individu échappé au « primariat » scolaire devant « les questions réelles que la vie nous donne à résoudre », à l’opposé des « questions conventionnelles » de collège. Le « primaire » est alors intéressant à observer comme type social. Il se dresse audessus de toutes les haines de partis, des braiements des porteurs de reliques, des fureurs des carnassiers dévorateurs de la substance humaine. Il est l’homme anti-conformiste dévoué à la liberté de l’esprit et à la révolte consciente, l’homme de la guerre à l’oppression, de la protestation contre le mensonge et l’iniquité, contre l’imposture et le crime, contre toutes les falsifications, si souveraines et si sacrées qu’elles soient devenues par les traditions et les usages de la vie sociale. Et, bien loin de s’affliger de la qualification de « primaire ». quand on la lui donne, cet homme la revendique, au contraire, comme un honneur de la part de ceux qui ne reconnaissent d’autre supériorité que la sottise d’un monde où tout ce qui pourrait faire la vie utile et belle pour tous les hommes est transformé en turpitudes accablantes.
Cette qualité de « primaire », il l’accepte avec l’orgueil de se voir écarté et méprisé par « l’élite » de sac et de corde, de brutes et de queues-rouges, de catins et de valets, de malfaiteurs et de proxénètes qui font l’ornement civique, intellectuel et moral de ce monde. Ce « primaire », tenu socialement comme « espèce inférieure », est fier de porter la tête haute et d’avoir les mains nettes parmi tant d’espèces supérieures aplaties et rampantes, souillées de sportule, de boue et de sang. Le « primariat » est la légion d’honneur de ceux dont la conscience n’est pas à vendre. Si le « primaire » a la tristesse de voir se manifester contre lui la haine des imbéciles — ils ne savent ce qu’ils font ! — il est heureux de soulever celle des coquins ; elle le soulage, l’encourage, l’exalte. Elle lui donne ses diplômes, ses titres, ses décorations. Les crachats de cette haine sont des étoiles sur sa poitrine comme sur la face du Christ aux Outrages, et ses compissements sont, sur son front, l’eau lustrale du plus merveilleux baptême.
Aussi, en dehors de toutes les distinctions universitaires et politiques, le « primaire » est-il, avant tout, par dessus tout, indiscutablement et intégralement, le PAUVRE. C’est le « névrosé » de Lumbroso, qui porte dans son organisme l’incapacité morbide de s’enrichir. C’est le loup affamé à qui les chiens de l’Ordre donnent la chasse. C’est le « vagabond », comme disent la loi et les gendarmes, le « bandit », comme éructe farouchement le bourgeois ému pourtant quand :
C’est celui qui « trouble la fête » rien que par la vue de sa silhouette miteuse à travers une glace de restaurant, et qui sème la terreur dans une société dont il atteste, par sa seule présence, l’indiscutable infamie. C’est celui qui ne sait pas, ou ne veut pas, s’adapter au muflisme, faire un « babbitt » ou un « gangster », collaborer avec la triple pègre aristocratique, démocratique et ochlocratique dans le « resquillage » social. C’est celui qui, par impuissance ou volontairement, demeure le « cochon de payant », la « poire », le « gogo », le « cavé », devant la f1ibusterie érigée en système universel. C’est celui qui conserve quelque politesse, quelque aménité dans les rapports humains, qui voit chez les hommes autre chose que des concurrents qu’il « faut avoir », chez les femmes autre chose que des « poules », dans la nature autre chose que des animaux et des objets à abattre, à exploiter, à vendre et à acheter.
« Primaire » est celui qui ne sait pas, ou ne veut pas convenir que « sans argent l’on n’est rien, avec de l’argent on est tout », et que « c’est l’argent qui fait l’homme », comme déjà le proclamait la démocratie athénienne qui tuait Socrate, poussait Démosthène au suicide et voyait dans les Coty de son temps des « amis du peuple » ! Le banquier Paul Laffitte, disciple de Guizot, qui disait à ses amis : « Enrichissez-vous ! » avait observé que :
« Un idiot pauvre est un idiot ; un idiot riche est un riche. »
Il avait vérifié que si l’argent ne rendait pas l’idiot intelligent, il ne lui fournissait pas moins le moyen d’imposer son idiotie au pauvre. Celui-ci reste un « primaire » qui ne veut pas s’enrichir, par scrupule, parce que la fortune ne vient jamais sans quelque chose de pas très propre fait à propos. Il est un malfaiteur dangereux, plus subversif de l’ordre social que tous les iconoclastes, les hérétiques, les révolutionnaires, car il insulte la plus souveraine des puissances, celle qui est au-dessus des dieux, puisqu’elle les fabrique à son gré : la phynance, sans laquelle Dieu lui-même, l’Unique avec une majuscule, n’existerait pas, sauf pour le « primaire » qui porte son Dieu dans son âme et non dans son portefeuille.
Aucun « primaire » ne fut plus voué aux gémonies que Proudhon quand il dit, et démontra d’ailleurs irréfutablement, que « la propriété c’est le vol ». On le lui fit bien voir, et il le voit toujours, bien qu’il soit mort et qu’une certaine « élite », non « primaire », prétende lui rendre hommage.
Il écrivait :
« Eh bien ! oui, je suis pauvre, fils de pauvre, j’ai passé ma vie avec des pauvres et selon toute apparence je mourrai pauvre. Que voulez-vous ! je ne demanderais pas mieux que de m’enrichir ; je crois que la richesse est bonne de sa nature et qu’elle sied à tout le monde, même au philosophe. Mais je suis difficile sur les moyens, et ceux dont j’aimerais à me servir ne sont pas à ma portée. Puis, ce n’est rien pour moi de faire fortune tant qu’il existe des pauvres... Quiconque est pauvre est de ma famille... De toute cette misère, je n’eusse dit jamais rien, si l’on ne m’eût fait une espèce de crime d’avoir rompu mon ban d’indigence et de m’être permis de raisonner sur les principes de la richesse et les lois de sa distribution. »
Il disait aussi :
« Pour se tirer d’affaires dans le monde actuel, il faut certains talents et certaines complaisances que je n’ai pas. »
Paul de Koch raisonnait en « primaire » quand il disait : « Il n’y a que les imbéciles que la fortune peut changer. » Il ne savait pas qu’en régime de muflisme la fortune rend intelligents les imbéciles alors que la pauvreté rend imbéciles les intelligents.
« Primaire » était Boileau disant aux poètes :
Ne soit jamais l’objet d’un illustre écrivain. »
« Primaire » était Stendhal quand il disait :
« L’homme d’esprit doit s’appliquer à acquérir ce qui lui est strictement nécessaire pour ne dépendre de personne — (ce nécessaire, pour Stendhal, était 6.000 francs de revenu annuel) — mais si, cette sécurité obtenue, il perd son temps à augmenter sa fortune, c’est un misérable. » Baudelaire n’était pas moins « primaire » en commentant ainsi l’opinion de Stendhal : « Recherche du nécessaire, et mépris du superflu, c’est une conduite d’homme sage et de stoïcien. »
M. A. Suarès a été un « primaire » doublé d’un blasphémateur quand il a écrit :
« Un des mensonges les plus corrupteurs, entre ceux qui font lupus sur l’âme moderne, consiste à donner pour de grands esprits ces faiseurs d’argent qui pullulent partout, qui fondent d’énormes fortunes dans tous les désordres publics, qui finissent en prison quand ils n’ont pas eu assez de bonheur, et au prytanée de l’admiration générale, quand ils réussissent. Il n’y a que le succès entre Rochette et Rockefeller... Il faut une merveilleuse bassesse pour qu’on les appelle « grands capitaines d’industrie » et qu’on les admire (les hommes d’argent). Leur habileté tient par toutes sortes de moyens et de pratiques à celle des voleurs. Il y a de l’ignoble dans tout ce qu’ils font, dans tout ce qu’ils sont, et dans tout ce qu’ils disent comme dans leur figure. Ces museaux vous ont un air respectable et cynique, où se composent les forces inégales du bagnard, du clergyman et du prêteur romain. »
« Primaire » est celui qui se fie aux apparences, aux paroles, aux promesses. Il est comme l’animal confiant à qui des coups sont nécessaires pour apprendre à se méfier.
« Primaire » est celui qui s’étonne que le commandement : « Tu ne tueras point ! » veuille dire : « Tu tueras patriotiquement ! », que le crime heureux soit juste et que la friponnerie devienne une vertu quand elle est pratiquée dans le grand.
« Primaire » est celui qui ne comprend pas que les bonnes œuvres ne comptent point sans la grâce, et qu’il y a plus de place au ciel pour un Cartouche dévot que pour un Socrate. (Voltaire.)
« Primaire » est celui qui croit que « les hommes sont égaux par l’âme (Renan), qui « veut organiser la conscience dans la démocratie » (Pressensé), et pense qu’il peut être un gouvernement incitant les hommes à autre chose qu’à monter de la pègre d’en bas à celle d’en haut.
« Primaire » est celui qui recherche dans l’art la nature et l’humanité et ne sait pas, comme les « intelligents critiques », trouver du génie dans l’insanité.
« Primaire » était Rabelais disant que « science sans conscience est la perte de l’âme », et « primaires » sont les savants qui représentent le savoir et le travail intellectuel parmi le peuple et non parmi le snobisme académique.
« Primaires » sont les peuples primitifs qui n’ont pas inventé le canon, les gaz asphyxiants, la conscription, le suffrage universel, le sex-appeal, et pour qui Mme Baker est une vulgaire négresse.
On n’en finirait pas d’énumérer les exemples du « primariat ». Il est innombrable, comme le muflisme dont il est la contrepartie, car, socialement, sont des « primaires » tous ceux qui ne sont pas des mufles, ne cherchent pas à arriver, à paraître par de vilains moyens. Il peut se faire qu’un « primaire », universitaire ou politique, soit un mufle ; il est aussi impossible à un « mufle » d’être un « primaire » social qu’à un riche d’entrer dans le royaume des cieux. Maxime Gorki, un « primaire » lui aussi, a posé aux « maîtres de la culture » cette question :
« Avec qui êtes-vous ? Avec la force laborieuse de la culture pour créer de nouvelles formes de vie, ou contre cette force pour maintenir la caste de rapaces irresponsables, caste à la tête pourrie, qui ne continue plus à agir que poussée par la force d’inertie ? »
Les « maîtres de la culture » risquent de se laisser mourir, comme l’âne de Buridan, parce qu’ils ne voudront pas choisir par affectation aristocratique. Pour nous, « primaires », notre choix est tout fait ; nous sommes avec la force laborieuse de la culture créatrice de nouvelles formes de vie, contre la caste des rapaces, contre la caste à la tête pourrie.
— EDOUARD ROTHEN.
PRIMITIF
adj.
Qui est à l’origine. Mot primitif : qui a donné naissance à des mots dérivés. Langue primitive : qui aurait été formée la première (mais y a-t-il eu une langue primitive ?) Ignorance toute primitive : qui a la simplicité des premiers âges. (Larousse) Couleurs primitives (en peinture) : qui, par leurs combinaisons, peuvent produire les autres couleurs (rouge, jaune, bleu, blanc et noir) ; (en physique) couleurs du spectre solaire : violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé, rouge. Terrains primitifs (géologie) : les plus anciens qui soient accessibles à notre investigation. « Le terrain primitif est privé de fossiles, mais il est « très difficile de le distinguer de certaines formations sédimentaires que le métamorphisme a rendues cristallines et chez lesquelles il a détruit les fossiles. Le terrain primitif paraît devoir être représenté par le gneiss et le micaschiste et par quelques autres roches cristallophyl1iennes. » (Ency.)
Nom m. Les primitifs, artistes, peintres et sculpteurs, qui ont précédé les grands maîtres. La primitive Eglise : celle des premiers siècles du christianisme (voir ces mots). Nom ancien des Quakers qui prétendaient faire revivre cette Eglise primitive. Les primitifs (ethnolog.) : peuples qui sont encore au degré le plus bas de la civilisation. Homme primitif : ancêtre qui est à l’origine de l’Humanité.
Les recherches sur l’homme primitif ont porté un coup mortel au dogme de la création. L’origine de l’homme (voir ce mot), remonte, non à 6.000 ans environ, comme l’indiqueraient les évaluations fantaisistes de la Bible, mais à plusieurs centaines de mille, sinon à des millions d’années. L’homme fossile a vécu à l’époque quaternaire. Il a été prouvé, par de multiples découvertes, que l’homme a été le contemporain, en notre pays, du Mammouth et du Renne. La science officielle a longtemps raillé Boucher de Perthes avant de s’incliner devant les preuves indiscutables qu’il apportait. Selon l’opinion de certains auteurs il ne serait pas impossible même que l’homme ait vécu à l’époque tertiaire (périodes pliocène). La découverte de silex ouvragés et d’ossements d’animaux entaillés rencontrés dans des gisements très anciens en seraient une preuve (mais non décisive). D’après l’examen des squelettes et surtout des crânes (race de Néanderthal) l’homme primitif était d’une extraordinaire bestialité et d’une robusticité très grande. Crâne très aplati, front fuyant, arcades sourcilières volumineuses, région occipitale projetée et en arrière, marche légèrement fléchie sur les jambes, etc., tous caractères qui placent l’Ancêtre entre le Singe et l’Homme actuel. (Pithécanthrope). Puis, les races se sont mélangées, de nouvelles ont surgi et l’homme, peu à peu, par son intelligence, est sorti de l’animalité primitive. A l’âge de la pierre (période quaternaire et début de la période actuelle) « nos ancêtres en sont arrivés à un degré de civilisation qui ne permet plus de les considérer comme des primitifs ». (Histoire des Peuples, Maxime PetitLarousse, édit.).
L’Homme subit autant l’influence du passé que celle du milieu dans lequel il vit. C’est pour cela que dans la mentalité des hommes d’aujourd’hui on constate, en maintes occasions, la survivance de la mentalité primitive. Le vernis de la « civilisation » — très superficiel — laisse apparaître les rudes instincts de l’Anthropoïde, et tel acte qui peut sembler grossier, « immoral », hors-nature, n’est que la répétition de milliards d’actes semblables commis dans les temps reculés.
— Ch. B.
PRINCIPE
(n. m. du latin principium, origine, commencement)
Les sens de ce mot sont nombreux. Il est parfois synonyme de source première, de raison d’être. On l’applique aux éléments constitutifs des corps. Il convient aux règles de la morale, de la science, de l’art. Une sèche énumération des principes secondaires qui dirigent l’activité humaine, dans les multiples domaines où elle s’exerce, serait fastidieuse. Elle serait, en outre, bien difficile à établir, les principes ne cessant de varier avec l’état de nos connaissances. Nous parlerons seulement des suprêmes règles auxquelles toute pensée logique obéit et dont l’ensemble constitue la raison.
Nos opérations intellectuelles ne s’accomplissent pas au hasard, elles sont régies par certaines lois très générales et d’une évidence immédiate qu’on appelle les principes directeurs de la connaissance. Ossature profonde et intime de l’esprit, c’est eux qui nous permettent d’organiser l’expérience, d’établir des rapports nécessaires entre les choses et les idées. Mais la conscience, interrogée à leur sujet, reste muette ; nous les découvrons grâce seulement à l’analyse des opérations psychologiques, en particulier du raisonnement. « Les principes généraux, constatait déjà Leibniz, entrent dans nos pensées dont ils font l’âme et la liaison. Ils y sont nécessaires comme les muscles et les tendons le sont pour marcher, quoiqu’on n’y pense point. L’esprit s’appuie sur ces principes à tous moments, mais il ne vient pas si aisément à les démêler et à se les représenter distinctement et séparément, parce que cela demande une grande attention à ce qu’il fait, et la plupart des gens peu accoutumés à méditer n’en ont guère. » Ajoutons que ces principes ne sont pas immuables. C’est l’opinion de Levy-Bruhl, qui attribue aux primitifs une mentalité prélogique et mystique, dominée, non par le besoin de rester d’accord avec ellemême, d’éviter la contradiction, mais par la loi de participation. « Dans les représentations collectives de la mentalité primitive, écrit Levy-Bruhl, les objets, les êtres, les phénomènes peuvent être, d’une façon incompréhensible pour nous, à la fois eux-mêmes et autre chose qu’eux-mêmes D’une façon non moins incompréhensible, ils émettent et ils reçoivent des forces, des vertus, des qualités, des actions mystiques, qui se font sentir hors d’eux, sans cesser d’être où elles sont. » Les représentations collectives exercent une profonde action sur le primitif ; il éprouve un attachement mystique pour son groupe et pour son totem. C’est par des causes surnaturelles qu’il explique tous les phénomènes ; aux données immédiates de la perception, il ajoute des pouvoirs occultes, des forces invisibles, des réalités impalpables ; entre l’au-delà et le monde sensible, il ne distingue pas. Un homme meurt-il, fut-ce de vieillesse ou par accident, il suppose que l’événement est dû à un sorcier ou à l’esprit d’un mort ; le maléfice lui semble évident, même si la mort est provoquée par la chute d’un arbre ou d’un objet inanimé. « Des préliaisons, qui n’ont pas moins de force que notre besoin de relier tout phénomène à ses causes, établissent, pour la mentalité primitive, sans hésitation possible, le passage immédiat de telle perception sensible à telle force invisible. Pour mieux dire, ce n’est pas même un passage. Ce terme convient pour nos opérations discursives ; il n’exprime pas exactement le mode d’activité de la mentalité primitive, qui ressemblerait plutôt à une appréhension directe ou à une intuition. Au moment même où il perçoit ce qui est donné à ses sens, le primitif se représente la force mystique qui se manifeste ainsi. Cette sorte d’intuition donne une foi entière en la présence et en l’action des forces invisibles et inaccessibles aux sens, et cette certitude égale, si elle ne la dépasse pas, celle des sens eux-mêmes. » S’ils admettent des rapports de cause à effet, les primitifs se les représentent donc autrement que nous. Mais, grâce à une épuration progressive, les deux grands principes qui dominent la pensée scientifique actuelle, le principe d’identité et le principe de causalité, furent mis finalement en pleine lumière. Chez les anciens et même chez quelques modernes, la notion d’identité garde un sens réaliste et substantiel. Pour eux l’essence des choses correspond à l’idée qu’en possède l’esprit : raisonnements, démonstrations portent, non sur des connaissances relatives, mais sur les choses elles-mêmes, identifiées avec leurs représentations. Immuables comme leurs concepts, les choses restent éternellement conformes à ce qu’elles sont. Changement, devenir s’avèrent simple apparence sensible, vaine illusion. Si un liquide se solidifie, c’est qu’une essence nouvelle a pris la place de l’ancienne. D’où les innombrables entités que l’on retrouve encore dans la physique du moyen âge : elle réduit la nature à une collection de substances. A l’inverse, la science moderne a vidé de tout sens réaliste le principe d’identité ; elle n’accorde aucune place à la notion de substance ; ses démonstrations reposent sur un principe purement logique, privé de tout contenu imaginatif. Les relations d’identité, établies entre les divers phénomènes, portent sur les connaissances de notre esprit, non sur les choses elles-mêmes. Par ailleurs le concept de causalité s’est transformé profondément ; peu à peu, il a perdu son caractère subjectif et anthropomorphique pour aboutir à l’idée d’un rapport constant. Loin d’être le résultat d’une vue intuitive, un don gratuit de la nature, la croyance en une loi d’universelle causalité fut une acquisition tardive, le fruit d’une laborieuse conquête de l’esprit. Elle reste encore ignorée de la grande majorité des hommes : à preuve l’importance que gardent, même chez les peuples civilisés, les notions de miracle et de hasard. « Le miracle, écrit Th. Ribot, en prenant ce mot non au sens restreint, religieux, mais dans son acception étymologique (mirari), est un événement rare, imprévu, qui se produit en dehors ou à l’encontre du cours ordinaire des choses. Le miracle ne nie pas la cause, au sens populaire, puisqu’il suppose un antécédent : la divinité, une puissance inconnue. Il la nie au sens scientifique, puisqu’il admet une dérogation au déterminisme des phénomènes. Le miracle, c’est la cause sans loi. Or, pendant bien longtemps, nulle croyance n’a semblé plus naturelle. Dans le monde physique, l’apparition d’une comète, les éclipses et bien d’autres choses étaient considérées comme des prodiges et des présages ; beaucoup de peuples sont encore imbus d’imaginations bizarres à ce sujet (c’est un monstre qui veut avaler le soleil ou la lune, etc.) et même, parmi les civilisés, il y a des gens que ces phénomènes ne laissent pas sans inquiétude. Dans le monde de la vie, cette croyance a été bien plus tenace : des esprits éclairés au XVIIe siècle admettaient encore les errores ou lusus naturae, considéraient la naissance des monstres comme d’un mauvais augure, etc. Dans le monde de la psychologie, c’est bien pis. Sans parler des préjugés si répandus dans l’antiquité (et qui n’ont pas disparu) sur les rêves prophétiques, présages de l’avenir, du mystère dont on a entouré si longtemps le somnambulisme naturel ou provoqué et les états analogues, des spéculations contemporaines sur l’occultisme, de ceux qui considèrent la liberté comme un commencement absolu, etc. ; il y a, même dans le cercle restreint de la psychologie scientifique, si peu de rapports de cause à effet bien déterminés, que les partisans de la contingence s’y trouvent à l’aise pour tout supposer. » Le hasard n’est pas invoqué moins souvent que le miracle et, pour ceux qui ne réfléchissent pas, il suppose une entité mystérieuse, impénétrable, ou se ramène à un événement sans cause ni loi. De cette notion du hasard, je crois avoir donné une analyse plus complète et plus poussée que celle de Cournot et de ceux qui l’ont suivi, dans Vouloir et Destin. Aucun des faits attribués à cette occulte et redoutable puissance n’échappe à la loi d’universelle causalité. Notre ignorance des antécédents, leur complexité, la tangence de phénomènes qui, primitivement, ne semblaient point destinés à se rencontrer, voilà la triple source d’où ils proviennent. Si étranges que paraissent certaines coïncidences, le passage d’un homme par exemple au moment précis où un mur s’écroule, elles seraient prévisibles pour qui connaîtrait avec exactitude les forces en présence, leur valeur et leur direction. La collision d’autos, que les conducteurs ne soupçonnent pas prochaine, un observateur la prévoit d’un lieu suffisamment élevé. Les idées de miracle et de hasard écartées, il importe d’éliminer aussi du rapport causal toute notion de fin, de direction intentionnelle. Pour les philosophes grecs, la nature possède des aspirations, des désirs aveugles qu’elle veut réaliser ; d’où la notion de cause finale, reste indéniable de l’anthropomorphisme primitif. A l’univers ils prêtent des intentions, un but comme à un vivant. Mais les découvertes scientifiques des XVIe et XVIIe siècles conduisirent à ne plus tenir compte de la finalité, « cette vierge stérile », selon le mot de Bacon ; la matière inorganique fut conçue comme déterminée et de nature strictement mécanique. Beaucoup, néanmoins, continuèrent de croire que si la matière est inerte en elle-même et dépourvue d’intentions, elle est mue, du dehors, par une intelligence supérieure : Dieu, qui lui impose un but et des lois. Avec des variantes, cette doctrine resta celle des philosophes spiritualistes du XIXe siècle. Lachelier a même voulu faire du principe de finalité le vrai fondement de l’induction scientifique. D’après lui, les rapports de causalité, dont les savants se contentent, s’arrêteraient à la surface des choses, sans rendre compte de l’extrême complexité des lois naturelles. Actions et réactions des forces cachées sont trop nombreuses et trop profondes pour être saisies même par la plus subtile des intelligences. En vertu du principe du déterminisme, nous ne pourrions formuler que des lois hypothétiques, ne sachant pas si se réaliseront de nouveau les conditions requises pour que les phénomènes observés se reproduisent. Or nous énonçons des lois catégoriques ; ce qui démontrerait notre croyance en un principe d’ordre au sein des choses, en un but grâce auquel les phénomènes naturels se groupent et présentent constamment des successions identiques :
« L’accord réciproque (éléments constants et uniformes) de toutes les parties de la nature ne peut, affirme Lachelier, résulter que de leur dépendance respective à l’égard du tout ; il faut donc que, dans la nature, l’idée du tout ait précédé et déterminé l’existence des parties ; il faut, en un mot, que la nature soit soumise à la loi des causes finales. »
Mais les efforts des spiritualistes n’ont pu empêcher la ruine du principe de finalité ; aucun penseur impartial n’admet aujourd’hui qu’il s’applique au monde de la matière inanimée, et, même dans le domaine restreint de la vie, il appert qu’il est inutile et dangereux. Selon l’expression d’Hamelin, la finalité serait une « détermination par l’avenir » ; or, l’avenir, qui n’est pas encore, ne saurait manifestement agir. On a été jusqu’à prétendre que, si le melon avait des côtes, c’était par un providentiel dessein de Dieu, afin qu’on puisse le manger en famille. Et certains continuent d’affirmer que tout, dans la nature, même les astres les plus lointains, furent créés pour l’homme. Vaniteuses prétentions que la science infirme depuis longtemps ! La finalité n’a d’existence que chez les êtres doués d’un rudiment au moins de vie psychologique. Chez l’homme, elle devient la causalité de l’idée ; chez l’animal, elle n’est d’ordinaire que la causalité du besoin. D’après Goblot, elle serait mise en évidence « quand il est établi que le besoin d’un avantage détermine une série d’effets tendant à réaliser cet avantage ». Le même auteur admet l’existence d’une finalité sans intelligence, conciliable avec une nature rigoureusement dominée par des lois inflexibles, et complètement aveugle. Quoi qu’il en soit, la finalité des anciens, définitivement éliminée par la science, a cessé d’être un principe pour les penseurs contemporains.
Après rejet des vieilles notions de substance et de finalité, nous restons en présence de deux principes très généraux et vraiment constitutifs de la raison : le principe d’identité et le principe du déterminisme, magnifique et suprême formule de la loi de causalité. Au premier se rattachent le principe de contradiction, simple expression négative de la loi d’identité, et le principe du tiers exclu, conséquence directe de la même loi. Base fondamentale de la logique formelle et des mathématiques, le principe d’identité légitime le raisonnement déductif. Le principe du déterminisme représente le terme ultime de l’évolution subie par l’idée de cause : il affirme la stabilité, la permanence du rapport qui unit l’antécédent au conséquent. Sur lui s’appuie l’induction scientifique ; il est la clef de voûte de nos connaissances expérimentales ; sa disparition entraînerait la ruine de toutes les lois naturelles, découvertes dans le monde de la vie aussi bien que dans celui de la matière inerte. Ces principes apparaissent, du point de vue psychologique, comme des instincts très profonds ou des habitudes mentales indéfectibles, contractées grâce aux millénaires expériences de l’humanité et sans cesse fortifiées par les progrès de la science. « Nos adaptations les plus nouvelles et les plus hardies ellesmêmes, écrit Ruyssen, ne réussissent qu’autant qu’elles répètent pour une large part des adaptations antérieures, des habitudes... Et l’on pourrait définir le principe d’identité, l’habitude de fonder toute pensée sur une habitude, l’habitude même de l’habitude... C’est encore en vertu d’une habitude que, dans la succession des phénomènes, notre attention se porte, de préférence, sur certains phénomènes et prépare la voie à la perception claire des suivantes, ou même à des adaptations prévoyantes, utiles entre toutes... En d’autres termes, les affirmations que l’on ramène communément au principe de raison suffisante (ou de causalité) n’énoncent rien de plus que des dispositions acquises qui nous portent à accueillir, autant que possible les expériences futures avec les mêmes modes d’attention et les mêmes gestes que les expériences passées. » Durkheim et ses disciples veulent expliquer ces habitudes par des facteurs d’ordre sociologique. Ils prétendent que la raison est un simple produit de la vie sociale et religieuse, et que les principes qui la constituent se ramènent à des règles collectives dépassant la mentalité des individus. Exagérations manifestes, nées du désir d’accroître démesurément l’importance de la société. C’est de la structure de notre cerveau, de notre organisation nerveuse et mentale que les grands principes de la connaissance dépendent en dernier ressort. La vie sociale présuppose des dispositions individuelles qu’elle développe seulement. Quant à la valeur de ces lois rationnelles, certes elle est relative ; mais en sa faveur plaident tout le passé de l’univers et tous les faits que l’expérience nous offre actuel1ement. C’est une preuve d’importance capitale, on en conviendra ; surtout si l’on songe que les doctrines, qui dénient à ces lois toute vraie valeur, apparaissent comme absolument arbitraires et sans appui dans le réel.
— L. BARBEDETTE.
PRINCIPE
n. m.
Le principe est une proposition qui sert de fondement à d’autres. Le principe tient, à l’origine, au début d’un acte, d’un fait ; il est la première cause, la raison, la base, la source. Par extension, on donne quelquefois le nom de principe à l’opinion, ce qui revient à dire que ces principes ne sont pas immuables ni guère scientifiques. Comme le principe signifie, au propre, la source, l’origine, il s’ensuit que, lorsqu’il ne s’agit pas d’une cause, il n’y a principe qu’au figuré.
Selon le sens d’une proposition, le principe signifie le commencement, représente le point de départ d’un raisonnement, d’une règle de conduite, comme il peut signifier ce qui n’a pas de source, de commencement.
Une expression qui a des valeurs si différentes, si opposées même, ne peut qu’embrouiller les questions qu’elle devrait aider à faire résoudre. A cet effet, Cicéron dit que : le principe est ce qui n’a pas d’origine, car c’est du principe que tout vient, et le principe, lui, ne saurait venir de nulle autre chose...
Si on donne au mot principe le sens figuré, on ne trouve de concevables, comme tels, que la force et la sensibilité ; le principe de mouvement et le principe de la connaissance. M. L. De Potter dira : les deux seuls ordres de faits, dont nous nous rendons compte, ne peuvent dériver d’ailleurs.
La première connaissance qu’acquiert la sensibilité est celle de la force qui la modifie, celle du mouvement, de la matière. Il lui reste à déterminer si elle est, elle-même, un résultat de ce que cette connaissance lui a servi à constater, ou si, indispensable à cette constatation, elle est antérieure à son objet. Au premier cas, la force existe seule ; au second, il y a de plus la sensibilité qui parvient à la conscience d’elle-même et établit, par la perception de modifications diverses, sa réalité immuable qui représente le principe.
A un moment où il n’y a plus de foi, encore pas de certitude du fait, que la vérité d’aucun principe ne peut être démontrée et pratiquée socialement, rien de plus incohérent que la question de principe. Aussi, malgré ou avec les prétendues lumières de l’époque, toutes les questions morales et sociales se réduisent à des questions d’ordre public, de nécessité temporaire, et les questions de principe ne comptent guère.
— Elie SOUBEYRAN.
A PRIORI
(locution latine signifiant de ce qui précède)
Cette expression est d’un usage courant dans le langage philosophique et scientifique ; elle s’applique aux pures créations de l’intelligence qui ne s’appuient sur aucun fait positif. Inversement, on déclare a posteriori (d’après les conséquences), raisonnements et systèmes basés sur la réalité observable. En effet, deux méthodes opposées s’offrent à l’esprit. Ou bien l’on part d’un principe posé d’avance, pour en tirer les conséquences et en prévoir les répercussions dans le monde expérimental ; ou bien des phénomènes particuliers l’on s’élève aux causes qui les engendrent, aux lois qui les gouvernent. La première méthode est a priori, la seconde a posteriori. Séduisante et facile d’aspect, la méthode a priori n’est pas soumise aux lenteurs de l’observation et de l’expérimentation ; elle assure plus d’unité et d’harmonie aux systèmes qu’elle élabore. Mais, réduite à elle-même, elle ne donne que des résultats hypothétiques, des constructions sans solidité. Avant de s’élever aux vues générales, aux formules d’ensemble, il importe d’examiner avec attention les faits particuliers. Dans sa recherche des causes et des lois, l’esprit doit s’appuyer, pour prendre son essor, sur le terrain solide de l’expérience. La méthode a priori trouvera sa place légitime, quand les principes seront bien établis. Alors seulement elle permettra d’aboutir à des conséquences d’une certitude absolue. En mathématique, la méthode a priori ou déductive est devenue essentielle de bonne heure, parce que cette science ne requiert qu’un nombre très limité de principes fort simples, et qu’elle entreprend de construire un monde abstrait, non d’expliquer le monde réel. Dans les sciences expérimentales, physique, biologie, psychologie, sociologie, histoire, qui se proposent de nous faire connaître l’univers tel qu’il est, la méthode a posteriori ou inductive s’avère d’une importance primordiale au contraire ; la déduction intervient seulement lorsque ces sciences, déjà très évoluées, peuvent exprimer leurs lois en langage mathématique. (Voir les articles Mathématiques et Physique.) Nombre de philosophes ont utilisé la méthode a priori pour édifier leur système. Ce fut le cas de Spinoza, de Fichte, de Hegel et de bien d’autres. Le premier procéda même à la façon des mathématiciens par axiomes, définitions, corollaires, etc. ; sa doctrine reste le type par excellence des métaphysiques déductives. La connaissance expérimentale n’a d’autre raison de nous intéresser, d’après Spinoza, que son utilité pratique ; c’est grâce à la déduction seulement que nous trouvons une vérité indépendante des hasards qui déterminent l’existence des objets. Erreur et vérité résultent d’un certain rapport entre les idées, nullement de la non constatation ou de la constatation d’un fait. Le concept de sphère, obtenu en faisant tourner un demicercle autour de son diamètre, est vrai ; pourtant, dans la nature, aucune sphère n’a été formée de la sorte et aucune n’est parfaitement conforme à la figure conçue par notre esprit. Une déduction, plus ou moins correcte, voilà ce qui sépare l’idée vraie de l’idée fausse. Si je déclare qu’un homme est brusquement transformé en rocher, je suis en présence d’une idée fausse, d’une fiction, non parce qu’expérimentalement je n’ai jamais rien constaté de pareil, mais parce que je n’arrive pas à me représenter réellement qu’un homme soit transformé en rocher. Je pense à un homme, puis à un rocher ; je ne vois pas comment l’événement s’accomplit. C’est de la manière dont on le pense que résulte la vérité d’un concept. Pour avancer sans crainte d’erreur dans la connaissance des choses un peu compliquées, il faut procéder comme le géomètre. La déduction correcte nous montrera comment telle chose est engendrée par une autre, qui l’est elle-même par une troisième et ainsi de suite. Mais comme il n’est pas possible de remonter indéfiniment de cause en cause, l’on aboutit à une vérité première, qui rend possible la déduction. Une connaissance intuitive et immédiate de chaque essence déterminée, voilà ce qui intervient constamment. L’erreur résulte de ce que nous avons des idées incomplètes ; le faux n’implique en soi rien de positif ; il n’est tel que pour nous et discursivement. En fait, Spinoza nous a donné une métaphysique, admirable de force déductive et de rigueur logique, mais dont la base fragile ne résiste pas à un sérieux examen.
C’est a priori que procèdent aussi, dans l’ensemble, les théoriciens de la politique. Ils posent d’abord une fin suprême, très variable selon les idées de l’auteur : intérêt national, triomphe de l’élite ou du prolétariat, égalité, justice, etc. Puis de l’idéal admis, ils tirent déductivement les règles concernant le travail, la propriété, le commerce, etc. Platon situe la fin de la société dans la vertu ; et, comme il n’y a de vertu solide que dans et par la philosophie, il importe, pour juger une collectivité, de savoir si la philosophie y règne ou non. Et, puisque la vertu consiste essentiellement dans l’unité, la cité idéale dont il rêve devra être une. En conséquence il condamne la propriété individuelle et l’esprit de famille ; il réclame la communauté des femmes et des enfants. Mais Platon ignore complètement la tolérance et ne prend aucun souci de la liberté individuelle. Il livre les citoyens pieds et poings liés à l’Etat, dont il fait une personne, un organisme ayant une tête, un cœur, un estomac. Thomas Morus, à l’époque de la Renaissance, rappelle Platon et se montre même plus hardi sur quelques points. Bien que de tendance sensualiste et matérialiste en philosophie, Hobbes utilise la méthode a priori en politique. Il part de l’idée que l’état de nature est l’état de guerre de chacun contre tous, que l’homme est un loup pour l’homme et conclut à la nécessité d’un gouvernement très fort, d’un monarque absolu qui dispose souverainement de la pensée et de la vie de ses sujets. Rousseau estime, au contraire, que les hommes naissent bons. Il veut « trouver une forme d’association, affirme-t-il, qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s’unissant à tous, n’obéisse pourtant qu’à luimême et reste aussi libre qu’auparavant ». De déductions en déductions, le philosophe de Genève arrive à préconiser la république comme le seul gouvernement légitime et naturel. Le système des petits Etats confédérés lui semble particulièrement favorable à la liberté. De Maistre raisonne déductivement ; et A. Comte opère de même en politique, bien qu’il s’imagine faussement faire œuvre positive. A notre époque, des penseurs d’opinions très opposées : un Maurras à droite, de nombreux socialistes à gauche, restent dans le domaine de l’a priori. Ils s’indignent, pourtant, lorsqu’on les qualifie d’idéologues, et se proclament hautement des réalistes, soucieux avant tout des leçons de l’histoire et des possibilités sociales. C’est en partant des aspirations de l’individu pour la richesse, et de la concurrence qui s’établit entre les égoïsmes individuels, que les économistes libéraux ont construit leurs systèmes. Karl Marx, reconnaissons-le, a eu le souci d’analyser les faits sociaux et de donner une base expérimentale à sa doctrine ; mais ses conclusions se perdent dans les nuages d’une idéologie qui n’a plus rien de scientifique.
Dans l’antiquité, Aristote voulait déjà procéder inductivement et faire œuvre de naturaliste en politique ; chez les modernes, beaucoup sont animés des mêmes intentions. Mais ceux qui ont le culte de l’Etat, qui respectent par principe l’autorité, ne garderont jamais, dans les recherches sociologiques, l’impartialité requise par le véritable esprit positif. Ils seront toujours victimes de leurs idées préconçues, comme on le constate chez Durkheim et ses élèves. Parce qu’il écarte toute considération d’opportunisme, rejette toute autorité autre que celle de la raison appuyée sur l’expérience et se déclare pour une critique intégrale ne respectant aucun tabou, l’anarchisme permettra de dégager inductivement des principes que la déduction utilisera ensuite pratiquement. Mais il faut qu’il adopte des méthodes vraiment scientifiques.
— L. BARBEDETTE.
PRISE (AU TAS)
n. f.
Cette expression, « la prise au tas », appartient au vocabulaire révolutionnaire et, plus particulièrement, anarchiste. Il faut entendre par là l’action de puiser librement, en dehors de toute réglementation, dans l’ensemble des produits obtenus par le travail de tous. C’est la faculté laissée à chacun de se procurer tout ce dont il a besoin, sans qu’il en soit matériellement empêché par autre chose que par l’absence ou l’insuffisance des ressources et produits qu’il désire. C’est, pour tout dire, la consommation libre.
Ainsi conçue et appliquée, la prise au tas présuppose nécessairement l’abolition du régime capitaliste et autoritaire et l’instauration effective du communisme libertaire. Elle ne peut trouver place que dans un milieu social débarrassé de l’Etat, de ses institutions et de ses survivances. S’il est vrai que, dans un tel milieu social, les exigences de la consommation seront appelées à déterminer et orienter l’effort de la production, il est également vrai que les exigences de la consommation auront pour limite les possibilités de la production ; et c’est en fin de compte — la production étant portée au maximum — la somme des produits obtenus qui fixera le caractère de la consommation.
La consommation, sous régime libertaire, ne peut être que limitée ou libre, et c’est la somme des produits obtenus, par rapport au chiffre de la population consommatrice, qui servira à déterminer le caractère de la consommation : rationnement ou prise au tas.
Exemples : les produits alimentaires sont-ils tous en quantité insuffisante ? Comparée aux besoins de la population, la somme de chacune de ces denrées alimentaires est-elle déficitaire ? Dans ce cas, le rationnement s’impose sur l’ensemble de ces denrées et sur chacune d’elles.
Y a-t-il insuffisance sur quelques-unes seulement de ces denrées, par exemple : le lait, la volaille, le poisson, les œufs, tandis qu’il y a surabondance sur les autres produits : pain, vin, viande de boucherie, légumes, fruits, etc. ? Dans ce cas, le rationnement joue sur les denrées en insuffisance et les autres : celles qui sont en excédent, bénéficient du régime dit de « la prise au tas ».
Il est à prévoir que, au début du régime communiste libertaire, le rationnement existera sur la totalité ou la presque totalité des produits : alimentation, logement, vêtement, mobilier, outils, machines, etc. Mais il sera facile d’accroître la production et de la régulariser. Allant au plus pressé, c’est-à-dire compte tenu des besoins les plus essentiels et de l’urgence à les satisfaire, les efforts de la production se porteront tout d’abord sur les produits de première nécessité. Quand l’équilibre sera réalisé entre les exigences de la consommation et les possibilités de production sur ces produits de toute urgence et de nécessité primordiale, les efforts de la production se porteront sur les produits d’une nature moins indispensable ou moins urgente, jusqu’à ce que, de progrès en progrès, la production générale, déficitaire d’abord, suffisante ensuite, finisse par devenir surabondante.
Chaque pas en avant dans ce sens éliminera le nombre des produits à consommation limitée, et il n’est pas chimérique de prévoir qu’un moment viendra où le régime de la consommation libre dit de « la prise au tas » s’appliquera : 1° au nécessaire ; 2° à l’utile ; 3° au confortable.
Ce système de « la prise au tas » laissant à chacun la faculté de prendre librement et sans restriction ce qu’il veut, tout ce qu’il veut et autant qu’il veut, choqua si fortement les idées et les habitudes ayant cours à notre époque (il est tellement en contradiction avec la mentalité actuelle et les règles présentement établies), que je crois devoir entrer dans le détail et fournir aux lecteurs de cet ouvrage des explications de nature à les renseigner et des précisions capables de les convaincre
Nous allons supposer une ville d’environ cent mille habitants. Ce n’est pas une de ces cités qui comptent une population considérable. Ce n’est pas non plus une localité dont la population se chiffre par quelques milliers de personnes. Je prends un centre moyen, une commune tenant le milieu entre la grande et la petite ville. Mes précisions s’appliqueront ensuite avec plus de simplicité à une agglomération plus importante ou à une population moins élevée.
Cette ville de cent mille habitants est divisée en dix secteurs, chacun d’eux comprenant, en moyenne, une dizaine de milliers de personnes. Dans chacun de ces dix secteurs se trouvent divers entrepôts dans lesquels sont centralisées les fournitures nécessaires à la satisfaction des besoins de ces dix mille personnes. Chacun de ces entrepôts a une destination spéciale : dans celui-ci, l’alimentation ; dans celui-là, le vêtement ; dans ce troisième, le mobilier et les articles de ménage, et ainsi de suite.
Nous voilà dans le pavillon de l’alimentation. Très spacieux, très clair, excessivement propre, ce pavillon est séparé en deux parties. Dans l’une, tout ce que chacun peut prendre et emporter librement, c’est « la prise au tas ». Dans l’autre, les diverses denrées dont la répartition ne se fait que limitée et contrôlée, c’est le rationnement. Des affiches bien en vue indiquent la quantité de chaque produit attribuée, ce jour-là, à chaque habitant, et des personnes de l’un et l’autre sexes, placées derrière un comptoir qui court le long de chaque étalage procèdent à la répartition et prennent note des quantités distribuées. Auprès de moi se trouve un jeune homme pour qui ce spectacle est tout nouveau. Il me questionne et je lui réponds :
MOI. — Ce qui t’étonne, c’est que, de ce côté-ci, les comptoirs soient à l’abandon et que chacun s’y serve soi-même et sans aucun contrôle ; tandis que, de ce côté-là, on soit servi et rationné.
LUI. — Oui ; explique-moi ça.
— C’est bien simple : il y a des denrées qui sont en abondance ; celles-là, on laisse à chacun le soin d’en prendre autant qu’il lui plaît. Mais il y a des denrées qui sont en insuffisance ; et celles-ci, il faut que chacun en ait la part qui lui revient.
— Mais comment sait-on d’avance que tel produit est en excédent et tel autre en déficit ?
— Tu vas comprendre ; ce pavillon d’alimentation dessert les habitants d’un secteur qui comprend environ dix mille personnes. C’est ici, pas ailleurs, que sont déposés les produits destinés à l’alimentation de ces dix mille personnes, et que celles-ci viennent s’approvisionner. Il n’est pas difficile d’évaluer à peu de chose près ce que cette population, composée de tant de vieillards, tant d’adultes et tant d’enfants, peut consommer en pain, viande, légumes, beurre, lait, vin, bière, huile, sucre, café, fromage, salade, fruits, épicerie, pâtisserie, etc. Il n’est pas plus difficile de savoir de quelle quantité on peut disposer de pain, de viande, de légumes, etc. Y a-t-il du pain plus qu’il n’en faut ? C’est la prise au tas. Y a-t-il du café moins qu’il n’en faut ? C’est le rationnement.
— Je comprends.
— Et ne vas pas croire que ce sont toujours les mêmes denrées qui sont en trop et toujours les mêmes qui sont en trop peu. Ici, il y a des produits qui ne manquent jamais ; ce sont ceux que la région fournit et qu’on a, pour ainsi dire, sous la main et à volonté. Mais il y a des produits moins abondants et moins réguliers, d’autres qui viennent de loin ; et ce sont ces produits-là — je citerai le sucre, le café, les pâtes alimentaires, les conserves — qui sont, parfois, en déficit.
— Eh bien ! Sur quelle base établissez-vous la répartition de ces produits déficitaires ?
— Sur la base de la population de ce secteur : dix mille bouches à nourrir. Il suffit, par conséquent, de diviser par dix mille le produit à répartir ; et le quotient de cette division fixe la quantité qui revient à chacun. À chaque famille, à chaque groupe de consommateurs, il est attribué un nombre d’unités à répartir correspondant au nombre des membres de chaque famille ou groupe. Voici que, aujourd’hui, le sucre manque. Eh bien ! Lis cette affiche placée au-dessus du rayon : sucre. Qu’y lis-tu ? 40 grammes, n’est-ce pas ? Cela veut dire que, pour aujourd’hui, chacun doit se contenter de 40 grammes de sucre. Chez moi, nous sommes cinq : on me donnera 200 grammes de sucre et cela fera mon compte. Est-ce clair ?
— Très clair et très simple. Mais, dis-moi : pour ces produits qu’on prend à volonté, sans contrôle, n’arrive-t-il pas que certaines personnes, peu consciencieuses, s’en attribuent plus que de raison et n’est-ce pas la source d’un gaspillage qu’il conviendrait d’empêcher, dans l’intérêt commun ?
— Au commencement du régime communistelibertaire, la production étant, dans son ensemble, déficitaire, les moyens de transport insuffisants ou défectueusement organisés et le mode de répartition mal défini, le système du rationnement fut appliqué à tous les objets de consommation. Mais ce ne fut qu’une période assez courte de transition. Réglée sur les besoins de la consommation, la production s’éleva graduellement et assez vite au niveau de ces besoins, le service des transports s’améliora et la répartition se fit de mieux en mieux. Puis, certaines denrées — ce furent, tout naturellement, celles qu’on obtient sur place et le plus facilement — dépassèrent peu à peu les besoins de la population. On eut aussitôt l’idée de substituer, pour ces denrées-là, le système de la prise au tas à celui du rationnement.
L’essai — c’était prévu et fatal — donna, les premiers jours, quelques mécomptes. Il n’y eut pas, à proprement parler, gaspillage ; seulement, par crainte de manquer, un certain nombre de personnes crurent prudent de se constituer des réserves ; mais ces réserves furent consommées les jours suivants et, lorsque la crainte de manquer disparut, personne ne s’avisa plus de prendre au tas abusivement. Tu parais surpris ? Et pourtant : réfléchis. Nous sommes cinq chez nous ; il nous faut, en moyenne, 3 kg de pain par jour ; cela fait 600 g par personne ; c’est largement suffisant. Pour quelle raison et dans quel but emporterais-je d’ici, où je viens m’approvisionner tous les jours, plus de 3 kg ? Demain, je prendrai encore mes 3 kg et j’aurai ainsi du pain frais. Si j’en emportais aujourd’hui 5 kg, il m’en resterait deux demain. Je n’en prendrais demain qu’un kilo et, demain, nous aurions à manger un kilo de pain tendre et deux kilos de pain rassis. Chacun s’arrange comme il l’entend.
Mais, encore une fois, il ne vient aujourd’hui à l’esprit de personne de gaspiller. J’ai cité le pain ; j’aurais pu citer toutes les autres denrées et mes explications eussent été les mêmes. On peut affirmer que, d’une façon générale, le gaspillage provient, soit de la privation, soit de l’insécurité du lendemain. On est tenté de se précipiter gloutonnement sur un produit dont, d’ordinaire, on est privé, lorsque, par hasard et exceptionnellement, on a l’occasion de s’en gaver. On est porté à en mettre de côté lorsqu’on appréhende d’en manquer. Mais quand on a la possibilité et la certitude de s’en procurer régulièrement, demain comme aujourd’hui, et après-demain comme demain, on ne songe ni à gaspiller ni à se constituer des réserves. N’es-tu pas de cet avis ?
— Tu as raison. Encore une question : n’y a-t-il pas certains produits sur lesquels la consommation se porte de préférence, par exemple la volaille ? Il me semble que, pour permettre à qui le désire de venir chercher ici la quantité de volailles qu’il lui plaît d’emporter, il faut qu’on en apporte une quantité prodigieuse. Il est vrai qu’il y a le rationnement et, la volaille étant un produit très recherché, il est probable que ce doit être un de ceux qui sont rationnés fréquemment, pour ne pas dire toujours ?
— C’est ce qui te trompe. Il en a été de la volaille comme d’une foule d’autres produits qui, sous le régime capitaliste, étaient l’apanage des privilégiés du Pouvoir et de l’Argent. Autrefois, un poulet sur la table d’un prolétaire, c’était une rareté ; un poulet coûtait cher ; et pour une famille tant soit peu nombreuse, la portion de chacun n’était pas bien grosse. Aussi, la volaille était-elle considérée comme un régal, un luxe, un extra. Quand débuta le régime du communismelibertaire, il fallut bien rationner ; sans quoi, pour satisfaire tout le monde, on eût été dans la nécessité d’abattre presque toute la gent volatile. Or, il fallait, tout au contraire, la multiplier. En conséquence, que fit-on ? Il fut convenu qu’on ne trouverait de la volaille au pavillon de l’alimentation qu’une fois par semaine. Ce régime dura au moins un an. L’année suivante, on put s’en procurer deux fois par semaine. Les amis de la campagne furent invités à pousser aussi activement que possible l’élevage des poulets ; de mois en mois, on améliora les conditions de cet élevage, en fournissant aux éleveurs tout ce qui facilitait leur tâche. Tandis que les hommes cultivaient les champs, les femmes donnaient leurs soins à la basse-cour. Si bien que, rapidement, le nombre des volailles augmenta à tel point que, depuis longtemps, on en trouve ici tous les jours.
Bien mieux : on a dû, depuis quelque temps déjà, restreindre l’effort de la production sur ce point, afin de le reporter sur d’autres points ; car, maintenant que tout le monde peut manger de la volaille à discrétion, personne n’en mange plus d’une ou deux fois par semaine. La consommation de la volaille a peu à peu diminué ; elle s’est stabilisée comme le reste et, si on ne réservait pas une partie de cette production aux vieillards, aux enfants et aux malades qui digèrent plus facilement du poulet que du bœuf ou du cochon, il y en aurait trop.
— C’est parfait. J’ai bien saisi tes explications. J’ai, maintenant, deux questions à te poser, si ce n’est pas abuser de ton temps et de ta complaisance.
— Vas-y, mon jeune camarade. Interroge tout à ton aise.
— Je voudrais d’abord savoir comment se trouventici toutes les denrées que nous voyons. Car, enfin, elles n’y sont pas venues toutes seules.
— Très intéressante, ta question, et j’y réponds avec plaisir. Il y a, dans ce pavillon, deux sortes de produits : les produits rapidement périssables et les autres. Les premiers exigent la plus grande fraîcheur ; il est désirable qu’ils soient consommés sans délai ; s’ils attendent, ils se flétrissent, deviennent trop durs ou trop mous, ils pourrissent, ils sentent mauvais, etc. Il faut donc qu’ils arrivent et partent chaque jour. Les autres produits peuvent attendre. Les denrées périssables sont apportées ici tous les matins, vers cinq heures ; les autres, tous les vendredis, vers quinze heures. Ce pavillon reste ouvert au public tous les jours de sept heures à seize heures, sauf le vendredi où la fermeture a lieu à midi. Tu me suis bien ?
— Parfaitement ; continue, je te prie.
— Toutes les denrées périssables arrivent aux halles centrales. Ces halles sont immenses ; elles sont reliées directement aux trois gares de chemin de fer, aux quatre gares de voitures et camions automobiles et au cours d’eau qui traverse la ville. De minuit à quatre heures du matin, elles présentent une animation extraordinaire. C’est une file ininterrompue de wagons, de camions, de véhicules de toutes sortes qui aboutissent au centre des halles. De ce centre, par des voies qui rayonnent en tous sens, chaque denrée est dirigée ensuite sur le pavillon destiné à la centraliser. Vers quatre heures du matin, la réception de ces denrées prend fin. Au fur et à mesure que wagons, camionsautomobiles, charrettes et véhicules divers ont déversé leur contenu, comme note a été prise des quantités reçues, il ne reste qu’à totaliser pour savoir de quelles quantités on dispose globalement. C’est à ce moment que s’établit la distinction entre denrées à répartir sans contrôle (prise au tas) et denrées soumises au rationnement. C’est à ce moment aussi que, par un calcul que ferait un enfant de douze ans, est fixée, en cas de consommation limitée et contrôlée, la ration par tête d’habitant. Cela fait, il ne reste plus qu’à répartir les produits ainsi groupés entre les dix entrepôts d’alimentation installés dans les dix secteurs de la ville.
Ce n’est pas tout : ces entrées et sorties de denrées alimentaires, enregistrées chaque jour, établissent une sorte de comptabilité journalière. Mais, à la fin de chaque mois, on détermine, par l’addition, la consommation absorbée, denrée par denrée, par la population entière de la ville. Ce calcul s’établit, ensuite, par trimestre, par semestre et par annuité, ce qui permet de fixer, par l’expérience, la quantité de produits consommés, et de voir quels sont ceux qui sont en surabondance et ceux qui sont en insuffisance. On règle ensuite, sur ces données mathématiques, la production à obtenir, dans l’ensemble et dans le détail.
— Voici ma seconde question : parties des halles centrales, les denrées destinées au pavillon dans lequel nous nous trouvons y parviennent. Il faut, dès leur arrivée, les décharger, les classer, les grouper, les empaqueter, les étaler, les détailler si c’est de la viande. Qui s’occupe de ce travail ? À quelle heure et comment se fait cette besogne ?
— Vers quatre heures du matin, je te l’ai déjà dit, l’arrivée des produits alimentaires aux halles centrales prend fin. Le travail d’enregistrement et de comptabilité dont je viens de te parler est promptement expédié ; c’est l’affaire d’une petite demi-heure. Aussitôt, les camions automobiles sont chargés et, par les voies les plus rapides, arrivent à destination. Dès leur arrivée, c’est-à-dire vers cinq heures du matin, le travail dont tu parles est exécuté, dans chaque pavillon, par des camarades accoutumés à cette opération : bouchers, charcutiers, épiciers, boulangers, etc. De la sorte, lorsque, à huit heures du matin, ce pavillon est ouvert au public, tout est prêt, fait et en ordre.
Je t’ai dit que ce pavillon est ouvert chaque jour de huit heures à seize heures et que le vendredi il est fermé à midi. Voici pourquoi : on estime que, à seize heures, tout le monde a eu le loisir de s’approvisionner. On ferme donc et on nettoie de fond en comble, tandis qu’on transporte dans les sous-sols et dans les glacières les denrées périssables qui restent et qui partiront le lendemain. On arrose à grande eau ; les pompes balaient détritus, déchets, toutes les malpropretés. Et, vers dix-sept heures, tout est bouclé jusqu’au lendemain.
Le vendredi, la fermeture se fait à midi, parce que c’est ce jour-là qu’a lieu la réception des denrées qui ne sont pas, ou sont moins périssables, denrées qu’il n’est pas nécessaire de renouveler chaque jour : le sucre, le café, les légumes secs, etc. Les produits arrivent des halles centrales vers treize heures ; on les classe, on les groupe, on les range, on les empile bien en ordre dans les comptoirs qui leur sont réservés et, quand ce travail est achevé, on s’en va. Tu vois comme c’est simple et, ce système de répartition des produits donnant satisfaction à tous et s’effectuant dans la joie commune et le bien-être général, tu ne saurais croire avec quel empressement la population se conforme aux indications qui lui sont données. Pas de vol (pourquoi volerait-on, puisqu’on a la faculté de prendre librement ce dont on a besoin ?) ; pas de marchandage, dispute ou contestation, puisque chacun choisit lui-même ce qui lui plaît et puisque, lorsque la consommation est limitée, on sait qu’elle l’est pour tous et que c’est une nécessité passagère.
— Comme c’est beau et pratique !...
— Nous savons que, naguère, au temps du capitalisme exploiteur, voleur et affameur, quand toute l’économie sociale reposait sur le profit et la valeur marchande des produits, lorsque, entre le producteur et le consommateur, pullulait la bande peu intéressante mais sordidement intéressée des détrousseurs du trafic commercial ; lorsque, constitués en classe possédante et gouvernante, les accapareurs du Pouvoir et de la Fortune écrasaient de leur domination la classe gouvernée et dépouillée de tout, nous savons que, dans ce temps-là, plutôt que de renoncer au profit escompté ou de se résigner à la réduction de ses gains, les forbans du capital, sous la protection des bandits de l’État, leurs associés et leurs complices, n’hésitaient pas à précipiter dans la mer, à incendier, à jeter dans les égouts ou à laisser pourrir sur place les montagnes de produits qui ne s’écoulaient pas, tandis que des millions de femmes et d’hommes, de vieillards et d’enfants dépérissaient de privations et succombaient à la misère.
Et nous nous demandons aujourd’hui s’ils n’étaient pas frappés de démence, ces monstrueux criminels : ceux qui avaient accaparé ces produits et systématiquement les anéantissaient. Et s’ils n’étaient pas atteints d’inconscience, ou pétris de lâcheté, ceux qui, après avoir, par leur travail, créé tous ces trésors de vie, se laissaient stupidement mourir de faim, au lieu de se révolter et de s’emparer, de haute lutte, des biens qui, en toute équité, leur appartenaient.
Ah ! Si c’était aujourd’hui, de telles atrocités seraient absolument impossibles. Si des affamés, des sans-abri, des loqueteux, d’où qu’ils vinssent, et quelles que pussent être leur langue et la couleur de leur peau, se présentaient à nous, avec quelle joie nous leur dirions de prendre, à nos côtés, place au banquet de la vie et de se rassasier ! Avec quelle satisfaction, dussions-nous nous serrer un peu, nous leur offririons l’abri de nos demeures ! Avec quel bonheur nous les inviterions à prendre, dans notre pavillon du vêtement, de quoi se vêtir !...
— Sébastien FAURE.
PRISON
n. f.
Vient du bas latin prensio, de prehensio : saisir, prise. Lieu où l’on enferme les accusés et les condamnés. On dit aussi : maison d’arrêt et de correction. Fig. : Demeure sombre et triste. Ce qui enveloppe fortement : la gangue est la prison du diamant. Loc. : Triste comme la porte d’une prison.
Dans le système pénitentiaire français, les prisons sont divisées en deux grandes classes : les prisons civiles et les prisons militaires. Les prisons civiles .sont, à leur tour, divisées en deux catégories : les prisons d’hommeset les prisons de femmes. Les prisons militaires sont aussi divisées en deux catégories, la première ne comprenant que les condamnés pour des délits strictement militaires ; la deuxième étant spécialement affectée aux condamnés de droit commun ou ayant été condamnés antérieurement pour un délit de droit commun.
Les prisons civiles sont classées en six catégories principales :
-
Maison de police ou Chambre municipale ; dans chaque canton, reçoit les individus condamnés par les tribunaux de simple police à quelques jours d’emprisonnement ;
-
Maison d’arrêt ; dans chaque chef-lieu d’arrondissement, reçoit les condamnés à moins d’un an et un jour d’emprisonnement ;
-
Maison de justice ; établie au chef-lieu judiciaire de chaque département. On y enferme les accusés, les jeunes détenus, les condamnés qui se pourvoient par appel devant les tribunaux du chef-Lieu ou devant les cours d’appel, ainsi que les condamnés jugés par la cour d’assises en attendant leur transfèrement ;
-
Maison de correction ou Prison départementale, reçoit les enfants détenus en vertu de l’a puissance paternelle et les enfants mineurs condamnés ;
-
Maison de détention ou de force, appelée communémentMaison centrale, où sont enfermés les condamnés à plus d’un an et un jour, les condamnés aux travaux forcés, mais ayant passé 60 ans. Les femmes, ne subissant pas la transportation, y sont, retenues à tout âge ;
-
Pénitencier agricole, sorte de maison centrale dont les détenus sont occupés à des travaux de plein air.
La peine des travaux forcés est subie par les hommes dans les colonies pénales. La peine spéciale de la détention prévue dans le cas de crime intéressant la sûreté extérieure de l’État est subie dans un quartier distinct de la Maison centrale de Clairvaux (Aube).
Avant la Révolution de 1789, il y avait des prisons d’État où l’on enfermait les coupables de délits ou de crimes politiques et ceux qui déplaisaient aux tenants du pouvoir. Ces prisons ont été supprimées par la Révolution. A présent, toutes les prisons sont des Prisons d’État.
La justice militaire possède, en plus de ses prisons ordinaires, pour l’exercice de sa répression, les Pénitenciers militaireset les Travaux publics. Des campagnes ardentes et répétées, notamment lors de la célèbre Affaire Dreyfus, ont été menées pour obtenir la suppression de ces « Biribis » et pour l’abolition des tortures qui étaient infligées par les chaouchs aux malheureux soldats emprisonnés : poteau, fers, poucettes, crapaudine, etc... Mais il semble bien que le résultat atteint ne soit guère en rapport avec les efforts fournis.
Avant la guerre de 1914–1918, l’administration des prisons civiles relevait du Ministère de l’Intérieur ; on l’a, de nos jours, rattachée au Ministère de la Justice.
Le travail est obligatoire dans toutes les prisons françaises, sauf pour les prévenus, les condamnés en appel ou en pourvoi de cassation. Le travail est rémunéré, mais le condamné ne touche qu’une faible partie de son maigre salaire, la plus grosse part allant à l’administration pénitentiaire. De la somme qui revient au condamné, de 3 à 5 dixièmes, selon qu’il estprimaire ou récidiviste, une partie est réservée au pécule qu’il touchera à sa sortie, une autre partie pouvant être affectée à l’achat d’aliments ou d’objets utiles et permis, à la cantine de la maison.
Le régime politique autorise le condamné à faire venir sa nourriture du dehors ; lui permet les visités d’amis qu’il voit librement et non à travers les grilles du parloir ordinaire des condamnés de droit commun ; lui laisse la faculté de correspondre chaque jour, de recevoir et de lire les journaux et ne le contraint ni au travail, ni au silence, ni au port du costume pénitentiaire. Le régime politique n’est pas un droit, mais une tolérance, une faveur soumise aux caprices des juges, des gouvernants et même du directeur de la prison, qui peut élargir ou resserer le régime à sa convenance. Aussi n’y a-t-il rien de plus arbitraire que l’application du régime politique en France. On a vu souvent des condamnés, pour un même délit, accomplir leur peine : les uns au droit commun, les autres au régime politique.
La durée de la condamnation prononcée par les tribunaux peut subir certaines diminutions. Accomplie en cellule, le condamné bénéficie de la remise du quart. C’est, selon le législateur, la portion équivalente du temps à l’aggravation de la peine par l’encellulement. On aimerait connaître par suite de quels calculs et à l’aide de quel instrument de mesure les législateurs sont arrivés à chiffrer cette équivalence. Lorsqu’un condamné primaire a fait la moitié de sa peine, il peut demander sa libération conditionnelle. Celle-ci est accordée ou refusée, selon les cas : bonne conduite pendant l’incarcération, renseignements favorables d’après enquête, etc... Elle peut aussi lui être retirée si, dans le laps de temps qui lui reste à faire, il commet une infraction aux conditions de libération qui lui sont imposées et qui sont consignées dans un carnet qui lui est confié. La « livrée du châtiment » — tant pour les hommes que pour les femmes — est de couleur morne et de coupe grotesque. Les condamnés ainsi vêtus forment une race à part, une race maudite. La société les a marqués d’infamie. Dans les prisons cellulaires, le costume s’agrémente d’un accessoire nommé cagoule, que les prisonniers doivent mettre sur leur tête et rabattre sur leur visage, de façon à le masquer à tous les yeux. Fabriquée dans la plus grossière des toiles à sacs, la cagoule obstrue presque complètement la vue. Pour y voir suffisamment pour se diriger, il faut avoir soin d’étirer quelques fils à l’emplacement des yeux.
Le silence est de rigueur dans toutes les prisons. Sur le « Règlement » affiché dans les cellules où sont énumérées les multiples interdictions faites aux détenus, l’obligation du silence est plusieurs fois stipulée. Aussi, dès qu’on a franchi le seuil d’une prison, que sa lourde porte s’est refermée, tout bruit cesse, l’agitation de la vie s’arrête, l’idée de la mort paralyse le cœur et le conseil du Dante angoisse le cerveau : Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate !
Tout le système pénitentiaire, établi sur les bases de la vieille et très sainte Inquisition, avec ses crasses, ses tortures et ses abjectes coutumes d’avilissement humain, est à jeter à bas. La prison n’est ni moralisatrice, ni réformatrice et il est assez prouvé que le système actuel de répression a fait faillite.
« La prison telle qu’elle est organisée est un véritable cloaque épanchant dans la société un flot continu de purulences et de germes, de contagion physiologique et morale ; elle empoisonne, abrutit et corrompt. » (Emile Gautier, 1889)
« Puisque, depuis des siècles et jusqu’à nos jours, la société n’a rien trouvé de mieux pour s’en défendre que d’enfermer les individus déclarés nuisibles, je pense qu’il serait humain de les faire vivre dans des locaux salubres ; je pense qu’il serait légal de leur donner un juste salaire pour leur labeur ; je pense qu’il serait juste de ne pas aggraver leurs condamnations par les humiliations, les vexations et les « passages à tabac » qui sont de règle, hélas, dans toutes les prisons.
» Ma voix grandit pour réclamer plus de justice dans notre humanité, pour demander une meilleure répartition des biens communs, c’est-à-dire le droit égal pour tous aux jouissances que procurent les richesses qui sont le fruit du travail de tous les hommes.
» Ma voix s’enfle pour exiger la sélection de la race humaine, telle au moins que l’on a jugé bon de l’adopter pour la race animale ; car il est certain que l’élimination des tarés, des incurables et des dégénérés, établirait l’équilibre nécessaire au maintien de l’ordre social, faciliterait l’entente fraternelle et la solidarité et diminuerait considérablement le nombre des malfaiteurs. Il est honteux, il est indécent, il est intolérable que notre société permette aux uns, qu’elle encense et soutient, tant de richesse insolente et laisse aux autres, qu’elle utilise et punit, tant de misère effroyable !
» Abolissez la pauvreté et vous pourrez démolir les prisons. » (Le Pourrissoir)
La question des criminels-nés : dégénérés mentaux, anormaux ; des délinquants anti-sociaux par accidents : traumatismes ou maladies ; des fous lucides, paranoïaques, obsédés et asthéniques de toute nature ; des incendiaires, des sadiques et des violeurs pourrait être parfaitement résolue par l’internement dans des asiles où ils seraient traités humainement et soignés en vue de leur relèvement, de leur guérison et de leur réintégration dans la vie en société.
— Eugène et Jeanne Humbert.
PRIVILÈGE
n. m.
Le privilège constitue un avantage exclusif qui dépend, au propre, de l’organisation sociale ; au figuré, de l’organisation individuelle. Ainsi le privilège est l’expression de la force, comme la justice est l’expression de la raison.
Au point de vue économique, le privilège par excellence est celui de la propriété privée du sol, qui fait naître un autre monopole se rapportant au développement général de l’intelligence. L’incompressibilité de l’examen fit tomber, en 1789, quelques privilèges attachés à la propriété individuelle foncière, tout en assurant aux bénéficiaires du nouveau régime les avantages primordiaux qui suivent et s’attachent à la possession de la propriété foncière. Elle remplaça la féodalité terrienne par la féodalité financière qui nous domine et nous régit. L’expérience de plus d’un siècle prouve que tant que le monopole foncier existera au profit de la finance, c’est-à-dire de quelques-uns, tous les privilèges que ce monopole entraîne se manifesteront à l’avantage exclusif des classes possédantes, qui sont, en dernier ressort, les classes dirigeantes. Quelles que soient les apparences d’un bien-être généralisé, il n’y aura d’autre progrès que vers le mal.
Quoi que les chantres du régime actuel entonnent des cantiques de triomphe en faveur de la rationalisation et autres combinaisons bourgeoises comme génératrices de bien-être généralisé, la misère des masses croît en raison du développement général des intelligences et en proportion de ce que l’économie politique appelle la Richesse publique qui n’est, en réalité, que la richesse d’une minorité d’exploiteurs du travail. En soutenant que la Révolution de 1789 a aboli le privilège de naissance, on commet une erreur. Cela ne serait vrai que si, naissant de n’importe qui et n’importe où, l’enfant arrivait au monde avec des droits égaux à son semblable, pour être l’artisan de sa fortune et de sa destinée. Or, à peine arrivé au monde — sauf exception —, l’enfant est en quelque sorte prédestiné à être riche ou pauvre, éclairé, instruit, ignorant ou abruti.
Pour qu’il n’y ait plus de privilèges, l’inégalité de position doit dépendre exclusivement de l’inégalité organique et de la volonté de chacun. La société de l’avenir devra remplir le devoir d’éviter qu’il puisse y avoir des malheureux, des déshérités, comme le cas se produit de nos jours. Le plus ou moins de bonheur et de bien-être sera la récompense du mérite. Il y aura justice.
— **Elie Soubeyran.
PROCÉDURE
n. f.
La procédure est l’ensemble des règles destinées à fixer la marche des procès.
Levasseur dit qu’elle suppose un état de civilisation où l’on a dépassé la phase dite de la Justice privée. Il ajoute que ce régime archaïque où l’individu lésé peut réaliser lui-même son droit, sans recourir à l’autorité publique, n’est pas compatible avec le besoin d’ordre et de stabilité d’une société en progrès. Il faut d’abord qu’une autorité préside à la dispute judiciaire, la surveille, la contienne dans des limites pour éviter de dégénérer en violences. Mais qu’il s’agisse de procès entre particuliers à l’occasion d’intérêts privés (procès civils) ou de procès à l’occasion de délits où l’intérêt public entre en jeu (procès criminels), il est nécessaire de réglementer l’action destinée à avoir raison de la violation du droit. Il est indispensable que celui qui se plaint d’être lésé dans son droit puisse faire triompher librement sa prétention comme il est indispensable que l’adversaire puisse librement se défendre.
Il est également indispensable que l’autorité, elle-même en charge de rechercher le droit et de mettre fin au conflit, soit enfermée dans des règles ou prescriptions destinées à l’empêcher de sortir de la loi pour tomber dans l’arbitraire. C’est là le but des lois de procédure. Elles protègent le plaideur inexpérimenté contre un adversaire plus adroit et moins scrupuleux ; elles le mettent à l’abri des caprices ou des passions du juge : elles sont la condition essentielle de la justice, attendu qu’elles favorisent la manifestation libre de la liberté.
J’emprunte également à Levasseur la partie historique de la procédure qui découle presque entièrement du Droit romain. Les Romains avaient trop souci de la légalité pour ne pas avoir compris l’importance de la Procédure. Dans le procès civil, « juridicium privatum », comme dans le procès criminel, « juridicium publicum ». Ils l’organisèrent avec un soin méticuleux, le soumirent à un ensemble de principes directeurs identiques, admirablement combinés pour concilier les droits de la société et ceux de l’individu. Non seulement les bases essentielles ont été les mêmes pour les deux variétés de la procédure, mais l’évolution historique s’est poursuivie avec un parallélisme constant. Partis d’un système encore rudimentaire, très proche, surtout en matière civile, du régime de la justice privée, les Romains en ont, peu à peu, admis un second, plus souple et mieux adapté aux nécessités changeantes des faits. Puis, sous l’influence des révolutions politiques, ils l’ont insensiblement abandonné pour un troisième, tout à fait en harmonie avec les tendances centralisatrices de l’époque impériale, avec l’idée grandissante des droits souverains de l’État. Ces principes identiques et ces variations historiques similaires ne peuvent être qu’exposés sommairement. On va le faire séparément, pour chacune des deux variétés de procédure.
Le principe fondamental qui domine la Procédure civile est une règle fort ancienne, probablement contemporaine des débuts de Rome, maintenue en tout cas jusque sous Dioclétien. C’est la séparation nécessairement imposée à tout procès civil, sa décomposition en deux phases : le jus et le judicium. À Rome, la fonction judiciaire n’est pas comme dans nos législations modernes, confiée à une personne unique, chargée, sous le nom de magistrat ou juge, de suivre l’évolution du débat du commencement à la fin et de trancher le différend par un jugement ; elle est répartie entre deux personnes, le magistrat et le juge. Le premier juridicundo est un agent du pouvoir. Il interpose son autorité dès le début, met fin immédiatement au litige s’il est possible, sinon le dirige vers son but final en faisant préciser par les parties ou en précisant lui-même les questions à résoudre. Là s’arrête sa mission. Il n’a pas à juger lui-même. Il renvoie l’affaire devant un juge, judex. Celui-ci, simple particulier, judex privatus, est un juré qui statue seul ou en collège avec d’autres. Il donne son avis, sententia, sur le bien-fondé de la prétention. Il met fin ainsi au débat judiciaire. Il y a donc deux phases dans le procès : le jus devant le magistrat, le judicium devant le juge. On retrouve ces deux stades dans le système primitif de procédure, système des legis actiones et dans le second système, système formulaire. Ils n’existent plus dans le troisième, système extraordinaire. Le trait caractéristique du premier système de procédure est l’allure solennelle et symbolique de la phase du débat qui se passe in jure. Ce sont, en effet, les parties elles-mêmes qui, par des paroles et des gestes réglés à l’avance, affirment solennellement leurs droits opposés. C’est en cela que consiste le legis actio, Le magistrat assiste à cette dispute contradictoire, mais il ne la dirige pas. Sa présence lui donne seulement un caractère officiel et licite. Elle l’empêche de dégénérer en conflit violent. Les parties, après avoir choisi leur juge, étaient renvoyées devant lui. Là, in judicio, avaient lieu les plaidoiries avec production des preuves, enfin était rendue la sententia. Ce système avait d’incontestables mérites. Il n’admettait aucune juridiction d’exception. Il confiait la sentence à des juges librement choisis par les plaideurs. Le débat in jure et in judicio était public.
Toutefois, de graves inconvénients amenèrent sa décadence et, finalement, sa disparition. Les parties, en effet, paralysées par un formalisme étroit et infécond, ne pouvant faire valoir une prétention, si juste quelle fût, quand elle n’avait pas été autorisée par la loi et munie d’une formule solennelle orale destinée à la mettre en mouvement. Le magistrat, impuissant, réduit à un rôle secondaire, ne pouvait, même s’il l’eût voulu, accueillir une pareille prétention. C’était là un double obstacle au développement du droit. Le second système restitua au magistrat le rôle prépondérant dans la phase in jure. Il en fit le véritable directeur du débat qui s’engageait devant lui, libre d’entraves, sans paroles solennelles, sans gestes symboliques, sans cérémonie d’aucune sorte. Ce que les parties lui demandent, c’est, ou bien de mettre fin au débat, s’il le peut, sinon de leur délivrer une formule écrite, dans laquelle il institue le juge choisi par les parties et lui indique en termes précis le point en litige, avec mission de condamner le défendeur, si la prétention du demandeur est juste, de l’absoudre, dans le cas contraire. L’obtention de la formula : tel est le but auquel tend essentiellement la première phase du procès. L’affaire est dès lors en état d’être jugée. Les parties n’ont plus qu’à aller devant le ou les juges privés. Elles y exposent librement l’affaire et administrent la preuve de leurs prétentions. Le débat est oral et public. La sentence se termine d’une façon définitive. Ce système date déjà des derniers siècles de la République. Une loi œbulia (vie ou viie siècle de Rome) l’implanta à côté de l’ancien système qui disparut peu à peu de la pratique, sans abrogation formelle. Le système formulaire ne fut pas seulement une heureuse transformation de la procédure qu’il avait simplifiée et allégée ; il eut la plus grande influence sur le fond du Droit. Ainsi, la procédure par formules servait à la fois à confirmer le droit civil et à le corriger. En même temps que la formule était l’organe d’application normale du droit d’autrefois, elle servait de véhicule aux idées nouvelles, elle faisait passer dans le droit étroit et rigoureux des quirites un large souffle d’humaine équité.
Plus tard, la distinction du jus et du judicium devait disparaître.
Les fonctions du magistrat et du juge se confondirent. Du début à la fin, l’instance civile se déroule devant la même personne, le judex, qui entend les parties, dirige le débat, rend la sentence. Sous le système formulaire, le magistrat, au lieu de renvoyer l’affaire à un juge, statue lui-même. Ces cas devinrent de plus en plus nombreux à la fin de l’Empire romain. L’empereur, à son tribunal, usa de ce procédé, et, tout naturellement, son exemple fut suivi par les magistrats. La procédure extra ordinem tendait à devenir le droit commun. En même temps, les magistrats perdaient le pouvoir de modifier les principes proclamés par l’édit perpétuel, désormais codifié. Asservis aux règles immuables d’un droit définitivement fixé, ils devenaient, comme le juge, des instruments d’application de la loi. La suppression des deux phases successives du débat rendit les formules inutiles : elles disparurent. Tout ce que la procédure retenait encore de l’antique formalisme disparut avec elles. Le juge, simple fonctionnaire, délégué de l’empereur, statue en son nom. De là le droit de contrôle sur ses décisions attribué à d’autres juges, plus élevés que lui dans la hiérarchie, et enfin à l’empereur qui les domine tous. Liberté dans la forme, souplesse dans la mise en mouvement, garanties de tout genre contre l’erreur du juge, publicité du débat et voies de recours à l’autorité supérieure, tels sont les principes derniers. La plupart des législations modernes n’ont rien trouvé de mieux que de s’en inspirer.
Les mêmes idées se retrouvent à peu près dans la Procédure criminelle. On retrouve un premier système où c’était le représentant de l’autorité qui était le seul juge. Sous la République, le besoin de garanties efficaces contre l’arbitraire des magistrats suprêmes suggéra une série de lois, leges de provocatione, qui investirent les comices centuriates de la juridiction criminelle. C’est là qu’il faut chercher la première ébauche d’une procédure criminelle. En investissant l’assemblée populaire du droit exclusif de juger les procès, entraînant la perte du caput (causes capitales), on n’enlevait pas aux magistrats leur droit d’enquête préliminaire ; ils y procédaient, sur l’accusation portée par n’importe quel citoyen, puis convoquaient l’assemblée, contio, où la plainte anquisitio était exposée et où pouvait se défendre l’accusé. Après trois contiones successives avait lieu le vote des comices. En réalité, et sous ces complications, apparaît le principe fondamental : la division de l’instance en deux phases, l’une préparatoire, conduite par le magistrat, l’autre définitive, où le jugement appartient exclusivement aux citoyens.
Puis, la procédure criminelle se raffine, elle se simplifie sans qu’on abandonne pourtant les garanties jugées essentielles. On crée les quœstiones perpetuee pour chaque nature d’infractions graves. En somme, une loi intégrale est faite, réglant la forme et le fond, la procédure et la peine.
La loi Julia (judiciorum publicorum) réglemente la marche générale du procès criminel quand il a lieu par voie de quœstio. Elle conserve le débat préliminaire contradictoire devant le magistrat, in jure. Celui-ci autorise l’action, choisit entre les accusateurs (divinatio), ordonne, s’il y a lieu, une instruction et forme le quœstio, Cette phase achevée, la phase injudicio commençait devant la quœstio rassemblée par le magistrat et présidée par lui. Elle comprenait l’accusatio et la defensio avec la production des preuves. Les jurés prononçaient la condemnatio ou l’absolutio.
L’Empire romain fait disparaître peu à peu les quœstiones perpetuee. C’est de plus en plus le magistrat qui statue à lui seul, après avoir lui-même procédé à l’instruction. Le procédé de la cognitio extra ordinem est devenu normal. Il a pris autant d’importance qu’en matière civile. Un des actes qui marquèrent le mieux la transformation fut la décision de Septime Sévère transportant au Prœfectus urbi et au Prœfectus vigilum la connaissance de tous les délits commis à Rome ou dans les 100 milles autour de la ville.
Dans les provinces, les gouverneurs reçoivent, par délégation de l’empereur, le droit de statuer au criminel, et la procédure cesse d’être accusatoire pour devenir inquisitoriale. La poursuite n’est pas intentée par un particulier quelconque, mais par le magistrat, représentant l’État, intéressé à la répression des infractions. Le magistrat est à la fois accusateur, instructeur, juge. Ainsi, après tant de siècles écoulés, on en revenait aux idées des temps des rois. Et la procédure, peu soucieuse des droits des individus, plus préoccupée de ceux de la société, n’a pas été sans influence sur la formation du droit criminel européen. Il a fallu attendre les temps modernes pour qu’on en revînt, dans les cas les plus graves, à une procédure qui ressemble singulièrement à celle des quœstiones, au jugement par jurés.
Cette partie historique de la procédure était indispensable pour la compréhension parfaite de la partie sèche qui va suivre les exposés si intéressants de Levasseur et de Gaston May ; et la forme qui préside actuellement à la marche de tout procès découle totalement, avec de bien faibles modifications, de celle qui existait il y a environ 2 000 ans. Les progrès sont lents en cette matière.
Les législateurs de l’époque qui précède notre génération et qui ont mis sur pied le monument de lois qualifié de « Code Napoléon » se sont inspirés du droit qui régissait la civilisation romaine. Notre IIIe République a, en somme, peu modifié l’attirail perfectionné qui réglait la marche des procès, et les années qui ont suivi la guerre de 1914–1918 n’ont rien ajouté ni retranché au système de procédure existant. Comme le flot de la mer qui foule et refoule, comme le flot des marées qui monte et qui descend, nos législateurs et l’administration qui les couvre, tour à tour, usent de la procédure au profit des moments, des individus ou des intérêts antagonistes qui fourmillent dans la société capitaliste.
La procédure civile et commerciale est l’ensemble des règles qui déterminent la compétence des divers tribunaux civils, les formes dans lesquelles les affaires sont instruites et jugées, la manière de faire exécuter et réformer les jugements. La procédure courante comprend une assignation par laquelle le demandeur cite son adversaire devant le tribunal, la constitution d’un avoué par ledit demandeur ; par l’avoué, des conclusions dans lesquelles chaque partie expose ses prétentions, des plaidoiries qui développent oralement ces conclusions ; enfin, le jugement qui est exécuté soit volontairement, soit même contre le gré de la partie condamnée. En matière commerciale, pour des raisons de rapidité et d’économie, les formes de la procédure sont simplifiées ; l’instruction se fait sans ministère d’avoués, les parties comparaissant soit en personne, soit par un fondé de pouvoir, mandataire, etc., devant un tribunal d’exception, créé spécialement : le tribunal de commerce. Les appels de ce tribunal viennent devant le tribunal civil avec la procédure civile.
La procédure du droit criminel varie suivant que les faits incriminés sont de la compétence, soit du tribunal de simple police qui juge les contraventions, soit du tribunal correctionnel qui connaît les délits, soit de la cour d’assises à qui sont déférés les crimes. Ces différentes juridictions sont saisies par l’action publique ou par l’action privée. L’action publique est mise en mouvement par le ministère public informé des faits à poursuivre, soit par des procèsverbaux et rapports de ses agents ou auxiliaires, soit par des plaintes, soit par des dénonciations. Il saisit toujours directement le tribunal de simple police et le tribunal civil lorsqu’il y a flagrant délit ou, dans les cas peu compliqués, par voie de citation directe. Ce droit de poursuite appartient aussi, à titre exceptionnel, à certaines administrations telles que les contributions, douanes, forêts.
La procédure devant le tribunal est la même qu’il y ait flagrant délit, citation directe ou renvoi du juge d’instruction. Le président du tribunal interroge le prévenu, entend les témoins cités à la requête du ministère public et du prévenu, puis la partie civile, s’il y a, en ses explications, le ministère public en ses réquisitions, la défense. Le greffier note les déclarations des témoins et les réponses du prévenu ; ces notes doivent être visées par le président dans les trois jours du prononcé du jugement d’incompétence, de renvoi ou de condamnation.
Il existe entre les jugements correctionnels les mêmes voies de recours qu’en matière de simple police : l’opposition et l’appel. L’opposition ne peut être faite que par le condamné ; l’appel peut émaner soit du condamné, soit du ministère public. En cas d’opposition, le prévenu est cité dans le plus bref délai devant le tribunal qui juge l’affaire comme s’il n’en avait pas encore connu. L’appel doit être fait par une déclaration au greffe dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement, sauf exception pour l’appel fait par le procureur général. Le procureur de la République doit alors réunir les pièces de la procédure qu’il transmet au procureur général, avec un rapport confidentiel sur l’affaire ou une requête d’appel s’il est lui-même appelant. Le procureur général fait citer à sa requête le prévenu pour l’audience indiquée. L’instruction a lieu publiquement à l’audience qui débute par un rapport fait par un des conseillers. C’est le procureur général qui est chargé de l’exécution de l’arrêt.
Dans les affaires contentieuses ou autres qui sont du ressort des tribunaux administratifs, c’est la procédure administrative qui règle les formes suivant lesquelles l’instance est engagée, le procès instruit et le jugement rendu. Ces formes sont relativement simples et les frais peu élevés. En outre, il est de l’essence de la procédure administrative d’être écrite, c’est-à-dire que les affaires s’y instruisent sur mémoires. Cette règle ne souffre que quelques exceptions, particulièrement devant les conseils de préfecture.
Les lecteurs de l’Encyclopédie Anarchiste ont pu apprécier par l’historique et l’exposé de la procédure ce que, à toutes époques et sous quelque régime qu’une société puisse exister, les intérêts en antagonisme créent de difficultés entre les individus, les procès étant la forme la moins brutale dont les différends peuvent être réglés.
Combien simplifiée et combien assouplie sera la procédure qui, dans un avenir plus ou moins lointain, mais dans un avenir certain, réglera, non pas les différends, mais les accords entre les individus d’une société où chacun comprendra que l’intérêt individuel sera la sauvegarde de l’intérêt collectif, et où l’antagonisme disparu fera place à l’harmonie universelle que nous entrevoyons. Ce jour-là, la procédure survivra aux procès des temps antiques, aux procès des temps barbares que nous vivons et réglera les rapports existant entre les différentes races réconciliées de la grande et parfaite humanité.
— Pierre Comont.
PRODUCTEUR
n. m. (du latin productor)
Personne, dit le dictionnaire, qui crée quelque chose ou met en œuvre une chose qui existe déjà. Cette définition est certainement exacte, si on ne considère que le sens général du mot producteur. Elle est, cependant insuffisante et imprécise, si on examine ce mot sous l’angle social, le seul, en vérité, qui nous intéresse ici. En effet, le producteur n’est pas seulement celui qui crée on qui transforme, il est surtout la personne qui crée de la richesse ou transforme la matière dans certaines conditions, variables suivant les régimes. Il est celui qui aspire à exercer son activité créatrice et transformatrice dans des conditions différentes, opposées en général à celles que l’ordre actuel lui impose.
En un mot, le producteur n’est pas seulement un rouage de la machine sociale, le plus infime en ce moment ; il n’est pas, non plus, exclusivement un instrument nécessaire, il a des aspirations, des désirs, un idéal, un but. Pour tout dire, c’est un Homme dans toute la force de ce terme ; un homme qui constate, depuis la naissance du monde — ou presque — que son effort n’a jamais été rétribué à sa valeur exacte ; se rend compte, depuis des siècles et des siècles, que d’autres hommes, favorisés par la naissance ou dénués de scrupules, retiennent par devers eux la plus grande partie (60 % en moyenne) du produit de son travail, sans produire eux-mêmes.
Cette constatation répétée, faite par des centaines de générations et dans tous les pays, l’a, tout naturellement conduit à formuler des désidérata, à exposer sa conception d’une égalité sociale toute différente du traitement matériel et moral qu’il subit mais n’accepte pad. Et c’est ainsi qu’il fut appelé à exprimer ses aspirations à la fois individuelles et collectives.
La première, c’est la rétribution intégrale de son effort ; la seconde, c’est la possession des instruments de production qu’il est seul à faire mouvoir.
Ce sont les deux grandes revendications que la logique lui imposa tout d’abord, A vrai dire, à l’origine, ces revendications étaient confuses dans son esprit ; elles étaient plutôt instinctives que raisonnées.
Elles ne tardèrent pas, cependant, à se préciser, à prendre une forme chaque jour plus concrète, à donner naissance à un idéal, à devenir un but constamment poursuivi, que chaque génération s’efforça d’approcher toujours d’un peu plus près, avec la certitude que l’une d’elles, plus éclairée, mieux armée, l’atteindra enfin.
Pour donner corps à ces revendications et force à leur action, les producteurs, sachant que leur faiblesse résidait dans leur isolement, s’associèrent, se groupèrent sous des formes diverses, pour arriver, en définitive, à se réunir dans des syndicats qui se fédérèrent et se confédérèrent, nationalement et internationalement. Là, ils prirent conscience de leurs véritables intérêts de tous ordres ; là encore, ils s’éveillèrent ; des sentiments nouveaux : la solidarité, l’entraide, la responsabilité individuelle et collective prirent naissance en eux. Une mentalité nouvelle, chaque jour plus élevée, une dignité toujours plus grande, un respect sans cesse accentué d’eux-mêmes et de leurs semblables, se manifestèrent. Et parallèlement à l’éclosion et au développement de tous ces sentiments, un idéal fraternitaire et égalitaire prit corps, se développa, lui aussi.
C’est ainsi que, pour entrer en possession du produit intégral de leur effort, les producteurs déclarèrent qu’ils voulaient abolir le salariat et faire disparaître le patronat sous toutes leurs formes ; qu’ils affirmèrent leur droit à la possession des Instruments dé production, d’échange et de répartition ; qu’ils précisèrent que cette possession, au lieu d’être individuelle et profitable à quelques-uns seulement, serait collective et profiterait à tous également ; qu’ils proclamèrent enfin que l’égalité devait être à la base des relations des individus entre eux et de ceux-ci avec la société ; que l’individu et la société sont deux réalités indéniables, qui réagissent l’une sur l’autre et sont inséparables l’une de l’autre ; qu’ils balbutièrent d’abord, pour l’affirmer catégoriquement bientôt, ce grand principe si éminemment humain : de chacun seIon ses forces, à chacun suivant ses besoins, qui constitue la base essentielle et fondamentale du communisme libertaire.
De là à déclarer que le travailleur — sens élargi du mot producteur — est à la fois la cellule initiale matérielle et morale, le moteur réel, le support logique et naturel des sociétés humaines, il n’y avait qu’un pas. Il fut assez vite franchi par le syndicalisme moderne, mouvement général des producteurs, qui s’est donné pour but de réaliser leurs aspirations de créateurs et d’hommes, tout à la fois.
Je ne crois pas utile de revenir sur ce que j’ai déjà écrit à maintes reprises à ce sujet dans mes études antérieures. J’aurai d’ailleurs l’occasion de serrer la question de plus près, lorsque je traiterai, plus loin, le mot syndicalisme, qui englobe toutes les aspirations des producteurs et précise leur doctrine en face de tous les problèmes humains.
— Pierre Besnard.
PRODUCTION
n. f.
Appropriation par l’homme, pour son usage, de la matière, sous toutes ses formes, et des forces naturelles ; utilisation de ces dernières, par divers procédés, pour transformer la matière et subvenir, en principe, aux besoins de la consommation humaine.
On distingue trois grandes sortes de production :
-
La production agricole, par la culture du sol ;
-
la production des matières premières, par voie d’extraction ;
-
la production industrielle, par les moyens divers de transformation.
En régime capitaliste, quel que soit le caractère de la production, trois agents interviennent :
-
L’ensemble des forces et moyens naturels ;
-
Le travail ;
-
Le capital. C’est ce dernier, en raison du rôle qui lui est assigné, qui domine les deux autres agents.
Contrairement à ce qu’enseigne l’économie politique, le capital n’est pas seulement l’ensemble des réserves constituées par les « économies » en argent, en machines, en outils, etc., il est surtout, entre les mains d’un petit nombre d’hommes, l’ordonnateur, l’agent dirigeant de toute la production. C’est de lui, de son abondance ou de sa pénurie, de sa circulation intense ou lente, de son afflux ou de son reflux, de sa fixation ou de ses migrations, des tendances, des désirs et des buts poursuivis par ceux qui le possèdent, que le sort de toute la production dépend. Les deux autres facteurs, qui devraient être seuls déterminants, sont, en fait, actuellement, tout à fait secondaires et, en tout cas, sont absolument subordonnés au capital. Il en est ainsi pour plusieurs raisons :
-
Parce que l’appropriation est le privilège d’un nombre très restreint d’individus ;
-
Parce que le capital représenté par les « économies » en argent, en machines, en outils, placé entre les mains d’un nombre limité de possédants, constitue fatalement une force hégémonique qui donne naissance, à la fois, à la dictature économique et au pouvoir politique, conséquence directe et corollaire forcé de la possession des richesses de toutes sortes ;
-
Parce que, ainsi dirigée, la production n’a plus pour but exclusif de satisfaire les besoins réels de la consommation ; qu’elle ne vise qu’à augmenter le capital et à le concentrer entre les mains d’un nombre toujours décroissant d’individus, groupés, en général par affinités d’intérêts, dans des organismes de formes diverses, mais n’ayant qu’un seul but : consolider, développer et renforcer la puissance du capital et des privilèges qui découlent de sa possession ;
-
Parce que cette « réserve » d’argent, de machines, d’outils, qui permet, non seulement de diriger, de contrôler, de contingenter la production, mais encore « d’acquérir » la matière sous toutes ses formes n’est constituée, en réalité, que par des prélèvements opérés par la force sur le travail, facteur essentiel de toute production ; que cette réserve accumulée, qui prend, en régime capitaliste, le nom de plus-value, n’est que le résultat d’exploitations successives de l’effort humain, non rétribué à sa valeur, et de l’accaparement des sources et moyens vitaux de la production ;
-
Parce que la circulation des produits n’est pas libre, que leur valeur marchande ne correspond pas à leur valeur réelle, en raison des méthodes industrielles, commerciales et surtout bancaires de l’ordre social capitaliste ;
-
Parce que, enfin, l’argent n’est plus, spécifiquement et exclusivement, un instrument d’échange et qu’il est devenu, au contraire, le seul moyen de possession et de rétention de la richesse ; que, par lui, celui qui le possède est, en réalité, le maître des gens et des choses.
Le développement de toutes ces considérations dépasserait singulièrement le cadre de cette étude. Aussi, dois-je me limiter et me borner à les énoncer. Elles suffisent d’ailleurs amplement à caractériser la production en régime capitaliste ; à démontrer que le troisième agent — qui ne serait rien sans l’existence des deux autres — est vraiment l’élément-force, déterminant, qui commande les deux facteurs essentiels de la production : la matière et le travail. C’est à ce paradoxe — auquel le capitalisme doit sa vie et sa perpétuation — que le système de production actuel a abouti. Il suffit d’en constater les résultats, pour être convaincu de la nécessité d’abolir un tel système, qui ne favorise qu’une infime minorité au détriment d’une immense majorité d’individus. Ce qui étonne le plus, c’est que tous les intéressés n’aient pas encore rétabli l’ordre naturel des facteurs qui concourent — et concourront de tout temps — à la production.
Quelle évolution la production a-t-elle suivie ? Selon quel processus s’est-elle développée et transformée ? Tels sont les deux points qu’il est possible d’examiner succinctement ici.
Constatons d’abord qu’il y a eu, à toutes les époques de l’histoire, un rapport très étroit entre la production et la vie des peuples. C’est ce qui donne au fait économique toute sa valeur, c’est ce qui en fait également, pour l’avenir, la base fondamentale de l’ordre social. Le bien-être matériel, tout relatif qu’il soit, a suivi, jusqu’à ces temps derniers — où le désordre capitaliste a atteint, au plus mauvais sens du mot, son maximum d’intensité — l’évolution de la production. Et il est tout à fait certain que si, demain, les moyens de production et d’échange, les richesses naturelles et le travail étaient libérés ; si la production était organisée rationnellement, suivant les besoins, et non en vue du plus grand profit, le bien-être matériel serait accru dans d’énormes proportions. De même, si cela était enfin réalisé, et si chacun produisait selon ses forces et consommait suivant ses besoins, ce bien-être matériel engendrerait spontanément un bien-être moral intellectuel et culturel équivalent. Rien ne prouve mieux que la vie, dans l’ensemble de ses manifestations dépend étroitement de la production : de son organisation, de sa répartition et de son échange. Qu’il s’agisse de la production agricole, de l’extraction des matières premières, de la production industrielle, l’évolution s’est poursuivie de façon identique, suivant le même processus, avec des alternatives diverses d’accélération ou de stagnation, selon que les découvertes scientifiques et leurs applications pratiques marchaient, elles-mêmes, à tel ou tel rythme et que le capital les permettait ou les interdisait, par intérêt.
C’est ainsi qu’au début, à l’âge de pierre, par exemple, la production agricole était nulle ou à peu près, que l’extraction des richesses du sol était infime et la production industrielle inexistante. Avec le fer, toutes les productions se sont accrues et la population s’est augmentée, à peu près parallèlement. Lors de la découverte de la vapeur, l’industrie, toute artisanale qu’elle était à l’époque, a fait un pas énorme en avant. L’emploi des combustibles minéraux, la découverte du gaz, celle de l’électricité surtout, l’utilisation du pétrole, de l’essence, du mazout, l’application de procédés techniques sans cesse perfectionnés, ont précipité, à pas de géant, l’évolution de la production industrielle.
Naturellement, l’industrie extractive, la production des matières premières a suivi ce rythme d’évolution.
Bien que la production agricole ait été très longtemps stagnante, que les procédés et instruments de culture ne se soient modifiés que lentement, que la mécanique et l’électricité ne commencent qu’à peine à pénétrer dans les campagnes, dans de nombreux pays déjà fortement industrialisés, il n’en est pas moins certain que depuis un quart de siècle, la production agricole a subi, elle aussi, de profondes transformations et évolue à une vitesse toujours plus grande.
Cette évolution générale de la production s’est d’ailleurs opérée sans plan, en dehors de toutes règles, sans souci des nécessités. Seul, l’égoïsme de chacun des possédants, le désir d’accroître sa propre « réserve » ont présidé à cette évolution désordonnée.
Après guerre, une certaine tendance à l’économie dirigée, de caractère international et d’origine bancaire s’est manifestée. Des grands cartels ont été constitués. La production, bien que fortement contingentée, circulait cependant avec une très grande rapidité, à peine gênée par des barrières douanières relativement peu élevées. Ce fut, pendant quelques années, l’âge d’or. Puis, tout à coup, les difficultés se firent jour. Les conséquences de la guerre produisirent leurs effets, que le capitalisme développa encore, d’une façon désastreuse, par son incompétence et son égoïsme sans intelligence.
La production industrielle, absolument déréglée : pléthorique ici, insuffisante là, cessa brusquement de circuler, en raison de la disparité des méthodes commerciales et bancaires. Un formidable conflit éclata entre l’industrie et la finance, la première voulant secouer le joug de la seconde. Elle y parvint dans nombre de pays et tout spécialement en Angleterre et en Allemagne et son système s’opposa bientôt à celui de la finance. C’est ainsi que, dans chaque pays, s’affirma bientôt une tendance à l’économie fermée, dirigée par les grands industriels.
L’Angleterre instaura une politique d’Empire, l’Allemagne et les pays danubiens s’engagèrent dans la voie d’une économie limitée aux pays centraux de l’Europe, la Russie, isolée, constitua un Centre à part ; le Japon voulut instituer une économie purement asiatique, dirigée par lui et l’Amérique se vit fermer tous les marchés.
Parallèlement à cette situation, aggravée par une série de mesures douanières outrancièrement protectionnistes, le grand patronat industriel adopta une politique de rationalisation des méthodes et moyens de production, faisant de l’homme l’esclave de la machine, alors qu’il aurait dû être libéré par elle.
Toutes ces mesures : économie fermée, élévation des droits de douane, rationalisation irrationnelle, eurent pour conséquence de déclencher la grande crise mondiale, qui dure depuis tantôt dix ans et va constamment en s’aggravant, dont le terme et la solution n’apparaissent pas. Et, une fois de plus, le fait économique prouva sa valeur. En effet, la crise dont il s’agit a pris, très rapidement et partout, le caractère d’une crise de régime qui atteint le capitalisme jusque dans ses fondements.
Ces méfaits sont l’œuvre du troisième agent de la production : le capital, sous toutes ses formes et, principalement, sous sa forme argent.
Soit qu’il se cache, soit qu’il agisse, les résultats de son activité sont toujours néfastes. Pléthorique, il engendre la surproduction, le chômage, la misère, la ruine ; insuffisant, il limite, paralyse et conduit à la famine.
Ceci prouve qu’il y a le plus grand intérêt à libérer de son emprise les deux autres agents : l’ensemble des forces et moyens de production et le travail. Ces deux agents suffisent d’ailleurs à assurer la production ; ils sont naturels, le troisième est artificiel ; l’humanité n’en a pas besoin, pour cultiver, extraire, transformer, constituer des réserves de machines et d’outils, échanger et répartir les produits de son effort, assurer la vie matérielle des individus et celle de la collectivité tout entière. Il faut donc se débarrasser au plus tôt de ce gêneur redoutable, de ce despote. Avec lui, disparaîtront : la propriété, le pouvoir et la contrainte qui assurent bien, eux, le perpétuel malheur des hommes.
Ce sera l’œuvre d’une révolution sociale gigantesque, déjà virtuellement commencée, dont le syndrome est trop évident pour laisser le moindre doute. De son caractère, de son orientation dépendra l’organisation future de la production et, partant, la vie des générations de l’avenir.
Plus que jamais, il appartient aux producteurs manuels et intellectuels, aux prolétaires des champs et de l’usine, aux travailleurs du bureau et de la mine, à tous ceux qui exercent une activité productrice de s’unir, de travailler sur leur plan de classe à la réalisation de ce destin.
Si tous les travailleurs : manuels, techniciens et savants, tous exploités, quoique diversement, par le capital parasitaire, unissent leurs efforts au sein d’un mouvement synthétique de classe, s’ils savent, au préalable, préparer les cadres indispensables à la production ; s’ils sont capables, par un effort puissant et bien coordonné, de la libérer de la pieuvre qui la paralyse, la production assurera son rôle naturel, trouvera son équilibre dans tous les domaines, donnera naissance à la prospérité et au bonheur, permettra à l’homme de jouir pleinement de la vie, dans une société vraiment humaine, dont toute exploitation sera bannie. C’est aux syndicats ouvriers qu’il appartient de préparer et de réaliser cette tâche. De son succès dépend le salut de notre espèce.
— Pierre BESNARD
PRODUCTION (COOPÉRATIVES DE)
La production revêt divers aspects. Elle est individuelle ou collective. Nous envisagerons ici un des aspects de la production collective : celle qui, en matière de production industrielle ou de main-d’œuvre ou agricole, est coopérative.
Les coopératives de production industrielle.
Ces coopératives sont des organisations dans lesquelles les producteurs-travailleurs sont eux-mêmes leurs propres entrepreneurs.
La production a, de tout temps, été plus ou moins coopérative. C’est même dans la production, et spécifiquement la production ménagère ou semi-industrielle, qu’on a le plus pratiqué l’entraide : soit pour construire mutuellement des huttes ou des maisons, soit pour s’aider mutuellement dans les travaux de la terre, de la ferme, ou dans la pêche, etc.
Mais pour trouver des coopératives industrielles de production systématiquement et juridiquement créées, il faut arriver au commencement du XIXe siècle. Fourier a été un des pères de la coopération, en ce qu’il a prédit la constitution des diverses formes coopératives, depuis les plus simples jusqu’aux plus compliquées, et parmi ces dernières les Phalanstères, qui étaient un amalgame des diverses modalités coopératives. Le type le plus parfait de cette dernière vision fouriériste existe au Familistère de Guise (Aisne) où elle a été créée par un disciple de Fourier : J.-B. Godin.
Mais Fourier n’a été qu’un simple théoricien de la coopération. La première coopérative industrielle de production a été fondée en 1831 par Buchez qui, en vertu de ses idées saint-simoniennes, voulut prêcher le mouvement en marchant. A cet effet, il constitua d’abord une coopérative d’ébénisterie, qui échoua rapidement. Mais celle-ci morte Buchez en créa une autre, en 1834, ouvriers bijoutiers en doré, qui ne disparut qu’en 1873, à la suite de la guerre. Buchez voulait faire accéder tous les travailleurs à la propriété « sans toucher au bien des propriétaires actuels et sans avoir recours à aucune des institutions qu’a fondées la charité bâtarde de la philanthropie moderne ». Ce moyen était pour lui l’association dans le travail, un salaire convenable moyen étant réservé aux coopérateurs, l’accumulation des bénéfices des coopératives de production jusqu’à ce que, peu à peu, ces coopératives parviennent à s’emparer de toute la production. Les coopératives à tendances communistes de Buchez ne connurent pas le succès.
Néanmoins, l’avènement de la IIe République détermina un mouvement favorable à ces organisations. Louis Blanc, en haine de la concurrence, fit de la propagande pour elles, et, après l’expérience des ateliers nationaux de 1848 (qui ne fut en rien coopérative), on en revint aux véritables idées de Louis Blanc. Malgré l’opposition de Thiers, qui se manifesta toujours hostile à toute nouveauté, une avance de trois millions fut votée pour permettre des prêts à ces associations. Ces avances furent si bien attribuées, et les travailleurs unis furent si consciencieux que, lorsqu’on fit le bilan de ces associations, on constata qu’elles avaient remboursé à l’Etat 2.500.000 francs, soit presque tout ce qu’on leur avait avancé ; contrairement à ce que disent les détracteurs de toute émancipation ouvrière, 150 associations avaient été fondées. Malheureusement, elles disparurent emportées par la réaction qui fut la conséquence du Coup d’Etat de 1851 ; car les coopérateurs étaient, dans l’immense majorité des cas, des hommes d’avant-garde. Si donc ces coopératives ont disparu, ce n’est point parce qu’elles avaient été mal gérées, c’est uniquement parce que le pouvoir central les a tuées.
Elles étaient si peu décidées à disparaître, qu’en 1849 elles avaient constitué une Fédération nationale qui, 34 ans plus tard, devait s’appeler la Chambre consultative des associations (aujourd’hui : sociétés) ouvrières de production.
Quand l’Empire devint « libéral » (1867), il se constitua un certain nombre d’associations coopératives de production. Mais la guerre de 1870 et la Commune emportèrent la plupart d’entre elles. Lorsque les proscrits de la Commune rentrèrent, en 1881, ils créèrent d’autres sociétés qui, unies à celles qui existaient encore, se réunirent en 1883 en un congrès national au nombre d’une trentaine et décidèrent la création de la Chambre consultative. En 1885, ces coopératives participèrent à l’Exposition du Travail, en y édifiant et y meublant un pavillon tout entier, qui impressionna vivement l’opinion publique et les Pouvoirs constitués. Le décret du 4 juin 1888, établi par Léon Bourgeois, avec la collaboration de Paul Doumer et Charles Floquet, dota les associations ouvrières de leur premier statut légal. Ce statut a été amélioré en 1920 et il est en instance devant le Conseil d’Etat pour des améliorations nouvelles.
En pleine guerre, le 18 décembre 1915, vote de la loi organique de la coopération de production et des fonds de dotation pour ces associations. Elle a été incorporée en 1927 dans le Code du Travail. Les adversaires des sociétés coopératives de production les représentent comme des gouffres dans lesquels disparaîtraient les richesses du pays. En vérité, depuis l’arrêté ministériel du 15 novembre 1908 jusqu’au 31 décembre 1930, les coopératives de production ont bénéficié de 1.017 prêts ou avances s’élevant à 33.254.000 francs, sur lesquels 18.641.095 francs ont été remboursés. Les pertes ? 510.724 francs, soit à peine 2,60 p. 100 de l’argent prêté.
Actuellement, il existe en France 340 coopératives de production, d’industries diverses, adhérant à la Chambre consultative. Elles ont fait, en 1930, environ 210 millions de francs d’affaires. A côté, non adhérentes, 263. Ces 603 coopératives ouvrières groupaient, en 1930, environ 23.000 associés, ayant fait environ 400 millions de francs d’affaires. (D’après les statistiques du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, il existerait 589 coopératives ouvrières de production, dont 564 ont répondu à l’enquête préfectorale permanente. D’après ces statistiques, ces coopératives se répartiraient de la manière suivante : pêcheurs et jardiniers, 11 ; mines et carrières, 9 ; alimentation, 8 ; bois, liège, vannerie, tabletterie, 55 ; industries chimiques, 3 ; industries textiles, vêtements et toilette, 31 ; métaux, 49 ; travaux publics et bâtiment, 250 ; travail des pierres, verrerie, 31 ; industries du livre et du papier, 69 ; cuirs et peaux, 10 ; transports et manutention, 26 ; divers, 12.)
A côté de la Chambre consultative, et avec des Conseils d’administration distincts :
-
la Banque coopérative des Sociétés ouvrières de production, qui fait des avances aux sociétés et escompte leur papier ;
-
l’Orphelinat de la Coopération de production, qui aide les orphelins des sociétaires et possède une maison de vacances à Chalo-Saint-Mars, dans la grande banlieue parisienne ;
-
la Maison de retraite de Chalo-Saint-Mars, pour les vieux coopérateurs sans famille ;
-
la Caisse de compensation qui attribue des allocations familiales.
En outre, la Chambre consultative possède un service de contentieux et d’assurances et un journal bimensuel, l’Association ouvrière, qui défend les thèses du mouvement.
La Chambre consultative s’attache à appliquer la formule fouriériste, grâce à quoi on établirait l’harmonie entre le Capital, le Travail et le Talent. Pour le surplus, les coopératives de production s’attachent à réaliser la formule proudhonienne de responsabilité et de liberté dans l’association : « Que le salaire soit proportionné à la nature de la fonction, à l’importance du talent, à l’étendue de la responsabilité. Que tout associé participe aux bénéfices comme aux charges de la compagnie, dans la proportion de ses services. Que chacun soit libre de quitter à volonté l’association, conséquemment de faire régler son compte et liquider ses droits, et réciproquement la compagnie est maîtresse de s’adjoindre toujours de nouveaux membres. » D’autre part, les associations ouvrières travaillent à l’abolition du salariat en réalisant la formule de Charles Gide :
« L’abolition du salariat sera simplement la substitution de la démocratie industrielle au patronat et l’abolition du profit par la suppression de tout prélèvement parasitaire sur le produit du travail. »
Programme ambitieux, objectera-t-on, mais pour quelles réalisations ! Il est vrai que les associations ouvrières de production n’ont pas encore pris dans l’Economie nationale, et dans l’Economie mondiale, la place éminente que ses protagonistes aspirent la lui voir s’attribuer. (Néanmoins, les coopératives industrielles de production, adhérentes à l’Alliance coopérative internationale, sont actuellement au nombre de 1.071 groupant 133.000 sociétaires, disposant d’un capital de 225.000.000 francs et ayant fait, en 1931, pour 950.000.000 francs d’affaires.) Mais il serait injuste de juger une méthode d’action aux simples résultats matériels du début. Et, en effet, si les coopératives de production n’ont pas encore, et il s’en faut, englobé dans leur activité toutes les entreprises, malgré tout, elles ont libéré un nombre respectable de salariés des inconvénients du salariat et, à ce titre, elles sont des facteurs éminents au point de vue social.
Le lecteur curieux de l’histoire et de l’évolution de ces coopératives lira avec plaisir et profit, notamment : La Societa coopérative de produzione, d’Ago Rabbena et les Cours sur les Associations coopératives de production, au Collège de France, par Charles Gide (1922–1923). Dans leurs ouvrages, ces auteurs étudient ces coopératives sous leurs aspects les plus variés, leurs statuts, les formes diverses (depuis celles à forme autonome jusqu’à celles à forme semi-capitaliste, en passant par celles à forme socialiste et syndicaliste). Parmi les premières, une qui a mal tourné, celle des Lunetiers ; deux dans lesquelles le directeur a autant d’autorité sur les associés qu’un véritable patron : celles des Ferblantiers réunis et celle des Charpentiers de Paris. D’ailleurs, cela n’a pas empêché ces dernières de réussir supérieurement.
Parmi les coopératives du type syndical, l’Association des Tapissiers de Paris ; celle des Fabricants de voitures et la vieille Verrerie ouvrière d’Albi qui, depuis 1930 est devenue une véritable association ouvrière, et non plus une Verrerie ouvrière, ainsi que l’avaient voulu Pelloutier, Hamelin et Yvetot. Parmi les sociétés à type socialiste (d’un socialisme économique), celles qui reçoivent des avances des coopératives de consommation, des communes, de l’Etat, pour fournir un travail déterminé. Mais nous en parlerons à propos des coopératives de main-d’œuvre. Parmi les coopératives ouvrières à caractère semi-capitaliste, la vieille maison Leclaire, fondée par Leclaire, en 1826. Cette société est très hiérarchisée, afin de sélectionner les associés qui parviendront au sociétariat et à la Direction dans la mesure où ils auront donné des gages de dévouement à l’œuvre commune. Leclaire était un patron fouriériste qui commença, en 1842, à instituer dans son entreprise, la participation du personnel aux bénéfices. Pour cela, il fut l’objet de la méfiance de ce personnel et faillit même être jeté en prison pour application d’idées « subversives ». Il s’en tira en affectant de donner à cette répartition des bénéfices un caractère philanthropique, et non point social, comme il le voulait. En 1869, la Société de secours mutuels de la maison Leclaire (aujourd’hui Laurent, Fournier et Cie) devint la propriétaire de tout l’avoir social et, de ce chef, aujourd’hui, tous frais payés, les bénéficiaires de l’entreprise sont les retraités de la maison. Leur retraite est fonction de l’âge et des années de présence dans la société.
Le Familistère de Guise est devenu, de par la volonté de son fondateur, J.-B. Godin, une entreprise coopérative du même genre. Elle est très importante, puisqu’elle produit, bon an, mal an, pour 200 millions d’appareils de chauffage.
Les obstacles au développement des coopératives de production résident dans la direction, dans les difficultés à trouver de la clientèle et du capital. Voilà pourquoi, barrées du côté du public qui ne les voit pas toujours avec sympathie, les coopératives ouvrières se sont retournées vers l’Etat pour lui demander des commandes, des prêts à faible intérêt. Ce n’est qu’au prix de grands efforts qu’elles ont pu obtenir tout cela. Un régime satisfaisant d’attribution de contrats gouvernementaux ne fonctionne en leur faveur que depuis octobre 1931.
En Angleterre, les socialistes chrétiens, avec Hingsley, Maurice, Ludlow, Hughes et Vansittart-Neale se mirent à la tête du mouvement coopératif de production industrielle, à la suite d’un voyage de Ludlow en France, à Paris en 1848. Ils eurent à lutter énergiquement contre toutes les puissances établies pour faire adopter leurs idées, presque autant que Robert Owen pour ses entreprises communistes du commencement de ce même siècle. La caractéristique des coopératives ouvrières anglaises était de ne pas faire appel à l’Etat. En fait, ce mouvement n’a pas plus réussi (économiquement) en Angleterre qu’en France ; mais, moralement, il a aussi donné des avantages intéressants.
Toutefois, il faut signaler une curieuse évolution que suit la coopération de production industrielle en Grande-Bretagne, et même en France. Il arrive assez souvent que ces coopératives disparaissent ; mais non point sans laisser de traces. Elles sont absorbées par les magasins de gros des coopératives de consommation, dont elles deviennent, dans ce cas, des rouages internes, sans que, d’ailleurs, la condition des anciens associés soit diminuée matériellement. Leur liberté n’est pas davantage altérée ; tandis que leur sécurité est augmentée.
A ce point de vue, le lecteur curieux des avantages comparés de la production autonome (par les coopératives ouvrières) et de la production fédéraliste (par les magasins de gros des coopératives de consommation) lira avec profit la thèse que notre regretté ami Claude Gignoux, mort directeur de la « Laborieuse », de Nîmes et président de l’ « Union des coopérateurs du Gard », a soutenue dans l’Almanach de la Coopération française pour 1909. Elle peut se résumer en ceci : ces deux modalités de la production coopérative présentent, l’une et l’autre, des avantages incontestables. Mais la production autonome ne peut être utilement tentée que dans la petite industrie ou dans les professions où la maind’œuvre reste la partie essentielle de l’exploitation (maçons, serruriers, charpentiers, peintres, imprimeurs, etc.). La production fédérale est surtout du ressort de la grande industrie, elle doit essentiellement viser la production des denrées de grosse consommation : minoteries, biscuiteries, savonneries, chaussures, vêtements, etc.
Les services de production des magasins de gros anglais occupaient, en 1930, 34.466 personnes dans les usines de tissage, de chocolaterie, de boucherie, de charcuterie, de margarinerie, de savonnerie, de meunerie, de brasserie, de cycles, motos et autos, de poteries, de véneries, d’ameublement, dans la mine de charbon, sur les navires, etc., etc. La même année, tout le personnel administratif et productif comptait 41.205 employés ayant touché 690.385.320 francs de salaires. Le chiffre total du magasin de gros anglais avait été de plus de 10 milliards et demi et la plupart des marchandises vendues par le dit magasin de gros à ses sociétés provenait de ses usines de production. Ce sont là des chiffres impressionnants.
Coopératives spéciales de production.
Il existe un certain nombre de coopératives spéciales, qui relèvent, certes, de la production, mais dont certaines n’ont rien d’ouvrier. La plus célèbre, sinon la plus âgée, la Comédie Française, date de 1643. Charles Gide cite des coopératives d’acteurs de café-concert, à Marseille ; d’auteurs de feuilletons pour journaux ; de coopératives artistiques. Ces années dernières, il s’est créé à Paris la coopérative des Comédiens associés.
De ces coopératives artistiques, il convient de rapprocher celles de travail ou de main-d’œuvre. L’origine de ces sociétés paraît être en Italie, où elles sont appelées coopératives de « braccianti ». Les braccianti sont des ouvriers ne possédant que leurs bras et qui comprennent la nécessité de devenir leurs propres entrepreneurs. Elles remontent à près d’un demi-siècle. La première fut fondée à Ravenne, la patrie de Dante. Lorsque des Communes, des Provinces, ou même l’Etat, ou des particuliers veulent faire exécuter des travaux de desséchement de marais, d’irrigation, de drainage, construire des canaux, des voies ferrées, des routes, ou produire diverses marchandises, ces coopératives de main-d’œuvre ou de travail interviennent et se substituent à l’entrepreneur qui, auparavant, faisait suer la main-d’œuvre ouvrière à son profit. Le roi d’Italie souscrivit, à titre d’exemple, la plus grande partie du capital de la première coopérative de main-d’œuvre. Son succès a été complet, puisque, actuellement, il y a, en Italie, plus de 3.000 coopératives de braccianti, groupées en 65 fédérations régionales, groupées elles-mêmes en une fédération nationale. Avant la guerre, le ministre Luzzatti inaugura une ligne de chemin de fer d’une trentaine de kilomètres, de Ciano à Reggio-Emilia, entièrement équipée et exploitée par des coopératives de braccianti et sur laquelle les trains partaient et arrivaient à l’heure. En France, il existe aussi quelques coopératives de travail pour le chargement et le déchargement des navires, notamment dans les ports de La Pallice, de Saint-Nazaire, du Havre, et pour la manutention des colis dans les gares de Paris-Etat et à la gare maritime de Calais. De tout temps, ces coopératives ont été fort bien vues par les économistes orthodoxes, notamment par Yves Guyot (qui pourtant n’aimait guère les coopératives). Et certains gros magnats de l’industrie envisagent, comme Ford par exemple, de traiter avec elles pour des fournitures de pièces détachées qui seraient assemblées dans l’usine centrale. Il y aurait, grâce à la distribution à bas prix (coopérative) du courant électrique, la possibilité de décongestionner les grandes entreprises industrielles en les transportant partiellement vers les campagnes, qui seraient à nouveau animées.
Au surplus, les regrettés Frédéric Brunet et Charles Gide ont soutenu qu’un jour viendrait où tous les rouages des communes, des départements et de l’Etat pourraient être confiés à des coopératives de travail, qui les géreraient sous leur propre responsabilité. Si ce système se généralisait — et il devrait l’être, ne serait-ce que pour rendre les fonctionnaires responsables — la coopération de travail prendrait en France (et ailleurs) une importance que peu de personnes ont soupçonnée jusqu’ici. D’ailleurs, le Journal Officiel est entré dans cette voie par le système de la commandite d’atelier, particulièrement étudiée par Yvetot.
Parmi les populations ouvrières, il est une catégorie de travailleurs tout particulièrement exploitée : celle des marins pêcheurs, en raison de leur inorganisation. Les marins pêcheurs sont inorganisés, parce que trop souvent ignorants et alcooliques. Depuis plusieurs années, le Crédit maritime a été organisé pour permettre à ces travailleurs de s’émanciper en s’outillant rationnellement pour la pêche. Malheureusement, une fois le poisson pêché, il reste à vendre. Les mareyeurs interviennent alors et le payent bon marché aux pêcheurs, quitte à le revendre cher aux consommateurs. C’est alors que des hommes dévoués sont intervenus et, grâce à la Direction des pêches maritimes, du Service scientifique des pêches, du Crédit maritime mutuel et des fonds de l’Outillage national, ils sont en train d’édifier dans les ports des Sables-d’Olonne, de La Rochelle, d’Arcachon et de Saint-Jean-de-Luz, des chambres froides et des magasins d’expédition dans lesquels les sardines fraîches congelées à 14° au-dessous de zéro, seront conservées en attendant d’être expédiées dans les centres de consommation, et notamment dans les coopératives de consommateurs.
Dans ses cours au Collège de France, Charles Gide a exposé les résultats remarquables obtenus dans ce sens par les 50 « positos maritimos » espagnoles pour la pêche et la vente coopérative du poisson et par les 275 coopératives maritimes de pêcheurs italiens. Ces dernières collaborent avec les municipalités pour l’écoulement du produit de leur pêche.
N’oublions pas, en terminant, les coopératives de travail qui, sous le nom d’artèles, existent en Russie, depuis un temps immémorial, pour la production coopérative des objets de la petite industrie familiale et dont le rôle n’est pas encore terminé, malgré les promesses du fameux Plan quinquennal, renforcé lui-même par un deuxième Plan quinquennal...
Les coopératives agricoles de production.
Le paysan est, instinctivement, rebelle à l’association, parce qu’il considère que lorsqu’il s’associe avec d’autres, il n’est plus libre et, dès lors, sa liberté étant diminuée, il se sent amoindri. Il est fidèle au vieux proverbe : « Qui a un associé a un maître. » Néanmoins, dans une société compliquée comme l’est la société moderne, le paysan ne pouvait guère échapper à la pratique inéluctable de la solidarité. Car un autre proverbe : « Malheur à l’isolé » est toujours d’actualité.
L’association, chez les agriculteurs, se manifeste sous trois formes essentielles : le syndicat, la mutuelle, la coopérative. (Voir notamment le cours de Charles Gide au Collège de France, sur les Associations coopératives agricoles, décembre 1924-mars 1925.)
Le syndicat agricole, comme le syndicat ouvrier, a été, à l’origine, un groupement de défense professionnelle des agriculteurs. Les syndicats agricoles étaient déjà en puissance dans la loi des associations syndicales entre propriétaires voisins et chargées d’exécuter des travaux d’intérêt commun, et même d’intérêt général, tels que desséchements, irrigations, drainages, digues contre les inondations. Mais le véritable statut légal des syndicats agricoles professionnels fut établi par la loi du 21 mars 1884, qui légalise les syndicats chargés de la défense des intérêts économiques, industriels et commerciaux. Les agriculteurs allaient être oubliés lorsqu’ un sénateur droitier du Doubs, M. Ondet, demanda qu’on ajoutât « et agricoles », et les agriculteurs purent bénéficier, eux aussi, des avantages de l’association syndicale professionnelle.
Généralement, et notamment à l’origine, ces syndicats agricoles ont borné leur activité à des buts strictement professionnels, de défense et de propagande corporative. Ils ont publié des journaux à cet effet. Mais, peu à peu, ils ont compris que leur activité devait être organique. A cette époque, les agriculteurs étaient odieusement exploités par des mercantis qui, profitant des conseils que donnait la presse agricole d’utiliser les engrais pour améliorer le rendement des terres, abusaient de leur candeur pour leur vendre des engrais de mauvaise qualité à des prix excessifs. Mêmes procédés blâmables en ce qui concerne les semences et, en général, tous produits, matériaux et cheptels nécessaires à l’exercice de la production agricole. On peut affirmer, sans crainte de se tromper, que les excès du commerce privé ont été, pour une large part, les responsables du succès des syndicats agricoles. Depuis 1884 à nos jours, ce succès n’a fait que s’affirmer, et, maintenant, la plupart des agriculteurs sont groupés dans leurs organisations syndicales, qui deviennent de plus en plus complexes. En effet, à côté des services syndicaux proprement dits, il s’est greffé le plus souvent sur eux des organisations diverses, tendant à renforcer la position des syndiqués. Ce sont les Caisses agricoles mutuelles de crédit, qui avancent à bon compte des fonds aux agriculteurs désireux d’emprunter : soit pour acheter de la terre, soit pour faire bâtir, soit pour perfectionner l’outillage ou le cheptel de la ferme, soit pour acheter des engrais, soit même pour attendre le moment favorable de vendre les récoltes engrangées. D’autre part, le paysan est tenu, s’il est tant soit peu prévoyant, de s’assurer contre l’incendie de sa ferme, de ses récoltes, contre la mortalité du bétail, contre la grêle, contre les accidents à son personnel et à son cheptel, contre la maladie, la vieillesse (assurances sociales).
Or, au début, les grandes compagnies capitalistes d’assurances et de crédit affectaient de mépriser cette clientèle « peu intéressante » qui, se voyant dédaignée par ces grandes puissances capitalistes, a dû faire ses affaires elle-même en créant des institutions ad hoc. (Voir l’article de M. Patier, dans la Correspondance coopérative de septembre 1931, sur les rouages de la Fédération nationale de la Mutualité et de la Coopération agricoles et leur fonctionnement.) Actuellement, cette Fédération groupe près de 600 organisations pour la plupart à cadre départemental ou régional, représentant elles-mêmes près de 20.000 associations locales, dépassant plus d’un million d’agriculteurs adhérents. Chose curieuse, les grandes puissances d’assurances et de crédit qui, à l’origine, se moquaient des agriculteurs assez audacieux pour vouloir participer à une vie solidariste, recherchent, maintenant que ces organisations agricoles mutuelles ont fait leurs preuves, la clientèle de ces organisations, ou en combattent sournoisement certaines, jusqu’au jour où, la preuve étant faite de leur vitalité, elles rechercheront — trop tard — leur clientèle ...
Au début, lorsque les agriculteurs achetèrent des produits en gros (pour bénéficier d’avantages à l’achat et au transport), ils se répartirent ces produits en gare, « à la bonne arrivée », de manière à réduire les frais généraux au strict minimum. Mais, peu à peu, lorsque le nombre des acheteurs augmenta, et surtout des petits agriculteurs ne disposant parfois pas de la place nécessaire à l’entreposage de ces produits, les syndicats agricoles durent stocker les excédents des produits répartis « sur wagon », quitte à les majorer quelque peu, pour couvrir les frais de manutention et de stockage. Ils pensaient ne point mal faire en agissant ainsi. Les adversaires de l’émancipation paysanne les firent poursuivre devant les tribunaux pour « abus de fonction ». Effectivement, l’entreposage et la manipulation des produits pour la ferme dépassaient le cadre de la loi du 21 mars 1884. Les agriculteurs contournèrent ces difficultés en constituant des coopératives agricoles qui, pour commencer, s’attachèrent le plus souvent à répartir les produits nécessaires à l’exercice de la profession agricole. Mais, logiquement, ayant acheté à leur coopérative agricole de la graisse pour les sabots des animaux, de la paille mélassée, des tourteaux pour les animaux de la ferme, ils en vinrent, par assimilation, à demander à cette coopérative du saindoux et de la margarine, du sucre, des légumes, du café, de l’épicerie pour le personnel de la ferme et ces coopératives, strictement agricoles au début, devinrent, par la force des circonstances, des coopératives générales de consommation, au grand dam des commerçants qui voyaient leur activité s’étendre.
Mais ce n’est pas tout de s’approvisionner à bon compte, d’obtenir du crédit à bon compte, et de produire des denrées dans de meilleures conditions. De tout temps, entre le producteur paysan et le consommateur, des intermédiaires se sont glissés, dont la mission a été de payer les denrées agricoles le meilleur marché possible au producteur pour les transformer et pour les vendre le plus cher possible au consommateur, une fois transformées. Et, parmi les consommateurs, des mêmes producteurs de denrées agricoles qui, par làmême, sont exploités au double titre de producteur et de consommateur. L’idée devait donc venir aux agriculteurs de vendre et de transformer eux-mêmes les denrées produites sur leurs fermes.
Les coopératives de vente ont obtenu des résultats remarquables, là où les associés sont capables de se discipliner. Le principal obstacle qui se dresse devant eux est la déplorable habitude qu’ont certains agriculteurs de « farder » les colis de légumes et de fruits ; c’est-à-dire de placer à la surface des colis des légumes et des fruits irréprochables, tandis que ceux du dessous sont de mauvaise ou de deuxième ou de troisième qualité. Heureusement, bien des syndicats ou coopératives agricoles luttent délibérément contre ces tristes pratiques qui ruinent la confiance des acheteurs dans les expéditions non contrôlées de primeurs. Les primeurs en provenance notamment des coopératives agricoles de l’Afrique du Sud, de Californie, du Canada, d’Italie, etc., se font remarquer par la correction avec laquelle les qualités expédiées correspondent aux qualités promises. Ces organisations sont arrivées à ce louable résultat en pénalisant sévèrement et impitoyablement les producteurs qui se permettent de farder les colis. En Italie, tout colis fardé est culbuté ; son contenu livré aux gamins et le fraudeur puni. Dans la plupart de ces pays, l’expédition des primeurs appelle à son aide les entrepôts, les wagons et les navires frigorifiques. En outre, les colis sont munis d’étiquettes représentant exactement les primeurs qu’ils contiennent et portent, à côté du nom de la coopérative expéditrice, le nom de l’expéditeur-producteur.
En plus des primeurs (fruits et légumes), les coopératives de vente expédient des fleurs, des oeufs, du lait, des lapins, de la volaille, de la laine, du coton, du tabac, des céréales, du bétail, des poissons (des Dombes ou des Mers). Les coopératives céréalières des Etats-Unis, du Canada, de l’Australie ont rendu de précieux services aux producteurs de blé de ces pays, malgré la crise grave qui, ces années dernières, a sévi, et sévit encore chez les céréaliers de tous pays.
Les coopératives agricoles de production proprement dites ne datent pas d’hier. Elles sont, elles aussi, les filles de la nécessité. De temps immémorial, elles existent dans les montagnes du Jura et de la Savoie où, pour fabriquer les fromages de ces régions, il fallait, il faut mettre en œuvre de grandes quantités de lait. D’où nécessité de réunir, au même lieu et au même moment beaucoup de lait. Dans ces conditions, les vaches sont, certes, stabulées chez leurs propriétaires ; mais, durant les journées d’hiver et durant la bonne saison, elles sont confiées à des gardiens qui les rassemblent et qui travaillent leur lait pour la production du fameux fromage de gruyère et des tomes de Savoie, lesquels sont fabriqués dans des fruitières coopératives. Il est vrai que, dans certains cas, des fromagers capitalistes achètent le lait des vaches et les paysans qui se débarrassent du souci de le traiter expient cruellement leur manque d’initiative, en ne touchant de leur lait que des prix de famine.
C’est par dizaines de milliers qu’on trouve dans le monde des beurreries-laiteries coopératives, généralement appelées laiteries, du nom sans doute du produit qui y est traité. Les premières de ces laiteries datent du commencement du XIXe siècle, dans le canton de Vaud (Suisse). Puis, elles se développèrent en Italie et, de là, elles passèrent en 1880 au Danemark, où elles ont pris un essor vraiment remarquable. Mais, de 1870 à 1880, les vignobles des Charentes et du Poitou furent ravagés par le phylloxéra. Les paysans de cette région étaient ruinés. Ils remplacèrent leurs vignes par des prairies sur lesquelles les vaches vivaient, mais le lait de ces vaches était maigrement payé par les industriels qui daignaient acheter le lait des paysans pour le transformer en beurre.
C’est alors qu’un modeste instituteur nommé Biraud eut l’idée géniale d’inviter ses compatriotes à constituer une laiterie coopérative qui a été un exemple fécond pour les agriculteurs non seulement de la région, mais encore pour ceux de la France entière. Ces laiteries coopératives se sont fédérées et, de nos jours, elles groupent environ 130 sociétés, comptant 75.000 membres, propriétaires de 200.000 vaches produisant environ 15 millions de kilos de beurre par an. L’exemple des agriculteurs des Charentes et du Poitou a été imité ailleurs, au point qu’aujourd’hui, il existe en France 300 laiteries coopératives qui rémunèrent convenablement l’effort de leurs sociétaires. Au point de vue technique, ces laiteries coopératives ont réalisé de grands progrès. D’abord, le lait est écrémé et travaillé tous les jours. De cette façon, la crème du lait fournit un beurre jamais rance, mais qui, au contraire, a un très agréable goût de noisette. Pour obtenir cet appréciable résultat, les laiteries coopératives ont discipliné leurs adhérents. Ces derniers payent une cotisation grâce à quoi ils assurent le salaire d’un agent qui se promène dans les champs des sociétaires et qui les met à l’amende s’il trouve dans ces champs des herbes qui, mangées par les vaches, pourraient communiquer un mauvais goût au lait fourni à la laiterie coopérative. L’ail est l’herbe la plus redoutable et la plus redoutée. Les laiteries coopératives possèdent des installations scientifiques remarquables. Le beurre fait, elles l’évacuent rapidement, en des wagons frigorifiques (appartenant à la Fédération) qui l’apporteront sur le marché de Paris ou anglais. Les laiteries coopératives sélectionnent le bétail qui produira le lait. Elles le font en agissant sur les taureaux d’une part et sur les vaches laitières d’autre part.
Un autre avantage des laiteries coopératives consiste dans l’utilisation des sous-produits. Lorsqu’on a extrait la crème du lait pour en faire du beurre, il reste encore le petit-lait dans lequel il y a encore des matières grasses et azotées. Souvent, en Danemark notamment, ce petit-lait est rendu aux agriculteurs au prorata de leurs apports laitiers. Il sert à engraisser des porcs, mélangé notamment avec de la farine de soja, légume d’Extrême-Orient. Ces porcs sélectionnés, adaptés à la production du bacon, lard maigre très apprécié des Anglais, sont expédiés surtout en Grande-Bretagne qui fournit d’énormes débouchés à la production des abattoirs coopératifs danois. D’autres fois, le petit-lait dont l’écrémage n’a point été trop « poussé » sert à fabriquer du fromage plus ou moins maigre. D’autres fois encore, par des procédés spéciaux, il sert à produire de la caséine, qui fournit des produits alimentaires « reconstituants » ou qui sert à fabriquer des objets divers pour lesquels on se servait auparavant d’ivoire, d’écaille, de celluloïd.
Les caves coopératives ont pris une importance vraiment inattendue, étant donné l’esprit férocement individualiste des producteurs de vin, et surtout des viticulteurs français. La première cave coopérative a été constituée en 1869, en Rhénanie et, en France, au commencement de ce siècle, à la suite de la mévente des vins, dans l’Hérault. Parce que le raisin des propriétaires est mis en commun et travaillé dans de bonnes conditions, il rend davantage de vin, qui est meilleur que celui produit par des procédés primitifs. D’autre part, les acheteurs étant certains de trouver dans les caves coopératives des vins de qualités constantes, « typisés », ces dernières le vendent mieux que ne le feraient de petits vignerons isolés, sans défense. Les caves coopératives se sont tellement développées dans les régions vinicoles de France, notamment des cinq départements gros producteurs de vin que, dans quelques années, le vin produit dans cette région ne le sera que coopérativement. Un jour viendra même où les caves coopératives, à la recherche de nouveaux débouchés pour les produits de la vigne, s’occuperont d’abord d’écouler les raisins de table de leurs adhérents, puis de fabriquer des jus de raisins pasteurisés, des sirops, des confitures, des gelées, des marmelades, des concentrés, des miels, des « saucissons », des « nougats » de raisins (simples et composés). Même, avec les marcs frais du pressurage des raisins, ils pourront fabriquer de délicieuses confitures stabilisées de raisins (procédé Monti) qui reviendront bon marché. En attendant, le marc du raisin des caves coopératives est « lavé » pour en extraire les dernières traces de vin qui, distillées, fournissent de l’alcool ; il est ensuite desséché et comprimé pour devenir tourteau pour la nourriture du bétail, ou encore engrais pour la vigne. Mais les caves coopératives ont réussi à séparer les pépins des raisins restant dans le marc et ces pépins, broyés et traités par le sulfure de carbone, fournissent 3 à 4 p. 100 du poids du raisin d’une huile excellente pour graisser les machines et les moteurs d’aviation. Mais comme le graissage des machines et moteurs n’absorberait point toute cette huile, une bonne partie est transformée en savon.
Si bien qu’on peut dire de mes compatriotes à peu près ce qu’on dit des Napolitains qui, avec une pastèque, mangent, boivent et se débarbouillent :
« Les viticulteurs, avec leur raisin, mangent, boivent et se débarbouillent. »
Mais ce n’est pas tout, pour des agriculteurs, de produire ; il faut écouler leurs denrées. Les intermédiaires les guettent pour les exploiter. Voilà pourquoi un certain nombre ont créé des meuneries coopératives pour transformer eux-mêmes leur blé en farine et la vendre. D’autres ont créé des sociétés d’élevage du bétail qui louent en bloc des montagnes entières, des « alpages », où ils mèneront paître leur bétail qui, ensuite sera abattu dans des abattoirs industriels.
Il existe encore des formes très nombreuses de coopératives agricoles de production : des huileries coopératives, des coopératives pour la collecte, la préparation et la vente du tabac (tabacoops) d’Algérie, de Bulgarie, de Roumanie, etc. ; des tomacoops (d’Algérie) pour la fabrication de conserves de tomates, de confitures, de sirop de raisin ; des distilleries coopératives de betteraves, de pommes de terre, de fleurs ; des confitureries et des conserveries coopératives. Lorsque les fruits et les légumes sont vendus à vil prix, les producteurs transforment les excédents en conserves ou en confitures, notamment à Perpignan (Pyrénées-Orientales) et à Echevannes-Saint-Marcel (S.-et-L.). Dans le Var et les Alpes-Maritimes, il existe plusieurs coopératives pour la fabrication des essences de fleurs de la région.
D’autres coopératives se créent un peu partout, sur le type des sociétés d’intérêt collectif agricoles, préconisées par M. Alfred Nast, l’auteur du Code de la Coopération, pour produire et utiliser l’électricité à la campagne. Quelquefois, elles se bornent à l’acheter en gros et à la répartir. Elles sont alors des coopératives de consommation. D’autres la répartissent entre les sociétaires des coopératives d’outillage agricole, qui défoncent et labourent les terres de leurs associés.
Dans son Cours d’Economie politique, Charles Gide évaluait, en 1929, à 5.000 environ le nombre des coopératives agricoles recensées en France. Parmi elles, 2.072 laiteries, beurreries, caséineries et fromageries, 628 caves et distilleries, 559 meuneries et boulangeries, 47 huileries, 1.069 coopératives de battage et d’utilisation de matériel agricole, 293 d’achat en commun et diverses.
Dans la Correspondance coopérative de février 1932, M. Pierre Moreau, délégué technique de la Fédération nationale de la Mutualité et de la Coopération agricoles, estimait que, depuis, le nombre de ces coopératives n’a cessé d’augmenter et que lorsque la Caisse nationale de Crédit agricole aura mis à jour sa statistique détaillée des coopératives agricoles, ces dernières atteindront sans doute le nombre de 6.000.
Et il en est des coopératives agricoles comme des assurances agricoles. Au début, le grand capitalisme des Intérêts économiques a affecté de les mépriser ; mais maintenant que ces coopératives tendent, par leur simple et rationnel développement, à se substituer aux transformateurs de denrées agricoles, ces mêmes grands Intérêts économiques s’attachent à leur mener la vie dure. Ils réussissent assez souvent à paralyser leur activité, sous divers prétextes ; ainsi, tandis que la Coopération agricole s’efforçait d’entrer en relations directes et organiques avec la Coopération de consommation, grâce à un statut de coopératives mixtes (proposition de loi Chanal), les adversaires de ces institutions ont réussi à « mettre en carafe » à la Chambre, cette proposition de loi votée par le Sénat.
De même, ils ont réussi à « mettre en carafe » devant la Chambre le Statut légal des coopératives agricoles de production.
L’Alliance coopérative internationale ne groupe malheureusement pas toutes les coopératives agricoles du monde. Néanmoins, elle réunissait dans son sein, au commencement de cette année, plus de 24.000 de ces sociétés, groupant 1.380.000 membres, avec un capital de 325 millions de francs et ayant fait, en 1931, 9.400 millions de francs d’affaires.
A côté des coopératives agricoles de production proprement dites, il existe en Italie, nous l’avons vu, déjà, des coopératives de braccianti. Elles ont supérieurement aidé l’Italie à détruire et à exploiter les fameux latifundia (grosses propriétés non cultivées et qui ont, dès la Rome ancienne, « perdu l’Italie »). Mais si ces coopératives de travail s’occupent surtout d’équiper des terres et même d’édifier des fermes, lorsque ces dernières sont en état de produire, des coopératives d’affermage se substituent à elles, qui exploitent les terres équipées, et payent une redevance aux propriétaires individuels ou aux collectivités propriétaires. Il semble qu’il existe actuellement environ 100.000 hectares équipés et travaillés coopérativement en Italie. De grands espaces sont cultivés par des coopératives d’affermage d’anciens combattants qui, notamment, en Toscane, près de Pise, ont fait des travaux remarquables de desséchement et d’équipement. Mais si M. Mussolini a sérieusement encouragé ces coopératives, n’oublions pas que, pour asseoir son régime, il a détruit de nombreuses maisons du peuple, qui donnaient asile à beaucoup de ces sociétés. Les éléments les plus vivants parmi elles se sont réfugiés en France, à l’avènement du fascisme. Ces coopératives de braccianti se sont reconstituées et ont entrepris des travaux sur les voies ferrées et ont donné toute satisfaction aux compagnies et sociétés qui ont utilisé leurs services.
Par ailleurs, en Europe centrale et orientale, de très nombreuses coopératives agricoles se sont créées pour permettre aux paysans à qui la terre a été donnée de l’exploiter : d’intensifier leur production (par l’adoption de procédés de culture perfectionnés), de mieux transformer, de mieux vendre et de mieux utiliser le produit de leurs récoltes. C’est là-bas, dans le désarroi total d’après-guerre, que les paysans ont pu apprécier les mérites de la coopération en agriculture.
Les Coopératives mixtes de producteurs et de consommateurs.
Depuis qu’il existe des coopératives agricoles de production et des coopératives de consommation (avec leurs magasins de gros), il ne manque pas de militants pour déclarer que les premières doivent vendre directement les denrées qu’elles produisent aux organisations coopératives de consommateurs. Le champion principal de cette tactique a été, à travers le monde, le Docteur V. Totomiantz, ancien professeur à l’Université de Moscou, organisateur éminent des coopératives russes avant la guerre. Il a même parcouru le monde pour prêcher cet accord indispensable. Malheureusement, si des relations de cette sorte se sont établies entre les coopératives agricoles irlandaises, danoises et les anglaises, et en Allemagne aussi, malheureusement, en bien d’autres pays, il n’en a pas été de même. C’est alors que nous avons préconisé, dès après la guerre, la création de coopératives mixtes de producteurs et de consommateurs. Ces hommes groupés dans les mêmes coopératives, sentiraient, dès lors, qu’ils ont les mêmes intérêts et pourraient aisément mieux s’entendre. Malheureusement les juristes ont estimé que l’entente serait plus facile si une loi intervenait pour régler ces accords organiques. Nous avons vu que sous la pression des grands Intérêts économiques, la Chambre n’a même pas discuté la proposition de loi Chanal, votée par le Sénat, à la demande notamment de deux anciens ministres de l’Agriculture, MM. le Docteur Chauveau et Fernand David, et qui avait été préconisée comme base d’action pratique par la Fédération nationale de la Mutualité et de la Coopération agricoles et par la Fédération nationale des Coopératives de consommation.
Cette proposition a été reprise par les grandes organisations coopératives internationales, notamment aux congrès de l’Alliance coopérative internationale de Bâle, de Stockholm, de Gand et de Vienne. Grâce à feu Albert Thomas, directeur du Bureau international du Travail, une commission consultative mixte composée de représentants de ce même Bureau et de l’Institut international d’Agriculture a été nommée, qui a préconisé la collaboration étroite des producteurs et des consommateurs en des coopératives mixtes, de manière à réduire les différences scandaleuses qui existent entre les prix à la production et ceux à la consommation, beaucoup sous l’influence d’intermédiaires onéreux et superflus. En septembre 1925, M. C. Chaumet, ministre de l’Agriculture, a cité le cas typique du blé « acheté à Bordeaux et vendu dans un département du centre, et qui est passé entre les mains de dix courtiers dont aucun n’a pris livraison, mais dont tous ont pris bénéfice ! » Dans son cours au Collège de France, Charles Gide a rappelé la parole du président Coolidge déclarant que :
« Le prix payé par le consommateur est hors de proportion avec celui reçu par le producteur. »
Pourquoi ? — Parce que, des statistiques officielles, aux Etats-Unis, il ressort que les denrées agricoles vendues par les producteurs 7 milliards et demi de dollars étaient payées par les consommateurs 22 milliards de dollars : soit environ 3 fois plus à la consommation qu’à la production. Or, aux Etats-Unis, il y a un détaillant pour 80 consommateurs. Et les Américains trouvent ce nombre excessif. Que diraient-ils si, comme en France, il y avait un détaillant pour 33 clients ?...
Les coopératives allemandes de consommation ont, depuis longtemps, essayé d’entrer en relations directes avec les agriculteurs. Mais elles ont souvent éprouvé, de ce côté, de sérieux mécomptes. Toutefois, elles ont eu de réelles satisfactions de leurs relations avec les coopératives d’utilisation et de vente de bétail qui sont au nombre d’un millier en Allemagne. En 1931, elles ont vendu 2.314.000 têtes de bétail pour une somme totale de 254 millions de marks. En 1930, le magasin de gros des coopératives allemandes de consommation leur a acheté pour près de 12 millions de marks.
Le magasin de gros des coopératives autrichiennes de consommation est devenu l’agent direct des relations entre ses sociétés et celles de production de haricots et de semences.
Le magasin de gros des coopératives françaises de consommation est l’agent des coopératives grecques et bulgares, pour l’écoulement en France de raisins de Corinthe et de tabacs produits et préparés par les coopératives de production de ces produits.
Lorsque, il y a de cela quelques années, l’Union coopérative suédoise, « Kooperativa Forbandet », voulut relier sa fameuse minoterie des « Trois couronnes » au chemin de fer, elle dut acheter une usine de superphosphates. L’opération se légitimait en outre par le fait que 60.000 membres des coopératives suédoises de consommation sont des paysans. Mais, d’autre part, les coopératives agricoles suédoises comptent beaucoup de membres et ne possèdent pas d’usine de superphosphates et elles voulaient résister au cartel des phosphatiers suédois. Cette usine vient de devenir la co-propriété de deux organisations coopératives, qui peuvent désormais contrôler les prix des phosphatiers suédois.
Depuis plusieurs années, les pools coopératifs canadiens du blé vendent d’importantes quantités de leur production aux Wholesales (magasins coopératifs de gros) de la Grande-Bretagne et, en échange, ils leur achètent bon nombre de produits fabriqués dans les usines des dits magasins de gros. En outre, les coopérateurs canadiens font une forte propagande coopérative auprès de leur population agricole, afin de réaliser le programme coopératif qui tend à mettre en relations directes les producteurs et les consommateurs. Charles Gide a écrit, en effet :
« L’association coopérative supprime tous les rouages inutiles ; elle fera parvenir, par les voies les plus directes, la richesse des moins du producteur dans celles du consommateur, et l’argent, en retour, des mains du consommateur dans celles du producteur. »
On comprend aisément que si toute l’activité économique était coopératisée, de très nombreux intermédiaires seraient fatalement éliminés, depuis les plus faibles jusqu’aux plus grands. Cela explique les oppositions, ouvertes ou sournoises que la Coopération sous toutes ses formes trouve devant elle, de la part des grands Intérêts économiques, appuyés par ses « utilités », les petits commerçants, et la lutte qui se poursuit entre la Coopération (sous toutes ses formes) et les dits grands Intérêts économiques, et leurs sportulaires (voir notamment la Correspondance coopérative de novembre, décembre 1931 et janvier et juin-juillet 1932).
Les coopératives de la Nouvelle-Zélande ont créé, en 1921, une agence mixte chargée de faciliter l’écoulement des beurres et des fromages d’abord, et des viandes ensuite, des coopératives agricoles de production auprès des coopératives de consommation de Grande-Bretagne. La proportion des produits livrés par les sociétés agricoles à celles de consommation a été, en. 1929, de 50 à 65 p. 100 des expéditions totales des premières. En 1929, cette agence a atteint près de 2 millions de livres sterling : 940.000 pour le fromage, 535.000 pour le beurre, 500.000 pour la viande.
D’autre part, les Wholesales de la Grande-Bretagne font des avances, à faible intérêt, aux coopératives céréalières d’Australie qui, à la récolte, ont besoin de fonds pour faire elles-mêmes, à la livraison, des avances aux producteurs associés, apporteurs de blé.
En 1931, le Comité économique de la Société des Nations a consacré un rapport très documenté sur la crise agricole. Il a déclaré notamment qu’il ne faut pas « chercher par des mesures protectionnistes un remède au manque d’équilibre économique ». En revanche, devant le nombre excessif d’intermédiaires, il a souhaité « l’établissement de relations commerciales entre producteurs associés, unis par des organisations coopératives liées organiquement les unes aux autres et possédant même des institutions communes ».
Comme on le voit, la Coopération, si elle tend à fortifier, c’est incontestable, la position des petits propriétaires, des ouvriers ou des artisans associés, tend, par contre, à éliminer les parasites, grands et petits, qui exploitent à la fois les producteurs et les consommateurs. A ce titre — et ses adversaires se chargent de le déclarer et de le faire publier par leurs plumitifs — elle est une puissance économique très révolutionnaire. Elle a le mérite, essentiel, à mes yeux, de créer de l’entraide, de la compétence intellectuelle et professionnelle et de la responsabilité dans un monde qui ne brille point précisément à ces points de vue. Et c’est là un motif qui me fait et doit faire apprécier les organisations coopératives sous toutes leurs formes, dans la mesure où elles tendent à émanciper, même pour leur propre succès, le Tiers-Oublié, le Consommateur, sans lequel la vie économique ne peut se concevoir.
— A. DAUDÉ-BANCEL.
PRODUIRE
Produire ne se rapporte qu’à l’homme ; et celui-ci produit en raison de ses besoins, de ses aptitudes et de sa volonté : c’est-à-dire suivant son travail. On dit, assez souvent, et surtout chez les économistes bourgeois et matérialistes :
« La terre produit, le capital produit, les machines produisent. »
Rien n’est plus dangereux, socialement, qu’un pareil langage qui a, jusqu’ici, justifié l’exploitation des masses. C’est sur ce triste abus des mots qu’est fondée la science économique contemporaine. C’est en mettant sur un pied d’égalité le fonctionnement et le travail que les classes dirigeantes et possédantes acculent, par des stratagèmes spécieux, les prolétaires au paupérisme et à la mort par la misère, le suicide ou le crime.
On ne produit que moralement, et non automatiquement, car la production, pour être telle, nécessite de l’intelligence et de l’instruction. Détruire est l’opposé de produire ou plus exactement, par rapport à l’homme, c’est produire dans un sens opposé, étant donné qu’il faut, dans certains cas, préalablement détruire pour produire réellement.
Résumons-nous. Produire c’est être homme ; c’est faire usage de l’intelligence pour modifier soit le sol lui-même, soit des produits du travail, de l’intelligence, sur le sol. Mais l’organisation actuelle de la société, de la propriété générale, donne une production désordonnée qui ne profite qu’à une minorité, aux maîtres de l’heure. Une organisation rationnelle serait le contraire de celle de nos jours ; elle donnerait à chacun le fruit de son travail, le résultat de ses efforts. La production se ferait en accord avec la justice.
— Elie SOUBEYRAN.
PROFESSEUR
n. m. (du latin professor, même signification)
La plupart des professeurs enseignent ce dont ils ne connaissent pas un traître mot. Plus ils sont ignorants, plus ils se croient savants. Cela porte à être modeste. En voyant ces faiseurs d’embarras, on se refuse à parler pour ne rien dire. Il faut vraiment être sûr de soi, ne pas avoir de sa personne une petite opinion pour se croire capable d’enseigner quelque chose à quelqu’un. Et en serait-on capable, de par un labeur acharné, des études spéciales, des recherches inlassablement poursuivies, un acquis scientifique véritable (je ne parle pas de ce vernis scientifique dont se parent certains énergumènes de réunion publique), que ce serait faire acte d’autorité que d’affirmer : « Ceci est vrai, ceci est faux. » Celui qui enseigne fait acte d’autorité, la plupart du temps. Ne pourrait-il pas plutôt faire acte d’amour, exposer une idée au lieu de l’imposer ? Dans ce cas, oui, nous pouvons écrire, parler en public, conférer et enseigner. Nous pouvons « professer ». Cela n’a plus rien de ridicule. Cela est utile et contribue à annihiler l’œuvre nuisible du pseudo enseignement.
Il y a des gens qui savent beaucoup de choses, mais sont incapables de les enseigner. C’est qu’ils manquent de cet enthousiasme, de cette sincérité, de cette foi qui communiquent de la vie aux études les plus arides et les font aimer des profanes. Celui qui enseigne doit créer : il ne saurait se contenter de répéter ce qui a été dit avant lui. Et il crée, s’il pense par lui-même et si ses auditeurs apprennent, à son contact, à penser par eux-mêmes. Son enseignement n’est pas stérile. Sans suivre la méthode traditionnelle, sans s’astreindre à des règles factices, il fait entrer dans les cerveaux plus de vérités que les pédagogues avec leurs plans et leurs fiches. À quoi sert-il de prendre des notes si vous n’êtes pas capable d’en tirer parti ?
Le professeur répète pendant vingt, trente ans la même leçon apprise par cœur, sans rien changer à sa manière, les mots se succédant dans le même ordre, accompagnés des mêmes gestes mécaniques. Le professeur ne vit pas et tue ceux qui l’écoutent. Son enseignement peut être très savant, mais mortel. Pendant des années, de vieux professeurs rabâchent les mêmes banalités sur le même ton insipide, et sans une erreur de mémoire. Ce sont d’excellents professeurs pour ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez.
Ces gens-là ne savent pas lire : comment apprendraient-ils à lire aux autres ? Dans un auteur, ils ne voient que ses défauts. Ce qu’il y a d’original chez un écrivain, ils le passent sous silence. Ils expurgent les œuvres des penseurs et les mettent à la portée des esprits faibles. Ils en font des enfants bien sages, sans une idée, peu subversifs, ressemblant à tout le monde. Alors, « les familles » sont rassurées : Molière, Racine, Victor Hugo ne risquent point de corrompre la jeunesse.
Le professeur « idéal » est un camarade dont la tâche consiste, en plus de la tâche quotidienne qu’il remplit pour vivre, à mettre à la portée de son auditoire les richesses de l’esprit humain, à faciliter aux intelligences l’accès de ses merveilles, sans rien leur demander en échange que leur attention. Le professeur qui agit uniquement pour instruire ses élèves est pareil au médecin qui soigne ses malades sans se faire payer et à l’avocat qui donne ses conseils sans recevoir d’honoraires. Le professeur ne voit pas dans ce qu’il enseigne un moyen de vivre. Il n’y voit qu’un moyen d’enrichir notre pensée. Le professeur ne cherche point à se faire applaudir, mais à former des caractères. Laissons aux bourgeois leur conception de l’enseignement : qu’ils instruisent les gens en recevant d’eux un salaire, ou qu’ils mendient des applaudissements, cela les regarde.
Si le professeur idéal est un être rare, par contre on trouve une infinité de « professeurs » qui ne se rendent pas compte de ce que c’est qu’enseigner. Instruire la jeunesse, pour eux, c’est former des âmes bourgeoises, prêtes à toutes les servitudes.
Les professeurs forment au sein de la société une caste peu intéressante. Ils peuvent être très calés, mais ils n’ont pas d’idées personnelles. Tout ce qu’ils disent, ils l’ont emprunté aux autres. Leur science est purement livresque. Ils compilent, ils compilent... Compiler est l’unique tâche du professeur. Avouez qu’elle est absurde. Ils accumulent fiches sur fiches, écrivent de gros bouquins, accouchent de lourdes thèses ; mais une fois qu’on a ôté les dates, les menus faits, les racontars et les potins, rien ne reste des recherches de ces savantissimes docteurs. C’est du travail inutile. Tout cela est évidemment très fort, mais qu’est-ce que cela prouve ? C’est du délayage. Certains acquièrent leurs grades en se donnant beaucoup de mal : ils y arrivent à force d’étouffer le peu d’originalité qu’ils possèdent. Ils passent parfois des examens brillants : et après ? Combien d’autodidactes leur sont supérieurs, qui n’ont ni titres, ni diplômes ! On peut être agrégé et n’être qu’un idiot. De cet enseignement amorphe, et combien neutre, il ne résulte aucun profit pour les individus. Tout lyrisme en est banni. Les coups d’aile sont proscrits. Être terne, plat et monotone pour parler à des élèves, tel est le mot d’ordre. Quand je vois certaines têtes de « professeurs », je m’enfuis. Certaines institutrices m’horripilent. Et dire que ces pauvres gens ont pour mission de faire l’éducation du peuple !
Le professeur idéal est celui qui n’a pas l’air d’un professeur. Il n’a rien du pédant ni du cuistre. Il est tolérant, conciliant. Et il ne croit pas qu’on est savant parce qu’on est ennuyeux.
L’esprit d’un enseignement sincère est « a-dogmatique ». Il cherche dans tous les sens la vérité. Il utilise toutes les méthodes. Il n’est pas exclusif. La liberté de pensée est à la base de toute éducation vivante.
L’éducateur doit être un initiateur. Il doit nous initier à ce qui rend la vie digne d’être vécue : l’art, la beauté, l’amour. Toute éducation vraiment digne de ce nom s’adresse à la fois à l’intelligence et à la sensibilité qu’elle se charge d’éveiller.
Il existe une différence entre l’initiateur et l’être conventionnel connu sous le nom de professeur. L’initiateur ne cherche pas à faire des élèves dociles incapables de penser et d’agir par eux-mêmes, mais des hommes qui, en toute circonstance, affirment leur personnalité.
Le pédagogue dit : « Mes élèves », comme il dirait : « Mes poules, mes cochons. » C’est un mercanti qui possède l’âme d’un vieux propriétaire endurci. Il ne faut pas qu’on touche à son bien. Il considère ses élèves comme sa chose, dont il fait ce qu’il veut et dont il tire ce qu’il peut.
L’« autorité » du maître sur ses élèves — ici, le mot autorité a un sens — ne peut résulter que de la confiance qu’il leur inspire, précisément parce qu’il ne fait pas sur eux acte d’autorité. Le véritable éducateur peut avoir des amis, non des disciples. Il peut avoir des continuateurs, non des imitateurs.
Le professeur suit un programme tracé d’avance, dont il ne s’écarte pas d’une semelle. Il le suit du commencement à la fin. L’initiateur n’a pas de programme tracé d’avance ; son enseignement est souple, vivant comme le vol de l’oiseau. À mesure qu’il avance dans ses recherches, il découvre de nouveaux horizons !
L’art des transitions est un art qu’il faut laisser aux pédagogues. Ils sont très forts dans l’art de ménager les transitions. Ils partagent ce genre d’originalité avec certains journalistes. Des faits qui n’ont entre eux aucun lien sont rattachés artificiellement. L’essentiel est de passer d’un paragraphe à l’autre sans qu’on s’en aperçoive. Les lecteurs ou auditeurs veulent être conduits par la main, comme des enfants. Ils sont incapables de marcher seuls. Le pédagogue leur tend la perche, si j’ose m’exprimer ainsi. Ce procédé est pratique quand on n’a rien à dire. Il donne l’illusion qu’on a beaucoup d’idées et qu’une idée centrale les relie. Ce subterfuge est inutile quand on parle pour dire quelque chose. Les idées s’enchaînent. Un lien invisible les rattache. Nous n’avons pas besoin de jeter un pont entre elles. Le fil des idées n’est pas perdu. En passant de l’une à l’autre, nous suivons la même idée, présentée sous mille faces.
Tout enseignement comporte des redites. Ce n’est qu’à force de répéter les mêmes choses qu’on a des chances d’être compris. Ceux qui ne se répètent pas n’ont souvent rien à nous apprendre. On a vite fait le tour de leur pensée. Jamais ils n’insistent sur tel ou tel fait : la question une fois traitée, on n’y revient plus. Ils évitent les sujets scabreux. Ils les escamotent. Ils ont trop peur de se compromettre. Ne craignons pas de nous répéter, dussions-nous passer pour des « radoteurs ». La pensée est un va-et-vient incessant, une sorte de flux et de reflux, s’enrichissant à mesure qu’elle se dépense : quiconque creuse une idée ne fait que se répéter. Il emploie toujours les mêmes termes ; s’il les modifiait, sa pensée serait moins claire. Il sait qu’en procédant ainsi, il risque de mécontenter les pédagogues qui examinent chaque question à part, suivant un plan tracé d’avance, qu’ils suivent jusqu’au bout. Ils savent où ils vont et ne font jamais fausse route. En sont-ils plus clairs pour cela ? Nullement. Qu’ils se répètent ou non, ce qu’ils disent est sans intérêt.
Il y a des gens qui n’hésitent pas à proclamer d’un ton tranchant et autoritaire que ce qu’ils disent est la vérité même. Ce sont de mauvais professeurs.
Je sais bien que des camarades ont besoin d’être guidés, dirigés dans leurs études. Mais que cet appui n’aliène ni la liberté de l’enseignant ni celle de l’enseigné. Le professeur est un ami qui ne cherche qu’à faciliter votre tâche et auquel vous devez faciliter la sienne. Point de tyrans de part et d’autre. Le véritable « professeur », mot qu’il me déplaît d’employer, mais qu’à défaut d’un autre je suis bien forcé d’utiliser, n’impose aucune doctrine ; il ne doit même pas en proposer une : qu’il se contente de l’exposer, c’est bien suffisant. Cependant, son impartialité ne va pas jusqu’à faire abstraction complète de sa personnalité. Il a le droit d’émettre un avis concernant telle ou telle question, mais cet avis n’engage que lui. L’autoritarisme n’a pas plus de raison d’être dans l’enseignement que partout ailleurs. Et si un enseignement ne doit pas être autoritaire, c’est bien celui de la philosophie qui laisse à chacun, professeur ou élève, le droit de penser ce qu’il veut.
« Vous détruisez tout enseignement, dira-t-on. Si l’élève n’ajoute pas foi aux paroles du maître, quel bénéfice retirera-t-il de son enseignement ? Il importe de contraindre des ignorants à croire tout ce que vous leur dites ! Nul n’a le droit de formuler une objection. Toute interruption doit être punie. Défense de poser des questions. L’enseignement sera accepté sans discussion, ou il ne sera pas ! »
On va loin avec cette théorie ! Cette méthode peut être employée pour l’enseignement du catéchisme, mais non pour celui qui incite l’élève à solliciter une explication, à exprimer une idée, une opinion. Or, l’enseignement traditionnel ne vise qu’à étouffer l’esprit critique. Si l’esprit critique faisait son apparition dans la société, c’en serait fait de l’Autorité. Il me semble qu’entre l’obligation de croire tout ce qu’enseigne le professeur et le fait de n’y ajouter aucun crédit, il y a un moyen terme. Mais ce moyen terme, qui est la sagesse même et non un compromis, exige que le professeur et ceux que nous désignons du nom d’élèves ne soient ni le professeur, ni les « étudiants » ordinaires que l’on rencontre partout, dans écoles et universités.
Le « maître » a autant à apprendre de ses élèves que ceux-ci ont à apprendre de lui. Tout enseignement digne de ce nom est une collaboration. C’est aussi une création. Enseigner, c’est créer. Apprendre, ce n’est point répéter machinalement les paroles du maître.
Le professeur doit s’appartenir, afin de mieux se donner. Maître de lui, il peut aider ses élèves à devenir maîtres d’eux-mêmes. La vraie éducation, ne craignons pas de le répéter, c’est l’induction qui « n’essaie pas de diriger les êtres, mais de leur faire trouver en eux cette direction ». Le professeur ne nous enrichit que dans la mesure où il s’est enrichi lui-même intérieurement, où il a médité, pensé, où il a renoncé à imiter ou à copier quelqu’un. L’induction permet à l’individu de se « ressaisir » sous les influences qui l’arrachent à lui-même. L’induction est une conquête ; elle s’accomplit du dedans au dehors ; l’éducation est une défaite, qui suit une marche inverse. Inducteur et éducateur ne poursuivent pas le même but.
Plus je donne, plus je m’enrichis. C’est ce que ne comprendront jamais les impuissants qui, n’ayant rien à donner, s’enrichissent extérieurement. Leur « enseignement » n’augmente personne. S’ils en tirent profit, personne n’en tire profit. Un cerveau vide ne peut former que des cerveaux vides. Certains professeurs ont les élèves qu’ils méritent, comme certains élèves sont dignes de leurs professeurs. Ces gens-là tournent dans le même cercle vicieux.
De même qu’en présence de l’œuvre d’art les individus qui ne sont pas totalement dépourvus d’intelligence et de sensibilité apprennent à mieux reconnaître et parviennent à découvrir leur véritable personnalité, toute œuvre d’art sincère leur révélant le sens de la vie, de même d’un enseignement rationnel chaque élève doit retirer un profit intérieur. C’est sa propre révélation qui lui est faite par un tel enseignement. Au fond, le seul enseignement, c’est l’enseignement esthétique, celui qui résulte de la contemplation des tableaux et des statues, de la lecture des poèmes, du contact avec toutes les manifestations de l’art. Toute autre éducation semble pâle à côté de l’éducation des esprits par l’art. C’est pourquoi tout enseignement doit s’efforcer d’être lui-même un art, afin de gagner les cœurs et de féconder les esprits. Si le maître doit avoir de l’autorité sur ses élèves, que celle-ci soit toute morale. Elle le sera, si son enseignement constitue pour eux un refuge contre la laideur et leur permet d’avancer avec plus d’assurance au sein des embûches tendues sur leur route par la société.
Tout enseignement sera objectif et subjectif à la fois, c’est-à-dire que le lyrisme et l’imagination y auront leur place, autant que la science et l’observation. Tout enseignement qui n’est pas l’un et l’autre n’est qu’une caricature d’enseignement, ou un demi enseignement. Un enseignement qui ne consisterait qu’en hypothèses ne reposant sur rien, qu’en belles phrases et tirades, ne serait même pas lyrique, car le lyrisme suppose l’observation. Un enseignement qui se contenterait d’accumuler fiches sur fiches, d’aligner froidement ces chiffres, ne serait même pas scientifique, car la science seule ne peut rien. Il faut que dans le professeur cohabitent l’artiste et le savant, dans une étroite union. Vous ne pouvez demander au professeur plus qu’il ne peut donner ; demandez-lui seulement tout ce qu’il peut donner.
Il est évident que le professeur ne peut tout tirer de son propre fonds, qu’il est obligé de consulter de nombreux documents et de lire une quantité d’ouvrages traitant des questions les plus diverses. La science infuse n’existe pour personne. Le professeur travaille sans cesse pour se mettre au courant des progrès de la science. Le peuple considère à tort les travailleurs intellectuels comme des paresseux. Celui qui pense est pour lui un être inutile. C’est que son travail ne se voit pas. Cependant, il n’en existe pas moins. Et il est plus pénible qu’on le croit. Il suppose une hygiène rigoureuse et toutes sortes de privations. Le professeur travaille pendant que les autres se soûlent ou vont au cinéma. Mais comme il ne travaille pas toujours aux mêmes heures que les autres, on le jalouse et on le méprise. L’art du professeur consiste à extraire, comme l’abeille, le miel des fleurs les plus rares comme des plus humbles, à préparer, pour les cerveaux, la nourriture substantielle dont ils ont besoin et qu’ils absorberont sans trop de fatigue. Le professeur leur mâche la besogne, si je puis m’exprimer ainsi. Il les dispense de recherches fatigantes et souvent fastidieuses. Il leur apporte tout préparé le plat qu’il a composé avec toute sa science et tout son art. Ils n’ont plus qu’à se mettre à table. Cependant, ce travail de mise au point et de synthétisation ne les dispense pas de réfléchir et d’associer des idées ; autrement, si l’élève demeurait passif sans rien ajouter à ce qu’il a reçu, s’il ne donnait rien de son côté, l’enseignement le plus vivant serait mort-né. Il faut que l’élève fasse un effort pour porter à sa bouche les aliments qu’on lui sert et les transformer en sa propre substance.
Quelque liberté que conserve l’élève de rejeter ou non l’enseignement du professeur, il est certain que son attitude vis-à-vis du maître, comme celle du maître vis-à-vis des penseurs et des savants qui ont travaillé toute leur vie sur le même sujet, doit cesser d’être le scepticisme, mais commande qu’on fasse confiance à autrui, qu’on accepte, sinon comme un dogme, du moins comme la meilleure des solutions celle qu’il propose, « dans l’état actuel des connaissances humaines ».
Les « digressions » ou « hors-d’œuvre » dont le professeur parsème ses leçons sont pour lui des moyens d’obliger les cerveaux à penser et à réfléchir. Elles constituent, en même temps qu’une gymnastique pour l’esprit, une halte qui lui permet de méditer sur le chemin parcouru avant de reprendre sa route. Il s’élève sur les sommets d’où il contemple les réalités qui l’entourent pour en dégager une réalité plus haute. Ces digressions et hors-d’œuvre, loin d’être en dehors du sujet, sont au cœur même du sujet, elles en sont l’âme ; sans elles, tout enseignement ressemble à un squelette, la chair et le sang qui seuls constituent la vie faisant défaut.
Dans tout enseignement, la théorie et la pratique doivent s’accompagner. Ne nous contentons pas d’écouter de belles théories ou de les exposer, mais mettons en pratique l’enseignement que nous recevons ou que nous donnons. Le philosophe, qui est l’amant de la sagesse, doit donner l’exemple de celle-ci dans toutes les circonstances de sa vie et partout où il se trouve en contact avec les hommes. Il doit prendre comme ligne de conduite de ne jamais participer aux erreurs de la foule et se tenir constamment au-dessus de la mêlée. Cependant, avant d’être un surhomme, le philosophe doit être un homme différent, par ses goûts, ses aspirations, sa conception de la vie, des âmes grégaires qui évoluent autour de lui. Au philosophe de remonter le courant des passions, de se réaliser « en beauté » au-dessus de la laideur, de manifester sa pensée en toute circonstance, d’agir contre la bêtise et l’ignorance chaque fois que l’occasion s’en présente. Il faut mettre ses actes en harmonie avec ses théories. Autrement, la philosophie n’est qu’un bluff.
Nous devons nous libérer d’une foule de mauvaises habitudes : habitudes de penser, habitudes de sentir, défectueuses à tous les points de vue. L’éducation de notre cœur comme celle de notre esprit commencent à peine. L’essentiel est surtout d’agir conformément à nos pensées, de façon à ce que notre exemple puisse être suivi. De quel droit parlerons-nous aux autres de justice et de fraternité, si nous sommes injustes et méchants ?
Deux méthodes s’opposent dans l’enseignement : la compilation et la création. Seule la seconde a un sens. Seule la seconde constitue un véritable enseignement. À quoi sert-il de se documenter si l’on n’a pas le souffle qui fait vivre le document ? L’enseignement ne se conçoit que vivant ; autrement, c’est un pseudo enseignement. La création suppose l’innovation, l’invention, la découverte, seules intéressantes, quelque chose qui s’ajoute à ce qui est, en le transformant et le dépassant. La compilation n’offre rien qu’une science indigeste. La création suppose la documentation, mais avec quelque chose en plus. Le document tout seul ne rend aucun service. Il ne nous apprend rien. Ce sont des matériaux épars, qui attendent qu’on les utilise pour une construction durable. La compilation sans ordre avec une apparence d’ordre ne produit que du désordre dans l’esprit, ne laisse qu’un souvenir vague et confus. Le compilateur, qui n’a rien appris lui-même, n’apprend rien aux autres.
Tout autre est le créateur. Il vit. Il n’a pas besoin de faire étalage de sa science. Sans en avoir l’air, il nous apprend mille choses. Il ne suit pas un plan rigoureux et, cependant, s’il semble s’écarter de son sujet, toute sa personne instruit. Nous suivons les méandres de sa pensée, nous créons avec lui. Nous cherchons, nous trouvons avec lui. Le créateur ne s’attarde pas à ce qui est insignifiant : il passe outre et ne voit que l’essentiel. Sa vision est synthétique. D’un coup d’œil, il embrasse le détail et l’ensemble. Écoutons-le. Avec lui, nous apprendrons vraiment quelque chose. Nous n’aurons pas perdu notre temps. N’est pas créateur qui veut : si la compilation s’acquiert, la création est un don. Vous aurez beau faire, vous resterez un compilateur, un « non-créateur », si vous n’avez dans le cœur et l’esprit ce je ne sais quoi qui communique la vie.
Ce qu’on ne tolère pas dans l’enseignement, c’est le lyrisme. La poésie est chassée de là comme de partout. Arrière, la spontanéité et l’enthousiasme ! Arrière, l’originalité et la vie ! La science doit être froide. Elle doit se préserver de toute émotion. L’émotion est une tare. Un professeur sérieux ne doit pas avoir d’idées personnelles. Ce serait un mauvais professeur. Ressembler à tout le monde, voilà la règle. Penser ce que tout le monde pense, ce qui équivaut à ne rien penser du tout. Dans le fond comme dans la forme, un professeur qui se respecte doit être banal et terne. On peut être une personnalité et ne pas avoir de personnalité : c’est même ce qui arrive la plupart du temps. Certains professeurs sont cotés, pontifient et attirent du monde à leurs cours qui, cependant, n’ont rien de bien transcendant. C’est une vogue qui passera comme tout le reste. Un professeur n’est bien vu que s’il est incolore, amorphe et quelconque. À lui tous les honneurs et un bon traitement. Il est vissé à sa chaire jusqu’à sa mort.
Parler pour ne rien dire ou pour dire des banalités, ce qui revient au même, à cela se borne le rôle du professeur traditionnel, qui rabâche sempiternellement ce qu’il a appris dans les livres. Ce genre d’éducation convient parfaitement aux peuples abâtardis, chez lesquels les imitateurs l’emportent sur les créateurs, et dont la mission consiste non à faire des hommes, mais des mannequins. Cela dégoûte d’enseigner, quand on voit un peu partout tant de pédants qui enseignent mal, ou qui n’enseignent rien. Et puis, il y a pour le penseur libre quelque répugnance à affirmer du haut d’une chaire des vérités passagères. C’est faire acte d’autorité que d’enseigner quoi que ce soit. Dans tout enseignement, il y a pression sur des élèves. L’enseignement est un apostolat qui exige des disciples. Comment résoudre cette délicate question d’enseignement, toute résolue pour des cuistres ? Ils ne s’embarrassent pas de tant de scrupules. Enseigner, pour eux, est une forme de mégalomanie. C’est leur folie des grandeurs. Il entre dans tout enseignement une part de cabotinage qui répugnera toujours aux consciences droites. Le penseur libre, promu au grade de professeur, s’efforcera de faire oublier qu’il « professe » ex cathedra. Le meilleur enseignement, c’est celui qui groupe des hommes libres autour d’un homme libre, dans un local quelconque n’ayant rien d’officiel, ce professeur n’enseignant au nom d’aucun gouvernement et pour le compte d’aucune administration. Que celui qui enseigne dans ces conditions exerce ailleurs un métier de professeur, ou un autre métier, il sera toujours heureux d’avoir devant lui un public intelligent, que les préjugés n’aveuglent pas.
L’éducateur se dégagera de la mentalité professorale, étroite et bornée, qui ne souffre aucune objection et veut être crue sur parole. En somme, que l’on s’exprime en public, devant une nombreuse assemblée ou un cercle restreint, dans un livre, un article ou une simple conversation entre camarades, on n’impose pas une idée : on l’expose. L’orateur n’exerce d’influence heureuse sur ses auditeurs que s’il leur expose des idées, au lieu de leur imposer ses idées. En restant lui-même, allégé de tout autoritarisme, mais ferme dans ses convictions, il donne aux autres un exemple qui n’est pas sans beauté. Il conserve son harmonie, afin que les autres découvrent leur harmonie.
Il faut éviter dans tout enseignement ces verrues que sont l’autoritarisme, le pédantisme, la lourdeur, l’incohérence et autres défauts insupportables. La science est œuvre d’amour : pour attirer à elle les ignorants et les simples, il faut soi-même aimer la science. Et on ne l’aime profondément que si on l’aborde avec sagesse, sans aucun parti-pris, ni idée préconçue.
« Ai-je le droit d’enseigner ? se demande l’homme libre. Est-ce que je ne fais point acte d’autorité en assumant ce rôle ? » Non, pensera-t-il, s’il envisage son enseignement comme utile à tous, et s’il répond au vœu des camarades qui sollicitent de lui cet enseignement. Là encore, il faut se donner, et se donner sans arrière-pensée.
Tout homme instruit a le devoir de communiquer son savoir à autrui, et cela sans faire de concession, sans émasculer sa pensée, sans la déformer ni la mutiler. Il faut donner toute la science ou ne rien donner du tout. Il y a une façon de la mettre à la portée de ses auditeurs, sans les diminuer ni se diminuer. Vulgariser, démocratiser la science, comme on dit, cela ne consiste pas à la châtrer, à la caricaturer, à en faire la parodie : c’est la clarifier, la simplifier, l’humaniser sans l’appauvrir. C’est en extraire le parfum d’idéal que tous ont le droit de respirer. Propager la science ne consiste pas à faire de tous les hommes des savants, mais à faire d’eux des esprits libres, curieux, avides de connaître le monde qui les entoure. Cela consiste à éveiller dans les cerveaux l’esprit critique sans lequel l’individu n’est qu’une brute, étant incapable de socialiser l’art et la science, de les mettre à la portée de toutes les intelligences. On a vu comment notre pseudo démocratie a réalisé son programme : en faisant payer au peuple l’entrée dans les musées. L’art et la science sont devenus des entreprises commerciales, aux mains des mercantis. Notre époque divinise la science, la met au-dessus de tout et, quand il s’agit d’initier la foule à la science, il n’y a plus rien : plus d’argent pour les collections, pour tout ce qui concerne un enseignement pratique et rationnel ; la guerre absorbe tout, livre bataille à la science en utilisant ses découvertes pour le malheur des hommes. Le temple de la science est fermé aux individus. Quand, par hasard, il ouvre ses portes, c’est pour exhiber des charlatans et des pontifes qui débitent aux foules ahuries des boniments auxquels elles ne comprennent rien. Si le mouvement des universités populaires a lamentablement échoué, la faute en est aux « professeurs » qui n’ont pas su se mettre à la portée de leur auditoire, en leur parlant un langage hermétique et en accablant leur mémoire de termes scientifiques et de formules indigestes dont il n’avait que faire.
Avant toute chose, le professeur doit s’efforcer de rendre la science compréhensible, attrayante même. Point n’est besoin pour cela de « saboter » son enseignement. L’art et la science peuvent s’enseigner au peuple, mais certain doigté est nécessaire pour cela. Il y a la manière, que n’ont ni les pédagogues ni les cuistres.
— Gérard de Lacaze-Duthiers.
PROGRÈS (ET INDIVIDUALITÉ)
n. m.
I.
Nulle notion ne nous semble plus familière que celle qu’exprime le mot progrès. Pourtant, il n’en est guère qui soit plus confuse, plus trompeuse et dont on fasse plus dangereux abus. C’est au désir de progrès que nous attribuons légitimement la plupart des facilités d’existence dont bénéficient les hommes de notre temps, par comparaison avec ceux de jadis. Mais c’est aussi sous prétexte de servir le progrès que l’on prétend perpétuer entre les hommes une inégalité qui serait, dit-on, aiguillon de leur activité, ou bien que l’on revendique le droit d’user de la force pour soumettre, déposséder, civiliser – assure-t-on – les peuples arriérés.
De quelque parti politique qu’il se réclame, nul n’osait, il y a peu d’années, abjurer le culte du Progrès. Toutefois, un revirement se produit aujourd’hui. Sous la leçon des événements dont nous venons d’être témoins, notre optimisme a été ébranlé.
Avant d’aborder la question du progrès, il semble indispensable de définir rigoureusement ce que nous devons entendre par ce mot ambigu.
Le mot progrès évoque d’abord la continuation d’un mouvement en conformité avec une direction suivie précédemment, mouvement ayant sa source dans une impulsion volontaire ; il implique par surcroît l’acheminement vers un état meilleur ou plus désiré. Si l’on parle du progrès d’un objet ou d’un phénomène, c’est qu’on lui attribue un dessein ; on imagine une force dans ce qui se meut. S’il est question du progrès d’une maladie, c’est que l’on se place au point de vue de l’agent qui cause cette maladie et que l’on enregistre le déploiement et le succès de son activité. Notre point de départ est donc une appréciation subjective. La connaissance que nous acquerrons du concept qui fait l’objet de notre examen ne s’épurera de cette tare, ne s’objectivera, si elle en est susceptible, que quand nous l’aurons confrontée avec les réalités.
Constatons-nous dans le monde de la matière inorganique quelque transformation qui réponde à notre définition élémentaire du progrès ? Évidemment non.
Dans son état présent, la science nous enseigne que le monde où nous vivons tend vers un état de moindre activité, que, si on le considère comme un système isolé, l’énergie qu’il renferme, de quantité invariable, se nivelle ou, comme on dit, se dégrade.
Pourtant, tout phénomène naturel ne se réduit pas à une consommation d’énergie immédiate et sans frein. Déjà, dans le domaine matériel, on constate des rehaussements ou, comme on dit, des réhabilitations d’énergie. L’eau qui est descendue des hauteurs à la mer revient à la montagne sous forme de nuages après s’être incorporée le calorique déversé par les rayons solaires. Mais ce cycle indéfiniment parcouru ne nous offre pas l’image d’un progrès ; il s’accompagne de dépense d’énergie n’aboutissant qu’à l’érosion du sol.
Tout change d’aspect avec l’apparition de la vie sur la terre. La plante emmagasine de la chaleur que sa combustion vive ou lente restituera, mais elle le fait en empruntant à l’atmosphère un déchet de révolution antérieure, une cendre fluide dont elle récupère le charbon. Les animaux herbivores, les carnivores qui en font leur proie captent à leur tour l’énergie des végétaux qu’ils consomment, énergie qui, en général, se fût perdue, car les possibilités de végétation et de reproduction des plantes sont limitées par la place disponible, ils la transforment en mouvements plus apparents.
Avec la vie, nous voyons donc apparaître des changements traduisant une tendance à réagir contre la dégradation et l’uniformisation, à maintenir et à édifier. Cette tendance est irrésistible. Des germes de matière vivante, dès qu’ils rencontrent des conditions favorables, tendent à envahir le monde.
Cette tendance spontanée, persistante, à capter, retenir et incorporer à la matière l’énergie vouée à la déperdition, ouvre dans le monde la voie au progrès. Elle oppose la création à l’anéantissement. Toute destruction non compensée est négation du progrès ; affirmation, au contraire, tout ce qui contribue à intensifier la vie.
Cependant, si la vie en elle-même est un principe de progrès, la succession des espèces vivantes est-elle la manifestation d’un progrès de la vie ? Évolution et progrès concourent-ils au même but, malgré des discordances accidentelles ?
Lorsque, visitant la galerie de paléontologie au Muséum, nous voyons des organismes, qui nous paraissent d’une extrême simplicité, se diversifier peu à peu, acquérir de nouveaux organes, se ranger en séries dont la structure, les facultés, le mode de vie se rapprochent, dans certains embranchements, des attributs caractéristiques de l’espèce humaine, s’efforcent à l’équivalence dans les autres, il nous semble impossible de nous refuser à la constatation d’un progrès général. Mais à quel critère nous référer pour confirmer cette première impression ?
Un ancien doyen de la faculté des sciences a examiné ce qu’il fallait penser d’un classement hiérarchique des espèces fondé sur leur adaptation au milieu, en choisissant, par exemple, le cas des vertébrés. Les poissons sont apparus les premiers ; ils devraient être les plus inférieurs : mais en quoi ? Dans leur milieu, ils sont supérieurs à tous ceux qui sont apparus après eux.
Pourquoi, d’ailleurs, les espèces seraient-elles en progrès les unes sur les autres ? On est enclin à admettre aujourd’hui qu’elles se différencient par l’effet de forces internes, mises en action sous l’influence du milieu, mais dont la résultante n’est pas en relation obligée avec les variations de ce milieu. L’être transformé va-t-il être mieux ou plus mal adapté ? Disons plutôt qu’il est dérouté en prenant le terme dans son sens étymologique. Comme ses ascendants, l’être nouveau conserve sa tendance à la vie. Si les circonstances mettent à sa portée une ambiance au sein de laquelle il ne soit pas trop défavorisé, l’abritant de ses ennemis, il vivra. Un animal qui naît aveugle pourra, sans être infériorisé, poursuivre son existence dans une caverne ou sous terre. Le cas est fréquent.
« La sélection, loin de conserver le meilleur, supprime simplement le pire. » (E. Rabaud)
Nous pouvons admettre qu’au lieu de nous attendre à rencontrer dans la nature le Progrès considéré comme un absolu, nous devrons nous tenir pour satisfaits d’y constater des progrès relatifs, simples ralentissements à la dégradation générale de toutes les sources d’énergie. Et si nous voulons classer les espèces vivantes, puis les structures sociales, il faudra mettre en tête celles qui contribuent le plus efficacement à ménager les forces naturelles, à faire prospérer la vie.
Cependant nous allons voir se manifester dans le monde vivant une qualité apparue tardivement et lentement développée : l’individualisation, qui deviendra chez l’homme le plus puissant instrument de domination sur la nature.
II.
Autant que la notion de progrès, celle d’individualité a donné lieu à bien des malentendus.
« L’individualisme est l’affirmation de ce qu’on est, par opposition à ce que l’on n’est pas, du moi par rapport au non-moi. Voilà le cœur de l’idée. C’est la tendance vers ce qui distingue les êtres les uns des autres, l’opposition à ce qui les confond ou les combine dans une action solidaire. »
Opposition à l’esprit grégaire, à la solidarité imposée, au conformisme servile. Comme toute notion, celle d’individualité repose sur la perception de ressemblances et de différences. L’individualité ne se comprend que dans le groupe, dans la société. Tandis que l’égoïsme ramène tout à un terme unique, le moi posé comme absolu, elle exprime un rapport, une relation ; et ce point de vue seul peut se justifier, car rien de ce qui a vie ne peut être conçu indépendamment du milieu vital, pour l’homme milieu social avant tout.
Suivre pas à pas le développement de l’individualité au cours de l’évolution sortirait de notre cadre. Nous nous bornerons à en mentionner les étapes les plus essentielles.
Aux échelons inférieurs du monde vivant, si l’espèce dure, c’est parce que la destruction aveugle de l’immense majorité de ses membres est simplement compensée par la prolifération. Le hasard seul préside au choix des survivants qu’aucune particularité ne signale. Dans la masse, ni les similitudes, ni les différences toujours minimes, résultant des circonstances occasionnelles ou d’un retard de développement, ne peuvent être perçues, car elles ne donnent lieu à aucun rapport spécial entre ceux qui en sont affectés. Chacun vit pour soi.
Plus tard, un fait nouveau se produit, les rejetons gardent le contact de leurs procréateurs, auprès desquels ils trouvent appui pendant la période la plus périlleuse de leur existence. Leur survie est sujette à moins d’aléas. Durant la période de vie commune, les relations sont celles d’hôte à parasite ; et il se trouve que les procédés par lesquels réagit le premier ne sont pas des réactions hostiles, mais acceptées, recherchées même, et concourent à la protection, à l’alimentation du second. Cette réaction, aussi nécessaire au bien-être du parent qu’elle est avantageuse au descendant, se consolide sous forme d’instinct. Dans l’ensemble, il y a progression de l’individualité dans le monde animal, à en juger par la multitude et la diversité des actes.
Devant l’animal adulte s’ouvrent trois voies différentes. Ou bien il rompt tous les liens de sujétion et poursuit dans l’isolement la satisfaction de ses tendances particulières, que la dureté de la lutte limite promptement au seul souci de la conservation ; ou bien, incorporé à la masse de ses semblables, modelé sur eux, il bénéficie, comme compensation à l’inhibition de ses possibilités de variation, d’une entraide rudimentaire. Ou enfin, recherchant alternativement les avantages des deux situations, il partage son existence en périodes d’isolement et périodes de rapprochement, lorsqu’il s’agit de pourvoir à des besoins périodiques communs à l’espèce, tels que les migrations.
Pour les espèces, le fait de s’engager dans l’une ou l’autre de ces voies n’est nullement arbitraire, il dérive du mode de nutrition. Ceux qui poursuivent une proie mobile, s’ils sont assez puissamment armés pour arriver à leurs fins sans le secours d’auxiliaires, tels les grands fauves, tendront à vivre dans l’isolement dès l’âge adulte ; chez eux, la distinction des fonctions, l’individuation, dont elle est la condition, seront étroitement limitées. L’isolement, supprimant les relations, abolit le sentiment de l’individualité.
Chez les végétariens vivant de matières inertes, l’agglomération « promiscuitaire » des êtres de tout âge n’a aucune raison de se dissoudre. Au contraire, moins habitués à la lutte, puisque leur subsistance n’en est pas le prix, ils ne pourront opposer à l’ennemi que leur masse. L’effectif de la horde dépendra de l’abondance des subsistances. Cependant, dans le troupeau on pourra voir un rudiment d’organisation, des fonctions spécialisées, signaleurs, combattants, simple ébauche d’individuation.
Les carnassiers médiocrement armés forment la troisième catégorie. Ils peuvent vivre dans l’isolement, mais, dans des circonstances pressantes, s’unir pour la chasse, varier et combiner leurs efforts et, de ce fait, prendre conscience de leur personnalité. C’est d’ailleurs dans cette catégorie que l’homme a trouvé le plus indispensable et le mieux doué de ses compagnons : le chien, sans lequel la domestication du bétail eût été sans doute impossible ou, tout au moins, peu avantageuse, car il eût fallu presque autant de gardiens que d’animaux captifs.
Dans toute l’animalité, le niveau de l’individualité ne saurait s’élever très haut. Isolés ou groupés, sauf au temps de la procréation, l’égoïsme est le trait dominant de la mentalité des animaux ; la satisfaction des besoins que son espèce a de tout temps ressentis absorbe toute l’énergie nerveuse de chacun de ses représentants. Loin de tendre vers le mieux, l’instinct spécifique se satisfait de l’équilibre.
Pour qu’il y ait progrès continu, il faut qu’il y ait déséquilibre permanent. En principe c’est une tare. Mais cette tare, qui ne se rencontre que dans le genre humain, l’homme a pu la faire tourner à son profit, en faire le ressort de progrès dont nous n’apercevons pas encore le terme.
L’individualisme, qui est la conséquence de ce déséquilibre, est, dans le genre humain, un caractère si indéniable qu’il a résisté à toutes les tentatives faites pour le stabiliser ou même pour restreindre l’innombrable variété de ses manifestations. Quel qu’ait pu être le désir de ceux qui ont détenu la puissance, conquérants ou gouvernants, jamais des formes de culture, des modes de comportement réservés à des collectivités privilégiées érigées en caste n’ont pu s’établir d’une façon durable. L’homme a toujours cherché, non seulement à sauvegarder son individualité, mais à la majorer.
Quelle est l’origine de cette variabilité dans le comportement qu’on ne rencontre chez nulle autre espèce animale ? Devant, à ce qu’il semble, compliquer les conditions de la vie et la rendre plus précaire, comment se fait-il qu’elle ait été le plus sûr agent du progrès, c’est-à-dire qu’elle ait acheminé l’humanité vers une vie plus large et plus intense ? C’est ce que nous nous proposons d’examiner maintenant.
III.
On attribue aujourd’hui, ainsi que nous l’avons dit, la différenciation des espèces à des mutations brusques qui font apparaître des êtres nouveaux que nous sommes tentés de qualifier de monstres, si nous les comparons à l’ancien type.
Sous l’influence de circonstances locales, certaines fractions de l’espèce peuvent évoluer d’une façon différente. Une même souche peut donner naissance, vers la même époque, à des branches dissemblables bien qu’apparentées.
C’est ce qui semble s’être produit dans le genre humain.
M. Guyénot, au cours d’une séance de la Semaine internationale de synthèse, en 1929, écrivait :
« L’homme ne paraît pas le produit d’une seule mutation, mais d’une série de mutations indépendantes, ayant porté sur le crâne, le cerveau, la mâchoire, les dents, etc. Une mutation sur le crâne peut ne pas avoir été accompagnée d’une mutation sur la mâchoire, ce qui permet de comprendre la coexistence, chez l’homme de Piltdown, d’un crâne humain et d’une mâchoire simienne. Une mutation peut avoir donné aux dents un caractère humain sans que la mandibule se soit trouvée modifiée, ce qui expliquerait la dentition humaine de la mâchoire pithécoïde de Mauer. »
Sur quoi ont porté la mutation principale et les mutations secondaires qui la caractérisent ? Sur le cerveau et sur l’ensemble de la tête ; celles du corps ne sont qu’accessoires.
Au prix de quels sacrifices l’accroissement de l’appareil cérébral s’est-il réalisé ? Comparé aux grands anthropoïdes, l’homme paraît un être dégénéré. On peut le considérer comme une machine plus délicate que les êtres auxquels il est apparenté, mais son rendement n’est pas moindre.
N’oublions pas qu’au point de vue physique, le primitif était plus solidement constitué que l’homme moderne. De plus petite taille, mais très massif, il avait des muscles puissants, une mâchoire robuste, une dentition très forte. En somme, après la mutation, le débit énergétique était resté équivalent, tandis que les possibilités d’utilisation étaient démesurément accrues. Ainsi, tandis que chez toutes les autres espèces, production d’énergie nerveuse, besoins et moyens d’emploi s’équilibraient sensiblement, il s’est manifesté dans l’espèce nouvelle une énorme disproportion entre ces facteurs. Ce remaniement est bien plus important qu’il ne semble résulter d’un examen superficiel des organes. Il ne porte pas seulement sur l’accroissement de l’étendue de la couche corticale grise, mais sur la multiplication des fibres de relation et d’association qui relient les cellules de la première, soit avec les organes sensitifs et musculaires, soit entre les fibres dont l’ensemble forme la substance blanche, dont le volume est proportionnel au cube des dimensions. Les neuf milliards de cellules grises, reliées par leurs cylindres-axes et plusieurs autres prolongements donnent la possibilité de combinaisons qui se chiffrent par milliards de milliards, alors que la vie humaine est loin d’atteindre trois milliards de secondes. Quelle latitude laissée aux différences de pensée et aux écarts de comportement, chez un individu ou entre divers individus !
Ces considérations sont appuyées par le fait que lorsqu’il s’agit de l’exercice de la pensée, beaucoup de biologistes modernes sont portés à attribuer un rôle prépondérant dans l’élaboration de la pensée aux fibres d’association et de transmission et non plus aux cellules elles-mêmes.
On peut avoir une idée de la constitution psychique de l’homme en se représentant un ouvrier dont la force musculaire est étroitement limitée et qui a à sa disposition un magasin approvisionné d’une multitude d’outils, susceptibles de combinaisons variées, appropriées à tous les genres de travaux qui pourront se présenter ; abondance telle qu’au cours de la plus longue existence, il ne trouvera l’occasion que d’en utiliser une infime partie. C’est un semblable excès des ressources mentales sur les moyens et les besoins physiologiques qui assigne à l’homme un rôle privilégié dans le monde vivant ou, du moins, qui le lui assurerait s’il avait la sagesse de le mettre à profit.
La mutation essentielle dont nous venons d’exposer la nature a été accompagnée d’une série de mutations indépendantes. On ne saurait mieux qualifier la plupart de celles-ci qu’en les appelant un remodelage de la face. Les masses osseuses et musculaires se réduisent, les arcades sourcilières s’effacent, le prognathisme s’atténue, la mâchoire s’amenuise, les dents sont moins volumineuses. Ce qui attire encore l’attention, c’est l’apparition et le dégagement du menton. Or, cette particularité nouvelle, jointe à celles qui sont relatives à l’articulation plus libre des branches de la mâchoire, à la souplesse des joues, à l’amincissement et à la mobilité des lèvres, donne plus de jeu aux mouvements de la langue, à la modulation des sons. Le langage articulé existait-il chez les précurseurs de Néanderthal ou d’avant ? Peut-être, mais à l’état réduit (Boule). Le remaniement facial ultérieur a considérablement accru non seulement les facilités d’expression, mais le champ même de la pensée.
« La sensation et le mouvement constituent la première et la dernière étape de la pensée, même de la pensée abstraite, spéculative, dans laquelle la région des images est dépassée et la parole semble paralysée. Le mot « si je ne parle pas, je ne pense pas », mis satiriquement dans la bouche de l’orateur Gambetta, synthétise cette intime articulation du langage, qui en accompagne l’extériorisation et qui est nécessité commune à tout homme, quelle que soit sa valeur mentale. » (Bruggia)
La faculté d’employer une quantité réduite d’énergie nerveuse à mettre en œuvre des comportements infiniment variés, selon les circonstances, donnait à l’homme une supériorité prodigieuse sur les représentants les plus voisins de l’ordre des primates dont il fait partie. Cet avantage s’alliait pourtant à quelques dangers. L’avantage est qu’un ajustement, moins étroitement standardisé, de la puissance nerveuse motrice et des rouages qu’elle peut mobiliser, a rendu possible à chaque individu de faire face, par ses propres moyens, aux incidents dont le milieu ambiant est le théâtre ; multipliant ses points de contact avec le monde, elle lui en facilitait la pénétration, lui fournissait des armes personnelles pour sa conquête. Dans l’animalité, l’accommodation est globale ; dans l’humanité, elle peut à la rigueur être individuelle et la possibilité d’isolement s’y accompagne d’une différenciation du comportement.
Ce penchant à l’individualité est une cause de dissolution des groupements humains. Le péril est grave tant que l’homme est insuffisamment armé pour la lutte. L’animal végétarien ou carnivore médiocrement puissant concentre sur un seul objectif, pour la défense ou pour l’attaque, tous les moyens restreints mais routiniers des membres de la horde. Le clan humain, uni par l’instinct grégaire reçu en héritage, agit de même. L’intelligence, rivale de l’instinct, va compromettre sa cohésion.
À la tendance dissociative de l’esprit, le langage puis l’écriture sont venus apporter un tempérament. Multipliant les moyens d’expression des idées et, par là, les occasions de relations entre les hommes, rendant aisée la communication de l’expérience personnelle, des connaissances acquises sur le monde, le langage restituait toute sa valeur à la cohésion sociale et tendait à la consolider. Aidé de l’écriture, il donnait naissance à la tradition qui, reliant les générations successives, leur permettait de constituer et de conserver intact le capital intellectuel de l’humanité.
Sous l’influence contraire de l’intelligence dissolvante et du langage serviteur des tendances à la sympathie, le groupe humain, au lieu de se disperser, allait se maintenir, mais sur une nouvelle base. Il n’allait plus reposer sur la contrainte inconsciente de l’instinct grégaire, mais s’orienter vers l’association consentie régie par la raison.
Si, comme on le fait communément, on appelle sociétés aussi bien les groupements animaux que les groupements humains, il faudrait dire non pas que l’homme est un animal sociable, mais que son état de civilisation est la conséquence de son naturel insociable.
En réalité, ce paradoxe est simplement l’effet d’une confusion due à l’application d’un vocable à deux types d’agrégats. En cessant peu à peu d’obéir à l’instinct, passion, sentiment, tendances se socialisent. Mais il ne faut pas confondre avec les sociétés animales, instinctives, les sociétés humaines de plus en plus artificielles. D’une part, il y a absence de personnalité, grégarisme, conformisme spécifique, autorité (dictature ou « sociocratie »). D’autre part, individualisation dans le cadre social, prévalence de la raison, initiative, liberté (socialisme libertaire).
Toute l’histoire de la civilisation est celle du passage, si loin encore d’être achevé, d’une structure sociale à l’autre.
IV.
Des deux tendances, l’une purement animale poussant au grégarisme instinctif, restrictif, l’autre plus spécialement humaine inspirant le socialisme rationnel, libertaire, comment se fait-il que la plus ancienne et la plus vile n’ait pas été supplantée par sa rivale vigoureuse et expansive.
Nous avons vu que c’est grâce au maintien du contact entre parents et descendants – rapprochement qui, en provoquant entre eux des comparaisons, éveille les idées de ressemblance spécifique et de différences particulières – que l’être est amené à prendre conscience de son individualité. Nous avons vu aussi que les relations qui s’établissent entre générations successives sont celles d’hôte à parasite.
Dans l’espèce humaine, en raison de la longue durée que nécessite la formation de l’adulte, formation progressive qui l’associe graduellement aux travaux de la famille, lui assigne une fonction à la mesure du développement de ses facultés, si le sentiment d’individualité croît avec l’importance du rôle assumé, par contre l’habitude de bénéficier de soins et d’une protection longtemps indispensables consolide le goût de la vie parasitaire.
Autre particularité : dans les familles, les naissances de rejetons successifs devancent l’époque à laquelle l’élevage des premiers nés est terminé. Circonstance éminemment favorable au développement de l’individualité, mais qui entraîne aussi une réciprocité de dépendance.
Le parasitisme, au lieu de demeurer unilatéral, est devenu commutatif ; il rend solidaires les générations, il est le fondement de la famille.
La tendance parasitaire, née dans la famille, devait naturellement s’étendre au clan.
La tendance individualiste n’était certes pas étouffée, mais, au lieu de se manifester dans chaque homme comme volonté particulière d’action, elle était transférée au groupe, à la puissance et à l’expansion duquel la personne devait se sacrifier.
Le fait de se dépouiller, en faveur du groupe social auquel on est incorporé, de la tendance naturelle à l’expansion de sa personnalité a donné naissance à l’esprit de caste, à l’esprit de corps, à l’orgueil racial ou national. Moins il y a de liberté individuelle, plus se développe la passion guerrière d’un peuple. Les régimes de dictature ont pour conséquence d’exalter chez ceux qui les supportent le nationalisme, de les entretenir dans des sentiments d’hostilité permanente à l’égard des peuples étrangers.
Les facteurs essentiels qui ont influé sur l’évolution des sociétés humaines peuvent donc se ramener à trois : instinct grégaire et instinct parasitaire, d’une part, et, d’autre part, aspiration consciente à développer l’individualité. Il était impossible que la première tendance pût l’emporter ; il eût fallu pour cela que l’organe si richement doté que l’intelligence humaine avait à sa disposition pour utiliser l’énergie nerveuse fût, dès son apparition, frappé de paralysie. Toutefois, sans être un obstacle infranchissable, l’instinct grégaire, vestige d’animalité rattachant l’homme au passé, allait persister en tant que frein au progrès.
La seconde tendance a joué un bien plus grand rôle. Elle a provoqué la formation de sociétés oligarchiques. (Voir le mot Oligarchie.)
Un régime d’inégalité, dans la mesure même où il laisse place au progrès, ne peut être stable. Or, l’instabilité, pour n’être pas une cause de ruine pour une société, doit elle-même obéir à des règles, et ces règles seront celles d’un régime contractuel visant à rétablir à chaque moment l’équilibre entre les tendances de chaque membre du groupe et celles de tous ses associés.
V.
De l’analyse que nous venons de faire de la nature humaine, quelles déductions pourrons-nous tirer relativement à la structure sociale propice à la mise en valeur de virtualités psychiques qui excèdent si démesurément le débit de l’énergie nerveuse individuelle nécessaire à leur utilisation ?
Comparons les êtres humains à des mécaniques comportant générateurs de force et machines opératrices – comparaison, certes, très grossière, puisque, dans notre cas, ce qui est le plus caractéristique est l’extrême abondance des transmissions qui permettent d’associer une grande variété d’outils, mais comparaison suffisante pour orienter nos recherches. En présence de l’énorme disproportion qu’il y a entre l’outillage et la force motrice, deux solutions extrêmes s’offrent à nous : ou bien, nous allons dans chaque atelier-individu appliquer toute la puissance disponible à la mise en marche d’un nombre limité de mécanismes, toujours les mêmes, d’autant mieux adaptés à leur usage que le mécanisme vivant a la propriété de s’entretenir et même de se perfectionner par son fonctionnement, ce qui est la promesse d’un rendement particulièrement avantageux ; ou bien, nous accouplerons le moteur alternativement avec tous les appareils, de telle façon que nul ne se dégrade ou se paralyse et qu’en conséquence chaque atelier-individu se maintienne interchangeable avec les autres et soit constamment prêt à satisfaire à la variété des besoins. On y gagnera en sécurité, mais le rendement sera moindre, ne fût-ce qu’en raison du temps perdu pour la mise en train des machines.
Ces deux solutions conduiront à des structures sociales très différentes. Avant de nous prononcer en faveur de l’une ou l’autre, nous nous permettons une digression. L’homme psychique aussi bien que physique est un être composite.
« En fait, l’unité du moi semble bien n’être qu’illusion ; c’est celle que donne la succession de clichés cinématographiques... La personnalité se compose donc de moi successifs. » (Dr A. Marie, 1928)
L’activité vitale, en effet, est une activité synthétique. La perception est la synthèse des données transmises par les analyseurs sensoriels touchés par les excitations reçues de l’extérieur. La réaction qui la suit est la synthèse qui met fin à la lutte des tendances qui viennent d’être éveillées. Toutes deux doivent être en accord suffisant avec la réalité extérieure ; tout obstacle à cette harmonie, qu’il soit imputable à un arrêt de développement ou à un défaut d’usage d’un faisceau de fibres nerveuses d’association, compromet l’équilibre mental et aboutit à ce que M. P. Janet a appelé la perte du sentiment réel.
Cette perte a des degrés. Si l’homme ne fait rien de plus qu’accorder quelque préférence à certaines des voies d’association dont son cerveau est doté, il se peut que la concentration de sa puissance psychique sur des sujets, que le vulgaire ne fait qu’effleurer, l’amène à des découvertes admirables.
« Certains esprits, avec les données intellectuelles et morales qui sont le domaine commun, créent des synthèses nouvelles, artistiques, scientifiques, morales ; et, sans doute, nous sommes particulièrement frappés, alors, de l’activité synthétique de l’esprit. » (P. Janet)
Nous parlons alors de génie. Mais du fait de cette spécialisation, le génie est toujours quelque peu détaché du réel. Et lorsque la spécialisation devient trop exclusive, le détachement trop prononcé, nous voyons poindre les conceptions chimériques, les idées délirantes, l’aliénation.
Nous verrons que la nature porte d’elle-même aux spécialisations utiles à la société. Ce qui ne saurait être admis, c’est la prétention de confiner artificiellement l’intelligence dans le domaine épuisé acquis à l’automatisme de créer une classe de dégénérés inférieurs.
Dans une direction opposée, au lieu de chercher à canaliser l’énergie nerveuse dans certaines voies préférées, on peut se proposer de la répartir, au moins périodiquement, entre toutes celles qui sillonnent le cerveau. Du coup, l’individu va être exposé à tomber dans la banalité. Le progrès sera compromis, du jour où les résultats accumulés dans chaque catégorie de sciences ou d’arts, dont l’assimilation préalable est indispensable à toute nouvelle avance, exigeront, pour être acquis, toute une existence. L’homme sera voué à la médiocrité en tout.
Les deux conceptions dont nous venons de résumer l’essence et de montrer les dangers ne sont pas demeurées théoriques. Elles ont été mises en pratique, et se disputent encore la prééminence.
C’est à la première que l’on peut rattacher la division en castes spécialisées : prêtres, guerriers, artisans et commerçants, agriculteurs et manœuvres, en général les régimes aristocratiques de l’Antiquité et du Moyen Âge. C’est cette opposition que consacrerait la rationalisation.
Le deuxième courant d’idées n’a pas, cependant, perdu tout pouvoir d’attraction. La généralisation et l’uniformisation de la culture ont le plus souvent été préconisées au sein de chaque classe particulière, surtout parmi celles qui tenaient le premier rang. Aux xviie et xviiie siècles, les plus grands esprits se gardent de se spécialiser. Dans le moment présent, ce sont les classes opprimées qui, pour sauvegarder leur dignité et l’intégrité de leurs facultés intellectuelles, réclament une instruction identique à la base et veulent, lorsque les exigences modernes auront diversifié les activités, qu’au moins les éléments d’une culture commune soient dispensés à tous.
Entre ces deux aspirations contraires, dont l’une nous incline à la spécialisation qui donne la primauté à l’intérêt de la société considérée, en quelque sorte, comme une entité métaphysique, tandis que l’autre nous fait désirer la culture générale qui rétablit dans l’intégrité de ses droits l’individu, réalité tangible, la conciliation pourra-t-elle s’effectuer ? Le sentiment nous porte à le croire ; la physiologie nous le confirmera en nous éclairant sur les conditions de l’accord.
Le comportement des vertébrés supérieurs, de l’homme même, n’est pas seulement sous la dépendance des hémisphères cérébraux. Tout un système relativement indépendant, qui a son aboutissement dans le crâne même, préside à la vie animale, peut même, à la rigueur, suffire à l’existence s’il s’agit des échelons inférieurs, l’entretenir du moins quelque temps dans le cas des plus élevés. Dans les conditions normales, influençant plus particulièrement les organes de la vie végétative : nutrition, circulation, respiration, reproduction, il en reçoit aussi les excitations, il est affecté par les sécrétions que ces organes élaborent et rejettent dans les vaisseaux sanguins.
« L’importance du système autonome dans la vie psychique, c’est qu’il commande aux réactions élémentaires fondamentales et les plus puissantes de l’être vivant. Il fait participer l’organisme, ses viscères, ses sensibilités les plus primitives, les plus obscures, les plus impérieuses à tous les niveaux de l’activité psychique où lui-même se trouve intégré, c’est-à-dire éventuellement à des intérêts dont les motifs peuvent être d’ordre purement intellectuel ou idéal. » (Dr H. Wallon.)
Cet appareil organo-végétatif détermine les tempéraments individuels innés, à peu près héréditaires et qualitativement variables, seulement dans de faibles limites, d’après les vicissitudes de l’existence.
C’est, jointe aux dissemblances corporelles, la diversité de ces tempéraments – que, pour la commodité du langage, on a ramené à quelques catégories tranchées – qui oriente l’activité particulière de chacun de nous et nous porte à mettre en œuvre, de préférence, tel ou tel ensemble de nos virtualités cérébrales. C’est de là que dérive normalement cette spécialisation naturelle, au surplus très large, qui se traduit par le contraste des attitudes. Spécialisation que l’on peut qualifier de préférentielle, car elle ne saurait être absolue, vu que la vie est phénomène d’ensemble auquel nulle partie ne peut être étrangère sans péril pour l’intégrité de l’être. Spécialisation qui incline l’individu à consacrer volontairement la majeure partie de son énergie psychique aux tâches que ses dispositions naturelles lui rendent le plus aisément abordables et qui correspondrait à sa bonne orientation professionnelle, si la Société comprenait que son rôle est d’aide plutôt que de contrainte.
D’où vient que l’espèce humaine seule nous offre le spectacle d’une telle variété de caractères physiques, de tempéraments, de dispositions intellectuelles ?
Dans une espèce animale, les conditions de vie sont les mêmes pour tous ; elles se modifient fort peu avec le temps, et les écarts affectent également chacun des spécimens du groupe. Tout jeune animal mal conformé physiquement ou psychiquement est voué à la disparition dès qu’il est livré à ses propres forces, ce qui arrive de bonne heure.
Dans l’humanité, au contraire, la protection familiale, dont l’enfant bénéficie si longtemps, donne d’abord à celui qui est anormal la possibilité de vivre pendant le premier tiers d’une existence moyenne. Les sentiments réciproques cultivés pendant cette longue période de vie en commun entre parents et descendants déterminent encore la prolongation de cette assistance aux faibles, devenue une obligation sociale. D’autre part, le développement de la civilisation, les migrations amenées, non plus par le besoin de conserver les conditions de vie habituelles, mais bien plutôt par le désir d’en expérimenter de nouvelles, sont des sources intarissables de différenciation physique ou mentale. Variations que la nature n’élimine plus, car la multiplication des industries, des fonctions donne la possibilité d’utiliser les anomalies, les vocations particulières, d’en rendre l’exploitation profitable à tous. L’originalité qui eût été néfaste à l’animal devient, dans notre cas, utile à l’individu, avantageuse au groupe, agent de progrès. L’anormal peut jouer dans l’organisme social un rôle utile, puisque l’acuité des sensations, la vivacité des réactions et l’esprit d’initiative peuvent triompher de la routine et provoquer l’invention. Il faut que les particularités ne s’éteignent pas dans l’isolement, qu’elles aient à leur disposition un champ d’action où elles puissent s’exercer librement.
L’homme est un composé d’une multitude de tendances, communes ou personnelles, desservies par une fédération de fonctions ; la Société doit être une fédération de groupes fonctionnels rapprochant pour l’action les aptitudes analogues, coordonnant enfin l’ensemble des tendances, substituant leur harmonie à la lutte.
VI.
Bien des hommes, avant Fourier, ont regardé l’homme comme un faisceau de tendances différentes, de l’un à l’autre, comme qualité et comme intensité, déterminant, selon leur prédominance, le caractère et le comportement de chacun. Mais Fourier est, sans doute, le premier qui ait conçu et décrit en détail une structure sociale basée sur cette considération.
Inclure toute l’activité d’un homme dans les limites étroites d’un phalanstère est aujourd’hui une impossibilité (les échecs des colonies communautaires en témoignent). Les produits s’échappent des mains de ceux qui les ont faits, ils passent à d’autres ateliers dont le fonctionnement leur demeure étranger, s’échangent et se consomment au loin ; celui qui les a créés ne saurait porter intérêt à son œuvre.
On entrevoit, certes, la direction dans laquelle on devra s’engager pour surmonter ces obstacles : orientation professionnelle d’après les aptitudes physiques et intellectuelles, d’après les goûts manifestés pour le travail de telle ou telle matière, d’après l’intérêt que l’on porte à l’usage de l’objet à la création duquel on collabore ; choix de l’atelier d’après la sympathie éprouvée pour ses associés ; multiplication des emplois accessibles dans le cadre de la profession et, enfin, compréhension du rôle joué par chacun dans l’appareil de la production, et conviction de grandir sa propre personnalité dans une société dont on aura accru la puissance.
La société est donc appelée à prendre la forme d’une fédération de groupes fonctionnels pourvoyant aux besoins de la vie civique et économique.
Participant à la conception de l’œuvre, participant à ses bienfaits, l’homme atteindra enfin à la satisfaction de ses aspirations, de celles mêmes que ses forces limitées ne lui permettaient pas de contenter et dont le concours de ses associés lui assurera la réalisation.
L’idéal du monde actuel est le citoyen, résidu que l’on obtient en dépouillant l’être réel de toute originalité, en évaluant ses facultés au taux le plus bas.
L’idéal du monde nouveau sera l’Homme, création sociale douée au plus haut degré de tous les attributs psychiques dont la nature a pourvu chacun des membres de la société ; chacun recevant, en compensation de son propre apport, avec la certitude de pouvoir extérioriser toutes ses tendances, le droit d’accéder aux domaines explorés par l’intelligence de ses semblables.
Un tel idéal n’est pas un absolu. Issu du cerveau de l’homme, il se précise et s’enrichit à la mesure du développement des facultés humaines. C’est à lui que nous devons nous référer lorsqu’il s’agit de porter un jugement sur la valeur des transformations que nous nous plaisons à qualifier de progrès.
VII. — Évolution de l’idée de progrès.
Si l’idée de perfection a toujours hanté le cerveau humain, il n’en est pas de même de la croyance au progrès :
« On n’a pas cru partout et de tout temps au progrès naturel ou nécessaire ; et, même, il est permis de se demander si l’homme n’est pas enclin à admettre plutôt l’idée opposée. Le désenchantement régulier de l’âge donne aux vieilles gens le sentiment que tout était mieux au temps de leur jeunesse... »
Et, d’autre part :
« Chacun de nous garde toute sa vie quelque trace de l’impression d’infériorité que nous avons justement éprouvée, étant enfants, à l’égard de nos parents, de nos maîtres et de nos aînés. » (E. Dupréel)
Nous avons, au début de cette étude, défini provisoirement le progrès comme la continuité dans une direction constante d’un mouvement ayant sa source dans une impulsion de l’individu qui tend à s’acheminer vers un état meilleur ou plus désiré.
L’état meilleur auquel aspire l’homme nécessite la réalisation d’un double équilibre :
« Équilibre entre les tendances et les besoins de la nature humaine d’abord, et aussi un certain équilibre entre les hommes. » (Le Fur)
Le perfectionnement auquel nous aspirons ne peut pas être limité à la personne, il doit être collectif. Pour être qualifié de progrès et n’en pas être seulement un élément, il faut encore qu’il soit illimité.
Or, nous allons voir que ce n’est qu’à de rares époques et chez peu de peuples que la continuité, le développement illimité, l’individualisation et la socialisation des perfectionnements, considérés comme éléments inséparables, ont été acceptés comme un idéal à poursuivre, comme un but accessible. De nos jours, même cette conception du progrès est loin d’être universellement admise.
« Les Anciens n’avaient nulle idée du progrès ; ils n’avaient même pas besoin d’en repousser l’idée, car ils ne l’avaient jamais conçue. Les nations orientales, maintenant encore, sont exactement dans le même cas. »
Les premières légendes de l’Antiquité reportent loin dans le passé la période heureuse de l’Humanité : c’est l’Âge d’or d’Hésiode, chez les Grecs ; c’est l’Éden de la Genèse, chez les Hébreux. À l’aurore de la civilisation, il était difficile de concevoir une harmonisation entre les exigences du clan ou de la tribu et les tendances de leurs membres. Le souci de la sécurité commandait la cohésion du groupe et refrénait l’essor de la personnalité.
Les lois de la cité doivent tendre à sa conservation, plutôt qu’à son enrichissement et à son extension. Peu ou point de relations extérieures, pas de critiques, pas d’irréligion, sous peine de prison ou de mort. C’est la négation du progrès sous toutes ses formes.
Cependant, au ve siècle avant notre ère se manifestait aussi une réaction contre la tyrannie de la cité, une revendication des droits de l’individu. Mais ce qui s’exprime ainsi, c’est un individualisme égoïste ; l’homme doit chercher le bonheur en soi et non dans les choses qui ne dépendent pas de lui.
« Le progrès moral est donc purement individuel et personnel. Ne dépendant pas des choses extérieures, il ne dépend pas du milieu où le sort nous a fait naître. L’idée qu’une transformation de la société, par une transformation préalable ou simultanée du milieu matériel, puisse rendre les hommes meilleurs, plus justes ou plus heureux parce qu’elle harmonise les individus avec la collectivité, est étrangère à la morale des anciens philosophes. » (L. Weber)
Rome introduit dans le monde l’ordre et, jusqu’à un certain point, la paix ; par contre, elle fait bon marché de l’individualité.
« Le Romain n’était pas un barbare vulgaire. Organisateur et administrateur hors ligne, il pesait de toute la force de son pouvoir méthodique sur ses administrés et, leur faisant goûter les fruits de l’ordre et apprécier les beautés du droit, dirigeait les énergies subsistantes dans l’élite vers les réalités politiques et sociales, c’est-à-dire dans une voie bien différente de celle qui avait conduit à l’étude désintéressée de la nature... La nullité scientifique des Romains n’a pas eu d’égale, si ce n’est celle des Chinois. » (L. Weber)
Progrès matériel, peut-être, mais ni progrès moral, ni progrès scientifique.
Cependant, à mesure que Rome étendait son hégémonie, abolissant l’autonomie des cités, et déracinait le citoyen dépouillé de son statut légal, prenait naissance l’idée de la valeur propre de l’individu. Le sentiment de la dignité de l’être humain et de la solidarité qui le lie à ses semblables se manifeste au iie siècle avant notre ère, chez Térence, par exemple.
La propagation des religions de salut, du Christianisme surtout qui triompha de ses rivales, parvint à dévier cette tendance, à dégrader l’homme en prétendant le spiritualiser, le détacher du monde au lieu de l’harmoniser avec lui.
« Selon le Christianisme, le progrès moral se ramène à la recherche du salut personnel, et le progrès social consiste dans la réalisation graduelle de l’Église universelle et de la communion des saints... »
« La préoccupation moderne du progrès est donc l’antipode des pensées qui élevaient l’âme chrétienne aux époques de foi. » (L. Weber)
« C’est avec la Renaissance que la théorie moderne du progrès devait naître pour se développer sans interruption jusqu’à nos jours. » (E. Dupréel)
Sans interruption, peut-être, mais pas sans difficultés, ni sans fourvoiements.
Au milieu du xve siècle, on acquiert une connaissance plus directe et plus exacte de la pensée des philosophes grecs ; on invente l’imprimerie, on découvre de nouveaux mondes. De ce fait, l’esprit critique s’éveille.
Aux xvie et xviie siècles, le scepticisme intuitif et subtil de Montaigne prépare le doute méthodique de Descartes. Chez ce dernier, chez Galilée, la science, au lieu de chercher son point d’appui dans l’autorité, dans la tradition, devient à la fois expérimentale et déductive. En résulte-t-il que l’on conçoit le progrès comme illimité ? Non.
« L’idée mère de Descartes, qui sera encore la chimère de Leibniz, c’est réellement l’idée d’une machine logique qui ouvre toutes les portes du savoir et qui périme les tâtonnements séculaires, avec leur résidu : les livres. »
Ce qui prévaut, au xviie siècle, c’est moins l’idée de progrès que celle d’un état de perfection qui, une fois atteint, ne laissera à l’homme rien d’autre à faire que vivre heureux et tranquille, dans l’attente de la béatitude qui lui est promise.
Au xviiie siècle encore, la foi au progrès est loin d’être générale. Rousseau voit toujours dans l’état de nature la condition de la vie heureuse.
Turgot, Helvétius, Diderot se font une autre idée du progrès ; ils ne séparent pas le progrès individuel du progrès social. Mais, pour que le principe du progrès soit accompagné de la conception des moyens de réalisation, il faut arriver à Condorcet qui, dans l’Esquisse du tableau historique des progrès de l’esprit humain, donne à l’idée son expression la plus complète.
« Condorcet prévoit une marche générale des sociétés vers l’égalité : égalisation des nations et des races humaines ; égalisation des individus dans chaque société, le morcellement des héritages nivellera les fortunes ; l’art d’instruire s’améliorera... La vie humaine durera plus longtemps grâce à une meilleure hygiène. On peut même espérer un développement supérieur des facultés intellectuelles de l’homme et de ses facultés morales. »
Telle devait être l’œuvre de la Révolution.
« Mais celle-ci n’amènera pas le repos dans la perfection : au contraire, elle fait la voie libre au progrès désormais irrésistible et ininterrompu. » (E. Dupréel)
Au xixe siècle, par crainte de nouvelles révolutions, chez de Bonald et de Maistre, par déception, chez les libéraux, on constate d’abord une régression de l’optimisme. Puis Comte reprend la tradition des philosophes, en mettant l’accent sur l’aspect intellectuel de la civilisation. À l’exemple de Condorcet, d’ailleurs, mais à l’encontre de celui-ci, il fixe un terme au progrès : le jour où la société aura été organisée conformément au schéma positiviste qu’il propose, dont la réalisation n’exigerait pas plus de 25 années, après quoi l’ère des révolutions serait close dans tout l’univers.
Le transformisme, les doctrines évolutionnistes qui prennent consistance dans la deuxième moitié du siècle dernier redonnent enfin une nouvelle vigueur à la notion de progrès indéfini, en l’étendant même à toute la nature. Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit de la part d’illusion que comporte cette conception anthropocentrique.
L’opinion qui a régné au sujet du progrès a toujours obéi à un certain rythme, suivant que les inventions techniques, la prospérité, la paix facilitent l’existence et incitent à l’optimisme, ou que la stagnation de l’industrie, la misère, la guerre, la rendent plus dure et provoquent le pessimisme.
Aujourd’hui, pour la première fois peut-être dans l’histoire, nous voyons le développement de la science, l’abondance des ressources naturelles, l’accroissement de la production devenir causes de détresse et nous faire douter de l’avenir.
L’habileté technique – tours de mains et de métiers – a, dès les premiers âges, porté l’homme à se singulariser ; et la monopolisation des découvertes en limitait l’essor. La science, au contraire, qui ne peut progresser que grâce à l’échange des idées, tendait à leur généralisation et aboutissait à doter l’humanité d’un fonds commun, à la socialiser.
Ce qui caractérise l’époque moderne, après François Bacon, empiriste, et Descartes, rationaliste, c’est la conjonction de la science et de la technique. Au milieu du xviiie siècle, la plupart des philosophes et les savants sont expérimentateurs, souvent même constructeurs de mécanismes.
Le but des deux fonctions, l’une pratique, l’autre théorique, jadis distinct, est le même aujourd’hui : fortifier la personnalité de l’homme, en lui donnant la maîtrise des forces naturelles, mettre de l’ordre dans le milieu et systématiser l’activité individuelle, dans la mesure nécessaire à l’harmonie de l’ensemble de la société, libérer les tendances particulières en ménageant les initiatives, en cultivant l’esprit d’invention ; au total, élever le niveau, assurer la sécurité de l’existence.
De l’accord entre les deux disciplines, si longtemps rivales, on était en droit d’attendre les plus grands bienfaits : d’abord une suppression des classes sociales, l’effacement de la distinction entre intellectuels et manuels.
D’où vient que l’époque à laquelle l’essor des sciences appliquées offrait à l’humanité de telles possibilités de bonheur soit précisément celle des plus insupportables inégalités, de la plus alarmante insécurité ?
C’est qu’il s’est produit, par l’effet même de la survivance des inégalités anciennes, une confusion entre les moyens et la fin, qui devait accroître les différences au lieu de les niveler. Plutôt que de s’appliquer à perfectionner la nature humaine, on a recherché la multiplication des richesses susceptibles d’être appropriées.
Accroissement incohérent et démesuré du rythme de la production et de sa masse, confiscation capitaliste des sources d’énergie naturelles et gaspillage de celles qui ne sont que des réserves limitées léguées par les temps révolus, rationalisation dont la dégénérescence est le terme, tout cela constitue notre civilisation quantitative qui n’a du progrès que l’apparence.
Le progrès humain, qui n’implique nullement le renoncement aux conquêtes de la science, exige avant tout le retour à une civilisation qualitative ayant pour but le développement de la personnalité humaine, lié à l’enrichissement d’une société qui dominera son œuvre, au lieu de se laisser écraser par elle.
— G. Goujon.
PROGRÈS
Étant donné l’article qui précède, je me bornerai à quelques réflexions personnelles. Notons avant tout que le mot progrès se classe parmi les très nombreux termes qui, tout en étant employés à tort et à travers, tout en ayant l’allure d’un désignatif clair et précis, sont, en réalité, désespérément vagues, ce qui donne lieu à des interprétations non seulement différentes, mais chaotiques et même contradictoires.
Malgré le nombre considérable d’auteurs qui ont cherché et qui cherchent toujours à établir la notion du progrès, à construire une théorie du progrès dans la Nature et dans la Société humaine, cette notion, cette théorie n’existent encore ni scientifiquement, ni philosophiquement. Chaque auteur traite et résout la question à sa façon, d’une manière plus ou moins fantaisiste. Le problème reste ouvert. La formule scientifique du progrès fait défaut. Toutes les hypothèses, plus ou moins fondées, sont admises, tant que les faits acquis ne les contredisent pas. Quant à ceux qui ne sont pas initiés aux œuvres de la science ou de la philosophie, ils se servent du mot progrès dans des cas et en des sens très variés. On ne pourrait rien déduire de l’emploi courant de ce terme. Dans le langage habituel, le mot progrès est lancé, à tout instant, d’une façon insouciante, sans précision aucune, par simple habitude. On l’applique toujours dans un sens très restreint, tout à faire conventionnel, purement empirique. Aussitôt sortis de ce terrain – immédiat, concret, mais très relatif, étroit et stérile –, nous tombons dans le vide.
D’ailleurs, l’existence même du progrès, aussi bien dans la Nature que dans la vie humaine, est fortement contestée de toutes parts. « Le soi-disant progrès dans l’activité de la Nature est un non-sens. Certaines séries de phénomènes biologiques nous donnent cette illusion ; mais ce n’est qu’une illusion humaine due à l’évolution et à l’adaptation naturelles des organismes. Le progrès suppose un mouvement général, en ligne plus ou moins droite et continue, dans une direction donnée, vers un certain résultat à atteindre. Plus précisément, progrès – dans le sens du mot qui nous intéresse ici – signifie marche en avant, vers le mieux. Or, quelle « direction », quel « résultat à atteindre », quel « mal », quel « bien » ou quel « mieux » pourrait-on voir dans le mouvement perpétuel et circulaire de la Nature ? De toute évidence, il ne s’agit là que des transformations cycliques continuelles, sans aucune orientation, ni direction, ni tendance... » Telle est l’opinion très répandue sur le progrès dans la Nature. Et, quant à la vie humaine (individu, société, « culture », « civilisation »), les avis négatifs sur le progrès dans ce domaine sont également très fréquents. Si, parfois, on est obligé d’admettre une sorte de progrès technique ou scientifique dans l’existence humaine – conquête croissante des forces de la nature par l’homme, par exemple –, nombreux sont ceux qui, d’une part, nient tout progrès moral ou social de l’humanité. Et puisque, d’autre part, les « conquêtes techniques et scientifiques » n’aboutissent, du moins jusqu’à présent, qu’à une dégénérescence physique (et peut-être aussi psychique) de l’humanité ; puisque, de plus, ces conquêtes sont mises surtout au service des instincts destructeurs et dominateurs de l’homme, sans arriver à améliorer le sort des vastes masses humaines – nombreux sont ceux qui refusent de reconnaître même à ces conquêtes un caractère vraiment progressif.
Donc, toutes les questions se rapportant à l’idée du progrès – qu’est-ce que le progrès ? Existe-t-il dans la nature en général ? Existe-t-il dans l’évolution de l’homme ? Et ainsi de suite – restent, en somme, sans réponse nette. Et, cependant, assez multiples sont les faits qui, malgré tout, nous suggèrent cette idée et la maintiennent. Ces faits appartiennent surtout au domaine biologique et, spécialement, à celui de l’évolution humaine. L’idée et le terme existent. Intuitivement, on admet assez souvent la réalité d’un progrès, au moins relatif. Volontiers, on reconnaît à l’évolution de la vie (évolution des organismes, évolution de l’homme) un caractère « progressif », sans arriver, toutefois, à le préciser, sans réussir à rallier à cette opinion la totalité des suffrages.
Le progrès existe-t-il ? Si oui, en quoi consiste-t-il ? Peut-il être considéré comme une sorte de loi ou de tendance générale dans la Nature ? Est-il, au contraire, tout à fait relatif, inhérent à l’évolution des organismes seulement ? Ou, peut-être, seule la vie humaine en est bénéficiaire. Quel serait le véritable sens du progrès dans l’un ou l’autre de ces cas ? Comment pourrait-on démontrer son existence ? Comment pourrait-on le définir ?
Tel est le problème. Pour l’aborder utilement, il faut se demander :
-
Quelle est la raison pour laquelle il n’a pu encore être résolu ?
-
Quels sont les éléments indispensables à sa solution ?
-
Sommes-nous actuellement en possession de ces éléments ? Si oui, il faut les utiliser pour tâcher de résoudre le problème. Sinon, il faut s’appliquer à les rechercher.
À ces questions, nous sommes obligés de répondre comme suit :
-
La raison primordiale de notre insuffisance quant au problème du progrès est l’ignorance totale des principes généraux qui régissent l’activité de la Nature. Nous ne connaissons pas les forces mouvantes principales de l’Évolution (voir ce mot). Les ressorts fondamentaux de l’évolution en général, de l’évolution de la vie, de l’évolution de l’homme nous restent toujours inconnus. Tant que nous ne connaitrons pas à fond tout le mécanisme du processus évolutionniste – ses bases, son fonctionnement, ses effets –, nous ne pourrons pas établir la notion du progrès.
-
L’élément le plus indispensable à la solution du problème du progrès est la connaissance du principe fondamental et des forces mouvantes de l’Évolution.
-
Cet élément nous fait toujours défaut. Il faut donc commencer par le rechercher.
Ainsi, les premières questions posées nous mènent au cœur même du problème du progrès. On voit que ce dernier est étroitement lié à celui de l’Évolution. Il nous y conduit directement. Car, tant que nous ignorerons le facteur initial, les principes fondamentaux, les véritables forces motrices du processus du transformisme évolutionniste, il nous sera impossible d’établir scientifiquement la notion du progrès. La clef de l’énigme gît au fond du grand problème de l’évolution de la Nature, de la Vie et de l’Homme. Jusqu’à présent, ce furent – hélas ! – la religion et la métaphysique qui prétendaient posséder le monopole de tout cet immense domaine. Il est grand temps que la science s’en saisisse d’une façon définitive.
Si le lecteur veut bien se donner la peine de parcourir, dans cette même Encyclopédie, quelques-uns de mes rapides aperçus (voir Création, Biologie, Faim, Matérialisme historique), il entrera déjà dans le cercle de certaines idées dont il trouvera ci-dessous un bref résumé. (Il va de soi que je ne pourrai développer ici un sujet aussi vaste, exigeant un ouvrage spécial. Quelques indications, nécessaires pour arriver à certaines conclusions sur le progrès, suffiront.)
J’estime, primo, que le facteur primordial, la véritable force motrice de l’évolution dans la Nature, est une énergie spécifique que j’appelle « énergie créatrice ». Je dis que c’est une énergie spécifique en ce sens qu’elle représente une forme d’énergie sui generis, de même que d’autres formes d’énergie connues jusqu’à présent (énergies mécanique, thermique, électrique, chimique, atomique, psychique, etc.), avec lesquelles elle ne coïncide pas. Et, de même que ces autres formes d’énergie, je la suppose transformable (en d’autres formes), inhérente à la matière, inconsciente. C’est à cette énergie que l’univers, tel que nous le connaissons, doit son existence. C’est elle qui détermine l’évolution de la matière, c’est-à-dire un mouvement qui, loin d’être un simple déplacement chaotique uniforme, éternellement pareil, des parcelles de la matière, est un mouvement de transformations consécutives : mouvement varié, compliqué, accusant une certaine direction ou tendance suivie.
J’estime, secundo, que cette énergie créatrice – de même que les autres formes d’énergie – n’est pas répandue, dans l’univers, d’une façon égale et uniforme. Ses aspects, ses effets et, surtout, son intensité, sont variables. Pour des raisons encore inconnues, cette intensité commence à augmenter, et l’activité de l’énergie créatrice commence à s’accroître dans certains points de l’univers. C’est là que se produit alors ce phénomène – l’évolution – qui nous intéresse ici particulièrement. Un « monde » naît et se développe.
J’estime, en troisième lieu, qu’une fois commencé, dans tel ou tel autre point de l’univers, ce processus d’accroissement de l’intensité de l’énergie créatrice y continue. C’est cette tension continuelle et continûment croissante de l’énergie créatrice que je considère comme le « principe fondamental », la véritable force motrice, l’essence même de l’évolution. Autrement dit, ce que nous appelons évolution est l’effet naturel de la tension continuelle et progressive (croissante) de l’énergie créatrice dans un point donné de l’univers. C’est, au fond, grâce à cet accroissement continuel de la tension de l’énergie créatrice que la nature, commençant – dans un point donné de l’univers – par une simple transformation de la matière brute (dite « inorganique »), arrive progressivement à la création de la cellule vivante et, ensuite, à l’évolution de la vie, jusqu’à ses formes supérieures.
J’estime, enfin, que toute cette évolution ou – ce qui revient au même – cet accroissement progressif de l’intensité de l’énergie créatrice, a une « tendance », une certaine « direction » (bien entendu, inconsciente). Au fur et à mesure de cette augmentation de tension, l’énergie créatrice se modifie qualitativement. Plus son intensité augmente, plus elle devient active, puissante, riche en combinaisons, « généreuse », variée, inventrice, organisatrice... Dans la matière brute, « inorganique » (minéraux, métaux, etc.), l’énergie créatrice se trouve en état primitif, état de tension très faible, état latent, passif, uniforme. L’évolution de la matière inorganique a pour cause plutôt le jeu d’autres sortes d’énergies (énergie mécanique, thermique, atomique, électrique, etc.) que l’activité de l’énergie créatrice. Mais la tension de celle-ci augmente progressivement. À un certain degré de son intensité, un nouveau pas est accompli par le processus évolutionniste : les premiers éléments organiques, vitaux apparaissent. L’énergie créatrice y est incomparablement plus active, plus apparente, plus puissante. Cependant, ce degré de son activité, de sa puissance reste encore très bas dans les organismes primitifs et aussi dans le monde végétal. La tension de l’énergie créatrice continuant d’augmenter, l’évolution arrive aux formes animales. Ici, l’énergie créatrice est plus prononcée que chez les plantes. Toutefois, tant qu’il s’agit des espèces animales, sauf l’homme, elle est encore loin d’y atteindre son plein épanouissement, de donner toute sa mesure. Dans le règne animal – sauf l’homme –, l’énergie créatrice reste limitée, « dosée », comme enfermée dans un vase clos. Elle est encore impuissante à s’y révéler, à « s’y réaliser » entièrement. Son activité, ses effets y sont très restreints, invariables chez chaque espèce donnée. Il ne s’agit pas encore là de la véritable faculté créatrice, pouvant varier infiniment, capable d’une auto-évolution illimitée, susceptible de se mettre au-dessus des autres forces et énergies de la Nature, de les dominer, de les maîtriser, de s’en emparer, de les faire servir... Mais l’évolution continue. Elle « tend » vers un être créateur par excellence ; un être qui – son organisation physique correspondant, par suite de cette évolution, à un niveau supérieur de la puissance créatrice – serait créateur avant tout, et dont la faculté créatrice serait complète, définitive, dominante, illimitée. Cet être, sur la Terre, est l’homme. En lui, la Nature atteint l’effet vers lequel elle « tendait » au cours des millions d’années : apparition – au bout de cette longue évolution (mue, au fond, par l’intensité continûment croissante de l’énergie créatrice) – d’un organisme qui possède cette énergie créatrice au plus haut point ; qui est, pour ainsi dire, lui-même « générateur » de cette énergie ; qui est bâti, en même temps, de façon à pouvoir, justement, la produire, la développer, la varier, la mettre à l’œuvre avec une diversité, avec une profusion magnifiques, sans qu’une limite quelconque vienne s’opposer à cette activité.
Oui, l’homme est surtout un créateur. Il possède l’énergie créatrice au suprême degré et un corps approprié, souple, se prêtant à une auto-évolution totale et fondamentale. Une activité créatrice infiniment riche et variée, tel est le véritable destin vers lequel l’humanité s’avance par le long et pénible chemin de l’évolution. La faculté créatrice – multiforme et quasi illimitée – fusionnée avec le besoin inné, irrésistible, de créer (besoin qui évolue également), tel est le trait le plus remarquable, le trait dominant, essentiel, fondamental, de la nature de l’homme. C’est même son unique trait nettement distinctif. À l’encontre du corps des autres animaux, celui de l’homme n’offre pas d’obstacle insurmontable à la pleine activité, à l’évolution illimitée de la faculté créatrice.
Et quant à certaines entraves que ce corps présenterait, en raison de sa parenté naturelle avec le corps animal en général ; quant, aussi, à certaines régressions physiques ou autres qui résulteraient parfois de toute cette évolution spécifique – très compliquée et tortueuse –, les unes et les autres pourront être surmontées et vaincues par l’avancement continuel de la même évolution, par l’activité incessante de cette même faculté créatrice de l’homme.
Ainsi, ce sont la faculté créatrice et l’organisme approprié qui déterminent l’évolution de l’homme. Il est poussé, au fond, par le triple ressort que voici : la présence de la faculté créatrice, le besoin impérieux de l’appliquer, et la possibilité physique de le faire.
L’homme est, sur la Terre, le combinateur, l’organisateur, l’inventeur, le créateur le plus riche, le plus parfait, le plus puissant qui puisse exister. C’est pourquoi il réussit à dominer, à maîtriser les autres forces et énergies de la Nature, ainsi que les autres formes de la vie végétale et animale.
La différence entre l’évolution de l’animal et de l’homme est frappante. L’animal – même le plus intelligent ou le plus social – s’adapte au milieu : il subit l’emprise de l’ambiance et il « s’y fait », au moyen d’un mécanisme de sélection et de variations anatomiques ou autres. L’homme évolue dans un tout autre sens : au lieu de s’adapter au milieu, il tend, dès ses débuts, à se soustraire à cette nécessité, à dominer le milieu. Il cherche, de plus en plus, à adapter le milieu à ses besoins. La différence est plus que frappante : elle est un indice. Car elle nous impose un « pourquoi » et nous mène ainsi vers la clef de l’énigme de l’évolution et du progrès.
Arrivée à l’Homme, la Nature a créé un être qui continue, lui-même, l’évolution par l’activité incessante et illimitée de son génie créateur. Arrivée à l’Homme, la Nature a créé, sur la Terre, la forme vitale supérieure, capable d’une auto-évolution illimitée, en sorte que, après l’Homme, la Nature ne créera pas de formes plus parfaites encore que lui. Elle abandonnera, pour ainsi dire, entre ses mains le sort de l’évolution ultérieure. Avec l’homme, l’intensité de l’énergie créatrice atteindra le point culminant. Désormais, c’est l’homme qui se chargera de la suite de la progression créatrice. Grâce à sa puissance de création, l’homme pourra : d’une part, se perfectionner lui-même ; et, d’autre part, il pourra façonner, modifier, maîtriser, adapter, organiser, mettre à profit, améliorer ou perfectionner tout ce qui l’entoure sur la Terre. (Il se peut même qu’il réussisse, un jour, à dépasser les limites de sa planète.)
Ce qui est le plus remarquable chez l’homme, ce qui le distingue effectivement des autres animaux et le met définitivement et à jamais au-dessus d’eux, ce n’est pas encore son intelligence (il existe des animaux très intelligents, et il est prouvé que leur intelligence peut évoluer) ; ce n’est pas, non plus, sa sociabilité (il existe des animaux très sociables, autant et même plus sociables que l’homme) ; ce ne sont pas sa « conscience », son « sens moral », etc. : c’est sa faculté créatrice, infiniment variée et infiniment évolutive. La célèbre définition de Pascal – « L’homme est un roseau pensant » – devrait, il me semble, être remplacée par celle-ci, plus significative :
« L’homme est un roseau créant. »
Les perspectives de l’évolution créatrice de l’homme sont illimitées. (Il va de soi que j’emploie cette expression – « évolution créatrice » – dans un sens tout autre que celui qui inspira à H. Bergson le titre de son ouvrage connu.) L’humanité n’est encore qu’au début de son chemin. Sa véritable ascension créatrice ne commencera pour elle qu’après qu’elle aura surmonté, sur le chemin de l’évolution, tout ce qui l’attache encore au monde purement animal, tout ce qui l’empêche de déployer rapidement et sans entrave son activité créatrice. Une bonne partie du chemin consiste, précisément, à se débarrasser entièrement du lourd fardeau que l’homme hérita de ses ancêtres, fardeau qui, certes, s’allège progressivement, mais qu’il aura à traîner encore longtemps, et qui retarde terriblement son ascension vers les splendides sommets d’une existence créatrice, vraiment humaine. C’est en raison de ce fardeau, et des effets de sa pression, que tant d’hommes, aujourd’hui, sont contraints à rester à l’écart de toute création.
Après tout ce qui précède, le lecteur comprendra aisément la façon dont il me semble juste de concevoir le progrès. Un bref résumé et quelques explications complémentaires suffiront. Naturellement, la notion du progrès – comme d’ailleurs, toutes nos notions – est purement humaine. « Progrès » signifie « marche en avant vers le mieux ». Or, la Nature, prise dans son ensemble, ne connaît ni le « bien », ni le « mal », ni le « mieux ». Elle ne connaît donc pas de progrès. C’est exact.
Mais la Nature connaît l’Évolution. Et l’évolution – telle que je la conçois et que j’ai tâché de la dépeindre – s’accomplit dans un sens qui mène (sur la Terre) à l’homme et qui le touche profondément. Or, l’homme connaît parfaitement le « mal », le « bien » et le « mieux ». En maintes occasions, l’homme connaît aussi la « marche en avant vers le mieux ». Il connaît donc le progrès. S’il ne s’agissait que de ces différentes occasions, le problème serait facile à résoudre. Au fond, il n’existerait même pas, car l’existence, dans la vie humaine, de certains progrès, est un fait indéniable. D’autre part, l’homme connaît aussi la régression, une « marche en arrière vers le pire ». De sorte qu’aucune déduction définitive ne pourrait être tirée de ces faits épars ou de ces fluctuations en elles-mêmes. À quelqu’un qui citerait des exemples pour démontrer l’existence du progrès dans la vie humaine, un autre pourrait répliquer en citant des exemples contraires, et la discussion n’avancerait pas d’un pouce, tant qu’on resterait sur ce terrain de faits décousus. Ce genre de discussion, très répandu malheureusement, est même l’une des raisons pour lesquelles le problème du progrès piétine. Or, il ne s’agit pas de ces faits épars ; il s’agit d’autre chose. Le problème qui nous importe est général, à savoir : l’évolution (de l’homme) dans son ensemble est-elle, oui ou non, une « marche en avant vers le mieux » ? Autrement dit : l’humanité, dans sa marche historique, va-t-elle, oui ou non, vers un progrès (un « mieux ») général et définitif, aussi bien individuel que social ? La « balance » de l’évolution humaine est-elle positive ou négative ? (Quant aux régressions – au cas d’une réponse affirmative –, il faudrait, tout simplement, chercher les raisons qui les expliqueraient.)
Si, par un moyen quelconque, nous apprenions aujourd’hui que, d’ici à des milliers d’années, l’humanité, en dépit de l’intelligence de l’homme, de ses succès techniques et de sa conquête des forces de la Nature, continuera de se mouvoir toujours, et sans autre issue possible, dans les cadres de la société absurde et horrible de nos jours – société basée sur l’autorité, l’exploitation de l’homme par l’homme, l’injustice, le profit des uns, la misère des autres, l’iniquité, la guerre et, surtout, comme résultat, l’écrasement de l’individu créateur –, nous dirions sans hésiter : « Non ! Au fond, le vrai progrès n’existe pas dans la vie humaine. » Car, naturellement, l’intelligence et le « progrès technique » en eux-mêmes – s’ils n’aboutissent pas à une vraie société, c’est-à-dire à un vaste ensemble de toutes sortes d’associations d’hommes sains, créateurs libres, à la place d’une « société » de profiteurs et d’esclaves dégénérés et malheureux – ne signifient nullement un vrai progrès général et définitif de l’humanité.
Si, d’autre part, nous apprenions que l’évolution de l’humanité aboutira finalement à une société semblable, par exemple, à celle des fourmis ou des abeilles, société rigide, à cloisons étanches entre des individus à fonctions fixes (même innées), société dont l’harmonie purement « mécanique » aura pour base le sacrifice total de l’individu, au profit de ce « mécanisme social » dont cet individu deviendra une « vis » quelconque (au lieu d’une société où tout individu puisse développer et appliquer librement et infiniment ses facultés créatrices), nous dirions encore : « Non ! Il n’y a pas de véritable progrès dans la société humaine. »
Ce n’est que si nous apprenons que la longue et pénible évolution de l’humanité aboutira à une société dont la solidarité et l’harmonie, pleines de vie, de mouvement réel, de création palpitante se feront non pas à l’aide d’un « ajustage » de « vis mécaniques », mais par le libre exercice, le libre jeu, la libre combinaison de l’activité créatrice de tous les humains ; société qui sera, par conséquent, une libre association d’individus créateurs ; société où tout homme, totalement émancipé, pourra développer et appliquer, sans entraves ni limites, toutes ses capacités de créateur (en art, science, métiers, technique, matière sociale, etc.), de sorte que l’harmonie collective, la vie et révolution ultérieure de cette société, basées sur la liberté totale, l’égalité sociale et la fraternité des hommes, seront assurées non pas par un mécanisme sans âme, mais, précisément, par cette création libre et pleinement épanouie de ses membres, auxquels, inversement, cette société assurera la pleine liberté et dont elle favorisera l’activité créatrice, ce n’est qu’alors que nous dirons sans hésitation : « Oui ! Cela, c’est du vrai progrès humain, général et définitif. Et si telle est la perspective de l’évolution humaine, alors, oui, cette évolution est franchement progressive. » Car le point essentiel de notre notion du progrès est, sans aucun doute, la libre activité créatrice de tous les humains, au sein d’une société favorisant cette activité, basée sur elle, et évoluant par elle.
Ainsi, ce qui, pour l’homme, caractérise et détermine généralement et définitivement le progrès, c’est la perspective d’une évolution créatrice de l’humanité. Or, en admettant ce qui a été dit précédemment, nous constatons :
-
Que l’évolution de l’homme se fait, au fond, précisément, dans ce sens.
-
Que la Nature, évoluant (sur la Terre) vers l’homme, évolue, au fond, dans le même sens. Nous constatons donc que, au point de vue humain (le seul possible et le seul qui nous intéresse) :
-
le progrès est inhérent à l’homme, à la société humaine, à l’évolution de l’humanité ; et
-
l’évolution générale de la Nature (du moins sur la Terre) – de la matière « inorganique » à la vie et, ensuite, à l’homme – est progressive.
-
Nous pouvons même essayer de définir le progrès, au point de vue humain, comme une tendance générale de la Nature, dans son évolution, vers le maximum d’activité de l’énergie créatrice, vers la réalisation, la « matérialisation » la plus complète possible de cette énergie ; tendance qui se manifeste par la croissance continue de l’intensité de cette énergie (là où l’évolution a lieu) ; tendance qui, sur la Terre, mène à l’hommecréateur, lequel, conséquemment, en développant et en appliquant ses facultés créatrices, évolue vers le plus grand bien que l’homme puisse concevoir : une activité créatrice libre, complète, illimitée, de tous les hommes, au sein d’une société parfaite, basée sur cette activité, l’assurant et la favorisant.
Soulignons, ici même (afin de faire mieux comprendre l’essence du progrès et de ses facteurs principaux : la faculté et l’activité créatrices), que cette activité créatrice forme non seulement le « but » vers lequel « tend l’évolution humaine, mais aussi, en même temps, le seul moyen d’atteindre ce but. En effet, ce n’est que par la voie de la création croissante que l’humanité parviendra à son splendide avenir. Cet avenir, c’est la vie créatrice. Et le moyen, c’est encore l’action créatrice. Sans cette dernière, l’humanité, vu les conditions spéciales de son existence, et malgré son intelligence ou sa sociabilité, serait infailliblement condamnée, soit à la dégénérescence complète et à la disparition, soit à la formation d’une société « mécanique » semblable à celle des fourmis ou des abeilles. Seules sa faculté et son action créatrices parent à ces menaces et guident l’humanité vers le triomphe définitif, affirmant sa progression au milieu et à travers des dangers, des difficultés et des obstacles de toutes espèces. Donc, le progrès en marche est formé par l’ensemble du moyen et du but, l’un étant inséparablement « soudé » à l’autre. Cette constatation est très importante pour comprendre le vrai caractère de l’évolution créatrice de l’humanité et pour arriver à des appréciations, à des déductions justes.
Précisément, nous avons dit plus haut qu’au cas où nous aurions admis le progrès, nous devrions chercher les raisons pour lesquelles la voie du progrès n’est pas absolument droite, nette, continue. En effet, l’humanité connaît, au cours de son évolution, des déviations, des interruptions, des arrêts, des égarements, voire des reculs et des régressions. D’autre part, elle est constamment contrariée et menacée dans sa marche par toutes sortes d’imperfections, de contradictions, de dégradations, de déchirements, etc., ce qui paraît justifier la mise en doute de l’existence même d’un progrès définitif. D’ailleurs, s’il en était autrement, le problème du progrès ne se discuterait pas, car le progrès serait alors évident. Si le problème se pose, c’est justement parce que le progrès n’est pas encore bien prononcé. On ne peut pas encore le concevoir autrement que d’une façon générale, cherchant à deviner, à dévoiler les ressorts profonds et cachés de l’activité de la Nature. Et quant aux raisons de cette marche entrecoupée, inconséquente du progrès, elles sont multiples, variées et compliquées. Il nous est impossible de les analyser, comme il convient, dans ces colonnes. Bornons-nous à constater deux choses :
-
L’homme, s’étant détaché du reste des animaux (par suite d’un surcroît, physiquement à peine perceptible et, cependant, décisif, de la faculté créatrice), resta au début très près de ses ancêtres. Pour plusieurs raisons, son éloignement progressif des animaux se fit – et se fait encore – très lentement et très péniblement, sans harmonie ni concordance. Tandis que, dans certains sens, l’homme se trouva bientôt très en avance, dans d’autres il reste encore aujourd’hui presque au niveau de l’animal. La grande tragédie de l’humanité consiste justement dans ce déchirement, dans ce tiraillement entre sa situation primitive tout près des animaux, d’une part, et, d’autre part, son éloignement par une évolution spécifique, singulière et, par conséquent, disproportionnée, accidentée, difficile, vers de nouveaux horizons d’une vie humaine, créatrice. C’est cette disproportion, ce tiraillement, ce contraste entre l’avancement très prononcé dans certaines matières et le piétinement dans d’autres, qui fait surgir sur la route du progrès humain des obstacles, des difficultés, des dangers sans nombre, et qui explique, tout au fond, les défaillances, les trébuchements, les culbutes et les reculs de l’humanité.
-
Hâtons-nous de le préciser – c’est encore et toujours la faculté et l’action créatrices de l’homme, et elles seules, qui lui permettront, en fin de compte, d’écarter toutes les entraves, de triompher de tous les dangers, de parer à de graves menaces de dégénérescence, de vaincre les faiblesses et ses imperfections, en les aplanissant ou même en les transformant en forces et avantages, de résoudre la tragédie et d’arriver au port. Et, d’ailleurs, la marche du progrès devient de plus en plus rapide et prononcée (en dépit des tiraillements qui, en raison même de cette accélération, se font sentir, eux aussi, d’une façon plus intense, soulignant davantage les contrastes tragiques de la progression humaine). Je pourrais citer, à l’appui de mes paroles, des exemples et des preuves à volonté, puisés dans la vie quotidienne. Le manque de place me le défend. Mais j’aime à croire que le lecteur les trouvera aisément lui-même, s’il veut se donner la peine de regarder attentivement autour de lui et de réfléchir. Il n’est pas si éloigné, le jour où la marche progressive de l’humanité vers les horizons créateurs – quelques gros obstacles étant franchis – deviendra moins pénible, moins accidentée, plus nette, plus ferme et plus alerte.
Soulignons, ensuite, que le progrès est illimité, dans ce sens et pour cette raison que ses sources – la faculté et l’activité créatrices de l’homme ainsi que les possibilités de les exercer – n’ont pas de limite, n’ont pas de « fin » (à moins de la disparition de notre monde). La création est infinie. Donc, infini est le progrès.
Précisons enfin, brièvement, encore un point important. C’est aussi uniquement par le chemin de la création, par l’effort créateur, que l’humanité arrivera à liquider la fameuse contradiction entre le progrès individuel et le progrès social, le conflit « éternel » entre l’individu et la société, ce gros tiraillement sur le chemin du progrès. C’est par son action créatrice que l’homme réalisera la grande synthèse qui conciliera l’intérêt, la liberté, le bien-être de l’individu avec le bien-être de la collectivité. Cette conciliation est, naturellement, un des éléments les plus indispensables du vrai progrès. Or, aucune force, en dehors de l’activité créatrice de l’homme, ne pourrait y aboutir. En l’absence de cette force, l’un ou l’autre – individu ou société – aurait été finalement, et fatalement, sacrifié. (Bien entendu, plutôt l’individu que la société. Voir, encore, la société des fourmis, des abeilles, etc.). Ce n’est que par ses capacités, ses aspirations et ses réalisations créatrices que l’homme parviendra à une solution où les intérêts, la liberté, le progrès de l’individu et le bien de la société coïncideront en une harmonie parfaite. C’est en cela que la société humaine diffère de celle des animaux, lesquels, faute de l’élan créateur, sont impuissants à arriver à une solution pareille. Et cela nous dit encore que la véritable base, le vrai levier du progrès humain est la force créatrice de l’homme.
Passons à quelques déductions et, aussi, à certaines réserves.
-
D’après notre conception, la véritable base, la vraie force motrice de l’évolution dans la Nature est l’énergie créatrice qui, par la croissance continue de son intensité, et sans intervention d’un autre principe spécial, pousse l’évolution, progressivement, à travers le développement de la matière « inorganique », au phénomène de la « vie » et à l’évolution de celle-ci (là où l’évolution a lieu). Cette conception nous mène à la liquidation de la fameuse controverse entre les « mécanistes » (ceux qui réduisent le processus évolutionniste à des phénomènes purement mécaniques) et les « vitalistes » (ceux qui supposent l’existence d’un « principe vital » distinct des autres forces de l’évolution). En effet, notre conception tend à réconcilier les deux doctrines opposées, car elle offre une synthèse unique où tous les phénomènes de l’évolution – qu’ils soient « mécaniques » ou « vitaux » – trouvent leur explication naturelle, sans qu’on ait recours à l’intervention d’un « principe vital » spécial.
-
D’après notre conception, la base, la force motrice du progrès humain est la puissance créatrice de l’homme (c’est-à-dire la faculté créatrice, le besoin de créer, et la possibilité matérielle de le faire). C’est cette force qui a poussé – et qui pousse toujours – son évolution en avant, depuis les premiers pas, la découverte et l’application du feu, jusqu’aux réalisations modernes sur tous les champs de l’activité humaine.
Cette conception nous oblige à rejeter comme inexactes les théories qui voient la base et la force motrice de l’évolution humaine dans la particularité des besoins matériels de l’homme, dans la croissance de ces besoins et des forces productrices de l’humanité – c’est-à-dire les théories qui reconnaissent, comme étant le facteur primordial du progrès humain, les nécessités matérielles de 1’homme et, ensuite, le facteur socio-économique. Pour nous, la nature particulière des nécessités humaines, la croissance des besoins et des forces productrices de l’homme sont des éléments « de second plan », des « dérivés » qui proviennent justement de sa substance créatrice, qui ne forment nullement le ressort fondamental du progrès (de même que l’intelligence de l’homme, sa sociabilité, etc.), et qui, par eux-mêmes, n’assurent pas forcément le progrès. Ce qui l’entraîne et l’assure au fond, et fatalement, c’est l’élément créateur de l’homme. Il faut creuser plus profondément pour arriver à la véritable base du progrès humain. La particularité des nécessités de l’homme, leur croissance, etc., nous laissent entrevoir déjà, justement, l’existence d’un élément spécial et plus profond, propre à l’homme : sa substance créatrice. C’est donc l’économisme marxiste (appelé inexactement « matérialisme historique ») que nous sommes obligés de rejeter définitivement. (Je regrette de ne pouvoir traiter ici ces questions importantes que très sommairement. J’espère, toutefois, que le lecteur lui-même voudra bien et pourra les approfondir.)
-
D’après notre conception, le vrai critère fondamental du progrès est le niveau – l’intensité, l’extension, les réalisations – de l’activité créatrice des hommes. Le progrès consiste en une évolution vers la plus grande « somme » possible de cette activité créatrice. Puisqu’il n’existe aucune limite dans le domaine de la création, puisque le « plein » ne peut jamais y avoir lieu, le progrès est infini.
Le dit critère de base du progrès peut être appliqué aussi bien à l’ensemble de l’évolution humaine (ou d’une époque historique entière) qu’à des faits séparés, tant individuels que sociaux. D’une façon générale, est progressif tout ce qui facilite, favorise et stimule l’éclosion, l’élan, l’épanouissement, l’extension de l’activité créatrice des hommes, tout ce qui augmente les possibilités de créer pour le plus grand nombre d’individus. Au contraire, tout ce qui diminue, empêche, entrave, restreint ou arrête ces possibilités est régressif.
Toutefois, il faut savoir manier ce critère (comme tout autre, d’ailleurs). Il faut s’en servir avec beaucoup de prudence et de savoir-faire, ce maniement étant délicat et présentant certains dangers pour le jugement de celui qui s’y prendrait maladroitement. En appliquant le critère du progrès à des faits concrets, il faut savoir regarder en profondeur et en largeur, savoir analyser, peser, calculer, comparer, établir la « balance », etc. ; sinon, on pourrait commettre de graves erreurs, les éléments et la marche du vrai progrès n’étant pas encore suffisamment simples, précis et visibles en eux-mêmes.
D’ailleurs, en affirmant que la puissance créatrice de l’homme est l’élément fondamental de son progrès, et que le niveau de l’activité créatrice en est le critère de base, je ne veux pas dire par là qu’ils sont le seul élément en général et l’unique critère. Ainsi, par exemple, la puissance créatrice de l’homme ne pouvant donner son véritable effet autrement que dans l’ambiance d’une entière liberté, cette dernière constitue un élément indispensable du vrai progrès. En appliquant notre critère de base, nous devons donc toujours tenir rigoureusement compte de cet élément essentiel du progrès : la liberté. Et généralement, nous faciliterons notre tâche, nous obtiendrons des résultats plus exacts en tenant compte de beaucoup d’éléments complémentaires qui viennent s’ajouter à l’élément fondamental, et qui sont souvent d’une grande portée pour notre jugement.
-
Je me rends parfaitement compte qu’il existe une multitude de questions, étroitement liées à notre problème et à ma thèse, qui se dressent devant nous et demandent impérieusement une solution claire. Malheureusement, il m’est impossible de les traiter dans ces colonnes. Je me bornerai à en citer quelques-unes et à donner à certaines d’entre elles une très brève réponse.
La première de ces questions – et certainement la plus importante – est celle-ci : qu’est-ce, concrètement, que l’énergie créatrice dans la Nature, en général, et la puissance (faculté) créatrice de l’homme, en particulier ? Cette question devrait faire l’objet d’un ouvrage spécial. Je me bornerai à dire que la faculté créatrice de l’homme pourrait être, dès à présent, précisée biologiquement (anatomiquement, physiologiquement) et psychologiquement. Et quant à l’énergie créatrice dans la Nature, je me permets de rappeler au lecteur que la nature concrète des autres formes d’énergie reste aussi inconnue, jusqu’à présent.
Autre question. La faculté créatrice est-elle propre à tous les hommes ou, seulement, à certains parmi les millions d’humains ? Je réponds brièvement : la faculté créatrice est une qualité dont chaque homme est doué, dans des domaines différents et aussi dans des proportions variées. Tous les hommes, par le fait même de leur naissance, possèdent la faculté créatrice. Mais cette faculté varie à l’infini, aussi bien qualitativement que quantitativement. J’ajoute que les conditions horribles de notre existence actuelle défendent à des millions d’hommes d’avoir conscience de leur faculté créatrice, de l’apprécier, de la développer, de l’appliquer. Ce fait est, d’ailleurs, connu. J’ajouterai qu’au fur et à mesure de l’avancement du progrès humain, la puissance créatrice des hommes se développera, elle aussi.
Encore une question : la conception de l’énergie créatrice dans la Nature, et de la faculté créatrice chez l’homme s’oppose-t-elle à la théorie de Darwin sur l’origine des espèces et de l’homme ? Je réponds : nullement. Cette conception ne s’oppose qu’aux deux théories suivantes : 1° celle de l’origine « accidentelle » de l’homme ; et 2° celle d’après laquelle l’homme serait un primate « dégénéré ». Quant à la théorie de Darwin, ma conception n’y apporterait que certains correctifs, compléments et développements. Elle tâcherait, ensuite, de répondre à certaines questions dont Darwin ne s’occupait pas, et qui se rapportent précisément au problème du progrès. J’ajouterai que, pour moi, la faculté même des espèces de varier, de s’adapter au milieu, etc., suggère l’idée d’une énergie créatrice – très primitive, très limitée – chez les animaux, ce qui, évidemment, n’exclue pas le rôle des facteurs immédiats constatés par Darwin. L’homme, soumis d’abord à l’action des mêmes facteurs immédiats, mais possédant l’énergie – ou, plutôt, la faculté – créatrice complète, illimitée, finit par dominer cette action, par se soustraire à ces facteurs, et même par les maîtriser. Il continue, ensuite, son évolution sur un tout autre plan. L’animal s’adapte, et s’arrête là. Il ne peut pas faire davantage. L’homme finit par ne plus s’adapter, mais par dominer. Quelles en sont les causes ? Est-ce du progrès ? Et si oui, pourquoi et dans quel sens ? Tel est, en partie, le problème auquel nous tâchons de répondre. Comme le lecteur s’en rend certainement compte, mes recherches s’orientent donc dans un autre sens – plus en profondeur – que celui des études darwinistes, sans contredire en quoi que ce soit les conclusions de ces dernières. Il m’est impossible de développer ici ce sujet, pourtant très intéressant.
On pourrait me demander encore ceci : la faculté créatrice de l’homme et le progrès dont je parle ne se confondraient-ils pas, en somme, avec le progrès de la science ? N’est-ce pas par la science que l’homme progresse ? Je réponds : non. La création humaine, le progrès humain sont pour moi des notions très vastes. L’opinion que « seule la science assure le véritable progrès de l’humanité » est – je le sais – fort répandue. Je ne la partage pas. Dans le domaine extrêmement vaste et compliqué de l’évolution, de la création, du progrès, la science et sa marche en avant ne forment qu’un élément (important, sans doute, mais pas unique ni fondamental) parmi d’autres. En elle-même, la marche en avant de la science n’assure pas le véritable progrès. Et puis, la science et son progrès sont eux-mêmes les conséquences de la faculté créatrice de l’homme.
On pourrait aussi me poser la question en quelque sorte inverse, notamment : si le « retour à la nature » (à la vie naturelle et primitive) ne constituerait pas le vrai progrès de l’humanité ? Je réponds : non. La doctrine du « retour à la nature » est, à mon avis, un égarement, explicable par le dégoût, sain dans le fond, des revers du chemin du progrès, mais qui n’en reste pas moins un égarement. On progresse en continuant la route et non pas en rebroussant chemin. Le progrès est à l’avant. Et c’est en avançant, et non pas en reculant, que nous aurons raison des « maladies du progrès ».
D’ailleurs, le besoin de créer est irrésistible chez l’homme. On ne peut pas l’arrêter. On ne peut que le fausser, en attendant son vrai triomphe définitif. C’est par ce besoin inné chez l’homme que je m’explique cette multitude de « succédanés » de la véritable création que nous observons de nos jours à chaque pas. Ne pouvant pas goûter à la vraie activité créatrice, les millions d’hommes se divertissent et se bercent par des illusions de cette dernière : la nature actuelle des « sports », le « cinéma » de nos jours, le « théâtre » moderne, la « littérature » contemporaine – bref, tout ce que l’homme de notre époque trouve à sa disposition, en qualité de satisfaction intellectuelle, spirituelle ou morale (en dehors de son travail professionnel, presque toujours accablant et absurde), n’est qu’une diversion instinctive qui trompe, qui fausse et qui assoupit son instinct de créateur, son besoin de créer.
Il existe, sans aucun doute, beaucoup d’autres questions liées à notre sujet principal et formulées par le lecteur au cours de mon exposé. Ne pouvant les traiter ici même, je m’arrête aux indications données.
* * *
Loin de moi la prétention d’avoir trouvé une solution définitive, incontestable du problème.
Je soumets au lecteur une hypothèse sur laquelle j’étais tombé presque accidentellement, il y a plus de vingt ans, et laquelle, ensuite, m’a été confirmée par un grand nombre de faits et aussi par mes études personnelles. Je dis presque accidentellement, car, depuis longtemps déjà, je cherchais une réponse satisfaisante à cette question :
« Pourquoi l’homme diffère-t-il tant des autres animaux ? »
J’ai scruté, d’une part, les théories qui cherchaient à réduire cette différence à peu de choses. J’ai examiné, d’autre part, les doctrines qui tâchaient de répondre à ce « pourquoi ». J’ai trouvé les unes et les autres tout à fait insuffisantes et très superficielles quant au fond du problème. Et c’est ainsi que j’étais arrivé à mon hypothèse. Je l’ai approfondie, éprouvée, travaillée, par la suite. J’ai trouvé des faits à son appui. Elle n’en reste pas moins une hypothèse, et restera telle jusqu’à sa confirmation ou son infirmation expérimentale et scientifique définitive. Mais il s’agit là d’un travail de longue haleine aboutissant à des ouvrages d’une allure spéciale.
Le lecteur serait en droit de me demander s’il existe déjà, dans la littérature scientifique ou philosophique, un exposé du problème du progrès se rapprochant de ma conception. Ce sujet n’a pas encore été, que je sache, traité sous cet aspect. Certains auteurs – des biologistes et des philosophes – ont prêté leur attention à la situation exceptionnelle de l’homme dans le règne animal. Ils en cherchèrent l’explication surtout dans l’évolution de l’intelligence. D’autre part, on parle bien, par-ci par-là, de l’action créatrice de l’homme, mais sans aucune tentative de précision ou de généralisation. Il existe des auteurs qui, non satisfaits des explications courantes, restent simplement décontenancés, profondément intrigués devant certains phénomènes frappants, inexplicables de l’Évolution. Quant à moi, je traite le problème dans la presse pour la première fois. Je le fais : d’une part, parce que ma conception est actuellement achevée dans son ensemble ; et, d’autre part, parce que j’espère pouvoir publier, sous peu, un ouvrage plus complet auquel l’exposé ci-dessus servirait d’une sorte d’introduction.
— Voline.
PROGRÈS
Un accroissement quelconque, en bien ou en mal, constitue un progrès. Le développement d’un être ou d’une activité constitue un progrès. Le progrès est représenté spécialement par le développement de la civilisation et de la justice. En résumé, le progrès est le mouvement, la marche vers un but. Dès lors, il y a autant de progrès, c’est-à-dire de marches que d’hommes et de mouvements. De là, bien des difficultés qui entravent la marche du progrès.
Quand deux ou plusieurs personnes se réunissent pour causer progrès, chacune en est partisane, mais pour peu que l’on s’explique sur ce mot, on ne tardera pas à constater qu’il n’y a pas deux personnes qui aient sur le mot « progrès » une communauté de vues identiques. Cela s’explique, surtout à notre époque qui se plaît à faire dire au même mot des choses différentes. Aussi, un jour, l’homme penche à droite, le lendemain à gauche ; et, en agitant le même mot, un tel fait machine en avant, quitte, le lendemain, à faire machine arrière. De ces interprétations multiples, le progrès réel est la victime. Dans son sens propre, le progrès ne convient qu’à l’ordre physique. Dans l’ordre moral, rien n’avance ni ne recule ; rien ne varie. Cet ordre, disent Colins, De Potter, etc., est ou n’est pas.
Depuis que l’humanité a une histoire, elle n’a pas fait un pas vers la vérité qui lui importe le plus, c’est-à-dire vers la vérité vraie. On raisonne sur l’ordre moral comme sur l’ordre physique. On oublie que les variations sont essentielles aux sciences naturelles et exactes et constituent toujours des progrès. Elles ont pour cause la découverte de faits nouveaux ou de nouveaux rapports entre les faits déjà constatés et, de la sorte, constituent une découverte que la science s’assimile par une coordination rationnelle en un système plus large et d’une portée plus étendue. Ces variations constituent un changement de forme, un progrès... Il en est de même de la civilisation qui varie avec les circonstances ; de même, aussi, pour l’organisation sociale, qui se modifie avec le besoin d’ordre. L’on peut en dire autant des religions révélées, qui dépendent du plus ou moins d’appui que les sociétés ou gouvernements leur demandent pour se conserver. L’exemple récent du pape-roi est la caractéristique de notre époque où l’odieux le dispute au ridicule. L’ignorance sociale du peuple et des... élites peut, seule, expliquer ce que certains considèrent comme un progrès, lorsque bien d’autres n’y voient qu’un recul de la civilisation. Ces variations sont le résultat d’une marche quelconque et représentent en bien ou en mal un progrès.
La raison, la morale, la justice, c’est-à-dire la vraie religion ne peuvent varier sans cesser d’être vérité. Pour elles, le mieux est l’ennemi du bien et il n’y a pas de progrès possible ; aussi, un protestantisme, si bien ordonné qu’il paraisse, ne représente qu’une succession non interrompue de variations.
Une agitation aussi confuse, dans un ordre social quelconque, mène nécessairement à reconnaître la nécessité de mettre un terme à ce progrès déréglé que la raison condamne et l’expérience confirme.
On a l’habitude de dire : il faut toujours marcher. À cette proposition, nous dirons oui et non. En effet, marcher est bien si l’on sait que la route qu’on suit nous mènera au but recherché ; mais marcher est indifférent et même mauvais si, en suivant le chemin à parcourir, on dépasse le but et si l’on aborde le port de l’Indifférence ou de l’Abîme. On marche pour arriver à un but et, le but atteint, on s’arrête ; marcher encore serait montrer qu’on ne savait pas ce qu’on voulait ; et dépasser le but, c’est le manquer.
Quand les hommes veulent avancer réellement, se sentant mal là où ils sont, il faut qu’ils soient convaincus de la possibilité d’être bien dans certains cas déterminés ; sans cela, ajouter à leurs maux le mal inutile de s’agiter sans résultats rationnels serait une folie.
Lorsque l’Humanité sera bien, quand les hommes arrivés au terme du progrès moral sauront qu’ils ont, qu’ils possèdent tout le bonheur qu’ils méritent, va-t-on supposer qu’ils s’agiteront encore pour retomber au mal ? De ce qu’ils ont mal raisonné jusqu’à ce jour, faut-il conclure qu’ils raisonneront toujours mal ? Nous ne le pensons pas. S’ils le faisaient, ce serait pour être mal de nouveau ; et alors ils ne seraient effectivement que des toupies ou des écureuils qui tournent sans savoir pourquoi, et le mot progrès n’aurait même plus aucune signification.
À notre époque d’ignorance sociale, le progrès dans le mal est certain et sert à titre d’indication nécessaire. N’oublions pas qu’il n’y a de mal que celui qu’on sent inévitablement ; ils ne sentent le mal qu’au physique.
Aussi longtemps qu’on peut faire croire aux malheureux qu’ils sont dans cette situation providentiellement, inévitablement, ils ne sentent le mal qu’au physique, ce qui, pour les exploiteurs des masses laborieuses, est peu de chose. Ce n’est que quand ces malheureux examinent, que la société ne peut plus les empêcher de comparer et de discuter, que les prolétaires sentent moralement leur malheur et cherchent à s’y soustraire. Pendant que les prolétaires s’agitent au lieu d’agir, et espèrent, par des moyens de fortune, faire cesser leurs souffrances, le mal contre lequel ils s’insurgent, plus ou moins chaotiquement, continue à être, en attendant une éducation rationnelle, une condition d’ordre relatif dans la société capitaliste.
À mesure que les prolétaires laisseront tomber les œillères qui les empêchent de voir clair, ils prendront conscience de la valeur de leur personnalité, aussi bien que des conditions sociales qui leur sont faites par leurs seigneurs modernes, et s’appliqueront à anéantir le paupérisme moral et matériel qui sert de refuge aux maux qui les accablent.
Les apôtres du progrès continu sont, par cela même, des partisans de réformes partielles et successives qui ne portent que sur les effets en laissant subsister la cause ; elles sont empiriques et ne peuvent que prolonger l’agonie d’une société qui se meurt d’hypocrisie et d’exploitation économique et sociale.
Ces prétendues réformes, plus ou moins empreintes d’éclectisme, ne font qu’entretenir le mal au lieu de le supprimer et ne constituent un progrès qu’en apparence. C’est ainsi que le bien n’étant pas déterminé, tout progrès est un pas de plus vers le mal. Par là, nous voyons que le malheur est essentiellement progressif ; s’il n’en était pas ainsi, il serait tolérable et n’aurait pas de fin. C’est le progrès excessif du mal qui imposera à l’Humanité la nécessité de s’y soustraire et la mettra sur la voie de la Vérité, de la Justice qui est son unique remède.
À ce moment, le progrès, dans tous les domaines, donnera toute la mesure de ses possibilités.
— Elie Soubeyran.
PROGRESSION
n. f. (du latin progredi, progressus, avancer)
Une progression mathématique est constituée par une suite de rapports égaux ; elle peut être ascendante ou décroissante. Toutes les sciences adoptent cette signification dès qu’il s’agit de mesure et de calcul. En psychologie, Fechner, formulant la fameuse loi psychophysique qui porte son nom, déclare que, quand les excitations croissent en progression géométrique, les sensations croissent en progression arithmétique. Ce qu’on peut résumer, d’une façon plus simple, en disant que les sensations croissent comme les logarithmes des excitations. Dans la progression géométrique, on passe d’un terme à un autre en le multipliant par une quantité fixe : on aura 1, 2, 4, 8, par exemple, ce qui représente 1, 1 × 2, 2 × 2, 2 × 2 × 2. Dans la progression arithmétique, on passe d’un terme à un autre en ajoutant toujours une même quantité ; ainsi, la progression 1, 2, 3, 4 équivaut à 1, 1 + 1, 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 + 1. On a d’ailleurs fortement critiqué la formule de Fechner ; ceux qui en admettent le principe déclarent que le rapport exact d’une excitation à la sensation provoquée est beaucoup plus compliqué qu’elle ne le suppose. La progression mathématique croissante aboutit rapidement à des chiffres invraisemblables. C’est ainsi que la reproduction des êtres unicellulaires par simple division (chaque cellule donnant naissance à deux cellules nouvelles) conduit parfois à des résultats stupéfiants. Placées dans des conditions favorables, certaines bactéries donnent journellement 70 générations. Il en résulte, d’après les calculs, qu’en vingt-quatre heures, une seule bactérie pourrait produire une quantité de microbes si énorme qu’il est difficile de l’exprimer numériquement. Le poids de cette masse égalerait 4 720 tonnes. Un infusoire qui, en sept ans environ, donnerait 4 473 générations, constituerait, d’après les calculs de Woodruff, une masse protoplasmique dont le volume surpasserait plus de 10 000 fois celui de la Terre. Pour atteindre un volume égal à celui de notre globe, quatre mois suffiraient. Et, si les conditions favorables de développement lui étaient maintenues durant quelque cent ans, elle pourrait combler l’univers visible par sa seule multiplication. Heureusement pour nous, les microbes rencontrent des conditions qui retardent ou empêchent cette pullulation ; et nous n’avons pas à craindre qu’un pareil événement survienne jamais.
Sans s’arrêter à des considérations numériques, on emploie aussi le terme progression pour désigner une suite ininterrompue et graduée ; en particulier, concernant les faits biologiques et psychologiques. Ainsi, le développement des animaux et des plantes, qui part d’une simple cellule et finit par donner un organisme perfectionné, apparaît comme une progression. L’étude de l’embryon chez les animaux s’avère particulièrement instructive à ce point de vue. De la fusion d’un gamète mâle et d’un gamète femelle naît l’œuf qui, par bipartition successive, donne d’abord une sphère pleine, une morula, puis une blastula ou sphère creuse, enfin une gastrula où l’on distingue un feuillet externe, l’ectoderme ; un feuillet interne, l’endoderme ; et plus tard un feuillet intermédiaire, le mésoderme. La suite du développement sera différente selon les animaux observés ; mais, chez les vertébrés, elle reste analogue dans toutes les espèces, assez longtemps. L’embryon s’allonge et se recourbe ; quatre bourrelets latéraux ébauchent les deux paires de membres ; sur les côtés se dessine un commencement d’œil et d’oreille ; des fentes branchiales (les futures branchies des poissons) se voient plus en arrière. Par développement progressif, l’ectoderme formera ensuite l’épiderme de la peau et le tube nerveux ; l’endoderme donnera la muqueuse digestive, de nombreuses glandes, les poumons ; le mésoderme produira la corde dorsale, la musculature et les séreuses. Après la naissance, la progression continuera, provoquant la croissance et le développement complet de l’organisme. Comme la vie, la pensée suppose un enfantement préalable et une marche ascendante vers la perfection. Indéfiniment, la science humaine s’enrichit de vérités nouvelles, augmente le trésor de nos certitudes. Au point que plusieurs prévoient l’impossibilité, pour nos descendants, d’emmagasiner la multitude d’expériences et de lois que l’on découvre sans arrêt. Ils se trompent. « C’est à remplacer les lois fausses par des lois vraies, non à entasser des documents inutiles que consiste le progrès. L’antique alchimie ne le cédait à la chimie actuelle ni par le nombre des formules, ni par la complication des théories ; pour retenir l’histoire des Hébreux, l’effort mental sera sensiblement le même, qu’elle soit l’œuvre d’un prêtre sans scrupule ou d’un érudit consciencieux. Puis, dans les sciences très avancées, découvrir reste possible grâce à la multiplicité des subdivisions ; physique, chimie, biologie se développent rapidement par suite d’une spécialisation poussée fort loin. D’ailleurs, l’exemple des mathématiques, sciences presque achevées en quelques-unes de leurs branches, démontre que, parfois, l’ultime progrès ramène à plus de simplicité. » (Vouloir et Destin.) Même dans l’ordre biologique, on arrive à concevoir la possibilité d’une existence indéfinie, l’apparition de conditions défavorables étant la vraie raison de la décrépitude et de la mort. Le célèbre naturaliste Weissmann prétend que, chez les êtres multicellulaires, la mort résulte d’une adaptation progressive, utile à l’espèce. Il affirme que :
« [Elle] a paru, non comme une nécessité intrinsèque absolue, inhérente à l’essence même de la matière vivante, mais en conformité avec le but, c’est-à-dire comme une nécessité découlant, non des conditions générales de la vie, mais des conditions spéciales dans lesquelles se trouvent précisément les organismes multicellulaires... Mal effroyable pour l’individu, la mort, pour l’espèce, apparaît comme un bien puisque, grâce à elle, l’espèce peut sans cesse se rénover, se raviver par des individus plus jeunes et plus robustes renouvelant les organismes vieux et usés. »
Alors que les choses inertes se désagrègent et tombent en ruine après un temps plus ou moins long, la matière vivante organise et construit sans cesse, au contraire. Ne nous étonnons point que de nombreux naturalistes lui donnent pour caractéristique l’immortalité, non la mort. Les expériences de Woodruf et de Metalnikov sur la pérennité des êtres unicellulaires sont connues. Les premiers, G. Haberland et Harrison ont montré que des tissus pouvaient continuer à vivre hors des organismes supérieurs qui les ont produits ; les méthodes adoptées par Carrel ont donné, depuis, une grande extension aux recherches concernant la multiplication des cellules à l’extérieur de l’organisme. Ainsi, la vie apparaît susceptible d’une progression sans fin. On peut en dire autant de la pensée, toujours en mouvement, jamais satisfaite de ce qu’elle connaît déjà. Et c’est vers un monde harmonieux qu’elle nous conduit, un monde débarrassé des credo inventés par les prêtres, des lois fabriquées par les gouvernants.
— L. Barbedette.
PROLÉTAIRE, PROLÉTARIAT
n. et adj., n. m.
Le dictionnaire Larousse nous donne du mot prolétaire une définition historique qui ne manque pas d’une certaine saveur. Reproduisons-la intégralement... Prolétaire – lat. proletarius – de proles (lignée). Homme pauvre, qui n’était considéré comme utile, à Rome, que par les enfants qu’il engendrait, et qui était exempt de la milice, sauf en cas de tumulte. Et voici pour une définition moderne... Celui qui n’a, pour faire vivre les siens et lui-même, que son travail. Quant au prolétariat, c’est l’ensemble de ceux qui jouissent de la liberté civique, mais qui n’ont que leur travail comme unique moyen de subsistance.
Il nous paraît inutile de relever ici ce qu’il peut y avoir d’ironie involontaire dans cette triple définition du prolétaire, dont toute la valeur sociale consiste à produire des enfants, et qui, ne possédant rien, dispose néanmoins de la liberté, c’est-à-dire d’un droit abstrait dont il n’a que faire, véritable leurre, par conséquent, dans l’état de misère physique ou intellectuelle où le régime le plonge. Il y a là, en quelques mots, un aperçu fort juste et suggestif de la destinée passée et présente du prolétaire. Tel quel, cependant, il ne répond pas à toutes les questions que pose l’existence du prolétariat, questions intéressant l’historien, le sociologue, l’économiste ; questions complexes au plus haut point, car les données manquent souvent pour retracer la vie du prolétaire. L’Histoire, si prolixe, quand elle retrace les faits et gestes des tyrans, des guerriers, des maîtres du monde, est à peu près muette sur le sort des travailleurs. Dans la plupart des cas, nous ne sommes informés que de leur existence collective, comme classe soumise et vouée au travail servile ; nous ignorons souvent leur vie matérielle et morale, leurs préoccupations, leurs misères, leurs espoirs, leurs révoltes. De temps en temps, seulement, nous apprenons qu’ils ont forcé la consigne qui les maintenait dans l’ombre et le silence et que, pour un temps très court, ils sont passés au premier plan de l’Histoire. Révoltes d’esclaves, jacqueries, grèves..., autant d’efforts des parias pour conquérir leur droit à une existence libre et humaine. Révoltes vite réprimées. Après ces courtes rumeurs, à nouveau, le silence règne et le vaincu, courbé sous la dure loi d’obéissance, travaille et se tait.
Pourtant, quelle que soit l’insuffisance de notre documentation, il n’est pas impossible de tenter une histoire du prolétariat. De nombreux historiens de l’école matérialiste se sont attachés à écrire la vie des travailleurs dans l’Antiquité et au Moyen Âge. Ils nous ont apporté des détails touchant leur travail professionnel, leur organisation, leur vie publique et privée, leurs rapports avec les maîtres et avec l’État. Grâce à tous ces travaux, l’ombre qui enveloppait l’existence des travailleurs s’est, en partie, dissipée. Nous avons vu peu à peu se dessiner, à côté de la brillante image du noble, du patricien, du chevalier et du bourgeois, l’humble silhouette de l’ouvrier et du paysan.
Il ne saurait être question de reprendre ici tout ou partie de ces travaux. À peine pourrons-nous les utiliser afin de préciser et d’éclairer notre travail par un recours à l’histoire lointaine du prolétariat, ou, tout au moins, de ce qu’on est tenté d’appeler ainsi. C’est, en effet, une question de savoir si, dans l’Antiquité et au Moyen Âge, il y a eu un prolétariat, c’est-à-dire une classe d’hommes dont le statut social, réel ou juridique, puisse en quelque manière se comparer à celui du prolétariat contemporain. Certains l’ont nié. Ils ont prétendu que le prolétariat était d’origine récente ; qu’il n’était apparu qu’avec le capitalisme moderne, c’est-à-dire avec l’essor prodigieux de la technique industrielle. Pour préciser une date, ils font remonter la naissance, en France, du prolétariat vers le milieu du xixe siècle, époque de la révolution industrielle, de l’emploi généralisé de la machine à vapeur, époque de la première concentration capitaliste se traduisant par le rassemblement de la main-d’œuvre dans les villes ou autour des usines, époque aussi des premières aspirations socialistes, des premières tentatives d’organisation d’une classe ouvrière et des premières formulations – avec Saint-Simon, Fourier, etc. – d’une doctrine d’émancipation des travailleurs.
Nous ne contesterons pas ce qu’il y a de fondé dans cette opinion. Il est bien certain que le prolétariat, tel que nous le définissons aujourd’hui, possède un ensemble de caractères originaux qui lui donnent une figure totalement nouvelle. Entre le travailleur libre de Rome et l’ouvrier d’usine de notre époque, on n’aperçoit d’abord aucun trait commun qui permette d’établir une filiation sociale de celui-ci à celui-là. Le temps, en modifiant complètement les modes de production, a modifié dans la même mesure les rapports sociaux entre les hommes. Il a créé des formes nouvelles de conscience, des types nouveaux d’individus. Marx l’a dit et nous ne faisons ici aucune difficulté pour le reconnaître. Pourtant, il nous semble possible et légitime de rechercher dans l’histoire s’il ne se trouve pas des formes d’existence, de groupement ou de pensée communes au monde des travailleurs présent et passé. Les formes sociales nouvelles ne naissent pas ex nihilo. Elles s’appellent en quelque sorte l’une l’autre. Même lorsqu’elles se contredisent, c’est toujours la même matière humaine, la même chair à travail qui sert à leur métamorphose. Pour nous en tenir à l’exemple de tout à l’heure, ne peut-on pas établir une certaine parenté entre le prolétaire contemporain et le travailleur romain, ne serait-ce que par leur commune appartenance à ce qu’on pourrait appeler la basse classe, celle qui travaille de ses mains et ne possède rien, celle des humiliores, ainsi qu’on la nommait à Rome, par opposition à la classe des honestiores comprenant l’aristocratie, les sénateurs, les chevaliers, les membres des curies municipales, etc. ? Ouvrons le cours d’histoire de Guignebert. Nous y lisons que les humiliores étaient tous les hommes libres pauvres et les affranchis. « Ils vivaient dans les villes de leur métier ou comme clients des riches. » Mais au moins, dira-t-on, leur genre de vie, leurs aspirations étaient-ils entièrement différents de ceux du prolétariat contemporain... Ils n’avaient pas le sens de l’organisation, le désir de lutte, ils ne cherchaient pas à se constituer en face du patronat et de l’État qui, de leur côté, n’ayant rien à craindre de leur soumission, n’exerçaient pas contre eux leur force contraignante et répressive. Pout tout dire, les humiliores acceptaient leur situation et n’avaient aucune conscience de classe. Or, continuons à lire Guignebert... Il écrit :
« Pour être moins isolés, ils se groupaient en associations, en collèges. Les plus importants étaient ceux des artisans de même métier. Le gouvernement les autorisait, d’abord difficilement, par crainte des agitations politiques. Mais, peu à peu, il se relâcha de sa rigueur et ces associations devinrent nombreuses et puissantes ; riches des cotisations de leurs membres et des dons de leurs protecteurs, elles avaient leurs bannières, leurs chapelles, leurs fêtes. »
Sans doute devons-nous nous garder de conclure à l’existence, à Rome, d’un prolétariat, au sens où nous entendons aujourd’hui ce mot. Les associations dont il est ici question ne rappellent en aucune manière les groupements de classe du prolétariat moderne, et particulièrement les syndicats. Elles s’apparentent plutôt, par leur caractère religieux et strictement corporatif, aux corporations du Moyen Âge. Cependant, et quoiqu’elles ne se proposent aucun but de réforme et de révolution sociales, elles introduisent dans l’ordre existant un élément de résistance, un commencement d’opposition, très faible assurément, mais assez fort pour inquiéter une oligarchie peu sûre de son droit et inquiète pour ses prérogatives. Le groupement même qu’elles réalisent n’est-il pas et n’a-t-il pas toujours été par lui-même, et en dehors de toute fin théorique ou pratique, une menace intolérable contre une minorité profiteuse ? Et la lutte que le gouvernement impérial engagea contre les associations n’est-elle pas la même que celle que mènent tous les gouvernements contre les groupements ouvriers ?
Mais la question que nous posons ici, si elle mérite notre attention, ne doit pas néanmoins nous faire oublier qu’à Rome et généralement dans tout le monde antique, l’état de travailleur libre, politiquement et socialement soumis, n’était pas la seule forme d’exploitation humaine. Au-dessous du travailleur libre se trouvait l’esclave sur le travail duquel reposait toute la société antique. Privé de tout droit, propriété de son maître, traité férocement, il n’a aucun espoir de voir son sort s’adoucir. Il fait partie de l’immense armée des servis, qui sont moins des hommes que des choses. Henri Berr écrit :
« C’est un des caractères essentiels de l’économie antique, qu’il y ait eu des êtres humains traités comme des choses... »
Réduits au rôle de capital de chair, d’outillage de muscles. Le monde antique acceptait un tel état comme une nécessité indiscutable. On connaît le mot d’Aristote : « L’esclavage sera indispensable tant que la navette du volant ne se mettra pas à voler toute seule. » Il fallut les révoltes de Cinadon, à Sparte, et de Spartacus qui, à la tête de 70 000 esclaves révoltés, tint tête pendant quelque temps aux armées romaines (70 av. J.-C.), pour que la question de l’esclavage se trouvât posée devant le monde ancien.
Elle fut résolue par la disparition progressive du système qui ne répondait qu’imparfaitement aux besoins d’une économie transformée. Esclaves des villes et des champs furent peu à peu affranchis. Au reste, on aurait tort de rechercher dans l’esclavage antique l’origine du prolétariat. L’esclavage ne saurait passer pour une forme particulièrement aggravée de l’exploitation d’une classe sur une autre. En réalité, comme le dit Henri Berr, les esclaves ne constituaient pas une classe d’hommes, mais uniquement un outillage de muscles, outillage précaire, d’ailleurs, et d’un rendement médiocre. Il pouvait fournir aux problèmes techniques du temps une solution paresseuse et provisoire. Mais l’évolution de la technique devait infailliblement en amener l’élimination. La disparition de l’esclavage n’a pas été, en effet, le résultat d’un mouvement d’émancipation des esclaves, l’aboutissant d’un long effort de libération d’une classe asservie. La disparition de l’esclavage s’explique uniquement par l’intérêt bien compris des classes privilégiées en possession d’une technique nouvelle où la force musculaire n’était plus le facteur unique de la production.
La société du Moyen Âge est donc une société sans esclaves. Le serf n’est plus la chose de son maître, du seigneur féodal, il est attaché à la glèbe, c’est-à-dire acheté et vendu avec elle. Il est toujours un capital de chair, mais dont la disposition est soumise à un certain nombre de restrictions juridiques. Quelquefois, il achète sa liberté, moyennant le paiement d’une rançon variable. Dès lors, son assujettissement personnel vis-à-vis du seigneur se borne à l’obligation de certaines corvées. Au xive siècle apparaissent, en France et en Angleterre, les journaliers agricoles. Quant aux ouvriers, il en était – surtout dans les campagnes – qui demeuraient soumis au joug féodal. Mais la plupart travaillaient librement, dans de petits ateliers, au contact direct de leurs patrons. Les corporations se reconstituaient avec des règlements très sévères. Elles groupaient indistinctement patrons et ouvriers.
Tels sont les éléments divers de ce qu’on pourrait appeler le prolétariat du Moyen Âge. C’est essentiellement une classe d’hommes qui travaillaient de leurs mains, par opposition avec la classe qui prie (le clergé) et la classe qui combat (la noblesse). On y chercherait encore vainement la trace ou la manifestation d’un esprit collectif d’organisation et de lutte, ce que nous appellerions aujourd’hui un esprit de classe. Pendant des siècles, les paysans souffriront sans se plaindre des exactions des barons. Pendant des siècles, les ouvriers des villes seront brimés par leurs maîtres, soumis aux règlements tyranniques qui leur interdisent, par la production du chef-d’œuvre, de devenir patrons.
Cependant, dès le xvie siècle, se produisent ici et là des velléités de résistance. Des grèves éclatent en divers endroits et elles durent, malgré l’effort conjugué des patrons et des autorités civiles. M. Hauser, dans son Histoire des classes ouvrières, nous raconte la grève qui éclata, en 1539, parmi les typographes de Lyon. D’autres « trics » se produisirent au xviie et au xviiie siècles, afin d’obtenir un adoucissement dans la situation des ouvriers. Certaines atteignirent une grande violence et durent être réprimées par la force.
Le prolétariat contemporain.
Les origines historiques lointaines du prolétariat – telles qu’on vient de les déterminer – ne doivent pas faire oublier que la notion moderne du prolétariat est une donnée originale, ayant ses caractères propres et irréductibles. Le prolétariat moderne se présente à nous comme un complexe social essentiellement et organiquement différent de toutes les espèces sociales que nous venons de dénombrer, au cours de ce bref historique. Quels sont ces signes distinctifs ? Comment définir le prolétariat contemporain ? C’est à cette question que nous allons tenter de répondre en nous servant de deux séries de critères : les premiers, d’ordre économique ; les seconds d’ordre psychologique.
Le prolétariat moderne est-il né, comme on l’a dit, de la révolution industrielle du xixe siècle ? Le fait paraît assez contestable. Certains historiens ont fait observer, à cet égard, que la concentration industrielle, ayant pour conséquence la concentration de la main-d’œuvre, a précédé l’emploi des machines. M. Henri Sée, dans son livre sur les Origines du capitalisme moderne, a montré clairement comment le capital commercial, après avoir pénétré dans les campagnes et mis la main sur le petit atelier rural et domestique, a pu développer son offensive contre les artisans des villes et réussir à les faire tomber progressivement du rang de producteurs indépendants à celui de salariés.
Ce sont donc avant tout les besoins constants d’accaparement et d’expropriation ; c’est, plus simplement, la loi d’airain du profit capitaliste qui est à l’origine de la prolétarisation des masses jusqu’alors insoumises au capitalisme. Cette loi du profit sans cesse accru a donc amené le capitaliste à contrôler des secteurs de plus en plus vastes de la production et, par conséquent, à s’assurer une main-d’œuvre bien à lui et, pour ainsi dire, dans sa main. D’autre part, les besoins de la technique aboutissaient aux mêmes résultats. De bonne heure, et antérieurement à tout emploi de machines, de par les nécessités mêmes de la division du travail, on assiste à la concentration dans de vastes ateliers et usines de tout le processus, jusque-là épars, de la fabrication. Dès le xviiie siècle, surtout dans l’industrie textile, on assiste à d’importantes concentrations de main-d’œuvre. À Louviers, quinze entrepreneurs groupent des milliers d’ouvriers. Il en est de même à Reims, à Troyes et à Paris.
Cependant, il est bien certain que l’introduction du machinisme va hâter une transformation déjà en voie de s’accomplir. Cette transformation est particulièrement visible en Angleterre où elle coïncide avec une concentration de la propriété foncière, amenant l’éviction brutale d’une masse de paysans hors des tenures transformées en pâturages, fournissant ainsi à l’industrie naissante une main-d’œuvre nombreuse et à bon marché. Pour être plus lente en France, cette prolétarisation de masses paysannes de plus en plus larges est un phénomène frappant dans la seconde moitié du xixe siècle, époque de la création des premières grandes usines, des chemins de fer, des bateaux à vapeur, de la grande industrie et du grand commerce. C’est l’époque où se crée un type nouveau de prolétaire, d’homme lié à la machine, d’esclave moderne d’un patron capitaliste. On a tout dit sur la misère physique et morale du prolétariat d’alors. Des enquêtes nombreuses, poursuivies en France et en Angleterre, ont mis en lumière l’épouvantable condition des ouvriers soumis à d’interminables journées de travail et ne recevant pour tout salaire qu’autant qu’il leur fallait pour ne pas mourir de faim.
Telle est bien l’origine du prolétariat moderne. Sans doute, et par sa misère même, est-il le descendant en ligne directe du prolétariat antique et moyenâgeux. Les historiens du temps peuvent insister sur cette filiation. C’est ainsi que Bazard, dans sa Doctrine saint-simonienne peut écrire :
« La condition respective où se trouvaient dans le passé les maîtres et les esclaves, les patriciens et les plébéiens, les seigneurs et les serfs... se continue à un très haut degré dans les relations des propriétaires et des travailleurs. »
Il n’en est pas moins vrai que le prolétariat moderne réalise un type nouveau d’exploités : les esclaves de la machine, déchus non seulement socialement, mais encore professionnellement. Le prolétaire d’aujourd’hui est, en effet, un travailleur dégradé. Proudhon a longuement insisté sur ce point... il écrit dans ses Contradictions économiques :
« La machine achève d’avilir le travailleur en le faisant déchoir du rang d’artisan à celui de manœuvre, car il en est d’une machine comme d’une pièce d’artillerie : hors le capitaine, ceux qu’elle occupe sont des servants, des esclaves. »
Il est inutile d’insister sur ce dernier caractère que, depuis lors, tous les historiens du travail ont mis en lumière, jusqu’en ces temps derniers où une réaction s’est produite en faveur de la machine. Il nous paraît plus important d’examiner quelle a été la portée sociale et politique du machinisme à travers l’évolution du prolétariat. Un premier point à noter est la force « agglomérante » du machinisme qui tend à constituer les immenses armées du prolétariat contemporain. C’est qu’en effet, pour que l’emploi des machines soit avantageux, il faut que celles-ci opèrent sur de grandes quantités de matière ou de produits. La machine pousse à la concentration industrielle en même temps qu’à la concentration capitaliste. D’autre part, en tuant toute concurrence de la part des petits producteurs, elle pousse à la disparition de ces derniers, accélérant ainsi le processus de prolétarisation que nous avons noté plus haut. Déjà, Pecqueur, dans son ouvrage Des intérêts du commerce, avait signalé le phénomène... Ainsi, écrivait-il, grâce à l’emploi des machines :
« Tout ce qui ne sera point capitaliste ira se ranger petit à petit parmi les travailleurs prolétaires ».
Cependant, Karl Marx devait jeter sur toute cette histoire une lumière décisive. On peut dire, en effet, que tout le Manifeste communiste gravite autour d’une définition moderne du prolétariat. Après avoir affirmé dans une phrase justement célèbre que l’histoire de la société humaine se résumait dans une lutte de classes, il montrait comment cette lutte se simplifiait jusqu’à n’être plus qu’un duel implacable entre la bourgeoisie et le prolétariat... Il écrit :
« De plus en plus, la société tout entière se partage en deux classes directement opposées : la bourgeoisie et le prolétariat. Or, ce prolétariat, c’est la bourgeoisie elle-même qui l’a engendré et qui le développe chaque jour davantage pour faire face aux exigences de la technique moderne et, particulièrement, du machinisme... À mesure, en effet, que grandit la bourgeoisie, c’est-à-dire le capital, à mesure aussi grandit le prolétariat, je veux dire cette classe des ouvriers modernes, qui n’ont de moyens d’existence qu’autant qu’ils trouvent du travail ; et qui ne trouvent du travail qu’autant que leur travail accroît le capital. »
Telle est la définition marxiste du prolétaire. Au reste, nous la retrouvons dans Le Capital, presque mot pour mot. Le prolétaire, c’est essentiellement un homme qui n’apporte, pour toute marchandise, que sa force de travail. Cette force, le capitaliste l’achète comme toute autre marchandise, en rémunérant son propriétaire sous la forme d’un salaire représentant le coût de la subsistance de l’ouvrier. Marx écrit :
« Ce qui caractérise l’époque capitaliste, c’est que la force de travail acquiert la forme d’une marchandise... Cette marchandise, de même que toute autre, possède une valeur. Comment la détermine-t-on ? Par le temps nécessaire à sa production. Le temps nécessaire à la production de la force de travail se résout dans le temps nécessaire à la production des moyens de subsistance de celui qui la met en jeu. » (Le Capital)
Nous n’entrerons pas dans le débat qu’une telle définition peut ouvrir. Il est bien évident qu’elle soulève de graves objections. Cependant, on peut dire qu’elle rend un compte suffisant de la réalité générale. Elle a, en tout cas, résisté au temps et aux tentatives des révisionnistes de toute école qui s’attachaient à nier l’existence d’une bourgeoisie et d’un prolétariat en tant que classes et, par voie de conséquence, la lutte de ces classes elles-mêmes. Nous reviendrons d’ailleurs sur ce point. Qu’il nous suffise, pour le moment, de compléter notre définition du prolétariat par d’autres considérations, non plus strictement économiques, mais morales et politiques.
Une question, immédiatement, se pose. S’il est possible de définir le « prolétaire économique », peut-on en faire autant du « prolétaire moral » ? En d’autres termes : existe-t-il un type moral, psychologique ou politique de prolétaire, comme il existe un type moral de bourgeois ? Grave question, à l’examen de laquelle on ne saurait trop s’attacher, car la réponse que nous apporterons sera – on le sent – grosse de conséquences dans l’ordre de la propagande révolutionnaire et anarchiste. Si, en effet, il n’existe pas et ne peut exister de type moral de prolétaire, on est en droit de penser que toutes les affirmations des révolutionnaires, touchant la lutte des classes, sont sans fondement. Le monde partagé en deux classes économiques, strictement hiérarchisées dans le domaine de la production et de la propriété, peut, dès lors, continuer son train sans incident et sans heurt. Il n’est pas à craindre que le prolétariat, prenant conscience de son existence de classe, ne demande un jour des comptes à la bourgeoisie, en face de laquelle il ne se distingue pas en tant que groupe fondamentalement antagoniste, pas plus qu’on ne peut supposer une révolte organisée des sociétés animales, par exemple, soumises par l’homme.
Examinons les faits. Il existe une morale bourgeoise, une esthétique bourgeoise, une pensée bourgeoise. Une innombrable littérature s’est efforcée de les préciser, de telle sorte qu’on peut dessiner les contours, assez fuyants sans doute, mais suffisamment généraux d’une conscience bourgeoise. Qu’on relise, à ce sujet, les pamphlets étincelants où M. Emmanuel Berl s’est essayé à en fixer l’image... On y verra, peint au vif, le caractère de tant de bourgeois contemporains qu’il est impossible de ne pas conclure à la ressemblance du portrait et du modèle. Et lorsque M. Goblot, dans un petit livre intitulé La barrière et le niveau, étudie les modes de penser, de vivre, de sentir, de préjuger bourgeois, il réussit pareillement à évoquer, au travers des individus, toute une classe sociale.
Peut-on, de la même manière, parler d’une morale et d’une pensée prolétariennes ? Évidemment, non. Tous les critères éducatifs, vestimentaires, esthétiques qui servent à M. Goblot ou à M. Berl ne peuvent, ici, être utilisés. Dira-t-on qu’il suffit de les retourner et que, définissant le bourgeois, on définit par là même, négativement, le prolétaire ? Rien ne serait plus faux. Il suffit, pour le prouver, de prendre un exemple. Le bourgeois, dit Goblot et dit Berl, est un homme qui a besoin de la considération de ses semblables. Il veut paraître. Il étale les signes qui le distinguent, qui le classent. Il veut que ses fils étudient le latin, non pas pour le savoir, mais pour affirmer qu’ils l’ont appris. Le latin est un signe de classe. Peut-on dire qu’inversement, le prolétaire se soucie fort peu de l’opinion des autres, qu’il vit pour soi, sans se préoccuper du qu’en dira-t-on ? Qu’il pense que le latin est une discipline superfétatoire, un enseignement de luxe, auquel il voudrait substituer une discipline moins formelle et plus scientifique ?... Assurément, non. Nous savons, pour l’avoir trop souvent observé, que le prolétaire tient autant que le bourgeois à l’estime de son entourage, qu’il affecte peu de tendances individualistes en art ou en morale, qu’il nourrit, le plus souvent, un conformisme au moins égal à celui du bourgeois, qu’il pense, par exemple, dans le fond de soi-même et sans plus de raisons que le bourgeois, que le latin des collèges et des séminaires, le latin des curés, doit être un savoir éminent qui ouvre les portes secrètes du langage et de l’intelligence... De la même manière, il croira, à quelques nuances près, en tous les dieux et en tous les mythes bourgeois ; il croira à l’honneur bourgeois, à la patrie bourgeoise, à la propriété, au suffrage universel, à la démocratie. Il y croira même plus fermement que le bourgeois qui, dans le fond de soi, cultive quelque scepticisme. Il enchérira souvent sur ses maîtres et, s’il affirme son incrédulité, s’il rompt avec les pratiques religieuses de ses frères, il se jettera souvent dans d’autres croyances terrestres non moins décevantes.
En un mot, dans son comportement habituel, le prolétaire n’a pas d’idéologie ni de sentiments qui lui sont propres. Dans la plupart des cas, il emprunte au monde bourgeois tout un système de valeurs qu’il accommode tant bien que mal à son existence de travailleur salarié, voué à la misère et à l’ignorance. Il utilise, pour son propre jugement, les éléments d’appréciation que lui transmettent l’école laïque, la presse vénale, le roman populaire et la tradition familiale. Il ne critique pas et ne cherche pas à ériger en système ses quelques velléités de pensée indépendante. Il adopte sans discernement, approuve ou réprouve, selon une règle qu’il ne formule pas, mais qu’il sent impérieusement éternelle.
Ainsi, ne peut-on pas dire, avec Marx, que :
« Le prolétaire vit avec sa femme et ses enfants dans des rapports qui n’ont rien de commun avec le lien de famille bourgeois. » (Manifeste communiste)
Il faut dire au contraire que, dans sa famille surtout, le prolétaire s’essaie à vivre et à penser en bourgeois. C’est qu’ici, en effet, il ne faut pas trop se hâter de conclure du matériel au spirituel, sans tenir compte de la force contraignante de l’éducation, des impératifs moraux collectifs, des habitudes héréditaires de soumission physique et mentale. Le lien de famille, par exemple, a pour le prolétaire le même caractère inviolable et sacré qu’aux yeux du bourgeois. Mieux encore, alors que, pour le bourgeois, ce lien de famille n’unit et ne maintient qu’en apparence et qu’il est permis de le rompre, pourvu que les apparences soient sauvées, pour le prolétaire, au contraire, le lien de famille oblige à de scrupuleuses solidarités. C’est un fait qu’aujourd’hui les familles vraiment unies, et dont les membres soient prêts à s’entraider sans réserves, sont des familles prolétariennes. C’est un fait aussi que, dans la pratique morale courante, le prolétaire moyen enchérit sur le bourgeois ; qu’il se montre plus scrupuleux, plus patriote, plus sincèrement religieux, plus pudique, plus près, en un mot, du modèle de l’honnête homme du xxe siècle édifié par la morale laïque et républicaine.
De là vient qu’il est quasiment impossible de donner une définition morale du prolétariat. De là vient, aussi, qu’il est impossible, littérairement, de peindre un type de prolétaire. La plupart des auteurs qui s’y sont essayés sont tombés dans l’exceptionnel ou dans le poncif. Alors que le roman et le théâtre abondent en portraits authentiques de bourgeois, la littérature dite prolétarienne est encore, faute de vocation, à la recherche de sa formule. Elle a pu donner des œuvres curieuses et émouvantes, elle n’a pas atteint le vrai. Dans la plupart des cas, elle s’est réfugiée dans un pittoresque de commande ; elle n’a saisi, dans la vie prolétarienne, qu’un élément de bizarrerie, un fumet de canaillerie qui, au sortir de la pompe, du confort ou du gourmé de la vie bourgeoise, ont pu obtenir un succès de surprise ou de scandale. On s’est intéressé aux habitants de l’Hôtel du Nord, un des romans les plus caractéristiques de cette littérature, comme à une faune curieuse qui changerait heureusement des jeunes premiers domestiqués et des belles passagères de transatlantiques. Le marlou, la môme, le débardeur, la ménagère tonitruante, les petits pouilleux ont revendiqué leur place au soleil. Les bistrots aux tables poisseuses, les hôtels borgnes, les rues des quartiers populaires ont pris la place des dancings sélects, des palaces et de la Côte d’Azur... Peut-on dire, pour autant, que le roman ait atteint l’âme (si l’on veut bien nous permettre de nous servir de ce vocable) prolétarienne ? Évidemment, non.
C’est qu’en effet les mœurs prolétariennes, dont le roman se proposait de tenter la peinture, ne sont souvent qu’une copie des mœurs bourgeoises, mais plus pâle et plus morne qu’elles. Un livre qui se fût astreint à les évoquer dans leur désespérante monotonie, se serait condamné à faire l’histoire d’une vie sans joie, sans beauté, sans coups de théâtre, partagée entre l’usine ou le bureau rationalisés et le foyer sans lumière et sans chaleur. Le travail abrutissant, les promenades dominicales, les enfants mal élevés, la femme lasse, les mille soucis qui assaillent la vie du travailleur ne sont pas matière « romançable ». Zola, lui-même, le peintre de la classe ouvrière sous le Second Empire, avait réduit la vie des prolétaires aux fastes crapuleux de l’ivrognerie et de la débauche.
Il n’est point, disons-nous, de mœurs prolétariennes. Il n’est point d’éthique ni d’esthétique prolétariennes. La vie morale du travailleur est une vie d’emprunt. Tous les gestes de son existence le rattachent à sa misérable condition de salarié ; et ce n’est qu’obscurément qu’il prend conscience d’une vie supérieure qui pourrait être la sienne. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’il rompt la lourde chaîne d’habitudes, de préjugés, de conformisme intellectuel et moral qui font du prolétaire un petit-bourgeois à portion congrue, révérant l’ordre social, citoyen soumis, soldat obéissant, subissant, sans se plaindre, la dure exploitation du capital.
Exceptionnellement, disons-nous. Encore ne faut-il pas ignorer qu’à côté du prolétaire moyen que nous venons de décrire, existe un prolétaire conscient et organisé, vivant en marge du monde capitaliste, ennemi du régime, refusant d’adhérer aux évangiles officiels, ayant définitivement rompu avec les modes de penser et de sentir bourgeois. C’est, en général, un autodidacte chez qui la culture ne se sépare pas de l’expérience des luttes de chaque jour contre l’état social. Animé par une haute conscience de classe, possédant un sens aigu des besoins du prolétariat, se refusant à parvenir malgré toutes les tentations, rebelle à la corruption, insensible aux persécutions, il réalise le type achevé du prolétaire révolutionnaire. Il est le levain de la pâte ouvrière.
Sur l’autre bord, chemine le prolétaire pourri, celui dont le sens de classe est inexistant ou s’est effrité, prolétaire vendu ou prêt à se vendre, n’attendant qu’une occasion pour s’évader de sa classe ou pour la trahir, prolétaire honteux ou dévoyé, gagné par la pourriture sociale, n’ayant pu résister à l’appât d’une vie plus facile ou bien encore ayant glissé dans ce lumpen prolétariat, dans cette canaille stigmatisée par Marx et Engels dans le Manifeste, « dans cette pourriture inerte qui forme les couches les plus basses de la société ancienne... », triste épave « que son genre de vie disposera à se laisser acheter pour des manœuvres réactionnaires ». Intellectuels besogneux, politiciens de sac et de corde, venus du peuple et aspirant à le piétiner, soldats de métier, policiers, gardiens de prison, maquereaux, nervis de toute obédience : toute un faune ignoble entre ainsi pleinement dans l’alliance avec la bourgeoisie. Ils forment les rameaux desséchés du tronc prolétarien.
Ce qui différencie, en effet, en tant que classes, le prolétariat de la bourgeoisie, c’est leur cohésion inégale, celle-ci, d’ailleurs, n’étant qu’un reflet de leur structure sociale différente. Tandis que la bourgeoisie tout entière, depuis le petit rentier propriétaire jusqu’au milliardaire américain, travaille constamment à raffermir l’ordre social bourgeois ; tandis qu’il est exceptionnel qu’un bourgeois trahisse sa propre classe pour se mettre au service du prolétariat, celui-ci, au contraire, trouve en lui-même ses ennemis les plus redoutables. Situation tragique, mais non nouvelle. Fait singulièrement grave et qui complique le problème de la lutte des classes et de la révolution.
C’est précisément à ce problème intéressant le « devenir » du prolétariat qu’il faut, maintenant et pour finir, nous attacher.
De tout ce qui précède, il ressort que l’idée de prolétariat repose essentiellement sur une base économique. Un prolétaire est un homme qui a besoin, pour vivre, de se vendre à un patron. Encore convient-il d’insister sur les conditions de cette vente. L’ingénieur, sorti d’une grande école, pourvu d’un diplôme d’État, qui, pour vivre, se vend à un usinier, moyennant un traitement lui assurant une large aisance, n’est pas un prolétaire. L’idée de prolétaire est, en effet, inséparable de celle d’un certain niveau de vie. Passé un certain niveau, on n’est plus un prolétaire, quel que soit, par ailleurs, son statut professionnel et même si celui-ci vous classe parmi les salariés. De nombreuses catégories d’intellectuels ou de techniciens, des fonctionnaires, des ingénieurs, des titulaires d’emplois supérieurs appartenant au commerce et à l’industrie se trouvent ainsi exclus des rangs du prolétariat. Inversement, on tombe au rang de prolétaire dès que son travail ne permet plus de vivre décemment, quel que soit ce travail et même s’il ne vous place pas directement dans la catégorie des exploités du capital. Cela est si vrai qu’on a pu parler d’un prolétariat rural, composé de petits propriétaires exploitants, de paysans pauvres travaillant eux-mêmes un bout de terrain qui leur permet tout juste de vivre. C’est ainsi également qu’on admet l’existence d’un prolétariat artisanal, formé de travailleurs indépendants mais qui, subissant durement la concurrence de la grande industrie, se trouve parfois dans des conditions économiques plus précaires encore que celles que connaît le prolétariat des usines.
Ainsi, parfois, la notion d’exploitation sociale se substitue à celle d’exploitation patronale pour la détermination de la condition de prolétaire. On est ou on n’est pas un prolétaire selon qu’on est plus ou moins misérable, plus ou moins exploité, quelle que soit, d’ailleurs, la forme de cette exploitation. Mais, du même coup, se trouve posé un grave problème de limitation, d’espèce, de mesure, d’appréciation. Jusqu’à quel point un paysan, un fonctionnaire, un ingénieur peuvent-ils se dire des prolétaires ? Question délicate au plus haut point et à laquelle se subordonne, par certains côtés, le problème général de la révolution à notre époque.
Qui ne voit que l’intérêt de la bourgeoisie est, ici, de brouiller les cartes ? Elle s’y attache en essayant de détacher du prolétariat des couches aussi nombreuses que possible et en les intégrant dans son propre système comme autant d’éléments alliés ou complices. Grâce à un système scolaire compliqué, elle réussit, sans modifier aucunement le statut social qui fixe les rapports généraux entre les classes, à puiser dans le prolétariat des hommes dont elle a besoin et dont elle fait ses contremaîtres, ses ingénieurs, ses savants, ses techniciens de toute espèce. Par une rémunération préférentielle, elle les attache à sa cause, elle en fait ses chiens de garde qu’elle dresse à mordre les chausses du prolétariat. Elle les constitue en une classe particulière, mi-bourgeoise, par son genre de vie, mi-prolétarienne par son origine et ses attaches.
Ainsi se trouve posé le problème des classes moyennes, Problème capital. De la force, du nombre, de la fidélité de cette classe moyenne dépend, en effet, le sort de la bourgeoisie. Qu’elle s’affaiblisse, qu’elle pactise avec la classe ouvrière, et voilà la bourgeoisie non seulement privée de techniciens, mais, encore, la voilà seule en face du prolétariat, sans cet État tampon qui amortit les antagonismes entre les deux classes fondamentales. Situation critique qu’elle doit à tout prix éviter. On peut dire qu’à cet égard, une des grandes préoccupations de la bourgeoisie est d’assurer le recrutement le meilleur de cette classe moyenne. Certains bourgeois pensent que le vieux système scolaire, avec son grossier empirisme peut y suffire. D’autres cherchent à perfectionner la machine à écrémer le prolétariat et se tournent volontiers vers les solutions préconisées par les radicaux partisans de l’École unique.
L’École unique, en effet, lorsqu’on en examine le principe et l’économie sans préjugé démocratique, mais à la lumière de la lutte des classes, apparaît bien comme une institution destinée à demander au prolétariat un tribut spécial et onéreux : celui de l’intelligence. Elle vise à arracher à leur classe d’origine les enfants aptes à devenir de bons techniciens et, grâce à l’éducation réactionnaire qu’elle leur dispensera, à les pourvoir d’une mentalité de petits bourgeois cupides et égoïstes. Elle vise à en faire les ennemis du prolétariat en développant en eux le goût de parvenir, de s’évader de leur classe, à les séparer économiquement et moralement de leurs frères de misère : les ouvriers et les paysans.
Qui ne voit le danger d’une telle entreprise qui, en rationalisant et en assurant le recrutement de la classe moyenne, prive en même temps le prolétariat de ses meilleurs éléments ? Certains pédagogues révolutionnaires ont déjà dénoncé cette nouvelle offensive de la bourgeoisie contre la classe ouvrière et, en dissipant les illusions mortelles que créait le vocable d’école unique, ont montré que seule la révolution pourrait créer l’école vraiment rationnelle et humaine, l’école unique de la science et du travail.
Revenant, à présent, sur la question de la classe moyenne, nous nous proposons de définir d’une façon plus précise son rôle social et sa destinée. À vrai dire, son existence même complique si profondément les rapports entre le prolétariat et la bourgeoisie qu’il a pu sembler à certains observateurs des conditions sociales actuelles que l’existence même d’une lutte des classes était assez problématique. D’aucuns n’ont voulu y voir qu’une invention simpliste de Marx reprise par les politiciens socialistes. Leur thèse peut se résumer ainsi : il n’y a pas deux, mais une infinité de classes sociales. Il n’y a pas une bourgeoisie et un prolétariat, mais une masse d’hommes oscillant entre la condition d’un bourgeois et celle d’un prolétaire. Il n’y a pas une lutte des classes, mais des conflits innombrables d’intérêts dont on peut bien dire qu’ils n’ont aucune portée révolutionnaire.
Voyez, disent-ils, les statistiques... Elles prouvent qu’on ne peut compter en France plus de sept ou huit millions d’authentiques prolétaires...
Or, c’est un fait que les statistiques donnent une allure scientifique aux plus mauvaises démonstrations et qu’elles arrivent à rendre acceptables les plus mauvaises causes. C’est un autre fait que, faute d’une critique suffisante, elles conduisent aux conclusions les plus erronées. Pour être bref, nous dirons que le nombre supposé de prolétaires est, de toute évidence, absolument faux et insuffisant. Nous allons en donner la raison. La plupart des statistiques reposent, en ces matières, sur une confusion. Elles assimilent, en effet, deux catégories sociales très distinctes : le prolétaire et le salarié. C’est ainsi, par exemple, que certains auteurs opposent aux huit millions (nous arrondissons à dessein) de salariés divers, les six millions de non-salariés comprenant, outre les deux millions de rentiers oisifs, des chefs d’établissements, des exploitants de toutes catégories et des isolés (artisans, petits commerçants, agriculteurs) n’employant aucune main-d’œuvre. On feint d’oublier qu’un grand nombre de non-salariés, en particulier les petits propriétaires terriens, employant ou non une main-d’œuvre régulière, sont effectivement des prolétaires, aux termes que nous avons définis plus haut, apparentes étroitement, par leur niveau de vie souvent médiocre, aux ouvriers des villes. La terre qu’ils possèdent – et à laquelle, bien souvent, ils tiennent – ne saurait, en effet, apparaître comme un instrument d’exploitation, mais constitue seulement un instrument de travail, un outil comparable, à quelques nuances près, à l’outil de l’ouvrier.
Tous les raisonnements que proposent nos négateurs de la lutte des classes sont donc faussés par cette erreur initiale. Toutes les conclusions auxquelles ils arrivent sont inacceptables. Ils voulaient nous prouver qu’il n’y avait pas de prolétariat et, partant, pas de lutte des classes. Ils oubliaient qu’il est d’autres prolétaires que ceux de l’usine et qu’il faut tenir compte de tout le prolétariat rural. Qu’on en juge à la lumière d’autres constatations. Si nous examinons les statistiques d’ordre fiscal, nous trouvons plus de quatre millions de personnes non salariées dont le revenu n’atteint pas 20 000 F. Or, à quelle catégorie sociale appartiennent ces non-salariés, sinon, pour la plupart, à la classe des petits propriétaires terriens ? Et n’est-il pas légitime, dès lors, de penser que ces quatre millions de personnes doivent entrer, pour la plupart, en déduction des six millions de non-salariés qu’on oppose triomphalement aux huit millions de salariés divers ? Du même coup, la situation des classes sociales, réduite en chiffres, se trouve singulièrement différente de celle qu’on nous présentait. Elle pourrait s’exprimer en mettant en regard des deux millions d’exploiteurs de toute espèce, bénéficiant d’un revenu de plus de 20 000 F, les douze millions de prolétaires.
Mais ces nombres eux-mêmes ne rendent pas compte de la structure sociale beaucoup trop complexe pour se plier à une représentation chiffrée. Certes, nous ne le nions pas, le phénomène de la lutte des classes ne peut se réduire à un simple schéma de bataille où l’on verrait ici des millions de misérables privés de tout, et là une poignée de profiteurs possédant le monde. Nous croyons seulement que ce n’est pas à l’aide de statistiques, forcément contradictoires et incomplètes (c’est ainsi que les chiffres que nous avons cités ignorent les ouvriers étrangers et coloniaux travaillant en France et dont le rôle économique et social est considérable) qu’on parviendra jamais à résoudre le problème que nous avons posé.
Il nous paraît plus efficace d’observer la réalité sociale et, munis des quelques données générales que nous connaissons, d’examiner s’il y a en France, aujourd’hui, un prolétariat et une lutte des classes. Dès lors, nous sommes frappés par un fait capital : celui de l’existence et du développement d’une classe moyenne. Il n’existe pas, en effet, un prolétariat et une bourgeoisie, constitués comme classes antagonistes et dont l’une doit forcément abattre l’autre ; mais il y a une infinité de conditions formant autant de catégories sociales dont les intérêts parfois divergent et parfois convergent. Il y a surtout de nombreuses catégories moyennes, constituées par des éléments petits-bourgeois et ouvriers aisés, plus ou moins bénéficiaires de l’ordre social actuel et, par conséquent, conservateurs.
Est-ce là un phénomène vraiment nouveau ? Le développement d’une classe moyenne est-il vraiment caractéristique de notre époque ? D’aucuns l’affirment. Mais l’histoire est d’un autre avis. À toutes les époques, en effet, on trouve la même variété de catégories sociales que nous constatons aujourd’hui. C’est ainsi qu’à la fin du xviiie siècle, à la veille de la Révolution, on aperçoit en France, entre le roi, possesseur théorique de toutes les richesses de son royaume, et le paysan misérable, serf encore sur certaines terres d’Église, une quantité innombrable de degrés d’élévation : petits métayers, fermiers ou propriétaires, petits officiers fiscaux ou justiciers, bourgeois aisés, commerçants ou armateurs, grands bourgeois parlementaires, fermiers généraux, etc. Ne pourrait-on pas, en y regardant attentivement, retrouver ici toute la variété de nuances du monde moderne ? Et cette structure sociale éparpillée a-t-elle, puisque c’est la question qui nous intéresse, empêché la Révolution, c’est-à-dire le groupement et l’offensive de toutes les forces bourgeoises, appuyées sur le prolétariat, contre le régime monarchiste féodal ?
Pourtant, nous reconnaissons bien volontiers que, si une telle analyse ne révèle pas d’importantes variations sociales qualitatives, elle nous oblige à enregistrer un très grand désaccord dans la disposition quantitative des éléments constitutifs des deux sociétés envisagées. En bref, on peut dire que les classes moyennes ont crû en nombre et en richesse. Une partie plus ou moins importante de la plus-value, résultant d’une meilleure exploitation des richesses du globe, s’en est allée à certaines couches sociales jusqu’alors très voisines du prolétariat. On a assisté à un enrichissement des titulaires de professions dites libérales et des techniciens supérieurs indispensables pour mettre en valeur les domaines nouveaux du capitalisme. Le médecin, le juge et l’ingénieur ont vu leur condition matérielle s’améliorer progressivement. Sont-ils devenus, du même coup, les indéfectibles alliés de la bourgeoisie contre le prolétariat ? Par leur existence même, les classes moyennes jouent-elles et sont-elles appelées à jouer un rôle contrerévolutionnaire ? Nous ne le croyons pas. Le résultat de la bataille des classes ne dépend pas d’elles. L’influence sociale de ce qu’on peut appeler la petite-bourgeoisie est, en effet, pratiquement nulle. Entre la bourgeoisie et le prolétariat, il n’y a de place que pour des éléments hétérogènes, aimantés sentimentalement en apparence, économiquement en réalité, par l’une ou l’autre des deux classes fondamentales. Dans l’hypothèse d’une révolution, le rôle de ces classes moyennes serait de servir le vainqueur, quel qu’il fût. Si elles peuvent, présentement, compliquer la formulation du problème social, elles ne sauraient en aucune manière en modifier la solution. Leur influence est donc plus apparente que réelle ; elles n’atténuent en rien l’antagonisme entre prolétaires et bourgeois. Si nous voulions user d’une comparaison, nous dirions que, de la même manière, l’adjonction dans un convoi de plusieurs wagons de seconde classe laisse intact le rapport d’inégalité entre les voyageurs de troisième et de première classes.
Que cet antagonisme soit conscient ou inconscient, il n’importe. Il nous suffira d’avoir montré que l’objection fondée sur l’existence des classes moyennes est sans valeur. Ceux qui la formulaient pensaient du même coup ruiner la théorie marxiste de la lutte des classes, en affirmant qu’il n’y avait pas de classes. Et voilà que l’idée marxiste sort victorieuse du débat. Mais, au surplus, Marx est-il le premier et le seul à avoir énoncé en termes clairs une théorie du prolétariat ? Non pas. Proudhon, à maintes reprises, avait posé l’existence des classes. Répondant aux petits-bourgeois républicains qui, après le Manifeste des Soixante, première opposition consciente au régime napoléonien, prétendaient qu’il n’y avait pas de classes en France, il montrait dans sa Capacité politique des classes ouvrières qu’il existait une classe ouvrière depuis 1789, depuis que l’ouvrier avait séparé son sort de celui de son patron avec lequel il était jusqu’alors uni dans la corporation. Qu’on le veuille ou non, écrivait-il, « la société française est divisée en deux classes ». Il y a d’un côté ceux qui travaillent pour un salaire bas et qui vivent exclusivement de leur travail et ceux qui vivent « d’autre chose que de leur travail, quand ils travaillent ». Observation féconde, en effet, et qui le conduisait à cette conclusion :
« La division de la société moderne en deux classes, l’une de travailleurs salariés, l’autre de propriétaires-capitalistes-entrepreneurs, est donc flagrante. »
Proudhon essayait ensuite de fixer le destin des deux classes ennemies. Il voyait le prolétariat chercher à comprendre son état, parler de son émancipation, monter, et la bourgeoisie hésiter, louvoyer, accepter tous les régimes et les rejeter l’un après l’autre. Tandis que le prolétariat prenait une conscience de classe, la bourgeoisie perdait conscience de la sienne. Déjà, elle n’était plus « une classe puissante par le nombre, le travail et le génie, qui veut et qui pense, qui produit et qui raisonne, qui commande et qui gouverne ; elle n’était plus qu’une minorité qui trafique, qui spécule, qui agiote..., une cohue ». Le rôle du prolétariat serait de réaliser la fusion des deux classes dans un monde égalitaire où, à la différence des fonctions, ne correspondrait pas une hiérarchie des conditions morales et matérielles.
Ici, Proudhon rejoignait Marx dans l’affirmation vigoureuse de l’existence des classes. Et, plus nettement encore que l’auteur du Manifeste, il indiquait au prolétariat sa voie : creuser toujours davantage le fossé qui le séparait de la bourgeoisie, se refuser à toute collaboration, à tout partage illusoire du gouvernement, s’abstenir de voter, de constituer à l’intérieur des assemblées représentatives une opposition qui serait vouée à l’impuissance et qui constituerait un trompe-l’œil démocratique. Mais, au contraire, constituer ses propres forces, ses propres institutions, dégager l’idée ouvrière par la lutte contre toute autorité, et particulièrement contre l’État, et par la recherche d’une formule sociétaire où l’échange des services devra se faire sur un pied d’égalité...
« La société devant être considérée, non comme une hiérarchie de fonctions et de facultés, mais comme un système d’équilibration entre forces libres, dans lequel chacun est assuré de jouir des mêmes droits, à la condition de remplir les mêmes devoirs, d’obtenir les mêmes avantages en échange des mêmes services, système, par conséquent, essentiellement égalitaire et libéral, qui exclut toute acception de fortune, de rang et de classe ».
Ainsi, la pensée de Proudhon fixait à la fois le présent et l’avenir. Pour le présent : lutte de classes. Pour l’avenir : approfondissement de cette lutte devant se terminer par le triomphe révolutionnaire du prolétariat. Les deux affirmations sont, en effet, corrélatives. La négation de l’existence et de la lutte des classes entraîne la négation de la révolution en faveur d’on ne sait trop quel progrès indéfini dans tous les domaines. Elle conduit droit au réformisme par la pratique d’une propagande purement idéaliste et subjective. Elle livre, sans défense, le prolétariat à la bourgeoisie.
À une telle doctrine, à l’usage des démocrates de la Ligue des droits de l’homme, s’opposera toujours victorieusement la théorie inattaquable de la lutte des classes. On ne la confondra pas avec un absurde fatalisme révolutionnaire, véritable caricature du marxisme, qui prétendrait assurer sans efforts le triomphe du prolétariat. Si l’on peut croire qu’il est des conditions objectives, indépendantes, dans une certaine mesure, de la volonté humaine, et hors desquelles la révolution ne sera pas, en revanche on peut dire qu’il est des conditions subjectives nécessaires pour le triomphe de cette révolution. Il ne suffit pas qu’une conjoncture économique et politique soit révolutionnaire, il faut encore que le prolétariat le soit.
Ce doit être une des préoccupations essentielles des anarchistes que de développer cette conscience révolutionnaire du prolétariat. En préconisant, selon les enseignements de Proudhon, une organisation politique autonome de la classe ouvrière, en acceptant toujours et dans tous les domaines la rupture de celle-ci avec la bourgeoisie, en travaillant à la formation d’une culture syndicale de classe s’opposant à la culture bourgeoise, en favorisant les courants contemporains en faveur d’une éthique et d’une esthétique prolétarienne ; ils dresseront, en face de la vieille et branlante société capitaliste, la société de demain, la société des travailleurs libres et égaux, sans dieux ni maîtres. — Lashortes.
PROLÉTAIRE
n.
Le travailleur, l’homme que l’on désigne sous le nom de prolétaire, est celui qui ne possède pas de fortune, n’occupe pas une situation suffisamment lucrative pour le rendre indépendant. Dans l’Antiquité, à Rome surtout, le prolétaire était, comme de nos jours, un homme pauvre, pour qui la société n’avait guère de considération que pour les enfants qu’il engendrait pour servir de chair à plaisir ou à travail aux classes dirigeantes de l’époque. Il y a plus de différence dans la forme que dans le fonds entre le prolétaire de la Rome antique et celui de notre époque. Le prolétaire a été et est encore plus ou moins ouvertement un esclave collectif et politique.
Afin de définir plus nettement notre pensée sur le prolétaire, nous disons : tout membre de la société qui est complètement privé de la propriété d’une partie du sol, ou de ce qui en provient, et qui dépend, pour vivre, des propriétaires fonciers ou des capitalistes est un prolétaire.
La propriété d’une richesse est une des conditions indispensables du travail, c’est-à-dire à la possibilité de pourvoir aux nécessités de la vie ; l’autre condition est l’intelligence développée par la participation aux connaissances acquises à la société générale.
Quand la domination du sol, et de ce qui en provient, pèse sur la classe moyenne et sur lui, le prolétaire est moins malheureux que lorsque le capital dans son ensemble – c’est-à-dire richesse foncière et richesse mobilière – appartient à la noblesse et l’écrase. Si le travailleur déshérité s’est insurgé pour la bourgeoisie contre la noblesse, c’est qu’il avait été fort longtemps horriblement exploité par celle-ci. De ce fait, il a quelque peu amélioré son sort quant à l’alimentation et à l’existence proprement dite ; mais, par contre, il a appris à sentir davantage, c’est-à-dire à souffrir moralement et, aujourd’hui comme par le passé, il reconnaît avec le fabuliste que : son ennemi c’est son maître. Cette situation de demi esclavage ne peut cesser que par une nouvelle organisation de la propriété, en général, et de la propriété foncière tout particulièrement. C’est de cette organisation sociale nouvelle qui, sans désorganisation et dans l’harmonie sociale, donnera à tous et à chacun les moyens d’être les artisans de leur fortune et de leur destinée, que le prolétariat disparaîtra. La propriété du sol entrée au domaine commun ou social et la participation de tous aux connaissances acquises sont les deux principales réformes à réaliser si l’on veut voir disparaître le prolétaire, le prolétariat et, par suite, le paupérisme.
Comme les propriétaires individuels formant des sociétés se combattent entre eux, malgré une apparente solidarité, et, à l’occasion, invoquent le secours des prolétaires pour renforcer leurs avantages, les travailleurs feront bien de se rappeler qu’ils sont encore les esclaves du capital et que leur intérêt véritable, sous toutes les latitudes, consiste à s’émanciper eux-mêmes.
— E. S.
PROPHYLAXIE
n. f. (du grec : pro, avant, et phulaxis, action de garantir)
Nous entendons par prophylaxie l’ensemble des moyens que l’on peut mettre en œuvre pour se préserver de tel danger qui surviendrait presque fatalement sans ces précautions.
La prophylaxie ne sera pas seulement hygiénique ou thérapeutique, comme on l’a volontiers considérée jusqu’ici, mais elle intéressera également le plan intellectuel et moral de l’individu. Bien plus, nous pouvons l’étudier jusque dans ses ressources salutaires pour se garantir contre les fléaux économiques et sociaux.
En résumé, la prophylaxie est l’action de neutraliser, par des moyens appropriés, tous les éléments nocifs pouvant attaquer l’individu ou la collectivité dans sa santé physique, morale et sociale.
Il faut remonter à la plus haute Antiquité pour trouver les premières règles de prophylaxie hygiénique. Moïse, Mahomet n’hésitèrent pas à proscrire de l’alimentation de leurs peuples certaines viandes (le porc, entre autres, à cause de la trichinose) et certaines boissons alcoolisées. Le ramadan chez les musulmans, le carême chez les chrétiens, n’ont pas d’autre cause que de forcer les individus à une carence alimentaire très utile, surtout à l’époque du printemps.
Au cours des siècles, les grands fléaux épidémiques qui s’abattirent sur les peuples forcèrent ceux-ci à se soumettre à une prophylaxie rigoureuse et souvent brutale. Lors de l’invasion de la lèpre, qui se propagea d’une façon redoutable en Europe, à l’époque des Croisades, on employa le seul préservatif efficace, qui fut l’isolement. C’est dans ce but que furent créées les léproseries. Il existe une déclaration royale du 24 octobre 1613 réorganisant l’assistance due aux lépreux et faisant défense à ceux-ci de se marier avec des gens indemnes.
Pour la peste, on employa des moyens plus radicaux encore. Le 26 août 1531, le Parlement ordonna que toutes les maisons infestées par la peste eussent aux portes et aux fenêtres une croix de bois. Et, comme rien n’est nouveau sous le soleil, le bâton blanc que nous voyons aujourd’hui aux mains de nos aveugles, fut donné aux pesteux.
On cite aussi ce cas d’une prophylaxie par trop expéditive : le 27 septembre 1720, à Aix-en-Provence, un homme étant mort de la peste, on mura sa maison. Celle-ci était dans le faubourg de la ville. Trois hommes de cette maison voulurent, le soir, rentrer en ville : on les mit à mort.
Et quand on songe que l’épidémie de choléra de 1832, débutant à Calais et atteignant Paris, fit plus de cent mille victimes ; celle de 1848, à Dunkerque, cent dix mille ; enfin, que celle de Marseille, en 1865, détermina dans cette seule ville 14 600 décès en quelques mois, on trouve bien naturel que la société emploie tous les moyens possibles pour se défendre, et cherche de plus en plus à les améliorer.
En 1798, le médecin anglais Jenner publia son premier ouvrage sur la vaccine et, en juin 1800, eurent lieu les premiers essais de l’inoculation vaccinale contre la variole : elle est pratiquée avec succès sur une trentaine d’enfants. C’est, on peut dire, la première grande victoire prophylactique, car il faut arriver ensuite aux belles expériences de Pasteur pour que la porte soit ouverte toute grande à la lutte contre les éléments nocifs des principales maladies humaines. Nous passerons en revue ces différents procédés de préservation quand nous nous occuperons de la prophylaxie thérapeutique.
Pour l’instant, disons quelques mots de la prophylaxie hygiénique.
L’hygiène est la clef de toute bonne santé. Il faut qu’elle existe, au point de vue général, dans tous les endroits où doivent vivre en commun des agglomérations d’individus. Tout le monde ne peut pas habiter un appartement luxueux, où règne tout le confort moderne. Il faut donc remplacer, dans les logements plus modestes, ce luxe par des choses pratiques, et d’une propreté méticuleuse.
Il est indéniable qu’un grand progrès est actuellement réalisé. La destruction de la « zone parisienne », son remplacement par la construction de grands immeubles à loyers modérés, et, dans beaucoup de quartiers des grandes villes, la suppression d’îlots insalubres, nids à tuberculose, à fièvre typhoïde, à cancer, permettent au travailleur d’améliorer sa façon de vivre.
La facilité de plus en plus grande des communications avec la banlieue lui permet également de se désintoxiquer des miasmes accumulés dans les villes, et dont ses poumons sont imprégnés. L’effort n’a pas été moindre en ce qui concerne l’hygiène générale dans les grosses agglomérations d’individus : villes, usines, casernes, écoles, grands magasins, hôpitaux, etc. Partout, l’air circule mieux ; la vue se repose sur des jardins, des squares, des arbres. La nourriture, pour ceux qui sont nourris par la communauté, est très sensiblement améliorée. Enfin, l’aération, la désinfection des locaux, les vaccinations préventives, l’hydrothérapie, l’assistance médicale, les secours aux femmes en état de grossesse, tous ces facteurs entrent en ligne de compte pour réaliser une amélioration très sérieuse de la vie de l’ouvrier.
Est-ce à dire que la perfection est obtenue ? Hélas ! Il y a encore beaucoup à faire ! On publie des décrets défendant ceci ou cela, pour le bien des gens. Mais combien s’y conforment ? On défend de battre les tapis aux fenêtres : vous passez et recevez tous les microbes possibles échappés de chiffons poussiéreux ; on défend de laisser aux étalages extérieurs les produits de l’alimentation ; passez devant les crèmeries ou magasins de fruiteries : tout est par terre, pêle-mêle, et j’ai vu des chiens ne pas hésiter à se soulager sur ces paniers où vous irez ensuite puiser vos provisions. J’ai vu souvent le soir, dans les pâtisseries, des employés balayer très consciencieusement la boutique, n’ayant cure des gâteaux restant à découvert sur les tablettes : ils seront resservis le lendemain pleins de combien de microbes ?... Et combien d’autres faits je pourrais citer dans cet ordre d’idées !
Il y a, certes, beaucoup à faire, et nous verrons, surtout quand nous parlerons de la prophylaxie sociale, que l’homme n’est pas prêt d’atteindre au bonheur auquel il semble normalement avoir droit.
Une des bases de la prophylaxie hygiénique individuelle est la propreté corporelle. Notre époque est une époque de propreté, et la pratique des sports y a pour beaucoup contribué. Évidemment, j’envisage ici l’homme de condition moyenne, ne m’attardant pas aux riches qui ont tout, et plus encore, pour se donner tout le confort hygiénique possible – ni, non plus, à l’homme déchu, vivant au bas de l’échelle sociale, abêti par les passions et l’alcool. Donc, pour cet homme de condition moyenne, les soins de son corps, et la culture du dynamisme de ses muscles, lui permettent d’échapper à nombre de maladies, et d’arriver à une vieillesse saine et heureuse sans s’en apercevoir.
Les soins à apporter à certains organes particuliers sont des plus importants. Je parlerai en tout premier lieu des dents.
L’hygiène dentaire est, actuellement, entrée dans les masses, et le temps n’est plus où les soldats se servaient de leur brosse à dents pour astiquer les boutons de leur capote. Dès le jeune âge, dans les écoles comme dans les familles, on habitue les enfants à se brosser les dents, et il ne pas avoir peur du dentiste. Les malformations dentaires sont corrigées par des appareils spéciaux, dont le principal est le Monobloc du docteur Pierre Robin. C’est qu’on ne se figure pas, dans le public, l’importance qu’ont les dents mal placées dans les mâchoires, ce qu’on appelle scientifiquement dysmorphoses, pour le développement physique et intellectuel de l’enfant.
« Vous les connaissez tous, ces sujets, qu’on appelle couramment adénoïdiens, aux dents irrégulières, à la voûte palatine ogivale, au menton en retrait ou en « galoche » ; chétifs, malingres, se développant mal, ils restent asthéniques, déprimés, en retard sur tout. La tête en avant, les épaules en dedans, ils sont des candidats à la tuberculose, préparée par des rhumes constants. La mastication qu’ils effectuent la bouche ouverte leur occasionne de l’aérophagie ; aussi sont-ils plus ou moins atteints d’entérite et d’infection gastro-intestinale, où l’appendicite prend une place importante. Leurs études sont retardées, leur caractère nonchalant et souvent coléreux : dans l’ensemble, ce sont des enfants difficiles à élever et donnant beaucoup de mal aux parents. » (Dr P. Robin.)
Que voulez-vous que de tels sujets deviennent dans la vie ? Ne seront-ils pas toujours des impedimenta sociaux, traînant avec eux leurs tares et les vices inhérents à leur déchéance physiologique ?
Grâce au traitement et à l’appareil du docteur Pierre Robin, grâce à cette méthode qu’il a appelée l’eumorphie, il arrive à faire de ces pauvres êtres tarés, disgraciés, condamnés à traîner une vie sur laquelle auront prise toutes les maladies et diathèses possibles, de ces malheureux, dis-je, il fera des sujets sains, normaux, armés pour la lutte physique et morale, sentant leur intelligence, autrefois atrophiée, s’éveiller de jour en jour aux idées saines et grandes, et parvenant ainsi à être des hommes, dans le sens le plus noble du mot.
À ces corrections thérapeutiques des anormaux, on peut joindre les exercices physiques qui ont pris une très large place dans l’éducation infantile moderne. Les institutions scoutes, réunissant des milliers d’enfants et de jeunes gens des deux sexes, apportent, par l’entraînement physique bien réglé, une contribution immense à la prophylaxie de tous nos maux.
Dans le même ordre d’idée, les danses eurythmiques, très en honneur dans toutes les classes de la société, apportent au corps une liberté, une souplesse, une élégance dans les gestes et la démarche qu’on ne retrouve réellement que dans les manifestations artistiques grecques ou latines.
Plus près de nous, nous voyons évoluer deux écoles sportives que l’on commence à envisager avec une curiosité sympathique : c’est le naturisme, des frères Durville, et le nudisme, de Kienné de Mougeot. Et ceci rentre bien dans notre étude, car la thalassothérapie et l’héliothérapie, c’est-à-dire les bains de mer et les bains de soleil, réclament, pour obtenir un maximum bienfaisant, une nudité absolue. Les nudistes affirment, d’ailleurs, que le nu est plus chaste que le demi nu, et que si, dès le jeune âge, on habituait les enfants des deux sexes à vivre ensemble à l’état de nature, ils n’auraient pas, plus tard, les curiosités malsaines de la puberté. L’éducation sexuelle en serait d’autant facilitée.
Voilà donc, envisagé dans ses grandes lignes, ce qui touche à la prophylaxie hygiénique.
Voyons rapidement, maintenant, les chapitres de la prophylaxie thérapeutique.
Ils embrassent toutes les grandes diathèses, toutes les grandes maladies ; c’est-à-dire qu’il faudrait un livre entier, que dis-je, plusieurs ouvrages, pour développer tous les traitements nouveaux, tous les moyens de défense contre les maladies, qui sont la gloire de notre nouveau siècle, avec les sérums, les vaccins, les bactériophages, l’hémothérapie et la transfusion du sang, la radiothérapie et les rayons X ; enfin, la dernière venue, l’opothérapie ou prophylaxie et traitement par les produits des glandes endocrines.
Quatre grandes diathèses déciment l’humanité : syphilis, tuberculose, alcoolisme, cancer. Voyons les données modernes qui peuvent protéger la société contre ces maladies, dans son individualité comme dans son hérédité.
Syphilis.
La syphilis n’étant plus, heureusement, considérée comme maladie honteuse, l’individu peut être mieux guidé et conseillé, d’abord pour éviter la maladie ; ensuite, l’ayant contractée, pour préserver son entourage de tout contage. On peut mieux lui apprendre à bien se soigner et, surtout, à considérer comme un crime de donner la vie à un enfant dans de telles conditions. Des livres, des pièces de théâtre, des tracts et des articles dans de nombreux journaux le mettront en garde contre la gravité de sa maladie, si les soins ne lui sont pas donnés à temps, et surtout s’il se figure être guéri parce que les premiers accidents auront rapidement disparu. Un syphilitique a, toute sa vie, une épée de Damoclès suspendue sur sa tête : qu’il ne l’oublie jamais.
Des centres vénériens existent aujourd’hui un peu partout et donnent une marche à suivre rigoureuse pour éviter ces accidents à retardement. La vraie prophylaxie de cette maladie est un peu illusoire : c’est un peu, comme dans la pièce de Brieux, le bon ou mauvais billet tiré à la loterie de l’amour. Cependant, je crois rendre service au lecteur en lui donnant ce conseil pratique : le plus tôt possible, après un rapport sexuel suspect, faire un savonnage prolongé des organes génitaux et des régions voisines (savon blanc de Marseille et eau chaude). Frictionner ensuite légèrement ces mêmes surfaces avec la pommade suivante, qui sera laissée en place deux à trois heures :
-
Cyanure de Hg : dix centigrammes ;
-
Thymol : 1,75 g ;
-
Huile de vaseline : 4 g ;
-
Calomel : 25 g ;
-
Lanoline : 50 g ;
-
Vaseline : q. s. pour 100 g. (Gauducheau.)
Tuberculose.
Nous avons dit plus haut que l’hygiène est la clef de toute bonne santé. Jamais aphorisme n’a été aussi vrai qu’en ce qui concerne la prophylaxie de la tuberculose.
L’air confiné, les séjours dans les locaux obscurs, sales, mal entretenus, où grouillent des nichées d’enfants, voilà les facteurs de la tuberculose. Et ceux-là ne pardonnent jamais. Prenez les mêmes nichées d’enfants, faites-les évoluer en plein air, qu’ils appartiennent à des bohémiens ou à des fermes campagnardes, dans lesquelles on les verra disputer le fumier aux porcs : jamais vous ne trouverez chez ceux-ci le bacille de la tuberculose. Ah ! Des croûtes d’impétigo ou autres teignes, tant que vous voudrez ! Mais les parents vous diront que « ça n’a pas d’importance, que c’est la santé de l’enfant... », et vous n’aurez rien à répondre. La vie au grand air, les exercices physiques, les bains de soleil et de mer, voilà la vraie prophylaxie de cette terrible maladie. Quant à son hérédité, on affirme aujourd’hui qu’elle est rare : l’enfant ne naît pas tuberculeux, il naît tuberculisable.
La lutte que la société livre à cette maladie est grande et donne de bons résultats. Des dispensaires existent dans chaque arrondissement de Paris, et le timbre antituberculeux, lancé chaque année, à Paris, leur apporte une source intéressante de revenus. On a fait un peu partout des préventoriums et des sanatoriums. Des affiches, dans tous les lieux publics, défendent de cracher, car les poussières remplies de bacilles sont absorbées rapidement. Malgré tout, le pourcentage de mortalité par tuberculose est trop élevé. « Là encore, les résultats obtenus, partout où la lutte est menée méthodiquement, montrent ce que leur généralisation pourrait nous conserver de vies humaines. » (Le Matin, 27 mai 1932.)
Les Italiens sont en progrès sur nous à ce sujet. Une loi va, en effet, instituer la fiche radiologique obligatoire dans les écoles, afin que soient dépistées les lésions initiales de la tuberculose chez les enfants, « les radiologistes italiens désirant collaborer d’une façon désintéressée à la grande bataille de rénovation de la race ». (10e Congrès radiologiste italien, juin 1932.)
Alcoolisme.
Il n’y a pas de prophylaxie de l’alcoolisme : il est ou il n’est pas. Il en est de l’alcool comme de tous les poisons : c’est par sa suppression catégorique que l’on peut arriver à un résultat positif. Deux grands exemples sont là : au moment de la guerre, on a supprimé les alcools et l’absinthe ; résultat : on ne voit plus dans les rues de ces clochards ivres morts. Ceci pour la France. En Amérique, on a institué le régime sec : on en discute encore le bien ou le mal que cela a occasionné. Il est certain qu’en ce qui concerne notre pays, on peut affirmer que l’ouvrier ne s’alcoolise plus. Regardez-le au bar : il prendra un « café arrosé », un « blanc », un « rouge bord », quelquefois un « calva ». Mais l’« anis » le dégoûte : ce n’est plus le bon « Pernod » d’autrefois, et les alcools coûtent trop cher.
Mais le vice s’est décalé, et c’est maintenant dans la classe riche qu’il sévit. L’alcoolisme règne en maître chez les buveurs de cocktails, de liqueurs à pleins « verres de dégustation » répétés je ne sais combien de fois dans une journée ou une soirée, et ce sont souvent les femmes dites « du monde » qui en détiennent le record. On peut dire que le cocktail est le poison actuel de la haute société, néfaste doublement comme alcool et comme mélange.
Cancer.
Le cancer est la grande maladie moderne, sournoise, tapant à coup sûr, sans qu’on puisse en deviner l’invasion. Certains, comme les cancers de la bouche, des lèvres, de la langue, peuvent être décelés par des spécialistes comme les dentistes avertis. Une prophylaxie bien dirigée, surtout par la suppression du tabac chez les fumeurs ou le meulage de certaines dents ou racines à arêtes coupantes, peut enrayer le mal. (Voir Tumeur.)
Dans l’état actuel de la science, on ne peut dire encore si le cancer est contagieux ou non. Il semblerait héréditaire. On parle aussi de régions, de maisons, même, où le cancer se développerait avec plus d’intensité que partout ailleurs. On lance, actuellement, dans la pharmacopée, des produits à base de sels de magnésium et de manganèse qui agiraient efficacement et d’une manière prophylactique sur la neutralisation des terrains cancéreux. Quoi qu’il en soit, le traitement classique, en dehors de cette médication, ressort entièrement de la chirurgie ou de la radiothérapie.
Notre étude serait incomplète si nous passions sous silence quelques grandes maladies, pour lesquelles la prophylaxie offre cent fois plus de ressources que le traitement lui-même.
Fièvre typhoïde.
Due, comme on sait, à la contamination des eaux par le bacille d’Eberth, elle n’existe pour ainsi dire plus dans les grands centres, où l’eau est stérilisée par différents moyens. Le plus moderne est la verdunisation, obtenue par l’action des rayons ultra-violets.
Il est si peu permis, aujourd’hui, aux compagnies des eaux de ne pas prendre toutes les précautions voulues pour donner une eau exempte de tous germes pathogènes, que la responsabilité de ces compagnies est parfaitement établie par les tribunaux, et que, dans une épidémie de fièvre typhoïde, les personnes atteintes sont en droit de réclamer des indemnités. Un habitant d’Oullins, près de Lyon, réclama 30 000 francs d’indemnité, son fils ayant eu ses études interrompues du fait de la typhoïde, et sa demande fut recevable.
Dans les grandes agglomérations d’individus, dans l’armée par exemple, la vaccination anti-typhoïdique a fait merveille, et les épidémies vraies n’existent pour ainsi dire plus. Pour renseigner encore mieux le lecteur, nous ajouterons cette nouvelle de la toute dernière heure (juillet 1932) : M. André Kling vient d’étudier le mécanisme suivant lequel l’argent métallique mis en contact avec une eau quelconque souillée, non seulement la stérilise, mais encore lui confère des propriétés bactéricides vis-à-vis du bacille typhique et du colibacille. Cette action serait due à une solubilisation de l’argent dans l’eau.
Diphtérie.
La prophylaxie de la diphtérie est intéressante, parce qu’elle est toute nouvelle et a donné, d’emblée, des résultats positifs. On sait l’angoisse des parents quand le croup venait tuer leur enfant, étouffant dans ses griffes mortelles. En disant « toute nouvelle », je veux parler de la sérothérapie préventive par le vaccin ou anatoxine de Ramon, parce que le sérum antitoxique de Roux est le traitement le plus ancien du croup, et celui qui a préservé des milliers de petits êtres, voués sans lui à une mort certaine.
Le sérum de Roux guérit, le vaccin de Ramon immunise ; et cette vaccination se fait aujourd’hui à tous les enfants entre quatre et sept ans. Trois injections seulement sont pratiquées. Jusqu’à sept ans, on ne constate aucune réaction. À partir de cet âge, le choc est sensible. L’on doit d’ailleurs s’abstenir chez les adultes.
Rage, tétanos.
Dans ces deux cas, la vaccination doit être prophylactique, et n’agit qu’autant que le virus n’a pas encore fait son attaque. Tout individu mordu par un animal suspect de rage doit être vacciné le plus tôt possible. Tout individu mordu par un serpent venimeux doit recevoir le sérum de Calmette. Cette sérothérapie constitue un traitement d’urgence. L’injection devant être précoce pour être curative.
De même, toute personne ayant fait une chute et ayant une blessure ou écorchure souillée de terre ou de poussière est susceptible de contracter le tétanos. Là aussi, le vaccin n’agira qu’à titre préventif. On ne saurait trop répéter ces conseils pratiques, car de la rapidité du traitement dépend toujours la vie du malade.
Quant aux autres maladies infectieuses ou parasitaires, la prophylaxie générale se résumera en quelques principes : isolement du malade ; port d’un masque de gaze et d’une blouse, par toute personne l’approchant (surtout pour la grippe) ; lavage des mains avec une solution antiseptique (permanganate de potasse, hypochlorite de soude, etc.) ; désinfection du malade (nez, bouche, frictions d’eau de Cologne) ; vaccination et sérothérapie ; régime alimentaire.
La prophylaxie sanitaire est moins rigide à notre époque qu’autrefois. Les « quarantaines » des navires se bornent à quelques jours de lazaret. La destruction des bêtes de toutes sortes, et, surtout, des rats à bord des navires, entre pour beaucoup dans la sécurité où se trouvent les voyageurs, en débarquant à terre, de n’être cause d’aucune contamination.
Quant aux moustiques, mouches, puces, tous vecteurs de germes, on sait la campagne qu’on mène activement pour leur destruction. Les journaux du 11 juillet 1932 faisaient passer un avis du Comité national de l’enfance, soulignant les dangers que font courir aux nourrissons les chaleurs et les mouches, celles-ci se posant volontiers sur le lait, d’où s’ensuivent des diarrhées infantiles mortelles.
Maintenant, pour terminer cette étude de la prophylaxie thérapeutique, voulez-vous que je vous donne un bon conseil ? En cas d’épidémie, soignez encore mieux votre moral que votre organisme ; faites agir votre subconscient et répétez-vous – autosuggestionnez-vous – que le bacille n’aura aucune prise sur vous. La peur du microbe est le commencement de la maladie. Et rappelez-vous la grande parole de Claude Bernard : « Le microbe n’est rien, c’est le terrain qui est tout. »
Cultivez donc votre terrain organique, soit par une bonne hérédité, soit par un fonctionnement normal de vos glandes endocrines.
Toute la prophylaxie est là.
Prophylaxie mentale.
La prophylaxie n’est pas seulement hygiénique et thérapeutique, elle est aussi mentale. Cela veut dire que chaque être, dès son jeune âge, doit être guidé, prémuni contre les embûches de la vie. On obtiendra cela par une instruction, par une éducation bien adaptées à son intelligence et au milieu dans lequel il évoluera, Ce sera le rôle des instituteurs et des éducateurs de développer sa personnalité, de façon à lui donner une idée plus juste de ce qui est vrai, de ce qui est bien. Quelle responsabilité pour un maître ! Car si, dans les premières années de l’enfance, il y a le lien naturel, instinctif qui force le père et la mère à développer, chez le tout petit, son être surtout physique, à la septième année, des besoins nouveaux apparaissent, et son être intellectuel va recevoir les forces qui agiront durant sa vie. Et le maître devra avoir la compréhension de ce bloc inerte et vierge dont il lui faudra façonner une œuvre forte, intelligente, harmonieuse. Le moindre germe jeté dans ce terrain inculte aura des répercussions insoupçonnées. Car il faut bien se dire que toutes choses, dans la vie, dépendent les unes des autres, et que les plus petites causes peuvent déclencher les plus formidables effets.
La meilleure prophylaxie mentale du petit enfant, c’est de le laisser libre dans toutes ses activités, dont la principale, la plus vivante est le jeu.
L’enfant grandit, arrive à la puberté et, ici, se place la grave question de l’école mixte et de l’éducation sexuelle. L’école mixte est rationnelle : il n’y a pas plus de raison d’empêcher des enfants de sexe différent de suivre ensemble les leçons d’un maître que d’empêcher des jeunes garçons et des jeunes filles de s’asseoir sur les bancs d’un amphithéâtre, soit à la Sorbonne, soit à l’école de médecine ou à l’école de droit, pour les besoins de leur instruction professionnelle.
L’éducation sexuelle doit être enseignée par des personnes ayant toute la confiance de l’enfant, par le médecin de la famille, ou, à leur défaut, par les parents ; mais ceux-ci sont, presque toujours, de très mauvais éducateurs.
Alors, du fait que les enfants seront libérés de toutes ces idioties dont on embue leur petite intelligence, et comprendront le mystère de la vie humaine par comparaison avec les métamorphoses de plantes ou d’insectes, il naîtra dans leur conscience toute une prophylaxie mentale qui les mettra à l’abri des curiosités malsaines de la puberté, et en fera des êtres normaux, psychiquement et physiologiquement parlant. Il n’y aurait pas tant d’adeptes de Sodome et de Lesbos si la franchise sexuelle existait chez l’enfant dès son tout jeune âge, à commencer par le nudisme intégral.
Nous ne nous écarterons pas de notre sujet en parlant de la tendance actuelle à niveler les classes de la société ; et le résultat s’en fera nettement sentir d’ici peu, car 1932 voit la suppression du ministère de l’Instruction publique et son remplacement par le ministère de l’Éducation nationale. Cette année voit aussi la gratuité de l’instruction dans les lycées. Et, pour bien montrer l’état d’esprit de la jeunesse actuelle, je veux citer la fin d’un discours prononcé cette année, au banquet des anciens élèves du lycée Pierre Loti, à Rochefort, par un élève de philosophie, invité :
« Depuis plusieurs années, les élèves de l’école primaire supérieure et les élèves du lycée ont appris que la diversité des programmes n’élevait pas d’irréductibles obstacles à une réciproque compréhension. Les règles de la vie commune, le zèle simultané aux exercices du corps comme aux travaux de l’esprit, les conversations et les débats à cœur ouvert, les hasards irraisonnés de la sympathie : tout concourt à effacer les barrières factices, les préjugés sans fondement, les égoïsmes nés d’une mutuelle ignorance. La jeunesse reconnaît la jeunesse, et sait lui tendre une main fraternelle par-dessus les institutions et les doctrines. Le travail a toujours la même valeur humaine, parce qu’il a toujours la même dignité... Aux paroles merveilleuses que chantent Homère et Virgile, voici que s’unissent le bruit des machines et la rumeur studieuse des ateliers. Puisse cette symphonie, d’abord étrange, vous sembler le symbole du présent et du futur. »
Voici donc un pas de fait vers cette éducation « mondiale », chère à beaucoup, qui mènerait à la Fraternité universelle.
J’ai dit, plus haut, que chaque être, dès son jeune âge, devra être guidé pour obtenir de la vie le maximum de ses bienfaits. Cependant, donnez les mêmes conseils à deux individus et suivez-les dans leur réalisation : l’un réussira, l’autre échouera ; l’un aura de la chance, l’autre, jamais.
C’est qu’il y a des quantités d’éléments impondérables qui viendront se greffer pour faire la chance de celui-là, la malchance de celui-ci. Ne peut-on donc devenir maître de sa destinée ? On peut tout au moins mettre beaucoup d’atouts dans son jeu, quand on joue le bonheur de sa vie, en s’appuyant sur ces trois facteurs indispensables : l’ordre, la méthode et la confiance en soi.
Malheureusement, il y a des contingences qui peuvent venir contrarier cette harmonie que devrait être la vie : l’hérédité bonne, qui fera de ce jeune homme un individu sain, intelligent, bien armé pour la lutte, donnera à cet autre, si elle est lourde, un handicap néfaste : victime de diathèses multiples, tuberculeuses, syphilitiques, alcooliques, bref, dégénéré au moral comme au physique, il paiera à la société cette dette accumulée sur sa tête par les tares pathologiques de ses parents.
En résumé, la prophylaxie mentale devra guider l’individu pour obtenir le plus de réussite possible dans la vie. Pour cela, il lui faudra un peu de psychologie, beaucoup d’intuition, une propreté morale et physique.
Ce qu’on appelle la « cote d’amour », due à un physique agréable, à une facilité d’élocution, ne peut qu’aider à cette réussite. En tout cas, celle-ci donnera la confiance en soi, et permettra d’obtenir mille petits avantages que n’auront jamais les timides et les endormis.
Prophylaxie sociale.
Nous parlerons en dernier lieu de la prophylaxie sociale ; et pourtant nous aurions dû la mettre en première ligne, car c’est bien d’elle que dépendent toutes les autres. Lorsqu’on veut qu’une graine germe bien, qu’un plant d’arbre fruitier se développe et donne son rendement maximal, que fait-on ? On soigne le terrain, on y ajoute les éléments déficients.
De même pour les animaux : quand on veut un produit parfait, on sélectionne les pères et mères et l’on entoure la procréation de tous les soins possibles. Et que fait-on pour l’animal doué de raison qu’on appelle l’homme ? Rien. On ne l’éduque même pas sur ses devoirs de procréateur. On le jette dans la vie « au petit bonheur la chance », fabriquant des enfants sans se rendre compte de l’acte formidable qu’on va faire : créer de la vie !
Ah ! Vous croyez avoir le droit de la créer, cette vie ? Et vous, mère, vous croyez avoir le droit de mettre cet enfant au monde ? Ce droit, vous l’avez, mais à une condition : c’est que vous serez sûre que l’être qui naîtra aura en lui toutes les forces, toutes les possibilités d’une nature saine, exempte d’une hérédité lourde ou même douteuse. Voulez-vous me croire – et c’est un médecin qui vous parle : tout le problème de la rénovation sociale et de la procréation est inclus dans une seule formule :
Je l’explique en deux mots.
Faites des enfants si vous êtes sains, père et mère, c’est-à-dire si vous n’avez pas une hérédité scrofuleuse, tuberculeuse, syphilitique ; si vous n’avez pas acquis vous-mêmes la tuberculose ou la syphilis ; ou bien si, l’ayant, vous êtes guéris de ces diathèses avant de vous marier. Et encore, je ne parle pas des alcooliques, des épileptiques, de tous les tarés du système nerveux.
Je pose donc en principe que c’est un crime de mettre un enfant au monde si vous n’êtes pas sûrs, parents, de lui léguer un terrain sain dans lequel travailleront ses organes dans une parfaite intégralité physiologique et euphorique.
Posé cet axiome, tout ce qu’on nous raconte sur la natalité n’est que littérature, utopie et même danger, car le danger sera aussi grand, pour une nation, de mettre au monde des enfants tarés que de n’en pas mettre du tout. Donc, soignez d’abord vos diathèses héréditaires ou acquises, et procréez ensuite.
Voyez-vous maintenant l’utilité du certificat prénuptial qui va son petit bonhomme de chemin ? Nous le verrons bien éclore un de ces jours. Il ne s’agit point, ici, des thèses qui intéressent le malthusianisme (voir ce mot) ; il n’est question que de la mise en pratique de l’eugénisme. Il était en honneur chez les Grecs et les Romains qui enfermaient les femmes enceintes dans le gynécée, entourées de belles statues, d’œuvres d’art splendides, pour qu’une imprégnation subconsciente vînt former un être beau et fort. Ils le pratiquaient aussi, ces mêmes peuples qui sacrifiaient impitoyablement les nouveaux-nés tarés ou malingres. Que la société prenne donc l’enfant sain, d’où qu’il vienne, et ne jette pas son injuste réprobation sur la fille-mère. On se plaint de dépopulation. Protégez la fille-mère et son rejeton. Vous ne verrez plus les avortements pulluler à tous les étages de la société, et ouvrant la porte à la prostitution, à la criminalité.
La prophylaxie criminelle n’existe pas encore. Mais son organisation est à l’étude sur l’initiative du docteur Toulouse. Partant de ce principe que les criminels sont le plus souvent des anormaux, ils attirent d’habitude, avant leurs attentats, l’attention de leurs proches ou des tiers par leurs façons d’agir : injures, violences, menaces, etc. Or, ces actes, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, sont suffisants pour qu’ils soient signalés aux centres de prophylaxie mentale, aux fins de traitements spéciaux. Ainsi seraient évités grand nombre de crimes. (Le Siècle médical, 1er juillet 1932.)
Si toutes ces prophylaxies dont nous venons de parler étaient mises en œuvre, nous aurions certainement une sélection d’individus qui amènerait fatalement une sélection de races. Et les conséquences en seraient merveilleuses : aux pensées et sentiments destructifs (laisser-aller, haine, égoïsme, cupidité, cruauté, laideur, mensonge), succéderaient des pensées et des sentiments constructifs de bonté, d’altruisme, de liberté, de travail, de tolérance, de vérité, etc. Tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes, et nous verrions, alors, les peuples vivre dans la paix et le bonheur : finis les conflits, finis les armements, finies les guerres ! Quel idéal plus pur peut-on désirer ?
Conclusion.
On a vu, d’après tout ce que je viens de dire sur la prophylaxie, que de siècle en siècle, d’année en année, de jour en jour, l’humanité essaie, par un mieux-être éternel, de lutter contre toutes les forces maléfiques qui s’agrippent à l’être individuel et social, comme pour lui dire : « Tu as beau faire pour améliorer ton existence, il y aura toujours, au bout, la fin devant laquelle nous sommes tous égaux : la mort ».
Mais avant la mort, il y a la vie, que nous devons essayer de faire la meilleure possible. Des intelligences de tous ordres s’attèlent à cela – nous l’avons montré – et réussissent après mille détours. La boutade de Spencer est toujours vraie :
« L’humanité ne finit par marcher droit qu’après avoir essayé de toutes les manières d’aller de travers. »
— Louis Izambard.
PROPRIÉTÉ
n. f. (du latin : proprietas, même signification).
Toujours et partout, les objets d’usage courant, nécessaires à l’entretien de la vie : nourriture, vêtements, par exemple, ont fait l’objet d’une appropriation personnelle qui rend possible leur consommation. Mais, en tant que fait social, la propriété implique l’existence d’un droit reconnu et protégé par les chefs ; elle serait une détention légitime que consacre la coutume ou la loi. Loin d’être une institution fixe et toujours identique à elle-même, comme beaucoup de contemporains le supposent, la propriété a revêtu, au cours des âges, des formes différentes.
Aujourd’hui, elle a pour caractéristique principale d’être individuelle ; mais, à l’origine, elle fut essentiellement collective. Conquise par le clan, la terre demeurait sa propriété indivise ; tous la cultivaient en commun et bénéficiaient des produits du sol. Le communisme, voilà le régime primitif. Très proches des hommes préhistoriques, les Fuégiens sont restés hostiles à la propriété telle qu’elle existe chez nous. Darwin écrit :
« Si l’on donne une pièce d’étoffe à l’un d’eux, il la déchire en morceaux et chacun en a sa part : aucun individu ne peut devenir plus riche que son voisin. »
Chaque horde revendique la propriété d’un vaste territoire de chasse et de pêche ; des espaces neutres séparent, d’ailleurs, les hordes les unes des autres.
La propriété individuelle porta d’abord sur les femmes et les esclaves, ainsi que sur les objets qui, comme les bijoux et les armes, servaient directement à la personne. Puis elle s’étendit à l’habitation, aux tombeaux des ancêtres et à de faibles portions du sol. Mais, de l’avis de tous ceux qui ont étudié ce problème, la propriété de la terre fut lente à s’établir. La langue hébraïque, remarque Meyer, n’a pas de mots pour exprimer la propriété foncière ; et Mommsen a noté que, chez les Romains, l’idée de propriété n’était pas associée primitivement aux possessions immobilières, mais seulement aux possessions en esclaves et en bétail. Ce qui n’a rien d’étonnant : une peuplade nomade ou qui vit de chasse ne pouvait guère s’intéresser à la possession du sol. Cette dernière n’apparut qu’avec les progrès de l’agriculture : née du désir d’obtenir des récoltes plus abondantes, plus suivies, et qui ne réclamaient pas le défrichement de terres incultes. Mais le droit de propriété fut d’abord réservé à quelques individus privilégiés : les chefs de famille, les seigneurs ou les rois. En Afrique, maints roitelets sont encore propriétaires du pays tout entier : hommes, sol et choses. En principe, le souverain est propriétaire du sol dans les monarchies absolues ; il l’est aussi en Angleterre, du moins à titre de fiction juridique. Dès cette époque, la religion intervient pour protéger l’appropriation ; interdits et cérémonies rituelles sont toujours en usage chez certaines peuplades arriérées. Lorsqu’ils établissent des bornes, les Indiens du Brésil appellent les pajés qui exécutent des cérémonies magiques en battant du tambour et en fumant de longs cigares. Afin de délimiter les frontières, ils pendent quelquefois aux arbres des morceaux d’étoffe ou des paniers. En Nouvelle-Zélande, si un Maori voulait protéger sa moisson, sa demeure, ses vêtements ou quoi que ce fût, « il n’avait, dit Frazer, qu’à les tabouer, et ces biens se trouvaient en sûreté. Pour indiquer que l’objet était tabou, il y faisait une marque : ainsi, s’il voulait se servir d’un arbre de la forêt pour s’y creuser une pirogue, il attachait au tronc un bouchon de paille ; s’il désirait se réserver un massif de roseaux dans un marais, il y fichait une perche couronnée d’une poignée d’herbes ; s’il quittait sa maison en y laissant toutes ses valeurs, il en assurait la porte avec un ligament de lin et l’endroit devenait aussitôt inviolable. »
Longtemps, les chefs de famille ne jouirent que d’une propriété temporaire et périodique. À l’époque de Tacite, les Germains partageaient la terre pour une année seulement, durée du cycle des opérations agricoles ordinaires. Avec le perfectionnement des méthodes de labour et le besoin d’un plus long laps de temps, on espaça davantage l’époque du partage. Le mir de l’ancienne Russie, l’allmend pratiqué dans divers cantons suisses peuvent être considérés comme des survivances de cet état de choses. Plus ou moins tôt, des individus ambitieux obtinrent la propriété définitive de leur lot, ouvrant ainsi la porte à des injustices innombrables. Gide observe que :
« Toutefois, ce n’est point encore la propriété individuelle, le droit de disposer n’existant pas : le chef de famille ne peut ni vendre la terre, ni la donner, ni en disposer après sa mort, précisément parce qu’elle est considérée comme un patrimoine collectif et non comme une propriété individuelle. Ce régime se retrouve encore aujourd’hui dans les Zadrugas de la Bulgarie et de la Croatie, qui comptent jusqu’à cinquante et soixante personnes ; mais elles tendent à disparaître assez rapidement par suite de l’esprit d’indépendance des jeunes membres de la famille. »
De familiale, la propriété est devenue individuelle, et la Révolution française la rangea parmi « les droits de l’homme », On a même cherché à rendre la propriété foncière aussi souple, aussi facilement utilisable que la propriété mobilière. En Australie, le système Torrens permet « au propriétaire d’un immeuble de mettre en quelque sorte la terre en portefeuille, sous la forme d’une feuille de papier, et de la transmettre d’une personne à une autre avec la même facilité qu’un billet de banque ou tout au moins qu’une lettre de change ».
Aujourd’hui, l’accaparement est complet dans les pays civilisés.
« Ce champ est à moi, ce coin de forêt m’appartient ; ne touchez pas ces fruits, car je les revendique ; ne cueillez pas ces fleurs, elles poussent dans mon pré ; écartez-vous de cette fontaine aux eaux limpides, elle est mon bien. »
Voilà ce qu’entendra partout le déshérité. Pas une motte de terre pour poser librement son pied ; pas un endroit pour dormir sans l’assentiment du propriétaire ; la grande route elle-même est aux mains de l’État, qui s’adjuge, en outre, tout ce que les particuliers ne revendiquent point. Et le même fait se reproduit dès que les Européens introduisent leur civilisation quelque part. Avec des documents irréfutables à l’appui, V. Spielman a dénoncé ce qui se passe dans nos colonies nord-africaines. De grands rapaces s’abattent sur les contrées soumises à notre administration ; terres productives, richesses minières leur sont livrées par l’État. Malheur à celui qui, pour toute fortune, ne dispose que de ses bras ! La même méthode, les mêmes abus s’observent d’un bout à l’autre du globe.
Alors qu’à l’origine, le droit de propriété n’était guère que le droit d’exploiter soi-même son bien ou de le faire exploiter par les personnes de sa famille, il a subi, depuis, une prodigieuse extension. D’autres travaillent et peinent pour le plus grand profit du propriétaire : dans l’Antiquité, ce furent les esclaves ; au Moyen Âge, les serfs ; à notre époque, ce sont les salariés de l’usine et des champs. La possibilité de vendre et de louer ne fut pas reconnue tout d’abord : il semble qu’à l’époque d’Aristote, elle n’était pas encore admise d’une façon générale. L’aliénation ne fut, à l’origine, qu’un acte anormal, entouré de cérémonies extraordinaires ; chez les Romains, la mancipatio ne pouvait se faire qu’en présence de cinq témoins représentant les cinq classes de la nation. Parce qu’il s’oppose au droit d’héritage collectif ou familial, le droit de léguer, qui prolonge la propriété, même après la mort, n’est apparu que tardivement : à Rome, la loi des douze tables le mentionne pour la première fois.
De bonne heure, une distinction s’établit d’ailleurs entre les tâches serviles et certaines fonctions considérées comme nobles, et entourées d’un respect religieux. Une véritable réprobation, qui subsistera jusqu’à notre époque, pèse sur le travail manuel. On sait en quel mépris furent tenus les esclaves, et combien peu enviable le sort des serfs ; nombre d’anciens philosophes considéraient le travail manuel et le commerce comme dégradants pour un homme libre ; la loi de Manou range parmi les péchés graves le fait d’exécuter de grands travaux mécaniques ou de surveiller une manufacture ; en France, un noble dérogeait, avant 1789, lorsqu’il se livrait à une occupation lucrative.
En brisant le régime corporatif, si important au Moyen Âge, et en instaurant un régime de liberté plus grande, la Révolution française aurait pu conduire à des transformations économiques heureuses et corriger bien des abus. Mais, comme l’a montré Mathiez, les grands ancêtres, que nos politiciens invoquent si volontiers, furent de jolies fripouilles dans l’ensemble. Leur corruption, leur vénalité firent échouer les tentatives d’affranchissement populaire ; elles assurèrent le triomphe de la bourgeoisie. Plus que toute autre, la législation issue de la Révolution française aura permis la royauté de l’or. En principe, elle reconnaissait à tous les individus le droit de propriété ; en fait, elle rendait possible la concentration des capitaux et l’accaparement des instruments de production par une féodalité d’argent. Théoriquement, le salarié était proclamé libre ; mais, en pratique, il était contraint, pour vivre, de louer ses services à un patron qui conservait, pour lui-même, une notable partie du fruit du travail de ses ouvriers.
Le Code civil napoléonien multipliait les garanties en faveur de la propriété ; il était presque muet concernant le travail, stipulant à l’article 1 781, qui fut abrogé en 1868, que « le maître est cru sur son affirmation pour la quotité des gages, le paiement du salaire de l’année courante, etc. ». Et le Code pénal faisait preuve d’une partialité non moins révoltante. Si des modifications furent apportées ensuite au texte primitif, elles n’ont en rien modifié la situation faite dans l’ensemble au salarié. Gide déclare :
« C’est un fait bien digne de remarque, quoique rarement signalé, que ni les textes du droit romain, ni même les articles du Code civil français, n’ont fait figurer le travail au nombre des divers modes d’acquisition de la propriété qu’ils énumèrent. On le comprend, à la rigueur, pour le passé, parce que, dans l’Antiquité, le travail était presque toujours servile... Mais, aujourd’hui, le travail à lui seul ne constitue jamais un titre juridique d’acquisition de la propriété : la caractéristique du contrat de travail, c’est que le travailleur salarié n’a aucun droit à exercer sur le produit de son travail. »
Comme l’esclave antique, l’ouvrier moderne n’est qu’un exécutant qui se borne à recevoir des ordres et des instructions.
La propriété, que le droit romain définissait jus utendi et abutendi, « le droit d’user et d’abuser », n’a pas perdu son caractère de droit illimité, n’ayant besoin d’aucune justification. D’après notre Code civil, elle demeure « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue ». Et le professeur Baudry-Lacantinerie, résumant l’opinion générale des jurisconsultes, donne ce commentaire du texte légal :
« D’une manière absolue, cela signifie que, pour déterminer l’étendue des pouvoirs que le propriétaire a sur sa chose, la loi ne procède pas par voie d’énumération, comme elle le fait pour les autres droits réels. Le propriétaire a, de droit, plein pouvoir sur sa chose. De celle-ci, il peut retirer, par des actes quelconques, matériels ou juridiques, tous les avantages qu’elle est susceptible de lui procurer, sans que personne, en principe, puisse lui demander compte de ses actes. Il jouit de sa chose comme il veut : même, si cela lui plaît, d’une manière abusive. »
Ainsi conçue, la propriété devient, très normalement, la base du patronat de droit divin que reconnaissent et protègent nos lois. Parce qu’ils possèdent une certaine quantité de richesses, des parasites peuvent accroître indéfiniment la somme des biens qu’ils détiennent, sans effort personnel. Mais celui qui ne possède rien arrive très difficilement à posséder quelque chose, malgré une vie de labeur continuel et de privations.
La libre concurrence n’est qu’un leurre. Pour s’exercer normalement, elle requiert, en effet, l’égalité dans les conditions extérieures de la lutte, de même que l’absence d’obstacles capables d’empêcher les individus d’occuper une fonction en rapport avec leurs facultés. Or, la situation sociale des parents et la transmission héréditaire des richesses suffisent déjà à rendre extrêmement inégales les conditions dans lesquelles s’engage le combat. Par les avantages qu’il assure, avant tout travail personnel, à des gens qui en sont fréquemment indignes, l’héritage fausse le libre jeu de la concurrence. En pratique, cette dernière a fait place à des monopoles ; une élimination progressive des petits s’est réalisée au profit des gros ; des entreprises géantes absorbent de plus en plus les moyennes entreprises. Et les grands producteurs, si hostiles aux syndicats ouvriers, s’unissent dans le plan national et dans le plan international. Trusts, cartels, ententes de toutes sortes permettent une exploitation plus fructueuse de l’ouvrier et du consommateur.
En France, nul n’ignore la monstrueuse puissance du Comité des Forges et les bénéfices scandaleux qu’il réalise aux dépens de la collectivité ; allié à d’autres trusts importants, il commande aux ministres et aux parlementaires. Les sociétés qui ont accaparé le pétrole inspirent la politique internationale, dictent les réponses des divers gouvernements. Nous pourrions multiplier les exemples et montrer que les magnats de la finance et de l’industrie sont au-dessus des lois que les autorités imposent, sans douceur, aux mortels ordinaires.
F. Delaisi écrit : « Lorsque le groupe Standard Oil et le groupe Dutsch Shell se disputaient les gisements de pétrole du Mexique, si le gouvernement de ce pays prenait des mesures favorables à l’un des deux rivaux, une « révolution » éclatait aussitôt et les deux armées marchaient régulièrement sur Tampico, région des puits de naphte. Invariablement, l’une était toujours fournie de canons, de mitrailleuses, voire d’avions de marque américaine, l’autre d’armes de fabrication anglaise. C’est ainsi que le Mexique fut, pendant vingt ans, en proie à la guerre civile. Il n’a retrouvé la tranquillité que depuis que les deux groupes ont constaté qu’on produisait trop de pétrole brut, et se sont entendus pour empêcher l’exploitation de nouveaux gisements désormais inutiles. La Chine nous offre, en plus grand, un spectacle analogue. Depuis vingt ans, cet immense pays est la proie d’une douzaine de toutous, véritables entrepreneurs de guerre qui lèvent des armées de mercenaires. Ces armées sont équipées à l’européenne ; et si l’on veut connaître la provenance de leurs armements, il suffit de suivre dans les journaux les visites de leurs officiers au Creusot, à Saint-Étienne, chez Krupp ou chez Vickers. Les grandes firmes d’armement leur procurent en abondance canons, mitrailleuses et munitions, et sont payées sur le produit du pillage des provinces. Chaque général a ainsi ses commanditaires dont on pourrait trouver les noms dans les banques de Hong-Kong, de Paris, de Londres, de New-York, de Yokohama, ou même de Moscou. De simples déplacements de capitaux déterminent la fusion ou la scission des armées, selon que les commanditaires changent de généraux, ou les généraux de commanditaires. »
Schneider, la société Hotchkiss et beaucoup d’autres ont vu croître leurs bénéfices grâce à la guerre sino-japonaise. Et l’on sait que, pour les industriels et les banquiers, les années qui vont de 1914 à 1918 furent une époque bénie entre toutes.
Traités, pactes internationaux, engagements solennels, rien ne compte lorsque l’intérêt des groupements capitalistes est en jeu. Chez nous, le Comité des Forges finançait, avant guerre, les associations patriotiques et les journaux bellicistes ; Krupp, en Allemagne, faisait de même. Or, ils s’entendaient parfaitement, afin de mieux rançonner les deux pays et, en cas de guerre, de prolonger le plus possible les hostilités. Barthe a déclaré à la tribune du Palais-Bourbon :
« J’ai ici le contrat qui a été signé avec Krupp, quelques années avant la guerre, et qui fait bénéficier le grand constructeur de canons d’une réduction de 40 marks par tonne. Ce qu’il y a de grave, c’est que lorsque l’industrie française a traité avec le constructeur de canons allemand, elle savait qu’elle traitait pour la production de guerre. Je dirais plus : elle savait qu’elle fournissait à Krupp un stock pour la guerre qui allait venir. Mieux encore : elle savait que la guerre éclaterait vers 1914. »
Le ferro-silicium étant nécessaire à l’industrie de guerre allemande qui en manquait, le Comité des Forges en mettait un stock à la porte de l’usine Krupp, pour qu’elle l’ait immédiatement à sa disposition, en cas de mobilisation. De plus, le même Barthe a déclaré, sans qu’on le démente :
« J’affirme que certains adhérents du Comité des Forges ont fourni, pendant la guerre, des matières premières à l’Allemagne et que, pour étouffer cette affaire, le Comité des Forges a gêné les investigations de la justice. »
Les industriels allemands n’hésitaient pas davantage à fournir aux Alliés les produits dont ces derniers manquaient et qu’ils avaient en abondance.
Le sang coulait à flots ; cela n’importait pas, puisque, des deux côtés de la frontière, les magnats du capitalisme étaient satisfaits.
Aucun crime n’arrête l’oligarchie financière qui, présentement, gouverne notre globe. Pour mieux tromper l’opinion, elle sait d’ailleurs revêtir des formes diverses. Voyez les assurances : en observant combien sont nombreuses les compagnies, il semblerait que là, du moins, règne la libre concurrence. Pourtant, dans ce domaine aussi, comme dans bien d’autres, un monopole de fait existe pour le plus grand profit d’une bande d’aigrefins. Sans doute, aucune pénétration ne se constate entre les compagnies, lorsqu’on les examine chacune séparément, à l’exception, bien entendu, de celles qui arborent une raison sociale unique pour chaque branche d’assurance. En apparence, les conseils des différentes raisons sociales sont distincts et sans lien ; la diversité des administrateurs persuade que chaque groupe reste isolé. Mais ces administrateurs émanent d’un même centre ; ils se retrouvent dans les bureaux de la haute finance, et font adopter partout ordres et directives de cette dernière. Pour la façade, les groupes ont l’air de se concurrencer ; en réalité, une poignée d’hommes, qui s’entendent au préalable, loin des regards indiscrets, exerce sur l’ensemble un pouvoir absolu. Et les bénéfices qu’ils réalisent annuellement atteignent des milliards. Ajoutons que les mêmes noms se retrouvent dans les conseils d’administration des compagnies de chemin de fer, des grandes banques, des grandes sociétés industrielles. Toutes les branches importantes de l’activité économique ont ainsi à leur tête les représentants d’une oligarchie financière, qui organise à son profit des monopoles de fait dont l’existence reste inconnue du populaire. Détenant à la fois les services publics, les organes de distribution de crédit et les grandes entreprises de production, en outre maîtresse des journaux les plus répandus, et accordant les pots de vin avec largesse, tant aux députés qu’aux sénateurs, la haute banque dispose des pouvoirs publics et des administrations. L’État, si tyrannique, si implacable pour les pauvres et les ouvriers, n’est que le premier de ses serviteurs. Par lui, elle impose à l’ensemble ses volontés, qu’il s’agisse de contrats, de tarifs ou de procédure ; et, lorsque ses affaires périclitent, le Trésor public se charge de remplir ses caisses vidées par une mauvaise gestion. Chemins de fer, compagnies de navigation, banques en déconfiture, etc., reçoivent ainsi, périodiquement, des sommes qui se chiffrent par milliards.
Débordant le cadre national, trusts et cartels s’organisent pour l’exploitation du marché international. L’après-guerre surtout a vu se multiplier les ententes de ce genre. Rhillon déclare dans sa forte étude Le Travail-Argent :
« En présence d’un marché national saturé et d’un trésor à sec, face à des marchés extérieurs envahis par la concurrence, l’extension du système des trusts et cartels s’imposa. C’est alors qu’on voit se créer, après de laborieux pourparlers, le cartel européen de l’acier, suivi bientôt du cartel des produits chimiques, du cartel de l’aluminium, etc. Ces ententes internationales, strictement limitées à un objectif défini – le maintien des prix –, et dont le joug s’appesantit sur les États satellites et vassaux, n’impliquent pas une idée d’équilibre et de stabilité, comme on a essayé de le faire croire. Non seulement elles sont susceptibles de s’effriter sous la poussée des circonstances, mais elles laissent le champ libre à toutes les intrigues, à tous les désirs séparés d’expansion, à toutes les manifestations d’impérialisme... Les cartels internationaux ont en vue d’assurer à leurs adhérents un profit normal sur les marchés du dehors. Ce profit normal relève du monopole de fait. Il est fixé sans débat et sans contestation possible du preneur par les maîtres de l’offre. Les organismes producteurs, membres du cartel, sont taxés pour un tonnage déterminé. S’ils le dépassent, ils opèrent une ristourne à la banque du cartel ; s’ils ne l’atteignent point, ils sont susceptibles de bénéficier d’une répartition des fonds constitués par les versements et ristournes, selon des modalités convenues et acceptées. Rappelons ici que le cartel de l’acier faillit se dissoudre, après quelques mois de fonctionnement, du fait que les adhérents allemands, ayant dépassé leur quantum d’exportation, prétendirent ne pas verser les sommes énormes qui leur étaient réclamées statutairement. Il fallut bien leur accorder une majoration de tonnage et une très forte diminution de la redevance. »
Dans le domaine financier, les ententes internationales sont beaucoup plus fortes, beaucoup mieux organisées. Maîtresse du globe, la haute banque contrôle la majeure partie de la production industrielle mondiale ; un président de république, un roi paraissent peu de chose à côté d’un Morgan, d’un Finaly ; et la mort d’un Lœwenstein ou d’un Kreuger a des répercussions beaucoup plus graves que la disparition d’un souverain. Ce n’est pas, comme on le croit, dans les parlements ou les présidences du conseil que sont les potentats modernes : ils sont à Wall Street, dans la cité de Londres, à la bourse de Paris, de New-York, de Rome et des autres grandes capitales. Mais cette royauté est instable ; elle peut s’écrouler soudainement, alors que l’État dure et ne perd jamais ses griffes, même lorsqu’il les rentre et fait patte de velours. L’humble fonctionnaire, souple et mielleux devant le banquier tout-puissant, change brusquement d’attitude quand la débâcle arrive. Dégrisés, beaucoup s’aperçoivent alors que s’ils commandèrent en maîtres, c’est parce que l’État, cette puissance plus formidable que le capital, les protégea et les soutint. Gualino, qui finança les entreprises de Mussolini avant de sombrer avec Oustric, a décrit ses impressions quand on l’emprisonna :
« Bien que je fisse tous mes efforts pour réagir contre le désarroi où me jetait cet incroyable événement, j’en éprouvais une impression et une émotion indicibles. Quelques heures auparavant, je m’occupais encore de mes employés ; j’étais à cent lieues de penser que, soudain, dans la nuit, on me conduirait en prison. Ah ! Ces verrous continuellement ouverts et refermés, ce cliquetis de clefs, ces longs corridors silencieux et noirs ! On me laissa dans une pièce obscure, partagée en deux par une voûte basse et profonde ; la page blanche d’un gros registre, ouvert sous la lumière électrique, répandait dans l’ombre des reflets clairs. Deux personnes : un scribe et son aide – un détenu – occupaient la pièce ; c’est à peine si, dans l’ombre, je pouvais les entrevoir. J’attendais ; le silence de tombe, qui régnait depuis un bon moment, fut interrompu tout à coup par le détenu :
« La dernière personne que je me serais attendu à voir ici, dit-il, c’est bien vous, monsieur le Commandeur. »
On me fit répéter mes nom et prénoms comme si on les ignorait. Quand les autres formalités usuelles eurent été faites et le registre signé, je dus subir l’acte le plus humiliant de mon existence : la fouille. Pourtant, je ne manifestai pas ma révolte avec autant de vivacité qu’on aurait pu le supposer : je fus pris d’un découragement inexprimable. Je dus me déshabiller dans l’humidité de la nuit, devant un inconnu ; il fouilla minutieusement chacune de mes poches, toutes mes doublures ; il m’enleva les lacets de mes chaussures, mon faux-col, mes jarretelles, mes bretelles, mes crayons, mon papier ; il me priva de tout... Devant un geôlier qui vous tâte et vous déshabille, assisté d’un autre qui attend avec son trousseau de clefs brillantes accroché à sa ceinture, tous deux indifférents et étrangers, vous n’êtes plus un homme, mais un simple numéro, vous avez la sensation d’être une pauvre chose : une feuille à la merci du vent, une molécule humaine écrasée par le destin. »
Gualino, dont le nom rayonnait dans le monde de la finance, qui faisait faire antichambre aux plus grands personnages, s’aperçoit brusquement qu’il n’est rien devant un policier muni d’un mandat d’arrêt.
Pareil au père qui mange ses enfants, l’État, protecteur et soutien du capitalisme, sacrifie les banquiers trop impopulaires ou trop compromis, afin de sauver l’institution. Ce qu’il veut, c’est maintenir à tout prix une propriété qui n’est qu’une expropriation forcée des véritables producteurs, c’est conserver, grâce à la loi, un régime qui dépouille la masse des travailleurs au profit d’une poignée de parasites. Ne nous étonnons pas que la haute finance se montre, en période électorale, d’une largesse royale à l’égard des candidats députés ou sénateurs qui, secrètement, promettent de soutenir ses intérêts. Et elle accepte que ses larbins parlementaires se badigeonnent en rouge vermillon, qu’ils affirment des programmes révolutionnaires et crient haro sur les bourgeois, afin de mieux piper les voix des électeurs. Elle sait que, souvent, ses meilleurs chiens de garde se recrutent parmi les partisans de la IIe ou de la IIIe Internationales. En France, nul n’ignore que la caisse de l’Union des intérêts économiques, alimentée par les versements des grands consortiums industriels, commerciaux et financiers, dépense des sommes fabuleuses, à chaque renouvellement de la Chambre des députés. Après le triomphe des cartellistes, en 1924, on fit mine de vouloir poursuivre Billiet, qui s’était chargé de distribuer une part du gâteau à chacun ; mais les députés compromis n’étaient pas tous de droite ; tant de radicaux et de socialistes avaient profité de l’arrosage qu’on renonça, bien vite, à percer le mystère dont s’entourait le corrupteur, chargé de l’achat des consciences par les seigneurs de la haute banque. Aussi est-il dans la logique des choses que les lois fabriquées par les parlementaires favorisent les vols quotidiens des possédants capitalistes, mais frappent sans pitié le pauvre qui dérobe au riche de quoi ne pas mourir de faim.
Dans son admirable livre La Douleur universelle il analyse avec pénétration les causes de l’injuste souffrance des pauvres, Sébastien Faure l’a dit : « Étrange filiation de toutes choses en ce monde : le vol d’en haut enfante le vol d’en bas ; la richesse des uns fatalise la mendicité des autres. Ne faut-il pas qu’il y ait des mains pleines de louis pour qu’il y en ait d’autres implorant un sou ? Les premières s’ouvrent pour donner, les autres se tendent pour recevoir. Pourra-t-il au moins voler et mendier en paix, ce paria ? Non ! La loi qui, consacrant et sanctionnant l’organisation sociale, fait infailliblement des vagabonds, des mendiants et des voleurs, la loi dispose de gendarmes et de policiers pour arrêter ces hommes dangereux, de magistrats qui les condamnent, de prisons qui les enferment. Et quand, une fois, une seule, la dure main des premiers s’est abattue sur le collet du délinquant, quand une seule fois, la voix blanche du président a prononcé l’arrêt de condamnation ; quand une seule fois, les portes de la prison se sont fermées sur ce criminel, tout retour en arrière lui est interdit, tout relèvement rendu impossible. Les Jésus modernes ne ressuscitent pas les Lazare de la pauvreté, pas plus qu’ils ne réhabilitent les Magdeleine de la prostitution. »
On a tenté, il est vrai, de légitimer le régime actuel en considérant la propriété comme une extension normale de la personnalité humaine, en la ramenant au droit qu’a chacun de disposer du fruit de son travail. Mais, nous l’avons déjà dit, le travail n’est même pas énuméré parmi les moyens d’acquisition de la propriété, soit par les lois anciennes, soit par les codes modernes ; et un examen des rapports actuels entre la propriété et le travail démontre, sans contestation possible, que la formation du capital s’opère non en vertu de l’épargne, mais grâce à la plus-value que l’entrepreneur perçoit sur le labeur de ses ouvriers ou à l’intérêt que le rentier prélève, sans faire œuvre de ses dix doigts. Un accroissement accidentel des valeurs détenues aboutit à l’enrichissement de qui les possède ; le mythe de l’épargne productive doit être chassé définitivement. Gide l’a reconnu :
« Qu’y a-t-il de commun entre ces deux actes : travailler qui est agir, épargner qui est s’abstenir ? On ne conçoit pas comment un acte purement négatif, une simple abstention, pourrait produire n’importe quoi. Le raisonnement qui fait de l’épargne la cause originaire de la formation des capitaux revient à dire, en somme, que la non destruction doit être classée parmi les causes de la production, ce qui paraît une logique bizarre... Celui qui met des pièces de monnaie dans un tiroir ne crée assurément ni richesse ni capitaux ; il retire, au contraire, une certaine richesse de la circulation. »
Le travail joue, seul, un rôle actif dans la production des divers biens ; la nature se borne à obéir aux sollicitations de l’homme, à se laisser faire, après de longues résistances parfois. Simple instrument de production, et résultat lui-même d’une production antérieure, le capital ne vaut que par le travail de celui qui l’utilise. Dans un régime équitable, chaque individu devrait donc garder pour lui l’intégral produit de son labeur, déduction faite de ce qu’il abandonnerait pour le maintien en bon état, ou le remplacement des instruments de production s’il s’agit d’une entreprise collective. Mais, dans l’usine contemporaine, il faut servir un intérêt au capitaliste, un loyer au propriétaire foncier, des profits à l’entrepreneur ; cette triple redevance pouvant être due à un même personnage, ou à des personnages distincts, selon les cas.
Le salarié – employé ou ouvrier –, qui peine pour enrichir les privilégiés, doit se contenter d’une maigre rétribution, prix de son travail considéré comme une marchandise soumise à la dure loi de l’offre et de la demande. Et, comme le chef d’industrie songe à diminuer autant que possible le prix de la main-d’œuvre, afin d’accroître ses profits et, quand la concurrence existe, de vendre moins cher, le salaire de l’ouvrier tend vers un strict minimum lui permettant tout juste de vivre, lui et sa famille. C’est la loi d’airain, dont Ricardo et Lassalle ont parlé avant Marx. On l’oublie maintenant parce qu’elle comporte d’assez nombreuses exceptions, parce qu’on s’est rendu compte que le minimum requis pour vivre dépendait des conditions générales d’existence du temps et du pays, parce que les travailleurs, ayant pris une conscience plus claire de leurs droits, ont réclamé davantage. Elle reste néanmoins exacte partout où la population est dense et où le nombre des bras qui s’offrent est supérieur ou seulement égal à la demande. Comme il est difficile à de pauvres gens très nombreux de se concerter et d’attendre, beaucoup acceptent de travailler à un taux réduit, lorsque les estomacs sont affamés. Dès que le chômage reparaît, la loi d’airain joue à nouveau, au moins sous une autre forme. Elle s’atténue quand les ouvriers sont peu nombreux et deviennent valeur demandée au lieu d’être valeur offerte. Si l’ouvrier fin, l’ouvrier habile échappe partiellement à la loi de misère, c’est qu’il est toujours marchandise rare. L’extrême division du travail et la rationalisation, chère aux Américains, tendent d’ailleurs à faire disparaître ce qu’on appelle l’ouvrier qualifié, car elles ramènent à des gestes purement mécaniques et indéfiniment répétés le labeur de tout ouvrier. Justement, parce qu’elles permettent de produire davantage avec un personnel moins nombreux, et parce qu’elles réduisent le travailleur au rôle de manœuvre, les puissantes machines de l’industrie moderne aggravent la condition des prolétaires ; les inventions scientifiques, qui devraient contribuer au bonheur de tous, ne servent qu’à multiplier les profits de quelques-uns. Comme l’écrit Sébastien Faure :
« Toute machine nouvelle ou tout perfectionnement apporté à un outillage existant déjà peut contribuer à accroître la force d’enrichissement du possédant, mais ne diminue pas la pauvreté du non possédant. Que dis-je ? Toute amélioration mécanique ajoute à celle-ci parce que, d’une part, elle intensifie la puissance de production de la classe ouvrière et que, d’autre part, elle diminue sa puissance de consommation. »
Ajoutons que les producteurs autonomes deviennent de plus en plus rares : petits artisans, petits boutiquiers se muent en ouvriers, commis, etc., travaillant pour le compte de sociétés anonymes ou de capitalistes milliardaires. Dans le commerce et l’industrie, les moins favorisés ont disparu, alors que d’autres ont vu leurs richesses croître démesurément. L’objet livré sur le marché par l’entrepreneur vaut plus que le salaire payé à celui qui l’a fait ; or, la différence, souvent très grande, entre le prix de vente et le prix de revient constitue le bénéfice du patron. Bénéfice d’autant plus considérable que l’entreprise sera plus importante. De plus, le capital exige une part de la production, l’intérêt, sans aucun travail de son possesseur ; la rente deviendra énorme si le capital est très élevé.
Selon la parole de l’Évangile, à celui qui a peu on ôte encore le peu qu’il a ; mais la richesse attire la richesse.
Ceux qui, par la rente foncière, s’étaient déjà rendus maîtres de la plupart des matières premières ont pu devenir possesseurs de tous les instruments de travail et de tous les moyens d’exploitation. L’économie capitaliste n’a pas encore fait disparaître la petite bourgeoisie, comme le croyait Karl Marx ; par contre, elle a conduit à une concentration toujours plus accentuée des entreprises industrielles, commerciales, financières. Elle a divisé les hommes en deux catégories : ceux qui vivent, totalement ou partiellement, du produit du travail des autres et ceux qui vivent exclusivement du produit de leur propre travail. Sans doute, il y a de grandes inégalités dans chacune de ces classes ; pourtant, comme le remarque Pierre Besnard dans son beau livre Les syndicats ouvriers et la Révolution sociale, cette distinction n’est nullement arbitraire. Il écrit :
« Pour moi, il n’y a pas l’ombre d’un doute ; l’ouvrier de l’industrie ou de la terre, l’artisan de la ville ou des champs – qu’il travaille ou non avec sa famille –, l’employé, le fonctionnaire, le contremaître, le technicien, le professeur, le savant, l’écrivain, l’artiste, qui vivent exclusivement du produit de leur travail, appartiennent à la même classe : le prolétariat. La rétribution inégale de leur effort, le caractère différent de leurs occupations ; la considération qui leur est accordée par leurs employeurs dans certains cas, celle qui découle parfois de leurs fonctions mêmes ; l’autorité qui leur est quelquefois déléguée et qu’ils exercent sans contrôle, l’abus qu’ils peuvent faire de cette dernière ; l’incompréhension totale de leur rôle exact, leur prétention de se situer hors des cadres de leur classe et de s’agréger à la classe adverse ne peuvent rien changer à leur situation sociale. Salariés ou non, ils vivent du produit de leur travail. Ils reçoivent d’un patron, d’un tiers, de l’État la rémunération de leur effort. Ils sont, restent et demeurent des prolétaires. Toutes les subtilités, tous les artifices de langage seront impuissants à changer quoi que ce soit à cet état de choses ; et, qu’ils le veuillent ou non, tous ces travailleurs sont appelés à s’unir, parce qu’ils ont des intérêts identiques. Leur association formera la synthèse de classe prolétarienne dans un avenir très prochain. De même qu’un industriel emploie dix ouvriers ou dix mille ; qu’un commerçant utilise quatre employés ou quatre cents ; qu’un financier brasse et fasse fructifier dix millions ou dix milliards ; qu’un propriétaire possède deux maisons ou vingt : tous ces individus appartiennent à la classe capitaliste. Les uns et les autres ne vivent pas exclusivement du produit de leur travail ; ils prélèvent, sur le produit du travail d’autrui, une part de la rétribution de celui-ci ; ils frustrent quelqu’un d’une partie de son effort pour s’enrichir ou pour vivre. Il y a opposition complète entre le frustreur et le frustré. »
Volé par son patron en tant que producteur, le prolétaire est victime, en tant que consommateur, des commerçants, petits, moyens et gros. Certes, le détaillant, lui aussi, est souvent victime d’une concurrence impitoyable ; pour tenir malgré ses rivaux, il doit observer avec soin, prévoir, calculer. Mais cette concurrence, qui occasionne un gaspillage énorme d’énergie, il conviendrait de la faire disparaître ; il ne faudrait pas non plus que quatre ou cinq intermédiaires inutiles séparent le producteur du consommateur, provoquant par leur multiplicité une élévation considérable des prix. Aussi, quel révoltant spectacle nous offre le monde capitaliste contemporain ! En haut, des oisifs, gavés de tous les biens, vivent dans des palais splendides, entourés d’un luxe insolent ; sur leur table ne paraissent que les mets les plus recherchés, les boissons les plus exquises ; le salaire annuel de plusieurs familles ouvrières ne suffirait pas à payer leurs habits (sans parler des bijoux de madame qui pourraient assurer le bien-être à des centaines de déshérités). Un nombreux personnel épie les désirs de ces demi-dieux ; leurs autos somptueuses disent à tous qu’il ne s’agit point de mortels ordinaires ; les autorités s’inclinent très bas devant ces personnages à qui leurs bank-notes procurent, sans effort, titres, décorations, mandats parlementaires. Même au cimetière, ils entendent se distinguer du vulgum pecus par la majesté de leurs tombeaux. Ils peuvent encore affecter des allures charitables, pour qu’une presse asservie vante partout leur générosité. Ainsi, Mme Schneider, la femme de l’usinier du Creusot, distribue aux œuvres cléricales quelques-uns des innombrables billets que valent à son mari les guerres qui désolent le globe. Une telle bienfaitrice et son digne époux auront une place de choix, au Paradis, pour avoir gratifié moines et curés de largesses royales. En bas, des prolétaires qu’un labeur de forçat nourrit maigrement, qui logent dans des taudis et que le chômage, la vieillesse et la maladie suffisent à plonger dans un extrême dénuement. Pour prix de la croûte quotidienne qu’il leur jette avec dédain, le patron s’efforcera d’asservir leur esprit, tout en épuisant leur corps ! Et le prêtre, son sinistre auxiliaire, ne parlera aux ouvriers que de résignation !
À ces parias, la société réserve menaces et punitions ; leurs habits usagés les désignent à la malveillance des gendarmes et des policiers ; pour d’insignifiantes vétilles on les conduit en prison. Ceux dont ils entretiennent le luxe, dont ils remplissent les coffres-forts, n’hésitent pas, quand ils le peuvent, à les priver du nécessaire. N’ont-ils pas récemment détruit d’immenses stocks de blé, de café, etc., plutôt que de consentir une baisse de prix favorable aux indigents ? Au sens littéral, ces derniers sont des damnés pour qui n’existent ni répit, ni miséricorde. Comme le dit si éloquemment Sébastien Faure, ils « naissent, grandissent, vivent et meurent sans autre horizon que la pauvreté, sans autre perspective qu’une mort prématurée ou une vieillesse indigente. Ils ne connaissent rien des contentements de l’esprit, des satisfactions du cerveau ; leur passé s’appelle déception, leur présent douleur, leur avenir désespérance. » Un régime qui aboutit à de pareilles conséquences, qui dépouille le travailleur au profit des fainéants, qui gaspille inutilement l’énergie humaine, qui assure la domination des grands bandits de la finance, est condamnable, manifestement.
Le libéralisme économique, qui compta de nombreux partisans au cours du xixe siècle, et dont les doctrines inspirèrent les législateurs en pays capitalistes, prétend qu’il est impossible et dangereux de vouloir modifier la situation actuelle. Il faut se résigner à voir éternellement des pauvres et des riches, des exploiteurs et des exploités ; c’est une erreur de tenir compte des aspirations de la conscience humaine vers plus de justice. Malgré son nom, un tel système s’avère hostile à la liberté véritable ; il vise uniquement à maintenir les privilèges des détenteurs de la richesse. Oubliant que le régime de la propriété a déjà subi de multiples transformations et qu’il est soumis à un devenir inéluctable, de même que les autres institutions sociales, il érige en principes universels et immuables les règles admises pendant une période limitée de l’évolution. Sa doctrine peut se réduire à trois points : 1° des lois fatales régissent les groupements humains ; ne les ayant pas faites, nous ne pouvons les modifier ; et si nous le pouvions, nous aurions tort d’y toucher, car elles sont bonnes ; 2° expression des rapports qui s’établissent spontanément entre les hommes, elles apparaissent dès que ceux-ci, abandonnés à eux-mêmes, n’agissent plus que par intérêt ; 3° production et distribution des richesses sont gouvernées par ces lois, que le législateur respecte lorsqu’il se borne à favoriser les initiatives individuelles.
Ajoutons que les partisans du libéralisme économique sont habituellement des patriotes acharnés ; dans l’usine, à la ferme, ils veulent un patron tout-puissant, dont l’autorité sera soutenue par l’État contre les revendications de ses employés. À leur avis, entrepreneurs et capitalistes ont raison de frustrer l’ouvrier d’une notable partie du fruit de son labeur. Malgré ce qu’affirment les professeurs d’économie politique et les manuels à l’usage des étudiants, la doctrine anarchiste, qui repousse énergiquement l’exploitation de l’homme par l’homme et condamne le régime de propriété consacré par le Code, n’est pas du tout de même ordre que le libéralisme économique. La formule : « Laissez faire, laissez passer », que ce dernier adopte, n’implique nullement la disparition d’un État que l’on charge, au contraire, de maintenir les injustifiables privilèges du propriétaire ; elle réclame seulement pleine liberté pour l’entrepreneur qui veut rançonner cyniquement ses employés ou ses clients ; et, de plus, elle affirme que, dans la lutte économique, le faible n’a qu’à disparaître, le fort ayant pour lui tous les droits. Ce culte du succès, cette apologie des forces malfaisantes se placent à l’opposé de l’idéal libertaire qui réclame pour chaque individu, même le plus faible, toute la somme de bonheur que sollicitent ses désirs. Et c’est dans l’accord de tous, non dans une lutte universelle et implacable, qu’il place le ressort du progrès.
Si j’insiste, c’est que cent fois j’ai entendu confondre libéralisme et anarchie, que nulle part je n’ai trouvé une réfutation méthodique de cette fausse assimilation, et que des penseurs, qui ne sont pas sans mérite, condamnent la doctrine anarchiste en raison des effets déplorables engendrés par le libéralisme économique. Ils identifient incohérence et désaccord général avec anarchie ! Cette dernière n’existe actuellement que dans le domaine scientifique et artistique ; encore la science officielle, l’art officiel s’efforcent-ils d’instaurer des dogmes, d’imposer le joug de pontifes qui secondent les desseins des puissants du jour. La concurrence économique, les luttes féroces qu’engendre le capitalisme résultent des privilèges que l’État garantit au propriétaire, au rentier, à l’entrepreneur, des vols que la loi autorise et sanctionne en les baptisant bénéfice ou intérêt. Doctrine insoutenable, le libéralisme économique part de faux principes et d’une analyse incomplète des faits. Gide écrit :
« L’idée que l’ordre économique existant est le produit spontané de la liberté – et qu’il ne pourrait être remplacé que par un ordre fondé sur la contrainte et, par conséquent, pire – ne paraît pas exacte. Cet ordre est, pour une part au moins, le résultat soit de faits de guerre et de conquête brutale (par exemple, l’expropriation du sol de l’Angleterre et de l’Irlande par un petit nombre de landlords a pour origine historique la conquête, l’usurpation ou la confiscation), soit de lois positives édictées par certaines classes de la société, à leur profit (lois successorales, lois fiscales, etc.). »
Loin de constituer des exceptions, comme Gide semble le croire, rapines violentes ou confiscations légales sont les sources premières de toute richesse un peu considérable. Et la concurrence économique n’est pas de même ordre que la lutte pour la vie, dans le domaine biologique. La seconde assure le triomphe de l’individu le plus fort, le mieux adapté, la première favorise surtout celui qui triche et fraude.
« [Elle] n’a nullement pour effet de rétribuer les fonctions et les travaux les plus utiles, tels que ceux de l’agriculture, qui tendent à être délaissés, alors que les plus improductifs, par exemple ceux des boutiquiers des villes ou des employés de bureau, sont disputés avec acharnement et ridiculement multipliés. »
Elle néglige l’association qui constitue pourtant une force, et si grande qu’elle parvient d’ordinaire à vaincre l’individu isolé, même s’il est énergique et intelligent. Ne soyons pas surpris qu’une telle concurrence se détruise finalement elle-même en engendrant le monopole : comme elle ne réalise pas l’équilibre entre la production et la consommation, des crises fréquentes éclatent qui favorisent l’accaparement du profit total par quelques privilégiés.
Les vices du régime actuel étant incurables, de nombreux réformateurs ont proposé de le modifier. Dans un passage de sa République, Platon déclarait déjà que, dans une société idéale, tout serait commun entre les citoyens. Au xvie siècle, Thomas Morus demandait que chacun ne désire rien pour lui-même qu’il ne désire, en même temps, pour tous ses semblables ; et Campanella exposait le système communautaire dans la Cité du Soleil. Les Esseniens, les Vaudois, les anabaptistes et d’autres sectes religieuses ont prêché la communauté des biens. Rousseau, Mably, Morelly furent des présocialistes ; Babeuf est le premier des communistes modernes. Avec Saint-Simon, Fourier et leurs disciples, on arrive à ce que l’on appelle, d’une façon ironique mais injuste, le socialisme utopique ou, encore, le socialisme sentimental.
Si Karl Marx les a fait oublier, c’est qu’il prétendit rompre avec les abstractions métaphysiques pour constituer une science historique. Avant lui, Ricardo et Lassalle avaient formulé la loi d’airain ; avant lui, Proudhon, qui a malheureusement trop dispersé ses idées, avait donné la théorie de la plus-value et signalé l’antinomie qui existe actuellement entre le mode de production et le mode d’appropriation. Mais, parce qu’on le crut non un rêveur mais un savant, Karl Marx exerça une action immense. Néanmoins, constatation troublante pour celui qu’anime le véritable esprit scientifique, son système tout entier repose sur le matérialisme historique, hypothèse séduisante et qui possède une apparence de rigueur logique, mais indéfendable, car elle néglige des facteurs de premier ordre, dont l’importance fut maintes fois prédominante. Déjà, Blanqui estimait qu’entre l’histoire et l’économie politique il existe des rapports si étroits qu’on ne peut les étudier l’une sans l’autre. Pour Proudhon, les sociétés se meuvent sous l’action des lois économiques, et le progrès social se mesure au développement de l’industrie et à la perfection des instruments. Karl Marx va plus loin et déclare que l’ordre politique et social dépend entièrement de l’ordre industriel, que la condition juridique de l’individu se définit par la place qu’il occupe dans le trafic, que la conscience est un simple reflet provoqué par l’action préalable du milieu tant matériel que social. En conséquence, les luttes économiques, la lutte des classes expliquent l’histoire, aussi haut que l’on remonte dans l’Antiquité.
« Toute l’histoire de la société humaine jusqu’à ce jour, déclare Marx, est l’histoire de la lutte des classes. Homme libre et esclave, patricien et plébéien, baron et serf, maître artisan et compagnon, en un mot oppresseurs et opprimés, dressés les uns contre les autres dans un conflit incessant, ont mené une lutte sans répit, une lutte tantôt masquée, tantôt ouverte ; une lutte qui, chaque fois, s’est activée soit par un bouleversement révolutionnaire de la société tout entière, soit par la destruction des deux classes en conflit. »
Marx oublie que les croyances, les sentiments, les besoins moraux, d’autres facteurs encore d’ordre intellectuel ou individuel, sont de puissants moteurs de l’activité humaine.
L’auteur du Capital a beaucoup insisté, par ailleurs, sur le phénomène si curieux de la concentration capitaliste. Successivement, les petites, puis les moyennes entreprises doivent disparaitre pour ne laisser place qu’à la grande industrie ; et, par une fatalité inéluctable, les classes moyennes iront rejoindre le prolétariat. Une infime minorité de possédants finira par détenir entre ses mains l’ensemble du capital et des instruments de production, tandis que les masses ouvrières, par une baisse progressive du salaire réel, subiront des conditions économiques de plus en plus dures. Mais cette réduction du nombre des possédants aboutira à la ruine du régime actuel, car les travailleurs, ayant acquis une conscience de classe, s’empareront, pour le compte de la collectivité, des richesses détenues par une poignée de potentats. Si Marx écrit, ce n’est point pour « abolir par des décrets les phases du développement naturel de la société moderne ; mais, pour abréger la période de la gestation et pour adoucir les maux de l’enfantement. »
En indiquant le processus nécessaire qui, parti du travail infiniment morcelé et parcellaire, doit aboutir au travail de plus en plus collectif, finalement concentré entre les mains de l’État, il se borne à « lire l’avenir prochain dans le présent bien compris ». Ce n’est pas parce qu’il est conforme à la justice et répond aux meilleures aspirations humaines que le communisme se réalisera, c’est « parce qu’il est dans l’enchaînement des faits historiques qu’il se fasse ». Il serait inutile de vouloir s’opposer à son avènement, car l’homme subit l’histoire ; mais en la comprenant et en y acquiesçant, il la rend moins pénible et la hâte un peu.
Beaucoup estiment que les faits n’ont pas confirmé les prévisions de Karl Marx. Ernestan déclare dans une étude très instructive, Le Socialisme contre l’Autorité :
« Il est inexact qu’en se développant, le capitalisme se soit centralisé. Sans doute, par l’entremise de cartels, groupes financiers, etc., le capitalisme tend à une organisation plus rationnelle, mais le capital se décentralise et devient de plus en plus anonyme par la constitution en sociétés par actions des moyennes et grandes entreprises. À ce propos, remarquons que, dans ses théories sur les mouvements du capital, Marx n’a pas suffisamment tenu compte (cela était peu développé à son époque) de la spéculation et du jeu effréné que permettent le système boursier et les pratiques modernes du crédit, procédés qui entrent pour une part immense dans le mouvement des fortunes d’aujourd’hui, et dont les règles déroutent les économistes les plus savants. Il est inexact que les classes dites moyennes aient disparu ou soient en voie de disparition par le développement de l’économie capitaliste. Les petits commerçants, boutiquiers, artisans, paysans (propriétaires, fermiers, métayers), employés, fonctionnaires, représentants de professions libérales, artistes, techniciens, etc., constituent, dans nombre de pays, une masse numériquement supérieure au prolétariat compris dans le sens « ouvrier ». Ce dernier terme lui-même devient singulièrement élastique et la conception simpliste de la « lutte de classe » peut amener à des anomalies bizarres. C’est ainsi que l’ouvrier chinois est le frère de classe de l’ouvrier américain qui gagne huit ou dix fois davantage. Par contre, le petit paysan ou boutiquier, se débattant contre la ruine, serait « l’ennemi de classe » du maître d’école ou du chef de gare, dont la situation matérielle est bien souvent meilleure. Le propre du capitalisme fut précisément de multiplier, plus qu’aucun autre régime, les catégories économiques et sociales. Il est inexact que le capitalisme doive nécessairement abaisser le salaire. Il peut aussi faire le contraire, et il le fit. Les rigides prédictions marxistes s’appliquent le plus souvent à faux sur le capitalisme, parce que ce dernier est doué de la plus grande souplesse. C’est précisément cette qualité qui rend ce régime le plus résistant et le plus difficile à abattre. »
Si Karl Marx indique le processus qui doit aboutir à la disparition du régime actuel, il reste muet sur la période constructive qui suivra cette disparition. Quand cessera l’exploitation économique, l’État, soutien de la bourgeoisie capitaliste, aura perdu sa raison d’être. D’où cette déclaration du Manifeste communiste :
« Le pouvoir politique, à proprement parler, est le pouvoir organisé d’une classe pour l’oppression d’une autre. »
Et Engels écrira qu’un jour « toute la machinerie de l’État sera reléguée près de la hache de bronze et du rouet dans les musées d’antiquailles ». Mais Marx admettra qu’à titre de force destructive, l’État peut passer au service du prolétariat, avant de s’évanouir de lui-même, lorsque la puissance du capitalisme sera définitivement abattue. Simple résultante de la domination de classe, il doit fatalement disparaître avec elle.
Dans l’État, les communistes voient, théoriquement, un mal indispensable mais transitoire, destiné à prendre fin avec le capitalisme d’État. En pratique – hélas ! –, il semble que, dans la Russie soviétique, comme ailleurs, les détenteurs de l’autorité n’abandonneront leur place que si on les y contraint. Les marxistes décrétaient, en 1871, au congrès de Londres, que « l’organisation du prolétariat en parti politique était nécessaire pour assurer le triomphe de la révolution sociale » ; et, l’année suivante, ils affirmaient que « la conquête du pouvoir politique est le grand devoir du prolétariat ». Dès lors, leur principale préoccupation fut de s’emparer de l’État : sa disparition étant reportée dans un avenir dont on ne s’inquiétait pas. Engagé dans cette voie, de plus en plus oublieux de ses origines, le socialisme a sombré finalement dans l’électoralisme : il ne songe aujourd’hui qu’à obtenir de nombreux sièges dans les parlements des divers pays européens. Un réformisme doucereux lui fait complètement oublier ses anciens buts révolutionnaires ; et des compromissions de toutes sortes le déshonorent quotidiennement. Un Millerand, un Viviani, un Paul Boncour, un Vandervelde, un Mac Donald, etc. – nous ne pouvons les citer tous : ils sont trop ! –, ont montré jusqu’où les politiciens de la IIe Internationale savent aller en matière de reniement.
Les partisans de la IIIe Internationale rejettent le parlementarisme et mettent leur confiance dans la dictature du prolétariat ou, plus exactement, dans la dictature du parti communiste. Lénine, fervent marxiste, se donne, en théorie, comme un adversaire de l’État. « La lutte des masses laborieuses pour s’arracher à l’influence de la bourgeoisie en général et de la bourgeoisie impérialiste en particulier, a-t-il écrit, est impossible sans une lutte contre les préjugés opportunistes à l’égard de l’État. » Et, rappelant le passage où Engels déclare que, le communisme instauré, l’État s’endort de lui-même et meurt, il ajoute :
« L’expression « l’État se meurt » est très heureuse, car elle exprime à la fois la lenteur du processus et sa fatalité matérielle. C’est l’habitude seule qui peut produire ce phénomène et qui le produira sans aucun doute. »
D’une façon plus catégorique, il dira même :
« Sur la suppression de l’État comme but, nous sommes complètement d’accord avec les anarchistes. »
Mais ce sera pour ajouter plus loin :
« Nous sommes d’accord sur les buts, pas sur les moyens. Et nous considérons l’État prolétarien, la dictature comme une nécessité. »
Cette dictature, qu’il identifie avec les ouvriers armés, est « un pouvoir qui s’appuie directement sur la violence et n’est lié par aucune loi ». Sur les ruines de l’État capitaliste, Lénine veut établir un État prolétarien, « à titre transitoire », assure-t-il. Ces vues théoriques furent expérimentées par lui, lors de la Révolution russe. Prévoir le résultat final des transformations accomplies dans la République fédérative des soviets de Russie est encore malaisé. Nous ne nous sommes point mêlés à ses adversaires, lorsqu’on l’attaquait de toutes parts ; et pourtant des faits personnels nous ont révélé l’étroitesse d’esprit de ses dirigeants. C’est vers elle qu’allait notre sympathie, quand tous les réactionnaires du monde se liguaient pour l’étrangler. Et nous lui sommes reconnaissants des coups qu’elle a portés au pouvoir capitaliste. Mais, chez elle, l’État omnipotent réduit l’individu à n’être qu’un numéro dépourvu d’idées propres ; elle fabrique les mentalités en série ; sur son sol, la liberté ne fleurit nulle part.
Ernestan écrit :
« L’État prolétarien ne semble pas avoir suivi les prescriptions du prophète Engels. Il ne paraît pas considérer ses interventions dans les affaires sociales comme devenant « de plus en plus superflues ». Quant à s’endormir ? Il ne déclare aucune fatigue et, à moins que le prolétariat russe ne se décide à le tuer, il vivra plus longtemps que le prestige d’Engels lui-même. Tout au contraire, le pouvoir d’État bolchévique enlaça dans ses tentacules, les uns après les autres, tous les éléments de la vie économique et sociale, paralysant du même coup les facultés créatrices et les forces potentielles du prolétariat et empêchant ainsi l’éclosion des véritables élites. L’État, maître de tout, doit par le fait pourvoir à tout ; l’abus engendre l’abus : chaque décret-loi, accentuant la dictature, écarte de plus en plus de la méthode socialiste. Comme ils se rendent compte des résultats, et pour combattre les déceptions, les théoriciens patentés du gouvernement russe se retranchent derrière le régime transitoire qui doit constituer les bases d’un socialisme futur. Ils tiennent le prolétariat en haleine et se dupent peut-être eux-mêmes avec l’électrification, la collectivisation des terres, le plan quinquennal et autres mots d’ordre présentés comme des mythes. Ils oublient ou n’ont jamais su que le socialisme ne se mesure pas à la capacité industrielle, au rythme de la production ou à la puissance économique, mais, avant tout, aux rapports économiques et sociaux des individus ; au fonctionnement de la justice sociale suivant le socialisme. »
Dans Vérités et mensonges du bolchevisme, G. Michaud note, avec beaucoup de finesse, les multiples contradictions auxquelles aboutit le régime soviétique. De plus en plus, le travailleur russe se voit frustré de ses droits au profit de l’État ; l’inégalité des salaires subsiste, elle est même beaucoup plus accentuée maintenant qu’au début de la Révolution ; les cerveaux des jeunes, savamment malaxés, ne savent plus que croire en Lénine et obéir à la dictature. G. Michaut écrit :
« L’État, comme l’individu, n’échappe pas à l’instinct de conservation : il le subit et se défend par la répression et le renforcement de ses prérogatives. Alors, apparaît l’importance de cette mystification qui poursuit le dépérissement de l’État en le fortifiant, qui prétend faire périr l’État tout en ignorant la voie qui mène à son extinction. »
Dans certains domaines, en matière de famille, de mariage, d’avortement, par exemple, les communistes russes sont parvenus à d’heureux résultats en s’inspirant des idées libertaires. Leur campagne systématique de déchristianisation provoque les protestations intéressées des clergés catholique et protestant : parce qu’ils ne font point appel à la violence, comme on l’a prétendu, nous l’approuvons pour notre part. Applaudissons de même à leurs efforts contre l’analphabétisme, à leur désir de diffuser l’instruction ; mais en regrettant qu’ils asservissent les cerveaux aux dogmes marxistes. Point de progrès possible dans l’ordre intellectuel si, abdiquant l’esprit critique, on érige en règle de foi ce qu’affirment les autorités. Comme la Révolution française, la Révolution russe marque une étape dans l’histoire des transformations sociales. En persécutant les anarchistes, les Russes commettent une faute comparable à celle des révolutionnaires français exécutant Babeuf, le précurseur du communisme.
Babeuf voulait instaurer un régime préférable à celui que la bourgeoisie fit adopter en 1789, et dans les années suivantes ; l’anarchie est si manifestement supérieure au communisme étatiste qu’un Marx et un Lénine le reconnaissent théoriquement. Mais ils affirment que l’heure de l’anarchie n’est pas venue, comme les jacobins de 1797 estimaient beaucoup trop hâtives les conclusions pratiques auxquelles aboutissait Babeuf. Pourtant, le communisme s’est imposé ; l’anarchie triomphera de même, retardée seulement par le culte de l’État que les bolchévistes érigent à la hauteur d’une religion. Et c’est alors qu’une cité fraternelle sera possible, que l’ère de l’universel amour naîtra. En science, nous concevons la possibilité de recherches et de progrès indéfinis ; dans les rapports entre humains, rien n’autorise à tracer des limites infranchissables aux améliorations qui surviendront.
Le succès des doctrines marxistes provoqua l’éclosion de multiples systèmes pseudo socialistes qui, pour rendre le régime actuel plus supportable, voulaient réformer quelques-uns de ses abus. Destinés à barrer la route aux conceptions collectivistes ou libertaires, qui font trembler la bourgeoisie, ce sont, aux heures difficiles, les auxiliaires du capital. En de nombreuses circonscriptions, il est bon de se dire socialiste pour plaire aux électeurs. Et de vagues considérations sur les souffrances du peuple, sur la nécessité d’atténuer des illégalités trop choquantes, introduites dans le programme d’un candidat, suffisent pour qu’il se proclame socialiste. Ainsi naquirent les socialistes patriotes, les socialistes chrétiens, les radicaux-socialistes ; Hitler suivit cet exemple, imité dans tous les pays par les pires réactionnaires. Le démocratisme vague et mensonger d’un grand nombre de partis politiques a, de même, pour but de capter la confiance des travailleurs naïfs. On parle de sécurité économique, d’entraide et de collaboration des classes, de disparition progressive du prolétariat ; les promesses ne coûtent rien, on les multiplie, mais en reportant toujours leur réalisation à plus tard. Pratiquement, l’on se borne à des palliatifs insuffisants, tels que l’intervention de l’État dans les conflits entre patrons et ouvriers, ou la participation des seconds aux bénéfices de l’entreprise pour laquelle ils travaillent.
L’État peut fixer un minimum de salaire pour atténuer l’effet de la loi d’airain ; il peut limiter le nombre des heures de travail, servir d’arbitre quand des contestations surviennent entre employeurs et employés. Mais nous savons par expérience, et la plus élémentaire logique nous oblige à estimer que l’État, n’oubliant jamais ses origines capitalistes, favorise toujours le patron. S’il affecte parfois de défendre l’ouvrier, s’il accorde des améliorations partielles, la loi de huit heures par exemple, c’est que, redoutant une insurrection, il veut calmer le mécontentement des masses, par des concessions qui ne portent pas atteinte aux privilèges essentiels du capital. Il accepte de donner des satisfactions secondaires, afin de maintenir l’injustice fondamentale qui permet à la bourgeoisie de s’enrichir sans travailler.
Dans le but de persuader l’ouvrier qu’il est un collaborateur du patron et nullement son adversaire naturel, on parla beaucoup autrefois de le faire participer aux bénéfices réalisés par son employeur. On en parla, mais très peu de maisons mirent la chose en pratique. Comme elles exigèrent au préalable un asservissement complet de leurs salariés et prétendirent ne faire que des bénéfices insignifiants, cette invention capitaliste ne fut jamais prise au sérieux par la classe populaire.
Le coopératisme, écrit Gide :
« A le rare privilège de rallier des adhérents venus des camps les plus opposés, du vieux socialisme idéaliste français de Fourier et de Leroux, du positivisme d’Auguste Comte, du socialisme évangélique de Carlyle et de Ruskin et des laboratoires de biologie ». Il a d’ailleurs revêtu, par suite de la variété des milieux où il s’est développé, des formes très différentes. « Dès le commencement de ce siècle, Owen, en Angleterre, et Fourier, en France, avaient pensé que l’on pourrait transformer complètement l’homme et le monde par le moyen de l’association libre, et ils avaient imaginé à cet effet des mécanismes plus ou moins ingénieux, que nous ne pouvons exposer ici. Mais la seule force des choses a fait surgir spontanément dans différents pays des formes très diverses d’association ; en Angleterre des associations de consommation, en France des associations de production, en Allemagne des associations de crédit, d’autres encore qui, quoique dans des proportions plus modestes, ont déjà commencé à réaliser d’assez sérieuses transformations dans les conditions économiques actuelles et à ouvrir le champ à de plus grandes expériences. »
Charles Gide, qui se fit le théoricien et l’animateur du coopératisme, le proclame le meilleur moyen de libération pour la classe ouvrière, et de rénovation, tant économique que morale, pour la société. Sans méconnaître son efficacité réelle, ni les résultats heureux auxquels il parvient souvent, nous le croyons incapable de mettre sérieusement en danger le régime capitaliste actuel. Tel est l’avis du patronat qui, d’une façon générale, ne témoigne pas à son égard d’une grande hostilité. Il réserve sa haine aux syndicats ouvriers, redoutables adversaires qui détruiront finalement son règne, s’ils échappent à la tutelle des politiciens et reprennent une mentalité révolutionnaire. Dans les pays capitalistes, le coopératisme subit des influences regrettables et s’accommode de déviations qui diminuent singulièrement sa valeur éducative. Stephen Mac Say a très bien mis en lumière les difficultés que rencontre, présentement, l’association libre, dans sa belle étude De Fourier à Godin, où il retrace l’histoire du familistère de Guise. (Voir Familistère.) Et constatant que, si l’œuvre fondée par Godin perdure, en tant qu’affaire, elle ne compte plus dans les espérances des travailleurs, il conclut :
« Le problème social ne se résout pas par agrégations successives. C’est un problème d’ensemble qui appelle des solutions générales. Les mieux intentionnées des tentatives particulières – pareilles à ces défenseurs du prolétariat enlisés lentement dans le marais parlementaire et légaliste – s’étiolent en compromissions, voient se pervertir leurs directives dans une réincorporation progressive aux formes ambiantes qui les enserrent de toute la puissance de l’âge et du nombre et de ce faisceau d’acceptations commodes qui lie l’individu aux choses établies. »
Pour que les associations libres de producteurs donnent tous les résultats qu’on est en droit d’attendre, pour qu’elles puissent régénérer le globe, il faut que disparaissent non seulement le régime capitaliste, mais l’État, son père et son soutien. Bakounine (qui se dressa contre Karl Marx, au nom de l’opposition libertaire) le dénonçait comme la cause première de l’ensemble des iniquités sociales. Pour lui, la liberté restait inséparable de l’égalité ; et, loin de n’être qu’une résultante, un reflet de la domination de classe, l’État était le grand adversaire qu’il fallait terrasser. Ce résultat serait obtenu, moins d’une façon en quelque sorte mécanique, par suite des contradictions internes du système capitaliste, que grâce à la volonté révolutionnaire du prolétariat. Alors que Karl Marx compte sur le fatalisme des événements historiques, Bakounine attribue une importance essentielle à l’action de l’homme. Et, parce qu’il répugne à établir des dogmes en matière économique, son œuvre est beaucoup plus scientifique que celle de son adversaire. On ne le crut pas.
Aujourd’hui encore, beaucoup ne s’aperçoivent point que l’attitude anarchiste n’est autre chose que l’attitude scientifique appliquée, non plus seulement à un cercle restreint de spéculations théoriques, mais à tous les domaines, indistinctement, de la connaissance et de l’action. Bakounine fut exclu, en 1872, de la Ire Internationale qui disparut, d’ailleurs, comme on le sait. Par la suite, les idées libertaires exerceront, assez longtemps, un réelle influence sur l’extrême gauche du parti socialiste. Mais le point de vue autoritaire et le point de vue anarchiste étant diamétralement opposés, aucune conciliation n’était possible. Sébastien Faure l’a magistralement montré dans le dernier chapitre de La Douleur universelle :
« Quand des hommes se proposent le même but et que les divergences de vue n’éclatent entre eux que sur la question des voies et moyens, l’accord est parfois long et difficile à se faire, mais il reste toujours possible et, à la faveur de certaines circonstances imprévues ou cherchées, il se réalise fréquemment. Mais lorsque cette divergence de tactique provient de la différence du point de départ et du but à atteindre, l’union ne peut se produire ; car sur quelle base s’assoirait-elle ? Imaginez une troupe d’individus devant effectuer le même voyage, c’est-à-dire partant du même lieu et se proposant d’arriver au même endroit : il pourra surgir des discussions sur l’heure du départ, l’itinéraire à suivre, le moyen de transport à employer, mais il est à espérer qu’ils finiront par se mettre d’accord sur ces diverses questions et à faire route ensemble. Tandis que si vous supposez des personnes ayant à effectuer non seulement des voyages différents, c’est-à-dire n’ayant ni le même point de départ, ni le même point d’arrivée, mais encore des voyages en sens inverse – les unes se dirigeant vers le nord et les autres vers le sud –, il est de toute évidence qu’elles n’arriveront jamais à suivre la même voie. »
Or, lorsqu’il s’agit de déterminer la cause première, l’origine de tous les maux qui dérivent des institutions sociales, un désaccord brutal survient parmi ceux qui estiment qu’une transformation complète du régime actuel s’impose.
« L’élément autoritaire voit cette origine dans le principe de propriété intellectuelle ; l’élément libertaire la découvre dans le principe d’autorité. »
Pour les uns, c’est de l’organisation économique, de l’existence d’une classe pauvre et d’une classe riche que proviennent les troubles douloureux constatés dans tous les domaines. Pour les autres, l’autorité s’avère génératrice de toutes les servitudes, parce qu’elle s’oppose à la libre satisfaction de nos besoins tant physiques qu’intellectuels et moraux. Prétendre que la disparition de la propriété individuelle transformerait en paradis l’enfer social actuel démontre, d’ailleurs, une étonnante naïveté. Sébastien Faure déclare :
« Si la suppression du travail excessif, de l’excessive privation et de l’insécurité du lendemain suffit à la joie de vivre, ainsi que semblent le croire les anti-propriétaires, comment se fait-il qu’ils ne soient pas parfaitement heureux ceux qui, vivant dans l’opulence et à l’abri des coups de la fortune, peuvent ne rien refuser à leur tube digestif, à leurs sens, à leur amour du bien-être, du confortable, du luxe ? Pourtant, ces privilégiés connaissent, eux aussi, la douleur. Ils ignorent les angoisses des estomacs affamés, des membres grelottant de froid, des bras tombant de harassement, c’est vrai ; mais ils sont en proie aux affres de la jalousie, aux déceptions de l’ambition, aux inquiétudes de la conscience, aux morsures de la vanité, aux tyrannies du « qu’en dira-t-on », aux sujétions du convenu, aux obligations familiales, aux exigences mondaines ; ils se débattent au sein des écœurements, des dégoûts, des indignations, des révoltes. »
Tant que subsisteront le formidable appareil répressif de la justice et l’écrasante hiérarchie du fonctionnarisme, l’individu connaîtra les souffrances d’une contrainte dont la nature ne s’accommode point. Prisons et tribunaux socialistes ne vaudraient pas mieux que ceux d’aujourd’hui.
« Seraient-ils heureux ceux qui comparaîtraient devant ces tribunaux et seraient plus ou moins longtemps détenus dans les nouvelles bastilles ou, encore, condamnés par la magistrature socialiste aux plus durs travaux ? Les rivalités s’exerceraient-elles moins violemment qu’aujourd’hui, entraînant à leur suite leur hideux cortège de haine, de rancune, d’envie, de calomnie, de bassesse, de flatterie, lorsque le champ commercial, industriel et financier leur étant fermé, elles se livreraient bataille pour les premières places dans la hiérarchie administrative ? Aurait-il, plus que de nos jours, la possibilité de satisfaire tous ses besoins, c’est-à-dire de goûter le bonheur, l’individu dont tous les appétits seraient, comme aujourd’hui, plus qu’aujourd’hui peut-être, incessamment prévus, réglementés et mesurés ? »
Ce qui se passe, à l’heure actuelle, en Russie, ne confirme que trop les prévisions de Sébastien Faure. Encore doit-on remarquer que l’effrayante et séculaire misère du peuple, en ce pays, prédisposait l’immense majorité des habitants à faire passer les besoins matériels avant les satisfactions intellectuelles et morales. Dans les contrées où les hommes sont plus instruits, les mentalités plus ouvertes, le goût de l’indépendance plus développé, un triomphe durable du bolchévisme apparaît improbable. L’échec de la propagande communiste, dans un grand nombre de pays, trouve là sa véritable explication.
L’anarchie aura l’avenir pour elle, quand les peuples feront passer au premier plan les aspirations du cœur et du cerveau. Mais c’est une illusion de croire qu’elle réclame, pour devenir possible, une perfection dont les hommes ordinaires sont incapables. Parfois, ses partisans eux-mêmes ne paraissent pas avoir une idée nette de la situation. Ils oublient qu’une association libertaire disposant des droits de sélection et de légitime défense ne serait point désarmée, comme on le laisse croire. Certes, elle ne contraindrait personne soit à entrer dans son sein, soit à y rester, mais elle n’aurait pas à faire vivre des parasites qui voudraient prendre sans rien donner. Voyez l’animal, il doit chercher sa nourriture, s’il reste à l’état isolé ; et, s’il fait partie d’un groupe (l’abeille ou la fourmi, par exemple), il doit fournir sa part de travail à l’œuvre collective. Pas davantage, l’anarchie n’implique absence de plan, manque de prévoyance ; c’est le contraire qui est vrai, puisqu’elle requiert le triomphe complet de la raison. Si la population devient trop dense, il faudra bien qu’une entente intervienne concernant la procréation ; et des accords entre producteurs seront toujours indispensables, pour éviter un vain gaspillage d’énergie. Grâce aux belles recherches d’E. Armand, nous connaissons de nombreux milieux de vie en commun ; très peu ont prospéré ; très peu ont fait œuvre durable. N’en soyons pas surpris : sans parler des difficultés qui résultent de l’ambiance, du manque de ressources, de l’incompatibilité des caractères, une association libertaire a contre elle de ne pouvoir utiliser son droit de légitime défense.
Depuis longtemps, la société se réserve de protéger choses et personnes, interdit de recourir à des mesures compensatrices sans intervention des juges, empêche par mille entraves légales le libre jeu de la réciprocité.
Or, les règles d’action des groupements anarchistes s’accordent mal avec les articles du Code ; de plus, tribunaux et police traitent avec une dureté insigne les adversaires de l’autorité. L’État les prive de tout moyen de défense, sans leur fournir aucun avantage compensateur ; il livre les associations libertaires à la merci de leurs adversaires, et du dehors et du dedans. Sa disparition, en rendant de nouveau possible l’exercice, par les groupes et les individus, des droits naturels de légitime défense et de réciprocité, modifierait complètement la situation. Une rigoureuse sélection évite bien des ennuis ; elle s’impose, lorsqu’on redoute une immixtion occulte d’individus malveillants ou d’agents secrets de l’État. Mais elle n’est praticable que dans les associations fermées, et n’apporte pas de solution au problème de la réorganisation de la société prise dans son ensemble.
Les syndicats peuvent devenir de précieux instruments d’action, sous l’influence et l’impulsion de l’esprit libertaire. Ils se fondent sur l’intérêt et jouissent d’une certaine tolérance légale, en raison de leur caractère professionnel. « Le syndicat, remarque Pierre Besnard, est la forme type et réellement concrète de l’association libre. On peut dire, en vérité, qu’il a toujours existé. En effet, à toutes les époques de l’histoire, les hommes – comme les animaux, les végétaux et les minéraux – se sont réunis par famille, par espèce, puis par affinité, pour se défendre collectivement contre les périls naturels d’abord ; contre les animaux qui leur disputaient le droit à la vie ; contre d’autres hommes, plus tard, lorsque la force, puis la ruse, créant la propriété, le pouvoir, l’autorité, l’État, firent des hommes : des esclaves et des maîtres, des seigneurs et des serfs, des pauvres et des riches, des capitalistes et des ouvriers, des gouvernants et des gouvernés. » Devenu pleinement conscient de sa raison d’être, doté de programmes méthodiques et précis, le syndicalisme, qui contraignit les pouvoirs publics à reconnaître son existence, au moins dans une certaine limite, connut chez nous de rapides succès à la fin du XIXème siècle et au début du XXème. Il fit trembler les défenseurs du capital et de l’État. Mais l’intrusion de politiciens, dans les postes de direction, provoqua des déviations qui l’affaiblirent et arrêtèrent ses progrès. Partisans de la IIème ou de la IIIème Internationale, ou même simples radicaux-socialistes, prétendent annexer, à leur profit, les organisations syndicales. Trop souvent, ils réussissent, pour le malheur de la classe ouvrière. Néanmoins, les succès du début sont, pour nous, riches de promesses futures : ils démontrent la possibilité pratique de vastes associations libres et révèlent l’existence d’aspirations anarchistes dans les masses populaires.
Ajoutons que les divergences de vue, qui séparent anarchistes communistes et anarchistes individualistes, nous semblent conciliables dans le domaine pratique. Les seconds acceptent généralement l’association en matière de production, mais n’admettent point le communisme en matière de répartition. Or, l’État disparu, rien ne s’opposerait à l’existence d’associations construites d’après des types très différents. Communistes et individualistes pourraient coexister, s’accordant sur cette base : que nul n’a le droit de priver autrui du fruit de son labeur, mais que chacun est libre d’adopter le mode de travail et de répartition qu’il préfère.
— L. Barbedette.
PROPRIÉTÉ et LIBERTÉ
La Révolution de 1789 a proclamé le droit de tous les hommes à la liberté et à la propriété. Or, ce que nous voulons expliquer ici, c’est :
-
que liberté et propriété sont choses absolument opposées, incompatibles, exclusives l’une de l’autre ;
-
que depuis la Révolution Française, c’est-à-dire depuis cent quarante ans, les événements ont de plus en plus démontré cette opposition, cette incompatibilité, cette exclusion, malgré tous les sophismes dont on a cherché à déguiser leur décevante réalité.
Sur la liberté, la Révolution a dit : « Les hommes naissent et demeurent libres... La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ; l’exercice des droits naturels de chacun n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi... Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint de faire ce qu’elle n’ordonne pas. » (Déclaration des droits de l’homme de 1789, et Constitution de 1791)
Sur la propriété, la Révolution a dit :
« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. » (Article XVII de la Déclaration de 1789, et Constitution de 1791)
Dans la Déclaration et la Constitution de 1795, il est dit :
« La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. »
Le Code Napoléon, devenu le Code civil d’aujourd’hui, a défini ainsi la propriété, dans son article 544 :
« … le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
La Révolution de 1848, dans sa Déclaration des droits de l’homme, précédant la Constitution des 4–12 novembre, se donna pour principes « la liberté, l’égalité, la fraternité », et pour bases « la famille, le travail, la propriété, l’ordre public ».
Lorsque fut élaborée la Constitution appelée « républicaine » de 1875, il ne fut plus question des droits de l’homme, et la liberté ne figura plus que dans cette vague devise : « Liberté, Égalité, Fraternité », qu’on imprima sur les papiers officiels, comme on imprimait sur les pièces de cent sous cette autre vague devise : « Dieu protège la France ». Les droits de l’homme planaient dans les nuages de l’empyrée politique, avec le souvenir de plus en plus brumeux des « grands ancêtres de 89 », avec le libéralisme idéaliste que les réalistes à la Guizot et à la Thiers avaient proprement transformé en banditisme politique (voir Politique), et les constituants, embourgeoisés d’opportunisme, n’avaient aucun souci de les rappeler et de les confirmer dans un texte précis. La Constitution de 1875 fut muette sur les garanties de la liberté ; elle ne le fut pas, par contre, sur celles de la propriété, comme nous le verrons. Elle homologua ainsi les violations antirépublicaines de la liberté, commises depuis trois quarts de siècle, faisant siens certains abus et ouvrant la porte à tous ceux que des gouvernants sans scrupules ne se priveraient pas de commettre tout en se donnant l’air de respecter la Constitution. C’est ainsi que la IIIe République a conservé la loi du 30 juin 1838 permettant les scandaleux « internements administratifs » et qui, avec l’article 10 du Code d’instruction criminelle, a marqué le rétablissement du « bon plaisir » des gouvernants et des « lettres de cachet ». C’est ainsi qu’en faisant les « lois scélérates » de 1893, 1894, 1920, elle a encore aggravé le système antérieur d’attentats à la liberté individuelle qui violent manifestement les principes de la Déclaration des droits de l’homme, et contre lesquels l’insurrection, a dit cette Déclaration, serait « le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ».
Par contre, la IIIe République a renforcé la puissance de la propriété, de ce qu’on appelle ses « droits », au point que ceux-ci ont été de plus en plus la négation de la liberté de tous les citoyens, même du plus grand nombre des propriétaires, par l’organisation d’un état de sujétion de plus en plus ploutocratiquernent favorisé. Par la faculté d’interprétation laissée à ses commentateurs et à ses applicateurs, le Code civil a été l’instrument de cette organisation et de l’étranglement progressif de la liberté, sous la domination de plus en plus absolue de la propriété. Ses 515 premiers articles ont été employés à sceller la soumission de la personne humaine aux convenances propriétaires de la famille et de la société. Les 1 800 autres ont consacré les droits et les usurpations de la propriété, « inviolable et sacrée », contre tous les autres droits de l’homme. Dans ce château fort de la légalité, plus imprenable que les anciennes demeures féodales, le nouveau seigneur, le nouveau roi, le capitaliste, nargue l’immense foule du salariat asservie à ses profits et dont la seule liberté est de crever de faim si elle ne veut pas se soumettre aux caprices du despote. Le Code pénal et le Code du travail, sentinelles vigilantes, montent la garde pour que digèrent et dorment en paix les heureux bénéficiaires du Code civil. Si les codes ne suffisent pas, il y a les fusils, comme en 1831, à Lyon. C’est contre les ouvriers défendant leur illusoire liberté du travail que l’armée française fit le premier essai, in anima vili, des balles Lebel, à Fourmies, en 1891... Aujourd’hui, on emploie les mitrailleuses et les bombes, dans les républiques de plus en plus « démocratisées », contre ceux qui demandent du travail !... « La société a assassiné civilement l’individu à qui elle a refusé du travail », disait Fourier, il y a plus de cent ans ; elle y a ajouté l’assassinat effectif que le code appelle « homicide prémédité ».
On a fait le 89 politique – et encore ! – contre les privilèges politiques. Il reste à faire ce que M. Albert Bayet appelle le « 89 économique » (Cahiers de la Ligue des droits de l’homme, 20 novembre 1931), sans lequel le premier n’est qu’une balançoire. Ce nouveau 89 ne sera possible qu’en attaquant et en supprimant la propriété. Un des présidents de la Ligue des droits de l’homme, Ferdinand Buisson, a dit fort justement :
« L’homme n’a pas de liberté s’il n’a que la liberté politique ; il n’y a pas de liberté là où il n’est pas réalisé la première de toutes les libertés, la liberté de vivre, la liberté d’être homme... Vous avez protesté pour la liberté de l’individu. Ne protesterez-vous pas en faveur de ces individus, et ils sont légions, qu’on appelle libres et qui meurent de faim ? »
La liberté de vivre est impossible sous le régime de la propriété pour quiconque ne vit pas du travail d’autrui. Or, c’est le cas de la majorité des hommes.
Nous avons déjà vu (Liberté individuelle) la contradiction de la Déclaration des droits de l’homme, au sujet de la liberté, lorsqu’elle dit, d’une part :
« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. »
Et, d’autre part :
« Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché. »
Nous avons vu comment la deuxième proposition détruit la première en favorisant l’exploitation des travailleurs par les détenteurs des entreprises du travail et de ses instruments. Cette exploitation, organisée sous le titre fallacieux de la liberté du travail, n’est-elle pas la négation de toute liberté pour le travailleur ?
La Révolution Française promettait à tous les hommes quatre choses qui sont incluses dans la Déclaration des droits : la liberté, l’égalité, la propriété, la sûreté. Elles étaient, disait-elle, des droits naturels, imprescriptibles, inviolables, sacrés, que la Nation devait faire respecter au bénéfice de tous les hommes. Qu’était-ce à dire, sinon que la propriété individuelle devrait être transformée en propriété de tous ? Comment, sans cela, établirait-on l’égalité des hommes, et comment leur garantirait-on la liberté et la sûreté ?... On n’établit et on ne garantit rien. La suite de la Révolution fut un habile escamotage ; ses principes firent cette « blagologie » dont devrait se satisfaire le « peuple souverain ». Les anciens propriétaires des biens féodaux furent remplacés par les nouveaux propriétaires des biens nationaux. Il était d’autant plus nécessaire pour eux de garantir l’inviolabilité de la propriété qu’ils en avaient à peine payé le quart, et qu’ils devraient en faire retour à la Nation si on s’avisait de réaliser l’égalité promise à tous les citoyens. Mais c’eût été tomber dans le communisme, dans le collectivisme ; c’eût été aboutir à cette vaste conception de l’État dont s’étaient inspirés tant de penseurs de la Révolution ; c’eût été empêcher l’établissement de ce troisième État qui, pour être « Tout », comme le voulait Siéyès, devait assurer sa prédominance par la possession des biens et du pouvoir. Et c’est ce que comprirent les premiers « constituants » qui refusèrent de discuter le principe de la propriété pour « ne pas la compromettre » (sic). On avait les gendarmes et la guillotine pour faire respecter la propriété, comme l’Ancien Régime avait eu les sergents et le gibet ; cela devait suffire. La Révolution, qui prétendait s’établir sur le droit, ne s’établit ainsi que sur l’arbitraire et la force. Ce fut sa faute, ce fut son crime, et c’est pourquoi elle est aujourd’hui à refaire.
La « blagologie » politicienne triomphait déjà dans les formules qui ne disent rien, produisent encore moins, mais suffisent à bercer les vagues espoirs des volontés incertaines. Un Danton pouvait dire : « L’homme a le droit de se gouverner lui-même et de conserver le fruit de sa libre activité. » Double sophisme, en présence de la Terreur et de la misère du temps. Les Girondins affirmaient, ex cathedra, que la propriété était antérieure à toute loi ; mais ils étaient, malgré ce, si peu sûrs de sa légitimité qu’ils refusaient de la prouver, disant :
« Quiconque essaie de consacrer la propriété la compromet ; y toucher, même pour l’affermir, c’est l’ébranler... »
En fait, il s’agissait surtout d’établir et de consolider les privilèges de la nouvelle féodalité de l’argent, plus avide encore que l’ancienne, et qui se constituait avec cette propriété industrielle que Barnave saluait, mais dont l’ouvrier était exclu comme possesseur, puisqu’il était dépossédé du fruit de son travail.
Rivarol disait avec juste raison que la Révolution avait été faite par les rentiers. Il faut ajouter : et la haute bourgeoisie capitaliste, maîtresse des banques. À la veille de la Révolution, rentiers et hauts bourgeois étaient déjà les maîtres de l’État, possédant les titres d’une dette publique de quatre milliards et demi. Or, ils craignaient la banqueroute de la royauté qui ne se gênait pas, à l’occasion, pour puiser dans les caisses des banques et avait fait rendre gorge plus d’une fois, à son profit propre, bien entendu, aux gens d’affaires enrichis des dépouilles du peuple. Il fallait aux oiseaux de proie un régime qui, non seulement ne les dépouillerait pas, mais qui, encore, ferait payer au peuple, comme on le voit pratiquer aujourd’hui sur une si grande échelle, les déficits de leur gabegie. Devant une puissance économique déjà si fortement organisée, si résolue et si ferme dans ses desseins, que pouvait le verbalisme d’une Déclaration des droits de l’homme qui se combattait elle-même par ses contradictions et semait la division chez ses propres défenseurs ? Elle fut d’ailleurs rédigée par la seule bourgeoisie, cette Déclaration dont Malouet disait, dès le 3 août 1789 :
« Pourquoi transporter les hommes sur le haut d’une montagne et, de là, leur montrer tout le domaine de leurs droits, puisque nous sommes obligés ensuite de les en faire redescendre, d’assigner des limites et de les rejeter dans le monde réel où ils trouveront des bornes à chaque pas ? »
Mais ne fallait-il pas que la nouvelle parole descendît d’un nouveau Sinaï pour consacrer l’imposture ? En bas, dans la réalité où pataugeaient les pauvres dupes, la dictature de la propriété, la déchéance de la liberté et de l’égalité étaient marquées par l’établissement du cens électoral que Cazalès accompagnait de cette déclaration cynique :
« Le propriétaire est le seul citoyen ! » La petite bourgeoisie elle-même protestait. L’abbé Grégoire constatait que le cens était le retour à « l’aristocratie des riches. »
Loustalot disait que cette aristocratie était « établie sans pudeur ». Camille Desmoulins écrivait :
« Pour faire sentir toute l’absurdité de ce régime, il suffit de dire que J.-J. Rousseau, Corneille, Mably n’auraient pas été éligibles. »
On lisait dans la Commune de Paris :
« La classe malheureuse, courbée sous la loi quelle n’aura ni faite ni consentie, privée des droits de la Nation dont elle fait partie, retracera la servitude féodale et mainmortable. »
Et Marat constatait ceci :
« Qu’aurons-nous à gagner à détruire l’aristocratie des nobles, si elle est remplacée par l’aristocratie des riches ? Si nous devons gémir sous le joug de ses nouveaux parvenus, mieux valait conserver les ordres privilégiés. »
On n’en finirait pas de citer les protestations plus ou moins violentes que publièrent les journaux du temps ou qui retentirent aux tribunes. Protestations fort inutiles, d’ailleurs. Pour les paysans, non seulement la Révolution ne fit pas la loi agraire du partage des terres, mais la Convention décida que seraient punis de mort ceux qui parleraient de cette loi !... Pour les ouvriers, leur exploitation fut organisée dès le 13 juin 1791 par la loi Le Chapelier, leur interdisant de se coaliser pour cesser le travail ou faire augmenter leurs salaires. Les grèves furent assimilées au brigandage ! Ce fut la Commune de Paris à qui, depuis Ponsard, on a tant reproché son « anarchisme », qui fit voter cette loi et la fit exécuter en en exagérant encore les dispositions déjà excessives. La loi Le Chapelier fut, de plus, aggravée en l793 par la sévérité de ses peines. C’est ainsi que l’homme eut « le droit de se gouverner lui-même et de conserver le fruit de sa libre activité », comme l’avait demandé Danton !...
Le Code Napoléon renouvela la vieille loi civile de tous les siècles qui donnait au propriétaire la faculté de vivre sans travailler, en dépouillant le travailleur du produit de son travail. Bien plus : par le développement incessant de la concentration capitaliste dans des sociétés anonymes, les parasites, appelés « actionnaires », sans faire autrement œuvre de leurs dix doigts que pour découper leurs coupons, quand un agent de change ne le ferait pas pour eux, retireraient les moyens de leur oisiveté d’une propriété qu’ils n’auraient jamais vue que représentée par un papier appelé « action », et qui serait quelque part, on ne sait où, au Creusot, à Bataville, au Zoulouland !... En même temps, ce Code Napoléon confirma l’état de vassalité des travailleurs devant la propriété détentrice des instruments du travail. S’il adoucit certaines pénalités, il maintint l’interdiction des coalitions ouvrières jusqu’en 1884, quand fut votée la loi sur les syndicats. L’article 1 781 du Code civil consacra, jusqu’en 1868, la supériorité légale du maître sur le serviteur, du patron sur l’ouvrier. Jusqu’en 1932, les « gens de maison » ne seraient ni électeurs ni éligibles ! Jusqu’à la loi de 1884, les ouvriers ne feraient pas partie des conseils de prudhommes institués en 1806, et qui furent un recul sur le système corporatif de l’ancien régime qui faisait juger l’ouvrier par ses pairs. Le livret ouvrier, véritable brevet d’esclavage, scella le tout et dura jusqu’en 1890. Voilà comment la Révolution organisa la liberté et l’égalité pour ceux qui n’étaient pas propriétaires et étaient réduits à subir les conditions du salariat.
La Révolution leur garantissait-elle, tout au moins, la sûreté qu’elle leur avait également promise, en leur assurant du travail et des conditions de vie normale ?... On peut en juger par des faits comme ceux-ci, répandus dans toute la France. La durée du travail dépassait 14 heures pour beaucoup d’ouvriers. Quand les relieurs demandèrent de ne plus faire que 14 heures, ils furent traités de « fainéants » ! Les salaires dérisoires étaient encore diminués par leur paiement en assignats dont la valeur baissait chaque jour ; ils ne suffisaient pas toujours à acheter du pain moisi ! La Convention avait livré au filateur Butel 500 fillettes de moins de dix ans, prises dans les hospices. Leur patron les nourrissait à peine, sans leur payer aucun salaire ! L’industriel Rumfort réconfortait ses 115 ouvriers d’une soupe à l’eau qui est restée légendaire sous le nom de « soupe à la Rumfort ». Une assiette de « potage à la ci-devant Condé » coûtait plus cher dans les restaurants où dînaient les « incroyables » que les 115 assiettes de soupe à la Rumfort réunies ! (Ilya Ehrenbourg, La vie de Babeuf.) Dans la seule région de Saint-Quentin, 60 000 ouvriers étaient réduits à la mendicité. Comme il se produit dans la « crise » actuelle, seules les industries de guerre prospéraient ! La loi du « maximum », que la Convention avait été obligée de voter contre les mercantis rapaces, était inopérante, avec la dégringolade des assignats. On trouvera dans les Histoires du Travail, notamment dans celle de Pierre Brisson, d’autres exemples de cet état incroyable de sujétion et de misère ouvrières. La situation des travailleurs était si lamentable, tant aux champs qu’à la ville, qu’ils n’avaient le plus souvent d’autre ressource que de se faire soldats, ce qu’on voit encore aujourd’hui. C’est ainsi que se formèrent les armées de la Révolution et de l’Empire, ces armées de « volontaires » que le plutarquisme représente levés par l’enthousiasme patriotique pour la défense de « la Patrie en danger » ! Comme toujours, les prolétaires dépouillés et affamés allaient défendre la propriété des riches, se battre pour les fournisseurs de l’armée, les trafiquants de la guerre, les nouveaux engraissés qui regorgeaient de leurs dépouilles et formeraient la nouvelle aristocratie, la nouvelle féodalité, contre la Patrie elle-même qu’en 1815 ils livreraient à des « altesses », pendant que les défenseurs de cette patrie pourrissaient sur les champs de batailles.
On comprend que l’égalité avait été éliminée des notions de droit. Troullier, le jurisconsulte de l’Empire, n’en reconnut plus que trois dans son Droit civil français : la liberté, la propriété et la sûreté. Or, la propriété avait rendu la liberté et la sûreté tout aussi inopérantes que l’égalité pour le plus grand nombre des hommes appelés ironiquement « citoyens ».
Il fallut cependant justifier la mainmise de la propriété sur la liberté, expliquer leur prétendu accord, démontrer que la première n’était que le produit de la seconde. Ce fut l’œuvre fallacieuse des théoriciens bourgeois du régime de la propriété, surtout depuis que Proudhon, répétant Platon à 2 500 ans de distance, eut prouvé que « la propriété, c’est le vol » ! Proudhon fit très justement remarquer à ce sujet combien il fut, de tout temps, nécessaire de justifier le droit de propriété et comment, malgré toutes les justifications qu’on a prétendu lui apporter, sa légitimité est toujours contestée. La liberté, l’égalité, la sûreté n’ont pas besoin de ces justifications ; personne ne peut s’aviser de les discuter ; elles sont des droits naturels universellement reconnus. Mais on a toujours perdu son temps, et on le perd toujours, quand on prétend faire de la propriété un droit naturel. La rhétorique la plus subtile ne peut arriver à donner le change sur ce qu’elle est : violence et usurpation.
L’équivoque la plus habile et l’affirmation la plus effrontée sont de soutenir que la propriété est fondée sur la liberté naturelle de l’individu, d’en faire l’expression même de la liberté et de la dire antérieure et supérieure à la loi faite pour la garantir. On nie ainsi qu’elle soit le produit du mensonge et de l’arbitraire. On dit : « L’homme ne peut être libre que si son existence est assurée. Pour cela, la propriété des objets assurant son existence lui est nécessaire. Le sauvage a ainsi, tout naturellement et légitimement, la propriété de son arc ; le nomade a, non moins naturellement et légitimement, la propriété temporaire de la terre qu’il a semée. » Cela était, ou paraissait juste ; mais, de déduction en déduction, on arrivait à démontrer que, tout aussi naturellement et légitimement, un homme pouvait avoir la propriété de toute une province avec celle de ses habitants, et qu’un autre pouvait accaparer à son profit le travail de milliers d’ouvriers. M. Thiers, entre autres cyniques, adopta ce beau raisonnement pour en faire découler l’organisation du pacte social, et dit :
« Je protège votre propriété pour que vous protégiez la mienne. »
Autrement dit, je vous assure la possession de votre arc pour que vous défendiez ma province et mes capitaux !... C’est ce que disaient déjà les barons à leurs serfs en l’an 800 !
Proudhon a ainsi remarqué combien, perfidement, on confondait le pétitoire, qui est le droit, la liberté de posséder, avec le possessoire, qui est la possession effective, réelle. Les prolétaires expropriés, pillés, volés, réduits au salariat, ont pour eux le pétitoire, le droit « inviolable » et « sacré » reconnu pompeusement par la Déclaration des droits de l’homme à tous les citoyens ; mais le possessoire est pour les propriétaires, ceux qui possèdent en fait, et là, ce ne sont plus les déclarations grandiloquentes du verbiage démagogique qui valent, ce sont les lois, les tribunaux, les gendarmes qui font respecter effectivement une propriété solide, nettement déterminée et décrite sur du papier résistant aux vers. Le pétitoire, c’est l’ombre pour laquelle le naïf lâche la proie ; c’est la carotte pendue devant son nez et qu’il ne peut jamais mordre, Le possessoire, c’est la proie que le malin ne lâche pas, et c’est la faculté de se faire porter sur le dos du naïf en le faisant courir après la carotte. Il est très académique de dire aux travailleurs :
« Grâce à la Révolution, vous avez la liberté et le droit de posséder le produit légitime de votre travail, le morceau de terre, la maison, le mobilier, la rente que, péniblement, vous avez pu acquérir en économisant sur votre salaire. »
Mais encore faudrait-il que cette acquisition ne fût pas rendue impossible par la liberté et le droit du patronat de s’approprier la meilleure part du travail, et de le payer d’un salaire qui ne permettra que tout juste, à l’ouvrier, de ne pas mourir de faim, cela sous le prétexte monstrueux que le patronat est propriétaire des instruments du travail ! Autant dire que ce patronat est aussi propriétaire de l’homme appelé « libre » qu’il fait travailler, comme il est propriétaire de la machine à laquelle il l’attèle, à la façon d’un bœuf ou d’un cheval. L’ouvrier n’est-il pas son « capital humain », comme il est, pour les états-majors qui mènent les guerres, le « matériel humain » !... Mais, même si le travailleur parvient à avoir son terrain, sa maison, son mobilier, sa rente, quelle garantie a-t-il qu’ils ne lui seront pas pris, saisis par le fisc ou par l’usurier à qui il se sera livré dans un moment de détresse ? « Inviolable et sacrée », la propriété. Oui, pour ceux à qui le brigandage social permet de piller la propriété des autres et assure le possessoire ; mais non pour ceux à qui l’état social ne garantit que le pétitoire.
Le pétitoire, c’est la propriété des sots intoxiqués d’un civisme imposteur qui, parlant emphatiquement de « notre pays », « notre industrie », « nos finances », se grisent de cette fumée en mangeant leur pain sec ou qui, n’ayant même pas de pain, sont envoyés en prison s’ils osent en prendre dans une boulangerie. Le possessoire, c’est la propriété qui a un nom au cadastre et au Grand Livre de la dette publique, c’est celle du blé qui se dore au soleil de Messidor et qu’on peut impunément détruire, pendant que des millions d’êtres meurent de faim.
Voilà ce que la loi, protectrice de la propriété, rend possible contre le droit des gens.
Voilà les rapports de la liberté et de la propriété. Sont-ils différents, depuis 1789, de ce qu’ils étaient dans la Rome antique ou sous Louis XIV ? Il y avait alors, comme aujourd’hui, des miteux, des clochards, des traîne-savates qui pouvaient rêver au pétitoire pour calmer leur faim ; et il y avait aussi des esclaves qui pouvaient s’affranchir, des vilains qui devenaient princes, en acquérant un solide possessoire par d’habiles et heureuses friponneries. Et qu’on ne vienne pas nous dire, pour vanter la supériorité du nouveau régime, que les hommes vivent mieux aujourd’hui qu’ils vivaient il y a cinq mille ans, ou seulement il y a cinquante ans ! Apprenons à ne pas toujours tout mélanger dans la question sociale et à ne plus faire ainsi le jeu d’un opportunisme sans cesse à l’affût d’une nouvelle place dans le royaume de la peste capitaliste et du choléra politicien. Apprenons à sérier les sujets, à ne pas confondre l’insanité politique avec le progrès humain, la métaphysique sociale, qui demeure aussi bourbeuse qu’au temps d’Aristote, avec les inventions de la vapeur et de l’électricité qui ont transformé la vie économique dans le monde entier. Sans la Déclaration des droits de l’homme, et fussions-nous encore sous un pharaon, un Néron, un Louis XIV – qui, entre parenthèses, n’étaient pas de plus dangereux et de plus malfaisants mégalomanes que les Napoléon, les Guillaume, les Poincaré –, nous n’en aurions pas moins, aujourd’hui, le télégraphe, le téléphone, l’aviation, les sous-marins. On prétend qu’en Amérique chaque ouvrier possède son automobile. Il n’y en a pas moins six millions de chômeurs qui ont faim et contre qui marchent les mitrailleuses quand ils réclament du pain. Apprenons à ne plus bâiller aux corneilles du pétitoire pendant que les filous du possessoire nous font les poches !
Le premier des sophistes modernes qui prétendirent prouver les rapports de la liberté et de la propriété paraît être Mercier de la Rivière. Il disait que la liberté de l’homme est le résultat de la propriété qu’il a de lui-même, de ses facultés et des instruments par lesquels il les exerce. Propriétaire de ses facultés, il est en conséquence propriétaire de ce qu’elles produisent. La liberté, qui est dans la propriété de la personne, passe ainsi dans celle des choses, dans la propriété mobilière, dans la propriété foncière, et il ne peut être porté atteinte à l’une d’elles sans toucher aux autres. On voit ainsi l’habileté du processus ; il ne faut plus qu’un peu d’audace, mais abritée toutefois derrière le gendarme, pour démontrer, au nom de la liberté, que les vingt-cinq millions de francs de bénéfices hebdomadaires tirés par certains du travail de « leurs » ouvriers sont le produit légitime de leur travail !...
On feignit de ne pas s’apercevoir que la personne et les objets de la propriété sont choses différentes, qu’on ne dit pas « ma main », « mon cerveau », comme on dit « ma maison », « mon champ », et qu’on ne dit pas non plus « ma femme », « mes enfants », comme on disait jadis « mes esclaves » et comme on dit aujourd’hui « mes ouvriers ». On ne dit pas davantage « ma maison », « ma charrue » comme on dit « mes usines », « mes machines ». La liberté de l’individu et la propriété de son corps, de ses facultés, de ses sentiments, sont exclusivement personnelles, essentiellement inaliénables. Et on ne peut aliéner, pas plus que sa personne, celle des autres, de sa femme, de ses enfants ; tout au plus peut-on mutiler ou détruire la personne, transformer les sentiments qu’on a pour autrui, se soumettre au sort de l’esclave ou de l’ouvrier. Mais la propriété de la personne reste intacte, si violée et si peu sacrée qu’elle soit. La liberté de la personne est absolument incompatible avec l’aliénation. Par contre, la propriété est essentiellement aliénable : elle n’existe que parce qu’elle peut être donnée, achetée, vendue, morcelée, transformée, qu’elle est un objet de transaction. Il est incongru d’assimiler la propriété de la personne à celle d’un objet extérieur, et il est perfide d’assimiler la propriété modeste d’une maison, d’un champ, d’une charrue, produit réel du travail de l’homme laborieux, à celle orgueilleuse d’usines, de territoires, de machines, produit du travail accumulé d’une foule de travailleurs dépossédés par le parasitisme capitaliste.
Destutt de Tracy, Cousin, Bastiat, et bien entendu M. Thiers, ont été les théoriciens de plus en plus insolents de ces sophistications. Benjamin Constant avait une conception plus saine, mais qui était utopique. Il constatait que la propriété a été crée par l’état social, prétendant que cette origine civile n’affaiblissait nullement la juste idée qu’on devait avoir de sa légitimité et de son inviolabilité, mais il ajoutait que cette origine « conduit à ne pas exagérer cette idée, à ne pas accorder un caractère particulièrement sacré au droit de propriété, à ne pas faire passer ce droit avant la liberté, avant le droit des citoyens »... Le respect de la propriété devait être fondé sur le respect de la liberté, et non le respect de la liberté sur celui de la propriété. B. Constant recherchait ainsi un compromis entre deux choses que le fait social rendait absolument inconciliables. Que pouvaient devenir de tels principes dans une société où le fait de ne rien posséder entraînait le délit de vagabondage, et où le propriétaire pouvait tuer froidement, avec l’absolution de la loi, l’homme altéré qui venait boire à son puits ? La propriété civile ne peut coexister avec le respect de la liberté. Elle est une violation constante de la propriété primitive attachée à la liberté naturelle.
Les bons apôtres qui soutiennent le système ploutocratique et sont favorables, aujourd’hui, à ce qu’on appelle une « réaction néo-capitaliste », ramenant le travail aux formes les plus dures du passé, y compris le fouet sous lequel l’esclave tournait la roue et le galérien manœuvrait la rame, se basent sur la différence de qualité et de valeur de la production pour justifier l’inégalité des salaires, c’est-à-dire l’exagération des prélèvements sur le travail d’autrui. Ils disent, avec ces façons cafardes, que tant d’ouvriers connaissent des « bons patrons » qui daignent discuter avec eux et ne pas les congédier brutalement :
« Le travail d’un Newton, qui a servi et sert encore aux générations qui l’ont suivi, est incomparablement supérieur à celui de l’ouvrier qui ne sert que des besoins immédiats, passagers, et qui peut être remplacé par tout autre ouvrier. »
C’est possible, mais la question n’est pas là ; elle est dans l’usage dolosif qui est fait des inventions d’un Newton. Nous admettons fort bien qu’un Newton puisse avoir droit à un salaire supérieur à celui de l’ouvrier ; mais est-il admissible que des individus, accaparant le travail de Newton et ne faisant rien par eux-mêmes, frustrent ceux qui font valoir ce travail ? Or, on ne donne même pas aux Newton ce salaire supérieur qui devrait leur revenir ; ils sont les premiers frustrés ! Un Bernard Palissy, un Sauvage, un Tellier, des centaines d’autres, dans tous les siècles, n’ont-ils pas été dépouillés des fruits de leurs inventions ? Et ne voit-on pas, aujourd’hui même, les cas de Branly et de Forest ? Un Branly est, à l’âge de quatre-vingt-quatre ans, réduit à une quasi misère, alors que des industriels ont gagné des milliards en exploitant ses découvertes ! La veuve de Forest est, à l’âge de soixante-seize ans, abandonnée à un sort misérable, alors que les perfectionnements mécaniques trouvés par son mari ont enrichi scandaleusement des fabricants d’automobiles ! Quels droits avaient ces industriels et ces fabricants de plus que les ouvriers qu’ils employaient, au bénéfice des inventions de Branly et de Forest, sinon ceux de l’immorale propriété de leur argent qui leur avait permis de s’emparer de ces inventions, appuyée de la non moins immorale complicité de la loi et du gendarme, c’est-à-dire de l’arbitraire et de la violence organisés ?
Mais voici la plus cynique explication de la propriété capitaliste, négation de la liberté de tous. Il fallait un M. Thiers pour oser la formuler ; c’est ce qu’il a fait dans son ouvrage De la propriété. Il y a dit en substance : « La propriété est un fait et un droit pris dans celle qu’a l’homme de ses facultés naturelles. La propriété est le produit du travail, de l’emploi des facultés. C’est le travail qui crée le droit de propriété. » Cela peut encore aller. Voyons la suite : « La propriété a été le plus souvent, à l’origine, l’appropriation violente, sans travail, mais la PROPRIÉTÉ S’ÉPURE par la transmission légitime et bien ordonnée. La propriété de chacun est la mesure de la personne et, partant, conforme à la justice. Le riche, par le capital qu’il distribue, FAIT VIVRE LE PAUVRE en travaillant. Il lui fournit ses instruments de travail et ses moyens d’existence à condition qu’il travaille pour lui. LE SUPERFLU DU RICHE N’EST PAS UN VOL FAIT AU PAUVRE ; c’est au contraire un fonds de réserve et d’épargne pour lui, où il puise sans cesse. C’est une propriété qui n’appartient qu’au riche, mais DONT TOUS DEUX ONT LA JOUISSANCE, en quelque sorte... » C’est de cette façon qu’on démontre aux pharisiens qui ne demandent qu’à se laisser convaincre, et aux pauvres d’esprit pour qui le royaume des cieux a été créé, que « le riche est le protecteur du pauvre », que « sans le riche, le pauvre ne pourrait ni travailler, ni vivre », etc. ! On connaît tout ce que peuvent tirer de ces insanités les « défenseurs de l’ordre » et les cafards de la philanthropie. Mais c’est aussi de cette façon qu’on donne aux gens sensés la plus irréfutable démonstration de la proposition de Proudhon : « La propriété, c’est le vol ! », et de l’incompatibilité existant entre la liberté et la propriété. « La propriété s’épure par la transmission légitime et bien ordonnée », disait M. Thiers qui avait tant besoin « d’épurer » la sienne. C’est ainsi qu’on justifie le mot de Boileau :
« Le crime heureux fut juste et cessa d’être crime. »
C’est ainsi qu’on peut friponner sans danger en pratiquant dans le grand. Heureux le pauvre à qui il n’en coûte que sa liberté pour recevoir les miettes de ces turpitudes !...
Il est donc impossible que liberté et propriété coexistent. L’enthousiasme idéologique avait fait proclamer la liberté par la révolution ; le froid égoïsme et la basse cupidité lui ont fait consacrer l’inviolabilité de la propriété. La seconde a dévoré la première. L’homme n’a été libre, et combien bassement, immoralement, qu’en étant propriétaire, et parce que le simple citoyen ne possédant rien est demeuré esclave. C’est ainsi que :
« Toutes les constitutions qui ont été données à la France garantissaient également la liberté individuelle, et sous l’empire de ces constitutions, la liberté individuelle a été violée sans cesse. » (B. Constant)
Même sous la forme légitime de la petite propriété, produit réel du travail, cette propriété porte en elle un vice fondamental en ce qu’elle fait naître et excite chez l’individu la cupidité et l’ambition d’une appropriation toujours plus grande et, partant, plus injuste et plus malfaisante. À l’encontre de tous ceux qui craignent de « compromettre » auprès des timorés l’idée de la révolution – comme d’autres craignent de « compromettre » l’idée de propriété –, ou qui ne pensent qu’à remplacer les « propriétaires » du troisième État par ceux d’un quatrième, Gorki a eu le courage de dire, et nous devons l’avoir avec lui : « Dans tous les pays, la classe paysanne – les millions de petits propriétaires – est un terrain propice à la croissance des rapaces et des parasites ; le capitalisme dans toute son horreur a grandi sur ce terrain. » Il a grandi sur tous les terrains prolétariens, ouvriers comme paysans, sur lesquels a pu s’ériger la propriété, même la plus modeste.
L’homme doué de bon sens et de réflexion doit se rendre compte du piège et de l’immoralité de cette liberté illusoire que la société bourgeoise offre au prolétariat en lui proposant la propriété individuelle. Là encore, Gorki a vu et a parlé clair en disant :
« En attirant vers elle les paysans et les ouvriers les plus doués, en les obligeant à servir ses intérêts, la bourgeoisie exalte la « liberté » avec laquelle un homme peut parvenir à un certain bien-être personnel, à un habitat commode, à une situation confortable. Mais vous ne nierez certes pas que dans votre société, des milliers d’hommes de talent meurent sur le chemin de ce vil bien-être, incapables de surmonter les obstacles que dressent devant eux les conditions morales de l’existence bourgeoise. »
N’oublions pas ce jugement de J.-J. Rousseau, dont la confirmation est de plus en plus sanglante :
« Le premier qui ayant enclos un terrain s’avisa de dire « ceci est à moi », et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres ; que de misères et d’horreurs n’eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant la fosse, eût crié à ses semblables : « Gardez-vous d’écouter cet imposteur ; vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tout le monde et que la terre n’est à personne ! ». »
J.-J. Rousseau a dit encore :
« Le démon de la propriété infecte tout ce qu’il touche. »
La propriété a besoin, pour s’engraisser, du sang et de la misère des hommes sur qui elle règne, comme une puissance de proie. Toutes les insurrections avortées, noyées dans le sang prolétarien, toutes les lois sociales qui rivent plus étroitement les travailleurs à leurs chaînes et apportent de nouvelles privations dans leurs taudis sont rassurantes pour la propriété. Elles font monter les cours de la bourse, grossir les fortunes, s’étaler avec plus de cynisme et de cruauté la muflerie des privilégiés.
Il ne pourra pas y avoir de vie harmonieuse entre les hommes tant qu’il n’y aura pas le bien-être et la liberté pour tous. Il ne pourra pas y avoir de bien-être et de liberté pour tous tant que tout ne sera pas à tous, pour la satisfaction des besoins de tous. Il n’y aura de véritable révolution que celle qui arrachera les pieux, comblera la fosse, effacera les limites des terres, les frontières des patries, et fera un immense incendie de tous les grimoires où sont écrits les droits fallacieux et odieux de la propriété.
— Édouard Rothen.
PROPRIÉTÉ
Dans la société capitaliste actuelle, la propriété n’est le privilège que d’une petite minorité par rapport à la multitude des prolétaires.
Quelle que soit la nature de l’objet possédé : champ, maison, matériel de production, espèces, etc., son propriétaire l’a acquis soit par l’exploitation d’autrui, soit par héritage, et dans ce cas la source du bien est la même que dans le précédent.
De plus, que font de ces biens ceux qui les détiennent ? Les uns s’en servent pour se procurer, en échange, une vie de bien-être et de jouissance, pour mener une existence pleine de loisirs, pour goûter à toutes sortes de plaisirs auxquels l’argent donne seul accès. Ceux-là sont les oisifs, les parasites, qui se dispensent de tout effort personnel et ne comptent que sur celui des autres. Pour mettre en valeur leurs terres, par exemple, ou leurs fermes, ils emploient une main-d’œuvre qu’ils rétribuent insuffisamment et qui, elle, en fournissant toute la peine, ne retire aucun gain véritable, ne touche pas le salaire intégral de son travail. S’il s’agit de biens mobiliers, le capital est employé à des fins étatistes, ou à des entreprises d’exploitation capitaliste. Quiconque possède plus qu’il n’a besoin pour sa consommation, ou plus qu’il ne peut mettre en valeur lui-même, soit directement en faisant valoir ses propriétés ou en montant des entreprises industrielles, soit indirectement en confiant ses capitaux aux industriels ou à l’État, est un exploiteur du travail d’autrui.
D’autre part, il est arrivé, au cours de l’histoire, que l’étendue de certains domaines en empêchait la mise en valeur totale et rationnelle, et que, tandis qu’il se trouvait des travailleurs sans ouvrage et des familles sans logement, de vastes terrains restaient en friche, faute de bonne organisation.
C’est contre cette propriété bourgeoise reconnue par l’État, jalousement défendue par lui, que s’élèvent tous les révolutionnaires, tous ceux qui professent des idées libératrices, qui aspirent à améliorer les conditions de vie de la masse ; c’est elle qu’attaquent et veulent détruire socialistes, communistes et antiétatistes de toute nuance ; c’est elle qui, en revanche, engendre l’illégalisme, le vol instinctif et brutal chez les uns, le vol conscient et raisonné chez les autres.
Le communisme a solutionné le problème en soustrayant à l’État le capital et les moyens de production pour les remettre à la collectivité, devenue à son tour souveraine et qui répartit les produits entre chacun, selon son effort.
Mais que la propriété soit aux mains de l’État, de la collectivité ou du milieu communiste ou de quelques capitalistes, comme à l’heure actuelle, elle rend l’individu dépendant de la communauté, elle engendre le maître et l’esclave, le meneur et le mené. Maintenu dans la soumission économique, le travailleur conserve une mentalité en rapport avec les conditions de dépendance qui sont siennes. Il est, à proprement parler, l’outil, l’instrument, la machine à production de son exploiteur – individu ou milieu –, il peut difficilement, dans de telles conditions, être un individu pleinement développé, dans toutes ses facultés, et conscient.
Venons-en au point de vue de l’individualisme anarchiste soucieux, avant tout, de l’entière libération individuelle, de l’épanouissement de chacun, sans entrave, de la libre expansion de l’unité humaine. L’individualisme anarchiste envisage la question sous un autre jour et apporte une solution qui n’entend pas que l’individu soit ainsi sacrifié et assimilé à un rouage. Il revendique, avant tout, pour tout travailleur, la possession inaliénable de son moyen de production, de quelque nature qu’il soit, outils ou terre arable, ou instruments de labour, ou livres, ou moyens d’expression de la pensée.
Ce moyen de production peut appartenir à l’association aussi bien qu’à l’isolé ; celà dépend des conventions faites.
L’essentiel est que l’outil, de quelque genre qu’il soit, soit la propriété du ou des producteurs et non de l’État ou des grandes firmes, ou du milieu où les circonstances ont fait naître l’individu.
De plus, il importe que le travailleur dispose librement, selon son gré et ses nécessités, du produit de son travail, de son œuvre. Qu’il n’ait à subir aucune intervention étrangère dans l’usage qu’il entend faire de celui-ci. L’individu ou l’association doit pouvoir, sans avoir à tenir compte de qui que ce soit d’autre, consommer lui-même sa production, ou l’échanger à titre gratuit ou de réciprocité, il doit lui être encore loisible de choisir ceux avec qui il échangera ses produits et ce qu’il recevra à la place.
L’individu une fois possesseur de son outil et de son produit, le capitalisme cesse d’être.
Et de cette transformation des conditions du travail, l’individu tirera autre chose qu’une amélioration économique : il en retirera un bienfait au point de vue éthique. Au lieu d’être le salarié exploité, victime du patronat, doué en conséquence d’une mentalité « je m’en fichiste » quant à la confection du produit puisqu’il n’en jouit pas, désireux d’épargner son effort puisqu’un autre en profitera, le producteur individualiste anarchiste s’intéressera à sa besogne, cherchera à la parfaire sans cesse, à y apporter de la nouveauté, y déploiera de l’initiative. Il acquerra une fierté de l’œuvre accomplie, une saine satisfaction personnelle, un intérêt si vif à son travail qu’il lui sera une source de joie de vivre et non plus un collier de misère. Le même goût au travail, le même souci d’une exécution irréprochable, la même lutte contre la routine et le « toujours pareil » se retrouveront dans tous les métiers, dans toutes les activités possibles – ce qui, à l’heure actuelle, n’est le privilège que d’une minorité, le plus souvent de travailleurs intellectuels, artistes, savants, écrivains, tous ceux qui œuvrent sous l’impulsion d’une vocation ou d’un choix déterminés.
La propriété ainsi comprise et mise en pratique n’a plus rien de commun avec « la propriété c’est le vol » ; elle marque un degré d’évolution et semble devoir être à la base de l’émancipation totale, de l’affranchissement de toutes les autorités. Ce sera la puissance créatrice restituée à chaque individu, selon ses capacités, bien entendu.
Il est évident que des accords peuvent survenir entre les consommateurs producteurs pour que soit évitée la surproduction, qui ne s’entendrait, la spéculation ayant disparu, que du surplus de la production, une fois que celle-ci aurait couvert les nécessités du producteur, isolé ou associé, ou que, par le jeu des échanges, ces nécessités auraient été satisfaites. Spéculation et exploitation ayant disparu, on ne voit pas que l’accumulation présente plus de dangers que dans le communisme. À vrai dire, qu’il s’agisse de communisme ou d’individualisme, leur réalisation économique au point de vue pratique ne peut être séparée d’une mentalité nouvelle, d’une autoconscience rendant inutile le contrôle, sous quelque nom qu’on le désigne.
L’anarchisme, dans quelque domaine qu’on le conçoive, est fonction de l’entière absence de contrôle ou de surveillance, l’un et l’autre ramenant toujours à la pratique de l’autorité.
— E. Armand.
PROPRIÉTÉ
La propriété représente la chose possédée en propre ; mais il n’y a de chose possédée, de propriété, que par rapport à l’homme.
La propriété, ou appartenance, comprend tout corps qu’un être capable de raisonner se rend propre, s’approprie pour son usage exclusif.
Il y a plusieurs espèces de propriétés que l’on désigne sous les noms de : propriété foncière et mobilière ; propriété individuelle et collective ; propriété de droit absolu et de nécessité relative ; propriété corporelle et enfin propriété intellectuelle.
Au cours des âges et des situations sociales, l’homme, stimulé par le besoin, approprie à son usage ce qu’il estime pouvoir lui être utile, soit en le produisant lui-même, soit en le recevant du producteur en don, en prêt à loyer ou à titre vénal.
En légalisant la possession exclusive qu’elle garantit comme propriété, la société sanctionne le travail qui est censé n’avoir de rapport qu’avec un besoin rationnel et non d’abus. Il va sans dire que partout où il ya société, il y a propriété.
Pour vivre, la société, qui est la collection des individualités, légitime la propriété en l’organisant relativement aux circonstances et à l’avantage exclusif des classes dirigeantes.
Sans entrer dans des développements qui auront leur place ailleurs, nous allons brièvement nous occuper des propriétés annoncées, et tout particulièrement de la propriété foncière,
Selon la période à laquelle on l’analyse, la propriété foncière s’annonce sous un aspect plus ou moins différent quant à son organisation. À l’origine des sociétés, étant donné l’étendue de l’Univers et la faible population qui l’habitait, la propriété foncière prenait certains aspects selon les circonstances et les besoins de ceux qui se l’appropriaient. L’ordre était plus facile à obtenir que de nos jours. De modifications en modifications, la propriété foncière, à travers les âges, aboutira à la propriété individuelle de notre époque. Ces diverses modifications, apportées au droit de propriété, n’ont été possibles que par l’ignorance des peuples tenus à dessein en dehors des connaissances de l’époque. Ce qui a été relativement bien à un moment donné ne l’a pas été à un autre et ne l’est plus à notre époque. Aliénée à un ou à plusieurs, la propriété foncière a été base d’ordre despotique, comme elle sera base d’ordre rationnel lorsqu’elle sera aliénée à tous, ce qui mettra le sol à la disposition de qui voudra l’utiliser.
Ainsi, le sol, ou propriété foncière générale, se présente à l’homme sous le caractère de l’indispensabilité. Il n’en est pas de même de la propriété mobilière, qui est le résultat du travail sur ou dans le sol, et qui représente le capital, c’est-à-dire une chose utile qui aidera à la production de richesses nouvelles. Mais l’économie politique, qui est la science de la production organisée pour l’intérêt des classes possédantes et dirigeantes, confond adroitement l’utile avec le nécessaire ; et ce petit tour de passe-passe légitime l’exploitation des masses au profit des minorités régnantes et possédantes. C’est de l’escamotage social fait au nom de la légalité.
Quand la liberté est suffisante pour examiner la justice de l’opération, l’appropriation individuelle du sol est un des principaux mobiles de l’anarchie en progrès accéléré. Tenues dans l’ignorance, les masses, à qui on apprend mille choses, et qu’on évite d’instruire sur les causes de leur misère et de leur servitude, s’agitent sur des buts plus ou moins puérils, socialement parlant, et n’agissent pas pour leur véritable intérêt. Elles sont le jouet d’illusions habilement entretenues pour le profit personnel des élites et de leur état-major.
Réfléchissons que la propriété mobilière – ou capital – est toujours fonction du régime d’appropriation du sol, et que rien ne peut changer – socialement – tant que la source passive de toute richesse reste appropriée individuellement.
Pour arriver à l’ordre social réel, une partie de la propriété mobilière, et provenant des générations passées, doit entrer, avec la propriété foncière, au fonds commun de prévoyance sociale. Quant à la richesse intellectuelle, dans une société organisée dans l’intérêt de tous, elle doit être socialement distribuée et rendue accessible à chacun suivant ses aptitudes.
Partout où la propriété s’annonce comme étant la prolongation de la personnalité humaine, cette propriété représente le fondement et le respect de la liberté individuelle qui permet une égalité relative dans une atmosphère de fraternité sociale.
— Elie Soubeyran.
PROSCRIPTEUR
n. m.
Celui qui proscrit. « Tous les temps et tous les régimes ont eu des proscripteurs », indique le Dictionnaire Larousse, sans autre commentaire sur ce mot.
Nous pouvons ajouter que le proscripteur est, en effet, celui qui proscrit ; mais celui-ci, s’il n’est le tyran lui-même, en est l’instrument, le valet, l’exécuteur officiel des hautes et basses œuvres.
En régime d’autorité, c’est ainsi que s’administre la volonté de l’empereur ou du roi contre les sujets récalcitrants ou simplement mécontents, le « bon plaisir » du souverain fait loi. On ne peut s’étonner qu’il y ait des proscripteurs quand on ne s’étonne pas qu’il y ait des monarques de droit divin ou des usurpateurs audacieux se faisant proclamer, par la ruse ou par la force, les maîtres d’un peuple ou d’une nation.
D’ailleurs, ne sont-ce pas souvent les peuples qui réclament des tyrans, comme les grenouilles de la fable demandaient un roi ? Mais il arrive aussi que les peuples se débarrassent de leurs monarques. Il est évidemment plus rare de voir un peuple supprimer son tyran que de voir celui-ci se passer des moyens de tyrannie à sa disposition. Proscripteurs et bourreaux sont des hommes indispensables à tout gouvernement énergiquement arbitraire. Et les gouvernements ne le sont-ils pas tous plus ou moins ? Peut-être le règne d’un usurpateur ou d’un aventurier parvenu, d’un militaire audacieux à l’ambition duquel la fortune a souri, sont-ils portés à l’exagération de la tyrannie : César, Cromwell, Napoléon n’ont, certes, pas ignoré ce moyen de régner. Le proscripteur est le vil serviteur du maître, qui ploie l’échine pour aplanir le chemin et éviter les cahots dangereux au char du tyran.
La « Dictature du Prolétariat » elle-même ne se dispense pas, sans doute, de se servir du proscripteur, aussi nécessaire qu’odieux, pour assurer sa sécurité. Le régime autoritaire, quel qu’il soit, conduit à l’arbitraire, à l’injustice, à la violence !
Donc, en tous pays, sous régime autoritaire, ceux qui ne pensent pas conformément aux volontés des chefs d’État risquent de tomber sous les coups du proscripteur. Bien entendu, le proscripteur comme le policier s’acharnent tout particulièrement après les hommes d’idées avancées, sur les apôtres de la liberté ou de l’émancipation des individus et des peuples. Le proscripteur est toujours prêt à sévir.
PROSCRIPTION
n. f.
Au temps de l’Antiquité romaine, c’était la mise hors la loi. C’était aussi la condamnation à mort sans forme judiciaire. Ce genre de proscription n’est pas à confondre avec la proscription des biens, consistant dans le partage ou la vente des biens d’un débiteur en fuite, au profit de ses créanciers. Mais l’on peut croire qu’une mesure de proscription contre une personne entraînait aussi la proscription de ce qu’elle possédait, sinon chaque fois, du moins très souvent, surtout quand ces mesures de violences prises contre les personnes consistaient en un bannissement illégal émanant d’un gouvernement de ses adversaires politiques en période de troubles civils, ou par des autorités militaires en temps de guerre. Ce qui a fait dire à Émile de Girardin que « toutes les lois de proscription sont des lois essentiellement révolutionnaires ».
C’est du Dictionnaire Larousse que j’extrais ce qui précède ainsi que ce qui suit.
« Encycl. — Depuis l’Antiquité, on trouve bien des exemples de sanglantes proscriptions, ayant pour objet de frapper non des coupables, mais des adversaires politiques. À Athènes, la proscription frappa, vers l’an 600 avant notre ère, la puissante famille des Alcméonides. En 510, Clisthène, chef de cette famille, força Hippias à abdiquer la tyrannie, et se rendit maître d’Athènes ; mais trois ans plus tard, les Alcméonides furent de nouveau proscrits avec sept cents familles athéniennes. Vers la fin de la guerre du Péloponnèse, les trente tyrans que Lacédémone imposa à Athènes frappèrent de proscription un grand nombre de personnes. La proscription frappait les individus dans leurs biens et dans leur vie, s’ils ne se hâtaient de s’exiler ; et il n’était guère de cité hellénique qui n’eût chez elle les proscrits d’une autre ville. À Rome, on comptait deux sortes de proscription : l’une qui interdisait au proscrit le feu et l’eau jusqu’à une certaine distance de la ville, avec défense à tous de l’accueillir ; l’autre qui autorisait tout individu à tuer le proscrit partout où il le rencontrerait. Des proscriptions en masse suivirent la mort de C. Gracchus. Marius ne prenait pas la peine d’inscrire les noms des proscrits. Il se promenait par les rues après avoir ordonné à ses soldats de tuer ceux à qui il ne rendrait pas le salut. Sylla fit afficher ces fameuses Tables de proscription, où parurent jusqu’à deux mille noms à la fois. Il comprit dans ces listes ceux qui avaient reçu et sauvé un proscrit, fût-ce un père ou un fils, et promit deux talents par meurtre. Plus tard, les triumvirs Antoine, Lépide et Octave imitèrent cet exemple. L’habitude de proscrire se conserva sous les empereurs, qui s’en servirent souvent comme d’un moyen de s’enrichir par la confiscation des dépouilles de leurs victimes. »
Les mêmes mœurs tyranniques se retrouvent au cours des siècles jusqu’à nos jours.
« L’histoire du Moyen Âge offre une interminable série de proscriptions politiques et religieuses. Les hérétiques, les juifs furent souvent proscrits. La lutte des Guelfes et des Gibelins, l’ambition des petits potentats provoquèrent en Italie d’innombrables proscriptions. Plus tard, ce furent les proscriptions des Armagnac sous Charles VI, celle de Guillaume de Nassau et de ses adhérents sous Philippe II, la journée de la Saint-Barthélemy, les dragonnades sous Louis XIV, les lois portées sous la Convention contre les émigrés, les mesures prises par le Directoire après le coup d’État du 18 fructidor, celles prises par Bonaparte après le 18 brumaire. La Restauration proscrit les régicides et la famille Bonaparte. Les transportations qui suivirent les journées de juin 1848 furent de véritables proscriptions, ainsi que les déportations prononcées après le 2 décembre 1851 et après la Commune de 1871. »
PROSCRIT
n. et adj.
Victime de la proscription. Nous y comptons bien des héros.
« Le proscrit à son tour peut remplacer l’idole. » (V. Hugo.)
Nous avons vu que le tyran, parfois, devient un proscrit et qu’un proscrit peut devenir tyran.
La proscription étant une arme odieuse de politique autoritaire, on ne peut s’étonner que tous les régimes et tous les gouvernements, en tous pays, en aient usé et abusé. La tyrannie n’a pas de limite, et la Révolution française elle-même a démontré, à sa façon, qu’elle aussi savait proscrire aussi bien que le régime déchu. Dans un livre récent, Les Derniers terroristes, l’auteur, M. G. Lenôtre, nous fait assister à l’extraordinaire, à l’invraisemblable odyssée des jacobins arrêtés après l’attentat de la rue Nicaise et déportés à Mahé, la plus grande des îles Seychelles, à 280 lieues de Madagascar, à 416 lieues de la Réunion, à 3 800 lieues de la France. On sait que leur aventure ne prit pas fin à Mahé, mais se prolongea et se divisa en nombreuses et interminables péripéties, toutes plus dramatiques les unes que les autres...
Il est facile de se renseigner sur ce que furent les proscriptions ou déportations à travers les siècles jusqu’à nos jours. Il serait trop long d’en faire ici l’énumération, mais celles de 1851 et de 1871 ne sont pas au-dessous des plus féroces proscriptions de l’Antiquité.
En outre des massacres répressifs de la Commune, les tribunaux de l’Ordre rétabli prononcèrent l3 700 condamnations qui ne laissent rien à désirer, comparativement aux condamnations des régimes antérieurs à cette République française que tant de braves gens du peuple avaient rêvée si belle avant son avènement...
D’ailleurs, n’en est-il pas de même aujourd’hui pour la Russie et pour l’Espagne ? Au lendemain d’une révolution – et parfois même durant son accomplissement –, des iniquités par trop flagrantes font naître des protestations si véhémentes, que les protestataires, par la parole, par l’écrit ou par l’action, sont aussitôt victimes de proscriptions dignes d’un tsar de Russie ou d’un roi d’Espagne ! Éternelle malfaisance de l’Autorité, de l’État !
En 1871, la Commune de Paris vaincue, la répression s’acharna, sous le masque de la légalité : ce n’était pas assez des massacres ignobles du peuple, dans les rues de la capitale envahie par l’armée de Versailles ; ce n’était pas assez de 30 000 fusillés, de 42 000 arrestations ; il y eut 13 700 personnes condamnées à la déportation, dont la plupart à vie. Leur crime était d’avoir cru à un avenir meilleur, à un régime de justice sociale. Cette vengeance bourgeoise contre le peuple de Paris, qui avait osé poser les jalons d’une société égalitaire assurant le bien-être à tous par le travail affranchi de l’exploitation, n’est-elle pas équivalente aux plus atroces proscriptions des régimes les plus tyranniques et les plus cruels ? Mais les proscriptions n’arrêtent pas l’évolution : elles contribuent à susciter les secousses efficaces que sont les révolutions.
— Georges Yvetot.
PROSE
n. f.
La prose était, chez les Latins, l’oratio prosa, le langage direct, libre, qui n’était pas entravé par des règles comme l’oratio vincta, langage de la poésie. De là le nom de prose donné au langage ordinaire, celui de la vie courante, et une abusive confusion de la prose avec le langage vulgaire. On a vu ainsi dans la prose la forme roturière du langage, alors que la poésie en était la forme noble, et on a fait du mot prose l’adjectif prosaïque pour qualifier ce qui est sans âme, sans distinction, froid, terre à terre et même blâmable et méprisable.
Or, la prose n’est pas plus à confondre avec le langage ordinaire que la poésie. Elles sont toutes deux des formes du langage littéraire inventé par l’homme pour donner une expression spéciale à sa pensée, et si la prose n’a pas été à l’origine de ce langage littéraire, comme y a été la poésie, c’est que précisément le langage ordinaire ne lui offrait pas les moyens de cette expression spéciale de la pensée qu’elle a trouvés plus tard. La prose ne le cède en rien comme noblesse à la poésie ; elles peuvent être aussi parfaites ou aussi médiocres l’une que l’autre. D’ailleurs, la véritable poésie peut être autant dans la prose que dans les vers, et elle peut être aussi absente des vers que de la prose. Ce qui est prosaïque n’est pas nécessairement de la prose, et ce qui est noble n’est pas nécessairement en vers. Beaucoup de gens, qui croient faire de la prose lorsqu’ils parlent ou écrivent, seraient étonnés d’apprendre qu’il est aussi difficile de s’exprimer en prose qu’en vers, d’écrire de belle prose que de beaux vers. Le maître de philosophie disant à M. Jourdain qu’il faisait de la prose quand il commandait : « Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit » était un flatteur, et M. Jourdain était moins sot que ceux riant de lui quand il répondait : « Par ma foi, il y a plus de quarante ans que je dis de la prose, sans que j’en susse rien. » Victor Hugo ne faisait pas plus de la prose que de la poésie quand il donnait ses ordres à sa cuisinière ; mais il faisait de la poésie autant lorsqu’il écrivait Notre-Dame de Paris en prose que lorsqu’il composait la Légende des Siècles en vers.
Si les règles de la prose sont plus libres que celles de la poésie, elle n’en a pas moins son mouvement, son rythme, qu’il ne faut pas confondre avec la rime, et qui, plus qu’elle, est la musique du langage. Ils ne sont pas les mêmes, mais ils sont aussi indispensables à la prose qu’à la poésie pour l’expression harmonieuse de la pensée. Si la poésie emploie des moyens plus conventionnels que la prose, elle n’exige pas plus d’art pour cela. Si les règles du langage poétique sont moins libres, ou d’apparences moins libres, suivant le système auquel elles se rattachent, elles ne suffisent pas plus à faire de la poésie que la liberté du langage ne suffit à faire de la prose.
Le langage littéraire fut inventé par les hommes pour exprimer tout particulièrement ce dont ils voulurent conserver le souvenir dans leur mémoire. Tant qu’ils ne disposèrent que des moyens de transmission orale, ils usèrent du langage poétique. La prose n’apparut qu’avec l’écriture, lorsque celle-ci permit aux hommes une fixation de leur pensée plus certaine que celle de la mémoire, et que les écrivains furent assurés que leurs œuvres demeureraient avec plus d’exactitude et de durée.
Voici ce qu’a écrit P.-L. Courier sur les dogmes de la prose, dans sa préface d’une traduction nouvelle d’Hérodote : « Hécatée de Milet, le premier, écrivit en prose, ou, selon quelques-uns, Phérécyde, peu antérieur aussi bien l’un que l’autre à Hérodote... Jusque là, on n’avait su faire encore que des vers ; car avant l’usage de l’écriture, pour arranger quelque discours qui se pût retenir et transmettre, il fallut bien s’aider d’un rythme, et clore le sens dans des mesures à peu près réglées, sans quoi, il n’y eût eu moyen de répéter fidèlement même le moindre récit. Tout fut au commencement matière de poésie ; les fables religieuses, les vérités morales, les généalogies des dieux et des héros ; les préceptes de l’agriculture et de l’économie domestique, oracles, sentences, proverbes, contes, se débitaient en vers que chacun citait, ou, pour mieux dire, chantait dans l’occasion aux fêtes, aux assemblées : par là, on se faisait honneur et on passait pour homme instruit. C’était toute la littérature qu’enseignaient les rhapsodes, savants de profession, mais savants sans livres longtemps. Quand l’écriture fut trouvée, plusieurs blâmaient cette invention, non justifiée encore aux yeux de bien des gens ; on la disait propre à ôter l’exercice de la mémoire, et rendre l’esprit paresseux... » Voit-on où on en serait aujourd’hui si les hommes n’avaient eu que leur mémoire pour fixer le souvenir des connaissances qu’ils ont acquises !...
P.-L. Courier a remarqué aussi que « la poésie est l’enfance de l’esprit humain, et les vers l’enfance du style, n’en déplaise à Voltaire et autres contempteurs de ce qu’ils ont osé appeler vile prose ». La remarque est d’autant plus juste concernant Voltaire que celui-ci ne fut jamais un poète. Il mettait une sorte d’affectation aristocratique à écrire en vers et à protester contre les poèmes en prose dans lesquels il voyait des monstres, des « concerts sans instruments » ; mais il serait bien oublié aujourd’hui s’il n’avait eu que les vers de ses pauvres tragédies pour le défendre et si sa prose, celle de ses contes en particulier, ne lui assurait pas toujours une merveilleuse jeunesse. La prose ne dut pas son développement et son importance à la seule écriture. Les connaissances humaines s’étendant hors du champ des légendes à celui de l’observation et de l’expérimentation, il fallait un langage plus technique, plus scientifique, plus précis que celui de la poésie. « Le monde commençait à raisonner, voulait avec moins d’harmonie un peu plus de sens et de vrai. La poésie épique, c’est-à-dire historique, se tut, et pour toujours, quand la prose se fit entendre, venue en quelque perfection », a dit encore P.-L. Courier, remarquant que les temps mythologiques de la Guerre de Troie étaient passés quand vinrent ceux, plus historiques, de Salamine et des Thermopyles. Personne n’aurait alors écouté Hérodote si son récit avait été en vers d’Homère.
Ce qui montre que la prose littéraire ne pouvait se confondre avec le langage ordinaire, c’est sa longue formation, les difficultés pour les écrivains de se créer un style, une prosodie différents de ceux du vers, en même temps qu’un vocabulaire répondant à tous les besoins nouveaux de l’expression de la pensée. Car tout cela était sous la dépendance directe du progrès de la langue. La poésie se desséchait faute d’un perfectionnement suffisant. Les proses grecque puis latine n’arrivèrent à leur perfection oratoire, celle d’un Démosthène et d’un Cicéron, que lorsque leurs langues furent parfaites. La belle prose ne peut être produite que par une langue parfaitement adaptée à l’expression claire des idées ; elle ne s’accommode pas, comme la poésie, d’une approximation hésitante et abstraite, mais suffisante dans la plupart des cas quand elle est sonore. Aussi n’y eut-il pas véritablement de prose française durant le Moyen Âge. Toute la littérature de ce temps est en vers, traduisant une pensée tumultueuse, incertaine, comblant par les artifices de la versification l’insuffisance d’un langage qui ne trouvait pas tous les mots nécessaires à la pensée. Les plus prosaïques des contes bourgeois, des fabliaux et des farces sont en langage poétique. C’est ainsi qu’après la mort de l’épopée antique, l’histoire redevint épique et fut chantée à la façon d’Homère. Les chansons de Roland, de Charlemagne, de la chevalerie de la Table Ronde, tous les cycles légendaires produits des mythologies celtes, franques, anglo-saxonnes, germaniques, scandinaves, sont les Iliade et les Odyssée des peuples nouveaux dans l’Europe en formation. Quand il fallut une relation historique plus exacte, plus proche de la vérité des faits, Villehardouin, puis Joinville, Froissart, Commynes, firent ce qu’avait fait Hérodote ; ils commencèrent à écrire l’histoire en prose. Mais il fallut arriver à la Renaissance, au temps où la langue fut définitivement formée, pour que la prose atteignît sa maturité, sa sûreté d’expression et prît une véritable beauté plastique et spirituelle ne lui venant pas des formes de la poésie.
Le xvie siècle fut le premier grand siècle de la prose française. Si elle a été dépassée depuis par la perfection de la forme, elle ne l’a pas été par la richesse de l’expression, l’exubérance de la vie, la vivacité des sentiments et de l’esprit et l’audace de la pensée. Si elle est devenue moins rude, moins touffue, plus élégante, plus concise, elle n’est pas plus vivante et plus expressive. Les mêmes constatations valent pour la poésie et pour toute la littérature, tant la perfection littéraire est tributaire de la langue et de la grammaire. Philarète Chasles a fait dater la prose française de Calvin. Son siècle, le xvie, fut en même temps celui de Rabelais, La Boétie, Amyot, Montaigne, Estienne, Charron, Monluc, La Noue, Brantôme, Du Thou, tous grands prosateurs d’une époque que clôtura dignement la Satire Ménippée et qui fut la plus vivante, la plus ardemment curieuse, passionnée, bruyante, batailleuse, enthousiaste, sensée et insensée, sinon la plus édifiante. Elle laissa l’édification aux théologiens et aux moralistes du xviiie siècle qui infesteraient à la fois la vie et la littérature, joueraient du mouchoir de Tartufe, mais regarderaient par les trous des serrures pour fournir la police de rapports inquiétants pour la liberté des gens. Dans ce siècle, la prose serait toutefois défendue et bien servie contre les préciosités, puis contre la rhétorique académique pompeuse, artificielle et vide de saine substance, par la précision scientifique de Descartes, la pureté de conscience de d’Aubigné et celle de Pascal, dont les Provinciales seraient tenues par Voltaire pour « le premier livre de génie qu’on vit en prose », la recherche du naturel et de la vérité de Balzac, de Retz, de Mme de Sévigné, de Molière, de La Rochefoucauld et de Saint Simon, l’humanité jointe à la netteté d’expression de La Bruyère et de Fénelon, la poétique fantaisie de La Fontaine, restaurateur de la vieille « gaieté gauloise », et de Perrault, dont les Contes faisaient écrire à Flaubert : « Et dire que tant que les Français vivront, Boileau passera pour un plus grand poète que cet homme-là. »
Rémy de Gourmont tenait le xviiie siècle pour la grande époque de la prose. Ce siècle a embrassé l’universalité des connaissances humaines avec les Encyclopédistes et tous ceux ayant rompu, plus ou moins, dans les sciences naturelles et morales, avec les formes classiques encombrées de rhétorique et dépourvues d’humanité. La philosophie y donna ses chefs-d’œuvre. La littérature y commença l’évolution qui la conduirait au romantisme, mieux par la prose que par la poésie restée attachée, jusqu’à Chénier, à des poncifs surannés. La prose poétique y prit, chez J.-J. Rousseau, Buffon, Bernardin de Saint-Pierre, les qualités qu’elle aurait chez Chateaubriand, et aussi les défauts qu’exagéreraient leurs disciples ou continuateurs, notamment Lamartine. La prose de Rousseau fut directement inspirée de la musique. Celle-ci eut une influence moindre, pour ne pas dire nulle, sur les romantiques, et on peut certainement attribuer à leur insensibilité musicale le dessèchement de leur prose, marqué déjà dans Les Martyrs, de Chateaubriand.
Flaubert était peu enthousiaste de la prose du xviiie siècle. Il disait à propos de Grandeur et Décadence des Romains, de Montesquieu : « Joli langage ! Joli langage, il y a par-ci par-là des phrases qui sont tendues comme des biceps d’athlète ; et quelle profondeur de critique ! Mais je répète encore que jusqu’à nous, jusqu’aux très modernes, on n’avait pas l’idée de l’harmonie soutenue du style ; les qui, les que enchevêtrés les uns dans les autres reviennent incessamment dans ces grands écrivains-là ! Ils ne faisaient nulle attention aux assonances, leur style très souvent manque de mouvement et ceux qui ont du mouvement (comme Voltaire) sont secs comme du bois. » Flaubert ne faisait pas moins de réserves sur la prose de la première moitié du xxe siècle. Après la lecture de Graziella, il écrivait que Lamartine n’avait pas « ce coup d’œil de la vie, cette vue du vrai qui est le seul moyen d’arriver à de grands effets d’émotion » ; et il ajoutait : « Jamais de ces vieilles phrases à muscles savants, cambrés, et dont le talon sonne. J’en conçois pourtant un, moi, un style qui serait beau, que quelqu’un fera quelque jour, dans dix ans ou dans dix siècles, et qui serait rythmé comme le vers, précis comme le langage des sciences, et avec des ondulations, des renflements de violoncelle, des aigrettes de feu. Un style qui nous entrerait dans l’idée comme un coup de stylet, et où notre pensée enfin voyagerait sur des surfaces lisses comme lorsqu’on file dans un canot avec bon vent derrière. La prose est née d’hier, voilà ce qu’il faut se dire. Le vers est la forme par excellence des littératures anciennes. Toutes les combinaisons prosodiques ont été faites, mais celles de la prose : tant s’en faut. » Pour Flaubert, Balzac ne savait pas écrire.
La belle prose a cependant abondé en France, au xixe siècle, depuis Chateaubriand jusqu’à Anatole France, et sous les aspects les plus variés. Sébastien Mercier annonçait toute l’importance de cette prose quand il écrivait, au début du siècle :
« La prose est à nous, sa marche est libre ; il n’appartient qu’à nous de lui imprimer un caractère plus vivant. Les prosateurs sont nos vrais poètes ; qu’ils osent, et la langue prendra des accents tout nouveaux ; les mots, les syllabes mêmes ne peuvent-ils se placer de manière que leur concours puisse produire l’effet le plus inattendu ? »
C’était là une sorte de définition de la prose poétique qui prenait alors la place de la poésie classique desséchée, en attendant le vers romantique, définition que Flaubert corrigerait et compléterait sous l’influence du naturalisme scientifique. Les principaux prosateurs de la première moitié du siècle furent généralement fidèles à la prose poétique : B. Constant, P.-L. Courier, Lamennais, Michelet, Quinet, etc. Proudhon lui-même lui resta attaché, malgré la nature de ses écrits. Il disait :
« Quiconque s’est mêlé d’écrire en une langue a dû remarquer que, toutes les fois que le style s’élève, s’épure ou s’harmonise, il tourne tout naturellement au vers. »
Avec Stendhal, Flaubert, Taine, la prose se dégagea de la poésie pour atteindre plus de précision technique et tomber souvent, chez leurs continuateurs, dans cette sécheresse que Flaubert reprochait au xviiie siècle.
La prose, encore plus que la poésie, a apporté dans la langue française la clarté, la précision, la concision et l’élégance. Plus que les poètes, les prosateurs l’ont défendue contre les conventions arbitraires où, dès la fin du Moyen Âge, la poésie épuisée était tombée avec les « rhétoriqueurs », et que continuerait la Pléiade puis l’académisme, pour faire régner les règles du « bon goût » ! On eut ainsi la prose académique que la pompeuse emphase, la fausseté sentimentale, l’absence de véritable humanité rendent boursouflée, maquillée, vide de toute substance. Après Voiture et autres précieux, l’Académie française, dont la solennité macabre épouvante même les croquemorts, a donné le ton de cette rhétorique aussi hypocrite qu’ennuyeuse où, depuis Pléchier, ont excellé tant de raseurs aussi inconnus qu’« immortels » qui se sont succédés dans cet hypogée de la littérature, du bon goût et de la distinction. M. Cousin, qui tint une place avantageuse dans ce monde fossilisé, voyait en Bossuet le plus grand prosateur français. Jugement bien académique et qui montre toute la distinction à faire entre la prose, expression de la pensée, et la rhétorique qui en est le vent. (Voir Rhétorique.)
— Edouard Rothen.
PROSTITUTION (la)
n. f.
Qu’est-ce que la prostitution ? La loi romaine appelait prostitution le métier des femmes qui ont choisi de se livrer contre de l’argent à tout venant (le verbe prostituo a le sens d’abandonner à tout venant). Le Dictionnaire de l’Académie l’explique ainsi : « abandonnement à l’impudicité », ce qui n’est ni clair ni complet. Le Dictionnaire encyclopédique Larousse explique :
« Métier qui consiste à livrer son corps au plaisir du public pour de l’argent. »
Dans son Histoire universelle de la Prostitution chez tous les peuples du Monde (1851), Pierre Dufour écrit qu’on doit entendre par prostitution tout trafic obscène du corps humain (à cause du terme prostitutum).
Dans La Prostitution clandestine (1885), le docteur Martineau :
« La prostitution est le commerce du plaisir ; est prostituée publique celle qui ne choisit pas son acheteur ; est prostituée encore, assurément, celle qui le choisit, mais ne l’est pas de la même façon. »
Dans La Prostitution au point de vue de l’hygiène et de l’administration (1889), le docteur Reuss :
« C’est le commerce habituel qu’une femme fait de son corps. — Une prostituée est une femme qui, se tenant à la disposition de tout homme qui la paie, se livre à la première réquisition. »
Émile Richard, ancien président du conseil municipal de Paris, dans La Prostitution à Paris (1890) :
« … doit seulement être réputée prostituée toute femme qui, publiquement, se livre au premier venu, moyennant rémunération pécuniaire et n’a d’autres moyens d’existence que les relations passagères qu’elle entretient avec un plus ou moins grand nombre d’individus. »
Le docteur Commenge, dans La Prostitution clandestine à Paris (1904), donne cette définition qui demeure l’une des meilleures : « La prostitution est l’acte par lequel une femme, faisant commerce de son corps, se livre au premier venu, moyennant rémunération, et n’a d’autres moyens d’existence que ceux que lui procurent les relations passagères qu’elle entretient avec un plus ou moins grand nombre d’individus. »
De ces définitions, il résulte que ce qui caractérise la prostitution, c’est d’abord la vénalité ; c’est ensuite, contre argent, de livrer son corps au premier venu ou à tout venant. La racine de tous les mots de la famille « prostituer » est le verbe latin prosto, qui signifie « saillir, avoir de la saillie, s’avancer en dehors » – être rendu public, d’usage commun –, « être vénal, être à vendre, être exposé en vente ».
Quelle fut la première prostituée ? L’espèce humaine apparue, avec ses défauts et ses sublimités, le sexe fort se rendit compte de sa force, et le sexe faible eut compréhension – ou prit conscience – de sa faiblesse. L’homme réduisit en captivité la femme, soit de gré, soit de force, pour la satisfaction de ses appétits charnels. Mais, inopinément, survenait un second mâle auquel plaisait la captive. Les deux hommes se battaient et la femme restait le butin du vainqueur.
À mesure que les hommes « s’humanisaient », c’est-à-dire à mesure qu’ils acquéraient plus de développement cérébral – aux dépens de leur force physique –, leur tactique se modifiait et ils commencèrent à solliciter les êtres de l’autre sexe. La femme, moins fougueuse en règle générale que l’homme, accepta ou refusa d’abord ingénument ses sollicitations ; mais l’homme conçut la ruse de mettre la convoitise de son côté. Le beau fruit qui pendait d’un rameau trop élevé pour que la femme pût le cueillir avec facilité, telle belle pièce, produit de la chasse ou de la pêche, autant de démons tentateurs pour le faible être féminin qui finit par céder, livrer son corps à l’homme en échange de ces aliments appétissants. En cédant, elle le reçut dans ses bras et lui ouvrit le lit de son corps, et tous deux formèrent « la bête à deux dos » chère au poète. Telle fut la première prostituée, la première qui se vendit pour un prix. Or, ceci se produisit certainement parmi les hommes primitifs : la prostitution est donc aussi ancienne que le monde, que l’humanité.
Certains auteurs voient dans l’hospitalité l’origine de la prostitution. Chez les primitifs, la notion de l’hospitalité due au voyageur était si profondément ancrée dans la mentalité humaine qu’elle était devenue un dogme sacré, une loi inviolable. C’est l’une des premières manifestations de la sociabilité humaine, qui devint par la suite une sorte de coutume ressortissant du droit des gens. L’hospitalité voulait que là où il frappait, l’étranger trouvât place au feu et à la table. À l’origine, il dut être considéré comme un parent inespéré. On l’adoptait, tant qu’il demeurait sous le toit de la maison où il était entré, comme l’un des membres de la communauté familiale. Et comme son séjour était censé attirer le bonheur, on voulait que l’hospitalité fût complète, voilà pourquoi il ne restait pas solidaire sur la couche où il se reposait : la femme ou la fille de l’hôte, l’une ou plusieurs des femmes résidant sous le toit qui l’abritait, venaient coucher auprès de lui. Les humains de ce temps-là n’auraient pas compris que l’amour fût exclu des bonnes choses que la coutume prescrivait de présenter au passant. Il n’y avait donc pas besoin de l’ordre du maître de la maison pour que l’hôtesse se prêtât de bonne grâce à l’usage consacré. Il est possible que plus tard, au départ de l’hôte, celui-ci ait remis à sa ou ses compagnes de passage un cadeau qui a pu être un objet provenant du pays d’où il venait et dont le semblable n’existait pas dans le leur. Ce ne doit être que par la suite que ce présent a pu être considéré comme une rémunération. La prostitution hospitalière qui se pratique actuellement, à titre de coutume, chez certaines tribus classées comme primitives ou demi-civilisées, accuse un calcul qu’ignorait l’hospitalité primitive.
Plus tard, les hommes, ayant divinisé les instincts, divinisèrent l’amour. L’amour physique, plus ou moins romantique, mais toujours instinctif, eut sa déesse spéciale, Vénus, qui reçut divers surnoms ou appellations, suivant les peuples qui l’adoraient et les motifs qui lui faisaient rendre un culte... On la donnait comme fille de Jupiter, née de l’écume et de la mer, sur les côtes de Chypre. L’amour physique eut aussi pour dieu Adonis, l’Adonaï des Israélites, l’un des nombreux amants qu’on attribua à Vénus. On les adorait tous deux en Phénicie sous le nom d’Astarté, divinité hermaphrodite, dont les statues réunissaient les deux sexes. Les peuples naissants se prévalurent de l’adoration qu’ils portaient à la fille de Jupiter pour augmenter leur population et leurs richesses. À cet effet, ils élevaient des temples à la déesse, lui assignaient de très belles prêtresses qui étaient dans l’obligation de se sacrifier à Vénus, c’est-à-dire de se livrer aux étrangers qui visitaient les bois sacrés et faisaient des dons pour l’entretien du culte de la déesse ; c’est ce qu’on appelait la « prostitution sacrée ». De cette manière, les navigateurs, marchands ou tout simplement libertins, trouvaient le plaisir qu’ils cherchaient dans ces bois sacrés, sans avoir besoin d’aller mendier ailleurs les faveurs féminines.
Nous ne mentionnerons qu’en passant les jardins suspendus de Babylone et le culte qu’on y rendait à Melitta – autre nom de Vénus –, où il était de notoriété que, selon une loi du roi chasseur Nemrod, fondateur de cette reine de l’Euphrate, toutes les femmes étaient obligées de se prostituer au moins une fois dans leur vie sur les autels de la déesse ; ce qui fut cause de l’agrandissement de la ville – l’Arménie avec son culte d’Anaïtis, dans les bois sacrés de laquelle seuls les étrangers pouvaient pénétrer, et où ils rencontraient de belles prêtresses, de jeunes et séduisants prêtres, les uns et les autres tous prêts à sacrifier avec leurs visiteurs sur les autels de la déesse. De même que les hommes créèrent le culte de Vénus, les femmes imaginèrent celui d’Adonis, qui se transforma plus tard en celui de Priape – ou culte de l’organe sexuel mâle. En Phénicie, donc, ces deux cultes se réunirent en un seul, dont les pratiquants et les pratiquantes se livraient aux délices charnelles sous toutes les formes concevables – en l’honneur duquel on sacrifiait à toute heure, dans les bois comme dans les maisons particulières, où les pères et les maris prélevaient le prix des sacrifices. Chypre, où on adorait Vénus – la « fille de l’île » –, sous autant de noms qu’en des points différents il lui était élevé de temples, une vingtaine, dont les deux principaux étaient érigés à Paphos et à Améthonte, où la prostitution sacrée atteignait une ampleur inconnue ailleurs ; Chypre, où les femmes consacrées au service de la déesse se promenaient sur les rives de la mer, attirant, telle une nuée de sirènes, par leurs chants, leur beauté, leur luxure, les marins, qui finissaient par laisser leur sang et leur or au profit de l’île. Les femmes de la Lydie (Asie Mineure) se livraient à une prostitution qui ne connaissait point d’entraves pour se procurer une dot qu’elles apportaient à leurs maris. Par contre, dans le pays des Amazones, sur les frontières de la Perse, les femmes qui se consacraient à Artémis (autre appellation de Vénus) le faisaient avec désintéressement, par pur mysticisme, pour se consoler de leur continence habituelle.
De l’Asie Mineure, la prostitution se répandit rapidement chez les Perses, les Mèdes, les Parthes ; en même temps que la musique et la danse, accompagnement obligé des « Fêtes de Vénus » que Macrobe et le rhéteur Athenaeus nous dépeignent comme des orgies où, sans souci de leurs parents, maris ou progéniture, les femmes se livraient à leurs appétits sexuels. Tout cela se faisait au son de la lyre, du tambourin, de la flûte, de la harpe. Faisant grand, les rois de Perse entretenaient jusqu’à mille concubines danseuses. Après la victoire d’Arbelles, Alexandre le Grand en trouva 329 dans la suite de Darius.
En Égypte, la prostitution et le libertinage trouvèrent à se déployer amplement. Outre la prostitution sacrée et la prostitution hospitalière, voici qu’apparaît officiellement la prostitution légale ou réglementée : en effet, à l’époque de Ramsès Ier, sa fille se prostitue dans les lupanars publics pour découvrir le voleur des biens dérobés à son père ; cette même fille de Chéops se prostitua afin de trouver les ressources nécessaires pour que s’achevât la grande pyramide (?). La tradition raconte que, comme cadeau, elle exigeait de ses amants une pierre ou la somme la représentant ; c’est de la masse de ces pierres que se compose la pyramide du milieu. Comme le nombre en est « incalculable » (?), cela donne une idée de la quantité de fois que la fille du Pharaon dut vendre son corps. La tradition attribue à une autre prostituée fameuse l’érection de la troisième pyramide, celle de Mykérinos. Mais la chronologie paraît démentir cette attribution (?).
Non loin de l’Égypte, dans la partie de l’Afrique où l’on bâtit Carthage, on trouvait également un grand nombre de prostituées ; témoin ce lieu appelé « Sicca Veneria », où on avait élevé un temple somptueux à Vénus, dans lequel les jeunes Carthaginoises des environs allaient se livrer religieusement aux étrangers ; elles réservaient au temple une partie des libéralités qu’elles recevaient, et le reste servait à les marier avantageusement. Là aussi, on rendait un culte à Adonis, cet amant passionné de Vénus que dévora un « sanglier furieux », allusion à l’épuisement qui suit chez le mâle l’accomplissement du coït. Dans les fêtes célébrées pour commémorer ce mystère, ou symbole, les prêtresses se flagellaient les unes les autres pour venger les Adonis victimes de la défaillance qui succède à l’acte d’amour.
En Grèce, et spécialement à Athènes, on distinguait toutes sortes de prostituées : au plus bas de l’échelle, les dictériades qui représentaient le prolétariat de la prostitution. Solon, le législateur de la Grèce et l’un des Sept Sages, avait acheté des femmes en dehors de son pays et en avait peuplé des maisons de prostitution appelées dictérions (sans doute en souvenir de Pasiphaé, la femme de Minos, qui habitait Dictae, en Crète). D’abord établies au Pirée, le port d’Athènes, puis répandues ensuite au port de Phalère, au bourg de Sciron et dans les alentours d’Athènes. Le dicterion était inviolable et on ne pouvait s’y rendre sous aucun prétexte que celui pour lequel il avait été institué. C’était un lieu d’asile absolu : le père n’y pouvait aller relancer son fils, la femme son mari, le créancier son débiteur. La loi autorisait le maître du lieu – le Pornobosceion – à s’opposer par tous les moyens aux intrusions étrangères. Bien que payant redevance à l’État (le 4e jour de chaque mois, les prostituées de profession exerçaient leur industrie exclusivement au profit du culte de Vénus) – ce qui permit à Solon d’ériger un temple à la « Vénus publique » –, elles étaient tenues à peu près hors du droit commun. Elles ne pouvaient entrer dans les temples, sauf ceux consacrés à Vénus, dont il leur était même permis de devenir les prêtresses. Elles ne pouvaient pas non plus figurer dans les solennités publiques, prendre place à côté des matrones, qui acceptaient cependant la présence des hétaïres. Les enfants des dictériades ne pouvaient être citoyens.
Les aulétrides étaient mieux considérées, vivaient libres et se déplaçaient comme bon leur semblait. Ces « joueuses de flûte » se louaient pour jouer de leur instrument favori, chanter et danser. On les employait parfois à la « prostitution politique », fort utilisée également dans les temps modernes. Pour considérées que furent les hétaïres, la loi leur défendait d’avoir des esclaves, et même des servantes à gages. Cette loi très sévère privait la femme libre qui se plaçait chez une courtisane de sa qualité de citoyenne ; non seulement elle était confisquée comme esclave au profit de la République, mais par le fait de son service chez une courtisane, elle était classée comme prostituée, et déclarée propre à être employée dans les dicterions. À vrai dire, ces prescriptions ne furent jamais suivies. Jamais les hétaïres ne manquèrent d’esclaves ou de servantes ; pas même les dictériades. Cette loi servait surtout aux avocats qui plaidaient contre les courtisanes. C’est parmi les hétaïres que se trouvèrent les grandes courtisanes qui ont laissé un nom dans l’histoire : les Aspasie, les Sapho, les Phryné, les « philosophes ». À Corinthe, chaque maison était un véritable lupanar. Strabon raconte que les dames honorables de la ville se rendaient sur la plage, y prenaient place et attendaient patiemment l’arrivée des marins étrangers. Cela n’empêchait pas que les professionnelles fussent très nombreuses, et il y avait même des écoles à leur usage.
Les courtisanes romaines ne furent pas aussi « fameuses » que celles de la Grèce. Cela tient à la psychologie différente des deux peuples. On compte peut-être à Rome un plus grand nombre de prostituées historiques ou connues qu’en Grèce, mais cela provient du nombre élevé d’artistes et de poètes qui voulurent les immortaliser, et non pas du mérite intrinsèque des privilégiées. Les Grecs étaient plus artistes, plus imaginatifs, doués d’un goût plus délicat que les Romains. Ils ne jouissaient pas uniquement par les sens ; la cérébralité jouait un grand rôle dans leurs plaisirs. Ils ne demandaient pas uniquement à la femme de satisfaire leurs passions ; ils attendaient d’elle qu’elle ornât, qu’elle agrémentât d’esthétique le don qu’elle faisait de sa personne. C’était dans la mesure où elles étaient intelligentes, artistes, etc., que les courtisanes prenaient de l’importance. Sapho, Aspasie, Phryné, etc., étaient sans contredit des femmes belles et lascives ; elles eurent des rivales aussi belles, aussi lascives qu’elles pouvaient l’être ; mais, faute de talent, de dons intellectuels, ces dernières ne purent jamais leur porter om-brage.
Une courtisane célèbre par la beauté de sa taille est enceinte : voilà un beau modèle perdu ; le peuple est dans la désolation. On appelle Hippocrate pour la faire avorter : il la fait tomber, elle avorte. Athènes est dans la joie, le modèle de Vénus est sauvé. Voilà l’esprit grec ! Les Romains étaient plus grossiers, plus sensuels, mais aussi plus positifs. Le rôle de la femme était de se montrer talentueuse et passionnée « au lit ». Son influence ne dépassait pas le cubiculum : la chambre à coucher, ou le triclinium : la salle à manger. Aspasie exerça une influence décisive sur la politique athénienne. Quelle que fût son intelligence, jamais une matrone romaine n’exerça une influence réelle sur les affaires de l’État.
Rome comptait un très grand nombre de prostituées. On divisait les courtisanes en deux grandes classes qui répondent à nos catégories actuelles : femmes publiques et femmes entretenues : prolétariat et aristocratie de la prostitution. Chacune de ces classes se subdivisait en une multitude de sous-classes selon le rang social, leurs prétentions, le quartier où elles habitaient. La description de ces sous-classes serait fastidieuse. Il suffira de dire que de l’épouse et mère de l’empereur à la pierreuse de dernier rang, chacune recevait une dénomination spéciale. On voit combien était dépassé en réalité le chiffre des prostituées immatriculées, des 35 000 courtisanes de haut et de bas étage qui payaient aux édiles la vectigal ou licentia stupri, portaient la togata, la tunique courte, et coiffaient la mitra, la mitre, sorte de bonnet phrygien avec des mentonnières.
L’avènement du christianisme ne supprima pas la prostitution, loin de là. Au xve siècle, Paris comptait cinq ou six mille femmes vouées à la prostitution. Dans une lettre datée de la capitale, le poète italien Antoine Artesani écrivait :
« J’y ai vu avec admiration une quantité innombrable de filles extrêmement belles ! Leurs manières étaient si gracieuses, si lascives, qu’elles auraient enflammé le sage Nestor et le vieux Priam. »
D’une façon générale, on peut dire qu’au Moyen Âge, les régions du Nord montraient plus d’indulgence pour la prostitution que celles du Midi. Somme toute, dans le Nord, elle ne connaissait guère comme limites que des règlements bénins et sans cesse tournés. Dans le Languedoc, il existait une organisation de la débauche publique plus régulière que celle de Paris. Les foires de Beaucaire attirant beaucoup de monde, la ville possédait une « ribauderie » dont la durée était celle de la foire. Cet endroit était placé sous l’autorité d’une gouvernante appelée abbesse. Elle ne pouvait accorder l’hospitalité pour plus d’une nuit aux passants qui voulaient loger dans son auberge. Avignon avait un statut spécial qu’avait élaboré la reine Jeanne de Naples. Dans les provinces centrales, on laissait aussi le champ libre à la prostitution : elle devait seulement, dans chaque endroit, payer des redevances féodales et se conformer aux usages.
À son retour de Palestine, Louis IX avait voulu détruire la prostitution par sa célèbre ordonnance de décembre 1254, où l’on trouve un article prononçant la suppression des lieux de débauche et le bannissement des professionnelles. Non seulement cette ordonnance ne fut jamais exécutée à la lettre, mais, deux ans plus tard, le « saint » roi était obligé de revenir sur son ordonnance et de se montrer tolérant pour la prostitution.
Les armées du Moyen Âge étaient toujours suivies d’une multitude de femmes. Le chroniqueur Geoffroy, moine de Vigeois, estime à 1 500 le nombre des concubines qui suivaient le roi de France, en 1180. Le nombre des filles folles de leurs corps enrôlées sous les drapeaux des capitaines de ce temps-là augmentait ou diminuait, en raison des succès ou des revers subis au cours de l’expédition. Mieux les armées étaient campées, approvisionnées, payées, plus elles comptaient de femmes à leur suite. Charles le Téméraire emmènera en Suisse deux armées, l’une d’hommes, l’autre de femmes ; après la défaite que subit à Granson l’orgueilleux duc de Bourgogne, les Suisses laissèrent courir les malheureuses qui suivaient. Louis IX avait eu fort à faire contre les croisés qui s’étaient mis à imiter les musulmans et entretenaient de véritables harems remplis d’esclaves achetées dans les bazars de l’Orient. Ses efforts pour rétablir de « bonnes mœurs » dans les camps n’eurent pas plus de succès que ses ordonnances contre la prostitution.
Les écrivains hostiles à la papauté ont toujours affirmé que la Rome papale était le centre de la démoralisation moyen-âgeuse. Deux ou trois extraits tirés des écrits des écrivains catholiques eux-mêmes montrent qu’ils n’ont pas exagéré :
« De capitale du royaume du Christ – écrit le jésuite Madeu –, ses mœurs l’avaient transformée en royaume de la concupiscence, en siège des plaisirs immondes, en patrie des prostituées, où les ministres du sanctuaire bondissaient de l’autel dans les lits du déshonneur, où l’on faussait les balances de la justice sur les injonctions de l’empire de la fornication, où les clés de ses trésors et de ses grâces se trouvaient aux mains des adultères, où les proxénètes les plus infâmes étaient les confidentes de ses prélats et de ses princes ecclésiastiques. »
« Ville où les prostituées sont comme des matrones – rapportaient au pape Paul III ceux qu’il avait chargés d’une enquête – qui suivent en plein jour les nobles, familiers des cardinaux et du clergé. »
« Pourrais-je passer sous silence la multitude des prostituées et le troupeau de jeunes garçons... et le sacerdoce alternativement acheté et vendu ? Le peuple ignorant et scandalisé des mauvais exemples que, sans cesse et de tous côtés, il a sous les yeux, abandonne toute espèce de culte et redoute même jusqu’à la piété. » (Pic de la Mirandole devant le concile œcuménique de Latran.) (Nous citons d’après une version espagnole.)
« D’où vient le libertinage des jeunes filles et des jeunes gens, sinon que celles-là sont séduites par les procureuses, par leurs amies, par les ecclésiastiques qui fréquentent la maison. » (Olivier Maillard, sermon dominical, dom. 3, serm. 6, fol. 14)
« Les gens d’église qui vivent dans le désordre et le sacrilège, la simonie et le concubinage, mangent avec les courtisanes la rente de l’Église destinée au soulagement des pauvres et livrent à des femmes publiques les biens du Crucifié. » (serm. de S.S. Felipe y Santiago, fol. 577, y de S. Trinidad, fol. 74)
« Une des plus grandes injures de ces temps-ci, c’est de jeter à la face de quelqu’un la faute de son père ou de sa mère, en le traitant de fils de curé. » (Dom. 4, Cuadrag..., fol. 105)
Tant que dura le pouvoir temporel des papes, la prostitution paya une redevance au Saint-Siège. Si, dans certains diocèses, les grands vicaires recevaient la permission de commettre l’adultère pendant l’espace d’une année ; si, dans d’autres, on pouvait acheter le droit de forniquer impunément pendant tout le cours de sa vie ; si l’acheteur en était quitte en payant chaque année à l’official une quarte de vin (Dulaure), c’est parce que l’officialité trouvait dans les Décrétales des papes le pouvoir qu’elle s’arrogeait sur le « péché d’impureté ».
« Tout est commun entre nous – disait le canon –, même les femmes. »
Le pape Sixte IV revêtit de sa signature une requête où on lui demandait la permission de commettre le péché de luxure pendant les mois caniculaires. Lorsque de Rome le Saint-Siège fut transféré à Avignon, il y amena un dérèglement de mœurs inouï, ce qui fera dire à Pétrarque (qui résidait à Avignon vers 1326) :
« Dans Rome la Grande, il n’y avait que deux courtiers de débauche ; il y en a onze dans la petite ville d’Avignon. »
En général, l’idée courante du Moyen Âge était de se résigner à la prostitution, mais de la parquer dans un quartier, une rue dont les « ribaudes » ne pouvaient sortir, sous peine d’un châtiment plus ou moins grave. On eut donc recours au port d’un costume spécial ou à la défense d’user de certains atours réservés aux « honnestes dames ». Du temps de saint Louis, où les prostituées ne pouvaient porter de « ceintures dorées », elles ne pouvaient pas se montrer en public sans porter une aiguillette sur l’épaule. Sous Charles VI, en 1415, une ordonnance du prévôt leur défendra de porter de l’or ou de l’argent sur leurs robes et leurs chaperons, de les décorer de boutonnières dorées, de se vêtir d’habits fourrés de gris, d’or ou d’écureuil ou autres « fourrures honnêtes », d’orner leurs souliers de boucles d’argent. En 1420, le prévôt revient à la charge : point de robes à collets renversés, à queue traînante. Tout cela à Paris. À Marseille, les femmes publiques ne pouvaient porter de robes écarlates.
Ces prescriptions vestimentaires et autres, les ribaudes finissaient toujours par les enfreindre, par les tourner. C’est alors qu’intervenaient les sanctions. On les « flambait », c’est-à-dire qu’au moyen d’une torche ardente on leur brûlait tout ce qu’elles avaient de poils sur le corps. On les fustigeait, on les « exposait » au grand plaisir des passants. À Bordeaux, on leur « baillait la cale », c’est-à-dire qu’on renfermait la patiente dans une cage de fer que l’on plongeait dans le fleuve et qu’on ne retirait pas toujours avant que l’asphyxie fût complète. À Toulouse, on leur infligeait l’accabusade : on menait la délinquante à l’hôtel de ville, l’exécuteur lui liait les mains, la coiffait d’un bonnet en forme de pain de sucre, orné de plumes, lui accrochait sur le dos un écriteau où était décrite l’infraction dont elle était coupable ; on la conduisait sur un rocher situé au milieu de la Garonne ; là on l’enfermait dans une cage de fer qu’on plongeait par trois fois dans le fleuve ; on la transportait, demi mourante, au « quartier de force » de l’hôpital où elle finissait le reste de ses jours !
Mais c’est surtout sur les entremetteuses, sur les maquerelles, que s’appesantissait la rigueur de la justice. Fustigation, pilori, promenade à dos d’âne ou de cheval à travers la ville, prison, exil, rien ne leur était épargné. Dans certains lieux (à Rennes, par exemple), on les marquait au fer rouge d’un M ou d’un P au front, aux bras ou aux fesses.
À l’époque de la Renaissance, les mœurs sont aussi relâchées qu’au Moyen Âge ; mais comme aux beaux temps du paganisme, davantage parmi les classes dirigeantes que parmi les classes dirigées. La « galanterie » est raffinement de gentilshommes où n’ont que voir les taillables et corvéables à merci, qui restent sous le joug moral du prêtre. Le tiers-état fera montre de vertus qui lui sont particulières, et les mœurs seront parmi ses membres beaucoup moins libres que dans la noblesse et, même, selon les époques, que dans une certaine partie du clergé. Rome, la seconde Rome, est alors dans tout son éclat de capitale esthétique et spirituelle du monde. Dans ses murs brillent les courtisanes à la mode athénienne, telle la belle Imperia, dans les salons desquelles se réunissent artistes, littérateurs, savants, tous les hommes d’esprit ou de génie du temps. On se dirait à Corinthe ou à l’ombre du Parthénon. Une certaine Galiana ayant été emmenée par quelques-uns de ses admirateurs de Rome à Viterbe, les Romains ne se résignèrent pas à la perte d’un tel trésor ; ils mirent le siège devant la « ville aux belles femmes et aux belles fontaines » et ramenèrent Galiana.
La Réforme restreignit la prostitution en Allemagne, à titre de réaction contre le laisser-aller des mœurs papistes. La plupart des maisons de prostitution allemandes étaient gérées par le bourreau de la ville, dont elles constituaient le revenu le plus important. La tâche lui incombait de tenir en bride, de protéger, de régenter les femmes publiques. Il remplissait le rôle que jouait en France le roi des Ribauds, office supprimé sous François Ier. Il devait veiller à ce qu’aucune fille ne fût retenue dans une maison close contre son gré, à ce que des femmes mariées ou des filles natives de la ville n’y fussent pas admises. Les mœurs acceptaient pourtant que, pour payer les dettes du mari ou des parents, une femme ou une fille fût louée ou engagée dans une maison de prostitution pour un temps donné. Tout ce qui était exigé alors, c’était le consentement de la personne ainsi mise en gages. Mais que d’ordonnances, de restrictions variant selon les municipalités ! On cite l’ordonnance du conseil d’Ulm qui, trouvant que dans les maisons de prostitution il y avait assez de vice toléré, ne voulait pas laisser les pensionnaires dans l’oisiveté. Quotidiennement, elles devaient filer, chacune, deux écheveaux de filasse, sous peine de payer trois hellers d’amende pour tout écheveau non filé. Toutes ces restrictions n’empêchaient pas la prostitution de prendre plus d’essor. En 1490, Strasbourg comptait cinquante-sept maisons publiques. À Lucerne, pour une population masculine de 4 000 personnes, on dénombrait, en 1529, 300 filles de joie.
Couronnements, mariages princiers, diètes, conciles, tournois, foires, toute fête, toute solennité était occasion à prostitution. Le Reichstag de Francfort, en 1394, avait attiré 800 femmes publiques, sinon davantage, en plus des prostituées habituelles. Et tous ceux qui exerçaient autorité tiraient profit de la prostitution : dignitaires ecclésiastiques, cloîtres, princes, seigneurs et municipalités.
La Réforme, avons-nous dit, réagit contre la prostitution autorisée. À Regensburg, Ulm, Breslau, Nuremberg, Augsbourg, Landshut, les bordels furent fermés. La syphilis, d’ailleurs, faisait déserter ceux qui restaient ouverts... Tout cela n’empêchait pas Luther et Melanchton d’autoriser le landgrave de Hesse à être bigame, « vu son tempérament particulier ».
Comme la Renaissance battait son plein, un fléau apparut, déjà nommé : la syphilis, qui changea en hurlements de désespoir les chants de triomphe qu’avait fait éclater l’avènement de l’humanisme. Prétendre que ce furent les marins de Christophe Colomb qui, à leur retour d’Amérique, en même temps que la découverte d’un nouveau monde, ramenèrent la syphilis est une absurdité. On a retrouvé des traces d’ulcérations syphilitiques sur des squelettes préhistoriques, et il est avéré que, de tous temps, la syphilis sévissait en Orient à l’état endémique. Il semble que les médecins aient commencé à l’examiner avec soin à la fin du xve siècle. Peut-être est-ce parce qu’elle ne s’était pas manifestée jusqu’alors sous une forme aiguë que la Faculté ne l’avait pas isolée, ou l’avait confondue avec la lèpre ?
Les lupanars étaient des foyers d’infection. Sous le règne de Charles IX, les autorités décrétèrent d’exécuter l’ordonnance de saint Louis, dont nous avons parlé en son temps, qui abolissait la prostitution légale et qu’on n’avait jamais osé appliquer. En général, on jugea l’ordonnance inapplicable à Paris. Plusieurs prescriptions furent cependant rigoureusement observées. Par exemple, les locataires d’une maison avaient le droit de forcer leur propriétaire à résilier le bail qu’il avait passé avec une « femme dissolue ». Plus encore : un locataire de « bonne vie et mœurs » qui demeurait dans une maison appartenant à une femme de « mauvaise vie » n’avait qu’à la dénoncer comme telle. Si une simple information judiciaire prouvait que sa dénonciation était exacte, la propriétaire était obligée de déloger. On ne put cependant fermer toutes les maisons de prostitution ; quelques-unes prouvèrent qu’elles avaient été en quelque sorte autorisées par saint Louis. Celles que le prévôt de Paris laissa subsister perdirent tous les droits qu’elles tenaient de l’ordonnance de saint Louis. Leur existence devint provisoire. C’est depuis cette époque qu’on appliqua aux lieux de débauche vénale le surnom qui est resté en vigueur : maisons de tolérance.
En perdant le droit d’exercer légalement son métier selon tarif fixe et redevances déterminées, la femme « commune » avait acquis, en revanche, la liberté de régler par elle-même les conditions de son industrie, qu’elle exerçait désormais en cachette. L’édit de Charles IX émancipa donc, économiquement parlant, la prostituée de métier.
Charles IX et Michel de l’Hôpital, son chancelier, avaient été si contents des applaudissement qui avaient accueilli leur édit qu’ils voulurent réformer les mœurs à coups d’ordonnances. Les lieux de débauche relégués hors de l’enceinte de la capitale, il restait à expulser les prostituées de la cour et des armées. Un nouvel édit, en date du 6 août 1570, prescrit à toutes les filles de joie et femmes publiques de déloger dans les vingt-quatre heures de « nostre diste cour, dans le dist temps, sous peine de fouet de marque ». La prostitution, naturellement, ne tarda pas à reparaître. À partir d’Henri III, sont à la mode les courtisanes qui se modèlent sur leurs ancêtres du temps de Périclès : les Louise Labé, les Marion de Lorme, les Ninon de Lenclos (autour de laquelle se presseront les plus illustres hommes du siècle). Sous Louis XIV, les favorites seront des reines officieuses. Sous Louis XV, tout se fera par elles. Le reste de l’Europe imitera la France.
La Révolution met un frein à la prostitution (les prostituées passant pour favorables à l’Ancien Régime). Après Thermidor, elle reparut et fut plus en vogue que jamais. Alors que, sur une population de 600 000 habitants, on comptait à Paris, en 1770, 20 000 prostituées ; vers 1800, il y en avait 30 000. En juin 1799, le commissaire Dupin se plaint au ministre de l’Intérieur : « La dépravation des mœurs – écrit-il en son style administratif – est extrême et la génération actuelle est dans un grand désordre, dont les suites malheureuses sont incalculables pour la génération future : l’amour sodomite et l’amour saphique sont aussi effrontés que la prostitution et font des progrès déplorables. »
Depuis, la prostitution n’a fait que croître ; et si la maison close – le bordel – tend à disparaître de nos grandes cités, la maison de rendez-vous, par contre, pullule, et la prostitution clandestine s’affirme de plus en plus. En 1870, il y avait quelque 8 700 filles publiques inscrites sur les registres de la police de Paris. En 1925, il s’en trouvait 7 000 et on comptait 200 maisons de tolérance. On évalue au décuple le nombre des prostituées clandestines, non compris bien entendu les entretenues et les demi entretenues.
Depuis 1875, pour fixer une date, une bataille s’est engagée sur la question de la prostitution considérée comme un délit. Si la prostitution est considérée comme un délit, c’est-à-dire si on ne reconnaît pas à la personne humaine le droit de se prostituer, si on n’admet pas que la location des organes sexuels relève uniquement de la conscience, la police des mœurs se comprend. On accepte du même coup la réglementation de la prostitution, privilège de l’État, gardien de la morale publique.
Mais ce privilège, l’État ne peut l’exercer que grâce à des délégués, à une police spéciale, que sa spécialité même mène à des abus ; d’abord celui de l’arbitraire. La prostitution est plus ou moins tolérée selon les gouvernements, selon les chefs de ces gouvernements, selon les fonctionnaires qu’ils délèguent à l’administration de la police, selon les agents et sous-agents que nomment les fonctionnaires.
Cette tolérance est accompagnée de toutes sortes de tracasseries qui placent en vérité les femmes qui y sont soumises « hors du droit commun ». C’est ainsi qu’elles sont obligées de se faire inscrire à la police, de se faire visiter par un médecin (la visite date du Ier Empire) appointé par celle-ci. Immatriculées, elles ne peuvent que très difficilement sortir de la situation sociale où elles ont été parquées. Il leur suffit de s’être prostituées quelque temps, pour être pratiquement considérées comme exerçant cette profession pendant tout le reste de leur vie. En France, une femme, surprise à se prostituer pour la troisième fois, est immatriculée de force, contrainte à la visite médicale régulière et à toutes les autres obligations dont le commerce de la prostitution est susceptible.
Nous avons fait, ci-dessus, allusion aux tracasseries dont la prostituée est l’objet ; la mesquinerie de ces tracasseries est absurde, et la décrire nous entraînerait trop loin. Dans telle ville, les prostituées peuvent racoler dans la rue ; dans telle autre, elles ne le peuvent pas. Dans certaines, elles peuvent exercer n’importe où leur commerce ; dans telle autre localité, des rues spéciales leur sont assignées. Dans les agglomérations où elles peuvent racoler dans les rues, on concède à chacune d’elle une rue et parfois même une portion de rue. Malheur à celle qu’on rencontre sur le trottoir où il est interdit de faire de la réclame pour leur commerce ! Une condamnation lui est infligée par un fonctionnaire devant lequel elle comparaît sans pouvoir même être assistée d’un défenseur... Il a fallu la croix et la bannière pour obtenir que les délits relatifs au métier de prostituée fussent soumis au tribunal de simple police où l’on peut se faire assister d’un défenseur. « L’autorité délivre patente aux filles, mais grevée de tant d’obligations restrictives qu’elle en devient caduque. Songez que ces demoiselles ne peuvent se montrer ni dans les rues obscures, ni dans les rues éclairées, ni dans les endroits déserts, ni dans les endroits passagers, et qu’il leur est fait défense d’exercer leur métier à domicile, tandis qu’il est interdit aux logeurs de les recevoir. C’est les tenir en perpétuel état de contravention, autrement dit de servitude. » (E. Reynaud, ancien commissaire de police, Mercure de France, 15 mai 1928.)
À certains jours, des rafles ont lieu, où, sous l’inculpation de racolage sur la voie publique, toutes ces femmes sont arrêtées et emprisonnées. On ne sait pas pourquoi on immatricule des commerçantes si ce n’est pas pour les laisser exercer leur métier, ni pourquoi ce qui était permis la nuit dernière ne l’est pas cette nuit-ci. Tout ce qu’on sait – dans une grande ville comme Paris, par exemple –, c’est qu’un peu avant telle grande exposition de blanc d’un grand magasin, on a vu la prison de Saint-Lazare se remplir à la suite de rafles de prostituées, munies ou non de cartes. Par une coïncidence curieuse, ce grand magasin faisait exécuter, en prison, juste à ce moment, des travaux de lingerie à des prix que des femmes du métier n’auraient jamais acceptés.
Et nous n’effleurerons que pour mémoire le chapitre des arrestations « erronées ». N’importe quel agent des mœurs peut appréhender une femme qui s’arrête à causer dans la rue à quelqu’un de l’autre sexe. Il peut affirmer qu’il l’a vue « racoler sur la voie publique », et on a vu des ouvrières et des employées, obligatoirement inscrites sur les registres de la Préfecture de police, sans s’être jamais prostituées. Mais tout cela n’est que le hors-d’œuvre. L’examen des différents systèmes de réglementation de la prostitution montre que c’est aux dépens uniquement du sexe féminin que la répression s’exerce. Et non seulement cela, mais que c’est la femme seule qui est rendue responsable de la contamination vénérienne. Au client qui cherche la commerçante, on ne demande rien. Il peut l’infecter, il n’encourt aucune poursuite. La réglementation de la police des mœurs consacre, de la façon la plus cynique, le système de la double morale, ou plutôt de la double moralité. La vente du plaisir sexuel est considérée comme un délit quant à la vendeuse, mais non quant à l’acheteur. On arrêtera la femme qui racole dans la rue, mais on ne dira rien à l’homme qui se sera adressé à elle le premier. Il est évident que cette paradoxale mise hors du droit commun a choqué des esprits généreux, dont la mentalité n’offre cependant rien de révolutionnaire.
Et, d’abord, la prostitution est-elle un délit ? Dans son rapport au Président de la République française, en juillet 1903, M. Émile Combes, ministre de l’Intérieur, a reconnu « que la prostitution ne rentre pas dans le cadre des actes délictueux et qu’elle n’est justiciable que de la conscience individuelle », qu’on ne pouvait contester « le droit pour l’être pleinement conscient de disposer de sa personne », mais il avait été précédé dans cette voie par les initiateurs du mouvement abolitionniste international, né en pays protestants.
Que veulent les abolitionnistes ? Ramener l’exercice de la prostitution dans le droit commun, abolir le régime d’exception qui procure à l’homme – et uniquement à l’homme – sécurité et irresponsabilité ! Les abolitionnistes maintiennent que l’État n’a pas le droit d’imposer à une femme quelconque la visite obligatoire, sous prétexte de ses mœurs. Leurs voix ont trouvé écho dans certaines contrées protestantes et en Russie, depuis la révolution. Dans ces pays, la réglementation de la police des mœurs a été abolie. Dans les pays catholiques, il n’en est pas ainsi. Mais, en examinant de près le programme abolitionniste, on aperçoit tout de suite l’hypocrisie puritaine qui a présidé à sa rédaction. Sur un point, ils ont raison. Partout où la visite obligatoire a été supprimée, le nombre des malades vénériens n’a pas augmenté, il le semble du moins – un essai fait en Italie n’ayant pas été concluant. Il est vrai que, dans certains pays, au Danemark, par exemple, la déclaration de ces maladies est obligatoire.
Mais ces abolitionnistes sont de farouches partisans de ce qu’ils appellent « la propreté de la rue », des adversaires non moins farouches du racolage, de l’outrage public à la pudeur, etc. Il faut s’entendre. Si la prostitution personnelle et privée ne relève que de la conscience, comme de s’adonner au métier de charcutier ou de modiste, il faut laisser à la prostituée la possibilité de faire son commerce. Ou alors l’abolition de la police des mœurs n’est qu’une hypocrisie, qu’une façon dissimulée d’aboutir à la suppression de la prostitution elle-même. En effet, si vous admettez que le charcutier ou la modiste déploient une enseigne, exposent un étalage, annoncent leur marchandise dans les journaux, il faut admettre aussi que la prostituée puisse faire de même. Sinon, elle est rejetée hors du droit commun. Supprimer la réglementation de la prostitution pour la remplacer par le délit de racolage, substituer à la police masculine des mœurs une police féminine de surveillance des voies publiques, c’est ne rien changer. C’est pourquoi il y a eu, et il y a encore, des arrestations arbitraires, même là où la police des mœurs et la réglementation de la prostitution ont été abolies.
L’abolition de la prostitution est conséquente à une transformation de la mentalité générale, qui n’accordera pas à la femme « mariée » ou de « bonnes mœurs » une situation morale privilégiée, par rapport à la femme « sexuellement émancipée » et « de mœurs faciles ». La disparition des maladies vénériennes est consécutive également à un état d’esprit courant qui n’établira pas de différence entre les affections des organes génito-urinaires et les lésions des autres parties du corps. Dans un sens plus moral, la prostitution féminine disparaîtra quand les rapports amoureux étant considérés comme des relations cimentant la bonne camaraderie entre humains des deux sexes, il ne viendra plus à personne l’idée qu’ils puissent s’acheter ou se vendre.
L’espace dont nous disposons ne nous a permis – on le concevra sans peine – que de parcourir très imparfaitement l’histoire de la prostitution. C’est à peine si nous l’avons envisagée ailleurs que chez les gréco-latins et en France. Il eût fallu décrire ce qu’elle fut, ce qu’elle est encore dans le reste de l’Europe (en Allemagne notamment), en Orient, chez les demi-civilisés. Nous ne voulons pas cependant terminer ce rapide et trop succinct exposé sans quelques remarques :
-
Dans tous les pays civilisés, la prostitution apparaît comme une institution destinée à sauvegarder la chasteté de la femme honnête, que nos mœurs veulent voir arriver « vierge » au mariage. Pour préserver les futures épouses des assauts masculins, la société sacrifie toute une portion de l’humanité féminine. Les femmes chastes naturellement ne savent aucun gré aux sacrifiées de protéger leur chasteté, et oublient que c’est parce que la profession de prostituée est tenue en un si grand discrédit que le mariage acquiert une valeur exceptionnelle. Ce n’est pas ici le lieu de démontrer qu’il n’y a pas grande différence entre le mariage et la prostitution et que, pour attirer un mari, la jeune fille bourgeoise a recours aux mêmes artifices de séduction – toilette, etc. – que la courtisane.
-
Certaines personnes appartenant à des milieux d’avant-garde, et qui tiennent pour une entrave à l’émancipation de l’individualité ce qu’elles appellent la morale des petits bourgeois et des petits rentiers, ont cru voir dans l’exercice du métier de prostituée une émancipation du capitalisme. Nul n’a droit, en société capitaliste, de condamner une prostituée, mais prétendre que cette industrie émancipe, c’est se tromper grossièrement. « N’avoir point de caractère à soi, se revêtir du caractère de son entreteneur » (comme le conseillait une maîtresse de maison, au temps du Directoire), parce que s’il rencontrait de la contradiction, il irait porter ailleurs son argent ; le salarié qui travaille pour un patron, le bandit qui attaque à main armée un fourgon de banque d’État, ne sont pas obligés de descendre jusque-là. L’ouvrier et le bandit peuvent conserver leur caractère propre, là où ils opèrent, à l’atelier ou sur la grande route. Ce n’est pas le cas pour la prostituée, à l’exception de quelques courtisanes de haut parage, et encore !
-
Malgré cela, ne semblent pas supérieurs aux prostituées tous ceux qui, pour gagner de quoi vivre, agissent contrairement à leurs convictions ou à leurs opinions. Du salarié obligé de travailler pour un patron, alors que lui répugne l’exploitation de l’homme par l’homme, au littérateur ou à l’artiste écrivant, peignant, sculptant, jouant la comédie sans but autre que de vendre leur production et relativisant celle-ci au goût de ceux qui peuvent payer : tous sont à un degré ou à un autre des prostitués. Et, comme la prostitution sexuelle, cette prostitution économique entraîne une déformation mentale qui vicie toutes les relations humaines. À qui se prostitue davantage : les honneurs, les situations les meilleures, l’avenir assuré. Tant qu’on regardera comme normal de vendre son effort musculaire ou cérébral, la prostitution des organes sexuels existera. C’est folie de vouloir que celle-ci disparaisse alors que fleurit l’autre. Et c’est ce qui explique l’inutilité de toutes les campagnes contre la prostitution sexuelle publique : elles n’aboutissent qu’à développer la prostitution clandestine ; la plus démoralisante de toutes.
— E. Armand.
PROSTITUTION
Dans l’Antiquité, la prostitution n’est pas méprisée. Elle est en quelque manière une condition supérieure de la femme. Les prostituées ont une certaine culture intellectuelle ; elles savent la musique, la danse, alors que les femmes mariées sont bornées aux travaux du ménage. Leur maison est une sorte de salon que les philosophes ne dédaignent pas de fréquenter. Chez elles, on mange, on boit et on s’amuse ; mais on disserte aussi sur la philosophie, la littérature et la politique. Il en est encore ainsi dans les pays musulmans. La maison des prostituées est ouverte, tout le monde y va. La bourgeoise d’Europe s’y rend avec son mari et ses filles ; on boit du café, on joue de la musique, on chante et on danse. Des jeunes filles des villages africains s’y engagent pour quelques années, afin d’amasser une dot ; après quoi, elles se marieront.
Dans les pays civilisés et notamment dans les villes, la prostitution constitue un métier plus ou moins toléré. Ce sont, en général, des filles du peuple qui deviennent prostituées. Souvent, elles y sont poussées par un amant qui veut vivre en parasite à leurs dépens. Parfois, c’est la paresse ou la débilité intellectuelle qui porte la femme à faire commerce de son corps. Il est dur de se lever tous les matins de bonne heure pour aller à l’atelier ou à l’usine ; il est dur aussi de travailler du matin au soir comme bonne, de subir les brimades d’une patronne énervée. Et quand on a goûté à cet argent gagné si facilement, en une nuit, à faire le trottoir, on y revient et on se laisse aller à en vivre. Mais le plus souvent, c’est la misère qui pousse la femme au trottoir. La société n’est pas encore arrivée à comprendre que la femme doit pouvoir, tout comme l’homme, gagner sa vie en travaillant. On lui offre des salaires insuffisants. Elle doit, pour vivre, compter sur l’aide de ses parents, d’un mari ou d’un amant. Quand elle n’a ni les uns, ni l’autre, il ne lui reste de choix qu’entre la prostitution et la mort.
Ce n’est pas exagéré. J’ai eu à examiner le cas d’une jeune fille qui s’était suicidée par misère ; et sa concierge m’a dit, inconsciente, ces mots révoltants :
« Elle était sage, Madame, bien trop sage !... »
Trop sage ! C’est-à-dire qu’avant le suicide, il lui restait, comme elle était jeune, le trottoir, et qu’elle n’avait pas su en profiter.
La prostitution n’est pas toute sur les trottoirs et dans les maisons de tolérance ; elle a hôtel et automobile. Qui l’alimente ? Des bourgeoises parfois, qui ont perdu leur fortune, des divorcées dont le divorce a amené la ruine, des femmes de petits bourgeois qui vont chercher à la maison de rendez-vous de quoi boucler le budget du ménage. « Pourquoi ne porterais-je pas les robes que je couds pour les autres ? » se dit la midinette de la rue de la Paix. Désir légitime en somme : il faut avoir, pour les blâmer, un mauvais naturel. Malheureusement pour les pauvres filles, la prostitution, comme tous les métiers, a beaucoup d’appelées et peu d’élues : on croit avoir le palace et on a la chambre d’hôtel des boulevards extérieurs.
La guerre, qui a modifié bien des choses, a transformé la prostitution. Les maisons de tolérance n’attirent plus la clientèle et diminuent en nombre. Le nombre des femmes en carte qui font le trottoir tend également à diminuer. La femme a une plus grande liberté sexuelle, et il en résulte que beaucoup se font demi prostituées. Dans le jour, elles ont une profession, parfois une profession libérale : avocate, journaliste, etc. ; et le soir, dans les dancings ou les réunions mondaines, elles se livrent pour de l’argent. Ces nouvelles mœurs sont considérées par certains comme les effets de la démoralisation. Au fond de leur réprobation, il y a l’attachement aux anciennes coutumes ; ils ne comprennent la femme qu’en puissance d’homme : mari, père ou frère. La femme disposant librement de son corps leur apparaît comme une aberration.
Certes, l’argent intervenant dans les relations sexuelles n’a pas pour effet de les idéaliser. Mais il faut se dire que toute l’éducation de la femme est sous le signe de la prostitution. Dès qu’elle se tient sur ses jambes, elle comprend qu’elle doit plaire. On lui apprend la coquetterie ; on soigne ses cheveux, sa mise, on éduque son geste. La spontanéité, le naturel sont bannis ; tout est recherché en vue de l’effet à produire. Recevoir des cadeaux est considéré par la femme comme chose naturelle. Le moindre amoureux est tenu d’offrir un bijou ; dans les milieux les plus modestes, un vêtement, un objet d’utilité. La jeune fille accepte-t-elle une promenade ? Le devoir strict de l’homme est de payer partout. Dans le ménage, la prostitution continue ; l’épouse déploie tout un art de se donner ou de se refuser, pour obtenir ce qu’elle désire ; si le mari se montre récalcitrant, elle est tout à coup malade et, lorsqu’elle accepte, elle ne manque pas de faire promettre :
« Oui, mais tu seras gentil… »
Il faudra bien du temps pour que la femme comprenne que, s’il est indifférent d’accepter des fleurs, il l’est moins de se faire offrir une automobile. Le comprendra-t-elle jamais ? Ce n’est pas sûr, tout au moins à l’heure actuelle, nous tournons le dos à cette ère de scrupule ; notre époque considère que l’honneur n’est qu’un mot, alors que l’automobile est une réalité tangible.
M. X..., médecin de Saint-Lazare, a rencontré dans une maison de rendez-vous une jeune fille qui venait y perdre sa virginité. Elle devait se faire entretenir richement par un parent éloigné, mais le dit parent ne voulait pas prendre la responsabilité de la dévirginiser. Que faire ? Se donner à n’importe qui, pour rien, aurait été, pensait-elle, stupide. À la maison de rendez-vous, un client lui offrait cinq mille francs pour l’opération ; comment ne pas accepter ?
Il ne faut pas oublier, en outre, que la vie de la femme seule est très difficile. La féminisation de certaines carrières ne doit pas faire illusion. Les professions accessibles aux femmes ne sont que de petits gagne-pain, permettant de vivre à la condition de ne se jamais départir de la plus stricte économie. S’il est plus vertueux de se contenter d’un manteau de drap avec un col de lapin, les manteaux de vison et de petit-gris sont bien beaux ! Comment avoir ces richesses autrement qu’en s’adressant à celui qui a l’argent, à l’homme ? Tant que l’homme seul disposera de l’argent, des carrières qui le procurent largement et qu’il sera disposé à acheter la femme, il y aura des femmes qui se vendront. L’argent a toujours été honoré, mais il semble l’être plus que jamais à notre époque. Si la pierreuse est méprisée, tout le monde fait bon accueil à la poule de luxe qui cote à haut prix ses faveurs.
Depuis la guerre, il semble néanmoins que la grande prostituée en titre, celle dont tout le monde connaît le nom soit disparue. Les Otero, les Liane de Pougy n’ont pas fait d’élèves. Il est sans doute des femmes qui gagnent des fortunes avec leur corps, mais elles font en même temps autre chose. Ce n’est pas leur qualité de prostituée qui est en relief ; il faut voir là un pas en avant dans la voie de l’affranchissement de la femme.
On soutient volontiers, aujourd’hui, que la prostitution est un métier comme un autre et qu’il n’a rien de déshonorant. J’accorde ; l’honneur est évidemment une chose dont le territoire est difficile à délimiter. En réalité, on peut dire que l’honneur, aujourd’hui, se confond avec l’argent ; honorable avenue des Champs-Élysées, la prostitution est déshonorante boulevard de Belleville.
Ce qu’on peut dire de la prostitution, c’est que c’est un vilain métier. Il faut se livrer à n’importe qui, souvent à des ivrognes, subir des caresses répugnantes. On attrape obligatoirement la syphilis, qu’il faut soigner toute sa vie et dont on meurt ; on gagne, en outre, toutes espèces de maladies sexuelles ou non. On est conduit forcément à une vie désordonnée, dans un milieu crapuleux, et on meurt prématurément, presque toujours. Aristide Bruant chantait, il y a quelque trente ans :
Faut s’établir Chaussée d’Antin. »
Exercée dans les milieux pauvres, la prostitution est un métier affreux. Carco, dans sa « Rue Pigalle », nous montre la vie lamentable des malheureuses filles de trottoir : vie de misère, de violences, de coups et que vient trancher dans sa fleur le couteau du marlou se jugeant lésé dans ses droits de seigneur et maître.
Que penser de la réglementation ?... Que c’est une législation barbare. Les hommes, pour se préserver des maladies vénériennes, ont imaginé de traiter comme un bétail, une catégorie de femmes. Ces femmes ne commettent aucun délit, car, enfin, personne n’oblige l’homme à suivre la prostituée ; on l’arrête, on la traite abominablement et elle passe en prison un temps variable. C’est un état de choses indigne d’un pays civilisé ; et notez que l’arbitraire ne frappe que la prostituée pauvre ; celle qui demeure avenue de l’Opéra ne va jamais en prison.
La prostitution est-elle utile ?... Oui, dans l’état actuel de nos mœurs. La femme a moins de besoins sexuels que l’homme, et le peu qu’elle en a, la société l’oblige à le réfréner. L’homme a l’habitude de trouver très aisément la satisfaction de sa sexualité, pourvu qu’il ait un peu d’argent. Si on supprimait la prostitution, il n’aurait plus que la ressource du viol ; et les femmes condamnées à la réclusion revivraient l’ancien esclavage.
Malgré l’exutoire que fournit la prostitution, les crimes sexuels, viols, viols suivis de meurtres sont assez communs. Ils sont souvent le fait, soit d’anormaux sadiques qui cherchent dans le sang la satisfaction sexuelle, soit de paysans brutaux vivant d’ailleurs loin de toute maison de prostitution. Si on supprime l’exutoire, les crimes sexuels seront journaliers ; non seulement le perverti, mais l’homme normal seront tentés de satisfaire par la violence le besoin sexuel qu’ils ne pourront plus satisfaire avec de l’argent.
La société future rendra inutile la prostitution : d’abord, parce que la femme, admise dans la production, pourra vivre de son travail ; ensuite, parce que les préjugés sur la vertu féminine, qui consiste à refouler la sexualité quand on n’a pas de mari, auront disparu. La Russie soviétique s’est engagée dans cette voie de la liberté sexuelle ; jusqu’ici, cependant, il semble que les femmes n’y aient pas gagné, bien au contraire. Les hommes, n’étant plus retenus par les lois et la crainte de l’opinion, en usent avec les femmes avec une grande brutalité. L’amour-sentiment aurait disparu, l’union sexuelle ne serait plus qu’un contact éphémère ; l’amant n’est plus un ami. Il faut penser que c’est là un état transitoire. Les couches prolétariennes qui s’élèvent en Russie sont de mentalité grossière ; la marche du progrès affinera leurs mœurs.
La cause de la prostitution ne doit pas être cherchée ailleurs que dans l’esclavage moral et social de la femme : l’affranchissement total du sexe féminin la fera disparaître. — Doctoresse Pelletier.
PROSTITUTION
La prostitution est un commerce très ancien. Mais il n’était pas autrefois un commerce libre ; son profit allait exclusivement au propriétaire mâle de la femme ou des femmes dont les charmes étaient mis en location. C’est une des formes de l’esclavage. Quand des hommes réduisaient d’autres hommes en servitude, ils tiraient le meilleur parti de leurs esclaves en utilisant leurs services suivant leur spécialisation (forgerons, bergers, charrons, etc.). Quant aux femmes, en plus du travail de leur spécialisation comme fileuses, tisseuses, etc., elles avaient aussi, quand elles étaient jeunes et jolies, à réjouir le cœur du maître, en partageant sa couche au gré de ses caprices.
Je n’ai pas l’intention de faire un historique complet, ni de revenir sur la prostitution sacrée, ni sur cette sorte de prostitution hospitalière qui existait dans certaines tribus primitives. Je commence par remarquer que l’indépendance de la femme n’existait pas autrefois, pas plus qu’elle n’existe en Orient aujourd’hui ; donc, il n’y avait pas de liberté sexuelle. La femme était obligée d’accepter passivement son sort, et il semble d’ailleurs que, sauf exception, l’orientation amoureuse, la différenciation sexuelle aient été assez vagues autrefois – et encore aujourd’hui –, ce qui explique l’indifférence pour la vierge d’être mariée à celui-ci ou à celui-là, et réciproquement. Autrefois, les parents vendaient leur fille en mariage, sans que celle-ci eût un mot à dire, et elle était si jeune qu’elle ne pouvait guère se rendre compte. Encore de nos jours, les filles en Orient et en Extrême-Orient sont dans cet état d’infériorité et de soumission complète au chef de famille, et ne font que passer ensuite sous l’autorité d’un mari qu’elles ne connaissaient pas avant. Les hommes non plus, chez les musulmans, ne connaissent pas leur fiancée ; mais les mœurs évoluent depuis quelques décades. Enfin, les bourgeois de notre civilisation moderne, arrangeant un mariage avantageux, ont coutume de dire : l’amour viendra après. Et il arrive, en effet, que chez ces êtres, pour qui l’argent passe avant toute sentimentalité, le mariage crée la reconnaissance sensuelle, le sentiment de protection chez le mari, celui de sécurité chez la femme, et y ajoute les liens qu’apporte la naissance des enfants.
Quoi qu’il en soit, et je le répète, sauf exception, ce qui caractérise l’Antiquité, c’est la passivité de la femme en matière d’amour et le peu de tendance au choix chez le mâle, sauf au point de vue des formes physiques. Le chef, le noble, le patricien, et plus tard l’homme riche, ont un harem de captives de guerre ou d’esclaves achetées, disons un lupanar individuel. La femme de condition libre ne s’appartient pas, sa vertu est sauvegardée par la coutume de la tribu. Même quand la tribu a évolué, que la cité est née, que les familles sont plus indépendantes, la femme est surveillée et protégée étroitement. Elle est toujours sous la domination du chef de famille. Des peines féroces frappent le moindre écart sexuel. À plus forte raison, il est impossible que la femme de condition libre, serait-elle plébéienne, glisse à la prostitution. C’est là une chose inconcevable.
Cependant, les cités ont grandi. En dehors des citoyens, elles contiennent une population hétérogène, des étrangers de passage venus pour un trafic quelconque, d’autres qui s’installent pour plus longtemps ou à demeure, commerçants ou artisans. Impossible pour eux d’avoir des relations sexuelles avec les femmes de la cité, ni avec les esclaves qui sont propriété privée et gardée. Les plus riches s’achètent eux-mêmes des esclaves. Le plus grand nombre n’a rien, ni même la possibilité du mariage ; des aventures, sans doute, avec des femmes faciles du bas peuple, moins surveillées que les patriciennes, et qui ont besoin d’argent. Encore, la dignité de la famille, de tous les citoyens, même les plus infimes, rend ces aventures scandaleuses et dangereuses, tout au moins dans les premiers temps de la République.
II y avait déjà des marchands d’esclaves, allant au loin en quête de marchandise, subornant les filles crédules, enlevant les femmes, ou bien, ce qui fut la règle plus tard, achetant régulièrement filles ou garçons de condition servile contre des produits manufacturés ou de l’argent. Ils fournissaient ainsi les lupanars individuels des aristocrates. Sans doute eurent-ils l’idée d’offrir aux besoins sexuels des étrangers déracinés leurs laissées pour compte ; de créer, avec celles des femmes esclaves qui ne trouvaient pas preneur, des lupanars collectifs à l’usage, non seulement des étrangers, mais aussi de tous les mâles de l’endroit. Si bien que Solon, au moment de la première extension d’Athènes, créa lui-même des lupanars municipaux avec des esclaves achetées à l’étranger (venues d’Asie). Il ne fit que réglementer un état de choses existant, en enfermant la prostitution dans un quartier de la ville sous surveillance officielle et en la taxant au profit de la cité.
La morale sexuelle de ces sociétés, en apparence policées, est sauve devant l’histoire, mais le sort des femmes de la plus basse classe, esclaves et même affranchies, est un martyre. Comment pourraient-elles se soustraire à la lubricité des mâles ? Les guerres incessantes renouvellent le troupeau des captives. À l’époque romaine, les légions ramènent d’un peu partout un butin de fillettes et de jeunes femmes ; les plus belles sont choisies par les chefs pour eux-mêmes ou vendues ensuite pour le harem des gens riches, tandis que les centurions et les soldats vendent leur part aux marchands pour le stupre ou pour le travail forcé. Devant l’extension de la cité et l’afflux d’une population venue du dehors, sans cesse grandissante, les patriciens romains n’hésitent pas, par amour du gain, à organiser eux-mêmes des lupanars, où ils livrent à la prostitution leurs propres esclaves, quelquefois ouvertement, le plus souvent par personne interposée. Cela se passe à l’époque de la République romaine, qui jouit, au point de vue historique, d’une réputation de haute moralité. Les esclaves femelles ne pouvaient ni protester, ni faire de scandale.
Ce qui devient un scandale pour les moralistes et les partisans de la réglementation, c’est quand la prostitution devient libre, quand s’étale au grand jour une débauche qui existait tout aussi bien auparavant, mais dont seules étaient victimes des esclaves silencieuses. Ils imaginent que l’avènement de la prostitution libre est dû à la fermeture des lupanars ; or, ceux-ci continuent d’exister avec leur population d’esclaves. C’est l’inégalité des richesses qui a rompu les cadres de la cité. Il s’est créé toute une catégorie de femmes, intermédiaire entre celle des femmes libres et celle des esclaves : affranchies, filles d’affranchis, parfois éduquées dès le jeune âge en vue de la prostitution, étrangères venues de Grèce, d’Égypte et d’ailleurs, et qui ont lâché leur famille pour vivre leur vie et tenter fortune, filles de petits propriétaires dépossédés, orphelines, jeunes veuves sans appui, plébéiennes désireuses d’une vie de plaisir, etc. La plupart ont été subornées par quelque richard ou quelque fils de famille. Lorsqu’elles ont cessé de plaire, il faut bien qu’elles fassent commerce de leur corps. Celles qui font florès sont celles qui ont quelque instruction et des talents de danseuse ou de musicienne. L’argent arrive à corrompre les mœurs d’une bonne partie des classes libres. Les hommes et les femmes de la classe riche ne connaissent aucun frein à leurs caprices. Les pouvoirs publics interviennent de temps en temps pour essayer de masquer l’étalage de la galanterie et de refouler la prostitution dans les maisons closes. Mais les mesures qui réglementent la prostitution de lupanar ne peuvent s’attaquer aux causes de la corruption des mœurs, qui sont des causes sociales et qui sont les conséquences d’une inégalité excessive.
Le christianisme ne change rien aux mœurs, puisqu’il ne touche pas à l’édifice social. On n’a qu’à étudier les mœurs de Byzance, après la disparition de l’empire d’Occident, pour constater que tout s’y passe comme dans la Rome impériale.
Au Moyen Âge, et au fur et à mesure que les villes se repeuplent, la prostitution se développe de nouveau. Les mœurs assez rudes et la claustration de la femme – mise à l’abri des violences, adonnée aux travaux pénibles et incessants du ménage (boulangerie, cuisine, filage, tissage, couture, blanchissage, etc.) et placée dans une situation d’infériorité – ne permettent pas de liberté sexuelle. La religion et l’éducation morale s’y opposent. Il n’y a de prostitution libre que dans quelques très grandes villes, grâce à l’afflux des étrangers riches. Encore les prostituées libres sont-elles souvent pourchassées par la police, et elles sont obligées, pour se protéger de la brutalité des mâles, d’être sous la domination d’un « maquereau ». Les lupanars, qui ont le monopole presque exclusif de la prostitution, sont des bouges où les femmes sont vraiment les esclaves des tenanciers et dans l’impossibilité absolue de jamais recouvrer leur liberté. Malgré tout, pour la malheureuse qui a fauté et est excommuniée par la famille et par l’opinion publique, c’est tout de même un refuge. Méprisée par les épouses légitimes, pourchassée par les mâles, dont la goujaterie n’a d’égale que l’insolence, elle préfère encore cette vie d’esclavage aux aléas, aux avanies et aux vexations qui sont le lot de toutes celles qui essayent de vivre isolées. Sauf quelques exemples rares de courtisanes riches et indépendantes, dans des milieux de luxe et protégées par le milieu, et dans des moments fugaces de civilisation plus libre.
La femme n’a pas d’indépendance. Elle est sous la domination familiale et économique de l’homme. Il faut arriver jusqu’aux Temps modernes, c’est-à-dire jusqu’à ce que la femme commence à avoir un peu d’autonomie économique, pour voir la liberté sexuelle apparaître et la prostitution se transformer.
Jusque-là, les bordels sont en pleine prospérité. Rien ne s’oppose au trafic des femmes. Les maisons de Paris fournissent la province et une partie de l’étranger. À cause des conditions tout à fait misérables du travail féminin, le recrutement se fait facilement, surtout parmi les filles qui arrivent désorientées de la province. On ne peut guère se représenter aujourd’hui quel pouvait être le sort d’une femme, souvent illettrée, arrivant dans une grande ville, à une époque où il n’y avait ni poste rapide, ni chemin de fer, ni télégraphe, etc. Elle était presque aussi isolée des siens que si elle était allée dans un pays étranger. Une fillette, livrée à elle-même, courait les plus grands risques de tomber dans les pattes d’un proxénète. Même plus tard, vers 1885, les révélations de la Pall Mall Gazette montrèrent qu’il existait à Londres un commerce courant de vierges et de fillettes impubères pour la consommation des riches amateurs. Le scandale fut tel que sous la pression de l’opinion publique et spécialement de l’opinion féminine anglaise, déjà plus éduquée que celle du continent, le gouvernement prit l’initiative de réprimer la traite des blanches et parvint à la supprimer en Angleterre.
* * *
Voilà pour le passé, quand les jeunes filles esclaves ne pouvaient pas échapper à la prostitution imposée par le maître, ou, plus tard, quand les filles isolées ne pouvaient guère se soustraire à la concupiscence des mâles.
Aux Temps modernes, l’indépendance de la femme commence à apparaître, mais une indépendance relative, avec les risques que comporte la liberté, surtout dans une société où l’argent est maître. Si la femme n’est plus sans défense devant la brutalité masculine, on ne peut aller jusqu’à dire que la prostitution soit volontaire. Aucune fille, dans ses rêves, n’a l’ambition ne se prostituer. Elle peut avoir plus ou moins consciemment l’ambition de trouver un mâle à son goût (époux ou amant) qui lui donnera, avec l’aisance ou le luxe, des satisfactions de vanité. Mais aucune n’aura jamais à priori l’idée de se prostituer, c’est-à-dire de vendre son corps sans amour ou sans goût. Pour glisser à la galanterie, il faudra qu’elle y soit amenée ou forcée par les influences et les circonstances du milieu.
Certes, il ya un petit nombre de femmes qui tomberont à la prostitution avec la plus grande facilité et, pour ainsi dire, sans résistance. De même qu’il y en a un petit nombre d’autres qui, en toute circonstance, feront une résistance invincible et préféreront le suicide à la capitulation. Entre ces deux pôles, et allant de l’un à l’autre avec des nuances infiniment variées, oscille la grande masse, l’immense majorité des femmes, plus ou moins influençables dans un sens on dans l’autre, suivant leur éducation, le milieu, les circonstances, les conditions économiques.
Suivant justement ces conditions économiques, suivant qu’on observe un milieu social dans une période de misère ou dans une période de prospérité, les résultats de l’observation sont différents. Dans la cohue misérable des fugitifs, en temps de guerre ou en temps de révolution, dans les périodes de famine, des jeunes filles se vendent pour pouvoir manger. En période de prospérité, et surtout lorsque la femme accède à une certaine indépendance économique, la prostitution a davantage pour mobile le goût des hommages et de la toilette ; elle n’est plus imposée, elle dépend plutôt du caractère. Dans le premier cas, elle est essentiellement un phénomène d’économie sociale, dans le deuxième cas l’influence morale intervient davantage, bien que le recrutement de la galanterie professionnelle se fasse surtout dans les classes déshéritées.
N’y a-t-il pas prostitution à un seul mâle comme il y a prostitution à plusieurs ? C’est cette seconde forme qui est considérée comme la véritable. Mais combien de jeunes filles se marient ou sont mariées, ou se donnent en dehors du mariage à un mâle qu’elles n’aiment pas, afin d’avoir la sécurité et de s’assurer une situation de supériorité comme richesse et comme rang social ? Combien de parents, pour ces mêmes raisons, poussent leur fille à entrer dans le lit légal d’un mari qui lui répugne ? Pourtant, faut-il condamner ces autres parents qui, plus expérimentés que leur enfant, cherchent à sauvegarder son avenir, en la détournant d’une amourette, d’un emballement irréfléchi, et lui conseillent un mari qui sera pour elle un compagnon sûr ? Et d’ailleurs, comment sonder les cœurs ? Comment établir les véritables mobiles, parfois inconscients, qui déterminent une femme à s’amouracher d’un homme riche, prometteur d’une vie facile ? Ne soyons pas absolus dans notre jugement. Mais nous pouvons nous étonner que tant de femmes mariées, qui ne sont à vrai dire que des femmes entretenues, mais légalement, osent juger avec mépris les femmes entretenues sans être passées par le mariage officiel, et englobant dans leur dédain même celles qui se donnent librement par amour.
Si une femme s’éprend d’un homme qui lui paraît supérieur par son prestige physique (force), par son prestige moral (courage), par le prestige de son intelligence ou de sa culture, par le prestige de ses dons artistiques, elle peut tout aussi bien être séduite par le prestige du chef, que ce soit un patron ou un roi. Tant de choses peuvent entrer dans la genèse de l’amour.
Et l’amour excuse tout. Mais ce qu’on appelle prostitution, c’est se donner sans amour ou sans goût à un mâle, afin de participer à ses richesses ou à sa puissance de domination.
Beaucoup de filles ou de jeunes femmes ont au fond du cœur un désir de domination sexuelle. Les romans, les flatteries des hommes dévergondent leur imagination. Elles se placent sur un piédestal, sur le piédestal de l’idole sexuelle. Du point de vue d’un moraliste chrétien, on pourrait dire que cet idéal inconscient de beaucoup de femmes est la cause profonde de leur perdition. Elles croient avoir été créées pour recevoir des hommages. Elles font la grâce de dispenser au mari, ou à l’amant, ou à d’autres encore, leur beauté et leur élégance (et quelquefois leur mauvaise humeur). Elles entendent ne pas partager les soucis du mâle et ne pas travailler. L’idéal des idoles sexuelles est d’être entretenues richement. Elles ont du rôle social de la femme une conception tout à fait erronée. À travers les âges, les femmes, même celles de la classe moyenne, ont toujours peiné à la tâche, quelquefois très durement, en tout cas plus longtemps que les hommes. N’ont jamais vécu dans l’oisiveté que les femmes de la classe opulente et quelques jolies filles de la classe pauvre servant au plaisir de quelques mâles riches. On peut admirer une idole sexuelle comme un objet d’art, on peut s’en servir avec joie pour des fins sexuelles. Elle ne sera jamais une associée, une compagne, ou bien il lui faudra abdiquer son esprit de domination.
Devant l’inégalité des conditions et des fortunes, l’appât des richesses est irrésistible pour certaines personnes. Dans toute autre société, d’ailleurs, il y aura toujours des dames désireuses de s’élever au premier rang dans l’adoration des hommes, et qui n’hésiteront pas à se servir de leurs avantages physiques pour y parvenir, tout au moins pour s’assurer les bonnes grâces et la protection des supérieurs dans une administration, même socialiste, et dans toute organisation hiérarchisée.
Il y a d’autres dames qui préfèrent conserver la considération publique, ou du moins qui ne séparent pas leur ambition de la prospérité familiale. À l’insu ou avec le consentement de leur mari, elles travaillent elles-mêmes à son avancement ou lui conquièrent des honneurs, des avantages, des bénéfices ou des richesses. Que ce soit un patron, un supérieur hiérarchique, un ministre ou un roi que ces épouses vont solliciter, c’est le même mobile qui les pousse. La femme d’un fonctionnaire, qui a des bontés pour le chef de son mari, est comparable en quelque sorte à Mme de Soubise, qui enrichit sa famille des libéralités de Louis XIV, ou à Sarah, femme d’Abraham, qui se prostitua au pharaon (Genèse, chap. XII).
En général, ces femmes sont libres de se prostituer ou non, et c’est même ce qui leur permet de tenir aux mâles la dragée haute et de faire leur chemin dans le monde. Toutes les femmes n’ont pas la possibilité de devenir idoles sexuelles, même à égalité de beauté. Chacune est plus ou moins fixée dans son milieu et par les relations qu’elle peut s’y faire. Il est rare qu’elle puisse s’en évader. Les femmes qui forment le troupeau des esclaves sexuelles, sous la surveillance avilissante de la police, ne peuvent pas sortir de leur catégorie, elles sont véritablement « des femmes perdues ». Si, donc, une jeune prostituée a débuté dans un milieu pauvre, il faut qu’elle se dépêche d’en sortir, sinon elle croupira dans l’abjection. Et comment, par quelles relations pénétrera-t-elle dans les milieux de luxe ? Les proxénètes sont eux-mêmes différents. Et elle est encore trop jeune pour comprendre ce qu’il faut faire, si elle n’est pas sous une protection éclairée. Un engagement dans la moindre revue de music-hall est un moyen de se faire valoir auprès des mâles de la classe riche, et c’est le rêve de quelques jeunes filles qui veulent se faire une place dans le monde. Mais il n’est pas donné à toutes de réaliser leur rêve. Le changement de milieu est donc affaire de chance. Tout dépend du hasard d’une aventure. Le rôle de la chance se fait bien voir dans le cas de ces courtisanes de luxe qui tombent, après une fortune éphémère, dans les rangs de la basse classe ; c’est qu’elles n’ont pas eu assez d’intelligence, ni assez de sécheresse de cœur pour se maintenir là ou le caprice du sort les avait placées.
Donc, l’intelligence a, elle aussi, un rôle effectif dans l’arrivisme d’une prostituée. Non seulement pour se maintenir dans les rangs de la haute galanterie, mais tout aussi bien pour y parvenir. À ce point de vue, on pourrait presque dire que les prostituées de luxe sont des prostituées volontaires, tandis que celles de la basse prostitution se contentent de vivre ; elles subissent leur sort avec passivité, sans rien y pouvoir. Celles qui, intelligentes et ambitieuses, ont commencé dans les bas-fonds se démènent pour capter la chance ; elles multiplient les tentatives, acquièrent de l’expérience, choisissent avec plus de discernement les lieux de plaisir où elles fréquentent, choisissent aussi leur amant de cœur au lieu d’en rester l’esclave, et s’en servent pour agrandir le cercle de leurs relations dans des milieux plus raffinés. (Voir les Mémoires d’Eugénie Buffet.)
Il est à peu près inutile de dire que les cas de réussite sont assez rares. Les malheureuses filles qui végètent dans la basse prostitution restent là où elles sont tombées. Elles ont l’esprit de mollesse, lié le plus souvent à une certaine stupidité (ce qui n’exclut pas la ruse, la ruse des arriérés) ; elles arrivent facilement à la résignation d’abord, à l’indifférence ensuite ; elles se laissent souvent exploiter par un souteneur ou un amant de cœur.
Entre les prostituées intelligentes et énergiques et celles qui sont apathiques ou débiles mentales, il y a toutes les nuances possibles, suivant le degré d’intelligence et suivant la chance. Pourtant, les unes et les autres présentent presque toutes le même caractère commun : elles n’ont pas beaucoup de sentiments affectifs.
Dans le domaine de la morale générale, l’affectivité joue déjà un très grand rôle ; elle sert de lien aux relations humaines et s’oppose aux réactions d’égoïsme antisocial. Dans le domaine particulier de la morale sexuelle, l’affectivité joue un rôle prépondérant. Ce qui donne la suprême joie, dans les rapports sexuels, c’est l’association de la jouissance charnelle et de la communion sentimentale de deux êtres. Quand il y a dissociation entre l’acte et les sentiments affectifs, cet acte devient une corvée. Chez un certain nombre de personnes, surtout chez les mâles, l’attrait physique peut compenser l’absence de sentiments ; mais la satisfaction physiologique obtenue, les plus délicats éprouvent le dégoût d’eux-mêmes et de leur partenaire.
Ces remarques s’appliquent aux gens chez qui les besoins sentimentaux ont pris un certain développement. Une femme, pourvue d’affectivité, se donnera corps et âme à son amant, mais répugnera à se donner à plusieurs. Elle fera donc plus d’efforts pour échapper à la prostitution – sauf si elle y est poussée par l’amant – que celles qui sont indifférentes. « Ça nous coûte si peu, disait Ninon de Lenclos, et ça leur fait tant de plaisir. » Devise d’une femme intelligente, sceptique et volage. Une certaine sécheresse de cœur et l’ambition de devenir une idole sexuelle, alliées à quelque intelligence, voilà les qualités de celles qui, avec beaucoup de chance, savent arriver à une situation enviable dans la prostitution de haut vol, en tout cas qui vivent en indépendance avec le souci des apparences.
Il ne faut pas confondre avec ces femmes, préoccupées du désir de paraître, la jeune fille qui a des relations sexuelles par amour, en dehors du conformisme légal. Par amour, ou même simplement par goût ou par plaisir, mais sans calcul. Tel est le cas de celle qu’on appelait la grisette, il y a cent ans, et qui existe toujours. Elle recherche la vie sentimentale, la tendresse de l’homme ; elle est sensible aux doux propos, aux gentilles attentions. La jeune fille se mettra en ménage avec un camarade de son âge, et, si cet essai ne réussit pas, elle prendra un nouvel amant, et arrivera assez souvent à se fixer, lorsqu’elle aura trouvé une affection sérieuse et un partenaire de son goût, ou lorsque le temps aura atténué le caractère un peu volage de ses propres sentiments. Ou bien la jeune fille, rebutée par la grossièreté de son milieu, prêtera une oreille complaisante aux compliments bien tournés d’un jeune bourgeois, étudiant ou autre, qui lui offrira des distractions et une vie plus gaie que celle qu’elle menait auparavant.
Qui osera jeter la pierre à celles qui préfèrent, comme beaucoup de jeunes garçons, une jeunesse de plaisirs à une vie morne et morose ? Pourquoi faire une distinction entre la morale masculine et la morale féminine ? La plupart des uns et des autres s’assagissent avec le temps et se fixent aux environs de 25 ans. On voit de ces jeunes filles épouser leur amant, dénouement si redouté par les familles bourgeoises. Chez presque toutes, les préoccupations de la vie matérielle l’emportent peu à peu sur le plaisir. Ou bien le désir d’avoir des enfants à choyer et à élever. Elles se mettent en ménage, et font d’aussi bonnes mères de famille que celles qu’on épouse avec leur virginité. Quelques-unes mènent une vie indépendante, tout en ayant des relations avec un ami de leur choix.
Il n’en est pas moins vrai qu’à fréquenter les milieux de plaisirs, les jeunes filles risquent de se laisser peu à peu imprégner par la moralité de l’endroit, d’autant que si elles sont d’esprit volage, elles sont amenées à changer de partenaire, soit par suite d’un mauvais choix, soit à cause du caprice de leur goût. Il n’y a que le premier pas qui coûte. Elles peuvent s’habituer aux mœurs que pratiquent les mâles et à ne pas attribuer d’importance au changement sexuel. Leur mentalité se modifie sous l’influence des flatteries et des sollicitations dont elles sont l’objet de la part des hommes, surtout si elles sont très jolies, et quelques-unes prennent celle des femmes entretenues, pour qui seuls les cadeaux comptent et sont un tribut obligé à leur beauté. Elles peuvent ainsi glisser à la galanterie, si elles sont nonchalantes ou si elles y sont acculées par le chômage.
Nous laisserons de côté la haute prostitution. Les dames qui sont assez intelligentes, assez dépourvues de sentimentalité et qui ont assez de chance pour conquérir une vie de luxe n’ont pas besoin de protection. Elles sont maîtresses de leur corps et elles savent mener les mâles par le bout du nez. Il y aura toujours sans doute des idoles sexuelles.
Toutes les femmes, comme les hommes, sont ou devraient être maîtresses de leur corps, c’est-à-dire de s’accoupler comme il leur plaît, et même d’en tirer profit. L’État considère la prostitution comme un délit toléré, mais ce n’est un délit que pour les pauvresses. Nous ne pouvons nous placer à ce point de vue, d’autant qu’on laisse aux mâles toute la liberté sexuelle.
Entendons-nous sur cette liberté. Seules les grues de haut vol peuvent choisir. Les femmes de la basse prostitution n’ont pas, en réalité, de liberté. Elles ont glissé à leur condition, beaucoup par suite de leur déficience mentale, et toutes par suite de leur infériorité sociale et des circonstances du milieu où elles étaient placées. Le rôle de la société devrait être de protéger les adolescentes et de les empêcher de tomber à la situation lamentable d’esclave sexuelle.
Intervenir après le glissement, c’est trop tard. Une fois tombée à la prostitution, la femme finit par ne plus éprouver ni dégoût, ni honte. Si quelques-unes se tirent hors de l’esclavage sexuel, ce n’est pas pour aller ou pour retourner à la servitude et à l’insécurité du salariat, puisqu’elles estiment que leur métier leur donne plus de profit et plus d’agrément. Il faut bien comprendre que l’habitude a changé leur façon de voir. L’habitude, pour elles encore, est une seconde nature.
Quelles sont les causes qui favorisent l’acheminement à la prostitution ? La puberté produit un certain déséquilibre dans le caractère et peut inciter la fillette non surveillée à des coups de tête dont elle sera la victime, dans les conditions sociales actuelles. Non pas que les sens soient éveillés, sauf chez quelques anormales qui présentent d’ordinaire, en même temps, de l’arriération mentale. On a remarqué, en effet, que ces arriérées ont souvent un développement sexuel précoce. Le sensualisme, plus précoce et plus accentué chez elles que chez les jeunes filles normales, n’étant pas contrôlé et freiné par l’intelligence, par une intelligence suffisamment développée, en fait de très bonne heure les victimes du premier malotru venu et, quelquefois, les proies des trafiquants de chair humaine. Prostituées et souvent délinquantes, ces malheureuses sont envoyées en maison de correction, quelques-unes plus tard en prison ; et elles achèvent de se corrompre dans ces établissements officiels. De toute façon, même si elles ont échappé aux mésaventures judiciaires, la paresse, l’insouciance, l’apathie les maintiennent dans la pratique habituelle de la prostitution ; elles peuplent les maisons de tolérance ; elles n’ont pas d’autre métier. Et leur ignorance, leur inintelligence, leur irresponsabilité en font les meilleures propagatrices des maladies vénériennes.
Mais toutes les autres adolescentes sont, elles aussi, exposées, si elles ne sont pas protégées. À la puberté, la fillette devient coquette, elle cherche à attirer l’attention masculine, elle est déjà une demoiselle, alors que le garçon n’est encore qu’un gamin qui n’a que rarement l’occasion et l’audace de passer à l’offensive de l’acte sexuel. La fillette, elle, n’a pas besoin d’être préparée à l’acte, elle n’a qu’à le subir. Elle est étonnée et flattée qu’un adulte, qui lui paraît bien supérieur par son âge, par sa situation lui fasse la cour, qu’un Monsieur lui présente ses hommages. Elle s’imagine connaître la vie, et cette prétention péremptoire la rend sourde aux avertissements. À cet âge tendre, beaucoup de fillettes ont besoin d’être protégées contre leurs imprudences et contre les tentatives de mâles lubriques. À vrai dire, il n’y a que le premier pas qui coûte, et l’habitude peut être vite prise par des fillettes irresponsables qui ne savent où elles s’engagent. La vie paraît si simple, elles sont courtisées et reçoivent des cadeaux. Mais encore, si elles sont capables de faire le saut toutes seules, faut-il, pour glisser à la prostitution, que le milieu, que l’entourage soient pour elles un encouragement, ou qu’elles soient entraînées par l’amant.
Les enquêtes faites à ce sujet montrent que, dans l’ensemble, les prostituées ont été déflorées entre 13 et 16 ans, c’est-à-dire au début de la puberté, quand la fillette n’est capable de faire aucun choix et qu’elle est une proie facile pour un mâle sans scrupules. Ce sont ces jeunes personnes qui fournissent d’ordinaire le troupeau des prostituées. Elles n’ont pas encore eu le temps de se créer une personnalité. Elles sont souvent peu intelligentes, ou en tout cas sans éducation, ou avec l’éducation d’un milieu spécial. Que feraient-elles en dehors du commerce de leurs charmes ? Elles n’y songent même pas, elles s’adaptent étroitement à ce genre de vie qu’elles continueront jusqu’à leur mort ou à la déchéance complète, à moins que des circonstances exceptionnelles ne les tirent du milieu.
Plus avancées en âge, de quelques années seulement, elles seront mieux averties et ne succomberont pas si facilement, ou bien ce sera quelquefois, brutalement, sous le coup de causes extraordinaires, comme un bouleversement social, une crise économique violente, des chutes individuelles dans la misère. La plupart des femmes, qui ont été ainsi amenées à se prostituer après 20 et surtout après 25 ans, n’en prennent pas toujours irrémédiablement l’habitude. Elles en tirent ressource provisoire et accessoire, ou bien ce sera le moyen pour elles de satisfaire leurs ambitions.
Donc, pour éviter la chute dans la galanterie, la protection de l’adolescente est nécessaire, une protection affectueuse, c’est-à-dire surtout la protection maternelle. Or, dans un milieu tout à fait misérable, si, en outre, les parents sont alcooliques, s’ils sont très prolifiques – ce qui va ordinairement ensemble –, qui prendra le temps et la peine de s’intéresser à la conduite d’une fillette ? L’enfance a besoin d’être protégée. Or, dans ce milieu, la question de nourriture passe au premier plan : il faut vivre, et les aventures sexuelles n’ont pas beaucoup d’importance. La défloraison est souvent précoce ; elle est la conséquence d’amusements risqués avec des garçons du même âge. Sans compter les cas ou la mère, la sœur aînée sont débauchées, la promiscuité fait disparaître toute pudeur, la pudeur qui est la première réaction de défense de la vierge. La fillette a hâte de s’évader d’une famille où les liens affectifs n’existent pour ainsi dire pas, où la vie est pénible. L’ignorance de tout métier la met dans un état complet d’infériorité sociale. L’influence de camarades vicieuses, de quelques voisines dévergondées n’est pas contrariée ou empêchée par l’affection familiale. Le manque de scrupules des mâles fera le reste.
Ajoutez à cela l’envoi en apprentissage beaucoup trop tôt, l’initiation perverse de l’atelier, etc. La démoralisation se fait par l’affrontement de deux morales : celle de l’adolescence, naïve, imaginative et généreuse, et celle des adultes, réaliste, ironique et cynique. Et puis il y a l’exemple et l’encouragement de camarades plus âgées, qui, ayant des mœurs mercantiles et se sentant plus ou moins consciemment dans un état d’infériorité morale, cherchent à faire du prosélytisme parmi les jeunes. Sans compter, parfois, le maquerellage de quelques patronnes ou contremaîtresses.
Certaines professions exposent, plus que d’autres, les adolescentes. Dans quelques-unes (métier de mannequin, etc.), où les jeunes filles sont obligées d’avoir quelque élégance, interviennent l’insuffisance des salaires féminins et les tentations. Dans d’autres, les femmes sont soumises directement aux sollicitations des mâles (filles de salle, domestiques, etc.). Et, ici, la cause principale est l’immoralité des patrons. Ce sont eux qui sont responsables de la tenue de leur maison. Il y a des maisons bien tenues, et d’autres où le patron, afin d’attirer la clientèle, favorise les entreprises des galants. Il faut aussi faire entrer en ligne de compte la lubricité des patrons eux-mêmes, qui cherchent à abuser de leur autorité pour assouvir leurs désirs. Et, enfin, dans le glissement à la galanterie, il faut considérer le rôle du suborneur, des proxénètes de toute espèce, y compris le jeune homme « du meilleur monde » qui entraîne la jeune fille dans les lieux de plaisir, dans les dancings, où la prostitution est considérée comme un moyen normal de gagner sa vie ; car l’opinion publique, l’opinion d’un milieu donné est le fondement de la morale de ce milieu.
Dans ces milieux de plaisir, l’alcoolisme joue un certain rôle, enlevant aux hommes et aux femmes le contrôle de leurs actes, les mettant à la merci de leurs impulsions, tout au moins faisant disparaître leurs hésitations. L’alcoolisme a encore un rôle plus général dans la genèse de la prostitution, car il est souvent la cause des familles nombreuses, il jette les fillettes hors du foyer familial intenable, il est responsable aussi de l’arriération mentale chez un certain nombre d’enfants.
L’excessive inégalité sociale place les jeunes filles de la classe pauvre dans une situation d’infériorité vis-à-vis de la concupiscence des hommes riches, et quelques-unes d’entre elles se laissent séduire par le désir d’une vie facile. Mais, s’ajoutant à toutes les conditions qui influent pour entraîner les adolescentes à la prostitution, le facteur le plus efficace de démoralisation est le manque de protection et l’isolement, agissant d’autant plus que les filles sont plus jeunes. Les grandes agglomérations urbaines réalisent le mieux cet isolement et y ajoutent les tentations. N’oublions pas, parmi les isolées, les jeunes filles qui viennent du fond de la province chercher du travail dans une grande ville, surtout celles qui sont sans métier, par conséquent mal armées pour l’existence.
Aujourd’hui, la femme peut pourtant mieux se défendre contre les entreprises brutales du mâle. Si elle tombe à la prostitution, c’est d’ordinaire sans y être contrainte directement. Celles qui aiment les aventures se contentent de passades espacées, si elles ont un métier. Et celles qui glissent à la pratique courante de la galanterie préfèrent la maison de rendez-vous à la maison close, où pourtant l’esclavage à vie n’existe plus. Cela se comprend bien ; ce sont seulement les aléas et la dureté des temps et des mœurs qui peuvent obliger un être humain à aliéner sa liberté. Ainsi, la forme même de la prostitution se modifie.
De leur côté, les hommes préfèrent de beaucoup conquérir une femme ou avoir l’illusion de la conquête. Les mœurs ont changé. Les brasseries de femmes ont disparu depuis longtemps, les maisons de tolérance ont diminué dans une proportion considérable. Le racolage n’existe plus à Paris qu’aux alentours des Halles et dans quelques rues mal famées. Les rencontres se font dans les dancings, les maisons de rendez-vous. La prostitution tend à devenir libre, elle n’est souvent qu’un moyen accessoire de se procurer des ressources complémentaires, destinées principalement à la toilette.
Dans une société encore plus évoluée, où ne sévirait plus l’inégalité économique avec son cortège de privations et de servitudes, les fillettes seraient sans doute mieux protégées, en ce sens que le besoin de gagner la vie ne forcerait plus les parents à les envoyer beaucoup trop tôt en apprentissage, où elles affrontent, non sans danger, la moralité des adultes. La plus grande réforme contre la prostitution serait de continuer l’instruction et l’éducation des adolescents jusqu’à la possession complète de leur profession, en même temps que d’une culture générale, et qu’on ne traitât pas autrement les étudiants techniques et professionnels (qu’on appelle les apprentis) que ceux ayant choisi la carrière des lettres ou des sciences. Si, parfois, quelque fillette faisait une escapade, elle ne risquerait plus d’en subir, comme aujourd’hui, des conséquences extrêmes et imméritées, et de tomber sous la surveillance de la police. Les essais amoureux comportent toujours un risque, mais ils ne sont tout à fait dangereux que dans les cas d’infériorité sociale, surtout dans une société mercantile. Les femmes adultes seront sans doute plus libres que maintenant de se comporter à leur gré, elles ne seront plus obligées de se prostituer. Le mercantilisme ayant disparu, l’attrait sexuel où intervient souvent la supériorité de l’amant (supériorité physique, ou intellectuelle, ou sociale) pourra s’exercer librement. Les femmes qui sont folles de leurs corps auront le pouvoir, comme aujourd’hui certaines dames de la classe riche, de choisir leur partenaire.
Mais la liberté sexuelle, déjà de plus en plus grande, comporte le risque de la diffusion des maladies vénériennes. C’est pourquoi beaucoup de moralistes, abandonnant la vieille pudibonderie religieuse, d’ailleurs souvent hypocrite, mettent en avant la santé publique, et, croyant la sauvegarder, réclament le maintien des règlements de police et celui des maisons de tolérance. Le procès de la police des mœurs – organisation de contrôle de la prostitution – n’est plus à faire ; elle est une ignominie. Ce n’est pas sortir du cadre de cette étude – car les prostituées, d’abord, sont ses victimes – que de rappeler ici les vices de l’institution, l’aberration de ses agents, leur fréquente abjection, leurs procédés souvent crapuleux.
La police des mœurs a été instituée, non pour combattre la prostitution, considérée comme un mal inévitable et même comme une profession utile, mais pour protéger les honnêtes gens, c’est-à-dire en majorité les fêtards, contre les insolences et les chantages des prostituées. C’est pourquoi, si elle protège les maisons de tolérance comme une institution sociale, elle entend tenir aussi les autres prostituées sous sa coupe, grâce à des règlements qui lui donnent un pouvoir absolu (pouvoir d’arrestation sans mandat et droit d’incarcération sans jugement). Pratiquement, les filles galantes sont ainsi soumises au bon plaisir des policiers qui surveillent leurs allées et venues, leur interdisent l’entrée des promenades et des établissements de bon ton (la courtisane de luxe peut passer partout), les arrêtent et les emprisonnent à la moindre incartade, ou supposée telle, laissant les unes racoler ouvertement et empoignant celles qui n’ont pas l’heur de leur plaire, sous le prétexte d’un délit imaginaire. Les agents des mœurs, qui, certes, n’ont pas postulé leur emploi pour des raisons de haute moralité et qui n’ont pas été choisis non plus pour leur intelligence, se trouvent chargés d’un service d’autorité sur des êtres privés de défense et ne pouvant leur opposer que la ruse ou le cynisme. Ils exercent leur fonction d’une façon arbitraire. La plupart le font sous la forme d’un système de terreur, soit par excès de zèle à l’encontre d’un troupeau méprisable, soit par sadisme, soit pour profiter gratuitement des faveurs des persécutées. Plus d’un va jusqu’à monnayer le commerce des filles qui, subjuguées, se vendent à son profit. Dans certains pays où la prostitution est interdite, celle-ci se pratique très bien, mais la prostituée doit payer une redevance aux agents des mœurs pour qu’on la laisse tranquille. Aucune protestation possible. Qui irait ajouter foi aux accusations d’une telle femme ?
Ce qui explique la psychologie et la conduite des gens en général, et des policiers en particulier, vis-à-vis des prostituées, c’est le mépris. On se croit tout permis à l’égard d’êtres méprisables et peu intéressants. Paul Valéry a marqué quelque part qu’il faut nécessairement mépriser les gens pour s’employer à les réduire. Il parlait des indigènes coloniaux, et tel est en effet l’état d’esprit de nos sous-officiers conquérants, traitant les Rifains de salopards et tout autre indigène de cochon et de saligaud. Le docteur Rousseau a noté le même état d’esprit chez les surveillants et administrateurs du bagne ; le mépris que ces gens-là ont des condamnés les amène à légitimer à leurs propres yeux tous les abus de pouvoir qu’ils commettent journellement, les mensonges, les vols et les concussions, la cruauté et le sadisme. Exploiter une prostituée apparaît donc comme tout à fait légitime. L’argent qu’elle gagne est de l’argent mal acquis, qu’elle jette ensuite par les fenêtres ; et elle le gagne si facilement. L’exploitation de ces malheureuses femmes paraît presque être considérée comme une revanche, au jugement de la plupart des mâles, et surtout des mâles qui constituent la brigade des mœurs. La pitié n’entre pas plus dans l’âme d’un proxénète que dans l’âme d’un policier ; et à ce point de vue, leur mentalité est la même.
Chair à plaisir, chair à subir. Comment pourrait-elle se défendre contre les vexations ? Dans toutes les institutions humaines, une autorité qui n’est jugée que par elle-même, sans que les assujettis aient aucun moyen de faire entendre une réclamation, fût-ce indirectement, et quand il n’y a qu’une seule garantie, théorique et illusoire, le contrôle des supérieurs sur les agents, cette autorité aboutit toujours à la pratique normale des abus. Les chefs se contentent de veiller à ce qu’il n’y ait pas de scandale, et ils ne s’aperçoivent pas que le véritable scandale est l’existence même de leur notoriété et de leur fonction.
Et le pouvoir discrétionnaire de la police ne s’arrête pas encore là. Il fait, lui aussi, le recrutement de la prostitution sous prétexte de moralité publique. Il opère l’arrestation des jeunes filles, peut-être légères, amoureuses du plaisir et des tendres propos, désireuses de passer leur jeunesse en joie, comme le font les jeunes garçons. Une fois arrêtées, c’est leur mise en carte, tout au moins à bref délai, et leur incorporation forcée dans l’armée des prostituées. Sans compter les erreurs et les abus de pouvoir. Bien des scandales ont été dénoncés par la Ligue des droits de l’homme. Le scandale véritable est la mise en carte. C’est l’effroi des débutantes, des irrégulières, de celles qui cèdent de temps en temps au plaisir et au profit de l’aventure, mais qui n’en ont pas l’habitude. Elles savent qu’immatriculées elles font définitivement partie d’une caste à part, surveillée et méprisée. Il faut qu’elles-mêmes acceptent un nouvel état d’esprit, rejettent toute espérance et prennent leur déchéance comme une condition normale. Et c’est peut-être cette acceptation qui scelle le caractère définitif de leur situation.
Ainsi la police, au lieu de combattre la prostitution, ne fait qu’étendre son domaine. Son idéal bureaucratique serait certainement de tenir sur ses registres et à la merci de son arbitraire toutes les femmes en situation irrégulière. Danger pour la sécurité publique, conflit entre le régime soi-disant de protection et le régime de liberté, il est vrai que la moderne police des mœurs prétexte le souci de la santé publique. Illusoire prétention...
En effet, la prostitution dite clandestine (où elle englobe d’ailleurs la liberté sexuelle) échappe de plus en plus à la répression. Les mœurs ont changé. Si les statistiques, souvent tendancieuses, semblent montrer que les bordels fournissent peu de maladies vénériennes, c’est que ceux-ci sont de moins en moins nombreux : 32 à Paris, 7 à Marseille. Leur persistance tient en grande partie à l’existence des garnisons militaires. Et l’observation médicale montre qu’on peut tout aussi bien qu’ailleurs y contracter syphilis et blennorragie, dans les moments d’affluence, quand les clients se succèdent sans interruption. La visite de santé hebdomadaire n’est nullement une garantie.
En réalité, la prophylaxie des maladies vénériennes dépasse amplement le débat sur les lupanars et sur la police des mœurs. Tandis que les maisons closes tendent à disparaître, la liberté sexuelle, de plus en plus grande, pose le problème pour toute la population. D’où la nécessité de l’éducation médico-hygiénique du public.
Le danger est que cette éducation ne porte pas sur les arriérées mentales, indifférentes et irresponsables. Les profanes ne savent distinguer, et pas toujours, que la grande aliénation mentale. Les juges et les policiers considèrent comme des paresseuses invétérées et comme des vicieuses de pauvres femmes qui sont des déséquilibrées, des instables ou des apathiques. Une enquête, faite par des médecins psychiatres, a montré que les neuf dixièmes des jeunes prostituées emprisonnées à la Petite Roquette sont des enfants arriérées. Il faudrait dépister les arriérées de bonne heure, avant l’âge de 7 ans, les placer en internat dans des écoles spéciales, et plus tard les protéger, spécialement les adolescentes, contre les aléas de la vie sociale. Toutes les adolescentes doivent être protégées, mais la protection doit être plus stricte quand il s’agit de fillettes anormales, et cette protection n’est actuellement réalisée que dans les familles aisées. Ainsi, de quelque façon qu’on envisage le problème, l’argent et l’inégalité apparaissent comme les causes sociales qui favorisent la prostitution.
— M. Pierrot.
PROTECTORAT (et Colonisation)
n. m.
« Les colonies étaient considérées, à l’origine, comme destinées exclusivement à l’utilité et à l’enrichissement de la métropole. » (Larousse)
Lorsque les Phéniciens fondèrent Carthage et les autres comptoirs de la Méditerranée, c’était dans une unique pensée de lucre ; commerçants avant tout, ils cherchaient le profit. Lorsque les marins espagnols et portugais du xve siècle allaient à la découverte de la route des Indes, ils n’avaient pas d’autre but que de s’enrichir. Lorsque l’Angleterre et la France (lire : la bourgeoisie mercantile des deux pays) se disputaient l’Inde et l’Amérique du Nord, c’était le riche marché de ces pays qui était l’enjeu de la lutte. Et lorsque, au cours du xixe siècle, toutes les nations dites civilisées se partagèrent le monde, c’était avant tout le besoin de débouchés qui poussait le capitalisme à se jeter avidement sur ces pays dits « neufs », riches de matières premières, de main-d’œuvre à vil prix, et prometteurs de consommateurs innombrables.
Actuellement, les 2/5 de la population terrestre sont « colonisés ». Les colonies occupent la moitié des terres qui couvrent la surface du globe.
Des trafiquants de Tyr aux modernes nations colonisatrices, en passant par les conquistadors et les négriers des siècles derniers, il n’y a qu’une différence de degrés. Le but poursuivi n’a jamais varié : le profit. Seulement, aux époques dites barbares, l’occupation de la colonie se faisait sans fard, en vertu de la raison du plus fort. Au fur et à mesure du progrès des idées humanitaires, le besoin de voiler désormais de sophismes ce droit du plus fort devient de plus en plus impérieux (car, lorsqu’on va au fond des choses, le « droit » n’apparaît pas ; il n’y a que crime et vol). De ce besoin découlent les idées de « peuples arriérés », de « missions civilisatrices », de « races inférieures » et de « races supérieures ». Et l’on aboutit à ce paradoxe, par exemple : l’Inde et la Chine, berceaux de la civilisation véritable, colonisées et civilisées (!) par la barbarie occidentale.
Jusqu’au xixe siècle, il est communément admis qu’un peuple qui se sent fort peut conquérir un pays plus faible. Première phase ; on dit : conquête de la Gaule, conquête du Canada, conquête de l’Algérie. Non seulement la force prime le droit, mais elle le légitime. Puis vient la période des tiraillements. La « conscience universelle », nouvellement créée (lire : la lassitude des prolétaires à servir continuellement de chair à canon pour des buts qui ne sont pas les leurs, puis le désir des conquérants de camoufler adroitement aux peuples colonisés l’occupation étrangère) a besoin d’apaisements. C’est alors qu’on s’arroge le droit de « protéger » un pays qui ne demande pas à l’être.
Deuxième phase ; on dit : protectorat (Tunisie, Annam, Cambodge, Maroc). Enfin, après l’effroyable boucherie de 1914–1918, s’inscrit la troisième phase. Wilson a passé là. On a lancé « le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ». Cependant, les colonies des vaincus, et même certaines parties de leur propre territoire sont bien tentantes. Heureusement qu’il est, avec la « conscience universelle », comme avec le ciel, des accommodements. On crée les « pays de mandat » (Syrie, Grand Liban, Cameroun, Togo).
Que ce soit en pays conquis, protégé, ou de mandat, la colonisation est partout la même ; c’est l’exploitation féroce des indigènes et du sol et c’est l’enrichissement de quelques requins omnipotents. Pour avoir une idée nette, prenons, par exemple, comme protectorat type, le protectorat français sur la Tunisie. Pénétrons au cœur du pays. Après cinquante ans d’occupation, que voyons-nous ?
I. Le fellah
Sous un ciel admirable, dans le cadre grandiose des hauteurs tourmentées de l’Atlas, ou dans les vastes plaines des contrées de céréales, le fellah a dressé son gourbi ; hutte primitive à peine plus confortable que la caverne des hommes préhistoriques. Il y vit avec sa femme, ses enfants, son chien, quelques poules. Il est là, misérable khammès (métayer) attaché à la glèbe pour la vie. Voici ce que dit de lui Élisée Reclus (Tunisie, p. 282), et son sort n’a pas varié depuis :
« L’esclavage est aboli depuis 1842, même avant qu’il l’eût été officiellement dans l’Algérie voisine ; mais nombre de journaliers indigènes, les khammès ou colons « au cinquième » qui labourent les domaines des grands propriétaires sont de véritables serfs tenus, comme ils le sont, par les avances que leur font les maîtres et qu’ils paient à intérêts usuraires, sur la part de récolte qui leur est attribuée. La famine a souvent sévi sur les populations de la Tunisie, si grande que soit la fertilité naturelle de la contrée ; pendant l’hiver 1867 à 1868, les mosquées et les zaouïas étaient emplies de faméliques, et chaque matin on allait y ramasser les cadavres par charretées. »
La misère ! Le mot ne pourra jamais évoquer la chose dans sa brutale réalité. P. Vigné d’Octon, dans son livre si courageux, La Sueur du burnous, dit, p. 112 :
« En réalité, si l’on considère que les fellahs réduits par nous à la famine représentent les trois cinquièmes au moins de la population tunisienne, il y a plutôt lieu de s’étonner que les actes de brigandage soient aussi peu nombreux dans la régence, depuis Bizerte et Tunis jusqu’à Gabès et Nefta. Et pourtant, je le répète, à côté de la misère des meskines, celle qui poussa les « Jacques » à l’assaut des châteaux et des couvents n’était rien. »
Parfois, le meskine n’a pas même un gourbi, mais une simple tente. Voici par exemple ce que vit Vigné d’Octon dans une de ces tentes (p. 127) : « Dans le fond, un fantôme dont la nudité osseuse se montrait sous des haillons, et dont le regard phosphorescent avait cette expression d’angoisse qu’ont les yeux des bêtes mourant de faim ; c’était sa femme. Accroupie sur une natte crasseuse, le seul meuble de la tente avec une cruche de grès et deux écuelles de bois, elle plongeait un bout de son sein cadavéreux et ridé dans la bouche d’un enfançon pareil aux fœtus livides qui nagent dans les bocaux.
« Comme elle n’avait pas une seule goutte de lait, l’enfant crispait ses lèvres verdâtres et laissait retomber sa tête, sans avoir assez de force pour pleurer. Une légion innombrable de mouches volaient autour de ces deux squelettes, allant des commissures du petit aux orbites caves du grand. »
On va dire : c’est l’exception. On va crier à l’exagération ; mais il n’en peut être autrement. Le khamnès devrait percevoir le cinquième de la récolte ; en fait, c’est à peine le vingtième qu’on lui donne. En outre, il doit payer l’impôt dont le plus inique est la medjba ou impôt de capitation, baptisé « taxe personnelle » depuis quelques années, le même pour tous, riches ou pauvres. À cet impôt viennent s’ajouter les nombreuses taxes ou amendes plus ou moins occultes prélevées par tous ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de sa perception. Le fellah, par le seul fait qu’il vit, est pris dans un engrenage sans fin de dettes, qui le rivent au sol jusqu’à sa mort.
On trouve, dans les naïves cantilènes – le meskine a parfois le cœur à chanter, tant il est vrai qu’on s’attache à la vie, si dure qu’elle soit –, l’écho de son sort douloureux :
Tu seras le khammès d’un maître
Dont le cœur sera noir, noir,
Comme la terre que tu remueras.
Et toi aussi, pour manger tu le voleras.
Dors ! dors, mon petit !
Car lorsqu’on dort on n’a pas faim. »
(Noté par Vigné d’Octon.)
À la misère s’ajoute la maladie. Et on peut imaginer aisément les hécatombes d’êtres humains qui se produisent périodiquement parmi ces populations sous-alimentées. Le meskine est la proie toute désignée du paludisme, du typhus et du choléra, qui sont à l’état endémique dans le pays.
Et comme si tout cela ne suffisait pas, pour compléter le malheur des meskines, la conscription vient enlever tous les ans les plus beaux gars du pays. Quand on les leur prend, ils pleurent, ces misérables ; ils pleurent comme des enfants eux-mêmes. Ils voudraient retenir de toutes leurs forces celui qu’ils aiment. Et leur souffrance est immense, car rien ne vient l’adoucir. Qui a vu une seule fois l’explosion de leur désespoir ne peut jamais l’oublier. Et qui connaît l’exploitation, la misère et la mort – œuvre des maîtres – qui désolent ce pays, par ailleurs si beau, s’il n’a pas le cœur endurci, se sent envahi par un sentiment profond de révolte et de pitié.
II. L’appareil administratif : cheiks et khalifas, caïds et contrôleurs civils, résident et bey.
Pour maintenir la masse des indigènes dans l’esclavage le plus complet, pour pouvoir pressurer le meskine jusqu’à l’ultime limite de ses forces, il existe un appareil administratif féroce, prêt à tout.
Il comprend (administration indigène) :
-
les caïds ;
-
les khalifas et les cheiks.
Le régime du protectorat a ajouté :
-
les contrôleurs civils (qui « contrôlent » – théoriquement – les actes des caïds et de leurs subordonnés) ;
-
le résident général, représentant de la France auprès du bey.
Le cheik est le fonctionnaire de base, modeste en apparence, mais au rôle essentiel. Il est en rapport constant avec ses administrés qu’il connaît intimement. Il sait la composition de chaque tribu, de chaque douar. Il suit les nomades dans leurs déplacements et peut dire d’une façon sûre combien telle tribu peut « suer » en impôts, en réquisitions de bétail, en hommes pour l’armée. C’est lui, d’ailleurs, qui se charge de taxer chacun et de recouvrer les sommes demandées. Jusqu’à quelles limites ? C’est simple : le meskine doit donner, à peu de chose près, tout ce qu’il produit : donc, le cheik lui prendra tout. Oh ! légalement : le fellah ne doit que la medjba (taxe de capitation), l’achour (impôt sur les céréales), le kanoun (impôt sur les oliviers et palmiers) et le zekkat (impôt sur le bétail) ; quatre petits impôts sans importance qui suffiraient à le maintenir dans son éternelle misère. Mais le cheik, s’il ne se contentait que de percevoir ces taxes légales, ne ferait pas son beurre ; le métier ne vaudrait rien. Profitant de ce que l’Arabe est illettré, il remet des reçus du tiers, du quart ou de la moitié de la somme versée, et fait ainsi régulièrement payer les impôts deux fois, au moins. Et l’Arabe paie... jusqu’à la saisie.
C’est alors que le cheik s’efface et laisse agir son supérieur : le khalifa. Celui-ci, impitoyable, avec l’aide de spahis, cerne le douar, se saisit des meskines, leur passe de lourdes chaînes aux mains et rassemble le bétail. Après des exactions sans nombre (injures, coups de crosses, viols parfois), on pousse sur la route le lamentable troupeau humain et les bêtes affolées, et on conduit le tout au caïdat. Ni les cris, ni les pleurs des femmes, ni les appels à la clémence et à la raison des vieillards, ni la détresse des petits enfants ne touchent le terrible khalifa. Puisqu’on n’avait plus d’argent à lui donner, c’est le pillage légal des meskines ; tant pis pour eux !
Du produit de leurs infamies, cheiks et khalifas vivent grassement. Aussi leur emploi est-il très disputé, malgré qu’au-dessus d’eux se trouve un supérieur insatiable aussi : le caïd – lequel est à son tour « contrôlé » par le contrôleur civil, représentant la France des Droits de l’homme et la République. Alors, le mécanisme est simple quand on sait que l’argent domine tout ; le candidat cheik arrose copieusement le jardin du caïd et celui du contrôleur en s’efforçant de faire mieux que son concurrent (qui arrose aussi). Le plus fort l’emporte. Celui-ci ne manque pas, par la suite, d’entretenir la grande bienveillance que lui portent ses chefs ; et cela se passe le plus aimablement du monde dans une avalanche de dons et de cadeaux, dont les meskines font tous les frais.
Le caïd, dans son caïdat, est maître quasi absolu de la liberté et de la vie même de ses administrés. Il dispose d’une force armée (spahis) et de prisons, souvent infectes, dans lesquelles il tient enfermé sans jugement et pour un temps indéterminé tout fellah qui a déplu. Malheur au meskine qui s’est laissé prendre à commettre un larcin, à faire paître ses brebis dans le domaine d’autrui ; malheur à lui s’il ne s’est pas soumis assez rapidement au caprice d’un colon ! Qu’il paie ! Sinon, c’est la prison, accompagnée de châtiments corporels ; et c’est parfois la mort par la sous-alimentation et les maladies (typhus). S’il paie, il peut recouvrer sa liberté. Tout se vend et tout s’achète, là-bas. Tel caïd qui a brassé des millions dans ce fructueux commerce finit un jour décoré de la Légion d’honneur. Les contrôleurs, complices de ses crimes, l’ont « contrôlé » en partageant avec lui les profits. Et il en est partout ainsi – à de rares exceptions près.
Au sommet de l’échelle se trouve ce souverain gâteux : le bey, « contrôlé » lui-même par le résident général. Mais on sait maintenant ce que veut dire « contrôler ». Et les dépenses énormes faites par l’un et par l’autre dans la ville d’été de La Marsa sont une insulte permanente à la misère immense des meskines du bled.
Et rien ne vient mettre un frein à toutes ces vilenies. Le Parlement croupion, appelé Grand conseil (représentant des colons et des fonctionnaires) n’est institué que pour décorer la façade. Le régime du « Protectorat » reste, pour le peuple qui en crève, la plus sinistre des farces.
III. Colons et compagnies minières. Les juifs.
Les juifs et les grands colons achèvent l’œuvre néfaste de l’appareil administratif, en portant à son comble la misère des fellahs. Et les bédouins disent, quand on les interroge sur leur sort :
« La sauterelle est un démon, le siroco en est un autre, ça ne fait jamais que deux ; mais les caïds, les contrôleurs, les grands colons et les juifs représentent tout l’enfer déchaîné par la colère d’Allah sur le bled. »
Quand on se reporte à la période de l’occupation de la Tunisie, un nom vient aussitôt à l’esprit, et c’est celui d’un « grand » homme d’État de notre IIIe République : Jules Ferry. Certes, la bourgeoisie eut raison de dresser sa statue à Tunis sur la belle avenue qui porte son nom. Elle lui devait bien cela. Dès 1881, il donna le signal de la curée. Financiers et directeurs de journaux (il fallait faire l’opinion), après le refoulement des tribus, achetèrent d’immenses domaines. Pour des prix variant entre 0,25 franc et 10 francs l’hectare, la Société marseillaise eut le domaine de l’Enfida (120 000 hectares). De la même façon, se constituèrent le domaine de Crétéville (1 600 hectares), de Rhédir-Soltane (3 000 ha), de Bow-Rebia (1 000 ha), etc. L’indigène fut dépouillé au profit de Mougeot, ancien ministre des P.T.T. et sénateur (scandale des terres Sialines, etc. Total : 12 000 ha) ; au profit de la famille de l’historien Taine (4 000 ha) ; au profit du directeur du Temps, A. Hébrard, et de son associé Paul Bourde (10 000 ha) ; au profit, enfin, de politiciens, sénateurs ou députés et anciens ministres comme Boucher (3 000 ha), Cochery (10 000 ha), Hanotaux (2 000 ha), Chaumié (3 000 ha), Krantz (5 000 ha), Pedebidon (10 000), Chailley-Bert (30 000 ha), Chautemps (4 000 ha). (Vigné d’Octon : La Sueur du burnous, p. 269.)
Un autre homme auquel le ventre des requins aurait dû être reconnaissant (on lui dressa un buste, il y a quelques années, à Tunis, mais il mourut pauvre), c’est Thomas, « l’inventeur » des phosphates tunisiens. Ce vétérinaire principal des armées découvrit, en effet, les riches gisements de Gafsa. Une fortune incalculable, qui se trouvait dans les terres stériles du Sud, se dressa ainsi tout à coup devant les yeux éblouis des pirates. Y mettre la main dessus fut l’affaire d’un instant. Par trois petits décrets, on déposséda les tribus, et ces terres, classées comme terres mortes ou terres collectives, devinrent propriété d’État. Le jugement du tribunal mixte disait :
« Les indigènes tunisiens (qui se prétendent lésés par les décrets) n’auraient jamais pu tirer parti des richesses minières de leur sous-sol ; par conséquent, leurs titres de propriété n’ont jamais pu s’appliquer à cela. En leur faisant dire aujourd’hui le contraire, le tribunal mixte, auquel incombe la tâche de les appliquer et de les interpréter, leur donnerait à tort une portée qu’ils n’ont jamais pu avoir et substituerait des conceptions imaginaires et fantaisistes au véritable état de choses. En faisant cela, non seulement il manquerait à son devoir, mais encore il créerait un obstacle à la colonisation de la Tunisie, en reconnaissant sur son sol à la population indigène des droits qui ne lui ont jamais appartenu. »
Ainsi donc, l’indigène est spolié. À peu près tout ce qui a une valeur est passé entre les mains des grands colons et des compagnies anonymes. Il reste à exploiter ces richesses.
MM. les ministres et sénateurs plus haut nommés n’ont pas, comme bien l’on pense, tenu la charrue. La grande culture s’est installée, et l’Arabe, pour vivre, a été obligé de suer pour le plus grand profit de ses nouveaux maîtres. Et puis on a songé (car nous sommes en Res-Publica !) à installer de petits colons dans le pays. Trop tard ! Plus de terres. Pourtant, si : en regardant bien, ici et là, chez ces messieurs, il y a quelques hectares de terres salées, quelques carrés insalubres ou rocailleux. L’hectare acheté par eux au prix que l’on sait est racheté par le gouvernement, de 100 à 500 francs. Et l’État le revend une deuxième fois, avec bénéfice, au petit agriculteur qui, venu de France, apporte avec lui quelques capitaux dans l’espoir de faire fortune. Hélas ! Combien y en a-t-il de ces malheureux qui ont englouti leurs économies dans l’achat de terres, de matériel, dans des constructions dans le bled désolé ? Combien y en a-t-il qui ont défriché, défoncé, peiné sous les siroccos ? Puis sont venues les années de sécheresse, les maladies, la misère... Enfin est venu le juif qui a prêté à 20, à 30 pour cent, et il est resté maître de tout !... Il a mis des khammès sur cette terre et c’est lui qui, exploitant l’indigène, a récolté en définitive le fruit des premiers efforts du petit colon. Protectorat !... Colonisation !... Le mirage est trompeur. Ah ! Qu’il se garde bien, le petit agriculteur français, de partir pour les « colonies » ; les pires déceptions seraient, bien souvent, la rançon de son imprudence.
Qui douterait maintenant que MM. les actionnaires des grandes sociétés minières (Saint-Gobain, Mokta-el-Hadid, etc.) n’aient su tirer profit de leurs immenses richesses ? Les tribus dépossédées et refoulées ont fourni une main-d’œuvre à vil prix. Des Kabyles, des Tripolitains, des Marocains, des Russes, tous ces faméliques que le bled ne peut nourrir forment un troupeau corvéable à merci. Ils triment de longues journées pour un morceau de pain. L’exploitation est féroce. Les moindres essais de résistance sont brisés sans pitié. Pas de syndicats. Des haines soigneusement entretenues dressent entre eux tous ces déchets du prolétariat. En certaines mines, on emploie les condamnés aux travaux publics, forçats qui fournissent un rendement assez élevé pour des frais insignifiants ; en d’autres mines travaillent aussi des enfants, venus des douars voisins, à des besognes exténuantes. La vie dans les mines est une atroce géhenne.
Quant au juif, il est partout, innombrable comme la sauterelle. Aux années de disette, il s’en va, doucereux, placer ses billets. Vous lui faites vraiment trop d’honneur d’accepter son argent. Il prête... il prête. Le lui rendre ? Allons donc, rien ne presse. D’ailleurs, n’est-il pas votre ami ? Enfin, voici une récolte magnifique (ce qui arrive tous les trois ou quatre ans). Pardon, le juif l’emporte, vous la lui devez. Des fellahs sont ainsi dépouillés, de riches familles indigènes aux chefs insouciants sont même ruinées, sucées par cette pieuvre jusqu’à la dernière goutte de sang.
De quelque côté qu’on se tourne, il n’y a place honorable, dans ce pays de protectorat, que pour les grands flibustiers et les Shylock. Ceux qui produisent, pressurés, volés, meurtris, forment la partie la plus lamentable de la grande cohorte de la douleur humaine.
IV. Le mouvement social. La religion. L’école. — Dans les pays coloniaux et en Tunisie, en particulier, les colons sont partisans de la politique du talon de fer. Leur raisonnement est simple : l’Arabe ne respecte que la force, donc soyons les plus forts et nous resterons les maîtres. Un chamelier encombre-t-il la route ? Un journaliste de Stax a écrit à ce sujet :
« Le premier chaouch venu devrait l’amener au khalifa qui lui ferait administrer cinquante coups de bâton. Ce serait fait en dix minutes et le bicot ne reviendrait pas de longtemps à encombrer la route. » (Vigné d’Octon, p. 243)
Un indigène cueille-t-il un raisin dans la vigne du colon ? Deux coups de fusil dans la poitrine ! (Cas : Abdallah ben Mohammed Nadji, à Oued-el-Katif.) Et le journaliste d’écrire :
« Vouloir enlever au propriétaire, déjà éprouvé par les intempéries, les sauterelles et maints fléaux, le droit de garder ses récoltes, le fusil en main, c’est vouer la colonisation à un échec certain. L’Arabe des campagnes, brute fanatique et sauvage, ne connaît que la peur. La justice française, avec ses bénévoles condamnations, sa loi de sursis, sa douce prétention pénale, il s’en rit. Ce qu’il craint, c’est la self protection pratiquée par l’individu.
« C’est l’application de cette loi de self protection qui, seule, a permis aux nations civilisées de s’implanter dans les pays primitifs. Quelle colonisation eût été possible dans les pays de l’ouest américain si la loi de Lynch n’avait été pour les honnêtes gens une sauvegarde contre les entreprises des coquins ? » (pp. 243 et 244)
À la veille du cinquantenaire de l’occupation (25 septembre 1930), La Tunisie Nouvelle pouvait signaler encore le fait divers suivant :
« Mardi dernier, le jeune Ahmed ben Mohammed ben Romdam a reçu une décharge de plusieurs coups de feu tirés par un colon, à Henchir M’riziga, près de la Mohammedia, parce que des bêtes appartenant au jeune indigène auraient mis le pied sur un terrain appartenant au dit colon.
« Quand il tira ces coups de feu qui atteignirent le jeune homme aux cuisses et aux jambes, le pionnier de la civilisation était confortablement assis à l’intérieur de sa voiture automobile.
« Le blessé, dont l’état est grave, a été admis à l’hôpital Sadiki, tandis que son protecteur et civilisateur jouit toujours de sa liberté d’attenter à la vie d’autrui, car les journaux d’information qui nous ont relaté cet « incident » n’ont pas dit qu’il a été arrêté.
« Au fait, vous ne le voudriez pas ! »
Tout ceci peint bien la mentalité des grands colons.
Et ce sont ces magnats qui sont écoutés en haut lieu. C’est, en effet, la politique de la force qui prédomine. Quand il arrive parfois qu’un administrateur se montre libéral envers les indigènes, il faut entendre le chœur des rapaces le maudire. Être arabophile, c’est avoir le pire des défauts.
Parallèlement aux mouvements sociaux de Turquie et d’Égypte, s’est constitué parmi la bourgeoisie riche et instruite le parti « Jeunes Tunisiens », qui a végété pendant un assez long temps, mais qui semble avoir pris un peu de vigueur depuis la guerre. Intellectuels en général bouffis d’orgueil, nationalistes forcenés, ces « Jeunes Tunisiens » n’ont, au fond, qu’une ambition : remplacer l’administration française par la leur et continuer de faire suer le burnous à leur profit. Politique éternelle de tous les partis, pépinières d’arrivistes. Est-il besoin de dire que le fellah ne gagnerait rien au triomphe de leur cause ? Préoccupés surtout de leurs petites affaires, ils boudent ou flagornent les maîtres, selon les contingences du moment. Ils ont réclamé le Destour (la Constitution), au passage de Millerand dans les souks de Tunis ; ils ont fait le vide devant lui quand il visita La Marsa, la ville résidentielle ; mais ils restent indifférents devant la navrante misère des meskines. Et ceci les condamne, irrémédiablement.
Les partis politiques français, transplantés en pays de protectorat, ressemblent à ces palmiers rabougris et tristes que nous gardons en pots sous notre ciel brumeux de France. Le parti radical possède, en Tunisie, une ou deux douzaines de membres. Le parti socialiste est plus florissant. Sa clientèle se recrute surtout chez les fonctionnaires ; mais son influence sur la masse indigène est infime. Les chefs, d’ailleurs, n’ont pas le courage – ou le désir – de se rapprocher des meskines, sans éducation et jugés dangereux par leur fanatisme. Ils se méfient des indigènes comme ils se méfient du pouvoir. Gens prudents, leur activité se consume en parlotes, banquets et désirs bêlants de réformes démocratiques.
Le parti communiste est, en fait, hors la loi. Pas de presse. À la suite de divers « complots contre la sûreté de l’État », les militants ont été chassés du sol tunisien. Ce parti n’a jamais eu grande influence sur les masses ; mais il est certain qu’en raison des idées qu’il véhicule, en un milieu surtout où la propriété collective des terres a existé depuis des siècles, il aurait pu agir, à plus ou moins brève échéance, comme un ferment susceptible de soulever la majeure partie des indigènes exploités.
Le mouvement syndicaliste se développe parallèlement à celui de France : sections tunisiennes de la C.G.T. (la colonisation transposée dans le plan syndical) ; quelques éléments de la C.G.T.U. Il y a eu, en 1925, un essai de groupement des forces prolétariennes indigènes dans une C.G.T. tunisienne. Les meskines des ports, des usines et des mines affluaient dans la jeune C.G.T. Le gouvernement du Protectorat a écarté ce danger sérieux en envoyant Jouhaux combattre ce mouvement et en emprisonnant le secrétaire et animateur : Mohammed Ali,
L’arbitraire règne d’ailleurs en souverain sur la Tunisie. Les gêneurs sont proprement embarqués sur le prochain bateau dès que le résident général le juge bon. Ceci en vertu d’un édit du roi Louis XVI, de juin 1778 ! Par cet édit, le roi autorisait les consuls de France, dans les Échelles de Barbarie et du Levant « à faire arrêter et renvoyer en France, par le premier navire de la Nation, tout sujet français qui, par sa mauvaise conduite et ses intrigues, pourrait être nuisible au bien général ».
L’édit a été appliqué en 1922 et 1924.
Pour renforcer cet arbitraire, deux décrets du 29 janvier 1926 sont venus encore supprimer toute liberté de pensée.
1° Un décret sur la presse :
« Tout journal ou écrit périodique qui aura encouru pour délit de presse, en la personne de ses propriétaires, directeur, gérant, rédacteurs, ou dans celle de l’auteur d’un article inséré, une condamnation correctionnelle, même non définitive, soit à l’emprisonnement, soit à une amende de 100 francs au moins, soit à des réparations civiles supérieures à cette somme, sera tenu, dans un délai de trois jours à partir de la condamnation, et nonobstant opposition, appel ou recours en cassation, de consigner à la caisse du receveur général des Finances, une somme égale au montant des frais, amendes et réparations civiles, s’il en a été prononcé. En cas de condamnation à l’emprisonnement, cette consignation ne pourra être inférieure à 500 francs par jugement de condamnation intervenu. À défaut de consignation, la publication cessera. »
2° Un décret sur les crimes et délits politiques :
« Article 4. — Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans, et d’une amende de 100 à 3 000 francs quiconque, par des écrits, des actes ou des paroles, publics ou non :
-
provoque à la haine, au mépris ou à la déconsidération du souverain, du gouvernement et de l’administration du Protectorat, des fonctionnaires français ou tunisiens chargés du contrôle ou de la direction du gouvernement ou de l’administration du Protectorat, ainsi que des ministres français ou tunisiens investis des mêmes attributions ;
-
cherche à faire naître dans la population un mécontentement susceptible de troubler l’ordre public.
« Article 5. — Le concert arrêté par deux ou plusieurs fonctionnaires publics en vue de faire obstacle par voie de démission collective ou autrement à l’exécution d’un service public est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans. »
Inutile de souligner le caractère odieux de tels décrets.
Et les meskines, que pensent-ils ? Quelles sont les aspirations des bédouins de la tente ou du gourbi ? Illettrés, saturés de pratiques religieuses, ils ont l’âme des vilains des époques médiévales. Ils se résignent, car le paradis d’Allah les attend. Cependant, parfois, la vie est la plus forte, et de l’excès de leur misère sourdent de naïves révoltes. On les leur fait chèrement payer. Et la religion est, là-bas comme ailleurs, à la base de leur asservissement. « Il faut au peuple un dieu par les prêtres fourbi. » Fortuné pays qui en possède au moins trois : le dieu du Coran, Jéhovah d’Israël et l’ineffable Éternel, dont la succursale de Rome essaie de placer la camelote. Les affaires ne vont pas mal, chaque membre de ce consortium ayant sa clientèle propre. Notre sainte mère l’Église se distingue même particulièrement dans l’accaparement d’immenses richesses (Carthage, domaines, subventions d’État, etc.), et elle se moque et de la misère des meskines et des autorités du Protectorat, comme elle l’a bien fait voir lors du congrès eucharistique de Carthage (1930).
Arrivé au terme de notre étude, une réflexion que nous avons souvent entendue nous revient en mémoire. On dit :
« Nul ne peut nier que l’occupation française ait apporté d’énormes progrès dans nos colonies. Économiquement, le pays a été totalement transformé ; il y a davantage de bien-être matériel. Malgré les excès qui ont pu être commis, notre civilisation a pénétré chez ces peuples moins avancés, et ceci est un résultat qui justifie la colonisation. »
D’abord, comme nous le savons, il est faux qu’on colonise pour « civiliser ». On colonise pour s’enrichir.
Et puis qu’est-ce que civiliser ? Est-ce industrialiser un pays et y transporter des méthodes d’exploitation de plus en plus américaines ? Le dernier mot est-il de rationaliser la production dans des bagnes infernaux ?
Certes, il y a des routes, des chemins de fer, des mines en pleine exploitation, des usines, des avions, des casernes, des arsenaux, des bistrots, des lupanars. Répétons les paroles de M. Violette, ex gouverneur de l’Algérie :
« Il y a une admirable façade de richesses, mais les indigènes sont dans un état pitoyable. »
Et ce n’est pas pour nous étonner ; n’est-ce pas « notre » civilisation que nous avons importée là-bas ? Notre civilisation que nous connaissons si bien dans la métropole, et dont les travailleurs sont les victimes ?
Quant au « progrès », il ne peut s’agir que du progrès intellectuel et moral, c’est-à-dire de l’évolution vers plus de liberté, vers une émancipation de plus en plus large des esprits. Or, ce progrès est si lent à constater qu’on ne peut pas l’évaluer dans une si courte période qu’est un siècle, ou même moins, d’occupation. D’ailleurs, il est des périodes de régression dans cette marche vers le progrès. Admettons pourtant qu’il y ait progrès, pourrions-nous affirmer qu’il résulte du fait de la colonisation ? Ne serait-il pas dû simplement au mouvement des idées qui emporte les peuples dans un formidable tourbillon, passant par dessus toutes les frontières, par dessus toutes les formes de gouvernement ?
Et constatons que, malgré la volonté des maîtres de l’heure, ce travail d’émancipation se prépare, et cela au sein même des organismes que les maîtres ont créés pour assurer leur sauvegarde. Phénomène bien connu : toute société oppressive portant en elle-même ses propres fossoyeurs. Nous dirons donc, pour finir, un mot sur l’école qui est, à notre avis, l’instrument le plus puissant – malgré tous les défauts que nous lui connaissons – de cette ascension vers le vrai.
Tout homme ouvrant un livre y trouve une aile, et peut
Planer là-haut où l’âme en liberté se meut. »
(Victor Hugo)
Nous n’ignorons point pour quelles fins on multiplie (oh ! à une cadence très honnête) les écoles en Tunisie et dans les autres pays de protectorat, mais il est certain que, dès que l’indigène sait lire, il arrive parfois qu’il pousse son éducation bien au-delà de l’étude des textes officiels dans lesquels on voudrait qu’il se confinât. Les indigènes envoient volontiers leurs enfants, garçons et filles, à l’école française. Ces élèves sont souvent de bons petits écoliers très studieux. Quand ils savent lire, les parents – avec juste raison – en sont fiers. Lire, cela permet de connaître la substance plus ou moins aride des décrets et des lois et de mieux se défendre contre les abus de pouvoir ; mais cela permet aussi d’assimiler les textes autrement féconds des grands penseurs de l’humanité.
Voilà pourquoi, malgré l’enseignement officiel du Coran dans les écoles d’État, malgré la parcimonie avec laquelle on distribue cette instruction, malgré la forme même qu’on lui imprime, la « civilisation » capitaliste sème les germes de la société plus libre, plus harmonieuse, plus fraternelle qui, un jour, la remplacera.
— Ch. Boussinot.
PROTÉONISME
En 1887, le professeur Raphaël Dubois (élève de Paul Bert), titulaire de la chaire de physiologie générale et comparée à l’université de Lyon, fut amené à définir sa conception scientifique nouvelle de la vie et choisit le néologisme « protéon » pour désigner le principe unique, à la fois force et matière, grâce auquel tout, dans l’Univers, apparaît, se transforme, évolue, disparaît.
À cette époque, toute la science était encore imbue des idées dualistes, et c’est pour éviter la confusion avec le monisme limité de Haeckel, avec le matérialisme, avec le spiritualisme, que R. Dubois nomma sa philosophie nouvelle « protéonisme ».
C’était la renaissance, sous une forme scientifique, des conceptions unicistes anciennes de la Grèce, de l’Égypte, de l’Inde, relativement à l’Aither, et aussi la concrétisation du panthéisme de Spinoza, de la théorie de l’identité de Schelling, du devenir de Hegel.
Pendant plus de vingt ans, le protéonisme sommeilla, défendu cependant par les plasmogénistes comme Herrera, Kuckuck, Victor Delfino, etc. Mais les travaux retentissants de Becquerel, de Curie, de G. Lebon démolissent toutes les vieilles conceptions sur la matière et donnent à cette philosophie un regain d’actualité. Le protéonisme oublié renaît sous le vocable d’énergétisme et devient à la mode. Tous les travaux modernes sur les atomes, la chaleur, la lumière, l’énergie, la radiation, confirment les thèses du grand pacifiste scientifique.
R. Dubois fut un vrai révolutionnaire et un penseur libre en un temps où l’enseignement public sortait à peine des mains des églises, où le créationnisme dominait, où la préparation de la guerre était à l’honneur ; ce fut un précurseur hautain, cinglant, incompris, auquel la bourgeoisie ne pardonna pas. Par-delà les frontières d’un monde étroit et divisé, il devinait dans l’avenir la Terre unie et les peuples réconciliés, travaillant scientifiquement au bonheur universel.
Voici ce qu’il écrivait à propos du protéonisme, dans ses Lettres sur le Pacifisme scientifique et l’Anticinèse, peu de temps avant de mourir, bien oublié des officiels, mais aimé de ses amis et élèves pacifistes du monde entier, auxquels il a ouvert de larges horizons sur la physiologie, la vie universelle et les conceptions biocosmiques dont il fut un des premiers défenseurs :
« Je ne suis pas matérialiste, pas plus que je ne fais profession d’être spiritualiste. J’ai introduit le monisme nouveau, ou néo monisme, dans l’enseignement officiel, bien avant qu’Haeckel ait généralisé son monisme primitif, lequel faisait dériver l’homme de la monère et n’allait pas au-delà. Pour moi, force et matière ne sont que deux aspects d’un principe unique, le protéon, qui, par ses innombrables et incessantes métamorphoses, donne à la Nature son infinie et merveilleuse variété. Rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout évolue sans cesse, partout, en nous comme en dehors de nous, selon des lois dont la connaissance nous est permise par la science et dont l’insubordination, consciente ou inconsciente, bien souvent fruit amer de l’ignorance, n’en comporte pas moins de terribles sanctions, dont la guerre n’est pas la moindre. Voilà ce que j’enseignais à mes étudiants, bien avant la découverte du radium et les démonstrations des savants qui ont établi définitivement que la matière n’est que de l’énergie compacte. Mais ils ont eu le tort de donner le nom d’énergétique, qui prête à confusion, à ce que j’avais appelé protéonisme, pour bien marquer qu’il s’agissait d’une doctrine philosophique nouvelle. »
Ainsi, dans le domaine biologique et philosophique universel, R. Dubois fit, il y a 45 ans, l’union entre matérialistes et spiritualistes, à peu près comme, de nos jours, notre ami Georges Kharitonov, qui démontre dans la Synthanalyse que l’émission, la radiation, l’ondulation, la mutation, etc., sont des aspects divers du même phénomène tourbillonnaire de la vie générale, en réconciliant ainsi les défenseurs divers de Newton, de Fresnel, de Maxwell, de Planck, dans une nouvelle synthèse universelle qui servira de base à des conquêtes humaines scientifiques et pacifiques en éternelle évolution.
— J. Estour.
Bibliographie. — R. Dubois : Leçons de Physiol. génér. comp., Masson, 1898, Paris ; Naissance et évolution du Protéonisme ; La Vie universelle, vol. I, pp. 21, 41, 62, 107, 128, 198 (Bulletin de l’Association internationale biocosmique) ; Lettres sur le Pacifisme scientifique et l’Anticinèse, Delpeuch, 1927 ; Qu’est-ce que la Vie ? Conférence radiophonique 14 septembre 1924 (La Science et la Vie.) — J. Thibaud : Spectroscopie de haute fréquence et nature de l’atome, avril 1926 (La Science et la Vie).
PROTOPLASMA
n. m. (du grec prôtos, premier ; plasma, matière façonnée)
Les progrès réalisés dans la construction des microscopes, au xixe siècle, ont permis d’observer les tissus vivants à des grossissements de plus en plus considérables. Le perfectionnement des fixateurs et des colorants, ainsi que la division en coupes très minces ont encore grandement facilité la tâche des histologistes. Et, comme on modifiait la substance vivante en la tuant, on est même parvenu à l’examiner sans altérer ses éléments, grâce à des dissections d’une délicatesse extrême. Quand Schwann déclarait, en 1832, que tous les tissus étaient des assemblages de cellules, ce n’était qu’une hypothèse ; de patientes recherches, poursuivies depuis, ont montré qu’il s’agissait d’une vérité générale que l’on devait étendre à la totalité du règne végétal comme du règne animal. En outre, il existe une multitude d’êtres unicellulaires que les microbiologistes étudient avec soin. Poussant plus loin, on a prouvé que les cellules des tissus les plus différents présentaient entre elles et avec les cellules microbiennes une remarquable unité de composition. D’une façon générale, chacune d’elles est limitée par une fine membrane qui renferme une matière visqueuse, le protoplasma, contenant lui-même un corps plus réfringent, le noyau.
L’anatomie détaillée de la cellule fait aujourd’hui l’objet d’une science spéciale, la cytologie. Formée de protoplasma plus consistant, la membrane a quelquefois l’aspect d’une pellicule colloïdale très nette ; dans d’autres cas, la cellule manque de limites bien distinctes. Quant au noyau, son apparence est très variable, selon les cellules et les moments. Limité par une membrane, il est constitué par une matière colloïdale assez fluide, le suc nucléaire, où se trouvent des granulations de formes différentes et avides de couleurs basiques, les grains de chromatine, ainsi qu’une autre granulation, le nucléole, très sensible, au contraire, à l’action des colorants acides. Le protoplasma a l’aspect d’une masse transparente et homogène qui renferme diverses particules en suspension. Mais sa complexité est si grande et la gamme de ses variétés si étendue que Rabaud déclare qu’il y a « non pas un protoplasme, mais des protoplasmes, d’innombrables protoplasmes ». Au point de vue chimique, il renferme du carbone, de l’hydrogène, de l’oxygène, de l’azote, du soufre, du phosphore. En dernière analyse, il apparaît comme une combinaison de matières albuminoïdes et d’acide nucléique : les premières sont des composés complexes de carbone, d’hydrogène, d’oxygène, d’azote et de soufre ; le second, un composé complexe de carbone, d’hydrogène, d’oxygène, d’azote et de phosphore. Le protoplasma, la membrane, ainsi qu’une partie du noyau sont des combinaisons basiques ou neutres d’albuminoïde, à l’état de saturation ou en excès, avec de l’acide nucléique. Par contre, la chromatine renferme de l’acide nucléique en excès. Comme les nucléo albuminoïdes, constitutives de l’ensemble, sont à l’état colloïdal, l’eau joue un rôle de premier ordre dans les continuelles transformations du protoplasma. Le Dantec affirmait :
« La vie est un phénomène aquatique. »
Lorsqu’elle se putréfie, la matière organique donne finalement de l’eau, de l’ammoniaque, du gaz carbonique, du phosphure d’hydrogène qui produit les feux follets des cimetières, du gaz sulfhydrique dont on connaît la mauvaise odeur.
On trouve différentes sortes de filaments et de grains dans le protoplasma colloïdal. Certains sont des éléments inertes, c’est le cas des vacuoles à contours plus ou moins nets et des grains de sécrétion ; d’autres, les mitochondries, sont des éléments très actifs. C’est par l’étude des colloïdes, base essentielle de la substance protoplasmique, que l’on pénètre le plus profondément dans le secret de la vie. L’état colloïdal (c’est-à-dire pareil à de la colle) apparaît comme intermédiaire entre la suspension dans un liquide et la solution normale, qui suppose les molécules du corps dissous uniformément distribuées et petites. En effet, il exige que ces dernières soient très grosses ou qu’elles forment des agrégats, les micelles, dont les propriétés annoncent déjà celles de la matière vivante. Parmi les micelles jouissant d’une activité particulièrement considérable, signalons les granulations zymasiques ou ferments solubles qui, à des doses infiniment petites, provoquent les divers genres de réaction chimique vitale. Ainsi, la présure fait coaguler, sans se détruire, deux cent cinquante mille fois son poids de caséine du lait. Ce sont des agents physico-chimiques catalytiques. L’instabilité des colloïdes est en rapport avec la mobilité incessante de leurs granulations. Raphaël Dubois (l’un des plus grands biologistes de notre époque, qui voulut bien me témoigner de l’amitié) écrit :
« D’où un brassage interne très complexe, car la forme et l’intensité des mouvements granulaires n’est pas la même pour toutes les granulations. Ils varient surtout avec les charges électriques que possèdent toujours ces dernières. Si ces charges électriques sont égales et de même signe, les granulations se repoussent, comme les boules de sureau d’un électromètre, et se tiendraient en équilibre stable si, à chaque instant, ces charges ne se modifiaient sous l’influence des agents extérieurs, d’où rupture d’équilibre et translation, agitation incessante. Bien plus, les charges peuvent changer de signe, les granulations de signe contraire se précipitent alors les unes vers les autres, produisant une sorte de coagulation qui porte le nom de « floculation », comme lorsque le lait vient à tourner. Si cette floculation se forme dans les capillaires du cœur ou du cerveau, c’est la mort subite. Mais elle peut être lente, passagère ou progressive, et c’est la maladie ou bien la vieillesse. Ce phénomène ne peut s’effectuer que par la déshydratation, c’est-à-dire par la séparation plus ou moins complète de l’eau et des granulations. »
Pour Raphaël Dubois, comme pour d’autres savants connus, la vieillesse est un dessèchement, un racornissement progressif et continu qui, finalement, entraîne le ralentissement oscillatoire des granulations et de toutes les fonctions qui en dépendent. Plusieurs, il est vrai, attribuent à des causes différentes le dépérissement progressif et la mort naturelle de l’organisme qui a pu échapper à toutes les causes accidentelles de destruction. Mais les recherches sur l’état électrique du protoplasma offrent, sans aucun doute, un puissant intérêt. Par ailleurs, si la richesse en eau d’un tissu n’est pas une preuve certaine de vitalité, il est manifeste cependant que les tissus jeunes et actifs sont plus hydratés que les tissus vieux ou dont la vie est paresseuse. Les zymases n’agissent, en effet, qu’avec le concours de l’eau qui leur assure l’état colloïdal, et c’est en hydratant les aliments apportés du dehors qu’elles les incorporent à la vie organique.
« La ptyaline de la salive, la pepsine du suc gastrique, la lipase du pancréas hydratent les féculents, les viandes, les graisses et les rendent absorbables, assimilables et propices au fonctionnement vital : après quoi, tout cela est finalement déshydraté, et les aliments colloïdes usés sont rejetés à l’état de cristalloïdes et d’eau libre par l’urine, par la sueur, etc. Les granulations zymasiques paraissent être le dernier refuge des propriétés vitales, car on peut dire qu’elles président à toutes nos fonctions : digestion, respiration, etc., et, chose bien frappante, elles subissent, isolées, les mêmes influences qu’exercent sur la substance vivante tous les agents mécaniques, physiques ou chimiques. Bien plus, les zymases que l’on peut isoler et faire fonctionner dans un verre, aussi bien que dans la cellule, comme la luciférose qui, agissant sur la luciférine, produit la lumière vivante, peuvent être remplacées par des agents artificiels colloïdaux et même cristalloïde, comme le permanganate de potasse qui peut donner de la lumière avec la luciférine. »
Aussi, n’apparaît-il nullement impossible que l’on puisse un jour créer du protoplasma et opérer la synthèse de la vie. La majorité des biologistes actuels estiment d’ailleurs que cette dernière ne résulte pas de propriétés irréductibles à des éléments connus, mais de processus physico-chimiques dont les complexes colloïdaux sont le siège. Elle ne cesse pas d’appartenir au milieu d’où elle émane, un échange continuel s’établit entre les deux : dans les substances qui l’entourent, le vivant puise des matériaux, puis il rejette au dehors les résidus de ses destructions. Disloquer en éléments plus simples les corps absorbés, pour redonner ensuite des substances du même groupe, voilà le cycle éternellement répété des transformations vitales. Albumines, graisses, hydrates de carbone contenus dans les aliments redeviennent, dans l’organisme, des albumines, des graisses, des hydrates de carbone. Ainsi, le terme des dislocations subies par les albumines sera la formation d’acides aminés, qui se combineront entre eux pour former des polypeptides ; lesquels polypeptides redonneront des matières albuminoïdes vivantes. Ces acides aminés sont au nombre d’une vingtaine ; et, comme le calcul démontre que le nombre des combinaisons possibles de vingt corps dépasse deux quintillions, le problème de la constitution des organismes apparaît singulièrement complexe, du point de vue chimique.
« Si nous parvenions, comme nous en avons constaté la possibilité, écrit Rabaud, à créer de toute pièce une substance vivante, reproduirions-nous spécialement l’une ou l’autre de celles qui existent actuellement ? Et si nous n’obtenions pas ce résultat, l’échec prouverait-il que les substances actuelles ont des propriétés distinctes, des propriétés physico-chimiques ? La question est souvent posée sous forme d’objection ; en fait, elle est oiseuse et n’a véritablement aucun sens. Il suffit que nous entrevoyions la possibilité de combiner un sarcode, pour nous sentir autorisés à affirmer l’unité fondamentale des corps vivants et des corps inertes. À coup sûr, reconstituer un organisme connu rencontrerait des difficultés presque insurmontables. Non pas, comme le prétend O. Hertwig, parce que les sarcodes actuels résultent d’un long développement historique que nous ne sommes pas en mesure de suivre une seconde fois. L’argument est proprement absurde, car il exprime une confusion entre la succession des conditions diverses qui ont déterminé la constitution actuelle et les constitutions successives corrélatives de ces conditions. Aboutir à une constitution donnée n’implique ni une durée, ni un ordre définis : les conditions pourraient se succéder rapidement et aboutir au même résultat ; tous les termes du processus ne sont pas forcément nécessaires : nous pouvons, in vitro, en quelques jours et par d’autres moyens, combiner ce qui s’est spontanément constitué au cours de nombreuses années. La vraie raison pour laquelle nous aurons de grandes difficultés à reconstituer l’un quelconque des organismes actuels réside dans l’infinité des combinaisons possibles. Si nous songeons qu’avec 20 acides aminés par molécule nous pouvons faire une quantité d’arrangements exprimée par un nombre de 19 chiffres, nous comprenons combien sont faibles pour nous les chances de retomber précisément sur une combinaison déterminée. Et cette multitude des combinaisons s’accroît encore du fait que les substances vivantes renferment, outre les protéiques, une série d’autres éléments. »
Un fait, découvert d’un autre côté, facilitera peut-être la solution de difficultés qui semblaient insurmontables : nous voulons parler de l’incompatibilité entre substances vivantes d’espèces différentes. Mis en présence, les colloïdes restent stables, s’ils sont de même espèce ; ils se précipitent et floculent, s’ils sont d’espèces éloignées. Il y aurait beaucoup d’autres choses à dire, par exemple, sur l’énergétique biologique et l’application des lois de la thermodynamique aux corps vivants ; sur le rôle considérable de la lumière, de la pesanteur, etc.
« La différence superficielle (a écrit le célèbre docteur Herrera, dont on connaît les expériences caractéristiques) entre le vivant et le non vivant, entre le protoplasma irritable et le protoplasma non irritable vient tout simplement du contenu en énergie de leurs molécules et de leurs atomes. La matière vivante contient des molécules ayant un haut degré d’énergie ; morte, elle contient moins d’énergie. Si nous arrivons un jour à donner au cadavre l’énergie perdue, il sera ressuscité. »
Rappelons que, selon Arrhénius, la vie peut se transmettre, dans ses formes élémentaires et microscopiques, d’une planète à l’autre et d’un système solaire à l’autre. La lumière exerce, en effet, une action répulsive sur tous les corps qu’elle frappe ; et lorsqu’il s’agit de corps très ténus, elle peut triompher des forces de gravitation. Arrhénius a même calculé qu’un germe microscopique, parti de la Terre, atteindrait Mars au bout de vingt jours, Jupiter au bout de dix-huit mois, Neptune après vingt-quatre mois de voyage. C’est d’une planète lointaine que serait parvenue sur notre globe la première cellule protoplasmique, source par la suite d’innombrables vivants. Constatons en terminant que, malgré de nombreuses lacunes, tous les progrès de la biologie s’accomplissent dans le sens d’une explication physico-chimique.
— L. Barbedette.
OUVRAGES À CONSULTER. — Prof. A. Herrera : Biologia y Plasmogenia. — R. Dubois : Qu’est-ce que la Vie ? — Rabaud : Éléments de biologie générale. — Jennigs : Vie et mort. Hérédité et évolution chez les organismes unicellulaires. — Lœb : 1. La théorie des phénomènes colloïdaux ; 2. La conception mécanique de la vie. — Rignano : Qu’est-ce que la vie ? – Dastre : La Vie et la Mort. – Lodge : La matière et la vie, etc.
Citons encore la revue des frères Horntraeger : Protoplasma (Berlin), et la Medicina Argentina (Buenos-Aires). À consulter également le Dictionnaire de biologie physiciste des frères Mary, et Ciencia nueva d’Herrera. Voir d’ailleurs les ouvrages mentionnés à la bibliographie de Plasmogénie.
L’étude du protoplasma ne peut d’ailleurs s’isoler de celle des colloïdes, des cristaux, des micelles, des gels, des monères et autres formes plasmiques. Il faut y rattacher aujourd’hui tout ce qui est « radiant », puisque les formes primitives de la vie organisée sont comparées à des radiations, à des émetteurs-récepteurs, selon Lackowsky.
Pour les colloïdes, voir les travaux de Selmi et Graham, tout au début de la chimie physique ; puis ceux de Mayer, Schoeffer et Terroine, pour le phénomène de Tyndall. En ce qui concerne l’ultrafiltration, consulter exp. de Bechlod. Pour la double réfraction accidentelle, Albert Mary cite Schewendener, von Ebner et G. de Metz. Dans les sols, les particules en suspension furent étudiées surtout par Naëgeli et Albert Mary, Pfeffer, Stéphan Leduc, von Weimarn, Burton F., W. Ostwald. Pour les émulsoïdes, on cite Martin Fischer et Marion Hooker ; pour les suspensoïdes : Gallardo, W.-B. Hardy ; pour l’absorption : Bredig, Armisen, Van Bemmeleln, Pauli, Biltz, Szirgmondy, Zacharias, Galleotti, Rocasolano, lscovesco, etc. Herrera et Delfino se rattachent, par leurs travaux, à ceux qui se sont occupés directement des colloïdes, comme A. Lumière.
Pour les gels, Albert Mary cite surtout Stéphan Leduc, Malfitano et Moschkoff, Rocasolano, Lambling, Herrera, A. et A. Mary, Jean Massart de Vriès, Bütschli.
Pour les monères : Haeckel, Cienkowsky, Huxley, de Lapparent, de Lanessan, Sinel, Jaonnes Chatin.
En biologie micellaire, le dictionnaire de Mary est riche de citations des travaux similaires aux siens ; on y trouve les noms de Galippe, Royo Villanova, Altmann, Zimmermann, R. Maire, Kohll, Mlle Loyez, Dangeard, Matruchot, A. Meyer, Fauré Frémiet, Goldsmith, Alex. Guilliermond, Regaud, Mme F. Moreau, F. Moreau, Rudolph, Sapehin, Levi, Löwschin, Le Touzé, DubreuiL, Beauverie, A. et A. Mary, Duclaux, Raphaël Dubois, Grynfeltt, Antoine Béchamp, S. Ramon y Cajal, Alex Braun.
En microbiose, on cite souvent les travaux de Grasset Hector, de Martin Kuckuck, Antoine et Jacques Béchamp, Estor, V. Galippe, Jagadis Chunder Bose, Ducceschi, Ralph Lillie, Albert Jacquemin.
Pour la question osmotique dans les phénomènes protoplasmiques, Albert Mary prie de consulter les ouvrages et travaux de Stéphan Leduc, Herrera, Laloy, F.-M. Raoult, Grasset, Lhermite, H. de Vriès, Rosemann, Galeotti, Foveau de Courmelles, Nicolini, Émile Gautier, J.-H. Van’t Hoff, Condamin et Nogier, A. et A. Mary, Loeb...
Pour les radiations (chapitre annexe moderne de protoplasme), citons les travaux de Niels Bohr, Lord Kelvin, Rutherford, Cheffer, Planck, Eddington, Curie, Chredinger, Lackowsky, Kharitonov, Carl Störmer, Dr Jules Regnault. Foveau de Courmelles, J. Perrin, etc.
PROVIDENCE
n. f. (du latin : providentia ; de pro, avant, et videre, voir)
Ce nom désigne un attribut de dieu, par lequel on lui reconnaît le gouvernement de toutes choses.
C’est la croyance qui veut que le créateur surveille sans cesse son œuvre, qu’il la dirige et la conduise dans son évolution, de telle façon que rien de ce qui se produit dans l’univers n’ait lieu sans son consentement. De plus, on a voulu voir dans cette sollicitude de tous les instants, la preuve de l’infinie sagesse et de la bonté suprême de dieu.
Dans cet attribut de dieu (voir ce mot), la prévoyance est non seulement inapplicable et inutile à une entité sans yeux, sans oreilles, sans cerveau, mais son acceptation se heurte à des objections multiples et capitales que les arguties des métaphysiciens de tous poils n’ont su, jusqu’à présent, réfuter.
Les deux principales sont : l’acte créateur et l’existence du mal.
La question du gouvernement du monde suppose celle de la création. Elle nous conduit à poser ce dilemme : ou bien le monde, tel qu’il est, est le résultat d’un acte créateur et, par conséquent, n’a pas besoin d’être gouverné, ou bien il est éternel et se conserve par sa virtualité propre. Il est impossible de concilier l’omnipotence et l’omniscience divines avec les actes d’un dieu gouverneur. Les dieux n’ont jamais rien possédé qui ne leur ait été donné par les hommes. Ceux-ci ont toujours logé dans leurs divinités les qualités et les défauts qu’ils possédaient, mais en les amplifiant au-delà du possible. C’est pourquoi le dieu adoré, sous des aspects variés, par les dévots du monde entier est considéré comme un pur esprit, éternel, infiniment bon, juste, parfait, miséricordieux, omnipotent et omniscient, qui a créé le monde et les êtres qui le composent et l’habitent. L’univers, dans son ensemble comme dans ses moindres détails, doit être nécessairement sans défaut ; jamais il ne peut y avoir une seule avarie dans l’agencement parfait des multiples rouages composant le mécanisme du cosmos ; car, émanant d’un être parfait, le monde doit être parfait. Une fois créé, il doit continuer à évoluer sans heurts, ni accidents, puisqu’il réalise la perfection.
Comment admettre alors un dieu gouverneur, une providence qui surveille, dirige, répare, même, l’œuvre parfaite du créateur ? La nécessité d’un gouverneur, d’un technicien surveillant la gigantesque machine qu’est l’univers est incompatible avec la perfection du geste créateur, car l’intervention de ce technicien prouve sans conteste la maladresse et l’incapacité du créateur. Que penser alors d’un dieu maladroit, d’un ouvrier qui rectifie sans cesse son œuvre ? Comment concilier cette notion avec celle de la toute-puissance et de l’omniscience d’une entité infiniment parfaite ? Supprimer un attribut de dieu, c’est nous mettre en présence d’un dieu incomplet et nous forcer à nier son existence. La providence nie donc le créateur, et le monde, loin d’être le résultat d’une création absurde et impossible, se conserve éternellement par sa virtualité propre, et ses lois sont, aujourd’hui, ce qu’elles étaient hier.
En second lieu, la croyance à un dieu gouverneur est la négation absolue de l’activité intellectuelle et matérielle de l’humanité. Elle nous force à admettre et à pratiquer un fatalisme absolu, plus rigoureux dans son application que la doctrine du déterminisme biologique que les croyants rejettent avec horreur. Si un dieu gouverne l’univers, depuis le plus petit phénomène jusqu’au plus complexe ; s’il dirige aussi bien l’apparition d’une comète, l’évolution d’une nébuleuse que l’éclosion d’une humble fleurette ou la chute d’un grain de sable, il ne se passe rien dans le monde qui ne soit l’expression de sa volonté. Contre elle, l’homme ne peut rien, jamais il ne pourra en arrêter l’action bienfaisante ou maligne : on ne lutte pas contre la volonté divine. Si elle dirige les mondes dans l’espace et maintient l’harmonie dans l’univers, quel besoin d’imaginer une mécanique céleste et d’en rechercher les lois ? Si elle régit le moindre phénomène, la science devient inutile, nuisible même puisqu’elle s’oppose à la volonté divine. Toute recherche est vaine, puisque dieu ne nous permettra de connaître des secrets de la nature que ce qu’il voudra bien nous montrer et qu’il peut, à tout instant, bouleverser toute son œuvre. Ce thème n’est-il pas la consécration absolue de la passivité humaine ; ne conduit-il pas aux renoncements les plus complets ? N’est-il pas la négation de tout effort, de toute lutte, de toute recherche. L’homme est réduit à jouer, dans le monde, un rôle de pantin, de marionnette grotesque dont la divinité tire les ficelles à sa fantaisie.
La notion de providence se détruit immédiatement lorsqu’on réfléchit à l’existence du mal. Le mal existe ; mal moral et mal physique. Partout nous constatons l’existence perpétuelle et universelle de la douleur, la lutte et l’inégalité entre les êtres. La loi de la vie, notamment, est d’une indicible cruauté et, à tout instant, des catastrophes dévastent le monde : inondations, séismes, typhons, éruptions volcaniques, etc. Les souffrances morales sont tout aussi nombreuses, aussi destructives que les manifestations brutales de la nature.
Puisqu’une providence gouverne la nature, il faut bien croire que tous ces cataclysmes, que toute cette souffrance sont son œuvre. Comment l’idée d’un dieu infiniment bon peut-elle se concilier avec toutes ces horreurs ? Si la providence existe, elle est l’auteur responsable de la souffrance, puisque rien n’arrive sans sa volonté. Dieu fait alors figure d’un despote implacable, d’un tortionnaire cruel qui se réjouit du mal de ses créatures. Reprenons à notre compte le raisonnement d’Épicure et posons avec lui les questions suivantes : ou dieu veut supprimer le mal du monde et ne le peut pas, ou bien il le peut et ne le veut pas. S’il le veut sans le pouvoir, il n’est pas tout-puissant ; s’il le peut sans le vouloir, il n’est pas infiniment bon. Dans les deux cas, il cesse d’être dieu, parce que ses attributs se contredisent et s’excluent mutuellement. La providence nie donc l’infinie bonté et la toute-puissance du créateur !
Comme les autres attributs de dieu, la notion de providence s’avère non seulement impossible, mais nuisible.
Les preuves tirées de l’ordre du monde et de l’harmonie universelle, preuves sur lesquelles elle s’appuie, ne sont convaincantes que pour ceux qui ne veulent juger les notions qu’on leur inculque qu’en faisant usage de la logique du sentiment ; elles permettent de faciles développements poétiques et déclamatoires qui dispensent de chercher l’essence des choses et de conduire les raisonnements selon les règles de la logique pure. Faisant avant tout appel aux sentiments, elles sont consolantes et, comme l’a dit le poète :
L’infortuné qui pleure a besoin d’espérance.
Elles empêchent de voir les choses telles qu’elles sont, et conduisent sûrement à des aberrations sociales : soumission, résignation, en éliminant l’homme, entité réelle, au profit de la divinité, entité fantôme.
— Ch. Alexandre.
PRUD’HOMIE, PRUD’HOMME
n. f., n. m.
Prud’homie a le sens de probité, sagesse dans la conduite, grande expérience des affaires. Le mot prud’homme signifie homme sage, probe et avisé. Nous ne nous occuperons ici de prud’homie que considérée comme une institution juridique ayant une mission déterminée, et de prud’homme que comme membre de ce qu’on appelle les conseils de prud’hommes. Le dictionnaire Larousse définit ainsi ces conseils :
« Les conseils de prud’hommes ont pour mission de concilier ou de juger rapidement les contestations s’élevant entre patrons et ouvriers, relativement à l’exercice de leur industrie. Ils ont été institués par la loi du 18 mars 1806, modifiée et complétée par les lois des 14 juin 1853, 7 février 1880 et 11 décembre 1884. Ils sont établis sur la demande motivée des chambres de commerce ou des chambres consultatives des arts et manufactures. Il n’en existe que dans les villes constituant des centres industriels. Ils sont recrutés parmi les patrons et les ouvriers, en nombre égal, et se composent d’au moins six membres, non compris le président, le vice-président et le secrétaire. Ils sont élus pour six ans et se renouvellent par moitié tous les trois ans. La liste des électeurs est arrêtée par le préfet ; elle comprend les patrons, les chefs d’ateliers, les contremaîtres et les ouvriers. Pour être éligible, il faut être électeur, être âgé de trente ans accomplis, savoir lire et écrire. Tout conseil de prud’hommes se divise en deux bureaux, qu’il constitue lui-même : l’un appelé bureau particulier ou de conciliation ; l’autre, bureau général ou de jugement. Le bureau particulier est composé de deux membres : l’un est patron, l’autre ouvrier ; il a pour mission de régler à l’amiable les contestations. Au cas de non-conciliation, l’affaire est renvoyée devant le bureau général, qui statue en dernier ressort, lorsque le chiffre de la demande n’excède pas 200 francs en capital ; s’il excède cette somme, il y a appel possible devant le tribunal de commerce. »
Le dictionnaire Larousse n’en dit pas plus, mais ce qu’il dit est exact, sauf à tenir compte des modifications apportées depuis la guerre de 1914–1918, en ce qui concerne la somme de 200 francs qui est, aujourd’hui, plus élevée (300 francs), pour les demandes à faire devant la juridiction des prud’hommes. Ainsi, doivent avoir également varié les indemnités des conseillers. Ce ne sont là que questions de détails sur lesquelles il est facile de se renseigner avec exactitude, selon l’opportunité.
Les conseillers prud’hommes ont, pour se faire reconnaître, la médaille des prud’hommes, instituée en 1823 (12 novembre). Les conseillers sont autorisés à porter cette médaille, à l’audience et en dehors, dans l’exercice de leurs fonctions. Cette médaille est en argent et suspendue à un ruban noir passé en sautoir. Elle porte sur un côté la devise « Servat et conciliat » et, au milieu, « Conseil des Prud’hommes » ; au-dessous, un sujet qui paraît être le même que l’attribut des francs-maçons : le triangle et le fil à plomb. Sur l’autre côté, un œil dans un nuage sous lequel figurent deux mains entrelacées au-dessus d’un sujet peu explicite, mais au-dessous duquel se voit très lisible, le mot « Équité ». Ce n’est, en somme, qu’un insigne de prud’homme, mais il arrive que certains bons bougres, ouvriers ou patrons, en font un hochet de vanité équivalant au sabre de M. Joseph Prudhomme, d’immortelle mémoire. Enfin, si cela ne les empêche pas d’être équitables !...
L’institution des conseils de prud’hommes mérite qu’on s’étende davantage ici sur ce que doit en savoir le monde ouvrier. Nous n’attachons pas plus d’importance qu’il ne faut à ce palliatif, qui remédie bien peu à l’iniquité sociale ; mais nous pensons qu’il est possible d’en tirer quelques minces avantages contre les véritables ennemis du travailleur : ceux qui l’exploitent. C’est toujours ça de pris et c’est beaucoup trop peu pour être susceptible de satisfaire à son juste esprit de revendication, à sa soif de justice et d’égalité, à son instinct de révolte !
Trop souvent, par timidité, par ignorance, les salariés renoncent à défendre avec les armes qui sont à leur portée les plus légitimes de leurs droits ouvriers. Il ne faut pas qu’ils s’effraient de la fréquentation du prétoire et des notions de procédure. Que de fois l’on a conduit devant la justice bourgeoise des travailleurs coupables de légers larcins faits à la propriété ou aux intérêts de leurs patrons ! Pourquoi ne profiteraient-ils pas d’une loi qui leur permet de revendiquer contre l’injustice flagrante ou l’exploitation sans bornes dont ils sont victimes ? Mais encore faut-il qu’ils sachent qu’ils ont certains droits – dus à la ténacité de ceux qui les ont conquis pour eux – et qu’il leur soit possible d’en user.
Voici, résumés, quelques renseignements :
Le conseil de prud’hommes, composé de patrons et d’ouvriers, est spécialement destiné à concilier d’abord et à juger ensuite les conflits survenus entre patrons et ouvriers. Souvent, ils donnent une solution équitable à des différends entre salariés et salariants, et donnent satisfaction à de justes réclamations d’exploités contre leurs exploiteurs. Il faut bien convenir que modestes sont ces revendications et que minces sont ces satisfactions. Ces conseils de prud’hommes n’ont à apprécier (à connaître, comme on dit en jargon juridique) que des litiges bénins, des contestations d’engagement, de louage, d’apprentissage, de conditions de travail.
Le conseil de prud’hommes est une sorte de justice de paix, et tout dépend du bon sens, de la mentalité, de l’équité du juge... Or, le juge est, à tour de rôle, un patron ou un ouvrier, assisté d’autres patrons et ouvriers.
Ce n’est pas toujours une garantie ; cependant, la mentalité syndicaliste réside assez souvent dans les jugements des prud’hommes, quand ceux-ci sont des militants sincères et des ouvriers conscients. Il arrive même qu’ils influent fortement sur les sentiments équitables des patrons, quand ceux-ci n’en sont pas complètement dépourvus.
Tous les patrons, ou ceux qui les représentent, ainsi que les ouvriers, employés ou apprentis, sont justiciables des prud’hommes. Selon la loi, est patron celui qui exerce habituellement un commerce ou une industrie.
Celui qui emploie occasionnellement ne dépend pas des prud’hommes. L’État n’est pas considéré comme patron. Aussi, les arsenaux, les établissements de la guerre ou de la marine, et les manufactures nationales, les départements, les communes, les ministères, les établissements publics ne relèvent pas des prud’hommes. Ouvriers et employés des administrations publiques et de l’État n’ont aucun recours à la juridiction des prud’hommes. Mais, au contraire, tous les salariés qui exécutent un travail, sous les ordres ou la surveillance d’un patron ou de ses représentants, en atelier ou chez lui, sont justiciables des conseils de prud’hommes. Ne l’est pas celui qui exécute un travail pour lui-même et par lui-même, quand il veut et comme il lui plaît.
Les sous-entrepreneurs, sous-traitants, tâcherons, contremaîtres, ne sont pas justiciables des prud’hommes pour les contestations possibles avec leurs patrons, mais ils le sont pour les litiges qui surviennent entre eux et leurs ouvriers, apprentis ou employés, quel que soit le mode de rémunération : à la journée, aux pièces ou de toute autre manière.
Sont encore justiciables des prud’hommes les ouvriers, employés ou apprentis des manufactures, usines, entreprises de terrassement, de bâtiment, de travaux publics, manutention, transport (chemins de fer, tramways, bateaux, autobus, voitures, etc.), de chargement et déchargement, des mines, des spectacles, employés de commerce, de banque, garçons de magasin, hommes de peine, livreurs, conducteurs, garçons de laboratoire, préparateurs en pharmacie, garçons de café, représentants et voyageurs de commerce, etc.
Ne sont pas justiciables des prud’hommes les domestiques et gens de service salariés par un commerçant ou un industriel, s’ils sont, non pas occupés à l’exploitation de leur patron, mais attachés à sa personne ou à sa famille. Il en est de même des navigateurs et marins du commerce, des salariés de l’État dans l’enseignement, postes, télégraphes, téléphones, enfin de tous les fonctionnaires du département, de la commune et des administrations publiques, fussent-ils qualifiés ouvriers de métiers.
Les mineurs, les femmes mariées et les étrangers sont, comme demandeurs ou comme défendeurs, justiciables du conseil des prud’hommes, si le contrat de louage a été conclu en France.
Le conseil des prud’hommes ne peut juger que les affaires relatives au travail ou au contrat de louage d’ouvrage, ainsi que celles qui concernent les contrats d’apprentissage ou les conditions de travail. Les accidents du travail ne relèvent pas de la juridiction des prud’hommes.
Donc, les conseils de prud’hommes sont compétents pour statuer sur toutes affaires naissant à l’occasion d’un contrat de louage d’ouvrage et de son exécution par les parties. Le conseil des prud’hommes est compétent, quel que soit le chiffre de la réclamation, s’il s’agit d’une demande entre ouvriers et patrons ; mais sa compétence cesse, s’il s’agit d’employés, au-dessus d’une somme de 1 000 francs. C’est alors le tribunal civil ou le tribunal de commerce qui est compétent. Le conseil des prud’hommes ne peut juger définitivement que si la somme litigieuse n’excède pas 300 francs. Au-delà de cette somme, le jugement est susceptible d’appel devant le tribunal civil. Les patrons savent cela, et leur cause mauvaise ou douteuse devant les prud’hommes devient évidemment toujours meilleure devant le tribunal civil, tribunal de classe.
Le salarié qui veut assigner devant le conseil de prud’hommes se rend au secrétariat du conseil de prud’hommes situé dans le rayon de territoire du lieu de son travail. S’il travaille en dehors d’un établissement, il s’adressera au conseil ressortissant du lieu où s’est fait l’embauchage. Il exposera son cas très sommairement et versera la somme du coût de la lettre de convocation qui sera adressée au patron : rendez-vous pour la conciliation. La loi autorise les parties à se présenter sans convocation préalable devant le bureau de conciliation, s’il y a accord. Les parties peuvent se faire représenter par une personne exerçant la même profession que la leur, par un avocat, ou par un avoué. Sauf avocat ou avoué, la personne représentant l’intéressé doit être munie d’un pouvoir sur papier libre et non enregistré. Une simple lettre peut suffire. Au bas de la convocation ou de l’original ou de la copie de l’assignation, les mots « bon pour pouvoir », suivis de la signature, sont indispensables.
Les audiences du bureau de conciliation ne sont pas publiques. Les hommes d’affaires ne peuvent assister les parties. Si l’affaire est importante, délicate ou compliquée, le salarié fera bien de se faire assister d’un avocat. En exposant brièvement son cas, il en fera la demande au bâtonnier de l’ordre des avocats près le tribunal qui en désignera un d’office. En cas de non comparution au jour et heure fixés, l’affaire est renvoyée à une prochaine audience. Le demandeur explique sa demande, expose son cas, et, s’il y a arrangement ou conciliation, il en est dressé procès-verbal. S’il y a serment d’une des parties sur la demande de l’autre, la contestation prend fin ; si le serment est refusé, il en est fait mention au procès-verbal et l’affaire est renvoyée à la prochaine audience du bureau de jugement, la conciliation étant impossible.
Le mineur doit être représenté par son père ou son tuteur ; le conseil peut l’autoriser à soutenir lui-même ses droits. La même autorisation peut être donnée à la femme mariée.
L’article 6 de la loi du 13 juillet 1907 fonde la femme mariée à ester en justice dans toutes les contestations relatives au produit de son travail personnel, dont elle a la libre disposition, sans l’assistance, le secours ou l’autorisation de son mari.
S’il n’y a pas eu conciliation ou si le défendeur ne s’est pas présenté, c’est le bureau de jugement qui devra statuer. Pour cette seconde comparution, il faut préalablement se rendre au secrétariat en vue d’une seconde convocation. Celle-ci se fera par lettre recommandée ou par assignation délivrée par huissier. Il y a à payer le coût de l’assignation, plus les frais de vocation. Il y a lieu, pour le salarié, de bien définir ce qu’il demande et de bien expliquer son cas au secrétaire chargé de convoquer ou à l’huissier qui assignera ; si, n’ayant pu se concilier, les parties sont d’accord pour éviter des délais et des frais, elles peuvent comparaître en portant elles-mêmes leur affaire devant le bureau de jugement qui statuera sur-le-champ. Elles pourront se faire représenter, comme pour la conciliation, et par les mêmes personnes. Elles seront entendues contradictoirement et le tribunal rendra son jugement ou l’ajournera à une prochaine audience. Le conseil pourra exiger des parties qu’elles prêtent le serment pour affirmer leurs déclarations. Le demandeur pourra obtenir du conseil un jugement ordonnant certaines mesures urgentes et conservatoires. Le conseil pourra ordonner la vérification d’écritures, de pièces, de lieux, l’expertise et la comparution de témoins. Ouvriers et employés de la maison du patron peuvent être cités et entendus comme témoins.
Les jugements des conseils de prud’hommes sont susceptibles d’appel seulement en cas d’incompétence, de connexité, ou de dépendance, ou quand la somme en litige dépasse le maximum (300 francs). Délai d’appel : dix jours à compter du jour de la signification du jugement. Le conseil peut ordonner l’exécution provisoire du jugement pour le quart de la somme en litige, sans qu’elle puisse dépasser 100 francs. Il peut ordonner l’exécution pour la totalité, à condition d’avoir au préalable fourni caution.
Au cas où un jugement aura été rendu par défaut, c’est-à-dire en l’absence du défendeur, il pourra être frappé d’opposition dans un délai de trois jours francs, à compter du lendemain de la signification du jugement. L’opposition arrête l’exécution du jugement, mais n’empêche pas l’exécution provisoire par provision, ni les mesures conservatoires qui auraient pu être ordonnées. Un délai de six mois est accordé pour l’exécution des jugements des conseils de prud’hommes.
La partie qui reçoit de son adversaire un acte d’opposition doit comparaître devant le conseil aux jour et heure fixés dans cet acte. L’affaire est alors jugée comme si elle venait pour la première fois. Le jugement de défaut ne compte pas. En cas d’un second défaut, une seconde opposition ne sera plus recevable. L’appel et l’opposition se forment par voie d’huissier.
La cour de cassation ne peut connaître des recours contre les jugements des conseils de prud’hommes qu’en cas d’excès de pouvoir ou violation de la loi. Ces pourvois en cassation seront déclarés au secrétariat du conseil de prud’hommes et inscrits sur un registre spécial. Le pourvoi en cassation ne suspend jamais l’exécution du jugement.
Pour agir avec prudence et sécurité, dans son intérêt matériel et moral, l’assuré doit ne pas craindre de se renseigner aux militants expérimentés de son syndicat ou, mieux encore, au conseiller prud’homme de sa catégorie qui lui donnera la marche à suivre pour l’assignation, pour l’assistance judiciaire et pour tout ce qui peut lui garantir l’avantage et la réussite de sa demande.
Les syndicats ont compris la nécessité de désigner des camarades éclairés, dévoués et de conviction sincère pour soutenir, défendre et faire triompher les intérêts des salariés devant la juridiction des prud’hommes. Ce n’est plus un tribunal de classe, mais un tribunal paritaire où il y a chance d’impartialité et de justice. C’est sans doute pour cela que, souvent, les patrons préfèrent se réfugier dans le maquis de la procédure plutôt que d’affronter la contradiction loyale des tribunaux composés en parties égales de patrons et d’ouvriers pour toutes les catégories de travailleurs salariés. Au point de vue syndical, le conseil de prud’hommes a l’utilité d’initier les travailleurs à la défense de leurs droits. Ils se défendent ainsi avec les seules armes que la bourgeoisie leur tolère, avec tant de parcimonie et souvent malgré elle.
Le militant syndicaliste, devenu conseiller prud’homme par le suffrage de ses camarades, ne doit jamais oublier qu’il est, par devoir et par conscience, le serviteur fidèle des intérêts qui lui sont confiés par ses frères, exploités comme lui sous le régime du salariat. Certes, ce n’est pas la juridiction des prud’hommes qui peut porter d’efficaces coups de pioche contre ce régime, mais il n’y a rien qui puisse, dans ce palliatif judiciaire d’intérêt individuel, détourner le travailleur des moyens plus énergiques de l’action directe et collective du prolétariat en œuvre d’émancipation.
Il faudrait un fort volume – que dis-je ? Il en faudrait plusieurs – pour faire l’historique des prud’hommes. Pour connaître de façon complète tout ce qui concerne la théorie et la pratique des conseils de prud’hommes, des ouvrages existent, utiles à consulter, impossibles à résumer. La librairie Dalloz – pour ne citer que cette librairie spéciale – a publié, en 1925, un ouvrage de René Bloch et Henry Chaumel, tous deux docteurs en droit, qui comporte 550 pages. On y trouve, en trois parties, l’origine, le développement, le fonctionnement et tous les renseignements concernant cette juridiction spéciale, sa compétence, sa procédure et un formulaire de 60 pages donnant modèles de contrats d’apprentissage, certificats de travail, procès-verbaux, etc.
Au point de vue historique, nous apprenons que, sous l’Ancien Régime, on donnait le nom de prud’hommes (homo prudens), suivant les localités, tantôt aux officiers municipaux, tantôt aux juges composant les tribunaux ordinaires, mais le plus souvent aux experts commis par la justice, pour avoir les lumières et les garanties de leur compétence spéciale sur toutes les contestations.
« C’est sous le règne de Philippe le Bel que furent constitués les premiers conseils de prud’hommes. En l’an 1296, le conseil de la ville de Paris créa vingt-quatre prud’hommes et les chargea d’assister le prévôt des marchands et les échevins, afin de juger, en dernier ressort, les contestations qui pourraient s’élever entre les marchands et les fabricants qui fréquentaient les foires et les marchés établis à cette époque ; ils allaient, de plus, faire la visite chez les maîtres et peuvent être regardés, par là, comme l’origine des gardes et jurés établis postérieurement dans chaque communauté d’arts et métiers. Pendant près de deux siècles, la ville de Paris posséda seule des prud’hommes...
Le petit paragraphe suivant a dû subir, au moment de sa composition typographique, un accident (il figure ainsi sur la version imprimée)… :
« Un édit du 29 avril 1464, rendu par Louis XI, à Nogent-le-Roi, permit aux bourgeois de Lyon de choisir [...] de prud’hommes remonterait, croit-on, à l’époque du [...] prud’hommes nommés à Paris. »
Si quelqu’un peut mettre la main sur le « Traité théorique et pratique des conseils de prud’hommes » de René Bloch et Henry Chaumel, Paris, Alcan 1912, Dalloz 1925, dont est tiré cet extrait, merci de nous contacter afin de completer la ligne manquante.
« Dans plusieurs villes maritimes, notamment à Marseille, existe une espèce de conseil de prud’hommes dont l’origine paraît fort ancienne. Ce sont des prud’hommes pêcheurs qui jugent les contraventions en matière de pêche maritime et les différends entre marins, à l’occasion de leur profession de pêcheurs. Cette catégorie de prud’hommes remonterait, croit-on, à l’époque du roi René, comte de Provence (1462). Des arrêts différents de mai 1758, novembre 1776, octobre 1778 et mars 1786 ont réglementé, sans beaucoup la modifier, cette institution qui traversa sans à-coup la Révolution de 1789, pour arriver telle quelle jusqu’à nos jours.
« Telle était l’organisation des prud’hommes vers le xve siècle. Lyon posséda, par la suite, un tribunal composé de juges appartenant à la fabrique lyonnaise, et dont le rôle consistait à vider les différends s’élevant entre les fabricants de soieries et leurs ouvriers. La loi de 1791 fit disparaître provisoirement ces tribunaux à la suite de l’abolition des maîtrises et des jurandes, si fatales à l’industrie.
« La liberté, proclamée par la loi du 2 mars 1791, ne fut pas sans produire un certain désarroi dans les mœurs ouvrières et patronales. Les litiges subsistaient, les juges n’avaient pas la compétence nécessaire pour apprécier, ils ignoraient les habitudes, les usages, les coutumes particulières à chaque corporation, aussi bien au point de vue technique qu’à celui des relations établies entre patrons et ouvriers pour se comprendre et se supporter. Les procès se multipliaient ; ils étaient fort coûteux et les parties adverses regrettaient l’ancienne juridiction.
« La loi du 21 germinal an XI (avril 1803) intervint pour remédier à ce mauvais état de choses. Cette loi, respectant le principe conquis par la Révolution, reconnaissait, néanmoins, la nécessité de régulariser le travail dans les manufactures et de maintenir l’ordre et la justice dans les relations entre fabricants et ouvriers. Elle créa une juridiction spéciale et particulière. Les affaires de simple police furent portées devant le préfet de police à Paris, devant les commissaires généraux de police dans les villes où il y en avait d’établis, et, dans tous autres lieux, devant le maire ou un de ses adjoints. Selon le code municipal, les magistrats ou fonctionnaires prononçaient, sans appel, les peines applicables aux divers cas. C’était, ainsi, l’application de l’article 19 du Titre V. L’article 20 prescrivait que les autres contestations fussent portées devant les tribunaux auxquels la connaissance en était attribuée par les lois.
« Cette juridiction, contestable, était suspecte de partialité aux ouvriers. Elle était confiée à des hommes généralement dépourvus de connaissances usuelles indispensables pour apprécier et décider entre maîtres et ouvriers. Les résultats en furent détestables et fort différents de ce qu’on en attendait. Lors du passage de Napoléon Ier à Lyon, les fabricants de soieries et leurs chefs d’ateliers lui représentèrent les inconvénients et les insuffisances de la loi de l’an XI, et demandèrent à l’empereur de leur donner une institution analogue à celle prescrite par la loi de 1791. Le 18 mars 1806 fut votée une loi portant établissement d’un conseil de prud’hommes à Lyon, et, par son article 34, ménageant au gouvernement le droit d’étendre le bienfait de cette institution à toutes les autres villes de fabriques et de manufactures. Un décret du 11 juin 1809, rectifié le 20 février 1810, et un autre décret du 3 août 1810 vinrent compléter l’institution des prud’hommes pour toutes les villes de fabrique. D’autres décrets encore s’ajoutèrent à ceux-là. Ils intéressaient particulièrement les ouvriers patentés, c’est-à-dire ceux qui, travaillant chez eux pour des fabricants, payaient patente. Certains décrets de 1811 et 1812 réglaient surtout les conseils de prud’hommes relativement aux marques de fabrique, à l’inspection des marques de savons, aux contestations que soulevaient les contrefaçons et, notamment, celle des lisières de drap. C’était plutôt commercial.
« Charles X ne s’occupa des conseil de prud’hommes que pour ordonner aux membres de ces conseils de porter, dans l’exercice de leurs fonctions, soit à l’audience, soit au dehors, la médaille d’argent suspendue à un ruban noir porté en sautoir. Aujourd’hui, la médaille en question n’éblouit plus personne, même pas ceux qui la portent. On apprécie plutôt un conseiller prud’homme à la conscience qu’il met à remplir son rôle qu’au soin qu’il apporte à s’orner d’un ruban avec une médaille suspendue. Le souci de Charles X égalait sa mentalité : on ne tire pas de farine d’un sac à charbon. Louis-Philippe voulut modifier les lois existantes sur les conseils de prud’hommes. Il afficha même l’intention de remanier ces lois dans un sens libéral – ce qui prouve qu’elles ne l’étaient guère –, mais ses conseillers, tous représentants de la plus haute bourgeoisie, firent de leur mieux pour empêcher l’exécution de ces projets. Huit commissions successives furent nommées, sans parvenir à établir un nouveau texte. La loi ne fut donc point remaniée et fut appliquée avec rigueur aux villes qui tentaient d’installer des conseils de prud’hommes.
« Cependant, partout où l’institution des prud’hommes avait été introduite, elle donnait des résultats. De 1830 à 1842, les affaires soumises à la juridiction de tous les conseils de prud’hommes institués en France s’étaient élevées à 184 514 ; sur ce nombre, 174 487 avaient été conciliées. Des 10 027 qui restaient à juger, 1 904 le furent en premier ressort, 3 274 en dernier ressort, et, sur les 1 904 jugements en premier ressort, 190 seulement avaient été déférés à la juridiction d’appel.
« Les principales villes manufacturières de France possédaient déjà, depuis longtemps, des conseils de prud’hommes, alors que Paris en était privé. On craignait cette institution dans l’ardente population de l’industrie parisienne. Cependant, les considérations politiques et la frayeur bourgeoise devaient céder à l’utilité de l’institution des prud’hommes dans la capitale. L’autorité ne voulut d’abord donner satisfaction aux vœux exprimés par la chambre de commerce de Paris et par le conseil municipal que partiellement et, pour ainsi dire, à l’essai.
« Ce fut le 29 décembre 1844 que Paris obtint du gouvernement de juillet un conseil de prud’hommes, ou, plus exactement, qu’il obtint qu’une expérience soit faite pour certains métiers. La loi de 1844 n’établit donc à Paris qu’un simple conseil des métaux et des industries qui s’y rattachent. Ce conseil était composé de 15 membres, dont 8 fabricants et 7 ouvriers, et, en outre, 2 suppléants. Cet essai calma les appréhensions par sa réussite. Une ordonnance du 9 juin 1847 créait trois nouveaux conseils de prud’hommes à Paris : un pour les tissus, un pour les produits chimiques, et un pour les diverses industries qui comprenaient les imprimeurs, les sculpteurs, les menuisiers, les entrepreneurs de charpente et de maçonnerie, les fabricants de chaux, de plâtre, etc. Une autre ordonnance du même jour, 9 juin 1847, étendait le ressort du conseil de prud’hommes pour l’industrie des métaux à tout le ressort du tribunal de commerce du département de la Seine.
« La législation impériale subsista sans modifications jusqu’en 1848, malgré les nombreuses réclamations qui s’élevaient contre elle. On lui reprochait l’exclusion presque totale des ouvriers pour la formation des conseils et la trop grande prépondérance donnée aux fabricants par cette législation des prud’hommes. À cette date, 75 villes possédaient des conseils de prud’hommes.
« La révolution de 1848 trouva les choses en cet état. Aussi, la République remania-t-elle de fond en comble cette législation des prud’hommes par une loi du 27 mai 1848, dont voici les dispositions, tendant à mettre cette institution plus en rapport avec les principes démocratiques :
« Elle déclarait électeurs pour les conseils de prud’hommes tous les patrons, chefs d’ateliers, contremaîtres, ouvriers et compagnons âgés de 21 ans et résidant depuis 6 mois au moins dans la circonscription du conseil de prud’hommes. Elle déclarait les mêmes éligibles, s’ils savaient lire et écrire et s’ils étaient domiciliés depuis un an au moins dans la circonscription du conseil. Elle rangeait dans la classe des patrons les contremaîtres, les chefs d’atelier et tous ceux qui payaient patente depuis plus d’un an et occupaient un ou plusieurs ouvriers. La présidence donnait voix prépondérante : mais elle durait 3 mois et était attribuée alternativement à un patron et à un ouvrier, élus chacun par leurs collègues respectifs. Les audiences de conciliation devaient être tenues par deux membres : l’un patron, l’autre ouvrier ; quatre prud’hommes patrons et quatre prud’hommes ouvriers devaient composer le bureau général ou de jugement. La loi spécifiait que le nombre des prud’hommes ouvriers serait toujours égal à celui des prud’hommes patrons et disposait que chaque conseil aurait au moins 6 membres et 26 au plus. Il était procédé à deux élections : dans la première, ouvriers et patrons nommaient un nombre de candidats triple de celui auquel ils avaient droit ; dans la seconde, qui était définitive, les ouvriers choisissaient, parmi les candidats patrons, les prud’hommes patrons, et les patrons choisissaient à leur tour les prud’hommes ouvriers sur la liste des candidats ouvriers.
« Cette législation, dictée des sentiments démocratiques animant le gouvernement d’alors, perdait peut-être un peu de vue l’idée que les prud’hommes sont surtout des arbitres et des défenseurs choisis par des intérêts en lutte ; incontestablement, la manière semble très libérale, mais le mode d’élection pouvait être justement critiqué.
« La loi du 7 août 1850 dispensa l’ouvrier, qui voulait se faire rendre justice devant les conseils de prud’hommes, de toute avance d’argent pour le timbre et l’enregistrement en débet – c’est-à-dire, en quelque sorte, à crédit – de toutes les pièces de procédure concernant la juridiction prudhommale ; les frais n’étaient payés qu’après jugement définitif et par la partie qui perdait le procès.
« Le Second Empire ne pouvait laisser subsister une législation aussi libérale. Sous prétexte que cette loi consacrait l’oppression du fabricant par l’ouvrier, sans les garanties qu’offrent l’éducation et l’expérience des affaires, et à propos de certains incidents peu importants, le gouvernement fit dissoudre quelques conseils qu’on accusa de démagogie et susceptibles de se servir des conseils de prud’hommes comme d’une arme dangereuse. Alors fut promulguée la loi du 1er juin 1853 qui, plus d’un demi-siècle, resta en vigueur dans ses plus importantes parties. Elle restreignait l’électorat en déclarant électeurs :
« 1° les patrons âgés de 21 ans accomplis, patentés depuis 5 années au moins et domiciliés depuis 3 ans dans la circonscription du conseil ;
« 2° les chefs d’atelier, contremaîtres et ouvriers âgés de 21 ans accomplis, exerçant leur industrie depuis 5 ans au moins et domiciliés depuis 3 ans dans la circonscription du conseil (art. 4).
« Cette loi de 1853 restreignait également l’éligibilité, car n’étaient éligibles que les électeurs âgés de 30 ans accomplis et sachant lire et écrire (art. 5). Les contremaîtres et chefs d’ateliers étaient rangés avec les ouvriers et votaient avec eux (art. 9). Les patrons nommaient directement les prud’hommes patrons, et les ouvriers les prud’hommes ouvriers.
« Mais l’innovation la plus grave était celle édictée par l’article 3, ainsi conçu : « Les présidents et vice-présidents des conseils de prud’hommes sont nommés par l’empereur. Ils peuvent être pris en dehors des éligibles. Leurs fonctions durent trois ans. Ils peuvent être nommés de nouveau. Les secrétaires des mêmes conseils sont nommés par le préfet et révoqués par lui, sur la proposition du président. » Le bureau général ou de jugement était composé, indépendamment du président et du vice-président, d’un nombre égal de prud’hommes patrons et de prud’hommes ouvriers (art. 11). Or, d’une façon générale, le préfet avait la haute main sur tout ce qui se passait au conseil de prud’hommes. Le principe de cette législation était ainsi devenu absolument contraire à l’esprit de son institution, qui veut que les prud’hommes soient nommés par leurs justiciables. N’est-ce pas ainsi, une fois de plus, la démonstration incontestable qu’un régime démocratique peut établir, presque toujours, par une mentalité plus ou moins révolutionnaire, de la justice et de l’égalité dans une loi, alors qu’un régime tyrannique ne manque jamais d’y substituer la provocation et l’arbitraire ?
« Une loi éphémère du 14 juin 1854, abrogée en 1867, força les ouvriers soumis à l’obligation du livret de s’en munir, s’ils voulaient être inscrits sur les listes électorales. La loi de 1853 fut complétée par celle du 4 juin 1864, laquelle instituait la discipline des conseils de prud’hommes. Cette loi de 1853 donna lieu à de vives critiques. Ce n’est que celle du 7 février 1880 qui restitua aux conseils de prud’hommes le droit d’élire deux de leurs membres comme président et vice-président et de nommer et de révoquer leur secrétaire. Préoccupé de l’équilibre entre les deux éléments rivaux, par cette loi, on voulut que les deux fonctions de président et de vice-président fussent partagées entre eux et que, dans le bureau de conciliation, la présidence roulât entre le conseiller patron et le conseiller ouvrier. Ce qui n’empêchait pas, d’ailleurs, l’un des éléments d’être toujours en prépondérance dans le bureau du jugement présidé et départagé par le président ou le vice-président, patron ou ouvrier, en sorte qu’un soupçon pouvait toujours s’élever sur l’impartialité de ses décisions. Cette part assurée aux ouvriers dans la présidence, cette perspective pour un prud’homme patron de se trouver, quelquefois, sous l’autorité de son propre ouvrier devaient soulever des protestations et des résistances. Il s’en produisit de très vives, à Lille, à Angers, à Armentières, sous la forme de démissions collectives et réitérées de prud’hommes patrons, qui rendirent impossible le fonctionnement des conseils, faute de l’un de ses deux éléments constitutifs. Une loi, du 11 décembre 1884, vint alors déclarer légal, en pareil cas, le fonctionnement des conseils composés uniquement de l’élément acceptant.
« À ces sujets d’antagonisme dans la juridiction des prud’hommes, d’autres s’ajoutèrent, tirés des mandats impératifs acceptés par les candidats ouvriers, réprimés par le Conseil d’État, chargé du contentieux des élections à cette époque. Il fallut bien refondre ou réformer la législation sur les conseils de prud’hommes. »
Depuis 1888, de nombreux projets ou propositions de lois furent déposés an Parlement sur l’organisation et le fonctionnement des conseils de prud’hommes.
Sur un rapport de M. Lagrange (6 août 1890), la Chambre des députés adoptait (17 mars 1892) un projet d’ensemble abrogeant expressément la législation antérieure et réglementant à nouveau la matière. Sur le rapport de M. Demôle (16 août 1893), suivi d’un rapport supplémentaire, le Sénat (11 juin 1894) votait un projet qui consacrait certaines innovations adoptées par la Chambre : élévation du taux de la compétence des conseils de prud’hommes, appel de leurs décisions devant le tribunal civil, réduction des frais de la procédure. Mais sur d’autres points, ce rapport du Sénat différait de celui de la Chambre, spécialement en ce qu’il refusait d’étendre la juridiction prudhommale aux employés de commerce, et modifiait la composition du bureau de jugement par l’introduction du juge de paix pour vider les partages. Ce projet ne fut point soumis à la Chambre par la commission. Une proposition de loi du député Dutrex, déposée le 14 novembre 1898, à peu près semblable à celle votée en 1892 par la Chambre, était adoptée sur le rapport de son auteur dans la séance de la Chambre du 14 février 1901. Sur le rapport de M. Savary, en date du 4 décembre 1902, après une longue et vive discussion, le Sénat maintenait presque intégralement le texte qu’il avait voté en 1894, et la Chambre se livra à de nouvelles études.
Il fallait pourtant aboutir, car le comité de vigilance des conseillers prud’hommes ouvriers du département de la Seine prit l’initiative d’une intense agitation. Contre le maintien de la législation prudhommale en vigueur, s’organisait une vigoureuse campagne qui se traduisait par des manifestations consistant en campagne de presse, menaces de démission, démarches auprès du gouvernement. C’est alors que M. Chaumié, garde des Sceaux, déposa au nom du gouvernement (6 avril 1905) un projet de loi qui, limité à l’organisation de la juridiction d’appel, reproduisait les articles 26, 32 à 34 du projet de loi sur lesquels les deux chambres s’étaient mises d’accord. Après d’autres difficultés et tergiversations entre les deux chambres, fut enfin votée et promulguée la loi provisoire du 15 juillet 1905.
« Elle apportait d’importantes réformes qui consistaient principalement :
-
à changer la composition du bureau de jugement des conseils de prud’hommes, en disposant que, désormais, celui-ci se composerait d’un nombre égal de prud’hommes patrons et ouvriers, y compris le président et le vice-président, et à décider qu’en cas de partage des voix, l’affaire serait jugée par le bureau, sous la présidence du juge de paix (art. 1er) ;
-
à élever la compétence en dernier ressort des conseils de prud’hommes à 300 francs (art. 2, § 1) ;
-
à appliquer le principe que la demande reconventionnelle fondée exclusivement sur la demande principale ne pourrait rendre l’affaire susceptible d’appel, lorsque la demande principale elle-même appartiendrait au dernier ressort (art. 2, § 5) ;
-
à déclarer les jugements susceptibles d’appel exécutoires par provision, avec dispense de caution jusqu’à concurrence du quart de la somme, sans que ce quart puisse dépasser 100 francs, l’exécution provisoire ne pouvant être ordonnée pour le surplus qu’à charge par le demandeur de fournir caution (art. 2, § 5) ;
-
à constituer le tribunal civil juge d’appel des jugements de conseils de prud’hommes (art. 3, § 1) ;
-
à organiser la procédure d’appel, en édictant les prescriptions spéciales relatives au délai de l’appel, à la représentation des parties devant le tribunal civil, et à l’obligation, pour ce tribunal, de statuer dans un délai déterminé (art. 3, § 2 à 9) ;
-
à réglementer le pourvoi en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par les conseils de prud’hommes et contre les jugements des tribunaux civils statuant en appel (art. 4) ;
-
à rattacher enfin les conseils de prud’hommes au ministère de la Justice, et les soumettre aux règles de discipline applicables à toutes les juridictions (art. 5).
« Cette loi n’avait qu’un caractère provisoire ; elle était destinée à donner satisfaction aux réclamations des salariés, en mettant de suite en application les dispositions sur lesquelles Chambre et Sénat étaient enfin d’accord. Toutefois, celles-ci savaient trop que l’opinion publique attendait d’elles une refonte et une codification générale et unique de la juridiction des conseils de prud’hommes. Elles se mirent à l’étude des anciens projets de 1894, 1903 et 1904, pour aboutir deux ans après à un accord sur le texte qui était devenu la loi fondamentale du 27 mars 1907 « concernant les conseils de prud’hommes », jusqu’à son incorporation dans le livre IV du code du travail. Son article 73 a abrogé expressément toutes les lois et décrets antérieurs relatifs à la compétence des conseils de prud’hommes. C’est donc la loi d’aujourd’hui, comme nous l’avons exposée au début, avec les modifications qui y ont été apportées, dont les plus importantes sont celles apportées par la loi du 3 juillet 1919, encore complétée par les lois du 30 mars 1920, 20 juillet 1921, 21 juin 1924. »
Nous avons dit ce que sont les conseils de prud’hommes de la façon la plus brève possible. Il y aurait bien d’autres choses encore à dire sur cette intéressante juridiction, imposée par la lutte incessante des militants ouvriers et la force menaçante des syndicats corporatifs d’avant-guerre. Mais il sera facile aux gens que la question intéresse tout particulièrement de se documenter dans des ouvrages spéciaux.
En ce qui concerne cette étude spécialement écrite pour notre Encyclopédie anarchiste, c’est dans l’introduction du vaste ouvrage de René Bloch et Henry Chaumel, intitulé Traité théorique et pratique des conseils de prud’hommes, édité par la librairie Dalloz, 11, rue Soufflot, à Paris, que j’ai puisé ce modeste exposé.
On se rend compte de la lenteur des travaux législatifs quand on passe en revue, comme je viens de le faire, l’histoire de la mise en vigueur d’une loi qui semble devoir avantager le travailleur, en diminuant tant soit peu sa peine et son esclavage de salarié. Quelles navettes de la Chambre au Sénat avant que soit promulguée une telle loi ! Que de protestations, de menaces pour obtenir, au cours du siècle dernier, que cette loi soit modifiée et rendue acceptable ! Il est très utile de savoir ces choses, pour comprendre l’âpreté des luttes ouvrières et la nécessité de cohésion des travailleurs dans leurs syndicats.
Et que de critiques encore on pourrait faire contre cette loi, aujourd’hui même ! Mais il y aurait surtout à critiquer les travailleurs devenus conseillers prud’hommes et ayant oublié le principe de la lutte acharnée, que rien ne doit et ne peut atténuer, entre l’exploité et son exploiteur.
« Notre ennemi, c’est notre maître. »
Les conseillers prud’hommes ouvriers doivent se pénétrer de cette vérité, s’en souvenir en toute occasion, et ne se servir de l’arme mise en leurs mains que pour la défense de leurs frères, les exploités.
— G. Yvetot.
PSYCHANALYSE
n. f. (du grec : psukhê, âme, et analyse)
La psychanalyse ou psycho-analyse (système du docteur Freud), que de récentes traductions ont fait connaître en France, compte ici autant de partisans que de détracteurs, parmi lesquels les patriotes, pour qui tout ce qui vient de l’étranger est suspect, et les moralistes, qui n’admettent pas qu’il y ait dans l’homme des instincts anormaux, sans compter les chroniqueurs et les vaudevillistes qui, cultivant la blague boulevardière, ont vu dans le pansexualisme freudien matière à faire de l’esprit. Ce système, évidemment, exige une mise au point. Débarrassée de ses exagérations et de ses interprétations fantaisistes, la psychanalyse constitue un excellent instrument d’investigation auquel le psychologue ne saurait renoncer.
On ne peut supprimer le « freudisme » de l’histoire de la philosophie. Il est venu à son heure, après les recherches de Pierre Janet sur l’automatisme psychologique. On n’a pas compris Freud, on n’a pas voulu le comprendre. Parce que Freud a mis en lumière la part qui revient à la sexualité dans notre existence, les gens honnêtes et bien-pensants se sont émus. Ils ont délégué à leurs philosophes le soin de réhabiliter la nature humaine outragée. Freud a touché le point sensible en les démasquant. Les « parties honteuses » de l’âme ont été exposées au grand jour avec une sincérité qui ne pouvait que déplaire aux hypocrites. Que dit-il, ce docteur Freud, honni des gens du monde qui ne l’ont même pas lu ? Il dit – et se fait fort de le prouver – que tous nos actes ont leur source dans l’instinct sexuel. Ce dernier est le réservoir dans lequel viennent s’alimenter toutes nos passions. Une bataille se livre, au fond de chacun de nous, entre le conscient et l’inconscient. Le conscient tente de refouler dans les profondeurs de l’inconscient les vices – ou soi-disant vices – que la société réprouve et punit ; mais, dans l’inconscient où ils se sont réfugiés, ils continuent d’agir sournoisement. L’inconscient reprend le dessus sur le conscient qui l’a refoulé et le dirige à son insu. Il le torture et lui joue des tours pendables. Il en résulte un conflit perpétuel entre l’homme individuel et l’homme social. Ce dernier s’oppose de toutes ses forces à l’apparition des instincts qu’il a refoulés. Il dispose, dans ce but, d’un arsenal de lois, de principes et de commandements. Il fait office de censeur ! « Censure » combien illusoire et toujours débordée. Les désirs refoulés prennent un détour et se manifestent de façon anormale : ils engendrent différentes « névroses », l’idée fixe et la folie. Mais ils peuvent prendre une autre direction, susceptible d’être avantageuse pour l’individu et pour le social dont il fait partie : ils peuvent se transformer en « sublimations ». En deux mots, voici ce dont il s’agit : l’instinct sexuel, ou « libido », refoulé dans l’inconscient et continuant à vivre, cherche des « dérivatifs ». Il y en a de nuisibles, il y en a d’utiles. Ces derniers constituent des sublimations. Au nombre des sublimations engendrées par le refoulement de la libido appartiennent le sentiment esthétique, le sentiment religieux ct le sentiment moral. Dans la psychologie freudienne, la névrose apparaît comme une œuvre d’art manquée, l’œuvre d’art comme une névrose réussie. L’art est une névrose, mais une névrose bienfaisante, et Freud est conduit à en dire autant de la morale et de la religion envisagées sous certains rapports. Ainsi, le refoulement de la libido engendre tantôt la folie, tantôt le génie. Elle est la source impure de multiples psychoses, ainsi que des sentiments les plus élevés.
Ce « refoulement » a pour complément le « transfert », Nous transportons un sentiment sur une personne analogue à la personne à laquelle ce sentiment s’adressait tout d’abord.
Le freudisme a tenté de pousser aussi loin que possible l’analyse en psychologie. La psychanalyse repose sur les données fournies par l’examen de la partie inconsciente de notre vie psychique. L’inconscient joue dans la psychologie freudienne le rôle essentiel ; il constitue la réalité interne de l’individu, la vie psychique produisant des actes dont le sujet n’a pas conscience. La psychanalyse part de ce principe que l’on retrouve dans nos gestes et nos paroles, en apparence quelconques et insignifiants, notre personnalité la plus profonde et la plus intime. Les menus faits de l’existence quotidienne passent au premier plan. Des oublis de noms, des défaillances de mémoire, des distractions, des maladresses, et, ajouterai-je, jusqu’à des fautes d’orthographe, ont une importance capitale pour le psychanalyste. Freud cite les reproches obsédants que s’adressent certaines personnes après la mort d’un être aimé, qu’elles ont cependant soigné avec dévouement, prolongeant le plus possible son existence. Bien que ces personnes n’aient pas causé la mort de l’être aimé, les reproches qu’elles s’adressent sont justifiés du fait que cette mort a procuré une satisfaction à un désir inconscient qui l’aurait provoquée, s’il avait été assez puissant. Le reproche réagit contre ce désir inconscient. Il est certain qu’en interprétant de cette façon tous les faits de la vie humaine on va loin, et l’on aboutit même à des absurdités. La psychanalyse peut rendre de grands services, à condition qu’on en use au lieu d’en abuser, et qu’on l’applique à des faits particuliers au lieu de généraliser.
Pour le docteur Freud, l’homme civilisé ne l’est qu’extérieurement, ses instincts n’ayant pas varié depuis les temps lointains de la Préhistoire. L’analyse de l’inconscient retrouve chez lui ses origines ancestrales. La « censure », qui n’est pas autre chose que la culture morale dominant l’atavisme, opère le refoulement de ses désirs dans l’inconscient, et l’empêche de donner libre cours, dans la société, à ces instincts primitifs : ces tendances cependant ne disparaissent pas tout à fait, mais prennent un détour pour se manifester. L’homme civilisé les satisfait, les orientant dans une autre direction. Cet inconscient, survivance dans l’individu de ses origines préhistoriques, constitue l’objet même de la psychanalyse. Ce « refoulement » de tendances ataviques, que l’on contente comme on peut, moi je l’appelle « hypocrisie » : l’homme social prend un masque, et justifie ses instincts en leur donnant des noms glorieux, en les légalisant, ce qui engendre un état social pire que celui de l’humanité primitive.
Freud fait de l’instinct sexuel, ou libido, le ressort essentiel de la psychologie. Celle-ci domine toute la vie de l’homme, inspire tous ses actes. Toutes nos aspirations sont de nature sexuelle. Les forces sexuelles refoulées dans l’inconscient par la censure, qui occupe le préconscient, constituent des « complexes ». Freud appelle ambivalente l’attitude de l’individu consistant dans le fait, pour lui, de vouloir accomplir un acte et d’être en même temps retenu par le dégoût que cet acte lui inspire. Freud explique par le psychisme inconscient ce qu’il appelle les instincts sexuels narcissiques, les défenses et prohibitions qui consistent dans le fait, pour certains individus, de ne pas transgresser les tabous qu’ils se sont donnés, la paranoïa ou délire chronique des persécutions, les phobies, les névroses obsessionnelles, etc. Freud a fait sur la « lubricité infantile polymorphe » des remarques intéressantes. La psychanalyse a donné de bons résultats dans l’étude des rêves. Le rêve est une réalisation détournée de certains désirs refoulés. L’être humain se détourne de la réalité pour se réfugier dans le rêve (religion, art, philosophie) ou la névrose. La névrose, pour Freud, résulte du refoulement en nous d’émotions auxquelles nous ne pouvons donner cours. Les « actes manqués » résultent de tendances réprimées.
Le freudisme a éclairé la psychologie de l’enfant, du primitif et du névrosé et donné des résultats psychasthéniques pratiques.
Ne reprochons pas à la méthode psychanalytique son « pansexualisme ». N’ayons pas l’hypocrisie de la condamner. Bornons-nous à dire qu’elle gagnerait à tenir compte, dans ce « refoulement », de certains facteurs physiques. La psychanalyse ne peut se passer du concours de la biochimie.
La psychanalyse a permis d’expliquer un certain nombre de phénomènes et fourni d’excellents résultats en thérapeutique. Elle est parvenue à guérir certaines névroses. Le « dogme pansexualiste », corrigé par Adler, Jung et son disciple Maeder, nous a ouvert de nouveaux horizons, notamment dans la psychanalyse de l’art.
Freud, « le Christophe Colomb de l’inconscient », a découvert un monde. Sans le comparer, comme il l’a fait lui-même, à Darwin et à Copernic, on peut lui accorder une place à côté de ceux qui, dans une voie différente, William James, Bergson ou Einstein, ont eu le mérite de systématiser des vues éparses, auxquelles ils ont imprimé le sceau de leur personnalité.
— Gérard de LACAZE-DUTHIERS.
PSYCHIATRIE
n. f. (ou « Médecine de l’Âme »)
Ce mot désigne l’ensemble des désordres mentaux issus d’un cerveau et d’un système nerveux central malades. Le mot âme ne signifie pas autre chose, en effet, pour les esprits positifs, que les fonctions du cerveau. Nous n’employons ce vocable de la vieille philosophie spiritualiste que pour la commodité du langage. Mais il demeure entendu qu’il n’y a pas la moindre différence de substance entre l’âme et le corps. Tout trouble de l’esprit ou du sentiment a un support organique dont il exprime la souffrance. Le symptôme lui-même, si impressionnant, si immatériel qu’il puisse paraître, n’est rien s’il n’est point relié à un organe qui a cessé de fonctionner normalement.
J’ai dit normalement, une fois encore par commodité de langage, car je dois rappeler que personne ne connaît intégralement le fonctionnement du cerveau et ne peut déterminer absolument si tel ou tel phénomène analysé est ou n’est point normal. Tout ce que l’on peut déclarer est qu’il n’est pas usuel, et cette déclaration entraîne fatalement des réserves. Sur le terrain de la folie, de celle surtout qui ne s’est pas encore révélée à l’observateur par une lésion déterminée de la substance organique, de pareilles réserves sont indispensables ; car les réactions psychiques qui sont souvent cataloguées folie ne le sont point aux yeux de tous les observateurs. Le terrain social et moral, en effet, où évoluent les phénomènes auxquels je fais allusion, est un facteur d’une particulière gravité et c’est en raison de cette gravité même, qui n’apparaît pas aussi sévère dès qu’il s’agit d’une autre fonction, comme celles du foie ou de l’estomac, que nous nous sentirons constamment en plein domaine de la relativité.
Bref, socialement parlant, il faudra parfois chercher le critérium d’un trouble mental dans une autre voie que la lésion organique, et cela tant que l’anatomie et la physiologie (psychologie) du système nerveux central ne pourront être rapportées à une sorte d’étalon.
Ce que je définis ainsi n’est du reste pas exclusif au cerveau. Qui donc, en effet, pourrait se targuer de connaître le prototype du squelette, de la chevelure ou des reins, tel que le créateur aurait pu nous le décrire, s’il y avait songé ? Nous sommes loin aujourd’hui de cette étrange définition de la dégénérescence donnée pourtant par un clinicien de premier ordre, le docteur Morel : la dégénérescence est la déviation du type normal de l’humanité. L’honorable médecin a eu pour excuse d’être un croyant, mais sa foi ne lui permit point de préciser les lignes du type normal. Et nous sommes aussi dépourvus qu’avant lui d’éléments de comparaison.
* * *
Ces préliminaires indispensables étant tracés, ma tâche reste simple, car elle consiste à délimiter le cadre des affections dites mentales et à en fournir une sorte de classification très provisoire, car, ici encore, il est fort difficile de trouver des classificateurs unanimes.
Nous suivrons pour la commodité la vieille division scholastique qui se prête assez bien à une description objective, à savoir les trois compartiments où l’on case les manifestations du psychisme : intelligence, sentiment, volonté.
Disons, en premier lieu, que les troubles qui prédominent dans la folie, soit qu’ils existent à l’exclusion de tous autres, soit qu’ils compliquent d’autres états, ressortissent aux sentiments. Notre maître, Magna, les désignait justement du nom d’éléments simples. Ils constituent bien, aujourd’hui, un groupe d’affections déterminées et reliées selon toute vraisemblance à des anomalies du système endocrinien, à savoir des troubles des glandes à sécrétion interne (corps thyroïde, glande surrénale, etc.) agissant sur le système nerveux par l’intermédiaire du sympathique.
Telles sont les deux antinomies manie et mélancolie, objectivement caractérisées par un excès morbide d’expansion ou de tristesse, la première allant jusqu’à la fureur, au désordre absolu de toutes les facultés (le tableau de la manie réalise bien la folie telle que les gens du monde se la représentent : agitation, incohérence, volubilité, excentricités, etc.). Quant à l’autre, la mélancolie, elle a des degrés aussi, depuis la simple dépression mentale avec dégoût insurmontable de l’existence jusqu’à la stupeur la plus complète, avec arrêt apparent de la pensée, en passant par une phase de délire, parfois hallucinatoire, où la tristesse, compliquée d’un sentiment de diminution de la personnalité avec accusations imaginaires, conduit au suicide.
Mélangeons à volonté ces deux éléments ; concevons une succession alternante entre eux et nous réalisons un tableau clinique des plus fréquents dans les asiles, lequel n’est lui-même que l’excès de dispositions normales (la joie et la peine alternent chez tous), et nous connaîtrons une forme de folie très commune : la folie dite à double forme, folie alterne, mieux encore : folie intermittente, que l’aliéniste allemand Kraepelin a dénommée psychose maniaco-dépressive où l’on tend à voir un état grave conduisant à la démence précoce et définitive. Ici, il s’agit de ces accès de mélancolie et d’agitation, dont l’intensité enlève au sujet tout moyen de diriger son comportement et qui, la plupart du temps, exigent l’internement. De tels accès durent parfois pendant des mois et même des années, les deux phases se succèdent avec brusquerie, sans trêve. Ce retour alternatif d’accès a fait appeler cette psychose folie circulaire.
Nous en aurions fini avec les états simples, purement affectifs, s’il ne fallait mentionner un autre élément simple que l’on rencontrera dans la plupart des psychoses, c’est l’hallucination. Ce symptôme fort curieux connu depuis toujours, même dans l’Antiquité, mais interprété de façon très diverse, est vraiment la marque de fabrique de la folie.
Il s’agit d’un fonctionnement en apparence automatique des centres où s’emmagasinent les images sensorielles. Il affecte les divers sens : la vue (visions d’êtres animés, animaux, personnages, scènes variées au gré de l’imagination du sujet) ; l’ouïe (audition de bruits vagues ou précis, voix, propos aimables ou pénibles, injurieux, obscènes, provocateurs, bruits de foule, explosions, monologues ou dialogues, etc.) ; l’odorat (perception d’odeurs inexistantes, fétides ou parfumées, produits chimiques, sensation de suffocation, etc.) ; le goût (sucre, sel, amertume, poisons de toutes sortes) ; le toucher (sensations de frôlement, de pincements magnétiques, électriques, brûlures, actions sur les organes génitaux, action sur le cerveau lui-même ; suspension de la pensée (hallucination psychique, automatisme verbal, etc.).
Faire l’histoire de l’hallucination serait faire celle de la folie à travers les âges, à travers l’histoire ; elle mettrait en jeu les grands inspirés, depuis la Pythie de Delphes jusqu’aux mystiques célèbres plus modernes, y compris les névropathes béatifiés, sanctifiés, les miraculés de tous ordres.
L’intérêt pratique de ce phénomène est de savoir qu’il n’est possible qu’à la faveur d’un trouble de la conscience ou de la vision intérieure.
Les sujets hallucinés, à de rares exceptions près, ne savent point qu’ils sont hallucinés et reçoivent les données de leurs sens comme autant de réalités, et l’on aperçoit d’ici quelles en peuvent être les conséquences.
Car, réelles ou fictives, les données de nos sens déterminent nos actions ou les successions d’états de conscience qui aboutissent à l’action. Si un citoyen s’entend injurier de façon persévérante et qu’il ne se rende pas compte que ce trouble auditif n’est né que de lui-même, il peut être conduit à des réactions dangereuses, tout comme s’il avait été réellement injurié. La plupart des crimes et délits, commis par les malheureux qui tombent entre les griffes de la justice, sont le fruit d’hallucinations. Ces désordres des sens jouent un rôle énorme dans les relations entre citoyens.
Elles forment, du reste, la base essentielle et suffisante d’une forme de psychose, aujourd’hui cliniquement isolée, et que l’on appelle l’hallucinose ; elle est essentiellement constituée par des hallucinations primitives, diversement appréciées par les sujets qui finissent par se constituer une nouvelle existence, une nouvelle personnalité. Car les aliénés de cette catégorie ne perdent point l’usage des rouages normaux du raisonnement. On peut raisonner très juste sur des données fausses. Ce qui fait le fond de cette grave folie, c’est la perte même du jugement, du contrôle primordial. Substituez une suggestion réelle à une suggestion fausse, le sujet reste dans la voie commune des associations d’idées ; il ne déraille en fait que parce que le jeu de ses pensées ne s’articule à l’origine qu’avec des erreurs.
L’intervention des sens est d’une extrême gravité, car le travail syllogistique de la réforme du raisonnement tombe constamment à faux, dès que l’intéressé est prêt à vous rétorquer : j’entends, donc cela est ; je vois, donc cela est. D’où il suit que les psychoses de cet ordre sont chroniques d’emblée et incurables. Il est notoire du reste qu’après une durée plus ou moins longue d’un tel état, les facultés intellectuelles perdent encore de leur acuité et que tout espoir de remonter le courant est perdu. Les malades tombent dans un état qualifié de démence vésanique, précurseur de la mort mentale.
L’intérêt de l’étude de l’hallucination que j’ai faite, même très brève, nous a permis de passer des troubles du sentiment vers les troubles de l’intelligence. On a vu l’affaiblissement et parfois la disparition du jugement, la substitution de l’automatisme à la vie mentale raisonnante, avec la conservation pourtant du jeu régulier des rouages de l’organe cérébral. Telle une montre dont le mécanisme est intact, mais dont les battements seraient irréguliers et fantaisistes
* * *
Les troubles, à proprement parler, de l’intelligence constituent un énorme département de la folie. Ce que j’en ai dit est fondamental et suffisant. C’est dire que le contenu de la psychose n’a rien à faire avec le fond : sur ce dernier, greffez toutes les fantaisies possibles et vous aurez objectivement les délires de persécution (les plus fréquents), les délires de grandeur, les mystiques, les hypochondriaques, les érotiques, etc. Le mélange, l’enchevêtrement des éléments simples fournissent le tableau final. Tel un peintre qui, en vertu de son même talent, et se servant des mêmes couleurs, saura représenter les scènes les plus différentes, tel un aliéné saura, selon la nature de son tempérament, de son expansivité, de ses refoulements et surtout de ses hallucinations, jouer le rôle d’un persécuté, d’un mégalomane, d’un libidineux, d’un mystique, etc.
Sur le terrain purement intellectuel, il me faut mentionner maintenant ces états raisonnants, dépourvus d’hallucinations qui, socialement parlant, sont beaucoup plus graves et dangereux que les précédents. Il s’agit, en effet, de sujets dits paranoïaques qui offrent toutes les allures de sujets normaux, mais qui excellent dans les raisonnements faux, absurdes, compliqués, où il est difficile de les suivre sans s’y perdre soi-même, mais qui offrent toujours les caractères de la vraisemblance. C’est dans cette catégorie d’aliénés que se recrutent la plupart des persécutés persécuteurs, beaucoup plus actifs dans leur délire que passifs. Nombre de persécutés supportent avec résignation les hallucinations les plus pénibles ; ce persécuté passif n’est pas celui qui tue. Mais ce raisonneur dont je parle ici n’est jamais un passif. Souvent même à l’origine de son épopée délirante, qui se traduit par ce qu’on appelle le délire des actes, il y a un noyau de faits réels, ordinairement insignifiants : la vie en est pavée. Mais à partir de ce noyau s’échafaudent mille raisonnements, mille interprétations stupides, illogiques et ridicules qui font nombre de complices, pendant quelque temps, jusqu’au jour où ces confidents se dérobent par la tangente. Alors, nos persécuteurs tombent dans l’erreur de la justice, en laquelle ils croient ; on les voit s’engager à perte de vue dans les procédures les plus échevelées ; ils constituent l’armée des processifs, des querelleurs ; ils rencontrent sur leur route maints parasites de la justice qui ne demandent qu’à les entretenir dans leur marotte dont ils vivent. Immanquablement, ils aboutissent à une impasse où ils ne connaissent plus que le scandale et la violence auxquels ils recourent pour appeler l’attention publique sur leur cas. C’est le moment où ils commettent quelque crime si, à la traverse, quelque autorité de bon sens ne les a colloqués à temps. La plupart des séquestrations dites arbitraires sont le fait de persécuteurs raisonnants, dont le cas émeut le populaire, si facile à tromper sur ce terrain. Autour de ces cas, on voit germer de véritables accès de psychose collective, contagieuse. La folie des foules ayant à sa base une suggestibilité, dont l’importance est en raison de la masse, est une psychose des plus curieuses. Elle se produit d’ailleurs dans tous les sens possibles : exaltation, emballements, enthousiasmes politiques, religieux, patriotiques ou autres, accès au cours desquels les meneurs intéressés, pour peu qu’ils aient quelque habileté, récoltent maints avantages. Elle se produit surtout dans le sens de la revendication. La folie des persécutés interprétateurs est féconde en complications médico-sociales qui requièrent une dose de sang-froid énorme pour que les intéressés formant la galerie échappent à la contagion.
* * *
Traitons maintenant des troubles mentaux où la volonté est principalement en cause. Souvent, on les range sous la simple rubrique « folie lucide ». En effet, ils coïncident le plus généralement, non seulement avec une conscience très claire, mais aussi avec une parfaite lucidité. C’est une série de phénomènes qui ont le don de stupéfier les observateurs non prévenus et qui sont bien propres à faire douter de l’unité de la personne humaine. Ils conduisent, en tous cas, vers la conception théorique, objective, et sans doute provisoire, d’un dédoublement possible de la personnalité, une partie observant l’autre, totalement impuissante à régler ou à modifier son comportement. La conscience du sujet domine la situation comme un véritable spectateur. Mais ce qui caractérise la situation, c’est que ce détraquement profond de la machine cérébrale coïncide avec une lucidité parfaite. Lucidité et conscience sont deux choses. Un persécuté aliéné peut être parfaitement conscient du mal qu’il éprouve, mais il n’a point de lucidité attendu qu’il ne sait point discerner que ses souffrances sont sans cause objective. Jamais un aliéné ne rapporte à lui-même la cause de son aliénation.
Les folies lucides sont symptomatiquement une anarchie de la volonté. Elles ressortissent comme éléments premiers à deux phénomènes psychologiques bien connus : l’obsession et l’impulsion. Un sujet sera hanté malgré lui par l’idée du suicide, alors qu’il n’a aucune raison d’accomplir cet acte. Il le reconnaît, l’avoue, se défend avec la dernière énergie contre cette idée stupide, implore du secours ; mais sa résistance est vaine : la souffrance morale que lui procure son aboulie est le mal suprême dont il est victime.
L’obsession et l’impulsion sont liées comme la pensée l’est à l’acte. Toutes deux sont aussi irrésistibles. Nombreuses sont les formes de folies lucides qui rentrent dans le cadre de ce que le grand public, que le mot de folie effraie, dénomme neurasthénie. J’énumère au hasard la folie du doute, la dipsomanie, l’impulsion homicide, la kleptomanie, la manie incendiaire, etc.
* * *
Examinons maintenant les états psychiques où les éléments simples, dont il a été question jusqu’ici, se trouvent mélangés par parties inégales. Tout de suite, ces états mixtes nous amènent sur l’immense terrain de la folie héréditaire ou folie des dégénérés.
Il y a sans doute des usures organiques auxquelles participent les divers systèmes de notre économie, usures qui sont l’aboutissant d’influences morbides accumulées au cours des générations. La disparition de familles, d’espèces, de races par une sorte d’épuisement progressif est connue, mais nulle part cet état de dégénérescence n’a été aussi frappant que du côté du système nerveux.
Si nous ne pouvons accepter la définition un peu ingénue de la dégénérescence que nous avons citée plus haut, nous pouvons, en restant sur le terrain des relativités, et en comparant des couches successives d’êtres humains, constater très simplement que la résistance aux causes de déchéance et de mort peut diminuer de génération en génération, jusqu’à aboutir au néant, et qu’une génération qui résiste moins que la précédente est dans un état de dégénérescence. Cette définition laisse entier le problème de la régénération qui à priori apparaît possible, si de meilleures conditions sociales le permettent.
Psychiatriquement parlant, les dégénérés sont classés en quatre catégories. Tout à fait en haut de l’échelle, les sujets dont l’intelligence reste intacte, dans chacun de ses éléments constituants, mais dont le déséquilibre est permanent. Même déséquilibre dans la sphère des sentiments et de la volonté.
À un second degré apparaît l’immense cohorte des simples d’esprit, dont l’intelligence est frappée en qualité comme en quantité.
Au-dessous, viennent les sujets frappés d’imbécillité et, tout de suite après, les idiots. Chez eux, l’intelligence disparaît, laissant la place à une pure instinctivité animale et à la stérilité complète. C’est l’extinction de la lignée.
Sur ces divers états fonciers, on peut greffer à volonté, selon la valeur de l’intervention des causes secondaires de la folie, empruntées aux différents milieux, des troubles délirants de toutes sortes, dont la rapidité et la spontanéité d’éclosion sont les marques caractéristiques. Un dégénéré sera reconnu à ce fait que, plongé parmi les causes communes d’ébranlement cérébral, il se déséquilibre plus vite que son voisin et tombe dans un accès de folie, là où beaucoup d’autres sujets résisteront indéfiniment.
Suivant la qualité de l’organe cérébral, la destinée de ces délires, de ces édifices surgissant comme des éruptions, est variable. Souvent éphémères et guérissant comme ils sont venus, ils sont d’autres fois incurables et entraînent plus ou moins vite une démence trahissant un anéantissement définitif de la vie mentale.
La notion de dégénérescence est pratiquement fort intéressante, car elle constitue un terrain qui compliquera d’autres états psychiques et les aggravera. Tel un accidenté du travail qui, au lieu de guérir dans un temps très court d’une commotion cérébrale, verra éclater à cette occasion un accès de folie. La prédisposition est un facteur de complications qui intervient à tout instant dans la liquidation de procès où sont en cause des accidents au cours desquels le cerveau a été intéressé.
Sans entrer ici dans le détail des causes de la dégénérescence qui sortirait de notre cadre, il faut pourtant signaler que des troubles survenant dans l’évolution sexuelle, lors de la puberté, amènent des cas graves de folie dont le nombre est très élevé et qui, sous les noms de hébéphrénie et de démence précoce, sont caractérisés d’emblée par une compromission de la vie psychique dont, tôt ou tard, ordinairement très vite, la conclusion sera la mort cérébrale.
Il nous reste à énumérer les maladies mentales à causes nettement déterminées, accidentelles, reposant sur une base nettement organique.
Deux grandes causes engendrent la folie : la syphilis et les intoxications, auxquelles il faut joindre, très logiquement, les infections graves.
La syphilis conduit à la paralysie générale qui n’est autre qu’une méningo-encéphalite à marche inexorable, mortelle dans l’espace de deux à trois ans. La syphilis est également justiciable d’un nombre énorme d’états héréditaires. L’hérédosyphilis portera les noms d’idiotie, d’hydrocéphalie, même d’épilepsie. Elle est une des causes principales de la décadence psychique de l’espèce.
On en peut dire autant des grandes intoxications dont les deux principales – l’alcoolisme et l’opiomanie – exercent une influence désastreuse sur l’espèce. Les folies alcoolique et opiomique ont des caractères cliniques sensiblement superposables. Ce sont des folies essentiellement aiguës, transitoires, fécondes en hallucinations, principalement de la vue.
Toutes les folies toxiques se ressemblent, quelle que soit l’origine du poison : les maladies microbiennes telles que la fièvre typhoïde, la diphtérie, l’encéphalite léthargique, procurent des délires transitoires, mais dont la terminaison peut aussi se faire par un affaiblissement plus ou moins rapide des facultés.
Pour terminer, je mentionnerai les complications cérébrales de l’épilepsie et de l’hystérie, d’une extrême fréquence, et les états psychiques qui ressortissent à des troubles de sécrétion des glandes endocrines, qui commencent à être bien connus. Exemple : les troubles cérébraux symptomatiques d’un thyroïdisme anormal. On sait qu’un nombre énorme de cas d’arriération mentale sont dus exclusivement à l’insuffisance de la glande thyroïde, à preuve qu’ils cèdent à des traitements basés sur l’emploi d’extraits thyroïdiens rectifiant cette insuffisance.
Cet article « Psychiatrie » ne saurait constituer un traité d’aliénation mentale. Il est tout juste bon pour orienter les esprits observateurs vers les manifestations anormales de l’intelligence, pour leur apprendre à les observer et à les cataloguer sommairement, et aussi à rectifier bien des erreurs et bien des préjugés qui s’infiltrent forcément dans nos conceptions.
Mettre la psychiatrie dans son cadre n’est point faire l’histoire de la folie dans ses aspects cliniques, ni en déduire tous les enseignements qu’elle comporte sur le terrain de la sociologie, de l’hygiène mentale et de la médecine légale. Chacun de ces points fournirait la matière de longs chapitres spécialisés.
— Docteur LEGRAIN.
PSYCHOLOGIE
n. f. (du grec : psukhé, âme, et logos, discours)
La psychologie est l’étude de l’âme, entendez par là non ce principe abstrait dont parlent les théologiens, mais l’ensemble des phénomènes qui se passent dans chaque individu. C’est toute la personne humaine, avec ses émotions, ses passions, son intelligence, sa volonté, etc., qui est du ressort de la psychologie. « La psychologie est l’étude scientifique des faits de conscience », disait Th. Ribot. On entend par « fait de conscience » des groupes de phénomènes que nous avons soin de distinguer les uns des autres, tels que les sensations, les sentiments, etc. Une question se pose dès qu’on aborde l’étude des phénomènes psychologiques : c’est celle de la méthode. Emploierons-nous, pour les étudier, la méthode subjective, ou la méthode objective, la première constituant une méthode d’introspection (regarder au-dedans) ou d’observation interne ; la seconde une méthode d’observation externe, le sujet cessant de se confondre avec l’objet, examinant du dehors, faisant appel à toutes les sciences pour se connaître et connaître les êtres qui l’entourent ? Chacune de ces méthodes offre des avantages et des inconvénients, mais en les associant, les combinant, les complétant l’une par l’autre, le psychologue diminue les chances d’erreur qui peuvent se glisser dans son observation.
La psychologie est devenue une partie si importante de la philosophie qu’elle a fini par se substituer à celle-ci : certains philosophes ont réduit la philosophie tout entière à la psychologie. En même temps qu’ils faisaient de la psychologie une science indépendante de la philosophie, dont le rôle se bornait à l’étude de problèmes généraux, d’ordre métaphysique, ils l’annexaient à la physiologie. Sans doute, on ne peut expliquer certains « faits de conscience » sans avoir recours à la physiologie, mais il s’en faut de beaucoup que cette dernière soit l’unique explication de ces faits. Il y a là une exagération qui exige une mise au point. Cette conception d’une psychologie physiologique ou d’une physiologie psychologique a donné naissance à de nombreuses « monographies » présentant un certain intérêt. Qu’il me soit permis de dire que l’analyse, si légitime qu’elle soit, dans les recherches scientifiques ou littéraires, n’est rien par elle-même : elle ne vaut que par la synthèse. C’est la synthèse seule qui donne la vie au document, vivifie l’observation et l’expérimentation, communique de l’intérêt aux travaux les plus terre-à-terre. Sans la synthèse, la science s’arrête à mi-chemin. Par la synthèse, elle rejoint la vie.
Les problèmes que soulève la psychologie sont extrêmement variés. On les range en trois groupes se rapportant à la vie intellectuelle, affective et active. Tour à tour, on examinera, en employant la méthode génétique, qui explique le supérieur par l’inférieur, les rapports du physique et du moral, les sensations, les perceptions, la mémoire, l’association des idées, l’imagination reproductrice et l’imagination créatrice, l’attention, la réflexion, le jugement, le raisonnement, l’abstraction, les signes et le langage, les principes rationnels de finalité, de substance, de causalité, de raison suffisante, d’identité, les concepts, les idées de la raison (l’espace et le temps), l’effort intellectuel, le plaisir et la douleur, les émotions, les affections, les passions, la sympathie, l’imitation, les inclinations, les sentiments, l’instinct, l’habitude, la volonté, la personnalité, l’idée du moi, etc. La psychologie anormale et pathologique apportera son concours à la psychologie normale, complétant celle-ci par l’étude des fous, des dégénérés, des malades. Nous y joindrons la psychologie de l’enfant, celle du sauvage, et jusqu’à celle des animaux, nos « frères inférieurs ». L’animal est plus intelligent que certains hommes. Mais les hommes qualifient d’instinct l’intelligence des animaux, et donnent à leur instinct le nom d’intelligence. Bien peu de choses séparent l’homme de l’animal. Celui-ci a son langage, sa philosophie, son art. L’homme est un animal plus compliqué, voilà tout.
Nous examinerons un chapitre nouveau de la psychologie, désigné par Pierre Janet sous le nom d’automatisme psychologique. Il y a un grand nombre de gestes inconscients et subconscients, que nous accomplissons sans nous en rendre compte. Ils ont cependant leurs lois, comme les phénomènes conscients. Les anciens philosophes se préoccupaient exclusivement des formes les plus élevées de l’activité humaine, méprisant ou, plutôt, ne soupçonnant pas ses formes inférieures : les nouveaux philosophes étudient la conscience et la sensibilité dans leurs formes élémentaires les plus simples, les plus rudimentaires (les lois de la maladie étant les mêmes que celles de la santé). Il faudra, désormais, compter avec l’inconscient, dont beaucoup de gens parlent inconsciemment. On sait quelle place a pris l’inconscient depuis quelques années dans la philosophie. On a cherché dans l’inconscient l’explication d’un grand nombre de phénomènes. En même temps que l’inconscient, dont le rôle avait été seulement pressenti par quelques philosophes, le sentiment était réhabilité, avec l’instinct. On opposait à la raison l’inconscient. Le pragmatisme trouvait dans l’inconscient sa justification ; au nom de l’inconscient on mettait en doute la valeur de la science. Il est certain que le rôle joué par l’inconscient dans la conscience humaine est considérable et ne peut être nié. Qu’est-ce au juste que l’inconscient ? Est-ce une conscience confuse, comme le croient les pan-psychistes ? Ou s’explique-t-il par la psychologie ou la physiologie ? Les philosophes sont loin d’être d’accord. Quoi qu’il en soit, l’inconscient est un fait. Il y aurait dans l’individu un moi conscient et un moi que Myers a appelé subliminal (au-dessous du seuil) : ce dernier, analogue au moi ancestral, à celui des animaux supérieurs et des primitifs, constituerait une sorte de vie végétative. L’inconscient et le conscient réagissent l’un sur l’autre. L’acte automatique joue un rôle dans la vie humaine, comme l’acte conscient. On constate chez l’être le plus intelligent des actes demi conscients. Psychologues, psychiatres, occultistes, métaphysiciens, sociologues, etc., ont dû tenir compte de l’inconscient dont ils ont étudié les effets dans la vie morale, intellectuelle et sociale de l’humanité.
Nous venons de parler de psychologie anormale. Elle a été le point de départ de recherches intéressantes. De nouvelles méthodes lui ont apporté leur concours. La psychothérapie a l’ambition de guérir les maladies de l’âme. Elle les traite comme des maladies du corps et s’efforce d’en prévenir le retour. La psychiatrie les constate et met en lumière différentes psychopathies. Les psychiatres font souvent fausse route. Ils ont les défauts de tous les spécialistes : ils ne voient qu’un aspect de la réalité. Les psychiatres mettent les artistes au nombre des « paranoïaques ». Tout ce qui sort de l’ordinaire est, par eux, traité de folie.
Ainsi, la psychologie envisage l’homme dans toutes ses attitudes. Elle le dissèque, le pèse, l’analyse, le triture en tous sens. Ce qui est dangereux, c’est l’abus qu’on fait de la psychologie. La psychologie des écrivains et celle des philosophes ne se ressemblent guère ; cependant, à ne faire que de la psychologie, objective ou subjective, expérimentale ou non, on risque d’être obsédé par l’idée fixe, qui est elle-même un cas fort curieux de psychologie anormale et pathologique.
— Gérard de LACAZE-DUTHIERS.
PSYCHOLOGIE
La psychologie a été incorporée à la philosophie en compagnie de la logique, de la morale et de la métaphysique.
C’est là un reste de la confusion primitive, où les connaissances scientifiques, la religion, la morale et la politique formaient un tout indivis.
On a même nié la psychologie ; Auguste Comte voulait en faire une partie de la sociologie, partant du fait que l’homme est un être social.
C’est une erreur. On pourrait plutôt rattacher la morale à la sociologie. Parce que la morale, science de ce qui doit être et non de ce qui est, gouverne le rapport des hommes entre eux.
On a voulu aussi faire de la psychologie une annexe de la physiologie, sous prétexte que le cerveau, organe de l’esprit, est une partie du corps.
Là aussi on s’est trompé, conduit par un matérialisme mal compris.
Le sphygmographe peut nous enseigner que le pouls précipite ses battements sous l’influence d’une émotion, mais il ne nous dit rien de l’émotion elle-même.
Le vrai est que la psychologie comporte une méthode spéciale, l’introspection, qui la rend très difficile, parce que le sujet de l’expérience en est en même temps l’objet. De là le peu de progrès fait par la psychologie depuis Aristote qui, déjà, avait découvert l’association des idées, dont l’étude fut complétée de nos jours par Stuart Mill.
La vieille théorie des facultés de l’âme : sensibilité, intelligence, volonté, n’a pas pu être remplacée.
L’introspection est complétée par l’extrospection, c’est-à-dire par l’observation des autres : enfants, vieillards, aliénés, idiots, hommes d’intelligence diverse. Mais nous ne pouvons connaître de l’âme des autres que ce qu’ils veulent bien nous en livrer ; en outre, il est peu de personnes vraiment capables de s’observer elles-mêmes ; le connais-toi toi-même socratique est rare.
Les faits psychologiques ont été étudiés aussi par leurs contours, si on peut s’exprimer ainsi. On a pu mesurer le temps qu’ils mettaient à se produire. C’est quelque chose ; mais cela ne dévoile pas le mécanisme intime de la pensée qui, peut-être, échappera toujours à la connaissance humaine. On a étudié avec plus de fruit ce qu’on pourrait appeler la psycho-sociologie, étude de l’influence du milieu social sur l’individu.
La psychanalyse de Freud est venue donner une vigueur nouvelle à la psychologie endormie dans les vieilles formules. On s’est livré à des interrogatoires très minutieux pour découvrir l’origine d’une obsession, d’une phobie ou d’une idée fixe. Freud, comme tous les auteurs de systèmes, a eu le tort de pousser à l’exagération l’influence de la sexualité dans la constitution de l’âme humaine.
Certes, le besoin sexuel, venant après les besoins de nourriture et de sommeil, ne peut pas ne pas avoir un rôle important dans l’esprit humain. Néanmoins, il n’y a pas que le sexe dans la vie mentale.
Freud, néanmoins, a rendu et rendra de grands services en portant à faire attention aux paroles, notamment en matière d’éducation. Il est des paroles qui ont la nocivité de poisons. Un enfant sera à jamais incapable, parce qu’on lui aura répété qu’il est incapable. En l’humiliant de manière constante, on provoque en lui des complexes d’infériorité qui pourront le diminuer sa vie entière.
Nos pères et nos grands-pères se conduisaient à cet égard comme des barbares. Ils croyaient avoir fait tout leur devoir en donnant à leurs enfants le vivre et le couvert. Ils passaient sur eux leur mauvaise humeur, leur volonté de puissance, s’ingéniant à les humilier.
La psychologie a été aussi appliquée à l’orientation professionnelle. Par des tests, on évalue les aptitudes des enfants et on leur conseille d’entreprendre une profession en rapport avec leurs dons naturels. Mais ces études sont encore bien loin d’être au point, d’autant mieux que, dans la société présente, c’est la situation et la fortune des parents, et non les aptitudes de l’enfant, qui déterminent son avenir.
— Doctoresse PELLETIER.
PSYCHOLOGIE
I. COMPARÉE.
Socrate donnait à l’homme un excellent conseil, en lui disant :
« Connais-toi toi-même. »
Le difficile est de l’appliquer. Faut-il faire porter exclusivement l’examen sur sa propre personnalité ? Est-il opportun d’étendre ces investigations à d’autres êtres, et, de l’analyse de leurs réactions élémentaires, déduire quelques notions sur le fonctionnement si complexe de notre esprit ?
La première méthode, pratiquée depuis la plus haute Antiquité, est celle de la psychologie classique, à laquelle des savants réputés demeurent fidèles. Ainsi, M. R. Anthony, professeur au Muséum, écrivait, il y a cinq ans :
« Du moment où l’on distingue une psychologie, on ne peut l’entendre que comme la science des faits de conscience envisagés en tant que faits de conscience, et rien de plus, rigoureusement ; il est impossible de vouloir étendre au-delà les limites de son champ. De cela résultent : directement, que la psychologie objective n’est pas de la psychologie et, indirectement, que la psychologie zoologique n’est pas une science, mais un fantôme de science seulement. »
Ce ne serait que des parties de la physiologie non dépourvues d’intérêt, certes, mais ne nous renseignant guère sur la nature et le jeu de notre esprit.
Cette psychologie classique nous a rendu le service d’analyser les plus fines nuances qui colorent l’expression de notre psychisme. Mais, depuis longtemps, elle ne fait plus que piétiner sur place. Elle s’en tient à la forme, elle n’atteint pas les fondements de notre activité mentale.
La plupart des philosophes et des savants de notre époque s’engagent dans une autre voie. M. J. Lhermitte, de la faculté de Médecine, nous dit :
« Sans diminuer la valeur de l’introspection, il est permis, croyons-nous, de soutenir que la meilleure manière de se connaître soi-même, c’est d’abord de connaître son cerveau. »
L’introspection peut même nous égarer. MM. Delmas et Boll font observer que :
« La connaissance de la personnalité d’un de nos semblables – et en particulier de notre propre personnalité – présente des difficultés considérables, qui sont imputables à plusieurs raisons : nous n’assistons jamais qu’à des faits, à des manifestations dynamiques ; seule une abstraction bien conduite permet de remonter du dynamisme au statisme, et on concevra les possibilités d’erreur qui peuvent se glisser dans de telles interprétations ; la personnalité innée est inconsciente, et chacun de nous se forge des idées erronées à ce sujet, idées qui proviennent de tout un système de raisonnements justificatifs et dont il convient, avant tout, de faire table rase. »
Il faudrait pouvoir expérimenter, dissocier les manifestations dynamiques de l’esprit, les actes ; en isoler et en fixer les parties. Opération à peu près impossible à réaliser sur nous-mêmes, presque aussi impossible à réaliser sur nos semblables, dont la conscience s’harmonise à la nôtre, obéit trop volontiers aux suggestions de celui qui l’interroge.
En somme, pour arriver à connaître l’homme, il faudrait observer et interpréter ses actes comme s’il s’agissait d’un animal, et non sans prudence encore. Pourquoi ne pas nous adresser directement à l’animal ?
Autre motif. Pour bien connaître la psychologie de l’adulte, n’est-il pas indispensable d’être éclairé sur son évolution ?
« Aucun fait n’est plus certain que le développement naturel et graduel de l’esprit à partir d’un début extrêmement simple ; aucun fait n’a de signification pratique et philosophique plus élevée, et aucun, cependant, n’est plus généralement méconnu. Nous savons fort bien que les plus grands hommes furent un jour des enfants, des embryons, des cellules sexuelles, et que les plus grands esprits furent un jour des esprits d’enfants, d’embryons, de cellules sexuelles ; et pourtant, ce fait extraordinaire n’a exercé que fort peu d’influence sur notre façon de concevoir la nature de l’homme et de l’esprit. Plus encore que pour le développement du corps, nous serons obligés de nous fier à la comparaison entre l’ontogénèse de l’homme et celle des animaux. » (Ed. Grant. Conklin, université de Princeton)
« Le sens et la courbe évolutive d’une fonction ne peuvent être obtenus que par son étude dans les différentes espèces. Plus elle devient complexe et plus cette nécessité s’impose. La psychologie ne saurait se limiter à l’homme. Elle doit même s’adresser d’abord à des séries animales, où le soudain éveil d’acquisitions héréditaires ne risque pas de trop submerger les termes régulièrement progressifs d’une fonction qui se développe. » (Henri Wallon, maître de conférences à la Sorbonne, 1930)
Mais il ne faut pas confondre la psychologie comparée avec ce que l’on nous a souvent présenté comme la psychologie animale, sujet d’extase en présence de bêtes auxquelles il ne manque que la parole, auxquelles même, parfois, on donne la parole pour notre propre édification.
« Le principe de la psychologie comparée est directement opposé à l’objection d’anthropomorphisme que s’est attirée parfois la psychologie animale. Sans doute, faire de l’histoire naturelle une sorte de miroir, sur lequel chaque espèce refléterait quelqu’un des traits dont l’homme a coutume de composer son propre visage, ce serait refaire en langage abstrait et pédantesque les caricatures, déjà bien oubliées, de Grandville. Le but est, au contraire, d’échapper aux interprétations de la conscience qui affuble nécessairement toute réaction des modalités et dénominations dont elle est en quelque sorte la somme – intention, délibération, choix – et leurs motifs subjectifs : sentiments, désirs, répugnances... C’est choisir les conditions d’individu et de milieu où cette affabulation est le moins probable, pour ne connaître des réactions observées que leurs concomitants et leur raison nécessaire. » (H. Wallon)
Un des points qui nous intéressent le plus, c’est la corrélation entre la pensée et ses organes, système nerveux et cerveau. Or, sur l’homme, l’expérimentation est impossible ; seules les monstruosités, les malformations, les blessures nous fournissent quelques données. Si nous nous adressons aux animaux, abstraction même faite de l’expérimentation proprement dite, nous pouvons suivre, à travers toute la série des espèces, le développement progressif de tout le système, depuis l’arc réflexe le plus élémentaire jusqu’aux couches supérieures de l’encéphale, aux lobes frontaux dont le volume caractérise l’espèce humaine. Nous pouvons en tirer de précieuses données relativement au progrès psychique.
Les méthodes à suivre pour l’étude de la mentalité animale sont l’observation et l’expérimentation.
Elles se distinguent peu tant que l’on n’envisage que les animaux les plus inférieurs, infusoires par exemple, auxquels on peut difficilement faire subir des modifications individuelles et dont on se borne à observer le comportement dans un milieu qui ne subit que des variations d’ensemble semblables à celles que provoquent les agents naturels, changements d’éclairage, de température, de concentration saline ou gazeuse. Les deux théories principales issues de ces observations sont celles de Loeb, des tropismes ; les mouvements de l’animal sont des mouvements forcés, indépendants de sa volonté, conséquences des réactions physico-chimiques de sa substance. À un degré supérieur, les forces internes sont mises en action par des changements brusques ou des dissymétries du milieu.
« L’animal est orienté par sa sensibilité différentielle ; 2° Jennings explique le comportement par la théorie des essais et des erreurs, imaginée d’après l’effet que le spectacle produit sur nous. L’animal exécute des mouvements au hasard, dans toutes les directions, jusqu’à ce que le résultat soit atteint, après quoi le mouvement cesse. »
C’est d’ailleurs à peine s’il y a quelque chose de moins mécanique, de moins déterminé que dans la théorie de Loeb.
C’est lorsque l’on s’élève à des êtres moins simples que l’observation et l’expérience se caractérisent véritablement. La première vise surtout à être descriptive. Elle étudie l’animal à l’état libre, dans son milieu, dans des conditions normales. Elle a été pratiquée par Fabre – peut-être avec un peu trop d’imagination sympathique et une idée trop classique de l’instinct, nous dit M. A. Lalande.
La seconde est explicative. Partant de la considération des actes les plus élémentaires, dont nous venons de faire mention, elle provoque et étudie leur complication progressive ; elle pose en quelque sorte des problèmes aux patients. L’expérimentation met en œuvre des stimulus de plus en plus compliqués, pour voir de quelle façon les animaux y répondent ; elle s’efforce de faire s’établir des réactions acquises adaptées à des événements devenus coutumiers, à mesurer le temps, le nombre d’épreuves nécessaires pour réaliser cette éducation, la durée de persistance de la mémoire, le secours que les expériences passées apportent à la ré-acquisition des gestes appropriés au cours d’expériences ultérieures.
La pratique de ce dressage, la comparaison des résultats numériques qu’il fournit permettent de distinguer les aptitudes et le degré d’intelligence des espèces animales, et même des individus d’une même espèce. Il s’agit de parcourir, à la recherche de la nourriture, des circuits, les uns conduisant au but, les autres en impasse, de discerner la forme ou la couleur des récipients qui la contiennent, de portes à ouvrir, de mécanismes à faire jouer, d’outils à inventer. Des singes, par exemple, non seulement savent faire usage de bâtons, mais aussi emmancher deux bambous l’un dans l’autre pour atteindre un objet désiré.
On a proposé de dresser des animaux bien doués à des opérations de triage fastidieuses pour l’homme.
« Il n’est pas interdit de penser qu’un jour, des équipes d’animaux se substitueront à l’homme pour les travaux industriels inférieurs. On utilise encore l’homme pour un certain nombre de ces travaux, faute de pouvoir lui substituer des appareils automatiques économiquement utilisables : par exemple, pour la séparation d’objets ne présentant que des différences de couleur ou de dessin, le classement des fruits selon leur maturité, d’œufs suivant leur fraîcheur, le classement des déchets métalliques d’après leur couleur, le triage de certaines semences, le triage des laines et cotons bruts, etc. Pour quelques-unes de ces opérations, le cerveau animal serait d’un emploi beaucoup plus économique que le cerveau humain. » (C. Bussard, Revue Scientifique, 13 juin 1931)
Les capitalistes, américains surtout, veulent, par la rationalisation, faire de l’homme, moins qu’un animal, un automate ; il s’agit maintenant d’éduquer l’animal pour lui faire concurrencer l’homme.
On veut aussi tirer de l’animal des éclaircissements sur la sociologie ; comprendre comment un chef peut se dégager de la masse des sujets, comment peut s’établir une hiérarchie.
« Jusqu’à présent, les lois sociales les plus simples nous ont échappé ou, du moins, nous n’avons pu les connaître avec certitude, faute pour le sociologue de disposer de la faculté d’expérimenter, comme on le fait dans toutes les sciences qui ne touchent pas à l’homme. Lorsqu’on sera en mesure de créer et de modifier à sa guise de petites sociétés animales, on pourra, peut-être, dégager des expériences faites des lois fondamentales qui régissent la grande Société, la nôtre. » (Id.)
L’auteur paraît perdre de vue que ce qu’il faudrait observer, puisque les hommes ont créé eux-mêmes leur grande société, ce sont les gouvernements que se donneraient spontanément les animaux ; mais ils ne sont pas si bêtes.
Ce rêve d’une « zoo-sociologie expérimentale » n’est sans doute pas près de se réaliser. Faut-il le regretter ? Des législateurs à quatre pattes seraient peut-être plus sages et moins dangereux, surtout, que des législateurs aux mains avides, aux doigts trop crochus.
Cette digression était pour faire sentir le danger que peut présenter l’école analogiste qui :
« S’efforce de comprendre les réactions animales par leur ressemblance avec celles de l’homme, et de les traduire en termes de conscience. Elle a le grand intérêt de faire de l’observation zoologique un instrument de psychologie comparative et de toucher par suite aux problèmes concernant la place de l’homme dans la nature et la genèse de ses facultés mentales. Mais c’est une méthode très glissante, où l’on est facilement tenté de prendre pour une explication la simple analogie avec les faits auxquels nous sommes accoutumés, ou de prêter aux animaux des phénomènes de conscience qui en font de petits hommes. » (A. Lalande, 1930)
Il faut :
« Ne jamais interpréter une action comme l’effet d’une faculté mentale supérieure, quand elle peut être considérée comme produite par une faculté occupant un degré inférieur de l’échelle psychologique ». (Morgan, cité par A. L.)
Dans un livre consacré à la psychologie comparée (A. Costes, édit.), Mlle M. Goldsmith nous montre quelles sont les données que nous fournit aujourd’hui cette partie de la science, encore peu approfondie, et aussi les promesses qu’elle nous apporte. Après avoir indiqué que ni la théorie des essais et des erreurs, ni celle des tropismes ne nous donnent l’explication des premiers actes impliquant le psychisme, elle montre que les réflexes, actes conscients ou inconscients, se distinguent des tropismes, surtout en ce que les voies qu’ils empruntent pour se manifester – système nerveux – sont visibles pour nous. Elle en vient aux instincts, réflexes héréditaires, moins parfaits et plus perfectibles qu’on ne croit. Je considère, pour ma part, l’instinct comme l’emploi rationalisé d’une force nerveuse parcimonieusement mesurée. Elle traite en dernier lieu des actes relevant de l’intelligence proprement dite, caractérisés par ce fait qu’au lieu d’obéir à l’excitation du moment, ils se combinent avec les excitations antérieures par le moyen de la mémoire et de processus associatifs. Suivi à travers toute la série animale, le développement intellectuel n’est pas régulièrement graduel ; mais dans chacun des grands groupements zoologiques, il s’accroît des formes inférieures aux supérieures, puis, dans le groupe suivant, redescend pour remonter plus haut. En fin de compte, Mlle Goldsmith conclut :
« Les méthodes, encore toutes nouvelles, de la psychologie animale se perfectionneront et s’unifieront. Et, alors, de vastes possibilités s’ouvriront à des séries de travaux systématiques... ; enfin, on pourra étudier la dépendance des aptitudes psychologiques d’un animal vis-à-vis de son milieu et de ses conditions de vie. »
L’animal humain fera son profit des renseignements fournis par ses frères inférieurs.
II. COLLECTIVE.
On n’est pas encore parvenu a tracer une ligne de démarcation incontestée entre le domaine de la psychologie et celui de la sociologie, ou encore à déterminer la part qui revient à l’individuel et au collectif dans la naissance et le développement des idées de l’homme et dans l’évolution des sociétés. Que ces deux sciences tendent à empiéter l’une sur l’autre, cela, nous le verrons, est assez naturel ; mais, ce qui est plus grave, c’est que chacune émet la prétention d’absorber l’autre.
Tout rapporter à l’individu, considéré comme un absolu, unique promoteur et légitime bénéficiaire de toute activité intellectuelle, amène inévitablement à professer l’individualisme égoïste. Toutefois, si cette inclination est fâcheuse, elle ne saurait, lorsqu’elle reste strictement personnelle, porter grand préjudice à la société. Celui qui ne compte que sur ses propres forces pour imposer sa loi se heurte bientôt à des résistances qui réfrènent son ambition. La suprématie d’un seul sur tous a peu de chances de durée. Pour se satisfaire, les égoïsmes ont toujours dû former des coalitions, se constituer en castes ou classes poursuivant la conquête du pouvoir, détenant la gestion de la chose publique. Mais, du fait même que l’égoïste s’incorpore à un groupement d’intérêts, il abdique une partie de ses prétentions, hypocritement sans doute, mais, pratiquement, il est devenu sociable.
La prééminence de la collectivité sur l’individu est un principe d’une portée infiniment plus redoutable. Certes, tant que l’agrégat reste sans organisation, n’est qu’une foule capricieuse, la contrainte qu’il exerce sur des dissidents, violente parfois, n’est guère durable. Par contre, dès que des groupements d’intérêts se sont dégagés du chaos, celui d’entre eux qui s’est assuré la supériorité veut qu’elle soit reconnue comme fondée en droit. Il prétend être l’âme du corps social. Il invoque l’existence d’une conscience collective dont il serait l’organe.
Cette notion de conscience collective, demeurée longtemps imprécise, on a cherché à la justifier en s’appuyant sur la biologie.
Un sociologue contemporain, Espinas, considérait l’individu comme une synthèse d’organes ; il serait plus exact de dire synthèse de fonctions. La société serait une synthèse d’individus. « La même concentration qui, en produisant l’individualité organique, fait surgir une conscience, la conscience individuelle, ne peut pas, lorsque, en se poursuivant, elle produit la société, ne pas de même faire surgir en elle une conscience : la conscience collective. La participation de plusieurs éléments vitaux à une même fonction essentielle, c’est le concours biologique... La conscience qui résulte de ce concours est la même, en nature, chez la société et chez l’individu. » (Espinas, d’après Davy.)
Le concept de conscience individuelle est une survivance animiste, la croyance « à un animal invisible habitant à l’intérieur de l’animal visible ». En fait, il y a la pensée de l’homme, pensée qui comporte des degrés, une hiérarchie, si l’on veut, mais reposant seulement sur la précision de son objet et l’étendue de sa compréhension.
« Nous pensons avec tout le corps, sans doute, et non avec le cerveau seul ; mais cela ne saurait signifier que le cerveau n’est pas l’organe le plus élaboré, celui qui marque le mieux le niveau de notre évolution. » (Léon Brunschvicg)
Cela est incontestable lorsqu’il s’agit de motiver la place occupée par l’homme dans la série animale. Dans l’être humain, la fonction du cerveau est une fonction de coordination intégrée dans l’ensemble des autres. À mesure que le flux nerveux ou psychique s’élève d’un échelon, intéresse des régions supérieures, il s’associe à d’autres courants, se coordonne avec eux, d’obscur devient clair, s’achève en pensée réfléchie accompagnée de jugement. On peut alors le qualifier de pensée consciente, sans prétendre que sa nature ait changé.
Y a-t-il dans une société quelque chose d’analogue qui mérite d’être qualifié de conscience collective ou sociale ? On peut assurément relever certaines analogies. Il y a dans le corps social des courants d’idées qui restent confinés dans un domaine restreint, associations civiques ou économiques à buts limités ou temporaires. D’autres englobent des intérêts plus généraux, mais localisés, sans grand retentissement extérieur. D’autres animent les grands appareils fonctionnels de l’État, inspirent leurs statuts et règlements professionnels, entretiennent leurs coutumes, vivifient leur esprit de corps. Enfin, des institutions communes consacrent la cohésion d’une nation.
Mais, de cet ensemble, plus ou moins judicieusement systématisé, voyons-nous surgir quelque chose de comparable à une entité de caractère transcendant, à laquelle nous devrions rendre hommage en la reconnaissant comme conscience sociale à caractère impératif, conscience nationale, dans l’état présent du monde ?
La personnification de la société comme qualitativement différente des personnes composantes est une pure hypothèse métaphysique. La réalité de la conscience sociale exigerait :
« Que la France fût une personne, que l’Autriche fût une personne, que l’Humanité pût devenir un jour une personne, que la conscience collective eût une existence et une sorte de moi distinct de nos consciences propres. » (Alfred Fouillée)
Durkheim l’admettait parce que, disait-il, la société est « la source et le lieu de tous les biens intellectuels qui constituent la civilisation ». Il n’y a là qu’une part de vérité.
« La source et le lieu ne constituent pas une conscience. La vraie source, d’ailleurs, le vrai lieu de la civilisation est dans les consciences individuelles qui, réunies en société, réagissent les unes sur les autres. C’est sans doute la société qui nous affranchit de la nature ; mais en résulte-t-il que nous devions nous la représenter comme un être psychique supérieur à celui que nous sommes et d’où ce dernier émane ? Cette théorie métaphysique de l’émanation sociale ne nous paraît guère plus soutenable que celle de l’émanation divine. » (A. Fouillée)
Mais, une fois écartée cette notion de conscience collective et désavouées les redoutables entités dans lesquelles on prétend l’incarner, il reste l’interaction des pensées individuelles et des idées qui règnent dans le milieu social.
« Il n’est rien dans l’individu qui ne soit marqué de l’empreinte sociale, il n’est rien en lui qui ne réagisse sur la société, qui ne tende à la transformer plus ou moins et, par là, à transformer tous les autres esprits, et à le transformer, indirectement, lui-même. » (Fr. Paulhan)
Quelle influence l’esprit individuel exerce-t-il sur les courants d’idées qui règnent dans le milieu social ? Quels germes de progrès y introduit-il ? Comment les innovations dues à son initiative se font-elles admettre et arrivent-elles à influer sur le comportement et l’orientation du groupe ? Cela constitue un chapitre de la sociologie.
De quels éléments empruntés au milieu social se forme et s’alimente la pensée personnelle ? Quel cadre ce milieu impose-t-il à l’activité intellectuelle ? Quelle aide lui apporte-t-il ? Quel frein lui impose-t-il ? C’est là une partie essentielle de la psychologie que l’on tend aujourd’hui à étudier et à systématiser sous le nom de psychologie collective.
L’objet de cette science est extrêmement complexe, « l’étude en est à peine abordée » (Ch. Blondel). Non pas que cet objet ait été méconnu, mais on a apporté trop de passion dans l’interprétation des faits sur lesquels on pouvait s’appuyer pour la recherche. Sociocrates et individualistes égoïstes les dénaturaient au bénéfice de leur doctrine.
Dès la naissance, le milieu intervient dans la formation intellectuelle de l’enfant.
« Alors que la plupart des animaux peuvent être abandonnés à eux-mêmes peu de temps après leur naissance, l’enfant a besoin, pendant de longues années, d’une protection attentive. Lorsqu’il est devenu un tant soit peu viable, il est déjà socialisé. » (G. Bouthone)
Auguste Comte admettait que, par sa nature même, la pensée de l’enfant évoluait conformément à la première phase de sa loi des trois états, qu’elle commençait par avoir un caractère animiste, religieux et même fétichiste. C’était attribuer à une innéité, dans le secret de laquelle nul ne peut pénétrer, pas même le sujet qui ne conserve aucun souvenir de sa toute première enfance, ce qui provient de l’ambiance.
« Il ne faudrait pas confondre avec une interprétation spontanée les personnifications d’objets inanimés dont parents et nourrices croient devoir se servir pour entrer en communication d’idées avec l’enfant et pour se mettre à sa portée. Pour étudier avec fruit le développement de l’âme enfantine, il importerait d’éliminer rigoureusement les influences étrangères ; ce qui n’est pas possible. » (Weber)
Plus tard, c’est le langage qui impose son cadre à la pensée, et le langage est apport social. Il n’est sans doute pas de pensée qui ne soit accompagnée de parole intérieure. L’être lui-même ne prend pleinement conscience de son existence que par ses relations avec la société. La durée, hors de celle-ci, ne serait pour lui qu’une sensation imprécise. La mémoire ne permet de classer les incidents personnels qu’avec l’aide des repères empruntés aux groupements auxquels on est incorporé : famille, milieux professionnel ou politique, dont les éphémérides ou la tradition précisent la date.
Les tendances physiologiques et psychiques, les sentiments affectifs font partie de notre innéité, mais la société leur impose leur forme et leur fournit les moyens d’expression qu’elle maintient dans des limites étroites et dont elle réfrène les écarts. Cette inhibition, à son tour, est source de progrès individuel.
Toute la formation technique et scientifique de l’homme est l’œuvre de la société ; l’homme n’apporte que ses tendances et ses aptitudes ; la matière et les instruments, grâce auxquels ces dons innés seront mis en valeur, sont un apport social.
Le champ d’action de la psychologie collective est donc fort étendu. De l’étude de cette partie de la science dépend la solution de nombreux problèmes sociaux, au nombre desquels il faut compter ceux qui sont relatifs à l’éducation.
— G. GOUJON.
PUBERTÉ
n. f. (du latin : pubis, poil)
L’époque de la puberté est celle où les organes sexuels des jeunes gens arrivent à un état de développement notable, où des spermatozoïdes se forment dans les testicules du garçon, où les menstrues surviennent chez la fille, provoquées périodiquement par l’expulsion d’un ovule mûr. Des poils naissent, chez le mâle, à la racine de la verge, plus tard au creux des aisselles, sur les joues et le menton. Testicules et verge augmentent de volume, alors que le scrotum prend une couleur brunâtre, se couvre de poils et se plisse. Les organes génitaux se gonflent et se durcissent sous l’effet d’impressions voluptueuses ou d’attouchements même minimes. La voix s’abaisse d’une octave environ ; parfois, cette mue résulte d’une transformation progressive et insensible ; parfois, elle s’accompagne d’enrouement et de troubles divers dans la tonalité. C’est à la castration pré-pubère que les chantres de la chapelle Sixtine, à Rome, devaient leur voix de femme, à diapason élevé. Chez la jeune fille, la puberté se manifeste par le développement des mamelles, une tendance à l’adiposité, l’apparition des menstrues. Des poils naissent sur le pubis, quelques semaines avant la venue de ces dernières, d’autres poussent aux aisselles, quelques semaines après. Le bassin s’élargit ; hanches et poitrine s’arrondissent ; les ovaires augmentent de volume et la longueur de l’utérus s’accroît considérablement ; à noter encore l’agrandissement des petites lèvres du vagin, la formation des bulbes vulvaires, le développement du clitoris. Les troubles spéciaux annoncent les premières règles ; parfois, le cœur devient le siège de désordres passagers ; la voix s’abaisse de deux tons seulement, en moyenne.
Dans les pays chauds, garçons et filles sont précoces ; chez les Hindous, il n’est pas rare de trouver un mari de quinze ans accouplé à une femme de douze ans. Mais les excès sexuels, à un âge trop tendre, ont des effets désastreux et pour l’espèce et pour les individus. La menstruation est plus rapide dans les races méridionales, à la ville, chez les filles riches ; plus tardive dans les races du Nord, à la campagne, chez les filles pauvres. À Paris, l’âge moyen est de 14 ans et demi.
En règle générale, le garçon est moins précoce ; puis son évolution sexuelle est plus lente. C’est vers 14 ans que ses poils pubiens se développent ; c’est vers 17 ans que ses organes génitaux acquièrent un volume assez considérable. Les modifications physiologiques qui caractérisent la puberté s’accompagnent de troubles psychologiques, souvent décrits par les poètes et les romanciers. Des aspirations vagues, des désirs mal définis, une inquiétude dont il ne connaît pas la raison tourbillonnent dans l’esprit de l’adolescent. Des bouffées de chaleur lui montent au visage ; il rougit facilement ; aisément, ses yeux se remplissent de larmes. Caresses et baisers maternels, joies simples de l’amitié, pratiques d’une dévotion outrancière et morbide sont désormais incapables d’éteindre le feu dont il brûle intérieurement. C’est l’époque des rêves héroïques, des productions enchanteresses et sublimes de l’imaginative ; c’est aussi celle où l’obscénité fleurit, car ils sont rares les jouvenceaux modernes qui ne soupçonnent point où la nature les conduit. Tout devient pour eux matière de plaisanteries sexuelles ; torturés par les impulsions énergiques de l’instinct procréateur, ils cherchent un dérivatif dans les lectures et les conversations grivoises. Presque tous recourent à l’onanisme solitaire ou collectif.
Sujette à de rapides variations d’humeur, à la fois vive et timide, la jeune fille ressent, elle aussi, une ardeur qu’elle ne s’explique pas. Des crises de larmes succèdent à de bruyantes explosions de joie ; c’est l’époque par excellence des amitiés tendres et de l’exaltation religieuse. Une extrême susceptibilité s’allie au désir secret d’être l’objet de soins empressés. La présence d’un compagnon masculin jeune et beau provoque chez la jouvencelle un trouble délicieux. De cet éveil de la sexualité dans une âme candide, l’auteur de Daphnis et Chloé nous a laissé une description d’une étonnante fidélité. Un jour que Chloé lavait le corps de Daphnis, elle s’avisa qu’il était beau, ce qu’elle n’avait point jusque-là remarqué ; sa peau lui parut douce et fine ; elle rêva de revoir son compagnon se baigner. Bientôt son esprit fut obsédé par l’image de Daphnis.
« Ce qu’elle éprouvait, elle n’eût su dire ce que c’était, simple fille nourrie aux champs, et n’ayant ouï en sa vie le nom seulement d’amour. Son âme était oppressée ; malgré elle, bien souvent ses yeux se remplissaient de larmes. Elle passait les jours sans prendre de nourriture, les nuits sans trouver de sommeil ; elle riait et puis pleurait ; elle s’endormait et aussitôt se réveillait en sursaut ; elle pâlissait et, au même instant, son visage se colorait de feu. La génisse piquée du taon n’est point si follement agitée. »
Plus discrètes que les garçons, concernant les choses sexuelles, les jeunes filles s’éprennent souvent entre elles d’amitié amoureuse ; peu vont jusqu’à la masturbation mutuelle. Cette pratique, fort répandue parmi les femmes d’âge mûr, sévit à un degré moindre dans les pensionnats féminins que dans les internats de garçons. Instinct procréateur, caractères physiques et moraux, dont l’apparition détermine la puberté, résultent moins de la présence d’éléments séminaux arrivés à maturité que de l’action de substances excitantes, sécrétées dans les parties génitales et répandues dans tout l’organisme.
La découverte de ces substances, les hormones, et de leur rôle, écrit le docteur Vachet dans son beau livre L’Inquiétude sexuelle :
« Repose sur certaines expériences décisives, dont les principales sont l’ablation des glandes génitales chez le mâle et chez la femelle, la transplantation de tissu glandulaire chez les animaux préalablement castrés, l’injection aux castrats du suc glandulaire dont ils sont privés. Nombreux sont les savants qui, dans ces vingt dernières années, ont fondé sur de telles expériences les connaissances solides que nous possédons aujourd’hui. »
Or, la sécrétion des hormones commence à la fin de la première enfance ; d’où il résulte que l’inquiétude sexuelle existe dès la période pré-pubère, quoi qu’en disent les auteurs traditionnalistes, respectueux des préjugés chrétiens. Freud a raison de placer avant la puberté les premières manifestations de l’instinct de reproduction. Mais nous ne saurions le suivre lorsqu’il étudie la sexualité chez le bambin. C’est un plaisir voluptueux, selon Freud, qu’éprouve l’enfant qui tète sa mère ou se réchauffe contre son sein :
« L’acte qui consiste à sucer le sein maternel devient le point de départ de toute la vie sexuelle, l’idéal jamais atteint de toute satisfaction sexuelle ultérieure. »
Frottement et chatouillement de certaines parties du corps, les zones érogènes, défécation et mixtion, après retenue intentionnelle, des excréments et de l’urine seraient des manifestations de l’érotisme enfantin. Amour de la mère, jalousie haineuse du père ou des frères, curiosité sexuelle, cruauté voluptueuse découleraient, plus tard, du même sentiment. L’enfant, toujours d’après Freud, fixe d’abord sa libido sur un objet d’élection, la mère par exemple, puis se met en imagination à la place du père, adoptant son caractère et se conformant à ses interdictions. Lorsqu’il comprend que son père est un obstacle à son amour, il le hait. D’où le complexe d’Œdipe, fait de haine et d’amour, qui se dissoudra plus tard, lorsque s’accroîtra la séparation entre la mère et le fils. À la puberté, complexes parentaux et tendances génitales erratiques fusionnent harmonieusement, chez les individus normaux. Le primat des organes génitaux s’affirme sur les autres zones érogènes ; l’objet du désir devient la personne du sexe opposé ; plaisir physique et tendresse amoureuse arrivent à fusionner.
Ces doctrines ingénieuses ont le tort d’être des constructions hypothétiques, que les faits sont loin de toujours confirmer. Par contre, l’existence de plaisirs sexuels dans la période pré-pubère est certaine. Jean-Jacques Rousseau raconte qu’à onze ans, une Mlle de Valson fit de lui son galant ; il prit la chose au sérieux et assure que, s’il l’aimait en frère, il en était jaloux en amant. Sacher Masoch avait dix ans quand eut lieu la scène qui détermina sa perversion. Le docteur Vachet a reçu cette confession d’un jeune homme :
« Je devais avoir environ quatre ans, et j’étais en parfaite santé, lorsqu’un jour, grimpant à un prunier, j’éprouvai une sensation étrange, à la fois amollissante et agréable, que je pris pour une envie d’uriner. Je m’efforçai à plusieurs reprises de la renouveler et j’y parvins presque régulièrement. Vers le même temps, un camarade de jeu, plus âgé que moi d’une année, me raconta que sa mère l’embrassait sur les fesses et que cela lui plaisait beaucoup. À nous deux, nous essayâmes de renouveler cette satisfaction qui, autant qu’il m’en souvienne, était beaucoup plus psychologique que physique. Peu de temps après, nous nous séparâmes et je ne pensai plus à ces choses. J’avais dix ans lorsque, à la campagne, une voisine, jeune fermière, qui me témoignait de l’affection et me gâtait, m’emmena dans un grenier où il faisait très chaud. Elle m’étendit à côté d’elle sur du foin et prit jeu à me chatouiller. Je devais être en état d’excitation et elle s’en aperçut. Toujours sous prétexte de jeu, elle défit mon vêtement et se mit à me caresser. Puis, feignant d’avoir trop chaud, elle se dévêtit aux trois quarts et commença à me donner une leçon d’anatomie. Je me sentais très excité et ce fut sans difficulté que je me prêtai à un exercice qui me fit éprouver une sensation violente, alors elle me serra contre elle en m’embrassant. Comme personne ne pouvait la soupçonner, et qu’avec un garçon de mon âge elle ne craignait point d’être fécondée, elle continua ce manège, durant tout le temps de mon séjour à la campagne. Je me sentais dans un état de trouble et de fatigue extrême. Je n’ai plus eu de ces relations avec cette femme, mais toute ma jeunesse a été hantée de ce souvenir qui me procurait un mélange de plaisir et de honte. Je me suis souvent demandé si cela ne me rendrait pas fou quelque jour. »
Des sensations érotiques si prononcées, pendant la période pré-pubère, sont exceptionnelles sans doute ; néanmoins, si une fausse honte n’empêchait bien des aveux, nous saurions que le nombre est grand de ceux qui, durant leur enfance, ressentirent des impressions sexuelles plus ou moins vagues. Inspirés par le christianisme, les moralistes occidentaux ont jeté l’anathème sur les plaisirs de la chair. Un opprobre accablant pèse sur tout ce qui concerne la procréation ; les organes sexuels sont réputés honteux ; l’union de l’homme et de la femme est entourée d’innombrables restrictions. Dans L’Éducation Sexuelle, un ouvrage qui lui fait honneur, Jean Marestan s’élève contre cette sotte pudibonderie. Il déclare :
« Il est un instinct charmant qui porte les femmes, en âge d’aimer, à mettre une certaine réserve dans le don d’elles-mêmes, à dissimuler leurs formes sous des étoffes, dont l’assemblage harmonieux et les couleurs seyantes sont un attrait de plus pour leur beauté. Et cet instinct, qui fait plus désirable encore ce qui semble se refuser aux regards, rend plus savoureux l’accomplissement de la grande loi d’amour. Il est, en outre, chez les hommes et les femmes d’essence supérieure, une sorte de goût raffiné d’isolement et de discrétion, pour ce qui concerne les actes de leur existence intime. Et ils contribuent ainsi, dans les liaisons passionnelles, à relever d’un caractère de troublante séduction ce qui, sans le secours d’un peu de poésie et d’un décor approprié, ne serait plus en soi que l’assez banal assouvissement d’un besoin physiologique. Mais il n’y a pas lieu de confondre ces tendances si compréhensibles de notre être, et qui ne sont point contraires aux exigences d’une vie normale, avec le préjugé grossier, pourtant aujourd’hui si répandu, qui consiste à montrer l’amour sexuel comme une faute, à faire systématiquement des organes de la génération un objet de honte et de mystère. »
De ce préjugé, les jeunes gens sont fréquemment victimes à l’époque de la puberté.
Trop de parents oublient que les besoins sexuels sont précoces, qu’ils sont impérieux et obsédants, qu’ils rongent et corrodent, à un âge où l’union des sexes n’est tolérée ni par la coutume, ni par la religion. L’être jeune subit des appels lancinants, douloureux, que l’organisation sociale ne lui permet point de satisfaire et dont, par timidité ou par honte, il n’ose même pas parler. Au prix du martyre de nombre d’individus, la civilisation occidentale tente de dominer l’instinct sexuel ; elle multiplie les interdictions et les défenses qui s’opposent à son développement normal. D’où la fréquence de l’onanisme chez les garçons ; plus de quatre-vingts pour cent s’y livrent ; et dans certains pensionnats religieux, où toute sortie libre est rigoureusement prohibée, c’est à de véritables matches de masturbation que s’adonnent les grands élèves. Ils se soulagent de la sorte, non sans une angoisse inavouée, parce qu’on flétrit violemment ces pratiques devant eux et qu’on assure qu’elles conduisent à de terribles maladies. Menaces imaginaires, les médecins en conviennent aujourd’hui ; seul l’excès est à craindre ; comme, d’ailleurs, il est pareillement à redouter en matière de coït.
Chez le grand nombre, l’accouplement normal fera oublier, plus tard, la masturbation collective ou solitaire ; pourtant, l’onanisme restera familier à quelques-uns, et quelques autres y gagneront des tendances durables à l’homosexualité. Tant que la nature ne réclame rien et que les organes génitaux de l’enfant n’ont pas atteint le développement requis, il serait criminel de l’initier à des pratiques qui compromettraient dangereusement son avenir. Mais il est absurde de vouloir contraindre à la chasteté des jeunes gens dont la virilité vigoureuse, exubérante, pleinement épanouie, réclame impérieusement d’être satisfaite. Voivenel a raison de constater qu’en amour on a la morale de sa chimie, et la chimie de ses glandes à sécrétion interne.
C’est bien vainement que les moralistes officiels prétendent ignorer la nature ; toujours, elle se venge de l’imprudent qui reste sourd à ses appels. Les jeunes filles ont des besoins sexuels moins violents et plus difficiles à éveiller que ceux des garçons. Celles qui se masturbent ne constituent pas une exception rarissime ; la plupart s’arrêtent néanmoins aux paroles tendres, aux caresses et aux baisers mutuels. Beaucoup sont effrayées par le coït et ses conséquences ; elles arrivent moins vite que l’homme à l’orgasme ; la brutalité des premiers contacts, les conséquences douloureuses de l’enfantement leur répugnent. Faute d’une éducation sexuelle suffisante, plusieurs s’adonnent à l’homosexualité d’une façon définitive. Quelques-unes cherchent un refuge dans la dévotion et deviennent la proie d’un mysticisme délirant. Une sensualité qui n’avait rien de céleste se mêlait aux pamoisons béatifiques d’une sainte Thérèse, d’une Marie Alacoque, etc. Chez sainte Thérèse, déclare Leuba, qui a longuement étudié la question, on peut attester la participation des organes sexuels aux jouissances extraordinaires que lui procurait son union avec son fiancé Jésus. « Sainte Marguerite-Marie nous a laissé la peinture la plus sinistre qui se puisse imaginer d’une vierge sexuellement surexcitée depuis l’enfance par des vœux perpétuellement réitérés de chasteté offerte au Christ, son fiancé, et par le sentiment presque ininterrompu de sa présence amoureuse. Son cas est de l’érotomanie nettement caractérisée. Dieu la récompense d’un acte répugnant de maîtrise de soi, en tenant, la nuit suivante, deux ou trois heures « sa bouche collée contre son Sacré-Cœur. À aucun moment, ni de jour ni de nuit, il n’y avait de trêve à l’ardeur de son amour divin ». On voit à quelles déviations peut aboutir l’instinct sexuel mal dirigé. Avec prudence, mais sans réticences dangereuses et déplacées, il convient d’éclairer garçons et filles, lorsque se fait entendre à eux l’appel de la tendance à procréer.
— L. BARBEDETTE.
PUDEUR
(du latin : pudor, sentiment de honte, de crainte, procédant lui-même de pudet, avoir honte)
M. Ch. Lalo écrit, dans Beauté et Instinct sexuel :
« Sans l’organisation sociale de l’amour, on peut dire que la pudeur n’aurait pas beaucoup plus raison d’exister chez les hommes que chez les animaux. »
L’enfant, en effet, ignore la pudeur.
Dans la Genèse, la pudeur et la crainte sont représentées comme introduites dans le monde en même temps. Adam craignait Dieu parce qu’il était nu (Gen. II, 11). C’est pourquoi les fils de Noé considérèrent comme un acte de piété filiale de jeter un manteau sur la nudité de leur père.
Le 20ème chapitre du Lévitique contient une foule de prescriptions relatives à l’anudation :
« Tu ne découvriras pas la nudité de ton père, de ta mère, de la femme de ton père (autre que ta mère), de ta sœur, de la fille de ton fils, de la sœur de ton père, de la sœur de ta mère, du frère de ton père, de ta belle-fille, de la femme de ton frère. »
Et comme cela n’est pas suffisant :
« Tu ne découvriras pas la nudité d’une femme et de sa fille en même temps, ni celle de la fille de son fils, ni celle de la fille de sa fille, ni celle de la sœur de ta femme en présence de celle-ci. », etc.
Tout cela est en abomination à l’Éternel et parfois puni de mort.
Dans son manuel des confesseurs, les Diaconales, Mgr Bouvier, évêque du Mans, renchérit sur le texte du Lévitique, d’accord avec la morale chrétienne qui a horreur du nu :
« Sauf le cas de nécessité grave ou d’utilité grave, c’est pécher mortellement que de regarder avec intention, même sans arrière-pensée lubrique, les parties sexuelles d’une personne plus grande et d’un autre sexe.
« C’est péché mortel que de regarder complaisamment les seins nus d’une belle femme.
« La femme qui n’a pas de mari pèche mortellement lorsqu’elle s’arrange avec l’intention de se faire aimer des hommes.
« À fortiori, pèche mortellement toute femme mariée qui s’arrange avec l’intention de plaire à tout autre homme qu’à son mari.
« C’est un péché mortel pour une femme de se découvrir les seins ou de les laisser voir sous une étoffe trop transparente.
« Ce serait évidemment un péché mortel que de tenir des propos trop obscènes, de prononcer le nom qu’on donne aux parties sexuelles, de parler du coït ou des différentes manières de coïter… »
La moralité laïque courante – et ce n’est pas une de ses moindres hypocrisies – n’est qu’un écho de celle pratiquée par une petite peuplade sémitique, il y a cinq mille ans ou davantage, lorsqu’elle considère comme honteux et impur de dévoiler son corps, de se montrer sans vêtements devant autrui. C’est la morale judéo-chrétienne qu’il faut rendre responsable de toutes les campagnes menées contre le nudisme ou les images ou les représentations prétendues licencieuses. Dieu condamne le nu et c’est se rendre agréable à lui que de le proscrire.
Les abbés Bethléem, les ligues contre la licence des rues, qui mettent en pièces ou signalent aux parquets des périodiques qui publient des images qui leur déplaisent, ne disent rien quand il s’agit de représentations de scènes de meurtres, de défilés militaires, de portraits d’officiers supérieurs en uniforme, d’images invitant les conscrits à s’engager. Cela n’offense pas Dieu, l’Éternel des Armées. Cela engendre tout simplement le goût du meurtre ou évoque l’idée de haine internationale.
Qu’on s’imagine sur les murs de Paris une affiche représentant deux êtres se procurant du plaisir sexuel ! Quelle levée de cafards et de tartufes dont tous ne seraient pas des bondieusards, hélas ! Ce serait des lacérations vengeresses, des appels désespérés à l’intervention de la police, à la répression pénale. Mais que ces murs soient couverts d’affiches représentant une escadrille d’avions de bombardement en activité : silence dans les rangs de ces hypocrites ! Et pourtant, la première de ces affiches pourrait tout au plus inciter ceux qui la contempleraient à se procurer du plaisir de la même façon, c’est-à-dire à passer quelques moments de plaisir, alors que la seconde ne ferait qu’éveiller des sentiments de férocité, en appeler aux passions destructrices, ou aux émotions terrifiantes qui sommeillent dans le tréfonds du subconscient humain.
Nous en avons assez dit sur ce chapitre dans l’article Obscénité pour ne pas insister sur le sujet.
— E. ARMAND.
PUÉRICULTURE
n. f. (du latin : puer, pueri, enfant, et cultura, culture)
I. DÉFINITION.
Le but de la puériculture a été ainsi défini par le docteur Weill-Hallé :
« Protéger l’enfant dès avant sa conception, assurer son développement intégral dans le sein maternel, éviter tous les accidents fâcheux lors de sa naissance, contrôler et favoriser sa croissance lorsqu’il aura vu le jour, éloigner les dangers inhérents aux dangers extérieurs et à la vie sociale, participer à son orientation au seuil de l’adolescence. »
Cette définition donne à la puériculture un programme extrêmement vaste, et bon nombre d’auteurs lui attribuent un rôle beaucoup plus restreint qui, ne commençant qu’à la naissance, se termine assez tôt, lorsque les enfants ont vingt dents. Pour ces auteurs, pendant cette période, la puériculture a un double but :
-
conserver les enfants, c’est-à-dire les empêcher de mourir ;
-
leur assurer le meilleur développement possible.
Cette deuxième conception de la puériculture a le grave tort de ne pas attirer l’attention sur les phénomènes d’hérédité (voir ce mot) et de pousser à la négligence de l’éducation sexuelle (voir Éducation).
II. LA PUÉRICULTURE PRÉNATALE.
« Lorsque l’enfant vient au monde, il est déjà un peu tard pour se préoccuper de sa destinée. Il n’est pas un jeune homme, il n’est pas une jeune fille qui, songeant à l’avenir, ne dise :
« Si j’ai des enfants, ils seront ceci, ils feront cela ; j’aurai pour eux telles ou telles aspirations… »
Mais bien rares sont les jeunes gens qui pensent :
« Je veux faire de la gymnastique pour avoir un jour des enfants forts ; je me priverai de tabac et d’alcool, parce que je ne veux pas empoisonner ma race et moi-même. »
Ou encore :
« J’épouserai un être sain moralement et physiquement, parce que je veux qu’il me donne une descendance saine. »
Nombreux sont les couples qui disent :
« Nous n’aurons qu’un ou deux enfants, parce que nos ressources ne nous permettent pas d’en élever davantage et de les rendre heureux. »
Mais bien rares sont ceux qui ajoutent :
« Nous choisirons pour les mettre au monde le moment propice, c’est-à-dire celui où l’un et l’autre nous nous sentirons dans les meilleures dispositions physiques et morales, parce que nous savons que cette minute de la procréation sera décisive pour l’avenir tout entier de notre enfant. » »
— Marguerite MARTIN.
Il est déjà un peu tard de dire cela aux parents ou même aux jeunes époux. C’est aux jeunes gens et même aux enfants qu’il faut s’adresser. « Nous ne pouvons tromper l’enfant, il est de notre devoir de lui exposer les faits sous une forme telle qu’elle n’offense pas la pudeur. Nous devons lui indiquer qui il est, d’où il vient et où il va ; nous devons lui faire comprendre que la sincérité et l’honneur sont dans la relation des sexes et que bien des accidents de jeunesse, comme on disait autrefois, peuvent détériorer toute une descendance. L’éducation, telle que nous devons la concevoir, doit être large, parce qu’elle doit préparer au mariage ; elle réclame l’éducation morale du cœur aussi bien que celle de l’esprit ; elle accorde une grande place à l’hygiène, aux notions d’hérédité ...
Il faut qu’au moment de se marier, chaque personne s’assure de sa santé et de celle de son conjoint et sache que, si elle est affligée d’une intoxication ou infection, elle risque de mettre au monde un petit être anormal ; il faut qu’elle connaisse le danger de s’unir au porteur de la même tare que celle dont elle est affligée. Pourquoi cet examen médical prématrimonial semblerait-il offensant au seuil d’un des plus importants actes de la vie, alors que cet examen est réclamé par une simple compagnie d’assurances. — Docteur GOVAERTS. (Voir le mot Hérédité.)
Supposons l’enfant conçu dans les meilleures conditions possibles, par des parents sains, conscients et éclairés. Cela ne suffit pas : il y a une hygiène spéciale aux futures mamans. Hygiène de l’esprit d’abord. Pendant tout le temps de la grossesse, il faut éviter à la femme enceinte les émotions trop vives, les idées obsédantes et les chagrins. Ce n’est pas souvent possible dans les milieux pauvres ; et là où le souci du lendemain troublait déjà l’esprit, l’attente d’une nouvelle bouche à nourrir, d’un enfant qu’il faudra vêtir et soigner ne peut qu’amener des soucis nouveaux :
« Toutes les impressions morales et physiques de la mère ont leur retentissement sur l’enfant, et contribuent à modifier sa constitution comme son caractère. Les Grecs, qui avaient connaissance de ce fait, avaient pris coutume d’isoler les femmes enceintes dans des jardins et des appartements spéciaux, ornés d’œuvres d’art, et il était interdit de leur donner le spectacle de laideurs ou de difformités. » (Marestan)
Les ouvrières sont, de nos jours, placées dans un milieu moins favorable, mais cependant elles ne doivent point oublier qu’elles-mêmes peuvent influer favorablement ou défavorablement sur l’enfant qui s’agite en leur sein. On ne peut, certes, pas être très gai quand il y a de la misère à la maison et plus de misère encore en perspective. Cependant, on peut combattre sa tristesse, s’imaginer un avenir meilleur, faire des lectures gaies, comme on peut aussi faire l’inverse ; et c’est si vrai qu’il est des personnes riches, bien portantes, n’ayant nulle raison d’être tristes et qui se complaisent dans une tristesse morbide, se plaisent à évoquer des scènes pénibles, etc. Pour être gaie, douce, affable, patiente, la future maman doit d’abord le vouloir.
« D’autre part, elle devra veiller plus que jamais sur sa santé. Dès le début de la gestation, elle portera des vêtements amples, afin de ne gêner en aucune façon le développement de l’utérus ; elle supprimera les jarretières et remplacera le corset par une ceinture de grossesse. Son alimentation sera substantielle ; certains médecins conseillent d’y ajouter du phosphate de chaux, l’enfant prenant à la mère les sels minéraux dont il a besoin pour son développement. Elle veillera à la régularité de ses fonctions digestives, la constipation pouvant provoquer des hémorragies ou des fausses couches. Pour éviter les crises d’éclampsie, si dangereuses, elle fera examiner ses urines tous les mois pendant le premier semestre, tous les quinze jours environ pendant les deux mois suivants, et tous les huit jours le dernier mois. Si l’examen décèle la présence d’albumine, elle se mettra au régime lacté. Vers le septième mois, elle demandera au médecin ou à la sage-femme de vérifier la position du fœtus ct de la rectifier au besoin. Elle ne changera rien à ses habitudes de propreté corporelle, c’est-à-dire qu’elle prendra comme de coutume bains de pieds, grands bains, douches et injections vaginales.
« Elle devra surtout, et pendant toute la durée de la grossesse, éviter le surmenage. Les trois derniers mois, le dernier tout au moins, devraient être pour elle un temps de repos presque absolu. » (Josette Cornec)
À vrai dire, les femmes d’ouvriers peuvent, en France, bénéficier de la loi d’assistance aux femmes en couches, mais l’allocation donnée demeure insuffisante pour suffire à permettre le repos prévu pour le dernier mois. La société capitaliste ne protège pas suffisamment les mères contre les privations et la misère, et, d’autre part, celles-ci sont déjà désavantagées par l’inégalité de l’homme et de la femme sur le terrain économique : plus bas salaires, etc.
III. LA PUÉRICULTURE APRÈS LA NAISSANCE.
Si nous nous reportons à la définition du docteur Weill-Hallé, nous voyons qu’il convient d’abord d’éviter tous les accidents fâcheux lors de la naissance. De ceci nous ne dirons rien : nos lecteurs savent bien que, malgré les « maternités » et quelques autres œuvres, les enfants des prolétaires se trouvent, ici encore, dans une situation plus défavorable que les petits riches. Notre seconde définition nous indique que le premier but de la puériculture, après la naissance, est d’empêcher les enfants de mourir.
La mortalité enfantine est, en France, d’environ 10 %. Ceci constitue déjà un progrès. En 1886, à Paris, la mortalité infantile était de 16 % ; en 1901, elle était tombée à 12 % et, depuis, comme nous venons de l’indiquer, elle a diminué encore. Pas encore autant qu’elle le pourrait, puisque, actuellement, elle est, en France, approximativement le double de ce qu’elle est en Angleterre, en Norvège, en Hollande, aux États-Unis, et le triple de ce qu’elle est en Nouvelle-Zélande, où le taux est de 3 %, le plus bas du monde entier.
Ce problème de l’abaissement de la mortalité est intéressant à considérer, non seulement pour diminuer le nombre excessif des décès « mais pour rechercher et éviter les causes de maladies qui laissent un très grand nombre d’enfants avec une santé débile ».
« On peut diviser les causes des décès des enfants en bas âge en deux grandes classes : les causes immédiates, c’est-à-dire les lésions organiques qui entraînent directement la mort, et les causes médiates, les plus utiles à connaître pour éviter les premières et qui en déterminent l’apparition. Souvent, en effet, quand la maladie existe, il est difficile d’y remédier, alors qu’il eût été relativement facile de l’éviter.
« Causes immédiates. — La plus importante est la gastro-entérite, qui compte pour 62 % des décès. Elle est l’aboutissant d’un régime défectueux (surcharge alimentaire, lait frelaté, administration des aliments farineux avant le 7e mois). Les convulsions comptent pour 10 % dans les décès, mais beaucoup de ces convulsions sont l’épisode terminal de la gastro-entérite. Les affections des organes respiratoires comptent pour environ 14 %, les maladies contagieuses 2 %, la faiblesse congénitale environ 6 %.
« Causes médiates. — Dans l’immense majorité des cas, les affections précédemment citées et qui entraînent un si grand nombre de décès sont sous la dépendance de trois facteurs de première importance qui sont : l’ignorance, la misère et le défaut d’hygiène générale.
« a) Ignorance. En pratique, la puériculture n’existe pour ainsi dire pas, l’élevage des enfants est livré aux préjugés et au hasard dans toutes les classes de la société. Les mères ne reçoivent aucune préparation dans ce but. C’est surtout dans l’alimentation que se commettent des erreurs capitales, qui déterminent l’apparition de la gastro-entérite et les convulsions, qui amènent 70 % des décès.
« b) Misère. La misère des parents est une des grandes causes du manque d’allaitement de l’enfant par la mère. Cette dernière est obligée, par le manque de ressources, d’aller travailler à l’usine ou à l’atelier...
« Ce manque d’allaitement maternel aboutit à l’allaitement au biberon, qui compte pour 16 % de décès, alors que le premier mode d’allaitement ne compte que pour 2 %. En Suisse, de 1896 à 1904, on a constaté une augmentation du nombre des décès en parallèle avec la diminution de l’allaitement au sein. En France, alors que la mortalité moyenne est de 20 %, elle n’est que de 7,6 % chez les riches. À Bruxelles, sur 306 décès par gastro-entérite, 295 se constatent dans la classe pauvre, 10 dans la classe aisée, 1 dans la classe riche. »
Nous empruntons cette étude des causes de décès à une conférence déjà ancienne du docteur Henrotin. Depuis, les pourcentages ont quelque peu diminué ; mais les causes restent les mêmes, et ce sont surtout les enfants des prolétaires qui meurent par ignorance des parents – qui reculent devant les frais médicaux –, misère et défaut d’hygiène générale.
c) Défaut d’hygiène générale. Résumons-les rapidement : maladies dues à l’hérédité (syphilis, alcoolisme, etc.) ; locaux mal éclairés, mal chauffés ; défaut de propreté ; mauvaise alimentation, etc.
Le docteur Pinard écrit :
« Avant tout, il faut remarquer une chose : le tout petit, le nouveau-né humain est, au moment de la naissance, le plus mal partagé des animaux. Au sortir de l’œuf, le petit poulet a du duvet, il a un vêtement, on n’a pas besoin de l’habiller. De plus, il peut, il sait marcher et courir de suite, il sait même prendre et choisir sa nourriture tout seul. Le petit canard qui doit vivre sur l’eau sait nager et même plonger.
Le petit être humain, le petit bébé, n’a aucun vêtement, il est tout nu ; il ne peut ni ne sait marcher. La seule chose qu’il sache faire, c’est téter, c’est-à-dire prendre sa nourriture ; mais il ne sait pas choisir entre ce qui est bon et ce qui est dangereux. Il faut donc tout connaître de ce qui lui est nécessaire, il faut tout savoir pour lui. »
Mais, comme l’écrit Mme Bélime-Laugier, l’inspiration ne suffit pas pour indiquer à la maman ce qu’elle doit faire. Pour n’en citer qu’un exemple, les cas de diarrhée ne deviennent si souvent mortels que parce que des mamans, ayant peur de faire mourir leur enfant de faim, ne se résolvent pas ou se résolvent trop tard à le mettre à la diète.
Après avoir prouvé par des chiffres et des arguments d’origine bourgeoise que le taux élevé de la mortalité infantile est dû à notre mauvaise organisation sociale, au capitalisme pour tout dire, et montré la nécessité, pour les mamans, d’apprendre leur métier de mère, il nous resterait à leur donner des leçons de puériculture ; mais ce serait trop long et nous devons nous borner à quelques conseils que nous engageons nos lecteurs à compléter par la lecture de quelque ouvrage spécial.
Il faut suivre et satisfaire les besoins de l’enfant.
1er BESOIN : oxygène (air pur)
Il faut que la chambre du bébé soit bien aérée : fenêtres grandes ouvertes, le plus possible, ou tout au moins vasistas ouverts ; au besoin, par temps froids, protéger le bébé avec un paravent en lui mettant des moufles et un bonnet et en fixant sa couverture de façon à ce qu’il ne puisse se découvrir. Il faut que l’air circule librement autour du berceau : pas de garniture en cretonne, ni de capote. S’il faut que l’air frais circule autour de la tête, il faut aussi éviter de le placer dans un courant d’air froid, assis par terre entre la porte et la cheminée, par exemple.
2e BESOIN : propreté.
Pendant les premiers mois, bains chauds, de 36 à 38 degrés (eau chaude à la main). Se placer dans un coin chaud, habiller et déshabiller rapidement ; laver sans savon ; éviter d’introduire de l’eau dans les oreilles ; sécher avec soin, en particulier dans les plis de la peau, avec des serviettes chaudes ; si ce séchage est bien fait, on peut se dispenser de poudrer l’enfant (talc, poudre de riz non parfumée, etc.).
Si les enfants sont bien portants et forts, on peut employer des bains froids dès deux ans.
Veiller aussi à la propreté des seins, des biberons et de leurs tétines que l’on nettoie avec les doigts et une pincée de sel.
3e BESOIN : alimentation et évacuation.
Il est, dit le docteur Jeudon, indispensable, pour établir et contrôler l’alimentation du nourrisson, de suivre très régulièrement l’évolution de son poids à l’aide d’un pèse-bébé ou d’une simple balance. On peut dire qu’en moyenne, en France, un enfant à terme qui pèse moins de 2,5 kg ou plus de 4,3 kg est anormal et mérite une enquête médicale.
Pendant les trois ou quatre premiers jours de sa vie, l’enfant diminue de poids ; ensuite, il doit augmenter régulièrement, atteindre son poids primitif vers le 10e jour ; ensuite, jusqu’à 4 mois, il augmente en moyenne de 25 grammes par jour ; de 4 à 8 mois, de 16 à 17 grammes par jour ; de 8 à 24 mois, de 8 grammes environ par jour. Ces chiffres sont des moyennes qui varient suivant les individus, mais tout enfant dont l’accroissement de poids paraît insuffisant doit être surveillé, et il est bon de consulter le médecin.
« Chez le nourrisson, dépourvu de dents, dont la salive est peu abondante et peu active, dont l’estomac n’acquiert son développement complet que vers le 13e mois, alors que son intestin a, dès les premiers mois, une structure assez complète, dont la sécrétion pancréatique est insignifiante, alors que la sécrétion biliaire est riche, il est évident que l’alimentation doit être liquide et dépourvue de toute substance amylacée qu’il serait incapable de digérer. C’est pourquoi le choix des aliments est très limité ; UN SEUL, en réalité, est physiologiquement indiqué : LE LAIT... De toutes les formes sous lesquelles on peut présenter le lait, la meilleure est de beaucoup le lait maternel... » (Dr Jeudon.) Le lait de femme présente avec les autres laits – avec le lait de vache, par exemple – des différences notables, qui font précisément sa supériorité, et dont les principales sont sa richesse plus grande en sucre (lactose) et sa teneur relativement faible en matières albuminoïdes et extractives (reste azoté) et en sels. « C’est ce qui explique sa parfaite adaptation au pouvoir digestif si fragile et encore incomplet du petit de l’homme, au cours des premiers mois de sa vie. » (Dr Jeudon.)
Si nous tirons les conséquences de ce qui précède, nous voyons :
-
que le lait maternel – lorsque la lactation est riche et assez abondante – doit être préféré ;
-
qu’au cas où l’on emploie du lait de vache, « il faudra le couper d’eau et l’additionner de sucre avant de le livrer au nourrisson, au cours des premiers mois, pour le rapprocher, dans la mesure du possible, de la composition du lait de femme. Les coupages habituellement admis consistent dans le mélange de deux parties de lait et d’une partie d’eau sucrée à 10 %, et ceci jusqu’à l’âge de quatre mois. Ensuite, on augmentera progressivement la proportion de lait pour le donner pur et sucré, à partir de l’âge de six mois. » (Dr Jeudon)
Malheureusement, le lait de vache que l’on vend en France est souvent sale, très sale, et, pour cette raison, de nombreux médecins recommandent les laits condensés sucrés ou, mieux encore, le lait sec.
« Le lait sec, ou lait en poudre, est le résidu sec du lait privé de son eau... On l’emploie au cours des deux premiers mois dans la proportion d’une partie de poudre de lait pour huit parties d’eau, en augmentant le taux de la dilution avec l’âge. Il donne de bons résultats dans les diarrhées cholériformes. » (Dr Jeudon)
Ce lait est le plus employé dans le cas d’intolérance au lait de vache.
En tenant compte du besoin de calories de l’enfant et de la composition du lait maternel :
« On a adopté, en général, la règle suivante qui consiste à donner une quantité quotidienne de lait correspondant, pendant le premier trimestre de la vie, au 1/6 du poids du nourrisson ; pendant le deuxième trimestre, à 1/7 ; pendant le troisième trimestre, à 1/8... »
Encore une fois, ces chiffres sont des moyennes donnant un plan général ; et, pour chaque nourrisson, il y a lieu d’adapter la ration à son poids, aux modalités de croissance et à l’état du tube digestif.
Nous ne parlons pas ici des premiers jours de la vie, où la mise au sein et l’établissement progressif des premières tétées sont parfois fort délicats, sujets à de nombreuses variations individuelles dont l’accoucheur doit prendre lui-même la direction et la responsabilité.
Cette quantité totale de lait quotidien doit être répartie en un certain nombre de tétées. Ici, un guide assez logique s’offre encore à nous : la capacité de l’estomac (qui est, à la naissance, de 30 à 50 cm3 ; à un mois, de 60 à 70 cm3 ; à trois mois, 100 cm3 ; à cinq mois, 150 à 200 cm3 ; à un an, 250 cm3 environ) et la durée de la digestion gastrique, qui varie de 1 h 30 à 2 heures.
D’où la règle suivante de répartition des tétées : de 0 à 3 mois : 8 tétées espacées de 2 h 30 (6 heures de repos la nuit) ; de 3 à 6 mois : 7 tétées espacées de 3 heures (6 heures de repos la nuit) ; de 6 à 9 mois : 6 tétées espacées de 3 heures (9 heures de repos la nuit) (Dr Jeudon).
« Dans aucun cas ne nourrir la nuit. L’enfant et la mère doivent dormir toute la nuit en paix. Mais, dans la journée, l’enfant doit téter à ses heures ; il faut le prendre, même s’il dort, et l’éveiller pour que toutes les fonctions se fassent régulièrement. » (Dr King)
Il faut tenir le bébé dans une position convenable pendant la tétée ; en général, on a le tort de le coucher contre le sein, ce qui est trop souvent la cause de déformation du menton et de troubles du nez et des oreilles ; il est préférable de le mettre presque debout.
Après chaque tétée, il faut mettre le bébé sur son pot pour régulariser ses fonctions et le faire devenir propre.
Il faut que l’enfant soit changé souvent pour éviter les irritations et les excoriations. Il faut se défier surtout de la gastro-entérite, qui, comme nous l’avons indiqué au début, est la cause la plus fréquente de la mort des jeunes enfants : si vous voyez une teinte verte apparaître sur les couches, si les déjections sont vert épinard, fréquentes et liquides, n’hésitez pas à recourir à la diète hydrique, supprimez-lui le lait pendant douze heures ou plus, en le remplaçant par des petits biberons d’eau bouillie ou d’eau de riz, et appelez le médecin.
Traitez la constipation comme une maladie : donnez d’abord des lavements de décoction de guimauve et modifiez l’alimentation (les mères nourrices devront prendre plus de légumes, manger moins de viande, éviter le chocolat, les mets épicés, les boissons excitantes : vin, café, etc.) ; pour les enfants élevés au biberon, on coupera les biberons d’eau de Vals ou de décoctions d’orge.
Dès le 6e mois, donnez un bâton de guimauve aux enfants pour exercer leurs mâchoires, et quelques aliments croquants dès qu’ils ont des dents. La mastication est un exercice indispensable. La nourriture molle cause la perte des dents et des végétations adénoïdes. Évitez les bonbons et les farines chocolatées.
4e BESOIN : mouvement et repos.
Le nouveau-né a surtout besoin de repos ; il doit dormir les 9/10 de son temps ; à 6 mois, les 2/3 du temps. Lorsque le bébé dort mal, cela provient, le plus souvent, d’une mauvaise alimentation, parfois aussi de vêtements trop lourds ou d’un air vicié. Si l’enfant crie et dort mal sans qu’on puisse en déterminer la cause, il est prudent d’appeler le médecin.
Au début, les petits ne remuent que par réaction : si on les touche, s’ils sont malades. Au bout de quelques mois, les mouvements deviennent plus fréquents et volontaires. Il importe qu’ils soient vêtus convenablement, de façon à avoir la liberté de leurs mouvements. Il faut fournir à l’enfant la possibilité et les occasions de se mouvoir, en écartant tous les dangers qui pourraient en résulter : ne rien laisser à sa portée qui puisse le blesser ; pas d’objets sales qu’il puisse sucer – il ne faut pas lui laisser prendre la mauvaise habitude de sucer son pouce– ; pas d’objets qu’il puisse avaler ; ne pas essayer de le faire marcher trop tôt : un enfant normal doit marcher entre un an et dix-huit mois.
5e BESOIN : chaleur. Les vêtements.
Le froid est l’ennemi du bébé. Il est bon que la température de l’air qu’il doit respirer ne soit pas au-dessous de 15° et ne soit guère au-dessus de 20°. L’air humide aussi est dangereux : n’étendez pas et ne faites pas sécher de linge dans la chambre où il dort. Abritez votre bébé du vent, de l’humidité, du soleil. Préférez la laine fine et chaude au coton peu chaud et lourd. Évitez les amas de vêtements qui gênent les mouvements et ne sont ni légers ni poreux. Supprimez la bande ombilicale, dès que la cicatrice est bien fermée. Employez des couches peu épaisses qui ne déforment pas les jambes. Ne gênez pas la respiration. Tenez chauds le ventre et les pieds de l’enfant ; au besoin, pour cela, employez des bouillottes d’eau chaude. Sous prétexte d’endurcir les enfants, évitez de leur laisser les bras et le cou nus en hiver. Si vous les transportez à bras, par mauvais temps, un grand châle est indispensable.
6e BESOIN : des habitudes régulières.
N’oubliez pas que l’enfant doit manger, dormir et évacuer à des heures absolument régulières.
Quelques conseils. Dans les pages qui précèdent, nous avons essayé de dire l’essentiel. Nous conseillons aux parents de s’éclairer plus encore par la lecture de quelque ouvrage spécial.
Il existe des œuvres sociales auxquelles les parents peuvent faire appel : maternités, consultations de nourrissons, etc. Malheureusement, ces œuvres, inexistantes à la campagne, sont insuffisantes dans les villes. Informez-vous, cependant, à ce sujet.
Des lois sociales, insuffisantes aussi, peuvent, cependant, apporter quelque aide aux parents pauvres ou ayant une nombreuse famille. Renseignez-vous sur les droits que vous accordent les lois bourgeoises. Et surtout, aimez bien les tout petits : ce n’est pas toujours suffisant – ne l’oubliez pas – pour écarter d’eux la maladie, la mort et la misère, mais c’est cependant l’essentiel.
Sachez enfin vouloir, pour l’avenir, une société meilleure qui aura davantage le souci de l’enfance.
— E. DELAUNAY.
PUNIR
(DROIT DE)
Sur l’origine historique du droit de punir, les idées communément admises au XIXème siècle sont rejetées par beaucoup à l’heure actuelle. Le droit pénal, disait-on, ne fut d’abord que le droit de vengeance, droit privé, héritage de toute une famille, qui valait non seulement contre la personne de l’offenseur, mais contre celle de ses enfants, de ses petits-enfants, de tous ses proches. A la vengeance privée aurait succédé, tantôt le wergeld ou rachat par l’argent, réglé d’après la coutume ou la loi, comme en Germanie, tantôt le principe de l’expiation religieuse, comme chez la plupart des orientaux. Suivant un grand nombre d’auteurs contemporains, la peine serait, au contraire, d’origine sociale ; elle caractériserait la contrainte de la collectivité par rapport à l’individu, et n’aurait rien à voir avec la vengeance privée. A l’origine, déclarent-ils, alors que la notion de respon- sabilité personnelle n’existe pas encore, c’est le dommage subi que l’on prend en considération. Les fautes ne sont pas appréciées comme des défaillances morales, elles ne provoquent aucune idée de répulsion contre le coupable ; on les estime seulement par rapport à la perte qu’éprouve le clan. Aussi le wergeld est-il proportionnel à l’importance sociale de la victime et à celle de l’offense. C’est de la sanction, appliquée à l’intérieur du clan, que serait née l’idée de responsabilité individuelle. Saleilles écrit :
« En même temps que ces wergeld, peines privées si l’on veut, il y avait, parallèlement, de véritables expiations publiques pour les faits qui portaient atteinte il la sécurité de la tribu, faits de trahison par exemple... Partout où il y a un petit groupe organisé, nous trouvons ces deux formes de la peine, la peine protection, du côté de l’extérieur (wergeld), et la peine expiation, du côté de l’intérieur ; et le jour où les groupes arrivèrent à se fédéraliser sans se confondre, ces deux côtés de la peine se trouvèrent également réunis, tout en gardant leurs fonctions distinctes. »
A l’intérieur du clan, on ne frappe pas brutalement comme à la guerre ; l’application de la peine devient un fait d’ordre religieux, que l’on entoure de formalités solennelles, consacrées par la loi ou par les rites traditionnels. Pour satisfaire un besoin instinctif et sauvage, l’on s’abrite derrière la divinité.
« Mélange de rites religieux et de formes juridiques, la peine n’est pas un simple moyen de défense, c’est une sanction du mal réalisé, une équivalence entre le mal commis et le mal infligé. »
La notion chrétienne du péché développa l’idée de responsabilité personnelle ; pour connaître les intentions cachées du coupable, on multiplia les tortures. Mais il est faux, à mon avis, de prétendre que, dès cette époque :
« La conception qui prévaut est l’idée d’exemplarité par la peine, et de défense sociale, non pas par l’amendement individuel, mais par l’intimidation universelle. »
Pour les penseurs chrétiens, le droit de punir est un droit mystique, émané directement du ciel et délégué aux souverains par le tout-puissant. C’ est plus tard, quand s’accentua le déclin des idées religieuses, que l’on insista sur la nécessité de défendre la société. Plusieurs, aujourd’hui, prétendent que l’on ne punit le coupable que pour l’amender. Saleilles déclare :
« À l’idée que la peine était un mal pour un mal, on substitue l’idée que la peine est un moyen pour un bien, ou un instrument soit de relèvement individuel, soit de préservation sociale. »
Ainsi les autorités gardent jalousement le droit de punir ; elles se bornent à lui donner, selon les époques, une base théorique différente qui concorde avec les idées du moment. Car nous ne pouvons croire, comme Saleilles, que la société soit si pleine de sollicitude à l’égard du délinquant, lorsqu’il n’est point de noble extraction ! Les chefs ne réalisent que des amendements de détails, des améliorations partielles qui satisfont le public, sans amoindrir le pouvoir qu’ils s’arrogent sur les individus. Dans tous les pays, la législation pénale se propose d’assurer la domination d’une secte, d’un parti, d’une classe pl us ou moins nombreuse, d’une forme de gouvernement. Liberté, bien-être, vie des particuliers, elle sacrifie tout à l’orgueilleux intérêt de ceux qui la fabriquent. La loi n’est qu’un instrument d’oppression ; le juge ne se distingue pas du bourreau. En Amérique, un Sacco, un Vanzetti sont condamnés à mort à cause de leurs idées ; en Espagne, en Italie, de nombreuses victimes ont payé de leur vie le crime de penser librement. En France, la répression est moins sanglante ; pourtant, sans que l’opinion s’émeuve, des ministres s’acharnent contre les chercheurs indépendants. Combien nous en avons subi de ces persécutions, moi et ceux qui commirent le crime de se déclarer mes amis ! Cela remplace les anciens procès d’hérésie et de sorcellerie, les édits qui défendaient, sous peine du bûcher, de faire tourner la terre autour du soleil ou, sous peine de la hart, d’enseigner une logique autre que celle d’Aristote. La justice a d’ailleurs deux poids et deux mesures : elle est autre pour les grands que pour les petits, autre pour le patron que pour l’ouvrier. Quand, par une exception rare, elle frappe le riche, c’est dans une minime partie de sa fortune ; quand elle frappe le pauvre, c’est avec une rigueur inflexible, sans souci de la détresse où se trouve le malheureux. Un Péret trône au Sénat, un Oustric vit en liberté ; les forbans de la banque et de la politique dictent leurs arrêts aux juges et reçoivent des brevets d’innocence qui leur confèrent, légalement, une blancheur immaculée. Mais aucune indulgence pour le chômeur qui dérobe quelques navets, pour le manifestant qui conspue un ministre prévaricateur. Une monstrueuse et méthodique organisation de l’injustice, voilà où conduit, en pratique, l’application du droit de punir. Et jamais les penseurs officiels n’ont pu lui découvrir de bases solides du point de vue de la raison. (Voir l’article sur la Peine de Mort.) Afin de persuader aux peuples qu’ils devaient se laisser conduire comme de vils troupeaux et bénir la main qui les frappait, on soutint longtemps que lois et institutions répressives avaient dieu pour auteur. Parce que dépositaires de la puissance céleste, les souverains avaient pour obligation première de se montrer impitoyables. D’après Joseph de Maistre, c’est tout exprès pour eux que le créateur, dans son infinie bonté, fabriqua le bourreau. « La raison, écrit-il, ne découvre dans la nature de l’homme aucun motif capable de déterminer le choix de cette profession... Qu’est-ce donc que cet être inexplicable qui a préféré à tous les métiers agréables, lucratifs, honnêtes, et même honorables, qui se présentent en foule à la force ou à la dextérité humaine, celui de tourmenter et de mettre à mort ses semblables ? Cette tête, ce cœur sont-ils faits comme les nôtres ? Ne contiennent-ils rien de particulier et d’étrange à notre nature ? Pour moi, je n’en sais pas douter ; il est fait comme nous extérieurement, et naît comme nous ; mais c’est un être extraordinaire, et pour qu’il existe dans la famille humaine, il faut un décret particulier, un fiat de la puissance créatrice. » Pour rendre l’expiation plus complète et mieux satisfaire la vengeance divine, il conviendrait que la loi soit cruelle, les supplices raffinés, pensait le même auteur. Et il prétendait que jamais la justice ne condamna un innocent. Si des hommes ont péri sur l’échafaud pour des crimes dont ils n’étaient pas coupables, c’est qu’ils avaient mérité cette peine par des forfaits restés inconnus. Les atrocités de l’Inquisition se réduisent à « quelques gouttes d’un sang coupable versé de loin en loin par la loi ». Quant à la guerre, elle est d’essence divine, c’est un fait surnaturel qui permet au Père Céleste d’assouvir sa vengeance et de frapper, tout ensemble, le coupable pour ses fautes, l’innocent en qualité de victime expiatoire. De pareilles folies ne trouvent créance nulle part, maintenant., sauf dans les séminaires. En 1914, quelques prêtres s’avisèrent de rappeler la théorie de la guerre-expiation ; on leur fit comprendre qu’elle n’était plus de mode et qu’il était préférable d’exalter le courage de ceux qu’on envoyait à l’a mort. C’est à peine si l’on prend davantage au sérieux les déclamations d’un Cousin ou les réflexions d’un Guizot, pour qui le droit de punir se fonde sur l’ordre moral et consiste dans la rétribution du mal pour le mal. Guizot déclare :
« Il n’est pas vrai que les crimes soient punis surtout comme nuisibles, ni que dans les peines la considération dominante soit l’utilité. Essayez d’interdire et de punir comme nuisible un acte innocent dans la pensée de tous, vous verrez quelle révolte saisira soudain les esprits. Il est souvent arrivé aux hommes de croire coupables et de frapper comme telles des actions qui ne l’étaient pas. Ils n’ont jamais pu supporter de voir le châtiment tomber d’une main humaine sur une action qu’ils jugeaient innocente. La providence seule a le droit de traiter sévèrement l’innocence sans rendre compte de ses motifs. L’esprit humain s’en étonne, s’en inquiète même ; mais il peut se dire qu’il y a là un mystère dont il ne sait pas le secret, et il s’élance hors de notre monde pour en chercher l’explication. Sur la terre et de la part des hommes, le châtiment n’a droit que sur le crime. Nul intérêt public ou particulier ne persuaderait à une société tant soit peu assise que là où la loi n’a rien à punir, elle peut porter la peine, uniquement pour prévenir un danger. »
Jamais les gouvernants, Guizot le premier, lorsqu’il fut ministre, n’ont hésité à prendre des mesures injustes, mais utiles à leurs partisans.
Les plus adroits, nous en convenons, n’oublient pas d’égarer l’opinion publique en couvrant leurs forfaits du manteau de la morale, de la religion, de l’honneur, etc...
Cette conception qu’on peut appeler classique, fut celle d’un grand nombre de spiritualistes au XIXème siècle. Les sanctions prenaient à leurs yeux l’aspect de véritables expiations, de châtiments qui devaient être proportionnés à la gravité du manquement moral. Circonstances atténuantes et aggravantes permettaient seulement au juge d’adapter la peine à la responsabilité. On présumait l’existence de l’a liberté morale dans tout acte répréhensible, et cette liberté on la supposait identique chez tous. Plus voisine de la théorie de de Maistre et des théologiens catholiques qu’il ne semblerait au premier abord, cette doctrine témoigne cependant d’un effort vers la laïcisation de la justice. Comme elle ne répond point aux idées modernes, on l’abandonne de plus en plus. En grande majorité, constate Tarde, les juristes « malgré leurs convictions religieuses, commencent à rompre l’antique association d’idées entre la liberté et la responsabilité — je pourrais citer Cuche, Moriaud et d’autres — et sont bien près de regarder le libre arbitre, à leur exemple, comme n’ayant rien à voir avec la responsabilité morale et pénale. A vrai dire, ce qu’on retient du libre arbitre, pour complaire, pense-t-on, il la conscience populaire, n’est-ce pas le nom plus que la chose ? Tout en disant qu’aux yeux du peuple la responsabilité implique la liberté, on ajoute que la liberté, telle que le peuple la conçoit, c’est tout simplement la normalité physiologique. Ce qui fait la mesure de son indignation, ce n’est pas le degré de liberté que l’acte implique, c’est le degré d’intérêt ou de répulsion que l’agent lui inspire d’après la nature de son caractère, révélé par ses actes et ses paroles. Autant vaut dire que la conscience populaire, en prononçant son verdict, se préoccupe de savoir non si l’acte incriminé a été libre... , mais s’il a été conforme au caractère permanent et fondamental de l’accusé ». Obligation, responsabilité, sanction ne sont, pour la plupart des juristes actuels que des institutions sociales, sans rapport avec le libre arbitre des métaphysiciens et le devoir des moralistes. En bonne logique, ils devraient conclure qu’il n’existe en soi ni bien ni mal et que les lois pénales reposent uniquement sur l’intérêt du groupe ou plus exactement de ceux qui le commandent. D’ordinaire, ils cherchent une solution mieux adaptée à l’hypocrisie des bien-pensants. Fidèles à l’exemple que leur donnait l’école utilitaire, quelques penseurs l’ont osé néanmoins. Dans la peine, ils ne voient « qu’une mesure de défense et de sécurité publique analogue aux mesures préventives prises à l’encontre d’un animal dangereux ou d’un fou ». Et si plusieurs déclarent qu’il faut soigner le délinquant, le guérir, non le punir, car il est victime de son milieu des conditions économiques, de son tempérament, beaucoup d ‘autres se montrent impitoyables à son égard. Gustave Le Bon ne croit ni à la liberté, ni aux entités morales fabriquées par les métaphysiciens, il ramène tout à l’intérêt. Il déclare, dans un livre écrit avant guerre :
« Pour arriver aux répressions nécessaires, il faudra guérir le public de son humanitarisme maladif et la magistrature de ses craintes. Quelques indices, bien insuffisants encore, permettent cependant d’espérer un peu cette guérison...
Les humanitaires sont, indirectement mais sûrement, beaucoup plus dangereux que les bandits... Lorsque le danger sera devenu trop aigu, et qu’un nombre suffisant de philanthropes aura été éventré, notre sentimentalité s’évanouira rapidement. Alors, comme les Anglais, nous emploierons des moyens efficaces, les peines corporelles surtout. Quand les 30.000 apaches qui infestent Paris auront acquis la solide conviction qu’au lieu d’une villégiature en Nouvelle-Calédonie ou dans une prison bien chauffée, ils risquent le fouet, un labeur forcé et la guillotine, le travail leur semblera préférable au vol et à l’assassinat. En quelques semaines, Paris sera purgé de son armée de bandits. Nos législateurs découvriront alors que de toutes les formes d’imbécillité connues, l’humanitarisme est la plus funeste, aussi bien pour les individus que pour les sociétés. Il a toujours constitué un énergique facteur de décadence. »
Gustave Le Bon, qui n’aimait que l’assassinat légal, aura eu la joie de voir l’humanitarisme s’évanouir tout à fait de 1914 à 1918. Avec une telle doctrine, la discussion devient inutile ; elle n’invoque pas hypocritement la morale et la vertu ; elle ramène le droit de punir à une question de force et d’intérêt sordide. Entre le délinquant et la société, il y a lutte ; cette dernière n’a rien à dire si le premier est le plus fort. Mais, comble de l’impudence ! maints auteurs modernes osent prétendre que la peine a pour but, non de châtier le coupable au sens traditionnel du mot, mais de l’avertir et de l’amender. Saleilles écrit :
« La peine a un but social, qui est dans l’avenir ; jusqu’alors on ne voyait en elle qu’une conséquence et comme une suite nécessaire d’un fait passé, sans référence à ce qu’elle pouvait produire dans l’avenir. aussi ne produisait-elle que des récidivistes ! On veut voir aujourd’hui le résultat il obtenir ... Et par suite, la peine pour chacun en particulier doit être appropriée à son but, de façon à produire le maximum de rendement possible. On ne peut ni la fixer d’avance d’une façon stricte et rigide, ni la régler légalement d’une façon invariable, puisque le but de la peine est un but individuel qui doit être atteint par l’emploi d’une politique spéciale appropriée aux circonstances. »
Mais est-ce pour amender le coupable qu’on le condamne à mort ? Et depuis quand la prison et le bagne sont-ils des écoles de vertu ? Juges, policiers, gardes-chiourme voudraient seulement convertir le condamné ! Laisse-moi rire ; les faits sont là pour contredire ceux qui prêtent de si belles intentions, tant aux enjuponnés des tribunaux qu’aux argousins des prisons. De plus, en ramenant la répression judiciaire à un art de guérir et d’améliorer moralement l’individu, n’est-ce pas reconnaître que l’on est incapable de légitimer le droit de punir, que la société s’attribue ? Cet aveu nous suffit et nous arrêterons là l’examen de théories que l’on a multipliées sans profit. Nous repoussons le droit de punir. Nous admettons, par contre, le droit de légitime défense. C’est grâce à lui qu’en régime libertaire l’individu sauvegardera sa personne contre les attaques d’adversaires malveillants. Nous n’avons pas à sacrifier notre vie aux caprices d’un injuste agresseur, ni à souffrir qu’il nous violente ou nous exploite. Respectueux de la liberté des autres, nous pouvons exiger qu’ils respectent la nôtre. Un second droit, qui nous paraît incontestable, c’est le droit à réparation pour les dommages injustement subis. On m’a dérobé mes instruments de travail ; je découvre le ravisseur et l’oblige a me les rendre. Bien entendu, il ne saurait être question de pénalité et un libertaire ne voudra pas recourir ft l’oppressive action des tribunaux ; mais il sera dans son droit en exigeant la restitution. II ne faut violenter personne ; pas davantage il n’est bon de se laisser violenter par autrui. Repousser la force par la force, c’est se défendre, ce n’est pas punir. Quant au droit à réparation, l’ouvrier qu’on exploite est fondé à en user contre son patron.
— L. BARBEDETTE.
PURGATOIRE
n. m. (du latin : purqatorius, de purgare : purger).
Le purgatoire est un lieu intermédiaire entre le ciel et l’enfer, où les âmes qui n’ont pas entièrement satisfait, en ce monde, à la justice divine sont purifiées des peines contractées par le péché, avant d’être admises en la présence de Dieu.
Les anciens n’avaient qu’une idée très vague du purgatoire ; nombre de peuples même l’ont totalement ignoré. Les Grecs avaient imaginé des limbes, séjour des enfants morts jeunes et un purgatoire où des traitements peu rigoureux purifiaient les âmes, mais ils n’en avaient tiré aucun corps de doctrine. Le Lamaïsme, dérivé du Bouddhisme, admet, ainsi que certains peuples Tartares, l’existence d’un purgatoire.
Cette doctrine est particulière à la religion catholique. D’après celle-ci, les âmes des hommes qui meurent avec de petits péchés, des imperfections vénielles sur la conscience, ne peuvent entrer, ainsi souillées, au royaume des cieux. Elles ne méritent pas, pour ces légers manquements, la damnation éternelle. II doit y avoir un lieu de purification possible. C’est au purgatoire qu’elles iront. Là, les âmes souffriront des peines proportionnées à leurs fautes et demeureront un temps déterminé selon la gravité de leurs péchés. De plus, les vivants ont la précieuse faculté — précieuse surtout pour les finances de l’Eglise — de soulager les âmes du purgatoire et abréger la durée de l’expiation, par des messes, des bonnes œuvres, des prières, faites à leur intention. L’Eglise s’est bien gardé de définir ni le lieu exact où se trouve le purgatoire, ni la nature des peines endurées par les âmes. Elle laisse cependant supposer que ces peines consistent en supplice du feu.
L’Eglise a professé, au cours des âges, les opinions les plus vagues, les plus variées, les plus contradictoires au sujet du purgatoire. Elle n’a d’ailleurs érigé cette croyance en dogme qu’après le concile de Florence, en 1439. Les Hébreux n’en avaient aucune idée. Leur livre religieux, l’Ancien Testament, n’en parle pas. Dans le Nouveau, il n’y a que d’imprécises allusions. encore faut-il beaucoup de bonne volonté pour considérer les versets 32 et. suivants de l’Evangile selon saint Mathieu (XII) comme une indication. Sur ce point., les pères de l’Eglise ont eu, à propos du purgatoire, des opinions divergentes, allant jusqu’à s’annuler l’une l’autre.
D’abord ils crurent que les âmes ne sont pas jugées après la mort, mais qu’elles doivent attendre la résurrection des corps, au jugement dernier, pour être punies ou récompensées. Ensuite, certains estimèrent le contraire et imaginèrent le purgatoire. Saint Augustin nie, dans plusieurs de ses Œuvres, l’existence du purgatoire. Saint Fulgence n’y croit pas, mais Origène l’admet fermement.
Cette doctrine s’imposa surtout après l’institution de la fête des morts (xre siècle) qui fut créée sur la foi apportée au récit suivant : cc Un pèlerin, revenant de Jérusalem, fut jeté dans une île où il trouva un ermite qui lui apprit que l’île était habitée par des diables qui plongeaient les âmes des trépassés dans des bains de flammes. Ces mêmes diables ne cessaient de maudire saint Odillon, abbé de Cluny, lequel, par ses prières, leur enlevait des âmes. Rapport de cela ayant été fait à Odillon, celui-ci institua, dans son couvent, la fête des morts. (Légende rapportée et certifiée digne de foi par le cardinal Pierre Damien, — d’après Voltaire -). L’Eglise adopta bientôt cette solennité.
Comme l’usage de racheter, par des aumônes et les prières des vivants, les peines des morts et des âmes du purgatoire, commençait à se généraliser et que, d’un autre côté, le pape délivrait pour cela des indulgences qui avaient une capacité de rachat supérieure aux simples prières, la fête dégénéra vite en abus. Les prêtres et les moines mendiants surtout, se firent payer pour tirer les âmes du purgatoire. Ils ne parlèrent plus que d’apparitions de trépassés, d’âmes errantes qui venaient implorer du secours, des châtiments éternels et des calamités qui punissaient les vivants assez hardis pour refuser du secours. Ce trafic éhonté des indulgences augmenta encore après l’institution des « jubilés » par Boniface VIII (1300). Pour permettre à tous les croyants de participer aux grâces que l’Eglise promettait en retour d’un pèlerinage à Rome, on institua des jubilés tous les 25 ans. Ces jubilés étaient l’occasion d’une vente massive d’indulgences plénières ou partielles.
Le commerce non dissimulé des indulgences, la rapacité des prêtres et des moines qui profitaient de la circonstance pour accroître leurs revenus déjà plantureux, les multiples excès résultant de cette coutume firent énormément pour le progrès des hérésies précédant la Réforme. (Voir ce mot). Afin de réprimer ces abus et pour lutter contre les ravages du protestantisme naissant, l’Eglise, soucieuse avant tout de ses intérêts spirituels et matériels, codifia la doctrine du Purgatoire et l’érigea définitivement en dogme au cours des conciles de Florence, en 1439, et de Trente, en 1545.
En admettant cette croyance chère aux classes pauvres, en faisant sienne cette superstition, l’Eglise se montra logique avec elle-même, car sans Ce royaume intermédiaire, elle ne saurait se tirer des contradictions et des absurdités qui découlent de la croyance au paradis et à l’enfer et du péché originel.
Pour ce dogme, comme pour tous les autres, l’Eglise, obligée par ses prétentions théocratiques, d’imposer au monde un certain nombre de croyances indémontrables, contrainte de répondre sans cesse aux hérésies renaissantes, en évitant de heurter trop directement le sens commun et les croyances générales, à dû imaginer une théologie qui répondait à toutes les objections. Elle a dû, pour sauvegarder l’essentiel de son patrimoine : ses intérêts financiers, progresser sans cesse dans l’absurde, et par des atténuations, des détours, des subtilités, donner au dogme un caractère et des formes en accord avec les besoins et les opinions du moment. Jusqu’au jour où, lassée des objections et des arguments dont l’intelligence humaine, sans cesse en progrès, commençait à l’accabler, elle eut l’idée (qui clôturait toute discussion !) de faire un « mystère » du dogme incriminé.
— Ch. ALEXANDRE.