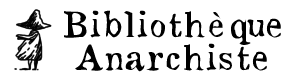L’Encyclopédie Anarchiste — M
M
MALADIE (SES SECRETS BIENFAITS)
MALTHUSIANISME et NÉO-MALTHUSIANISME (ou MALTHUSISME et NÉO-MALTHUSISME)
MALTHUSIANISME, NÉO-MALTHUSIANISME
MARXISME (POINT DE VUE COMMUNISTE-SOCIALISTE)
MARXISME (Point de vue communiste-anarchiste)
MARXISME (Point de vue du socialisme rationnel)
Progrès individuel et progrès social
MATIÈRE (Point de vue du socialisme rationnel)
MÉDECIN, MÉDECINE, MÉDICASTRE...
MÉMOIRE (SA GENÈSE, SON ÉVOLUTION, SA CULTURE)
MÉMOIRE (CARACTÈRES GÉNÉRAUX, ÉDUCATION, etc.)
Les étapes de la mémoire ‒ Comment se servir de sa mémoire
L’instinct maternel et l’instinct sexuel
La Mère dans la société et devant la loi
MÉTAPHYSIQUE (selon le socialisme rationnel)
MÉTHODE (SCIENTIFIQUE OU EXPÉRIMENTALE)
MÉTHODE (Point de vue individualiste)
MÉTHODE (ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT)
Procédés, techniques et méthodes.
Méthodes logiques et méthodes pédagogiques.
Unité de la méthode pédagogique.
Vers la méthode idéale d’enseignement.
MILIEUX [DE VIE EN COMMUN] et [COLONIES]
LISTE DES COLONIES ET MILIEUX DE VIE EN COMMUN.
MORALE (RECHERCHE D’UNE RÈGLE DE VIE)
MORALE (ÉTHIQUE INDIVIDUELLE ET SOCIALE)
MORALE (SES BASES ILLUSOIRES ; SA DUPERIE ACTUELLE)
I. Historique succinct des systèmes de morale.
II. Genèse et évolution de la morale individuelle.
III. — Genèse et évolution de la morale collective.
MORALE (DE LA MORALE DE MAITRE A L’HARMONIE DU SAGE)
MORALE (La) ET L’INDIVIDUALISME ANARCHISTE
MORALE (POINT DE VUE DU SOCIALISME RATIONNEL)
II. ON PEUT MORALISER. LIBERTÉ, VOLONTÉ ET FORCE DES IDÉES.
III. CONNAISSANCE DES RÉALITÉS. MARCHE DU PROGRÈS. EGOÏSME ET ALTRUISME.
V. MORALE ET SATISFACTION DES BESOINS.
VI. MORALE ET CRÉATION DE BESOINS NOUVEAUX.
VII. DOUBLE ROLE DES ÉDUCATEURS : BUTS ET MOYENS.
VIII. POURQUOI L’ÉDUCATION MORALE EST NÉGLIGÉE. CONNAISSANCE DE L’ENFANT.
IX. EXTENSION DU BESOIN D’ATTACHEMENT.
X. IL FAUT CRÉER DES HABITUDES MORALES. AUTORITÉ ET EXEMPLE. QUELQUES CONSEILS.
XI. FACTEURS DU COMPORTEMENT. ÉTAT PHYSIOLOGIQUE. FACTEUR AFFECTIF : BESOINS, TENDANCES.
XII. UN EXEMPLE : L’ÉDUCATION MORALE ET LE BESOIN DE POSSÉDER CHEZ LES ENFANTS.
XIII. QUELQUES PRÉCISIONS SUR LE DÉVELOPPEMENT AFFECTIF.
MUSULMANS (LES) NON CONFORMISTES : ISMAÏLIENS ET HASCHISCHINS
MACÉRATION
n. f. (lat. maceratio, de macerare ; certains le rattachent au grec massô, pétrir, de la racine sanscrite makch ou maks, broyer, amollir, d’où viendrait aussi masticare, mâcher).
Au propre, c’est l’action de macérer, de plonger plus ou moins longtemps un corps dans un liquide pour qu’il s’en imprègne ou y perde, par dissolution, 1 ou plusieurs de ses composants. On a recours à la macération pour certains condiments (cornichons, concombres), pour les fruits (prunes, cerises, pêches, etc.), pour le gibier, le poisson et autres matières animales que l’on conserve ou prépare dans la saumure et aussi dans le vinaigre et l’alcool. Mélanges acides et liqueurs corrosives prennent, à la faveur de ce mariage, le chemin de l’organisme.
On substitue judicieusement à ces procédés – après l’utilisation « nature », la première à considérer – soit la dessiccation simple, la salaison ou le sucrage, la stérilisation à l’étuvée, la pasteurisation, soit l’entreposage, dans un local approprié et tenu à une température convenable, des légumes et des fruits dont on veut échelonner la consommation. Quant aux viandes, dont l’absorption fraîche est la moins nocive, le raffinement qui consiste à les faire macérer ou « faisander » accroît évidemment leur toxicité.
Par une macération de plusieurs mois dans un liquide à base de sublimé corrosif on met les cadavres à l’abri de la putréfaction et on évite l’altération des formes. En chimie, macérer a pour but de débarrasser un corps de ses particules solubles, à la température ambiante. La solution ainsi obtenue porte aussi ce nom. Cette opération est particulièrement fréquente en pharmacie, L’extrait de quinquina, par exemple, s’obtient par macération.
On a donné par extension le nom de macération aux pratiques ascétiques de certaines religions, aux passions pieuses qui recherchent dans la souffrance un agrément au Seigneur. Dans ce mépris de « l’enveloppe charnelle » excellent en particulier, avec quelques religieux solitaires, les ordres cloîtrés dans des monastères ou assujettis à des règles collectives rigoureuses. Jeûnes, disciplines, flagellations, mortifications, privations et austérités de toute nature viennent au secours d’une mystique qui regarde comme une monstruosité la portion tangible de « l’œuvre de Dieu ». Pour échapper au démon de la chair, à cet appel de la reproduction sans lequel la lignée des créatures divines serait vite affranchie de ses stériles hommages, frères mineurs et bénédictins, moines œuvrants ou contemplatifs imposent à leur corps un épuisement et des supplices qui leur valent, à défaut d’une victoire totale sur leurs sens, au moins des trêves partielles et une paix provisoire. Ils y goûtent, dans la prostration de l’être affaibli, dans les troubles de l’hypnose, le délire et l’extase, cette évasion anticipée qu’ils caressent comme un délice et sur l’heure de laquelle la Providence aux secrets desseins leur interdit d’anticiper par un geste décisif. Ainsi le fanatisme égare les êtres à amoindrir en eux, à résorber si possible les forces les plus légitimes de conservation et de vie.
L’homme sain, raisonnable et lucide ne peut voir dans ce refoulement une avance vers la perfection. Il n’entre en lutte avec lui-même que contre ses désordres maladifs et les obstacles que tares et préjugés obstinés accumulent devant l’être qui veut s’épanouir. Il tient pour absurde de s’insurger contre les poussées normales de sa vitalité. Il cherche seulement à accorder ses joies aux possibilités – d’ailleurs évolutives – de sa nature. Il en tâte l’harmonie permanente et sait qu’on ne rompt pas impunément d’ailleurs un impérieux équilibre. De la continence aux divagations sensuelles, de l’abstinence consomptive aux excès épuisants s’offre à sa jouissance une gamme sûre de plaisirs sans folie. Et s’il a, lui, la liberté du suicide, il n’y court pas davantage par la frénésie que par la macération...
— L.
MACHIAVÉLISME
s. m. (prononcez makiavélisme)
Système politique que Machiavel, écrivain et homme d’État italien du XVIe siècle (1468–1517) développe avec hardiesse dans le livre du Prince. Cette doctrine est regardée couramment comme celle du succès à tout prix, et justifiant le recours aux moyens les plus propres à y conduire, indépendamment de leur moralité. Mais elle a besoin, pour être bien comprise, d’être située dans son époque et entourée des circonstances qui firent un impie sans scrupule du disciple ardent de Savonarole. Vue de plus haut qu’en ses artifices ou sa brutalité, c’est aussi la doctrine athée de qui cesse d’en appeler à Dieu de l’iniquité invaincue pour ne plus mettre que la force au service de ses convictions.
Arme à deux tranchants, le machiavélisme commence par se considérer comme l’instrument de l’indépendance pour n’être en définitive, que celui du despotisme. Il manque à cette exaltation de l’énergie le contrôle de la raison, le scrupule à cette habilité, le respect de l’homme à une théorie affranchie de la sujétion divine. Une réprobation proverbiale, excessive comme tous les jugements sans appel, s’attache à l’homme qui se tourne vers les ressorts de l’ homme pour le triomphe de ses visées, la réussite de ses combinaisons ; au système qui, délaissant les implorations stériles et renonçant aux réformations incertaines, entend se servir des vices eux-mêmes pour le salut public et tente de « faire sortir de la servitude générale le miracle de la liberté ». Autoritaire avant la lettre, convaincu que la tyrannie est un mal nécessaire, il lui demande le salut de la patrie. Au seuil du monde moderne, alors que, des siècles après lui, d’autres chercheront dans la force l’équilibre des sociétés, il remet au despote le soin d’assurer le bonheur commun. Et certains, qui aujourd’hui, fondent de bonne foi leurs espoirs sur la dictature, procèdent des mêmes illusions sans avoir les mêmes excuses...
Par extension : en parlant des affaires privées : perfidie, déloyauté.
Cependant, dans l’esprit de bien des auteurs et non des moindres, machiavélisme et jésuitisme se confondent. Or, voici ce que disait il ce sujet Edgard Quinet :
« Je voudrais marquer ici la différence du machiavélisme et du jésuitisme, celui-ci est le complément nécessaire, indispensable de celui-là. Le premier n’atteint que l’homme extérieur ; le second s’empare de l’homme tout entier corps et âme. Après Machiavel la raison reste entière ; après Loyola, il ne reste que Loyola. Le machiavélisme est la doctrine des peuples vainqueurs, qui abusent de leur force en exploitant la faiblesse des peuples vaincus. Le jésuitisme est la doctrine des peuples vaincus qui acceptent la défaite en la couvrant du nom de victoire. »
Machiavel développe longuement la théorie de la servitude. Il permet à son prince, toutes les tromperies, toutes les vilenies, tous les crimes. Il ne met qu’une condition : qu’il soit fort, invincible, inexpugnable.
« Lorsqu’il a ainsi formé de tous les vices, de tous les mensonges, et même de ce qui peut rester de vertu dans l’enfer, cette incroyable machine de guerre, ne croyez pas qu’il contemple stérilement l’œuvre de ses mains. Non, quand il l’a armée de toutes les puissances du mal, chargée de tous les crimes utiles, fortifiée de tout ce que peuvent la prudence, la dissimulation et la fraude empoisonnée de tous les venins de la terre, Il la soulève en face de l’Europe, et la précipite contre les invasions des étrangers. »
Puis Machiavel exhorte le Prince à délivrer l’Italie, en des pages puissantes de lyrisme et de colère qui font presque oublier l’ignominie des moyens préconisés.
Pour Machiavel, le but à atteindre est tellement au dessus des contingences, que les moyens importent peu. Pour le Jésuite, la règle « la fin justifie les moyens », ne s’applique pas qu’à la gloire de Dieu, mais à tous les faits de l’existence. Le Jésuitisme n’est qu’une généralisation du Machiavélisme.
— A. LAPEYRE.
MACHINATION
n. f. (rad. machiner)
Intrigues, menées secrètes pour faire réussir quelque complot, quelque mauvais dessein.
Dans une société où tout est à vendre et à acheter, l’agio, le commerce, ne sont le plus souvent qu’une vaste machination pour enrichir le vendeur aux dépens de l’acheteur. Un tel, veut-il acheter un « commerce » ? Tous les coups de bourse, le débinage auprès des clients, parfois intervention de la police, ou en tous cas d’agents véreux qui, par chantage couvert ou par un jalonnement tortueux de menées légales, mettent le commerçant dans la nécessité de vendre à n’importe quel prix. Ou bien, désirant lui-même se débarrasser d’une maison qui ne rapporte pas, et au plus haut prix, le marchand cherche une « poire d’acheteur », machine contre lui, intrigue, pour l’amener à acheter dans les conditions prévues. Des amis, des agences interviennent pour vanter « l’affaire » ; des clients sont payés pour simuler un mouvement commercial qui n’existe pas, etc... D’autres fois, et presque en permanence, d’astucieux trafiquants font le vide sur le marché, machinant ainsi une hausse de denrées qu’ils ont en abondance et veulent écouler au tarif le plus élevé.
Des industriels pour obtenir des marchés, machinent de grandes hausses et baisses qui ruinent leurs concurrents. Ou bien, aidés des banquiers, contre leurs concurrents ils machinent une bonne petite guerre, appelant, au secours de leurs combinaisons, des principes qui ne sont eux-mêmes qu’une perpétuelle machination contre les peuples.
Tel homme est-il dangereux pour la tranquillité des privilégiés, vite, la police machine contre lui quelque traquenard où il faudra qu’il tombe coûte que coûte. L’histoire n’est qu’un long tissu de machinations, destinées à amener au pouvoir puis à y maintenir. Des guerriers, des forbans, des seigneurs, des rois, des politiciens, en usent tour à tour ou simultanément.
Les religions et les morales sont des machinations destinées à maintenir les peuples dans le servage, avec leurs sanctions extra-terrestres ; ciel, enfer ; ou terrestres : le gendarme.
Les lois sont des machinations concourant au même but. Et comme s’il n’était pas suffisant que religion et États trâmassent d’ignobles machinations contre les individus ceux-ci se rendent la vie plus atroce encore, en machinant sans-cesse contre la liberté.
Législ. Parmi les « machinations » que la loi frappe de durs châtiments, mentionnons au passage celles qui constituent, d’après le Code, les « intelligences avec l’ennemi ». Nos gouvernants les ont souvent invoquées au cours de la guerre de 1914–18 et elles leur ont permis, non seulement d’envoyer au poteau ou de tenir en prison, les « traîtres » avérés, les « agents de l’étranger », les « espions », mais aussi de se débarrasser de leurs adversaires politiques, en même temps que des hommes demeurés fidèles à leurs convictions antipatriotiques, ainsi que les adeptes trop clairvoyants du pacifisme, à point baptisés « défaitistes ».
— A. L.
MACHINE
n. f. (latin machina ; du grec méchané, proprement : ruse, art, puis instrument, de méchos engin)
On appelle ainsi, d’une manière générale « tout appareil combiné pour transmettre une force, soit d’une manière identique et intégrale, soit en la modifiant sous le rapport de la direction et de l’intensité ». (Larousse). Du levier primaire, adjuvant de la force humaine, aux puissantes machines modernes, de rythme presque autonome, qui la remplacent ou la multiplient, quel chemin parcouru et quelle complexité !
Peut-on dire, avec Eug. Pelletan, que « l’humanité rejette sur la machine la plus lourde partie de son travail » quand on sait quelle somme d’efforts exige sa fabrication et son entretien et surtout combien, par les besoins croissants qu’elle engendre ou favorise, elle ébranle de labeur nouveau ? N’est-ce pas plutôt le cercle vicieux de l’agitation humaine qui veut qu’une peine s’apaise par de nouveaux tourments ?... Sans caresser même l’espoir de modifier un cycle qui est peut être celui de la vie même, attachons-nous à accroître les joies recueillies et à en rendre possible une équitable distribution. Travaillons à sortir de cet état où, comme dit Proudhon, « le travailleur qui consomme son salaire est » – et n’est que cela – « une machine qui se répare et se reproduit ». Si nous les admettons, tâchons au moins de rendre positifs les avantages généraux de la machine : qu’ils soient répartis hors du privilège et du paradoxe et que l’accès en soit ouvert à toute l’humanité. Que qui fournit le plus cesse d’être le moins à recevoir, que l’effort animé – et non l’argent – devienne l’étalon de la tâche accomplie et que le besoin soit présent à la répartition.
D’autre part :
« Non contente d’amener des crises dans les salaires, la machine abrutit l’ouvrier, lui enlève toute spontanéité, le réduit à l’état d’engrenage, et l’entasse par surcroît dans des ateliers malsains. » (Sismondi)
Hâtons donc l’époque où l’hygiène pénétrera intimement les méthodes de production et où une participation généralisée permettra de réduire pour chacun le temps et le stade où il est l’esclave des monstres qu’il conduit. Et que l’intelligence du travailleur, pour ainsi dire inemployée dans le moment de l’effort productif, trouve, au sortir de l’usine ou du chantier où chacun verse au bonheur commun sa quote-part d’énergie, mille objets pour s’employer, pour s’ éveiller et se parfaire. Sinon, ce que l’on appelle ordinairement le progrès risque de nous apporter, pour rançon, un abaissement du niveau général et de mettre une cohue de manœuvres en face de quelques cerveaux impulseurs... Il faut que rien dans l’avenir ne puisse justifier ce mot de Bonald, d’une vérité actuelle terriblement ironique :
« Partout où il y a beaucoup de machines pour compléter les hommes, il y aura beaucoup d’hommes qui ne seront que des machines. »
Pour situer, en bref, l’angoissant problème posé par la machine, empruntons à Proudhon ce réquisitoire sévère qui, une fois encore, cloue au pilori une de nos plus troublantes contradictions économiques : « L’introduction des machines dans l’industrie s’accomplit en opposition à la loi de division, et comme pour rétablir l’équilibre profondément compromis par cette loi. Dans la société, l’apparition incessante des machines est l’antithèse, la formule inverse de la division du travail ; c’est la protestation du génie industriel contre le travail parcellaire et homicide. Qu’est-ce, en effet, qu’une machine ? Une manière de réunir diverses particularités de travail que la division avait séparées. Toute machine peut être définie « un résumé de plusieurs opérations une simplification de ressorts, une condensation de travail, une réduction de frais ». Sous tous ces rapports, la machine est la contre-partie de la division. Comme la découverte d’une formule donne une puissance nouvelle au géomètre, de même l’invention d’une machine est une abréviation de main-d’œuvre qui multiplie la force du producteur, et l’on peut croire que l’antinomie de la division du travail, si elle n’est pas entièrement vaincue, sera balancée, neutralisée. Les machines, se posant dans l’économie politique contradictoirement à la division du travail, représentent la synthèse s’opposant dans l’esprit humain à l’analyse ; et, comme dans la division du travail et dans les machines l’économie politique tout entière est déjà donnée, de même, avec l’analyse et la synthèse on a toute la logique, toute la philosophie. L’homme qui travaille procède nécessairement et tour à tour par division et à l’aide d’instruments ; de même celui qui raisonne fait nécessairement et tour à tour de la synthèse et de l’analyse, et rien de plus. Mais par cela même que les machines diminuent la peine de l’ouvrier, elles abrègent et diminuent le travail qui, de la sorte, devient de jour en jour plus offert et moins demandé. Peu à peu, il est vrai, la réduction des prix » – parfois provisoire et souvent enrayée avant qu’elle ne descende au niveau où elle s’équilibre au préjudice que la machine cause au travail – « faisant augmenter la consommation, la proportion se rétablit et le travailleur est rappelé ; mais, comme les perfectionnements industriels se succèdent sans relâche et tendent continuellement à substituer l’opération mécanique au travail de l’homme il s’ensuit qu’il y a tendance constante à retrancher une partie du service, partant à éliminer de la production les travailleurs ».
« Or il en est ici de l’ordre économique comme il en est, pour le dogmatisme, dans l’ordre spirituel ; hors de l’Église, point de salut... hors du travail, point de subsistance ! La société et la nature, également impitoyables, sont d’accord pour exécuter ce nouvel arrêt. Il ne s’agit pas ici d’un petit nombre d’accidents, arrivés pendant un laps de trente siècles par l’introduction d’une, deux ou trois machines ; il s’agit d’un phénomène régulier, constant et général. Après que le revenu, comme a dit J.-B. Say, a été déplacé par une machine, il l’est par une autre, et toujours par une autre tant qu’il reste du travail à faire et des échanges à effectuer. Voilà comme le phénomène doit être envisagé et présenté ; mais alors convenons qu’il change singulièrement d’aspect. Le déplacement du revenu, la suppression du travail et du salaire est un fléau chronique, permanent, indélébile qui tantôt apparaît sous la figure de Gutemberg, puis qui revêt celle d’Arkwright ; ici on le nomme Jacquart, plus loin James Watt ou Jouffroy. Après avoir sévi plus ou moins de temps sous une forme, le monstre en prend une autre ; et les économistes, le croyant parti, de s’écrier : « Ce n’était rien ! » Tranquilles et satisfaits, pourvu qu’ils appuient de tout le poids de leur dialectique sur le côté positif de la question, ils ferment les yeux sur le côté subversif, sauf cependant, lorsqu’on leur reparlera de misère, à recommencer leurs sermons sur l’imprévoyance et l’ivrognerie des travailleurs. »
« Personne ne disconvient que les machines aient contribué au bien-être général, mais j’affirme, en regard de ce fait irréfragable, que les économistes manquent à la vérité lorsqu’ils avancent, d’une manière absolue, que la simplification des procédés n’a eu nulle part pour résultat de diminuer le nombre des bras employés à une industrie quelconque. Ce que les économistes devraient dire, c’est que les machines, de même que la division du travail, sont tout à la fois, dans le système actuel de l’économie sociale, et une source de richesse et une cause permanente et fatale de misère. J’ai assisté à l’introduction des machines à imprimer. Depuis que les mécaniques se sont établies, une partie des ouvriers s’est reportée sur la composition » (que refoule aujourd’hui la linotypie), « d’autres ont quitté leur état, beaucoup sont morts de misère : c’est ainsi que s’opère la réfusion des travailleurs à la suite des innovations industrielles. Autrefois, quatre-vingt équipages à chevaux faisaient le service de la navigation de Beaucaire à Lyon tout cela a disparu devant une vingtaine de paquebots à vapeur. Assurément le commerce y a gagné ; mais cette population marinière, qu’est-elle devenue ? S’est-elle transposée des bateaux dans les paquebots ? Non, elle est allée où vont toutes les industries déclassées : elle s’est évanouie. »
« Un manufacturier anglais a dit et écrit : « L’insubordination de nos ouvriers nous a fait songer à nous passer d’eux. Nous avons fait et provoqué tous les efforts d’intelligence imaginables pour remplacer le service des hommes par des instruments plus dociles, et nous en sommes venus à bout. La mécanique a délivré le capital de l’oppression du travail. Partout où nous employons encore un homme, ce n’est que provisoirement, en attendant qu’on invente pour nous le moyen de remplir sa besogne sans lui ». Quel système que celui qui conduit un négociant à penser avec délices que la société pourra bientôt se passer d’hommes ! La mécanique a délivré le capital de l’oppression du travail ! C’est exactement comme si le ministère entreprenait de délivrer le budget de l’oppression des contribuables. Insensé ! Si les ouvriers vous coûtent, ils sont vos acheteurs. Que ferez-vous de vos produits quand, chassés par vous, ils ne consommeront plus ? Ainsi le contrecoup des machines, après avoir écrasé les ouvriers, ne tarde pas à frapper les maîtres ; car si la production exclut la consommation, bientôt elle-même est forcée de s’arrêter. L’influence subversive des machines sur l’économie sociale et la condition des travailleurs s’exerce en mille modes, qui tous s’enchaînent et s’appellent réciproquement : la cessation du travail, la réduction du salaire, la surproduction, l’encombrement, l’altération dans la fabrication des produits, les faillites, le déclassement des ouvriers, la dégénération de l’espèce, et, finalement les maladies et la mort. »
« Mais il faut pénétrer plus avant encore dans l’antinomie. Les machines nous promettaient un surcroît de richesse ; elles nous ont tenu parole, mais en nous dotant, du même coup, d’un surcroît de misère. » – elles ont accentué l’écart des situations, hissé plus haut le détenteur des mécaniques de remplacement, enfoncé davantage et avili le producteur – « Elles nous promettaient la liberté ; elles nous ont apporté l’esclavage. Qui dit réduction de frais, dit réduction de services, pour les ouvriers de même profession appelés au dehors, comme aussi pour beaucoup d’autres dont les services accessoires seront à l’avenir moins demandés. Donc, toute formation d’atelier correspond à une éviction de travailleurs : cette assertion, toute contradictoire qu’elle paraisse, est aussi vraie de l’atelier que d’une machine. Les économistes en conviennent, mais ils répètent ici leur éternelle oraison : qu’après un laps de temps, la demande du produit ayant augmenté en raison de la réduction du prix, le travail finira par être, à son tour, plus demandé qu’auparavant. Sans doute, avec le temps, l’équilibre se rétablira ; mais, encore une fois, il ne sera pas rétabli sur ce point que déjà il sera troublé sur un autre, parce que l’esprit d’invention, non plus que le travail, ne s’arrête jamais. Or quelle théorie pourrait justifier ces perpétuelles hécatombes ? « On pourra, écrivait en substance Sismondi, réduire le nombre des hommes de peine au quart ou au cinquième de ce qu’il est à présent ; on pourra même les retrancher absolument et se passer enfin du genre humain ». Et c’est ce qui arriverait effectivement si, pour mettre le travail de chaque machine en rapport avec les besoins de la consommation, c’est-à-dire pour ramener la proportion des valeurs continuellement détruites, il ne fallait pas sans cesse créer de nouvelles machines, ouvrir de nouveaux débouchés, par conséquent multiplier les services et déplacer d’autres bras. En sorte que, d’un côté, l’industrie et la richesse, de l’autre la population et la misère s’avancent, pour ainsi dire, à la file, et toujours l’une tirant l’autre... »
Sans préjuger, encore une fois, du rôle futur de la machine (bienfaits croissants ou course sans fin) retenons pour l’instant, avec Proudhon, que « dans l’état actuel de la civilisation » et sous l’économie que nous subissons, « les machines sont des engins de misère et de servitude » et que « leur introduction a été funeste aux travailleurs ». Et que, s’ils ne sont pas fondés à les haïr en droit, ils ne peuvent accepter qu’elles engendrent une prospérité unilatérale – au reste précaire – et les malheurs présents qu’elles leur apportent justifient leur colère. Tant que les fruits de la machine ne seront pas versés dans le bien commun et n’alimenteront pas l’aisance générale, tant que le gain de temps et le soulagement direct de l’organisme suppléant, qui se répercutent aujourd’hui en chômage et en privations pires que les maux épargnés, n’auront pas leur corollaire logique de santé préservée, de loisir élargi et de bien être accru, il ne pourra être question d’une machine prodigue et adoucisseuse. Et le machinisme ne sera, pour qui ne mange qu’autant qu’on appelle ses services et qu’on monnaie l’usure de ses bras, qu’un rival sans entrailles et un affameur grandissant.
(Voir les articles suivants sur machine et machinisme et aussi production, progrès, travail, besoin, etc.).
* * *
En mécanique (voir ce mot), on appelle machine simple (ou élémentaire) « l’appareil au moyen duquel l’effet se transmet directement de la force à la résistance » comme dans le levier, le coin, la poulie, le treuil, les cordes, la vis, le plan incliné ; et machine composée l’appareil formé d’organes combinés qui se transmettent la force de proche eu proche ». Les machines ont des dénominations appropriées à leur principe moteur, ou à leur technique, ou à leur fonction. On dit machine à vapeur (à haute et basse pression, à simple et double effet, etc.), machine hydraulique, pneumatique, électrique, architectonique, machine à compression, machine arithmétique, machine à calculer, à diviser, machine parallactique (astronomie), etc...
Au théâtre, on appelle machine l’appareil servant à mouvoir les décors, à les substituer les uns aux autres ; machines de théâtre désignent aussi « les moyens mécaniques employés pour entretenir l’illusion de la vue dans les changements de décorations, le vol des acteurs qui s’élèvent dans les airs, la descente de nuages sur le plancher de la scène, l’animation d’animaux en carton, de reptiles en étoffe, au moyen de poids et de contre poids, etc. ». D’où le nom de machinistes donné au personnel affecté à cette manœuvre. Des pièces à machines : celles qui usent de ficelles scéniques exagérées, d’effets dramatiques grossiers et qui visent davantage à l’impression visuelle. Parlant du champ propre à l’art théâtral et de ses ressorts limités, Piron disait :
« Notre machine tragique ne tourne guère que sur ces trois grands pivots ; l’amour, la vengeance et l’ambition. »
En littérature, les XVIIe et XVIIIe siècles usaient volontiers de cette métaphore poétique : la machine ronde, la machine de l’univers :
« On ne va qu’à tâtons sur la machine ronde. » (Voltaire)
« En est-il un plus pauvre en la machine ronde ? » s’exclame le bûcheron de La Fontaine implorant la mort.
Et Diderot écrit :
« Sénèque se charge de la cause des dieux ; il ouvre leur apologie par un tableau majestueux de la grande machine de l’univers. »
Le mot machine s’emploie, par analogie, pour désigner l’assemblage des organes qui constituent notre corps et celui des animaux. Nicole dira :
« La machine de notre corps est composée de mille ressorts cachés... »
Et même (Jean Macé) :
« Le cœur est la machine qui fait circuler le sang ». Bossuet, agitant, au bénéfice de l’âme, l’orgueilleux désir d’immortalité qui tourmente les humains, s’écriait : « Ne verrons-nous dans notre mort qu’une vapeur qui s’exhale, que des esprits qui s’épuisent, qu’une machine qui se dissout et qui se met en pièces ? »
L’appellation s’étend aussi à ce qui concourt à un but d’ensemble : la machine de l’État par exemple (le char de l’État est une licence du même ordre). On dira que, « pour le paysan, le gouvernement n’est qu’une machine administrative » (Stern). Déjà La Bruyère observait qu’ « il y a des maux qui affligent, ruinent ou déshonorent les familles, mais qui tendent au bien et à la conservation de la machine de l’État et du gouvernement ».
On donne également ce nom à tout objet considérable exécuté par la main de l’homme (tour Eiffel, Obélisque, etc.), architectures monumentales (Saint-Pierre de Rome, etc.) vastes œuvres d’art (la Cène de Véronèse, etc., etc.
Au figuré, machine a aussi le sens de machination que nous avons vu défini plus haut :
« Je soupçonne, dessous, encor quelque machine » dira la gent trotte-menu dans une fable du Bonhomme. George Sand appelait le mysticisme « une grande machine à mutilation morale. »
L’être impersonnel et sans volonté, le sot, le faible, l’ignorant qu’autrui ou les événements dirigent à leur fantaisie, que pétrissent les mœurs ambiantes et les préjugés, est aussi pitoyable machine. « L’homme ignorant, dira Lamennais, est une machine entre les mains de ceux qui l’emploient pour leur intérêt personnel » ou pour servir leurs ambitions. Et Voltaire :
« Les hommes sont comme des machines que la coutume pousse comme le vent fait tourner les ailes d’un moulin. »
Les masses travailleuses ne sont, pour l’homme politique, que de machines à voter. Elles sont aussi des machines pour ceux qui n’estiment en elles que le produit matériel du travail et le profit qu’il leur assure, et demeurent indifférents devant leur qualité humaine. Tels, dans le passé, furent les peuples, et tels, nous le redoutons, ils seront encore demain :
« Dans tous les âges, les hommes ont été des machines qu’on a fait s’égorger avec des mots. » (Chateaubriand)
Et aussi le pauvre, le besogneux, la foule déshéritée :
Qui courbent nos maigres échines ?
Où vont les flots de nos sueurs ?
Nous ne sommes que des machines...
clamait Pierre Dupont dans « le Chant des ouvriers ». Ils le seront tant qu’ils ne se seront pas élevés à cette résolution qu’il faut pour accomplir (et à la conscience et au savoir nécessaires pour en rendre durable le geste) l’exhortation de cet autre chansonnier :
Prends la terre, paysan !
Par assimilation aux outils ou instruments servant à mettre en œuvre les matériaux ou agents naturels, un cheval, un ouvrier sont des machines dans le langage de l’économie politique. L’art de la guerre, que le journalisme a enrichi d’une terminologie savoureuse, a fait de ces machines le « matériel humain » poussé sur les charniers... Pour conclure en reprenant à la base notre désir ardent d’élever les hommes au-dessus de cette condition d’automate qui les prédispose à toutes les servitudes, nous rappellerons, avec Paul Janet que l’éducation qui nous est chère a pour objet « non de faire des machines, mais des personnes »...
— Stephen MAC SAY.
MACHINE
On ne conteste plus, aujourd’hui, les bienfaits dont nous sommes redevables à la machine mais on commet souvent une erreur sur la nature des services qu’elle nous rend. On admet volontiers, sans examen suffisant que la machine fournit du travail, produit de l’énergie, alors qu’en réalité elle en consomme. Paul Lafargue exaltait, jadis, ces esclaves d’acier qui, un jour, affranchiront l’homme de la plus grande partie de son travail. Un écrivain socialiste contemporain a caressé le même espoir illusoire.
Or, cette erreur n’est pas sans conséquence. L’homme produit plus qu’il ne consomme, son labeur donne naissance à une plus-value. Il nous paraît équitable qu’il bénéficie intégralement du produit de son travail, soit directement, soit en échangeant des services contre des services équivalents, des produits ayant exigé l’apport d’une certaine énergie contre d’autres ayant requis un apport égal. Si la machine, collaborant à l’œuvre des hommes, produit, elle aussi, plus qu’elle ne consomme, celui qui en a fait la fourniture ne va-t-il pas, au jour du partage des fruits, avoir le droit de réclamer en sus de ses frais de construction, une part de la plus-value due à son matériel. Ainsi serait justifié l’intérêt dû au capital, ou plus exactement au capitaliste détenteur des moyens de production.
Quand la machine est réduite à sa plus simple expression, outil ou engin mu par le bras de l’ouvrier, chacun voit bien qu’elle ne fournit par elle-même aucun travail, qu’elle reste inerte tant qu’une volonté ne lui a pas infusé sa vigueur. Elle donne au travailleur la possibilité d’exécuter des besognes dont sans elle il n’aurait pu venir à bout, mais elle lui emprunte son énergie et, même, ne lui rend pas tout ce qu’elle a reçu. Uri homme qui élève, à la hauteur d’un mètre cinquante pierres de 10 kilos dépense 500 kilogrammètres ; avec un palan, il soulèvera à la même hauteur un fardeau de 500 kilos et il aura fourni le même nombre de kilogrammètres et même un léger supplément pour vaincre les frottements et la raideur des cordes.
Mais il n’y a pas que des machines-outils ; il y a celles qui sont mues par la vapeur, l’eau, le vent. Eh bien ! celles-là aussi sont consommatrices et non productrices d’énergie. Le bénéfice qu’elles nous apportent vient de ce qu’elles nous permettent d’utiliser des forces naturelles, celles qui proviennent des combustibles tirés des entrailles de la terre où des causes fortuites les avaient mises à l’abri de la dégradation inévitable des matières organiques, ou des agents actuels, courants aériens ou chute de l’eau, qui revient à son niveau après un cycle souvent décrit.
Considérons, par exemple, le charbon. Si d’un puits de 500 mètres nous avions extrait une pierre de 1 kilo, nous aurions, en l’y laissant retomber récupéré les 500 kilogrammètres que nous a coûté son élévation. Sa combustion, au contraire, produira 8.000 calories, soit 8.000 x 425 kilogrammètres soit 3.400.000 kilogrammètres. Déduction faite des frais d’extraction, de transport, etc., équivalant au plus aux 9 dixièmes du total, il nous testera 340.000 kilogrammètres. Or, la machine à vapeur ordinaire ne nous en rend que 10 à 11 % soit 34.000. Le profit est important malgré tout, car il correspond à une heure de travail d’un manœuvre. Des calculs analogues nous renseigneraient sur le rendement des autres forces naturelles.
Mais ces richesses, ce n’est pas le capitaliste qui en est l’auteur. De quel droit vient-il donc en réclamer la jouissance ?
Ainsi les machines-outils accroissent l’empire de l’homme sur son milieu, elles étendent son rayon d’action, multiplient les biens dont il jouira, mais n’ajoutent rien à la somme de travail qu’il met en œuvre, et par conséquent à leur valeur, si nous faisons du travail la mesure de la valeur.
Les machines motrices consomment plus d’énergie qu’elles n’en restituent, mais cette énergie est empruntée à la nature et il y a là un enrichissement évident de l’humanité. Par contre nul n’a de titres à l’appropriation de ce dont la nature nous a gratifié. Le capitaliste constructeur ou fournisseur de l’outillage mécanique a droit, comme chacun au remboursement du travail qu’il a apporté à la masse. Une fois cette compensation perçue, tout prélèvement périodique sur les résultats d’une activité à laquelle il ne participe pas est illégitime. Rien ne justifie l’intérêt du Capital.
— G. GOUJON.
MACHINISME
n. m. (de machine)
Ce mot désigne l’emploi régulier, l’utilisation systématique des machines pour alléger, diminuer ou supprimer même le travail humain.
Il est devenu, grâce au développement toujours plus grand de la science appliquée et de la mécanique, synonyme d’un vaste et profond mouvement de transformation des anciennes méthodes de travail. Par l’introduction de procédés mécaniques de plus en plus puissants, perfectionnés, complexes et rapides, se trouve multiplié et intensifié dans des proportions formidables le rendement de l’effort.
Le mot de machinisme est assez moderne. Il date surtout de l’emploi des moteurs mécaniques, des machines à vapeur. Car c’est de l’époque où elle n’exigea plus la force musculaire humaine pour être mise en mouvement que la mécanique a pris un essor considérable. Tant que la machine devait être manœuvrée par les bras humains et qu’il n’était guère possible d’augmenter à son gré le chiffre des hommes à son service, la mécanique se trouvait limitée dans son extension. Mais dès que la vapeur permit de concentrer une force illimitée, pouvant égaler celle de milliers d’hommes en certains cas, et pouvant tourner à des vitesses que le muscle humain ne pourrait soutenir, le machinisme est entré dans une phase nouvelle, et il va sans cesse s’accroissant et se perfectionnant. Après la vapeur, le pétrole et l’électricité sont devenus des puissances motrices, plus légères, souples, rapides et délicates, et ce fut une poussés accélérée du machinisme. A tel point que tous les espoirs sont permis aujourd’hui, et que nul ne pourrait dire où s’arrêtera le progrès mécanique, ni s’il s’arrêtera jamais.
Avec la vapeur d’abord, le pétrole, l’alcool industriel, l’électricité ensuite, nous sommes entrés dans l’ère propre du machinisme. Il est à l’ordre du jour partout ; il est au premier plan des préoccupations de tous ceux qui s’intéressent à l’industrie, à l’agriculture, aux transports, à toutes les modalités du travail humain.
Toutefois, bien avant l’introduction des machines à vapeur, on se servait de machines, de mécaniques plus ou moins rudimentaires et grossières. Le premier homme qui imagina de se servir d’un bâton pour frapper et décupler sa force, celui qui découvrit les propriétés tranchantes et contondantes d’un silex, inventèrent les premiers outils, et un outil est une machine à l’état simple.
On trouve, dans l’histoire économique de la Chaldée, de l’Assyrie, de l’Égypte, des descriptions de machines à élever l’eau du fleuve pour faciliter l’irrigation, ainsi que des instruments aratoires assez rudimentaires, mais constituant de gros progrès pour l’époque.
L’invention de la roue, des chars et des voitures vint soulager beaucoup les transports. Pour faire la guerre, le siège principalement, Grecs, Égyptiens, Carthaginois et autres se servirent de machines spéciales. Les blocs de pierre, servant à écraser le grain, devinrent des meules, que l’on fit mouvoir par les courants d’eau. On peut suivre ainsi les progrès lents et séculaires du machinisme bien avant l’utilisation de la vapeur comme force motrice.
Mais c’est à partir de l’invention de la machine à vapeur que la mécanique, disposant d’une force motrice illimitée, fit des pas de géant. Ce fut surtout l’œuvre du XIXe siècle. La première moitié de ce siècle voit apparaître l’application du machinisme à l’industrie textile et aux transports. De nombreuses usines de filature et tissage se montent et s’agrandissent. (Depuis que les fileuses mécaniques d’Arwright et de Watt ont remplacé les ouvriers fileurs, cinq personnes suffisent pour surveiller deux métiers de 800 broches). Les chemins de fer apparaissent, puis la navigation à vapeur laissant rapidement derrière eux, d’une part les diligences et les lents convois routiers, d’autre part les bateaux à traction animale sur les cours d’eau, et, sur les mers, la voile encombrante et aléatoire.
Il serait trop long de faire ici un historique du développement du machinisme. Disons brièvement que, peu à peu, toutes les industries ont été conquises et transformées par la machine. En moins d’un siècle, les conditions de travail ont été radicalement transformées. Avec le même personnel, l’industrie aujourd’hui transforme, fabrique, manipule et transporte dix fois plus de produits qu’il y a cent ans. Le rendement de la production, par tête d’ouvrier, a pour le moins décuplé depuis cette époque. Comparez les métiers à filer le coton ou la laine, dont nous parlions tout à l’heure, avec leurs mille broches tournant à une vitesse vertigineuse et surveillées seulement par trois ou quatre personnes, avec l’archaïque rouet. Voyez l’antique métier à tisser à la main, un bon ouvrier produisant 4 ou 5 mètres de tissu par jour, en regard des métiers mécaniques, et des 100 à 150 mètres de tissu par jour et par ouvrier.
Dans la métallurgie, les progrès sont encore plus considérables. Il eut été complètement impossible, avec le travail à la main, le marteau et l’enclume, d’arriver à la centième partie de la production moderne, ni surtout de fabriquer des machines, des outils et des objets aussi perfectionnés et délicats que ceux qui sont devenus d’usage courant.
Dans les cuirs et peaux, dans l’imprimerie, l’industrie du bois, le bâtiment, dans le commerce même, partout la machine a pénétré, accélérant le travail, la fabrication et les échanges.
L’agriculture qui, routinière, a été plus lente à prendre le chemin des progrès techniques, s’est tournée résolument vers le machinisme, surtout depuis que les cours élevés de leurs produits a permis aux patrons agricoles d’avoir à leur disposition des capitaux importants.
De tout ce travail accru et précipité, est sorti un flot de production qui aurait bouleversé nos aïeux. Les produits ne manquent plus ; ils sont en abondance, et si le régime social était mieux constitué, la production apparaîtrait pléthorique. Elle provoque aujourd’hui le chômage, la société mal organisée ne permettant pas aux populations de consommer tout ce qui est produit.
C’est surtout dans les moyens de transport que les progrès sont fantastiques : trains rapides, paquebots puissants, automobilisme, aviation. A tout cela vient s’ajouter la poste, le télégraphe, le téléphone, la T. S. F. Les distances ne sont pas encore supprimées, mais considérablement diminuées. On se déplace avec facilité et rapidité ; les nouvelles du monde entier circulent en quelques minutes et sont mises quotidiennement, par la presse, à la portée de tous.
Presque chaque jour apporte son invention nouvelle, un perfectionnement à quelque machine plus ancienne. Nul ne peut prévoir jusqu’où ira cette fantastique expansion du machinisme. Une nouvelle mentalité se dégage. Jadis, on croyait facilement au miracle divin. Aujourd’hui, on ne s’étonne plus du progrès. L’humanité attend, comme une chose toute naturelle, la réalisation de progrès techniques toujours plus merveilleux. Le miracle humain est devenu normal. Les hommes ont la foi dans la science technique. Certains écrivains ont même affirmé que la solution de la question sociale se trouvait dans le développement du machinisme qui, fabriquant des produits à profusion, permettrait de donner à tous des moyens d’existence supérieurs même à ceux qu’ils pourraient rêver dès maintenant.
Malheureusement, cette mystique du progrès technique est souvent démentie par les faits. Le machinisme et la puissance de production se développent toujours, intensément, mais on ne saurait, sans mentir, affirmer que les conditions d’existence du peuple s’améliorent avec le rendement de la production.
L’organisation sociale actuelle s’oppose à cela. Le machinisme, comme tous les progrès, sert les intérêts de la classe dirigeante et possédante, mais ne profite que très peu au prolétariat. Quand un procédé nouveau est introduit dans une industrie, le patronat en garde presque exclusivement tout le bénéfice n’accordant à ses ouvriers que des améliorations ne représentant pas la dixième ou la vingtième partie des économies réalisées. Que l’on compare les moyens d’existence des prolétaires d’aujourd’hui avec ceux de leurs aïeux d’il y a un siècle. Malgré une production intensément multipliée, c’est à peine si leur possibilité de consommation a augmenté de 40 à 50%. Tout le reste a été gardé par la classe qui détient le capital, laquelle gaspille sans vergogne la plus-value due au machinisme. Le machinisme a surtout contribué à augmenter le luxe des hautes couches sociales, et n’a guère profité au prolétariat. Si des ouvriers en ont retiré quelques bribes, combien lui ont dû — et lui doivent — les angoisses du chômage, l’incertitude du lendemain, l’instabilité et l’insuffisance de leurs ressources.
Henry Ford, le grand industriel américain, a soutenu, en deux ouvrages, que le machinisme et la rationalisation, auraient pour effet de diminuer les prix de revient, et partant les prix de consommation, et qu’ils pousseraient ainsi celle-ci à se développer. C’est là une théorie que la pratique de la vie dément. Les prix de vente sont loin d’avoir diminué dans la proportion des économies réalisées. Et encore, les diminutions furent provisoires, jusqu’au jour où un cartel de gros Industriels y mit le hola ! En réalité, le machinisme a permis aux détenteurs de la richesse d’augmenter leurs bénéfices, donc leur consommation, mais n’a transformé qu’isolément et exceptionnellement les conditions d’existence des travailleurs.
Les bénéfices du machinisme ont été accaparés par une caste sociale. Et il en sera ainsi tant que l’organisation sociale ne se transformera point pour permettre à tous de profiter des progrès. Il ne suffit point de perfectionner la technique du travail, il faudrait aussi que parallèlement, la société se transformât, et que le progrès social accompagnât le progrès de la mécanique.
Tel n’est pas le cas. Il est même à craindre que le machinisme, en versant abondamment des richesses aux capitalistes, ne renforce leur puissance, ne leur permette une corruption plus facile des meilleurs éléments ouvriers, ne leur facilite la défense de leur régime par un asservissement toujours plus complet de la presse, par une pression plus énergique sur le pouvoir, par la constitution d’une garde ou armée mercenaire, bien outillée, que les économies réalisées sur la main-d’œuvre leur permettront d’entretenir.
Le machinisme a créé, socialement, et amplifié cette plaie de notre époque : le chômage. Aussi paradoxal que cela puisse apparaître en pure logique, l’abondance de la production, l’accumulation des denrées et objets, réduit une portion de plus en plus forte du prolétariat à la plus profonde misère. La machine remplace les bras. Ceux-ci sont inemployés. Et le travailleur sans ouvrage n’a point de salaire. Dans les pays fortement industrialisés, où le machinisme est poussé à son maximum, le nombre des chômeurs s’accroît sans cesse ; des millions aux États-Unis, en Angleterre, et en Allemagne. Le problème du chômage est devenu un problème social de premier ordre, singulièrement angoissant. Un ordre social quelconque ne peut laisser long. temps, sans être en danger, des millions d’hommes inoccupés et sans moyens d’existence. D’autre part, le chômage aura sa répercussion inévitable sur la natalité.
C’est un problème assez complexe. Il est dû surtout au déséquilibre qui règne par suite de l’introduction brusque du machinisme dans un cadre qu’il déborde. En examinant le mécanisme social actuel on s’aperçoit que le machinisme introduit sur un point, ne provoque pas inexorablement le chômage, mais des ondes qui tendent à se fondre dans une nouvelle dispersion. Si les prix de revient sont abaissés, les prix de vente baissent ; la population, ayant les mêmes capacités d’achat, peut augmenter sa consommation de la quantité d’économie réalisées sur un produit. Si ce sont les patrons et intermédiaires qui gardent tout le bénéfice, ils le dépensent ailleurs et font ainsi vivre d’autres industries. La main-d’œuvre supprimée en une industrie trouve à s’occuper ailleurs. Le chômage correspond surtout à la période de recherche et de réadaptation de la main-d’œuvre. Seulement, comme de nouveaux perfectionnements viennent sans cesse révolutionner la technique, et que cette course à un machinisme toujours plus rapide va sans cesse s’aggravant l’équilibre na pas le temps de s’établir. A peine les travailleurs d’une industrie ont-ils trouvé un remplacement, qu’une autre, ou plusieurs autres industries, en licencient à leur tour. Le nombre de chômeurs et le malaise qui en résulte dans une nation indique donc la rapidité de transformation du machinisme dans cette nation. A cette cause principale peuvent venir s’ajouter d’autres causes dues à la concurrence d’autres pays, etc., mais le machinisme est le facteur essentiel de cette perturbation.
On a cru que le machinisme libérerait l’ouvrier, le salarié ! Ce pourrait être vrai si la machine appartenait au travailleur, isolé ou associé. Ce ne l’est point dans la société actuelle. Comme l’a proclamé un jour, brutalement — on l’a rappelé ici tout à l’heure — un industriel. « La mécanique a délivré le capital de l’oppression du travail. » C’est une boutade, mais elle contient des vérités. Jadis, il fallait plusieurs années d’apprentissage pour faire un bon ouvrier manuel, connaissant bien son métier. Un bon ouvrier ne se remplaçait pas facilement. Ce qui constituait, pour le travailleur qualifié, à la fois une fierté professionnelle et une garantie de stabilité et de placement aisé. Certes, l’ouvrier était lié pour toute sa vie à la même corporation, mais le patron subissait lui aussi cette dépendance, car on n’improvisait pas un bon travailleur en quelques jours.
Avec le machinisme, transformation profonde des mœurs corporatives. A l’exception de quelques professionnels, de plus en plus rares, les machines les plus délicates peuvent être conduites par les plus ignorants, après quelques jours ou même quelques heures de mise au courant. Les patrons peuvent « fabriquer », des ouvriers en série, en un temps très court. Il leur suffit de quelques contremaîtres avisés pour régulariser l’effort d’ensemble. Cette rapidité d’initiation, qui serait précieuse dans une société autrement organisée et où le travailleur serait appelé, selon ses goûts, à changer plus souvent d’occupation, donne seulement aujourd’hui à l’industriel toutes facilités pour licencier les travailleurs trop fiers, fortes têtes, meneurs et mécontents. On les remplace aisément. Le temps n’est plus où un ouvrier, fort de ses capacités pouvait encore, appuyé sur elles, tenir tête, dans une certaine mesure, à l’employeur. Certaines grandes usines licencient tout ou partie de leur personnel quand les commandes se raréfient, pour réembaucher dès que la demande afflue de nouveau. Ce lock-out plus ou moins déguisé est devenu de pratique normale dans certaines corporations, notamment aux États-Unis, et dans la grosse industrie du monde entier. Le personnel devient un troupeau — mécanique lui aussi — qu’on fait entrer ou sortir suivant les besoins, sans se soucier de ce qu’il peut devenir.
Autre conséquence du machinisme, morale celle-là, c’est la dégénérescence intellectuelle qu’il provoque. A rester pendant des heures à servir une machine, à répéter le même mouvement machinal, un engourdissement intellectuel envahit le cerveau du travailleur. Plus d’amour du métier, plus de conscience ni de dignité professionnelle, plus de repos de l’esprit se délassant par la variété des occupations, plus d’initiative et d’enrichissement technique : l’ouvrier est réduit à l’état de machine. Si l’on y ajoute les conséquences de la rationalisation, qui exige une tension concentrée pour parvenir à accompagner la rapidité d’une machine, on se rend compte que le machinisme éteint, pendant 8 ou 9 heures par jour, l’activité intellectuelle du travailleur « mécanisé ». Ainsi compris, le machinisme, déjà perturbateur de l’économie loin de libérer l’esprit, conduit à l’abrutissement.
Proudhon a jeté l’anathème sur la machine. On a lu par ailleurs son jugement. Mais il est évident que la réprobation dont il frappe le machinisme atteint avant tout l’organisation sociale qui en fausse le rythme et le caractère. La machine, ennemie momentanée de l’ouvrier dans la condition du salariat, pourrait être au contraire génératrice de loisirs et de biens.
Le machinisme a contribué à l’unification de l’espèce humaine, en rapprochant les peuples. Le machinisme en intensifiant dans des proportions fantastiques le rendement du travail et la production permet à nos aspirations vers une meilleure société de devenir des réalités, de prendre corps positivement. Le véritable communisme libertaire n’est possible que par l’abondance des produits. En diminuant la fatigue nécessaire au travail, le machinisme permet de le rendre plus sain, plus agréable, plus acceptable par tous.
Certes, dans l’état actuel de la civilisation, il est gros de crises, de souffrances et de dangers. Mais dans une autre civilisation, ses avantages comprimés s’épanouiraient, Par le machinisme, l’homme a réalisé des miracles techniques, qui auraient ébloui nos ancêtres. Par le machinisme, l’homme pourrait réaliser ce qui jusqu’à présent a paru une chimère « l’égalité de tous dans le bien-être et la liberté », sinon dans le bonheur.
Personne ne songe plus sérieusement à détruire les machines mais il convient d’en dégager les profits sociaux. La question qui se pose, c’est que le machinisme ne soit plus à la disposition d’une caste sociale mais devienne la propriété commune d’une humanité libre, égale et associée.
— Georges BASTIEN.
MAGASIN
n. m. (de l’italien magazzino, dérivé du pluriel arabe makhasin, même sens)
Pièce d’appartement, de maison qui sert à faire du commerce. Dans ce local se trouvent plusieurs articles et produits destinés au négoce, vaguement annoncés par l’enseigne commerciale. Dans les villes et localités quelque peu importantes, certains quartiers et rues sont particulièrement occupés par des magasins. Ainsi, dans un certain rayon et dans les magasins, se trouvent les marchandises les plus variées.
Dans notre société, c’est généralement par les magasins particuliers que se fait la distribution des richesses mobilières aux individus.
Le magasin est une espèce de petit marché, un lieu où s’opère soit le troc, soit la remise des produits contre monnaie conventionnelle. L’échange direct est de plus en plus rare et l’on pratique surtout communément l’achat ou la vente des objets et des denrées qui font du producteur au consommateur un chassé-croisé parfois complexe (voir commerce, négoce, trafic, etc.).
Si dans la société actuelle tous les magasins (ou à peu près), appartiennent au domaine privé, et par là se prêtent à la spéculation pour l’avantage exclusif des négociants, il devrait en être autrement dans une société rationnellement organisée.
Sans entrer dans le fonctionnarisme commercial il devrait y avoir – dans le système auquel je marque ma préférence – des magasins-types et de contrôle indicateur comme prix maximum pour chaque produit, en laissant la liberté à chacun de pouvoir faire du commerce en quelque sorte moralisé par l’impossibilité de l’exploitation abusive. Ainsi la spoliation du travail à l’avantage du capital se trouverait endiguée par un bénéfice qui n’aurait rien de commun avec ce qui se produit actuellement sous la domination du capital. Les magasins abriteraient des travailleurs sérieux et honnêtes qui ne compteraient plus sur la spéculation pour s’enrichir, mais sur le travail.
Dans d’autres systèmes, à base communiste notamment (voir coopérative, communisme, socialisme, répartition, etc.), les magasins seraient représentés, d’une part, par des entrepôts généraux, de préférence régionaux, qui centraliseraient les principales productions, et d’autre part, par les magasins particuliers – ou de répartition – plus ou moins spécialisés, qui recevraient des premiers l’approvisionnement et tiendraient produits ou objets manufacturés à la disposition des consommateurs. Quel que soit ici le mode d’échange adopté (entièrement libre ou avec bons soumis à un barème de contrôle ou selon toute autre modalité regardée comme plus équitable ou plus sûre), il n’y aurait pas davantage de place pour la spéculation qui caractérise le commerce actuel et fait des magasins des antres perfides où l’on détrousse, légalement et avec le sourire, le chaland qui s’approvisionne.
* * *
Par analogie : lieu où l’on serre certains objets en grande quantité : « C’est dans l’eau que les castors établissent leur magasin » (Buffon). On donne aussi ce nom à une des parties d’une usine où se trouve un approvisionnement de circonstance ; à un ensemble de ressources personnelles ; à un entassement de choses inutiles ou disparates, etc. Par extension, en littérature, on appelle ainsi certains recueils périodiques : le « magasin pittoresque ». Dans ce sens se généralise l’usage du terme étranger : magazine.
Les magasins généraux, fondés en France par un décret du 21 mars 1848 « sont régis par une loi du 28 mai 1858, un décret du 12 mars 1859 et une loi du 31 août 1870 ». Depuis cette dernière loi, toute personne peut ouvrir un magasin général ; mais l’autorisation du préfet et un cautionnement sont exigés.
Ces magasins, recevant les marchandises que tout négociant ou industriel veut y déposer, ont pour but de faciliter les ventes et les prêts sur gages.
« Celui qui fait un dépôt dans un magasin général, reçoit deux titres : le récépissé et le bulletin de gage ou warrant. Le premier est destiné à transférer la propriété de la marchandise ; l’autre doit servir à placer la marchandise, à titre de gage, entre les mains du prêteur. Ces deux titres sont transmissibles par voie d’endossement. Le magasin général détient la marchandise soit pour le compte du propriétaire, porteur du récépissé, soit pour celui du créancier, porteur du warrant » (Larousse).
— E. S.
MAGASINS COOPERATIFS
La plupart des gens considèrent les magasins coopératifs comme des boutiques de vente de marchandises à bon marché. C’est une conception étroite, étriquée, et en désaccord avec le caractère même de la coopération.
Dans les pays musulmans, où l’on a souffert comme ailleurs de la crise de vie chère, les Arabes appellent volontiers magasin coopératif, ou « coopérative » , toute boutique (privée ou capitaliste) qui vend, ou a la réputation de vendre, à bon marché. Et même, dans les pays à population évoluée, combien de ménagères et d’hommes, appellent « coopératives » des succursales de maisons d’alimentation à succursales multiples, lorsque ces succursales vendent, ou ont la réputation de vendre, à bon marché...
Ceux qui envisagent le problème coopératif de ce point de vue ont une lamentable mentalité. Certes, dans l’ensemble, les magasins coopératifs ont l’avantage de débiter des marchandises bonnes, à bon marché et au juste poids. Certes, dans l’ensemble, ils répartissent en fin d’année à leurs sociétaires des trop-perçus intéressants et soutiennent des œuvres sociales recommandables. Mais tout cela n’est rien par l’apport à l’action organique déterminée par la création et le fonctionnement de ces magasins.
D’abord, ils opposent un frein aux appétits déchaînés du capitalisme (petit ou grand), des mercantis et même des marchands. Et, mieux que cela, qui n’est pas mince, ils groupent organiquement, pour des entreprises collectives concrètes, la poussière des consommateurs qui, isolés, ne seraient rien, mais qui, unis, disposent de la plus grand puissance qui soit au monde, celle devant laquelle s’inclinent respectueusement les plus grands capitaines du commerce, de l’industrie, de la banque, du Capitalisme, en un mot : la puissance d’achat des consommateurs.
Supposez cette puissance d’achat groupée dans les succursales des coopératives régionales ; celles-ci groupées dans leur Fédération nationale, leur Magasin de Gros, leur Banque et toutes ces institutions groupées dans leur Alliance coopérative internationale, dans leur Banque internationale, dès lors, c’est la Société coopérative, avec toutes ses possibilités.
Les consommateurs sont groupés d’abord comme nous venons de le voir. Ils savent de combien de tonnes de marchandises ou denrées ils auront annuellement besoin. Dès lors, avec leurs capitaux propres, collectifs dans leurs magasins coopératifs, ou avec leurs réserves, ils dirigent les productions, qui seront absorbées par leurs sociétaires, en créant des usines ou des ateliers coopératifs. Ils croissent. Ils se trouvent en présence des trusts et, par la force des circonstances, ils entrent en lutte et les expériences qui ont été faites en Allemagne, en Angleterre, en Suède, en Finlande, en Suisse et même en France prouvent que les trusts, même les plus puissants, ne sortent pas victorieux de leur lutte contre les consommateurs groupés dans leurs magasins coopératifs.
Cette poursuite de l’idéal coopératif a pour effet certain de faire participer à une action organique concrète et profondément révolutionnaire, sur le plan économique, des gens que rien n’avait, jusque-là, préparés à une action sociale profonde et qui se laissaient, jusque-là, emporter, comme des bâtons flottants, par les eaux du capitalisme.
L’avantage aussi de cette action organique des magasins coopératifs est qu’ils constituent, par l’association libre et volontaire des individus, dans l’actuelle société, un capital collectif et impersonnel, qui va grandissant sans cesse et qui se transmet de générations en générations et, par ce fait même, crée des habitudes de pensée et une moralité nouvelles, dégagées de l’emprise capitaliste. Et, à cause de leurs mérites actuels et futurs, les magasins coopératifs sont des instruments éminents d’une Révolution sociale profonde ; tandis que les myopes intellectuels les ont considérés (v. Karl Marx) et les considèrent encore (les « révolutionnaires » verbaux) comme de simples boutiques commerciales perfectionnées...
— A. DAUDÉ-BANCEL.
MAGIE
(du grec : mageia)
Art prétendu de produire des phénomènes merveilleux, grâce à l’évocation de puissances invisibles, et l’utilisation de forces mystérieuses. La magie est aussi ancienne que les sociétés humaines, et l’on trouve des traces de ses rites dans les annales de tous les peuples. Là où elle n’est pas toute la religion, elle s’exerce, d’une façon plus ou moins clandestine, à côté de la religion reconnue par les classes dirigeantes. La haine du clergé à l’égard des pratiques magiques semble due, principalement, à ce qu’elles représentent pour la profession ecclésiastique une concurrence. Au moyen-âge l’Église faisait brûler vifs ceux qui étaient soupçonnés de s’y livrer, sous prétexte qu’ils faisaient commerce avec les démons et Satan lui-même, dans des intentions criminelles. Mais, pour s’adresser à Dieu, à la Vierge, et aux Saints, les cérémonies du culte, avec leurs prières chantées, leurs fumigations d’encens, leurs accessoires et leurs symboles, n’en ont pas moins avec les cérémonies magiques de si frappantes ressemblances, qu’il est impossible de ne point découvrir entre elles une parenté.
Dans l’antiquité, la magie a été en honneur principalement dans l’Inde, en Égypte et en Perse, où étaient dénommés « mages » les prêtres de la religion de Zoroastre. On attribuait aux magiciens la faculté de prédire l’avenir, de converser avec les âmes des morts, de voir et d’entendre ce qui se passait dans des lieux éloignés, de créer des illusions collectives, de guérir miraculeusement des malades, d’influencer à leur gré les événements, etc... Le charlatanisme et la prestidigitation se sont d’ailleurs inspirés de ces légendes pour amuser les foules ou exploiter la crédulité publique. De même que les religions, la magie tend à disparaître devant les progrès de la science et la généralisation de l’enseignement. Cependant, il semble que, dans les traditions que la magie nous a léguées, il ne soit pas que rêveries absurdes et superstitions grossières. Sous les noms d’hypnotisme, suggestion, auto-suggestion, télépathie, etc..., la science expérimentale a étudié et soumis à son contrôle diverses catégories de faits étranges qui, jadis, faisaient partie du domaine du merveilleux. De même que l’alchimie, pleine d’obscurités et de formules effarantes, a donné naissance à la chimie, les antiques pratiques des mages paraissent sur le point de nous doter, à défaut de pouvoirs surnaturels, de connaissances physio-psychologiques très précieuses, et de méthodes thérapeutiques non négligeables.
Par extension, le mot magie est employé comme synonyme de charme ou de séduction. On dit, par exemple : la magie du style pour indiquer la puissance d’évocation d’une bonne littérature ; on dit aussi : la magie de l’éloquence, pour désigner le pouvoir de suggestion que l’éloquence exerce fréquemment sur les foules, et qui les dispose à des actes qu’elles n’auraient jamais accomplis d’elles-mêmes sans cette circonstance. C’est une manière de sortilège dont l’homme raisonnable et averti se défie particulièrement. L’art de la parole est digne d’estime à maints égards, et il acquiert dans la propagande des idées une importance considérable. Il n’en est que plus dangereux lorsqu’il est mis au service du sophisme ou de l’erreur. Nul n’est plus que lui, en effet, apte à farder agréablement la vérité, ou nous lancer à la poursuite de mirages. Méfions-nous donc des enthousiasmes irréfléchis, des effets de tribune qui s’adressent plus à notre sensibilité nerveuse qu’à notre conscience. Avant d’accepter comme justes, définitivement, les thèses révélées dans le feu des tournois oratoires, ayons cette sagesse de les passer au crible de la critique, dans cette atmosphère de paix et de clarté qui se dégage de la solitude et du silence.
‒ Jean MARESTAN.
À CONSULTER :
Apologie pour les grands personnages accusés de magie (G. Naudé, 1625) ; De la magie transcendante (M. Brecher, 1850) ; La magie et l’astrologie dans l’antiquité et au moyen-âge (Alfred Maury, 1860), ce dernier ouvrage particulièrement sérieux et instructif ; etc.
MAGISTRAL(E, AUX)
adj.
Pédant. Qui convient au maître (magister) ; qui tient du maître : allocution prononcée d’un ton magistral. Autorité magistrale. Sévérité magistrale. Air solennel, important : Les petits esprits affectent volontiers la dignité magistrale.
Dessin, style magistral : qui a de l’ampleur, qui rappelle la manière des maîtres.
Prébende magistrale : dans certaines églises cathédrales, on donnait ce nom à la prébende qui, dans d’autres, s’appelait : préceptoriale.
Dans l’ordre de Malte : Commanderies magistrales, celles qui étaient annexées à la dignité de grand-maître.
En géométrie : ligne magistrale ; la ligne principale d’un plan, tracée par l’ingénieur.
En fortifications : magistrale, crête extérieure d’un mur d’escarpe.
Médecine et pharmacie : médicament magistral, que l’on prépare seulement au moment de l’emploi, selon la formule du Codex ou que donne le médecin ; contrairement aux médicaments officinaux qui, pouvant se conserver, sont préparés à l’avance.
S. M. (T. de métallurgie) : le magistral est un mélange de sulfate de fer et de cuivre employé avec le mercure comme agent amalgamation de certains minerais d’argent.
MAGISTRAT, MAGISTRATURE
n. m. et f. (latin magistratus, de magister, maître)
Ce terme de magistrature eut d’abord un sens étendu. Il s’appliquait, à Rome, à toute fonction revêtue d’une parcelle de l’autorité publique (potestas). Quand s’y ajoutait ‒ comme pour les consuls ‒ l’imperium (haut commandement militaire), la magistrature atteignait son degré suprême. Il y eut ensuite des magistratures ordinaires (celles des questeurs, des tribuns, des édiles, etc.). D’aucunes furent, à certains moments, électives. On vit aussi des magistratures extraordinaires (dictature, décemvirat). Les magistratures furent patriciennes (majores ou minores) ou plébéiennes, etc. Dans le droit romain, et dans un sens restreint, le terme de magistrat s’opposait à juge. Le premier avait ainsi la prérogative de la première phase de l’instance judiciaire. Il délivrait aussi la formule. Ses attributions variaient d’ailleurs avec le système de procédure...
En France, malgré l’expression conservée de « premier magistrat de la République » (le Président) ou de la commune (le maire), et d’un certain nombre d’autres de ce genre, le magistrat est surtout l’officier, le fonctionnaire revêtu d’un pouvoir judiciaire ; et la magistrature : la dignité, la fonction (et la durée de cette fonction) de magistrat, comme aussi l’ensemble des personnes attachées au fonctionnement de l’appareil judiciaire. La magistrature actuelle, dont la réorganisation date de 1810 (sous Napoléon), comporte deux branches : la magistrature assise (conseillers à la Cour de cassation, juges et présidents des Cours d’appel, juges et présidents des tribunaux civils) et la magistrature debout (le Parquet) qui comprend les procureurs généraux, les juges d’instruction, etc. La première est particulièrement honorifique et davantage soumise au choix, à la faveur, dans son recrutement et ses grades. Elle est réservée en quelque sorte à la bourgeoisie aisée et de vieilles familles nobiliaires ne dédaignent pas d’y installer leurs rejetons. L’autre, plus active, plus ouverte et d’un avancement plus rapide, est comparativement mieux rétribuée.
Certains établissent entre l’insuffisance actuelle, pour d’aucuns, des revenus de la charge et la corruption qui tend à gagner la maison de Thémis une relation de cause à effet. Cela nous paraît excessif et nous y verrions tout au plus un facteur d’aggravation. D’ailleurs, ne l’oublions pas, la rétribution relevée ne relèverait pas la fonction. Quelle que soit du reste la part du besoin dans des pénétrations qui accentuent un discrédit déjà ancien, ce corps, en apparence fermé et étranger aux secousses extérieures et regardé traditionnellement comme intègre, n’échappe ni aux petitesses de l’ambition, ni aux séductions de l’argent. La magistrature s’avère agitée, sous un vernis de distance et d’incorruptibilité, par les passions ambiantes et les remous de la politique...
Sous un autre angle, pressions du pouvoir et « persuasion » de la richesse, manœuvres toutes émanant du clan des maîtres et des favorisés du sort, viennent à point accentuer les tendances injustes et les préventions du juge que sa naissance prédispose à chercher le vice dans la pauvreté, la faute parmi les hommes déjà voués aux charges sociales. La magistrature, d’instinct ou par calcul, par une pudeur ou une prudence d’ailleurs immorale, couvre volontiers les forfaits de sa classe, tourne ses foudres vers « la lie populaire ». Particulièrement hostile ‒ par atavisme, par éducation, par toutes les attaches d’un milieu de tradition ‒ au changement et à l’innovation, elle ne peut manquer de se montrer à la fois incompréhensive et sévère à l’égard de ceux qui, souffrant, dans leurs fibres ou dans leur raison, des injustices qu’ils coudoient, se dressent pour les réparer et s’efforcent de remonter à la source pour en prévenir le retour...
« Nul n’ignore, dit M. Georges Guy-Grand, qu’il y a chez les magistrats de carrière, de naissance et d’éducation bourgeoise, et héritiers des légistes de l’ancien régime, un esprit conservateur qui est en raison directe de leurs appointements, et que Tocqueville connaissait bien. Un magistrat inamovible, ou qui touche comme en Angleterre, 125.000 francs par an d’appointements, sera, certes, impartial vis-à-vis du pouvoir ; le sera-t-il vis-il-vis d’un « énergumène » qui voudrait transformer le régime économique qui lui assure une si belle situation ? »
La magistrature, comme la « justice » qu’elle départit, est conservatrice et contre-révolutionnaire par essence et par destination et les sentences inflexibles s’abattent, avec une cruauté rituelle, sur la misère pitoyable comme sur l’audace sensible et généreuse. Elle appelle impartialité le soutien du passé et le service des forts : elle opte pour le parti du Prince et pour les biens éloquents. Et elle n’a en rien cessé, n’en déplaise à M. Poincaré, d’être « doctrinaire, formaliste et réfractaire aux idées nouvelles ». Il ne faut pas se leurrer d’ailleurs. Comme le remarque M. G. Guy-Grand, « faire appel à « l’impartialité » des hauts magistrats et des hauts administrateurs, c’est toujours prendre dans quelque mesure un esprit de classe pour arbitre d’un autre esprit de classe : ne soyons pas trop surpris si de temps à autre des plébéiens résolus refusent de s’incliner devant les verdicts de personnalités ou de collectivités étrangères à leur genre de vie, qui, par tradition et par position, sont nécessairement conservatrices, et dont les arrêts ne peuvent signifier qu’une transaction passagère entre les forces qui continueront de s’opposer jusqu’à ce qu’elles arrivent ‒ si elles y arrivent jamais ‒ à la fusion définitive... N’y a-t-il que de la « démagogie » dans les récriminations qui flétrissent les « services » d’une magistrature de classe ? »
Il suffît de voir les poursuites engagées ‒ au mépris même d’une légalité pourtant favorable au régime ‒ contre les contempteurs de « l’ordre » établi, les opinions, jusqu’aux tendances (exactes ou prêtées) mises en cause en dehors même d’un commencement d’exécution, les sympathies déjà regardées comme un délit. Il suffit d’observer ces multiples procès de l’après-guerre, intentés, à tout propos et hors de toute garantie, aux anarchistes et aux révolutionnaires, aux bolchevistes en particulier (danger prochain et pour cela terreur des tenants actuels). Il suffit du spectacle des « complots » imaginaires montés par les ministres, de connivence avec une police à tout faire, et dont les magistrats, sachant leur qualité, se servent sans vergogne contre les accusés. Il suffit de savoir comment sont faites les recherches, de relever I’unilatéralisme des enquêtes, la complaisance des instructions aux conclusions fixées d’avance, de connaître le « scrupule » qui préside à la fabrication des dossiers... Il suffit de noter l’état fait des aveux arrachés par des procédés scandaleux, l’arbitraire des détentions préventives, l’atmosphère des audiences de bataille où les débats sont conduits avec une partiale agressivité, la défense contrariée par des manœuvres qu’on ne prend même plus la peine de masquer, la lumière systématiquement étouffée, les condamnations enlevées au pas de charge et soulignées comme un triomphe. Il suffit de constater l’attitude et la stratégie des robins modernes pour être pénétré jusqu’à l’évidence qu’on se trouve en présence d’une magistrature de combat et d’une « justice » de barricade...
* * *
Que demande-t-on au magistrat ? Un bagage léger de science juridique, une licence en droit dont on sait qu’elle est ouverte aux médiocrités intellectuelles que la bourgeoisie veut cependant caser « aux honneurs ». Après deux années d’un stage plus nominal qu’effectif à quelque barreau, on estime assez au point des capacités, et son expérience assez sûre pour le charger du soin de décider de la liberté des vagues espèces justiciables... À peine dégagée de ses fredaines libertines (au préjudice des filles du peuple), qui, pour les fils de famille, remplacent d’ordinaire le travail au quartier latin, nantie d’une culture aussi superficielle, et cependant admise au bénéfice d’une sorte de pouvoir discrétionnaire, cette jeunesse va-t-elle apporter dans ses œuvres, à défaut d’un savoir efficient, un sens droit des réalités, un regard clairement ouvert sur la vie, une conscience avertie des contingences, un scrupule toujours en éveil devant de poignantes responsabilités ? Elle y arrive grisée de succès facile et d’orgueilleuse suffisance, toute pénétrée de supériorité aristocratique ‒ vertu de remplacement ! ‒ attentive aux avantages et au prestige de la fonction, indifférente à ses charges. Elle entre dans le métier judiciaire avec cette conviction tranquille que, parmi l’humanité de « par delà la barre » sont les jetons qu’il s’agit de pousser, d’un geste adroit, sur l’échiquier de la carrière. Pour gravir allègrement les échelons de la hiérarchie, elle fera jouer d’autre part ses protecteurs influents, les puissantes recommandations, attirera, par ses complaisances, ‒ euphémisme ici de servilité ‒ les remerciements intéressés du garde des sceaux, dispensateur souverain de l’avancement. L’inamovibilité ‒ que poursuivaient déjà les Montesquieu, les Condillac ‒ garantie minimum contre la fantaisie des pouvoirs successifs, n’a pu suffire à tenir la magistrature dans l’intégrité et juger n’est un sacerdoce que par exception et mystique provisoire. Car la jettent en avant tous les appétits positifs de grade, de gloire et d’argent que dispense, au mieux soutenu ou au plus empressé, une autorité avide de services.
Nous avons, à propos de la justice (voir d’ailleurs ce mot, et juges, et plus loin tribunal, et toutes les études gravitant autour de ce vaste sujet) souligné l’archaïsme des considérants, l’anachronisme des personnages et du cadre, la vétusté d’un appareil en accord avec notre civilisation « comme le seraient, dit Gourmont dans ses Épilogues, le Deutéronome ou les Établissements de Saint-Louis »... Qui s’attend à voir les audiences imprégnées de quelque haut souci de moralité ‒ caduque souvent et plus d’une fois injuste, mais susceptible de sincérité ‒ en percevra à peine la façade. Il sera déconcerté par le prosaïsme des séances distributives. Il entendra le juge invoquer, administrativement, ses tarifs, ravalant ses arrêts à un barème d’épicier. Il le verra tenir conciliabule, le nez dans le rabat d’un collègue, de mille sujets étrangers à l’affaire et revenir à celle-ci, comme par une série de désagréables réveils, distrait et agacé. Il l’entendra, tourné vers le malheureux qu’on lui livre à merci, hochet soumis à la mécanique omnipotente de ses enchaînements argutieux, tour à tour grincer, mordre et railler, jongler, ânonnant ses articles, comme un prêtre ses répons, avec la pauvre proie pantelante sous sa griffe...
De cet aveu, inconscient et banal, du mépris dans lequel elle tient la justice, la corporation des jugeurs professionnels donne un spectacle singulièrement édifiant. Cette désinvolture avec laquelle elle effleure les problèmes, si souvent tragiques, proposés à son examen, son éloignement souriant et cynique, la profusion des facteurs extra-juridiques qui déterminent ses jugements, l’octroi machinal de peines parfois terribles, la rigueur, tantôt froide et comme absente, tantôt vindicative, de ses verdicts, Arthur Bernède, dans sa pièce Nos Magistrats, Brieux, dans la Robe rouge, Anatole France, avec Crainquebille, et les Mirbeau, les Courteline, les Tolstoï... nous en ont donné des satires âpres et spirituelles, des tableaux aigus et décisifs...
Dans son Étienne Dolet, Aug. Dide a montré de quelle façon les conseillers de la grand’chambre, au XVIème siècle, traitaient un accusé, « abominable non seulement parce qu’on le soupçonnait d’hérésie, mais parce qu’étant imprimeur et homme de lettres passionnément épris de littératures païennes, il incarnait des états odieux » à ses juges très dévots. Il dépeint le malheureux succombant « victime des passions religieuses et aussi des haines accumulées, de l’esprit du temps, de la rudesse des mœurs exprimées dans les lois, des préjugés et de l’étroitesse de cœur de ceux qui allaient arbitrer de son sort ». À des siècles de distance, ne retrouve-t-on pas, tout près de nous, dans les « cours spéciales » du fascisme, jugeant a priori et au mépris des faits, dédaigneuses, à plus forte raison, des mobiles et du lieu, la même vindicte insolente et cruelle ? Qui a suivi d’ailleurs, dans nos démocraties férues de formules prometteuses, arguant de jurisprudence libérale, devant les tribunaux d’avant ou d’après-guerre, quelques-uns de ces procès typiques ‒ que nous évoquions tout à l’heure ‒ intentés aux subversifs du temps, retrouve cette même volonté, hautaine ou voilée, de culpabilité nécessaire et ce mépris évident de l’équité...
Si l’inamovibilité d’origine met à la fonction comme un prestige d’investiture, si la transmissibilité de fait continue à accuser, autour des toques, un grotesque halo divin, l’infaillibilité qu’il s’arroge par tradition achève de faire du magistrat un danger public. Pourralt-il, par l’aveu (trop humain), qu’il s’est fourvoyé, entacher le pur renom qui nimbe les oracles ? Un juge peut-il vraiment se tromper et le voyez-vous revenir, en simple, sur ses erreurs ? Quand on sait cependant la fragilité des témoignages apportés, leur malfaisance confuse ou voulue, les déformations (voire les inventions) qu’y introduisent l’inconscience et la vanité, quand on fait la part de la peur, des préjugés et de la vindicte, quand on connaît l’empire formidable de la suggestion et qu’on pénètre la psychologie des foules, quand on pèse l’illusoire véracité que nous emportons des événements déroulés sous nos yeux, l’impossibilité, au fond, de projeter assez de clartés sur les éléments d’une affaire pour affirmer qu’on en possède tous les secrets, on est stupéfait de l’outrecuidance de ceux qui prononcent, avec tant de légèreté, sur le crime de leurs contemporains ! Mais ne sont-ils pas là pour juger ? Voulez-vous donc qu’ils renoncent au mouvement qui prouve leur nécessité ? Voulez-vous qu’ils proclament inutile ‒ ou nocive ! ‒ la carrière que décora toute une généalogie et qu’ils ont aussi la conviction d’illustrer ? Faire aveu public d’impuissance et de superfluité ? Ils s’en garderaient bien, même si quelque sagacité inattendue les avait amenés à cette constatation...
D’ailleurs, « ceux qui veulent que les arrêts des tribunaux soient fondés sur la recherche méthodique des faits sont de dangereux sophistes et des ennemis perfides de la justice civile et de la justice militaire ». La magistrature « a l’esprit trop juridique pour faire dépendre ses sentences de la raison et de la science dont les conclusions sont sujettes à d’éternelles disputes. Elle les fonde sur des dogmes et les assied sur la tradition, en sorte que ses jugements égalent en autorité les commandements de l’Église. Ses sentences sont canoniques. J’entends qu’elle les tire d’un certain nombre de sacrés canons. Voyez, par exemple, qu’elle classe les témoignages non d’après les caractères incertains et trompeurs de la vraisemblance et de l’humaine vérité, mais d’après des caractères intrinsèques, permanents et manifestes. Elle les pèse au poids des armes. Y a-t-il rien de plus simple et de plus sage à la fois ? Elle tient pour irréfutable le témoignage d’un gardien de la paix, abstraction faite de son humanité et conçu métaphysiquement en tant que numéro matricule et selon les catégories de la police idéale... Quand l’homme qui témoigne est armé d’un sabre, c’est le sabre qu’il faut entendre et non l’homme. L’homme est méprisable et peut avoir tort. Le sabre ne l’est point et il a toujours raison. » La magistrature « a profondément pénétré l’esprit des lois. La société repose sur la force et l’a force doit être respectée comme le fondement auguste des sociétés. La justice est l’administration de la force... Si je jugeais contre la force, s’écrie le président Bourriche, mes jugements ne seraient pas exécutés. Remarquez, Messieurs, que les juges ne sont obéis qu’autant qu’ils ont la force avec eux. Sans les gendarmes, le juge ne serait qu’un pauvre rêveur. Je me nuirais si je donnais tort à un gendarme. D’ailleurs le génie des lois s’y oppose... L’agent 64 est une parcelle du Prince. Le Prince réside dans chacun de ses officiers. Ruiner l’autorisé de l’agent 64, c’est affaiblir l’État... Désarmer les forts et armer les faibles, ce serait changer l’ordre social que j’ai mission de conserver. La justice est la sanction des injustices établies. La vit-on jamais opposée aux conquérants et contraire aux usurpateurs ? Quand s’élève un pouvoir illégitime, elle n’a qu’à le reconnaître pour le rendre légitime. Tout est dans la forme, et il n’y a entre le crime et l’innocence que l’épaisseur d’une feuille de papier timbré ». (Anatole France)...
C’était à Crainquebille, évidemment, à « être le plus fort ». Proclamé « empereur, dictateur, président de la République », le président Bourriche n’eut plus retrouvé le coupable qu’il tenait dans ce délinquant minable et malchanceux... Quelle est, au reste, la tâche d’un magistrat qui sait ce qu’il doit à la société.
« Il en défend les principes avec ordre et régularité. La justice est sociale. Il n’y a que de mauvais esprits pour la vouloir humaine et sensible. On l’administre avec des règles fixes et non avec les frissons de la chair et les clartés de l’intelligence. Surtout, ne lui demandez pas d’être juste ; elle n’a pas besoin de l’être puisqu’elle est la justice, et je vous dirai même que l’idée d’une justice juste n’a pu germer que dans la tête d’un anarchiste. » (A. France)
La magistrature est l’instrument d’un organisme de consolidation. Elle n’a pas besoin d’entrailles pour argumenter la « raison » des suprématies. Quelques propos conformistes et deux argousins lui suffisent.
* * *
Honnis de tous les âges, les « instruments séculaires des intrigues du pouvoir, de toutes les férocités tournées contre les vaincus, les affamés, les opprimés, les révoltés » ont été cloués au pilori par nos meilleurs écrivains. Les traits acérés et les coups de boutoir des Rabelais, des Pascal, des La Fontaine, des La Bruyère, des Voltaire, des Diderot, des Beaumarchais et des Paul-Louis Courrier, pour retenir, ici, quelques penseurs classiques, ont fait à l’hermine légendaire des déchirures inoubliables, revanche provisoire qu’emporte l’esprit en marche vers la justice. Écoutez Grippeminaud lui-même s’exaltant en ce discours à Panurge, étalant sa haine tournée vers la faiblesse : « Or ça, nos lois sont comme toiles d’araignée, les simples moucherons et petits papillons y sont pris, les gros taons malfaisants les rompent et passent à travers. Semblablement, nous ne cherchons les gros larrons, ils sont de trop dure digestion... » Elle n’a pas beaucoup changé, dites-moi, la magistrature, depuis Rabelais. Et il vaut mieux, si l’on tient aux égards et à la liberté, s’approcher d’elle sous les traits de Rochette ou de M. Klotz qu’en gueux vagabondant ou en voleur bénin... Montaigne, lui, s’étonne d’avoir vu tant de « condamnations plus criminelles que le crime ». Pascal estime juge et justice « piperie bonne à duper le monde ». La Bruyère, plus timide, déclare pourtant qu’ « il est bien hardi à un honnête homme de se dire à l’abri d’une condamnation pour vol ou meurtre » et il se permet de douter de l’incorruptibilité des magistrats. On a cité déjà, dans cet ouvrage, distiques et quatrains vengeurs du Bonhomme contre les Perrin-grugeurs et les « jugements de cour ». Le défenseur de Callas, précurseur d’un Zola en mouvements hardis pour l’innocence, regarde avec des yeux d’horreur « ces privilégiés, artisans du malheur, qui achètent comme une métairie le pouvoir de faire du bien et du mal »... Dans ses Mémoires à consulter, c’est non seulement leur honnêteté prise en défaut et déchirée, « leurs préventions, leurs mensonges, leurs pièges, leurs traquenards, leur barbarie » dénoncés, mais aussi leur défaut d’intégrité que dévoile Beaumarchais. Apparaissent avec lui, dans leur corruption, « juges subornés, juges prévaricateurs ». Et Le Sage les porte au théâtre, et le public souligne les railleries de Crispin, dit la chronique, d’applaudissements « indécents »...
Après ces artistes, maîtres de la satire et de l’épigramme ; que la contrainte du siècle et de royales susceptibilités obligent aux pointes protégées et au sarcasme, aux âpres allusions, aux colères concentrées, voici les attaques de front des tribuns de la Révolution, des Danton, des Marat « contre ceux qui font état de juger ». Trompeurs du peuple, comme les prêtres, voici les magistrats les égaux des charlatans, et traités comme eux. Mais comme la religion, enracinée dans la faiblesse de l’esprit, la magistrature, qui a ses racines dans la passivité, résiste à la tempête qui vient de balayer, pour un temps, la royauté... Et les romantiques retrouvent ces fossiles, enchâssés dans leurs formes et traînant leurs simarres et leurs robes rouges à travers les sociétés bouleversées. En dépit de la Charte, Benjamin Constant, le général Foy dénoncent les magistrats « persécuteurs des faibles, créant des délits factices, se faisant les instruments fanatiques du pouvoir », servant les factions, suivant la fortune des ministères. Et ils montrent ‒ nos contemporains peuvent reprendre leurs dénonciations adopter leurs termes : la confrérie a peu varié ‒ ces « juges vendus aux gouvernements par l’ambition par l’intérêt et qui ont licence de perquisitionner, d’arrêter d’emprisonner, d’accuser, de calomnier, de condamner à tort et à travers... sans qu’il soit permis de former contre eux aucun recours ». Après juillet face aux barricades triomphantes, le Roi bourgeois promet leur sacrifice. Papeline, insinuante, faisant la chattemitte, la magistrature circonvient ses victimes d’hier et le Palais prodigue aux nouveaux maîtres ses bons offices : « services aux ministres, services aux riches, services à toutes les puissances en mesure de le gagner ou de l’intimider... » Les systèmes politiques s’échelonnent : monarchies constitutionnelles, pâles Républiques, Empires restaurés, ploutocraties parlementaires, et les robins adaptés résistent aux assauts obstinés du peuple, toujours secouru par les libres esprits...
Cependant l’auréole est tombée. Qui respecte encore cette noblesse agrippée aux vices des régimes ? On n’a plus de considération pour sa personne, on redoute seulement ses arrêts. « On ne croit plus à sa pureté ; elle peut effrayer encore par le déploiement de son attirail, elle ne peut plus en imposer ». La judicature n’est plus qu’une force dangereuse dont on surveille la puissance, vivace et toujours terrible... Magistrats de droit divin ! Séides armés du Code romain ! Leur vêture sacramentelle n’est plus qu’un accoutrement ridicule qui souligne leur discrédit et leur jargon accuse leur caducité !
* * *
Mais si les magistrats s’attachent au pouvoir et si ce dernier, malgré ses visages successifs, se sert d’eux avec insistance, c’est que chacun trouve dans l’autre un appui nécessaire. Solidaires dans leur intérêt, ‒ fait de jouissance et de règne ‒ ils dressent un commun obstacle devant les attaques, d’ailleurs incohérentes, du peuple, devant celles des philosophes et des gens de cœurs qui réclament leur dispersion... Plus de juges ! Nos maîtres se garderaient bien de se découvrir avec tant d’imprudence ! Entendez le Capital soutenir, contre cette menace, l’institution :
« Et les traditions de servitude auxquelles se plie si douloureusement l’innombrable foule des humbles, qui les maintiendra ? Et la société, dont je suis la charpente vitale, qui la défendra ? Les possédants, qui les protégera ? Les appétits, qui les réfrènera ? Les désordres publics, les séditions populaires, qui les réprimera ? Le vol, la violence, l’homicide, qui les châtiera ?... Plus de juges ! Qui donc appliquera les lois ?... » (Henri Leyret)
La riposte est logique et nous l’attendions. Elle est spontanée, jailli de l’instinct de conservation. Sans la magistrature, fille de la « Justice » et des lois, qui défendra le Privilège ? On connaît notre réponse :
« Mettre bas la forteresse du capital est notre espérance avouée ; pourrions-nous être émus de la voir démantelée ? Nous attaquons bastions et remparts, au contraire, nous nous efforçons d’en ruiner la mystique et les armes, et tout ce qui prépare ou présage la chute nous réjouit. »
Mais il n’y a pas que ce refus intéressé, prévu, qu’on nous oppose. Il n’y a pas que le capital, arcbouté sur ses positions, qui résiste à nos congédiements. D’autres reprennent ses cris éplorés. Car cette appréhension, ce désarroi est en même temps « l’argument dicté par la vie et ses petitesses. Il paraît irréfutable à tant de pauvres créatures qui frissonneraient de peur, jour et nuit, si elles ne se sentaient entourées de gendarmes terriblement équipés, de cachots solidement verrouillés. En vérité, il traduit à merveille le gros bons sens des masses, l’égoïsme cruel des individus, la crainte affolante qui arme chacun de nous contre son semblable. Le tien, le mien... Vite qu’un arbitre nous départage (et nous gruge !) qu’entre les deux il prononce souverainement ! » (Henry Leyret). C’est la voix du sens grossier d’appropriation, d’exemple si lointain, de légitimation séculaire ; de l’étroit désir, au calcul erroné, de thésaurisation personnelle ; de l’égoïsme, au devenir faussé par l’immobilisation propriétaire, qui cherche la jouissance dans une possession dénaturée ; c’est la voix de tout ce qui empêche l’humanité d’apercevoir en grand son intérêt, sa sécurité et sa voie...
On veut bien mépriser la magistrature et tenir pour malfaisantes ses interventions, pour iniques ses arrêts, mais on se tourne vers elle avec insistance comme vers une plaie nécessaire et l’on feint de la tolérer comme un moindre mal. Que disent à son endroit les programmes socialistes ? Que promettent ceux qui prétendent à faire, demain, le bonheur du peuple ? Ils vont l’amender, la réglementer, l’épurer ; ils brûleront du soufre dans la maison, retailleront les lois, changeront les hommes... puis ils y ramèneront l’encens, ils habilleront de rouge les nouveaux chats-fourrés ‒ ou les anciens déjà convertis ‒ et nous reprendrons le chemin des anciennes prisons, mais au rythme, cette fois, d’ironiques Carmagnoles...
Donner congé aux juges, faire table rase de l’institution ? Combien qui dénoncent leurs méfaits avec véhémence et qui chancellent devant le vide que ferait leur disparition ! Ne parlons pas des États ; malgré leurs protestations hypocrites, ils en ont besoin. Mais la foule des hommes elle-même tremble d’aspirer à cette délivrance. Elle a trop longtemps vécu sous l’obéissance et le fardeau : le bât des charges passées, les chaînes à sa tête et à son corps lui semblent nécessaires à sa vie ; elle a peur de la liberté, comme si, ses entraves dispersées, allaient l’assaillir de traîtres dangers. L’inconnu surtout l’effraie. Et non seulement, habituée qu’elle est à cheminer sous le joug, il lui semble qu’elle ne pourrait aller ainsi, avec ses épaules dégagées, mais, si durs et innombrables, elle a, pour ses malheurs présents, identifiés au moins vaguement, une sorte d’attachement de connaissance :
« Même cruelles, disent les individus gémissants, nous avions nos habitudes. Hors de nos maux familiers quels risques allons-nous rencontrer ? À l’imprévu que vous offrez et qui tient, dites-vous, notre libération, nous préférons nos tourments actuels, rassurants pour leur certitude... »
Ainsi les hommes regardent-ils toute originalité comme une calamité. Et les États qui se retiennent au passé, comme ceux qui le réinstallent dans l’ordre nouveau, trouvent un assentiment quasi unanime à cette conservation.
« Intimement attachés au modus vivendi pratiqué par les générations antérieures, il apparaîtrait à tant d’individus comme une audace révoltante d’entamer cet héritage. » (H. Leyret)
L’esprit d’innovation, quel hôte indésiré quand il se mêle de façonner des réalités ! Les vieilles prescriptions, les contrats lointains et prohibitifs n’ont-ils pas creusé l’existence de dépressions qu’ils épousent ? L’être n’a-t-il pas pris l’habitude de marcher avec leur poussée sur ses jours ? Si elles cessent de le malaxer, de diriger ses membres et de dominer sa pensée, si elles n’agissent plus sur lui, où retrouvera-t-il son équilibre ?...
« Pour neuves et larges qu’apparaissent nos conceptions, une chose les rapetisse toujours : la prédominance des conventions sociales, le fétichisme, avoué ou secret, de la loi. » (H. Leyret)
Et la loi, et le juge, ainsi, gouvernent, invincibles. Comme dit M. Pierre Mille :
« Ne faut-il pas que notre esprit, que notre conviction persistent à croire à la Loi et au Juge. Sinon, il n’y a plus de paix à l’intérieur des sociétés, il n’y a plus de sociétés ! »
Si le bourgeois lettré regarde leur fin comme un effondrement et se retient à leur croyance, comme à une fatalité, à quoi se raccrochera le troupeau des hommes désemparé :
« Nos magistrats porteurs d’étrivières, nos meurtrissures aimées, nos lois inextricables, nous voulons nos chaînes ! » criera-t-il...
Diderot a beau établir, « en sa logique pressante, la prééminence originelle de la raison individuelle sur la raison publique, de la décision de « l’homme » sur celle de l’homme de loi ; ‒ « Est-ce que l’homme n’est pas antérieur à l’homme de loi ? Est-ce que la raison de l’espèce humaine n’est pas tout autrement sacrée que la raison d’un législateur ? Nous nous appelons civilisés et nous sommes pires que des sauvages. Il semble qu’il nous faille encore tournoyer, pendant des siècles, d’extravagances en extravagances et d’erreurs en erreurs, pour arriver où la première étincelle de jugement, l’instinct seul, nous eût menés tout droit. » (Henri Leyret).
La loi se dresse sur les ruines de nos meilleurs instincts dont elle a paralysé l’évolution. Elle a forgé, devant la maxime éternelle des sages, née du contrôle de l’égoïsme le plus pur : « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fit », et son corollaire positif : « fais aux autres ce que tu aimerais qu’on te fît ! », le réseau protecteur des premiers rapts propriétaires, la garantie de la faveur. Sur les ruines de l’harmonie naturelle, elle a échafaudé les conventions de la morale, habile, du bandit. Elle a légitimé le vol fait aux humains par les premiers oppresseurs. Et c’est autour du mensonge qui « justifia » le crime que se serrent aujourd’hui peureusement les hommes !
Quand nous disons que la « justice » (il s’agit ici, encore une fois, de l’appareil et des codifications qui usurpent ce nom, et non de l’esprit et des mœurs de l’équité) a sa source, sa causalité dans la propriété et que dès qu’elle apparaît, aux côtés de l’autorité, la tyrannie commence, nous entendons qu’elle a eu pour objet initial la légitimation de la mainmise de quelques individus avides ou faussement et exagérément prévoyants, au préjudice de ce patrimoine qui fut primitivement le bien de tous les hommes et n’eut jamais du être divisé. C’est pour maintenir cette division, profitable aux minorités ambitieuses ou princières, pour consacrer la prise de possession individuelle et unilatérale, pour en affirmer le droit permanent et le défendre, pour le consolider et l’étendre que lois, codes, système judiciaire se sont emparés de la liberté du monde. Enchâssant le privilège dans une armature de sauvegarde et d’exaltation, ils sont devenus les fondements d’une société dévoyée, de « l’ordre » artificiel issu d’une spoliation primitive.
Quoi, si l’on interroge les codes, les hommes auraient, ébranlé d’eux-mêmes « une société plus infernale que l’enfer des prêtres ? Ils ne se seraient associés que pour se voler, s’entre-tuer ? Suspects à eux-mêmes, ils se seraient jugés incapables d’aller dans la vie autrement qu’au milieu d’un cortège de chaînes et de châtiments ? Se condamnant au rôle d’automates, entassant lois sur lois, ils n’auraient imaginé ce prodigieux ensemble de prohibitions dégradantes que pour mieux limiter leur action, entraver leurs facultés, et cela librement, d’un commun accord, de gaieté de cœur ?... Supposer que les hommes auraient été assez absurdes pour s’appliquer à se diminuer sous peine de supplices divers, quelle injure ! Et ces chaînes qu’ils traînent leur vie durant, ils les auraient forgées par amour de la « justice », unanimes à abdiquer leurs droits naturels ?... Non, la loi n’a pas une origine si simple ou si extraordinaire. Elle fut l’œuvre diabolique d’une minorité. Les premiers oppresseurs l’inventèrent pour légitimer leurs attentats contre l’égalité humaine. Le droit de punir n’est sorti que du désir d’acquérir, de conserver, de dominer. Ce n’est pas l’oisiveté qui est la mère de tous les vices, c’est la propriété. Du jour-où il y eut des possédants et des non-possédants, l’harmonie naturelle se trouvant rompue à jamais, notre espèce connut tous les tourments avant-coureurs des actes qui, depuis, sont appelés crimes. Le droit eut pour mission de brider les pauvres en divinisant les riches. La loi fut la charte de la servitude. » (Henry Leyret)...
La longue pesée des temps, l’habileté des bénéficiaires ont fait oublier la fourberie à la base. L’erreur codifiée a pris figure de vérité, de condition normale. Une morale est venue à point l’idéaliser. À telle enseigne que c’est l’état naturel de la propriété, c’est-à-dire sa mise égale à la disposition de tous, (état jadis étouffé ou détruit), qui apparaît aujourd’hui comme une revendication injuste ou utopique. Et que l’institution de la magistrature se présente comme « tellement de l’essence de l’ordre social » ‒ ce désordre anti-humain que nous dénonçons ‒ « que sans elle, nous dit-on, cet ordre ne peut subsister »... Et il est vrai, en effet, que cet échafaudage, hors un recours divin périmé, ne s’agglomère que par le ciment conventionnel de la légalité et l’artifice vigilant du Code. Et que la magistrature, Cerbère préposé à sa garde, en prévient, par ses ripostes empressées, la dislocation... Mais, d’autre part, hors le maintien de la propriété de vol, « justice » et magistrats n’ont plus de raison d’être. Que viendraient faire et les juges et la loi autour d’une propriété dont ne serait, à personne, interdit l’accès et sur laquelle les hommes, éclairés enfin sur la valeur de leur bien et décidés à ne plus le laisser aliéner entre des mains particulières, étendraient leur collective protection ?...
‒ Stephen MAC SAY
MAGNANIMITÉ
n. f. (du latin magnanimus, magnanime)
Le terme magnanimité a quelque chose d’imprécis, la grandeur d’âme pouvant revêtir bien des formes et bien des aspects. Disons qu’il suppose non seulement retenue, détachement, mais élan positif de l’être, déploiement d’une activité qui se porte au devant d’autrui ; l’homme magnanime est tout ensemble désintéressé et généreux. À la possibilité d’une si haute vertu, La Rochefoucauld ne croyait guère, lui qui place dans « l’amour de soi » le mobile essentiel des actes humains, soutenant que « toutes nos vertus vont se perdre dans l’intérêt, comme les fleuves dans la mer ». Et l’on connaît ces maximes fameuses où il dissout en vices secrets nos plus belles qualités :
« La pitié est une habile prévoyance des maux où nous pouvons tomber. »
« La générosité n’est qu’une ambition déguisée qui méprise de petits intérêts pour aller à de plus grands. »
« L’amitié la plus désintéressée n’est qu’un commerce où notre amour-propre se propose toujours quelque chose à gagner. »
« La bonté n’est que de la paresse ou de l’impuissance, ou bien nous prêtons à usure sous prétexte de donner. »
« D’une manière générale toutes nos vertus ne sont qu’un art de paraître honnêtes... à une grande vanité près, les héros sont faits comme les autres hommes. »
Malgré les cris indignés des moralistes officiels, La Rochefoucauld a bien décrit les sentiments qui animaient les grands de son époque, et de toutes les époques. L’erreur consiste à les prêter aux esprits élémentaires ; chez beaucoup le calcul de l’intérêt ne joue pas le rôle qu’on lui attribue ; pour arriver là il faut une puissance de réflexion assez considérable. Réaction personnelle, instincts, tendances souvent inavouables sont le motif fréquent de nos actions ; la psychanalyse permet de s’en rendre compte. Et de cet examen l’homme ne sort pas grandi ; La Rochefoucauld faisait de lui un habile calculateur, trop souvent il n’est qu’une brute cruelle et lubrique.
Selon Freud, la civilisation n’a modifié que l’apparence extérieure ; l’analyse de l’inconscient, chez l’individu cultivé, révèle l’existence de complexes, dont la grossièreté répugnante rappelle les temps primitifs : haines contre les autres, idées de vengeance, goûts sanguinaires, désirs de possession sexuelle surtout. L’instinct sexuel, voilà, pour le professeur viennois, l’animateur secret du dynamisme mental inconscient, disons mieux : l’inspirateur de toutes nos pensées, de tous nos sentiments, de toutes nos actions. De lui découleraient même les instincts vitaux, même l’instinct de conservation, instinct sexuel narcissique, dont l’objet serait l’individu lui-même. Mais un pouvoir psychique, la Censure, résultat de nos contraintes éducatives, sociales, morales, veille à l’entrée du conscient, refoulant les complexes en discordance avec nos goûts et nos pudeurs ou les déformant avec soin pour les rendre méconnaissables. Pourtant la blancheur apparente d’un cercueil ne peut faire oublier la noirceur du contenu ; ainsi doit-il en être concernant la mentalité humaine. Initiateur de génie, comme Gall, Freud a construit un édifice artificiel par bien des côtés ; il aura le mérite d’avoir exploré les régions sombres du moi.
Si une analyse profonde montre combien factices certains désintéressements, combien superficielles parfois nos vertus, elle montre aussi qu’à côté de l’égoïsme il y a place pour la générosité, dans le tréfonds du cœur humain. L’existence de sentiments désintéressés, qu’ils se rapportent à nos semblables ou à des objets supérieurs, vrai, beau, bien, ne paraît pas niable. Pendant plus d’un mois j’ai observé une chatte et son petit ; cette pauvre bête, vorace d’ordinaire, restait immobile près des aliments reçus ; elle attendait que son petit fût rassasié, se passant de nourriture s’il ne laissait rien. L’intensité de l’amour maternel, même dans des espèces inférieures, annélides, crustacés, mollusques, a frappé les naturalistes ; l’héroïsme qu’il suscite, chez ces animaux stupides, ne peut avoir sa source dans l’intelligence, mais dans l’instinct.
En dehors de tout attrait sexuel, certains singes s’exposent à la mort pour défendre leurs compagnons. Et, chez l’homme, ce sont des impulsions instantanées, irréfléchies, qui le poussent à sauver, au péril de sa propre vie, l’enfant qui se noie ou qu’un incendie va étouffer. Je crois peu au désintéressement de l’artiste, du savant, encore moins à celui de l’homme religieux ; quoiqu’on dise, les deux premiers travaillent fréquemment pour la gloire, le troisième pour se garder de l’enfer. Citons pourtant un cas où le désir, soit d’une place, soit de la renommée, n’était pour rien dans le besoin de connaître. Un Hongrois vécut trente ans à Paris, dans un réduit infect, se satisfaisant d’eau et de pommes de terre ; il étudiait vingt heures par jour et ne s’interrompait qu’un jour par semaine, afin de donner les leçons de mathématiques lui permettant de subvenir à ses maigres dépenses. Mentelli, c’était son nom, n’a pas laissé trace de ses immenses recherches. Si le sentiment religieux est foncièrement égoïste, s’il se rattache à l’instinct de conservation, au désir d’être en bons termes avec les êtres forts, par excellence, les dieux, il arrive à perdre ce caractère dans l’exaltation mystique, déviation probable des désirs sexuels où le croyant s’identifie avec l’objet de son adoration. Pendant l’extase, lorsque le corps a perdu toute sensibilité aux impressions du dehors, l’esprit croit ressentir les transports de la possession et de l’amour. Les confessions des grands mystiques, malgré la diversité du symbolisme et des métaphores, s’accordent sur ce point. Même si l’on néglige ces faits, qui confinent à la pathologie, il demeure que l’homme n’est pas totalement égoïste.
On peut s’en étonner de prime abord, car un abîme sépare les individus. L’entraide est réalisable dans les circonstances nées des conditions sociales, du milieu, de la profession ; dès qu’entrent en jeu les lois inéluctables de la vie, la nature nous repousse avec brutalité. Qu’une grande douleur éclate à côté de nous, bien vite nous sentirons notre impuissance. On présente les condoléances banales ; est-il aisé d’en sortir ? S’il s’agit d’une perte cruelle, croit-on guérir la plaie en égrenant la litanie des arguments lénitifs, donnés par les traités de philosophie ? Il tourne vite au personnage muet, le rôle de consolateur ; quelques larmes, un serrement de mains, voilà ce qu’on offre de mieux. Et, devant le lit d’agonie de la mère, de l’ami, qui se débattent sous l’étreinte de la mort, alors qu’on donnerait pour eux la totalité de sa vie, un mur se dresse infranchissable ; de vaines paroles, des sanglots inutiles, c’est tout ce que nous trouvons dans la détresse de notre cœur... Pourtant l’égoïsme absolu est contre nature ; il se rencontre seulement chez les hypocondriaques ou déments atteints d’insensibilité morale. Mais la sympathie pour autrui présente de multiples degrés qui, de la synergie ou tendance à l’imitation, s’élèvent jusqu’à l’amour et l’amitié, en passant par la synesthésie ou contagion des émotions, la pitié, la bienveillance, la bienfaisance, etc. Elle affecte aussi des formes diverses, inclinations corporatives, philanthropiques, humanitaires ; elle peut s’étendre aux animaux, aux plantes, au cosmos tout entier. Parce que notre être rejoint tous les autres dans l’être universel, parce que nous vivons de lui, nous aspirons à faire pénétrer dans notre personnalité transitoire et finie l’infini de l’éternel univers. Nous sommes frères de tous les hommes, frères des animaux, frères des plantes, frères des astres ; êtres et choses sont des formes passagères d’une même vie. Cette conception, familière depuis des millénaires aux penseurs d’Orient, ne fut inconnue de ceux d’Occident, ni dans l’antiquité ni dans les temps modernes. C’est une de ces doctrines éternelles dont l’inventeur n’est pas nommé et qui ne sauraient mourir, parce qu’à toute époque elles germent naturellement dans plusieurs cerveaux. Avec elle l’âme atteint à la magnanimité suprême puisqu’elle se hausse à la taille de la réalité prise dans sa totalité. Et elle justifie le sentiment d’universelle fraternité éprouvé par l’esprit qui, s’élevant au-dessus de l’espace et du temps, perçoit l’identité finale de tous, par-delà les oppositions transitoires des personnes.
Malheureusement la générosité, fausse ou vraie, a revêtu parfois des formes déplorables : parmi ces dernières citons l’aumône. Humiliante pour le pauvre qui la reçoit, elle flatte la superbe du riche qui la donne ; sans efficacité durable, elle trompe le peuple et permet au parasite repu d’afficher des allures charitables. Prêtres et moralistes la conseillent pour que l’injustice, créatrice de misère, puisse subsister ; quotidiennement l’on voit des requins du négoce, de la finance ou de l’industrie verser ostensiblement une obole aux malheureux que détrousse leur avidité. Et cette infâme comédie se place habituellement sous l’égide de la fraternité ; on arbore le mot en accomplissant le contraire de la chose. Pourtant la fraternité véritable est l’une des notions les plus révolutionnaires puisqu’elle implique égalité totale des droits et complète indépendance des individus. Donner les miettes de sa table n’a rien d’un geste fraternel ; ni riches, ni pauvres, ni maîtres, ni serviteurs : dans une maison de frères c’est pour tous que la table doit être servie. Mais les ministres de dieu et ceux du pouvoir ont grand soin d’entretenir une confusion dont profitent les riches, leurs protecteurs.
— L. BARBEDETTE.
MAGNÉTISME
n. m. rad. magnétique (lat. magneticus, de magnes, vient du grec magnes (aimant), comme magnésie et magnésium.)
A : PHYSIQUE
Le magnétisme est connu depuis la plus haute antiquité. Le nom lui-même prend son origine dans les pierres magnésiennes (ou de magnésie) ou magnèles, pierres d’aimants naturels ayant la propriété d’attirer le fer, que l’on trouvait dans la région de la cité thessalienne de Magnésie (ancienne Grèce). Le terme de magnétisme désigne aujourd’hui tous les phénomènes d’aimantation et d’induction.
Ces phénomènes, très complexes, sont assez mal connus dans leurs origines premières et dans leurs causes initiales bien que leurs effets aient été longuement étudiés et observés et que les hypothèses explicatives ne manquent point.
Les phénomènes d’aimantation sont démontrés par la propriété des aimants et par l’action de la terre sur une aiguille aimantée. Si on promène une de ces aiguilles sur une pierre d’aimant taillée en sphère, on constate que cette aiguille subit deux sortes d’orientations : l’une tendant à placer son axe longitudinal dans le sens des méridiens ou longitudes de cette sphère en dirigeant la pointe aimantée vers un point où paraissent converger tous les méridiens et que l’on appelle pôle Nord par rapport au point opposé appelé pôle Sud ; l’autre orientation tend à faire varier horizontalité de l’aiguille qui, parallèle à la surface de la sphère à l’équateur, s’incline de plus en plus en approchant des pôles et devient verticale sur les pôles même. Le magnétisme terrestre est très variable à la surface du globe ; cette variation est séculaire, annuelle et diurne et les diverses positions de l’aiguille aimantée s’écartant plus ou moins des méridiens géographiques (ou axes idéals tracés d’un pôle à l’autre) indiquent la déclinaison magnétique. Il en est de même pour les variations de horizontalité appelée inclinaison.
D’autre part, on constate qu’en approchant un aimant d’un autre aimant suspendu les pôles de même nom se repoussent et que les pôles contraires s’attirent. Comme la sphère terrestre se comporte vis-à-vis de l’aiguille aimantée de la même façon que la pierre d’aimant ; comme la force d’attraction exercée sur l’aiguille ne peut ni la mouvoir d’un mouvement de translation qui tendrait à la déplacer toute entière vers les pôles, ainsi que le prouve l’immobilité d’un aimant léger placé sur du liège flottant sur l’eau ; ni la mouvoir d’un mouvement semblable à celui de la pesanteur, comme le démontre l’immobilité de la balance sur laquelle est placé un barreau d’acier avant et après son aimantation, on suppose que l’aimantation résulte de l’existence de deux forces égales et de sens contraires agissant d’un pôle à l’autre, ce qui justifie le déplacement oscillatoire de l’aiguille et son impossibilité de translation.
Les phénomènes d’induction sont produits par des champs magnétiques réalisés avec les aimants, principalement les aimants artificiels. Si l’on tamise de la fine limaille de fer sur une feuille de papier au-dessus d’un barreau aimanté, elle se répartit suivant certaines lignes, appelées lignes de force, allant d’un pôle à l’autre. Si l’aimant est en forme de fer à cheval ces lignes de force créent entre les deux pôles un champ magnétique lequel à la propriété de faire naître un courant électrique induit dans tout circuit métallique fermé plongé dans ce champ. Lorsqu’on le retire il se produit également un autre courant induit, mais de sens inverse du précédent. On voit qu’il faut qu’il y ait variation du champ magnétique pour engendrer un courant induit. Le même résultat est obtenu en éloignant ou en approchant un aimant d’un circuit fermé.
Les résultats pratiques de ces expériences constituent presque toutes les applications actuelles de l’électricité. Le magnétisme terrestre permet aux navigateurs de connaître à peu près leur situation et de trouver leur route à l’aide de boussoles très compliquées nécessitant quelques données astronomiques. Les phénomènes d’induction sont utilisés pour la construction des dynamos produisant du courant électrique obtenu en faisant tourner des circuits fermés, appelés induits, entre des électroaimants ; des moteurs qui sont des sortes de dynamos réversibles recevant du courant et fournissant de l’énergie mécanique ; des transformateurs créant des courants de haute ou basse tension ; etc., etc. Bien qu’il y ait d’autres moyens de l’obtenir pratiquement les phénomènes d’induction sont les seuls utilisés industriellement pour les grandes productions d’électricité.
B : ANIMAL.
Sous le nom de magnétisme animal on désigne des états pathologiques connus depuis des temps très reculés mais observés seulement depuis quelque cinquante ans avec une certaine régularité. Au XVIème siècle un mélange curieux d’astrologie et de physique, utilisant les propriétés surprenantes des aimants, conçut diverses hypothèses dans lesquelles un fluide mystérieux, appelé fluide universel, fluide magnétique, esprit universel ou esprit vital, répandu dans l’univers, mettait en rapport tous les êtres et toutes les choses et constituait l’agent essentiel de tous les phénomènes. De l’abondance ou de la diminution de ce fluide résultait la santé ou la maladie et la thérapeutique consistait précisément en l’art de l’équilibrer ou de l’augmenter. On croyait même possible le traitement de toutes les maladies à distance ; c’était le traitement par sympathie. Quelques progrès scientifiques dissipèrent ces hypothèses chimériques mais deux siècles plus tard, vers 1780, l’allemand Mesmer, sorte de médecin-charlatan, les renouvela et entreprit des guérisons sur une vaste échelle au moyen de son fameux baquet fermé, rempli d’eau et de limaille de fer, d’où émergeaient des tiges de fer coudées, lesquelles distribuaient par leur contact le non moins fameux fluide sur les parties malades tandis que les patients attachés ensemble par une corde renforçaient ainsi l’intensité de la magnétisation. Un piano jouait des airs variés et appropriés aux circonstances. Cela fit beaucoup de bruit, tracassa les concurrents médecins et le gouvernement nomma cinq savants dont Franklin et Lavoisier et quatre médecins pour examiner de près cette nouvelle thérapeutique. Après de multiples et méthodiques expériences il fut décidé qu’il n’y avait aucun fluide, que l’imagination des malades constituait le fonds essentiel des faits observés et que les crises provenant du traitement étaient plus dangereuses que bienfaisantes. Un adepte de Mesmer, le marquis de Puységur, pratiquait vers cette époque une thérapeutique assez voisine de la sienne en provoquant un somnambulisme magnétique par attouchement avec une baguette de fer.
De nombreux observateurs s’occupèrent alors de ces phénomènes, les uns restant partisans du fluide magnétique, les autres croyant uniquement à la suggestion. Il serait trop long de faire l’historique de l’hypnotisme depuis cette époque mais les simulateurs l’ayant sérieusement discrédité, Charles Richet entreprit, vers 1880, de le défendre et de l’étudier plus scientifiquement. Deux écoles rivales s’occupèrent alors de la question. La première fut celle que dirigea Charcot à la Salpêtrière ; elle attribuait tous les faits de l’hypnotisme a des troubles organiques désorganisant les réflexes profonds. Cette thèse, appuyée par quelques démonstrations utilisant l’influence des aimants, se rapprochait quelque peu du vieux magnétisme animal. L’autre école créée par Bernheim à Nancy, faisait reposer entièrement l’hypnotisme sur la suggestion ou le pouvoir des idées. Les expériences et les observations ne donnèrent complètement raison ni à l’une ni à l’autre, bien que l’école de Nancy ait mieux compris la nature des faits.
Pierre Janet, qui a longuement étudié ces étranges modifications de la personnalité conclut à l’existence de désordres mentaux plus ou moins profonds. D’après ses observations Il ne serait ici nullement question de fluides mais de désagrégations psychologiques. Dans notre état normal toutes les parties du moi concourent à établir à chaque instant les relations exactes entre les diverses activités du subjectif et la réalité de l’objectif et a déterminer la meilleure adaptation de ce moi aux conditions extérieures. L’ensemble de ces actes psychiques constituent tous les faits de la pensée ; reconnaissance, appréciation, raisonnement, délibération, jugement, choix, détermination volontaire, etc., etc. Dans cet état normal il y a déjà des sortes de petites désagrégations de notre moi créant des distractions, des oublis, des tics, dans lesquelles une partie de notre moi n’est plus en relations avec le reste. Cela se produit également pendant le sommeil. Mais dans les cas vraiment pathologiques la désagrégation est nettement accusée. Le moi n’est plus une fonction synthétique reliant les images, les souvenirs du passé avec les perceptions présentes et les jugeant ; il est formé de sortes d’îlots isolés s’ignorant les uns les autres, de perceptions partielles déclenchant des réactions automatiques et fragmentaires séparées du reste de la personnalité comme dans les troubles connus sous le nom de catalepsie, perte ou dédoublement de personnalité, somnambulisme, insensibilité ou anesthésie, aboulie ou manque de volonté, paralysie, etc. Enfin le spiritisme lui-même ne serait, d’après Pierre Janet, qu’un des effets de la désagrégation mentale du médium.
C’est ainsi que, fondé d’abord sur une conception erronée, le magnétisme animal, par les recherches nombreuses qu’il a nécessitées dans la pathologie mentale, a grandement contribué à nous faire comprendre la complexité et la fragilité du moi et le déterminisme rigoureux de toute pensée.
‒ IXIGREC.
MAGNÉTISME (ANIMAL)
Le magnétisme curatif fut connu dès la plus haute antiquité, et maints guérisseurs lui durent, au moyen-âge, d’être brûlés comme sorciers. Paracelse, Van Helmont, etc., avaient ouvert la voie où s’engagea Mesmer (1734–1815). Ce dernier admettait l’existence, chez l’homme, d’un fluide dont l’action était particulièrement puissante sur le système nerveux. On parla bientôt des cures merveilleuses, obtenues grâce aux méthodes qu’il préconisait ; le baquet mesmérien fit, tout ensemble, bien des enthousiastes et bien des incrédules. Mesmer resta sept ans à Paris ; fut l’objet d’un engouement énorme, puis dut s’éloigner, accusé de charlatanisme par les commissions scientifiques chargées d’examiner son système. C’est à Vienne et Munich qu’il s’était d’abord fait connaître ; et les déboires éprouvés en France ne l’empêchèrent pas de recruter des adeptes dans tous les pays d’Europe.
Avec Puységur, Deleuze, du Potet, l’abbé Faria, etc. le magnétisme perdra, peu à peu, ses allures mystérieuses pour devenir un objet de recherches rationnelles et positives. Braid (1795–1860), l’inventeur de l’hypnose, se bornera, quoi qu’il en pense, à produire par une autre méthode, des phénomènes que les vieux magnétiseurs connaissaient déjà. Durand de Gros, Durville, de Rochas, tout près de nous, furent de vrais savants, malgré les théories fort contestables qu’ils donnèrent pour expliquer des faits certains. Deux fois, en 1825 et 1837, l’Académie de médecine condamna le magnétisme ; mais, contradiction trop explicable lorsqu’on connaît les savants consacrés par l’État, elle admit l’hypnose, qui n’est que le magnétisme affublé d’un autre nom, et reçut parmi ses membres Charcot, (1825–1893) célèbre pour ses études sur l’hystérie et la suggestion.
Une querelle survenue entre l’école de Paris, dont le chef était Charcot, et l’école de Nancy, représentée surtout par les docteurs Bernheim, Beaunis, Liébault, mit l’hypnose à la mode, dans le monde des psychologues et des médecins. La première distinguait trois phases successives dans la grande hypnose : la catalepsie, la léthargie, le somnambulisme. Un bruit intense et inattendu, la fixation d’un objet brillant suffisent à produire la catalepsie. Dans cet état les muscles, restés très souples, conservent toutes les positions qu’on leur donne, même les plus incommodes. Gestes et physionomie s’harmonisent, d’ailleurs, automatiquement : lorsqu’on donne au visage une expression de colère, les membres prennent une attitude correspondante, et les mains se joignent, le recueillement s’imprime sur la face, quand on oblige le sujet à se mettre à genoux. Dans l’état léthargique, obtenu par la simple occlusion des paupières, intelligence, mémoire, conscience, tout paraît aboli. Mais la surexcitation du système névromusculaire est au paroxysme ; le plus léger frôlement détermine la contraction des muscles sous-jacents à la peau, même de ceux qui sont soustraits à l’empire de la volonté. Dans l’état somnambulique, troisième phase de l’hypnose, le sujet voit décupler sa force musculaire et l’acuité de ses sens, de la vue surtout et de l’ouïe. La suggestion favorisée par ce sommeil morbide, mais non constituée par lui, exerce alors une influence particulièrement efficace.
Au dire de l’école de Nancy, ces trois phases successives ne se rencontreraient que chez des individus savamment formés, et la suggestion suffirait à les expliquer. Si l’hypnose favorise la suggestibilité, elle est elle-même un effet de la suggestion. Alors que Charcot avait surtout mis en lumière les rapports de l’hystérie avec le somnambulisme, naturel ou provoqué, Bernheim a montré que la suggestion rend compte de presque tous les phénomènes hypnotiques. Elle fait comprendre pourquoi les anciens magnétiseurs ont cru à l’existence d’un fluide mystérieux et pourquoi des somnambules s’imaginèrent le percevoir. Elle fournit encore la clef de l’énigme, lorsqu’il s’agit de l’action des métaux ou des aimants sur les sujets hypnotisés. Bertrand écrivait déjà en 1823 :
« Ce sont toujours les idées des magnétiseurs qui ont de l’influence sur les sensations des somnambules... les métaux, lorsque les magnétiseurs le veulent, ne doivent avoir aucun empire sur les personnes magnétisées, c’est l’idée qui les rend nuisibles. »
Et pour prouver qu’il ne peut être question de fluide, mais seulement de « force d’imagination », le Dr Ordinaire, rappelait en 1850 qu’il avait obtenu « sans magnétisation préalable, l’insensibilité... la paralysie, l’ivresse, le délire, et cela sans avoir besoin d’endormir le sujet, simplement en disant « je veux ». »
On peut admettre que l’hypnose est de la même famille que le somnambulisme ; il y a entre eux la différence de l’art et de la nature : le premier est artificiel et le second spontané. Mouvements brusques et silencieux, gestes automatiques, bras pendants tête fixe, yeux généralement ouverts, paupières immobiles, voilà ce qui frappe chez le somnambule. Au mental, il se concentre sur un seul objet, il est en état de nono-idéisme. Ses sens sont fermés à toutes les impressions étrangères à son rêve, mais pour celles qui le concernent, ils peuvent atteindre un degré d’hyperesthésie extraordinaire. De plus le somnambule dont la mémoire est surexcitée parfois durant les crises ne conserve, réveillé, aucun souvenir de ce qu’il a pu faire ou dire pendant l’accès. D’où son étonnement lorsqu’on le réveille avec brusquerie, et son impossibilité d’expliquer la situation où il se trouve. Ces remarques sont applicables à l’hypnose. Des procédés nombreux permettent de la provoquer, chez les personnes prédisposées à ce genre de phénomènes. Les enfants sont d’ordinaire aisément hypnotisables ; de même les sujets atteints de certaines maladies nerveuses. Quelques individus sont rebelles ; quelques autres ont l’étoffe de parfaits somnambules. On connaît le système de passes employé par les magnétiseurs d’autrefois il est presque abandonné aujourd’hui. Regarder fixement le sujet fut longtemps à la mode ; mais il suffit que ce dernier concentre ses regards sur un objet brillant, un miroir à alouettes ou un bouchon de carafe par exemple. On peut aussi commander le sommeil en phrases impératives et frotter doucement les globes oculaires. En réalité c’est la monotonie d’une sensation ou la continuité de l’attention, jointe à l’idée qu’on va dormir, qui provoque le sommeil. Certaines personnes peuvent s’endormir elles-mêmes en fixant un point lumineux ; chez beaucoup un bruit monotone et prolongé aboutit au même résultat. Et les animaux sont hypnotisés par des procédés semblables : une poule le sera par la blancheur d’une ligne tracée à la craie ou par un balancement rythmique, quand sa tète est cachée sous son aile au préalable.
Innombrables sont les phénomènes produits par la suggestion, chez les hypnotisés. Parfois ils restent d’apparence cataleptique et consistent dans la répétition des actes et des paroles de l’interlocuteur. « Une jeune dame, somnambule, rapportait le Journal du magnétisme en 1849, mise en rapport avec une personne quelconque, devient immédiatement son sosie. Elle reflète les gestes, l’attitude, la voix et jusqu’aux paroles de ses interlocuteurs. Chante-t-on, rit-on, marche-t-on, elle fait immédiatement la même chose, et l’imitation est si parfaite et si prompte que l’on peut se tromper sur l’origine de l’action ». Des hallucinations extrêmement diverses seront aisément provoquées par les paroles du magnétiseur ; elles affecteront la sensibilité générale ou les sens particuliers à volonté. Sur une simple affirmation, le sujet entendra des chants, verra des fleurs, soulèvera des fardeaux qui n’existent que dans son imagination ; il grelottera en juillet si l’on déclare que la température est glaciale, mangera avec délices une betterave donnée pour du gâteau, boira sans répugnance un breuvage exécrable baptisé vin de choix, et trouvera une odeur suave à l’ammoniaque supposée parfum. « Au début de mes recherches sur le somnambulisme, écrit Pierre Janet, n’étant qu’à demi convaincu de la puissance de ces commandements, je commis l’étourderie grave de faire voir à une somnambule un tigre entrant dans la chambre. Ses mouvements convulsifs de terreur et les cris épouvantables qu’elle poussa m’ont appris qu’il fallait être plus prudent, et depuis je ne montre plus à l’imagination de ces personnes que de belles fleurs et des petits oiseaux. Mais si elles ne font plus de grands gestes de terreur, elles n’en font pas moins d’autres mouvements adaptés à ces spectacles plus doux : les unes, comme Marte, caressent doucement les petits oiseaux ; d’autres, comme Lucie, les saisissent vivement à deux mains pour les embrasser ; d’autres comme Léonie, qui se souvient de sa campagne, leur jettent du grain à la volée. » Il est facile de faire apparaître au sujet la Vierge, les Saints, le Christ en personne et, s’il est dévot, sa figure prend la physionomie inspirée, ses bras, son corps l’attitude extatique que les artistes donnent, en général, aux bienheureux. Le bon somnambule devient insensible : chatouillements, piqûres, décharges électriques mêmes le laissent indifférent.
Si le magnétiseur commande un acte ou une série d’actes, de lever les bras, de marcher, de courir par exemple, l’hypnotisé obéit fidèlement. Le geste à faire peut d’ailleurs être rattaché à un signal convenu, qui sera donné plus tard. Pierre Janet écrit :
« Je dis à Marie : « Quand je frapperai dans mes mains, tu te lèveras et tu feras le tour de la chambre. » Elle a bien entendu et garde le souvenir de mon commandement, mais ne l’exécute pas de suite : je frappe dans mes mains et la voici qui se lève pour faire le tour de la chambre. »
On contraindra le sujet à prendre les postures les plus incommodes, les plus drolatiques ; et c’est chose courante dans les exhibitions publiques. Pourrait-on lui faire accomplir un crime ? Plusieurs le pensent ; mais nous n’en sommes pas certain. Idées coutumières, tendances, habitudes subsistent, en général, chez l’hypnotisé ; quoi qu’on ait affirmé longtemps, il semble capable de résistance. Et le même qui acceptera dé simuler un assassinat en chambre, refuserait peut-être d’accomplir un meurtre pour de bon. Ce problème, qui passionna autrefois l’opinion, n’est pas encore résolu, croyons-nous.
Mais il est incontestablement possible de faire des suggestions posthypnotiques, et d’ordonner des actes que le patient n’exécutera qu’après son réveil. Actes dont l’accomplissement sera quelquefois reporté à plusieurs jours ou même à plusieurs mois de distance. Endormie dans l’inconscient, l’idée du geste à accomplir se réveillera, le moment venu, et le sujet obsédé, inquiet, obéira poussé par une impulsion dont il ne connaîtra pas l’origine. À l’heure dite il fera du feu, se mettra au lit, rendra une visite, écrira à telle personne, etc. Bernheim dit :
« A. S... j’ai fait dire, en somnambulisme, qu’il reviendrait me voir au bout de treize jours ; réveillé, il ne se souvient de rien. Le treizième jour, à dix heures, il était présent. »
Deleuze, Charpignon, du Potet, et bien d’autres avaient depuis longtemps décrit ces phénomènes ; mais les savants officiels professaient un tel mépris pour le magnétisme animal qu’il fallut les travaux de Ch. Richet, en 1875, pour les faire admettre. Les suggestions posthypnotiques portent sur des hallucinations, même sur celles qu’on dénomme négatives, aussi bien que sur des actes. « Nous possédons en ce moment une somnambule, écrivait, en 1854, le Dr Perrier, chez laquelle l’insensibilité la plus parfaite et l’illusion du goût persistent pendant plusieurs heures à son retour à la vie normale. Avant de la réveiller nous émettons une volonté quelconque, et, à son réveil, elle éprouve toutes les hallucinations des sens que nous lui avons imposées. Un individu présent reste pour elle parfaitement invisible ; elle en voit un autre dont elle n’entend pas la voix ; un troisième la pince et elle ne le sent pas. Les liquides ont, dans sa bouche, la saveur que nous désirons ; l’ouïe perçoit les sons les plus variables. Ses perceptions se transforment comme les images de nos pensées. » Ajoutons que certains sujets se laissent persuader, en état d’hypnose, qu’ils ont vu tel événement, entendu telle parole, accompli tel acte ; et, après leur réveil, ce souvenir s’impose à leur esprit, sans qu’ils en puissent soupçonner la raison. C’est grâce aux suggestions posthypnotiques, que plusieurs ont compté sur le magnétisme pour corriger les enfants vicieux, les ivrognes, les déséquilibrés mentaux. Mais les résultats n’ont pas répondu à leurs espérances ; chez le grand nombre, le champ des suggestions efficaces reste très restreint. Le cerveau de l’hypnotisé n’est nullement la table rase, l’esprit vide de tendances et de pensées, que les premiers expérimentateurs avaient cru découvrir ; la puissance de dissimulation demeure étrangement forte d’ordinaire. Et l’hypnotiseur n’a point sur un sujet la toute-puissance que les romanciers lui prêtèrent pour corser leurs récits. De là une réaction, peut-être trop vive, concernant le magnétisme ; et son discrédit actuel parmi les psychologues et les médecins. Il s’est vu détrôné par la psychanalyse, qui permet d’explorer l’inconscient sans endormir la personne, mais ne fournit pas le moyen de décupler le pouvoir de la suggestion.
Ce pouvoir, dans l’hypnose, va parfois jusqu’à déterminer une modification de toute la personne ; d’une pauvre femme on fera un soldat, un archevêque, un marin, etc., qui joueront leur rôle avec une grande perfection. Durand de Gros écrivait en 1860 :
« J’ai dit à Mlle N... « Vous êtes un prédicateur. » Aussitôt ses mains se sont jointes, ses genoux se sont légèrement fléchis ; puis, la tête penchée en avant et les yeux tournés vers le ciel avec une expression de piété fervente, elle a prononcé lentement et d’un ton très ému quelques paroles d’exhortation. »
Transformée en général, Léonie, un sujet de Pierre Janet :
« se lève, tire un sabre et s’écrie : « En avant ! du courage !... sortez moi des rangs celui-là, il ne se tient pas bien... où est le colonel de ces hommes ?... allons, rangez-vous mieux que cela... oh ! la mitrailleuse, comme cela tonne... ces ennemis sont nombreux, mais ils ne sont pas organisés comme nous, ils ne sont pas à leur affaire, ah ! mais... » Elle tâte sa poitrine « mais oui... j’ai été décoré sur le champ de bataille pour la bonne tenue de mon régiment. »
Et les comédies de ce genre, voisines, hélas ! de celles qui se jouent dans la réalité, peuvent être multipliées à l’infini ; elles seront plus ou moins remarquables selon la tournure et la force de l’imaginative chez l’hypnotisé.
Restent certains phénomènes peu fréquents, mais non moins naturels, quoi qu’en disent les prêtres des différentes religions. La vision à distance est du nombre ; un très bon somnambule décrira un événement qui se passe au loin, nous renseignera sur les occupations d’un ami, d’un parent. C’est chose rarissime ; dans ce domaine la supercherie règne en maîtresse ; l’adresse est prise pour du merveilleux, par des spectateurs simplistes. Aucune difficulté, d’ailleurs, pour expliquer les cas certains, sans recourir ni à dieu ni au diable. Il s’agit là de faits télépathiques, d’ondes nerveuses probablement qui, à l’instar d’une télégraphie sans fil, permettent à quelques cerveaux de communiquer entre eux directement.
Rien de surnaturel non plus dans les phénomènes organiques obtenus par suggestion. Charpignon constatait déjà :
« Un magnétiseur peut faire qu’une douleur fictive produise une trace de blessure ou qu’un sinapisme idéal rougisse la peau. »
Les médecins savent combien de guérisons s’obtiennent avec de l’eau ou des pilules de mie de pain, baptisées de noms extraordinaires. De nombreux magnétiseurs sont parvenus à produire des plaies, qu’il est impossible de ne pas prendre pour des brûlures véritables ; et par la seule force de l’imagination des sinapismes inexistants provoquent un gonflement de la peau. Pierre Janet écrivait :
« Ce gonflement de la peau est étroitement en rapport avec la pensée du somnambule ; d’abord il se produit à l’endroit qui a été désigné et non à un autre ; puis il affecte la forme que le sujet lui prête. Je dis un jour à Rose, qui souffrait de contractures hystériques à l’estomac, que je lui plaçais un sinapisme sur la région malade pour la guérir. Je constatais quelques heures plus tard une marque gonflée d’un rouge sombre ayant la forme d’un rectangle allongé, mais, détail singulier, dont aucun angle n’était marqué, car ils semblaient coupés nettement. Je fis la remarque que son sinapisme avait une forme étrange : « Vous ne savez donc pas, me dit-elle, que l’on coupe toujours les angles des papiers Rigollot pour que les coins ne fassent pas mal ? » L’idée préconçue de la forme du sinapisme avait déterminé la dimension et la forme de la rougeur. J’essayai alors un autre jour (les sinapismes de ce genre enlevaient très facilement ses contractures et ses points douloureux) de lui suggérer que je découpais un sinapisme en forme d’étoile à six branches ; la marque rouge eut exactement la forme que j’avais dite. Je commandai à Léonie un sinapisme sur la poitrine du côté gauche en forme d’un S pour lui enlever de l’asthme nerveux. Ma suggestion guérit parfaitement la malade et marqua sur la poitrine un grand S tout à fait net. »
Nous saisissons, ici, le secret des stigmates portés par François d’Assise et plusieurs saintes, ainsi que celui des guérisons miraculeuses obtenues à Epidaure dans l’antiquité, sur la tombe du diacre Pâris au XVIIIème siècle, à Lourdes et dans les milieux théosophiques aujourd’hui. Un médecin suisse vient tout récemment de confirmer cette action thérapeutique de la pensée, non seulement lorsqu’il s’agit de maladies nerveuses, mais lorsqu’il s’agit d’affections manifestement organiques. Par la seule force de l’imagination, et sans recourir au sommeil hypnotique, il est parvenu à guérir un nombre prodigieux de verrues, jusque-là rebelles à toute médication. Ces petites tumeurs de la peau semblaient pourtant n’être soumises que très médiocrement à l’influence du système nerveux.
L’idée est une force, du moins lorsqu’à l’élément cognitif s’ajoutent des éléments d’affectivité : joie ou souffrance, désir ou répulsion. Elle tend à se réaliser, et se réalise en fait lorsqu’aucun obstacle ne l’empêche de se transformer en actes, en mouvement. De cette loi psychologique des vérifications expérimentales nous sont constamment données : lorsqu’on n’y prend garde, rire, bâillement, toux, accent sont contagieux, aussi la peur, l’enthousiasme et les autres émotions. La mode, en matière d’habits comme d’opinions, les multiples manifestations de l’esprit grégaire, l’imitation sous toutes ses formes sont autant de preuves nouvelles de la puissance de l’idée. Dans un troupeau de moutons, il suffit d’un fuyard pour déterminer une panique ; et les manifestations de joie ou d’irritation collective sont fréquentes chez les animaux. Le vertige a sa cause dans l’idée du vide ; les mouvements du pendule de Chevreul dans celles du nombre et de la direction pensés, ceux des tables tournantes ou frappantes dans la croyance des assistants ; on sait que la publicité repose sur la suggestion. C’est de la même façon que s’expliquent un très grand nombre de phénomènes magnétiques. Sans reconnaître à ces derniers l’importance excessive que leur attribua le XIXème siècle finissant, nous refusons de faire nôtre l’opinion de Delmas et Boll qui réduisent l’hypnotisme à une « simulation de sommeil somnambulique par mécanisme mythomaniaque ». Sujets et médiums sont quelquefois des mythomanes et des « menteurs constitutionnels » ; il serait faux de croire qu’ils le sont toujours.
‒ L. BARBEDETTE.
MAHOMÉTISME (ou ISLAMISME)
n. m. (de Mahomet, forme occidentale de l’arabe Mohammed)
Sans parler des travers inhérents à toute religion, l’islamisme a répandu trop de sang, fait verser trop de larmes pour que nous prenions sa défense. Pourtant l’on doit reconnaître que les auteurs occidentaux, ceux qu’anime la mauvaise foi catholique surtout, se montrent en général d’une partialité insigne lorsqu’ils parlent de Mahomet, de sa personne ou de son enseignement. Accusations injustifiées, mensonges, calomnies foisonnent sous leur plume ; contre le concurrent arabe de Jésus-Christ ils font flèche de tout bois. Alors que nous manquons de documents authentiques concernant le Christ et qu’il est même permis de douter de son existence effective, nous possédons sur le fondateur de l’islamisme des renseignements absolument certains. Sa bonne foi ne saurait être mise en doute. Impressionnable au point de se trouver mal en respirant certaines odeurs, il était sujet à de violentes crises nerveuses qu’il tenait de sa mère. Halluciné, comme tant de mystiques chrétiens, il crut sincèrement voir des anges, entendre des voix. Ses préoccupations religieuses l’avaient conduit à s’affilier aux Hânijs, secte de dévots dissidents qui priaient, jeûnaient, se privaient de vin et voulaient remplacer le polythéïsme arabe par le culte d’un dieu unique. Mais il fut épouvanté et se crut possédé d’un djinn, quand un ange (il sut plus tard que c’était Gabriel) lui révéla pour la première fois sa mission en 611. La vision, semble-t-il, eut lieu pendant son sommeil, alors que, retiré dans la solitude du mont Hira, il se livrait à des jeûnes et à des méditations qui surexcitaient son cerveau. Fort simple, bon pour les femmes, les pauvres, les animaux, Mahomet ou mieux Mohammed, n’était ni orgueilleux, ni vaniteux ; et, bien que le prophétisme fut chose assez courante chez les sémites, il s’estimait indigne d’être choisi par Dieu. Ses scrupules devinrent tels, malgré les encouragements de sa femme Khadidja, qu’il songea au suicide. Mais, trois ans plus tard, les visions reparurent et en plein jour la voix de Gabriel avait toujours le même timbre ; Mahomet la percevait à travers un bourdonnement comparable, disait-il, à la grosse clochette du chameau qui marche en tête d’une caravane : « Tu es le prophète du Seigneur », disait l’envoyé céleste. A la fin, il se persuada de la vérité de sa mission et les longs déboires du début, les moqueries et les persécutions qu’il devra subir ne parviendront pas il ébranler sa conviction. On le traita de fou et de charlatan, on lui jeta des pierres, on lui cracha au visage ; ce fut en vain, Et après les triomphes qui suivront, lorsqu’il aura savouré les joies de la toute-puissance, sa mort témoignera encore de sa sincérité. Sentant qu’il était perdu, il s’en vint à la mosquée pour déclarer au peuple :
« O vous qui m’écoutez, si j’ai frappé quelqu’un sur le dos, qu’il me frappe. Si j’ai blessé la réputation de quelqu’un qu’il m’injurie. Si j’ai pris de l’argent à quelqu’un qu’il se paye. »
Et il fit indemniser aussitôt un homme qui lui réclamait le paiement d’une petite somme. Sauf les trois derniers jours où son état ne le permit plus, il continua de prier en présence du peuple.
Mais Mahomet ignora absolument la tolérance ; aussi cruel que le clergé catholique du moyen-âge il voulut imposer sa doctrine par la force. Contre les adorateurs des idoles, les païens, il fut féroce ; mieux disposé à l’égard des juifs et des chrétiens « détenteurs d’Ecritures », il persécutera pourtant les premiers, « des ânes chargés de livres », parce qu’ils l’accusaient, non sans raison, de plagier la Bible. Fort modéré dans sa conduite ordinaire, il perdait toute mesure dès qu’il s’agissait d’infidèles refusant d’admettre son enseignement. Il dira :
« Combattez ceux qui ne croient pas à Dieu et au Jour Dernier. Si vous ne marchez pas au combat, Dieu vous en demandera un compte sévère. Il mettra un autre peuple à votre place. »
Le djihad, la guerre sainte, est particulièrement agréable à Allah :
« Le paradis est à l’ombre des épées. Les fatigues de la guerre sont plus méritoires que le jeûne, la prière et les autres pratiques de la religion. Les braves tombés sur le champ de bataille montent au ciel comme des martyrs. »
On voit combien l’islamisme se rapproche de l’Église romaine, à ce point de vue. Ne lit-on pas dans Saint Thomas d’Aquin :
« L’hérétique est pire qu’un chien enragé et doit comme lui être abattu ! »
Croisades chrétiennes et atrocités de l’Inquisition constituent le digne pendant des brutalités musulmanes. Lors de sa guerre contre les mecquois, le prophète arabe se comporta en brigand ; il fit massacrer tous les hommes d’une tribu juive et réduisit en esclavage les femmes et les enfants ; après le combat de Deür, il mit à mort des prisonniers et, à l’un d’eux qui lui demandait angoissé : « Qui prendra soin de mes enfants ? », il répondit implacable : « Le feu de l’enfer ! » S’il amnistia presque tous ses ennemis, après la prise de la Mecque, ce fut par calcul, afin d’assurer la soumission rapide du reste de l’Arabie. Sur son lit d’agonie, il donnait encore des instructions à ses lieutenants pour l’expédition militaire de Syrie ; il fut l’inspirateur de la politique de conquête que les Arabes suivront après sa mort.
On sait que la doctrine de Mahomet est contenue dans le Coran (voyez ce mot), recueil des paroles et des discours que ses disciples transcrivirent de suite avec un soin pieux ou gardèrent fidèlement dans leur mémoire. La première édition parut en 633, sous le khalifat d’Abou Bekr, et le texte définitif en 659, sous celui d’Othman. C’est une œuvre de bonne foi, dont l’authenticité ne peut être mise en doute, au moins pour l’ensemble. Au point de vue littéraire les appréciations portées à son sujet sont contradictoires. Salomon Relnach le qualifie de pauvre livre :
« Déclamations, répétitions, banalités, manque de logique et de suite dans les idées y frappent à chaque pas le lecteur non prévenu. Il est humiliant pour l’esprit humain que cette médiocre littérature ait été l’objet d’innombrables commentaires et que des millions d’hommes perdent encore leur temps à s’en imprégner. »
Barthélémy Saint-Hilaire émet un jugement tout opposé :
« C’est, d’après lui, le chef-d’œuvre incomparable de la langue arabe, et ses qualités littéraires ont contribué à l’influence inouïe qu’il a exercée. On a cru d’autant mieux qu’il était la parole de Dieu, que jamais encore homme parmi les Arabes n’avait fait entendre de tels accents. »
Quoi qu’il en soit, l’éloquence naturelle de Mahomet fut admirée de ses adversaires comme de ses amis. « Son art, disaient les premiers, ne consiste que dans sa parole insinuante » ; et l’un de ses fidèles déclarera, après l’avoir entendu pour la première fois :
« Mahomet parle comme je n’ai jamais entendu parler personne. Ce n’est ni de la poésie, ni de la prose, ni du langage magique ; mais c’est quelque chose qui pénètre et remue. »
Certaines conversions fameuses, celle d’Omar et du poète Lebid par exemple, furent dues au charme de ses harangues. A ceux qui lui demanderont un signe, une preuve de sa mission divine, le prophète n’hésitera pas il répondre :
« Écoutez la pureté de ma langue ! »
Et, craignant une concurrence dangereuse pour son prestige, il ira jusqu’à faire assassiner poètes et poétesses, ses ennemis. Mais les discours perdent généralement à être lus ; l’écriture ne parvenant à rendre ni l’accent, ni le geste, ni l’émotion vivante qui, chez l’orateur, accompagnait le texte. Ceci est particulièrement vrai de la prose rythmée, aux phrases très courtes, que parlait Mahomet. Aujourd’hui le Coran a perdu de son charme, il est souvent d’une lecture difficile ; mais, d’après les arabisants, ses strophes bien déclamées seraient encore fort agréables ; au moins en dialecte ancien, car à leur avis elles perdent leur saveur dès qu’on les traduit en français.
Outre le Coran, de nombreux musulmans, les Sunnites, admettent la Sunna « la Tradition », recueil de renseignements et de commentaires, donnés par les premiers disciples de Mahomet et transmis d’abord oralement. Ils ne furent recueillis et rédigés que deux siècles plus tard ; avec de nombreux traits concernant la vie du prophète et celle de ses compagnons, ils contiennent des explications capables d’éclairer le texte du Coran. Autour des traditions prophétiques les plus cohérentes, celles dont le dogme a le moins varié et qui constituent jurisprudence en matière religieuse, se sont groupées quatre grandes sectes ayant leur zone d’influence. Le « rit hanafite » prévaut en Orient et le malékite en Afrique du Nord, (c’est à lui que se rattachent les musulmans de l’Algérie). En Égypte, c’est le chafaïte et, en Syrie et en Arabie, le hanbalite. La véritable force de la société islamique réside davantage dans le prestige mystérieux qui enveloppe les confréries mystiques que dans son « clergé » ou sa magistrature. Ce sont ces « théocraties », analogues aux « prophètes de la synagogue » du royaume d’Israël qui s’opposent irréductiblement aux ulémas. Leur développement fut parallèle à celui de la théologie émanant des sectes dissidentes.
Nombreuses furent (on le verra plus loin) les branches hérétiques. On les divise en huit classes principales, subdivisées elles-mêmes en soixante-douze fractions. Une des plus considérables parmi ces hérésies fut celle des schiites. Les musulmans schiites, tels ceux de Perse, rejettent absolument la Sunna. Ajoutons qu’il existe plusieurs biographies de Mahomet écrites en arabe, qui ne font point partie des livres sacrés admis par les églises musulmanes. Très prolixes en détails minutieux, elles inspirent cependant la défiance par la place qu’elles accordent au merveilleux : intervention des anges, prédictions, etc.
« Allah est le seul Dieu et Mahomet est son prophète ! » tel fut le credo de l’Islam. Peu spéculatif, il n’a pas multiplié les dogmes à plaisir comme le catholicisme romain. Dieu est un, éternel, tout-puissant ; ses décrets sont éternels comme lui et sa volonté immuable ne saurait être modifiée même par la prière. Or rien ne peut se faire sans Allah, puisque sa puissance divine est illimitée ; toutes les actions humaines sont prévues par lui :
« Tout est écrit d’avance. L’homme porte son destin suspendu à son cou. »
D’où la doctrine du fatalisme absolu ; et la nécessité pour le croyant de se soumettre sans murmures inutiles ; islam signifie en arabe résignation totale à la volonté de Dieu. « C’était écrit ! » ou « Allah est grand ! » voilà le cri du pieux Musulman, même s’il subit un sort qu’il ne méritait pas. Entre Dieu et les hommes existent des êtres intermédiaires, les anges et les djinn ; les premiers, dont le corps est composé d’un feu subtil, n’ont pas de sexe et n’éprouvent aucun de nos besoins. Ils adorent Allah de manière constante ; chaque homme en a deux à ses côtes, qui notent, l’un ses actions bonnes, l’autre ses actions mauvaises. Pour avoir refusé de saluer Adam, Iblis et les anges qui le suivirent dans sa révolte furent maudits par le tout-puissant. Quant aux djinn ou génies, si chers aux arabes avant la prédication de Mahomet, il en est de mâles et de femelles, d’hérétiques et de musulmans. Création du monde et chute du premier homme sont racontées d’après la Bible, avec des variantes néanmoins. Pour communiquer ses volontés Dieu se sert des prophètes : Noé, Abraham, Moïse, Jésus, furent du nombre. Mais Mahomet, le dernier, leur est supérieur à tous, car il apporte la vérité entière, alors que ses prédécesseurs n’en purent communiquer que de faibles parcelles. Avec lui la série des prophètes est close définitivement, les hommes n’ayant plus rien à apprendre. Seulement Mahomet ne se donna jamais pour une incarnation divine, pour un fils d’Allah descendu sur terre.
En dehors des moments où l’archange Gabriel l’inspirait, il restait un arabe ordinaire, soumis à la tentation, sujet au péché et, comme les autres, destiné à mourir.
L’âme humaine est immortelle ; jugée par Dieu, elle va au ciel ou en enfer, suivant qu’elle a bien ou mal agi. Aux enseignements du prophète, ses disciples ajoutèrent de nombreuses précisions. Après la mort, l’âme doit passer, au-dessus de l’enfer, par un pont « mince comme un cheveu et tranchant comme le fil d’une épée ». Les pécheurs trébuchent et tombent ; sans autre nourriture que des ronces, ils rôtissent sur un feu ardent et, pour que le supplice se renouvelle sans répit, ils sont munis d’une peau neuve chaque fois que l’ancienne est brûlée. Du moins l’enfer n’est pas éternel, sauf pour les infidèles ; les musulmans n’y restent que le temps d’expier leurs forfaits. De là, ils gagnent le paradis où quelques justes parviennent à se faire admettre du premier coup. « La paix éternelle et l’éternelle joie » règnent dans ce séjour enchanteur où coulent des rivières de lait, de vin et de miel, où les arbres touffus inclinent leurs branches pour que le promeneur en cueille commodément les fruits. Vêtus de brocart et de satin vert brodé, couverts de bijoux, les élus s’attablent près de fontaines jaillissantes, dans des jardins ombreux, avec des houris charmantes ; et des serviteurs nombreux, des échansons portant coupes ou gobelets d’un breuvage exquis, s’empressent à leur moindre désir. La résurrection des corps fut formellement enseignée par Mahomet ; toutefois, dépassant ces plaisirs vulgaires les plus sages ont la joie « de voir la face de Dieu matin et soir », Judaïsme et Christianisme ont fourni, on le voit, de nombreux éléments à la dogmatique musulmane ; ce n’est pas par l’originalité que valent les conceptions doctrinales du prophète, c’est par une simplicité qui les rendit accessibles aux esprits les moins cultivés.
Même simplicité en matière de prescriptions rituelles et morales. Un khalife comme chef suprême, que la communauté des fidèles a le droit de prendre n’importe où d’après les sunnites ; qui, d’après les schiites, doit être nécessairement de la famille de Mahomet. Ce dernier en mourant ne désigna pas son successeur ; c’est à propos d’Ali, son gendre, exclu du khalifat, que ces divergences doctrinales éclatèrent. Point de clergé, mais un simple directeur des prières : l’iman, dont la présence à la mosquée n’est d’ailleurs pas indispensable, et un muezzin pour annoncer l’heure de la prière. Cinq fois par jour le musulman doit prier. Après des ablutions sur les mains, les avant-bras, le visage et les pieds ; avec de l’eau autant que possible, avec du sable s’il est au désert, il se tourne dans la direction de la Mecque, s’incline puis se prosterne, en récitant les formules consacrées. Pendant trente jours consécutifs, chaque année, à partir de quatorze ans, il s’abstient de manger, boire et fumer, depuis le matin « dès que la lumière suffit pour distinguer un fil blanc d’un fil noir », jusqu’au coucher du soleil ; c’est le jeûne du mois de Rhamadan (voir jeûne) qui rappelle l’époque où le prophète eut ses premières visions. Seuls les malades en sont dispensés, mais avec obligation de faire un jeûne de trente jours, dès qu’ils seront rétablis.
« L’odeur de la bouche qui jeûne est plus agréable à Dieu que celle du musc. »
Ajoutons que les rigueurs du Rhamadan sont adoucies par les plantureux repas absorbés de la tombée de la nuit au lever de l’aurore. Une fois dans sa vie, le musulman doit se rendre à la Mecque. Il y tourne sept fois autour de la Kaaba, suivant une coutume que Mahomet trouva établie ; et, après- s’être fait raser entièrement la tête, en récitant des prières se rend sur une montagne à dix-sept kilomètres de la ville sainte, pour entendre un sermon. Le fondateur de l’Islam, qui lui-même avait connu la pauvreté, témoigne d’une sollicitude particulière à l’égard des pauvres :
« Vous n’atteindrez à la piété parfaite que lorsque vous aurez fait l’aumône de ce que vous chérissez le plus. Faites l’aumône de jour, faites-là de nuit, en public, en secret. Tout ce que vous aurez donné, Dieu le saura. »
Et dans l’insistance qu’il mit à plaider la cause des orphelins, le souvenir des souffrances endurées dans son enfance, lorsqu’il eut perdu ses parents, fut sans doute pour quelque chose. Les musulmans distinguent deux sortes d’aumônes, l’une volontaire et l’autre légale ; cette dernière, véritable impôt, est destinée à soulager les croyants pauvres et à subventionner les entreprises religieuses, la guerre sainte en particulier. Bien que le Coran ne parle pas de la circoncision, elle est pratiquée par tous les fidèles, Dieu l’ayant ordonnée dans une révélation antérieure. Mahomet réduisit à quatre le nombre des femmes légitimes, mais il reçut de Gabriel la permission expresse de ne point suivre la loi commune et, Khadidjâ morte, il se constitua un harem bien peuplé. Ignorante, à demi-esclave, tenue de se voiler en public, la femme fut en outre presque éloignée du culte ; la religion musulmane s’adresse spécialement aux hommes, différente en cela de la catholique qui, tout en excluant les dames du sacerdoce, voit en elles ses ouailles de prédilection. Aujourd’hui du moins, car on sait que Saint Paul leur défendait vertement d’élever la voix dans les assemblées chrétiennes, et qu’un grave concile délibéra longtemps pour savoir si elles possédaient une âme à l’instar de leurs compagnons masculins. Pour limiter les divorces, le fondateur de l’Islam imposa au mari l’obligation de rendre la dot. Il défendit au père de tuer ses enfants et d’enterrer ses filles vivantes, selon une habitude arabe consacrée par la tradition. Mensonge, calomnie, orgueil, vol, avarice, etc., furent rangés parmi les vices comme chez les juifs et les chrétiens ; le vin et les boissons fermentées en général, la viande de porc, les jeux de hasard furent prohibés ; afin d’éviter un retour possible à l’idolâtrie, peintres et sculpteurs durent s’abstenir de représenter la figure humaine. Mahomet ne supprima pas l’esclavage, mais il en atténua les rigueurs et tendit même à le faire disparaître :
« Dieu n’a rien créé déclarait-il, qu’il aime mieux que l’émancipation des esclaves. »
En morale, il n’innova pas ; il emprunta aux religions déjà existantes et fit de nombreuses concessions aux mœurs arabes ; toutefois, si l’on excepte les prescriptions relatives à la guerre sainte, il s’efforça d’introduire plus de douceur dans des coutumes souvent atroces. Le Coran servit de code civil aux musulmans ; il devint l’inspirateur de leur jurisprudence, la base essentielle de leur législation civile et criminelle. Aujourd’hui encore, les indigènes d’Algérie, de Tunisie et du Maroc sont jugés d’après ses prescriptions.
A côté de ses légistes l’Islam eut ses théologiens, dont les principaux furent les « maîtres de la Tradition ». L’un d’eux Bokhâri, mort en 870, réduisit les 600.000 « Nouvelles » proposées avant lui à 7275 anecdotes dignes d’être crues. Ces théologiens défendirent le mahométisme orthodoxe contre ses déviations hérétiques ou schismatiques. Ils répondirent aussi aux attaques chrétiennes ; et l’on sait quel éclat jettera la civilisation arabe. Mahomet n’avait rien du contempteur de la science que les occidentaux ont supposé :
« Enseignez la science, lit-on dans le Coran ; qui en parle loue le Seigneur ; qui dispute pour elle livre un combat sacré ; qui la répand distribue l’aumône aux ignorants. La science éclaire le chemin du paradis. Elle est le remède contre les infirmités de l’ignorance, un fanal consolateur dans la nuit de l’injustice. L’étude des lettres vaut le jeûne et leur enseignement vaut la prière. »
En conséquence d’importantes universités, de riches bibliothèques furent créées dans les divers pays musulmans. Pas davantage les peuples vaincus par les arabes ne furent convertis de force ou massacrés. S’ils acceptaient l’islam, ils devenaient de droit les égaux du vainqueur ; s’ils refusaient, ils conservaient néanmoins leurs terres, à condition de payer une capitation pour leur personne et un tribut pour leurs biens. On exigeait encore que les non-musulmans s’abstiennent de boire du vin et de réciter leurs prières en public, qu’ils portent un costume spécial et ne laissent pas voir leurs porcs. Mais, chose plus grave, ils ne pouvaient presque jamais obtenir justice contre un fidèle de Mahomet, tant il est vrai que toute religion garde une âme de persécutrice, même lorsqu’elle affecte des dehors bienveillants. Et, comme on les pressurait souvent, les conversions devinrent innombrables. Reconnaissons toutefois qu’en fait de crimes, les musulmans n’atteignaient généralement pas à la hauteur des chrétiens. Quand il prit Jérusalem, en 636, Omar assura le libre exercice de leur culte aux juifs et aux chrétiens ; il garantit la sécurité de leurs personnes et ne les spolia pas de leurs biens. En moins de huit jours, au contraire, Godefroy de Bouillon et ses croisés, maîtres de la Ville Sainte exterminèrent 70.000 juifs ou mahométans.
Hérésies et schismes, nous l’avons dit, abondèrent dans l’Islam, comme dans toutes les religions. A côté des sunnites ou orthodoxes, il y eut bientôt les schiites qui se rattachaient au gendre de Mahomet, Ali. Officiellement les maîtres en Perse depuis 1499, ils ont aussi beaucoup de partisans dans l’Inde. Moins rigides en ce qui concerne l’usage du vin et la représentation des êtres vivants, ils rejettent la Sunna, et tendent souvent vers un panthéisme plus ou moins voilé. Eux-mêmes donnèrent naissance à des sectes nouvelles : les Ismaïliens presque libres-penseurs ; les Druses qui ne s’accordent ni avec les chrétiens, ni avec les autres musulmans, etc. Les Suffites, dont l’origine remonte à Rabia, une femme morte vers 700, sont des mystiques pour qui l’âme est une émanation de Dieu et qui rêvent d’un retour à lui par la voie de l’amour. Ils devinrent assez nombreux en Perse à partir du IXe siècle et fondèrent des couvents. Au sein de l’islamisme orthodoxe, des tentatives de réforme ont eu lieu également : les Motazilites voulaient purifier la religion ; les Wahhabites s’insurgeaient contre le relâchement des mœurs, ainsi que contre le culte des saints et des reliques. Ils s’emparèrent de la Mecque au début du XIXe, mais furent vaincus en 1818 par Méhémet-Ali agissant au nom du Sultan. On ne peut donner même une simple liste de toutes les sectes soit sunnites, soit schiites. Rappelons seulement qu’une confession nouvelle, le Bâbisme, fut prêchée en Perse, à partir de 1840, par le réformateur Madhi el Bâb que l’on fusilla en 1850, mais dont l’œuvre fut continuée par des disciples enthousiastes, les babistes, nombreux malgré les persécutions qu’ils ont eu à subir, réclament l’admission des femmes aux cérémonies du culte, la suppression de la polygamie et du voile, des mesures en faveur des pauvres et des opprimés. Par ailleurs les « Jeunes Turcs », qui en 1908, mirent fin au règne abominable d’Abd-ul-Hamid, cherchèrent à concilier la civilisation moderne et le Coran. Sous le gouvernement de Mustapha-Kemal des transformations religieuses autrement profondes sont survenues. En 1924, l’Assemblée nationale supprima le khalifat ; elle décréta encore la séparation de la religion et de l’État. Aujourd’hui le mariage est laïcisé en Turquie ; la polygamie est interdite ; et les écoles donnent un enseignement d’inspiration rationaliste. Pourtant l’Islam n’a pas dit son dernier mot dans l’histoire du monde ; il compte plus de deux cent millions d’adhérents et ne cesse de faire des progrès du côté de l’Inde, ainsi qu’en Afrique. En Europe les préventions anciennes contre le prophète de Médine sont en voie de disparition ; à beaucoup sa doctrine n’apparaît pas plus absurde que celle de Jésus-Christ, et une mosquée s’élève actuellement en plein Paris.
Peu-être l’Islam doit-il, pour une bonne part, à ses confréries l’activité conquérante dont il est toujours animé. A l’exemple des moines chrétiens ou buddhistes, de dévots musulmans entreprirent, de sauver leur âme à tout prix en s’imposant des prières surérogatoires et en réchauffant le zèle des croyants. D’où les ordres religieux ou confréries qui cachèrent leurs visées politiques sous le manteau d’un mysticisme désintéressé, absolument comme chez les catholiques romains. Et leur influence devint telle, que généralement les pouvoirs publics n’osèrent leur résister ; leur nombre aussi s’accrut démesurément. Chacune possède un supérieur général ; au-dessous, des moqaddem ou prieurs dirigent les groupes provinciaux et confèrent l’initiation dans la contrée qu’ils gouvernent ; puis viennent les khouans ou frères. Tous les membres de l’ordre se doivent aide mutuelle et protection ; ils appartiennent au chef, corps et âme. Ce dernier réunit les moqaddem, une ou deux fois l’an, pour arrêter les décisions importantes que l’on communique ensuite aux khouans. Les plus curieuses de ces confréries, mais non les plus influentes, sont celles des derviches, appelés jadis safis ou fakirs. Après un long noviciat et de pénibles épreuves, les derviches font vœu de pauvreté, de chasteté et d’humilité, puis reçoivent une initiation particulière du supérieur ou cheik. Ils mendieront ensuite pour leur couvent et prêcheront sur les places publiques. Les derviches tourneurs, dont la maison-mère est à Konieh, possèdent un monastère dans le faubourg de Péra et se livrent publiquement à des danses sacrées, le mardi et le vendredi. Après une procession solennelle et un salut au cheik, ils tournent avec une adresse étonnante et une volubilité extrême, au son du tambourin et de divers instruments. Quant aux derviches hurleurs, ils arrivent à l’anesthésie cataleptique par des invocations répétées à leur fondateur, Mahomed-ben-Aïssa, des cris suraigus, et des oscillations rapides de la tête au-dessus d’une cassolette où brûle du benjoin. Et lorsqu’ils sont arrivés au paroxysme de l’exaltation, ils se transpercent les joues, se labourent le corps, lèchent des fers rougis, tiennent des charbons allumés entre les dents, accomplissent mille tours que le vulgaire qualifie miracles, mais que le savant explique par les seules forces du système nerveux et de la suggestion.
Comme les autres religions, le mahométisme aboutit aux manifestations maladives d’un mysticisme délirant. Dominer les corps, détruire les âmes, voilà le résultat indéniable auquel parviennent sectes et Églises qui se réclament d’une divine révélation. Moïse, Buddha, Jésus, Mahomet, Allan Kardec, Krishnamurti apportèrent aux hommes des chaines intellectuelles ; ce furent de faux prophètes, des dieux inconsistants, soit volontairement trompeurs, soit trompés eux-mêmes.
— L. BARBEDETTE.
MAILLOT
n. m. (rad. maille)
Nous ne ferons pas à ce mot le procès de ce vêtement collant, espèce de caleçon de douteuse élégance et parfois de libidineuse transparence, que les lois imposent au corps humain dans des exhibitions publiques. Qu’il s’agisse d’esthétique ou de manifestation culturelle, de plastique ou d’hygiène, d’harmonie ou de santé, chaque fois que l’homme essaie de retrouver son milieu naturel d’air et de lumière, une société, qui cache sous sa vêture une corruption raffinée et souvent une ordure scandaleuse, plaque cet écran « moral » sur nos nudités indésirables. D’autres, à des sujets appropriés, dénonceront ces mœurs et ces obligations hypocrites, toutes pétries de la chrétienne réprobation du sexe...
Ici nous nous arrêterons à ce carcan dans lequel on enserre les petits des hommes à peine échappés du ventre protecteur de la mère. Ils y goûtaient encore, dans leur claustration transitoire, une indépendance relative, pouvaient y bouger, s’y retourner. Mais dès qu’ils sont entrés dans le riant royaume où se traînent nos joies jugulées, les prêtresses du maillot, à peine contrariées par les servants d’Esculape, s’emparent de leur petite chair et l’emprisonnent sous d’affreux ligaments. Pendant des siècles, le maillot a garrotté leurs membres, écrasé leur poitrine, comprimé tout l’être avide de développement... Se situant, en matière d’élevage, parmi les plus bornées des espèces animales, mettant leur faible intelligence à refouler les indications les plus claires de nos instincts, les familles se sont complus, vis-à-vis de l’enfance, à des pratiques étouffeuses qui ont leur prélude dès le premier vagissement de la progéniture...
Qu’invoquent les nourrices pour justifier cette séquestration barbare ? Des considérations de chaleur de propreté et le souci d’empêcher les déformations. Ce sont les « avantages » (nous les retrouverons tout à l’heure) que la routine nous oppose. Gribouille échappant à la pluie par l’immersion pourrait lutter de perspicacité avec les défenseurs du maillot : « Dans le sein même de la mère », écrit Larousse sur le chemin d’une puériculture libérée, « le fœtus change très souvent de position ; pourquoi le réduire après sa naissance à un repos absolu ? L’homme le plus indolent lui-même ne pourrait, sans en éprouver un grand malaise, rester sans mouvement dix fois moins de temps qu’un enfant dans son maillot ». Et c’est, mettant à profit sa malléabilité, c’est cet agglomérat de cellules essentiellement mobiles, partout et dans tous les sens en voie d’expansion, c’est cet enfant sans cesse gesticulant qu’on a imaginé de soumettre à ce refoulement systématique, à la torture de l’immobilité ? Regardez-le, d’ailleurs, quand son bourreau desserre les bandes conjuguées ; voyez ses muscles se gonfler, ses traits s’épanouir, bras et jambes rythmer des gambades de réjouissance, tout son corps faire effort pour se ressaisir... et suivez sa pauvre figure renfrognée quand on ramène sur lui l’encerclante prison. Il résiste d’ailleurs (et il y serait plus disposé encore s’il ne jouissait de la satisfaction du nettoyage qui vient d’accompagner sa mise à nu), il crie, pleure, se débat, dans la mesure où le lui permettent ses entraves bientôt victorieuses, et ne se résigne que fatigué de lutter...
Les résultats physiques de ce beau régime ? Un médecin pénétré de son rôle pourrait, dès la « délivrance », les mettre en relief devant les gardiennes empressées de la tradition, qui ficèleront et épingleront bientôt avec ferveur le nouveau venu :
« La pression exagérée du maillot paralyse les muscles et les ligaments, dont la texture est encore si molle. Les os eux-mêmes peuvent changer de forme et de direction, surtout au niveau des articulations, où la pression produit souvent du gonflement et des nodosités. Les membres inférieurs, qu’on s’imagine rendre plus droits et plus réguliers en les comprimant l’un contre l’autre avec une bande, affectent une tournure disgracieuse ou des déviations irrémédiables. Le système circulaire n’est pas moins affecté que le système osseux ; une forte compression sur tout le corps empêche le sang d’arriver en quantité suffisante dans les capillaires superficiels ; aussi le liquide nourricier, refluant dans les organes intérieurs, aura une tendance à se concentrer vers les poumons et le cerveau ; de là l’imminence des congestions pulmonaires et cérébrales. » (Larousse)
Mais c’est surtout du côté de la poitrine qu’on observe les effets pernicieux du maillot. Celui-ci nuit essentiellement à la liberté de la respiration, en empêchant l’élévation des côtes et leur dilatation, ainsi que les mouvements connexes du diaphragme au moment de l’inspiration. La quantité d’air qui pénètre dans les poumons est insuffisante, l’enfant éprouve le besoin de respirer plus souvent, et il peut conserver toute sa vie une respiration courte et gênée », sans compter que la capacité réduite de la cage thoracique entraîne un véritable rachitisme pulmonaire, particulièrement favorable à l’éclosion et au triomphe de la tuberculose... Quant à la chaleur vitale, comme si elle était compatible avec une circulation paralysée !
La survivance obstinée du maillot, sous ses formes plus ou moins adoucies, tient, en même temps qu’au préjugé, au désir de tranquillité des mères. L’usage du maillot les dispense de la surveillance et à moins de crises intempestives, s’accommode d’un élargissement à heure fixe. Ce qui n’empêche pas qu’on nous a chanté la propreté qu’il assure. Comme si, derrière cet accoutrement, se pouvaient soupçonner, au moment opportun, les besoins de l’enfant ! Les évacuations excrémentielles se produisent, la plupart du temps, sans qu’on s’en aperçoive et seules les décèlent ou l’avertissement de notre sens olfactif ou la plainte du patient embrené, comme eût dit Rabelais. D’autre part, la nourrice a tendance à tergiverser devant cette opération toujours compliquée de l’assemblage à défaire et à refaire. Elle hésite, recule et l’attente est toujours préjudiciable à l’enfant. Au lieu de la propreté qu’on nous promet, c’est surtout (dans une région déjà débilitée, appauvrie par le manque d’air) l’inflammation des muqueuses au contact des matières fécales, et les excoriations, fréquentes, consécutives...
On connaît les anathèmes de Rousseau contre ces liens funestes, opposés à la croissance du sujet. Ils ont porté à la forme la plus rigoureuse du maillot un coup mortel. Nous ne pouvons que les reprendre avec force et nous insurger encore contre ses derniers vestiges. La coutume, nous le savons, a jeté du lest. On enroule les bandelettes avec moins d’acharnement. Les bras ont échappé aux honneurs de la ligature. Mais les langes multipliés continuent à paralyser les mouvements et à priver d’oxygène un épiderme sacrifié. Les jambes végètent toujours « à l’étouffée » et les draperies ingénieuses ‒ la gloire des mères s’y complaît ‒ épousent encore des formes impatientes.
L’ensemble du maillot actuel ‒ dit « français » ‒ se compose d’une chemise et de plusieurs brassières et d’une sorte de long étui « formé d’une serviette de linge dite « couche », dans les plis de laquelle on enveloppe séparément les jambes, et, par-dessus, d’un ou deux langes d’étoffe épaisse de coton ou de laine ». Le tout, enroulé autour du corps, à la hauteur des bras, avec ses bords superposés, épinglés selon la ligne du dos et le bas replié droit, a ainsi l’allure d’un sac. C’est dans ce fourreau, plus ou moins serré selon le caprice ou le « savoir » des mères ou des nourrices, que l’enfant accomplit, encore de nos jours, si je puis user de ce terme sans ironie, sa première étape dans la vie. À cet équipement... modernisé, certains substituent, soit dès les premiers temps, soit pour faire suite au précédent, un maillot ‒ anglais, cette fois, ‒ qui consiste principalement en un vêtement fait d’une robe ouverte devant et sans manches, avec deux couches triangulaires (l’une de toile, l’autre de laine), formant culotte.
Déjà, depuis longtemps, sous la pression du bon sens, allié à une meilleure connaissance de notre organisme, des médecins (Drs Périer, Foveau de Courmelles, etc.), ont préconisé l’emploi du « maillot modifié », mais ils n’ont conseillé qu’avec timidité l’adoption de la méthode que pratiquent l’Angleterre et l’Amérique et dont nous avons souligné la simplicité judicieuse et les bienfaits à propos des « nourriceries », du Familistère de Guise. Ce procédé consiste à placer l’enfant dans le son où il s’ébat à son aise et d’où ses déjections sont facilement expulsées, quitte, dans les régions froides ou pour certaines natures débiles (qu’on entraînera d’ailleurs progressivement) à l’envelopper la nuit dans quelque chaud lainage suffisamment lâche où dans une pelisse appropriée à l’âge et à la saison. L’enfant grandissant, le vêtement se fera moins incommode, deviendra le petit manteau occasionnellement protecteur sur les robes courtes, légères et flottantes... On peut, on le voit, concilier la liberté des mouvements et les exigences de la croissance, obtenir la température suffisante et en commander l’équilibre, sans étrangler, comme à plaisir, les fonctions organiques.
Il n’y a pas si longtemps ‒ pour une fois, sous nos yeux, la mode s’est trouvée, assez tardivement, d’accord avec la nature ‒ que le corset tenait dans son étau le buste féminin et que les fillettes, sous prétexte de soutien... préalable, en connaissaient le supplice, bien avant la puberté. Ainsi se prolongeait le maillot première prison de l’enfance et symbole précoce d’esclavage physique... et moral.
‒ S. M. S.
MAIN
n. f. (latin manus)
« Organe de préhension, siège principal du toucher, qui termine le bras de l’homme et de quelques animaux. » (Larousse)
Des savants (Owen, P. Gratiolet) ont voulu définir l’homme comme étant le seul animal possédant deux mains et deux pieds. À ces prétentions, Huxley répond par cette objection que, d’une part, chez l’homme, c’est la civilisation qui a accentué les différences, nullement radicales à l’origine, du pied et de la main ; et que, d’autre part, c’est à tort qu’on dit le singe quadrumane, le membre postérieur du gorille se terminant par un véritable pied ayant un gros orteil mobile :
« Ce pied, dit-il, est préhensile ; mais le pied des résiniers des Landes, selon Bory de Saint Vincent, le pied d’une femme de race blanche que Trémaux a vu retombée à l’état sauvage en Afrique, le pied toujours nu de l’homme qui marche dans des terres hérissées d’obstacles ou qui grimpe à des arbres fort branchus, présentent de petits orteils plus longs et un gros orteil en même temps plus écarté et plus opposable. »
Le pied possède, avec la main, quelques différences caractéristiques, telles : la disposition de l’os du tarse, la présence des muscles courts fléchisseurs et extenseurs, l’existence du long péronier qui assure la solidité du gros orteil et en fait l’ordonnateur des mouvements du pied. On trouve ces particularités dans le pied des singes anthropoïdes. « Il suffit, dit à ce sujet le Dr Duchenne, que les muscles de la racine du pouce soient atrophiés dans une main d’homme pour qu’elle présente un caractère simien »...
Renvoyant aux ouvrages spéciaux pour une étude anatomique de la main, pour diverses connaissances connexes, biologiques ou autres, ainsi que pour les considérations plus particulièrement dépendantes de l’anatomie comparée, et pour tant de curieux éclaircissements auxquels le transformisme a donné l’essor, nous nous contentons de consigner, ici, quelques observations générales, allant de l’anatomie à la psychophysiologie et que nous estimons typiques, et de marquer sommairement combien le rôle important joué par la main dans les mouvements de l’homme, a eu de rapports avec son évolution générale et a tourné vers elle une attention qui participe de tous les domaines de l’activité intellectuelle.
Helvétius disait :
« C’est à la main, cet instrument des instruments, que l’homme doit toute son adresse et les arts qu’il exerce, enfin sa supériorité sur tous les animaux. »
Et il ajoutait :
« Si l’homme avait eu un sabot à l’extrémité de son bras, il n’aurait jamais fait un progrès. »
Il y a, dans cette opinion, une part de vérité que le transformisme a mise au point. Sans rechercher ici la supériorité première de tel ou tel organe humain, nous pouvons dire que la question d’attribuer au cerveau ou à la main les raisons de la prodigieuse avance réalisée par l’homme sur les espèces environnantes comporte, si elle est tranchée systématiquement en faveur de l’un ou de l’autre, un absolu que contredit l’évolution.
La suprématie lointaine de l’homme (dont le départ remonte sans doute à quelque cause accidentelle) servie par certaines conditions initiales, des circonstances primitives favorables, a entraîné peu à peu toute une série de répercussions réciproques entre ses organes. Le besoin (entre autres la nécessité de répondre aux exigences d’organes plus avancés), a hâté maints développements et provoqué d’heureuses conformations. Le mouvement lui-même, l’usage fréquent, les fonctions nouvelles ont accentué la puissance des plus actifs. Parmi ces derniers, l’organe coordinateur par excellence : le cerveau, toujours porté à concevoir d’ingénieuses transformations, des œuvres toujours plus délicates, et la main, plus apte que tout autre par sa position et sa mobilité, à en faciliter l’exécution, ont entretenu des rapports constants. Et les réalisations et les possibilités excitant de nouvelles exigences, il s’en est suivi entre eux comme une émulation incessante et une course parallèle, toujours plus rapide, vers leur perfectionnement. À tel point qu’aujourd’hui, au degré de complexe capacité auxquels ils sont parvenus et que leur entente persistante accroît sans arrêt sous nos yeux, il apparaît que la réduction à l’impuissance, à un moment de l’évolution, de l’un de ces facteurs essentiels du progrès, eût entraîné pour l’autre une véritable paralysie. Une coordination continue et un mutuel appui nous rendent difficile de concevoir la marche de l’un privé du secours de l’autre. Quelle qu’eût pu être clans cette conjoncture le sens du développement de notre espèce, qui eût subi, nous semble-t-il, quelque grave stagnation mais qui peut-être eût trouvé à s’agrandir dans une autre voie, nos constatations actuelles nous permettent de noter entre les progrès de la pensée et la dextérité avertie de la main des relations qui comportent des portions multipliées de causalité. Une innervation particulièrement ramifiée et harmonique atteste, par sa structure même, l’abondance des échanges et une connivence pour ainsi dire toujours en éveil. Et le magnifique épanouissement des arts et cette floraison moderne d’appareils mécaniques sont parmi les fruits les plus beaux de cette heureuse collaboration...
Pour en revenir (et conclure à cette occasion) à l’argument avancé par Helvétius, notons, en effet, « que l’intelligence du cheval participe des conditions inférieures de son pied, et qu’il est certain qu’une maladie qui convertirait la main de l’homme en sabot aurait pour effet récurrent » sinon d’abaisser son esprit au niveau de celui du cheval, du moins de le frapper d’une sorte de stupeur plus ou moins prolongée et de faire dévier son orientation. « L’homme ne doit sa supériorité ni à sa main, ni à son cerveau, ni à tel ou tel organe, mais à l’unité plus complète des différentes pièces de son organisme. Avec des éléments à peu près pareils, inférieurs souvent » (en tant que puissance directe par exemple) « il conçoit et réalise plus de rapports. La réciprocité de ses organes est plus grande et ils se perfectionnent l’un par l’autre » (Larousse). Quelle richesse majestueuse que celle du cerveau humain ; mais que de merveilles dans une simple main !
L’importance des aptitudes de la main et ses services multiples, son intervention courante dans les manifestations de la vie ont entraîné, dans tous les temps, des interprétations où la fantaisie n’a pas manqué de prendre une large part. La cabalistique, la chiromancie, secondées par l’astrologie, y ont cherché ‒et y recueillent encore ‒la marque de nos caractères et le secret de nos destinées. Conformation de la paume et des doigts, ampleur et saillie des masses musculaires (monts de Vénus, de Mars), disposition des lignes (étoiles, croix, brisures) etc., autant de signes ou d’indices, sans valeur pour les profanes, mais où les initiés poursuivent implacablement notre horoscope...
Les attributions vont de la superstition, habilement exploitée, ou sincèrement mise au service de « presciences » prestigieuses, à la science, encore enfantine, des empreintes (souvenirs, prédispositions, etc.) que laisse dans nos organes le jeu de nos facultés. La chirognomie prétend au diagnostic moral de la main. Psychiatres, aliénistes lui demandent des indications sur l’état intellectuel, les caractéristiques mentales des sujets qu’ils soignent ou étudient.
Les travaux des Dally, des Lucas concordent sans entente préalable, avec les anciennes idées des Égyptiens, mentionnées par Macrobe, et avec les rénovations de Paracelse sur l’importance physionomique de la main. De certaines formes très spatulées des doigts, d’Arpentigny, après Hippocrate, induit à la phtisie. De spéciales dispositions anatomiques externes témoignent, nous dit-on, des mauvaises conditions dans lesquelles opèrent des agents précieux en dépit de leur petitesse. Doigts ronds, boudinés : insuffisante fonction des filets nerveux. Bout des doigts plat, ridé, fendu : mauvais état des papilles. Absence des mamelons de la paume (les « monts » de la chiromancie !) : rareté ou chétivité des corpuscules de Paccini, siège par excellence du tact. D’autres rapprochements : (pouce court et prédominance des instincts, racine du pouce ridée en grille et lubricité, premières phalanges fendues et défaut d’idéalité), sont des signes déjà consignés dans les antiques chiromancies et ils montrent celles-ci dotées d’une part non négligeable d’observation.
Que d’autres traits, que d’indices réels ou imaginaires, rigoureux ou amplifiés ne relève-t-on pas dans la façon de tendre la main, de donner une poignée de main, de lever la main pour prêter serment, etc... Dans la rencontre plus étroite des corpuscules de Paccini, dans le geste des doigts enlacés et des paumes jointes, dans celui des mains imposées sur le front ne déduit-on pas, là un rapport d’union, de concorde, ici de puissance dominatrice, de suggestion, de guérison ?... Les écrivains (et au premier rang les romanciers) ont usé d’images où les mains viennent comme révéler ou traduire soit les états d’âme, les desseins de leurs personnages, soit seulement leurs tendances ou les influences majeures de la physiologie ou du caractère. Il y a pour eux des mains « bêtes, gourdes, brutales et des mains bonnes, belles et fortes ». Les mains crispées, griffues, agrippantes d’un Grandet, et les mains douces, déliées, caressantes de quelque héroïne charitable ont pour eux, chacune, leur éloquence terrible ou apaisante...
De la physionomie de la main à son éducation, il n’y a qu’un pas. Et Buffon l’avait esquissé qui écrivait, nous ramenant d’ailleurs aux gains réciproques du cerveau et de la main dans leur commerce attentif, intelligent, méthodique :
« Un homme n’a peut-être plus d’esprit qu’un autre que pour avoir fait, dans sa première enfance, un plus grand et plus prompt usage du toucher ; dès que les enfants ont la liberté de se servir de leurs mains, ils ne tardent pas à en faire un grand usage... Ils s’amusent ainsi ou plutôt s’instruisent de choses nouvelles. Nous-mêmes, dans le reste de la vie, si nous y faisons réflexion, nous amusons-nous autrement qu’en faisant ou en cherchant à faire quelque chose de nouveau ? »
« Étonnez-vous que tous les hommes remarquables aient été des « touche-à-tout » dans leur enfance, et qu’il y ait si peu d’hommes normaux et complets qu’on les regarde comme des phénomènes ! Le simple fait de prendre une plume, c’est-à-dire de la serrer entre les doigts, glace les hommes superficiels et excite les hommes de pensée à réfléchir plus et à exprimer mieux... Tout le monde comprend que l’index est le doigt qui, mieux que les autres, indique la route ; que le médius est lourd et immobile... Avant d’être un compas la main a été, crispée, une pince et fermée : un marteau. Avant de modeler, de peindre et d’écrire, elle a brisé, fendu et lacéré. Avant d’être des points d’appui qui servent à la précision du tact, les ongles ont été des griffes. La main a suivi son évolution ; elle a eu son histoire... » (Larousse)
Et nous voici arrivé au dualisme séculaire de nos mains, sœurs inégales, dont le rythme instinctif, dans certains mouvements (apprentissage de l’écriture, gymnastique, etc., etc.), révèle pourtant le parallélisme des moyens. À l’une, la droite, nous avons ‒fortuitement, sans doute, à l’origine, sinon par prédisposition, puis par la répétition logique d’un rappel là où se sent déjà une expérience, une propension acquise, un moindre effort non seulement d’exécution de la part de l’artisan, mais de commande et de surveillance de la part de l’impulseur ‒nous avons accordé la prééminence. Et les ans ont entretenu, consacré (de dextre, n’a-t-on pas fait dextérité, habileté, talent ?), ils ont porté à un tel point la supériorité habituelle de la main droite que l’autre apparaît comme la sœur inférieure, frappée d’incapacité ‒j’allais dire de gaucherie ‒invétérée. Et pourtant, au lieu de cette servante malavisée, à peine en état de tenir un second rôle, d’accomplir une tâche de complément, nous pouvions avoir, dans nos multiples travaux ‒ csont près d’y atteindre ‒deux aides également adroites et fortes, dociles et empressées ? N’est-ce pas le délaissement auquel nous l’avons condamnée, la condition de manœuvreà laquelle nous l’avons réduite qui ont fait de notre main gauche une auxiliaire embarrassée, entachée de considération subalterne ? Et ne pouvons-nous dire, avec Maquel, que « c’est un véritable préjugé que de croire qu’on doive tout faire de la main droite ? »
Cette préférence que l’homme donne à sa main droite sur sa main gauche a-t-elle sa source, comme le prétendent certains, dans « une prédominance naturelle accentué du côté droit sur le côté gauche ? » La main droite a-t-elle bénéficié de cette particularité de l’organisation et le premier appel à son concours participe-t-il d’un instinct déjà averti et disposé à accorder plus de confiance et à fonder plus de sécurité dans cette portion privilégiée de l’organisme ? Faut-il chercher en lui ‒ou seulement dans quelque hasard ‒le point de départ d’un recours qui souffre aujourd’hui de rares exceptions ? Si les qualités secrètes de l’organisation ont ici favorisé l’éclosion d’habitudes consécutives à un premier emploi, il est évident qu’elles en ont recueilli un renforcement correspondant... Quant à la main droite, appelée à l’exercice fréquent et régulier, elle en a retiré promptitude, adresse et vigueur. Et c’est elle qui, presque universellement, coopère aux ouvrages les plus remarquables conçus par l’esprit humain. Mais ce degré d’habileté et cette multitude de services ne doivent-ils pas justement nous faire regretter tous ceux que nous pourrions obtenir aussi de notre main gauche qui, « douée de la même organisation, aurait les mêmes talents si l’éducation les lui donnait ? » Pourquoi l’homme délaisse-t-il, sur le chemin de la perfection, un instrument aussi précieux à sa portée ?
Admettons qu’il faille, pour former notre main gauche, vaincre quelque faiblesse originelle ? Est-ce le seul cas où l’homme ait triomphé d’un tel obstacle ? Difficulté toute relative d’ailleurs, dès le commencement, et qui bientôt s’évanouirait « d’autant mieux que, par les leçons que reçoit la main droite, la gauche contracte une secrète aptitude à reproduire les mêmes mouvements, et que, déjà façonnée par les vives impressions du cerveau, elle est pour ainsi dire imitatrice, avant qu’elle ait réellement imité ». (Larousse). N’avons-nous pas, autour de nous, des faits qui prouvent combien cette initiation pourrait être rapide ?
« Un habile dessinateur perd la main droite et, au bout de deux mois, il écrit et dessine de la gauche avec la même facilité. Que ne peut d’ailleurs la volonté mue par le besoin ? Un homme qui n’a point de bras transforme ses pieds en mains (exemple, le peintre Ducornet) et fait avec eux des prodiges d’adresse. Or ce que l’homme fait par force, Il faudrait qu’il le fît par sagesse, et que sa raison eût sur son esprit le même empire que la nécessité. »
« Cette distinction physiologique entre la main droite et la main gauche a exercé des influences de plus d’un genre sur les idées et les usages de l’homme et, pour la race aryenne en particulier, ces influences nous apparaissent dans les temps les plus reculés. Dans les idées mythiques et sacerdotales de cette race, la force et l adresse sont l’apanage de la main droite, qui se trouve ainsi chargée des principales fonctions actives. C’est cette main qui préside au travail et au combat qui manie également les outils et les armes. De là les idées d’estime et même de respect qui s’associent à tout ce qui la concerne ? Elle devient le symbole de la rectitude, le gage de la sincérité, le signe de l’honneur. Les idées contraires s’attachent naturellement à la main gauche, et les unes comme les autres s’appliquent de plusieurs manières aux rapports sociaux, aux usages cérémoniels ou religieux, aux croyances superstitieuses, etc. De plus, chez les peuples primitifs et, même encore chez les Grecs et les Romains, par suite de son infériorité naturelle, la main gauche se trouvait chargée tout spécialement des fonctions impures ou malpropres qui auraient souillé la main droite et déshonoré la dignité de son rôle. De là l’habitude de tenir la main gauche sous le manteau et de ne jamais offrir que la droite. »
(Aujourd’hui encore il n’est pas de bon ton d’offrir la main gauche ; pour certains, ce geste s’accompagne de mépris ou en tout cas d’une insuffisance de considération dont ils s’offusquent).
« Il en est encore de même chez les Turcs, et c’est probablement aussi par suite des mêmes idées que les Romains attachaient à la main gauche une idée de sinistre augure. Il est curieux de retrouver ces scrupules chez les nègres de la côte de Guinée. Suivant Lanoye, ils ne se servent pour manger que de la main droite, toujours bien entretenue, tandis que la gauche est destinée aux usages immondes. » (Larousse)
En même temps qu’elle nous rendrait maîtres de moyens physiques étendus, l’éducation de la main gauche, en la réhabilitant, débarrasserait les esprits et les mœurs de croyances et de coutumes faites de tradition superstitieuse. Rendons-lui donc, au prélude même de la vie, une place digne d’elle. Faisons appel à tous les éléments, à toutes les vertus inévoluées que nous laissons sottement dormir en elle ? Élevons-la à la dignité première, sur le même plan que notre droite... Sur moi-même et sur des enfants confiés à mes soins j’ai expérimenté cette éducation et j’ai mesuré combien elle pouvait donner. En dépit d’un lourd atavisme, la main gauche, chez les petits, ne demande qu’à s’employer. Elle s’offre avec une spontanéité pleine de promesses. Et elle les tient quand nous insistons. Et les résultats personnels que j’ai enregistrés sur ce point sont suggestifs. Pour l’écriture, au jeu, au travail, garçons et fillettes, autour de moi, donnaient libre essor à la bonne volonté délaissée de leur main gauche. Et elle nous montrait vite combien était justifiée la confiance mise en elle... Les gauchers ne sont pas rares d’ailleurs dès la première enfance, mais on les refoule. Par un coup d’œil, une face courroucée, la grosse voix, par des tapes sur la « menotte » déconsidérée, on fait lâcher au bébé le jouet ou la cuiller saisis par la main gauche. À mesure qu’il grandit les défenses se codifient ; on invoque la coutume, la politesse, la bienséance, etc. (ce n’est pas beau, ou convenable, ou propre !) que sais-je, et notre gauche repoussée ne résiste pas. Pourtant, porté moi-même dès le jeune âge à revendiquer ses services (et contrarié sur ce point, à l’époque, il va de soi, par la famille) je suis revenu, systématiquement, à l’emploi de mes deux mains, un emploi aussi régulier, aussi équilibré que possible, et je n’ai eu qu’à me louer d’avoir, ici encore, surmonté les préjugés et les habitudes néfastes pour regagner une situation normale et des conditions naturelles. Combien de personnes accidentées, privées ‒momentanément ou à jamais ‒de l’usage de leur main droite, ont regretté qu’on n’ait autour d’eux ‒et qu’ils n’aient eux-mêmes ‒davantage estimé leur main gauche !
Nous pourrions, puisque nous en sommes aux réhabilitations, nous attacher à relever ‒s’il en est besoin encore auprès de ceux qui nous lisent ‒le travail des mains, regardé comme indigne ou inférieur par les aristocrates et par certains intellectuels. À ce dernier mot, nous avons montré, et tout près encore, à manuel, nous rappellerons qu’il n’y a pas de tâche dégradante lorsqu’elle accroît le patrimoine et sert la vie et le bonheur des hommes et que, du plus fruste et du plus humble effort, de la plus grossière comme de la plus « méprisée » des occupations, dans l’activité des mains calleuses et des mains noires ‒dont le labeur nourrit notre corps ! ‒résident en puissance, une dignité et une valeur morale égales à celles des travaux les plus glorieux de l’esprit.
* * *
Voici quelques locutions courantes dans lesquelles entre le mot main :
-
Avoir de la main : être adroit, exécuter avec habileté. Reybaud dit : « La main est nécessaire chez le peintre, mais le goût l’est bien davantage. Rien n’est plus aisé que de se gâter la main. »
-
Large comme la main : de peu d’étendue.
-
La main de l’homme : son travail.
-
Les croyants sont courbés sous la main de Dieu : symbole ici de puissance, d’autorité.
-
On désigne aussi par ce mot l’effet d’Influence, la force : la main de la nature, de la destinée : « Il n’y a, a dit E. de Girardin, que la main de la liberté qui puisse dénouer le nœud des nationalités. » Et Voltaire : « La main lente du temps aplanit les montagnes. »
-
Le gouvernement, la maîtrise : Charles Nodier parle de « la main digne qui brisera le fer de la guillotine. »
-
La manière de commander : intervenir d’une main ferme, ou légère.
-
La protection, le soutien, la consolation : essuyer « d’une main secourable » les larmes d’un ami. « Belles petites mains qui fermerez mes yeux » a dit Verlaine.
-
La possession, la disposition : Les idées sont des fonds qui ne portent intérêt qu’entre les mains du talent. (Rivarol)
-
Être nu comme la main : dépouillé.
-
Pas plus que sur la main : manque, pénurie ‒Ne pas y aller de main-morte : frapper rudement.
-
Biens de mainmorte : appartenant à des gens réunis en communauté, lesquelles, par le renouvellement constant de leurs membres, échappent aux règles ordinaires des mutations de propriété.
-
Avoir la main légère : ne pas s’appesantir, être habile : Les femmes ont la main plus légère que les hommes pour panser les plaies.
-
La main leste (ou légère) : être prompt aux coups, au rapt ‒La main sûre. Mettre en mains sûres : de confiance, il une personne probe ‒Un outil bien à la main : d’un usage commode.
-
Avoir toujours la bourse à la main : être prompt aux dépenses ‒Mettre l’épée à la main : combattre.
-
Ouvrage de main d’homme : par opposition à ceux de la nature ‒Main-d’œuvre : voir ce mot.
-
Y mettre la main : entreprendre, collaborer, participer, et aussi s’immiscer :
Chacun y veut mettre la main. (A. BARBIER).
-
Mettre la dernière main : achever. Mettre la main à... : apporter son concours.
-
Travail des mains : occupations, besognes manuelles : « L’homme vraiment utile à la société est celui qui vit du travail de ses mains. » (J. Macé)
-
Faire par ses mains : soi-même, par ses propres moyens.
-
Tour de main : tour d’adresse ; se dit aussi d’une action rapide : cela sera fait en un tour de main.
-
Forcer la main : contraindre.
-
Main basse : main gauche ; gens de basse main : la lie de la population (deux vieilles locutions).
-
Faire main-basse : s’emparer.
-
Avoir les mains crochues : enclines à la rapine.
-
Tenir la main à quelque chose : y veiller, s’en occuper activement.
-
On dit aussi : former de ses mains sa destinée, adage qui n’est que partiellement exact.
-
Prendre de toutes mains : sans s’inquiéter de l’origine. « L’Église est en possession de demander de toutes parts et de prendre de toutes mains. » (Dupin)
-
Jeu de mains : brutaux.
-
De main de maître : à la perfection.
-
Être à toutes mains : apte à toutes les besognes.
-
Avoir la riposte, la parole en main : être prompt à la réplique, avoir l’élocution facile.
-
Donner la main : aider.
-
Prêter les mains à... : condescendre, se faire complice.
-
Prendre en main une cause : défendre.
-
Élever les mains vers quelqu’un : implorer.
-
Ouvrir les mains : se déposséder.
-
Pousser la main : exercer une pression.
-
Tenir la main haute : veiller, se montrer exigeant.
-
L’emporter haut la main : sans peine, avec une avance marquée.
-
Avoir la main heureuse : avoir de la chance ; les mains nettes : être honnête.
-
Avoir le cœur sur la main : être généreux.
-
Mettre la main sur le feu : être convaincu.
-
Se donner la main : être aussi filous l’un et l’autre.
-
Se tenir par la main ou se tenir la main : aller de concert, dépendre l’un de l’autre. « L’ignorance et l’opiniâtreté se tiennent par la main. » (La Rochefoucauld)
-
Il n’y a que la main : un rien de différence. « D’intendant à fournisseur, il n’y a que la main. » (Balzac)
-
Avoir les mains longues (on dit plutôt aujourd’hui : le bras) : avoir de l’influence.
-
Mettre la main à la pâte : besogner.
-
Sous la main : à portée.
-
À main (droite ou gauche) : direction.
-
Des deux mains : avec empressement, etc.
Proverbes :
-
« Froides mains, chaudes amours » (corrélation populaire entre la froideur des mains et le tempérament amoureux).
-
« Que la main gauche ignore le bien que fait la main droite » (rendez service avec simplicité, sans faire étalage de votre obligeance et n’en tenez pas étroitement registre).
-
« Dieu regarde les mains pures plutôt que les mains pleines » (un proverbe qui doit faire trembler de multiples « chrétiens » à l’heure de « comparaître »... ).
-
« Un oiseau dans la main vaut mieux que deux dans la haie » (Prov. anglais équivalant à notre « Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras »), etc..
* * *
-
Main (subst.) pap. cahier de 25 feuilles.
-
Petite main (artis.) : ouvrière sortant d’apprentissage.
-
Main de roi, main souveraine (droit ancien) : souveraineté.
-
Main de justice : autorité judiciaire : un emblème portait aussi ce nom ; on disait aussi main pleine, main moyenne, etc..
-
Main bote (pathol.) : difformité palmaire ou dorsale.
-
Main de gloire, main de Fatma, etc. : amulettes, objets de superstition.
-
Main de fer (mar.) : poignée avec crochet d’abordage.
-
Main courante (escalier) : partie supérieure de la rampe sur laquelle glisse la main.
-
Main du diable (zool.) : nom vulgaire de divers corollaires-alcyons, etc..
‒ LANARQUE.
MAIN-D’ŒUVRE
n. f.
Nous n’examinerons ici que la main-d’œuvre telle que ses conditions, son utilisation, sa valeur et les conséquences de son estimation se posent dans le régime actuel de la production. Nous laisserons à ce dernier mot, ainsi qu’à travail et autres mots connexes, l’étude de la contribution du travail dans l’avenir ‒ de la main-d’œuvre dans son sens élargi ‒ et du rythme prévu de sa participation en vue du rendement nécessaire à une production équilibrée.
Le Larousse donne cette définition de main-d’œuvre : « Travail des ouvriers dans la confection d’un ouvrage. » « Le prix de main-d’œuvre, joint à celui des matières premières, établit la valeur intrinsèque d’un objet manufacturé » (Lenormant) ‒ Prix payé pour le travail dans un ouvrage quelconque. (Pluriel : des mains-d’œuvre) ‒ Encycl. (Econ. polit.) : « La main-d’œuvre est le travail de l’homme appliqué à la production ou à la transformation des choses ; extrêmement variable quant à son prix, elle est un des éléments de la valeur définitive des fabrications, des constructions, des cultures, etc. » ‒ La question de main-d’œuvre est complexe ; deux intérêts parallèles tendent constamment à son abaissement : celui de l’entrepreneur, qui bénéficie de l’écart entre le prix de revient (où la main-d’œuvre joue le plus souvent le rôle principal) et le prix de vente ; celui du consommateur (naturellement intéressé à acheter au tarif le plus bas), lequel, la concurrence aidant, fait baisser proportionnellement le prix de vente. Mais un intérêt antagoniste des deux précédents tend au contraire, à faire hausser le prix de la main-d’œuvre, c’est l’intérêt de l’ouvrier. Dans cette lutte inégale entre l’ouvrier et l’entrepreneur, (celui-ci représentant ‒ après lui-même ‒ le consommateur), la victoire n’appartient presque jamais à l’ouvrier.
L’entrepreneur doit peser deux facteurs : son bénéfice personnel dans l’œuvre en cours et la satisfaction de la clientèle pour les commandes futures ; ces deux facteurs étant influencés eux-mêmes par la concurrence. À cela s’ajoute, souvent encore, le rapport de l’argent employé. Pour tenir haut son intérêt tout en ménageant le consommateur, l’entrepreneur est porté non à réduire son prélèvement, mais à diminuer la part de l’ouvrier. Compression grosse de risques, malgré l’état de dépendance du travail : exécution inférieure, intensité affaiblie, éloignement des capacités, pénurie même de la main-d’œuvre, grève ouverte ou perlée, etc. Cependant, il y a tendance à maintenir le taux de la main-d’œuvre aux alentours du niveau strict des besoins (voir salaire) et ceux-ci sont généralement sous-estimés. Il en résulte une baisse, accidentelle ou chronique dans l’effort effectif par suite de la répercussion, sur les possibilités physiques, d’une rétribution insuffisante (mauvaise qualité des aliments d’entretien, logement exigu et malsain, etc.) À ces défaillances, à ces affaiblissements, certaines entreprises s’emploient à parer, avec plus ou moins de succès, par une rigueur accrue dans la surveillance ou par l’introduction de procédés mécaniques qui enlèvent à l’ouvrier la latitude du relâchement (voir rationalisations), etc.
D’autres éléments, sans rapports directs avec la main-d’œuvre, peuvent avantager l’entrepreneur vis-à-vis du client : telle la fraude sur la matière ou les matériaux (nombre, qualité) employés, l’éviction de besognes préparatoires ou intermédiaires, etc., procédés aujourd’hui fréquents par exemple dans le bâtiment. Mais, d’une façon générale et pour ainsi dire systématiquement, la reprise déloyale, du côté du consommateur, n’empêche pas le resserrement des tarifs du personnel. En dehors de ces pratiques malhonnêtes et des économies, à la fois déraisonnables, inhumaines et souvent maladroites, que constituent les réductions de salaires, il est des dépenses que l’on peut réduire ou supprimer, dans les conditions actuelles de la production : introduction de certaines machines qui allègent la tâche et accroissent le rendement, sans mécaniser l’ouvrier, suppression des forces mortes, des débours improductifs, contrôle et choix avisé des méthodes, plans simplifiés d’opération, réduction des pertes secondaires, etc.
La comparaison et les réflexions de Larousse, quant au ménagement et à la rétribution de l’ouvrier, ‒ toutes tendances à l’équité insuffisantes et relatives, mais difficiles et souvent impossibles à réaliser sans toucher au fond même du système de production ‒ ne manquent ni de bon sens, ni de piquant « Un laboureur, dit-il, a deux façons de réduire la dépense que lui occasionnent ses bêtes de labour : diminuer leur nourriture et augmenter leur travail ; mais, s’il est intelligent, il saura que ni l’un ni l’autre procédé ne conduisent à des résultats véritablement économiques, et qu’en tout cas leur association aurait des conséquences fatales. Bien plus fatales seraient les conséquences si les bœufs du laboureur avaient la faculté de discuter la conduite de leur maître et de s’insurger contre ses exigences tyranniques. La nécessité d’entretenir la santé et la satisfaction de l’ouvrier s’impose donc à l’entrepreneur dans la question de la main-d’œuvre. Le bon marché à outrance a des résultats anti-économiques et antisociaux, et lorsqu’on est appelé à utiliser le travail des hommes, on est tenu d’être au moins aussi intelligent qu’un simple bouvier ». Paroles que méditeraient avec fruit nombre d’employeurs modernes, mais ils s’en gardent généralement, même quand leur intelligence le leur permet.
Nous avons vu que la main-d’œuvre est un facteur de premier ordre dont l’exploitation est obligée de tenir compte pour établir le profit à tirer. Le capitaliste n’a souvent d’autre mal que de fournir l’argent indispensable à l’acquisition de la matière première de l’objet à confectionner ou du produit à travailler. L’entrepreneur, intermédiaire aujourd’hui regardé comme indispensable à l’exécution des travaux, est appelé à une plus grande dépense d’énergie et il s’emploie parfois avec activité pour arriver à obtenir des bénéfices satisfaisants. Mais l’un et l’autre ont intérêt ‒ et c’est le point aigu des conditions courantes de la production ‒ à ce que la main-d’œuvre revienne au plus bas prix.
Cependant la main-d’œuvre ‒ le travail ‒ est le principal facteur : celui dont la valeur intrinsèque est la plus grande, malgré qu’il ait tendance à être le plus méprisé. Le capitaliste peut disparaître avec son système, l’entrepreneur devient un rouage inutile, au moins dans son ensemble, dans un régime où les travailleurs seraient les seuls organisateurs du travail, comme les producteurs le seraient de la production. Mais la main-d’œuvre demeurera toujours, malgré que le travail manuel proprement dit s’efface toujours davantage devant la machine comme transformateur des choses. D’une estimation plus régulière serait alors la main-d’œuvre, enfin située dans son cadre exact et avec sa portée normale. Elle n’entrerait en discussion dans l’établissement du « revient » que pour définir le temps nécessaire à l’achèvement d’un travail et pour calculer le nombre d’ouvriers qu’il serait utile d’employer pour y parvenir. En admettant à la rigueur que le salaire subsiste (si l’on peut encore donner ce nom aux bons de travail, ou coupons d’échange ou à tout autre procédé en usage dans un système à base socialiste) il s’agirait simplement d’en examiner le montant collectif pour le travail accompli, et, l’accord établi sur le chiffre rémunérateur de la main-d’œuvre entre producteur et consommateur (deux conditions qui s’interpénètrent étroitement dans une société rationnelle et cessent de se contrarier et de s’opposer), le montant du travail serait également réparti entre tous les ouvriers. Ainsi la main-d’œuvre serait équitablement et logiquement rétribuée et la consommation, mise en contact direct avec la production et pénétrée de leurs rapports constants, verrait s’établir la valeur du produit, non plus au détriment de la main-d’œuvre et suivant la fantaisie du fabricant ou du vendeur (des deux la plupart du temps) mais sur confrontation des exigences légitimes du travail et du calcul exact des frais généraux.
Mais la main-d’œuvre n’est pas encore parvenue à ce stade heureux de juste appréciation. Il est donc nécessaire que ceux qui la constituent opposent une résistance constante et solidaire aux empiètements des appétits adverses. Si les avantages ainsi conservés ou arrachés ne sont que des adoucissements provisoires, bons seulement à rendre possible la vie et la lutte, si les réformes en elles-mêmes, avec leur contre-partie de vie chère et de difficultés nouvelles, ne sont qu’un va-et-vient de perte et de reprise sans portée sociale durable, un véritable piétinement économique et, somme toute, un leurre, elles constituent une réaction d’ordre quotidien indispensable et, bien situées, dépouillées de leurs illusions, elles sont susceptibles d’entretenir une cohésion et une combativité si nécessaires à la tâche révolutionnaire.
‒ Georges YVETOT.
MAISON
n. f. (latin mansio, demeure)
On a vu, aux mots architecture, habitation, logement ; on reverra à taudis, ville, etc., la plupart des aspects du problème de l’habitation : artistique, historique, technique, social, scientifique, hygiénique, etc., et le sens de l’évolution, particulièrement lente, du logement. Nous ne nous arrêterons donc à ce mot que pour quelques notes complémentaires, les sens spéciaux, et quelques locutions ou mots composés ‒ Maison se définit : un édifice construit en vue de l’habitation. Le bâtiment d’habitation peut ainsi comprendre plusieurs corps de logis, abriter plusieurs familles et maison se trouve avoir, sur ce point, un sens plus étendu que logement.
On a vu (architecture) que, pour l’Europe, les habitations les plus représentatives de l’art antique avaient été les demeures, de lignes tour à tour sobres ou luxueusement délicates, mais toujours d’une ampleur majestueuse, des grands de la Grèce et de Rome. Chaque civilisation eut ainsi ses types accusés dont le style général et la conformation extérieure d’une part, la distribution et l’aménagement d’autre part, accompagnaient à la fois le climat et les ressources naturelles, les mœurs et l’organisation publique et domestique. Comme les habitations de l’Inde ou de la Chine, de la Perse ou de l’Égypte, ou les constructions dispersées de la civilisation arabe, les maisons occidentales ou du proche Orient ont toujours reflété les préoccupations des maîtres opulents et non celles de la multitude dépouillée, celles de la classe riche ou aisée et non celles des parias. Question de prestige et de prédominance, de culture et de moyens, de loisir et d’exigences, d’importance et de degré d’élévation des fonctions ou des rapports publics et de la vie privée. Là, palais des rois, des princes et des chefs, demeures somptueuses à péristyle, à vestibules et à étages, avec plafonds ornés d’arabesques, lambris sculptés, mosaïques, et métaux ciselés. Ici, maisons patriciennes, avec atrium (pièce de réception), œcus, tahlinum... et chambres d’esclaves. Mais partout ‒ creusées dans le roc, ou soutenues par des quartiers de bois, des entassements de brique crue, avec, pour pavé, la terre battue ‒ les rudimentaires abris de la plèbe, le nid grossier du prolétaire, bête à labeur...
Les siècles ont maintenu l’écart, sinon quant aux matériaux, du moins quant à la puissance architecturale et au fini décoratif, à la cohésion durable et au confort interne. À côté des lourds castels aux pierres séculaires, imposant et vaste, solide et élégant sera encore, avec ses pans de bois et ses encorbellements (bientôt sa maçonnerie) l’habitat des corporations marchandes, des bourgeois du XIème au XVIème siècle, si on le compare au frêle abri, plus refuge que maison, où le vilain se blottit aux heures du repos. Depuis un siècle, les maisons se sont davantage diversifiées. L’aisance, sinon la fortune, s’est étendue à des fractions sociales jusque-là déshéritées. Les progrès de la locomotion, de l’industrie et de l’art de bâtir ont élargi les possibilités. Non seulement les grandes villes, mais les modestes cités et jusqu’aux bourgades rurales connaissent les maisons aux structures raffinées, mêlant les styles et les époques, cherchant l’éclat ou la commodité. Mais, s’il faut pénétrer dans les campagnes (où les habitations fixent encore le particularisme des anciennes provinces), pour retrouver la maison basse et le chaume du paysan, grosses agglomérations citadines comme humbles villages offrent toujours le contraste d’un noyau minime de belles et accueillantes maisons, par rapport aux masures ou aux casernes de l’ouvrier, au taudis du malheureux. Le pauvre a pris place, çà et là (bon pour « jouir » des derniers vestiges, des formes périmées) dans les maisons déclassées qu’ont laissées les riches après usure. Les bâtisses que le temps n’a pu jeter bas, mais lézardées, délabrées, véritables conglomérats d’insalubrités, reçoivent aujourd’hui les prolifiques familles du peuple. À lui, après la hutte de branchage ou la niche du troglodyte, après la cabane ou la chaumine enfumée, les logements resserrés des maisons de rebut, plus perfidement meurtrières...
* * *
Maison désigne aussi le ménage lui-même, les meubles : une maison bien tenue ; les gens y habitant (on dit aussi la maisonnée) ; la race, la descendance d’une famille : la maison des Guise, des Bourbon ; un séjour, une retraite : « L’homme est un mystère pour lui-même ; sa propre demeure est une maison où il n’entre jamais et dont il n’étudie que les dehors » (E. Souvestre). Dans maison de jeu, de santé, de retraite d’aliénés, de commerce, d’éducation, de tolérance (de prostitution) le deuxième nom indique la destination des maisons dont il est question. Maison d’arrêt : où l’on détient les prévenus ; de correction (voir ce mot) : où l’on enferme la jeunesse dite « coupable » sous prétexte de la « moraliser ». Maison commune : la mairie : Gens de maison : domestiques, etc.
Maisons meublées (ou garnies) : celles dont les logeurs offrent au public les pièces garnies de meubles et payables à la journée, à la semaine ou au mois. Fortement tarifées, dépourvues de commodités, privées de vie intime, les chambres meublées ‒ les meublés, comme on dit couramment ‒ sont souvent le logement de l’ouvrier trop pauvre pour « se mettre dans ses meubles » ou que le chômage ou la maladie, les revers ont contraint d’abandonner au Mont de Piété son mobilier et parfois ses hardes.
Maisons mortuaires. Ces établissements dont nous avons souligné l’utilité manifeste à propos des inhumations (voir ce mot) ont pour but de prévenir les enterrements prématurés. Inaugurés en Bavière, à la fin du XVIIIème siècle, ils sont aujourd’hui répandus dans les grandes villes d’Allemagne et de plusieurs autres États. Il est à peine besoin de dire que là encore, comme presque toujours lorsque l’on touche aux applications pratiques de la science, la France est très en retard sur l’étranger et que ces institutions sont chez nous à peu près inconnues. Elles provoquent sans doute le sourire de nos « connais-tout » superficiels qui portent ailleurs leur sollicitude. Rappelons que, dans ces chambres les corps des décédés sont déposés sur une sorte de lit incliné, visage et poitrine découverts, et « l’un des doigts passés dans l’extrémité d’un fil de soie correspondant à une sonnerie placée dans la chambre des veilleurs ». Le nombre de personnes arrachées par ces moyens à une mort atroce a déjà suffisamment justifié l’intelligence et l’humanité de ces précautions.
Maison du roi (hist.) Officiers de la couronne, personnalités nobiliaires attachées à la personne du souverain ou aux charges de la cour, souvent même aux affaires du royaume, comme sous les Capétiens. Les rois de France avaient leur maison civile (clergé, chambellans, maîtres d’hôtel, intendants, officiers d’écurie et de vénerie, maîtres des cérémonies, etc.). En 1789, malgré les compressions opérées par Necker, elle comprenait encore 4.000 personnes, évidemment privilégiées. La maison militaire groupait les régiments spéciaux, de garde ou d’apparat : mousquetaires, grenadiers, etc. plus particulièrement rattachés au service du roi... La maison du roi avait son ministre spécial, dit secrétaire d’État. Il avait pour attributions, outre l’organisation de la maison du roi, le clergé, les dons et brevets civils, diverses généralités etc. Plus tard lui succéda l’intendant de la liste civile... Reine, princes et princesses de sang royal avaient aussi leur « maison ». L’ensemble de ces services coûtait à la nation de 40 à 45 millions, la dixième partie du revenu public de l’époque. La démocratie a répudié la maison du roi mais, aux frais de la « princesse populaire », ministres et gros fonctionnaires, entretiennent souvent d’opulentes « maisons civiles » particulières. Quant au Président de la République, outre les personnes attachées aux diverses fonctions de représentation, aux services de liaison, de cérémonie, de cortège, de protection, etc., il conserve l’agrément honorifique d’une caricature de « maison militaire » commandée par un officier général.
Litt. Parmi les œuvres littéraires dont le titre utilise le mot maison, deux, particulièrement, sont à signaler ici. Ce sont : Maison de Poupée, drame d’Ibsen, où l’auteur pose, face aux préjugés sociaux et aux enchaînements du mariage, le droit (revendiqué par Nora que son mari voudrait tenir au rôle de poupée) de refaire sa conscience et de libérer sa vie, de « développer l’être humain qui est en elle », d’aller jusqu’au bout de sa personnalité... L’autre est : Souvenirs de la maison des morts, suite de tableaux entremêlés de récits, ou Dostoïewsky, au sortir du bagne tsariste, a fixé, avec une sincérité naïve et émouvante, la vie des malheureux auprès desquels il vécut.
‒ S. M. S.
MAÎTRE, MAÎTRISE
n. m. et fém. (latin magister, du même radical que magis, plus et major, plus grand)
On désigne par le titre de maître toute personne qui gouverne, qui commande, qui impose sa volonté, régit autrui à son gré.
Quand un anarchiste rapporte à cette concise et suggestive formule : « Ni Dieu, ni maître », les dénonciations essentielles de sa philosophie, il se sépare à la fois de tous les dieux qui trônent sur la conscience et l’esprit à la faveur du surnaturel et des tyrans de toute nature qui à tous les échelons de la vie sociale assoient leur empire sur la faiblesse ou la pusillanimité des hommes. Face aux divinités dont l’omniscience s’oppose à sa curiosité, il proclame sa méfiance à l’égard de la révélation et lui oppose sa conception, virile, du savoir. Et il répudie, avec celle des religions agrippées à la créature, l’emprise des religiosités qui se disputent sa pensée. En même temps, il repousse comme illégitime, au contrôle du droit naturel, la souveraineté que revendiquent, sur quelque portion de l’humanité, des unités plus fortes ou plus habiles. Il nie que soient fondées en raison les prérogatives du règne ou du commandement et qu’elles se soient affirmées autrement que par traîtrise ou duperie, sous les auspices de l’avidité ou de l’intolérance, avec les armes de la perfidie ou de la violence. Il n’est pas de supériorité qui justifie à ses yeux la domination d’une personnalité sur une autre, la mise à merci de l’esclave à la toute-puissance du maître. Et il se refuse à obéir aux injonctions, voire aux invites, dont la base est un pouvoir tenu par lui pour une usurpation. « Ni Dieu, ni maître ! » Pas de souverain d’une autre essence, de chef mystérieux et suprême tyrannisant l’univers et répondant à nos questions sur l’inconnu par des explications éternelles. Pas davantage de maître humain, campé sur l’activité des peuples et leur évolution, s’immisçant jusqu’au cœur de la vie individuelle, substituant à notre volonté sa fantaisie omnipotente. Pas de préposé ‒ plus ou moins légitimement mandaté ‒ à la gérance de nos intérêts et de nos destinées. Pas de direction imprimant à notre conscience, à notre pensée, à notre vie même son mouvement et son opinion propres. Pas d’impératif ‒ déguisé ou catégorique ‒ nous enchaînant à quelque décision étrangère. Au foyer comme dans la société, pas de chef sur l’individu !
Nous ne reconnaissons que des hommes, aux capacités diverses, aux possibilités multiples et, pour chacun, la faculté, dans le champ commun ouvert à notre essor, de librement s’épanouir... Tant de siècles ‒ et le nôtre encore ‒ n’ont connu que ces deux camps : une poignée de maîtres distribuant des ordres, un troupeau soumis les exécutant. Contre cette obéissance séculaire, fruit de l’erreur, de la lâcheté, d’un lointain sentiment d’infériorité que les mieux doués ont exploité, contre l’abdication du grand nombre devant l’intrigue, la force ou la rapacité, nous dressons ces revendications premières : pas d’autorité imposée, pas d’influence qui comporte un assujettissement, pas de maîtrise qui paralyse. L’entraide, non la compression, l’élan solidaire, non la montée de quelques-uns sur l’épaule ployée des autres. Que chacun s’affirme et s’éploie, aidé par les lumières et l’effort du prochain. Mais que nul ne s’avise ‒ parce que plus fort, ou plus fin, ou plus savant ‒ de ramener sur nous le sceptre ou la férule du passé !
Il y a dans l’histoire des collectivités, des millénaires de dictature, de sujétion dans la vie des êtres. La source nous en ramène à l’arbitraire initial des conquérants égoïstes, à la domestication des faibles sur les premiers biens usurpés. La ruse et les poings ont perpétré le rapt et, pour mieux en défendre le fruit, les triomphateurs ont répandu la légende de leur titre sacré à la propriété et au pouvoir. Ils ont appelé la morale à leur secours et ils ont préposé ‒ garantie cynique ‒ les spoliés à la garde du butin, devant leurs forfaits magnifiés.
Les maîtres du monde ont, avec plus ou moins de brutalité et de franchise, affirmé leur droit à maintenir les générations sous le joug. Tandis que fléchissait leur prestige divin, ils inclinaient à invoquer, pour sauvegarder l’auréole à leur main-mise, le bien même des masses à leur merci. Leur convoitise multiforme, leur passion de lucre et de suprématie, les folles satisfactions de la vanité et du caprice se paraient d’enseignes généreuses à mesure que des doutes inquiétants en soulevaient la supercherie. Pères, arbitres familiaux, guerriers influents, chefs de clans et de tribus, roitelets primitifs, empereurs antiques et rois du moyen-âge étalaient hardiment les droits de leur absolutisme et n’en tempéraient point la rigueur par des « raisons » déjà défensives. À l’approche des temps modernes le pouvoir, contesté déjà dans son essence et çà et là controversé, va troquer sa nature divine pour des justifications temporelles ; il va s’éparpiller, se dérober, prendre, comme l’hydre, plusieurs têtes. Il introduira, dans son principe, plus de démonstration, apportera, dans ses interventions, plus de souplesse raffinée. Une maîtrise hypocrite et savante ; une autorité ramifiée, préside à l’asservissement des peuples d’aujourd’hui. Les arbitres des nations ‒ grands propriétaires, riches industriels, financiers, détenteurs rentés des capitaux ‒ exercent leur règne en secret et les agents qu’ils portent aux premiers postes des États, ils ont eu l’ingénieuse idée de les faire « désigner » par le suffrage des multitudes qui s’imaginent avoir ainsi choisi leurs « délégués ».
Nombreux sont, dans cette Encyclopédie, les mots où la nature et la qualité des maîtres, leur valeur intrinsèque et conventionnelle sont mises à nu et disséquées. Partout, en cet ouvrage, est attaquée une organisation qui cherche entre ces deux pôles antagonistes : esclave et tyran, maître et serviteur, chef et soldat, un impossible équilibre et une fallacieuse « harmonie » ; partout les maîtres, tant publics que privés, tant sociaux qu’individuels, placés sur le plan d’une critique rationnelle et humaine y sont dépouillés de ce halo trompeur, de ces vertus abusives et de cette fausse nécessité que lui attribuent, pour des desseins de consolidation, coutumes, préjugés, morales et institutions. On consultera, pour une documentation aussi complète que possible, les études sur anarchie et anarchisme, autorité, capitalisme, communisme, dictature, gouvernement, liberté, majorité, société, etc. d’une part, et d’autre part les articles sur enfant, enseignement, éducation, individu, mariage, morale, préjugé, sexe, union, vie, etc. On y aborde sous quelque face le problème que nous frôlons seulement ici et nos lecteurs feront d’eux-mêmes la large et cohérente synthèse qu’appelle la logique.
Disons, pour poursuivre ce résumé, que, dans tous les domaines de la vie publique ou particulière, c’est à qui exercera sur autrui sa puissance, voudra, par d’autres moyens que la persuasion, peser sur toute orientation différente, briser la ligne personnelle, détruire l’indépendance voisine ; c’est à qui fera valoir une vertu le prédestinant à régner sur son entourage. Fonctions officielles, rapports économiques, situations sociales, culture, occupations, vie conjugale, relations avec la progéniture, etc., autant de prétextes ou d’occasions pour l’individu de faire étalage de quelque « supériorité » et d’affirmer, s’il rencontre à sa portée la passivité favorable, son penchant a dominer. Ce qu’il y a de frappant, en effet, pour l’observateur, c est cette mentalité de maître en puissance qu’on trouve dans les classes sociales les plus éloignées de la direction des affaires, cette aspiration, jusque chez le plus servile et le plus ignare, à posséder à son tour la couronne et le sceptre, n’eût-il pour esclave que sa femme ou son chien. La masse des hommes ne voit d autres qualités que celles qui s’affirment contre quelqu’un. Il faut à la plupart un empire, fût-il d’opérette ou de cirque et Intelligence à leurs yeux ne prouve sa valeur que si elle plastronne, et pédantise, et tonitrue, parée de hochets enfantins et brillants, que si elle manie finalement les armes et les tonnerres du commandement. Besoin de paraître, désir de subjuguation, recours constant aux formes sans nombre d’une autorité qui dirige, qui façonne ou qui broie, vaincrons-nous jamais ces obstacles à la marche consciente des êtres ? Pourrons-nous en chacun, ébranler assez de lucidité et d’énergie réactive pour rendre inopérantes tant de velléités tyranniques ?... Toujours, cependant, les hommes ont senti au moins confusément, combien le bonheur est rare et précaire si la liberté ne l’avive. Satiristes et philosophes ‒ anarchistes avant la lettre ‒ ont éclairci cette intuition, proclamé la quiétude impossible sous la dépendance des maîtres. C’est Ancelot, bonhomme, qui constate :
« Quand on n’a pas de maître, on peut dormir tranquille. »
Puis Voltaire, avec ce clair conseil :
« Voulez-vous vivre heureux, vivez toujours sans maître. »
Et La Fontaine, enfin, jetant, droit, l’aphorisme :
Je vous le dis en bon français. »
À part quelques « bons despotes », qui œuvrèrent dans le sens du bien public, les maîtres des peuples ne sont qu’accidentellement, et souvent contre leur désir (parce qu’ils sentent l’aiguillon des poussées populaires) les artisans du progrès général. Ils sont des facteurs de conservatisme et de régression, toute marche en avant se faisant à leur détriment, effritant cette omnipotence si chère à l’orgueil des princes. L’histoire nous les montre singulièrement malfaisants, longtemps cyniques et, nous l’avons vu, vers nous davantage dissimulés. Fourier disait :
« L’aigle enlève le mouton, qui est l’image du peuple sans défense. Ainsi que l’aigle, tout roi est obligé de dévorer son peuple. »
Et Toussenel, complétant, de l’expérience moderne, cette image de l’autocratie monocéphale, ajoutera :
« Je tiens seulement à constater que l’aristocratie enlève plus de moutons que la royauté. »
Ceux qui regardent œuvrer les bourgeois ploutocrates, pourront dire que leur tyrannie anonyme fait de ces symboliques animaux des hécatombes plus suivies et autrement perfectionnées...
L’autorité (restituons ici, un instant, à ce mot son sens élevé d’influence), l’autorité véritablement propulsive et heureuse ne réside presque jamais dans le gouvernement : il n’en connaît que l’arbitraire de la force. La maîtrise salutaire, faite d’ascendant profond, qui galvanise les masses vers l’action, imprègne les actes, et pétrit le galbe et l’âme des révolutions, nous la trouvons toujours dans l’initiative individuelle. Même quand le gouvernement paraît émaner de la volonté populaire, c’est rarement dans son sein que se trouvent les éléments agissants, de ses représentants que partent les courants décisifs. Pendant la grande Révolution, la Convention, malgré son envergure et son prestige, prenait à travers les Clubs, officieux satellites, contact avec la masse des faubourgs, recevait d’elle ses vivifiantes impulsions. En 1848, malgré la popularité du gouvernement provisoire, « l’autorité de salut universel » n’habitait pas l’assemblée, pourtant républicaine, des émules de Louis Blanc. Proudhon, hors du gouvernement, la personnifiait, qui fut alors le symbole de l’agitation révolutionnaire des masses. Déjacques dit :
« Et pour cette représentation-là, il n’est besoin ni de titre, ni de mandat légalisés. Son seul titre, il lui venait de son travail, c’était sa science, son génie. Son mandat, il ne le tenait pas des autres, des suffrages arbitraires de la force brute, mais de lui seul, de la conscience et de la spontanéité de sa force intellectuelle. Autorité naturelle et anarchique, il eut toute la part d’influence à laquelle il pouvait prétendre. Et c’est une autorité qui n’a que faire de prétoriens, car elle est celle de l’intelligence : elle échauffe et elle vivifie. Sa mission n’est pas de garrotter ni de raccourcir les hommes, mais de les grandir de toute la hauteur de leur tête, mais de les développer de toute la force d’expansion de leur nature mentale. Elle ne produit pas, comme l’autre, des esclaves, au nom de la « liberté » publique, elle détruit l’esclavage par la puissance de son autorité privée. Elle ne s’impose pas à la plèbe en se crénelant dans un palais, elle s’affirme dans le peuple comme s’affirment les astres dans le firmament, en rayonnant...
Quelle puissance plus grande aurait eu Proudhon, étant au gouvernement ? Non seulement il n’en aurait pas eu davantage, mais il en aurait eu beaucoup moins en supposant qu’il eût pu conserver au pouvoir ses passions révolutionnaires. Sa puissance lui venant du cerveau, tout ce qui aurait été de nature à porter entrave au travail de son cerveau aurait été une attaque à sa puissance. S’il eût été un dictateur botté et éperonné, investi de l’écharpe et de la cocarde suzeraines, il eut perdu à politiquer avec son entourage tout le temps qu’il a employé à socialiser les masses. Il aurait fait de la réaction au lieu de faire de la révolution... »
À vouloir codifier et titrer la maîtrise nous en desséchons la sève et en rendons la flamme languissante. Il la faut conserver à son milieu naturel et à son normal épanchement. Si nous la portons au pouvoir, elle cesse d’être un moteur pour n’être plus qu’un rouage. C’est à une incompréhension de la maîtrise, de son caractère et de ses vertus profondes, c’est à cette aberration qui consiste à ne la voir rayonnante qu’identifiée avec les fonctions directrices qu’obéissent ceux qui cherchent le salut de la révolution dans un « gouvernement révolutionnaire ». Il va sans dire que nous n’entendons pas ici par révolution ces compétitions superficielles qui aboutissent à des substitutions de personnes, ni les bouleversements qui affectent uniquement l’ordre politique et au-delà desquels on retrouve toujours les masses aussi misérables, mais un mouvement qui s’attaque aux bases mêmes de l’édifice sociétaire dans le dessein de régler en un mode équitable les rapports de ses participants.
« Tout gouvernement dictatorial, qu’il soit entendu au singulier ou au pluriel, tout pouvoir démagogique ne pourrait que retarder l’avènement de la révolution sociale en substituant son initiative, quelle qu’elle fût, sa raison omnipotente, sa volonté civique et forcée à l’initiative anarchique, à la volonté raisonnée, à l’autonomie de chacun. La révolution sociale ne peut se faire que par l’organe de tous individuellement ; autrement elle n’est pas la révolution sociale. Ce qu’il faut donc, ce vers quoi il faut tendre, c’est placer toute le monde et chacun dans la possibilité, c’est-à-dire dans la nécessité d’agir, afin que le mouvement, se communiquant de l’un à l’autre, donne et reçoive l’impulsion du progrès et en décuple et centuple ainsi la force. »
« Ce qu’il faut enfin, c’est autant de « dictateurs » qu’il y a d’êtres pensants, hommes ou femmes, dans la société, afin de l’agiter, de l’insurger, de la tirer de son inertie ; et non un Loyola à bonnet rouge, un général politique pour discipliner, c’est-à-dire immobiliser les uns et les autres, se poser sur leur poitrine ; sur leur cœur, comme un cauchemar, afin d’en étouffer les pulsations ; et sur leur front, sur leur cerveau, comme une instruction obligatoire ou catéchismale, afin d’en torturer l’entendement. » (J. Déjacques)
Nous ne pouvons entrevoir une révolution aux bienfaits durables que si elle est faite par des individus éclairés, virils et autonomes, par des hommes qui soient assez leur propre maître pour que ne puissent se reformer sur eux les maîtres et les chefs. Tant qu’il y aura défaillance et abdication renaîtra l’élèvement tyrannique. Pour longtemps encore, dans la vie publique et privée, la liberté demeurera un bien qui se défend. Et si les faibles ‒ car nous n’avons pas la naïveté de supposer que toutes les unités seront de ressort équivalent ‒ n’ont pas la clairvoyance de s’étreindre autour d’elle, en un faisceau solidaire, ils verront se reconstituer les forces régrescentes qui leur ont valu tant de maux et qu’ils auront mis des siècles à vaincre. Ils ne pourront relâcher leur vigilance que le jour, lointain peut-être, où nul ne voudra plus descendre à dominer, où les hommes ayant enfin connu, après des dévoiements séculaires, le chemin d’une existence assez haute pour que l’oppression leur apparaisse non seulement comme indigne mais comme antinaturelle et préjudiciable à leur développement, ils souffriraient ‒ alors qu’ils en jouissent aujourd’hui ‒ des « joies » cueillies dans la peine et l’agenouillement d’autrui. Car l’évolution ne se fera dans la sécurité que lorsque les humains auront dépouillé, à la faveur d’une mentalité nouvelle, l’état d’esprit qui se traduit par ces deux mots également bas : commander et obéir, et qu’ils s’épanouiront hardiment vers la plénitude d’eux-mêmes.
‒ LANARQUE
MAÎTRE, MAÎTRISE
Dans les corporations médiévales, l’ouvrier devait passer par trois grades successifs, s’il voulait tenir lui-même boutique et devenir patron : l’apprentissage, le compagnonnage, la maîtrise. Peut-être l’idée qui présida à cette institution fut-elle d’arrêter l’artisan incapable ; mais rapidement elle dégénéra, les riches ou les fils de patron arrivant, ou presque seuls, à la maîtrise, conférée après la fabrication longue et souvent ruineuse du chef-d’œuvre exigé par les règlements. On sait que la Révolution française abolit les corporations et laissa chacun libre d’ouvrir une boutique à son compte. La franc-maçonnerie a gardé, dit-on, les grades d’apprenti, de compagnon et de maître, entendus non plus dans le sens d’une habileté professionnelle de plus en plus grande, mais d’une formation intellectuelle et politique plus poussée. On continue également d’appeler « maîtres », les grands artistes, les grands écrivains, les grands savants, ou du moins ceux que l’on suppose grands, ainsi que les avocats inscrits au barreau. Ce terme est fréquemment employé par flagornerie, dans le but de mieux duper celui à qui on l’adresse.
« Ce gandin, qui donne du « cher maître » aux badernes falotes de Sorbonne ou de l’Institut, attend le succès de leur vanité satisfaite, non de ses mérites personnels. » (Par delà l’Intérêt)
En un sens différent mais qui reste voisin parce qu’il implique l’idée de supériorité, le maître est celui qui commande, celui auquel on obéit. Le propriétaire de l’esclave, dans l’antiquité, était son maître ; aujourd’hui l’ouvrier a pour maître le patron qui le fait travailler le plus possible mais le rétribue au plus bas prix. Dans l’armée, le malheureux soldat est contraint d’obéir aux innombrables galonnés qui s’arrogent sur lui tous les droits, même celui de l’obliger à tuer s’il ne veut être tué lui-même. Chefs d’État et ministres disposent également de la liberté et des biens de leurs administrés ; ce sont les maîtres, le simple citoyen n’ayant qu’à payer des impôts et se taire. Quant aux prêtres, ils détiennent la clef du paradis et des trésors spirituels ; c’est eux qui dominent sur les âmes. Maîtres spirituels, ils déforment les cerveaux enfantins, d’accord sur ce point avec les instituteurs du gouvernement, préposés au maintien des dogmes d’État. Qui dira les méfaits de ces prétendus maîtres, de ces diplômés de tout grade chargés par les forts de préparer des générations d’esclaves ! Méprisons ces faux savants qui peuvent connaître tout ce qu’on a dit avant eux, mais dont l’esprit n’est pas libre et qui acceptent d’être les chiens de garde de la société.
‒ L. B.
MAÎTRE
Maître désigne le propriétaire, en général, des personnes ou des biens : le maître d’un champ. « Les paysans russes ont cru longtemps que le ciel était réservé pour leurs maîtres » (De Custine). ‒ S’est dit du patron, de l’employeur : « Quand deux ouvriers courent après un maître, les salaires baissent » (F. Bastiat). ‒ Synonyme de professeur, d’éducateur : « Le meilleur maître est celui qui nous donne le désir d’apprendre et qui nous en offre les moyens » (Ferrand). ‒ Titre qu’on donne par bonhomie, aux vieillards, surtout à la campagne : maître François. ‒ La Fontaine en affuble, avec ironie, les animaux : maître Renard, maître Corbeau, etc. ‒ Personne talentueuse : être passé maître dans son art. ‒ Qui triomphe d’un péril, domine un danger : se rendre maître du feu. ‒ Qui a de l’empire sur soi : « Toutes les passions sont bonnes quand on en reste le maître ; toutes sont mauvaises quand on s’y laisse assujettir » (J.-J. Rousseau). ‒ Qui a la liberté, la faculté de faire quelque chose : être maître d’aller et venir.
Au figuré, se dit, par analogie, de l’objet qui régit, passionne, constitue le pivot des actions humaines : l’or est le maître du monde ; « la nécessité est la maîtresse des choses humaines » (Lerminier). ‒ Qui exerce sur l’homme une influence tyrannique : « L’argent est un bon serviteur et un mauvais maître » (Bacon). ‒ Modèle, exemple, objet qui sert d’enseignement : « Le temps et la liberté sont de grands maîtres. »
Locutions : maître de l’univers (Dieu), de la terre (rois, princes), etc. ‒ Titres de certains ordres : grand-maître. ‒ Jurisprud. maître ès-lois : jurisconsulte. ‒ Beaux-Arts : les maîtres de l’école flamande. ‒ Maîtres-chanteurs : associations de poètes et de musiciens allemands (sujet d’un conte d’Hoffmann et d’un opéra de R. Wagner). ‒ maître-chanteur : celui qui par menace, campagne de presse, etc. extorque de l’argent. ‒ Maître à danser, maître de ballet, etc. ‒ Techn. Au temps du compagnonnage, titre donné après la réception dans un corps de métier ; maître-maçon, etc. ‒ maîtresse : féminin courant de maître. Sens particulier : femme avec qui on entretient des rapports amoureux hors du mariage : « rois et grands seigneurs entretinrent de ruineuses maîtresses ». ‒ Quelques ouvrages littéraires : les maîtres mosaïstes, les maîtres sonneurs (G. Saud) ; maître Cornélius (Balzac), le maître d’école (F. Soulié) ; le maître de danses (Wicherly), ‒ Tableaux : le maître de la vigne (Rembrand) ; le maître d’école (Van Ostade), etc.
MAÎTRE (MORALE DE)
Voir morale.
MAJORITÉ
n. f. bas latin majoritas (du latin major, plus grand)
Appliqué aux élections et aux assemblées délibérantes, le terme majorité désigne la quotité de suffrages requis (voir suffrage), pour qu’un candidat soit choisi, pour qu’une loi soit admise. Appliqué aux individus, il indique l’âge exigé pour l’exercice de certaines fonctions ou prérogatives sociales. Parmi les sens multiples du mot, nous retiendrons ces deux-là seulement.
Dans nos sociétés actuelles aucune confusion n’est possible entre les droits naturels inhérents à notre qualité d’homme et les droits positifs que les autorités nous accordent au compte-gouttes comme membres de la cité. Non seulement les premiers, que nous tenons de la seule nature, sont infiniment plus larges que les seconds, mais fréquemment ils les contredisent. D’où les conflits qui mettent aux prises individu et société : celui-là conscient d’être injustement ligoté par des lois cruelles, celle-ci exclusivement préoccupée de rabaisser le grand nombre (voir nombre) au profit du groupe restreint des dirigeants. Nul doute sur l’origine du droit naturel, c’est dans la personne humaine qu’il a sa source profonde. Soit qu’on le considère comme un simple. aspect de la liberté, comme une résultante de l’indépendance assurée par la nature aux volontés individuelles ; soit qu’on le fasse dériver des désirs ou des besoins qui, nés de la vie et bons comme elle, exigent avec justice d’être satisfaits. L’homme possède en lui-même une fin propre, son bonheur et sa perfection ; aucune autorité extérieure ne saurait l’en distraire légitimement ; il ne peut sans immoralité devenir physiquement ou mentalement l’esclave de quiconque, il ne doit obéissance à personne et n’a d’autre maître que son vouloir éclairé par sa raison. Rester libre de ses actions comme de ses pensées, respectueux seulement de l’égale liberté des autres personnes, voilà qui résume parfaitement l’essentiel du droit naturel humain. Et nul législateur n’a besoin de le promulguer ; il reste identique à travers le temps et l’espace, aussi vrai au XXème siècle qu’au Xème, non moins exigible en Chine qu’en Australie, aux États-Unis qu’au Japon si l’on s’en tient non aux conditions extérieures, mais à ce qu’affirme impérieusement la raison.
Le droit positif (voir droit), que la société prétend élargir ou restreindre à son gré, s’avère par contre toujours arbitraire, souvent injuste, parfois absolument contre nature. Il change avec les époques et selon les pays ; ne s’inspire que de l’intérêt des classes privilégiées ou des caprices du maître, en règle générale. Réduire l’individu à n’être qu’un rouage sans âme de la grande machine sociale, un aveugle instrument dans la main de ceux qui ordonnent, voilà son but inavoué mais réel. Certains placent son fondement dans la force, d’autres dans l’intérêt ; en fait il découle tantôt de la première, tantôt du second, souvent des deux associés. Quant aux prétentions, affichées par des moralistes, de fonder le droit positif actuel sur la valeur de la personne humaine, ils témoignent d’une singulière ignorance des diverses législations du globe, toutes plus oppressives les unes que les autres. Ils témoignent encore de la volonté, qu’ont ces valets du pouvoir, de légitimer la tyrannie étatiste, dont pauvres et subordonnés sont aujourd’hui les victimes. Mais les forts, après avoir utilisé les muscles, firent parler les dieux ; ils se doivent de chercher à mettre de leur côté une raison frelatée, aujourd’hui que la théologie est passée de mode. C’est ainsi que la majorité, génératrice des lois dans les pays démocratiques, n’est qu’une application déguisée du culte de la force. Autrefois l’on procédait à coups de poings, on luttait avec des armes plus ou moins perfectionnées ; et la victoire, en général était celle du nombre. On a simplifié le combat en décidant de se compter ; lances ou fusils sont remplacés par les bulletins de vote ; quant au hasard des batailles qui assurait parfois le succès des moins nombreux, il est largement compensé par les aléas des campagnes électorales, aux résultats si décevants. Et naturellement la majorité s’arroge, sur la minorité, tous les droits du général vainqueur sur les peuples vaincus. Avouons qu’en un sens il y a progrès, puisque, dans cette guerre intestine le sang ne coule pas ; toutefois remarquons que justice ou vérité sont oubliées et qu’il s’agit simplement d’une question de force ou d’adresse, comme on voudra : la seconde étant, dans l’ordre mental, l’équivalent de ce qu’est la première dans l’ordre physique.
Mais, pensera-t-on, il s’agit également d’une question d’intérêt. Oui, l’intérêt donne la main à la force en matière d’élection ; et là encore, du moins en apparence, on observe un progrès. Quand la volonté d’un monarque faisait et défaisait les lois, son seul intérêt entrait en ligne de compte. De même tant qu’une minorité de riches, fut appelée aux urnes, l’intérêt du peuple fut oublié ; avec le suffrage universel, le travailleur ne peut être négligé aussi complètement. Néanmoins, après plus d’un demi-siècle de suffrage universel, en France, l’ouvrier reste l’esclave du patron ; et des constatations identiques s’imposent dans tous les pays. Les aristocraties, habiles dans l’art d’exploiter les diverses situations, sont demeurées maîtresses ; elles ont seulement varié leurs procédés de gouvernement, feignant, à l’occasion, de se préoccuper du sort des malheureux, qu’elles abrutissent aux champs comme à l’usine. Pour diriger l’opinion, elles utilisent la presse et l’Église, ces deux puissances autrefois à la solde des nobles, attelées aujourd’hui au char de la finance. Et, par l’exemple de l’Italie et de l’Espagne, nous savons que la légalité ne compte guère, à leurs yeux, lorsqu’il s’agit de sauver l’ordre capitaliste. Dans les républiques d’Europe et d’Amérique, elles fabriquent, à leur guise, les majorités : le peuple étant trop simple pour s’apercevoir qu’il est la dupe dont on se gausse éternellement. Corruption individuelle, suggestion collective entrent en jeu lorsqu’il s’agit d’élection. Un système d’espionnage méthodiquement organisé permet aux amis du gouvernement d’être renseignés sur les idées politiques de chaque citoyen, sur ses désirs et ses ennuis personnels ; de fines mouches, d’habiles courtiers se chargent ensuite de l’achat des consciences. Pour le troupeau, des consommations gratuites à l’estaminet, de maigres secours donnés de la main à la main suffisent ; il faut davantage pour satisfaire l’électeur influent : décorations, places du gouvernement, passe-droits, le tout proportionné à la situation du personnage, voilà ce qu’on promet d’ordinaire. La suggestion collective, si puissante sur la mentalité des foules intervient de son côté. On l’observe déjà chez les animaux vivant en groupe : les moutons fuient ou s’arrêtent tous ensemble, les coqs se répondent au lever du soleil. D’instinct l’enfant imite ceux qui l’entourent ; et les grandes personnes rient, baillent, toussent, sans raison, lorsqu’on le fait à côté d’elles. Les foules, peu capables de réfléchir, son facilement secouées par des émotions intenses, pitié, enthousiasme, cruauté, contre lesquels l’individu réagit peu. Quelques fuyards déterminent une panique ; la mode repose sur la tendance à l’imitation ; crime, révolte, suicide sont contagieux. De même les maladies nerveuses ; et de nombreux miracles n’ont pas d’autre origine. Parmi les premiers chrétiens beaucoup étaient sujets, pendant les réunions, à des accès de glossolalie ou émission de sons inarticulés ; ces manifestations, regardées comme divines, furent interdites aux femmes par l’apôtre Paul, tant elles devinrent incommodes. À Lourdes la contagion des émotions joue un rôle énorme, je m’en suis rendu compte personnellement ; tout est disposé pour agir avec force sur l’imagination, et l’on amène des milliers de malades afin que, dans le nombre, quelques-uns soient prédisposés par leur constitution nerveuse à recevoir le choc efficace ! Tant pis si le chiffre des morts est de beaucoup supérieur à celui des guéris, pendant les pèlerinages ; les prêtres n’en ont cure, pourvu qu’ils fassent des dupes et récoltent de l’argent. Lorsqu’il s’agit de tromper l’électeur rétif, nos politiciens savent, eux aussi, manier la suggestion : affiches, journaux, réunions, leur permettent de lancer des formules qui engendrent l’espoir ou la peur. On se souvient de l’effet produit, en 1919, par la crainte de l’homme au couteau entre les dents et du résultat obtenu, en 1924, par les promesses du cartel. Chaque fois le peuple s’y laisse prendre, malgré des déconvenues successives lui faisant dire, aux heures de colère, qu’il a fini de croire aux boniments des candidats. Inutile d’ajouter que, dans les assemblées législatives, corruption et chantage s’exercent plus facilement que si l’on doit atteindre l’ensemble du pays. D’où les continuelles trahisons des élus à l’égard de leurs électeurs, et l’infecte cuisine tripotée, dans les couloirs des Chambres, par les grands manieurs d’argent.
Même si tous les élus étaient d’une probité rigide et tous les électeurs pleinement éclairés sur les conséquences de leur choix, le règne de la majorité deviendrait-il, pour autant, légitime ? Non, car aucun homme ne doit obéissance au voisin. Ni la fortune, ni l’hérédité, ni l’intelligence, ni les suffrages de ses concitoyens, rien ne donne, à quiconque le pouvoir moral de commander celui qui veut rester autonome. On répond, il est vrai, par l’hypothèse d’un contrat ou d’un quasi-contrat, né, sinon de la volonté directe des hommes du moins de nécessités matérielles qui conduisent à l’accepter. L’état naturel serait le règne de la violence, la lutte de tous contre tous ; mais comme la paix s’affirmait préférable à la guerre, les hommes s’engagèrent de bonne heure à respecter réciproquement leur vie, leurs biens, etc. Pour veiller à l’observation du pacte, ils instituèrent une autorité supérieure, l’État. Et voilà pourquoi tous doivent obéissance à l’autorité, qu’elle se transmette héréditairement, comme au Japon, ou qu’elle sorte de l’urne électorale, comme dans les républiques. D’après ce pacte toujours, les citoyens ayant déclaré se soumettre aux lois édictées par le plus grand nombre, il en résulte que la minorité a le devoir d’obéir dans les pays démocratiques.
L’étude des sociétés primitives infirme absolument cette manière de voir ; c’est la force ou la ruse, non l’intérêt collectif, qui donna naissance à l’autorité. Tous les sophismes propagés sur ce sujet viennent d’une confusion malheureuse entre l’association et l’autorité, la société et le gouvernement. Que l’association soit favorable au développement des individus, c’est vrai en général ; que la société, requise par la division du travail, soit condition du progrès, au moins matériel et scientifique, la chose est indéniable. Mais qu’un homme ou qu’un groupe s’érige en maître des corps et des esprits, voilà qui cesse d’être naturel et acceptable. Pour rester juste l’association doit combiner l’entraide et l’indépendance ; la société dégénère en tyrannie dès qu’elle prétend contraindre les individus. Celui qui s’agrège à une entente, à une organisation est tenu de participer aux charges qui rendent ces groupements possibles, encore faut-il, en bonne justice qu’il soit libre d’y entrer et libre d’en sortir. Est-ce le cas dans nos sociétés ? Il faudrait une mauvaise foi insigne pour l’affirmer. Le fait de naître de tels parents ou dans telle région suffit pour que le bambin soit embrigadé dans un État déterminé pour qu’il devienne sujet d’un gouvernement. Et pas une parcelle de terrain habitable ne subsiste, sur le globe, pour l’homme désireux de se soustraire aux volontés arbitraires des monarques ou des majorités ; pas un pouce de terrain pour l’indépendant qui, renonçant aux avantages de la société, vent en secouer les chaînes !
Si l’on admet que la disparition de toute autorité est un idéal encore lointain, irréalisable affirment plusieurs, du moins devrait-on reconnaître que le renforcement de l’étatisme marque une régression, son affaiblissement un progrès, dans l’ordre associatif. Il semble que Lénine, plus clairvoyant que bien d’autres, ait soupçonné, mais pour un avenir imprévisible selon lui, le triomphe des tendances libertaires, préambule obligatoire d’une ère de vraie fraternité. Ajoutons que, dès aujourd’hui, des organisations particulières, îlots perdus au sein de l’Océan, peuvent s’inspirer de cet idéal nouveau. Une sélection rigoureuse des membres rend inutile autorité et règlements ; j’en ai acquis la preuve par l’existence depuis le début de 1921, de la « Fraternité Universitaire ». Mais je sais combien différentes les formes possibles de l’association, combien malaisée, à notre époque, la vie de pareils groupements ; et je crois que de nombreuses expériences seront nécessaires avant de mettre parfaitement au point les formules associatives qui garantissent les avantages de la vie en commun, sans porter atteinte à la liberté des personnes.
Au point de vue individuel, la « majorité » désigne l’âge où quelqu’un devient capable de tous les actes de la vie civile. « La majorité est fixée à vingt-et-un ans accomplis », dit l’article 488 du Code français. On distinguait à Athènes une double majorité. La première ou majorité civile s’accordait à dix-huit ans ; après des épreuves physiques et militaires, on remettait officiellement une lance et un bouclier au candidat qui prêtait un serment à la fois patriotique et religieux. On n’arrivait qu’à trente ans à la seconde majorité ou majorité politique ; c’est alors seulement qu’on était admissible aux fonctions publiques. Inutile d’insister sur la discordance fréquemment observable entre la capacité naturelle et la capacité légale ; sur les caprices du législateur qui, sans motif valable, donne à l’un ce qu’il refuse à l’autre ; sur l’éternelle minorité de la femme dans les pays latins. Ajoutons qu’il faudrait habituer de bonne heure les enfants à l’exercice de la liberté ; j’approuve les Russes d’avoir amoindri l’autorité des maîtres, en laissant une place à l’initiative des élèves. Dans La Cité Fraternelle, j’ai raconté comment l’Université de Dôle fut administrée par les étudiants eux-mêmes, pendant plusieurs siècles ; et jamais l’école ne fut aussi prospère qu’à ce moment-là. Malheureusement qu’il s’agisse de cette question ou de toute autre, l’État moderne fait fi du bonheur des faibles et sauvegarde seulement les injustes privilèges des forts.
‒ L. BARBEDETTE.
MAJORITÉ
Plus grand nombre. S’emploie par opposition à Minorité qui signifie plus petit nombre.
Lorsqu’une proposition recueille dans une assemblée quelconque la moitié des suffrages exprimés plus un, elle obtient la majorité. Lorsqu’un candidat, dans une élection, obtient la moitié des suffrages exprimés plus un, il est élu à la majorité absolue. S’il obtient au deuxième tour de scrutin, un plus grand nombre de voix que ses concurrents, sans réunir la moitié des suffrages exprimés plus un, il est élu, à la majorité relative.
De l’application de ce principe est découlé une loi qu’on a appelée à juste titre, loi de la majorité ou loi du nombre.
Principe et loi ont été fort critiqués dans les milieux anarchistes et la discussion à leur sujet est loin d’être close. Il se peut même que cette discussion dure aussi longtemps que le monde.
L’argument massue de ceux qui n’acceptent pas la loi du nombre (voir ce mot) est le suivant : en principe, ce sont toujours les minorités qui ont raison, qui représentent le progrès et se rapprochent le plus de la vérité. S’il n’est pas sans valeur, il est cependant exagéré de dire que les minorités ne peuvent se tromper, tout comme les majorités. L’argument n’est donc pas irrésistible. Il n’a point une valeur absolue.
Et puis, il y a presque toujours au sein d’une collectivité quelconque, dans un groupement, dans une assemblée, deux sortes de minorités : l’une d’avant-garde et l’autre d’arrière-garde. La première va résolument vers l’avenir. La seconde reste encore attachée au passé, qu’elle ne juge pas entièrement révolu.
Ces deux minorités encadrent le plus souvent un centre qui cherche sa voie et regarde tantôt en avant, tantôt en arrière. Pendant que la première cherche à entraîner la masse centrale, la seconde fait office de frein modérateur.
C’est cette double action en sens contraire qui donne au centre, au groupement une certaine stabilité. Selon que l’une ou l’autre est prépondérante le groupement avance, piétine, ou même recule. Leur action alternée assure en quelque sorte, l’équilibre et la majorité exprime une opinion qu’on peut qualifier de moyenne, qui tend à accepter l’avis de la minorité d’avant-garde tout en tenant compte des craintes ou des arguments de la minorité d’arrière-garde.
Il n’est pas douteux, cependant, que si la minorité d’avant-garde persévère dans son action, le centre se déplacera vers l’avant et que la minorité d’arrière-garde devra suivre bon gré mal gré, la marche vers l’avant, vers le progrès. Il importe donc que le moteur soit plus actif que le frein.
S’il en est ainsi, la minorité d’avant-garde deviendra à son tour majorité. Elle donnera naissance, un jour, à une nouvelle minorité qui agira comme elle ‒ c’est la loi inflexible de l’évolution ‒ jusqu’au moment où tous les individus seront suffisamment évolués pour décider de tout par consentement général et mutuel. Ce stade ne sera sans doute atteint que dans des temps très éloignés.
La loi du nombre me semble, pour longtemps, très difficile à remplacer. Si tout le monde, dans un groupement quelconque, est d’accord, tant mieux ; mais, si un seul participant ou associé s’oppose à l’avis de tous, on sera dans l’obligation de faire appel à la loi de la majorité. Et cette majorité aura, alors, pour devoir impérieux de passer outre, d’accomplir la tâche qu’elle reconnaîtra indispensable ou même simplement nécessaire. Si elle ne le faisait pas, elle manquerait à tous ses devoirs.
Il n’y a qu’un seul cas dans lequel il ne peut être question de majorité ou de minorité : c’est lorsque la majorité prétend violer un contrat accepté par tous, passer outre à des principes qui constituent la base d’un statut dressé en commun. Dans ce cas, la minorité est gardienne du contrat, du statut, et la loi de la majorité ne saurait s’exercer. Pour qu’elle puisse jouer à nouveau librement, normalement, il faut : ou que la majorité revienne au respect du contrat et accepte de délibérer dans le cadre des principes qui en forment la base ou que les associés aient, au préalable, modifié de plein gré et unanimement le contrat.
Il se peut encore qu’une majorité réellement clairvoyante et bien inspirée, soucieuse d’équilibre et mesurant nettement la portée de ses actes, ait affaire à une minorité désireuse d’aller toujours en avant sans se rendre compte des difficultés à surmonter. Dans ce cas la majorité doit s’efforcer de convaincre la minorité sans la brimer, de lui démontrer que le développement intellectuel des associés et la capacité de réalisation de leurs organismes économiques ne permettent pas d’accélérer, sans danger, le rythme de la marche en avant.
À moins que la minorité ne soit composée d’ignorants, de démagogues ou de fous, elle se rendra compte que la marche en avant, dans de telles conditions, se traduirait en réalité, et finalement, par un recul certain. Elle acceptera donc le point de vue de la majorité et joindra ses efforts aux siens. Cette éventualité est probable en période révolutionnaire.
‒ Pierre BESNARD.
MAL
n. ou adj. masc. (du latin : malum)
Le Mal représente l’ensemble de ce qui est nuisible, désavantageux, douloureux, pénible, préjudiciable, difforme, ou incomplet, dans un domaine quelconque. C’est l’opposé du Bien (voir ce mot), qui représente le bonheur, la perfection, l’équilibre, l’harmonie, la joie, le plaisir, la satisfaction. Le Mal existe-t-il dans l’univers indépendamment de la volonté des hommes ? Évidemment oui, puisque l’on y observe, d’une façon permanente, la souffrance, non seulement inutile, mais encore imméritée, pour un nombre incalculable d’êtres doués de sensibilité, dont rien ne justifie la triste situation, si ce n’est l’injustice profonde d’un aveugle destin ! Quoi qu’en disent les théologiens, la permanence de la souffrance dans le monde demeurera toujours, à l’égard des probabilités d’existence de leur Dieu « infiniment bon, juste et aimable », l’argument majeur, contre lequel se révèlent impuissants les plus habiles sophismes. Alors que des humains, qui sont loin d’être parfaits moralement, et n’ont aucune prétention à la sainteté, se précipitent spontanément au secours de personnes en détresse, non seulement sans espoir de récompense, mais encore parfois au péril de leur vie, comment supposer qu’un Être Suprême, pouvant tout, sans risque, ni effort, puisse demeurer indifférent au spectacle des tortures qui résultent de l’insuffisance de sa propre création ?
Les théologiens affirment que le Mal provient du péché originel, c’est-à-dire de la faute commise par Adam et Ève, lorsqu’ils désobéirent à Dieu dans le Paradis terrestre. Mais, en admettant que cette faute eût été digne d’un châtiment sévère, comment peut-on concilier, avec une élémentaire équité, la décision divine de faire supporter, à un nombre indéfini d’innocents les conséquences des erreurs commises par leurs premiers parents, alors que ces innocents n’avaient même point encore fait leur apparition dans le monde ?
Les théologiens affirment aussi que Dieu respecte la liberté des hommes, même lorsqu’ils font le mal, et que les maux dont souffrent ces derniers proviennent de leurs méfaits. Mais c’est ne vouloir considérer que la liberté des méchants, qui sèment autour d’eux le deuil et la douleur, sans prendre en considération celle de leurs victimes. Car, lorsqu’il y a meurtre, par exemple, si l’on peut arguer de la liberté du meurtrier d’accomplir, ou de ne pas accomplir, son forfait, peut-on prétendre que de mourir, à ce moment, de mort violente soit, pour la victime, le résultat de son libre choix ? Aucun croyant n’oserait, dans aucun tribunal d’aucun pays civilisé, s’il y était juré, lorsque se trouve condamné par contumace un criminel en fuite réclamer que soit, à la place de ce criminel, livré au bourreau son enfant en bas-âge. Aucun croyant n’oserait pour essayer, de justifier sa lâcheté, prétendre qu’il laissa, malgré ses plaintes et ses appels au secours violenter une fillette par une brute, sous prétexte de respect de la liberté de cette brute de satisfaire ses instincts. D’où vient donc qu’il n’est aucun croyant qui ne se prosterne devant l’autel élevé à la glorification de l’Être auquel se trouve attribué, par les fidèles eux-mêmes, une moralité, ou plutôt une absence de moralité, dont tous ils auraient honte, s’il leur en était fait un grief personnel.
Il est des milieux spiritualistes dans lesquels on tient un autre langage : Concevant toute l’absurdité qu’il y a dans l’admission philosophique de la coexistence du Mal et d’une divinité toute-puissante et infiniment bonne, on prétend que le Mal n’existe pas, qu’il est une illusion de nos sens abusés. Si ceux qui tiennent ce langage étaient appelés à mourir avec lenteur dans les tourments comme, à tout instant, une quantité innombrables d’êtres, non seulement par le fait de l’ignorance et de la cruauté des humains, mais encore par le simple jeu des forces naturelles, sans doute ne seraient-ils plus de cet avis ? Si, cependant, nous admettions leur thèse, il nous faudrait admettre aussi, par voie de conséquence logique, que s’il n’est ni Bien ni Mal, toutes les actions, quelles qu’elles soient, deviennent indifférentes, et que la morale n’est qu’un préjugé. Dans ces conditions, n’est-il pas surprenant de constater jusqu’à quel point se contredisent les théoriciens qui nient le Mal, ou se prétendent au-dessus de l’illusion du Bien et du Mal, lorsque couramment, dans la vie pratique, ils font figure de moralistes, en morigénant de la belle manière ceux qui ne se comportent pas en conformité de ce qu’ils voudraient être la règle de conduite universelle ? Que ceci ne se produise ordinairement que lorsque se trouve en cause la défense de leurs intérêts personnels n’enlève rien de leur valeur à des déclarations qui, pour être implicites, n’en constituent pas moins une reconnaissance d’un Bien et d’un Mal, autant qu’une profession de foi philosophique nettement exprimée.
D’après les théosophes, et la plupart des spirites, cette forme du Mal qu’est la souffrance serait une condition indispensable de notre évolution. Après avoir supporté les épreuves de l’existence successivement dans les règnes minéral , végétal, et animal, pour arriver au degré humain, les âmes seraient appelées à se perfectionner, grâce à de multiples incarnations, en subissant, dans chacune d’elles, le choc en retour de leurs bonnes et de leurs mauvaises actions, jusqu’à leur accession au plan divin, par le renoncement à la volonté personnelle, c’est-à-dire par la soumission aux règles du Bien absolu.
Pour être plus satisfaisante que les précédentes, cette doctrine spiritualiste n’est pas à l’abri de toute critique. Si nous sommes Dieu, si tout est Dieu, pourquoi cette volontaire chute dans l’obscurité de la matière ? Pourquoi ce douloureux et long réveil à une conscience qu’il ne tenait qu’à nous de conserver ? S’il demeure au-dessus de nous un Dieu tout-puissant et personnel, infiniment bon, ordonnateur de toutes choses, pourquoi toutes ces épreuves, infligées par lui à ses créatures en vue de leur perfectionnement, alors que lui-même, Être parfait, n’ayant été dans la nécessité de passer par aucune d’elles, aurait pu, de toute évidence, les éviter à ses protégés ?
De quelque côté que nous tournions nos regards dans le champ des hypothèses spiritualistes, nous nous heurtons à l’absurde, tout au moins à l’incompréhensible. Sans vouloir décourager personne à l’égard des recherches philosophiques, le plus sage est donc de nous en tenir, pour les directives de la vie pratique, à ce que nous enseigne la méthode expérimentale, laquelle ne tient compte que de ce qui est démontré et démontrable pour tout le monde, comme le feu qui brûle, la pierre qui tombe, l’eau qui apaise la soif. Partant de là, il nous suffit de constater que le Mal est ce qui, sans nécessité, cause de la souffrance, et entrave l’essor humain vers le plus grand bonheur concevable, pour que nous apparaisse comme premier devoir d’en faire disparaître les causes immédiates, avant que de s’éterniser sur le problème peu soluble des origines et des fins.
‒ Jean MARESTAN.
MAL
Le mal est le contraire du bien. M. de La Palisse en aurait dit tout autant. Mais cela n’avance pas d’une syllabe la définition du terme « mal », cela ne prouve pas non plus qu’il existe.
Il y a le mal métaphysique dont je ne veux pas m’occuper et qui renferme en soi une notion d’imperfection, de défaut, de lacune qui n’est admissible que si l’on accepte a priori qu’existe la perfection. Or, dans la pratique, la perfection n’existe pas. La notion d’un être parfait est un concept purement chimérique. Ni la nature, ni l’homme ne sont parfaits. La terre est souvent bouleversée par des cataclysmes destructeurs, les saisons ne se succèdent pas toujours dans un ordre régulier, les organismes vivants sont sujets à toutes sortes de maladies ; corporellement parlant les hommes sont loin d’être impeccables. D’ailleurs, des soleils immenses à la plus minuscule des cellules, tout ce qui est se trouve dès son apparition attaqué par l’environnement physicochimique et est inéluctablement destiné à la dissolution, à la désagrégation, à la mort ; la mort suffit à prouver l’inéluctable imperfection universelle.
D’ailleurs, on ne trouve nulle part, dans le sens de perfection et d’imperfection, le « bien » dissocié du « mal ». L’entretien des organismes vivants est fonction d’une consommation d’un genre ou d’un autre, donc de destruction. On ignore si les éruptions, les raz-de-marée, les tremblements de terre, les cyclones, les vagues de froid ou de chaleur ne sont pas indispensables à la « bonne santé » du globe où nous gîtons, etc. En se défendant contre l’ambiance tellurique et cosmique, les hommes ont fini par tourner à leur avantage ce qui leur avait été dès l’abord préjudiciable, à « utiliser » pour leur « bien », ce qui leur avait antérieurement fait tant de « mal », ce qui prouve combien est relative la notion de « mal ».
Ce qui se produit pour le « mal » dit physique a son équivalent dans le « mal » prétendu moral. Pris individuellement, selon les circonstances, selon qu’il y trouvera son intérêt, selon les exigences de sa sensibilité, un même homme est tendre ou cruel, loyal ou faux, bassement avare ou exagérément prodigue. J’ai connu un surveillant-chef de prison qui ne regardait pas à passer des nuits auprès d’enfants malades, qui n’étaient pas siens, cependant ; mais qui n’hésitait pas à faire envoyer en cellule de punition ‒ trop souvent antichambre de maladies mortelles ‒ de malheureux détenus coupables d’infraction au règlement pénitentiaire.
Il y aurait long à écrire sur cette coexistence du bien avec le mal. Ce qui m’intéresse surtout, c’est le « mal » au point de vue social. On s’aperçoit vite que là, mal est synonyme de « défendu ». « Un tel » ‒ raconte La Bible ‒ « fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel » et cette phrase se retrouve en de nombreux livres sacrés des Juifs, qui sont aussi ceux des chrétiens ; il faut traduire : Un tel fit ce qui était défendu par la loi religieuse et morale telle qu’elle était établie pour les intérêts de la théocratie israélite... Dans tous les temps et dans tous les grands troupeaux humains, on a toujours appelé « mal » l’ensemble des actes interdits par la convention, écrite ou non, convention variant selon les époques ou les latitudes. C’est ainsi qu’il est mal de s’approprier la propriété de celui qui possède plus qu’il n’en a besoin pour subvenir à ses nécessités, de tourner en dérision ceux qui fabriquent ou ceux qui appliquent les lois, de nier la patrie, d’entretenir des relations sexuelles avec un consanguin très rapproché. Et ainsi de suite.
Pour l’individualiste anarchiste, il n’est pas de permis ni de défendu, de « bien » ou de « mal ». Isolé ou associé, les choses, les faits, les gestes lui sont utiles ou nuisibles, agréables ou déplaisants, lui procurent de la jouissance ou de la souffrance. Il ne croit pas que ce soit par les restrictions et les constrictions qu’on éliminera le « mal », c’est-à-dire ce qui est désavantageux à l’individu ou à l’association, ce qui procure de la douleur, ce qui engendre du déplaisir. Il pense que la réciprocité bien comprise permet à chacun d’échanger les produits du déterminisme personnel ou groupal, de trouver en ces échanges la satisfaction des besoins, des désirs, des appétits, des aspirations que peuvent formuler les divers tempéraments humains, telle jouissance, nuisible pour celui-ci, pouvant être bienfaisante pour celui-là. L’exercice de la réciprocité, dans un milieu ignorant le permis et le défendu, implique la réponse à presque tous les appels que peuvent émettre le psychologique et le physiologique. Seuls restent insatisfaits les cas pathologiques vraiment caractérisés et nous savons que là où il n’est plus morale d’État ou d’Église, ils se réduisent à peu de chose.
‒ É. ARMAND.
MALADIE (SES SECRETS BIENFAITS)
Dans une erreur alimentaire ou dans un abus de même nature, commis par deux hommes de même âge, de mêmes conditions de vie, l’affection qui naîtra de cette erreur sera-t-elle la même pour chacun des deux sujets ?
La réponse est négative, pour 99 cas sur 100 ; la seule fois que les affections seront de même nature, chez l’un et l’autre des deux sujets, identiquement frappés, c’est exception à la règle.
La maladie, dans ses symptômes, sa nature, sa force, sa durée, ses reliquats, se traduira de façons différentes selon les prédispositions du sujet à des tares afférentes à son hérédité, à ses affections anciennes, à des états imputables à des professions malsaines ou déformatrices d’une fonction organique, ou bien à des préoccupations morbides, etc...
La maladie est mal appelée, ou bien on l’interprète mal dans son sens, son origine.
La maladie, c’est simplement un état de fièvre réagissant contre le mal enfin constitué ou sur le point de l’être.
La maladie sera quelconque et différenciera de nature cependant que les causes qui la constituent seront identiques.
En somme, ce n’est pas la maladie qu’il importe de vaincre puisque son rôle est de protéger le sujet contre le mal déferlant sur l’organisme. Lutter contre la maladie, c’est lutter contre la guérison ; aider la maladie, voilà ce que devrait être le rôle du médecin (de santé).
La maladie, c’est le règlement d’échéances suprêmes, desquelles on ne saurait remettre le paiement sans danger d’accumuler les chances de faillite. Celui qui échappe, en fraude, à la maladie qu’il a méritée fait une véritable banqueroute ; la peine qu’il subira de ce fait, à la prochaine récidive, ne profitera pas de l’indulgence du tribunal qu’il aura, pour l’avenir, indisposé plus gravement à son égard.
Le rôle du médecin (de maladie) est de faire vivre le mal un quart d’heure de plus, en conjurant la maladie qui, seule, compte pour le « patient ! »
Ce qu’on ne permet pas de faire contre le social est permis quand il s’agit de la société que constitue le corps humain ! Cependant il y a des cas où l’on se comporte contre le mal social à l’instar des méthodes médicales employées contre la maladie des humains : quand une région se rebelle contre les mauvais traitements qu’elle subit ou parce qu’elle manque de pain, on expédie, contre elle, non pas des secours de justice ou de bouche, tout d’abord ; mais la force armée qui étouffe la rébellion, aussi légitime soit-elle !
Le corps humain, malmené par l’ingestion habituelle d’aliments nocifs, par les atteintes du toxique, du stupéfiant alcool ou tabac, se plaint-il, quelque part, de ne plus pouvoir tant en supporter ? L’homme, le plus révolutionnaire du monde, enverra la force brutale, contre la province révoltée, sous la forme de médicaments provenant du pharmacien ou du bistrot, les deux se confondant de plus en plus.
Révolutionnaires contre la société et réactionnaire contre soi-même, dans des cas réclamant la même mesure de moralité, voilà une situation contradictoire commune à beaucoup d’hommes se prétendant éclairés, défenseurs de la vérité !
Pendant les quinze premières années que je me suis consacré à l’étude de l’ordinaire médecine officielle, je m’expliquais très bien pourquoi les maladies étaient innombrables.
Les faits ne démontraient-ils pas, à chaque instant, qu’il n’y avait pas de maladie ‒ au sens médical du mot ‒ mais rien que des malades ayant des affections « sur mesures » ?
La maladie me semblait s’apparenter aux mille incidences de la vie affective des sujets, aux mille tumultes de leur organisme malmené, aux mille attentats (jalousement dissimulés), livrés à la chair suppliciée et aussi à la conscience, jusqu’à l’abêtissement.
Dans ce monde, infiniment peuplé de secrètes dispositions, innées les unes, et vicieuses les autres, sur lequel s’échafaudait le mal, je voyais la médecine si petite et toujours tant distancée, par des affections nouvelles s’ajoutant à des milliers de maladies encore insaisissables, que je m’en voulais d’avoir perdu mon temps à le consacrer à une science vaine ne pouvant plus qu’à peine constater le mal, sans jamais le dépister à temps ni pouvoir lui couper les vivres surtout.
Les causes de la maladie, persistant et s’amoncelant, chaque jour et de plus en plus : alcoolisme, tabagisme, vinisme, carnivorisme, caféisme, cocaïnisme, falsificationisme, surmenage, sexualisme, prostitution et taudis creusant tous le lit, toujours plus profond, des fléaux les plus redoutables, les épidémies augmentant le nombre de leurs victimes, la société devenant le prolongement de l’asile d’aliénés, c’était, pour moi, plus qu’il n’en fallait pour me sidérer de stupéfaction lorsque j’entendais parler de la découverte qui devait assurer la guérison d’une des mille tuberculoses, aux cent têtes, décimant l’humanité.
Le mot guérison me semblait impropre à la maladie qui, pour moi, n’était tout d’abord qu’une force réagissant contre la puissance du mal, menaçant de tout incorporer à ses fins, mot impropre aussi, désormais, en pratique médicale honnête.
Littré n’avait-il pas dit, sans que sa parole trouve franchement écho dans le corps médical, que « la maladie est une réaction de la vie, soit locale, soit générale, soit immédiate, soit médiate, contre un obstacle, un trouble, une lésion » ?
Je ne croyais la possibilité d’appliquer le mot guérison, qu’à l’action qui consiste à se débarrasser d’un vice, d’une habitude, de passions ou de besoins contraires au bon sens, nuisibles à la santé, à la société, à la nature.
* * *
La maladie fait plus de mal autour du malade qu’à lui-même.
Une boutade reproduite maintes fois, nous fixera sur ce point : Une maman appelant le médecin au chevet de son enfant, atteint de rougeole, demanda au médecin, une réduction du prix de sa consultation parce que son petit avait collé la rougeole à tous les enfants du quartier !
Dans la médecine (établissant son règne sur de telles incidences), comme dans la politique, tout est opportunisme, relativisme, irresponsabilité, intolérance, abus.
Quelqu’un a dit :
« La cause du faible est un objet sacré ! »
Oui, cela est vrai si on considère que le faible, et le malade peuvent entraîner, avec eux, le reste de l’humanité dans le marasme, dans le néant alors cela devient pressant pour les forts, de s’occuper du faible les menaçant de tout contaminer même les médecins. Aussi serait-il urgent de faire de l’École de Médecine une École de prévention du mal et non pas une École de constatation et d’exploitation du mal, dans l’individu et dans la société.
Déjà, le malade instruit vraiment de son mal, de ses fautes et de ses ignorances, qui se soignerait, apporterait plus de sécurité que les malades au comble de la résistance au mal, s’en remettant au médecin de la maladie, aussi ignorant qu’eux du secret d’une bonne santé. Et puis, il n’y a rien de plus dangereux qu’un bien portant qui ne se soigne pas ; ne vaut-il pas mieux lui préférer le malade qui se soigne ?
Voilà donc la question de se bien soigner posée ; mais nous n’aborderons pas la solution de ce problème, si pressant, avant d’avoir insisté sur le détail que nous allons exposer.
La maladie est un accès de fièvre réagissant contre le mal, en voie de constitution ou déjà constitué, avons-nous dit déjà, mais nous nous devons d’ajouter que cet état de fièvre est, lui-même, organisé par une succession de petits états de fièvre non enregistrés par un organisme insensible, ou stupéfié, ou anesthésié, par vice de mal vivre.
Celui qui fume, se « chloroformise » ; comment pourrait-il être sensible aux sommations les plus désespérées de sa santé aux abois ? Celui qui boit un seul verre de vin (falsifié ou non), un seul petit verre d’alcool, ou simplement une tasse de café, provoque sur l’instant, un état de fièvre qui peut être supérieur à celui lui signalant à temps, le danger d’une contamination ou d’une affection naissante. C’est ce qui explique pourquoi ce dernier dira ‒ à qui voudra bien l’entendre ‒ qu’il ne se ressent jamais de rien, qu’il a un estomac à digérer du mâchefer, etc., jusqu’au jour où...
Se soigner, veut dire : avoir de la sollicitude pour soi. Prendre soin de sa santé, c’est avoir de l’attention pour soi, de l’inquiétude pour son foyer, pour sa vie et de la présence d’esprit en face des dangers de la maladie.
Une personne « sans soin » nous montrera parfaitement, par renversement des rôles, ce que nous devons faire pour nous soigner. Attendre pour se soigner qu’on soit, très malade, ou simplement malade, ce n’est pas avoir de la sollicitude, de l’attention pour soi, ni faire montre de présence d’esprit.
N’être pas disposé ou capable de se soigner, c’est se mépriser, ne pas s’aimer et n’avoir ni le droit d’aimer ni la prétention d’être aimé ; fumer, s’alcooliser, c’est se placer dans ce cas.
* * *
Se soigner, c’est échapper à l’esclavage des choses, pour s’évader de celui des hommes.
Se soigner, c’est rendre libres ses facultés sensorielles, pour être averti des moindres atteintes du mal et être en état de vaincre sans combats. Dans l’atmosphère putride des villes, sur les routes pétrolées des campagnes, par les eaux polluées des sources contaminées par l’industrie corrodant tout, le mal peut atteindre un homme, se soignant parfaitement, comme il atteindra un tout autre homme. Mais, c’est de la façon dont on se débarrasse du mal, de qui importe l’état de santé, et non pas de la façon dont on attrape ou supporte le mal.
Voilà en quoi diffèrent ceux qui se soignent de ceux qui ne se soignent pas.
En général, il faut se défier de celui qui déclare aimer mieux vivre « sa vie », pendant quelques années, plutôt que « végéter » pendant toute une vie... Ceux qui parlent ainsi sont des gens qui ne donnent espoir à aucun idéal, à aucune amitié, à aucun amour, à aucun espoir de s’élever, de vivre et éclairer l’avenir. Ce sont des « ventres », des « gueules », des « tubes digestifs à deux pattes », « des morts en sursis » desquels il fait bon s’écarter afin de les inviter, si possible, à la réflexion et se prémunir contre leur égoïsme maladif ou sadique...
La maladie vient se révéler sur le visage, en particulier, en y marquant les stades successifs des différents états qui la composent. Mais, combien sont nombreux ceux qui se font un visage par moyen de fards qui en transforment la nature ? Des gens bien portants se fardent, si maladroitement et si stupidement, qu’ils se font des physionomies de cancéreux, de pulmonaires, de cardiaques, de rénaux, de lymphatiques, de biliaires, rendant l’examen de leur visage difficile, à leur grand détriment.
Cependant, un mal signalé est un mal déjà dépisté ; la maladie aura d’autant moins d’acuité que la conscience organique ‒ le visage en est l’expression parlée ‒ aura été aidée, dans les secours réclamés, par les postes transmetteurs de ses appels. Une maladie qui cherche, en vain, à se signaler sur un corps insensible à ses sommations, verra l’énergie organique, propre à contenir le mal, dévier du point d’attaque et le mal accomplira, sans encombres, son œuvre jusqu’à son plein épanouissement.
Les symptômes du mal ne sont que les Indices des luttes que l’organisme livre aux éléments de morbidité, s’ajoutant, se succédant, dans l’ordre d’une évolution fatale, jusqu’à l’éclosion de la maladie. La maladie, c’est l’ouverture d’émonctoires supplémentaires à des fonctions ordinaires d’éliminations, trop encombrées, ou viciées dans leurs attributions.
La maladie, on le voit par tout ce qui précède, sera quelconque ; ce qu’il importe de savoir pour l’aider à réagir, c’est de connaître la nature des actions de vie de celui qui s’est livré au mal. Après ces renseignements obtenus, la lutte s’organisera automatiquement en ne la nourrissant plus de ses ordinaires pâtures. La maladie est toujours précédée d’états prédisposant à ses atteintes ; ces états correspondent tous à des erreurs alimentaires, à des abus qui, connus, permettent de prédire, longtemps à l’avance ‒ en tenant compte du passé pathologique du sujet ‒ l’affection qui résultera de ces causes de morbidité.
La maladie est toujours précédée, aussi, d’une certaine effervescence organique, marquant sur le visage une apparence trompeuse de bonne santé. Cet état peut durer quelques semaines, quelques mois ‒ voire même quelques années ! ‒ car la maladie ne s’organise pas d’un jour à un autre, elle couvera un certain temps, qui variera avec le pouvoir réactif du sujet.
Un cerveau abêti par des pensées morbifiques ou émasculatrices de l’intelligence organique, un estomac abruti par le faux-aliment et le surmenage qu’il réclame de celui qui en use, se verront condamnés dans le pouvoir, qu’ils ont, de signaler le moindre mauvais usage que l’on fait d’une vie.
Toutes les tares, toutes les maladies, avons-nous dit, se révèlent sur le visage humain.
Alliées au caractère, les maladies et les tares qui les créent, bien souvent, creusent les mêmes stigmates, les mêmes sillons, les faisant se révéler à un œil observateur, médecin ou non.
Le développement physique d’un sujet malade aura été marqué d’arrêts, de déficiences, de carences, comptant leurs altérations dans un visage.
L’éducation, elle-même, apporte, sur une physionomie, l’influence, bonne ou mauvaise, de ses principes.
Les indications héréditaires s’inscrivent en tête de liste du tout, marquant, plus spécialement, les défauts de nature sur lesquels s’échafaudent les affections nées des prédispositions fa tales.
Plus tard, les déformations professionnelles et le « physique de l’emploi » s’ajouteront, avec les traces des désastres causés par les vicissitudes de la vie contemporaine, à une foule d’indices compromettant l’harmonie, la régularité ou la normalité du visage.
Un petit adénoïdien (végétations nasales), un petit amygdalien (végétations du pharynx), un petit myxœdémateux, un petit candidat à l’acromégalie (augmentation considérable des extrémités), verront leur visage subir, graduellement, une transformation les moulant, sous l’empreinte de leurs affections dues, la plupart, à une mauvaise alimentation, de famille. Les malades du rein, du cœur, du foie, des poumons, de l’estomac, de l’intestin, de l’innervation, de la circulation, de troubles génitaux, afficheront sur leur visage, en lettres majuscules, la nature et la virulence de leurs maux.
L’examen de l’œil, des dents, des muqueuses, de la peau, de la forme et de la coloration du nez, des joues, des lèvres, offre le moyen de prévoir le mal avant son éclosion. Les oreilles, elles-mêmes, le cheveu, ont leurs attitudes pathologiques.
Pour connaître tout cela, j’ai passé une longue partie de ma vie à des études de sémiologie (art de dépister le mal) et je me suis, un jour, rendu compte que c’était trop de vanité de ma part, puisque je découvrais, enfin, qu’il ne suffit pas de dépister le mal, si on ne peut pas en détruire les causes profondes...
‒ Louis RIMBAULT.
MALCHANCE (et CHANCE)
n. f. de mal et chance
« Le mot chance, chéance, kéance, kéanche (latin cadencia, de cadere, choir) était d’abord un terme du jeu de dés et signifiait le point que donne un dé en tombant (chéant) sur la table, ou bien encore un coup de dé » (Larousse). Sens général : probabilité unilatérale, bonne fortune, succès, tournure privilégiée des événements, attribués au « hasard », aux coïncidences, à l’intervention d’une force protectrice (naissance, signe astral, protection divine, etc.). Voir les mots hasard, jeu, préjugés, religions et religiosité, superstitions, etc. La malchance correspond aux états et aux situations contraires : circonstances hostiles, dénouements adverses, accidents regardés comme malheureux. Plus encore que la chance, la « malchance » saisit l’esprit de ses croyants ; elle leur inspire comme une inquiétude permanente, les frappe de prostration découragée, les incline au fatalisme. Qu’il s’agisse de chance ou de malchance, nous sommes évidemment en présence d’un tri tendancieux de cas fortuits et de déductions qui procèdent des superstitions générales engendrées par la faiblesse, la crédulité et l’ignorance.
Il est logique que les hommes qui s’aventurent dans le tournoi périlleux de la Société contemporaine, de ce capitalisme qui ne doit son pseudo-équilibre qu’au déplacement, calculé et méthodique, des « chances » dont il connait et manie les directives, soient plus souvent des « chançards » et des « malchançards » que ceux qui s’évadent et vivent harmonieusement en la Nature.
Si les mots chance et malchance étaient pris dans le sens exact de leur étymologie, on les confondrait littéralement. En effet, combien de gens prennent pour malchance des épreuves salutaires à l’enseignement de la vie, et qui sont ainsi de véritables chances. Inversement, des chances entraînent à des conséquences désastreuses pour la conscience et l’avenir de ceux qui en sont les privilégiés les plus enviés.
Chance et malchance veulent exprimer la probabilité de réussite, l’alternative ; c’est le coup du hasard, le coup de dés et cependant bien que, ainsi entendu, l’homme demeure étranger à l’issue envisagée, on emploie couramment les expression suivantes : Cela est soumis à bien des chances ‒ Rendre les chances égales ‒ Si nous n’amenons pas toutes les chances à nous ‒ Quand on a les chances contre soi ‒ Calculer les chances ‒ On va tenter la chance, etc.
Si la chance et la malchance sont coup de dés, comment peut-on la calculer ? Comment peut-on entreprendre de l’amener TOUTE à soi ? Avoir les chances contre soi, c’est les distinguer, les identifier ; tenter la chance, c’est en connaître la nature. C’est un peu ce qui se passe dans les sociétés de « veinards », les sociétés d’hommes les plus austères, les plus rigides, les plus imposantes, se réclamant de quelque église ou politique que ce soit, véritables syndicats de garantie contre les coups d’un destin, (dont ils sont les maîtres !) De peur d’être victimes, ces hommes s’assurent des concours d’influences et d’intérêts, plus ou moins honnêtes, laissant bien loin derrière eux les scrupules enseignés par l’idéal dont ils se réclament. Ils organisent avant tout leurs chances. En somme, toute la morale contemporaine des chançards et des malchançards se tient en ces expressions de l’égoïsme le plus étroit et le moins pacifiste : amener la chance qu’il leur faut, calculer et favoriser la chance (la leur), tourner la chance contre autrui...
Pour nous la malchance, chez nombre de gens, peu clairvoyants, c’est l’épreuve ; la malchance, c’est la nature par trop rudoyée, la justice naturelle méprisée, fixant leurs inéluctables arrêts ; la malchance, c’est l’effet de quelques trahisons envers soi ou envers autrui ; la malchance, c’est la perte de l’appétit après avoir violenté son organisme ; la malchance, c’est être obligé de servir la guerre, corollaire d’une avidité générale ; c’est de payer son tribut de douleur et de déchéance à tous ces faux besoins tels que : Alcool, boissons fermentées, tabac, café, thé, opium, « coco », et aussi l’or, le luxe, les pierreries et tous les hochets, souvent homicides, de la vanité ; la malchance, c’est le total d’une addition de petits mensonges, de dissimulations, de cachotteries envers les petits qui, le plus innocemment du monde, deviennent des mauvais courriers ; la malchance, c’est tomber sous le bistouri du chirurgien après avoir armé le bras du boucher ; la malchance, c’est avoir des mauvais fils, au sang corrompu, après les avoir intoxiqués ou nicotinisés jusqu’aux moelles par une alimentation malsaine et des médicaments par dessus le tout ; la malchance, c’est se voir livré à l’exploitation à vie, pour contenter des vices ou des passions qui s’opposent à la liberté et justifient les parasites, les fraudeurs et leurs juges ; la malchance, c’est refuser son secours aux misérables qui, laissés sans soins, peuvent semer l’épouvante en étendant leurs purulences sur le reste de l’humanité ; la malchance, c’est l’hôpital après la ripaille, indigente ou dorée ; c’est la prison après les performances de l’arrivisme tragique ; c’est la mort stupide après avoir méprisé la vie et l’oubli pour n’avoir jamais existé.
Celui qui ne veut être servi que par ceux qu’il sert lui-même et ne veut connaître de trahisons que celles qu’il avait prévues, après avoir travaillé pour les rendre moins indignes, ne connaît pas la malchance.
‒ L. RIMBAULT.
MALFAITEUR, MALFAITRICE
n. (latin malefactorem, de male, mal et facere, faire)
Couramment : Qui commet des crimes, des actions coupables ou, pour mieux dire, des actes mal considérés par l’opinion et punissables par les lois : jardin saccagé par les malfaiteurs. La loi punit des travaux forcés toute association de malfaiteurs, etc.
Ce qualificatif s’applique à tout individu qui agit dans un sens contraire à la morale, aux mœurs, ou aux lois. Le fait que morale, mœurs, lois, sont essentiellement multiples et changeants ; qu’ils se différencient selon les pays, les climats, les latitudes ; selon le temps, et les développements de l’économie ou de l’intelligence, il s’en suit nécessairement que ce terme de malfaiteur n’a une valeur ni absolue, ni immuable, puisqu’il suit les fluctuations mêmes du Bien, et du Mal (v. ces mots).
C’est ainsi que l’on considère comme « malfaiteur » un ou plusieurs individus qui s’attaquent à la propriété des autres et s’en emparent par la force, ou par fraude, ou par chantage, la propriété étant encore considérée comme « un droit inviolable et sacré », ceux qui détruisent ou endommagent cette propriété, etc. Alors que tout le monde saisit confusément, si sa compréhension ne l’admet encore en dépit de l’évidence, que les « biens » actuellement détenus par les propriétaires ont leur source, directe ou indirecte, dans l’exploitation, le dol, le vol (selon l’aphorisme connu de Proudhon) ou dans la violence conquérante, le rapt armé : guerres, expéditions coloniales, etc... Mais des détenteurs de la propriété, les lois consacrent et consolident les prérogatives. Et il voient les agissements les moins recommandables, mais perpétrés dans le sens officiel de cette propriété, couverts ou tolérés par le code. Et leur fortune, leurs influences, la solidarité qui lie entre eux les bénéficiaires, s’emploient à incorporer rapidement leurs actes dans la légalité, ou à tourner celle-ci le cas échéant, s’ils commettent quelque infraction et se livrent à des manœuvres pourtant regardées comme répréhensibles. Leur situation fait d’eux, malgré tout, des « honnêtes gens »... (voir honnêteté, propriété, vol, etc.).
Règle générale, qu’un individu, soit par vengeance, jalousie, ou dans l’intention de le voler, tue un autre individu, il est à peu près certain que, « malfaiteur », on l’arrêtera et que si on ne le tue pas, on l’enverra finir sa vie au bagne. L’ordre de faits n’est pas différent si, au lieu d’un « malfaiteur », plusieurs se sont groupés pour le meurtre : ce sera la mort ou les travaux forcés. Et cependant, lorsque ceux qui président aux destinées d’une nation, rois, dictateurs ou parlements ‒ estimant que les industriels ou les commerçants, ou les banquiers de leur pays, ont besoin de s’emparer de territoires, de mines, d’usines, d’acquérir une clientèle pour leurs produits, d’obtenir des placements avantageux pour leurs capitaux ‒ dressent des millions de jeunes gens au maniement des armes, les plus meurtrières, leur font enseigner l’art de tuer sur une vaste échelle, de brûler les villes, les fermes et les moissons, d’empoisonner les eaux ou les airs, de répandre des maladies monstrueuses, de détruire tout ce qui a vie, pourvu que soient respectées certaines formes des lois qu’ils font, défont et transforment eux-mêmes, cela n’est pas regardé comme l’œuvre d’un malfaiteur, mais, au contraire, d’un grand politique, d’un penseur éminent, d’un patriote averti ! Vous chercheriez en vain une différence, quant au fond, entre le malfaiteur et ce « grand honnête homme ». Cela est tellement vrai qu’un grand catholique : J. de Maistre, dans son livre fameux : Du Pape, 1821, écrit... « ce qu’on ne saurait lire sans un sentiment profond de tristesse, c’est l’accusation intentée contre les Papes d’avoir provoqué les nation an meurtre. Il fallait au moins dire à la guerre ; car il n’y a rien de plus essentiel que de donner à chaque chose le nom qui lui convient. Je savais bien que le soldat tue, mais j’ignorais qu’il fut meurtrier. On parle beaucoup de la guerre sans savoir qu’elle est nécessaire, et que c’est nous qui la rendons telle. ».
Or, la loi civile, comme la loi religieuse, sont parfaitement d’accord pour considérer comme criminel l’acte qui prive le prochain de sa vie, dans quelque but que ce soit. Cependant l’État, qui par le service militaire, exerce au meurtre, qui, par la déclaration de guerre, déclenche le massacre ; et le juge qui condamne à mort un individu, lequel peut fort bien être du reste innocent de ce dont on l’accuse ; et le bourreau qui l’exécute ; et le prêtre qui exhorte le patient ; et l’avocat qui sanctionne par sa présence ; et le public qui laisse faire ; et, d’autre part, dans la vie quotidienne, l’usinier, le patron qui, par « économie », ne garantit pas ses ouvriers contre les risques, et l’ouvrier qui bâtit des maisons défectueuses, susceptibles de s’écrouler, qui fabrique des conserves qu’il sait toxiques, des armes dont il connaît la nocivité ; et le professeur qui sophistique son enseignement pour faire accepter la nécessité de la douleur, de la soumission, du sacrifice ; et les journalistes, écrivains, orateurs, qui trompent le public pour mieux le plier à l’asservissement des gouvernants ; enfin, tous les parasites, les inutiles, qui spéculent sur le travail des autres, s’enrichissent de leur misère et de leurs souffrances, les surmenant et abrégeant ainsi considérablement leur vie ; tous ces gens-là (des canailles par quelque côté, c’est évident), ne sont frappés ni de la réprobation ni du châtiment public : ce ne sont pas des malfaiteurs.
Mais le pauvre être falot, né dans un milieu corrompu, sans pain ni vêtements, sans éducation ni instruction, sans métier ni volonté, qui n’a « poussé » qu’en volant et en mendiant, avec, sous les yeux, l’exemple de la bassesse, du vol, de l’estampage, du « maquereautage », du crime : malfaiteur !
Mais la fillette qui grandit de même, qu’on viole à douze ans pour dix sous, une friandise, un abri, ou pour rien ; qui vend son corps aux passants, risquant la maladie et la maternité, refoulant ses dégoûts, qui se révolte un jour et qui vole dix francs dans la poche d’un « miché » : malfaitrice !
Mais la jeune fille, la femme, ignorantes des choses de la conception, que séduit un homme (où mufle, ou ignorant lui aussi) et qui, à la naissance d’un enfant non désiré, qu’elle ne peut pas élever, le tue : malfaitrice. Ou bien, si enceinte et ne pouvant assurer les charges d’une maternité, elle se fait avorter, rendant au néant ce qui n’est encore qu’un amas de cellules sans conscience : malfaitrice.
Malfaiteur encore celui que les infirmités, l’âge ou le chômage jettent à la rue et qui n’a pas de toit pour l’abriter. Malfaiteur celui qui, devant les abus de l’autorité, s’indigne et dit haut et fort, ou écrit ce qu’il pense ; celui dont le geste traduit le sentiment, l’exaspération ; malfaiteur celui qui ne veut voir dans le drapeau, au lieu d’un symbole de gloire, qu’un symbole de souffrance, de haine. Malfaiteur, en définitive, le clairvoyant, le juste, le révolté. Mais malfaiteur surtout le malheureux, le déshérité !
En vérité, autour de nous, seul le faible est malfaiteur. Qu’il ait pour lui la force et le crime est absous, quand il n’est pas vénéré. Dans la société actuelle, il ne s’attache à ce mot aucune idée réelle de justice ou d’injustice, mais seulement de faiblesse.
‒ A. LAPEYRE.
MALLÉABILITÉ, MALLÉABLE
n. et adj. latin malleare (de malleus, marteau), battre au marteau
Au propre, malléable signifie : qui peut être étendu sous le marteau et conserver la forme donnée. La malléabilité des métaux ‒ quoiqu’ils soient pour la plupart à la fois ductiles et malléables, ils ne possèdent pas ces deux qualités au même degré ‒ est en général faible à la température ordinaire. On l’accroît en portant le corps à travailler à une température plus ou moins élevée. Non seulement ils obéissent alors au refoulement et s’aplatissent sous la frappe, mais ils sont susceptibles de s’allier étroitement soit avec une portion de même nature, soit avec un autre métal. La forge utilise depuis longtemps la malléabilité du métal chaud pour façonner et souder le fer. Cette propriété est mise aussi à profit par le laminoir pour étirer en feuilles ou en fils. L’or est le plus malléable des métaux. Il peut être aminci jusqu’à un dix-millième de millimètre. Le nickel est parmi les plus résistants.
Au figuré, malléable se dit des êtres à qui l’on imprime aisément sa volonté, que l’on plie à ses desseins. Chez l’enfant, le cerveau est davantage malléable et familles et pédagogues multiplient les efforts ‒ souvent conjugués ‒ pour façonner le caractère et la conscience selon les préjugés du temps, la morale et les institutions en vigueur. Il ne faut pas cependant s’exagérer cette malléabilité du jeune âge et s’imaginer qu’il offre une cire molle et vierge attendant l’influence et obéissant sans réaction à la pression des déformateurs. L’enfant apporte en naissant des dispositions héréditaires et un tempérament ‒ tares ou qualités ‒ qui résistent parfois victorieusement à toutes les tentatives faites pour les modifier. Mais, malgré ses insuccès partiels et sa portée limitée, la mesure dans laquelle agit l’éducation est encore suffisante pour inquiéter d’une part tous ceux qui s’intéressent au développement de la personnalité et d’autre part pour expliquer que religions et systèmes sociaux fassent des efforts persévérants pour assujettir l’enfant à leurs desseins. Ajoutons que les scrupules de sauvegarde des premiers ont presque toujours à contrecarrer des tendances et des acquis hostiles tandis que l’école et le groupe familial opèrent davantage ‒ pour la majorité des cas ‒ dans le sens des dispositions natives et du milieu et agissent surtout en renforcement. Avec l’âge l’individu se fixe et se laisse moins entamer. Mais il demeure cependant assez malléable pour s’abandonner aux altérations que lui font subir, par des campagnes intéressées, gouvernants et meneurs, pour abdiquer sans résistance entre les mains des grands et céder aux aberrations jusqu’à leur sacrifier sa vitalité.
‒ L.
MALTHUSIANISME et NÉO-MALTHUSIANISME (ou MALTHUSISME et NÉO-MALTHUSISME)
n. m.
Doctrine biologique, économique et sociale, dont le nom vient de Malthus (Thomas-Robert), économiste anglais (1766 — 1834), qui en formula les premiers principes.
Ce sont les vues sociales et morales des révolutionnaires français du XVIIIe siècle, notamment celles de Condorcet, ainsi que les théories de William Godwin, protagoniste d’idées communistes, qui amenèrent Malthus à publier les objections qu’il avait formulées déjà dans les cercles savants, contre les plus ardents partisans des systèmes socialistes et des réformes conduisant à l’application de ces systèmes.
Sans nier la valeur des critiques adressées à l’organisation sociale, sans méconnaître la noblesse du but poursuivi par les apôtres d’un changement dans cette organisation, Malthus expliquait que les vices reprochés aux gouvernements ne leur étaient pas entièrement imputables. Des obstacles naturels, indépendants des régimes sociaux, s’opposent à toute réalisation de vues généreuses, à tout perfectionnement des sociétés et des individus et maintiennent parmi les hommes la misère, le vice, la souffrance. La cause principale qui agit constamment et puissarnment pour entretenir « cette distribution trop inégale des bienfaits de la nature que les hommes éclairés et bienveillants ont de tout temps désiré de corriger », c’est la tendance constante qui se manifeste, non seulement dans l’espèce humaine mais chez tous les êtres vivants, à accroître les individus plus que ne le comporte la quantité de nourriture qui est à leur portée. (Darwin allait plus tard utiliser cette vérité pour développer la doctrine de la sélection naturelle).
Pour rendre en ce qui concerne l’homme sa démonstration plus tangible, pour illustrer sa thèse, Malthus confrontait dans une opposition très nette deux principes, ou lois, auxquels il donnait un tour mathématique frappant, qu’on peut ainsi formuler :
-
Toute population humaine, si aucun obstacle ne l’en empêche, s’accroit, de période en période, en progression géométrique ;
-
Les moyens de subsistance, notamment la nourriture, ne peuvent, dans les circonstances les plus favorables, augmenter plus rapidement que selon une progression arithmétique.
Pour établir le premier point Malthus s’appuyait sur la fécondité féminine et sur des accroissements constatés dans les pays où la population n’avait été que peu gênée dans sein expansion. Il admettait que le doublement de la population pouvait avoir lieu, comme aux Etats-Unis, déduction faite de l’émigration et de la reproduction de l’émigration, durant les périodes envisagées, en l’espace de 25 années.
C’était rester bien au-dessous de la réalité. Au vrai si les femmes donnaient tous les enfants qu’elles peuvent avoir de l’âge de la puberté à celui de la ménopause, si tous les êtres nés pouvaient recevoir les soins qui leur sont nécessaires, tous — presque tous, en admettant une mortalité prématurée inévitable — si, en somme, les obstacles agissaient au minimum, la population doublerait dans une période beaucoup plus courte.
Mais, quelle que soit cette période, qu’elle soit de 13 années comme le voulait Euler, de 10 années, comme le pensait William Petty, de 25 années, comme l’admettait Malthus, qu’elle soit de 50 ans ou même de 100 ans, le fait même, le fait seul de l’accroissement possible en progression géométrique est indéniable. Il conduit à une augmentation énorme et rapide de la population .
Quant à la loi d’accroissement de la nourriture, si l’on peut admettre que, par un développement extraordinaire de l’industrie agricole, les produits récoltés puissent doubler une première fois dans une période de 25 années, il est certain que nous serons en dehors de toute vraisemblance en admettant qu’elle puisse quadrupler dans les 25. années suivantes. Personne ne peut un instant admettre l’augmentation en progression géométrique indéfinie de la production alimentaire. Même il est impossible de l’admettre indéfiniment en progression arithmétique. Un principe agronomique, hors de conteste, celui de la productivité diminuante du sol, celui de la productivité de la terre non proportionnelle aux capitaux et au travail qu’on lui applique, s’oppose à la progression indéfinie des récoltes. Mais Malthus feignit, par une concession exagérée à ses critiques, que ce dernier accroissement pouvait avoir lieu.
Confrontant ensuite les deux progressions, il montrait sans peine que la première l’emportait énormément sur la seconde, qu’il y avait disproportion colossale entre deux lois naturelles, qu’une antinomie formidable existait entre la faculté reproductive des hommes et la productivité de la terre, entre l’amour et la faim. D’où il suit évidemment que la lente progression de la quantité de nourriture entrave l’exubérance reproductive naturelle de la population, forme l’obstacle initial et général à son augmentation rapide, d’où il suit que le nombre des hommes est de toute nécessité contenu dans la limite des produits alimentaires.
La population ne s’accroît donc pas généralement en progression géométrique, elle tend seulement à le faire : la population a une tendance constante à s’accroitre au-delà de la limite alimentaire. C’est la loi de Malthus. Elle exprime ou la tendance réelle à un accroissement supérieur, comme celle qui s’est toujours manifestée au cours des temps, comme celle qui se manifeste de nos jours, dans toutes les nations, et dont la conséquence est une pression, variable selon les pays, de la population sur les aliments, ou une tendance virtuelle, qui serait celle d’une société dont les membres agiraient pour refréner, régler leur reproduction et supprimer l’avance que leur nombre pourrait prendre facilement sur les subsistances.
L’obstacle initial, fondamental, au développement de la population est donc le manque de nourriture. Mais il n’agit d’une manière directe et violente que dans le cas de famine. La recherche des subsistances, la crainte du manque et de l’insuffisance, produisent un grand nombre d’obstacles dérivés, habitudes, mœurs, coutumes individuelles, familiales, sociales. Ces obstacles à l’accroissement de la population ne peuvent être évidemment que de deux sortes :
-
Ils détruisent prématurément les existences ;
-
Ils empêchent les naissances.
A la première catégorie appartiennent les famines, les guerres, les meurtres de toute sorte, les épidémies, les occupations malsaines, le surmenage, la mauvaise hygiène, etc., tout ce qui se rapporte à la pauvreté, à la misère. Ce sont les obstacles répressifs. On peut les assembler sous ces deux chefs : homicide, infanticide.
A la seconde catégorie appartiennent la stérilité, la chasteté, l’avortement, les moyens d’empêcher la conception. Ce sont les obstacles préventifs. On peut les réunir sous ces trois rubriques : avortement, anticonception, chasteté.
L’action de l’un ou de plusieurs des obstacles de la catégorie préventive a-t-elle été quelque part assez puissante pour supprimer définitivement l’action des obstacles répressifs ? On peut à cette question, disent les malthusiens, répondre par la négative. L’examen des obstacles à la population dans les différents pays sauvages, barbares, pasteurs, civilisés, anciens et modernes, de même que la statistique, l’histoire, l’ethnologie, les relations des voyageurs montrent que jamais, nulle part, quelle qu’ait été leur puissance, les obstacles préventifs ne se sont suffisamment manifestés, qu’ils ont toujours laissé place à une action prépondérante des obstacles répressifs douloureux. Aujourd’hui, comme de tout temps, ces derniers détruisent un nombre effroyable de vies humaines. Le nier, selon les malthusiens, c’est nier les bas salaires, le chômage, la faim, les haillons, les taudis, la misère, c’est nier le prolétariat et ses revendications, c’est nier la guerre.
Le hasard préside aux mouvements de la population.
Par l’ignorance et l’insouciance parentale, les hommes arrivent au jour dans une société pauvre, incapable de leur assurer les produits de première nécessité. Non que les humains multiplient tout à fait comme des animaux. A des degrés divers ils sont capables de prudence génésique, mais si, en cette affaire, une minorité fait intervenir la raison, des brutes en nombre immense s’abandonnent aux impulsions de leur appétit sexuel. La plupart des couples engendrent plus d’enfants qu’ils ne sont capables d’en nourrir et élever convenablement. L’immense prolétariat est fécond. C’est à sa pullulation qu’il doit sa misère et son nom.
La faculté reproductrice de l’espèce humaine donc, insuffisamment refrénée, suit sans difficulté toute augmentation de production, comble sans effort les vides produits par la mort. A un accroissement de subsistances correspond un accroissement supérieur de population. Par l’ampleur donnée à la culture, la foule humaine devient plus nombreuse, mais non pas moins pressée, mais non pas plus heureuse. Semblable à une barrière extensible, à un anneau élastique étreignant un faisceau, la production enserre à tout moment la population, la maintient dans sa limite avec une vigueur d’autant plus grande que l’accroissement humain tente avec plus d’énergie de la franchir. Serrés les uns contre les autres dans l’espace étroit où les enferme une force supérieure les hommes luttent, s’entre-déchirent, tandis que de nouveaux combattants naissent, occupent les places laissées par la mort, et maintiennent, avec la pression permanente sur la limite variable des subsistances, la misère, la douleur et le malheur, la cruauté et la haine. La cause initiale des souffrances humaines, que toutes les écoles socialistes et anarchistes attribuent uniquement à une organisation défectueuse des sociétés, réside ainsi avant tout, selon le malthusianisme, dans la puissance de l’instinct générateur.
Les malthusiens soutiennent en conséquence qu’on ne peut pas plus faire de sociologie sans tenir compte de la loi de population, qu’on ne peut faire d’astronomie sans la loi de gravitation. Cette loi est, suivant eux, la cause originelle, occulte, puissante, de causes secondes plus apparentes, comme la propriété individuelle, la distribution inégale des richesses, l’autorité, etc., qui retiennent davantage l’attention et provoquent l’action généreuse des militants sociaux.
Il n’est guère possible ici de répondre à toutes les objections qui ont été faites à la loi malthusienne. En général elles appartiennent, dit le malthusien J.-S. Mill, à la catégorie des sophismes par ignorance du sujet. Ceux qui découvrent que l’expérience n’a pas confirmé la double progression géométrique de la population, arithmétique des subsistances, ou ceux qui formulent des lois particulières en remarquant par exemple que la population peut être plus nombreuse dans un pays où la terre est fertile et qui possède des avantages naturels que sur un sol ingrat, ne s’opposent pas au principe de population.
Les malthusiens n’ont jamais prétendu que la terre soit arrivée à sa plus haute puissance de production et ne puisse nourrir beaucoup plus d’habitants qu’il n’en existe aujourd’hui, ils ne soutiennent pas que la population ne puisse s’accroître par la culture de nouveaux terrains, par l’amélioration du sol, par une dépense plus considérable de capital et de travail, par l’intelligence et le labeur des habitants, par une sage économie de toutes les forces productives et de tous les produits, etc. Ce qu’ils disent, c’est que toute augmentation, par un moyen quelconque, des produits à consommer, a eu et aura pour conséquence, aussi longtemps que la reproduction ne sera pas fortement et généralement contenue, une augmentation correspondante de la population, et qu’ainsi le rapport entre les deux termes reste le même. Chaque vieille nation et la terre entière, demeurent à tout moment trop peuplées, non pas par rapport à la surface, mais par rapport aux produits disponibles. Il en fut ainsi à chaque époque en général, à un degré plus ou moins grand, depuis les débuts de l’humanité.
Parmi les adversaires de la thèse malthusienne il faut retenir le philosophe anarchiste Kropotkine qui s’est efforcé de prouver que la surpopulation, c’est-àdire le trop-plein de population par rapport à une production agricole donnée, est une absurdité aussi bien en ce qui regarde le présent qu’en ce qui concerne l’avenir. Il s’est attaché à démontrer qu’on peut faire de merveilleuses récoltes sur des espaces restreints, qu’on peut obtenir par exemple toute la nourriture nécessaire annuellement à un homme sur une surface bien cultivée et fertilisée de 200 m2. Une simple multiplication lui permet d’affirmer que le territoire cultivable d’un pays comme l’Angleterre ou la France pourrait nourrir sans importation des centaines de milllons d’habitants.
Il n’y a pas, selon les malthusiens, d’argument plus fallacieux et au demeurant plus ridicule que celui-là :
« On éprouve, dit l’un d’eux, quelque humiliation à la pensée qu’il a pu faire les délices d’une multitude de publicistes et de journalistes bourgeois ou libertaires. Mais ce n’est qu’une illustration de plus de cette vérité qu’un esprit généreux peut être en même temps un esprit faux. »
La quantité de matière fertilisante répandue sur un are ou deux ares peut être facilement trouvée chaque année, mais celle qui est nécessaire pour fertiliser les millions d’ares cultivables de pays comme la France, l’Angleterre, l’Allemagne, ou la Russie, etc. n’est pas disponible, elle est déficitaire. Il n’y a pas assez de produits fertilisants pour généraliser les méthodes de culture intensive.
William Crookes a démontré il y a quarante ans que ce problème de l’insuffisance des matières fertilisantes, des nitrates entre autres, devenait de plus en plus urgent, qu’il agirait sur la situation des masses humaines, que la réduction des exportations de l’Amérique du Nord, où les terrains neufs abondent cependant, et la hausse du coût de la vie se feraient sentir de plus en plus. Kropotkine n’a même pas fait allusion au travail de l’éminent physicien anglais. A la vérité, sir William Crookes pense qu’on pourrait conjurer le péril, au moins un certain temps, par la synthèse chimique des nitrates.
« Il n’est pas loin d’être insensé, de la part du prince Kropotkine, de se lancer dans la démonstration des possibilités infinies de production des subsistances sans tenir compte de l’opinion de Crookes. Il lui faut se souvenir que chaque fois qu’il accroît la récolte du blé d’une tonne il doit trouver, pour qu’il en soit ainsi, 20 kilogrammes au moins de nitrogène utilisable et indiquer comment il peut obtenir le total de matière fertilisante nécessaire. Nous n’ignorons pas que certains agriculteurs estiment qu’il y a environ 500 kilogrammes de nitrogène et 400 kilogrammes d’acide phosphorique présents, par are, dans les vingt premiers centimètres de profondeur d’un sol moyen. Mais il appert que tout cela n’est pas disponible pour l’assimilation immédiate par les plantes et ne doit le devenir que graduellement, suivant une lente progression, justifiant, en fait, l’accroissement arithmétique des subsistances que Malthus suggérait. » (Dr Ch.-V. Drysdale)
Si Kropotkine avait lu W. Crookes, ajoute le Dr Drysdale, nul doute qu’il se serait rallié à ce physicien quand il déclare que si la puissance électrique du Niagara, était appliquée à la synthèse des nitrates, elle pourrait pourvoir à l’accroissement de la population mondiale pour des années à venir. Mais il faut dire que William Crookes a pris une estimation trop faible des possibilités d’accroissement de l’espèce humaine. Il ne s’agit, dans sa pensée que d’un accroissement lent, au taux actuel, accroissement maintenu par le célibat, la restriction volontaire, l’avortement et la perpétuelle sous-nutrition. Au fait, en application de l’idée de Crookes, les mines gui produisaient de l’acide nitrique ou du nitrate de calcium, donnaient, en 1912, selon le Dr Ch.-V. Drysdale, pour une force de 200.000 H. P. une production annuelle de 60.000 tonnes d’acide nitrique et de cynamide de calcium, c’est-à-dire pas mème le centième de ce qui est nécessaire pour maintenir la récolte anglaise à son taux actuel. Le Dr Ch.-V. Drysdale dit encore :
« Quoique des merveilles puissent être encore accomplies dans l’avenir, la raison peut-elle admettre que ces merveilles arrivent à pourvoir à un doublement de la population mondiale seulement tous les trente ans ? »
Pour tenir tête à un accroissement comme celui que ne craint pas d’envisager Kropotkine, il faudrait qu’immédiatement les récoltes soient portées à plusieurs fois (peut-être trois ou quatre fois) ce qu’elles sont aujourd’hui et périodiquement accrues au même taux.
Il est étonnant que les théoriciens qui combattent Malthus ne soient pas frappés du peu de progrès réalisés depuis qu’il s’agit de culture intensive. Il est étonnant aussi que des anarchistes imbus des idées de Kropotkine ne se soient pas mis à la besogne pour démontrer l’excellence de ses vues, même sur de petits territoires. Le peu de renseignements qu’on peut avoir sur les colonies agricoles socialistes ou anarchistes, en France ou en pays lointains, tendent à démontrer qu’il n’est pas aussi facile d’accumuler les récoltes en grange que de les amonceler sur le papier. La pratique journalière agricole, même celle qui s’inspire des essais de laboratoire, atténue considérablement les exagérations des cultivateurs en chambre. Il est en outre tout à fait puéril de s’imaginer que les agronomes, que les propriétaires et les fermiers soient, de parti pris, hostiles à toute agriculture scientifique. L’intérêt est un motif puissant d’action. Si les procédés dont fait état Kropotkine étaient facilement applicables, s’ils donnaient à coup sûr les résultats annoncés, ils seraient vulgarisés depuis longtemps.
Il y a aussi, parmi les adversaires des malthusiens ceux qui les invitent à envisager les progrès futurs, à compter par exemple sur la fabrication industrielle des aliments. Leur objection appartient aussi, selon les théoriciens malthusiens, à la catégorie des sophismes par ignorance du sujet. Les pastilles azotées de Berthelot ne pourraient vaincre qu’un moment la difficulté. Leur fabrication, l’intervention aussi de la radio-activité, ou même simplement la fabrication industrielle d’engrais azotés puisés dans l’air, reculeraient simplement fort loin la limite de l’enclos qui nourrit les hommes, mais ne produiraient qu’une amélioration temporaire dans leur situation, à moins que n’interviennent les obstacles préventifs.
Or, les pastilles que Berthelot promettait, il y a près de quarante ans, n’existent pas encore et si la synthèse ammonicale et la radio-activité promettent, elles ne nous font pas encore tenir. Rien de tout cela ne nourrit présentement les milliers et les milliers d’hommes auxquels l’agriculture, et même l’industrie, manquent à pourvoir.
La loi malthusienne est universelle et perpétuelle.
Les facultés de reproduction de l’homme, et les facultés de productivité du sol sont facultés naturelles, générales, permanentes. A supposer que la pression de la population sur les subsistances cesse par l’effet d’une action concertée, judicieuse, réglant la marche de l’accroissement humain sur celle des subsistances disponibles, la loi de population n’en régirait pas moins virtuellement l’humanité comme la loi de la chute des corps régit l’avion qui vole.
Tel est le principe. Et les malthusiens combattent la croyance générale que la terre donne aujourd’hui assez de moissons pour nourrir abondamment et les vivants et tous ceux qui peuvent être appelés au monde. L’affirmation suivant laquelle il y a constance d’excédents de produits, l’affirmation que la quantité d’aliments récoltés dépasse de beaucoup les nécessités de la consommation est fausse pour eux. Dès qu’on calcule, tout montre, suivant eux, au regard de la population, pénurie pennanente de subsistances et de capitaux.
Deux faits s’élèvent, disent-ils, contre l’idée vulgaire de la surabondance d’aliments : le coût élevé de la vie, la spéculation. Un surcroît de denrées devrait, par l’action de l’offre et de la demande, entraîner leur bon marché. Or, le coût de la vie fut toujours très élevé. Il y a donc insuffisance d’aliments. Quant à la spéculation, elle ne peut se manifester que sur les produits peu abondants. Puisqu’elle existe sur ceux du sol, sur les céréales, la viande, les œufs, le beurre, les légumes, sur la nourriture enfin, et sur des produits primordiaux comme le charbon, l’essence, la laine, le coton, le cuir, etc., puisque cette spéculation s’intensifie dans les années de récolte ou d’extraction médiocre ou mauvaise, la surabondance d’aliments et de produits du sol est un mythe. Les falsifications, les succédanés, les aliments de remplacement, peuvent être aussi considérés comme des preuves de pénurie.
Il est certain que ces déductions ne peuvent suffire à convaincre une opposition qui, tout en refusant d’aligner ses chiffres, en réclame de ses adversaires. On ne peut considérer comme ayant une valeur la brochure Les Produits de la terre, attribué à Elisée Reclus et qui gavait les hommes de toutes leurs récoltes et de toute la viande de leur cheptel, sans réserver pour l’ensemencement, la nourriture des animaux, l’industrie, etc., les quantités nécessaires. Aussi les malthusiens ont-ils été conduits à fournir une évaluation statistique des produits du sol opposée à celle de la population. Dans Population et Subsistances, l’un d’eux, Gabriel Giroud, utilisant les chiffres fournis par les statistiques officielles de chaque nation a fait, pour une bonne année de production (1887) le relevé des subsistances végétales et animales dont pouvait disposer l’humanité civilisée, déduction faite, parmi les produits végétaux, de ce qui est nécessaire aux ensemencements, à la nourriture des animaux, aux productions industrielles, etc. Puis, ayant établi la ration moyenne qui reviendrait à chaque humain dans l’hypothèse d’un partage égal — en tenant compte des différences d’âge et de sexe — et après l’avoir confrontée avec celle qui est reconnue nécessaire dans une alimentation rationnelle, Giroud arrivait à cette conclusion que les hommes, dans le partage des produits, auraient une ration très insuffisante. Vingt années après, il recommençait le même travail pour une année de bonne production moyenne (1907) et le résultat fut identique. Il apparaît donc, selon les Malthusiens, quand on se réfère aux chiffres, qu’il y a, non pas surproduction alimentaire, mais infra-production, production déficitaire, insuffisance permanente de la ration moyenne générale par rapport à la population.
Au surplus, sans aller tant au fond de la question, et si étonnant que cela puisse paraître, les malthusiens montrent que la récolte française des céréales est à peu près la même en 1928 qu’en 1852, qu’elle est de beaucoup inférieure à la moyenne des années qui précèdent la guerre, que nous sommes loin des récoltes rêvées par Kropotkine et ses adeptes.
Et l’indigence alimentaire n’est pas la seule. Relativement aux capitaux, soutiennent les malthusiens, il y a surabondance d’individus, surpopulation ouvrière permanente, mais pression de la population totale sur la richesse sociale. On peut à ce point de vue soulever une série de problèmes concernant les satisfactions à donner aux foules.
Quel peut être, par exemple, et c’est une question de première importance pour les malthusiens, quel peut être le coût moven de l’élevage de tous les enfants de la naissance à l’âge où ils deviennent producteurs capables, dix-huit ans si l’on veut ? Elevage sans luxe mais confortable, dans un logis clair, aéré, sain ? Aucune différence entre les enfants, bien entendu. Pas d’ « assistés ». Egalité au point de départ. Tous les jeunes mis à même de réaliser, dès la naissance, les promesses de leur personnalité. Instruction aussi complète que possible, quelle que soit la voie où leurs capacités les engage, dans des locaux vastes et bien pourvus. Quelque taux raisonnable que l’on prenne et pour quelque époque que soit fait le calcul, on constate, affirment les néo-malthusiens, que la pauvreté des nations ne permet, nulle part, l’élevage général convenable et l’éducation de tous les enfants.
On peut de même examiner, sous le rapport financier, et c’est ce que font les malthusiens, les réformes sociales envisagées chez nous ou à l’étranger par les partis politiques dits « avancés » ou par les bourgeois à tendances généreuses, celles qui concernent l’enseignement, par exemple, ou l’assistance, ou les retraites, ou l’aide aux familles nombreuses aux vieillards, et l’on sera étonné, à ne pas lésiner, de l’extrême pauvreté générale (que la suppression des budgets de la guerre et de la marine atténuerait à peine).
Voilà donc les malthusiens obligés de nier les droits constamment invoqués par les philanthropes, les politiciens et les militants sociaux les plus autorisés. Le droit au travail, à la protection, au repos, à l’instruction, à l’art, à l’amour, au pain, au logis, le droit de vivre sont, disent-ils, des droits virtuels. Matériellement, effectivement, l’exercice de ces droits dépend des conditions d’équilibre entre la population et les ressources sociales. C’est là une déduction rigoureuse d’un principe incontestable et de faits multipliés qui viennent l’appuyer. Lorsque la quantité des hommes excède celle que les produits, le capital et le travail permettent de nourrir, vêtir, loger, instruire, tous les droits imaginables restent des droits imaginaires. Il ne peut y avoir, en pareil cas, pour chaque individu, que le droit de lutter, de tenter, par tous les moyens, d’accroître au détriment d’autrui sa part insuffisante. Le seul droit réel est alors celui du plus apte, du plus fort, du vainqueur. Jusqu’alors le « droit à la vie » fut un phantasme, une fantasmagorie. Il pourra cesser d’être chimérique lorsque l’étendue des besoins humains primordiaux n’excèdera plus le montant des ressources sociales. La grande difficulté qui attend les révolutionnaires, la difficulté insurmontable que rencontrent actuellement les communistes de Russie, c’est de pourvoir de biens matériels une population beaucoup trop élevée par rapport aux produits distribuables. Que les anarchistes soient suivis, que l’autorité disparaisse, l’obstacle qui ramènera l’autorité c’est l’insuffisance de la part individuelle et la pauvreté générale insupportable et génératrice de désordres.
Le problème social tout entier se ramène donc, selon les malthusiens, à la question de savoir par lequel des obstacles préventifs doit être effectuée l’inévitable limitation de l’accroissement humain.
Pour Malthus, prêtre anglais, et pour ses disciples chrétiens, le seul moyen acceptable est le moral restraint, la restriction morale (!), qui serait bien plutôt une restriction physique, l’union tardive, une espèce de chasteté prolongée de telle façon qu’entre l’époque du mariage pour la femme et l’âge de la ménopause, chaque famille ne puisse avoir que peu d’enfants.
Mais cette solution, pour avoir son plein effet économique, réclame l’absolue continence sexuelle de tous les humains jusqu’à l’âge de quarante ans au moins... Et Malthus lui-même restait sceptique quant à son efficacité : « J’ai dit, écrit-il, et je crois rigoureusement vrai, que notre devoir est de différer de nous marier jusqu’à l’époque où il nous sera possible de nourrir nos enfants, et qu’il est également de notre devoir de ne point nous livrer à des passions vicieuses (sic). Mais je n’ai dit nulle part que je m’attendais à voir l’un ou l’autre de ces devoirs exactement remplis ; bien moins encore l’un et l’autre à la fois ». L’orthodoxie malthusienne comporte donc un pessimisme profond. L’humanité ne peut sortir de son ornière de pauvreté, de misères, de luttes. Il n’y a rien à faire au fond. Vous aurez toujours des pauvres autour de vous, les guerres perdureront, les prolétaires s’offriront toujours à l’exploitation, les inégalités, les injustices sociales, sont inévitables... Il n’y a plus qu’à recourir à la charité chrétienne.
Mais viennent alors ceux qui, délaissant la résignation religieuse, veulent triompher des maux humains, ceux qui, repoussant la chasteté, veulent, avec le partage des biens matériels, celui des joies de l’amour. Ce sont les néo-malthusiens. Pour eux, l’amour est un besoin, chez l’homme et chez la femme. L’appétit sexuel doit être satisfait sous peine de souffrances, d’accidents pathologiques, de perversions. Les sécrétions internes des glandes sexuelles ont une profonde influence psychique et tout obstacle à l’instinct générateur, ainsi qu’à la dépression et à l’excitation mentale qui l’accompagnent est une cause irritante et puissante de désordres mentaux et nerveux. L’exercice régulier, la satisfaction normale, modérée, de l’appétit sexuel peuvent être même des remèdes aux affections des organes sexuels. Ce n’est pas que la continence absolue ne puisse, en aucun cas, être supportée, ni qu’il ne faille le régler dans une certaine mesure, et le contenir jusqu’à un certain âge et jusqu’à un certain point, mais il reste qu’elle ne peut être observée d’une façon complète sans dommage pour la santé physique intellectuelle et morale, et que tenter de l’imposer à tous pendant de longues années, revient à demander de violer une loi inflexible et de subir les inconvénients parfois graves que la méconnaissance ou l’ignorance des phénomènes naturels peut infliger à l’homme.
Les néo-malthusiens choisissent donc parmi les obstacles préventifs, sans rejeter la chasteté qui peut être de convenance individuelle, les procédés « vicieux » qui permettent d’éviter la conception et même, faute de mieux, comme pis aller, en attendant les moyens anti-conceptionnels parfaits, dans des conditions bien entendu de sécurité aussi complète que possible, ceux qui permettent l’interruption de la grossesse.
Ils s’adressent aux prolétaires, font appel à leur responsabilité personnelle, les prient de songer aux charges qui peuvent leur incomber dès qu’ils sont en situation d’engendrer.
« Ayez peu d’enfants, leur disent-ils. Les nourrir en bas âge, les élever, leur procurer les moyens d’entrer dans la carrière avec des chances raisonnables de se créer, par leur effort, une vie libre, digne, indépendante, est une œuvre difficile. Ne vous laissez pas abuser par la cohue des politiciens et des philanthropes. Ils promettent beaucoup, ne tiennent pas, ne peuvent pas tenir. Attendez avant de vous charger d’enfants, que les logements soient habitables, que les cités soient assainies, que vos salaires soient plus élevés, que vos loisirs soient plus nombreux. Attendez avant de procréer que les réformes dont on vous proclame l’urgence soient accomplies. »
Il ne s’agit point de supprimer totalement les naissances, ce serait faire disparaître l’humanité. Il s’agit de mettre les humains en état de limiter, distribuer, répartir les charges de la maternité, en tenant compte des principes eugéniques, en ayant égard à la santé et à la liberté des couples, de la femme, sans accroître les charges des unions, des familles, de la société, sansperdre de vue que le dépeuplement vrai peut être aussi nuisible que le surpeuplement.
Les moyens d’éviter les naissances superflues et indésirables sont-ils nuisibles à la santé ? Il faut croire qu’il n’en est rien puisque d’une statistique publiée par le Dr Lutaud, il résulte que sur 1.800 ménages de médecins parisiens, on compte en moyenne moins de deux enfants par ménage.
Les médecins ne sont-ils pas des gens instruits et parfaitement à même de juger ce qui est nuisible à la santé ? Peut-on admettre qu’ils mettraient en pratique des mesures de nature à donner lieu à une foule de maladies et à abréger l’existence ?
L’avortement ne peut être qu’un pis-aller et il sera d’autant moins employé que les moyens anticonceptionnels le seront davantage. Les fauteurs d’avortement, les fauteurs d’infanticide, comme les fauteurs de misère et de guerre, ce sont les adversaires de la diffusion de l’hygiène sexuelle et anticonceptionnelle, ce sont les contempteurs de la propagande néo-malthusienne, que ces contempteurs soient de gauche ou de droite, qu’ils soient socialistes ou anarchistes, qu’ils adoptent ou qu’ils repoussent la doctrine malthusienne.
Les néo-malthusiens soutiennent d’ailleurs qu’il n’y a pas un Seul des problèmes sociaux agités de tout temps et de nos jours qui ne trouve dans la « prudence parentale », dans la « prudence procréatrice », comme disait Paul Robin, une aide efficace et le fondement même de leur solution.
L’union libre, par exemple, la liberté de l’amour (voir ces mots), ne sont possibles pour la femme que dans la liberté corporelle, dans la liberté de la fonction génératrice. Toute femme doit pouvoir aimer sans engendrer. La liberté de l’amour a pour condition primordiale celle de la maternité. Le néo-malthusianisme pratique favorise l’indépendance féminine matérielle et spirituelle, individuelle et sociale. Il agrandit le cercle de l’activité des femmes, relève leur dignité, leur autorité, en fait les égales et les camarades de l’homme et par là, physiquement et psychiquement, améliore les individus et le milieu social. En écartant la crainte des parturitions non désirées, il permet à toutes, et à tous, les expériences, la « papillonne », la recherche des plus hautes sensations, la satisfaction entière, de besoins dont l’accomplissement participe à la santé et à l’harmonie corporelle. Il permet le choix de l’époux ou de l’amant, celui de l’épouse et de l’amante. Il modifie complètement les mœurs et la morale sexuelle. Cela bien entendu ne va pas sans la mesure, la modération, sans une morale basée sur les besoins du corps, et la nécessité de préserver la santé individuelle, de sauvegarder l’intérêt social. Il peut y avoir une éducation franche, scientifique, capable de maintenir chez les humains informés l’équilihre sexuel comme l’équilibre physique et mental. Nous n’insisterons pas ici sur cette éducation sexuelle que préconisent aussi bien des militants qui ne sont pas spécifiquement néo-malthusiens, ni sur l’initiation sexuelle qui pourrait être scientifiquement dispensée aux jeunes pour assurer leur bonheur.
Le néo-malthusianisme renferme aussi, disent ses partisans, le moyen de réduire la prostitution, dont la source principale se trouve dans la pauvreté et dans la nécessité des plaisirs sexuels. Ces derniers étant possibles par la liberté de la maternité, et la pauvreté étant vaincue puisque les naissances n’ont lieu que dans l’aisance, la prostitution diminue et même, peutêtre, disparaît.
L’eugénisme est également favorisé par la limitation contrôlée des naissances. Les néo-malthusiens prétendent même qu’il ne peut y avoir d’eugénisme sans néo-malthusianisme. C’est un point sur lequel ils sont d’accord, indépendamment de toute théorie économique, avec les birth-controllers. Sans l’intervention des moyens anticonceptionnels ou abortifs, pas de sélection négative, puisqu’il s’agit d’entraver la reproduction des tarés, des malades, des chétifs, des déficients physiques et mentaux. Pas non plus de sélection positive, car la reproduction au hasard, la multiplication sans modération des couples sains manque son but si les progénitures ne trouvent point les ressources d’alimentation, d’aération, d’exercice physique, d’élevage, etc. qui les maintiendront en bon état. La grande cause des déchéances, la grande pourvoyeuse, la grande entreteneuse des tares, c’est la pauvreté, c’est la misère. Les enfants sains qui manquent de soins dégénèrent. Les eugénistes qui, comme le Dr Pinard, prétendent mettre en opposition l’eugénisme et le néo-malthusianisme vont contre le but qu’ils prétendent atteindre. Le conseil donné aux couples malades de renoncer à la procréation doit être complété par le conseil donné aux couples sains d’éviter de se charger d’enfants qu’ils exposeront à une diminution physique et mentale par l’impossibilité de les pourvoir convenablement.
De même, pas de puériculture sérieuse sans une prudence constante quant au nombre des naissances. Pas d’éducation ni d’instruction prolongées pour tous sans limitation familiale et sociale de la progéniture.
II est à peine croyable, remarquent les néo-malthusiens que les plus éminents leaders des partis politiques et sociaux aient été hostiles non seulement au malthusianisme comme doctrine économique, mais encore au néo-malthusianisme en tant qu’instrument de lutte révolutionnaire. Ni Proudhon, ni Marx, ni Bakounine, par exemple, n’ont admis, comme moyen de combat social, la limitation des naissances prolétariennes. Et leurs disciples, ou bien se sont tus sur ce sujet, ou bien ont condamné l’action des militants qui ont vu là, au contraire, une des voies principales qui conduisent à la solution des problèmes sociaux, une aide formidable à l’émancipation humaine.
Cependant les néo-malthusiens insistent :
« Est-il vrai, oui ou non, que les travailleurs s’ils étaient moins nombreux, obtiendraient des salaires plus élevés ? La loi de l’offre et de la demande ne règle-t-elle pas la valeur de la marchandise travail comme celle de toutes les autres ? »
Les bas salaires, c’est-à-dire la misère, sont dus fondamentalement à la multiplication prolétarienne. Les maîtres de l’industrie, du commerce, de la finance n’ont qu’à profiter et profitent de l’hostilité fatale, des compétitions inévitables qui naissent spontanément entre travailleurs trop nombreux. Les grèves ne changent rien, du point de vue général, à cette situation. Elles sont à peu près inefficaces, inutiles et causent d’indicibles et vaines douleurs. Tous les remèdes préconisés par les socialistes, comme la limitation de la journée de travail, comme l’établissement d’un minimum de salaire, par exemple, ne sont valables que s’ils sont accompagnés par une réduction considérable du nombre des concurrents au travail. Nul ne saurait prétendre que les travailleurs se reproduisant plus rapidement que les places à occuper, il soit possible, après avoir limité, par exemple, à six heures la journée de labeur, on puisse par suite de l’accroissement du nombre des travailleurs la fixer ensuite à quatre, puis à deux, et ainsi de suite, jusqu’à cet aboutissement absurde de la réduire à rien, sous prétexte de partager le travail et d’en assurer à tous ceux qui naissent.
Là où il y a du travail pour deux, on ne peut faire qu’il y en ait pour trois, de façon que chacun des trois ait le même salaire que chacun des deux, sans que tous soient lésés. Un marché surchargé d’ouvriers et de forts salaires à chacun d’eux sont choses tout à fait incompatibles. Ce qui protègera le mieux la liberté de tous les travailleurs et les acheminera le mieux vers le socialisme, ou le communisme, ou l’anarchisme, c’est que les patrons aient besoin d’eux et soient contraints ainsi de partager avec eux les biens sociaux.
Quant au minimum de salaire, une fois fixé l’impossibilité de le maintenir serait bientôt reconnue, si aucun contrôle n’a lieu sur l’accroissement de la maind’œuvre. Il faudrait bientôt, ou laisser en dehors de toute rétribution une partie de la population ou se résoudre à diminuer le salaire minimum...
Le syndicalisme est lui-même incapable, à moins de limiter le nombre des ouvriers à admettre dans chaque corps de métier, de relever, de maintenir même les salaires. Mais limiter le nombre des travailleurs dans chaque corporation, c’est laisser en dehors de toutes, les hommes en surnombre, c’est provoquer le chômage, c’est refuser d’admettre au festin ceux qui pourraient en détruire l’harmonie. Le syndicalisme n’a supprimé le chômage nulle part et si, en France, il y a moins de chômeurs que partout ailleurs cela est dû principalement, on pourrait dire uniquement, à la diminution des naissances. Cependant l’action syndicaliste peut avoir pour conséquence d’amener les travailleurs à remarquer qu’en définitive l’amélioration de leur condition est liée à la réduction de leur nombre, à leur ouvrir les yeux sur la valeur de la question malthusienne et néo-malthusienne.
Bien entendu les néo-malthusiens reconnaissent que la question de population, celle de la restriction des naissances sont urgentes pour toutes les contrées. Il est évident que si, dans un pays qui limite sa population l’importation de la main-d’œuvre des pays prolifiques est favorisée ou tolérée les travailleurs perdent les avantages qu’ils devraient tirer de leur prudence. Pour avoir son plein effet le néo-malthusianisme doit être international, universel.
Bien des socialistes et des anarchistes font cette objection que l’aisance, la vie moins étroite, procurée par la diminution de la main-d’œuvre, inocule aux individus le « virus bourgeois », rend les salariés égoïstes, en fait des conservateurs incapables de secouer le joug et de conquérir les moyens de production. Pour gagner le paradis social il faut des révolutionnaires croupissants dans la misère, recuits dans l’ordure, la crasse et l’ignorance.
Faudrait-il donc, en conséquence, pour avancer le bouleversement régénérateur, s’unir aux capitalistes, adapter plus fortement les ouvriers à la détresse, accroître leur malheur, exacerber leur désespoir ? Et ne serait-ce pas se leurrer sur la portée des sacrifices ainsi imposés aux travailleurs ? Car les esprits émancipés, les hommes conscients et énergiques, les révolutionnaires au sens vrai du mot — au sens d’hommes agissant pour provoquer un chargement progressif et rapide, sans indication nécessaire de la violence — ne se rencontrent que rarement dans les milieux misérables. Abruties, broyées, émasculées, les foules peuvent faire des jacqueries, provoquer des commotions temporaires, mais sont incapables d’apporter une modification générale, profonde, durable, décisive à leur situation. Il n’y a rien à tirer des résignés et des brutaux. La valeur d’une révolution est subordonnée au degré d’évolution des individus. Le plus souvent les minorités qui la régissent se trouvent, au lendemain de leur triomphe, en face de difficultés telles que la dictature et la tyrannie deviennent fatales pour maintenir les appétits et mâter la populace. L’ignorance et la misère ne sont pas révolutionnaires. Un monde nouveau ne peut sortir que de l’aisance répandue, de l’instruction généralisée. Et le néo-malthusianisme pratique favorise par la hausse du salaire et l’accroissement des loisirs, le perfectionnement des qualités individuelles, l’adoucissement des mœurs. Des salariés bien payés, ayant peu d’enfants, en mesure de les soigner, nourrir, vêtir, loger convenablement, de prolonger leur instruction, de parfaire leur éducation, prépareront des générations qui sauront réduire à sa juste valeur la théorie de la dépendance et de la protection. La procréation raisonnée civilise, augmente les chances d’installation d’une société nouvelle où seront satisfaits les besoins primordiaux et les aspirations de chacun.
Quant à l’effort pacifiste des socialistes ou des anarchistes, les néo-malthusiens vont jusqu’à soutenir cette espèce de paradoxe que l’union des peuples réalisée, les Etats-Unis du monde instaurés, le problème de la paix n’est pas à tout jamais résolu. Il reste en effet « l’énigme du sphinx, comme disait Huxley, la question auprès de laquelle toutes les autres disparaissent », il reste à conjurer la difficulté biologique et sociologique de l’accroissement de la population. Menace permanente et indépendante de l’union des Etats ! Abolissez le militarisme, désarmez tous les peuples, vous n’aurez fait, en négligeant et en méprisant le principe de population qu’une avancée temporaire dans la voie de la paix. Si, supprimant le frein guerre, vous négligez le frein limitation des naissances, c’est le frein misère qui sévira avec une force accrue. Et la misère ramène à la guerre. De la multiplication irraisonnée renaîtront insensiblement l’existence difficile, le travail excessif, la nourriture insuffisante, l’hostilité, la lutte entre individus, les rivalités, les conflits, la répression, la police, la brutalité, l’armée, la guerre. Les tueries guerrières ne sont au fond que des crises de la concurrence exacerbée.
Quand l’on vise à donner aux bommes la plus grande somme de liberté et tout le bonheur possible, il ne faut pas trop les serrer. La réglementation, la sujétion, la contrainte, sont dans une grande mesure fonction du nombre. Les coutumes, les législations, les conditions de la vie sont d’autant plus mesquines, d’autant plus étroites d’autant plus strictes et limitatives que les populations sont plus pressées. Toutes aisances égales d’ailleurs, le nombre force à la discipline, tend à opprimer les aspirations, à entraver et déprimer les initiatives et les volontés individuelles.
Certains anarchistes et socialistes allèguent contre le néo-malthusianisme des raisons pessimistes, le triomphe de la paresse, de la médiocrité, la disparition de la civilisation même et le règne de la platitude universelle. Ces sombres prévisions sont opposables, aussi bien, répondent les néo-malthusiens, à toute vue de perfectionnement social, elles sont d’ailleurs formulées aussi par ceux-là même qui, profitant du progrès et jouissant en égoïstes de biens qui devraient être communs, n’apprécient leur bonheur que par contraste avec la détresse d’autrui.
Mais ces prévisions ne tiennent pas selon les néo-malthusiens. La destination de l’humanité est de lutter contre les forces naturelles, de les dompter et asservir. Cette lutte il faut qu’elle soit menée sans faiblesse, sinon l’homme deviendrait la proie de l’univers hostile. Il doit combattre s’il ne veut pas mourir. Mais les motifs qui le portent aujourd’hui à écraser ses semblables, il les trouvera, sous la protection néo-malthusienne, dans la nécessité commune d’amender ou de vaincre la nature, dans la joie aussi de sentir toutes ses forces et d’utiliser toutes ses facultés. La nécessité de l’activité, le bonheur qu’elle procure ramènent à l’optimisme. Il n’est nul besoin de contrainte pour agir, ni de concurrence forcenée. L’humanité saura découvrir entre le nombre de ses membres et les produits de la terre et du travail, un harmonieux équilibre assurant à chacun, par un court labeur joyeusement accepté, l’abondance et, par les loisirs et la liberté complète des relations affectives, le bonheur.
Il n’y a pas de problème plus vaste que celui de la population, du néo-malthusianisme. Il tient à tout, et le traiter c’est traiter toutes les questions qui se rapportent à la vie humaine. Je n’ai envisagé rapidement que quelques-unes de celles qui sont mises au premier rang dans la lutte coutre l’organisation sociale actuelle.
Mais ce problème n’a pas été sans préoccuper les conservateurs. L’abondance de population, la surpopulation, est nécessaire pour assurer le recrutement de la main-d’œuvre, pour maintenir l’état de sujétion du prolétariat, pour perpétuer les classes, les privilèges. La patrie a besoin de soldats, l’usine a besoin de travailleurs, l’église a besoin de fidèles. Ici jouent les grands mots. L’industrie, le commerce, l’agriculture ne peuvent fonctionner qu’avec une population nombreuse. Et les surpeupleurs opposent des chiffres aux néo-malthusiens. Ils clament, avec habileté, que la France se dépeuple, que les nations voisines nous menacent par leur natalité supérieure, que notre pays offre l’aspect lamentable d’une « dying-nation », d’une nation qui va mourir. Il serait trop long de donner ici tous les arguments que les néo-malthusiens opposent aux conservateurs. Il sera suffisant d’insister seulement sur quelques erreurs communes propagées par la presse sur la question de la natalité et de la mortalité.
D’abord il n’y a nulle part, en aucun pays, dépopulation. Les chiffres montrent que, même en France, où l’on déplore depuis plus de cent ans cette « dépopulation », ce phénomène n’a jamais, au vrai, été observé que tout à fait rarement. Il y a, il est vrai, chez nous, un abaissement de la natalité, correspondant à un abaissement de la mortalité. Voici un tableau des naissances et décès pour 1.000 habitants qui donnera une idée de ces deux faits :
Naissances et décès annuels, en France, pour 1.000 habitants :
-
1851 — 1860 ... 26,3 Naissances — 23,9 Décès
-
1871 — 1880 ... 25,4 Naissances — 23,7 Décès
-
1881 — 1890 ... 23,9 Naissances — 22,1 Décès
-
1891 — 1900 ... 22,2 Naissances — 21,5 Décès
-
1901 — 1910 ... 20,7 Naissances — 19,6 Décès
-
1911 ... 18,7 Naissances — 18,6 Décès
-
1921 ... 20,7 Naissances — 17,7 Décès
-
1922 ... 19,3 Naissances — 17,5 Décès
-
1923 ... 19,1 Naissances — 16,7 Décès
-
1924 ... 18,7 Naissances — 16,9 Décès
-
1925 ... 19,0 Naissances — 17,4 Décès
-
1926 ... 18,8 Naissances — 17,5 Décès
-
1927 ... 18,1 Naissances — 16,5 Décès
L’abaissement du taux de la natalité, la dénatalité comme disent aujourd’hui les surpeupleurs, n’est pas particulier à la France. Il se produit dans tous les pays. Et dans tous les pays le taux de la mortalité diminue beaucoup plus qu’en France, surtout depuis la guerre. (c.f. le tableau Natalité et mortalité par pays, pour 1.000 habitants, en 1921 et 1927.)
| Natalité | Mortalité | |||
|---|---|---|---|---|
| 1921 | 1927 | 1921 | 1927 | Pays |
| 25,3 | 18,3 | 14,8 | 12,0 | Allemagne |
| 21,9 | 17,8 | 15,7 | 14,9 | Autriche |
| 30,3 | 26,9 | 17,4 | 15,6 | Italie |
| 23,8 | 17,0 | 12,8 | 12,4 | Angleterre |
| 30,4 | 28,4 | 21,4 | 18,8 | Espagne |
| 27,6 | 25,2 | 18,9 | 17,6 | Hongrie |
| 24,0 | 19,6 | 11,0 | 11,3 | Danemark |
| 24,6 | 18,8 | 11,5 | 11,3 | Norwège |
| 21,4 | 16,1 | 12,4 | 12,7 | Suède |
| 27,5 | 23,1 | 11,2 | 10,3 | Pays-Bas |
| 20,8 | 17,4 | 12,7 | 12,3 | Suisse |
| 21,8 | 19,0 | 13,8 | 13,3 | Belgique |
On remarquera que la France, en dépit de sa faible natalité a une mortalité plus élevée que dans plusieurs pays dont la natalité est très inférieure. Elle présente ainsi le phénomène, non d’une dépopulation, mais d’un accroissement très lent de la population. Elle fait exception à la loi générale que les pays à forte natalité ont la mortalité la plus élevée, mais il faut remarquer en même temps qu’elle ne fait pas exception à la loi générale que la mortalité augmente ou diminue avec la natalité. Ce n’est pas ici le lieu de nous étendre sur les explications qui ont été données de l’anomalie présentée par la France. Il faut simplement constater avec les néo-malthusiens que l’accroissement de la population est général et que « la pression de la population sur les subsistances se maintient même avec une amélioration des conditions d’existence. »
La France qui avait 33.500.000 habitants dans la période de 1841 à 1850, en avait 38.400.000 dans la période de 1891 à 1900. Le recensement de 1906 donnait 39.300.000 habitants et celui de 1911, 39.600.000 habitants. Après la guerre l’accroissement s’est poursuivi ainsi, après une chute due à la guerre :
-
1920 : 39.200.000
-
1925 : 40.600.000
-
1927 : 40.960.000
Les autres pays se sont accrus en population de façon plus accusée encore.
| 1920 | 1925 | 1927 | |
|---|---|---|---|
| Allemagne | 62.000.000 | 62.395.000 | 63.220.000 |
| Angleterre | 42.760.000 | 43.780.000 | 44.190.000 |
| Italie | 36.870.000 | 40.340.000 | 40.600.000 |
Sans compter la Russie, la Pologne, les Etats baltes, l’Europe s’est accrue, depuis 1921, de près de 17 millions d’habitants, c’est-à-dire d’une population supérieure à celle qu’avait la Roumanie en 1921. Les morts de la guerre sont remplacés. On peut recommencer. Il ne faut pas s’étonner des difficultés que rencontrent toutes les nations d’Europe pour se nourrir. Aucune ne peut vivre sur son territoire. Et les Etats-Unis et le Canada, l’Argentine et les pays importateurs, dont la population augmente, ont des difficultés de plus en plus grandes pour ravitailler l’Europe. Il ne faut pas s’étonner davantage de la tendance marquée de tous les pays à revendiquer des débouchés pour leurs produits, des colonies pour leur ravitaillement et leur émigration. M. Mussolini réclame hautement, et cyniquement ce que chaque gouvernement cherche plus ou moins hypocritement à obtenir : de la place, de la nourriture, des débouchés... pour une population débordante et difficile à ravitailler.
Il n’y a donc dépopulation ni en France, ni en Europe. Il y a partout surpopulation.
Si, disent les malthusiens, la natalité baissait à tel point qu’il se produise une diminution vraie de la population, ce ne serait pas au fond une dépopulation, mais, pendant une période assez longue, une désurpopulation, établissant un heureux équilibre entre la population et la production agricole, avantageux pour les exploités, favorable à l’instauration d’un régime nouveau, créant égalité de forces entre possédants et dépossédés, entre exploiteurs et exploités, préparant une morale sociale nouvelle, une révolution sociale par une rapide évolution sociale.
Les chances semblent, malheureusement plus grandes pour que cette diminution de la population se produise tout autrement, c’est-à-dire par la dévastation et le massacre. Car la guerre est aussi, selon les malthusiens, un des produits de la concurrence entre nations surpeuplées, comme la misère est la conséquence de la concurrence entre travailleurs trop nombreux.
Il faudrait examiner aussi un des arguments des surpeupleurs officieux ou officiels qui est que la haute natalité et l’accroissement de la population d’un pays marquent sa supériorité. A quoi les néo-malthusiens répondent qu’une nation est supérieure à une autre quand la vie moyenne de ses habitants est plus élevée, quand le nombre de ses adultes producteurs est proportionnellement plus considérable, quand le célibat, la mortalité infantile, la prostitution y sévissent moins, quand l’émigration y est rare.
Il nous entraînerait trop loin de discuter les unes ou les autres de ces assertions et de les appuyer des statistiques, d’ailleurs rares ou partielles ou frelatées, d’après guerre. Celles qui ont été publiées avant la guerre par G. Hardy dans son ouvrage sur la question de population tendent à démontrer que les nations à natalité réduite sont loin d’être des nations inférieures, et que, en ce qui concerne la France, les départements à basse natalité, présentent des conditions matérielles et intellectuelles supérieures à celles des départements à forte natalité.
La théorie malthusienne et même, tant qu’il s’est agi de recommander soit le mariage tardif, soit la chasteté dans le mariage a eu, comme défenseurs, les économistes les plus renommés de tous les pays et notamment, en France, J.-B. Say, Sismondi, Ricardo Rossi Destutt de Tracy, du Puynode, etc. Elle fut même pratiquement patronnée par des personnages officieux, M. Ch. Dunoyer, par exemple, membre de l’Institut et préfet de la Somme, n’hésita pas à recommander à ses administrés de « mettre un soin extrême à éviter de rendre leur mariage plus prolifique que leur industrie ».
Mais, dès qu’apparurent les moyens néo-malthusiens, les économistes cessèrent de patronner ouvertement la théorie malthusienne, et, tout en la considérant en général comme parfaitement exacte, n’en firent plus, officiellement, si l’on peut dire, la base de leurs arguments contre les systèmes sociaux qui menaçaient la propriété, la religion, la famille et la patrie. Ils s’aperçurent que le néo-malthusisme comportait pratiquement plus de danger pour les privilégiés que les théories sociales les plus révolutionnaires. Il y eut cependant des exceptions et un membre de l’Institut Joseph Garnier, tout en rejetant les vues socialistes ou communistes, se déclara nettement néo-malthusien.
Il n’en reste pas moins que le néo-malthusianisme a été, dès son apparition, combattu, dénoncé par une copieuse littérature cléricale, républicaine, socialiste, anarchiste, etc., et qu’il l’est encore. Les gouvernements surtout ont tous agi contre lui. En France, mille moyens ont été examinés et employés pour entraver la « dépopulation » et le néo-malthusisme. Des commissions ont été nommées, des enquêtes poursuivies, des sociétés créées ayant pour but le relèvement de la natalité. Impôts sur les célibataires, sur les successions, primes aux naissances, secours aux familles nombreuses, faveurs aux procréateurs, répartition de terres, charités etc., mille combinaisons ont été établies, mises en œuvre, soutenues par l’Etat pour atteindre le but.
En face de cette action s’est affirmée la propagande néo-malthusienne dont j’esquisserai ici l’histoire en insistant sur le mouvement français.
Peu après l’Essai de Malthus, les démocrates anglais admettaient déjà les moyens artificiels rejetés par l’économiste. En 1811, James Mill, dans l’article « Colony », du Supplément de l’ Encyclopédie britannique, disait déjà nettement que la grande question pratique consistait à trouver les moyens de limiter le nombre des naissances dans le mariage. Ces moyens, disait-il, « ne doivent être considérés ni comme douteux, ni comme difficiles à appliquer ».
En 1822, Francès Place, préconisait comme remède à la misère, les moyens de préservation sexuelle. Robert Owen, l’illustre fondateur de la colonie de NewLanark, puis Richard Carlile (1825), Robert Dale Owen (1832), l’Américain Charles Knwolton (1833) publièrent des ouvrages nettement néo-malthusiens qui leur valurent des poursuites parce qu’ils indiquaient les moyens anticonceptionnels. John Stuart Mill apportait, en 1848, dans ses Principes d’Economie politique une approbation tacite à la diffusion des procédés de limitation des naissances. Enfin, en 1854, paraissait, à Londres, un ouvrage dont l’influence fut immense sur la propagation des théories et pratiques néo-malthusiennes : Elements of Social Science or Physical, sexual and Natural Religion. L’auteur gardait l’anonymat. C’était le Dr Drysdale (1827–1904).
A la suite de circonstances qu’il serait trop long d’évoquer, Charles Bradlaugh, chef du parti ultra-radical en Angleterre, rédacteur en chef du National Reformer et Annie Besant, provoquèrent volontairement un procès en distribuant ouvertement un opuscule contenant des indications pratiques et interdit par la loi. Ils comparurent en juin 1877 et leur procès dura trois jours. Annie Besant et Bradlaugh se défendirent avec éloquence. Leur discours émurent le jury qui pourtant rendit un verdict énigmatique ainsi libellé : « A l’unanimité, nous croyons que le livre en question a pour but de dépraver la morale publique ; mais en même temps nous exonérons entièrement les défendeurs de tout motif corrompu dans la publication de ce livre ».
Bradlaugh et Mme Besant ayant déclaré qu’ils continueraient à répandre ce livre quelle que soit la peine qu’on leur infligerait, furent condamnés à l’amende et à la prison. Une cour supérieure annula le jugement. Les poursuites ne furent pas renouvelées.
A la suite de ce procès retentissant, une ligue (The Malthusian League) fut fondée à Londres en juillet 1877, dont le but était de faire de l’agitation pour l’abolition de toutes les pénalités applicables à la discussion publique de la question de population, et d’obtenir une définition légale qui ne permette plus, dans l’avenir, de mettre ces sortes de discussions sous le coup des lois de droit commun. Elle se proposait aussi de répandre, par tous les moyens, dans le peuple « la connaissance de la loi de population, de ses conséquences, de ses effets sur la conduite de l’homme et sur la morale ». Deux ans plus tard paraissait son organe The Malthusian, devenu aujourd’hui The New Generation. Depuis 1921 une autre société, non spéciflquement malthusienne, revendiquant la base eugénique, s’est fondée sous l’action de la doctoresse Marie Stopes. Sans s’appuyer sur la doctrine de Malthus, elle n’en aboutit pas moins par certains côtés à la limitation des naissances. Son eugénisme ne peut se passer de l’anticonception. Elle a un organe intitulé Birth Control News.
Les Hollandais et les Allemands suivirent l’effort anglais respectivement en 1879 et 1892, les premiers avec énergie et un réel esprit pratique, les seconds sans élan et tout à fait théoriquement.
C’est seulement en 1895 que le mouvement néo-malthusien s’avéra publiquement en France sous l’impulsion de Paul Robin qui avait été, en Angleterre, un des premiers adhérents et militants de la Ligue fondée par le Dr Ch.-R. Drysdale. Paul Robin avait préludé à cette action publique par des tentatives auprès de ses amis de l’Internationale afin d’incorporer la propagande néo-malthusienne au mouvement socialiste, par une adresse au Congrès ouvrier de Marseille (1879), par des tracts répandus parmi ses amis, ses élèves, ses correspondants, par une conférence aux socialistes et étudiants de Bruxelles (1890), par l’installation, la même année, à Paris, d’une modeste clinique de pratique anticonceptionnelle.
Il ne rencontra auprès des leaders sociaux qu’il fréquentait qu’indifférence, hostilité et sarcasmes. « Tu entraves la Révolution » lui disait Kropotkine. « Tu ridiculises l’émancipation du travail » lui écrivait James Guillaume. Et Elisée Reclus refusait d’insérer ses articles néo-malthusiens sous prétexte que c’était là une question privée et que, du point de vue général, la limitation des naissances n’était qu’une « grande mystification ». Rien de plus curieux que l’attitude timorés de Benoît Malon par exemple, ou méprisante de Lafargue, ou sarcastique de Sembat, etc., etc.
En dépit de ces difficultés, il entreprit, après sa révocation comme directeur de Cempuis, en 1895, une série de conférences sur la question de population et la question sexuelle. Il agita les mêmes problèmes dans les congrès socialistes, féministes, de libre-pensée, et dans les sociétés savantes, notamment à la Société d’anthropologie.
Voici un extrait du sommaire de ses conférences :
« Pour arriver au bonheur de tous, il faut :
Une bonne organisation de la société humaine.
Celle-ci n’a pu être réalisée par les individus, en très grande majorité presque sauvage, des temps passés et présents, Elle le sera par les générations prochaines ayant reçu :
Une bonne éducation. De celle-ci, seuls auront tiré tout le profit possible, pour eux et leurs semblables, ceux qui seront de :
Bonne naissance.
Des expériences sociologiques impossibles aujourd’hui dans notre état d’intérêts antagonistes, de concurrence acharnée, de luttes, de divisions, de haines, seront faciles à des gens de bonne volonté, ayant tous la même culture, basée sur le réel, vivant dans l’abondance, dans un milieu d’intérêts concordants. — Bonne éducation, c’est-à-dire exclusivement fondée sur les réalités scientifiques, sur l’observation, l’expérience, la liberté, l’affection, tout à fait dégagées des résidus métaphysiques. — Bonne naissance, de parents de bonnes qualités, s’étant choisis en parfaite liberté et n’ayant enfanté qu’avec volonté bien réfléchie.
Le problème du bonheur humain a donc trois parties à résoudre dans cet ordre et dans cet ordre seul :
Bonne naissance ;
Bonne éducation ;
Bonne organisation sociale.
Les efforts pour résoudre une partie du problème sont en grande partie perdus tant que ces précédentes sont mal résolues.
C’est aux mères de résoudre la première. Toutes savent que c’est un grand malheur, une grande faute, de mettre au monde des enfants qui ont des chances d’être mal doués, ou de ne pouvoir, dans les conditions actuelles, recevoir la satisfaction entière de leurs besoins matériels et moraux.
Cette vérité est la plus importante de toutes.
Les femmes doivent savoir que la science leur fournit les moyens efficaces et non douloureux de ne mettre des enfants au monde que quand elles le veulent, et elles ne le voudront certainement alors que dans des conditions telles que leurs enfants aient toutes les chances d’être sains, vigoureux, intelligents et bons. Que toutes l’apprennent, les inférieures aussi bien que les supérieures, De la sagesse, de la prudence, de la volonté raisonnée de celles-ci, de l’heureuse abstention de celleslà, dépend d’abord leur propre satisfaction, puis la première, la plus importante condition du bonheur de l’humanité.
En un mot, la maternité doit être absolument libre. Que le nombre des hommes diminue provisoirement ou définitivement, peu importe. Mais que la quantité de tous marche résolument vers l’idéale perfection. »
En août 1896, Paul Robin fonda une Ligue de la Régénération humaine, dont voici l’exposé des motifs :
« Négligeant toute condition imposée aux satisfactions sexuelles par les lois et les coutumes des divers pays nous posons en principe :
Que l’utilité de la création d’un nouvel humain est une question très complexe, contenant des considérations de temps, de lieux, de personnes, d’institutions publiques ;
Qu’autant il est désirable, aux points de vue familial et social, d’avoir un nombre suffisant d’adultes sains de corps, forts, intelligents, adroits, bons, autant il l’est peu de faire naitre un grand nombre d’enfants dégénérés, destinés la plupart à mourir prématurément, tous à souffrir beaucoup eux-mêmes, à imposer des souffrances à leur entourage familial, à leur groupe social, à peser lourdement sur les ressources toujours insuffisantes des assistances publiques et de la charité privée, aux dépens d’enfants de meilleure qualité.
Nous considérons comme une grande faute familiale et sociale de mettre au monde des enfants dont la subsistance et l’éducation ne sont pas suffisamment assurées dans le milieu où ils naissent actuellement.
Nous ne contestons pas que certaines réformes et améliorations permettront à la terre de nourrir plus tard un grand nombre d’habitants ; mais nous affirmons qu’il est indispensable, avant de vouloir augmenter le nombre des naissances, d’attendre que ces réformes aient été exécutées et aient produit leur effet, et que, du reste, la préoccupation de la qualité devra toujours précéder celle de la quantité.
La Ligue se propose :
De répandre les notions exactes des sciences physiologiques et sociales, permettant aux parents d’apprécier les cas où ils devront se montrer prudents quant au nombre de leurs enfants et assurant, sous ce rapport, leur liberté et surtout celle de la femme ;
De lutter contre toute fâcheuse interprétation légale ou administrative de la propagande humanitaire de la Ligue ;
Enfin et en général, de faire tout ce qui est nécessaire pour que tous les humains connaissent bien les lois tendancielles de l’accroissement de la population, leurs conséquences pratiques, et les moyens de lutte scientifique contre d’apparentes fatalités, afin qu’ils deviennent plus heureux et par conséquent meilleurs. »
La fondation de cette Ligue déchaîna la presse sportulaire qui réclama des mesures légales pour interrompre son action. Elle n’en vécut pas moins jusqu’en 1908. Pendant la période la plus active de son existence, de 1902 à 1908, Paul Robin fut secondé par quelques militants convaincus, notamment par Eugène Humbert. Sous leur direction un combat admirable fut mené, qui ne fut pas sans inquiéter les puissances gouvernementales. En 1908, une scission malheureuse se produisit. Le périodique de Paul Robin, Régénération, fut remplacé par Génération Consciente, que dirigeait Eugène Humbert, Rénovation, édité par les ouvriers néo-malthusiens, et le Malthusien, publié par Albert Gros. Le mouvement s’amplifiait. L’activité néo-malthusienne, correspondant à la baisse du taux de la natalité, fut de nouveau dénoncée comme dangereuse aux pouvoirs publics. Des poursuites furent intentées, des condamnations prononcées. La guerre interrompit la propagande. Sauf une tentative de G.Hardy (le Néo-Malthusien) faite pendant la guerre et que la censure entrava, aucun effort n’a été possible depuis, et la loi du 31 juillet 1920, une des lois les plus scélérates qui aient jamais été promulguées, interdit maintenant non seulement la propagande pratique anticonceptionnelle, mais même toute littérature « contre la natalité » (!).
La propagande française provoqua des actions identiques en Espagne, en Italie, en Belgique, au Portugal, en Suisse, en Amérique du Sud, etc. Elle ne fut pas complètement étrangère à celle des Etats-Unis qu’illustrèrent les martyrs Moses Harman et Id Craddock. Dans ce dernier pays, où la propagande théorique de l’eugénisme et du néo-malthusianisme n’est pas prohibée, trois périodiques s’y livrent aujourd’hui : The Critic and Guide, du Dr W.-J. Robinson ; The Birth Control Review de Margaret Sanger et The Birth Control Herald, organe de la Voluntary Parenthood League. En 1923, Margaret Sanger a pu, à New-York, installer des cliniques où l’information anticonceptionnelle est donnée aux personnes atteintes de maladie héréditairement transmissibles. Depuis, d’autres cliniques s’ouvrent un peu partout, en se conformant aux lois des différents Etats et généralement en se limitant strictement à un eugénisme assez étroit.
Une Fédération universelle des Ligues malthusiennes a été fondée en 1900, au premier Congrès néo-malthusien. Un bureau international de secours fut également institué pour soutenir les militants néo-malthusiens poursuivis, ou condamnés. Ces deux institutions ont aujourd’hui disparu.
Quel est l’avenir du néo-malthusianisme comme doctrine et comme propagande ? Il est bien hasardeux d’exprimer une certitude à ce sujet. Il a pour lui un certain nombre de partisans parmi les plus savants biologistes, sexologistes et économistes étrangers. Beaucoup de personnalités qui poursuivent la réforme des mœurs sexuelles dans un sens scientifique, positif, approuvent le « birth control ». Havelock Ellis, Magnus Hirschfeld, Bertrand Russell, H.-G. Wells, etc. sont à la tête de mouvements ayant d’étroits rapports avec le néo-malthusianisme. Il est donc probable que la question reviendra, sous une forme ou sous une autre, en dépit des lois et de la conjuration formée tacitement par toute la presse pour étouffer la voix des néo-malthusiens. M. Mussolini lui-même en appelant cyniquement les Italiens à conquérir le monde par l’afflux de leurs naissances, appelle l’attention sur l’importance des problèmes que soulève la surpopulation. Il est possible que cette surpopulation européenne et mondiale, en rendant menaçantes, imminentes des guerres nouvelles et des famines, des révolutions sanglantes et sans cesse renouvelées, amène les gouvernements eux-mêmes, afin d’éviter des destructions effoyables, à prendre des mesures pour modérer au moins l’accroissement de la population et la maintenir à un niveau qui rende moins âpre la concurrence entre nations et entre individus, moins précaire la vie des travailleurs. Ces mesures favoriseraient, en dépit de l’autorité elle-même, l’avènement de l’ère de prospérité générale et de bonheur individuel rêvée par les rénovateurs sociaux.
— C. LYON.
BIBLIOGRAPHIE (langue française).
MALTHUS, Essai sur le principe de population.
J.-S. MILL, Principes d’économie politique.
J. GARNIER, Du principe de population.
Général BRIALMONT, De l’accroissement de la population.
G. DRYSDALE, Eléments de science sociale.
Dr MINIME (Lutaud), Le néo-malthusianisme.
Alfred NAQUET, Religion, Propriété, famille ; L’Humanité et la Patrie ; Anarchisme et collectivisme ; Temps Futur.
Paul ROBIN, Le Secret du bonheur ; Pain, Loisir, Amour ; Libre amour, Libre Maternité ; Malthus et les Néo-Malthusiens ; Population et prudence procréatrice
Gabriel GIROUD, Population et subsistances. Dr ELOSU, Amour infécond.
Sébastien FAURE, Le problème de la population.
Dr Ch.-V. DRYSDALE, Y a-t-il assez de subsistances pour tous ?
Manuel DEVALDÈS, La chair à canon ; La brute prolifique ; La famille néo-malthusienne ; La maternité consciente.
Dr GOTTSCHALL, Valeur scientifique du malthusianisme ; La Génétique. - Gabriel HARDY, Malthus et ses disciples ; La loi de Malthus ; Socialisme et néo-malthusianisme ; La question de population.
Jacques BERTILLON, La dépopulation de la France.
Paul LEROY-BEAULIEU, La question de la dépopulation.
Elisée RECLUS, Les produits de la terre.
Pierre KROPOTKINE, Champs, Usines et Ateliers.
Fernand KOLNEY, La grève des ventres.
etc.
MALTHUSIANISME (NÉO)
Le néo-malthusianisme ou, plus correctement, le néo-malthusisme, est une doctrine qui a pris pour base les enseignements de Malthus, mais en étendant jusqu’à l’eugénisme, ou procréation rationnelle, la portée de ces enseignements, et en leur fournissant des moyens d’application plus pratiques que ceux qui furent préconisés par l’auteur de l’Essai sur le Principe de Population.
Constatant que la faculté naturelle de multiplication des humains était hors de proportion avec leurs possibilités d’augmenter, dans le même temps, leurs moyens de subsistance, Thomas-Robert Malthus avait conclu que la misère, et tous les maux qui en résultent, ne pouvait disparaître qu’à la condition essentielle que la procréation fût, à toute époque, et dans chaque foyer, subordonnée aux ressources alimentaires acquises. Par pudibonderie, car il était pasteur protestant, Malthus ne voulut admettre tout d’abord, pour parvenir à ce résultat, que le moral restraint, c’est-à-dire la continence et le mariage tardif, ce qui n’est dans les possibilités que d’une minorité infime de gens, favorisés par la frigidité naturelle, ou le fanatisme religieux, et fait des plaisirs de l’amour un luxe réservé aux riches. Cependant Malthus se montra, dans la deuxième édition de son ouvrage, moins rigoriste, et il favorisa l’éclosion d’idées nouvelles en reconnaissant la difficulté d’application de son système, et en déclarant, sans légitimer pour cela les « passions vicieuses » que ces dernières représentaient, par leurs conséquences, un moindre mal que celui de la prolifération sans mesure dans des circonstances défavorables.
Complétant sa pensée, en apportant à ses concept.ions plus d’audace, des disciples de Malthus, tel Francis Place, dans son livre intitulé Illustrations et Preuves du Principe de Population, eurent le courage de prétendre — ainsi que le fait ressortir dans sa remarquable thèse de doctorat en droit le Dr George Beltrami — qu’il n’est point honteux, pour des gens mariés, menacés par la misère, de recourir à des précautions préventives qui, sans compromettre la santé de l’épouse, lui permettent d’éviter un surcroît de progéniture. Ce fut le point de départ, en Angleterre, d’un important mouvement de propagande qui rallia des noms illustres, tels que ceux des écrivains Richard Carlyle, Richard Owen, John-Stuart Mill, et rencontra, en le Docteur Charles Drysdale, auteur des Eléments de Science Sociale, et fondateur, en 1877, de la Malthusian League, le plus dévoué de ses hommes d’action. Ce mouvement, combattu, avec autant de violence que de mauvaise foi, par les puritains et les démagogues, se propagea sur le continent, où la plupart des philosophes du XVIIIe siècle lui avaient préparé les voies, par leurs critiques, sans attaquer à fond la question. C’est en Hollande, à Amsterdam, que les théories de Malthus, réformées par ses partisans, sont, pour la première fois, dénommées « néo-malthusianisme » par un de leurs adeptes les plus notoires : le professeur Van Houten. En France, ce n’est qu’à partir de 1895 que ce mouvement prend force et vigueur, grâce à Paul Robin, ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, ex-directeur de l’Orphelinat de Cempuis, fondateur, en 1896, de la Ligue de la Régénération Humaine, et de la revue « Régénération », et qui sut grouper autour de lui, ou inspirer de sa doctrine, un certain nombre d’écrivains, de publicistes, et de savants, parmi lesquels il y a lieu de citer : Alfred Naquet, les docteurs Meslier, Elosu, Klotz-Forest et Darricarère ; Urbain Gohier, Gabriel Hardy, Nelly Roussel, Manuel Devaldes, Eugène Humbert. A cette phalange du début, devaient se joindre, plus tard, nombre de militants appartenant à des organisations révolutionnaires, plutôt hostiles, dès l’abord, (car elles voyaient dans le néo-malthusianisme une déviation dangereuse), puis des écrivains comme Victor Margueritte. Aujourd’hui, cette doctrine s’est répandue dans le monde entier ; elle est mise en discussion dans tous les milieux possédant quelque culture, même aux Etats-Unis où, malgré les rigueurs d’un puritanisme vraiment excessif, elle a trouvé, en partie, droit de cité, sous la dénomination édulcorée de « contrôle des naissances ». Quant à la diminution appréciable du taux de la natalité dans les grandes nations civilisées, elle est l’indice que si, peu nombreux sont les néo-malthusiens qui s’avouent tels, innombrables sont, par contre, ceux qui le sont en secret, pour leur profit personnel, en feignant l’indifférence ou se déclarant ses adversaires.
Au point de vue théorique le néo-malthusianisme, proprement dit, a fait cause commune avec les idées de génération consciente, et de réforme de la moralité admise, en ce qui concerne les choses sexuelles. C’est-àdire que le point de vue économique n’est pas seulement pris en considération, mais aussi celui de la reproduction de l’espèce dans des conditions suffisantes de santé et de beauté, par une sélection des géniteurs.
Comme toutes les doctrines nouvelles, révolutionnaires, le néo-malthusianisme a subi et subit encore des persécutions, notamment pour ce qui concerne la divulgation des procédés anticonceptionnels dans les classes pauvres. Sous prétexte d’outrage aux bonnes mœurs, d’atteinte à la moralité publique, à la religion, à la sécurité de l’Etat, il a été, d’une façon plus ou moins ouverte ou déguisée, l’objet de mesures de répression dans divers pays, particulièrement en Suède, en Belgique, en Allemagne, en Hollande, et en France, où les dispositions de la loi du 31 juillet 1920 ne trouvent d’équivalence, en fait d’arbitraire, que dans les lois, dites « scélérates », de 1804, contre les menées anarchistes.
Il n’est à retenir, à l’égard du néo-malthusisme que deux objections sérieuses : L’une, d’ordre médical, a trait aux inconvénients que présentent pour les femmes, l’emploi de certains moyens et la stérilité volontaire, quand elle se prolonge abusivement ; l’autre, d’ordre social, nous fait entrevoir le danger d’une extinction progressive des éléments humains les plus intelligents et les plus cultivés, les plus réfléchis par conséquent, au profit des peuples arriérés, des dégénérés et des êtres frustes, qui n’ont pas les mêmes scrupules, et sont généralement incapables d’apporter, dans leurs relations conjugales, les mêmes réserves.
— Jean MARESTAN
MALTHUSIANISME, NÉO-MALTHUSIANISME
D’autres camarades traitent ici du malthusianisme du néo-malthusianisme tels que le conçurent Malthus, Paul Robin, Drysdale et leurs disciples avec beaucoup plus de compétence scientifique que je ne saurais le faire. Aussi, me bornerai-je à rechercher quelle est l’attitude individualiste anarchiste relativement à cette très importante question.
Le point de vue théorique du malthusianisme n’a jamais conquis les individualistes. En premier lieu, quelles statistiques valables peut fournir une production non point basée sur les besoins de la consommation mais réglée sur l’avidité de la spéculation ? En second lieu, l’emploi des moyens préventifs ne rend ni meilleur ni pire ; les classes aisées le pratiquent et c’est dans leur sein que se recrutent accapareurs, privilégiés, monopoleurs. La natalité serait-elle réduite à un strict minimum que cette réduction ne suffirait pas pour rendre les hommes plus conscients et plus heureux, au sens profond du terme ; ils ne seraient ni moins ambitieux, ni moins violents, ni moins jaloux. Ce qui n’empêcherait qu’en régime néo-malthusien, il se trouverait, comme actuellement, des humains généreux, larges, aux aspirations élevées.
Le bon sens démontre que dans tout milieu social basé sur un contrat imposé, moins on a de charges, plus on est libre ; moins on accepte de responsabilités, plus on est indépendant. Des êtres raisonnables sélectionneront toujours, entre leurs besoins, leurs aspirations, leurs appétits, leurs, fonctions, ceux de nature à les rendre les moins dépendants possibles des conditions économiques de la société capitaliste et des préjugés de l’ambiance sociale.
Indifférents aux gémissements des moralistes, négateurs des jouissances sensuelles et prêcheurs de résignation, des repopulateurs parlementaires aux familles restreintes, des chefs du socialisme qui comptent sur l’accroissement des miséreux pour les hisser au pouvoir, les individualistes néo-malthusiens voulurent opposer au déterminisme aveugle et irraisonné de la nature leur déterminisme individuel, fait de volonté et de réflexion.
Ce n’est donc pas au point de vue de la « loi de population » que se sont situés les individualistes qui ont réclamé la faculté de libre exposition de la théorie et de la pratique néo-malthusienne. Considérant que pour se défendre contre les intempéries, l’homme a construit des habitations, s’est couvert de vêtements, a allumé du feu ; qu’il a réagi contre l’obscurité par des appareils d’éclairage toujours plus perfectionnés, contre la foudre par le paratonnerre, etc., etc., ils ont revendiqué pour l’humain émancipé la même possibilité d’éviter, par des procédés d’ordre mécanique, la venue d’une maternité non désirée.
A la suite de spécialistes, les individualistes néo-malthusiens démontrèrent que « la procréation n’est pas une fonction indispensable à la vie individuelle » ce en quoi elle diffère de certains phénomènes comme la nutrition, la respiration, etc.
C’est partant de là que les individualistes ont toujours soutenu qu’il était « exorbitant que d’un coït passager il puisse résulter pour la femme une maternité non désirée, qu’une relation sexuelle accidentelle fasse envisager à un homme la responsabilité d’une paternité ».
En revendiquant pour leurs compagnes la faculté d’ètre mère à leur gré les individualistes néo-malthusiens virent, non un conformisme aux fameuses « lois de Malthus », mais tout simplement : les uns un « pis aller », les autres « un moyen de résistance de plus contre l’oppression et le déterminisme des circonstances extérieures ». Ce point historique fixé, aujourd’hui que des lois liberticides interdisent rigoureusement toute propagande anticonceptionnelle, les individualistes anarchistes revendiquent, comme pour toutes les autres expressions de la pensée humaine, pleine liberté de discussion, de diffusion, d’exposition théorique et pratique de la thèse de la limitation des naissances. Ici en France, comme cela a lieu en Russie et avec films à l’appui, si c’est nécessaire pour la démonstration.
Une chose est le désir de s’étreindre, autre chose celui de vivre côte à côte. Rien ne garantit — les exemples abondent pour le prouver — que l’être avec lequel on cohabite actuellement plaira toujours ou qu’on lui plaira toujours. Les faits indiquent que des couples ont pu assez longtemps vivre en bonne harmonie sans enfants ou avec un enfant ou deux, chez lesquels la mésentente et l’amertume se sont introduits dès que la progéniture s’est accrue.
Les individualistes que le sujet a intéressé ne préconisèrent jamais la stérilité systématique, bien qu’en ce qui les concerne leur vie en marge des conventions et des préjugés, leur existence d’ « en dehors » ne leur permissent guère d’assumer les charges d’une progéniture. S’ils revendiquèrent, s’ils revendiquent pour la femme le « droit » à la maternité librement désirée et librement consentie, c’est qu’il leur apparaît de toute évidence « que c’est à la précréatrice, à la mère de décider quand elle veut enfanter et de choisir le procréateur de son enfant qui peut être autre que son compagnon habituel ». Ils ont ajouté que c’est une question d’eugénisme, de qualité et non de quantité ; que des enfants qui viennent au monde à assez grand intervalle, par exemple, ont beaucoup plus de chance de grandir sainement, de devenir des êtres instruits, vigoureux, mieux doués, plus aptes que ceux qui se succèdent sans interruption ou presque.
Faisant abstraction des exagérations de l’eugénisme, l’espèce humaine ne peut retirer qu’un avantage toujours plus appréciable de la pratique des progénitures sélectionnées. D’autre part, utiliser la volupté sexuelle, les raffinements de plaisir, de jouissance auxquels elle peut donner lieu, non plus en vue uniquement de la procréation, mais dans le dessein d’augmenter son bien-être individuel, n’est-ce pas accroître du même coup le bien-être de l’espèce, l’espèce (somme toute) se composant d’individus.
— E. ARMAND
MAMMIFÈRES
adj. et subs. (du latin mamma, mamelle et ferre, porter : qui porte des mamelles)
Les mammifères nous intéressent tout particulièrement parce qu’ils forment la classe animale à laquelle nous appartenons nous-mêmes et que leur étude nous permet de comprendre l’évolution de l’homme depuis des temps considérables et qu’elle nous permet également d’entre-voir les grandes lois biologiques qui se manifestent dans l’évolution de la vie à la surface du globe. Cette connaissance peut nous guider pour éviter certaines erreurs et nous permettre de construire plus sûrement notre édifice social.
Les mammifères se caractérisent principalement par une température constante : 39° pour la plupart d’entre eux, 37,5° pour l’homme (oiseaux 42° à 44°) ; un épiderme souple, adipeux, couvert de poils ; le développement embryonnaire effectué dans l’organisme matériel et enfin la nutrition des petits par une sécrétion fournie par des glandes cutanées appelées mamelles.
L’origine des mammifères n’est pas exactement déterminée, comme d’ailleurs la plupart des origines concernant l’apparition des diverses classes animales et même celles concernant la formation des grands embranchements du règne animal. Que le transformisme s’impose actuellement à tout esprit débarrassé de mysticisme, cela ne fait aucun doute pour qui exige de ses propres représentations mentales des processus intellectuels cohérents, coordonnés, liés dans l’espace et dans le temps, conformes aux données objectives de l’expérience et de l’observation. La démonstration de l’évolution d’un humain depuis l’œuf jusqu’à la sénilité est l’argument sans réplique par quoi le déterministe triomphera toujours des explications spiritualistes. Mais s’il est encore possible de suivre ontogéniquement l’évolution d’un être il est bien difficile de retrouver toutes les formes phylogéniques ayant précédé cet être depuis les premières ébauches de la vie à la surface de la terre jusqu’à sa forme actuelle.
Trois études différentes permettent néanmoins de jeter un peu de lumière sur les ténèbres du passé et de retrouver, dans ses grandes lignes, l’évolution compliquée des êtres organisés. Ce sont : la morphologie et l’anatomie comparée, qui étudient la conformation intérieure et extérieure des êtres vivants ; la Paléontologie qui s’intéresse aux restes fossilisés des animaux disparus ; l’embryologie, qui observe les différentes transformations de l’être vivant depuis la simple cellule initiale jusqu’à la forme parfaite de l’adulte.
Ces trois études se basent sur la ressemblance des caractères observés, sur le rapprochement évident des formes ; sur des comparaisons favorables à des ramifications, des descendances, des parentés plus ou moins voisin es ou éloignées.
La Morphologie et surtout l’Anatomie comparée groupent les mammifères actuels en une douzaine d’ordres renfermant des différences assez grandes soit comme aspect, soit comme mœurs. Alors que la classe des oiseaux présente une certaine fixité, des types assez voisins les uns des autres, les mammifères, par leur facilité d’adaptation à des milieux très variés, se sont diversifiés considérablement au point de ne plus même se ressembler morphologiquement, tels les chauve-souris, les baleines ou les chevaux.
Au bas de l’échelle des mammifères, les Monotrèmes, qui vivent seulement en Australie (l’Ornithorynque, au bec de canard et l’Échidné, couvert de piquants) pondent des œufs qu’ils couvent ensuite. Leur température varie entre 25° et 28° et les petits sont allaités par la mère. Les Marsupiaux (Kanguroo d’Australie, Sarigue d’Amérique) mettent au monde un embryon à peine formé, lequel placé par la mère dans une poche placée sous son ventre où se trouvent les mamelles, termine ainsi sa croissance. Ces deux groupes d’animaux, par leur constitution, rappellent certains caractères des reptiles et des oiseaux et nous montrent quelques types intermédiaires entre les ovipares et les vivipares.
Les Insectivores (Taupe, Hérisson, Musaraigne, etc.) beaucoup plus répandus à la surface des continents, sont des mammifères nettement caractérisés, à température constante élevée et à développement placentaire.
Les Chiroptères (Chauves-souris, Vampire, etc.) sont des insectivores adaptés au vol. Leurs formes sont assez particulières et constituent un des aspects curieux des possibilités de variations des mammifères.
Les Carnivores sont trop connus pour en parler ici. Il en est de même des Rongeurs dont quelques-uns, tels le lapin et surtout le rat disputent à l’homme, parfois avec succès, le droit à la vie.
Les Pinèdes (Phoques, Otaries, Morses) se sont adaptés à la vie marine, ainsi que les Siréniens (Lamantin, Dugong) et les grands Cétacés (Dauphin, Cachalot, Baleine). Ces animaux marins ne paraissent point avoir la même origine. Il est possible que les cétacés dérivent de quelques reptiles nageurs du secondaire, tandis que les Siréniens, descendraient plutôt des protongulés du tertiaire inférieur.
Les Édentés (Fourmiliers, Tatous, Paresseux), ne sont pas classés nettement et leur ascendance reste problématique. Les Proboscidiens se réduisent aux seuls Éléphants d’Afrique et d’Asie. Les Ongulés présentent plus de variétés et le Rhinocéros, le Cheval, le Bison, le Chameau, le Cerf, la Girafe sont assez différents les uns des autres ainsi que l’Hippopotame, le Gnou et le Sanglier.
Les Primates se divisent en trois sous-ordres : les Lémuriens, vivant surtout à Madagascar ; les Simiens, répandus dans toute la zone tropicale, s’écartent peu des régions chaudes. Quelques formes sont intermédiaires entre les Lémuriens et les Singes comme les Ouistitis et possèdent des griffes. D’autres Singes (Platyrrhiniens) ont le pouce peu séparé de la main, les narines écartées, la queue prenante. Tels sont les Alouates, les Sapajous, les Sakis de l’Amérique du Sud. Les Catarrhiniens comprenant les Babouins, Mandrills, Macaque, Magot et enfin les anthropoïdes dont l’Orang-Outang des îles de la Sonde, les Gibbons de l’Inde, le Chimpanzé et le Gorille d’Afrique. Le dernier sous-ordre des Primates est uniquement constitué par les Hominiens peu différents, anatomiquement, des anthropoïdes.
La Paléontologie retrouve des traces de Mammifères dès le début du Secondaire, dans le Triasique. C’étaient de tout petits animaux, probablement insectivores, vivant sur les arbres. Leurs ancêtres probables doivent être cherchés parmi les Théréodontes (sous-ordres des Théromorphes), sortes d’intermédiaires entre les reptiles nettement caractérisés et les Mammifères du Secondaire. Les Théréodontes descendaient probablement eux-mêmes des Rhynocéphales, lesquels provenaient sans doute des Stégocéphales vivant à l’époque Pesmienne dans le Primaire. Ces sortes d’animaux mi-reptiles, mi-batraciens, de formes assez diverses (serpent, lézard) ont précédé les grands Reptiles du Secondaire, contemporains des petits mammifères arboricoles.
Remarquons ici que l’on trouve des traces d’Insectes du genre Blatte, ainsi que des Scorpions dans le Silurien, ce qui montre l’ancienneté prodigieuse des animaux à respiration trachéenne. Remarquons également que, tandis que les Mammifères comptent tout au plus 3.000 espèces environ sur les 272.000 espèces animales connues à ce jour les arthropodes en comptent 209.000, et les insectes 180.000 à eux seuls. On voit qu’au cours des siècles la variation ne s’est point effectué de la même manière, ni dans le même temps, chez les différents animaux.
Les oiseaux sont postérieurs aux Mammifères car leur ancêtre possible l’Archéoptéryx, de la taille d’un gros corbeau, ne se rencontre que dans le Jurassique supérieur. C’était un animal étrange avec un squelette de Reptile, une queue de Lézard emplumée, des mâchoires dentées, et des plumes nettement formées jusque sur les jambes terminées par des pattes griffues. À cette époque le Jurassique contenait déjà plus de 25 espèces de Mammifères de la taille du Rat et du Glouton et se rapprochant des Monotrèmes actuels. C’était l’époque des Reptiles gigantesques, maîtres incontestés de tous les continents, dont quelques-uns, tel I’Atlantosaurus des Montagnes Rocheuses, atteignaient les dimensions colossales de 36 mètres. Jusqu’alors la température paraît avoir été à peu près égale sur la surface terrestre mais à partir du Crétacé les saisons commencent à se former et l’évolution se précise alors en faveur des Mammifères. Par leur température interne régulière et élevée ces derniers purent se maintenir et s’adapter à des températures extérieures très diverses tandis que la faune reptilienne disparaissait et ne se maintenait désormais que sous les tropiques avec des dimensions bien réduites.
Un autre facteur de triomphe des Mammifères fut le développement exceptionnel de leur cerveau, particulièrement du cerveau antérieur le télencéphale. Cette écorce cérébrale est constituée par deux régions assez indépendantes l’une de l’autre : le rhinencéphale et le néopallium. La première centralise toute l’activité olfactive de l’animal, la deuxième centralise la sensibilité visuelle, auditive et tactile. Alors que chez les Poissons le néopallium est excessivement réduit, chez les Reptiles il augmente d’importance, tandis que chez les Mammifères il se développe considérablement en proportion de la régression du rhinencéphale.
Si, pendant l’énorme durée du Secondaire (plus de 400 millions d’années d’après Carl Stœrmer), les Mammifères se sont peu différenciés ; si, dans le Crétacé, une certaine homogénéité existait encore, dans l’Éocène ancien diverses variations importantes commencent à se préciser, variations déterminées par le genre de vie, principalement l’alimentation. Déjà les Créodontes, ancêtres des Carnassiers, les Condylarthres, ancêtres des Ongulés et peut-être des Siréniens, les Pachylémuriens dont le nom indique les descendances ultérieures, offraient des différences appréciables et très marquées. Chaque ordre s’écarte considérablement de sa forme primitive. La vie marine, terrestre, arboricole, aérienne, modifie la morphologie des Mammifères. En plein Crétacé un petit groupe d’insectivores s’était déjà séparé des autres Mammifères tout en conservant les caractères primitifs des Marsupiaux et se rapprochant des Créodontes. C’étaient les Ménotyphlas, actuellement vaguement représentés par les tupaïas vivant d’insectes et de fruits dans les arbres de la Malaisie et se rapprochant des Lémuriens. Dans le Paléocène de l’Amérique Centrale on trouve les restes des deux branches de Primates : les Lémuriens et les Tarsoïdés déjà différenciés. Ils ont ensuite émigré en d’autres régions et les Lémuroïdés, aujourd’hui localisés principalement à Madagascar, dans le sud de l’Inde et dans l’Afrique Orientale, ont peu évolué depuis ces époques lointaines. Les Tarsoïdés, réduits actuellement aux Tarsiers de la Malaisie étaient représentés à cette époque par six genres dont l’un : Anaptomorphus Homonculus, a été regardé par Cope comme l’ancêtre commun à tous les singes. Rémy Perrier admet que c’est dans l’Amérique Centrale que s’est effectuée la séparation des singes en Platyrrhiniens et en Catarrhiniens, lesquels ont émigré dans l’ancien monde et ont continué leur évolution en diverses directions. Il est assez difficile de suivre cette évolution et cette migration mais dans le gisement des Siwaliks, au pied de l’Himalaya, on trouve déjà des types très nettement différenciés d’anthropoïdes dont le fameux Dryopithécus, duquel descendait le genre Palœosimia d’où proviendrait l’orang-outang ; le genre Palœopithhécus ayant abouti au Gorille et le genre Sivatherium ancêtre possible des Hominiens.
Les découvertes de la Préhistoire diminuent chaque jour l’écart entre l’homme et ses ancêtres arboricoles. Les hommes de Mauer, de Néanderthal, de la Madeleine nous montrent l’évolution et les transformations progressives de la morphologie hominienne vers les types humains actuels.
Si l’on compare les résultats des liaisons établies par la paléontologie entre les divers échelons de l’animalité mammalogique du crétacé jusqu’à l’homme actuel ; si l’on tient compte de l’insignifiance des recherches souvent accidentelles et nullement en rapport avec l’immensité des espaces non encore fouillés ; si l’on tient également compte des causes nombreuses de disparition des fossiles et des bouleversements géologiques (effondrements de continents, éruptions volcaniques, incendies, etc.) détruisant toute possibilité de recherches, il faut véritablement reconnaître que la paléontologie, malgré ses nombreuses lacunes, a tracé une généalogie fort satisfaisante des Mammifères et de l’Humanité. Quelques points restent encore bien obscurs, tels le, ou les lieux d’origine du genre humain et son unité ou sa pluralité originelle. Le premier point ne peut encore se résoudre par une affirmation basée sur quelques certitudes. On trouve des restes d’Hommes fossiles en différents endroits situés en Afrique, en Europe et en Asie, englobant une vaste région presque circulaire encore inexplorée. La majorité des naturistes paraît pencher pour l’origine asiatique de l’Humanité, mais il est également possible qu’elle ait eu lieu ailleurs et peut-être en plusieurs endroits différents ce qui soulève la question de l’origine monophylétique ou polyphylétique du genre humain. L’Anatomie comparée nous montre une certaine unité dans les races humaines peu compatibles avec les ascendances diverses ayant engendré les anthropoïdes actuels : Gorilles, Chimpanzés, Orang-Outangs, etc.
Peut-être les hominiens, descendant d’un anthropoïde très répandu, très migrateur, voisin des Dryopithécus, se sont-ils formés en diverses régions de la Terre. Ce sont là, au fond des questions secondaires dont les diverses solutions paraissent peu susceptibles d’ébranler l’origine animale de l’homme.
L’Embryologie nous montre les processus évolutifs des mammifères non seulement très voisins les uns des autres mais encore très semblables aux premiers stades de développement des diverses classes de vertébrés. On sait que l’Ontogénie d’un être vivant répète, très brièvement, la phylogénie de ses ascendants. Edmond Perrier a donné à ces faits le nom de Loi de Patrogonie. Cette évolution ne saurait d’ailleurs être totalement comparable à celle de ses ancêtres, car nous voyons les germes d’animaux inférieurs se suffire immédiatement dans la lutte pour la vie alors qu’aucun embryon de Mammifère ne pourrait y parvenir. Si donc cet embryon passe par des formes rappelant quelque peu celles d’animaux beaucoup plus primitifs, si des organes apparaissent et disparaissent dans cette évolution accélérée (par exemple les fentes branchiales, l’appendice caudal de l’embryon humain) il ne peut en un temps aussi réduit repasser par toutes les formes apparues successivement pendant la colossale durée des temps géologiques. La Tachygenèse elle-même, ou accélération embryogénique, ne pourrait expliquer la rapidité de cette évolution et la suppression de la plupart des formes phylogéniques intermédiaires. Il faut plutôt admettre que la cellule germinative des Mammifères actuels diffère chimiquement des cellules germinales primitives des vertébrés et des invertébrés et que, soustraite aux influences primitives, elle se développe dans des conditions différentes, produisant alors des formes différentes. Le développement embryogénique ne reproduit donc nullement la forme adulte des ascendants, mais reproduit leurs ébauches embryonnaires très voisines les unes des autres correspondant à des conditions analogues de leur évolution.
L’Embryologie comparée permet de rapprocher tous les vertébrés entre eux beaucoup plus que de tout autre embranchement du règne animal ; de suivre leur évolution embryonnaire et de reconnaître chez les Mammifère placentaires trois dispositions particulières les répartissant en trois séries comprenant, premièrement, les Rongeurs, les Insectivores et les Chiroptères ; deuxièmement, tous les autres groupes sauf les Lémuriens ; troisièmement, les Lémuriens et les Primates. Ce qui confirme, en somme, toutes les autres données concernant l’origine et la parenté de l’Homme.
Cette évolution remarquable aboutissant finalement à l’épanouissement de l’intelligence humaine peut paraître plus ou moins surprenante. On ne manquera pas de faire remarquer que les mêmes causes extérieures ont agi sur les mêmes animaux et que leurs profondes divergences restent bien mystérieuses. On peut trouver en effet que les Oiseaux, par exemple, ont également une température élevée et mènent une vie arboricole et aérienne favorable au développement du néopallium. On peut objecter encore que les autres Mammifères et principalement les Anthropoïdes ont une existence arboricole, possèdent des mains et se rapprochent considérablement des hominiens sans atteindre leur évolution intellectuelle. On pourrait tout aussi bien comparer l’évolution si intéressante des insectes, pourtant très éloignée de la nôtre, et rechercher les causes des divergences aussi profondes chez les différentes espèces animales. On ne peut, ici, rechercher ce qu’il y a, au fond, de commun entre tous les êtres vivants malgré leurs grandes différences apparentes ; ni préciser l’unité de l’intelligence (qui n’est qu’une fonction de la vie) dans tout le règne animal.
Ce qui a favorisé l’Homme, c’est précisément un ensemble de faits réalisés partiellement par d’autres animaux mais réunis circonstanciellement en son espèce. C’est ainsi que la vie arboricole développa, nous l’avons vu, des facultés visuelles, auditives et tactiles. Les bruits de la forêt éveillèrent l’attention ; les difficultés des déplacements développèrent l’agilité, l’adresse, la précision. La mémoire plus fertile permit des représentations plus étendues et des associations de sensations beaucoup plus compliquées. La curiosité s’accrut en proportion de l’extension des possibilités d’adaptations nouvelles. La station verticale accéléra cette évolution ; elle détermina le perfectionnement de la main, laquelle suppléant de plus en plus à la mâchoire, dans de multiples actes vitaux, libéra les muscles faciaux de maints efforts violents. La station verticale nécessitant beaucoup moins d’efforts des muscles soutenant ta tête, le crâne moins comprimé atteignit un développement plus grand. Enfin la vie sociale engendra la nécessité de l’échange des impressions et facilita l’apparition et le fonctionnement du langage articulé. Il est aussi probable que la formation intra-utérine des jeunes êtres favorisa peut-être le développement anormal de certains organes (le cerveau entre autres) aux dépens des autres.
C’est ici qu’il convient de remettre au point le fameux concept : la fonction crée l’organe. La fonction étant essentiellement le jeu vital d’un organe (son effet) il semble paradoxal d’affirmer qu’un effet puisse exister avant sa cause. Or, ce n’est pas ainsi qu’il faut entendre les choses. Quelle que soit la manière dont nous cherchions à nous expliquer l’origine de la vie, il faut admettre qu’elle a débuté par une forme infiniment plus simple que toutes celles que nous connaissons actuellement. Cette « forme », ce mouvement, cet organe de vie, issu du fonctionnement universel, créa par ses réactions immédiates avec le milieu, la fonction vitale. Chaque mouvement vital, conquérant le milieu extérieur, a bien constitué ainsi la fonction vitale, mais toute variation de ce milieu se présentant avec des particularités nouvelles a déterminé dans l’organisme ancien (donc sans organe nouveau) une réaction nouvelle (donc une fonction nouvelle exécutée tant bien que mal par un organisme ancien) laquelle modifiait alors cet organisme ancien. Si la modification persistait il y avait apparition de réactions nouvelles, création d’organes nouveaux agissant hors de l’influence objective. On peut dire que la fonction est une réaction de la substance vivante contre le milieu, déterminée tantôt par le milieu lui-même (apparition de la fonction ou réaction avant l’organe) tantôt par la substance vivante (l’organe existe alors avant la fonction). Les biologistes mécanistes tels que Lœb et Bohn ont démontré que les réactions de la matière vivante s’effectuaient très souvent sans finalisme aucun, que parmi ces multiples réactions ainsi créées, seules celles qui favorisaient la conservation de l’être pouvaient aboutir, par la sélection, à la formation d’organes nouveaux. Cela permet de relier correctement le Darwinisme au Lamarckisme ; de libérer celui-ci de sa tendance finaliste et de donner un sens intelligible à la sélection naturelle qui, sans cela, explique très bien la disparition des organes mais nullement leur apparition.
Ce rapide exposé de l’évolution des Mammifères peut nous aider grandement dans l’établissement de nos concepts philosophiques et sociaux. L’origine animale de l’homme, les causes de son évolution physique et intellectuelle, ses luttes ancestrales, ses lentes acquisitions morales, sa formation sociale, ses multiples hérédités forment autant de repères nous permettant de comprendre les difficultés des transformations rapides que nous voudrions réaliser. Mais loin de nous mener vers un pessimisme inhibiteur le spectacle de cette évolution prodigieuse d’animaux mi-batraciens, mi-reptiles aboutissant à l’homme sensible, généreux, curieux et inventif est au contraire fort satisfaisant. La rencontre d’humains de proie ou de types grégaires, mystiques ou primitifs ne doit point nous étonner outre-mesure, car nous savons que la vie grégaire fut nécessaire à l’éclosion de l’Humanité ; que l’ignorance et la peur furent à son point de départ et qu’elle ne dût son triomphe dans la lutte pour la vie qu’à son audace et son esprit conquérant.
Son évolution animale nous montre des causes d’apparence insignifiante engendrant des conséquences très importantes. C’est ainsi que si les Mammifères étaient restés dans la plaine ils n’auraient point acquis leurs facultés intellectuelles, mais d’autre part s’ils n’avaient point ensuite vécu dans la Savane ils n’auraient point dépassé le niveau des anthropoïdes actuels. Cela nous montre l’utilité de certaines formes sociales passées mais nous indique également la non moins grande utilité de changer d’habitudes, de mœurs, de milieu si nous voulons nous transformer et évoluer dans d’autres directions. Les grandes différenciations des Mammifères nous indiquent également les dangers de toute spécialisation exclusive déformant les êtres, les modifiant en types distincts et séparés, presque étrangers les uns aux autres. Enfin l’unité anatomique et embryogénique des Hominiens nous fait entrevoir des possibilités d’entente, de compréhension et peut-être d’harmonie entre les hommes sur le plan intellectuel et moral.
Connaissant les possibilités de transformation des êtres vivants nous pouvons agir sur notre milieu, l’orienter vers notre concept social plus équitable, mieux équilibré, plus rationnel, plus avantageux pour l’ensemble des humains.
Le Mammifère du Crétacé évolue et doit encore évoluer vers l’Age de Raison et c’est notre intérêt de l’y aider.
‒ IXIGREC.
OUVRAGES A CONSULTER.
La Genèse des espèces animales (L. Guénot).
Les mammifères et leurs ancêtres géologiques (O. Schmidt).
Un problème de l’Évolution (Vialleton).
La place de l’homme dans la série animale (R. Périer, « revue philosophique » 1929).
L’Embryologie comparée (L. Roule).
La Terre avant l’apparition de l’homme (F. Priem).
La Descendance de l’homme (Darwin).
Hist. de la création des êtres organisés (Haeckel).
Philosophie zoologique (Lamarck).
Traité d’anatomie comparée pratique (C. Vogt et E. Young).
Traité de Zoologie (Claus).
Les mammifères tertiaires (tome II des Enchaînements du monde animal : A. Gaudry).
La Genèse de l’homme (de Paniagua).
etc.
Et les ouvrages mentionnés aux mots : darwinisme, évolution, homme, terre, transformisme, etc.
MANDAT, MANDANT, MANDATAIRE
n. m. (du latin mandatum, chose mandée)
On donne le nom de mandat à une délégation d’une durée variable donnée, dans des circonstances généralement déterminées, par un individu, une collectivité, un gouvernement ou un groupe de gouvernements, à un tiers ou à plusieurs personnes, pour les représenter au sein d’une assemblée chargée de définir des droits, d’examiner ou de défendre des intérêts, d’arbitrer un conflit, etc...
C’est ainsi que les membres, d’un syndicat, d’une coopérative, d’une société quelconque, se réunissent en assemblée générale et, à la majorité ou à l’unanimité, désignent l’un ou plusieurs des leurs pour les représenter dans une assemblée ou un Congrès. Ils indiquent, généralement, dans quelles conditions, ils désirent être représentés. Ces conditions constituent le mandat, c’est-à-dire le caractère de la délégation qu’ils donnent à leur mandataire et que celui-ci accepte de ses mandants.
Un député tient son mandat de la majorité absolue ou relative, de ses électeurs ; son mandat, c’est le programrne sur lequel il a été élu. Il conserve le mandat le plus longtemps possible et il oublie, en général, son programme le lendemain de son élection.
Il en est, malheureusement, souvent de même pour les mandataires des organisations ou sociétés de tous ordres. Le délégué oublie la fonction qui lui est confiée et ne tient compte que de son désir personnel, qui se confond trop souvent avec sa satisfaction individuelle ou son propre intérêt. Le seul moyen d’obtenir du mandataire le respect de son mandat, c’est de le contrôler sévèrement et de ne lui confier qu’une délégation ayant un but très précis et une durée limitée. Si les députés pouvaient être « révoqués » dès leur premier abandon de programme, ils agiraient avec moins de désinvolture.
Ce qui est vrai pour les députés, l’est d’ailleurs, en général, pour tous ceux qui savent conserver les mandats et les délégations longtemps, sans se soucier de l’avis de leurs mandants.
Les gouvernements mandatent leurs représentants dans les conférences internationales politiques, économiques et financières pour y défendre l’intérêt national.
L’après-guerre nous a valu un nombre incalculable de conférences de cet ordre et l’institution d’un organisme international : La Société des Nations où les représentants des gouvernements discutent toutes les grandes questions qui nécessitent un examen commun. La Société des Nations, elle-même, donne des mandats à certaines puissances de premier rang, qui exercent le gouvernement de pays coloniaux, ou de zones de pays ex-belligérants qui sont placés sous l’autorité de la Société des Nations, pour éviter des conflits entre grands pays.
Il y a, enfin, différentes formes de mandats : juridiques et judiciaires. Par exemple, un homme peut donner mandat à un autre de le représenter en justice, dans un arbitrage. Un tel mandat prend le nom de « pouvoir ».
Le juge instruction dispose également de mandats. Ce sont : les mandats d’arrêt et de perquisition, les délégations judiciaires et les commissions rogatoires. Il donne même, parfois, un mandat en blanc, qui est la véritable lettre de cachet moderne. Muni d’un tel mandat, un policier quelconque peut arrêter n’importe qui, pour n’importe quoi et même sans prétexte, raison ni motif. Aujourd’hui, on arrête même sans mandat et en masse, par raison d’État.
Les mandats d’arrêt et de perquisition sont exécutés par la police, soi-disant sous la responsabilité du juge. En réalité, la police opère sans contrôle, comme elle l’entend et ne rend compte que de ce qu’elle veut.
Si un juge donna mandat à la police pour enquêter, entendre des témoins, etc., etc. ce mandat prend le nom de délégation judiciaire. Lorsqu’un magistrat doit recueillir le témoignage d’une personne habitant hors de son ressort, il peut faire entendre le témoin par le juge d’instruction du ressort dont dépend l’intéressé. C’est ce qu’on appelle la commission rogatoire.
En résumé, les magistrats usent largement du mandat et les policiers en abusent plus largement encore, c’est ce qui explique tant d’affaires scandaleuses, tant d’ atteintes portées à la liberté individuelle.
‒ Pierre BESNARD.
MANICHÉISME
n. m. (rad, manichéen, de Manès ou Manichée)
Le manichéisme a été l’une des hérésies les plus importantes du christianisme, si toutefois on peut le classer parmi 1es sectes chrétiennes. Son fondateur, Manès, Mani ou Manichée , naquit en Perse, vers 218 de l’ère vulgaire. On le représente comme un homme austère, doué d’une vaste érudition. Les uns veulent qu’il ait été prêtre, les autres médecin ; on assure même qu’il peignait fort agréablement. Haï des chrétiens, parce qu’hérétique, mal vu des persans qui le considéraient comme chrétien, il parvint à se maintenir jusqu’en mar 277 (d’autres disent jusqu’en 274) époque où la légende veut qu’il ait été écorché vif sur l’ordre du roi de Perse, Varahram Ier. Mani avait visité l’Inde et était entré en relations étroites avec les prêtres de Bouddha.
Quelles étaient donc les doctrines des manichéens pour qu’elles leur aient valu les persécutions de l’Église ? On retrouve dans le manichéisme des influences gnostiques ‒ ce sont les principales ‒ mésopotamiennes, perses, bouddhiques. Deux principes coexistent éternellement : l’un bon (symbolisé par la lumière) et appelé prince de lumière, l’autre mauvais (symbolisé par les ténèbres) et dénommé Prince de ce monde, Satan et aussi Matière. La Matière, ayant subi le rayonnement de la lumière, voulut s’élever jusqu’à elle et il y eut guerre entre les deux éléments. En vain pour contre-balancer les efforts de la Matière, le bon principe ou Dieu créa-t-il l’homme primitif (spirituel) ; ce dernier fut vaincu et emprisonné dans la Matière. L’homme actuel a été créé par le principe mauvais de même que sa descendance : l’humanité, soumise aux mêmes tentations que lui. Le salut est en la connaissance de la vraie science, apportée par le prophète Mani ; cette Connaissance a été diffusée parmi les hommes par l’histoire de Jésus-Christ, purement symbolique, d’ailleurs.
Dans la pratique, plus radicalement, plus austèrement que le christianisme, le manichéisme place le salut dans le renoncement, l’abstention.
Le fait de considérer Jésus comme un symbole et non comme un vivant mena les manichéens à nier le mystère de l’Incarnation et celui de la Résurrection, à tenir comme nul le sacrement de la communion, le pain et le vin ne pouvant être la chair et le sang d’un fantôme ; les manichéens avaient en aversion les représentations de la croix, ils tournaient en dérision la fable de la vierge-mère et plus tard le culte qui lui fut rendu ; ils niaient la résurrection de la chair. Le bon ne pouvant se lier avec le mauvais, ils rejetaient le mariage et combattaient vigoureusement la procréation ; ils ne mangeaient pas de viandes, ils ne consommaient pas de vin ; à part les poissons et les reptiles ils ne tuaient pas les animaux ; l’enfer et plus tard le purgatoire sont considérés comme des inventions insensées ; c’est sur terre que l’âme subit son enfer qui durera jusqu’à ce que des incarnations successives (qui peuvent être animales) l’aient purifiée et délivrée de sa prison de chair.
Les manichéens menaient une vie en apparence très austère, ils se glorifiaient de mener l’existence des apôtres. Leurs adversaires prétendaient que cette sévérité d’attitude cachait des mœurs relâchées au point de vue sexuel et la pratique de l’homosexualité. Il y avait deux catégories distinctes d’adeptes : les néophytes ou « auditeurs », les initiés ou élus ou « parfaits ». Ceux-ci seuls, en somme, renonçaient au plaisir, au travail, au mariage ; connaissaient la signification réelle des symboles doctrinaires ; les autres suivaient de loin, renonçaient à moins, ne connaissaient qu’imparfaitement.
Il est évident que la doctrine de la coexistence du bien et du mal, leurs principes étant considérés comme égaux en force et en puissance, était aux antipodes de la doctrine prêchée par le christianisme, qui croyait au triomphe final de l’Église, de Dieu, du principe de l’autorité sur celui de la rébellion. La chute de l’homme est le résultat de sa désobéissance, elle n’est qu’un accident ; il n’y a jamais lutte égale entre les deux adversaires, Dieu tolère Satan et, théoriquement, chaque fois que la désobéissance entre sérieusement en lutte avec l’obéissance, c’est celle-ci qui remporte la victoire.
C’est sans doute ce qui explique l’opposition féroce de l’État romain aux progrès du manichéisme qui avait envahi la Perse, le Tibet, la Chine, le Turkestan et comptait de nombreux sectateurs dans le sud de l’Italie et la province d’Afrique (Saint Augustin a été manichéen pendant huit ans). Les gouvernants de l’Empire considérèrent le manichéisme comme une sorte d’anarchisme (plus redoutable, certes, que le christianisme), qui devait logiquement conduire ses adeptes à l’abandon de tous leurs devoirs de citoyens et d’hommes, comme une importation étrangère ne pouvant convenir à des Romains. C’est le point de vue auquel se place Dioclétien dans son terrible édit (vers 300) qui prononce contre les manichéens les pénalités les plus dures. Les édits de Valentinien Ier et de Théodose ler ne furent pas moins sévères. On considéra le manichéisme comme écrasé au IVème siècle.
On a contesté que les manichéens aient réellement admis le dualisme absolu et éternel du bon et du mauvais, l’existence infinie de deux Dieux s’équivalant. Toujours est-il que l’Église a toujours combattu les manichéens avec la dernière rigueur. Ils n’admettaient pas les livres de l’Ancien Testament, ils n’acceptaient les Évangiles qu’en se réservant le droit d’y faire les coupures ou les changements qui pouvaient les mettre en harmonie avec leurs opinions particulières. Ils considéraient Orphée, Zoroastre, etc., comme de véritables prophètes, la raison et le verbe leur apparaissaient comme se trouvant chez tous les hommes, devant produire partout les mêmes effets, répandre partout la même clarté ; aussi le nombre des écrits à consulter s’étendait-il bien au-delà des livres canoniques.
Le Jésus du manichéisme est purement gnostique, c’est un ange du Principe ou Dieu bon, chargé de délivrer les âmes engeôlées par la Matière ou le Dieu mauvais.
Les édits des empereurs romains n’avaient pas anéanti le manichéisme. Il demeurait assoupi, latent, dans l’empire byzantin, chez les Slaves. On le retrouve en Arménie, vers le milieu du VIIème siècle (ses adeptes s’appellent alors Pauliciens), en Bulgarie ; mais voici qu’il fait tache d’huile dès la fin du Xème siècle, on signale des manichéens ou Cathares (du grec katharos, pur), en Champagne. Du XIème au XIIIème siècle, l’église cathare, la pure, la véritable, se dressera contre l’église romaine, « la synagogue de Satan » en Italie, en Sardaigne, en Espagne, en Aquitaine, dans l’Orléanais (en 1017, Robert le Pieux fera tenailler et brûler treize cathares à Orléans), à Liège, dans le nord de la France, en Flandre, en Allemagne, en Angleterre, en Lombardie, en Lorraine et jusqu’en Bretagne. À vrai dire, la lutte entre les deux églises n’atteint d’acuité que dans la France du Sud-Ouest et l’Italie du Nord. Comme Albi est le principal centre de l’hérésie, les manichéens sont connus sous le nom d’Albigeois.
Il semble qu’il y ait eu une certaine différence entre le manichéisme, doctrine d’austérité, et l’albigéisme, représenté comme une doctrine de vie facile. On a souvent opposé les vaudois, qui menaient une existence ascétique, aux albigeois, tenus pour dissolus. À la vérité l’austérité n’était exigée que des initiés ou parfaits ; la masse des fidèles ou auditeurs pouvaient vivre selon leurs instincts et leur bon plaisir, surtout dans cette nouvelle phase du manichéisme ; il suffisait qu’un parfait plaçât les mains sur la tête d’un croyant pour effacer toutes ses impuretés ; cela s’appelait « la consolation », mais comme elle ne pouvait être dispensée qu’une seule fois dans le cours de l’existence, l’auditeur n’avait généralement recours au parfait qu’à l’article de la mort.
L’albigéisme régnait en maître dans tout le Languedoc ; il comptait seize églises ou diocèses dont les principaux se trouvaient dans la région qui s’étend entre les Cévennes, les Pyrénées et la Méditerranée. Il y avait des évêques cathares et on a même prétendu, sans preuves, qu’il a existé un pape cathare. À Toulouse, les catholiques en étaient réduits ou peu s’en faut à se cacher. Le pape Innocent III organisa une croisade contre les Albigeois et appela les seigneurs du nord de la France à y prendre part. « Il faut que les malheurs de la guerre ‒ écrivait Innocent III, 1207 ‒ les ramènent à la vérité ». Cette guerre fut sauvage, atroce. Elle débuta par une boucherie à Béziers (1209) ; les Français du Nord exterminèrent la population : dans une seule église, ils égorgèrent sept mille personnes, des femmes, des vieillard, des enfants ; après quoi, Béziers, mis à sac, fut totalement détruit par l’incendie. Dix ans plus tard, de semblables horreurs se répétèrent à Marmande, et de sang-froid : « on tua, dit un contemporain, tous les bourgeois avec les femmes et les petits enfants ».
Vingt ans durant, le Midi fut mis à feu et à sang, sans que l’hérésie cessât de subsister. Pour achever de la détruire, le concile de Toulouse, en 1229, créa les inquisiteurs de la foi, dont les moines Dominicains assumèrent la charge. Le roi de France reçut comme récompense de l’assistance prêtée à l’Église le comté de Toulouse.
Quant aux cathares, force leur sera de se dissimuler désormais ; ils cessent d’être un danger pour l’Église, dans tous les cas. Après le XIVème siècle, on n’en trouvera plus guère. S’il en existe encore, c’est vraisemblablement en pays slaves ou aux États-Unis.
‒ E. ARMAND.
MANIE
n. f. (grec mania, folie)
Manie est un des plus vieux mots de la médecine mentale. On le trouve employé par les plus anciens médecins de l’Antiquité : Hippocrate, Celse, Galien, etc. Comme la matière elle-même à laquelle se rapporte le mot, sa signification a varié à l’infini. Encore utilisé par les aliénistes d’il y a un siècle comme Pinel, Esquirol, Marc et tant d’autres pour signifier tout uniment la plupart des formes de la folie, surtout celles qui s’accompagnent d’un désordre considérable dans les pensées et dans les sentiments, d’agitation, d’excentricités incohérentes, il a été peu à peu restreint exclusivement à une seule forme mentale caractérisée par un désordre général des idées et des sentiments. Il est encore utilisé aujourd’hui dans la description des maladies du cerveau (voir Psychiatrie). J’en donnerai une idée sommaire.
Le maniaque se présente aux yeux de l’observateur comme un malade en proie à une agitation incohérente, agitation portant sur les paroles et sur les gestes. Il représente le fou tel que l’imagination vulgaire se l’imagine : un être gambadant, criant, faisant des discours sans aucune suite à la cantonade, le vêtement dans un désordre absolu, souvent malpropre et déchiré, violent par simple brusquerie sans y mettre la moindre méchanceté intentionnelle, manifestant par son attitude les états émotionnels les plus variés et les plus opposés, d’une minute à l’autre : colère, raillerie, gaîté ; religiosité, mégalomanie, érotisme. Le geste est en rapport avec l’état d’âme momentané, ce qui fait du maniaque une sorte de cabotin jouant tous les rôles possibles avec une rapidité de cinéma. Dans le fil des discours on ne saurait remarquer la moindre association logique ou rationnelle. Une idée naît d’un regard, d’une sensation et la succession en est si rapide que le malade n’a pas même le temps de former une phrase compréhensible. Mettez tous les mots du dictionnaire dans une boîte agitez-Ies et sortez-les les uns après les autres à la queue leu-leu, vous avez l’image des discours du maniaque, et en même temps des idées.
Cet état a quelque chose d’impressionnant bien qu’il ne soit qu’un orage, un tumulte, une tempête, et ne corresponde pas à une destruction profonde et définitive du fonctionnement cérébral. Il ne s’accompagne pas de fièvre, Il dure parfois fort longtemps, des mois et même des années sans qu’on ait le droit de dire qu’il ne guérira pas. Dans certains moments d’accalmie, si l’on interroge le malade, on s’aperçoit, que son intelligence est toujours aussi vive, la mémoire est intacte et, lorsque le maniaque guérit, il a une souvenance parfaite de tout ce qui s’est passé ; il ne perd pas la notion des traitements qu’on lui a fait subir, ni des violences qu’il a pu subir de la part d’agents inhumains.
L’internement de ces malheureux s’impose naturellement à raison du désordre où ils vivent et où ils plongent tout ce qui les entoure.
Telle est la manie aiguë. Il lui arrive de devenir chronique, quand les facultés s’affaiblissent, alors les malades sont plongés pendant de longues années dans un état de déchéance où ils n’ont presque plus rien d’humain, vivant dans la saleté, dans le gâtisme, couverts d’oripeaux burlesques. La manie ne tue point. On voit de vieux maniaques de 70 ans. Leur mort est accidentelle et due aux seuls progrès de l’âge.
Il me faut mentionner cependant une autre variété de manie extrêmement fréquente, tout en conservant les caractères ci-dessus décrits, c’est la manie intermittente. Si beaucoup de maniaques n’ont qu’un seul accès de manie dans leur vie ; il en est d’autres chez lesquels il y a récidive et les récidives sont parfois si fréquentes que les malades ont très peu de vie libre. Dans d’autres circonstances, on voit la manie alterner avec la mélancolie. Le contraste est frappant. Très vite, presque du jour au lendemain, on voit le maniaque se calmer et tomber dans un état de tristesse absolue avec mutisme complet, inertie, refus de s’alimenter, etc. Puis, après des mois ou des années de dépression, voici que l’agitation recommence pour redevenir mélancolie. Elle est ce qu’on appelle la folie circulaire. Elle n’est en somme que l’exagération des états émotionnels que nous subissons tous dans le cours de la vie où se succèdent sans désemparer des humeurs joviales ou tristes suivant les contingences où nous sommes mêlés.
AUTRES MANIES
Le mot de manie a une autre acception, plus commune, plus populaire, non moins importante que la précédente, du pur point de vue de la psychologie. On désigne par là certaines habitudes devenues inconscientes, comme les tics, variables de fréquence et d’intensité, que l’on acquiert tout doucement sans s’en apercevoir et dont on se débarrasse avec plus ou moins de peine. Nous sommes tous des tiqueurs parce que nous sommes tous des imitateurs, sorte d’état simiesque qui ne fait que reproduire la grande loi du mimétisme à laquelle sont assujettis tous les êtres vivants.
Le propre de ces « manies » est de s’installer sournoisement, de s’incorporer au psychisme sans qu’il en soit apparemment troublé, de se reproduire avec un parfait automatisme. Pour en prendre conscience il faut le vouloir ou y être invité et alors on se heurte aux difficultés du « pli pris » pour se guérir. Il y a des manies ridicules, qui sont uniquement affaire de mode, dont les gens intelligents, sérieux et avides de tuer toutes les servitudes se débarrassent avec un léger effort, mais il est d’autres maniaques qui subissent sans protester la tyrannie pendant toute leur vie sans faire le moindre geste pour récupérer leur liberté. Il faudrait des volumes pour retracer et critiquer toutes les manies (geste, toilette, costume, ritualisme religieux ou laïque, reproduction automatique « parce que cela s’est toujours fait », etc.), dont l’humanité restée animale encombre sa marche. Ces manies prennent parfois une forme tout à fait obsédante, pénible, cruelle même, et constituent de vraies psychoses conscientes et irrésistibles que nous retrouverons à l’article Obsession. De ce nombre seront la dipsomanie, la folie du doute, la pyromanie, l’onomatomanie, la manie homicide, la manie suicide, etc. Tous ces états reproduisent un prototype curieux qui sera décrit plus loin.
Pour en revenir aux manies vulgaires, je dirai un mot des bases psychologiques sur lesquelles elles s’échafaudent. J’ai dénommé la loi d’imitation, le mimétisme, elle est à la base de cet autre phénomène capital qu’on appelle la contagion mentale et la suggestion.
L’imitation est partout dans la nature comme une sorte d’attraction réciproque en vue d’uniformiser, d’égaliser, d’équilibrer ce qui est inharmonique. On ne saurait nier que l’harmonie vaut mieux que le désordre et que l’attraction universelle, loi d’équilibre, s’applique aux êtres vivants. L’équilibre parfait n’existe point ; il semble que ce serait la fin de tout, mais la tendance à l’obtenir est constante. L’égalité produite, on est ramené à l’allégorie de l’âne de Buridan. Toute conception de liberté disparaît, encore qu’en deçà de cette équation parfaite, la liberté reste dans le domaine des illusions. Les influences mutuelles sont énormes, intentionnelles ou non. Quand, à l’imitation de Socrate, nous plaidons une idée avec ardeur, conviction, et quand finalement nous faisons capituler un adversaire nous avons forcé et réalisé l’imitation dont nous nous sommes proposés comme types. Nous avons déguisé notre liberté du nom de discussion ; en fait nous avons été déterministes et déterminés. On voit ainsi que le modeste phénomène naturel du mimétisme se retrouve dans toutes les formes les plus élevées de l’activité humaine.
Une autre base de l’imitation d’où procèdent les manies repose sur l’état de faiblesse mentale plus ou moins accentuée dès la naissance. Faible résistance aux influences s’appelle suggestibilité. L’état émotif accentué prépare les voies à l’imitation et à l’emprise des adversaires. La puissance du suggestionneur se traduit objectivement par la réduction de l’état d’inertie, de passivité du suggestionné.
La contagion mentale existe, elle est continuelle, banale, dans la vie de chaque jour. C’est la lutte entre les malins et les sots, entre les politicards, les bons bergers et les gens de foi.
Relisez Darwin et ses beaux travaux sur le mimétisme, généralisez et vous concevrez la psychologie des foules, le mysticisme, la contagion de la folie, le triomphe de l’habileté, de la force contre la faiblesse, et l’individualisme vous apparaîtra comme un refuge relatif.
DES MONOMANIES
Un dernier mot sur les états psychiques désignés par des termes où entre en composition le mot de manie. Il y a un siècle toutes les folies étaient rangées sous la seule rubrique de monomanie, qui désignait ce qu’on appelait les folies partielles, c’est-à-dire celles auxquelles ne participait pas l’entendement tout entier. Le monomane ambitieux par exemple était lucide sur tous les points qui ne touchaient pas à sa marotte de grandeur. Un monomane mystique pouvait être un habile citoyen, très maître de soi, quand il n’était point sur le terrain de ses hallucinations religieuses, etc.
La classification était simpliste. Le bloc des monomanies a été dissous. Seules ont été conservées les obsessions (voir ce mot). Quant aux autres, elles ont pris place pour la plupart dans le grand groupe des psychoses systématiques, à évolution lente, progressive, aboutissant à une transformation complète de la personnalité et à la démence. Il en sera parlé à l’article PSYCHIATRIE.
‒ Dr LEGRAIN.
MANIFESTATION
n. f. (latin manifestatio)
C’est un de ces mots fréquemment employés dans le langage courant et dont la signification est assez vague. Il indique en général l’action de produire au dehors, de rendre apparent, évident, manifeste, un caractère, des sentiments, une œuvre d’art, etc. Parmi ces extériorisations nous intéresse surtout le mouvement, la démonstration par lesquels une ou plusieurs personnes, un comité ou une foule expriment publiquement leurs désirs, leurs volontés, leur satisfaction ou leur réprobation. Le but de telles manifestations, concertées ou non, est d’attirer l’attention sur quelque objet ou desiderata, et de provoquer des mouvements d’opinion publique.
Les manifestations artistiques, littéraires, industrielles, commerciales, etc., sont des spectacles, des exhibitions, des expositions d’art, de science, de machines, de produits, etc., etc. tenant à la fois de l’attraction et de la publicité commerciale.
Il y a des manifestations officielles ou officieuses qui sont des cérémonies dans lesquelles, avec déploiement d’apparat, les autorités tentent d’impressionner l’esprit des foules. Ce genre de manifestations (officielles, patriotiques, religieuses, etc.), entretenant l’admiration des notabilités dirigeantes ou influentes, le prestige des maîtres, contribue à fausser la mentalité collective, à entretenir la servilité, à perpétuer l’adhésion béate et passive des masses abusées et asservies. Répétées avec régularité, se déroulant dans un cérémonial adroitement combiné pour les rendre impressionnantes, faisant appel à des hommages pleins de solennité, maintes de ces manifestations finissent par devenir de véritables cultes. Elles trouvent dans la badauderie, l’impulsivité moutonnière, les tendances mystiques des masses d’hommes rassemblées un terrain admirablement préparé. Les rites proprement religieux se sont ainsi affirmés. Souverains et chefs d’État ont bénéficié de la pompe dont s’accompagnaient leurs contacts avec le peuple. La religion de la patrie, de ses emblèmes et de ses appareils, appuyée sur des manifestations périodiques et rythmées protocolairement, a pu étendre sur des millions d’individus son emprise malfaisante que couronnent des guerres imbéciles et sanglantes.
Citons, enfin, les manifestations populaires. L’usage tend ici à donner au mot de manifestation la signification plus étroite, plus précise de rassemblement d’une foule (soit dans une salle ou mieux encore dans la rue), clamant ses protestations, ses indignations et ses révoltes contre telle ou telle mesure des gouvernants et des politiciens, des despotes économiques qui régentent le travail et pèsent sur les besoins des besogneux. Pris dans cette acception de jour en jour plus répandue, le terme de manifestation évoque une grande masse populaire défilant dans la rue en cortège pacifique ou déferlant en flot tumultueux, chantant des refrains subversifs et révolutionnaires, poussant des cris de colère, huant les objets de son courroux, et, parfois, dégénérant en bagarres, s’attaquant aux propriétés ou aux personnes.
Autant les dirigeants des nations aiment affirmer, dans de fastueuses cérémonies leur pouvoir sur les multitudes accourus à leur appel, autant ils sont flattés d’y respirer l’encens et d’y voir prodigués les gestes d’adoration qui constituent un affermissement moral de leur autorité, autant ils craignent et redoutent les manifestations populaires issues du mécontentement, secouées d’indocilité, parfois ouvertement hostiles. Celles-ci ne sont-elles pas l’indice qu’un malaise latent, des impatiences sont prêtes à se transformer en révolte ouverte et active ?
La grande force morale qui consolide le règne des gouvernants et des exploiteurs, c’est le sentiment d’isolement et d’impuissance qu’éprouvent les exploités et les gouvernés. Pris individuellement, chacun des malheureux, des déshérités, des victimes de l’organisation sociale actuelle, exprimera son insatisfaction. Il dira ses griefs confus contre le sort qui lui est dévolu, son écœurement, son ressentiment même au spectacle de tant d’injustices qui l’atteignent, ira jusqu’à exprimer son désir de voir tout cela transformé, amélioré, mais il conclura sur une plainte ou un geste vague : là se bornera ce qu’il est capable de faire. Tout, d’ailleurs, dans les institutions et les mœurs, concourt à le châtrer de ses énergies et le premier soin des puissants est de verser les meilleurs soporifiques sur sa détresse résignée. « Je voudrais bien sortir de cet état, dit parfois, le pauvre hère, mais je n’y puis rien. Si je fais quelque chose, je serai seul. Mes frères de misère seront même contre moi. » Et il s’abandonne...
Mais, que sur l’initiative d’individualités remuantes, ou de groupes organisateurs ou que, sous l’impulsion d’une grande colère soulevée par une iniquité plus grave que de coutume, ces isolés se trouvent rassemblés, leur nombre fait disparaître la peur ; de se sentir arrachés à leur dispersion douloureuse, de percevoir qu’un même sentiment anime des centaines ou des milliers d’êtres comme eux, la résignation fait place à la révolte ; la terreur soumise s’efface devant l’audace, et celle-ci peut devenir révolutionnaire.
Les dirigeants connaissent cette psychologie des foules, cette volonté collective qui se dégage des manifestations populaires et peut susciter les plus importants événements sociaux.
On commence par manifester dans une salle, paisiblement assis, applaudissant à l’éloquence d’un orateur, votant des ordres du jour. On manifeste ensuite dans la rue sons la conduite de bergers ayant le souci de l’ordre public, ne voulant pas compromettre leur carrière politique dans un choc entre les forces populaires et le rempart du régime. C’est le cortège pacifique, avec musiques et drapeaux. Mais cela peut devenir, dans l’explosion d’une colère longtemps contenue et qui trouve soudain son écho dans la colère voisine, sous la surexcitation d’une injustice plus criante, ou la provocation de la police ou de l’armée, à la faveur de quelque autre événement ou circonstance, parfois secondaire, mais qui joue le rôle d’étincelle et met le feu aux poudres, la manifestation peut être le premier grondement de l’émeute imprévue et de la révolution qui couvait.
Les grandes révolutions politiques ou sociales n’ont pas débuté autrement que par des manifestations où le peuple prenait conscience, dans le coude à coude, de sa puissance collective. La prise de la Bastille fut précédée de manifestations dans la rue, surtout aux abords du Palais-Royal. Les journées révolutionnaires, comme celle du 10 août et d’autres, furent des manifestations populaires.
La première révolution russe, de 1905, fut marquée par la grande manifestation devant le palais du tsar, où le peuple encore confiant et disant naïvement sa misère, fut accueilli par la mitraille.
Les gouvernants savent très bien que le meilleur fondement de leur puissance est la crainte que le peuple éprouve en face des forces militaires, policières et judiciaires. Qu’une manifestation, se transformant en bagarre, prenne figure d’émeute, que le peuple se sente le plus fort, ne fût-ce qu’un moment, et c’en est fini de la terreur organisée, systématique, dans laquelle il se débattait, et le pouvoir politique entend sonner le glas de son autorité balayée.
Aussi ne faut-il s’étonner si le droit de manifestation populaire, au titre de doléances ou de réclamation, n’a jamais été admis, sous aucun régime, par les gouvernements. Quelle que soit l’étiquette politique ou constitutionnelle des pouvoirs, la manifestation populaire a toujours été considérée par eux comme une menace et un danger qu’il fallait écarter à tout prix, et cela d’autant plus que le malaise s’avérait sérieux et inquiétant. Toutes les forces répressives sont mises en jeu dès qu’il s’agit d’interdire une manifestation. On sait de quelle façon sauvage les policiers procèdent, par ordre, dans ces cas-là. Coups de matraques, arrestations, condamnations, fusillades guettent le peuple souverain. On connaît aussi la formule hypocrite qu’étale, le lendemain, la presse bourgeoise : « La police a du faire usage de ses armes », ce qui veut dire qu’on a assassiné des manifestants, la plupart du temps désarmés.
Un gouvernement ne se maintient que par la crainte qu’il inspire Enlevez cette crainte, et aucun pouvoir, politique ou autre, ne peut subsister. C’est pour lui une question de vie ou de mort. On tolère bien certaines manifestations, mais à contre-cœur et exceptionnellement, et sous réserves et avec garantie que « tout sera calme ». Et dans les centres, les quartiers ou les artères ne présentant aucun risque pour la stratégie de la répression officielle. Dans les grandes villes et surtout dans les capitales, le droit de manifestation populaire est presque toujours totalement et sévèrement prohibé.
Les partis politiques, même ceux d’opposition, n’usent que très rarement, et en l’entourant de restrictions, de la manifestation populaire, dont ils redoutent la portée et les conséquences imprévues. Ils sentent, instinctivement ou consciemment, que c’est une arme qui peut se retourner contre eux. La fureur populaire a toujours déplu et déplaira toujours aux maîtres d’aujourd’hui, d’hier ou de demain. On ne sait jamais’ où elle s’arrêtera. Et il ne faut pas habituer le peuple à braver la férule et à prétendre tenir tête au pouvoir !
Certains camarades, surtout ceux qui fondent tous leurs espoirs sur l’évolution individuelle, méprisent plus ou moins les manifestations populaires. C’est, à mon avis, une erreur. La poussée des foules, longtemps souterraine et qui soudain explose, a autant de vertu révolutionnaire que la volonté patiente des individus. C’est elle qui est à l’origine de bien des transformations sociales. Et nous devons la plupart des quelques maigres libertés dont nous jouissons aux manifestations populaires. Si on ne nous les enlève pas toutes, c’est parce que les gouvernants craignent encore un peu le soulèvement des masses. Les manifestations demeurent un des meilleurs moyens que possèdent les exploités pour faire entendre leur voix, attirer l’attention sur leurs maux et sur leurs espérances, faire reculer les tentatives de réaction, et préparer l’avènement des libertés.
‒ G. BASTIEN.
MANIFESTE
adj. (latin manifestus)
Caractérise ce qui est clair, évident et n’appelle pas de longue démonstration : erreur, menteur manifestes. Subst. On désigne ainsi (il commençait, invariablement, jadis, par la formule manifestum est : il est manifeste, d’où son nom), en politique, l’exposé public des réclamations ou des motifs d’agir, adressé par un gouvernement à une ou plusieurs nations étrangères. Il est parmi les gestes qui précèdent les conflits guerriers et qui prétendent à les expliquer, souvent même à les justifier. Sous les intentions pacifiques qu’invoquent les pouvoirs dont il émane et les efforts tentés, prétend-on, pour prévenir le choc de la force brutale, se dissimule le plus souvent la duplicité de campagnes insidieuses, semées de faux et de provocations, qui ont préparé ou rendu inévitables des conflagrations attendues ou escomptées. Il procède ainsi de cet art ancien de circonvenir les peuples que la presse a si magnifiquement secondé, dans les temps modernes. La manifestation écrite qui, avant la déclaration de guerre et la rencontre des armes, s’annonce en éclaircissement, résume habilement, et transpose au besoin, les griefs et les contestations qui sont à la base de la mésentente ; l’adversaire se trouve être à point le responsable et le manifeste aux ombres réticentes exalte à souhait les spécieux facteurs d’intervention. Il convient donc d’y chercher davantage un savant enveloppement d’attitudes souvent indéfendables et le dernier palabre hypocrite avant les recours aux « arguments » de la force, bien plus que l’écho véridique des « droits » qui s’affrontent et qu’une ultime tentative pour prévenir la mise en branle des masses armées.
L’usage du manifeste est des plus anciens et c’en est vraisemblablement une forme ironique que l’envoi présomptueux, fait jadis par les Scythes à Darius, d’un rat, d’un oiseau, d’une grenouille et d’une flèche... Manifestes du roi et du parlement pullulèrent en Angleterre sous le règne tourmenté de Charles Ier. On ne les vit apparaître officiellement en France en tant qu’adresse aux nations en face d’une guerre imminente qu’au XIVème siècle. L’histoire cite volontiers chez nous le manifeste du duc de Brunswick, cette sommation insolente des coalisés de Coblentz qui provoqua le sursaut du 10 août. Pleins de fougue éloquente et de volonté révolutionnaire, les manifestes de la Convention tranchaient par leur chaleur sincère et leur allure droite avec les écrits, pétris d’astuce et de subtile diplomatie, des monarchies que ses principes nouveaux refoulaient... En 1859, après les guerres d’Italie, François Joseph d’Autriche, contraint à la paix, exposait les raisons de cette obligation dans son « Manifeste à mes peuples ». Roi de Prusse et empereur des Français, en 1870, lancèrent des manifestes où chacun expliquait le bien-fondé de son recours aux armes. En de multiples déclarations officielles, adressées à leurs nations respectives, les chefs d’États belligérants de la dernière « guerre du Droit » accumulèrent aussi les manifestes justificatifs où instigateurs pogromistes, agresseurs, complices, supputeurs masqués prenaient figure d’innocentes victimes et se défendaient « d’avoir voulu cela ! »...
À l’intérieur, les prétendants au trône, les fauteurs de coups d’État, les aspirants au règne politique usèrent, à travers les siècles, de ces appels à la nation pour préparer le terrain à leurs tentatives, rendre l’opinion publique favorable à leurs desseins, galvaniser des cohortes de partisans. Les manifestes marquent la route du pouvoir de méthodiques apprêts, entretiennent, ravivent au besoin le prestige et la popularité. On connait les proclamations du premier Bonaparte, les exhortations et les harangues lapidaires qui jalonnent sa fortune de conquérant monomane. Des adresses de Napoléon le Petit, parant son front médiocre de l’auréole du nom, aux invocations épileptiques de la Ligue des Patriotes, aux plaidoyers cyniques des modernes « sauveurs » à la Mussolini, aux déclarations de principes de tous les politiciens en mal de chars et de fouets enrubannés, s’échelonnent rodomontades et suppliques, gestes et propos circonvenants. Habiles à impressionner le peuple de « raisons de salut public », à ramener, autour de formules renouvelées de gouvernement, invariablement « rédemptrices », une foi à la longue fléchissante, à rendre sympathiques des promesses de réformes enflées en boniments, florissent les manifestes du bien général dont il ne reste, la baudruche crevée, que les chétives grimaces de l’ambition...
Pour tenir à l’étiage le « moral » précieux de la nation, au cours de la longue « dernière », on ne manqua pas de faire une publicité à ce monument de lourde suffisance et d’avilissant renoncement qu’est le Manifeste des Intellectuels allemands, se rangeant aux côtés des guerroyeurs mégalomanes de l’Empire. Chez nous, d’ailleurs, n’attendant que l’occasion (qu’ils eussent au besoin provoquée) répondirent ‒ pendant grotesque ‒ d’aussi plates déclarations de loyalisme patriotique de la part de nos vedettes littéraires ou artistiques, des sommités de notre monde scientifique. Un concert monocorde de périphrases en fausset, une orgie de phantasmes amphigouriques exaltaient, de chaque côté des frontières, l’unilatéralisrne d’une « civilisation » menacée. Et l’on voyait un Anatole France, l’historien de la Pucelle, supplier (derrière un Hervé et un Jouhaux) qu’on lui donnât une arquebuse pour bouter l’Allemand hors de France. Les manifestes des partis ‒ succédanés et renforts de ceux des États ‒ foisonnèrent pendant ces quatre années d’abdications et de reniements. Grands chefs, clercs et menus bergers, dans le dessein d’amadouer le « jugement de l’histoire », y délayèrent (phrases pompeuses sur les virilités défaillantes) leurs évidentes trahisons.
Les socialistes dirigeants, délivrés d’un Jaurès, venaient solennellement, par le canal des Guesde et des Thomas, prostituer au service des capitalismes en lutte, la doctrine de l’internationale des prolétaires, s’agenouillaient sur les fauteuils des ministères de guerre. Et ils n’avaient pas de peine à trouver, dans leur arsenal de démagogues et de rhéteurs, les doucereux propos magnifiant le sacrifice de l’agneau. Il n’est pas jusqu’à quelques-uns des nôtres ‒ mieux avertis, nous dit-on (lumière soudaine pour plusieurs) des contingences et de l’ évolution ‒ qui ne lancèrent aux camarades de ce pays une explication de leur attitude, appel de fait à une participation active, destinée, selon eux, à sauvegarder l’étape de notre « civilisation supérieure » (voir Seize : Manifeste des Seize). Seul, sur tous ces manifestes d’acquiescement, normaux ou inattendus, retentissait dans le monde (trait d’union des hommes de paix demeurés dignes, réconfort des consciences éparses résolues à ne pas abdiquer) au-dessus de la mêlée, le manifeste de sauvegarde morale d’un Romain Rolland criant la survivance de l’idée humaine quand les doctrines s’inclinaient...
Dans les arts, la littérature, on appelle aussi manifeste la publication de nouvelles manières de voir, de modes d’expression encore inusités, qu’accueille avec méfiance ou mépris le public traditionaliste et les cercles prévenus. Tel le manifeste littéraire de l’école romantique.
‒ LANARQUE.
MANNE
n. f. (de l’hébreu man ou mah ou de l’égyptien man)
Un des livres de la Bible (l’Exode, Ch. XVI) raconte que les israélites, sous la conduite de Moïse, traversant le désert de Sin et manquant de vivres, murmurèrent contre Moïse et Aaron, disant regretter le pays des Égyptiens et leurs potées de chair. Alors l’Éternel entendit leurs murmures et leur envoya d’abord un plein camp de cailles rôties, puis il leur désigna comme du pain « une petite chose ronde, menue, comme de la blanche gelée sur la terre » et qui avait fait place, tout autour du camp, à une couche de rosée. Cette masse comestible (ce pain), fut appelé Manne : « et elle était comme de la semence de coriandre : elle était blanche et elle avait le goût des beignets au miel ». Selon la légende et les livres sacrés, les israélites s’en nourrirent pendant les quarante ans qu’ils restèrent au désert.
Cet aliment miraculeux et gratuit a donné son nom, par extension, à tout aliment abondant et peu coûteux ex. : La datte est la manne de l’arabe. La pomme de terre est la manne des ouvriers.
La manne est un suc découlant spontanément ou par incision de l’écorce de certains frênes. Les caractères en sont les suivants : couleur blanche jaunâtre, odeur particulière et nauséabonde, saveur sucrée, miellée, et cependant désagréable. Elle est composée d’un principe doux et cristallisable, qui est : la mannite, et d’une matière extractive et incristallisable ; mais ces principes varient suivant les diverses espèces de mannes, qui sont au nombre de quatre : la manne en larmes, la manne qéraci, la manne grasse et la manne de Calabre. La première, est la plus sucrée. La manne est employée dans l’art médical comme purgatif.
Manne de Briançon : très faiblement purgative, qui exsude des feuilles de mélèze, pendant les étés chauds, dans une partie des Haute-Alpes. Manne d’Alhagi, manne en petits grains, qui exsude d’une espèce de sainfoin de Perse. Manne liquide, matière gluante assez semblable à du miel blanc, que l’on récolte en Perse et en Égypte, sur les feuilles de divers arbrisseaux. (Faudrait-il voir là la source de cette manne dont parle la Bible ?). Même dans nos contrées, pendant la saison chaude, dans certaines conditions de température, les arbres de nos forêts : chênes, frênes, bouleaux, noisetiers, etc., produisent dans les premières heures du jour une matière sucrée qui apparaît sur les feuilles et que recueillent les abeilles. Cette sécrétion dite miellée, parfois assez abondante pour que les insectes y trouvent un appréciable butin, mais insuffisante pour que l’homme en puisse profiter directement, est vraisemblablement le correspond de cette « manne liquide » exotique. Manne d’encens : Encens choisi qui a la couleur de la belle manne.
Au figuré : se dit des aliments de l’esprit : La liberté est la manne des peuples.
MANNE n. f.
Grand panier de forme rectangulaire ou cylindrique, à fond plat, en osier ou bois et dans lequel on transporte des marchandises : pain, pâtisserie, fruits, poisson, vaisselle, etc. Manne (la) : Tableau de Nicolas Poussin, au musée du Louvre, représentant la scène biblique : ensemble d’épisodes rendus avec une maîtrise et une harmonie magistrales.
‒ A. LAPEYRE.
MANŒUVRE
(bas latin manus-opera de manus, mains, et opera, œuvre)
a) n. f.
Action de régler, de diriger ou de vérifier le mouvement ou la marche d’un corps quelconque, d’un mécanisme, d’une machine, avec la main : manœuvre d’une pompe, d’une presse, etc., manœuvre maladroite, manœuvre habile, etc. Le mot manœuvre s’emploie surtout pour désigner la façon de réussir quelque chose qui paraît difficile à première vue : Ce n’est que par une manœuvre savante qu’il réussit ce tour de force, ou d’adresse.
On appelle aussi manœuvre l’exercice qu’on fait faire aux soldats : Aller à la manœuvre. Les grandes manœuvres sont des exercices où l’on simule à peu près la guerre, et qui durent généralement plusieurs semaines au cours desquelles les soldats quittent complètement la caserne avec tout leur « barda » et cantonnent dans les pays qu’ils traversent.
Au figuré, une manœuvre est le fait d’agir par des moyens détournés et souvent hypocrites, pour obliger quelqu’un à agir dans le sens où l’on veut le diriger, quelquefois pour le perdre, très souvent pour le tromper, toujours pour le maîtriser. Les gens qui veulent acquérir, ou conserver une certaine domination, un certain prestige se connaissent dans ce genre de manœuvre. Ils agissent ainsi là où une action franche, un ordre, ou la persuasion ne réussiraient pas à orienter les événements dans le sens qu’ils désirent. Quelquefois, ils intriguent dans votre entourage ; d’autres fois, ils vous tendent des pièges. Ainsi, par exemple, si vous êtes un libre-penseur actif et gênant pour eux, les curés iront trouver votre patron si vous êtes ouvrier, ou votre clientèle si vous êtes artisan ou commerçant, pour vous faire « remercier » de votre place ou nuire à vos affaires, ou vous obliger à vous abstenir de propagande. Ou bien, si vous êtes soldat et qu’un gradé vous poursuive de sa haine, ou un excellent ouvrier et que le contremaitre veuille vous faire mettre à la porte, le gradé ou le contremaitre sauront vous brimer et vous pousser par leurs provocations à commettre des actes très sévèrement punis par les règlements, afin de vous perdre, s’il le peuvent. Il y a mille et mille façons de manœuvrer les gens. Avec l’un, c’est une façon de faire qui réussit ; avec l’autre, c’en est une autre. La manœuvre, pour aboutir, doit toujours tenir compte du tempérament, des penchants et des points faibles de celui que l’on veut manœuvrer. Il est impossible, et inutile, d’énumérer ici toutes les manœuvres qui ont cours dans la société, mais on peut dire que, d’une façon générale, la manœuvre est presque toujours un traquenard tendu par la crapulerie des aigrefins à la simplicité, la loyauté, la franchise ou les bons sentiments des individus trop confiants.
Je veux, avant de finir, dire un mot de cette « Grande Manœuvre », qui consiste à faire accepter la guerre et toutes ses horreurs, avec gaieté de cœur, voire même avec entrain et enthousiasme, à des gens dont tous les sentiments profonds et souvent les vrais intérêts sont à l’opposé. Tout est mis en œuvre pour inculquer aux masses l’idée qu’il est non seulement nécessaire, mais digne, moral et glorieux de courir sus à « l’ennemi ». Journaux, brochures, gravures, récits, cinémas, etc., toutes les équipes qui fabriquent l’opinion s’y emploient avec insistance et frénésie. Toute l’habileté vendue ou à vendre est employée pour faire croire aux gens toujours influençables qu’ils auront mérite et avantage à la bonne marche de la guerre et qu’ils y trouveront honneur et profit, ou les deux. À l’un la considération, à l’autre de meilleurs placements pour ses capitaux, à un troisième un écoulement assuré de ses produits ; celui-ci en retirera une place honorable ou lucrative, celui-là ne connaîtra plus de chômage. Tous mêmes y réaliseront cet espoir cher de la sécurité définitive. L’occasion s’offre à eux, leur dit-on, « d’abattre le militarisme »... ou de faire la Révolution !
Plus qu’à ces manœuvres techniques où les militaires s’avèrent généralement d’une effrayante incapacité, nos gouvernants s’entendent à organiser ces « grandes manœuvres » publicitaires qui tritureront l’opinion et la rendront favorable à leurs desseins secrets.
b) n. m.
Ouvrier manuel n’ayant pas de profession définie et occupé dans toutes les branches du travail, aux besognes rudes ou malpropres, mais secondaires et vite apprises, par opposition à l’ouvrier qualifié, qui a fait, lui, un apprentissage et qui a un métier en main. C’est rarement à son incapacité naturelle que le manœuvre doit sa condition. La plupart du temps, par suite de la pauvreté de ses parents, il a du gagner son pain dès avant l’adolescence. Les siens n’ont pu payer pour son apprentissage et ils n’auraient pu même le nourrir pendant la durée de celui-ci. Il lui a fallu accepter les travaux les plus faciles pour toucher de suite un salaire. Et c’est sur ce plan que se déroulera sa carrière de besogneux. L’enfant de la misère sera toujours l’homme de peine, aux gros efforts, aux tâches rebutantes et aux maigres rétributions.
Car si l’existence de l’ouvrier qualifié est loin d’être brillante, celle du manœuvre est presque toujours précaire et infériorisée. Parce qu’il peut être remplacé rapidement par n’importe qui, le patron en profite pour le payer moins cher et ne l’embaucher que lorsque le travail presse. Le manœuvre connaît donc le chômage plus que quiconque, et, avec le peu d’agrément de sa profession, il arrive parfois à être vite dégoûté du travail, ce qui aggrave encore sa triste condition.
L’ouvrier qualifié lui-même, qui tire souvent orgueil de ses quelques connaissances et des avantages qu’elles représentent, n’a généralement que peu de sympathie pour le manœuvre et trouve très normal qu’il soit encore moins payé que lui. Il protesterait s’il en était autrement : « Ce ne serait pas la peine d’avoir fait deux ou trois ans d’apprentissage, lui entend-on dire, si je ne gagnais pas plus ». En réalité, le manœuvre fait un travail aussi indispensable que l’ouvrier qualifié et sa besogne est presque toujours plus dure, plus fatigante et plus ennuyeuse. Que chacun fasse le travail qui lui revient, c’est entendu, mais puisque tous deux ont les mêmes besoins, qu’ils soient placés devant les mêmes conditions d’existence.
Le syndicalisme a bien cherché quelque peu à rapprocher ces travailleurs, en les réunissant dans les mêmes organisations, et en leur apprenant à présenter des revendications communes, mais il est loin d’avoir complètement réussi et le même état d’esprit subsiste encore, ou à peu près, parmi ces ouvriers. Ne voit-on pas souvent, dans un même syndicat, manœuvres et ouvriers qualifiés, organisés ensemble, réclamer des salaires de 5 fr. de l’heure pour l’ouvrier qualifié, par exemple, et de 3 fr. 50 ou 4 fr. seulement pour le manœuvre ? N’est-ce pas un non-sens et une méconnaissance du syndicalisme ? Que le patronat établisse une échelle de salaires entre ses ouvriers, s’est son intérêt : cela lui permet de débourser moins en définitive et cette inégalité entretient toujours la division parmi son personnel.
Que les ouvriers n’arrivent pas toujours à l’en empêcher, cela se comprend, mais qu’ils réclament eux-mêmes le maintien de salaires différents, voilà qui est inadmissible.
Dans la grande industrie d’aujourd’hui, qui fait de plus en plus redescendre, à l’état de manœuvre, l’ouvrier qualifié, l’importance du manœuvre s’amplifie avec la transformation apportée dans beaucoup d’usines par le développement du machinisme et la rationalisation. De cette modification de son rôle, le manœuvre ne tire aucun avantage, mais l’ouvrier de métier est ainsi de plus en plus remplacé par le « manœuvre spécialisé », à moins qu’il ne devienne lui-même ce « manœuvre ». Ce sort nouveau, qui le touche au vif de ses intérêts immédiats, lui fera-t-il mieux comprendre l’injustice des catégories de salariés et se sentira-t-il davantage le frère du manœuvre ?
Le travail de chaque ouvrier, devenant de plus en plus limité à un seul genre d’exercice, ne comportant que quelques mouvements, toujours les mêmes, il arrive qu’en quelques jours seulement, quelques heures même, n’importe qui peut acquérir l’habileté suffisante pour exécuter ce qu’il aura à faire toute l’année et, parfois toute sa vie (voir machinisme). D’ailleurs si, au début, il lui manque la dextérité nécessaire, la machine, qui l’oblige à régler ses mouvements sur les siens, se chargera de la lui donner par force ; il devra la suivre, s’il veut conserver sa place.
Au lieu donc de disparaître, les manœuvres tendent toujours à devenir plus nombreux dans la grande industrie qui ne conservera qu’un chiffre infime d’ouvriers qualifiés et demandera surtout des serviteurs interchangeables de la machine. Les ouvriers ainsi ramenés au même niveau sauront-ils en profiter pour mieux se comprendre et mieux se défendre ? L’accroissement du chômage qui résulte de ces nouvelles méthodes de travail et qui est accepté mondialement sans sursaut sérieux ne permet guère d’augurer d’aussi heureux résultats.
‒ E. COTTE.
MANUEL
adj. (Est la traduction du latin manualis qui vient de manus, main)
Il s’applique à ce qui se fait avec les mains, au travail physique qui produit des choses matérielles et qui est généralement accompli avec les mains. Le travail manuel se distingue ainsi du travail intellectuel, ou travail de la pensée.
Ces deux formes de l’activité sont-elles, vis-à-vis l’une de l’autre, dans un état d’Interdépendance ou sont-elles, au contraire, nettement séparées, au point même que leurs rapports sont hostiles ? Il n’est pas superflu de poser une telle question lorsqu’on considère l’usage que la phraséologie de notre époque a fait du mot manuel par opposition à intellectuel, en les employant tous deux comme substantifs. On s’est mis à dire : un manuel, pour « un travailleur manuel », un intellectuel (voir ce mot), pour « un travailleur intellectuel » et, ne se bornant pas à cette distinction entre les travailleurs, on est arrivé à les opposer les uns aux autres au point d’en faire deux classes ennemies !
Il convient d’observer que la période aiguë de cet état d’antagonisme s’est produite surtout avant 1914, lorsque le syndicalisme ouvrier présentait une certaine unité et constituait une force avec laquelle il semblait qu’on devait compter. Pour les uns, alors que le manuel était l’homme en qui s’incarnait le travail utile, bienfaisant, producteur de la richesse et du bonheur universelle, qui possédait toutes les qualités populaires et représentait toutes les vertus sociales ; l’intellectuel était le prototype du parasite, le frelon de la ruche, la mouche du coche, le lys qui ne travaille pas ou dont l’activité est inutile sinon malfaisante, et aussi le corrupteur, le traître, le complice de l’organisation bourgeoise et capitaliste qui asservit les prolétaires. Pour les autres, au contraire, le manuel, l’homme aux mains calleuses et au front baissé vers la terre demeurait la « canaille » de jadis, le croquant, le goujat grossier, brutal, illettré, sans éducation, « l’espèce inférieure » uniquement bonne à fournir de la main-d’œuvre en attendant que, le machinisme le remplaçant complètement, les mâles ne fussent plus utlisables qu’à la caserne et les femelles réservées à la reproduction et au lupanar ; l’intellectuel l’homme aux mains blanches et au front levé vers les étoiles était le dieu par qui se répandait toute science et toute sagesse, « l’élite » précieuse dont la pensée et la volonté éclairaient et dirigeaient le monde. Manuel était synonyme d’exploité, de prolétaire. Intellectuel était synonyme d’exploiteur, de bourgeois. Un ouvrier que des combinaisons d’affaires et de politique aurait fait patron, millionnaire, député, demeurerait un « prolétaire » aux yeux de ses anciens compagnons de misère. Un artiste, un écrivain, un médecin, un avocat, voire un de ces miteux « grapignans » de basoche qui sont au plus bas de l’échelle des « professions libérales », resterait marqué « bourgeois » jusqu’à la fin de ses jours, catalogué fainéant et jouisseur, même s’il mourrait de misère physiologique dans un chauffoir municipal. Si déplumé qu’il serait et si révolutionnaire qu’il se manifesterait, « l’intellectuel » n’appartiendrait pas moins à la classe bourgeoise, ennemie des « prolétaires ». Par contre, le « manuel », arrivé à la table des ministres, serait toujours un prolétaire ; en buvant leur cognac et en fumant leurs cigares, il vengerait les « camarades », les « frères de misère » qui continueraient à peiner dans l’enfer capitaliste. Des « résidus de bourgeoisie », disait dédaigneusement M. Clemenceau, quoique bourgeois lui-même, des fonctionnaires qui lui rappelaient qu’ils étaient des prolétaires.
Voilà à quelles aberrations la phraséologie d’avant-guerre avait abouti. Aujourd’hui que la classe ouvrière mutilée, divisée et devenue impuissante, a fait la dure expérience qu’il n’était pas nécessaire d’aller chercher parmi les « intellectuels » des « traîtres » qui la livreraient à ses ennemis, et que ceux de chez elle y suffiraient amplement, on paraît marcher vers une plus saine et plus exacte appréciation des choses. Nous verrons mieux, au mot ouvriérisme, ce qu’ont été la formation, le développement et les conséquences de la division des travailleurs en manuels et intellectuels opposés les uns aux autres.
Le travail manuel ne se sépare pas du travail intellectuel. Aucun homme, et même aucun animal, n’est une simple mécanique. Dans tout geste, même le moins réfléchi, dans tout travail, même le plus machinal et le plus grossier, il y a une part d’observation, d’initiative, d’intelligence qui fait que le geste, ou le travail, répond plus ou moins bien à ses fins. Le cantonnier ne lance pas ses cailloux à tort et à travers sur la route, le maçon observe l’indication du fil à plomb pour construire un mur, le haleur est attentif au rythme du refrain qui fait tendre à la même seconde ses muscles et ceux de ses compagnons pour un effort simultané. À tout travail musculaire correspond un travail du cerveau variable suivant qu’il est plus ou moins réfléchi. Plus le travail est individualisé, c’est-à-dire normalement distribué suivant la capacité de chacun, plus il demande de participation intellectuelle. C’est ainsi qu’il y a au moins autant d’invention intellectuelle que d’habileté manuelle dans la besogne de l’artisan. Si la sottise d’un prétendu aristocratisme fait refuser la qualité d’artiste à l’artisan (voir Beaux-Arts), il est aussi sot de classer « intellectuel » l’artiste qui peint, qui sculpte, qui grave, qui joue d’un instrument de musique, se servant incontestablement de ses mains dont l’habileté est indispensable pour traduire dans la matière et produire la forme physique, plastique ou auditive, conçue par sa pensée. Il n’y a pas plus d’hommes-machines que d’hommes-cerveaux ; tous ont besoin d’exercer leurs mains et leur intelligence. Même dans l’état social actuel où le machiavélisme capitaliste est arrivé, par le taylorisme, la rationalisation et autres procédés esclavagistes, à rendre le travail manuel de plus en plus impersonnel, dépourvu de toute intelligence ouvrière, la démarcation des travailleurs manuels et intellectuels constitue une calamité.
Lorsque les hommes seront parvenus à fonder une société où la concurrence féroce n’entretiendra plus entre-eux, entre les individus comme entre les groupes, l’état de guerre dans lequel ils vivent et où le travail ne sera plus un moyen d’exploitation, une source de douleur et de misère, mais sera au contraire producteur du bonheur de tous, les activités manuelles et intellectuelles seront normalement distribuées pour chaque individu selon ses dispositions et ses préférences. Il n’y aura plus de damnés manuels, le travail des mains étant devenu le complément harmonieux de celui du cerveau, c’est-à-dire de l’activité librement choisie. Il n’y aura plus de bienheureux intellectuels, chacun devant apporter sa part suivant ses facultés et ses forces à l’activité commune. Il n’y aura que des élus qui travailleront tous, de leur intelligence et de leurs mains, pour un heureux équilibre individuel et social.
Mais pour arriver à cela, il faut d’abord que les travailleurs, dans la lutte où ils sont engagés, ne fassent plus un choix empirique, et d’après des étiquettes stupides, de leurs amis et de leurs ennemis. Il faut qu’ils jugent les hommes d’après leur œuvre. Il faut qu’ils se débarrassent de cette phraséologie malsaine qui les divise en manuels et intellectuels. Car la preuve est faite aujourd’hui : c’est dans leurs propres rangs, plus que dans ceux des intellectuels, que les manuels ont rencontré les « traîtres » les plus dangereux et les plus malfaisants, depuis le simple flic qui les passe à tabac jusqu’aux représentants de l’« Internationale Ouvrière » qui figurent dans les conseils des gouvernements et les inviteront, à l’occasion, à marcher encore pour la prochaine « dernière guerre ».
‒ Édouard ROTHEN.
On appelle aussi manuel un petit livre, commode à porter dans une poche ou à tenir à la main, qui donne le résumé d’une des connaissances humaines. On en a composé pour toutes ces connaissances, depuis les plus abstraites jusqu’aux plus pratiques. Il y a des manuels de philosophie, de théologie, de littérature, comme de gymnastique, de cuisine, de savoir-vivre. Il y en a pour toutes les classes et toutes les professions : Manuel des souverains, Manuel des nourrices, etc... La collection des Manuels Roret, qui compte environ 300 volumes, a embrassé tous les métiers qui se sont pratiqués entre 1825 et 1873. On a fait depuis et on doit faire encore beaucoup mieux en raison de l’extraordinaire développement scientifique et industriel qui s’est produit durant ces cinquante dernières années.
Les manuels ont généralement remplacé les abrégés dont l’objet est semblable. L’abrégé traite le plus souvent d’un sujet intellectuel. Le manuel a prévalu avec l’extension des sciences et des métiers.
MANUEL
Pour Doudchenko, le travail manuel doit être un devoir universel, moralement obligatoire pour tout le monde. Il a basé sa thèse d’une façon explicite et très claire sur plusieurs considérations (principalement d’ordre moral). En les acceptant on se sent obligé par sa conscience de partager avec tous ses semblables le travail dur, le travail monotone et si peu poétique, le travail désagréable, qui donne du pain quotidien à toute la famille humaine. Brièvement, pour Doudchenko la répartition universelle de cette nécessité ‒ parfois si peu souriante ‒ n’est qu’une manifestation et conséquence inévitable de l’acceptation sincère des principes de Liberté, d’Égalité, de Fraternité. C’est surtout le sentiment de fraternité qui poussa Doudchenko à s’inquiéter avant tout de la vie humaine, en renonçant aux conquêtes dites « scientifiques » et aux chefs-d’œuvres artistiques là où ils s’achètent au prix d’une existence lamentable, presque animale des masses et deviennent un privilège raffiné d’une « élite » infime...
Il semble à certains ‒ tel Romain Rolland ‒ que si le travail manuel était réparti entre tous les hommes, la vie humaine serait plongée dans des ténèbres bien tristes, que les « soleils » de la Beauté et de la Vérité seraient éteints, et que l’humanité ne connaîtrait plus de Michel-Ange, de Beethoven, de Spinoza, de Newton, etc. Ils considèrent l’appel au travail manuel comme un attentat « contre les Beaux-Arts, contre la Science, contre le Savoir, contre la Vérité », contre toutes les valeurs intellectuelles et spirituelles, comme enfin une tentative déplorable de retourner à une barbarie vulgaire...
Mais c’est là une interprétation et une appréciation inexactes de l’effort de ceux qui voudraient que les peines et les joies soient réparties d’une façon plus régulière, et qui font appel à tout le monde pour participer au travail physique... Je partage le point de vue de Doudchenko. Pour moi aussi la répartition de la dure, désagréable et monotone besogne entre tous les membres de la grande famille humaine serait un acte de justice, une application pratique des principes humanitaires.
Est-ce que cela témoigne de notre indifférence ou même de l’hostilité envers l’art ou le savoir ?... Mais pas du tout ! Au contraire : c’est parce que nous considérons les beaux-arts et la science comme le plus parfait ornement de la vie et aussi comme un des principaux moyens d’élever cette dernière au-dessus du niveau de la vie animale, que nous voudrions les rendre accessibles à tout le monde, en détruisant le vieux préjugé d’après lequel ils sont le privilège d’une caste. Si la production des biens matériels était bien organisée et équitablement répartie, personne ne devrait travailler (manuellement) plus de 3 1/2-4 heures par jour. Comptez maintenant combien d’heures il resterait journellement à la disposition de qui voudrait aussi s’occuper du travail intellectuel, artistique, spirituel !... Je ne crois pas que quelques heures de travail manuel pourraient affaiblir ni surtout tuer le talent d’un Beethoven ou d’un Spinoza ; au contraire je suis plus porté à croire qu’un tel travail ‒ un travail rationnel, bien organisé et équitablement partagé ‒ fortifierait leur corps (comme un sport quelconque) et les préserverait de cette dégénérescence rapide qui est aujourd’hui le fléau de ceux qui se sont imprudemment débarrassés du travail musculaire aussi bien que de ceux qui sont écrasés par un travail disproportionné.
Un partage juste du travail physique non seulement ne supprimerait pas les hommes de génie, mais, au contraire, il donnerait enfin la possibilité de se développer aux talents de tous ceux qui, quoique bien doués, commencent et finissent leur vie, aplatis contre la terre par de lourds préjugés et par de dures conditions matérielles et qui n’osent ‒ ou n’ont le loisir ! ‒ lever leur regard au ciel...
Ce n’est qu’un seul Beethoven, un seul Spinoza sur dix qui peut, qui ose, dans le milieu social actuel, développer son talent et devenir ce qu’il doit être, tandis que les neuf autres succombent sous le poids d’injustices et de préjugés sociaux... Mais une juste répartition du travail ouvrirait enfin la tombe et briserait enfin le cercueil, dans lequel sont enterrés vivants tant de talents, tant de possibilités !
À la houillère, où je travaille, parmi les hommes âgés qui m’environnent, il en est que j’ai remarqués jadis, les uns, pour leurs dispositions musicales, les autres pour leur esprit clair et puissant, en qui j’ai noté le germe des dons les plus différents. Mais la vie qui devait les ouvrir les a anéantis. Là, ce sont les circonstances de la détresse familiale, ici les longues et pénibles journées et la misère qui les ont pris pour un lourd labeur manuel et éloigné des études, qui ont brisé ou étouffé leur essor, qui ont refermé cette fleur de l’activité intellectuelle qui ne demandait qu’à s’épanouir...
Et pourtant, qui voudrait affirmer qu’il n’y avait pas parmi eux des Newton, des Spinoza, des Beethoven ? Et si, dans le temps de leur jeunesse, à l’âge où s’affirment les facultés, leur travail eût été partagé par ceux de ces jeunes bourgeois quelconques, qui, grâce à leurs privilèges sociaux, ne faisaient rien ou bien faisaient semblant (avec un air grave) de faire quelque chose ; et si, ainsi, ils eussent obtenu la possibilité de disposer librement d’une partie considérable de leur journée, qui sait de quelles valeurs (littéraires, philosophiques ou scientifiques) se serait encore enrichie notre vie...
De cette génération, qui déjà appartient davantage au passé, transportons maintenant le regard vers ses enfants. Si, en pensant à eux, je désire ardemment un tel changement dans les habitudes sociales, qui transférerait une partie de ces longues journées, par lesquelles était écrasée l’âme de leurs pères, sur les épaules de ceux qui dégénèrent à cause de leur oisiveté, est-ce que je suis un ennemi ou un ami de l’art et de la science ?
Dans la cité ouvrière où j’habite, j’observe beaucoup d’enfants appartenant aux familles ouvrières. Je les compare aux enfants de familles riches, que j’ai quelquefois l’occasion d’observer autre part, et je me demande toujours sur quoi sont fondées ces assertions étranges ou plutôt atroces, qui prétendent que les premiers sont faits pour passer leur vie au fond des mines, auprès des fours d’usines, dans les cités ouvrières couvertes de fumées, etc..., et les deuxièmes pour passer la leur dans les ateliers artistiques, dans les laboratoires, dans les rédactions, dans les bureaux (sinon au Monte-Carlo, à la Riviera, à Montmartre).
Si le talent, le génie méritent souvent, ont besoin quelquefois d’être placés dans des conditions spéciales, il faut tout de même commencer par une telle organisation et répartition du travail, qui permettrait à tous les germes ‒ faibles et tendres ‒ de dons, de talents différents de percer la croûte dure de la vie, de pousser et de prendre racine...
Et puis une juste répartition du travail manuel contribuerait beaucoup à purifier le « temps de l’Art », où une quantité considérable de « marchands » et de « prostitueurs » se réfugient rien que pour se sauver de la nécessité de gagner leur pain par un travail plus dur... Parmi les ouvriers aussi il se fait maintenant un grand effort pour quitter les usines, les ateliers, les mines et pour s’emparer d’une petite profession libérale, bourgeoise, qui éloignerait les rares « veinards » de ce terrible spectre qu’est pour eux le travail physique. Puisque on parle toujours d’une vie ‒ légale et « bonne », à ce qu’on dit ‒ qui permet toujours de rester bien propre, de ne pas avoir les mains calleuses, de ne pas courir mille risques et périls dans les mines et les fabriques, de ne pas arriver au désespoir à cause de la monotonie de leur besogne, etc..., etc... puisque on parle constamment de tout cela ils n’ont qu’un seul rêve : c’est de rompre le plus vite possible avec tout leur passé et de ne plus retomber dans ce milieu ouvrier, auquel ils ont eu le « malheur » d’appartenir...
Quand j’aspire à une organisation du travail manuel qui répartirait les exigences actuelles de la nécessité, assurerait la possibilité de se débarrasser de certaines peines en se réfugiant, les tâches dures achevées, dans le « temple » réconfortant de l’art et de la science, suis-je un ami ou un ennemi de ce temple ?
Enfin, je crois que l’acceptation du travail manuel par tout le monde établirait un contact entre les masses populaires et les intellectuels, duquel ne pourrait sortir qu’une quantité infinie de conséquences salutaires. D’un côté il y a dans la vie un tas de choses, que les intellectuels n’arriveront jamais à comprendre s’ils ne partagent jusqu’au bout, jusqu’à l’extrême la vie des masses laborieuses. Les livres, les théories, les expériences de laboratoires et les petites excursions dans les quartiers populaires ne peuvent leur apporter que des lumières incomplètes et insuffisantes.
Il faut que l’intellectuel, tout en gardant ses facultés « internes », devienne en même temps, un travailleur, un « prolétaire » afin que sa vue devienne capable de pénétrer plus loin qu’elle ne pénètre, quand il reste toujours dans sa coquille bourgeoise, en se berçant par la pensée présomptueuse qu’« il sait déjà tout »... Pour que ses propres facultés, ses propres forces intellectuelles atteignent un plus haut degré de développement il est indispensable qu’il commence à travailler avec une pioche, un marteau, un burin ou une pelle. La pioche qu’il prendra entre ses mains rafraîchira, rajeunira ses pensées, qui languissent dans le cercle vieux et vicieux de l’existence bourgeoise. Tout cela n’enlèvera pas de sa vie ancienne ce qu’il y avait en elle de bon, de vrai, mais seulement y ajoutera des valeurs nouvelles.
Et de l’autre côté plus que jamais les masses populaires ont besoin qu’un fort courant intellectuel et spirituel soit introduit dans leur vie, qui, par sa monotonie et par le manque total d’intérêts « intérieurs » les étouffe ou les livre aux excès de désespoir, de jalousie et de haine. Au lieu de répéter aux masses qu’elles doivent accepter leur vie actuelle, comme la plus naturelle, ou que les plus énergiques doivent tâcher (en piétinant sur le dos des plus faibles) d’ « arriver à quelque chose », au lieu de tout cela il faut leur démontrer la possibilité de faire deux choses à la fois : de rester ouvrier et de s’élever intellectuellement et spirituellement toujours plus haut et plus haut. Il faut éveiller chez eux l’effort vers le rehaussement de leur dignité humaine dans toute son ampleur. Il faut leur apprendre à utiliser rationnellement leurs loisirs, au lieu de s’empoisonner dans les cafés et dans les bistrots, au lieu de s’avilir dans les vulgaires cinémas et dancings.
Grâce à la journée de 8 heures l’ouvrier est devenu un peu plus libre, un peu maître d’une partie de sa journée ; mais il faut lui apprendre à profiter immédiatement de cette petite libération, sinon... il s’ensuivra un égarement et puis un recul, une réaction.
Donc si d’un côté il y a quantité de choses que les intellectuels doivent apprendre chez les travailleurs manuels, chez les « prolétaires », par contre dans la vie actuelle de ces derniers il y a beaucoup de lacunes, que seule une sincère et dévouée collaboration des intellectuels pourrait enfin combler...
Oui une collaboration sincère, étroite, poussée jusqu’au bout, est nécessaire, pour le bien de tout le monde. Et faut-il dire qu’une telle collaboration (par le partage de la même vie, de toutes les peines et de toutes les joies) serait utile non seulement pour améliorer le côté matériel de la vie, mais avant tout pour la rendre plus belle et plus noble. Si tous ceux qui trouvent la possibilité de développer leurs dons, leurs talents au lieu de déserter les mines et les fabriques (de quoi j’ai déjà parlé plus haut) y restaient et y exerçaient l’influence ennoblissante de leurs facultés, de leurs talents, pourrait-on prévoir toutes les bonnes conséquences qu’amènerait l’application constante d’une telle influence ?
J’observe quelquefois pendant le travail l’action d’une chanson chantée par un camarade ou l’animation que provoque un dessin accompli avec un morceau de craie sur une planche, ou enfin l’intérêt profond que suscite un entretien sur un sujet quelconque et ces observations me forcent chaque fois à penser, que c’est ici que doit être la place de ces écrivains, artistes, intellectuels, qui veulent être des serviteurs du beau et du vrai, mais qui se plaignent en même temps de la surdité du public et qui avouent même parfois leur propre impuissance. Ont-ils du moins le droit de se plaindre ? Je crois que non, car ce sont eux-mêmes, qui se sont placés dans cette situation « infructueuse », et si leurs plaintes sont sincères, tout ce qu’on pourrait leur conseiller est, il me semble, de quitter le cercle vicieux dans lequel leur pensée étouffe, et où personne n’a besoin d’eux, et d’aller dans les mines et dans les fabriques. Là, je suis sûr, ils seront mieux appréciés et mieux accueillis, à condition naturellement qu’ils ne viennent pas avec des prétentions démesurées et ridicules...
Malheureusement les serviteurs du beau, du savoir et de l’esprit en considérant leur propre vie comme une valeur suprême et tout à fait indépendante, comme une « valeur en soi », parlent non seulement du droit, mais même du « devoir », de s’éloigner de tout ce qui est « grossier » et « vulgaire », de tout ce qui pourrait troubler leurs pensées et leurs sentiments. Hélas, jusqu’à présent le talent, le beau, la poésie, le savoir quittent la vie des masses populaires, et pendant que cette dernière reste inanimée, comme un gigantesque squelette, dépourvu de chair et d’âme, ils vont se vendre dans les cafés-concerts, dans les cinémas, dans les théâtres, chez les éditeurs, chez les « patrons », qui ont une grosse bourse...
Pour finir, je dirai qu’il serait d’une grande importance, que les apôtres de la vérité, se déclarent sans réserve amis d’une collaboration entre tous les chercheurs sincères d’une vie nouvelle et juste ; mais est-ce qu’il n’est pas évident qu’on ne peut pas parler de collaboration là où les uns refusent de porter et de partager le fardeau des autres, et où chacun se retire dans son propre coin ?
On doit se rapprocher, on doit se connaître ; alors viendra la compréhension mutuelle, et tout cela portera beaucoup de fruit.
‒ A. HILKOFF, ouvrier de charbonnage.
MANUFACTURE
n. f.
Couramment, ce mot a le même sens que celui d’usine. Ou plutôt c’est le terme d’usine qui a tendance à se substituer à celui de manufacture, beaucoup plus ancien. Étymologiquement, manufacture vient du latin manus (main) et facere (faire) ; fabriquer à la main. Avec l’introduction du machinisme, le mot a évidemment pris un autre sens, plus large. Le vocabulaire et le dictionnaire sont comme toutes choses : ils évoluent avec le temps et les événements. Une manufacture, c’est un endroit, un bâtiment, où sont rassemblés un certain nombre d’ ouvriers pour la fabrication d’objets ou produits déterminés.
Les premières manufactures datent de quatre à cinq siècles. C’est surtout dans l’industrie textile qu’elles se formèrent : manufactures de toiles, de draps, de soieries, de tapis, et ensuite de cotonnades qui prirent naissance en Italie, et dont la pratique se propagea dans les Pays-Bas, l’Angleterre et la France.
On se rappelle que Colbert, ministre de Louis XIV, fonda ou fit revivre plusieurs manufactures importantes, dont la plupart subsistent encore à l’heure actuelle : Gobelins, Beauvais, etc. L’industrie de la tannerie et de la corroierie, puis celles de la verrerie, des glaces, de la porcelaine suivirent et, enfin, un peu plus tard, vers la fin du XVIIème siècle et au XVIIIème siècle, la métallurgie entra dans ce stade de l’évolution économique, par les premières manufactures pour la fabrication des tôles, qui demandait une mise de fonds assez importante et une certaine spécialisation du travail.
La manufacture a marqué un tournant de l’histoire économique et technique des nations. Au travail personnel, individuel et isolé, à l’ouvrier qui fabriquait seul et complètement un objet, l’ébauchait et le finissait, la manufacture substituait le travail en commun et en grandes quantités. Pour réussir, elle exigeait deux conditions principales : primo un capital assez important pour fonctionner : bâtiment, outils ou machines matières premières ; et secundo, des débouchés commerciaux à peu près réguliers. Le stade de la production manufacturière coïncide donc avec la naissance du capitalisme, de la finance, et avec la constitution d’organismes commerciaux dune certaine envergure. Finance, commerce et industrie, ces trois formes du capitalisme ont nécessairement marché de pair ; l’un ne pouvant se développer sans l’appui des autres.
En même temps qu’elle marquait une phase de développement du capitalisme, la manufacture apportait dans la méthode du travail une profonde transformation : elle provoqua le développement du système du salariat et la pratique de la spécialisation du travail.
À l’ouvrier confectionnant un objet totalement on substitua une série d’ouvriers spécialisés dans les parties différentes de ce travail, et prenant les objets les uns après les autres pour leur faire subir une fraction du travail d’ensemble. On peut dire que le travail à la chaine dont on parle tant aujourd’hui a son origine première à la fondation des manufactures tellement il est vrai qu’on trouve toujours dans un lointain passé les traces des institutions ou pratiques nouvelles.
De même, si la Rome antique a connu des prolétaires, si les artisans du moyen-âge avaient des compagnons salariés, si le salariat est vieux de plusieurs dizaines de siècles, il faut néanmoins en arriver à la période manufacturière pour voir le salariat devenir un système pratiqué sur une large échelle et les prolétaires constituer une caste sociale bien définie ; une caste vendant uniquement au maître sa force-travail, et qui, une fois le salaire touché, n’a plus aucun droit sur le produit de ses peines.
La fameuse Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de la Révolution française a été comme bien d’autres théories politiques, en retard de plusieurs siècles sur l’évolution économique, quand elle affirme le droit sacré à la propriété.
On pouvait comprendre, au moyen-âge, quand les seigneurs et les prêtres rançonnaient les travailleurs, que le paysan des villages et l’artisan des villes réclamassent le droit au produit de leur travail, tout entier sorti de leurs mains, ce qui n’eut été qu’une revendication basée sur le strict sentiment de la justice ; on le comprend moins avec le nouveau procédé de fabrication institué par la manufacture.
Il n’est plus possible, avec le travail spécialisé, divisé, nécessitant du matériel, de la matière première et des débouchés, de dire : « Ceci est le produit de mon travail, c’est ma propriété ». La manufacture, en transformant les méthodes économiques, dépassait les revendications politiques des révolutionnaires de 1789 et posait autrement la question sociale, ce que n’ont point su ou voulu apercevoir les rédacteurs de la fameuse « Déclaration » regardée pourtant comme symbolique.
La manufacture a eu une autre conséquence, également de première importance ; elle a permis l’extension indéfinie du machinisme. Le travail individuel ou familial n’était guère propice à l’introduction de la mécanique, laquelle exige, tant pour s’installer que pour fonctionner à plein rendement, un certain développement de l’entreprise qui l’utilise.
Nous avons examiné par ailleurs l’importance, l’influence et les conséquences du machinisme, tant actuelle que futures. Qu’il nous suffise de dire ici qu’il n’aurait pu se développer sans les manufactures, la fabrication à grand rendement.
Le passage des méthodes artisanales de travail à la production manufacturière n’a pas dû se faire sans heurts. Si l’histoire officielle nous enseigne les dates des batailles, traités, naissances et morts de rois, et autres détails sur la vie des grands, elle est par contre muette sur les conflits sociaux. Pour les maîtres, la vie et les souffrances des peuples ont moins d’importance que l’excursion d’un souverain ou le discours d’un tribun politique.
Les quelques renseignements que nous avons nous permettent de conclure qu’il a dû se produire une certaine résistance, et qu’en tout cas l’adaptation des artisans au régime du salariat s’est fait péniblement. Exemple ces ordonnances féroces de Colbert qui, pour redonner une nouvelle vie aux manufactures existantes qui végétaient, rédigea un Code cruel et tyrannique, avec des désignations pénales très sévères, comportant l’amende, la prison, l’exposition au pilori, etc. Naturellement, la grève était considérée comme un crime, et plus d’un gibet s’est orné par la pendaison de grévistes. C’est par la terreur qu’on a formé cette mentalité spéciale et presque héréditaire des salariés soumis. Plus d’une fois en lisant l’histoire, m’est apparue cette lueur de vérité que, dans les siècles passes, le peuple n’était peut-être pas aussi résigné et obéissant qu’on se le figure d’ordinaire et qu’il savait réagir. Malheureusement, ces réactions salutaires n’étaient ni organisées, ni cohérentes, ni continues, et les révoltes prolétariennes ont été brisées par la coalition des forces de la monarchie et la noblesse, du clergé et de la bourgeoisie naissante.
Il faudrait, si nous avions l’espace nécessaire, étudier la misère et les révoltes des tisserands, des « canuts » lyonnais, avant et après la révolution de 1789, à l’époque de l’introduction de la manufacture. Il faudrait aussi retracer le douloureux calvaire du prolétariat anglais, dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle, et dans la première moitié du XIXème, lorsque les manufactures se développèrent en Angleterre ; les conditions misérables des travailleurs, les femmes jetées à l’usine, les enfants de 10, 9, 8 et même 6 ans employés dans les manufactures.
L’histoire de la manufacture, c’est celle du prolétariat et du capitalisme. La lutte des classes, l’opposition des exploiteurs et des exploités en deux camps distincts, antagonistes par la force des choses, a surtout pris sa naissance, et revêtu sa forme actuelle, concrète et précise, et toujours plus ample et plus aiguë, avec l’instauration du système de travail dans les grands ateliers, ou usines, ou manufactures : le patron à la tête, les sous ordres au milieu et les travailleurs tout en bas.
Ce n’est pas qu’il faille désirer le retour aux méthodes anciennes de production artisanale, individuelle, manuelle. Les besoins ont crû avec les procédés rationalisés de travail. On ne saurait raisonnablement demander à l’humanité de revenir à plusieurs siècles en arrière. Elle a pris des goûts nouveaux, et un intense besoin de jouissances nécessite, pour être satisfait, que la pratique du travail collectif se continue, se perfectionne même.
Ce qui est à déplorer, c’est que l’évolution morale et sociale n’ait pas marché du même pas que l’évolution technique et économique c’est que la manufacture ait permis à la seule classe bourgeoise d’en retirer des profits, et que le peuple ouvrier n’ait ramassé que les miettes du festin du progrès technique.
Pour ramener les situations à une normale équitable, ce qui est à désirer, il faut que l’expropriation du capitalisme s’opère, et qu’au patronat, exploiteur et rapace, se substitue l’association des travailleurs, du personnel groupé librement et œuvrant en harmonie, que la manufacture devienne une sorte de petite république ouvrière, ayant son administration autonome.
‒ Georges BASTIEN.
MARCHANDAGE
n. m. (du bas-latin mercatans, mercadare, marchand)
Action de marchander. Forme de contrat de travail, qui consiste dans la convention, passée entre un sous-entrepreneur dit « marchandeur » ou « tâcheron », et les ouvriers qu’il emploie, à l’heure ou à la journée, pour l’exécution des travaux qu’il a sous-entrepris ; le marchandage a pour conséquence l’abaissement des salaires de l’ouvrier.
Encycl :
« Le marchandage est libre ou licite lorsqu’il intervient dans des conditions d’équité et procure à l’ouvrier un gain suffisant ; il devient au contraire délictueux lorsqu’il donne lieu à une exploitation dolosive des travailleurs par l’abaissement abusif du taux des salaires. Toute exploitation de l’ouvrier par voie de marchandage est punie de peines correctionnelles. » (Larousse)
Il ne faut jamais perdre de vue qu’en un temps de domination capitaliste les dictionnaires ne peuvent guère être que le reflet de la mentalité officielle et des conceptions de l’État. S’il est vrai que le marchandage avilit les salaires de l’ouvrier, et que ceux-ci doivent s’organiser pour être eux-mêmes leurs propres entrepreneurs, il n’est pas vrai que l’État punisse de peines correctionnelles « toute exploitation de l’ouvrier par voie de marchandage » ; et punirait-il ce cas d’exploitation, l’ouvrier n’en serait pas moins exploité par le premier entrepreneur, qui ferait travailler avec des contremaitres, et surveiller de très près leur travail. Le nombre des exploiteurs du seul producteur réel, l’ouvrier n’en serait pas diminué. Chaque fois que l’on examine une question sociale, économique ou non, il faut bien prendre garde à ne pas la séparer des autres questions, auxquelles elle est intimement liée, et avec lesquelles elle forme « la question sociale ». Les salaires (V. ce mot), sont basés davantage sur le coût de ce que l’on considère comme indispensable à la conservation relative de la force de travail de l’ouvrier, que sur le bénéfice que le patron retire de son exploitation.
L’existence du tâcheronat ou marchandage, prouve surtout quels bénéfices scandaleux tout entrepreneur prélève sur le travail de ses ouvriers, puisque un sous-traitant peut s’enrichir également. Au fond, tâcheron ou entrepreneur, sont, au même titre que l’intermédiaire commercial, des parasites. Avec un peu de bonne volonté, une éducation sérieuse et un esprit de camaraderie effectif, les ouvriers, sans attendre une Révolution dont on ne sait quand elle viendra, pourraient remplir à leur profit, le rôle d’entrepreneur et d’ouvrier, en formant des associations de production.
Mais quand la majorité des ouvriers se sentira capable d’œuvrer dans ce sens tant dans le domaine de la production que dans celui de la consommation, la Révolution sociale sera réalisée.
‒ A. LAPEYRE.
MARCHANDISE
n. f. (rad. marchand)
Tout objet, tout produit qui donne ou peut donner lieu à négoce entre individus est considéré comme marchandise. L’utilité des marchandises consiste à satisfaire les besoins des consommateurs et à leur procurer le plus de satisfactions possibles.
Dans notre société, s’il y a des marchandises au delà des besoins des riches, la consommation générale, qui comprend riches et pauvres non satisfaits, les repousse et ne peut les utiliser. Dès lors, les marchandises se détériorent, s’anéantissent sans que la collectivité générale en ait profité. La production des marchandises est chaotique et indifférente aux nécessités.
Les marchandises se consomment en raison des ressources que l’homme possède et non en raison des besoins que tout producteur ressent, ce qui est illogique. (Voir production, besoin, consommation, travail, société, etc.).
Par extension, on peut d’une manière générale, appliquer la loi qui règle la consommation des marchandises, à l’utilisation des prolétaires par les classes possédantes. Si les prolétaires se présentent en surnombre pour les besoins des riches ceux-ci font des travailleurs ce qu’ils font des marchandises qu’ils ne peuvent consommer après avoir satisfait leurs besoins, c’est-à-dire qu’ils ne les emploient pas ou mal, par suite les renvoient et dès lors les prolétaires dépérissent rapidement.
D’une manière ou d’une autre, le capitalisme hâte toujours la fin des prolétaires. Quand on réfléchit à une pareille situation, on se demande comment il est possible qu’un état social où les masses laborieuses ne figurent que comme marchandise-travail de quelques privilégiés, puisse perdurer et même se fortifier, alors qu’il serait possible et même facile aux prolétaires de faire cesser cet esclavage économique.
Pour arriver à ce résultat, il faudrait que d’une part la portion la plus éclairée de l’humanité, se préoccupant un peu moins d’elle-même et s’intéressant à la libération du travail de l’emprise du capital, activât une régénération sociale de liberté, de bien-être et de justice. Et que d’autre part, une concertation avisée et vigoureuse des intéressés, pénétrés de leur dignité humaine et résolus à briser le faisceau d’iniquités que leur passivité consacre, permît l’édification de modalités sociales enfin rationnelles.
Pour si lent que soit le progrès, il faudra bien que la marchandise humaine disparaisse un jour du contrat social : la justice l’exige.
‒ E. S.
MARCHÉ
n. m. (latin mercatus)
On appelle marché toute convention faite pour l’achat ou la vente d’un ou plusieurs produits. La location ou la vente d’une propriété constitue également un marché. Le terrain, le local public, où l’on vend et achète toutes sortes de choses qui vont parfois directement chez le consommateur ou n’arrivent à la consommation que par de nouvelles transactions.
Au figuré, l’expression « être quitte à bon marché » signifie éprouver moins de perte qu’on avait pu craindre. ‒ Une opération de bourse relative à l’achat ou à la vente d’un titre constitue un marché ‒ Dans le langage commercial on dira quelquefois « par dessus le marché », ce qui signifie : en plus, en outre ‒ De même quand on fait des provisions l’on dit qu’on fait le marché ‒ Témoigner qu’on est prêt à rompre un engagement se traduit par l’expression : mettre le marché en mains.
Dans un sens plus général l’Univers apparaît comme marché suprême où l’on traite, dans les conciles de l’Empire de l’Or, non seulement des marchandises destinées à l’approvisionnement de l’Humanité, mais aussi les conditions d’existence des individus et des peuples qui créent les produits. C’est au Temple de la Bourse, au marché financier, que se décide l’attribution des produits du travail aux individus. Sous cet aspect le marché financier est le marché qui détermine et conditionne l’existence des sociétés par la valeur attribuée aux choses. Le prix vénal des objets et produits traités aux marchés se compose de deux éléments : 1° la part abandonnée aux ouvriers, aux travailleurs prolétaires qui ont contribué à la production des richesses ; 2° la part prélevée par le bailleur de fonds ou du capital utile à la production et à la transformation des richesses. De l’attribution de ces parts dépend le bon marché ou la cherté des produits (voir main-d’œuvre, valeur, etc.). Dans la détermination d’un marché il faut d’abord savoir lequel des deux éléments désigné dans la fixation d’un prix a influencé sur la hausse ou sur la baisse du produit.
Quand le capital domine, comme actuellement, les prix sont élevés, au maximum, pour les déshérités et à bon marché pour les capitalistes. Si le travail dominait le capital, les produits hausseraient nécessairement de prix sous le rapport salaire, mais ils baisseraient sous le rapport capital. Les conditions du marché seraient interverties et la consommation générale, qui n’est faite aujourd’hui que par les riches, augmenterait avec le nombre de ceux qui pourraient satisfaire les besoins ressentis. N’oublions pas que les besoins croissant, augmentant avec la facilité de les satisfaire, il y aurait ainsi action et réaction parce que le travailleur jouirait des fruits de son travail proportionnellement aux efforts qu’il aurait du faire pour les produire. Pendant ce temps la consommation se généraliserait et la production multiplierait les richesses pour l’avantage général.
À notre époque, malgré la standardisation des gros capitalistes et la rationalisation des capitaines d’Industrie, les objets ne sont relativement à bon compte ‒ pour une minorité ‒ que parce que l’ouvrier a été pressuré autant qu’il était possible de le faire. Dans le produit net le capitaliste se réservant tout le bénéfice pour lui, l’attribution des richesses aux individus se fait à son avantage et au maximum des circonstances.
Les divers marchés de l’Univers nous fournissent la preuve que la spéculation et l’agio fleurissent sous la domination du capital. Relativement au développement général des intelligences qui fait naître chaque jour de nouveaux besoins, plus l’ouvrier déshérité travaille, plus il devient misérable.
Les marchés de notre époque ne favorisent que le capital. L’ouvrier, le travailleur fournit, par la spoliation dont il est victime dans la production générale, la possibilité de consommer les marchandises et produits à ses maîtres. Le marché qu’il a contracté est un marché d’esclave et s’il n’est pas consommé directement il ne meurt pas moins de privations de toutes sortes. Au banquet de la vie il n’y a pas de couvert à la disposition des prolétaires qui doivent se contenter des miettes tombées de la table de l’opulence.
Les conditions des marchés, dans une société rationnellement organisée, seraient interverties par l’apport à la société actuelle.
‒ Élie SOUBEYRAN.
MARÉE
n. f. (se rattache étymologiquement à la forme barbare marcare, mariare, qui vient de mare, mer)
La marée se produit deux fois par jour sur les côtés de l’Océan à l’exclusion des mers de moindre étendue et qui revêtent la forme de lacs tels la Méditerranée, la Baltique, la Caspienne, etc.
La marée consiste dans un relèvement (flux) et un abaissement (reflux) des eaux : cette oscillation régulière est en tous points analogues à une respiration de la mer.
L’intervalle entre une marée et la suivante est de 12 heures 25’ 14 » en moyenne, c’est-à-dire de la moitié du temps qui existe entre deux passages de la lune au méridien.
Les marées sont produites par l’attraction lunaire, qui est de 2/3 et l’attraction solaire qui est de 1/3 combinées avec la rotation terrestre. Elles sont particulièrement fortes lorsque la lune est plus près de la terre et des époques de nouvelles et pleines lunes, lorsque le Soleil et la Lune sont en conjonction et opposition parce qu’alors l’effet simultané de leur attraction se fait sentir davantage.
Lorsque les eaux ont atteint leur plus grande élévation elles restent stationnaires quelque temps, c’est la haute mer. Quand le reflux arrive à sa plus basse dépression elles demeurent aussi quelque temps en repos, c’est la basse mer.
Les plus grandes marées ont lieu à l’équinoxe du printemps et de l’automne et ne se font sentir nulle part d’une façon aussi saisissante que sur les côtes de la Bretagne et de la Normandie.
Notons encore que les marées des Océans propagent aussi leurs ondes à travers les masses gazeuses de l’atmosphère où les masses aériennes atteignent également leurs maxima vers le 21 mars et le 23 septembre et sont presque toujours marquées par des tempêtes et des ouragans qui prennent par leurs tourbillons des proportions de véritables catastrophes, comme au 20 septembre 1926, à Miami (Floride), où 1.500 personnes furent tuées, le 22 septembre de la même année, à Encarnacion, au Paraguay, et le 25 du même mois à Itamble, au Brésil (200 morts), et le 28 à Vera-Cruz, au Mexique.
‒ Frédéric STACKELBERG.
MARIAGE
n. m. latin maritaticum, de maritare, marier
Le mariage, qui est l’union des sexes sanctionnée par la loi, ou consacrée par la coutume, a été en honneur chez tous les peuples, à toutes les époques de leur histoire, mais avec un cérémonial et des obligations très différents. La polygamie, pratiquée en Asie et en Afrique depuis un temps immémorial, permet à l’homme d’avoir plusieurs épouses. La polyandrie, qui en est une forme reconnue seulement dans quelques régions au nord de l’Inde, autorise la femme à prendre pour maris, en même temps que l’aîné d’une famille, tous ses frères cadets. Quand ils sont six ou sept, l’épouse de cette fraternelle coopérative ne chôme pas, et c’est, pour l’association, à défaut de mieux, une excellente mesure contre le cocuage.
Les nations chrétiennes n’admettent que la monogamie, c’est-à-dire l’union d’un seul homme et d’une seule femme, qui se doivent réciproquement fidélité, mais peuvent être néanmoins séparés, en certains cas, par le divorce ou l’annulation des épousailles. Il est vrai que le recours des femmes aux hommages des bons amis, et celui des hommes aux services des prostituées, y permettent, avec fréquence, de rétablir l’équilibre avec les autres parties du monde.
La célébration des noces comporte ordinairement des réjouissances, auxquelles participent l’entourage, les parents des conjoints, et qui ont lieu en conformité de rites traditionnels, à caractère plus ou moins symbolique, souvent pittoresques et empreints de poésie, parfois cyniques et ridicules. Quant à la cérémonie, elle n’est pas forcément très compliquée. Ce peut être, comme chez les premiers chrétiens, la simple bénédiction du patriarche. Il en va différemment, à l’époque actuelle, dans la plupart des grandes nations civilisées, où le mariage comporte la fourniture d’une paperasserie nombreuse et, à lui seul, tout un code de règlements et de lois, tant civiles que pénales. On s’y marie, non seulement à l’hôtel-de-ville et à l’église, ou au temple, sous des torrents de musique sacrée, mais encore chez le notaire. C’est même, pour la classe riche, ce dernier mariage qui compte le plus. Par exception, aux États-Unis d’Amérique, où le temps est apprécié à sa juste valeur, les fiancés peuvent, dans divers États, faire « bénir leurs nœuds », par un pasteur, en une durée moindre que pour un massage facial. Quand on arrive en automobile chez cet augure, ce n’est pas une prodigalité que de laisser en marche le moteur.
Voici quelques usages curieux qui persistent en plein xx° siècle, ou dont on trouve encore trace dans des campagnes reculées : Chez les Arabes, les jeunes filles, dès la puberté, ont le visage presque entièrement voilé, et il leur est défendu d’avoir des relations, même de pure courtoisie, avec des hommes étrangers à la famille. Le prétendant ne connaît donc — ou n’est censé connaître — celle dont il désire faire son épouse que par les louanges qui lui sont faites de ses qualités. Lorsque le jeune homme est agréé par le père, c’est-à-dire lorsqu’il a convenu avec lui de combien de moutons et présents divers serait payée sa future compagne, la mariée est, à jour fixé, conduite au bain. On parfume sa chevelure ; elle prend place sous une sorte de tente fermée que porte un chameau, et elle est amenée, au son des flûtes et des tambourins, jusqu’au domicile de l’époux, qui traite et divertit ses amis, la nuit durant, avant de se rendre auprès de sa femme. Quelques heures plus tard, on expose en public le drap sur lequel fut consommé le mariage, et qui doit être taché de sang, pour démontrer que l’épouse était vierge... et, sans doute, le mari valeureux.
Dans l’Inde, chez les Parsis, les enfants sont fiancés dès un âge fort tendre : quatre ou cinq ans. Pour cela, on place les futurs sur une estrade ; les prêtres leur lancent à poignées du sucre et du riz ; puis, après un festin, on les promène en public, au son des instruments, et suivis d’une foule d’autres enfants recouverts, comme pour un carnaval, des oripeaux les plus bizarres. Dans certaines parties de la Russie, chez les paysans, le lit nuptial devait être préparé par la fiancée elle-même, sur des gerbes de seigle et de blé. Et, pour marquer la transmission des pouvoirs, le père, après en avoir légèrement frappé sa fille, remettait à son gendre un fouet, emblème de l’autorité, et garantie d’apprivoisement.
Il est des villages, en Finlande, où, lorsqu’une jeune fille désire se marier, elle se promène avec une gaine vide attachée à sa ceinture. On. sait ce que cela veut dire. Si un garçon est séduit par cette offre allégorique, il n’a qu’à enfoncer un couteau dans la gaine. Si l’arme ne lui est pas rendue, c’est que les sentiments sont partagés. En Géorgie la future est fardée, couverte de bijoux et de riches atours. Mais, à l’église, le prêtre, pour éprouver leur continence, passe autour de la poitrine de chacun des époux un cordon de soie blanche, qui est cacheté à la cire, avec un sceau représentant la croix. Ils ne doivent rompre le sceau, pour se débarrasser du cordon, qu’après le troisième jour, et c’est seulement alors qu’ils peuvent se témoigner leur ardeur.
En France, il existe encore, paraît-il, dans le Poitou, une coutume que l’on nomme le « maraichinage » et qui constitue une épreuve d’un tout autre genre. Considérant que le mariage ne doit pas être conclu à la légère, mais accepté en toute connaissance de cause, les futurs prennent ensemble les plus grandes libertés, de façon à se rendre compte de ce que pourra être l’existence à deux. Ils ne s’unissent définitivement que si cet essai leur a donné satisfaction. Il est encore des campagnes françaises où l’on soumet les nouveaux mariés, non à des épreuves, mais à des brimades.
Lorsque l’heure est tardive, et que le bal qui a suivi le banquet touche à sa fin, on les surveille sans en rien laisser paraître ; on invente mille farces pour les empêcher de faire ce qu’ils ont à faire. Quand ils se croient bien seuls, on simule un incendie pour les contraindre à déguerpir à demi vêtus, ou bien leur extase est troublée, à l’instant le meilleur, par l’arrivée d’un flot de convives en ribote, venus pour 1eur apporter au lit de la soupe et du vin chaud. Quels préparatifs, quel décor pour une première nuit d’amour ! Il est vrai que, chez les Hottentots, le sorcier bénit les conjoints en les arrosant de son urine.
Les premiers contacts gagneraient certainement à plus d’intimité et de réserve. Ne pourrait-on se décider à laisser en paix les nouveaux époux ? Aucun cérémonial ne remplace ni n’embellit l’amour, qui ne trouve sa plus haute expression que dans la liberté entière du don réciproque, et dont la meilleure fête est celle de la mutuelle possession.
La Russie Soviétique a réduit à leur plus simple expression les exigences du mariage. Il n’est plus qu’une formalité d’état-civil ; encore est-elle dénuée de complications vaines. Le jeune homme à partir de l’âge de dix-huit ans, la jeune fille qui a seize révolus, n’ont, s’ils veulent s’unir, qu’à se présenter, munis de quelques pièces d’identité, devant le scribe désigné pour cet office. Sans qu’aucune autorisation familiale soit requise, leur déclaration d’union est. enregistrée. Et c’est tout !
Les nouveaux mariés peuvent prendre pour nom, indifféremment, celui de l’épouse ou celui de l’époux, ou bien les deux noms de famille associés par un trait. Leurs droits sont identiques. Chacun d’eux conserve la libre disposition de son avoir personnel. S’ils veulent divorcer, libre à eux. Nulle nécessité de l’approbation d’un juge, ni d’enquêtes de police vexatoires et inconvenantes, pour qu’ils soient dégagés de tout lien. Il n’est pas même exigé qu’ils soient d’accord pour cette séparation. Il suffit que l’un des deux se rende au bureau de l’état-civil et déclare qu’il renonce à l’union pour que ce soit chose accomplie. Le conjoint absent est informé par lettre. L’enregistrement du mariage soviétique ne répond qu’à deux objets : l’obligation d’entr’aide des époux, qui se doivent assistance en cas de dénuement ou maladie ; la responsabilité de ces derniers à l’égard d’une partie des frais d’entretien et d’éducation des enfants nés de leurs amours, même lorsque celles-ci n’ont été que temporaires.
Quelles que soient les formes politiques et religieuses, ou les pratiques rituelles d’un pays, le mariage, du point de vue de l’utilité sociale, ne correspond pas à autre chose quant au fond, qu’à ces deux ordres de préoccupation, de nature strictement économique. La femme étant appelée à être mère, c’est-à-dire placée avec régularité, pour un temps plus ou moins long, dans l’impossibilité de travailler pour gagner sa vie, alors que les enfants déjà nés constituent pour elle une très lourde charge, force lui est bien, en dehors de tout esprit de lucre, de rechercher auprès de l’homme de son choix des garanties matérielles que ni sa famille ni la société ne sont disposés à lui assurer. Cependant l’homme ne les accorde, ces garanties, qu’autant que la femme réserve pour lui seul ses faveurs, et s’engage à ne pas lui faire supporter l’entretien de rejetons qui ne seraient point issus de ses œuvres. C’est pourquoi, dans notre organisation sociale, la femme ne peut être vraiment indépendante que lorsque ses ressources personnelles lui permettent de se suffire constamment à elle-même et d’élever, par surcroît, des enfants, si elle ne se voue à la stérilité volontaire. C’est pourquoi l’émancipation féminine ne pourra être totale que lorsque les femmes pourront trouver, dans le mutuellisme d’une société plus rationnelle et plus humaine, les avantages indispensables qui ne leur sont actuellement conférés, par leurs époux et par leurs proches, qu’au prix d’un servage souvent douloureux, toujours humiliant.
Jean Marestan
MARIAGE
Outre l’union sexuelle, le mariage est aussi une communauté d’intérêts, et c’est cette communauté qui maintient l’union malgré les traverses des amours illégitimes. Dans la classe bourgeoise ces intérêts forment souvent un bloc inébranlable. Mais même lorsque la religion renforçait encore les liens sacrés du mariage, le cocuage était et est encore un dérivatif fréquent à cette union forcée.
L’habitude à son tour maintient les époux dans la vie en commun. Les époux se trouvent liés inconsciemment par leurs manies, la certitude de retrouver au foyer les choses familières et le déroulement mécanique de la vie matérielle, sans que l’esprit ait à faire un nouvel effort d’adaptation. La plupart des humains ont horreur du changement, et il leur faudrait une énergie révolutionnaire pour rompre les liens de l’habitude.
Même si l’on fait abstraction de l’opinion publique, des lois civiles et religieuses, même si l’on suppose une société où l’homme et la femme seraient affranchis des questions d’intérêt matériel et pourraient vivre d’une vie indépendante, il semble bien que les unions resteraient stables dans la grande majorité des cas. D’autant qu’on peut imaginer que les questions d’argent ne viendraient plus fausser les ententes matrimoniales et que la sympathie et l’amour présideraient aux rapprochements sexuels. Fondés sur l’affection mutuelle et sur l’amour des enfants, cimentés par les habitudes de vie commune, les mariages ont toujours tendance à se stabiliser. On le voit bien dans les pays où le divorce est accordé avec la plus grande facilité, par exemple aux États-Unis. Et même en Russie, où, d’après les calomnies des gens bien pensants, la promiscuité et le dévergondage sexuels devraient être la règle, c’est au contraire les unions permanentes qui sont l’immense majorité.
Ce qui fait de l’effet, ce sont les divorces répétés des instables et des déséquilibrés de l’un ou de l’autre sexe. Mais c’est une délivrance pour l’autre conjoint, d’être débarrassé d’un individu volage ou inadapté à la vie en commun. Le divorce est nécessaire aussi pour libérer des époux mal assortis par le caractère ou pour toute autre cause, et leur permet de trouver ensuite, avec ou sans. tâtonnements, une association sexuelle convenable et mieux choisie.
Ajoutons aussi, comme cause importante de la stabilité des mariages, le progrès moral lui-même. L’opinion publique a été pendant longtemps le, frein moral principal réagissant sur les actions des individus et se traduisant par des lois de coercition civiles et religieuses. Certes l’opinion publique s’exerce et s’exercera toujours sur les actes humains, mais avec moins de tyrannie ; et de plus en plus les individus trouvent en eux-mêmes le contrôle de leurs actions. Le contrôle de soi accompagne l’adoucissement des mœurs et l’évolution morale vers la liberté. Cette liberté consiste à refréner spontanément caprices ou impulsions sans y être obligé par le gendarme. Si donc il arrive qu’un époux ait perdu son amour, mais s’il a conservé quelque estime et quelque affection pour son conjoint, il s’abstient de rompre le lien pour ne pas lui causer de douleur. Ne pas créer de souffrance, tel est l’axiome qui se dégage des tâtonnements des hommes à travers tous les systèmes moraux qu’ils ont successivement élaborés.
Un tel contrôle de soi ne va pas jusqu’au sacrifice. Seuls des chrétiens ou des stoïciens peuvent envisager l’union avec une femme acariâtre ou avec un mari autoritaire et ennuyeux par exemple, comme un devoir comportant un impératif absolu. La crainte religieuse a pu imposer de tels devoirs. Mais la société humaine se dépouille peu à peu des vieilles morales religieuses, et il est improbable qu’elle adopte une morale absolue, incompatible avec la variété de la vie sociale. La famille ne ressemble plus à la maison d’Albanie entourée de murs que couronnent des fagots d’épine. Dès aujourd’hui la femme ne dépend pas toujours de son mari, elle n’est pas obligée de s’attacher à lui comme à un protecteur légal, elle peut déjà vivre indépendante, et, de plus en plus, les deux sexes seront sur un pied d’égalité.
« Ménagère ou courtisane », a dit Proudhon. Aujourd’hui bien des femmes menant une vie conjugale régulière ne s’occupent plus du ménage. Les soins ménagers sont simplifiés par le progrès de la technique et seront, de plus en plus, faits par des spécialistes. En tout cas on peut dire que la femme pourra choisir ses occupations et ne sera plus a priori astreinte par le mariage à la besogne domestique.
Il est probable aussi que les familles n’auront pas des enfants très nombreux, que ceux-ci jouiront d’une éducation plus indépendante, et que, sans être sevrés de la tendresse et du contrôle des parents, ils ne seront plus couvés par leur mère jusqu’à leur majorité. Les parents seront plus libres et au point de vue familial et au point de vue économique. Il y aura probablement plus de divorces par consentement mutuel, parce que les jeunes gens, aussi bien garçons que filles, se mariant plus librement, feront quelquefois des mariages précoces mal assortis à cause de l’aveuglement même de l’amour, mais d’où il sera possible de s’évader plus facilement pour trouver enfin une union stable avec un conjoint mieux choisi. La vie éduque les caractères. Le fille-mère ne sera plus une malheureuse paria chargée de la réprobation publique . Le mariage de l’avenir, c’est-à-dire l’union sexuelle pour la famille, cessera de reposer, tout au moins exclusivement, sur la protection jalouse de l’homme et sur la reconnaissance et l’obéissance de la femme envers son mari. Notre mariage actuel ne ressemble déjà plus du tout au mariage antique.
Sans que je m’en aperçoive, le terme de mariage a fini par se confondre sous ma plume avec l’union familiale à caractère stable, mais dépourvu du caractère sacré que lui attribuent jusqu’à présent, du moins jusqu’à la révolution russe, les lois divines et humaines.
C’est pour cela que « le mariage, se marier » ne sont pas employés, dans cette étude, uniquement pour désigner la cohabitation légalisée, mais d’une façon générale, toute union ou recherche d’union, durable, au moins dans son principe ou ses desseins.
Cette union familiale s’oppose à l’amour libre. A l’époque actuelle l’amour libre n’est trop souvent que la liberté du lâchage, qui ne profite qu’à l’égoïsme du mâle et abuse de l’infériorité de la femme. Mais dans une société où la femme aurait conquis son indépendance économique, où l’enfant aurait droit à la protection sociale en pleine égalité avec les autres enfants, le divorce, même par la volonté d’un seul, ne serait pas toujours un drame et serait souvent une délivrance. Il ne s’agit pas seulement des cas où le divorce unilatéral délivre d’une femme insupportable ou d’un mari tyrannique ou vice-versa. Mais le conjoint, abandonné par un être égoïste ou instable, n’est-il pas au fond plus à féliciter qu’à, plaindre, une fois les premiers déchirements passés, soit d’amour déçu, soit d’amour-propre égratigné ?
La théorie de l’union libre (voir ce mot), repose sur une équivoque. On peut comprendre sous ce vocable l’union familiale établie en dehors des formes religieuses ou légales, mais garantie par l’affection et la confiance mutuelles et aussi par l’amour des enfants.
C’est ainsi qu’Elisée Reclus, dans une allocution prononcée au mariage libre de ses filles, a exposé le caractère de leur union. Avec l’émancipation économique de la femme, cette forme du mariage deviendra sans doute plus fréquente. Mais on confond souvent l’union libre avec l’amour libre, ou plus exactement avec la passade, conséquence du simple attrait physique et sans affection durable. En réalité, il existe deux morales sexuelles bien distinctes, celles qui ne va pas plus loin que le goût physique, l’autre qui est fondée sur le besoin d’une liaison où l’amitié et l’estime s’associent au désir charnel.
Je ne crois pas qu’on puisse opposer l’amour-passion à l’union familiale. Certes on peut faire cette opposition, si l’on s’en tient à l’observation des mœurs de la classe bourgeoise où assez souvent l’amour n’a aucune part à la formation du mariage. Mais cette monstruosité morale disparaîtra avec la société mercantile. Quand il y a passion, les deux êtres ne veulent plus vivre que l’un pour l’autre, ils rompent toute relation, toute amitié extérieure, ils s’enferment dans leur amour exclusif. Et quand la passion s’est dissipée, l’union persiste si les caractères sont en harmonie, si les deux partenaires ont appris-à s’estimer. Leur amour s’adoucit en une affection de confiance qui s’étend à leurs enfants. Si au contraire les caractères sont en désharmonie, le divorce ou la séparation intervient. Mais l’amour véritable n’a jamais pour point de départ la prévision de cette séparation, il espère l’union éternelle et ne voit d’autre bonheur-que la vie en commun.
Il y a très peu d’hommes qui vivent en célibataires. L’homme répugne à vivre dans la solitude. Il a besoin d’une compagnie affectueuse. La plupart des jeunes gens qui professent la morale de l’amour libre finissent par se marier eux aussi. On objectera que c’est parce que leurs amis sont mariés et qu’ils restent seuls et désemparés. Mais il semble que le mariage devienne un besoin quand on arrive à un certain âge, quand le bruit, l’agitation, la danse ont cessé d’être le plaisir dominant. Où peut-on trouver amitié plus vraie, plus désintéressée que dans l’union amoureuse ? Les amis du même sexe sont pris par leur famille et leurs intérêts particuliers. L’amour crée la communauté des sentiments, la confiance et la solidarité.
Beaucoup de célibataires mâles ont en réalité une liaison. Ils ont une bien-aimée qu’ils vont voir à peu près chaque jour, peut-être plus pour la douceur de sa compagnie et la sûreté de son affection que pour le commerce charnel. Cette liaison est pour eux une habitude, un refuge et ne se distingue du mariage légal que par l’absence de cohabitation.
Il n’y a le plus souvent de véritables célibataires que chez les femmes. Ce n’est pas par parti pris. Si elles ne sont pas mariées, si elles n’ont pas de liaison, c’est parce que dans l’état actuel des mœurs elles n’ont pas pu faire autrement. Elles ne demandaient pas mieux d’aimer et de fonder une famille. Elles en ont été empêchées par leur infériorité économique et par l’infériorité morale où la société repousse encore la fille-mère. Enfin le scrupule empêche quelques hommes de se mettre en ménage, parce qu’ils sont malades ou qu’ils n’ont pas le sou. Ajoutons encore ceux ou celles, rares à là vérité, qui, fidèles à un amour malheureux, ou ne pouvant pas se marier avec l’être de leur choix, restent toute leur vie dans l’impasse du célibat.
En général, les femmes réfléchissent un peu plus que les hommes, quand ce sont elles-mêmes qui font leur mariage, soit que chez elles le besoin physiologique, ait un caractère moins impérieux, soit qu’elles aient conscience de leur faiblesse dans la vie sociale, soit surtout qu’elles éprouvent davantage le besoin d’une vie affective. Elles considèrent le mariage comme un refuge ; elles doivent pouvoir compter sur le mari et s’accorder avec lui. La moins coquette fait faire un stage à son soupirant, afin de se rendre compte s’il s’agit d’amour véritable ou d’un simple désir charnel, et aussi pour juger de son caractère.
Malgré la difficulté du choix, malgré la puissance de l’impulsion sexuelle ou des calculs d’intérêt, les hommes choisissent aussi. La plupart voient plus loin que la simple satisfaction charnelle ou que la conquête d’une dot. Ils ont le goût du foyer et l’ambition d’être heureux en ménage. Ils ont assez de maîtrise de soi pour refréner l’imagination avant qu’elle se soit transformée en hallucination passionnelle. Ils sentent plus ou moins confusément que pour une union stable, pour le mariage, il faut élire celle dont on voudrait avoir des enfants. La règle est la même pour l’autre sexe. Par conséquent, l’attrait sexuel ne suffit pas, il faut aussi qu’on puisse avoir pour l’être vers lequel on se sent attiré une certaine confiance, une certaine estime, due au caractère d’abord, à l’intelligence et à la culture quelquefois, et non à des qualités toutes superficielles de séduction.
D’ordinaire, les adultes ne se contentent pas de rechercher la beauté et l’élégance. La coquetterie et. la légèreté repoussent plus qu’elles ne séduisent beaucoup d’aspirants au mariage. Ils préfèrent celui ou celle qui a du sérieux. L’égoïsme est plus difficile à juger, puisque l’amour est la suppression de l’égoïsme et devient un égoïsme à deux. L’effet ordinaire du mariage légal ou illégal est de transformer l’égoïsme personnel en égoïsme familial. Le plus souvent, la bonté féminine ne s’étend pas au-delà du mari et des enfants. Pour la plupart des femmes, le meilleur des maris est celui dont l’activité, la générosité, les préoccupations sont limitées à la famille. Périsse l’humanité, pourvu que la famille prospère ! On est parfois étonné de rencontrer des hommes durs, autoritaires, farouchement égoïstes, exigeant dans leur propre maison la soumission de l’épouse et des enfants, se montrer pointilleux pour le moindre affront, le moindre tort fait à quelqu’un de leur entourage. Ils en ressentent vivement un sentiment d’infériorité. Leur amour-propre se révolte contre toute offense faite à l’un des leurs, et ils poursuivent avec vigueur, en dehors même du bon droit, une réparation qu’ils estiment nécessaire à leur propre dignité.
Tel était autrefois le tableau de la famille. Elle ressemblait, comme je l’ai déjà dit, à la maison d’Albanie, entourée de murs élevés que recouvrent des fagots d’épine. Les femmes acceptaient la soumission à l’autorité du mari, qui leur donnait la sécurité. Avec une indépendance plus grande de la femme, cette morale est encore en vigueur. Pendant la période actuelle de mercantilisme, la morale d’égoïsme familial est la suprême vertu.
On comprend que dans le cas où la famille subit des vicissitudes, sa solidité en est renforcée. Le mari et la femme s’appuient l’un sur l’autre pour résister aux coups du sort, qu’il s’agisse des maladies des enfants ou de difficultés économiques ou de dangers d’autre nature. L’affection s’en trouve accrue. Trop de facilité tend au contraire à desserrer les liens du ménage. Richesse et oisiveté sont les causes les plus importantes du dévergondage sexuel.
Notons que si l’union s’est faite sans affection, ou si l’indifférence et la mésentente sont survenues, la mauvaise fortune peut être le prétexte de la rupture. La mort de l’enfant ou des enfants sera le prélude du divorce. Ou bien les mauvaises spéculations du mari inciteront la femme à réclamer sa dot. D’autre part, la communauté seule des intérêts en péril peut au contraire rapprocher des époux sans mansuétude l’un pour l’autre. C’est peut-être l’association des intérêts qui fait, au moins en partie, que le mariage dans la classe moyenne est plus solide que dans les autres classes.
En général, aujourd’hui, les conditions familiales sont moins serrées. Le mari et la femme sont davantage sur un pied d’égalité. Le mari ne peut plus compter sur son autorité exclusive. La vie en bon accord n’est plus fondée sur la soumission de la femme. A vrai dire, l’harmonie des caractères a toujours été utile. Elle est encore plus nécessaire à l’époque actuelle. Dans certaines unions, c’est l’attrait sexuel qui entre le premier en jeu, quitte à être contrôlé par l’accord moral. Dans d’autres, surtout quand on cherche celui ou celle dont on voudrait avoir des enfants, c’est l’inclination morale qui est le point de départ. Cette inclination réunit ceux dont les caractères concordent et qui ont sur les choses et les gens les mêmes appréciations. Ils se plaisent ; l’attrait moral fixe l’attrait sexuel et le transforme en amour.
Dans le mariage, l’important est l’accord des caractères bien plus que la recherche de la vertu. Les gens vertueux sans indulgence, ou sans énergie, ou bien sans gaieté, ou sans intelligence, ne sont jamais de bonne compagnie. Ils ne sont même pas bons à faire des pédagogues. La vertu — par maîtrise de soi — en vue du choix du plaisir n’a pas les mêmes inconvénients que la vertu fondée sur le Devoir. La pratique du devoir donne parfois un résultat paradoxal. A force de refouler, on arrive à supprimer toute spontanéité, à dessécher les sentiments, à créer une nouvelle forme d’égoïsme, l’égoïsme puritain, à se donner à. soi-même la conviction d’une supériorité morale, à se rendre en somme insupportable aux autres, à devenir en quelque sorte un être antisocial. Tandis qu’on, voit d’autres, êtres antisociaux par suite d’égoïsme impulsif, de ceux qu’on classe dans la catégorie des indésirables, fonder parfois des amitiés solides, mais exclusives.
L’accord des caractères est donc la condition nécessaire d’une union stable. Voici deux êtres autoritaires : ils ne pourront pas se supporter, il leur faut choisir un conjoint dont la douceur confine à la soumission. On pourrait multiplier les exemples. Remarquons que certaines dissemblances s’atténuent par la vie en commun. Bien des femmes, par exemple, font l’éducation de leur époux, l’affinent, réussissent à adoucir sa grossièreté et ses tendances impulsives. Les maris s’occupent beaucoup moins, en général, de l’éducation de leur femme.
Dans le rapprochement des sexes, la communauté des goûts et des caractères est le facteur principal de la confiance dans l’attachement. Ainsi peut s’expliquer la solidité de certaines unions qu’on aurait pu croire destinées à l’instabilité à cause de la disparité de l’âge. Si le conjoint plus jeune a des goûts sérieux, si le plus âgé a gardé un caractère enjoué, et si entre les deux existe une estime mutuelle, il y a des chances pour que l’union soit aussi solide que toute autre. Mais, dans la plupart des cas, la différence d’âge implique une différence tranchée et même une opposition des habitudes, des goûts, des plaisirs, des jugements et des comportements. Cette différence peut s’observer parfois entre deux conjoints du même âge, mais elle est pour ainsi dire de règle et elle est plus nette entre personnes appartenant .à des générations éloignées. Je ne parle pas seulement de l’esprit différent des générations. Chacune, en effet, a sa morale, ses habitudes, ses modes, ses préjugés, ses goûts, ses jugements qu’elle porte avec elle pendant toute son existence. Mais le heurt des conjoints ou des amants tient surtout à la différence de mentalité et de goûts qui dépend de l’âge lui-même. Les jeunes ont besoin de mouvement, d’activité, d’agitation. Ils sont curieux, ils ne sont pas encore blasés. La danse, les sorties nocturnes ou le sport les attirent. Mille enthousiasmes les soulèvent, souvent puérils ou qui paraissent tels aux gens plus âgés. Peu de pondération : des jugements absolus, et, d’autre part, des impulsions qui ressemblent à des caprices ou à des enfantillages.
Sans doute, les exemples abondent, surtout autrefois, où une jeune fille, mariée à un vieil homme, doit refouler sa gaieté et ses rires et s’adapter tristement à la vie monotone et renfrognée d’un foyer sans joie. Mais aujourd’hui les jeunes sont moins résignés et souvent plus indépendants. Dans les mariages légaux, on s’ingénie à sauver la face. Dans les unions illégales, l’indépendance apparaît mieux. La femme âgée fermera les yeux sur les escapades ou les incartades de son jeune amant. Le vieux protecteur, au lieu de se rendre ridicule à faire le jeune fou dans les lieux de plaisir pour satisfaire aux caprices du tendron, se résigne à laisser ce rôle à un gigolo, à celui que Sacha Guitry appelle dans une de ses pièces le veilleur de nuit.
Ni les ouvriers, ni les paysans, ni les petits bourgeois, c’est-à-dire la grande masse de la population et celle qui travaille, n’ont d’attirance pour la « petite oie blanche ». Leur amour va vers celle qu’ils sentent leur égale et qui sera leur compagne et leur associée.
Ceux qui ont le dessein d’épouser une petite oie blanche entendent la pétrir et la modeler à leur usage, en somme en faire une esclave docile. Ils ont le désir. de dominer, et, n’étant pas sûrs, au fond de l’âme, de leur propre valeur, ils veulent tout de suite imposer leur prestige à une vierge innocente et ignorante, dont ils pourront abuser des sentiments et des jugements à leur profit.
Est-ce un idéal d’avoir une compagne incapable de se conduire elle-même, et toujours attentive à l’autorité du maître et seigneur ? D’ailleurs, est-il bien sûr que le seigneur et maître puisse compter sur l’adhésion et la soumission éternelle de l’épousée ? Même s’il a la simple prétention de lui suggérer ses idées et ses goûts personnels, il a bien des chances de se leurrer. Car sous sa réserve et sa timidité, l’adolescente a déjà sa personnalité toute formée et des tendances fortement enracinées. Enfin, nous ne sommes pas dans une société où la femme reste enfermée au harem ou même dans l’ancienne famille, strictement isolée. Derrière le front de la petite niaise, il serait bien vain de dire à l’avance quelles pensées vont se développer. On ne peut pas savoir non plus quelle conduite va tenir une personne à qui on n’a jamais laissé prendre de décision. Qu’arrive-t-il le plus souvent à l’usage ? C’est que la petite oie blanche se transforme rapidement en virago aigre et revendicatrice, ou bien que, sous le masque de la candeur et de l’obéissance, elle cocufie sournoisement son mari prétentieux et sur de sa domination, ou bien encore qu’elle reste une oie sans cervelle, soumise mais ennuyeuse, molle et douée mais incapable de donner un bon conseil ou un simple encouragement.
Le sport, l’automobile, l’instruction ont fait peu à peu disparaître presque complètement ce modèle de jeune fille bourgeoise bien élevée. La guerre, les révolutions ont précipité la transformation du type féminin.
Il n’en reste pas moins que beaucoup d’hommes sont encore séduits par la fragilité (souvent artificielle) d’une jeune femme, soit parce que cette apparence flatte leur instinct de réduire au servage sexuel l’objet de leurs désirs, soit qu’elle satisfait leur sentiment de protection.
De leur côté, beaucoup de personnes du sexe faible, se rendant compte que leur faiblesse est un moyen de séduction, en usent comme instrument de coquetterie.
Je ne veux pas dire que le type féminin de l’avenir sera la virago. Entre celle-ci et la fille soumise, il y a place pour la femme évoluée moralement et intellectuellement, ayant développé le charme de son sourire, la grâce de ses mouvements, la douceur de ses propos, la patience et la persévérance dans l’action en même temps que la culture des idées et la sûreté du jugement. On peut espérer que le mariage de l’avenir, fondé sur l’amour, ne sera plus entaché de servitude, comme il l’a été trop souvent dans les anciens temps, et qu’il sera de plus en plus une association libre.
Parmi les causes, de l’instabilité du mariage j’ai mentionné la difficulté du choix. Cependant, même avec un choix qui peut paraître excellent, la fidélité conjugale n’est pas assurée.
Dans toutes les sociétés, les exemples d’infidélité abondent, surtout de la part du mari. Pour le mâle, l’infidélité est péché véniel ; ses conquêtes lui sont un titre de gloire. Pour là femme, c’est le déshonneur. Le mâle, maître de la famille, punit par la mort le faux pas de l’épouse. La femme est obligé de fermer les yeux sur les frasques de son mari.
Du moins autrefois. Aujourd’hui, les femmes manient le revolver avec maestria. Il n’en reste pas moins que l’opinion publique, maîtresse de la morale, est indulgente aux époux et sévère aux femmes. Les femmes elles-mêmes ne sont pas les moins féroces pour les personnes de leur sexe.
En dehors des conditions sociales consacrant la suprématie masculine, les mœurs ont certainement-tenu compte, du moins inconsciemment, du fait que les mâles, sont davantage poussés par le besoin physiologique et les femmes tenues, pour la plupart, parle sentiment affectif.
Le désaccord conjugal aboutit à l’adultère ou au divorce. Mais beaucoup de maris pratiquent l’adultère sans qu’il y ait désaccord conjugal. Les religions et l’opinion publique réprouvent à la fois l’adultère et le divorce. Mais, jusqu’aux temps modernes, la religion et l’opinion publique étaient beaucoup plus sévères pour la rupture du mariage que pour le manque de fidélité. Cette différence peut sans doute s’expliquer en remontant dans la nuit des temps. L’abandon de 1a femme et des enfants, ordinairement assez nombreux, était un crime social, puisque les conséquences en retombaient-sur la tribu. La répudiation fut admise peu à peu en faveur du mari, surtout et d’abord de l’homme riche et puissant, mais sous certaines conditions, d’ordinaire en cas de stérilité. L’adultère n’est qu’un crime familial, qui entraînait seulement la vengeance de l’époux trompé, c’est-à-dire du mari. Car la femme n’avait que des droits assez limités. Si les pauvres gens ont toujours pratiqué une morale d’association et de confiance, fondée sur la monogamie, la polygamie était le privilège des mâles riches. La fidélité conjugale du mâle était donc toute relative, puisqu’on s’enrichissant il pouvait acheter d’autres épouses. Le sentiment de fidélité ne correspondait pas du tout à ce qu’il est devenu pour la conscience moderne. La confiance s’entend entre égaux, la fidélité est le devoir du vassal envers le maître. Le mari polygame devait simplement protection à ses femmes, et celles-ci lui devaient fidélité.
Les religions et les morales ont depuis longtemps oublié ce point de départ. Elles ne doutent point de détenir la Vérité morale, révélée, la Loi suprême absolue. Comment donc se fait-il, si la Loi morale vient de la divinité, ou de la conscience, considérée comme le reflet de la divinité, qu’elle ne condamne pas le mensonge adultérin plus fortement que la rupture du lien conjugal ? Les mœurs modernes acceptent peu à peu le divorce légal et égal, et bientôt par consentement mutuel. I1 semble tout à fait légitime de se séparer d’un conjoint indésirable et antipathique, avec qui la vie commune est un enfer ; tandis que la conscience moderne considère l’adultère comme un mensonge, c’est-à-dire comme une atteinte à la confiance, en tout cas comme une diminution morale de l’individu.
La conscience moderne est en contradiction sur ce point, comme sur d’autres, avec les morales anciennes. Je mets à part le stoïcisme, qui est d’ailleurs le prototype de la morale moderne et qui est une morale moderne par comparaison avec les morales religieuses, ce qui ne veut pas dire qu’il soit une morale définitive. Les religions ont presque toujours empêché le divorce ; elles n’ont jamais empêché l’adultère, quoiqu’on les invoque comme les instruments les plus efficaces de la moralisation. En fait, la religion, comme la morale, est le reflet de l’opinion publique. Maintenant que la femme peut être libre et indépendante, la notion d’émancipation conjugale arrive peu à peu à s’imposer, le divorce devient possible, légal, moral.
En définitive, et j’y reviendrai, quand j’étudierai le progrès moral, c’est l’opinion publique, et non pas l’intérêt individuel, ou le plaisir individuel, ou la religion, qui a créé la morale. Dans la pratique, opinion publique et religion se confondent, puisque la religion est l’armature même. de la coutume, armature rigide qui se modifie moins facilement que les mœurs. Mais religion et coutume maintiennent longtemps l’opinion et les mœurs dans la forme traditionnelle. L’amour lui-même est le plus souvent incapable de briser leurs entraves. Les religions se sont toujours opposées aux mariages mixtes. L’amour pendant longtemps n’a rien pu ou rien osé contre cette opposition. Aujourd’hui encore, les coutumes et les mœurs primitives ont conservé toute leur force parmi les Juifs de l’Europe orientale. Quel est le jeune homme ou la jeune fille de ce milieu qui se décidera à prendre un conjoint n’appartenant pas à sa religion ? Ils n’oseront pas entrer en révolte contre la réprobation familiale et surtout contre la réprobation publique, ce qui ne veut pas dire que des relations charnelles ne puissent avoir lieu, mais sans caractère officiel.
Cette explication vaut aussi pour l’adultère en général. On se sent libre de le pratiquer, à condition de le tenir secret, d’abord pour ne pas « avoir d’ennuis » avec le conjoint légitime, mais aussi pour garder une réputation honorable devant l’opinion. Il est impossible, par contre, de cacher un concubinage ; il était donc impossible d’échapper à la réprobation publique, quand le mariage était considéré comme un lien sacramentel indissoluble. Aujourd’hui encore, on ne recevra pas officiellement dans le monde un faux ménage, de conduite irréprochable, tandis qu’on accueillera un couple légitime, de conduite douteuse, pourvu qu’elle ne fasse pas scandale. Eviter le scandale, tout est là ; et l’opinion publique est beaucoup plus indulgente pour l’épouse libertine, à condition qu’elle masque ses aventures extra-conjugales, que pour la fille qui se donne librement à l’amant de son choix.
La morale change aussi avec les milieux. Elle est souvent fonction des conditions sociales. Le décorum et le respect de l’opinion publique, ont, par exemple, moins de prise sur les ouvriers que les préoccupations alimentaires, et laissent plus. de liberté à la morale sexuelle. Mais chez eux l’union. conjugale, légitime ou habituelle, est renforcée par l’association ; et les caprices sexuels sont écartés par les préoccupations économiques elles-mêmes et par la nécessité de donner tout leur temps et leurs forces au travail. Quelques brèves passades viennent parfois rompre la monotonie sexuelle, mais elles sont sans lendemain.
Dans la petite bourgeoisie, le décorum et le respect de l’opinion règnent en maîtres. L’association conjugale est encore renforcée par la nécessité de sauvegarder le bien de famille ou l’entreprise, et se manifeste par un solide égoïsme familial. C’est la classe où la morale sexuelle est observée avec la plus stricte rigueur. Le travail, là aussi, laisse peu de loisirs. Gagner de l’argent est pour le bourgeois, petit ou moyen, d’ordre aussi impératif que gagner sa vie l’est pour l’ouvrier. Mais le dépenser en fantaisies amoureuses apparaît comme un scandale..Tout au plus laisse-t-on le jeune homme jeter sa gourme et ferme-t-on les yeux s’il met à mal quelque fille de la classe pauvre. Son établissement matrimonial n’en souffrira pas.
Dans la classe riche, les gens sont libérés de toute préoccupation alimentaire et de toute préoccupation économique en général. La préoccupation sexuelle passe au premier plan. Les loisirs et l’argent leur donnent toute facilité pour courir l’aventure charnelle. L’adultère devient un sport. Il est l’apanage des héros de roman et de théâtre. L’affaire importante de la vie est de conquérir des femmes et de n’être pas trompé soi-même.
Le choix, le meilleur choix avant le mariage ne met pas une union à l’abri de l’adultère. Celui qui commet cette infraction à la règle n’est pas toujours le coupable. Une jeune fille, quand elle a accroché un mari à l’hameçon, ne doit pas s’imaginer qu’elle est garantie contre l’infidélité ou l’abandon ; .elle ne doit pas prétendre être. servie à pieds baisés. Le mari, de son côté, aurait tort de croire qu’il n’a plus besoin de se gêner devant sa femme et qu’il peut se dispenser des petites attentions qu’il prodiguerait à une maîtresse.
C’est qu’une maîtresse il n’est pas sûr de la conserver, tandis que le mariage le libère du sentiment d’insécurité. Comme amant il s’efforce de plaire, comme mari il y renonce aisément.
Mais le lien légal du mariage tend à perdre sa force coercitive. Il ne sera bientôt plus qu’un statut pour la sauvegarde des enfants. Le concubinat n’existe pour ainsi dire plus dans certains États de l’Union américaine du Nord et en Norvège (si l’on en croit Bedel), puisque la facilité dans les formalités d’union et de divorce font du mariage une sorte d’union libre. Si l’on veut conserver l’affection et la fidélité du conjoint, il ne faut pas trop compter sur l’effet de la. séduction première, il faut s’efforcer de continuer à lui plaire tant au point de vue physique qu’au point de vue moral. Autrement dit, le mariage futur ne sera jamais une garantie définitive et ne saura dispenser les conjoints d’être toujours attentifs l’un à l’autre.
L’épouse d’autrefois sentait que son sort dépendait de la protection du mari. Elle avait une ribambelle d’enfants. C’est pourquoi, prise toute entière par son rôle de mère et de ménagère, elle ne pouvait guère songer à l’indépendance sexuelle. Toute sa vertu était dans la fidélité et dans la défense du foyer .
La femme moderne a moins d’enfants. Aux États-Unis, tout au moins dans les États de l’Est, la natalité est. encore moindre qu’en France. Dans un stade avancé de civilisation, les femmes se dérobent aux maternités répétées, soit pour avoir une vie plus libre, soit pour assurer mieux l’éducation et l’établissement de leur progéniture. Ces ambitions n’ont pas de raison d’être dans les populations misérables ou de civilisation primitive. La liberté de la femme n’y existe guère, et le problème de l’éducation et de l’établissement des enfants ne se pose pas.
Dans une humanité future, où les enfants seront protégés et leur éducation assurée, la femme sera tout à fait libre vis-à-vis du mari. La vie sentimentale prendra un plus grand développement. Au lieu du devoir imposé, l’attrait sexuel et l’attrait affectif seront seuls facteurs de la stabilité du mariage. C’est surtout le sentiment affectif qui, en l’absence du sentiment religieux servira de frein au dévergondage.
M. Pierrot
MARIAGE
On connaît la thèse individualiste concernant le mariage. Résumons-la rapidement. Affectives, sentimentales, sensuelles, les relations sexuelles sont actuellement empreintes d’une très grande duplicité. La société capitaliste affecte de ne connaître qu’une sorte d’amour : l’amour légal, c’est-à-dire l’union pour toute une vie à un être qu’avant « le mariage » on ne connaît souvent pas, qui dissimule son véritable caractère et dont, malgré le divorce, on, ne saurait, dans bien des cas, se séparer sans graves inconvénients économiques ou sociaux. L’union libre se différencie très peu du mariage, entrée qu’elle est de plus en plus dans nos mœurs. Qu’il s’agisse donc du mariage légal ou non légal, par respect des convenances, nombre d’individus « papillonnants » de nature doivent paraître « constants ». De là des cohabitations qui sont de véritables tortures et des repaires d’hypocrisie domestique. De là un raffinement de bassesse de la part des conjoints s’efforçant de se dissimuler l’un à l’autre leur véritable tempérament, nouant des intrigues qui, pour être menées à bien, exigent le mensonge à l’état permanent. Par suite : abaissement du niveau du caractère, amoindrissement général de la personnalité.
À l’amour esclave, on le sait, les individualistes anarchistes opposent la liberté de l’amour, c’est-à-dire la possibilité, pour chaque être humain, de se déterminer, femme ou homme, individuellement, au point de vue sentimental, sexuel, génital, sans imposer à qui que ce soit son propre déterminisme personnel. C’est l’entière possibilité pour l’unité humaine d’en aimer une ou plusieurs autres (synchroniquement) conformément à son déterminisme particulier. C’est l’absolue faculté de s’associer temporairement ou à titre plus ou moins durable avec un, quelques-uns ou un certain nombre d’êtres humains pour constituer des associations amoureuses volontaires.
En réponse aux critiques ou aux observations des protagonistes du mariage légal ou non légal ; les individualistes ne disent pas que l’association-couple est moralement supérieure ou inférieure à une autre forme d’union sexuelle, la camaraderie amoureuse au communisme sexuel, etc., ils veulent que toutes les formes de relations amoureuses puissent s’expérimenter ou se réaliser, du couple jusqu’à la promiscuité sexuelle, en passant par toute la gamme d’associations amoureuses intermédiaires, la propagande ou le recrutement en faveur de l’une ou l’autre forme d’association ne rencontrant- aucun obstacle. Et cela dans tous les lieux et dans tous les temps.
Mais nos thèses sont trop connues pour m’y étendre. Je voudrais effleurer un sujet qui n’est que rarement traité. Outre les concessions qu’ils font au milieu social, les anarchistes militants se marient. Qu’en penser ? Ma réponse est que nous ne pouvons porter de jugements trop sommaires (à condition d’admettre qu’un « anarchiste » puisse porter « jugement » sur les faits et gestes d’un camarade, alors qu’il n’implique pas acceptation par lui d’une fonction d’autorité) sur telles concessions dont nous ne connaissons pas les motifs ultimes et profonds. Il y a des camarades qui condescendent à la formalité du mariage pour ne pas handicaper les enfants pour .le reste de leur vie, par exemple J’ai connu un compagnon qui s’est marié légalement avec une étrangère pour lui éviter d’être expulsée, alors que son existence dépendait peut-être de son séjour en France ; j’en connais un autre qui n’avait aucune famille et qui résidait souvent en prison : le mariage légal seul pouvait le laisser en relations avec le monde extérieur durant ses villégiatures pénitentiaires. J’en ai connu un troisième qui ne pouvait pratiquer la pluralité amoureuse qu’en acceptant l’union légale avec sa compagne habituelle, faute de quoi elle eût immanquablement perdu sa situation et le camarade dont il s’agit n’était pas en état de lui en procurer une autre. Je pourrais multiplier les exemples.
Et alors ? La ou le camarade qui font cette concession restent, selon moi, des camarades dès lors qu’ils ne la nous présentent pas comme une réalisation d’ordre anarchiste et qu’ils ne la prennent pas au sérieux. C’est ainsi que je m’attends à trouver les anarchistes se trouvant dans ce cas de bien plus énergiques exposants et pratiquants de la liberté de l’amour que les autres. Mon choix est fait : entre un union-libriste jaloux et exclusif et un camarade marié qui n’est ni l’un ni l’autre, c’est ce dernier qui m’apparaît le plus individualiste anarchiste des deux, puisqu’il n’admet pas que sa compagne soit sa propriété. Et vice versa, bien entendu.
— E. Armand
MARINE
n. f. (du lat. mare, mer)
Art. de la navigation sur mer. Ensemble des bâtiments grands et petits d’une nation.
Les premiers essais de navigation semblent avoir été faits par les Atlantes 3.000 ans environ avant J.-C., ils remontèrent tout le long des côtes et parvinrent, même jusqu’en Asie. Certains prétendent même, se basant sur les écrits d’historiens grecs, que chez eux, dans les ports, de petits bateaux se dirigeaient sans pilote comme sans rameurs, c’est ce qui donne corps à la croyance que les Atlantes connaissaient l’électricité et savaient employer les ondes.
Les Grecs ne commencèrent à s’aventurer sur mer que vers l’an 2700 avant J,-C. mais, ce n’est en réalité que vers l’an 600 avant J.-C. que la marine prit de l’importance par l’apparition des galères, lesquelles étaient actionnées par des équipes de rameurs, qui s’aventuraient sur mer, pour aller faire du commerce avec les autres continents et se battre à l’occasion ; c’est de cette façon que les Phéniciens fondèrent Carthage.
Le premier bateau qui surpassa toutes les galères établies jusqu’à ce jour fut construit 215 ans avant J.-C. sur l’ordre de Hérion II, roi de Syracuse, qui le destinait au transport des blés. Archius de Corinthe, en dressa les plans et Archimède lui-même assura la direction supérieure des travaux. Un certain Maschien, historien, raconte que ce bateau absorba plus de sapins qu’il n’en eût fallu pour construire une flotte de 60 galères, trois cents charpentiers travaillèrent sans cesse à la construction de ce monstrueux édifice qui fût nommé Alexandrin.
L’Alexandrin était un navire à voiles, mais surtout à rames, on lui donna trois ponts étagés l’un au-dessus de l’autre. Le pont supérieur restait libre ; l’on y fit asseoir les rameurs : le navire d’Archius était un navire à vingt rangs de rames.
Comme tous les bateaux de cette époque qui servirent en même temps pour le commerce et pour la guerre, la défense de l’Alexandrin était assurée par des tours dans lesquelles étaient placées des lithoboles qui lançaient à la distance de près d’une encablure des pierres du poids d’environ cent kilos. En cas de voie d’eau, la vis sans fin, inventée par Archimède, intervenait sur l’heure pour élever l’eau introduite dans la cale. Le navire était muni de quatre ancres en bois et de huit en fer ; son premier voyage eut lieu de Syracuse à Alexandrie.
Peu de temps après, Ptolémée Philopala enchérissait encore sur la tentative hardie d’Archimède et d’Archius en faisant mettre en chantier un navire dont le mouvement était imprimé par quatre mille rameurs. Les dimensions du navire sont les suivantes : longueur du pont 130 mètres ; largeur 18 mètres ; 26 hommes tirent sur chaque aviron, lequel dépasse 17 mètres de long. L’équipage se compose de 400 matelots qui manœuvrent les voiles et les ancres et de deux mille huit cent cinquante épibates qui n’auront qu’à se préoccuper du combat, plus une troupe considérable occupée à tirer les vivres de la cale pour les distribuer aux rameurs, soit en tout un équipage de plus de huit mille hommes.
C’est à cette époque que les Égyptiens construisirent les premiers bassins de radoub.
Soixante ans plus tard, les Romains et les Gaulois se livraient un combat à Vannes qui s’appelait Vénète, sur des galères primitives.
Pendant des siècles, les moyens d’attaque et de défense des bateaux à distance ne se composèrent que de lithobole et des feux grégeois (ces feux inventés par des moines byzantins au VIème siècle avaient un effet terrible et l’eau n’avait comme pouvoir que d’en augmenter l’activité). Ce n’est que vers l’an 1515 que les navires furent armés de canons de bronze et de fer lançant des boulets.
Vers 1800, toutes les marines marchaient à la voile, ce n’est que vers 1844 que la vapeur fût appliquée à la marine militaire sur une grande échelle : bateaux à roues d’abord, comme l’on peut encore en voir quelques-uns dans le port de Malte ; puis la roue fut abandonnée pour faire place à l’hélice.
En 1860, Dupuy de Lôme construisit le premier bateau cuirassé blindé. Ce navire était terminé à lavant par un très fort éperon qui devait, à l’abordage, couper en deux les bateaux en bois existant à l’époque.
Peu à peu les ingénieurs modifièrent la forme et la puissance pour arriver au type Liberté, cuirassé d’escadre de 14.868 tonnes ; ce dernier fut détruit en rade de Toulon par une explosion qui se produisit le 25 septembre 1911, ensevelissant avec le navire environ 400 victimes.
Enfin, pendant la guerre 1914–1918 une nouvelle série dite « cuirassé d’escadre dreadnought » fut mise en service. Les unités du type Paris mesurent 165 mètres de long, 27 de large, jaugent 23.500 tonnes ; la puissance motrice de 26.200 chevaux est donnée par deux turbines ; la vitesse est de 20 nœuds, l’armement de 12 canons de 305 millim., 22 cartons de 140 millim. et 4 tubes lance-torpilles sous-marins.
L’équipage se compose de 1.200 hommes ; le service du bord, affecte l’activité d’une petite ville, avec ateliers, boulangeries, prisons, etc. La vie y est extrêmement pénible, la discipline stupide et rigoureuse ; ajoutez à cela la mauvaise nourriture, et vous saurez pourquoi presque toujours une révolution commence par la révolte des marins.
Ces formidables forteresses, sur lesquelles comptaient les militaristes jusqu’au-boutistes pour écraser l’ennemi, firent preuve d’une impuissance totale, étant à la merci des torpilleurs, petits bâtiments légers, dont les plus grands atteignent environ 100 mètres, et principalement des sous-marins dont la dimension varie entre 30 et 100 mètres et l’équipage entre 12 et 80 hommes. Ces petits bâtiments naviguent en surface et plongent pour attaquer l’adversaire ; ils se dirigent en plongée au moyen du périscope ; une seule torpille lancée au bon endroit suffit pour anéantir un cuirassé moderne et les millions qu’il représente et engloutir tout l’équipage.
Certains affectent de voir dans les progrès réalisés tant dans la construction des bateaux, que dans leur vitesse et armement, le triomphe de la science domptant les éléments. Quoique ce raisonnement soit exact dans une certaine mesure, ce qu’il faut surtout retenir, c’est, comme toujours, le fait que les découvertes de la science sont utilisées ici au seul service de la malfaisance et de la destruction, la marine de guerre n’ayant d’autre rôle que de porter au loin l’asservissement, la misère et la mort aux peuples faibles, qui ne demandent qu’à conserver leur indépendance. La colonisation, en attendant les guerres d’envergure, est le champ « pacifique » d’activité des ruineux monstres marins.
La marine marchande est ainsi dénommée parce qu’elle sert au transport des marchandises en même temps que des passagers. Elle englobe tous les bâtiments, petits et grands, se livrant au commerce, depuis les petits voiliers caboteurs (ne s’éloignant guère des côtes) jusqu’à leurs grands frères : les voiliers, à 5 mâts qui se font de plus en plus rares.
Une autre catégorie désignée à part sous le nom de bateaux de pêche, comprend les petits voiliers avec trois ou quatre hommes et aussi les Terre-Neuvas, beaucoup plus importante, qui partent chaque année pêcher la morue à Terre-Neuve, et les chalutiers à vapeur se livrant à différentes pêches.
Enfin les bateaux à vapeur qui sillonnent les mers en tous sens, depuis le cargo-boat de 100 mètres environ affecté au transport du charbon et du pétrole jusqu’aux grands bâtiments mixtes qui transportent marchandises et passagers, et dont certains, comme Le Foucault, atteignent 150 mètres de long, 18 mètres de large, déplacent 14.624 tonneaux, comportent 195 hommes d’équipage, et possèdent une force motrice de 6.900 chevaux et deux hélices actionnées par deux machines à triple expansion.
Nous arrivons enfin aux super transatlantiques, genre Lutetia, qui effectuent les grandes traversées. Un tel bâtiment mesure 217 m. 50 de long sur 28 mètres de large. Le tonnage est de 39.900 tonnes. La force motrice propulsée au moyen de turbines à vapeur atteint 52.400 chevaux et permet une vitesse de 23 nœuds. On vient de lancer le super-paquebot Atlantique, destiné au service Bordeaux-Buenos-Aires, qui mesure 225 mètres de long.
Le luxe réalisé à bord pour l’agrément des riches passagers est inouï. L’on y trouve des jardins d’hivers, des salles de jeux, concerts, dancings, des courts de tennis, des appartements et des salons d’un confort aussi élégant que les plus opulents hôtels particuliers.
En nous reportant au premier bateau construit par Archimède, 215 ans avant J.-C., nous voyons que les dimensions sont restées sensiblement les mêmes ; par contre la vapeur a remplacé la voile, décuplant ainsi la vitesse et rapprochant de ce fait les continents.
Si nous envisageons la peine des hommes, nous constatons que peu de chose a été fait pour diminuer leurs souffrances. Autrefois, ils tiraient sur l’aviron, pendant que les maîtres se prélassaient sur le pont dans la contemplation des étoiles ou recevaient les baisers des femmes. Aujourd’hui, pendant qu’au son du jazz, les épidermes se frôlent et que les lèvres s’humectent dans l’étreinte et la possession, tout au fond de cette ville flottante, les soutiers enfouis dans les cales étouffantes et armés d’une pelle amènent sans trêve le charbon que les chauffeurs précipitent sans arrêt, dans la gueule des immenses chaudières qui produisent la vapeur pour actionner machines et turbines. Ces hommes sont nus, couverts de sueur ; la poussière de charbon vient se coller sur leur corps ; ils sont plus noirs que des Africains. Ce travail si pénible et malsain est, selon la coutume, mal rétribué et ceux qui l’accomplissent méritent bien le nom de modernes forçats de la mer.
‒ Georges CHÉRON.
MARQUE
s. f. (de l’allemand mark)
Empreinte, signe qui sert à faire reconnaître une personne ou une chose. C’est ainsi qu’on dit : la marque d’une vaisselle, la marque du linge, la marque de fabrique, etc. L’instrument avec lequel on établit l’empreinte ou le signe porte aussi le nom de marque. L’impression qui se faisait au fer chaud sur l’épaule d’un condamné constituait une marque. La trace que laisse sur un corps une blessure, une éruption, une lésion est une marque. Le morceau de bois dont se sert le boulanger et sur lequel il fait une coche quand il livre du pain à crédit à un client s’appelle marque. Le jeton, la fiche dont on se sert au jeu, prend aussi le nom de marque. Au figuré, l’indice, le présage, de même la preuve, le témoignage sont autant de marques différentes.
‒ E. S.
MARTYR
n. m. (mot latin, formé du grec martus, témoin)
Martyrs, frères d’idéal, et vous pauvres esclaves qui, en Jésus, aviez salué le libérateur d’outre-tombe, et vous, nobles esprits qu’une Église sanguinaire mura dans des cachots ou étouffa sur des bûchers, et vous, leurs héritiers, semeurs de vérité, apôtres de l’amour, que la justice moderne condamne au bagne ou à la chaise d’électrocution, vous qui, à toute époque et dans toute région, avez souffert dans votre corps pour témoigner de votre foi, soyez bénis pour la sublime leçon que vous donnez aux hommes ! Devant la phalange des éternels crucifiés, des victimes innombrables, des anonymes comme de celles dont l’histoire a retenu le nom, combien mesquines nos vanités et fades nos plaisirs ! Comme s’effacent aussi les divergences d’idées, pour laisser place à une suprême admiration ! Irrécusable preuve de la fragilité de tous les programmes, mais qui démontre qu’à travers des doctrines éphémères, des formes transitoires circule un même souffle de vie, une sève génératrice de fleurs et de fruits sans cesse renouvelés.
Un besoin d’évasion, un élan vers l’idéal supérieur à la réalité présente, la nostalgie d’un futur qui demande à naître, voilà l’onde jaillissante dont boiront les héros de l’avenir comme y burent leurs frères du passé. Et son enivrante douceur toujours captivera les insatisfaits, cœurs ou cerveaux de flamme, que la société tue avant de les adorer, généralement. Ne sont-ils pas les trouble-fête, les contempteurs-nés de l’ordre établi ; et les princes, de ce monde, de Néron à Hoover ou Poincaré, sont restés les mêmes : ils aiment et défendent un présent qui leur vaut de commander. Mais un obscur frisson, une secrète angoisse saisissent souvent les foules devant l’homme enchaîné pour sa foi ; si, en tuant les corps, on tue parfois les idées, il arrive que la terre fécondée par le sang des martyrs porte des moissons inattendues. Aux dieux souffrants, à l’ Orphée des grecs, à l’Osiris des bords du Nil, l’affection des âmes ne manqua jamais ; et c’est l’universelle douleur qui devait assurer le triomphe du crucifié du Golgotha. Un Socrate, un Mani, un Jean Huss, une Jeanne D’arc furent grandis infiniment par le supplice ; bientôt les rejoindront dans la région des surhumains ces douces victimes : les Ferrer, les Vanzetti et les Sacco. Parmi les simples, étrangers à l’art du gouvernement, quel cœur resterait insensible, quels yeux ne deviendraient humides devant ces témoins du sang ; et ne surpassaient-ils pas la commune mesure ceux dont la volonté ne fléchit point au milieu des tourments, les couronnés d’épines, les flagellés de tous les temps ! Si nouvelle, si bafouée soit-elle une doctrine est quasi invincible lorsqu’elle rend fort, même devant le bourreau. Le christianisme, aujourd’hui persécuteur, fut tel au début. Aux humbles, aux pauvres, aux misérables à qui le monde antique était si dur, il parlait de fraternité ici-bas et d’éternelles béatitudes pour le lendemain de la mort. À l’esclave, brutalisé par un maître cruel, il donnait l’espérance et une échappée sur un coin du ciel. Sans doute de bonne heure il gagna quelques esprits cultivés et quelques patriciens au cœur généreux, témoin la condamnation du consul Flavius Clemens et de sa femme, sous Domitien, « pour athéisme et mœurs juives », mais ils furent l’exception ; petites gens, esclaves, captifs, hommes et femmes de mauvaise vie, déclassés, visionnaires constituèrent pendant les premiers siècles sa clientèle de prédilection. Ajoutons qu’en matière religieuse les Romains étaient d’une tolérance extrême. Les divinités des pays conquis furent accueillies dans leur panthéon ; elles s’installèrent à côté des dieux et des déesses italiotes sans que personne s’en choquât, plus nombreuses à mesure que la domination romaine s’étendait plus loin. Et les étrangers, qui vivaient sur les rives du Tibre conservaient le culte en usage dans leur pays d’origine ; s’ils s’acquittaient de leurs devoirs envers les dieux nationaux, les citoyens eux-mêmes pouvaient embrasser librement les pratiques rituelles des autres peuples. Sous l’empire, Isis, Mithra et d’autres divinités orientales obtiendront, à Rome, une vogue extraordinaire. Les juifs, avec qui l’opinion confondit longtemps les chrétiens, jouissaient d’une large tolérance ; c’est à l’ombre de la synagogue que grandit l’église son ennemie, et Domitien unira les deux dans une commune réprobation.
Mais le principe fondamental du christianisme s’opposait aux principes fondamentaux de l’État romain. Héritier fidèle, en cela, du vieux Jahvé des hébreux, Christ s’affirmait jaloux, n’admettant point de partage. La religion nouvelle émancipait les consciences de l’autorité impériale ; alors que la conception romaine postulait l’asservissement total de l’individu. On n’était bon citoyen que si l’on adorait Rome elle-même divinisée et sa vivante incarnation, l’empereur, dont temples et statues se dressaient dans toutes les contrées soumises à la puissance romaine. Seules furent persécutées les religions qui refusèrent une place à l’Empereur dans leur Olympe ; le druidisme sera du nombre, aussi le christianisme dont le prosélytisme ardent, fort étranger à l’ancienne synagogue, inquiètera de bonne heure les autorités impériales. D’où les martyrs, ainsi appelés d’un mot grec signifiant témoin ; car le christianisme se recrutait surtout parmi les hommes de condition servile et, pour un esclave, témoigner en justice, ou souffrir c’était tout un, la loi romaine n’admettant son témoignage qu’obtenu par la torture. Les historiens ecclésiastiques ont dressé une liste de dix persécutions : celles de Néron, de Donatien, de Trajan, d’Antoine, de Marc-Aurèle, de Septime-Sévère, de Maximin, de Decius, de Valérien, de Dioclétien. Liste fantaisiste ; le gouvernement central de l’avis des auteurs impartiaux, ne chercha point, par dix fois, à supprimer la religion nouvelle sur l’ensemble du territoire, en recourant à la violence, Néron et Domitien ne sévirent contre les disciples de Jésus, associés aux Juifs, que dans des cas très spéciaux. Trajan, le premier, introduisit dans la loi le crime d’être chrétien. Il écrivait en 112 à Pline le jeune :
« Il ne faut pas rechercher les chrétiens, mais si on les dénonce et qu’ils soient convaincus, il faut les punir. Si toutefois quelqu’un nie être chrétien et le prouve en suppliant nos dieux, qu’il obtienne son pardon. »
Jusqu’à Décius les directives données par Trajan serviront de règle aux fonctionnaires romains. Les persécutions furent locales et intermittentes, occasionnées par l’intransigeance des chrétiens ou par la haine des populations païennes qui multipliaient les dénonciations.
Faites au hasard des circonstances, elles comportaient des moments d’accalmie et d’autres de violence ; très modérées dans certaines provinces, elles pouvaient, à la même époque, s’avérer fort sanglantes ailleurs. C’est en 250 seulement, sous Décius, que la lutte devint générale contre la nouvelle religion ; le peuple, persuadé que les calamités publiques provenaient de l’impiété des chrétiens, réclamaient leur mort ; les lettrés et les patriciens déploraient l’abandon des antiques traditions nationales. On infligea des tortures effroyables aux contempteurs de la divinité impériale. Après avoir subi le supplice du chevalet et des plaques rougies au feu, un malheureux fut oint de miel et dévoré par les mouches ; sous Dioclétien tous les habitants d’une ville de Phrygie furent brûlés. L’apologiste Lactance écrit :
« Les chrétiens, sans distinction d’âge ni de sexe, étaient condamnés aux flammes ; et comme ils étaient en grand nombre, on ne les livrait plus isolément au supplice, mais on les entassait sur les bûchers. Les esclaves étaient jetés à la mer avec des pierres au cou ; la persécution n’épargnait personne. »
Mais l’inutilité de cette lutte tardive apparut bientôt ; et l’ambitieux Constantin s’appuiera peu après, sur l’Église pour obtenir le pouvoir souverain. Les auteurs ecclésiastiques ont d’ailleurs singulièrement exagéré le nombre des martyrs ; beaucoup de ceux qu’on inscrivit au catalogue des saints n’ont jamais existé ; et les plus belles légendes concernant les confesseurs de la foi furent inventées de toute pièce par des dévots peu scrupuleux. Afin de multiplier les reliques, dont les fidèles étaient friands, certains papes baptisèrent corps de martyrs tous les squelettes extraits des catacombes ou même des vieux cimetières romains. On poussa l’impudeur jusqu’à garnir les châsses de rondelles d’os de chiens. Des prêtres modernes Duchesne, Ulysse Chevalier, etc., ont eu le courage de reconnaître combien l’Église s’était fourvoyée en matière de reliques, de légendes pieuses, de canonisation, d’apostolicité des églises, etc. ; naturellement, les évêques contraignirent au silence ceux dont le courage n’était pas à la hauteur de l’esprit. Mais Houtin et quelques autres, amoureux surtout de vérité, refusèrent de pactiser avec les profitables mensonges chers à leurs confrères du clergé.
Rappelons aussi qu’au dire des apologistes, une preuve de la divinité du catholicisme résulte de la rapidité de sa diffusion. Or au troisième siècle de notre ère le paganisme était plein de vigueur ; beaucoup plus miraculeuse, puisque beaucoup plus rapide, devrait nous apparaître la diffusion de la religion musulmane ou du protestantisme. En réalité les progrès du christianisme furent d’une lenteur étonnante, explicable seulement par la résistance des patriotes romains, persuadés que la prospérité de l’empire dépendait du maintien des rites ancestraux. Si la palme du martyre fut cueillie par de nombreux chrétiens, beaucoup d’autres apostasièrent. Ils obtenaient leur pardon à des conditions diverses :
« Que celui qui a succombé après de longues souffrances passe quarante jours en un jeûne rigoureux et en œuvres pieuses, puis qu’il soit admis à la communion ; une année de pénitence pour ceux qui ne souffrirent en rien et prirent la fuite par frayeur. Que celui qui a trompé les persécuteurs par des artifices, soit en achetant des attestations libellées, soit en se substituant des païens, fasse pénitence six mois ; un an s’il s’est substitué des esclaves chrétiens qui sont au pouvoir du Seigneur ; trois ans de pénitence pour les maitres qui ont permis ou commandé à leurs esclaves de sacrifier. Qu’il soit pardonné à ceux qui, après avoir succombé une première fois, retourneront au combat et souffriront avec constance. » (Pierre, évêque d’Alexandrie.)
Des évêques apostats, en assez grand nombre, livrèrent l’Écriture Sainte aux païens pour être brûlée. Un schisme éclata à leur sujet dans l’église d’Afrique à la fin des persécutions, Donatus de Carthage et ses partisans déclaraient nuls et sans effet les sacrements administrés par eux. Saint Augustin combattit les donatistes et, secondé par les édits impériaux, fit admettre que l’efficacité du ministère sacerdotal ne dépendait pas du caractère personnel du ministre.
À peine l’Église cessa-t-elle d’être persécutée qu’elle devint persécutrice à son tour ; le sang de ses martyrs était encore chaud qu’elle commença de répandre celui de ses adversaires. Et sa cruauté, croissant avec sa puissance, finit par dépasser de beaucoup celle des empereurs romains. Si Constantin ménagea au début la vieille religion nationale, il jeta le masque après la
mort de son collègue Licinius qui régnait en Orient. Lui-même ne reçut le baptême que sur son lit de mort, mais il manifesta ouvertement son mépris pour les anciens dieux, encouragea les conversions, écarta les païens des fonctions publiques et se déclara partout le protecteur de l’Église. Il disait aux Pères du concile de Nicée :
« Moi aussi, je suis évêque ; vous êtes évêques pour les choses qui se font au-dedans de l’Église ; et moi, Dieu m’a institué comme un évêque pour les choses du dehors. »
Ses successeurs iront plus loin : deux lois de Théodose, quatre d’Honorius fermeront les temples, supprimeront leurs revenus, interdiront les sacrifices, édictant la peine de mort pour fait de religion. En 385, l’évêque espagnol Priscillien sera exécuté, pour crime d’hérésie, avec six de ses principaux partisans.
Saint Jérôme, saint Augustin feront appel au bras séculier ; et le pape Léon Ier proclamera en 447, qu’il est juste et bon d’ôter la vie aux hérésiarques. Doctrine abominable que l’Église ne répudiera jamais et qui fit des milliers et des milliers de martyrs surtout au moyen-âge. La violence entrera si bien dans les mœurs chrétiennes qu’un Charlemagne contraindra les Saxons à choisir entre la mort et le baptême, en massacrant d’un coup plus de 4.000. Les ducs de Pologne procèderont de même à l’égard des Vendes, les Chevaliers Teutoniques à l’égard des Prussiens, les Chevaliers Porte-glaive à l’égard des païens de Lituanie, de Livonie et de Courlande. Toujours et partout, dès qu’elle fut maîtresse, l’Église se montra implacable contre ses adversaires. On sait à quelles horreurs aboutit la croisade prêchée par Innocent III, en 1208, contre les Albigeois. Durant une vingtaine d’années, de pieux catholiques, encouragés par les légats pontificaux, pillèrent des villes florissantes, tuèrent par le glaive ou la flamme des multitudes d’innocents ; sans parler des malheureux que l’Inquisition laissa pourrir dans ses geôles, jusqu’à leur mort. Les Vaudois, coupables de lire l’Écriture Sainte malgré la défense du Pape et de mettre en pratique les conseils évangéliques, furent également brulés par centaines. En 1663 et 1687 le très chrétien Louis XIV ranimera contre eux les anciennes persécutions : ils s’indignaient de voir l’Église si riche alors que Jésus fut si pauvre, crime de tous le plus impardonnable aux yeux du clergé. Jean Huss et Savonarole, pour avoir dénoncé des abus criants subirent aussi le supplice du feu. Que dire des innombrables martyrs faits par l’Inquisition et des raffinements de torture qu’elle infligea à ses victimes ! (voir inquisition, massacres, tortures, etc.). Heureusement, pour le protestantisme, cette sinistre institution avait perdu de sa force au XVIème siècle, dans les pays germaniques. La Saint-Barthélémy en France, les massacres du duc d’Albe dans les Pays-Bas, les atrocités de l’Inquisition Espagnole attestent pourtant que l’Église catholique affectionnait toujours la violence. Luther, de son côté, poussa au meurtre des paysans anabaptistes qui proclamaient les hommes égaux ; et le supplice de Servet donne une piètre idée de la tolérance de Calvin.
Entre protestants et catholiques la lutte continua pendant les XVIIème et XVIIIème siècles ; depuis, la réconciliation s’est faite sur le dos des incroyants, leurs communs ennemis. Contre les penseurs libres, contre les hommes irréligieux ils sont d’accord aujourd’hui. Si les moines espagnols furent les meurtriers de Ferrer les Puritains d’Amérique ont conduit à la mort Sacco et Vanzetti. C’est parmi les adversaires des religions et des lois que se recrutent, à notre époque, les vrais successeurs des premiers martyrs chrétiens.
‒ L. BARBEDETTE.
MARXISME (POINT DE VUE COMMUNISTE-SOCIALISTE)
‒. m. (Doctrine de Karl Marx)
Le socialisme est tour a tour, selon le point de vue d’où on l’embrasse, action et idée, mouvement pratique et conception doctrinale. Action de masses, mouvement pratique, il consiste essentiellement dans la lutte de classe, menée contre la bourgeoisie capitaliste par le prolétariat ouvrier. Aussi ancienne que le régime capitaliste, la lutte de classe est à l’origine, trouble, confuse et faible. Mais elle gagne avec les années en force, en étendue et en conscience. Elle sait aujourd’hui où elle va et qu’elle ne se terminera que par une transformation sociale profonde, caractérisée par l’abolition des classes et par l’avènement d’un mode socialiste de production, et de propriété.
La lutte de classe revêt des formes multiples et changeantes : offensives ou défensives, positives ou négatives, réformatrices ou révolutionnaires, selon les circonstances et la force respective des classes en conflit. Propagande orale et propagande écrite, agitation par la presse, les meetings ou les manifestations de masse, organisation politique, syndicale, coopérative et culturelle du prolétariat, limitation de l’exploitation capitaliste par la grève et par la législation du travail, lutte contre les partis bourgeois, effort continu pour améliorer les positions des travailleurs et affaiblir d’autant celles de la bourgeoisie, opposition résolue à l’impérialisme, au colonialisme et à la guerre, ‒tout cela (et nous en passons) constitue le socialisme en tant que mouvement pratique ; tout cela fait le fond de la lutte de classe, tout cela a pour but le renversement du pouvoir de la bourgeoisie et son remplacement par le pouvoir révolutionnaire des masses travailleuses.
Le mouvement socialiste ainsi défini s’appuie sur un programme. Mais ce programme n’est pas le fruit de l’arbitraire ou du caprice : il plonge ses racines dans des conceptions doctrinales marquées, si l’on peut dire, d’un sceau de permanence. Il se peut que, dans le détail, de pays à pays, les programmes socialistes ou syndicaux présentent certaines différences, tous les pays, tous les prolétariats n’ayant point marché du même pas. Au contraire, les conceptions doctrinales, l’ensemble d’idées théoriques dont les programmes se nourrissent et s’inspirent, et qui les sauvent de l’empirisme, sont parvenus partout, au cours du dernier demi-siècle, à une sorte d’unité substantielle et de fixité.
Cet ensemble de conceptions doctrinales, c’est le marxisme.
Le marxisme, philosophie du socialisme.‒Après avoir éliminé peu à peu, dans le mouvement ouvrier, toutes les conceptions antérieures (utopisme des grands précurseurs, démocratisme et romantisme révolutionnaires des « hommes de 1848 », mutualisme de Proudhon si timide sous ses formules retentissantes, sans oublier le blanquisme et sa pratique des coups de main, ni le bakouninisme participant à la fois de l’anarchie proudhonienne et du blanquisme autoritaire), le marxisme s’est imposé dans tous les pays où sévit l’exploitation capitaliste. Il est la chair et le sang de tous les programmes socialistes ‒et même, avec certaines adjonctions léninistes dont l’avenir vérifiera le degré de validité, de tous les programmes communistes du monde. Il n’est pas jusqu’aux anarchistes qui n’en aient subi l’influence, tout anarchiste qui reconnaît la lutte de classe étant, qu’il le veuille ou non, marxiste au moins sur ce point-là.
Le marxisme n’est autre chose que le soubassement théorique du mouvement socialiste. Il en est, pourrait-on dire, la philosophie. Il est le socialisme en tant que sociologie, le socialisme à l’état pur.
Par dessus les distinctions de temps et de lieu, il confère au mouvement socialiste, dans toutes les parties du monde, un caractère saisissant de continuité, d’unité profonde, d’universalité. Non seulement il a fini par prévaloir sur les systèmes qui l’avaient devancé, mais il a merveilleusement résisté aux nombreux assauts que le révisionnisme(Bernstein vers 1898–1900, Sorel de 1904 à 1908, De Man depuis la guerre) a dirigés contre lui, avec des points de départ et d’arrivée d’ailleurs assez différents.
Chose curieuse : il n’existe pas, du marxisme, un exposé d’ensemble, du moins pour la propagande populaire. Ni Marx, ni Engels (sauf ce dernier, dans l’Antidühring, gros livre d’accès difficile) n’ont jugé nécessaire de codifier leurs vues sociologiques. Les éléments du marxisme se trouvent disséminés un peu partout. La difficulté est de rassembler ces notions éparses, de les classer et de les mettre en ordre sans en trahir la lettre ni l’esprit.
Le marxisme n’est pas apparu brusquement à la façon d’un météore. Sa genèse, d’ailleurs parfaitement connue, n’a rien eu de spontané, et Marx n’a jamais dissimulé tout ce qu’il devait aux grands courants philosophiques et sociaux où s’est formé son esprit. Le marxisme est un produit complexe. Il est sorti par voie de développement, de correction ou de rupture, de la philosophie allemande, du socialisme français et du mouvement ouvrier anglais.
La philosophie allemande, nommément celle de Hegel, lui a fourni sa conception dialectique de la nature et de la société. Le socialisme français, lui-même fils de la Révolution française, lui a transmis la notion du but à atteindre, pour ne pas dire de « l’idéal à réaliser » ; ce but, c’est le communisme. Le mouvement ouvrier anglais (trade-unionisme, chartisme), né au-delà de la Manche de la grande industrie capitaliste, l’a initié pratiquement à la lutte de classe.
À ces trois grandes sources, on pourrait en ajouter une quatrième : l’économie politique classique (Smith et surtout Ricardo). À l’étude de celle-ci Marx et Engels n’ont cessé de s’appliquer du jour où, s’étant rendu compte de l’impuissance de la philosophie, de la religion et du droit à expliquer le monde humain, il se sont avisés que la clé de tout mouvement social, de tout développement historique, ne pouvait être donnée que par la science, si mystérieuse encore, de la production et de l’échange des richesses.
L’œuvre de Marx et d’Engels a consisté à lier en un système compact tous ces matériaux divers. Ces deux jeunes Allemands, nés l’un et l’autre en Rhénanie (où l’influence de la Révolution française était demeurée très vive) avaient 25 et 23 ans lorsqu’ils se virent pour la première fois à Paris, en 1843 et purent y constater « l’admirable et fortuite coïncidence de leurs idées » (Andler). Tous deux d’origine bourgeoise (Marx fils d’un juriste de Trèves, Engels d’un industriel de Barmen) ; tous deux nourris de philosophie hégelienne ; tous deux se rattachant aux tendances les plus radicales de la pensée et de l’action ; tous deux également décidés à arracher le socialisme naissant à la fragilité de l’empirisme, comme aux mirages de l’utopie, à le pourvoir d’une base doctrinale solide comme l’airain.
Dans cette vue ils se mirent à l’œuvre. L’élaboration du marxisme dans ses parties maîtresses leur demanda quatre ou cinq ans (1843–1848).
La source la plus ancienne du marxisme, son vrai point de départ, c’est Hegel et l’hégélianisme qui les ont fournis. Faire tenir ici, un aperçu de cette prestigieuse philosophie qui bouleversa jadis toutes les têtes allemandes est assurément impossible. Contentons-nous de fixer quelques points essentiels. Tandis qu’auparavant, la philosophie avait tenté d’expliquer un monde immobile (elle n’en concevait pas d’autre), Hegel conçoit et explique un monde en mouvement. « Ce qui est est, ce qui est demeure » aurait pu dire l’ancienne philosophie, toujours à la poursuite de vérités immuables. « Ce qui est aujourd’hui n’était pas hier, et ne sera plus demain », eût pu répondre la philosophie nouvelle ; rien n’est, mais tout devient. À la philosophie de l’Être, Hegel oppose celle du Devenir.
« La véritable grandeur et le, caractère révolutionnaire de la philosophie hégélienne consistent en ce qu’elle bat en brèche, une fois pour toutes, la prétention à une validité définitive de toutes les créations de la pensée et de l’action humaine. » (Engels)
Tout coule, on ne descend jamais deux fois le même fleuve, avait proclamé cinq siècles avant notre ère Héraclite d’Ephèse. Tout passe, répète Hegel vingt-trois siècles plus tard ; cet univers où l’on n’a vu longtemps que du définitif, n’offre que du transitoire. Le monde donne le spectacle d’une immense accumulation de processus, où rien n’est éternel hormis cette loi d’incessante mobilité qui courbe sous elle tout ce qui a été, est et sera, qui condamne irrévocablement à périr tout ce qui est né, tout ce qui naîtra.
Tout phénomène peut-être considéré comme le théâtre d’un combat entre deux éléments contradictoires : l’un conservateur ‒l’affirmation ou, comme disait Hegel, la thèse : l’autre révolutionnaire ‒la négation, l’antithèse. Ce combat se termine finalement par la négation de la négation, la synthèse, en quoi fusionnent, en se modifiant, les deux principes contradictoires et qui, à son tour, deviendra le théâtre du même duel acharné, condition nécessaire de tout développement et de tout progrès.
Avant de pousser plus avant, il convient d’observer que le monde de Hegel n’est pas du tout celui que le sens commun se représente. Celui du sens commun est un monde matériel, et, de ce monde matériel, les idées que s’en fait notre esprit par l’entremise de nos sens, n’offrent que le reflet et l’image. Le monde de Hegel, au rebours, est, si l’on peut dire, une création, une projection, une extériorisation de l’Idée, élément primitif et facteur essentiel. Au cours de son « auto-évolution », l’Idée crée le monde, le monde naturel comme le monde humain, c’est-à-dire que la Nature, la Pensée et l’Histoire se trouvent n’être en fin de compte que des réalisations successives et progressives de cette Idée absolue, laquelle « a existé on ne sait où, de toute éternité, indépendamment du monde et antérieurement au monde » (Engels). Inutile d’en dire plus : dans cette Idée préexistante à tout et créatrice de tout, on reconnaît le bon vieux Dieu des religions et des Églises dont elle n’est que le prête-nom philosophique. « Au commencement était le Verbe », dit l’Évangéliste. L’Idée hégélienne, qu’est-elle d’autre que le Verbe biblique ? L’Idéalisme philosophique a trouvé dans le philosophe berlinois le dernier, le plus impérieux, le plus absolu de ses grands prêtres.
L’hégélianisme ne survécut pas longtemps à Hegel (mort en 1831), du moins dans la forme que celui-ci lui avait donnée. Les représentants de ce qu’on appela la gauche hégélienne(Strauss, Bauer, Stirner et surtout Feuerbach) se chargèrent de le mettre en pièces. Tandis que les disciples orthodoxes glissaient doucement vers le spiritualisme et le conformisme religieux, et que le centre s’efforçait de tenir la balance égale entre la droite et la gauche, cette dernière, Feuerbach en tête, évoluait rapidement vers le matérialisme. Il est vrai qu’elle n’alla pas jusqu’au bout. Après s’être attaqué à la religion, ce qui était moins dangereux que de s’en prendre à l’État, après avoir démontré qu’il n’existe rien en dehors de la nature et de l’homme, et que Dieu n’est qu’un produit de notre imagination, Feuerbach s’arrêta là, comme à bout de souffle. On le vit aboutir à une sorte de divinisation de l’homme ‒et de quel homme abstrait, intemporel, irréel ! ‒et se faire le champion d’une morale d’amour universel aussi impuissante que celle de l’impératif kantien et beaucoup plus fade.
Il appartenait à Marx d’en finir une fois pour toutes avec toute espèce d’idéalisme. Renversant l’ordre des valeurs dressé par le vieil Hegel, il affirma l’antériorité de la Matière et sa souveraineté dans le domaine de la Nature. « Pour moi, écrira-t-il plus tard, le monde des idées n’est que le monde matériel transposé et traduit dans l’esprit humain. » Puis de ce matérialisme restauré, il tira, dans le domaine de l’Histoire, des conséquences que n’avaient pas entrevues, même en rêve, nos matérialistes du XVIIIème siècle, ‒conséquences révolutionnaires entre toutes et dont la fécondité scientifique ne sera pas de sitôt épuisée.
Mais revenons sur nos pas. Nous avons vu que l’hégélianisme, philosophie du Devenir, conçoit le monde non pas comme immobile, mais comme sujet à d’incessantes métamorphoses, à de perpétuels changements.
L’union de l’idéalisme ‒ qui nie la Matière ou, tout au moins, la subordonne à l’Idée ‒ et de la dialectique ‒ qui affirme le mouvement, l’évolution, le devenir, ‒ voilà la grande nouveauté de l’hégélianisme. Or, lorsque Marx, jetant par dessus bord l’élément idéaliste de cette philosophie, se fut résolu « à concevoir le monde réel ‒ la nature et l’histoire ‒ comme il se présente de lui-même à qui l’approche sans prévention idéaliste », il se garda bien de toucher à ce qu’il considérait à bon droit comme l’élément révolutionnaire du système : la dialectique. Seulement la dialectique cessa d’être chez lui ce qu’elle avait été chez Hegel : l’auto-développement de l’Idée, se faisant tour à tour nature, conscience humaine, mouvement social ; elle devint la loi générale à laquelle obéit toute réalité, qu’elle soit matière ou esprit, qu’elle fasse l’objet des sciences naturelles ou des sciences sociales. En bref ‒ et pour reprendre son mot célèbre ‒ cette dialectique hégélienne qui jusque-là s’était tenue incongrûment sur la tête, Marx la planta sur ses pieds. Ainsi retournée, la dialectique allait être pour lui et pour Engels, au cours de leur carrière scientifique et révolutionnaire, « leur meilleur instrument de travail et leur arme la plus puissante ».
De même que Hegel avait introduit la dialectique, le mouvement, au sein de l’Idéalisme, Marx, après Feuerbach, mais avec autrement de hardiesse, l’introduisit au sein du Matérialisme. Ainsi équipé le Matérialisme marxiste ne ressemble plus guère à celui du XVIIIème siècle. Celui-ci concevait l’univers sous la forme d’une immense machine admirablement agencée, et réduisait l’homme avec son cerveau, ses volitions et ses idées, au rôle inglorieux d’un rouage. Comment la machine avait-elle pu se constituer ? Jamais l’ancien matérialisme ne parvint à s’en rendre compte ; jamais non plus, il ne parvint à fournir une explication satisfaisante de l’Histoire, laquelle en surplus ne devait naître comme science qu’au début du XIXème siècle.
L’idée fondamentale du matérialisme dialectique celle qui le distingue du matérialisme d’Holbach et d’Helvétius, c’est que le monde doit être conçu « comme un ensemble de processus où les choses qui paraissent stables, ainsi que leurs images cérébrales, les concepts, passent par une transformation ininterrompue du devenir et du périr, où, malgré toute contingence apparente, et malgré tout regret passager, une évolution progressive s’affirme en fin de compte... » (Engels). Cette idée, il ne suffisait pas de l’introduire dans les sciences naturelles, voire de l’appliquer au domaine des sciences religieuses. Dépassant hardiment Feuerbach qui n’avait fait que renverser Dieu de son trône ou, si l’on veut, que transférer le divin du ciel à la terre et de Dieu à I’Homme, Marx entreprit de déloger l’idéalisme de son dernier repaire, les sciences dites « morales et politiques », les sciences de la société humaine, dont l’histoire est la base : il n’en est pas qui offrent plus clairement le spectacle de ce perpétuel changement dont Hegel avait fait la loi de toute chose ; il n’en est pas non plus où le préjugé idéaliste se soit plus longtemps maintenu. Marx aura été le premier à donner de ces sciences, à commencer par l’histoire, une explication radicalement matérialiste.
Conception matérialiste de l’Histoire.‒La lutte de classe.‒Avant Marx, on considérait volontiers l’histoire comme résultant du jeu d’une volonté divine (Providence) ou de l’effort des volontés humaines. On ne doutait pas qu’il ne dût y avoir, derrière l’apparent chaos des événements historiques, une sorte de dessein caché, de but idéal plus ou moins consciemment poursuivi. Pour Bossuet, le but de l’histoire, c’est le triomphe de l’Église et des commandements divins. Pour le XVIIIème siècle incrédule et laïque, c’est le progrès constant des lumières et donc des institutions politiques. Pour Hegel, c’est la réalisation parfaite de l’Idée ; pour les historiens français d’après 1820, c’est la victoire du Tiers sur la féodalité, etc.
Marx nie, bien entendu, que l’histoire poursuive un but providentiel ; elle est, but et moyens, œuvre purement humaine. Les hommes font leur histoire, ne cessera-t-il de dire, et Engels redira :
« Les hommes font leur histoire en poursuivant leurs fins propres consciemment voulues : la résultante de ces nombreuses volontés agissant en sens divers et de leur action sur le monde extérieur, c’est là précisément l’histoire. »
Constater que les hommes eux-mêmes font l’histoire est-ce pourtant expliquer l’histoire ? Reste encore à préciser quelles « forces motrices » se cachent derrière la complexité de ces volontés humaines en action. Si les hommes font leur histoire, ils ne la font ni au gré de leur fantaisie ni dans des conditions de leur choix ; ils la font, au contraire, « dans des conditions qu’ils ont trouvées toutes faites, dans des conditions données, transmises. » (Marx, XVIII Brumaire.)
C’est a découvrir les forces motrices de l’histoire ou, plus exactement, ses facteurs matériels, que Marx employa, tout d’abord, les ressources de sa dialectique matérialiste. De bonne heure, son attention avait été attirée par les luttes qui, depuis un quart de siècle, sur le terrain de la grande industrie en Angleterre, en France et même en Allemagne, mettaient aux prises la bourgeoisie et le prolétariat. Il avait appris, des historiens bourgeois de la Révolution française, à considérer cette dernière comme l’aboutissement d’une longue lutte livrée par la bourgeoisie ascendante à l’aristocratie féodale. À la lumière de ces faits, il lui apparut que toute l’histoire, à l’exception de celle des sociétés primitives, n’était que l’histoire de luttes de classes ; que les classes en lutte sont partout et toujours les produits de l’économie de leur époque ; que par conséquent la structure économique d’une société forme la base sur laquelle repose toute la superstructure des institutions politiques et juridiques, des conceptions religieuses, philosophiques et morales.
« Ainsi l’idéalisme était chassé de son dernier refuge : la science historique ; la base d’une science historique matérialiste était posée ! La route était ouverte qui allait nous conduire à l’explication de la manière de penser des hommes d’une époque donnée par leur manière de vivre, au lieu de vouloir expliquer, comme on l’avait fait jusqu’alors, leur manière de vivre par leur manière de penser. » (Engels)
Et voilà ce que l’on nomme la conception matérialiste de l’histoire. Aux explications antérieures par la volonté humaine ou, ce qui revient au même, par l’individu, elle substitue l’explication par les classes. Mais ces classes, elles aussi, sont soumises à la loi du devenir : elles naissent, grandissent, se heurtent à d’autres classes et finalement dépérissent et meurent : et ces péripéties, au long des siècles, sont le contenu profond de l’histoire. À suivre le développement des classes qui ont laissé un nom, qu’aperçoit-on ? C’est qu’il est dominé, commandé par le développement économique.
Autrement dit, la destinée des classes se lie à celle des modes de production depuis la chasse et la pêche primitives jusqu’à la grande industrie. Le développement de la bourgeoisie s’explique par le mode de production capitaliste, fondé sur la division du travail, l’accumulation du capital, la concentration industrielle. Ce mode de production, dès qu’il apparaît (XVIème siècle), ne tarde pas à entrer en conflit avec le mode de production antérieur, ‒féodal et corporatif. D’où une série de conflagrations violentes (révolutions anglaises du XVIIème siècle, révolution française du XVIIIème siècle), qui renversent féodalité et corporations et, du même coup, la structure politique de l’ancien régime, ainsi que l’idéologie monarchique dont tant de siècles s’étaient nourris. L’avènement de la bourgeoisie consacre la défaite de l’aristocratie féodale. Mais au sein du nouvel état de choses, de nouveaux antagonismes vont inopinément se faire jour. Le mode de production capitaliste, se développant toujours, concentrant au sein des villes tentaculaires des capitaux énormes, va entrer en conflit avec des formes de propriété(Marx, économiste et non juriste, les appelle rapports de production) demeurées immobiles et figées. Des hommes vont naître ‒les prolétaires ‒qui, exploités et opprimés dans leur chair par le mode de production et de propriété, tireront du conflit ses conclusions révolutionnaires et se feront un jour les fossoyeurs de l’ordre établi.
C’est donc le mode de production qui constitue la base ‒l’infrastructure‒de la société et des classes qui la composent. C’est lui qui détermine les formes de propriété, de famille et de pouvoir, bref la superstructure des institutions juridiques ; c’est lui dont l’action se fait sentir, d’une manière plus ou moins saisissante, selon des incidences plus ou moins immédiates, sur les idéologies, les religions et les morales. À ces dernières, les anciens historiens assignaient sur le cours des événements un rôle capital ; la conception matérialiste, elle, les rejette à l’arrière. Leur rôle n’est pas négligeable, mais c’est un rôle de second plan.
Marx a résumé cette doctrine si neuve en quelques phrases lourdes de substance : « C’est dans l’économie politique qu’il faut chercher l’anatomie de la société civile... Le mode de production de la vie matérielle détermine, d’une façon générale, le procès social, politique et intellectuel de la vie. Ce n’est pas la conscience de l’homme qui détermine son existence, mais son existence sociale qui détermine sa conscience. » Si le mode de production restait immobile, tout l’ordre social, politique et intellectuel serait frappé d’immobilité cadavérique. Mais il change, comme tout ce qui est ; il est même en état de perpétuel changement.
« À un certain degré de leur développement, continue Marx, les forces productives de la société sont en contradiction avec les rapports de production qui existent alors, ou, en termes juridiques, avec les rapports de propriété à l’intérieur desquels ces forces productives s’étaient mues jusqu’alors. »
À ce moment qu’arrive-t-il ? Les rapports (ou formes) de propriété deviennent des obstacles à l’expansion des forces productives.
« Alors naît une époque de révolution sociale. Le changement de la base économique ruine plus ou moins rapidement toute l’énorme superstructure. » (Critique de l’Économie politique, préface.)
À prendre ce schéma à la lettre, on risque de s’imaginer que l’homme n’est dans l’histoire qu’un instrument passif, asservi à l’empire d’une sorte de fatalisme économique. Il n’en est rien. Le matérialisme de Marx ne saurait être confondu avec celui du XVIIIème siècle qui faisait de l’homme l’esclave docile des circonstances et du milieu. Dès 1845, à Bruxelles, tandis qu’il élaborait sa conception de l’histoire, il faisait grief à Feuerbach et aux matérialistes antérieurs, d’avoir laissé dans l’ombre le côté humain et actif de la réalité, autrement dit d’avoir perdu de vue l’homme dans la nature. Faute de concevoir l’activité humaine elle-même comme « activité objective », Feuerbach par exemple n’avait pas vu « l’importance de l’activité révolutionnaire pratique-critique. » (Marx s’exprimait alors en jargon hégélien.) Aux doctrinaires matérialistes pour qui les hommes n’étaient que le produit des circonstances et de l’éducation, Marx ripostait : « Ce sont précisément les hommes qui changent les circonstances et l’éducateur doit lui-même être éduqué ! » Aucun des modes de production qui se sont succédé dans l’histoire n’est en effet, tombé du ciel : tous sont œuvres humaines. Si les circonstances changent peu à peu les hommes, il y a de la part des hommes, réciprocité constante. Tout l’effort de l’humanité, depuis des milliers d’années, a consisté à modifier les circonstances et le milieu, à vaincre la nature en la soumettant à l’esprit, à domestiquer l’univers. L’art, la technique, la science en un mot le travail, n’ont pas d’autre but. Encore une fois, les hommes font leur histoire, ce qui ne veut pas dire, tant s’en faut, qu’ils peuvent la taire à leur guise et que leur volonté commande en souveraine.
Non le matérialisme historique n’est pas une école de fatalisme stupide, de résignation et d’inactivité. Il est au contraire ‒et le professeur Andler la bien dit ‒un appel à notre énergie de vivre :
« Il amène une orientation de toute pensée vers la pratique et de toute pratique vers l’organisation réfléchie. »
Il opère la synthèse de la matière et de l’esprit, de l’action et de la pensée, de la pratique et de la théorie. Il opère aussi, comme l’a montré Kautsky, la synthèse des sciences de la nature et des sciences morales, soumises désormais aux mêmes lois. Et comme il n’y a jamais pour lui de résultats définitifs, comme il est essentiellement le matérialisme du devenir, comme il exclut tout dogmatisme et, partant, tout conservatisme, le même Andler a pu dire qu’avec lui a été fondée « la méthode révolutionnaire éternelle ».
Dans la dernière de ses onze Notes sur Feuerbach, qui marquent si curieusement sa rupture avec le matérialisme abstrait et doctrinaire (1845), Marx a écrit :
« Les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde de différentes manières ; or, il importe de le changer. »
En même temps qu’un penseur avide de comprendre le monde Marx était un révolutionnaire avide de le changer. Cherchant à expliquer l’apparition du prolétariat dans l’histoire, il s’était élevé par degrés à une interprétation générale mettant à la base de tout processus historique les compétitions des classes entre elles, leurs luttes acharnées, souvent sanglantes, pour la prééminence et le pouvoir. Quant aux classes, elles-mêmes, il avait discerné, d’une part, qu’elles sont liées, dans leur développement, à des modes de production déterminés ; d’autre part, que leurs compétitions ne font que traduire socialement des collisions inévitables entre un mode de production qui se transforme et des formes de propriété qui restent fixes, ‒entre l’économie et le droit.
En bref, Marx avait découvert que la clé de l’histoire, c’est l’économie qui la donne, ‒ l’économie et non la politique, et non la religion, le droit ni l’idéologie ‒et qu’un bon historien doit avoir, pour bien faire, approfondi l’économie.
Mais encore une fois, il importait moins au Jeune Marx de comprendre le monde que de le changer. Il ne fut pas long à se rendre compte qu’il avait en main, avec le matérialisme historique, une méthode d’action révolutionnaire d’une incalculable portée.
Dans quel état se trouvait le socialisme lorsque Marx et Engels, fuyant l’atmosphère prussienne, se retrouvèrent à Bruxelles en 1845 et commencèrent à échanger leurs vues ? Les écoles, les sectes, les sociétés plus ou moins secrètes pullulaient. Elles n’avaient pas une idée commune. Elles étaient sans prise sur les masses ; l’agitation ouvrière grandissait à leur insu. Le saint-simonisme n’était plus qu’un souvenir, une pièce de musée ; ses disciples s’étaient dispersés. Le fouriérisme, grâce à Considérant, gardait une certaine vigueur, mais n’attirait que des petits bourgeois ; son idéologie compliquée laissait indifférent l’ouvrier. Cabet était autrement populaire, à cause de la simplicité de son communisme sentimental, mais il songeait moins à organiser les prolétaires en parti de classe qu’à réaliser pacifiquement son Icarie. En Angleterre, Owen était depuis longtemps dépassé, mais le mouvement chartiste, tout en offrant l’exemple du premier grand mouvement politique de la classe ouvrière, manquait d’idées doctrinales, ne voyait pas au-delà du suffrage universel. En France et chez les ouvriers allemands disséminés à l’étranger, nombreux étaient les groupements communistes révolutionnaires, mais là encore la doctrine prêtait le flanc, du point de vue de la science, aux plus graves critiques, ‒et les moyens tactiques étaient à l’avenant : Weitling n’avait-il pas imaginé un plan d’attaque consistant à délivrer les criminels des prisons et à les lancer à l’assaut du régime ? Tout prolétariens que fussent ces premiers groupements ‒débris de la Société blanquiste des Saisons ou de la Ligue allemande des Justes, ‒aucun ne semblait se douter de la mission assignée par l’histoire elle-même aux prolétaires en tant que classe, aucun ne croyait encore à l’avenir révolutionnaire du prolétariat et donc à la nécessité de l’organiser et de l’instruire.
Si diverses à tant de titres, ces écoles d’avant 48, ces sectes fermées, ces conspirations impuissantes avaient pourtant deux traits communs : d’abord leur attitude critique à l’endroit de la société bourgeoise, de l’industrialisme et de la concurrence ; puis, le caractère primitif, utopique, de leurs programmes et de leurs méthodes.
En ce qui concerne l’attitude critique, rien à objecter certes, et Marx n’a fait le plus souvent que suivre la voie des précurseurs. Mais il devait écarter sans pitié tout ce qui était inconsistant, illusoire sentimental contraire aux données de la science et de l’économie, en un mot tout ce qui était utopique. « Il fallait démontrer ‒écrira-t-il plus tard, et effectivement il démontra ‒que ce qui était en question, ce n’était pas l’application d’un système utopique quelconque, mais la participation consciente à l’évolution historique de la société qui se passe sous nos yeux ».
Or, l’évolution historique que Marx avait sous les yeux, de quoi était-elle faite ? De la croissance simultanée ‒singulièrement sensible en Angleterre, où Engels avait pu l’analyser à loisir ‒d’un mode de production capitaliste, d’une bourgeoisie maîtresse des instruments de production, et d’un prolétariat salarié. ‒Participer à l’évolution historique « qui se passe sous nos yeux », ce ne pouvait être que participer à la lutte de classe des prolétaires, des salariés, contre le mode de production capitaliste et contre la puissance grandissante de la bourgeoisie, encore renforcée par l’appui que lui prêtait l’État. Et c’est à cette « participation consciente » que Marx appela les communistes révolutionnaires. Abandonnez les sectes, leur dit-il, ces cellules sans air ni lumière sont « étrangères à toute action réelle, à la politique, aux grèves, aux coalitions, bref, à tout mouvement d’ensemble » ; allez au mouvement ouvrier. Le communisme ne sortira pas de l’agitation désordonnée de sectes impulsives, mais d’un mouvement ouvrier porté à sa plus haute puissance ; il sortira de la lutte de classe des prolétaires gagnés à l’idée communiste et devenus, par elle, plus conscients et plus sûrs d’eux-mêmes, mieux organisés et plus forts. Avant tout autre, Marx a deviné que le mouvement ouvrier, si faible encore, portait en lui un nouveau monde ; avant tout autre, il a compris que la société communiste ne serait autre chose que le mouvement ouvrier parvenu ‒après « de longues luttes et toute une série de progrès historiques qui transformeront les circonstances et les hommes » ‒au terme fatidique de son évolution. Lorsque Lassalle s’écriera « Le prolétariat est le roc sur quoi sera bâtie l’Église de l’avenir », il ne fera que reproduire sous une forme oratoire une idée maîtresse du marxisme. (Encore sied-il de ne point prendre à la lettre l’éclatante métaphore de Lassalle, le prolétariat n’étant nullement, dans le processus de l’édification socialiste, un substratum inerte : c’est sur lui, mais c’est aussi par lui, que l’Église de l’avenir (le socialisme) s’élèvera).
Le Manifeste Communiste(1848) eut précisément pour objet d’unir en une synthèse puissante le mouvement ouvrier et le communisme militant, ‒la force et l’idée. Il annonce la mission historique du prolétariat ‒réaliser le communisme, ‒parce qu’il identifie ces deux termes jusque-là séparés : révolution communiste et libération du prolétariat. Bien entendu, cette libération sera l’œuvre du prolétariat lui-même, ainsi que le proclamera plus tard ‒sous la dictée de Marx ‒la première Internationale. Les communistes abandonnés à leurs seules forces y seraient bien impuissants. Ayant à définir dans le Manifeste« la position des communistes par rapport à l’ensemble des prolétaires ». Marx et Engels rabattent sans hésiter communisme et communistes sur le plan du prolétariat, du mouvement prolétarien :
« Les communistes n’ont point d’intérêt qui les séparent de l’ensemble du prolétariat. Ils ne proclament pas de principes distincts sur lesquels ils voudraient modeler le mouvement ouvrier... Pratiquement, ils sont la fraction la plus résolue des partis ouvriers de tous les pays, la fraction qui entraîne toutes les autres ; théoriquement, ils ont sur le reste du prolétariat l’avantage d’une intelligence claire des conditions, de la marche et des fins générales du mouvement prolétarien... Les conceptions théoriques des communistes ne reposent nullement sur des idées, des principes inventés ou découverts par tel ou tel réformateur du monde. Elles ne sont que l’expression globale d’une lutte de classe existante, d’un mouvement historique évoluant de lui-même sous nos yeux. »
Fidèles à la méthode du matérialisme historique, Marx et Engels ont intégré le communisme au prolétariat.
Ainsi donc, partis de la conception matérialiste de l’histoire, Marx et Engels aboutissent, par la lutte de classe prolétarienne, à la révolution sociale. Matérialisme historique, lutte de classe, révolution socialiste, ce sont les éléments fondamentaux de la construction marxiste, ‒ les colonnes du temple. Au point où en est notre analyse, nous savons que les modes de production et les formes sociales qui en résultent « avec nécessité » sont le fondement de l’histoire ; nous savons que cette histoire tout entière est faite de luttes de classes, plébéiens contre patriciens, serfs contre seigneurs, compagnons contre maîtres, tiers-état contre noblesse ; nous savons enfin que le socialisme n’est autre chose que l’expression, dans la conscience moderne, de la lutte de classe du prolétariat contre la bourgeoisie, et que la victoire du prolétariat sera celle du socialisme.
Ce n’est pas là pourtant l’intégralité du marxisme. Il ne pouvait suffire à Marx d’avoir remis sur leurs pieds l’histoire d’abord, le socialisme ensuite. Il ne pouvait lui suffire non plus d’avoir fondé le socialisme sur la base inexpugnable du prolétariat et de la lutte de classe. Il lui restait pour achever sa tâche à porter la main sur le sanctuaire de la science bourgeoise, à renverser les autels dressés au Capital par les grands prêtres de l’Économie politique, à faire place nette en un mot pour le socialisme scientifique qu’il méditait de constituer.
C’est à quoi il s’employa sans relâche lorsqu’en 1849, l’échec des révolutions européennes lui eut fait reprendre le chemin de l’exil.
Avec l’ancien socialisme, les économistes avaient eu vraiment beau jeu. Le caractère fantaisiste de ses constructions en plein ciel, sa méconnaissance de l’histoire, son ignorance des acquisitions les plus sûres de l’économie politique bourgeoise faisaient de lui une cible facile. C’était à qui, dans le monde des tenants de la « science » le criblerait de réfutations en règle ou de sarcasmes altiers. Après 1848, ils crurent si bien le socialisme mort qu’un d’eux s’écria, triomphant :
« Parler de lui, c’est prononcer son oraison funèbre. »
C’est à ce moment que Marx se dressa devant eux, lanière en main. Alors, pour ces messieurs, ce fut fini de rire. Marx allait s’attaquer sans ménagements académiques aux dogmes sophistiqués de la « Science ». Il allait arracher son voile à cette moderne Isis : la production capitaliste, démonter pièce à pièce le mécanisme économique instauré à son profit par le Capital, analyser les antinomies qui déchirent la vieille société et qui, de choc en choc, de crise en crise, finiront par la tuer.
« La chute de la bourgeoisie et la victoire du prolétariat sont également inévitables. »
C’est en ces termes que, dès 1848, le Manifeste annonçait aux prolétaires les destinées de leur classe. Ce n’était qu’une prophétie. Restait à la fonder sur des faits. Marx y consacra près de vingt ans. Le Capital, paru en 1867, formule la loi qui préside au mouvement de la société bourgeoise et, de l’observation de ce mouvement, conclut à la nécessité du socialisme. Le socialisme cesse d’être un rêve de justice sociale ; son avenir est garanti, sa réalisation est certaine : il sortira du développement même de la société capitaliste, en même temps que de la volonté et de la conscience des prolétaires. Pour la classe ouvrière qui souffre, se débat et lutte, quelle force désormais de pouvoir se dire : « Quoi qu’il arrive, l’avenir est à moi, je vaincrai ! » Cette grande force les travailleurs la doivent à Karl Marx.
Le mystère de la production capitaliste (valeur et plus-value). ‒Le Capital est une œuvre gigantesque, puissante, touffue, une forêt de faits et d’idées où il n’est guère prudent de s’aventurer sans guide. Comment résumer en quelques lignes une œuvre de cette envergure ?
Marx se place sur le même terrain que les chefs de l’économie politique classique, les Adam Smith et les Ricardo. Mais où ceux-ci croyaient avoir découvert des lois naturelles inflexibles, il ne voit, lui, que des lois historiques, donc circonstancielles et éphémères. Pas de lois naturelles, mais des lois inhérentes à une société donnée, qui a commencé et qui finira : la société capitaliste, productrice de « valeurs d’échange », de « marchandises ». Marx introduit l’histoire dans le sanctuaire, peuplé d’abstractions, rigides comme des statues, de l’économie classique : et cette initiative hardie constitue à elle seule une révolution scientifique.
De quoi s’agit-il pour Marx ? Il s’agit d’éclaircir le « mystère de la production capitaliste. » Comment le capital est-il venu au monde ? Comment a-t-il grandi, ne cesse-t-il de grandir ? Comment, n’étant que du travail cristallisé, ne cesse-t-il d’asservir, d’exploiter le travail vivant ? Qu’est-ce que le prolétariat ? D’où vient-il ? Où va-t-il ? Quelles sont les perspectives du développement capitaliste ? La domination du capital sera-t-elle éternelle ?
Dans le cours de sa longue recherche, Marx ne fait appel qu’aux lois économiques, jouant avec une nécessité de fer, qui président à l’échange des marchandises. Il part d’une définition de la valeur empruntée en partie aux économistes classiques. La valeur d’une marchandise n’est autre chose que la quantité de travail humain incorporée dans cette marchandise (non de travail individuel, ce qui rendrait toute mensuration impossible, mais de travail socialement nécessaire à une époque donnée, avec des moyens techniques également donnés). Le travail, voilà la substance de la valeur ; le temps de travail socialement nécessaire, en voilà la mesure. Tant il y a de travail inclus dans une marchandise, tant elle vaut.
Ceci étant entendu, comment se forme et s’accumule le capital ? ‒Comment, en d’autres termes, s’enrichit la classe capitaliste ?
L’échange d’une marchandise contre une autre marchandise ne rend pas en soi les échangistes plus riches ; chacun ne fait que céder à l’autre un même nombre d’heures de travail incorporées dans des marchandises différentes (1). Comment se fait-il alors que tout possesseur d’un produit qui l’apporte sur le marché et qui le vend, réalise en fin de compte un enrichissement ?
(1)
En fait on n’échange plus guère une marchandise contre une autre, on l’échange contre de l’argent. Mais pour notre raisonnement, il n’importe : l’argent, en régime d’économie monétaire n’est autre chose qu’un signe représentatif de marchandises, donc d’heures de travail.
C’est que la production d’une marchandise exige non seulement un capital, mais du travail humain ; elle exige des travailleurs. Des travailleurs, en régime capitaliste, ce sont des prolétaires, ‒ hommes qui, n’ayant pour tout bien que leur force de travail, se trouvent, pour subsister, dans l’obligation de la vendre à ceux qui possèdent le capital (les usines, les machines, l’argent accumulé, bref les moyens de production). Or, en régime capitaliste, la force de travail est une marchandise comme une autre, et qui s’échange sur le marché ‒en général contre un salaire en argent ‒selon les mêmes lois que toutes les marchandises : elle s’échange pour ce qu’elle vaut, ni plus ni moins. Sa valeur, comme celle de n’importe qu’elle autre marchandise, est déterminée, mesurée, par le nombre d’heures de travail socialement nécessaires pour la produire : autrement dit, par le nombre d’heures de travail incorporées dans les moyens d’existence (aliments, vêtements, logement, etc.) qui sont nécessaires à la réfection quotidienne de la force de travail de l’ouvrier ; la force de travail d’un ouvrier vaut ce que valent, à une époque et dans un lien donnés, les moyens d’existence nécessaires à cet ouvrier pour maintenir en état sa force de travail, l’activité de ses muscles et de son cerveau.
Or qu’arrive-t-il ? C’est que l’ouvrier qui vend au capitaliste sa force de travail à sa valeur de marché, telle qu’elle vient d’être énoncée (mettons : 4 heures de travail, soit 20 francs) produit dans sa journée de dix heures une valeur toujours supérieure à ce salaire de 20 francs : évaluons-là à 50 francs... La force de travail est en effet la seule marchandise au monde qui, en se consommant, ajoute une valeur nouvelle à une valeur ancienne, crée en un mot de l’excédent. Mais cet excédent, à qui appartient-il ? À l’ouvrier ? Allons donc ! il n’est dû à ce pauvre diable qu’un salaire fixé d’avance... L’excédent appartient au capitaliste, à l’acheteur-consommateur de force de travail.
Cet excédent a nom plus-value. Le temps que l’ouvrier passe en usine, non plus pour gagner de quoi vivre, mais pour enrichir le capitalisme, ce temps de travail non payé se nomme le sur-travail. Plus la journée est longue, plus aussi le travail est intense, et plus le capitaliste empoche de plus-value.
Profit, intérêt, rente, tout cela n’a qu’une source : le sur-travail, le travail non payé, la plus-value.
À l’origine de l’accumulation du capital dans les mains d’une classe, à la base de la société capitaliste et de la civilisation bourgeoise, il y a des milliards et des milliards d’heures de travail non payées, d’heures de travail gratuitement extorquées, pendant des siècles, à des milliards de prolétaires. La richesse de la bourgeoisie est faite, tout simplement, de la misère du prolétariat.
Le voilà donc dévoilé, le mystère de la production capitaliste ! Acheter à sa valeur réelle, soit 4 heures de travail ou 20 francs, la force de travail d’un prolétaire, le faire travailler non pas 4 heures, mais 10, et vendre ensuite ce qu’il a produit dans sa journée à sa valeur réelle, soit 10 heures de travail ou 50 francs, tout le « mystère » est là !
Un semblable régime est un fait historique nécessaire. Un fait conforme à la justice ? C’est une autre question, et qui n’est point, pour un marxiste, la question primordiale. La question primordiale, c’est de savoir si le capitalisme restera nécessaire jusqu’à la fin des temps. Les économistes répondent par l’affirmative au nom de la fameuse « nature des choses », qui ferait du capitalisme comme le couronnement de l’histoire. Tous ne vont pas jusqu’à dire, avec l’inénarrable Thiers, que « la société actuelle reposant sur les bases les plus justes ne saurait être améliorée », mais croyez bien qu’ils le pensent tous. Marx au contraire hausse les épaules et proteste. La nature des choses ? Invention d’après-coup pour la consolidation du fait accompli ; il n’y a pas de lois naturelles, il n’y en a jamais eu ; il n’y a que des lois passagères, des nécessités historiques provisoires, et des sociétés périssables... Cette société bourgeoise où une classe s’exténue de surtravail, tandis que l’autre s’engraisse de plus-value, n’a pas toujours existé, n’existera pas toujours. La bourgeoisie est de date relativement récente. Née à la fin du moyen âge, elle a grandi avec le commerce et l’industrie ; elle a fait dix révolutions à son profit, le XIXème siècle a vu son apogée ; le XXème verra sa fin. Son histoire, Marx la connaît mieux que personne : c’est l’histoire même du Capital, pleine de violences sans nom. Il suit la bourgeoisie dans sa course acharnée à la poursuite de la plus-value, il montre la progression rapide de l’accumulation capitaliste allant de pair avec l’asservissement des travailleurs dépouillés peu à peu de leur instrument de travail, la petite propriété personnelle, et rejetée par masses toujours croissantes dans l’abîme du salariat.
L’historien, dans Marx, dépasse encore, si l’on peut dire, l’économiste. Il a ressuscité en d’admirables pages ‒vraies estampes à la manière noire ‒où l’ironie, le mépris, la colère ont peine à se contenir, ce passé brutal et sanglant. Le Capital, ce sont les Châtiments de la bourgeoisie capitaliste, à qui Marx pourrait dire, ainsi qu’Hugo à Bonaparte :
Mais je tiens le fer rouge et vois ta chair fumer...
Le Capital pourtant n’est pas un pamphlet, c’est une œuvre de science austèrement objective. Mais si Marx analyse en savant, il conclut en révolutionnaire. Après avoir formulé scientifiquement la loi du développement capitaliste et fait voir dans la plus-value la source de l’accumulation, Marx, se tourne vers l’avenir. Où va le capitalisme ? Quel destin lui est réservé ? Il est venu au monde « suant le sang et la boue par tous les pores ». Comment en sortira-t-il un jour, de ce monde spolié, asservi, exploité par lui durant des siècles ? En quatre pages saisissantes, Marx va répondre à cette question ; il va esquisser « la tendance historique » du Capital, telle qu’elle ressort des lois du développement capitaliste même.
Ces quatre pages pourraient s’intituler : Grandeur, décadence et mort du Capital.
Tâchons d’en faire tenir en quelques lignes la substance.
À l’origine du Capital, il y a avant tout « l’expropriation du producteur immédiat, la dissolution de la propriété fondée sur le travail personnel de son possesseur ». En d’autres termes, il y a l’expropriation et la destruction d’une classe nombreuse de petits propriétaires autonomes, de petits producteurs indépendants : artisans, paysans. L’existence de ces petites gens impliquait « le morcellement du sol et l’éparpillement des autres moyens de production. » C’était là l’ancien régime économique, beaucoup plus dédaigné des historiens que l’ancien régime politique : à peine connaissait-il, si même il les connaissait, la concentration, la coopération, la division du travail, le machinisme ; il n’était compatible « qu’avec un état de la production et de la société extrêmement borné ». Mais parvenu peu à peu à un certain niveau de développement technique et social, l’ancien régime économique commence à se nier lui-même.
On voit apparaître en son sein des forces irrésistibles dont le progrès causera plus tard sa mort (ce n’est plus Saturne qui dévore ses enfants, mais les enfants de Saturne qui dévorent leur père !) Les moyens de production individuels donnent naissance à des moyens de production de plus en plus concentrés, et « de la propriété naine du grand nombre » va sortir, merveilleusement équipée, « la propriété colossale de quelques-uns ».
« Cette douloureuse, cette épouvantable expropriation du peuple travailleur, voilà les origines, voilà la genèse du Capital. »
« L’expropriation des producteurs immédiats s’exécute avec un vandalisme impitoyable qu’aiguillonnent les mobiles les plus infâmes, les passions les plus sordides et les plus haïssables dans leur petitesse. La propriété privée, fondée sur le travail personnel, cette propriété qui soude pour ainsi dire le travailleur isolé et autonome aux conditions extérieures du travail, va être supplantée par la propriété privée capitaliste, fondée sur l’exploitation du travail d’autrui, sur le salariat. »
Tendance historique du développement capitaliste (L’expropriation des expropriateurs)
Mais à expropriateur, expropriateur et demi ! L’expropriation, inexorable loi du développement capitaliste, finit par se retourner contre le régime qui l’engendre. De même que le petit capital a vaincu autrefois la petite propriété personnelle et refoulé la libre production artisane ; de même, le grand capital finit par vaincre et par exproprier le petit capital. La production capitaliste se concentre peu à peu dans un nombre de mains de plus en plus restreint. Qu’arrive-t-il alors ?
À mesure que diminue le nombre des potentats du capital qui usurpent et monopolisent tous les avantages de cette période d’évolution sociale, s’accroissent la misère, l’oppression, l’esclavage, la dégradation, l’exploitation, « mais aussi la résistance de la classe ouvrière sans cesse grossissante et de plus en plus disciplinée, unie et organisée » par le mécanisme même de la production capitaliste. Le monopole du capital devient une entrave pour le mode de production qui a grandi et prospéré avec lui et sous ses auspices. La socialisation du travail et la centralisation de ses ressorts matériels arrivent à un point où elles ne peuvent plus tenir dans leur enveloppe capitaliste. Cette enveloppe se brise en éclats. L’heure de la propriété capitaliste a sonné. Les expropriateurs sont à leur tour expropriés.
La théorie économique de Marx est d’une incomparable grandeur et, pour la, propagande, d’une fécondité merveilleuse. Il n’est pas étonnant qu’elle se soit imposée à tous les partis socialistes du monde. Le prolétaire qui l’a comprise n’en peut plus détacher son esprit. Ayant dissipé les nuées de l’apologétique bourgeoise, il cesse de croire à la pérennité du mode de production capitaliste. Et la mission historique du prolétariat lui apparait dans sa haute certitude, toute chargée de promesses révolutionnaires.
Nous arrivons au terme de, ce court aperçu. Le lecteur possède maintenant quelques données sommaires sur les grandes conceptions doctrinales qui forment l’ossature du marxisme. Ce sont, dans l’ordre chronologique (ne craignons pas de nous répéter) :
-
La conception matérialiste de l’histoire ;
-
La théorie de la lutte des classes (d’où résulte, pratiquement, l’intégration du socialisme dans le mouvement ouvrier ;
-
La théorie de la plus-value, clé du « mystère » de la production capitaliste.
dans ces trois conceptions fondamentales, le marxisme n’est pas inclus tout entier. Nous n’avons rien dit par exemple d’une théorie essentiellement marxiste et que la propagande socialiste a largement vulgarisée : la théorie de la concentration capitaliste. Une allusion y est faite dans le texte de Marx que nous venons de citer en partie. Elle s’énonce à peu près comme suit : À mesure que le capitalisme se développe, le capital se concentre en un nombre de mains de plus en plus réduit ; la grande exploitation l’emporte sur la petite exploitation.
La concentration capitaliste
La théorie de la concentration a, dans la sociologie marxiste, une importance de premier plan. Ce n’est pas, bien qu’on l’ait dit souvent, de la concentration que Marx attend la réalisation du socialisme (il ne l’attend que de la lutte de classe), mais elle est pour lui une des conditions décisives de cette réalisation. De toutes les prédictions de Marx, c’est celle qui s’est le plus complètement vérifiée, au point que, dans certaines branches d’industrie, la petite exploitation est dès aujourd’hui entièrement éliminée. Marx n’a connu ni les trusts ni les cartels, mais ceux-ci sont l’illustration la plus frappante de sa théorie.
Plus le capital se concentre, plus l’industrie se monopolise, plus aussi se concentre le prolétariat. Plus donc le problème de la réalisation du socialisme approche de sa solution. « La concentration, dit Kautsky, produit les forces nécessaires à la solution du problème, c’est-à-dire les prolétaires, et elle crée le moyen de le résoudre, à savoir la coopération sur une grande échelle ; mais elle ne résout pas elle-même le problème. Cette solution ne peut sortir que de la lutte du prolétariat, de sa force de volonté et du sentiment qu’il a de ses devoirs. »
Les adversaires du marxisme lui attribuent souvent des théories qui lui sont étrangères : par exemple la fameuse loi d’airain des salaires, la théorie de l’écroulement capitaliste(dite encore de la catastrophe), la théorie de la misère croissante du prolétariat.
La loi d’airain n’est pas marxiste ; elle est lassallienne (et guesdiste) : commode pour la propagande, elle manque de valeur scientifique. Tout au plus exprime-t-elle une tendance, qui, sans cesse contrecarrée par des tendances adverses, ne se réalise pour ainsi dire jamais.
La théorie de l’écroulement et celle de la misère croissante ne sont pas davantage marxistes, ainsi que Kautsky, polémiquant jadis avec Bernstein, l’a fortement établi. Marx a montré le capitalisme en proie à des crises périodiques déterminées par ce dérèglement de la production dont on peut dire, au risque de paraître jouer sur les mots, qu’il est la règle du régime. Le capitalisme, sous l’aiguillon de la concurrence, finit toujours par surproduire. Alors les marchés s’engorgent, les prix s’effondrent, les transactions s’arrêtent, les krachs se multiplient, engendrant chômage et misère. Tout cela est parfaitement exact. Marx, toutefois, n’a jamais dit que le capitalisme s’écroulerait un jour de lui-même, emporté par une crise de surproduction plus torrentielle que les autres. « L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes » ; elle ne saurait résulter d’une catastrophe économique, d’un accident de l’histoire. Encore une fois, marxisme et fatalisme s’excluent.
Quant à la théorie de la « misère croissante » elle n’exprime, elle aussi, qu’une tendance. Cette tendance se réalise parfois (combien de fois et dans combien depays ne s’est-elle pas réalisée depuis la guerre I) ; parfois mais pas toujours, étant souvent contrebattue dans son action par des tendances contraires qui viennent l’annihiler. La révolution, Marx ne l’a jamais attendue d’une explosion de misère émeutière, mais de l’organisation du prolétariat en parti de classe et en syndicats, et de la volonté des prolétaires de se faire libres.
Marx et l’État.
D’airain, théorie catastrophique de l’écroulement, thèse de la misère croissante, parce qu’elles excitent vivement l’imagination populaire, ont beaucoup contribué à vulgariser le socialisme. Au contraire, les disciples ont laissé dans l’ombre la théorie marxiste de l’État, jugée, sans doute, trop révolutionnaire, et c’est leur faute si Marx a passé longtemps pour un étatiste renforcé, un partisan déterminé de la transformation sociale par l’intervention de l’État.
Cette réputation qu’on lui a faite est fausse. Marx est au moins autant que Bakounine un adversaire de l’État, fut-il démocratique et républicain. Vingt textes parfaitement authentiques pourraient en témoigner ici. Dès le Manifeste communiste,il écrit que lorsque les antagonismes de classes auront disparu « toute la production étant concentrée dans les mains des individus associés, alors le pouvoir politique [perdra] son caractère de classe... À la place de l’ancienne société bourgeoise, avec ses classes et ses antagonismes de classes, [surgira] une association où le libre développement de chacun [sera] la condition du libre développement de tous. » Vingt-cinq ans plus tard, au plus fort de la lutte contre Bakounine, Marx écrit encore : « Tous les socialistes entendent par anarchie ceci : Le but du mouvement prolétaire, l’abolition des classes, une fois atteint, le pouvoir d’État qui sert à maintenir la grande majorité productrice sous le joug d’une minorité exploitante peu nombreuse, disparaît, et les fonctions gouvernementales se transforme en de simples fonctions administratives. » On connaît, d’autre part, la célèbre phrase d’Engels : « La société qui organisera la production sur les bases d’une association de producteurs libres et égalitaires, transportera toute la machine de l’État là où sera dès lors sa place : dans le musée des antiquités, à côté du rouet et de la hache de pierre. » Où Marx et Engels se séparent de Bakounine, c’est quand celui-ci veut faire de l’anarchie non seulement la fin, mais le moyen de la Révolution.
Conclusion
La conquête du pouvoir politique, Marx n’a cessé de voir en elle « le premier devoir de la classe ouvrière ». Mais il ne confondait pas le pouvoir politique‒sorte de comité de salut public prolétarien, chargé de liquider la société bourgeoise et de veiller à la sûreté de la Révolution ‒avec les pouvoirs publics traditionnels de la bourgeoisie, avec le vieil État de classe que les monarchies transmettent aux républiques et auquel celles-ci se gardent bien de toucher. L’État de classe, le premier acte du prolétariat vainqueur ne pourra être que de le détruire de fond en comble. L’État une fois détruit, gisant dans la poussière, avec tous ses rouages, qu’y aura-t-il ? Un régime purement provisoire, la dictature du prolétariat :
« Entre la société capitaliste et la société communiste, se place la période de transformation révolutionnaire de la première en la seconde. À quoi correspond une période de transition politique où l’État ne saurait être autre chose que la dictature révolutionnaire du prolétariat. »
Reprise, il y a 12 ans, par Lénine et la Révolution russe, cette formule, qui date de 1848, est devenue fameuse : on en use et abuse tous les jours. Au vrai, on ne la rencontre chez Marx qu’accidentellement. Quant au sens qu’il lui attribuait, on peut s’en faire une idée par cette citation d’Engels :
« Voulez-vous savoir, Messieurs, ce que veut dire cette dictature ? Regardez la Commune de Paris. Voilà la dictature du prolétariat. »
Pour Marx et pour Engels, dictature du prolétariat n’était qu’un synonyme expressif de Révolution prolétarienne. Eussent-ils approuvé sans réserves, eux, les apologistes de la démocratique Commune, n’importe quelle dictature ? On peut en douter. Rien n’autorise à croire, par exemple, qu’ils eussent admis sans mot dire une dictature du prolétariat s’exerçant, comme cela se voit en Russie, sur le prolétariat lui-même par l’entremise bureaucratique d’un parti militarisé à l’extrême, et duquel est exclue toute démocratie réelle.
Une question capitale, qu’il nous faut laisser de côté, c’est de savoir comment se réalisera le socialisme. Le marxisme, qui se garde autant qu’il peut, des prophéties, toujours plus ou moins contredites par les faits, répond, nous l’avons vu, que le socialisme se réalisera par la lutte de classe. Mais la lutte de classe revêt des formes multiples : elle n’exclut pas plus les moyens pacifiques que les moyens de force. La seule chose absolument certaine, c’est que le socialisme se réalisera ! Il a pour lui, dès à présent, la Nécessité économique : il ne lui manque plus que la volonté ouvrière. Quand ces deux facteurs décisifs se rejoindront et confondront leurs forces, l’heure du capitalisme aura sonné. Alors la mission historique du prolétariat annoncée par Marx s’accomplira et l’humanité unifiée, sans classes et sans frontières, passera « du règne de la fatalité dans celui de la liberté. » Alors, il n’y aura plus, dans l’ordre nouveau du monde, que des hommes égaux, soumis à la seule loi du travail. Il n’y aura plus que des travailleurs qui, foulant pour la première fois d’un pied libre le sol où reposent des générations innombrables d’esclaves, de serfs et de salariés, se sentiront enfin une patrie. Et l’adjuration sublime du vieux Pottier, le poète prolétaire, résonnera dans les cœurs comme l’évangile des temps nouveaux.
Ô travailleur, deviens l’Humanité !
— Amédée DUNOIS.
MARXISME (Point de vue communiste-anarchiste)
Que devons-nous comprendre sous le nom de Marxisme ? Des principes, une théorie économique ; une explication des phénomènes sociaux ; une méthode d’action ? L’œuvre de Marx comprend tout cela, mais le marxisme a rétréci la doctrine au lieu de la parfaire ou de la réviser. Et, si nous compulsons les livres du Maître, nous sommes déroutés non seulement par leur obscurité, par leur lourdeur, mais encore par les lacunes et même les contradictions que nous y relevons. Il arrive parfois que sa correspondance, sur la fin, corrige ce que ses vues primitives avaient de trop absolu. Aussi, quiconque critique Marx sur un point est exposé à voir un de ses disciples, s’appuyant sur des textes longuement médités, tel un docteur du moyen âge féru d’Aristote, prétendre le convaincre d’ignorance ou d’erreur d’interprétation. Passant outre, nous nous bornerons à considérer dans la doctrine les seuls points que la généralité des socialistes en a retenus.
Le fondement de la doctrine est la conception matérialiste de l’histoire. Le développement des sociétés ne s’effectue pas sous l’influence des idées, ou mieux d’un idéal, mais il dépend des modifications survenues dans les conditions économiques, dans les moyens techniques dont l’homme dispose pour exploiter son domaine terrestre. Le stimulus de l’idée ne peut agir qu’autant que l’évolution préalable de l’appareil de la production en a provoqué l’éclosion. L’idée est un effet, non une cause ; elle n’est qu’un accessoire des forces matérielles génératrices des transformations sociales.
Pour comprendre la genèse de cette doctrine, il faut se reporter à l’époque où elle a été professée. Au milieu du siècle dernier, régnait encore sans conteste, dans les sciences naturelles, la croyance créationniste. Le monde était la mise en œuvre d’une volonté transcendante qui s’était manifestée par la création d’espèces sériées, que l’on pouvait certes rattacher à un certain nombre d’archétypes préconçus, mais qui étaient libres de tous liens génétiques. Si Lamarck avait cependant admis l’existence de ces liens, s’il attachait quelque importance aux modifications du milieu, c’est dans une idée immanente à l’être, née du besoin ressenti, qu’il voyait la source des transformations. « Or, ayant remarqué que les mouvements des animaux ne sont jamais communiqués, mais qu’ils sont toujours excités, je reconnus que la nature obligée d’abord d’emprunter des milieux environnants la puissance excitatrice des mouvements vitaux et des actions des animaux imparfaits, sut, en composant de plus en plus l’organisation animale, transporter cette puissance dans l’intérieur même de ces êtres et qu’à la fin elle parvint à mettre cette même puissance à la disposition de l’individu. » Transcendante ou immanente, venue d’en haut ou issue des profondeurs de l’être, la cause d’une variation était toujours une volonté.
Dans le domaine social, nous voyons les réformateurs, tout comme les législateurs antiques, messagers de la divinité, croire à la possibilité de substituer à des institutions imparfaites des conceptions de leur cerveau, de créer artificiellement un ordre nouveau, utilisant certes des matériaux tirés du chaos actuel, mais en disposant les éléments suivant un plan préétabli. Babeuf, Fourier, Saint Simon et ses disciples (avant de se lancer dans l’industrie), Auguste Comte lui-même, à la fin de sa carrière, élaborent des constitutions destinées à se substituer purement et simplement à celles qui régissent les peuples. Une idée, une volonté, voilà qui suffit à changer la face du monde. Proudhon seul, mais vers la même époque que Marx, a une idée moins simpliste de la réforme sociale.
Vers les années 50, Darwin élaborait son système biologique. Les diverses espèces ne sont pas issues de créations successives indépendantes, ce sont des lignées qui se sont transformées. Les êtres, spécifiquement semblables à un moment, sont variables dans des limites fort étroites sans doute, mais les variations sont susceptibles de s’additionner. Parmi des changements survenus fortuitement, la nature fait le tri, elle retient et accumule ceux qui sont avantageux dans la lutte pour l’existence et élimine les autres. Au fond, c’est la contexture du milieu qui précise et confirme l’effet du hasard, qui détermine la sélection. Les spécimens légèrement différents d’un même type entrent en compétition les uns avec les autres et en lutte avec les forces cosmiques, ceux qui l’emportent et survivent sont les mieux adaptés au milieu naturel et social. Hasard et milieu sont les facteurs du transformisme darwinien ; la volonté de l’individu n’a d’autres armes que celles empruntées à sa chance ; l’effort propre, les tendances internes n’ont plus le rôle que leur attribuait Lamarck.
C’est sous l’influence de ce mouvement d’idées que Marx élaborait sa doctrine du matérialisme historique : « Cette idée, (la lutte de classes) dans mon opinion, fera faire à la science de l’histoire le progrès que la théorie darwinienne a fait faire à l’histoire naturelle. Nous avions peu à peu approché de cette idée tous deux, plusieurs année déjà avant 1845. » (F. Engels, 1883.) Les inventions techniques, les découvertes scientifiques ont le même effet que les variations fortuites. Elles introduisent des dissemblances entre les individus, fournissent des armes nouvelles aux classes dont elles avivent les antagonismes, dont elles éveillent l’ambition. Renouvelant les conditions de la production, elles modifient l’équilibre du milieu social qui évoluera avec une accélération en rapport avec l’importance de l’innovation. Individus et classes entreront en lutte, les plus forts les mieux adaptés au nouvel état de choses élimineront les retardataires. La société ancienne porte dans ses flancs la société nouvelle qui doit la supplanter. Il y a évolution, non création préméditée.
Darwin avait, plus tard, reconnu que les causes invoquées par Lamarck méritaient de prendre place à côté de la sélection, que l’influence indirecte du milieu, provoquant la sensation de nouveaux besoins, mettant en action des tendances innées tenues en quelque sorte en réserve, était une source de variations. De nos jours, du reste, on est de nouveau porté à accorder un rôle prépondérant à l’innéité. Marx convint aussi qu’il avait sous-estimé la puissance des aspirations humaines que reflète l’idéologie régnante.
En réalité, la personne humaine n’est pas un absolu, il n’est aucune de nos perceptions, aucune de nos actions qui ne porte une empreinte sociale ; la société, d’autre part, n’est pas une entité, elle ne vit, ne s’exprime que par l’intermédiaire des individus ; facteurs idéologiques, facteurs physiques et sociaux sont inséparables, leur action combinée se retrouve à l’origine de tous les ébranlements qui changent la face de l’humanité. C’est incontestablement la passion religieuse qui anime les croisés. Les besoins d’argent de la féodalité ont pu la seconder, mais le mysticisme était seul capable de lui imposer son orientation, de donner un but à l’esprit d’aventure. La Réforme, plus tard, eut son point de départ dans la réprobation qu’inspirait à des croyants sincères le spectacle d’une Église corrompue qui retournait au paganisme. L’avidité des princes, les appétits de la finance naissante ont simplement exploité une force spirituelle qu’il était d’ailleurs prudent de canaliser. La Révolution française, la généralisation de ses principes en Europe, sont bien dues à l’explosion des idées égalitaires exaltées au XVIIIème siècle. Seules elles pouvaient émouvoir et mobiliser des masses désintéressées, leur faire brûler les étapes et inaugurer un monde nouveau, alors que la haute bourgeoisie se serait contentée d’une lente infiltration dans les organes de l’ancien Régime.
Simple dérivation d’un courant d’idées scientifiques contemporain, le Matérialisme historique de Marx, s’il a eu l’heureux effet de faire renoncer aux constructions artificielles dont on se satisfaisait jusqu’alors, a eu, par contre, la désastreuse conséquence de mettre au premier plan les revendications égoïstes qui, si elles ne sont pas dominées par un idéal commun aboutissent trop souvent à opposer les unes aux autres les fractions d’une même classe. Et l’idéal ne doit pas être, comme celui des utopistes, le produit d’un unique cerveau ou d’un petit nombre ; il doit avoir ses racines dans les faits, les malaises ressentis, les possibilités envisagées et pénétrer plus ou moins profondément dans l’esprit de l’immense majorité des citoyens, pour les incliner à l’acceptation d’un nouvel ordre social.
L’innovation qui, au dire de Marx, va avoir pour effet la transformation de nos sociétés, c’est le développement pris depuis le XVIIIème siècle par le capitalisme. Pour comprendre l’importance du fait capitaliste, il faut d’abord se rendre compte de ce qu’est la valeur.
« La valeur est le nœud gordien de l’économie politique ».
À l’économie politiqua bourgeoise Marx emprunte ses notions de valeur d’usage, reposant sur l’utilité et de valeur d’échange, base des transactions commerciales. Quelle est l’essence de cette valeur d’échange ?
« Pour que deux marchandises, de nature et de proportions différentes arrivent à valoir autant l’une que l’autre, il faut que l’une et l’autre contiennent en quantité égale une substance commune commensurable. Hormis l’utilité, les marchandises n’ont qu’une seule autre propriété commune : elles sont toutes des produits du travail humain, leur création a nécessité une dépense dé force humaine. »
C’est à peu près ce qu’avaient déjà exposé Smith et Ricardo. Nous ne discuterons pas en ce moment cette théorie. En parlant de la machine, nous avons déjà dit que le travail humain n’entrait pas seul dans la constitution de la valeur ; le travail des forces naturelles y a sa part. Au surplus, c’est une erreur d’identifier, dans la société actuelle, valeur et travail. Valeur n’est qu’un mot dont le sens n’a jamais été défini. Elle reste dans l’ombre. Ce qui apparaît sur le marché, ce sont des prix, conditionnés par les besoins respectifs des échangeurs, la rareté, l’accaparement, la spéculation, et, dans une moindre proportion souvent, par le travail. Pour que les marchandises s’échangent en proportion du seul travail humain qu’elles contiennent, il faudra un effort de notre volonté, une révolution précisément.
Mais nous devons signaler ici la façon dont Marx esquive le problème de la mesure de la valeur. Il admet que les travaux sont plus ou moins pénibles, plus ou moins compliqués ‒c’est confondre travail et peine, alors que la peine ne doit pas être associée à un travail réparti suivant les aptitudes, et physiologiquement dosé. Il faut les réduire les uns aux autres. « Quand nous parlons du travail humain au point de vue de la valeur, nous n’envisageons que le travail simple, c’est-à-dire que la dépense de la force simple que tout homme ordinaire, sans éducation spéciale, possède dans son organisme. Le travail simple moyen varie, il est vrai, suivant les pays et suivant les époques, mais il est toujours déterminé dans une société donnée.
Le travail supérieur n’est que du travail simple multiplié, il peut toujours être ramené à une quantité plus grande de travail simple : « une journée, par exemple, de travail supérieur ou compliqué à deux journées de travail simple ». Notons, en passant que quelle que soit la nature du travail, un homme sans éducation spéciale prendra de la peine sans résultat. Un mathématicien n’arrivera pas mieux à tracer un sillon qu’un laboureur à résoudre un problème d’algèbre s’ils ne s’y sont pas préparés.
Nous voudrions que Marx, nous présentât l’unité de mesure, le travailleur ordinaire. Faudra-t-il, avec le mètre-étalon, l’enfermer dans un coffre-fort du Pavillon de Breteuil ? Et comment s’y prendra-t-on pour lui comparer les autres travailleurs ? Une théorie scientifique, même si elle ne nous donne pas encore une solution complète du problème, devrait nous indiquer la voie à suivre pour l’atteindre, sans se résigner à un empirisme grossier. Or, Marx nous renvoie, pour établir le coefficient d’augmentation ou de réduction par rapport à la moyenne, au marché libre, au marchandage du travail.
« L’expérience montre que la réduction de tous les travaux à une quantité d’une seule et même espèce de travaux se fait tous les jours. »
Évidemment, par l’inégalité des salaires. Ford, si copieusement rémunéré a, sans doute, une éducation très spéciale. Mesurer la valeur par le travail, puis apprécier le travail d’après le montant du salaire n’est-ce pas un cercle vicieux ? Si la monnaie sujette d’ailleurs à spéculation, est en dernière analyse l’étalon de valeur, ce n’est plus dans l’armoire du Bureau International des Poids et mesures qu’il faudra le chercher, mais dans le coffre des capitalistes. Pour sortir de l’impasse, il faut approfondir la notion de la valeur et élucider le rôle et les variations de la monnaie.
D’ailleurs, Marx se propose moins de mesurer la valeur que d’expliquer la formation du capital. Il remarque très justement que le travailleur, dans sa journée, produit plus qu’il n’est nécessaire pour sa subsistance. Il appelle plus-value cette différence. Le choix du mot est peu heureux, si la valeur est le travail, il n’y a pas possibilité de plus-value, mais excédent de production sur les besoins, qui permet de dépouiller le producteur sans attenter à sa vie. Ce n’est là d’ailleurs qu’une impropriété de terme, puisque le fond n’est pas contesté. Cette plus-value nous donne la clef de la formation du capital : le capitaliste, ne donnant à l’ouvrier, sous forme de salaire que ce qui est indispensable pour son entretien, bénéficie du reste. Avec ce reste il achète de nouvelles forces de travail de telle sorte que son capital s’accroît indéfiniment, ou du moins le capital de la classe bourgeoise, car les exploiteurs luttent entre eux et se dépouillent mutuellement. L’analyse comprend une grande part de vérité, mais non toute la vérité.
Vilfredo Pareto a parodié d’une façon originale les raisonnements de l’auteur du Capital. Nous mettons entre parenthèses, les mots que le critique a remplacés par d’autres. « La valeur d’usage des marchandises une fois mise de côté, il ne leur reste plus qu’une qualité, celle d’être des produits du capital (Marx a écrit du travail). La quantité de valeur d’une marchandise resterait évidemment constante, si le temps nécessaire à sa production restait aussi constant. Mais ce dernier varie avec chaque modification de la force productive du capital (au lieu de travail) qui de son côté dépend de circonstances diverses, entre autres de l’habileté moyenne des travailleurs... des combinaisons sociales de la production... » Une couseuse loue une machine à coudre pour 30 centimes par jour. Le travail de trois heures de cette machine produit : 1° les 30 centimes du loyer de la machine ; 2° la somme de 70 centimes qui est strictement nécessaire à l’ouvrière pour vivre (dans un passé lointain ! !) Mais « l’ouvrière (l’homme aux écus) a payé la valeur journalière de la force de travail de la machine (de l’ouvrier) ; son usage pendant le jour, le travail d’une journée entière lui appartient donc. Que l’entretien journalier de cette machine (cet ouvrier) ne coûte que trois heures de travail de la machine (de l’ouvrier) bien que la machine puisse travailler la journée entière, c’est une chance particulièrement heureuse pour l’ouvrière (l’acheteur). Elle (notre capitaliste) a prévu le cas et c’est ce qui la (le) fait rire. »
Nous n’avons fait cette citation que pour montrer l’inconsistance des thèses des économistes de l’un et l’autre bord. Ici, elles s’éloignent moins l’une de l’autre qu’on ne le supposerait, si le capital n’est que du travail présent ou passé accumulé. Mais tous deux ont également tort de négliger un élément essentiel. Le capitaliste ne bénéficie pas uniquement de la confiscation de la plus-value humaine, mais de la monopolisation injustifiée de forces naturelles, chutes d’eau, houille, pétrole, engrais minéraux. On voit au surplus que l’exemple de Pareto, machine à coudre, mue par l’effort de l’ouvrière, était particulièrement mal choisi. Au lieu d’une machine-outil, il eut fallu considérer une machine génératrice de force, avec son approvisionnement de charbon, pétrole... pour une journée.
Le capital d’ailleurs ne se récolte pas uniquement par le moyen de prélèvements directs sur le producteur attaché à la manufacture. Le terrain de chasse, l’emplacement de la curée déborde la clôture des ateliers. On a fait depuis 1867 de sérieux progrès dans l’explication de la concentration des capitaux et les nouvelles observations chargent encore le capitalisme, bien loin de l’innocenter.
Avant même d’être un théoricien, Marx a été un agitateur, un des dirigeants de la Fédération communiste. Il prit part à la Révolution allemande de 1848 et, réfugié à Londres après la victoire de la réaction, il fut un des fondateurs de l’Internationale.
Le manifeste communiste qui contient l’essentiel de la doctrine révolutionnaire de Marx et d’Engels, fut élaboré en 1847. Il ne faut pas se méprendre sur le sens du mot communiste. Il fut préféré, dit Engels, au mot socialiste, parce que ce dernier désignait alors des utopistes ou bien des réformateurs bourgeois. En fait ce manifeste est « l’écrit le plus répandu, le plus international de toute la littérature socialiste. »
Après avoir rappelé le rôle révolutionnaire de la Bourgeoisie, les auteurs indiquent que « les armes dont elle s’est servie pour abattre la féodalité se retournent contre elle-même », que par contre, en même temps que grandissait la bourgeoisie, grandissait le prolétariat, auquel la division du travail et le machinisme enlevaient toute possibilité d’indépendance et de bien-être. tandis que la concentration de l’industrie les groupe en masses compactes où prend naissance la conscience de classe.
Les intermédiaires entre riches et déshérités, les classes moyennes disparaissaient, écrasées par les grandes puissances industrielles et financières, elles tombent dans le prolétariat ; la lutte se poursuit aujourd’hui entre deux classes.
« Avant tout la bourgeoisie produit ses propres fossoyeurs. La ruine de la bourgeoisie et la victoire du prolétariat sont également inévitables. »
Les communistes (socialistes) sont la fraction la plus résolue des partis ouvriers ; ils ont, sur la masse prolétarienne l’avantage que donne l’intelligence des conditions, de la marche et des résultats généraux du mouvement prolétarien.
« Le but immédiat pour les communistes est le même que pour tous les autres partis prolétariens : la constitution du prolétariat en classe, le renversement de la domination bourgeoise, la conquête du pouvoir politique par le prolétariat. »
Quel usage fera-t-il de ce pouvoir ?
« Il va de soi que cela impliquera, dans la période de début, des infractions despotiques au droit de propriété et aux conditions bourgeoises de la production. ». Pourtant, le communisme n’ôte à personne le pouvoir de s’approprier des produits sociaux ; mais il ôte le pouvoir d’assujettir et de s’approprier le travail d’autrui. »
Suit un programme en dix articles, auquel souscrirait notre parti radical, sauf peut-être en deux points : expropriation de la propriété foncière et abolition de l’héritage ‒encore ai-je souvenir d’une conversation A. Aulard, au cours de laquelle ce dernier se prononçait énergiquement contre l’héritage. Alors, « à l’ancienne société bourgeoise, avec ses classes et ses antagonismes, se substituera une association où le libre développement de chacun sera la condition du libre développement de tous. »
Au point de vue dialectique ce programme est admirablement coordonnée. Pourtant si la conclusion est la nôtre, les moyens de réalisation ne sauraient nous agréer. Puis, au style et à la clarté d’expression près, l’exposé marxiste ressemble trop à une réplique du Discours sur l’histoire universelle de Bossuet, à une apologétique magnifiant une providence qui a pris en mains les destinées de la classe ouvrière, et à travers de dures épreuves la conduit à un inévitable paradis, terrestre à vrai dire.
Au surplus la description schématique de la société contemporaine et les pronostics avancés sur son avenir n’ont guère été confirmés par les événements. La classe moyenne se transforme, elle ne disparait pas. Intellectuels de toutes catégories, techniciens et cadres supérieurs du commerce et de l’industrie, ouvriers et employés très qualifiés, même, petits propriétaires ruraux, forment une masse flottante qui, selon ses intérêts et ses craintes, se rallie aux partis conservateurs ou au contraire réformistes et révolutionnaires. D’autre part, la classe capitaliste ne reste pas passive ; elle imagine chaque jour de nouvelles formes d’activité et gagne en puissance au lieu de se résigner à la défaite.
Marx et Engels confondent conquête du pouvoir et acquisition de la puissance. Nous devons regarder les pouvoirs politiques et administratifs comme de simples mandataires des détenteurs des forces matérielles que la naissance ou la chance ont concentrées en quelques mains, ou des forces spirituelles vestiges des croyances et des préjugés du temps passé. Substitués, par un coup de baguette magique aux gouvernants actuels, les représentants du prolétariat seraient asservis aux mêmes maîtres que leurs prédécesseurs. Ce qui importe principalement aux salariés c’est l’acquisition des connaissances techniques, de la pratique organisatrice de ceux qui les exploitent. Sans doute on ne doit plus rien attendre du renouvellement des tentatives qui séduisaient les précurseurs elles rêveurs du siècle dernier. Il s’agit maintenant d’entreprendre une besogne méthodique de préparation : s’initier au fonctionnement de l’appareil capitaliste, en créant au sein de chaque établissement industriel ou financier des groupements de toutes les catégories de salariés s’entraidant pour en étudier les rouages ; mettre son pouvoir d’achat et d’épargne au service de toutes les branches de la production et de la répartition où il sera possible de concurrencer les puissances rivales encore mal consolidées ; préparer de cette façon les cadres de la société future et ramener à soi les techniciens qui savent que la production ne saurait s’accommoder du désordre et de l’imprévision ; inculquer à la masse des travailleurs, avec le sentiment de la dignité humaine, l’esprit combatif qu’entretiendra la conviction d’acquérir, de jour en jour, la capacité de faire vivre une société nouvelle.
En résumé, Marx et. ses disciples nous ont apporté une conception de l’histoire qui néglige une moitié des facteurs qui président à l’évolution des sociétés ; une théorie de la valeur et de la formation du capital qui ne nous éclaire suffisamment ni sur la mesure de l’une, ni sur la nature et l’origine de l’autre, non plus que sur le processus de son accumulation ; un programme révolutionnaire de médiocre envergure et qui, nous venons d’en avoir l’exemple, expose aux pires déceptions si on en aborde l’exécution sans préparation préalable.
Le marxisme, en dépit des bonnes intentions qui l’animaient, a divisé les classes laborieuses au lieu de les unir ; il a fait perdre un demi-siècle d’efforts gaspillés en intrigues politiques auxquelles syndicats et coopératives ont eu grand peine à se soustraire, faisant dévier et tarir le courant d’idées proudhoniennes qui tendaient à détourner le peuple de remettre son sort entre les mains de directeurs de conscience et l’invitaient à étendre ses propres capacités.
Marx, économiste et sociologue, n’eut été classé qu’an second rang ; c’est à son rôle d’agitateur qu’il a du sa notoriété populaire. Marx doit plus à la classe ouvrière que la classe ouvrière ne doit à Marx.
‒ G. GOUJON
MARXISME
n. m.
Doctrine de Karl Marx exposée dans les œuvres de cet auteur, notamment dans « Le Capital ». Le marxisme développe la théorie de l’exploitation de la classe ouvrière par le patronat, laquelle a pour but d’apporter une plus-value au capital, plus-value produite par l’ouvrier, mais que le patron s’approprie.
La valeur a pour origine le travail C’est le travail qui donne de la valeur à la marchandise. Sans le travail le problème de la valeur ne se poserait pas pour les objets, et chacun en aurait la consommation libre, comme, par exemple, l’air que nous respirons. Une pierre brute ramassée au bord du chemin n’a pas de valeur : mais si nous la supposons ensuite taillée, cette pierre prend de la valeur parce qu’on y a ajouté du travail.
Pour acquérir des valeurs la patron achète à l’ouvrier sa force de travail ; mais il ne la paie pas ce qu’elle vaut car il s’en réserve une part pour lui. Le patronat tend, à diminuer le taux de la force de travail ; pour cela il a deux moyens : 1° Augmenter le nombre des heures de travail sans augmenter le salaire ; 2° Diminuer le salaire de manière à le réduire au strict nécessaire à l’entretien de la vie de l’ouvrier.
L’accumulation du capital résultant des plus-values qui s’ajoutent constamment, enrichit de plus en plus les patrons. En outre, par l’effet de la concurrence entre eux et du progrès de l’industrie, les patrons tendent à diminuer en nombre en même temps que les entreprises croissent en grandeur. Le petit commerce et la petite industrie tendent à être éliminés par le grand commerce et la grande industrie. Leur personnel tombe dans le prolétariat, c’est la disparition des classes moyennes.
Au fur et à mesure du développement économique, il tend à se former deux classes : 1° Un patronat de moins en moins nombreux et de plus en plus riche ; 2° Un prolétariat de plus en plus nombreux et de plus en plus pauvre.
Le capital renferme ainsi en lui son germe de mort, car il est évident que par le seul processus du développement économique la révolution doit éclater un jour. il viendra un moment où l’on n’aura plus que quelques individus à déposséder pour transformer la société capitaliste en une société socialiste.
Si l’on s’en rapporte aux déductions logiques du marxisme, la révolution est donc indépendante des volontés humaines ; elle arrivera par la force des choses. Il en est d’ailleurs ainsi pour tous les phénomènes sociaux. On a tendance à s’imaginer que ce sont les idées qui mènent le monde ; il n’en est rien selon le marxisme. Les idées ne sont qu’une suprastructure sans importance. Le monde est gouverné par les phénomènes économiques. C’est l’état économique d’un pays qui cause les guerres, le régime politique, la structure sociale, les mœurs, les religions. C’est ce que le marxisme appelle le matérialisme historique.
Le marxisme a la prétention d’être le socialisme scientifique ; il s’oppose au socialisme utopique des Sismondi, des Saint-Simon, des Fourier, etc. Pour ces théoriciens, le socialisme sera l’œuvre de la volonté humaine éprise de justice. Certains mêmes fondaient leurs espérances sur la bonne volonté d’un patron (Owen) qui instaurerait le socialisme par humanité,
Le marxisme est-il scientifique comme il le prétend ? Oui, dans une certaine mesure. La concentration capitaliste est un fait et d’autre part la théorie du matérialisme historique renferme une grande part de réalité. Il est certain que nombre d’événements historiques sont déterminés par des causes économiques. Souvent ces causes sont cachées aux peuples et pour les faire agir on invente de toutes pièces la superstructure idéologique : amour propre national, protection d’un peuple faible, etc, La dernière guerre, dite guerre du droit, dont la cause la plus importante était la rivalité économique de l’Angleterre et de l’Allemagne, est une éclatante illustration de la théorie marxiste, du matérialisme historique.
Néanmoins, le marxisme ne saurait prétendre à être une science car il renferme des erreurs. Certes les intérêts économiques ont une grande importance. Cependant l’idéologie (c’est-à-dire les croyances, les préjugés, les mœurs, l’amour-propre), sont loin d’être d’effet nul. On peut même dire que sans cette suprastructure, c’est-à-dire sans les passions, jamais les intérêts matériels ne réussiraient à déclencher les événements. L’Idéologie, comme d’ailleurs l’infrastructure économique elle-même, ne sauraient agir qu’au travers des volontés humaines. C’est ce que Marx n’a pas vu assez ; de là le caractère inerte de sa doctrine.
Marx était un disciple d’Hégel dont le système comportait la thèse, l’antithèse et la synthèse. Le marxisme de même comprend une thèse : l’évolution du capital, une antithèse : l’accroissement du prolétariat et enfin une synthèse qui sera le socialisme.
En dépit de son matérialisme, le marxisme présente donc un côté mystique. Le développement économique apparaît comme une force aveugle et fatale qui agit par dessus les hommes et en dépit d’eux.
Si la concentration capitaliste s’est trouvée confirmée, il n’en est pas de même de la disparition des classes moyennes. Le petit commerce continue à trouver sa vie à côté du grand commerce, répondant à des besoins que jusqu’ici le grand commerce n’est pas parvenu à satisfaire. En outre les classes moyennes se transforment et ne disparaissent pas ; entre le patron et l’ouvrier il y a toute une hiérarchie d’employés à haut traitement dont les intérêts se confondent avec ceux du patronat et non avec ceux de la classe ouvrière.
La loi d’airain d’après laquelle le prolétariat tend vers une paupérisation croissante n’est pas vraie. La paupérisation du prolétariat est au contraire en raison inverse de l’évolution économique ; plus l’état économique est développé (États-Unis), plus hauts sont les salaires. Car en même temps que l’état économique monte le niveau intellectuel du prolétariat, l’ouvrier a des besoins plus grands et exige de hauts salaires.
Le Manifeste Communiste de Karl Marx est une œuvre révolutionnaire. Cependant, jusqu’en 1914, les marxistes ont tiré de leur doctrine la justification du parlementarisme et du réformisme. Puisque la révolution doit venir d’elle-même par le seul jeu de l’évolution économique, point n’est besoin d’y inciter le prolétariat. En poussant jusqu’au bout la théorie du matérialisme historique, on pouvait même aboutir à l’inaction absolue ; si en effet les volontés humaines ne jouent aucun rôle, toute propagande est inutile.
La théorie de la dévalorisation des hommes au profit des choses a servi aux leaders démagogues à flatter les masses. L’ouvrier a la haine des supériorités, c’est un défaut de son ignorance et de son esclavage. Il aime les leaders et en même temps il les jalouse. La théorie de la négation de l’influence des hommes dans le déterminisme des événements avait pour effet d’atténuer son ressentiment contre le propagandiste. Quand un orateur lui disait : « Mais je ne suis rien, mon action est nulle, seule l’évolution économique amènera le socialisme », l’ouvrier lui pardonnait presque. Cette humiliation formelle n’empêchait pas bien entendu le propagandiste de profiter des ouvriers, d’en tirer un siège au Parlement et de les trahir plus tard pour passer à la bourgeoisie.
Néanmoins, dans son action mondiale, le marxisme a fait œuvre révolutionnaire. Il a mis la révolte au cœur du prolétariat du monde entier. Et on peut dire même que la prétention du marxisme à être scientifique a servi la cause de la révolution. Sans avoir jamais lu le Capital, les ouvriers ont cru, sur la parole de leurs leaders, que le socialisme n’était pas l’expression d’un désir de justice, mais quelque chose de certain qui devait arriver fatalement comme une éclipse.
Et le premier essai de révolution sociale a été fait en Russie, par des hommes qui avaient passé leur vie à étudier le marxisme.
‒ Doctoresse PELLETIER
MARXISME
N’étant pas royalistes et encore moins fascistes, nous ne saurions être suspects d’avoir le culte des personnalités. Il y a, en effet, longtemps que nous avons fait nôtre le guéris-toi des individus lancé par Anacharsis Clootz, du haut de sa guillotine, comme une objurgation suprême contre toute velléité césarienne et dictatoriale. Du reste, Karl Marx, dont la pensée planait avec la même sérénité sur les sommets du savoir de son temps qu’elle savait descendre dans les profondeurs de notre enfer social, était le moins marxiste des hommes et ce n’est que rendre un juste hommage à la vérité que d’affirmer que Marx a été pour la sociologie ce que Darwin et Lamarck ont été en biologie et Newton, Kepler, Galilée et Copernic en astronomie. Copernic et la pléiade d’astronomes qui l’ont complété ont découvert la véritable position de la Terre dans l’Univers, Darwin surtout a situé l’homme à sa place exacte dans la biologie et Marx a enfin rompu avec tous les mirages trompeurs du déisme et du spiritualisme en assurant la victoire définitive de la conception matérialiste et moniste de l’histoire.
C’est désormais la fin de toutes les légendes héroïques et des miracles. L’histoire humaine cesse d’être inspirée par l’intervention divine et actionnée par des surhommes : princes, guerriers ou prophètes, pour être déterminée par l’évolution économique inhérente à notre planète. La trame de l’histoire, dit Karl Marx, ce sont les luttes de classes qui ont fait évoluer notre espèce de l’anthropophagie à l’esclavage, de l’esclavage au servage et du servage au salariat. Dans le lendemain historique qui se prépare, ces luttes de classes vaincront avec le salariat, dernière forme de l’esclavage, toute hiérarchie sociale en créant ainsi les conditions voulues pour l’avènement de la société communiste dans laquelle la lutte pour la vie cessera d’être la guerre entre les hommes pour revêtir de plus en plus le caractère d’une lutte contre les forces de la nature environnante, afin de les utiliser pour le bien de l’humanité affranchie.
Le processus économique résulte non seulement de l’intervention humaine, mais encore de toutes les forces cosmiques, telluriques, géologiques en action permanente sur notre habitat céleste et dont l’influence est prépondérante. L’apport de l’homme est relativement minuscule. Mais il n’est pas nul et, pour ne pas être le créateur des inéluctables transformations, il peut cependant, en tant qu’accoucheur, hâter leur éclosion. Pour Marx l’avènement de la Société Communiste n’est pas seulement une conviction, mais une certitude, un axiome mathématique.
Les principaux leviers de la Révolution communiste sont la lutte de classes devenant de plus en plus consciente par les effets de la loi des salaires et de la concentration capitaliste, que hâteront l’expropriation générale, frayant la voie à la société sans classes. La lutte de classes avec la loi d’airain des salaires, rive l’ouvrier à sa chaîne d’esclavage et la concentration capitaliste, oblige les capitaux, ces molécules de la ploutocratie, à se chercher et à s’agglomérer en vertu même des lois mathématiques de la nature selon lesquelles les corps s’attirent en raison de leurs masses et en raison inverse du carré de leurs distances. La lutte de classes est un fait indéniable et ne saurait être niée que par l’ignorance ou l’imposture.
Tous les travaux, les plus impérieusement nécessaires, les plus utiles, les plus indispensables à la vie même, comme, par exemple, le travail des mines, de l’alimentation, de la construction des maisons, de la confection des vêtements, de la locomotion, etc... , etc... se font par des travailleurs qui ne possèdent comme instruments de production que leurs mains et leurs cerveaux, tandis que le sol, les usines, chantiers, ateliers, fabriques,. toutes les richesses et tous les instruments de production en fer, en fonte ou en acier sont détenus par des maîtres improductifs et leurs négriers ou surveillants de la production humaine. De là, forcément, antagonisme d’intérêts du travailleur exigeant plus d’aisance avec moins de surmenage, tandis que les détenteurs illicites de la richesse sociale que d’autres mettent en œuvre ont tendance à exiger de leurs travailleurs, c’est-à-dire de leurs esclaves, plus de travail pour moins de salaire.
Le jour, heureusement prochain, où la classe ouvrière dans sa majorité deviendra consciente de cet état honteux et abominable, l’expropriation des expropriateurs aura sonné et tout ce qui fait obstacle à l’émancipation du prolétariat et, par le prolétariat, à l’émancipation de tous les êtres humains sans distinction d’âge, de sexe, de nationalité, de race et de couleur, devra être impitoyablement renversé, balayé, anéanti.
Nous ne préconisons pas le châtiment des dirigeants et des exploiteurs, mais simplement leur suppression, comme moyen de défense de la Révolution, par la force ou à l’amiable, parce que nous avons parfaitement conscience que, pour vivre et durer, l’ordre nouveau que nous voulons instaurer doit bannir de ses mœurs jusqu’à l’idée même de la récompense et du châtiment.
Nous touchons ici au point névralgique, vulnérable de la Révolution sociale.
Presque tous les révolutionnaires du passé et parmi eux les meilleurs, comme Marat et Babeuf, ont préconisé, pour la période transitoire, la dictature révolutionnaire et impersonnelle.
Karl Marx, malheureusement, a également préconisé ce qu’on appelle la dictature révolutionnaire du prolétariat, mais avec moins d’insistance que les Bolcheviks, et son ami et alter-ego Frédéric Engels a même déclaré que la prise du pouvoir par le Prolétariat ne devait durer que le temps qu’il faudrait pour exproprier et socialiser la propriété. Karl Marx, m’a-t-on dit, devait publier un volume abordant et traitant ce sujet. Malheureusement la mort l’en a empêché...
Nous pensons qu’il règne parmi les révolutionnaires, par atavisme et pour ne pas avoir su tirer, lors de la première Internationale, de la thèse socialiste et de l’antithèse anarchiste, une synthèse communiste libertaire, une grande et dangereuse confusion. De tous temps tous les penseurs socialistes ont déclaré sur tous les tons qu’il fallait substituer au gouvernement de l’homme sur l’homme l’administration des choses et finalement on aboutit, après s’être traîné mutuellement dans la boue, à déclarer du côté bolchevik que les socialistes allemands, qui ont toujours travaillé pour la réconciliation de la France et de l’Allemagne ainsi que pour l’avènement de la République allemande, étaient des social-fascistes, accusation insensée à laquelle les hommes de la deuxième Internationale répondent que Staline, l’auteur du seul Code au monde qui consacre l’égalité des sexes et la liberté de l’amour et qui semble enfin reconnaître la nocuité de la Nep, préparerait, dans l’ombre, on ne sait quel Thermidor portant dans ses flancs un bonapartisme renouvelé !
Pour sortir de cette pétaudière, une clarification dans les idées et une révision profonde de la tactique révolutionnaire s’impose. La disparition ou l’évanouissement de l’État comme disait Lénine n’est pas un but final et lointain, mais une nécessité de vie pour le socialisme. L’Armée, la Police, la Magistrature et l’Église, ces assises principales de l’État, ne sauraient être mises au service de la Révolution sous peine de l’absorber et de la tuer, mais doivent être détruites, anéanties sous et par la ruée des peuples soulevés.
Seule, la socialisation de toute la propriété complétée par la socialisation de la distribution rendra ensuite possible l’abolition du salariat en réalisant l’égalité économique et la liberté individuelle de tous par l’égal droit de chacun sur le rendement social. Là est le salut, il n’est pas ailleurs.
‒ Frédéric STACKLBERG
MARXISME (Point de vue du socialisme rationnel)
Dans une étude relative au problème social, nous exposerons que la question d’appartenance des richesses est du domaine du raisonnement et non l’effet mécanique du prétendu déterminisme économique comme l’enseigne plus ou moins nettement le marxisme en tant que doctrine socialiste.
Quoiqu’en disent les marxistes de stricte observance aussi bien que quelques néo-marxistes, le marxisme n’est qu’une religion aussi inopérante, socialement, que celle qu’il prétend remplacer pour l’instauration du socialisme Par le fait que la solution du problème social dépend, selon Marx avant tout, du déterminisme économique, le marxisme ne peut conduire la société que vers des déceptions plus ou moins cruelles. Cela ne veut pas dire, à notre époque d’ignorance sociale sur la réalité du droit, que le marxisme n’est qu’un cadavre à enterrer. Comme tous les préjugés, le marxisme a et aura la vie longue.
Alors que les religions révélées défaillantes donnaient la mesure de leur incapacité à vaincre le paupérisme intellectuel, moral et économique, Marx et quelques disciples pensèrent que l’Humanité avait fait fausse route en cherchant à infuser dans la conscience individuelle un sentiment religieux ou moral de solidarité humaine. Pour eux, la société n’a pas à s’intéresser à la question morale qui se résoudra toute seule par l’efflorescence du politique dans l’économique. Le mécanisme suffit à tout pour bien des marxistes. Ce que les religions révélées n’ont pu faire, au nom de la foi et de la grâce, la religion marxiste du déterminisme économique avec Marx et ses disciples, le résout au nom de la fatalité d’une science mystique bien plus spécieuse que réaliste. Il est presque inutile de s’intéresser à ce qui doit être, diront plus ou moins les marxistes, l’Usine marxiste fabriquera toujours des produits socialistes quelle qu’en soit l’origine. Les produits seront sains ou nocifs, moraux ou amoraux selon les besoins ; ainsi le veut l’Évangile de Marx.
C’est ainsi qu’avec des sophismes de circonstances, le marxisme, pendant la seconde moitié du siècle dernier et le commencement de celui-ci, va remplir de gestes politico-économiques la plupart des manifestations populaires. Grâce aux fictions sur lesquelles le marxisme repose, il pourra faire de nombreux adeptes dans les classes laborieuses, cependant que les classes possédantes n’auront pas à souffrir des conquêtes illusoires qu’elles accorderont aux prolétaires. Il y aura mirage à l’avantage des élites. Cependant, le marxisme apparaissait et reste nettement une méthode empirique de réalisation socialiste toujours prochaine. Du fait de cette croyance prolétarienne, la parodie socialiste s’ancrait dans le cerveau d’un grand nombre d’opprimés et un mouvement de libération sociale naissait d’une méthode, d’une doctrine qui s’annonçait révolutionnaire en théorie et restait conservatrice dans la pratique. Comme résultat, les prolétaires, qui n’ont ni le temps ni les moyens de s’instruire, attendent... l’avènement du socialisme promis mécaniquement et se demandent, non sans crainte, de quoi demain sera fait. Vu à travers les lunettes du marxisme, le socialisme s’annonce comme une utopie. Ses prêtres avaient cependant prêché maintes fois du haut des chaires de l’église socialiste marxiste, qu’une catastrophe rédemptrice ne pouvait tarder à se produire. Il y a quelque quatorze ans que la prophétie semblait se réaliser. Nul ne peut nier que, comme catastrophe, la guerre mondiale n’en ait été une grande, et que la Révolution Russe, aux mains des marxistes, n’ait pas donné l’illusion que les prophéties marxiennes allaient donner la mesure de leur valeur sociale. La transsubstantiation de l’ordre capitaliste à l’ordre socialiste n’allait pas tarder à se produire ; les travailleurs allaient être débarrassés du cauchemar économique et l’harmonie sociale allait régner, d’abord en Russie, dans l’Univers ensuite.
Il serait superflu, sans vouloir dénigrer le moins du monde l’expérience russe, d’entrer dans des explications développées pour savoir que, non seulement le travail n’est pas plus libre en Russie qu’ailleurs, et constater qu’il n’a pas anéanti le paupérisme moral. Ce sont cependant des marxistes, plus ou moins orthodoxes, qui détiennent le pouvoir et les richesses. L’éducation socialiste est entre leurs mains. Le temps, et un temps relativement prochain, nous dira ce qu’a valu cette éducation. Ce qui s’est produit en Russie était inévitable et depuis 1900 nous l’avons exposé, dit et redit dans de nombreux articles de journaux, de revues et dans les livres sur la Souveraineté du Travail et le Collectivisme Rationnel. Nous verrons en exposant quelques-uns des sophismes sur lesquels le marxisme repose, qu’il fallait mettre beaucoup de complaisance pour croire à la puissance créatrice de certains mythes.
De différentes manières, la vie sociale de notre époque nous prouve que le déterminisme économique qui est, en quelque sorte, le pivot sur lequel le marxisme repose, peut, tout aussi bien accoucher de l’impérialisme financier le plus redoutable aux opprimés, comme aux États-Unis, que du socialisme libérateur du travail. Pour être plus explicite, nous reconnaissons qu’il n’y a que de bien faibles chances pour que ce déterminisme opère en faveur des opprimés, quelles que soient les apparences que des rhéteurs habiles mettront en relief. Si, comme nous en avons la conviction, le socialisme doit être instauré sur notre terre et y vivre, c’est à une conception scientifique de liberté et par suite de responsabilité, non seulement différente de celle de notre époque, mais le plus souvent opposée, que nous le devrons. Le socialisme succédera au capitalisme, sans le continuer, comme le jour succède à la nuit. Bien des signes avant-coureurs font comprendre que le jour approche où il ne sera plus possible de diriger une nation par le sophisme d’un progrès qui ne fait qu’augmenter les moyens de domination d’une caste et le mirage d’une production faisant de plus en plus comprendre aux masses laborieuses le manque de satisfaction des besoins ressentis. Nous pensons avec H. de Man, sans nous associer le moins du monde à sa méthode de réaliser le socialisme toujours à venir, que « le moment est de placer les questions sur leur véritable terrain, de se débarrasser d’anciennes formules qui cachent plus souvent qu’elles n’expriment ce que l’on veut en réalité. »
Il n’y a pas qu’en Belgique où le marxisme soit contesté et combattu : les pays anglo-saxons n’ont jamais compris que le marxisme puisse avoir un prestige sur les masses. En France, la question n’est pas moins trouble qu’ailleurs ; nous sommes tentés de dire qu’elle est pire. Des politiciens se réclament du communisme, d’autres du seul mot de socialiste, pendant que certains se désignent comme républicains socialistes et d’autres se veulent être des radicaux-socialistes qu’il ne faudrait pas confondre avec les socialistes-radicaux. Pour un peu, tous les parlementaires arboreraient la cocarde socialiste. Dans un pays où tant de... socialismes foisonnent, il est tout indiqué qu’il n’y en ait aucun de scientifique et d’équitable. Aussi, assistons-nous à des marchandages politiques sans fin et sans portée réellement socialiste. Le profit personnel est roi. S’il apparaît que le vieux monde politico-économique chancelle, on ne s’intéresse pas, pour cela, à étudier ce qu’il faudrait mettre à la place si un incendie ou une inondation obligeait à remplacer la maison détruite. On cherche, par un éclectisme de circonstance, à faire quelques réparations qui dureront autant, sans doute, que les législateurs qui les ordonnent...
Dans son nouveau livre « le Marxisme a-t-il fait faillite ? » M. Vandervelde fait un sérieux effort, quoique se disant agnostique, pour expliquer que le Manifeste Communiste aussi bien que le programme d’Erfurh ont conservé leur valeur socialiste ; et, s’appuyant sur certaines déclarations, cherche à revigorer la doctrine marxiste d’une âme nouvelle. À cet effet, il veut bien nous faire savoir qu’une littérature marxienne a été publiée en Russie et qu’elle compte quarante-deux volumes. Désormais, en s’appuyant sur Marx ou sur quelque autre marxiste, plus ou moins orthodoxe, il sera toujours possible d’utiliser, quelques mots extraits d’un livre, quelques phrases d’un document ou quelques passages sortis à propos d’un ouvrage pour montrer que le marxisme est le pur socialisme et le seul système social qui puisse résister à l’examen. En utilisant, par le même procédé, des extraits appropriés à une thèse différente ou opposée, divers passages des écrits des mêmes auteurs, on peut étayer un système social contraire.
Encore une fois ce que nous disons du marxisme ne signifie pas que tout est mauvais dans la théorie marxiste ni dans la pratique de cette doctrine, qui est plutôt une méthode à appliquer selon les lieux et les circonstances, mais prouve qu’elle prend trop souvent ses désirs pour la réalité, ce qui n’est pas... bien... scientifique... Le marxisme n’est pas une doctrine, mais une méthode souple et variable, qui s’adapte merveilleusement aux circonstances quand le recrutement politique, pour la conquête des pouvoirs publics, le permet. En peu de mots, le marxisme est, avant tout, une machine électorale pour assurer l’élection de ceux qu’il prend sous sa protection.
Le marxisme, étudié de près, n’est qu’un mysticisme permanent de matérialisme et de déterminisme économique valable pour la conquête des pouvoirs publics. Rien d’étonnant que le marxisme touche à tout, sans rien déterminer scientifiquement ; et c’est la raison pour laquelle, selon les lieux et les circonstances le marxisme rejette brusquement les idées relatives à la morale, à la liberté et à la justice, quitte à les reprendre vaguement pour les besoins de la cause politique à défendre à une autre occasion.
Pour un socialiste marxiste, le socialisme est une espèce de transsubstantiation matérielle qui change en pur diamant tous les erzats que l’économie politique fait surgir des institutions sociales, en commençant par la prétendue production... socialisée, chère aux déterministes aussi bien qu’à M. E. Vandervelde.
Le rôle social des futurs dirigeants marxistes sera d’autant plus aisé à remplir que la fatalité des événements, devant suppléer à la volonté et à la science humaine, aura préparé la route à suivre.
Dès lors, du côté intellectuel et moral, le socialisme n’a pas à s’intéresser, comme le soutiennent Colins et ses disciples, depuis près d’un siècle, de ce que Lafargue appelle des grues métaphysiques. C’est simple, et, disons-le nettement, trop simple pour avoir une valeur sociale sérieuse. Le socialisme ne peut être que l’application de la justice à la société. Alors que le marxisme n’est pas une science réelle, il peut être considéré au point de vue social, comme une théorie d’adaptation au milieu, susceptible de prendre les formes les plus diverses et par là, dans certains cas, pourra aider à l’avènement du socialisme rationnel, seul durable et scientifique. Il pourra aussi être le naufrageur du socialisme. Cette manière de poser la question sociale ouvre au marxisme un horizon nouveau avec des avenues commodes pour atteindre le pouvoir et les richesses qu’il orienterait vers l’usage général, en raison du travail et du mérite de chacun dans une atmosphère d’harmonie sociale où la liberté individuelle n’aura plus rien à craindre. L’ignorance sociale de l’époque sert le marxisme, qui repose sur des mythes économiques...
Le socialisme rationnel substitue au marxisme une méthode réaliste, morale, économique et pratique, telle que Colins l’a formulée dans son œuvre immortelle de science sociale.
Pour résumer notre pensée sur le marxisme, nous dirons :
-
Que cette doctrine est un modèle d’illusionnisme ;
-
que l’illusionnisme est aussi vieux que le monde, mais qu’il a servi jusqu’ici, avec des secousses morales et économiques, à maintenir un ordre relatif ;
-
que tant que le désordre n’a pas commis tout le mal qu’il peut faire et que, de ce fait, la nécessité sociale n’est pas suffisamment exigeante pour y mettre fin, la société ignorante doit continuer d’expier ses fautes sous le fouet de l’illusion ;
-
que pour si chaotique et boueuse que soit notre époque, il peut être nécessaire de faire l’expérience d’une illusion nouvelle ;
-
que de plusieurs maux il faut choisir le moindre, surtout quand ce mal nécessaire peut devenir un bien relatif à l’instauration du Socialisme juste et scientifique, où l’illusion fera place à la vérité-réalité que le bon raisonnement déterminera, après avoir retourné dos à dos le matérialisme et l’anthropomorphisme.
De ce que nous avons dit du marxisme, il résulte que cette méthode d’organisation économique se présente comme facteur possible, plus ou moins déterminant, d’un éclectisme presque providentiel, où l’on trouve de tout un peu. En époque d’ignorance sociale, le marxisme, en déplaçant certains maux dont souffre la société, peut amener quelques modifications accidentelles favorables à la vie générale, en attendant que la nécessité sociale oriente l’Humanité vers la suppression effective du paupérisme moral aussi bien que matériel. Le marxisme conduit au fonctionnarisme et à une variété de socialisme étatiste.
Le marxisme prétend, non seulement organiser la propriété générale, mais il tend à organiser aussi l’exploitation des richesses. Par là, le marxisme prépare la gestation et la naissance du fonctionnarisme le plus despotique que l’univers ait connu.
Il est conduit à cette solution parce qu’il ne discerne pas scientifiquement, dans l’appropriation sociale des richesses, la différence essentielle qu’il y a entre la source passive des richesses ‒sol général ‒qui est nécessaire, pour la production générale, et les produits travail, simplement utiles au bonheur social. Le marxisme fait, plus ou moins ouvertement, cause commune avec l’économie politique courante, ne remarquant pas que l’escobarderie des politiciens enseigne la confusion de l’indispensable avec l’utile en confondant ainsi le propre avec le figuré. Cette confusion générale des richesses, voulue par les économistes et passablement de socialistes, a, pour conséquence sociale de faire payer tous les impôts par les travailleurs, d’établir le salaire ‒ou prix du travail ‒au minimum des circonstances, et, par suite, de maintenir, le mieux possible, l’esclavage des masses.
Le marxisme, loin d’être le fossoyeur du régime bourgeois, qu’il combat théoriquement par des mythes, le continue pratiquement sur un plan fonctionnariste où, par une solidarité illusoire la liberté individuelle et l’égalité relative au mérite de chacun seraient écrasées par une vague et irresponsable administration des choses aussi despotique que la féodalité financière de notre époque.
Le socialisme rationnel, en tant qu’organisation sociale, peut et doit développer, chez les travailleurs, l’esprit d’examen et par suite, selon les connaissances et les circonstances, l’esprit d’association libre...
L’homme, naturellement, ne peut tendre, en toute circonstance, pour une association forcée...comme il ressort du marxisme appliqué... L’homme doit être libre de travailler en association ou isolément.
De ce qui précède, il résulte que le marxisme est la caractéristique d’une époque de dissolution sociale. Ne sachant exactement quelle route suivre, il s’attache mystiquement à l’apparence des faits qui naissent du mécanicisme d’une période de désordre social et économique.
Fasciné par le mirage économique de la théorie du mouvement, le marxisme étudie spécialement les effets d’un système d’iniquités sociales sans remonter aux causes. Dans un but spécialement politique, le marxisme entretient l’équivoque, soit en ne faisant qu’effleurer le sujet dont il paraît s’occuper, soit en passant sous silence les faits dont il redoute l’examen.
Le marxisme, plus ou moins orthodoxe ou I’Au-delà du marxisme, reposent sur des fictions ou des utopies qui situent le socialisme dans le domaine du mysticisme.
‒ Élie SOUBEYRAN
MASSACRE
s. m. (du bas allem. mastken, égorger)
Carnage, tuerie de gens qui ne peuvent se défendre. Par analogie : grande tuerie de bêtes. Fam. : Destruction d’objets nombreux. Populaire : Homme qui travaille mal, qui ne sait point exécuter convenablement ce qu’on lui a donné à faire. Vénerie : Bois de cerf ou de daim dressé à l’endroit où l’on va donner la curée.
La lutte est la loi constante de la vie. Rien ne subsiste que d’entredévorement. Les minéraux sont décomposés par les végétaux qui, à leur tour, se ravissent leur substance. Les animaux mangent les végétaux et font, d’autres animaux, leur pâture. L’homme, animal tard venu sur le globe, malgré sa faculté de raisonner (apparente ou réelle) n’échappe pas à cette loi, ne peut pas y échapper ; mais alors que, dans le règne animal, rarement les individus d’une même espèce s’entretuent, chez l’homme c’est un fait normal et universel. Son instinct contrarié et complexe, sa faculté d’induire et de déduire, l’ont amené à considérer toute la nature comme un vaste champ d’expérience, où chaque individu peut être consommé, soit directement, soit dans les produits de son activité. Le seul critérium possible aux premiers âges de l’humanité, est la force. Sa force propre d’abord, sa force d’individu, puis celle de sa famille, de son clan, de sa tribu, celle enfin de son pays. Et aussi, dans le sein même de son clan, de sa tribu, sa propre force agissant sur les autres composants du milieu ; dans le pas, sa famille, son clan, son parti, agissant sur les autres individus ou les autres clans ou les autres partis.
La force, d’abord brute, toute d’agilité et de ruse, ne tarde pas à se sophistiquer. La force s’adjoint « le droit à la force », et le devoir de se soumettre à la force, non plus seulement du muscle et de la ruse, mais encore du raisonnement. Et cette force altérée, déviée, trouve son expression dans le gouvernement.
Le gouvernement puise sa force dans la croyance que les gouvernés ont de son droit à gouverner. Pour faire accepter cette foi, les prêtres enseignent l’existence d’un Dieu Tout-Puissant qui a révélé aux hommes sa loi. Cette loi est d’obéir au Prince : « Car toute autorité vient de Dieu » (Saint Paul). Ce Dieu, Justicier Suprême, invisible, mais toujours présent, punira de supplices inimaginables, quiconque transgressera sa loi.
Tant que les hommes, les peuples ne mettront pas en discussion la révélation, l’ordre règnera. Aussi le Pouvoir devra-t-il empêcher par tous les moyens l’examen de cette règle. Il y parvient : 1° En s’appropriant le sol et toute richesse sociale, maintenant ainsi les peuples dans la plus grande misère matérielle et intellectuelle ; 2° En supprimant incessamment tout individu qui ne se soumet pas à la règle.
Mais les révélations, les règles, sont aussi multiples que les groupements nationaux. Les guerres, le commerce, mettent en présence des individus ayant des croyances différentes. L’esprit critique se développe nécessairement et menace dans chaque groupe, dans chaque pays, la révélation, et partant : l’ordre. Le pouvoir du moment (religieux ou de prétention divine), sous peine de disparaître, doit se débarrasser des « fauteurs de désordre », il sévit brutalement. Ses tribunaux condamnent et quand les hérétiques, les indisciplinés sont trop nombreux ses soldats les massacrent par dizaines, par centaines, par milliers. Aussi l’histoire ; n’est-elle qu’une longue série de carnages, de massacres. Dans leur fureur aveugle, les reîtres tuent tout : femmes, vieillards, enfants. Tantôt, ces massacres se font au nom de Mahomet, tantôt au nom du Christ, tantôt au nom du Roi, du Prince, de la Patrie, de l’Idée. Mais si les peuples, spoliés, las d’être miséreux, se sont parfois soulevés contre les gouvernants et les ont massacrés, souvent, presque toujours, ce sont ceux-ci (absous par les juges, bénis par les prêtres) qui ont massacré le peuple. Prêtres et gouvernants, les uns s’appuyant sur les autres, ont toujours marché la main dans la main lorsqu’il s’est agi de mieux asservir les peuples.
Voltaire, a fait le décompte des victimes immolées au saint nom du Dieu des chrétiens. Le total se montait à neuf millions sept cent dix-huit mille huit cents (9.718.800). Encore avait-il, de bonne foi, réduit tantôt de moitié, tantôt d’un tiers les rapports des historiens. Voici un abrégé du dénombrement fait par Voltaire et donné par Pigault-Lebrun (Le Citateur) : L’an 251, Novatien disputait la papauté au prêtre Corneille. Dans le même temps, Cyprien et un autre prêtre, nommé Novat, qui avait tué sa femme à coups de pieds dans le ventre, se disputaient l’épiscopat de Carthage. Les chrétiens des quatre parties se battirent, et il y a modération en réduisant le nombre des morts à deux cents, à... 200.
L’an 313, les chrétiens assassinent le fils de l’empereur Galère ; ils assassinent un enfant de huit ans, fils de l’empereur Maximin, et une fille du même empereur, âgée de sept ans ; l’impératrice, leur mère, fut arrachée de son palais, et traînée avec ses femmes par les rues d’Antioche et l’Impératrice, ses enfants et ses femmes furent jetés dans l’Oronte. On n’égorge pas, on ne noie pas toute une famille impériale sans massacrer quelques sujets fidèles, sans que les sujets fidèles ne perforent quelques égorgeurs ; portons encore le nombre des morts à deux cents, ci... 200.
Pendant le schisme des donatistes en Afrique, on peut compter au moins quatre cents personnes assommées à coups de massue, car les évêques ne voulaient pas qu’on se servit de l’épée, parce que l’Église abhorre le sang, ci... 400.
La consubstantialité mit l’Empire en feu à plusieurs reprises ; et désola pendant quatre cents ans des provinces déjà dévastées par les Goths, les Bourguignons, les Vandales. Mettons cela à 300.000 chrétiens égorgés par des chrétiens, ce qui ne fait guère que sept à huit cents par an, ce qui est très modéré.
La querelle des Iconoclastes et des Iconolâtres n’a pas certainement coûté moins de soixante mille vies.
L’impératrice Théodore, veuve de Théophile, fit massacrer, en 845, cent mille manichéens. C’est une pénitence que son confesseur lui avait ordonné, parce qu’il était pressé, et qu’on n’en avait encore pendu, empalé, noyé que vingt mille, ci... 120.000.
N’en comptons que vingt-mille dans les vingts guerres des papes contre papes, d’évêques contre évêques, c’est bien peu : ci... 20.000.
La plupart des historiens s’accordent et disent que l’horrible folie des croisades coûta la vie à deux millions de chrétiens. Réduisons le compte de moitié, et ne parlons pas des Musulmans tués pas les chrétiens.
La croisade des moines-chevaliers-porte-glaives, qui ravagèrent tous les bords de la Baltique, peut aller au moins à cent mille. (100.000).
Autant pour la Croisade contre le Languedoc, longtemps couvert des cendres des bûchers (100.000).
Pour les Croisades contre les Empereurs depuis Grégoire VII, nous n’en compterons que trois cent mille.
Au quatorzième siècle le grand schisme d’Occident couvrit l’Europe de cadavres ; réduisons à cinquante mille les victimes de la « rabbia papale ».
Le supplice de Jean Huss et de Jérôme de Prague fit beaucoup d’honneur à l’empereur Sigismond, mais il causa la guerre des Hussistes, pendant laquelle nous pouvons hardiment compter cent cinquante mille morts.
Les massacres de Mérindol et de Cabrières sont peu de chose après cela : vingt-deux gros bourgs brûlés ; (les enfants à la mamelle jetés dans les flammes ; des filles violées et coupées en quartiers ; des vieilles femmes qui n’étaient plus bonnes à rien, et qu’on faisait sauter par le moyen de la poudre à canon qu’on leur enfonçait dans les deux orifices ; les maris, les pères, les fils, les frères, traités à peu près de même ; tout cela ne va qu’à dix-huit mille, et c’est bien peu.
L’Europe en feu depuis Léon X jusqu’à Clément IX ; le bois renchéri dans plusieurs provinces par la multitude des bûchers ; le sang versé à flots partout ; les bourreaux lassés en Flandre, en Hollande, en Allemagne, en France, et même en Angleterre ; la Saint-Barthélémy, les massacres des Vaudois, des Cévennes, d’Irlande, tout cela doit aller au moins à deux millions.
On assure que l’Inquisition a fait brûler quatre cent mille individus. Réduisons encore de moitié, 200.000.
Las Casas, évêque espagnol, et témoin oculaire, atteste qu’on a immolé à Jésus, douze millions des naturels du Nouveau-Monde. Réduisons cela à cinq millions ; c’est être beau joueur, ci... 5.000.000.
Réduisons, avec la même économie, le nombre des morts pendant la guerre civile du Japon ; on le porte à quatre cent mille, et je n’en compterai que trois cent mille, ci 300.000. Total : 9.718.800.
L’énoncé de Voltaire mériterait certes d’être continué. Tant de sang pour instaurer le règne du pape et des prêtres, cela fait frémir d’horreur et de rage. On ne sait ce qu’il faut le plus : ou maudire la duplicité sanglante de l’Église, ou plaindre l’incommensurable sottise des fanatiques massacreurs. Voltaire donne ici, en bloc, le compte des victimes du christianisme ; il faut nous arrêter plus particulièrement sur les massacres proprement dits, qui jalonnent l’histoire, douloureusement. C’est tout le Calvaire de la Pensée libre et de l’Individu qui s’inscrit ici en lettres de sang.
Tantôt pour le pape, tantôt pour le roi ; pour défendre « la règle », ou la propriété ; pour faire des adeptes en les dérobant aux autres révélations, ou pour agrandir la propriété seigneuriale ou nationale en volant celle des autres, des millions d’hommes se sont entrégorgés, massacrés. Et quand le libre-examen devient théoriquement la seule règle du Droit, les sociétés débarrassées des luttes religieuses et seigneuriales, manœuvrées par des forbans de la banque et de l’industrie, du commerce et de l’agio au nom de la civilisation, de la Patrie, du Droit, de l’Honneur, se ruèrent les unes contre les autres. Des milliers de prolétaires, puis des millions, jonchèrent les champs de carnage. Amenés au loin, dans les « colonies », les soldats (fils du peuple) gavés d’alcool, ignorants et ignobles, toujours au nom de la civilisation, et pour le plus grand profit des banques, massacrèrent des populations entières sans excepter femmes et enfants.
La Propriété et le Pouvoir : l’Autorité ! voilà l’hydre qu’il faut abattre pour que ne se renouvellent plus jamais ces massacres stupides et terrifiants. De se savoir seuls attelés à une telle œuvre, les anarchistes comprendront-ils l’effort inouï qu’ils doivent fournir ?
Nous ne pouvons ici que signaler brièvement quelques-uns des principaux massacres dont l’histoire nous a conservé le souvenir. Certains emplissent des volumes ; nos lecteurs devront recourir aux ouvrages spéciaux dont il sera parlé au dernier volume de cette Encyclopédie.
Massacre de Vitry
1137. ‒ Louis VII succède à Louis le Gros. Une guerre terrible éclate entre lui et Thibault, comte de Champagne, qui avait pris la défense de Pierre de la Châtre, archevêque de Bourges, promu à ce siège par le pape, contre la volonté du roi. Louis VII marcha contre la Champagne, mit tout à feu et à sang, assiégea la ville de Vitry, et après avoir fait violer les femmes et massacrer les habitants, il eut la barbarie de faire murer les portes d’une église où quinze cents personnes s’étaient réfugiées comme dans un asile inviolable et sacré ; ensuite, il y fit mettre le feu...
Massacres de Champagne
1235–39. ‒ Le 8 novembre 1235, Grégoire IX étendit la Sainte Inquisition à toute la chrétienté. Il délégua en Champagne, comme Inquisiteur, un ancien Cathare, nommé pour ce motif : Robert le Bougre. Il découvrit à Montwimer ‒ lieu encore appelé Montaimé ou Monthermé ‒ un nid de Patarins, chrétiens groupés autour de leur Évêque, Moranis, et n’étant point d’une orthodoxie absolue.
Jugés et condamnés en huit jours, le 29 mai 1239, cent quatre-vingt trois furent brûlés.
« Cette pieuse cérémonie était honorée de la présence du roi de Navarre, des barons du pays, de l’archevêque de Reims, de dix-sept évêques, sans compter les abbés, prieurs, doyens, etc... et une foule estimée à cent mille âmes. Le moine Albéric, un contemporain, dit que ce fut un holocauste agréable à Dieu. » (Abbé Meissas, Ephémérides de la Papauté.)
Vêpres Siciliennes
30 mars 1282. ‒ Jean, seigneur de l’île de Procida, avait été dépouillé de ses biens par Charles d’Anjou, et banni en Sicile, ce qui avait excité en lui un tel ressentiment, qu’il forma le dessein d’introduire le roi d’Aragon, comme héritier de la maison de Souabe, dans le royaume de Sicile. Il se trouva secondé dans ses projets par Nicolas III, Michel Paléologue et Pierre d’Aragon.
Pour renverser la puissance de Charles d’Anjou, ils organisèrent dans chaque ville de la Sicile, une conspiration infernale.
Charles, lancé à la conquête de Constantinople voulut commander lui-même sa flotte, et vint assiéger Michel Paléologue dans sa capitale ; malheureusement pour lui son armée fut battue par les Grecs, et il se vit contraint de rentrer à Naples.
Cette nouvelle parvint bientôt en Sicile, et augmenta l’audace des conjurés ; le jour de Pâques, 30 mars 1282, à l’heure de vêpres, aux premiers sons des cloches, les Siciliens se ruèrent sur les Français, les massacrèrent dans les rues, dans les maisons, et jusqu’au pied des autels ; les femmes prenaient aussi leur part de cette boucherie. En moins de deux heures, huit mille victimes furent égorgées.
Émeute des Pastoureaux
1320. ‒ Sous ce règne éphémère (Philippe V : 1316–1322) dit le moine de Saint-Denis, Jean XXII, pape, fit prêcher par ses moines que la conquête de la Terre Sainte se ferait par des bergers. Aussitôt les gardeurs de troupeaux abandonnèrent leurs moutons, leurs bœufs et leurs porcs, se réunirent par troupes, et parcoururent les provinces, ravageant les campagnes pillant les châteaux, les abbayes, et rançonnant les villes pour se procurer le moyens de passer en Asie. Les Juifs surtout avaient à redouter leur passage, car lorsqu’ils tombaient au pouvoir de ces fanatiques ils étaient impitoyablement massacrés. On raconte qu’une fois les Pastoureaux, après avoir saisi dans une seule ville plus de cinq cents de ces infortunés, les renfermèrent dans une grande tour à laquelle ils mirent le feu.
Ils traversèrent ainsi la France, et vinrent s’abattre sur Carcassonne, où les Vaudois les massacrèrent jusqu’au dernier.
La Jacquerie
1357–58. ‒ Soulèvement des paysans (ou Jacques) de l’Ile de France contre l’oppression des seigneurs et des gens de guerre, français, anglais, navarrais. Voici ce qu’en dit la chronique de Saint-Denis : « Le lundi, vingt-huitième jour de mai 1357. les gens de labour s’émurent dans le pays de Beau-voisin, et coururent sus aux gentilshommes, sous la conduite de Guillaume Caillet leur capitaine ; ils égorgèrent les seigneurs, leurs femmes et leurs lignées ; dans plusieurs villes la bourgeoisie se joignit aux paysans, dont l’insurrection coïncidait avec la tentative révolutionnaire d’Étienne Marcel. Celui-ci envoya au secours des Jacques un contingent, sous la conduite de Jean Vaillant, prévôt des monnaies.
Étourdie d’abord et consternée, la noblesse se ravisa bientôt, et Charles de Navarre écrasa les Jacques près de Meaux (1358). On les massacra sans pitié, on brûla leurs villages, on mit l’Ile-de-France à feu et à sang.
Révolte des Maillotins
1380. ‒ Écrasés d’impôts, les Parisiens se soulevèrent et coururent à l’hôtel de ville, en brisèrent les portes, s’emparèrent des armes qu’ils y trouvèrent, prirent des maillets en plomb dans l’Arsenal et se ruèrent dans les rues, assommèrent les soldats, les fermiers des aides et tous les suppôts de la tyrannie ; ils délivrèrent les prisonniers, brûlèrent les hôtels des princes, et se déclarèrent libres et affranchis de toutes sujétions royales ou princières.
Mais Charles VI entra avec son armée dans Paris et fit brûler le jour même plus de cinq cents insurgés ; pendant plus de trois mois il en fit constamment torturer et pendre jusqu’à trente et quarante par jour.
Enfin, lorsque le jeune roi fut rassasié de sang, il fit publier à son de trompe que le peuple eût à se rassembler sur la place du Palais ; et là, assis sur un trône étincelant d’or et de pierreries, il fit lire par son chancelier, Pierre d’Orgemont, le discours suivant : « Manants et bourgeois de Paris, vous avez mérité mille morts pour avoir massacré les maltôtiers au lieu de payer vos impôts ! ne savez-vous pas que les rois ont reçu de Dieu le pouvoir de prendre vos biens, vos femmes et vos enfants, et même votre vie, sans que vous ayez le droit de faire entendre un murmure ? Ainsi, vous qui avez eu l’audace de vous révolter, tremblez sur la punition de vos crimes, car Charles le Bienaimé est juste, et il vous fera une justice terrible ».
Cependant il eût l’air de se laisser fléchir et il exigea que Paris lui versât vingt millions de francs.
Massacre des Vaudois
1488. ‒ Le pape Innocent VIII, décrète la disparition des Vaudois, secte chrétienne qui n’admettait d’autre source de foi, que l’Ancien et le Nouveau Testament et n’admettait par la confession auriculaire, ni le culte des saints, ni le jeûne.
Voici en quels termes Perrin raconte cette persécution : « Albert, archidiacre de Crémone, ayant été envoyé en France par Innocent VIII pour exterminer les Vaudois, obtint du roi l’autorisation de procéder contre eux sans formes judiciaires, et seulement avec l’assistance de Jacques de Lapalu, lieutenant du roi, et du conseiller maître Jean Rabot. Ils se rendirent au Val de Loyse à la tête d’une bande de soldats pour en exterminer les habitants. Mais, à leur approche, ceux-ci s’étaient enfuis et cachés dans les cavernes...
Pourchassés comme des renards on les grilla dans ces cavernes, on les y massacra... La terreur qu’inspirait ce supplice devint telle que la plupart des Vaudois qui avaient jusque là échappé aux recherches des envoyés du pape, s’entretuèrent d’eux-mêmes ou se jetèrent dans les abîmes de la montagne pour éviter d’être rôtis vivants...
Les bourreaux firent si bien la besogne, que de 6.000 Vaudois qui peuplaient cette vallée fertile, il n’en resta pas 600 pour pleurer la mort de leurs frères.
Batailles de Jarnac et Montcontour
1569. ‒ À l’instigation de sa mère, Charles IX leva une armée dont il confia le commandement au maréchal de Tavannes. Les troupes protestantes du prince de Condé et de l’amiral Coligny, soutenues par les Anglais s’étaient repliées sur La Rochelle et reprirent l’offensive. Mais inférieures aux troupes catholiques elles furent battues dans deux combats et y subirent des pertes terribles. À Jarnac, Louis de Bourbon, prince de Condé, fut tué avec huit mille religionnaires ; à Montcontour, plus de vingt mille protestants restèrent sur place. Dans cette dernière journée, les catholiques montrèrent une excessive cruauté, disent les chroniques ; ils massacrèrent des corps entiers qui avaient déposé les armes ; et s’ils firent quelques prisonniers, ce fut parce qu’ils étaient las d’égorger. Néanmoins, Pie V blâma fort le maréchal Tavannes de ce qu’il avait laissé la vie sauve à quelques hérétiques ; et, pour réparer cette faute, il écrivit immédiatement au roi de France : « Au nom du Christ, nous vous ordonnons de faire pendre ou décapiter les prisonniers que vous avez faits sans égard pour le savoir, pour le rang, pour le sexe ou pour l’âge, sans respect humain, ni sans pitié... » (Cité par Lachâtre : Rist. des Papes, t. II).
La Saint-Barthélémy
23 août 1572. ‒ Massacre des protestants sous Charles IX. Il eut lieu au lendemain des fêtes du mariage de Henri de Navarre avec Marguerite, sœur de Charles IX, fêtes qui avaient attiré à Paris un grand nombre de nobles protestants.
Ce drame continua pendant plusieurs jours. Soixante mille personnes (hommes, femmes, enfants), furent tuées. La France presque tout entière fut ensanglantée.
« Ce massacre général des Huguenots, suivit de si près l’élection de Grégoire XIII, qu’on eût dit qu’il était destiné à servir de fête à son couronnement ; toujours est-il que le pontife en recueillit la nouvelle avec une joie inexprimable ; il fit tirer le canon du Château Saint-Ange, commanda des réjouissances publiques pour célébrer le triomphe de la sainte cause, et publia ensuite un jubilé dans toute l’Europe, « afin disait-il, que les peuples catholiques se réjouissent avec leur chef de ce magnifique holocauste offert à la papauté par le roi de France. »
Incendie du Palatinat
1689. ‒ Les Hollandais l’ayant chassé de leur territoire, Louis XIV envoya Turenne en Allemagne, à la tête d’une forte armée. Les troupes passèrent le Rhin, firent une marche forcée de quarante lieues en quatre jours, surprirent les ennemis dans une plaine près de Sintzheim, ville du Palatinat, les culbutèrent et demeurèrent maîtresses du pays. Turenne écrivit alors à la Cour de France qu’on eut à lui envoyer de nouvelles troupes ‒ car il avait engagé des combats meurtriers, ‒ pour garder sa conquête, ou il se verrait forcé, afin d’éviter toute rébellion, « de manger le pays entre Heidelberg et Manheim ». Louvois répondit immédiatement au général :
« Sa Majesté a besoin de son argent pour ses propres dépenses ; elle ne veut point faire de nouvelles levées de soldats, et préfère que le pays soit dévoré. »
Turenne se conforma à ces ordres. En moins de dix jours, cent mille habitants, hommes ou femmes, vieillards ou enfants, jeunes filles et adolescents, avaient été violés, noyés, brûlés vifs ou égorgés ; et partout, les villes, les bourgs, les forêts, les récoltes avaient disparu sous le fer ou le feu.
Massacres du Champ de Mars
17 juillet 1791. ‒ Le 20 juin 1791, Louis XVI s’était enfui des Tuileries avec sa famille pour rejoindre l’armée de Coblentz. Reconnu et arrêté à Varennes, en Argonne (Meuse), il fut ramené à Paris.
La Constituante, essentiellement conservatrice, avait prononcé la suspension des fonctions exécutives du roi, puis il fut réinstallé dans ses appartements.
Le peuple, indigné de la conduite du roi qui, à la « fête de la Fédération » du 14 juillet 1790, avait solennellement promis fidélité à la constitution, et de la faiblesse de la Constituante, le 17 juillet 1791, se rendit au Champ de Mars pour signer une pétition demandant la déchéance de Louis XVI et la proclamation de la République.
Bailly et La Fayette, effrayés par cette manifestation du peuple désarmé se dirigèrent sur le Champ de Mars à la tête de nombreux bataillons, dans lesquels ils avaient répandu des agents de police déguisés en militaires ; puis arrivés devant les attroupements, ils publièrent la loi martiale. Au lieu de se retirer, le peuple couvrit de huées le commandant général et fit retentir les airs des cris : « À bas La Fayette ! à bas les baïonnettes ! » La Fayette ordonna alors aux troupes de faire feu !... Ensuite il commanda une charge à la baïonnette et déblaya l’esplanade et les glacis.
Dans un rapport qu’il fit plus tard à la Convention, Saint-Just déclare que deux mille cadavres furent relevés pendant la nuit. Le marquis de Ferrières, dans ses mémoires, en note quatre cents.
Massacres des 25 et 26 juin 1848
1848 ‒ Le gouvernement bourgeois dissout les ateliers nationaux. Rejeté dans la misère, le peuple de Paris se soulève, dresse des barricades, appelant à la lutte, tous les prolétaires, pour fonder la République socialiste. Des premiers combats ont eu lieu le 23 juin. Le général Eugène Cavaignac est promu commandant en chef des troupes de Paris. Le 24 juin, la Commission exécutive fait place à la dictature de Cavaignac. Le 25 juin, des combats très meurtriers ont lieu dans les rues de Paris. L’armée tue tout, massacre sans pitié femmes et enfants. Enfin, au 25 juin, la révolte est noyée définitivement dans le sang des ouvriers. Thiers s’exerce et Cavaignac, qui fut ensuite candidat républicain contre Napoléon III, agit. Il massacre dix mille ouvriers, ouvrières ou enfants, et en déporte quelques autres milliers. Mais l’histoire officielle présente un Cavaignac si peu conforme à l’original, que nous ne pouvons pas ne pas donner la page que voici, extraite de L’Armée contre la Nation, d’Urbain Gohier :
« Le second égorgeur du nom, le général Eugène (Cavaignac), appliqua les maximes que le sanglant inquisiteur d’Arcueil prêche maintenant à son fils. Il brandit le glaive, sévit, terrorisa. »
Il tua délibérément dix mille ouvriers parisiens ; il en déporta plusieurs milliers. Tout le monde le sait ; mais on ne sait pas assez de quelle volonté supérieure Cavaignac II était l’instrument.
Dans la Vie du R. P. de Ravignan, de la Cie de Jésus, par le R. P. de Pontlevoy, de la même Compagnie, nous lisons :
« Le père de Ravignan avait ramené jadis à la religion pratique Mme Cavaignac, épouse du Conventionnel, qui fut un des tribuns de l’ancienne République de 1793, et mère du général dictateur de la nouvelle République de 1848.
Cette femme vraiment forte et comme taillée à l’antique, en restant une romaine par la tête, devint toute chrétienne par le cœur, sincère dans ses opinions politiques, mais avant tout dévouée à ses croyances religieuses. Le P. de Ravignan, à l’époque de son départ de Paris en 1846, l’avait adressée à un excellent prêtre de ses amis, M. Locatelli, vicaire de Notre-Dame-de-Lorette, et depuis curé de Passy. À son retour, il la retrouva presque mère d’un roi, puisque son fils était le chef du pouvoir exécutif...
Le général avait un véritable culte pour sa mère. Il fut facile à Mme Cavaignac d’inspirer à un cœur si proche du sien les sentiments les plus intimes de son âme, et tout naturellement le général se sentit incliné vers le P. de Ravignan.
Des ordonnances partaient souvent du grand hôtel de Monaco, ‒ (Cavaignac logeait à l’hôtel de Monaco) ‒ pour apporter à la petite cellule de la rue de Sèvres des messages sous le sceau du Pouvoir exécutif. C’était tantôt la mère et tantôt le fils qui consultaient le P. de Ravignan, sur des questions d’un haut intérêt pour l’Église, et ce seul fait, que je me plais à signaler, montre assez la droiture de leurs intentions.
Cavaignac, plus fort en tactique militaire qu’en discipline ecclésiastique, savait, du moins, consulter avant de résoudre... »
Coup d’État du 2 décembre 1851
1851. ‒ Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République, ne pouvant être réélu en 1852, la Constitution s’y opposant, résolut de renverser l’Assemblée et de s’emparer du pouvoir. Il change l’état-major de l’armée de Paris et y place des hommes à sa dévotion. Il remplace les régiments qui tenaient garnison dans la capitale par d’autres dont les chefs étaient à lui ; enfin il place à la tête de cette armée un homme taré, méprisé, prêt à tous les crimes : le général Magnan. Il fait, dans la nuit du 1 au 2 décembre, arrêter ses principaux adversaires : le général Changarnier, Thiers, les généraux Lumorlcière, Cavaignac et Bedeau, le colonel Charras. Le colonel Espinasse investit le palais législatif et procède à l’arrestation des questeurs Le Flô et Baze. Les troupes se déploient dans tous les quartiers de Paris, cavalerie, infanterie, artillerie ; les canons chargés, les canonniers ayant en mains la mèche allumée, prêts à mitrailler les citoyens ; les soldats pourvus de cartouches, ivres et menaçants, les officiers insolents et provocants.
Dans la matinée du 2 décembre, Paris semblait une ville prise d’assaut.
Le 3 décembre, les députés républicains et les délégués des sociétés secrètes se réunissent et forment un comité d’insurrection, où étaient : Victor Hugo, Michel (de Bourges), Charamaule, Maurice Lachâtre, etc. Des barricades s’élèvent sur divers points de la capitale ; plusieurs représentants de la Montagne se mettent à la tête des combattants. Baudin, Esquiros, Mavier de Monjan, qui est blessé à la barricade du boulevard Beaumarchais ; Baudin est tué raide d’une balle au front, à la barricade de la rue Sainte-Marguerite, par des soldats du 19ème de ligne, commandés par le chef de bataillon Pujol.
Le 4 décembre, la besogne du dictateur était presque terminée, mais il fallait faire sentir au peuple que le silence était de rigueur. On enlève vingt-cinq millions à la Banque ; les rouleaux d’or sont distribués aux officiers, un million est attribué à Saint-Arnaud, un autre million à Magnan ; des tonneaux de vin, de liqueurs, d’absinthe, sont mis à la disposition des soldats. L’action commence. Boulevard Poissonnière une foule compacte et inoffensive est en face des soldats. Tout à coup, sur l’ordre du colonel Lourrnel, sans provocation, sans prétexte, les soldats, ivres pour la plupart, font une décharge terrible et foudroient les infortunés qui sont devant eux, puis le bataillon ouvre les rangs pour faire place aux canons qui tirent à boulets sur les maisons !... Le pavé des boulevards et de la rue Montmartre est jonché de cadavres... On en compta quatre cents.
La Commune
Mars 1871 (voir Commune). ‒ Comme en 1848, la bourgeoisie massacre le peuple. Au gouvernement, le même « sauveur » : Thiers. L’armée de Versailles rentre dans Paris, le 21 mai et le massacre commence aussitôt, 90.000 Parisiens sont assassinés.
Voici, en outre, un état des travaux des Conseils de guerre, publié au début de 1875 (cité par C. Morel, dict. Socialiste) :
Condamnations contradictoires 10.137 ; condamnations par contumace : 3.313. Total : 13.450, dont 157 femmes.
Peine de mort : 270, dont 8 femmes. Travaux forcés à temps et à vie : 410, dont 29 femmes. Déportation dans une enceinte : 3.989, dont 20 femmes. Déportation simple : 3.507, dont 16 femmes et 1 enfant. Détention : 1.260, dont 8 femmes. Réclusion : 64, dont 10 femmes. Travaux publics : 20. Emprisonnement jusqu’à 3 mois : 432. Emprisonnement de 3 mois à 1 an : 1.622, dont 50 femmes et 1 enfant. Emprisonnement de plus d’un an : 1.344, dont 15 femmes et 4 enfants. Bannissement : 432. Surveillance de haute police : 117, dont 1 femme. Amendes : 9. Maison de correction pour enfants : 56 Jugements cassés : 59.286 détenus n’avaient pu être condamnés que pour port d’armes et exercice de fonctions publiques. 766 condamnés dits de droit commun l’étaient, 276 pour arrestations, 171 pour la bataille des rues, 132 pour saisies et perquisitions qualifiées vols et pillage. La révolution « cosmopolite » laissait aux mains des chefs militaires 396 étrangers seulement, la révolution des « repris de justice », 7.119 condamnés sans antécédents judiciaires, contre 524 qui avaient encouru des condamnations pour délits politiques ou de simple police, et 2.381 convaincus de crimes ou délits non spécifiés. Sur les 10.137 condamnés, 29 étaient membres de la Commune, 49 membres du Comité Central, 225 ‘Officiers supérieurs, 1.942 officiers subalternes, 7.418 étaient des gardes et des sous-officiers.
Massacre de Fourmies
1er mai 1891. ‒ À l’occasion du 1er Mai, des manifestations eurent lieu à Fourmies (Nord), comme dans toutes les agglomérations industrielles de France. Partout des ordres sévères avaient été donnés ; armé, police, gendarmerie étaient alertés. Les prolétaires devaient une fois encore pleurer des larmes de sang sur leur impuissance.
Voici ce que dit Charles Verecque (Dictionnaire du Socialisme) : « On le sait, comme leurs camarades des autres villes, les ouvriers fourmisiens s’étaient préparés pour la manifestation internationale du travail. Ils avaient décidé un banquet populaire pour le matin, une représentation théâtrale pour l’après-midi et un bal pour le soir. Ces préparatifs n’étaient pas menaçants, mais ils apeurèrent les patrons. Ces derniers firent savoir qu’ils renverraient de leurs fabriques les ouvriers qui ne travailleraient pas le 1er Mai. Puis ils demandèrent à la municipalité de faire venir la troupe. Le 145ème d’infanterie, en garnison alors à Maubeuge, vint camper à Fourmies.
Dès le matin du 1er Mai ‒ et cela pour intimider les ouvriers ‒ des charges furent opérées par les gendarme et des arrestations furent faites à tort et à travers. L’après-midi, une colonne de manifestants s’organisa pour porter à la mairie la liste des revendications ouvrières et réclamer la mise en liberté des prisonniers. Deux jeunes gens se trouvaient en tête : Giloteau, portant un drapeau tricolore, et sa bonne amie, Maria Blondeau, portant à la main un mai, c’est-à-dire une branche fleurie.
Quand les manifestants furent à deux pas de la mairie, les soldats, à l’exception d’un seul, le soldat Lebon, manœuvrèrent leurs fusils. Le crime était accompli. Pour la première fois, les fusils Lebel avaient été essayés sur des poitrines françaises. Voici les cadavres qu’on releva sur le pavé sanglant : Maria Blondeau, 18 ans ; Edmond Giloteau, 19 ans ; Émile Cornaille, 11 ans ; Gustave Pestiaux, 13 ans ; Félicie Pannetler, 17 ans ; Ernestine Diot, 19 ans ; Louise Huhlet, 21 ans ; Émile Segaux, 30 ans : Charles Leroy, 22 ans, et Camille Latour, 50 ans. »
Le 4 mai, la Chambre repoussa l’enquête par 329 voix contre 156.
Fusillades de Draveil, 2 juin et Villeneuve-Saint-Georqes, 30 juillet 1908
1908. ‒ « C’est à Draveil, petite ville de Seine-et-Oise, le 2 juin 1908, sous le ministère Clémenceau, que les gendarmes tirèrent sur les grévistes réunis dans une salle de conférences. »
« Une manifestation contre ces fusillades eut lieu à Villeneuve-Saint-Georges, le 30 juillet 1908, ce qui donna à la police l’occasion de sévir avec violence. La cavalerie chargea. Il y eut beaucoup de blessés. Dret, du syndicat des cuirs et peaux, dut être amputé d’un bras. On apprit, plus tard, qu’un syndicaliste, nommé Métivier, chaud partisan de la manifestation, était de la Sûreté Générale et avait eu, préalablement, une entrevue avec M. Clémenceau, ministre de l’Intérieur. »
Chaque pays agit de même, mais des volumes seraient nécessaires pour dire la millième partie des massacres froidement ordonnés et férocement exécutés : d’hérétiques, de révolutionnaires, de « sauvages ». Nous donnons ici quelques extraits d’un livre très documenté d’André Lorulot : « Barbarie allemande et Barbarie universelle », paru en 1921.
« Comment les PORTUGAIS ont-ils « colonisé » l’Amérique du Sud ? Voilà du reste, d’après le capitaine Palomino, exactement ce qui se passait dans ces petites excursions. Si les habitants recevaient les Européens en amis, les Européens les mettaient à la torture pour les forcer à avouer où se trouvaient leurs trésors. Si au contraire, ils abandonnaient leurs maisons, les Européens commençaient par y mettre le feu pour s’amuser, puis ils traquaient les fugitifs à l’aide de chiens dressés à cet effet et quand ils les avaient découverts, ils les empalaient ou les brulaient vifs. Quelquefois, en chemin, nos hidalgos remplaçaient leurs montures par des hommes. Ils en traînaient toujours une troupe derrière eux, attachés à la douzaine par un licol. Quand l’un de ces pauvres diables tombait de fatigue, ils lui coupaient la tête afin de ne pas être forcés d’ouvrir le cadenas qui fermait son carcan. (Gaston Donnet, Le Temps, 23 mai 1903). »
« L’ESPAGNE ! c’est le Pérou ravagé par Pizarre, c’est le Mexique ensanglanté. C’est Cuba...
Le général Weyler, à Cuba, avait donné l’ordre à ses subordonnés d’être sans pitié avec les insurgés et ils ne lui obéissaient qu’avec trop de zèle. Un jour, quelques insurgés se présentèrent dans une ferme et y reçurent l’hospitalité, les gens qui l’habitaient n’étant pas en force pour leur fermer la porte au nez. Après le départ des insurgés, un colonel espagnol fit arrêter les malheureux fermiers, une famille composée de six personnes (dont une jeune fille de 15 ans)... Après un interrogatoire sommaire, le colonel se retira dans un coin de la salle, se mit à genoux et demeura pendant une bonne demi-heure absorbé dans une muette et ardente prière. Enfin, le pieux guerrier se releva, la figure animée de l’inspiration céleste et donna l’ordre de fusiller les six malheureux. » (La Tribune de Genève (conservateur), 1er novembre 1897).
« Les correspondants des journaux anglais ont dit comment les ITALIENS, avaient sauvagement massacré 400 femmes et enfants et 4.000 arabes, en Tripolitaine.
Le quartier arabe, dit le correspondant de la Westminster Gazette, a été envahi par des soldats surexcités qui, armés de revolvers, tiraient indistinctement sur les hommes, femmes et enfants qu’ils rencontraient. Les officiers étaient pires que les hommes. »
Voici maintenant à l’œuvre la France colonisatrice :
« Nos balles Lebel font des blessures effroyables et presque toutes mortelles... Nous avons eu 6 morts et 11 blessés. Les Dahoméens ont eu 400 morts et 600 blessés, dont beaucoup ont dû succomber à leurs blessures. C’est une vraie boucherie. » (Le Journal, 1892)
« Quelques tirailleurs ont été tués ou blessés. Afin de faire un exemple, le capitaine Voulet fait prendre vingt femmes mères avec des enfants en bas âge et les fait tuer à coups de lance, à quelques centaines de mètres du camp. Les corps ont été retrouvés et le fait est certifié par le capitaine Dubreuilh. » (Vigné d’Octon, Ch. des députés, 19 nov. 1900)
Enfin, un dernier fait pour terminer :
« Une expédition, sous les ordres du commandant Gérard, chef d’état-major, parcourait le pays depuis plusieurs semaines, ne rencontrant à peu près partout que des manifestations pacifiques. Forte de 1.000 fusils, elle se trouvait à deux heures d’Ambike où le roi Touère, chef du district, préparait une réception triomphale au commandant Gérard, étant animé vis-à-vis de la France des dispositions les plus pacifiques. À Ambike se trouvaient également MM. Blot, enseigne de vaisseau et Samat, agent des Messageries maritimes auxquels le roi Touère avait offert une hospitalité empressée. Tous deux vinrent rejoindre le commandant Gérard et l’aviser des excellentes dispositions du pays. Pour toute réponse le commandant Gérard prévint l’enseigne qu’il aurait le lendemain à prendre part à l’attaque. Quelques instants plus tard, il refusait de recevoir le roi Touère, venu à son tour pour lui présenter ses hommages.
Le lendemain, au point du jour, on entre dans la ville par six côtés à la fois. Le massacre commence. Surprise, sans défiance, la population entière est passée au fil des baïonnettes. Les tirailleurs n’avaient l’ordre de tuer que les hommes, mais on ne les retint pas ; ils n’épargnèrent pas une femme, pas un enfant. Le roi Touère fut tué ; les serviteurs de M. Samat furent tués. La ville ne fut plus qu’un immense charnier. Les Français vainqueurs ne perdirent pas un seul homme. Le nombre des morts fut de 2.500 au moins. Tous les blessés furent achevés. La Gazette officielle annonça qu’on avait fait 500 prisonniers ; c’était un mensonge. Pas un indigène n’était sorti vivant de ce massacre.
M. Galliéni, général, gouverneur, couvrit de son approbation M. Gérard qui eut un bel avancement... » C. A. Laisant. (La barbarie moderne, d’après Vigné d’Octon)
Les guerres sans fin qui ont ensanglanté l’humanité ont eu maintes fois le caractère de véritables massacres. Et la dernière en date mérite bien, au premier chef, cette triste gloire... Les rivalités des nations et des groupes d’affaires, les convoitises coloniales les méthodes intensives d’exploitation sociale, la soif de domination des partis politiques et religieux l’avidité l’ambition, l’intolérance persistantes, servis par les progrès de l’art de détruire, réservent aux générations prochaines d’autres mémorables hécatombes.
L’anarchie ‒ qui travaille à supprimer, avec l’autorité les causes de conflits entre les peuples, à tarir la source des haines, à éloigner du cœur des hommes l’hostilité et de leurs mœurs la violence ‒ ne pénètre que lentement de son influence bienfaisante la mentalité et les rapports humains. Et, avant que son esprit les ait vivifiés et épurés, l’humanité connaîtra encore ça et là, d’odieux massacres dont les patries, les religions et les classes seront le prétexte ou l’occasion.
‒ A. LAPEYRE.
MASSE
s. f. (du bas latin massa)
Les parties conglomérées de matière qui font corps ensemble. Corps compact très solide. Un gros corps, informe, est qualifié de masse. La totalité d’une chose. Le fonds d’argent d’une société ou d’une succession. Une grande quantité d’objets. La caisse spéciale d’un régiment à laquelle tous les soldats contribuent.
En mécanique, le rapport d’une force à l’accélération du mouvement qu’elle produit dans certaines applications. L’ensemble d’un édifice par rapport à ses proportions. Gros marteau ou maillet, espèce de massue. Bâton à tête d’argent ou d’or qu’on portait dans certaines cérémonies. Gros bout de la queue de billard.
Dans la terminologie politique, et économique et sociale, le peuple, en général, constitue la masse. Sous ce rapport il ne faut pas oublier qu’il n’y a des hommes qu’on appelle la masse ou les masses que parce qu’il qu’il y a ignorance sociale. Ces masses sont alors matières à exploitation.
Cette exploitation, qui est condition d’ordre relatif pour autant qu’il est possible aux classes dirigeantes de la maintenir, est regardée par celle-ci comme une nécessité puisque l’ordre social dont elles bénéficient est à ce prix.
« L’emploi du mot masses par nos réformateurs dans le sens peuple ou prolétaire, dit de Potter, suffit pour faire comprendre que la réforme qu’ils projettent est exclusivement matérielle, et qu’eux-mêmes, le sachant ou l’ignorant, sont matérialistes. »
Ce sont ces mêmes hommes qui, faisant fonctionner leur esprit, en appellent au mécanisme de l’intelligence pour établir la physique sociale.
Qu’il y eût des masses pour ceux qui fondaient la société sur la foi, c’est facile à concevoir ; qu’il y ait encore des masses pour les conservateurs sociaux qui veulent substituer la force par la ruse à la croyance, c’est logique. En est-il de de même quand on cherche et désire la découverte de la vérité et l’application de la justice ? Cela ne s’explique plus.
Ceux, alors, qui semblent s’apitoyer sur le sort des masses et vouloir améliorer leurs conditions ne font que déplacer la question qui les embarrasse. En invitant ces masses à se débarrasser d’un ordre de choses dont eux-mêmes sont mécontents parce qu’ils n’y ont pas la part dominante qu’ils désirent, ils préparent des lendemains cuisants.
Combien de réformateurs, dans notre République, sont devenus conservateurs quand leur part leur a paru suffisante ? Cela prouve que l’instruction ne suffit pas pour former la probité et l’honnêteté. L’éducation faisant défaut chez ces personnes, leur conscience est conforme à leur appétit.
Ainsi les masses ont vu et voient tous les jours que la plupart de ceux à qui elles ont permis de se gorger de richesses ne changent pas leur condition sociale. Et cependant malgré les douloureuses leçons de l’expérience, ces masses restent amorphes sous l’emprise des préjugés que les mauvais bergers leur ont inculqués, au lieu de leur apprendre les causes de leur misère et de leur esclavage économique, ainsi que les moyens propres à accélérer leur libération générale.
‒ Élie SOUBEYRAN
MASSE, LES MASSES
Expression généralement employée par les propagandistes sociaux, pour désigner les travailleurs des villes et des campagnes. Cette dénomination n’a, en fait, aucune signification précise, réelle, concrète. Les communistes autoritaires la remplacent souvent par celle de « couches profondes »qui n’a pas un caractère plus net, plus spécifique.
En réalité, les masses ce sont : le prolétariat, la classe ouvrière, la grande masse des spoliés et des déshérités, catégorie singulièrement imposante par le nombre si on la compare à la minorité que favorise le régime, multitude vers laquelle se tourne, dépouillée d’orgueil et d’ambition, la sympathie de ceux qui souffrent de ses maux.
Les anarchistes et les syndicalistes révolutionnaires fédéralistes ont, du caractère et de la valeur des masses, et de l’intérêt à lui porter, une conception toute différente de celle des autoritaires marxistes. Ils hésitent même aujourd’hui à employer ce terme, à voir de quelle façon dédaigneuse l’utilisent trop souvent les États-Majors, et ces propagandistes du Parti communiste qui, eux, il va sans dire, constituent « l’élite », sacrée telle par elle-même.
Pour nous les « masses » méprisées par les politiciens, et auxquelles on lance, périodiquement, des appels tour à tour véhéments et rageurs, insultants et stupides, ne sont pas des êtres amorphes, sans pensée, sans vie propre, sans désirs, sans idéal ; qui n’ont d’autre mission historique que de hisser au pouvoir telle ou telle clique politique qui règnera sur elles ; que de servir de « cobayes » aux chirurgiens et aux « docteurs » de la « révolution » au cours de leurs « expériences sociales ».
C’est du sein des masses, sous leur impulsion, que surgiront les hommes d’action qui renverseront l’ordre bourgeois ; ce sont les masses qui règleront les comptes du capitalisme ; ce sont ces « masses » qui édifieront elles-mêmes, pour elles-mêmes, sous le concours des stratèges patentés ‒et certainement contre les soi-disant élites » ‒l’ordre social égalitaire qui remplacera le régime d’exploitation de l’homme par l’homme base de toute idéologie étatique.
Au cours de l’histoire, les masses ont été constamment trahies par « les élites ». Toutes les révolutions l’attestent. La dernière, la plus importante : la révolution russe le confirme avec éclat.
Aussi, il convient que ces masses, qui sont aujourd’hui la chair à canon, à exploitation, ne soient pas demain, par le caprice de politiciens dénués de scrupules mais avides de commander et de diriger, de la chair à expériences douloureuses et nuisibles.
Elles peuvent trouver, dans une organisation solide et préalable, sur le plan du travail ‒base réelle de tout ordre social ‒une préservation efficace contre l’assujettissement qui les guette.
Si ces masses, dédaignées des futurs dictateurs le veulent, elles peuvent constituer dès maintenant, sur le terrain de la résistance, les organismes qui se transformeront automatiquement, en période révolutionnaire, en rouages politiques, économiques et sociaux qui assureront la vie régulière, normale et rationnelle d’un nouvel ordre social issu de leurs propres délibérations et correspondant à leur désir d’égalité sociale et de liberté.
La fameuse formule de la première Internationale : La Libération des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes reste plus que jamais d’actualité.
Ce sont les « masses » et non les élites qui la réaliseront.
‒ Pierre BESNARD
MASSE (...ÉLITE ET PROGRÈS)
Dans la société actuelle Ferrière distingue trois catégories d’individus :
-
ceux qu’il appelle d’un nom générique : la masse, et qui acceptent de se soumettre à l’autorité ;
-
« des individualistes intransigeants qui ne jouent pas de rôle social immédiat ou ne jouent que le rôle négatif de contrepoids à l’égard des forces collectives unificatrices » ;
-
les élites : « meneurs, chefs, hommes de culture étendue ou spécialistes faisant autorité, tous ceux qui ont l’art de réunir en un faisceau les forces individuelles éparses ou qui seraient aptes à jouer ce rôle si leur valeur n’était pas méconnue ».
L’esprit des masses
Ce qui crée cet esprit, c’est d’abord l’identité des besoins. Pour que ces besoins soient satisfaits, il faut que l’individu commence par s’adapter à son milieu, la contrainte sociale intervient pour contribuer à cette adaptation, les masses elles-mêmes ne tolèrent pas les inadaptés : « Il faut, dit un proverbe populaire, hurler avec les loups ». Cette adaptation de l’individu à la société est facilitée par l’esprit d’imitation. Le conformisme social, ou, si l’on préfère, le conservatisme, caractérise les masses, qu’elles soient bourgeoises ou prolétariennes, et c’est pourquoi ces masses sont réfractaires aux changements brusques qui comportent une part d’inconnu et de risque. Les propagandes révolutionnaire et réactionnaire sont, à cause de cela, de peu d’effet sur les masses.
Contrainte, suggestion et imitation s’unissent pour créer chez l’homme de la masse « un fonds de réactions pareilles, d’usages pareils et d’opinions pareilles. » « Ceux qui imitent parfaitement, écrit Ingegnieros, les hommes médiocres, pensent avec le cerveau de ceux qui les entourent » ou, comme l’affirme Péguy, « veulent par volontés toutes faites ».
« Ils sont en un sens les abeilles de la ruche ; ils vont de la vie à la mort à travers les obscures voies que la société a tracées pour eux, par des volontés à peine personnelles, que la conscience éclaire sans proprement les créer, écho en eux des impératifs collectifs, sorte de conformisme social où il entre moins de réflexion que de discipline. » (Ch. Blondel)
L’homme de la masse est encore : imitatif, partant traditionaliste ; sentimental et par suite mystique, impulsif, changeant, irritable, facilement intolérant et autoritaire envers les plus faibles ; dominé par l’inconscient, n’ayant pas d’aptitude à observer les faits et les événements et à en tirer des conclusions justes.
Il ne faudrait pas tirer de tout ce qui précède des conclusions trop défavorables à la masse.
« La continuité de la vie sociale serait Impossible sans cette masse compacte d’hommes purement imitatifs, capables d’acquérir et de conserver toute l’expérience collective que la société leur transmet par l’éducation. L’homme médiocre n’invente rien, c’est certain, il ne dérange rien, ne brise rien, ne crée rien ; mais en revanche, il garde jalousement l’armature que la société a forgée durant des siècles sous la forme d’usages et de routines et défend ce patrimoine commun contre les entreprises des individus inadaptables. » (Ingegnieros)
Faute d’avoir compris les caractères de la masse, leurs causes et leur utilité, des militants qui avaient espéré tout autre chose se sont souvent découragés. Certains, comme Vallet, (La Révolution Prolétarienne, septembre 1925) ont conclu à la « faillite du syndicalisme » à « l’incapacité des classes ouvrières ». Vallet écrivait :
« Mon pessimisme vient de cette conviction de plus en plus forte qu’il en sera toujours ainsi ; que la masse est incapable de concevoir plus haut et plus grand ; qu’elle est juste en puissance d’opposer à l’ordre établi ce minimum de résistance réalisé par la poussée des besoins les plus élémentaires et les plus grossiers, disons-le. Ne pas crever tout à fait de faim : ruer dans les brancards quand le râtelier est trop vide. C’est tout. Quant à des aspirations à la justice et à un véritable ordre dans la production et la répartition, c’est une autre affaire : la classe ouvrière n’y songe pas. Elle ne souffre pas de l’ensemble du désordre économique. Elle ne s’indigne pas du chaos dans lequel le capitalisme se meut. Chaque individu et chaque groupe n’en aperçoit que ses répercussions fragmentaires et encore quand il est touché lui-même. Voilà l’infirmité foncière des masses, le vice rédhibitoire des classes ouvrières : ça peut se traduire par le mot Incapacité (incapacité intellectuelle, sentimentale, morale ; incapacité de révolte ; incapacité technique et politique à la fois). »
D’autres, tel Astié, attribuent tout le progrès social à l’élite, c’est-à-dire aux individus qu’il définit ainsi : Est de l’élite tout individu qui a une vie intérieure intense, qui pèse ses actions, ses pensées, qui les projette généreusement autour de lui, qui est arrivé à la conception de l’indulgence, de la bonté, de l’amour, du dévouement, du désintéressement, qui cherche à se cultiver et qui travaille suivant ses facultés pour être utile aux autres. » (Plus Loin ; novembre 1929).
Cet excès de pessimisme qui succède à un optimisme également exagéré n’est pas justifié. Tout d’abord, il n’y a pas, ainsi que nous le montrerons, de limite bien nette entre la masse et l’élite ; enfin les masses que nous connaissons constituent déjà un notable progrès sur les masses primitives.
Dans les masses prolétariennes, tout aussi bien que dans la bourgeoisie, les besoins se sont multipliés et différenciés et de ceci est résulté la multiplication et la différenciation des groupements. Notre société est bien plus complexe que la société primitive, elle se divise en une foule de groupes : politiques, économiques, professionnels, religieux ou antireligieux. Les individus qui font partie d’un grand nombre de ces groupes, pour la plupart choisis par eux, subissent des influences diverses qui assurent à chacun une certaine individualité ; trouvent en certains de ces groupes un soutien contre la tyrannie qui pourrait venir d’autres groupes. La différenciation, sans subordination, des groupements syndicalistes, coopératifs, politiques ou philosophiques, est un progrès social qui prépare d’autres progrès sociaux parce qu’il a pour conséquence d’assurer le progrès des individus dans le sens d’une différenciation et d’une personnalité croissantes, c’est-à-dire vers plus de liberté.
« Les sociétés primitives, au contraire, sont étroites et homogènes. Leur action pèse d’un poids à peu près uniforme sur tous leurs membres. Les individus ont peine et ne songent pas à s’y différencier. Elles sont conformistes et traditionalistes à rendre rêveur M. Maurras. La loi y est de penser et de faire exactement ce que les ancêtres ont pensé ou fait. L’essor y est donné à la vie mentale non par un appel il la réflexion et à l’analyse, mais par l’obligation impérieuse que le groupe impose à ses membres d’enregistrer scrupuleusement la masse des idées et des pratiques en la persistance desquelles il voit une condition de son salut. » (Ch. Blondel)
Un sociologue et psychologue, Ferrière, distingue dans l’évolution des individus, comme dans celle des sociétés, trois principales étapes du progrès : d’abord le régime de l’autorité acceptée, ensuite le régime de l’anarchie relative, enfin le régime de la liberté réfléchie. Mais les individus, comme les sociétés, ne parviennent pas tous, à bien loin près, à l’étape supérieure du progrès. Ce qui complique nos sociétés c’est qu’elles sont composées d’individus différemment évolués ; les uns ont conservé une mentalité de tyrans ou d’esclaves, d’autres sont des individualistes non solidaristes et bien peu en sont au stade de la liberté réfléchie.
Nombreux encore sont ceux qui se sentent faibles et demandent aide, protection ou soutien, soit à l’État, soit au contraire à des groupements. La masse ne se dégage que peu à peu des siècles de servitude dont elle porte l’héritage en son subconscient.
De la masse à l’élite
Il y a de nombreux degrés entre les bas-fonds des masses et les sommets des élites. La masse qui demande à être dirigée en tout, qui donne procuration, tout à la fois, au député pour faire les lois, aux dirigeants syndicaux pour la défendre, à des chefs pour déterminer son travail, etc., voit peu à peu ses rangs s’éclaircir.
Les changements profonds qui se produisent tout autour de nous, à une allure beaucoup plus rapide que dans les siècles écoulés ‒que l’on songe à la multiplication des automobiles et des avions, à la T. S. F. ‒ne peuvent laisser les individus indifférents. Tout au moins ces changements leur donnent-ils l’idée de la possibilité des changements futurs, les préparent à admettre les transformations techniques, sociales, etc.
Les individus deviennent aussi de plus en plus inventifs et capables d’initiative dans quelque travail : s’efforcent de se faire une opinion personnelle au moins à propos de quelques sujets. « Alors que la pensée créatrice devait agir, autrefois, dans des conditions qui l’obligeaient à perdre le meilleur de son dynamisme à vaincre les résistances de la foule ignorante et rendue apathique par son état de dépendance, aujourd’hui, tant par l’effet de l’instruction obligatoire que par la liberté critique rendue aux individus, cette même pensée créatrice est assurée du concours très efficace d’une multitude de cerveaux... ». « En effet, les cerveaux d’exception, les visionnaires de génie sont aidés dans la mise en application de chacune de leurs propositions ou innovations par l’apport, en apparence médiocre, mais en réalité souvent décisif des plus modestes artisans depuis que ceux-ci sont devenus capables d’autre chose que d’un travail purement mécanique. Prenons un exemple : Si le phonographe et la T. S. F. ont franchi la période des tâtonnements et des balbutiements avec t-elle maestria que, en quelques années, grâce à ces inventions, l’espace et le temps ne sont plus, comme autrefois, une entrave à la communication directe entre les hommes séparés par des milliers de kilomètres ou, ce qui est pire, par les années et même par les coups de faux de la mort, c’est que les Marey, les Lumière, les Branly, les Edison ont été secondés, sans les avoir sollicitées, par des intelligences plus terre à terre, mais parfaitement adaptées à une technique particulière, qui ont suggéré, les unes une transformation, les autres une innovation, une expérience ». (Ch. Dulot).
D’autre part l’homme de l’élite, si supérieur soit-il, reste toujours par quelque côté semblable à l’homme de la masse. Le domaine des connaissances est si vaste que nul ne peut se vanter de l’approfondir, les savants se spécialisent de plus en plus et chacun hors de sa spécialité ne peut que s’en rapporter à autrui, suivant ses affinités et ses sympathies. Quoi d’étonnant alors à ce que de grands savants, Pasteur, par exemple, aient été des croyants ; que le nombre des ingénieurs catholiques aille actuellement croissant. Ceci ne prouve en aucune façon en faveur des croyances religieuses mais seulement que chez des individus d’élite l’activité rationnelle et critique n’a pas étouffé toutes les survivances mystiques qui tiennent seulement une plus large place dans l’esprit de l’homme de la masse.
Ceci dit nous pouvons essayer de caractériser l’homme de l’élite, étant bien entendu que le portrait que nous en tracerons sera un idéal imparfaitement atteint par les meilleurs.
L’homme de l’élite a un esprit original, capable d’imaginer quelque chose sans se laisser influencer par le milieu ; apte à saisir les ressemblances, les relations entre les choses il combine pour créer ; doué d’esprit critique il est capable d’observer les faits, de raisonner d’après eux et d’après l’expérience et d’en tirer des conclusions justes ; mais surtout il s’est créé des idées, des conceptions, un idéal qu’il s’efforce de propager, non pas par caprice individuel mais au nom de principes supérieurs auxquels il se soumet : vérité, justice, etc. Bref l’homme de l’élite veut adapter le milieu à son idéal (Voir aussi au mot : Élite).
Il ne faut pas confondre les chefs et les élites. L’homme de la masse se choisit toujours un chef ‒au moins ‒mais ce chef n’appartient pas toujours à l’élite et d’autre part il est des hommes d’élite qui restent sans influence, incapables d’adapter une société à leur idéal.
C’est que l’homme de la masse choisit pour chef celui qui coordonne consciemment, qui exprime clairement ses désirs subconscients. De cela profitent trop souvent des démagogues : doués d’un certain flair ils savent reconnaître les aspirations des masses, tant pis si ces aspirations sont nuisibles au progrès social ; ils savent les exprimer avec une conviction et un enthousiasme apparent ; leur talent oratoire et leur adresse à manier les hommes leur permettent de rester dans des généralités suffisamment imprécises pour qu’elles donnent satisfaction à tout le monde ou à peu près.
Dans La Révolution Prolétarienne de juillet 1926, B. Louzon écrivait :
« La résolution du dernier « Exécutif élargi de l’Internationale communiste » sur la question française contenait le paragraphe suivant :
« 3° Le Parti, tenant compte de l’état transitoire de la crise politique actuelle, ne doit pas renoncer aux revendications partielles qui, dépassant les cadres du régime capitaliste, peuvent devenir le point de départ d’un large mouvement de masse, parce qu’elles apparaissent aux masses comme susceptibles de réalisation immédiate, comme par exemple les mots d’ordre suivants :
Extinction de la dette antérieure de l’État aux frais des banques et du gros capital ;
transfert du poids de tous les impôts sur les riches ;
mesures impitoyables contre la fuite des gros capitaux à l’étranger, etc.
La plupart de ces mots d’ordre ne peuvent être contenus dans le programme des mesures révolutionnaires du gouvernement ouvrier et paysan. Ils lui enlèveraient son vrai contenu révolutionnaire. Bien qu’ils ne puissent être réalisés par aucun gouvernement bourgeois, ils apparaissent aux masses comme immédiatement réalisables et par conséquent sont capables de les mobiliser, de les entraîner et de leur faire comprendre la nécessité du gouvernement ouvrier et paysan et des mesures révolutionnaires plus radicales qui sont à son programme. En lançant de tels mots d’ordre, le P. C. ne doit donc jamais se lasser de démontrer aux masses qu’aucun gouvernement capitaliste, même s’il est formé de social-démocrates, n’est capable de les réaliser. » (Cahiers du Bolchevisme, 15 avril 1928)
« Ainsi donc le Parti communiste doit lancer des mots d’ordre que d’une part aucun gouvernement bourgeois ne saurait réaliser et que, d’autre part, le Parti communiste ne mettrait pas dans son programme s’il était au pouvoir... Abusons les masses, en leur présentant comme objectifs des objectifs impossibles, parce qu’ils apparaissent aux masses à tort comme possibles, telle est la politique que préconise officiellement dans ce tertio de sa thèse sur la France l’Internationale communiste...
Ce qui résulte de tous les actes comme de toutes les paroles de la plupart des membres du Parti communiste, c’est que l’idée essentielle qui domine chez eux, l’idée qui distingue ceux qui sont « dans la ligne » de ceux qui ne le sont pas, est celle-ci : il y a les « masses », et il y a l’élite : Les « masses » sont ignares et imbéciles ; comme leur intervention est cependant indispensable pour l’accomplissement de la Révolution, il faut leur faire faire la Révolution malgré elles, sans qu’elles s’en aperçoivent, pour cela l’« élite » c’est-à-dire le Parti communiste et plus spécialement son appareil doit non point tendre à débarrasser les « masses » de leurs préjugés, mais à utiliser ces, préjugés. »
De tels procédés ont été employés de tout temps par les Jésuites (voir à ce mot) pour assurer leur domination ; ils ne sauraient être un moyen d’émancipation sociale.
Il y a par contre une véritable élite qui reste méconnue des masses parce qu’elle ne connaît pas elle-même les masses et qu’elle les devance dans la voie du Progrès. Nombreux sont les hommes d’avant-garde auxquels l’humanité n’a rendu justice que longtemps après leur mort.
« Mais il y a aussi, on l’a vu, une élite dont l’action est efficace : c’est celle qui, sans perdre le contact avec la masse, la devance juste assez pour voir dans quel sens l’avenir dirige la marche du progrès social, mais pas assez pour que les sentiments, les besoins, les connaissances, les moyens d’action de la société contemporaine lui soient étrangers. » (Ferrière)
L’homme de l’élite adapté, par avance, à une société différente de la société actuelle et s’efforçant d’adapter son milieu à son idéal trouve des partisans, amis de la nouveauté, des indifférents et des hostiles ; l’habileté pour lui consiste à pressentir ce qu’il peut obtenir de la masse et il se concilier un nombre suffisant de partisans mais la fin immédiate qu’il pense pouvoir atteindre ne doit pas lui faire perdre de vue l’idéal poursuivi. Il ne s’agit pas de tromper la masse mais seulement de diviser un progrès global, inaccessible d’un seul coup, en un certain nombre de progrès partiels.
Il y a d’ailleurs des hommes d’élite qui agissent sur le progrès social d’une façon indirecte et même, en un sens, involontaire : spécialistes, techniciens, savants, etc.
Il y a ainsi de nombreuses façons d’appartenir à l’élite comme aussi de multiples degrés dans l’élite. Tel qui est de l’élite dans son village peut n’être que d’une valeur médiocre par rapport à d’autres individus des alentours ; tel homme d’élite, en sa spécialité, s’en rapporte à autrui pour d’autres sujets ; tel bon théoricien d’une profession, capable d’influer utilement sur la pratique de ses confrères, reste inférieur à ceux-ci dès qu’il s’agit de passer de la théorie à la pratique ; tel praticien artiste et intuitif est incapable d’exposer et de justifier clairement sa pratique. Ajoutons encore à ces élites les individus capables de formuler un idéal lointain ou rapproché, particulier et précis ou plus vague mais plus général ; les spécialistes et les individus de culture générale non spécialisée, etc.
En résumé, dans la masse et l’élite il y a une diversité extrême. Ne nous en plaignons pas, cette diversité répond à une diversité des besoins. Le mal n’est pas dans la différenciation sociale mais dans ce que chacun n’est pas mis à la place qu’il pourrait occuper le mieux et, s’il est vrai qu’une organisation sociale convenable est impossible en régime capitaliste, il est non moins vrai qu’une révolution qui ne pourrait résoudre ce problème d’organisation serait une révolution manquée.
Ayant montré toute la diversité des individus je puis continuer mes explications sans que l’on suppose que je range les hommes en un petit nombre de catégories bien distinctes ni qu’on attribue aux mots : masse et élite, un sens autre que celui dans lequel je les emploie.
Incontestablement si certains individus n’avaient pas existé « la collectivité se présenterait autrement qu’elle ne se présente » et nous ne saurions méconnaître le rôle des élites. La masse a besoin des hommes à qui une culture philosophique générale permet de dominer les questions, des techniciens, des administrateurs, des savants. Le prolétariat italien (trompé, il est vrai, par les chefs effrayés et freinant les audaces révolutionnaires), devenu maître des usines ne sut que les arrêter. Le prolétariat russe (vite ressaisi lui aussi par la férule étatiste du bolchevisme), après avoir chassé ses techniciens et les avoir, à l’occasion, sortis des usines en brouette, a dû faire appel à leur compétence ; dire qu’il les a achetés comme cochons en foire masque mal la déception causée par l’incompétence de la masse.
Mais si les élites sont nécessaires, si la masse ne s’intéresse pas aux réalisations lointaines, est sentimentale à l’excès et plus capable de détruire que d’édifier il n’en est pas moins vrai qu’elle ne joue pas un rôle purement passif dans la marche du progrès. La masse ne se laisse pas imposer le Progrès, elle choisit ses guides, qui agissent sur elle comme des ferments sociaux. Ainsi les individus capables d’initiative et de création ne conviennent pas en tout temps et en tout lieu.
« Un Ajax ne connaît pas la gloire à une époque de fusils à longue portée ; et pour citer en termes différents un exemple cher à Spencer, qu’aurait fait un Watt chez un peuple auquel aucun génie précurseur n’aurait appris à fondre le fer ou à manier le tour ? » (W. James)
Les élites vraiment soucieuses du Progrès social ne doivent donc pas perdre contact avec les masses, elles doivent s’efforcer de connaitre leurs besoins, leurs désirs ‒et plus particulièrement les besoins et les désirs inexprimés et vaguement ressentis ‒leurs connaissances, leurs moyens et leurs possibilités d’action, car tout cela : besoins, désirs, connaissances, etc., c’est le point de départ et s’il est nécessaire d’avoir une claire vision du but que l’on veut atteindre il ne l’est pas moins de bien connaître les moyens et les possibilités d’y parvenir. Les transformations sociales ne sont durables qu’autant qu’elles répondent à des besoins plus ou moins clairement ressentis par les masses.
Ne méprisons pas le rôle des masses ; il est vrai qu’elles sont parfois victimes de leur sentimentalité, qu’elles se laissent abuser par le talent oratoire, l’apparente profondeur des convictions, mais les foules formées par les élites sont-elles à cet égard bien supérieures aux masses ? Il est vrai aussi que les plus habiles à manier les hommes n’appartiennent pas toujours à l’élite morale, ni même à l’élite intellectuelle, mais il y a là encore presque toujours un phénomène commun aux foules et, pris isolément ou en petits groupes, les hommes de la masse ne se laissent pas prendre autant qu’on le semble croire, par le bavardage, le charabia et le bourrage de crâne... Dans les groupements où chacun se connaît réellement, les masses ne donnent procuration qu’à ceux en qui elles sentent des chefs pour la lutte, des galvanisateurs d’énergies, des ouvriers compétents, consciencieux et justes.
En résumé le Progrès social résulte de l’action réciproque de deux facteurs humains : l’individu capable d’initiative, de création et de suggestion de la masse et d’autre part cette masse sympathique à l’individu et capable d’imitation.
De ce qui précède une conclusion me semble pouvoir être tirée ‒pour notre temps et notre milieu tout au moins, car des faits de ce temps et de ce milieu je n’ai pas la prétention folle de tirer des vérités éternelles et universelles ‒le système fédéraliste est mieux adapté aux problèmes de la sélection de l’élite, de l’utilisation des initiatives et de la formation des individus capables d’initiative.
L’idée fondamentale du bolchevisme (voir ce mot p.259) qui aboutit à la centralisation et à la dictature méconnaît ces faits que nous nous sommes efforcés d’indiquer au cours de cette étude : il n’y a pas de limite bien nette entre la masse et l’élite ; les masses actuelles diffèrent des masses primitives et, par le plus ou moins d’initiative des individus qui les composent, ont des capacités créatrices dont le centralisme ne peut tirer parti et qu’il risquerait au contraire d’affaiblir et de faire disparaître ; les élites actuelles, souvent trop spécialisées, se trouvent placées en face de problèmes de plus en plus complexes et leurs solutions risquent souvent d’être mauvaises ; il est des cas où le bon sens et l’intention des masses valent mieux que la science et la logique des savants.
Progrès individuel et progrès social
Il s’agit d’instruire et d’éduquer tous les individus suivant leurs capacités et leurs aptitudes, puis de permettre à chacun d’occuper la place qui lui convient le mieux : celle où ses capacités et ses aptitudes lui permettraient de remplir un rôle social aussi utile que possible.
Si notre société était une société juste, c’est-à-dire sans classes sociales, ce problème général se diviserait seulement en deux problèmes particuliers : 1° problème d’éducation et d’instruction, c’est-à-dire problème de développement des capacités et des aptitudes ; 2° problème d’orientation professionnelle, c’est-à-dire problème de l’utilisation des capacités et des aptitudes.
Mais, d’une part, la société actuelle n’assure pas également le développement des aptitudes, de nombreux individus de valeur étant insuffisamment instruits pour pouvoir être pleinement utiles à eux-mêmes et aux autres ; et, d’autre part, celte société ne se préoccupe du problème de l’utilisation des capacités et des aptitudes que dans la mesure où il ne peut gêner la classe possédante et dirigeante.
Il en résulte pour le prolétariat l’existence d’un troisième problème : le choix de son élite.
Comme nous avons déjà traité le premier des trois problèmes que nous venons d’indiquer (Éducation, Enfant, Instruction, etc.), et comme nous aurons l’occasion de parler du deuxième (Orientation professionnelle) nous allons nous borner à quelques réflexions à propos du dernier.
Théoriquement, il paraît insoluble ; l’incompétence ne peut juger la compétence, la masse ne peut choisir l’élite et ainsi la sélection ne peut venir que par en haut. Mais qui désignera les sélectionneurs, ceux qui seront chargés du choix de l’élite ? Si des bas-fonds de la masse on distingue mal les sommets de l’élite, si les spécialistes ne sont-pas capables de bien juger de l’élite en dehors de leur spécialité, nous avons déjà fait remarquer que la masse d’un petit groupement sait fort bien, la plupart du temps, désigner l’élite de ce groupe. L’élite ‒toute relative ‒d’un certain nombre de petits groupes pouvant, à son tour, procéder à une nouvelle sélection sans trop de chances d’erreurs, de sélection en sélection, on peut ainsi parvenir à solutionner de façon assez satisfaisante le problème du choix des élites. Il y a il est vrai, des individus qui. dépassent trop leur groupe et risqueraient d’être méconnus si la sélection s’opérait sur un seul plan et uniquement par en bas. Actuellement l’organisation syndicale permet, quoiqu’imparfaitement, une sélection sur deux plans : d’une part, plan de la spécialité avec les Fédérations ; d’autre part, plan de la culture générale avec les Unions. Je dis imparfaitement parce que les besoins de la lutte syndicale font négliger le souci du métier et qu’ainsi le travail d’organisation de la lutte prime le travail d’organisation du métier ; ainsi les groupements syndicaux sont-ils bien plutôt constitués en vue de l’attaque de la classe capitaliste et de la défense des intérêts des syndiqués qu’en prévision de l’organisation du travail. Ceci n’est point un défaut de l’organisation syndicale ; tant que les travailleurs vivront misérablement et ne pourront obtenir qu’avec peine les moyens de satisfaire imparfaitement leurs besoins primordiaux, on ne peut espérer qu’ils puissent vraiment s’attacher à une besogne constructive désintéressée.
J’en reviens au problème du choix des élites. Il me semble que la sélection par en bas doit être corrigée par une sélection par en haut, les sélectionnés par en bas repêchant ceux que l’incompétence de la masse a tenus écartés. Ici encore il s’agit d’une difficulté pratique, il faut choisir une juste mesure entre un système démocratique qui fatalement laisse dans l’ombre une partie de l’élite et une méthode de sélection par en haut qui ne peut mener qu’à une autocratie qui, elle aussi, barrerait plus tard la route à certains individus d’élite.
À ma solution quelque peu compliquée ‒mais pas plus que la vie cependant ‒certains préfèrent une solution plus simple ‒simple comme la théorie ‒ : le parti communiste groupe les élites qui doivent diriger le prolétariat.
Le parti communiste ! Mais c’est Staline, Trotsky, Zinovief, Boukarine, etc... Lesquels d’entre eux seront nos guides parmi lesquels se heurtent les points de vue hostiles et qui ont recours à l’excommunication ? Comment voulez-vous que j’aie confiance dans les capacités dirigeantes des uns ou des autres alors que les uns et les autres n’arrivent pas à se mettre d’accord à ce sujet. Puis, pourquoi repousserais-je les prétentions des autres partis, pourquoi ne demanderais-je pas aux anarchistes de guider le mouvement syndical ? Parce que, me répondra-t-on, le parti communiste a fait une révolution. Mais, diront les anarchistes, cette révolution prouve la justesse de nos prévisions, les communistes russes ont montré comment il ne fallait pas faire une révolution ; ils ont supprimé puis rétabli l’héritage, le salaire aux pièces, les examens, la vente de l’alcool, etc... , les mercantis, les bureaucrates, les enfants abandonnés par centaine de mille, etc... , prouvant qu’ils ne peuvent prétendre avoir créé une organisation sociale modèle.
En résumé, c’est encore la solution fédéraliste, qui fait appel à l’initiative d’en bas, qui nous paraît la plus sûre.
Et maintenant : comment l’élite doit-elle agir pour guider et élever la masse ? Poser le problème nous paraît insuffisant. C’est dans toute l’Encyclopédie Anarchiste, dans maints ouvrages et maintes revues que les militants doivent chercher une partie des éléments de la solution. Nous disons une partie, car la lecture des ouvrages et des journaux n’est pas tout, l’essentiel est de vivre intensément en observant la vie tout autour de soi.
‒ E. DELAUNAY
MASSES (PSYCHOLOGIE DES)
Le mot masses figure fréquemment dans la littérature libertaire. On y parle souvent du rôle des masses, de l’action des masses, de la création des masses, etc. La plupart des anarchistes estiment, en effet, que les grandes transformations sociales, ‒la révolution sociale surtout ‒sont, en dernier lieu, l’œuvre des vastes masses humaines mises en mouvement par certains facteurs économiques, politiques, sociaux ou autres, et développant alors une énorme activité, aussi bien destructive que positive et créatrice.
Toutefois, cette opinion est infirmée ou même contestée de différents côtés. Pour beaucoup de gens, pour beaucoup d’anarchistes même, le fait reste douteux. Pour eux, les transformations sociales ou les révolutions sont plutôt l’œuvre ou d’une minorité « éclairée et agissante », ou de certains individus supérieurs et des coalitions de tels individus (réformateurs, hommes d’État, partis politiques, etc.) ; et quant aux masses, elles ne sont et ne peuvent être que de simples exécuteurs des idées et des dispositions de ces individus ou de ces minorités.
Dès lors, une étude plus approfondie et plus précise de la question s’impose.
* * *
Tout d’abord, ce sont nos adversaires doctrinaires, les « marxistes » (socialistes, « communistes ») qui nous reprochent le vague de notre terme préféré : masses. Ils parlent, eux, moins volontiers des masses(notion trop vaste et imprécise, disent-ils), que du prolétariat ou de la classe ouvrière(notions moins vastes et plus précises, parait-il). Et cette classe ouvrière doit, d’après eux, être guidée, conduite justement par une minorité éclairée et agissante : le parti politique et ses dirigeants.
Disons tout de suite que les discussions purement théoriques avec les marxistes perdent actuellement, tous les jours davantage, leur intérêt et leur importance d’autrefois. En effet, la solution du problème se poursuit déjà sur le terrain même de la vie. C’est l’expérience vive et immédiate qui s’en est saisie et qui est plus concluante que n’importe quelle argumentation théorique.
Cette expérience ‒je parle des événements en Russie et de leur répercussion dans d’autres pays ‒nous fournit deux conclusions décisives.
La première est celle-ci : Toute transformation sociale de vaste envergure ‒d’autant plus une révolution sociale ‒reste stérile si une minorité « éclairée » s’en empare pour la guider et la diriger. Car, dans ce cas, le phénomène suivant se produit fatalement : les masses sont obligées de céder leur initiative et leur liberté d’action à la minorité ; or, cette dernière, dont l’activité se substitue ainsi à celle des masses se montre impuissante à résoudre les gigantesques problèmes qui surgissent de tous côtés et qui exigent, précisément, le concours libre des millions d’énergies et d’initiatives. Se cramponnant quand même à son autorité néfaste et opprimant de plus en plus les masses, la minorité finit par acculer la révolution à une impasse sans issue. Telle est, une fois de plus dans l’histoire humaine, la grande leçon de la révolution russe. Elle patauge dans l’impuissance parce qu’elle remet son sort entre les mains d’Une minorité « éclairée et agissante » traitant la masse en simple exécutrice de ses décisions et prescriptions maladroites, incompétentes et finalement régressives.
L’autre conclusion n’est pas moins significative. Les bolcheviks eux-mêmes, et ensuite les « communistes » des autres pays, durent reconnaître que « la base de la révolution »devait être« élargie ». La « classe ouvrière » est appelée aujourd’hui à « faire bloc », non seulement avec les paysans, mais même avec la petite bourgeoisie. Cette thèse ‒« l’élargissement de la base de la révolution » ‒nous intéresse en tant qu’elle se rapproche, après l’expérience faite, de notre idée qui est la suivante : La révolution sociale est l’œuvre non seulement de la classe ouvrière (qui elle-même est loin d’être homogène socialement et idéologiquement), mais de très vastes masses humaines comprenant une grande partie de la classe ouvrière, une partie de la population paysanne (dont l’importance numérique varierait selon le pays), et aussi de nombreux autres éléments : bourgeois (rompant avec leur classe, bien entendu), intellectuels (tels Lénine, Trotsky et autres), etc., etc., qui, s’aidant (et non pas dirigeant) les uns les autres, finiront par aboutir.
Les socialistes « modérés » pourraient objecter que l’expérience des bolcheviks n’est pas probante, ces derniers ayant faussé les idées de Marx, du socialisme et de la révolution. Pour notre controverse, cette objection serait sans valeur, la différence entre les socialistes ‒bolcheviks et les socialistes modérés ne portant que sur les méthodes d’action et non pas sur le principe même d’une minorité « consciente » et « supérieure » guidant et dirigeant les masses.
* * *
Ce qui nous importe et nous intéresse beaucoup plus, c’est la divergence d’opinions et un certain flottement qui existent, par rapport aux masses, dans nos propres milieux.
Comme déjà dit, assez nombreux sont les anarchistes qui éprouvent à l’égard des masses un sentiment de doute, de méfiance, même d’hostilité. Certains vont plus loin encore, jusqu’à dédaigner, mépriser, voire haïr les masses. (Voir : Foule). Pour eux, la masse est bête, moutonnière, lâche, veule, perfide, incapable de la moindre initiative ou action créatrice, capable par contre des crimes les plus cruels, les plus stupides, les plus crapuleux. Ces camarades s’appuient surtout sur les faiblesses et les mauvaises actions des masses, fort connues dans l’histoire ancienne et moderne des sociétés humaines : inconscience, insouciance, crédulité, inconstance, légèreté, veulerie, absence d’idéal, d’indépendance morale et de résistance, manque de courage, conduite lâche, trahisons, actes de cruautés, pogromes, assassinats, lynchage etc., etc...
Toutefois, il ne suffit pas de constater le fait : il s’agit de l’expliquer, de le comprendre. Il est grand temps qu’on pousse le problème des masses à fond. Il faut chercher à le résoudre pour ne plus flotter dans l’incertain, comme c’est souvent le cas aujourd’hui. Tâchons de l’éclaircir, dans la mesure de nos moyens. D’abord, quelques considérations d’ordre général.
Les masses ont des faiblesses, elles commettent de mauvaises actions, même des crimes. C’est un fait. Mais l’histoire et la vie nous disent aussi que les masses ont des qualités, qu’elles sont capables de bonnes actions également, d’actes courageux, même héroïques. C’est un autre fait. Donc, ce que nous pourrions constater en toute impartialité, serait ceci : les masses ont des faiblesses et des qualités, elles commettent de bonnes et de mauvaises actions. Entre ceux qui citent des faits pour démontrer que la masse est foncièrement bonne, et ceux qui font autant pour soutenir qu’elle est foncièrement mauvaise, toute discussion serait, par conséquent, vaine et stérile. Les uns et les autres y apporteraient des preuves irréfutables. Tant que le problème en restera là, il ne pourra pas être tranché. La constatation que nous venons de faire, ne dit encore rien.
Autre chose. Puisque la masse n’est pas toujours bonne, admettons pour un instant qu’elle est foncièrement mauvaise. La masse est un ensemble d’individus. Si elle est mauvaise, c’est que l’individu en général ne vaut pas grand chose lui non plus. Se méfiant de la masse (la méprisant, etc.), on se méfie, en réalité, de la presque totalité des individus qui la composent (sauf soi-même et quelques autres exceptions). Alors, on est obligé d’adopter l’une des deux solutions suivantes :
1° La supériorité de quelques individus et partant une minorité d’élite chargée de diriger les masses et le processus social.
Cette solution soulève des objections qui finissent par l’annuler. En effet :
-
Il n’existe pas de supériorité générale de quelques individus sur le reste des humains. (Il existe, bien entendu, une supériorité spécifique de tel homme sur tels autres, en telle ou telle autre matière concrète : en tel art, en telle science, en divers genres de travail, en intelligence, en force de caractère, en l’une ou l’autre des mille aptitudes, capacités ou qualités variées à l’infini. Un tel homme supérieur en telle matière, est bien inférieur en telle autre. Cette supériorité variée des hommes les uns sur les autres, supériorité relative et mutuelle, n’est donc pour rien dans la question dont nous nous occupons ; ou, plutôt, elle renforce, justement, l’idée d’une activité libre et naturellement combinée des vastes masses, contre la thèse d’une élite dirigeante. Et quant à toute autre supériorité, elle n’est qu’une fiction.
-
Supposons même que de tels individus généralement supérieurs aux autres existent ; rien ne nous garantit que l’élite dirigeante ‒formée surtout en pleine effervescence sociale ‒sera composée précisément de ces individus. Il est, au contraire, à peu près certain que ces personnages hypothétiques, réellement supérieurs, resteront à l’écart, et que l’élite dirigeante sera composée d’éléments fortuits et nullement « supérieurs ». Et d’ailleurs, qui serait expert et juge de la supériorité ? ‒3. Si même l’élite dirigeante était composée d’individus très supérieurs, leur supériorité ne saurait être universelle ni omnipotente, au point qu’ils puissent avoir la haute main sur la formidable activité infiniment mobile et variée des millions d’êtres humains. En réalité, l’« élite » ne saurait être maitresse de cette activité, car pour cela il lui faudrait pouvoir embrasser, à tout instant, toute l’immensité mouvante de la vie : pouvoir tout connaître, tout comprendre, tout entreprendre, tout surveiller, tout voir, tout prévoir, tout résoudre, tout organiser, tout arranger... Or, il s’agirait d’un nombre incalculable de besoins, d’intérêts, d’activités, de situations, de combinaisons, de créations, de transformations, de problèmes de toute sorte et de toute heure. Ne sachant plus où donner de la tête, l’élite dirigeante finirait par ne pouvoir rien saisir, rien arranger, rien « diriger » du tout. Non seulement sa supériorité ne saurait jamais être telle qu’on puisse substituer avantageusement son action à la libre activité, à la libre création, à la libre organisation des masses, mais, au contraire, l’élan de celles-ci serait fatalement entravé ou même paralysé par l’ingérence malheureuse d’une « minorité » impuissante mais prétentieuse.
Il n’existe donc pas de supériorité qui justifierait la remise entre les mains d’une élite des intérêts vitaux et des destinées historiques des millions d’hommes. Prétendre le contraire serait vraiment tomber dans l’absurdité. Et pourtant, c’est cette absurdité qui se trouve à la base de toutes les théories d’une « minorité dirigeante » et de toutes les expériences de ce genre. Quoi d’étonnant si ces expériences se terminent pour les travailleurs, partout et toujours, en queue de poisson ! Les grandes révolutions des temps passés et, en dernier lieu, la révolution russe appuient nos objections.
Notons cependant, en passant, que lorsque les étatistes, les autoritaires, les doctrinaires politiques(socialistes, « communistes », etc.) prêchent le principe d’une élite dirigeante, ils sont parfaitement logiques ; tandis que les antiautoritaires, les anarchistes, s’ils renient les masses et se rabattent sur une minorité d’élite perdent toute conséquence avec eux-mêmes. Car comment peut-on s’imaginer une société sans État ni autorité si l’on n’a pas confiance dans les capacités organisatrices et créatrices des masses ? Et quoi d’étonnant, encore, si de tels anarchistes finissent par tomber dans le bolchevisme ou dans des conceptions qui n’en sont guère loin !
Donc, cette première solution ne résiste pas à l’examen critique.
Ceux qui la rejettent ‒je parle toujours de ceux qui croient les masses infirmes‒n’ont en réserve qu’une seule solution possible :
2° Cette deuxième solution suppose que les masses sont au moins capables de devenir un jour qualifiées pour la bonne cause. (Pour ceux qui ne l’admettent pas non plus, cette solution n’est même pas à envisager. Ils sont donc obligés soit d’adopter la première, soit de flotter dans le vague). Ils s’agit d’attendre jusqu’à ce que l’écrasante majorité des individus composant la masse soit devenue le contraire de ce que cette majorité est aujourd’hui, c’est-à-dire qu’elle s’affirme intelligente, consciente, d’un esprit et d’une action indépendants, courageuse, active, loyale et constante, capable de toute initiative et d’action créatrice, incapable de crimes, porteuse d’idéal élevé, etc. Autrement dit, il s’agit de faire, en attendant, l’éducation de l’individu et partant de la masse.
Cette solution se heurte également à des objections qui l’anéantissent : 1) Dans l’ambiance sociale donnée, est-elle possible, la véritable éducation, effective et progressive, de l’individu et de la masse ? Il suffit de regarder attentivement et sans parti-pris autour de soi, de méditer quelque peu sur ce qui se passe dans la société actuelle, pour y répondre négativement. Ne pouvant pas m’étendre ici sur ce sujet un peu spécial (voir : Éducation, Propagande, Révolution, etc.), je me bornerai à quelques argument frappants. ‒D’abord, quelques faits récents. Malgré les exemples historiques de fraîche date, malgré surtout la propagande antimilitariste intense de nombreux partis et groupement d’avant-garde, ainsi que de tant d’écrivains et d’apôtres universellement vénérés et populaires, malgré tout un courant anti-guerrier d’une puissance telle qu’elle laissait espérer un refus catégorique des masses d’être engagées dans une nouvelle aventure, ces masses, dans tous les pays, continuent à se laisser tromper. Elles ont marché à l’ignoble et absurde boucherie de 1914 « comme un seul homme », avec un élan stupéfiant. Après la guerre, les masses, tout en ayant esquissé, dans certains pays, quelques mouvements de révolte et même entamé une belle révolution en Russie, fléchissent rapidement et cèdent le pas à des dictateurs et profiteurs de toute espèce, acceptant ainsi, de nouveau, un esclavage écœurant. Une fois de plus, elles n’ont pas su se rendre maîtresses de la situation qui leur était, pourtant, extrêmement favorable. ‒Quant à l’éducation proprement dite, quelle est-elle ? La vie d’un homme de la masse est connue, dès son enfance. La famille ne peut pas lui fournir une éducation saine. Viennent ensuite : l’école (!), la rue et le bistro, le journal (!!), le cinéma (!!!), et surtout le travail de bête de somme alternant avec un sommeil à peine suffisant. Contre toute cette « éducation » immédiate, concrète, permanente, ‒s’exerçant, de plus, dans une ambiance (État ! Autorité ! Église ! Argent ! etc.) qui elle-même façonne l’homme en dépit de toute autre influence, ‒que peut-elle, la poignée de gens capables de s’occuper de la véritable éducation de l’individu et de la masse ? ! Dans les conditions données, cette éducation n’est qu’un rêve irréalisable. ‒2) En affirmant que l’action éducative de quelques individualités ou groupements ne saurait rendre qualifiées les masses qui ne le sont pas aujourd’hui, je ne veux pas dire que l’éducation des masses ne se fait pas du tout. Certes, elle se fait, au cours des siècles, sous la poussée de plusieurs facteurs d’une puissance inégale. (L’activité éducative y joue un rôle relativement assez modeste). Mais, ce processus est excessivement lent(et, de plus, intermittent). Et alors, le problème reste entièrement ouvert. En effet, il serait résolu au cas seulement où l’on aurait la certitude que les masses seront prêtes au moment de grands événements sociaux. Or, c’est exactement le contraire qui est certain. Sans le moindre doute, les bouleversements sociaux auront lieu longtemps avant que les masses soient dûment éduquées et cultivées. Sans le moindre doute, les masses seront alors, au point de vue d’éducation et de culture, à peu près les mêmes qu’elles sont aujourd’hui. Si, de nos jours, elles sont foncièrement mauvaises et non qualifiées, ce n’est pas l’activité éducative qui les modifiera pour le jour des grands événements.
Donc, pour ceux qui supposent la masse mauvaise et incapable, l’« éducation » n’est pas non plus une solution du problème.
Alors, que penser ? Quelle décision prendre ? Quelle est la véritable psychologie de l’individu et de la masse ? L’individu est-il bon ou mauvais ? La masse est-elle mauvaise ou bonne ?
* * *
Nous avons constaté que les masses ont des faiblesses et des qualités, qu’elles commettent de bonnes et de mauvaises actions. Cette constatation nous suggère déjà l’idée que la masse n’est ni bonne ni mauvaise, et qu’il faut chercher à expliquer tout autrement sa psychologie et son attitude.
Une petite expérience personnelle et une analyse rapide nous aideront dans cette tâche.
Que le lecteur prenne une feuille de papier. Qu’il la divise en deux, avec un tracé de crayon. Qu’il parcoure ensuite mentalement toute sa vie passée, en détail autant que possible, très scrupuleusement, très sincèrement. Chaque fois qu’il se souviendra d’une mauvaise action commise (ou d’une mauvaise action qu’il fut tout prêt à commettre et que certaines circonstances empêchèrent), il placera un petit trait de crayon d’un côté du tracé. Chaque fois qu’il se rappellera, au contraire, une bonne action commise (ou qu’il fut décidément prêt à commettre), il placera un trait de l’autre côté. (Il faut comprendre sous une « mauvaise action » tout acte anti-moral, antisocial ou autre condamné par la conscience du lecteur ; sous « bonne action » on comprendra tout acte de haute moralité, de dévouement, etc., d’après l’avis même du lecteur). L’opération terminée, il trouvera plusieurs traits de crayon des deux côtés du tracé. Il constatera ainsi qu’au cours de sa vie, il a commis (ou il fut tout prêt à commettre, ce qui, psychologiquement, revient au même), plus d’une fois, des vilenies, des actes condamnables, allant même jusqu’à ce qu’on pourrait qualifier « crime », et que, d’autre part, il a accompli aussi (ou il fut tout prêt à accomplir), plusieurs fois, des actes louables, de très bonnes actions, allant même jusqu’à l’héroïsme. Parfois même, les unes et les autres se suivaient à une courte distance.
Quelle est la conclusion de cette petite expérience psychologique ? Elle est celle-ci : La psychologie de l’individu n’est pas une chose stable. Elle se trouve continuellement en mouvement, semblable à l’oscillation d’un balancier. L’envergure de cette oscillation est très vaste, puisque le même individu peut aller du crime à l’héroïsme. (Bien entendu, l’énergie psychique d’un individu peut se trouver momentanément à l’état de repos, d’équilibre passager, comme toute autre énergie, et alors la mobilité de la psychologie humaine ne se fait pas voir si facilement. ‒Bien entendu, aussi, tels individus ont un penchant plutôt au mal, tels autres, plutôt au bien, ce qui veut dire que les premiers commettent de mauvaises actions plus ‒ou même beaucoup plus ‒facilement que les seconds. Tout ceci ne change en rien le fond des choses : l’instabilité, la mobilité de la psychologie humaine et l’envergure de cette mobilité).
La constatation que nous venons de faire, nous suggère tout de suite une autre idée que voici :
Si l’ambiance, le milieu, tout l’ensemble social et autre sont tels qu’ils facilitent et favorisent les mouvements dans le sens du bien(rendant, de plus, difficiles et inutiles ceux dans le sens du mal), alors les premiers deviennent, chez l’individu, plus fréquents, plus accentués, plus prolongés que les seconds. La situation favorable se maintenant et la force de l’habitude aidant, les bons mouvements tendent à se perpétuer, et les mauvais, à disparaître. Ceci d’autant plus que le bon chemin une fois entamé, il entr’ouvre des horizons splendides, il entraîne les gens, il les enthousiasme de plus en plus, il rend la vie de plus en plus belle, riche, intéressante, active, souriante, avenante. ‒Si, au contraire, l’ambiance sociale est telle qu’elle facilite et stimule les mouvements dans le mauvais sens, entravant les oscillations opposées, l’effet en est aussi exactement inverse : les mouvements dans le sens du mal s’accentuent, l’emportent sur les autres, tendent à s’éterniser.
Abandonnons maintenant le terrain de la psychologie individuelle. Les masses étant un ensemble d’individus, leur psychologie et ses effets sont essentiellement pareils à ce que nous avons observé chez ces derniers.
Donc :
-
La psychologie de la masse est instable, mobile ;
-
L’envergure de cette mobilité est très vaste, les oscillations s’effectuant du crime à l’héroïsme et retour ;
-
Le sens des oscillations dépend de toute l’ambiance sociale qui facilite ou empêche les mouvements dans l’un ou l’autre sens.
Lorsque l’ambiance, le milieu, tout l’ensemble social facilitent et favorisent les mouvements dans le sens du bien, ces mouvements deviennent naturellement de plus en plus fréquents, prononcés, prolongés, et l’action des masses s’affirme, alors, de plus en plus positive, saine, franche, loyale, belle, vigoureusement créatrice, pendant que les mouvements et l’activité contraires faiblissent, décroissent, s’éteignent. Et vice versa.
C’est dans cet ordre d’idées, précisément, que nous devons nous intéresser au rôle de l’ ambiance sociale, à son influence sur la psychologie des masses.
* * *
Pourquoi de nos jours, et aussi dans le passé, les masses s’avèrent-elles souvent défaillantes, lâches, veules, criminelles ? Parce que des millions d’individus sont poussés dans ce sens, depuis des siècles, par toute l’ambiance sociale, intellectuelle et morale. C’est pour celle raison qu’en temps « normal » les masses nous causent tant de désillusions.
Cette attitude des masses en temps ordinaire ne noua dit encore rien sur leur véritable psychologie, sur leurs qualités ou leurs défauts effectifs. Car c’est une attitude mensongère, faussée, trompeuse. Elle peut devenir tout autre, lorsque les circonstances l’exigent et que l’ambiance se modifie pour de bon. Ce qui est, en effet, remarquable, édifiant, c’est que les mêmes masses changent rapidement d’aspect et de conduite aussitôt que l’ambiance défavorable se désagrège sérieusement, prête à changer, elle aussi, de fond en comble.
L’histoire des révolutions nous dit qu’au cours des combats décisifs, au moment de la victoire, et pendant les quelques semaines ‒ou quelques mois ‒qui la suivent, les masses, se voyant libres d’agir, remplies d’un grand espoir, ne ressemblent plus en rien au troupeau moutonnier qu’elles furent encore à la veille des événements. Elles se montrent courageuses, vaillantes, actives, riches d’initiative et de ressources, prêtes à tous sacrifices, pleines d’esprit de recherche et de création. La révolution russe de 1917 le prouva une fois de plus, de façon éclatante.
Hélas ! Dans toutes les révolutions, jusqu’à présent, ‒y compris la révolution russe, ‒la liberté d’agir conquise par les masses fut vite bridée et leur espoir déçu. La nouvelle ambiance favorable se déformait rapidement, celle d’avant-révolution ‒fatale pour la liberté et l’activité des masses ‒rentrait dans ses droits et l’attitude des masses redevenait plate, servile, basse. Ce phénomène frappant trouve, entre autres, une explication fort répandue : les masses, affirme-t-on, n’ont pas de fond, elles sont vite fatiguées, épuisées, lasses, elle abandonnent la cause, et alors naturellement la révolution dégénère. Le lecteur trouvera plus loin une autre explication de cette dégénérescence. Mais quant à la lassitude des masses, disons tout de suite qu’à notre avis, c’est exactement le contraire qui se produit : la lassitude et l’abandon des masses sont non pas les causes, mais les conséquences du déclin et du non-aboutissement de la révolution. Ce n’est pas la révolution qui ne réussit pas parce que les masses en sont fatiguées, mais, au contraire, les masses deviennent lasses et indifférentes lorsque et parce que la révolution ne leur apporte pas le résultat recherché. Ce n’est pas la lassitude des masses qui précède le dépérissement de la révolution, mais toujours inversement : la déviation, l’égarement, la dégénérescence de la révolution précèdent, entraînent et expliquent la lassitude et l’abandon des masses. Aussi longtemps que ces dernières gardent intact l’espoir en la révolution, leur enthousiasme, leur activité, leur dévouement restent entiers. Ce n’est qu’au moment où elles sentent la révolution faussée, égarée, perdue pour elles, qu’elles lâchent pied. Et alors, tout change... C’est en étudiant de plus près la marche des révolutions passées et en suivant, témoin actif, les péripéties de la révolution russe, que j’ai acquis définitivement cette conviction.
Quelle est donc l’ambiance qui facilite et favorise les mouvements de l’individu et de la masse dans le sens du bien, c’est-à-dire, de la vaillance, de l’initiative et de l’activité créatrices, du dévouement, de la persévérance, etc., etc... ?
Pour nous, la réponse n’est pas douteuse : Cette ambiance favorable est la liberté d’action pour l’individu et l’ensemble d’individus (la masse). Liberté intégrale, effective, sans restriction ni réserve d’aucune sorte. Liberté de s’entendre par tous les moyens possibles ; liberté de s’organiser, de coopérer ; liberté de chercher, d’essayer, d’appliquer toute initiative, de déployer toute énergie, de détruire, de construire, de commettre des erreurs, de les rectifier, de faire, de défaire, de refaire, en un mot : d’agir, dans le plus vaste sens du terme.
Il va de soi qu’il existe d’autres éléments importants, tels que l’égalité (véritable), le sentiment mutuel de confiance et de fraternité, etc..., lesquels, une fois acquis, complètent et parfont cette ambiance. Mais c’est la liberté qui en est la condition primordiale. C’est elle, précisément, qui permet à ces autres éléments de prendre corps, qui y mène même nécessairement, tant qu’elle n’est pas supprimée. C’est la liberté qui favorise l’action positive des masses et leur donne l’élan enthousiaste indispensable à la création, à l’inauguration progressive de la société nouvelle. C’est la liberté qui rend possibles la manifestation, l’application, l’activité féconde et le triomphe décisif des millions d’énergies et d’initiatives robustes et saines exigées par la tâche gigantesque de la reconstruction sociale.
Soulignons que, pour produire ses effets, la liberté doit être entière, générale, parfaite. Une demi-liberté, une liberté partielle, limitée, conditionnelle, réduite, ‒timidement octroyée et rapidement retirée, à la première occasion, par l’autorité ‒ne produirait aucune confiance, aucun enthousiasme durable et, finalement, aucun résultat. Pis encore : elle donnerait, justement, un résultat négatif. Ce n’est que le souffle puissant et continuel d’une véritable liberté, intégrale, universelle, qui serait en mesure de soulever et de jeter graduellement dans la grande action toutes les innombrables énergies positives d’un peuple. Ce n’est que dans l’ambiance d’une telle liberté que les éléments sains, vigoureux, productifs et créateurs pourraient triompher définitivement de tous les obstacles, de toutes les difficultés, de toutes les forces obscures et malsaines qui auraient surgi des ténèbres du passé.
Nous avons déjà attiré l’attention du lecteur sur un phénomène significatif qui se reproduit dans toutes les grandes révolutions (1789, en France ; 1917, en Russie) et qui appuie nos affirmations. Au début de la révolution, une fois le gouvernement par terre et la liberté d’agir acquise par les masses populaires, ces dernières se montrent pleines d’enthousiasme, de bonne volonté, d’un élan prodigieux vers le bien, vers une grande activité positive. Tout ce qu’il y a dans les masses de bon, de grand, d’actif, se fait jour, prêt à se mettre à l’œuvre inlassablement. Un certain temps s’écoule. Un nouveau gouvernement s’installe et commence sa besogne. Bientôt, l’ambiance change, et ce changement s’accentue tous les jours davantage. Des restrictions de toute sorte s’annoncent et se multiplient. Les masses se sentent surveillées, suspectées, serrées de près, repoussées. Leur initiative, leur activité sont de plus en plus ligotées, s’avèrent de plus en plus inutiles, sans but. L’initiative et l’action du gouvernement et de ses agents s’y substituent. Le souffle de la liberté s’éteint. De nouveau, comme auparavant, ce n’est pas la masse qui est libre d’agir, mais l’autorité et les milieux dirigeants, malgré qu’ils soient d’une nouvelle espèce. Alors, l’enthousiasme s’évapore, la masse s’arrête, se recroqueville, elle retombe dans son attitude ancienne : passive, obscure, négative.
Mais alors, une question ayant trait, justement, au problème des défauts de la masse, se pose. Si les masses sont pleines de ressources, si elles possèdent de l’énergie, de la bonne volonté, de l’initiative, si elles sont éprises de la liberté, de l’activité positive, etc., etc., comment expliquer alors que, chaque fois, elles cèdent tout ceci à une minorité dirigeante, se montrant ainsi impuissantes de maintenir la liberté acquise au début de la révolution, de la défendre, de la mettre en œuvre ? Un gouvernement ne nous tombe pas du ciel ! Ce sont les masses elles-mêmes qui le portent au pouvoir, qui, au moins, lui permettent de s’installer, qui, souvent, le réclament, l’acclament, lui prêtent confiance et concours, lui obéissent de bon gré. Alors ? (Une autre question serait légitime aussi. Comment se fait-il qu’à l’aube de l’histoire humaine, lorsque les premières grandes collectivités étaient en train de se former, les masses primitives, au lieu de bâtir et de développer une société basée sur la liberté, la création collective, etc., permirent à d’autres éléments, absolument contraires, de prendre le dessus et de déterminer toute l’évolution ultérieure de la vie sociale ?
Ne pouvant pas traiter ici ce sujet, vaste et compliqué, qui n’a, d’ailleurs, qu’un rapport assez lointain avec le problème actuel des masses, disons, toutefois, ceci : Les raisons pour lesquelles l’évolution des premières sociétés humaines avait « dévié » et les masses s’étaient laissées subjuguer, sont compréhensibles si l’on se donne la peine d’étudier la question de près. Ces raisons n’existent plus aujourd’hui. Rien, au fond, n’empêcherait donc plus les sociétés et les masses humaines actuelles de prendre le beau chemin, véritablement humain, d’une évolution collective, libre et créatrice. Mais une fois engagée sur la voie tortueuse de l’autorité, de la propriété, etc., l’humanité fut acculée à la suivre jusqu’au bout. Toute son évolution ultérieure, jusqu’à nos jours, n’est que le développement naturel des conséquences logiques de cette déviation initiale. Une fois prises dans le formidable rouage de la société autoritaire, les masses, naturellement, ne pourront plus s’en arracher qu’au prix d’efforts, de luttes, de souffrances et de sacrifices incalculables. Il n’existe aucun rapport entre cette situation et la capacité‒ou la non-capacité‒des masses.)
Alors, oui ! Il s’agit là, en effet, d’un gros défaut des masses populaires, mais d’un défaut tout spécial et superficiel (malgré son influence funeste sur la marche des choses), d’un défaut non « organique », temporaire, guérissable. Et cependant, c’est, précisément, ce défaut qui explique, en grande partie, la déviation et la dégénérescence des révolutions passées.
Ce défaut consiste en ce que ni avant, ni pendant la révolution, les masses ne distinguent clairement la bonne, la vraie voie à prendre. Il s’agit donc d’un certain défaut de la vue, d’un genre de « cataracte » qui empêche de voir le bon chemin, mais qu’il est possible de supprimer. C’est précisément par rapport à ce défaut qu’on pourrait parler de l’ignorance des masses. On pourrait comparer la masse à un géant plein de force, capable des actes et des exploits les plus magnifiques, mais qui, après avoir démoli les premiers obstacles, se trouve toujours, au moment décisif, au carrefour de plusieurs routes, sans pouvoir distinguer celle qui le mènera vers le but. Alors, il hésite, il ne sait plus que faire, où aller. Il reste là, inactif. Et alors, voici ce qui se passe. Quelqu’un vient à lui et lui dit : « Donne-moi ta main, car moi, je vois, je connais le bon chemin. Je te mènerai directement au but, malgré ta cécité ; tu n’as qu’à me suivre... ». Le géant, décontenancé et confiant, suit le bonhomme. Or, celui-ci, se faisant illusion, lui-même, sur le véritable chemin, s’égare et fait égarer le colosse. Bientôt, tous les deux s’enfoncent dans le marais. Impossible d’en sortir ! La cause est perdue.
C’est en raison de ce défaut que même les situations les plus favorables n’ont servi à rien, jusqu’à présent. Et c’est ainsi que dans la révolution russe, l’ambiance générale, extrêmement favorable au début, devint rapidement le contraire sous la conduite prétentieuse mais fausse du Parti Communiste.
Ajoutons qu’en parlant des masses, nous parlons de millions d’individus. Nous voulons dire que des millions d’individus ne voient pas le chemin. Nous voulons même dire que personne ne le voit exactement. C’est pourquoi, justement, le bonhomme, trop sûr de lui, a tort et ne peut que s’égarer, avec celui qu’il conduit. Au point de vue de l’instruction, de l’éducation, il existe, certes, pas mal d’individus supérieurs au niveau général des masses. Mais quant à savoir quel est le véritable chemin de l’émancipation sociale, les individus y sont aussi aveugles que la masse entière. Personne ‘est donc qualifié pour conduire les masses vers le but. Or, tandis que l’individu ‒ou même un groupe d’individus ‒serait impuissant à aboutir (même s’il possédait la vue juste), la masse, qui est un ensemble formidable d’initiatives et d’énergies, de forces et de capacités, d’instructions et d’éducations de toute sorte, aboutirait certainement si elle voyait clair. La masse, elle, finirait par trouver le bon chemin, au moyen d’efforts collectifs et solidaires, si elle pouvait voir. Il s’agit donc, non pas de conduire la masse aveugle, mais d’« enlever la cataracte » à des millions d’individus, pour que cette vaste masse puisse chercher, trouver et, enfin, prendre le bon chemin elle-même. C’est pourquoi l’anarchiste ‒et c’est là la différence essentielle entre lui et les autres ‒ne veut pas conduire le géant aveugle et passif. L’anarchiste vient à lui et lui dit : « Au lieu de suivre aveuglément quelqu’un, ce qui te perdrait, tu devrais voir et marcher toi-même. Je ne viens donc pas pour te conduire, mais pour t’aider à enlever ta cécité, ce qui te permettra d’agir en toute indépendance, avec toute la vigueur et toute la conscience indispensables ».
Ainsi, le « communiste » dit au géant :
« Tu ne vois pas clair : je vais te conduire. »
L’anarchiste lui dit :
« Tu ne vois pas clair : je vais t’aider à enlever le mal, à voir et à marcher toi-même. »
Jusqu’à présent, et pour plusieurs raisons, le géant n’entend pas l’anarchiste. La proposition de l’autre lui paraît, dans son état actuel, plus pratique, plus expéditive, moins compliquée. Et puis, la voix anarchiste est encore si faible qu’il la perçoit à peine. Il accepte la proposition de l’autre. Il commet ainsi une erreur fatale et s’égare.
Le défaut dont nous venons de parler, ne ressemble en rien ni à la lassitude, ni au manque de fond, ni à l’incapacité, ni à d’autres défauts imaginaires, dont on se plaît à gratifier les masses, sans s’apercevoir de leur défaut réel, temporaire et beaucoup moins grave. La différence est importante. En effet, les autres défauts seraient « organiques », donc irréparables, tandis qu’une vue insuffisante peut être améliorée et réparée. En cas de manque de fond, d’incapacité, etc..., la situation serait désespérée, tandis que s’il s’agit d’un simple manque de vue guérissable, elle ne l’est nullement.
Mentionnons aussi un autre défaut des masses, lequel, s’ajoutant au premier, l’aggrave et rend la « guérison » plus difficile, plus lente. Les masses ne se rendent pas bien compte, ni de leur force latente, ni de leur imperfection. Le géant n’est encore conscient ni de sa magnifique puissance, ni de sa cécité, ni du rôle néfaste du bonhomme prétentieux, aussi aveugle que lui-même... C’est, précisément, dans ce sens qu’on pourrait parler de l’inconscience des masses. Toutefois ; ce défaut est aussi passager et guérissable que l’autre.
Une question se dresse, néanmoins : Quand et de quelle façon ces défauts pourraient-ils être supprimés ?
Nous sommes d’avis que deux facteurs principaux s’en chargeront :
-
Le facteur matériel qui est l’expérience immédiate. C’est elle qui apprend le mieux. Et c’est le bolchevisme, qui, au cours de son existence, et par ses résultats néfastes, universellement connus, ouvrira les yeux aux masses, leur démontrant, définitivement et irrévocablement, le péril de suivre aveuglément quelqu’un, même le parti qui se dit « le plus ouvrier », « le plus révolutionnaire ». Tel est, croyons-nous, le rôle historique du bolchevisme.
-
Le facteur moral qui est notre propagande.
Ces deux facteurs, appuyés par d’autres encore, de moindre importance, finiront par guérir les masses. Ce sont surtout les événements historiques eux-mêmes qui feront le nécessaire. Évidemment, nous ne pouvons fixer aucune date. Les processus historiques sont encore assez lents. Nous sommes sûrs, toutefois, que les résultats négatifs du bolchevisme ouvriront bientôt de nouveaux horizons à la propagande anarchiste et la rendront rapidement beaucoup plus efficace qu’elle ne le fut auparavant.
* * *
Dernière question, la plus importante peut-être. Même en admettant que les masses seront, un jour, guéries de leurs défauts actuels, qu’elles verront clair, qu’elles deviendront conscientes, etc..., seront-elles capables d’accomplir l’énorme tâche positive, édificatrice et créatrice qui leur incombera ? La prétendue création des masses, ne serait-elle pas une mauvaise illusion, propre à soutenir des utopies absurdes, mais stérile et dangereuse si l’on a la naïveté de la prendre au sérieux ?
Beaucoup de gens prétendent, en effet, qu’un acte de création ne pourrait être autre qu’individuel. C’est le cerveau de l’individu qui crée, disent-ils. La « masse » n’étant pas un « être au cerveau commun », comment pourrait-on l’imaginer créant ?
Précisons donc ce qu’il faut entendre par la « création des masses ».
Il est à distinguer deux sortes de création humaine, lesquelles diffèrent aussi bien comme actes que comme résultats : il y a la création individuelle et la création collective. On comprendra dans la première tout acte créateur d’un caractère personnel, et dont le résultat porte, par conséquent, le sceau de l’individualité qui l’a accompli. Exemples : ouvrages littéraires de tel ou tel auteur, œuvres de musique, de peinture, etc..., certaines inventions scientifiques ou techniques, et ainsi de suite. Dans la seconde, il faut classer toute œuvre créatrice accomplie par les efforts (simultanés ou non) de plusieurs individus. Une ville, par exemple, qui représente le résultat d’une activité créatrice de millions d’hommes de plusieurs générations, est une création collective. Certaines œuvres d’art, certaines inventions le sont aussi.
La vie des sociétés humaines dans son ensemble représente, à chaque moment donné, le résultat d’une création collective, car elle est le total ou la synthèse d’un nombre incalculable d’idées, d’énergies, d’initiatives, d’efforts et de réalisations infiniment variés des millions d’individus de multiples générations consécutives.
Il va de soi que le problème de la création des masses est justement celui d’une vaste création sociale, donc d’une création collective. Toutefois, en posant ce problème, nous nous intéressons non pas à l’activité déployée par des millions d’individus au cours des siècles passés, mais à la vaste action sociale simultanée, solidaire et combinée des millions d’hommes vivant et agissant actuellement. C’est donc l’activité créatrice collective et simultanée de millions d’individus qui nous intéresse et que nous désignons ici par le terme création des masses. Est-elle possible ? Sous quelle forme pourrait-on l’envisager ?
Certes, le point de départ de toute création humaine est une idée qui naît dans un cerveau individuel(et dont la source ‒notons-le en passant ‒se trouve souvent au fond du cœur, du sentiment). Mais, tandis que, dans le domaine de la création individuelle, l’idée suffit, n’ayant plus besoin que d’être exprimée pour achever son œuvre (sous forme d’une publication, d’une œuvre d’art ou d’un acte individuel), dans celui de la création sociale, collective, une idée individuelle est loin de suffire. Elle n’est même que très peu de chose. Plus exactement, elle n’est qu’un des nombreux éléments composants dont l’ensemble seul compte réellement pour quelque chose, car ce n’est que cet ensemble qui assure la bonne exécution, la réalisation effective, l’achèvement fécond de toute œuvre entreprise. Ces éléments absolument indispensables sont les suivants :
-
Il faut que de nombreuses idées surgissent de toutes parts chaque fois qu’il s’agit d’une Œuvre sociale, d’un intérêt collectif ;
-
Il faut que toutes ces idées s’expriment et circulent en toute liberté, s’entre-croisent, s’entre-choquent, se critiquent et se contrôlent mutuellement, se combinent, se complètent les unes les autres, s’harmonisent, ‒bref, qu’elles subissent tout un travail complémentaire en passant par le creuset d’examen, de vérification, d’expérience, etc. ;
-
Il faut qu’à cette occasion ‒qu’à chaque occasion ‒se produise, de plus, la coopération d’un grand nombre de connaissances, d’intuitions, de suggestions, de sentiments, de capacités, etc. ;
-
Il faut que dans ce croisement d’idées, celles qui s’avèreraient fausses, maladroites, inapplicables, disparaissent, et que les bonnes survivent ; donc, qu’une sélection d’idées ait lieu ;
-
Il faut, enfin, que les idées bonnes, justes, utiles, se traduisent en actes, en réalisations libres, conscientes, d’un genre créateur. Cette réalisation créatrice (libre, enthousiaste) des idées émises et trouvées intéressantes, est justement le côté le plus typique de la création collective. Cette dernière est toujours bilatérale : elle comprend l’idée et sa réalisation, toutes deux libres, créatrices, inspirées par un besoin bien senti et par un élan sincère. Les uns lancent des idées, les autres s’adonnent plutôt à leur application pratique, ce qui dépend surtout du tempérament, des dispositions et des facultés personnelles, etc...
C’est toute cette activité multiforme, tout ce mouvement formidable d’idées et de réalisations pratiques que j’appelle, dans son ensemble, « création sociale » ou « création collective » ou encore « création des masses ». C’est donc, pour moi, une sorte de synthèse féconde d’éléments individuels et collectifs, éléments d’idée et d’action.
Il va de soi que pour toute cause de petite envergure, ce mouvement se produirait « en miniature », tandis que pour les grands problèmes d’ordre général, il se déploierait en grand. Le fond des choses, l’essence même de la création collective n’en reste pas moins, toujours et partout, la même, qu’il s’agisse de petites ou de grandes causes.
Citons quelques exemples qui illustreront ce qui vient d’être dit.
Certes, il est impossible, à notre époque, d’observer la création des masses sous sa vraie forme, c’est-à-dire, bien développée, sur une grande échelle, absolument libre et vigoureuse, poussant en avant et déployant toutes ses ressources. Mais les quelques épisodes que j’ai vus et vécus, fixèrent définitivement mes idées là-dessus. Je crois utile de les soumettre à l’attention du lecteur.
Le premier épisode auquel j’ai assisté étant, à cette époque, jeune étudiant, fut la construction d’une barricade dans une rue de Saint-Pétersbourg, en 1905. Cinq à six cents personnes, ouvriers et autres, y prirent part. Faute d’expérience, on ne savait pas, au début, comment s’y prendre. Et alors, voici ce qui se produisit. Quelques hommes lancèrent toutes sortes d’idées. Les unes furent tout de suite rejetées comme peu pratiques. Les autres furent immédiatement adoptées et mises à exécution. Cette exécution exigeait, parfois, un certain savoir-faire : il a fallu, par exemple, abattre des poteaux soutenant des fils conducteurs d’un très fort courant électrique ‒ opération délicate et dangereuse. Des hommes se révélèrent alors qui savaient comment il fallait procéder en l’occurrence. Ils l’expliquèrent, ils aidèrent les autres... La masse, poussée par un élan vigoureux, s’y prêta de bonne volonté. En quelques minutes, la barricade fut construite.
Tous les éléments que nous avons énumérés plus haut figurent déjà dans cette « miniature ». Plus intéressant et plus vaste fut, ensuite, le deuxième épisode vécu à Pétrograd, en 1917–1918. Une grande usine employant de 3 à 4.000 ouvriers, était menacée d’un arrêt complet, faute de matières brutes et d’autres éléments indispensables. Une réunion générale des ouvriers de l’usine fut convoquée à l’effet de prendre une décision suprême. Les ouvriers ne voulaient pas fermer l’usine. Ils avaient le ferme désir de sauver la situation, de trouver le nécessaire, de continuer la production. À la réunion, un spectacle triplement curieux et significatif eut lieu. D’une part, l’invitation à une action vigoureuse, et l’exposé de quelques idées générales sur la ligne de conduite à prendre fait par un délégué anarchiste. (Les bolcheviks venaient à peine de s’installer au pouvoir, et le mouvement anarchiste n’était pas encore mis hors la loi). D’autre part, la compréhension parfaite et l’acceptation consciente de cet appel par la masse ouvrière qui manifesta, en cette occurrence, une belle énergie, une activité positive prodigieuse, un savoir-faire remarquable, car elle trouva, séance tenante, des idées pratiques et fécondes, des moyens justes pour arranger les choses, des hommes prêts à s’en charger, ‒bref, l’élan nécessaire pour emporter un succès définitif. Et enfin, l’intervention du membre du gouvernement, Commissaire du Peuple au Travail, qui, tout en constatant l’impuissance du gouvernement à faire l’indispensable et à assurer le fonctionnement de l’usine, interdit aux ouvriers toute action indépendante, blâma la proposition de l’anarchiste (en le traitant de « désorganisateur »), déclara la décision des autorités de fermer l’usine en en licenciant tout le personnel avec une indemnité de trois mois et, finalement, menaça non seulement le délégué anarchiste de mesures de répression, mais aussi tous les ouvriers de sanctions sévères en cas de non-obéissance. Dans cet épisode, également, tous les éléments en question jouèrent leur rôle respectif : idées lancées, leur discussion, leur adoption, une ébauche de leur réalisation dans un élan collectif. Il y eut, de plus, l’élément contraire, hostile à l’action collective, typique en sa qualité d’étouffeur de cette action : l’intervention de l’autorité, la contrainte gouvernementale. Pour compléter notre récit, ajoutons que cette dernière l’emporta et que les ouvriers durent s’incliner devant la violence. L’usine fut fermée. (Il s’agit de l’usine anc. Nobel. Le délégué anarchiste fut l’auteur de ces lignes. Et le Commissaire du Peuple au Travail, dépêché à l’usine par le gouvernement « ouvrier », fut Alexandre Chliapnikoff).
Mais l’expérience la plus concluante m’a été offerte par les grands événements en Ukraine, au cours des années 1919–1920. Je parle du formidable mouvement des masses dit « mouvement makhnoviste ». C’est là surtout que j’ai vu les vastes masses en pleine action positive, en train de créer elles-mêmes, en toute indépendance, une vie nouvelle, à l’aide des mêmes éléments dont nous avons parlé plus haut. Bien entendu, il m’est impossible de présenter ici un exposé détaillé de cet épisode vécu. Une telle étude devrait faire l’objet d’un ouvrage spécial que je m’apprête, d’ailleurs, à accomplir aussitôt que mes loisirs me le permettront. (Pour l’instant, je conseille à quiconque ne l’aurait pas encore fait, de lire l’Histoire du mouvement makhnoviste, par P. Archinoff œuvre qui trace déjà un tableau suffisamment instructif des dits événements ‒N. Makhno lui-même fait paraître une série de volumes sur la révolution en Ukraine. Mais, cette publication n’étant qu’à ses débuts, je ne puis pas encore me prononcer là-dessus. Ici, je me bornerai à dire que j’ai eu le grand bonheur de prendre part, pendant quelques mois, à cette ébauche d’une véritable création collective et de voir confirmées, par une expérience immédiate de grande envergure, mes idées à ce sujet. J’y ai vu surgir, des profondeurs mêmes des masses laborieuses, des milliers d’hommes qui, par intelligence, leur force de caractère, leurs autres facultés, leurs différentes connaissances se joignant les unes aux autres, leur soif de la vraie liberté, leur dévouement à la cause, etc., etc..., surent comprendre l’âme même de la révolution et jeter les bases d’un mouvement collectif d’une vigueur, d’une beauté et d’une conscience incroyables. J’y ai vu coopérer, dans une excellente harmonie, tous les éléments d’une activité révolutionnaire et créatrice des masses en lutte pour leur véritable émancipation. J’ai vu aussi les premiers résultats de cette activité nouvelle et rénovatrice. (Pour Iles lecteurs qui ne seraient pas assez au courant des événements, je rappellerai que les bolcheviks, ayant réussi à mettre la main, rapidement et définitivement, sur le mouvement populaire en Russie centrale, ne purent pas, pour plusieurs raisons, et pendant une période assez prolongée, s’établir de façon stable en Ukraine, ce qui permit à la population travailleuse de cette dernière de pousser assez en avant l’ébauche d’une véritable création collective : libre et consciente. Je suis certain que si les divisions rouges, envoyées par Moscou, n’avaient pas, en fin de compte, noyé dans le sang ce beau mouvement des masses, l’expérience aurait donné des résultats d’une immense portée, non seulement pour la révolution russe, mais aussi pour les événements dans d’autres pays).
Et quand on me demande si une action créatrice collective est possible, je ne puis que répondre ceci : non seulement elle est possible, non seulement elle est indispensable pour que le résultat recherché soit obtenu, mais elle est absolument certaine le jour de la vraie révolution sociale. Cette action se produira fatalement dès que les masses, en pleine lutte révolutionnaire, n’auront plus à compter que sur elles-mêmes, après avoir coupé court à toutes les tentatives de « conduite » politique et autoritaire. Plus on réfléchira sur le rôle et les éléments de cette formidable activité des masses en révolution, mieux on comprendra l’impossibilité ‒c’est-à-dire, la nullité, la stérilité ‒non pas de cette action créatrice des masses, mais, précisément, de toute « minorité dirigeante » autoritaire.
Bien entendu, il y aura, dans toutes les branches de l’activité populaire, des hommes qui aideront les autres, qui donneront des conseils et des indications, qui guideront, qui parfois « dirigeront ». Mais, comme nous l’exposons d’une manière détaillée ailleurs (voir Autorité, voir aussi maître, maitrise, etc.), il s’agira là non pas de « directives » émanant d’un centre politique et autoritaire, mais d’indications et d’actes dirigeants d’un caractère professionnel ou technique, exercés un peu partout, et de façon naturelle, par des hommes plus expérimentés, plus habiles ou mieux doués dans tel ou tel autre domaine, plus instruits, plus compétents, plus clairvoyants, etc... Ce sera une influence purement morale, d’une utilité, d’une nécessité évidente, immédiate. Ces influences, ces actes dirigeants, s’exerçant en bonne camaraderie, seront acceptés sciemment, librement, volontairement. Ils seront multiples, disséminés, ils s’entre-croiseront dans tous les sens, ils ne remettront jamais entre les mains de ceux qui les exerceront, les armes d’un pouvoir général et autoritaire. Certaines branches d’activité, certains services, certaines directions seront centralisés, techniquement ou administrativement, dans la mesure du nécessaire, sans aboutir pour cela à l’établissement d’une autorité permanente et coercitive. J’ai observé ces choses dans le mouvement ukrainien.
En ce qui concerne, justement, les formes sous lesquelles toute cette activité se produira, une précision est nécessaire. D’aucuns se demanderont si les masses réalisant la tâche seront des masses organisées ou non-organisées ? Autrement dit : l’organisation préalable des masses laborieuses en syndicats, unions professionnelles, coopératives, etc., sera-t-elle utile ou non à l’action créatrice des masses ? Cette action, se produira-t-elle d’une façon entièrement spontanée (organisations et groupements surgissant au moment même de l’action, individus actifs, etc.) ou d’une manière qui mettra les organisations ouvrières existantes à la base de l’œuvre créatrice ?
J’ai la ferme conviction qu’il ne sera pas question de ou, mais de et. Bien entendu, les organisations existantes seront indispensables et joueront un grand rôle dans les événements. Je suis même d’avis que l’absence d’organisations ouvrières en Russie avant la révolution fut l’une des causes principales de sa faillite. Mais ceci ne m’empêche pas de prévoir que les masses non-organisées déploieront, elles aussi, une belle activité, créant des organisations spontanées de grande importance, faisant naître toutes sortes d’associations et de groupements légers, « mobiles », constitués ad hoc, et dont l’action complètera très utilement celle des organisa« fixes ». Et je pense que des individus actifs, doués, instruits, dévoués, surgis des profondeurs des masses, auront aussi des tâches importantes à accomplir (autres que de se saisir du pouvoir politique et de former un gouvernement). Là, encore, je prévois une synthèse de tous les facteurs, de toutes les forces utiles à l’œuvre : et les organisations ouvrières existantes, et les masses non-organisées agissant spontanément, et l’action Individuelle, tous ces éléments auront leur mot à dire, leur rôle à jouer, pourvu que cette activité se déploie dans une ambiance de liberté entière, c’est-à-dire, en l’absence de tout gouvernement nouveau, l’ancien une fois jeté bas par la révolution.
* * *
Encore quelques mots. Comme le lecteur s’en rend certainement compte lui-même, il ne faut pas confondre les masses dont il a été question le long de notre exposé, avec la foule. La foule embrasse une agglomération plus ou moins fortuite, toujours momentanée, de gens de toute espèce, ou quelque chose d’encore plus vague. Une foule, c’est toujours un ensemble « mécanique » de personnes n’ayant entre elles aucun lien permanent, intime, organique. Or, quand nous parlons des masses, nous entendons sous ce terme des millions d’hommes liés entre eux « organiquement », et de façon permanente, par des qualités nettes et plus ou moins homogènes, menant une existence plus ou moins laborieuse, ayant à peu près les mêmes intérêts, la même culture générale, les mêmes aspirations et idéals. Je tiens à souligner ici cette différence, parce que la confusion est fréquente et qu’on attribue assez souvent aux « masses » des défauts propres à la « foule ».
Le lecteur pourrait se demander s’il existe une analyse sérieuse, un ouvrage d’allure scientifique sur la psychologie des masses. Constatons que le sujet n’a encore jamais été traité scientifiquement. Les psychologues et les sociologues se sont intéressés un peu, justement, à la « psychologie de la foule », ce qui ne nous intéresse pas ici. Il existe bien quelques ouvrages, peu scientifiques d’ailleurs, qui s’en occupent. Mais quant à la masse, on ne la connaît pas !
En ce qui concerne la littérature anarchiste, jusqu’à présent le problème n’y est qu’effleuré, d’une façon éparse et plutôt fortuite, dans divers articles de publications périodiques et dans quelques ouvrages d’ordre général.
‒ VOLINE
MASSUE
n. f.
Bâton noueux beaucoup plus gros par un bout que par l’autre. La massue est certainement l’arme la plus ancienne ; on la trouve dans tous les temps et chez tous les peuples. L’écriture en arme Caïn et Samson, de même que la mythologie la met entre les mains d’Hercule. Les Romains avaient dans leurs armées des combattants armés de massues garnies de clous ; Ils les appelaient : clavatores. La massue, sous le nom de « masse d’armes », a de même été employee dans la milice française jusqu’à la découverte de la poudre. Toutes les peuplades d’Afrique ou d’ Amérique connaissaient la massue, Fig. et famil. : Coup de massue : Accident fâcheux et imprévu : ce fut pour lui un coup de massue.
Botanique : Partie supérieure du corps des champignons, lorsqu’elle se compose d’un renflement faisant suite au stipe ou qui en est séparé par un bord sensible. Massue d’Hercule : Variété de concombres ainsi nommée d’après la forme de son fruit. Massue des sauvages, nom donné aux racines du mabouyer, que les naturels du pays employaient pour faire des massues. Massue, ou grande massue d’Hercule, nom donné par les marchands de coquilles au rocher cornu, à cause de la longueur du canal et de la brièveté de la spire de cette coquille ; on l’appelle aussi, massue épineuse.
Argument massue. Celui que l’on tient en réserve comme le plus probant. Dans un discours ou un écrit, il est généralement tenu en réserve comme l’arme suprême, destinée à frapper un grand coup, à confondre l’argumentation adverse.
MASTICATION
n. f. latin masticatio, action de broyer, de mâcher les aliments
Bien que, de prime abord, le sujet paraisse minime, il est cependant d’importance, la mastication jouant un rôle de premier plan dans la nutrition de l’individu. Son action a pour but, non seulement de réduire en bouillie par le broiement plus ou moins attentionné, les aliments solides ; mais surtout d’imprégner de salive (agent très actif de digestion), chaque particule alimentaire.
L’erreur qui consiste à croire que les phénomènes digestifs ont pour théâtre unique l’estomac est très répandue. Cependant l’élaboration des substances alibiles commence dans la bouche pour se poursuivre le long du réseau gastro-intestinal. La salive, comme les sucs gastriques, pancréatiques et hépatiques est ainsi un élément indispensable à la bonne marche de la digestion.
Il faut donc bien se garder de croire que le fait d’absorber des aliments liquides ou demi-liquides (tels que : lait, potages, bouillies) dispense d’une mastication appliquée ou d’une trituration buccale qui, à l’occasion, en tient lieu. Les aliments ayant subi une insuffisante imprégnation salivaire pénètrent dans l’estomac incomplètement préparés. Et cet organe, aux tâches déjà lourdes et qu’il conviendrait d’alléger, devient le siège de troubles fermentescibles dont le cycle d’ailleurs se poursuivra inéluctablement jusqu’à l’évacuation.
Les amylacés sont, en particulier, justiciables d’une bonne digestion buccale. Plus que tous autres ils exigent une insalivation soigneuse, les sécrétions parotidiennes, sous l’action de ferments spécifiques, transformant l’amidon en sucre et en dextrine.
Non seulement, les aliments insuffisamment broyés et insalivés sont susceptibles de provoquer, à la longue, des troubles digestifs et autres par l’élaboration de poisons résultant des fermentations stomaco-intestinales qu’ils engendrent, mais la valeur nutritive des parties non digérées est absolument nulle. Elles ont été absorbées en pure perte malgré l’énorme travail qu’elles ont imposé aux organes intéressés.
Des expérience tentées sur des sujets normaux et maladifs ayant adopté une méthode masticatoire rationnelle permirent à ceux-là de réduire de 50 p. 100 leur ration alimentaire sans diminuer pour cela leur force ni leur poids. Au contraire, dans les cas pathologiques une amélioration sanitaire fut constatée.
Si nous nous reportons, par la pensée, aux époques reculées où vivaient les hommes primitifs, nous sommes obligés d’admettre que leur mode d’alimentation différait sensiblement du nôtre. Ne connaissant ni l’usage du feu qui, par la cuisson, amollit la cellulose végétale ou l’albumine animale, ni aucun instrument, même rudimentaire, permettant leur fragmentation, ils étaient astreints obligatoirement, ainsi que les animaux, à une vigoureuse gymnastique maxillaire. La robustesse de leurs organes sains et exercés taisait le reste. Mais, quand le génie inventif des hommes les eut dotés d’instruments et d’ustensiles appropriés, quand ils eurent développé leurs procédés culinaires, réduisant à mesure la part de la contrainte naturelle, l’effort pénible ‒ mais vivifiant ‒ attaché à la sustentation s’adoucit et les générations s’abandonnèrent de plus en plus à de faciles déglutitions. Je dis s’abandonnèrent, car le relâchement de l’énergie dépassa le secours des agents de complément et les humains, portés, par la paresse, la gourmandise et une hâte circonstanciée, à des absorptions précipitées, mâchèrent toujours moins leurs aliments. On les vit ‒ l’exemple en est aujourd’hui quotidien chez nos contemporains surmenés ‒ engloutir en moins d’un quart d’heure des mets copieux et étrangement cuisinés. Ils appauvrirent ainsi, tarirent parfois les bienfaisantes sécrétions glandulaires excitées jusque là par des efforts physiques de nécessité primaire...
Le nouveau-né cependant n’échappe pas à cette loi de pré-digestion buccale. Chez lui, la succion remplace la mastication et déclenche semblablement et automatiquement la sécrétion salivaire. Le lait, appelé par minces filets, est abondamment insalivé avant la déglutition ; il pénètre dans l’estomac par menues portions et il y est, grâce à son extrême division, facilement attaquée par les sucs gastriques. Ce qui explique que l’alimentation artificielle du nourrisson ne doit s’effectuer qu’au moyen de biberons dont la tétine est percée de trous minuscules.
L’Américain Fletcher est, à notre connaissance, le premier pionnier de la mastication méthodique et volontaire. Ayant constaté les heureux effets de son application sur un grand nombre de personnes souffrant préalablement de troubles dyspeptiques, il entreprit une campagne de vulgarisation dans la presse américaine avec le concours de médecins qu’il avait convertis à cette idée. Un grand nombre de ses compatriotes, pour qui « le temps c’est de l’argent », et qui ne consacraient au repas qu’un laps de temps dérisoire, furent convaincus de l’efficacité de cette nouvelle méthode et, grâce à elle, recouvrèrent, pour la plupart, la santé. Le fletchérisme était né. Aujourd’hui, sa consécration médicale et hygiénique est un fait accompli.
Outre la valeur thérapeutique du flélchérisme, la satisfaction gustative qu’il procure aux gourmets vaut bien la peine de l’astreinte. Les aliments mâchés convenablement procurent un plaisir sensuel que la gloutonnerie aux impatiences avides ne peut susciter. Les travaux de Pavlov établissent qu’une mastication prolongée accroît aussi les sécrétions gastriques.
Une mastication convenable a d’autres conséquences insoupçonnées. La physiologie enseigne que tout organe demeurant sans fonction est voué à l’atrophie. La non-observance de la mastication engendre une déchéance organique du système dentaire ‒ favorisée par l’usage alimentaire de substances désagrégeantes ‒ qui se traduit si fréquemment aujourd’hui par une altération prématurée de la denture du civilisé. Si les hommes persistent dans cette abstention d’une part, et si, d’autre part, ils restent abusivement fidèles aux aliments corrodant, les générations futures devront recourir à la prothèse dentaire dès l’âge le plus tendre.
Le jeu de l’appareil masticateur, l’action du broiement alimentaire déterminent une congestion de la gencive qui est favorable à la nutrition des dents et contribue à leur conservation. Inutile d’ajouter que l’hygiène de la bouche ne peut que renforcer ce résultat.
L’habitude de la mastication constitue donc une mesure préventive et curative d’hygiène. Adjointe aux autres pratiques hygiéniques, elle contribue à assurer l’équilibre des facultés physiques et mentales des individus. Une rééducation de cette fonction s’impose donc chez ceux qui tiennent à l’intégrité de leur santé. C’est affaire de discernement et de volonté.
‒ J. MÉLINE.
MATÉRIALISME
s. m. rad. matériel.
Littré définit :
« Système de ceux qui pensent que tout est matière et qu’il n’y a point de substance immatérielle. »
Deux éléments constituent donc la doctrine : affirmation de l’existence substantielle de la matière ; négation de Dieu, de l’âme, des esprits, de toute substance non matérielle.
La plupart des spiritualistes ne niant pas la matière, on les nomme souvent dualistes et certains matérialistes préfèrent se déclarer monistes. Mais Ernest Haeckel, par exemple, tient à distinguer son monisme « du matérialisme théorique qui nie l’esprit et ramène le monde à une somme d’atomes morts ». Il brandit comme un drapeau le mot de Gœthe : « La matière n’existe jamais, ne peut jamais agir sans l’esprit, et l’esprit jamais sans la matière ». Il adhère, affirme-t-il, au « monisme pur, sans ambiguïté, de Spinoza : la matière (en tant que substance indéfiniment étendue) etl’esprit ou énergie (en tant que substance sentante et pensante) sont les deuxattributs fondamentaux, les deux propriétés essentielles de l’Être cosmique divin qui embrassa tout, de l’universelle substance ». Hélas ! Haeckel expose de façon bien ambiguë le monisme, « sans ambiguïté » en effet, du maître dont il se réclame. Spinoza serait sévère pour ce passage confus où les parenthèses appellent substances ce que la phrase nomme attributs. Il ne saurait plus — et je ne sais plus — ce que pense Hœckel ou même s’il pense quelque chose. De tels accidents sont fréquents aux savants qui veulent philosopher. Le poisson est plus à son aise dans l’eau.
Nous ne connaissons que des phénomènes. La substance nous est inaccessible et certains philosophes dits phénoménistes nient son existence ou la négligent comme les matérialistes nient l’existence de l’esprit, comme les idéalistes (au sens métaphysique) nient l’existence de la matière. Si, avec le sourire du XVIIIè siècle, ou avec la rigueur positiviste, nous opposons métaphysique et sagesse, nous répéterons volontiers après Voltaire : « Les sages auxquels on demande ce que c’est que l’âme répondent qu’ils n’en savent rien ; si on leur demande ce que c’est que la matière, ils font la même réponse ».
Monisme, dualisme et même certaines façons de comprendre le pluralisme ; matérialisme, spiritualisme, idéalisme et même certaines façons de comprendre le phénoménisme : tout cela appartient à la métaphysique, c’est-à-dire au domaine des antinomies.
Le concept fondamental de n’importe quelle métaphysique se manifeste, sous la lumière analytique projetée par l’adversaire, un nid de contradictions. Le matérialiste prouve que l’âme ou Dieu, est une idée contradictoire. L’idéaliste et le phénoméniste infligent le même anéantissement à l’idée de matière. Quel serait le composant concret de la substance ? Peu importe ici que la science moderne, cessant de considérer l’atome comme simple, le compose d’un nombre considérable de particules et que ces corpuscules, différenciés en négatifs et positifs, dansent ensemble comme le soleil et le chœur des planètes. Logiquement, il faut que la matière, ce composé, soit formé de composants. Mais le composant fuit à l’infini. Poser l’étendue et poser la divisibilité, ce n’est pour l’intelligence qu’une seule opération. Tant qu’il y a de l’étendue pour mon esprit, la logique me contraint à le diviser. Pour obtenir l’indivisible, je refuserai donc l’étendue à l’élément dernier de la matière. Mais des zéros peuvent-ils constituer un nombre et l’addition de points sans étendue, une étendue ?...
Le phénoméniste triomphe ici, mais pour être vaincu par une autre nécessité logique. Je ne parviens pas à concevoir le phénomène suspendu dans le vide. Comme la fumée monte du feu, comme le feu suppose un combustible, le phénomène émane d’une substance. C’est une application peu évitable — et si quelques philosophes l’évitent dans les mots, l’évitent-ils dans leur pensée secrète ? — du principe de causalité. Mais le même principe va exiger une cause à cette substance, une cause à la cause de cette substance... Puis-je accepter le recul à l’infini ? Ou suis-je contraint de postuler, — Dieu ou matière, — quelque chose d’éternel, c’est-à-dire, il faut l’avouer, une cause sans cause ? Oui, une cause sans cause. Car il est difficile de contenir son rire devant les plaisants théologiens et les plaisants matérialistes qui disent gravement de Dieu, ou de la matière, qu’Il est ou qu’Elle est sa propre cause.
Je répondrai plus volontiers que, constaté uniquement dans la série phénoménale, le principe de causalité ne saurait s’appliquer correctement en dehors de cette série. Mais alors où ai-je pris le droit de réclamer la substance ? Je n’ose plus affirmer avec le substantialiste et je ne me résous pas à nier avec le phénoméniste.
Pour moi, le vrai refuge est dans l’agnosticisme. Je constate en riant que nulle métaphysique n’a de prise sur le monde extérieur. Dans la pratique, dans la recherche scientifique, je repousse toute métaphysique. Que cette gosse reste à la porte du laboratoire. Mais cet oubli méthodique pourquoi le rendrais-je définitif ? Eh ! si j’aime les caresses de la gosse. J’ai des besoins poétiques et, parmi eux, des besoins métaphysiques. Cet univers dont la science ne saisit que la surface et n’étudie que des fragments, j’aime rêver son ensemble et ses profondeurs.
Quand nous nous abandonnons à ce jeu, si indispensable à quelques-uns, sachons que nous sommes aux pays de la liberté et du rêve. Ne nous indignons pas si d’autres rêvent un autre songe que nous. Matérialistes et monistes si nous avons le tourment de l’unité ; pluralistes si le sens de la diversité l’emporte en nous : ne nous étonnons pas que les goûts du voisin diffèrent des nôtres. Ne méprisons que l’intolérance et le dogmatisme.
Les positivistes nomment quelquefois matérialisme l’effort pour expliquer le complexe par le simple, et, par exemple, le biologique par le mécanique. Ils condamnent dans cette tentative une faute logique. Hélas ! expliquer ou paraître expliquer, c’est toujours simplifier. Hélas ! simplifier, c’est toujours appauvrir et déformer.
Les camarades qui ont une forte culture philosophique liront avec fruit, sur la question du matérialisme et quelques questions connexes : Le Pluralisme de J.-H. Rosny aîné ; Les Synthèses suprêmes de Han Ryner, et surtout, malgré son ancienneté, le livre capital de Lange, Histoire du Matérialisme.
— HAN RYNER
* * *
MATERIALISME. L’histoire du matérialisme pourrait résumer l’histoire de la pensée humaine, si une pareille œuvre pouvait se réaliser dans toute son ampleur. Malheureusement la partie la plus intéressante de cette évolution nous manquera toujours car les premiers efforts de la pensée humaine nous resteront à jamais inconnus. Il faut comprendre, en effet, qu’une conception aussi géniale que celle d’un Démocrite, suppose une faculté d’observation, de raisonnement, d’abstraction tellement développée que, seule une civilisation prolongée, précédée d’une pré-civilisation infiniment plus étendue, peut à peine expliquer.
Ce que l’on peut observer actuellement de la mentalité des peuples arriérés nous montre un des premiers degrés de la compréhension humaine des phénomènes. L’animisme, malgré sa naïveté d’interprétation des faits, représente déjà un effort d’imagination et de généralisation tendant à doter l’univers d’esprits, d’intentions, de volontés humaines. L’anthropomorphisme y prend ses racines très visiblement. Le fétichisme, le totémisme représentent des croyances générales, des déductions tâtonnantes mais ce n’est qu’à un degré plus élevé que l’abstraction, l’induction se précisent plus nettement.
Quelques documents peuvent jeter une certaine lueur sur les connaissances antiques. En Chine, le légendaire Fou-hi, auteur supposé du Y-King (livre des transformations), écrit il y a près de 5.000 ans, divise les éléments en deux : le ciel représentant le principe mâle, la puissance supérieure ; la terre représentant le principe féminin, la faiblesse et la passivité. Les choses naissent par composition et disparaissent par décomposition. Plus tard, vers le XIè siècle avant notre ère, Lao-tsen et Confucius fondèrent, chacun de son côté, une doctrine plutôt morale que philosophique. Pour Lao-tsen tout n’est que recommencement ; être équivaut à ne pas être. Confucius fonda une morale naturelle et fut davantage un sage qu’un métaphysicien. L’Egypte possédait, il y a quelque six mille ans, toute une mythologie et une métaphysique très compliquées, sinon raffinées. Nous trouvons encore ici le dualisme entre le bien et le mal, la lumière et la nuit, etc., et les divinités multiples personnifient les divers aspects de la réalité. La Chaldée, aussi vieille que l’Egypte, possédait également une mythologie exubérante mais plus érotique et anthropomorphique que la précédente. Le principe humide et femelle se rencontre partout avec le principe mâle, le phallus, et toute la nature est ainsi partagée entre ces deux éléments de la fécondité. La civilisation indoue, un peu moins ancienne que les précédentes, offre les mêmes conceptions dualistes et une mythologie plus vaste, plus poétique, plus symbolique. Un des plus anciens livres sacrés, le Rig-Véda, dont le recueil, attribué à Vyasa, remonte à 3.500 ans en arrière, fait jaillir toutes choses d’Aditi, sorte d’entité féminine vague, antérieure à toute existence et mère de l’Univers. Toutes les divinités engendrées par Aditi personnifient les divers éléments de la terre et du ciel. Le brahmanisme, plus métaphysique, se révèle surtout plus rituel et liturgique. C’est une religion solidement constituée. Le boudhisme, plus philosophique, plus humain, forme presque une sagesse par ses aperçus profonds sur l’éternel recommencement de toutes choses, l’anéantissement final dans le Nirvana. C’est le triomphe de l’investigation subjective, de la méditation, de la contemplation du moi.
Si nous passons à la philosophie gréco-latine, relativement récente, nous trouvons une tournure d’esprit très subtile et très observatrice. Thalès de Milet pensait que les diverses transformations de l’eau donnent naissance à toutes les substances connues. Il croyait à l’immortalité de l’âme. I1 est un des premiers philosophes Ioniens. Anaximandre, disciple direct de Thalès, fut un génie plus profond et le précurseur de Démocrite. Pour lui la substance et le mouvement sont indissolublement liés. Cette substance composée d’éléments éternels, immuables et indéterminés, forme par ses innombrables combinaisons tous les corps, y compris l’homme. Anaximène, qui fut son élève, fit plutôt rétrograder la compréhension des choses en attribuant la diversité des substances aux transformations de l’air. Contemporainement à ces philosophes Ioniens, Phérécyde et Xénophane enseignaient d’autres philosophies. Phérécyde, qui paraît avoir été le père du spiritualisme, croyait à une cause ordonnatrice, modelant intelligemment la matière informe. Il admettait, probablement, la transmigration des âmes et Pythagore, son disciple, en tira sa métempsychose, Xénophane, après avoir douté de tout, après avoir pensé que si les animaux se représentaient des dieux, ils les feraient à leur image, après avoir affirmé que nous ne pouvions rien savoir, poussé par le besoin d’explication, créa le Dieu unique, parfait, auteur de l’univers. Il est le créateur de l’idéalisme.
Pythagore eut quelques intuitions curieuses avec sa théorie des nombres. Peut-être songeait-il que l’aspect des choses ne dépendait que du nombre des éléments simples le composant. Sa philosophie mêlée de totémisme et de tabous resta très obscure et sa rnétempsychose fut une sorte de totémisme raffiné. Après lui, Héraclite expliquait tout par le feu. De l’aspect contradictoire des faits perçus par les sens il déduisait que ceux-ci sont trompeurs ; que seule la raison, la raison universelle pouvait enseigner la vérité et, comme cette raison cherche à unifier et généraliser les faits, il concluait à une unité finale du monde. Ce qui en était une sorte de destruction. Hippocrate, le fameux médecin grec, raisonnait à peu près de même et faisait du feu l’âme matérielle de toutes choses.
Parménide, né à Elée vers 519, fut plus un métaphysicien qu’un observateur des faits et peut être considéré comme un des premiers rationalistes cherchant, sans le secours des sens, une explication de l’univers par le seul usage de la raison. Adversaire de la philosophie Ionienne, il croyait la détruire en affirmant qu’une substance ne pouvait être à la fois ce qu’elle était et en même temps autre chose en se transformant. Ce qui n’est pas, disait-il, ne peut provenir de ce qui est. D’autre part ce qui est n’a pas de degrés dans le fait d’être ; donc il est indivisible et immobile, et il n’y a ni naissance, ni commencement de choses, ni transformations, ni mouvement. L’image de ce qui est, peut se représenter, disait-il, par une sphère parfaite, limitée, également pesante en tous sens ; elle est incréée, indestructible, continue, immobile et finie. Son disciple, Zénon d’Elée, poussa l’art du raisonnement encore plus loin et Aristote fait de lui le fondateur de la dialectique. Il croyait démontrer l’absurdité de la discontinuité par le raisonnement suivant : si le multiple est composé de points sans grandeur, il est composé de rien, ce qui est absurde ; si le point a une grandeur ou de l’étendue il est encore divisible, donc il n’est pas l’unité. De même entre chaque point il y aura place pour d’autres points et ainsi à l’infini. Ses arguments pour nier le mouvement sont ingénieux. Dans Achille et la tortue, il croit nier la discontinuité en démontrant l’impossibilité pour Achille d’atteindre la tortue puisqu’une infinité de points l’en répare et qu’on ne peut atteindre l’infini. Dans La flèche qui vole, il essaie de nier le mouvement en supposant que si le temps est composé de mouvements indivisibles, par conséquent sans durée, la flèche ne pouvant occuper qu’un seul espace à la fois pendant ces moments-là restera donc à tous moments au repos.
Nous verrons plus loin la valeur de ces jeux de l’esprit mais remarquons que Zénon d’Elée, ouvre la voie au doute systématique et oriente, dès ce moment, les philosophes dans deux directions : ceux qui croient à l’explication sensuelle des choses ; ceux qui se réfugient dans la spéculation intellectuelle. Les premiers préparent la science expérimentale les seconds s’enferment dans une verbologie creuse et négative. Remarquons encore que la philosophie athée et matérialiste des premiers fut toujours impopulaire tandis que la deuxième, amoureuse du mystère, fut toujours goûtée des multitudes.
Empédocle, très matérialiste dans l’ensemble de sa doctrine, admet plusieurs éléments ordonnés nécessairement par la raison, le fameux Logos. Anaxagore admet l’éternité de la matière et l’éternité d’un principe ordonnateur. De même que les formes matérielles momentanées périssent, de même les âmes formées de ce principe sont mortelles mais l’âme universelle est immortelle. On considère Anaxagore comme le fondateur véritable du dualisme spirituel. Avec Leuccipe et Démocrite la connaissance fait un pas gigantesque délaissant toutes les inventions mythologiques et enfantines ; Démocrite développa l’idée de son maître Leuccipe sur le plein et le vide, construisit, par une induction géniale, une explication mécaniste de l’univers et fonda l’atomistique. Tout ce qui existe est formé de particules infimes, de formes multiples, animées de mouvements divers et leurs rencontres, leurs diverses combinaisons créent la diversité des choses sans l’intervention d’aucune divinité. Démocrite fut toutefois quelque peu contradictoire en affirmant qu’il n’y avait rien de vrai, rien de connaissable. Il faut voir là une conséquence de l’opposition entre les concepts fournis par la raison et les données fournies par les sens. Ce scepticisme devait assurer une certaine base aux joutes célèbres des sophistes. On connaît leur art oratoire et leur science profonde de la dialectique démontrant victorieusement l’évidence des concepts les plus opposés. Parmi eux Gorgias démontrait qu’il n’y avait rien, ou que ce qui existait était inconnaissable ou intransmissible et Protogoras, plus positif, affirma que : l’homme est la mesure de toutes choses.
Socrate laissa volontairement de côté ces questions qu’il jugeait inutiles pour le bonheur de l’homme. Influencé par la subtile dialectique des sophistes, il se servit de leur art pour ramener toute question à la seule qui l’intéressait : la culture intérieure, le connais-toi toi-même. Platon pencha nettement pour le rationalisme et fut un des précurseurs de l’intuition, source de connaissance antérieure à l’expérience. Péniblement enfermé dans sa subjectivité il recommença les éternelles et inutiles démonstrations sur l’Etre Un ou Multiple et balança plus ou moins subtilement entre Parménide et Démocrite pour admettre finalement Dieu, le démiurge façonnant la matière aussi vieille que lui. Il supposait que chaque objet possédait quelque chose de simple et de général, existant par soi-même, connu intuitivement par la raison et formant les fameuses idées. Aristote mit de l’ordre dans l’expression de la pensée et consacra plusieurs ouvrages à l’étude de la logique. Peut-être les excès des Eléates et des Sophistes l’y déterminèrent-ils. Esprit vaste et encyclopédique, très observateur, il faisait de la sensation la base de la connaissance et sa philosophie expérimentale était, en somme, réellement matérialiste mais l’influence rationaliste de Platon, troubla quelque peu la belle unité de ses concepts et sa métaphysique contradictoire se compliquait de l’inévitable cause première : Dieu. Sous le nom de catégories (au nombre de dix) il précisait les divers aspects de la substance et l’existence de toutes choses.
Pyrrhon ne fut ni un négateur systématique, ni un sceptique absolu. Le spectacle chaotique des événements et des êtres et surtout celui des philosophies lui firent penser que tout était relatif et qu’il était imprudent d’affirmer ou de nier quoi que ce soit, surtout en métaphysique. Tout était possible, rien n’était vrai ou faux. Avec Zénon de Cittium et Epicure nous atteignons deux conceptions philosophiques précises. Zénon, fondateur du stoïcisme, admettait l’origine sensuelle de la connaissance, le dualisme de la matière et de la force et une sorte de panthéisme où la nature et l’univers étaient Dieu. Il soutenait le libre arbitre, la puissance absolue de la volonté et la souveraineté de la raison. Le stoïcisme admettait une sorte d’harmonie préétablie, un lien universel et la raison, parcelle de la nature divine, cherchait l’accord de la partie avec le tout. Né en 341, avant J.-C., Epicure reprenant la conception de Démocrite développa une explication de l’Univers très voisine de la conception moderne. I1 n’admettait pas la divisibilité de la substance à l’infini mais seulement son extrême petitesse, ainsi que le vide nécessaire au mouvement. Rien n’existe en dehors du mouvement des atomes et leur déclinaison crée toutes les innombrables transformations de la matière. Quelques-unes de ses affirmations sont à connaître : les sens ne trompent jamais — L’erreur ne porte que sur l’opinion — l’opinion est vraie lorsque les sens la confirment ou ne la contredisent pas. L’opinion est fausse lorsque les sens la contredisent ou ne la confirment pas — il en déduisait que tout raisonnement, toute certitude vient des sens.
Ænésidème et Agrippa s’attaquèrent, un siècle avant notre ère, à la métaphysique. Le premier nia non seulement l’idée de cause, d’origine anthropomorphique, mais encore les rapports de cause à effet. Il affirma l’impossibilité de passer du connu a l’inconnu et réduisit le rôle de la démonstration théorique à une gymnastique verbale. Le deuxième : Agrippa, relevant les contradictions de la métaphysique, essaya de la détruire en démontrant que ses assises les plus sûres étaient inadmissibles car elles se réduisaient à la contradiction, aux progrès à l’infini, la relativité, l’hypothèse et le cercle vicieux et se résumaient à affirmer ce qu’il faut démontrer. Aux premiers siècles de notre ère, le stoïcisme, représenté par Sénèque, Epictète, Marc-Aurèle, fut plutôt une belle culture de la volonté qu’une recherche de vérité objective. L’Ecole d’Alexandrie, vers le deuxième siècle, fonda l’éclectisme dont Plotin fut l’illustre représentant. Il pensait que l’Un, qui se pense lui-même, est l’être, par excellence, possesseur de toutes réalités en qui l’intelligible et l’intelligence ne font qu’un. Il est probable que ses conceptions sur la matière, qu’il affirmait complètement indéterminée, se résumaient à penser qu’elle n’était qu’un effet de l’action des Uns, mais le mysticisme de ces concepts ne pouvait être d’aucune utilité pour la connaissance humaine.
Vers le onzième siècle jaillit la fameuse querelle entre nominalistes et réalistes ; ceux-ci croyant avec Platon à la réalité, à l’existence objective des idées générales ; les autres ne croyant, avec Aristote, qu’à leur valeur abstraite, nominale et subjective. Vers la même époque quelques philosophes Arabes et Espagnols, plus ou moins aristotisant, vivant à l’écart de la lèpre christianisante, méditaient sur ces problèmes ardus. Avicenne distingua le possible du nécessaire et imagina un premier moteur. Algazali nia le témoignage des sens et la valeur des démonstrations logiques ; ce qui le mena tout droit au mysticisme. Maimonide, esprit vaste et très cultivé, essaya de concilier la foi avec la raison en donnant la priorité à cette dernière. Averrhoès nia indirectement la création, l’immortalité de l’âme, le libre arbitre et crut que la force, l’intelligence mouvaient la matière.
Il faut arriver à Roger Bacon, vers la fin du XIIIè siècle, pour retrouver quelques assises solides hors des subtilités des rationalistes. I1 rejette la foi et la raison pour n’user que de l’expérience qui affirme ou nie. Il n’y a, pense-t-il, que des individus composés de substances et des faits produits par les rapports entre les substances et les contacts entre les individus. Trois siècles plus tard, François Bacon et Descartes eurent, comme trait commun, l’idée de faire table rase de tout le passé ; mais, tandis que le premier, admirateur de Démocrite, constituait la connaissance par la méthode objective et la recherche expérimentale, le deuxième use plutôt de la métaphysique et du rationalisme stérile. Malgré sa conception mécanique de l’Univers et son génie mathématique, il pensait que nous devions douter du monde extérieur, mais que nous pourrions admettre son existence parce que Dieu, qui ne saurait nous tromper, nous en a donné l’idée. Gassendi revint au matérialisme d’Epicure et fut l’adversaire de Descartes dont il attaqua le fameux : « Je pense, donc je suis », en démontrant que l’existence peut se déduire de tout autre acte que celui de penser. Il regardait le temps et l’espace comme existant par eux-mêmes et accordait aux atomes matériels une identité de substance avec une différence de formes. Au commencement du XVIIè siècle, Hobbes pensait que la substance formée d’éléments infiniment petits crée par le mouvement de ses parties les diverses modifications que nos organes sensuels perçoivent comme accidents et qui sont relatifs à notre sensibilité. Il songeait que la sensation est produite par le mouvement de la substance vivante impressionnée par les mouvements objectifs. La logique déductive partait de l’expérience et de l’induction. A la même époque Spinoza composait son Ethique célèbre dans laquelle il dote la substance de tous les attributs que la raison connaît sous forme d’étendue et de pensée. Il ramène Dieu, l’Etre parfait à la substance en soi, ce qui revient à le supprimer. Locke, contemporain de Spinoza, combattit les idées innées, démontra le développement progressif de l’intelligence chez l’enfant par l’acquisition sensorielle et, conséquemment, l’origine strictement sensuelle des idées. Nous ne connaissons de la substance que des attributs, perçus avec une certaine constance, dans un certain ordre et ces abstractions forment nos idées. Sa philosophie est exprimée dans : « Essai sur l’entendement humain ». Leibniz écrivit : « Nouveaux essais sur l’entendement humain » pour réfuter Locke et démontrer que les idées ne viennent point des sens. Ne pouvant expliquer les rapports de l’âme et du corps il inventa l’Harmonie préétablie, faisant jouer à chaque monade matérielle ou spirituelle (sortes de points métaphysiques doués de vertus plus ou moins chimériques) un rôle déterminé depuis le commencement des mondes, en sorte que, tout comme dans un orchestre, le matériel et le spirituel, tout en s’ignorant, s’accordent chacun de son côté avec son associé inconnu. Ce parallélisme extravagant créait un univers immuable, et enfermait en chaque monade tout le devenir possible, tout le passé écoulé, sans justifier aucunement le libre arbitre puisqu’au fond chaque monade ne pouvait que se conformer aux volontés de son créateur.
Dès le début du XIIIè siècle, nous trouvons deux sceptiques bien distants l’un de l’autre. Le premier, Berkeley, voulant détruire les témoignages des sens ruinant la foi, imagina la négation du monde extérieur et la seule existence de l’esprit ne connaissant et n’affirmant que lui-même, ignorant l’existence d’autres moi. Cela n’empêcha point cet idéaliste qui doutait de tout d’admettre Dieu et de vouloir démontrer — à qui ? — que l’univers n’existait pas. Hume reprit toute l’argumentation des sceptiques et affirma qu’il n’y avait rien en dehors de la perception et que les idées de cause, de nécessité, de réalité objective n’étaient qu’une habitude. Les mathématiques ne correspondent à rien de concret ; la science objective n’est qu’une nomenclature de phénomènes et le monde extérieur le sujet inconnu de la sensation. La Mettrie par son Histoire naturelle de l’âme, son Homme-machine et son Homme-plante mérite d’être considéré comme un des précurseurs des mécanistes actuels ramenant tout au jeu de la substance universelle. Voltaire attaqua surtout le fanatisme et Diderot, plus positif, paraît avoir eu l’intuition des découvertes scientifiques modernes et conçu le grandiose transformisme. Kant voulut supprimer la métaphysique oiseuse, mais son point de vue, uniquement subjectif, prit la connaissance humaine hors de son évolution biologique et s’englua dans le rationalisme. Il admettait une raison pure, antérieure à l’expérience, ne nous faisant connaître que des phénomènes par l’intermédiaire des sens, mais non les noumènes ou choses en soi. Max Stirner attaqua la métaphysique kantienne et ramena toute chose à l’intérêt de l’individu, seule réalité tangible et indestructible. Schopenhauer, contradictoirement sceptique et idéaliste affirma : « le monde est ma représentation » et conclut que le monde n’est : « qu’un phénomène intellectuel ».
Vers la fin du XVIIIè siècle et le commencement du XIXè, Lamark créait avec son ouvrage « Philosophie Zoologique », la philosophie transformiste, tandis que Lavoisier venait de fonder la chimie moderne. La méthode objective s’élaborait lentement. Auguste Comte refit une classification de nos connaissances et rejetant tout a priori, fit de la méthode expérimentale la base unique du véritable savoir mais son Positivisme ne put éviter l’écueil métaphysique et religieux. Il rejeta le matérialisme expliquant « le supérieur par l’inférieur » et, croyant rester dans le pur domaine scientifique construisit une sociologie hiérarchique et théocratique dans laquelle le grand Être Collectif (humanité) remplaçait les vieilles divinités. Stuart Mill, partant d’un scepticisme inutile pour la compréhension des choses conclut à l’unique réalité des sensations et émit cette surprenante conception : « La matière est une possibilité permanente de sensation ; si on admet cela je crois à la matière, sinon je n’y crois pas mais j’affirme avec sécurité que cette conception de la matière comprend tout ce que tout le monde entend par ce mot ».
La philosophie évolutionniste avec Darwin, Spencer, Bain, Büchner, Hæckel, Romanès, Karl Vogt et maints autres penseurs délaissa l’explication subjective pour la recherche expérimentale, l’analyse scientifique, la déduction et l’induction appuyées sur l’observation. Avant d’examiner quelques philosophies plus récentes remarquons que jusqu’alors les efforts des penseurs, vers la compréhension du monde, peuvent se ramener à deux méthodes différentes : l’une qui paraît s’appuyer exclusivement sur les concepts subjectifs et comprend toutes les spéculations de l’esprit telles que : spiritualisme, idéalisme, rationalisme, parallélisme, dualisme, criticisme et néo-criticisme, vitalisme, etc. L’autre, beaucoup plus influencée par les faits objectifs apparaissant nettement déterminés, s’oriente davantage vers le témoignage des sens, vers les résultats de l’expérience et comprend : l’empirisme, le matérialisme, le positivisme, l’évolutionnisme, le transformisme, le monisme et la philosophie mécaniste.
Alors que la première méthode est essentiellement personnelle et garde un irréductible élément d’appréciation subjective indémontrable ; la deuxième ne peut être que scientifique, expérimentale et impersonnelle dans toutes ses hypothèses et affirmations.
Entre ces deux formes extrêmes de la connaissance d’autres systèmes se sont interposés pour essayer d’en concilier les avantages ; tels sont : le scepticisme, l’agnosticisme et plus récemment le pragmatisme, l’intuitionnisme et le pluralisme. Il semblerait que les efforts malheureux et infructueux des philosophes passés dussent servir d’exemples aux constructeurs contemporains et pussent leur éviter les erreurs de leurs prédécesseurs ; mais chaque méthode est à ce point influente et déterminante que, quelle que soit la valeur de ses adeptes, elle conduit inévitablement aux mêmes résultats. Le subjectivisme aboutit à un acte de foi : l’objectivisme à la simple constatation de ce qui est expérimentalement démontré. Le premier voulant expliquer les choses au delà du compréhensible n’explique rien, car un acte de foi n’est pas une explication. Le deuxième n’expliquant qu’un aspect de ce qui est, est accusé de ne rien expliquer du tout.
L’esprit humain est encore si primitif et si superstitieux qu’il doute des plus élémentaires certitudes mais accorde un crédit illimité aux œuvres de pure imagination. Examinons quelques philosophies subjectives.
Vers le milieu du XIXè siècle, Charles Renouvier fonda le néo-criticisme, modifiant le criticisme de Kant lequel admettait le déterminisme universel du monde phénoménal. Ce néo-criticisme devint le Personnalisme qu’il est intéressant d’étudier rapidement car, réfutant le matérialisme, et bien que fortifié par les innombrables systèmes philosophiques précédents, il va nous montrer par ses multiples contradictions et son insuffisance explicative évidente l’impuissance de la méthode subjective. En voici les principaux aspects :
« Le néo-criticisme admet la conscience comme fondement de l’existence ; la personne comme premier principe causal à l’égard du monde et pose la thèse métaphysique d’un premier commencement des phénomènes, à raison de l’impossibilité logique de leur rétrocession à l’infini. »
« La liberté est la condition de possibilité de la morale et du devoir. La création est et doit être ainsi que le commencement hors de notre compréhension. »
Cela ne l’empêche nullement d’écrire ceci :
« L’hypothèse d’une création est plus intelligible, plus conforme à la logique que l’hypothèse d’une série infinie de phénomènes successifs sans origine. La nécessité qu’une cause soit toujours causée est contradictoire à la nécessité d’une première cause ; elle est réfutée si celle-ci est prouvé. »
Cette réfutation, nous dit Renouvier, est réalisée par le principe de contradiction que voici :
« Toute suite de chose nombrables, réelles et distinctes les unes des autres, forme une suite donnée et déterminée, qui ne peut être à la fois infinie et effectuée. Une somme de phénomènes, s’ils ont été réels et distincts, doit donc être une somme donnée et déterminée à ce moment, car une somme déterminée ne peut pas se composer de termes à l’infini. Les idées d’infinité et de sommation sont des idées mutuellement contradictoires. »
Donc pour Renouvier le monde a été créé, puisqu’il est un nombre et que tout nombre a un commencement. Il dit aussi :
« L’inférieur et le privatif au commencement ne peuvent être la source du supérieur et du parfait qui leur sont irréductibles. »
Pour ce philosophe le monde est composé de monades très diverses douées d’activité, de perception, d’appétition et réglées par une harmonie préétablie. Ces monades formaient à l’origine une sphère très homogène, de densité croissante de la circonférence au centre. Les humains étaient primitivement des êtres extraordinaires mais leur volonté disloqua cette homogénéité et créa des systèmes cosmiques séparés, tels les monarques se disputant la surface de la terre. Cette déchéance humaine prendra fin par la restauration du monde primitif, sorte de rédemption, dans lequel la pesanteur sera remise en place sous le gouvernement de la volonté. Il nous dit aussi : « L’anthropocentrisme est le point de vue moral de l’univers ». Partisan des actions à distance il repousse le système de l’impulsion mécanique, laissée, dit-il, sans explication et n’hésite pas à soutenir qu’on peut être sur le terrain de la logique en admettant les deux postulats indémontrables suivants : « Il n’y a pas d’argument capable de vaincre cette affirmation qu’une proposition dont les termes sont contradictoires pour notre entendement peut cependant être vraie en soi ; ou cette autre affirmation que l’existence d’une chose impossible à connaître et même à définir est cependant une chose réelle et certaine ».
Ces quelques extraits nous montrent les méfaits de la métaphysique et son impuissance même à conduire correctement les raisonnements abstraits. Sans nous arrêter à la sphère homogène, à la chute et la rédemption de l’humanité qui sont de pures et naïves fantaisies, le personnalisme enferme au moins six contradictions internes qui en détruisent les fondements :
-
il admet en même temps et l’incompréhension absolue de la création et son intelligibilité ;
-
il déclare irréductible le supérieur à l’inférieur et l’impossibilité d’évolution de l’inférieur au supérieur alors qu’il affirme l’évolution du supérieur à l’inférieur ;
-
même contradiction pour la perfection humaine primitive engendrant la déchéance présente, laquelle à son tour doit récréer la perfection primitive. Tour à tour la perfection engendre l’imperfection et celle-ci à nouveau engendre celle-là ;
-
l’impulsion mécaniste est laissée, dit-il sans explication et il affirme alors la réalité de l’extraordinaire pouvoir des actions à distance sans en donner lui-même aucune explication ;
-
II soutient la nécessité de la liberté et du libre arbitre et il admet en même temps l’harmonie préétablie dans laquelle chaque monade est inévitablement déterminée dans tout le cours de son existence par l’acte créateur ;
-
enfin sa fameuse preuve contradictoire est totalement erronée en ce sens qu’il substitue avant toute chose à l’infinité des phénomènes une somme finie et qu’il déduit cette somme finie de la notion d’existence. Or il est évident que la notion d’existence est indissolublement liée aux notions de durée et d’étendue, lesquelles ne forment aucune somme finie dans l’infini. Nous sommes dans un cercle vicieux qui consiste à appuyer toute l’argumentation sur le fini alors qu’il s’agit précisément de le démontrer.
Si nous ajoutons à ces multiples contradictions, l’affirmation naïvement animiste de l’anthropocentrisme point de vue moral de l’univers, qui fait de l’homme la raison d’être des mondes infinis et donne une explication supprimant toute recherche, en donnant la réponse avant même que se formulent les questions ; si nous constatons enfin que les deux postulats détruisent radicalement toutes connaissances par leurs deux affirmations successives qui précisent l’une : que toute chose contradictoire peut être vraie, ce qui supprime tout raisonnement, l’autre : qu’une chose inconnaissable est une chose réelle, ce qui ruine toute certitude et toute évidence, on peut se demander quelle est la valeur d’une telle œuvre.
Un philosophe contemporain, Bergson, a tenté un suprême effort pour donner la métaphysique de ses stagnantes contradictions. Comprenant les difficultés du spiritualisme pour expliquer les rapports de l’immatériel au matériel ; et croyant suppléer à l’insuffisance du matérialisme, qui ne peut, paraît-il, expliquer l’immatérialité de la conscience par la matière, il a essayé par de subtils raisonnements d’établir les propositions suivantes :
-
La matière est telle qu’elle nous apparaît ;
-
Le corps n’est que matière et ne peut penser ;
-
Les rapports de la matière et de l’esprit (ou conscience) inexplicables avec le matérialisme et le spiritualisme peuvent s’expliquer par l’extension des perceptions et leur contraction par l’esprit ;
-
L’étendu et l’inétendu, la qualité et la quantité sont réductibles par suite de cette contraction particulière des états de la matière par l’esprit ;
-
L’esprit est hors de l’espace.
Comme la matière, telle qu’on croit la connaître en pays métaphysique, ne peut paraît-il penser. Bergson nous dit :
« La vérité est qu’il y aurait un moyen, un seul de réfuter le matérialisme, ce serait d’établir que la matière est absolument comme elle paraît être. »
Voyons ses autres affirmations :
« J’appelle matière l’ensemble des images et perceptions de la matière. La matière est donc telle que nous l’apercevons et le cerveau, masse matérielle, ne peut que recevoir, inhiber ou transmettre du mouvement. La perception pure est le plus bas degré de l’esprit, l’esprit sans mémoire et fait partie de la matière telle que nous l’entendons. On peut même dire que la matière a une certaine mémoire. Si la matière ne se souvient pas du passé, c’est parce qu’elle répète le passé sans cesse, c’est parce que, soumise à la nécessité, elle déroule une série de moments dont chacun équivaut au précédent. Puisque la perception est tout l’essentiel de la matière et que tout le reste vient de la mémoire il faut que la mémoire soit une puissance absolument indépendante de la matière. »
Ainsi, pour Bergson, la matière continue est en mouvement ; mais ses états conscients trop brefs, ses perceptions trop fugitives pour constituer une représentation sont conservés dans la mémoire, c’est-à-dire par l’esprit qui recueille pour ainsi dire toutes les perceptions successives et en fait du souvenir. Le système nerveux ne serait qu’un réseau transmetteur de perception, le cerveau un bureau téléphonique central incapable de conserver aucune image, aucune représentation. Cependant, comme Bergson s’est donné pour but d’expliquer les rapports de la matière et de l’esprit, de l’étendu et de l’inétendu, voici comment il explique leur point de contact :
« II y a deux mémoires théoriquement indépendantes ; l’une qui conserve dans l’esprit les souvenirs classés dans leur ordre précis et dans laquelle nous allons chercher les renseignements du passé pour les utiliser dans l’action présente ; l’autre constitue les divers mouvements de l’organisme, commencés par les perceptions, puis ordonnés par les souvenirs qui créent ainsi une série de mécanismes coordonnés pouvant se déclencher automatiquement sous l’influence directe des perceptions. La première est spontanée, capricieuse. La seconde orientée dans le sens de la nature, reste sous la dépendance de notre volonté. »
Bergson admet même une certaine intelligence des excitations nerveuses qui, après avoir choisi leur voie à travers le système nerveux, utilise des mécanismes moteurs appropriés constituant l’adaptation. « Le rôle du corps n’est pas d’emmagasiner les souvenirs mais simplement de choisir, pour l’amener à la conscience, le souvenir utile ». Ainsi toute perception détermine un commencement d’action de la mémoire matérielle, laquelle fait surgir de la mémoire-souvenir tous les souvenirs utiles du passé. Comme il faut faire un choix approprié dans ces innombrables images, Bergson dit tantôt que la mémoire-matérielle ne devra accepter que ce qui peut éclairer la situation présente ; tantôt ce rôle est dévolu à la conscience qui choisit alors dans ces images celles convenant à l’action présente :
« Perceptions et souvenirs se pénètrent donc toujours, échangent toujours quelque chose de leur substance par un phénomène d’endosmose. »
Le passage de l’inétendu spirituel à l’étendu matériel s’effectue ainsi :
« Les images des choses sont en dehors de l’image de notre corps ; elles sont dans les choses elles-mêmes. Mais alors notre perception faisant partie des choses, les choses participent de la nature de notre perception. L’étendue matérielle n’est plus, ne peut plus être cette étendue multiple dont parle le géomètre ; elle ressemble plutôt à l’extension indivisée de notre représentation. »
Notre nature est donc formée de trois états :
-
les perceptions présentes déterminant un commencement d’action ;
-
le souvenir pur, inextensif et impuissant, ne participant de la sensation en aucune manière ;
-
le souvenir-image qui est la matérialisation présente d’un souvenir pur quittant le passé pour s’actualiser dans l’action et marquer le présent sans l’influence de la conscience. Celle-ci préside donc à l’action et éclaire le choix.
Enfin l’opposition entre la qualité et la quantité se résout par la théorie suivante : Les qualités sont discontinues, hétérogènes et ne peuvent se déduire les unes des autres ; les changements homogènes ou quantités par contre se prêtent au calcul ; il suffit donc de supposer que l’hétérogénéité des choses est assez diluée pour être pratiquement négligeable, mais notre mémoire, accumulant par contraction et par la durée ces différences infimes, crée alors les notions de qualités. L’irréductibilité de deux couleurs, par exemple, peut provenir surtout de l’étroite durée où se contractent les trillons de vibrations qu’elles exécutent en un de nos instants. Si nous pouvions vivre cette durée dans un rythme plus lent nous verrions, avec le ralentissement progressif du rythme, les couleurs pâlir et se confondre avec des ébranlements purs. Ainsi :
« La mémoire n’est donc à aucun degré une émanation de la matière ; bien au contraire, la matière telle que nous la connaissons occupe toujours une certaine durée, dérive en grande partie de la mémoire. »
Nous voyons alors se dessiner la conception de la matière :
« La matière se résout ainsi en ébranlements sans nombre, tous solidaires entre eux et qui courent en tous sens comme autant de frissons. »
L’espace étant homogène et continu « toute division de la matière en corps indépendants aux contours absolument déterminés est une division artificielle ». Autrement dit c’est notre action vitale sur la matière qui crée artificiellement sa divisibilité.
« Le mouvement vital nous éloigne donc de la connaissance vraie. »
Nous pouvons résumer ainsi cette conception : la matière est homogène, étendue et animée d’états rythmiques très rapides que seule notre durée consciente contracte et transforme en qualités différentes suivant nos besoins vitaux. Nos perceptions, par extension, participent donc de l’étendue de la matière et deviennent l’inétendue des sensations. D’autre part, notre esprit contractant par une tension particulière les quantités homogènes fait de ces quantités de la qualité. Le rôle de l’esprit est donc de lier les moments successifs de la durée des choses. C’est dans cette opération qu’il prend contact avec la matière et qu’il s’en distingue également puisqu’il contient la durée totale des choses conservées dans le souvenir pur.
Nous voyons que Bergson s’efforce d’expliquer comment l’esprit entre en contact avec la matière mais son explication, loin de simplifier les choses, les a singulièrement compliquées. Avant son essai il n’y avait que deux choses irréductibles l’une à l’autre, ou incompréhensibles l’une par l’autre : la matière et l’esprit. Après son ouvrage il y en a dix : l’esprit, la conscience, la volonté, l’intelligence, le souvenir, la durée, la perception, la tension, l’extension et la matière.
La perception, dit-il par exemple, est l’essentiel de la matière et se trouve dans les choses plutôt qu’en nous et cette perception pure est le plus bas degré de l’esprit ; mais il nous dit en même temps que l’esprit n’est pas dans la matière et qu’il n’y a pas de transition entre elle et lui. Il suffit d’examiner ces affirmations successives pour en constater l’incohérence. Tantôt il est dit que la perception (ou le plus bas degré de l’esprit) est l’essentiel de la matière, tantôt cet esprit minima s’en distingue radicalement. Nous ne savons donc pas ce qu’ils sont. Il est dit également que les perceptions de la matière sont une succession de durées fugitives tandis que le souvenir conserve toutes les durées. Il ne peut donc pas y avoir une différence de nature entre le souvenir et la perception mais seulement différence de quantité, mais alors cela détruit l’affirmation que les souvenirs purs ne sont pas une émanation de la matière ou un de ses attributs. Et comment expliquer intelligiblement que ces perceptions originellement matérielles, une fois cueillies par l’esprit deviennent soudainement immatérielles dans le souvenir, puis se rematérialisent pour l’action ! Comment Bergson n’a-t-il pas vu que sa philosophie, uniquement inventée pour expliquer les rapports de la matière et de l’esprit, passait de l’un à l’autre, comme dans les philosophies de tous ses devanciers, sans en expliquer aucunement le mécanisme. Les perceptions matérielles ont beau être accumulées dans le souvenir, celui-ci ne reste qu’une collection de choses matérielles et nous ignorons toujours ce qu’est la perception de la matière par elle-même. La tension et l’extension restent mystérieuses et munies de pouvoirs énigmatiques. En effet, pour que l’esprit puisse contracter les perceptions dans le souvenir et transformer les quantités homogènes en qualités hétérogènes il faut qu’il agisse sur ces choses matérielles. Or, c’est précisément admettre le miracle que l’on refuse au cerveau. On refuse au cerveau matériel la possibilité d’engendrer l’inétendu et la pensée et on admet le double miracle d’une substance immatérielle agissant sur la matière et faisant de cette matière étendue de l’inétendu. Quant à l’extension on se demande par quoi on peut bien se la représenter intelligiblement, sinon par du verbe pur. Comment l’image objective et la représentation subjective peuvent-elles se fusionner dans cette extension mélangeuse et comment notre perception faisant partie des choses étendues pouvons-nous dire que ces choses participent de notre inétendu, puisqu’il n’est entré en nous que de l’étendu ! Comment notre action vitale peut-elle créer la divisibilité de la matière puisque nous n’agissons qu’en fonction de nos représentations et que celles-ci sont inétendues !
Mais que dire de l’intelligence du corps qui choisit les souvenirs utiles pour les amener à la conscience ? Qu’est-cette intelligence active et matérielle qui se promène dans le souvenir passif et spirituel pour y décrocher le renseignement utile et l’amener ensuite à la conscience. A quoi sert donc cette conscience puisqu’il y a eu choix sans elle ! Et que peut bien être cette volonté qui gouverne la mémoire matérielle, puisqu’il vient d’être dit que cette mémoire ou intelligence matérielle sait se conduire toute seule et choisir ce qui lui convient ?
Le mystère s’assombrit de plus en plus, car notre conscience ayant la faculté merveilleuse de contracter et de collectionner toutes les perceptions, qui sont également des états conscients fugitifs, nous assistons alors à cette extraordinaire aventure d’une conscience inexplicable agglutinant des morceaux de consciences tout aussi inexplicables et tout cela pour se mettre au service d’un corps matériel qui choisit, à son heure et selon ses besoins, ce qui lui convient le mieux. Enfin la matière elle-même devient complètement incompréhensible et l’adaptation de notre organisme un mystère de plus. Si, en effet, les durées sont liées uniquement dans notre esprit et nullement dans les choses, on peut se demander quelle peut être la continuité de ces choses et comment, n’étant pas liées les unes aux autres par des états s’engendrant dans le temps, elles peuvent présenter de la cohérence à notre entendement. Autrement dit, comment établir que « la matière est absolument comme elle paraît être » si notre esprit déforme par contraction les états successifs de la matière ! Si, au contraire, notre esprit laisse les choses telles qu’elles sont, il ne contracte plus rien du tout ; il n’est qu’une suite de reflets conservés par notre mémoire ; mais, alors, comment admettre que l’homogène et l’étendu matériel et objectif bergsonien se muent en inétendu et en hétérogène subjectif ? Si la première hypothèse est bonne, l’adaptation du subjectif devient incompréhensible, car notre corps matériel, devant s’adapter à des phénomènes matériels ne trouvera comme directive dans l’esprit que des images contractées et déformées, différentes de la réalité. Si c’est la deuxième hypothèse qui s’impose, l’esprit, ni la conscience, n’ont plus aucun pouvoir spirituel, car l’intelligence matérielle toujours déterminée par l’objectif et soumise aux lois mécaniques de la matière, choisira mécaniquement dans la mémoire l’image matérielle convenant à son fonctionnement matériel. Nous sommes dans le déterminisme pur, dans le mécanisme parfait. Ainsi s’écroule le fragile échafaudage péniblement édifié pour sauver la liberté, la spiritualité et la conscience et dépouiller la matière de tout pouvoir psychique.
L’erreur de Bergson et de tous les métaphysiciens c’est de croire la pensée irréductible à la matière et d’inventer toutes sortes d’explications plus ou moins contradictoires pour le démontrer. Ils ne veulent aucunement admettre que la matière vivante a des propriétés très différentes de la matière non vivante ; ni convenir qu’il n’y a pas plus d’écart entre une pensée et un mouvement cérébral, qu’il y en a entre une vibration aérienne et un son. Le miracle est dans tout ou dans rien, car le passage d’une forme à une autre forme, la création d’une différence, l’apparition d’un état nouveau entre deux moments irréductibles pour notre durée sont toujours des choses inexplicables bien qu’évidentes. Il ne faut pas oublier que l’explication est la compréhension de tous les états intermédiaires d’une transformation des choses et lorsque, entre deux états différents, nous ne pouvons plus trouver d’états intermédiaires, nous sommes devant une évidence inexplicable. La vie usuelle est saturée de ces évidences qui constituent pour nous l’aspect normal des choses ; nous ne sommes réfractaires qu’aux grands écarts, aux sauts de la nature. C’est l’habitude qui nous fait juger compréhensibles ou incompréhensibles les faits objectifs, car l’habitude est faite du souvenir des durées nécessaires à l’avènement des choses. La métaphysique bergsonienne a complètement échoué dans ses assauts contre le matérialisme.
Un autre métaphysicien contemporain, Emile Boutroux, a essayé d’attaquer le déterminisme en affirmant que l’être étant contingent tout était radicalement contingent, mais en même temps il admet que les phénomènes ne peuvent qu’avoir des antécédents ou causes invariables, ce qui détruit la première affirmation. Pour justifier alors cette contradiction, il soutient qu’il n’y a pas une valeur absolue entre la cause et l’effet, que le conséquent n’est pas identique à son antécédent puisqu’il en diffère par la quantité ou la qualité et qu’en somme la cause ne peut contenir tout ce qu’il faut pour expliquer l’effet. Nous sommes ici en pleine métaphysique et il est flagrant qu’il y a confusion entre les termes différence et équivalence. Nous avons vu que l’évolution des choses exige qu’entre deux moments représentant une durée irréductible pour notre perception, il y ait inévitablement un changement dont le mécanisme situé hors de notre perception nous échappe, mais cela ne nous confère nullement le droit d’en déduire que ce nouveau n’est pas strictement conditionné par la multiplicité des causes connues ou inconnues l’ayant déterminé. Comment ne pas apercevoir l’absurdité manifeste de cette affirmation que : la cause doit contenir tout ce qu’il faut pour expliquer l’effet. C’est du charabia métaphysique. Le conséquent ne peut être identique à son antécédent sous peine de se confondre tous deux, de se supprimer et de réduire l’univers à l’immobilité, au néant. Le caillou (cause) lancé contre une vitre ne ressemble en rien à l’effet (verre brisé). Niera-t-on ici que la cause ne suffit point entièrement pour expliquer l’effet ! Nous appelons cause et effet une succession de faits s’effectuant inévitablement dans un ordre donné et invariable. Ou ces effets, ces phénomènes, sont toujours précédés de quelque chose connu ou connaissable, nécessaire à leur apparition : alors c’est le déterminisme pur ; ou ils ne sont précédés de rien : ce qui détruit toute connaissance, toute relation, tout savoir. Quant au concept d’équivalence de la cause et de l’effet il nous vient tout d’abord de leur liaison inséparable dans le temps ; ensuite de la conservation de quelque chose (substance ou énergie, qui se retrouve dans les différentes transformations qui s’effectuent à l’échelle de notre connaissance.
Comprenant que cette thèse libre-arbitriste ne pouvait se soutenir qu’en niant la nécessité, Boutroux a essayé alors de démontrer : « qu’aucune fin ne doit nécessairement se réaliser, car aucun événement n’est d lui seul tout le possible, et que ses chances de réalisations a l’égard d’autres chances de réalisations sont comme un est à l’infini ». Remarquons, avant de critiquer cette conception, que son affirmation détruit toute liberté et toute divinité que ce philosophe essaie surtout de démontrer, car si les choses sont à ce point chaotiques, l’homme libre se mouvra au milieu de ces incohérences efficientes avec autant d’improbabilité qu’un joueur à la roulette et cette imprévision le soumettra aveuglément aux forces capricieuses et fantasques du milieu. Quant à la divinité, elle sombre dans cette éternelle et insoluble antinomie du dieu à la fois tout-puissant et cause du monde ; et impuissant puisqu’il y a des effets sans causes, se suffisant à eux-mêmes. La nécessité, c’est ce qui est ; ce qui ne peut pas ne pas être. On peut essayer de tourner cette évidence gênante de toutes les façons, on ne pourra jamais en tirer autre chose qu’une impossibilité absolue de supprimer la réalité objective. La mort inévitable de tout être humain est suffisante à elle seule pour le démontrer. Toutes les lois naturelles sont des nécessités et nul humain ne peut les supprimer. Tout au plus peut-on, à ses dépens, les ignorer. Comme ces lois se manifestent par des mouvements présents, qui sont des réalités indestructibles engendrant inévitablement des transformations obligatoirement déterminées et nécessaires qui sont la résultante de tous les mouvements, affirmer la contingence des lois de la nature c’est affirmer que ce qui est pourrait ne pas être. C’est affirmer que les chances de mort sont comme un est à l’infini et que nous pourrions tout aussi bien ne pas mourir. Nous sommes encore dans le verbiage pur.
Comme tous les métaphysiciens, Boutroux s’est enfermé dans d’inextricables contradictions et bien qu’admettant que les choses réelles ont un fond de durée et de changement qui ne s’épuise jamais, il soutient en même temps que « l’essence divine est immuable parce qu’elle est pleinement réalisée et qu’un changement ne pourrait qu’être une déchéance. Le résultat de cet état est une félicité sans changement ».
La métaphysique est rongée de ce vice fondamental qui lui fait chercher un sens humain et moral à l’insondable univers et vouloir absolument pétrir et modeler la grandeur vertigineuse et inconcevable de l’infini pour en tirer une justification de nos puériles inventions.
Le pluralisme de Rosny se différencie considérablement de toutes ces rêveries vieillottes. Sa philosophie admet toutes les données scientifiques, mais devant les difficultueuses explications du passage de la cause à l’effet, du simple au complexe, il conclut à la diversité irréductible de toutes choses et à l’absence de toute homogénéité. Il rejette l’identité, soit de la substance, soit du mouvement et par conséquent le monisme et n’admet que l’analogie qui groupe les choses par ressemblances très rapprochées, mais en fait son hétérogénéité, est plutôt singulière puisqu’il admet une sorte d’évolution vivante de la substance cosmique engendrant par des transformations successives tous les aspects du monde connu. Il se trouve alors devant des difficultés qui me paraissent insurmontables. Cette matière-énergie qu’il appelle la Nébula et qui proviendrait d’éléments dénommés Nébules, issus eux-mêmes de l’éther prodigieusement varié et multiforme, évoluant éternellement en d’inépuisables transformations ; ces innombrables éléments absolument dissemblables formeraient, en se groupant, des substances très voisines les unes des autres, analogues entre elles sans que cette opération extraordinaire, qui engendre du semblable avec du dissemblable, ne paraisse à son auteur tout aussi miraculeuse que la théorie adverse qu’il combat et qui veut faire du dissemblable avec du semblable. Nous retombons, ici même, dans les contradictions de Renouvier.
L’analogie reste d’ailleurs inexplicable et incompréhensible si elle ne renferme pas une identité quelconque cachée sous des différences. Si tout est vraiment dissemblable, substance et mouvement, on se demande ce qui créera l’analogie. Deux « nébulas » ne peuvent être analogues si elles n’ont rien de commun. D’autre part, admettre que le même éther, même différencié, engendre d’autres formes substantielles qui diffèrent les unes des autres, c’est admettre visiblement que les mêmes éléments peuvent, groupés de façons différentes, engendrer des formes variées à l’infini. Mais alors pourquoi refuser ce pouvoir évolutif aux premiers éléments eux-mêmes et ne pas admettre que des variations de quantités, de groupements, de mouvements, etc., peuvent engendrer les modalités illimitées du monde sensible ? Pourquoi, également, trouver extraordinaire que la vie, dynamisme nouveau, ne puisse jaillir d’autres dynamismes antérieurs et différents ?
Enfin l’admission de l’hétérogénéité absolue des éléments supprime toute explication et tout savoir. Nous ne connaissons en effet que les choses dont les caractéristiques générales coïncident avec nos souvenirs et si tout diffère de tout, chaque image d’un objet ou d’un fait passé sera inutilisable pour un événement présent ou à venir, et nos milliards d’images n’auront aucune utilité. Enfin l’existence d’éléments semblables groupés selon des lois identiques nous permet de ramener l’inconnu au connu alors que la différenciation absolue des choses nous en interdit toute étude et toute compréhension.
En somme, dans cette philosophie, Rosny ne voulant point admettre la formation du complexe par le simple supprime celui-ci et ne laisse que du complexe irréductible, ce qui, dès lors, nous place en face d’une infinité d’inconnus. D’ailleurs, reporter sur les éléments analytiques les attributs qui nous paraissent les caractéristiques des synthèses me semble inadmissible. Cela revient à dire que la partie vaut le tout et qu’il y a autant de possibilités de constructions géométriques avec une seule ligne droite qu’avec cent.
Toutes ces tentatives d’explications des choses se ramènent en fait au problème fondamental de la connaissance elle-même. La compréhension, l’explication du monde objectif et subjectif a pour but essentiel de rechercher les similitudes, les ressemblances, les identités parmi la diversité des choses à seule fin d’en trouver, par comparaison, les processus morphologiques d’apparition, de formation, d’évolution ou de disparition pouvant s’appliquer à tous les cas particuliers ou généraux. Plusieurs faits inconnus pouvant s’expliquer par un seul fait connu ou, inversement, plusieurs faits connus pouvant expliquer un fait inconnu, nous voyons que la compréhension consiste à diminuer l’inconnu par une analyse tendant à ramener ses éléments à du connu, autrement dit la compréhension de l’univers suppose que la multiplicité de ses aspects peuvent être l’objet d’une reconnaissance de notre part uniquement parce que cette diversité d’apparence illimitée nous paraît formée d’éléments connus, groupés selon des dynamismes également connus, ce qui exige des identités, des permanences, des répétitions de ces éléments en mouvement. Nous sommes donc ramenés obligatoirement à rechercher ce qu’est exactement la connaissance.
Dans notre rapide exposé des diverses philosophies nous avons vu que les philosophes, dans leurs explications, ont constamment oscillé entre les conceptions issues du témoignage des sens et les conceptions issues du raisonnement. Nous avons également constaté que ces deux méthodes ont inévitablement abouti, quel que soit le génie de leurs partisans, à des résultats à peu près identiques. La méthode subjective aboutit à des actes de foi contradictoires heurtant notre raison. La méthode objective, basée sur l’observation sensorielle, laisse de côté la question qui intéresse précisément la plupart des humains : le rapport du subjectif à l’objectif. Il importe donc dans cette recherche de la connaissance de savoir quelle est la nature de ce que nous connaissons et ce en quoi elle consiste.
Nous pouvons déjà remarquer que la méthode purement subjective, utilisant la connaissance déjà réalisée par des humains relativement âgés, ne peut aucunement expliquer la formation de la connaissance exclusivement rationnelle, puisque le propre de la conscience c’est d’être le résultat des états psychiques existants et non d’assister, de toute éternité à la contemplation de leur formation. C’est pourquoi toutes les digressions sur l’intuition, la connaissance pure, les idées innées, la raison pure, etc., tendant à les séparer de toutes perceptions et influences expérimentales, tournent dans un cercle vicieux puisqu’on affirme que la connaissance et la certitude ne peuvent être fournies par les sens, qu’elles sont intuitives et rationnelles, alors qu’on ne peut précisément faire abstraction de cette inexpugnable expérience sensuelle subie depuis les origines mêmes de la vie.
Si nous utilisons la méthode objective et que nous observons la formation de la connaissance chez un enfant, nous voyons qu’il y a là, chez le nouveau-né, un organisme qui s’est construit dans l’utérus maternel selon les lois de la matière vivante et qui ignore tout du monde extérieur. Les sensations, bien que perçues, ne signifient rien pour l’enfant, tout comme la perception d’une langue inconnue ne signifie rien pour nous. Ce qui donne un sens aux sensations c’est la relation, très longue à s’établir, entre les différents états subjectifs du moi et les coïncidences sensuelles. L’enfant est littéralement baigné dans un monde phénoménal qui l’imprègne de sensations se rapportant toujours à des états physiologiques, lesquels constituent toute la réalité pour lui. Mais il est évident que ces états affectifs sont eux-mêmes des sensations : sensations de faim, d’effort, de fatigue, d’énergie, de plaisir ou de douleur, lesquels correspondent à cette sensation confuse du mouvement vital lui-même, résultat de tout notre fonctionnement organique que nous appelons kinesthésie.
Si nous songeons au nombre incalculable de sensations subies par l’enfant durant son éducation vitale ; si nous comprenons que tout ce qui l’entoure le sature de trillons d’images se succédant dans l’espace et dans le temps sans grandes variations ; si nous admettons qu’une seule vision, même rapide, peut être composée d’un nombre prodigieux d’images successives, presque identiques entre elles, nous comprendrons l’origine de la certitude et des généralités. Dans cette répétition fabuleuse de sensations, l’organisme non seulement conserve ce qui se répète souvent, mais il est encore davantage déterminé par les répétitions fréquentes que par celles plus irrégulières, ce qui, en définitive, place aussi bien les caractères généraux dans l’objet que dans le sujet.
Il est aussi aisé de constater que la conscience de l’enfant est invariablement proportionnée à sa connaissance sensuelle, à sa richesse de perception, mais il est également facile de constater que l’enfant, bien que percevant tout ce que nous percevons, parfois même beaucoup mieux que nous-mêmes, n’en a pas du tout une compréhension précise, ni une conscience égale à la nôtre. Ce qui prouve que les perceptions ou sensations ne suffisent pas entièrement à constituer toute la connaissance et que leurs modes de succession ou de groupement dans l’espace et dans le temps exigent encore quelque chose pour se préciser à notre entendement.
C’est ici que les métaphysiciens ont excellé dans l’art d’embrouiller l’évidence même. Ils ont résolument attribué à la raison le pouvoir d’inventer les notions de temps et d’espace, mesures de toutes choses. Or il est flagrant que le temps et l’espace sont les fils du mouvement, que celui-ci n’est rien sans la sensation et que nous ne pouvons les concevoir d’aucune façon dans l’immobilité absolue. Si l’enfant ne comprend pas ce qu’il perçoit, ou s’il se l’imagine mal, c’est parce que ces sensations ne sont pas absolument liées à des états organiques et que, de ce fait, l’ordre des choses est sans intérêt pour lui. Dès que l’intérêt s’éveille il suit le processus des causalités sensuelles et construit sa connaissance avec la rigide logique enfantine et selon les procédés connus, en prolongeant l’expérience sensuelle au delà même du sensuel. Ce qui prouve tout le contraire des affirmations rationalistes. Il manque à l’enfant la nécessité de s’intéresser à ce qu’il voit et cette nécessité ne peut exister, puisqu’elle manque de tous ses éléments constituants qui ne se forment qu’avec son enrichissement sensuel. Ainsi l’intérêt vital ou état affectif (curiosité, attention, etc.), est nécessaire pour puiser dans ce flux incessant des sensations et cet intérêt s’accroît progressivement en proportion de la multiplicité des images sensorielles, amplifiant le pouvoir conquérant de l’être vivant.
Nous pouvons alors rechercher quelle est la nature de la sensation, quel est le rapport entre le subjectif et l’objectif et en quoi consiste notre connaissance. Autrement dit, comment les propriétés d’un objet peuvent pénétrer dans notre cérébralité, sous forme de sensations et s’y conserver sous forme de souvenirs. Ce que l’on sait des excitations nerveuses nous fait supposer que nos éléments nerveux sont modifiés physico-chimiquement par les excitants et qu’entre la nature des excitants et notre sensibilité s’établit un contact lié à notre état général. Ce contact, ou image subjective, qui paraît être une sommation colossale de modifications de notre substance nerveuse semble inexplicable matériellement aux psychologues spiritualistes parce que tout souvenir, toute sensation même, par le fait même qu’elle est consciente, ne ressemble en rien à l’image objective qui n’est que matière. C’est l’immuable affirmation que ce qui n’est pas de la pensée ne peut former de la pensée. Un psychologue remarquable, Alfred Binet, critiquant la thèse matérialiste, émet la supposition que l’examen du système nerveux d’un homme regardant un paysage ne révélerait nullement, dans les ébranlements nerveux, la présence des arbres et des maisons avec leurs formes et leurs couleurs et que toute les recherches anatomiques du cerveau n’y ont jamais fait découvrir une image objective. Proposant alors à son tour une explication de la matière et de la conscience, il constate que la conscience ne perçoit aucunement les vibrations matérielles de son propre système nerveux et qu’elle ne connaît que ce qui se passe au dehors. Ce qui, d’après lui, dissimule précisément à notre investigation objective supposée, les images subjectives, c’est la substance nerveuse elle-même, mêlée à ces images. La conscience ne peut percevoir cette substance, toujours égale à elle-même, insuffisamment variée, tandis qu’elle perçoit parfaitement toutes les excitations extérieures diverses et changeantes. Nos ébranlements nerveux contiendraient donc toutes les propriétés des corps : formes, couleurs, bruits, solidités, etc., etc., mêlées à notre propre substance et la conscience seule en séparerait, par ses facultés abstractives, les images objectives. Nous connaîtrions donc les choses comme elles sont véritablement. Mais pourquoi faut-il que l’auteur détruise lui-même cette conception en affirmant que toutes nos sensations sont fausses comme copies des objets matériels et qu’il nous est défendu de faire une théorie de la matière, en elle-même, en termes de nos sensations. Seule la matière empirique et physique pourrait se représenter sensuellement. C’est admettre, implicitement, que la matière peut avoir d’autres propriétés que celles que nous transmettent nos sens, mais si notre connaissance est exclusivement sensuelle, si, d’autre part, toutes nos sensations sont fausses, on se demande par quelle révélation extraordinaire on pourra finalement savoir ce qui est vrai et ce qui est faux.
Ce scepticisme est le résultat de quelques expériences démontrant, paraît-il, le témoignage contradictoire des sens. En voici le résumé : un même excitant détermine sur nos diverses terminaisons nerveuses des impressions différentes ; inversement des excitants différents déterminent sur la même terminaison la même sensation. On en conclut donc que si l’unique est perçu diversement et le divers perçu uniformément, nous ne sommes point renseignés exactement sur la réalité objective.
On ne fait pas attention, dans cette expérience fondamentale, que l’on se contente uniquement d’opposer les sens entre eux et qu’on accorde soudainement la réalité objective à l’un d’entre eux, pour servir de juge et d’étalon, très arbitrairement au détriment des autres. De quel droit affirmer que l’excitant créant des sensations diverses ne contient qu’une seule excitation ? De quel droit également affirmer que les différents excitants créant une même excitation ne contiennent pas tous le même excitant, sinon en admettant comme démontré que l’on connaît réellement la nature extra-sensuelle des excitants ? Ce qui est la négation même de toute l’argumentation. Admettons au contraire que les excitants ne sont que des synthèses et que chacun de nos sens s’est spécialisé pour en percevoir analytiquement les éléments, et les contradictions disparaissent.
Le sceptique, enfermé dans sa subjectivité, ne peut s’expliquer la multiplicité des faits objectifs s’imposant à sa volonté et qu’il ne peut aucunement extraire de son moi. D’autre part le spectacle contradictoire de ses efforts désespérés pour convaincre des êtres qui n’existent point, ou définir des faits qu’il affirme inconnaissables détruit toute valeur documentaire à ces fantaisies verbales.
La théorie de Binet n’explique d’ailleurs pas la conscience elle-même, ni le procédé extraordinaire par lequel la matière inconnue peut soudainement se faire connaître à une conscience simple et bornée, laquelle utilisant ces faux renseignements, devrait mener, me semble-t-il, à sa plus rapide disparition le corps qui la loge si témérairement.
L’observation directe ne nous permettra peut être jamais de voir si les éléments nerveux excités ont véritablement quelque chose de l’excitant ; si la couleur, la forme ou le son courent le long des nerfs centripètes mais le fait qu’entre notre représentation des choses et leur existence réelle notre vie se réalise normalement prouve tout au moins que les relations sont justes. Si ces relations sont justes, il faut donc admettre qu’à chaque variation objective correspond une variation subjective et que notre cerveau conserve des équivalents quelconques de ces variations. La difficulté consiste alors à passer de cette variation et de ce mouvement cérébral matériel à l’état conscient soi-disant immatériel mais précisément nous avons vu que la conscience se développe en proportion de ces variations ou sensations. La conscience ne serait donc que le rapport des sensations entre elles, rapport synthétique englobant des sommations de sensations liées à l’état affectif de l’organisme.
Comme la matière vivante se différencie de la matière non-vivante par sa faculté de persistance dans les diverses réactions physico-chimiques où les autres substances se détruisent, les perceptions se conservent également et par leurs rapports mutuels engendrent la pensée qui n’est pas plus immatérielle que la lumière ou la pesanteur.
Il n’y a donc pas plus de différence entre une pensée et un mouvement qu’il y en a entre un mouvement et une couleur. Celle-ci est une synthèse d’ondulations ; celle-là une autre synthèse d’oscillations. Le passage du discontinu objectif au continu subjectif s’explique alors par le seul fait que la connaissance ne pouvant jaillir que d’une sommation de sensations, cette sommation ne peut. être discontinue sous peine de disparaître ; tout comme disparaît la forme d’un triangle dont on sépare les côtés. Ainsi la question de savoir-si l’image subjective est identique à l’image objective et si notre cerveau contient véritablement des paysages en miniature n’a plus aucun sens, car notre image subjective, formée probablement d’innombrables éléments épars dans notre cerveau ne peut révéler à l’anatomiste la plus petite figure d’arbre ou de fleurs. L’anatomiste et le psychologue se placent à un point de vue analytique, tandis que notre conscience est le résultat d’une action synthétique de nos éléments nerveux pas plus visibles au microscope que la chaleur elle-même dont on ne peut nier les effets synthétiques.
Notre connaissance est donc un effet du monde objectif et cet effet ne peut se différencier considérablement de sa cause. Or, dans sa thèse psychologique, Binet affirme que si toutes nos sensations sont vraies, cela revient exactement au même pour la compréhension du, monde objectif que si toutes étaient fausses car étant toutes irréductibles les unes aux autres aucune ne peut expliquer les autres et par cela même la constitution de la matière. C’est expédier un peu vite une question de première importance. Le but de la méthode objective, c’est précisément de ramener par l’analyse toutes les choses perceptibles à des éléments communs. Mais Binet lui-même pouvait remarquer que toutes les sensations sont susceptibles de variations, d’augmentation ou diminution d’intensité, de modifications diverses éveillant des idées de rapports, d’évaluations quantitatives. Si dans les diverses analyses objectives nous ne trouvons pas toujours des odeurs, des sons, ou des saveurs mais que, par contre nous rencontrons invariablement du mouvement, je ne vois pas pourquoi nous choisirions l’odorat comme explication universelle des choses. Il est donc infiniment plus logique de faire du mouvement la base unificatrice de toutes nos sensations et des réalités objectives puisqu’il est inévitablement présent à toutes nos sensations que de ne prendre qu’un seul de ses aspects sous forme de son et de saveur.
Nous voici donc arrivé au terme de notre étude avec la certitude que notre connaissance est essentiellement sensuelle, que les sensations elles-mêmes sont des effets du monde objectif et que la différence entre l’objectif et le subjectif est de nature identique à celle existant entre toute cause et son effet. Ce qui revient à dire qu’il ne saurait y avoir plus de différence entre notre connaissance de la matière et la matière elle-même, qu’entre deux états consécutifs de cette matière.
Que pouvons-nous tirer de cette connaissance positive concernant les divers problèmes examinés par les philosophes antérieurs. Tout d’abord, selon que ces problèmes se rapportent à la connaissance immédiate du monde sensible, susceptible d’expériences et de démonstrations, ou qu’ils envisagent la connaissance du monde extra-sensible au delà de notre espace et de notre temps, nous pouvons les résoudre plus ou moins affirmativement.
Le premier mode de connaissance est actuellement représenté par la méthode scientifique construisant patiemment une explication mécaniste de l’univers. Que celui-ci soit constitué par les trois sortes d’atomes fluides de Clémence Royer comprenant l’atome éthéré en nombre infini et les atomes vitalifères et matériels en nombres finis ; que ce soit la conception radioactive de Gustave Lebon nous représentant le monde comme une sorte de matérialisation et de dématérialisation successives et incessantes de la substance s’évanouissant par dissociations de ses innombrables éléments ; que ce soit la thèse électro-magnétique qui nous explique ce même mode par un fourmillement d’électrons, de ions, de quantas tourbillonnant vertigineusement en des systèmes inimaginablement réduits, il est évident que ces divers systèmes s’accordent au fond sur la substance et sur le mouvement perçu à notre échelle sensuelle et qu’ils ne divergent mutuellement que dans leurs explications Imaginatives extra-sensuelles.
La biologie, la physiologie, la psychologie même s’inspirent profondément de la méthode expérimentale. Des psychologues comme Ribot et Fouillée ont établi une conception de la connaissance nettement déterministe. Ribot fait de la conscience une simple spectatrice des faits et ramène au premier plan les états affectifs de l’individu volontairement ignorés par les spiritualistes ; Fouillée prenant les idées, non comme des abstractions mais comme des centres d’énergie, les a dénommées des idées-forces ; ce qui se rapproche quelque peu du concept de Charles Richet considérant le système nerveux comme un accumulateur et un régulateur d’énergie. Enfin la biologie relie le phénomène vital aux autres manifestations du monde objectif.
Dans cette voie, des biologistes remarquables tels que Lœb, Bonn, Edmond Perrier, Derrier, Le Dantec ont précisé le caractère strictement physico-chimique de la vie. Lœb, tout particulièrement, a démontré expérimentalement l’absence de finalisme de la vie et les cas innombrables d’inadaptations vitales. L’œuvre de Le Dantec est d’une puissance saisissante. Avec une logique très sûre il s’est élevé, des manifestations les plus élémentaires de la vie, jusqu’à la compréhension des problèmes les plus complexes intéressant notre activité. Combattant énergiquement le scepticisme élégant de son ami Henri Poincaré, affirmant que la vérité est une question de commodité, et la métaphysique pragmatique de William James, présentant la vérité comme une question d’avantage, d’intérêt, une invention humaine avantageuse, il s’est élevé contre cette manière de penser complètement opposée à la méthode scientifique :
« La vérité n’est ni bonne, ni mauvaise, ni personnelle, ni même humaine. »
Sa philosophie nettement mécaniste est une des plus solides, des plus logiques et des plus claires conceptions de l’univers. « Rien ne se passe à notre connaissance qui ne soit susceptible de mesure » nous dit-il pour exprimer le déterminisme le plus rigoureux qui seul peut expliquer l’univers.
« Nous ne connaissons que des synthèses qui, seules, sont à notre échelle sensuelle et, hors de ces synthèses qui sont vraies, puisque nous vivons, nous n’avons pas le droit d’imaginer l’inconnu d’après le connu. Ce qui est en dehors de notre perception est pour nous inexistant, inconnaissable, métanthropique. »
Tout comme Huxley et Ribot il fait de la conscience un épiphénomène, une simple spectatrice des faits subjectifs. Ses connaissances biologiques contribuèrent considérablement à établir la solidité de ses certitudes par le spectacle permanent des causes de vie et de mort, bien supérieur, comme critère de la vérité, à toutes les subtilités métaphysiques évoluant mystiquement hors de l’inflexible sélection vitale.
Si nous passons maintenant au monde extra-sensible, le monde que Le Dantec déclare métanthropique, l’étude des questions du mouvement et de la substance en soi, de commencement absolu, d’infini, nous entraînerait, vraisemblablement, dans les contradictions de Renouvier, Bergson, Boutroux et autres métaphysiciens. Il nous suffira d’indiquer rapidement les erreurs de raisonnement engendrant ces concepts pour en comprendre l’inutilité.
Tous les philosophes ayant pali sur le thème du commencement de l’univers ont absolument voulu enfermer leurs adversaires entre ces deux alternatives également inconcevables : le recul à l’infini ou la création, sans remarquer qu’ils vivaient au temps présent et que ce temps présent, seule réalité finie, pour des humains également finis, ne pouvait se rapporter en aucune façon à l’infini du temps et de l’espace. Vouloir se représenter l’une ou l’autre de ces alternatives c’est limiter, finir l’infini ; ce qui n’a aucun sens humain.
La recherche de la substance en soi, le concept d’étendue et de divisibilité viennent, nous l’avons vu, d’une incompréhension de notre connaissance. Puisque nous ne connaissons que ce qui nous est transmis par nos sens, il est facile de voir que l’étendue est un concept engendré par le trait et la vision, lesquels sont des synthèses de perceptions spatiales. La divisibilité est également un concept sensuel, une représentation mentale du fractionnement des synthèses spatiales précédentes Au-dessous du seuil de perception du tact et de la vision, il ne peut plus y avoir rien d’intelligible pour nous, puisque précisément nous ne pensons qu’avec des images sensuelles. Il y a donc à la limite de notre faculté perceptive une sensation minima qui constitue la dernière synthèse perceptible, la plus petite étendue et lorsque notre pensée divise encore cette étendue, elle l’augmente tout d’abord pour la diviser ensuite. Et cela indéfiniment. En somme, nous coupons et recoupons toujours la même étendue. La substance étant, pour nous, une synthèse d’éléments, il est absurde et vain de rechercher ce qu’elle est en elle-même car nous attribuerions à la partie ce qui est la conséquence du tout et que nous ne pourrons jamais percevoir un seul élément puisque la perception n’est qu’une synthèse d’éléments subjectifs heurtée par une autre synthèse d’éléments objectifs.
Il en est de même du mouvement en soi. Puisque jamais la connaissance d’un mouvement ne s’est réalisée autrement que par des perceptions successives et différentes de la substance, le mouvement est inévitablement une synthèse de sensations déterminée par les états successifs de la substance et il est absurde de l’en séparer ainsi que le font des énergétistes, tel Bechterew, affirmant que : « derrière le mouvement des particules de matière que nous tenons pour les manifestations de l’énergie, il y a quelque chose qui ne peut être inclus dans le concept de matière » lequel « contient aussi à l’état potentiel le psychique qui, dans certaines conditions, peut surgir de l’énergie ». Expliquer la pensée, dont la nature nous est soi-disant inconnue et reste irréductible à la matière, par une autre inconnue également différente de la matière c’est, tout d’abord, ne rien expliquer du tout car l’explication d’un mystère par un autre mystère n’est pas une explication ; c’est ensuite revenir à la poussiéreuse conception dualiste de la matière, masse inerte et amorphe, et de l’esprit animant cette matière.
Si le matérialisme actuel diffère profondément du matérialisme primitif par les récentes découvertes scientifiques et les dernières investigations ultra-microscopiques et radio-actives sur la constitution des corps ; si notre connaissance des choses prend une orientation plus expérimentale, plus prudente et moins spéculative qu’aux temps reculés des joutes sophistiques, la philosophie matérialiste représente dans tout le cours de son évolution une sorte d’éclosion de la pensée véritable se dégageant lentement de l’ignorance primitive et de la grossièreté des premiers concepts ; une lutte irrésistible de l’intelligence audacieuse et méthodique refoulant l’inconnu et les terreurs mystiques des premiers âges.
Alors que le propre de toutes les métaphysiques et de toutes les religions est d’enserrer l’individu dans un réseau de croyances l’asservissant à d’absurdes et criminelles obligations ; alors qu’elles obnubilent l’esprit critique, cristallisent l’intelligence, favorisent l’ignorance, encouragent et développent la superstition, le concept matérialiste dégage la personnalité humaine de ces servitudes écrasantes, la libère des épouvantes et des terreurs, forme son jugement et sa raison.
Aucun progrès, aucune découverte, aucune amélioration sociale qui soient véritablement issus d’une spéculation métaphysique ou d’une mystique contemplation. Tout ce qui est savoir et bien-être est le résultat d’un souci matériel, les conséquences d’un raisonnement libéré des croyances superstitieuses, des tabous momifiants et de la peur. Nous pouvons même aller plus loin. L’esprit métaphysique et religieux représente l’ancestrale mentalité humaine mélangée de mysticisme, de morale et de naïves ingéniosités reculant pas à pas devant l’envahissement progressif de l’esprit d’analyse et d’observation. Incapable de résoudre aucune des questions qu’elle pose, la métaphysique s’est totalement révélée impuissante à comprendre même que le pourquoi des choses, ultime produit de la synthèse humaine finie, ne pouvait avoir aucun sens réel par rapport aux éléments analytiques constituant l’univers infini.
Et ce n’est pas parce que le matérialisme présente une explication logique ou illogique de l’univers qu’il est haï et méprisé, c’est parce qu’il supprime les dieux et tous les bénéficiaires de la religiosité ; c’est parce qu’il présente une explication claire et compréhensive d’un fonctionnement universel, se suffisant à lui-même, sans mystère redoutable, sans surnaturel angoissant ; c’est surtout parce que, ne recherchant uniquement que ce qui est, il ne s’occupe point de morale et sépare nettement la vérité de l’intérêt humain. Le matérialisme ne cherche pas la morale de l’univers, il n’en cherche pas les finalités d’après le fini humain. Il explique seulement comment nous sentons cet univers.
Issu de l’esprit aventureux de l’homme, il est l’expression, le résumé de ses découvertes L’homme peut utiliser ces découvertes, se connaître, se comprendre et créer alors une morale humaine, uniquement humaine, proportionnée à sa nature et à sa durée et non créer l’étrange folie de faire tourner les mondes autour de son nombril.
Ainsi la philosophie matérialiste loin d’être le culte de l’immobile, du statique et du stagnant nous apparaît comme l’histoire même de la naissance et de l’évolution de l’intelligence humaine.
— IXIGREC.
OUVRAGES A CONSULTER. — P. Janet : Le Matérialisme contemporain — Lange : Histoire du Matérialisme (2 vol.) — A. Lefèvre : La Philosophie — A. Binet : L’âme et le corps — Le Dantec : Savoir ; Contre la métaphysique, etc. — J. Sagerat : La vague mystique ; La dévolution philosophique et la science — Em. Bréhier : Histoire de la Philosophie (2 vol.) — Bergson :Matière et Mémoire — Renouvier : Le Personnalisme — Boutroux : De la contingence des lois de la nature — J.-H. Rosny aîné : Le Pluralisme — M. Boll : La science et l’esprit positif — A. Darbon : L’explication mécanique et le nominalisme, etc., ainsi que les ouvrages indiqués, plus loin, à la bibliographie de Matière.
MATERIALISME (individualiste)
Des plumes plus compétentes que la mienne consacreront sans doute au matérialisme philosophique et à son histoire des pages remplies d’érudition. Elles décriront le duel entre le matérialisme et le spiritualisme, avoué ou camouflé, duel toujours en cours ; elles exposeront les thèses diverses des partisans de l’unité de la matière, elles raconteront l’histoire de l’évolution du matérialisme ; elles examineront son influence sur l’art, la littérature, la sociologie.
Je me contenterai d’envisager le matérialisme au point de vue particulier de notre individualisme anarchiste, autrement dit d’un individualisme qui s’insoucie complètement des restrictions et des constrictions d’ordre archiste, cet archisme fût-il religieux ou civil. Qui dit individu dit réalité. Parler de matérialisme, d’autre part et pour nous, est synonyme de parler de réel. Rien ne nous intéresse en dehors du réel, du sensible, du tangible individuellement, voilà notre matérialisme. La réalité, c’est la vie. Nous rendre la vie, notre vie individuelle, la plus agréable, la plus plaisante qui soit ; fuir la souffrance, les soucis, les désagréments ; faire des années de notre vie une succession de jouissances, de voluptés ; en désirer autant pour nos amis, nos camarades, tous ceux qui en veulent autant pour nous, voilà l’aspiration que nous prenons à tâche de convertir en réalité.
Nous nous insoucions de l’immortalité de l’âme, de l’existence de Dieu, de l’au-delà, bon ou mauvais. Ces hypothèses ne nous sont d’aucune utilité dans nos recherches de plus de bonheur, notre course au plaisir. La spéculation métaphysique ne nous apparaît que comme un amusement ou une distraction et le monde moral comme un domaine fantomatique. La seule réalité, c’est que la satisfaction de nos désirs nous procure de la joie, leur irréalisation nous aigrit, à moins qu’elle ne nous enlève notre énergie. Nous nous sentons nés, faits, confectionnés si l’on veut, pour profiter, bénéficier des bonnes choses que peut nous procurer la nature ambiante, pour en épuiser le contenu, le vider jusqu’à l’ultime possibilité de sensation. De par notre effort ? Soit ! Mais nous voulons que notre effort serve à nous rendre le réel, l’existence, notre existence plaisante et agréable à vivre. S’il fait froid, que notre effort serve à nous vêtir chaudement ou à substituer de la chaleur artificielle à la chaleur naturelle ; si c’est la nuit qui règne, que notre effort serve à remplacer l’absente clarté du soleil par un procédé lumineux ; s’il pleut, que notre effort serve à nous créer un abri contre l’onde que laissent échapper les nuages se dissolvant. Et ainsi de suite.
Notre individualisme est un individualisme de réalité. Notre matérialisme fait de nous des amants de la joie de vivre. Notre individualisme n’est pas un individualisme de cimetière, un individualisme de tristesse et d’ombre ; notre individualisme est créateur de joie — en nous et hors nous. Nous voulons trouver de la joie partout où faire se peut — c’est-à-dire en rapport avec notre puissance de chercheurs, de découvreurs, de réalisateurs ; et nous voulons en créer partout où il nous est possible, c’est-à-dire partout où nous constatons l’absence de préjugés et de conventions relatifs au « bien » ou « mal ». Nous évoluons sous le signe de la joie de vivre. Et c’est à cela que nous reconnaissons que nous nous portons bien : quand nous voulons donner et recevoir de la joie et de la jouissance, fuir pour nous-mêmes et épargner à ceux qui nous rendent la réciproque les larmes et la souffrance.
Quand ce n’est pas le printemps qui chante en notre for intérieur ; lorsqu’au fond, tout au fond de notre être intérieur, il n’y a ni fleurs, ni fruits, ni aspirations voluptueuses, c’est que cela va mal et qu’il est temps de songer, j’en ai peur, à l’embarquement pour l’obscure contrée dont nul n’est jamais revenu. Ce n’est pas une question d’année en plus ou en moins. Comme ceux de l’Olympe, nos « dieux » sont éternellement beaux et jeunes éternellement. N’importe que l’automne touche à sa fin et que nous ignorions si demain, nous verrons se lever l’aube pour la dernière fois : l’essentiel est qu’aujourd’hui encore, nous nous sentions aptes à revendiquer la joie de vivre.
Il y a le matérialisme individualiste de ceux qui veulent se créer de la joie en dominant, en administrant, en exploitant leurs semblables, en recourant à la puissance sociale dont ils sont détenteurs — gouvernementale, monétaire, monopolisatrice. C’est l’individualisme des bourgeois. Il n’a rien de commun avec le nôtre.
Nous voulons, nous autres, un individualisme qui rayonne de la joie et de la bienveillance, comme un foyer de la chaleur. Nous voulons un individualisme ensoleillé, même au cœur de l’hiver. Un individualisme de bacchante échevelée et en délire, qui s’étende et s’épande et déborde, sans prêtres et sans surveillants, sans frontières et sans rivages ; qui ne veut pas peiner et porter de fardeaux, mais qui ne veut pas accabler autrui ni lui imposer de charges ; un individualisme qui ne se sent pas humilié quand il est appelé à guérir les blessures qu’il peut avoir étourdiment infligées en route.
Qu’est-ce donc que l’individualisme des « faiseurs de souffrance », de ceux qui font faux-bond aux espoirs qu’ils ont suscités (je ne parle pas de ceux chez lesquels causer de la souffrance et s’en réjouir est une obsession maladive, un état pathologique), sinon une pitoyable doctrine à l’usage de pauvres êtres qui hésitent et vacillent, qui redoutent de se donner, tant leur santé intérieure laisse à désirer ? Ils sont ceux qui « reprennent » ce qu’ils donnent, ceux qui voudraient la rivière sans méandres, la montagne sans escarpements, le glacier sans crevasses, l’Océan sans tempêtes. Leur individualisme refuse la bataille parce qu’il y aurait un effort a faire. Ah ! le piètre matérialisme individualiste !
Pour vivre un tel individualisme qui veut rayonner, porter, créer l’amour de la joie de vivre, il faut jouir d’une bonne santé, d’une riche, d’une robuste constitution interne. Tout le monde n’est pas apte, par exemple, à assouvir les appétits de la sensibilité qu’on a déclenchée chez autrui. Et cette santé-là ne dépend pas d’un régime thérapeutique, n’est pas œuvre d’imagination, ne s’acquiert pas dans les manuels. Pour la posséder, il faut avoir été forgé et reforgé sur l’enclume de la variété et de la diversité expérimentale ; avoir été trempé et retrempé dans le torrent des actions et réactions de l’enthousiasme pour la vie. Il faut avoir aimé la joie de vivre jusqu à préférer disparaître plutôt que d’y renoncer.
Telles sont les lignes de développement de notre matérialisme individualiste.
— E. ARMAND.
MATÉRIALISME HISTORIQUE
D’autres collaborateurs traitent à fond le « matérialisme historique » dans les colonnes de cette Encyclopédie (voirMarxisme). Pour ma part, je me bornerai à soumettre au lecteur quelques observations et réflexions d’ordre personnel J’espère que ces quelques notes, tout en étant rapides et brèves, alimenteront un peu sa pensée et l’aideront à situer son opinion.
-
MATÉRIALISME ou ÉCONOMISME ? Tout d’abord, l’expressionmatérialisme historique prête à une confusion fâcheuse qu’il faudrait éliminer une fois pour toutes. D’une part, on peut comprendre ce terme dans un sens vaste, général. Dans ce cas, il signifierait ceci : les forces motrices qui se trouvent à la base de l’évolution historique des sociétés humaines, ne sont nullement mystiques ou spirituelles (Dieu, idées, volonté, etc...), mais purement et simplement matérielles (cosmique, géographiques,biologiques, physiques, chimiques, etc...). Une telle interprétation de la formule du matérialisme historique rallierait certainement les suffrages de l’écrasante majorité des anarchistes. Et ce fut précisément Kropotkine qui, en tant que naturaliste, établit et précisa cette thèse. Ce fut lui qui préconisa l’application des méthodes naturalistes à l’étude des phénomènes sociaux. Ce fut encore lui qui plaça l’élément biologique à la base de l’évolution de l’homme et de la société humaine. (A l’époque de K. Marx, la biologie, comme science, était encore à l’état rudimentaire). D’autre part, on peut entendre par « matérialisme historique » ce que Marx et ses disciples désignèrent ainsi, et notamment la thèse que voici : c’est la structure économique de la société (mode et rapports de production, lutte de classes) qui forme la base et les « forces motrices » de l’évolution humaine. Une chose est facile à constater : cette idée est beaucoup plus étroite que le terme en question par lequel on voudrait la désigner. Il serait plus exact, plus « scientifique », de présenter cette théorie non pas sous le nom de « matérialisme historique », mais sous celui d’économisme historique. (C’est ainsi que je la désignerai plus loin). De cette façon, toute confusion deviendrait impossible, et la discussion y gagnerait en clarté et en précision.
-
MONISME ou PLURALISME ? La théorie marxiste de l’économisme historique mène naturellement à la discussion, même entre les partisans de la conception matérialiste de l’histoire. Car, loin de se confondre avec le matérialisme historique, elle ne découle même pas nécessairement de ce dernier. (C’est là que la confusion devient grave). En effet, il n’est nullement prouvé que les bases générales matérielles (biologiques) de l’évolution humaine signifient précisémentl’économie comme facteur fondamental de cette évolution. Ce n’est pas tout. Comme on sait, la théorie de l’économisme historique est une conception monistique : elle affirme que l’économie est l’unique facteur fondamental de l’évolution humaine. Or, ce monisme historique n’est pas prouvé non plus. Au contraire, l’idée même du mouvement continuel, si chère aux marxistes avec leur « dialectique », nous mène, avec beaucoup plus de logique et de « scientifisme », à la conception pluraliste de l’histoire humaine. Personnellement, je conçois les forces motrices de cette histoire comme suit : II n’y a pas de « facteur fondamental » parmi les forces immédiates en action. L’histoire humaine est un champ d’activité denombreux facteurs différents, s’entre-croisant, s’entre-choquant, changeant constamment d’intensité et d’influence, bref — se trouvant en mouvement perpétuel, comme la vie elle-même. A chaque moment historique donné, c’est la résultante de ces multiples forces et facteurs qui joue un rôle prépondérant. Cette résultante se déplace constamment, elle se trouve aussi en mouvement continuel. Elle passe à proximité tantôt de tel, tantôt de tel autre facteur. De nombreux exemples historiques pourraient appuyer cette thèse au besoin.
-
MATÉRIALISME ou IDÉALISME ? En admettant que la base de l’évolution humaine soit d’ordre matériel (surtoutbiologique), quel serait le rôle des facteurs « idéologiques » (ou psychologiques) ? S’agirait-il d’un rôle secondaire, subordonné, d’une « superstructure », d’après la terminologie de l’économisme historique ?
Ce problème mériterait une étude à part. Ici, je ne puis qu’exprimer succinctement mon opinion. La voici.
Fixons, d’abord, ce que nous entendons par « facteur idéologique ». Habituellement, on entend par là les idées, la conscience, la volonté, la morale... On oppose ces éléments à ceux d’ordre « matériel », et l’on affirme que ces derniers jouent un rôle plus important, plus fondamental que les premiers.
Pour moi, il ne s’agit pas des « idées », de la « conscience », de la « volonté », de la « morale », etc... Il s’agit d’une faculté spécifique primordiale, propre à l’homme, faculté qui finit par le séparer nettement des autres espèces du règne animal, et qui explique toute son évolution historique. Cette faculté (qu’il m’est impossible d’analyser ici de plus près) est la force créatrice de l’homme, son énergie psychique spécifique, son esprit chercheur, scrutateur, inventeur. C’est cette force que je compare avec d’autres éléments déterminants, pour savoir à quoi m’en tenir. La conclusion à laquelle j’arrive, est la suivante.
Bien entendu, la force créatrice de l’homme est d’origine biologique, donc parfaitement naturelle et « matérielle ». Par conséquent, son existence ne change rien à la base matérielle de l’évolution humaine. Sous ce rapport général, la conception matérialiste de cette évolution est la seule qui peut être admise scientifiquement. Mais d’autre part (surtout lorsqu’il s’agit du processus historique), la faculté créatrice de l’homme, s’affirmant de plus en plus, devient elle-même un facteur extrêmement important, autonome. Elle commence à engendrer de nombreux phénomènes et éléments nouveaux. De plus en plus, elle donne l’impulsion immédiate, directe à tout le processus de l’évolution humaine. Plus cette évolution avance,plus ce facteur psychologique devient puissant. En voici une illustration. Les partisans de l’« économisme historique » nous disent :
« Si le mode de production restait immobile, tout l’ordre social, politique et intellectuel serait frappé d’immobilité cadavérique. »
Cette supposition devrait prouver que c’est le mode de production qui est le facteur primordial de l’évolution humaine. Mais, pourquoi donc le mode de production lui-même change-t-il ? Il y a donc quelque chose qui lefait changer. Il existe une force qui est plus profonde, plus forte encore que le mode de production lui-même, puisqu’elle le soumet à son influence, le fait changer, le met en mouvement. Autrement, le mode de production lui-même resterait immobile. Cette force est justement la force créatrice de l’homme. Au cours de l’évolution historique, elle s’infiltre de plus en plus dans le processus purement matériel. Ce dernier lui cède du terrain, tous les jours davantage. Lentement, mais sûrement, la force créatrice de l’homme et ses résultats démontrent la tendance à dominer les forces « matérielles », à les soumettre, à s’installer en maîtres absolus.
C’est la faculté créatrice de l’homme qui, véritable « force motrice », donne l’élan à son évolution historique. C’est elle qui se trouve à la base de cette évolution. Ses manifestations et son influence immédiates étant insignifiantes au début, elle s’affirme de plus en plus au cours de cette évolution, et tend à devenir son facteur prépondérant.
Cette constatations faite, je n’ai plus à choisir entre le « matérialisme » et l’« idéalisme » historiques. Pour moi, « le processus historique » est un mouvement formidable de très nombreux éléments de toute sorte, mouvement qui réalise une vaste synthèse de facteurs purement matériels et psychiques, et où les premiers sont remplacés, peu à peu, par les derniers. Je réunis donc le « matérialisme » et l’« idéalisme » historiques en un immense mouvement général où les éléments et les forces purement matériels, prépondérants au début, cèdent peu à peu par leur influence à celle de la force psychique créatrice de l’homme, avec toutes ses manifestations innombrables.
Je soumets au lecteur un petit croquis qui exprime bien ma façon de comprendre le processus historique :
(manque)
Le côté A y représente les débuts de l’évolution humaine où la faculté créatrice de l’homme, en état potentiel, ne se manifestait presque pas, et où les forces matérielles primaient tout. Le côté Z est celui de l’avenir lointain de cette évolution où l’influence de la force créatrice de l’homme l’emportera sur celle des forces matérielles. La partie noire montre l’importance des facteurs purement matériels, en décroissance progressive. La partie blanche représente le rôle de la force créatrice et conscience de l’homme, en accroissement constant. La flèche indique le mouvement historique de A vers Z. Et la ligne m n désigne, à peu près, l’époque actuelle et l’importance relative des deux sortes de facteurs, telle que je me l’imagine aujourd’hui.
— VOLINE.
OUVRAGES A CONSULTER
-
Sur MARXISME. — Karl MARX : Le Capital : Le procès de la production du capital (4 vol.) ; Le procès de la circulation du capital (4 vol.) ; Le procès d’ensemble de la production capitaliste (4 vol.) ; Critique de l’économie politique ; Misère de la philosophie ; Salaires, prix, profits ; Critique du programme de Gotha ; Lettres à Kugelman, etc. — MARX et ENGELS : Manifeste communiste. — ENGELS : Philosophie, économie, politique, socialisme. Testament politique ; La guerre des paysans en Allemagne, etc. CAFIERO : Abrégé du « Capital » de Karl. Marx. — PROUDHON : Philosophie de la misère ; Système des contradictions économiques, etc. — M. BAKOUNINE : Dieu et l’Etat ; Œuvres (6 vol.) ;Correspondance. — James GUILLAUME : Etudes révolutionnaires (2 vol.) ; L’Internationale (souvenirs) (4 vol.) — G. SOREL : La décomposition du marxisme, etc. — DESLINIÉRES : Délivrons-nous du marxisme, etc. P. GEMAHLING : Les grands économistes. — Ch. GIDE et RIST : Histoire des doctrines économiques. — DURKHEIM : Le socialisme. — J. LONGUET : La politique internationale du marxisme. — J. LAPIDUS et K. OSTROVITIANOV : Précis d’économie politique ; la Philosophie du marxisme. — PLEKHANOV : Les questions fondamentales du marxisme. — RIAZANOV : Marx et Engels, etc.
Ainsi que les ouvrages mentionnés à anarchisme, communisme, socialisme, syndicalisme, etc. Voir aussi ci-après la bibliographie de « matérialisme historique ».
-
Sur MATÉRIALISME HISTORIQUE. — Les œuvres de Marx et Engels, etc. — SELIGMAN : L’interprétation économique de l’histoire. — LABRIOLA : Essai sur la conception matérialiste de l’histoire. — ENGELS : L’origine de la famille, de la propriété et de l’Etat, etc. — J. JAURÈS et P. LAFARGUE : Idéalisme et matérialisme dans la conception de l’histoire. — POKROVSKI : Pages d’histoire. — M. MONDOLFO : Le matérialisme historique. — N. BOUKHARINE ; : La théorie du matérialisme historique. — P. LAFARGUE : Le déterminisme économique de Karl Marx. — M. EASTMAN : La science de la révolution. — H. DE MAN : Au-delà du marxisme. — H. SÉE : Matérialisme historique et interprétation économique de l’histoire. — M. BEER : Histoire générale du socialisme et des luttes sociales, etc.)
Voir aussi la bibliographie de marxisme et celles mentionnées aux études sociales et économiques.
MATERNITÉ
n. f. rad. maternel du latin maternus
Le fait d’être mère, de mettre au monde un ou plusieurs enfants.
L’instinct maternel n’est pas aussi universel qu’on le pourrait penser. Il est des femelles animales : chattes, rates, souris qui dévorent leurs petits dès qu’elles les ont mis au jour ; bien des poules mangeraient leurs œufs si les éleveurs ne prenaient la précaution de les leur enlever.
Néanmoins, ces infanticides animaux sont l’exception. L’instinct maternel est la sauvegarde de l’espèce, il est donc la loi générale. Tout le monde a pu admirer avec quel soin la mère chatte allaite ses petits, avec quel amour elle les lèche et avec quelle délicatesse elle les saisit par la peau du cou pour les transporter d’un lieu à un autre.
Chez les femmes l’instinct maternel n’est pas également développé ; il en est qui ne le possèdent pas. Chez presque toutes il faut, pour qu’il apparaisse, un certain temps. La nouvelle accouchée toute pantelante ne pense pas à son enfant. Ce n’est qu’au bout de quelques jours qu’elle commence à l’aimer.
L’allaitement au sein semble intensifier l’amour maternel. La mère éprouve, lorsque l’enfant tête, un plaisir sexuel et cela ne fait que resserrer le lien entre la mère et l’enfant.
La misère, les maternités trop nombreuses affaiblissent l’amour de la mère pour ses enfants ; à ce point de vue on peut dire que l’amour maternel est un luxe ; dans les familles pauvres l’enfant reçoit plus de coups que de caresses. Les noms de mépris que l’argot donne au bébé : le salé, le lardon, montrent que les pauvres gens considèrent comme un malheur la venue de l’enfant qui sera une lourde charge.
Chez les animaux, la mère ne choie ses petits que lorsqu’ils sont trop jeunes pour se subvenir à eux-mêmes. Dès qu’ils sont grands, elle les chasse et les mord. C’est en vain que Croc Blanc, le héros de Jack London, fait fête à sa mère la louve qu’il a retrouvée ; elle a d’autres petits et elle fait comprendre à son ancien fils qu’elle ne le connaît plus.
Dans l’humanité, la société prolonge l’amour maternel ; mais ici, encore, il faut considérer les classes. Seuls les parents riches ont le loisir de choyer longtemps leurs enfants. Chez les pauvres, dès que le fils est à peu près en âge de gagner sa vie, on le renvoie ; souvent même c’est lui qui veut partir, heureux d’échapper enfin à l’autorité parentale et de quitter un foyer où il n’a connu que la misère.
Presque toujours la maternité est imposée à la femme malgré elle. Jeune, les sens en éveil, elle cède à l’homme qui lui parle d’amour et souvent lui promet le mariage. Ignorante, la pauvre fille devient vite enceinte et celui qui est l’auteur de la grossesse l’abandonne avec des injures. Mariée, la maternité est aussi imposée la plupart du temps à l’épouse. Elevée dans les préjugés, la femme n’ose pas réfléchir aux choses de la reproduction, elle se contente de subir et croit qu’il n’y a rien à faire contre la nature.
Cette mentalité, il faut le dire, est en voie de disparition. Si la jeune fille se laisse encore prendre aux premiers rapports sexuels, la bêtise qu’elle a faite lui sert de leçon et elle apprend à se préserver.
Dans le mariage, l’homme, à moins qu’il ne soit une brute alcoolique, comprend qu’il n’a pas intérêt à accabler son épouse d’enfants qu’il lui faudra nourrir sur son travail.
L’interdiction de l’avortement est un des faits de la loi de l’homme ; c’est une contrainte odieuse qui viole la liberté la plus essentielle de l’individu : celle de son Corps.
Imposée à la femme, la maternité est méprisée lorsqu’elle a lieu hors mariage. La famille jette à la porte la fille mère dont l’enfant viendra y apporter le déshonneur ; il est encore des pères qui se croient alors en droit de tuer la coupable et si le monde ne les approuve pas, il les excuse.
Cette idéologie barbare est l’expression du millénaire esclavage dans lequel la femme a été tenue. Seul l’homme compte dans l’humanité et la seule raison d’être de la. femme est de fabriquer l’homme ; on impose donc à la femme la maternité, comme le fermier l’impose aux femelles de ses troupeaux.
Individuelle dans son acte initial : l’enfantement, la maternité le devra-t-elle rester dans l’élevage et l’éducation des enfants ? Je ne le pense pas.
L’industrialisation doit s’étendre à la formation des générations futures, car là, comme ailleurs, l’individualisation fait contre beaucoup de peine de mauvais travail.
Pour s’en rendre compte, il suffit d’évoquer la salle luisante de propreté de l’institut de puériculture et de lui comparer le taudis de la famille pauvre où le bébé croupit dans ses langes souillés.
C’est en vain que les gens qui s’évertuent à vouloir mettre sur les plaies sociales des cataplasmes inopérants, font enseigner la puériculture aux petites filles des écoles primaires. Pour faire de l’hygiène, il ne suffit pas d’en avoir appris jadis les rudiments ; il faut en avoir le courage, en avoir le temps, la place, et avoir de l’argent, toutes choses qui manquent nécessairement lorsque l’on doit travailler tout le jour pour un salaire insuffisant.
La société présente se substitue, par ses écoles, à la famille pour l’éducation des enfants ; celle de l’avenir fera un pas de plus et elle assumera tout entier l’entretien de l’enfance.
La maternité, comme l’industrie, cessera d’être individuelle pour devenir sociale. La femme sera ainsi libérée du plus lourd fardeau de sa vie.
Car si c’est un plaisir pour la femme riche d’embrasser, à certains moments de la journée, son bébé coquettement paré, l’élevage d’un nourrisson est un fardeau écrasant pour la femme pauvre. Plus de sommeil : le bébé crie la nuit, il faut se lever, le calmer, le changer, l’allaiter. Plus de jeunesse : les pauvres plaisirs de l’ouvrière sont proscrits, le bébé ne doit pas être quitté d’un instant. La morale sévère même blâme la jeune mère qui se détournerait de ses devoirs pour songer aux plaisirs. J’ai vu des mères susciter l’indignation parce qu’elles emmenaient leur bébé au cinéma.
Pour peu que la femme écoute les conseils des repopulateurs et qu’elle ait une demi-douzaine d’enfants, sa vie est finie. Lorsqu’ils seront élevés, elle sera vieille et les fatigues de la grossesse et de l’allaitement auront fait d’elle une loque.
La maternité éteint l’intelligence de la femme. Il lui faut se mettre au niveau du bébé qu’elle fait sauter sur ses genoux ; pour l’amuser elle ressasse pendant des heures des chansons puériles.
Comment lire, lorsque, d’une bout de la journée à l’autre il faut allaiter, débarbouiller, changer, bercer, laver les couches, etc. L’étudiante dont l’esprit éveillé s’intéressait à tout, n’est plus qu’une ménagère abrutie.
Ceci n’est pas une vue personnelle, je n’en prendrai pour exemple que la chanson poitevine :
Quand je vis tous ces drapiaux Etalés sur la palisseCela me fit jurer, ma foi, Que je resterais toujours fille.
Le sacrifies de la mère fait-il le bonheur de l’enfant ? Non, certes, et Freud nous a montré ce que le bourrage officiel nous empêchait de voir, c’est que l’enfant, loin d’aimer ses parents, les déteste ; leur autorité lui est odieuse.
La maternité, en effet, ne saurait donner ni l’intelligence, ni la science pédagogique. L’esprit de l’enfant se développe au petit bonheur. Pour bien des mères l’enfant n’est qu’une poupée dont elles s’amusent ; un incident heureux vient-il de leur advenir, elles couvrent l’enfant de baisers ; sont-elles de mauvaise humeur, elles rudoient, elles frappent même le pauvre petit qui n’y comprend rien.
De la culture intellectuelle de l’enfant, la plupart des parents ne s’occupent pas du tout ; sans la loi sur l’instruction obligatoire, beaucoup ne l’enverraient pas même à l’école.
On a dit que l’éducation sociale enlèverait aux enfants leur originalité. On oublie que l’originalité est une fleur rare qui ne pousse guère en terre inculte et que d’ailleurs une éducation bien comprise peut, loin de l’étouffer, la susciter au contraire.
L’essentiel est de donner à l’enfant la santé, le bien-être physique, la culture intellectuelle et morale ; les spécialistes de la maternité sociale le feront beaucoup mieux que les mères.
La maternité sociale donnera la vie rationnelle à l’enfant et, grâce à elle, la femme pourra enfin oser vivre pour elle-même.
Doctoresse PELLETIER.
A CONSULTER. — L’amour libre : Ch. Albert. — Maternité consciente : Manuel Devaldès. — L’amour et la maternité : Doctoresse Pelletier. — Maternité (roman) : Brieux. — Libre amour, libre maternité, etc.
MATERNITÉ (CONSCIENTE)
Est-il une locution plus belle dans le vocabulaire ? On peut, forçant quelque peu le sens habituel de l’adjectif, la considérer dans les deux sens du mot « conscience » ; soit que le père et la mère, doués d’une haute conscience morale, ne donnent naissance au nouvel être formé de leurs deux chairs qu’avec le sentiment de la grande responsabilité que, ce faisant, ils assument à l’égard de l’enfant comme envers l’humanité : soit qu’ils le fassent consciemment, avec toute la connaissance que cette expression implique et que l’acte procréateur requiert pour des humains très civilisés.
Certes, il y a un abîme entre cet idéal et la réalité commune. Cet idéal n’est guère davantage, actuellement, que l’apanage d’un petit groupe de scientistes et de réformateurs moraux et sociaux, suivis par un petit nombre d’humains d’élite qui le traduit en fait.
Et il faut que la grande masse de l’humanité soit encore bien arriérée, tant au point de vue de l’intelligence qu’à celui de la moralité, pour qu’il soit encore nécessaire de militer, plus ou moins dangereusement, pour l’application du concept de maternité consciente.
Ce que, depuis longtemps, les éleveurs font pour les animaux de l’étable ou de la basse-cour, ce que les cultivateurs accomplissent pour les céréales, les légumes et les fruits, l’homme le refuse à son espèce et son enfant est le résultat du hasard et de l’inconscience, quand il n’est pas celui de bas calculs (voir naissance).
C’est qu’évidemment, dans le cas de l’homme, nous nous trouvons dans un domaine où ni la raison ni le grand amour ne sont maîtres. L’instinct le plus aveugle et le plus puissant, allié aux passions les plus obscures et les plus secrètes, d’une part ; les intérêts évidents de certains dominateurs et prédateurs, l’ignorance et la crédulité de leurs victimes, d’autre part, entrent en jeu dans le déterminisme de la reproduction de l’espèce humaine. Mais les facultés les plus intelligentes et les vertus les plus hautes, des vertus qui d’ailleurs, n’ont rien d’orthodoxe, sont nécessaires aux humains pour qu’ils procèdent à leur génération consciemment et avec conscience. Raison, maîtrise de soi, égo-altruisme, pitié envers les faibles, et les souffrants, respect de la personne d’autrui, justice, amour, grand amour : voilà quelques-unes des nécessités intellectuelles et morales de l’homme, et spécialement du masculin, pour que la maternité consciente soit la règle et non plus la très rare exception.
Tout être humain en qui vibre une sensibilité affinée éprouve une angoisse à la pensée des souffrances dont il peut être l’ouvrier sur autrui par le simple effet de la vie qui est en lui-même. Celui-là s’efforce de réduire au minimum les conséquences du pouvoir de malfaisance qu’il porte à l’égal de tout être vivant.
Autrui, c’est d’abord l’enfant qu’il faut introduire dans l’existence. Il le voudrait fort, en bonne santé, heureux. Si, par malheur, il est porteur de quelque tare héréditairement transmissible, il s’abstiendra de toute procréation, quelque amer regret que puisse lui laisser une telle résolution. Doter un enfant de, la faiblesse, de la maladie, de la pauvreté qui pourra en être la conséquence, de la douleur, cette pensée lui fait horreur.
Car si, dans un couple, un seul des associés sexuels est taré ou que l’un et l’autre le soient, l’homme et la femme sont criminels en transmettant la vie, ne fût-ce qu’une fois. S’ils ne le sentent pas d’eux-mêmes, on doit le leur apprendre, et si l’éducation sexuelle était donnée à l’école, comme elle devrait l’être, ce serait une des tâches les plus urgentes de cet enseignement que de faire naître chez les jeunes le sentiment d’une telle responsabilité. Les saboteurs de la vie doivent être considérés et traités comme des malfaiteurs par les humains affinés qui sentent en eux-mêmes la souffrance de tous les pauvres êtres ainsi engendrés. Et leurs enfants, à l’âge de raison, auront parfaitement le droit de les mépriser et de les haïr..
* * *
Il existe chez les individus sains, normalement constitués, une capacité de résistance à tous les maux, à tous les périls, qui leur confère une immunité relative, qui les rend moins aptes à contracter les maladies dont sont immédiatement atteints les individus physiquement plus faibles. Comme dit certain proverbe :
« Bon sang ne peut mentir. »
C’est ce type seul qui devrait se reproduire, qui devrait être produit. Ceux qui, malades, engendrent des malades sont des gens infâmes. Et ce fait n’est pas, comme on pourrait le croire, uniquement celui de l’inconscience. Il est parfois au service d’un calcul cynique, de considérations d’argent, d’héritage, etc. Ce qui n’empêche que ces scélérats manifestes sont, selon la morale courante, de dignes et estimables parents.
Plus on descend dans les classes de la société inférieures au point de vue économique, moins il y a de chances de créer des individus forts. Niceforo dit :
« Il y a certainement dans la foule des classes pauvres une sensible quantité d’individus qui sont redevables de leur infériorité économique et sociale à leur infériorité physique et mentale ; ils constituent le dernier échelon d’héritages successifs de maux physiques et moraux qui marquent l’individu de leur sceau et de leurs tares inguérissables. »
Mais il y a aussi ceux qui sont victimes du milieu défectueux. Niceforo ne l’ignore pas et il ajoute :
« Il n’est pas moins certain qu’une grande quantité de stigmates d’infériorité physique et mentale constatés chez les pauvres est le résultat — et non là cause — des conditions externes : milieu tellurique, économique, intellectuel et autres. »
Ceux-là sont les victimes du milieu défectueux, pour autant qu’on puisse dissocier les deux agents de dégénérescence.
La victime de l’hérédité et la victime du milieu sont en effet assez souvent confondues dans le même individu. Souvent aussi, si l’intelligence avait gouverné et la sensibilité inspiré les actes de ses parents, il n’aurait pas vu le jour. Qu’un taré mette au monde des enfants qui hériteront de sa tare pour en souffrir, c’est un malfaiteur. Qu’un pauvre fasse de même pour des enfants qui sont voués à la pauvreté, c’en est un également.
* * *
Se soucier de l’individualité en germe de l’enfant n’implique nullement que celle de la femme qui lui donne la vie soit à dédaigner ou même à considérer comme l’objet d’un souci secondaire, comme une chose subordonnée à l’être futur. Laissons une fois de plus cette cruauté à l’Eglise qui, lorsqu’il faut choisir, sacrifie la mère à l’enfant, ce qui existe, sent et pense à ce qui existe à peine, sent confusément et ne pense pas. Le soin des deux individualités doit être harmonisé autant que possible.
Ce serait un singulier individualisme que celui qui, dans une sorte de religion de l’évolution, sacrifierait sans cesse le présent à l’avenir, l’être vivant et développé à celui qui n’est qu’en puissance ou à l’état rudimentaire. Notre conception de la maternité consciente est scientifique et rationnelle à tous égards. Certes, elle est aussi idéaliste, mais notre idéalisme n’est pas mystique ; il tient à faire bon ménage avec notre réalisme. L’idée de maternité consciente embrasse aussi bien le bonheur de la mère que celui de l’enfant d’aujourd’hui et de l’homme de demain.
Une femme a, cela va de soi, droit à l’individualité, à la personnalité même, autant que son compagnon et son enfant. A nous d’établir l’harmonie entre ces trois unités constituantes de la famille.
C’est elle qui supporte le fardeau des maternités et de l’élevage, qui souffre pour mettre l’enfant au monde, qui parfois meurt durant cette opération : il résulte des statistiques publiées par le ministère de la santé d’Angleterre qu’en ce pays 3.000 femmes, en moyenne, meurent chaque année en couches ou des conséquences de l’accouchement.
En dehors de ce que tout être vivant a droit à l’individualité du seul fait qu’il existe, droit plus ou moins nettement admis par les sociétés les plus civilisées et en. tout cas reconnu par l’élite humaine, ces lourdes charges constituent pour la femme un titre indiscutable au dit droit.
Mais la mère n’est pas seule dans la conception de l’enfant. Il est difficile de parler de maternité consciente sans s’occuper parallèlement de l’idée de paternité consciente. L’homme droit éduqué dans la morale traditionnelle, qui ne songe pas un instant qu’on puisse adhérer publiquement à cette morale et, hypocritement, faire le contraire de ce qu’elle prescrit, cet homme s’indigne de l’acte de quelque « fils de bonne famille » rendant mère une jeune fille grâce à son ignorance et l’abandonnant ensuite, elle... et son enfant.
La même répugnance est éprouvée par l’homme qui a fait sienne l’éthique nouvelle que nous préconisons ici, devant l’individu qui, fût-il marié légitimement avec elle, profite de l’ignorance, de l’inconscience ou de la faiblesse de sa compagne, pour lui imposer, par égoïsme ou pour toute autre raison, une maternité qu’elle ne désirait pas... L’homme noble a de l’individualité de sa compagne un souci égal à celui de la sienne propre. Il juge aussi criminel de rendre une femme mère contre sa volonté que de commettre un acte d’oppression ou un meurtre quelconques...
Outre la nécessité pour les humains d’acquérir la connaissance des diverses raisons d’ordre physique et moral qui commandent la maternité consciente, il est nécessaire, pour la pratique de cette dernière par le plus grand nombre possible d’individus, qu’une sensibilité nouvelle se manifeste en eux, principalement chez les hommes, mais aussi chez les femmes.
Nous disons bien : une sensibilité nouvelle, car trop peu d’humains la connaissent aujourd’hui et pour la plus grande masse elle serait vraiment une nouveauté. Elle doit être suscitée, développée, cultivée pour que naisse en chaque être humain de l’un et l’autre sexe le sens de la responsabilité parentale et en chaque homme le respect de l’individualité féminine...
Tout homme doit apprendre que la femme n’est pas une esclave qu’un Dieu masculiniste aurait créée pour le plaisir de l’autre sexe, qu’elle a son individualité propre, qu’elle a droit à la culture, à la joie, au bonheur. Une femme qui est, par la force de violence ou de ruse, en vertu de quelque impulsion secrète du mâle, plongée contre son gré dans des maternités indésirées, voire abhorrées, cette femme est réduite à une sujétion aussi abjecte que celle de la femme orientale ou de la femelle du primitif, il faut bien le dire, c’est surtout dans le prolétariat que cette situation se rencontre...
Si l’amour de sa compagne existait chez l’homme, il ne la contraindrait pas à une maternité à laquelle elle répugne, à laquelle elle peut avoir des raisons de répugner, surtout si maintes autres l’ont précédée, comme c’est généralement le cas dans les classes pauvres. La maternité consciente implique la maternité consentie. Non seulement le souci de sa compagne, mais la pensée de l’être à naître doit émouvoir cette sensibilité nouvelle que nous voudrions voir susciter chez le générateur. Chez la génératrice aussi, il va sans dire qu’on doit provoquer l’éclosion de cette sensibilité neuve à l’égard de l’enfant.
* * *
La morale sexuelle ancienne (voir sexe, morale sexuelle, etc.), qui survit à sa raison périmée, avec son actuelle louange aprioriste et barbare des familles nombreuses, de la fécondité illimitée des couples, cette morale a sa part de responsabilité dans le présent état de choses.
Mais l’éthique sexuelle nouvelle, une éthique qui s’ennoblit d’esthétique, se substitue peu à peu à elle. Elle s’opposera un jour, fermement, à la continuation des pratiques d’égoïsme inférieur et cruel des dégénérés, des imprévoyants et de ceux, intéressés ou stupides, qui les encouragent.
Victorieuse, elle nous délivrera de l’enfer génésique où la civilisation menace de sombrer, soit par la dégénérescence qu’entraîne la multiplication des tarés, soit par la guerre que la surpopulation ramène périodiquement.
— Manuel DEVALDÈS.
MATHÉMATIQUE
n. f. (du latin mathematicus, grec mathématikos)
La mathématique étudie les grandeurs soit discontinues ou numériques, soit continues ou géométriques ; c’est la science de la quantité. Elle vise tant à mesurer les grandeurs qu’à déterminer les rapports de variations corrélatives qui existent entre elles. La quantité discontinue fait l’objet de l’arithmétique ; le nombre dont traite cette branche des mathématiques provient essentiellement de l’addition de l’unité avec elle-même ; résultat de l’activité créatrice de l’esprit, il implique abstraction et généralisation préalables. Simplifiant davantage, l’algèbre remplace les chiffres déterminés par des lettres représentant n’importe quel chiffre ; elle fait par rapport aux nombres ce que fait le nombre par rapport aux objets. D’où le nom d’arithmétique universelle que lui donnait Newton. Un degré d’abstraction de plus et on obtient le calcul des fonctions qui recherche comment varie une quantité lorsqu’on en fait varier une autre. La géométrie, science de la quantité continue, établit les propriétés des figures tracées par l’esprit dans l’espace homogène à l’aide du point et du mouvement. Par l’invention de la géométrie analytique, Descartes a réconcilié les sciences, jusque là irréductibles, des grandeurs continues et des grandeurs discontinues ; à chaque figure il fit correspondre une équation et par l’étude des variations de la seconde il parvint à déterminer les variations de la première. Enfin le calcul infinitésimal, découvert par Leibnitz et Newton, permit la mesure des grandeurs continues, grâce à l’adoption, comme unité conventionnelle, de l’élément infiniment petit. Aujourd’hui la méthode des mathématiques est, avant tout, déductive ; non qu’elle descende du général au particulier comme dans le syllogisme verbal ; elle consiste dans une substitution de grandeurs équivalentes et se présente comme une suite d’égalités.
Loin de se borner à piétiner sur place, à tirer d’une proposition générale les propositions particulières qu’elle contient, la démonstration mathématique progresse vers des vérités nouvelles et généralise constamment. Elle fournit le vrai type de la déduction scientifique, bien différente de la déduction formelle dont les scolastiques abusèrent si fâcheusement. Et la rigueur des conclusions qu’elle permet d’établir a valu aux mathématiques le titre de sciences exactes. Mais il n’en fut pas de même dès l’origine ; longtemps elles utilisèrent la méthode expérimentale. Aucun procédé rationnel de démonstration géométrique chez les Babyloniens, les Hébreux, les Égyptiens ; c’est expérimentalement qu’ils estimèrent égal à 3 le rapport de la circonférence à son diamètre et que la surface d’un triangle leur apparut comme le produit de la moitié du plus grand côté par le, plus petit. En fait de mesure, ils s’en tenaient naturellement à des approximations grossières, Galilée évaluait encore expérimentalement le rapport de l’aire de la cycloïde à l’aire du cercle générateur, et Leibnitz nous parle d’une géométrie empirique qui démontrait les théorèmes relatifs à l’ égalité des figures en découpant ces dernières et en rajustant les diverses parties de manière à former des figures nouvelles. La physique moderne continue de rendre des services nombreux aux sciences mathématiques ; elle leur impose des problèmes et en suggère parfois la solution. Si les premiers éléments d’une notion géométrique de l’espace se manifestent déjà dans les dessins préhistoriques de l’âge du renne, peut-être faut-il remonter encore plus loin quand il s’agit du nombre ; on démontre en effet qu’un chimpanzé parvient à compter jusqu’à 5. Toutefois, parce que plus abstraite, l’arithmétique ne se constitua comme science rationnelle qu’après la géométrie. Égyptiens, Chaldéens, Phéniciens, arrivaient difficilement à concevoir des nombres supérieurs à ceux que présente l’expérience ordinaire ; les Grecs eux-mêmes ne s’élevèrent pas jusqu’à la notion du nombre pur que ne soutient aucune intuition concrète ; et c’est d’une manière géométrique qu’ils résolvaient d’ordinaire les problèmes numériques.
L’invention par les Hindous, et l’adoption par les Arabes, du système de numération qui est devenu le nôtre permit à l’arithmétique de faire des progrès sérieux. Si nous devons la géométrie aux Grecs, c’est aux orientaux incontestablement que nous empruntâmes, au moyen-âge, les bases essentielles de la science des grandeurs discontinues. Viète, qui vivait au XVIème siècle, peut être considéré comme le créateur de l’algèbre ; Stévin, vers la même époque, trouva la mécanique rationnelle. Dans son ensemble le développement des sciences exactes apparait donc lié à une progression sans cesse croissante du pouvoir d’abstraction. Aujourd’hui, l’expérience a complètement cédé la place à la déduction en mathématiques. Définitions, axiomes, postulats constituent les éléments essentiels de cette déduction. Génératrices des nombres et des figures, universelles, immuables, pleinement adéquates à leur objet, les définitions, d’après la thèse rationaliste, seraient essentiellement des créations de l’esprit ; quelques-uns même ont prétendu qu’elles existaient toutes faites en nous, et qu’il suffisait à la pensée de se replier sur elle-même pour les découvrir. D’après la thèse empiriste, au contraire, elles dérivent de l’expérience et restent entièrement tributaires des données sensibles. La notion de quantité numérique serait extraite, par abstraction, des multiplicités concrètes et qualitativement hétérogènes que nous percevons. De même les figures géométriques auraient une origine expérimentale ; en se superposant les figures sensibles neutraliseraient leurs irrégularités et l’abstraction achèverait de leur donner un caractère idéal. Associant rationalisme et empirisme, certains ont défini nombres et figures des créations de l’esprit suggérées par l’expérience. Pour Henri Poincaré, les définitions mathématiques sont des conventions commodes, sans aucun rapport avec l’expérience, mais qui peuvent varier selon les besoins scientifiques de l’esprit ; il les appelle des hypothèses, ce terme n’étant pas entendu dans son sens ordinaire mais signifient ce qu’on prend pour accordé, ce dont on part. Conditions primordiales de la démonstration, elles en constituent les principes immédiatement féconds. Le rôle des axiomes est moins apparent. Applications directes, dans le domaine de la quantité, des principes d’identité et de contradiction, les axiomes sont des propositions évidentes, indémontrables qui énoncent des rapports constants entre des grandeurs indéterminées. Ils n’interviennent pas visiblement dans la trame des déductions, mais c’est eux qui légitiment les enchaînements des propositions mathématiques et justifient la série des substitutions. Les postulats, propositions spéciales à la géométrie, énoncent des propriétés particulières de grandeurs déterminées ; ils sont indémontrables, mais leur évidence est moins immédiate que celle des axiomes ; leur rôle est à rapprocher de celui des définitions. Toutefois, pour Henri Poincaré, axiomes et postulats sont simplement des définitions déguisées ; entre eux il n’y aurait qu’une différence de complexité ; ce sont les définitions les plus générales, nécessaires à l’ensemble des sciences mathématiques. Certains géomètres, entre autres Lowatchewski, ont rejeté le postulat d’Euclide ; d’autres ont imaginé un espace à 1 ou 2 ou 4 ou n dimensions. Mais les espaces à moins de 3 dimensions ne sont que le résultat d’une abstraction, et les espaces à 4, 5, n dimensions d’artificielles créations de l’esprit.
Les équations entre 3 variables correspondant à notre espace euclidien, on a supposé qu’aux équations entre 4, 5, n variables correspondaient des espaces à 4, 5, n dimensions. En mathématiques, la démonstration sera synthétique ou analytique selon qu’elle partira d’un principe évident pour redescendre à un problème posé ou que d’un problème posé elle remontera à un principe évident. Euclide nous a donné un merveilleux exemple de la démonstration synthétique dans ses Éléments ; c’est à Hippocrate de Chios que nous devons, semble-t-il, la première idée de la démonstration analytique. La démonstration par l’absurde est un cas particulier de l’analyse des anciens ; elle consiste à prouver une proposition par l’absurdité des conséquences qui s’en suivraient si on ne l’admettait pas. Plusieurs savants contemporains ont insisté sur le rôle de l’induction ; elle interviendrait lorsqu’on généralise les résultats obtenus par démonstration, ainsi que dans les raisonnements par récurrence, fréquents en arithmétique, en algèbre et en analyse infinitésimale. Une propriété étant vérifiée pour le premier terme d’une série, l’esprit suppose cette vérification valable pour le terme suivant et, par récurrence, pour n’importe quel terme de la série. Mais, remarque Poincaré, alors que l’induction ordinaire se fonde sur la croyance à un ordre existant hors de nous, dans la nature, l’induction mathématique « n’est que l’affirmation de la puissance de l’esprit qui se sait capable de concevoir la répétition indéfinie d’un même acte, dès que cet acte est une fois possible ». Ces deux formes d’induction apparaissent donc irréductibles l’une à l’autre et sans autre lien que celui de la communauté du terme qui sert à les désigner.
Depuis toujours, les mathématiques passent pour les sciences par excellence. Il est certain que leur valeur est grande, du point de vue pédagogique, pour la formation de l’esprit ; elles développent le besoin d’évidence, le goût des démonstrations rigoureuses, des raisonnements clairs. En nous plongeant dans un monde abstrait, peut-être engendrent-elles aussi un dédain injustifié pour l’observation, une méconnaissance dangereuse des mille contingences du monde concret. D’autre part, c’est aux mathématiques que les sciences expérimentales demandent les formules nettes, précises, distinctes qui remplacent, dans l’énoncé des lois, les déterminations qualificatives toujours vagues dont on eut tort de se contenter trop longtemps. Bacon insistait de préférence sur l’aspect expérimental des sciences de la nature ; Descartes, par contre, voyait dans les mathématiques une sorte de plan général du monde. Arithmétique et algèbre, écrivait-il, « règlent et renferment toutes les sciences particulières. Elles sont le fondement de toutes les autres ». Il rêvait de construire avec elles, une science universelle capable de résoudre même les problèmes d’ordre concret. Le point de vue de Bacon a triomphé un moment, aujourd’hui, c’est celui de Descartes qui l’emporte ; délaissant la qualité, les sciences positives s’intéressent surtout à la quantité. Elles utilisent des instruments de précision, exigent des mesures, et finalement traduisent en langage mathématique les résultats obtenus. Dans ses parties les plus avancées, la physique aboutit à des séries de formules qui facilitent les applications techniques et permettent de suivre aisément la marche des phénomènes ; la chimie, elle aussi, fait appel de plus en plus à la mesure et au calcul. Biologie, sociologie ne sont pas encore parvenues au stade du mathématisme, mais elles s’en rapprochent lentement, la première surtout qui fait de fréquents emprunts à la physique et à la chimie. Contre ce triomphe des mathématiques, Boutroux, Bergson et d’autres philosophes se sont insurgés vainement. Applicables avec rigueur ou presque dans le monde inorganique, les formules mathématiques cessent de l’être dans le domaine de la vie et plus encore dans celui de la pensée, d’après Boutroux. Les lois scientifiques nous renseignent sur la marche ordinaire des phénomènes ; mais, dans la nature, il y a de la contingence, de l’indétermination ; il arrive que les faits sortent des limites que nos formules leur assignaient, comme les eaux d’un fleuve débordent quelquefois hors du lit qui les contient habituellement. Bergson prétend de son côté, que l’évolution est créatrice et qu’il y a dans la nature incessante apparition de nouveauté. Comme la raison qui les engendre, les mathématiques visent des buts pratiques ; très utiles pour l’action, elles sont incapables de nous donner une connaissance vraie du réel ; ne saisissant des choses que la surface, le dehors, solidifiant ce qui est devenir ininterrompu, elles déforment absolument les faits vitaux et psychologiques auxquels on prétend les appliquer. Comme de juste, les belles phrases de Boutroux et de Bergson n’ont pas arrêté les savants ; chaque jour des découvertes nouvelles prouvent que, dans la nature, rien n’échappe au déterminisme. Il faut la mauvaise foi ou l’ignorance d’un évêque pour déclarer, comme celui de Plymouth, Masterman :
« L’atome paraît se comporter de manières aussi différentes qu’inexplicables et une sorte de liberté rudimentaire semble appartenir à la structure du monde physique. »
Il n’ y a place dans la nature que pour un enchaînement rigoureux de causes et d’effets.
‒ L. BARBEDETTE.
MATIÈRE
(n. f. du latin materia)
Suffit-il d’ouvrir les yeux, d’étendre la main, d’user des sens en général pour percevoir la substance des objets qui nous entourent ? L’immense majorité des ignorants, plus quelques pseudo-philosophes, singes d’Aristote, le supposent volontiers. Pour eux, l’esprit est un miroir fidèle du monde extérieur : les choses sont bien telles que nous les voyons, telles que nous les palpons ; pourtant, nous savons aujourd’hui, de science certaine, qu’il n’en est rien ; les couleurs, déclare la physique, se réduisent à de simples vibrations dans la réalité objective, et les sensations tactiles proviennent de modifications mécaniques ou chimiques des terminaisons nerveuses. Les sons résultent d’ondulations acoustiques parfaitement étudiées ; l’odorat, le goût présentent un caractère subjectif indiscutable. Or la couleur, le son ressemblent si peu à des vibrations, qu’il a fallu des siècles de recherche avant d’aboutir aux connaissances actuelles ; nous ignorons encore le mécanisme secret des sensations tactiles dans leur rapport avec l’excitant externe. Notre esprit n’est point un miroir fidèle ; en lui l’univers observable ne se reflète pas sans modification ; tel une glace déformante, il impose aux données sensibles un enchaînement et des aspects qui résultent de la nature intime des organismes récepteurs. Le daltonien perçoit vert ce que l’œil normal perçoit rouge ; de nombreux troubles nerveux prouvent à l’évidence qu’un excitant demeuré identique provoque des sensations différentes lorsqu’une modification survient dans les organes périphériques ou dans le cerveau.
Résultat d’un compromis entre les vibrations extérieures et l’appareil nerveux impressionné, la sensation nous révèle l’existence d’une cause excitatrice, elle reste muette sur la nature profonde de cette cause. Un objet particulier n’est pour nous que la somme des sensations diverses qu’il provoque ; l’orange, par exemple, se réduit à un ensemble d’impressions visuelles, tactiles, gustatives, olfactives coexistantes. Mais quel substratum se cache sous la couleur, détermine goût et parfum, se révèle sphérique à la palpation des doigts ? Et ce que je dis de l’orange je puis le dire, avec quelques variantes concernant surtout les sensations gustatives et olfactives, d’un meuble, d’une pierre, d’un morceau de fer, de n’importe quel objet. Ainsi se trouve posé le problème de l’existence de la matière ; problème insoluble pour le métaphysicien mais que le savant arrive déjà à rendre moins obscur.
L’existence de la matière fut niée par certains idéalistes ; Berkeley, évêque anglican de Cloyne mérite de retenir particulièrement l’attention. Ému de l’impiété grandissante au XVIIIème siècle, il voulut extirper la croyance en la réalité d’un substratum matériel des qualités sensibles. Les choses, à son avis, n’ont pas d’existence hors des esprits qui les perçoivent ; elles sont seulement en tant que connues. « Pour une idée, exister en une chose non percevante, c’est une contradiction manifeste, car, avoir une idée et la percevoir, c’est tout un ; cela donc en quoi la couleur, les figures, etc., existent, doit les percevoir. Il suit de là clairement qu’il ne peut y avoir de substrat non pensant de ces idées ». Et Berkeley rend sa doctrine plus compréhensible par l’exemple suivant : « Je vois cette cerise, je la sens, je la goûte : or je suis sûr que rien ne peut être vu, ni goûté, ni touché ; donc elle est réelle. Supprimez les sensations de douceur, d’humidité, de rougeur, d’acidité, et vous supprimez la cerise. Puisqu’elle n’a pas une existence distincte des sensations, je dis qu’une cerise n’est rien de plus qu’un agrégat d’impressions sensibles, ou d’idées perçues par des sens différents : idées qui sont unifiées en une seule chose par l’intelligence ; et cela, parce qu’on a observé qu’elles s’accompagnent l’une l’autre. Quand j’ai certaines impressions déterminées de la vue, du tact, du goût, je suis sûr que la cerise existe ou qu’elle est réelle ; sa réalité, d’après moi, n’étant rien si on l’abstrait de ces sensations. Mais si, par le mot cerise, vous entendez une matière inconnue, distincte de toutes ces qualités sensibles, et par son existence quelque chose de distinct de la perception qu’on en a, je l’avoue ni vous, ni moi, ni personne au monde ne peut être assuré qu’elle existe ». Et le philosophe accumule les arguments pour démontrer que les qualités premières comme les qualités secondes restent subjectives et que la notion de matière est contradictoire. Mais tous ses raisonnements échouent devant une double constatation ; celle de la simultanéité constante et invariable des diverses impressions visuelles, tactiles, etc., se rapportant au même objet, et celle de l’accord de tous les hommes normaux sur les sensations perçues dans un même endroit de l’espace, au même moment du temps. Rougeur, humidité, douceur de la cerise sont toujours données ensemble ; et ce fruit n’est point perçu par un individu seulement, il l’est par tous les individus présents. En manière d’explication Berkeley invoque l’action de Dieu, ce pantin métaphysique qui permet aux philosophes de concilier en apparence les plus évidentes contradictions. Cette carence est la meilleure preuve de l’existence, hors de nous, d’une substance productrice des sensations.
Mais, sur la nature de ce substrat, les opinions ont varié extrêmement. Pour les premiers penseurs grecs, matière inanimée, matière vivante, principe spirituel résultent d’un élément unique ou de plusieurs éléments qui engendrent toutes les formes animées. Avec les Eléastes l’être s’oppose au devenir, l’un au multiple ; ce qui change n’a pas d’existence propre, ce qui demeure identique à soi constitue la vraie substance. Peut-être Anaxagore distingua-t-il le premier la matière, force inerte et passive, de l’esprit, principe organisateur et actif. Leur séparation est nette dans la philosophie socratique. De l’Idée provient toute existence, d’après Platon ; la matière en dérive mais ne la manifeste qu’à l’état de reflet confus. Selon Aristote, les corps se ressemblent par la matière, principe commun, indéterminé, source de l’étendue, mais ils diffèrent par la forme, principe simple, actif, déterminé et déterminant ; la matière explique la différence individuelle, la forme rend compte de la différence essentielle. Les stoïciens adopteront une conception qui n’est pas sans parenté avec celle d’Aristote ; alors que les Alexandrins s’inspireront de celle de Platon. La théorie atomique de Démocrite, acceptée par Épicure, se rapproche singulièrement des idées scientifiques modernes sur la constitution de la matière. Au XVIIème siècle, Descartes préconisa le mécanisme géométrique ; il n’y aurait point d’atomes, point de vide, l’essence des corps serait l’étendue et l’étendue deviendrait ainsi identique à la matière. Le mouvement rectiligne, qui suppose le vide, serait impossible, tout mouvement serait circulaire ; d’où la théorie cartésienne des tourbillons. À Leibnitz, par contre, la matière apparaît comme un aspect inférieur de l’esprit. Le monde est réductible à un ensemble de forces que nous devons concevoir sur le modèle de celle que nous connaissons le mieux, la pensée. Dans chaque centre de force ou monade il faut voir une conscience inétendue, douée de perceptions plus ou moins claires, d’appétitions plus ou moins développées. La matière n’est que le système de perceptions obscures qui se déroulent dans les monades ; et un accord préalable fait subsister entre ces dernières une harmonie parfaite.
Les savants du XIXème siècle ont accepté la théorie atomistique de Démocrite et d’Épicure : théorie transformée et précisée à la suite des nombreuses expériences qu’ils effectuèrent. Aujourd’hui physiciens et chimistes considèrent l’atome lui-même comme décomposable en un système d’électrons : un électron positif servirait de noyau central et des électrons négatifs, animés d’une prodigieuse vitesse, tourneraient autour à la manière de planètes. Convenons qu’il s’agit là d’hypothèses dont la démonstration reste à faire. Indiquons néanmoins, quelques-uns des faits qui leur donnèrent naissance. À la suite des expériences de Crookes en 1886, reprises et continuées par d’autres physiciens, on admit le transport d’électricité négative, rayonnant de la cathode, dans un tube où le vide était poussé jusqu’au millionième d’atmosphère et que traversait un courant. Et l’on déclara, après d’autres recherches, qu’il ne s’agissait pas d’ondulations, mais de véritables corpuscules arrachés aux atomes des corps matériels, les électrons négatifs, vrais constituants matériels de diamètre infime. L’ampoule de Crookes montre d’ailleurs, dans une direction opposée au rayonnement cathodique, un autre rayonnement beaucoup plus lent : les rayons-canaux de Goldstein, formés d’ions positifs. Dépassant les données expérimentales, certains savants concluent de ces faits à l’origine électromagnétique de toute matière pondérable. Les atomes différeraient entre eux, tant par leur complexité que par le nombre de leurs éléments : celui d’hydrogène étant le plus simple, ceux du radium, du thorium, de l’uranium étant les plus lourds. Mais tous seraient réductibles, dans leurs éléments infimes, à des charges électriques positives et négatives qui se neutraliseraient dans l’atome complet. Au dire des mêmes, les découvertes radio-actives confirmeraient cette théorie, puisqu’elles révèlent une véritable désintégration de la matière, une décomposition de l’atome chimique en éléments moins complexes : électrons et noyaux d’hélium. Aussi la transmutation des corps simples, entendue il est vrai d’une manière qui n’était pas celle des alchimistes, apparaît-elle passible. L’explication des raies du spectre semble également facilitée par la croyance aux électrons, qui rempliraient le rôle de vibrateurs et, par leurs mouvements, produiraient les couleurs caractéristiques des corps.
Bien franchement nous reconnaissons que la théorie électromagnétique de la matière soulève de très grosses difficultés. Qu’en penseront physiciens et chimistes, d’ici un demi-siècle ? N’en préjugeons pas. Mais constatons que, contrairement aux affirmations des positivistes d’accord en cela avec les métaphysiciens, il est possible à la science expérimentale de nous renseigner sur la substance constitutive de l’univers. Remarquons encore que le peu connu, jusqu’à présent, suffit à condamner, sans rémission, le dualisme chrétien qui oppose la matière inerte à l’esprit actif. Dualisme que les scolastiques, infidèles à la pensée d’Aristote, mais soucieux de rendre service à la religion, avaient déjà poussé très loin et que Descartes exagérera encore, dans le dessein de maintenir l’existence de l’âme hors de toute contestation. La matière est passive, répétait-on sous mille formes, seul l’esprit est animé ; donc impossibilité absolue de les confondre. Nous savons aujourd’hui combien relative l’inertie prétendue de la matière, et que rien ne permet de la distinguer substantiellement de l’esprit. Entre la matière inorganique, la matière vivante et la pensée, le savant constate qu’il n’existe aucun saut brusque, aucune coupure véritable.
Point de fait vital spécifique ; tous les phénomènes qui s’accomplissent dans l’organisme sont d’ordre physique, chimique ou mécanique. Le protoplasma, base de la vie, est infiniment plus complexe que la matière inorganique mais il reste de la matière ; nous pouvons déjà en faire l’analyse, nos descendants en obtiendront la synthèse. Substance gélatineuse de la nature des colloïdes, il doit ses propriétés spéciales à l’incessante mobilité de granulations, caractéristiques de l’état colloïdal. Celles que l’on dénomme zymases, et qui rentrent dans la catégorie des agents catalytiques, semblent l’ultime refuge des propriétés vitales. Or, ces zymases sont isolées sans cesser d’être actives ; on peut les remplacer par des agents artificiels ; et les réactions digestives, respiratoires, etc., obtenues par les granulations zymasiques, isolées de la substance vivante, sont également obtenues avec les colloïdes du platine, de l’or, etc., résultat de la fixation d’eau sur ces métaux par l’électricité. Le cristal, d’apparence inerte, provient de granulations, véritables cellules munies de noyau, qui présentent les caractères de la vie ; et sans aboutir encore à la synthèse d’une cellule vivante, de courageux chercheurs en font entrevoir la possibilité. Donc aucun abîme entre la matière organique et la matière brute ; de nombreux contemporains l’admettent d’ailleurs. Mais il faut pousser plus loin et reconnaître qu’il n’y a pas davantage coupure entre la matière et l’esprit. S’il est un fait essentiel à la pensée vivante, c’est le souvenir. Or, la matière se souvient. Un fil d’acier, traversé par un courant et mis en rapport avec un microphone, enregistrera les vibrations acoustiques. Le son, en modifiant la structure moléculaire, sera incorporé au métal, et non plus seulement inscrit comme sur un disque de phonographe. Et le fil impressionné reproduira le son, si on le déroule devant un appareil construit à cet effet. Attraction et répulsion des atomes ou des électrons ne sont-elles pas l’équivalent des désirs et des répugnances manifestées par tout vivant ? Entre la matière et l’esprit les savants découvrent, chaque jour, des analogies qui rendent leur parenté de plus en plus certaine.
Si le matérialisme d’un Büchner est dépassé, on peut dire du spiritualisme chrétien qu’il est mort définitivement. Le corps brut contient en puissance la vie et la pensée ; de l’inorganique sortent par évolution la plante et l’animal ; quant à l’esprit qui aime et connaît, il est encore le résultat de millénaires transformations. Rien ne permet de supposer le monde organisé du dehors par un artisan divin ; pas davantage nous ne pouvons l’imaginer, à l’instar de certains modernes, comme un vivant supérieur, doué d’une conscience et d’une personnalité. C’est en lui-même que l’univers détient ses propres lois ; le germe de son devenir éternel n’eut besoin d’être déposé par personne, il a sa source dernière dans l’impérissable substance dont matière, vie et pensée sont les aspects successifs.
‒ L. BARBEDETTE.
BIBLIOGRAPHIE. ‒ Büchner : Force et Matière ; Science et Nature ‒ Dauriac : Matière et Force ‒ Stallo : la Matière et la Physique moderne ‒ Lord Kelvin : Constitution de la Matière ‒Hannequin : Essai critique sur l’hypothèse des atomes dans la science contemporaine ‒ Dastre : la Vie et la Mort ‒ Le Bon : l’Évolution de la Matière ; l’Évolution des Forces ‒ Lodge : la Matière et la Vie ‒ G. Kharitonov : la Synthanalyse ‒ Stormer : De l’Espace à l’Atome ‒ Perrin : Les Atomes ‒ D. F. Strauss : Der Alte und Neue Glaube ‒ J. Moleschott : Lettres sur la circulation de la vie ‒ Ch. Vogt : Leçons sur l’ homme ‒ Lamettrie : L’homme-machine ; Histoire naturelle de l’âme ‒ D’Holbach : Système de la nature ‒ Dr C. Doljan : Architecture de la Matière ‒ Lossky : La Matière, l’Intuition et la Vie ‒ Le Dantec : La Matière vivante ; la Science de la vie, etc. ; ainsi que les ouvrages mentionnés à Matérialisme.
(Voir aussi les études sur Amour, Avortement, Malthusianisme, Mère, Naissance, Procréation, Sexe, etc.).
MATIÈRE (Point de vue du socialisme rationnel)
Ce qui est divisible, ce qui tombe sous les sens, ce qui est susceptible de toute forme et de toute dimension constitue la matière. Toute chose physique, corporelle ou non, prend le nom de matière. La matière représente toujours un phénomène et se rapporte à l’ordre physique, à l’ordre naturel. Au figuré, le sujet d’un écrit, d’un discours, d’une thèse, enfin une cause, un prétexte sont autant de matières à discuter.
À côté des considérations qui précèdent, il est un point à développer relatif à la matière qui se rattache tout particulièrement à la vie sociale, à la vie de l’humanité. Alors même qu’elle nous apparaît comme inerte la matière est essentiellement mobile. Le mouvement est la caractéristique de la matière devenant force modificatrice. Dès lors partout où il y a matière il y a force. Disons mieux : la matière est le mouvement même, le changement, la modification sans distinction possible de bien ou de mal, et conséquemment sans direction réelle possible vers l’un ou vers l’autre.
Ce mouvement, ce changement, cette modification, n’est perçu réellement que par l’homme qui, sous l’impulsion de la force, jointe à la sensibilité exclusive à l’humanité, perçoit le sentiment de son existence, s’intéresse à ce qui l’environne et s’oriente en vue d’utilisation pratique des faits, non seulement pour le présent, mais aussi pour l’avenir. À notre époque, outrancièrement matérialiste et despotique, certains se demandent si la matière et d’autres êtres ne pensent pas au même titre que l’homme, en se basant sur certains mouvements, sur certains gestes qui paraissent plaider en ce sens pour l’emploi de la force dans la vie sociale.
Ignorant l’impasse où ces personnes aboutissent par une acceptation trop rigoureuse de la thèse matérialiste, elles en arrivent, tout en attribuant la pensée relative à tous les êtres, à l’admettre en puissance dans la matière générale, d’où elle sort mécaniquement au moment opportun pour se métamorphoser en pensée réelle que la volonté dirige.
Pour être en accord avec la loi d’évolution, appliquée à la vie sociale, on attribuera à la matière une sensibilité métaphysique comme le fait M. J. de Gaultier, représentant pour l’homme ‒ comme pour les autres êtres et à un degré moindre ‒ une réalité ‒ illusoire ‒ supposée suffisante, qui a la propriété singulière de s’éloigner du but, à mesure qu’on approche pour l’atteindre. L’œuvre de servage économique qui s’édifie sous le pavillon de l’évolution reçoit ainsi une consécration... d’apparence... scientifique.
La matière peut paraître penser, apparaître comme pensante à ceux qui observent superficiellement, qui prennent pour critérium de leur raisonnement l’analogie.
On est matérialiste ou on ne l’est pas, et, quand on l’est, on raisonne ainsi, ne pouvant raisonner autrement.
Il n’est pas douteux que l’homme, comme les autres êtres est matière, mais est-il exclusivement matière ? Telle est la question majeure.
Du fait d’être matière, rien ne s’oppose à ce qu’il perçoive réellement le sentiment de son existence, alors que les autres êtres n’en ont qu’un sentiment instinctif et illusoire. Nul ne peut nier que l’homme perçoit dans le temps, qu’il se rend compte qu’il existe, qu’il vit, non, seulement en vue du présent mais de l’avenir. Il sent, en réalité et non en apparence, il jouit et souffre, connue il s’efforce d’éloigner la souffrance pour se rapprocher de la jouissance. Tout cela prouve qu’il pense et raisonne d’une manière plus qu’illusoire, plus qu’automatique : c’est-à-dire réellement.
Si nous observons, si nous analysons l’ordre de la matière, l’ordre physique, nous verrons que tout y est fatal, en quelque sorte nécessaire, et que dans cet ordre il n’y a pas de choix. Il est ce qu’il est, sans plus. Du reste, comment pourrait-il y avoir liberté, là où il ne peut y avoir que fatalité, intelligence réelle, là où il n’y a que mouvements ? Théorie et pratique aboutissent logiquement à reconnaître l’impossibilité de faire naître la liberté de la fatalité, aussi bien que la qualité de la quantité.
Ainsi, de la question de la matière sort la question de la liberté et de l’indépendance. Ces facultés appartiennent à l’ordre moral et non à l’ordre physique, et comportent une coordination de faits en vue d’une amélioration générale. Le sentiment que nous avons en chacun de nous de la matière, du mouvement qui nous modifie, du phénomène qui nous intéresse, nous prouve, par la coordination de la pensée et de l’action, que nous sommes sensibles réellement et non illusoirement.
Un fait, pour si intéressant qu’il puisse être, n’a aucune valeur par lui-même ; il ne vaut que par l’utilité, ou la nécessité, dont l’homme ressent le besoin et en fait usage.
Les valeurs sont toutes déterminées par le besoin que l’homme ressent ; elles appartiennent au monde social ; à l’ordre rationnel et non à l’ordre naturel.
Réfléchissons que si l’homme est tout matière, comme celle-ci est tous les autres êtres et corps, notre vie apparaît comme une série de modifications sans spontanéité, sans réalité, sans volonté, qu’elle subit tout mouvement sans en avoir conscience et sans s’y intéresser réellement. L’homme agirait comme une girouette tourne, c’est-à-dire qu’il fonctionnerait tout simplement.
« Pour qu’il y ait ordre de volonté, ordre moral, dit Colins, pour qu’on puisse admettre la liberté de l’action véritable, et par suite des droits et des devoirs, il faut qu’il y ait autre chose que du matériel ; il faut qu’il y ait de l’immatériel. Cet immatériel doit être non seulement cru, mais prouvé et prouvé incontestablement. »
Si cette preuve ne peut s’établir, rien ne serait plus facile que de mettre au-dessus de toute contestation qu’il n’y a point de droit, pas de devoir, et de ce fait, pas de justice.
En pareil cas, la force fait le droit, et mieux, elle est le seul droit possible. Que le mal triomphe du bien, que le juste mais faible soit écrasé par le fort, rien qui ne cadre pas avec la loi d’évolution physique. C’est bien, du reste, sous cette influence, sous cette direction, si on peut dire, que les diverses sociétés se sont constituées empiriquement à travers les âges. La société actuelle n’est que la continuation des sociétés précédentes sous une autre forme.
La force, qui est l’essence de la matière, qui lui est inhérente, contribue à expliquer, par le raisonnement qui est l’essence de l’Humanité, l’apparition successive sur la terre des êtres inorganisés et organisés ; elle explique enfin l’apparition du globe terrestre.
Cependant, malgré sa puissance naturelle, la force ne règne que par à-coup et, sous divers signes, l’intelligence, qui n’est que la raison, la ronge constamment. Elle finira par la miner et la renverser en faisant d’elle sa servante, son aide et non sa directrice, parce que la vie des sociétés est à ce prix.
La force, la matière doit, socialement, servir l’Individu et non l’asservir si nous voulons que la liberté ne soit pas un mythe. La liberté est d’une essence autre que celle de la force. Le pouvoir d’agir ou de ne pas agir constitue la liberté psychologique.
En définitive, quand elle se manifeste comme cause la Matière est force ; comme effet elle est mouvement ; comme objet elle est modification.
Le but de conservation et d’amélioration que certains déterministes avaient découvert dans la matière, n’a rien de réel, de conscient. Il y a illusion et confusion de l’apparence avec la réalité. Un fait est ce qu’il est et n’a pas à le savoir ; c’est au raisonnement à le déterminer. Qu’un fait soit le contraire de ce qu’il est, la nature, la matière n’en sera pas affectée pour cela ; le monde social peut l’être et l’est fort souvent. La différence est due à la liberté psychologique.
Du moment que la matière a pour propriété le changement, la modification, il apparaît que la constance, la conservation, le repos sont la négation de la matière.
Ces constatations nous amènent à comprendre qu’il faut situer les moyens de rénovation et de réalisation sociale équitable en dehors de la matière et du matérialisme déterministe.
C’est ainsi que l’idée généralement admise, qu’on se fait de la matière conduit la Société à la domination de la force et de l’arbitraire et non à celle de la raison et de la justice qui sont nécessaires à la vie sociale et à la manifestation de la liberté.
‒ Élie SOUBEYRAN.
MATRIARCAT
n. m. (du latin mater, tris, mère et du grec arkhê, commandement)
Le témoignage de la Bible fit croire longtemps que le patriarcat était le seul régime familial connu des anciens. Et des philologues, désireux de confirmer les dires des livres saints, faisaient remarquer avec complaisance que le mot pater est employé dans toutes les langues européennes pour désigner le chef de famille ; preuve, assuraient-ils, de l’existence de la famille patriarcale dans la race indo-européenne primitive, antérieurement aux migrations. Des économistes ultra-réactionnaires renchérissaient, affirmant, comme le font encore les conférenciers des ligues pour la repopulation, que c’est la famille, non l’individu, qui constitue la cellule sociale originelle. Avec Le Play, certains, n’osant demander pour le père le droit de vie et de mort sur sa femme et ses enfants, réclamaient du moins une famille souche « où l’union se perpétuerait après la mort du père, où la communauté d’existence continuerait sous la direction d’un de ses enfants, seul héritier ; cet héritier grouperait autour de lui ses frères ou sœurs que le père de famille, de son vivant, n’a pas établis dans une condition indépendante et perpétuerait au foyer paternel les habitudes de travail, les moyens d’influence et l’ensemble des traditions utiles créés par les aïeux. » Droit d’ainesse, esclavage déguisé de la femme et des enfants, voilà ce que voulaient ces bons apôtres, soutenus par des romanciers à la Paul Bourget et par le clergé catholique qui se montrait alors fort hostile aux revendications du féminisme en progrès. Et, ce faisant, l’on prétendait ramener la famille au type primitif, depuis toujours existant, que Dieu même prit la peine d’établir lorsque, fabriquant le père Adam et la mère Ève, il leur enjoignit de procréer des rejetons.
Mais les recherches sociologiques ont réduit à néant ces prétentions : notre mariage actuel n’a rien de primitif ; au cours des âges, les institutions familiales ont subi de prodigieuses transformations ; et les rapports de parenté, la filiation même n’eurent pas la fixité que les bien-pensants supposent. La promiscuité sexuelle totale, tel fut l’état des premiers hommes, probablement. On l’a contesté parce que polygamie ou monogamie se rencontrent déjà chez un grand nombre d’animaux et qu’elles constituent la règle générale chez les singes anthropoïdes. L’argument n’est pas sans valeur ; toutefois les exemples sont empruntés à des espèces dont les individus vivent, non par bandes, mais isolément. Lorsqu’ils s’associent en groupes, et ce fut sans doute le cas des hommes primitifs, les animaux s’en tiennent à la promiscuité sexuelle. Les auteurs anciens, Hérodote en particulier, signalent de nombreux peuples, ainsi les Agathyrses et les Massagètes, où tous les hommes et toutes les femmes pouvaient s’unir librement ; Strabon dit la même chose des Celtes d’Irlande et Pline des Garantes. Plus près de nous, on aurait découvert des mœurs analogues aux îles Andaman, chez les Haïdahs, chez les Indiens de la Vieille Californie, en Syrie chez les Ansariehs et les Yazidiés, etc. Mais beaucoup pensent que l’on a confondu la promiscuité avec le mariage par groupes, premier essai de réglementation sexuelle. Dans ce cas, les mariages sont interdits entre personnes d’un même clan et les hommes d’un clan doivent s’unir aux femmes d’un autre clan de la même tribu. C’est chez les Australiens et chez certaines peuplades de l’Inde que le mariage par groupes se trouve sous sa forme la plus accentuée. Ainsi chaque tribu de Kamilaroï comprend deux clans et les hommes d’un clan traitent en épouses toutes les femmes de l’autre clan, sans avoir le droit d’entretenir des relations sexuelles à l’intérieur de leur propre clan. C’est à Hovvitt et Fison, qu’est due l’expression de « mariage par groupes » ; ces sociologues ont recueilli une documentation abondante sur la mise en pratique et les modalités de ce genre d’union. Chez les Australiens Wotjoballuk du Nord-Ouest de Victoria, dont la tribu est divisée en Gamutch et en Krokitch, les hommes du clan Gamutch sont naturellement les maris des femmes du clan Krokitch et réciproquement.
« Mais ce n’est qu’un droit virtuel. En pratique, pendant les grandes fêtes de l’initiation, les vieux de la tribu, réunis en conseil, distribuent entre les garçons d’un clan les filles disponibles de l’autre clan. Le mariage, appelé « Pirauru » chez les Dieri et connu des colons sous le nom de « Paramour custon », donne le droit à l’homme du clan Gamutch, par exemple, de faire acte de mariage avec les femmes ainsi désignée du clan Krokitch, quand l’occasion s’en présentera. Cependant, comme la même femme peut être « allouée » dans la succession des fêtes à plusieurs hommes, il y a certaines règles de préséance à observer dans l’accomplissement des devoirs conjugaux, si le hasard met deux hommes en présence de leur femme commune ; le frère aîné a alors le pas devant le cadet, l’homme âgé devant le jeune, etc. »
L’idée d’exogamie, c’est-à-dire d’union en dehors du clan, est intimement associée, on le voit, à celle du mariage par groupe. Elle aurait eu pour but d’éviter les conséquences désastreuses que provoquent les relations sexuelles entre parents trop proches. Lubbock écrit :
« L’avantage des croisements si bien connu des éleveurs de bestiaux devait donner bientôt aux races qui pratiquaient l’exogamie une prépondérance marquée sur les autres races : nous n’avons donc pas lieu d’être surpris que l’exogamie soit devenue si générale parmi les sauvages. Quand cet état de chose eût duré quelque temps, l’usage, comme le fait si bien observer Mac Lennan, a dû produire un préjugé chez les tribus qui observaient cette coutume, ‒ préjugé aussi fort qu’un principe religieux, comme est apte à le devenir tout ce qui a trait au mariage ‒ contre l’idée d’épouser une femme de sa tribu. »
Du point de vue biologique, ce qu’affirme Lubbock est discutable ; par contre il faut reconnaître que la pratique de l’exogamie fut presque générale, et qu’elle a laissé des traces chez un très grand nombre de peuples.
De la communauté primitive des femmes ou du mariage par groupes devait sortir la polyandrie, caractérisée par l’union d’une femme et de plusieurs maris. Elle fut pratiquée chez les anciens arabes, d’après Strabon :
« La communauté des biens existe entre tous les membres d’une même famille, écrivait cet auteur, mais il n’y a qu’un maître, qui est toujours le plus ancien de la famille. Ils n’ont aussi qu’une femme pour eux tous. Celui qui, prévenant les autres, entre le premier chez elle, en use après avoir pris la précaution de placer son bâton en travers de la porte (l’usage veut que chaque homme porte toujours un bâton). Jamais, en revanche, elle ne passe la nuit qu’avec le plus âgé, avec le chef de la famille ; une semblable promiscuité les fait tous frères les uns des autres. Ajoutons qu’ils ont commerce avec leur propre mère. En revanche, l’adultère, c’est-à-dire le commerce avec un amant qui n’est pas de la famille est impitoyablement puni de mort. »
Mac Lennan signale l’existence de la polyandrie aux îles Marquises, en Nouvelle-Zélande, aux îles Canaries, chez quelques Iroquois, etc. ; mais c’est l’Inde et surtout le Tibet qui constituent par excellence ses pays d’élection. Sauf chez les Cosaques Zaporogues, où elle se rapprocherait singulièrement de la communauté des femmes et chez quelques autres peuplades dont les habitudes sexuelles sont difficiles à rattacher à un type bien défini, la polyandrie revêt la forme fraternelle, c’est-à-dire que les maris d’une même femme sont frères. Au Tibet, elle se combine avec le droit d’aînesse et le patriarcat ; l’aîné est l’héritier unique, mais ses frères plus jeunes participent à sa femme comme à ses biens.
La recherche de la paternité étant en règle générale impossible, tant que duraient et la promiscuité sexuelle et la communauté des femmes et le mariage par groupe et la polyandrie, au moins dans quelques-unes de ses formes peu évoluées, c’était par les femmes qu’on établissait filiation et parenté. Sur l’enfant, le père n’avait aucun droit, il appartenait à la mère qui l’élevait et lui donnait son nom ; ce nom se perpétuait par les filles, non par les garçons. À ce système, que découvrirent Bachofen et Mac Lennan, on a donné le nom de matriarcat. Très opposé à nos habitudes actuelles, il a laissé des traces, même chez les peuples occidentaux et n’a pas encore totalement disparu du globe. Giddings écrit :
« Dans la trente-troisième année de Ptolémée Philadelphe, la matronymie était encore la loi de l’Égypte. Les parties comparaissaient dans les actes publics comme les fils de leur mère, sans que le nom du père fut mentionné. Les parentés Se comptaient d’abord par les mères chez les Germains et probablement chez les Grecs. »
De son côté Letournean déclare :
« Le clan peau-rouge, d’après Giraud-Teulon, est une petite république ayant droit au service de toutes les femmes pour cultiver le sol, à celui de tous les hommes pour la chasse, la guerre, la vendetta. C’est à la femme qu’appartient le wigwam ou la loge familiale, ainsi que tous les objets possédés par la famille, et le tout se transmet par héritage, non au fils, mais à la fille aînée ou à la plus proche parente maternelle, parfois au frère de la morte. Pourtant cet héritage doit s’entendre dans le sens d’un simple usufruit. En réalité, c’est le clan maternel qui était propriétaire et aucun des membres de la communauté ne pouvait aliéner sérieusement le fonds social. Seulement, dans la plupart des tribus, le mari n’avait aucun droit sur les biens et sur les enfants ; tout cela restait dans le clan maternel ; c’était la filiation maternelle qui réglait le nom, le rang, les droits successoraux. »
Chez les Australiens Wotjoballuk, dont nous avons déjà parlé, les enfants d’un homme Gamutch marié à une femme Krokitch et les enfants d’un homme Krokitch, marié à une femme Gamutch, sont la propriété du clan maternel. Cette filiation utérine a pour effet d’empêcher les mariages entre parents très proches. Sans doute, théoriquement, un père Krokitch pourrait épouser sa fille Gamutch ; mais ces cas sont évités en pratique par l’existence de classes dans la tribu et la prohibition de l’accouplement entre les membres de certaines classes. Morgan, qui étudia soigneusement la parenté, a dressé un remarquable tableau des liens de famille, chez cent trente neuf peuples ou tribus. Tous ces systèmes de parenté sont ramenés par lui à deux grandes classes : la parenté par description, celle des races aryennes, ouraliennes et sémitiques, qui n’admet la classification des parents que lorsqu’elle concorde avec le système numéral et qui désigne d’ordinaire les consanguins collatéraux par modification ou combinaison des termes fondamentaux de parenté ; et la parenté par classification, celle des races américaines, malaises, touraniennes, qui, confondant des parentés distinctes dans le système précédent, réduit la consanguinité à de grandes classes, coupées dans la série des générations. Ainsi dans sa forme la plus simple, chez les Maoris et les Micronésiens, on distinguera cinq groupes : le premier formé de l’individu, de ses frères, sœurs et cousins ; le second formé de son père, de sa mère, ainsi que de leurs frères, sœurs et cousins ; le troisième qui réunit ses grands-parents avec leurs frères, sœurs, cousins ; le quatrième composé des cousins de ses enfants qu’il considère comme ses fils et filles ; le cinquième groupant les petits-enfants de ses frères et sœurs qu’il considère comme ses petits-enfants. Naturellement, chez les peuples où règne ce système de parenté et qui pratiquent le mariage par groupes et l’exogamie, les craintes relatives à l’inceste ne sont pas les mêmes que chez nous. Si les rapports sexuels avec les personnes d’un clan prohibé sont généralement punis de mort en Australie, ce n’est pas semble-t-il à cause de la consanguinité, mais en vertu d’un des nombreux tabous qui défendent de toucher aux personnes de même espèce totémique. Le totémisme dut jouer un grand rôle dans l’établissement de l’exogamie, car, chez les primitifs, le lien totémique est plus fort que le lien du sang dans nos sociétés modernes. C’est avec lenteur probablement que la filiation paternelle se substitua au matriarcat. La coutume du rachat des fils par le père, chez les Limbous de l’Inde, alors que les filles restent propriété de la mère, constitue peut-être une forme de passage.
Dans les sociétés à filiation utérine, la femme jouait certainement un rôle important ; chez les peaux-rouges, elle avait la première place dans la vie domestique et disposait des provisions ; d’après Wright, malheur au mari, mauvais chasseur, qui revenait sans venaison suffisante. Mais, sauf de rares exceptions, l’influence des femmes n’était pas prépondérante dans le gouvernement de la cité. Chargées de tout le travail industriel et agricole, elles avaient un sort peu enviable dans les tribus américaines ; toutefois, elles intervenaient dans la vie politique chez les Iroquois et c’était un conseil composé de quatre femmes qui, chez les Wyandots, élisait le chef du clan. Chez les Natchez, au début du XVIIIème siècle, la plus proche parente du chef ou soleil, mère de l’héritier présomptif de ce dernier, s’appelait femme-chef ou femme-soleil et avait droit de vie et de mort sur les membres de la tribu. En Afrique la filiation utérine s’allie à l’omnipotence du mari qui traite sa conjointe en véritable esclave. La femme n’ayant pas la force physique suffisante pour diriger le groupe, c’est à son frère que revenait souvent l’autorité principale. Tacite remarquait que le parent le plus proche d’un enfant, chez les Germains, c’était l’oncle maternel ; Lubbeek fait la même remarque touchant les peaux-rouges :
« Bien que le frère de la mère d’un individu, écrit-il, s’appelle son oncle, il a en réalité plus de pouvoir et de responsabilité que le père. Le père se trouve classé au même rang que le frère du père et la sœur de la mère ; l’autorité paternelle est exercée par le frère de la mère. En résumé, quoique les termes expriment la parenté suivant la coutume du mariage, les idées reposent sur l’organisation de la tribu. »
Au matriarcat succédera le patriarcat, fondamental dans la législation romaine ; Il n’admettait que la parenté par les mâles. De même qu’on ne peut avoir aujourd’hui qu’une nationalité, de même, à Rome, on ne devait appartenir qu’à une famille, celle du père. Le droit moderne reconnaît la parenté aussi bien dans la ligne maternelle que dans la ligne paternelle ; néanmoins, influencé par la tradition judéo-chrétienne et par les écrits des légistes romains, il favorise singulièrement le père au détriment de la mère ; c’est le premier qui donne son nom à l’enfant et qui exerce l’autorité dans la famille ; la femme, éternelle mineure, reste constamment sous la tutelle de son mari. Pourtant la filiation maternelle est facilement constatable, alors que la filiation paternelle ne saurait être démontrée scientifiquement dans l’état de nos connaissances biologiques. De plus, dans la reproduction, c’est à la femme qu’incombent les charges pénibles ; alors que l’homme se borne à jouir, la mère a les ennuis de la grossesse, les douleurs de l’accouchement ; et c’est d’elle encore, de son lait et de ses soins, que le tout jeune enfant a besoin. Aussi, révisant les idées consacrées par les codes modernes, plusieurs revendiquent présentement pour elle le privilège de donner son nom à ses enfants, et d’être chargée de leur éducation, du moins tant qu’ils demeurent privés de la raison. Une réforme de ce genre aurait l’avantage de supprimer l’abominable distinction, établie par nos lois bourgeoises, entre l’enfant issu de relations libres et celui qui est né du mariage ; entre les unions dites légitimes parce que les conjoints passent à l’église ainsi qu’à la mairie, et celles que les bien-pensants réprouvent comme contraires aux règles édictées par le pape et les parlements. De cette vue d’ensemble sur les relations familiales dans l’humanité primitive, retenons encore que les rapports sexuels entre maris et femmes ont singulièrement changé au cours de l’évolution. Et suivons avec sympathie les efforts de ceux qui veulent innover dans ce domaine particulièrement difficile et dangereux. L’insuffisance de l’éthique actuelle éclate aux yeux des moins prévenus ; éclipsé à notre époque par les préoccupations d’ordre économique, le problème sexuel s’imposera avec une acuité particulière après l’effondrement définitif de la morale religieuse. Aucune expérience ne doit donc être dédaignée ; toute tentative intéressante mérite d’être accueillie sans prévention. Mais lorsque certaines féministes prônent le matriarcat, dans le but avoué d’assurer la prépondérance politique aux femmes, je reste sceptique. Non que je refuse aux épouses des droits égaux à ceux des maris ; seulement, nantis de l’autorité, elles prendront les défauts des tyrans masculins.
‒ L. BARBEDETTE.
OUVRAGES A CONSULTER. ‒ Summer Maine, Les Institutions primitives. ‒ Engels, Les Origines de la Famille. ‒ Le Play, Réforme sociale. ‒ Letourneau, L’Évolution du Mariage et de la Famille. ‒ Starcke, La Famille primitive. ‒ Lubbock, Les Origines de la Civilisation ; L’Homme préhistorique. ‒ Frazer, Le Totémisme, etc.
MATURITÉ
n. f. (du latin maturitas, de maturus, mûr)
La nature ne connaît pas l’immobilité ; tout change, tout varie, tout se transforme dans l’univers. Et dans le domaine de la vie et de la pensée, la maturité caractérise l’état de complet et d’harmonieux développemeru de l’être. Après l’enfance, l’homme passe par l’adolescence, puis arrive à l’âge mùr, époque du cornplet épanouissement de ses forces physiques et mentales. C’est en général à ce moment qu’il donne la mesure de sa valeur et produit des oeuvres durables, s’il en doit produire. Les exercices scolaires et les travaux de jeunesse peuvent fournir tout au plus des indications. Ajoutons que les cerveaux les plus précoces sont loin d’être toujours ceux qui aboutissent aux résultats les meilleurs, de même que les premiers fruits n’ont généralement pas la saveur de ceux qui mûrissent tardivement. Or, dans l’Université, tous les avantages sont pour les esprits précoces ; concours d’entrée pour les grandes écoles, examens divers ne sont accessibles qu’aux jeunes, aux très jeunes même. Et comme la législation moderne se refuse à reconnaître le mérite de l’homme dépourvu de parchemins, il en résulte que les esprits profonds, n’obtiennent pas d’ordinaire les places auxquelles ils auraient droit et que les hauts postes sont occupés par des médiocres, dépourvus de tout pouvoir créateur et jaloux des talents supérieurs. Il est vrai qu’aux grands dignitaires de l’enseignement, l’autorité demande moins de sélectionner les meilleures intelligences que d’écarter les esprits frondeurs, jugés dangereux par l’ordre social. On conçoit que la campagne menée par La Fraternité Universitaire, pour que l’on juge les hommes à l’oeuvre, d’après leurs travaux effectifs plutôt que d’après leurs diplômes scolaires, n’ait pu plaire aux gouvernements. C’est que les fils de la bourgeoisie, supérieurs non par la puissance cérébrale, mais par les droits légaux qui sanctionnent les longues années d’étude consacrées à la conquête d’un parchemin, se verraient souvent rejetés au second rang. Ils cesseraient d’avoir le monopole des postes de commandement ; ce qu’on veut éviter à tout prix.
Les races et les peuples ont, comme les individus, une enfance, une jeunesse, un âge mûr, et, disons-le, une vieillesse et une mort. Clameurs et discours patriotiques ne purent empêcher l’inévitable en Grèce et à Rome, ils n’y réussiront pas davantage à notre époque. La géologie démontre, de son côté, que les espèces animales disparaissent après un temps plus ou moins long, cédant la place à des organismes nouveaux. Notre espèce a-t-elle atteint sa maturité ? Non assurément, elle sort à peine de l’enfance. L’humanité grandie ne connaîtra plus les injustices de l’ordre économique, les chaînes d’une légalité faite par les exploiteurs, les brutalités de la guerre, la division entre maîtres et esclaves. Avec leurs chapelets, leurs médailles, leurs prêtres, les Européens ne sont pas aussi éloignés qu’ils le pensent de la mentalité nègre ; ils n’ont pas le droit de rire des fétiches et des sorciers africains. Et le citoyen conscient. qui court aux urnes a souvent une âme plus servile que celle de l’habitant du Dahomey. Arrivée à son plein développement l’humanité rejettera tous les dieux et secouera toutes les chaînes.
— L. B.
MAXIMALISME
Sous le nom de maximalisme, est désigné, en Russie, un courant d’idées socialistes révolutionnaires qui s’était fait jour au cours de la révolution de 1905–1906. Les partisans de ce courant d’idées, les maximalistes, rejetèrent le programme minimum du parti socialiste-révolutionnaire, se séparèrent de ce dernier et déclarèrent la nécessité de lutter immédiatement pour la réalisation du programme maximum, donc pour le socialisme intégral. Les maximalistes ne formèrent pas de parti politique : ils créèrent l’Union des socialistes-révolutionnaires-maximalistes. L’Union édita quelques brochures exposant son point de vue. Elle publia aussi quelques périodiques, de brève durée. Ses membres furent, d’ailleurs, peu nombreux. Elle développa toutefois une forte activité terroriste, prit part à toutes les luttes révolutionnaires, et fut assez connue. Plusieurs de ses membres périrent en véritables héros. Comme tous les autres courants d’idées autres que le bolchevisme, le maximalisme fut écrasé par ce dernier.
Par l’ensemble de leurs idées, les maximalistes se rapprochent beaucoup de l’anarchisme. Le maximalisme, en effet, est antimarxiste. Il nie l’utilité des partis politiques. Il critique violemment l’État, l’Autorité. Toutefois, il n’ose pas y renoncer immédiatement et complètement. Il croit indispensable de les conserver encore pour quelque temps jusqu’à leur disparition complète. En attendant, il propose la fondation d’une République Laborieuse où les principes d’État et d’Autorité seraient réduits au minimum. Le maintien « provisoire » de l’État et de l’Autorité sépare nettement le maximalisme de l’anarchisme.
MAZDÉISME
n. m. (du zend mazdâo, grandement savant, omniscient)
On ne sait dans quelle partie exacte de l’Iran, le mazdéisme ou zoroastrisme prit naissance. Ce fut sans doute dans une contrée particulièrement froide, puisque le soleil et le feu sont pour lui des divinités bienfaisantes, alors qu’il voit dans l’hiver une création diabolique. D’après la légende, cette religion aurait pour fondateur un prêtre, Zoroastre (Zarathustra), mède ou bactrien qui vécut vers 1100 avant l’ère chrétienne. Mais sur lui nous ne savons rien de positif et beaucoup d’historiens mettent son existence en doute. Ahura-Mazda ou Ormazd, le dieu bon, lui aurait dicté en personne le texte de l’Avesta. Cyrus connaissait déjà les préceptes de Zoroastre, puisqu’il s’est conformé à l’un d’eux en détournant le cours du Gyndanès pour retrouver le cadavre d’un cheval qui souillait les eaux. Darius, dans ses inscriptions, invoque Ahura-Mazda qui, pour lui, n’est pas le dieu unique, mais le plus grand des dieux. Jamais ce prince ne fait allusion à Angra-Mainyu, dieu du mal, l’Ahriman du persan moderne ; d’où l’on a parfois conclu, mais sans preuves, qu’il ignorait la dualité mazdéenne. Par contre, que la religion des Achéménides diffère sur plusieurs points de celle que pratiqueront plus tard les Sassanides, c’est ce que confirme la lecture d’Hérodote.
L’Avesta actuel, appelé encore Zendavesta, le livre sacré dès mazdéens, n’est qu’une minime partie de l’ouvrage primitif. Adopté par les Sassanides, vers 230 de notre ère, il comprend des morceaux très anciens et d’autres beaucoup plus modernes. La mythologie de l’Iran et la légende de Zoroastre y voisinent avec des recettes pharmaceutiques, des hymnes en dialecte archaïque, des formules de prières. Tant d’inepties fourmillent d’un bout à l’autre que Voltaire déclarait :
« On ne peut lire deux pages de l’abominable fatras attribué à ce Zoroastre sans avoir pitié de la nature humaine. Nostradamus et le médecin des urines sont des gens raisonnables en comparaison de cet énergumène. »
Animisme et totémisme ont laissé, dans ce livre, des traces nombreuses ; animaux, plantes, éléments y sont personnifiés. D’innombrables prohibitions y sont annoncées dans un style alambiqué et prétentieux. À la demande de Zarathustra qui voulait connaître « l’acte le plus énergiquement mortel par lequel les mortels sacrifient aux démons », Athura-Mazdu, répondit :
« C’est quand ici les hommes, se peignant et se taillant les cheveux ou se coupant les ongles, les laissent tomber dans des trous ou dans une crevasse. Alors, par cette faute aux rites, il sort de la terre des Daévas, des Khrafstas que l’on appelle des poux et qui dévorent le grain dans les greniers, les vêtements dans la garde-robe. Toi donc, ô Zarathustra, quand tu te peignes, ou te tailles les cheveux, ou que tu te coupes les ongles, tu les porteras à dix pas des fidèles, à vingt pas du feu ; à cinquante pas des faisceaux consacrés du baresmân. Et tu creuseras un trou profond et tu y déposeras tes cheveux en prononçant à haute voix ces paroles, etc. »
Pourtant, de l’Avesta se dégage une leçon de justice, d’élévation morale, un désir de progrès et même un souci d’hygiène qui placent le mazdéisme au premier rang des religions orientales.
C’est dans la lutte du bien et du mal, d’AhuraMazria et d’Angra-Mainyu, que le Zoroastrisme résume l’essentiel de sa doctrine. Le premier, créateur du monde, est aidé dans sa tâche par six divinités principales, dont Straosha qui juge les âmes après la mort, et par des myriades de génies qui personnifient soit des abstractions morales, soit des forces de la nature. Mais sa puissance est limitée ; contre lui se dressent le dieu des ténèbres, Angra-Mainya, et l’armée de démons malfaisants qu’il dirige ; de ces derniers, six occupent une place prépondérante, les autres, les drujs, sont chargés de lutter à outrance contre les esprits créés par Ahura-Mazda. En nombre égal, bons et mauvais génies ont chacun un adversaire particulier qui entrave leur influence. Après de longs combats, Ahriman sera vaincu, grâce au secours que les prières et les sacrifices des hommes apportent au dieu bon, grâce aussi à Sraosha resté fidèle. Alors naîtra un Messie, Bahram-Amavand, qui ressuscitera les morts ; les justes seront séparés des pécheurs, dont la peine toutefois ne sera pas éternelle et qui, après une purification générale du monde, deviendront à leur tour des adorateurs d’Ormazd.
Toute souillure étant produite par un démon, les purifications jouent un rôle primordial dans le mazdéisme. Plusieurs sont d’une complication qui dut rendre leur observance difficile, même autrefois. Des peines corporelles sont exigées dans certains cas ; il faut 2.000 coups de verge pour racheter une offense Involontaire à la pureté. La destruction d’animaux néfastes rentre aussi parmi les pénitences imposées :
« Il tuera 1.000 serpents, dit l’Avesta, il tuera 1.000 grenouilles de terre, 2.000 grenouilles d’eau ; il tuera 1.000 fourmis voleuses de grains et 2.000 de l’autre espèce. »
Souiller la terre, l’eau ou le feu est un véritable crime. Pline l’Ancien raconte qu’un mage se refusait à naviguer pour ne point salir l’eau avec ses excréments ; et c’est pour n’avoir ni à brûler, ni à ensevelir le cadavre humain, chose impure par excellence, que les Parsis le donnent à manger aux vautours. Le repentir efface certaines fautes, mais il en est d’inexpiables ; des offrandes aux temples permettent de se racheter des pénitences corporelles.
Le sacerdoce est héréditaire, mais le fils d’un prêtre doit subir trois initiations successives avant d’être prêtre lui-même : la première, à l’âge de sept ans et demi, le fait entrer dans la communauté mazdéenne ; elle consiste en un bain rituel, suivi de l’imposition d’une camisole et d’une ceinture de laine, faite de soixante-douze fils entrelacés, que les Parsis portent sur eux constamment. Dans les temples, une chambre obscure abrite un feu éternel, dont l’entretien est minutieusement réglé ; pour ne le souiller ni par son attouchement ni par son haleine, le prêtre qui l’approche porte aux mains des gants et un voile devant la bouche. Des offrandes de viande, de lait, de fleurs, de fruits, de petits pains non levés ont lieu ; la plante liturgique par excellence est le haôma dont les feuilles jaunes sont douées de vertus surnaturelles. Sa cueillette, sur I’Elbruz, est faite par les prêtres, avec des faisceaux de baguettes sacrées appelées baresmân et suivant des rites invariables.
L’urine de bœuf, qui intervient dans certaines purifications, est douée pareillement de propriétés magiques. Dans l’ordre moral le mazdéisme prescrit la sincérité, l’amour du travail ; il condamne la contemplation stérile et l’ascétisme contraire à la nature. Un liquide extrait de l’haôma est versé par le prêtre dans la bouche et les oreilles du Parsi à l’agonie ; après la mort son cadavre est porté, à Bombay du moins, sur les fameuses tours du silence signalées par tous les voyageurs. Des oiseaux de proie viennent dévorer les chairs ; et les os qui restent sont jetés dans un puits central. Pour le mazdéen, le mariage consanguin est presque une obligation ; chaque homme ne doit avoir qu’une seule femme, néanmoins, si elle est stérile, il peut, avec sa permission expresse, en épouser une seconde.
Quand le dernier roi des Sassanides, Yezdigerd, dut s’enfuir, après des défaites répétées, devant l’envahisseur musulman, quelques zoroastriens suivirent Firouz, fils du roi, dans le Turkestan d’abord, puis en Chine. Un nombre beaucoup plus considérable gagna le Konhistan ; d’où, cent ans plus tard, leurs descendants partiront pour la ville d’Ormuzd sur le golfe Persique. Ils y séjourneront quinze ans, puis s’embarqueront pour l’Inde ; établis à Dia d’abord, ils s’installeront, dix-neuf ans plus tard, à Sandjan et ne tarderont pas à se répandre dans d’autres localités. Vainqueurs des musulmans qui s’avançaient du côté de l’Inde, ils seront, ensuite, irrémédiablement battus et tomberont dans une complète décadence. Au début du XVIIIème siècle, le sort des mazdéens restés en Perse était bien supérieur à celui de leurs frères émigrés dans l’Inde. Mais, depuis, la situation s’est modifiée : les sectateurs de Zoroastre forment à Bombay une colonie extrêmement florissante, alors qu’ils vivent misérablement dans leur pays d’origine. Toutefois ceux de l’Inde ont subi, au point de vue physique, une détérioration due au climat ; ceux de Perse, au contraire, forment une race plus belle et plus saine que la race musulmane qui les environne. Iraniens authentiques, ils ont évité le mélange de sang arabe, mongol et turc qui résulte des invasions successives. D’une religion qui jadis régna sur l’ensemble de la Perse, il ne subsiste, on le voit, que de rares représentants.
Une branche issue du mazdéisme devait jeter dans l’histoire un éclat particulier : nous voulons parler de la réforme manichéenne, opérée au IIIème siècle de notre ère. Son fondateur Mani, ancien élève des mages, fut très mal reçu par eux ; après de nombreux voyages, il finit, à l’âge de 60 ans, sur une croix, comme Jésus. Mais des disciples enthousiastes continuèrent de prêcher sa doctrine, dont l’idée dominante reste celle du combat entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres avec, en plus, des éléments empruntés tant au christianisme qu’au bouddhisme. Persécutés en Perse, les manichéens se répandirent vers l’Inde, le Turkestan, la Chine et aussi vers la Syrie et le nord de l’Afrique. Dioclétien, puis les empereurs chrétiens prirent de sévères mesures contre eux ; poursuivis d’une façon impitoyable par Justinien et ses successeurs, on les retrouve néanmoins en Arménie sous le nom de Pauliciens, du VIIème au XIIème siècle, et en Thrace sous celui de Bogomiles, au Xème et XIème siècles. En France, ils donnèrent naissance, à la secte des Albigeois ou Cathares, exterminée si cruellement par ordre du pape Innocent III.
Gens fort paisibles, les manichéens furent calomniés et persécutés, par les clergés des Églises existantes, avec un acharnement qui n’était pas désintéressé. Leur doctrine, longuement combattue par saint Augustin, ne manquait ni de poésie, ni de grandeur. Pour eux, Dieu, l’esprit bon, résidait dans le monde de la lumière, avec ses émanations primitives ou éons, et Satan clans celui des ténèbres. Mais ce dernier rêve de conquérir les champs de la lumière éternelle ; pour défendre son royaume, Dieu suscita une émanation nouvelle, l’âme du monde, qui, assaillie par les puissances de la nuit, fut vaincue et mise en pièces. Avec ses débris, l’esprit divin, envoyé à son aide, fit le monde : soleil, lune, étoiles, en sont les parties les plus éthérées, animaux et objets sensibles les parties les plus matérielles. Dispersée dans chacun des atomes de notre univers, l’âme du monde se trouve donc comme emprisonnée ; elle doit lutter contre les entraves qui partout l’enchaînent. Souffrante, cette essence divine s’efforce vers la délivrance ; elle n’est autre que Jésus, messager de lumière, dont la naissance et la mort ne furent que de trompeuses apparences. Ce n’était point, pensaient les manichéens, pour répandre un sang qu’il n’avait pas que le Christ était venu sur la terre, mais pour apporter une vérité capable d’attirer les parties spirituelles égarées dans la matière. Dans l’homme, si l’âme était lumineuse le corps était obscur ; aussi est-ce à l’affranchissement de l’âme captive et à son ascension vers le soleil, séjour du Christ, qu’il importait de travailler durant la vie présente. Ici-bas on trouvait des pneumatiques ou parfaits, capables de se débarrasser de la chair et de se purifier dans la lumière ; ils formaient le clergé manichéen et s’abstenaient du mariage, de viande, de vin. Mais la masse des fidèles était composée de psychiques, passionnés, faibles quoique non mauvais, qui devaient recommencer une vie nouvelle dans d’autres corps. Au-dessous les hyliques, pécheurs incorrigibles, en puissance des démons, ne pouvaient espérer l’immortalité future. Ainsi, l’âme ordinaire avait à traverser plusieurs existences, soit dans d’autres hommes, soit dans des animaux ou même des plantes, avant de se réunir au principe divin ; c’était le dogme de la métempsycose, très répandu dans l’antiquité et que les théosophes continuent d’admettre aujourd’hui. La religion manichéenne était fort simple ; elle comportait des jeûnes, des prières, une sorte d’initiation donnée, en général, à l’article de la mort parce qu’elle assurait la remise des fautes passées. Sa morale se résumait dans les trois sceaux : sceau des lèvres, sceau des mains, sceau de la poitrine. Le premier avait pour but de fermer la bouche au blasphème et à toute nourriture animale ; le second portait défense de tuer les animaux et de cueillir les plantes, vrais soupiraux de la terre, dont les parfums et les exhalaisons sont des essences divines s’élevant vers le ciel ; le troisième fermait le cœur aux passions, le mariage et la procréation des enfants ne pouvant s’accommoder d’une vie parfaite. C’est surtout parce qu’il ne poussait point à la multiplication de l’espèce humaine que le manichéisme fut, de bonne heure, suspect aux pouvoirs publics.
Saint Bernard, n’ayant pu convertir les Albigeois français, dont la doctrine s’inspirait de celle des Pauliciens bulgares, l’Église leur déclara une guerre implacable. Une croisade fut prêchée contre eux et, durant vingt ans on tua sans pitié dans la région du Midi occupée par ces hommes inoffensifs. À Béziers soixante mille personnes périrent, catholiques ou albigeois : « Tuez-les tous, avait dit le légat du pape, Dieu reconnaîtra les siens ». Et Simon de Montfort n’entendit faire grâce à personne, pas même à ceux qui abjuraient : « S’il est sincèrement converti, disait-il de l’un de ces derniers, il expiera ses péchés dans la flamme qui purifie tout ». D’innombrables malheureux montèrent sur les bûchers ou pourrirent dans les geôles de l’Inquisition. Ainsi disparut le manichéisme qui avait recruté de nombreux partisans sur le sol français.
‒ L. BARBEDETTE.
OUVRAGES À CONSULTER. ‒ Darmesteter, Ormazd et Ahriman, Le Zendavesta. ‒ Henry, Le Parsisme. ‒ Bréal, Le Zendavesta. ‒ Söderblom, La vie future d’après le mazdéisme. ‒ Jackson, Zoroaster. ‒ De Stoop, La diffusion du manichéisme dans l’Empire romain. ‒ Luchaire, Innocent III et la croisade des Albigeois, etc.
MÉCANICIEN
n. m.
Celui qui s’occupe de construction mécanique, qui dirige une machine ou la conduit.
Dans la construction mécanique moderne, le mécanicien est dédoublé à l’infini. C’est ainsi que l’on doit distinguer entre un ajusteur, un tourneur, un traceur, un monteur, un modeleur. L’emploi de chacun est différent, mais ils travaillent tous dans la mécanique.
Cependant, dans la pratique, n’est qualifié de mécanicien que l’ouvrier dont les connaissances s’étendent à l’assemblage des pièces usinées, à leurs relations, à leur fonctionnement, à la mise en état de marche de la machine construite ; en un mot seul est mécanicien celui qui connaît la mécanique dans son application générale.
L’ouvrière qui, dans la confection de l’habillement, de la chaussure, coud à la machine est, aussi, appelée mécanicienne. Par définition, le mécanicien est le complément de la machine, ce qui lui manque, c’est-à-dire : sa vue et son cerveau.
La puissante locomotive qui remorque à vive allure des tonnes de marchandises ou des centaines de voyageurs, est appelée machine. L’homme, qui voit et pense pour elle est appelé mécanicien.
Dans la voie où la vie moderne s’est engagée, l’habile mécanicien jouera un rôle de premier ordre .
‒ RIPOLL.
MÉCANIQUE
n. f. (grec : Mêkhané, machine)
Se dit de la partie des mathématiques qui a pour but l’étude des lois du mouvement et de l’équilibre, ainsi que de leur application.
Pratiquement, la mécanique est l’art d’imiter, de reproduire artificiellement tous les mouvements de l’espèce animale et d’en accélérer le rythme.
C’est ainsi que, dans le déplacement, la locomotive, l’automobile, l’avion sont intervenus utilement.
Dans l’exercice musculaire qu’exige la production pour la satisfaction des menus besoins de la vie quotidienne, la mécanique est venue augmenter le rendement d’une façon considérable. Cette science est l’une des plus belles découvertes de l’homme, si l’on se rapporte à tout ce qu’elle a d’humain dans son application pratique. Une griffe accouplée à un levier, lui-même déplacé par une bielle, n’est-ce point l’articulation combinée du bras, de l’avant-bras et de la main ? Et combien plus rapide.
La mécanique a tout de l’homme, excepté cependant la vue et le cerveau.
Aussi dit-on d’un travail où l’intelligence n’a que peu de part, qu’il est mécanique.
Tel homme qui répète une fable ou tout autre chose sans ardeur ni flamme, sans comprendre ce qu’il fait ou dit, qui se meut, s’agite à une cadence régulière et toujours irréfléchie, agit mécaniquement, sans penser.
Présentement, hélas ! la mécanique, par ses applications désordonnées, est un facteur de désordre et de misère ; le chômage si préjudiciable aux producteurs est un enfant né de l’application mécanique. (Voir machine, machinisme.)
Cependant, dans une société humaine comme la rêvent les anarchistes, la mécanique sera une grande amie de l’homme, la préservatrice de ses muscles et de son temps, en lui fournissant abondamment tout ce dont il aura besoin, chassant et le souci et la fatigue.
Puisse ce temps ne pas être trop éloigné !
‒ On appelle également mécanique un dispositif placé à côté d’un conducteur de voiture hippomobile et qui sert à freiner les roues de celle-ci.
‒ J. RIPOLL.
MÉCANISME
n m. (bas latin mechanisma, de mékhané)
Ensemble des pièces qui composent une machine. Au fig. combinaison d’éléments : mécanisme du langage, du raisonnement, etc. Ensemble de procédés manuels mécaniques dont l’artiste ne peut se désintéresser, etc.
Philosophie. ‒ Système qui explique tous les phénomènes par des actions mécaniques, les ramène aux propriétés mécaniques de la matière. « Le mécanisme, comme cause immédiate de tous les phénomènes de la nature, était devenu, disait Maine de Biran, le signe distinctif des Cartésiens. » Pour Descartes, en effet, rien, à l’exception de la pensée, n’échappe au mécanisme. Plus uniciste, le matérialisme moderne, au moins en certaines de ses tendances, incorpore au « mécanisme » (un mécanisme à la fois souple, évolutif et vivant) la pensée elle-même. (Voir Matérialisme).
MÉCÈNE
n. m.
Mécène fut un favori d’Auguste qui encouragea les artistes et les poètes, en particulier Virgile, Horace et Properce. Son nom est devenu, par la suite, synonyme de protecteur des lettrés, des savants et des artistes ; il s’applique couramment aujourd’hui en guise d’adjectif ou de nom commun. De même le préfet « Poubelle » fut immortalisé grâce aux boîtes à ordures dont il fut l’inventeur et Barrême grâce au livre des Comptes Faits qu’il publia au XVIIème siècle. Les rois et les papes se donnèrent souvent des allures de mécènes ; ainsi Léon X, françois Ier, Louis XIV. C’était une adroite façon de domestiquer les intellectuels, et de faire servir à leur glorification personnelle les talents des peintres, sculpteurs, architectes et écrivains. Corneille ayant paru trop indépendant à Richelieu fut congédié par lui, comme n’ayant pas l’esprit de suite. Louis XIV s’opposa longtemps à l’élection de La Fontaine à l’Académie, parce qu’il était l’auteur de Contes jugés immoraux par ce souverain, dont les bonnes fortunes furent innombrables. Plier l’échine, se montrer docile, célébrer le maître, telles étaient les conditions primordiales pour rester bien en cour et se voir servir une maigre pension. Naturellement toute velléité révolutionnaire, toute critique du régime établi devaient être rigoureusement bannies. On arrivait ainsi aux platitudes d’un Bossuet, que-l’on a loué surtout parce qu’il représente l’ordre, la tradition, le catholicisme dans notre littérature. Malheur au candidat qui s’aviserait, aujourd’hui encore, de dire ce qu’il pense de cette baudruche, gonflée outre mesure par les critiques universitaires ! Si les rois ont disparu, la corruption continue de sévir comme autrefois.
« Chez nous l’Académie, corruptrice officielle, joue un rôle prépondérant dans l’achat des consciences ; citadelle du traditionalisme le plus borné, elle met au service de la réaction, ses immenses richesses et son influence. À ses yeux, l’art n’est admissible qu’à la remorque de la Finance ou de l’Église ; la franchise est une tare qu’elle ne pardonne pas. Pourquoi ce protestant, cet israélite, ce libre-penseur saluent-ils si bas nos puissants prélats, pourquoi une telle déférence à l’égard des plus sots préjugés ? Travail d’approche, prélude d’une candidature ; l’échine doit être souple lorsqu’on fut rouge et mécréant. D’où ces transformations savantes qui vous blanchissent un écrivain, ces conversions lentes ou brusques qui camouflent en partisan de l’ordre un ancien champion de la république. » (Le Règne de l’Envie)
Si, durant quelques années, l’Académie Goncourt put paraître un peu moins réactionnaire que son aînée l’Académie Française, il appert qu’elle aussi est en voie de se convertir et de prendre ses directives dans les sacristies. Comme, d’ailleurs, l’immense majorité de tous les organes soi-disant littéraires, ouverts seulement aux adorateurs du veau d’or et aux serfs de notre « saint-père » du Vatican. Elles foisonnent, ces ignobles feuilles parisiennes : Nouvelles Littéraires, Candide, Gringoire, etc., qui se croiraient déshonorées de citer les organes ou les litres d’avant-garde. Et le chantage des éditeurs qui ne publient que les écrits bien comme il faut ! À notre époque, autant, plus même qu’autrefois, il faut se résoudre à n’être qu’un valet de plume si l’on veut avoir sa place marquée au râtelier officiel.
Quant aux écrivains, aux savants, aux artistes qui restent en dehors des cénacles et des partis, qui se refusent à encenser personne, ils savent que de mécènes ils n’en rencontrent jamais. Aujourd’hui surtout où la bourgeoisie s’est tournée en bloc vers l’Église, maudissant les libres esprits qu’elle regrette d’avoir applaudis autrefois. Et tous ceux qui, à un titre quelconque, sont mêlés au mouvement d’avant-garde, tous ceux qui s’efforcent de faire vivre une publication propre ou de propager une ligue, un mouvement, savent au prix de quelles difficultés effroyables ils parviennent à boucler leur budget, quand ils y parviennent. Mais consentez seulement à être spirite ou théosophe, à garder la croyance en Dieu tout en rejetant les dogmes, à admettre un christianisme édulcoré, et des dames riches, de généreux bienfaiteurs se rencontreront pour remplir votre escarcelle vide. Demandez plutôt à Krishnamurti, le nouveau messie inventé par Annie Besant ! L’athée, lui, ne peut attendre que persécution des bien-nantis, même lorsqu’ils se disent anticléricaux.
MÉDECIN
n. m. (du latin medicus)
Le médecin est un homme parmi les hommes, un être exerçant la médecine et vivant au sein d’une société qui agit sur lui de toute sa puissance collective et sur laquelle il réagit dans la mesure de ses moyens individuels. En d’autres termes, il s’avère fonction du milieu qu’il habite, et modifie cette ambiance selon les possibilités, très souvent restreintes ou nulles, de sa propre personnalité. La société fait le médecin ; chaque époque de l’histoire a les médecins qu’elle mérite. Pour savoir ce que le médecin fut autrefois, est aujourd’hui, deviendra demain, il faut, et cela suffit, étudier le passé, examiner le présent, scruter l’avenir de la civilisation.
Tout de suite, il apparaît que, dans les premiers groupements ethniques entrés dans l’histoire, les médecins étaient les prêtres. Durant leurs primitifs balbutiements, l’art et la science évoluèrent dans le domaine du merveilleux ; et, à l’instar de toutes les spéculations intellectuelles initiales, la médecine s’affirme au début sacerdotale. La superstition voyait dans les maladies des manifestations maléfiques dirigées contre les hommes par les forces inconnues mouvant l’univers et craintes autant que vénérées sous le nom de dieux. Servants et bénéficiaires du culte mystagogique, les prêtres constituaient les intermédiaires obligatoires entre les patients et les puissances du mal. Partout, dans toutes les civilisations antiques de l’Inde, de l’Asie centrale, de l’Asie Mineure, de l’Égypte, de la Grèce, ils soignent par les paroles, les évocations, les incantations, les exorcismes, et aussi par les végétaux et le scalpel. En Grèce, avant la période hippocratique (460 av. J.-C.), la médecine se pratiquait dans les temples d’Esculape, ou asclépions. Le malade était déposé dans le temple, y couchait, recevait le plus souvent la visite du dieu, racontait au réveil les rêves inspirés, dont le prêtre donnait l’interprétation et tirait les formules de traitement. On conçoit aisément quel rôle la mystification et le charlatanisme pouvaient jouer dans cette mise en scène religieuse et cette enceinte sacrée.
Lorsque, par le développement de l’esprit humain, l’exercice de la médecine nécessita la connaissance d’une doctrine et d’une thérapeutique plus positives ; ainsi que celle d’un manuel opératoire précis, elle échappa à la main-mise de la caste des prêtres, ennemis professionnels de la pensée novatrice et de l’action efficace, pour passer à la classe laïque des philosophes, observateurs de la nature et facteurs de progrès. Hippocrate et ses élèves, son contemporain Platon et, à une époque postérieure (350 av. J.-C.), Aristote comptent parmi les plus illustres de ces médecins philosophes, dont les enseignements influencent encore la science médicale moderne.
La force matérielle et la conquête romaines, ruinèrent l’école philosophique ; et les premiers médecins de la république latine furent presque tous des esclaves ou des affranchis, émigrés des colonies grecques ou de l’Asie-Mineure et apportant avec eux une pratique grossière frelatée de thaumaturgie. Venu en 164 de Pergame à Rome, Galien se distingua parmi tous, sortit sa profession de l’ornière de l’empirisme Alexandrin, et fonda la médecine expérimentale par ses recherches anatomiques et physiologiques sur les animaux.
Depuis Galien jusqu’au Moyen-Age et durant celui-ci, la médecine se trouva entre les mains des Arabes, ensuite des Arabistes et de leurs fils spirituels, les Juifs, tous praticiens qui profitèrent de l’enseignement de Galien mais en l’amplifiant, le déformant et l’obscurcissant jusqu’à l’oubli de sa source même. Du VIIème au XVIème siècle, l’Europe Occidentale entière demeura tributaire de la science orientale arabe appliquée par des Juifs. Charlemagne avait pour médecins deux Juifs. À cette époque « le médecin à la mode est un étranger, un Juif ou un Maranne, pompeusement habillé, avec au doigt de nombreuses bagues d’hyacinthe, prononçant avec emphase des grands mots semi-barbares, grecs ou latins (Dr Meunier, « Histoire de la Médecine », p. 183). » À cette époque obscure et troublée, le médecin était donc un charlatan au profil sémite et à la bourse dorée.
Mais depuis le Xème siècle, l’Église catholique travaillait à gagner la toute puissance. Lorsqu’elle parvint à établir sa suprématie, elle condamna les Juifs et, sous peine d’excommunication, interdit aux chrétiens de se faire soigner par eux. Dès lors la médecine retomba entre les mains des prêtres, les seuls savants de l’époque. Les médecins étaient tous des clercs et, comme tels, astreints au célibat. Jusqu’à la fin du XVIème siècle, l’Église « garda la haute main sur les praticiens qui, orthodoxes ou non, devaient cesser leurs visites aux malades qui, au bout de trois jours n’avaient pas fait appeler leur confesseur (Conciles de Latran, de Tortose, de Paris). » Reflets de leur siècle, les médecins d’alors se montraient cafards et falots.
Dans son traité institué « Questions médico-légales », Paul Zacchias qualifie les médecins du XVIIème siècle en disant « qu’il n’y avait rien de plus sot qu’un médecin si ce n’est un grammairien ; qu’il n’y avait pas de bons médecins qui n’eussent de mauvaises mœurs ; bref, qu’ils avaient tous les défauts : envieux, querelleurs, bavards, irréligieux ; qu’ils étaient autrefois des esclaves, que ce ne sont aujourd’hui que des infirmiers ; qu’ils ne valent pas mieux que les sages-femmes ; qu’un satirique a eu raison de dire : medicus, merdieus, mendicus ». Sans souscrire de confiance à un tel jugement, on peut en inférer que les médecins du grand siècle arrivaient à l’étiage de leurs contemporains, qui pour la plupart étaient ignares, serviles, solennels et courtisans.
Le XVIIIème siècle marque la défaite du cléricalisme et le triomphe de la philosophie ou du moins des philosophes. De même qu’au moment de l’épanouissement de la pensée grecque, la caste sacerdotale voit s’évanouir son prestige moral sous le souffle de l’esprit critique, son hégémonie intellectuelle devant le rayonnement de la recherche scientifique. L’aristocratie entière, française et européenne, répond à l’appel de Voltaire, travaille à « écraser l’Infâme » et il déboulonner les Dieux. Si tous les médecins d’alors ne furent pas des Helvétius le Père ou des Cabanis, en bons enfants de leur siècle ils devinrent des esprits forts sinon des athées, et s’inspirèrent davantage de la physiologie animale que de la théologie humaine ou de la scolastique classique.
Fils de Rousseau, le XIXème siècle jucha l’homme sur le piédestal vidé de ses divinités. L’opinion se fit humanitaire, sentimentale, charitable. Un déisme vague se substitua à l’idolâtrie de naguère, et le culte nouveau compta de nombreux servants. Plus que tout autre, le médecin parut exercer une sorte de sacerdoce laïque auréolé d’apostolat. Il jouait le rôle de consolateur des affligés de misères physiques au-dessus des ressources de l’art. À l’exemple des prêtres des religions périmées, le nouvel officiant bénéficiait d’immunités civiles et militaires, de privilèges fiscaux tacites, jouissait des honneurs publics et privés, percevait des honoraires soustraits au contrôle et au marchandage. En revanche, il assumait la charge morale d’assister gratuitement les déshérités de la fortune. À l’image de son siècle, le praticien était romantique.
Quatre grandes caractéristiques sociales distinguent actuellement le XXème siècle : le développement mécanique, la prédominance du groupement, la prépondérance du chiffre d’affaires, l’absolutisme de la fiscalité d’État. Reflet plus ou moins pâle de son milieu d’action, le médecin d’aujourd’hui se trouve technicien, syndiqué sinon syndicaliste, attentif au rendement financier de son travail, patenté et imposé sur toutes les coutures.
Finis, le sacerdoce et l’apostolat. La société demande au médecin non de consoler, mais de guérir ; non de présenter une haute valeur morale et une miséricordieuse bonté, mais d’être compétent. Le malade n’a cure de paroles ni souci de boniments. Il veut être observé, palpé, percuté, ausculté, pesé, mensuré ; il réclame une analyse d’urine, l’examen de l’expectoration et du sang, le cathétérisme de tous ses conduits, la radioscopie et la radiographie de chacun de ses organes ; il requiert, à la conclusion, une intervention médicale ou chirurgicale rapide et efficace. Il ne souhaite ni attendrissement ni prières, mais exige un diagnostic et un traitement. Dès lors la médecine cesse d’être une profession pour devenir un métier.
La complexité de la tâche y impose, comme dans l’industrie, la division du travail et le recours à la spécialisation. La multiplicité des techniques, les particularité des groupes morbides, la diversité des thérapeutiques empêchent un homme d’en connaître et pratiquer à fond l’ensemble, l’obligent à restreindre son effort sur une partie bien délimitée de l’art médical. D’ailleurs, chaque jour davantage, le patient va de lui-même chez le spécialiste. Le médecin de famille, amical et vénéré, a vécu ; le technicien, impersonnel et impassible, lui succède.
Faisant œuvre de ses mains autant que de son cerveau, devenu « ouvrier », le médecin devait fatalement suivre le mouvement de concentration issu de la forme capitaliste de l’économie contemporaine, constituer son groupement professionnel en lui imprimant cependant ses caractéristiques propres. Composée de praticiens assurant à la fois la conception et l’exécution de leur travail, l’organisation corporative médicale tient tout ensemble du trust patronal et du syndicat prolétarien. À l’instar du premier, elle s’efforce à maintenir et consolide. son monopole de l’exercice de l’art de guérir ; comme le second, elle lutte pour une rémunération toujours plus large du labeur individuel. Le syndicat médical d’aujourd’hui est donc un groupement sinon d’appétits, du moins d’intérêts.
Une de ses tâches primordiales consiste en la sauvegarde du privilège légal de ses membres et la poursuite de l’immense légion des guérisseurs non patentés : rebouteurs, magnétiseurs, masseurs et infirmiers à prétentions doctorales. Le nombre de ces faux médecins augmente d’une façon incroyable ; et il n’y a plus de coiffeur pour hommes ou pour dames qui n’opère au hasard le traitement des affections de la peau et du cuir chevelu par les rayons ultra-violets. Les syndicats cherchent surtout à réprimer le préjudice matériel causé par des concurrents exerçant sans le diplôme d’État et par conséquent sans les préalables sacrifices pécuniaires nécessaires à son obtention. En réalité, le plus grand inconvénient ne se trouve pas là ; la clientèle ira de préférence au praticien officiel, s’il est dûment outillé. Le danger réside principalement dans le discrédit que les fautes et les erreurs des manipulateurs incompétents peuvent faire rejaillir sur des modes thérapeutiques inoffensifs et efficients quand ils sont administrés avec discernement par des gens du métier. La médecine est un art déjà bien difficile pour les initiés. Quelle source de périls peut-elle devenir entre les mains d’ignorants dont le seul crédit repose sur l’incommensurable crédulité publique !
Le relèvement des honoraires apparaît le second but Immédiat poursuivi par les syndicats médicaux. Ils suivent leur époque dans la marche à l’argent succédant à la marche à l’étoile, si tant est que celle-ci ait jamais prévalu. Le spectacle de l’enrichissement des négociants de tout ordre a déchaîné dans l’ensemble des corporations une émulation passionnée et agissante. Comment ! l’épicier, le marchand de vin du coin, sans apprentissage spécial, sans compétence technique, auront acquis une fortune rondelette en une dizaine d’année, tandis que le médecin de quartier, de ville ou de campagne aura peine à vivre bon an mal an au prix d’un diplôme difficilement obtenu et chèrement payé ! Nuit et jour sur la brèche, impuissant même à jouir sans inquiétude d’un loisir qu’il sait pouvoir lui être à chaque instant arraché, le praticien harassé devra se contenter d’émoluments à peine supérieurs à ceux d’un ouvrier qualifié à travail horairement limité ? Cette situation devenait intolérable pour les intéressés ; et leurs syndicats prirent à cœur de la modifier. À tort, à raison ? Le Dr de Fleury, académicien aimable et disert, trouve « les jeunes générations médicales un peu trop pressées d’en finir avec la médiocrité pécuniaire » (« Le Médecin », p. 63, Hachette, 1927). En un siècle où l’argent est roi, comment les médecins ne se rangeraient-ils pas parmi ses humbles sujets ?
Pourtant, les préoccupations morales ne sont pas étrangères au corporatisme médical, comme le démontre son attitude actuelle en face de la loi française sur les Assurances Sociales. Les praticiens refusent leur collaboration au gouvernement tant que ne sera pas respecté le secret médical, assuré le libre choix de son médecin par le malade, sauvegardée la liberté de médication durant le traitement. Ils ne veulent pas laisser traiter les assujettis à la loi en personnes de deuxième ou troisième catégorie, auxquelles seraient refusées les garanties dont jouirait la clientèle bourgeoise. Ils entendent épargner aux déshérités de la fortune l’étalage de leurs misères physiques et mentales sur une masse inutile de papiers administratifs ; leur réserver la latitude de faire appel aux soins de qui a leur confiance ; leur voir donner le droit à tous les médicaments sans restriction ni considération de leur prix marchand : trois conditions de traitement rationnel et légitime que les projets de règlement jusqu’ici élaborés refusent au futur assuré. Enfin, pour éviter tout soupçon de connivence en vue de l’exploitation abusive des caisses d’invalidité, le médecin traitant demande à être honoré directement par le malade en lui délivrant un reçu d’après lequel l’administration calculerait la part légalement remboursable à l’intéressé.
L’âpreté au gain, remarquée complaisamment chez les médecins mais d’ailleurs commune à toute la génération actuelle, rencontre une justification dans l’âpreté concomitante du fisc. La saison des privilèges officiels est le passé ; la discrétion tutélaire et ancien régime des agents des contributions, un rêve évanoui. Le praticien paie toues les taxes imposées aux contribuables de marque : personnelle, mobilière, patente, impôt sur les bénéfices professionnels, sur le revenu global. L’échappatoire devient pour lui un sport difficultueux devant la ténacité et la curiosité des contrôleurs qui exigent la preuve flagrante de la sincérité des déclarations. Le gouvernement fouille les poches et les allège consciencieusement. Les clients à leur tour voient s’élever leur note d’honoraires dans une juste proportion. Le désintéressement miséricordieux de jadis a disparu. Quand viendra le temps des échanges fraternels ? Et quel est l’avenir du médecin ?
Son sort ne peut qu’être étroitement lié à celui de son siècle. Par le développement et la particularisation de ses techniques, la médecine subit une mécanisation progressive ; et chaque jour davantage le médecin deviendra le serviteur d’une machinerie, un véritable « ouvrier » ; d’une part ouvrier d’élaboration, de perfectionnement, de modification et de contrôle des techniques ; d’autre part ouvrier d’application et de commande des techniques. Le praticien fera figure de distributeur automatique ; le chirurgien de manipulateur de manettes d’embrayage et de débrayage. Ne voit-on pas les opérateurs commencer à utiliser des bistouris électriques ?
Comme ses contemporains le médecin de demain constituera un rouage d’une énorme mécanique sociale.
‒ Docteur F. ELOSU.
MÉDECIN, MÉDECINE, MÉDICASTRE...
Les mauvais médecins sont ceux qui ont été investis par le jeu des bonnes relations de leurs papas « dorés » ou qui deviennent médecins pour satisfaire des traditions de famille ou de caste.
Pour ces parents, peu scrupuleux de l’idéal, peu importe la nature de leurs enfants à diplômer, coûte que coûte, au détriment de ceux sur lesquels ils s’exerceront sans humanité.
Les médecins, ni bons ni mauvais, sont ceux qui monnayent leur savoir ‒ ceux-là en ont ‒ sans plus s’occuper des causes pitoyables, nourrissant le mal dont ils vivent le plus largement possible.
Les bons médecins sont ceux qui instruisent le malade, mais seulement jusqu’où leur industrie commence.
Les vrais médecins sont ceux qui n’exercent pas ou n’ exercent plus ou qui n’ayant jamais recherché le diplôme, malgré des études sérieuses et persévérantes, font de la médecine vulgarisatrice des secrets d’une santé se passant, à tout jamais, de la médecine, sans vivre de cet enseignement.
La médecine, telle qu’on l’enseigne dans les facultés, ne s’apprend que sur ce qui meurt et non pas sur ce qui vit.
Poursuivre le mal sur un terrain ensemencé d’éléments favorables à la maladie, à la dégénérescence, avec la chimie en ampoules, en flacons ou en cachets, alors que l’organisme est saturé de chimie organique virulente, corrodante, voilà à quoi se résume la science médicale contemporaine.
À l’École de Médecine, c’est comme à l’École Militaire : on y apprend à combattre, à guerroyer et non pas à secourir ou à pacifier.
Le médecin et le militaire possèdent, chacun, un arsenal et un laboratoire : deux choses dont la nature saurait se passer ;
Quand l’homme appelle le médecin, déjà la morbidité s’organise en lui, quelque part, où le mal fait son trou. Le médecin, lui, fera le sien propre dans la vie du « patient ».
Mais, insistons sur ce point : que c’est très probablement le malade qui a créé le médecin ; ce dernier, lui, a créé le « sens médical », ce qui fait dire : que n’ont besoin du médecin, que ceux voulant bien se donner la peine d’être malades ou de se croire tels.
Le chirurgien, quand il n’est pas un sadique de la vivisection et lorsqu’il ne mesure pas le morceau à couper avec les ressources probables de ses clients, est presque indispensable à l’humanité. Je dis ressources probables, car il n’y a pas de gens plus experts pour juger, d’après les « signes extérieurs et intérieurs », de l’état de fortune des gens, qu’un médecin ou un chirurgien. Quels admirables agents du fisc feraient ces messieurs !
Quant aux guérisseurs, ce sont des malins dont toute la... science consiste à savoir déplacer la mal ou à séparer, pour un instant, le malade de sa douleur.
Les guérisseurs procèdent du phénomène qui se produit, lorsqu’une personne, souffrant atrocement du mal de dent, voit sa souffrance se calmer, ou disparaître, en saisissant le pied de biche à la porte du dentiste.
C’est ce trouble humoral, ce trouble émotif, que les guérisseurs provoquent, pour guérir, à la petite semaine, des malades tout spéciaux qui, pendant le reste de leurs jours, restent de fidèles clients, malgré qu’ils soient ‒ selon leurs dires ‒ parfaitement guéris !
Quand le malade tient, consciemment ou inconsciemment, à sa maladie et qu’il a perdu confiance en la médecine ou lassé l’honnête médecin, quand il ne croit plus aux vaines et coûteuses « combines » des guérisseurs, on le voit se livrer aux littérateurs de la médecine qui feront métier de l’embarrasser, de plus en plus, à mesure que les livres s’ajouteront aux livres, et quels livres !
Livres que l’on achète sur le conseil intéressé des conférenciers subtils, ramasseurs marrons des clientèles d’officines d’hypnotiseurs professionnels ; livres qui conduisent de malheureux malades, pieds et poings liés, aux « psychothérapeutes » se refilant le client jusqu’à épuisement de ses ressources d’argent, de patience, de vie !
Les livres de médecine soignante ou de vulgarisation de la médecine officielle, quelle bonne blague... pour eux qui ne tiennent pas à être malades ou ne font rien pour le devenir !
Dans ces livres, la maladie y est traitée comme si elle ressemblait toujours à elle-même, cependant que, d’un malade à un autre, elle différencie de nature, d’intensité même, d’une heure à une autre.
Devant ce fait, à quoi sert toute cette littérature, dite de vulgarisation médicale ?
Un médecin est appelé au chevet d’un malade et diagnostique une affection toute autre que celle dépistée par un premier médecin appelé la veille ; cela s’explique facilement. Ces deux médecins ont raison tous les deux. Confrontez-les, ils ne s’entendront que si le consultant les garde tous les deux. Deux raisons s’offrent à expliquer cette attitude : la première, c’est qu’en quelques heures, ainsi que nous le disons plus haut, le mal peut changer de nature, se déplacer ; la seconde, c’est qu’un médecin qui revient d’une erreur, en face d’un client, est perdu vis-à-vis de ce dernier. On croit trop facilement que le médecin ne peut jamais se tromper et, de même, que la maladie ne le trompe pas.
Un médecin-naturiste (pourquoi pas des pharmaciens naturistes aussi ?) a demandé que chacun fasse son apprentissage de malade, pour être capable de se choisir un bon médecin ! C’est absolument comme si l’on demandait à quelqu’un de se faire cordonnier pour acheter de bonnes chaussures.
Chacun sait combien de défaites cela vaut, pour un électeur, de chercher à avoir un bon député ! Si, pour savoir se choisir un médecin, il fallait passer son existence à être malade, se laisser transformer en écumoire par les piqûres et les vaccins et s’ivrogner de médicaments jusqu’à se faire interner, les rôles de malade et d’électeur s’identifieraient, dans le plus grand supplice de la compréhension humaine.
Ce serait peut-être un moyen conduisant l’humanité vers la sagesse qui sait se passer de députés et de médecins ‒ ils sont souvent les deux à la fois ‒ par motif de suppression de leur nécessité, même quand ils se disent « naturistes ».
Laissons le médecin aux malades, plus ou moins volontaires et voyons l’hygiéniste à son rayon ; car, là encore, on tient boutique.
L’hygiéniste, quand il ne nous a pas indiqué cent produits de sa signature, avec des noms bizarres où il se reconnaît du reste à peine lui-même, nous aura comblés de littérature (lui aussi !) et de conseils, admettons-le, sages et désintéressés.
Il nous a dit :
« Respirez profondément, ouvrez vos fenêtres la nuit, lavez-vous, chaque matin, le corps entièrement nu, à l’eau froide, portez des vêtements légers, fréquentez la campagne, la mer, la montagne, autant que vous le pourrez »
Mais, la consultation terminée, notre éminent hygiéniste s’entoure de plusieurs épaisseurs de flanelles (de sa marque), de tricots « spéciaux », de paletots, de pardessus, de trench-coats, puis s’engouffre dans le métro, ou dans sa limousine plus souvent, pour, de la journée, de la semaine, d’un mois à un autre, y être enfermé pour courir les adresses de ses clients ‒ de plus en plus nombreux ‒ entre deux bains de vapeur !
Sur ses conseils, vous achetez ‒ chez lui ‒ un spiroscope, des instruments à singer le travail utile, des haltères de toutes natures, des cordes à nœuds, et une foule d’attirails qui feront ressembler l’endroit où on les resserre, à un coin de tribunal sous l’Inquisition !
Notre hygiéniste aura sa gymnastique « spéciale », condamnant toutes les autres. Il excellera dans l’art de créer, de toutes pièces, un régime excluant tout ce que ses confrères auront permis et recommandant tout ce qu’ils auront interdit. Et tout cela, avec force théories qui lui vaudront d’être la véritable « Sorbonne » d’une foule de sociétés, dites savantes.
Quelquefois, un établissement spécial ‒ le sien ‒vous est plus particulièrement imposé et l’on vous y soigne en « ami » pendant tout le temps... nécessaire.
La maladie a ainsi créé ses commerces, ses industries, ses politiques, ses modes, ses arts, ses sciences, ses intrigues et ses poètes ! Dénoncer tout cela, ce serait soulever un monde, et quel monde ! Nous ne voulons pas, ici, nous spécialiser dans cette partie, quelque belle œuvre de salubrité que ce soit.
Nous en avons juste assez dit pour que soient avertis ceux qui ne sont pas tout à fait inaptes à la santé du corps et de l’esprit.
‒ L. RIMBAULT.
(Voir aussi maladie, prophylaxie (hygiène), nourriture (et alimentation), naturisme, santé, végétarisme, végétalisme, etc.)
MÉDECINE
n. f. (rad. médecin)
La médecine est l’art de soigner les malades. Depuis qu’il y a des hommes, elle s’est penchée sur la souffrance pour la soulager. Elle a pris, pour arriver à cette fin, ce qui lui a semblé le meilleur, c’est-à-dire qu’elle a usé des connaissances qu’elle avait sous la main ‒ connaissances qui n’étaient parfois que des croyances ou des préjugés, mais qui souvent étaient des acquisitions empiriques d’une efficacité réelle, bien qu’assez limitée.
La médecine est donc essentiellement une pratique. Le médecin est surtout un praticien ; il a souvent besoin d’agir tout de suite, sans attendre la certitude, d’agir pour le mieux, avec la préoccupation de ne pas nuire à son client.
En toutes choses l’humanité a vécu d’empirisme, c’est-à-dire qu’elle a agi par tâtonnements. Mais elle s’est efforcée de remonter aux causes des phénomènes et même de les mesurer : c’est ce qui constitue la science, qui, elle, nous donne le moyen de reproduire le phénomène, ou de l’éviter, ou de le combattre. La science est en perpétuel devenir. Ce n’est pas parce qu’elle se meut dans le relatif qu’il faille proclamer sa faillite. Ceux qui ont besoin d’une certitude absolue ont conservé l’âme et la mentalité des primitifs, c’est-à-dire de ceux qui ne savent rien.
La science a commencé de se constituer dans l’étude des phénomènes les plus simples. Même là, l’évolution a été très lente. L’esprit humain était trop encombré par la croyance aux influences mystiques pour envisager la causalité toute nue. Les Grecs ont libéré l’esprit humain, mais l’arrivée du christianisme a annihilé l’essor scientifique, et il a fallu parvenir aux temps modernes pour que la science reprît librement le cours de ses recherches. Il n’y a pas si longtemps que la chimie est étudiée scientifiquement. À cause de la complexité des phénomènes et de l’impossibilité presque complète de faire des expériences, la médecine et la sociologie vont encore plus lentement.
Pourtant un grand pas a été fait, lorsque Pasteur, qui était non pas médecin, mais chimiste, découvrit, en étudiant les fermentations, la cause des maladies infectieuses. Or, les maladies infectieuses, c’est-à-dire les maladies microbiennes, tiennent la plus grande part dans la pathologie. La connaissance des microbes, de leur culture, de leurs réactions a été un débroussaillement nécessaire. L’étude des réactions humorales, celle des glandes à sécrétion interne commencent à s’amorcer. On ira plus loin, on ira, de plus en plus loin. La pratique scientifique de la médecine ne fait que commencer.
Elle a déjà eu des résultats éclatants dans l’art chirurgical. Les progrès de la chimie avaient donné le pouvoir d’annihiler la douleur en endormant le patient. La connaissance de la cause des suppurations a permis de faire, en toute sécurité, grâce à l’antisepsie et à l’asepsie, les opérations les plus risquées : comme d’ouvrir un ventre, ce qui se fait aujourd’hui couramment. En cinquante ans la pratique chirurgicale a étendu son domaine triomphalement. Il semble même qu’elle a atteint son point culminant et que les progrès dans l’art de soigner et de guérir les tumeurs, les cancers, les processus inflammatoires (par exemple dans le cas de l’appendicite) rétréciront peu à peu son champ d’action.
De toute façon, avant d’agir, le médecin est obligé d’établir un diagnostic, c’est-à-dire d’interroger et d’examiner le malade, souvent même de recourir à l’aide du laboratoire ou au concours d’un spécialiste, pour déterminer la cause des symptômes morbides dont se plaint le patient. Celui-ci ne voit que le malaise qui le gêne, il ne se rend pas compte que ce malaise n’est qu’une des apparences d’un état pathologique plus profond. Il ira parfois chercher directement chez le pharmacien un cachet contre un mal de tête ou une potion contre la toux, ou quelque chose pour couper la fièvre. Il se laissera aussi bien guider par les réclames de la 4ème page des journaux. Il s’adressera à un charlatan, à un vendeur d’orviétan ou de tout autre remède secret et miraculeux.
Or, le mal de tête, par exemple, peut être une névralgie causée par une mauvaise dent ou par une sinusite, par une tumeur, ou bien une migraine, ou bien une céphalée entraînée par une mauvaise accommodation visuelle, ou bien le symptôme d’un embarras gastrique, ou bien le prélude d’une maladie infectieuse en incubation, ou bien l’accompagnement d’une syphilis à la période secondaire, ou bien encore des troubles liés à une urémie latente, etc. La conduite a tenir n’est pas la même dans tous les cas, et l’administration inconsidérée d’un remède peut même aggraver l’état de l’urémique.
Pour agir avec quelque efficacité, il faut donc découvrir la cause des symptômes apparents. Les anciens médecins s’en rendaient bien compte, mais ils n’avaient que très rarement le moyen de remonter à cette cause. Ils se contentaient de faire le diagnostic d’une péritonite, ils savaient qu’elle apparaissait souvent comme symptôme terminal de la fièvre des femmes en couches, sans d’ailleurs concevoir le rôle de l’infection, mais ils ignoraient que souvent aussi elle est le symptôme terminal d’une appendicite méconnue, car ils ignoraient l’appendicite et ils parlaient alors d’une péritonite a frigore (causée par un refroidissement). Ils englobaient sous le nom de fièvre putride toutes sortes de maladies infectieuses, sous le nom d’affections pulmoniques chroniques, ou de bronchites chroniques, des états divers où la tuberculose tenait sans doute la plus grande part. L’étiquette d’anémie recouvrait des états pathologiques les plus différents. Les médecins regardaient le chancre mou, la blennorragie et la syphilis comme les manifestations d’une même maladie vénérienne. Ils ignoraient l’hérédo-syphilis. Encore de nos jours confondons-nous sous le nom de rhumatisme des affections différentes, et notre classification actuelle des maladies cutanées et celle des maladies mentales sont-elles quelque peu obscures.
Mais on progresse. Lorsque Bichat eut commencé à créer l’anatomie pathologique, lorsque de nouveaux procédés d’exploration, comme la percussion et l’auscultation, eurent permis de localiser nombre de lésions des organes, lésions qu’on pouvait étudier à l’autopsie, on put préciser de nombreux diagnostics, par exemple celui d’une pleurésie. Celle-ci paraissait avoir définitivement conquis son existence et son autonomie. Ce fut presque un scandale quand, il y a 30 ans, Landouzy émit l’hypothèse que la grande majorité des pleurésies relevait d’une tuberculose de la plèvre. La lésion de l’organe n’est pas tout. On cherche maintenant à établir son diagnostic étiologique, c est-a-dire le diagnostic de la cause qui a amené la lésion.
Le diagnostic une fois établi, on sait ce qu’il faut taire et surtout ce qu’il ne faut pas faire. Mais il faut connaître aussi l’état des différents organes, évaluer la possibilité de leur tolérance ou de leur défaillance vis-à-vis de tel ou tel médicament, il faut prévoir, autant que faire se peut, les réactions humorales etc. Le médecin agit en s’aidant des connaissances accumulées par les travaux médicaux du monde entier et en se guidant sur son expérience personnelle. Tous les jours la science médicale fait de nouveaux progrès. Elle est Internationale. Des congrès de médecine générale ou spécialisée rassemblent chaque année des travailleurs du monde entier. Les périodiques professionnels tiennent d’ailleurs les praticiens au courant des recherches en cours, des hypothèses et des découvertes faites par les médecins dans tous les pays civilisés. Il n y a plus de remède secret. Une découverte amorcée dans un laboratoire est souvent parachevée dans un autre. Il se passe en médecine ce qui se passe dans les autres sciences. Leur progrès s’appuie sur la solidarité et sur la rivalité intellectuelle (ce qui est la même chose) d’une multitude de travailleurs, en dépit des erreurs et des bluffs, d’ailleurs vite reconnus.
Depuis. soixante ans environ, ce progrès marche à pas de géant. Il y a cent ans, la veuve d’un médecin en vendant la bibliothèque de son mari, pouvait en tirer un prix rémunérateur. Aujourd’hui, au bout de cinq ans, les ouvrages de pathologie sont périmés. Le médecin est obligé de rester un perpétuel étudiant. Le progrès des autres sciences (physique, chimie) apporte de nouveaux procédés d’exploration (radiologie) ou de traitement. L’art médical devient de plus en plus complexe et compliqué, ce qui entraîne la naissance de nombreuses spécialités.
La médecine traditionnelle a vécu. Le médecin d’aujourd’hui ne peut plus agir seul. Il a besoin du laboratoire pour l’examen à l’ultra-microscope, pour des analyses de crachats en série, pour de multiples analyses du sang ou du liquide céphalo-rachidien etc. etc. Il a besoin d’examens radiographiques ou radioscopiques. Il a besoin de faire pratiquer la cystoscopie par un spécialiste des voies urinaires, l’examen du fond de l’œil par un ophtalmologiste, du larynx par un laryngologiste, etc., etc.
En dehors des traitements afférents à sa spécialité, le spécialiste, dans l’examen général d’un malade ne peut être qu’un analyste, fournissant un renseignement particulier au praticien. En somme c’est ce dernier, qui, grâce à un travail d’induction, peut faire la synthèse des éléments recueillis, établir le diagnostic et orienter le traitement. Son influence morale a aussi une grande importance. Mais la collaboration est nécessaire et constante entre le praticien et ses confrères spécialisés.
Les nouveaux procédés d’investigation permettent un diagnostic non seulement plus précis, mais aussi plus précoce. Or, il est extrêmement important de pouvoir reconnaitre une affection à son début ; l’efficacité de la thérapeutique est à ce prix. Confirmer le diagnostic d’un chancre dès son apparition, déceler la tuberculose pulmonaire de bonne heure permet d’instituer un traitement qui pourra, dans la plupart des cas, enrayer l’évolution de la maladie. On s’efforce de découvrir le cancer aussitôt que possible, car si l’intervention chirurgicale peut être tentée, c’est au début qu’elle aura les plus grandes chances de succès.
Les anciens médecins n’avaient guère pour avertissement que la souffrance qui amenait les patients à leur consultation. Or, si la douleur est un signal d’alarme, elle est souvent beaucoup trop tardive et elle manque de précision. La médecine de l’avenir sera la médecine préventive. Déjà la médecine actuelle est capable de déceler de petits risques d’insuffisance fonctionnelle des reins, auxquels elle peut remédier, grâce à quoi elle peut écarter ou éloigner l’apparition brutale de l’urémie. Il en est ainsi pour le foie, pour le cœur, etc. Mais nous sommes encore bien loin des possibilités futures.
Pour me faire mieux comprendre, je prendrai pour exemple l’art dentaire. Il y a cent ans, arracher la dent était le seul remède contre la douleur. Aujourd’hui non seulement on peut supprimer la souffrance en dévitalisant la pulpe, mais on empêche la carie par un plombage précoce. Il ne devrait plus y avoir de mâchoires édentées et puantes. Les personnes aisées se font examiner la bouche tous les six mois, pour que le dentiste puisse apercevoir les premiers signes d’altération dentaire. Le médecin de l’avenir sera sans doute capable de combattre les déficiences humorales qui causent la décalcification et d’empêcher les pyorrhées de s’amorcer. Il n’y aura plus de dents gâtées que par hasard ; et les dentiers ou les bridges seront devenus rarissimes.
La preuve des progrès de la médecine est dans la diminution de la mortalité dans les pays civilisés, surtout de la mortalité infantile. De grandes masses humaines peuvent se rassembler (par exemple dans la dernière guerre) sans être décimées par des épidémies meurtrières, comme c’était la règle autrefois.
L’hygiène sociale s’appuie sur les bases scientifiques de la médecine. On sait la façon dont se propagent les grands fléaux sociaux, les causes de l’insalubrité, le rôle des taudis, de l’encombrement, de l’obscurité, de l’ignorance et de la misère, on connaît la pollution des eaux, du lait, etc., et les falsifications alimentaires. Mais on n’y remédie pas toujours, car, dans une société mercantile, les intérêts particuliers sont souvent plus respectables et plus puissants que la santé publique.
Le progrès de la médecine continuera. Nous n’avons aucune idée des moyens d’investigation dont nos successeurs disposeront. Il y a quarante ans, personne n’aurait pu se douter de la découverte des rayons X et des nouveaux moyens qu’ils allaient donner. L’outillage dont se serviront les médecins de l’avenir sera de plus en plus compliqué. Le praticien ne pourra plus exercer isolément, il sera obligé de donner ses consultations dans une maison de santé de quartier. La naissance et la mort ne se passeront plus dans les domiciles particuliers. Les malades seront traités dans des cliniques pourvues des derniers perfectionnements.
Le machinisme médical coûtera cher. Il sera impossible au jeune médecin de s’installer en pleine indépendance. En dehors des hôpitaux de l’Assistance publique, où les malades sont considérés comme des indigents, et couchés dans la promiscuité des salles communes, à qui appartiendra la maison de soins ? Aux caisses, créées par les Assurances sociales, où les médecins seront des fonctionnaires obéissants et salariés ? À des médecins riches, comme certains chirurgiens, ayant sous leurs ordres une équipe de praticiens spécialisés ? À des entreprises financières et capitalistes, où les médecins seront traités comme des employés ?
Au point de vue social, la meilleure solution serait sans doute que les médecins qui sont des producteurs de soins, fussent organisés librement en coopératives de production, comprenant praticiens et spécialistes. Les maisons de santé seraient édifiées par les coopératives de consommateurs (les consommateurs de soins) ; elles seraient pourvues de laboratoires et de l’outillage moderne. Mais la direction technique appartiendrait en toute indépendance à la coopérative médicale.
Ce problème s’apparente à celui de l’avenir des techniciens en général dans la société capitaliste. Sa résolution aura non seulement un effet social, mais aussi une répercussion sur le développement de la technique elle-même, suivant que celle-ci sera libre ou asservie.
‒ Docteur M. PIERROT.
MÉDIÉVAL
Voir Moyen âge.
MÉDISANCE
n. f. (de médire)
Au sens général, médire c’est mal parler d’autrui, c’est révéler ses vices ou ses fautes, colporter des histoires désobligeantes à son sujet, soit par sottise, soit dans l’intention de lui nuire. En un sens plus restreint, la médisance est quelquefois opposée à la calomnie, cette dernière étant synonyme d’accusation fausse, alors que la première consiste dans une accusation malveillante mais vraie. Aussi les moralistes chrétiens, qui se plaisent à dresser une hiérarchie compliquée, aussi bien des fautes que des mérites, placent-ils la médisance moins bas que la calomnie, dans le catalogue des péchés. Du moins lorsque les intérêts de la sainte Église ne sont pas en jeu, car lorsque les prêtres en peuvent tirer bénéfice les plus abominables inventions deviennent méritoires. Les dévotes le savent, d’où leurs mensonges hypocrites, leurs perfidies sans nom à l’égard des incroyants. Médire et calomnier découlent, en réalité, d’une même tendance, celle qui porte chacun à mordre à belles dents le voisin, même s’il n’est ni concurrent, ni adversaire. Louer son talent, ses mérites ? Vous n’y songez pas ; de telles conversations seraient puissamment somnifères. Détailler ses défauts, voilà, par contre, qui réjouira même ses prétendus amis. « Le besoin de médire semble vital chez beaucoup. Telle vieille, qui espionne le prochain des journées entières en égrenant son chapelet, oubliera le dîner pour les commérages. Heureux si elle s’arrête à la lisière des lettres anonymes qui préviennent charitablement le fiancé des frasques de la promise ou l’épousée des infidélités du mari. Et cette blonde qui trottine avec sa compagne, zélatrice comme elle des filles de la Vierge-Mère, ne croyez pas qu’elle s’entretienne du dernier sermon. Elle déshabille en pensée les prétendants à sa main, et ses lèvres énumèrent la litanie de leurs défauts : le nez trop long déplaît chez l’un, l’autre a la maigreur du héron, un troisième serait passable s’il était moins gros, sans parler du bellâtre dépourvu de cerveau, de l’intellectuel fagoté d’inénarrable façon ou du gringalet dont l’esprit ne supplée pas l’absence de mollets. Critique toute de surface, où nuance des cravates, coupe du veston, timbre de la voix, élégance du maintien prennent une importance capitale. Comme le fin politique ou le vieil académicien, notre ingénue saisit de préférence les travers. Cette universelle malveillance expliquera, plus tard, l’incessant va-et-vient du personnel, madame réclamant de ses domestiques une perfection qu’elle même ne possède point. » Les ordres religieux ont organisé la médisance d’une façon systématique. « Dans les couvents catholiques, moines ou nonnes se font une guerre au canif, très édifiante quand on la connaît. Espionnage et délation mutuels s’y transforment en devoirs primordiaux ; chacun épie intentions et murmures du voisin, pour l’avertir des fautes commises ou, mieux, le dénoncer aux supérieurs. On dit les femmes particulièrement expertes dans l’art d’admonester leurs compagnes ; la charité faisant un devoir de ne point négliger l’ombre même d’un défaut. Seulement coups de griffes ou de dents n’ont cours qu’à l’intérieur, rien ne transparaît en dehors ; pour le public, ton doucereux, allures patelines sont uniformément de rigueur. » (Par delà l’intérêt). On raconte qu’Esope, un simple esclave phrygien mais qui avait beaucoup plus d’esprit que son maître, ayant reçu de ce dernier l’ordre d’acheter ce qu’il y avait de meilleur, pour le servir dans un festin, n’acheta que des langues. « N’est-ce pas ce qu’il y a de meilleur ? » répondit-il, quand on le questionna. Mais ayant reçu l’ordre d’acheter ensuite ce qu’il y avait de pire, le même Esope n’acheta encore que des langues, déclarant que c’était incontestablement ce qu’il y avait de pire, la langue étant la mère des plus grands maux. Le fabuliste avait raison. Si le langage rend seul la civilisation possible, il faut convenir que des existences, en grand nombre, sont empoisonnées par les diffamations, les cancans, les ragots de toutes sortes. Et malheureusement la médisance est commune à tous les milieux ; elle est encore pire dans les milieux trop étroits, trop fermés, ainsi que dans les petites villes où chacun se connaît et s’épie. Contre cette tendance, il est regrettable de constater que les esprits éclairés, les hommes d’avant-garde ne réagissent pas toujours. Pourtant rien de plus destructif de la sympathie fraternelle qu’ils désirent instaurer, au moins dans le cercle restreint de ceux qui peuvent les comprendre. Ce qui ne veut pas dire qu’il soit bon de faire comme l’autruche et de fermer les yeux, pour se laisser duper par n’importe qui. Mais, pour accorder sa bienveillance à quelqu’un, est-il nécessaire qu’il soit sans défaut ? Si oui, rien à faire, personne n’étant dans ce cas ; résignons-nous à rester solitaire. De plus, il se tromperait pitoyablement celui qui se croirait parfait ; comme autrui, il a ses faiblesses, il a besoin que ceux qui l’entourent l’excusent et lui pardonnent certains travers.
Utilisons la médisance, lorsqu’elle nous atteint, pour nous corriger quand elle est justifiée, au moins en partie. Pour le reste, méprisons-la. Que la défiance entre en nous, lorsque quelqu’un passe son temps à dire du mal de ses connaissances, de ceux-là même qu’il proclame ses amis. Dès que nous tournerons le dos, ce sera notre tour d’être étrillé.
‒ L. B.
MÉDITATION (et PRIÈRE)
n. f.
J’aime méditer et souventes fois, vous m’aviez reproché de ne pas tendre l’ouïe aux bruits de la rue. De ne prêter l’oreille aux rumeurs qui s’élèvent des carrefours et des avenues. De rester sourd aux clameurs qui se répercutent sur les places et sur les marchés, aux tumultes des assemblées et des attroupements.
Après maintes hésitations, j’ai voulu tenter une expérience. J’ai ouvert toute grande celle de mes croisées qui donne sur la voie publique. Toute grande. Et dans ma chambre d’homme studieux, aux parois tapissées de volumes, de thèses, de brochures, aux tables pliant sous les manuscrits, les périodiques, les amas de notes, les monceaux de coupures, dans ma chambre d’homme qui pense, qui lit, qui médite, qui cherche, qui réfléchit, qui compose, dans ma chambre s’est engouffré comme une trombe de cris et de paroles, comme un cyclone de sons mêlés, enchevêtrés, confus, discordants, désordonnés, volumineux.
Sans doute, dans cet étrange tourbillon, j’ai perçu le grondement de colère des déshérités, pareil au bouillonnement du flot qui bat avec furie les quais, les digues, les jetées ‒ ce qui l’entrave et ce qui l’encercle. Sans doute, dans ce tourbillon, j’ai reconnu les lamentations des misérables que, sans relâche, un sort adverse et ironique talonne, terrasse et piétine ; les râles d’agonie des désespérés qui exhalent l’ultime souffle en blasphémant Dieu ou les circonstances, en maudissant la Société ou la Nature, en reniant ceux qui les ont engendres ou éduqués. Sans doute, dans cet effrayant tourbillon, j’ai entendu vibrer l’écho du fracas des batailles des insurrections, des mises à sac, des catastrophes, des cataclysmes humains et extra-humains qui se sont succédés depuis que la planète est planète. Mais j’y ai aussi distingué un vacarme assourdissant d’appels, de répliques, d’Injures, d’exclamations, d’imprécations, d’interjections, d’éclats de voix se heurtant, s’entrecroisant, s’efforçant de se dominer l’un l’autre, assez semblable au tapage qui remplit, les nuits d’été, les marécages stagnants où les grenouilles coassent et s’ébattent par milliers.
Toutes les observations, les remarques, les discussions, les approbations, les critiques que suscitent ou soulèvent les débats du Parlement les audiences des tribunaux, les discours des gens qui incarnent l’autorité les articles « de fond » de la demi-douzaine de quotidiens qui dirigent, régentent, « font » l’opinion publique. Les phrases redondantes, les périodes à effet, dont Il ne reste plus rien une fois qu’on les a analysées et disséquées, Tous les flonflons de la « musique de cirque » intellectuelle qu’est le bavardage écrit ou parlé des rhéteurs de la politique. Tout ce qui s’élucubre ou s articule pour que les hommes, l’immense majorité des hommes, puissent se faire une opinion qu’ils ont le front, ensuite, de proclamer « personnelle ». Tous ces mots s’infiltraient, pénétraient dans ma chambre, tel un déluge submergeant et irrésistible.
Accablé, abasourdi, aveuglé par cette inondation et par cette poussière de voix et de sons, je ne reconnaissais plus ni mon environnement ni moi-même. Je ne pouvais plus ni imaginer, ni concevoir, ni inventer. Mes facultés de résistance, d’observation d’initiative n’étaient plus, oblitérées, annihilées, anéanties qu’elles paraissaient. Je me sentais dans l’état d’un baigneur imprudent qui s’est aventuré loin de la plage qui a laissé la marée monter, monter encore, l’entourer l’assiéger, l’investir et qui s’aperçoit tout à coup qu’il ne reste aucune chance de salut. Mon cerveau vacillait dans cette atmosphère cacophonique ; mes nerfs cédaient. Rassemblant enfin tout ce qui me restait d’énergie latente, dans un dernier effort, j’ai volé vers la croisée que j’avais si imprudemment ouverte, celle qui donne sur la voie publique. Et je l’ai close, hermétiquement close.
Dans ma chambre d’homme studieux aux parois tapissées de volumes, de thèses, de brochures aux tables pliant sous les manuscrits, les périodiques, les amas de notes, les monceaux de coupures, dans ma chambre d’homme qui pense, qui lit, qui médite, qui cherche qui réfléchit, qui produit, la quiétude et le silence sont maintenant revenus. La quiétude et le silence propices à l’élaboration, à la création, au labeur. La solitude où croissent, s’épanouissent et portent leurs fruits les facultés créatrices et productrices. Le calme et le silence en dehors desquels il ne se conçoit ni ne s’achève rien de profond ni d’original. Rien qui persiste ou qui résiste ; rien qui perdure.
Mais je n’ai pas seulement besoin de méditer. J’ai besoin de prier, moi, le matérialiste, le mécaniste, l’athée. J’ai besoin de prier, c’est-à-dire de m’épancher, de me raconter à moi-même mes afflictions, mes peines, mes désirs, mes aspirations. Et voici, ou à peu près quelle est ma prière, celle qui me réconforte aux heures de faiblesse ou de découragement : « Forces, Énergies, puissances affirmées, à l’œuvre ou latentes en moi, qui n existez que parce que je suis, qui sont moi-même. Sans lesquelles je ne serais ni convenable, ni imaginable, ni existant. Faites que Je me développe jusqu’à l’extrême de mes aptitudes, jusqu’à l’ultime limite de mes capacités de sensations et de jouissances. Que je me révèle à moi-même ce que je suis en réalité. Que je sois doué de la volonté indispensable, de la persévérance nécessaire, du discernement convenable pour accomplir mes desseins, et cela sans me laisser diminuer à mes propres yeux ‒ de l’intelligence efficace et de la ruse inévitable pour me procurer quotidiennement ma subsistance ‒ de la fermeté de résistance voulue pour ne rien livrer volontairement de soi-même au troupeau social ‒ du caractère qu’il faut pour traverser les heures difficiles sans me laisser entamer ou mutiler intérieurement. Que ma volonté s’accomplisse toujours et cela sans contrarier la volonté d’autrui et que, ne réclamant de comptes à personne, je ne me mette jamais dans le cas ‒ sauf contrat librement accepté ‒ d’être comptable à qui que ce soit ».
‒ E. ARMAND.
MÉDIUM
(Voir magnétisme, métapsychie, spiritisme, suggestion, etc.)
MÊLÉE
n. f.
Combat ou les deux troupes sont mélangées dans le corps à corps. Ex. : se jeter au milieu de la mêlée. Dans le sens figuré et familier, se dit d’une vive, opiniâtre discussion entre plusieurs personnes. Lutte de paroles. Ex. : se tirer tant bien que mal de la mêlée. Quelle mêlée ! Se dit aussi d’un conflit quelconque : la mêlée des intérêts. La mêlée sociale : la bataille (quotidienne et qui revêt mille formes tour à tour insidieuses ou brutales) qui met aux prises les privilégiés de la fortune et les déshérités du sort, les riches et les pauvres, les puissants et les faibles, les patrons et les ouvriers, les maîtres et les gouvernés. Dans cette mêlée les masses populaires, jugulées par les lois, bernées par des habiles, divisées perfidement en partis hostiles, ont eu invariablement le dessous. Car elles n’ont su que s’en remettre à quelques malins bergers ‒ tyrans du lendemain ‒ du soin de réaliser en profit durable leurs victoires passagères.
Mêlée vient du mot latin pop. : misculare, mélanger, mettre ensemble deux ou plusieurs choses : mêler des grains. Se confondre avec : la Marne mêle ses eaux avec celle de la Seine. Mêler du fil, des écheveaux, les brouiller de telle sorte qu’on ne puisse pas aisément les dévider ou les séparer. Fig. : joindre : maintenant que vous mêlez vos regrets et vos larmes. Unir : mêler les affaires au plaisirs ; mêler la douceur à la sévérité. Mêler une serrure : fausser les gardes ou quelque ressort d’une serrure, en sorte que la clé ne puisse ouvrir. Mêler quelqu’un dans une accusation : l’y comprendre. Mêler quelqu’un dans des discours : parler de lui de manière à le compromettre ou à lui déplaire. Se mêler à la conversation : y prendre part.
Synonymes : mêler, mélanger. Mêler, c’est mettre ensemble, réunir plusieurs choses ; mélanger c’est combiner avec dessein et dans une certaine intention.
N.-B. ‒ Nous venons de voir que l’expression la mêlée désigne couramment les rencontres guerrières. Elle fut, tout au long de la dernière guerre, d’un emploi familier. Et elle s’offrit à la plume d’un Rolland pour son Appel aux hommes. Des camarades l’incorporèrent dans les titres des organes qu’ils lancèrent ou tentèrent de maintenir pendant la tourmente. Tels La Mêlée et Par delà la Mêlée qu’animèrent Pierre Chardon et Armand...
Dans la brève étude générale que nous avons consacrée à Manifeste, nous avons signalé Au-dessus de la Mêlée comme étant ‒ sur tous les manifestes conformistes de la « guerre du Droit » que l’aile d’une presse intéressée emportait à travers le monde ‒ le seul qui parvînt, malgré elle, jusqu’au grand public. Nous n’entendions pas fonder sur son éclat tout le mérite de ce cri, ni prétendre qu’il fut, parmi la lourde angoisse du carnage, le seul courageux anathème. D’autre réprobations surgirent, moins heureusement répercutées, mais parfois plus encore audacieuses, et tout autant réconfortantes et dignes. Nous avons pensé qu’il convenait d’y revenir, de leur consacrer ici quelques lignes, non tant pour les nôtres qui savent, que pour tous ceux qui ‒ dans l’avenir surtout ‒ pourraient commettre la méprise de croire que seules s’élevèrent contre le fléau « les voix historiques ».
Maintes tentatives ‒ dont le silence hostile ou la répression étranglèrent la portée ‒ furent faites par les adversaires de la guerre. Par la parole, par le tract, militants obscurs ou notoires, individualités résolues, groupements clandestins se dressèrent, dans la carence générale, contre l’hécatombe sans nom, tentèrent de jeter quelque clarté dans les ténèbres sanglantes et de réveiller les masses aberrées. Des premiers, les anarchistes, avec les socialistes demeurés fidèles à leurs convictions, portèrent dans la foule quelques vérités nécessaires. Citons, pour exemple, les manifestes de Séb. Faure : Vers la Paix et La Trêve des Peuples, d’un ton plus hardi et plus net que celui de Rolland et qui l’ont précédé. Notre camarade persévéra d’ailleurs dans son opposition et il lançait, fin 1915, Ce qu’il faut dire, journal hebdomadaire harcelé par la censure et autour duquel se serraient les résistants et réfractaires à la guerre... Combien d’appels antiguerriers ‒ dans les conditions difficiles où ils durent s’élaborer et se répandre ‒ sont aujourd’hui oubliés, noyés qu’ils furent sous la vague de chauvinisme et les campagnes des « bourreurs » nationaux.
‒ LANARQUE.
MÉLODRAME
(Voir théâtre.)
MÉLOPÉE
(Voir musique.)
MÉMOIRE (SA GENÈSE, SON ÉVOLUTION, SA CULTURE)
Si l’on excepte les mots techniques ou désignant quelque objet ou acte incomplexe, la plupart des termes du langage courant ont des acceptions multiples ou vagues, soit par l’effet des fluctuations de l’usage, soit en raison de la difficulté qu’il y a à délimiter le concept qu’ils expriment. Le mot mémoire est au nombre de ces derniers.
Quelle est l’essence, quelle est l’étendue des phénomènes que symbolise le vocable mémoire ?
Dans son sens le plus large, le mot mémoire exprime la persistance du passé dans le présent, « un effet consécutif d’événements disparus sur les phénomènes actuels ». (H. Piéron). Mais alors, il faut en doter les corps bruts. Auguste Comte a écrit :
« La faculté de contracter de véritables habitudes, c’est-à-dire des dispositions fixes, d’après une suite suffisamment prolongée d’impressions uniformes, faculté qui semblait exclusivement appartenir aux êtres animés, n’est-elle pas aussi clairement indiquée, pour les appareils inorganiques eux-mêmes. »
En vibrant, les instruments de musique acquièrent la propriété de vibrer davantage. L’usage les rend plus sonores. Or, nous dit le professeur Pierre Delbet :
« L’habitude (voir ce mot) est une mémoire. On peut aussi bien dire inversement que la mémoire est une habitude. Il n’y a pas de différence entre les deux phénomènes. » C’est là l’opinion de beaucoup de physiologistes qui admettent une forme inorganique de la mémoire. « Qu’est-ce que la déformation de l’épine dorsale contractée, chez tant de jeunes enfants, à la suite d’une position vicieuse habituelle ? C’est tout simplement le signe extérieur, la preuve de la mémoire du rachis. » (Van Biervliet)
Une mauvaise direction pédagogique déforme le corps comme l’esprit, Le magnétisme rémanent, les transformations moléculaires d’un métal sons l’influence de vibrations longtemps répétées, l’image photographique révélée longtemps après exposition sont évidemment le prolongement, dans les réactions présentes d’une action passée.
Si cette extension du mot mémoire au domaine dé la matière brute est souvent rejetée, on fait moins de difficultés pour admettre la mémoire biologique. On a vu, dans la mémoire, un phénomène de résonance caractéristique de la vie (Le Dantec). L’héritage dans une lignée serait un fait de mémoire. (Richard Semon ; Eugénie Rignano). L’immunité acquise après certaines maladies ou certaines inoculations serait comparable à un souvenir. Et les expériences de Pavlov et de ses élèves viennent appuyer cette manière de voir. Voici l’une des plus récentes. Si l’on injecte une albumine dans le péritoine d’un animal, ce dernier réagit par une sécrétion qui neutralise les effets de la substance injectée. Que l’on répète souvent l’épreuve en l’accompagnant de l’émission d’une même note de musique, il arrivera un moment où le seul excitant musical, sans injection d’albumine, suffira à provoquer la sécrétion coutumière. Il y a là un fait de tout point comparable au ravivement d’un souvenir par l’effet d’une sensation qui lui a été antérieurement associée.
La mémoire psychologique, à son tour, comporte une infinité de degrés dont les premiers se relient aux formes précédentes. Ce sont des animaux inférieurs qui placés en aquarium prennent leurs attitudes habituelles à l’heure de la marée dont ils ne ressentent plus les effets. Ce sont des rythmes qui persistent lorsque la cause qui leur avait donné naissance s’est inversée. L’homme qui est appelé à travailler de nuit, conserve, quelques jours, le minimum de température nocturne que le repos ne motive plus.
Cependant. dès que l’on s’élève dans la série animale, un facteur nouveau apparaît ou du moins devient prépondérant (car il se manifestait déjà dans les expériences de Pavlov) : c’est la mémoire associative.
« La mémoire associative consiste essentiellement en ceci qu’une réaction provoquée par un facteur apparaîtra sous l’influence d’une autre facteur qui aura été plus ou moins souvent associé au premier. »
C’est le chien qui las d’être enfermé manifeste sa joie lorsque son maître met son chapeau. C’est le bébé qui remue avidement les lèvres lorsqu’il voit allumer le réchaud sur lequel on fait tiédir sa bouillie.
La mémoire humaine ne paraît différer de la mémoire animale que parce que l’individu prend connaissance de lui-même par le dedans, c’est-à-dire subjectivement. L’influence du passé dont le physiologiste (qui l’étudie du dehors, objectivement) reconnaît le caractère matériel, se manifeste à nous par des images qui semblent insubstantielles. Nous nous figurons que le passé se représente à nos yeux. Pourtant la mémoire résulte du jeu d’une fonction comme toute autre ; l’acquisition des souvenirs se fait suivant une loi semblable à celle qui régit certaines réactions physicochimiques.
En adoptant la définition la plus générale du fait de mémoire nous ne trouvons pas de solution de continuité entre le monde inorganique et le spécimen le plus évolué des êtres organisés ; l’application d’une même désignation à l’ensemble est justifiée.
Les psychologues, pour la plupart, repoussent cette extension. Certains, comme Th. Ribot ont laissé de côté les faits physiques et les habitudes du monde végétal. D’autres, plus rigoureux ne veulent comprendre dans le concept mémoire que ce qui est reproduction spontanée et non simple conservation « alors le souvenir doit être défini, non plus un état qui dure, mais un état qui renaît. » (Dugas). ‒Où serait-il entre son origine et sa renaissance ? ‒En outre, il n’est point « le retour fixe, à intervalle régulier, la persistance rythmique de perceptions passées, mais le retour incertain, à un moment quelconque, de ces perceptions. » Réaction appropriée aux circonstances « elle est un phénomène d’adaptation. » ‒Il est pourtant des souvenirs fâcheux, d’effet nuisible. Il se distinguerait des habitudes, uniformes, involontaires, car il est variable et conscient ‒et les obsessions ? ‒Enfin le souvenir est intégré dans notre personnalité. « Un souvenir c’est un événement qui n’est pas seulement venu à telle heure dans ma vie, mais qui l’a marquée plus ou moins. » « Le souvenir doit avoir sa localisation dans le temps et son attribution au moi. » Si subtile que soit cette définition, qui, à la rigueur, pourrait s’appliquer à des animaux très inférieurs, elle a son utilité si elle ne tend qu’à circonscrire et à préciser le caractère de la mémoire humaine, la plus développée, la mieux nuancée, en laissant de côté la genèse de la fonction.
En réalité nous sommes bien en présence d’une série continue. Au point de départ, la mémoire passive ou inerte, fragmentaire. Au point d’arrivée, la mémoire active ou vive, systématisée. D’un bout de la chaîne à l’autre la passivité se réduit et l’activité s’accroît. Mais ni l’une ni l’autre, n’est jamais totalement absente. Un choc laisse une trace sur la pierre qui le subit passivement, mais ce choc prolonge activement ses effets : l’ébranlement moléculaire consécutif, la dégradation de la surface moins résistante aux agents naturels. À l’opposé, lorsqu’un souvenir paraît surgir spontanément, entrer en activité au moment favorable pour nous, il faut bien qu’il ait son origine dans des empreintes, des modifications de la matière organique dont notre corps est composé. La systématisation, nulle au début de la série, se développe de même progressivement à mesure que les connexions cellulaires et nerveuses prennent de l’importance.
Il est important de remarquer que « la mémoire doit être regardée comme une fonction dynamique et non comme un magasin d’images ». (Von Monakow, Piéron). Il faut se garder de considérer un souvenir comme un minuscule cliché conservé dans une cellule de notre cerveau. Celles-ci sont assez nombreuses pour suffire à tous nos besoins (plus de neuf milliards dans la seule écorce cérébrale), mais toute perception complexe qui pénètre en nous se décompose en éléments.
« La mémoire n’est pas autre chose que le renforcement, la facilitation du passage de l’influx nerveux dans certaines voies... La mémoire ne réside pas dans l’image, considérée comme un ensemble statique, mais dans le pouvoir dynamique de reconstitution de la perception, dont les éléments ne sont autres que des sensations, sensations ravivées, sensations suscitées par une excitation d’origine centrale au lieu de l’excitation périphérique habituelle, sensation qui pourrait aussi bien être provoquée par une excitation électrique artificielle si nous pouvions limiter celle-ci aux éléments corticaux utiles. » (Piéron)
On a souvent opposé à la mémoire, l’intelligence et la raison.
Assurément, tant qu’il n’y a rien de plus que la conservation de l’empreinte du passé, qu’il s’agisse de matière inorganique (cas de la loi de Lenz-Le Chatelier) ou d’êtres vivants (sensibilité différentielle) il peut y avoir réaction adaptée, mais c’est seulement quand il y a liaison entre les traces laissées dans l’organisme par des sensations simultanées que le psychisme peut s’ébaucher et quand des relations s’établissent entre des ensembles de sensations ou phénomènes consécutifs, que la raison commence à se manifester. L’intelligence est la connaissance des rapports entre des phénomènes qui se sont succédé. Il ne peut y avoir intelligence sans mémoire. Toute opération intellectuelle comporte une association d’idées et cette association n’est possible que grâce à la conservation de souvenirs intégrés à notre personnalité.
De même que l’assimilation des éléments par notre corps rencontre une limite, l’intégration dans notre personnalité mentale de la multitude d’impressions qui nous assaillent est soumise à des conditions, elle a des bornes, reculées sans doute, mais que ne sauraient être transgressées sans risque de fourvoiement. Un afflux trop considérable et trop précipité d’impressions provoque l’affolement de notre esprit, l’impossibilité d’un classement, d’une élaboration qui ne peut résulter que d’une fusion des sujets nouveaux avec l’essence des événements passés. Faute d’un choix parmi les sensations perçues, leur masse confuse sera rejetée en bloc, sans avoir été digérée, sans avoir nourri l’esprit. C’est le cas des mémoires brutes, automatiques.
Comment s’opère le choix des éléments à retenir ? Il exige d’abord l’attention, l’intérêt porté à une certaine catégorie de phénomènes. « Quand on ne sait pas ce que l’on cherche, on ne comprend pas ce que l’on trouve », a dit Claude Bernard. On encombre son cerveau de matériaux inutilisables qui s’éparpillent après en avoir disloqué le tissu fragile. Normalement, le plus grand nombre, parmi les collections d’impressions reçues, ne rencontrant pas de semblables dans le contenu de notre appareil psychique, passe inaperçu ou tombe presque aussitôt dans l’oubli. L’oubli est la condition même de la mémoire associative. Parmi les faits retenus, une discrimination s’effectue. Ceux qui concordent avec des expériences maintes fois reproduites, qui ont provoqué des réactions constantes de notre comportement, servent simplement à renforcer ces réactions, à consolider une habitude. Quant aux autres, après une confrontation immédiate ou différée, suivant les cas, avec les données antérieurement enregistrées, ils sont incorporés à notre patrimoine intellectuel. Tout fait qui prend place parmi nos souvenirs a été l’objet d’un jugement préalable ; à son tour il est le point de départ de nouveaux jugements. Mémoire, association et raison progressent de conserve.
Le fait de mémoire, nous l’avons dit, n’est pas une image qui se dévoile, le passé qui se reproduit intégralement. Nous ne vivons que dans l’instant présent, présent qui est constitué par la synthèse de toute notre vie passée (passé ancestral compris, au moins pour la partie qui n’a pas été éliminée au cours des réductions génétiques.) Le souvenir d’un événement passé n’est jamais que le passé influencé par tout ce qui nous est survenu depuis. Ceci est important lorsqu’il s’agit d’apprécier la valeur des témoignages. Le témoin le plus sincère peut, à son insu, dénaturer la vérité. On peut même avancer qu’aucun témoin ne rapporte la vérité intégrale. Celle-ci ne peut venir, et encore à grand peine, que de la confrontation d’un grand nombre de témoignages. Testis unus, testis nullus.
La mémoire n’est pas une faculté complètement individualisée. Elle est d’origine sociale pour une large part ; et cela explique la richesse comparative de la mémoire humaine. Halbwachs a publié un ouvrage sur « les cadres sociaux de la mémoire » où sont étudiés « les caractères et les conditions de ces souvenirs précis, déterminés, localisés et datés, relatifs à des événements qui n’ont eu lieu qu’une fois et qui ne se sont jamais intégralement reproduits ».
« Ce n’est donc pas de notre mémoire proprement personnelle que notre passé tient la consistance, la continuité, l’objectivité en un mot, qui le caractérise à nos propres yeux... il les doit à l’intervention de facteurs sociaux, à la perpétuelle référence de notre expérience individuelle, à l’expérience commune à tous les membres de notre groupe, à son inscription dans des cadres collectifs auxquels les événements se rapportent au fur et à mesure qu’ils se vivent, auxquels ils continuent d’adhérer une fois disparus et au sein desquels nous en effectuons non seulement la localisation, mais même le rappel. » (Blondel)
« Comme la perception générique, le souvenir proprement dit est l’acte d’une intelligence socialisée et opérant sur des données collectives. »
Pourtant l’action du milieu social sur l’individu ne s’exerce pas toujours dans un sens favorable. Nous avons vu que dans la série animale le progrès de l’intelligence était parallèle à celui de la mémoire en voie d’organisation. Il en a été sans doute de même au début des sociétés humaines. De la haute perfection de la mémoire au début de la période historique, nous avons la preuve dans la transmission orale des légendes et des longs poèmes, dans le rôle de la tradition dans l’évolution des sociétés et la conservation des connaissances techniques. Il semble que depuis lors la capacité mnémonique se soit restreinte plutôt qu’accrue, du moins relativement aux exigences de la vie.
« Les intelligences individuelles ne paraissent pas non plus progresser nécessairement dans leur niveau moyen pour ce qui est des races depuis longtemps civilisées ; le savoir seul est en croissance. Le progrès mental est incontestable mais il concerne le savoir ; or le savoir n’est plus individuel ; il n’est pas héréditaire non plus, semble-t-il, il est social. L’évolution biologique de la mémoire paraît terminée ; mais il existe en outre une évolution sociale de la mémoire qui, à notre époque, est déjà singulièrement avancée. » (Piéron)
Le volume moyen des cerveaux reste le même, les bibliothèques s’agrandissent.
« Mais le progrès risque d’être enrayé par la charge de plus en plus lourde des acquisitions antérieures que doivent traîner les générations nouvelles ; la force excessive de la mémoire sociale devient réellement dangereuse pour l’individu qu’elle emprisonne et qu’elle stérilise. » (id.)
Quelle direction devons-nous donc donner à l’enseignement théorique et technique pour que le savoir ne porte pas préjudice à l’intelligence ? Devons-nous tenir pour suspecte une très bonne mémoire ? Non, Comme le fait remarquer P. Delbet :
« C’est une grande force de pouvoir évoquer d’un coup un nombre considérable de souvenirs, de façon à envisager les phénomènes au point de vue le plus général. »
Il dit encore :
« Pour moi qui fais passer des examens de chirurgie, la question est celle-ci. En présence d’un malade, le candidat devenu médecin, retrouvera-t-il ses souvenirs ? L’excitation causée par la constatation d’un symptôme sera-t-elle suffisante pour faire entrer en fonction ses cellules cérébrales ? Si oui, le candidat sait. Si non, il ne sait pas. Ses connaissances sont pratiquement inutilisables ; elles sont comme si elles n’étaient pas. »
Il faut donc cultiver la mémoire. Et cette culture est à la fois psychologique et physiologique. Les impressions pénètrent en nous par les sens. Il faut donc développer, aiguiser, fortifier les sens. Œuvre de détail et aussi d’ensemble, car le fonctionnement des organes de relation est dans la dépendance de la santé générale. Il faut que les impressions ne soient pas fugitives, ce qui réclame l’attention, d’abord sensibilité soutenue de tout l’organisme à tout changement, état qui ressortit au tonus musculaire et nerveux, puis concentration de cette sensibilité sur un objet spécialement choisi dans l’ensemble des faits particuliers qui composent le phénomène total observé. Ceci réclame la mise en jeu de l’énergie psychique et aussi de l’activité de tout l’être, car il faut analyser le phénomène, raviver les souvenirs anciens pour établir des relations entre les impressions. passées et celles du présent, enfin introduire celles-ci dans la personnalité. Ceci constitue un jugement. L’intégration à la personnalité resterait précaire, si le souvenir qui vient d’être emmagasiné demeurait inerte. Il faut donc qu’à son tour il soit le point de départ de processus analogues, qu’il entre fréquemment en activité. Perfectionnement de la sensation, de l’attention du jugement, de l’activité, voilà en quoi consiste la culture de la mémoire. Et la recherche de ces qualités serait compromise si l’état physique de l’individu n’était pas lui-même l’objet de soins assidus. La mauvaise opinion que nous avons de la mémoire vient de ce que nous confondons les souvenirs dus à un travail personnel avec la mémoire paresseuse ou infirme qui consiste à retenir des jugements tout faits sur des objets que d’autres ont observés, à saturer le cerveau de reflets de deuxième ordre.
Devons-nous aller jusqu’à rejeter l’expérience de nos devanciers, former les esprits en leur faisant parcourir à nouveau le cycle d’essais et d’hypothèses qui ont amené la science à son état actuel ? Cela serait impraticable. D’ailleurs, durant le premier âge, l’enfant est naturellement conduit à utiliser à la fois l’expérience des adultes qui l’entourent et la sienne propre ; sa raison naissante a besoin du secours de leur raison. Mais c’est à des objets qui sont à sa portée, aux événements de sa vie même que doivent se rapporter les règles logiques dont on lui montre l’usage. L’enseignement des sciences devra être accompagné d’un résumé de leur histoire. La répétition du processus de découverte est même de rigueur pour quelques lois essentielles. Ainsi, sans surcharger la mémoire de l’enfant, en fera naître en lui l’ambition de créations personnelles ou tout au moins de combinaisons nouvelles.
On a prétendu soulager la mémoire grâce à des procédés artificiels dits mnémotechniques. Tout l’exposé que nous avons fait condamne ces artifices le plus souvent puérils. Le véritable appui de la mémoire est l’intérêt que porte l’élève au sujet étudié, s’ajoutant à la conscience qu’il prend des liens logiques qui l’unissent aux connaissances déjà acquises.
L’apprentissage doit s’inspirer des mêmes principes. L’habitude, nous l’avons vu, n’est qu’une forme de la mémoire. Si celle-ci risque d’être automatique et bornée, celle-là peut devenir routinière et exclusive. La formation professionnelle ne doit pas se restreindre à une spécialité unique. Le degré d’entraînement d’un organe et d’une faculté isolés est limité ; pour gagner un échelon, il faut faire profiter l’ensemble. Il y a un équilibre obligé dans le jeu de tous les appareils vitaux ; l’éducation technique est dans la dépendance de la culture générale, elle requiert une sensibilité étendue, du jugement, une personnalité puissante. Le développement du machinisme moderne, séparant la pensée de l’action, uniformisant et disciplinant sévèrement les gestes, refrénant les initiatives, abolissant la personnalité, met en danger la civilisation plus encore que l’esclavage antique. Étroite spécialisation, taylorisation du travail non compensée par la variété des occupations, autant de menaces pour l’intelligence humaine.
‒ G. GOUJON.
MÉMOIRE (CARACTÈRES GÉNÉRAUX, ÉDUCATION, etc.)
Ce que c’est que la mémoire
Les psychologues et les philosophes admettaient presque tous autrefois que chaque individu possédait un corps et une âme douée de certains pouvoirs ou facultés : faculté de vouloir ou volonté, faculté de se souvenir ou mémoire, etc. Aujourd’hui cette conception est abandonnée.
« Si, en disant : nous avons la faculté de la mémoire, vous n’entendez rien autre qu’une abstraction désignant le pouvoir intérieur de se souvenir du passé, il n’y a là aucun mal. Nous possédons cette faculté, puisque nous avons incontestablement ce pouvoir. Mais si par faculté vous entendez un principe d’explication de notre pouvoir général de réminiscence, alors votre psychologie est vide. La psychologie associationniste, au contraire, donne une explication de chaque fait particulier de la mémoire, et elle explique ainsi la faculté en général. Dire de la mémoire : c’est une faculté, n’est donc pas une explication réelle et dernière, car elle doit être elle-même expliquée par l’association des idées... Si la mémoire était une faculté accordée à l’homme dans un but tout pratique, c’est des choses les plus nécessaires que nous devrions nous souvenir le plus aisément. La fréquence des répétitions et la date récente de l’idée reçue dans l’esprit ne joueraient aucun rôle. Mais nous nous souvenons mieux des choses arrivant fréquemment et à une date peu éloignée ; nous oublions les choses anciennes expérimentées une seule fois. Dans l’hypothèse émise plus haut, tout cela est une anomalie incompréhensible. » W. JAMES. (Causeries pédagogiques)
Mais si, comme l’indique fort bien W. James, on n’explique rien en disant que nous nous souvenons parce que nous avons une faculté que l’on appelle : mémoire, on n’explique pas tout au moyen de la psychologie associationniste. Sur bien des points même la psychologie associationniste ‒ qui a évolué et évoluera encore ‒ paraît nettement en désaccord avec les faits. C’est le cas par exemple des souvenirs globaux d’images : ce n’est pas à la suite de l’association des détails d’une image que nous reconnaissons cette image, nous pouvons, par exemple, être incapables de reconnaître chacun des détails d’un portrait, pris isolément, tout en pouvant aisément reconnaître l’ensemble. Il est souvent plus aisé de se souvenir des ensembles que des détails ; il sera plus facile à un enfant de reconnaître cinq ou six mots, présentés globalement, que cinq ou six lettres et les auteurs des méthodes globales de lecture ont tiré parti de ce fait.
En réalité, la psychologie scientifique est de date récente, les problèmes qui se posent à elle sont extrêmement compliqués et les résultats qu’elle a obtenus sont peu nombreux et souvent discutables. Nous n’essaierons donc pas d’expliquer les pourquoi de la mémoire. Deux hypothèses sont possibles au sujet de la conservation des souvenirs :
-
les souvenirs se conservent sous forme de modifications cérébrales ;
-
ils se conservent sous forme de phénomènes psychologiques inconscients, indépendants du cerveau.
D’après Bergson, ces deux hypothèses seraient partiellement vraies, le passé se survivrait sous deux formes distinctes :
-
dans les mécanismes moteurs dépendants du cerveau ;
-
dans des souvenirs indépendants.
Il n’y a pas davantage accord en ce qui concerne les limites de la mémoire. Dans le langage courant on donne le nom d’habitude à une mémoire motrice résultant de la répétition mais ce que l’on considère comme mémoire est bien souvent dû, en réalité, à un apprentissage moteur, l’enfant qui récite une poésie le fait grâce à des souvenirs moteurs d’articulation beaucoup plus qu’à l’aide de la mémoire des idées.
On tend « généralement aujourd’hui, écrit Piéron, à envisager comme habitude tout apprentissage, toute acquisition qui se perfectionne par répétition, et à réserver à la mémoire les souvenirs d’événements uniques non susceptibles d’être répétés, repassés ».
Un certain nombre de psychologues restreignent le sens du mot mémoire d’une autre façon. La mémoire ne serait pas seulement l’évocation d’une expérience antérieure ; pour qu’il y ait fait de mémoire la persistance, l’aptitude à renaître du souvenir doit être complété par un caractère personnel, subjectif, il faut que l’individu ait conscience que le souvenir évoqué est un élément de son expérience antérieure. C’est un tel sens restreint qu’admet Dugas lorsqu’il distingue le savoir des souvenirs et écrit : « Ce n’est pas à la qualité d’être conservées et rappelées, mais à celle d’être reconnues par l’esprit comme ses acquisitions individuelles et propres que les connaissances doivent le titre de souvenirs. »
Des divisions de la mémoire
Il est d’observation courante que les individus diffèrent considérablement en ce qui concerne leur aptitude à se souvenir non seulement au point de vue quantitatif mais encore au point de vue qualitatif. Certes l’intérêt est pour beaucoup dans ces différences : si le marchand se souvient mieux des cours des marchandises, le sportsman des records athlétiques, etc., ceci tient pour une bonne part à l’Intérêt et à la répétition, mais il n’est pas vrai qu’on retienne aisément tout ce qui intéresse et notre magasin de souvenirs en renferme assez souvent qui ne nous intéressent que peu ou point. La complication de la mémoire apparaît surtout lorsqu’on étudie les anormaux, les surnormaux et les malades.
En 1861, Broca, à l’aide de deux autopsies, démontra que l’aphasie est liée à une lésion siégeant dans la partie supérieure du pied de la troisième circonvolution frontale du cerveau gauche. Ce serait dans cette partie du cerveau que serait localisée la mémoire des mots et par suite d’une lésion cervicale la mémoire des mots pourrait disparaître ou être affaiblie alors que la mémoire générale resterait intacte.
À la suite des travaux de Broca, d’autres savants s’efforcèrent d’établir de nouvelles localisations et différenciations ; c’est ainsi que selon Djérine il n’y aurait pas une mémoire verbale mais trois : la mémoire visuelle des caractères, la mémoire auditive des mots et la mémoire motrice d’articulation.
Mais il y eut des excès dans ces tentatives de localisation, soit par suite de l’interprétation abusive d’observations cliniques incomplètes soit parce que les lésions cérébrales observées étaient trop étendues ou sans limites précises.
Enfin les premiers observateurs ne tinrent pas assez compte de différences individuelles souvent fort importantes. Pour n’en prendre qu’un exemple, le centre de Broca se trouve d’ordinaire du côté droit chez les gauchers.
Se plaçant à un autre point de vue, des psychologues ont pensé qu’il y avait lieu de distinguer deux formes de la mémoire : la mémoire statique et la mémoire dynamique. Lorsque nous nous souvenons de la couleur ou de l’odeur d’une fleur, par exemple, il y aurait mémoire statique. Si au contraire nous avons une poésie à apprendre nous n’aurons pas à retenir des mots, que nous connaissons déjà, mais l’ordre de ces mots, notre souvenir sera réduit à une nouvelle série d’associations entre des souvenirs-états (souvenirs statiques) précédemment acquis.
Mais c’est tout à fait arbitrairement que l’on peut ainsi diviser la mémoire et opposer l’image statique et l’enchaînement dynamique ; cette distinction, comme celle des diverses étapes de la mémoire que nous allons voir plus loin, est nécessaire pour apporter plus de clarté à l’étude mais n’est pas l’image exacte de la réalité.
Le langage et les enchaînements dynamiques interviennent en effet sans cesse dans les souvenirs sensoriels qui n’existent à l’état pur que chez le tout petit enfant. Si je veux me souvenir de la couleur d’une rose, j’observerai, par exemple, que sa couleur est intermédiaire entre le jaune de l’orange et le jaune du citron ; j’intellectualiserai ainsi mon souvenir et ferai appel à des enchaînements dynamiques. Ceci a une grosse importance au point de vue de l’utilisation de la mémoire, les procédés mnémotechniques employés ont pour but de remplacer la mémoire des sensations par la mémoire des idées.
On oppose aussi parfois mémoire sensorielle et mémoire verbale, mémoire brute et mémoire organisée. Toutes ces oppositions sont également quelque peu arbitraires et, bien qu’il n’y ait pas équivalence absolue entre les termes, on peut dire, d’une part : mémoire statique, sensorielle ou brute, et d’autre part : mémoire dynamique, verbale ou organisée. Mais, comme nous l’avons déjà dit, la forme statique, sensorielle ou brute de la mémoire n’existe, à l’état pur, que chez le tout petit enfant et on peut même dire que toute mémoire est associative car le rappel même des éléments purement sensoriels est le résultat d’une excitation de nature associative.
Lorsque l’on parle des formes de la mémoire il ne faut pas oublier la mémoire affective. Les souvenirs affectifs sont d’ailleurs, en partie, produits par des associations intellectuelles.
Les étapes de la mémoire ‒ Comment se servir de sa mémoire
Si nous examinons l’évolution d’un souvenir, nous pouvons distinguer ‒ mais cette distinction est quelque peu arbitraire ‒ quelques étapes. L’évolution des souvenirs est soumise à des lois, que nous indiquerons à propos de ces étapes, dont la connaissance est utile à tous ceux qui veulent apprendre à se servir de leur mémoire.
1° L’acquisition.
L’acquisition peut être spontanée sans que l’individu le veuille ou même malgré sa volonté. « Elle dépend alors de l’intensité de l’excitation, de sa valeur affective, des dispositions d’esprit plus ou moins réceptives dans lesquelles le sujet se trouve, de la répétition de l’excitation. »
Souvent l’acquisition est voulue et nécessite un effort d’attention plus ou moins prolongé du sujet.
a) Les facteurs de la fixation.
L’acquisition d’un souvenir se fait d’autant mieux et d’autant plus vite qu’on y consacre un plus grand effort d’attention. Pour rendre les enfants aptes à apprendre vite et bien il faut développer leur capacité d’attention par l’éducation. L’attention est nécessaire pour acquérir des impressions vives et des notions claires. Pour se souvenir d’un fait, il faut l’avoir bien observé. C’est une erreur que d’agir envers la mémoire de l’enfant comme envers la panse d’un ruminant en voulant y accumuler des notions confuses que l’on supposerait devoir être assimilées plus tard. La mémoire de l’enfant ne peut retenir et utiliser de telles notions.
Les états affectifs, plaisir, peine, passion, augmentent la vivacité de l’impression et « l’action fixatrice de certaines émotions paraît dépasser de beaucoup celle que peut posséder l’attention la plus vive. » (Piéron).
En dehors de la volonté, le plus puissant levier de l’attention est l’intérêt qui, surtout chez les enfants, est « le facteur le plus efficace de l’acquisition rapide des souvenirs. » En un certain sens, l’art de se souvenir est donc l’art de s’intéresser à quelque chose ; de ce point de vue des études superficielles sont condamnables, on ne s’intéresse pas à ce que l’on ne comprend pas ou que l’on comprend mal, mais l’intérêt vient et s’accroit au fur et à mesure qu’on approfondit les sujets d’études.
Cette importance de l’intérêt justifie par là même la nécessité d’aller toujours du facile au difficile, les progrès rapides servent de stimulant.
Si vous avez à faire appel à la mémoire des enfants, songez avant tout à obtenir la vivacité de l’impression et la clarté de la notion à enseigner et pour ceci sachez utiliser l’intérêt extrinsèque : images des livres, récompenses, compositions, etc., mais songez qu’il ne vaut pas l’intérêt intrinsèque qu’il importe avant tout d’obtenir (voir au mot intérêt). Un autre moyen d’augmenter la vivacité de l’impression, c’est de faire appel à la multiplicité des images coexistantes.
« L’expérience a appris qu’une multiplicité de sensations, à la condition bien entendu que toutes se réfèrent au même objet, favorise la mémoire. » (Binet)
Plus il y aura de sens à enregistrer une impression, plus celle-ci sera vive et durable.
Ceci ne veut pas dire qu’il faut faire également appel à tous les sens. Chacun de nous a d’ordinaire un sens qui prédomine, il faut avant tout se servir de ce sens mais il ne faut pas s’en servir exclusivement. Chez la plupart des individus on peut constater une réelle supériorité de la mémoire visuelle, de là l’utilité des gravures, des graphiques, des schémas, des caractères qui diffèrent par la grandeur, la couleur, etc., des mots soulignés, etc.
Si nous voulons bien nous souvenir d’une rose nouvelle, il nous faut observer attentivement sa couleur, son odeur, sa forme, sa grosseur, sa tenue (plus ou moins rigide), le soyeux de ses pétales, en utilisant nos yeux, notre nez, nos doigts même pour faire ainsi appel à la multiplicité des impressions. Mais nous rendrons nos souvenirs plus sûrs, plus précis encore si nous faisons appel à des associations d’images et d’idées. Si nous comparons la couleur de cette rose à la couleur d’autres roses ou même d’autres fleurs, si nous découvrons par exemple qu’elle est rouge coquelicot, etc. ; si nous observons, si nous réfléchissons également à propos de sa forme, etc., nos souvenirs gagneront en richesse. La mémoire ne peut rendre ce qu’on ne lui confie pas : si on confie à la mémoire d’un enfant des phrases incomprises, cet enfant ne peut se souvenir des idées correspondantes ; l’activité de la pensée est l’une des plus importantes conditions d’une bonne mémoire.
« Après l’attention, dit Atkinson, l’association des idées est le facteur le plus important de la mémoire. C’en est même un facteur nécessaire, à tel point qu’il ne peut y avoir, selon Piéron, d’acquisition de souvenirs isolés, d’images indépendantes, la loi de notre vie mentale étant d’être faite d’enchaînements. C’est, dit-il, avant tout par la multiplicité des liens associatifs que la mémoire humaine apparaît supérieure. Ce sont ces liens qui permettent d’évoquer les souvenirs. Mais ces liens, c’est l’intelligence qui les crée ou les découvre ; « il faut donc une pensée constamment active et qui laisse chaque fois entre les éléments de l’esprit comme les fils d’une gigantesque et précieuse toile, grâce à laquelle elle peut ensuite retrouver plus facilement la route déjà suivie. » (Ch. Julliot)
Comment créer de tels liens associatifs ? Binet nous donne à ce sujet de précieux conseils ;
« En premier lieu, on cherchera, toutes les fois qu’on veut acquérir un souvenir important, à effectuer des rapprochements entre ce qu’on apprend et ce qu’on sait déjà, afin que l’acquisition fasse corps avec le stock des connaissances... En second lieu, on cherchera à créer des associations entre le souvenir et des points de repère qui serviront à l’évoquer... En troisième lieu, ce qu’il faut éviter, ce sont les associations dangereuses, qui rapprochent ce que l’on doit tenir séparé. Une règle de pédagogie, malheureusement peu connue, servirait à éviter celte erreur ; c’est que c’est au moment de la formation d’un souvenir qu’il faut intervenir de la manière la plus active pour éviter les mauvais nœuds d’association... si vous enseignez l’orthographe, ne mettez pas en discussions l’orthographe des mots inconnus, ou ne relevez pas tout haut des erreurs commises, ou enfin ne donnez pas à vos élèves l’occasion de commettre des erreurs dans des dictées mal préparées... On évitera bien des erreurs, bien des confusions d’esprit, et bien du travail inutile, en se rappelant que la mémoire consiste à conférer d’abord à ce qu’on apprend une individualité ; c’est seulement lorsque le souvenir est bien individualisé qu’on peut risquer des comparaisons entre objets analogues ou peu différents. »
b) Le rythme dans la mémorisation.
Notre vie est soumise à des rythmes multiples : les alternatives de sommeil et de veille, la respiration, la circulation, le développement physique des individus avec ses périodes de croissance, etc. L’effort d’attention nécessaire, dans presque tous les cas, à la mémorisation ne saurait échapper à cette influence du rythme. L’état de nos forces est chose variable mais, en règle générale, nous pouvons dire que nous nous fatiguons de plus en plus pendant la veille et que nous réparons nos forces pendant le sommeil. Or, si l’individu fatigué peut encore se livrer à un travail machinal, il ne pourra que mal apprendre s’il veut se livrer à l’étude : les candidats surmenés qui préparent un examen gardent peu de souvenirs de ce qu’ils ont appris étant en cet état. Il semblerait donc que l’étude du matin serait plus fructueuse que l’étude du soir. Mais il y a des différences individuelles, certaines personnes sont mal disposées à l’étude le matin et enfin pendant le sommeil notre inconscient travaille et il le fait le plus souvent avec les matériaux qui lui ont été fournis peu de temps auparavant, « quelques personnes ont remarqué que si on lit la leçon le soir, on la trouve sue au réveil... » (Binet). Il est donc essentiel de choisir l’heure de l’étude après avoir recherché à quel moment de la journée l’effort de mémorisation est le plus profitable pour nous.
La durée de l’effort n’est pas non plus sans importance et varie également selon les individus. Pour faire un travail quelconque nous devons d’abord nous mettre en train et cette période de mise en train est une période de rendement faible mais croissant qui précède une période de rendement maximum, suivie elle-même, lorsque le travail se prolonge et amène la fatigue, d’une période de rendement décroissant.
Il convient donc d’éviter : d’une part, une durée trop courte qui serait prise entièrement ou presque par une période de mise en train ; d’autre part, une étude trop longue amenant la fatigue, c’est-à-dire un rendement défectueux en quantité et en qualité.
Il faut, certes, faire effort et se défier des acquisitions rapides car ce qui est vite appris est vite oublié, mais il faut aussi ménager l’effort et savoir prendre des repos, « la fixation d’un souvenir comporte un processus physiologique qui évolue assez lentement dans l’intimité de la substance nerveuse ; il faut attendre, avant de faire un nouvel effort, que l’effort précédent ait donné à peu près tout son effet. De même les bons rameurs ne précipiteront pas leurs coups d’avirons, mais ne pèseront à nouveau sur la rame que lorsque l’effort précédent aura rendu ce qu’Il pouvait rendre, se réglant sur un rythme optimum » (Piéron). Binet évalue la durée d’étude optimum à un quart d’heure environ et Piéron écrit :
« Le rythme optimum sera atteint pour un intervalle de dix minutes entre les efforts successifs. »
Mais il est évident que ces durées sont approximatives et qu’elles dépendent des individus comme aussi de la difficulté de l’effort à accomplir. Mais que faut-il faire pendant les intervalles entre les efforts ? il est bon de se reposer ou de faire un travail machinal ; car cette phase qui suit un travail actif n’est du repos que par l’apparence ; en réalité, à ce moment là les souvenirs qu’on vient de fixer s’organisent, ils deviennent plus stables, ils entrent définitivement dans la mémoire, comme un liquide trouble qui se dépose. (Binet).
« Allons plus loin ; si, après avoir exercé sa mémoire on ne peut pas trouver le repos qui est nécessaire à l’organisation des souvenirs qu’on vient de fixer, il faut tout au moins prendre une précaution, ne pas se livrer à un travail analogue à celui qui vient de nous occuper ; quand on veut apprendre par cœur un morceau de musique, on compromettrait l’œuvre de la mémoire si aussitôt après on se mettait à lire ou à chanter d’autres airs de musique. Des expériences nombreuses de Cohn, Bourdon, Münsterberg, Bigham, mettent ces effets hors de doute, et V. Henri, qui rapporte en détail ces recherches de laboratoire, y ajoute une remarque bien intéressante. Si nous nous rappelons mieux le matin une leçon apprise la veille au soir que si nous l’avions apprise le matin et cherchions à la réciter le soir, c’est parce que dans le premier cas nous nous sommes reposés pendant l’intervalle, tandis que dans le second cas l’intervalle à été rempli par un grand nombre d’impressions, qui ont nui au travail d’organisation des souvenirs. » (Binet)
Comment faut-il répéter un texte que l’on veut apprendre par cœur ? Il y a diverses manières : d’abord la lecture à haute voix et ensuite la répétition mentale, généralement les écoliers préfèrent la première manière, plus machinale, mais l’expérience prouve que la seconde manière, qui demande plus d’attention, est celle qui a le plus d’efficacité.
Deux autres manières de répéter s’opposent également : l’une fragmentaire, l’autre globale. « Quand un enfant s’exerce librement à mémoriser une poésie, il découpe le morceau en strophes, et chaque strophe en une grand nombre de petits fragments qu’il cherche à se rappeler chacun pour son compte. Or, plusieurs expérimentateurs (Miss Steffens, Larguier des Bancels, Lobsien) ont démontré que ce procédé fragmentaire est défectueux et donne de moins bons résultats que le procédé global qui consiste à lire une série de fois, mais toujours d’un bout à l’autre, le morceau à apprendre. Ce procédé global est préférable, non pas parce qu’il assure la rapidité de l’acquisition, mais parce qu’il intensifie la conservation. » (Demoor et Jonkheere).
Mais pourquoi la méthode globale serait-elle supérieure à la méthode fragmentaire ?
« Nous croyons, dit Binet, que la supériorité de la méthode globale tient à beaucoup de petites causes ; mais la principale, à notre avis, c’est qu’elle utilise la mémoire des idées, tandis que par l’autre méthode, on ne fait intervenir que la mémoire sensorielle des mots. »
« Les souvenirs, écrit Piéron, tendent à s’effacer les uns les autres ; si vous savez un chapitre, le fait d’apprendre le chapitre suivant vous fera oublier le précédent... D’ailleurs, entre les fractions apprises, par cette dernière méthode, il persiste des entailles, où le bloc mnémonique se coupera, tandis que, dans la méthode globale, le bloc n’aura pas de fissures aussi marquées. »
« Toutefois, affirment Demoor et Jonckheere, les expériences récentes que nous avons faites avec les enfants d’école primaire font accorder au procédé fragmentaire la même valeur qu’au procédé global, lorsque, au lieu de morceler la poésie à l’infini, les enfants utilisent des fragments qui expriment une idée. »
Il nous paraît possible de concilier les méthodes fragmentaire et globale. Qu’il s’agisse d’étudier un chapitre d’un ouvrage pour en retenir la teneur analytique ou une poésie que l’on veut apprendre par cœur, nous commencerons par une lecture totale qui nous permettra de saisir l’idée générale du morceau, de résumer ce morceau en une ligne ou en quelques lignes. Cette vue d’ensemble est forcément plus ou moins confuse et notre deuxième opération, comme la suivante, aura pour but d’approfondir l’étude et de se faire une idée plus précise du texte. Pour cela nous diviserons ce texte en quelques parties, assez peu nombreuses pour éviter la confusion, que nous devrons subdiviser à leur tour. Nous noterons ces divisions et subdivisions sur un papier, en ne négligeant ni l’emploi des accolades ni celui des encres de couleur différentes pour les titres ou idées essentielles. Si la succession des diverses parties n’est pas suffisamment nette, nous nous efforcerons de la rendre plus claire en recherchant pourquoi telle ou telle partie suit une autre partie et en précède une troisième. À l’occasion, si l’établissement d’enchaînements logiques paraît trop difficile, nous pourrons user de la topologie. Cependant, avant d’user d’un procédé mnémonique, il convient de s’efforcer de s’en passer dans la mesure du possible, il convient donc d’abord de voir si les deux parties que l’on désire enchaîner l’une à l’autre forment une succession, si la deuxième est le complément ou développement de la première, si elle est déduite de celle-ci ou s’il n’y a pas opposition entre ces deux parties. Lorsque nulle liaison naturelle ne paraît possible, lorsqu’on ne peut imaginer nulle prose de liaison que l’on pourrait intercaler entre les parties, il est alors bon, comme nous venons de l’écrire, de recourir à la topologie. Cette méthode de mémorisation fut recommandée par Cicéron et est par conséquent fort ancienne, elle consiste à choisir des lieux familiers placés dans un ordre invariable et à y accrocher les idées.
Imaginez par exemple que vous quittiez votre maison et suiviez un chemin bien connu ; sur ce chemin se trouvent, je m’imagine, un arbre, une maison, etc., qui peuvent servir de points de repère. Accrochez donc la première partie de votre texte à l’arbre, la deuxième partie à la maison, etc., puis essayez, si cela vous paraît utile, d’accrocher les parties secondaires à des parties des choses ou objets de rappel ; aux branches, au tronc de l’arbre ; aux fenêtres, aux portes, à la cheminée, au toit, etc., de la maison. L’emploi de la topologie est justifié par la supériorité de la mémoire visuelle.
Après avoir classé et associé les différentes parties, il faut pousser l’effort d’analyse plus avant en procédant à l’étude des phrases et des mots employés.
S’efforcer d’exprimer les mêmes idées sous des formes différentes, essayer de remplacer certains mots pat des synonymes et voir si cela va mieux ou plus mal et apprécier la différence de sens qui résulte de ces changements, se demander pourquoi l’auteur a employé tel terme plutôt que tel autre, pourquoi il a employé certaine répétition ou pourquoi il l’a évité sont des moyens de développer l’esprit et d’enrichir la mémoire.
Nous avons bien classé, bien associé et approfondi l’étude du sens et de la forme, il nous faut répéter : en choisissant, si cela se peut, le moment favorable ; en donnant aux efforts de mémorisation la durée optimum et en les espaçant comme il convient. Il s’agit alors de savoir si nous voulons retenir la teneur littérale du texte, apprendre par cœur, ou nous contenter de sa teneur analytique, ou même procéder à une sélection et ne nous efforcer de retenir que certaines parties que nous voulons associer à des connaissances passées pour enrichir notre savoir sur un sujet donné. S’il s’agit avant tout de retenir des idées, c’est à la répétition mentale qu’il convient surtout de faire appel. Mais si nous voulons apprendre par cœur, il nous parait préférable de répéter à voix haute en donnant l’accentuation convenable ‒ après avoir recherché les mots importants ‒ et accompagnant cette lecture de gestes, qu’il faudra soigneusement choisir lors de la première lecture, en évitant de changer ces gestes aux différentes répétitions.
Il faudra aussi s’efforcer peu à peu de se passer du livre en ayant soin de vérifier fréquemment au début si la récitation est restée conforme au texte.
2° L’évanouissement.
« Peut-être aucun souvenir ne se perd-il complètement comme semblerait le prouver la reviviscence dans certaines circonstances exceptionnelles d’images qui semblaient oubliées. Mais pratiquement il ne faut envisager que la conservation efficace des souvenirs. C’est-à-dire que ne peuvent être considérés comme vraiment conservés que ceux qui peuvent être rappelés sans trop de peine au moment opportun. De ce point de vue on peut dire que la capacité de conservation est très limitée... L’oubli, entendu non comme une perte de l’expérience antérieure mais comme l’incapacité de l’évoquer dans les conditions favorables, s’étend donc à de larges tranches de notre passé. Sauf peut-être dans une période précoce de la vie il peut être considéré comme une condition de la mémoire et un allègement nécessaire de notre vie mentale. » (Vermeylen)
« Il y a quelque vérité dans l’opinion que la mémoire, non seulement se fatigue, mais s’oblitère. Si un souvenir ne chasse pas l’autre, on peut du moins prétendre qu’un souvenir empêche l’autre et qu’ainsi pour la substance cérébrale, chez l’individu, il y a un maximum de saturation. » (Delbœuf)
Il faut donc se défier de l’oubli et repasser fréquemment ce que l’on veut retenir. « Pour trouver facilement le souvenir que l’on possède dans le magasin de sa mémoire, il faut constamment « pratiquer » ce magasin ; au lieu de le remplir indéfiniment, au risque de n’y plus rien retrouver, mieux vaut se rendre capable d’aller toujours tout droit où se trouve ce que l’on cherche ». (Piéron).
3° L’intensification du souvenir. L’évocation.
Je connais le nom des rosiers de mon jardin ; mais il arrive parfois que je me trouve incapable de dire comment se nomme l’un d’eux, j’ai le nom « sur le bout de la langue » mais je ne peux le prononcer, je suis incapable de l’évoquer mais je ne l’ai pas oublié, je sais que si l’on prononce ce nom parmi d’autres je le reconnaîtrai et que je le reconnaîtrai aussi en feuilletant rapidement un catalogue où se trouve ce nom. La reconnaissance est un stade inférieur de la capacité d’utilisation du souvenir, il semble que ce soit une évocation inachevée. Pour qu’un souvenir soit facilement utilisable, il faut qu’il puisse être facilement évoqué.
L’évocation peut être automatique, comme dans le cas d’un écolier qui récite par cœur grâce à de simples associations de contiguïté. Elle peut être au contraire le résultat d’une association logique et réfléchie des idées.
Or, l’évocation automatique risque de nous faire prisonniers de notre mémoire. Si l’écolier qui a appris un résumé par cœur ne peut répondre à une question qui correspond à une phrase de ce résumé sans reprendre la récitation de ce résumé par le commencement, il se trouve être un tel esclave.
Il faut se dégager d’une telle contrainte en utilisant des études nouvelles. Il n’est pas bon de tout garder de nos acquisitions passées et il convient d’assouplir ce que nous voulons garder. C’est, dit Piéron, le jeu de l’activité intellectuelle assouplissante qui nous libère de la mémoire dans la mesure même où elle la développe.
Le développement de la mémoire.
Les premières manifestations nettes de mémoire apparaissent dès le troisième mois. Entre le 3ème et le 6ème mois l’enfant a un sentiment précis de familiarité. Vers 8 à 9 mois, l’enfant reconnaît les personnes de son entourage, après 3 ou 4 jours d’absence. À dix-huit mois cette reconnaissance se fait après plus d’une semaine d’absence. Avant deux ans l’enfant garde des souvenirs nets d’événements datant de plusieurs semaines.
Vers trois ans l’enfant peut localiser approximativement son souvenir dans le temps et dans l’espace mais ce n’est qu’entre sept et onze ans que les souvenirs commencent à s’ordonner en séries chronologiques.
La fixation des souvenirs débute dès les premiers mois et l’aptitude à la fixation croît avec l’âge. Si l’on énonce des séries de chiffres à des enfants de différents âges ils peuvent, en moyenne, en répéter 2 à 3 ans, 3 à 4 ans, 5 à 8 ans, 6 à 10 ans, 7 entre 12 et 15 ans. De même ils peuvent répéter six syllabes à trois ans, une phrase de dix syllabes à cinq ans, une phrase de seize syllabes à six ans, une phrase de vingt-six syllabes à quinze ans.
« La reconnaissance d’êtres ou d’objets croît également avec l’âge. »
« Si on demande à des enfants de retrouver, parmi d’autres qu’ils ne connaissent pas, des dessins qui leur ont été présentés un instant auparavant on constate qu’ils peuvent en retrouver 5 à 6 ans, 6 à 7 ans, 7 à 8 ans, 8 à 10 ans. » (Vermeylen)
« Enfin la conservation se prolonge de plus en plus. Alors qu’à 2 ans l’enfant garde déjà le souvenir d’événements datant de plusieurs semaines, à 4 ans on voit ce temps de conservation s’étendre à plusieurs mois ; à 5 ans des événements s’étant passés à plus d’un an de distance sont retenus. » (Vermeylen)
Cependant les événements de l’enfance laissent peu de traces en la mémoire, les premiers souvenirs conservés se localisent généralement entre deux et quatre ans. Cet oubli des événements enfantins paraît tenir à la transformation mentale qui se produit chez l’enfant entre 5 et 10 ans.
« Pendant cette période la manière de penser de l’enfant passe de la forme subjective et personnelle à la forme objective. Tout ce qui n’a pas été repensé sous cette forme nouvelle et définitive ne parvient plus à se conserver et s’efface alors progressivement. » (Vermeylen)
Mémoire enfantine et mémoire adulte.
L’opinion la plus répandue est que l’enfant a une meilleure mémoire que l’adulte. Cependant les expérimentateurs qui ont mesuré la capacité mnésique des enfants et des adultes ont constaté un accroissement progressif de cette capacité au cours du développement de l’enfant.
Cependant il ne semble pas que la mémoire se développe vraiment avec l’âge, Binet pense même qu’elle est à son apogée dans l’enfance et en conclut que c’est alors qu’il faut surtout la cultiver « et profiter de sa plasticité pour y imprimer les souvenirs les plus importants, les souvenirs décisifs dont on aura le plus besoin plus tard dans la vie ».
Mais si les premiers souvenirs sont mieux fixés et persistent plus aisément chez les enfants que chez les adultes, le développement de l’attention et du jugement, la multiplication des liens associatifs permet à ces derniers de mieux se servir de leur mémoire ; aussi le nombre des souvenirs emmagasinés et le pouvoir d’évocation associative croissent avec l’âge.
Mémoire, témoignage et mensonge.
L’étude du témoignage et du mensonge se rattache étroitement à celle de la mémoire.
Nous renvoyons aux mots mensonge et témoignage pour de plus longs développements, mais nous voulons dès maintenant faire observer que la mémoire n’est pas toujours fidèle. L’imagination qui l’aide parfois à renforcer les souvenirs les combine, les amalgame et y ajoute souvent une part d’invention ce qui fait du tout une conception parfois irréelle. Ceci est d’autant plus à craindre que l’esprit critique fait d’autant plus défaut et que l’affectivité est vive.
Or les enfants sont tout à la fois des affectifs et des imaginatifs sans esprit critique. Leur suggestibilité est partant d’autant plus forte qu’ils sont plus jeunes.
Il convient donc d’une part de n’accorder qu’une valeur toute relative aux témoignages des enfants et d’autre part de ne pas considérer comme mensonge ce qui n’est pas vraiment altération volontaire de la vérité mais erreur due soit à des perceptions erronées, soit à l’imagination, soit à la suggestibilité, soit au manque de développement intellectuel, soit à l’affectivité.
‒ E. DELAUNAY.
MÉMOIRES
n. pl.
Par extension du sens du mot mémoire qui indique la faculté de se souvenir, on appelle Mémoire, avec une majuscule, un plaidoyer écrit et Mémoires, au pluriel, des récits d’événements auxquels l’auteur a été directement mêlé ou dont il a été témoin.
Parmi les Mémoires les plus célèbres pour soutenir des causes devant des juges ou devant l’opinion publique, il y a ceux composés par Voltaire pour les défenses de Sirven, de Calas, du chevalier de La Barre, et aussi ceux de Beaumarchais où l’on trouve de curieuses indications sur les mœurs judiciaires, celles des juges et des plaideurs, à la veille de la Révolution française. Proudhon a expliqué qu’en écrivant ses deux Mémoires contre la Propriété, il avait eu pour but de « refaire toute la législation en substituant de nouveaux principes aux anciens », et il a défini ainsi le « genre Mémoire » qui lui paraissait lui convenir :
« Moitié science, moitié pamphlet, noble, gai, triste ou sublime, parlant à la raison, à l’imagination et au sentiment : je crois que je ferai mieux de me tenir à cette forme. La science pure est trop sèche ; les journaux trop par fragments ; les longs traités trop pédants ; c’est Beaumarchais, c’est Pascal qui sont mes maîtres. Mais quel avantage j’ai sur eux ! Je fais intervenir le monde entier dans mes écrits ; il n’est pas une question de philosophie, de morale, de politique, que je ne puisse faire entrer dans ces Mémoires. » (Proudhon : Lettres)
Les Mémoires qui racontent les événements appartiennent a la fois à l’histoire et à la littérature. Pour l’histoire, ils sont une source de documents des plus précieux, avec les annales, les chroniques et les archives. En littérature, ils sont un des genres les plus vivants et, comme tel, ils ont toujours eu la faveur du public, de préférence aux œuvres d’imagination dont le succès est soumis davantage aux caprices de la mode. Ce sont eux surtout qui, parmi les matériaux de l’histoire, la font lire avec plaisir parce que les événements en sont curieux », disait Mably, et il ajoutait :
« Je ne suis plus un lecteur qui lis, je suis un spectateur qui vois ce qui se passe sous mes yeux. »
Ph. Chasles a constaté qu’en France les Mémoires historiques et littéraires étaient des produits de la sociabilité particulière formée par la sagacité et l’esprit d’analyse et d’ironie. Il a écrit :
« De cette sociabilité française émana le Mémoire historique, le seul genre d’histoire qui nous convienne, celui dans lequel nous avons excellé. Notre histoire véritable, ce sont des lettres, des anecdotes et des portraits, œuvres de bonhomie et de vanité, où l’amour propre prend ses aises. La vie en France se compose d’actes et de sensations beaucoup plus rapides et plus vifs que dans les autres pays de l’Europe ; ces sensations recueillies par nos gens de cour, d’église ou de cabinet, forment une admirable galerie d’études sur l’humanité vue dans l’état social. Aux Mémoires de Retz de Saint-Simon, de Mme de Staël, aux Confessions de Jean-Jacques, les peuples étrangers ne peuvent rien opposer ; c’est de l’esprit, de l’éloquence, de la conversation et du drame. »
Sainte-Beuve a remarqué que :
« Tout homme qui a assisté à de grandes choses est apte à faire des Mémoires. »
Nous verrons plus loin que les Mémoires ne méritent pas toujours une entière confiance par leur exactitude. Voltaire disait que « l’histoire est le récit des faits donnés pour vrais, au contraire de la fable qui est le récit des faits donnés pour faux ». C’est en produisant à la fois le récit des faits donnés pour vrais et donnés pour faux que les Mémoires sont de l’histoire et de la littérature. Mais si tendancieux qu’ils soient, ils contiennent toujours une vraisemblance, sinon une vérité, que n’ont pas la légende, la fable, le roman. Ils font penser que si les faits ne se sont pas produits exactement comme ils sont racontés, si les individus n’ont pas été absolument tels qu’on les a ou qu’ils se sont dépeints, ils pouvaient se produire ou être ainsi. C’est cette vraisemblance qui a permis le plutarquisme (voir ce mot) par ses apparences de vérité. Elle manque, malgré les références de certains livres appelés « historiques » aux fantasmagories adaptées à l’histoire d’après la mythologie, et il faut les pauvres cervelles dévoyées par la Bible pour croire aux Samson et aux Jonas transposés des fables d’Hercule par les Hébreux imitant les Grecs. Il faut de même avoir le crâne bourré de religion et de nationalisme pour arriver à se convaincre « historiquement » que saint Denis marcha en portant sa tête dans ses bras, que l’étendard des rois fut remis par un ange à des moines, que le Saint Esprit apporta du ciel l’huile dont ces mêmes rois seraient oints à leur couronnement, que des voix célestes commandèrent à Jeanne d’Arc de sauver la France, que des immortelles poussèrent à l’île d’Aix sous les pas de Napoléon et que sainte Geneviève arrêta la marche des Allemands en 1914. Par contre, il suffit que la plupart des mots historiques soient vraisemblables pour qu’ils soient tenus pour certains, le plutarquisme aidant.
Les annales ont été la première forme de l’histoire. Elles ont consisté dans l’enregistrement chronologique des événements dont on voulait conserver le souvenir. Celles des Chinois, Assyriens, Égyptiens, Grecs, Romains sont du plus grand intérêt pour l’histoire de la haute antiquité. Leur synonyme fastes visait particulièrement les faits glorieux chez les Romains. On donne encore le nom d’annales à nombre de publications qui enregistrent les événements au fur et à mesure de leur production. Les commentaires sont les notes sommaires écrites par un personnage illustre sur les faits auxquels il a été mêlé. Ce genre a son modèle dans les Commentaires de César. On a aussi appelé commentaires des ouvrages qui sont plutôt des chroniques ou des mémoires comme ceux de Montluc ou de Rabutin. Les archives sont les collections de titres spéciaux, de chartes, de contrats, et généralement de tout ce qui était la coutume, le droit coutumier public ou privé des communautés ou des familles. Les archives nationales sont réunies dans des bibliothèques spéciales sous la garde d’archivistes. Les annales, augmentées de commentaires, devinrent les premières histoires. Tacite a appelé Annales ses récits des faits qui lui ont été antérieurs et Histoires ceux des faits de son temps. Des annales sortirent les chroniques qui furent l’histoire écrite au moyen âge. Elles donnèrent plus ou moins de développement aux annales pour fournir simplement de sèches énumérations de faits ou de véritables récits historiques. Les plus célèbres, rédigées par des laïques, furent celles de Villehardouin, de Joinville et de Froissart, mais le plus grand nombre fut écrit par des religieux. Elles avaient été précédées de la Chronique d’Eusèbe continuée par saint Jérôme, de celles de Grégoire de Tours, de Frédégaire, de Flodoard qui sont les documents à peu près uniques sur lesquels l’histoire des mille premières années du moyen âge a été établie. On a appelé Grandes Chroniques de France celles rédigées à l’abbaye de Saint-Denis jusqu’en 1350. Une liste détaillée des chroniques du moyen âge a été donnée dans la Bibliotheca historica de Potthast. Les bénédictins de Saint-Maur commencèrent. le recueil des Historiens des Gaules et de la France dont les deux premiers volumes parurent sous le nom de Dom Bouquet en 1738. Depuis 1834, la Société de l’Histoire de France publie la Collection de textes pour servir à l’étude de l’histoire et fait paraître chaque année six volumes d’anciennes chroniques.
La chronique devint les Mémoires lorsque l’auteur prit une place personnelle de plus en plus importante dam le récit. Elle mêla alors aux faits historiques et d’ordre général des points de vue particuliers intéressants, surtout quant aux mœurs et à l’état de la critique. Les Souvenirs de Mme de Caylus, qui seraient apocryphes d’après M. Funck-Brentano, et les Confessions de J.-J. Rousseau sont en ce sens des Mémoires. L’histoire a trouvé une mine inépuisable, après les annales et les chroniques, dans des Mémoires comme ceux de Du Clercq et de Commines (XVème siècle), d’Olivier de la Marche, de Montluc, de Saulx-Tavaunes, de La Noue, de d’Aubigné, de la reine de Navarre, de Pierre de l’Estoile (XVIème siècle). À partir du XVIIème siècle, ils se multiplièrent. Il n’est guère d’hommes d’État, de guerre ou d’église, de grands seigneurs et de mondains qui n’aient écrit les leurs, depuis Sully jusqu’aux principaux acteurs de la Révolution. Il faudrait une longue nomenclature pour les citer tous. Les Mémoires les plus célèbres sont ceux du temps de la Fronde, ceux de Retz, de Molé, de Mm. de Montpensier, puis ceux de La Rochefoucauld, de Dangeau, de Saint-Simon, de l’abbé de Choisy, de La Porte, de Mme de La Fayette, de Duclos, du maréchal de Richelieu, de Mme du Hausset sur la Pompadour, de d’Argenson, de Bachaumont, de Mme de Campan sur la vie privée de Marie-Antoinette, de Mme d’Epinay, de Mme du Deffand, etc... Nombreux aussi sont les mémoires du temps de la Révolution qui vit en particulier ceux de : Mme Roland d’une si grande élévation et d’une si sereine pensée.
Au XIXème siècle, les Mémoires furent de toutes sortes, depuis ceux militaires des maréchaux de l’Empire, ceux appelés Mémorial de Sainte-Hélène auxquels Napoléon collabora pour mettre un dernier maquillage sur son histoire, ceux politiques de Chateaubriand, de Mme de Rémusat qui fut un témoin lucide et un juge sévère de la cour impériale, ceux politiques aussi de Guizot, ceux littéraires d’A. Dumas, de P. de Kock et autres, jusqu’à ceux de M. Claude qui sont un bas feuilleton policier écrit dans un style d’une platitude désarmante. Il y eut aussi les Mémoires fantaisistes ; ceux de Joseph Prudhomme, prototype de Foutriquet, de Bouvard et Pécuchet, de Tribulat Bonhomet, du père Ubu, de M. Lechat, écrits par Henri Monnier, sont les plus réussis.
La fantaisie se mêla de plus en plus aux Mémoires pour les transformer en romans généralement inférieurs. Aujourd’hui, il n’est pas de soliveau ministériel ou académique, de cabotin ou de catin à la mode, ayant joué un rôle plus ou moins malfaisant, ridicule ou scandaleux, qui n’écrive ou plutôt ne fasse écrire « ses Mémoires » par quelque plumitif affamé. On a eu, il n’y a pas longtemps, ceux de Mme Otero qu’une publicité sans pudeur compara aux Confessions de J.-J. Rousseau !...
Diverses collections réunissent les Mémoires qui ont fourni à l’histoire le plus intéressant des apports : celle des Mémoires relatifs à l’ Histoire de France, par Petitot et Monmerqué (1819–1829) en 130 volumes ; celle des Mémoires relatifs à l’Histoire de France depuis la fondation de la monarchie française jusqu’au XIIIème siècle, réunie par Guizot (1823–1835) en 31 volumes, et sa suite depuis le XIIIème siècle jusqu’à la fin du XVIIIème, par Michaud et Poujoulat (1836–1839) en 32 volumes ; celle des Mémoires relatifs à la Révolution Française, par Berville et Barrière (1820–1827) en 55 volumes, et d’autres. Il faut citer encore les Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres suivis de ceux de l’Institut, ceux de l’Académie des Sciences, et la collection des Mémoires sur l’art dramatique où sont réunis ceux de Goldoni, Collé, Mlle Clairon, Talma et d’autres auteurs ou acteurs, formant 14 volumes. Citons enfin, parmi les Mémoires d’auteurs étrangers, ceux de Frédéric II, de Catherine II, de Franklin, de Mme Elliott, de J efferson, de Rostopchine, et parmi les Mémoires autobiographiques, ceux de Benvenuto Cellini, Casanova, Luther, Gœthe, Wagner et Tolstoï.
Tous les Mémoires dits « historiques » n’ont pas la même valeur. Souvent, leurs récits ne doivent être admis qu’avec la plus grande circonspection et après de nombreuses confrontations. À côté des tendances particulières aux auteurs et qui dominent chez presque tous sur la vérité historique, il faut tenir compte de celles des partis, et bien des jugements sont sujets à caution. Voltaire, comparant les Mémoires qui paraissaient simultanément en Angleterre et en France, disait :
« S’ils s’accordent ils sont vrais ; s’ils se contrarient, doutez. »
Renan a écrit à propos des Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps, de Guizot :
« C’est presque une obligation pour l’homme qui a tenu dans sa main les grandes affaires de son pays de rendre compte à là postérité des principes qui ont dirigé ses actes et de l’ensemble de vues qu’il a porté dans le gouvernement. »
Cela serait très bien, si ces hommes n’avaient pas agi si souvent sans principes et n’étaient pas surtout occupés, en écrivant leurs Mémoires, a donner le change sur leurs erreurs pour rechercher des justifications posthumes. On attend toujours les Mémoires d’un homme d’État qui, faisant loyalement son examen de conscience, dira :
« Voilà comment je me suis trompé. Tirez-en les enseignements nécessaires !... »
Ils sont pourtant nombreux ceux qui devraient s’exprimer ainsi. Est-il, par exemple, un seul des responsables de la grande guerre qui reconnaîtra son crime et son impéritie ? Non. La librairie est encombrée de la masse de leurs Mémoires où ils étalent avec une impudente vanité leur prétendu rôle dans la direction d’événements qui les avaient dépassés dès le premier jour. Tous ces apprentis sorciers sont fiers des calamités qu’ils ont déchaînées et de leur criminelle aberration.
Un grand nombre de Mémoires sont apocryphes ; d’autres sont nettement faux, tels ceux attribués à Mme de Maintenon. Voltaire, qui a volontiers « plutarquisé » dans son Histoire du siècle de Louis XIV, en disait :
« Presque chaque page est souillée d’impostures et de termes offensants contre la famille royale et contre les familles principales du royaume, sans alléguer la plus légère vraisemblance qui puisse donner la moindre couleur à ces mensonges. Ce n’est point écrire l’histoire, c’est écrire au hasard des calomnies qui méritent le carcan. »
Parmi les Mémoires apocryphes, il y a des Mémoires de d’Artagnan, des Chroniques de l’Œil de Bœuf, des Mémoires de Napoléon Bonaparte. Ce genre se retrouve dans celui, fort en vogue aujourd’hui, des biographies romancées pour continuer à mêler à l’histoire les fables les plus aventureuses, les fantaisies les plus grossières et les plus tendancieuses. M. Daniel Mornet, maitre de conférences à la Sorbonne, a sévèrement jugé ce genre en écrivant fort justement : « Les biographies romancées sont dangereuses. Elles sont des écoles de truquage ou, plus poliment, de rhétorique. Elles habituent à « farder la vérité » et à goûter la vérité fardée. Elles sont à la vie vraie et à la conscience ce que leur sont le monde où l’on se farde et la conscience de ceux qui s’y plaisent. » Ce genre ne pouvait que convenir à notre époque où la sophistication s’étend à tous les domaines pour égarer l’opinion et lui faire accepter, démocratiquement, le retour à toutes les turpitudes du passé.
‒ Édouard ROTHEN.
MENCHEVISME
n. m.
Vers 1900, une divergence d’idées importante se manifesta au sein du Parti social démocrate Russe. Une partie de ses membres, se cramponnant au « programme minimum », estimait que la révolution russe, imminente, serait une révolution bourgeoise, assez modérée dans ses résultats. Ces socialistes ne croyaient pas à la possibilité de passer, d’un bond, de la monarchie féodale au régime socialiste. Une république démocratique mais bourgeoise, qui ouvrirait les portes à une rapide évolution capitaliste, telle était leur idée fondamentale. La « révolution sociale » en Russie était, à leur avis, chose impossible pour l’instant.
Beaucoup de membres du parti avaient une opinion opposée. D’après eux, la révolution aurait toutes les chances de devenir une « révolution sociale », avec ses conséquences logiques. Les autres socialistes renoncèrent au « programme minimum », ils s’apprêtèrent à la conquête du pouvoir et à la lutte immédiate et définitive contre le capitalisme. Les leaders du premier courant furent : Plékhanoff, Martoff et autres. Le grand inspirateur du second fut Lénine.
La scission définitive, irrémédiable, entre les deux camps eut lieu en 1903, au Congrès de Londres. Les social-démocrates de la tendance léniniste se trouvèrent en majorité. « Majorité » étant en russe bolchinstvo, on appela les partisans de cette tendance bolcheviki (en français : majoritaires). « Minorité » étant en russe menchinstro, on dénomma les autres mencheviki (en français : minoritaires). Et quant aux tendances elles-mêmes, l’une obtint le nom de bolchevisme (Voir ce mot), l’autre, celui de menchevisme (tendance de la minorité).
Après la victoire des bolcheviki en 1917, Ils déclarèrent le menchevisme contre-révolutionnaire et l’écrasèrent.
MENDIER
(latin mendicare)
v. n. : demander l’aumône. v. a. : demander comme une aumône, mendier son pain. Par extension : rechercher avec bassesse : mendier des approbations, des protections.
Action du gueux, de l’indigent, qui demande l’aumône, action du mendiant. Cette action, ou mendicité, est réglementée par des lois. Autrefois, la mendicité était tolérée. Il y avait même à Paris un quartier obscur, composé de rues étroites, tortueuses, sales, dont les maisons, mal bâties et d’apparence sordide, servaient de repaire à toute une armée de mendiants. Ce quartier s’appelait la Cour des Miracles. On l’avait ainsi nommé, parce que les pauvres qu’on voyait pendant le jour aux portes des églises, sur les places publiques ou dans les rues sollicitant la charité des passants, tous estropiés, mutilés ou couverts d’ulcères, n’étaient pas plus tôt rentrés dans leurs domiciles, que, jetant leurs béquilles, ils se redressaient sur leurs jambes, d’où, par suite du même miracle, les ulcères avaient disparu. La police finit par intervenir, et les mendiants, obligés de se disperser, renoncèrent à leur métier ou allèrent le continuer ailleurs. Ce quartier a été reconstruit depuis le commencement du XIXème siècle, et la « cour des miracles » ne présente aujourd’hui plus rien de son aspect de cette époque.
Tous les mendiants, ne furent pas des gueux ; d’aucuns (et non des moins vils et avides d’aumônes) avaient érigé la mendicité en théorie de vie sainte ; ils constituèrent des compagnies, des associations de religieux ne voulant vivre que des aumônes, y réussissant fort bien et, quoique très nombreux, parvenant à enrichir leurs sociétés : ce furent les ordres mendiants. Comme d’autres gagnaient le ciel à conserver saintement leur crasse, ils le voulaient gagner en ne travaillant pas et en s’abaissant toute leur existence. Voici ce qu’en dit le dictionnaire Lachâtre :
« Ordres mendiants : On comprend sous cette dénomination générale, non seulement les instituts religieux et monastiques qui reconnaissent saint François d’Assise pour fondateur, mais encore beaucoup d’ordres qui, nés à peu près vers la même époque, faisaient également vœu de pauvreté et ne vivaient que du fruit des aumônes qu’ils obtenaient des fidèles. Voici le dénombrement des institutions qui se glorifiaient de ce surnom :
les frères mineurs ou franciscains ;
le second ordre ou les clarisses instituées par sainte Claire, en l’année 1212 ;
le tiers-ordre ou les tertiaires, à qui le même fondateur donna une règle en 1221 ;
les capucins, l’un des ordres les plus nombreux de l’Église ;
les minimes, fondés par François de Paule ;
les frères prêcheurs ou dominicains, établis vers 1216, sous les auspices et la conduite de saint Dominique de Guzman : les religieux de cet ordre furent appelés Jacobins en France ;
les carmes, venus de la terre sainte en Occident, pendant le XIIIème siècle ;
les ermites de saint Augustin, dont l’institut fut mis au nombre des ordres mendiants par le pape Pie IV, en 1567 ;
les servites ou ermites de saint Paul, les hiérolymites, les cellites, etc. ;
enfin l’ordre du Sauveur et celui de la pénitence de la Madeleine.
Tous ces instituts, qui avaient eux-mêmes des rejetons et des subdivisions, formaient ce qu’on appelait les quatre ordres mendiants dont les noms suivent par ordre de préséance : les franciscains, les dominicains, les carmes et les augustins. »
Et ces gens-là vivaient à l’aise, si l’on en croit le dicton populaire (« gras comme un moine ») et amassaient des sommes considérables, tant il est vrai que la bêtise humaine est vraiment apte à donner une idée de l’infini. Qu’on en juge : Parlant des capucins le Larousse déclare :
« Établis en France en 1573, ils y possédaient 400 maisons en 1790, lorsqu’ils furent supprimés. »
Ce n’est déjà pas si mal, mais à propos de ces mêmes « capucins » dans un ouvrage publié en 1793, par G. Carlo Rabelli : « Mascarades monastiques et religieuses de toutes les nations du globe, etc... », on peut lire :
« Quelqu’un qui n’aimait pas les capucins, disait : ils sont paresseux, ignorants et sanglés comme des ânes ; barbus, lascifs, sales et puants comme des boucs ; enfin ce sont les punaises de la chrétienté. »
Cet ordre ainsi dégagé de toutes les entraves qui pouvaient nuire à sa propagation, vit augmenter ses recrues, et put bientôt marcher de pair avec les congrégations les plus étendues et les plus florissantes ; il a prodigieusement pullulé ; il est divisé en plus de cinquante provinces et trois custodies, où l’on compte plus de seize cents couvents, et 25.000 capucins ; non compris les missionnaires du Brésil, du Congo, de la Barbarie, de la Grèce, de la Syrie, de l’Égypte et de toutes les autres parties du monde où il y a des capucins missionnaires. »
Actuellement, les ordres religieux, pratiquent tous la mendicité, en vivent grassement, mais lui donnent un autre nom : ils font des quêtes.
Pour le vulgaire, la mendicité est défendue par la loi et il n’est pas rare de voir des communes qui s’enorgueillissent d’écriteaux ainsi rédigés et apposés aux coins des rues :
« La mendicité est interdite sur le territoire de la commune. »
Ici, sans doute, nous sommes en pays civilisé : cela se voit, cela se lit, ici, il n’y a pas de mendiants... Est-ce à dire qu’il n’y a pas de miséreux, pas de pauvres infirmes, de vieillards chenus et sans soutien ? que non pas ! cela signifie simplement, que le riche, le pourvu, le bien vêtu, le ventre plein, n’entend pas être dérangé quand il rumine.
C’est pour le misérable, privé du nécessaire que ces lois sont faites et leurs injonctions sont formelles et le gendarme est sans pitié : Un décret du 7 juillet 1808, en déclarant que la mendicité était interdite dans toute la France, avait prescrit dans chaque département la création de « dépôts de mendicité », où devaient être conduits les mendiants n’ayant aucun moyen d’existence. Ce que sont ces dépôts de mendicité ? Des prisons ! Aussi les miséreux poussés à tendre la main, les craignent-ils plus que la faim, le froid, la prison ordinaire et même la mort solitaire dans quelque coin de bois. Le législateur ne pouvait ignorer ce qui allait nécessairement se produire et il a édicté les peines suivantes :
« Tout individu qu’on a surpris mendiant est justiciable de la police correctionnelle. Si, dans le lieu où il a été arrêté, il existe un dépôt de mendicité, il peut être puni d’un emprisonnement de trois à six mois, et, après l’expiration de la peine, il doit être conduit au dépôt ; s’il n’y a pas d’établissement de ce genre, et si le mendiant est valide, l’emprisonnement ne sera que de un à trois mois. Si le mendiant a été arrêté hors du canton de sa résidence, l’emprisonnement sera de six mois au moins et de deux ans au plus. Si un mendiant use de menaces, ou s’il s’introduit sans l’aveu du propriétaire dans une maison d’habitation ou dans un enclos qui en dépende ; s’il a feint des infirmités ou des plaies ; s’il a mendié avec un autre individu, à moins que ce ne soit un aveugle et son conducteur, un père et son fils, un mari et sa femme, la peine est la même. Tout mendiant surpris travesti, porteur d’armes, etc., bien qu’il n’en ait pas fait usage, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans ; si on trouve en sa possession des objets d’une valeur excédant 100 francs, dont il ne peut justifier l’origine, il encourt la peine d’emprisonnement de six mois à deux ans. En cas de crime, le mendiant subit toujours une peine plus forte que l’accusé non mendiant. En cas de récidive, la peine sera au moins du maximum, et pourra même être portée au double. » (Art. 474 du code pénal)
Voilà la « justice » assise sur la pitié !
Ayant ainsi légiféré et éloigné de sa sensibilité humaine le choquant spectacle du pauvre quémandeur, le bourgeois délivré songe que « l’ordre règne à Varsovie » et qu’il n’y a plus de mendiants par les routes, donc plus de pauvres, plus d’affamés, plus rien que des bien nantis. Il sent alors son cœur s’amollir, une larme lui venir à l’œil ; rappelant une pitié désormais sans emploi, il rédige un second écriteau qui susurre ce conseil :
« Soyez bons pour les animaux !... »
Avec la mendicité, c’est toute la question sociale qui se pose ; en vain jouera la charité (V. ce mot), publique et privée, en vain se produiront des dévouements parfois sublimes, le mode d’appropriation du sol et des instruments de travail engendre nécessairement le paupérisme moral et matériel. La charité est impuissante à guérir les plaies purulentes qu’elle constate chaque jour parce qu’elle ne s’attaque pas aux causes, mais aux effets. Pour un individu qu’elle secourt, deux autres viennent grossir le bataillon des affamés.
La mendicité est un véritable fléau par la pourriture morale qu’elle provoque ou amplifie. En effet, l’être qui demande l’aumône, qui mendie, qui tend la main, subit un abaissement de sa personnalité, toujours plus accentué. Scrupules, fierté s’émoussent et il tombe à n’être plus qu’un animal quêtant sa pitance. Les autres sentiments humains se ressentent évidemment de cette chute morale ; aussi, un anarchiste a-t-il pu dire que si le vol est plus dangereux que la mendicité il est du moins autrement honorable.
Dans les pays où le chômage ne sévit pas encore comme un fléau, où les méthodes modernes de production rationalisée ne jettent pas encore à la porte de l’usine l’ouvrier à 45 ans, la mendicité l’emporte considérablement sur le vol, car tant qu’il peut travailler, gagner son pain sec, l’ouvrier ne songe pas à prendre ailleurs ce qui lui manque, et quand il ne gagne plus sa vie, infirme ou trop vieux, il manque de volonté, d’énergie, de ressort, pour oser autre chose que mendier.
Dans les pays où la rationalisation industrielle jette sur le pavé des hommes encore jeunes, susceptibles de vouloir et d’oser, le vol l’emporte de beaucoup sur la mendicité. L’homme qui a conservé quelque ressort vital répugne à demander l’aumône et prétend se procurer ce qu’il considère comme devant lui appartenir, par des moyens plus dangereux certes, mais qui ne sont pas acceptation passive d’un sort inique et ne le livrent pas, rampant, à la merci du don.
Il semble bien que dans la société actuelle, une partie de l’humanité doive nécessairement osciller du vol à la mendicité et de la mendicité au vol. Et il n’y a pas, absolument pas, d’autre remède que celui-ci : le peuple prenant conscience de son état de mendiant permanent et voleur audacieux, faisant rendre gorge aux profiteurs de son travail, détruisant l’État, et ne voulant plus produire que pour lui-même.
‒ A. LAPEYRE.
MENEUR (SE)
(de mener)
Subst. : Personne qui mène : Le meneur de la danse. Celui qui mène, qui conduit une femme par la main dans certaines cérémonies. Meneuse de nourrices, femme qui recrute des nourrices dans certains villages pour les conduire à Paris ou dans les grandes villes. Meneur d’ours, celui qui mène un ours dans les rues et qui gagne sa vie à lui faire faire des tours. Meneur de gens de guerre, se disait, dans l’ancienne hiérarchie militaire, des commissaires de guerres. Meneuse de table, ouvrière qui forme des jeux avec les cartes après qu’on les a coupées. Meneur de ciseaux, ouvrier cartier qui découpe des cartes.
Au fig. et famil. Se dit de celui qui prend un ascendant sur les autres et les assujettit à sa volonté : les meneurs d’un parti. C’est plus particulièrement dans ce sens que le mot est employé, et le plus souvent par la classe bourgeoise qui se rend compte de l’influence de certains individus dans tous les mouvements de masses. Aussi quand la grande presse parle des meneurs révolutionnaires, elle y ajoute un sens péjoratif afin de disqualifier les militants susceptibles d’amener au succès un mouvement de revendication. Elle emploie ce terme également afin de cacher au prolétariat son véritable degré d’évolution. Elle lui dit :
« Bien sûr, tu réclames, tu protestes, tu te révoltes, mais tu n’en es pas moins un pauvre troupeau absolument incapable de te guider toi-même ; il te faut un chef, un meneur !... »
Aujourd’hui encore, même quand il n’y a pas de meneur, même quand le mouvement est spontané, le peuple en vient néanmoins à croire qu’en effet, si tel et tel camarade n’étaient pas là, agissant comme chefs, comme meneurs, il eût été incapable d’action. Cette conviction entrée en lui, si on arrête « les meneurs », si on les emprisonne, l’ouvrier perd confiance en sa propre capacité, se décourage et cesse la lutte.
Les partis politiques dits de gauche, et même les syndicats à tendances politiques, ont aussi besoin du meneur. Cet être hybride et sans conviction profonde, prêt à toutes les besognes, aux meilleures et aux pires, à la fois chef et valet, se hisse, à la force d’un coup de gueule, aux bonnes places pour manœuvrer le prolétariat dans un but personnel ou pour le service d’un parti. Le meneur est l’affirmation permanente de l’inconscience du peuple, de sa faiblesse et de son abandon.
Autre chose est, par contre, le militant qui agit vigoureusement et intelligemment (seul ou dans le sein d’un mouvement quelconque) n’étant rien, ne voulant rien être qu’un homme libre qui sait ce qu’il veut, le veut bien, et essaie d’entraîner ses compagnons et non de se substituer à eux, de les mener... Le premier suppose un troupeau. Le second affirme des individus.
‒ A. LAPEYRE.
MENSONGE
n. m. (du bas latin mentitionica de mentiri, mentir)
On n’admet plus aujourd’hui que la religion soit une invention pure et simple des prêtres ; elle serait d’origine sociale et, parmi ses facteurs primitifs, comprendrait les tabous, l’animisme, le totémisme, la magie. Mais l’on oublie trop le rôle énorme joué par le caprice ou l’intérêt sacerdotal, dans l’établissement des dogmes, des rites, des prescriptions morales. Purgatoire et confession, pour ne citer que ces deux exemples, furent inventés par les théologiens catholiques, le premier pour extorquer l’argent des fidèles, la seconde pour renseigner le clergé sur les agissements secrets de ses adversaires. Pas un mot du purgatoire dans l’Évangile ; et c’est au XIème siècle seulement que les croyants se mirent à racheter les peines des morts en faisant de larges aumônes aux monastères. Dans la primitive Église, certains fidèles s’accusaient publiquement des fautes qu’ils avaient commises, par esprit d’humilité ; mais on ne trouve rien qui ressemble à la confession auriculaire d’aujourd’hui. C’est en 1215 seulement qu’elle fut rendue obligatoire par Innocent III, ce pape intrigant, qui rêvait d’asservir toute la chrétienté. Comme il fallait faire la cour aux grands et trouver pour eux des accommodements avec le ciel, les confesseurs inventèrent une science nouvelle, la casuistique, permettant de rendre bonnes, chez le maître, des actions qui, chez le valet, restaient mauvaises. Chose facile puisque l’Église allonge ou raccourcit, à volonté, la liste des fautes qui conduisent en enfer ou au purgatoire ; par contre il faut beaucoup d’ingéniosité pour masquer une contradiction si flagrante et lui donner une apparence de raison. Cette duplicité éclate avec une force spéciale lorsqu’il s’agit du mensonge.
Mentir, dit le catéchisme, c’est parler contre sa pensée ; il ajoute que l’on ne doit jamais mentir. Les théologiens vous expliquent qu’en effet le mensonge est intrinsèquement mauvais, c’est-à-dire mauvais en soi ; Dieu a donné la parole à l’homme pour traduire sa pensée ; un accord permanent doit régner entre celle-ci et celle-là ; le rompre constitue une faute. Et ils ajoutent qu’au prix du plus petit mensonge il serait criminel de sauver toutes les âmes de l’enfer. Voilà ce qu’on enseigne au peuple et aux enfants. Mais aux grands l’on dit autre chose. Sans doute le mensonge est défendu, affirme le casuiste, mais tromper n’est pas mentir : la parole doit répondre à la pensée, seulement vous pouvez n’exprimer tout haut qu’une partie de la phrase et l’achever pour vous seul, de manière que personne ne l’entende. « Avez-vous vu Pierre tuer Paul ? » vous demandera-t-on. Vous l’avez vu ; pourtant vous pourrez répondre : « Non » sans mentir, à condition d’ajouter intérieurement : « du moins pas pour le dire ». Le prêtre qui vient d’extorquer l’héritage d’une mourante niera ou affirmera ce qui lui convient, en vertu du même principe ; sa conscience restera blanche, immaculée. C’est la restriction mentale, dont l’Église autorise l’usage dans tous les cas, même si l’on prononce un serment ; excepté bien entendu lorsqu’on parle à son confesseur et aux dignitaires ecclésiastiques.
Admirez cette invention machiavélique qui permet d’esquiver la vengeance céleste, sans se priver néanmoins de mentir. Pour marcher dans de pareilles combinaisons, Dieu doit être un bien triste sire ! La raison heureusement ignore les fantaisies criminelles de la théologie. On recherche un homme innocent pour le massacrer, j’estimerai bon d’égarer ses persécuteurs. Mais, au voyageur perdu dans la montagne, je serais coupable d’indiquer un chemin sans issue. Un chef m’interroge, poussé par le désir d’utiliser ce qu’il apprendra contre moi ou contre mes amis, il ne saura point la vérité, n’y ayant nul droit ; je la dirai spontanément au malheureux que l’on trompe par intérêt. Si l’enfer existait, je mentirais avec plaisir pour arracher à leurs tortures les victimes de Jahveh ; et, ce faisant, je m’estimerais moralement supérieur à leur geôlier. Tout homme sensé m’approuvera ! Ainsi, dire ou non la vérité ne devient mauvais ou permis qu’en raison des conséquences et du but ; c’est en fonction d’une norme extrinsèque que chacun apprécie le mensonge. Peut-être les théologiens l’ont-ils compris ; la restriction mentale serait alors un moyen d’adoucir la règle primitive. Pourquoi ne pas reconnaître franchement sa caducité ? Ce serait plus honnête ; mais pour gouverner, prêtres et grands ont besoin d’être renseignés par ceux mêmes qu’ils exploitent. L’action secrète un peu large, voilà leur pire adversaire ; contre elle l’Église se devait de brandir la peine du feu éternel.
À la base de la morale chrétienne, comme de toute morale théiste, gît d’ailleurs une insoluble difficulté. Pourquoi Dieu ordonne-t-il ceci, défend-il cela ? Bien et mal sont-ils une création arbitraire de sa volonté ou, supérieurs à Dieu même, s’imposent-ils à son intellect comme à celui des hommes ? Dans le premier cas vertus et vices dépendent des caprices du vouloir divin. Que Jahveh l’ordonne et tuer ses parents, calomnier, boire jusqu’à l’ivresse, deviendront des actes méritoires. Doctrine monstrueuse, dont l’immoralité révolte, mais qui s’impose si le bien résulte du commandement divin le mal de la défense divine. Dans le second cas Dieu cesse d’être tout-puissant, puisque la loi morale s’impose impérieusement à sa volonté. Et cette loi morale résulte de la nature des choses ; elle subsisterait donc intégralement en l’absence même de Dieu. Si Jahveh ordonne d’aimer ses parents, non parce qu’il le veut arbitrairement, mais parce que la chose est bonne en soi ; cette chose restera bonne en l’absence du vouloir divin. Le rôle du Père Éternel n’est plus que celui du gendarme, veillant sur des trésors qui ne lui appartiennent pas. On voit la naïveté de qui explique tout par l’existence de l’Être suprême, poubelle métaphysique où l’on entasse à plaisir d’incroyables contradictions.
Ne nous étonnons plus si, après avoir condamné théoriquement le mensonge (exception faite pour la restriction mentale), l’Église, interprète de Jahveh, le catalogue ensuite parmi les vertus ; sous le nom d’humilité, de modestie, de politesse, etc. Volontiers le croyant s’accuse devant Dieu d’être un pêcheur digne de son courroux ; il se frappe la poitrine et s’écrie :
« C’est ma faute, c’est ma très grande faute... pardonnez-moi Jésus. »
Mais, dans la litanie des manquements qu’il énumère, il oublie les vices profonds ; il regrette d’avoir négligé la messe, mangé du lard le vendredi, nullement d’avoir volé ses ouvriers s’il est patron, extorqué les économies du pauvre s’il est financier. Infatué de sa personne, le dévot s’estime infiniment supérieur aux mécréants qui l’entourent.
« Par moi-même je ne suis rien, dit le curé à ses ouailles, mais, en qualité de représentant de Dieu, il est indispensable que je sois obéi, respecté, que j’occupe toujours et partout la première place. »
L’humilité du chrétien vise en général à donner le change sur son orgueil forcené. Comment ne pas se croire un personnage quand on est l’ami de Jésus et qu’une éternité de gloire vous attend ? Même remarque au sujet de la modestie, affectée par les prêtres et les nonnes ; sous des allures de chattemite, elle cache habituellement des désordres profonds. Séminaires et couvents sont des pépinières de choix pour les vices contre nature ; mais la façade peinte en blanc détourne les soupçons. Assurément la politesse a son utilité ; toute vie sociale deviendrait impossible si chacun blessait les autres sans ménagement. Et quel homme n’a rien à se faire pardonner ! Masquer une froide malveillance sous des formules hypocrites est bien différent ! Or de nos jours la politesse consiste trop souvent, à prononcer des phrases que l’esprit ne contresigne pas ; ce n’est plus la manifestation d’une sympathie fraternelle, c’est un moyen commode de tromper son prochain.
Organisations politiques et religieuses, structure sociale et économique reposent sur le mensonge : il serait invraisemblable que les individus puissent échapper à l’emprise universelle de l’hypocrisie. Mais à l’homme d’État, au diplomate, à l’administrateur, au privilégié, on fait un mérite de tromper l’adversaire, de cacher ses desseins, alors qu’on appelle dangereux menteur le prolétaire qui en fait autant.
– L. BARBEDETTE.
MENSONGE (et ENFANT)
Le jeune enfant ne se soucie pas de communiquer exactement sa pensée et de décrire objectivement les faits. Il distingue mal les produits de son imagination et les réalités et comble inconsciemment les lacunes de sa mémoire par de la fabulation.
Les causes de ses erreurs sont nombreuses, il y a :
-
Les perceptions erronées, les erreurs des sens, qui sont d’autant plus fréquentes que l’individu est plus jeune ;
-
L’imagination, moins vive que chez l’adulte mais moins bien contrôlée par l’esprit critique ;
-
La suggestibilité, « Montrons-nous circonspects, écrit Jonckheere, en posant des questions, car leur forme peut influencer la réponse et provoquer des erreurs de fait ». Quelqu’un vient de passer ; nous pouvons demander, par exemple : Comment la personne qui vient de passer était-elle coiffée ? La personne qui vient de passer était-elle coiffée ? La personne qui vient de passer était-elle coiffée d’un chapeau ou d’une casquette ? La personne qui est passée tout à l’heure n’avait-elle point un chapeau sur la tête ? Les premières de ces questions n’impliquent aucune suggestion mais il n’en est pas de même de la troisième et surtout de la quatrième.
-
Le manque de développement intellectuel ne permet pas le travail de l’autocritique. Le jeune enfant admet sans difficulté des données contraires.
-
L’affectivité est liée plus étroitement à tous les processus psychiques de l’enfant.
* * *
Le jeune enfant ne ment pas et ne dissimule pas. Quand découvre-t-il le mensonge et commence-t-il à dissimuler ? La plupart des psychologues admettent que ce n’est que vers sept ans. À vrai dire il nous semble que des enfants plus jeunes altèrent sciemment la vérité, mais ils le font plutôt par jeu que dans l’intention de tromper.
Comment l’enfant devient-il capable de mentir ?
Peut-être, parce qu’il s’aperçoit qu’il avait commis une erreur et en avait tiré profit. Peut-être parce qu’il a surpris quelques mensonges de ses parents ou d’autres adultes. Peut-être parce que le mensonge lui apparaît comme un moyen de parvenir à ses fins.
Pourquoi l’enfant ment-il ? Des enquêtes ont été faites à ce sujet ; elles sont loin d’être parfaitement concordantes ; cependant, il semble bien que la crainte soit l’une des principales causes du mensonge enfantin. Mentir est pour l’enfant un moyen de défense.
Parfois aussi l’enfant ment par étourderie, par intérêt, par paresse, etc. II est aussi des mensonges qui ne s’expliquent que par des causes d’ordre pathologique ; on a observé des enfants qui obéissent à une impulsion presque irrésistible, qui s’accusent de délits ou de crimes qu’ils n’ont pas commis.
* * *
De même que la fièvre est le plus souvent la conséquence et non la cause de la maladie, le mensonge nous apparaît comme un résultat. Si nous voulons corriger des enfants menteurs ou, mieux, éviter que nos enfants ne deviennent menteurs, il faut nous en prendre aux causes réelles du mensonge.
Tout d’abord lorsque de jeunes enfants disent le contraire de la vérité, il convient de ne pas considérer leurs erreurs comme des mensonges. Il ne faut alors ni leur attribuer l’épithète de menteur, ni les punir mais s’efforcer d’attirer leur attention sur l’erreur commise et éveiller peu à peu leur esprit critique.
Deuxième conseil : il ne faut pas donner aux enfants l’exemple du mensonge, ni surtout leur ordonner de commettre des mensonges. Combien de parents, par exemple, ont dit à leur fils ou à leur fille :
« Va dire que je ne suis pas là. »
Puis se sont indignés ensuite d’un mensonge du bambin.
Troisième conseil : il faut avec les enfants pratiquer la politique de la confiance et paraître croire qu’ils sont incapables de dénaturer volontairement la vérité. Profitons de leur suggestibilité, feignons de croire qu’il y a erreur ou faiblesse passagère mais non mensonge.
Ce conseil est d’autant plus important qu’il y a bien souvent malentendu ; de là un quatrième conseil : efforçons-nous de comprendre les enfants et de nous faire comprendre d’eux. Une anecdote toute récente viendra illustrer ce conseil. Nous avions donné à de jeunes enfants le problème suivant : « Il y avait 184 morceaux de sucre dans un sucrier mais la maman a pris 86 de ces morceaux. Combien y a-t-il encore de morceaux dans le sucrier ? » Un bambin, après quelques autres, nous présenta bientôt son travail. La réponse était exacte, mais, chose singulière, l’enfant dans sa soustraction, avait placé le plus grand nombre au-dessous.
– « Tu as copié ? »
– « Non, monsieur. »
Avait-il copié et était-il un menteur ? Ceci paraissait probable et pourtant quelque doute subsistait dans notre esprit.
« Comment as-tu donc fait ? »
Question facile à poser pour nous, mais à laquelle il était difficile au bambin de répondre car les jeunes enfants n’expriment pas toujours facilement leurs idées, si bien qu’enfants et adultes se comprennent souvent fort mal.
Cependant, en y mettant du temps, nous finîmes par comprendre ceci : dès la lecture du problème l’enfant avait été frappe par le rapprochement des nombres 84 et 86 et voici, par suite, comment il avait raisonné intuitivement (car il ne s’agit pas là d’un véritable raisonnement logique) : en retirant 84 morceaux des 184 il en restera 100 mais il faut que nous en retirions encore 2 morceaux (86–84). On devine le reste l’enfant intuitivement et mentalement avait trouvé la réponse sans avoir fait nul calcul écrit, cette réponse était pour lui l’essentiel il avait ensuite placé au petit bonheur les trois nombres 184, 86 et 98. Si nous nous étions fiés aux apparences, nous aurions accusé cet enfant d’un mensonge qu’il n’avait pas commis, nous aurions alors paru à ses yeux comme une personne incapable de distinguer un mensonge d’une vérité et à laquelle on peut mentir sans danger.
Cinquième conseil : Évitons de poser aux enfants des questions qui peuvent les suggestionner par leur forme ou par leur ton. Ne les intimidons pas.
Sixième conseil : Le mensonge étant presque toujours le résultat d’une faute antérieure (paresse, vol, gourmandise, .etc.) corrigeons l’enfant des défauts qui peuvent le conduire au mensonge.
Dernier conseil : N’inspirons pas la crainte – cause principale du mensonge – et développons chez lui le sentiment du courage tout en lui faisant comprendre qu’il doit avouer ses fautes.
– E. DELAUNAY.
MENTALITÉ
n. f. (radical mental, latin mentalis, de mens, esprit)
Au sens étymologique, le terme mentalité désigne d’une façon spéciale, l’intelligence, la connaissance ; il exclut alors de sa compréhension vie sentimentale et vie active. Mais, d’ordinaire, il est pris dans un sens plus large et s’applique à la totalité de la vie psychologique ; il devient donc synonyme d’état d’esprit. En art, en morale, en science, etc. il résume l’ensemble des tendances et des idées qui guident un individu, qui caractérisent une collectivité, une époque, un milieu.
Complexité, mobilité, continuité, voilà le triple aspect qu’offrent les phénomènes psychologiques, dont le déroulement ininterrompu constitue notre vie intérieure. Nous sommes en présence, non de faits isolés, séparables du tout, doués d’une vie indépendante, mais d’états qui se mêlent, se pénètrent, se colorent. Leur ensemble constitue une mosaïque compliquée, dont les éléments, impossibles à juxtaposer dans l’espace, subissent, à chaque instant, l’influence de tous les autres. À ma sensation actuelle s’incorporent des images, des souvenirs, des jugements, des idées, une nuance affective qui ne font qu’un avec les données primitives de ma perception ; une rage de dents, le bourdonnement d’une mouche suffiront à faire évanouir les plus sublimes idées ; et lorsqu’un gai soleil brille au dehors, la mélancolie s’attarde moins facilement dans les cœurs. Rien de stable, d’ailleurs ; les ondes fuyantes de la vie intérieure ne s’immobilisent jamais ; dans l’intimité secrète du moi, les phénomènes psychologiques jaillissent inlassablement. Avec raison l’on a comparé la conscience au cours d’un fleuve, dont les flots, sans cesse, changent et fuient ; un devenir perpétuel, telle est la loi de toute pensée. Mais ce devenir implique continuité, enrichissement ; aucun état n’apparaît radicalement nouveau, séparé par un infranchissable vide des états qui l’ont précédé. Une même coloration personnelle, la nuance toujours identique donnée par le moi profond, relient les eaux qui viennent aux eaux qui s’en vont. Sans doute, obéissant à un rythme, la vitesse du courant s’accélère et se ralentit tour à tour, mais grâce à la mémoire nul état psychologique ne s’évanouit définitivement ; dans le présent vécu par la conscience, toujours un lambeau du passé se retrouve. Le sommeil même, probablement, ne provoque point de rupture dans la trame de la vie intérieure, une série continue de rêves reliant le moi qui s’endort au moi qui s’éveille.
Mais, pour la commodité des recherches scientifiques, nous décomposons par abstraction cette réalité complexe et changeante en larges groupes de phénomènes où l’on introduit ensuite des classes de plus en plus menues. Déjà Platon distinguait trois parties dans l’âme humaine : la raison qu’il plaçait dans la tête, le principe des inclinations généreuses qu’il situait dans le cœur, l’appétit inférieur, véritable hydre à cent têtes, qu’il logeait dans le ventre. Aristote, dont la doctrine sera reprise au moyen âge, admettait quatre puissances essentielles : la puissance végétative ou nutritive, la puissance sensitive, la puissance motrice, la puissance raisonnable. Descartes et beaucoup d’autres après lui réduiront ces facultés à deux ; l’entendement et la volonté ; dans la sensibilité ils ne verront qu’une forme inférieure de l’entendement. Aujourd’hui l’on distingue d’ordinaire la vie affective, la vie intellectuelle, la vie active, qui, dans le langage courant, répondent, d’une façon globale, aux termes de cœur, d’esprit, de volonté. Naturellement, la psychologue moderne, débarrassé des préjugés métaphysiques, ne voit dans ces trois facultés, comme aussi dans toutes les subdivisions dont elles sont susceptibles, que des aspects de l’activité mentale, des points de vue sur une même réalité intérieure, et non des puissances distinctes, des entités spirituelles comme l’admirent un trop grand nombre de philosophes anciens. Expression interne de l’unité de l’être, la conscience, qui demeure dans une étroite dépendance du système nerveux, ne peut former qu’une large synthèse dont les divers éléments ne sauraient vivre et subsister les uns sans les autres.
Au-dessous d’un point central, comportant un maximum de clarté, la conscience psychologique se prolonge en zones marginales, dont la lumière s’atténue par degrés. Si j’écris à quelqu’un, j’aurai une connaissance précise et claire des nouvelles que je veux lui transmettre, des lettres que ma plume trace sur le papier ; mais du bruit fait par les voitures ou les piétons qui passent sous mes fenêtres, je n’aurai ‘déjà qu’une conscience très atténuée ; et, pour sentir la température de ma chambre, le contact de mes habits, il faudra que mon attention soit attirée spécialement de ce côté-là. Sans être toujours conscients, les états, placés à l’extrême limite du côté lumineux de l’âme, restent d’ailleurs perceptibles aisément et continuent en général d’influencer la conscience ; que le tic-tac du moulin cesse et le meunier, rendu insensible au bruit par une longue habitude, remarquera cet arrêt aussitôt. Mais une analyse régressive, lorsqu’on la pousse assez loin, oblige à supposer qu’une large partie de l’esprit plonge dans une complète obscurité. La vie psychologique normale témoigne de l’existence d’états mentaux inconscients.
Nos tendances, nos affections ne cessent pas d’être, quand elles cessent d’être senties ; et souvent la passion, avant d’éclater au grand jour, s’est développée lentement à l’insu de l’homme qu’elle consumera. Une mort, un départ vous révéleront brusquement la profondeur d’une affection que l’on croyait superficielle ; et c’est un événement fortuit qui, fréquemment, permettra de découvrir la force d’un amour resté jusque-là inconscient. Notre défaut d’attention, leur propre faiblesse ou leur continuité nous empêchent de percevoir maintes sensations. D’innombrables souvenirs subsistent en notre esprit qui ne viendront à la lumière que très rarement, si même ils y reviennent. C’est d’une secrète incubation de la pensée que résulte l’inspiration soudaine bien connue de l’artiste et du savant. Et, dans l’acte instinctif ou habituel, la conscience s’atténue au point de disparaître : on porte les mains en avant pour parer un coup sans attention préalable, et les doigts du pianiste continuent de jouer correctement même lorsque son esprit vagabonde au loin. L’automatisme psychologique, aux manifestations si diverses et si multiples, prouve à l’évidence que de larges pans d’ombre existent dans notre esprit.
Les techniques psychanalytiques de Freud ont justement pour objet d’explorer ces régions obscures. Au médecin placé à son chevet, le malade dira tout ce qui lui passe par la tête, donnant libre cours aux images, aux idées, aux souvenirs qui naissent associativement dans son cerveau ; ou bien, avant toute réflexion, il débitera les phrases, énoncera les pensées que lui suggèrent des mots inducteurs prononcés à dessein. Oublis, lapsus, retards, méprises ou erreurs diverses auront une cause que le psychanalyste pourra découvrir ; des expressions inattendues, des termes révélateurs, l’émotion dont s’accompagnent certains aveux, le renseigneront sur le contenu de l’inconscient.
Une interprétation méthodique des rêves permettra également de découvrir les désirs refoulés. En songe, l’enfant croit manger le sucre d’orge dont on le priva durant la journée. Mais un revêtement imaginatif, d’apparence absurde, défigure en général le souhait du dormeur ; d’où un symbolisme, dont il importe de détenir la clef pour découvrir le vrai sens des constructions oniriques. « Une malade rêve qu’elle n’arrive pas à donner à dîner à ses invités. La psychanalyse découvre qu’elle réalise en réalité un désir secret et inconscient qu’elle n’avait pas accusé au médecin : celui de ne pas donner à une de ses invitées (une amie maigre qui plaisait à son mari et dont elle était jalouse) l’occasion de bien manger et d’engraisser... Un jeune homme, amant clandestin d’une jeune fille, rêve qu’il est arrêté pour infanticide ; il ne réalisait pas ainsi le désir de tuer l’enfant qui pouvait naître de ses amours coupables ; mais il avait depuis peu le souci d’avoir pu rendre sa maîtresse enceinte et se tranquillisait par ce rêve, en imaginant son enfant mort ». Freud exagère la portée de certaines observations ; sa symbolique, ses interprétations paraissent quelque peu arbitraires ; mais nul n’a mieux mis en relief le rôle joué par l’inconscient, tant dans les psychoses et névroses que dans la vie normale et courante.
À notre activité mentale, consciente ou non, les spiritualistes ont donné pour support une entité métaphysique : l’âme. Et ce principe immatériel et simple, qu’utilise le cerveau durant la vie présente, continuerait de penser, vouloir et sentir, même après la mort. Prêtres et philosophes ont noirci d’innombrables pages pour étayer ce mensonge intéressé. Récemment Bergson dépensa beaucoup d’ingéniosité pour rajeunir cette doctrine absurde avec une virtuosité indéniable, il usa d’un vernis fait de science et de poésie pour masquer la vieille erreur spiritualiste, attaquée de toutes parts. Mais le vernis a craqué, et l’antique aberration dualiste, reparue, a précipité le déclin du bergsonisme. Sa faillite est si complète, si définitive qu’un disciple de Bergson, Jacques Chevalier, ose écrire de son maître :
« Aujourd’hui, l’âge est venu, l’œuvre est inachevée ; et, autour de nous les fruits n’ont pas répondu à la promesse des fleurs... Des doctrines qu’on croyait mortes ont tiré de nouveau les intelligences vers le Mécanisme et la Matière. »
Cet aveu a dû singulièrement coûter à son auteur un clérical militant, dont la république a trouvé bon de faire un professeur de Faculté ; il constate le discrédit qui atteint de nouveau les idées chrétiennes, du moins parmi ceux qui réfléchissent. Bergson dit :
« De même qu’un vêtement accroché à un clou déborde ce clou, la conscience accrochée au cerveau déborde ce cerveau. »
Et ce philosophe, qui a l’habitude de remplacer les arguments sérieux par de simples analogies, conclut que l’esprit décroché, libéré, continue de vivre lorsque disparaît le cerveau, « sans que je puisse toutefois promettre, ajoute-t-il avec un sérieux qui frise le comique, plus qu’une survivance temporaire, c’est-à-dire sans que je puisse promettre encore une survivance indéfiniment prolongée ou définitive ». En somme, il adopte les thèmes de la métaphysique judéo-chrétienne et se borne à modifier quelque peu les accords jugés inharmoniques aujourd’hui ; ce qu’il y a de neuf chez lui c’est le langage, non les solutions. L’art subtil du narrateur, l’agrément des périodes, une finesse d’observation indéniable ne pouvaient cacher indéfiniment la faiblesse de sa doctrine. Que les spiritualistes en prennent leur parti le charme est rompu du bergsonisme ; la raison a repris ses droits. Comment admettre l’existence d’un esprit distinct du corps, alors que le mental reste dans une dépendance si complète du physiologique ? Seule la communauté d’origine rend compte du prodigieux parallélisme qui fait coïncider, de façon minutieuse, les modifications cérébrales et les états psychologiques. Les expériences de Flourens ont démontré que l’animal décérébré n’était qu’une machine, un automate capable d’exécuter certains mouvements réflexes ou habituels, mais dépourvu d’intelligence et de besoins. Un pigeon se laissera mourir d’inanition devant un monceau de grains, toutefois il avalent les aliments que l’on placera dans son bec. Et l’ablation des hémisphères cérébraux aura des effets d’autant plus notables que l’on s’élèvera davantage dans la série des vertébrés ; tant il est vrai que le développement de la conscience est en raison directe de la perfection du système nerveux. Combien misérables aussi les élucubrations de Bergson touchant les maladies de la mémoire et ses jeux d’acrobate pour démontrer que les souvenirs ne se conservent point dans le cerveau. Sans doute la physiologique ignore beaucoup de choses touchant le système nerveux mais le mystère n’est pas plus grand de savoir pourquoi la régénération d’un tissu nerveux suffit a faire reparaître les images qu’il gardait en réserve, que de savoir pourquoi l’empreinte digitale revient rigoureusement identique après une brûlure profonde ou une plaie.
Nous devons donc conclure que la base dernière de la mentalité psychologique c’est le cerveau. Alors que l’homme se croit le maître de l’univers, nous apprenons, par les récentes découvertes médicales, que lui-même obéit aux glandes endocrines. Ses vices, ses vertus, son caractère en découlent, de même que son tempérament physique et la nonchalance ou la vivacité de son intellect. Mais l’éducation reçue, le milieu où l’on vit, la profession que l’on exerce, influent également sur le contenu de l’esprit. Des hommes fort cultivés et par certains côtés très modernes ont été comme arrêtés dans leur développement par une formation qui retarde de plusieurs siècles. Ceci se remarque souvent parmi les anciens élèves de l’enseignement congréganiste. Pour eux, la scolastique représente le dernier cri de la sagesse ; ils ne lisent qu’avec des lunettes théologiques, n’ont que dédain pour l’art affranchi des préoccupations religieuses ou patriotiques et ne voient dans les soulèvements populaires que de diaboliques machinations. De même, la profession crée des habitudes, des préjugés, qui marquent l’individu de façon indélébile généralement ; d’où la mentalité sinistre du politicien, du juge, du militaire, du patron. Milieu physique et moral, opinions philosophiques ont une importance non moindre ; l’homme du nord se distingue aisément de l’homme du midi, et l’on sait combien efficace l’action de la publicité, de l’opinion, de l’exemple. Sans doute le tempérament contredit parfois les idées, mais toutes choses égales, un libertaire cherchera moins a tyranniser ses semblables qu’un partisan de l’autorité. Ajoutons, chez les esprits d élite un sentiment de révolte à l’égard des contraintes que la famille, la société, l’église prétendent leur imposer ; un besoin d’être soi-même, de se frayer sa propre voie, les détourne du conformisme traditionnel.
Toute mentalité humaine comporte certains éléments identiques ; c’est en vertu des principes souverains de la raison que nos opérations logiques deviennent possibles ; leur disparition serait le signal d’une éclipse de la pensée. Néanmoins de prodigieuses différences sont observables, soit dans le temps soit dans l’espace, entre les manières de sentir et de juger des peuples comme des individus. La fiévreuse activité chère aux habitants d’Europe et d’Amérique contraste avec la passivité qu’affectionnent les orientaux ; un artiste original, un vrai savant passeront pour des anormaux aux yeux du petit-bourgeois apeuré ; le cerveau libéré des dogmes est aux antipodes de l’esprit grégaire. Avec l’âge, la mentalité se transforme souvent ; socialiste à vingt ans, le même individu, surtout s’il a fait fortune, pourra s’affirmer réactionnaire à cinquante ; l’inverse arrive aussi quelquefois. Une crise lente ou brusque, une révolution intellectuelle ou sentimentale surviennent fréquemment chez les jeunes, moins souvent chez l’homme mûr, provoquées par le travail de la réflexion interne ou par des circonstances extérieures. Méprisables lorsqu’elles n’ont d’autre guide que l’intérêt, de pareilles transformations imposent le respect, quand elles ne valent à l’individu que des injures et des persécutions. Assurément le nombre est restreint de ceux qu’attire le sentier abrupte, rocailleux, bordé de précipices, qui conduit vers les sommets de la pensée ; ils existent pourtant et nous devons les aider à se découvrir eux-mêmes, à trouver leur chemin, à s’orienter.
– L. BARBEDETTE.
MENTALITÉ (NOUVELLE)
Ce qui distingue le monde ou l’humanité individualiste anarchiste, c’est qu’il ne consacre pas l’avènement d’un parti – économique, politique, religieux – d une classe sociale ou intellectuelle – d’une aristocratie, d’une élite, d’une dictature. Ce monde, cette humanité n’existe qu’en fonction d’une mentalité nouvelle d’une conception autre que celle qui domine dans la société archiste, d’une façon différente de situer l’unité humaine dans le milieu humain.
La grande, l’ineffaçable caractéristique de cette mentalité nouvelle, c’est la place qu’elle fait à l’unité humaine, considérée comme base de toute activité, de toute réalisation sociale – à la personne humaine envisagée dans toutes les situations comme intangible, comme inviolable. C’est l’impossibilité absolue pour le social d’opprimer ou de restreindre l’individuel. C’est, dans les rapports de toute nature qu’ils peuvent entretenir les uns avec les autres, la mise sur le même pied, à un niveau semblable, des collectivités et des isolés, des totalités et des unités. Autrement dit, l’assurance qu’aucun désavantage ou infériorité – en matière d’accords, de tractations, d’ententes, de contrats ou autres – ne pourra résulter pour la personne humaine du fait de vivre, agir, produire ou consommer isolément.
Aucune humanité ne sera du goût de l’individualiste anarchiste si elle ne se fonde pas sur cette « mentalité nouvelle ».
– E. ARMAND.
MENUISIER
n m. (tiré du latin minutiare)
Le menuisier travaille le bois en planches pour en faire des boiseries, des huisseries et des meubles. Menuisé a signifié : rendre menu, petit, menus travaux. Ce mot fut appliqué avec raison par les orfèvres qui étaient de deux catégories : les grossiers et les menuisiers.
Dès la plus haute antiquité les métiers du bois se confondaient dans celui du charpentier.
Des écrits et des gravures anciens nous révèlent qu’avec le bois, certains façonnaient et ornementaient des petits ouvrages, c’étaient des menuisiers sans en avoir la dénomination. (Afin de ne pas nous répéter, pour les détails nous renvoyons le lecteur aux mots : Bois, Charpentier, Ébéniste.)
Si l’on peut y ajouter foi, pour certains points matériels, l’Ancien Testament nous apprend que le temple de Salomon, décoré à l’intérieur par des Juifs et des Phéniciens, était orné de lambris en bois de cèdre et planchéié de sapin ; les portes de l’oracle étaient en olivier et celles de l’entrée du temple en sapin.
En Égypte, une peinture découverte à Thèbes montre que l’on y façonnait des portes à deux vantaux à panneaux. Les nombreuses pièces trouvées dans les monuments ensevelis : sièges, tabourets, stèle, se rapportent aux travaux de menuiserie des égyptiens.
Les Indiens sont les premiers à découper le bois pour l’ornementation des édifices ; ce n’est que 300 ans avant J. C. que dans cet immense pays on commença les constructions en pierre, jusque-là tout était édifié en bois.
550 ans avant J. C., on prétend que les collèges d’ouvriers du bois ont eu une existence régulière sous Servius Tullius et que sa constitution demeura en vigueur jusqu’à 241 ans avant J. C.
Sous Jules César (101 à 44 avant J.-C.) les outils étaient : la scie à main, le marteau, le ciseau, le maillet ; d’après Pline : l’herminette inventée par Dédale, la hachette, la rape, le rabot, le bouvet, la vrille. Lucrèce dit que la colle de taureau (colle forte) s’employait pour coller le bois.
Vitruve (29 ans avant J.-C.) rapporte que les Romains employaient le quercus (chêne) le sapinea (sapin) pour les lambris et les travaux des temples païens. L’ouvrier qui faisait les portes, fenêtres, volets se nommait : intestinarius (aménagement intérieur).
En Palestine israélite, il y a 1900 ans, à l’époque de J.-C., les meubles se composaient de lits et chaises, les portes en bois de pin tournaient sur des gonds et se fermaient au moyen de verrous en bois. Le professeur apportait à l’école sa chaise qu’il avait lui-même façonnée.
En 90, Plutarque cite que les charpentiers (tignarii) forment une centurie. Ce qui prouve que le métier était organisé. Les centuries de métiers étaient les plébéiens qui avaient des devoirs qui leur étaient imposés par les patriciens, dirigeants et usuriers de ce temps.
Dans les collèges romains les artisans travaillent pour le compte des associations publiques réglementées par les empereurs.
Rome était essentiellement militaire, les faveurs n’étaient octroyées qu’aux métiers utiles à la guerre. L’esprit romain voyait un abaissement dans les autres travaux manuels disant que c’était la prostitution de la dignité d’homme libre. Cet esprit de caste entraîna à la paresse et les époques qui suivirent furent en dégénérescence pour les travaux du bois et pour l’art en général.
Malgré cela, l’intelligence dominant dans les collèges d’artisans romains, ils eurent une grande influence sur la Gaule conquise ; en Allemagne, les pré-guildes religieuses qui en sortirent agirent sur les métiers et les impulsèrent.
Chez les Gallo-Romains, les portes d’entrée s’ouvraient du dedans au dehors ; il en était de même chez les Grecs.
Les guerres et les invasions successives de la Gaule font disparaître les corporations romaines ; le commerce et l’industrie dédaignés par les grands et les classes nobles sont aussi la cause qu’à l’époque franque, au commencement du roman et du moyen-âge il n’est que peu question du travail du bois.
Du IIIème au Vème siècle, le travail servile et monastique imprégné de mysticisme arrête l’évolution des premiers chrétiens.
Un pupitre de Sainte-Radegonde à Poitiers est du VIème siècle.
Guizot dit que jusqu’au Xème siècle tout était livré au hasard de la force. Ce fut la faillite de la civilisation romaine.
Au Xème siècle disparaît l’ouvrier et le paysan, qui appartenait au seigneur et qui était vendu comme le mobilier ; d’esclave il devient serf.
Les corporations se rénovèrent un peu au XIème siècle ; le travail est brut, il a perdu son fini et ses assemblages raisonnés, les joints sont doublés par des ais (couvre-joints) assujettis par des pointes.
Au XIIIème siècle, les croisées sont surtout des volets qu’avec les coffres et les bahuts façonne le hucher ; on commence à revêtir les murs de boiseries en chêne.
Consultant les faits par les constructions, ponts, cathédrales, châteaux-forts, on voit qu’avec l’affranchissement des communes au XIIème siècle, diverses associations se formèrent dans les villes ; même au IXème siècle, on note des confréries et guildes. Nous voyons que les boiseries de la cathédrale de Noyon sont de 1190, celles de Notre-Dame de Paris et de Chartres sont de 1196, celles de Ivenack en Mecklembourg sont de l’époque romane ; à Salzbourg, en Allemagne, existe un siège pliant de style roman datant de 1238.
Les corporations étaient des petites républiques, dont les chefs étaient élus par les maîtres et les ouvriers. Aucune preuve de l’existence du compagnonnage n’apparaît avant les XIIIème et XIVème siècles
Au XIIème siècle on mentionne qu’à Strasbourg, la fédération des francs-maçons englobait les métiers du bâtiment : charpentiers, huchers, etc.
Les règlements des divers corps de métiers existaient bien avant Saint Louis (XIIème siècle), mais n’étaient point officiellement adoptés. Le serf n’étant devenu que depuis peu l’artisan travaillant pour lui-même.
Étienne Boileau, prévôt sous Louis IX, rédigea le livre des métiers ; ses statuts servirent de modèle aux règlements des métiers qui furent établis dans toute la France. Ils mentionnent que les apprentis doivent être nés d’un loyal mariage. Le livre des métiers, en instituant les Corporations, stipule le classement en apprentis, valets, maîtres : ceux qui s’instruisent, ceux qui servent, ceux qui commandent. L’huissier ne peut travailler la nuit ; à Paris, le travail commence et finit au son de la cloche de la paroisse, du lever du soleil au crépuscule. Il est noté que les charpentiers font les gros travaux : fermes, poutres, ponts, etc. ; les huchers : les huches, bancs, tables ; les huissiers : les portes et fenêtres ; les cochetiers : les navires et les voitures. Le lien à la Corporation n’est encore que conditionnel, mais les statuts et les ordonnances le rendent efficace, rétrécissant la liberté des ouvriers en les attachant aux maîtrises et aux confréries. Le métier est une propriété du monarque, qui l’accorde à titre de récompense. Dans les provinces, ce droit dépend du Seigneur ou de l’Évêque. En réalité l’ouvrier indépendant est inconnu.
En 1290, Jehan de Montigny, prévôt de Paris, fit adopter aux vingt-neuf maîtres huchers de la ville de nouveaux statuts qui les détachaient des charpentiers ; les huchers et huissiers sont confondus et peuvent confectionner les escrins (bières et cercueils). Les jurés exigent des compétences professionnelles pour exercer le métier. Défense était faite d’embaucher l’ouvrier d’un confrère sans qu’il soit libéré de tout engagement ; l’ouvrier est engagé à l’année. Dans les villes le pouvoir est exercé par les métiers où domine l’influence de la bourgeoisie marchande ; cette dernière est quelquefois en lutte contre l’aristocratie de la ville, questions d’intérêt dans lesquelles les compagnons et apprentis n’avaient rien à gagner.
Au milieu du XIIIème siècle, les menuisiers travaillaient le merrain (chêne ou châtaignier scié sur quartier) tandis que les charpentiers employaient le bois à l’avenant et sur dosses.
Le rabot, en partie disparu depuis les Romains, réapparaît au XIVème siècle ; jusqu’ici, les bois étaient aplanis à la hache, herminette et au racloir.
Jean Bacin, en 1361, fait trois chéières pour la reine, qui lui sont payées 110 sous.
Au moyen-âge, les portes et fenêtres étaient sans cadres et sans assemblages. Ce n’est que sous Charles V que les menuisiers installent la bibliothèque du roi dans la tour du Louvre et se signalent par des assemblages dans les huisseries, les lambris, les sièges, les pupitres.
En 1370, la hiérarchie est sévère dans les corps d’états. Confréries et Compagnonnage naissant en font une chose à eux ; il en fut de même par les guildes en Allemagne.
Sous Charles VI, en 1371, H. Aubriot, prévôt de Paris, délivre des statuts aux menuisiers. Ceux-ci n’en sont pas enthousiasmés, beaucoup ne veulent pas les accepter, mais le Parlement les confirme et les impose en 1382.
Tous les gens du métier doivent faire partie de la Confrérie religieuse (surtout alimentée par les amendes). Les menuisiers adoptèrent Sainte Anne comme patronne.
Après une requête auprès d’Aubriot, ceux qui font les bancs, bahuts, coffres, tables, portes et fenêtres sont détachés des charpentiers pour former la communauté des huchiers (huchers). En 1382 ils prennent le nom de menuisiers.
C’est alors que le chef-d’œuvre est imposé à l’apprenti pour devenir Compagnon et au Compagnon pour passer Maître.
Avec la Renaissance, vers 1400, le Compagnonnage entre en puissance et s’impose pendant quatre siècles pour exercer le métier.
Le Compagnonnage se sent fort, il s’impose pour travailler. Son engagement terminé avec le Maître (patron), le compagnon est libre d’aller chez un autre. L’apprenti ne peut sortir de sa tutelle, les maîtres sont autorisés à les battre. Les maîtres fournissent tout l’outillage, l’ouvrier fournit ses bras et son initiative.
En France, en Angleterre, en Allemagne, en Lombardie, le chêne était presque seul en usage pour les meubles et les boiseries. Le noyer fut employé pour les lits (moins couramment), dressoirs, fauteuils, bancs, coffres. La sculpture devint distincte de la menuiserie ; dans le gothique fleuri, elle donna naissance à la profession des imagiers qui travaillaient également la pierre et le bois.
Les ouvrages des XIVème et XVème siècles sont déjà des chefs-d’œuvre de menuiserie, impulsés en sciences et en art du dessin gothique, dans lequel vient s’allier celui de la Renaissance, tels la chapelle de Blois, de Saint-Ouen de Rouen, les caisses d’horloges à Beauvais et à Reims. Jehan de Liège, au XIVème siècle, fait les portes de la cathédrale de Dijon.
La généralisation de l’art et des principes du travail prend un caractère international surtout à la fin du gothique. Les ouvriers commencent à voyager.
Au commencement du XVème siècle (1405), les menuisiers exécutèrent le coffre du premier coche qui transporta pour leur mariage Isabeau de Bavière et Charles VI.
La bannière était promenée les jours de fêtes et dans les cérémonies. Les armoiries de la bannière sont un blason d’azur portant une varlope d’or, un ciseau à manche d’or et un maillet d’or.
En 1471, Louis XI délivre aux huchers de nouveaux statuts.
C’est en 1486 que menuisier est appliqué sans autre épithète.
Le musée de Cluny possède du XVème siècle le bois d’une des premières varlopes.
La menuiserie se perfectionne dans la Renaissance par l’embellissement des châteaux, des hôtels particuliers, des églises ; les beaux meubles massifs sortent des mains du menuisier.
Vers 1550 quelques compagnons menuisiers veulent se rendre indépendants, ils se réfugient dans le faubourg Saint-Antoine et y travaillent en association avec les charpentiers.
Sous Charles IX, le taux des salaires est établi chaque année, il est de dix sous tournois par jour en 1560.
En 1580, les statuts sont révisés.
En 1640, l’ouvrier hucher entrant chez un nouveau maître doit payer quatre sous à la caisse de la Confrérie et à la bannière du métier.
Sous Louis XIII, les portes cochères sont des pièces architecturales avec assemblages et embrèvements.
Sous Louis XIV, d’autres nouveaux statuts sont promulgués aux menuisiers concernant surtout les maîtres ; nul ne peut l’être s’il n’est Français ou naturalisé ; ordonne que le fils du patron doit produire un chef-d’œuvre ; de même l’apprenti après six ans d’apprentissage. Nul ne peut travailler s’il n’est reçu compagnon ou maître.
L’entrée à Paris d’un compagnon est fixée à cinq sous pour la communauté. Le menuisier ne doit exécuter que portes, fenêtres, lambris, stalles, pupitres d’autels, etc.
Dès 1650, les nouveaux maîtres doivent être catholiques, apostoliques romains.
En 1660, la Confrérie est étroitement liée à la Corporation.
On ne travaille ni les dimanches et jours de fêtes, ni les samedis et veilles de fêtes après vêpres, ni la nuit.
Les valets (compagnons) se louent à la semaine, au mois ou à l’année ; l’embauche se pratique au carrefour de la rue Saint-Antoine, carrefour des chars ; ils prêtent serment d’obéissance au patron et aux règlements.
La révocation de l’édit de Nantes, en 1685, fait retirer la Maîtrise aux protestants, qui s’exilent en Angleterre, en Allemagne, en Hollande avec toute leur science qu’ils y développent.
Pour payer les frais énormes des guerres, les prix des maîtrises sont majorés en 1704. Les caisses corporatives s’appauvrissent en créant une irritation générale des ouvriers, ce qui a comme résultat pour les menuisiers l’interdiction sous aucun prétexte de se réunir.
En 1744, sous Louis XV est ordonnée la Communauté des Maîtres Menuisiers et Ébénistes. La Confrérie de Sainte-Anne est consacrée aux menuisiers dans l’église des Carmes des Billettes, qui est ensuite abandonnée pour Sainte-Marguerite. Tous les membres de la corporation sont tenus d’assister aux offices.
Le Maître ne peut avoir qu’un atelier.
Par la force du Compagnonnage et de la religion, dont dépend la corporation des menuisiers, le XVIIIème siècle arrête quelque peu l’évolution scientifique et l’esprit d’indépendance des ouvriers.
Ce n’est qu’en janvier 1776 que le ministre Turgot supprime les Corporations et accorde à l’ouvrier la liberté de travailler pour son compte sans brevet ni redevances. Naturellement les maîtres s’insurgent et sentent leurs privilèges compromis.
En août, Turgot est destitué et les jurandes et les maîtrises sont rétablies. Néanmoins, la vieille institution a reçu du plomb dans l’aile, on la sent décliner un peu chaque jour par la volonté d’émancipation que manifestent les menuisiers et d’autres corps de métiers.
La fameuse nuit du 4 août 1789 condamne de nouveau les maîtrises et la loi du 7 juin 1791 confirme que les corporations sont définitivement abolies et supprime les communautés d’arts et manufactures.
De 1789 à 1814, on relate qu’en technique la menuiserie est en décadence.
Si la Révolution a suscité les idées de liberté, les longues et ruineuses guerres de l’Empire les ont complètement anéanties.
Quoique n’étant plus que toléré, le compagnonnage influence les menuisiers et les tient en les facilitant pour voyager et loger chez les mères ; c’est lui qui portera mollement jusqu’au milieu du XIXème siècle le drapeau des revendications corporatives.
Un esprit nouveau est né avec la Révolution de 1848, les nouvelles sociétés, l’esprit d’association et de corporation. L’ouvrier de plus en plus matérialiste, rejette le mysticisme spiritualiste.
Le compagnonnage se modifie, de nombreux compagnons s’en détachent : les uns forment le Club des Compagnons du Devoir, d’autres les Compagnons Indépendants.
En 1849 dans toutes les villes de France une scission se produit chez les menuisiers entre les aspirants, qui veulent être traités à égalité, et les compagnons.
Perdiguier, compagnon du Devoir de liberté, ouvrier menuisier, dit Avignonnais-la-Vertu, est élu député de Paris par 117.292 voix ; il écrivit quelques livres très sensés et essaya d’unir tous les compagnons qui se querellaient. Un malaise régnait, un esprit nouveau se manifestait, les croyances s’évanouissaient. En 1853, c’est à Bordeaux que l’on se dispute ; en 1857, à Marseille, les rixes sont violentes entre Compagnons et Aspirants.
Dans le travail, le progrès mécanique se manifeste, à l’Exposition de 1850 par la scie mécanique verticale, par la machine à mortaiser, à raboter. Les machines ne sont encore l’apanage que de quelques gros entrepreneurs, parce qu’elles coûtent cher ; l’ouvrier y voit un mal, il la combat, craignant le chômage. En 1866, les machines se généralisent, la scie à ruban est inventée et figure à l’Exposition de 1867.
Après 1878, les menuisiers sont en partie libérés des Sectes compagnonniques ; ils fondent la Chambre Syndicale des ouvriers menuisiers, d’abord socialiste ; puis, quelques années plus tard, sans se déclarer anarchiste et sous l’influence de divers ouvriers très studieux, tels que Montant le Savoyard, orateur plein d’arguments et de verve, de Franchet de Blois, de Jamim le dessinateur, de tortelier, etc., le syndicat fait de la propagande révolutionnaire socialiste et anarchiste, qui en fait la corporation la plus avancée de France.
En 1888 c’est la manifestation contre la misère et le chômage que les menuisiers organisent à l’esplanade des Invalides avec Louise Michel et Pouget, qui sont condamnés à cinq et huit ans de prison.
Jamin avec l’aide du Syndicat, fait paraître La Varlope en 1835, journal corporatif anarchiste. Des cours de dessin sont ouverts par le Syndicat, l’un, rue Miollis avec Cardeillac, l’autre, rue Charlot avec Jamin, lesquels sont à la fois des cours techniques et sociologiques.
Rétrospectivement, l’outillage fut d’abord rudimentaire, un seul fer était dans les rabots. Longtemps après, probablement à la Renaissance, on mit un simple contre-fer qui empêchait les éclats de bois. Ce n’est qu’au commencement du XIXème siècle que quelques menuisiers font ajuster des vis au contre-fer, qui s’appliquent de différentes manières en Allemagne, en France, en Angleterre, ce qui permettait de raboter plus finement.
Depuis 1880, l’outillage fut d’abord en fer et en acier, fabriqué en Angleterre, puis en Amérique, fut introduit en Allemagne et en France ; il permit de travailler avec plus de précision et moins de dépenses physiques ; ce sont les rabots droits et cintrés à volonté, les scies à mains, grandes et petites, qui remplacent peu à peu les encombrantes scies à refendre, à débiter et à araser. La routine des vieux menuisiers a été dure à surmonter dans l’outillage. Elle existe encore un peu aujourd’hui.
Les mèches cylindriques à couteaux et à vis remplacent celles dîtes à cuiller, à queue de cochon et anglaises.
Les progrès du machinisme qui se généralise dans le débit des bois, le sciage, le rabotage, moulurage, assemblage et, à présent le ponçage, firent naître la spécialisation, qui nécessita des traceurs, des monteurs, des finisseurs et des poseurs ou pailleux.
Dans les ateliers modernes le taylorisme commence, les ouvriers sont groupés en spécialistes : scieurs attachés à la scie circulaire ou à ruban, d’autres à la raboteuse, à la toupie ou à la ponceuse, etc. Ce sont, après les monteurs de portes, fenêtres, etc. les affleureurs et chevilleurs ; puis, les ferreurs et les poseurs.
Le métier dans le progrès de la machiné s’est subdivisé en menuisiers en bâtiment, menuisiers en meubles, menuisiers en sièges, menuisiers en voitures, ébénistes en pianos, menuisiers de théâtres, layetiers, tabletiers, etc.
Dans tout ceci l’ouvrier menuisier acquiert de la vitesse mécanique au détriment des connaissances techniques générales, qu’il abandonne et perd un peu chaque jour.
S’il y a avantage pour la rapide production, qui profite surtout au patronat, il y a déchéance morale pour l’ouvrier.
Tous les progrès ne profitent qu’au capitalisme, qui y trouve une source immédiate de profits vite réalisés, alors que le menuisier, s’il a moins de mal que jadis, n’en a pas plus de repos ni de bonheur intellectuel, il est modernisé de l’ancien esclave, serf, valet, en ouvrier dépendant du Maître, du Capital et de l’État, qui le pressure d’impôts.
Tous ces progrès pourraient être une source de bonheur pour tous par le rendement intensif en n’occupant l’ouvrier qu’une heure ou deux chaque jour dans les travaux du taylorisme abrutissant. L’ouvrier, le reste du temps, pourrait se consacrer à d’autres travaux manuels ou intellectuels non moins utiles. Mais nous sommes en période de mercantilisme, d’exploitation de l’homme par l’homme, de capitalisme soutenu par l’État. Toutes choses a détruire par la Révolution pour établir la Liberté et le bonheur pour tous.
– L. GUERINEAU.
MÉPRIS
n. m. (de mépriser, pour mespriser, de mes (mal) et priser)
À l’opposé du respect se place le mépris dans la gamme des sentiments ; c’est le manque de considération ou d’estime pour quelqu’un ou quelque chose. On dira qu’un tel méprise le danger, le qu’en-dira-ton, les préjugés du milieu et du moment. Malheureusement, en majorité, les hommes sont attirés par l’argent, la renommée, le pouvoir ; ils admirent ceux dont la situation sociale est brillante, mais dédaignent ceux dont le rang ne leur semble point digne d’envie. Il est pénible de constater la platitude trop fréquente dont le pauvre fait preuve à l’égard du riche, l’ouvrier à l’égard du patron, le vulgaire citoyen à l’égard des autorités et, à l’inverse, leur arrogance à l’égard d’un plus misérable qu’eux-même, d’un plus faible, d’un plus persécuté. Il suffit de parler de condamné, de détenu, de bagnard pour qu’aussitôt les bien-pensants fassent les dégoûtés ; de malheureux forçats du travail, qui triment sans répit pour arrondir le magot d’un usinier millionnaire, affecteront des allures méprisantes à l’égard de l’irrégulier, du vagabond qui vivent en marge des oppressions collectives ; et la femme, qui eut besoin du maire et du curé pour s’unir à un homme qui la trompe quotidiennement, passera hautaine près de celle qui ne demande à personne la permission de vivre avec celui que son cœur a choisi. Dans les administrations, le chef semble d’ordinaire se croire d’une essence supérieure à celle de ses subalternes ; le professeur de faculté dédaigne le professeur de lycée qui, à son tour, le rend au primaire, trop porté lui-même à se considérer comme infiniment supérieur aux ouvriers dont il instruit les enfants.
Par une adroite distribution de titres, de médailles, de galons, la société entretient soigneusement la croyance en des mérites imaginaires qui élèvent l’individu au-dessus du vulgum pecus et, par contre-coup, provoquent le mépris pour toute existence qui se résigne à rester obscure. « En toutes matières et sans répit, dans nos écoles, le maître classe, numérote, hiérarchise, coupant des cheveux en quatre, s’il le faut, afin d’avoir un premier et un dernier. Travail malaisé, je vous assure, quand les copies se valent à peu près ou que l’appréciation garde un caractère subjectif comme en devoir français. La manie du classement éclate jusque dans les manuels scolaires ; en histoire, en littérature, les personnages sont disposés par ordre de grandeur, tels des poupées de cire dans la vitrine d’un musée ; et ce sont d’interminables querelles pour savoir qui l’emporte de Corneille ou de Racine, de Robespierre ou de Danton. Mais foin de la masse anonyme : on ne s’intéresse qu’aux hommes à qui l’on dresse des statues. Ainsi germent les désirs de gloire, de richesses ou d’aventures dans le cerveau de nos enfants, incapables désormais de comprendre la noblesse des taches obscures ». « Observez les enfants pendant qu’on lit un palmarès ou qu’on donne les résultats d’une composition : la flamme qui brille dans la prunelle des bien-casés, les éclairs de haine, les lèvres balbutiantes des autres ; quand l’attitude de l’ensemble ne témoigne pas d’un mépris souverain pour le correcteur. Et peut-être croirez-vous moins aux bienfaits de l’émulation ! On dresse de petites idoles, infatuées de leur personne, jalouses des concurrents sérieux, méprisantes pour les camarades étiquetés médiocres ou nuls ; prodiges à quinze ans, fruits secs à quarante, munis de parchemins peut-être, dénués pourtant du pouvoir créateur qui caractérise l’homme de génie. » (Le Règne de l’Envie). Et, si les maîtres méprisent les serviteurs qui peinent quotidiennement pour les engraisser, ces derniers, à défaut de plus malheureux qu’eux-mêmes, se vengeront sur les animaux. Les coups, la fatigue, avec les maigres joies d’une pauvre pitance, voilà, pensent-ils, qui suffit à leurs compagnons douloureux ; point de survie pour ces derniers, point de justice par delà la tombe ; cet espoir, les prêtres le réservent aux hommes. Aux yeux d’un catholique c’est chose ridicule d’être bon pour les bêtes même domestiquées. Du haut en bas doit régner le mépris pour ce que nous estimons des formes inférieures de vie.
À l’inverse, nous pensons que le mépris n’est légitime qu’à l’égard des exploiteurs de l’ignorance et de la sottise humaine. Dans tous les autres cas, c’est la pitié, une pitié sans borne, qui doit nous guider, lorsqu’il s’agit de malheureux humains victimes de l’injustice sociale, de la nature ou du sort, et même en présence du plus humble des organismes vivants. « Fils de la terre, frères de tout organisme en voie d’évolution, inclinons-nous avec douceur vers la fleur entrouverte, n’écrasons pas sans raison le vermisseau gisant à nos pieds. Qu’une infinie pitié nous soulève devant la souffrance imméritée de l’homme et des autres vivants ses compagnons ; opérons l’œuvre rédemptrice que les dieux n’ont pu faire. » (Par delà l’Intérêt). Le fouet de notre mépris réservons-le aux vendeurs du temple, aux potentats que les peuples bernés adorent, aux faux savants, aux larbins de l’Académie, aux parlementaires tripoteurs, aux institutions et aux hommes qui oppressent les consciences et les volontés. Aux autres, même coupables, même peu intéressants, distribuons les trésors d’une compassion aussi universelle que la souffrance.
– L. B.
MERCANTI
s. m. du latin mercans, mercantis, marchand
Marchand dans les bazars d’Orient et d’Afrique, ou à la suite des armées en campagne. Bas commerçant, profiteur de la guerre.
Ce mot n’était guère usité avant la guerre de 1914–1918 : il existait cependant l’esprit mercantile, c’est-à-dire l’amour excessif du gain. La guerre ayant désaxé le commerce puisque la consommation dépassait la production, les marchands de toutes catégories tant que durèrent les hostilités, alors que les hommes s’entretuaient et mouraient par millions, réalisaient des bénéfices inouïs, faisant des fortunes en quatre ou cinq ans.
L’acheteur, individu ou collectivité, était immanquablement détroussé par les marchands. Et ceux-ci s’attirèrent comme un qualificatif de mépris, celui de mercantis... Vengeance anodine qui n’empêchait pas les spéculateurs de perfectionner leurs agissements et d’étendre leur champ de rapine.
D’ailleurs, le commerce étant l’art de faire payer 6 francs ce qui en a coûté 4 et d’acheter 4 ce que l’on vendra 6, ne saurait « déchoir » parce que l’on a fait payer 6 ce qui ne coûtait que 2 francs. Il y a là seulement une question de proportion et d’appétit qui ne change rien an principe et souligne seulement davantage l’absurdité des échanges par voie mercantile. Ne vivons-nous pas à une époque où l’intermédiaire arrive toujours à tirer son épingle du jeu – une épingle d’or très souvent – tandis que le producteur se débat dans les difficultés et la gêne. Puisque le commerce est le vol autorisé, le mercanti n’est, après tout, qu’un commerçant un peu plus voleur que ses confrères.
MERCENAIRE
adj. et subst. (du latin mercenarius, même sens, fait de merces, salaire)
Qui se fait pour le gain, pour un salaire convenu : labeur mercenaire, occupations mercenaires. Les sociétés humaines, en détournant l’effort productif de ses voies droites et légitimes, en l’assujettissant au service de la force, de la jouissance oisive et de l’ambition, en monopolisant ses fruits entre des mains privilégiées, ont fait du travail (voir ce mot) une tâche avilie et mercenaire. Elles en ont voilé le but naturel et tari les joies normales. L’équilibre est constamment faussé entre le quotient d’énergie exigé du producteur et la part qui lui revient des richesses obtenues.
Les conditions mercenaires dans lesquelles s’accomplit le labeur ont fini par en faire perdre de vue au plus grand nombre l’objet véritable. Le travail humain, écarté de sa ligne simple et logique, donne bien davantage l’impression d’un sacrifice incessant à quelque Moloch-Argent, entité insatiable, que d’une œuvre utilitaire rythmée aux exigences des besoins. Le gain, le salaire sont au premier plan du travail des masses laborieuses ; c’est vers eux que l’effort est tourné comme s’ils étaient son unique fin. La plupart des hommes en sont venus à ne plus regarder dans leur besogne autre chose que cet aboutissement ; plus d’activité qui ne soit monnayée : l’effort est tout entier mercenaire. Dépouillé de sa nécessité directe et de sa grandeur native, corrompu par une philosophie frelatée qui en « justifla » les déviations, il se traîne, lui aussi, parmi les mensonges conventionnels du social.
* * *
On appelle troupes mercenaires les troupes étrangères dont on achète le service ; cette qualité peut s’étendre aux troupes indigènes. Dès l’antiquité empires et républiques commerçantes de la Méditerranée, colonies phéniciennes, ioniennes, Athènes même, la république romaine enfin firent appel à des auxiliaires thraces, gaulois, asiatiques, celtibériens, etc. La Rome impériale, après avoir levé des légions sur les terres asservies par ses conquêtes, enrôla des mercenaires empruntés aux peuplades barbares riveraines. Jusqu’au moyen-âge d’ailleurs routiers et condottieri, brabançons et navarrais vinrent chercher solde auprès des maîtres des nations. Reîtres et lansquenets allemands, compagnies suisses passaient tour à tour des bannières des évêques ou des rois de France sous les pavillons des princes impériaux. Ces marchés de soldats s’étendirent, chez nous, jusqu’au seuil de la Révolution française sous forme de gardes attachés aux palais royaux. Tels les Suisses d’argent qui furent le rempart de la cour du dernier des Capets.
L’introduction de l’esprit démocratique dans la vie moderne a modifié le caractère des armées. Le XIXème siècle a marqué une tendance toujours plus accentuée à répudier les armées de métier, les troupes vénales rendues suspectes d’ailleurs par quelques trahisons célèbres. Il leur a substitué les armées nationales, de souche évidemment populaire, les nobles se réservant les hauts grades et les bourgeois aisés s’achetant des remplaçants. Puis les républiques sont venues, proclamant l’obligation militaire générale, instituant le service dit obligatoire. Elles ont amené dans les casernes multipliées les différentes couches sociales, séparées néanmoins par le choix des armes, car cavalerie, artillerie, sont demeurées le refuge de l’aristocratie et de sa jeunesse fortunée, embrigadant quelques gars dociles des campagnes, l’infanterie ouvrant ses rangs aux contingents massifs de la ville et des champs.
Mais le développement de l’industrialisme a donné naissance à de fréquentes revendications collectives des travailleurs rassemblés dans les ateliers et les usines. Cessant par moment, d’ensemble, le travail, les salariés se sont mis en grève. Ces mouvements, parfois violents au point de donner des inquiétudes aux patrons, aux manufacturiers, ont provoqué, de la part des gouvernements, des meures « d’ordre ». Contre les ouvriers révoltés on a appelé, au secours des gendarmeries débordées, les soldats détournés de leur rôle officiel. Mais, d’abord docile et prompt à servir la répression, le peuple sous l’uniforme a fini par prendre conscience de la solidarité qui l’unit au travailleur luttant pour le pain quotidien. Il s’est, çà et là, refusé au rôle de briseur de grève. En dépit des mensonges qui troublent ses affinités de classe et d’une discipline qui châtie durement ses élans, l’armée du service obligatoire a cessé d’être la sauvegarde assurée de l’ordre privilégié. On se méfie de ses répugnances croissantes, on craint ses fraternisations susceptibles de s’amplifier en complicités révolutionnaires...
Et la bourgeoisie régnante revient, par l’extension de sa police, par la création de gardes mobiles – corps salariés – par d’alléchantes primes d’engagement et de rengagement qui entraînent la formation d’importants noyaux de militaires payés au sein même des troupes régulières, la bourgeoisie revient, pour sa suprême défense, aux groupes mercenaires. Ultime carte d’une classe favorisée qui range ses derniers esclaves autour du butin amoncelé. La mesure ne la sauvera pas des crises et de la, défaite finale. Comme l’empire romain décadent, confiant sa garde aux guerriers sans âme du mercenariat, le capitalisme verra fléchir, à l’heure critique, le dévouement payé des défenseurs qui ne retiennent à ses côtés que des intérêts momentanés et d’ailleurs équivoques. Les mercenaires retarderont peut-être sa chute. Ils marqueront de quelques pauses sanglantes la marche douloureuse du prolétariat. Mais ils ne sauveront pas le régime que minent de foncières incompatibilités et dont la forme agglomère, facticement, l’organisme.
– LANARQUE.
Par analogie, mercenaire se dit de ce qui a pour essence, pour mobile ou pour but un intérêt sordide, servi par une basse flagornerie ; il désigne des manœuvres intéressées, parfois soudoyées : âme mercenaire, louanges mercenaires.
Hist. Ecclés. : Se disait de prêtres qui n’étaient attachés à aucune paroisse.
Au fig. Homme intéressé, facile à corrompre pour de l’argent : « les ambitieux qu’on loue tant sont des glorieux qui font des bassesses, ou des mercenaires qui veulent être payés » (Fléchier),
Histoire : Guerre des mercenaires : guerre terrible que Carthage eut à soutenir en Afrique contre ses troupes mercenaires, qui s’étaient révoltées parce qu’elles n’étaient pas payées. Elle eut lieu pendant l’intervalle de la première à la deuxième guerre punique (241–238). Mathos et Spendius furent les principaux chefs des rebelles ; Amilcar, chargé de les combattre, réussit à enfermer dans un défilé un corps d’insurgés, et les fit tous massacrer à mesure qu’ils en sortaient ; de 40.000 hommes, pas un n’échappa. On nomma cette guerre la Guerre inexpiable, à cause des fureurs auxquelles elle donna lieu. G. Flaubert s’en est inspiré pour écrire Salammbô.
MÈRE
n. f.(du latin : mater)
Femme qui a mis au monde un ou plusieurs enfants.
Dernier stade de l’évolution de la femme, tant dans le domaine physiologique que psychologique. La vierge, la femme stérile, sont des femmes incomplètes. Physiquement, la femme qui a été mère est plus belle et conserve sa fraîcheur plus longtemps que la femme qui n’a pas connu la maternité. Évidemment, il ne peut être question des femmes aux maternités trop souvent répétées, pour lesquelles la maternité ne signifie que gêne, restrictions et fatigues. Mais, à âge égal, la femme qui n’a jamais été mère est en général plus fanée que celle qui connut quelques maternités heureuses, assez espacées pour permettre au corps de se raffermir et de reprendre sa vigueur, et qui n’eut pas à connaitre les privations et le surmenage. La maternité est l’épanouissement de la femme, la mère est la femme dans la plénitude de sa force et de sa grâce. Le charme puéril et gracile de la vierge ne peut pas être comparable à la beauté de la mère. Qui n’a admiré le tableau d’une jeune mère allaitant son enfant ? C’est une image de vie d’une force saisissante, et devant laquelle le penseur est ému. C’est que la « Mère » est dans le sens de la vie. Dans l’ordre naturel aussi bien que dans l’ordre social, la femme qui n’est pas mère n’a pas de raison d’être. La mère est la fondatrice de la famille et de la société. À l’origine des âges, l’homme, nomade par instinct, ne s’est fixé au sol que parce que la mère l’y a fixé. Élie Reclus, dans son ouvrage sur Les Primitifs nous le dit éloquemment : « Nonobstant la doctrine qui fait loi présentement, nous tenons la femme pour la créatrices de la civilisation en ses éléments primordiaux. Sans doute, la femme à ses débuts ne fut qu’une femelle humaine ; mais cette femelle nourrissait, élevait et protégeait plus faible qu’elle, tandis que son mâle, « fauve terrible, ne savait que poursuivre et tuer. Il égorgeait par nécessité et non sans agrément. Lui, bête féroce par instinct ; elle, mère par fonction... »
C’est sur cette fonction de la mère que la civilisation s’est édifiée. La mère est aussi vieille que l’humanité. Les primitifs ignoraient la paternité, n’établissant pas de relation entre l’acte sexuel de la fécondation et la mise au monde d’un enfant par une femme. Mais le lien maternel était indéniable. Fécondée au hasard par l’un ou par l’autre, la mère seule existait. Ses enfants l’entouraient. La horde primitive ne connaissait pas le père. Elle allait sous la conduite du chef, auquel tous obéissaient, mâles et femelles ; les mères chargées des petits, les hommes chargés du butin. Quand la horde se fixa, la mère devint la créatrice du foyer. Dans la hutte grossière, elle était la gardienne et la protectrice des enfants, pendant que les hommes étaient à la chasse et à la pêche, ou s’occupaient à cultiver le sol, chez les peuples agriculteurs. Gardienne des enfants, elle devint également gardienne du butin et des récoltes, qu’elle dut conserver et administrer. De là ces fonctions qui sont devenues la consécration sociale de la femme, mais qui, ne l’oublions pas, lui ont été conférées parce qu’elle était la mère. Mais là ne s’est pas bornée la participation de la mère à l’œuvre civilisatrice. La civilisation lui est encore redevable de la plus noble des forces morales qui ait soutenu et consolé l’humanité et qui la conduira vers l’harmonie et le bonheur : l’amour. L’amour maternel est à l’origine de tous les amours. Fait sans doute d’instinct et d’animalité dans son expression première, il était cependant l’amour, et le seul amour qui fut. Ayant à protéger plus faible qu’elle, à soigner, secourir, consoler, la mère apprit le dévouement, la sollicitude, la tendresse patiente, la pitié, l’indulgence, le pardon. Toutes ces vertus qui, par la suite, se développeront d’âge en âge, et qui contiennent la rédemption morale du monde, c’est la mère qui les a apportées au monde. Ce n’est pas la femme, ainsi qu’on le dit couramment. La femme, prise en tant qu’individu au même titre que l’homme, est, comme lui, égoïste et comme lui recherche le plaisir et la jouissance. Elle ne s’élève à l’altruisme, au désintéressement, que par la maternité qu’elle porte en elle et qui domine toute sa vie, même lorsqu’elle n’est pas mère. Il est nécessaire de ramener toujours une question à son point de départ, et celle-ci plus que toute autre. On a tendance aujourd’hui à décrier la maternité, à rabaisser la mère, à l’inférioriser socialement et moralement. C’est une grave erreur des temps modernes. Le machinisme, qui enlève la mère à ses enfants et détruit l’harmonie du foyer, obnubile notre raison et nous porte à juger faux en subordonnant aux questions d’ordre secondaire les vérités primordiales et fondamentales de la vie. Le machinisme passera. La mécanisation à l’américaine n’est heureusement qu’une de ces erreurs comme l’humanité en commet dans sa marche au progrès, mais dont elle guérira. Et « la mère » survivra au mal moderne, comme elle a survécu à tous les bouleversements sociaux et économiques. Elle y survivra précisément parce qu’elle est la Vie, source de vie et d’amour, dispensatrice du bonheur humain, régulatrice des mœurs et de la morale. Toutes les vieilles religions du passé ont élevé sur le monde le mythe rédempteur d’une mère portant un enfant sur ses bras. C’est un symbole d’une haute signification, qui est encore l’espoir des penseurs et des moralistes, dans l’apparente confusion et contradiction des théories de l’heure présente. Mais la confusion n’est qu’apparente. L’ordre est la loi du cosmos et le rythme du temps. La « mère » restera la conception la plus parfaite de l’universelle vie et de l’universel amour, parce qu’elle est l’image la plus vraie du principe d’Universalité.
* * *
Fonction physiologique
Physiologiquement, la mère passe par trois phases distinctes : l’attente, l’enfantement, l’allaitement. Toutes les femmes ne ressentent pas de la même façon la première phase. Si l’enfant est désiré, conçu volontairement, s’il est aimé avant sa conception même, l’attente est une période heureuse. Il se produit alors, chez la future mère, un travail psychologique qui marche de pair avec la fonction physiologique et qui est du plus heureux effet sur l’intelligence et la pensée. Ramenée sans cesse vers le petit être qu’elle sent vivre en elle, la femme se trouve presque à son insu portée vers les graves questions de la vie. Cet enfant qui va naître lui révèle le monde. Si l’enfant n’était pas désiré, ou si la mère est déjà fatiguée par des maternités pénibles, cette période de l’attente pourra être, à ses débuts surtout, une source d’ennui et de mécontentement. Mais, même dans ce cas, l’apaisement se fait, surtout si la femme a déjà été mère, car il lui devient alors impossible de séparer celui qui va naître de celui ou de ceux qui l’ont précédé. En général, quand l’enfant naît, s’il est mal accueilli du père – ce qui arrive fréquemment dans la classe populaire, lorsqu’il vient s’ajouter à d’autres – il est déjà aimé par sa mère. Les hommes du peuple protestent contre la charge de nombreux enfants, mais n’apportent aucune prudence dans l’acte procréateur. Et il est remarquable que ce soit la mère, fécondée sans sa volonté, qui témoigne alors le plus de désintéressement, et accueille le pauvre petit non désiré, sinon avec joie, du moins avec une pitié tendre. L’homme peut mépriser son petit, l’insulter de noms grossiers ; mais la mère, dès l’enfantement, éprouve déjà le besoin de protéger et de soigner. Il y a certes des exceptions, mais nous n’avons à nous occuper ici que de la règle générale. L’instinct maternel est un fait indéniable. Il n’est ni miraculeux, ni sacré, ni infaillible. Il ne confère pas l’intelligence à qui ne la possède pas. Il repose tout entier sur la communauté physiologique. La mère aime son enfant parce qu’il fait partie d’elle-même, parce qu’il est le prolongement de sa vie, un peu de sa chair qui continue à vivre en dehors d’elle. Elle est unie à lui par la sensibilité qu’elle a d’elle-même. Les cris de souffrance de son enfant se répercutent en elle comme un écho de sa propre souffrance, ce qui explique cette clairvoyance maternelle, que nombre de médecins attesteront, et qui souvent sauve l’enfant malade. La nourrice-mercenaire, presque toujours avertie trop tard, réclame le médecin alors qu’il n’est plus possible d’intervenir. La mère, elle, peut exagérer dans le sens contraire ; mais le souci constant que lui inspire son petit, l’inquiétude permanente qui veille en elle, sont la sauvegarde même de l’enfant.
Quoi qu’en prétendent certains adversaires de la maternité, la mère ne se remplace pas. La maternité, étant fonction de vie, de pensée et d’amour, ne s’industrialisera jamais. Le Dr Vatrey dit :
« Toutes les précautions qui doivent entourer un enfant ne sont vraiment bien prises que par la mère. »
À l’appui de cette déclaration, il donne les statistiques suivantes, établies par lui-même, d’après ses propres observations :
-
Enfants nourris au sein par la mère, mortalité, 11,9 pour 100 ;
-
Enfants nourris au biberon par la mère, mortalité, 30,6 p. 100 ;
-
Enfants nourris au sein par une nourrice, mortalité, 36 p. 100 ;
-
Enfants nourris au biberon par une nourrice, mortalité, 77 p. 100.
Ainsi donc, l’enfant élevé par sa mère au biberon a plus de chances de vivre que l’enfant élevé au sein par une nourrice.
L’instinct maternel et l’instinct sexuel
Qu’il y ait dans l’attachement de la mère pour l’enfant un souvenir de l’instinct sexuel, c’est évident et explicable par la physiologie même de la maternité qui a son point de départ dans l’ovaire, lequel est également l’organe sexuel féminin.
Le plaisir de l’allaitement est analogue au plaisir sexuel surtout masculin : c’est une sécrétion non spontanée, mais arrachée.
Mais prétendre, comme Freud, qu’il y ait dans la tendresse de l’enfant vers la mère une préformation de l’instinct sexuel, c’est mythologie pure. C’est mettre la charrue avant les bœufs. La sensualité de l’enfant n’est rien d’autre qu’un mouvement pour reformer la communion alimentaire qui existait dans la vie intra-utérine. Tout au contraire, c’est l’instinct sexuel qui, lorsqu’il se produira, conservera quelque chose de l’amour de l’enfant pour la mère.
« Il rêvera partout à la chaleur du sein », dit Vigny. Le principe positif qui doit nous guider ici, est le suivant : tout le passé est conservé dans le présent ; mais l’avenir physiologique n’y est pas annoncé. Supposer le contraire est le fait d’un esprit mal dégagé des vieilles croyances religieuses.
* * *
Évolution de l’amour maternel. – L’amour maternel est un thème universel. La littérature, la poésie, l’art, y ont puisé au travers les siècles.
Présent toujours au moindre appel,
Qui dira jamais où commence
Où finit l’amour maternel ?
SULLY-PRUDHOMME.
Force aussi vieille que le monde, au-dessus de tout ce qui passe et se transforme, l’amour de la mère est resté l’amour qui ne passe pas. Seul, il sait faire abstraction des formes de la matière pour aimer seulement l’être que cette matière enferme. Pour l’amour maternel il n’y a pas de difformité, de laideur, d’infériorité. Il donne sans espoir de retour. Il n’attend pas la prière, il la devance, il la rend inutile. Il est à la mesure même de la nécessité ; il descend aux plus infimes détails et s’élève aux plus hautes conceptions de la pensée. Il est puéril et sublime. Il est la faiblesse et la force. Il est la vie qui passe et pourtant demeure. Il est patient comme Dieu parce qu’il est éternel comme lui. Il est Dieu matérialisé et vivant. Au demeurant le seul Dieu, puisqu’il est le seul amour, source de tout amour et de toute vie.
Pour expliquer cette force de l’amour maternel, il faut comprendre que la grandeur de l’amour se mesure à sa puissance de renoncement. Or, l’amour maternel est fait de renoncements successifs, de déchirements répétés. C’est d’abord la déchirure de l’enfantement, physiquement la plus cruelle, et cependant celle qui est la plus rapidement oubliée. Car le petit est là. La communion intra-utérine, un moment détruite par la rupture du cordon ombilical, se reforme dans l’allaitement qui prolonge l’union de la chair. Mais avec le sevrage le lien du sang est définitivement brisé. Pourtant le tout-petit est encore étroitement uni à sa mère, dont il lui faut les soins incessants, la surveillance continuelle. Puis, il apprend à marcher, il s’en va seul, sans son aide. Nouvelle rupture et nouveau déchirement. Il en sera de même à chaque phase de la vie enfantine : l’école, les départs de vacances, l’apprentissage, les amitiés qui se noueront en dehors du foyer familial. Un jour ce sera l’éloignement définitif. Ainsi se développe et s’accroît l’amour maternel. Il a puisé ses racines premières dans le lien physiologique. D’abord instinct presque animal, égoïste dans ses manifestations, il s’élève peu à peu au sentiment le plus pur, parce qu’il conserve, à sa base, la sensibilité primitive, sensibilité sans cesse renouvelée par la série des déchirements imposés par la loi de nature. Fortifié par les craintes, les absences, les inquiétudes, par l’habitude prise de donner gratuitement, il devient alors capable des plus grands renoncements, compréhensif jusqu’à l’acceptation de rester incompris. Arrivé à ce stade il est devenu altruiste.
Ainsi la mère, par le fait même de sa maternité, touche au sublime humain. Restée sensible par la déchirure jamais cicatrisée de ses entrailles, elle reste davantage vivante, soumise aux nécessités de la vie, capable de répandre autour d’elle la sollicitude généreuse dont elle a enveloppé ses enfants. Si, dans le domaine physiologique, la mère est la femme parvenue à son complet épanouissement, dans le domaine psychologique la mère est la femme intégralement développée. Ce sont précisément les qualités maternelles que la femme porte potentiellement en elle qui font d’elle la dispensatrice du bonheur humain et la régulatrice des mœurs. Une telle femme peut avoir une influence morale profonde et bienfaisante sur son milieu. C’est pourquoi ce serait commettre une faute irréparable que de réduire la femme à n’être plus qu’un rouage du mécanisme industriel, une machine à écrire ou à calculer, une femelle à laquelle on arracherait ses petits pour les élever comme des troupeaux, parqués dans des internats. La mécanisation, si nuisible à l’homme, est néfaste à la femme, dont elle détruit les forces créatrices, lui enlevant ainsi toute signification dans la société humaine. La femme a mieux à faire qu’à s’épuiser pour la production de richesses fictives, en des besognes qui tariraient en elle la source de la sensibilité. Où la sensibilité manque, la vie manquera toujours. Et quel bénéfice tirerait l’humanité d’une richesse acquise au prix même de la vie ?
* * *
La Mère éducatrice
De tout ce qui précède, il s’ensuit que nul n’est qualifié comme la mère pour être la première éducatrice de l’enfant, l’initiatrice à la vie, à ses nécessités et à ses lois. Cette première éducation, toute de douceur et de patience, demande comme condition essentielle la compréhension et la tendresse. Or, la mère a appris à connaître son enfant dès que la vie s’est manifestée en lui. Elle sait distinguer dans ses cris, la joie, le besoin, la souffrance. Dans ses premiers essais de langage, elle devine l’esquisse des mots, elle en aide l’articulation en les lui répétant inlassablement. Ensuite, elle lui apprendra à assembler les mots pour en faire des phrases. Elle lui révèle les vérités élémentaires : le feu brûle, la lumière éclaire, le couteau coupe, l’eau mouille, la boue salit. Elle lui apprend les premières prudences pour éviter les accidents ; l’acceptation des choses inévitables ; l’accoutumance à l’effort. Elle le console de ses échecs, l’invite à la persévérance. Elle l’initie à l’endurance et au stoïcisme en le faisant sourire après une douleur : « Allons, n’y pense plus », dit-elle en lui donnant un baiser. Tout cela peut paraître mesquin à qui regarde superficiellement ; tout cela, pourtant, c’est l’apprentissage de la vie, et la formation du caractère. Et ce n’est pas, ainsi qu’on a pu le prétendre, une œuvre niaise et abêtissante. Au contraire, c’est une œuvre qui réclame toutes les vertus et tous les dévouements ; une œuvre où la sensibilité joue le rôle essentiel. Des mercenaires en seront toujours incapables. Et quelle mercenaire voudrait accepter pareille tâche, fastidieuse si l’amour ne l’éclaire pas ? Jamais une étrangère ne remplacera la mère, à quelques exceptions près. Socialiser la maternité est chose impossible. L’éducation première réclame une présence, toujours la même, une vigilance inlassable, ne se mesurant ni à l’heure, ni à la journée. L’œuvre maternelle ne peut ni se chronométrer, ni se tarifer. Et réjouissons-nous qu’il en soit ainsi, dans cette folie de standardisation qui sévit aujourd’hui.
Si la mère, ai-je dit, est la dispensatrice du bonheur humain, n’est-ce pas parce qu’elle en fait l’apprentissage en donnant à son enfant la science du bonheur ? Elle la lui donne par sa présence, par sa gaîté, par ses caresses, par les chansons qu’elle lui chante, par les promenades où elle lui fait observer le vol des papillons et la beauté des fleurs, par la quiétude dont elle l’entoure. Elle la lui donne en apaisant ses colères et ses inquiétudes, en lui enseignant à dominer ses petites passions. Elle la lui donne par ces premières initiations que j’énumérais tout à l’heure. Elle lui enseigne la grâce de vivre, lui apprend à être heureux, ce qui est peut-être la science la plus difficile à enseigner, et pourtant celle dont l’humanité a le plus besoin. Cet enseignement commence avec la vie. L’enfant qui n’a pas connu le bonheur dans ses premiers ans, conservera toujours une ombre sur son caractère, une inquiétude dans sa pensée, nuisibles à son développement. La confiance et la générosité pourront, de ce fait, lui faire défaut.
Cette éducation de la mère n’est ni didactique, ni livresque. C’est une éducation faite de gestes et d’échange de tendresse, inspirée par l’heure et les circonstances. Dans cet échange, la mère, à son tour, puise des ressources nouvelles d’amour, de patience, de compréhension de la vie. Elle se pacifie, s’élève à la sérénité, acquiert une philosophie naturelle où le bon sens s’alimente à la source sensible qu’elle porte en elle, et qui, si souvent, lui fait voir juste et raisonner sainement.
La mère n’a pas à donner l’éducation intellectuelle. Elle peut y aider, à la maison, si l’enfant fait appel à ses connaissances, demande un renseignement, un éclaircissement. Mais l’instruction proprement dite devra être donnée en dehors. Je l’ai maintes fois répété : il faut, à l’éducation rationnelle de l’enfant, la coopération du foyer et de l’école. « L’idéal éducatif, ai-je dit, c’est l’enfant élevé dans sa famille, par ses parents, près de ses frères et sœurs, avec comme point de contact social l’école en commun plusieurs heures par jour en compagnie d’enfants de son âge ». Je ne puis que le redire encore. L’école donne l’enseignement ; la famille développe le sens moral. Mais l’éducation morale doit avoir précédé tout enseignement, et la première éducation maternelle est essentiellement morale, non pas par des préceptes, mais par l’exemple, et par l’ambiance qui enveloppe l’enfant. C’est pourquoi l’école ne devra pas commencer trop tôt ; mais seulement vers la sixième année. Le caractère, alors, étant formé, la société des autres enfants deviendra nécessaire à l’enfant pour lui permettre d’acquérir les qualités de sociabilité, d’endurance, de tolérance, d’urbanité, qui lui seront indispensables pour la conduite de sa vie. L’enfant qui serait exclusivement instruit dans sa famille deviendrait un tyran, à tout le moins un incapable de vie sociale. Mais, près de l’école où il puise les notions d’égalité civique et de fraternité humaine, le foyer restera le refuge toujours ouvert où il retrouvera la paix, le bonheur, la tendresse, et cette liberté individuelle dont chacun a besoin ; le foyer où la mère fera rayonner la bienfaisante influence de sa douceur, accrue et augmentée par l’expérience qu’elle-même aura acquise pendant l’accomplissement de sa tâche maternelle.
On prétendra peut-être que j’ai donné là une définition de la mère idéale. Sans doute. Mais toute mère peut et doit réaliser cet idéal. Il lui suffit d’apprendre et de comprendre la grandeur de sa tâche, sa vraie tâche, celle que lui assignent la nature et la vie. Je ne prétends pas qu’elle ne puisse pas en remplir d’autres ; mais les autres tâches peuvent se passer d’elle, alors qu’elle est irremplaçable dans sa mission maternelle. Il faut qu’elle sache qu’en la désertant, c’est l’humanité qu’elle voue à la misère morale.
Les Mères et la Paix, l’Universelle Maternité. – Puisque la mission maternelle est une mission d’amour, il faut que les mères comprennent qu’elles ont à remplir un devoir auquel jusqu’à présent elles ont insuffisamment songé. Il faut qu’elles deviennent des éducatrices de paix. Cette science du bonheur qu’elles donnent à leurs enfants, il faut qu’elle soit orientée vers le bonheur universel. Cette paix des gestes, du langage, de la vie familiale, il faut qu’elle contribue à former chez l’enfant un esprit pacifique.
La mère, qui a d’abord aimé son enfant égoïstement, a appris à l’aimer pour lui-même, en acceptant les ruptures naturelles, les séparations imposées par la vie. Mais, en l’aimant assez pour le voir libre et éloigné d’elle, elle ne l’entoure pas moins d’un amour exclusif. Elle veut son bonheur sans songer aux conditions mêmes de ce bonheur. Il faut qu’elle fasse un pas de plus sur ce chemin de l’altruisme. Il faut que sa maternité s’élève au principe d’universalité ; il faut qu’elle veuille non seulement le bonheur des siens, mais encore le bonheur de tous. Ce principe d’universalité, elle le trouvera dans l’amour de son enfant, si elle songe qu’elle-même n’est qu’une fraction de l’Universelle maternité, et que l’amour qui l’anime est celui de toutes les mères. Quand les mères auront compris cela, elles seront des éducatrices splendides, car elles auront également compris qu’en élevant leurs enfants dans le souci des autres, elles augmentent pour eux-mêmes les chances de bonheur. Elles auront compris que le bonheur d’un seul n’est pas possible dans une humanité rongée par l’orgueil et l’égoïsme.
La guerre, épouvantail des mères, serait impossible demain, si ce principe de maternité universelle était reconnu, si les mères savaient étendre l’amour qu’elles ont pour leurs fils à tous les fils, si elles se sentaient vraiment les « mères de tous les hommes ».
* * *
La Mère dans la société et devant la loi
L’importance du rôle maternel n’est pas une vérité nouvelle. Les penseurs de tous les temps ont honoré la maternité. Dans tous les pays et à toutes les époques le rôle de la mère a été particulièrement respecté. Les premières civilisations scandinave et germanique admettaient la mère dans leurs assemblées, tenaient compte de ses conseils, et dans les circonstances graves – particulièrement en ce qui touchait la famille – s’en remettaient à son jugement. Dans l’Inde, la mère prenait le titre de djajaté, « celle qui fait renaître ». Chez les Juifs, la maternité conférait à l’épouse des droits particuliers. En Grèce, l’épouse était soumise à la même réclusion que la vierge tant qu’elle n’avait pas enfanté. À Rome, la maternité donnait à l’épouse le droit d’hériter, non seulement de son mari, mais encore d’un étranger. Les sénateurs romains se découvraient devant la femme enceinte. L’antique Égypte divinisait la mère. Les exemples abondent. Et on a pu être frappé, à juste titre, de la contradiction qui, existait entre ce respect de la maternité et la sujétion dans laquelle les mères étaient légalement tenues. Libres par leurs enfants, elles n’avaient le droit ni de les élever, ni de les diriger, ni de les marier. Cette, ancienne législation se retrouve encore aujourd’hui dans notre loi française. Le Code assimile la mère aux mineurs, aux repris de justice et aux fous. La maternité, cette plus haute fonction humaine puisqu’elle est créatrice, cette première fonction sociale puisqu’elle est la base de la société, la maternité est ravalée au rang de la servitude par l’obligation faite à l’épouse d’obéir à son mari. Or, la noblesse même de la maternité est atteinte par cette obligation de servitude. Qu’il n’en soit pas tenu compte dans les unions heureuses, c’est exact ; mais il n’en est pas moins vrai que la loi qui consacre cette servitude existe, et que tant qu’elle ne sera pas abrogée, elle blessera la dignité de la mère. La maternité ne doit pas seulement être libre dans l’accomplissement de l’acte, elle doit encore conférer à la mère la liberté légale et sociale. Si la mère est la protectrice et l’éducatrice naturelle de l’enfant, celle qui le comprend le mieux, celle dont l’amour constitue la sauvegarde des jeunes générations, on ne peut pas admettre qu’elle soit maintenue légalement dans une situation humiliante pour sa fonction d’éducatrice. Il faut à l’enfant, tant que la raison ne peut pas encore lui permettre de diriger sa vie, des protecteurs naturels. Notre Code le reconnaît ainsi : « L’enfant reste, jusqu’à sa majorité ou son émancipation, sous l’autorité de son père ou de sa mère ». Ce serait bien si le Code ne s’empressait d’ajouter ; « Le père exerce seul cette autorité ». C’est là une injustice flagrante. Sans que l’autorité soit exclusivement accordée à la mère (comme certains le demandent) puisque la responsabilité du père lui confère à lui aussi des droits, il serait pour le moins équitable que la loi établît l’égalité des droits du père et de la mère pour la tutelle et la direction des enfants. Actuellement, une mère ne peut pas autoriser sa fille à s’inscrire aux examens du baccalauréat ; elle ne peut pas l’autoriser à contracter un mariage que son cœur désire. Le père peut être violent, despote, alcoolique, malade, c’est lui qui détient tous les droits. Même disparu (si sa mort n’est pas enregistrée) il exerce encore son autorité. On peut être surpris qu’à notre époque il faille encore insister sur ce qu’une telle législation conserve de barbarie et de caducité.
La mère, si justement appelée la gardienne du foyer, devrait avoir sa place marquée dans les institutions sociales où ses qualités particulières l’appellent. Pour tout ce qui touche l’éducation, la protection de l’enfance abandonnée, les œuvres de solidarité, la cause de la paix, les tâches de réconciliation humaine, son concours serait précieux, parce qu’elle y apporterait ces dons de clairvoyance et de sensibilité que la maternité lui confère. Le machinisme est l’ennemi de la mère parce qu’il lui fait perdre ces qualités essentielles de sa nature. Mais il n’en est plus de même en ce qui concerne les fonctions sociales. Une femme qui a été mère et éducatrice est devenue de ce fait un individu évolué, en pleine possession de toutes ses facultés. Quand sa tâche maternelle ne la réclame plus, la vie active de la femme est loin d’être terminée. C’est alors qu’elle deviendra, dans la société et la coopération humaine, une collaboratrice précieuse, mère encore, mère toujours, en apportant à la communauté les vertus qui firent d’elle la providence familiale.
– Madeleine VERNET
Voir aussi maternité, paternité (sentiment paternel), paix (point de vue éducatif et moral), etc.
MÉRIDIEN
n. m. (du latin meridianus ; de méridies, midi)
On appelle méridien tout cercle passant par les pôles et croisant perpendiculairement l’équateur. Un méridien divise donc le globe terrestre en deux parties égales, dans un sens opposé à l’équateur.
D’après la théorie tirée par Newton de la loi de l’attraction universelle rattachée à la rotation de notre planète autour de son axe passant par le pôle nord et le pôle sud, la terre doit représenter un ellipsoïde de révolution aplati aux pôles et renflé à l’équateur. Pour plus de simplicité représentons-nous la terre comme une sphère parfaite ; le diamètre de cette sphère étant suffisamment prolongé percera le globe en deux points appelés les pôles de la terre ; celui tourné vers l’étoile polaire (alpha de la petite Ourse) s’appellera le pôle nord, l’autre sera le pôle sud. La ligne qui joint les deux pôles l’un à l’autre (diamètre de notre sphère) constitue l’axe de la terre ou ligne des pôles.
Considérant l’axe terrestre, par le centre de notre planète, menons un plan qui lui soit perpendiculaire. Ce plan divisera la sphère en deux parties égales dont chacune renfermera un pôle. Ce grand cercle qui divisera le globe en deux hémisphères est l’équateur. Un plan quelconque passant par les axes terrestres, donc par les pôles du globe, et croisant perpendiculairement l’équateur constituera un méridien. Il s’en suit qu’il y a autant de méridiens que l’on peut concevoir de points sur l’équateur par lesquels on puisse faire passer une ligne passant par les deux pôles ou, en d’autres termes, tout cercle passant par les deux pôles est un méridien. Tout objet sur la terre a son méridien, il suffit de faire passer par un des pôles la ligne partie de lui et de la ramener à cet objet en passant par l’autre pôle ; le méridien change évidemment quand l’objet n’est pas immobile : le méridien de l’homme se déplace avec lui.
L’équateur de notre globe a été divisé en 360 parties ou mieux en deux fois 180 degrés ; par chacun de ces points de divisions on a fait passer un méridien en comptant 180 méridiens à l’est et 180 à l’ouest, à partir d’un méridien initial choisi comme méridien d’origine. En numérotant les méridiens dans chaque sens, est et ouest, de 0 à 180, à partir du méridien d’origine, on obtient une première détermination d’un point à la surface de la terre. Mais comme il ne suffit pas de savoir qu’un point se trouve sur un méridien déterminé pour connaître sa position exacte il a fallu imaginer une seconde ligne sur laquelle il se trouve également. Cette deuxième ligne c’est un parallèle. Un parallèle correspond à une ligne imaginaire parallèle à l’équateur et perpendiculaire à la ligne des pôles. Les méridiens ont été divisés à partir de l’équateur et de part et d’autre de celui-ci en 90 parties égales et par chacun de ces points de divisions on a fait passer un parallèle. La position d’un point à la surface de la terre est donc déterminé exactement quand on sait sur quel parallèle et sur quel méridien il se trouve. Sa position sera donc à l’intersection du parallèle et du méridien ; nous avons ainsi les coordonnées géographiques d’un point. (Voir latitude et longitude.) Jadis chaque nation choisissait comme méridien d’origine celui qui passait par l’observatoire de sa capitale. Cette façon de faire était une source de confusions regrettables pour la comparaison des longitudes. Une entente internationale entre les différents États a, depuis, mis fin à ce désordre et une réforme heureuse a décidé que désormais on compterait les longitudes à partir du méridien de Greenwich (Angleterre), choisi comme méridien d’origine. À cette unification nécessaire a correspondu l’unification de l’heure sur toute l’étendue du globe.
La mesure exacte de la terre et la détermination de sa forme ont, avons-nous dit, conduit les savants à admettre que la terre a la forme d’un ellipsoïde de révolution aplati aux pôles et renflé à l’équateur. La forme du méridien n’est donc pas un cercle mais celle d’un ellipsoïde dont le petit axe dirigé suivant la ligne des pôles a environ trois centièmes de moins que le grand axe dirigé suivant le diamètre de l’équateur. Si la terre était rigoureusement sphérique, un arc de méridien joignant deux points de la terre par un nombre déterminé de degrés de latitude aurait partout la même longueur. La mesure d’un arc de méridien doit donc nous renseigner non seulement sur la forme exacte de notre globe, mais encore nous donner les dimensions de celui-ci.
Ces mesures furent entreprises de tout temps.
Ératosthène exécuta la première mesure astronomique de la longueur d’un degré méridien entre Alexandrie et Syène au IIIème siècle avant l’ère chrétienne et trouva – en supposant la valeur du stade égale à 158 mètres, chose, dont on n’est pas certain – pour la circonférence de la terre : 250.000 stades, ce qui équivaut en chiffres ronds à 39.500 kilomètres. Deux cents ans plus tard, Posidenius exécuta entre Rhodes et Alexandrie une mesure de degré analogue, mesure qui ,fixe la circonférence du globe avec une exactitude allant jusqu’à 1/20ème. Au IXème siècle de notre ère les Arabes exécutèrent des mesures de degrés où la circonférence de la sphère ressortit avec une exactitude de 1/25ème. Il fallut attendre jusqu’au début du XVIIème siècle, après la longue période d’obscurantisme religieux et d’anémie intellectuelle qui s’appelle le moyen âge, pour arriver à une nouvelle mesure d’arc en Europe, par Fernel en France. En 1615, Snellius applique pour la première fois la méthode exacte de géodosie dite de « triangulation » en mesurant la longueur d’un arc de méridien entre Alkimaar et Bergen. En 1669, le savant géomètre Picard mesura le côté d’un triangle entre Malvoisière et Amiens et trouva un résultat de 57.060 toises (une toise égale 1 m. 95) pour la longueur d’un degré. Mentionnons, les mesures de degré des astronomes Cassini et Lahire, en 1680 et 1718, qui conduisirent à ce curieux résultat que les longueurs de degrés devaient augmenter du nord au sud, c’est-à-dire des pôles à l’équateur. Deux expéditions célèbres, celle de La Condamine et Bouguer en Amérique du Sud et celle de Maupertuis et Clairaut en Lapenie, qui furent les premières à travailler vraiment d’une façon scientifique, eurent lieu pour connaître la forme exacte de notre terre qu’on commençait à ne plus croire parfaitement sphérique. Les premiers mesurèrent la longueur d’un degré d’arc sur le plateau de Quite dans l’État de l’Équateur et obtinrent pour résultat 56.753 toises ; les seconds trouvèrent sur la glace du golfe de Toméa, par 66 degrés de latitude nord, une étendue de 57.437 toises, c’est-à-dire 684 toises de plus dans le nord que sous l’équateur. Cette mémorable expédition confirma la théorie pressentie par Newton qui voulait que la terre tut un ellipsoïde de révolution aplati aux pôles et montrait que la longueur d’un degré de méridien augmente à mesure que la latitude géographique s’accroit, par conséquent dans la direction des pôles : Il ne nous est pas possible de donner, même en raccourci, un aperçu des multiples et importantes mesures de degrés effectuées au cours du XVIIIème et du XIXème siècle par les savants les plus éminents pour étudier la véritables figure de la terre. Nous nous contenterons de mentionner la seconde grande mesure de degrés faite en France à la fin du XVIIIème siècle et qui servit à la réforme du système des poids et mesures (voir système métrique). L’Académie des Sciences chargea les astronomes Méchain et Delambre de mesurer le grand arc de méridien entre Dunkerque et Barcelone ; le résultat de ces travaux établit que le quart du méridien terrestre était égal à 10 millions de mètres ; la précision des mesures actuelles a fait rectifier ce dernier chiffre. Aujourd’hui les travaux nombreux et précis des savants portent à admettre que la terre a la forme d’un géoïde et que « le demi grand axe de l’ellipsoïde terrestre, c’est-à-dire le rayon de l’équateur du globe a pour valeur 6.377.000 mètres ; le demi petit axe, c’est-à-dire la distance d’un des pôles au centre de la terre a pour valeur 6.356.510 mètres. L’aplatissement a pour valeur 1/297°. Ce qui donne pour circonférence du globe : 40.054.000 mètres. La superficie de la terre, est donc de 510 millions de kilomètres carrés et son volume équivaut à 1.083.260 millions de kilomètres cubes. » (D’après Alph. Berget. La vie et la mort du globe. Paris 1927.)
ASTRONOMIE
-
Lunette méridienne : Instrument se composant d’une forte lunette astronomique pourvue d’un réticule à micromètre et mobile autour d’un axe horizontal disposé de façon que la lunette puisse se mouvoir dans le plan du méridien du lieu, qu’elle parcourt dans sa partie visible. La lunette méridienne est toujours accompagnée d’une horloge sidérale et elle sert à fixer la position d’une étoile sur la voûte céleste en faisant connaître les éléments fondamentaux nécessaires pour établir cette position, c’est-a-dire sa déclinaison et son ascension droite, coordonnées astronomiques correspondant aux coordonnées géographiques : latitude et longitude.
-
Service méridien d’un observatoire : Consiste à observer les astres et les planètes à leur passage au méridien et de comparer les heures et les distances zénithales de ces passages à celles que la théorie prévoit. Son but est de fournir des éléments incessants d’observations et de déterminer aussi exactement que possible la position précise des étoiles qui sont classées dans les catalogues d’étoiles.
-
Méridienne d’un lieu : Plan déterminé par la verticale d’un lieu et la ligne des pôles. On donne aussi le nom de méridienne à tous les points de la surface du globe qui sont situés dans le plan d’un même méridien, parce que midi arrive au même instant sur tous les points situés dans ce plan.
-
GÉOMÉTRIE : Méridienne : Section que fait, dans une surface de révolution, un plan passant par l’axe de cette figure.
-
Faire sa méridienne : Sieste faite vers le milieu du jour dans les pays chauds ; par extension, fauteuil sur lequel on s’étend pour faire sa sieste.
– Charles ALEXANDRE.
MÉRITE
n. m. (latin meritum, chose méritée)
Au sens général le mérite c’est ce qui rend digne d’estime ou de considération, c’est la valeur. Aussi parle-t-on des mérites d’un objet, d’un instrument, d’une plante, d’un animal. Le même terme s’applique aux qualités physiques ou intellectuelles de l’homme ; fréquemment il est question, dans la conversation ou dans les livres, du mérite d’un écrivain, d’un artiste, d’un orateur etc, C’est pour apprécier la valeur et le savoir des jeunes gens que l’Université a établi des examens d’ailleurs très mal compris en général. De même que la vigueur physique peut s’apprécier objectivement, de même le mérite intellectuel semble aisément constatable à l’ensemble des hommes. Il en va autrement lorsqu’il s’agit du mérite moral. Au point de vue moral le mérite suppose un accroissement volontaire de perfection ; c’est une notion connexe à celle de la responsabilité. L’homme qui pratique le bien verrait croître ses mérites ; la pratique du mal au contraire le diminuerait. Ainsi compris le mérite apparaît comme une entité métaphysique invisible pour l’homme et perçue seulement par Dieu et les esprits désincarnés ; en d’autres termes c’est une création imaginaire des prêtres et ds philosophes. Mais de théologique cette idée devait devenir positive comme tant d’autres. L. Barbedette a soutenu que le mérite moral était mesurable tout comme les dispositions physiques ou les capacités intellectuelles ; il pense qu’un jour il existera des laboratoires spéciaux pour l’étude et le développement des qualités morales. À l’aide de piqûres, d’instruments, de procédés scientifiques ordinaires, on pourra modifier les tendances, opposer ou faire naître les passions, traiter les dispositions mentales dépendantes à l’heure actuelle dans ce qu’on nomme la morale. Une telle conception heurte trop les idées courantes pour être admise de sitôt. Néanmoins des expériences ont déjà été faites en ce sens ; elles ont donné de bons résultats.
Pour le plus grand nombre des moralistes, le mérite demeure l’entité occulte des théologiens. En obéissant aux prêtres, en leur donnant beaucoup d’argent, le catholique s’imagine ainsi des mérites invisibles, des grâces célestes qui lui vaudront une éternité de bonheur. Mais comme beaucoup veulent une récompense dès ici bas, les gouvernements ont créé des titres, des médailles, des rubans pour les citoyens méritants. Il va sans dire que, par citoyen méritant, l’autorité entend, l’homme servile toujours disposé à obéir aux chefs ou l’esprit rusé qui dupe les autres et les exploite. On anoblissait avant la Révolution ; sous la République, les hommes politiques disposent de kilomètres de ruban rouge, vert ou violet. L’industriel, le financier, le négociant qui surent amasser une fortune, en volant selon le code, finissent en général dignitaires de la Légion d’honneur ; de même l’écrivain respectueux de la tradition et de l’ordre établi. On voit ce qu’il faut entendre par mérite au sens des autorités actuelles, c’est le comble de l’immoralité, le sacrifice de l’indépendance à des intérêts inavouables, la platitude devant les exploiteurs de l’humanité. Presse, écoles, églises, opinion ne reconnaissent et n’honorent naturellement que ce mérite-là.
MESURE
n. f. (du latin mensura)
Mesurer une grandeur, c’est la comparer à une grandeur de même espèce prise comme unité. Le but primitif, et encore le but principal de cette opération, est de procurer aux hommes les enseignements nécessaires à l’identification des objets dont ils parlent, dont ils font usage ou qu’ils échangent entre eux. Le nombre des qualités soumises à la mesure, la précision exigée de celle-ci, croissent avec le progrès des sociétés.
Du jour où l’homme ne vit plus seulement de chasse et d’élevage, mais cultive la terre, le besoin de mesures de longueur et de superficie se fait sentir. C’est dans la vallée du Nil et dans les contrées comparables comme fertilité que prit naissance la géométrie. Dès que se développa le commerce, d’autres mesures furent indispensables. Selon M. Martin, inspecteur des poids et mesures de Grande-Bretagne, c’ est alors qu’il devint indispensable d’avoir une mesure de capacité permettant d’acheter ou de vendre des marchandises, céréales, boissons, etc. La nécessité des mesures de poids ne se fit sentir que beaucoup plus tard avec les progrès de la civilisation, quand les hommes commencèrent à faire des affaires avec les pays voisins, pour les métaux et autres matières qui ne peuvent s’échanger exactement à l’aide de mesures de capacité.
Pour que les unités de mesure pussent fournir en toutes, circonstances les données requises pour la reconnaissance des objets énoncés, il était utile que chacun des contractants les eût à sa disposition. Il est donc naturel que les dimensions du corps humain aient servi de base pour l’ établissement des unités de longueur ; leur avantage c’était que chaque homme les possédait sur lui partout où il allait et que, quand il le fallait, la moyenne des mesures prises sur plusieurs individus, donnait l’unité avec assez d’exactitude pour l’époque.
« La mesure principale prise sur le corps humain se prêtait particulièrement à la subdivision. La longueur du pied était presque la sixième partie de la hauteur d’un homme ou de la distance d’une extrémité à l’autre des bras étendus. La distance du coude à l’extrémité des doigts (coudée égyptienne de six palmes) était environ une fois et demie la longueur du pied. La longueur de l’extrémité du pouce était environ la douzième partie du pied, et celle du poing fermé environ le tiers. Chacune de ces mesures pouvait être fixée avec autorité comme mesure étalon et les autres pouvaient s’y référer. »
L’unité de capacité elle-même, équivalente à la pinte en de nombreux pays, fut, sans doute basée sur les besoins du corps humain ; elle représentait, pense-t-on, la quantité de boisson nécessaire à un repas.
Dès que les sociétés furent mieux organisées, les étalons de mesure durent être définis avec plus de précision. Au British Museum, on conserve des poids du temps de Nabuchodonosor, poids portant la mention de garantie de membres du sacerdoce. À Rome, les poids étaient frappés au sceau de l’État.
De nos jours une convention du 20 mai 1875 oblige 28 États qui se sont entendus pour adopter comme unité de longueur une barre métallique dite mètre déposée au Bureau international des poids et mesures, au Pavillon de Breteuil. Chaque pays adhérent en possède une copie et, périodiquement, on vérifie par comparaison avec le prototype que la longueur de celle-ci n’a pas varié. La barre déposée au Bureau de Sèvres, représente, environ, la dix-millionième partie du quart du méridien terrestre. (Voir système métrique.)
Les comparaisons faites jusqu’ici ont montré qu’il était infiniment probable que la longueur de la barre-type n’avait subi, avec le temps, aucune modification. Cependant, comme nos connaissances physiques actuelles jettent quelque doute sur la pérennité de la matière, on a jugé prudent d’adjoindre aux étalons métalliques d’autres susceptibles de contrôler leur invariabilité. « La fixité, dans le temps, de l’unité métrique déjà bien assurée par les remarquables propriétés du platine iridié dont sont faits le prototype international et ses témoins, avait trouvé un premier contrôle dans la détermination du rapport des longueurs d’onde fondamentales au mètre. Le Comité International des Poids et Mesures a voulu, cependant, se prémunir encore contre les possibilités d’une variation ultérieure de ce rapport, et pour cela constituer un troisième terme de comparaison par l’établissement et la détermination d’étalons en quartz cristallisé, substance offrant toutes garanties de stabilité et d’inaltérabilité. » En fait, la longueur dé référence, au lieu d’être un objet matériel serait la longueur d’onde d’une lumière monochromatique, celle de la raie rouge du Cadmium.
Une fois définie l’unité de longueur, on a intérêt à en faire dériver toutes les autres. On constitue ainsi un système de mesures rationnelles, tel que notre système métrique, qui, depuis le développement de la science et de l’industrie, est complété par le système C. G. S. dont les unités sont : une unité de longueur, le centimètre ; une unité de masse, le gramme ; une unité de temps, la seconde.
Signalons que depuis une loi du 2 avril 1919, l’unité de force a été changée. Cette unité, le Sthène, est la force qui, en une seconde, communique à une masse égale à une tonne, un accroissement de vitesse de un mètre par seconde. Comme unité de force tolérée demeure le kilogramme-poids ou kilogramme force, force avec laquelle une masse de un kilogramme est attirée par la terre. Le kilogramme poids est pratiquement égal à 0.98 centisthène.
* * *
On dit quelquefois qu’il n’y a science que des choses mesurables. Cela serait vrai de la science parfaite, si elle était possible, mais non de la science qui se fait ; ou, si l’on veut, on doit reconnaître des degrés dans la mesure.
Toutes les grandeurs sont-elles mesurables, comparables a une autre de même espèce prise comme unité ? Nullement. Deux conditions sont indispensables. Pour qu’au nombre exprimant une mesure corresponde un caractère fixe et défini d’une grandeur, il convient que celle-ci soit, au préalable, analysée qualitativement et réduite à la simplicité.
Il faut, comme première condition, que deux corps, objets de mesure équivalents à un troisième par rapport à la propriété étudiée, soient encore équivalents, par rapport à la même propriété, vis-à-vis de tout autre corps. Cela ne se réalise pas pour certaines grandeurs complexes et mal définies. Sous le nom de dureté nous comprenons à la fois la résistance à la rayure et la résistance à la déformation. Si l’on mesure la dureté des différents corps à l’échelle de Mohs (rayures) ou à la bille de Brinell (surface de l’empreinte laissée par une bille d’acier de 10 m/m de diamètre sous 3.000 kg.), le classement n’est pas le même. La dureté, grandeur susceptible de plus et de moins, est sujette à l’appréciation et non à la mesure. Cette simple appréciation est cependant une connaissance scientifiquement indispensable à l’industrie. Au contraire, deux corps qui produisent le même effet sur une balance se comportent de même vis-à-vis d’un peson à ressort. La grandeur poids est mesurable.
Une seconde condition est encore obligatoire : l’additivité.
« La juxtaposition de plusieurs corps semblables doit permettre de constituer un système équivalent, par rapport à une propriété donnée, à un autre où cette propriété est plus développée. »
Par exemple une longueur de 22 centimètres peut être constituée par l’adjonction de 22 éléments de un centimètre. La longueur est mesurable. Au contraire une température de 22° ne peut être obtenue par la réunion de 22 corps à un degré. La température n’est pas directement mesurable, au sens strict du mot. On ne peut même pas dire qu’une température est le double ou le triple d’une autre. C’est pour cela, par exemple, que la réfrigération devient de plus en plus coûteuse à mesure qu’on se rapproche du zéro absolu. B. Brunhes disait que la difficulté qu’il y aurait à descendre de 10° à 5° absolus est du même ordre que celle qu’il y aurait à obtenir à l’autre bout de l’échelle une température double (comme chiffre) de la plus haute température obtenue jusqu’ici.
Mais la température est repérable ; on peut en effet la caractériser d’une façon univoque par l’intermédiaire d’une propriété mesurable qui varie dans le même sens ; par exemple la dilatation d’une barre de métal, d’un gaz, d’une colonne de mercure.
Les grandeurs qui satisfont à la deuxième condition sont des extensivités. Celles qui se comportent comme la température sont des intensités.
Nous voyons que notre connaissance des grandeurs comporte des degrés : Appréciation, repérage, mesure. Et tous ces modes de connaissance d’une précision croissante et tous utilisables peuvent être qualifiés de scientifiques. En fait, les sciences les plus complexes, la biologie, la sociologie, la psychologie ne sont pas celles qui nous intéressent le moins et si elles ne sont guère encore accessibles à la mesure mais seulement à l’appréciation ce n’est pas une raison pour les considérer comme restant en marge de la science et pour manifester trop de scepticisme à l’égard des enseignements qu’elles nous offrent aujourd’hui.
– G. GOUJON.
MESURE
Les hommes se sont toujours efforcés de connaître leur milieu de vie pour s’y adapter et surtout pour l’adapter à leurs besoins.
Ils ont connu ce milieu, grâce il leurs organes des sens ; à leurs oreilles, à leurs yeux, etc. Mais ces organes ne leur ont permis d’avoir que des connaissances imparfaites et fragmentaires.
« L’œil, par exemple, ne perçoit pas la dixième partie du spectre lumineux ; s’il pouvait distinguer les radiations émanées de tous les êtres vivants en raison de leur température, il les verrait clairement pendant la nuit. L’être que nous percevons est une forme fictive créée par nos sens. Si nous parvenions a le contempler tel qu’il existe réellement entouré de la vapeur d’eau qu’il exhale, du rayonnement que sa température engendre, ce même être nous apparaîtrait sous l’aspect d’un nuage aux changeants contours. » (Dr Gustave Le Bon)
Même dans le domaine qui leur est accessible, nos organes des sens nous induisent souvent en erreur ; lorsque nous nous ennuyons le temps nous paraît plus long ; si, avec notre main, nous voulons comparer les poids d’une boîte de carton et d’une balle de plomb, nous risquons fort de nous tromper car les objets plus gros paraissent plus légers que les objets de même poids, mais plus petits, etc.
Il est un premier moyen de nous préserver contre les erreurs dans les rapports que nous font nos organes des sens, c’est d’éduquer ces organes. Par l’exercice nos sens se perfectionnent : « Un marin distingue la forme et la structure d’un navire sur la mer, quand le passager ne voit encore qu’un point trouble et informe. Un Arabe dans le désert distingue un chameau et peut dire à quelle distance il se trouve, alors qu’un Européen ne voit absolument rien. » (Dr E. Laurent.)
Il est d’autres moyens de nous garder contre les erreurs et d’accroître nos connaissances ; ce sont d’abord : le contrôle du rapport d’un organe des sens par le rapport d’un autre organe (ou de plusieurs) : l’œil, par exemple, en nous renseignant sur la nature d’un objet peut nous prémunir contre l’illusion de poids que nous venons de signaler ; la comparaison plus minutieuse grâce au calcul et à l’expérimentation : Jean et Pierre ont chacun un sac de billes, ils voient bien qu’ils en ont autant ou presque autant, en les comptant ils seront plus exactement renseignés ; ces mêmes bambins viennent à l’école en suivant des sentiers et des chemins différents, quel est celui qui a la plus longue distance à parcourir ? Pierre est convaincu que c’est lui, mais Jean fait observer que sur son chemin à lui il y a des arbres, des maisons, une mare, etc. qui attirent l’attention, distraient l’esprit et font paraître plus court le temps passé a parcourir ce chemin comme aussi ce chemin lui-même, enfin nos bambins, pour la même raison, décident de mesurer leur chemin, comme ils ont mesuré le contenu de leurs sacs de billes ; chacun d’eux comptera le nombre de pas qu’il doit faire pour venir à l’école. Ces deux cas suffisent pour nous montrer que la mesure est une opération imaginée par l’homme pour rendre ses comparaisons moins imprécises et moins subjectives.
Mais l’on ne passe pas tout d’un coup de l’imprécision à la précision, de la subjectivité à l’objectivité... Imaginons que les enfants, dont nous parlions tout à l’heure, réalisent leur projet et que Pierre et Jean nous disent le lendemain combien chacun d’eux a fait de pas pour venir à l’école ; si les nombres sont quelque peu rapprochant nous resterons dans le doute, car nous savons que le pas du premier est plus (ou moins) long que celui du second. Nous arriverions à un peu moins d’imprécision si un seul de ces enfants, s’efforçant de marcher d’un pas égal, comptait le nombre de pas qu’il doit faire pour parcourir chacune de ces deux distances, la mesure en ce cas serait ainsi moins subjective que dans le cas précédent. Cette mesure serait pourtant loin d’être précise, il est difficile de marcher d’un pas égal, surtout s’il se trouve un bout de chemin accidenté, pierreux ou creusé d’ornières. En définitive, les mesures naturelles – le pas, le pouce, le pied, la brassée, la poignée, la pincée etc. – suffisantes pour certaines nécessités de la vie pratique et qui, à cause de cela, sont encore utilisées journellement, n’apportent qu’une documentation tout approximative. Et leur précision devient de plus en plus insuffisante à mesure que la civilisation se développe.
Un progrès fut réalisé par l’étalonnage de ces mesures naturelles. Si, pour en revenir à notre exemple, ni Pierre, ni Jean ne peuvent marcher d’un pas exactement égal, ils peuvent convenir de couper une baguette de la longueur du pas de l’un d’eux et de s’en servir d’instrument de mesure. Si nous négligeons les erreurs subjectives résultant d’un emploi plus ou moins attentif et habile de cet instrument, nous pourrons dire que Pierre et Jean vont pouvoir comparer objectivement, grâce à cet instrument de mesure, les distances qu’ils ont à parcourir pour se rendre en classe. Ils pourront même prêter leur baguette à quelques camarades désireux de suivre leur exemple. Si quelques-uns de ces derniers sont pressés, ils pourront encore imaginer de couper d’autres baguettes, chacune de ces baguettes ayant, aussi exactement que possible, la même longueur que la baguette primitive. Celle-ci sera ainsi devenue une baguette étalon qu’on pourra utiliser comme instrument de contrôle pour la confection de baguettes analogues.
Il est possible aussi que, dans un autre lieu, d’autres enfants, plus grands ou plus petits, imaginent d’autres mesures naturelles, qui pourront être les mêmes que celles imaginées par le groupe précédent mais qui pourront aussi être différentes. Ce pourra être, par exemple, non plus la longueur du pas mais celle de l’avant-bras et de la main étendue qui servira de mesure pour les longueurs... Dans ce cas encore les nécessités de la vie groupale amèneront les individus qui veulent se comprendre, œuvrer ensemble ou échanger, à éclairer et régulariser leurs données et leurs comparaisons, bref à étalonner une mesure choisie. La fantaisie de chacun ne peut apporter la rigueur nécessaire aux échanges, il faut qu’un accord intervienne sur une mesure-type et que la convention acceptée devienne d’observation courante. Discipline finalement bienfaisante et qui, si l’on en pénètre intelligemment les vertus, peut être amiable, tacite, libérée de la contrainte d’une codification tyrannique. Mais là encore il apparaît que la vie sociale n’est pas possible sans une certaine restriction de la liberté, sans un certain effort de chaque individu pour se mettre à la portée des autres en adoptant même langage, mêmes mesures, mêmes mœurs, etc.
Imaginons maintenant que deux enfants appartenant à nos deux groupes différents se rencontrent et évaluent des longueurs, l’un en pas, l’autre en coudées ; les nombres qui exprimeront ces longueurs ne permettront pas des comparaisons précises puisqu’ils s’appliqueront à deux unités de mesure différentes et nos deux enfants devront choisir entre ces deux unités de mesure ou en imaginer une troisième.
Pour les mêmes raisons les hommes vivant en société ont, successivement, utilisé des mesures naturelles ; puis créé des étalons de mesure ; enfin – dans un effort pour plus d’objectivité, de simplicité et de logique – recherché un système international de mesures.
Pour faire comprendre un autre aspect du progrès dans le choix des unités de mesure nous pouvons prendre à nouveau des enfants en exemple. Il suffit de les observer dans leurs jeux. Comptent-ils toujours les longueurs, qu’ils doivent mesurer dans certains jeux (billes, bouchons, etc.), en pas ? Ceci devient impossible lorsque les longueurs à comparer sont inférieures à un pas, il leur faut alors imaginer d’autres unités de mesure : pied, pouce, etc., qui leur permettent de mesurer avec assez de précision et de rapidité. De même la ménagère qui fait sa soupe n’emploie pas la même mesure naturelle pour mesurer le poivre (pincée) que celle qu’elle utilise pour la mesure du sel (poignée). Pour satisfaire tout à la fois leurs besoins de précision et de rapidité dans la mesure, les hommes vivant en société emploient, suivant les cas, des unités différentes de mesure dont les unes sont dites unités principales et dont les autres sont des unités secondaires : pour les longueurs l’unité principale est le mètre mais si je mesure la largeur d’une planche, par exemple, j’exprimerai le plus souvent cette dimension en centimètres ; le centimètre est l’une des unités secondaires de longueur.
* * *
Ainsi ce sont les besoins de la vie pratique, surtout sociale qui sont à l’origine de la mesure et qui ont tout d’abord, et avant toutes autres causes, provoqué un perfectionnement des moyens de mesure. Mais la mesure a acquis aussi, peu à peu, une importance considérable à l’égard des recherches scientifiques.
« Les rapports entre les phénomènes, rapports dont la découverte est l’objet même de la science, sont le plus souvent tellement marqués par divers facteurs connexes, qu’il est nécessaire, pour les mettre en lumière, d’une mesure délicate. Ce n’est qu’en mesurant deux phénomènes dans des circonstances différentes qu’on peut établir si leurs variations sont concomitantes, et par conséquent s’il existe entre eux une certaine relation. » (Claparède)
« La mesure n’est au fond qu’un artifice employé par l’intelligence humaine pour s’aider dans l’analyse délicate des phénomènes complexes. » (Decroly)
On ne mesure pas pour le plaisir de mesurer mais pour analyser, pour voir s’il y a, ou s’il n’y a pas, une relation – et laquelle –entre deux phénomènes.
« Il n’y a pas de science sans mesure. » (Ch. Féré)
Comme Goujon, nous croyons que cette affirmation est un peu trop catégorique. Certes, pour être réellement mesurable, les grandeurs doivent obéir aux lois d’équivalence et d’additivité et il est des phénomènes, ceux de conscience par exemple, qui sont des qualités, c’est-à-dire des valeurs plutôt que des grandeurs, qui ne peuvent se réduire à un continu homogène et n’ont par conséquent rien de quantitatif. Les sciences les plus complexes doivent se contenter du repérage, indiqué par Goujon ; de la sériation, ou mise en ordre d’un groupe de grandeurs discontinues et des mesures indirectes. Ainsi que l’indique Goujon la température n’est pas mesurable mais repérable bien qu’une loi sur les unités de mesure (2 avril 1919) veuille définir l’unité de mesure des températures.
Les savants ne sont pas d’accord en ce qui concerne la mesure du temps.
« Le temps psychologique n’est pas continu parce que les instants qui le composent sont formés de phénomènes perçus l’un après l’autre. » (Euriques)
Cependant « nous avons la sensation du rythme de certaines séries acoustiques que nous appelons isochrones ; les différentes séries de sons, que nous percevons comme isochrones, nous fournissent des mesures de temps comparables entre-elles, et nous amènent ainsi, bien qu’avec une exactitude restreinte à une même appréciation des durées égales, et, par conséquent, à, une même mesure naturelle du temps. » (Euriques). L’accord des horloges entre elles – des horloges de précision s’entend – et avec les observations astronomiques, nous paraît prouver la possibilité de la mesure du temps physique. Le langage populaire ne s’embarrasse pas de toutes ces difficultés et de toutes ces distinctions ; le commerçant parle du « poids » de ses marchandises alors que pour le savant il s’agit, en réalité, de leur « masse ». Le poids d’un corps est une grandeur qui varie selon la latitude et l’altitude ce mot « poids » doit éveiller en nous l’idée de l’attraction des corps par la terre. La masse ou quantité de matière des corps est par contre une quantité invariable qui ne dépend ni de l’altitude, ni de la latitude. Des savants eux-mêmes emploient le mot mesure lorsqu’il s’agit en réalité dune sériation, d’une comparaison aussi objective que possible, c’est ainsi que l’on parle de la mesure de l’attention, de la mémoire, de l’intelligence, etc.
* * *
« Dans les mesures proprement dites, le choix arbitraire de l’unité est en principe indifférent, mais il est indispensable d’arriver à une convention uniforme, afin que les chiffres donnés par différents expérimentateurs soient comparables, sinon la confusion serait extrême. Cela est cependant difficile pour deux raisons. En premier lieu, il ne convient pas d’employer la même unité pour des grandeurs très différentes de la même propriété, sans quoi les mesures seraient exprimées par des nombres ayant trop de chiffres figuratifs. Pour éviter ce premier inconvénient, on peut prendre des unités différant dans le rapport de 1 à 1000 ; de cette façon les confusions ne sont guère possibles. On emploie ainsi pour les longueurs le kilomètre, le mètre et le micron ; pour la quantité de chaleur la grande et la petite calorie.
Une seconde difficulté résulte de traditions anciennes difficiles à déraciner.
Jusqu’à la Révolution on employa, en France, des mesures qui présentaient deux inconvénients principaux :
une confusion extrême : un même mot pouvait désigner plusieurs unités de valeurs différentes ;
les subdivisions des différentes unités n’étaient pas en rapport avec notre système de numération qui était et est encore décimal.
En 1790, la Constituante adopta un projet d’unification des unités de mesure. De 1792 à 1799 un arc du méridien de Paris, entre Dunkerque et Barcelone fut mesuré, on en déduisit la longueur totale du méridien et la quarante millionième partie de cette longueur fut prise pour unité de longueur et reçut le nom de mètre. Le mètre servit de base à toutes les autres unités du nouveau système dit système métrique et ce système dit aussi système des poids et mesures – à tort car les poids sont des mesures, comme les longueurs, les surfaces, etc. – employa le système décimal pour les multiples et les sous multiples.
Ce n’était pas là le terme du progrès. En 1881 un congrès d’électriciens adopta le système C. G. S. ayant pour bases le centimètre, le gramme et la seconde. Un troisième système connu sous le nom de système M. K. S. prend comme unités de mesures le mètre, le kilogramme et la seconde.
Enfin une loi sur les unités de mesure, du 2 avril 1919 (Journal officiel, 4 avril 1919) impose un nouveau système, dit système M. T. S., parce qu’il a comme unités fondamentales le mètre, pour les longueurs ; la tonne, pour les masses et la seconde, pour le temps. Cette loi était justifiée par les progrès scientifiques et industriels ; l’énergie électrique, par exemple, est aujourd’hui de vente courante et exige l’emploi d’unités spéciales qu’il était utile de fixer comme l’étaient les unités de longueur, de surface, de volume, etc. De cette loi qui n’apportait nul changement à notre système monétaire, nous extrayons le tableau des unités principales :
Longueur. L’unité principale de longueur est le mètre. L’étalon pour les mesures de longueur est le mètre, longueur définie à la température de 0 degré par le prototype international en platine iridié qui a été sanctionné par la conférence générale des poids et mesures, tenue à Paris en 1889, et qui est déposé au pavillon de Breteuil, à Sèvres.
L’unité de longueur, de laquelle seront déduites les unités de la mécanique industrielle, est le mètre.
Masse. L’unité principale de masse est le kilogramme. L’étalon pour les mesures de masse est le kilogramme.
L’unité de masse, de laquelle seront déduites les unités de la mécanique industrielle est la tonne, qui vaut 1000 kilos.
Temps. L’unité principale de temps est la seconde. La seconde est la fraction 1/86400 du jour solaire moyen.
L’unité de temps, de laquelle seront déduites les unités de la mécanique industrielle est la seconde.
Électricité. Les unités principales électriques sont l’ohm, unité de résistance, et l’ampère, unité d’intensité de courant, conformément aux résolutions de la conférence des unités électriques, tenue à Londres en 1908.
L’étalon pour les mesures de résistance est l’ohm international qui est la résistance offerte à un courant électrique invariable, par une colonne de mercure à la température de la glace fondante, d’une masse de 14,4521 grammes, d’une section constante et d’une longueur de 106.300 centimètres.
L’ampère international est le courant électrique invariable qui, en passant à travers une solution de nitrate d’argent dans l’eau, dépose de l’argent en proportion de 0,00111800 grammes par seconde.
Température. Les températures sont exprimées en degrés centésimaux.
Le degré centésimal est la variation de température qui produit la centième partie de l’accroissement de pression que subit une masse d’un gaz parfait quand, le volume étant constant, la température passe du point 0° (température de la glace fondante) au point 100° (température d’ébullition de l’eau), tels que ces deux points ont été définis par la conférence générale des poids et mesures de 1889 et par celle de 1913.
Intensité lumineuse. L’unité principale d’intensité lumineuse est la bougie décimale dont la valeur est le vingtième de l’étalon Violle.
L’étalon pour les mesures d’intensité lumineuse est l’étalon Violle, source lumineuse constituée par une aire égale à celle d’un carré d’un centimètre de côté prise à la surface d’un bain de platine rayonnant normalement à la température de solidification, conformément aux décisions de la conférence internationale des électriciens, tenue à Paris en 1884 et du congrès international des électriciens, tenu à Paris en 1889. »
Nous avons cité intégralement ce tableau pour en tirer quelques remarques. D’abord la loi a suivi, avec assez de retard même, des progrès dans la mesure résultant de progrès industriels et commerciaux comme aussi des accords scientifiques internationaux réalisés par des savants. La loi sur les unités de mesure a sanctionné des mesures adoptées, tout comme la loi sur les syndicats ouvriers a sanctionné des libertés conquises par la classe ouvrière.
Une deuxième remarque s’impose. Alors qu’on s’est efforce et qu’on s’efforce encore de montrer aux écoliers la logique du système métrique en faisant dériver les unités des mesures de surfaces, de volumes, de capacités, de poids, et des monnaies, d’une seule unité principale, le mètre, dont la longueur serait elle-même déterminée avec précision par notre globe, le tableau précédent ne laisse pas apparaitre un tel enchaînement. C’est que cet enchaînement était en grande partie artificiel et que ses données étaient légèrement inexactes : un décimètre cube d’eau, aux conditions indiquées ordinairement ne pèse pas tout à fait un kilogramme ; la différence est inférieure à un trentième de gramme mais n’en existe pas moins. Ainsi les unités des mesures de poids, de masse, etc., sont indépendantes de l’unité des mesures de longueur. Ce n’est pas tout. En mesurant le méridien on a commis des erreurs, de nouvelles mesures seraient sans doute plus précises ; mais cependant on ne pourrait pas affirmer trouver la mesure de ce méridien à un dix millionième près ; or, on peut construire actuellement des mètres qui ne diffèreront du mètre déposé au pavillon de Breteuil que d’une quantité inférieure à un dix-millionième de la longueur de ce dernier et cette construction peut être faite en bien moins de temps qu’il n’en faudrait pour recommencer la mesure d’une fraction suffisante du méridien de Paris. La définition du mètre par une barre type est donc plus précise. L’unité de mesure initiale ne peut qu’être arbitraire et ceci est sans importance, l’essentiel est que cette unité (le mètre pour les longueurs) « puisse être réalisée par des types comparables entre-eux et dont chacun reste comparable à lui-même ».
Un autre gros avantage de nos systèmes actuels, c’est que les multiples et sous-multiples des unités principales suivent la méthode décimale – ce qui n’est vrai que parce que notre système de numération est décimal – les multiples de l’unité portent les noms de l’unité précédés des préfixes : déca (da, en abrégé) qui veut dire dix ; hecto (h) = 100 ; kilo (k) = 1 000 ; myria (ma) = 10 000 ; hectokilog (hk) = 100 000 ; méga (rn) = 1 000 000. Les sous-multiples portent les préfixes : déci (d) = 0,l ; centi (c) = 0,01 ; milli (m) = 0.001 ; décimilli (dm) = 0,0001 ; centimilli (cm) = 0,00001 ; micro = 0,000 001.
Cette multiplicité des multiples et des sous-multiples s’explique par le perfectionnement de nos appareils et de nos méthodes de mesure. Pour des mesures qui diffèrent tellement, nous employons des appareils différents ; par exemple, pour les longueurs le fil d’Invar sert à mesurer le kilomètre, le palmer est employé pour mesurer le millimètre et on mesure les microns avec l’appareil à franges de Fizeau.
Les méthodes de mesure peuvent être divisées en deux catégories : les mesures directes qui sont celles dans lesquelles on applique directement la définition de la mesure, c’est-à-dire dans lesquelles on recherche le nombre de corps unité qu’il faut juxtaposer pour constituer un système équivalent à la grandeur étudiée ; les mesures indirectes sont celles qui ne satisfont pas à cette condition. Nous faisons directement la mesure d’une longueur ; nous faisons une mesure indirecte lorsque nous calculons une surface après avoir mesure ses dimensions. Il est des mesures plus indirectes encore « consistant à ramener la mesure d’une grandeur à celle d’une autre qui soit une fonction déterminée de la première, c’est-à-dire qui lui soit rattachée par une loi dont nous connaissions la formule exacte. Parfois même, on est obligé de superposer l’intervention de plusieurs lois ».
La mesure se compose ainsi souvent de deux opérations : l’une physique, expérimentale, accompagnée de dénombrement ; l’autre qui est un calcul, l’application d’une ou de plusieurs formules. Ces deux opérations entraînent des erreurs que l’on s’efforce de rendre aussi minimes que possible, au moyen de procédés opératoires et de calculs, souvent fort compliqués et que nous ne pouvons exposer ici.
* * *
En pédagogie l’emploi de la mesure – qui est plutôt une sériation – a surtout pour but de parvenir à une appréciation moins subjective du rendement scolaire et de la valeur des procédés didactiques. L’emploi des tests (voir ce mot) est cependant encore loin d’être généralisé bien que les examens actuels soulèvent depuis longtemps des critiques nombreuses. Nous sommes encore éloignés de ce que Claparède a appelé « l’école sur mesure » (voir au mot : École). La plupart des ouvrages qui traitent de ces sujets s’adressent à des spécialistes de la pédagogie et sont ignorés de la grasse masse des instituteurs. J’en signalerai quelques-uns à la fin de cette étude ne pouvant m’attarder sur un sujet ardu qui n’intéresserait que peu de lecteurs de l’Encyclopédie.
* * *
Je serai presque aussi bref en ce qui concerne l’emploi de la mesure par l’enfant. Actuellement à l’école primaire quelques défauts sont à signaler.
D’abord on ne mesure pas assez. Les enfants font trop de calculs sur les longueurs, les surfaces, etc., sans opérer de mesures effectives.
On veut, en ce faisant, aller vite et éviter toute perte de temps ; en réalité, on enseigne des notions qui sont mal assimilées et on ne forme pas l’esprit. Pour former l’esprit il faut être moins pressé et, sans vouloir faire passer les enfants par toutes les étapes du progrès, il est bon de procéder à une récapitulation abrégée. Il est utile que les enfants se rendent compte, en les employant, de l’inconvénient des mesures naturelles, même étalonnées, et avant de leur faire calculer des surfaces, il est utile de leur en faire mesurer (avec un centimètre carré en papier pris comme unité de mesure, par exemple).
Enfin il faut éviter d’enseigner des erreurs (nous en avons signalé quelques-unes au cours de cet article) et s’efforcer de bien faire comprendre quels sont les avantages principaux de notre système actuel de mesures.
– E. DELAUNAY.
BIBLIOGRAPHIE.
Sur la mesure en général, nous conseillons de lire : H. LE CHATELIER : Science et Industrie ; Ch. GUILLAUME : Initiation à la mécanique.
Sur l’emploi de la mesure en psychologie et en pédagogie : DUMAS : Traité de psychologie(1er vol.) ; CLAPARÈDE : Psychologie de l’Enfant et pédagogie expérimentale ; CLAPARÈDE : Comment diagnostiquer les aptitudes chez les écoliers ; PRESSEY : Initiation à la méthode des tests ; DEÇROLY BUYSSE : Introduction à la pédagogie quantitative ; BINET : Les idées modernes sur les enfants ; SIMON : Pédagogie expérimentale ; Mlle RÉMY : Un essai d’enseignement sur mesure ; J. GAL : Des faits à l’idée.
– E. D.
MÉTALLURGIE
n. f. (et MÉTAUX) (du grec métallon : métal et ergon : ouvrage)
Les métaux, à l’exception de quelques-uns tels que l’or, l’argent, le platine, ne se trouvent pas dans la nature à l’état natif ou pur. Ils se rencontrent à l’état de combinaison avec des agents minéralisateurs. Ces composés naturels se nomment minerais. L’art d’extraire le métal du minerai et de le rendre propre aux multiples usages auxquels il est destiné prend le nom de métallurgie.
Technique. ‒ On emploie actuellement deux traitements pour extraire les métaux :
-
traitement chimique, par voie sèche ou par voie humide ;
-
traitement électrique.
Le traitement chimique est de beaucoup le plus utilisé. Comme il est le plus anciennement connu, on est arrivé, par des améliorations successives, à le doter d’un outillage considérable parfaitement au point. Il a, d’autre part, l’avantage d’être le plus économique.
Le traitement électrique n’est pratiqué que dans les régions où le courant électrique coûte très bon marché, et pour certains métaux seulement. Mais quel que soit le traitement du minerai, chimique ou électrique, le métal fourni par la première opération – sauf pour la fonte grise – n’est jamais pur. Pour l’affiner on lui fait subir un ou plusieurs autres traitements, chimiques ou électriques, qui différent avec la nature du métal.
Le fer. – La métallurgie du fer (sidérurgie) est, de toutes, la plus importante étant donné qu’on utilise ce métal dans toutes les industries, dans des proportions variables mais toujours considérables.
La chimie indique que le fer est un corps simple, mais pratiquement, dans l’industrie, cette appellation est étendue aux métaux combinés dont le fer est l’élément essentiel. La combinaison, en proportions plus on moins grandes, du carbone, du silicium, du phosphore, du soufre, du manganèse, du nickel, de l’arsenic, de l’antimoine, du chrome, etc... avec le fer en modifie les propriétés et donne naissance à des métaux absolument différents, classés dans deux groupes principaux :
-
les fontes ;
-
les fers et les aciers.
Les métaux renfermant des corps étrangers au fer dans des proportions assez fortes (2,6 p. 100 et plus) sont classés dans le premier groupe ; Ceux qui contiennent des proportions infimes de corps étrangers au fer, appartiennent au second groupe. Leurs propriétés sont totalement différentes.
La fonte se liquéfie à basse température sans passer par un état intermédiaire entre l’état solide et l’état liquide. Son point de fusion est d’environ 1200°. Elle n’est pas malléable, même à chaud, si bien que lorsqu’on veut modifier la forme d’une pièce en fonte il est indispensable de la faire fondre et de la couler dans un moule de forme appropriée à l’usage désiré.
À l’inverse de la fonte, les fers et les aciers connaissent un état intermédiaire entre l’état solide et l’état liquide. Lorsqu’on les chauffe, ils passent, bien avant d’atteindre leur point de fusion, à l’état pâteux où ils deviennent malléables et peuvent changer de forme sous un effort mécanique. Le point de fusion des fers et des aciers croît en proportion de la pureté du métal mais n’est jamais inférieur à 1500°.
Ces deux classes principales se subdivisent à leur tour en catégories ou spécialités. La première, celle des fontes, en : fonte grise et fonte banche ; la seconde, celle des fers et aciers, en : fers soudés et aciers fondus.
-
Fonte grise. – La fonte grise est appelée ainsi à cause de sa couleur qui varie du gris clair au gris foncé. Elle est particulièrement employée pour les pièces moulées de mécanique à cause de sa très grande fluidité lorsqu’elle est en fusion (1200°) ; pour la construction de certains appareils nécessaires à l’industrie chimique à cause de sa résistance (supérieure à celle du fer et de l’acier) aux agents chimiques ; à la construction des masses polaires de dynamos en raison de sa possession d’une certaine force coercitive. Sa teneur en carbone combiné est relativement faible (0,5 à 2 p. 100) s’étant séparé au refroidissement pour se former en graphite (1,3 à 3,7 p. 100). Elle contient également du silicium dans les proportions de 2 à 4 p. 100. Sa densité varie entre 6,8 et 7.
-
Fonte blanche. – De couleur blanc d’argent, cette fonte est lourde (densité 7,5 à 7,7) cassante et dure. Elle est impropre à l’usinage mécanique et sert presque exclusivement à la fabrication du fer et de l’acier. Son point de fusion est d’environ 1100°. Sa teneur en carbone combiné est de 2 à 3 p. 100 et en graphite de 0,2 à 0,5 p. 100.
-
Fers soudés. – On comprend sous cette appellation les fers qui prennent naissance à l’état pâteux et ne sont pas totalement expurgés de leurs scories. Ils sont constitués par des grains formés isolément et soudés ensemble. Les fers soudés sont peu résistants et ne prennent pas la trempe. Leur teneur en carbone est de moins de 0,5 p. 100.
-
Aciers fondus. – À la différence des fers soudés, les aciers fondus prennent naissance à l’état liquide et sont débarrassés de la totalité de leurs scories. Ils sont homogènes et très résistants, ils prennent la trempe. Leur teneur en carbone est de au moins 0,5 p. 100. Les fers et les aciers fondus se substituent de plus en plus aux fers soudés.
Indépendamment de ces deux catégories principales, il y a les fontes spéciales obtenues par alliages telles que les ferro-siliciums (fer et silicium) les ferro-manganèses (fer et manganèse), les ferro-chromes (fer et chrome), les ferro-tungstènes (fer et acide tungstique), les ferro-nickels (fer et nickel), les ferro-molybdènes (fer et acide molybdène), les ferro-vanadiums (fer et oxyde de vanadium), les ferro-aluminium (rognures de fer et aluminium). Ces alliages servent presque exclusivement à la fabrication de l’acier dans lequel ils sont en combinaison dans des proportions déterminées, lui donnant ainsi des propriétés spéciales très intéressantes. Ces combinaisons de fontes spéciales donnent naissance à toute une gamme d’aciers fondus spéciaux. Lorsqu’on ajoute à l’acier un seul élément nouveau, il est dit ternaire ; lorsqu’on y ajouté deux éléments, il est dit quaternaire. Ainsi le ferro-nickel (ternaire), combiné avec l’acier augmente la résistance de celui-ci sans en augmenter la fragilité. La présence simultanée dé ferro-tungstène et de ferro-chrome dans l’acier (quaternaire) permet de le porter au rouge sans lui faire perdre de sa dureté ni de sa résistance ; cette propriété le recommande pour l’exécution de travaux où le frottement échauffe l’outil, soit par la vitesse, soit par la dureté. Cet acier quaternaire est appelé ordinairement acier à coupe rapide.
Le haut-fourneau. – Le fer est très répandu sur notre globe à l’état d’oxydes et de carbonates. L’extraction du métal s’obtient par la réduction de l’oxyde de fer par l’oxyde de carbone produit au moyen du coke dans le haut-fourneau. Le coke étant employé comme agent réducteur constitue donc une matière première dans la métallurgie du fer.
Comme nous l’avons dit plus haut on obtient pas le fer immédiatement après le premier traitement. La réduction du minerai de fer en haut-fourneau (traitement chimique) donne la fonte, produit intermédiaire entre le minerai et le fer.
L’oxyde de fer à réduire n’est jamais pur, il est toujours mêlé de matières argileuses (silicate d’aluminium impur), siliceuses ou calcaires selon la nature du gite et qui constituent ce qu’on nomme la gangue. Comme ces matières qu’il faut séparer du fer (oxyde de fer réduit) sont non-réductibles, la séparation ne peut s’opérer qu’en les transformant en substances fusibles susceptibles de s’écarter du métal par leur différence de densité. À cet effet, on ajoute au minerai les éléments qui manquent à sa gangue pour former des silicates plus fusibles (silicates d’aluminium et de calcium). La matière ajoutée prend le nom de fondant ; c’est l’argile pour les minerais calcaires et le calcaire pour les minerais argileux. Le mélange du minerai de fer et du fondant se nomme lit de fusion, et la gangue ainsi fondue s’appelle laitier.
Le haut-fourneau est un grand four vertical formé par deux troncs de cône réunis par leur base et formant une cuve de 15 à 30 mètres de hauteur selon l’importance de la production, et d’un petit cylindre placé à la partie inférieure : le creuset. L’ouverture dû sommet s’appelle gueulard, elle porte une trémie assurant l’ouverture et la fermeture du haut-fourneau et par laquelle sont introduits le coke, le minerai et le fondant ; Le tronc de cône supérieur le plus grand, constitue la cuve proprement dite ; le tronc de cône inférieur forme les étalages. Les cônes sont formés de deux parois entre lesquelles on place des fragments de briques afin de permettre la libre dilatation de la cuve. La paroi inférieure est faite en briques très réfractaires, la paroi extérieure est construite en maçonnerie légère et armée de cercles de fer à l’extérieur.
Lorsque le haut-fourneau est chaud (24 heures après l’allumage) on introduit par le gueulard, en couches successives, le coke et le minerai (celui-ci mêlé de fondant), puis on envoie de l’air chaud (800° environ sous une pression de 25 centimètres de mercure) par les tuyères qui débouchent immédiatement sous les étalages, dans l’ouvrage. Cet air chaud qui réagit sur le charbon au rouge en le portant aux environs de 2000° forme le gaz carbonique. Ce gaz rencontre bientôt du carbone en excès qui le ramène à l’état d’oxyde de carbone. Lequel oxyde traversant la couche de minerai le réduit tout en se transformant partiellement en gaz carbonique ; gaz carbonique qui rencontre de nouveau, en traversant la couche de charbon supérieure, un excès de carbone qui le ramène à l’état d’oxyde. Ces transformations successives du gaz carbonique en oxyde et de l’oxyde en gaz s’opèrent de couches en couches jusqu’à la hauteur du gueulard où les gaz constitués par un mélange d’azote, d’anhydride carbonique et d’oxyde de carbone sortent à une température d’environ 400° pour se rendre dans les appareils de récupération. Cela constitue la marche ascendante des gaz.
Les matières solides : minerai, fondants, coke, qui sont chargées de temps à autre, dessèchent dans la partie supérieure du haut-fourneau. Dans la partie inférieure de la cuve et au ventre s’effectue la réduction de l’oxyde de fer par l’oxyde de carbone. Dans les étalages où la température varie entre 1.600° et 1.700° le fer se combine au carbone en excès et donne la fonte, alors que le laitier se forme par la combinaison de la silice, de l’alumine et de la chaux. Le laitier, étant fusible à la température où l’on opère, descend dans le creuset avec la fonte à l’état de fusion et, plus léger que cette dernière, il surnage. Comme deux trous sont ménagés, l’un au fond du creuset, l’autre à un niveau plus élevé, il suffit de les délivrer de leur bouchon d’argile pour que la fonte s’échappe par le premier et les scories, plus légères, par le second. Cela constitue la marche descendante des matières solides.
Par ce traitement au haut-fourneau on obtient la fonte blanche et les fontes spéciales destinées, après affinage, à donner les fers et les aciers et la fonte grise de moulage. La nature de la fonte obtenue dépend essentiellement : de la composition chimique du minerai employé ; du lit de fusion ; de la température qui règne dans la zone de fusion et de la vitesse de refroidissement pendant la solidification.
L’affinage a pour but d’éliminer la plus grande partie des corps étrangers que nous avons signalés plus haut et qui se trouvent dans la fonte en combinaison avec le fer. Il repose sur l’oxydation de ces corps par l’oxygène de l’air ou par les oxydes de fer, les impuretés étant plus oxydables que le fer. Ce traitement s’effectue selon différents procédés : le four Martin-Siemens, le convertisseur Bessemer et le traitement basique de Thomas et Gilchrist. Cet article est déjà trop technique pour que nous nous permettions de décrire chacun de ces procédés. Il nous suffira de signaler que l’amélioration qu’apportèrent au convertisseur Bessemer les anglais Thomas et Gilchrist en 1875, aboutissant à l’élimination du phosphore, a permis l’utilisation du minerai phosphoreux jusqu’alors inutilisable. Pour obtenir les aciers spéciaux on ajoute, dans des proportions déterminées, les éléments indispensables à la combinaison désirée.
Cuivre. – Le cuivre est, après l’argent, le meilleur métal conducteur de chaleur et d’électricité. Comme il est moins rare que l’argent, partant meilleur marché, on l’emploie chaque fois qu’on a besoin d’un bon conducteur calorifique ou électrique. Aussi est-il fait une grande consommation de cuivre, dans les industries électriques, la fabrication des chaudières, d’alambics, d’appareils de distillerie, de raffinerie, etc...
On rencontre le cuivre dans la nature, à l’état d’oxyde, de carbonate, mais surtout de sulfure. Le cuivre natif, très peu oxydé, est simplement soumis à la fusion dans un four à réverbère. À l’état d’oxyde le minerai est réduit par le coke en présence d’un fondant.
La métallurgie des minerais sulfurés est, pratiquement, plus compliquée. Voici quel en est le principe : le minerai est soumis successivement à des grillages et à des fusions répétés jusqu’à l’obtention d’un cuivre impur. Au cours des grillages, le soufre, l’arsenic, l’antimoine se trouvent partiellement brûlés. Le gaz qui se dégage pendant ces opérations est transformé ordinairement en acide sulfurique. Dans la fusion on ajoute au minerai grillé des produits siliceux dont le rôle consiste à se combiner à l’oxyde de fer, qu’il contient en faible proportion, pour former des silicates fusibles. La masse fondue se sépare en deux parties : une scorie formée par les silicates et de plus faible densité et la matte de sulfure cuivreux. Cette matte subit de nouvelles fusions jusqu’à l’obtention d’un cuivre noir qui est ensuite affiné ou purifié soit par électrolyse, soit par une nouvelle fusion.
Le cuivre pur est de couleur rouge ; son point de fusion est de 1085° ; à 2100° il bout ; sa densité est de 8.85. À l’air humide il se recouvre d’hydrocarbonate de cuivre appelé communément vert-de-gris. Après le fer, la fonte et l’acier, le cuivre est le métal le plus employé soit à l’état pur, soit en alliages. Les principaux alliages de cuivre sont les bronzes (cuivre et étain) et les laitons (cuivre et zinc).
Pour les autres principaux métaux qui viennent, par leur importance dans la vie industrielle, après le fer, la fonte, l’acier et le cuivre, nous nous bornerons à une simple énumération accompagnée de leurs propriétés essentielles.
Le Plomb. Le plomb est un métal gris bleuâtre, mou, très malléable, ductile. Il fond à 327° et bout à 1250°. Sa densité est de 11,2. L’Étain. L’étain est blanc d’argent avec reflet bleuâtre, c’est le plus fusible des métaux (point de fusion 232°). Son point d’ébullition est d’environ 2.170° et sa densité 7,22. Le Zinc. Le zinc est un métal d’un blanc bleuâtre qui fond à 412° ; sa densité est de 6,8. L’Aluminium. Métal blanc légèrement bleuté, fond à 650°. C’est le métal usuel le plus léger (densité 2,5). Il est ductile et malléable. Le Mercure. Liquide blanc et très brillant, il est l’un des métaux les plus lourds (densité 13,51). Il se solidifie à — 39°5 et bout à + 357°. Le Platine. Le platine est blanc lorsqu’il est aggloméré et noir lorsqu’il est en poudre. C’est le métal le plus lourd (densité 21,5), son point de fusion se situe aux environs de 1780°. Étant inoxydable et inattaquable par les acides il est très employé dans la chimie et la physique. L’Or. À l’état pur, métal jaune clair, il est mou et le plus ductile et malléable de tous les métaux. Sa densité est de 19,5. Il fond à 1065° et bout à 2800°. Comme le platine il est inoxydable. L’Argent. Métal d’aspect blanc éclatant qu’il doit à son grand pouvoir réfléchissant ; sa couleur véritable est jaune. Sa densité est de 10,5. Après l’or, il est le plus malléable et le plus ductile des métaux. Son point de fusion est de 962° et d’ébullition 1850°.
* * *
Alors que les minerais, et particulièrement le minerai de fer, sont répandus dans toutes les parties du globe, très peu de pays possèdent une métallurgie importante. Cela tient à deux facteurs : l’absence de houille en quantité suffisante et les difficultés d’accession pour l’exploitation.
Comme nous l’avons remarqué dans le chapitre précédent, la métallurgie emploie comme matière première non seulement le minerai, mais aussi le charbon. D’où la nécessité, pour produire les métaux dans de bonnes conditions, d’avoir abondamment dans une même région et la houille et le minerai. Comme cette condition n’est pas toujours réalisée par la nature, la métallurgie s’est développée surtout dans les grands bassins houillers et à proximité des grandes voies maritimes ou fluviales, le minerai allant à la rencontre de la houille parce que de moindre valeur. Il arrive même quelquefois que les hauts-fourneaux, les forges et les aciéries s’établissent dans des régions dépourvues de houille et de minerai, au voisinage de ports situés sur les grandes voies maritimes. La houille et le minerai matières encombrantes et de valeur relativement faible, ne sont transportés dans des conditions avantageuses et en grosses quantités que par voie d’eau, le transport par voie ferrée, outre qu’il est encombrant, est trop onéreux.
Il n’est guère que les États-Unis qui possèdent dans leur sous-sol la houille et les minerais nécessaires à leur métallurgie gigantesque. Les autres pays qui ont une métallurgie importante sont obligés d’importer soit la houille, soit le minerai qui leur manque en échange de l’une ou de l’autre de ces matières qu’ils ont en excès. C’est le cas pour l’Angleterre, l’Allemagne, la France, la Belgique. Aussi la métallurgie de ces pays s’est-elle établie auprès des grandes voies maritimes ou fluviales comme nous le verrons plus loin.
Nous avons déjà dit que le fer est le métal le plus usité à travers le monde. En 1925, la production mondiale de minerai de fer a été de 150 millions de tonnes, dans laquelle la part des États-Unis s’est élevée à 63 millions de tonnes, soit 42 %. Sur cette part il n’a été pour ainsi dire rien exporté. La métallurgie indigène fut tout juste approvisionnée par cette masse énorme de minerai.
La situation géographique des États-Unis et la disposition naturelle des richesses de leur sous-sol sont, peut-être plus encore pour la métallurgie que pour les autres industries, véritablement exceptionnelles. Les grands gîtes métallifères de Vermillon, de Mésabi, de Cuyana, dans le Minnesota, sont à proximité du Grand Lac Supérieur, comme d’ailleurs les gisements de Gogebic, de Marquette et de Ménominee, dans le Wisconsin, alors que les grands bassins houillers, qui s’étendent en une large bande ininterrompue depuis l’État de New-York jusqu’à celui de Tennessee, se trouvent à l’autre extrémité des Grands Lacs. C’est sur cette bande de 500 000 kilomètres carrés que s’est installée pour une grosse part la métallurgie américaine.
Le minerai du Minnesota vient se concentrer dans les ports de Two Harbourg, Supérieur City et, surtout, de Duluth aménagés spécialement pour le recevoir. D’autres ports également agencés à cet effet tels que ceux d’Asholand et de Marquette reçoivent le minerai du Wisconsin.
Les lacs américains n’ont aucune analogie avec ceux que nous connaissons en Europe ; ce sont de véritables mers intérieures dont la profondeur a permis aux États-Unis de construire toute une flotte de cargos de gros tonnage affectée spécialement au transport du minerai ou de la houille. Ainsi les minerais chargés à Duluth ou à Marquette – ports d’expédition – sont acheminés : par le lac Michigan, vers Milwaukee, Chicago, Gary ; par le lac Huron, vers Detroit ; par le lac Erie, vers Teledo, Sandusky, Cleveland, Buffalo, etc..., ports de débarquement du minerai et centres métallurgiques importants. Dans l’Alabama, le Colorado, le Texas, le Montana, il existe encore d’autres centres aussi bien avantagés que ceux que nous venons de citer.
Si la métallurgie américaine absorbe une grosse quantité de minerai, elle exporte très peu de fonte, de fer et d’acier – à peine 2 millions de tonnes – en proportion de sa production. Celle-ci est totalement résorbée par les industries mécaniques indigènes dont le rythme de production, s’accentuant d’année en année, n’est pas le moindre sujet d’effroi pour les industriels du vieux monde qui appréhendent d’être submergés sur leurs propres marchés nationaux par les quantités considérables des produits manufacturés de la métallurgie que les États-Unis expédient à destination des cinq parties du globe sous forme de machines-outils, agricoles, à écrire, outillage, automobiles, etc...
La France possède après les États-Unis, la plus grosse métallurgie du monde et elle tient la première place en ce qui concerne l’exportation des fontes des fers et aciers. En 1925, elle a exporté 710 000 tonnes de fontes diverses et 3 millions 160 000 tonnes de fers et aciers. La France n’a acquis cette situation privilégiée sur marché métallurgique qu’à la faveur du traité de Versailles qui lui a fait retour, dans son domaine territorial, de l’Alsace-Lorraine avec ses riches minerais du bassin de Briey qui portent sa production extractive à 35 740 000 tonnes, soit 24 % de la production mondiale et un peu plus de la moitié de celle des États-Unis, après laquelle elle est la plus importante du monde.
Mais la France, si elle a beaucoup de minerai de fer, a, par contre, très peu de charbon ; elle doit le demander à l’Angleterre, à l’Allemagne et à la Belgique.
Naturellement la métallurgie française subit la loi économique commune, et ses hauts-fourneaux comme ses forges et aciéries se sont installés auprès des charbonnages ou aux environs des grandes voies maritimes et fluviales. C’est dans la région de l’Est – près de la frontière franco-allemande – que se trouvent les plus importants gîtes métallifères de la France. Les départements de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle sont les plus gros producteurs de minerai de fer avec les groupes de Nancy, Champigneules, Frouard, Pompey, Jœuf, Homécourt, Hayange, Briey, etc... Dans la région nancéenne il n’y a pas de charbon, mais ces hauts-fourneaux reçoivent les charbons allemands de la Ruhr et de la Sarre que leur apportent la flotte de péniches allemandes par les canaux de la Marne au Rhin et de la Sarre. Venues le ventre rempli de houille, ces péniches s’en retournent à leur port d’attache – Duisbourg, Dusseldorff, etc... – le ventre plein de ce minerai lorrain qui manque aujourd’hui à la métallurgie allemande. Le trafic dans les deux sens est considérable ; pour être moins intense, celui qui s’effectue sur le canal de l’Est est également important. Par péniches, le charbon belge descend le canal de l’Est à destination de tout le bassin de Briey. Au retour, les mêmes péniches remportent le minerai lorrain vers le centre métallurgique de Charleroi, en Belgique. En France, c’est surtout à la rencontre du charbon des bassins du Nord que va le minerai de l’Est. Là, la métallurgie, outre qu’elle y trouve le coke, est entourée d’industries de transformation capables d’absorber sa production Aussi s’est-elle fortement concentrée dans la région du Nord, à Maubeuge, Jeumont, Anzin, Valenciennes, Denain, Lille, Hazebrouck, pour ne citer que les centres les plus importants.
Plus bas sur la côte de la Manche, dans la région havraise, qui n’a ni charbon ni minerai, la métallurgie a dressé ses hauts-fourneaux et ses aciéries. C’est que là le charbon anglais arrive facilement par la mer tout comme le minerai normand situé plus bas sur la côte, dans le Calvados. Les gisements de Normandie (Caen) et de Basse-Bretagne (Redon) fournissent des minerais très riches en teneur et de grande pureté qui les font rechercher par la métallurgie anglaise spécialisée dans la production d’aciers spéciaux requérant des minerais purs. D’ailleurs ces deux gisements français, après avoir alimenté la métallurgie des régions havraise et nantaise et quelque peu celle du Nord, expédient l’excédent de leur production, par Nantes, à Cardiff et par Caen, à Newcastle, en Angleterre. Il est même une partie de ces minerais qui remonte jusqu’à Rotterdam, à l’embouchure du Rhin et descend celui-ci à destination de l’Allemagne.
D’autres gîtes métallifères de moindre importance sont disséminés à travers la France. On rencontre du fer dans le Centre, l’Ariège, les Pyrénées-Orientales, mais relativement peu de métallurgie dans ces contrées si l’on excepte, en Saône-et-Loire, le centre du Creusot, universellement connu qui reçoit une grande partie de son minerai de l’Est par le canal du Sud et par la Saône et son charbon des bassins de la Loire, par le canal du Centre.
Quoique première puissance exportatrice de fontes et d’aciers, la France n’épuise pas ses capacités de production métallurgique et vend annuellement à d’autres pays 9 millions de tonnes de minerai de fer qu’elle ne peut transformer sur place, faute de charbon. La France est donc également la première puissance exportatrice de minerai de fer.
À l’inverse de la France, l’Angleterre, qui possède dans son sous-sol une réserve prodigieusement riche de charbon, n’a pas suffisamment de fer pour sa métallurgie qui est dans l’obligation d’importer presque le tiers du minerai indispensable au fonctionnement de ses hauts-fourneaux. Malgré cela, l’Angleterre a su, grâce à sa situation géographique, à sa richesse charbonnière et à une organisation commerciale admirable, se doter d’une puissante métallurgie qui fut longtemps la première du monde, et qui, quoique actuellement au troisième rang, rivalise dans le domaine de l’exportation avec la métallurgie française en se classant immédiatement après elle par l’importance du tonnage.
En Angleterre la nature a disposé le fer près de la houille et les bassins houillers près de la mer, à l’exception de celui du Yorkshire qui s’en trouve à peine éloigné de 150 kilomètres. La métallurgie a donc pu, très tôt, se développer dans de bonnes conditions. Pour le minerai qui lui manque, 4 millions de tonnes en 1925, l’escadre importante des charbonniers anglais se charge de le drainer dans les pays, proches ou lointains, où elle dépose sa cargaison de charbon britannique. Ainsi, le minerai constitue-t-il pour cette flotte spécialisée un fret de retour avantageux.
De Suède, à Luléa et Stockolm, les charbonniers anglais, appelés aussi colliers, emportent vers Newcastle et Hull les minerais scandinaves riches et purs, mais trop abondants pour leur pays d’origine. De Caen, en France, encore vers Newcastle, ils emportent les minerais normands, et de Nantes, vers Cardiff, ceux de la Bretagne.
L’Espagne, qui extrait de son sous-sol 3 millions de tonnes de minerai de fer et en utilise à peine le sixième, fournit également un très avantageux fret de retour aux colliers anglais. Enfin, l’Algérie, démunie de charbon, reçoit celui de l’Angleterre en échange des beaux minerais du Zaccar et de l’Ouenza.
Tous ces minerais étrangers joints au minerai indigène, alimentent les centres métallurgiques d’Edimbourg, de Newcastle, de Middlesbrough, de Hull, sur la Mer du Nord ; de Glasgow, de Workington, de Withehayen, de Liverpool, de Cardiff, de New-Port sur l’Atlantique ; ainsi que les fiefs métallurgiques de Manchester, de Sheffield, de Nottingham, de Birmingham au Centre.
Toutefois, si l’Angleterre exporte presque autant de produits bruts de la métallurgie que la France, sa production totale est beaucoup moindre – à peine 8 millions de tonnes contre 14 millions pour la France.
En Europe, c’est l’Allemagne qui produit le plus de fontes et d’aciers après la France. Pour les exportations elle arrive après la France et l’Angleterre avec 3 250 000 tonnes. Par contre, depuis le traité de Versailles qui l’a amputée du gisement lorrain (celui-ci fournissait, avant-guerre, 80 % de la production allemande) au bénéfice de la France, l’Allemagne est le pays qui achète le plus de minerai de fer à l’étranger. En 1925, 11 millions et demi de tonnes.
Comme l’Angleterre, l’Allemagne possède plus de charbon qu’il n’en faut à ses industries. Ses bassins houillers de la Saxe et de la Haute-Silésie restée allemande approvisionnent le marché national. Le charbon de la Ruhr, après avoir alimenté la région rhénowestphalienne, remonte, pour une bonne part, le cours du Rhin sur une magnifique flotte fluviale vers les centres métallurgiques français de la Meurthe-et-Moselle, par le canal de la Marne au Rhin. Pour une autre part le charbon de la Ruhr descend le Rhin vers Rotterdam et Anvers d’où de grands cargos le mèneront dans les pays scandinaves qui enverront, au retour, du minerai.
La métallurgie allemande s’est installée sur le bassin rhénan-westphalien dont Essen, Bochum, Gelsenkirchen et Dortmund sont les groupes les plus fameux ; en Saxe et en Thuringe dans les centres de Smalkalden, Zwickau et Saalfeld ; enfin, dans la partie de la Haute-Silésie restée allemande, dans les districts de Beuthen et de Gleiwitz.
Les États-Unis, la France, l’Angleterre et l’Allemagne sont les quatre grands pays de la métallurgie du fer – la plus importante, répétons-le – ; viennent ensuite le Luxembourg, la Belgique, le Canada, la Suède, l’Espagne, la Russie, la Tchécoslovaquie, l’Italie. En ce qui concerne les autres métaux, les États-Unis sont les plus gros producteurs pour : le cuivre (58 % de la production mondiale), le plomb (43 %), le zinc (60 %), l’aluminium (57 %), l’argent (30 %). Ils arrivent après l’Afrique du Sud (41 %) dans la production de l’or avec 15 % de la production mondiale.
La France produit peu de cuivre (0,08 % de la production mondiale), peu de plomb (2 %), peu de zinc (2 %), pas d’or ni d’argent mais 6,6 % d’aluminium.
L’Angleterre a très peu de cuivre mais en reçoit de ses Dominions – le Canada en produit 3,4 %, l’Australie 2 % et les Indes Britanniques 2,5 %, toujours de la production mondiale. Faible productrice de plomb, l’Angleterre le trouve également dans ses colonies – Canada 3,5 %, Australie 6,6 %, les Indes 4 %. Sa production de zinc n’est guère supérieure à celle de la France, sa production d’aluminium lui est même inférieure (6 %). Si l’Angleterre ne produit ni or ni argent, ses colonies en sont largement pourvues (Afrique du Sud 41 % d’or, Australie 7 % d’or, 5 % d’argent, canada 4,6 % d’or, 7,7 % d’argent).
L’Allemagne produit du cuivre (3,3 %), du plomb (9 %), du zinc (15 %), de l’aluminium (10 %). La Belgique produit du zinc (12 %) et du plomb (3,5 %). La Norvège fournit aussi du zinc (2 %) et de l’aluminium (4,6 %). L’Espagne est un gros producteur de plomb (16 %). Le cuivre, plutôt rare en Europe, se trouve dans les deux Amériques ; outre les États-Unis avec leurs 58 % de la production mondiale, le Mexique donne 6 %, le Chili 8 %, le Pérou 4 %, la Bolivie 1 %, Cuba 1 %. En Afrique, le Congo en donne 2,3 %. Enfin le Japon produit près de 8 % de la production mondiale de cuivre. Le Mexique produit également 7 % de plomb, 4,5 % d’or et 36,7 % d’argent. Le Canada, la Suède, l’Allemagne (en Saxe), la Silésie, la Hongrie et la Nouvelle-Calédonie sont des régions productrices de nickel. La Russie, les Indes, la France, l’Allemagne, l’Angleterre, les États Unis possèdent du manganèse. Enfin, les Indes et les iles de la Sonde sont, avec les États Unis, les plus gros producteurs d’étain.
* * *
Les origines de la métallurgie sont entourées d’épaisses ténèbres ; elles remontent très loin dans la chaine des siècles. Mais s’il est audacieux de leur fixer une époque, on peut affirmer que son histoire et son évolution sont intimement liées à celles de la civilisation et des progrès de l’humanité. Il n’a point été de sa faute si les hommes l’on trop souvent utilisée à des fins de destruction et de mort, alors qu’elle peut aussi bien donner et faciliter la vie de l’humanité.
Des préhistoriens ont prétendu que l’art d’extraire les métaux de leurs minerais fut pratiqué par les hommes entre les XIVème et XIIème siècle avant notre ère. D’autres font remonter encore plus loin, dans la nuit des temps, la connaissance de sa pratique en Chine et aux Indes.
Sans vouloir prendre parti dans la dispute, on peut dire qu’il est hors de doute que les peuples civilisés de l’antiquité ont employé des outils de fer pour tailler la pierre de ces gigantesques monuments dont les siècles n’ont pas totalement effacé les traces, aussi bien que pour travailler la terre à laquelle ils demandaient leur subsistance, et surtout pour fabriquer des armes.
Une autre dispute met aux prises les savants préhistoriens. À savoir lequel des métaux fut le premier connu des hommes ? Autrement dit l’âge du bronze a-t-il précédé l’âge du fer ou lui fut-il postérieur ? Le choix, autant que l’affirmation, est difficile en pareille matière. Nous inclinons cependant à croire que la métallurgie du fer est antérieure à celle du bronze du fait que celui-ci, étant un alliage de cuivre et d’étain, deux métaux qui se trouvaient rarement dans les mêmes contrées, suppose une époque de navigation et de commerce très développée, ce qui n’était pas encore le cas. D’autre part le bronze n’a pas une résistance suffisante pour justifier la pérennité des monuments de l’antiquité. Il est par contre indéniable que le bronze ait eu les préférences des peuples primitifs pour certains usages en raison de son vif éclat, de son inoxydabilité à l’air et la facilité avec laquelle il se prête au moulage. Il fut certainement une des premières matières de troc entre les peuplades sous forme d’ornementations et d’objets à usage domestique.
Naturellement nous n’avons aucune notion de la technique métallurgique des peuples de l’antiquité, mais tout nous laisse supposer que son évolution fut très lente et que ses procédés ne différaient guère de ceux dont le moyen âge nous a laissé la trace. À cette époque le minerai était réduit dans des foyers de bois, à proximité des forêts, celles-ci fournissant le combustible des foyers et des forges installés tout près. Il se conçoit aisément qu’avec cette méthode la production était bien faible et que seuls les minerais riches en teneur de fer pouvaient être traités.
Ce n’est qu’au XIVème siècle qu’apparut en Allemagne l’appareil qui, en se perfectionnant à travers les siècles, devait devenir le haut-fourneau que nous connaissons aujourd’hui. Le stückofer, c’était le nom de l’appareil, n’était autre chose que l’ancien foyer recouvert d’une cuve de 3 à 4 mètres, par le haut de laquelle on introduisait les minerais et le charbon de bois afin qu’ils s’échauffassent progressivement avant d’arriver au cœur du foyer. Sa première utilité fut d’économiser du combustible, mais l’observation révéla qu’en activant le foyer par l’envoi plus rapide d’une quantité d’air supérieure, on obtenait un métal fondu en place de la traditionnelle loupe pâteuse qu’il fallait pétrir à la forge pour la débarrasser partiellement de ses scories, Le stückofer s’adapta à ce nouveau procédé et ainsi naquit la fonte propre au moulage, et avec elle l’artillerie et les boulets de fonte.
La méthode allemande se répandit rapidement dans son pays d’origine d’abord et ensuite en Angleterre, sans déranger toutefois la métallurgie des régions forestières où elle était établie, son combustible continuant à être le charbon de bois. Ce n’est que vers 1730 qu’en Angleterre on imagina de carboniser la houille pour la transformer en coke, nouvel aliment du haut-fourneau. La métallurgie du continent fut longue à faire une place à ce nouvel arrivant et l’Angleterre resta longtemps seule à bénéficier de ses avantages. La métallurgie conserva cependant l’usage du charbon de bois pour l’affinage.
Mais c’est surtout à la fin du XVIIIème siècle que nous découvrons les origines de la métallurgie moderne. Les perfectionnements apportés à la machine à vapeur et sa généralisation dans toutes les industries furent pour la métallurgie d’une importance capitale. Jusqu’alors elle avait été condamnée à la fabrication de pièces de dimensions réduites, faute d’avoir dans ses forges des organes propulseurs assez forts pour actionner de puissants marteaux capables, par leur poids et leur pression, de forger des masses volumineuses. La machine à vapeur va permettre à la métallurgie de créer pour ses forges un outillage puissant qui comblera cette lacune. Ce progrès a une importance considérable, mais la machine à vapeur va faire plus fort et plus grand. En s’introduisant dans toutes les industries, elle va transformer les rapports des hommes entre eux au point que le XIXème siècle présidera une révolution universelle autrement importante que celle de la fin du XVIIIème siècle. L’ère de la machine commence, et avec elle celle du capitalisme. Dans la production, l’homme passe au second plan, il cède sa place à la machine qui va créer un tel besoin de métal, que la métallurgie sera d’abord débordée. Mais devant ces besoins et ces débouchés nouveaux, qui sont considérables, les métallurgistes sont contraints de rechercher des perfectionnements toujours plus grands à leur technique, en un mot, il leur faut adapter leur production au marché nouveau qui se constitue.
L’anglais Cort va d’abord trouver le four à puddler qui permettra l’affinage à la houille. Puis il inventera le laminoir à cannelures à l’aide duquel les loupes de fer, à l’état pâteux, seront transformées en barres de toutes formes et de toutes dimensions beaucoup plus rapidement, et économiquement, que par le martelage.
En 1830, la métallurgie expérimente – et adopte – l’emploi de l’air chaud dans les hauts-fourneaux écossais. Cette pratique va permettre d’élever le haut-fourneau progressivement de 10 mètres à 20 mètres de hauteur, partant, la production passera de 15 à 50 tonnes par jour.
À cette époque, la métallurgie anglaise est encore bien avancée dans la voie du progrès par rapport aux autres métallurgies continentales. Ces dernières n’abandonneront le charbon de bois et l’air froid qu’aux environs de 1840, au moment où les chemins de fer et les navires en acier en faisant leur apparition, accroîtront encore la demande du métal, en même temps qu’ils transformeront les rapports jusque-là établis entre les diverses régions du monde. Ces nouveaux moyens de transports auront une grosse influence sur la métallurgie. Elle pourra, avec leur concours, envoyer ses produits dans un rayon plus étendu et concurrencer les usines restées réfractaires ou qui n’ont pu, pour des raisons multiples, s’adapter aux progrès de la technique. C’est alors que, sous la poussée des faits, se produit la concentration pour réaliser les conditions optima de production. Les régions forestières sont désertées au bénéfice des bassins houillers où, désormais, la métallurgie puisera l’une de ses principales matières premières : le charbon transformé en coke ; au bénéfice également des régions avoisinant les grandes voies maritimes ou fluviales.
À partir de ce moment la technique se développe prodigieusement. Le marteau-pilon fait son entrée dans la forge et en modifie le caractère. Il pèse d’abord 1 000 kilos, puis, progressivement, la hardiesse humaine ira jusqu’à construire et utiliser des piliers de cent mille kilos. Les laminoirs subissent toute une série de modifications, et les hauts-fourneaux acquièrent une capacité de production de 100 tonnes par jour.
La métallurgie connaîtra une nouvelle révolution dans sa technique lorsque, vers 1860, l’anglais Bessemer et le français Martin trouvent, presque simultanément, le moyen d’obtenir de l’acier par fusion. Auparavant, les frères Siemens, en Allemagne, avaient inventé un four permettant d’atteindre de très hautes températures. Cette invention facilita d’ailleurs les travaux de Martin.
L’acier, plus résistant que le fer, eut rapidement fait de remplacer celui-ci dans de multiples fabrications. C’est ainsi que le fer fut totalement éliminé de la fabrication des rails et des bandages, et partiellement dans la construction mécanique, les tôles de marine, etc. La première, l’Allemagne construisit ses canons en acier fondu, dont la supériorité pendant la guerre de 1870 fut tellement marquée que, depuis, tout le matériel de guerre des nations est construit en acier fondu.
La presse hydraulique naquit à son tour du besoin de forger des lingots de plus en plus lourds, qui, même, dépassaient les 100 tonnes et pour lesquels les marteaux-pilons devenaient insuffisants ou leurs fondations se révélaient trop fragiles.
En 1879, un clerc de notaire anglais, Thomas-Gilchrist, allait de nouveau provoquer une révolution dans la technique métallurgique en trouvant le moyen de réduire le phosphore dans le convertisseur Bessemer par le procédé basique. Cette découverte rendit utilisable les minerais phosphoreux – tels ceux de la Lorraine – jusqu’alors impropres à la production de l’acier. Elle assura définitivement le passage de l’âge du fer à l’âge de l’acier.
Depuis cette époque jusqu’à la guerre 1914–1918, la métallurgie s’est enrichie de multiples perfectionnements qui ont accru sa production dans des proportions considérables, en même temps qu’ils en abaissaient le prix de revient. Ainsi la métallurgie a transformé des villes entières comme Essen, en Allemagne, le Creusot, en France, Birmingham, en Angleterre ; Pittsburg, aux États-Unis en vastes usines essentiellement métallurgistes.
En un siècle, quelles transformations de toutes sortes ? Car l’évolution technique en a entraîné bien d’autres, avec des conséquences sociales telles, que le contemporain du stückofer en eût été effrayé au seul énoncé.
Avant la machine à vapeur, le rayon d’action de la métallurgie n’allait que très rarement au-delà du centre où elle était établie. Les besoins étaient réduits et, à débouchés restreints production faible et technique stagnante. La machine à vapeur, en augmentant le nombre et la capacité des débouchés, élargit le marché et force la métallurgie à sortir de sa pratique routinière en cherchant des procédés de fabrication plus rapides et moins chers. La métallurgie, sous le fouet des nécessités, trouve cette nouvelle technique ; mais pour la mettre en pratique il lui faut des sommes fabuleuses bien supérieures aux ressources individuelles des Maîtres des Forges de l’époque. Allait-elle être arrêtée par un obstacle de cette nature ? Non pas ! Ce qu’un seul ne put faire, l’association le fit. Sous la forme de sociétés par actions, les entreprises se constituèrent par la réunion de capitalistes, quelquefois étrangers à l’industrie elle-même. Aussi a-t-on pu dire avec raison que l’industrie était la mère de l’un et de l’autre.
Alors, largement pourvue de capitaux, la métallurgie put abandonner les régions forestières pour s’installer sur le minerai ou la houille, avec un outillage nouveau et plus apte à la grosse production. La facilité des échanges, due au développement des chemins de fer et de la marine de gros tonnage, stimula autant qu’elle créa la production, car combien de produits n’auraient jamais vu le jour si les moyens de transports rapides et peu coûteux ne les eussent rendus utilisables. Si bien que les marchés, de régionaux devinrent nationaux. Et bientôt les cadres de la nation eux-mêmes se révélèrent trop étroits et la métallurgie réclama l’univers comme marché.
Il ne faut tout de même pas croire que cette évolution se soit accomplie sans à-coup. Bien des résistances furent à vaincre avant d’aboutir à la constitution des grandes entreprises et des puissants organismes de la métallurgie que nous connaissons aujourd’hui. Aussi nombreux se trouvèrent les rebelles à la tendance de double concentration capitaliste et industrielle, qu’il y en avait eus aux progrès techniques. Et l’on compta souvent plus de vaincus par la nécessité de se soumettre ou de disparaître, que de convaincus par les faits d’un caractère nouveau. Ce n’est donc que lentement que la métallurgie se développa dans le cadre national. Mais bientôt surgit une nouvelle difficulté. La coexistence de plusieurs grandes entreprises dans un même pays aboutissait à une concurrence effrénée dont bénéficiait le consommateur (c’est-à-dire l’industrie de transformation mécanique) et souvent la métallurgie étrangère.
C’est pour obvier à ce double inconvénient que naquirent les syndicats nationaux de production. Dans ces organismes chaque entreprise adhérente garde son autonomie intérieure mais se soumet à certaine réglementation :
-
Production maxima limitée ;
-
Zone de vente indiquée et strictement limitée ; dans cette zone l’entreprise jouit d’un monopole de fait ;
-
Prix de vente uniforme et fixé en commun.
Ainsi – théoriquement – la concurrence est éliminée dans le cadre national puisque le consommateur rencontrera partout le même prix de vente, et dans sa région un seul fournisseur. Mais pratiquement le système s’avéra insuffisant en dépit des amendes qui frappaient les infractions au règlement susmentionné. Comme un retour en arrière n’eût point résolu le problème, c’est donc un pas en avant dans l’organisation que fit la métallurgie. Elle compléta le syndicat national de production par le Cartel de vente. Celui-ci s’interposa entre le producteur et l’acheteur ; il devint, nationalement, l’organe commercial de la métallurgie en même temps qu’il faisait de celle-ci une industrie nationale.
Pourvue de cette unité, la métallurgie se trouve en face de deux problèmes angoissants, dont les peuples ont payé et payeront encore de leurs souffrances et de leur sang la solution toujours temporaire.
Le premier de ces problèmes est celui de l’approvisionnement en matières premières : houille ou minerais, dont le sous-sol national est trop chichement doté par la nature. Le second est celui des débouchés, car rien ne sert de produire si l’on ne peut vendre pour amortir et faire fructifier les capitaux. Alors, identifiant les intérêts de la métallurgie, devenue industrie nationale, aux intérêts de la patrie elle-même, les Cartels, usant et abusant du pouvoir politique que leur confère leur puissance économique, exigèrent des gouvernements une politique de soutien qui, si elle leur est profitable, n’est pas sans peser lourdement sur les peuples. Pour se défendre contre la concurrence étrangère, les Cartels exigèrent d’abord l’édification d’un réseau de barrières douanières, qui leur fût accordé. Par un paradoxe ironique, à l’abri de ce réseau dont fut proclamée la nécessité pour la protection de la Nation, les Cartels vendirent leurs produits beaucoup plus cher à leurs nationaux qu’aux, étrangers, sûrs qu’ils étaient de ne pas être gênés par la production des autres pays métallurgiques. Cette opération qui consiste à vendre souvent très cher sur le marché national et à vendre souvent à perte sur les marchés internationaux porte le nom de dumping. Mais en même temps, les Cartels nationaux des pays industriels émettaient la prétention d’écouler l’excédent de leur production non absorbée par le marché national, dans les pays neufs et, par conséquent, peu industrialisés. Naturellement la conquête de ces débouchés nouveaux suscita une compétition exaspérée entre les différents Cartels nationaux. Toujours forts de leur puissance économique, à laquelle ils n’hésitèrent pas quelquefois à joindre leur capacité de corruption, ceux-ci firent entreprendre par leurs gouvernements respectifs des guerres de conquête coloniale, au nom de la toujours sainte patrie et de ses intérêts vitaux. À la vérité, il faut dire que la métallurgie ne fut pas seule à suivre cette voie : d’autres industries firent de même, et cette pratique donna naissance à ce qu’on a appelé le nationalisme économique auquel s’ajouta l’ambition d’accroître son patrimoine de pays à production complémentaire, ambition qui caractérise ce qu’on nomme ordinairement l’impérialisme. Les impérialismes et les nationalismes économiques se heurtèrent donc pour la conquête des matières premières et des débouchés jusqu’à aboutir, de conflit en conflit, à la conflagration générale de 1914. Sans être l’unique cause de la guerre mondiale, la métallurgie n’en a pas moins joué un rôle très important dans son déclenchement. La possession du Bassin de Briey qui assure aujourd’hui la première place à la métallurgie française après les États-Unis, a beaucoup plus, sa place dans la liste des buts de guerre que le trop fameux principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
La guerre de 1914–1918 fut une ère de grande prospérité pour la métallurgie. Si le problème de l’approvisionnement en matières premières se posa quelquefois tragiquement, la métallurgie n’eut pas à s’inquiéter de l’écoulement de sa production : la guerre, insatiable, absorbait tout ce qu’elle voulait bien lui donner pour ses canons, fusils, mitrailleuses, obus, tanks, avions, cuirassés, sous-marins, etc. Aussi bien, la guerre terminée, la métallurgie connut une crise de réadaptation qui, n’eût été la pauvreté des puissances, eût pu dégénérer à nouveau en conflagration générale à la suite des exigences de la métallurgie française qui entraînèrent l’occupation de la Ruhr.
En dépit de sa production gigantesque, et peut-être à cause d’elle, la métallurgie n’a pas retrouvé son équilibre. La facilité des échanges internationaux qui caractérise notre époque, a poussé la métallurgie à déborder le cadre national pour s’organiser, non pas internationalement, comme on l’affirme trop souvent par ignorance, mais par groupes nationaux. Ainsi le Cartel de l’Acier, de l’Étain, du Zinc.
Si cette nouvelle forme, ou plutôt ce nouveau stade de la concentration réduit les compétitions sur les marchés internationaux (matières premières, débouchés) il ne les supprime pas. À être moins nombreuses, les compétitions n’en sont que plus violentes et le conflit qui en sortira n’en sera que plus facilement universel.
* * *
Ainsi les hommes ont dompté la nature. Par leur génie et leur travail séculaire ils ont arraché ses secrets à la matière inerte et lui ont donné la vie. Par un tragique retour des choses de ce monde, la matière, devenue vivante par la main des hommes, s’est vengée sur eux de l’avoir tirée de son sommeil plusieurs fois millénaire en les y plongeant à sa place.
Fatalité ! disent les uns. Aberration monstrueuse ! répliquent les autres. La métallurgie, si elle sème la ruine et la mort, est capable de créer la joie et la vie.
C’ est à cette dernière tâche que la partie éclairée du prolétariat mondial, lasse d’être la victime de son génie, entend se consacrer. Elle sait que la métallurgie ne soulagera la peine des hommes que lorsque ses matières premières et ses produits jouiront d’une libre circulation dans les artères de la société humaine.
Pour cela, il faut que cesse l’exploitation de l’homme par l’homme. Aussi poursuit-elle la destruction du régime capitaliste et l’avènement du travail libre dans uns société libre. Alors, et alors seulement, l’homme pourra être fier de sa métallurgie.
– A. GUIGUI.
MÉTAMORPHOSE
n. f. (latin metamorphosis)
Les métamorphoses sont des transformations profondes de l’aspect de certains animaux subies au tours de leur évolution depuis leur sortie de l’œuf jusqu’à leur forme définitive d’animal adulte et parfait. Ces transformations paraissent surprenantes en certains cas parce qu’elles s’effectuent assez brusquement sous nos yeux et que chaque forme différente dure un certain temps, comme par exemple dans le cas du papillon vivant tout d’abord sa vie larvaire de chenille rampante avant de se muer en chrysalide et de prendre son vol, mais tous les êtres vivants, sans exception, passent par des transformations aussi étonnantes, depuis la formation du germe qui les engendra jusqu’à leur forme adulte et définitive.
Chaque être actuel, étant le terme d’une longue série de transformations subies par tous ses ascendants partis des formes les plus primitives, résume plus ou moins nettement et brièvement une partie de ces formes intermédiaires, parce que chacune d’elles est le produit des réactions inévitables de la matière vivante en équilibre avec les forces physico-chimiques du milieu. C’est ainsi que la segmentation de l’œuf, la formation des cellules, l’assimilation, l’accroissement, etc., présentent, à peu près, les mêmes particularités dans tout le règne animal. Les premières manifestations de la vie des êtres soumis à des causes semblables se ressemblent donc quelque peu, mais chaque espèce actuelle a sa forme d’équilibre spécifique déterminée par la composition chimique de ses éléments, lesquels, par une suite d’actions et de réactions avec le milieu ambiant, évoluent, se fixent et se cristallisent en une forme ultime constituant l’animal adulte. Si l’être humain passe ainsi par toutes sortes de transformations, celles-ci sont graduelles et continues jusqu’à la formation du fœtus et s’effectuent hors de notre vue, tandis que les métamorphoses sont des transformations apparentes, accélérées et très accentuées. Chez certains insectes la différence entre la jeune larve et l’individu parfait n’est pas très grande et consiste en une différence de taille, ou d’apparition d’ailes. Tels sont les pucerons, sauterelles, criquets, blattes. Par contre les abeilles, fourmis, scarabées, papillons ont, au sortir de l’œuf, un aspect vermiforme et en cet état se montrent très voraces ; une deuxième transformation les mue en nymphe presque immobile avant leur forme finale.
Lubbock suppose que tous les insectes proviennent d’une même forme ancestrale, quelque peu semblable au tardigrade actuel et se rapprochant de l’état larvaire . Ce n’est que leur adaptation ultérieure aux conditions variables du milieu qui les aurait diversifiés et, de fait, la nourriture et la température paraissent avoir une importance considérable sur leur évolution.
D’autre part les têtards de grenouilles, privés de leur glande thyroïde, ou alimentés avec du thymus, grandissent sans jamais se métamorphoser ; mais ils y parviennent à l’aide de l’iode : inversement, si on les alimente avec de la thyroïde, la métamorphose s’effectue plus rapidement que la croissance et les grenouilles restent naines. Des pucerons, normalement aptères, vivant sur des rosiers arrosés avec des sels de magnésium, acquièrent des ailes. Certaines chenilles, vivant habituellement sur le pêcher, transportées sur des acacias se transforment en une espèce voisine de celle vivant sur ceux-ci.
Chaque mue serait ainsi déterminée par des réactions spéciales déterminées par le milieu, s’ajoutant les unes aux autres et le polymorphisme, apparemment volontaire, des abeilles, des termites et des fourmis s’expliquerait assez aisément. Les phénomènes internes des métamorphoses sont entièrement effectués par les globules du sang, fonctionnant comme phagocytes en lesquels se résorbent la plupart des organes, muscles, glandes, etc. pendant la nymphose. Ces globules eux-mêmes doivent subir une modification chimique très caractéristique et leur équilibre nouveau entraîne inévitablement des réactions nouvelles. C’est la période d’histolyse. Pendant la période suivante d’histogenèse, les tissus et organes se reforment et constituent l’être parfait. Les métamorphoses ne sont donc que les effets apparents des modifications chimiques intérieures produites soit par l’évolution même des êtres accumulant d’imperceptibles variations, soit par l’influence directe du milieu extérieur provoquant ces mêmes variations.
Les métamorphoses de certains polypes, semblables à des plantes, en méduses flottantes à forme de cloche munies de tentacules sont assez curieuses mais les plus extraordinaires transformations paraissent réalisées par les Sacculines, sorte de tout petits crustacés vivant en parasite sur le crabe vulgaire. À sa sortie de l’œuf l’être microscopique prend la forme larvaire d’un nauplius, c’est-à-dire un aspect ovale, transparent, avec un œil médian et trois paires de membres munis de filaments. Après quatre mues l’animal, enfermé dans une coquille bivalve semblable à une très petite moule, se fixe la nuit sous de tout petits crabes ; puis, en une cinquième mue, rejetant la plupart de ses organes, sauf les glandes sexuelles, il se change en une sorte de sac appelé kentrogou. En trois mues successives ce sac vivant enfonce une aiguille creuse à, travers la carapace du jeune crabe et par cet étroit canal les cellules informes pénètrent dans leur hôte et là, se développent sous formes de ramifications, envahissent totalement le crabe, depuis les pattes jusqu’aux yeux, mais respectant le cœur et les branchies.
Vivant de l’organisme même du crabe, la Sacculine n’a presque plus d’organe propre et se réduit à quelques muscles, des ganglions nerveux et des glandes sexuelles. L’accroissement du parasite devient tel qu’il perce la carapace de sa victime et fait une énorme saillie au dehors. C’est dans cette partie que se formeront les œufs, lesquels, à leur maturité, se détacheront et recommenceront le cycle des transformations.
Les découvertes ultérieures de la biologie éclaireront d’une façon plus précise le rôle des constituants chimiques de toute cellule et les conséquences morphologiques de leurs modifications créant non seulement les métamorphoses mais encore tous les phénomènes de la vie, y compris ceux de la sénilité et de la mort.
― IXIGREC.
MÉTAPHYSIQUE
n. f. (du grec meta la phusika, Choses en dehors des choses physiques)
Ce terme n’est pas toujours très nettement défini et maints penseurs lui ont donné un sens bien différent. Ainsi tandis que James affirme que :
« La métaphysique n’est qu’un effort particulièrement obstiné pour penser d’une façon claire et consistante. »
Sully Prudhomme dit :
« Il n’y a de métaphysique dans l’être que l’inconcevable. La métaphysique commence où la clarté finit. »
Ce même penseur dit aussi :
« Est métaphysique toute donnée reconnue inaccessible soit au sens, soit à la conscience, soit à l’observation interne, soit à l’observation externe. Cette règle assigne du même coup leur objet aux sciences positives : une science n’est positive qu’à la condition de ne viser que des rapports. »
L’origine du terme paraît provenir du classement effectué par Aristote de ses ouvrages, dans lequel la partie abstractive ne venait qu’après les traités de physique ; mais le terme lui-même, créé par Andronicas de Rhodes qui recueillit les œuvres d’Aristote, n’apparaît qu’ultérieurement dans Plutarque, et n’est formulé en un seul mot que vers le moyen âge, par les grammairiens du temps.
La partie des ouvrages d’Aristote ainsi désignée recherche les principes et les causes premières et comprend la connaissance des choses divines. C’est la conception moyenâgeuse. Kant entendait la métaphysique comme une faculté transcendantale d’établir, à l’aide de principes et des connaissances synthétiques à priori, des propositions synthétiques dépassant le cadre de l’expérience. Pour saint Thomas d’Aquin la métaphysique était la science du surnaturel. Pour Descartes et Malebranche elle s’opposait au spatial et au sensible. Schopenhauer s’exprime ainsi :
« Par métaphysique j’entends toute connaissance qui se présente comme dépassant la possibilité de l’expérience. »
Dans la grande Encyclopédie, il est dit :
« La métaphysique est la science des raisons des choses. Tout a sa métaphysique et sa pratique. »
Paul Janet la définit :
« La science des premiers principes et des premières causes et la recherche dus rapports du sujet et de l’objet, de la pensée et de l’être. »
Ch. Dumas va plus loin :
« Poser quelque chose soit comme existence, soit comme une vérité, c’est selon moi faire de la métaphysique. »
Celle-ci, pour Bergson, est « le moyen de posséder une réalité absolument, intuitivement, sans traductions aux représentations symboliques ».
Fouillée lui donne ce sens :
« Connaissance du réel par l’analyse réflexive et critique aussi radicale que possible, et par la synthèse, aussi intégrale que possible de l’expérience, notamment de l’expérience intérieure, fondement et condition de toute autre. »
Le Dantec précise également le rôle de la métaphysique :
« Je considère comme ressortissant à la métaphysique toute opinion dont la vérification expérimentale est sûrement impossible. »
De ces quelques citations nous pouvons conclure que la métaphysique peut se ramener au moins à deux concepts ; l’un qui comprend l’étude de toutes les choses invérifiables expérimentalement et partant entièrement issues de notre imagination : c’est la métaphysique péripatéticienne et théologique ; l’autre qui relie des faits sensuels connus et expérimentés et par déduction conduit à la connaissance et la compréhension de faits nouveaux par le seul usage de l’intuition. C’est la conception de Fouillée mais il est clair qu’ici il y a confusion entre l’hypothèse scientifique et l’invention métaphysique. Le Dantec dans son ouvrage : « Contre la métaphysique », a nettement démontré la différence considérable qui sépare la métaphysique de la solide et constructive logique déductive appliquée aux expériences scientifiques. Il est évident que la connaissance, dans son fait le plus essentiel, ne signifie pas uniquement documentation, ni accumulation d’expériences, mais encore et surtout utilisation de ces données pour connaitre, à priori, tout phénomène à venir, prévoir l’évolution ultérieure des faits, relier entre eux des effets à leurs causes, trouver l’enchaînement et le développement des choses affectant notre sensibilité.
L’homme façonné par les faits depuis des milliers de siècles porte dans sa structure cérébrale l’empreinte de leur évolution dans le temps et dans l’espace et sa logique n’est que l’ordre même de ces faits, leurs relations entre eux, leur alternance, leur succession, leur durée, etc., etc. Cette perception sensuelle et partielle du monde appliquée à la connaissance générale du monde sensuel peut conduire à des résultats toujours vérifiables puisque cela reste dans le domaine du sensuel. Ainsi donc le raisonnement intuitif quittant l’expérience directe mais s’appuyant sur elle au point de départ peut diriger nos recherches, leur donner un sens précis et sous forme d’hypothèses et de calculs, nous faire découvrir des vérités que l’expérience vérifiera plus tard.
L’astronomie et la physique nous donnent quantité d’exemples de découvertes de cette nature. Kepler trouva par ses calculs sur les planètes, un hiatus entre Mars et Jupiter et ce ne fut que deux siècles plus tard que Piazza découvrit le premier des astéroïdes : Cérès, circulant entre ces deux astres. Leverrier, partant d’un fait positif : les perturbations d’Uranus, entreprit par le calcul la découverte de l’astre causant ces perturbations, en indiqua le lieu précis et l’astronome Gall, de Berlin, le trouva en effet au point désigné. Ce qui montre la valeur du raisonnement et de la logique humaines, c’est qu’en même temps que Leverrier, un autre savant, l’astronome Adam, parvenait en Angleterre au même résultat, tout en ignorant les travaux de son collègue.
L’exemple le plus récent de la sûreté du raisonnement intuitif nous a été donné par Einstein au sujet de la pesanteur de la lumière déviée par les astres, phénomène constaté plusieurs fois depuis, lors de certaines éclipses demeurées célèbres.
L’étendue de notre faculté intuitive est apparemment très vaste et peut nous faire espérer de prodigieuses découvertes sur le mécanisme même de l’univers, et en particulier celui des êtres vivants. Si l’astronomie, la physique, la chimie nous révèlent quelque jour la constitution intime des corps, la biologie peut, sous les efforts géniaux de l’intuition humaine, atteindre la connaissance réelle du phénomène vital et triompher peut-être de la maladie, de l’usure et de la sénilité.
Par son intelligence et sa connaissance de la nature l’homme peut espérer vaincre les forces de l’univers, les asservir à ses fins, augmenter sa durée et sa sécurité.
* * *
La véritable métaphysique ne poursuit point de tels buts. Si la nécessité de prévoir, d’imaginer l’inconnu, de rechercher les causes a créé tardivement la déduction scientifique, notre imagination et notre curiosité spéculative, fruits de ce fonctionnement cérébral, nous ont déterminé à rechercher le pourquoi des choses en vertu de cet anthropomorphisme primitif qui attribue une volonté d’agir à, tout objet.
Le raisonnement scientifique recherche le comment, parce qu’il est, dans son essence même, orienté vers le déterminisme mécanique. La métaphysique recherche le pourquoi des choses parce qu’elle est entièrement dominée par l’idée anthropomorphique d’une volonté dirigeant toute chose, dont il faut deviner la raison agissante sinon les caprices. C’est ainsi que la recherche du commencement absolu des choses, de leur raison d’être, de la cause première sont essentiellement des attributions de la conscience humaine étendue à l’objectif.
L’homme croit, consciemment, produire des commencements absolus par sa volonté et n’être déterminé par rien d’autre que sa raison pure comme le croyait Kant. Il s’imagine être une cause première, une chose en soi, un noumène agissant sur l’objectif ou phénomène.
Puisque, par sa volonté toute puissante, il crée, anime, meut ou détruit ce qui est à son échelle, il suppose qu’à l’échelle universelle un être infiniment plus puissant crée et anime également cet univers. Il est compréhensible que la suppression du pourquoi anthropomorphique supprime radicalement la raison d’être de l’univers au point de vue humain et partant toute divinité, tout but volontaire, tout commencement, toute évolution intentionnelle du cosmos.
Mais il reste d’autres questions qu’il paraît difficile au premier abord de classer soit dans la métaphysique, soit dans l’investigation scientifique. Ce sont les questions concernant la nature et l’essence des choses : matière, énergie, mouvement, étendue, conscience, durée, etc., etc. Pour limiter ici le terrain de la métaphysique et celui de la science il suffit de s’en tenir aux définitions de Le Dantec et de Schopenhauer sur ces deux aspects de la pensée humaine. Par cette méthode nous voyons que tant que les explications sont susceptibles d’expériences et de démonstrations, nous restons dans le domaine sensuel et scientifique. Dès que les explications dépassent l’expérience, et, par leur nature extra-sensuelle, s’opposent à toute vérification possible, nous faisons de la métaphysique.
Notre connaissance étant essentiellement sensuelle, toutes nos explications ou hypothèses scientifiques devront relier des faits entre eux, établir des rapports, des rapprochements, des liaisons, des ressemblances de telle manière qu’il n’y ait jamais d’affirmation basée uniquement sur la foi ou l’imagination et qui ne soit susceptible d’expérience et de démonstration.
Si nous examinons maintenant les concepts de matière, d’énergie, de conscience, nous voyons que, si loin que nous poussions nos investigations et nos explications, nous restons toujours dans le connu c’est-à-dire que nous ne pouvons cesser de douer la matière d’étendue, l’énergie de mouvement, la conscience de représentations, car ce sont précisément par ces caractéristiques qu’elles s’objectivent et deviennent réalité. Autrement dit, ces concepts ne se manifestent à nous que par des propriétés affectant particulièrement notre sensibilité et que nous nommons : mouvement, étendue, conscience, etc. Voulons-nous nous représenter ces concepts hors l’élément sensuel, nous tombons dans la métaphysique qui peut, par deux voies différentes, soit tout expliquer par des mots sans signification et satisfaire ainsi les intelligences puériles avec du verbe pur comme : Dieu, âme, infini, l’être-non-être, etc. ; soit prolonger dans l’inconnu, dans l’extra-sensuel, la connaissance sensuelle et permettre le jeu naïf du sectionnement indéfini d’un point que l’imagination grossit et recoupe sans cesse, sans parvenir à se représenter le moins du monde une étendue qui n’ait ni périmètre, ni milieu. Ici la métaphysique s’appuyant sur une réalité sensuelle ; le morcellement infinitésimal de la matière, prolonge indéfiniment, et au delà du compréhensible et du perceptible, cette perception des choses et croit démontrer ainsi l’existence réelle de l’infini dans la petitesse, comme nous admettons l’infini de l’univers. Mais l’absurdité de la métaphysique est ici manifeste. En effet, si l’infini existe entre deux points, tout déplacement, et partant tout mouvement est impossible car pour passer de l’un à l’autre il faudrait franchir l’infini, ce qui est ridicule, attendu qu’on ne peut véritablement, et d’aucune manière, entrevoir le franchissement de l’univers ; mais, par un des effets inévitables des raisonnements faux, les métaphysiciens mettent alors une borne à cet infini en admettant un Dieu créateur du temps et de l’espace.
La métaphysique s’appuie donc toujours d’un côté sur une réalité sensuelle, de l’autre elle plonge dans le vide des spéculations hasardeuses, fantasques et indémontrables. Elle est donc néfaste pour l’harmonie des humains et cela d’autant plus que, ne pouvant, chez les esprits droits, donner aucune réponse satisfaisante sur la réalité des choses qui ne soit une tautologie ou une divagation, elle essaie de discréditer notre connaissance directe, source de tout notre savoir, en croyant démontrer l’illusion des sens et l’insuffisance de notre expérience pour atteindre la vérité.
Sachant que notre sensibilité est le produit de notre réaction avec le milieu nous devons, au contraire, accorder toute confiance à nos sens, à notre raisonnement, à nos expériences, car ils sont le résultat d’une longue adaptation spécifique et nous font connaitre les synthèses de la substance en mouvement que nous percevons à différentes échelles d’organisation et de condensation, vue à des plans différents, qui pour nous constitue le seul monde qui nous intéresse, car il nous donne la réalité de la joie de vivre.
– IXIGREC.
OUVRAGES À CONSULTER. – ARISTOTE : La Métaphysique – MALEBRANCHE : Entretiens sur la métaphysique. – Emm. Kant : Critique de la raison pure ; Prolégomènes à toute métaphysique future ; Esthétique et dialectique transcendantales, etc. – LIARD : La science et la métaphysique – BROCHARD : Les sceptiques grecs – H. SPENCER : Les premiers principes ; Principes de psychologie – RAVAISSON : La Philosophie au XIXème siècle ; Rapport sur le prix V. Cousin – SAISSET : Le scepticisme – RABIER : Leçons de philosophie – FOUILLÉE : L’avenir de la métaphysique ; Le mouvement idéaliste ; L’évolutionnisme des idées-forces ; La philosophie de Platon, etc. – LE DANTEC : Contre la métaphysique – DERGSON . L’énergie spirituelle, etc. – GUYAU : La genèse de l’idée de temps ; L’irréligion de l’avenir, etc. – LODGE : La survivance humaine – BOS : Psychologie de la croyance – DIDE et JUPPONT : La métaphysique scientifique – DUNAN : Essai sur les formes à priori de la sensibilité – HUME : Traité de la nature humaine – GARNIER : Traité des facultés de l’âme – STUART MILL : Philosophie de Hamilton – LEIBNIZ : Monadologie ; Correspondance avec Clarke ; Nouveaux essais ; Théodicée – BOUTROUX : De la contingence des lois de la nature – BOUILLIER : Le principe vital de l’âme pensante – TAINE : L’intelligence ; Les philosophes classiques – BÛCHNER : Force et matière – LANGE : Histoire du matérialisme – DESCARTES : Discours de la méthode ; Méditations – BOSSUET : Traité de la connaissance – FÉNELON : Traité de l’existence de Dieu – JANET : Les causes finales ; La morale – SECRÉTAN : La philosophie de la liberté – BERTAULD : Introduction à la recherche des causes premières – RIBOT : La philosophie de Schopenhaüer – HARTMANN : La philosophie de l’inconscient – VACHEROT : La métaphysique et la science – CARO : L’idée de Dieu – PLATON : Le Phédon – LAMENNAIS : Esquisse d’une philosophie – A. BERTRAND : De immortalitate pantheistica – P. LEROUX : L’humanité – Jean REYNAUD : Terre et ciel – J. SIMON : La religion naturelle – SPINOZA : Éthique – SCHOPENHAUER : Le fondement de la morale, etc.
MÉTAPHYSIQUE
La métaphysique est un monde dans lequel on ne doit pénétrer qu’avec prudence, en s’entourant de toutes sortes de précautions, si l’on ne veut pas perdre tout bon sens. Nous sommes ici dans le domaine de l’absurde. Ici, l’esprit plane sur les confins de l’absolu. Il se perd dans les nuées. Il erre dans le vide. Il construit des mondes qui ne reposent sur rien, il plonge dans l’irréel et en retire le néant. On se trouve face à face avec ces monstres qui sont l’inintelligible, l’indéfinissable, l’inimaginable, l’indéterminé, l’inconcevable, l’invérifiable, le supra-normal etc. On conçoit que la science positive et la métaphysique ne fassent pas bon ménage, bien que la science positive ne soit guère plus positive qu’elle. La science positive a beaucoup à se reprocher. Son impérialisme finit par devenir insupportable. Ne condamnons pas toute métaphysique ; condamnons ses excès, et reconnaissons que le rêve, l’utopie, l’idéal, l’illusion, sont aussi nécessaires à l’homme que le pain. Ils ont leur réalité. Vous ne pouvez pas supprimer l’hypothèse. Les savants les plus endurcis sont forcés de lui faire une place. Et l’hypothèse, c’est du rêve, c’est de la métaphysique. L’imagination joue un rôle primordial dans l’existence humaine. La spéculation philosophique sert de contre-poids à la spéculation tout court. La métaphysique n’est qu’une forme de la poésie. Elle constitue pour l’esprit humain un allègement, un soulagement. Il a besoin parfois de s’évader en plein ciel, et même, s’il se trompe, il vaut mieux qu’il se trompe généreusement que d’avoir raison platement. L’esprit jette du leste, quitte la vulgarité et la bassesse pour voguer dans l’azur libre. Tout le monde ne peut en faire autant : c’est le privilège d’une élite de vivre de la vie de l’esprit, de renoncer au terre-à-terre. On ne peut pas toujours vivre au sein des réalités : il faut, comme Blanqui dans sa prison, rêver l’éternité par les astres. Ces gens qui ne croient qu’à ce qui tombe sous leurs sens, qui ne jurent que par la matière, sont désespérants. Leur bon sens est un non-sens. Au fond, ils rejoignent ceux qui ne vivent que dans l’irréalité, et dont la métaphysique, au lieu d’être le prolongement de la vie, en est la négation. La métaphysique a malheureusement subi le sort de tout ce qui essaie d’arracher l’homme à son égoïsme : elle est devenue la proie des mystificateurs ; ils l’ont exploitée afin de justifier leur conduite. Au lieu d’être une poésie supérieure, la métaphysique n’a cessé d’être un bavardage ennuyeux, aussi prétentieux que vide sur des sujets quelconques : c’est la plus haute forme du charlatanisme philosophique. Ce qui se débite sous ce nom est un pur verbiage. Sous prétexte de chercher à percer le mystère de l’inconnu – occupation noble et élevée – on n’a fait que l’embrouiller et l’obscurcir. On ne voit goutte dans les élucubrations des métaphysiciens : ce qu’il y a de plus clair là-dedans, c’est qu’ils se moquent de nous. On ne peut prendre au sérieux certains métaphysiciens. Avec eux, on perd contact avec toute réalité, on affirme, on ne prouve pas. On disserte, on ergote : on ne pense pas. On s’appuie sur différentes autorités qui, elles-mêmes, s’appuient sur d’autres, et toutes ces autorités se tiennent par la main et dansent la ronde macabre du néant. La métaphysique ainsi conçue me fait l’effet d’un film où l’on verrait défiler à une allure vertigineuse, à toute vitesse, pèle-mêle, au petit bonheur, dans un désordre indescriptible, se poussant les uns les autres, différents fantômes grimaçants et pervers symbolisant les théories les plus absconses sur Dieu, le Monde, l’Âme, la Matière, l’Infini et l’Indéfini, et autres problèmes insolubles « dans l’état actuel des connaissances humaines », dirons-nous en employant le cliché consacré ; problèmes que les abstracteurs de quintessence ne font que rendre plus obscurs encore, car ils les entourent de ténèbres épaisses, de façon à passer pour des êtres supérieurs en possession de la vérité.
Les métaphysiciens sont de tous les philosophes ceux dont l’esprit va le plus loin dans le domaine de la divagation. Ils doivent bien rire dans leur barbe. Les métaphysiciens ne doutent de rien. Ils affirment avec un aplomb imperturbable n’importe quoi. Leur langage hermétique n’en impose qu’aux amateurs d’obscurité.
La métaphysique groupe dans une armée disparate tous les fanatiques de l’au-delà, mystiques, mages, occultistes, théosophes, tous les pseudo-idéalistes au plumage aussi varié que leur ramage. Elle a pour adversaires peu intéressants les matérialistes, scientistes, mécanistes, et autres libres-penseurs qui ne sont ni plus clairs, ni plus raisonnables, ils font également de la métaphysique. Les premiers nient la matière, les seconds l’âme. Les uns et les autres se querellent, et de leurs querelles jaillit l’obscurité. C’est surtout des métaphysiciens, à quelque école qu’ils appartiennent, qu’on peut dire qu’ils sont des coupeurs de cheveux en quatre. La métaphysique a beaucoup d’ennemis, conscients ou inconscients, mais ses pires ennemis ce sont les métaphysiciens. Ils ont plus fait pour discréditer la métaphysique que tous ses adversaires réunis. Ils justifient par leurs extravagances tous les reproches qu’on lui adresse, leurs exagérations semblent donner raison au matérialisme le plus épais. La bêtaphysique, devrait-on dire pour désigner toutes ces psychopathies. C’est le bon sens qui manque aux métaphysiciens. Entendez par bon sens l’esprit critique.
Quand la métaphysique est une œuvre d’art, toutes les audaces lui sont permises, parce qu’elle sont créatrices. La métaphysique nous arrache alors à l’obsession du médiocre et du terre-à-terre. Elle nous transporte sur les sommets. Elle nous fait vivre d’une vie nouvelle, où tout ce qu’il y a de laid autour de nous est oublié. Elle incarne la poésie la plus profonde, elle constitue la plus haute réalité.
Vacherot, métaphysicien lui-même, disait :
« Les métaphysiciens sont des poètes qui ont manqué leur vocation. »
Nous croyons que les véritables métaphysiciens n’ont pas manqué leur vocation : ce sont de véritables poètes. Le métaphysicien est un poète : qu’il n’ambitionne pas d’autre titre. Qu’il se contente de cette gloire ! Toute métaphysique est Poésie, c’est-à-dire une création où la pensée a autant de part que le sentiment, l’imagination que l’observation, où le monde est transformé et transfiguré ; toute poésie est métaphysique, du moment qu’elle ne copie pas la réalité, et qu’elle parle à l’âme et au cœur. Considérons les métaphysiques comme des systèmes impérieux pour expliquer l’univers, exposés avec plus ou moins d’art et de génie. Loin d’être poètes, nos métaphysiciens sont les plus prosaïques des hommes. C’est la faune métaphysique que nous combattons, c’est la caricature, la parodie du rêve et de l’idéal. Elle nous rend plus précieuse la vraie métaphysique, qui est le droit pour l’esprit de concevoir une réalité plus harmonieuse que la réalité utilitaire. Il n’est point interdit à l’esprit humain de vagabonder loin des sentiers battus, de faire l’école buissonnière hors de la férule des pédagogues. L’utopie n’est point interdite au cerveau, car elle est la vérité de demain. Il y a utopie et utopie. Les bourgeois ont leurs utopies. L’utopie du bourgeois est mesquine : c’est de vivre en paix au sein de sa famille. Le bourgeois croit que sa domination est éternelle. Il ne peut concevoir un monde meilleur, sauf dans l’autre vie. L’utopie est créatrice d’action, elle nous arrache à l’obsession de la réalité présente pour nous faire entrevoir la réalité de demain. Elle est du domaine de la poésie, et la poésie est partout où il y a de la vie. Un esprit uniquement préoccupé par les choses matérielles, accaparé par l’affairisme, s’abstenant de toute incursion dans la sphère des idées, ayant banni le spirituel de la vie, serait un monstre. Et il y a beaucoup de monstres dans la société. Leur originalité consiste à se vautrer dans la boue. Aucun idéal n’ennoblit leur existence. Ce sont des êtres dont rien ne justifie la présence dans le monde, on se demande ce qu’ils sont venus faire sur la terre. Il y a parmi eux des utopistes qui ont fait de l’utopie une chose absurde, ils déshonorent l’utopie. Celle-ci aura toujours, pour l’arracher à la matière de nobles esprits, formant une élite au sein de la société, qui entendent conserver le droit de penser et de rêver malgré l’impuissance et la mort.
Les métaphysiciens sont des poètes. C’est pourquoi ils nous intéressent. Un métaphysicien est un poète qui est avant tout lui-même. Là encore, l’individualisme créateur joue un rôle. Méfions-nous des métaphysiciens qui ne sont pas poètes, qui ne sont que métaphysiciens. La véritable métaphysique est une poésie supérieure, qui traduit le tempérament de son auteur. Une métaphysique est l’expression d’une individualité. Elle est le reflet de son créateur : belle ou laide, elle reflète son visage. Suivant le cerveau qui l’élabore, la métaphysique aboutit, soit à une œuvre de génie, soit à une œuvre de folie.
La métaphysique n’est pas toujours cet « art d’apaiser les antinomies, de calmer les contradictions internes qui sont en nous », dont parle Han Ryner. Elle laisse ce soin à l’esthétique. Lorsqu’elle l’interroge, elle s’expose à moins d’erreurs. Elle est sur le chemin de la sagesse.
Il y a des métaphysiques absurdes. On ne peut les prendre au sérieux. Elles n’ont même pas l’excuse de la poésie. Tant vaut le métaphysicien, tant vaut la métaphysique. Il faut voir dans les métaphysiques des systèmes plus ou moins ingénieux pour expliquer l’origine du monde et de la vie. Sachons goûter toutes les métaphysiques, en restant fidèle à la nôtre. N’excluons aucun système, mais sachons choisir entre tous celui qui choque le moins notre harmonie intérieure.
Nous ne faisons pas assez de métaphysique et nous faisons beaucoup trop de pseudo-métaphysique. La métaphysique ouvre de vastes horizons. Elle est à l’avant-garde de la philosophie. Elle joue le rôle d’éclaireur. Si elle s’égare, le monde entier s’égare avec elle.
Toute science suppose une métaphysique. Sans métaphysique, une science est un corps sans âme. La métaphysique se tient à côté de la science, pour guider ses recherches. Compagne assidue, elle veille sur sa destinée. Nous ne pouvons nous passer d’hypothèses. Elles font progresser la science et la philosophie. Elles créent de nouvelles formes de beauté et de nouvelles raisons de vivre. Polir emprunter encore une définition de Han Ryner, je dirai :
« La métaphysique est le prolongement rêvé de toutes les sciences et peut-être de tous les arts. »
Certains esprits myopes veulent chasser la métaphysique de la vie, c’est-à-dire en exclure toute poésie. Prétention que rien ne justifie ! La métaphysique, ou la poésie – c’est la même réalité – reprend toujours ses droits. On a beau la chasser de la vie, elle y revient sans cesse. Elle est diverse, comme elle. Elle épouse toutes ses formes ; unité, dualité, trinité, pluralité, le métaphysicien a le choix. Qu’il écrive un poème harmonieux, c’est pour nous l’essentiel. Qu’il fasse œuvre d’art, il fera œuvre de philosophie.
On ne peut se passer de métaphysique, mais on peut se passer de certains métaphysiciens. La métaphysique, cette « poésie des profondeurs » – ainsi la qualifie Han Ryner –, durera autant que l’humanité. L’humanité ne peut pas se passer de rêves. Il y a des rêves étroits, comme ceux que font les âmes bourgeoises. Il y a des rêves vastes comme l’univers. Ce sont ces rêves que les vrais métaphysiciens ne cesseront de faire, chaque fois que l’âme humaine se recueillera en présence de l’infini.
La métaphysique, ou ontologie (science de l’être), encore appelée philosophie première, envisage les problèmes de la psychologie, de la logique et de la morale, à un point de vue universel et absolu. Elle s’efforce d’atteindre la réalité cachée sous les apparences. À la métaphysique se rattachent le problème de la valeur de la connaissance, où s’affrontent le réalisme et l’idéalisme, – le problème de la matière, où l’on voit aux prises le mécanisme et le dynamisme, – le problème de la vie qui a reçu différentes solutions, parmi lesquelles l’hypothèse du transformisme, auquel s’oppose le créationnisme, – le problème de l’âme, qui engendre le conflit du matérialisme et du spiritualisme, – le problème de l’existence de Dieu, soulevant la question du dualisme et du panthéisme. D’autres problèmes aussi complexes sont abordés par la méthode métaphysique, qui a ses avantages et ses inconvénients, comme toute méthode. L’origine de la vie, la matière, la force, ont donné lieu à des hypothèses hardies. Dernièrement, les théories einsteiniennes (qui intéressent par certains côtés la métaphysique) ont modifié notre conception de l’univers. Vous savez tout le bien et le mal qu’on a dit d’Einstein. La presse lui a consacré des colonnes entières. L’Institut l’a boudé. Einstein est un génie, un homme, j’allais dire un surhomme, dans la plus noble acception du mot. Cet Allemand est un grand européen par son cœur et son esprit. C’est un grand pacifiste. On a beaucoup écrit en France sur la théorie de la relativité restreinte et généralisée (citons Nordmann, Fabre, Langevin, Becherel, Berthelot, Warnand, Painlevé), modifiant nos idées sur l’espace et le temps, ce qui démontre, une fois de plus, que rien dans la science n’est définitif, et que ce qui fait en somme son intérêt ce sont ces déplacements de perspective, ces perpétuels recommencements, choses consolantes et déprimantes tout ensemble. Les théories einsteiniennes viennent appuyer dans une certaine mesure le mouvement connu sous le nom de pragmatisme auquel ont collaboré, à des titres divers, des savants et des philosophes tels qu’Henri Poincaré, Boutroux, Bergson et William James.
* * *
Un des problèmes examiné par la métaphysique, c’est celui de la valeur de la science. La valeur de la science a été mis en doute par un certain nombre de métaphysiciens, et même par quelques savants. On a accusé la science de ne pas avoir tenu toutes ses promesses. On a eu raison. Pourtant, ne lui a-t-on pas demandé plus qu’elle ne pouvait donner ? La science apporte son explication des choses et s’arrête où commence la métaphysique.
On s’est trop empressé (Brunetière en tête) de proclamer la faillite de la science, au nom d’un pseudo-idéalisme. La véritable science est idéaliste et réaliste à la fois. C’est dans un esprit réactionnaire que s’est engagée la campagne contre la science, que les exagérations même de la science paraissaient justifier. La vraie science ne peut tuer le rêve : le rêve lui est nécessaire ; il l’entraîne avec lui sur les sommets. On a aussi reproché à la science – et ce reproche est le plus justifié – de s’être mise au service des forts, des maitres de l’heure, des grands bandits légaux qui président aux destinées de l’Humanité. La science s’est faite la servante des hommes de guerre et de haine. Au nom de la science, comme au nom de la patrie, on assassine, on tue. Cette religion de la science est néfaste comme toutes les religions : elle a ses fanatiques. Elle a aussi ses martyrs. Les savants ont mis la science au service de la mort, rarement au service de la vie. Ils en ont fait une puissance de destruction, qui n’a pas dit son dernier mot. Cette science « assassin de l’oraison, et du chant, et de l’art, et de toute la lyre », comme disait Verlaine, est la honte de la civilisation. La science au service du crime doit être châtiée et découronnée de tout prestige. À bas la science au service du prétendu droit et de la prétendue civilisation ! Quand on voit les résultats auxquels a abouti la science, il n’y a pas de quoi être fier. La science doit cesser d’être humanitaire pour devenir humaine. La science a favorisé le progrès matériel au détriment du progrès moral. Les progrès matériels eux-mêmes tant vantés sont bien aléatoires. Ils multiplient les chances de mort parmi les hommes, en multipliant les moyens de locomotion, les explosifs, les prisons, etc. La science, dans ses applications multiples, soi-disant pratiques, ne tend qu’à substituer l’artifice à la nature, le mécanisme au sentiment. Une humanité des savants, ou plutôt de pseudo-savants, serait inhabitable. Quant à guérir la souffrance, les maladies, la science s’en préoccupe bien, mais si peu ! La médecine qui, parait-il, a fait d’énormes progrès, n’a guéri ni le cancer, ni la tuberculose, ni la syphilis. Elle n’est même pas capable de soulager les maux de dents. La chirurgie est fière de ses tours de force. Mais les frères coupe-toujours sont le plus souvent des brutes, dont il faut se méfier. Malheur aux patient qui tombe entre leurs mains ! C’est de la chair à chirurgie pour la table d’opération. Les grandes découvertes que font la T.S.F., l’Aviation, etc. ne valent pas un poème écrit avec son cœur par un poète qui a souffert. Il sera beaucoup pardonné à la science pour quelques découvertes utiles, profitables à tous, cependant il faut nous opposer de toutes nos forces à cet esprit scientiste, qui ne voit que la science et ne jure que par elle. Le Homaisisme est une plaie. S’il n’y avait hélas ! que la science pour faire notre bonheur nous serions bien malheureux. Il faut combattre cette confiance aveugle dans la science, qu’engendre des pédants, de froids calculateurs. La science, soit, mais complétée, dépassée, augmentée, renouvelée et humanisée par l’art. Cessons d’opposer l’art et la science. N’opposons à l’art que la science de mort. Le cœur et l’esprit sont faits pour s’entendre ; de leur union naît l’harmonie. Opposer la science et l’art, c’est absurde. Il y a de la science dans l’art, et de l’art dans la science. Il faut être un demi savant ou un demi poète pour opposer la science véritable et la véritable poésie.
* * *
À la métaphysique appartient encore le problème de la liberté et du déterminisme, auquel se rattache celui de la responsabilité, bien mal résolu par les criminologistes et autres psychiatres. Sommes-nous libres ? Sommes-nous responsables de nos actes ? Ne sommes-nous pas plutôt le jouet d’influences de toute nature ; hérédité, milieu, éducation, forces physicochimiques ? Problème redoutable que les religions et les morales ont résolu à leur profit. On ne peut le résoudre à la légère. Il semble bien que le déterminisme explique la plupart des actions humaines. Et cependant, l’individu possède le pouvoir de réagir. Il peut se libérer. Selon qu’on envisage le problème, tout l’édifice social est consolidé ou jeté à terre. La société a-t-elle le droit de punir ? Ne doit-elle pas soigner les criminels, comme elle soigne les malades ? Problème accroché aux précédents, et qui dépend de leur solution.
Que de problèmes ne propose-t-elle pas à nos méditations ! Le monde est-il l’œuvre du hasard ? Les choses marchent-elles vers un but défini, ou bien s’écoulent-elles pèle-mêle, en désordre, sans aucun plan conçu d’avance ? Que sommes-nous venus faire sur ce globe où le hasard nous a fait naître ? Y a-t-Il par delà cette planète passagère d’autres mondes habités ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ? Que sommes-nous ? Existe-t-il une vie future et sous quelle forme pouvons-nous la concevoir ? La mort est-elle le terme de l’existence humaine ? Qu’y a-t-il après la mort ? Questions qui ont fait le désespoir des poètes et des philosophes. Questions peut-être insolubles ? Quand le penseur y songe, son front s’emplit de brume. Cependant, il finit par contempler sans trouble la vérité en face. Pour lui, rien ne commence et rien ne s’achève, tout meurt, tout se transforme. La création n’est qu’un flux et un reflux d’éléments contraires. La métaphysique s’adresse à la science, lui demandant de l’aider à sonder l’abîme. Par elle, elle acquiert quelques certitudes. Ensuite, elle interroge l’éthique. Elle lui pose cette question :
« À quoi bon agir, à quoi bon s’agiter puisque tout est chimère ? Pourquoi vivre ? Pourquoi ne pas se suicider tout de suite, puisque tout passe, disparaît, se dilue... ? »
L’éthique la conduit vers l’esthétique, qui lui apporte sa consolation, la politique et la morale ne pouvant constituer pour l’homme que des refuges illusoires. L’esthétique donne un sens à la vie. S’adressant à la métaphysique, à ses doutes, à ses atermoiements, elle lui confie sa foi :
« Vivre, certes, malgré la souffrance qui est dans la vie, mais vivre en beauté. Lutter contre toutes les laideurs, même si cela est parfaitement inutile. S’affirmer un homme libre, au sein des brutes déchaînées... »
Tout est là. Il n’y a pas d’autre existence pour l’homme. La, métaphysique reprend courage, et elle envisage désormais avec plus de sérénité tous les problèmes que pose la vie.
Le problème de la valeur de la vie, comme celui de la valeur de la science, est du ressort de la métaphysique. Celle-ci le résout, tantôt par l’optimisme, tantôt par le pessimisme. Optimisme et pessimisme ne signifient rien, au fond. La vie n’est ni bonne, ni mauvaise. Ce n’est pas un cadeau bien fameux que nous ont fait là nos parents, nous nous en serions bien passés. Mais puisque ce cadeau nous a été fait, sans que nous ayons été consultés, donnons-lui un sens. La vie vaut-elle la peine d’être vécu ? Pas toujours. Le problème de la valeur de la vie est angoissant. Les jouisseurs déclarent :
« La vie est belle. »
Les malheureux répondent :
« La vie est triste. »
Où trouver un refuge contre les maux d’origine naturelle ou sociale – Ces derniers sont les plus nombreux – qui nous accablent pendant le peu de temps que nous vivons ? Est-ce la religion qui nous apportera un réconfort ? Ne comptons pas sur elle. Plus que la science, la religion a fait faillite. Elle n’a empêché ni la guerre, ni tout autre fléau. Elle n’est pas restée fidèle à l’esprit de son fondateur (C’est de la religion chrétienne qu’il s’agit ici). Tantôt elle résiste au mouvement des idées, tantôt elle s’adapte bien maladroitement aux idées. La religion est une affaire. Les prêtres tiennent commerce d’au-delà. Ils sont vendus au veau d’or ; ils s’agenouillent devant les puissances d’argent ; ils ne courtisent que les riches et, pour donner le change, ils font semblant de s’intéresser aux pauvres.
Trouverons-nous un refuge dans sa rivale, la théosophie ? Les théosophes nous prodiguent d’excel1ents conseils. Mais les belles paroles ne suffisent pas à panser les plaies. Il y a beaucoup à prendre dans la théosophie qui poursuit le bonheur de l’humanité par sa régénération. Enfin, l’esthétique apporte aux hommes un refuge contre toutes les formes de laideur. Elle apaise le tourment de l’individu qui cherche le sens de la vie, qu’il n’a découvert, ni dans la religion, ni dans la morale, ni dans la politique. Elle calme ses angoisses et l’aide à supporter les maux inévitables qui frappent tout être humain. Refuge, hélas ! momentané. Il faut nous résoudre à n’avoir que peu de joie, en échange de beaucoup de souffrance morale et physique. Plus là pensée s’élève, plus l’être est malheureux. Telle est la vie, et il faut se résoudre à souffrir. Il importe, en attendant la mort, de créer autour de nous le plus de joie possible, afin de n’avoir pas vécu inutilement. Celui qui porte un idéal vivant dans l’âme peut vivre sans n’avoir aucun reproche à s’adresser, cet idéal fait à la fois son bonheur et son malheur. Si la beauté, – qui est aussi la vérité et la justice –, l’encourage à vivre, la laideur le touche plus profondément que les hommes dont l’inconscience la perpétue. Cependant semblable existence est bien préférable à l’existence amorphe du troupeau qui n’a jamais réfléchi à quoi que ce soit.
– Gérard DE LACAZE-DUTHIERS.
MÉTAPHYSIQUE (selon le socialisme rationnel)
Le livre que vient de publier M. Jules de Gaultier sur la sensibilité métaphysique, entrevue ou comprise sous le prisme déterministe du matérialisme historique nous a incité à faire connaître ce que le Socialisme Rationnel entend sous le même vocable.
Si, pour M. J. de Gaultier et la plupart des philosophes passés et présents, la métaphysique apparaît comme suprême efflorescence de la matière qui, à travers les espèces et les âges, trouve son épanouissement dans l’Humanité en s’appuyant sur les théories de Hégel relatives à la ruse des idées amenant à concevoir la possibilité de la mutation de quantité en qualité, Colins et son école philosophique et socialiste, se refusent à admettre, comme scientifiquement démontré le processus métaphysique qui va de l’atome au minerai, du minerai à la plante, de celle-ci au règne animal et, par suite, à l’homme tout entier. Si, pour M. J. de Gaultier comme pour Colins et son école il existe une sensibilité métaphysique, il faut convenir qu’elles sont d’essence différente. Il est cependant curieux et intéressant de constater que, partant de prémisses différentes, nous arrivons, d’une manière relative, au système moral dualiste que nous exposons depuis 1842. Nos philosophes modernes se sont aperçus qu’avec l’unité de nature il est impossible de concevoir l’idée de liberté autrement que comme une mécanique dirigeante, celle de l’égalité comme un stupide nivellement du reste impraticable, celle de la fraternité ou solidarité que comme un instrument de domination du fort sur le faible. Nous sommes d’accord sur les mots sensibilité métaphysique et non sur les idées que ces mots expriment et représentent. Les uns appellent métaphysique la science qui vient après la physique ; d’autres la qualifient : théorie de l’abstraction.
Pour le socialisme rationnel la métaphysique est l’opposé de la physique ; le non-physique, l’immatériel, le réel en tant qu’immuable et non-phénomène. Dès lors, la science sociale établit rigoureusement que la métaphysique est le domaine moral, celui du raisonnement, de la liberté, de la vérité, de la réalité. Le principe fondamental de la morale, de la liberté du raisonnement etc., est la sensibilité immatérielle réellement métaphysique. Rien d’identique entre les conceptions du socialisme rationnel et les Thèses de M. J. de Gaultier. Celui-ci en écrivant son livre dans un langage où les mots suivent la loi du transformisme, subissant des mutations comme les espèces, nous présente une métaphysique de l’instinct qui s’épuise jusqu’à l’intelligibilité.
Ce n’est pas le lieu de discuter minutieusement, par l’analyse, les thèses de M. J. de Gaultier. Notre devoir est de donner un raccourci de la thèse métaphysique telle qu’elle nous parait se dégager de la Science Sociale de Colins et qui est la nôtre. Pour la compréhension facile de ce qui va suivre nous appellerons métaphysique : les mathématiques des réalités. À ce sujet, Liebnitz a dit :
« Si quelqu’un voulait écrire en mathématicien dans la métaphysique ou dans la morale, rien ne l’empêcherait de le faire avec rigueur... Je crois que, si on l’entreprenait comme il faut, il n’y aurait pas sujet à le regretter. »
En général, les philosophes s’élèvent contre ce qu’ils appellent l’insoutenable prétention de vouloir appliquer à la philosophie la science rigoureuse des mathématiques. Réfléchissons qu’en dehors des sciences exactes il ne peut y avoir, en morale, que des à peu près. C’est donc la que doit se trouver la vérité qui importe le plus, la vérité sur laquelle nous devons rendre toute contestation impossible, avant de passer à ce qui n’en est qu’une conséquence. Il est superflu d’ajouter qu’une vérité ne peut et ne doit être confondue avec l’illusion plus ou moins empreinte de mysticisme.
N’est-il pas évident que, si nous ne savons réellement ce que nous sommes, et comment nous devons agir pour notre bien, tout comme pour celui de la société, à quoi nous serviraient, sous le point de vue moral ou social les sciences physiques avec leurs incessants et admirables progrès ? On peut en dire autant des sciences exactes avec leurs indubitables théorèmes. Mais on peut les appliquer pour opérer le mal comme pour faire le bien. Si l’ordre moral n’existe pas, s’il n’est d’autre ordre que l’ordre physique, nous n’avons pas de critérium du bien et du mal et nous ne pouvons distinguer les sciences, l’une de l’autre sans crainte de nous tromper.
Le défaut d’une règle morale dont la réalité n’est pas démontrée rationnellement nous livre sans défense à l’entrainement des passions. Les événements sociaux qui seraient l’opposé de ce qu’ils sont si la question morale était connue et en voie de réalisation, ne nous inciteraient pas à suivre les uns les autres, à troubler l’ordre social et à créer ou maintenir le mal que nous paraissons combattre. Le désordre et le despotisme financier de notre époque, qu’un empirisme volontaire entretient, feraient place à une société harmonique où chacun recevrait selon ses œuvres. En résumé, la méconnaissance du droit, l’ignorance de la métaphysique, l’entraînement vers un faux raisonnement sont autant de fauteurs de misères, d’exploitation de l’homme fort sur l’homme faible, de la ruse, comme dit Hégel, sur la loyauté ; c’est-à-dire de l’immoralité de la morale de notre époque.
La question sociale reste toujours une question d’honnêteté scientifique et de vraie moralité. La connaissance de la métaphysique vraie pourra, seule, opérer la rénovation sociale dans le domaine intellectuel aussi bien que dans le domaine économique.
– Elie SOUBEYRAN.
MÉTAPOLITIQUE
n. f. et adj. (de meta, et politique ; en dehors, au-dessus de la politique)
Ce néologisme paraît avoir été employé pour la première fois dans les documents de la République supranationale (voir supranational). Union mondiale d’individus contre les tyrannies nées de la fiction des intérêts nationaux.
H.-L. Follin, initiateur de cette communauté définit ainsi le mot « Métapolitique » en tant que substantif :
« Ce qui dépasse le domaine de la politique en le transformant ; la recherche et le service de l’intérêt public en dehors, au dessus et au delà de l’art et de la Science politique. Exemple : la Métapolitique supranationale : Philosophie de l’intérêt public qui s’élève au-dessus des nations et caractères nationaux et qui dépasse la politique. »
« Le mot « politique » justifie son étymologie en ce qu’il évoque l’intérêt public, que les anciens ne concevaient pas hors des limites de la Cité ; mais il a débordé son origine, et sa signification actuelle la plus certaine est celle qui caractérise l’emploi de la force : force des armes, de la loi, du chef ou du nombre ; ou l’emploi de l’habileté, soit aux fins de la poursuite de l’intérêt public plus ou moins limité, soit même à toutes autres fins. Le domaine politique est spécifiquement celui des États et des Gouvernements, détenteurs de la force par laquelle ils peuvent imposer leur volonté, sauf, pour économiser la dépense de force, à faire accepter ces volontés par leur habileté. »
« Le néologisme « Métapolitique » justifie donc sa double racine, en ce que les buts de la Métapolitique restent la recherche et le service de l’intérêt public généralisé (celui de la cité universelle), mais qu’elle repousse les moyens de la politique, substituant rigoureusement la persuasion à la force et la sincérité à l’habileté. »
L’adjectif « métapolitique » signifie : ce qui a trait à la métapolitique.
La République Métapolitique supranationale a pour but, comme nous l’avons dit plus haut, de combattre les tyrannies nées de la fiction politique d’intérêts collectifs nationaux et, éventuellement, internationaux. Elle veut défendre contre ces tyrannies les droits primordiaux des individus qui se placent sous sa sauvegarde, notamment le droit de ne pas tuer et apprendre à tuer.
Cette Union est purement morale et spirituelle. Elle est apolitique, ne poursuivant la conquête d’aucun pouvoir ni d’aucun prestige matériel, et répudiant jusque dans son fonctionnement intérieur toute velléité de contrainte et de souveraineté absolue, même d’une majorité.
Elle est antipolitique, en ce double sens : 1° qu’elle combat chez les institutions politiques cet esprit de domination coercitive et de souveraineté absolue qu’elle répudie pour elle-même ; 2° qu’elle a pour but de substituer, pour la protection de la sécurité et des libertés essentielles de ses membres en particulier, et de tous les individus humains en général, une autorité morale et spirituelle à celle de toutes les puissances politiques matérielles.
Enfin elle est surtout métapolitique, en ce qu’elle dépasse toutes les conceptions et organisations politiques ; et doit, dans sa sphère d’action, les dominer en les plaçant sous son propre contrôle moral.
La philosophie métapolitique supranationale vise donc à l’abolition de l’État sous son aspect tyrannique ; elle s’apparente par là, dans une certaine mesure, aux conceptions anarchistes. Elle se distingue pourtant de celles-ci, en ce qu’elle ne combat pas l’idée de l’État en soi ; mais elle n’admet cette forme de l’organisation humaine que si elle se limite à un rôle purement administratif et juridique, demeurant au service des individus sans les dominer.
Ceux-ci doivent être d’ailleurs libres de choisir l’État administratif et juridique auquel ils entendent se rattacher, ou de renoncer tout à fait à la qualité de citoyens d’un État quelconque.
Selon H.-L. Follin, il serait désirable que lorsque les États seront ainsi transformés, il soit maintenu entre les individus désireux de se protéger contre le retour offensif de la tyrannie politique, un lien moral métapolitique ; ils formeraient une Cité suprême ou Métapolis. Cette Cité ne comporterait aucun culte, emblème, ni symbole religieux ou patriotique ; aucune armée, ni aucun tribunal jugeant les faits et gestes de ses membres. La protection, par des moyens métapolitiques, des droits essentiels de ces derniers serait la seule fonction des représentants de cette Cité.
On voit donc les tendances libertaires, ou tout au moins autarchistes, qui se manifestent dans cette doctrine nouvelle et originale.
La devise des citoyens supranationaux est :
« Laissons à César ce qui appartient à César, et rendons à l’homme ce qui appartient à l’homme. »
– René VALFORT.
MÉTAPSYCHIE
n. f. (de mêta, en dehors, au-delà et psykhé âme)
On sait la vogue qu’obtinrent, à la fin du XIXème siècle, et au début du XXème, le spiritisme, l’occultisme, l’étude des phénomènes supra-normaux en général. Mais à une constatation des faits, rendue souvent défectueuse par une crédulité sans borne, s’ajoutaient des hypothèses explicatives si manifestement enfantines que tout homme instruit et solidement équilibré ne pouvait s’empêcher d’en sourire. Aussi certains chercheurs d’esprit plus positif entreprirent-ils de constituer une science nouvelle, la métapsychie (au-delà du psychisme), étrangère a toute préoccupation théologique et métaphysique, qui traiterait le merveilleux d’après les méthodes admises par le biologiste ou le physicien et, délaissant les théories spiritualistes, se cantonnerait sur le terrain de l’expérience positive. Un peu partout l’on rencontre aujourd’hui des Instituts et des revues métapsychiques, d’innombrables volumes ont déjà paru sur cette branche du savoir humain et des Congrès réunissent, de temps à autre, ses partisans les plus connus.
L’idée était bonne qui présida à la naissance de la métapsychie ; elle a provoqué des travaux dont plusieurs ne sont pas dénués de mérite, et nous ne mettons pas en doute la bonne foi des quelques vrais savants qui s’en sont occupés. Malheureusement, maints adeptes de la nouvelle science n’ont point dépouillé les préoccupations théologiques qui étaient les leurs ; en fait ils n’ont étudié les phénomènes supra-normaux que dans le but secret de parvenir à étayer sur des bases plus solides les chimères de la philosophie spiritualiste. Inconsciemment ou non, ils déforment donc les faits dans le sens de leurs théories, oublient de mentionner ceux qui les contredisent manifestement et s’empressent de parler d’âme ou d’entités spirituelles, lorsque la cause productrice n’apparaît pas du premier coup. Certains ne reculent point devant les faux les plus éhontés. Un livre parut, voici quelques années : « Le médium Mirabelli ; ce qu’il y a de vrai dans ses « miracles », sa médiumnité discutée et prouvée », dont la Revue Métapsychique donna un compte-rendu. Mirabelli était un médium brésilien ; les faits avaient eu lieu « en plein jour, en public » ; 72 médecins avaient signé le rapport où ils étaient relatés. Renseignements pris, Mirabelli n’avait jamais fait parler de lui au Brésil, et l’on ne put découvrir ni les 72 médecins, ni les 555 témoins qui s’étaient portés garants des merveilles accomplies par le prodigieux thaumaturge. Les Annales des Sciences psychiques publièrent un récit qui devint rapidement fameux. Une dame avait rêvé qu’un corbillard s’arrêtait devant sa porte et que son conducteur lui adressait ces paroles : « Madame, êtes-vous prête ? » Or, quelques jours plus tard, elle se disposait à monter dans l’ascenseur d’un grand magasin, de Chicago, quand elle reconnut le conducteur du corbillard dans l’homme préposé à l’ascenseur et, pour comble, ce dernier ajouta : « Madame, êtes-vous prête ! » D’où recul de la dame, qui refusa de monter. Heureusement pour elle, car la cage s’écrasa sur le sol quelques instants après. Mais une seconde version circula bientôt : la scène se serait déroulée à Paris non à Chicago ; le rêveur était un prince hongrois, non une dame américaine. Une enquête poursuivie, tant à Paris qu’à Chicago, prouva qu’aucun fait de ce genre ne s’était passé. Une sérieuse critique d’un grand nombre de phénomènes supra-normaux, colportés par des fourbes et admis par l’inépuisable crédulité populaire, donnerait des résultats de même ordre. Bien peu de récits merveilleux subsisteraient, et ceux que l’on conserverait, après contrôle, auraient perdu le caractère surnaturel que la légende leur avait complaisamment prêté. Cette adresse, trop grande pour être honnête, elle éclate à propos des prophéties que des voyantes célèbres se croient tenues de débiter, à l’occasion du premier de l’an. Jamais leurs vaticinations ne cadrent exactement avec la réalité ; pourtant elles se bornent à des affirmations vagues qui laissent beaucoup de jeu aux fantaisies de l’interprétation, ce sont des thèmes assez généraux pour s’appliquer à un grand nombre de faits qui se répètent souvent. Au cours de douze mois, il y aura toujours sur notre globe, soit des morts célèbres, soit des procès retentissants ; et malheureusement, dans l’état actuel, pas besoin d’être prophète pour déclarer que les hommes se battront sur l’un ou l’autre coin de la planète : « Voici venir (disait Mme de Thèbes, dans son almanach de 1914), après 1913, année aurorale, voici venir 1914 (du 21 mars 1914 au 20 mars 1915), l’année fulgurante, année des beaux gestes et des grands héroïsmes. Nous serons toujours dans le cycle de Mars, mais en conjonction avec Saturne, au summum, pour ainsi dire, des fatalités du sort, les plus graves, les plus décisives. Année heureuse entre toutes cependant pour nous, dont les cœurs se sont mis à battre pour les grands idéals, sauveurs et régénérateurs des peuples ! malgré le sang, malgré les larmes. Année glorieuse parmi les glorieuses du passé de la France ; année de discorde puis de concorde ; année de haine puis d’amour ; année de déchirements puis d’entente entre les peuples européens et d’autres grands peuples. Les temps sont accomplis, nous touchons aux moissons après tant de semailles où, si souvent, le bon grain tomba sur le sable ou fut emporté par le vent.
« Quel renouvellement d’hommes dans le monde ! Quel appétit de formes nouvelles !... Entendez bien que je ne dis pas que tout, en un moment, se trouvera accompli ; je dis seulement que les choses vont s’accomplir. Douze mois ne sont rien dans la marche du temps. C’est assez cependant pour que se dessine le chemin du destin. 1914 suffira à nous montrer la naissance d’une Europe nouvelle, d’un état d’esprit nouveau, d’une fulguration du réveil de l’idéal, d’un besoin d’amour et de paix pour les grands espoirs et les grands labeurs, et ce sera par le retour au culte du passé, de ce qu’il eut de meilleur, que nous serons encore une fois améliorés, sauvés, régénérés. La paix sortira de la guerre, et ce qui est proche s’arrangera dans la crainte de ce qui est lointain ; l’Europe se consolera de l’ébranlement de l’Asie... » Quelle bouillabaisse, que de vieux clichés, et pourtant, malgré une indéniable adresse à mêler les contraires, quelle preuve accablante de l’ignorance où se trouvait Mme de Thèbes d’un avenir très prochain ! Année heureuse entre toutes 1914 année d’entente entre les peuples et qui devait voir un réveil du besoin d’amour et de paix pour les grands labeurs ! On croit rêver ; heureusement pour les pythonisses, le peuple oublie avec une déconcertante rapidité, et les plus cinglants démentis infligés aux prophéties dont on gargarise sa crédulité ne sauraient avoir raison de son inextinguible besoin de merveilleux. Pour n’être pas agrémentées de formules astrologiques, les vaticinations du général X... , rapportées par R. d’Arman, dans Les Prédictions sur la fin de l’Allemagne, n’en sont pas moins pleines de mensonges. « La France, déclarait le général, déjà désolée par les factions, serait alors envahie et dans la nécessité de se défendre avec toutes ses ressources pour ne pas être ruinée, démembrée, asservie. Les égarements de cette vieille terre d’honneur et de foi étant alors punis, Dieu se souviendrait de l’empire de Saint-Louis et de Charlemagne. Il tournerait sa justice contre l’avidité et la malice des superbes, qui avaient juré le renversement du royaume très chrétien. Un premier appel aux armes n’aurait pas sur la nation un effet décisif ; mais un second appel est entendu. L’ardeur de la croisade se ranime comme au XIIIème siècle. Le révélateur exhibe la découverte d’un engin de guerre formidable. L’enthousiasme est à son comble. Neuf jours après les démonstrations de l’engin puissant, une affaire s’engage avec l’ennemi. L’avantage demeure aux Français. Le général chef de ces derniers, hardi, prudent, religieux, doué en tout d’éminentes qualités, ne dédaignant pas les bons conseils se trouve à la hauteur de la situation. Tout d’abord, les ministres sacrés avaient été appelés sous les armes, mais sur l’avis de l’homme inspiré, ils sont laissés dans leurs foyers pour consoler les populations déjà si désolées des malheurs de l’État. L’agitation est extrême, tout change de face aussi. Les cœurs ouverts à l’espérance sourient à la joie d’une rénovation générale. Cependant, le plus pressé est de balayer l’étranger de notre territoire. La veille d’une bataille décisive, les Italiens osent réclamer Nice et se mettent en marche sur Lyon. Apprenant la défaite de leurs Alliés, ils repassent la frontière. Une nouvelle bataille se livre, les chances sont douteuses un moment mais c’est aux armes de la France que reste la victoire. L’étranger a 80.000 hommes hors de combat. Trois de ses armées reculent par des chemins différents. Metz est délivré, le Rhin est passé ; la coalition est détruite, la domination germanique finit. La prépondérance de la France est rétablie. L’Europe se réorganise. La Pologne obtient sa nationalité. »
Les erreurs foisonnent dans ce morceau, inspiré au général X... par le dieu de Charlemagne et de Saint-Louis ; et comme cette bien-pensante prophétie vous a des allures religieuses et politiques ! Son auteur était réactionnaire, voilà le seul renseignement qui s’en dégage avec une clarté parfaite.
Elles abondent, d’ailleurs, les prédictions de ce genre, véritables machines de guerre, dont le but évident est de magnifier l’autel et le gouvernement, quand il ne s’agit pas de préparer les esprits simplistes à une guerre ou à un coup d’État. On dit que de 1914 à 1918, voyantes, cartomanciennes etc., reçurent, à Paris, l’ordre impérieux d’annoncer la victoire française, sous peine de voir fermer leur cabinet. La fameuse Mme Lenormand n’affirmait-elle pas que « la guerre serait de courte durée », et ceci en 1913 ! Voilà qui doit retenir l’attention des indiscrets qui veulent connaître les secrets desseins des gouvernants, à l’heure où les prophéties éclosent dans le cerveau des devins en renom.
S’agit-il d’apparitions fantômales, de photographies transcendantales, de rayonnement magnétique, de lévitation à distance d’objets matériels, etc. la défiance ne saurait en rien diminuer. Car l’opinion des psychistes officiels n’est point faite pour rassurer ; constatant que le nombre des médiums diminue singulièrement depuis que le contrôle devient plus sérieux, ils voudraient que l’on se montrât moins sévère à l’égard des fraudeurs pris en flagrant délit. F. Niard écrit :
« Je ne comprends pas que l’on rejette, sans rémission, des médiums qui semblaient avoir réellement une valeur parce qu’on les a pris en flagrant délit de fraude. L’expérience m’a appris que tout médium à effet physique fraude, quel que soit le monde auquel il appartient, quelle que soit sa valeur morale et intellectuelle – et il fraude d’autant plus que le milieu où il opère le soupçonne, croit à la fraude. – La suggestion joue un rôle indéniable dans l’obtention du phénomène. Or, que sont devenus par exemple des médiums tels que Carancini, et plus récemment Erto ?... En rejetant à tout jamais des médiums tels que Erto, les savants métapsychistes agissent comme les professeurs de Sorbonne qui ont examiné Eva et Guzik. Ils ont cru à la fraude et s’en sont désintéressés totalement. Pourtant, Eva et Guzik étaient indéniablement des médiums et l’ont prouvé dans d’autres milieux. Les médiums sont trop précieux et trop rares pour ne pas essayer de tirer parti de ceux que nous avons découverts ; même si beaucoup de scories se mêlent au pur métal. » Soyons donc indulgents pour ces pauvres médiums, ne les contrôlons pas de trop près, si nous voulons éviter les fraudes, et gardons-nous de les enlever au milieu où ils procèdent en toute liberté, pour les transplanter dans un laboratoire ou une salle de société savante ! Price écrit, à propos du médium Léonore Zugün : « Les phénomènes de télékinésie, dont nous fûmes témoins au Laboratoire National, n’étaient pas si importants que ceux que nous pûmes contempler à Vienne. Il en fut exactement de même avec Willy Schneider. Dans son pays, il fournit des phénomènes magnifiques ; à Londres, les phénomènes étaient plus faibles. Je ne puis imaginer autre chose, sinon qu’il se produit un changement psychologique de ces médiums exotiques, lorsqu’ils quittent leur pays. Il est possible que le fait d’être éloignés de leurs foyers – séparés de leurs amis et parents – ou l’étrangeté du nouvel entourage puisse avoir une certaine influence qui cause l’inhibition du phénomène. »
Le Dr Osty a fait des constatations identiques ; même dans le laboratoire de l’Institut Métapsychique de Paris, où le candide et somnolent professeur Richet signe à son réveil toutes les relations qu’on lui présente, d’excellents médiums perdent une bonne partie de leurs moyens. Avant eux, Alex Aksakof avait déjà déclaré, dans Animisme et Spiritisme, que la condition essentielle pour obtenir de bons résultats médiumniques c’est « un milieu approprié », que « tout dépend du milieu ». Or, si l’on observe que la salle où apparaissent les fantômes doit être plongée dans une obscurité totale ou tout au plus éclairée par une faible lueur rouge, reconnaissons que les fraudes deviennent étrangement faciles, quand le médium est entouré de parents et d’amis, disposés par avance à jouer le rôle d’esprits désincarnés. Aussi, que de supercheries grossières apparurent, des que des assistants moins crédules s’avisèrent de contrôler ! C’est la fameuse Albertine, attachée avant l’expérience dans un sac plombé, qu’un homme résolu empoigne, croyant saisir l’apparition ectoplasmique. Sortie du sac, malgré des précautions qu’on croyait sérieuses, Albertine glissait comme une ombre authentique, avec une moustiquaire sur la tête. Un autre médium, qui défrayait depuis longtemps les chroniques métapsychiques, cachait tout simplement une bande de gaze qui, dépliée avec adresse, passait pour un ruban ectoplasmique. Gardée dans son jardin secret, la gaze, par hasard, tomba en plein jour ; ce fut la fin d’une carrière déjà brillante. Feuilles de papier, ampoules électriques, pierres à briquet, maniées avec dextérité et discrétion, suffirent à bien d’autres pour s’extérioriser ; elle serait d’une longueur impressionnante la liste des médiums qui virent, après une impunité parfois longue, leurs trucs dévoilés. N’oublions pas celui-là, dont les mains étaient tenues par deux assistants, dans une salle obscure, et qui parvenait, l’habile homme, à dégager subrepticement sa main de l’étreinte d’un contrôleur pour lui donner à tenir celle du contrôleur voisin. On pense s’il se permettait de spirituels attouchements sur les joues et le menton des messieurs à portée de son bras. Une illumination inattendue de la salle mit en évidence les facéties de cet évocateur des esprits. L’affaire de Mantes est de fraîche date ; et l’on ne peut avoir oublié combien de pauvres dupes sur la foi de photographies transcendantales, se crurent environnés de trépassés, qui n’étaient que des mannequins adéquatement costumés.
Quant aux appareils construits pour déceler le fluide vital, aux déviations d’un pendule ou d’une aiguille, on a démontré de façon péremptoire que ces derniers se produisent grâce à l’électrification du verre qui les environne. Prenez une ampoule électrique dans les mains et frictionnez-la vigoureusement, elle apparaîtra bientôt lumineuse, si l’on se tient dans une pièce obscure ; d’une luminosité dont l’intensité dépendra du vide plus ou moins complet de l’intérieur. Effet du fluide, déclaraient les amateurs de merveilleux. Hélas ! on prouve aujourd’hui qu’il s’agit là d’un simple phénomène d’électricité statique. L’attraction par le doigt d’un léger pendule, placé dans un tube de verre (fait d’action à distance ou de télékinésie selon les métapsychistes), résulte de même d’une électrisation ; un chercheur consciencieux, Mondeil, l’a établi de façon définitive. Même constatation touchant l’aiguille d’appareils qui décelaient, disait-on, la présence du fluide vital :
« Le frottement du verre qui entoure cette aiguille – ou comme je l’ai dit ailleurs, sa manipulation répétée à main sèche – suffit à déterminer par induction, les déviations considérées. Cela d’autant plus facilement que le système est plus sensible. La chaleur, toutefois, ajoute à l’électrisation et peut la compléter lorsqu’elle est résiduelle. La complexité de l’équipage intérieur ne change rien au processus. » (Mondeil)
On conçoit dès lors la demande de nombreux savants qui, pour prendre au sérieux les phénomènes métapsychiques, voudraient que l’on allumât les lampes, dans la salle où ils se produisent, que l’on vît et que l’on touchât même et surtout lorsqu’il s’agit d’ectoplasme et d’apparitions de défunts.
Mais longtemps une crédulité béate permit d’écouter, comme vérités certaines, des divagations insensées. S’il s’agissait de faits survenus dans des régions lointaines, où tout contrôle était impossible, le merveilleux prenait des proportions fantastiques. Sur les fakirs en particulier, que n’a-t-on pas dit ! Rappelons quelques-uns des prestiges rapportés par des voyageurs. Le docteur Hentsold raconte :
« Le fakir prit un large plat de terre, y versa quatre à cinq litres d’eau et le tint d’aplomb sur sa main gauche, tandis que l’autre main était élevée à la hauteur de son front. Tout à coup, le plat diminua de volume a vue d’œil et devint de plus en plus petit, si bien qu’on ne pouvait plus l’apercevoir qu’au moyen d’un verre grossissant. Enfin il disparut complètement. II fallut, pour opérer cette étonnante diminution de volume et cette disparition totale, environ une minute et demie. Nous allions nous retirer, croyant la séance terminée, lorsque soudain, nous vîmes apparaître un petit point noir, pas plus gros qu’un grain de sable, ce point noir grandir sans qu’on puisse dire comment cela pouvait se faire, et en moins d’une autre minute, le plat de tout à l’heure, d’un pied de diamètre, rempli d’eau jusqu’au bord et du poids d’au moins quinze livres, reparut à nos yeux. »
Hentsoldt assista, un autre jour, au miracle de la corde suspendue en l’air :
« Le yogi prit une corde de quelques pieds de long et d’un pouce d’épaisseur, à peu près. Il tenait un bout de la corde dans sa main gauche, tandis qu’avec sa main droite, il lança l’autre bout en l’air. La corde, au lieu de retomber, resta suspendue en l’air, même après que le yogi eut retiré son autre main ; elle semblait avoir la consistance et la rigidité d’une colonne. Alors le yogi la saisit avec les deux mains, et à mon grand étonnement, il se mit à grimper le long d’elle, suspendu en dépit des lois de la gravité, alors que le bout extrême de cette corde était à au moins cinq pieds du sol. À mesure que le yogi s’élevait en grimpant, la corde semblait s’allonger au-dessus de lui en même temps qu’on ne la voyait plus au-dessous de lui, et il continua de grimper jusqu’au moment où on cessa de le voir. Je ne pouvais plus distinguer que le turban blanc du yogi et un tout petit bout de l’interminable corde. À ce moment, mes yeux ne purent supporter l’éblouissante lumière du ciel et, lorsque je m’efforçais de regarder encore une fois, le yogi avait complètement disparu. »
Nous trouvons, sous la plume d’Osborne, officier de l’armée anglaise, le récit suivant de l’enterrement d’un fakir endormi :
« À la suite de quelques préparatifs, qui avaient duré quelque temps et qu’il répugnerait d’énumérer, le fakir déclara être prêt à subir l’épreuve. Le maharadjah, le chef des Sikhes et le général Ventura se réunirent près de la tombe en maçonnerie construite exprès pour, le recevoir. Sous nos yeux, le fakir ferma avec de la cire toutes les ouvertures de son corps qui pouvaient donner entrée à l’air, en exceptant sa bouche, puis il se dépouilla de ses vêtements ; on l’enveloppa alors dans un sac de toile, et, suivant son désir, on lui retourna la langue en arrière de manière à lui boucher l’entrée du gosier. Après cette opération, le fakir tomba dans une sorte de léthargie. Le sac qui le contenait fut fermé et un cachet fut apposé par le maharadjah. On plaça ensuite ce sac dans une caisse de bois cadenassée et scellée, qui fut descendue dans la tombe ; on jeta une grande quantité de terre dessus, on foula longtemps cette terre, on y sema de l’orge ; enfin, des sentinelles fluent placées tout à l’entour, avec ordre de veiller jour et nuit. Malgré ces précautions, le maharadjah conservait des doutes ; il vint deux fois, dans l’espace de dix mois, pendant lesquels le fakir resta enterré, et il fit ouvrir devant lui la tombe ; le fakir était dans le sac, froid, inanimé, enfin tel qu’on l’y avait mis. Les dix mois expirés, on procéda à l’exhumation définitive. On ouvrit, en notre présence, les cadenas, on brisa les scellées et, après avoir enlevé la caisse hors de la tombe, on retira le fakir ; nulle pulsation au cœur, point de respiration, le sommet de la tête était resté seul le siège d’une chaleur sensible qui pouvait faire soupçonner la présence de la vie. Alors une personne lui introduisit très doucement le doigt dans la bouche et replaça sa langue dans sa position normale ; puis on le frictionna, on versa sur tout son corps de l’eau chaude ; petit à petit, la respiration, le pouls se rétablirent, et le fakir se leva et se mit à marcher en souriant. Il nous dit que, pendant son séjour sous terre, il avait fait des rêves délicieux, mais que le réveil était toujours très pénible ; avant de recouvrer sa connaissance, il avait, dit-il, des vertiges. Cet homme est âgé de trente ans (en 1888), sa figure est désagréable et a une certaine expression de ruse. Il s’entretint longuement avec nous et nous offrit de se faire enterrer une autre fois en notre présence. Nous le prîmes au mot et nous lui donnâmes rendez-vous à Lahor. Après avoir choisi un endroit convenable et fait construire une tombe en maçonnerie et une caisse bien solide, munie d’un système de cadenas et de clefs fort sûr, nous fîmes venir le fakir ; il arriva en protestant du désir qu’il avait de nous prouver qu’il n’était nullement un imposteur et nous dit qu’il était prêt à subir l’épreuve, mais il nous demanda quelle serait sa récompense. Nous lui promîmes une somme de 1500 roupies et un revenu de 2000 par an, qu’on se chargeait de lui obtenir du roi. Satisfait de ces conditions, il désira savoir quelles précautions on comptait prendre à son égard ; on lui montra les cadenas et les clefs, et on l’avertit que des sentinelles, choisies parmi les soldats anglais, veilleraient autour du tombeau pendant une semaine ; il ne voulut pas accéder à ces conditions et exigea que des doubles clefs fussent remises à ses coreligionnaires et que ce fussent eux qui seraient chargés de veiller autour de sa tombe. Les officiers ne voulant pas souscrire à ses demandes, il se retira, disant que l’on avait l’intention d’attenter à sa vie. »
Un juge de l’Inde française, Louis Jacolliot, a narré pareillement les merveilles, de moindre calibre il est vrai, dont il fut témoin. En sa présence, et autant de fois qu’il le voulait, un fakir fit monter des feuilles d’arbre le long d’une tige de bois qui les transperçait, grâce à une lointaine imposition des mains. Les mêmes feuilles s’agitaient chaque fois que, songeant à un ami décédé, il prenait une lettre mobile répondant à son nom. Et ce fakir fit résonner des sons dans l’espace, tracer dans l’air des caractères phosphorescents, voltiger une couronne de fleur. Un autre, nommé Covindassamy, fit apparaître un nuage lumineux d’où sortirent seize mains humaines ; l’une d’elles, arrachant un bouton de rose d’un bouquet qui se trouvait là, en fit don à Jacolliot ; d’autres mains écrivirent quelques phrases en caractères de feu. Après des incantations nouvelles, une forme vaporeuse, planant près d’un réchaud, prit l’aspect d’un brahmane sacrificateur qui jeta des parfums sur la braise ; puis apparut un musicien des pagodes qui joua d’un harmoniflûte qu’il tenait à la main. Covindassamy provoqua encore la germination et la croissance rapide d’une graine de papayer. Il avait laissé Jacolliot libre de choisir, à sa guise, le vase et la graine, mais avait exigé qu’il prît, dans un nid de fourmis blanches, de la terre saturée du liquide secrété par ces insectes. Après avoir planté la graine donnée par l’Européen, le fakir tomba en catalepsie et resta les bras étendus vers le vase, l’espace de deux heures. À son réveil il montra une tige de papayer haute de vingt centimètres ; on retrouva une marque faite par Jaccoliot sur les pellicules, encore adhérentes aux racines, de la semence productrice.
Après les désagréables aventures de Thara-Bey et des autres fakirs qui commirent l’imprudence, voici quelques années, de venir en Europe, il n’est plus besoin d’insister sur les tricheries continuelles de ces thaumaturges. Arrivés chez nous avec une auréole quasi divine, ils nous quittèrent avec le renom mérité de charlatans assez vulgaires, dont les fraudes percées à jour n’apparaissent pas supérieures à celles des prestidigitateurs ordinaires. Malgré la rage concentrée de nos métapsychistes occidentaux, Heuzé et quelques autres démontrèrent que leurs meilleurs tours, sans excepter l’ensevelissement, n’exigeaient qu’un peu d’adresse, jointe à une endurance que l’on acquiert aisément. Honteux comme des renards que des poules auraient pris, ils ont déserté les scènes parisiennes ou du moins ne s’y présentent plus comme apportant les preuves indéniables de l’existence d’une survie. Cette prétention pourtant était celle de Thara-Bey et des autres fakirs que le succès de ses mensonges avait séduits. Ajoutons, pour l’édification du lecteur, qu’on a enfin découvert le secret de la corde qui se maintient d’elle-même en l’air. N’en déplaise au docteur Hentsoldt, un naïf semble-t-il, c’est un tour de passe-passe, comme en témoignent des constatations faites dans l’Inde et que l’on a pu lire dans un écho du Mercure de France. Des comparses tendent un fil ténu mais solide, à une hauteur suffisante pour qu’il soit invisible, avant que l’opérateur lance d’en bas sa corde ; pour rester droite elle n’aura besoin, on le voit, d’aucun support immatériel. Et ne rions pas trop des moines hindous ; des croyants occidentaux font preuve d’une ingéniosité non moins admirable. En 1907, la pieuse librairie Blond et Cie publiait un livre du docteur Hippolyte Baraduc : La force curative à Lourdes et la psychologie du miracle. Ce dévot médecin avait photographié les forces miraculeuses qui, à Lourdes, se dégagent tant des prières qui montent d’en bas que des grâces versées, d’en haut, par la sainte mère du Christ. Il écrit :
« Les eaux sont couvertes d’un dynamisme intensif d’aspect fantômal, facteur de cure. »
« Un cliché a été pris au moment du miracle de Fanny Combes ; il représente un ruban fulgurant. »
Hippolyte Baraduc faisait, d’ailleurs, une autre constatation moins orthodoxe, et presque injurieuse pour la toute-puissance du Père Céleste, à savoir que les effluves divines de Lourdes ne guérissent pas en hiver. Pour l’envoi des malades il faudrait tenir compte des saisons :
« Telle affection morale, mentale, serait envoyée en juillet et août ; telle autre, nerveuse, en septembre et octobre, suivant les données temporaires (ou plutôt de temps) que les observations nombreuses de cures recueillies par les médecins pourraient indiquer. »
Ainsi la grâce divine, de nature invisible d’après les théologiens d’autrefois, laisse maintenant des traces sur les plaques photographiques ! Délicieux, n’est-il pas vrai ? Et les fakirs n’ont rien trouvé qui surpasse l’invention, trop peu connue, de Baraduc le pieux docteur. Bientôt, espérons-le, Notre-Dame en personne posera devant l’objectif de ses bons serviteurs.
Assurément nous pouvons conclure qu’elles ont lamentablement échoué, les démonstrations de l’existence de Dieu et de l’immortalité de l’âme basées sur l’étude des faits supra-normaux ; c’est en vain qu’on cherche à jeter des ponts entre la terre et l’au-delà, entre le sensible et la sur-nature. Mais dans une métapsychie, définitivement libérée des doctrines et des préoccupations religieuses, il y aurait beaucoup à glaner. La science humaine n’est qu’à ses débuts ; à côté des forces connues de nous, il existe une immense gamme de radiations que nos sens ne perçoivent pas et que nous n’arrivons à étudier qu’indirectement, par le moyen de leurs effets. Rayons infra-rouges et ultra-violets, ondes hertziennes rentrent dans ce cas ; l’existence des rayons X ne fut prouvée que grâce aux plaques photographiques et aux corps phosphorescents. Si elle parvient à se cantonner dans le domaine des réalités purement expérimentales et des hypothèses strictement positives, la métapsychie expliquera un jour des faits tels que les prévisions, la télépathie, les mouvements de la baguette divinatoire, la vision à travers des corps opaques ou à des kilomètres et des kilomètres de distance. Certains prestiges des fakirs hindous, comme aussi nombre de phénomènes observés par les psychistes européens, perdront leur caractère surnaturel pour prendre rang parmi les manifestations normales des forces simplement humaines.
Il y a d’abord les faits d’action à distance ou de télékinésie ; de loin le médium provoque le mouvement d’objets plus ou moins lourds, l’infléchissement du plateau d’une balance, l’arrêt d’une horloge, etc. Eusapia Palladino se rendit célèbre dans ce genre d’exercices ; mais elle fut accusée de fraude par un expérimentateur qui, au cours d’une séance, vit entre ses mains un mince filet luisant, un cheveu ou un fil de soie à son avis. Les métapsychistes la défendirent. Bozzano en particulier. Il raconta qu’après une scéance, « Eusapia encore un peu épuisée, était assise auprès de la table. Tout à coup, le médium parut se réveiller de l’espèce d’engourdissement dans lequel il se trouvait ; il se frotta les mains ; après quoi, en les éloignant l’une de l’autre et en les poussant en avant, il les approcha d’un petit verre posé sur la table ; alors, en faisant avec les mains des mouvements tantôt en avant, tantôt en arrière, il parvint à imprimer au petit verre en question des mouvements analogues de traction ou de répulsion à distance... Pendant que se déroulait ce phénomène, tous les expérimentateurs furent à même d’apercevoir très clairement, à l’improviste, quelque chose comme un gros fil d’une couleur blanchâtre, lequel, en partant d’une manière indéfinie des phalanges des doigts d’une main d’Eusapia, allait se joindre d’une façon tout aussi indéfinie aux phalanges des doigts de l’autre main. Aucun doute : le médium trichait ; chacun des expérimentateurs ne put s’empêcher de songer, en ce moment, à l’épisode de Palerme. Mais voilà que le médium lui-même se prend à s’écrier avec un ton de joyeuse surprise : Tiens ! Regardez le fil ! Regardez le fil ! À cette exclamation spontanée, sincère du médium, le chevalier Peretti imagina de tenter une preuve aussi simple que décisive. Il allongea le bras et commença à presser légèrement et ensuite à tirer vers lui, lentement, ce fil, qui s’arqua, résista un instant, puis se brisa et disparut tout à coup ; une brusque secousse nerveuse fit tressaillir tout le corps du médium. Inutile de décrire l’étonnement général ; un tel fait suffisait à résoudre d’un coup toute incertitude : il ne s’agissait point d’un fil ordinaire, mais d’un filament fluidique ! » Quel dommage, diront ceux qui n’ont pas la foi de Bozzano, qu’un morceau du cordon fluidique ne soit pas resté entre les mains des assistants.
Le docteur Julien Ochorowicz, métapsychiste notoire, s’aperçut de même que Mlle Stanislawa Tomczyk, mise en état somnambulique, arrêtait à volonté l’aiguille d’un appareil de prestidigitation connu sous le nom d’horloge magique. Elle parvint plus tard à soulever de loin, différents objets : une boîte d’allumettes, un aimant, une grosse paire de ciseaux, une balle en celluloïd, etc. ; à arrêter, puis à remettre en mouvement le balancier d’une pendule. Ochorowicz constata la présence d’un fil, comme Bozzano. Dans une circonstance analogue à celle d’Eusapia, écrit-il, « je n’ai pas réussi à saisir le fil qui disparut trop tôt, et malgré cela la secousse nerveuse éprouvée par le médium fut tellement forte, que la contracture douloureuse du bras droit persista plusieurs minutes. Mais en gardant certaines précautions j’ai pu, dans d’autres occasions sentir ce fil sur ma main, sur mon visage et sur mes cheveux. Lorsque le médium écarte ses mains le fil s’amincit et disparaît, et la sensation tactile qu’il procure ressemble beaucoup au contact d’une toile d’araignée ». Avec le cordon fluidique de Bozzano et d’Ochorowicz nul besoin assurément d’esprits pour expliquer les faits d action à distance, la force nerveuse suffit. Néanmoins regrettons que le fil de Stanislawa Tomczyk, tout comme celui d’Eusapia, n’ait pas été l’objet d’une étude scientifique, capable de lever les légitimes suspicions des saints Thomas d’aujourd’hui.
La télépathie, par contre, apparaît comme un fait bien établi ; des milliers de constatations l’étayent. On en trouve des exemples, dont beaucoup n’éveillent aucun soupçon de fraude, dans les recueils de Warcollier, Flammarion, Bozzano, Richet, etc., ainsi que dans les nombreuses revues psychiques et métapsychiques. L’un de ses amis écrivait à Wiétrich :
« En 1872, j’étais attaché à l’administration des télégraphes de Charleroi. J’eus, une nuit, un rêve où je voyais d’abord un poseur de télégraphe, agent dont la fonction est de poser et d’entretenir les fils conducteurs. Immédiatement après, j’eus la vision d’un homme tué. Quand j’arrivai le lendemain au bureau, j’appris la nouvelle qu’un poseur avait été tué, dans la nuit, par un train, du côté de la gare de Lodelinsart, localité voisine de Charleroi.
En 1877, où au début de 1879, pendant mon service militaire, je rêvais que je voyais une jeune fille de ma connaissance. Immédiatement après j’éprouvais une sensation indéfinissable, mais qui, pour moi, évoquait l’idée de mort. Au réveil, je fus si impressionné par ce rêve, que j’eus la très claire impression que j’allais recevoir de fâcheuses nouvelles. Les deux distributions postales passèrent néanmoins sans m’apporter autre chose qu’un journal que je lus en entier, y compris les annonces de décès. N’y ayant rien découvert ayant trait à la mort de cette jeune fille ni même d’une personne de ma connaissance, je me dis que mes pressentiments étaient trompeurs. Mais voilà que vers 9 heures du soir arrive un de mes camarades retour de congé, habitant Courcelles, petite ville du Hainaut ; il m’apportait, de la part de mes parents, une lettre mortuaire, qui m’annonçait la mort d’une jeune fille voisine de chez nous, enfant pleine de vie et de santé. Ce n’était pas la jeune fille de mon rêve, mais elle lui ressemblait comme taille, corpulence et vivacité de caractère. Particularité curieuse, les deux jeunes filles avaient les mêmes noms et prénoms. »
Sous la signature de Jeanne Jean, nous lisons dans Psychica :
« Une cousine s’était trouvée dans un état d’anémie si inquiétant que plusieurs médecins l’avaient déclarée atteinte de tuberculose. Je l’avais fait soigner sérieusement et le mal avait pu être enrayé. Quelques années plus tard, elle s’était mariée et avait eu une petite fille. Cette enfant avait deux ans quand j’eus à son sujet un rêve étrange et impressionnant : je voyais la jeune mère près du lit de son enfant malade ; elle me tendait ensuite un mouchoir en me suppliant de trouver de l’eau fraîche pour l’y tremper et l’appliquer, ensuite sur le front brûlant du bébé. Mais j’essayais vainement de la satisfaire ; je parcourais des lieues et des lieues dans la campagne sans rencontrer la moindre source, le moindre ruisseau. À tout instant, j’apercevais une mare, un étang, mais toujours pleins d’une eau si verdâtre, si boueuse et si fétide que je n’osais y tremper le mouchoir. Et je me réveillais dans un paroxysme de découragement. Je contai à mes filles ce rêve, d’autant plus singulier, que je n’avais pas vu ma cousine depuis un an et ne savais rien d’elle ni de son enfant. Le premier courrier m’apporta le lendemain la lettre de faire-part du décès de la pauvre petite ; le jour suivant j’assistai à son enterrement et j’appris qu’elle était morte d’une méningite. Comment ne pas supposer que la nuit de la mort de sa fille, la maman avait envoyé une pensée désespérée à la parente qui l’avait sauvée autrefois et que peut-être elle aurait souhaitée près d’elle ? »
Si la transmission télépathique s’opère, de préférence, pendant le sommeil du sujet récepteur, elle peut aussi avoir lieu à l’état de veille, en plein jour, et concerner les événements les plus divers de l’existence, insignifiants ou très graves, peu importe. Fréquemment elle précède de peu la mort d’une personne aimée ; et, comme elle frappe davantage alors, l’on en garde un souvenir bien précis. Mais pas plus que la télékinésie, la télépathie ne requiert la présence d’entités surnaturelles. Comparable à notre télégraphie sans fil, elle lui reste nettement inférieure par la difficulté de son maniement et par l’imprécision habituelle des renseignements transmis. Aussi n’est-il pas probable qu’elle puisse la remplacer de sitôt ; même lorsqu’on parviendra, comme c’est déjà le cas chez certaines personnes, à la produire à heure fixe, par un effort intentionnel du cerveau. Chacun s’aperçoit aujourd’hui que des ondes nerveuses rempliraient avantageusement le rôle attribué, par nos pères, aux esprits. La lecture de pensée, sa transmission sans paroles, ni signes visibles, phénomènes qui valurent un si grand renom à quelques saints catholiques, au curé d’Ars en particulier, n’ont plus rien d’extraordinaire pour le savant. On sait quelle fut la vogue, durant plusieurs années, du cumberlandisme ou lecture de pensée, ainsi appelé du nom de Cumberland le prestidigitateur qui l’avait propagé. On cache un objet, à l’insu du sujet jouant le rôle de devin, de « percipient ». Une personne, qui connaît la cachette, imagine fortement l’endroit où se trouve l’objet ; le « willer » touche la main ou la tempe du sujet qui, généralement, se dirige assez vite vers le lieu pensé par son conducteur involontaire. On peut varier cet exercice en choisissant une action à faire, un numéro à trouver, etc., plutôt qu’un objet à découvrir. Pierre Janet écrit :
« J’ai eu l’occasion d’assister une fois à une séance de ce genre donnée par un russe, Osip Feldmann, qui a eu, il y a quelques années, une assez grande réputation comme émule de Cumberland. Quoique des séances de ce genre, surtout lorsqu’elles sont publiques, laissent toujours quelque doute et ne puissent pas être rapportées avec autant de confiance que des expériences personnelles, je crois que, dans ce cas, les mesures de précaution contre des supercheries possibles étaient assez bien prises. Dans cette séance de « mentévisme », comme il disait, Osip Feldmann arrivait, non pas toujours, mais assez souvent, à exécuter l’acte auquel on pensait en lui serrant fortement le poignet. Il réussissait mieux les expériences compliquées que les plus simples, celles qui comportaient beaucoup de mouvements que celles qui devaient être faites sur place. Il réussissait également mieux avec certaines personnes qu’avec d’autres ; ainsi j’essayai en vain de le diriger, il ne comprit rien à ce que je pensai, tandis qu’il comprenait très bien plusieurs de mes amis. Il parvenait même à comprendre une personne qui ne le touchait pas, mais se contentait de le suivre partout en restant à un mètre de distance : cette expérience est déjà décrite en Angleterre. Mais voici un tour de force de ce genre que je n’ai vu rapporté nulle part. Au lieu de se faire tenir directement par la personne qui avait choisi l’action à accomplir et qui jouait le rôle de « willer », il interposait entre elle et lui une troisième personne totalement ignorante de ce qu’il y avait à faire et dont le rôle consistait uniquement à tenir d’un côté le poignet du devin et de l’autre la main du willer sans penser elle-même à rien de précis. J’ai vu cette expérience curieuse réussir avec beaucoup de précision. »
Et Pierre Janet expliquait la lecture de pensée, grâce à l’existence de mouvements accomplis par les sujets sans qu’ils le sachent et sans qu’ils le veuillent. C’est dans l’automatisme psychologique, dans l’activité mentale inconsciente, nullement dans une révélation divine, que réside le secret de la transmission des idées, pensait de même le docteur Grasset, un catholique pourtant. Il fait remarquer, à la suite de Pierre Janet, « que l’expérience réussit d’autant mieux que le sujet à mouvements inconscients est naturellement dans un état plus voisin de la désagrégation psychique (de la misère psychologique), comme l’est par exemple un hystérique anesthésique ». De plus il a rencontré des sujets qui, dans l’état d’hypnose, se souvenaient des mouvements qu’ils avaient accomplis, inconsciemment, à l’occasion de la lecture de pensée. À cette conception, qui reste vraie, dans une large mesure, il convient, lorsqu’il s’agit d’une transmission opérée sans contact, de surajouter ce que nous avons dit touchant les faits télépathiques. Pas plus les anges que les démons n’ont, certes, besoin d’intervenir ; un homme instruit qui lira Kephren avec intérêt, ne pourra que sourire en parcourant les divagations théologiques de M. de Mirville, il y a moins d’un demi-siècle encore si estimées des croyants.
Baguette divinatoire et pendule explorateur ont perdu pareillement leur vieux caractère diabolique. La première est une baguette de coudrier en forme de fourche ; le devin prend ses deux branches, une dans chaque main et s’avance sur le terrain qu’il doit explorer. Il ne bouge pas volontairement les bras, mais si la baguette oscille et s’incline malgré lui, c’est que la source ou le trésor cherché gît là. Le pendule explorateur, qui remplace fréquemment aujourd’hui l’antique baguette divinatoire, se compose essentiellement d’un corps lourd, un anneau par exemple, suspendu au bout d’un fil. On tient l’extrémité du fil au-dessus d’un récipient, verre, boîte, cuvette, etc. ; et la réponse aux questions posées se traduit par les battements du corps lourd contre la paroi du récipient. Chevreul a établi que les déplacements du pendule explorateur résultent des mouvements, involontaires et inconscients, de la personne qui tient le fil dans ses doigts. Imagine-t-elle que le pendule doit osciller dans un sens, frapper tant de coups, il obéit fidèlement, mû par une agitation imperceptible du bras, que l’on est parvenu à mettre en évidence ; se le représente-t-elle immobile, il s’arrête parce que tout mouvement musculaire s’évanouit. Simples manifestations de cette loi bien connue : l’idée, qui est une force, tend à se réaliser et se réalise en fait lorsqu’elle n’est pas contredite par des représentations contraires. Cette explication vaut encore, lorsqu’il s’agit de la baguette divinatoire qui tourne grâce aux mouvements inconscients du sourcier. Maintenant nous ne dirons pas, comme Sollas et Edw. Pease : « Tout dépend de la perspicacité du devin et la baguette n’y est pour rien ». Nous ne croyons pas le problème définitivement tranché. Il est possible que des radiations spéciales, décelant la présence d’eau ou de métaux enfouis dans le sol, soient perçues plus ou moins consciemment par les personnes capables de faire tourner la baguette. Peut-être s’agit-il, comme plusieurs le pensent, d’un courant électrique ordinaire. Peut-être l’unique cause des réussites obtenues serait-elle l’aptitude du devin à découvrir, inconsciemment, la vraie nature des terrains qu’il explore, comme les psychologues, de la fin du dernier siècle l’admettaient d’ordinaire. Mais une chose est désormais certaine c’est que nul esprit n’intervient lorsque se meut soit la baguette soit le pendule. Pas plus que n’interviennent les trépassés, lorsque les tables tournent et répondent dans les séances que les spirites organisent. Elles tournent et répondent, sans jonglerie ni tromperie, mais ce sont les assistants, dont les mains s’appuient sur elles, qui, involontairement, inconsciemment, les meuvent et les poussent. Chevreul, Pierre Janet, le docteur Grasset et d’autres chercheurs consciencieux l’ont prouvé définitivement. La seule intelligence qui intervienne dans les réponses, c’est celle, souvent très bornée, des assistants. Comment les spirites ne s’aperçoivent-ils pas que les élucubrations reçues de l’au-delà sont en général d’une sottise déconcertante.
« Corneille, quand il parle par la main des médiums, ne fait que des vers de mirliton, et Bossuet signe des sermons dont un curé de village ne voudrait pas pour son prône. »
De plus, ces messages reflètent, avec fidélité, les doctrines et les tendances chères aux assistants ; aussi les tables se comportent-elles de façon très différente en pays catholique et en pays protestant. Pierre Janet écrit :
« Chez des catholiques, l’abbé Bautain voit une corbeille se tordre comme un serpent et s’enfuir devant le livre des Évangiles qu’on lui présente, demander des prières et des indulgences. Chez des protestants, les tables n’ont plus peur de l’eau bénite, n’ont plus de respect pour les scapulaires et annoncent avant dix ans la chute de la papauté... Chez ceux qui croient à l’ancienne magie noire, les esprits obéissent aux formules magiques et tremblent devant les triangles sacrés. »
Et les même divergences, produites par des causes identiques, se retrouvent, lorsqu’on utilise l’écriture automatique ou l’un quelconque des autres moyens dont nous disposons, pour converser familièrement avec de prétendus trépassés. Tant il est vrai que les messages d’outre-tombe émanent des vivants, non des morts.
Peut-être certains individus sont-ils doués de sens que ne possèdent pas les hommes ordinaires. D’où l’allure merveilleuse de phénomènes pourtant très naturels. Au milieu de gens privés d’odorat il passerait pour un sorcier incomparable, celui qui n’aurait qu’à flairer pour savoir qu’ici furent des violettes, là des fromages, qu’une fuite de gaz rend un péril imminent, qu’un cadavre est caché, depuis plusieurs jours, dans telle caisse ou tel appartement. Au dire des métapsychistes sérieux bien des faits étranges s’expliqueraient, de la sorte, par l’existence de perceptions inconnues du grand nombre ; ce sont elles qui permettraient à quelques devins de nous renseigner sur les possesseurs successifs des objets que l’on dépose entre leurs mains. Les prémonitions d’événements prochains auraient même origine. Il est vrai que, dans ce domaine, les chercheurs gardent une réserve prudente.
« La préconnaissance de l’avenir en général est tout au moins extrêmement rare et, si l’on veut, problématique. » (Docteur Osty, Les Miracles de la Volonté.)
On a remarqué que certaines prémonitions ne requéraient pas la connaissance de faits vraiment imprévisibles. Témoin ce récit extrait du livre de Flammarion : La mort et son mystère. L’auteur écrit :
« La narration suivante m’a été adressée de Biarritz le 9 juillet 1917, en réponse au désir que j’avais manifesté à Mme Storins Castelet, mon érudite collègue de la Société astronomique de France, qui m’avait raconté le rêve, d’en recevoir directement le récit par l’observatrice. C’est la vue, trois jours à l’avance, d’une mort subite.
« ... Malgré toute la tristesse qu’une telle communication puisse réveiller en moi, je peux vous affirmer que la mort de mon fils Jean me fut annoncée le jeudi qui précéda le dimanche où mon cher enfant, alors à l’étranger avec son frère Louis, nous quitta pour toujours. Ce rêve très simple le voici :
Je voyais dans une maison inconnue mon fils Louis, en larmes ; et comme je lui demandais la raison de son chagrin, il me répondit :
« Oh ! maman, Jean est mort !... »
Mon cher enfant avait dix-neuf ans, une santé superbe, et rien ne pouvait faire pressentir une fin si foudroyante... Une embolie, pendant une tranquille promenade à bicyclette, en compagnie de son frère et d’un oncle. Longtemps après, je sus que le jeudi où j’eus l’affreux pressentiment, mon enfant avait eu une syncope provoquée par une coupure au doigt : coïncidence étrange ! »
À propos de ce cas, remarquons qu’une embolie peut résulter d’un traumatisme même sans gravité ; et la blessure dut être assez grave puisque le jeune homme tomba en syncope. Par ailleurs la mère, alertée lors de l’accident, ne l’a pas été au moment de la mort. Ne serait-ce pas que l’inconscient soit du blessé, soit de son frère, pronostiqua les fâcheuses conséquences que cette lésion provoquerait. Dès lors nous serions en face d’un fait télépathique, non d’une prophétie véritable. Dans d’autres cas, et fort nombreux, c’est la coïncidence qui fait croire à l’existence de la prédiction. Combien de femmes rêvent que leur mari, que leurs enfants sont morts ; mais elles oublient leurs visions lorsqu’elles sont démenties par les faits et ne gardent le souvenir que de celles qu’un hasard réalisera ; une sur mille ou dix mille peut-être.
« Quand, pour justifier la réalisation d’une prophétie, le savant invoque la coïncidence, on est tenté, en général, de voir là une échappatoire. Or cela est parfaitement inexact. La coïncidence a ses droits au même titre que dans toute la science physique ou naturelle. Rien n’est plus injustifié que l’opinion courante d’après laquelle invoquer la coïncidence fortuite, est faire appel à l’arbitraire, à une cause verbale, à une mauvaise raison mise en avant faute de mieux. Les droits du hasard peuvent être calculés avec une précision qui devient très nette quand on opère sur un nombre de cas suffisamment élevé et le calcul des probabilités donne le moyen de l’exprimer en chiffre. » (Delage, Le Rêve)
Pour un individu qui aura rêvé les nombres exacts devant sortir dans une loterie, des milliers d’autres seront tombés dans l’erreur en croyant aux chiffres que des songes leur avaient prédits. Seulement le premier racontera partout sa bonne fortune, alors que les autres tiendront secrets leurs déboires ; grâce au hasard, une prophétie authentique s’ajoutera à la liste de celles que les métapsychistes connaissaient déjà. Sans peine nous admettons, d’ailleurs, la prévisibilité des choses déjà existantes, au moins dans leurs causes cachées. Fréquemment la mort pourrait être annoncée à l’avance par un médecin expérimenté, et cela malgré les apparences d’une robuste santé. Pourquoi l’inconscient de certaines personnes ne jouerait-il pas le rôle de médecin ? Et nous pourrions faire des remarques identiques touchant les événements politiques, les crises économiques, etc., virtuellement réalisés dans leurs antécédents. L’insuccès qu’éprouvent, à tour de rôle, les prophètes les plus huppés, dès qu’il s’agit de fixer l’avenir au delà de quelques semaines ou de quelques mois, prouve qu’ils ne participent en rien à la prescience divine dont parlent les prêtres et les métaphysiciens.
Bien d’autres phénomènes métapsychiques mériteraient de retenir notre attention. Leur étude nous entraînerait trop loin ; nous devons nous limiter. Quels qu’ils soient, d’ailleurs, des plus complexes aux plus simples, il appert dès aujourd’hui qu’ils n’ont rien de surnaturel, rien qui relève de volontés extraterrestres. Loin d’établir de façon scientifique l’existence de l’au-delà, les expériences métapsychiques aboutissent à l’effondrement des espoirs qu’avaient mis en elles les penseurs spiritualistes.
– L. BARBEDETTE.
OUVRAGES À CONSULTER. – RICHET : Traité de Métapsychique ; Notre sixième sens – FLAMMARION : La Mort et son Mystère ; L’Inconnu et les problèmes psychiques – BOZZANO : Phénomènes psychiques au moment de la mort ; À propos de l’introduction à la métapsychique humaine ; Pensée et Volonté – Dr BRET : Précis de Métapsychique – DELANNES : Les apparitions matérialisées des vivants et des morts ; Recherches sur la Médiumnité – Dr GIBIER : Spiritisme – Olivier LODGE : La Survivance Humaine – MAXWELL : Les Phénomènes psychiques – MONTANDON : Les radiations humaines – Dr OCHOROWICZ : L’état actuel des recherches psychiques – R. SUDRE : Introduction à la Métapsychique humaine . – Dr VACHET : Lourdes et ses mystères – H. KEPHREN : La Transmission de pensée – MONDEIL : Le Fluide Humain, etc.
MÉTAPSYCHIE
Notre époque pourrie de matérialisme, qui ne voit rien au-delà de la jouissance immédiate, nie le mystère qui est partout, qui nous enveloppe des pied à la tête. Mystère auquel les métaphysiques et les religions ont apporté différentes réponses et que les sciences psychologiques et physiologiques tentent d’expliquer à leur tour. Mystère qui recule à mesure que notre pauvre savoir tente de le dissiper. Ne désespérons pas, cependant. Un jour viendra peut-être où nous pourrons enfin connaître la réalité cachée sous les apparences. Quelques-uns de ses « secrets » nous ont été révélés. En ce qui concerne la vie mystérieuse du « moi », des faits inexpliqués, qualifiés de surnaturels par les cerveaux malades, deviennent explicables : l’auto-suggestion explique jusqu’aux « miracles ». La vie est pleine de miracles ; ils obéissent à des lois aussi naturelles que la chute des corps ou l’attraction universelle. Dans la vie humaine tout entière, l’inconnu joue un rôle, et bien sot qui ose le nier.
Le mystère nous entoure. Nous vivons dans le mystère. Nous en sommes imprégnés. Quand il n’existe pas, nous le créons. Tout est mystère en nous et hors de nous. La vie ? La mort ? Que sont-elles, nous n’en savons rien. Un phénomène physico-chimique ? Mais cela n’explique rien. Ne compliquons pas les choses en les obscurcissant par nos théories.
Dernière venue parmi les sciences nées de l’étude du mystère, la « métapsychie » a apporté sa précieuse collaboration à la psychologie et à la métaphysique. Elle tient d’ailleurs de ces deux disciplines. On ne peut nier le puissant intérêt que présentent les recherches métapsychiques. Elles tendent à démontrer qu’un ensemble de phénomènes qu’on considérait à tort jusqu’ici comme surnaturels peuvent être étudiés expérimentalement. Tout un côté obscur de l’âme humaine est ainsi mis en lumière. On explique désormais normalement des faits qui semblaient anormaux. Rien de plus naturel que ces faits. Encore une science qui combattra la superstition. La métapsychie peut avoir de grosses conséquences en sociologie et en morale. Le surnaturel – ou ce qui passe pour l’être – imprègne tous nos gestes. Par l’étude de ces faits peut être modifiée la conduite de l’individu. Il peut agir sur sa destinée.
J’entends d’ici les journalistes, gens prêts à blaguer ce qu’ils ne comprennent pas :
« Les métapsychistes sont des fumistes. Leurs expériences sont truquées. Elles ne prouvent rien. Tout le monde peut en faire autant... La métapsychie, quelle bonne blague ! Aimez-vous les médiums ? On en a mis partout. Méfions-nous des médiums, ce sont gens capricieux. Il y en a pour tous les goûts et même pour tous les dégoûts. Ectoplasme rime avec cataplasme... » etc...
Ces gens-là confondent tout : spiritisme, magnétisme, tables tournantes, maisons hantées, marc de café, médiumnité, fakirisme, satanisme, magie, corps astral, sur-âme... Ils embrouillent les questions, selon leur habitude. Ne portons pas grande attention aux critiques qu’ils adressent aux chercheurs désintéressés. Suivons avec intérêt les travaux de ces derniers. Il y a une vraie et une fausse métapsychie. Ne tenons compte que des recherches sérieuses dues à de véritables savants. La métapsychie n’en est qu’à ses débuts. Faisons lui crédit, comme nous le faisons à toutes les parapsychologies de l’avenir.
Ne nions pas ce qu’il y a de sérieux au fond de cette « métapsychie » blaguée par les sceptiques du boulevard. L’après-guerre lui donne un aspect de nouvelle religion : la religion de ceux qui n’en ont pas. Elle est la preuve que l’esprit ne peut se contenter du fait brutal qui tombe sous les sens. Il y a d’autres faits qui, pour ne pas tomber immédiatement sous les sens, n’en sont pas moins réels. On expliquera un jour ou l’autre par la télépathie ou la médiumnité certains faits qualifiés d’étranges, aussi facilement qu’on explique la forrnation des nuages ou la condensation de la pluie. La physico-biologie dira son mot dans ce domaine, comme elle le dit dans tant d’autres. N’excluons pas de la science ce que nous ne comprenons pas. Nous savons peu de chose en face de ce que nous avons encore à connaître. Laissons lui le temps de mettre au point ses méthodes. La psychanalyse pourra également venir en aide à la métapsychie en recourant elle-même aux méthodes de la science. La métapsychie ne pourra pas plus se passer de son concours que de celui de la chimie ou de la physique mathématique.
Il y a tout un ensemble de sciences occultes qui côtoient la métapsychique : chiromancie, onomancie, astromancie et autres. C’est un legs que nous a fait le Moyen Âge, entre tant d’autres legs. Il sied de ne pas trop s’attarder en leur compagnie : on deviendrait fou. Il faut n’en prendre qu’une faible dose si l’on veut conserver son équilibre. Certes, l’occulte vaut d’être étudié, mais avec prudence. Il convient de contrôler les preuves apportées par les occultistes et de ne pas prendre à la lettre tout ce qu’ils racontent. Gardons-nous d’ajouter foi aux boniments des charlatans. Des gens ont l’habitude d’accepter les yeux fermés tout ce qui sert leurs théories. Ils sont aveugles. Ils permettent aux charlatans de se faire prendre aux sérieux. Les recherches occultes offrent de l’intérêt. Ne les repoussons pas de parti-pris. Mais méfions-nous des mystificateurs. Ils sont légion. Leurs « fumisteries » jettent le discrédit sur des recherches louables. Le mercantilisme fait ici des siennes, comme partout ailleurs. Les pires indésirables prennent part aux « expériences », « séances » et autres « réunions » plus ou moins spirituelles. Il y a là d’étranges abus. Charlatans et naïfs font autant de mal. Il est bien difficile de démêler ici la bonne foi du mensonge. Il importe de se méfier, non seulement des « fumistes », mais des gens qui voient partout de la « fumisterie ». Ils sont aussi dangereux.
Dans le domaine des sciences occultes, que d’erreurs à combattre ! Les charlatans sont ici les maîtres. La mystification fait son œuvre. Agissons avec prudence et ne nous fions pas au premier venu. Robert Houdin nous amuse, sans essayer de nous convaincre. Il n’est que prestidigitateur. Combien de gens essaient de nous convaincre de ce qui n’existe pas, sans être eux-mêmes convaincus.
– GÉRARD DE LACAZE-DUTHIERS.
MÉTAYER
s. m. (du latin medictatarius)
Tout exploitant rural qui fait valoir une propriété dans certaines conditions d’exploitation et se rapportant plus particulièrement à l’attribution d’une partie des récoltes comme rétribution prend le nom de métayer.
Cette attribution d’une partie des produits du sol à celui qui l’exploite est variable. Dans certaines contrées le métayer perçoit, pour prix de son travail, la plus grande partie des récoltes ; dans d’autres, c’est le propriétaire qui a la plus forte part ; dans d’autres le partage des produits du sol se fait par parts égales.
La différence du fermier proprement dit de celle du métayer consiste en ce que, dans le premier cas, la rente du sol est payée en espèces et, dans le second elle l’est en produits du sol.
La mise en valeur du sol, dans le métayage, s’effectue avec les ressources, machines, animaux et engrais du propriétaire. Le métayer ne fait les avances ni de fonds, ni de matériel qui incombent au fermier dans le système locatif. D’autre part, le propriétaire conserve le contrôle des travaux exécutés et demeure l’arbitre de la marche générale de l’entreprise. L’art. 5 de la loi sur le bail à métairie (18 juillet 1889) spécifie que « le bailleur a la surveillance des travaux et la direction générale de l’exploitation, soit pour le mode de culture, soit pour l’achat et la vente des bestiaux ». Une convention ou, à son défaut, les usages locaux délimitent en la matière les droits des parties. Plus qu’un mode de louage le contrat de métayage est un mode d’association. Son principe et ses résultats sont supérieurs à ceux du salariat, car l’exploitant est intéressé au rendement et recueille, par voie presque directe, une partie des fruits de son effort. Mais la dépense d’énergie qu’elle exige du propriétaire, tenu au moins à un minimum de participation, puisqu’il conserve la responsabilité de l’organisation, est cause que beaucoup préfèrent donner à fermage et toucher une redevance fixe en argent.
Le métayage ou colonat partiaire est néanmoins pratiqué encore en France dans nombre de départements, surtout méridionaux.
MÉTEMPSYCHOSE
n. f. (du grec metempsukhosis, formé de mêta, indiquant ici changement et empsuchon, animer)
La doctrine de la transmigration des âmes fut très répandue chez les anciens. Elle dérive probablement du panthéisme oriental et de son système d’émanations ; au sein de la nature, d’après les penseurs hindous, un seul esprit, une vie unique circulent sous l’infinie variété des formes ; créations et destructions se succèdent, faisant passer la substance universelle de la vie à la mort et de la mort à une vie nouvelle. Rien n’est inanimé ; dans le corps des moindres insectes, dans les plantes, dans les pierres même, des âmes sont captives ; au cours de leurs migrations continuelles, ces dernières se dégradent ou se perfectionnent, s’éloignent de leur divin principe par le péché ou s’en rapprochent par la pratique de la vertu. Le voluptueux pourra renaître pourceau, le tyran animal féroce, l’impie, le voleur insectes ou bestioles immondes ; alors que le sage, le saint s’élèveront progressivement, dans la hiérarchie des êtres, pour faire retour à l’esprit dont ils émanent. Comme le brahmanisme, le bouddhisme est dominé par la croyance à la transmigration des âmes. Gaulama, qui se souvenait de ses incarnations précédentes, les racontait sous forme d’histoires et de fables charmantes, les Jâtakas capables de faire comprendre à ses disciples l’universelle solidarité de tout ce qui existe et vit. Il enseignait, de plus, qu’en épuisant la volonté de vivre, non par le suicide, mais par l’ascétisme et le renoncement, l’homme échappait aux renaissances successives pour entrer dans le nirvana. Hérodote affirme que les égyptiens croyaient aussi à la métempsychose : « Les égyptiens, écrit-il, ont avancé les premiers que l’âme des hommes est immortelle, et qu’après la dissolution du corps, elle passe successivement dans de nouveaux corps par des naissances nouvelles ; puis, quand elle a ainsi parcouru tous les animaux de la terre, elle rentre dans un corps humain, qui naît à point nommé : cette révolution de l’âme s’accomplit en trois mille ans. » Mais, sur la condition des esprits après la mort, les idées des égyptiens varièrent singulièrement au cours des siècles ; et, de bonne heure, la croyance à la métempsychose se compliqua de spéculations d’un autre ordre. Elle disparut ou presque, laissant des traces dans la doctrine de la réincarnation du double ou ka : quand la momie était détruite, ce dernier trouvait un support matériel dans les statuettes qui peuplaient le tombeau, au dire des prêtres égyptiens.
En Gaule, les anciens druides admettaient la transmigration des âmes, que l’on réduisit plus tard à un voyage vers le pays des morts situé à l’Occident. Chez les Grecs, les mystères orphiques permettaient à l’initié d’éviter le cycle des renaissances, grâce aux formules dont les prêtres le munissaient pour l’au-delà. À la base de l’orphisme on trouve, en effet, le dogme de la métempsychose. Pythagore, né entre 540 et 500, croyait se souvenir de ses incarnations précédentes : tour à tour il aurait habité les corps du guerrier Euphorbe, d’un pêcheur misérable, du célèbre devin Hermotine. Selon qu’elle avait bien ou mal vécu, disait-il, l’âme, après la mort, passait à un état supérieur ou inférieur, réduite parfois à revenir dans le corps d’un animal. Platon exposera des conceptions semblables : « Celui qui passera honnêtement sa vie retournera après sa mort à l’astre qui lui est échu et partagera sa félicité ; celui qui aura faibli sera changé en femme à la seconde naissance ; s’il ne s’améliore pas dans cet état, il sera changé successivement, suivant le caractère de ses vices, en l’animal auquel ses mœurs l’auront fait ressembler ; et ses transformations ne finiront point avant que, se laissant conduire par les mouvements du même et du semblable en lui, et domptant par la raison cette partie grossière de lui-même,... il se rende digne de recouvrer sa première et excellente condition. » Une métempsychose d’ordre plus élevé et de modalité différente fut admise par Virgile, comme en témoigne le sixième chant de l’Enéide. D’autres auteurs latins ont pensé de même. Les modernes partisans de la transmigration des âmes peuvent, à bon droit, constater que cette croyance se retrouve, plus ou moins atténuée, chez de nombreux penseurs anciens. Mais prétendre la découvrir dans les écrits canoniques des juifs et des chrétiens, c’est se tromper manifestement ; pas un mot qui l’étaye ni dans les Évangiles ni dans les Épîtres, et, si l’on excepte Origène et quelques auteurs alexandrins, de bonne heure condamnés comme hérétiques, on ne la rencontre dans les écrits d’aucun Père de l’Église.
Fait curieux, la métempsychose a trouvé de nombreux défenseurs dans les temps modernes. Fourier écrit :
« Où est le vieillard, le fondateur de l’école phalanstérienne, qui ne voulut être sûr de renaître et de rapporter dans une autre vie l’expérience qu’il a acquise dans celle-ci ? Prétendre que ce désir doit rester sans réalisation, c’est admettre que Dieu puisse nous tromper. Il faut donc admettre que nous avons déjà vécu avant d’être ce que nous sommes et que plusieurs autres vies nous attendent, les unes renfermées dans le monde ou intra-mondaines, les autres dans une sphère supérieure ou extra-mondaines avec un corps plus subtil et des sens plus délicats. Toutes ces vies, au nombre de huit cent dix, sont distribuées entre cinq périodes d’inégale étendue et embrassent une durée de quatre-vingt-un mille ans. De ces quatre-vingt-un mille ans, nous en passerons vingt-sept mille sur notre planète et cinquante-quatre mille dans l’atmosphère. Au bout de ce temps toutes les âmes particulières, perdant le sentiment de leur existence propre, se confondront avec l’âme de notre planète car les astres sont animés comme les hommes. Le corps de notre planète sera détruit, et leur âme passera dans un globe entièrement neuf, dans une comète de nouvelle formation pour s’élever de là, par un nombre infini de transformations successives, aux degrés les plus sublimes de la hiérarchie des mondes. » Dans son livre Terre et Ciel, Jean Reynaud imagine, après cette vie, une suite d’autres vies sur une infinité de globes, sans que jamais la personnalité vienne à périr. Nous existions avant notre arrivée sur terre, nous continuerons d’exister, après notre départ, dans des mondes de plus en plus parfaits. Mais si la doctrine de la réincarnation des âmes jouit présentement d’une si grande vogue, en Europe et en Amérique, c’est au spiritisme et à la théosophie (voir ces mots) qu’elle le doit. Dans le Livre des Esprits, sorte de catéchisme où alternent demandes et réponses, Allan Kardec s’explique clairement sur ce sujet :
« Comment l’âme, qui n’a point atteint la perfection pendant la vie corporelle, peut-elle achever de s’épurer ? En subissant l’épreuve d’une nouvelle existence. »
– Comment l’âme accomplit-elle cette nouvelle existence ? Est-ce par sa transformation comme Esprit ?
« L’âme, en s’épurant, subit sans doute une transformation, mais pour cela il lui faut l’épreuve de la vie corporelle. »
– L’âme a donc plusieurs existences corporelles ?
« Oui, tous nous avons plusieurs existences. Ceux qui disent le contraire veulent vous maintenir dans l’ignorance où ils sont eux-mêmes ; c’est leur désir. »
– Il semble résulter de ce principe que l’âme, après avoir quitté un corps, en prend un autre ; autrement dit, qu’elle se réincarne dans un nouveau corps ; est-ce ainsi qu’il faut l’entendre ?
« C’est évident. »
– Quel est le but de la réincarnation ?
« Expiation, amélioration progressive de l’humanité ; sans cela où serait la justice ? »
– Le nombre des existences corporelles est-il limité, ou bien l’Esprit se réincarne-t-il à perpétuité ?
« À chaque existence nouvelle l’Esprit fait un pas dans la voie du progrès ; quand il s’est dépouillé de toutes ses impuretés, il n’a plus besoin des épreuves de la vie corporelle. »
– Le nombre des incarnations est-il le même pour tous les Esprits ?
« Non ; celui qui avance vite s’épargne des épreuves. Toutefois ces incarnations successives sont toujours très nombreuses, car le progrès est presque indéfini. »
– Que devient l’Esprit après sa dernière incarnation ?
« Esprit bienheureux ; il est pur Esprit. »
Allan Kardec estime qu’il ne serait conforme ni à la justice ni à la bonté divine de frapper irrévocablement le pécheur après sa mort. L’homme doit pouvoir accomplir, dans de nouvelles existences, ce qu’il n’a pu faire ou achever dans une première épreuve. Ces incarnations successives s’accomplissent, d’ailleurs, sur des globes différents ; à mesure que l’esprit se purifie, le corps qu’il revêt acquiert un perfectionnement plus considérable et se spiritualise en quelque sorte. Dans les mondes supérieurs, les passions animales s’affaiblissent, l’égoïsme disparaît ; guerres et discordes sont inconnues. Alors que l’ancienne métempsychose supposait possible le retour de l’âme humaine dans un corps d’animal, le spiritisme n’admet qu’une marche progressive ; l’âme s’élève dans la hiérarchie des êtres, elle ne descend jamais. Théosophes et occultistes des différentes écoles acceptent, eux aussi, la doctrine de la réincarnation ; avec un luxe de détails qui ne manquent pas de saveur, ils nous racontent même comment s’opère le retour vers la matière :
Papus écrit :
« Dans le plan spirituel, l’esprit prend conscience que les épreuves doivent être poursuivies pour son évolution personnelle et l’évolution de tous les autres esprits, dont il n’est qu’un élément. C’est alors que le grand sacrifice lui est demandé. Il est en pleine conscience de toutes ses incarnations antérieures, il sait ce qu’il a gagné ou ce qu’il a perdu dans ses dernières existences et il sait également quels sont les clichés dont il aura à triompher dans l’existence qui va s’accomplir. Il y a une véritable agonie avec toutes ses affres, il y a une lutte terrible entre l’esprit et ses souffrances futures, analogue de l’agonie terrestre et de la lutte de la matière qui ne veut pas quitter l’esprit qu’elle incarne. Devant les épreuves entrevues : le mariage douloureux, la mort des enfants, la séparation des êtres chers, la ruine terrestre, la prison, le déshonneur, le bagne, peut-être compensée par quelques joies bien faibles ; l’esprit est rempli d’angoisse, sa lumière s’obscurcit et il s’écrie, commentant la parole qui a retenti à travers toutes les sphères visibles et invisibles :
« Eli, Eli, lama sabactani ? » (Mon Père, mon Père ! m’as-tu abandonné ?...)
C’est alors qu’interviennent les esprits de protection ; toutes les lumières des ancêtres, tous les rayons divins de l’envoyé céleste se concentrent vers la lumière obscurcie d’angoisse de la victime de la fatale évolution, et les chants célestes l’entourent et, le réconfortent. Dans un moment d’enthousiasme sublime, passant en revue tout le cycle des êtres de tous les plans qui vont évoluer avec lui, l’esprit s’écrie :
« Mon père, je suis prêt, permettez-moi seulement sur terre d’être un soldat de notre Seigneur, ne m’abandonnez pas et que votre présence me sauve dans cet enfer terrestre où je vais volontairement m’engloutir. »
Puis les fluides du fleuve astral et non physique entourent l’esprit qui va descendre. Cette perte de mémoire est indispensable pour éviter le suicide sur terre... L’esprit peut essayer plusieurs corps et ne prendre définitivement possession que du plus fort. Dans la mort des tout petits enfants, il n’y a pas toujours retour de l’esprit au plan divin : il y à essai des différents corps, ce qui est tout autre chose. On peut, en général, dire que cet essai ne dépasse jamais sept mois. »
Les pages de ce genre abondent chez les écrivains qui défendent la réincarnation ; leur cerveau accouche de mille divagations invérifiables ; et c’est avec une tranquille audace, bien faite pour impressionner les simples, qu’ils débitent leurs insanités. Mais réclame-t-on des preuves, ces phraseurs si prolixes avouent qu’elles sont surtout d’ordre sentimental, qu’une rigoureuse démonstration est impossible et qu’il faut croire sans trop chercher à approfondir. Quelques-uns pourtant ont rassemblé les arguments qui militeraient en faveur de cette doctrine. Pauvres arguments, preuves sans portée, qui font sourire dès qu’on les examine à la froide lumière de la science et de la raison.
Henri Regnault écrit :
« Parfois, on se trouve en présence d’un inconnu pour qui l’on ressent, sans raison apparente, une antipathie ou une sympathie invincible. Voilà des observations faciles à faire presque journellement, sans que naturellement, la question de l’attraction des sexes ait à intervenir. Parfois, aussi, l’on est disposé à rendre service, à être agréable à quelqu’un dont on ignore le nom. Pourquoi cela ? Question de fluide, en certains cas, c’est possible, mais ce n’est pas là une explication toujours suffisante. Ces êtres, qui, tout en étant apparemment étrangers, sont cependant irrésistiblement attirés l’un vers l’autre, se sont sans doute connus dans d’autres existences. Avec leurs sens emprisonnés dans le corps physique, il leur est impossible de se reconnaître, mais leurs esprits sont attirés d’une façon impalpable, imperceptible, incompréhensible pour ceux qui ne connaissent pas notre théorie. »
N’en déplaise à Henri Regnault, le fait qu’il signale s’explique, même sans recourir à des fluides, par la loi psychologique de l’association des idées. Telle personne m’est sympathique ou antipathique parce que dans sa physionomie, ses gestes, ses allures, le son de sa voix, il y a quelque chose rappelant d’autres individus que j’aime ou que j’exècre. Et le coup de foudre, en amour, ne résulte lui-même que de la rencontre imprévue d’une personne répondant à l’idéal que l’esprit caresse en secret. Les aptitudes naturelles, les vocations irrésistibles, les différences observées entre enfants et parents, entre frères et sœurs, ne requièrent pas davantage la croyance à la réincarnation. Sans doute la physiologie cérébrale n’est qu’à ses débuts, les lois de l’hérédité sont encore mal connues, mais le biologiste sait déjà, de façon certaine, que tous ces faits relèvent des modalités du système nerveux. Et nous ne pouvons que sourire lorsqu’un Léon Denis dévoile, aux yeux éblouis des profanes, la vraie cause des infirmités naturelles :
« Par exemple – et le cas nous a été révélé – si, tel de nos amis est sourd et muet de naissance c’est que jadis il a, par ses propos malveillants, causé des malheurs et amené une catastrophe. J’ai connu une petite naine, vieille et difforme, recueillie par l’hospice de Tours et qui fut toujours un objet de répulsion pour tous ceux qui l’approchaient. Elle s’intéressait au spiritisme et je lui prêtais volontiers les publications qu’elle venait me demander périodiquement. Après sa mort, les Esprits nous dirent que cette existence pénible et maladive avait été un correctif de l’orgueil qui était le fond de son caractère dans ses vies antérieures. Ainsi, la plupart des misères et des infirmités qui affligent les humains s’expliquent par des causes plus ou moins lointaines lorsqu’elles n’ont pas été choisies librement par l’Esprit comme un moyen efficace d’épuration et d’avancement. » Hélas ! alcoolisme et syphilis ont des effets tout pareils à ceux que Léon Denis attribue aux vices contractés dans une vie antérieure. Et, pour qu’une femme enceinte accouche d’un infirme ou d’un monstre, une frayeur suffit, au dire d’une vieille tradition populaire. À toutes les maladies, médecine et physiologie assignent aujourd’hui des causes qui n’ont rien à voir avec l’au delà.
Le sentiment du déjà vu, éprouvé par quelques personnes en face d’un objet, d’un individu, d’un paysage perçus cependant pour la première fois, parut longtemps un argument plus sérieux.
Le moraliste japonais Kenke écrivait au XIVème siècle :
« Les paroles que j’entends, je les ai déjà entendues ; les choses que je vois, je les ai déjà vues autrefois ; quand ? je ne saurais le dire. »
Plusieurs cas semblables sont rapportés par les auteurs spirites qui, généralement, ont soin de les enjoliver quelque peu, afin de frapper davantage l’imagination du lecteur.
Le Rév. Forbes disait :
« Il y a une dizaine d’années, en 1906 je visitais Rome pour la première fois. À plusieurs reprises, dans la ville, j’ai été saisi par ce flot de reconnaissances. Les thermes de Caracalla, la voie Apienne, les Catacombes de Saint-Calliste, le Colisée, tout me paraissait familier. »
Visitant à Rome la bibliothèque vaticane, Méry :
« Y fut reçu par de jeunes hommes, des novices en longues robes brunes, qui se mirent à lui parler le latin le plus pur. Méry était bon latiniste, en tout ce qui tient à la théorie et aux choses écrites, mais il n’avait pas encore essayé de causer familièrement dans la langue de Juvénal. En entendant ces Romains d’aujourd’hui, en admirant ce magnifique idiome, si bien harmonisé avec les monuments, avec les mœurs de l’époque où il était en usage, il lui sembla qu’un voile tombait de ses yeux ; il lui sembla que lui-même avait conversé en d’autres temps avec des amis qui se servaient de ce langage divin. »
Malheureusement pour les spirites, la fausse reconnaissance ou paramnésie est un trouble de la mémoire bien connu des psychologues. Ribot, dans Les Maladies de la Mémoire, en donne des exemples typiques et cherche à découvrir le mécanisme de cette illusion. Il écrit :
« Un homme instruit, raisonnant assez bien sur sa maladie et qui en a donné une description écrite, fut pris vers l’âge de trente-deux ans d’un état mental particulier. S’il assistait à une fête, s’il visitait quelque endroit, s’il faisait quelque rencontré, cet événement, avec toutes ses circonstances, lui paraissait si familier qu’il se sentait sûr d’avoir déjà éprouvé les mêmes impressions, étant entouré précisément des mêmes personnes ou des mêmes objets, avec le même ciel, le même temps, etc. Faisait-il quelque nouveau travail, il lui semblait l’avoir déjà fait et dans les mêmes conditions. Ce sentiment se produisait parfois le jour même, au bout de quelques minutes ou de quelques heures, parfois le jour suivant seulement, mais avec une parfaite clarté. »
D’ordinaire la fausse mémoire est liée à un désordre mental lorsqu’elle est durable, à une fatigue profonde lorsqu’elle est passagère. Elle est d’origine physiologique, et n’a rien à voir avec la métempsychose, de l’avis de tous les savants consciencieux.
Que penser maintenant du souvenir d’une vie antérieure spontanément reparu, à ce qu’on assure, chez quelques enfants ? Les occultistes ne s’en étonnent point, car ils prennent au sérieux toutes les divagations du bambin. Papus dira :
« L’enfant voit ses ancêtres, voit son génie familier lui apparaître souvent et jouer avec lui. Si les parents sont assez intelligents pour ne pas couper ses relations, cette existence en partie double peut avoir une grande importance dans la destinée terrestre. »
Malheureusement certains parents, non seulement ne répriment pas les folles illusions de l’imagination enfantine, mais peuplent le cerveau de leur rejeton des spectres et des fantômes dont leur propre esprit est le jouet. Les réminiscences, observées chez les bambins par un entourage crédule, résultent du souvenir gardé par eux de conversations maintes fois entendues. « Dès qu’il a commencé à parler, lit-on dans la Revue Spirite, Raoul (un petit brésilien) a répété à maintes reprises ces paroles : « en morri », qu’il est impossible de traduire en français dans leur concision,car elles signifient, au sens littéral, je suis mort, c’est-à-dire j’ai déjà passé de vie à trépas. Les parents n’attachèrent pas d’abord d’importance à ces mots. Mais, le 1er novembre 1927, un incident significatif se produisit. Voyant sa mère préparer des couronnes funéraires, il demanda pour qui. Le père nomma ses enfants pré-décédés. Et Raoul de dire :
« Mais, papa, je suis François.
– Non, dit le père, tu es Raoul.
– Avant, j’étais François, répondit Raoul, et j’étais grand comme ça. »
En disant ces mots il se dressa sur ses pieds et, levant la main, marqua la taille de son frère, qui était très grand. Et il ajouta :
« J’ai été très malade, je suis mort, on m’a enterré et après, je suis revenu avec les hommes et je suis maintenant Raoul. »
Il mentionna ensuite qu’au moment de sa mort ses parents habitaient une autre maison, dans une autre rue. Quelques jours après, le 7 novembre 1927, Raoul, voyant sur une table un gobelet de poche en aluminium qui avait été donné à François et que son père se disposait à emporter, s’écria :
« Papa, tu as donné ce gobelet à François, mais maintenant c’est moi qui suis François, ce gobelet est à moi ; seulement je veux bien te le prêter. »
Dans les paroles du petit Raoul, nous retrouvons l’allure ordinaire des histoires qu’enfante si volontiers l’imagination des bambins. Des parents inconsolables ont parlé devant lui du grand frère qui n’était plus ; sur ses goûts, ses objets préférés, les circonstances de sa mort, ils ont donné maints détails que la mémoire de Raoul a enregistrés soigneusement. Et d’instinct, peut-être pour obtenir plus de caresses, peut-être par caprice de l’imaginative ou de l’association des idées, l’enfant a opéré une de ces substitutions de personne que les psychologues connaissent bien. Mêmes remarques concernant le cas de la petite Nelly Horster.
J.-J. Horster écrivait en 1892 :
« Il y a douze ans, j’habitais 111, comté d’Effingham. J’y perdis une enfant, Maria, au moment où elle entrait dans la puberté. L’année suivante, j’allais me fixer à Dakota, que je n’ai plus quitté depuis. J’eus, il y a neuf années, une nouvelle fille que nous avons appelée Nellie et qui a persisté obstinément à se nommer Maria, disant que c’était son vrai nom duquel nous l’appelions autrefois. Je retournai dernièrement dans le comté d’Effingham, pour y régler quelques affaires, et j’emmenai Nellie avec moi. Elle reconnut notre ancienne demeure, et bien des personnes qu’elle n’avait jamais vues, mais que ma première fille Maria connaissait fort bien. »
Comment peut-on nous servir des histoires d’un merveilleux si frelaté ! Ce que la jeune Nelly n’avait pas vu, elle l’avait entendu décrire ; ses réminiscences d’une vie antérieure n’étaient qu’un écho des conversations tenues par ses parents. De temps en temps, il est vrai, des récits plus corsés circulent, qui obligent le lecteur à crier au prodige. Mais lorsqu’on veut contrôler, aller aux sources, toute certitude s’évanouit généralement. Malgré de nombreuses lettres, Henri Regnault ne put obtenir de renseignements précis sur le petit Édouard Espuglas Cabrera qui, disait-on, gardait un étonnant souvenir de ce qu’il avait fait dans une précédente incarnation. La physiologie est loin d’avoir dit son dernier mot ; bien des forces seront découvertes plus tard que nous ignorons présentement. Dès aujourd’hui, néanmoins, nous sommes certains que la métempsychose est un mythe au même titre que le ciel et l’enfer des chrétiens. Car le suprême et dernier argument que ses partisans allèguent, le souvenir des vies passées provoqué durant l’état d’hypnose, est aussi faible que les précédents. Endormie par de Rochas, qui s’adonna longtemps à des recherches de ce genre, Mme Trinchant narra qu’elle fut jadis une jeune fille arabe, assassinée vers l’âge de vingt ans. Un autre sujet, Henriette, plongé par le même dans l’état somnambulique, revivait en souvenir l’existence de l’évêque De Belzunce ; encouragés, au moins indirectement, par l’hypnotiseur, bien d’autres ont fait depuis des récits du même genre. Inutilement pour la cause de la réincarnation, car on s’est aperçu qu’il s’agissait, dans tous ces cas de troubles maladifs de la personnalité. L’imagination du sujet et les suggestions de son entourage suffisent à expliquer le roman, parfois très prolixe, débité par certains hypnotisés touchant leurs vies antérieures. Altérations, transformations, dédoublements plus ou moins complets de la personnalité sont des phénomènes bien étudiés par les magnétiseurs.
Pierre Janet écrit :
« Cette singulière coutume des somnambules de se dédoubler est très fréquente et a été signalée dès les premières études sur ce sujet. »
Deleuze dit :
« Les somnambules parlent d’eux-mêmes à la troisième personne, comme si leur individu dans l’état de veille et dans l’état de somnambulisme était deux personnes... Mlle Adélaïde ne convenait jamais de l’identité d’Adélaïde avec Petite, nom qu’elle recevait et se donnait pendant sa manie (somnambulisme), etc. »
« Leur esprit de veille et celui du somnambulisme, dit Aubin Gauthier, sont deux choses différentes. »
Tous les écrivains du magnétisme animal ont d’ailleurs décrit ce fait, qui est aussi fréquent qu’il est curieux. N... qui se trouvait d’abord changée, prétendit bientôt qu’elle était autre.
« Qui étiez-vous donc alors ! » lui ai-je demandé.
– « Je ne sais pas... je crois que je suis la malade. » ...
Lucie, qui restait la même, disait-elle, pendant le premier somnambulisme, change complètement d’avis quand on la met dans le second. Le changement devient probablement trop fort, car elle ne se reconnaît plus ; elle prend alors spontanément un autre nom, celui d’Adrienne. »
Qu’un partisan de la réincarnation assiste à l’une de ces crises de dédoublement, qu’il suggère au sujet l’idée d’une existence antérieure et ce dernier, tout naturellement, sans intervention d’une entité de l’au-delà, imaginera mille détails se rapportant à la personnalité dont on l’affubla. En réalité, si la métempsychose a trouvé à notre époque tant de défenseurs, c’est qu’elle prétend justifier les inégalités sociales et laver dieu du crime de barbarie, que les croyants pourraient lui adresser à bon droit. Henri Regnault écrit :
« La logique interdit d’accepter la création par Dieu, infiniment bon, infiniment parfait, infiniment juste, d’êtres qui, venus au monde aussi dissemblables à tous les points de vue, auraient cependant, vis-à-vis de lui, la même responsabilité. Combien ce mystère apparent devient clair si l’on n’admet pour chacun des enfants qui naissent ici-bas, l’existence préalable de vies antérieures. »
Et Léon Denis fait sienne la communication médiumnique suivante :
« La grande idée de la réincarnation est seule capable de revivifier la société décadente qui est la nôtre. Seule elle peut réfréner cet égoïsme envahissant qui désagrège Famille, Patrie, Société, et qui substitue à la généreuse idée du devoir cette conception féroce d’une individualité qui doit s’affirmer quand même à tout prix. »
Après de telles déclarations, nous sommes fixés. Voyant crouler de toutes parts les vieux dogmes chrétiens, quelques partisans de l’exploitation des pauvres par les riches, des sujets par les gouvernants, ont estimé qu’une large diffusion de la croyance aux vies successives remplacerait avantageusement la peur d’un enfer qui paraît très problématique à l’homme qui réfléchit tant soit peu. Dans l’espoir d’être mieux partagé dans une prochaine existence, de faire partie des dirigeants, d’être un génie illustre, un patron redouté, peut-être un prince, un ministre, un roi, le malheureux tâcheron des champs ou de l’usine peinera sans se plaindre pour nos grands féodaux. Et sa situation pitoyable lui semblera un juste châtiment de fautes commises antérieurement. Concevoir un anesthésiant meilleur à l’usage du populaire parait à bon droit difficile. L’incarnation du Christ en la personne de Krishnamurti, messie selon le cœur de l’Angleterre, doit achever de convaincre ceux qui ne pouvaient admettre de si noires machinations. Esprit médiocre qui, sans les citer naturellement, s’inspire des écrivains libertaires dans ce qu’ils ont de meilleur, ce nouvel Instructeur du monde se contente de répéter ce que d’autres dirent avant lui. Mais les dirigeants de la politique anglo-saxonne espèrent que son influence leur sera favorable dans l’Inde ; et ils comptent sur lui pour aider, si possible, au réveil religieux de l’Occident.
– L. BARBEDETTE.
OUVRAGES À CONSULTER. – Papus, La Réincarnation. – L. Denis, Après la mort. – , La Réincarnation. – H. Regnault, Tu revivras. – A. Besant, Nécessité de la Réincarnation. – Allan Kardec, Le Livre des Esprits. – Bergson, L’Énergie spirituelle. – Ch. Lancelin, Comment on meurt, comment on nait. – Sausse, La Réincarnation selon le Spiritisme. – Ribot, Les Maladies de la Mémoire. – Pierre Janet, L’Automatisme psychologique, etc.
MÉTÉOROLOGIE
(n. f. grec meteorologia)
C’est la science qui fait partie de la physique et qui traite des phénomènes atmosphériques, du climat, du temps qu’il fait.
Il est curieux de constater que la science qui est arrivée à prédire, par le calcul, le retour de certaines comètes et les éclipses du soleil et de la lune, des siècles et des siècles en avance avec une précision remarquable, à la seconde près, reste muette pour ce qui concerne les perturbations atmosphériques.
Il nous est absolument impossible, n’en déplaise à certains calendriers, de prévoir le temps qu’il fera, même une semaine d’ avance et il suffit, par exemple, qu’un ouragan qui se dirige de Terre-Neuve vers l’Europe rencontre au cours de sa route une tempête venant d’une direction contraire pour que les côtes de l’Angleterre et de la Bretagne, qui s’attendaient à recevoir dans quatre jours le contre-coup de la tempête annoncée, soient épargnées de cette visite inopportune.
Quant à la Lune, qui a pourtant une action si prépondérante sur les marées avec leurs flux et reflux, il est généralement admis que son influence sur l’atmosphère, c’est-à-dire sur le temps, est entièrement nulle.
Heureusement, notre ignorance totale en matière météorologique se borne aux prédictions du temps qu’il fera et à l’action sur les tremblements également incalculables d’avance et qu’ils sont susceptibles d’exercer sur l’atmosphère.
En dehors de cette lacune importante, nos connaissances météorologiques sont d’une précision mathématique et nous savons qu’ici comme ailleurs « natura non fecit saltus ». (La nature ne fait pas de sauts.)
Certes, notre planète, qui est un petit soleil refroidi, a passé par de grandes variations de température et nous savons que vers la fin de la période tertiaire, il y a quelques millions d’années, la Sibérie était peuplée de palmiers et qu’à l’époque glaciaire, dont l’apogée ne date même pas de cent mille ans, la plus grande partie de l’Europe était recouverte de glaces polaires.
Mais depuis la période historique, il n’y a pas eu de changement fondamental au point de vue climatérique. Les changements existants sont superficiels et sont dus à des causes accidentelles, comme les déboisements, les lacs mis à sec, les petites rivières détournées de leurs cours, etc..., etc...
D’une façon générale, on peut affirmer que depuis l’antiquité romaine il n’y a eu aucun changement dans les climats de notre Terre et que même les températures moyennes des années varient peu l’une de l’autre. Ainsi, nous constatons que depuis la découverte du thermomètre par Cassini, en 1699, l’écart de la température annuelle de Paris, qui est de 10 degrés en moyenne, n’a jamais dépassé entre l’année la plus froide et la plus chaude, 2 à 2,5 degrés.
La température moyenne de notre planète, au niveau de la mer, est de 15 degrés centigrade, c’est-à dire sensiblement la même que celle de la ville de T’oulon. En montant, la température de l’atmosphère, dont la hauteur est d’environ cent kilomètres, diminue pendant les premiers quatre kilomètres de l’ascension de 5 degrés par mille mètres pour descendre, dans les régions interstellaires à -273 degrés.
Quant au vent, qui peut atteindre une vitesse de 80 à 140 kilomètres par heure, et même davantage, sa température est déterminée par l’altitude et la latitude par lesquelles il passe.
Les régions circumpolaires de notre globe restent éternellement blanches et glacées à partir du 80ème parallèle. Le pôle sud est un haut plateau avec des montagnes s’élevant à plus de 3000 mètres. Il est le plus froid des deux pôles, mais n’a pas encore été suffisamment exploré. Quant au pôle Nord, atteint par Peary le 6 avril 1909, il se trouve en plein Océan Arctique, éternellement glacé. On a trouvé dans ces parages jusqu’à 4000 mètres de profondeur, ce qui indique évidemment l’absence de toute terre dans le voisinage. La température du mois de juillet se maintient dans la région circumpolaire du pôle Nord dans les environs de zéro et est, en hiver, un peu moins froide que celle de la Sibérie septentrionale. Cette atténuation relative du froid est due aux crevasses longues de plusieurs kilomètres et larges de plusieurs centaines de mètres qui se forment, même en plein hiver, probablement sous l’action combinée des marées et de la rotation terrestre pour regeler aussitôt. C’est là l’équation polaire.
Pour ce qui est des régions équatoriales de notre Terre, Alexandre Humbold estimait à 28 degrés leur température annuelle moyenne. Cette moyenne varie, en réalité, entre 26,5 et 29, et atteint ses maxima à environ 15 latitudes au nord et au sud de l’équateur, où l’épaisseur de la croute terrestre, qui est en moyenne de 50 kilomètres, est la plus mince.
Les plus hautes températures enregistrées sur notre globe, à l’air libre et à l’ombre, sont de 52 à 56 degrés. La plus haute moyenne mensuelle est de 36 et a été notée à Massaouah, en Érythrée. Les plus basses températures, par contre, ont été relevées, non pas dans le voisinage du pôle, mais en Sibérie, avec une moyenne de -40 pour décembre, janvier et février avec un minimum absolu de -63 à Jakoutsk (lat. 62 long. est) et de -45 en moyenne à Nerchnojansk, pôle du froid de la Terre (lat. 67).
La température des océans, qui est voisine de zéro dans les régions circumpolaires, est de 26 à 30 dans les régions équatoriales et tropicales et peut dépasser 32 à Aden dans la mer Rouge et atteindre 35 au sud du golfe Persique. Dans les grandes profondeurs, l’eau de mer a une température voisine de zéro et peut même descendre à -2°. Dans les profondeurs de la Méditerranée qui peuvent atteindre 4600 mètres, la température se maintient invariable à 13 degrés.
Voici maintenant, à titre de renseignement, les températures minima, maxima et moyennes des principaux habitats de notre sphère terrestre : Buenos-Aires s’inscrit pour le mois le plus froid de son année par le chiffre 9, pour le mois le plus chaud, par le chiffre 24 degrés. Rio-Janeiro, 21 et 26,7 avec maximum absolu de 39 et minimum absolu de 10,7. Para, presque sur l’Équateur brésilien, par environ 29 et 27 avec maximum annuel de 35 et minimum de 23. La Havane, capitale de la perle des Antilles, janvier, 21,8, juillet 28, maximum absolu 39, minimum absolu 12. L’Île de Ceylan, 25 et 27,8. Bombay, 22,8 et 29,6. Madras, 24,5 et 31. Le Caire, 12 et 30. Alexandrie, 14,7 et 26,8. Palerme, 12 et 25,5. Alger, 12,8 et 25,9. Rome, 7,2 et 24,5. Naples, 9,3 et 24,2. La Rivièra (Nice-Menton), 9 et 23,5. Barcelone, 9 et 24,5. Paris, 2,4 et 18,3. Berlin, 0 et 19. Varsovie, -3,8 et 18,8. Moscou -11 et 19 avec maximum absolu 38 et minimum -43. Leningrad, -9,3 et 17,8 avec maximum 35 et minimum -39. New-York -1 et 23,9. Saint-Louis, -1,5 et 25,6. Nouvelle-Orléans, 12,3 et 28,4. San-Francisco, 9,9 et 14,8. Yokohama (Japon), 5 et 24. Tokio, 3,2 et 24,5. Pekin, -5 et 26,2.
Pour terminer cette nomenclature, en apparence aride, mais en vérité très parlante, disons encore qu’il tombe le plus d’eau dans les pays tropicaux, notamment aux Indes et que les pays les plus arides et secs sont l’Égypte, l’est de la Russie, l’Asie centrale, l’intérieur de l’Australie et une bande de terre entre les Andes et le Pacifique qui traverse Lima, la capitale du Pérou.
Maintenant, ajoutons encore, pour terminer, ce fait curieux que toutes les villes qui se trouvent sur la voie ferrée qui relie, par plus de huit mille kilomètres Paris, par Berlin, Varsovie, Moscou, etc., etc., à Irkoutsk, capitale de la Sibérie, située au bord du lac Baikal, profond de 1375 mètres, ont la même température moyenne pour le mois de juillet, soit de 18 à 19 degrés, tandis que la moyenne de janvier est de 2,4 à Paris et de -25 immédiatement à l’est de Irkoutsk.
Ainsi se présente à l’observateur attentif notre Terre, alternativement glacée et torride avec des montagnes dépassant 8800 mètres d’altitude et des creux d’Océan descendant à 10 kilomètres au-dessous du niveau de la mer et qui, « légère comme une plume », tourbillonne autour de son axe en 23 heures 56’ 4 » et autour du Soleil dans une année, à raison de 29 kilomètres et demi par seconde, en suivant l’astre du jour qui l’entraîne dans sa course vertigineuse de 20 kilomètres par seconde sur une courbe non mesurée encore de la Voie Lactée.
– Frédéric STACKELBERG.
N.-B. – Jakoutsk et Verchnojausk ont une température annuelle moyenne de -11 et -17 degrés. L’écart des maxima, qui peuvent atteindre 33 à 34 degrés au mois de juillet, et des minima (plus de -63 en janvier) est près de 100 degrés. En Martinique (Antilles), où les températures ne varient que de 21 à 35, cet écart n’est que de 14 ; à Para (Brésil équatorial), pas plus de 12 degrés (23 à 35), et à Quito, qui est situé sur l’Équateur, à 2850 mètres d’altitude, la température moyenne de l’année se maintient constamment entre 13,3 et 13,7.
– F. S.
MÉTHODE
s. f. (latin methodus ; grec methodos)
L’ordre qu’on met, qu’on suit pour dire, enseigner ou faire quelque chose, pour arriver à un but constitue une méthode. La manière d’être ou d’agir prend ce nom occasionnellement. L’ouvrage qui contient, rangés dans un ordre de progression logique, les principaux éléments d’une science, d’un art, s’appelle méthode.
En philosophie, la marche rationnelle de l’esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration de la vérité. Ainsi la règle employée pour faire une démonstration scientifique prend le nom de méthode.
Dès lors la méthode nous apparait comme une démonstration par le raisonnement. En fait de raisonnements, s’il en est de bons, il en est aussi de mauvais, de sorte qu’il en est de même des méthodes. Colins dit :
« Si les hommes ont généralement mal raisonné, il ne faut pas en conclure qu’ils raisonnent toujours mal ; la nécessité sociale les forcera à bien raisonner ou à disparaitre. »
Il est plus difficile que certains ne pensent de bien raisonné, et surtout d’employer la bonne méthode pour arriver à cette fin, parce que les préjugés sont vivaces. La première chose à faire consiste à se défaire des préjugés qui faussent l’intelligence, comme la méthode à employer pour bien raisonner consiste à oublier ce que l’on croyait savoir pour y substituer ce qu’on saura.
Cette méthode nous paraît la meilleure pour acquérir les connaissances qu’on ignore. L’expérience nous permet de constater que les enfants apprennent bien plus vite que les personnes âgées. Cela se comprend. Les enfants ne savent pour ainsi dire rien ou bien peu, ils ont plus ou moins conscience de leur état d’ignorance ; aussi sont-ils portés à s’instruire volontairement.
Il en est tout autrement des hommes, qu’on appelle instruits, quand il s’agit de s’assimiler une autre règle, de suivre une autre méthode pour acquérir une instruction dont ils ne soupçonnent pas le besoin.
De Potter dit :
« Les hommes instruits croient savoir, et même bien savoir, tout ce qui est du domaine de l’intelligence. Leur vanité ne leur permet pas de supposer qu’aucune raison personnelle puisse avoir un horizon plus étendu que le leur. Il en est ainsi parce que ces hommes reculent devant le travail de se faire enfant pour se former un autre raisonnement, un langage nouveau dont ils n’avaient pas même l’idée. Ils feignent d’ignorer que tout doit changer, jusqu’aux expressions ou du moins jusqu’à la valeur vague, jusqu’ici impropre, souvent fausse qu’on leur avait enseignée. »
Nos savants oublient que ce qui était relativement bon pour le passé, devient mauvais dans le présent et ne peut plus, pour l’avenir, être base d’ordre. Malgré les déceptions que les systèmes plus ou moins empiriques apportent dans la vie sociale, ces mêmes personnes ne se résoudront que bien difficilement à chercher et à trouver une nouvelle voie qui leur donne la preuve de leurs fautes en les orientant vers la vérité.
Acculé dans ses derniers retranchements, le savant de nos jours consentira péniblement à adopter par-ci, par-là, quelques modifications qu’il engrènera, au petit bonheur des circonstances, dans son système, espérant ainsi opérer une rénovation générale. Il ne réfléchit pas assez qu’un système est une œuvre tout d’un jet ou d’une pièce qui doit, non seulement exposer le but qu’il poursuit, mais démontrer les possibilités de l’atteindre.
Que le prolétaire, l’opprimé, le déshérité s’intéresse à ajuster, à coudre un morceau de tissu neuf sur un habit usé, la nécessité lui en fait souvent une obligation dans notre société ; mais que les classes possédantes, qui sont plus ou moins les classes dirigeantes, fassent une obligation légale aux classes laborieuses et opprimées de vivre de privations, alors que la société générale regorge de richesses, n’est et ne peut être que le résultat, la mise en pratique d’une mauvaise méthode.
Ainsi, au point de vue social qui nous intéresse particulièrement, la méthode employée jusqu’à ce jour ne permet pas de pouvoir espérer une rénovation sérieuse et scientifique des conditions d’existence des opprimés qui n’ont rien à espérer de bon de l’organisation sociale de nos jours.
Une méthode, pour être réellement scientifique, doit se présenter dans le cadre de l’harmonie générale, elle ne doit pas viser à tasser des choses disparates ni à accoupler des choses inconciliables.
D’un bon raisonnement, d’une bonne méthode appliquée à la vraie science dépend le bonheur domestique et social. C’est vers cette méthode et cette science que les efforts de l’Humanité doivent tendre.
– Elie SOUBEYRAN.
MÉTHODE (SCIENTIFIQUE OU EXPÉRIMENTALE)
La connaissance scientifique s’oppose à la connaissance mystique. Celle-ci repose sur l’intuition, la foi, l’autorité, celle-là sur l’expérience, le raisonnement, la critique. Si l’une n’est rien de plus que l’expression des sentiments de l’homme, simples reflets des passions du groupe qui l’encadre, d’une subjectivité, simple nuance de l’opinion commune, l’autre est une conquête du monde naturel due à l’initiative d’une individualité libérée des entraves du préjugé, l’aboutissement de recherches objectives dont les conclusions vaudront pour quiconque suivra librement la même voie.
La connaissance scientifique résulte de l’application à l’étude de la nature, d’une méthode logique d’observation, d’expérience et de discussion, méthode préconisée dès le XIIIème siècle par le moine Roger Bacon, précisée, trois siècles plus tard, par son homonyme, le Chancelier François Bacon, qui recommande de se défier des idées a priori, de recourir à l’observation et au raisonnement et, avec prudence, à l’induction, c’est-à-dire de ne conclure du particulier au général qu’après de nombreuses expériences, qu’après maintes épreuves légitimant la loi formulée.
Il était réservé à Descartes d’imposer et de vulgariser l’emploi de la méthode scientifique. Son œuvre, quoi qu’elle ait été moins novatrice qu’on ne le suppose, par le retentissement qu’elle eut, a puissamment agi sur l’orientation de l’esprit humain.
La méthode cartésienne consiste à n’accepter comme vrai que ce qui est évident et à accepter comme vrai tout ce qui est évident. D’abord rejeter les idées préconçues et les arguments d’autorité.
« Entreprendre une bonne fois d’ôter de sa créance toutes les opinions reçues jusqu’alors, afin d’y en remettre par après, ou d’autres meilleures ou les mêmes, lorsqu’on les a ajustées au niveau de la raison. »
Rien, pourtant, dans notre constitution physiologique, ne correspond au sentiment d’évidence, « comme il y a sentiment de joie, sensation de chaud, impression de fait ». D’où nous vient la clarté ? Nous distinguons les faits qui se produisent en nous et ceux qui se produisent dans le monde extérieur.
« Les premiers varient avec chaque individu, les seconds sont communs à toutes les personnes avec qui nous communiquons. »
Le critérium cherché pour l’évidence pourrait être l’accord général. Mais « une proposition scientifique ne peut être admise que si on la comprend et le nombre des personnes capables de comprendre est petit, plus qu’elles ne le croient. L’accord, s’il existait, serait donc un accord de spécialistes ; en fait il n’existe pas » (Campbell). À l’accord effectivement réalisé, il faut donc substituer la possibilité d’accord entre tous ceux qui seront capables d’appliquer la méthode. Et encore, y a-t-il des sensations anormales. Heureusement, grâce à la corrélation entre diverses manifestations sensibles d’un même fait, nous pouvons éliminer les sensations anormales. Un homme atteint de daltonisme pourra identifier des rayons lumineux d’après leur position dans le spectre, d’après leur longueur d’onde. Les sensations anormales peuvent ainsi être remplacées par des sensations normales susceptibles d’assentiment universel.
Il y a, en effet, des sensations que l’on peut regarder comme universellement normales, comme exprimant des propriétés reconnues par tous. Ce sont celles sur lesquelles reposent les mesures, fondements de la science. Un physicien anglais en distingue trois espèces :
-
jugements de simultanéité, de séquence et d’intercalation dans le temps ;
-
jugements de coïncidence et d’intercalation dans l’espace ;
-
jugements numériques.
En somme :
« Le critérium de l’accord général est issu de la nature de notre expérience et de notre manière de penser. Une altération de cette nature est une supposition folle. La faillite du critérium serait la faillite de la pensée. »
Quelles sont les modalités de l’observation et de l’expérimentation ? D’après Stuart Mill, elles sont au nombre de quatre : Méthode de concordance (Comparaison de cas nombreux et différents concordant par la présence du phénomène étudié ; ils doivent aussi concorder par la présence des phénomènes que l’on suppose lui être invariablement liés). Méthode de différence (Examen des cas semblables différant seulement par la présence ou l’absence d’un seul phénomène. Le phénomène lié au premier doit être, de même, présent ou absent). Méthode des variations concomitantes (Les deux phénomènes en relation supposée doivent présenter des variations corrélatives). Méthode des résidus Si on retranche d’un phénomène complexe toutes les circonstances déjà expliquées par certaines causes, il peut rester des circonstances inexpliquées. Celles-ci seront la conséquence des faits antérieurs non utilisés pour l’explication : (Découverte de Neptune, par Leverrier.)
Qu’est-ce qui guidera nos pas dans la recherche ? Qu’est-ce qui nous incitera même à l’entreprendre ?
« Quand Descartes disait qu’il ne faut s’en rapporter qu’à l’évidence ou à ce qui est suffisamment démontré, cela signifiait qu’il ne fallait plus s’en référer à l’autorité, comme faisait la scolastique, mais ne s’appuyer que sur les faits bien établis par l’expérience. De là il résulte que, lorsque dans la science nous avons émis une idée ou une théorie, nous ne devons pas avoir pour but de la conserver en cherchant tout ce qui peut l’appuyer et en écartant tout ce qui peut l’infirmer. Nous devons, au contraire, examiner avec le plus grand soin les faits qui semblent la renverser, parce que le progrès réel consiste toujours à changer une théorie ancienne qui renferme moins de faits contre une nouvelle qui en renferme davantage. » (Claude Bernard)
« Toutefois, la manière de procéder de l’esprit humain n’est pas changée au fond pour cela. Le métaphysicien, le scolastique et l’expérimentateur procèdent tous par une idée a priori. La différence consiste en ce que le scolastique impose son idée comme une vérité absolue qu’il a trouvée, et dont il déduit ensuite, par la logique seule, toutes les conséquences. L’expérimentateur, plus modeste, pose au contraire son idée comme une question, comme une interprétation anticipée de la nature, plus ou moins probable, dont il déduit logiquement des conséquences qu’il confronte à chaque instant avec la réalité au moyen de l’expérience. Il marche ainsi des vérités partielles à des vérités plus générales, mais sans jamais prétendre qu’il tient la vérité absolue. » (Cl. Bernard)
C’est l’intuition ou le sentiment qui engendre l’idée expérimentale.
« Toute l’initiative expérimentale est dans l’idée, car c’est elle qui provoque l’expérience... Si l’on expérimentait sans idée préconçue, on irait à l’aventure ; mais d’un autre côté, si l’on observait avec des idées préconçues, on ferait de mauvaises observations et l’on serait exposé à prendre les conceptions de son esprit pour la réalité. » (Cl. Bernard)
Cette méthode expérimentale qui, à première vue, paraît si complexe, est non seulement accessible à tous, mais en fait chacun la met spontanément en pratique. Le savant viennois Mach a dit :
« L’activité intellectuelle du chercheur et de l’inventeur ne diffère pas essentiellement de celle du commun des hommes. Le savant érige en méthode ce que les autres hommes font instinctivement. »
Un autre savant anglais, Pearson, dit de son côté :
« L’importance d’une juste appréciation de la méthode scientifique est si grande, que l’on pourrait avec raison, je crois, demander à l’État de placer l’éducation scientifique à la portée de tous les citoyens. En fait, nous devrions regarder avec une méfiance extrême les grosses dépenses publiques pour des institutions techniques ou similaires, si l’enseignement manuel que l’on se propose d’y donner n’est pas accompagné de science pure. L’habitude scientifique de l’esprit est une habitude que tout le monde peut acquérir ; les moyens les plus simples de la prendre doivent être placés à la portée de tous. »
L’apprentissage d’un métier ne doit pas se réduire à l’acquisition d’une routine ; il doit être raisonné, méthodique, éveiller l’intelligence autant qu’il discipline les gestes.
Nous avons, au début, signalé l’opposition entre mysticisme et science ; cependant nous avons déjà constaté que l’intuition était le propulseur de la recherche expérimentale. C’est qu’opposition ne signifie pas abîme infranchissable, discontinuité absolue. Au début, l’homme primitif ne connaît d’abord comme cause de changement que sa propre volonté ; il attribue une volonté semblable à tout ce qui se meut. Remarquant ensuite que des changements obéissent à certaines règles immuables, alors que son esprit, ses tendances propres sont versatiles, il confère à un être supérieur, maître de soi-même, persévérant dans ses desseins, la direction de l’évolution du monde. Dans les deux cas son mysticisme s’appuie sur l’expérience, obéit à une certaine logique ; il est science embryonnaire. L’homme se fourvoie, au contraire, dès l’instant que, s’en tenant à ces premières explications, il met un frein à sa curiosité. L’opposition fondamentale consiste en ceci : le mysticisme est immobilité, torpeur, suicide ; la science est mouvement, attention, vie.
– G. GOUJON.
MÉTHODE (Point de vue individualiste)
Il est de mode de prétendre, dans certains milieux, que les individualistes anarchistes manquent de méthode ; c’est mal connaître l’individualisme anarchiste.
La méthode en cours chez les individualistes consiste d’abord en une œuvre de démolition, ensuite en un labeur de reconstruction.
Nous cherchons à extirper du cerveau et de la conduite de ceux avec qui nous venons en contact et avec lesquels nous restons en rapport, la mentalité bourgeoise et petite-bourgeoise, et nous insistons jusqu’à ce que se soit effondré le dernier appui, l’ultime base, le dernier étai sur lequel se fondait ou reposait cette mentalité. Nous la traquons jusqu’en ses derniers refuges, jusqu’en ses repaires les plus cachés. Dans ces entités sonores : mal, bien, juste, injuste, vice, vertu, amour, haine, courage, paresse, foi, jalousie, doute, cause, parti, église, honneur, vergogne, convenances, pudeur, obscénité, famille, mariage – dans mille autres – nous voyons autant de fantômes qu’agitent comme des épouvantails les dirigeants et les gouvernants, civils comme religieux, laïques comme ecclésiastiques. Nous entreprenons de démasquer, de dégonfler, de crever ces baudruches. Nous voulons faire sonner le creux de la phraséologie hypocrite et puritaine à l’abri de laquelle les hommes d’état, les gens de finance et les maîtres-chanteurs perpètrent leurs mauvais coups.
Notre méthode consiste à déraciner du cerveau et de la conduite de ceux auprès desquels nous avons accès, les « valeurs morales » en cours en ce monde, ce vieux monde de dominateurs et de dominés, d’exploiteurs et d’exploités – que ces « valeurs » soient d’ordre éthique ou civique, spirituel ou économique, pratique ou méta. Toutes, sans en excepter une seule.
Nous sommes d’abord des négateurs, des démolisseurs, des désagrégateurs, des artisans de « tables rases ». Nous le sommes parce que la mentalité bourgeoise et petite-bourgeoise, les « valeurs » morales en cours, sont en leur essence arcbistes et parce qu’en dernier ressort, elles murent l’unité humaine, cadavre ambulant, dans la tombe du défendu, de l’interdit, du prohibé.
La méthode individualiste anarchiste consiste à desceller la pierre tombale, à faire sortir de la fosse l’infortuné qui y croupit et qui y pourrit, à lui crier –et très haut et très fort :
« Rien ne t’est défendu, interdit, prohibé que ce que tu ne peux accomplir par ton propre effort, isolé ou associé aux tiens. »
Notre anarchisme ne date pas de la querelle doctrinale qui mit aux prises Bakounine et Marx ni de Gorgias, ni de Protagoras ; il remonte au premier humain, à l’ancêtre pré-historique ou anté-historique qui refusa de se « laisser faire » par les chefs de tribu d’alors, d’accomplir une action qu’il n’aurait pas accomplie si on ne l’y avait pas obligé.
Dans un article de l’Anarchie, le compagnon Albert Libertad écrivait : « Pour connaître véritablement la liberté, il faut développer l’homme jusqu’à ce que nulle autorité n’ait possibilité d’être ».
Nous avons fait nôtre cette opinion et nous l’avons complétée par certaines propositions que voici :
« Il convient de développer en l’unité humaine la mentalité alégaliste jusqu’à ce que nulle loi ou légalité n’ait possibilité d’être ; il convient de développer la mentalité amoraliste Jusqu’à ce qu’aucune morale ou moralité officielle ou coercitive n’ait possibilité d’être ; il convient de développer la mentalité de camaraderie ou de sociabilité jusqu’à ce que le sociétarisme ou le grégarisme n’ait plus de possibilité d’être. »
Voilà la méthode individualiste anarchiste.
Que l’application de cette méthode n’aille pas sans quelque danger, qui le nie ? Plusieurs des nôtres ne l’ignorent point. Quand on voyage en avion, c’est plus périlleux qu’en automobile ; quand on se déplace en automobile, c’est plus risqué que lorsqu’on utilise une charrette à âne. Marcher est le mode de locomotion le plus sûr, somme toute.
Il est encore bien plus sûr de rester chez soi.
Eh bien oui : quand on a mis au rancart mentalité bourgeoise et petite-bourgeoise ; jeté au fumier les valeurs morales en usage ; anéanti en soi l’esprit vieux-monde ; lorsqu’on est sorti du tombeau et qu’on nargue ou défie convenu, établi, routine, définitif, tout ne va pas comme sur des roulettes et de temps à autre on doit s’attendre à buter contre des obstacles et de sérieux, soit dit entre parenthèses.
Nous ne cherchons pas de parti-pris, de gaieté de cœur, les alarmes, les passes difficiles, les détresses mortelles, les situations sans issue. Au contraire. Mais la voie sur laquelle se sont lancés les individualistes à notre façon n’est pas toujours libre. Avis aux timorés. Que ceux qui ne veulent pas de notre méthode restent chez eux, mais qu’ils ne nous accablent pas de conseils, d’avis, alors que nous avons pesé le pour et le contre avant de partir.
La méthode individualiste anarchiste n’implique pas seulement entreprise de démolition, elle est reconstructive. Nous ne sommes pas seulement des iconoclastes, nous faisons de la réédification. Nous acceptons les désavantages auxquels nous exposent nos théories et nos thèses, mais nous poursuivons tous les bénéfices qu’elles impliquent.
Une fois leur cerveau décrassé, nous appelons à nous ceux avec qui nous sommes restés en contact et nous leur disons : « Parallèlement à une propagande antiétatiste la plus vivante et la plus profonde qu’il soit possible d’imaginer, formons, créons des groupes, des milieux, des associations ou, toute ingérence archiste étant écartée, nous vivrons comme nous l’entendrons. Venez tels que vous êtes, même avec les désirs et les aspirations que vous n’osez vous avouer ou révéler à vous-mêmes. Vous ne rencontrerez, parmi nous, ni bonzes moralisateurs, ni moralisateurs réfrigérants pour vous arrêter dans vos élans ou vous reprocher de vous écarter des textes reçus ou encore de manifester des besoins contraires au « bon sens ». Nous voulons instaurer des milieux où le but poursuivi est de se procurer la plus grande somme de bonheur réalisable – et cela « en camaraderie » – c’est-à-dire réunis par des affinités d’un genre ou d’un autre et sans qu’à aucun moment il y ait recours à la fraude, à l’imposition, à la violence – et cela dans tous les domaines, chacun sachant de quoi il retourne – et cela en vue de la pleine satisfaction des appétits de chacun. Il se peut que nous n’arborions pas toujours nos couleurs sur le faîte des demeures que nous entendons rebâtir, que nous ne hissions même aucun pavillon, mais « en dehors » – nous ne nous sentons comptables pour quoi que ce soit aux « en dedans ».
La méthode individualiste anarchiste vise, en somme, à rendre l’unité humaine apte à faire elle-même son destin, à accomplir son déterminisme personnel – dût ce procédé lui être plus désavantageux que de s’en remettre aux directives d’un milieu auquel nous ne reconnaissons pas le droit de décider pour qui rejette sa tutelle. Tel que nous le concevons un individualiste anarchiste est parfaitement capable d’exécuter les termes d’un contrat qu’il aurait librement passé, lesdits termes seraient-ils cent fois plus rigoureux que les clauses imposées, pour atteindre un but semblable, par la société archiste.
Cette méthode nous l’appliquons indistinctement aux ouvriéristes, aux syndicalistes, aux communistes, aux individualistes anarchistes qui s’ignorent, à tous ceux que nous approchons. Mais, qu’elle ait échoué ou non, tous ceux qui ont été attirés vers nous savent bien qu’ils ne nous ont pas quittés sans que nous ayons fait tout ce qui dépendait de nous pour abolir en leur cerveau et en leur conduite jusqu’au dernier des vestiges du besoin d’une autorité imposée, d’un contrat irrésiliable.
– E. ARMAND.
MÉTHODE (ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT)
Procédés, techniques et méthodes.
Le lecteur des ouvrages et des revues pédagogiques rencontre à chaque instant le mot méthode appliqué à des choses fort diverses. Tantôt il s’agit de l’emploi et de l’éducation de la pensée : méthodes intuitive, déductive, rationnelle-analytique, synthétique, etc. ; tantôt il est question de l’organisation scolaire et du mode de travail des élèves : méthodes individuelle, collective ; parfois il s’agit de l’ordre et de la manière d’enseigner telle ou telle technique : méthodes de lecture, d’écriture, de calcul, etc. ; enfin les conceptions pédagogiques de certains auteurs, comme aussi les systèmes appliqués dans certains établissements prennent également le nom de méthodes : méthodes Montessori, Decroly, etc., de Winnetka, etc. En présence d’un emploi si généralisé du mot méthode, tout instituteur qui a imaginé un procédé quelconque – peut-être simplement retrouvé par lui et déjà employé par maints autres pédagogues, – qui enseigne ou croit enseigner d’une manière originale, personnelle, s’empresse de parler de sa – ou de ses – méthodes.
Un pédagogue novateur de notre temps, voulant réagir contre l’emploi abusif du mot méthode, a écrit :
« Ce grand mot de méthode a été tellement galvaudé par tous les faiseurs de manuels de toutes sortes, qu’il nous est difficile aujourd’hui de lui redonner le sens précis et complet que nous lui voudrions en éducation. »
Qui dit méthode dit système d’éducation basé sur des éléments sûrs, prouvés scientifiquement, et coordonnés d’une façon absolument logique. Or, la science pédagogique en est encore à ses balbutiements et nulle méthode aujourd’hui existante ne peut s’en réclamer.
Seule l’Église, qui dédaigne la Science, et s’appuie inébranlablement – croit-elle – sur la révélation et la croyance, a sa méthode d’éducation, éprouvée par des siècles d’emploi, avec ses procédés, ses techniques presque immuables malgré les découvertes ; méthode qui ne recherche d’ailleurs pas la libération de l’individu, mais seulement sa résignation à l’ordre établi, son asservissement toujours plus grand à ses maîtres.
« Hors cet essai relativement logique, il n’y a pas encore eu, pour la pédagogie populaire, de véritable méthode d’éducation. » (C. Freinet.)
Pour utile que soit cette réaction, elle n’en est pas moins excessive et si l’on admettait la définition que Freinet nous donne du mot méthode, on ne pourrait l’approuver lorsqu’il écrit que l’Église a une méthode : Freinet se contredit évidemment lui-même.
Il importe donc de préciser le sens du mot méthode.
« Qu’est-ce que la méthode ? » demandait Delon à la session pédagogique de Cempuis, en 1893. Il disait :
« C’est la voie logique même ; – méthode signifie chemin ; – c’est la route à parcourir pour arriver à la connaissance raisonnée des faits. » Cette définition est un peu étroite, car il y a des méthodes de travail manuel tout comme il existe des méthodes de pensée, mais cette étroitesse tient à ce que Delon parlait alors « De l’unité de la méthode dans l’enseignement. »
Un psychologue contemporain nous définit ainsi ce mot :
« Une méthode est la marche raisonnée que l’on suit pour atteindre un but. » (Cellerier)
Enfin un pédagogue, P. Bernard, précise :
« C’est, étymologiquement parlant, la route, la voie que l’on suit pour arriver à un but, c’est une manière de se conduire. Le savant a sa méthode de recherche, le professeur a sa méthode d’enseignement, le laboureur a sa méthode de culture. Agir méthodiquement, ce n est pas s’évertuer au hasard, se fier à l’inspiration du moment, se dépenser en élans, ce n’est pas s’agiter ; agir méthodiquement, c’est avoir une pensée directrice et un plan d’action ; c’est disposer, organiser, composer ses pensées et ses actes ; c’est choisir avec discernement, en toutes circonstances, les moyens propres à réaliser le plus sûrement et le plus rapidement la fin qu’on s’est fixée. Un instituteur qui a de la méthode peut dire : voilà l’idée qui me mène, voici ce que je veux ; j’ai une doctrine qui ordonne l’ensemble et les détails de mon enseignement ; je puis, de ce point de vue, expliquer et justifier mes procédés, rendre raison de toutes mes démarches ; je sais où je vais, comment j’y vais. »
Il convient de distinguer le procédé, la technique et la méthode. Le procédé, nous disent les dictionnaires c’est la méthode à suivre pour faire une opération un travail. Cette définition rend mal compte de la différence qu’il y a entre un procédé et une méthode. La technique est, disent encore les dictionnaires, l’ensemble des procédés d’un art ou d’un métier. Précisons par un exemple. J’observe un jardinier qui lève un écusson de rosier, le pose et le ligature sur un églantier ; il ne lève pas l’écusson de la même manière que je le ferais moi-même, il le pose et le ligature différemment, ses tours de main, ses procédés, sont différents des miens, il a une technique de l’écussonnage, j’en emplois une autre ; ces deux techniques peuvent être sensiblement de même valeur si une méthode dirige le choix des procédés comme aussi leur adaptation à chaque cas particulier. Je sais les conditions qu’il faut réaliser pour que l’écussonnage puisse réussir, je sais par exemple que la partie centrale de mon écusson doit bien s’appliquer sur la zone génératrice du sujet et pour réaliser cette condition, j’abandonnerai parfois le procédé de ligature qui m’est familier pour en utiliser un autre moins satisfaisant dans d’autres cas ; je sais aussi qu’il faut éviter que l’écusson reçoive trop ou trop peu de sève de l’églantier et, suivant que cet églantier aura beaucoup ou très peu de sève, je serrerai ma ligature plus fortement au-dessus ou au-dessous de l’écusson. Avoir une méthode, c’est donc choisir entre les procédés d’une technique et modifier, au besoin, certains des procédés adoptés en tenant compte du but poursuivi et des conditions de la réussite. On donne aussi parfois le nom de techniques à la lecture, à l’écriture et au calcul considérant ainsi que ces connaissances sont des connaissances outils qui permettent d’acquérir d’autres connaissances et sont ainsi des techniques du savoir. Mais l’étude de ces techniques peut être méthodique : il y a, certes, de fausses méthodes de lecture, etc., qui ne sont qu’un amas de procédés appliqués à une matière d’étude morcelée plus ou moins arbitrairement, mais il y a aussi de vraies méthodes reposant sur une idée directrice, ce qui ne veut pas dire qu’elles soient bonnes pour ce!a, car il y a bien évidemment de bonnes et de mauvaises méthodes. Il y a surtout des individus qui appliquent les procédés d’une méthode d’une manière figée sans tenir compte de l’esprit qui doit les animer et sans essayer de les modifier ou de les adapter aux divers cas particuliers qui se présentent à eux.
Méthodes logiques et méthodes pédagogiques.
L’utilité de distinguer ces méthodes a été ainsi démontrée par Cellerier :
« Une méthode d’enseignement est l’ensemble des voies et moyens, des attitudes, des activités que nous adopterons pour enseigner une notion à un élève. Le but de la méthode sera non seulement de déposer cette notion dans la mémoire de l’entant, mais de la rendre facilement utilisable. »
Ouvrons ici une parenthèse. Si nous rapprochons ces arguments des explications de Bernard, nous voyons clairement qu’on ne peut prétendre avoir une méthode si on ne se préoccupe pas de choisir ou de réaliser les conditions de temps et de milieu les plus favorables à l’obtention des résultats poursuivis. Or il est indéniable que de nombreux pédagogues encore se préoccupent plus d’enseigner suivant un ordre preconçu que d’adpter leur enseignement au temps, et de taire une place à cet enseignement occasionnel, si intéressant et si profitable pour les enfants.
Il est plus évident encore qu’on ne se soucie guère de réaliser les conditions de milieu les plus favorables. Certes, Mme Montessori et surtout le Dr Decroly et Dewey, pour ne citer que les principaux, ont proclamé l’importance du milieu éducateur et ont fait des efforts méritoires en vue de sa réalisation, mais la plupart des pédagogues bourgeois ont négligé cette partie du problème de la méthode. S’il fallait réaliser un bon milieu éducateur pour tous les enfants des prolétaires, cela coûterait cher : il faudrait démolir les écoles-taudis, multiplier les établissement d’instruction –pour éviter les classes trop nombreuses, les doter de vastes cours pour les jeux, de petits jardins, de petits élevages, etc. Et alors, placé dans un tel milieu, le petit prolétaire sentirait plus âprement les tares du milieu familial –qui est aussi un milieu éducateur mais souvent à rebours, parce que l’air y est confiné dans des taudis et parce que les parents ne peuvent pas toujours donner la nourriture, les soins, etc., utiles au développement physique, intellectuel et moral de leurs enfants.
Signalons aussi dans cette parenthèse, que Cellerier se préoccupe seulement du problème de meublage laissant de côté le problème de formation de l’esprit, du caractère, etc.
« Mais le terme de méthode s’emploie aussi en logique. Il signifie, alors, la marche rationnelle que suit l’esprit dans ses recherches, soit pour atteindre, soit pour démontrer la vérité. Or dans l’enseignement, nous sommes souvent appelés à exposer à l’élève un raisonnement. Et le raisonnement suit une de ces méthodes de la logique. Le raisonnement à exposer sera analytique s’il consiste à disséquer les parties d’un tout, comme c’est le cas dans l’étude de la phrase grammaticale ; il sera synthétique lorsque nous partirons de quelques éléments simples pour construire un vaste édifice tel que celui de la géométrie ou de l’astronomie. Il sera inductif dans les sciences qui se fondent sur l’observation des faits pour en tirer des lois ; déductif dans les sciences synthétiques, etc... Tout cela ce sont des méthodes logiques, c’est-à-dire des modes, des qualités de la manière enseignée à l’élève, mais non les qualités de notre enseignement. C’est, pour ainsi dire, l’itinéraire suivi par l’esprit dans une recherche, non l’attitude adoptée par le maître pour exposer cet itinéraire à l’élève. »
Or les attitudes de notre esprit peuvent varier d’instant en instant.
« Pour démontrer que la somme des angles d’un triangle est égale à deux angles droits, nous passons quatre ou cinq fois de l’analyse, qui scrute les rapports entre tel côté, tel et tel angle, à la synthèse qui en tire telle ou telle déduction, et vice-versa. »
L’analyse et la synthèse sont corrélatives, l’analyse conduit à la synthèse puis la synthèse perfectionne l’analyse, il n’ y a pas opposition entre elles. Dans ce va-et-vient de l’analyse à la synthèse, il y a changement dans l’objet enseigné, changement de méthode logique, mais le mode de l’enseignement, la méthode d’enseignement ne varient pas.
Il faudrait donc distinguer :
« Ces deux ordres de choses si différents : la matière enseignée et les méthodes qu’elle peut enfermer, d’une part, et l’acte d’enseigner, avec les formes qu’il peut revêtir, de l’autre. Les méthodes logiques (modes de raisonnement) dépendent de la nature de l’objet enseigné. Les méthodes pédagogiques (attitudes adoptées dans l’enseignement) se règlent au contraire en grande partie sur la nature de l’enfant, son développement, etc. »
Unité de la méthode pédagogique.
Il faut que l’instituteur, s’élevant au-dessus des procédés et des techniques, ait une méthode d’enseignement de la lecture, une méthode d’enseignement du calcul, une méthode d’enseignement du dessin, etc., mais ces méthodes ne doivent être que des cas particuliers d’une méthode pédagogique plus générale qu’il faut appliquer en tenant compte des individualités enfantines et en l’adaptant aux diverses matières d’enseignement, aux divers sujets d’étude.
Si l’on a bien compris notre distinction des méthodes logiques et des méthodes pédagogiques, on doit admettre que les divers enseignements que nous donnons à un même enfant doivent s’inspirer d’une même méthode. Non pas seulement même méthode d’enseignement, mais encore même méthode pour l’enseignement et l’éducation. Comme nous allons le voir tout à l’heure, il existe, en effet, une liaison étroite entre l’éducation et l’enseignement : la méthode des logiciens ne peut être qu’une méthode d’autorité car le pédagogue qui ne peut ou ne veut pas avoir un enseignement vraiment intéressant doit imposer l’étude, s’il veut que ses élèves retirent quelque profit de cet enseignement.
Le progrès pédagogique s’accomplit, certes, partiellement à la suite de réformes dans les détails ; mais il procède plutôt par bonds, par révolutions. Vouloir passer progressivement d’une méthode pédagogique à une autre méthode, c’est agir comme le ferait un piéton qui, désireux d’apprendre à pédaler, déciderait d’adopter une solution réformiste et de passer progressivement de la marche à la pratique de la bicyclette. Une méthode est un tout, une construction et non un tas de moellons, il faut adopter le tout ou choisir une autre méthode ; il faut éviter d’avoir plusieurs méthodes pédagogiques.
Vers la méthode idéale d’enseignement.
Disons d’abord pourquoi nous devons avoir une méthode idéale d’enseignement. Certes, il nous est assez difficile d’avoir une vision claire et nette des buts poursuivis, nous ne pouvons pas bien souvent apprécier l’utilité lointaine des exercices scolaires employés et des notions enseignées ; nous ne sommes pas certains que d’autres exercices et d’autres notions n’auraient pas une utilité plus grande pour l’élève et de ceci résulte, en grande partie, la surcharge des programmes. Certes, nos connaissances psychologiques en général et la connaissance que nous avons de chacun de nos élèves en particulier, ne peuvent nous permettre d’éviter des erreurs dans l’application de la méthode. Notre connaissance des sujets d’étude n’est peut-être pas assez large et assez souple pour nous permettre de choisir ce qui convient au moment opportun. Et enfin le milieu éducateur avec son matériel d’ enseignement et d’éducation, son jardin, etc., n’est pas celui que nous voudrions pour nos élèves. Mais, précisément, en ayant une méthode idéale, nous prendrons conscience des efforts qui nous sont nécessaires pour détruire, au moins partiellement, les obstacles qui se présentent devant nous et qui proviennent de nous, de l’enfant ou du milieu.
Les anciens navigateurs qui, par nuits claires, levaient les yeux pour observer les constellations ne les ont point atteintes et ne cherchaient pas à les atteindre. Mais ces constellations les guidaient et c’est aussi un guide que nous cherchons dans la détermination d’une méthode idéale. Cette méthode dirigera nos réalisations de chaque jour, leur donnera un sens, nous permettra de constater les défauts à corriger et d’imaginer les perfectionnements futurs. Avoir une méthode idéale ce n’est pas seulement concevoir ce qui est mauvais et peut être perfectionné dans notre enseignement, c’est savoir choisir entre plusieurs perfectionnements possibles, être capable de renoncer à des progrès trop chèrement acquis, c’est-à-dire à ceux qui auraient des conséquences mauvaises, autrement dit encore, c’est pouvoir distinguer les progrès essentiels des progrès secondaires et ne pas sacrifier les premiers aux derniers.
Laissant de côté les amalgames de méthodes, qui sont tout le contraire d’une méthode, nous pouvons dire qu’il n’existe en réalité que trois méthodes : celle des logiciens, celle des pédagogues artistes, celle des psycho-pédagogues.
L’enfant fut longtemps considéré comme un petit homme imparfait qu’il fallait éduquer et instruire suivant un idéal éducatif et des programmes d’enseignement. Éduquer, c’était ordonner, défendre, punir. Instruire, c’était faire acquérir une certaine somme de connaissances logiquement divisées et subdivisées en matières que l’un commençait par définir. Nos anciens manuels d’histoire, de géographie, de grammaire, d’arithmétique, commençaient par de telles définitions : « l’histoire est... », etc. De plus, l’étude de chaque matière se faisait toujours suivant une progression logique qui partait toujours des éléments : on commençait l’apprentissage de la lecture par l’étude des lettres, celui du calcul par l’étude de la numération, celui du dessin par le tracé des lignes, etc. L’étude de la géographie, de la grammaire, etc., commençait de même par des éléments : golfes, caps, îles..., parties du discours, etc.
Évidemment les logiciens qui voulaient aller vite et droit au but, sans perte de temps, croyaient suivre la marche du facile au difficile. Il faut reconnaître qu’en suivant un ordre logique et en avançant pas à pas et « de proche en proche », comme le veut M. J. Gal, on se rapproche fort d’une telle marche, cependant on ne la suit pas toujours.
Demandez à un tout jeune enfant de dessiner une ligne droite et une pomme : il vous présentera une ligne qui ne sera pas droite à côté du dessin d’une pomme beaucoup plus satisfaisant. Essayez de faire apprendre à lire, à un débutant, des lettres (éléments de mots) et des mots, en nombre égal, présentés globalement : ce sera ce dernier apprentissage qui demandera le moins de temps.
Qu’il apprenne à parler ou à marcher, l’enfant suit un ordre naturel qui n’est pas l’ordre logique, et l’on peut s’en rendre compte également en étudiant les progrès des enfants lors de l’acquisition des notions de nombre. Nous disons bien les progrès des enfants, car la marche n’est pas identique pour tous : il y a pour les enfants plusieurs marches du progrès. Si même nous ne tenons pas compte des différences individuelles –qui font, par exemple, que certains enfants font l’acquisition de la notion de 2 avant d’acquérir celle de 1 – et que nous considérions l’enfant moyen, nous avons l’ordre d’acquisition moyen : 1, 2, 3, 1/2, 4, 5, 1/4,... (1/3 apparaissant plus tard), etc... Non seulement cet ordre psychologique n’est pas l’ordre logique, mais encore l’acquisition des notions ne se fait pas progressivement, l’enfant ne « monte pas une marche, puis une autre, puis une autre... » comme le voudrait J. Gal, il fait des bonds successifs, puis s’arrête. La compréhension des notions nouvelles se fait brusquement, puis l’enfant s’efforce de fixer sa nouvelle découverte, l’appliquant à propos et hors de propos ; enfin arrive l’abandon, le repos plus ou moins apparent auquel succède un nouveau bond et le progrès se continue suivant le même rythme : découverte, fixation de la découverte, repos. Tous les progrès de l’enfant sont soumis au rythme, l’enfant a ses métamorphoses, il va de l’avant par révolutions autant que par évolution et l’enseignement, qu’il s’agisse de lecture, de calcul, etc..., donné pas à pas, progressivement peut atténuer mais non empêcher cette périodicité des progrès.
La méthode des logiciens n’est pas seulement combattue par les psychologues parce qu’elle ne tient pas compte du développement mental de l’enfant – considéré dynamiquement et non statiquement – mais aussi parce que le souci de meubler l’esprit nuit à la formation des intelligences : en enseignant à l’enfant une logique d’adulte, on ne lui permet pas de se servir de sa propre logique et de la développer.
Enfin pédagogues artistes et psychologues sont d’accord pour faire grief aux méthodes logiques de leur manque d’intérêt. Tout d’abord, dit le pédagogue allemand Stiehler, les Logiciens construisirent leur système « en dehors de l’enfant ». Les formes géométriques, analytiques, synthétiques réjouirent le cœur des mathématiciens et des pédagogues pédants qui adoptèrent un ordre logique et des formes rigides : pentagone après triangle, etc... Mais l’enfant indocile ne veut rien savoir, il désire dessiner des choses, des scènes animées qui font battre son cœur, mais que les logiciens déclarent être trop difficiles à dessiner pour lui.
Ce que Stiehler dit de l’enseignement du dessin est vrai pour tous les autres enseignements. La méthode des logiciens est un désert aride, sans intérêt pour l’enfant.
Les défauts de la méthode logique provoquèrent la réaction des pédagogues artistes. Comme dans toute réaction, ils furent à l’extrême opposé. Gradation et graduation logique et autorité furent abandonnées. Intérêt et Liberté furent les nouveaux mots d’ordre.
Les centres d’intérêts et le souci d’éduquer remplacèrent la division logique et le souci d’instruire.
Pour satisfaire l’intérêt des enfants, on employa des méthodes globales de lecture, d’écriture, de dessin, etc., et, plaçant au-dessus de tout l’intérêt de l’enfant, on ne se préoccupa guère de savoir si de telles méthodes étaient plus ou moins rapides que les anciennes. Cette pédagogie fut impressionniste, intuitive et libérale.
Cependant, tout comme les logiciens, les pédagogues artistes l’avaient, en une certaine mesure, construite en dehors de l’enfant. Il y a des éléments intellectuels dans les facultés et les intérêts de l’enfant.
« L’idée erronée d’après laquelle on peut, en faisant appel aux tendances spontanées et en ayant recours à de nombreux matériaux, se passer entièrement du travail logique, vient de ce qu’on ne se rend pas compte de la grande part jouée dans la vie de l’enfant par la curiosité, le raisonnement, l’expérience, la preuve. Nous sous-estimons ainsi l’élément intellectuel, c’est-à-dire le seul élément éducatif dans le jeu et le travail plus spontané de l’individu. Tout maître attentif à la manière dont la pensée intervient dans les expériences faites par l’enfant normal, évitera aisément de confondre la logique avec la préparation systématique préalable de la matière à enseigner ; il ne se figurera pas non plus que le seul moyen d’éviter cette erreur est de négliger toute considération logique. Il apercevra que le but réel de l’éducation intellectuelle est de faire que des dispositions naturelles deviennent des aptitudes exercées et éprouvées, capables de transformer la curiosité plus ou moins fortuite et la suggestion dispersée en attitudes qui disposent à la recherche active, prudente et poussée à fond. Il verra que le psychologique et le logique, loin d’être opposés (ou simplement indépendants l’un de l’autre) sont liés au même titre que le premier et le dernier terme d’un même processus continu d’évolution normale. » (Dewey)
Il y a, d’ailleurs, trois écueils que n’ont pas toujours su éviter les pédagogues artistes. D’abord ils ont risqué de tarir l’intérêt à sa source. Que l’enfant fasse ce qui lui plaît, ce qui l’intéresse, fort bien si son travail ne présente ni trop ni trop peu de difficultés, car un travail trop difficile décourage et un travail trop facile n’intéresse que dans une faible mesure. Ensuite, si l’on demande à l’enfant ses désirs et ses besoins, ils deviennent tyranniques, et si l’on fournit un aliment à tous les intérêts manifestés, on risque d’entretenir des intérêts qui ne présentent plus d’utilité pour l’individu qui évolue, au détriment du meilleur épanouissement de cet individu dont on retarde ainsi le développement. Enfin nous ne saurions admettre que l’on tienne si peu compte des pertes de temps qui résultent de l’emploi d’une telle méthode. L’humanité n’a progressé que parce que chaque génération s’est assimilée rapidement, en sa jeunesse, les connaissances acquises par les générations antérieures et a pu, ainsi, ajouter ensuite sa pierre au progrès.
Malgré les critiques, qu’ils s’adressent mutuellement, logiciens et pédagogues artistes reconnaissent que l’enfant doit, travailler, faire effort et s’intéresser à son travail. Les logiciens eux-mêmes, pour qui la progression prime l’intérêt, essaient d’obtenir cet intérêt au moyen de procédés : recherche de livres bien illustrés, de problèmes amusants, etc...
Mais logiciens et partisans de l’intérêt oublient que l’enfant est un être qui évolue ; les premiers confondent le but à atteindre et le chemin à parcourir ; les seconds oublient que les intérêts de l’enfant sont de valeur inégale, qu’il en est de périmés, au rôle fini, que d’autres sont en plein épanouissement ou même seulement naissants.
Les psycho-pédagogues expérimentaux, eux, ne cultivent pas tous les intérêts, mais une sélection d’intérêts utiles au développement de l’individu, ils veulent aider l’enfant à s’épanouir, à devenir lui-même mais non pas le maintenir dans un stade intérieur de son développement.
L’intérêt, pensent-ils, doit être entretenu par une progression des difficultés qui permette aux efforts de l’enfant d’être aussi productifs que possible. Cette progression doit être fixée expérimentalement et non logiquement avec le souci de former la logique de l’enfant et non avec celui de lui imposer la logique de l’adulte. Cette logique d’adulte est une fin, non un moyen.
En résumé, les psycho-pédagogues expérimentaux, dans leur marche vers ce que nous pouvons appeler la méthode idéale d’enseignement et d’éducation, se préoccupent, en tenant compte des aptitudes, des intérêts et des besoins de l’enfant :
-
de fixer le but à atteindre ;
-
de rechercher le point de départ, c’est-à-dire la liaison entre le but à atteindre d’une part, les intérêts et les besoins de l’enfant de l’autre ;
-
cette recherche n’est possible que si le maître connaît bien la matière d’enseignement pour choisir la manière de l’aborder en tenant compte des intérêts de l’élève, de la technique spéciale à cette matière, d’une progression psychopédagogique qui tienne compte des difficultés réelles et de l’importance de chacune d’elles ;
-
des conditions de milieu et de tous les moyens qui peuvent agir dans un sens favorable au but poursuivi ;
-
d’apprécier les difficultés qui ne permettent pas d’atteindre l’idéal entrevu pour s’efforcer d’adapter cet idéal aux réalités en atteignant l’optima, c’est-à-dire le maximum du possible.
Pour être clair ce résumé doit être développé, nous le développerons donc en suivant un ordre logique, mais nous tenons à faire observer que cet ordre, qui nous est imposé par la nécessité d’être aussi clair que possible, n’est pas l’ordre chronologique. En réalité, le pédagogue, soucieux de marcher vers la méthode idéale, n’attend pas que l’un des cinq problèmes que nous avons posé soit solutionné pour s’occuper du suivant ; ces solutions sont provisoires, sujettes à révision et perfectionnées peu à peu ; il n’a pas à trouver cinq réponses isolées, indépendantes ; tout se tient et la fixation du but, pour n’en prendre qu’un exemple, ne peut être parfaite qu’après étude des autres problèmes et doit sans cesse subir des modifications puisqu’elle est établie en fonction d’un être qui évolue.
I. Recherche du but.
Cette question du but a été traitée longuement par nous au mot « Éducation » auquel nous renvoyons le lecteur. Peut-être nous y sommes-nous un peu trop préoccupés du futur ; il importe aussi de se préoccuper des besoins actuels de l’enfant qui grandit. Avant de songer à préparer à la vie, il faut penser à ce qui est vivifiant pour le présent.
Ce but général que nous avons indiqué nous impose des buts secondaires qu’il s’agit d’abord de déterminer. Certes les instituteurs publics ont des programmes officiels qui leur imposent certains de ces buts secondaires ; il ne leur en reste pas moins une certaine liberté de choix ; chaque maître a ses matières d’enseignement, ses sujets préférés ; malheureusement cette préférence résulte le plus souvent des goûts personnels. Il faudrait que pour chaque matière d’enseignement, chaque sujet d’études, le maître se demandât : « Quel sera actuellement l’effet de mon enseignement ? Quelle en sera la portée lointaine ? » et qu’à la suite de telles questions, il négligeât le moins utile au profit de l’essentiel.
Il est nécessaire aussi de préciser ces buts. Il pourra paraître suffisant à un père de famille de me dire : « Apprenez à lire à mon fils ? » mais cette réponse imprécise ne me satisfera pas.
Je réfléchirai après avoir observé la vie. Je constaterai que la lecture la plus usitée et la plus utile n’est pas la lecture à haute voix, courante et expressive, à laquelle on attache encore tant de prix dans nos écoles mais la lecture mentale silencieuse et compréhensive : qui a pour but de nous communiquer par la vue une pensée formulée par écrit. Je verrai que la classe capitaliste tire parti de cette connaissance pour empoisonner la pensée ouvrière avec sa presse bourreuse de crânes et je penserai que savoir lire peut être nuisible à qui manque d’esprit critique. De ces observations et d’autres encore, je tirerai des conclusions, et ces conclusions me permettront de préciser le but que je dois atteindre en lecture, m’indiqueront, en une certaine mesure, les moyens d’y parvenir qui seront pour moi de nouveaux buts secondaires.
Je réfléchirai encore après avoir étudié dans les livres de sociologie, de psychologie, de pédagogie, etc., et observé l’enfant. Ayant, par exemple, appris que l’adulte qui lit n’épelle pas, je me dirai que l’épellation n’est peut-être pas utile, ou tout au moins aussi utile qu’on le pense, pour l’apprentissage de la lecture et ceci m’engagera à entreprendre des recherches qui me permettront d’améliorer ou de changer ma méthode d’enseignement de la lecture.
II. Recherche du point de départ.
Le développement actuel de l’humanité, les connaissances acquises, sont tels qu’ils sont parce que les hommes, dans le passé et dans le présent, ont eu et ont des intérêts, des besoins et des aptitudes que nous retrouvons chez les enfants. Ces intérêts, ces besoins, ces aptitudes sont plus ou moins développés, n’existent parfois qu’en germe et à l’état latent chez les enfants ; il faut pourtant les découvrir, car ce sont eux les leviers du progrès, les points dont il nous faudra partir pour, par une récapitulation abrégée (voir Éducation) faire acquérir à l’enfant une partie des conquêtes de l’humanité. Il faut que l’éducateur connaisse, aussi complètement et d’une manière aussi souple que possible, les expériences que l’humanité a faites – le savoir qu’il peut faire acquérir à ses élèves n’en est qu’un résumé, – qu’il sache quels sont les intérêts, les besoins, les pouvoirs de l’enfant pour les mettre en œuvre, les exercer, les diriger vers les buts possibles qu’il se propose. « Chacun, dit Roszger, a en lui la place où le maître peut piocher de la façon la plus sûre. Alors il s’agit de mettre la main à cette place... d’obliger chacun... à économiser et à fortifier sa puissance particulière. Et la puissance particulière sera le point de départ d’où les autres territoires seront renforcés et fécondés... le descriptif fera un effort volontaire s’il doit expliquer sa description par le dessin. »
Ainsi le progrès enfantin ne sera pas obtenu malgré l’enfant et nous ne compterons pas non plus sur son bon plaisir ou sa fantaisie pour le diriger dans la voie du progrès ; ce que nous voulons ce n’est pas que l’enfant fasse tout ce que nous voulons ou tout ce qu’il veut mais qu’il veuille tout ce qu’il fait et ceci n’est possible que si, connaissant bien l’enfant, nous le plaçons dans des conditions telles que nous puissions agir envers lui de telle façon qu’il veuille ce qui est bon et utile à ses progrès.
III. Recherche de la progression.
Ayant déterminé le point de départ et le but, avons-nous besoin de prévoir l’ordre que nous suivrons pour aller de l’un à l’autre ? Une progression, un plan sont-ils utiles ? La question n’est pas superflue, les pédagogues artistes s’en rapportent à leur flair pédagogique ; leur amour de l’enfant leur permet de trouver intuitivement la route qu’il convient de suivre plus sûrement, pensent-ils, que des recherches méthodiques. Sans cesse on nous donne en exemple le sentiment maternel, la pédagogie maternelle faite d’amour et d’intuition. Certes, l’amour des enfants est une des conditions du succès en éducation et non la moins importante. Cependant, malgré leur intuition et leur amour, de nombreuses mamans pleurent des bébés qu’elles ont perdus parce qu’elles ne connaissaient pas, n’appliquaient pas des règles élémentaires de puériculture. Malgré leur intuition et leur amour, de nombreux parents donnent à leurs enfants une éducation mauvaise.
On a voulu ainsi apprendre des langues étrangères par des méthodes directes empiriques, sans se rendre compte que l’âge des élèves permettait d’utiliser des moyens d’enseignement que l’on ne peut employer avec des tout petits. Il est résulté de cela des pertes de temps qu’il convient d’éviter.
Le progrès naturel nous offre d’ailleurs des exemples d’ordre, de gradation. Étudiant cet ordre dans l’acquisition d’une langue, Louis Marchand écrit : « Il y a un sens dans le développement du vocabulaire. Ce sens nous est indiqué à la fois par le coefficient d’usage des mots et leur degré d’élaboration ». Évidemment des mots comme aller, venir, la maison, le père sont plus employés que horizon, blême, badiner, spontané, etc.
« De plus, dans tous les milieux linguistiques, les mots s’élaborent par le jeu des gradations suivantes (nous résumons) :
Gradations de formes ou étymologiques. Ex. : Tous les Français apprennent pouvoir avant possible, impossible, possibilité, impossibilité, etc.
Gradations de sens. Ex. : Tous les Français apprennent rouler (quelque chose) avant rouler (quelqu’un, etc...).
Il en est de même pour la grammaire. Nous y trouvons des gradations :
Dans la construction de la phrase ;
Dans la conjugaison des verbes ;
Dans l’emploi des mots variables ;
Dans l’emploi des mots invariables.
Par exemple, tous les Français apprennent automatiquement :
La proposition principale avant la subordonnée ;
L’indicatif avant le subjonctif ;
L’adjectif petit avant l’adverbe petitement ;
Les prépositions pour, depuis avant les conjonctions pour que, depuis que, etc... »
Il est d’autres ordres encore dont le pédagogue doit tenir compte. S’il veut faire étudier les mathématiques à ses élèves, le professeur n’ira pas au gré de sa fantaisie, car les mathématiques sont une étude constructive, il faut savoir ce qui précède pour pouvoir comprendre ce qui suit et il faut, dans cette étude logique, suivre un ordre logique. Ainsi deux ordres : l’ordre de vie et l’ordre logique doivent d’abord préoccuper le pédagogue.
Le plus souvent il devra, chose difficile, s’efforcer d’adapter son enseignement à ses deux ordres. Prenons un exemple : dans le programme de sciences figure l’étude des phénomènes naturels : pluie, vent, neige, etc... Ces phénomènes il faudra les observer (ordre de vie), les expliquer (ordre logique). On pourra sans doute, alors, comme le propose Elslander, distinguer l’ordre éducatif qui suit la marche naturelle des découvertes de l’ordre scientifique qui a pour objet l’organisation des connaissances ; mais cette distinction est au moins aussi théorique que pratique, car on ne peut songer à faire tout redécouvrir à l’enfant (voir Éducation).
Ainsi la vie, celle de notre milieu, doit nous de guide dans l’ordre des études. Non pas en ce qui concerne l’observation – il est bien évident qu’on n’observera pas les fleurs, les fruits, la neige, etc..., n’importe où et n’importe quand – mais encore pour tous autres sujets d’étude ; en lecture par exemple, il importe de commencer par l’étude des mots plus familiers à l’enfant.
La logique des matières d’étude est notre second guide. Il est évident que le théorème C ne sera étudié qu’après les théorèmes A et B si la connaissance des théorèmes A et B est nécessaire à la démonstration du théorème C.
L’enfant constitue un troisième guide dont nous nous efforcerons d’alimenter les intérêts par l’observation de l’ordre de vie et d’autres moyens. Mais l’intérêt de l’enfant n’est pas seul en jeu ; il faut tenir compte de tout son développement mental, alors que les mathématiques nous imposent une gradation logique, le développement mental de l’enfant nous impose une graduation ; il faut que l’enfant apprenne ce qui est facile avant d’étudier ce qui est difficile. Il y a des enseignements qui sont prématurés parce qu’on les donne à des enfants trop jeunes, qui apprennent des mots ou des phrases qu’ils ne peuvent comprendre.
Résumons-nous. Nous avons à nous préoccuper de rechercher des gradations – qui permettront d’éviter l’amas des difficultés, nuisible à l’intérêt ; ces gradations seront établies en tenant compte d’un ordre de vie favorable à l’observation et à l’intérêt et d’un ordre logique nécessaire à la compréhension de certains sujets – et des graduations qui, assurant la marche du facile au difficile, seront favorables à la compréhension, à l’intérêt et à la bonne assimilation des connaissances.
Faute d’ordre logique, il y a efforts vains et perte de temps.
Faute d’ordre de vie, il y a manque d’intérêt et verbalisme.
Faute de graduation, il y a tous les inconvénients qui précèdent avec, en plus, découragement de l’enfant lorsqu’il se heurte à des difficultés qu’il est incapable de surmonter. Pour exercer l’enfant à faire effort, il faut que les efforts demandés soient gradués et bien gradués.
Pour établir la progression qu’il convient de suivre, il est donc nécessaire de tenir compte de trois facteurs :
-
La gradation de l’ordre de vie, imparfaitement prévisible à l’avance et qu’on ne peut déterminer avec précision ;
-
La gradation de l’ordre logique ;
-
La graduation des difficultés.
L’ordre logique n’est pas aussi rigide qu’on le pense, même en ce qui concerne les mathématiques qui constituent la matière la plus logique de notre enseignement et surtout dans l’enseignement donné aux jeunes enfants.
Si nous examinons des ouvrages d’arithmétique destinés aux élèves de l’école primaire, nous constatons que ces ouvrages suivent des ordres divers ayant cependant un certain nombre de points communs. Qu’est-ce que la logique exige ? Que nous rattachions chaque étude nouvelle aux connaissances déjà acquises qui permettent de la comprendre. Ainsi l’étude des procédés employés lors de l’étude des cas particuliers de la multiplication (multiplicande et multiplicateur terminés par des zéros, etc.) doit être rattachée aux connaissances déjà acquises sur la multiplication, mais nulle logique ne nous oblige à étudier ces procédés avant ceux employés pour l’étude des cas particuliers de la division.
De même l’ordre habituel : règle de trois, puis d’intérêt et enfin d’escompte n’est justifié que par la tradition. Dans les trois cas, il s’agit de l’étude de grandeurs proportionnelles. La différence n’existe que dans les conditions différentes de vie et si l’on veut que les enfants abordent ces problèmes avec fruit, c’est la vie qu’il faut d’abord leur faire comprendre, c’est l’ordre de vie qui nous permettra de choisir la gradation à observer dans l’étude de ces trois cas.
L’ordre logique de l’adulte présente aussi parfois l’inconvénient de ne pas tenir compte de la graduation des difficultés : « L’enfant peut apprendre la numération parlée ou écrite et l’appliquer longtemps avant d’en comprendre les raisons et de savoir pourquoi l’on a adopté la base décimale plutôt que la base duodécimale ou binaire. La règle qui recommande d’aller du connu à l’inconnu n’a, en général, qu’une valeur relative. Si l’on veut faire travailler l’esprit, il est bon d’y déposer par anticipation des notions qui soient de véritables points d’interrogation. Ces notions, d’abord incomprises, sont les matériaux sur lesquels s’exerce un travail d’élaboration vraiment fécond. » (G. Richard).
L’ordre logique des adultes, introduit pour faciliter la compréhension et gagner du temps en évitant les tâtonnements et les recherches, ne permet pas à l’enfant d’exercer sa propre logique. On n’apprend pas à raisonner en apprenant des raisonnements, mais en raisonnant soi-même.
« Aujourd’hui, le maître précède ses élèves sur la route du Savoir ; et sans cesse il se retourne vers eux pour leur crier :
« Ne perdez pas de vue mon panache blanc. Il ne vous égarera pas : je l’ai découpé dans mon Brevet supérieur. » ...
Qu’il marche désormais à côté d’eux, sans hâte, et qu’il ne les aide pas si les difficultés du voyage ne sont pas décourageantes. Au lieu de vouloir faire d’eux des virtuoses précoces et de leur faire parler le jargon du spécialiste, qu’il leur montre seulement comment on cherche. Ils seront beaucoup plus habiles, plus tard, si on les habitue à coordonner leurs efforts que si, durant des années, on leur fait copier des modèles d’une perfection déprimante et d’une origine mystérieuse. » (Roorda)
En résumé, la gradation logique est pour nous but beaucoup plus que moyen et le souci d’aller vite et droit au but peut être préjudiciable à la formation de l’esprit.
Le souci de graduer les difficultés n’est pas nouveau. Déjà Pestalozzi écrivait : « Il faut diviser l’enseignement suivant la marche progressive des forces de l’enfant, et déterminer avec la plus grande précision... ce qui convient à chaque âge, de manière à ne rien omettre de ce que l’élève est complètement en état d’apprendre, de manière aussi à ne pas accabler et troubler son intelligence par des études qu’il n’est pas encore tout à fait capable d’apprendre ».
Mais, quoi qu’en pense Ferrière, nous sommes encore assez loin de posséder « des vues assez complètes sur l’échelonnement des difficultés ». Trop souvent l’intuition et la logique des adultes ont présidé à des graduations arbitraires bien que présentées comme expérimentales.
Or, là où il n’y a qu’un échelon pour nous, il y en a bien souvent deux pour la plupart des enfants trois ou quatre pour d’autres. Prenons en exemple deux problèmes :
-
On a partagé, par parties égales, 25 noix entre 5 enfants. Combien chaque enfant a-t-il eu de noix ?
-
J’avais 25 noix que j’ai données à des enfants. Chaque enfant a eu 5 noix. Combien y a-t-il eu d’enfants qui ont reçu des noix ?
Le lecteur non averti constatant que dans les deux il obtient la réponse en divisant 25 par 5 pensera qu’il n’y a là qu’une seule et même difficulté que les enfants pourront surmonter d’une seule et même manière. La réalité est toute autre ; dans le second cas, il s’agit de faire ce que nous pouvons appeler une division-mesure (dividende et diviseur sont de même nature) le problème est plus difficile que le précédent et les débutants, pendant longtemps, n’en trouveront la solution que par tâtonnements et multiplications ; dans le premier cas, nous avons au contraire, une division-partage (dividende et quotient sont de même nature) que les enfants solutionnent plus facilement et en procédant plus tôt par division véritable.
Si nous voulons que les enfants ne perdent pas leur temps à faire des travaux qui ne présentent plus de difficulté pour eux ou ne se rebutent pas en présence de travaux trop difficiles, il faut que nous recherchions la graduation naturelle des difficultés sans oublier que cette graduation varie dans certaines limites suivant les individus. Et, si nous voulons agir efficacement sur le développement mental des enfants, il faut que nous pénétrions suffisamment la pensée enfantine pour savoir de quelle manière – souvent différente de la nôtre – les enfants surmontent les difficultés graduées des exercices et travaux que nous leur proposons.
Mais comment faire ? Aimer les enfants d’abord, car sans amour il ne peut y avoir confiance et collaboration. Or, il faut que les enfants nous aident, il faut qu’ils soient persuadés que leurs échecs ne provoqueront pas notre dédain, que leurs procédés naïfs ne seront pas pour nous sujet à moqueries.
Cette collaboration confiante des enfants ne suffit pas. Souvent l’enfant nous trompe en se trompant lui-même et ceci provient de deux causes principales : d’abord son langage ne lui permet pas toujours d’exprimer convenablement sa pensée, il sait, mais ne sait pas comment dire ; ensuite il est peu apte à s’analyser lui-même et si nous lui demandons d’expliquer comment il a fait en tel ou tel cas, il se peut qu’il imagine une façon de faire parfaitement plausible, mais qui n’est pas celle qu’il a employée.
À cela il est deux remèdes : les recherches expérimentales, l’étude des ouvrages de psychologie et de pédagogie.
Les recherches expérimentales, cela va de soi, devront être conduites suivant les méthodes de la psychologie et de la pédagogie expérimentales que nous ne pouvons exposer ici. L’étude des ouvrages, des ouvrages récents surtout, guidera certaines recherches et permettra d’en éviter d’autres, car il est bien évident qu’il est inutile de chercher ce qui a déjà été trouvé par des psychologues ou pédagogues expérimentaux dignes de foi. Il n’y a peut-être pas inutilité absolue et il n’est pas mauvais parfois de vérifier et de contrôler, mais ce n’est généralement pas par là qu’il faut commencer. Notre exposé divisé logiquement peut faire croire qu’il faut rechercher successivement et séparément : la gradation de l’ordre de vie, la gradation de l’ordre logique, la gradation des difficultés ; puis, tenir compte de ces trois facteurs pour déterminer la progression convenable. Constatons d’abord que l’importance de ces trois facteurs varie avec les sujets d’étude : on se préoccupera plus de la gradation logique pour l’enseignement des mathématiques que pour celui de la géographie, par exemple.
Il peut d’ailleurs être possible d’obtenir une progression tout aussi satisfaisante en procédant différemment. Voulant rechercher, par exemple, la progression convenable pour l’enseignement de la lecture, nous avons fait lire des textes quelconques mais ne contenant que des mots usuels et familiers aux enfants, en notant au fur et à mesure, grâce à des procédés qu’il nous a fallu imaginer au préalable, les difficultés rencontrées et les étapes du progrès. Il est bien évident que les résultats constatés dépendaient de l’ordre de vie et de l’ordre de graduation des difficultés. Nous aurions pu rechercher séparément ces deux ordres, mais c’eût été plus compliqué et plus long et nous aurions été embarrassé par la suite, ne sachant au juste quelle est l’importance relative de ces deux facteurs.
IV. Recherche du milieu et des moyens.
La question du milieu, fort négligée habituellement, préoccupe, à juste titre, tous les grands pédagogues. Le milieu est l’un des facteurs les plus importants de la méthode. Dewey écrit qu’il faut « mettre l’enfant dans des conditions si conformes à ses facultés et à ses besoins, qu’elles favorisent d’une manière permanente ses aptitudes d’observation, de suggestion et ses dispositions à l’investigation. » Decroly, après avoir comparé les situations des enfants des villes et des campagnes, déclare : « j’ai compris qu’il fallait, pour obtenir une amélioration, essayer, tout d’abord, de réaliser le milieu convenable pour l’enfant. Il m’a été permis ainsi de me convaincre plus encore de l’énorme influence qu’il exerce sur sa mentalité et son activité.
« Je me suis aperçu, peu à peu, que la classe est un pis-aller, que le milieu naturel est constitué par une ferme, des champs, des prairies, des animaux à élever, des plantes à semer, à soigner, à récolter, représentait le vrai matériel intuitif capable d’éveiller et de stimuler les forces cachées dans l’enfant. Je me suis pénétré aussi de la vérité que, chez la majorité des élèves, l’intérêt latent pour les choses de la nature, êtres et phénomènes, permettait d’y trouver une mine inépuisable de sujets capables de servir de prétextes à penser, à calculer et à écrire de la manière la plus normale et la plus rationnelle. C’est le moyen qu’ont pratiqué les hommes depuis qu’ils sont à la surface du globe, et c’est celui que les adultes, qui sont dans la vie vraie, doivent pratiquer, chaque jour, pour s’adapter et remplir leur tâche sociale.
« … De là est venue aussi la conviction :
qu’il faut tendre à reporter toutes les écoles primaires vers la campagne ; qu’en attendant, il faut y introduire le plus de nature vraie possible, et mettre très souvent les enfants en contact avec elle, par la culture, l’élevage, les excursions botaniques, zoologiques, géologiques, et autres ;
Qu’il faut tâcher de faire voir et pratiquer dans la mesure du possible, à l’enfant, les métiers simples qui transforment la matière brute en objets utiles ou en aliments assimilables (menuisier, cordonnier, tailleur, forgeron, charron, meunier, boulanger, cuisinier, etc.) ;
Qu’il faut aussi essayer de lui montrer sur le vif, les formes élémentaires de la vie sociale, de l’organisation communale, et de les lui faire pratiquer en introduisant dans la classe, des charges, des responsabilités ; puis peu à peu, lorsque l’âge est venu, en les faisant intervenir dans la discipline et les rouages divers de la grande famille dont il fait partie. »
De ce milieu scolaire fait partie le matériel d’enseignement. Trop souvent le matériel est fait pour permettre au maître d’expliquer, d’expérimenter alors qu’il faudrait surtout qu’il puisse permettre à l’élève d’observer et de faire des recherches. Trop souvent aussi le matériel vivant (chenilles qu’on élève, etc.), qui est fort utile pour l’intérêt de l’enfant et ses observations, est négligé. Cependant le défaut de matériel est l’un des moindres défauts de notre école. Les procédés imaginés sont nombreux mais d’inégale valeur ; il conviendrait de faire parmi eux une sélection méthodique en n’oubliant pas qu’ils sont des moyens de réaliser une méthode, qu’ils doivent être les esclaves de la méthode et qu’il est souvent besoin de les adapter en tenant compte de cette méthode.
Dans le milieu scolaire il y a le maître. Les habitudes du maitre ont une influence évidente sur les enfants ; sans qu’il le veuille, souvent elles font partie de sa méthode. Le gros défaut actuel, c’est que le maître occupe une place trop importante dans le travail des enfants ; il faudrait qu’il soit plutôt aide et conseiller que directeur. Il importe aussi qu’il n’exagère pas son inf1uence personnelle, sache apprécier des goûts différents des siens, des idées originales, sans cela il ne pourrait habituer ses élèves à l’indépendance de pensée, car ceux-ci s’attacheraient. avant tout à fournir des réponses qui lui plaisent et limiteraient ainsi leur effort. Il n’est pas désirable que le résultat et l’effort des enfants « soient uniquement appréciés d’après le degré où ces réponses sont conformes à celles que le maître désire. »
V. Adaptation de la méthode.
Imaginons qu’ayant quitté notre classe, on nous confie un jour un seul élève. Il nous faudra tout d’abord, mais peu à peu, au cours de notre œuvre éducative, faire connaissance avec cet enfant, nous efforcer de connaître l’état de son développement mental, ses acquisitions antérieures, ses aptitudes, ses intérêts, car le but que nous proposerons doit être adapté à tout cela, à moins que nous ne voulions poursuivre l’irréalisable et remplacer l’éducation par le dressage. Ceci nous sera également indispensable, si nous voulons déterminer nos points de départ et adapter les progressions à suivre aux possibilités de notre élève. Après cela la méthode sera, au moins théoriquement, fort simple : il nous suffira de choisir ou de réaliser les conditions de milieu, de matière et de procédés de telle façon que ce choix ou cette réalisation réponde aux intérêts de l’enfant – surtout à ceux qui sont en plein épanouissement ou naissants ; – permette de suivre la progression que nous avons déterminée. Il nous faudra choisir, sélectionner parmi de multiples occasions, faire naître au besoin des occasions favorables, car le pédagogue, si libéral soit-il, ne doit pas être un soliveau. On s’imagine aisément un tel enseignement idéal placé à la croisée des chemins dont l’un conduit au savoir suivant une progression soigneusement déterminée et dont l’autre, plus tourmenté, suit l’évolution des intérêts de l’enfant.
L’application de la méthode idéale à une collectivité d’enfants suppose en plus la détermination pour toutes les matières et tous les types intellectuels :
-
de la progression convenant aux élèves moyens ;
-
des étapes de cette progression qui peuvent être réunies lors de l’enseignement aux élèves forts ;
-
de celles de ces étapes qui doivent être divisées pour faciliter les progrès des élèves faibles.
Si l’on joint à ceci toutes les conditions que nous avons indiquées précédemment, il n’est pas malaisé de se rendre compte que l’idéal que nous avons déterminé est parfaitement inaccessible. Mais, comme nous l’avons dit dès le début de cette étude, cet idéal est un guide précieux qui nous permettra de marcher dans la voie du progrès sans sacrifier les améliorations essentielles aux progrès de moindre importance.
VI. De quelques conditions du progrès.
Cette recherche de la méthode idéale nous permet de concevoir également quelques conditions qu’il serait nécessaire de réaliser pour favoriser la marche du progrès. Citons seulement les principales :
-
transformation des milieux éducateurs ;
-
meilleure formation des maîtres ;
-
collaboration des maîtres et des familles ;
-
classes à effectifs réduits.
Méthodes et systèmes
Il a été question, au début de cette étude des méthodes Decroly, Montessori, etc. Il en est d’autres ; à certaines on donne tantôt le nom de méthode et tantôt celui de système et parfois même le mot plan (plan Dalton, etc.) est employé.
Pour l’étude de ces méthodes, systèmes ou plans nous renvoyons le lecteur au mot système.
– E. DELAUNAY.
BIBLIOGRAPHIE. – Faute de place nous avons négligé certains sujets. Sur la méthode scientifique on pourra lire : H. Le Chatelier : Science et Industrie (Flammarion, édit.) ; divers ouvrages de Louis Favre (A. Costes, édit.), etc. Sur les méthodes de la psychologie nous recommandons l’étude de Lalande, Tome 1 du Traité de Psychologie de Dumas (Alcan, édit.) Sur les méthodes de psychologie et de la pédagogie expérimentale on lira avec fruit : Ed, Claparède : Psychologie de l’enfant et Pédagogie expérimentale (Fischbacher, à Paris ou Kundig, à Genève). Sur le développement de l’Enfant les ouvrages de Descoeudres, Piaget, Luquet, etc. Sur la méthode propre à la formation de la pensée : Dewey : Comment nous pensons (Flammarion édit.).
– E. D.
MÉTIER
n. m. (anciennement : mestier ; du latin populaire misterium, altération de ministerium, office, service)
Le mot métier désigne certaines machines ; il peut s’appliquer à une profession quelconque ; surtout il est synonyme d’art manuel. En ce qui concerne la technique des métiers, le machinisme industriel, la socialisation des instruments de production, l’orientation professionnelle, etc..., nous renvoyons aux articles spéciaux. Ici nous étudierons la raison d’être des métiers, le sens de leur évolution, la parenté originelle et durable qui permet d’associer l’habileté manuelle au savoir et à la beauté.
Inférieur par la force ou l’adresse à nombre d’espèces animales, faible et presque désarmé, lorsqu’il est réduit à la seule puissance de ses jambes et de ses bras, l’homme possède, par contre, cette supériorité incomparable de savoir se servir d’outils. Lancer des pierres, frapper avec un bâton, déchirer à l’aide d’un éclat de silex, ces actions, si simples en apparences et qui réclamaient si peu de réflexion, marquèrent pour l’activité humaine le début d’une ère nouvelle. Utiliser la matière inerte pour décupler ses forces organiques, contraindre la nature à le servir, le chelléen savait le faire et probablement aussi ses ancêtres très lointains dont la préhistoire (voir ce mot) parle encore à peine. Les premiers métiers de nous connus consistèrent à tirer, de morceaux de silex : haches, couteaux, racloirs et instruments divers. Pour aboutir là, les efforts de bien des générations furent indispensables, car la pierre n’est point matière docile ; à l’époque de la pierre taillée, la psychologie du sculpteur reste rudimentaire, mais son adresse manuelle est considérable déjà. En affirmant, de l’homme, qu’il a une intelligence parce qu’il a une main (voir ce mot), Anaxagore était plus proche de la vérité qu’on ne le croit d’ordinaire. C’est au cours de sa lutte contre la matière que l’esprit s’est développé ; la main est aujourd’hui l’instrument docile de la pensée, mais la pensée fut éduquée par le travail de la main, à l’origine. Parce qu’il a façonné bois et pierre, afin de les utiliser comme instruments, l’homme s’est éloigné du gorille pour devenir l’être raisonnable qui commande en maître aux éléments. Entre les métiers assurant la fabrication des haches de silex, puis, plus tard, des objets en ivoire ou en bois de renne, et les métiers modernes, les différences s’avèrent prodigieuses ; néanmoins, les seconds dérivent des premiers. L’histoire de leurs perfectionnements successifs se confond avec l’histoire même du progrès humain. Ajoutons que technique manuelle, art et science restèrent longtemps confondus. C’est afin de mieux régler les travaux des champs que le laboureur désira connaître le cycle exact des saisons, c’est afin ne de pas s’écarter de la bonne route que le pilote s’intéressa aux mouvements sidéraux ; il n’est pas jusqu’aux mathématiques qui ne se confondent, à l’origine, avec l’art de l’architecte et de l’arpenteur. Bien plus tard seulement la connaissance scientifique cessa d’être associée à la pratique d’un métier pour devenir spéculative et désintéressée. Même aujourd’hui, certaines professions manuelles exigent un savoir théorique de haute qualité. Quant à l’art, il resta durant des millénaires, intimement uni à l’exercice des métiers. Sculpter, peindre, etc..., supposent, il est vrai, des qualités mentales qu’on ne saurait confondre avec la dextérité manuelle ; mais c’est à des objets d’utilité pratique que l’homme appliqua d’abord ses talents d’artiste. Le décorateur, l’architecte furent longtemps de simples constructeurs ; le potier devint rapidement peintre et dessinateur ; le fondeur, ouvrier d’art. Si nous passons, de l’époque préhistorique, à celle mieux connue déjà de l’Égypte ancienne, nous trouvons l’artisan ravalé au niveau de la bête par les puissants de ce temps-là. « J’ai vu le forgeron à la gueule du four, lit-on sur certains papyrus ; ses doigts sont rugueux, comme des objets en peau de crocodile ; il est puant plus qu’un œuf de poisson. Les bras du tailleur de pierres sont usés... ses genoux et son échine sont rompus. Les bras du maçon s’usent au travail ; il se ronge lui-même, ses doigts lui sont des pains ; il se fait humble pour plaire ; quand il a son pain, il rentre à la maison et bat ses enfants. Le tisserand est plus malheureux qu’une femme ; il ne goûte pas l’air libre. Si, un seul jour, il manque à fabriquer la quantité d’étoffe réglementaire, il est lié, comme le lotus des marais. C’est seulement en gagnant par des dons de pain les gardiens des portes qu’il parvient à voir la lumière du jour. Le teinturier, ses doigts puent l’odeur des poissons pourris ; ses yeux sont battus de fatigue ; sa main ne s’arrête pas ; il passe son temps à couper des haillons ; c’est son horreur que les vêtements. Le cordonnier est très malheureux ; il mendie éternellement ; sa santé est celle d’un poisson crevé ; il ronge le cuir pour se nourrir. » Ainsi l’artisan égyptien travaillait sous la surveillance de gardiens féroces qui n’épargnaient ni le vieillard, ni le malade. Temples, palais, pyramides, etc..., furent construits grâce aux corvées que chefs et prêtres imposaient aux classes laborieuses ; et, pour toute récompense, l’on distribuait aux travailleurs une ration de vivres généralement insuffisante.
À Rome, les divers métiers furent exercés, soit par des esclaves, soit par des gens de la plèbe, des humiliores. Vers la fin de l’Empire, chaque ville possédait des corps de métier, sortes d’associations industrielles qui groupaient les artisans d’une même profession. Elles avaient un lieu de réunion, des fêtes religieuses, des chefs librement élus ; Alexandre Sévère les autorisa à recevoir des legs et dons. Mais les membres de ces sociétés étaient réduits à une quasi-servitude, et leurs fils étaient contraints de continuer le métier de leur père. Ce fut l’origine des corporations (Voir ce mot) du moyen âge. Ces dernières ne furent pas sans avantage pour l’ouvrier, qu’elles garantissaient contre la concurrence, le chômage et la misère. De plus, elles assuraient une meilleure fabrication des produits, les peines édictées contre les fraudeurs étant d’une sévérité extrême. En 1456, la falsification du vin était punie de mort à Nuremberg ; et c’est à l’étroite surveillance exercée sur les brasseurs que la bière bavaroise dut sa réputation. Mais les inconvénients de cette règlementation outrée l’emportèrent sur les avantages ; ce fut bientôt la disparition complète de la liberté, ce bien de tous le plus précieux. Pour entrer dans un métier, il fallait un apprentissage dont la durée variait de trois à douze ans, selon les cas. Puis d’apprenti on devenait compagnon, c’est-à-dire ouvrier pouvant vivre chez soi, mais sans avoir le droit de travailler hors de l’atelier du patron. Quelques-uns seulement obtenaient la maîtrise, après des épreuves consistant dans la fabrication d’une pièce difficile, d’un chef-d’œuvre ; c’étaient, en général, des fils de patrons ou des ouvriers riches. Solennellement reçus par les jurés ou chefs de la corporation, ils pouvaient alors tenir boutique. Les conditions du travail étaient de même réglementées de la façon la plus minutieuse, et des prud’hommes veillaient à la stricte application des statuts. On aboutit de la sorte, à la stagnation, à la routine, à une méfiance instinctive contre tout progrès. L’absence de concurrence permit de faire payer à la clientèle des prix exorbitants. Enfin la parenté et la richesse comptèrent beaucoup plus que le talent et le mérite aux yeux des jurés chargés d’examiner les candidats à la maîtrise. La tyrannie imposée par les corporations était devenue si intolérable, les maux qu’elles engendraient si patents que leur disparition, pendant la Révolution française, fut saluée avec joie par l’ensemble. Ajoutons que les artisans, trop peu nombreux, deux millions ou deux millions et demi, ne jouèrent qu’un rôle de comparses en 1789 et dans les années suivantes.
Le développement du machinisme (voir ce mot), au XIXème siècle devait modifier complètement la situation des travailleurs manuels. Vapeur, électricité, inventions mécaniques, chimiques, physiques, qui se sont succédées depuis plus d’un siècle sans interruption, ont complètement modifié la technique industrielle. Une infinité de machines effectuent, avec précision et rapidité, des travaux qui exigeaient l’effort prolongé de nombreux spécialistes ou dépassaient même la limite des forces humaines. De plus en plus, la nature, devenue docile grâce à la science, se soumet aux ordres de la raison. Voilà l’aspect brillant du progrès industriel et de la transformation des métiers anciens. Mais ce progrès a eu des conséquences d’un autre ordre. Il a rendu possible la concentration des capitaux, le développement formidable des grandes usines, des grandes compagnies de transport, des grandes banques. À l’atelier, où le patron travaillait lui-même avec quelques ouvriers, s’est substitué l’usine qui groupe des centaines, parfois des milliers d’hommes, sous la direction de contre-maîtres et d’ingénieurs. De pareilles entreprises requièrent des millions ; et la distance est aujourd’hui infiniment plus grande qu’autrefois entre le travailleur manuel et le patron. La facilité croissante des transports a permis, par ailleurs, une concentration des industries elles-mêmes, dans certaines régions, autour des mines et des ports en particulier. Et les petites et moyennes entreprises disparaissent, absorbées par de puissantes sociétés nationales et internationales, par des cartels géants. Ainsi est née la question ouvrière ; nous renvoyons, pour son étude, aux articles concernant le capitalisme et les syndicats.
Le progrès du machinisme et la division du travail, division poussée si loin dans les entreprises où règne la taylorisation, ont achevé aussi d’enlever tout caractère artistique et même tout caractère réfléchi au travail de l’ouvrier. Interminablement le même individu répétera un geste identique, reproduira un mouvement fixé une fois pour toutes. Nul besoin d’intelligence pour effectuer une pareille besogne ; l’usine devient un milieu abrutissant, un bagne en miniature ; et l’on ne s’étonnera pas qu’idiots et Crétins soient particulièrement prisés par de grands patrons américains. Voilà où aboutissent les merveilles d’une « rationalisation » (voir ce mot) qui ne deviendrait légitime que si elle assurait à l’ouvrier, non seulement le confort, mais des loisirs quotidiens pour qu’il puisse cultiver son esprit. Entre l’ingénieur qui coordonne les efforts de l’ensemble et l’ouvrier manuel réduit au rôle de machine, on a ainsi creusé un abîme. De continuels et regrettables malentendus surgissent entre ceux qui travaillent de leur cerveau et ceux qui travaillent de leurs doigts. On sait jusqu’où certains disciples de Karl Marx ont poussé la haine des intellectuels et comment les politiciens exploitent la sourde rancune des masses contre les hommes dont les efforts restent inaperçus parce qu’ils ne sont pas musculaires. D’autre part, les intellectuels n’ont point le droit de mépriser les travailleurs manuels (voir intellectuel, manuel), leurs frères, qui s’élèvent parfois à une hauteur de pensée qu’eux-mêmes n’atteignent pas. Puis la routine est plus dangereuse quand elle envahit l’esprit que lorsqu’elle concerne uniquement les bras ; et la grande majorité des intellectuels, c’est chose triste à dire, semble composée de larbins de la plume, de tâcherons de la pensée, bien inférieurs en dignité, comme en mérite, aux manuels qu’ils prétendent dédaigner. Seuls les créateurs, ceux qui sortent de l’ornière commune et ne sont point esclaves du métier, témoignent d’une supériorité vraie, que ce soit dans le domaine pratique ou dans celui de la spéculation. Terminons en remarquant que la séparation actuelle entre la science, l’art et l’habileté manuelle ne semble ni nécessaire, ni définitive. Certains métiers ont résisté à l’ambiance commune, ils continuent d’associer à une technique modernisée l’amour du beau et du vrai. Inconscience et machinisme ne représentent point la dernière phase du progrès ; les instruments mécaniques valent comme moyens seulement, ne l’oublions pas.
– L. BARBEDETTE.
MÉTRIQUE
(SYSTÈME) n. m. (du latin, metricus ; en grec, métrikos)
Le système métrique est l’ensemble des mesures qui ont le mètre pour base. Le système métrique est décimal, parce que les multiples et les sous-multiples des diverses unités varient comme les puissances de dix. Ce système est établi sur les bases suivantes :
-
Pour chaque espèce de grandeurs, les différentes unités sont des multiples ou des sous-multiples décimaux de l’unité principale ;
-
Toutes les unités principales dérivent d’une mesure unique : le mètre, l’unité principale de longueur ;
-
Le rapport liant les unités principales des différentes espèces de grandeurs est également décimal.
Antérieurement à la réforme du système des poids et mesures, les systèmes en vigueur présentaient de graves inconvénients. Ils étaient loin d’être simples et uniformes. Les subdivisions des diverses unités se déduisaient mal les unes des autres ; des mesures portant le même nom variaient d’une région à l’autre. Il en résultait des difficultés extrêmes pour les calculs. C’est ainsi que nous rencontrons parmi les anciennes mesures qui avaient généralement cours avant l’établissement du système actuel : la toise, valant environ 1 m. 94 ; le pied, qui valait le 1/6 de la toise, soit environ 0 m. 323 ; le pouce, représentant le 1/12 du pied et valant 0 m. 027 ; la ligne, représentant le 1/12 du pouce et valant 0 m. 002.
Déjà, différents rois de France avaient songé à remédier aux inconvénients des anciens systèmes de mesures. L’Assemblée Constituante réalisa cette pensée et un décret du 8 mai 1790 décida l’uniformité des poids et mesures pour l’étendue de la France. Pour donner à ce système une base invariable, on eut la pensée de la prendre dans les dimensions du globe. Une commission de savants, parmi lesquels figuraient Laplace, Monge et Lagrange, proposa de fonder le nouveau système sur une unité de mesure fondamentale naturelle qui devait être invariable et facile à trouver. En même temps elle décida de donner à tout le système la forme décimale, ce qui est sans conteste le plus grand progrès accompli dans le domaine des poids et mesures (voir ce mot), et elle établit que pour toutes les mesures de longueurs, de contenu et de poids, une unité déterminée de longueur : le mètre, servirait d’étalon.
Pour établir l’unité fondamentale du nouveau système métrique, il fallut exécuter, avec des méthodes perfectionnées, d’observation et de calcul, des mesures de degrés aussi exactes que possible sur un méridien, c’est-à-dire sur un arc d’ellipse perpendiculaire à l’équateur et passant par les deux pôles, de l’axe de la terre (voir Méridien). Les astronomes Méchain et Delambre mesurèrent le grand arc méridien entre Dunkerque, sur la côte septentrionale de la France, et Barcelone, sur la côte nord de l’Espagne. Ce méridien fut ensuite prolongé, pendant les premières années du XIXème siècle, en 1806, jusqu’à l’île de Fermentera, à l’ouest des îles Baléares, par les astronomes Biet et Arago, qui furent chargés de collaborer aux mesures entreprises par Méchain et Delambre afin d’en activer l’achèvement. Ils terminèrent donc la mesure de l’arc de méridien en question et calculèrent qu’un méridien entier devait contenir 20.522.960 toises et que la longueur du 1/4 du méridien, c’est-à-dire la distance du pôle à l’équateur, était égale à 5.130.740 toises. Cette longueur a été divisée par dix millions et on a trouvé pour la longueur du mètre 0 toise 513.074 ou 443.296 lignes de Paris, ou encore 3 pieds, 11 lignes 296 millièmes, On construisit alors trois barres de platine ayant cette longueur, qui furent déposées aux Archives Nationales et, ce fut la longueur d’une de ces barres, prise à la température de zéro degré centigrade, qui constitua le mètre. Avec le temps ces mètres étalons s’usèrent considérablement par suite des nombreuses comparaisons pour lesquelles on les utilisa et à cause de la résistance insuffisante du platine. On décida donc, en 1872, de reconstruire de nouveaux prototypes du mètre avec un alliage de métaux particulièrement résistant et en leur donnant une forme spéciale. C’est donc cette unité qui est devenue la base du système métrique des mesures, dont les principaux avantages sont de ramener le calcul des grandeurs rapportées aux mesures métriques au calcul des nombres entiers et décimaux, et de faire dépendre le poids d’un corps de son volume et de son poids spécifique.
Un décret du 2 novembre 1801 avait rendu le système métrique obligatoire, mais à la suite de vives protestations, le gouvernement autorisa la fabrication de mesures, dites usuelles, qui portaient le nom des anciennes, mais qui étaient en rapport exact avec les nouvelles ; ainsi il y eut un pied égal au tiers du mètre, une toise de deux mètres, etc.
Ce n’est que depuis la loi du 4 juillet 1837, exécutoire à partir du 1er janvier 1840, que le nouveau système a été rendu officiellement exclusif, qu’il a été accepté effectivement par les masses. Un grand nombre de nations ont adopté le système métrique, qui comprend les unités de longueur, de surface, de volume, de capacité et de poids.
Mais la base fondamentale du système métrique n’est rien moins qu’invariable. En effet, le rapport du mètre à la circonférence de la terre est arbitraire difficile à obtenir et n’est mesurable qu’avec inexactitude. Cette opération est toujours susceptible d’un perfectionnement ultérieur avec les progrès de la science. Les mesures exactes d’arcs de méridien qui ont eu lieu au cours du XIXème siècle, établissent qu’aujourd’hui le mètre étalon se trouve être trop court d’environ 2/10 de millimètre (exactement 19/100e de mm.). Les savants ont estimé qu’il était inutile de recommencer, pour un écart si faible, les longues et minutieuses expériences qui ont servi à établir l’étalon prototype. Le mètre est donc, comme les autres unités anciennes, une mesure conventionnelle ; il ne représente donc plus, actuellement, exactement la dix millionième partie du quart du méridien terrestre, et il convient de le définir comme suit : le mètre est la longueur, à la température de zéro degré centigrade, d’une barre de platine iridié – prototype international – en forme d’X, déposée au bureau international des poids et mesures, au pavillon de Breteuil, à Sèvres, près de Paris.
Notre système métrique comprend six espèces d’unités qui sont : le mètre pour les mesures de longueurs ; le mètre carré pour les mesures de surface ; le mètre cube pour les mesures de volume ; le litre pour les mesures de capacité ; le gramme pour les mesures de poids ; le franc pour les monnaies. Pour évaluer avec plus de facilité les diverses grandeurs on emploie avec les unités principales, des multiples et des sous-multiples décimaux de ces unités. Les multiples se forment à l’aide des mots grecs suivants placés devant le nom de l’unité principale : Déca qui signifie dix ; hecto qui signifie cent ; kilo qui signifie mille ; myria qui veut dire dix mille. Les sous-multiples s’expriment à l’aide des mots latins suivants que l’on place comme les précédents, devant l’unité principale : déci qui veut dire dixième ; centi qui veut dire centième ; milli signifiant millième.
Mesures de longueur
Mesures servant à évaluer l’étendue considérée sous une seule dimension : la longueur. Le mètre en est l’unité principale. Les multiples du mètre sont le décamètre, l’hectomètre, le kilomètre et le myriamètre valant respectivement 10, 100, 1.000 et 10.000 mètres. Le mégamètre, utilisé en géodésie, vaut 1 million de mètres. Les astronomes emploie fréquemment l’unité astronomique, représentant la distance de la Terre au Soleil, soit 149.400.000 kilomètres. L’année lumière qui est la distance parcourue en un an par la lumière qui voyage à raison de 300.000 kilomètres à la seconde, soit 9 trillions 467 milliards de kilomètres, et le parsec (dérivé du parallaxe-seconde) qui vaut 3 1/4 année lumière, soit 31 trillons de kilomètres, sont des unités également employées en astronomie.
Les sous-multiples du mètre sont le décimètre, le centimètre, le millimètre valant respectivement le 1/10, le 1/100, le 1/1.000 du mètre. Les microbiologistes et les physiciens ont adopté des unités plus petites encore : le micron, millionième partie du mètre ; la millionième partie du millimètre et le tenth-mètre ou dix-millionième partie du millimètre.
Mesures de surface
Mesures servant à évaluer l’étendue considérée sous deux dimensions : longueur et largeur. L’unité principale est le mètre carré ou le carré qui a un mètre de côté. Les multiples du mètre carré sont le décamètre carré, l’hectomètre carré, le kilomètre carré valant respectivement 100, 10.000 ; un million de mètres carrés. Les sous-multiples sont le décimètre carré qui vaut le centième du mètre carré ; le centimètre carré qui vaut le dix-millième du mètre carré et le millimètre carré valant le millionième du mètre carré. Les multiples et les sous-multiples du mètre carré forment une suite d’unités qui sont de cent en cent fois plus grandes ou plus petites.
Les mesures agraires qui servent à évaluer des terrains de peu détendue ont une unité principale : l’are, valant un décamètre carré ; l’hectare, son seul multiple, égale cent ares ou un hectomètre carré ; le centiare ou mètre carré est le seul sous-multiple de l’are.
Mesures de volumes
Mesures servant à évaluer l’étendue considérée sous trois dimensions : longueur, largeur et épaisseur ou hauteur. L’unité principale est le mètre cube. Les multiples de ce dernier sont peu usités, ce sont le décamètre, l’hectomètre, le kilomètre et le myriamètre cubes. Les sous-multiples sont : le décimètre cube, le centimètre cube, le millimètre cube valant respectivement le millième, le millionième et le milliardième du mètre cube. Les multiples et les sous-multiples du mètre cube forment une suite d’unités qui sont de 1.000 en 1.000 fois plus grandes ou plus petites.
Le stère est l’unité principale employée pour évaluer le volume du bois de chauffage. Il vaut exactement un mètre cube et n’a qu’un multiple et un sous-multiple : le décastère valant dix stères et le décistère qui vaut la dixième partie du stère.
Mesures de capacité
Ce sont celles que l’on emploie pour mesurer le liquide et les matières sèches. L’unité principale de capacité est le litre, dont la contenance égale un décimètre cube. Les multiples du litre, ainsi que ses sous-multiples s’expriment de la même façon que ceux du mètre et forment une suite d’unités de dix en dix fois plus grandes ou plus petites. Le litre est le volume d’un kilogramme d’eau pure prise à son maximum de densité et pesée dans le vide, (Définition théorique.)
Mesures de poids
Mesures dont on se sert pour peser. L’unité principale de poids est le gramme, qui représente le poids dans le vide d’un centimètre cube d’eau distillée prise à son maximum de densité, c’est-à-dire à la température de 4 degrés centigrades. (Définition théorique.)
Les multiples du gramme s’expriment comme ceux du mètre et du litre ; ils forment eux aussi une suite d’unités de dix en dix fois plus grandes. Dans le commerce et l’industrie, où souvent on a besoin de fortes pesées, on se sert du quintal qui vaut 100 kilos et de la tonne qui en vaut 1.000. Les sous-multiples du gramme expriment des unités de dix en dix fois plus petites que l’on obtient aisément en faisant précéder le mot gramme des termes latins que nous avons nommés.
* * *
Les monnaies se rattachent au système décimal, par le franc qui pèse cinq grammes et qui doit être formé de neuf parties d’argent et d’une partie de cuivre. Inutile d’ajouter qu’aujourd’hui cette convention est loin d’être respectée ; nos monnaies sont remplacées en majeure partie par des billets de banque et les rares pièces de monnaies encore en circulation sont loin d’être conformes à la définition primitive. Nous n’insisterons pas plus longtemps sur cette partie du système métrique.
La lecture de ce qui précède renseignera, mieux qu’une longue dissertation, sur les avantages du système actuel des poids et mesures. Un nombre déjà important de pays les ont compris et ont rendu le système métrique obligatoire sur leur territoire et dans leurs colonies, au moins pour les transactions officielles et publiques : Ce sont l’Allemagne, la République Argentine, le Chili, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Brésil, la Colombie, le Danemark, l’Espagne, la France, les Pays-Bas, l’Équateur, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, le Mexique, la Norvège, le Pérou, le Portugal, la Russie, la Roumanie, la Serbie, la Suède, le Vénézuela, la Suisse. D’autres en admettent seulement l’usage facultatif. Tels les États-Unis, la Grande-Bretagne et ses dépendances, l’Égypte, etc...
On comprend mal l’esprit particulariste, la routine ou l’amour-propre qui retiennent ces nations à des mesures incommodes et aux calculs compliqués, incomprises au dehors. Si, entre autres, les pays de langue anglaise entraient dans le groupe des nations ralliées au système métrique, un pas décisif serait fait vers la généralisation de ce système, car il deviendrait pratiquement mondial. Cette unification apporterait aux échanges internationaux, paralysés par des restrictions et des obstacles de tout ordre, des facilités profitables à tous les peuples.
– CHARLES ALEXANDRE.
BIBLIOGRAPHIE. – Bigourdin : Le système métrique.
MICROBE
n. m. (grec mikrobios, de mikros, petit et bios, vie)
Le mot microbe, créé par le Dr Sédillot en 1878, fut appliqué, d’abord, à des organismes très différents, bien que tous également invisibles à l’œil nu. Puis il devint presque synonyme de bactérie. Utilisant des microscopes encore très imparfaits, Leenvenhoeck, au XVIIème siècle, avait découvert un grand nombre de ces vivants minuscules, dans les infusions végétales et les matières en décomposition. En 1773, grâce aux progrès survenus dans la construction des instruments d’optique, Müller donne une étude détaillée sur eux, en les désignant sous le nom d’infusoires. Ehrenberg publie, à leur sujet, en 1833, un ouvrage remarquable ; mais il continue de considérer tous ces êtres microscopiques comme des animaux. Un peu plus tard, Cohn et Nœgeli devaient les classer dans le règne végétal. Enfin Pasteur et Tyndall (précédés par Raspail) montrèrent le rôle énorme de ces animalcules, tant au point de vue médical qu’au point de vue industriel. Et, dès lors, l’étude des microbes sera l’une des branches essentielles de la science expérimentale. Pasteur démontra que, dans l’état actuel, la vieille formule de Harvey : omne vivum ex ovo (tout vivant sort d’un œuf), reste vraie. Non qu’il ait déclaré l’homme radicalement incapable de produire de la matière vivante, comme on le laisse croire d’ordinaire pour l’édification des bien-pensants ; dans une conférence faite à la Société Chimique de Paris, le 22 décembre 1883, il donne à entendre qu’il a tenté cette suprême découverte. Mais il établit que les liquides organiques, même les plus putrescibles, sont incapables de donner directement des êtres vivants ; c’est aux germes, qui abondent dans l’air non calciné, que sont dues les altérations qu’ils subissent d’ordinaire. Un liquide, stérilisé au préalable, se conserve indéfiniment dans l’air privé de germes soit par simple filtration à travers une bourre de coton ou d’amiante, soit par une calcination à 130°, soit de tout autre manière. Il n’existe pas actuellement de génération spontanée. En fut-il toujours de même ? Pasteur n’a pas, ne pouvait pas trancher la question. Beaucoup pensent que les conditions physico-chimiques des époques primitives ou primaires ont rendu possible l’apparition d’un protoplasma (voir ce mot) rudimentaire mais vivant, qui n’impliquait point l’existence d’un œuf antérieur. Plusieurs estiment même qu’aujourd’hui encore la vie sort de l’inorganique et que la faible portée, aussi bien de nos instruments que de nos sens, est la seule cause qui nous empêche de le démontrer clairement. Quant à la théorie déjà ancienne des germes se propageant de planète à planète pour y faire éclore la vie, elle a recruté de nombreux partisans, depuis que l’on a mis en relief l’action propulsive des rayons lumineux sur les poussières cosmiques. L’intérêt philosophique, arbitrairement prêté par les penseurs spiritualistes aux expériences de Pasteur sur la génération spontanée, s’avère donc de médiocre importance. Mais elles conduisirent le célèbre chimiste à l’étude approfondie des ferments, puis des virus. De tout temps on avait rapproché les fermentations des maladies infectieuses ; mais alors que le milieu fermentescible est inerte, modifiable et déterminable à notre gré, l’organisme infecté s’avère vivant et d’une complexité impénétrable. Aussi Pasteur rechercha-t-il d’abord les causes profondes de la fermentation : « Depuis longtemps, a-t-il écrit, j’ai été conduit à envisager les fermentations (voir ce mot) comme des phénomènes chimiques corrélatifs d’action physiologique d’une nature particulière. Non seulement j’ai montré que leurs ferments ne sont point des matières albuminoïdes mortes, mais bien des êtres vivants, mais j’ai provoqué, en outre, la fermentation du sucre, de l’acide lactique, de l’acide tartrique, de la glycérine, dans des milieux exclusivement minéraux, preuve incontestable que la décomposition de la matière fermentescible est corrélative de la vie du ferment et que cette matière constitue un de ses aliments essentiels. Ce qui sépare les phénomènes chimiques des fermentations d’une foule d’autres, et particulièrement des actes de la vie commune, c’est le fait de la décomposition d’un poids de matière fermentescible bien supérieur au poids du ferment en action. Je soupçonne que ce caractère particulier doit être lié à celui de la nutrition en dehors du contact de l’oxygène libre. Les ferments sont des êtres vivants, mais d’une nature spéciale, en ce sens qu’ils jouissent de la propriété d’accomplir tous les actes de leur vie, y compris celui de leur multiplication, sans mettre en œuvre d’une manière nécessaire l’oxygène de l’air atmosphérique. » Plus tard, Pasteur étendra aux maladies contagieuses les propositions fondamentales établies pour les fermentations. Toutes deux résultent de la multiplication d’être vivants invisibles à l’œil nu, les microbes ; à chaque maladie infectieuse correspond un virus spécifique, comme à chaque fermentation différente un microorganisme particulier. Parasites capables d’une vie indépendante, les virus peuvent être cultivés hors de l’organisme, dans des milieux artificiels ; ce qui procure un excellent moyen d’investigation. Après des recherches approfondies sur les ferments et la maladie de la bière, Pasteur aborda l’étude du charbon, qui décimait alors les troupeaux, puis de la rage. Ses découvertes mémorables lui valurent une gloire dont nous ne contestons pas la légitimité. Mais s’il eut le mérite d’attirer l’attention sur le rôle des microbes, disons que ses successeurs modifièrent ses méthodes et ses idées sur bien des points. Après une phase de vogue extrême, le pasteurisme médical est fort malmené aujourd’hui ; l’explication microbienne des maladies contagieuses, ainsi que la fixité morphologique des microbes venus du dehors ou exogènes sont battues en brèche. On s’arrête de préférence à l’action des glandes endocrines et de leurs produits, à celle des doses infinitésimales, dont les homéopathes avaient déjà montré l’importance, à l’interprétation chimique des maladies et au rôle des équilibres ou arcs nerveux. Néanmoins l’on aurait tort de sous-estimer la place de la microbiologie ; elle reste et restera essentielle en médecine, en chirurgie et dans maintes branches de l’industrie.
Ainsi que nous l’avons dit précédemment, le terme microbe est devenu presque synonyme de bactérie dans le langage courant ; néanmoins certains champignons, des levures et des moisissures surtout, ainsi que plusieurs protozoaires sont à ranger parmi les microbes. Bien que dépourvues de matière colorante en général, les bactéries sont classées parmi les Cyanophycées ou Algues bleues, à cause de leur mode de reproduction. On distingue, d’après leur forme, les Microcoques, corpuscules arrondis tels que les ferments acétiques, les Bacilles, bâtonnets rectilignes comme les microbes du charbon, les Vibrions, filaments incurvés pareils à ceux du choléra, les Spiriles en forme de baguettes spiralées, les Spirochètes, aux spirales serrées, etc... Il existe des virus filtrants, invisibles même avec les meilleurs microscopes, tant leurs dimensions sont exiguës, et qui traversent les bougies-filtres Chamberland. Les virus de la fièvre jaune, de la rage, de la variole, de la scarlatine rentrent dans cette catégorie ; ce sont des bactéries semble-t-il, toutefois celui de la fièvre jaune paraît être un protozoaire. Ajoutons que la forme des microbes change avec le milieu nutritif et les variations de température, ce qui rend malaisé parfois leur détermination spécifique. Dans une solution de peptone, à 36°, les vibrions du choléra se transforment en petits bâtonnets, tandis que les bâtonnets du charbon donnent de longs filaments, quand ils sont cultivés dans un bouillon de poule. Nombre de bactéries possèdent des cils vibratiles qui leur assurent une grande mobilité ; on admet que chacune est composée d’une cellule unique, avec membrane et noyau réduit à des granulations éparses de chromatine, dans certaines espèces. Chez les microcoques, le protoplasme est peu volumineux ; toute la partie centrale semble occupée par un noyau. C’est par étranglements successifs que s’opère la multiplication des bactéries ; chaque cellule se coupe transversalement, et les deux parties ainsi engendrées, après avoir grandi, se sectionnent à leur tour. Si le milieu est favorable, la multiplication peut se faire avec une extrême rapidité ; un bacille rameux en donnera parfois quatre millions en douze heures ; mais elle s’arrête lorsqu’il devient contraire. Dans certaines conditions, des spores apparaissent, corpuscules sphériques entourés d’une membrane fort résistante. Protégées contre le froid ou la dessiccation, ces spores gardent longtemps leur vitalité ; elles germent pour se multiplier à nouveau dès que les circonstances redeviennent favorables. Les microbes aérobies ont un besoin absolu d’oxygène ; ils le puisent directement dans l’atmosphère ou le dégagent de combinaisons peu stables où il entre comme élément. Ainsi les bacilles du charbon décomposent l’oxyhémoglobine du sang pour absorber l’oxygène et provoquent l’asphyxie des tissus. Par contre, les microbes anaérobies cessent de se multiplier dès qu’ils sont en contact avec l’oxygène libre ; c’est le cas du bacille butyrique qui, atteint par l’air, devient immobile et meurt. Mais les anaérobies utilisent l’oxygène en combinaison ; ce qui conduit, en définitive, à des résultats identiques. Entre aérobies et anaérobies il existe d’ailleurs de nombreux intermédiaires ; le bacille de la fièvre typhoïde peut vivre sans air, il se développe mieux cependant au contact de l’oxygène. Pour la majorité des bactéries la température la plus favorable est comprise entre 35 et 40° ; beaucoup sont tuées lorsqu’elle s’élève de 60 à 80°. Mais la résistance de leurs spores est parfois très grande ; celles de la gangrène ne sont tuées qu’à 108°, celles du foin à 120° ; celles du charbon peuvent supporter 123° dans un milieu sec. Une température de 100° n’est donc pas suffisante pour obtenir une stérilisation parfaite ; elle tue néanmoins la majorité des germes. Quant aux basses températures, elles restent sans effet ; le microbe de la rage n’est pas tué à -20°, et celui du charbon continue de vivre après avoir supporté -130° pendant toute une journée. À la longue, l’air exerce une action destructive sur la majorité des bactéries, de même la lumière solaire, grâce aux rayons bleus, violets et surtout ultra-violets ; certaines substances dites antiseptiques sont également microbicides, ainsi le bichlorure de mercure, le permanganate de potasse, le formol, l’acide sulfureux, le lait de chaux, le sulfate de cuivre, le chlorure de chaux, l’acide phénique. Pour étudier les microbes on les cultive dans des milieux nutritifs appropriés : bouillons de viande ou de végétaux, peptones, sérum sanguin, tranches de pommes de terre ou de carottes, fruits, morceaux de gélatine ou de gélose. Ensemencées au préalable, ces substances sont conservées dans des tubes ou des ballons et maintenues à la température de 35°. Les laboratoires bactériologiques arrivent à disposer d’une collection de microbes très variés ; plusieurs toutefois n’ont pu être cultivés de la sorte jusqu’à présent. Veut-on obtenir un milieu liquide, un bouillon de viande par exemple, on commence par faire macérer à froid, dans un litre d’eau, 500 grammes de bœuf ou de veau que l’on a divisé, au préalable, en menus fragments. Après avoir exprimé ce mélange, on ajoute 5 grammes de sel marin, plus 1 gramme de phosphate de soude, au bouillon obtenu, que l’on maintient dix minutes dans un autoclave à 115° et que l’on passe sur un filtre mouillé. Une solution de soude au dixième permet ensuite de neutraliser ; puis le liquide est de nouveau maintenu quinze minutes dans un autoclave à 120°. La liqueur filtrée sera répartie dans des tubes ou des ballons, stérilisés au préalable, et refermés ensuite avec un tampon d’ouate. Pour obtenir un milieu solide à la gélatine, on ajoute 100 grammes de gélatine à 1000 grammes de bouillon ; on porte à l’ ébullition et lorsque le mélange est ramené à 50°, on colle au blanc d’œuf et on alcalinise faiblement. Après quinze minutes d’autoclave à 110°, on filtre et répartit le produit dans des tubes stérilisés que l’on portera de nouveau à 110°, durant dix minutes. Plus tard, à l’aide d’une pipette ou d’une aiguille stérilisée, on introduira, dans le milieu liquide ou solide, une minime portion de substance contenant le microbe à cultiver. Par d’ingénieux procédés, l’on parvient à isoler une espèce de bactéries de toutes les autres qui coexistent avec elle dans le milieu ambiant et l’on arrive à des cultures pures permettant de démontrer, par inoculation, que tel ou tel microbe est l’agent d’une maladie donnée. Le même milieu ne convient pas à toutes les espèces indifféremment ; le bacille tuberculeux qui prospère dans le sang gélosé ou glycériné, ne pourra vivre dans la gélose pure. Ajoutons que la virulence d’un microbe pathogène peut s’accroître ou diminuer, selon les conditions de culture ; elle s’aggrave, pour le microcoque rabique, en passant par l’organisme du lapin ; elle s’atténue à 42° 5, pour le bacille charbonneux qui, inoculé impunément aux animaux, constitue alors un vaccin.
Fermentations et maladies sont deux manifestations particulièrement étudiées de l’activité microbienne. La fermentation alcoolique est provoquée par des champignons, les levures, dont la multiplication s’opère par bourgeonnement et qui vivent, soit au contact de l’air en se comportant comme une plante ordinaire, soit dans un milieu privé d’oxygène libre où elles doivent résister à l’asphyxie. Dans ce dernier cas, la levure de bière secrète l’invertine et la zymase, deux diastases dont la première transforme la saccharose en glucose et la seconde détermine la fermentation du glucose. Levure ellipsoïde et levure apiculée secrètent seulement la zymase. C’est sous l’influence du mycoderma aceti que s’accomplit la fermentation acétique ou transformation de l’alcool éthylique en acide acétique. La bactérie lactique, essentiellement aérobie, utilise les lactoses et les glucoses pour donner l’acide lactique. Quant au ferment butyrique, le bacille amylobacter, très l’épandu dans la nature, il est l’agent habituel de décomposition des tissus végétaux, mais reste sans action sur les tissus lignifiés ou subréfiés, ainsi que sur certaines variétés de cellulose. Il se substitue souvent à la bactérie lactique, quand l’oxygène est épuisé ; à l’état libre, ce dernier gaz le tue rapidement.
La science chirurgicale fit aussi une heureuse application des principes de Pasteur. Peut-être lui procura-t-elle son plus grand triomphe dans l’ordre médical, car on a reconnu que l’obscur travail des infiniment petits n’entre pour aucune part dans l’origine de nombreuses maladies. L’infection des plaies rendait souvent mortelles des opérations considérées présentement comme anodines. On ignorait la cause de cette infection, et les microbes les plus virulents, introduits par l’opérateur, pullulaient bientôt, provoquant des complications fatales. Elles ont à peu près disparu et, avec elles, le principal danger des interventions chirurgicales : septicémie, érysipèle, tétanos, infection purulente sont de lointains souvenirs. Les plaies faites au cours des opérations guérissent seules, maintenant, en quelques jours. Dès 1830, un humble médecin de campagne, Jean Hameau, avait eu l’intuition géniale des méthodes qu’il fallait employer ; Hœberlé, Le Fort et d’autres attribuaient une énorme importance aux soins de propreté ; Alphonse Guérin, vers la fin de 1870, songeait à préserver les membres amputés du contact de l’air. Mais c’est un chirurgien d’Edimbourg, Lister, qui, s’inspirant des travaux de Pasteur, créa vraiment la méthode antiseptique. Aujourd’hui, nouveau perfectionnement, tous les objets mis en contact avec la plaie sont, au préalable, stérilisés par la chaleur : instruments, aiguilles, agrafes passent dans des étuves sèches ; ouate, fil, objets de pansement dans des autoclaves. L’opérateur porte des gants, un masque, une blouse stérilisés ; malheureusement, malgré les lavages et brossages de la peau à l’endroit que le bistouri doit attaquer, malgré la teinture d’iode dont on la recouvre, des germes peuvent subsister, et l’air des salles d’opération n’est, lui aussi, que bien difficilement purifié des poussières qui voltigent partout. Ces derniers progrès se sont accomplis sous l’impulsion de Terrier qui, à la méthode antiseptique de Lister, substitua la méthode aseptique ; la première luttait contre l’infection des plaies par des moyens chimiques ; la seconde vise à l’éviter par l’emploi généralisé de la stérilisation préalable. On voit quelles prodigieuses répercussions les recherches microbiennes ont eu sur la chirurgie.
En médecine pure, après avoir voulu tout expliquer par les bactéries, on a constaté que bien des maladies étaient d’ordre biologique et soulevaient des difficultés qui ressortissent tant de la haute physique que de la chimie transcendante. Néanmoins, lorsqu’il s’agit de maladies transmissibles, c’est à la microbiologie qu’il faut recourir pour en connaître et les causes et les remèdes. Tuberculose, syphilis, diphtérie, fièvre typhoïde, choléra, charbon, rage, peste, fièvre jaune, fièvres paludéennes, tétanos, dysenterie, teignes, fièvre récurrente, maladie du sommeil, variole sont du nombre ; et l’on sait que plusieurs de ces affections comptent parmi les pires fléaux du genre humain. Koch découvrît, en 1882, le bacille de la tuberculose, mais ni lui ni aucun chercheur n’a pu trouver, jusqu’à présent, de sérum d’une efficacité indiscutable contre cette maladie si répandue. C’est dans les poumons, dont il détruit les tissus en formant de petits corps grisâtres et durs, les tubercules, qu’il s’installe de préférence ; ces tubercules s’amolliront plus tard et se transformeront en crachats, laissant à leur place des excavations ou cavernes qui s’agrandissent avec les progrès de la maladie. Le bacille de Koch possède cette particularité d’avoir une membrane imprégnée de cire. Nous dirons peu de chose du tréponème, producteur de la syphilis, dont on parlera ailleurs ; il est très difficile à étudier parce que sa culture est impossible dans nos milieux artificiels, soit liquides, soit solides. On sait les ravages causés en Afrique par la maladie du sommeil qui atteint les animaux domestiques et les hommes ; elle est due, à un protozoaire, le trypanosome, inoculé dans le sang par la piqûre de la mouche tsé-tsé. Contre nombre d’affections microbiennes, le charbon, la rage, la diphtérie, la fièvre typhoïde, la peste, par exemple, on a trouvé des vaccins efficaces. Ce fut le médecin anglais Jenner qui, en 1796, découvrit le premier vaccin ; la variole faisait de grands ravages en Europe ; Jenner avait observé que les personnes ayant eu aux mains la vaccine ou cow-pox, maladie bénigne qui produit des pustules sur le pis des vaches, étaient immunisées contre la variole humaine. Il eut l’idée de pratiquer méthodiquement l’inoculation de la vaccine ; et les résultats obtenus confirmèrent ses suppositions. Depuis les découvertes de Pasteur, la liste des vaccins ne cesse heureusement de s’accroître d’année en année. Si le cancer, ce mal effroyable, était d’origine microbienne, on pourrait espérer qu’un jour un sérum serait découvert contre lui. Mais beaucoup ne l’attribuent point à l’action des infiniment petits ; ses causes véritables seraient d’une toute autre nature, et l’on devrait chercher dans un sens différent pour obtenir sa guérison. Disons qu’à ce sujet, l’on ne peut hasarder aucune affirmation sûre. A côté des microbes pathogènes, il en existe un grand nombre qui n’exercent aucune action nocive sur l’homme ou les animaux ; quelques-uns sont utiles, on le remarque à propos de la digestion. C’est le bacille amylobacter qui, dans notre estomac, décompose la cellulose des végétaux tendres, dans une proportion de 25 à 50 p. 100 ; proportion qui devient plus considérable chez les herbivores.
L’atténuation de la virulence, lorsque le microbe pathogène est soumis à certaines conditions, a permis la création de vaccins artificiels. Maintenue huit jours à 42° 5, une culture de bacille charbonneux devient inoffensive. Elle est, de plus, capable de conférer l’immunité, comme le démontrèrent les expériences faites par Pasteur, le 5 mai 1881, à la ferme de Pouilly-le-Fort, près de Melun. L’immunité que confère l’inoculation résulte d’une réaction humorale de l’organisme, productrice d’anticorps qui agglutinent et dissolvent les corps étrangers. Chez le cobaye, vacciné au préalable contre le choléra, l’on constate après une injection du bacille virgule, cause de la maladie, que le liquide péritonal agglutine les microbes en amas granuleux puis les dissout. De délicates expériences ont même prouvé que cette action dissolvante est due à deux substances : une substance sensibilisatrice développée par le sérum (elle est spécifique et n’agit que sur les microbes de l’espèce injectée) ; une substance complémentaire existant dans le sang normal et qui agit sur les microbes les plus divers. Quand certaines espèces animales jouissent d’une immunité naturelle, qui les protège contre des maladies microbiennes déterminées, c’est qu’elles renferment normalement, dans leurs humeurs, les anticorps qui lutteront contre les germes de ces maladies. Le sérodiagnostic utilise la formation de sensibilisatrices spécifiques pour se prononcer sur l’existence ou non de telle ou telle affection. On peut, d’ailleurs, conférer l’immunité avec des toxines microbiennes atténuées. Si l’on filtre un bouillon de bacille diphtérique, le liquide obtenu sera privé de microbes, mais contiendra toujours les toxines que secrétèrent ces derniers ; toxines fort dangereuses et dont l’inoculation, à des doses infinitésimales, provoquera les accidents paralytiques de la diphtérie ordinaire. Or, atténuées par une chauffe à 37°, pendant trois semaines, en présence d’une petite quantité de formol, ces toxines n’ont pas d’effet nocif et prémunissent contre la maladie. De plus, l’entraînement développe l’immunité ; grâce à des injections graduées et successives, un cheval arrive à jouir d’une super-immunité. Pour obtenir le sérum qui sauvera l’enfant atteint de diphtérie pure, il suffira dès lors de saigner ce cheval, et de mettre en réserve, dans des flacons stérilisés, le sérum recueilli après coagulation. Vaccins et sérums sauvent les patients grâce à des antitoxines ; mais la vaccination conduit l’organisme à les produire lui-même et confère ainsi une immunité durable, tandis que le sérum les introduit du dehors et ne provoque qu’une immunité passagère : le premier est préventif, le second curatif. Le nombre des sérums ne cesse de croître comme celui des vaccins ; il en existe contre le tétanos, le choléra, le charbon, et la sérothérapie est devenue une branche importante de la médecine.
Mais l’introduction, dans l’organisme, de colloïdes microbiens vivants ou non-vivants n’a pas toujours pour effet de le rendre réfractaire à la maladie ; parfois, au contraire, elle le rend plus sensible à une atteinte ultérieure. Ce phénomène est appelé anaphylaxie ; il oblige à des précautions dans l’emploi des sérums curatifs. Personne ne peut soupçonner quelles découvertes futures nous réservent les recherches micro-biologiques ; nous avons assez parlé de celles qui sont acquises aujourd’hui, pour montrer combien utile, et aussi combien complexe, est l’étude des infiniment petits.
– L. BARBEDETTE.
MICROSCOPE
n. m. (du grec : mikros, petit et skopein, observer)
Instrument d’optique destiné à observer les objets ou les êtres trop petits pour être suffisamment accessibles à notre vue. Il y en a de deux sortes : le microscope simple ou loupe et le microscope composé à qui l’on conserve plus particulièrement le nom de microscope.
La loupe est une petite lentille très convergente qui est employée comme verre grossissant. Elle est ordinairement montée sur un cercle de corne ou d’écaille et certaines possèdent un dispositif permettant de les adapter à un manche ou à un pied porte loupe, elles sont ainsi d’un usage manuel plus facile. Il existe maints modèles de « loupes doubles », formées de deux lentilles montées ensembles l’une devant l’autre et donnant un grossissement plus fort.
Le microscope composé est, comme son nom l’indique, composé de plusieurs parties distinctes dont voici les principales : le statif ou support avec l’appareil d’éclairage ; le tube qui renferme les lentilles ; le dispositif pour le changement des objectifs et les pièces optiques : objectifs, oculaires, condensateur.
Dans le statif qui supporte tout l’appareil, il y a lieu de distinguer la base, point d’appui du microscope. Au tiers inférieur du statif est adapté une platine, percée en son centre d’un petit trou dont on diminue à volonté l’ouverture à l’aide de diaphragmes de grandeurs différentes. Indépendamment des microscopes possédant un statif fixe, la grande majorité des appareils ont un statif pouvant s’incliner à 90 degrés.
Les lentilles qui servent à grossir les objets que l’on examine sont de deux espèces : l’oculaire et l’objectif. L’oculaire est ainsi appelé parce que c’est la lentille qui se place près de l’objet. Dans l’oculaire comme dans l’objectif, il y a plusieurs verres superposés. L’objectif donne une image réelle, renversée et amplifiée de l’objet que l’on étudie. L’oculaire est placé de telle sorte que l’œil qui regarde à travers, au lieu de voir l’image simplement agrandie par la première lentille, voit une image virtuelle de nouveau agrandie.
Les objets à examiner sont posés sur des lames de verre minces appelées lames porte-objets dont l’épaisseur est comprise entre 0,9 et 2 mm. La préparation placée sur la lame doit très souvent être incluse dans un liquide ou un autre médium approprié et recouverte d’une autre lamelle de verre très mince de 0,1 à 0,2 mm d’épaisseur. La préparation ainsi apprêtée est posée sur la platine du microscope. Le trou percé au centre de la platine sert au passage de la lumière, car il est indispensable, dans la plupart des cas, que la préparation que l’on veut étudier soit fortement éclairée. À cet effet sous le plateau se trouve un miroir, plan d’un côté, concave de l’autre. On utilise généralement le miroir concave qui est mobile et on le dirige de façon que la lumière en passant par le trou de la platine vienne se concentrer sur l’objet à examiner.
Le microscope est un instrument dont la construction peut prendre les formes les plus diverses et dont les parties mécaniques et optiques sont dans une très large mesure susceptibles d’être remplacées par d’autres parties semblables. Il est indispensable que les diverses pièces constituant ce merveilleux moyen d’investigation soient interchangeables pour que le microscope puisse s’adapter aux différents usages envisagés.
Aussi les équipements des microscopes se distinguent-ils les uns des autres non seulement par le grossissement maximum qu’ils sont capables d’atteindre, mais encore par la forme de l’appareil d’éclairage et de la platine, par le nombre des objectifs et des oculaires et leur adaptation aux divers genres d’observations.
Grâce aux progrès réalisés dans l’optique par les constructeurs modernes, le grossissement qui dépend surtout de l’objectif, dépasse parfois 3 000 fois en diamètre. Il est difficile de se représenter un pareil grossissement, car grossir 3 000 fois un objet c’est agrandir 9 000 000 de fois sa surface. De telles amplifications diminuent de beaucoup la netteté des contours et la clarté des images. C’est pourquoi dans la majorité des cas, pour les études d’analyses, le grossissement dépasse rarement 1 000 diamètres, c’est-à-dire 1 million de fois la surface réelle de l’objet examiné.
Il est possible de rendre visible aux yeux d’un auditoire nombreux les merveilleuses révélations d’un microscope. Les constructeurs sont parvenus à disposer cet appareil de telle façon que l’image puisse être projetée sur un écran. Ces microscopes sont destinés à donner dans l’obscurité une image réelle, très amplifiée des objets transparents excessivement petits. L’objet vivement éclairé donne sur un tableau convenablement disposé une image éclatante et prodigieusement amplifiée, au point qu’un cheveu paraît avoir un décimètre d’épaisseur, que la griffe d’une puce soit grande comme la main (microscope solaire et microscope photo électrique).
L’ultra microscope, cette dernière et merveilleuse conquête de la science, dans lequel le champ visuel sombre est traversé latéralement par un rayon lumineux très intense permet de discerner des particules ayant un diamètre de trois à six millionièmes de millimètre.
Le microscope fut découvert au moment précis où l’humanité allait commencer une existence nouvelle, à l’époque où une renaissance intellectuelle allait enfanter plus de découvertes en trois siècles que l’humanité n’en avait fait depuis les temps historiques. La loupe fut connue la première. On en a découvert dans les ruines de Ninive. En Grèce et à Rome les graveurs sur pierre en faisait généralement usage. Le microscope fut inventé à peu près à la même époque ; le télescope en 1590, par l’opticien Zacharie Janssen, de Middlebourg, en Hollande. Cornélius Drebbel le perfectionna en 1610. Néanmoins il se passa bien du temps encore avant que l’usage du microscope se répandit et un siècle après son invention les savants continuaient à faire leurs observations avec de simples lentilles de verre. Ce n’est qu’en 1758, après la découverte de l’achromatisme et surtout depuis le milieu du XIXème siècle qu’on a porté sa construction à un degré de perfection aussi admirable qu’étonnant. Aujourd’hui le microscope s’est imposé dans tous les domaines de la science. Il sert au physicien comme au chimiste ; le biologiste l’emploie comme le médecin et le botaniste. Cette merveille de l’ingéniosité humaine nous a révélé le monde de l’infiniment petit, c’est grâce à sa merveilleuse puissance que nous devons les observations si curieuses des structures de la constitution organique végétale et animale, les découvertes si précieuses du monde des infiniment petits, les merveilles du royaume immense de la vie microscopique qui peuple de millions d’êtres une goutte d’eau, une feuille d’arbre et le tissu délicat de nos corps.
On donne aussi le nom de « microscope » à une constellation de l’hémisphère austral, située près du Sagittaire, juste au dessous du Capricorne.
– Ch. ALEXANDRE.
MIEL
n. m. (du latin mel, d’où mellifère : plante mellifère, qui sécrète du miel)
À certaines heures de la journée et dans des conditions favorables de température, les abeilles recueillent, sous forme de nectar, dans le sein des fleurs où il exsude, un liquide sucré qu’elles emportent, jusqu’à leur ruche, dans leur jabot. Dans ce premier estomac, sous l’influence de la salive et du suc gastrique, le nectar subit une digestion partielle. Dégorgé ensuite dans les alvéoles de cire, débarrassé de son excès d’eau par une active ventilation des insectes diligents, il devient cette substance onctueuse et parfumée qui est le miel ; produit connu de tous les peuples pour sa valeur nutritive et sa teneur en calories et possédant la propriété, grâce à sa transformation initiale, d’être éminemment digestible. Le miel emprunte également aux fleurs diverses qualités thérapeutiques.
D’abord liquide, sirupeux, lorsque l’apiculteur le tire des rayons où l’abeille l’a entreposé, le miel s’affermit ensuite et se solidifie. Plus ou moins rapidement selon la flore d’origine, il durcit et granule pour prendre enfin sa consistance et sa teinte définitives. Certains miels – c’est l’exception – demeurent onctueux et leur aspect primitif persiste avec le temps. Mais, émollient ou ferme, le miel possède au même degré les vertus alimentaires et médicinales qui l’ont fait apprécier dès la plus haute antiquité... Les différences d’arôme et de coloration des miels naturels dépendent uniquement de la prédominance, sous un climat et sur un sol donnés, des variétés de fleurs visitées par les abeilles. Avec les saisons et les régions où il est butiné varient ainsi le goût et la nuance du nectar.
* * *
Le miel a toujours joué un rôle important dans l’alimentation de l’homme et il a constitué de tous temps une de ses ressources nutritives les plus fréquemment mises à contribution. Certains peuples lui attribuaient une valeur telle qu’ils l’offraient aux dieux à titre de sacrifice ; en Égypte l’abeille était considérée d’ailleurs comme aussi sacrée que le miel.
Avant l’introduction du sucre, de nombreux peuples se servaient du miel pour édulcorer leurs boissons et il est inutile de rappeler de quelle importance est son emploi dans la confection de certains gâteaux.
Dans l’Inde, le miel est considéré comme un aliment propre à conserver en bonne santé ceux qui le consomment ; une goutte de miel épandue sur la langue d’un nouveau-né est un présage de bonne santé.
Tout le monde sait combien le miel sert à la fabrication des confitures.
On se souvient que la principale attraction de la Terre de Chanaan, fut le rapport des espions hébreux disant que c’était « un pays découlant de lait et de miel ». L’auteur des Psaumes nous dépeint les paroles de Jéhovah comme « plus douces que miel et rayon de miel » ; le souvenir du juste est plus doux que « miel en la bouche de tous ».
On peut faire d’excellente bière avec du miel. Une boisson ressemblant à de l’hydromel consistait en un mélange de vin, de miel et de poivre. De nombreuses tribus de l’Afrique méridionale et orientale consomment de la bière ou du vin de miel. Sur les bords du Niger, on boit un breuvage mélangé de millet et de miel. Les Égyptiens tiraient du miel une bière sucrée et les héros d’Homère consommaient une boisson dont le miel formait le principal ingrédient. Le « muslum » romain, le « lipetz » russe, le « clary » et le « bragget » de l’Angleterre médiévale sont des breuvages où entrait le miel.
Les Juifs considéraient, mêlé au lait caillé, le miel comme une friandise ; ils s’en servaient également pour confectionner des gâteaux qu’ils considéraient comme des desserts. La légende prétend que les Pythagoriciens se nourrissaient exclusivement de pain et de miel ; Jean Baptiste, autre personnage légendaire, se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.
À une certaine époque, en Égypte et en Syrie, le miel a servi à l’embaumement des cadavres. On a découvert le corps d’un petit enfant embaumé dans une jarre de miel, au couvercle scellé. Le corps d’Alexandre fut conservé par cette méthode et l’historien juif Josèphe raconte que le corps du roi Aristobule fut préservé dans le miel jusqu’au moment où Antoine envoya le cadavre royal rejoindre les os de ses ancêtres en Judée.
Les anciens considéraient le miel comme doué d’un pouvoir thérapeutique spécial. Pline dresse une longue liste de maladies pouvant être guéries par le miel ; les Grecs croyaient qu’il prolongeait la vie. On considérait le miel ancien comme un remède à la toux (ce qui s’est perpétré jusqu’à nos jours) et à la bile ; on affirmait même qu’il accroissait la force et la virilité. Les Veddas regardaient la bonne santé dont ils avaient joui jadis comme la conséquence du fait qu’à un moment donné leur nourriture se composait principalement de miel.
Dans nombre de pays, on considère le miel comme doué d’une puissance magique bénéfique, capable de chasser les esprits malins ou de conjurer le sort. C’est surtout à la naissance, au moment de la puberté, à l’heure du mariage, qu’on lui attribue ce pouvoir.
Au cours des cérémonies auxquelles la naissance donne lieu, chez les Indiens du Pendjab, les gâteaux de miel jouent un rôle de premier plan ; à un certain moment on les promène autour de la tête du nouveau-né dans le but bien défini de chasser les mauvais esprits. En Croatie et en Turquie, on offre à la fiancée, sur le pas de sa porte, une coupe de miel. Les Polonais édulcorent avec du miel les lèvres de la fiancée. Dans les Balkans, le fiancé et la fiancée mangent ensemble, le soir de leurs fiançailles, un gâteau, cuit plusieurs jours auparavant, qu’ils trempent dans du miel. Dans les mariages célébrés à Vlasca,en Valachie, on fait cadeau à la fiancée de beurre et de miel pour enduire la porte de sa maison.
Le miel est enfin considéré comme emblème de la pureté et figure à ce titre dans le rituel de nombreuses religions. Dans l’église chrétienne primitive, le lait et le miel symbolisaient la consécration et l’on plaçait du lait et du miel dans la bouche du nouveau baptisé comme allusion à la terre de Chanaan.
Les Hindous regardaient le miel comme un aliment des dieux. On représentait Vichnou sous la forme d’une abeille posée sur une feuille de lotus. Krishna portait sur le front une abeille bleue. Les statues de pierre des dieux de l’Inde sont lavées, à de certaines époques, avec un liquide miellé.
Nous avons parlé au début de cet article du rôle du miel comme offrande aux dieux. On a découvert un papyrus égyptien remontant au IIème siècle qui confirme cet emploi du miel. Il s’agit d’une sorte de facture spécifiant la fourniture de « seize gâteaux, huile, miel, lait et toutes épices, sauf l’encens » au stratège du nome pour le sacrifice au Nil très sacré.
– E. A.
MIGRATION
n. f. (latin migratio, migrare)
Exode en masse de certains peuples qui changent de pays. Déplacements – réguliers ou accidentels – d’animaux qui recherchent, avec les saisons, d’autres climats : les migrations des hirondelles. Déplacement d’être parasites, au cours de leurs transformations. Ce mot a formé émigration : abandon d’une contrée pour une autre et immigration : pénétration, installation sur une terre nouvelle.
Parmi les grandes migrations humaines l’histoire enregistre celles des peuples barbares se répandant, au IVème siècle, dans l’empire romain. De l’entrée des Huns en Europe, en 375 à la conquête de l’Italie par les Lombards en 568 s’étend la grande période des migrations barbares au moyen-âge. Exubérance de population, cataclysmes, nomadisme natif, appât des richesses, etc., ont ainsi jeté sur les civilisations occidentales les hordes dévastatrices de l’Asie. L’Amérique a vu la migration des Aztèques...
« Parmi les migrations, régulières mais non périodiques, qu’accomplit l’individu isolé au cours de son développement, il faut mentionner celle des endoparasites comme les trichocéphales, les trichines, les ténias, les ankylostomes, etc..., qui conduisent l’œuf de l’hôte où il a été pondu à l’hôte où il achève de se développer en individu adulte en passant par un plus ou moins grand nombre d’intermédiaires. Ces migrations semblent avoir été d’abord un phénomène accidentel, qui s’est régularisé et est devenu normal en vertu de la sélection, parce qu’il était avantageux. Les migrations, au surplus, déterminent des changements de formes, liés aux changements des conditions d’existence ». (Larousse)
On attribue à des causes diverses les migrations des animaux adultes : défaut d’aliments (singes, locustes, etc...) ; variation de la température (antilopes, hirondelles, cailles, grues, etc...) ; nécessités de la reproduction (saumons, etc...). Parfois semblent seuls intervenir des facteurs mécaniques (courants, perturbations atmosphériques). D’une façon générale les migrations apparaissent comme un des procédés de défense de l’espèce...
Les migrations rencontrent, selon les catégories d’animaux, des circonstances plus ou moins favorables. Les oiseaux, doués d’appareils rapides de locomotion, les poissons plongés dans un milieu d’incessante translation sont au premier rang des animaux voyageurs. Peu de mammifères (à part quelques rongeurs et carnassiers) et moins encore de reptiles émigrent. On connait, chez les insectes, les migrations redoutées des sauterelles...
Une faculté – qu’a commandée vraisemblablement le besoin – est commune aux espèces périodiquement migratrices, c’est le sens de la direction, de l’orientation, encore mal connu. Le cosmopolitisme de certaines espèces (hibou, brachyote, etc...) parait tenir à leurs migrations irrégulières à travers les continents, migrations suspendues par de longues stations... Les phénomènes de dissémination qui déplacent certaines espèces végétales est parfois aussi appelé migration...
MILIEU
n. m. (préfixe mi et lieu : du latin medius locus)
Ce mot est synonyme de centre. Il sert à désigner un endroit à peu près également éloigné des extrémités ou de la périphérie. On dit : le milieu d’un lac, ou d’une route, ou d’un parcours donné. On dit aussi, philosophiquement parlant : le juste milieu, pour situer les thèses, ou les doctrines morales, qui se maintiennent prudemment à égale distance des conceptions extrêmes, en s’efforçant de les concilier. En physique, est dénommé milieu tout corps fluide ou solide pouvant, à l’exemple de l’air ou de l’eau, être traversé par d’autres corps. Par extension, le milieu, du point de vue sociologique, est représenté, non seulement par la société dans laquelle se meut un individu, mais encore par l’ensemble des circonstances ayant contribué à faire de cet individu ce qu’il est, au moment où se porte sur lui notre examen.
Quand les déterministes affirment que l’individu est le produit de son milieu, ils entendent par là que la constitution de son être, au physique et au moral, et toutes les manifestations de son être, sont le résultat de la combinaison de trois facteurs importants : l’hérédité, l’éducation et l’adaptation. Si l’on considère, en effet, un homme appartenant à la plus basse catégorie sociale, tel un criminel endurci, bestial et illettré, on découvre ordinairement :
-
Que ses impulsions violentes et son penchant à la paresse sont dus à une dégénérescence de la famille dont il est issu, dégénérescence ayant souvent pour origine l’alcoolisme et l’insuffisante alimentation ;
-
que son enfance et son adolescence, livrées à peu près au hasard, ne bénéficièrent ni des soins spéciaux, ni de l’entourage favorable que son hérédité chargée eût rendus particulièrement nécessaires ;
-
que le dénuement, joint à son incapacité de se plier avec régularité à des travaux exténuants et mal rétribués, l’a conduit à rechercher, dans le rapt brutal, la satisfaction de besoins qu’il aurait pu contenter sans nuire à personne, si la destinée avait été, pour ses ascendants et pour lui plus clémente, et la société humaine moins marâtre.
Il est donc possible de dire que, si cet homme était né de parents normaux, s’il avait profité d’une bonne éducation, d’une hygiène et d’une instruction suffisantes, s’il avait pu avec facilité gagner sa vie, grâce à un travail en rapport avec ses aptitudes, son existence aurait pu être, et eût été probablement, toute différente. Cette constatation nous conduit à professer moins d’admiration pour les favorisés de la vie, mais, en revanche, une large indulgence pour les pires actions de ceux qui en sont les déshérités.
Cependant ce serait une grave erreur de croire que seules la misère et la mauvaise éducation sont génératrices d’êtres antisociaux. Bien qu’elles aient à souhait l’utile et le superflu, les classes riches en produisent de plus redoutables, dont les criminalistes ne font point état dans leurs ouvrages. Ces malfaiteurs ont ordinairement pour eux la loi, la faveur des grands, et il est rare qu’ils aient à subir les rigueurs de l’emprisonnement. Ce n’est pas la faim qui les incite, mais le goût passionné d’une puissance toujours accrue, et d’un luxe sans limites. Et pourtant, que sont les méfaits du banditisme vulgaire auprès des exploits de certains financiers qui, pour augmenter encore leurs scandaleuses fortunes, n’hésitent pas à mettre en péril la sécurité des travailleurs, à frustrer d’un élémentaire bien-être des milliers de familles, ou provoquer les ravages d’une guerre moderne ! On ne peut nier que ces malfaiteurs d’en haut ne soient aussi les produits de leur milieu. Et c’est ce qui complique le problème social, lequel serait relativement simple s’il ne s’agissait que d’assurer à chacun la table et le couvert au prix d’une tâche modérée, pour que l’harmonie régnât parmi les hommes. Aux données philosophiques anciennes de ce problème, il faut adjoindre les possibilités d’une large aisance généralisée, et d’un enseignement moral très sévère qui, dès les premiers ans, atténuera les impulsions des êtres de proie, et disposera ceux qui sont plus modestes et raisonnables à se défendre contre leurs suggestions.
Il ne faut pas oublier que si un homme, puissant ou misérable, étudié isolément, peut être considéré comme déterminé, dans ses actes répréhensibles, par les conditions sociales qu’il est contraint de subir, ce raisonnement ne peut être appliqué à l’humanité tout entière. Il n’est pas, en effet, de loi inique, de coutume barbare, de croyance absurde, d’appareil meurtrier, qui ne soient dû à l’initiative des collectivités humaines, tout au moins de certains hommes, servis, appuyés par ces collectivités, dont ils ne sont pas forcément les tyrans, mais dont ils symbolisent et résument les caractères distinctifs. Le seul milieu dont l’humanité conçue dans son ensemble, puisse être considérée comme le produit, c’est la Nature, qui varie peu. Tout ce qui est d’ordre social est, à toute époque, proportionnel aux besoins, aux passions, aux aspirations plus ou moins généreuses, aux connaissances acquises des groupements humains.
Aussi est-ce du progrès de l’humanité dans son ensemble, en tant que connaissances scientifiques, applications industrielles, ennoblissement physique et moral, que l’on peut attendre seulement une amélioration réelle des conditions de la vie sociale. Mais on ne voit guère l’ensemble de l’humanité s’avancer d’un même pas dans la voie du progrès. C’est une règle communément observée que celle qui consiste en ce que les mieux doués en chaque genre soient appelés, souvent au prix du sacrifice personnel, à servir d’éclaireurs et de pionniers, pour que, grâce à leur effort, soit préparé le milieu social nouveau où se développeront conformément à des normes plus favorables que celles de jadis, ceux qui eussent été incapables d’opérer par eux-mêmes cette substitution.
– Jean MARESTAN.
MILIEU
La notion du milieu, en dehors de son sens géométrique et topographique, s’applique à tout ce qui est en dehors de l’individu, à tout ce qui est distinct de son être. Du point de vue humain, le milieu c’est tout ce qui est en dehors du moi, donc tout ce qui constitue le non moi. Réduite ainsi à une simple désignation de relation de l’être avec ce qui l’entoure cette notion n’aurait que bien peu d’intérêt si, précisément, cette relation ne présentait une importance considérable pour son évolution. En fait, la connaissance exacte de cette relation résume tout la connaissance humaine. L’éternelle opposition de la liberté et du déterminisme (voir ces mots), vient de la négation de l’action efficiente du milieu.
Dans le plan purement abstrait, on peut imaginer un seul des éléments constituant l’univers se mouvant solitairement selon son orientation particulière, sans causes modifiantes objectives. Là, seulement se trouverait la liberté absolue. Mais tout ce que nous savons de la constitution des mondes nous montre la quantité inimaginable de ces éléments le constituant. Comme ces éléments se heurtent en se mouvant, il y a perpétuellement modification de leurs directions et conséquemment déterminisme absolu. Autrement dit l’être n’existant point seul est nécessairement modifié par les autres êtres qui forment le milieu, dont il modifie également l’orientation.
Les êtres organisés présentent cette particularité d’être construits par ces heurts et de former des mécanismes conquérants et conservateurs luttant contre le milieu qui les absorbe finalement dans un cycle sans fin. Cette manière de concevoir les choses explique la co-éternité des êtres élémentaires, donc l’éternelle coexistence de l’un et du milieu, mais elle admet, dans la succession des cycles, l’antériorité du milieu inorganisé à l’être organisé. Celui-ci est donc le produit de celui-là. Les êtres vivants, une fois constitués, se trouvent alors en présence de deux sortes de milieu : le milieu inorganisé, ou physico-chimique, et le milieu organisé ou vital, formé par tous les êtres vivants. Ceux-ci, en se reproduisant, passent par toutes sortes de phases progressivement complexes sous les influences du milieu physico-chimique, de telle sorte que chaque germe nouveau est le double produit du milieu organisé et inorganisé ; celui-ci continuant de déterminer celui-là.
S’il nous est impossible d’assister à ces commencements absolus d’organisation, il est relativement aisé d’en suivre l’évolution conquérante chez la plupart des êtres vivants. Cette évolution s’effectue suivant des plans de plus en plus compliqués formant autant de milieux différents dans lesquels réagit l’individu. Le premier milieu qu’il subit est le milieu physico-chimique contribuant à sa formation et à sa croissance. Cette influence est démontrée par la nécessité absolue de certaines conditions extérieures pour en favoriser l’évolution : chaleur, humidité, azote, oxygène, etc. Des expériences très nombreuses démontrent la dépendance étroite du phénomène vital des actions physico-chimiques le modifiant. Par exemple, dans l’évolution de l’œuf de l’oursin, la plupart des sels contenus dans l’eau de mer se révèlent indispensables de la manière suivante : la fécondation ne peut s’effectuer sans potassium et sans magnésium ; la segmentation exige le chlore et le sodium ; la cohésion des cellules entre elles nécessite la présence du calcium ; la croissance ne peut se réaliser sans potassium et sans calcium ; le tube digestif ne peut se former sans le souffre et le magnésium ; la formation du squelette ne s’effectue point sans carbonate de chaux, etc..., etc...
Les œufs d’un poisson marin, le Fundulus, plongés dans une solution d’eau de mer et de chlorure de magnésium, donnent naissance à de petits poissons n’ayant qu’un seul œil sur la ligne médiane de la face.
Chez certains pucerons vivant sur le rosier, la femelle parthénogénétique donne naissance à des jeunes dont les uns deviennent ailés et les autres restent aptères. Si l’on arrose le rosier avec certaines solutions de sel de magnésium, ou d’antimoine, ou de nickel, de zinc, d’étain, de plomb, de mercure, ou de sucre, tous les jeunes deviennent ailés. L’alcool, l’acide acétique, l’alun, le tannin, les sels de calcium, de strontium, de potassium empêchent, au contraire, la formation des ailes.
On sait enfin que les têtards de grenouille nourris avec de la thyroïde de mammifères se métamorphosent très rapidement, sans attendre leur croissance normale et donnent naissance à des grenouilles naines. Nourris avec du thymus, c’est tout le contraire : les têtards croissent très rapidement et parfois ne se métamorphosent point.
Ainsi, l’être n’est rien sans le milieu qu’il conquiert et dans lequel il puise les éléments pour sa croissance et son évolution, mais il est compréhensible que tous ces éléments ayant formé, par leur hétérogénéité, la diversité des formes vivantes, l’être, à son tour, sera plus ou moins modifié suivant les variations de ce milieu. D’où les différences profondes, même entre les divers individus d’une même espèce.
Ces phénomènes d’assimilation et de désassimilation se passent sur un plan moléculaire peu connu, dont nous ne voyons que les effets. L’ensemble des êtres forme ensuite un autre milieu (milieu social pour les espèces vivant en société) précédant également l’apparition de l’individu et le déterminant psychologiquement, ce qui est déterminé, ici, c’est le système nerveux commandant l’orientation générale et spéciale de l’individu. On a cru nier l’influence du milieu en disant que l’individu faisait le milieu et que celui-ci n’était rien sans celui-là. En nous représentant d’abord chaque individu comme étant le milieu pour autrui, nous pouvons déjà prévoir que l’homme détermine l’homme et que, par conséquent, l’influence du milieu humain sur l’individu ne peut se nier. Si nous observons ensuite l’évolution des individus dans l’espace et dans le temps, nous voyons alors que la notion de milieu prend une importance considérable, parce que, de même que chaque être organisé vit différemment suivant la complication de son organisme, de même chaque forme sociale détermine différemment les individus qui en font partie. Plus le groupement social est limité en quantité et en désirs conquérants, et plus sa forme de coordination est simple et peu organisée. L’influence de chaque membre vis-à-vis des autres n’y est pas très accusée, ainsi en est-il chez la plupart des sociétés animales.
Cela change énormément avec les sociétés humaines. L’imagination, les désirs de conquête, les nécessités de lutte ont groupé les hommes autour des plus valeureux, des chefs, des patriarches, des sorciers, etc., etc., et cette coordination ne s’est point effectuée chaotiquement, mais selon des habitudes, des mœurs, des traditions, des lois, transmises de générations en générations, imposées par les plus forts aux plus faibles et, par conséquent, par les parents à leurs enfants. Comme la mentalité individuelle est fonction de la mentalité héréditaire et de l’éducation reçue, nous voyons que l’enfant est tout entier le produit de son milieu et que devenu homme, il en sera le continuateur. Sa seule chance d’évolution, hors la norme routinière ne peut provenir que d’une modification causée par une variation lors de sa procréation déterminant de virtuelles aptitudes évolutionnelles sous l’influence de l’hétérogénéité sociale. Si, donc, nous suivons le fonctionnement social, nous voyons que l’affirmation, que le milieu fait l’individu, est rigoureusement vraie si on examine les faits dans leur succession dans le temps.
Pour l’enfant, les adultes représentent des réalités déterminantes aussi impérieuses que le froid ou la faim. Pour l’adulte, les autres humains ; artisans, savants, commerçants, guerriers, dirigeants, sexes différents, etc..., etc..., sont autant de réalités déterminantes d’autant plus importantes qu’avec le nombre et le degré d’organisation les comportements individuels se modifient, améliorant ou empirant les relations des humains entre eux. Le milieu social n’est donc pas quelque chose d’abstrait ; il est formé de l’action de tous les êtres ayant précédé l’individu et de celle des êtres coexistant avec lui.
On compare parfois l’évolution sociale à l’évolution individuelle ; l’analyse des deux fonctionnements nous montre que les mêmes causes engendrent les mêmes effets sans qu’il en résulte une similitude parfaite des deux organisations. Autrement dit la division des cellules et leur agglutination s’effectuent selon une complication progressive déterminant parallèlement une modification ou différenciation de chacune d’elle ou de certains groupes, mais l’ensemble constitue un tout très solidaire, très limité, très individualisé, évoluant de la naissance à la mort.
La multiplication des individus crée également une complication du milieu social, lequel, à son tour, détermine diversement l’individu, ou des groupes d’individus, mais l’étendue, la durée de ce milieu n’est point limitée et la solidarité des individus entre eux ne peut se comparer à celle des cellules entre elles. L’évolution individuelle, le moi, suit une courbe physiologique à peu près invariable de la naissance à la mort. L’évolution et la forme sociale ne sont point limitées dans l’espace et dans le temps et l’ensemble des individus ne saurait constituer une unité, un moi social comparable au moi individuel.
Cette différence s’accentue si nous comparons la rapidité de deux évolutions. L’unité individuelle se modifie relativement vite si nous examinons l’être soumis à des causes modifiantes l’écartant de l’influence du milieu. L’évolution sociale est beaucoup plus lente parce que, précisément, les causes modifiantes n’ont point l’amplitude nécessaire pour créer une nouvelle psychologie, une nouvelle coordination collective de tous les individus. Le problème de l’éducation et de la transformation sociale est, de ce fait, très ardu. La comparaison du fonctionnement social avec le fonctionnement individuel, permet tout de même de trouver une certaine similitude entre le rôle conservateur joué par la structure de l’organisation sociale et le même rôle déterminé par la structure de l’organisme individuel. Chez celui-ci la multiplication cellulaire crée la différenciation des cellules par l’accumulation de certaines substances agglutinantes contribuant également à former l’architecture de l’individu, son squelette. Or les combinaisons chimiques de l’œuf sont telles que son évolution est invariablement et spécifiquement déterminée et qu’un œuf de grenouille, par exemple, ne donnera jamais naissance à un aigle ou à un rhinocéros. Ainsi, en se construisant, l’être acquiert des organes qui ne peuvent le faire vivre que selon leur fonctionnement particulier, leur coordination générale qui fait que l’ensemble de l’animal constitue un poisson, un mammifère ou un oiseau menant une existence bien définie. Mais dans le cours de sa vie, l’être subit les influences physico-chimiques du milieu, surtout lors de sa formation, et il se modifie plus ou moins, mais cette différenciation de sa nature est infime si on la compare à celle du jeune être qu’il engendrera à son tour et qui sera très différent de lui. Nous voyons que la structure de l’individu le maintient dans une certaine constance fonctionnelle et qu’un véritable changement ne peut se produire que par la création d’un autre individu.
Le milieu social, dès ses débuts, est également très modifiable et, suivant la cérébralité des individus le composant, il se construit sur un type ou sur un autre ; mais au fur et à mesure de son évolution, les individus, par division du travail, spécialisation, créent des organisations différentes, lesquelles déterminent à leur tour une psychologie particulière, une déformation professionnelle, de telle manière que, l’ individu et sa fonction ne sont plus que la partie d un tout : l’individu créant et exécutant la fonction ; la fonction déformant l’individu.
L’organisation du milieu social peut alors se comparer quelque peu à l’organisation animale par ses innombrables constructions matérielles, ses édifices, ses industries, ses routes, etc..., formant un ensemble cohérent, une sorte de squelette déterminant l’aspect particulier qui lui est propre. Ce squelette, par une sorte de cristallisation, produit du fonctionnement social détermine à son tour l’activité collective et s’oppose à toute transformation tendant à modifier profondément sa structure. L’inévolution morale, sa stagnation ne paraissent pas avoir d’autres bases. Le milieu social ne forme pas un tout coordonné harmonieusement, comme cela devrait être ; il crée de multiples milieux à intérêts opposés, développant l’esprit de lutte, l’esprit agressif, inter-humain, et non l’esprit de concorde. Cet esprit de lutte favorise bien l’intelligence, mais nullement le sens moral, continuellement heurté par des éléments contradictoires.
Le problème de l’amélioration et de la transformation des sociétés humaines par l’éducation ou la révolution est donc très difficultueux, car il se heurte à des impossibilités de réalisation dans les deux cas... La révolution (qui peut être considérée comme une mort de l’organisation sociale supprimée) laisse les germes sociaux qui sont les individus avec des mentalités à peu près identiques et peu transformées. Ils donnent donc naissance à d’autres sociétés peu différentes des anciennes, ainsi que nous le montrent tous les événements historiques.
D’autre part, l’éducation véritable s’effectue par ces différents organismes sociaux, ces différents milieux qui tendent à se perpétuer toujours semblables à eux-mêmes. Ainsi se prolongent les milieux bourgeois, ouvriers, commerçants, industriels, militaires, paysans, intellectuels, artistes, etc... etc... Comme il n’est au pouvoir de personne de changer subitement la psychologie de ces milieux, ils influencent et éduquent les jeunes êtres selon leurs concepts moraux opposés les uns aux autres, et contribuent ainsi à prolonger l’immoralité générale tendant à favoriser les intérêts particuliers au détriment de l’intérêt général. L’évolution morale collective sera donc excessivement longue par cette persistance des causes d’immoralité.
On peut entrevoir une issue à ces difficultés par la création de milieux absolument nouveaux, fondés par des individus hardis et novateurs, coordonnés plus harmonieusement, éduquant les êtres selon une morale fraternelle et strictement objective, unifiant les efforts volontaires dans l’intérêt de tous et, conséquemment, de l’individu.
– IXIGREC
MILIEUX [DE VIE EN COMMUN] et [COLONIES]
Il est de fait que depuis la diffusion sur une grande échelle des idées collectivistes, communistes, coopératives et anarchistes (communistes comme individualistes), il s’est trouvé des partisans de ces doctrines ou de ces conceptions pour tenter de mettre en pratique leurs théories. Différents mobiles les poussaient : tantôt il s’agissait de démontrer la praticabilité de thèses que leurs opposants prétendaient irréalisables, tantôt on se proposait d’anticiper l’avènement de la « Société future » ou du « Royaume des Cieux » dont tarde si longtemps la venue, au gré de l’impatience sincère. Certains chrétiens socialistes ou anarchistes visaient tout simplement à vivre en marge ou en dehors d’une société dont ils ne pouvaient plus supporter la structure antifraternelle, l’oppression capitaliste ou les bases autoritaires, selon le cas.
Les milieux libres, colonies ou communautés ont soulevé maintes discussions dans les journaux et groupes socialistes ou anarchistes. Leurs adversaires – presque toujours doctrinaires orthodoxes – leur ont reproché de ne pas durer indéfiniment (?) ; de subir des échecs qui « nuisent à la propagande » ; de créer de petites agglomérations d’indifférents à tout ce qui n’est pas le petit centre où se déroule leur vie.
Au point de vue individualiste anarchiste, il paraît difficile de se montrer hostile à des humains qui, ne comptant que sur leur vitalité individuelle, tentent de réaliser tout ou partie de leurs aspirations. Même s’ils ne croyaient pas à la valeur démonstrative des « tentatives de vie en commun », les individualistes anarchistes font une telle propagande en faveur des « associations volontaires » qu’ils auraient mauvaise grâce à renier les milieux où leur thèse se pratique avec moins de restrictions que n’importe où ailleurs.
En dehors de cette constatation que certaines colonies ont prolongé leur existence pendant plusieurs générations, on peut se demander pour quel motif les adversaires des « colonies » veulent qu’elles durent indéfiniment ? Où en est l’utilité ? Pourquoi serait-ce désirable ? Toute « colonie » fonctionnant dans le milieu actuel est un organisme d’opposition, de résistance dont on peut comparer les constituants à des cellules ; un certain nombre ne sont pas appropriées au milieu, elles s’éliminent, elles disparaissent (ce sont les colons qui abandonnent la colonie après un séjour plus ou moins prolongé). Les cellules qui résistent, aptes à vivre dans le milieu spécial, s’usent plus rapidement que dans le milieu ordinaire, en raison de l’intensité de leur activité. Il ne faut pas oublier que, non seulement, les membres des colonies ont à lutter contre l’ennemi extérieur (le milieu social dont l’effroyable organisation enserre le petit noyau jusqu’à l’étouffer), mais encore, dans les conditions actuelles, contre l’ennemi intérieur : préjugés mal éteints qui renaissent de leurs cendres, lassitude inévitable, parasites avoués ou cachés, etc... Il est donc illogique de demander aux « colonies » autre chose qu’une durée limitée. une durée trop prolongée est un signe infaillible d’amollissement et de relâchement dans la propagande que toute colonie est censée rayonner : telle est du moins l’expérience acquise.
À ceux qui proclament que l’échec, toujours possible, des « colonies » nuit à la propagande socialiste, anarchiste communiste, tolstoïenne, etc..., suivant le cas – les protagonistes et les défenseurs des colonies répliquent : « Est-ce que les échecs des hommes de science les ont empêchés de recommencer des centaines de fois peut-être l’expérience destinée à les conduire à telle découverte scientifique, entrevue en théorie seulement, et à laquelle manquait la consécration de la pratique ? Est-ce que les conférences anarchistes, etc... ont amené aux idées énoncées par les propagandistes un si grand nombre d’auditeurs qu’on puisse affirmer que leur propagande par la parole ait réussi ? Est-ce que les journaux, brochures, livres d’inspiration libertaire, etc... ont produit tant d’êtres conscients qu’on ne puisse les nombrer ? Est-ce que l’agitation dans la rue a amené la révolution dans les cerveaux et les mœurs d’une telle foule de militants que le milieu anarchiste, tolstoïen, communiste ou autre s’en trouve transformé ? Faites-nous l’addition de vos échecs, puis expliquez-nous ensuite pourquoi et comment vous n’avez pas abandonné causeries, conférences, écrits de toute sorte ? Après, nous entendrons vos objections. »
D’ailleurs, on ne comprend plus ce souhait de durée indéfinie, dès qu’on considère la « colonie » pour ce qu’elle est : un moyen, non un but. Nous ignorons absolument si « la colonie » communiste, individualiste ou coopérative a quoi que ce soit de commun avec une société communiste individualiste ou coopérative qui engloberait un vaste territoire ou la planète toute entière ; c’est pour nous pure folie que de présenter « une colonie » comme un modèle, un type de société future. C’est « un exemple » du résultat que peuvent déjà atteindre, dans le milieu capitaliste et archiste actuel des humains déterminés à mener une vie relativement libre, une existence où l’on ignore le moraliste, le patron et le prélèvement des intermédiaires, la souffrance évitable et l’indifférence sociale, etc... C’est également un « moyen » éducatif (une sorte de « propagande par le fait »), individuel et collectif. On peut être hostile aux « Milieux libres », mais il n’est personne de bonne foi qui ne reconnaisse que la vie, dans une « colonie », porte plus à la réflexion que les déclamations ordinaires et les lieux communs des réunions publiques.
Je viens de parler de résultat ? – « Les partisans des Milieux libres ou Colonies ont-ils à leur actif des résultats ? » – C’est la question que pose toujours n’importe quel adversaire des tentatives de vie en commun.
On peut répondre par l’exemple fourni par les groupes des États-Unis, sur le territoire desquels – surtout de 1830 à 1880–1900 – s’est épandu un véritable semis de colonies ou communautés, s’échelonnant de l’individualiste extrême au communisme absolu ou dictatorial en passant par toutes sortes de tons intermédiaires : coopératisme (oweniste, fouriériste, henry-georgiste) ; communisme libertaire ; collectivisme marxiste ; individualisme associationniste, etc... Tout ce que la flore non conformiste est susceptible d’engendrer a peuplé et constitué ces groupements : sectaires dissidents et hérétiques, et athées ; idéalistes et matérialistes ; puritains et partisans de libres mœurs ; intellectuels et manuels ; abstinents, tempérants, omnivores ou partisans d’une alimentation spéciale, etc..., etc...
Tous les systèmes ont été essayés. Il y a eu le régime de la propriété privée, chacun étant propriétaire de sa parcelle, la cultivant et en gardant les fruits, mais s’associant pour la grosse culture, la vente et l’achat des produits. On a cultivé, vendu, acheté en commun et on a réparti aux associés ce dont ils avaient besoin pour leur consommation, chaque ménage vivant chez soi. On a vécu ensemble dans le même bâtiment, mangé à la même table, parfois dormi dans un dortoir commun.
La répartition des produits peut avoir lieu selon l’effort de chacun, mesuré, par exemple, par son temps de travail. On peut vivre chacun sur sa parcelle, propriété individuelle dans tout le sens du mot, n’avoir affaire économiquement avec les voisins qu’en basant ses rapports sur l’échange ou la vente. Enfin, la propriété du sol peut appartenir à une association dont le siège est au dehors de la colonie, les colons ne possédant la terre qu’à titre de fermage ou de concession à long terme.
Toutes ou presque toutes ces modalités ont été pratiquées dans les « colonies » des États-Unis. Le communisme absolu cependant n’y a pas été expérimenté, je veux dire le communisme poussé jusqu’au communisme sexuel, bien qu’à Oneida, il n’ait pas été très loin de se réaliser. Pourtant, il y a eu des colonies où la liberté des mœurs a été telle qu’elles ont ameuté contre elles la population environnante et provoqué l’intervention des autorités.
Eh bien, que disent de ces établissements et de leur population ceux qui les ont visités ?
Qu’en disait William Alfred Hinds qui y avait séjourné ? Quelles « inductions » tirait-il de ses constatations, malgré les « nombreuses imperfections » des associations ou communautés existant de son temps (American Communities, pp. 425 à 428) : – que le paupérisme et le vagabondage y étaient ignorés – ainsi que les procès et autres actions judiciaires onéreuses – que toutes les possibilités de culture morale, intellectuelle et spirituelle y étaient mises à la portée de tous les membres – que riches et pauvres y étaient inconnus, tous étant à la fois prolétaires et capitalistes – que leur prospérité ne dépendait pas d’une théorie unique des relations sexuelles, les communautés monogames ayant aussi bien réussi que celles admettant le célibat, et celles préconisant le mariage plural n’ayant pas eu moins de succès que les autres. – « Une communauté idéale, concluait-il, est un foyer agrandi – une réunion de familles heureuses, intelligentes, conscientes – un ensemble de demeures, d’ateliers, de jardins vastes, spacieux – de machines destinées à épargner le travail – toutes facilités destinées à améliorer et rendre plus heureuses les conditions dans lesquelles chacun coopère au bien commun. Pareil foyer se montre supérieur au logis ordinaire en tout ce qui rend la vie bonne à vivre, comme il le surpasse par les facilités offertes à ceux qui constituent cette société de camarades. Si, malheureusement, l’esprit de dissension pénètre dans une de ces associations, l’expérience prouve que les difficultés et les misères se multiplient dans la mesure où on le laisse prendre racine ».
Charls Nordhoff qui avait visité, quelque vingt-cinq ans auparavant, les colonies américaines, ne fait pas entendre un autre son de cloche. Son enquête avait été très consciencieuse (The Communistic Societies of the United States, 1875). Il reconnaît que les colons, pris en général, ne se surmènent pas – qu’ils n’ont pas de domestiques – qu’ils ne sont pas paresseux – qu’ils sont honnêtes – humains et bienveillants – qu’ils vivent bien, de façon beaucoup plus saine que le fermier moyen – qu’ils sont ceux des habitants de l’Amérique du Nord qui montrent le plus de longévité – que personne, parmi eux, ne fait de l’acquisition des richesses un des buts principaux de la vie. Le système des colonies libère la vie individuelle d’une masse de soucis rongeurs..., de la crainte d’une vieillesse malheureuse. « En comparant la vie d’un « colon » heureux et prospère (c’est-à-dire d’un colon ayant réussi) à celle d’un mécanicien ou d’un fermier ordinaire des États-Unis, renommés cependant pour leur prospérité – plus spécialement aux existences que mènent les familles ouvrières de nos grandes villes, j’avoue – conclut Nordhoff – que la vie d’un colon est débarrassée à un tel point des soucis et des risques ; qu’elle est si facile, si préférable à tant de points de vue, et dans tous les aspects matériels de la vie ; j’avoue que je souhaite de voir ces associations se développer de plus en plus dans nos contrée ».
Dans son « Histoire du Socialisme aux États-Unis », le socialiste orthodoxe Morris Hillquit ne donnera pas une autre note. C’est pourtant un adversaire de ces expériences qu’il qualifie de « socialisme utopique » ; il en proclame hautement l’inutilité. Malgré tout, il ne peut nier l’influence bienfaisante de la vie en commun sur le caractère de ses pratiquants.
Nous citerons quelques-unes de ses conclusions (History of the Socialism in the United States, 1903, pp. 141–145) :
« Quiconque visite une colonie existant depuis quelque temps déjà ne peut manquer d’être frappé de la somme d’ingéniosité, d’habileté inventive et, de talent montrée par des hommes chez lesquels, à en juger par l’extérieur, on ne se serait pas attendu à rencontrer pareilles qualités... Rien ne m’avait surpris davantage, avait constaté Nordhoff, observateur très impartial, que la variété d’habileté mécanique et pratique que j’ai rencontrée dans chaque colonie, quelque fût le caractère ou l’intelligence de ses membres. »
« En règle générale, les colons se montraient très industrieux, bien que la contrainte fût ignorée dans leurs associations. »
« Le plaisir du travail en commun est un des traits remarquables de cette vie spéciale, considérée dans sa phase la meilleure. »
« Que faites-vous de vos paresseux ? » ai-je demandé, en maints endroits, – écrit Nordhoff – « Mais on ne rencontre pas de fainéants dans les colonies... Même les « Shakers d’hiver », ces lamentables va-nu-pieds qui, à l’approche de l’hiver, se réfugient chez les Shakers ou dans quelque autre milieu similaire, exprimant le désir d’en faire partie, ces pauvres hères qui viennent au commencement de la mauvaise saison, comme un « ancien » Shaker me le racontait, « la malle et l’estomac vides et s’en vont, l’une et l’autre remplis, dès que les roses se mettent à fleurir ». Eh bien ! ces malheureux ne peuvent résister à l’atmosphère d’activité et de méthode de l’ambiance et ils accomplissent leur part de travail sans aucun murmure, jusqu’à ce que le soleil printanier les pousse à nouveau à courir les routes. »
« Contrairement à l’impression générale, la vie dans les colonies était loin d’être monotone. Les colons s’efforçaient d’introduire dans leurs habitudes et leurs occupations autant de variété que possible. Les Harmonistes, les Perfectionnistes, les Icariens, les Shakers changèrent plusieurs fois de localité. Parlant des habitants d’Onéida, Nordhoff écrivait : « Ils semblent nourrir une horreur presque fanatique des formes ; c’est ainsi qu’ils changent fréquemment de métiers, qu’ils modifient très soigneusement l’ordre de leurs récréations et de leurs réunions du soir ; ils changeaient jusqu’à l’heure de leurs repas. » Dans les phalanges fouriéristes, la diversité d’occupations était l’un des principes fondamentaux, et il en était de même pour presque toutes les autres « colonies ».
« L’apparente quiétude des colons cachait une gaieté et un entrain appréciables ; ils étaient rarement malades et on n’a jamais signalé chez eux un seul cas de folie ou de suicide. Ce n’est donc pas surprenant que leur longévité n’ait point été surpassée par les autres Américains [1] ».
« L’influence de la vie en commun semble avoir eu un effet aussi bienfaisant sur l’intellect et le moral que sur la vie physique des colons. Amana, qui consiste en sept villages qui dépassèrent à un moment donné 2000 habitants, ne compta jamais un avocat dans son sein. Amana, Bethel, Aurora, Wisconsin Phalanx, Brook Farm et nombre d’autres colonies déclaraient avec fierté qu’elles n’avaient jamais eu à subir un procès ni vu un de leurs membres en poursuivre un autre devant les tribunaux. »
« La comptabilité était tenue de la façon la plus simple ; bien qu’aucune caution ne fût exigée des administrateurs de ces associations, on ne cite pas un cas de détournement de fonds ou de mauvaise gestion. »
« Il faut noter que les colons apportaient invariablement une grande attention, tant à l’éducation de leurs enfants qu’à leur propre culture intellectuelle. En règle générale, leurs écoles étaient supérieures à celles des villes et villages des environs ; la plupart des colonies possédaient des bibliothèques et des salles de lecture, et leurs membres étaient plus éduqués et plus affinés que les autres gens de l’extérieur, d’une situation sociale égale. »
Il a existé une colonie individualiste anarchiste fondée par l’initiateur de Benjamin R. Tucker, le fameux proudhonien Josiah Warren. Cette colonie nommée Modern Times était située aux environs de New-York. Un essayiste américain assez connu, M. Daniel Conway, la visita vers 1860. Nous extrayons de ses Mémoires, publiés à Chicago, en 1905, certaines des impressions que lui laissa sa visite :
« La base économique, à « Modern Times » était que le coût (la somme des efforts) détermine le prix et que le temps passé à la fabrication détermine la valeur ; cette détermination se réglait sur le cours du blé et suivait ses variations. Un autre principe était que le travail le plus désagréable recevait la rémunération la plus élevée... La base sociale s’exprimait en deux mots : « Souveraineté individuelle » ; le principe de la non intervention dans la liberté personnelle était poussé à un point qui aurait transporté de joie un Stuart Mill et un Herbert Spencer. On encourageait vivement l’autonomie de l’individu. Rien n’était plus voué au discrédit que l’uniformité, rien n’était plus applaudi que la variété, nulle faute n’était moins censurée que l’excentricité... Le « mariage » était une question purement individuelle ; on pouvait se marier cérémonieusement ou non, vivre sous le même toit ou dans des demeures séparées, faire connaître ses relations ou non ; la séparation pouvait s’opérer sans la moindre formalité. Certaines coutumes avaient surgi de cette absence de réglementation en manière d’union sexuelle : il n’était pas poli de demander quel était le père d’un enfant nouveau-né ou encore quel était le « mari » ou quelle était la « femme » de celle-ci ou celui-là... « Modern Times » comptait une cinquantaine de cottages, proprets et gais sous leur robe mi-blanche et mi-verte dont les habitants s’assemblèrent dans leur petite salle de réunions... car on avait annoncé, pour l’après-midi, une réunion de conversation... la discussion roula sur l’éducation, la loi, la politique, le problème sexuel, la question économique, le mariage : ces sujets furent examinés avec beaucoup d’intelligence et, témoignage rendu à l’individualisme, pas un mot de déplacé, ou une dispute, ne s’éleva ; si toutes les vues exprimées étaient « hérétiques », chaque personne avait une opinion à elle, si franchement exprimée, qu’elle faisait entrevoir un horizon de rares expériences... Josiah Warren me fit voir l’imprimerie et quelques autres bâtiments remarquables du village. Il me remit une des petites coupures employées comme monnaie entre eux. Elles étaient ornées d’allégories diverses et portaient les inscriptions suivantes : Le temps, c’est la richesse. – Travail pour Travail. – Non transférable. – Limite d’émission : deux cents heures. – Le travail le plus désagréable a droit à la rémunération la plus élevée... Je n’ai jamais revu « Modern Times », mais j’ai entendu dire que, dès que la guerre civile eut éclaté (en 1866), la plupart de ceux que j’avais vus avait quitté la colonie sur un petit bâtiment et s’en étaient allés fixer leur tente sur quelque rive paisible du Sud-Amérique. »
On me dira qu’il s’agit de colonies créées par des nordiques qui passent, de par constatation et tradition, pour plus persévérants que les latins et méridionaux en général. Il y a eu, au Brésil, une colonie fondée exclusivement par et pour des communistes anarchistes italiens c’est la fameuse Cecilia, qui dura de 1890 à 1891. Son initiateur, le Dr Giovanni Rossi, écrivait à son sujet, dans l’Università Popolare de novembre-décembre 1916, les lignes suivantes :
« Pour moi, qui en ai fait partie, la colonie La Cecilia ne fut pas un fiasco... Elle se proposait un but de caractère expérimental : se rendre compte si les hommes actuels sont aptes à vivre sans lois et sans propriété individuelle... À ce moment-là, à l’exposé doctrinaire de l’anarchie, on objectait : – Ce sont des idées très belles mais impraticables aux hommes actuels. La Colonie Cecilia montra qu’une centaine de personnes, dans des conditions économiques plutôt défavorables avaient pu vivre deux ans avec de petits différends, et une satisfaction réciproque sans lois, sans règlements, sans chefs, sans codes, sous le régime de la propriété commune, en travaillant spontanément en commun... Le compte rendu, opuscule publié sous le titre de « Cecilla communauté anarchique expérimentale », aboutissait à cette conclusion. Il fut rédigé par moi et approuvé par l’unanimité des colons. »
Est-ce à dire que nous niions les jalousies, les désaccords les luttes d’influences, les scissions et tant d’autres formes des guerres intestines de plus ou moins noble aloi, qui ont dévasté, déchiré, ruiné prématurément trop de Colonies ou Milieux Libres ? Certes, non, mais nous prétendons que ces difficultés ou ces traîtrises se rencontrent partout où des humains d’esprit avancé s’assemblent, même quand leur réunion a en vue un objet purement intellectuel. Dans les colonies ces taches ou ces souillures sont plus évidentes, plus visibles, voilà tout.
Je nie si peu les ombres du tableau que trente ans d’études et d’observations m’ont amené a considérer, au point de vue éthique (je ne dis pas économique) les circonstances ou les états de comportements ci-dessous, comme les plus propices à faire prospérer et se prolonger les milieux de vie en commun, leurs membres fussent-ils individualistes ou communistes :
-
le colon est un type spécial de militant. Tout le, monde n’est pas apte à vivre la vie en commun, à être un milieu-libriste. Le « colon-type » idéal est un homme débarrassé des défauts et des petitesses qui rendent si difficile la vie sur un terrain ou espace resserré : il ignore donc les préjugés sociaux et moraux des bourgeois et petits bourgeois. Bon compagnon, il n’est ni envieux, ni curieux, ni jaloux, ni « mal embouché ». Conciliant, il se montre fort sévère envers lui-même et très coulant à l’égard des autres. Toujours sur le guet pour comprendre autrui, il supporte volontiers de ne pas l’être ou de l’être peu. Il ne « juge » aucun de ses coassociés, s’examine d’abord lui-même et, avant d’émettre la moindre opinion sur tel ou telle, tourne, selon l’antique adage, sept fois sa langue dans sa bouche. Je ne prétends pas qu’il soit nécessaire que tous les aspirants colons aient atteint ce niveau pour instaurer un « milieu libre ». Je maintiens qu’en général le « colon-type » aura en vue ce but individuel et que s’efforçant de s’y conformer, il ne lui restera que peu de temps pour se préoccuper des imperfections d’autrui. Avant d’être un colon extérieur, il convient d’être un colon intérieur ;
-
la pratique du stage préparatoire a toujours donné de bons résultats ;
-
le nombre permet le groupement par affinités ; il vous est plus facile de rencontrer parmi deux cents que parmi dix personnes seulement quelques tempéraments qui cadrent avec le vôtre. L’isolement individuel est logiquement funeste à l’existence des milieux de vie en commun ;
-
une grande difficulté est la femme mariée, légalement ou librement, et entrant dans le milieu avec son « mari » ou « compagnon » ; avec des enfants, la situation est pire. Le « colon-type » est célibataire en entrant dans la colonie ou se sépare de sa compagne en y pénétrant (ou vice-versa, bien entendu) ;
-
point de cohabitation régulière entre les compagnons et les compagnes, et le milieu a d’autant plus de chances de durée. Il en est de même lorsque les « compagnes » sont économiquement indépendantes des « compagnons », c’est-à-dire quand il n’est pas une seule compagne qui ne produise et consomme en dehors de toute protection ou intervention d’un compagnon, quel qu’il soit ;
-
tout milieu de vie en commun doit être un champ d’expériences idéal pour la pratique de la « camaraderie amoureuse », du « pluralisme amoureux », de tout système tendant à réduire à zéro la souffrance sentimentale. Tout milieu de vie en commun, où les naissances sont limitées, où les mères confient leurs enfants dès le sevrage (au moins pendant la journée) à des éducateurs de vocation, où l’enfant ne rend pas esclave celle qui l’a mis au monde, a de grandes chances de durer plus longtemps ;
-
toute colonie constituant un foyer intensif de propagande – même simplement au point de vue industriel : fabrication d’un article spécial, par exemple – augmente ses chances de durée ; toute colonie qui se renferme en soi, se replie sur elle-même, au point de ne plus rayonner à l’extérieur, se dessèche et périt bientôt ;
-
il est bon que les participants des milieux de vie en commun se fréquentent, surtout entre sexes opposés ; qu’ils se rencontrent en des réunions de distraction ou de conversation, repas en commun, etc... ;
-
le régime parlementaire ne s’est montré d’aucune valeur pour la bonne marche des colonies, qui exigent de la décision, non de la discussion. Le système de l’animateur, de l’arbitre, inspirant confiance aux associés, gardant cette confiance, quelle que fût d’ailleurs la méthode d’administration adoptée, semble, de préférence, avoir réussi. C’est une constatation que je ne suis pas seul à faire. Dans son ouvrage « Les Colonies Communistes et Coopératives », M. Charles Gide écrit : « Toute association quelle qu’elle soit – non seulement les associations communistes mais la plus modeste société de secours mutuels, tout syndicat, toute coopérative – doit sa naissance à quelque individu qui l’a créée, qui la soutient, qui la fait vivre ; et si elles ne trouvent pas l’homme qu’il faut, elles ne germent pas ». Paroles à méditer et que confirme l’histoire étudiée des colonies ;
-
la durée de toute colonie est facteur d’un pacte ou contrat, peu importe le nom de l’instrument, précisant ce que le Milieu attend de ceux qui participent à son fonctionnement et ce que ceux-ci sont en droit d’attendre de lui. Les charges et les profits doivent s’équilibrer et il est nécessaire que l’on s’entende d’avance sur le cas de résiliation et les conséquences impliquées ; enfin, le « contrat » définira, en cas de litige ou différend, à quelle personne est confiée le règlement du désaccord.
L’étude attentive des « colonies » et « milieux de vie en commun » – et c’est impliqué dans les remarques ci-dessus – me pousse à conclure que la durée d’un milieu de ce genre est fonction des réalisations particulières qu’il offre à ses membres et qu’il est impossible à ceux-ci de rencontrer dans le milieu extérieur. Ces réalisations peuvent être d’un ordre ou d’un autre, mais la poursuite de la réussite purement économique ne suffit pas, l’extérieur offrant beaucoup plus d’occasions d’y parvenir que la colonie la mieux organisée. C’est ce qui explique le succès des colonies à base religieuse, toujours composées de sectaires, dont les adhérents ne se rencontraient que dans ces groupements, ou dont les croyances ou le mode de vie ne pouvaient se manifester ou se pratiquer qu’en « vase clos ».
Je souhaite simplement que ces remarques soient prises en considération par quiconque songe à fonder une colonie, milieu libre ou centre de vie en commun : ce ne sera pas du temps perdu.
– E. ARMAND.
LISTE DES COLONIES ET MILIEUX DE VIE EN COMMUN.
Il est excessivement difficile de se procurer des documents relatifs aux « Colonies », non pas que ces associations n’aient publié des journaux – ils abondent, tout au contraire – et des brochures de propagande, mais tirés à un nombre restreint d’exemplaires, journaux et publications deviennent pratiquement introuvables. Arthur M. Baker, de Londres, qui avait commencé à éditer une série de brochures ayant trait aux colonies et qui possédait, selon son expression « une masse immense de matériaux », m’écrivait déjà en 1904 qu’il fallait consacrer force argent à l’achat d’imprimés et de périodiques très rares. Chaque fois qu’il tombait sur un numéro intéressant, il y trouvait des informations sur une ou deux colonies dont il n’avait jamais entendu parler. On ignore exactement combien de milieux de ce genre ont été créés. La liste ci-dessous n’est donc que très approximative, sa valeur réside en ce qu’elle est établie pour la première fois et je serais heureux que cet essai, si imparfait soit-il, servît de point de départ à de nouvelles recherches.
Lorsque je l’ai pu, j’ai indiqué la durée de la colonie, son effectif en membres, etc. Souvent, j’ai dû me contenter d’un nom, d’une date, d’une information.
— E. A.
-
Afrique du Sud. – Ile de Tristan d’Acunha : îlot isolé ; population ayant varié de 75 à 150 habitants, vivant relativement en communisme, depuis le début du 19ème siècle.
-
Allemagne. – « Eden », à Oranienburg, près Berlin, comptait, en 1905, 110 membres ; existe encore.
« Die Neue Gemeinschaft », à Schluchtensee, près Berlin, en 1902 comptait 40 membres.
« Volks-Landsheim », dans la colonie de Walter Mett (idéaliste) à Born auf dem Marss, en Poméranie. En plein fonctionnement.
Il a existé en 1903 une communauté moniste près de Hambourg dont W. Ostwald était l’inspirateur.
-
Angleterre. – « Clowsden Hill » près Newcastle, 1891–98, débuta avec une douzaine de membres.
« Harmony Hall », Hampshire, 1839 (dernière tentative de Robert Owen).
« Manea Free », « Queenwood », vers 1840 : citées par M. A. Baker.
« Purleigh » : 1896–1902 ; 20 membres (tolstoïenne).
« The Sanctuary », dans le Sussex, 1923 (socialiste-chrétienne). Existe encore. William C. Owen y est mort en 1929.
« Starnthwaite », cité par M. A. Baker.
« Whiteway Colony », dans le Gloucestershire depuis 1902 ; communiste puis individualiste. Population cosmopolite variant de 75 à 150, croyons-nous (27 en 1906).
-
Argentine. – « Colonia Libertà » province de Misiones (1923) : composée de sectaires sabbatistes russoallemands.
En 1903, il existait aux environs de Buenos-Aires une colonie communiste chrétienne nombrant 70 membres.
Il doit exister en Argentine des colonies mennonites et de sectaires russes.
« La Protesta » du 15 novembre 1927 a parlé d’une colonie agricole aux expériences mouvementées qui avait récemment existé ou existait encore dans le Grand Chaco. Sans détails de lieu, de date, d’effectif.
-
Australie. – « The New Australia » : fut abandonnée en 1893 pour « Cosme » au Paraguay.
Autriche. – En 1913, il existait une colonie tolstoïenne à Semriach (Styrie).
Les « Vardanieri » : 200 membres, pratiqueraient la communauté des femmes (1928). Pas de nouvelles.
Colonie « idéaliste » de Waldhofen an der Ybbs (1927).
-
Belgique. – « Milieu libre d’Eeckeren », près Anvers (1903).
« Stockel Bois » : 1905–1906, une douzaine de membres inspirateur : Émile Chapelier.
-
Brésil. – « Cecilia », dans l’État de Parana, 1890–1891 : une centaine de participants, Dr Giovanni Rossi Inspirateur.
« Kosmos » disparue en 1904, ayant donné naissance à une autre colonie « Hansa » dont les membres habitaient Blumenau et Joinville (État de Ste-Catherine).
« Guararema », dans l’État de S. Paul, sous l’inspiration de Neblind, les colons vont et viennent sans faire de séjour prolongé.
« Monte Sol » (1905) : pas de nouvelles.
En 1912, il existait dans l’État de Rio Grande do Sul des colonies allemandes plus ou moins communistes et il s’en trouve certainement encore dans l’État de S. Catherina. Il a été aussi question de colonies naturistes dont nous n’avons plus entendu parler.
-
Bulgarie. – Il a existé vers 1922–1923 une colonie communiste libertaire aux environs de Roustchouk. Elle a dû sa chute à ce qu’elle a été trop souvent considérée par des illégalistes comme un lieu de refuge.
-
Canada. – « Christian Community of Universal Brotherhood » (Doukhobors) : depuis 1899, répandus dans le Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie britannique ; 10 à 12000 membres ; sous la direction de Pierre Vérighine, puis de son fils. Les Doukhobors comprennent des groupes scissionnistes ; une aile gauche, en lutte avec le gouvernement canadien ; plus ou moins partisans – au moins idéalement – de la « pluralité amoureuse » ou de la « camaraderie amoureuse », le recours à l’anudation publique est une de leurs formes de manifestations fréquentes (1930) ; communistes au point de vue économique.
« Hutterites » : colonies moraves, venues de l’Allemagne, 16 colonies dans l’État d’Alberta, 3000 membres.
« Redder Alta » (1906), communiste libertaire, débutant avec une quarantaine de colons, ne savons comment elle a fini.
Les « Colonies mennonites », très importantes, ont dû quitter le Canada, ne s’entendant plus avec le gouvernement.
-
Chili. – Au début de 1904, « La Protesta », de Buenos-Aires, faisait remarquer qu’il existait des colonies communistes au Chili.
-
Costa-Rica. – « Granja Far Away » : existe depuis un certain nombre d’années (1919 ou 1920 peut-être) ; quelques familles, que rejoignent de temps à autre des camarades venant des États-Unis ou d’Europe, lesquels s’en vont après un séjour peu prolongé, à tendance individualiste associationniste. L’un des inspirateurs (Palomarès), édite (ou éditait) jusqu’en ces derniers temps (1930) une revue dactylographiée : « Le Semeur ».
-
Cuba. – « La Gloria Colony » 1904, passait pour individualiste.
-
Écosse. – « Orbiston », 1824–28, première tentative oweniste.
-
Espagne. – « Tampul », en Andalousie (entre 1840 et 1850), fouriériste, dissoute par le gouvernement.
Il doit ou a dû exister en ce pays, de fondation récente, des colonies « naturistes ».
-
États-Unis. – « Adonai Shamo », Massachussetts, 1861–96, 30 membres.
« Altruist Community of Gibsonville », Michigan, 1894-?, individualiste-communiste.
« Amana », New-York, puis Iowa, fondée en 1714 en Allemagne, émigrée en Amérique en 1842, comptait encore 1500 membres en 1908 (l’un de ses animateurs, Christian Metz, est resté célèbre dans l’histoire des colonies).
(En 1903, « Amana » comptait sept villages : « Amana », « East Amana », « Middle Amana », « Amana near the hill », « West Amana », « South Amana », « Homestead » et 1800 habitants.)
« Alphadelphia Phalanx », Michigan, 1844–47, 200 membres, fouriériste.
« Anaheim », Californie, 1857. Une cinquantaine de familles. Coopérative, puis individualiste.
« April Farm », en Pennsylvanie, fondée par le millionnaire Garland, qui avait renoncé à son héritage, une douzaine de participants, la question de la liberté sexuelle y jouait un rôle important, dissoute de ce fait en 1926.
(À ce sujet, des journaux américains ont parlé d’une colonie qui existait vers 1865, dans les mêmes parages et qui fut dissoute pour les mêmes raisons, les biens mobiliers des colons auraient été dispersés aux enchères publiques. Impossible de savoir de quel milieu il s’agissait.)
« Arden », Delaware, 1900, six ans après comptait 80 familles, henry-georgiste.
« Army of Industry », Californie, 1914--?, 30 à 40 membres au début.
« Aurora », 1856–1911, dans l’Oregon, 250 membres.
« Aurora Colony », en Californie, 1910, fut créée par l’un des Isaac, éditeur de « Free Society », individualiste.
« The Barbara Fellowship Colony », Californie, 1923, n’existe plus.
« Bethel », Missouri, 1844–80, population ayant varié de 175 à 1000.
« Bishop Hill Community », dans l’Illinois, 1846–62, comptait 1000 membres en 1848.
« Bloomfield Association », New-York, 1844–46, 148 membres, fouriériste.
« British Colony », Californie, 1919- ?
« Brook Farm Community », Massachusetts, 1841–47, 115 membres, à tendance fouriériste. A compté parmi ses membres des orateurs, des poètes, des philosophes comme Emerson, des romanciers comme Nathaniel Hawthorne.
« Brotherhood Cooperative Community of Equality », 1898–1906, Washington, d’abord socialiste, puis individualiste, 300 membres. Chute due au défaut d’un leader énergique.
« Brotherhood of New Life », Virginie, 1851, puis New-York, 1862. Disparue vers 1870. 100 membres.
« Bruederhoff Communities », South Dakota, 1862, plusieurs centaines de membres en 1900.
« Bureau County Phalanx ». Illinois, 1843, fouriériste.
« Celesta Second Adventists », Pensylvanie, 1843, 20 membres.
« Cheltenham », Missouri, 1856–64, de 180 membres à 42, icarienne.
« Christian Commonwalth », Georgie, 1896–1900, 500 membres.
« Clarkson Industrial Association », New-York, 1844, 2000 membres, fouriériste.
« Clermont Phalanx », Ohio, 1844–47, 120 membres, fouriériste.
« Coburn Township », ?-1910.
« Colorado Cooperative Colony », Colorado, 1894–1910.
« Columbia Phalanx », Ohio, 1848, 128 membres, fouriériste.
« Rurley Cooperative Brotherhood », Tacoma, 1903- ?
« Coopolis », ?, anarchiste chrétienne, avait peine à vivre fin du XIXème siècle.
« Dos Palos », Californie, 1910.
« El Capitan », Californie, 1910.
« Ephrata », 1728, existait encore en 1900, a compté jusqu’à 300 membres, basée sur le célibat.
« Fairhope », fondée en 1904, a compté 400, 700 membres, henry-georgiste, la « colonie de l’impôt unique », dans l’Alabama, a donné naissance à une dizaine de colonies semblables.
« Feiba Peven », 1826, oweniste, fusionna avec « New Harmony ».
« Fellowship Farm Colony », Massachusetts, 1906. A compté 26, 40 membres, avait établi une filiale à Norwood Inspirateur : George Elmer Littlefield.
« Free Acres », New-Jersey, 1910, une douzaine de familles, henry-georgiste, Bolton Hall, inspirateur ou participant.
« Fruitlands », Massachusetts, ? (A succédé à « Brook Farm ».)
« George Land » , Massachusetts, 1910, henry-georgiste.
« Germania Colony », ?, 1856–79, une quinzaine de familles.
« Golden Life », Minnesota, 1902–1903, 8 camarades au début, communiste anarchiste.
« Goose Pond Community », Pennsylvanie, 1844, 60 membres, fouriériste.
« Halidon », ?
« Harmonists (the) », Pennsylvanie (1804), puis Indiana, puis retour en Pennsylvanie, 1894–1900, 1000 membres en 1825 ; Rapp, inspirateur et animateur.
« Haverstraw », New-York, 1826, 80 membres. Puis Kendal, Ohio, 150 membres. Oweniste.
« Heaven everywhere ». Illinois, 1923.
« Home Colony », Washington, dans la première décade de ce siècle, a compté une cinquantaine de familles, non compris force jeunes gens des deux sexes. Individualiste anarchiste. La question de la liberté sexuelle y a joué un rôle important et lui a attiré maints désagréments. A été un centre actif de propagande, où s’est publié « Discontent », « The Demonstrator » et des brochures.
« Hopedale Colorry », Massachusetts, 1842–58, 275 membres, fouriériste.
« House of David », Michigan, fondée en 1903, 1000 membres en 1926, petite filiale en Australie. Son animateur, Benjamin Purnell, plusieurs fois poursuivi sous prétexte d’immoralité. Mystique.
« Icaria Speranza », Californie, 1883–1886, 54 membres, icarienne.
« Icarie », Texas, Louisiane, puis Iowa, 1848–78. 1000 à 1500, au Texas ; 250 à 500 à Nauvoo, en Louisiane ; 250 au début à Corning, dans l’Iowa, 35 en 1863, 83 membres en 1876. Colonie fondée par Cabet.
« Integral Phalanx », Illinois, 1845–47, 120 membres, fouriériste.
« Jefferson County Industrial Association », New-York, 1843, 400 membres, fouriériste.
« Kaweah » ?
« Koreshan Unity », Floride, fondée en 1889, 200 membres. Ces sectaires ont créé des filiales à Washington Heights et à Englewood, non loin de Chicago (60 personnes).
« La Grange Phalanx », Indiana, 1844–46, 120 membres, fouriériste.
« Leraysville Phalanx », Pennsylvanie, 1844–46, 40 membres, fouriériste.
« Llano Cooperative Colony », Californie, puis Louisiane. Fondée en 1884 par Job Harriman, a compté 800 participants en 1920, 350 en 1923, 188 en 1927, publie un hebdomadaire : « The Llano Colonist », Administrateur actuel : Geo Pickett. Coopérative.
« The Lord’s Farm », New-Jersey, a duré 18 ans, et nourri 2000 personnes. Existait encore en 1919. Colonie de passage.
« Mac Kean County Association », Pennsylvanie, 1843, fouriériste.
« Mme Modjeska’s Colony », Californie, colonie d’intellectuels polonais fondée à Cracovie en 1876, puis transplantée en Amérique.
« Macluria », 150 membres, fusionna avec « New Harmony ». Oweniste.
« Modern Times », New-York, une cinquantaine de cottages en 1860, disparue en 1866, lorsque a éclaté la guerre de Sécession. Individualiste-anarchisante, fondée par Josiah A. Warren.
« Marlboro Association », Ohio, 1841–45, 24 membres, fouriériste.
« Mohegan Colony », New-York, fondée par Soldes, dure depuis plusieurs années, à tendance anarchisante.
« Moorehouse Union », New-York, 1843, fouriériste.
« Nevada Colony », 1916–18, Nevada. 100 membres.
« New Harmony », dans l’Indiana, créée par Robert Owen, dura deux ans, de 1825 à 1827, a compté 800 membres. Cette colonie engendra huit ou neuf filiales qui ont vécu peu de temps, parmi lesquelles :
« Nashoba Colony », dans le Tennessee, destinée aux noirs. (« Nashoha » fut créée par une écossaise, Frances Wright, que son échec ne découragea pas, car nous la trouvons mêlée à toutes sortes de mouvements émancipateurs.)
« North American Phalanx », New-Jersey, 1843–56, 112 membres, fouriériste.
« Northampton Association », Massachusetts, 1842–46, 130 membres, fouriériste.
« Nouvelle Icarie », Iowa, 1878–98, comptait encore 21 membres en 1895, la dernière colonie icarienne.
« Ohio Phalanx », Ohio, 1844, 100 membres, fouriériste.
« Oklahoma Colony », Oklahoma, comptait, en 1928, 34 membres, coopérative.
« Oneida », d’abord à Putney (Vermont), puis à Oneida (New-York), après réunion avec la colonie de Wallingford. La colonie des Perfectionnistes, du « complex marriage » par lequel chaque homme était marié à toutes les femmes de la colonie et chaque femme à tous les hommes, de l’éducation en commun des enfants considérés comme les enfants de la colonie, de la limitation des naissances, de l’auto-critique. Fondée par John Humphrey Noyes. 87 membres en 1849, 295 en 1851, 298 en 1875, 306 en 1878. Ce qui restait d’Oneida, qui avait abandonné en 1879 et, en même temps, la vie en commun et le mariage complexe, s’est transporté en 1917 à Sherill, à 400 kilomètres à l’est.
« One-mention Community », Pennsylvanie, 1843, 40 membres, fouriériste.
« Ontario Community », New-York, 1844, 150 membres, fouriériste.
« Prairie Home Community », Ohio, 1843, 130 membres, fouriériste.
« Raritan Bay Union », New-Jersey, 1853, fouriériste.
« Rose Valley », Pennsylvanie, existait en 1904, colonie artistique.
« Rosicrucian Fellowship », Californie, colonie de Rosicruciens existant depuis plusieurs années et publiant un journal : « Rays from the Red Cross », Il a été question d’un établissement en Égypte.
« The Roycroft Shop », à East Aurora, créée en 1895 par un homme très original, Elbert Hubbard, d’abord disciple de William Morris et de Walt Whitman et qui devint très personnaliste. A été parmi les victimes du torpillage du « Lusitania ». Avait édité « The Philistine », « The Fra ». Son fils a repris « la suite des affaires ».
« The Ruskin Colony », Tennessee, puis Géorgie, 1894–1901, 300 membres.
« The Separatiste of Zoar », Ohio, 1819–98, 500 membres. Colonie où l’on vivait très vieux, la plus démocratique des « colonies à base religieuse ».
« Saint-Naziaz Colony », Wisconsin, basée sur le célibat, constituée de catholiques romains.
« Skaneateles Community », 1844–46, New-York, 90 membres.
« The Shakers », New-York, fondée en 1776, ont compté jusqu’à 21 établissements et 5000 membres, il doit rester une colonie et 200 membres à Mount Lebanon. (Les Shakers ont compté jusqu’à 17 établissements : « Mount Lebanon » et « Watervliet », New-York ; « Hencock », « Harvard » et « Shirley », Massachusetts ; « Enfield », Connecticut ; « Canterbury » et « Enfield », New Hampshire ; « Alfred » et « New Gloucester », Maine ; « Union Village », « Whitewater » et « Watervliet », Ohio ; « Pleasanthill » et « South Union », Kentuck ; « White oak », Géorgie ; « Narcoosee », Floride.)
« Shalam », New Mexico, 1884–1901, colonie d’enfants.
« Social reform Unity », Pennsylvanie, 1842, 20 membres, fouriériste.
« Sodus Bay Phalanx », New-York, 1844, 300 membres, fouriériste.
« Spring Farm Association », Wisconsin, 1846–49, 40 membres, fouriériste.
« Sylvania Association », Pennsylvanie, 1842–45, 145 membres, fouriériste.
« Temple Home Colony », Californie, 1903.
« Trumbull Phalanx », Ohio, 1844–47, 200 membres, fouriériste.
« Tuscarawas », Ohio, vers 1840, fondée par le proudhonien Josiah Warren.
« Unitarian Association », Wisconsin, 1844, 200 membres, fouriériste.
« United Cooperative Industries », fondée en 1923.
« Utopia Colony », New-Jersey, créée par Upton Sinclair, incendiée en 1907 ; 70 membres, socialo-fouriériste.
« Van Eeden Colony », Caroline du Nord, 1912, pas de nouvelles.
« Vineland », New-Jersey, comptait 12000 habitants en 1861, créée par Charles K. Lundis. Type du milieu autonome de création purement personnelle.
« Wayne Produce Association », Géorgie, fondée en 1921, 75 membres, composée exclusivement de Finlandais.
« Western New-York Industrial Association », 1844, 359 membres, fouriériste.
« Wisconsin Phalanx », 1844–50, 180 membres, fouriériste.
« Women’s Commonwealth ». Texas, 1876–1906, composée uniquement de femmes célibataires.
« Yellow Springs », Ohio, 1824, 75 à 100 familles. Colonie swédenborgienne.
– Victor Considérant avait également fondé, en 1852, une colonie fouriériste au Texas, qui échoua après avoir englouti 2 millions (12 à 15 millions actuels).
– Un mystique, Bill Simpson, s’inspirant de François d’Assise, a créé récemment un mouvement qui a donné naissance à plusieurs colonies, parmi lesquelles on cite « Stepping Stones », « Wellington », « New Hope ».
-
France. – « Famille Saint-Simonienne », à Ménilmontant, Paris, 1828–29. A compté 40 à 50 participants, fondée par Enfantin.
« Colonie sociétaire de Condé-sur-Vesgre », Seine-et-Oise. Commencée avec 600 participants. N’en reste que des vestiges : une maison de campagne où vont prendre des vacances les rares fouriéristes qui demeurent encore.
« Colonie de Citeaux », Côte-d’Or, 1841–42, fondée par un Anglais, Young ; fouriériste.
« Milieu libre de Vaux », près Château-Thierry, Aisne, 1902–04, n’a pas dépassé 20 membres. Fondé par Butaud et Sofia Zaïkowska. Plus tard, il y eut un autre milieu libre à Bascon ; créé en 1911, il a plus ou moins duré jusqu’à ce jour, s’affirmant de plus en plus végétalien.
« Hautes-Rivières », Ardennes, 1904, 2 mois. 4 membres, communiste-anarchiste.
« Glisy », près Amiens, Somme, début de 1905, 5 ou 6 colons, communiste libertaire.
« Ciorfoli », Corse, 1906–07, une demi-douzaine de membres, communiste libertaire.
« La Rize », Rhône, 1907, une demi-douzaine de membres, communiste libertaire.
« Aiglemont », Ardennes, a débuté, créée par Fortuné Henry, en 1904, avec 5 colons et s’est pratiquement éteinte en 1907. Communiste anarchiste.
« Liéfra », à Fontette, Aube, créée en 1908, sous l’inspiration de M. Paul Passy, 77 membres, socialiste chrétienne, rattachée aux associations « enclaviennes », autrement dit « henry-georgiste ».
« Colonie de Saint-Germain », 1906–1908, créée par E. Girault et André Lorulot, une douzaine de membres, communiste libertaire.
« Pavillons sous Bois », Seine, 1910–12 ; colonie communiste libertaire qui a compté parmi ses membres les quatre frères Rimbault et Garnier, des « bandits tragiques ». Cette dernière affaire y mit fin.
« L’Intégrale », à Puch, Lot-et-Garonne, fondée en 1910 par Victor Coissac, s’est maintenue autour d’une dizaine de membres, collectiviste.
« Milieu libre de La Pie », à Saint-Maur, Seine, créée début 1913, par G. Butaud et Sofia Zaïkowska. A compté 20, puis 30, puis 52 participants (sept, 1913), Dispersé par la guerre de 1914.
« Terre Libérée », colonie végétalienne, fondée en 1924, par Louis Rimbault, à Luynes, près de Tours.
« La Kaverno di Zaratustra ». Établie d’abord à Spreenhagen, par le Dr Goldberg, un idiste qui a adopté le pseudonyme de Filareto Kavernido, puis transportée à Rotes Luch, l’une et l’autre localités aux environs de Berlin (avec filiale à Dusseldorf Eller). Se trouvait transplantée, en 1923, à Le Villars, par Tourettes-sur-Loup (Alpes-Maritimes), où elle a compté jusqu’à une quarantaine de membres ; émigrée en Corse, près d’Ajaccio, vers 1927, où est venue la rejoindre une bonne partie du milieu allemand, mais où elle a été décimée par la malaria et les dissensions. Communiste anarchiste, naturiste, nudiste. Le Dr Goldberg a toujours eu maille à partir avec les autorités des régions où il a établi ses colonies. Au moment où paraissent ces lignes, il se trouve à Saint-Domingue, où il s’efforce de reformer une colonie (1930).
« Le Ray », près de Contes, Alpes-Maritimes, 8 à 10 membres, s’est terminée par la mort de Gardey, son fondateur, juin 1922.
« Terre Nouvelle », à Oraison, Basses-Alpes, fondée par Freytag, colonie agricole adventiste ou néo-adventiste, à base foncièrement évangélique et messianique. Remarquable par l’abstention de « commerce charnel » entre colons des deux sexes, qui s’aiment « en amis », mais pas plus. La vie étant éternelle, la procréation est inutile. Ne doit pas dépasser 20 à 30 membres.
« L’Universalité Pratique », aux portes de Nice, Alpes-Maritimes, créée par Gothland (1912), plus ou moins théosophe. Agriculture et élevage. Végétaliens. Ne dépasse par une dizaine de membres (1930).
« Le Phalanstère », essai de colonie, créée par Philippon, disciple de Robin, près d’Alès, Gard : en est à sa période constructive (1930).
-
Inde. – Il a existé dans l’Inde deux colonies owenistes de peu de durée et dont l’histoire n’est pas connue (1826-?).
-
Irlande. – « Ralahine », 1833–36, oweniste, la colonie des « bons de travail », fondée par Arthur Vandeleur, qui se ruina au jeu ; comme la colonie était érigée sur ses terres, elle fut dissoute par ses créanciers qui, d’accord avec la loi anglaise, ne voulurent pas admettre qu’elle fût propriété commune de ses membres.
Il a existé d’autres colonies en Irlande, dont l’une aux environs de Dublin, en 1819, et une autre qui vécut longtemps à Dublin même, administrée par les Quakers.
-
Italie. – « Abbaye de Santa Barbara », colonie de Thélémites, dans l’Italie méridionale, dissoute par le gouvernement italien en 1927.
« Colonia Arnaldi », sur les rives de la mer Tyrrhénienne, existait en 1922.
Il a certainement existé d’autres colonies en Italie.
-
Japon. – « Itto-En », colonie dont l’animateur est le mystique Tenko Nishida (existait en 1928).
-
Mexique. – « Topobolampo Colony », sur la côte occidentale du Mexique, 1891–1900, a compté 6 à 700 membres au début, oweniste, fouriériste. Fondée par Albert K. Owen.
Il y a eu d’autres colonies au Mexique. En 1903, il existait des colonies mormones, qui n’avaient pas voulu accepter la suppression de la polygamie.
À la suite de leur désaccord avec le gouvernement canadien, un certain nombre de « mennonites » se sont transportés dans l’État de Chihuahua et y ont établi des colonies.
En 1927, Alfred Sors a réuni 4 ou 5 camarades dans l’État de Durango, petite colonie à laquelle a mis fin la révolution.
-
Océanie. – Il est d’usage de compter parmi les colonies communistes les établissements créés par les mutins du « Bounty » (1825) à Pitcairn Island, Norfolk Islands, Lord Howe Island et qui, en fait, se gouvernent à leur façon, avec une ingérence minimum du gouvernement de la Métropole ou de l’Australie.
-
Panama. – « Cooperative Colony », 1916.
-
Palestine. – « Colonies sionistes », individualistes, communistes, coopératives. Les plus démonstratives sont pour les coopératives la colonie de « Nahalla » (80 familles) et pour les communistes celle de « Nures ». Au début de 1927, il aurait existé, en Palestine, 35 groupes communistes israélites, dont la population variait de 10 à 800 personnes.
-
Paraguay. – « Cosme Colony », près Caazapa, 1893–1904, a compté de 65 à 150 participants, communiste, fondée par William Lane, la colonie des distractions et l’une de celles qui a rendu ses membres les plus heureux.
« Colonies mennonites ». – Dans le « Chaco Paraguayen ». Ont obtenu une charte spéciale du gouvernement. Sont établis en 15 villages, avec leurs temples, leurs écoles, leurs champs communaux, sans intrusion garantie des autorités judiciaires ou policières du pays. Aux dernières nouvelles (1930), des mennonites de Pologne, Allemagne et Russie se proposaient de les rejoindre.
En 1913, un essai de colonie a été tenté par des anarchistes communistes, à quelques kilomètres du fleuve Paraguay, mais a échoué complètement.
-
Pays-Bas. – Au début du siècle, il y a eu un mouvement en faveur des colonies assez important, comprenant deux tendances : l’une ayant en vue la possession communiste du sol, qu’animait le socialiste-idéaliste et écrivain van Eeden (plus tard converti au catholicisme) ; l’autre, tolstoïenne, inspirée par le pasteur Kijlstra, communiste.
Les tolstoïens, ou anarchistes-chrétiens, ont créé la colonie de Blarikum (1899–1903) où résida Kijlstra et qui a été incendiée le lundi de Pâques 1903 par les gens du pays – et la colonie d’Amersfoort, qui consistait en une imprimerie.
L’autre tendance coopérative a créé « Walden » en 1898, où résidait F. van Eeden et qui comptait 35 membres.
« Huizen », 1902.
« Nieuw Harmonie », 1902, à Nederhost den Berg.
Il y avait également à Blarikum, où se sont trouvées réunies, à un moment, de 30 à 40 personnes, des partisans de la tendance de la possession communiste du sol.
« De Ploeg » (1920–1928), colonie agricole, dans la povince du Noord Brabant, créée par des camarades qui voulaient vivre, en coopération, du travail de leurs mains. Composée d’individualistes et de communistes, les uns et les autres s’accusent mutuellement d’être la cause de sa chute.
-
Pérou. – « Les Buenos Amigos », 1853, ?
-
Russie. – En 1914, il existait une colonie agricole, à tendance tolstoïenne-communiste à « Linbovka », à 25 kilomètres de Kharkov, 65 membres. En 1924, il existait deux colonies du même genre : l’une au bord de la Mer Noire, entre Novorossik et Batoum, l’autre en Ukraine, tout près de Poltava.
« Kuzba », 1922, aurait compté jusqu’à 2000 membres, dont plusieurs centaines d’Américains. Colonie coopérative dont l’intervention du gouvernement soviétique a amené le déclin.
« Uhlfeld », colonie communiste composée d’Autrichiens, établie dans la province d’Orenburg, mais que le gouvernement des Soviets a obligé à émigrer, en 1927, dans la steppe des Khirgiz.
Il a existé, et il existe encore, en Russie de nombreuses colonies de « sectaires » occultes ou publiques.
BIBLIOGRAPHIE. – E. Armand : « Les tentatives de Communisme pratique », Paris, 1904. – Arthur M. Baker : « New Moral World Series », Londres. – Félix Bonnaud : « Cabet et son œuvre », Paris, 1900. – Redelia Brisbane : « Albert Brisbane », Mental Biography, Boston 1873. – G. Butaud : « Seigneur de Château-Thierry, Nogent l’Artaud et autres lieux, et Croquant de Bascon », 1908. – M. Cabet : « Voyage en Icarie », Paris, 1846. – Émile Chapelier : « Une colonie communiste, Stockel-Bois », 1906. – Émile Chapelier : « La Nouvelle Clairière, drame social en 5 actes », Stockel-Bois, 1906. – T. Combe : « Whiteway, un coin de terre heureux », Paris, 1904. – « Communities of the Past and Present », Newllano, 1924. – James Connolly : « Labour in Irish History », Dublin, 1910. – Craig : « History of Ralahine ». – Édouard Dolléans : « Robert Owen », Paris, 1905. – Maurice Donnay et Lucien Descaves : « La Clairière », comédie en 5 actes, Paris, 1900. – Ch. Gide : « Les Colonies coopératives et communistes », Paris, 1927–28. – John Boston Godman : « Brook Farrn », Historie and personal Memoirs, Boston, 1894. – Fortuné Henry : « Communisme expérimental ». – André Mounier : « En Communisme », Aiglemont, 1905. – Morris Hillquit : « History of the Socialism in the United States », New-York, 1903. – William Alfred Hinds : « American Communities », Chicago, 1902. – Alexander Kent : « Cooperative Communities in the United States » (in Bulletin of Departement of Labor, n° 35, july 1901). – George Browning Lockwood : « The New Harmony Communities », Marion 1902. – André Lorulot : « Une expérience communiste : la colonie libertaire de Saint-Germain », Saint-Germain, 1908. – Georges Narrat : « Milieux libres : quelques essais de vie communiste en France », Paris, 1909. – Ch. Nordhoff : « The Communistic Societies of the United States, from personal visits and observations », New-York, 1875. – Jules Prudhommeaux : « Icarie et son fondateur, Émile Cabet », Paris, 1907. – Lindsay Smith : « Brook Farm, its members, scholars and visitors », New-York, 1900. – Sagot : « Communisme dans le Nouveau Monde », Dijon, 1900. – Bertha Shambaugh : « Amana, the Community of true Inspiration », 1918. – Charles Sotbevan : « Horace Greeley and other Pioneers of American Socialism », New-York, 1872. – John Spargo : « My visit to the tolstoyan colony of Whiteway », 1905. – Van Eeden : « Kolonie in N. Carolina », Amsterdam, 1912.
MILITAIRE
adj. (lat. militaris, de miles, militis, soldat)
Qui concerne l’armée, les soldats et, conséquemment, la guerre vers laquelle sont orientées les institutions militaires. Ce mot désigne une mentalité, des mœurs, une politique, une organisation ; il évoque des charges sociales, des tyrannies de caste, de sanglantes suprématies, des entr’égorgements de peuples et, en général, un abaissement du niveau humain qui ne peuvent que le faire haïr de tous les hommes libres. Tous ceux qui pensent avec quelque indépendance, ont plus ou moins marqué de réprobation l’esprit et les œuvres militaires. Quelques citations typiques en feront foi. Jusqu’aux grands de l’Église d’ailleurs qui, revenant, à certaines heures, à la logique de leurs enseignements, en ont dénoncé les méfaits !
« Ce qu’il y a de plus fatal à la vie humaine, c’est l’art militaire. » (Bossuet)
« Un prince qui n’a eu que des vertus militaires n’est pas assuré d’être grand dans la postérité. » (Massillon)
« Quinze ans de despotisme militaire changent tout dans les mœurs d’un pays. » (Mme de Staël)
« L’éclat des succès militaires éblouit même de bons esprits. » (J. de Maistre)
« La gloire militaire ne justifie pas le despotisme, mais elle le décore. » (Benj. Constant)
« Une démocratie n’existe plus là où il y a une force militaire en activité dans l’intérieur de l’État. » (Chateaubriand)
« La servitude militaire est lourde et inflexible comme le masque de fer du prisonnier sans nom. » (Alf. de Vigny)
« La vie militaire est anormale et prive la société des hommes les plus forts. » (Maquel)
« L’honneur militaire est le plus bizarre et le plus variable de tous. » (Valéry)
etc...
L’art militaire est proprement l’art de tuer. Le métier qu’il exige comporte un entraînement systématique à la destruction des choses et des personnes ; il n’existe pas en dehors d’une collaboration, selon certaines méthodes, aux crimes collectifs que sont les guerres. La caserne et le service militaire obligatoire en ont systématisé l’apprentissage... La justice, dite militaire, est rendue par un conseil de guerre, c’est-à-dire un tribunal où les chefs jugent leurs subordonnés. Elle fonctionne, plus encore que la justice civile – qu’elle méprise d’ailleurs, comme le proclamait, de façon typique, sous l’affaire Dreyfus, le parti de l’État-major – avec un dédain insolent de l’équité. Elle rend des sentences à la fois grotesques et terribles. Et elle fait exécuter – préoccupée d’exemple ! – par ses camarades les malheureux que frappent ses arrêts de mort. Pour les autres, elle a ses bagnes où opèrent des tortionnaires raffinés. De la caserne à Biribi, de la discipline à la sanction disproportionnée, de la brimade bouffonne et lancinante à la punition sadique, s’étalent ridicules, tracassières et cruelles, des compressions de l’être humain qui sont des vertus proprement militaires. Elles n’abdiquent à aucun moment, et la guerre les connaît accrues et davantage florissantes...
En temps de guerre, les actes de répression militaire sont caractérisés par des violences de toute nature, dirigés contre des adversaires ou ennemis, contre des villes ou des provinces, ou seulement contre des habitants, des prisonniers, des vaincus, par ordre des chefs militaires et sous prétexte d’exemple ou de représailles. Aux colonies surtout – où c’est d’ailleurs en permanence l’état de guerre, où sévit en fait, sans interruption, l’occupation militaire, – combien d’actes infâmes n’a pas couvert la prétendue civilisation ! Est-il besoin d’aller plus loin que l’exemple, sous nos yeux, de ce que fait la France, en Indochine ; aux Indes, l’Angleterre ? Le règne militaire incarne à merveille la domination du plus fort. Le militaire colonisateur, qui porte à la pointe des baïonnettes les bienfaits des « grandes » nations, s’accompagne souvent de ces deux auxiliaires doucereux qui parfont sa tâche généreuse : la religion et l’alcool. « By the Bible and by the gin » (comme disent les fils d’Albion, experts dans l’art du rendement colonial), on obtient, les armes remises pour un temps au fourreau, ce que n’a pu achever la conquête...
Dirons-nous, pour compléter le tableau, quelques mots de cette discipline « qui fait la force principale des armées », comme s’expriment les manuels d’instruction ? Évoquerons-nous le dressage méthodique des unités confiées aux formations militaires, le refoulement de la personnalité, l’obligation d’une obéissance qui ne connaît ni raison, ni raisons. Pour les jeunes gens contraints à enfermer dans les casernes une portion précieuse de leur existence, est-il souvenir plus humiliant que cet abaissement devant le galon prestigieux, le silence devant une « supériorité » toute d’arrogance et d’arbitraire ? Militaire est synonyme de soumission aveugle, de mise à merci « sans discussion ni murmure ». L’esprit militaire exige qu’on abdique, l’individualité est sa proie. L’armée s’applique à niveler et à mâter les hommes dont elle s’empare. Elle prétend à l’obéissance passive. Les œuvres militaires s’accomplissent sous le signe d’une docilité totale et moutonnière. Et c’est des troupeaux qu’elles ébranlent...
C’est assez dire que la conception militaire est une force avec laquelle nous ne pouvons transiger et qu’à sa mentalité, ses rouages et ses buts, nous opposons une critique et une propagande incessantes. Contre elle, les libertaires ne marchandent ni leur temps, ni leur liberté. Plus d’un a payé de sa vie la révolte contre ses prétentions et ses crimes. Avec eux, les syndicalistes révolutionnaires, comprenant quel levier de classe, quelle puissance anti ouvrière est l’armée, ont essayé de sauvegarder les dignités menacées, de maintenir actives les énergies tapies sous le joug parmi les jeunes travailleurs enrôlés. L’antimilitarisme agissant (voir militarisme) est dans la logique de nos principes : il commande les attitudes de tous les révolutionnaires éclairés qui voient, plus loin que les coups de main de violence, une société affranchie des fléaux autoritaires. Intense pendant les années qui précédèrent la guerre, l’effort antimilitariste a souffert de l’écœurement des foules trompées cherchant, quand elles ne sombrent pas dans l’indifférence, une obscure revanche dans les illusions bolchevistes. Comme si les mêmes armes et les mêmes moyens ne ramenaient pas aux mêmes dangers et ne ressuscitaient pas des malfaisances du même ordre ! Le peuple pour se défendre, ne peut favoriser la formation d’une nouvelle organisation militaire qui, avec la même mentalité, se retournera de nouveau contre lui, au service de quelque caste, ou de quelque aventurier...
Opposé au mot civil, le mot militaire est un terme générique qui désigne l’ensemble de la force armée. Il y a, entre les deux éléments, une démarcation plus nette encore dans le langage vulgaire que dans le langage technique. Qui porte habit militaire semble avoir revêtu un prestige et des vertus qui manquent aux autres mortels. « Il fut un temps où le militaire s’imaginait volontiers appartenir à la race des héros invincibles et traitait avec une désinvolture quelque peu dédaigneuse le simple pékin. » Il y aurait de la naïveté à croire ces temps révolus. La recrudescence des préoccupations militaires au sein des nations troublées d’après-guerre a ressuscité des prérogatives et ramené des délits de lèse-majesté qu’on croyait à jamais disparus. Au pays de Voltaire, un regard nuancé d’ironie suffit à autoriser les porteurs de galon à se croire insultés et à exiger contre vous des sanctions...
À l’heure où la France, pour sauvegarder sa fallacieuse « victoire », porte à un si haut degré le mal militaire, il est piquant de rappeler le jugement de celui qui, alors premier consul, devait faire bientôt de l’Europe le champ-clos des armées :
« Il ne faut pas, disait-il, raisonner des siècles de barbarie aux temps actuels. Nous sommes 30 millions d’hommes réunis par les lumières, la propriété et le commerce. 3 ou 400 000 militaires ne sont rien auprès de cette masse. Outre que le général ne commande que par les qualités civiles, dès qu’il n’est plus en fonction, il rentre dans l’ordre civil. Les soldats eux-mêmes ne sont que les enfants des citoyens. L’armée, c’est la nation. Si l’on considérait le militaire, abstraction faite de tous ces rapports, on se convaincrait qu’il ne connaît point d’autre loi que la force, qu’il rapporte tout à lui, qu’il ne voit que lui. »
« L’homme civil, au contraire, ne voit que le bien général. Le propre du militaire est de tout vouloir despotiquement ; celui de l’homme civil est de tout soumettre à la discussion, à la vérité, à la raison. Elles ont leurs prismes divers, ils sont souvent trompeurs ; cependant la discussion produit la lumière. Je n’hésite donc pas à penser, en fait de prééminence, qu’elle appartient incontestablement au civil. »
Si le guerroyeur forcené de l’Empire a oublié le parallèle – peu flatteur pour le militaire – tracé par Bonaparte, que dirons-nous de la cécité d’une République qui entretient au paroxysme, sous des prétextes de sauvegarde, toutes les vertus qui alimentent le césarisme ?...
— Georges YVETOT
À LIRE : Psychologie du militaire professionnel (A. Hamon) ; Sous-Offs (L. Descaves) ; Biribi (G. Darien) ; L’Armée contre la Nation. (Urbain Gohier) ; Le livre d’or des officiers français (Chapoutot) ; les satires de G. Courteline, etc...
MILITANT(E)
rad. militer adj.
Qui fait la guerre, qui combat. Une nation guerrière et militant, — Qui lutte, qui dispute une victoire : La vie de l’homme est une vie militante. Politique militante : Politique de lutte. — Substantiv. : Partisan de cette politique : Les militants. Église militante (v. Église).
Mais il est un sens — pour nous familier, et qui entre de plus en plus dans la terminologie courante — sur lequel nous voulons, ici, nous étendre davantage. Qu’est-ce qu’un militant ? Le militant tel que nous le comprenons s’apparente à l’apôtre, à l’agitateur et à l’animateur. Comme l’apôtre il se voue à la propagation et à la défense d’une doctrine, d’une idée, d’une cause, avec l’enthousiasme de la foi, un prosélytisme ardent et le désintéressement d’une conviction inébranlable. Comme l’agitateur, il est celui qui réveille les masses populaires et les entraîne à la lutte contre les iniquités sociales. Comme l’animateur, il organise, éduque, enflamme et galvanise ceux qui, comme lui, comprennent que leur émancipation totale ne dépend que de leur effort, individuel et collectif. (Voir les mots Agitateur, Apôtre).
Parlons de nos militants. Par la parole, par l’écrit et par l’action les militants anarchistes, dans le monde entier — et surtout à la fin du siècle dernier et au commencement de celui-ci — ont donné l’exemple, parfois farouche et tragique, de l’esprit de sacrifice entier à la cause révolutionnaire. Nombreux sont les justiciers, les vengeurs, les généreux exaspérés qui ont remué les masses miséreuses et. terrifié la bourgeoisie par leur propagande individuelle.
Leur admirable apostolat n’a pas été couronné du succès tant espéré... Leur sacrifice n’a pas amené le triomphe de l’anarchie ; mais l’espoir a jailli de partout et la philosophie anarchiste s’est largement répandue parmi les exploités, elle a pénétré les mouvements de revendication prolétarienne... Malgré, les persécutions, la discussion des idées subversivespartout continue. Les idées et les militants les plus connus de l’anarchie eurent des sympathies dans tous les milieux de la société. L’objection qu’ils rencontraient dans leur propagande était le plus souvent celle-ci :
« Ce que vous préconisez est trop beau pour une humanité si laide ! »
Mais discuter une idée, c’est vouloir la comprendre et la comprendre c’est commencer à l’adopter. L’idée faisait donc son chemin. D’autant plus que partout les procès retentissants de militants anarchistes passionnaient l’opinion publique. Des propagandistes admirables réfutaient pied à pied les objections de l’éloquence judiciaire au service de la justice bourgeoise. Quant aux responsables de « propagande par le fait », leur attitude, simple ou crâne, fut toujours celle de héros vaincus, mais non désespérés du triomphe de l’Idée et heureux de l’occasion qui leur était donnée d’expliquer et de justifier leurs actes « devant des ennemis et non des juges », comme ils disaient. L’activité de ces militants, leur audace affolaient les bourgeois, mais réconfortaient les travailleurs emportés par de tels exemples loin des pitreries des tréteaux politiques.
De cette propagande de « l’époque héroïque » anarchiste, l’éducation populaire se ressentit fortement. Une mentalité nouvelle se révélait. Les militants de l’anarchie, orateurs et écrivains, développaient avec succès les généreuses idées de liberté et de fraternité humaine. Ces idées se discutaient et les espoirs d’un avenir très prochain se formulaient surtout parmi les travailleurs. Il s’agissait de favoriser et d’amplifier cet acheminement vers la justice sociale par l’organisation de la classe ouvrière. Ce fut le rôle des militants syndicalistes.
Les travailleurs groupés en vue de revendiquer un meilleur salaire offraient en effet un terrain merveilleux pour une propagande plus hardie et plus logique que celle de l’entente des exploités avec leurs exploiteurs et, dans ces groupements, il était facile de montrer la solidarité ouvrière s’effectuant dans l’action revendicatrice autrement que par la mutualité.
Tout est mieux compris entre frères de misère, entre compagnons de chaîne. Souffrir et espérer ensemble prédispose singulièrement à avoir mêmes pensées. C’est pourquoi les ouvriers affranchis du respect de l’autorité, imbus d’idées de justice sociale et animés de saine révolte contre les iniquités furent aptes à se faire comprendre parmi les travailleurs en leur parlant de la possibilité de conquérir (par l’union et par l’action sur le terrain économique, dans le syndicat) le Bien-Être et la Liberté. Loin de dénigrer le Travail, source de toute la richesse sociale dont ne profitent point les travailleurs, ils en démontrèrent la nécessité et la beauté à la condition que le Prolétariat — par son action énergique et coordonnée — ait supprimé l’iniquité sociale sur laquelle est basée le régime bourgeois : l’exploitation de l’homme par l’homme.
Ces militants anarchistes ou libertaires surent se faire comprendre. Ils surent convaincre. A leur contact les travailleurs prirent conscience de leur valeur et comprirent qu’ils devaient rester unis pour être forts. C’est de cette éducation poursuivie dans les syndicats que naquit la C. G. T. La propagande syndicaliste des militants anarchisants nous semble la seule efficace pour aboutir à la « suppression du Patronat et du Salariat », principe fondamental de la C. G. T. et but suprême du syndicalisme. C’est du producteur, affranchi dans sa mentalité par l’éducation, que surgira l’action prolétarienne propice à l’éclosion d’une société nouvelle d’hommes libres sachant s’entendre et s’entr’aider pour la vie...
Les militants syndicalistes surent donner aux syndicats ouvriers une allure combative qui ne fut pas sans alarmer les exploiteurs et leurs défenseurs. L’État mit au service des patrons contre les ouvriers tous les moyens de répression possibles. Magistrature, Police, Armée furent mobilisées contre la classe ouvrière en œuvre d’émancipation. De nouvelles lois répressives furent vite bâclées et appliquées aux militants. Une presse servile trompa sciemment l’opinion publique pour l’ameuter contre l’ouvrier syndiqué et contre ceux qui, sans ambition personnelle, attaquaient droit l’édifice d’iniquité.
Mais tout cela n’empêchait nullement le syndicalisme d’être redoutable par sa tactique révolutionnaire et ses formules d’action directe. Tout cela n’empêchait pas les militants de continuer une propagande salutaire, exhortant les masses à opposer la force ouvrière à la force patronale et combattant ardemment, par la parole et par la plume, les actes de répression gouvernementale et les lâchetés parlementaires. Les années de prison s’accumulaient sur la tête des militants qui osaient qualifier, selon leurs mérites, les valets de la bourgeoisie capitaliste. Ces militants avaient compris leur rôle. Ils savaient qu’ils ne devaient plus s’arrêter en chemin ; puisqu’ils avaient mis le prolétariat sur la voie de la révolution sociale, ils devaient l’accompagner jusqu’au bout, dût, parfois, les interrompre un repos-forcé dans les prisons de l’État. Devant les juges, eux aussi, revendiquaient hautement la part de responsabilité qu’ils avaient dans l’effervescence révolutionnaire parmi les travailleurs. Ils marchaient crânement sur les traces des syndicalistes américains que l’histoire du mouvement ouvrier honore sous la dénomination de Martyrs de Chicago.
C’est sous l’influence de militants libertaires que les syndicats se débarrassèrent de plus en plus de complications paperassières, de règlements inutiles, d’obligations surannées et remplacèrent les « sollicitudes législatives » à l’égard des syndicats, par des mœurs ouvrières adéquates à la mentalité syndicaliste. La tactique d’action dans les grèves fut également transformée. Ce n’est pas ici la place d’en décrire toute l’efficacité, ni d’en dénombrer les résultats ailleurs exposés. Revenons au militant. Définissons bien ce qu’est ou doit être le militant syndicaliste.
Contrairement à l’opinion de certains anarchistes hostiles au syndicalisme, nous pensons que le syndicat ne diminue pas la personnalité de l’anarchiste. S’il est ouvrier, sa place est au syndicat. Il y doit faire nombre et œuvrer pour revendiquer aussi son droit à la vie meilleure. S’il veut devenir un militant syndicaliste digne de ce nom, il lui suffira de ne pas se croire d’essence supérieure à ses camarades, de n’afficher au milieu d’eux aucun pédantisme, de n’affecter aucun dédain de leur ignorance, de se montrer, en un mot, pénétré d’affectueuse tolérance et partisan d’une fraternelle égalité. Pour cela, sans aucune vanité, il prendra plaisir à partager son savoir, à faire don de son érudition. Rien de plus facile à un travailleur que de parler simplement à des travailleurs et de se rendre sympathique à tous, par sa franchise et sa sincérité. Car si les travailleurs manquent parfois d’éducation et trop souvent d’instruction, ils ont, en général, bon sens et clairvoyance. Ils savent, peu à peu, reconnaître la bonne foi et le désintéressement et apprennent à se défier de qui veut les influencer pour les tromper. Les politiciens bavards ont dégoûté les travailleurs et les intellectuels prétentieux les ont écœuré ; du moins dans les syndicats d’avant-guerre il en était ainsi.
Comment on devient militant ? Ce sont les circonstances de la lutte ouvrière qui donnent ordinairement l’occasion à un militant de se révéler, de sortir de l’ombre. Une conviction forte étouffe vite des sentiments de modestie mal placés. L’ardeur avec laquelle le militant se dispose à servir les intérêts de tous, en. défendant énergiquement la cause commune, n’échappe pas à ceux qui admirent ses qualités. D’instinct, ils pressentent en lui l’homme qui serait un guide. Il est choisi. On le désigne pour représenter ses camarades, pour les impulser, pour parler en leur nom. Il ne séparera pasl’affranchissement de l’individu de l’émancipation des travailleurs. Pourvu que nulle ambition mal placée ne se dévoile un jour chez ce militant, le voilà qualifié et mis à même de besogner dans un milieu qui est le sien, avec sa classe, en accord avec la collectivité si intéressante des exploités, le voilà apte à mener dans la bonne voie révolutionnaire le groupement ouvrier qui lui fait confiance. Il n’y faillira pas, si les travailleurs qui l’ont choisi ne se sont pas trompés. Car, il faut bien convenir qu’il n’y a pas toujours que des individus d’élite parmi les militants ouvriers. Les événements nous l’ont prouvé. L’ambition, la vanité, la paresse font vite de mauvais militants des profiteurs et des arrivistes. Il y a des renégats partout. Il n’est pas de troupeaux, dit-on, où il n’y ait quelque brebis galeuse. Pourtant, le syndicat devrait être le seul groupement réfractaire à ces produits malsains, car il est ce que le font les syndiqués. Ceux-ci ne doivent donc pas se désintéresser de leur syndicat (voir ce mot). Le groupement syndical ne doit pas être la chose de quelques-uns ; il est un groupement des intérêts de tous. C’est ce que le militant doit y répéter sans cesse en agissant conformément à ce principe. Le militant sincère, sûr de lui-même, exige toujours le contrôle de tous sur sa conduite, sur ses actes. Il fait ainsi précisément comprendre qu’il est le représentant et non le dirigeant du syndicat. De cette façon,, il se rend digne de là confiance qui lui est donnée et s’abstient rigoureusement d’en abuser. Il reste l’égal de tous dans un groupement de parfaite égalité... C’est un devoir d’agir en militant quand on en possède les rares et précieuses dispositions et toutes les qualités. Mais comme nul n’est obligé d’accepter ce rôle public, il faut, quand on y consent, l’être loyalement, entièrement, fièrement et surtout proprement. Le syndicat vaut ce que valent les syndiqués. Et les militants sont ce que leur tempérament, leur conviction, leur honnêteté leur permettent d’être et de rester. Que l’on choisisse bien l’homme qu’il faut pour être militant dans un groupement ouvrier. De lui dépend la bonne marche de l’organisation. Surtout veillons à ce qu’il ne soit ou ne devienne pas un politicien. On sait tout le mal fait par la politique et par les politiciens à la classe ouvrière quand celle-ci fut sa proie (et comme elle marque, momentanément il faut l’espérer, une fâcheuse tendance à le redevenir aujourd’hui). La politique, au syndicat, c’est la division fatale entre travailleurs ; c’est alors le mépris mutuel faisant place à l’estime réciproque des syndiqués entre eux. C’est la pire des déviations. C’est, de plus, une absurdité à l’égal de celle d’un « syndicat confessionnel ». Le militant doit en dénoncer le péril à tous les syndiqués. La politique divise les travailleurs, en fait des frères ennemis, finit par détruire le syndicat.
Il est peu logique de se prétendre fervent syndicaliste en même temps que socialiste politique convaincu. Il y a contradiction flagrante à dire aux syndiqués : « Faites vos affaires vous-mêmes, et-ne comptez que sur vous pour conquérir votre affranchissement social » et à proclamer, en réunion publique, devant des électeurs : « C’est par la conquête des Pouvoirs Publics, par le bulletin de vote, par l’envoi des vôtres aux Assemblées législatives que vous serez les maîtres de vos destinées »..., étant donné que toujours on a vu, par ce moyen, non pas ces bons apôtres conquérir les Pouvoirs Publics, mais être conquis par eux... ce qui n’est pas du tout la même chose. Que les ouvriers, dans leurs syndicats ne soient pas dupes de ces « trop dévoués à la cause », ayant ordinairement deux visages et dont le « désintéressement » est, de ce fait, suffisamment équivoque. Le syndicat ne doit pas servir de plate-forme d’apprentissage aux arrivistes, de tremplin aux ambitieux. Le militant syndicaliste doit savoir qu’il n’a rien à espérer d’autre en son apostolat que des satisfactions morales, des consolations de sa conscience forte, dans le devoir accompli, malgré les persécutions des gouvernants au service du patronat. Peut-être même rencontrera-t-il l’ingratitude de ceux qui le devraient aimer, soutenir et encourager. Le militant doit braver tout et tout subir stoïquement ou se retirer simplement s’il craint de succomber sous la lassitude ou le dégoût.
Ce qui fait la force du militant, tel que nous l’envisageons, c’est justement la faculté qu’il a de reprendre sa place dans le rang, quand la charge de militant lui paraît trop lourde à porter. Rien n’est plus réconfortant qu’un militant conscient de sa valeur et soucieux de sa dignité qui sait se retirer « en beauté », sans un regret, sans un reproche, tout en conservant intactes ses convictions, heureux de se retremper dans le milieu même, où il pourra, sans rancune, savourer fièrement la joie d’avoir été un vrai militant, ne boudant pas à l’heure, qui peut se représenter encore, où il sera, nécessaire de tout braver dans l’intérêt commun.
— Georges YVETOT.
MILITARISME
n m. (rad. militaire)
Le militarisme est un système qui consiste à avoir et entretenir des militaires, des armées. Son but essentiel et avoué est la préparation de la guerre. Le recrutement d’une armée permanente ; l’organisation des cadres d’une armée de réserve ; l’accumulation, la mise, le maintien en état de servir d’un matériel de guerre toujours plus moderne, plus perfectionné, bref, c’est l’organisation préalable de la guerre.
Cette organisation colossale, mise à la disposition des gouvernements, leur permet de poursuivre un double but : pouvoir lutter contre les gouvernements étrangers en cas de conflit entre eux et avoir sous la main un appareil formidable de répression violente en cas de soulèvement populaire. Les gouvernements ont un absolu besoin de l’armée tant contre leurs ennemis de l’extérieur que contre ceux de l’intérieur.
Théoriquement, pour justifier l’existence du militarisme, on dit que son but est la défense nationale, la sauvegarde de l’intégrité du territoire. En réalité, lorsqu’on suit l’histoire de ces derniers temps, et qu’on voit l’armée servir à attaquer les autres pays, à conquérir des colonies, à réprimer les manifestations ouvrières et les grèves, le rôle de l’armée apparaît tout autre : c’est la défense de l’autorité gouvernementale établie qu’elle assure. D’autres articles démontrent le bluff du patriotisme et de la défense nationale (voir ces mots). D’autres établissent que l’État (avec son gouvernement) n’est qu’une institution au service des grandes et puissantes organisations capitalistes : financières, industrielles et commerciales. D’autres encore prouveront que la guerre défensive ou offensive – et qui pourrait faire réellement la distinction ? – ne sont que des chicanes entre divers groupes de capitalistes, chicanes qui se règlent dans le sang des peuples mobilisés.
Contentons-nous de faire voir que le militarisme est l’arme par excellence de domination des gouvernements, que c’est le bras armé qui frappe les ennemis des dits gouvernements, ennemis nationaux ou étrangers.
Les maîtres ont des rivalités d’intérêts avec les maîtres d’autres régions ; ou bien ils ont jeté leur dévolu sur une contrée coloniale incapable de se défendre et contenant des richesses ; ils lancent leur armée ou la nation entière rassemblée dans la bataille pour imposer leurs volontés et en tirer des bénéfices.
D’autres fois, les peuples, à bout de patience et révoltés par une exploitation trop féroce ou une tyrannie trop cruelle, secouent leurs préjugés et leur résignation, et se révoltent. Alors, l’institution policière et judiciaire étant devenue insuffisante pour faire rentrer tout dans l’ordre gouvernemental, on fait intervenir les forces militaires avec leurs moyens puissants et perfectionnés de destruction. Le capitalisme yankee n’a-t-il pas mis en œuvre, dans les grèves, les mitrailleuses et les gaz ?
Ce double objectif du militarisme est nettement visible dans son évolution actuelle.
Le capitalisme, surtout le financier, s’internationalisant, les grands consortiums étant arrivés à conclure des ententes ou à se résorber l’un dans l’autre ; la dernière guerre ayant tellement remué le monde que les intérêts capitalistes s’en sont trouvés menacés, on assiste à ce phénomène : l’internationalisation du capitalisme est suivie parallèlement par une internationalisation des gouvernements. La Société des Nations n’est qu’un essai, encore informe, d’un gouvernement international qui sera le chargé d’affaires des groupes financiers internationaux comme les gouvernements nationaux le sont des groupes capitalistes nationaux. Ces groupes financiers internationaux, qui deviennent de plus en plus puissants, ont des intérêts un peu partout. Une guerre leur serait préjudiciable, tout au moins une guerre entre les nations qui leur sont asservies. Ils tentent de faire disparaître ces sortes de conflits, pour ne conserver la guerre que contre les pays qui ne voudraient pas se soumettre à leur puissance. Peu à peu, ainsi, se constitue une sorte de Super- État qui, lorsqu’il sera arrivé à son apogée, fera régner la paix capitaliste, semblable à l’ancienne paix romaine, paix qui signifiera l’asservissement de tous les peuples à quelques groupes financiers reliés par un pacte et donnant des ordres au Super-État. Cette évolution est visible à l’ heure actuelle.
D’autre part, une autre évolution se poursuit : celle des méthodes de guerre que la science transforme de jour en jour. Grâce à l’automobile, à la mécanique, à la balistique, aux explosifs nouveaux, à l’aviation, à la T. S. F., aux rayons électriques, aux créations d’une chimie ingénieuse, aux gaz asphyxiants, à la bactériologie, la guerre future se présente sous d’autres aspects que dans le passé. Au lieu de voir manœuvrer d’immenses cohortes, des millions d’hommes mobilisés et armés, suivis d’un matériel lourd et considérable, se précipiter sur d’autres groupes semblables, on verra des escadrilles d’avions survolant le pays ennemi, laissant tomber des obus, des bombes à gaz ou incendiaires sur tous les points vitaux de la région, semant la ruine et la terreur. Pour ce genre de guerre, il suffit d’une petite armée de techniciens, de mercenaires destructeurs pilotant les appareils de mort, et d’une nation travaillant dans les usines pour leur fournir matériel et munitions nécessaires. Le service militaire obligatoire, les grosses armées permanentes, la mobilisation générale sous les armes peuvent disparaître, la guerre ne s’en poursuivra pas moins, et elle restera toujours suspendue sur la tête des peuples comme une épée de Damoclès, mille fois plus meurtrière, plus grosse de ravages étendus, rapides et profonds.
Cette double évolution des méthodes de guerre, et de formation d’un super-État capitaliste, devrait logiquement amener la disparition ou la diminution du militarisme, la réduction des budgets de la guerre, le désarmement même si réellement le militarisme n’avait d’autre but que de garantir la défense nationale.
Il n’en est rien, et c’est ce qui prouve que le militarisme a un autre but, inavoué celui-là : le maintien de l’ordre gouvernemental à l’intérieur, lequel exige de plus en plus des organismes de répression souples et puissants, capables de tenir tête, à l’occasion, aux soulèvements populaires, de briser dès I’ aube les révolutions.
Peu à peu, l’armée de conscription fait place à une armée de métier. On enrôle systématiquement des mercenaires (voir ce mot) ; on enrégimente, pour le service de marâtres métropoles, de pauvres bougres de coloniaux. En 1929, on comptait, en France, 326.000 mercenaires, armée formidable et toujours prête à donner main-forte au gouvernement si son existence était menacée. Cette armée mercenaire, augmentée d’une gendarmerie mobile et d’une police toujours renforcée et qui sera bientôt étatisée, c’est-à-dire près de 500000 hommes bien armés et outillés pour la répression, est plus forte que l’armée de conscription. C’est le plus formidable outil de défense que l’État français ait jamais institué. C’est un militarisme qui retourne à l’ancienne conception de l’armée de métier, colossale gendarmerie dont le rôle sera de tenir le peuple dans l’assujettissement le plus absolu.
Dans les autres pays capitalistes, on constate la même évolution. Elle est la caractéristique du militarisme moderne qui se trouve ainsi orienté vers deux fins : une armée de guerre, relativement peu nombreuse, mais pourvue des moyens les plus scientifiques de destruction ; une garde formidable, dispersée dans tout le pays, chargée de tenir dans l’obéissance la multitude ouvrière.
En résumé, le militarisme évolue avec la constitution des États, et avec les méthodes de guerre, mais il persiste. Il change de forme, mais c’est pour reparaître plus formidable, mieux outillé, mieux adapté aux conditions du temps. Quant ,à son but et à sa destination, il reste le même à travers les temps : assurer la domination là d’un individu ; ailleurs : de groupes tyranniques suçant et rançonnant la masse.
On peut dire que le militarisme a pris naissance en même temps que la domination de l’homme sur l’homme. Ceux qui commandaient les autres humains on t toujours pensé que leur règne devait, par prudence, ne pas compter exclusivement sur la résignation et une soumission bénévole, mais avoir une force de violence à leur disposition pour mâter les adversaires.
Aussi loin qu’on fouille l’histoire, on s’aperçoit que le militarisme a toujours été un corollaire obligatoire de l’autorité. Au fur et à mesure que l’autorité se concentrait dans les mains d’un puissant souverain, l’organisation du militarisme se compliquait et s’amplifiait. C’est sur le militarisme, et avec son aide, que les grands États se sont formés : Égypte, Chaldée, Assyrie, Perse, Grèce, Rome, dans l’antiquité. Et plus près de nous, les grands États ne se sont agglomérés que par la constitution et l’intervention d’armées toujours plus puissantes, lesquelles affermissaient l’autorité du souverain, d’abord, et s’étendaient ensuite, par la conquête, aux contrées voisines. Le militarisme n’est pas la conséquence du patriotisme, puisque ce sont, presque toujours, les conquêtes des armées et l’annexion militaire imposée et maintenue qui ont rassemblé ces blocs factices que sont les patries modernes. La patrie est fille du militarisme. Aussi est-il naturel, logique, que les patriotes soient en même temps militaristes. On ne renie pas aisément ses origines. Et ceux qui nous présentent un patriotisme édulcoré, presque honteux de lui-même devraient bien se rappeler que les notions de patrie, d’armée et le militarisme sont en étroite filiation. D’ailleurs, qu’éclate un conflit ou leur patrie est en jeu, et les voilà versant obligatoirement dans un militarisme suraigu.
Avec la constitution des royaumes et empires stables, on a assisté à l’organisation de plus en plus méthodique des armées permanentes. Les premiers souverains appelaient aux armes leurs nobles vassaux, qui accouraient avec leurs hommes d’armes. La nécessité de maintenir l’ordre intérieur, la domination du souverain et celle de livrer des guerres incessantes, a poussé les monarques à constituer des formations durables, solidement organisées, pliées sous une discipline de fer, prêtes à intervenir à chaque instant et n’importe où. Mais c’était toujours l’armée du roi, la marine royale.
La révolution française de 1789, en ruinant politiquement le pouvoir absolu du monarque, a modifié le caractère de la souveraineté qui s’abrite sous le masque des États. Et elle a amené la transformation du militarisme. Aux armées mercenaires royales sont venues se substituer les armées nationales, amenées par la conscription obligatoire. La centralisation des États se renforçant, les guerres exigèrent des forces de plus en plus puissantes. L’ère du militarisme moderne s’ouvre avec la Révolution ; puis c’est Napoléon, la constitution d’un empire russe, d’un empire allemand, d’une royauté italienne, d’un empire austro-hongrois, etc... Plus les États sont puissants et centralisés, et plus les militarismes se développent. Ce sont deux organismes connexes : l’un est le corollaire de l’autre. Et si quelque jour, nous voyons se constituer un super-État européen, il aura à sa disposition un militarisme formidable auprès duquel ceux d’aujourd’hui ne sont que des jouets. Il en est déjà question.
Vouloir se débarrasser du militarisme en conservant les États est une plaisanterie ou une chimère. L’État soi-disant prolétarien de Russie, surtout dans le cadre mondial actuel, est autant, sinon plus, militariste que les autres.
Un État sans appui militaire, sans appareil de coercition ne pourrait point vivre, bientôt secoué par les revendications des basses couches sociales. D’autre part, un militarisme sans État n’a point de raison d’exister.
Cette institution indispensable aux gouvernements est effroyablement onéreuse pour les peuples. S’il fallait calculer ce qu’ont coûté d’abord les périodes préparatoires des années de « paix armée » si lourdes pour les budgets des nations, puis, en vies humaines, en destructions imbéciles ou monstrueuses, en richesses anéanties, les guerres et les répressions, et si on y ajoutait les dettes contractées par les États pour parer aux dépenses formidables des unes et des autres, on resterait confondu. Il suffit de voir les milliards gaspillés par l’Europe d’après-guerre en préparation militaire pour comprendre que le militarisme, en même temps qu’il en est l’engin destructeur, est la sangsue des sociétés modernes.
Prenons la France comme exemple. Elle a actuellement une dette intérieure et extérieure dépassant 400 milliards, provenant exclusivement des dépenses de guerre. Les arrérages payés pour ces dettes de guerre se montaient, en 1929 (rentes consolidées ou amortissables) à 14 milliards. Les pensions de guerre et retraites militaires se chiffrent à environ 7 milliards. Les budgets de la guerre, de la marine de guerre, des colonies (dépenses militaires) et des corps expéditionnaires, sont d’à peu près 20 milliards. Soit, en tout, 31 milliards. Voilà ce que coûte le militarisme à la population française. Et, chaque année, cette charge va grossissant.
Plus de 30 milliards par an pour le militarisme et ses conséquences ! Alors que l’ensemble des salaires de tous les ouvriers, paysans, employés, fonctionnaires, mis ensemble, n’atteint pas 60 milliards (chiffres officiels). Que de réformes sociales, que d’améliorations au sort du peuple si ces 30 milliards étaient utilisés pour le bien-être de tous ! Rien que cette économie, à elle seule, vaut la peine de faire une révolution sociale, sans compter le reste.
Les budgets de la guerre et de la marine, réunis, en France, étaient de 548 millions en 1868, de 663 millions en 1878, de 727 millions en 1888, de 938 millions en 1898, de 1165 millions en 1908, de 1814 millions en 1913. Ils sont maintenant de plus de 10 milliards. Comme on le voit, l’ascension est constante. Malgré la réduction du service militaire de 7 ans à 5, puis à 3, puis à 2, les dépenses ont augmenté sans cesse. Il en a été de même dans tous les pays.
Depuis la grande guerre les exigences de ce militarisme que certains, naïvement, avaient caressé l’espoir de détruire, n’ont encore fait que croître, C’est, de nouveau et avec plus d’intensité, la course aux armements. Armée de terre, armée de mer, armée de l’air, ont des besoins de plus en plus forts. La science transformant chaque jour les méthodes guerrières, chaque État veut se tenir à jour des découvertes, ne point se laisser distancer par les voisins. Et pour parachever ce joli tableau, nous verrons prochainement la Société des Nations, le super-État, se mettre lui aussi de la partie et organiser son militarisme.
On peut, sans exagération aucune, estimer qu’aujourd’hui l’entretien des militarismes absorbe au moins un vingtième de la production industrielle des pays dits civilisés, que deux autres vingtièmes sont gaspillés à payer les intérêts des dettes contractées par suite des guerres, et qu’un vingtième environ de la population mâle valide est enrégimenté dans les armées. Tant en efforts utiles gaspillés dans l’œuvre de mort qu’en parasites entretenus à une besogne nuisible, le militarisme coûte aux nations de 20 à 25 % de leur capacité de production, c’est-à-dire qu’il réduit d’autant le bien-être.
Un des premiers efforts d’une société organisée pour la justice, la liberté et le bien-être, devra être la disparition du militarisme, qui entraînera celle des patries et celle des États, perdant leur soutien.
La suppression du militarisme, à elle seule, apportera un immense soulagement matériel, une augmentation considérable des satisfactions de chacun. Et la disparition de ce formidable instrument de tyrannie et d’oppression sera la meilleure garantie de la liberté de tous.
– Georges BASTIEN.
MILITARISME
Prépondérance exagérée de l’armée dans une nation. Tous les États sont militaristes, mais principalement les monarchies ; exemples : l’Allemagne et la Russie avant la guerre.
Le roi, toujours égoïste, songe avant tout à lui-même. Il se croit très au-dessus de l’humanité, non par l’effet d’une valeur intellectuelle personnelle, mais du fait d’en engendrement spécial et supérieur. Le peuple n’a pour lui qu’une importance secondaire ; il s’en préoccupe aussi peu que le propriétaire d’une maison se soucie du bien-être des rats qui en habitent les caves.
Mais ce qui lui importe c’est l’armée (voir ce mot). L’armée qui défend le pays, mais qui surtout protège sa précieuse personne contre les ennemis de l’intérieur.
La cavalerie vêtue de couleurs vives, ornée d’acier et de cuivres bien astiqués, casquée de métal doré, caracole autour de la voiture impériale.
Le peuple fait la haie, il écarquille les yeux pour ne pas perdre une miette de ce beau spectacle. Comme cela brille ! Il acclame, il hurle : Vive l’empereur ! Vive l’armée !
Cette armée n’est belle que dans les parades. Les casernes sont malpropres, sans aucun confort. Les soldats y couchent en chambrée et la nuit il se dégage de tous ces jeunes corps mal tenus une odeur infecte. Le soldat n’est pas une « petite maîtresse », dit l’officier, les odeurs ne le gênent pas, même celle des matières chères à Cambronne.
La nourriture est détestable, préparée en grand par un cuisinier paresseux. Les vivres, bien que vendus chers au gouvernement, sont de mauvaise qualité et la préparation en est faite sans soin. Le soldat, qui ne doit pas avoir d’odorat, ne doit non plus avoir de goût.
Ça fait du bien par où ça passe...
Quand on a faim tout est bon évidemment et le soldat ne continue pas moins de manger son rata, si on a trouvé dans la marmite une demi-douzaine de souris... noyées par accident.
Souvent des épidémies éclatent : rougeole, variole, scarlatine, fièvre typhoïde ; l’hygiène est très mauvaise, l’eau est contaminée. De la caserne, le soldat passe à l’hôpital militaire qui ne vaut guère mieux. Souvent au lieu de guérir de la maladie qu’il a, il contracte celle qu’il n’a pas et il meurt. Aucune importance. Si on est à la caserne pour apprendre à tuer ne doit-on y apprendre à mourir aussi ?
Toute la « casernée » s’ennuie mortellement. Les exercices sont fastidieux ; on apprend en un ou deux ans ce qui peut s’apprendre en trois mois. L’exercice fini, c’est le désœuvrement dans la promiscuité avec des gens qu’on n’a pas choisis. Le recrutement jette un coup de filet dans la rue, dans les champs ; le poisson est médiocre. Lire ? impossible. Toute la chambrée hurle ; d’ailleurs on aurait vite arraché son livre à ce rat musqué d’intellectuel ; le papier imprimé est surtout bon à un tout autre usage.
Mais les brutes s’ennuient aussi. Pourquoi sont-elles là ? L’un voudrait être derrière sa charrue, l’autre à son atelier, l’étudiant voudrait continuer ses études. Le temps passé à la caserne est du temps perdu et l’on est en colère contre le gouvernement qui vous force d’être là où on n’a que faire. La patrie, a dit le colonel...
« Oui, cause toujours, on la connaît ! »
Pour se forcer à l’espoir on écrit sur le mur derrière son lit le nombre de jours qui restent et il se trouve que chaque jour ce nombre diminue d’une unité :
Plus que 327 ; allons, ça se tire... vivement la classe !
Cependant on reste là ; rares sont ceux qui se révoltent, c’est que les châtiments sont terribles. Le conseil de guerre Biribi.
De soif et d’ faim.
La Boétie se demanderait comment une poignée d’officiers peut avoir raison de cette masse d’hommes.
C’est que les hommes sont très inférieurs. Pour mener à bien une révolte, il faudrait s’unir, s’organiser, avoir une volonté déterminée d’échapper à la caserne. Et tout cela nécessiterait une culture, une intelligence, un caractère que les hommes sont très loin de posséder. Chacun est incapable de voir plus loin que lui-même. Certes, l’adjudant-flic l’enrage ; mais il n’y a que patience à prendre ; un jour tout finira. On reverra ses champs, sa rue...
Seuls se révoltent les têtes brûlées : dégénérés pour la plupart, et aussi quelques anarchistes, quelques antimilitaristes pleins de courage. Du courage, il en faut ; toute une vie sacrifiée pour un résultat général très minime.
Le dimanche, dans la ville de garnison, les soldats déambulent par groupes de cinq ou six, les bras ballants, à travers les rues. Que faire ? la ville est étrangère, on n’y connaît personne. Quand on a un peu d’argent on va au beuglant, café-concert de bas étage, ou des artistes de dernier ordre régalent le soldat de refrains d’une obscénité répugnante. Il rit bruyamment en buvant du gros vin frelaté. Le soir, derrière la caserne des filles aux haillons souillés rôdent. Elles sont vieilles, véritables épaves de la prostitution. Leur visage est flétri, leurs cheveux sont gris, leurs seins pendants. Mais elles sont bon marché et le soldat n’est pas riche.
Mais la vérole est attrapée.
La vérole, maladie terrible encore, malgré les progrès de la médecine. Il faudra se soigner toute sa vie, autrement gare le tabès, l’hémorragie cérébrale ou la paralysie générale. À quarante ans ce sera fini ; mais quarante ans, quand on en a vingt, on pense que cela ne viendra jamais.
Si les partis réactionnaires sont militaristes c’est parce que l’armée est pour le peuple une école de soumission. Le peuple y apprend à obéir sous la terreur du code militaire qui a la mort à chaque page. Le général, le colonel, personnages chamarrés de galons qu’on ne voit que très rarement et de très loin mais qui sont terribles ; la vie du soldat est entre leurs mains. Ils peuvent le faire fusiller et, en défilant devant son cadavre, la musique du régiment jouera « Sambre-et-Meuse ». Et nunc erudimini, vous qui songez à la révolte !
Les grenadiers adoraient, paraît-il, Napoléon 1er. Plus tard, Freud dira que c’était d’un amour sexuel. Ces sentiments sont le fait des armées de métier. Le soldat d’aujourd’hui passe trop peu de temps à la caserne pour avoir l’amour du chef. Le chef moderne n’a pas, comme Napoléon, intérêt à caresser sa chair à canon, surtout en république. L’officier, le général de division lui-même, n’est qu’un fonctionnaire ; le soldat ne l’intéresse pas du tout.
Sorti de l’armée, l’homme est formé pour la vie à l’obéissance. Il comprend que, bâtie depuis toujours, la nation a une puissance formidable et qu’en face d’elle lui, individu, n’est rien. Pas autre chose à faire que de suivre les sentiers battus ; il travaillera tous les jours, il respectera son patron comme il respectait l’adjudant Flic, il se mariera, aura des enfants et mettra de l’argent à la caisse d’épargne. Il lira le Petit Journal ou l’Ami du Peuple, parce que ces journaux ne sont pas dangereux, ne sont pas compromettants. Il s’intéressera aux faits divers. Les plus allants fréquenteront les manifestations sportives.
Il se défiera des révolutionnaires, des « fous » ou des « ambitieux », qui tentent de le faire sortir de la bonne voie. Évidemment, il y a des riches, ce n’est pas juste ; mais « cela a toujours été et sera toujours » !
L’armée, comme la société, est divisée en deux classes dont le grade de sous-lieutenant forme la barrière. Au-dessus du sous-lieutenant est la bourgeoisie, au-dessous est le peuple.
Le sous-lieutenant a le plus profond mépris pour l’adjudant Flic. Il est allé au lycée et de là à Saint-Cyr. L’adjudant Flic n’est allé qu’à l’école primaire ; la salle de police, les tinettes, les balais sont de son domaine. Le sous-lieutenant, lui, plane très haut au-dessus de ces malpropretés ; le soldat le dégoûte.
La guerre a brisé pour un temps la cloison : force a été de fabriquer des officiers avec des soldats. Le poilu, certes, était loin d’avoir dans sa musette le bâton du maréchal Foch ; néanmoins, il pouvait sans ambition désordonnée rêver au mince galon du sous-lieutenant. Mais la guerre finie, la démarcation reparait ; les officiers sortis du rang ont pu rester en fonctions, ils encourent le mépris de leurs camarades.
L’officier est un homme cultivé, mais d’une culture spéciale. Sauf exceptions, son esprit est borné par le milieu. Il a des idées réactionnaires ; celui qui montre des opinions avancées est persécuté par ses collègues ; on met tout en œuvre pour l’amener à quitter l’armée. Autrefois, on allait jusqu’à le tuer en lui suscitant des duels répétés, auxquels il ne pouvait se dérober. L’officier peut avoir du courage à la guerre, mais dans la vie il n’en a aucun. C’est un fonctionnaire, sans personnalité. Comme le soldat, lui aussi est terrorisé, il lui faut obéir à ses chefs, leur donner des marques de respect qui n’existent dans aucune administration civile.
Le métier est monotone et sans intérêt. À part l’élite qui va à l’école supérieure de guerre, ceux qui travaillent dans les inventions, les années de service n’apportent aux officiers que l’abrutissement. Leur vie privée est celle de petits bourgeois. Ils ont beaucoup d’enfants et vivent serrés dans un petit logement. En province ils ont une vie un peu plus large et aussi plus de considération. L’aristocratie de la petite ville s’agglutine pour lutter contre l’ennui. La femme aménage un petit salon et a son jour. Entre femmes d’officiers s’établit une hiérarchie comique qui correspond à celle des maris. Et que de cancans ! malheur à qui ne pense pas et n’agit pas comme tout le monde...
Le métier d’officier ne favorise pas beaucoup le développement, intellectuel ; la vieille baderne de colonel, ou même de général est classique. Le « Colonel Ramollot », personnage d’avant-guerre, l’a immortalisée.
Les républiques, même militaristes, subordonnent encore le pouvoir militaire au pouvoir civil « la grande muette » ; l’armée n’est qu’un instrument. Le chef d’armée habitué à commander à des soldats qui n’ont qu’à obéir et à se taire n’a pas, sauf exceptions, la souplesse nécessaire à l’homme d’État qui doit manœuvrer, non des mannequins, mais des gens qui pensent, qui du moins ont la prétention de penser.
On ne peut pas faire la révolution contre l’armée. La Russie, le Portugal, dans leurs révolutions, avaient l’armée avec eux. Au régiment et à l’atelier sont les mêmes hommes ; mais jusqu’ici on n’a jamais pu décider le prolétariat à former une armée révolutionnaire. Dans les émeutes, l’armée a toujours devant elle la foule sans armes. Plutôt que d’aller le soir dans une cave faire des mouvements d’ensemble devant un camarade, l’ouvrier préférerait renoncer à la révolution. Il n’y a que les prolétaires réactionnaires qui consentent à ce sacrifice. Au moment où j’écris, cent mille casques d’acier viennent de défiler au pas de l’oie dans les rues de Coblentz en acclamant la revanche.
Rendre l’armée sympathique à la révolution est très difficile. Les soldats sont jeunes. Sortis de chez leurs parents, ils n’ont pas encore vécus de la vie indépendante ; ils comprennent très peu les idées. En outre, la plupart sont des paysans et ils sont jaloux des ouvriers des villes, qu’ils considèrent comme des fainéants passant leur vie dans les plaisirs.
« Divide ut imperes », Thiers s’est servi de l’antagonisme des paysans et des citadins pour écraser la Commune de 1871. Un adjudant Flic, plus féroce encore que nature aurait dit alors à un malheureux condamné :
« Tu le vois, ton frère, il va te fusiller ! »
Il faisait allusion au vieux cliché de propagande :
« Soldat, ne tirez pas sur vos frères ! »
Les guesdistes d’avant la guerre conseillaient à leurs jeunes adhérents d’aller à la caserne et d’y conquérir des galons afin de pouvoir d’autant mieux, le cas échéant, servir la révolution. Pure illusion, les soldats militants ne seront jamais qu’une minorité infime.
La révolution portugaise et aussi la grande révolution française avaient l’armée avec elles. Mais ils ne faut pas oublier que c’étaient des révolutions bourgeoises ; les chefs étaient acquis et les soldats suivaient les chefs. La révolution russe a eu avec elle une partie de l’armée, mais alors l’armée était désorganisée par une très longue guerre et elle avait rassemblé non seulement les jeunes, mais des hommes faits.
Tout homme d’opinion avancée ne peut pas ne pas détester le militarisme.
Le militarisme, c’est la guerre. L’adage « Si vis pacem para bellum. » n’est pas vrai. « Les canons, les munitions », lorsqu’ils sont en trop grand nombre, doivent servir. Les officiers veulent pouvoir monter en grade à la faveur des vides que fera la mort. Et la guerre à son tour renforce le militarisme. L’armée passe au premier plan ; les grands chefs deviennent des idoles exposées à l’adoration des foules.
Les hommes meurent par millions, la vie économique est arrêtée, la pensée est jugulée. Les villes sont lugubres, le peuple foulé. On meurt au front, vous avez la chance d’être à l’arrière : souffrez !
La vie du soldat ne compte plus. On en fait massacrer des milliers dans une offensive inutile, uniquement pour mettre quelque chose dans le « communiqué » distribué à la presse. Sous Louis XIV, un général faisait tirer l’artillerie sur ses propres troupes pour leur apprendre ce que c’est que la guerre. Peu de changement.
Le militarisme, c’est la guerre et c’est aussi la réaction. « Le sabre et le goupillon », comme on disait pendant l’affaire Dreyfus ; le soldat et le prêtre : deux hommes du passé qui veulent dominer par l’abêtissement et la force.
– Doctoresse PELLETIER.
MILLIARDAIRE
n. m.
Personne qui possède un ou plusieurs milliards. Ce terme est devenu l’appellation, dans la langue courante, d’une personne immensément riche, d une sorte de nabab de l’argent et des affaires.
S’il y a quelque chose qui démontre l’iniquité du régime social actuel, c’est bien la possibilité, pour un individu d’accumuler une fortune allant jusqu’à un milliard ou le dépassant. Un ouvrier relativement bien payé – salaires pris dans l’ensemble du pays – peut gagner 10 000 francs par an. Il lui faudrait donc travailler 83 333 années pour avoir cette somme, en admettant qu’il ne dépense rien pour sa nourriture, logement, habillement, etc... Un technicien intellectuel, ingénieur, etc., qui touche 50 000 francs par an est considéré comme ayant une bonne place. Il lui faudrait 20 000 ans pour gagner un milliard.
Ces deux exemples nous montrent toute l’iniquité d’une organisation dans laquelle il est permis à un homme, par des opérations de finances, des spéculations plus ou moins malpropres, de rafler, en quelques années, ce que le produit, même bien rétribué, du travail utile, ne permettrait pas, à mille ouvriers habiles ou à 400 techniciens capables, de gagner en toute une vie de cinquante années de labeur.
Rien ne prouve mieux que ce qu’on dénomme la propriété n’est pas le produit du travail, n’est que la conséquence de tractations, combinaisons et opérations de toute nature, étrangères pour la plupart à l’effort productif.
Dans notre société contemporaine, le nombre des milliardaires et des archi-millionnaires s’accroît continuellement. C’est une des marques les plus frappantes de la situation économique actuelle, que cette concentration des capitaux en quelques mains favorisées. Le travail, la production, sont relégués au second plan, c’est en dehors d’eux et à leur détriment que s’édifient de rapides et colossales fortunes.
Un homme peut arriver à mettre en exploitation toute une industrie, ou un commerce, ou une branche de l’activité humaine. Les milliardaires – dont l’Amérique est le berceau de prédilection : elle a les Rockfeller, les Pierpont, Morgan, etc... – se désignent souvent par les noms retentissants et bien suggestifs de : roi du pétrole, roi de l’acier, roi de l’automobile, etc...
Et c’est, en effet, une véritable royauté, une souveraineté tyrannique que ces potentats de l’or étendent sur les branches capitales de l’économie sociale : ils accaparent les sources, commandent la mise en valeur et les transactions ; leurs trusts (voir ce mot), contrôlent les marchés mondiaux et la majeure partie des profits affluent vers leurs coffres-forts.
L’argent est devenu le magique talisman. On l’adore comme une divinité et ses grands prêtres, millionnaires et milliardaires exercent, sous ses auspices, un pouvoir incontesté. Les États, les gouvernements, les formations politiques avec leurs pavillons bariolés et leurs apparentes oppositions, ne sont que des trompeuses façades derrière lesquelles les milliardaires – princes de finance – manient les personnages d’un théâtre de fantoches.
Ce sera pour les siècles futurs, un bien curieux tableau et un déconcertant contraste que l’ascension parfois précipitée de ces magnats du capital, échafaudant dans l’agiotage, la spéculation et l’escroquerie des concentrations scandaleuses, tandis que les multitudes – sous le sceptre reconnu et souvent admiré du veau d’or – s’épuisent à la poursuite du salaire et s’étiolent de privations devant les fruits amoncelés de leur travail.
– G. BASTIEN.
MINE
n. f.
Avec le sens de physionomie, prestance, etc., ce mot (dont les langues du Nord offrent des for mes similaires) semble avoir des attaches germaniques ; il dériverait d’un verbe signifiant : extérioriser, faire paraître. Mine (bonne, mauvaise mine, faire bonne, ou grise mine, etc.), désigne l’aspect, l’expression du visage regardé comme le reflet de l’état physique ou des dispositions intérieures. La Fontaine nous met en garde contre le penchant – assez fréquent – à établir entre le caractère, les qualités internes et l’allure, les traits, l’apparence des corrélations rigoureuses :
De juger les gens sur la mine.
MINE (de miner : origine controversée, mais qui paraît remonter au latin miniaria (mine de minium), terme qui se serait étendu à toutes les mines) désigne un gîte métallifère ou carbonifère que l’on exploite pour les besoins de l’industrie.
Mine (ou mieux trou de mine) s’applique, à une excavation creusée pour déposer un explosif : procédé courant des carriers pour faire sauter des fragments de rochers, des blocs de pierres. Ce sens s’étend aussi aux galeries souterraines, aux travaux d’approche auxquels a recours l’art militaire poursuivant la destruction d’ouvrages ennemis.
C’est à l’ensemble des travaux combinés en vue de l’extraction du charbon ou du minerai aux chantiers souterrains, où peine durement une catégorie particulièrement éprouvée du prolétariat que nous nous arrêterons plus longuement ici. Le charbon et les métaux jouent un tel rôle dans le développement précipité de l’industrie moderne et la prépondérance du capitalisme que la mine est pour nous d’un grand intérêt social.
Une mine est une série de carrières profondes aux quelles accèdent, par des puits verticaux communiquant avec des galeries horizontales, les ouvriers mineurs occupés à extraire à l’intérieur de la terre des minéraux comme la houille ou le sel, et des minerais (fer, cuivre, plomb, etc.).
Après avoir désigné d’abord les minéraux mêmes utiles à l’homme, et triés par lui pour ses besoins (le mot a donné naissance à minéral, minerai, minéralogie), puis le filon de minéraux, l’endroit où gisaient minéraux et minerais, on comprend, aujourd’hui, quand on parle d’une mine, une exploitation complète d’extraction des minéraux comportant des puits par où se fait la descente et la montée des ouvriers (les mineurs), l’évacuation des minéraux extraits, les galeries qui suivent les gîtes ou filon du minéral, galeries parfois assez larges et garnies de rails pour faire circuler les wagonnets, et galeries d’extraction ayant la même dimension que le filon à exploiter. Ces dimensions sont parfois si exiguës que le mineur doit y marcher courbé et replié, et doit se mettre à plat ventre ou sur le dos pour détacher, avec son pic, des blocs de houille ou de minerai. À la mine se rattache extérieurement une vaste cour où s’opère le triage du minerai ou du charbon et les différentes manipulations nécessaires pour le nettoyage du produit extrait : c’est le carreau de la mine. Divers bâtiments, et de nombreuses machines (ascenseurs pour descendre et mon ter les bennes, grues, rails, locomotives, etc) complètent cette importante organisation.
Une mine est une entreprise industrielle considérable. Elle nécessite un gros outillage mécanique et exige, tant pour l’installation que pour le roulage, un capital important. Aussi des compagnies minières, au capital de plusieurs millions, voire de centaines de millions, se sont-elles formées pour l’exploitation des gisements.
Depuis quelques années, l’industrie de l’extraction de la houille ou charbon a subi de grandes transformations, grâce à d’importantes découvertes chimiques. La mine de houille s’est augmentée d’industries annexes. Les sous-produits de la houille sont obtenus directement à la sortie même du puits. Et la fabrication de ces sous-produits a parfois pris davantage d’importance que le commerce brut du charbon.
À titre indicatif, signalons les centrales électriques installées à proximité des mines, envoyant leur courant électrique sur un réseau englobant plusieurs départements. La lumière, la force motrice, le chauffage même sont ainsi transportés d’une façon plus rationnelle et hygiénique que le charbon. S’il n’y avait point les bénéfices abusifs des compagnies à monopole qui imposent des prix du kilowatt à des tarifs prohibitifs, lumière et chauffage électriques pourraient être obtenus à meilleur marché que la combustion directe du charbon dans les poêles. Et quel progrès au point de vue propreté et hygiène pour les habitations.
En distillant la houille on obtient d’une part du coke, qui est utilisé dans les hauts-fourneaux de la métallurgie, et du gaz d’éclairage qui, traité spécialement, fournit une grande quantité de sous-produits : le goudron, pour les routes et autres usages et entretiens, pour ses matières colorantes, telle l’aniline ; l’ammoniaque utilisé dans les usines et appareils frigorifiques ; des engrais chimiques pour l’agriculture, etc.
À la mine de houille s’est agglomérée toute une série d’industries annexes, ce qui donne à certaines exploitations minières modernisées, l’aspect d’une industrie complexe et gigantesque.
De même, les mines où l’on’ extrait des minerais métalliques sont étroitement liées – souvent sous la gestion de la même firme industrielle – à l’industrie métallurgique. Le minerai de fer est traité à la sortie de la mine dans les hauts-fourneaux, transformé en fonte, puis en fer et en acier, et cette dernière industrie prend de plus en plus d’importance, au fur et à mesure du progrès de la mécanique.
Si la mine de houille est devenue le grand centre des industries chimiques, la mine de fer est le cœur de l’industrie métallurgique. Les régions où git le fer, comme celles où s’extrait la houille, sont des pays de production industrielle très intense, couverts d’usines de toutes sortes, qui groupent une population très dense.
Ces régions, on le conçoit aisément, sont âprement convoitées par les grosses firmes industrielles, les groupements financiers, lesquels, agissant sur les gouvernements à leur dévotion, provoquent au besoin les guerres pour mettre la main sur les concessions de telle contrée minière. Les convoitises allumées autour du bassin de Briey appartiennent à l’histoire de la dernière guerre. On sait qu’il était – à portée du feu de l’artillerie et des avions français – la réserve où l’industrie allemande, gênée par le blocus maritime, trouva jusqu’au bout un aliment pour ses fabrications militaires, mais qu’on évita de le bombarder afin de ménager le précieux avantage de le retrouver intact à la « victoire ». Ce sont des appétits de cette nature qui ont conduit à l’occupation de la Ruhr, lamentable fiasco de « récupération nationale », mais filon fructueux pour quelques affairistes...
Les expéditions et les conquêtes coloniales ont eu – et ont encore – presque toujours pour objet la main mise sur les richesses minières. Les indigènes n’extraient ni la houille, ni le fer, ni le cuivre, ni les autres minerais, ou l’extraient mal. Dès que des explorateurs ont prospecté ces ressources enfouies dans le sous-sol, on commence la campagne, on provoque ou l’on invente des incidents, et, le prétexte trouvé, c’est la conquête. Sitôt celle-ci terminée et le pays « pacifié » à coups de fusil, les concessions des mines sont octroyées aux financiers avides.
La propriété du sous-sol est devenue un monopole formidable, qui a permis à de nombreuses fortunes de s’échafauder. Le monde industriel actuel ne peut plus vivre sans les mines devenues une des parties fondamentales de l’activité humaine. Aussi la propriété des mines constitue-t-elle un monopole d’exploitation qui rapporte de fabuleux profits à ceux qui en sont les détenteurs.
On cite telle compagnie de mines dont les actions émises à mille francs, il y a un demi-siècle, lors de l’octroi de la concession, se négocient en bourse à des cotes atteignant plusieurs centaines de milliers de francs et dont les dividendes annuels représentent cent ou deux cents fois le capital initial versé. C’est la main mise éhontée grâce à la complicité de l’État (lequel laisse aujourd’hui accaparer de même la « houille blanche ») sur une incommensurable richesse naturelle, par une poignée de capitalistes bénéficiaires.
Jadis, les mines étaient propriété du souverain, et leurs revenus allaient à lui exclusivement. Mais le régime capitaliste s’étant développé, les hommes d’argent ont fini par faire glisser entre leurs mains cette richesse devenus inestimable avec le développement de l’industrie moderne. Les métiers mécaniques, la machine à vapeur, le chemin de fer, toute la métallurgie grosse ou petite, ont considérablement enrichi les propriétaires de mines. Fait très significatif et très important dans l’histoire économique et politique, c’est à l’époque précise où l’industrie prenait naissance, au début de son essor, aux premières années du XIXème siècle, que les capitalistes ont mis la main sur l’industrie minière.
La loi du 21 avril 1810 a consacré cette substitution, ou plutôt cette prise de possession. Elle créait deux sortes de propriété, celle de la surface de la terre – propriété foncière – et celle du sous-sol, propriété minière, et elle donnait au gouvernement le pouvoir de concéder la propriété minière à qui lui plairait. Mais le gouvernement ne pouvait exploiter directement une mine qu’en vertu d’une loi spéciale.
En fait, il n’a jamais exploité que de misérables concessions de mines de sel gemme. L’extraction du fer et de la houille, a été partout abandonnée à des compagnies financières, montées la plupart par actions.
L’État prélève un impôt sur les bénéfices, c’est-à-dire partage une part – la plus petite – du profit ; tout le reste va aux actionnaires et aux administrateurs.
L’histoire des mines est certainement la plus scandaleuse des escroqueries faites à la collectivité par le capitalisme, dominant les pouvoirs politiques. Ce résultat tangible de l’ère dite républicaine et démocratique n’est guère à son honneur.
Après avoir parlé des propriétaires, voyons le sort des ouvriers mineurs. Le travail de la mine est, certes, un des plus fatigants, des plus malsains et des plus dangereux qui existent. Le mineur doit rester huit heures dans son trou, à peine éclairé par une lampe, respirant un air méphitique. La chaleur augmente au fur et à mesure que l’on s’enfonce dans les entrailles de la terre. L’ouvrier mineur, couvert de sueur et de poussière de charbon, ou de poussière de minerai, presque nu, suant, haletant dans une atmosphère lourde – l’aération, malgré les progrès apportés, est souvent défectueuse, c’est toute une science pour l’ingénieur en mines d’aérer suffisamment, et les compagnies lésinent sur les crédits et les travaux – travaille, en outre, bien souvent, dans des postures torturée, plié, courbé, sur le ventre, sur le dos, agenouillé, enveloppé de poussière, recevant de l’eau boueuse qui suinte à travers la terre, et qui provoque parfois l’inondation des galeries lorsque la couche qui sert de fond à une nappe d’eau souterraine a été crevée.
C’est un des métiers les plus pénibles. Et aussi un des plus dangereux. On reconnait, au premier coup d’œil, l’ouvrier mineur de houille ; il porte à la face, sur le corps, les mains, des sortes de tatouages bleuâtres, ce sont les blessures occasionnées par la chute des blocs : le charbon, pénétrant dans la chair, y a laissé des marques indélébiles. De cette masse de houille amoncelée sous terre se dégage sournoisement un gaz carbonique, incolore, qui s’accumule et emplit l’atmosphère, et qui s’allume, explose au premier contact avec une flamme quelconque. C’est le coup de grisou. C’est par milliers que des mineurs ont été les victimes du terrible gaz. On connaît la catastrophe, en France, de Courrières, en 1906, où périt un millier de mineurs, et, plus près de nous, en Allemagne, celle d’Alsdorf qui a fait 282 victimes. Il n’est pour ainsi dire pas de semaine où, de l’Europe à l’Amérique, et de l’Afrique du Sud à l’Orient colonisé, la mine n’alimente de quelque hécatombe tragique la chronique des journaux à sensation. Combien d’ensevelis, murés dans les boyaux souterrains, qui ont connu les affres d’interminables agonies... Ailleurs, ce sont les poussières de charbon condensées qui déflagrent, c’est l’inondation, les éboulements, l’effondrement du plafond des galeries, le wagonnet qui vous coince et vous broie dans le passage étroit, le câble de la cage de descente qu’on « oublie » d’entretenir et qui se rompt, etc., etc. La mine offre le plus fort pourcentage d’accidentés du travail.
On pourrait, certes, améliorer les conditions de travail du mineur, et réduire considérablement les causes d’accidents. Mais il faudrait, pour cela, engager des dépenses, ne plus exiger un rendement aussi intensif, transformer l’aération, boiser à mesure et plus consciencieusement les galeries, etc... Mais l’on conçoit que cela ne fait pas l’affaire des exploitants. Qu’importe la santé ou la vie des ouvriers, ce qui compte, avant tout, c’est le profit des propriétaires !
La législation du travail a bien créé le corps des délégués mineurs, élus par les ouvriers. Mais comme ils sont, d’une part, des fonctionnaires dépendant plus ou moins du préfet et, d’autre part, que leur élection est presque toujours une manifestation politique, ce remède n’a pas apporté grande amélioration. D’ailleurs, qui tient compte de leurs avertissements ? La catastrophe de Courrières et l’impuissance du délégué Simon nous en a fourni un exemple typique.
Les premiers ouvriers de la mine furent des forçats, au sens réel du mot. Dans la Grèce antique et à Rome, les esclaves qui avaient déplu à leurs maîtres, ou commis quelque grave délit, rébellion ou désobéissance, étaient condamnés aux mines. Après la peine de mort, c’était la plus grave condamnation qui venait frapper la plus basse des castes sociales. De même, aujourd’hui, les travaux forcés viennent immédiatement après la guillotine ou la chaise électrique. La peine des mines est devenue, plus tard, la peine des galères ou des travaux forcés. Mineur, galérien, forçat, telle fut l’évolution. La Russie des Tsars a conservé la peine des mines jusqu’à la Révolution. Les forçats allaient travailler dans les mines de Sibérie. Est-ce cette origine qui a pesé, de tout le poids d’un passé séculaire, sur la condition des mineurs ?
Certes, la profession de mineur a suivi l’évolution générale. Le mineur est, lui aussi, théoriquement, un homme libre. Mais, en fait, les Compagnies, à qui l’on avait concédé le sous-sol, ont réalisé, on le conçoit, assez de bénéfices pour acheter le sol. Les sociétés minières, partout, détiennent le terrain ; l’ouvrier loge dans les maisons de la compagnie, dans l’alignée morne des « corons », s’approvisionne à ses économats va à son cinéma ou à son église. Des enquêtes suggestives ont montré cette dépendance. C’est le régime de la féodalité moderne qui contrôle jusqu’aux échappées intermittentes d’une illusoire activité politique.
On n’a pas oublié les longues et parfois violentes révoltes des esclaves de la mine, leurs sursauts courageux et comme désespérés, les grèves acharnées et tenaces. C’est le choc d’un prolétariat surexploité, dominé, surveillé, ligoté contre une lies plus formidables puissances d’argent soutenue par les forces du pouvoir politique.
À notre époque de vie industrielle intense, la mine est indispensable au fonctionnement économique de la société. La captation des forces hydrauliques peut diminuer la nécessité des mines de houille, mais les autres mines conservent, pour l’instant, leur indispensabilité sociale.
Or, l’exploitation des mines exige, comme personnel et connue matériel, une organisation industrielle étendue et compliquée. À moins de revenir en arrière de plusieurs siècles et de renoncer à ses bienfaits, il faudra, de toute nécessité, sous n’importe quel régime social, conserver l’organisation industrielle de la mine. Et son fonctionnement n’est possible que par la formation de grands groupements collectifs de travailleurs, remplaçant les compagnies minières.
L’individualisme économique ne peut faire fonctionner la mine. Seul, le communisme libertaire, mettant à la place des exploitants l’organisation des producteurs associés, sur une très large échelle, peut continuer la production minière, sans laquelle la civilisation ne peut vivre.
La mine aux mineurs ! Ou plutôt le travail de la mine organisé par les mineurs associés, traitant sur les bases fédéralistes avec les autres corporations, adoucissant ensemble, au maximum, les conditions de travail : voilà le mot de libération que nous devons lancer continuellement aux forçats qui peinent dans leurs sombres galeries.
– Georges BASTIEN.
MINISTÈRE
n. m. (latin ministerium, de ministrare : fournir)
Son sens le plus courant est celui de charge, d’emploi, de fonction. Ainsi pour les ministres du culte, et surtout, dans l’organisation politique des États, pour les personnages ayant la charge des affaires de la nation et faisant partie d’un gouvernement.
Déjà, dans l’antiquité, on appelait ministres les grands officiers entre les mains desquels les rois se déchargeaient d’une partie de leurs fonctions. À Rome, sous l’Empire, les ministres étaient moins des administrateurs que des officiers. On retrouve la trace de charges ministérielles chez les Mérovingiens ayant adopté les méthodes de l’administration romaine. Au moyen-âge, en France, les rois eurent des secrétaires d’État investis de l’administration intérieure des provinces. Avec Louis XIV, ces secrétaires devinrent des ministres, La Constituante confia le maniement des fonds d’État à des commissaires relevant de l’Assemblée. Elle rendit les ministres responsables de leur gestion tout en laissant au roi constitutionnel les prérogatives du choix et de la révocation. Après la chute de la royauté, le ministère devint un « Conseil Exécutif » nommé par la Convention qui remplaça les ministres par des commissions exécutives. Mais la Constitution de l’an III rétablit les dix départements ministériels. Premier Empire, Restauration, Second Empire virent des ministres en général trop dépendants du pouvoir pour être réellement responsables...
La IIIème République (Constitution de 1875) les rendit « solidairement responsables devant les Chambres » mais il s’agit là d’une responsabilité fictive. Aucune sanction, nulle amende ne frappent ministres incapables ou criminels. Ils peuvent à loisir se fourvoyer aux dépens du peuple, le traîner dans les aventures ruineuses et sanglantes, trafiquer de leur influence et dilapider les deniers publics... Depuis que le régime parlementaire, sous le contrôle de la finance et des grands détenteurs du capital, s’avère toujours plus corrompu, les ministres s’aventurent sans vergogne dans les entreprises équivoques. Le fait qu’un homme politique a trempé dans quelque scandale – dégradant selon la moralité courante – ne suffit pas à lui interdire les marches du pouvoir. On voit un Clemenceau, un Tardieu s’ériger – malgré leur passé de requins – en chefs cyniques d’une république dégénérée. Qu’un « tripotage » plus impudent oblige la majorité parlementaire à lui donner congé n’implique pas pour le ministre malhonnête l’éloignement définitif des sphères dirigeantes. C’est une retraite temporaire, le temps de se refaire, dans l’oubli si prompt de l’opinion, une virginité et il reparaît à la tête d’une nouvelle équipe, acclamé par quelques centaines de mameluks avides de monnayer leur domesticité.
Depuis quelques années surtout, illusoire est, sur la conduite des ministres, le contrôle des Assemblées d’élection dites populaires, Les ambitieux et les bavards qui, à la faveur d’un suffrage faussé par la presse et assujetti à l’économie, aspirent à régner sur le pays, n’apportent guère à la Chambre que le souci de leurs appétits personnels. Et ils servent les ministères dans la mesure où se satisfont leurs desseins. La complicité servile des partisans, à peine contrariée par une opposition de façade, dont le rêve est d’être à son tour aux honneurs et aux profits, couvre avec éloquence impéritie, gabegie, palinodies et chantages ministériels.
Au début de la guerre de 1914–1918, le ministère a pris – sans consulter les Chambres, passives et effacées devant le prestige de l’État-major, arbitre de l’heure – les plus graves décisions, souvent néfastes pour le pays. Même lorsque, devant l’invasion et les difficultés croissantes, le directoire de fait consentit à convoquer cette caricature de représentation nationale, digne du fameux Parlement-croupion, il n’en persista pas moins, pendant tout le cours de la guerre, à prendre l’initiative de mesures importantes et souvent extra-légales que contresignaient ensuite les Chambres serviles. Plus tard – les nations revenues à cette période de guerre sournoise que l’on persiste à appeler la paix – un Poincaré introduira le recours aux décrets-lois, prolongation des mœurs de l’état de siège. Consultés après coup les Aragouins applaudiront. Le régime des décrets tend d’ailleurs, à l’heure où nous écrivons ces lignes, à devenir courant dans les pays de fascisme latent.
Pendant les vacances de nos honorables (un bon tiers de l’année se passe pour eux dans les circonscriptions) les politiciens dirigeants ont toute latitude pour s’exercer à la dictature. Et l’on n’en voit point que l’amour du bien public pousse à s’insurger contre des méthodes qui mènent à l’étranglement des dernières libertés du peuple... Déjà, on a vu aux mots État, Gouvernement, puis bientôt (à Parlement, Politique, etc.), on reverra de quelles illusions les démocraties couvrent les agissements des ploutocrates et combien députés ou sénateurs, et plus encore les hommes installés aux postes directeurs, répartis dans les ministères, y apportent le souci constant d’agir selon les intérêts de la catégorie sociale à laquelle ils appartiennent, de cette bourgeoisie dont ils sont issus ou qui a su les conquérir. Cumulant avec leurs fonctions publiques, celles d’avocats, de membres des conseils d’administration de grandes compagnies et de sociétés financières ils ne cessent de faire, au pouvoir, les affaires de ceux qui sont leurs véritables mandants, et les maîtres réels de l’illusoire démocratie.
Primitivement le ministère en France comportait onze portefeuilles (intérieur, finances, justice, guerre, affaires étrangères, etc., pour rappeler les principaux). Mais les appétits de l’après-guerre ont élargi le cercle des convives attablés autour de l’assiette au beurre. Ils sont maintenant jusqu’à 18 ou 20 budgétivores nantis de ministères ou de sous-secrétariats. Et le char de l’État n’en est que mieux embourbé...
– LANARQUE.
MINORITÉ
n. f. (latin minoritas)
« La minorité, dans une assemblée, est le petit nombre en opposition avec la majorité. » (Larousse) (Voir majorité.)
Longtemps, il a été admis que la masse devait obéissance absolue à une minorité qui constituait l’élite. (Chefs temporels : roi ; chefs religieux : prêtres.) La raison était indiscutablement du côté de cette minorité (raison de droit divin, ou raison du plus fort).
Puis, l’échelle des valeurs a changé. À la suite de révolutions et d’évolutions, il a paru tout naturel et très raisonnable que ce soit la minorité qui s’incline devant la majorité :
Le Tiers État n’est rien. Que doit il être ? Tout...
Le suffrage universel est venu. Les serfs ont été baptisés citoyens. Raison a été donnée – en théorie – au plus grand nombre (voir ce mot).
Dans l’un, comme dans l’autre cas, l’individu – qui est la minorité réduite à sa plus simple expression – est toujours victime, tantôt du bon plaisir des « élites », tantôt de la loi du nombre. Ni ici, ni là, il n’y a place tranquille au soleil, ni pour un Diogène, ni pour un Galilée, ferments du monde. Obéissez au nom de Dieu et du Roi, ou au nom du peuple souverain, mais obéissez !
En fait, la majorité, qui est la foule veule et bête, ne sait rien, ne veut rien, n’impose rien : elle suit, tout simplement. Et malgré les apparences, ce sont les minorités qui font tout. La source des religions, des partis, des sectes, de tout groupement humain est dans une poignée d’individus, souvent en un seul. Et chacun sait comment on crucifie tout novateur qui, nécessairement, bouscule les saintes idoles, chacun sait aussi comment on fabrique l’opinion publique et comment on la triture (voir, exemple entre mille, l’histoire de « l’ennemi héréditaire », en France).
Dans l’exercice du pouvoir, ce sont des minorités incontestables qui s’imposent dans les régimes de dictature déclarée ; ce sont des minorités voilées dans les régimes démocratiques. (Voir : La Douleur universelle, de Sébastien Faure : le suffrage, dit universel, aboutissant, en définitive, par le jeu échelonné des « majorités », à la dictature d’une infime minorité.)
Dans la lutte contre ce même pouvoir, ce sont des minorités également qui finissent par imposer à la masse amorphe et malléable leurs idées d’abord jugées dangereusement subversives. En définitive, c’est le martyr qui a raison.
Les groupements « lutte de classe » n’échappent pas à cette loi. Ils sont « menés » par une minorité agissante. La masse a peut-être, dans ces groupements, l’air de savoir ce qu’elle veut ; au fond, elle s’imprègne de l’idée des animateurs, et elle agit.
L’humanité apparaît donc comme un vaste champ d’expériences où des forces incalculables sommeillent, à l’état latent. Vienne un ferment, un de ces impondérables qui, par sa volonté opiniâtre, traduit les sentiments obscurs de la masse, ou réussit, en lui voilant adroitement le mensonge, à lui persuader qu’elle doit se dresser, et cette masse entre en effervescence. Alors, on crie : Dieu le veut ! ou bien : C’est la volonté nationale ! ou encore : Vive la Révolution ! À ce moment, c’est simplement une minorité qui a fini par imposer son point de vue.
Ces constatations ont ceci de réconfortant, c’est que le moindre des efforts n’est jamais perdu, qu’il n’est pas permis de désespérer et qu’au contraire on doit penser que toute idée juste finit par s’imposer un jour tant est grande la force de la vérité et tant est puissant le rôle des minorités qui la propagent.
– Ch. BOUSSINOT.
MIRACLE
(du latin : miraculum ; de mirari, admirer)
Si l’on s’en tient à la signification étymologique du mot, qui paraît la plus rationnelle et la seule digne d’être retenue, un miracle est un fait extraordinaire, en contradiction apparente avec ce que l’on observe habituellement, et qui, en raison de son extrême rareté, et de ce que l’on ne s’explique point ses causes, provoque l’étonnement, l’admiration, voire l’épouvante, parmi les ignorants et les fanatiques, toujours plus disposés à découvrir, en ceci, la marque d’une intervention divine qu’un phénomène dû à des circonstances encore mal définies.
À toute époque, les humains ont été portés à croire que la nature était limitée à ce qu’ils en observaient quotidiennement, ou à peu près, et à juger, par conséquent, comme d’ordre surnaturel, ce qui était pour eux à la fois incompréhensible et, sinon nouveau, du moins peu commun. Terrifiés par le fracas du tonnerre, et l’éblouissante clarté de la foudre, les Anciens ont fait de cette dernière le moyen d’expression de divinités diverses. Il s’agissait de la manifestation grandiose d’une force qui, de nos jours, sert à faire marcher les tramways. Aux premiers sauvages qui les virent se servir des armes à feu, pour semer autour d’eux la mort, les hommes de race blanche apparurent comme des magiciens, ayant soumis à leur volonté des puissances invisibles. Lorsque, dans des régions demeurées très superstitieuses, comme la Bretagne, se montrèrent sur les routes les premiers automobilistes, les paysans firent des signes de croix sur leur passage, parce que n’ayant jamais vu de voitures traînées autrement que par un âne, des bœufs, ou un cheval, ils ne s’expliquaient point qu’elles pussent avancer, sinon par un artifice du Malin. Lorsque, il y a quelque vingt-cinq ans, eut lieu une éclipse de Soleil, qui devait être particulièrement visible en Tunisie, quantité de savants se rendirent à Sfax, pour y observer à loisir un phénomène dont ils avaient méticuleusement prévu l’heure d’apparition, et qui, par conséquent – quelles que fussent leurs croyances religieuses, ou leur incroyance – pour être moins fréquent qu’un simple lever de Lune, n’offrait à leurs yeux avertis rien de plus mystérieux. Cependant la foule des indigènes illettrés, qui ne se rendait point compte de ce qui se passait, voyant en plein jour le Soleil, source de toute vie, progressivement disparaître derrière une grande ombre qui semblait devoir l’absorber en totalité, se livra à toutes sortes de manifestations ridicules, traduisant à la fois sa crainte de ne plus revoir la lumière, et son espérance de fléchir par ses supplications Allah le Dieu unique, souverain maître des destinées.
La croyance au surnaturel en présence de ce qui est, à la fois, anormal et inexpliqué, est une loi psychologique qui souffre peu d’exceptions, et qui a été, et est encore, très largement exploitée par le clergé de toutes les religions, notamment de la religion catholique qui, non contente d’attribuer au Dieu de la Bible le prodige de la création universelle, et ceux qui sont narrés dans les Écritures, prétend encore, grâce à la Vierge Marie, et à quelques saints spécialisés dans cet office, détenir le monopole des interventions miraculeuses en faveur des malades, ou des personnes en péril, soit par des médailles, des reliques, ou des objets bénits, soit par le pèlerinage en certains lieux réputés propices, tels la grotte de Lourdes.
Les prodiges décrits dans les Écritures, comme le passage de la Mer Rouge à pied sec par les Hébreux, la chute de la manne dans le désert, ou le voyage du prophète Jonas qui, sans dommage, demeura, dit-on, trois jours dans le ventre d’un poisson de belle taille, sont d’une invraisemblance grossière. Il s’agit, de toute évidence, sinon de récits dus entièrement à l’imagination de leurs auteurs, du moins d’enseignements symboliques, ou de faits amplifiés et déformés par la légende, tels que l’on en trouve dans les annales de tous les peuples, aux époques primitives, caractérisées à la fois par l’ignorance et par la crédulité. Depuis qu’il existe des méthodes de recherche positives, et que les classes populaires reçoivent quelque instruction, il n’est pas de pays civilisé dans lequel on puisse prétendre avoir enregistré, de façon récente, quoi que ce soit d’approchant. Il n’est pas illogique d’expliquer, par de simples coïncidences, les événements heureux qui surviennent contre notre attente, lorsque tant de satisfactions légitimes demeurent refusées aux croyants, malgré leurs prières ardentes et leurs persistants désirs. Quant aux guérisons dont Lourdes et des lieux semblables seraient de nos jours le théâtre, en admettant qu’elles ne soient pas toutes dues à des phénomènes d’autosuggestion, en admettant même – ce sur quoi nous faisons toutes réserves – qu’il en soit d’inexplicables par l’auto-suggestion, ceci ne serait pas de nature à nous faire accepter comme valable l’hypothèse d’une intervention céleste, sous prétexte que les connaissances scientifiques actuelles ne pourraient fournir d’explication immédiate, contrôlable, à l’égard de ces faits mystérieux. Ce n’est pas en un temps où la science expérimentale, par la découverte d’énergies jusque-là insoupçonnées, permet à l’homme des merveilles, comme celles de la télégraphie et de la téléphonie sans fil, qui jadis eussent été désignées comme d’essence surhumaine, qu’il pourrait devenir admissible de retomber dans de vieux errements, source d’innombrables superstitions, à la première annonce de quelques étrangetés, ou sur la référence de quelques observations de prime abord déconcertantes. Si pouvaient être reconnus véridiques les documents du Bureau des Constatations Médicales de Lourdes, ne serait-il pas, malgré cela, contradictoire et absurde d’attribuer, à un Être de suprême bonté, ces quelques bien faits, tout en supposant, d’autre part, cette personne assez cruelle pour obliger des milliers de malades à supporter les fatigues d’un long et douloureux voyage, dans l’espérance d’une guérison que la plupart n’obtiennent pas ? Ne demeurerait-il pas plus absurde encore d’attribuer ces faits à une divinité Toute-Puissante, alors qu’il est avéré que l’on ne guérit pas tout à Lourdes, et que jamais un amputé n’a vu se reconstituer au sortir de la piscine, son membre absent ?
Si, pour les croyants, un miracle est le résultat d’une intervention divine en contradiction avec les lois de la nature, pour les rationalistes, il ne saurait être question, dans ce domaine, jusqu’à nouvel ordre, que de faits rares, mal interprétés, ou encore insuffisamment mis en lumière, lorsqu’il ne s’agit pas, plus simplement de récits légendaires ou d’histoires inventées de toutes pièces, dans un but intéressé.
– Jean MARESTAN
MIRACLE
Fait contraire aux lois naturelles. Les lois naturelles sont conditionnées par la nature même des choses ; elles sont le résultat du rapport des choses entre elles et on ne peut concevoir d’événements qui leur soient opposes ou en dehors de leur logique.
Les lois naturelles qui portent avec elles leur agent d exécution, ou plutôt sont agent d’exécution, ne peuvent pas, comme les lois humaines, être violées. Rien n’échappe à leur rigueur. Si vous les négligez un moment, ou si vous tentez de les transgresser, la sanction ne se fait pas attendre. Oubliez que vous êtes pesant et laissez-vous choir d’une certaine hauteur ; oubliez que le feu brûle et mettez-y votre main, vous serez vite rappelé à la réalité. Les lois naturelles ne souffrent aucune dérogation. Or, c’est cette dérogation qui constitue le miracle.
Par exemple, l’eau doit, normalement, se transformer en vapeur à une température de 100°. Si, parvenue au point d’ébullition, elle se changeait en glace, je pourrais dire : Il y a miracle. Mais cela est tellement invraisemblable que n’importe qui, en voyant se produire un tel phénomène, soupçonnerait, il aurait même la certitude qu’il cache quelque supercherie, ou que le témoin est victime d’une illusion. D’ailleurs, pour constater qu’il y a miracle et tenir pour tel le fait signalé, il faudrait connaître, dans sa totalité, le jeu des lois naturelles, ce dont personne ne peut se vanter, et, ensuite, avoir pénétré dans leurs moindres détails, toutes les circonstances qui ont déterminé le miracle. Qu’il demeure la plus petite cause obscure et le miracle est contestable.
Croire à un miracle parce que vous en avez eu le spectacle, spontané ou provoqué ? Mais, alors, pourquoi ne pas authentiquer le merveilleux que fera défiler sous vos yeux le premier prestidigitateur venu ? Pourquoi ne pas accorder sans réserve votre foi aux tours d’adresse et de subtilité, que la surprise et la rapidité d’exécution ne vous permettront pas de comprendre, et qui paraîtront apporter des résultats incroyables ? Et cependant, vous demeurerez sceptiques devant les tours de passe-passe prodigués pour votre amusement, alors que vous croiriez au miracle proclamé, enseigné par le religieux ? Pourquoi ? Parce que le prestidigitateur, tout en provoquant des faits, des enchaînements de faits aussi extraordinaires que le second ne fera pas intervenir au cours de ses présentations ingénieuses, un être imaginaire et ne vous inspirera pas de la crainte. Sauf le cas où il est, lui aussi, l’instrument de quelque théurgie, il ne cherche qu’à vous laisser l’impression qu’il est un homme extrêmement habile et doué de capacités qui vous manquent, à un tel degré du moins. Il ne s’entourera pas, pour frapper votre esprit de l’appareil rituélique des religions...
Mais qu’il introduise un peu plus de sérieux dans ses tours de physique, qu’il revête ses opérations d’un cérémonial approprié, qu’il vous dise que c’est l’esprit de Louis XIV ou de Voltaire qui fait tourner la table ou qui frappe des coups à la porte et voilà déjà que vous ne prenez plus la chose « à la rigolade », vous ne riez plus, car vous redoutez de paraître sot ou d’être irrévérencieux, ou de déplaire à l’esprit qui pourrait vous clouer sur place ou vous emporter avec lui dans le fond de la terre ou l’immensité de l’espace. Vous sentez que votre doute a quitté le persiflage et s’oriente vers l’acceptation. Vous ne parlez de ce que vous avez « vu » qu’avec précaution et respect. Vous ne savez pas encore si vous devez faire crédit au surnaturel, mais vous n’osez nier...
Les enfants, et aussi les peuples (qui sont, en grand, l’image de l’enfance dans la société), ont toujours aimé les réalisations merveilleuses, les événements qui s’accompagnent de quelque féerie. Ne pouvant arriver assez vite, à leur gré, à commander aux éléments par leurs découvertes et leur travail, ils aiment doter des êtres imaginaires d’un pouvoir qu’ils voudraient posséder eux-mêmes, et leur faire accomplir les choses les plus extraordinaires conçues par leur imagination. Aussi, les contes, les fables, les récits (voir fable, légende, mythologie, etc... ) qui narraient ces actions saisissantes, ces faits enchanteurs furent toujours goûtés des foules, et ils se les transmirent, avec plus d’embellissement encore que de fidélité, de génération en génération. Le fantasmagorique, l’irréel ont toujours bercé les peuples, endormi leurs misères ou flatté leur orgueil. Si puissante est la séduction exercée par le merveilleux que, même présenté sous forme de conte, on arrive sans peine à l’identifier au réel. On commence par désirer que les choses se soient passées ainsi ; puis, à force d’animer ce désir, on se range tout entier sous le charme et on finit par croire que c’est vrai. Ne voyons-nous pas des enfants, et même des grandes personnes, après la lecture d’un beau roman qui les a passionnés, arriver à dire : « Cela, a dû être vécu, ce doit être arrivé, les personnages de ce livre ont bel et bien existé ». Il en est de même pour le cinéma qui laisse de telles empreintes sur le cerveau des enfants qu’ils croient non seulement à l’exactitude, à la véracité (rien, ni personne d’ailleurs, ne fait, en général, pour leurs esprits neufs, la démarcation) des spectacles les plus fantaisistes qu’on leur fait admirer, mais en viennent, plus d’une fois, a tenter de les réaliser eux-mêmes.
Cette disposition des peuples à croire tout ce qui force leur admiration a grandement facilité les entreprises religieuses. Elles ont su s’implanter à leur faveur et, grâce à elles, se maintiennent encore ou à peu près. Elles ont dû faire accomplir à leurs dieux, des actions surnaturelles, des miracles pour donner à la croyance populaire un aliment. Un Dieu qui ne pourrait faire de miracles ne serait pas un Dieu. Il ne tarderait pas à être détrôné, « disqualifié ».
Si nous faisons une incursion dans la religion catholique, qui est davantage à notre portée, pour y examiner le « miracle » religieux, nous nous heurtons, dès l’abord, a la coexistence des lois naturelles et d’un Dieu à la fois créateur et omnipotent.
S’il est animateur de toutes choses, Dieu est également le créateur des rapports des choses entre elles, c’est-à-dire des lois naturelles. S’il a créé et s’il régit ces lois, il est maître, en effet, d’y faire des dérogations c’est-a-dire de faire des miracles. Mais on se demande quel besoin a un Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent, de cette norme régulatrice que sont les lois naturelles. Puisqu’il peut tout, sait tout, voit tout et est partout, c’est là pour lui combinaison superfétatoire. Il lui suffit de dire :
« Dans chaque circonstance de l’Univers, il arrivera ce que je voudrai qu’il arrive. Nul autre que moi n’a le droit de prévoir ni de savoir ce que je me réserve de faire, car je veux conserver ma toute-puissance. »
L’établissement de « lois naturelles » est une abdication de sa puissance ; si d’autres que lui peuvent traiter la matière et savoir ce qu’ils en obtiendront dans des circonstances données, il n’est plus le maître absolu, il n’est plus le Dieu qui s’agite pour nous dans l’imprévisible. La constatation de l’existence de lois naturelles est ainsi une preuve de l’inexistence de Dieu. Mais, d’autre part, si les lois naturelles n’existaient pas, elles ne pourraient subir de dérogations ; il n’y aurait donc pas de place pour le miracle ou, ce qui revient au même, tout serait miracle. Cela montre que, pareil à tant d’inventions destinées à abuser les naïfs, le miracle se désagrège à l’analyse et qu’il n’a point de consistance pour l’homme qui pense.
Aussi la religion le sait-elle qui ne fait état de ses miracles qu’auprès de ceux que leur simplicité dispose à les accueillir quand, devançant la stratégie religieuse, ils ne vont pas eux-mêmes jusqu’à les inventer. Auprès des personnes réfléchies, les marchands de miracles sont plutôt embarrassés et ils se délesteraient volontiers des plus grossiers qui illustrent la Bible s’ils pouvaient les jeter par-dessus bord. De même que le Dieu exalté par l’Église, lorsqu’elle discute avec des incrédules, n’a pas grand chose de commun avec celui qui donna à Moïse les tables de la loi divine. Elle ne soutient pas les mêmes miracles avec les gens de libre examen qu’avec ceux qu’elle sait disposée à tout accepter sans contrôle. Mais aussi comme elle sait bien que la grande majorité des êtres humains ne réfléchit guère au pourquoi ni au comment des choses et qu’il lui faut du merveilleux, elle continue de lui servir périodiquement des « miracles » qu’exaltent, auprès de la clientèle religieuse, ou à masque de religion, les bulletins paroissiaux, les Croix, et autres feuilles sacrées.
La Bible est farcie de « miracles » tellement stupides que l’Église n’en fait plus guère état aujourd’hui tellement ils sont en contradiction avec les faits. C’est d’abord celui de la création en sept jours, puis celui du déluge, de la confusion des langues, et une foule d’autres où Dieu opère en personne. Fatigué sans doute de ces travaux d’Hercule, il délégua ensuite le pouvoir de faire des miracles à certains de ses prophètes. C’est alors Jonas, avalé par une baleine (au gosier distendu pour la circonstance), qui sort vivant le troisième jour ; c’est Josué arrêtant le soleil (!) pour lui permettre d’achever l’extermination de ses ennemis ; c’est Samson tuant mille Philistins avec une mâchoire d’âne (on ne dit pas si c’est la sienne ou celle de l’auteur du récit) et faisant écrouler un temple en en renversant les piliers ; ce sont les eaux de la Mer Rouge se soulevant pour laisser passer les Juifs poursuivis par les Égyptiens et se refermant ensuite sur ces derniers ; ce sont les murs de Jéricho qui, au siège de cette ville par les Juifs, s’effondrent au bruit des trompettes, etc., etc. On croirait lire les contes des Mille et une Nuits avec, en faveur de ceux-ci, cette différence qu’ils ne nous éblouissent que pour nous charmer, tandis qu’ailleurs on y poursuit, sans rire, des prétentions grotesques à la véracité.
Puis ce sont les miracles de Dieu le Fils : Jésus-Christ guérit les incurables, multiplie les pains, ressuscite le mort Lazare et se ressuscite lui-même trois jours après sa mort ; puis il monte enfin au ciel où il trône depuis ce temps à côté du Père et du Saint-Esprit, ne faisant qu’un Dieu à eux trois, entouré des anges et des saints.
De nos jours, la fabrique aux miracles, essoufflée sans doute par l’effort de tant d’œuvres d’art, ne sort plus de produits aussi sensationnels que ceux qu’a consignés la Bible. Nous sommes trop près pour les voir dans tout leur enjolivement. Nous n’avons pas le recul favorable au mirage. Les miracles, pour nous, n’ont pas eu le temps de s’embellir et de s’enfler comme toutes les légendes à mesure qu’elles s’enfoncent dans le passé, au point de nous méduser par leur importance.
L’Église moderne refrène habilement l’extravagance compromettante. Elle se contente de miracles plus modestes. Elle opère le plus souvent dans cette partie où la science est encore la plus imprécise : la médecine, où les cas, mal connus, apparaissent encore tellement variables avec les individus qu’on ne peut guère, jusqu’ici, formuler de règles générales. La plus grande officine de miracles est sans contredit celle de Lourdes, où les malades guérissent en se baignant dans la piscine aux microbes.
En psychologue avisé, c’est toujours aux êtres faibles que s’attaque surtout l’Église pour assurer sa domination et c’est sur ce terrain qu’elle arrive à circonvenir également les forts, car tout être est faible à un moment donné de sa vie. C’est sur les enfants, les femmes, les pauvres, qu’elle se jette pour inculquer ses principes ; aux vieillards, aux moribonds, qu’elle arrache les acquiescements de la terreur, en un mot c’est sur tous ceux qui ont besoin d’aide et ne peuvent guère lui résister qu’elle étend son dévolu. Il en cuit souvent à quiconque est faible et ne veut pas se plier aux exigences de l’Église. D’ailleurs la débilité mentale accompagne souvent la faiblesse physique et prévient même toute possibilité de résistance. Obstinez-vous au contraire à repousser les avances cléricales et ce peut être pour vous la perte du travail, le congédiement du maigre logis si vous êtes pauvre, et l’abandon, même par votre famille, si vous êtes malade et ne voulez pas vous prêter à la comédie de Lourdes ou autres pèlerinages et épreuves semblables. Car il n’y a pas que les croyants qui vont à l’Église et ont recours aux offices de la religion dans certaines circonstances de leur vie Les vrais croyants sont d’ailleurs très rares, presque aussi rares que les vrais athées dans un monde soumis à des milliers d’années de pression religieuse. Mais entre ces deux extrêmes il existe une multitude d’individus amorphes, sans opinion arrêtée ou indifférents, ou attentifs seulement aux avantages, ou sous l’empire de craintes vagues et persistantes. Ceux-là suivent la mode ou cherchent à se ménager les influences favorables : ils se rangent toujours du côté où les pousse leur intérêt ou leur lâcheté. Ils marchent dans la vie selon l’habitude ou la peur mais jamais par conviction. Ils restent fidèles aux religions sans y croire parce qu’ils savent que l’Église, force insinuante et bien organisée, peut leur nuire dans une foule de circonstances alors que les athées, les incroyants ne se vengeront pas sur eux, ni ne chercheront à leur nuire à cause de leurs pratiques religieuses. C’est là aussi une des raisons pour lesquelles les idées d’affranchissement et de liberté avancent si lentement. Mais revenons à Lourdes et à ses miracles.
Parmi ceux qui vont chercher la guérison en la cité pyrénéenne, il en est qui sont véritablement, organiquement malades et incurables. Ceux-là en reviennent exactement dans l’état où ils étaient à leur départ, quelquefois avec une déception de plus, s’ils avaient quelque vague espoir, ou une aggravation due aux imprudences du voyage, des séances de piété et des immersions. L’eau de la piscine est sans pouvoir sur eux. Cependant la faillite du miracle ne laisse pas la religion au dépourvu : c’est parce que le malade n’était pas assez croyant, n’avait pas une foi assez profonde, n’était pas assez pur que la guérison ne s’est pas produite ou bien encore parce que Dieu veut prolonger encore l’épreuve du fidèle, s’il est vraiment croyant, afin de lui faire mieux mériter le paradis. Et ces explications trouvent toujours crédit...
Il en est, par contre, qui guérissent, et radicalement. Ceux-là sont montés en épingle et cités en exemple. Les feuilles catholiques publient leurs noms et leurs adresses et cela produit toujours son effet auprès de ceux qui les lisent sans en connaître les héros ou les héroïnes. Par contre, il est bien rare que ceux qui ont connu les miraculés avant leur guérison accordent crédit au miracle. Souvent ils ont remarqué quelque chose de louche dans la maladie et les allures du malade. Sa moralité, sa, ruse habituelle laissent supposer quelque chose d’anormal. Pas de doute, c’est un simulateur.
Certains simulent complètement une maladie : paralysie, rhumatisme, sciatique, etc. ; d’autres entretiennent et aggravent même intentionnellement des maux ou plaies qui, bien entendu, ne peuvent guérir que du jour où ils cessent de les alimenter. D’autres encore ont des maladies ou des maux qu’ils font soigner par un médecin mais dont on ne proclame la guérison, obtenue par la science, qu’au retour de Lourdes. Quelques-uns sont des névropathes que galvanise la suggestion mystique, mais que guérirait, plus sûrement, la suggestion clinique. Approchez d’un peu près les « miraculés » de Lourdes et vous doutez de suite du miracle. Contrôlez-les sérieusement et vous découvrez la supercherie.
Dans un livre fort instructif et documenté : « Lourdes et ses mystères », le docteur Pierre Vachet examine quelques-unes des guérisons miraculeuses les plus importantes, celles dont l’Église fait état avec le plus d’insistance et il montre la simulation indiscutable des miraculés les plus notoires.
Il cite des cas où les miraculés étaient vraiment trop intéressés pour que leur guérison, ou leur maladie, puisse être prise au sérieux. Et il explique aussi comment il peut se faire que des guérisons soient réellement obtenues à Lourdes, comme elles pourraient l’être n’importe où, si les mêmes circonstances étaient réunies. C’est le cas pour les névrosés, les hystériques, les malades par suggestion. Il n’est pas surprenant que, dans ces derniers cas, il soit obtenu des guérisons puisque tout est fait pour impressionner les malades, pour les persuader qu’ils vont guérir, etc. ; mais ces cas de guérison n’ont rien de miraculeux et il serait encore préférable pour ces malades d’être soignés dans des établissements de psychothérapie par des médecins capables d’étudier sérieusement leur cas, plutôt que d’aller à l’officine des charlatans de Lourdes... On peut affirmer sans crainte de se tromper que les guérisons, obtenues à Lourdes, de malades de cette catégorie (les malades plus ou moins imaginaires) ne comptent que pour un chiffre infime parmi les réussites proclamées, la plus grande partie, la presque totalité des « guérisons » obtenues étant celles de simulateurs ou de ceux qui entretenaient un mal jusqu’à leur passage à Lourdes ou cachaient une guérison obtenue par les médecins pour la faire proclamer à leur sortie de la fameuse piscine.
Les prétendus miracles de Lourdes, comme tous les miracles d’ailleurs, ne sont qu’astucieuse tromperie. Mais ils servent à entretenir le prestige de l’Église auprès des simples d’esprit... Comme la maladie est une bonne chose à exploiter et qu’il n’y a pire que ceux qui ont la promesse d’un paradis pour avoir peur de la mort, il n’y a pas qu’à Lourdes qu’on obtient des guérisons miraculeuses. Un peu partout il existe des guérisseurs qui, avec des signes de croix, de l’eau bénite et des prières, s’attaquent à toutes les maladies. Nombreux sont encore ceux qui s’adressent à ces gens tout en se faisant soigner, d’autre part, par un médecin. Il est bien entendu que s’il y a guérison, c’est le « toucheux », comme on l’appelle vulgairement, qui l’a obtenue. Et lorsqu’on revient sans être guéri, on ne s’en vante pas, de sorte que ces croyances perdurent longtemps. C’est comme dans une baraque foraine où l’on s’est fait « rouler » ayant payé très cher pour ne rien voir : on ne manque pas de dire en sortant à ceux qui vous demandent des renseignements que c’est « épatant », afin de cacher sa propre déconvenue et de savourer, en compensation, la jobardise des imitateurs.
On constate cependant que malgré les éclaircissements de la science, la tendance à croire au miracle ne recule que très lentement. À peine une croyance « usagée » passe-t-elle au rebut qu’une autre « à la mode » lui est substituée... Il faut dire que presque toutes les superstitions favorisent trop les desseins de la classe dirigeante pour qu’elle ne fasse pas l’impossible pour en assurer la survie ou en faciliter le développement. La croyance a ses vogues, ses courants. Elle se porte comme les fétiches et les amulettes. Et il est de bon ton d’afficher celles que l’opinion consacre. Ne va-t-on pas au pèlerinage à Lourdes ou ailleurs, comme il est à la mode d’aller voir le spirite ou la somnambule ! On se moque de l’Arabe ou du Sénégalais qui se croient perdus s’ils n’ont pas sur eux leur « grigri » porte-bonheur et l’on ne partirait pas en auto sans son fétiche protecteur et sa médaille de Saint Christophe, sauvegarde contre les accidents ! (Que serait-ce donc s’ils n’en avaient pas ?)
La science (nombre de savants du moins qui ont partie liée avec la classe dont ils sont issus) feint de planer au-dessus de ces superstitions puériles. Elle évite, pour diverses raisons, de les attaquer de front. D’abord la bourgeoisie ne tient pas à ce que la science dessille les yeux de ceux qu’elle berne avec tant d’avantages. Ensuite elle préfère s’attacher les sympathies des trafiquants de la crédulité qui opèrent autour de toutes les croyances et tirent influence ou monnaie des miracles de Lourdes, de ceux de la communion ou de l’âme éternelle. Aujourd’hui que tout est commercialisé, où les actes ne sont que des jalons du bénéfice, il est de bonne tactique d’annexer à sa fortune les bonnes dispositions de M. Mercanti, qu’il soit marchand de médailles, de couronnes, de chapelets, d’eau bénite, bazardier ou régaleur public.
La croyance au miracle disparaîtra lorsque les hommes, au lieu de chercher sottement les solutions dans l’invraisemblance, auront la sagesse de réserver leur adhésion jusqu’au jour où les investigations méthodiques d’une science désintéressée auront mis en lumière les vérités explicatives, dont l’absence momentanée favorise de barbares superstitions.
– E. COTTE.
MIRAGE
n. m. (rad. mirer)
Ce terme a servi primitivement à désigner une illusion d’optique, fréquente dans les pays plats et chauds tels que les déserts de sable. Elle résulterait d’une inégale réfraction des rayons solaires, due à l’inégal échauffement et densité des couches d’air. Fréquemment les villages d’Égypte, bâtis sur des éminences, semblent, à midi, comme entourés d’une nappe d’eau, dont la surface ondoyante réfléchit, avec le bleu du ciel, l’image renversée des palmiers et des maisons. Parfois le phénomène se complique singulièrement : les objets se déforment, atteignent des dimensions monstrueuses et paraissent courir dans tous les sens. Rien d’étonnant donc que le mot mirage soit devenu synonyme d’illusion dans le langage ordinaire, surtout lorsqu’il s’agit d’illusions ayant leur source dans l’observation. Or, les tromperies, inhérentes à notre constitution organique ou mentale, à notre mode de perception, soit des phénomènes conscients soit du monde extérieur, sont singulièrement importantes et nombreuses. « Notre esprit n’est pas un miroir où l’univers se reflète avec une passive fidélité ; comme les glaces déformantes, il modifie ce qu’il représente d’après les lois de sa complexion. Autant que de l’objet perçu les sensations dépendent de l’objet qui perçoit ; lunettes noires ou bleues donnent aux choses, quand on les porte, une teinte qu’elles n’ont pas ; une maladie de foie suffit, pareillement, pour que tout devienne jaune. De l’espace, l’insecte minuscule possède une notion qui n’est point celle de l’éléphant ; le premier estime incommensurable ce que le second juge étroit. Et nous trouvons énormes dans l’enfance, des hauteurs et des distances qui paraîtront médiocres plus tard. Nuance et vivacité d’une sensation dépendent tant de celles qui la précèdent que de celles qui l’accompagnent ; peintres, musiciens, tailleurs aussi et cuisiniers le savent ; la température qui semble chaude, si l’on sort d’une pièce froide, sera crue froide, si l’on sort d’une chambre surchauffée. Entre nos perceptions et les causes extérieures qui les provoquent, aucune ressemblance, le physicien s’en porte garant ; hors de nous les sons se réduisent à des ondes, les couleurs à des vibrations ; sensations acoustiques ou lumineuses rappellent si peu les mouvements qui les engendrent, qu’on attendit des siècles avant de soupçonner que notes de la gamme ou teintes de l’arc-en-ciel n’étaient séparées que par des modalités quantitatives ; ignorants et sauvages continuent de croire distincts, radicalement, des couleurs ou des sons qui résultent d’une même excitation fondamentale. Et une cause identique produit des sensations dissemblables, si les organes, soit périphériques, soit centraux, viennent à être modifiés : l’œil atteint de daltonisme perçoit vert ce qui paraît rouge à l’œil ordinaire ». (Face à l’Éternité). Il existe encore des mirages d’un autre ordre, non moins nombreux, non moins décevants, ceux qu’engendrent nos désirs, nos besoins, nos affections. On est tout disposé à croire ce que l’on désire ; comme la haine, l’amour est aveugle. Et le bonheur, que nous poursuivons invinciblement, qui s’avère la fin suprême de toute activité réfléchie, engendre, lui aussi, plus d’une illusion. « Le bonheur est un but pour l’homme ; pour la nature il n’est qu’un signe, un appât peut-être, tendu tel celui d’un pêcheur au poisson. Quoi de plus décevant que sa poursuite : il fuit qui le recherche, échappe à qui le tient, pour s’évanouir lorsqu’on croit le saisir à la gorge... Plaisirs ou douleurs ne sont qu’apparence affective, revers sentimental d’un travail profond de perfectionnement ou de destruction. Boire et manger conduisent à refaire nos forces ; jouir des saveurs reste un accessoire. Et les délices enivrants de l’amour aboutissent à la procréation : piège heureux pour l’espèce, bien que parfois, fatal aux infortunés parents. Légendaires sont les noces tragiques de l’abeille-mère qui arrache, en plein ciel, les entrailles de son amant ; l’histoire des insectes est fertile en récits analogues. Semblable à la fleur carnivore des tropiques, 1’amour attire par sa couleur et son parfum, souvent, comme elle, il devient le tombeau de l’imprudent que retint son calice. » (A la Recherche du Bonheur.) Mais pour dissiper les mirages, qu’il s’agisse de ceux du cœur ou de ceux des sens, l’homme possède une lumière infiniment précieuse, celle de la raison. C’est en vain qu’un Bergson, qu’un James ont voulu l’obscurcir ; toutes les fumées mystiques, accumulées par les farceurs à la solde des Églises ou des Académies, se dissipent lentement sans que ses clairs rayons aient rien perdu de leur vivifiante énergie. Un Brunetière proclamant la faillite de la science nous apparaît grotesque ; seuls un sorbonnard, un académicien ou un ancien élève des Jésuites peuvent ignorer que la valeur de nos connaissances positives s’avère tout ensemble certaine et relative. Mais les hommes préfèrent souvent de creux mirages à la dure vérité ; ils acclament qui les trompe et se détournent de qui les éclaire.
— L. B.
MISÉRABLE
(du lat. miserabilus), adj. et subs.
Malheureux digne de pitié. Nous le sommes tous ; un peu plus ou moins nous avons droit à la pitié mutuelle et nous n’avons pas à la refuser à d’autres, si nous entendons que nul n’est misérable uniquement par sa faute. Dans l’antiquité, le misérable était une victime de la fatalité. Il y en avait parmi les maîtres et parmi les esclaves. On le pouvait devenir du jour au lendemain aussi bien jadis qu’aujourd’hui. Selon Pascal, on est d’ autant plus misérable que l’on est tombé de plus haut. Selon Voltaire, tout misérable est digne de pitié :
Qu’un oubli d’un moment a pu rendre coupable. »
La charité chrétienne se fait gloire de secourir les misérables. La solidarité sociale, comme nous la comprenons s’attache à supprimer les causes engendrant les misérables.
Le mot s’applique fréquemment aux choses : Une vie misérable ; une fin misérable.
Au sens figuré se présente une signification particulière et individuelle, différant avec le sentiment caché derrière ce mot. Ce qui est misérable pour un individu de conception bourgeoise, de mentalité quelconque n’a plus la même signification dans la bouche d’un homme d’idées avancées et libres. Nous ne pouvons pas dire que la vie et la mort de la plupart des apôtres et des martyrs de la Muse anarchiste furent misérables, puisque nous estimons qu’ils ont vécu et qu’ils sont morts en beauté. Mais nous prenons à la lettre le sens que lui donne la bourgeoisie quand elle qualifie de misérable leur existence, si l’on entend par là qu’ils n’ont pas profité de leurs idées et de leur apostolat pour vivre bourgeoisement selon l’expression qui s’attache à ce mot. Il n’y a pas déchéance, mais souvent grandeur à vivre en misérable ; en n’exploitant personne, en restant digne et fier, content de peu, mais heureux et riche de ses belles et généreuses idées, fussent-elles pour longtemps encore chimériques à cause de l’ignorance et de l’inconscience des misérables inaptes à les comprendre et à les vivre.
Les Misérables. Roman de Victor Hugo, dont les lignes suivantes, tirées de la Préface, suffisent à dire toute la pensée : « Tant qu’il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale ... ; tant que les trois problèmes du siècle : la dégradation de l’homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l’atrophie de l’enfant par la nuit, ne seront pas résolus ; tant qu’il y aura ignorance et misère, les livres de la nature de celui-ci ne seront pas inutiles »...
Avec le poète et nombre de penseurs, nous croyons que « les misérables ont fait souvent de grandes choses ». Et, comme Labruyère, nous pensons : « qu’il vaut mieux s’exposer à l’ingratitude que de manquer aux misérables ». Mais nous déclarons que sont bien méprisables les misérables qui s’enrichissent du bien des pauvres. Sus aux profiteurs qui dupent, bernent, pillent les misérables...
G. Y.
MISÈRE
(du lat. f. miseria), n. f.
Ce mot prête souvent à confusion pour qui n’est pas habitué à l’ironie de certains mots français et à leurs multiples sens.
Le Dictionnaire Larousse donne, sur celui-ci , les indications suivantes :
« État digne de pitié ;
-
par le malheur : LA MISÈRE de Napoléon à Sainte-Hélène ;
-
par la pauvreté : LA MISÈRE porte au désespoir (Pascal).
C’est une MISÈRE que d’avoir affaire aux gens de lois. — Que de MISÈRES l’on imprime. — La richesse a ses MISÈRES. — Poétiquement : La vile Oisiveté est fille de MISÈRE (A. de Musset). — La MISÈRE de l’homme se conclut de sa grandeur (Pascal). — La terre où les hommes sont livrés à toutes sortes de maux, est souvent appelée : Vallée de MISÈRES. »
MISÈRE et compagnie, est un terme populaire qui dit bien que la misère engendre la misère. Reprendre le collier de MISÈRE veut dire qu’après un repos, un congé, un répit, il faut retourner au travail forcé.
Crier MISÈRE n’est pas une solution au mal. C’est souvent un moyen hypocrite d’apitoyer ou de tromper les gens. Par des dehors misérables, un égoïste, un avare, un peureux cachent leurs biens assez souvent mal acquis, peut-être par des profits inavouables, une exploitation honteuse de leurs semblables. Ils craignent les envieux et les curieux.
Enfin, il y a encore la misère physiologique qui découle souvent de la MISÈRE elle-même, par l’hérédité, le surmenage, le manque d’hygiène. C’est la MISÈRE sociale qui s’affiche ainsi par ses victimes.
La vie large, naturelle, saine peut, seule, apporter remède à cette misère-là... Pourtant, bien qu’on parle beaucoup des bienfaits que verserait une existence moins douloureuse et délivrée de la privation, ce sont toujours les parasites sociaux qui profitent, jusqu’à crever de pléthore, des richesses acquises et accumulées par le travail de la multitude. Ce sont ceux qui ne travaillent pas et qu’aucun labeur utile ne lasse qui, chaque année, vont à la mer, à la montagne. Ils ont besoin de vacances, de repos, sans doute pour réparer les fatigues de ceux qui les entretiennent... Et la misère continue.
La misère, elle est le résultat de l’ esclavage, sous la forme du salaire... Elle ne peut disparaître qu’avec la suppression du patronat et du salariat. Tant que le travailleur n’aura pas su s’éduquer, s’organiser et, par l’union des exploités, se dresser pour supprimer l’exploitation, la misère subsistera, se perpétuera, s’aggravera. Ce n’est pas avec des malheureux prostrés par le travail et l’ignorance qu’on peut espérer transformer le monde et rendre socialement bon ce qui trouble aujourd’hui la vie et les rapports humains. Ce n’est pas rêver, en mystique, à la perfection des hommes que de vouloir d’abord supprimer les causes de leur misère. Il n’y a dans nos projets rien de chimérique. Ce que nous voulons, avec ardeur, c’est instituer sur le monde prétendu civilisé, une organisation nouvelle du travail. Et nous trouvons tout naturel que les travailleurs soient les artisans essentiels de cette organisation.
Il n’y aura plus de MISÈRE quand les producteurs auront compris la nécessité de produire pour eux, de régler leur production sur leur consommation et celle des êtres qui, dans la société, ont un motif ou une excuse raisonnable de ne point collaborer à la production. Si, comme l’a écrit Musset, qui ne l’entendait pas ainsi : La vile Oisiveté est fille de Misère..., nous aurons fait disparaître la fille en n’entretenant plus la mère.
— G Y.
MISÈRE
La misère, dit-on, porte à la résignation, à la lâcheté, au désespoir. Elle s’oppose à la révolte... Écrasés sous le faix de leurs peines, accablés par les difficultés de la vie, le cœur broyé par la souffrance des leurs, les pauvres ne songent qu’à sauver un lendemain précaire, non à assurer un avenir meilleur. D’abord manger, tarir l’angoisse du manque ! Il suffit de voir les lamentables troupeaux qui guettent, regard morne et front bas, les miettes de la bienfaisance et de la charité, d’observer les files de chômeurs attendant quelque maigre secours, implorant, malgré leurs chaînes, un travail de salut, pour comprendre que les prisonniers de la misère sont des vaincus et que, d’eux-mêmes, ils ne pourront, en cet état, se redresser pour affirmer leurs droits. Une insurmontable dépression pèse sur leur conscience, le malheur obscurcit leur compréhension et broie leur volonté. L’homme qui a faim se livre pour un morceau de pain. Et le problème social ne dépasse pas pour lui l’appel de son estomac torturé...
Ce n’est qu’accidentellement, sous la poussée de courants qu’ils n’ont pas ébranlés, que les misérables apportent leur énergie dernière aux causes qui libèrent. Les révolutionnaires se doivent cependant de déposer dans cette masse leurs ferments de régénération. S’ils savent, à certaines heures, canaliser ces forces que le besoin commande et les jeter contre l’obstacle, leur élan personnel pourra s’en trouver élargi en poussée irrésistible. Mais c’est là l’inconnu des heures de crise que régissent tant d’impondérables. C’ est déjà le vent des émeutes, la montée des révolutions qui, pour un temps, élève les hommes plus haut qu’eux-mêmes... Dans la vie quotidienne, la misère peut aiguiser quelques natures d’élite, elle enténèbre et rapetisse le grand nombre...
— L.
MISÈRE
Il est des pages qui vivront aussi longtemps que l’organisation sociale que nous subissons et qui, même quand aura lui l’aube des temps nouveaux, serviront encore à marquer, du signe de l’infamie, les temps qui ne seront plus. Témoin celle-ci que Proudhon écrivait, il y a près d’un siècle, sur la MISÈRE : « Le phénomène le plus étonnant de la civilisation, le mieux attesté par l’expérience et le moins compris des théoriciens, est la misère. Jamais problème ne fut plus attentivement, plus laborieusement étudié que celui-là. Le paupérisme a été soumis à l’analyse logique, historique, physique et morale ; on l’a divisé par famille, genre, espèces, variétés, comme un quatrième règne de la nature ; on a disserté longuement de ses effets et de ses causes, de sa nécessité, de sa propagation, de sa destination, de sa mesure ; on en a fait la physiologie et la thérapeutique... Les titres seuls des livres qui ont été écrits sur la matière empliraient un volume. A force d’en parler, on est parvenu à en nier l’existence ; et c’est à peine si, à la suite de cette longue investigation, l’on commence maintenant de s’apercevoir que la misère appartient à la catégorie des choses indéfinissables, des choses qui ne s’entendent pas...
...La MISÈRE, selon E. Buret, qui a préféré généraliser moins afin de saisir mieux, la misère est la compensation de la richesse. Que de plus habiles expliquent cela, s’ils peuvent ; quant à moi ma conviction est que l’auteur ne s’est pas lui-même compris. La cause du paupérisme, c’est l’insuffisance des produits (c’est-à-dire le paupérisme) : opinion de Chevalier. La cause du paupérisme, c’est la trop grande consommation (c’est-à-dire encore le paupérisme) : opinion de Malthus. Je pourrais, à l’infini, multiplier les textes sans tirer jamais des auteurs autre chose que cette proposition, digne de faire pendant au premier verset du Coran : « Dieu est Dieu » la misère est la misère et le mal est le mal. La conclusion est digne de ces prémisses : Augmenter la production, restreindre la consommation et faire moins d’enfants en un mot, être riche, et non pas pauvre... Voilà, pour combattre la misère, tout ce que savent nous dire ceux qui l’ont le mieux étudiée, voilà les colonnes d’Hercule de l’économie politique !... Mais, sublimes économistes vous oubliez qu’augmenter la richesse sans accroître la population, c’est chose aussi absurde que de vouloir réduire le nombre des bouches en augmentant le nombre des bras. Raisonnons un peu, s’il vous plait, puisqu’à moins de raisonner nous n’avons plus même le sens commun. La famille n’est~elle pas le cœur de l’économie sociale, l’objet essentiel de la propriété, l’élément constitutif de l’ordre, le bien suprême vers lequel le travailleur dirige toute son ambition, tous ses efforts ? N’est-ce pas la chose sans laquelle il cesserait de travailler, aimant mieux être chevalier d’industrie et voleur ; avec laquelle, au contraire, il subit le joug de votre police, acquitte vos impôts, se laisse museler, dépouiller, écorcher vif par le monopole, s’endort résigné sur ses chaînes, et pendant les deux tiers de son existence, semblable au Créateur, dont on nous a dit qu’il est patient, parce qu’il est éternel, ne sent plus l’injustice commis contre sa personne ? Point de famille, point de société, point de travail ; au lieu de cette subordination héroïque du prolétariat à la propriété, une guerre de bêtes féroces : telle est, d’ après la donnée économique, notre première position. Et si vous n’en découvrez pas en ce moment la nécessité, permettez que je vous renvoie aux théories du monopole, du crédit et de la propriété. Maintenant, le but de la famille, n’est-ce pas la progéniture ? Cette progéniture n’est-elle pas l’effet, nécessaire, du développement vital de l’homme ? N’est-ce pas en raison de la force acquise, et pour ainsi dire accumulée dans ses organes par la jeunesse, le travail et le bien-être ? Donc, c’est une conséquence inévitable de la multiplication des subsistances, de multiplier la population ; donc, enfin, la proportion relative des subsistances, loin de s’accroitre par l’élimination des bouches inutiles, tendrait invinciblement à dominer, s’il est vrai qu’une semblable élimination ne puisse s’effectuer que par la destruction de la famille, objet suprême, condition sine qua non du travail. Ainsi, la production et la population sont l’une à l’autre effet et cause ; la société se développe simultanément et en vertu du même principe en richesse et en hommes : dire qu’il faut changer ce rapport c’est comme si, dans une opération où le dividende et le diviseur croîtraient toujours en raison égale, vous parliez de doubler le quotient. Quoi donc ! Économistes, vous osez nous parler de misère ! Et quand on vous démontre, à l’aide de vos propres théories, que si la population se double, la production se quadruple ; qu’en conséquence le paupérisme ne peut venir que d’une perturbation de l’économie sociale au lieu de répondre, vous accusez ce qu’il est absurde d’appeler en cause, l’excédent de la population ! Vous nous parlez de misère ! Et quand, vos statistiques à la main, on vous fait voir que le paupérisme s’accroît en progression beaucoup plus rapide que la population, dont l’excès, suivant vous, le détermine ; que, par conséquent, il existe là-dessous une cause secrète que vous n’apercevez pas, vous dissimulez et ne cessez de mettre en avant la théorie de Malthus ! Mais nous vous signalerons à la défiance des travailleurs ; nous redirons partout, avec un éclat de tonnerre : L’Economie politique est l’organisation de la misère ; et les apôtres du vol, les pourvoyeurs de la mort, ce sont les économistes. Il est prouvé désormais que cette nécessité de la misère, qui tout à l’heure nous a plongés dans la consternation, n’est point absolue ; c’est, comme dit l’école, une nécessité de contingence. Contre toute probabilité, la société souffre de cela même qui devrait faire son salut. Toujours la misère est prématurée, toujours le paupérisme anticipe. A l’encontre du sauvage, à qui la disette vient par l’inertie, elle nous vient à nous par l’action, et notre travail ajoute sans cesse à notre indigence. L’équilibre n’ayant pu être atteint, il ne reste d’espoir que dans une solution intégrale qui, synthétisant les théories, rende au travail son efficacité, et à chacun de ses organes sa puissance. Jusque-là, le paupérisme reste aussi invinciblement attaché au travail que la misère l’est à la fainéantise, et toutes nos récriminations contre la Providence ne prouvent que notre imbécillité. Depuis cinquante ans, observe E. Buret et, après lui, Fix, la richesse nationale en France a quintuplé, tandis que la population ne s’est pas accrue de moitié. A ce compte, la richesse aurait marché dix fois plus vite que la population. D’où vient qu’au lieu de se réduire proportionnellement, la misère s’est accrue ? Les crimes et délits, comme le suicide, les maladies et l’abrutissement, sont les portes par où s’écoule la misère. D’après les chiffres officiels, l’accroissement moyen de la population étant 5 p. 1.000 celui de la criminalité, somme totale, 31.2, il s’ensuit que le paupérisme arrive sur nous six fois et un quart plus vite que, d’après la théorie de Malthus, on n’avait lieu de l’attendre. A quoi tient cette disproportion ? La même chose se prouve d’une autre manière.
En général, les nations occupent, sur l’échelle de la misère, le même rang que sur l’échelle de la richesse. En Angleterre, on compte un indigent sur cinq personnes ; en Belgique et dans le département du Nord, un sur six ; en France, un sur neuf ; en Espagne et en Italie, un sur trente ; en Turquie, un sur quarante ; en Russie, un sur cent ; l’Irlande et l’Amérique du Nord, l’une et l’autre placées dans des conditions exceptionnelles et tout opposées, présentent, la première, la proportion effrayante d’un et même plus sur deux ; la seconde un et peut-être encore moins sur mille. Ainsi, dans tous les pays de population agglomérée, où l’économie politique fonctionne régulièrement, la misère se compose exclusivement du déficit causé par la propriété à la classe travailleuse. »
Les tendances de l’économie politique, si vigoureusement fustigées par Proudhon, n’ont fait que s’accentuer. Plus un pays est riche et plus la grande partie de ses habitants vit dans la misère : vols, meurtres, suicides, « portes par où s’écoule la misère » vont sans cesse en augmentant. Périodiquement, la grande presse fait écho aux angoisses capitalistes et déplore que le blé, le vin soient abondants. L’industrie, comme l’agriculture, souffre de pléthore. Il y a de toute marchandise en trop grande quantité. La vente n’est jamais suffisante pour compenser la production. Bientôt, tous les marchés seront accaparés, et il s’établit autour du moindre petit peuple, client possible, des concurrences inouïes, brutales, déclenchant parfois et de plus en plus souvent des guerres atroces. Faute d’acheteurs pour leurs produits, des industries jettent sur le pavé pour des mois, des centaines de mille de travailleurs qui vivront dans la misère la plus féroce.
Le machinisme se développant sans cesse augmente au centuple la production, supprime la main-d’œuvre, jette sur le marché du travail des bras en quantité qui s’offrent, nécessairement, au plus bas prix, avilissant encore des salaires cependant bien minimes, enlevant à la classe la plus importante de la société tout moyen de consommer ces produits qui manquent de consommateurs. Et cependant, malgré la misère qu’il crée et les embarras qu’il suscite aux gouvernements et aux capitalistes, le machinisme ne peut être repoussé sous peine de voir péricliter puis disparaître toute industrie sous la concurrence des industries étrangères capables, dans la misère de leurs ouvriers, de trouver des produits coûtant si peu et pouvant, par conséquent, se vendre au minimum. En vain, on garantira l’industrie ou l’agriculture par un système de douane : protectionnisme ne vaut pas mieux que libre-échange (voir ces mots).
Le grand mal dont souffrent les sociétés modernes, c’est la propriété. On produit uniquement pour vendre et non point pour consommer. Devant des filatures qui ferment leurs portes pour cause de mévente, des centaines de mille de prolétaires défilent, vêtus de hardes infâmes, faute de pouvoir en acheter d’autres. Et ainsi pour le cultivateur, le mégissier, le chausseur, l’éleveur, etc.
Une société où la misère existe en permanence, au milieu de richesses parfaitement inemployées, est une société d’abrutis, d’ignorants ou de fous. Seul un renversement total des valeurs, seule une Révolution pourra supprimer la misère en soumettant définitivement la production à la consommation, en ne produisant plus pour négocier, mais pour satisfaire des besoins.
— A. LAPEYRE.
MISÉREUX
n. m. (rad. misère)
C’est encore un vieux mot repris de nos jours, surtout dans les milieux que préoccupe la question sociale. Il est synonyme de misérable, mais à la commisération qu’il traduit se mêle une protestation et comme une pointe de révolte. Il s’emploie fréquemment dans le monde ouvrier. Les écrivains qui usent de ce mot ont l’intention bien marquée de ne point lui donner le sens de vil et de méprisable qui accompagne si facilement le mot misérable. Quelque part, Séverine a employé cette phrase : « Il est d’autres parias que les miséreux en bourgeron », Cela signifiait qu’il y a d’autres exploités que les ouvriers d’usines. Il y a les employés de commerce, d’administration, diverses catégories de fonctionnaires de l’État, de la ville, des banques, etc., etc. En un mot, il y a des miséreux partout où il y a des exploités.
Ces miséreux sont des nôtres. Travailleurs sous le joug de l’exploitation et de l’autorité, quels que soient vos bourreaux et la misère dont vous souffrez ; unissez-vous pour être forts ; ne vous laissez pas dominer par la détresse.
— G. Y.
MISSION
n. f. (du lat. mittere, envoyer)
Présentement le mot mission s’emploie dans les domaines les plus divers. Nous parlerons des missions religieuses surtout, un peu aussi des missions militaires et scientifiques.
C’est à évangéliser Israël, non à conquérir le monde entier que songeaient les premiers apôtres de Jésus. Mais les Juifs, ceux qui avaient émigré au dehors comme ceux de Palestine, mirent peu d’empressement à se convertir. Par contre les prosélytes venus du paganisme accueillirent avec joie la nouvelle doctrine, et Paul se tourna franchement vers eux. Malgré les récriminations de Pierre et des chrétiens de Jérusalem, attachés au particularisme juif, il abandonna la loi mosaïque et dispensa les gentils de la circoncision et des autres rites chers à la Synagogue. Ce coup d’audace assurera le triomphe du messianisme chrétien, qui, oubliant sa première origine, se muera en religion universaliste ; bientôt les résultats obtenus permettront toutes les espérances et l’esprit de prosélytisme deviendra l’une des caractéristiques de la nouvelle secte partie à la conquête du monde gréco-romain. À cette époque chaque fidèle se doublait d’un apôtre ; il y avait pourrait-on dire autant de missionnaires que de chrétiens.
Après la conversion de Constantin, lorsque l’Église devenue maîtresse se gorgea sans retenue de tous les biens terrestres, le zèle des propagandistes se ralentit naturellement. Lois, tribunaux, force armée étant à la disposition des prêtres, ceux-ci utilisèrent la violence de préférence à la persuasion, pour convertir les sujets, restés infidèles, des très chrétiens empereurs. Avec les barbares, qu’ils ne pouvaient menacer du préteur et des bourreaux, ils devront néanmoins procéder différemment ; alors se précisa le rôle particulier dévolu aux missionnaires, chargés de prêcher l’Évangile dans les pays où l’Église n’avait pour elle ni la faveur du peuple ni celle des souverains. Ce fut l’arianisme, exclu de l’empire, qui pénétra le premier chez les Germains, vers le milieu du IVème siècle ; parmi ses principaux propagateurs, il convient de citer l’évêque Ulphilas qui traduisit la Bible dans la langue des Goths. Vendales, Burgondes, Wisigoths étaient déjà ariens lorsqu’ils pénétrèrent sur les terres de l’Empire ; seuls les Francs, les Saxons et les Angles, restés plus longtemps païens, se convertirent directement au catholicisme. Clovis, chef fourbe et cruel, fit baptiser d’office ses guerriers francs, afin de gagner la bienveillance de l’épiscopat gaulois. À la fin du VIème siècle, le moine Augustin et ses compagnons, envoyés de Rome par Grégoire le Grand, réussirent avec l’appui de la reine Berthe à convertir les Anglo-Saxons. Très adroitement les papes et les évêques utilisèrent les princesses pour aboutir à leurs fins ; on sait le rôle joué par Hélène près de Constantin, par Clotilde près de Clovis ; c’est Théodelinde, l’épouse du roi Agilufe, qui fit disparaître l’arianisme du royaume lombard ; c’est Ingonde, la femme du malheureux Hermenégilde, qui prépara le retour des Wisigoths à l’orthodoxie romaine. Et Brunehaut, la sinistre reine d’Austrasie, reçut du pape Saint Grégoire le Grand de nombreuses lettres de félicitations pour la manière dont elle élevait ses enfants et gouvernait ses États. À cette ardente catholique il envoyait souvent des livres et des reliques, ne cessant de répéter, à qui voulait l’entendre, que les Francs devaient s’estimer heureux d’avoir une pareille souveraine. Mais l’Irlandais Colomban, fondateur du monastère de Luxeuil et qui devait mourir à Bobio, en Italie, après de multiples pérégrinations, ne s’étant pas trouvé du même avis et ayant parlé de Brunehaut sans ménagement, dut fuir pour échapper à la vengeance de cette implacable furie. Au VIIIème siècle, l’Anglo-Saxon Boniface évangélisa la Germanie ; il mourut en 755, assassiné par les Frisons. Au IXème siècle, les missionnaires poussèrent jusqu’en Danemark et en Suède, en même temps qu’ils étendaient leur action sur les bords du Danube. Conjointement avec Cyrille qui traduisit la Bible en langue slave, Méthode évangélisa la Bulgarie, puis il passa en Bohème, d’où le christianisme, gagnera la Pologne et la Hongrie, à la fin du siècle suivant. En 983, le chef russe Wladimir se convertit sous l’influence de sa grand-mère, la princesse Olga. Quant à l’Irlande, elle dut à Patrice d’être chrétienne dès le Vème siècle. De leur côté, les Nestoriens de Perse envoyèrent des missionnaires en Tartarie et en Chine, vers la fin du VIème siècle ; l’œuvre qu’ils accomplirent fut importante mais peu durable.
Déjà, les anciens ordres religieux avaient permis aux dignitaires ecclésiastiques de recruter, à bon compte, les missionnaires dont ils avaient besoin. Les moines irlandais et les bénédictins affectionnèrent la prédication en terre lointaine, du moins tant qu’une corruption effrénée ne s’installa pas à demeure dans la majorité des couvents. Sur l’orgie monastique, Saint Ber nard a écrit des pages que nos journaux de gauche, toujours soucieux de respecter la religion à ce qu’ils disent, refuseraient d’imprimer. La fondation des ordres mendiants, franciscains et dominicains, au XIIIème siècle, fournit au pape des serviteurs fanatiques et bénévoles, qui remplacèrent avantageusement les bénédictins défaillants. Sans négliger les missions lointaines, ils s’adonnèrent particulièrement à ce que l’on dénomme aujourd’hui les missions intérieures, s’efforçant de ranimer le zèle des chrétiens attiédis, prêchant, confessant, dénonçant aussi aux rigueurs de l’autorité civile les fidèles suspects d’hérésie. Cette dernière besogne fut chère aux dominicains, ces infatigables pourvoyeurs des bûchers de l’Inquisition. Mais, à leur tour, les ordres mendiants sombreront, soit dans les excès d’un mysticisme délirant, soit dans la paresse et la goinfrerie.
Au XVIème siècle, la création des Jésuites donna un regain de vie aux missions catholiques. François Xavier, l’un des premiers compagnons d’Ignace de Loyola, évangélisa l’Extrême-Orient ; d’autres jésuites iront vers l’Amérique, si cruellement traitée par les Espagnols, et s’installeront en maîtres dans le Paraguay, doté par eux d’une organisation économique souvent rappelée par nos socialistes. Toutefois l’affaire des rites chinois, un peu plus tard, montrera que les disciples d’Ignace faisaient bon marché des dogmes et de l’autorité épiscopale, dans les régions malaisément accessibles aux occidentaux, quand ils en tiraient richesses et profits. En Europe, par contre, ils se donnaient pour les champions d’une stricte orthodoxie, luttant sans merci contre le protestantisme et pour le triomphe des orgueilleuses prétentions du pontife romain.
Afin de centraliser les résultats obtenus par les missionnaires et de leur imposer les vues que lui dictait son ambition, Grégoire XV fonda en 1622 la Congrégation de la propagande, de propaganda fide. Cette institution subsiste toujours ; elle est devenue l’un des rouages essentiels de l’administration papale. Plusieurs cardinaux la dirigent, assistés d’un personnel nombreux ; elle dispose de ressources formidables, l’or drainé dans l’univers entier, sous prétexte de missions, aboutissant à ses coffres-forts. De là partent des instructions impératives à destination des pays les plus reculés, car, pour les bureaucrates du Vatican, le monde catholique n’est qu’un vaste échiquier dont ils manœuvrent les pions au gré des intérêts politiques et financiers du saint-père. La Congrégation de la Propagande possède une imprimerie capable d’éditer des livres et brochures dans plus de cinquante langues ; pour avoir des fonctionnaires dociles, elle a fait construire un collège où sont formés de futurs missionnaires. Un décret de Clément XI, en 1707, obligea d’ailleurs les supérieurs d’ordres religieux à destiner un certain nombre de leurs sujets aux missions lointaines. Aussi toutes les congrégations quelque peu importantes d’hommes et même de femmes possèdent-elles des succursales dans les pays qui échappent à la domination du catholicisme romain. Les Lazaristes, dont la création remonte à Vincent de Paul, puis le Séminaire des Missions Étrangères de Paris, qui date de 1663, donnèrent une impulsion nouvelle à l’œuvre des missions. De nombreuses congrégations, nées depuis, surtout au XIXème siècle, ont associé leurs efforts à ceux des ordres anciens : Rédemptoristes, Marianites, Maristes, Picpusiens, Oblats de Marie, Assomptionistes, Salésiens, Pères du Saint-Esprit, Pères Blancs, etc. D’abondants subsides leur sont fournis par l’œuvre de la Propagation de la Foi, commencée il Lyon vers 1804 et officiellement approuvée en 1822, par l’œuvre de la Sainte Enfance, par le produit de quêtes périodiquement renouvelées et aussi par maints gouvernements occidentaux, Dans certaines régions, les missionnaires ont acquis d’immenses domaines, même des fabriques ; et, comme ils donnent aux travailleurs indigènes un salaire de famine, leurs bénéfices annuels atteignent des chiffres prodigieux. Malheur à leurs locataires s’ils paient tardivement, dans les ports d’Extrême-Orient dont ils possèdent, en notable partie, les magasins et les maisons ! C’est à des milliards que s’élève, en Afrique, la fortune des Pères Blancs et des autres missionnaires. Sans parler des commissions versées par les entreprises coloniales et les négociants d’Europe, dont ils favorisent les rapines et les déprédations. Dans nos colonies, juges et fonctionnaires sont leurs plats valets ; qu’une contestation éclate entre un infidèle et un chrétien, c’est eux qui dictent la sentence toujours inspirée d’un parti-pris évident. Et, dans les pays non encore accaparés pat les occidentaux, il suffit qu’ils se plaignent pour que l’Europe expédie, à leur aide, des diplomates, ses cuirassés, ses militaires. Mais beaucoup sombrent dans l’alcoolisme ou dans une débauche sexuelle effrénée ; l’autorité ecclésiastique ferme les yeux pourvu qu’ils travaillent à grossir le trésor du pape et à lui recruter des partisans.
Chez les peuplades restées primitives, en Afrique, en Océanie, les missionnaires trouvent sans peine des adeptes, car la mentalité fétichiste s’accommode fort bien des pratiques superstitieuses du catholicisme romain. Par contre, Arabes, Hindous, Chinois, Japonais ne mordent pas à l’hameçon qu’on leur tend ; en général les Orientaux qui se convertissent sont des voleurs, des assassins, désireux de fléchir les juges européens, ou des pauvres qui reçoivent une grosse sommes pour prix du baptême. Jusqu’à ces derniers temps, les dignitaires ecclésiastiques étaient toujours choisis parmi les blancs, dans les pays infidèles, mais, afin de mieux capter la confiance des jaunes, Pie XI vient récemment d’élever à l’épiscopat des Chinois et des Japonais.
Naturellement, les prêtres cachent les abus et la situation véritable aux adolescents qu’ils embrigadent pour les missions du dehors. Parmi ces jeunes gens, les convaincus sont beaucoup moins rares que parmi les Séminaristes ordinaire, et l’on s’efforce de les tenir en haleine, jusqu’au jour où, expédiés à l’autre bout du monde, leurs yeux fatalement s’ouvriront. Trop tard ; pour revenir en arrière, il faudrait un mépris du bien-être et de l’opinion, une volonté de fer, qui se rencontrent rarement. Je parle par expérience d’une situation que je connais bien. Pour les missions du dedans, celles qui visent à fanatiser les fidèles par une série de conférences et d’exercices de dévotion, elles n’exigent qu’un bon gosier, joint à une forte dose d’hypocrisie, de la part des prédicateurs. Ces derniers sont souvent des religieux, dont l’accoutrement baroque et les allures patelines ou cavalières, selon le milieu, impressionnent favorablement l’auditoire. Sous la Restauration ces missions furent particulièrement nombreuses ; dans maintes paroisses, elles ont lieu tous les cinq ou dix ans. Malgré la triste besogne que Rome leur impose, malgré un goût des richesses que leurs aînés ne connurent pas, les prêtres qui se destinent à la prédication lointaine sont, en général, nettement supérieurs à ceux qui restent en Europe ; ils ont une largeur de vue, un amour du risque, un dédain pour les mesquineries dévotes et les préceptes d’une morale étroite, qui les rendraient parfois sympathiques, si l’on ne savait qu’ils propagent de sinistres erreurs.
Longtemps les Églises protestantes se préoccupèrent peu d’envoyer des missionnaires au dehors. La première société anglaise constituée dans ce but remonte à 1647, la seconde à 1698 ; Frédéric IV de Danemark dota richement celle qui se fonda dans son pays en 1704 ; à partir de 1732, les frères moraves se mirent aussi à l’œuvre, ne craignant pas de pénétrer jusque dans les régions polaires. Pendant deux siècles c’est à l’émigration surtout que le protestantisme dut de se répandre hors de l’Europe. Mais, depuis le XVIIIème siècle, il fait une rude concurrence à l’Église romaine. De nombreuses sociétés fournissent, aux pasteurs qui consentent à s’expatrier, les ressources dont ils ont besoin : l’Angleterre et les États-Unis viennent au premier rang pour les sommes recueillies à cette intention. Parce qu’il n’a point la prétention de garder le célibat et parce qu’il fait une petite part à la raison, en proclamant la doctrine du libre examen, le missionnaire protestant nous semble moins dangereux que le missionnaire catholique. Toutefois les bonnes relations que les Églises réformées entretiennent de plus en plus avec celle de Rome, et l’esprit étroit de certains protestants ne sont pas faits pour nous rassurer. Ajoutons que si les prêtres catholiques travaillent pour le plus grand profit du Vatican, les pasteurs n’oublient pas en général de servir les intérêts du pays qui les envoie. Les missions intérieures, comprises assez différemment selon les sectes et les contrées, sont bien connues des protestants d’Europe et d’Amérique. Le pasteur Bodelschwingh les développa en Allemagne, au XIXème siècle, avec une ardeur comparable à celle que Vincent de Paul avait déployée pour les implanter chez les catholiques, deux cents ans plus tôt. On connaît les exhibitions de I’ Armée du Salut, fondée à Londres en 1872 par William Booth ; elles ne surprennent pas dans les pays anglo-saxons où les revivals ou réveils de la conscience religieuse font surgir quotidiennement de nouvelles sectes et des prédicants inspirés. Église grecque, bouddhisme, mahométisme envoient, eux aussi, des propagandistes au loin ; avec des ressources infimes, les musulmans obtiennent des résultats que pourraient envier les prêtres catholiques et les pasteurs protestants.
Les missions chrétiennes, et ce sera leur honte éternelle, ont souvent préparé la voie aux missions militaires. Le Père Huc, explorateur de la Chine et du Tibet, l’Anglais Livingstone, qui resta en Afrique australe de 1852 à 1873 et mourut de fatigues, après avoir fait connaître le lac Ngami et parcouru le vaste bassin du Zambèze, firent preuve d’un courage extraordinaire. On ne peut oublier qu’un assez grand nombre de missionnaires sont morts dans des tortures effroyables et que d’autres ont montré un amour de la science et des hommes qui contraste avec l’égoïsme et la mauvaise foi des prêtres ordinaires. Mais pourquoi faut-il que derrière leur silhouette apparaisse presque toujours celle des soldats européens ; c’est la guerre et non la paix qu’annoncent les messagers de l’Évangile. Les persécutions de Tu-Duc contre les missionnaires servirent de prétexte à la France pour s’installer en Cochinchine. Et, si les Chinois détestent foncièrement les chrétiens, ce n’est certes pas sans raison, tant les peuples occidentaux ont molesté l’Empire Céleste sous le couvert des intérêts catholiques ou protestants. De même, soi-disant pour sauvegarder l’indépendance des chrétiens, les grandes puissances européennes sont fréquemment intervenues dans l’administration intérieure de la Turquie ; sans Mustapha-Kemal, elles auraient continué indéfiniment. Avec une hypocrisie, bien caractéristique de la mentalité actuelle, les nations dites civilisées ont, d’ailleurs, pris l’habitude d’appeler « missions militaires » les envois de troupes qu’elles effectuent sans déclaration de guerre officielle, les expéditions destinées à châtier des tribus rebelles ou à soumettre des contrées jusque-là indépendantes. Ce vocable euphémique fait oublier aux citoyens d’Europe ou d’Amérique que la ruse, l’injustice et la cruauté sont à la base des entreprises coloniales et des impérialismes contemporains.
Quant aux missions scientifiques, qui tendent à faire progresser le savoir humain, nous les approuvons volontiers, à condition bien entendu qu’elles ne camouflent pas des visées nationalistes inavouées. Mais alors, sauf l’idée de voyage en terre lointaine, elles n’ont rien de commun avec les missions religieuses ou militaires ; seuls les caprices du langage ont pu les réunir sous un vocable commun. Si Marco Polo, au XIIIème siècle, ne se désintéressait pas du commerce, ses voyages contribuèrent néanmoins au progrès de la navigation et de la géographie. Nous ne pouvons rappeler tous les explorateurs qui l’ont suivi, parfois simples aventuriers, parfois aussi animés des intentions les meilleures. L’histoire de ces missions se confond avec celle de la découverte du globe et du progrès scientifique.
– L. BARBEDETTE.
MOBILISABLE
adj.
« Qui peut être mobilisé », lit on dans les dictionnaires... C’est qu’en effet, au point de vue bourgeois, il n’y a guère plus à dire sur un tel mot, étant donné qu’un fils du peuple, ayant reçu l’éducation laïque et obligatoire (aussi bien d’ailleurs que celui qui reçut celle de l’école congréganiste) doit savoir ce qui lui reste à faire quand il plaît au gouvernement de déclarer la Mobilisation générale. S’il a été jugé bon pour le service, s’il a fait son devoir militaire, en un mot si rien n’est venu modifier ses aptitudes essentielles de mobilisable, il est possesseur d’un livret militaire sur’ lequel sont indiqués les jour, heure et lieu où il doit se présenter pour être équipé, dressé, entraîné et dirigé pour servir et défendre la Patrie. Se dérober à cette obligation prend immédiatement un caractère de gravité dont la multitude des mobilisables redoute les conséquences matérielles et morales et le risque physique. Pour le jeune homme sous les drapeaux au moment de la mobilisation, c’est plus simple : il n’a qu’à se laisser conduire sans savoir où il va ; c’est absolument comme le troupeau qu’on mène à l’abattoir, mais ici le nom de la destination change : elle s’appelle le champ d’honneur.
C’est à ce champ d’honneur que le mobilisable – et cela est d’une inconscience effroyable – de lui-même, doit se rendre et être exact, surtout, au rendez-vous. Le grand souci de la plupart des mobilisables n’est-il pas toujours de savoir si la feuille du livret militaire leur donnant toutes indications est bien exacte ? Aussi, n’attendent-il pas, souvent, la visite du gendarme pour les rectifications possibles et s’en vont-ils, à leurs dépens, à la gendarmerie pour se renseigner et, bien souvent, se faire rabrouer par les aimables chiens de garde de l’Ordre, de l’Autorité et de la Propriété. Cela n’empêche nullement le mobilisable de se croire un citoyen conscient et de se prétendre même un homme libre !
MOBILISATION
n. f. (rad. mobiliser)
En toute logique, mobilisation ne peut signifier autre chose que l’action de remuer des choses ou des êtres. Cela peut signifier aussi les faire remuer par un ordre, un sentiment, une poussée. Le vent fait acte de mobiliser les feuilles en les chassant sur les chaussées des villes ou dans les champs, après les avoir plus ou moins violemment arrachées des arbres.
Mobilisation peut signifier encore retenir une chose ou plusieurs ; des bestiaux, des outils, des meubles et immeubles. C’est ce qui se fait en temps de guerre. Ne pas confondre avec réquisitionner (voir ce mot), bien qu’il y ait une sorte d’analogie dans l’action de mobiliser et dans celle de réquisitionner : c’est une question de circonstances. Mais l’on se rend rapidement compte du sens différent : celui qui convient à l’un ne convient pas à l’autre de ces deux termes. La mobilisation se passe au début et la réquisition au cours de la guerre.
« EN DROIT : Mobilisation est l’action de déclarer dans un contrat qu’un immeuble sera considéré comme meuble et en prendra les caractères au point de vue juridique. On dit plutôt : ameublissement. »
« EN BIOLOGIE ET PHYSIOLOGIE : Mobilisation est « la transformation des réserves nutritives fixes en matières assimilables, ou directement utilisables, et leur transport au point où elles sont employées. »
« EN FINANCES : Mobilisation est l’action de mobiliser. Ex. : Les valeurs mobilisées réalisent la mobilisation des affaires de commerce et d’industrie. » (Larousse)
Le contraire de mobilisation est immobilisation.
Au point de VUE MILITAIRE, on sait bien que la mobilisation est l’opération ayant pour objet, d’après un plan établi, de faire se réunir une armée ou une fraction d’armée susceptible de se mouvoir pour se mettre en campagne.
La mobilisation consiste à fournir tout ce qu’il faut pour composer et entretenir un nombre déterminé de combattants et à rassembler ces combattants eux-mêmes en certains points de concentration pour les opposer à des armées ennemies envahissant ou ayant envahi le territoire... À moins que ce ne soit pour les lancer à l’attaque du pays adverse. En un mot, comme en trois : la mobilisation, c’est la guerre !
Certes, on s’en souvient, de cyniques politiciens, après avoir tout fait pour ne pas éviter la guerre, ont cru utile d’afficher, sur les murs du pays, ce mensonge : La Mobilisation, ce n’est pas la Guerre ! Mais, en même temps, dans chaque commune, dans chaque village, partout on apprenait officiellement par le tambour de ville, par l’affiche blanche et par le journal, la proclamation gouvernementale suivante : « La mobilisation générale est déclarée. Le premier jour de la mobilisation est pour le dimanche 2 août. Aucun homme ne devra partir avant d’avoir consulté l’affiche qui sera apposée incessamment ». Déjà, depuis plusieurs jours, les soldats permissionnaires avaient été rappelés, les officiers de réserve convoqués, la presse de toutes nuances chauffait à blanc l’opinion publique ; les manifestations patriotiques, les phrases historiques et grotesques débitées par les parlementaires infâmes se succédaient aux tribunes officielles, se répétaient, s’imprimaient. La folie, le fanatisme étaient au paroxysme partout. Ce qui avait débuté par ce mensonge : « La mobilisation, ce n’est pas la guerre », se continuait par l’affreux démenti, cruel en sa réalité : « La mobilisation, c’est la guerre ! »
Voilà donc ce qui se passa en ces inoubliables journées de 1914.
La Mobilisation s’opéra sans qu’il y ait eu de manifestations particulières ou collectives bien marquantes. Il y eut bien quelques-uns de nos camarades anarchistes qui osèrent revendiquer hautement leur droit de refuser de tuer. Il y eut bien quelques manifestations révolutionnaires contre la guerre, par des jeunes syndicalistes et par des antimilitaristes convaincus. Mais on étouffa tout sous la grandiloquence des professions de foi patriotardes et humanitaires. On faisait, disaient les uns, la guerre à la guerre en courant à la frontière. On la faisait, disaient les autres, pour donner la liberté à nos frères de tous les pays du monde... Que sais je ? Enfin, les troupeaux humains, bêlant pour la guerre du Droit, ou bêlant contre la guerre des Peuples, obéissant tous à leurs mauvais bergers, de chaque côté des frontières, opérant la Mobilisation, partirent à la boucherie.
Depuis bien des années, pourtant, une propagande incessante, acharnée faite chez tous les peuples pouvait donner l’impression de l’impossibilité d’une guerre européenne. Mais, en 1914, la Mobilisation presque parfaitement accomplie, nous a dessillé les yeux sur la grande illusion. Qu’étaient devenues toutes les créatures si hautement conscientes ? Dans les congrès ouvriers, dans les congrès socialistes, en toute occasion, en toutes circonstances, on avait proclamé notre haine de la guerre et fait voter des ordres du jour, selon les formules audacieuses suivantes : « L’ouvrier n’a pas de patrie ! » « À l’ordre de mobilisation, nous répondrons par la grève générale ! », avaient affirmé les syndicalistes... « À une déclaration de guerre, nous répondrons par l’insurrection », avaient proclamé les révolutionnaires. « À la Mobilisation, nous opposerons l’Immobilisation », disaient les travailleurs, en mesure d’arrêter tout trafic, dans chaque pays. S’ils avaient été capables de s’entendre et d’oser le geste salutaire, ils auraient déclenché la révolution sociale et internationale et l’auraient opposée à la guerre, puisqu’elle était déclarée. De tout cela, hélas ! rien ne fut réalisé, ni même sérieusement tenté, il faut bien le reconnaître.
La Mobilisation fut une réussite inespérée, surprenante pour les gouvernants.
Après cela, il n’y avait plus qu’à attendre les résultats d’un si joli début. Ce fut la guerre horrible, interminable, faisant des millions de victimes et laissant partout des vides immenses, reculant pour longtemps les frontières de la Raison, de la Justice sociale et de l’Humanité...
Après une telle hécatombe, il ne devrait plus y avoir, semble-t-il, de propagande à faire contre l’Idée de Patrie, contre le Militarisme, contre la Guerre ! La misère des vainqueurs et des vaincus ; le sang versé, les cadavres enfouis, les larmes désespérées, les deuils, les pertes irréparables, les milliards dépensés durant ces quatre années de meurtre collectif entre pauvres gens qui ne se connaissaient même pas ! Un tel résultat ne devrait-il dessiller à jamais tous les yeux ? Ceux qui croyaient se battre et mourir pour une idée sont morts pour le profit de bandits internationaux et, aussi, dans chaque nation, pour la vanité de quelques guerriers à galons et à décoration, pour la gloire aussi de fourbes politiciens...
C’est l’acte initial de la Mobilisation qui a mis au tombeau les millions de nos frères abusés ou peureux, que les profiteurs traitent de héros....Après tout cela, est-ce qu’une nouvelle Mobilisation devrait être possible encore parmi les peuples tant éprouvés ?
– G. YVETOT
NOTA. – On sait que, faussant le caractère des idées et des méthodes exposées par Jaurès dans l’Armée Nouvelle (système d’ailleurs contestable encore qu’il vise des nations à régime socialiste), le Robespierre en simili – Paul-Boncour – a tenu à attacher son nom à une conception, soi-disant nouvelle, de la mobilisation, qui n’est, au fond, qu’une consécration légale et une extension à des catégories jusque-là tenues en dehors de l’activité pro-guerrière. En vertu de la législation inaugurée sous ses auspices, seront mobilisés, « pour la défense de la patrie, tant au titre civil qu’au titre militaire, tous les individus valides, sans distinction d’âge ni de sexe ». Cette emprise des préoccupations et des exigences guerrières étendue à toute la population d’un pays (et assimilée, par habile démagogie, aux milices levées pour la défense des conquêtes socialistes) n’est, en fait, que la mise à discrétion, pour le soutien des intérêts ploutocratiques, de toutes les forces disponibles de la nation. C’est à cette abdication de principe stupéfiante, à cette précipitation des masses trompées sous la bannière du capital, aux armes prises et au travail donné pour le soutien de ses compétitions qu’aboutit la phraséologie réformiste qui se décore pompeusement de l’étiquette socialiste. Elle conduit, non seulement à la lutte pure et simple, « à son corps défendant » pour les biens de la bourgeoisie, ses convoitises et ses provocations, mais à une défense pour ainsi dire volontaire, zélée, dévouée des richesses et des institutions d’un capitalisme dont l’idéologie socialiste prétend poursuivre la disparition. Par les soins de Paul-Boncour et autres Renaudel, les troupes disciplinées du « socialisme » viendront lier leur sort à celui d’un régime théoriquement abhorré. Elles se prêteront, avec la masse du peuple ignorant, à « cette mobilisation totale pour la guerre totale » qui sera le tombeau de leurs espérances bafouées... Stratégie singulière, au surplus, que cette mobilisation qui sera, tout à l’encontre d’une accélération rêvée, une paralysie générale et frappera au cœur la vitalité du pays. Il est vrai que les rafales scientifiques de la guerre des gaz – massive et sans avertissement – se chargeront, sur une autre échelle, de la panique et de la désorganisation.
MOBILISÉ
n. m.
L’homme qui, déjà sous les drapeaux, fait partie du nombre des soldats qui sont ou vont être envoyés à la frontière pour une période de présence, d’activité que déterminent les circonstances, la gravité, et la durée des hostilités. La guerre de 1914 — 1918 a maintenu pendant plus de quatre ans des hommes qui croyaient quitter leur foyer pour un laps de temps très court. Il en est qui, mobilisés en 1914, ont fait toute la guerre, bien qu’ils eussent depuis long temps passé l’âge de compter avec l’armée active. En revanche, il en est d’autres, et non des moins aptes, qui furent embusqués en des emplois de tout repos ou des besognes anodines, loin du front et de ses dangers. Ces mobilisés spéciaux n’étaient pas toujours les moins enthousiastes à vouloir la guerre jusqu’au bout. Mais, en général, le mobilisé, non protégé, non privilégié, non débrouillard, fut toujours – brave ou résigné – un malheureux condamné. S’il échappa, par hasard, à la mort, il peut se proclamer, parmi tant de victimes de la guerre, un heureux rescapé. Si, de plus, il a pu sortir de cet enfer sans être endommagé ni physiquement, ni moralement, il lui reste un devoir à remplir : ce n’est pas celui de se vanter et de se glorifier, mais celui de proclamer à tous et partout l’horreur de la guerre. Celui qui a vu, qui à vécu, qui a souffert de ce mal horrible qu’est la guerre n’a pas le droit de rester muet. Il doit dire ce que fut l’ignoble tuerie de quatre années voulue par de vieux routiers et des habiles de la politique et des affaires, subie par de jeunes hommes ignorants ou trompés. Blessé ou non, le revenant de la guerre doit être l’acharné militant contre la guerre. Il doit combattre les guerriers professionnels qu’il a vus à l’œuvre et qui ne sont pas restés nombreux, ceux-là, parmi les hécatombes. S’il a l’esprit critique, s’il a des facultés intellectuelles suffisantes, il se doit de vouloir apprendre et faire connaître les causes et les responsables de la guerre pour les dénoncer hautement, par toutes les manières qu’il croit les plus justes et les meilleures pour convaincre les plus obtus. Voilà quelle doit être la vraie besogne glorieuse du mobilisé, démobilisé.
– G. Y.
MODE
n. m. et f. Ce mot vient du latin modus, qui signifie mesure, quantité, et aussi manière, moyen, méthode
En français, suivant les applications de ces différentes significations, on emploie mode comme substantif masculin ou féminin. Jusqu’au XVIème siècle, mode ne fut que féminin. Au masculin, on disait moeuf comme terme de grammaire et de musique. Lorsque l’emploi de ce mot devint plus fréquent en s’étendant à la philosophie et à la jurisprudence pour indiquer la manière d’être d’une chose, ce qui la rend modale et fait sa modalité, moeuf se changea en mode, substantif masculin.
En grammaire, le mode est une des formes du verbe, suivant les conditions de l’état ou de l’action qu’il exprime. Il y a six modes : indicatif, conditionnel, impératif, subjonctif, infinitif et participe. En musique, le mode est la disposition de la gamme, d’après la place qu’occupent les tons. Dans la musique ancienne, il y avait autant de modes que de gammes. La musique moderne n’en a que deux : le majeur et le mineur. En langage ordinaire, mode est synonyme de manière, moyen, procédé, méthode. On dit : « le mode de gouvernement », « le mode d’enseignement », etc.
La mode est le goût, la fantaisie, la façon de faire de chacun (chacun vit à sa mode), ou ce qui constitue les usages d’un groupe, d’un pays (la mode de chez nous, la mode de Bretagne, la mode française). Mais elle est surtout un usage passager, soumis au caprice, qui règne sur la forme des meubles, des vêtements, des parures et, généralement, de tous les objets matériels. En fait, elle domine la vie sociale dans toutes ses manifestations non seulement matérielles, mais aussi intellectuelles et morales. Aucune n’échappe à cette tutelle du moment qu’elle devient collective, qu’il s’agisse de logement, de costume, de cuisine, d’hygiène, de travail, de distraction, d’art, de religion ou de politique. Suivant le temps et les circonstances, il est de mode, c’est-à-dire de « bon ton », de « bon goût », selon le ton ou le goût du plus grand nombre, d’être gras ou maigre, barbu ou glabre, carnivore ou végétarien, casanier ou d’aimer les voyages, d’user ou de s’abstenir de l’alcool ou du tabac, de préférer les arts aux sports, ou vice-versa, d’être une « belle brute » ou un « fin intellectuel », d’avoir du penchant pour les maritornes robustes ou les darnes botticellesques, d’être pour le mariage ou le concubinage, de se montrer belliqueux ou pacifique, croyant ou athée, nationaliste on anarchiste, d’aller chez les curés ou chez les francs-maçons, quand ce n’est pas chez les deux à la fois, etc., etc.
Aucune raison véritable ne détermine la plupart de ceux qui obéissent à la mode. Ils sont comme l’Iphis de La Bruyère qui « voit à l’église un soulier d’une nouvelle mode ; il regarde le sien, il rougit, il ne se croit plus habillé ». On suit le mouvement, on se livre au vent qui passe, venant on ne sait d’où et qui fait tourner les têtes comme des girouettes indifférentes aux directions qu’elles prennent entre les points cardinaux de l’intelligence et de la sottise, de la raison et de la folie. La mode est, en somme, la façon de penser, de sentir et d’agir, ou de paraître penser, sentir et agir, à partir d’un moment et pour un temps donnés, sur un territoire plus ou moins vaste et pour une population plus ou moins nombreuse, suivant un modèle (objet d’imitation) sur lequel tout le monde se guide quels que soient les incompatibilités, les inconvénients et même les dangers qui peuvent en résulter pour chacun. C’est le creuset dans lequel toute personnalité se dissout, toute curiosité d’esprit et toute indépendance de caractère et de goût disparaissent pour réaliser l’état larvique de la foule anonyme, amorphe et interchangeable. C’est le nombre d’où sort la « majorité compacte » dont l’inconscience coagulée soutient les partis, les parlements, les académies, les administrations, les armées, les églises, les patries et tout ce qui fait la mécanique de l’asservissement et de l’abrutissement humains.
La mode est plus puissante que la loi ; elle la brave quand celle-ci ne veut pas la sanctionner. C’est ainsi que souvent les usages font loi. L’œuvre de centralisation, de nationalisation des pouvoirs politiques de plus en plus tentaculaires, n’aurait pas été possible sans l’unification des idées et des mœurs qu’elle a présidée sur des territoires de plus en plus vastes, détruisant peu à peu l’esprit local et créant une mentalité avec des besoins uniformes. La mode de parler le langage de Paris, de s’habiller comme à Paris, de penser à la façon des beaux esprits de Paris, a plus fait pour la soumission de la province au pouvoir central et pour l’unité française que toutes les guerres, tous les décrets et toutes les ordonnances. La facilité des communications a multiplié et étendu au monde tout entier sa puissance de prosélytisme. Le livre et le journal, auxquels se sont ajoutés le télégraphe, le téléphone, la T. S. F., le cinématographe, font qu’en quelques jours la mode de Paris, de Londres ou de Berlin devient celle de tout le globe. Le Parisien de 1930 peut aller n’importe où, à Moscou, à Pékin, dans le centre africain, en Patagonie ou au Kamtchatka, il est sûr de pouvoir y renouveler sa provision de faux-cols, d’y rencontrer des joueurs de belote et d’y entendre Ramona.
On a dit : « les fous inventent les modes et les sages les suivent ». Cette formule est trop brève pour avoir un sens complet. Telle quelle, elle n’est pas exacte. Il y a des sages et des fous des deux côtés ; beaucoup de fous, très peu de sages. Dans le plus grand nombre des cas, les inventeurs de la mode sont des gens intelligents mais sans scrupules, ne cherchant qu’à exploiter la sottise publique. Ces gens, qui ne se préoccupent pas plus des conséquences de leurs agissements que les mégalomanes conducteurs des peuples, sont certainement plus près de la folie que de la sagesse, et ceux qui les suivent ne sont pas plus sages. Il y a de la sagesse pour l’individu indifférent à tout vain besoin de paraître (voir ce mot), à adopter une mode quand il la reconnait bonne et la trouve à sa convenance. Elle favorise parfois un heureux changement auquel on n’aurait pas pensé ou qu’on n’aurait pas pu réaliser par sa seule initiative. Le fait que des modes peuvent être réellement utiles et ne servent pas seulement à remplacer arbitrairement d’autres modes, mais qu’elles s’attaquent à des coutumes néfastes et à des préjugés malfaisants, prouve qu’elles ne sont pas toujours l’invention de fous. La trop fréquente adoption de modes pernicieuses démontre qu’elles sont plus souvent suivies par des fous que par des sages. Il y a autant de sagesse à suivre une mode qu’à l’inventer lorsqu’elle est sage, mais elle n’est pas sage en soi, elle l’est par ses conséquences. Celle qui introduisit l’usage du tabac apporta aux hommes une de leurs coutumes les plus néfastes. Celle qui leur apprit à manger des pommes de terre leur rendit un service immense.
Comment naît la mode ? D’après ce qui précède, il semblerait qu’elle est l’unique produit de la fantaisie de certains dont l’intérêt plus ou moins légitime est de la créer. La question est plus compliquée, surtout en ce qui concerne les formes usuelles de la vie. Si l’intérêt des inventeurs de la mode est toujours en jeu, il est soumis à des considérations multiples et souvent à des raisons économiques qu’on ne peut négliger si on veut réussir. On ne peut, par exemple, lancer la mode d’une marchandise dont il n’y aura pas abondance sur le marché. Il faut donc tenir compte de la production des matières premières, de la facilité de se les procurer, de la concurrence qui se les dispute, des moyens de les manufacturer et de les rendre plus ou moins avantageuses pour le fabricant et pour le consommateur. La mode sera alors aux meubles anciens ou modernes, en bois clairs ou sombres, aux ustensiles de cuisine en cuivre, en fonte ou en aluminium, aux étoffes de soie, de laine ou de coton, au linge blanc ou de couleur, aux fourrures, à la paille ou à la plume, aux coiffures compliquées de postiches ou aux cheveux coupés, etc.
Dans les, limites très larges de ces considérations de caractère économique, la mode n’a pas d’autre loi que le caprice de ceux qui l’inventent et la passivité de ceux qui la suivent. Le champ du caprice est d’autant plus vaste que, quoiqu’on puisse en dire, le véritable sentiment du beau, pas plus que celui de l’utile, n’a de rapport obligé avec la mode. Le sentiment de la beauté change avec la mode, ce qui exclue de celle-ci la véritable beauté (voir ce mot). L’esthétique, formule plus ou moins conventionnelle de la beauté et qu’il ne faut pas confondre avec elle, est au contraire souvent tributaire de la mode. « Les femmes n’ont que le sentiment de la mode et non celui de la beauté », a dit Th. Gautier. On peut en dire autant des hommes que la mode, dans bien des cas, rend ridicules alors que les femmes ne sont que disgracieuses. La vrai beauté est tellement étrangère à la mode que, du jour au lendemain, celle ci fait paraître grotesque ce qui était tenu la veille pour le dernier mot du bon goût et de l’élégance. La belle femme, qu’on admire dans le costume du jour, paraitrait laide si elle se montrait, en 1930, avec les manches à gigot et la « tournure » d’il y a quarante ans, ou dans la crinoline de sa grand-mère ; mais elle repartirait belle et désirable dans ces vêtements s’ils redevenaient à la mode.
La mode, en multipliant les variétés de la parure, est avant tout un excitant sexuel que les plus prudes ne dédaignent pas. On a dit, en la considérant, que le XIIIème siècle avait été celui de la poitrine, le XIXème, celui de la croupe, et que le XXème était celui de la jambe. Tous sont du bas-ventre, et l’esprit s’y mêle rarement. Au temps où « l’abondance » est de mode, seins en caoutchouc ou en satin, fesses en crin et mollets en carton corrigent les anatomies insuffisantes et multiplient les rotondités. Le XXème siècle est celui de la femme plate, dont l’allure est appelée « sportive ». Certaines vont jusqu’à faire « raboter » par des « chirurgies esthétiques » des seins qui les gênent pour conduire une automobile ou des mollets qui déforment leur ligne quand elles jouent au tennis.
La mode, en déplaçant ou en supprimant toutes les notions de la beauté et de la morale, révèle mieux que tous raisonnements ce que ces notions ont de conventionnel, pour ne pas dire d’inexistant. Quel sentiment de la beauté peuvent posséder ces dames d’âge canonique qu’on appelle aujourd’hui des « barbonnes », qui exhibent des chairs tombantes et faisandées, et ceux qui les admirent parce qu’elles suivent la mode, alors qu’ils railleront au contraire une femme fraiche montrant des nudités radieuses dans un costume démodé ? La mode abolit ainsi, non seulement tout sens esthétique, mais aussi tout sens moral en fournissant la preuve de la fausseté d’une morale qui est toute de circonstance. Ainsi se vérifie l’exactitude de cette observation de Molière que : « L’hypocrisie est un vice à la mode et tous les vice à la mode passent pour des vertus ». Suivant les latitudes et les mœurs, les femmes cachent ou couvrent des parties différentes de leur corps. Qui se permettrait de soutenir que l’africaine, voilant son visage et découvrant son derrière, est plus impudique que l’européenne montrant le premier et couvrant plus ou moins le second ? Les femmes les plus impudiques sont celles qui sont les plus voilées. C’est des couvents que sont sorties les lupercales et les bacchanales ; c’est dans les couvents que l’ange, descendant plus bas que la bête, s’est livré aux pires orgies et a pratiqué les plus ingénieuses dépravations.
Gresset a dit :
Désir de None est cent fois pis encore. »
Chaque fois que la nature est endiguée dans son cours régulier et normal, elle devient un torrent furieux qui emporte tous les barrages du conformisme. Les prêtres luperques et les bacchantes de l’antiquité, les ensoutanés modernes, n’ont été et ne sont si excités que parce qu’ils ne pouvaient et ne peuvent encore satisfaire normalement leurs besoins sexuels, l’hypocrisie religieuse prétendant leur imposer une abstinence contre nature. Leurs sermons furieux contre ce qu’ils appellent le « dévergondage de la mode » n’ont pas d’autre raison. Les modes les plus sages sont, sur ce chapitre, celles qui n’entravent ni ne surexcitent la nature.
La Bruyère a dit :
« Une chose folle et qui découvre bien notre petitesse, c’est l’assujettissement aux modes quand on l’étend en ce qui concerne le goût, le vivre, la santé et la conscience. »
Si on ne considère que la santé, combien la mode lui a été souvent nuisible ! Un ministre de Charles X constatait que « les femmes coquettes n’ont jamais froid ». Elles n’en sont pas moins la proie de la maladie dès qu’un refroidissement de la température se produit. À Paris, les dix premiers jours de février 1929, durant lesquels le froid fut particulièrement rigoureux, virent 2684 décès au lieu de 1335 suivant la moyenne habituelle. On voit la femme coquette trottant sous l’averse, les jambes presque nues dans des bas transparents et les pieds dans des souliers découverts rapidement transformés en cuvettes où ils trempent dans un bain glacé. La grippe, que cette crânerie inutile ne désarme pas, emporte parfois cette femme en quelques jours. Les talons hauts, le corset, détraquent chez les femmes les organes profonds et les préparent à des’ maladies redoutables. Une alimentation incohérente, l’usage des fards, des teintures et des stupéfiants ajoute encore a tous ces dangers. Après la guerre « régénératrice » de 1914, la mode a fait prendre aux femmes l’habitude du tabac, et elles y ajoutent aujourd’hui le goût de l’alcool absorbé sous forme de mixtures, appelées « cocktails », qui sont le plus sûr et le plus rapide moyen d’abrutissement « distingué » inventé par la folie humaine après lès trémoussements hystériques du « dancing ».
Plus un peuple est primitif, moins ses modes sont changeantes. Les peuples primitifs qui demeurent encore ont des modes remontant à leurs origines, les progrès d’une civilisation qu’ils ignorent n’ayant pas développé chez eux le besoin de les varier. Comme les animaux qui en sont réduits aux moyens de séduction de leurs premiers parents, les primitifs ont gardé les premières modes ; mais si un nouvel artifice est mis à leur portée, ils s’empressent de l’adopter. Ils « font le beau » en arborant un vieux gibus ou des jarretelles qui ne soutiennent aucune chaussette, et en baragouinant le jargon des « mocos » qui vont les « civiliser » ; tel Vert-Vert paraissant : « Beau comme un cœur, savant comme un abbé », en répétant les incongruités apprises des dames Visitandines et des bateliers de la Loire. On constate ainsi que l’esprit d’imitation est chez l’homme comme chez l’animal et dans des conditions aussi primitives ; II est à la base de la mode avec le besoin de paraître. D’abord adaptée au climat, aux ressources des différents pays et aux nécessités locales, la mode s’est transformée, avec les relations, pour des buts de plus en plus futiles. La civilisation lui a fait prendre un caractère cosmopolite de plus en plus étranger aux vrais besoins des individus, les obligeant à une adaptation antinaturelle et les mettant toujours plus dans l’incapacité de vivre suivant un goût personnel.
Les raisons économiques dont nous avons parlé ne suffiraient pas pour susciter les différents changements de la mode au gré de ceux qui l’exploitent. Toutes sortes de motifs, les plus abracadabrants, leur viennent en aide, fournis par la badauderie publique elle-même. Ainsi, il y a trente ou quarante ans, à Londres, un jour de courses de chevaux, la pluie s’étant mise à tomber, le prince de Galles retroussa les bas de son pantalon. Immédiatement tous les élégants qui l’entouraient l’imitèrent, et la nouvelle, transmise par le télégraphe, fit retrousser les bas de pantalon de tous les élégants du monde. Depuis, il est, toujours des gens pour qui il n’a pas cessé de pleuvoir à Londres. Une reine, même authentique, qui n’est pas des halles ou de théâtre, est femme avant d’être reine ; « la garde qui veille aux barrières du Louvre » ne la détend pas plus de la coquetterie que de la mort. Si elle a de belles épaules, de belles jambes, elle voudra les montrer. Si, au contraire, ses épaules sont maigres et ses jambes difformes, elle les cachera. Il n’en faut pas plus pour fixer les modes de tout un règne, pour que les corsages soient décolletés ou fermés et pour que les robes soient courtes ou longues. Des centaines d’exemples semblables pourraient être cités, montrant la badauderie des gens soumis aux caprices de la mode et leur assujettissement à l’ostentation vaniteuse de leurs maitres. Que peut-on attendre des cervelles qu’occupent de pareilles futilités et des foules attirées par elles qui s’écrasent dans les grands magasins, les jours de « réclame » ?...
C’est le snobisme (dont nous reparlerons au mot paraître) qui entretient l’état d’esprit favorable à la mode. On aurait tort, de croire qu’il ne se manifeste qu’à partir d’un certain niveau social et qu’il caractérise une aristocratie ; on le rencontre dans toutes les classes et il n’a que des différences de qualité. Les riches paient plus cher, les pauvres ont les rogatons à bon marché ; il y a autant de sottise chez les premiers faisant rectifier chaque jour le pli de leur pantalon par le grand tailleur, ou allant bailler à une musique dépassant leur intelligence, que chez les seconds endossant les confections interchangeables du « décrochez-moi ça », et empuantissant leur cerveau des mélasses de la chanson à la mode. Le dandy Brummell faisait l’admiration de la Courtille comme des salons. Les Pétrone, « arbitres de l’élégance », qui ont des millions à dépenser mais ne paient pas leur blanchisseuse, changent plusieurs fois par jour de costume, de cravate, de chapeau, de chaussures et de gants. Combien d’ouvriers et d’employés à l’exemple de ces gens « chics », de ce « gratin supérieur », se croiraient déshonorés si, comme au temps de leurs grands-pères, ils devaient se transmettre d’une génération à l’autre le vieux « grimpant » familial ?
D’anciennes rondes d’enfants chantaient :
J’aurai sa vieille culotte ;
Quand mon grand papa mourra,
J’aurai sa culotte de drap. »
Béranger, faisant une chanson sur le vieil habit qu’il brossait depuis dix ans, serait aujourd’hui tout à fait ridicule. Combien laisseraient passer « l’heure de la révolution » si elle arrivait avant qu’ils eussent fait leur nœud de cravate ?...
Au temps de la « guerre en dentelles » il était plus honorable de se faire battre que d’aller à la bataille avec une perruque mal poudrée. On a raconté que dans la première année de la « Grande Guerre », les Anglais se laissaient surprendre dans leurs tranchées où les Allemands les trouvaient occupés à se faire la barbe. Ces choses sentaient peut-être leur « gentilhomme », leur « gentleman », elles pouvaient être très « smart », très « snob », elles n’étaient pas de circonstance. Il n’est pas non plus de circonstance, pour des prolétaires, de se laisser gagner par les puérilités de la mode. Elles peuvent avoir leur intérêt pour les oisifs qu’elles distraient, pour les cabotins qu’elles mettent en évidence, pour les mercantis dont elles font la fortune ; elles sont dangereuses pour les prolétaires en ce qu’elles les entrainent à rechercher des satisfactions dont ils sont les premières victimes. Que la mode soit à l’hygiène, nous y souscrivons ; il est nécessaire que tous les hommes apprennent à se tenir proprement et à défendre leur santé ; mais trop souvent la mode est niaise et corruptrice, La jeunesse ouvrière doit être en garde contre ses tentations si elle veut, faite aboutir l’œuvre de transformation sociale ; elle doit savoir que la véritable élégance n’est pas dans le vêtement au dans tel ou tel jargon de bar et de dancing, mais qu’elle est dans la pensée et dans les actes. On peut être un gentilhomme sous la cotte de l’ouvrier ; on peut être un voyou dans le smoking le plus impeccable. On ne le voit que trop tous les jours.
Ce n’est pas, pourtant, que le monde ouvrier manque d’occasions de réfléchir sur la mode et sur ses méfaits qui sont ceux de l’exploitation humaine organisée. Les exemples abondent autour de lui, dans les ateliers où sévissent le sur-travail, l’insuffisance des salaires, le chômage et toutes les misères ouvrières. N’est-ce pas dans, les industries de la mode que ces misères sont les plus cruelles ? Combien de fois n’a t-on pas fait le tableau lamentable du sort des ouvrières en chambre ? Les fictions poétiques sont insuffisantes pour donner le change. Jenny l’Ouvrière est définitivement morte de phtisie, à côté de son pot de fleurs, malgré tout le chiqué romantique dont on a entouré la pâle vie de bohème. Il y avait encore Mimi Pinson et sa chanson ; on en a fait un usage si écœurant pendant la guerre qu’elles ont été emportées dans la boue patriotique des beuglants. Il reste les « midinettes », les « cousettes » et leurs sœurs les « dactylos » que le soucis de se pourvoir de poudre, de rouge et de noir pour leur maquillage, de porter le dernier chapeau et la dernière robe, prive de la nourriture substantielle nécessaire à leur santé. Les agences de prostitution, en font des « poules », des « miss », des « reines de beauté », des « star de cinéma » qui prennent plus souvent le chemin de Buenos-Aires que celui de la fortune. Une classe ouvrière ayant simplement le souci de la dignité humaine ne doit-elle pas se dresser farouchement contre une mode qui fait un tel emploi de ses filles ?
On appelle plus particulièrement modes (au pluriel) la confection des chapeaux de femmes mais ce terme englobe tout ce qui est du costume et des accessoires de l’élégance féminine. Au XVIIIème siècle, l’Almanach général des Marchands en donnait cette définition : « le nom qu’on donne à certaines marchandises dont les formes et l’usage sont essentiellement soumis aux décrets suprêmes, mais changeants, du caprice et du goût ». Le même Almanach énumérait les objets des « modes ». Ils comprenaient toutes les formes de costumes, de coiffures, de chaussures, jusqu’aux habits de cour et de théâtre en passant par tous les accessoires de la parure : sacs à ouvrages, nœuds d’épée, cordons de montre et de canne, bourses à cheveux et bourses à argent, guirlandes, manchons, gants, éventails, etc. De tout temps, les modes ont été composées d’attributs de ce genre pour compléter et varier l’agrément du costume. Elles sont aussi anciennes que les premiers vêtements dont se couvrirent les hommes et, s’il est exact qu’ils se vêtirent lorsqu’ils « connurent qu’ils étaient nus », comme le dit la Bible, on peut ajouter que les modes sont nées avec l’hypocrisie sexuelle. El les n’ont pas cessé d’être sous sa dépendance en multipliant sa parure, masque agréable que prend toujours le « tentateur » des premiers hommes.
Des ouvrages spéciaux ont décrit les modes à travers les âges et étudié l’histoire du costume dans toutes ses formes. Nous ne referons pas cette étude. Signalons seulement certaines modes particulièrement excentriques qui devaient être, bien souvent, singulièrement gênantes et ridicules. Après le costume grec, puis romain,qui fut, de tous, le plus simple et le plus élégant, le moyen-âge et les temps modernes se livrèrent à des complications extrêmes. On vit les robes longues et étroites du moyen-âge, puis celles en cloches du XVIème siècle et les paniers de plus en plus larges des XVIIème, et XVIIIème. La crinoline fut une sorte de compromis entre ces excentricités et les robes étroites et courtes d’aujourd’hui. La coiffure connut les différentes transformations des postiches, depuis les cheveux blonds des Gaulois, dont les dames romaines étaient entichées, jusqu’aux « chichis » de nos jours, en passant par tous les genres de la perruque. Le XIVème siècle vit les modes cornues, que Michelet appelait « immondes », du hennin sur la tête des femmes, des souliers à la poulaine aux pieds des hommes.
À partir du XVIIème siècle, les modes prirent, en France, une importance qui devait arriver à en faire un « art national ». Les modistes de Paris, appelées alors « dorlottières », eurent une influence universelle dans le domaine du chapeau ; les modes de Paris devinrent celles de l’Europe entière. Fait curieux, au XVIIIème siècle, alors que le costume masculin se simplifiait à l’imitation des modes anglaises jusqu’à arriver à la tenue sévère du quaker américain, le costume féminin se compliquait à l’extrême pour atteindre à l’extravagance des robes à grands paniers et des coiffures en échafaudages, véritables monuments d’architecture qu’on appelait des « poufs ». On voyait le « pouf au sentiment » où l’on plaçait l’image de celui qui était aimé. La duchesse de Chartres faisait tenir dans ses cheveux « son nègre, son perroquet et une femme assise dans un fauteuil et portant un nourrisson, en l’honneur du duc de Valois et de sa nourrice ». La duchesse de Lauzun exhibait tout un paysage en relief : « mer agitée, chasseur tirant des canards, moulin dont la meunière se faisait courtiser par un abbé et, tout au bas de l’oreille, on voyait le meunier conduisant un âne ». Il y eut le « pouf à la circonstance », pour flatter les jeunes souverains ; « un soleil levant éclairait un champ de blé que moissonnait l’Espérance ». Le « pouf à l’inoculation » célébrait l’opération subie par Louis XVI et les princes. Le « pouf à la frégate » portait un navire de guerre pour rendre hommage au bailli de Suffren. Le « pouf de la victoire » consolait des défaites subies par les Soubise et autres maréchaux de France.
Les arts de la mode furent à leur apogée au temps de la reine Marie-Antoinette et l’on vit s’installer à Paris « les faiseurs de mode ». La plus célèbre était Mlle Bertin ; elle tenait boutique à l’enseigne du Grand Mogol et fournissait la reine. Sa faveur était telle à Versailles que l’étiquette de cour en était bousculée, au grand scandale des « dames du service royal » dont les protestations étaient vaines. Personne n’osait s’insurger contre le véritable pillage des deniers publics qui se pratiquait pour payer les mémoires toujours plus élevés de Mlle Bertin et des autres fournisseurs de la cour. Le luxe de la reine et de la noblesse, l’ostentation qu’on mettait à l’afficher, ne furent pas parmi les moindres causes de l’irritation populaire à la veille de 1789. M. de Nolhac, dans son livre : Autour de la reine, a donné des détails particulièrement suggestifs sur les dépenses somptuaires de la cour et sur la garde-robe de Marie-Antoinette, de même que sur la modiste, Mlle Bertin et le coiffeur Léonard, véritables rois de l’époque.
Depuis, les modes se sont peu à peu démocratisées. Leur clientèle se multipliant, les « faiseurs de modes », couturiers et modistes, sont demeurés rois dans la République, comme ils l’étaient jadis. Le syndicalisme a encore tout à faire pour défendre les travailleurs de la mode contre ces féodaux de la frivolité.
La royauté impérieuse et universelle de la mode en fait un des éléments les plus actifs et les plus productifs du commerce. Aussi, les commerçants ne manquent pas de la courtiser, d’entretenir ses caprices et, pour mieux réussir, de la diriger. Ils ne cessent de lui trouver des séductions nouvelles. La publicité, sous toutes ses formes, a en elle sa principale clientèle et les journaux sont au premier rang pour cette publicité. Des pages entières sont consacrées à la réclame des grands magasins dans les quotidiens. La mode a, en outre, à son service, une foule de journaux spéciaux et des plus luxueux. Il y avait eu, aux XVIème et XVIIème siècles, des livres de costumes. Le premier journal de mode fut, à Paris, le Mercure Galant qui devint le Mercure de France. En 1829, Émile de Girardin fonda, sous le patronage de la duchesse de Berry, une revue hebdomadaire qu’il appela La Mode et qui devint, en 1856, la Mode Nouvelle. Les journaux de ce genre se sont multipliés depuis, tant à l’étranger qu’en France, et le ton de la mode, sous toutes ses formes, y est donné par des écrivains spécialisés tant dans la philosophie la plus transcendante que dans l’art de faire une omelette ou d’élever des lapins. Le bergsonisme y voisine avec la fabrication de la pâte à rasoir.
La mode est, en définitive, dans tous ses avatars, la manifestation de l’esprit grégaire des individus soumis aux disciplines sociales et incapables de se manifester eux-mêmes. Elle est la règle de vie de ceux qui n’en ont pas personnellement, qui ont besoin d’un régent pour leur pensée comme pour leur costume et ne sauraient vivre sans tailleur, sans coiffeur et sans chemisier comme sans journal, sans gendarmes et sans gouvernement.
– Édouard ROTHEN.
MODE
Le Larousse s’étend assez longuement sur ce mot : Manière individuelle, qui consiste à agir à sa fantaisie : « Chacun vit à sa mode », dit-il. Ne retenons que cette phrase pour nous entendre sur le mot : Mode. Il y a, dit-on, un certain ridicule à fuir la mode et il y en a autant à l’affecter. Pour être au-dessus de tout cela, disons de suite que la mode est peu dans nos soucis. L’homme qui pense laisse à d’autres le soin de suivre la mode. Raisonnablement, nous estimons chacun libre de vivre comme il lui plaît et nous pratiquons la plus large tolérance sur ce point. S’il est pour certains hommes un besoin de se faire remarquer par toutes sortes de manières étranges de penser, de parler, d’agir... libre à lui. L’essentiel est qu’il ne m’oblige pas à subir ce qui me choque et qu’il me soit toujours possible de l’éviter. Que d’autres aiment à porter lorgnon, lunettes, monocle, sans en avoir besoin, cela ne me gêne pas plus que ne me gênent ceux qui portent cravates gigantesques, chapeaux à larges bords, bottes et culottes bouffantes. Tout cela n’a guère d’importance. Selon l’humeur où l’on se trouve, on s’en amuse plus qu’on ne s’en émeut. Soyons pitoyables à tous, même à ceux que nous jugeons excentriques et qui, peut-être, nous jugent de même. Pourvu que ce soit avec la même tolérance, c’est ce qu’il faut souhaiter. Je passe outre aux modes féminines. Il y aurait trop à dire et vraisemblablement, serions-nous mal placés pour en parler comme il faudrait. Incontestablement, la femme est esclave de la mode, même dans la classe ouvrière. Que de femmes sont loin de prendre de la mode ce qu’elle a de bon quand elle en a. Mais les hommes ont-ils regardé la poutre de leur œil sur la mode ? Par exemple : le peu d’empressement qu’ils ont à se débarrasser de ce qui les incommode, parce que la mode est de le porter ? Je n’insiste pas.
Aussi bien, il n’y a pas que les manières de vivre, de se comporter, de s’habiller, de se conduire qui changent de mode. Il n’y a pas que les mœurs et les habitudes, il y a aussi les idées.
Certes, je ne prétends pas qu’il y a forfaiture à changer d’idées. Il est certain que bien des hommes d’un certain âge n’ont pas les idées qu’ils avaient à vingt ans. Qu’ils aient tort ou raison, c’est un fait. Mais où cela me paraît blâmable, c’est quand il est avéré que ces hommes se vantent d’avoir varié, sans donner d’autre motif que celui-ci :
« La mode change ! À vingt ans, j’avais les idées à la mode. Quel est le jeune homme généreux qui n’a pas été anarchiste à vingt ans ? »
Pour oser de telles déclarations, il faut ne pas avoir crainte d’étaler son peu de conviction. Ils peuvent appeler cela de la franchise. Ils n’empêcheront pas qu’on puisse penser que c’est du cynisme, tout simplement et qu’il est bien permis de croire que ces hommes si variables ne furent et ne sont nullement sincères. D’ailleurs, on les remarque surtout dans le journalisme et dans la politique, mais assez rarement dans le monde ouvrier ; c’est du moins mon avis. Eh quoi ! est-ce par mode que tant de camarades assez connus n’ont jamais abandonné leurs idées et s’y sont conformés toute leur vie – courte ou longue – quelles qu’en fussent les désillusions et les déboires, n’aimant à se souvenir que des beaux jours d’enthousiasme et de foi en leur radieux idéal. Ils vieillissent aussi ces hommes, mais leur idéal qui ne vieillit pas leur laisse jusqu’à la mort un cœur toujours jeune. Or, cela est une richesse inappréciable, ignorée des hommes qui ont cru posséder des idées mais qui s’en étaient simplement affublés parce que c’était la mode. Est-ce aussi parce que c’est la mode que, du jour au lendemain, quelques-uns changent d’idées et vont d’un extrême à l’autre ? Que dire de ces hommes, hier libertaires et aujourd’hui aspirants, disent-ils, à une dictature quelconque ? Est-ce aussi la mode qui produit de telles conversions ? En ce cas, plaignons ces pauvres esclaves de la mode, et n’en parlons plus.
Il y a une mode qui ne passera pas, hélas ! c’est celle de n’avoir d’idées qu’autant qu’elles flattent la vanité ou concordent avec les intérêts de ceux qui en changent si facilement !
– G. YVETOT.
MODERNE
adj. et n. m. (bas latin modernus)
Moderne s’oppose à ancien ; il désigne ce qui est récent, ce qui est nouveau. Mais l’imprécision d’un terme si vague, utilisé arbitrairement dans des conditions très opposées, ne doit pas nous détourner de l’examen des problèmes qui se posent à son sujet. Deux surtout méritent d’être retenus : l’un, d’ordre philosophique, s’apparente étroitement à celui du progrès humain ; l’autre, d’ordre historique, concerne les discussions survenues, à toute époque, entre partisans des jeunes et partisans des vieux ou, plus exactement (car certains vieux restent toujours jeunes et certains jeunes se classent très tôt parmi les fossiles) entre partisans de l’esprit ancien et partisans de l’esprit nouveau.
Les politiciens ont tellement abusé du mot progrès (voir ce mot) qu’il est devenu suspect à beaucoup. Non sans raison, car les vocables les plus sonores, ceux qui suscitèrent le plus d’enthousiasme et pour lesquels le sang humain fut même répandu à flots, ne recouvrent souvent que d’imaginaires abstractions ou une absence totale d’idée. Mais, laissant de côté les creuses phraséologies, l’on peut se demander si, dans l’ordre intellectuel, artistique, moral, dans l’ordre matériel aussi, l’homme moderne est en progrès sur ses ancêtres, si le trésor des connaissances intellectuelles s’est accru sensiblement au cours des temps historiques et préhistoriques, en un mot, si l’âge d’or, pour notre espèce, doit être placé à l’origine ou à la fin. Selon la Bible, Adam fut créé parfait physiquement et moralement ; c’est en punition de sa désobéissance qu’il sera plus tard astreint au travail, condamné à souffrir et à mourir, ainsi que ses descendants. Ce souvenir de l’Éden primitif qui faisait dire à Lamartine que « l’homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux », a longtemps empêché la vérité de se faire jour. Pour les penseurs chrétiens, c’est à l’origine qu’il faut sans conteste, placer l’âge d’or de l’humanité. Mais la science a infirmé absolument cette manière de voir et démontré que nos premiers ancêtres étaient plongés dans une complète barbarie. À l’origine, ainsi que le poète latin l’avait dit avec infiniment plus de vérité, « lorsque certains animaux, troupeau muet et hideux, furent sortis en rampant sur les terres nouvelles, ils combattirent pour du gland et des tanières, avec les ongles et les poings d’abord, ensuite avec des bâtons, puis avec les armes que l’expérience leur avait fait fabriquer ». L’homme n’a pas échappé à la loi naturelle de l’évolution, et c’est grâce à une série de transformations successives qu’il est devenu, même physiquement, ce qu’il est aujourd’hui. Après la découverte du pithécanthrope faite à Java, en 1891, par le docteur Dubois, le doute n’était déjà plus permis ; l’on était en présence d’un type intermédiaire, au point de vue de la capacité crânienne, entre l’homme et les plus perfectionnés des anthropoïdes. Aujourd’hui, le problème est définitivement tranché. Des fouilles effectuées aux environs de Pékin ont permis, récemment, d’extraire d’importants restes fossiles appartenant à des individus très voisins du pithécanthrope. Ainsi le docteur Dubois n’avait point trouvé le crâne d’un monstre, comme le répétaient en chœur les écrivains spiritualistes ; ils s’agissait bien d’une race humaine très inférieure. Le piquant de cette découverte, c’est qu’elle ait eu lieu à une époque où de pseudo-savants s’efforçaient de discréditer le transformisme ; mais, naturellement, la grande presse n’en a soufflé mot, et des revues qui se prétendent sérieuses feignent encore de l’ignorer. Le progrès est donc manifeste dans le domaine cérébral ; il ne l’est pas moins si l’on compare l’outillage des époques préhistoriques avec celui du XXème siècle. « Quand les écrits manquent, les pierres parlent », disait Boucher de Perthes, que les savants d’alors raillèrent sans pitié, parce qu’il déclarait taillées de main d’homme les haches en silex du quaternaire. Or les premiers instruments en pierre témoignent que nos ancêtres vécurent, à l’origine, dans un dénuement complet. Sans doute l’évolution ne s’est pas faite en ligne droite, mais en zigzag ; elle a connu des arrêts et des reculs ; il est incontestable pourtant qu’en matière de confort les modernes sont plus favorisés que leurs prédécesseurs de l’époque chelléenne ou tardenoisienne, et même d’époques beaucoup plus rapprochées. Au point de vue artistique et moral, le progrès n’est pas aussi net ; plusieurs parlent de régression, sans qu’on puisse leur donner complètement tort. Résultat d’un effort collectif, continué de siècle en siècle la science voit grossir indéfiniment le trésor de ses certitudes ; un étudiant moderne d’esprit très ordinaire, en sait plus que Torricelli en physique, plus que Lavoisier en chimie. Par contre, l’art n’implique pas la même impersonnalité ; il dépend surtout de la valeur individuelle. Le vieil Homère ne fut éclipsé ni par Dante, ni par Hugo ; Phidias dépasse encore les sculpteurs actuels ; et peu de peintres modernes supporteraient la comparaison avec Raphaël ou Michel-Ange. Néanmoins, même en matière artistique, il y a progrès dans la technique. Et j’ai cherché à établir qu’en morale une observation impartiale conduit à des conclusions semblables : « Non que les hommes soient meilleurs : pour l’affirmer, il serait indispensable de lire dans les cerveaux ; mais les problèmes sont posés de façon plus équitable et les solutions admises s’avèrent d’une efficacité supérieure ». (Par delà l’Intérêt.) Ainsi les modernes sont incontestablement plus favorisés que les anciens à de nombreux points de vue ; l’antiquité d’une croyance ou d’une tradition ne prouve pas en sa faveur ; loin d’être une tare, la nouveauté serait plutôt un mérite. Pourtant il convient de s’entendre à ce sujet. Un élève moyen, un cancre même, qui usa de nombreux fonds de culotte sur les bancs des écoles, saura bien des choses qu’Archimède, que Newton, qu’Ampère ignoraient ; un chirurgien actuel, dépourvu dé talent, réussira des opérations qu’Ambroise Paré n’eut pas osé faire. Dira-t-on de l’élève et du chirurgien moderne qu’ils sont supérieurs aux génies que je viens de nommer ? On reconnaîtra sans peine que les seconds furent des géants capables, par leurs découvertes d’enrichir la science humaine, alors que les premiers sont des nains, aptes seulement à utiliser ce que d’autres inventèrent. L’évolution ne place pas tous les êtres d’une époque sur un plan identique ; entre certains, elle maintient un abîme. De même qu’un paysan du Xème siècle l’emporterait sur un gorille du XXème, de même un Descartes, un Kant resteraient supérieurs de cent coudées à l’immense majorité des modernes qui s’occupent de philosophie. Ne soyons donc pas de ces rétrogrades incorrigibles, des ces antiquaires de l’esprit qui collectionnent pieusement de vieilles idées, comme d’autres collectionnent de vieux vases. Aimons les choses nouvelles, mais soyons reconnaissant aux anciens qui, au prix d’un labeur méritoire, nous ont permis d’être ce que nous sommes, de savoir ce que nous savons. Et, délaissant toute forfanterie, admettons de bon cœur que parmi ceux qui nous précédèrent, que parmi ceux qui portent des cheveux blancs il en est qui nous sont très supérieurs.
Il suffit, d’ailleurs, et nous abordons ici le côté historique du présent travail, de jeter les yeux sur le monde actuel pour apprendre, hélas ! que moderne n’est pas toujours synonyme d’esprit nouveau, et que jeunesse est loin d’être l’équivalent fatal de supériorité. Constatation, pour moi, d’autant plus pénible que j’ai pour les générations qui montent une profonde affection. Trop de jeunes, aujourd’hui, ont un cerveau pétrifié ; religion, militarisme, réaction sous toutes ses formes, recrutent parmi eux leurs propagandistes et leurs adhérents. Après l’effort scientifique du XIXème siècle, il semble qu’une vague de mysticisme se soit abattue sur ceux qui grandirent avant 1914, et qu’une vague d’arrivisme l’ait remplacée depuis 1918. Leurs aînés eurent parfois une autre allure ; et nous n’oublions pas le rôle joué par la jeunesse dans certaines révolutions. Ne désespérons pas de ceux qui vont suivre ; aidons autant qu’il est en notre pouvoir l’éclosion des tendances libératrices dans les cerveaux encore tendres qui s’ouvrent à la lumière. Si, passant des individus aux collectivités, nous considérons les peuples qualifiés modernes, les États-Unis, par exemple, le spectacle s’avère non moins affligeant. Dans ce pays, cité comme modèle, l’amour de la liberté ne va pas jusqu’à permettre de critiquer la Bible ou d’enseigner le darwinisme ; la royauté du dollar s’impose sans discussion et, comme de juste, la superstition règne en maîtresse. Nul doute que le sol soit plus fertile, que les villes soient mieux construites, que le confort soit plus développé qu’en Europe, mais les âmes y sont aussi serves. Et les spécimens d’art américain, vulgarisés par le phonographe et le cinéma, achèvent de démontrer que l’extrême richesse matérielle peut s’allier aisément à une pauvreté cérébrale peu ordinaire. Pourtant beaucoup s’y laissent prendre parce qu’on prétend bien modernes des sottises et des horreurs qui, hélas ! sont de tous les temps. Il est vrai que pour tromper les électeurs simplistes, les dirigeants d’Europe, comme d’Amérique, qualifient nouvelles les plus vieilles ritournelles religieuses ou politiques. Si ce terme était employé dans un sens très précis, non d’après l’usage courant, seuls mériteraient l’épithète de, modernes les individus et les groupements dont la supériorité mentale se traduit par un complet mépris des préjugés régnants. À bon droit, certains jeunes seraient alors rangés parmi les représentants d’une faune antique, alors que des vieux compteraient parmi les spécimens de l’espèce la plus évoluée. Ce que l’histoire démontre, c’est que les hommes se sont toujours séparés en partisans de l’esprit ancien et en partisans de l’esprit nouveau. « Monarchie constitutionnelle, puis république symbolisèrent, en leur temps, des tendances extrémistes ; mais les précurseurs ont poussé plus loin, pendant que les monarchistes d’hier se muaient en républicains. Toujours, parmi les hommes, s’en trouvent qui retardent, tandis que d’autres avancent ; des uns comme des autres, les formules varient selon l’époque et le milieu. » (À la Recherche du Bonheur). D’où il résulte que les luttes qui mettent aux prises jeunes et vieux, doivent disparaître dans les groupements qui ne comportent ni gouvernants, ni gouvernés, ni pontifes, ni fidèles, mais seulement des frères pour qui les différences d’âge sont chose secondaire. Ces luttes n’ont de raison d’être que dans les partis, les églises ou les associations qui disposent de prébendes capables d’exciter l’envie. Nés plus tôt, nés plus tard, qu’importe, ils peuvent tous s’aimer ceux qui sont de la race des éternels persécutés, des éternels porte-lumière.
Fréquemment, mais d’une façon superficielle en général, les écrivains ont traité des querelles, renaissante presque à chaque époque, concernant les modernes et les anciens. Déjà Horace, un partisan des modernes, demandait ironiquement à ses contradicteurs combien d’années au juste étaient requises pour l’ancienneté. En France, Desmarets de Saint-Sorlin, qui se croyait appelé à défendre la religion en littérature ; Boileau, etc., se firent, au XIIème siècle, les défenseurs des anciens contre, Charles Perrault, l’auteur des Contes de Fées, qui déclarait catégoriquement et avec beaucoup de bon sens :
Mais je ne crus jamais qu’elle fut adorable...
Platon, qui fut divin du temps de nos aïeux,
Commence à devenir quelquefois ennuyeux...
Puis la dispute reprit, un peu plus tard, entre Mme Dacier, une admiratrice d’Homère, et Houdard de la Motte qui faillit la faire mourir de dépit. Les deux adversaires se réconcilièrent par la suite, à la table de M. de Valincourt. On sait que, dans la république des lettres actuelles, les moins-de-trente-ans, et même les moins-de-quarante-ans poussent de furieux jurons à l’adresse des vieilles barbes qui peuplent les académies et détiennent les bonnes places. Ces enfantillages me feraient rire, si je ne songeais que, demain, nantis d’honneurs et d’argent, ces révolutionnaires à l’eau de rose seront, à leur tour, les fermes soutiens de la tradition. Ceux-là, seuls, m’intéressent, quel que soit leur âge, dont le cerveau reste jeune constamment.
– L. BARBEDETTE.
MODERNISME
n. m.
Le modernisme fut une tentative pour mettre d’accord science et foi, pour adapter les manifestations de la vie religieuse à l’esprit du jour. C’est dans les derniers lustres du XIXème siècle et au début du XXème que ce mouvement se développa parmi les catholiques instruits ; le protestantisme libéral lui avait facilité la tâche et montré la voie. À partir de 1850 un certain nombre de pasteurs, dont le principal porte-parole fut T. Colani, de Strasbourg, s’efforcèrent d’accréditer une théologie rationnelle où le Christ devenait tout humain, où la Bible perdait son caractère infaillible. Schérer, Réville, Pécaut, militèrent en faveur de cette doctrine qui suscita révolte et scandale chez les protestants orthodoxes. Au synode de 1872, présidé par Guizot, la fraction libérale fut condamnée ; ses principaux champions furent exclus des chaires pastorales ; Athanase Coquerel fils, qui exerçait à l’Oratoire de Paris, fut destitué. Néanmoins, quelques années plus tard, lorsqu’on ouvrit une faculté de théologie à Paris pour remplacer celle de Strasbourg, deux professeurs de tendance libérale y purent enseigner. En 1879, E. Ménégoz déclarait, dans l’Évangile du Salut, que la croyance en des dogmes précis n’était pas requise pour être bon chrétien. Puis Harnack, le fameux théologien berlinois, fit accepter, dans le monde protestant, certains résultats de l’exégèse rationaliste ; l’Histoire des Dogmes et l’Essence du Christianisme comptent parmi ses principaux livres. Le philosophe américain William James utilisait le pragmatisme pour rénover l’apologétique chrétienne et publiait l’Expérience Religieuse. À Paris, le doyen de la faculté de théologie, Sabatier, écrivait son Esquisse d’une Philosophie de la Religion et un autre volume, publié seulement en 1904 après sa mort, Les Religions d’Autorité et la Religion de l’Esprit. Pour lui, les dogmes, déterminés par le milieu historique, ont seulement une valeur transitoire et symbolique. Ceux du christianisme, nés de cerveaux judéo-grecs, exprimés en langue grecque, ne furent que les symboles à travers lesquels les premiers fidèles exprimaient leur foi ; ils n’ont, en conséquence qu’une valeur toute relative. Le pasteur Wagner, fondateur du Foyer de l’Âme, en viendra à ne plus distinguer entre libres penseurs, juifs et protestants. Sans aucune doute, le modernisme catholique doit beaucoup aux travaux des écrivains que nous venons de citer. Il s’inspire aussi des recherches exégétiques que David Strauss, Édouard Reuss, Michel Nicolas, Ernest Renan avaient accréditées au XIXème siècle, précédés d’ailleurs dans cette voie par Spinoza, Richard Simon et même des écrivains dévots comme Tillemont, qui se bornait, il est vrai, à montrer l’absurdité de maintes légendes pieuses. C’est au cardinal Newman, qui eut la chance de mourir assez tôt pour n’être point condamné par Rome, que le modernisme emprunta l’idée de l’évolution des dogmes, idée qu’il avait exposée dans un Essai sur le développement de la doctrine chrétienne, paru en 1845. Ancien professeur d’Oxford, animateur avec Pusey du mouvement tractarien, il s’était converti au catholicisme en 1845. Accueilli à bras ouverts par Rome, qui comptait sur son influence pour ramener les anglicans à l’orthodoxie, il fut nommé recteur de l’Université catholique de Dublin et, plus tard, cardinal. Mais, en encourageant les penseurs catholiques à préciser comment les dogmes naissent et se transforment, il ouvrait la voie aux libres recherches historiques d’un Duchesne, d’un Loisy, d’un Batifol. Une encyclique de Pie X condamna le modernisme en 1907. (Voir l’article Néo-Catholicisme.) Parmi les membres du clergé particulièrement compromis beaucoup n’osèrent pas rompre avec Rome ; ce fut le cas des prélats Duchesne et Batifol, mais jusqu’à leur mort ils restèrent suspects aux autorités ecclésiastiques. Leurs ouvrages les meilleurs ne sont pas faits, il faut en convenir, pour affermir la croyance dans l’infaillibilité de l’Église. Tyrrel, Loisy, Houtin et d’autres ne se soumirent pas ; jamais pourtant ils ne songèrent à créer une nouvelle secte chrétienne. Le modernisme était et resta un mouvement scientifique. Malgré ses prétentions à l’immutabilité, le catholicisme a souvent changé son fusil d’épaule, se réclamant tantôt de Platon, tantôt d’Aristote, tantôt de Descartes, condamnant le lendemain ceux qu’il approuvait la veille, utilisant sans vergogne les idées à la mode, puis les rejetant dès qu’il y trouvait intérêt. Aussi les nouveaux réformateurs pouvaient-ils croire qu’ils rendaient service à l’Église en la débarrassant du poids mort des dogmes surannés. L’intransigeance de Rome mit fin à leurs espérances ; et, pour ma part, je ne le regrette pas, beaucoup de catholiques qui auraient continué d’admettre une foi rajeunie ont cessé de croire depuis. Mais si le pape affecte, officiellement du moins, de ne pas céder en matière dogmatique, il se montre, dans le domaine politique, d’un opportunisme qui donne une singulière idée du Saint-Esprit, son céleste inspirateur. Dans le Syllabus, Pie IX condamnait expressément les gouvernements populaires ; suffrage universel, république, socialisme étaient pour lui des inventions diaboliques. Dès 1891, Léon XIII conseillait aux catholiques français de se rallier à la république ; et l’on sait qu’aujourd’hui les démocrates chrétiens, sauf ceux d’Italie, sont particulièrement bien vus au Vatican. Le socialisme lui-même, depuis que son succès apparaît probable, ne semble plus aussi pernicieux aux rusés diplomates de Rome ; Marc Sangnier, couvert d’anathèmes par Pie X, se voit chaudement approuvé par Pie XI. Avant de condamner les communistes russes, le pape se montra tout miel à leur égard ; on n’a pas oublié les amicales conversations du nonce et de l’envoyé des Soviets, à l’époque où les bureaux du Vatican rêvaient d’étendre leur domination sur les orthodoxes russes, privés de chef suprême. Pie IX déclarait que, de siècles en siècles, ses successeurs excommunieraient les rois d’Italie, tant qu’ils n’auraient pas rendu à l’héritier de Saint-Pierre la totalité de ses États ; or le pape actuel n’a réclamé qu’un insignifiant lopin de terre pour se réconcilier avec la maison de Savoie. Il y a mieux ; Pie XI, imitant d’ailleurs en cela ses prédécesseurs, estime que bien et mal changent avec la latitude et le méridien ; alors qu’en France il condamne les royalistes et réserve ses faveurs aux cléricaux devenus républicains, en Italie, il favorise les fascistes et réduit au silence les démocrates chrétiens. En fait de politique, le Vatican cherche à utiliser tous les partis fort ; voilà bien du modernisme, et dans le plus mauvais sens du mot. À l’instar des pontifes de Rome, les prêtres ordinaires se montrent d’une adresse incroyable pour remplir leurs caisses et obtenir les faveurs des gouvernements successifs. Pour attirer les jeunes, ils créent des patronages, s’occupent de sport, ouvrent des cinémas. Chaque paroisse quelque peu importante possède un bulletin hebdomadaire, destiné aux adultes ; elle aura bientôt sa caisse de retraite, ouverte en conformité avec la loi sur les Assurances sociales. Selon le public auquel il s’adresse, le prêtre affecte aussi des allures différentes ; familier et bon enfant avec le peuple, il devient homme du monde dans les salons et se donne comme libéral et peu dévot lorsqu’il fréquente des incroyants. Dans cette manière d’agir il y a quelque chose d’antipathique et de méprisable ; je ne conseillerai à personne de prendre modèle sur les catholiques en matière d’hypocrisie. Souhaitons seulement que les esprits libérés ne manquent pas les occasions qui s’offrent de ruiner les faux prestiges ou les opinions surannées. Et s’ils ne peuvent éclairer pleinement leurs interlocuteurs, qu’ils les amènent du moins au degré de développement dont ils sont susceptibles. Spiritisme, occultisme, théosophie s’avèrent de médiocres illusions, et je ne conçois pas qu’une intelligence solide s’y laisse prendre longtemps ; mais, par rapport au catholicisme et aux autres Églises rigoureusement hiérarchisées, ils sont un moindre mal. Lorsqu’il s’agit d’hommes irrémédiablement religieux, incapables de dépasser le stade des chimériques consolations, obtenons qu’ils s’arrêtent à ces formes atténuées d’un mal trop vieux pour disparaître, chez tous, du premier coup. De nos multiples adversaires, n’oublions pas que la religion reste le plus solide et qu’il faut lutter contre elle sans désemparer.
– L. BARBEDETTE.
MŒURS
n. f. pl. (latin mos, moris, habitudes, règles)
Les mœurs se définissent comme des habitudes acceptées ou condamnées, du point de vue moral du bien et du mal. De là cette double désignation de bonnes ou de mauvaises mœurs, Si le bien et le mal correspondaient eux-mêmes à des critériums biologiques sûrs, on pourrait presque désigner les bonnes mœurs : des habitudes avantageuses ; et les mauvaises ; des habitudes nocives. Mais l’imagination humaine (surtout le mysticisme) a tellement perverti le sens naturel de la vie que les notions de bien et de mal elles-mêmes ne signifient plus rien et qu’il vaut mieux considérer les mœurs comme l’ensemble des habitudes concernant la vie d’un individu ou d’une collectivité. Ce sens plus précis, quoique plus général, peut alors s’appliquer à tout être vivant, possesseur d’un système nerveux, susceptible de construire des mécanismes de réflexes le déterminant à des comportements répétés appelés : habitudes (voir ce mot).
Le fait que les mœurs sont des habitudes devrait rendre prudent tout moraliste jugeant ou condamnant les mœurs des autres au nom des siennes, car les habitudes étant le résultat d’une infinité de circonstances et de causes, varient considérablement dans l’espace et dans le temps. Une science des mœurs parait donc quelque peu difficile, car il n’y a connaissance réelle d’un phénomène qu’après un nombre suffisant d’expériences complètes, embrassant la totalité du phénomène et permettant d’en déduire le processus réellement invariable.
Il serait d’autre part extraordinaire que l’être vivant, produit par des phénomènes mécaniques, puisse échapper à un certain processus mécanique, engendrant les divergences et différenciations des mœurs éparses à travers le monde vivant. Cela ne veut point dire qu’il y a un plan vital et une finalité incluse dans chaque habitude. Bien au contraire. L’étude des mœurs nous montre une grande incohérence dans leur manifestation et leur rôle surajouté, parfois opposé même au bon fonctionnement biologique de l’individu. Il est donc intéressant d’étudier l’origine et l’évolution des mœurs et d’essayer d’en dégager un enseignement pour notre propre évolution.
Une pareille étude nécessiterait une encyclopédie pour elle seule, car elle comprend toutes les manifestations humaines. Une description chaotique et sans ordre des différentes habitudes des divers peuples de la terre, bien que très instructive au point de vue comparatif, n’amènerait aucune conclusion autre que la suivante : il y a des peuples comme ceci ou comme cela et nous, nous sommes autrement. Il est donc nécessaire de démontrer que les divergences correspondent à des faits objectifs et que leur connaissance peut nous aider dans notre effort constructif.
D’autre part chaque peuple vit dans des conditions matérielles différentes et en des lieux différents, variant avec les siècles et les transformations telluriques ; ce qui complique l’étude des conditions agissant dans l’espace et dans le temps. Nous ne pouvons, ici, qu’esquisser très rapidement, et sans souci de chronologie précise, les multiples transformations des mœurs à travers les grandes périodes, de l’histoire.
Une des raisons principales qui devrait nous faire admettre les habitudes comme la source initiale des grands mouvements sociaux, c’est que l’espèce humaine, issue des mammifères supérieurs, ne pouvait avoir, à ces lointaines époques, aucune des coutumes reconnues chez les peuples actuels, même les plus primitifs.
Quelles pouvaient être les mœurs de ces êtres ? c’est ce que nous ignorerons probablement toujours. Ces mœurs avaient certainement quelque chose d’instinctif et d’héréditaire, déterminé par les principaux besoins de l’organisme et les difficultés rencontrées pour les satisfaire. L’examen des découvertes préhistoriques ne donne point d’ailleurs des indications précises sur cette partie réellement intéressante de notre évolution. Pourtant des habitudes collectives ont dû se former dès ces débuts puisque on les observe chez de nombreuses espèces animales. Tout ce qu’on est obligé d’admettre c’est que l’homme n’a point inventé un langage, un art, une industrie et des croyances semblables à ceux des plus vieilles civilisations sans un nombre prodigieux d’efforts accumulés et transmis de générations en générations. Mais de cet état primitif, voisin de l’animalité, à la vie du clan australien quel écart formidable ! quelle évolution ! Ici on trouve tout un ensemble de croyances, de coutumes, tellement enracinées profondément, qu’on en ignore les origines et le sens utilitaire. La vie du clan australien est coordonnée par les croyances totémiques, répartissant un certain nombre d’hommes, formant une tribu, en deux phratries, lesquelles à leur tour comprennent un nombre irrégulier de clans, formés eux-mêmes d’un nombre variable d’individus. Le totem (voir totémisme) est une sorte d’emblème mystique et sacré, généralement un animal, parfois un végétal ou tout autre chose, considéré comme l’ancêtre mythique de la tribu. Chaque clan et chaque individu a également son totem et il existe aussi des totems sexuels. Les rapports sexuels sont assez variés. Le mariage peut y être individuel mais exogamique, c’est-à-dire que l’union sexuelle est interdite entre membre d’un même clan ; elle n’est possible qu’avec ceux d’un clan voisin. Le mariage peut également avoir lieu par groupe, c’est-à-dire que tous les hommes d’un clan sont, de droit, les maris de toutes les femmes d’un autre clan, et réciproquement. Mais des coutumes variables, réglées par les anciens donnent une certaine instabilité à ces mœurs et selon les circonstances, l’homme tout en ayant sa femme habituelle, peut encore avoir plusieurs femmes de l’autre clan, ce qui est une combinaison des deux mariages. Inversement il arrive que plusieurs hommes ont une femme commune et des règles de préséance assurent les devoirs conjugaux, avantagés en faveur des aînés. Enfin de nombreuses fêtes, accompagnées de scènes érotiques, libèrent momentanément les êtres de ces conventions et permettent tous les accouplements. Le rapt de la femme avant la consécration du mariage, est une coutume brutale qui consiste en une fuite de la jeune fille, sa poursuite et une agression plutôt violente par le futur mari qui peut alors en prendre possession. Il arrive encore qu’en certains pactes d’alliance entre hommes, ceux-ci échangent leurs femmes qui deviennent communes à chaque groupe. Chose singulière, en diverses tribus, les jeunes filles nubiles sont déflorées, avant leur mariage, par les hommes même de leur clan qui ne pourront plus les approcher plus tard. (Voir mariage, mère, sexe, morale sexuelle, etc.).
La vie économique est assez primitive car l’Australien, uniquement chasseur, chasse par bande sur les territoires réservés à chaque tribu. Le sens de la propriété y est assez large, il y a des choses collectives comme le territoire et le gibier tué communément ; il y a la lutte appartenant à un groupe plus limité ; enfin les armes et autres produits ou objets personnels sont propriété individuelle. Les croyances sont essentiellement basées sur l’existence des esprits, génies et autres êtres imaginaires mêlés à la plupart des actes de leur vie. Pour eux rien ne se produit naturellement. Tout y est soumis au pouvoir des esprits et des sorciers et les morts sont plus redoutés que les vivants. Cette mentalité jointe à une responsabilité et une solidarité collective rigide rend responsable chaque clan des agissements de chacun de ses membres.
À un stade supérieur nous trouvons la société organisée selon la famille maternelle ou utérine et cela en des régions très diverses : Afrique, Amérique, Océanie. (Il en est d’ailleurs de même de la vie tribale des clans totémiques.) La vie sédentaire, pastorale et culturale crée une certaine fixité et le village commence à apparaître avec toute son organisation. L’habitation vraiment familiale (Longue-Maison) est composée d’un assemblage de cases, parfois de huttes agglutinées les unes aux autres, à l’intérieur desquelles vivent tous les membres d’une même famille alliés par les femmes. C’est encore le régime de la tribu, de la phratrie et du clan mais beaucoup plus vaste et plus régional, dont les grandes assemblées sont régies par trois chefs formant un conseil élu par les chefs de tribu. Le mariage est également exogamique, mais ici le mari n’habite pas avec sa femme ; il reste dans le clan de sa mère et ne visite son épouse qu’à l’heure des repas ou le soir. Ses enfants appartiennent donc au clan de la mère ; c’est le frère de celle-ci qui en est le plus proche allié mâle et qui leur sert de père et de tuteur. De son côté le mari, s’il a une sœur, remplit les mêmes offices envers ses enfants. L’administration de la Grande-Maison est confié par voie d’élection au chef-de-feu, qui représente la famille dans les conseils politiques ; et à la matrone, également élue, qui l’assiste dans ses fonctions. C’est elle qui a la haute direction des affaires intérieures et un réel communisme règne, paraît-il, dans cette grande famille. Dans certaines tribus l’avis des matrones prédomine sur celui des hommes en cas de conflits belliqueux ; en d’autres ce sont elles qui élisent le chef du clan et qui jugent avec lui. La terre appartient à la tribu, qui la répartit entre les différentes familles qui ne la possèdent qu’à la condition de la travailler. Il n’y a donc pas d’héritage, ni de propriété individuelle, pas plus que dans le clan.
Le passage du stage matriarcal au stade patriarcal est assez difficile à comprendre. On a voulu le faire dériver de l’affaiblissement des droits de l’oncle en faveur des droits du père, car tout homme était père et oncle en même temps, sans expliquer pourquoi ce droit s’est modifié, dans une société relativement heureuse. Quoi qu’il en soit, on assiste à ce passage chez quelques peuples de l’Indonésie. Deux sortes de mariage y sont pratiqués ; l’un, le mariage ambilien, incorpore l’homme à la famille de la femme ; l’autre, le semondo, laisse les deux conjoints dans leurs familles respectives, mais selon l’importance du mari et la valeur des présents, l’enfant appartient à une famille ou à l’autre. Enfin, chez d’autres peuples c’est la jeune fille elle-même qui va vivre chez son mari, lequel en échange, verse une somme convenue. On en a déduit que cet usage était comme un dédommagement offert à la famille maternelle pour la perte de ses droits. Malheureusement comme la réciprocité existe des deux côtés des groupements et qu’il y a par conséquent équivalence des pertes et profits, l’explication ne vaut pas cher. De même le passage du culte des morts, plus ou moins régulier jusque-là, à celui si précis du culte des ancêtres n’est pas très clair. L’Égypte, d’ailleurs, qui poussait très loin ce culte était à un stade matriarcal mixte, où les deux sexes s’égalaient, sans aucune puissance paternelle. Le fils ou la fille aînés étaient les représentants de la famille et ce fait est, pour quelques auteurs, le premier pas vers l’avènement du patriarcat. Celui-ci se reconnaît par le pouvoir absolu du père sur toute la famille et son rôle de prêtre du culte des morts. Du même coup, la femme est exclue de ce culte par son mariage avec l’homme d’un autre culte, car nul étranger n’y était admis. Cette dépréciation expliquerait, paraît-il, la coutume d’exposer les filles à leur naissance, tandis que les garçons plus nécessaires en étaient préservés.
Chez les Grecs ou les Romains, chaque maison possédait un autel où brûlait sans cesse le feu sacré. Ce culte du foyer et le culte des dieux domestiques marchaient de pair. Les mariages ne s’effectuaient point dans les temples, mais dans la maison, devant l’autel familial où brûlait le feu sacré. Ce caractère sacré du foyer, inviolable par l’étranger, s’étendit à la terre, aux troupeaux, aux biens attenant à la maison. La propriété aurait ainsi, selon quelques sociologues, une origine plus religieuse qu’économique, ou politique. La succession du père au fils aîné n’était même pas un héritage ; elle n’était qu’une continuation. Par contre, la fille n’héritait point si elle était mariée, et dans le droit grec, elle n’héritait en aucun cas. Chaque fils aîné était alors le véritable père de famille et toutes les branches cadettes étaient placées sous son autorité. Leurs serviteurs ou clients n’avaient aucun droit, aucun culte particulier, bien qu’ils eussent plus ou moins participé à la prospérité de la famille dont ils faisaient partie. Tous les descendants d’une même famille formaient la gens. Chaque cité, formée de familles assemblées en phratries, celles-ci en tribus et finalement en cité, avaient également des dieux qui n’appartenaient qu’à elle et ces dieux étaient, tout comme les dieux familiers, des âmes humaines divinisées par la mort. Primitivement, le roi de chaque cité en était également le prêtre, parce qu’il en avait, le premier, posé le foyer. Leur caractère était donc sacré et la loi se confondait avec la religion. Chaque cité était indépendante des autres cités, bien que souvent aucune barrière naturelle ne les isolât. De là des luttes et des alliances perpétuelles entre ces peuples propriétaires et fanatiques. Quarante-trois villes du Latium furent rasées par les Romains, ainsi que vingt-trois cités habitées par les Volsques. Pillages, destruction, anéantissement total, telles étaient ces mœurs lointaines.
L’État devenu puissant par la puissance de cités devint à son tour tyrannique comme l’était le père de famille. En cas de besoin, la cité pouvait s’emparer des biens de chaque citoyen. À Sparte, le mariage tardif était puni, l’oisiveté y était prescrite, tandis qu’à Athènes c’était tout le contraire. À Rhodes, la loi défendait de raser la barbe et la loi punissait celui qui avait un rasoir chez lui. À Sparte c’était l’inverse. Tout oscillait autour de l’intérêt de la cité et chaque citoyen (père de famille ou patres) se devait entièrement à elle. La plèbe formait un élément à part, en dehors de la justice, de la loi et de la religion. Alliée avec les rois contre les patriciens (pères de famille), elle imposa plus tard, après la période républicaine, les tyrans ou chefs choisis hors l’influence de la religion. Réciproquement, ces chefs favorisèrent la plèbe contre les patriciens. Finalement, après des luttes centenaires, plébéiens et patrioiens eurent à peu près les mêmes droits, mais la richesse et la pauvreté créèrent alors une barrière économique aussi dangereuse entre ces deux classes de citoyens. Le commerce et l’industrie étaient entre les mains des riches qui employaient des esclaves. Le citoyen libre et pauvre fit alors la guerre au riche pour la conquête du pouvoir et de la richesse. L’Aristocratie marquait le triomphe des uns ; la Démocratie était le triomphe des autres. Devant l’insuffisance de ses efforts, la plèbe nomma des tyrans tout puissants contre les riches, lesquels luttèrent pour leur liberté et leurs privilèges. En même temps, le vieil esprit religieux s’effritait sous ces faits et sous l’influence des philosophes. Les Sophistes répandaient le doute, les cyniques méprisaient les dieux, les mœurs et les lois, les épicuriens les ignoraient, les stoïciens séparaient l’homme du citoyen. Parallèlement à cette influence morale dissolvante, la conquête romaine détruisait par la force, chez les cités conquises, tous les cultes et toutes les institutions locales, ce qui contribuait à transformer et ruiner le vieil esprit patriarcal, jadis si puissant. Le christianisme acheva cette ruine sans apporter aucun système social pour lui succéder.
Cette évolution d’un type particulièrement pur du patriarcat est loin d’avoir été la même chez les différents peuples qui l’ont pratiqué ou le, pratiquent encore. La vie sédentaire ou nomade y amènent inévitablement de grandes différenciations. La vie de la femme grecque était confinée dans le gynécée ou dans l’atelier domestique au service de son époux. Seules les courtisanes avaient une existence indépendante et des mœurs cultivées. Il en était de même pour les bayadères de l’Inde. En Chine, le sort de la femme était encore plus dur ; il l’était beaucoup moins chez les Kabyles. Chez les Assyriens, malgré le système patriarcal, la femme pouvait hériter ; certaines lois la défendaient et son père fournissait une dot. Coutume exactement inverse de celle du stade précédent. L’origine de cette dot est assez énigmatique. D’une manière générale, la polygamie était, et est encore, liée au patriarcat. En Chine, outre la femme principale, il pouvait y avoir de nombreuses concubines. Il en était de même chez les Juifs. On connaît la polygamie de la plupart des orientaux. Chez les Germains, les chefs avaient aussi ce privilège, mais ici la dot était apportée par le mari. Au Tibet, quatre ménages peuvent se constituer :
-
Plusieurs maris avec plusieurs femmes ;
-
Plusieurs maris avec la même femme ;
-
Un seul mari et plusieurs femmes ;
-
Le couple monogame.
La femme y est relativement libre. Le mariage temporaire se pratique aussi en Perse et au Japon. Enfin, chez de nombreuses populations nègres, la polygamie est le seul état normal. En Sénégambie, en Abyssinie, dans l’Angola, chez les Cafres et les Béchuanas, chaque femme à sa hutte particulière, où elle vit avec ses enfants, et le mari les visite à tour de rôle. Chez les Hottentots et chez les Bassoutos, il y a une femme de premier rang avec laquelle vit le mari ; les autres femmes sont visitées ensuite dans un ordre donné. Certains rois nègres ont jusqu’à sept mille femmes plutôt esclaves qu’épouses, mais sans aucun autre époux que le roi. Chez les peuples slaves, la femme et ses enfants étaient la propriété du père et traités assez durement et, dans l’Inde, il en est encore ainsi actuellement. Le moyen-âge fit disparaître de vieilles choses et en fit surgir d’autres, intermédiaires entre tette époque et la nôtre. Mais la société actuelle, bien que fortement individualisée ou impersonnalisée, est loin de représenter un type fixe et satisfaisant.
De cette évolution de la solidarité du clan à l’individualisme moderne peut-on tirer quelque enseignement précis ? Peut-on faire un rapprochement entre les mœurs connues des différents peuples et leur organisation sociale ? Autrement dit, les mœurs sont-elles le produit du milieu, ou celui-ci le produit de celles-là ? Et, dans un cas ou dans l’autre, quelle serait la cause des transformations ?
Si l’on examine l’art, par exemple, nous voyons des différences ou des ressemblances très accusées entre ces peuples ayant une organisation très dissemblable. C’est ainsi que la peinture, la gravure et même la sculpture de l’époque Paléolithique ne sont pas inférieures à celles de certaines peuplades nègres ayant dépassé le stade du clan. Mais tandis que de nombreux peuples vivant au stade patriarcal n’ont qu’un art rudimentaire, on voit la Grèce se couvrir de merveilles architecturales et l’Égypte antique, plus proche du matriarcat que du patriarcat, se créer une esthétique originale et grandiose. La conception de l’art ne paraît pas absolument liée à l’organisation ; elle parait plutôt dépendante de la sensibilité de l’artiste et de son milieu. L’art hindou avec son luxe d’ornements écrasant la simplicité des lignes est bien le fruit d’une pensée mystique, méticuleuse et abstraite. Il en est de même de l’art arabe, plein d’imagination, imprégné tout de même de quelque sobriété occidentale. Tous deux contrastent avec la simplicité harmonieuse de l’art grec et la sévérité symbolique du style assyrien. L’utilitarisme romain se devine dans ses monuments. Quant à l’art nègre, plus instinctif que rationnel, il indique une sensibilité vive plus près de l’animisme et du fétichisme que des hautes abstractions. Beaucoup de Noirs sont d’habiles forgerons et d’assez beaux sujets de bronze et de statuettes en bois, sortis de leurs mains, sont dignes de nos primitifs moyenâgeux.
L’art (voir ce mot) apparaît donc plutôt comme un effet que comme une cause sociale d’évolution. La situation économique et géographique peut avoir joué un assez grand rôle dans cette évolution, mais ici encore il y a des faits assez déconcertants. Par exemple, les Mélanésiens et les Papous, bien que construisant de très bon bateaux à voile ne s’aventurent guère en pleine mer, tandis que leur voisins, les Polynésiens n’hésitent point à franchir des distances énormes en se guidant au vent et aux étoiles et d’après certaines cartes plus ou moins grossières. D’autre part, ces derniers sont fortement organisés et hiérarchisés en aristocrates et en plébéiens, alors que les premiers en sont encore aux mœurs matriarcales. Les Turcs nomades qui peuplent les steppes de la Sibérie orientale mènent une vie patriarcale avec culte des ancêtres, tandis que les Yakoutes, peuple chasseur, vivent par plusieurs centaines à la fois, sous le régime du clan maternel, à côté des premiers.
Les coutumes locales n’ont pu avoir non plus une grande importance. La danse, les rites, les mœurs particulières à chaque peuple sont toujours les effets de quelque chose qui les crée. La danse, dont on retrouve certains indices préhistoriques, fut, à l’origine, une extériorisation d’une trop forte émotion, d’une trop forte joie. La chasse et la guerre en furent les principales causes ; peut-être faut-il y ajouter quelque influence sexuelle. Chez les Australiens, elle fait partie d’une série de fêtes où la moitié de la population danse, tandis que les femmes l’accompagnent en jouant. Certaines danses érotiques et lubriques sont dansées uniquement par les femmes, comme le font les Hawaïennes. Chez les Esquimaux elle le sont par les deux sexes. Il est des danses chez les Papous, les Aïnos, les Araucaus, etc..., qui tournent à la pantomime avec chants, accompagnés de musique et de travestissement. On peut y voir là l’origine du théâtre.
Le chant et la musique sont répandus chez tous les peuples, mais souvent réduits au rythme seul. La gamme en usage paraît être surtout dépendante de l’instrument qui la produit. C’est ainsi que l’on croit que notre gamme heptatonique doit son origine à la flûte primitive qui n’avait pas plus de 6 à 8 trous, correspondant aux doigts disponibles. Les Nègres ont une gamme différente de la nôtre, ainsi que les Chinois. Le premier instrument à corde fut probablement l’arc et la harpe que l’on trouve chez les Cafres et les Nègres d’Angola. Il est difficile de trouver deux instruments accordés semblablement chez les primitifs et leur musique d’ensemble manque évidemment d’harmonie. Le tam-tam africain, formé de bois creusés et sonores, est employé à de multiples fins : danses, fêtes, rites, guerres, avertissements, etc... Il joue le rôle du gong et de la cloche des civilisations asiatiques et européennes.
La pudeur paraît inconnue à la plupart des primitifs. Les femmes mélanésiennes, quoique vivant entièrement nues, sont paraît-il très chastes. Quelques ethnologues pensent que les parures cachant les organes sexuels étaient destinées précisément à attirer l’attention sur eux. Le vêtement aurait donc fait naître la pudeur. On sait d’ailleurs que les enfants ignorent totalement cet état d’esprit imposé par l’éducation sociale. Chez les Japonais, les hommes et les femmes se baignaient autrefois ensemble. Il en était de même en Russie au siècle dernier. L’indécence, pour une femme chinoise, c’est de montrer ses pieds nus. La musulmane surprise au bain cache surtout son visage, tandis que, dans les mêmes circonstances, une laotienne cache surtout ses seins. L’âge des menstrues n’indique point le moment des premiers rapports sexuels. Chez la plupart des peuples de l’Inde, chez les Turcs, les Mongols, les Persans, les Polynésiens, les Malais et les Nègres, la vie sexuelle pour les filles commence entre 8 et 11 ans, alors qu’elles ne sont réglées qu’entre 11 et 13 ans. Remarquons également que les peuples les plus lascifs ne sont pas les moins intelligents, ni les moins hardis, tels les Polynésiens.
Peut-être faut-il voir dans la parure l’origine du vêtement, dans les pays où le froid ne le justifie pas. La plupart des primitifs se tatouent, se colorient la peau, de plus ou moins bizarre façon. Les Tibétaines se collent de petites graines sur le visage enduit de colle d’amidon. Les Malais, Japonais, Chinois, Annamites se laquent les dents. On les arrache aux jeunes Australiens à l’époque de la puberté. En Afrique occidentale, on les taille en pointe ; en Malaisie, en triangle ou en cercle. Sans parler de la castration ou de la circoncision trop connues, on pratique l’incision du clitoris au Soudan, et quelques autres mutilations des organes génitaux. Les pieds des Chinoises sont déformés par des bandelettes ; il en est de même du crâne des jeunes enfants de la région toulousaine, au Pérou, en Bolivie, etc... Certaines incisions sur la peau forment des cicatrices spéciales déformant le visage et sans parler des anneaux dans les oreilles, dans les lèvres et dans le nez des Nègres, mœurs qui sont connues, la femme Tatar porte des anneaux au nez, les Esquimaux des rondelles en os aux commissures des lèvres et les Malais de Sumatra s’incrustent des feuilles de métal ou des pierres précieuses dans les dents.
La plus étrange des déformations est certainement obtenue par les femmes à plateaux (femmes Saudé et Bantou de l’Afrique équatoriale et occidentale), qui portent dans l’une ou dans les deux lèvres percées et tendues des disques de bois ayant jusqu’à vingt centimètres de diamètre. Lorsqu’on voit les civilisés se rendre imposants et éblouissants, sinon impressionnants, par la plume, le poil, la soie, le verre et le métal et cela aussi bien à l’église qu’au palais, dans les music-halls et les cirques que dans les ambassades et les académies, on ne peut guère établir de rapport entre le degré d’organisation sociale et les mœurs déterminant le goût.
L’alimentation ne donne pas de meilleurs renseignements. L’homme, à travers les âges, a mangé et mange encore de tout : végétaux de toutes sortes, insectes, crustacés, reptiles, poissons et oiseaux de toutes tailles ; gros et petits animaux à poil, à écaille, à plume, à piquant, etc... Il a même mangé et mange encore de la terre au Sénégal, sur la Côte-d’Or, au Caucase, en Perse, dans l’Amérique du Sud, etc... Les femmes accouchées du Brésil, chez les Tappuya, mangent leur placenta et certaines coutumes semblables sont en usage, parait-il, dans quelques coins de l’Italie, lorsque le lait ne monte pas. Enfin, l’anthropophagie, pratiquée par besoin alimentaire, par gourmandise ou par nécessité religieuse, n’est pas absolument le fait de races arriérées, puisque les Niam-Niam du centre africain à demi-civilisés et assez fortement organisés en font des rites spéciaux. L’anthropophagie existe encore en Australie, aux iles Salomons, aux Nouvelles Hébrides, à la Nouvelle Bretagne, dans l’Ouhanghi, etc... Ces derniers font macérer les cadavres dans l’eau, mais ne mangent-on pas des viandes faisandées et des fromages fermentés dans le vieux monde !
La cuisson ou la préparation des aliments paraît universelle et le feu semble connu de tous les peuples de la terre. Chez les Brahmanes actuels, il est encore obtenu, pour les cérémonies religieuses, par le frottement de deux baguettes de bois spéciaux. Les Indiens en font encore de même pour les fêtes sacrées. Beaucoup de peuples actuels ne connaissent pas la farine et mangent les graines rôties jetées sur des pierres très chauffées. Pourtant on trouve des mortiers chez un grand nombre de peuplades incultes, les uns en pierre (Indiens de l’Amérique du Nord), les autres en bois (Afrique et Océanie). Le pilage est presque partout l’attribution des femmes. Les Boschimans, les Kabyles et les Arabes se servent de deux pierres plates tournant l’une sur l’autre. C’est là l’ancêtre de la meule et du moulin. Chez les primitifs cultivateurs, les hommes procèdent au défrichement et à la préparation du sol, mais ce sont les femmes qui ensuite font la culture et la cueillette des produits. La culture à la boue remonte à la plus haute antiquité ; celle avec charrue et bêtes de somme est en usage en Europe depuis le néolithique et parait, pour l’Asie et l’Égypte, avoir pris naissance en Mésopotamie. La Chine pratique encore sur une large échelle la culture à la houe et les peuples anciens de l’Amérique centrale n’en connaissaient pas d’autres.
Les excitants sont universellement connus et les boissons fermentées également. Il est certain que les stupéfiants ont dû jouer un rôle assez grand chez certains peuples. L’Inde et la Chine sont victimes de l’opium et les populations entières ont disparu par l’usage de l’eau-de-feu.
Les Turco-Mongols fabriquent le koumys avec le lait fermenté de jument et en tirent un alcool appelé arka. Les Moï de l ‘Indochine font de la bière de bambou ; les nègres en font avec du millet ; en Afrique occidentale ils font une boisson appelée dolo, avec du miel, du gros mil et une prune sauvage. Dans l’océan Indien on fabrique du vin avec le jus du sagoutier. Le kava des Polynésiens est fabriqué en mâchant et en crachant dans un plat commun les feuilles et racines d’un poivrier. La noix de kola est employé en Afrique comme stimulant ; le maté (sorte de houx du Brésil) est la boisson de l’Amérique du Sud. Différentes racines et poissons sont employés à Java comme aphrodisiaque. La coca mâchée et mastiquée avec des cendres riches en potasse donnent aux Péruviens et aux Boliviens des rêves suaves. Enfin le bétel traité de la même façon, mais avec de la chaux, donne aux Malais une haleine purifiée, mais pris en excès amène le cancer de la langue et la chute des dents. Le tabac originaire d’Amérique est suffisamment connu. Les Indiens le fument modérément et en certains cas, la pipe ou calumet de paix joue un rôle social et rituel. Le hachich, extrait du chanvre indien, est fumé en Perse, en Asie Mineure et en quelques parties du Congo. Le tabac est prisé chez de nombreux Nègres porteurs de tabatières minuscules logées dans le lobe de l’oreille, mais, plus raffinés, les Indiens de l’Amazone mettent dans un tube une poudre très excitante, tirée des graines séchées d’une légumineuse appelée Inga, et se la soufflent ainsi mutuellement dans le nez.
Nous voyons qu’on ne saurait tirer de ces faits, très abrégés, aucune indication pour trouver de bonnes ou de mauvaises mœurs d’après le degré d’organisation des peuples qui les pratiquent, et vice-versa.
Les tabous ne sont pas exclusifs aux peuples primitifs, bien qu’ils aient chez eux une importance excessive, notamment dans l’archipel polynésien, où ils défendent les nombreux privilèges détenus par les riches et les aristocrates. Le tabou s’étend à une infinité de choses, qui prennent un caractère tel, dès qu’on les a déclarées tabou, qu’elles peuvent entraîner toutes sortes de conséquences fâcheuses à tous ceux qui, ne tiennent aucun compte de ce caractère particulier.
Il y a donc des tabous pour la chasse, la pêche, la guerre, la naissance, la mort, la sexualité, etc. Les sorciers et magiciens sont tout puissants pour prononcer des interdictions et des ensorcellements, mais les prêtres ne restent pas en arrière pour sacrer, bénir, honnir, excommunier, jeter des mauvais sorts et vouer aux tourments éternels leurs ennemis.
Le système des castes, si inflexible chez les Hindous et les Égyptiens, est une sorte de tabou et tous les privilèges, défendus encore moralement jusqu’à nos jours, en sont des restes. Les jugements par ordalie ne sont pas plus étonnants et le fait de démontrer son innocence ou sa supériorité en avalant du poison, en plongeant sa main dans un récipient contenant des serpents venimeux, en traversant une rivière pleine dé caïmans, en se tenant plongé sous l’eau jusqu’à l’asphyxie, etc., n est pas beaucoup plus illogique que celui d’aller chercher (pour résoudre nos conflits modernes, issus d’un esprit nouveau) dans le passé un droit vieux de quelques millénaires, pas très fameux à son époque, et établi pour d’autres mœurs.
* * *
De cet examen trop rapide que pouvons-nous conclure concernant l’évolution et l’influence des mœurs ? Essayons, avant d’aborder cette conclusion, de résumer nos observations. Parmi les multiples causes agissant comme agents transformateurs, voici celles qui paraissent les plus importantes : l’augmentation de la population – l’opposition de la tradition à l’expérience individuelle – la sécurité ou l’insécurité – l’opposition des croyances à la réalité des faits – l’âge de procréation – les phénomènes naturels.
L’augmentation de la population n’a pas toujours les mêmes conséquences, suivant les ressources naturelles, l’étendue du terrain et le mode de vie, sédentaire ou nomade. Il peut en résulter la dislocation des groupements trop considérables, en groupements plus réduits, lesquels, placés dans des conditions différentes, peuvent évoluer différemment. Nous pouvons voir là une des raisons principales de la fin du matriarcat et du patriarcat. La cité antique s’est détruite par le dedans, par l’augmentation de la famille plaçant les cadets en état d’infériorité par rapport aux aînés ; par l’augmentation et le fractionnement des cités devenant concurrentes. De même la Longue-Maison matriarcale atteint un maximum qu’elle ne peut matériellement pas dépasser. Chaque groupe, chaque peuple qui se déplace et qui s’organise autrement sous l’empire des nécessités, tend à maintenir sa nouvelle organisation si elle lui est avantageuse. C’est ici que l’opposition de la tradition à la réalité des faits, à l’expérience individuelle et à la vie elle-même joue son rôle particulier. L’enfant n’hérite d’aucun préjugé, d’aucune connaissance ou tradition accumulées depuis la nuit des temps. Il faut toujours recommencer l’éternel travail de l’enseignement et de l’éducation. L’enfant est toujours un adversaire, un animal primitif en révolte tendant à échapper au joug social. Tout événement favorisant cette pente naturelle, tout relâchement de la tradition travaille à l’effacement de l’acquis conventionnel et artificiel de la civilisation pour ne laisser que l’animal avec ses tendances naturelles, combatives et conquérantes. L’instinct vital lutte donc toujours et sommeille au cœur de chaque humain pour tourner ou modifier la tradition.
L’esprit conservateur humain sent bien cette menace perpétuelle peser sur la fragilité de la tradition. De nombreux exemples historiques justifient ces craintes. Des tribus indiennes, autrefois prospères, possédant organisation et tradition, mais refoulées et dispersées, sont devenues misérables et sans liens entre elles. Ainsi en a-t-il été des peuples de l’Amérique centrale dispersés par les conquérants européens : Mayas, Aztèques, Incas, disparus depuis quelques siècles à peine sans laisser d’ histoire, de légende, de tradition. Il en est de même de l’empire des Khmers, dans l’Indochine, dont les ruines grandioses d’Angkor indiquent la puissante organisation, mais dont les restes enfouis sous la végétation finissent par devenir même ignorés des habitants du pays.
Les peuples vont, viennent, émigrent, se refoulent, fusionnent, se forment, se concentrent, se dispersent ou disparaissent. Les éléments naturels : épidémies, disettes, sécheresses, incendies, inondations, tremblements de terre, dislocations de continents, apparitions ou disparitions d’îles, de lacs, de terres, etc., entravent ou favorisent les peuples, les isolent ou les relient et cet ensemble de faits modifie les traditions. Si la sécurité ou l’insécurité se mêlent aux déplacements de population il en résulte une stagnation ou une évolution plus ou moins rapide. La longue durée de clan primitif explique la cristallisation des esprits. Les croyances momifient les peuples pour des siècles et l’Inde, quoique très avancée en civilisation, est encore plongée dans son mysticisme stupéfiant. Enfin l’âge de la procréation peut avoir une importance très grande. L’homme n’acquérant ses facultés psychiques positives qu’à l’âge mûr, il est plus avantageux de procréer à cet âge-là qu’à l’adolescence, comme chez les peuples tropicaux, car si les connaissances ne se transmettent point, les aptitudes individuelles, développées par le fonctionnement, peuvent influer sur les aptitudes des descendants.
Au regard de tous ces faits, les mœurs se divisent en deux activités différentes : les usages et les croyances. Les premiers englobent tout ce qui s’ajoute aux diverses fonctions de la vie et servent à satisfaire les sens. Ils concernent les modes, les coutumes, les goûts et les arts. Leur influence est quasi-nulle sur la cérébralité des humains et nous avons vu maints peuples de différentes cultures briller par leurs dons artistiques. Cela n’empêche point d’ailleurs la sensibilité esthétique de se perfectionner, de s’éduquer et de se transmettre héréditairement. Il faut tout simplement isoler l’esthétique de l’éthique et ne pas faire absolument une relation de cause à effet entre la présence de l’un et de l’autre. Les croyances constituent le fond même de la tradition et tout l’acquis des ancêtres accumulé et transmis à travers les générations. Dans cet immense patrimoine tout n’est pas forcément bon, tout n’est pas forcément mauvais. Les hommes n’ont pas accumulé des absurdités dans l’unique dessein de devenir encore plus absurdes. Ces croyances et ces connaissances sont le fruit du fonctionnement rationnel du système nerveux et par conséquent directeur et coordonnateur de l’individu. Il en résulte que l’enfant (et son instinct vital) se trouve coordonné, dans la société, par ces connaissances traditionnelles ; et le conflit ou l’harmonie (entre sa nature conquérante et le milieu) résultent de la plus ou moins grande coïncidence de l’instinct vital et de la tradition. Les bonnes mœurs résideraient alors entre la coïncidence parfaite des habitudes collectives et le fonctionnement biologique de l’individu. Comme ces habitudes collectives laissent, à travers les hérédités successives, des aptitudes mentales particulières nous voyons que la sensibilité éthique comme la sensibilité esthétique peuvent s’améliorer, se transformer ou dégénérer suivant les modifications du milieu et de la tradition. Nous pouvons donc conclure que les mœurs formées lentement par accumulation de traditions, travaillent à la formation et à la stratification des sociétés dont elles sont à la fois la cause et l’effet et que l’évolution vient de la nature conquérante de l’homme, source dynamique d’efforts transformateurs heurtant le statisme des traditions.
– IXIGREC.
BIBLIOGRAPHIE. – La Bruyère : Les caractères ou les mœurs de ce siècle – Cosentini : Essai sur la pensée et la vie sociale préhistoriques – Deniker : Les races et les peuples de la terre – Duclos : Considérations sur les mœurs – M. Deraisme : Nos principes et nos mœurs – Abbé Fleury : Mœurs des Israélites ; des Chrétiens – Fustel de Coulange : La cité antique – Frazer : Le Rameau d’Or ; Le Totémisme – L. Friedlaender : Tableau des mœurs romaines – Kant : Fondement de la métaphysique des mœurs – Lévy-Bruhl : La mentalité primitive ; La morale et la science des mœurs. – J.-M. Lally : Du clan primitif au couple moderne. – Montesquieu : Considération sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains. – G. Richard : La femme dans l’histoire. – A. Rambaud : Histoire de la civilisation. – Tylor : La civilisation primitive. – Taines : Œuvres. – Tacite : Mœurs des Germains. – Voltaire : Essais sur les mœurs et l’esprit des nations. – É. Reclus : L’Homme et la terre ; La Géographie universelle. – H.-M. Williams : Aperçu de l’état des mœurs et des opinions en France à la fin du XVIIIème siècle. – Etc., etc. Voir aussi bibliographie de : droit, habitude, individualisme, morale, peuple, progrès, races, religions, société, etc., ainsi que les études correspondantes. Voir également les mots : culte, famille, mariage, milieu, mode, naturisme, nudisme, préjugés, sexe et morale sexuelle, etc.
MOI
n. m. (du latin : me)
Un des problèmes les plus angoissants que les hommes se sont posé depuis les temps les plus reculés, c’est celui de leur existence, celui de la réalité de leur moi. Être ou n’être pas ! Comme le fait d’être ne se manifeste qu’au moment même où se précise le moi, le problème se présente immédiatement dans toute son étendue, sans aucun degré de compréhension intermédiaire.
Que sommes-nous ? Pourquoi vivons-nous ? Que faire ?
Les nombreux philosophes qui ont essayé d’approfondir le Moi, ont tous employé la méthode introspective, seule capable, à leurs yeux, de découvrir l’essence véritable de l’être en son apparente unité. Or cette méthode, employée par des hommes déjà très évolués psychiquement, ne peut que constater l’existence du Moi, son indissoluble unité et l’impossibilité de l’ expliquer par tout ce qui constitue le non-moi. Elle en fait une chose absolument à part, différente de tout ce qui est connu, comme substance et comme mouvement, et qu’elle appelle âme, esprit, pensée, conscience. Dans cette voie, le Moi paraît irréductible au monde phénoménal, et inconnaissable dans son essence.
Pour savoir si la conscience est connaissable en elle-même, il est nécessaire d’étudier ses manifestations caractéristiques, de les analyser. Remarquons immédiatement que, si la conscience paraît être un élément indispensable de toute connaissance objective et subjective, elle, apparaît comme absolument inanalysable en elle-même. Ce fait presque insignifiant est d’une importance extrême. Deux hypothèses en découlent ; ou la conscience est une chose existant par elle-même, réfractaire par sa nature à toute analyse ; ou la conscience est le résultat d’un fonctionnement, lequel disparaît par l’analyse, ce qui rend, évidemment, celle-ci impossible. Autrement dit, la conscience étant l’élément primordial de la connaissance, la conscience ne peut s’analyser sans se détruire elle-même et sans détruire du même coup la connaissance, (V. Conscience).
Dans les deux cas, la conscience paraît rester inconnue, mais tandis que dans le premier on ne sait absolument rien de sa nature (qu’est-ce qu’une conscience sans objet ?) ; dans le deuxième elle peut être assimilée à d’autres synthèses objectives connues et rentre dans le domaine du compréhensible. N’oublions pas que la connaissance humaine est essentiellement sensorielle, et que connaître quelque chose c’est le situer, dans ses rapports avec les autres choses, dans l’espace et dans le temps ; lesquels ne sont perceptibles et concevables que par le mouvement. Si donc nous pouvons analyser les manifestations de la conscience et en trouver une sorte de correspondance objective parallèle, nous pourrons décider de sa liaison aux phénomènes objectifs et conclure qu’elle n’échappe point aux processus connus du déterminisme universel.
Examinons tout d’abord la sensation. On sait que les sensations paraissent irréductibles les unes aux autres et que l’on ne peut comparer une couleur il une odeur, ni une forme à un son. Comme, d’autre part, des expériences anatomiques nous révèlent que le même excitant peut créer, dans des fibres nerveuses différentes, des impressions différentes ; et que des excitants différents créent dans la même fibre la même impression, on en conclut que la sensation ne correspond point à la réalité objective. Ici la connaissance intuitive ne fait pas avancer la question d’un pas. Elle crée des barrières insurmontables entre les sensations d’abord ; entre le subjectif et l’objectif ensuite ; et c’est tout. Une plus profonde étude des excitants et du système nerveux nous montre, que tous les excitants se ramènent à une certaine unité de comparaison qui est le mouvement ; ensuite que les influx nerveux, assimilables expérimentalement à des courants électriques, ne sont autre chose que du mouvement transmis par les fibres nerveuses. Ce qui explique que des excitants différents contenant tous du mouvement donnent une même sensation dans la même fibre ; tandis qu’un même excitant agissant sur des fibres nerveuses différentes, mais aboutissant à des centres sensoriels différents, engendre des sensations différentes. Cet excitant éveillant des sensations différentes ne les crée pas en réalité, et en fait, la sensation ainsi obtenue n’est point une image précise mais une sensation confuse. D’autre part il ne crée aucune image mais éveille des sensations antérieures. Il est à supposer qu’un excitant, agissant ainsi sur des cellules nerveuses, vierge d’impressions sensorielles, ne créerait absolument rien de comparable à une image fournie par l’organe sensoriel extérieur. On peut aller plus loin dans cette voie. Non seulement la sensation paraît ainsi liée au mouvement, mais il faut encore admettre une origine et une formation de la sensation dans l’espace et dans le temps.
Déjà l’observation nous indique que ce qui nous paraît, intuitivement, inétendu et qualitatif est en réalité corrélatif à des phénomènes physiques et chimiques créés dans notre système nerveux, déterminant une modification de notre substance cérébrale. Toute perception s’effectue dans l’espace, par de nombreuses voies nerveuses amenant successivement les influx nerveux déterminés par les phénomènes objectifs ; ce qui prend une certaine durée. Toute sensation est donc le produit d’une quantité prodigieuse de mouvements rythmiques dans l’espace et dans le temps. Mais si chaque sensation nous paraît nette et précise, c’est parce qu’en réalité elle est incluse dans tout un réseau d’autres sensations liées à notre fonctionnement organique. Prise isolément elle ne signifierait plus rien. Il suffit, pour nous en rendre compte, de regarder une phrase écrite en une langue inconnue pour voir que cela n’éveille rien en nous, sinon que ce simple degré de connaissance : c’est une langue étrangère. Si nous n’avions jamais connu d’écriture, la connaissance se rétrécirait encore ; nous penserions, peut-être : c’est du dessin. Et si nous ne connaissions pas le dessin, cela n’éveillerait, probablement, aucune relation en nous. On pourra penser que cela n’empêcherait point la sensation consciente de voir cette phrase écrite. Il ne faut pas séparer voir de comprendre, car il est probable que l’on ne voit que ce que l’on comprend. Autrement dit la sensation visuelle ne prend un sens précis et conscient qu’au moment où l’image se relie à d’autres sensations, lesquelles ont déjà un sens par rapport au fonctionnement biologique de l’individu. Ainsi les mots étrangers seront vu, même par un illettré, parce que depuis très longtemps les lignes formant les lettres sont classées comme éléments vus et connus dans le monde objectif. Mais on sait que des aveugles-nés, ayant recouvré la vue, n’ont absolument rien compris à ce qu’ils voyaient. Le jeune garçon, cité par Romanès, confondait tout, ne distinguait aucun objet d’un autre, ne pouvait utiliser aucune des données visuelles nouvellement acquises. Pourtant ses sensations étaient innombrables, simultanées et successives. Qu’aurait-il éprouvé s’il n’avait perçu qu’un seul point lumineux, toujours semblable à lui-même ?
Si nous éliminons ainsi progressivement les éléments sensoriels, en nous rapprochant de l’enfance, jusqu’à la naissance, nous rétrécissons la précision du moi ; nous diminuons le champ de la conscience ; nous ne trouvons plus qu’un fonctionnement organique sans pensée, sans aucune notion du moi. Peut-on encore parler de conscience ? Et n’est-il pas évident que la conscience n’est que le produit des sensations, lesquelles sont dépendantes des influx nerveux, lesquels à leur tour sont créés par des phénomènes physico-chimiques de l’être vivant et du milieu. Ainsi nous assistons avec l’accumulation des perceptions à la formation de la conscience. Il est intéressant de constater que la vie existe bien avant la formation du moi et qu’elle continue également sans lui ; soit dans les fonctions organiques qui sont inconscientes et qui constituent la plus grande partie de l’activité ignorée de l’individu, soit dans le sommeil, soit dans les nombreux cas pathologiques. Ainsi la chose la plus importante et la plus primitive des êtres vivants n’est point de penser, mais de se développer, d’assimiler, de conquérir et cela peut s’effectuer sans conscience précise du moi, comme il est probable que cela se réalise dans tout le règne végétal et le règne animal inférieur. La coordination s’effectue bien par l’intermédiaire du système nerveux, mais c’est accessoirement que la pensée s’est développée. Le système nerveux parait, primitivement, orienter l’être entier vers la lutte et coordonner ses différentes parties pour cette fonction. Les premiers réflexes sont donc des réflexes moteurs, mais chaque excitation sensorielle n’est point entièrement utilisée dans le réflexe ; une partie de l’énergie ainsi libérée parcourt d’autres voies nerveuses et forme ainsi le souvenir lié, par conséquent, a un état précis du monde objectif, et à un état également précis de l’être sensible. Comme cet être est littéralement baigné dans d’innombrables excitations depuis sa naissance, on voit que tous ces influx nerveux, venant simultanément des surfaces sensorielles et non transformées en mouvement, se transforment en sensations (représentations conscientes) liées les unes aux autres dans l’espace et dans le temps.
Remarquons encore que, dans la matière cérébrale, les souvenirs se fixent ainsi simultanément dans l’espace, puisque chaque organe des sens, situé dans l’espace, a ses centres sensoriels liés entre eux spatialement ; et qu’ils se fixent également dans le temps par répétition, succession, renouvellement des sensations. Comment pouvons-nous alors relier ces faits objectifs aux connaissances subjectives concernant la douleur, le plaisir, la volonté, le choix, le temps, l’espace, l’étendue, la durée, le passé, le présent ; les souvenirs et leur reconnaissance qui forment ainsi le moi tel qu’il se précise en son sens inétendu, s’opposant aux souvenirs eux-mêmes ?
C’est ici que l’attention va nous expliquer bien des choses. Il faut entendre par attention une quantité d’influx nerveux cérébral. Le système nerveux réalise, comme on le sait, une organisation à plusieurs étages, c’est-à-dire que les influx nerveux, déterminés par les phénomènes objectifs, peuvent parcourir plusieurs voies ; soit en passant directement dans la moelle épinière et les cellules motrices, ce qui constitue les réflexes primitifs ; soit en montant jusqu’au bulbe, puis au cerveau moyen ; soit encore en atteignant le cerveau supérieur, les zones sensorielles et les zones d’association. Le nombre de cellules nerveuses mises ainsi en jeu successivement augmente considérablement avec le parcours et chaque relais, chaque centre de jonction rencontré constitue une étape où l’influx nerveux peut s’accumuler, se transformer en réflexes moteurs ou se diffuser plus loin dans les zones de la perception, de la sensation et de l’association. Certains centres nerveux, plus particulièrement liés au fonctionnement physiologique de l’individu, sont ainsi de gros producteurs ou accumulateurs d’énergie, laquelle libérée alors plus ou moins régulièrement, durablement et intensément, met en jeu des liaisons extrêmement compliquées du réseau cérébral ; liaisons perpétuellement modifiées sous la variation de l’influx nerveux, lequel, finalement, peut n’aboutir à aucune réalisation motrice (action avortée, hésitation, réflexion, méditation, émotion, etc.), ou se terminer par l’action visible objectivement. La diffusion et la dispersion de l’influx nerveux dans de multiples réseaux très compliqués explique très bien l’hésitation et le choix, car, ainsi dispersé et divisé, il ne peut déclencher qu’une suite de réflexes contradictoires ou inhibiteurs ; mais il explique aussi l’action soudaine, même très énergique, sous de minimes excitations objectives, car cet influx nerveux rencontrant, dans son cheminement, un centre d’énergie puissant peut le libérer brusquement vers les voies plus frayées de la motricité et de l’action. Ce qui donne l’illusion du choix.
Il est aisé de relier ainsi toutes les fonctions psychiques entre elles par l’étude des mécanismes nerveux les déterminant. Puisque tout le fonctionnement cérébral se ramène à des influx nerveux parcourant des réseaux liés entre eux mais formant des mécanismes distincts, construits à des moment successifs, et parfois très distants les uns des autres, nous pouvons appeler instinct un mécanisme de réflexes transmis héréditairement, antérieur à l’expérience individuelle, réagissant seulement dans des cas limités et précis. C’est l’intelligence spécifique créée, renforcée par chaque individu au cours de l’évolution de l’espèce et transmise aux descendants. L’aptitude est un mécanisme héréditaire, également antérieur à l’individu, nécessitant l’expérience pour l’affirmer et se préciser. L’intuition est l’utilisation ultérieure, et en dehors de l’expérience objective immédiate, des mécanismes sensoriels édifiés antérieurement, par l’individu, depuis sa naissance jusqu’au moment considéré. L’intelligence est la construction successive des mécanismes nerveux, déterminés par l’expérience personnelle depuis la naissance jusqu’à la mort. Elle représente une sorte de construction graduelle dont les diverses propriétés se traduisent par l’action coordonnée, modératrice, équilibrante ou inhibitrice des influx nerveux déclenchés par les réactions vitales. L’habitude est un mécanisme formé par l’intelligence et fixé par la répétition automatique des mêmes actes. Les passions, les sentiments sont constitués par des centres émetteurs d’énergie, liés à des mécanismes coordonnant les fonctions importantes de la vie : nutrition, sexualité, combativité, motricité, etc. ; lesquels liés également aux mécanismes précédents, leur fournissent l’énergie nécessaire pour déclencher tous les processus psychiques, depuis l’acte violent et irréfléchi (décharge brusque de l’influx nerveux par les voies les plus usitées de la motricité) jusqu’à la plus abstraite des méditations. L’intelligence n’apparaît donc aucunement comme une faculté mystérieuse, inexplicable et uniquement humaine. Elle est un ensemble de mécanismes coordonnateurs créés par l’action du milieu sur l’individu et déterminant sa réaction, d’après des mécanismes formés antérieurement, et issus des luttes millénaires de la substance vivante en équilibre avec les forces physico-chimiques de l’univers.
L’attention est donc un écoulement d’énergie s’effectuant dans une direction continuelle, sous l’influence d’un réflexe biologique important, mais cette décharge d’énergie peut être supérieure à celle nécessitée par le réflexe même et l’excédent, se diffusant dans de multiples directions, crée la sensation de plaisir. On voit que l’habitude, constituant un mécanisme déjà construit, canalise rapidement l’influx nerveux vers des mécanismes moteurs, ce qui en évite la diffusion et la sensation de plaisir. Ainsi ni la volonté, ni le plaisir ne sont des éléments d’action, comme se l’imaginent la plupart des humains. Ce ne sont que des effets du fonctionnement biologique. Ce qui trompe l’analyse introspective, c’est la durée des phénomènes’ subjectifs. Le sujet ignore totalement les états biologiques de son cerveau, antérieurs à l’apparition d’une volonté. Il ignore également les cheminements de l’influx nerveux donnant l’illusion du libre-arbitre, du choix. De même qu’il ignore totalement toutes les constructions ou images cérébrales situées hors de l’état conscient, mais entre l’instant où le réflexe biologique crée l’état volontaire ou agréable, et celui où se réalisent ses conséquences motrices, ou actions objectives, la conscience saisit la sensation diffuse du plaisir, ou la sensation continue de l’attention, et accorde à ces états subjectifs, seuls connus par elle, le pouvoir de déclencher l’action. Autrement dit, la conscience créée par les influx nerveux, ne peut en aucune façon les créer. La douleur peut être liée à un fonctionnement déficitaire de l’organisme, inversion de rythme ou de courant, entraînant des inhibitions motrices diverses.
Les notions de durée, de temps, de passé, de présent, correspondent à des localisations spéciales liées à tout un enchevêtrement d’images situées non dans le temps immatériel, comme le voudrait Bergson, mais dans l’espace. Se remémorer le passé, c’est assister, actuellement à l’écoulement de l’influx nerveux, par des voies extrêmement compliquées, créées lors des événements antérieurs et plus ou moins déformés et isolés par d’autres événements, ou le non fonctionnement (oubli). Nous pensons donc toujours dans le présent et nous ne vivons aucunement dans le passé. Il n’y a pas de passé, puisque rien n’est immuable. Il n’y a que conservations de liaisons successives qui apparaissent absolument différentes des liaisons actuelles. Un événement vécu dix ans plus tôt, ne se situe dans cet éloignement que par la quantité des événements écoulés la disparition de nombreux éléments contemporains les liaisons successives que parcourt l’influx nerveux pour renouer, plus ou moins facilement, la chaîne des faits. La fraîcheur des souvenirs d’enfance ne détruit en rien cette théorie. Notre substance cérébrale plus jeune, plus plastique, conserve plus facilement et plus profondément les empreintes objectives liées entre elles très solidement, et l’influx nerveux les parcourt plus aisément que les empreintes ultérieures, aussi sont elles très vives et très durables. Leur situation réelle dans le passé, par rapport au présent, dépend des changements objectifs effectués successivement et conservés plus ou moins nettement, subjectivement comme documents spéciaux de comparaison et d’éloignement. L’avenir n’est également concevable que réalisé subjectivement dans le présent. C est-a-dire qu’une construction intellectuelle : projet, but, etc., s’est établie sous l’influence d’une importante fonction biologique – manger, boire, dormir, travailler, jouer, aimer, etc. – et cette construction, déjà réalisée spécialement en nous, coordonne nos influx nerveux vers des actes moteurs tendant à conformer nos gestes a nos pensées.
L’être ne vit donc absolument que dans le présent. Le temps – ou événements successifs – ne se traduit et ne se conserve en nous que sous forme d’espace et si les souvenirs ne peuvent s’évoquer en désordre (cela arrive partout très souvent, avec la confusion erronée des choses) ou simultanément, comme un immense panorama, c’est qu’il est impossible à l’influx nerveux de parcourir tous les mécanismes à la fois et d’un seul coup et qu’il est obligé de s’écouler, dans le temps et la durée, à travers les voies du prodigieux réseau construit précisément dans les mêmes conditions d’espace et de durée. Celle-ci est donc la perception minima et maxima des sensations isolées ou simultanées que notre attention saisit entre deux sensations différentes et successives. La durée est donc proportionnelle à l’attention et à la variation objective.
L’espace et l’étendue sont déterminés subjectivement par les mouvements réalisés par l’individu depuis sa naissance. L’enfant n’évalue immédiatement aucune distance et l’aveugle guéri, dont parle Romanès, croyait que tous les objets, proches ou éloignés, touchaient ses yeux et se trouvaient au même plan. C’est donc l’expérience, l’habitude, la perception simultanée, donc spatiale, des impressions ; en un mot le mouvement, qui créent la notion d’espace et d’étendue. Cette notion ne peut également s’acquérir qu’avec des déplacements successifs dans le temps, et nous voyons ainsi que les concepts d’espace et de temps se conditionnent expérimentalement l’un-l’autre et qu’ils sont engendrés tous deux par le mouvement.
Si donc toute notre connaissance n’est que sensations ; si celles-ci ne sont que des mouvements, des synthèses de vibrations ou de rythmes, pourquoi, dira-t-on, en jaillit-il une impression d’unité, d’inétendu opposée à toutes les images successives du souvenir ?
La raison en paraît être, nous venons de le voir dans l’impossibilité pour l’influx nerveux de se diffuser instantanément et avec la même intensité dans tout le mécanisme cérébral. Une telle opération détruirait d’ailleurs toute liaison des choses et ressemblerait à la tentative de représentation visuelle et simultanée de tous les points de l’horizon. Cependant certains cas pathologiques créent des dissociations de la personnalité, morcèlent le Moi en plusieurs moi ; et, au début de certains assoupissements, il est possible d’observer, en soi-même, et simultanément, des constructions mentales diverses.
Il en résulte que, à l’état de veille, seule une faible partie des souvenirs, constituant le présent, est éveillée par l’influx nerveux. Mais tout le fonctionnement biologique est intimement lié aux multiples perceptions objectives qui assaillent l’individu de toutes parts, et ces influx incessants, indéfiniment renouvelés sans aucune solution de continuité excitent continuellement ce fonctionnement, créant cette sensation d’existence de permanence du moi, d’inétendu et d’unité. Ainsi le moi, avec toutes ses variations dans l’espace et dans le temps, est la synthèse de ces rythmes innombrables mais imprécis et confus, que le monde extérieur détermine d’une façon continue dans notre sensibilité spéciale, joint à notre cénesthésie ou sensibilité générale, que notre fonctionnement biologique détermine également d’une façon continue et que l’attention oppose (opposition du moi et des images) aux mécanismes plus précis déclenchés par un réflexe important. Mais les fortes émotions et les profondes pensées absorbent totalement le moi et le font disparaître connue il est facile de l’observer.
Il n’y a donc, aucune raison de supposer un esprit immatériel, et immortel, agissant d’une manière absolument incompréhensible sur notre corps matériel. Nous avons observé toutes les conditions d’apparition, de disparition, de fonctionnement de la conscience et nous l’avons toujours trouvée intimement mêlée aux phénomènes objectifs et postérieure à leur apparition. Les expériences de Pierre Janet, et de nombreux autres psychiatres, sur certains psychopathes, démontrent d’ailleurs que l’on peut, en certain cas, suggérer un acte à un sujet et qu’il s’imagine ensuite vouloir cet acte. Toutes les observations pathologiques confirment l’absolue dépendance du moi du fonctionnement physiologique de l’individu. Si d’autre part on analyse minutieusement tous les faits et pensées de l’homme, qu’on en dissocie jusqu’à l’extrême limite les éléments synthétiques, on ne trouve plus que des réponses, des réflexes du sujet à une excitation du milieu. L’homme, conscience sans objet, n’existe pas, ne peut pas exister. La plus profonde, la plus transcendante des pensées se ramène toujours à connaître des mouvements subjectifs et objectifs. Ce qui identifie merveilleusement le moi et le non-moi. Nous savons d’ailleurs que la conscience varie d’un individu à un autre comme varient leurs expériences et cela démontre bien la solidarité du corps et de l’esprit. Le corps n’obéit donc nullement à l’âme mais celle-ci peut s’entendre comme le fonctionnement synthétique des centres d’associations et il est certain qu’une longue réflexion (dispersion de l’influx en de multiples régions centrales) détermine un tout autre comportement que le fonctionnement d’un réflexe immédiat.
La première question : Que sommes-nous ? se résume alors ainsi « le moi est une synthèse de sensations, ou réactions de la matière vivante, contre l’influence du milieu. Il a toute la valeur d’existence des synthèses et disparaît avec elle ».
La deuxième question : Pourquoi vivons-nous ? peut également se résumer assez simplement « nous vivons pour réaliser notre fonctionnement » ou si l’on préfère : nous vivons pour vivre. Il n’y a pas d’autres explications plus satisfaisantes. Nous sommes notre propre but et notre fin est en nous-même. Nous ne vivons essentiellement ni pour penser, ni pour être heureux, ni pour réaliser d’autres fins que la conquête, l’assimilation, la lutte et la mort. Nous ne pensons que parce que nous vivons. Le plus extraordinaire c’est que l’esprit, orgueil de l’homme, n’apparaît que comme un accessoire tardif, voué au fonctionnement de la machine matérielle admirablement coordonnée, qui le précède, le crée et le détruit en se dissolvant. La conscience, la pensée, la joie, le plaisir ne sont que des conséquences, des effets de la vie n’apparaissant qu’en certains cas seulement, et chez les êtres évolués, mais nullement nécessaires au fonctionnement biologique puisque l’immense majorité des êtres vivants ne les connaît point. La mort suffit d’ailleurs à elle seule à démontrer l’impuissance de la pensée à agir sur la vie. D’autre part l’éternité inconnue et incompréhensible qui nous a précédé, et qui inquiète si peu les mystiques, nous renseigne sur l’éternité à venir, tout autant dénuée d’intérêt psychique, qui torture tant les croyants. Il ne nous reste qu’une seule certitude : la réalité synthétique de notre moi dans le présent.
La dernière question : Que faire ? n’est donc point une constatation pessimiste de notre impuissance. C’est le désir de rechercher la meilleure réalisation de notre synthèse individuelle, de notre moi. Puisque l’immense majorité des êtres vivants (végétaux, animaux, inférieurs) vivent sans le savoir, ce qui équivaut à ne pas être, ce n’est pas la vie elle-même, sorte de mouvement aveugle, chaotique, contradictoire, créateur et destructeur, qui nous intéresse ; c’est la vie consciente, le moi dans ses rapports compréhensifs avec les autres mois et avec toutes les manifestations du monde objectif.
Puisque la conscience n’est point déterminante, dira-t-on, quel est le rôle de cette spectatrice impuissante, et que signifie vouloir réaliser quelque chose, si seule la mécanique biologique, avec ses innombrables réseaux nerveux, parcourus par d’incessants courants d’énergie, nous meut et-nous propulse tout comme une machine sans conscience ?
Remarquons tout d’abord que le fait d’être choqué de quelque chose ne prouve point son irréalité ; pas plus que le fait de désirer et de s’inventer une immortalité ne prouve son existence. Ensuite la postériorité de la conscience aux phénomènes nerveux ne prouve nullement qu’elle ne signifie rien. Elle est au contraire un effet inséparable de certains actes psychiques extrêmement compliqués, tout comme la forme d’un triangle est absolument inséparable de la liaison des trois lignes le déterminant. Mais de même que cette figure n’existe point par elle-même, avant la liaison linéale, de même notre conscience ne peut exister avant la formation des synthèses sensorielles formant notre moi. La conscience indique donc que des opérations intellectuelles s’effectuent en nous, que notre intelligence fonctionne, que notre influx nerveux se dépense régulièrement et énergiquement (attention, volonté) et que parfois l’excédent se diffuse plus ou moins longuement (plaisir, joie, bonheur).
C’est l’acceptation pure et simple de soi, de son fonctionnement, de sa totalité, de sa synthèse vivante. C’est la constatation de ce qui est. C’est assister à son propre spectacle et à celui des autres. Cela n’est nullement attristant, ou décourageant. Sentir, penser, vouloir, c’est fonctionner, c’est conquérir, c’est réaliser. C’est assister, confiant en ses réflexes, à sa vie en action.
Se réaliser revient donc à constater qu’il y a en soi un mouvement conquérant se traduisant consciemment par : je veux, je désire, je cherche, je réalise, je suis heureux. Comme les phénomènes émanés des individus : gestes, paroles, écriture, actions, sont des éléments déterminants et modificateurs, il est compréhensible que nous cherchions (mouvement conquérant de notre mécanisme biologique) à nous modifier mutuellement, conformément à notre mécanisme intérieur, pour notre meilleur fonctionnement personnel. C’est l’égoïsme dans toute sa force et sa simplicité. C’est également la lutte inévitable, mais cette lutte se présente sous deux aspects différents ; soit qu’elle engendre des gestes entièrement destructeurs ; soit qu’elle enferme des éléments constructeurs et vitaux. Comme les modifications ne sont produites en nous que par une certaine imitation de l’objectif, il en résulte que les faits favorisant l’individu ne seront point ceux amplifiant le moi, au détriment des autres mois ; car l’imitation de ces actes déterminera, tôt ou tard, les autres mois à se développer, à leur tour à nos dépens. Mais ce seront ceux qui, imités et pratiqués par tous les Mois, se traduiront par l’augmentation de puissance, de vitalité, de conscience de tous les individus. La morale individuelle et collective ne peut donc avoir d’autres bases que les données biologiques de fonctionnement, d’imitation, d’équilibre déterminant le développement de tous les individus, la lutte pour l’utilisation des forces naturelles et l’harmonie de tous les « moi ».
– IXIGREC.
MOI
Notre sévérité pour autrui n’a d’égale que notre infinie tendresse pour nous-même. Avant toute réflexion, d’instinct, aveuglément nous aimons notre moi chéri ; et cet amour persiste, infrangible, au soir de l’universel naufrage que représentent certaines vies. Désirs, convictions, amour de l’existence peut-être, auront sombré sous le coup de douleurs folles, de déceptions pires que la mort ; dans le secret de la conscience, une immense pitié, une affection sans borne subsisteront envers notre malheureuse personne.
...Dès qu’il y va du salut individuel, dans un incendie, lors d’une tempête, l’instinct de conservation rend criminels des hommes fort policés. Charité, bienséance et autres vertus chrétiennes s’envolent comme feuilles mortes découvrant chez beaucoup un naturel d’une férocité inouïe. Quant à l’humilité, si prisée du prêtre, elle étale les fautes légères pour mieux cacher les vices profonds. On veut des compliments sans être assez franc pour le dire ; d’où mille roueries, mille détours, et des rages intérieures contre les maladroits qui ne comprennent pas...
Une éducation restée religieuse, des habitudes millénaires, une presse asservie, les chaires de pestilence d’églises innombrables ont répandu le microbe de l’hypocrisie. L’opinion, dressée contre la franchise, n’a que sourires pour les dépravations pudiquement voilées ; dans le jargon des moralistes, l’homme sans détour n’est qu’un brutal, mais la modestie devient la qualité du sournois.
Quelle indignation, chez les âmes saintes, lorsqu’on parle de soi sans modestie affectée, rappelant les défauts, n’oubliant point les qualités. Parce qu’ils repoussent la vérité avec une désinvolture parente de la fausse humilité du croyant, on préfère la jactance bavarde du vaniteux ou l’orgueil fou de l’homme d’État. Payez les louanges dont vous couvre la presse, des grincheux seuls y trouveront à redire. Mais haro sur l’imbécile qui se loue au lieu de charger autrui de le faire : chose pourtant facile lorsqu’on dispose de grandes ressources financières. Placez dans l’encensoir charbons et, parfums, attisez soigneusement la flamme, puis empruntez une main mercenaire pour balancer devant vous l’instrument. La morale est sauve, quand le compliment revient à l’inspirateur par le canal d’une bouche étrangère ; on ne condamne point l’amour des dignités, le mal réside dans une manière franche de l’avouer. Nulle atteinte à la modestie, si vous soufflez, des coulisses, l’hymne chanté en votre honneur ; mais lorsqu’on s’exhibe soi-même en public, il est indispensable de faire montre d’humilité. D’où l’universelle habitude d’appliquer sur l’égoïsme un masque de désintéressement. Et comme l’enseigne ne dit rien du contenu de la boutique, des surprises attendent lorsqu’on pénètre au dedans. Illusions de l’amour-propre, fausses perspectives utilitaires s’évanouissent, telles des ombres devant la lumière, si l’on observe non en acteur mais en témoin...
* * *
Au-dessous de la zone consciente, dont la lumière centrale s’atténue par degrés, le moi comporte une large région souterraine où ne pénètre aucune clarté. Refoulés par nos contraintes éducatives et nos habitudes sociales, tendances supposées, mortes, idées que l’on croyait évanouies, tout un monde d’appétences, de souvenirs, d’instincts infâmes ou grossiers, vivent là dans les profondeurs sombres de l’inconscient. Inspirateurs cachés souvent, ces éléments remontent à la surface quand s’atténue le contrôle de la raison ; ainsi dans le rêve qui démontre aux plus dignes que la brute ancestrale s’agite toujours en eux. Policé au dehors, notre moi reste, au fond, lubrique, obscène, cruel ; son apparente philanthropie masque, en général, un égoïsme forcené. Les psychanalystes l’assurent et nous en serions convaincus, si notre attention n’esquivait le côté désagréable pour s’en tenir à l’aspect séduisant. Juge hargneux lorsqu’il s’agit des autres, nous devenons, quand nous sommes en cause, l’avocat qui plaide non-coupable éternellement. Et l’exception n’est qu’apparente dans l’amour qui conduit à des sacrifices allant jusqu’à la mort. Entre l’amant et l’amante une identification s’est faite, souffrances et joies sont devenues communes, un seul moi vit en deux personnes, une seule âme dispose de deux corps. L’amitié c’est encore un élargissement de l’individu ; chez le sage, il s’étend au genre humain tout entier, parfois à l’universalité des vivants. On admire ces cœurs fraternels, on les suit peu, soupçonnant qu’ils ont raison sans en être très certains.
* * *
Chez d’autres l’amour de soi prend une forme étroite, rabougrie : tel l’égoïsme de certains vieux. Peser leur pain, mesurer leur boisson, se garer des courants d’air, pester contre les enfants, jouer d’interminables parties de billard, voilà qui suffit à remplir leurs journées. Ils sont paisibles, tant qu’on ne trouble pas leur repos, font les délices des propriétaires, s’occupent peu des voisins, mais ne leur demandez aucune aide, ils restent indifférents à tout, sauf à leur propre satisfaction. Un égoïsme mesquin en empêche beaucoup de comprendre les autres ; idées ou sentiments personnels s’opposent à la rectitude de leur vision. Gestes et paroles du prochain sont interprétés en fonction de leur propre mentalité ; gratis ils lui donnent mérites et travers dont eux-mêmes sont lestés. D’innombrables erreurs en découlent...
L’égoïsme s’avère créateur d’illusions plus profondes : enthousiasmes ardents, espoirs illimités, qui caractérisent l’adolescence sont du nombre. À cette époque bienheureuse tout paraît facile, aisé ; pour cueillir les fruits d’or, entrevus dans des rêves enchantés, il suffit d’étendre la main à ce qu’il semble. Chez le grand nombre, une dure expérience dissipera l’erreur avec brutalité. Échecs sur échecs les attendent, l’un après l’autre leurs espoirs s’évanouiront...
Même chez le vieillard besogneux, assez d’amour de l’existence subsiste pour qu’il s’émeuve quand ses pauvres joies sont en jeu. Qu’une mort survienne, chacun s’évertue à lui trouver des causes que l’on se flatte secrètement d’éviter : celui-ci fut imprudent, cet autre négligea son mal, un troisième ne suivit pas les prescriptions du médecin. Reproches souvent exacts ; mais nous voulons indéniablement oublier le sort qui sera nôtre, et les survivants éprouvent comme une impression de triomphe en se voyant debout près des compagnons tombés. Parce que chacun se flatte d’éviter, pour son compte, ces terribles fatalités, les masses restent parfois indifférentes devant l’innocent qu’on opprime ou le pauvre qui meurt de faim. Trop de victimes à la fois feraient peur à l’ensemble et de telles craintes sont génératrices de révolutions ; aussi les chefs multiplient les étapes, échelonnant en série leurs forfaits et, grâce à une individualisation du crime se débarrassent doucement des gêneurs. En période calme, car, aux époques troublées de l’histoire, c’est en frappant sans pitié qu’on assure la durée d’un gouvernement.
Les prêtres exploitent l’égoïsme en promettant l’immortalité bienheureuse au fidèle qui les sert ; et leurs dupes sont nombreuses, tant leur illusoire assurance répond aux désirs secrets de beaucoup. Notre moi chéri disparaître, se fondre dans l’ensemble, devenir un impersonnel élément du Tout ! Volonté de vivre, instinct de conservation se révoltent contre pareille éventualité ; notre amour de nous-même ne peut s’y résigner. Que les personnages anciens dont parlent les livres, que les indifférents de notre entourage soient morts définitivement, nous le croirions sans peine ; nous croyons ainsi l’animal à jamais disparu. Mais que parents, amis, que notre moi s’éparpillent anonymes dans l’immense univers, voilà qui contredit trop notre égoïsme foncier. Aussi, comme il avait fait de dieu le résumé de nos ignorances, le théologien prévoyant concrétisa notre infini besoin de vivre dans la notion d’immortalité. Et la raison chercha des arguments pour légitimer nos désirs : le résultat posé d’abord, une logique illusoire imagina de prétendues démonstrations. Ainsi procède l’apologétique chrétienne qui, tour admirable de passe-passe ! montre la science, lors même qu’elle se contredit, toujours d’accord avec l’Écriture. Création, déluge, merveilles du Sinaï, confirmés par la prétendue science du XIIIème siècle, s’accordent, assure-t-on, avec les données absolument contraires de la science d’aujourd’hui.
* * *
Si les illusions dont le moi s’entoure, si les fantômes qu’il imagine assuraient son bonheur, peut-être conviendrait-il de n’y point porter une main sacrilège. Mais, pareilles aux griseries de l’opium que suit un réveil angoissé, les joies dangereuses de rêves éphémères ont pour lendemain les sanglants démentis de la réalité. Un médecin honnête vise moins à diminuer la souffrance qu’à guérir la maladie ; c’est le fer rouge qu’il introduit dans la plaie, non un liquide sans énergie, quand il combat gangrène ou venin. Traiter la pneumonie comme un rhume ordinaire compromettrait la vie sans atténuer les douleurs du patient ; et l’on n’extirpe une tumeur que grâce au bistouri du chirurgien. Bâtir sur le mensonge serait bâtir sur du sable mouvant la vérité dort servir de base à l’art pour faire œuvre durable, en soignant les esprits comme en soignant les corps. Simple moyen quand le malade est guérissable, l’anesthésie ne devient fin que s’il est condamné à mort. On ne remédie aux faiblesses de l’âme qu’en dissipant mensonges de l’amour-propre et faux calculs de l’intérêt. Ne faisons pas du moi une idole, reléguée dans un sanctuaire où la lumière ne pénètre à aucun moment, une statue dont on ne sait si elle est de plâtre, de marbre ou d’or. Cet absolu intangible, norme suprême des vouloirs humains, n’apparaît guère plus solide que les dieux ses prédécesseurs. Indifférente aux concepts logiques de notre raison, la nature se plaît à mêler les contraires, à confirmer nos systèmes et à les infirmer tout ensemble, à montrer successifs ou coexistants des faits que nous estimions opposés. À côté du plaisir elle met la douleur, et place l’égoïsme proche du désintéressement. Mais nos théories morales filtrent le réel infiniment compliqué ; pour clarifier elles gardent, en général, un seul élément. Simplification utile à la précision des idées ainsi qu’à la rigueur des discussions, et nuisible, par contre, à une adéquate compréhension de la vérité. Les termes égoïsme, désintéressement recouvrent, d’ailleurs, des tendances si contradictoires que l’on s’étonne de les voir accouplées sous un vocable commun.
Une longue gamme d’égoïsmes s’offre, le moi se diversifiant comme le corps et l’esprit. Aspect mental du tout complexe et un, identique et changeant, qui constitue la personne, il correspond à l’effort de synthèse que représente la vie. Apparu dès le premier germe, il croît avec l’organisme et ne s’évanouit qu’à la mort ; limite tracée dans l’espace par notre épiderme, durée que notre mémoire circonscrit dans le temps, voilà ses racines essentielles. La nature oppose l’individu au reste du monde, en isolant le corps dans une gaine de cuir ; en réduisant l’esprit à ne saisir que Ses propres modifications. Pour dépasser les apparences, il faut une science, des réflexions dont peu sont capables. D’où l’égoïsme de l’homme replié sur lui-même, tel l’escargot dans sa coquille, ne voulant rien savoir du reste de l’univers. Mais forces aveugles, malignité des vivants obligeront le solitaire à s’entendre avec ses pareils, dans la majorité des cas. Plaçons à l’opposé l’égoïste qui s’enfle comme la grenouille du fabuliste, rêvant conquête ou monopole du globe entier. Autocrates, milliardaires, dictateurs économiques ou militaires sont taillés sur ce patron-là ; de même tous ceux, grands et petits, que tourmente l’instinct de domination. Plus sympathique me semble l’égoïste qu’anime la volonté d’harmonie ou celui que l’amour pousse à sacrifier son moi...
À l’égoïsme mauvais nous devons nobles, prêtres, guerriers, rois de la finance ou du négoce, fleurs vénéneuses et parasites épanouies de préférence sur les débris putrides des corps humains décomposés. Aidé par la sottise populaire, le moi des maîtres s’hypertrophie au point de réduire leurs serviteurs à l’état d’aveugles machines.
* * *
Synthèse active et consciente, transitoire et limitée, le moi possède une valeur indéniable bien que relative. Sa liberté rappelle l’indépendance des bulles qui flottent à la surface de l’océan ; son individualité ressemble à celle des vagues qui n’émergent un instant de la masse que pour s’y fondre à nouveau. La personne n’a pas la fixité qu’on suppose ; loin d’être toujours identique, le contenu du moi se renouvelle incessamment. À chaque minute, des cellules meurent, des résidus s’éliminent, remplacés par des éléments puisés dans le milieu. Et, comme les pierres d’une bâtisse en ruine servent à construire d’autres maisons, les atomes anciens se retrouvent, dans cet échange perpétuel entre le dehors et les vivants, matériaux durables d’individualités successives.
Même va-et-vient dans le domaine intellectuel, même utilisation d’idées, de sentiments, de désirs identiques au fond. En art, l’originalité réside dans le dosage et la synthèse d’éléments qui ne varient pas. Dramaturges et romanciers empruntent aux vivants qualités ou travers de leurs personnages ; déformer, accroître, grouper d’autre façon, tel est le rôle de l’imaginative. Si fantaisiste que soit la statue d’un homme, elle comportera une tête, un corps, les membres essentiels ; et, dans un paysage, le peintre n’élimine les parties déplaisantes que pour leur substituer des sujets observés ailleurs. Perceptions, images, souvenirs, concepts sont un legs indestructible ; la nouveauté se borne à l’agencement inédit de matériaux anciens. Centre du tourbillon, qui constitue notre personne, l’activité du moi s’évanouit sans qu’un atome meure, sans qu’une idée soit perdue ; ainsi l’eau du lac demeure, quand ses remous sont dissipés. Nos pensées continueront de peupler les cerveaux, nos composants physiques d’alimenter les corps, après notre retour à la commune source des forces universelles. Si notre individualité est éphémère, notre moi transitoire, nous sommes vieux pourtant d’une éternité ; et, dans la course sans fin de nos éléments primordiaux, nul ne peut assigner un terme à notre immortalité. Aussi nos actions sont-elles moins vaines qu’il semble au premier abord ; le plus minime effort est gros de conséquences imprévisibles. Point de brusque coupure dans la trame des phénomènes enchevêtrés, toute cause a son effet et tout effet à son tour devient cause. Pourquoi une très humble vie n’aurait-elle pas son importance dans l’histoire de l’univers ? Grain par grain, les mille et mille gouttelettes du fleuve ont creusé son lit ; les vagues anonymes et, toujours renaissantes obligent la falaise à de continuels reculs. De nombreuses forces, autrefois indociles, sont domestiquées, à notre époque, par les savants ; peut-être l’homme deviendra-t-il le guide conscient des éternelles transformations cosmiques. Non qu’il tire jamais quelque chose du néant ; sa puissance n’a rien, d’arbitraire, il arrange, et ne crée pas ; pour maîtriser la nature, il commence par lui obéir. Mais à l’énergie canalisée il fixe un travail, assigne un but ; sa raison éclaire le jeu des forces obscures ; en vue des conséquences, sa volonté choisit les causes. Dans la trame serrée des faits, s’il ne fabrique les fils, du moins il les dispose ; et la navette, du savoir lui permet d’intervenir selon ses vœux. Lui-même doit réaliser la justice, accomplir les miracles qu’il attendit en vain des dieux. Seulement une loi, dont il suspend l’action sans la vaincre, veut que soit anonyme l’œuvre la plus durable, après un temps court ou long. Comme fut anonyme le travail du vent, de l’eau, et celui des milliards de plantes et d’animaux qui peuplèrent le globe. Rien n’est perdu pour l’ensemble, ce qu’a produit chacun demeure, contribuant à l’évolution générale ; l’effet subsiste détaché de sa cause, l’œuvre se continue impersonnelle, séparée du moi qui en fut l’artisan. L’enfant sera le portrait de lointains ancêtres sans que le sachent ni lui ni ses parents ; sur la cupule du gland, ne se lit point le nom du chêne son producteur. Atavisme implique mémoire ; mais une mémoire de l’espèce dédaigneuse des individus. Par le livre, par le bronze, par la pierre, l’homme combat l’oubli ; ne lui dénions pas des victoires partielles, la gloire est une survie. De triomphes définitifs nous n’avons point d’exemple, la mort guette le souvenir ; sur les inventeurs du feu, de l’écriture, des premiers instruments, histoire et tradition restent muettes. Qu’adviendra-t-il de célébrités plus récentes ? La disparition de notre espèce, celle de notre planète leur assigne une fin, dont l’éloignement paraît proche, comparé à l’immensité des temps.
* * *
Reconnaissons la valeur, à la fois considérable et relative,de la personne humaine ; comprenons qu’amour de soi et amour d’autrui coexistent, plantes voisines, dans le champ de notre pensée. Pour chacun le moi s’avère centre, il est l’unique portion de l’univers dont nous ayons conscience précise et possession entière ; au regard du Tout, il n’est que l’élément d’un ensemble, le maillon d’une chaîne ininterrompue. Ces points de vue sont divers, sans être opposés ; les harmoniser serait facile, si la société, troublant l’ordre de la nature, ne sacrifiait le grand nombre à l’égoïsme de quelques uns. Hiérarchie légale, classements admis par le code créent ides ‘intérêts factices, contraires à l’intérêt simplement humain. L’existence de parasites engendre un bien des exploiteurs contraire au bien des exploités. Mais dans une classe sociale, dans une profession, le bonheur de chacun reste lié au bonheur de tous ; l’ouvrier pâtira, dans l’ensemble, si le coût de la vie augmente, alors que ne croît pas le salaire moyen. À l’intérêt individuel, résultat des aptitudes ou de la situation personnelle, s’ajoute un intérêt collectif indéniable. Quand la raison enfin maîtresse aura débarrassé le globe des artificielles cloisons qui séparent ses habitants, quand les peuples ne travailleront plus pour des paresseux inutiles, le bien collectif sera celui que la nature assigne à notre espèce prise dans sa totalité. Pour maitriser les énergies hostiles, améliorer leurs conditions de vie, reculer les bornes de l’ignorance, il sera bon que les hommes continuent d’associer leurs efforts. En évitant au moindre de leurs frères toute douleur inutile, ils rempliront leur tâche spécifique et seront les dieux de demain...
Point de vie collective possible lorsque chacun se désintéresse du bien général pour ne songer qu’à soi ; une solidarité vraiment juste implique réciprocité des services rendus. Mais, quand auront disparu les désœuvrés de l’aristocratie qui consomment beaucoup sans rien produire, le travail des autres sera singulièrement allégé. Des réformes seraient faciles. dans ce sens, si les chefs ne s’y opposaient ; car les faits sociaux, résultats de vouloirs humains, n’ont pas la fatalité des phénomènes cosmiques. En attendant, seule la solidarité pleinement consentie devient règle d’action aux yeux du sage ; des contraintes imposées du dehors il se libère avec joie. Et toujours, il se penche avec tendresse sur les cerveaux sans lumière ou les cœurs ulcérés de ses frères malheureux.
– L. BARBEDETTE.
MOI (LE), LE SOI
Il y aurait de longues pages à écrire sur les différentes définitions qui ont été données du moi par les diverses écoles modernes. En le définissant une chose qui pense – res cogitans ; – en énonçant sa fameuse proposition : « Je pense, donc je suis », Descartes donnait au moi la première place et le substituait à l’âme, comme il apparaît clairement de sa Sixième Méditation, § 8, où il dit : « Il est certain que moi, c’est-dire mon âme, par laquelle je suis ce que je suis est entièrement et véritablement distincte de mon corps et qu’elle peut être ou exister sans lui ». La philosophie allemande, par la suite, donna au moi un sens plus métaphysique, plus absolu. On sait que Kant considérait le moi comme la conscience elle-même se réfléchissant dans ses actes et dans les phénomènes sur lesquels son influence s’exerce. Fichte faisait du moi « l’être absolu lui-même, la pensée substituée à la puissance créatrice et tirant tout de son propre sein : l’esprit et la matière, l’âme et le corps, l’humanité et la nature, après qu’elle s’est faite elle-même ou qu’elle a posé sa propre existence ». Pour Schelling et Hegel, le moi :
« Ce n’est ni l’âme humaine, ni la conscience humaine, ni la pensée prise dans son unité absolue et mise à la place de Dieu : c’est seulement une des formes ou des manifestations de l’absolu, celle qui le révèle à lui-même, lorsqu’après s’être répandu en quelque sorte dans la nature, il revient à lui ou se recueille dans l’humanité ».
Sigmond Freud est venu qui a compliqué la situation en exposant la coexistence d’un moi et d’un soi, le soi étant « l’ensemble coordonné, anonyme, impersonnel des forces ataviques, des instincts », alors que le moi – centre de la conscience – est l’ensemble des images, idées, émotions et réactions coordonnées. Ce moi se débat, dans le système de Freud, entre deux influences ennemies, empiétantes et menaçantes toutes deux, qu’il s’occupe perpétuellement à concilier : d’une part, la réalité extérieure, avec ses coercitions sociales ; d’autre part, les exigences instinctives et irréfléchies du soi ; Freud admet encore un Surmoi ou « moi idéal », souvenir inconscient des interdictions imposées au petit enfant par ses parents, interdictions qui pèsent toute la vie sur le caractère de l’adulte.
Je n’ai cité ces fragments de l’histoire du Moi, de Descartes à Freud, que pour leur comparer le « Moi », tel que l’entendent les individualistes anarchistes – un Moi corporel et passager, à l’instar de « L’Unique » de Stirner. Le « Moi » des individualistes n’a rien, pour eux, d’une abstraction, pas davantage que ne leur est une abstraction le « non-moi ». Ce sont pour eux des réalités vivantes, de tous les jours.
Quoiqu’on fasse et quoi qu’on dise, je suis et je me sens, en tant qu’individu, un être isolé, différencié, à part des autres. Rejetant toute métaphysique, je suis – de par mon expérience et pour ne considérer que la douleur – que lorsque je souffre, c’est moi et non autrui ou le voisin qui ressent de la souffrance, peu importe que cette douleur soit de l’ordre psychologique ou physiologique. Quand je n’ai pas à manger suffisamment, quand je ne puis embrasser la femme que je voudrais tenir en mes bras, quand je me trouve au-dedans des murs d’un cachot, quand par suite d’un accident j’ai perdu l’usage d’un membre, c’est moi qui souffre et non mon ami le plus intime. En vain me dira-t-on, à cause de l’identité de substance, que le non-moi souffrirait autant que moi, placé dans les mêmes conditions :
-
cette proposition n’enlève pas ma douleur et c’est cela, pour-moi, l’important ;
-
mon expérience m’a démontré que le non-moi ne réagit pas du tout de la même façon en présence de certains faits ou de certains événements susceptibles de me faire souffrir atrocement, expérience que tout te monde a pu faire. Tant et si bien que les conseils des non-souffrants m’ont paru parfois ou cruels ou ridicules. Contre cette réalité, aucune théorie ne saurait prévaloir.
Donc, le Moi des individualistes anarchistes n’a rien d’abstrait ni de romantique. C’est leur corps, considéré à part des autres corps humains, avec ses réactions et ses réflexes de tout genre, ses désirs, ses appétits, ses attributs de toute nature. Ils ne disent pas que leur « moi corporel » est supérieur aux autres « moi corporels » ; non, mais ils ne veulent pas qu’aucun « moi corporel » puisse forcer un autre « moi » – par violence, contrainte, ruse, menace ou privation quelconque – à faire ce qu’il ne ferait pas ou à ne pas faire ce qu’il ferait s’il n’était obligé au contraire.
C’est cela que veulent dire les individualistes anarchistes lorsqu’ils revendiquent l’autonomie de leur moi ou de leur soi, ils entendent par là un état de choses où la personnalité humaine, différenciée nettement des autres unités, ne soit pas forcée de subir, dans ses relations avec autrui, des charges sociales, une méthode de vie, une façon de se comporter, que, laissée indépendante, elle aurait pu tout aussi bien rejeter. Ils n’admettent pas non plus que ce rejet puisse les priver du moyen de production, s’il les privait de tout autre avantage sociétaire. Contre tout milieu social qui ne leur consent pas au moins cela, les individualistes anarchistes se situent, en général, en état de légitime défense, selon la phrase consacrée.
– E. ARMAND.
(À consulter les mots égoïsme, personne-personnalité, la série des études sur individu-individualisme, etc.).
MOINE
n. m. (latin monacus, grec monakhos, de monos, seul)
Religieux qui vit dans un couvent ; membre d’une communauté religieuse d’hommes. La vie monastique suppose le renoncement au monde et la pratique de la pénitence. Conséquence logique de la croyance aux vérités révélées, de la religion, à savoir : que l’âme seule a chez l’individu une vie réelle, une existence libre et immortelle, que le corps n’est qu’un phénomène, un accident, par conséquent une chose absolument négligeable. Le corps n’est qu’un moyen pour l’âme de mériter ou de démériter, de gagner l’infini des jouissances ou de sombrer dans les souffrances éternelles : le ciel ou l’enfer. Les tendances du corps sont comme lui-même, nécessairement matérielles, limitées, finies, et celles de l’âme, comme elle-même : spirituelles, illimitées, infinies. Les premières éloignent de Dieu, de sa loi, tandis que les seconds rapprochent de l’Être suprême. Il faut donc soumettre les tendances du corps (passions), aux tendances de l’âme (foi). On devra ainsi, pour faire son salut, éviter les occasions de pécher, sauvegarder le corps de tout ce qui peut éveiller ou exacerber les désirs et les passions, d’où cet éloignement du monde, cette retraite au désert ou dans les couvents. Et quand, malgré tout, le corps se rebelle et que grondent ses appels, il faut diminuer son emprise, l’affaiblir, le punir – d’où la pratique de la pénitence, de la macération, de l’ascétisme – afin de le rendre plus souple, plus docile à la volonté de l’âme... Le grand ennemi des religions, c’est la vie. Toute doctrine religieuse qui enseigne un au-delà de la vie, est une doctrine de mort.
Il est assez difficile d’indiquer à quelle époque les moines firent leur apparition ; toutefois on en trouve trace vers la moitié du troisième siècle de l’ère chrétienne, en Orient ; sous le nom d’ermites ou anachorètes, ils vivaient dans des cabanes solitaires. Il fut donné, en effet, au christianisme de produire cette espèce d’individus qui se faisaient une gloire de la vermine et de la crasse de leur corps, qui exaltaient la mort et maudissaient la vie.
Mais, pour une pareille existence, une foi robuste était indispensable ; nul doute ni sur la réalité de la Révélation, sur celle de l’existence d’un ciel et d’un enfer, ni d’un Dieu, ne devait effleurer l’esprit du moine. L’ignorance y devait pourvoir. Mais vinrent les siècles de doute ; la règle fut examinée, la vie reconquit en partie ses droits. Seuls les peuples continuèrent à accepter la loi de renoncement aux joies et aux richesses ; leurs conducteurs, reprenant la tradition païenne, s’essayèrent à faire de leur vie une perpétuelle jouissance. Les moines avaient été rassemblés en communautés par Saint-Pacôme qui, en 340, institua les premiers cénobites. Sa sœur, vers la même époque, ouvrait aux femmes les premiers couvents de nonnes.
Au IVème siècle, saint Basile, évêque de Césarée, avait composé la fameuse règle qui régit encore aujourd’hui les moines orientaux. Au VIème siècle, saint Benoît de Nursie, abbé du Mont Cassin, légiféra pour les moines de l’Occident. Sa règle forma les moines Bénédictins qui donnèrent naissance aux Camaldules, aux Chartreux, aux ordres de Citeaux et de Clairveaux.
Tant que dura la foi, les monastères furent de sévères retraites, de saints lieux de prières, de mortifications et de labeur. Mais les moines ne tardèrent pas à subir l’attrait du grand courant qui entraînait les princes et le pape lui-même vers les fêtes et les plaisirs. Dès lors, très souvent, le couvent est transformé en une vaste maison de débauche. Le travail y est délaissé, la « mortification » consiste à bien manger, boire et paillarder.
Cependant, l’Église a su répandre, dans le monde, une légende peu controversée qui consiste à nous présenter les monastères comme des maisons de science à qui nous devons la transmission de tous les trésors de l’antiquité. On cite les Bénédictins comme des modèles d’application, de patience et de savoir. Or, à de très rares exceptions près, la vérité est toute autre. La patience et l’application des moines copistes a été des plus néfastes. Certes, ils nous ont légué dés manuscrits parfaitement écrits et aux enluminures merveilleuses ; mais on y cherche en vain les œuvres profanes de la Grèce et de la Rome antiques. Mieux, les quelques œuvres qui sont parvenues jusqu’à nous et qui nous ont révélé le degré de civilisation atteint par ces ancêtres, ont subi de tels outrages – résultats de la patience et de l’application des moines altérateurs – qu’on a dû les soumettre à l’analyse chimique et critique, afin de séparer le faux du vrai, magistralement embrouillés pour les intérêts de la cause chrétienne.
Et quand on leur reproche ces faux ignobles que, grâce à la science, ils ne peuvent plus nier, voici comment ils se défendent, par la voix du grand catholique Joseph de Maistre : « De ce vague qui régnait dans les signes cursifs, ainsi que du défaut de morale et de délicatesse sur le respect dû aux écritures, naissait une immense facilité et, par conséquent, une immense tentation de falsifier les écritures ; et cette facilité était portée au comble par le matériel même de l’écriture ; car, si l’on écrivait sur la peau, in membranis, c’était pire encore, tant il était aisé de ratisser et d’effacer ».
C’est principalement au moyen-âge, et spécialement au VIIème siècle, que les moines, manquant de papier à l’heure où les chicanes religieuses battaient leur plein, et ne pouvant plus compter sur les fabriques d’Égypte détruites par Omar, se ruèrent sur les manuscrits que l’on avait enfermé dans les monastères pendant les invasions des barbares, les grattèrent, les lavèrent et y couchèrent leurs élucubrations.
« Le papyrus, même malgré son peu d’épaisseur, n’échappa point à cette exécution. Véritable armée de destructeurs, enrégimentés sous les ordres de docteurs irascibles et vindicatifs, les moines saccagèrent toutes les richesses bibliographiques des temps anciens, et ne laissèrent échapper à l’étreinte de leurs doigts crasseux et repoussants que quelques débris d’une littérature qu’ils ignoraient ou qu’ils considéraient comme néfaste... Un ou deux fragments d’un véritable intérêt littéraire ont été surpris de la sorte sous l’écriture plus récente de quelques ouvrages de piété ou de controverse. Les recherches d’une érudition patiente, aidées du secours de la chimie, sont parvenus à rétablir des morceaux, même d’une certaine étendue, comme, par exemple, la République de Cicéron, retrouvée en grande partie par M. A. Maï. » (G. Itasse dans son étude sur les « faux », C. Delagrave, 1898)
Voici ce que nous dit Michelet, à ce sujet :
« S’il est vrai, comme s’efforcent de nous le persuader les écrivains prévenus en faveur du monarchisme, que les rescriptions aient sauvé quelques ouvrages importants, il est bien plus certain que le grattage en a fait périr un nombre qui ne se peut calculer. Plût au Ciel que les Bénédictins n’eussent jamais su ni lire ni écrire ! Mais ils eurent la rage d’écrire et de substituer d’ignobles grimoires aux chefs-d’œuvre sublimes qu’ils ne comprenaient point. Sans eux, la fureur des barbares et des dévots eût été à peu près stérile. La fatale patience des moines fit plus que l’incendie d’Omar, plus que celui des cent bibliothèques d’Espagne et de tous les bûchers de l’Inquisition. Les couvents où l’on visite avec tant de vénération les manuscrits palimpsestes, ce sont ceux où s’accomplirent ces idiotes Saint-Barthélémy des chefs-d’œuvre de l’antiquité. »
Vers le XIIIème siècle, fleurissent les ordres mendiants. On ne se cache plus ; la règle consiste à accomplir le vœu de pauvreté et à ne vivre que d’aumônes. Il y avait quatre ordres de moines mendiants : les franciscains, les dominicains, les carmes et les augustins, chacun de ces groupes donnant naissance à d’autres catégories. On comptait :
-
Les frères mineurs ou franciscains ;
-
Le second ordre ou les clarisses, instituées par sainte Claire, en l’année 1212 ;
-
Le tiers-ordre ou les tertiaires, à qui le même fondateur donna une règle en 1221 ;
-
Les capucins, l’un des ordres les plus nombreux de l’Église ;
-
Les minimes, fondés par saint François-de-Paul ;
-
Les frères prêcheurs ou dominicains, établis vers 1216, sous les auspices et la conduite de saint Dominique de Guzman ; les religieux de cet ordre furent appelés Jacobins en France ;
-
Les carmes, venus de la terre sainte, en Occident, pendant le XIIIème siècle ;
-
Les ermites de saint Augustin, dont l’Institut fut mis au nombre des ordres mendiants par le pape Pie IV, en 1567 ;
-
Les servites ou ermites de saint Paul, les hiérolymites, les cellites, etc... ;
-
Enfin l’ordre du Sauveur et celui de la pénitence de la Madeleine.
Les ordres et les monastères se multiplièrent. Le nombre des moines s’accroissait avec une rapidité inouïe. On comprend facilement que dans les pays de la chrétienté, tous pauvres, les paysans immensément miséreux, proie inoffensive des seigneurs, victimes des guerres ininterrompues, ne faisaient pas volontairement l’aumône suffisant à satisfaire toute cette racaille d’inutiles, d’oisifs, ayant bonne gueule et le reste. Il y eut des moines pillards, quand les menaces de l’enfer ne produisaient pas l’effet attendu. Potter rapporte que :
« Lors de l’enquête faite par ordre du Parlement de Paris, et à la demande des syndics et consuls de la ville d’Aurillac (22 avril 1555), plus de 80 témoins déposèrent que les moines et les religieuses des deux couvents de la ville se livraient à tous les excès de la débauche. Chaque moine avait une ou plusieurs maîtresses, filles enlevées ou débauchées à leurs parents, femmes ravies à leurs maris ; 70 bâtards étaient nourris, avec leurs mères et les moines, dans le couvent, des offrandes des fidèles. Les moines s’emparaient des filles et des femmes qu’ils trouvaient à leur convenance, en plein jour, au vu et au su de tout le monde, et les chassaient devant eux à grands coups de poings et de pieds jusqu’à leur repaire. Les plaintes continuelles des bourgeois et surtout les violences que les moines commettaient à leur égard, et les assassinats même dont ils s’étaient rendus coupables, firent séculariser le couvent. Dans la maison abbatiale, on découvrit un cabinet chargé de peintures obscènes et qui était appelé le lupanar de M. d’Aurillac. »
Le Lachâtre nous dit :
« Presque toujours, les moines ont mérité la réprobation qui les a frappés, notamment au XVIème siècle, quand Rabelais et toute la pléiade des écrivains leur faisaient une si rude guerre d’esprit et de bon sens. Voici le portrait du moine, d’après H Estienne :
Il faut qu’il soit ord (sale) et gourmand,
Paresseux, paillard, mal-idoine (malpropre),
Fol, lourd, yvrogne et peu sçavant ;
Qu’il se crève à table en buvant
Et en mangeant comme un pourceau.
Pour peu qu’il sache un peu de chant,
C’est assez, il est bon et beau...
D’un autre côté, un abbé, Bois-Robert, décrit ainsi les moines de son abbaye :
Mes moines sont cinq pauvres diables,
Portraits d’animaux raisonnables ;
Mais qui n’ont, pas plus de raison
Qu’en pourrait avoir un oison.
Mais ils ont grosse et large panse,
Et par leur ventre je connoy
Qu’ils ont moins de souci que moy.
Sans livre, ils chantent par routine
Un jargon qu’à peine on devine.
On connait moins dans leur canton
Le latin que le bas-breton.
Mais ils boivent, comme il, me semble,
Mieux que tous les cantons ensemble.
Voici comment Sanlesque peint ceux de son époque :
Les moines, dirait-il, ont d’étranges défauts ;
Ceux qui ne sont qu’oisifs sont les bons de Clairvaux.
Dès qu’un Célestin tousse, il lui faut de la viande ;
La jambe du Feuillant sent la pâte d’amende.
Le Capucin voyage un mois pour un sermon ;
Le Fontevrault s’occupe à tripler son menton ;
Le Carme est devenu marchand de scapulaire.
Parmi les Jacobins, point de foi qu’au rosaire ;
La guêtre au Récollet donne un air cavalier ;
Le Cordelier, enfin, est toujours cordelier.
Rabelais plaisante ainsi les moines de son temps :
« Semblablement ung moine ne laboure, comme le paysan ; ne guarde le pays, comme l’homme de guerre ; ne guarit les malades comme le médecin ; ne presche ny endoctrine le monde, comme le bon docteur evangelicque et pédagoge ; ne porte les commoditez et choses nécessaires à la républicque, comme le marchant. C’est la cause pourquoy de tout sont huez et abhorryz. Il n’y ha rien si vray que le froc et la cagoule tire à soy les opprobes, injures et malédictions du monde, tout ainsi comme le vent dict Cecias attire les nues. La raison péremptoire est parce qu’ils mangent la merde du monde, c’est-à-dire les péchez... Si entendez pourquoi un cinge en une famille est toujours mocqué et harcelé, vous entendez pourquoy les moynes sont de tous refuys et des vieulx et des jeunes. Le cinge ne garde point la maison, comme ung chien ; il ne tire pas l’aroy (charrue), comme le boeuf ; il ne produit ny lait, ny laine, comme la brebis ; il ne porte pas le faix, comme le cheval. Ce qu’il faict est tout conchier et de guaster, qui, est la cause pourquoi de tous receoipt mocqueries et bastonnades. »
Toutes les productions de l’époque nous présentent le moine gros, gras, franc licheur et trousseur de servantes. En vain quelques papes voulurent endiguer le flot qui soulevait tant de railleries, de dégoûts, de haines, les moines furent plus forts que les papes.
L’inutilité, la vilenie, l’inconduite, les crimes des moines facilitèrent beaucoup l’éclosion, puis le développement du protestantisme. Soumis dès lors à une sorte d’examen public, obligés de se défendre contre les attaques qui leur venaient de toute part, parfois désavoués par Rome qui sentait la domination lui échapper, les moines furent soumis à une règle extérieure un peu plus sévère. Beaucoup émigrèrent aux pays nouveaux, où ils apportèrent leurs vices et y furent souvent d’une âpreté et d’une férocité inouïes. Ils furent dans les pays latins les inquisiteurs qui ont inscrit dans l’histoire les pages les plus sombres.
Incapables d’enrayer le vaste mouvement d’émancipation spirituelle, intellectuelle et politique qui, du protestantisme, allait au siècle des encyclopédistes, de la Révolution d’Angleterre à la Révolution française, ils durent s’adapter pour ne pas disparaître. Et il faut avouer qu’ils y ont réussi pleinement. L’aumône et la vente des indulgences nourrissant peu les moines, ils se firent marchands, commerçants, industriels. Ils se formèrent en congrégations (voir ce mot) et raflèrent de par le monde des fortunes considérables. Tous les moyens leur furent et leur sont bons : captations d’héritage, comme exploitation d’usines ou de commerces.
Sous sa forme originelle, le monachisme était une folie, sous sa forme actuelle, il est une ignominie, ce que Diderot, avec son grand talent, a ainsi exposé : « Les monastères sont-ils donc si essentiels à la constitution d’un État ? Jésus-Christ a-t-il institué des moines et des religieuses ? L’Église ne peut-elle absolument s’en passer ? Ne sentira-t-on jamais la nécessité de rétrécir l’ouverture de ces gouffres où les races futures vont se perdre ? Toutes les prières de routine qui se font là valent-elles une obole que la commisération donne au pauvre ? Dieu, qui a créé l’homme sociable, approuve-t-il qu’il se renferme ? Dieu, qui l’a créé si inconstant, si fragile, peut-il autoriser la témérité de ses vœux ? Toutes ces cérémonies lugubres qu’on observe à la prise d’habit et à la profession, quand on consacre un homme ou une femme à la vie monastique et au malheur, suspendent-elles les fonctions animales ? Au contraire, ne se réveillent-elles pas dans le silence, la contrainte et l’oisiveté, avec une violence inconnue aux gens du monde, qu’une foule de distractions emporte ? Où est-ce qu’on voit des têtes obsédées par des spectres impurs qui les suivent et qui les agitions emporte ? Où est ce qu’on voit des têtes obsédées pâleur, cette maigreur, tous ces symptômes de la nature qui languit et se consume ? Où les nuits sont-elles troublées par des gémissements, les jours trempés de larmes versées sans cause et précédées d’une mélancolie qu’on ne sait à quoi attribuer ? Où est-ce que la nature, révoltée d’une contrainte pour laquelle elle n’est point faite, brise les obstacles qu’on lui oppose, devient furieuse, jette l’économie animale dans un désordre auquel il n’y a plus de remède ? En quel endroit le chagrin et l’humeur ont-ils anéanti toutes les qualités sociales ? Où est-ce qu’il n’y a ni père, ni frère, ni sœur, ni parent, ni ami ? Où est le séjour de la haine, du dégoût, des vapeurs ? Où est le lieu de la servitude et du despotisme ? Où sont les haines qui ne s’éteignent point ? Où sont les passions couvées dans le silence ? Où est le séjour de la cruauté et de la curiosité ?... Faire vœu de pauvreté, c’est s’engager par serment à être paresseux et voleur ; faire vœu de chasteté, c’est promettre à Dieu l’infraction constante de la plus sage et de la plus importante de ses lois ; faire vœu d’obéissance, c’est renoncer à la prérogative inaliénable de l’homme, la liberté. Si l’on observe ces vœux, on est criminel ; si on ne les observe pas, on est parjure. La vie claustrale est d’un fanatique ou d’un hypocrite. »
En France, les vœux ne sont pas reconnus par les lois, ils ont été supprimés par l’Assemblée Constituante le 13 février 1790 ; cependant le christianisme sait provoquer les vocations et quand l’expérience paraît mauvaise, bien peu osent s’affranchir. Dans une société où la vie est sans cesse diminuée, appauvrie, limitée à quelques manifestations strictement codifiées ; où tous les généreux élans sont brisés, il est normal que des individus insatisfaits, par réaction, parce qu’ils n’ont pas le courage de vivre quand même, contre ou hors les lois, trouvent un goût étrange, agréable même, à cette mort partielle qui, pensent-ils, les délivrera des laideurs de la vie. Les réveils de la chair sont parfois terribles et les disciplines n’ont d’autre effet que de développer les passions anormales.
Les lois ne peuvent rien contre cet état déplorable ; seule une organisation sociale meilleure y apportera remède en redonnant tout son sens à la vie.
– A. LAPEYRE.
MOLÉCULE
n. f. (du latin fictif molecula, diminutif de moles, masse)
Signifie donc petite masse, petite particule de matière. Cette définition prête à confusion : on pourrait, en l’adoptant, être conduit à confondre atomes et molécules, qui seraient ainsi pris indifféremment les uns et les autres pour désigner les parties constituantes de la matière. Le véritable sens précis auquel s’est arrêté la chimie moderne est le suivant : La molécule est la limite de la divisibilité de la matière. Choisissons un exemple.
Prenons un morceau de cristal de roche (quartz) ; à l’aide d’un marteau divisons-le en fragments de plus en plus petits. Chacun des dits fragments continuera à présenter les propriétés physiques et chimiques du quartz : ses facettes feront entre elles des angles dièdres invariables qui se rencontreront dans le plus petit fragment. Quand il ne nous sera plus possible de pousser la division du cristal de roche envisagé, jusqu’à en obtenir une particule qui ne pourrait plus être décomposée en éléments quartz, nous aurons obtenu une molécule de quartz. La molécule est ainsi la plus petite quantité d’un corps qui puisse exister à l’état libre. C’est donc, ici, la plus petite quantité de quartz qui puisse exister. Si, au cours de modifications nouvelles, une molécule de quartz change, ce n’est plus une molécule de quartz. La substance formée est aussi dissemblable du quartz qu’elle peut l’être. La science moderne nous a révélé que les molécules sont elles-mêmes composées d’éléments plus petits encore appelés atomes (voir ce mot) lesquels seraient eux-mêmes divisibles en particules plus ténues encore : ions et électrons. Les atomes restent la plus petite quantité d’un élément qui puisse exister dans la molécule.
La matière de tous les corps, et par conséquent la matière universelle, est formée par l’agrégat des molécules, elles-mêmes constituées d’atomes. Lorsque tous les atomes d’une molécule sont les mêmes, nous nous trouvons en présence des corps « simples » ou éléments tels que le fer, l’oxygène, etc. Quand les atomes entrant dans la constitution des molécules sont différents, nous avons des corps « composés » : amidon, sulfate de cuivre, albumine, pyrite de fer, etc. Entre les molécules d’un corps existent des espaces intermoléculaires dont les dimensions sont plus grandes que celles des molécules, tout comme il y a, dans les molécules, des espaces inter-atomiques. Tous ces espaces sont occupés par l’éther. Dans la masse de la matière, les molécules et dans celle des molécules, les atomes sont animés d’un mouvement extrêmement rapide, échappant à nos sens et sans lequel la matière n’existerait pas. On a l’image de cet état de choses dans le Cosmos, où les astres sont – toutes proportions gardées – comme les molécules d’un corps et maintenus dans l’espace par leur mouvement perpétuel. L’agitation des molécules échappe à notre perception directe ; mais elles sont animées de mouvements très vifs et désordonnés. Ce mouvement incessant des molécules, particulier à toute la matière, auquel on a donné le nom de mouvement « Brownien » ne s’arrête jamais. Il est éternel et spontané.
Il nous est pour ainsi dire impossible de connaître le poids absolu et la grandeur des molécules. On ne peut saisir entre elles que des rapports de poids et de volume. Ces rapports constituant la connaissance des poids et des volumes moléculaires sont rapportés à une unité constante : le poids d’un atome d’hydrogène. Les molécules des différents corps pèseront donc plus ou moins que l’atome d’hydrogène, lequel pèse notablement moins « que le milliardième de milliardième de milligramme ». (J,. Perrin : les Atomes.)
Il nous est difficile de nous faire une idée de la petitesse des atomes constitutifs des molécules – deux atomes au moins devant être réunis pour constituer une molécule. – Dans une tête d’épingle ordinaire, il y aurait 8 sextillions d’atomes (8000 milliards de milliards). Un millimètre cube d’hydrogène contiendrait 36 millions de milliards de molécules. Et un millimètre cube d’éther renferme d’après Clausius et Maxwell, 7716 x (10 élevé à la 54ème puissance) d’atomes ou 7716 suivi de 53 zéros !
La vitesse avec laquelle se meuvent les molécules a été évaluée a 1698 mètres par seconde pour l’hydrogène, tandis que pour les gaz plus lourds, elle varie avec le poids tout en diminuant d’une façon notable.
La chimie moderne ne saurait se passer actuellement de la théorie atomique ; sans elle toutes les conceptions qu’elle renferme s’écrouleraient. Ce n’est cependant qu’une hypothèse ; nous n’avons aucune idée réelle de ce qu’est un atome. Nous ne savons rien de sa constitution, de sa forme, de son poids réel, de sa position, de sa couleur. Mais, venue de l’Antiquité jusqu’à nos jours, toujours perfectionnée, et vivante, confirmée et renouvelée par les travaux modernes sur la radioactivité, elle a l’avantage énorme d’être un instrument fécond dont les fruits et les applications sont nombreuses et bienfaisantes et c’est grâce à elle que le problème de la matière a cessé d’être un problème métaphysique, pour devenir de plus en plus un problème d’ordre expérimental et positif.
– Ch. ALEXANDRE.
MONARCHIE
n. f. (latin, monarchia : de monos, seul, et arkhein, commander)
La monarchie, cette vieille souillure de notre planète, date de l’anthropophagie. Elle a pour emblème un oiseau de proie et constitue un recul monstrueux, une honte et une dégradation ignominieuse de l’espèce humaine sur sa propre préhistoire.
De nombreuses recherches historiques attestent que l’homme primitif vivait relativement heureux dans la promiscuité sexuelle et la communauté de la cueillette et de la pêche au bord des grands fleuves de la forêt vierge.
Mais les intempéries et les attaques des bêtes sauvages, l’insécurité et la pénurie créèrent, stimulées par l’ignorance et la peur : Dieu, le règne de la ruse, de la force et la notion antisociale du tien et du mien qui enfantèrent, avec le prêtre, le guerrier et le trafiquant, l’inique société humaine, basée sur la Religion, la Propriété et la Famille.
-
La Religion, cela veut dire la croyance en un Dieu de justice, de bonté et de toute-puissance qui, en créant l’homme à « son image », le tire du néant et le condamne férocement à mort en lui donnant la vie. La Religion, c’est encore le dualisme du Corps et de l’Esprit au lieu du monisme de la nature.
-
La Propriété, cela signifie la division de l’humanité en classes rivales et ennemies, en riches et en pauvres, en exploiteurs et en exploités, en gouvernants et en esclaves travaillant depuis des millénaires, sans répit ni espoir, « à la sueur de leur front » pour engraisser une minorité infime de parasites malfaisants.
-
La Famille, hypocrisie suprême ; c’est la paternité physiologiquement incertaine dont la loi fait le pivot du groupe affectif au lieu de la maternité qui ne saurait être douteuse. C’est l’enfant à tout âge qui doit, d’après le § 371 du Code, respect à ses parents et de la femme, que les § § 212 et 213 du même Code condamnent à obéir à son mari, seigneur et maître, qu’elle doit suivre où bon lui semble. La famille, embryon de monarchie, c’est l’inégalité des sexes, la discorde à domicile et la flétrissure de l’amour libre, qui est seul conforme à la sélection naturelle.
La monarchie est la forme politique la plus cyniquement arbitraire qui ait jamais reflété le tréfonds d’antagonismes et d’iniquités des sociétés humaines. Rien que son caractère héréditaire constitue la consécration de l’esclavage du régime. (V. État, société, etc.)
Mais la monarchie, en dépit de son nom, n’a jamais été, au sens absolu du mot, le gouvernement d’un seul. Partout et toujours le roi absolu partageait le pouvoir avec une hiérarchie restreinte, héréditaire, et aristocratique, gouvernant et exploitant la foule des travailleurs, parias et esclaves, au profit de ses privilèges.
Le gouvernement d’un seul, dans le sens exact du mot, n’a jamais été qu’un pieux désir des faibles et des impotents à la recherche d’un homme, incarnation suprême de leur Dieu, qui se chargerait de gouverner la société en comblant de ses bienfaits les bons et en châtiant les méchants.
Même les Républiques historiques qui sont des progrès indéniables – moralement – sur l’abjection monarchiste, comme le Salariat l’est sur l’esclavage antique, ne sont, elles aussi, qu’un moyen de gouverner et d’asservir le peuple producteur, sous le voile hypocrite de la souveraineté nationale, aux élus de la naissance et de la fortune.
L’histoire de l’humanité, a dit Büchner, est un épouvantable cauchemar d’où émergent trois points lumineux : la Grèce antique, la Renaissance et la Grande Révolution Française, c’est-à-dire l’aspiration vers le beau, la prise de possession de la Terre avec la conquête du Ciel, et l’affirmation des Droits de l’Homme, complétée par le Manifeste des Égaux réclamant l’égalité de fait, l’égalité économique.
Le reste de l’histoire humaine appartient, hélas ! aux rois et aux prêtres, à ce cauchemar sinistre dont parle le philosophe matérialiste allemand et qu’éclairent seuls les bûchers des suppliciés. La royauté, l’empire, la monarchie... un long cri d’angoisse répond il cette évocation, à cette horreur des horreurs !
Comme Jéhovah, d’après la Bible, n’a pu trouver un juste à Sodome et Gomorrhe, nous ne voyons pas un monarque, mais pas un seul – Marc Aurèle, l’empereur philosophe y compris –, qui, en bonne justice, n’aurait pas dû être mis à mort en vertu de cette loi d’hygiène et de préservation sociale qui dit que celui qui se met au-dessus de l’humanité doit être extrait du nombre des vivants.
Les antiques monarchies de l’Orient, l’égyptienne, l’assyrienne, la mède et la persane étaient des despoties pures. L’assyrienne et la chaldéenne, avec sa somptueuse capitale Babylone, aux jardins suspendus de Sémiramis et aux cent tours, est caractérisée par la légende qui veut que, pendant une orgie qui eu lieu au palais du roi, des lettres de feu apparurent sur les murs formant les mots mane, thecel, phares, c’est-à-dire pesé, compté, divisé... et Babylone fut détruite et rasée.
Au pays des Pharaons, la vanité des monarques sacrifiait la vie de milliers d’hommes, de fellahs, pour se faire construire des monuments funéraires, vieux comme la pyramide de Chéops de 6000 ans et atteignant 150 mètres de hauteur. Pour excuser les Pharaons on a prétendu que les pyramides avaient été édifiées pour faire des observations astronomiques. Elle y ont été partiellement affectées, mais ce goût des Pharaons constructeurs pour l’astronomie semble tout de même douteux.
Les Romains, sur lesquels nous avons pris modèle pour les lois, ont été un grand peuple, mais féroce, le peuple des cirques, du panem et circenses, des combats des gladiateurs et du fameux : Christianos ad leones !
César – ave Cesar morituri te salutant ! – se tenait dans sa loge et donnait le signal du combat et il pouvait, si tel était son bon plaisir, ordonner la mort ou faire grâce au vaincu. Police verso, police recto ! César, le modèle des dictateurs, qui frayait la voie à l’Empire, à Rome avait été « l’amant de toutes les femmes et le mignon de tous les hommes ». Il fut aussi l’amant de la célèbre Cléopâtre qui, après « s’en être servis » jeta ses amants en pâture aux crocodiles.
À ce César nous devons les mots ailés : À son batelier : « Tu portes César et sa destinée ». Au Sénat romain, le message : « Veni, vidi, vici ». (Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu). Et aussi le fameux : Si vis pacem, para bellum. (Si tu veux la paix, prépare la guerre)... et le monde, pendant des siècles, a saigné par tous les pores.
Et les successeurs de César, les empereurs romains ? Une collection de sadiques et de monstres, depuis Tibère et Néron en passant par Caracalla jusqu’au chrétien Constantin !
Voici le moyen-âge. Si ce n’est pire, ce n’est guère mieux. Comme levée de rideau sur le moyen-âge, voici d’abord Attila et l’invasion des Huns, « sous les chevaux desquels l’herbe ne repoussait plus » ; puis celle des Normands ; ensuite cette parole consolatrice, pendant le massacre de Béziers : « Dieu reconnaitra les siens ! » Les Croisades, les guerres et les déchirements de l’Allemagne éternellement morcelée par ses princes et ses grands. L’invasion des Mongols, en Russie, Ivan le Terrible. L’Inquisition en Espagne !...
En France, la monarchie élective – dit-on – cède la place à la monarchie héréditaire qui s’établit avec Hugues Capet en 987. Louis VIII fait encore sacrer son fils. Saint Louis en fait autant pour le sien et les rois se maintiennent en équilibre entre la noblesse et la bourgeoisie en lutte.
Mais, avec les Bourbons, commence la royauté absolue : toutes les libertés meurent à la fois, la liberté politique dans les États, la liberté religieuse par la prise de La Rochelle et la liberté littéraire par la création de l’Académie française.
Sous Louis XIII, Richelieu achève la consolidation monarchiste de la France et Louis XIV, le « roi soleil », ose dire en 1661 « L’État c’est moi ! », mot qui a trouvé son pendant dans la parole qu’un courtisan adressait à Louis XV, en lui désignant la foule :
« Sire, tout ce peuple est à vous ! » ...
Sur le tout, se brochent des guerres de succession et des guerres religieuses, jusqu’au jour où le couperet de la guillotine met fin à l’effrayante mascarade royaliste... Mais, hélas ; pour un temps seulement. Car le jeu sinistre a recommencé de plus belle avec le grand assassin, Napoléon 1er, restaurateur de l’esclavage des Noirs et de la marque infamante et qui disait cyniquement, après la bataille d’Austerlitz : « Ce n’est rien, une nuit de Paris réparera tout cela ! »...
Contrairement à ce qui s’est passé en France dans la seconde moitié du moyen-âge, où la royauté tenait la balance entre la noblesse et la bourgeoisie, en Angleterre la royauté absolue fut vaincue, parce que nobles et bourgeois firent cause commune contre elle...
À l’heure où nous sommes, en l’an de grâce 1931, la royauté, après avoir passe par toutes les variantes de l’hypocrisie « constitutionnaliste », semble définitivement vaincue, mais le fascisme, qui n’est qu’un bonapartisme vêtu à la moderne, guette la Révolution au premier tournant de l’histoire qui se présentera. Cela ne saurait faire le moindre doute.
La situation mondiale est périlleuse, angoissante au premier chef. La vieille société décomposée né veut pas mourir et la nouvelle ne sait pas naître.
Il n’y a plus de parti monarchiste proprement dit parce qu’il n’y a plus de mouvement foncièrement républicain égalitaire et libertaire. Droite et Gauche, discréditées toutes les deux, se confondent – tout en se combattant, – dans la défense de l’ordre social actuel.
Les partis révolutionnaires (socialistes de gauche, communistes et anarchistes) sont chaotiques et manquent de plate-forme nette, précise pour le combat révolutionnaire. Et cependant cette plate-forme, qui rallierait toutes les bonnes volontés révolutionnaires, serait facile à trouver.
Le Droit n’est rien sans la Possibilité de s’en servir. La République politique, pour aussi radicale qu’on la suppose, n’est rien si elle n’est doublée de la République économique.
SOCIALISER LA PRODUCTION À LA RUSSE SANS SUPPRIMER LE SALARIAT ET SANS ÉTABLIR LE DROIT ÉGALITAIRE DE CHACUN SUR LE RENDEMENT SOCIAL N’EST QU’UNE DEMI-MESURE.
Laissons dire ceux qui prétendent que le progrès ne peut s’accomplir que par étapes. Compter là-dessus, c’est se condamner à tourner éternellement sur place.
Ce n’est qu’en brisant la chrysalide que le papillon prend son vol. Ce n’est qu’en renversant l’État et en tuant le régime de la propriété que nous pourrons établir la République Sociale, la société sans Dieu ni maîtres dans laquelle tous les hommes et toutes les femmes seront économiquement égaux, intellectuellement affranchis et moralement solidaires.
– Frédéric STACKELBERG.
MONDE
Voir Terre, Univers, etc.
MONISME
n. m. (de monos, seul)
Doit être dit moniste tout système, matérialiste ou spiritualiste, il n’importe, qui prétend expliquer l’univers à l’aide d’un seul élément. Dès l’origine, les penseurs s’efforcèrent de simplifier l’apparent fouillis que constituent les phénomènes, de ramener le multiple à l’un, le particulier à l’universel. Pour les premiers philosophes grecs, il n’existait qu’une substance fondamentale, la matière, force vague et mal définie qui engendrait tout ensemble et les êtres vivants et les corps inorganiques. Plus tard, la matière supposée passive et inerte fut opposée à l’esprit, essentiellement actif, et l’on aboutit au dualisme cher aux scolastiques, ainsi qu’à Descartes. Dans l’homme se rencontreraient deux principes hétérogènes, l’âme, d’une part, le corps de l’autre ; dans l’univers à côté de la matière coexisterait un esprit éternel, infini, nécessaire : Dieu, qui en fut le créateur ou l’ordonnateur. Mais Spinoza revint à l’idée d’une substance unique. Étendue et pensée, en d’autres termes matière et âme, sont pour lui deux attributs, les seuls que nous connaissions, de la substance divine constitutive de toute réalité. Aussi ancien probablement que la philosophie, puisque nous le retrouvons dans les premiers livres de l’Inde, le panthéisme, aux formes très variables et que le christianisme ne parvint pas à tuer définitivement même en Europe, confond d’ordinaire le monde et dieu en un être unique.
Nombreux furent les penseurs du XIXe siècle qui admirent de même que les substances dites individuelles et contingentes étaient des déterminations, des modalités, d’une substance simple, immuable, infinie. Dieu serait immanent et dans l’ensemble de l’univers et dans chacun des êtres qui le composent ; non seulement il n’existerait pas sans les individus, mais il n’aurait d’être et de réalité que dans et par les individus. Aujourd’hui, le monisme, dont la vogue fut si grande au début du XXème siècle, continue de désigner des systèmes absolument irréductibles. Celui de Haeckel par exemple, tout à fait matérialiste, s’oppose à l’idéalisme moniste des penseurs protestants. Selon Haeckel, matière et énergie sont les deux attributs inséparables d’une substance unique, qui explique la vie et la pensée au même titre que les phénomènes inorganiques. Elle est la raison d’être de notre, univers pris dans sa totalité, comme dans ses détails ; aussi point de science véritable qui ne repose sur l’expérience. Les prétendues révélations divines sont de vaines illusions ; c’est du travail de nos sens et des cellules nerveuses de notre cerveau que résulte la connaissance ; les sciences de l’esprit sont en conséquence un simple chapitre de la biologie. Bien d’autres philosophes, dont les idées varient par ailleurs, voient dans la matière le fond commun d’où tout sort, même la pensée. Et la majorité des savants actuels, de ceux à qui l’intérêt ne ferme pas la bouche, semble s’être ralliée à cette conception radicalement contraire aux fallacieuses suppositions des théologiens catholiques. Mais il existe un monisme spiritualiste, qui fait de la pensée le principe primordial de tout, même de la matière. Le système des monades, soutenu par Leibniz, en fut l’annonciateur dans les temps modernes ; d’autres doctrines sont nées depuis, qui s’inspirent plus ou moins de Pythagore, de Platon, des Alexandrins. Une même pensée animerait l’univers ; et, sous des formes différentes, une intelligence assez forte percevrait un thème identique, et dans le monde sensible, et dans le monde moral, et dans le monde des idées. Malheureusement, ces traductions en langages différents de l’idée divine, génératrice de l’univers, restent indéchiffrables pour nous ; c’est une sorte d’instinct qui d’ordinaire nous avertit qu’en définitive le multiple se ramène à l’un. Pour le monisme idéaliste, qui fut très florissant dans les universités anglo-saxonnes, le monde n’est pas une collection de faits, mais un grand fait unique, qui renferme tout. Un esprit absolu, Dieu crée les faits particuliers par cela même qu’il les pense, comme le romancier crée les personnages de ses livres, comme le rêveur crée l’objet de ses songes. L’univers et l’absolu sont un seul fait ; les deux se compénètrent, car être, pour une chose finie, consiste à être un objet pour l’absolu, et, pour l’absolu, être c’est penser l’ensemble des objets particuliers, le tout. Une revue de Chicago, The Monist, se donna comme mission de répandre ces idées parmi les protestants : elle avait comme maxime cette pensée, que l’on déclare admirable et qui est simplement absurde : « Imitons le Grand Tout ». Ces rêveries métaphysiques qu’aucune preuve n’étaie, que la science positive contredit à chaque instant, sont à ranger parmi les mythes dépourvus de tout fondement. S’il est moins poétique, le monisme matérialiste apparaît infiniment plus vrai.
À l’opposé du monisme se place le pluralisme qui proscrit la recherche de l’unité et considère chaque fait comme pouvant être seul de son espèce. William James « admet comme possible que la somme totale absolue des choses ne fasse jamais l’objet d’une expérience positive, ou ne se réalise jamais ni en aucune façon sous cette forme, et qu’un aspect de dispersion ou d’incomplète unification soit la seule forme sous laquelle cette réalité s’est constituée jusqu’à présent ». Ce philosophe a mis le pluralisme au service du spiritualisme et de la religion, ce qui explique l’immense succès obtenu par ses écrits. Mais le pluralisme s’accommode aussi du matérialisme et de l’athéisme le plus complet, ainsi que l’ont montré des penseurs de très grand mérite. (Voir pluralisme.)
C’est dans le plan expérimental que doit être placé le problème du monisme, à notre avis ; fantaisies théologiques, chimères métaphysiques peuvent seulement nous divertir. Or, dans toutes les branches du savoir positif, on tend à rattacher les faits à des lois, et les lois particulières à des lois plus générales. De là les grandes théories, celle de l’unité de composition des corps en chimie, les doctrines électromagnétiques et les thèses d’Einstein en physique, etc. Et les découvertes qui résultent de ce besoin d’unité démontrent, semble-t-il, qu’il répond à la réalité des choses, autant qu’à une inclination subjective. Mais si le monisme est admissible au point de départ, c’est le pluralisme qui convient au point d’arrivée. Partie de l’un, la nature aboutit au multiple ; et de même que le modèle l’emporte sur l’image, l’individu l’emporte sur les abstractions idéologiques auxquelles on s’efforce de le rattacher. Excellente pour établir la filiation des causes, la tendance à l’unité deviendrait régression dangereuse si elle voulait interdire l’infinie diversité dont témoignent et la vie et la pensée. « Un sanglant désir d’unité aveugle certains esprits. Il ne comprennent pas que l’harmonie totale doit résulter de la diversité individuelle, non d’une impossible et néfaste uniformité. »
— L. B.
BIBLIOGRAPHIE : E. Haeckel : Le Monisme ; les Énigmes de l’Univers, etc...
MONNAIE
n. f. (latin moneta)
La forme primitive de l’échange fut, sans doute, le troc. Mais faut-il admettre, avec les économistes, que celui-ci, à l’origine, consistait à donner les objets dont on pouvait se passer pour obtenir ceux dont on avait besoin ? Rien de moins sûr. L’homme de la horde primitive n’envisageait pas les choses d’un point de vue objectif, il n’en appréciait pas l’importance d’après leurs propriétés matérielles et sensibles, mais plutôt d’après les sentiments que suscitaient chez lui les pouvoirs occultes qu’il leur attribuait. Les premiers échanges ne comportaient pas de mesures, les premières transactions ne furent pas des contrats privés, mais en quelque sorte des actes religieux, publiquement sanctionnés. Les cessions immobilières ont longtemps conservé ce caractère.
Le commerce, tel que nous l’entendons, a eu vraisemblablement sa source dans la dissemblance des produits du sol, entre peuples éloignés, et la division du travail, au sein des groupes particuliers. Mais cette division fut accompagnée d’une hiérarchisation des fonctions et d’une subordination des droits. La force, l’autorité présidaient à la répartition des produits entre les membres des familles et des clans. Dans les relations entre clans différents, la notion d’équilibre des services, de rétribution du travail, n’influaient qu’obscurément, elle était effacée par le sentiment de convoitise excité par la vue même de l’objet rare, par le monopole. Les échelles de comparaison entre les richesses faisant l’objet du troc étaient donc essentiellement arbitraires, et lorsque la multiplication des échanges eut éveillé l’idée d’une commune mesure entre les diverses matières, l’étalon fut défini sans précision et ne prit qu’à la longue l’aspect d’un symbole. Chez les peuples chasseurs, on choisit des peaux de bêtes, des armes ; certaines pierres taillées avec des soins particuliers dans des roches de provenance lointaine auraient servi de monnaie ; chez les peuples pasteurs, ce furent des têtes de bétail : il nous en est resté le mot pécune, de pécas (bétail), capital, de caput (tête) ; chez les agriculteurs, ce furent des produits du sol, céréales, noix... À la naissance de l’industrie, ce furent des objets manufacturés, pièces de toile, objets de parure, particulièrement en métaux précieux universellement désirés.
La monnaie telle que nous la connaissons, matière dont une quantité déterminée et garantie sert d’étalon de valeur pour toutes les marchandises, fut longtemps avant d’entrer en usage. Dans notre occident, elle paraît avoir été inventée en Grèce, vers 900 avant J.-C., et peut-être aussi en Lydie, d’Asie mineure. Elle ne fut introduite en Égypte que lors de la conquête par les Perses, d’où le nom de la pièce Dariques, de Darius. À Rome, ce ne fut qu’au milieu du Vème siècle avant J.-C. que fut usitée une monnaie véritable en cuivre estampillé dont l’État monopolisait la fabrication. Cette correspondance entre la valeur et l’utilité du cuivre marque le caractère réaliste du peuple romain. La conquête du monde au IVème siècle, faisant affluer à Rome les trésors enlevés aux vaincus, amena l’emploi des métaux précieux. Dès le début de l’empire, l’Empereur se réserve la frappe de l’or et de l’argent, abandonnant au Sénat celle du cuivre, monnaie d’appoint.
Par le choix de l’or, la monnaie se rattache à la parure.
« Si nous consultons l’histoire, l’or semble avoir été employé en premier lieu comme une matière précieuse propre à l’ornementation, secondement comme moyen d’accumuler de la richesse, troisièmement comme moyen d’échange et enfin comme une mesure de la valeur. » (Stanley Jevons)
De droit, l’or appartient aux puissants ; le monnayage est le privilège des rois ; les pièces sont marquées de leurs sceaux.
« Comme on les employait pour indiquer la propriété et ratifier les contrats, ils devinrent un symbole d’autorité. » (S. J.)
Le souverain devient, en effigie, partie dans toutes les transactions, s’effectuant même loin de ses yeux. Faisant équilibre à tous les produits, la monnaie frappée à l’image de César indique que toutes les choses de ce monde appartiennent à César. On la lui restitue dès qu’il l’exige, c’est le tribut, c’est l’impôt.
De nos jours, la monnaie est :
-
Un moyen d’échange ;
-
Un étalon de valeur ;
-
Un moyen d’emmagasiner de la valeur.
Pour remplir le premier et le troisième rôle, il faut qu’elle soit une marchandise appréciée que chacun soit disposé à recevoir et veuille détenir. Pour servir à l’accumulation, il faut encore qu’elle soit inaltérable et que son rapport avec les richesses qu’elle représente soit sujet aux moindres variations. Les métaux précieux, toujours recherchés, répondent à peu près à ces conditions ; ils sont peu altérables et quant à leur valeur relative elle ne se modifie que lentement en temps normal. S’il arrive qu’ils soient en surabondance pour les transactions commerciales, la bijouterie les emploie ; si, au contraire, les besoins en numéraire augmentent, les bijoux se vendent pour le monnayage. Pendant de longues périodes la compensation s’établit spontanément sans mesures spéciales. L’usage du billet de banque, des chèques et autres titres de crédit, aide au maintien de l’équilibre.
Pour remplir son deuxième rôle, il faut que la matière qui fournira l’étalon concrétise la qualité commune à tous les objets échangeables que nous considérons comme constituant la valeur. Sans insister ici sur la notion de valeur (voir ce mot), nous pouvons dire que la tendance moderne est de concevoir une corrélation entre la valeur et le travail. L’équité exige que lorsque des hommes échangent entre eux produits et services ils ne fassent état d’autre chose que de la quantité de leur propre travail qu’ils leur ont incorporée, sans tirer un profit abusif des dons gratuits de la nature.
Or Marx a montré qu’aux pays de production, l’or est évalué en fonction du travail que l’extraction et le traitement du minerai exigent. Cependant la correspondance n’est pas rigoureuse ; les écarts, en temps ordinaire, ont pu atteindre 10 à 15 %. Ils peuvent occasionnellement devenir bien supérieurs avec la découverte de nouvelles mines et, à un moindre degré, avec le perfectionnement de la métallurgie. On y remédierait à la rigueur par le monopole de la production et la mise en réserve du surplus de celle-ci, de telle sorte que la portion introduite dans la circulation correspondit toujours à une même quantité de travail. Notons que pareille mesure ne serait pas possible si l’on prenait comme étalon une denrée de première nécessité. Pourrait-on restreindre la production du blé ou du fer pour leur conserver leur valeur ?
Mais, comme nous l’avons vu, ce ne sont pas des lingots pesés qui servent de monnaie légale, ce sont des disques dont le titre et le poids sont garantis par les États. L’expérience nous montre que c’est l’insuffisance de cette garantie qui motive les plus grands écarts de la valeur. L’altération des monnaies est un procédé dont toujours les gouvernements ont usé pour se tirer d’embarras financiers sans provoquer les récriminations des gouvernés. Au premier siècle de notre ère, l’étalon représentait 7 gr. 80 d’or, au titre de 990 0/00. Au début du IIIème siècle, il ne contient plus que 6 gr. 50 et, dès lors, le poids tombe si rapidement que l’or cesse d’être en usage. Le denier d’argent qui, au début de l’empire contenait 3 gr. 41 au titre de 99, voit son titre baisser à 50 % sous Septime Sévère. On le remplace par une pièce de 5 gr. qui tombe bientôt à 3 gr. Le titre n’est plus que 5 %, puis la pièce se réduit à une plaque de cuivre recouverte d’une pellicule d’argent.
Avant la IIIème République, nos rois ont recouru aux mêmes fraudes. Le moyen d’y mettre un terme serait l’adoption dune monnaie internationale qui obligerait les gouvernements des divers pays à se surveiller mutuellement, si même la frappe n’était pas confiée à un atelier commun. Ce serait au surplus une précaution contre les velléités guerrières, car si une telle mesure ne suffisait pas à assurer la paix, elle apporterait une grande gêne aux expédients financiers des pays belliqueux.
On peut se demander s’il ne serait pas encore plus simple de supprimer l’emploi de la monnaie, l’échange s’opérant par l’intermédiaire de coupures représentant des heures de travail. Nous ne le pensons pas. La garantie de ces billets serait-elle personnelle ou sociale ? Dans le premier cas, il consacrerait une servitude personnelle de l’acheteur envers le vendeur, le premier se reconnaissant débiteur d’une certaine durée de labeur vis-à-vis du second ou de son substitut. Dans le second cas, elle aboutirait à la servitude de tous vis-à-vis de l’État investi des fonctions de garant et bientôt de régulateur de l’activité des citoyens, d’agent obligé de la répartition. Ce serait l’instauration d’un régime essentiellement autoritaire.
Malgré ses inconvénients, la monnaie est, en réalité, un instrument de libération de l’individu. Comme nous l’avons signalé, elle n’était pas usitée en Égypte sous les Pharaons et le peuple n’en était pas moins soumis à un dur esclavage ni moins pressuré. Renoncer à la monnaie métallique n’apporterait aucun soulagement à la misère des hommes si les cadres sociaux n’étaient préalablement transformés. Les relations des hommes avec les choses dépendent avant tout de la façon dont sont conçues les relations des hommes entre eux.
– G. GOUJON.
MONNAIE
Aristote, dans sa Politique, livre 1er, chapitre III, a retracé en quelques lignes l’histoire de la monnaie, et il n’y a pas grand’ chose à ajouter, après tant de siècles, à ce raccourci : « On convint de donner et de recevoir dans les échanges une matière qui, utile par elle-même, fut aisément maniable dans les usages habituels de la vie : ce fut du fer, par exemple, de l’argent ou telle autre substance, dont on détermina d’abord la dimension et le poids et qu’enfin, pour se débarrasser d’un continuel mesurage, on marqua d’une empreinte particulière, signe de sa valeur ou plus exactement de son poids et titre ».
Mais ce n’est qu’après de longs, très longs tâtonnements que les sociétés humaines ont fini par adopter, comme instrument d’échange, un métal précieux, qui ne fut pas toujours, comme le remarque Aristote, l’argent, l’or ou même le platine. Non seulement on s’est servi du fer, mais on a employé (et on emploie encore) le cuivre, le plomb, I’électrum (alliage de 3/4 d’or et 1/4 d’argent) ; bref un corps présentant les avantages nécessaires à un outil de troc : homogénéité, inaltérabilité, divisibilité, malléabilité, facilité de transport.
À l’enfance de la civilisation, on s’est servi de têtes de bétail. Homère chante que tandis que l’armure de Diomède ne coûte que 9 bœufs, celle de Glaucus en coûte 100. On a employé comme monnaie : les coquilles dans l’Amérique du Nord, les cauris en Guinée, le sel à Sumatra et au Mexique, des bouts de paille au Congo, le thé en T’artarie chinoise, le sel et la poudre en Abyssinie, des fourrures dans le territoire de la Baie d’Hudson et ces instruments d’échange ne sont pas encore complètement tombés en désuétude.
Jusqu’à Pierre le Grand, on employait le cuir comme monnaie en Moscovie. Dans les Massachusetts, en 1641, le blé était légalement accepté comme paiement des dettes. En 1669, le tabac servait de monnaie en Virginie. En, 1812, selon ce qu’écrit Adam Smith, dans sa « Richesse des Nations », des tenanciers de cabarets écossais acceptaient encore des clous comme paiement de l’ale qu’ils débitaient. Enfin, jusqu’à la révolution de 1868, les marchandises et les traitements des fonctionnaires étaient, au Japon, évalués en riz.
L’emploi des bestiaux comme monnaie, chez les peuples habitant les rives de la Méditerranée, a laissé de tels souvenirs qu’il a formé le mot pecunia, pécune.
On s’est servi, à l’origine de l’apparition de la monnaie métallique, de barres ou lingots. Dans son Histoire Naturelle, Pline raconte que jusqu’au temps de Servius Tellius, les Romains se servaient, pour leurs échanges, de barres de cuivre grossières. Mais le système des lingots d’or et d’argent, quand ces métaux précieux furent utilisés, présentaient de graves inconvénients : il fallait les peser et les « essayer ». Quand Abraham achète un champ à un personnage du nom d’Ephron pour y ensevelir sa femme Sara, il pèse les 400 sicles d’argent qu’il lui a coûté « en présence des fils de Heth » et probablement de tous ceux qui entraient par la porte de la ville. (Genèse, XXIII.) Plus tard, pour éviter tant de complications – poids, présence de témoins – on trouva plus commode de frapper les lingots d’un sceau officiel, garantissant d’abord la qualité ou l’aloi du métal, puis son poids. Le commerce prenant de grandes proportions, on finit vers le VIIème siècle avant l’ère vulgaire par avoir recours aux pièces de monnaie, c’est-à-dire à des lingots généralement cylindriques de très petite épaisseur, dont des empreintes, sur la face comme sur le revers, garantiraient l’aloi et la valeur d’échange, lui conféreraient droit de circulation. La pesée ne devenait nécessaire que dans le cas où l’on craignait la fraude.
Jusqu’à une époque récente, les marchands chinois étaient invariablement munis d’une petite balance destinée à peser les lingots, la poudre ou les fils d’or ou d’argent.
L’Égypte des Pharaons ne connut pas les pièces de monnaie. On se servit comme instrument de troc : d’or, d’argent, d’electrum, de cuivre, de plomb, de fer qu’on manipulait sous la forme de pépites, de bourses (contenant paillettes ou poudre), de briques (tuiles, barres, plaques), d’anneaux – forme la plus fréquente – appelée tabnous, divisés en dix kites.
En Grèce, dans les colonies grecques ou les pays influencés par la civilisation hellénique, on a employé plusieurs systèmes monétaires qui dépendaient des circonstances politiques et des conditions commerciales des villes ou pays de frappe, mais quel que fut le système, la drachme (sicle des orientaux) ou la double drachme ou statère, constituait la pièce principale ou étalon.
-
Dans le système eginétique la drachme d’argent pèse 6 gr. 28
-
Dans le système lydien le statère d’électrum 15 gr.90
-
La drachme d’argent attique 4 gr. 36
-
Le sicle médique ou drachme perse 5 gr. 60
-
Le double-drachme ou statère d’argent phénicien 11 gr. 20
-
Le Statère ou double-drachme d’or d’Alexandre 8 gr. 60
-
Le sicle ou drachme d’argent juif, à l’époque des Macchabées 14 gr. 25
-
Le statère ou double-drachme d’argent corinthien 8 gr. 22
À comparer avec l’ancienne pièce française de 1 franc (5 francs de notre monnaie actuelle) en argent pesant 5 grammes et la pièce d’or de 10 francs d’avant-guerre pesant 3 gr. 226.
Le denier ou drachme d’argent romain pèse 4 gr. 30, le denier d’argent carolingien, puis féodal, n’atteint plus que 2 à 3 grammes.
Les Grecs avaient une monnaie de compte qu’ils appelaient talent (talenton équivaut à plateau de balance, poids) et qui représentait la valeur d’une somme d’or ou d’argent pesant le poids d’un talent (poids variable, mais qu’on peut évaluer en moyenne à 19 kg 500). La drachme grecque se subdivisait en hémidrachme ou triobole, diobole ou 1/3 de drachme, l’obole ou 1/6 de drachme, l’hémi-obole. C’était le système duodécimal.
Nous le retrouvons d’ailleurs chez les Romains. L’as de cuivre de Servius Tellius qui pesait une livre romaine (327 gr.) était divisé en 12 onces. Il fallut attendre jusqu’en 269 avant l’ère vulgaire pour frapper de la monnaie d’argent à Rome et comme l’atelier de monnayage était situé dans une dépendance du temple de Junon Moneta (l’avertisseuse), on donna le nom de moneta (d’où, provient notre mot « monnaie ») aux espèces qui y étaient frappées. L’or ne fut frappé à Rome qu’au temps de Sylla. L’antique denier romain était divisé en deux quinaires, eux-mêmes divisés en deux sesterces. Sous l’empire romain, la pièce étalon d’or est l’aureus. Constantin établit une nouvelle pièce étalon, le solidus d’or, qui devient, en nos contrées, le sol ou sou.
En France, à partir du moment où le pouvoir central s’affirma, on compta en livres tournois (de Tours, où existait un atelier de monnayage). La Livre tournois se divisait en 20 sols, le sol en 12 deniers, le denier en 2 oboles, l’obole en 2 pite, la pite en 2 semi-pites. Il va sans dire qu’on n’a jamais frappé de livres tournois.
La livre tournois a constamment tendu à diminuer de valeur. En la comparant au franc-or d’avant guerre, elle a valu : de 1258 à 1278 : 20 fr. 26 – de 1278 à 1295 : 20,11 – de 1330 à 1337 : 18,32 – de 1360 à 1,369 : 10,82. En 1400, elle ne valait plus que 9 fr. 81 ; en 1450 : 7,12 ; en 1500 : 5,47 ; en 1559 : 4,06 ; en 1600 : 3,15 ; en ,1650 : 2,02 ; en 1700 : l,52 ; en 1750 : 1,02 ; en 1800 : 0,99. Le prix du métal baissait, mais l’unité monétaire perdait, parallèlement, de son pouvoir d’achat. Il suffit de multiplier par 5 pour convertir les chiffres ci-dessus en francs stabilisés.
Au moyen-âge et dans les temps modernes, pour faire face à leurs embarras financiers les souverains altéraient la monnaie, en modifiaient la valeur à leur gré, ce qui n’était qu’un expédient tout passager, d’ailleurs, les utilités de consommation ne subissant de fluctuations de valeur que dans une limite assez restreinte. L’altération du poids ou du titre des monnaies, les modifications imposées à leur valeur n’avaient d’effet que dans les paiements que l’État avait à effectuer à ses créanciers sur le moment. Après quelques années de chaos, les prix des marchandises et les salaires finissaient par s’harmoniser avec la nouvelle monnaie.
On a discuté très sérieusement sur le droit du Prince (ou de l’État) d’altérer la monnaie ou de faire varier sa valeur. Nicolas Onesme conseiller de Charles V (comme Bodin au XVIème siècle) ne lui reconnaissaient pas cette puissance. Le conseiller d’État Lebret. (XVIIème siècle) reconnaît au Prince, au contraire, le droit de hausser ou de baisser, le prix de la monnaie quand ses affaires l’exigent. Montesquieu (Esprit des Lois, XXII, chap. 11) et le juriste Pothier sont du même avis, avis qu’a confirmé le Code Civil en son article 1895, qui énonce que :
« L’obligation qui résulte d’un prêt en argent, n’est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du payement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du payement. »
Au fond, c’est la thèse de Philippe-le-Bel qui a prévalu, mais, comparé aux stabilisations d’après-guerre, son faux monnayage apparaît comme lamentable : les ministres des finances de ce roi fameux n’étaient que des apprentis au regard de nos conseillers ès-finances contemporains.
L’or et l’argent ayant été trouvés trop incommodes on a fini par remplacer, pour les grosses transactions, la monnaie métallique par la « monnaie fiduciaire » – billets de banque d’État, bons du Trésor – dont l’emploi repose sur la confiance et le crédit, c’est-à-dire sur l’assurance qu’elle peut être à volonté échangeable ou remboursable contre de la monnaie métallique. Il est évident que l’emploi de la monnaie fiduciaire saine évite non seulement l’usure et les ennuis du transport, mais des frais d’assurance, etc.
Quand l’État ne se trouve plus en mesure de rembourser par de la monnaie métallique la monnaie fiduciaire, il décrète que cette dernière aura cours forcé et le papier-monnaie devient l’unique instrument d’échange des habitants du territoire où son emploi est devenu obligatoire. Que nous voilà loin du lingot primitif, monnaie réelle ! Quelle évolution de cette barre de métal qu’on pesait et qu’on essayait de façon à ne point être trompé ni sur la qualité ni sur la quantité, au billet de banque dont la circulation est imposée et dont la valeur est fictive, puisque non remboursable.
Dans ses Premières Notions d’Économie politique, M. Charles Gide écrit que la monnaie « est un des plus admirables instruments inventés par l’homme, tout comme l’alphabet ou le système décimal et qui, tout comme ceux-ci, peut servir indifféremment au mal ou au bien ». Citant l’exemple de certains pays d’Afrique où, en partie, à cause du manque de monnaie, les Noirs sont victimes de l’exploitation la plus éhontée, il constate que « l’avènement de la monnaie est pour eux une libération ».
Si la plupart des communistes-anarchistes prévoient – un peu trop hâtivement – la suppression de toute monnaie dans les transactions que les humains peuvent conclure entre eux – un grand nombre d’individualistes anarchistes (spécialement ceux rattachés à la tendance B. Tucker — J.-H. Mackay – E. Armand) revendiquent le droit d’user d’une valeur d’échange-monnaie au cours des transactions qu’ils peuvent avoir à réaliser soit avec les autres humains, soit plus simplement avec leurs camarades. La frappe libre de la monnaie métallique et la libre émission de la monnaie fiduciaire figurent en bonne place dans la liste de leurs revendications.
Du moment qu’on se refuse à admettre le communisme général de la production et de la consommation, cette attitude est compréhensible et évidemment justifiable. Les individualistes anarchistes n’acceptent point qu’il suffise à un être quelconque de se présenter à un comptoir ou à un magasin – sans justification du travail intellectuel ou manuel qu’il a accompli – pour se procurer tout ce dont il a besoin. Il n’admettent pas la suppression de l’échange entre individus pris personnellement ni son remplacement par un centre privilégié, imposant son intervention. Ils veulent pouvoir jouir personnellement du produit intégral de leur labeur obtenu sans l’exploitation du travail d’autrui et cela grâce à leur possession, à titre individuel et inaliénable, du moyen de production (sol, outils, engins divers). L’échange direct entre producteurs-consommateurs, isolés ou associations, sous-entend une valeur et peu importe sa base : peine que l’objet ou la transformation de la parcelle de matière a coûté ou rareté de l’utilité. La monnaie apparaît comme la représentation ou le signe représentatif par excellence de cette valeur ou affirmation de l’effort personnel.
Peu importe, d’ailleurs, au point de vue anarchiste, la forme et la base de la monnaie servant aux échanges ou trocs entre isolés, associations ou fédérations d’associations. Dans un milieu individualiste où n’existeraient ni domination, ni exploitation ou interventionnisme d’un genre quelconque, les étalons, les mesures de la valeur, les instruments d’échange pourraient varier à l’infini. Ils se concurrenceraient et cette concurrence-émulation assurerait leur perfectionnement.
Chaque personne, chaque association se rallierait au système cadrant avec : son déterminisme, s’il s’agit d’individualités – avec le but qu’elle se propose, s’il s’agit d’associations. Par conséquent, de l’individu ou de l’association frappant ou émettant par ses propres moyens sa valeur d’échange-monnaie à l’association créée spécialement pour frapper de la monnaie métallique ou de la monnaie fiduciaire, il y a de la marge. Comme il y a de la marge du bon-heure de travail ou du bon de consommation à la pièce de monnaie-instrument d’échange. Or, il n’est aucune de ces conceptions qui ne puisse trouver place en une économie individualiste anarchiste. D’où s’ensuit que les individualistes considèrent comme relevant de l’ordre archiste tout milieu social, toute organisation qui les empêcherait de se servir de monnaie ou valeur d’échange, ou encore d’en préconiser l’emploi.
– E. ARMAND.
OUVRAGES À CONSULTER. – A. Arnauné : La monnaie, le crédit et le change. – L. Bamberger : Le métal argent à la fin du XIXème siècle. – J. Decamps : Les changes étrangers. – P. Decharrne : Les petites coupures de billets. – Delmar : La valeur des métaux précieux. – Yves Guyot : Le probl. de la déflation monétaire. – Irving Fischer : L’illusion de la monnaie stable. – Stanley Jevons : Économie politique. – G. Lachapelle : Les batailles du franc. – G. Boris : Probl, de l’or..., etc.
MONOANDRIE, MONOGAMIE
n. f.
Monoandrie (du grec monos, seul, et andros, homme), état d’une femme mariée à un seul homme, se rapporte exclusivement au sexe féminin ; Monogamie (du grec gamos, mariage), état de la femme mariée ou unie à un seul homme ou de l’homme marié ou uni à une seule femme s’applique à l’un comme à l’autre sexe. Monogame s’entend également de l’état d’une personne qui n’a été mariée qu’une seule fois.
La Grèce et Rome, polythéistes, n’ont jamais attribué qu’une ‘importance relative à la monogamie et toujours dans un sens favorable à l’élément masculin du couple.
À Rome, le concubinat, admis en dehors du mariage, jouissait d’un statut légal.
Les dieux de l’Olympe donnaient de si fréquents coups de canif dans le contrat matrimonial qu’il aurait fallu à leurs sectateurs une dose de naïveté peu commune pour prendre la monogamie au sérieux.
On trouve dans notre code une allusion à cette légalisation du concubinat, puisque le fait d’entretenir une concubine hors du domicile conjugal ne constitue pas un délit. D’ailleurs, alors que la femme convaincue d’adultère est passible d’emprisonnement de trois mois à deux ans (C. pén. § 337), le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale s’en tire avec une amende de 100 à 2.000 francs (C. pén. § 339).
Il fallut le christianisme – monothéiste – pour faire apparaître la monogamie comme un idéal religieux et social. Selon la thèse chrétienne, le mari est censé aimer son épouse comme le Seigneur aime l’Église – c’est la définition paulinienne des rapports entre conjoints ; des enfants sont la suite de l’union conjugale et la famille qui en résulte est une reproduction en miniature de la communauté chrétienne. Dans ces enfants, le couple chrétien se voit et se sent continué, en attendant de poursuivre spirituellement, au-delà du tombeau, l’union commencée charnellement ici-bas, il est vrai, mais sanctifiée par un sacrement. De l’autre côté de la tombe, les parents retrouvent également leurs enfants. Comme il est entendu que, dans la Cité céleste, il n’y a pas de différenciation sexuelle, cela résout bien des difficultés.
Dans la société chrétienne (et la société civile lui ressemble beaucoup en ce domaine), la femme et les enfants obéissent au mari comme l’Église obéit à son chef spirituel : l’hérésie, c’est-à-dire l’affirmation d’une volonté autre que celle de l’époux ou du père – n’est pas plus admissible dans la famille que dans l’Église. Domestiques, soyez soumis à vos maîtres ; femmes, soyez soumises à vos maris ; enfants soyez soumis à vos parents – tel est l’idéal chrétien, celui du moyen âge et celui de la société moderne, dont tous les codes, malgré certains adoucissements de détail, reflètent cette conception religieuse des conséquences de l’union monogame.
Voici quelques articles du Code Civil qui suffiront à convaincre tout lecteur impartial de la corrélation existant entre la conception canonique du mariage et la notion laïque.
Si l’article 214 exige que le mari protège sa femme (comme le Seigneur le fait pour l’Église), la femme doit obéissance au mari ; elle est obligée d’habiter avec son mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider ; Un arrêt de la Cour de Cassation (9 août 1826) a décidé que le mari dont la femme refuse d’habiter avec lui peut l’y contraindre manu militari ; un autre arrêt (26 juin 1878) a décidé que les juges peuvent prononcer une condamnation à des dommages-intérêts contre la femme pour la contraindre à réintégrer le domicile conjugal.
Quant à l’enfant issu du mariage monogamique, voici le statut qui le régit : il reste sous l’autorité de ses père et mère jusqu’à sa majorité ou son émancipation ; le père seul exerce cette autorité durant son mariage ; l’enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n’est pour enrôlement volontaire, après l’âge de 18 ans (art. 372, 373, 374 du Code Civil). Le père a même le droit d’interdire à ses enfants toute communication avec les membres de la famille ; il faut qu’il s’agisse des ascendants pour que les tribunaux puissent intervenir et autoriser de simples visites (Cour de Cassation, arrêts du 28 juil let 1891 et du 12 février 1894).
Bien plus, si l’enfant est âgé de moins de seize ans, le père peut, s’il en est gravement mécontent, le faire détenir pendant un mois au plus, sans que le président du tribunal d’arrondissement puisse refuser de délivrer l’ordre d’arrestation (C. civ. § 376).
Pour en revenir à la conception chrétienne du mariage, il convient de remarquer ici que le christianisme ne faisait que répéter et accomplir le mosaïsme – autre religion monothéiste – qui prescrivait un châtiment très rigoureux pour l’adultère de la femme. Jésus n’a jamais sanctionné l’adultère. S’il s’est refusé à condamner la femme adultère (et ce récit manque dans les missels les plus anciens), c’est parce que ceux qui voulaient lapider la malheureuse faisaient, en secret, la chose qu’ils lui reprochaient. Dans son entretien tout spirituel avec la Samaritaine, Jésus lui fait bien remarquer que l’homme avec lequel elle vit n’est pas son mari (Jean, VI). D’ailleurs, il est de toute évidence qu’il s’agit uniquement ici d’une relation symbolique : puisque les juifs orthodoxes ne veulent pas du message divin, il sera porté aux hétérodoxes, tels les Samaritains, et même des femmes aux mœurs dissolues l’entendront.
Il suffit de lire le XIXème chapitre de Matthieu et le Xème de Marc – deux évangiles les plus imprégnés de l’esprit mosaïque – pour se rendre compte que Jésus était hostile au divorce ou à la répudiation, sauf en cas d’adultère. Dans le chapitre précité de Marc, il déclare nettement : « Celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet adultère à son égard ; si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet adultère ».
Il va sans dire que pour examiner le problème de la monogamie, les individualistes anarchistes se placent à un tout autre point de vue que la société actuelle, toute saturée d’esprit judéo-chrétien.
On peut considérer comme cellule fondamentale d’un milieu social donné la famille – le couple – l’individu. Si l’on considère l’unité humaine, prise isolément et personnellement, comme la cellule initiale du groupe, on y relativera la forme de vie sexuelle qui s’y pratiquera à l’individu, envisagé à part toute cohabitation, toute limitation à son expansion sentimentale ou sexuelle, tout sentiment de propriété affective ou corporelle, toute entrave à sa recherche de désirs ou de sensations.
Le problème de la monogamie consiste à savoir si cette expression de la vie sexuelle, même pratiquée temporairement, est restrictive ou non de la liberté personnelle dans le domaine sexuel – si elle favorise ou non les possibilités d’expérience et d’initiative individuelles dans tous les domaines – si elle est bonne conductrice de sociabilité – si, en un mot, les avantages qu’elle procure compensent les pertes qu’elle occasionne.
Lorsque Edward Carpenter fait remarquer qu’à force de cohabitation et de fidélité ou d’exclusivisme sexuel ou sentimental, les éléments du couple finissent par se ressembler non seulement moralement, mais encore physiquement, il énonce, sans en tirer toutes les conséquences, une constatation qu’aucun individualiste ne saurait enregistrer sans frémir en son for intime. Il n’est pas question ici de débauche ou de laisser aller sexuel, la question est bien plus haute. Que du fait de l’exercice de la monogamie, un individu puisse se fondre tellement dans un autre qu’il en perde sa faculté propre de raisonner, de chercher, d’apprécier, de choisir – voilà qui ne peut s’admettre dans un milieu basé sur l’ego, l’unique.
Même s’il n’y avait pas absorption, s’il y avait simple amputation des attributs personnels de l’un des éléments du couple par suite de la supériorité ou de l’influence de l’autre élément, le milieu individualiste y perd nécessairement. Les désirs, les initiatives, les espoirs refoulés sont autant de pertes sèches pour lui, puisqu’il ne saurait jouir des conséquences que tout cela pourrait provoquer. Pour un milieu basé sur le fait individuel, l’accaparement ou l’exclusivisme monogamique est un rapt ou un vol : il ne peut pas être un facteur de sociabilité. Là où un des composants du milieu individualiste aliène son autonomie sentimentale ou sexuelle à un seul de ses coassociés, il devient comme un étranger, un hors-du-camp par rapport aux autres, dans ce domaine tout au moins et nous savons quelle est l’étendue de son rayonnement.
La monogamie est-elle productrice d’autonomie individuelle, toute question sentimentalo-sexuelle mise de côté ? Favorise-t-elle davantage les possibilités d’expansion individuelle, de liberté de choix d’expérimentation, de conclure des contrats. Voilà le problème posé au point de vue individuel et il n’est pas ailleurs.
On ne peut nier que la monogamie tende sans cesse à sacrifier à l’autre l’un des éléments du couple – tantôt l’un, tantôt l’autre dans les circonstances les plus favorables. L’un des éléments s’abstiendra de passer certains contrats parce que l’une ou plusieurs de ses clauses déplaisent à l’autre élément ; ce dernier s’interdira, mû par le même motif, certains, déplacements certaines tentatives, certaines aspirations même ; il renoncera à fréquenter certaines personnes. Tout cela parce que ces contrats, ces tentatives, ces aspirations, ces fréquentations risquent de troubler l’harmonie sans laquelle la monogamie cesse d’être praticable. De sorte que les individualistes anarchistes n’ont pas tort de reprocher à la monogamie d’impliquer abstention, restriction, refoulement, résignation.
Que ce soit au point de vue intellectuel, éthique, sentimemtalo-sexuel, la fréquentation simultanée de plusieurs individualités ne peut que profiter à l’ego. Il en est de cette fréquentation comme d’un voyage à la découverte : faire connaissance d’autres coutumes que celles auxquelles on est habitué, fouler d’autres sols, contempler d’autres panoramas, s’assimiler de nouveaux dialectes, enrichit inévitablement l’explorateur. La connaissance intime de plusieurs autruis peut faire jaillir des profondeurs du moi des aspects nouveaux de la personnalité, aspects qui seraient à jamais demeurés ensevelis et stériles sans cette occasion.
Ces considérations diverses – et on pourrait les étendre – indiquent pourquoi les individualistes anarchistes, ne considèrent pas la monogamie comme favorable a l’expansion de l’unité individuelle ou de tout milieu basé sur le fait individuel. Toute réserve étant faite pour certains déterminismes particuliers, se révélant à la suite d’ expériences loyalement faites et ayant assez duré pour en tirer une conclusion.
Nous n’ignorons pas que, dans la société actuelle, les conditions économiques permettent difficilement à la femme de se tirer d’affaire toute seule. Mais on ne, voit pas pourquoi une association d’ordre économique entre un homme et une femme – qu’elle soit basée sur l’affinité idéologique, la communauté de vues au point de vue éthique, un rattachement d’ordre affectueux ou autre – impliquerait fatalement observation de la restriction à la capacité d’essai, entrave à la saisie des occasions, exclusivisme monopolisateur. Il ne peut venir à l’esprit d’un individualiste anarchiste, femme ou homme, parce que, dans le ménage, il apporte tout ou partie des ressources indispensables à son fonctionnement, de proposer un contrat restreignant l’amplification individuelle, limitant le champ d’expériences de son ou de ses coassociés. De tels contrats entre camarade ne peuvent se supposer. Même une association de camaraderie amoureuse ne saurait interdire a ses membres (sauf lorsqu’il y a à redouter l’intrusion d’éléments archistes, suspects, un danger d’indiscrétion ou quelque péril pour l’ensemble) d’entretenir des relations affectives avec des personnes n’appartenant pas à l’association dont ils font partie.
On peut comprendre et admettre qu’un des membres de l’association économique ou idéologique veuille être monogame pour son propre compte, mais qu’il l’impose à un ou plusieurs de ses coassociés, cela ne peut s’imaginer entre gens respectueux de l’autonomie d’autrui. Parce qu’on fait « bouillir la marmite », tracer des limites aux possibilités d’expansion de ses cohabitants, ce n’est pas compréhensible de la part d’un anarchiste, c’est-à-dire d’un humain dont la préoccupation principale est non la question économique, mais la délivrance de la tutelle autoritaire. Tout au moins, quand il s’agit de ceux de « son monde », de ceux qui parlent la même langue que lui.
– E. ARMAND.
(Voir : polygamie, sexe, sexualité, sexuelle (morale), etc., etc.)
MONOGÉNISME
n. m. (de monos, seul, et genos, race)
Théorie qui fait remonter à un type primitif unique toutes les races du globe (voir Races). Religions antiques, christianisme, traditions l’ont professée et soutenue. Des savants jusqu’à nos jours s’y sont ralliés, de Buffon à de Quatrefages. Parmi ceux qui soutiennent la multiplicité des origines, citons : Bory de Saint-Vincent, Lamarck, puis Morton, Gliddon, Knox et Agassiz, auxquels il faut ajouter, pour leurs recherches ethniques sur les métissages et le berceau de certains types (scandinaves, celtes, etc.) : Pœsche, Schrader, Peuka, Laumonier et Gumplovicz.
On lira avec intérêt sur ce sujet ; Introduction à l’étude des races humaines : de Quatrefages ; La lutte des races : Gumplovicz ; Les procédés de défense de la race ; Homogénésie et dégénérescence : J. Laumonier ; Le préjugé des races : Jean Finot ; L’anthropologie : Topinard ; Mémoires de la Société d’anthropologie : P. Broca ; Paradoxes : Max Nordau ; Anthropologie : Waitz ; De l’origine des espèces ; De la variation des animaux : Darwin ; Principes de biologie : Spencer ; Mécanisme de la variation des êtres vivants : A. Gautier, etc.
MONOPOLE
n. m. lat : monopolium, (du grec, monopôlion, de monos, seul, et pôlein, vendre)
Étymologiquement, c’est donc le privilège pour un individu, un groupe, une organisation d’être seul à vendre tel ou tel produit. Le sens s’en est étendu aux faits sociaux, aux actes économiques les plus divers. On dit maintenant tout aussi bien le monopole de la vente, ou de l’achat, de la fabrication, de l’ extraction, le monopole de l’enseignement, etc. Mais à ce mot s’attache toujours le même caractère d’exclusivité, qu’il s’agisse des faits, de l’usage ou du droit. Pratiquer un monopole consiste (soit légalement) avec l’aide du gouvernement ou de privilèges reconnus et protégés par la loi, (soit en fait par une organisation puissante) a supprimer toute concurrence sur telle ou telle opération économique déterminée.
Proudhon dénonçait déjà vigoureusement « l’égoïsme monopoleur ». Il disait :
« Le monopole est, pour l’homme qui ne possède ni capitaux, ni propriété, l’interdiction du travail et du mouvement, l’interdiction de l’air, de la lumière et de la subsistance... Le monopole s’est enflé jusqu’à égaler le monde ; or un monopole qui embrasse le monde ne peut demeurer exclusif, il faut qu’il se républicanise ou bien qu’il crève. »
Il signifiait ainsi au monopole total (capitalisme particulier ou d’État) l’impossibilité d’exister. Le monopole symbolisait à ses yeux cette redoutable tyrannie économique dont notre siècle aura vu l’apogée et, souhaitons-le, la défaite.
On range généralement les monopoles dans trois catégories : les monopoles naturels, les monopoles fonciers, les monopoles légaux. L’économie moderne s’est enrichie de monopoles de fait.
Les premiers se rapportent aux inégalités naturelles, aux capacités de tout ordre qui différencient les hommes (force physique, adresse, aptitudes techniques, intelligence, volonté, etc). Ce « privilège devant la vie » influence les vertus productrices et tend à commander la rémunération de l’effort. Pour ce qu’il écrase le défavorisé naturel, les écoles socialistes se sont élevées contre ce monopole. Elles tendent à lui substituer une économie compensatrice dont la formule « De chacun selon ses forces, à chacun selon ses besoins » est l’expression la plus large. Quelques essais fragmentaires n’ont pu démontrer la valeur de ce correctif, non plus que l’infirmer. Il a pour lui nous semble-t-il, la vertu d’introduire l’équité humaine là où la naissance a prodigué un choquant et douloureux déséquilibre. Mais il reste à trouver les modalités heureuses qui assureront la vitalité du principe...
Les monopoles fonciers ont trait à l’appropriation privée du sol (nous les reverrons à ce dernier mot). On sait déjà quels dangers fait courir à la collectivité un tel accaparement. Moins sensible dans les pays où la propriété est fortement divisée, son arbitraire éclate dans un pays où – comme hier en Russie et aujourd’hui encore en Angleterre – la richesse foncière est entre les mains d’une poignée de hobereaux...
Les monopoles légaux qui sont par excellence les monopoles d’État et ceux dont l’État garantit à des particuliers l’exercice et le fruit, ont pour eux l’apparence de la légitimité, puisqu’ils fonctionnent sous l’autorisation et le contrôle de l’autorité légale. On a vu suffisamment en cet ouvrage quelles illusoires garanties offre cette autorité pour qu’il soit inutile de faire ressortir que ces monopoles – sous le couvert du bien public et de l’intérêt général – ou poursuivent un but purement fiscal et assurent, indirectement et hypocritement, une pressuration intense du contribuable, ou ramènent entre des mains privilégiées les avantages d’exploitation dont tous les bénéfices devraient revenir à la nation. Ceux du tabac, des allumettes, de la monnaie, de certaines administrations sont du type du premier ordre. Ceux des mines, des chemins de fer sont caractéristiques du second.
Le monopole d’État n’est qu’un impôt déguisé. S’emparant du commerce d’un objet de consommation, l’État en interdit la fabrication, l’échange et la vente dans le commerce libre et, naturellement, conserve pour lui tous les bénéfices de l’opération. Ces monopoles d’État sont une véritable exploitation du consommateur qui paie fort cher des produits médiocres. On voit couramment les produits monopolisés, de très mauvaise qualité, être vendus plusieurs fois leur valeur réelle, tels les allumettes et le tabac en France. Incapacité, négligence, mépris souverain du public président librement aux fabrications d’État. N’a t-on pas vu « notre » manufacture nationale employer, pour ses allumettes, des bois ignifugés ?... Le consommateur ne peut ni se défendre, ni s’adresser à un concurrent. Notre maitre, l’État, seul arbitre, est aussi notre unique et couteuse Providence...
Il est assez curieux (et aussi significatif) que des partis politiques, dits d’avant-garde (socialistes, radicaux-socialistes) aient inscrit dans leurs programmes, la consolidation des monopoles d’État existants et l’extension du principe de monopole à d’autres produits. On peut aisément se rendre compte, par le fonctionnement des monopoles existants, que le consommateur serait livré pieds et poings liés aux fantaisies d’une administration complètement irresponsable.
Quant aux « monopole de consentement » – concessions d’exploitation délivrées à certains individus ou, plus fréquemment, à des compagnies exploitantes – ils constituent une véritable escroquerie au détriment du public. Beaucoup de services publics d’intérêt général sont ainsi mis sous la coupe d’une poignée d’exploiteurs. Exemples probants : les monopoles accordés aux compagnies de chemin de fer, tramway, gaz, électricité. Ces compagnies commencent généralement à se faire octroyer de très fortes subventions d’établissements par les pouvoirs publics, État, départements ou communes. Les actionnaires fournissent le reste. Ensuite, par des conventions ou avenants passés avec les dits pouvoirs publics, elles majorent fortement les tarifs de la consommation, sous prétexte d’amortissements. Enfin, elles se font réserver des garanties
d’intérêts ; c’est à dire que les pouvoirs publics s’engagent à couvrir les déficits éventuels. Les Compagnies de chemin de fer, en France, ont ainsi reçu de l’État un chiffre élevé de milliards. On peut dire que le terrain que le terrain, les voies, le matériel et les bâtiments ont étés payés par l’État, c’est à dire par les contribuables, ce qui n’empêche pas que tout cela demeure la propriété exclusive de la Compagnie concessionnaire.
Je pourrais citer également les exemples de plusieurs compagnies de gaz. Par une majoration des tarifs du prix du mètre cube et de locations d’appareils, elles amortissent toute la valeur de leurs usines, matériel, canalisation, etc., en quinze ou vingt années. Certaines fonctionnent depuis trois quart de siècle et ont ainsi amorti trois ou quatre fois leur capital. Le montant des actions a même, en certains cas, été remboursé intégralement. De nouvelles actions ont été délivrées à titre gratuit aux anciens actionnaires, représentant l’augmentation réelle du capital – nouvelles installations, nouveau bâtiments, etc. – réalisée avec les bénéfices des exercices. Les consommateurs, qui n’ont pas la possibilité d’aller se fournir ailleurs, qui sont scandaleusement rançonnés, qui n’ont pas la faculté de protester, ont payé le capital initial, ont payé les améliorations ultérieures, ont tout payé, et ce sont les actionnaires qui restent propriétaires de l’exploitation. Ceci constitue une véritable escroquerie, mais escroquerie couverte par les lois et les conventions ayant force de lois.
Dans un pays comme la France, des milliards sont annuellement extirpés à la consommation, des fortunes s’échafaudent, sous le couvert du monopole, soi-disant instauré dans l’intérêt public.
Il va sans dire qu’entre les politiciens détenteurs de fonctions publiques et les dirigeants des compagnies à monopole, c’est le régime des tractations louches et malhonnêtes, des pots-de-vin, qui est la règle normale. Pour modifier, à leur avantage, tell ou telle clause de la convention, les dirigeants de la compagnie n’hésitent pas à récompenser largement le politicien qui leur facilite l’opération.
Ce genre de monopole a une autre conséquence très importante au point de vue de l’économie sociale : il constitue une entrave sérieuse au développement du progrès technique. Telle invention nouvelle, par exemple, ou quelque perfectionnement peut amener un produit concurrent à diminuer la consommation du produit monopolisé. Pesant de toute la force de leurs relations, les compagnies à monopoles font décréter des mesures pour tuer dans l’œuf cette concurrence.
Le transport des produits lourds par voie fluviale a été très entravé par les Compagnies de chemins de fer, lesquelles ont fait pression sur les gouvernants pour qu’on ne les facilite pas, qu’on les décourage, au contraire, par toute une série de « raisons ».
L’automobilisme – surtout sous la forme autobus – aurait dû depuis longtemps permettre des communications entre les communes rurales qui, en majorité, n’ont pas de gares. On a tout fait pour faire échec à cette commodité, qui aurait réduit le trafic ferroviaire. Et si maintenant des lignes d’autobus s’établissent avec plus de fréquence, c’est que, par un accord, leur exploitation a été livrée aux compagnies de chemins de fer, qui complètent ainsi leur monopole de la voie ferrée par le monopole des transports en commun sur route.
Les concessions minières sont également une autre sorte de monopole. Par loi ou décret, on a conféré à une société ou à une individualité le droit exclusif d’extraire la houille ou le minerai sur tel territoire déterminé. Toute l’exploitation minière ayant ainsi été répartie entre quelques compagnies, il en ‘résulte que la consommation se trouve livrée aux appétits des concessionnaires de ces compagnies, lesquels réalisent de ce chef des profits scandaleux. On cite telle compagnie de mines, dont les actions, émises à mille francs, il y a 50 ou 75 ans, se négocient couramment à des centaines de milliers de francs – après avoir été totalement remboursées aux actionnaires.
C’est surtout dans les colonies que le régime des concessions et monopoles privés s’épanouit sans mesure. Sur d’immenses superficies, le monopole de la culture est attribué à certaines sociétés. Également le monopole du commerce, des ports, etc., etc. On est allé jusqu’à établir l’esclavage (dénommé travail forcé) au profit des compagnies à monopole, en leur accordant le droit de réquisitionner la main-d’œuvre, de la faire travailler et de la payer suivant le régime du bon plaisir des administrateurs.
À côté de ces monopoles officiellement reconnus et légalisés, il y a les monopoles de fait, organisés par les trusts (voir ce mot), cartels ou consortiums capitalistes.
Quelques gros magnats d’une industrie, ou quelques financiers, réalisent une entente pour mettre la main sur toute cette industrie. Soit en absorbant les concurrents par libre accord ou en achetant leurs actions, soit en les tuant par la concurrence et le « dumping », ils parviennent, en fait, à devenir (nationalement ou internationalement) les maîtres de la dite industrie, pour la fabrication, les échanges et la vente. Dès le moment où ils ont ainsi réalisé un véritable monopole de fait, où la consommation doit obligatoirement passer sous leurs fourches caudines, ils se conduisent comme les dirigeants des sociétés à monopole légal. Les consommateurs, ne pouvant plus se défendre, sont rançonnés sans merci ; et les monopolistes, raréfiant à volonté les produits du marché, en fixent les prix à leur convenance, et réalisent, de ce fait, de formidables profits.
Sous quelque forme qu’il se présente, le monopole n’est qu’une entreprise de spéculation, un pacte de famine, une escroquerie. Le monopole n’a qu’un objectif : mettre en coupe réglée la consommation, tondre le consommateur.
Les économistes qui défendent la société bourgeoise prétendent que l’équilibre économique s’y établit tout naturellement par le jeu du marché libre, de la concurrence. Il peut y avoir, disent-ils, des périodes troublées où la concurrence ne joue plus, mais cela ne peut être que provisoire, temporaire. La loi de l’offre et de la demande rétablit automatiquement un équilibre normal des prix. Une marchandise vendue chère attire les producteurs qui se dépêchent d’en fabriquer, et cette affluence de la production fait baisser les prix.
Tout cela, c’est de la théorie bourgeoise, mais la réalité est toute autre. On peut affirmer, sans crainte de démenti, que la libre concurrence n’existe pas dans la majorité des cas. Les monopoles des États, les monopoles des services d’intérêt public, les monopoles de fait créés dans les industries essentielles, les monopoles établis par des mesures douanières, ont, dans la pratique, à peu près supprimé la concurrence. La consommation est à la merci des industries et des trafics privilégiés, des compagnies concessionnaires.
Cette théorie de l’équilibre par la concurrence est une pure hypocrisie. Si l’on recherchait l’origine de toutes les grandes fortunes, on trouverait, neuf fois sur dix, à la source, un monopole quelconque, officiel ou non.
En fait, grâce à la pratique du monopole, les États d’une part, les organismes capitalistes d’autre part, ont pratiqué l’accaparement des produits et permis ainsi la réalisation de profits plus qu’abusifs, au détriment de la grande masse du public.
Il ne peut en être autrement dans une société basée sur le principe de l’autorité. Les maîtres s’entendent pour spolier les esclaves. L’expropriation des compagnies à monopole et la remise de leurs biens aux libres associations des usagers et du personnel, ne sera qu’une mesure de stricte justice une restitution d’un bien malhonnêtement acquis.
Ce n’est, en effet, logiquement, ni à l’État ni aux pouvoirs publics, ni aux groupements capitalistes, qu’il appartient de diriger les services publics et les indus tries, mais aux consommateurs intéressés, aux usagers organisés pour tirer de ces services la plus grande utilité, le plus de bienfaits possibles et aux meilleures conditions.
– Georges BASTIEN.
MONOPOLE
On a vu plus haut que le « monopole » est le privilège exclusif de fabriquer ou de vendre certaines utilités, d’exploiter certains services, d’occuper certaines charges publiques. Il y a ainsi des monopoles légaux et des monopoles de fait.
Il y a monopole légal lorsque l’État se réserve, par des lois, des décrets, des ordonnances, l’échange, l’émission, la fabrication, la vente de certaines productions – frappe de la monnaie, fabrication de la poudre, émission de billets de banque ; exploitation des postes, téléphones ; des moyens de transport et de charroi, du gaz, de l’électricité (on dit alors que ces monopoles sont exercés dans un but d’ordre et de sécurité publique) – tabac, allumettes, alcool, etc. (on dit alors que c’est dans un but fiscal) – réserve à des inventeurs, des industriels, des commerçants, des producteurs intellectuels d’un monopole temporaire leur garantissant l’exploitation exclusive de leurs découvertes ou initiatives productrices (on dit alors que c’est dans un but d’encouragement à la science, à la production intellectuelle, à l’industrie, etc.).
Les monopoles de fait sont ceux qui suppriment ou limitent la concurrence professionnelle, commerciale ou industrielle en favorisant un individu ou une catégorie au détriment d’autres individus ou catégories (agents de change, médecins, pharmaciens, notaires, avoués, tenanciers de maisons de tolérance, etc.)
La lutte contre les monopoles tient une trop grande place dans le mouvement individualiste anarchiste rattaché à l’école Warren-Tucker pour que nous n’examinions pas les raisons de cette attitude et les conclusions qu’ils en tirent. Cette école – qui se réclame également de Proudhon – dénonce quatre grands monopoles :
-
Le monopole monétaire, c’est-à-dire la confiscation par l’État – à son profit – de l’émission des billets de banque et de la frappe de la monnaie. Du fait de ce monopole, les détenteurs de monnaie perçoivent un intérêt pour son usage journalier, si bien qu’un très grande nombre de personnes sont empêchées de produire ou de faire du commerce pour leur compte à cause des taux élevés qu’il leur faut payer pour obtenir du crédit. Journellement, des millions et des millions de consommateurs paient des milliards de dollars, marks, lires, francs, pesos, pesetas, etc., etc., à titre d’intérêt supplémentaire sur les produits qu’ils se procurent.
-
Le monopole foncier, c’est-à-dire la faculté légale que possède le propriétaire de sol de laisser ses terrains improductifs ou de ne pas les occuper lui-même. Le résultat de ce monopole, c’est le loyer, la rente de la terre, qui affecte tout le monde.
-
Le monopole des douanes, qui maintient à des prix élevés les utilités fabriquées, confectionnées, façonnées ou finies à l’intérieur, d’où perte pour le consommateur, qui ne peut bénéficier de la concurrence extérieure.
-
Le monopole des brevets, marques de fabrique, droits d’auteur, etc., qui empêche ou limite la concurrence et l’initiative en matière d’inventions, de spécialités industrielles, etc...
Cette école ne dit pas que la disparition de ces quatre monopoles abolirait absolument l’inégalité, mais elle produirait l’abondance et, de ce fait, l’inégalité tendrait toujours plus à disparaître.
Clarence L. Swartz, l’un des disciples immédiats de Tucker, a cherché à étayer cette thèse, dans What is mutualism ? en se basant sur les statistiques officielles relatives à la richesse et au revenu aux États-Unis, statistiques datées 1926. Voici, d’après elles, pour la période quinquennale 1918–1923, la répartition moyenne des revenus totaux des États-Unis :
-
Gages et salaires 50 %
-
Bénéfices commerciaux et industriels 20 %
-
Profits du capital, vente de terrains, garanties et nantissements, ventes d’actif divers, etc. 4 %
-
Loyers, redevances, intérêts et dividendes 26 %
Les 20 % attribués aux bénéfices commerciaux et industriels se divisent naturellement en deux sections :
-
La première comprend les bénéfices provenant de l’initiative et de l’habileté dans la gestion des affaires ou entreprises de caractère commercial ou industriel, c’est ce que C.-L. Swartz appelle Profit of Enterprise. Il pense que sur ces 20 %, il lui revient 6 %.
-
La seconde section comprend les bénéfices provenant des droits de douane, des exemptions de taxe, des privilèges spéciaux.
-
Prenons les droits de douane : en examinant les divers tarifs de douane en vigueur aux États-Unis depuis 50 ans, on s’aperçoit qu’ils ont eu pour effet de faire hausser d’un tiers le prix général des objets de consommation ; on peut sans exagérer évaluer au tiers de cette surcharge ou 11 % le bénéfice personnel des fabricants, manufacturiers, intermédiaires ;
-
Des documents officiels montrent que 1/8 à 1/10 des taux payés pour les utilités publiques le sont à titre de franchises, d’exonérations, de dégrèvements, de privilèges, de primes diverses. La même chose peut se dire des frais de transport ;
-
Il y a enfin les bénéfices résultant d’exemption et de privilèges légaux concédés aux industries de l’agriculture, du bâtiment, des mines. Tout cela, C.-L. Swartz l’appelle Profit of Privilege.
-
En estimant à 10 % le bénéfice des opérations effectuées sur la fabrication, le négoce, les transports et les utilités publiques privilégiées, c’est rester au-dessous de la vérité. En 1922, le revenu brut de ce groupe s’élevait à 90 milliards de dollars, dont le 10 % est 9 milliards de dollars, soit, du revenu national total : 14 %.
Rétablissons ainsi le tableau du revenu national des États-Unis (moyenne 1918–1923), qui s’élève à 64 milliards de dollars.
| Répartition | % | Milliards de |
|---|---|---|
| Gages et salaires. | 50 % | 32 |
| Bénéfices initiative ou entreprise particulière. | 6% | 3,8 |
| Bénéfice du Privilège. | 14 % | 9 |
| Profit du capital, ventes de terrains, garanties et nantissements, ventes d’actifs divers. | 4% | 2,6 |
| Loyers, redevances, intérêts et dividendes. | 26 % | 16,6 |
| Soit : | 100 % | 64,0 |
| Revenu de l’effort et du travail. | 56 % | 35,8 |
| Revenu du privilège. | 44 % | 28,2 |
Mais ce n’est pas tout, les dépenses gouvernementales, aux États-Unis, s’élèvent à 11 milliards de dollars, soit 8 à 10 % du revenu national annuel. Comme la plus grande partie des impôts est finalement payée par les salariés en tant que consommateurs, il est très modéré d’en déduire que 10 % de ce qui est attribué à l’effort et au travail lui est enlevé pour subvenir à l’improductive activité gouvernementale. Il faut donc ramener à 46 % la part du revenu de l’effort et du travail.
Il ressort de tout cela que 50 % au moins du revenu total annuel des États-Unis est versé ou extorqué à titre de tribut ou de taxe au profit du monopole ou pour l’entretien de l’improductif appareil gouvernemental ; de sorte que si les femmes et les hommes employés, aux États-Unis, à un effort productif, recevaient le salaire intégral de leur travail, ils toucheraient le double de ce qu’ils reçoivent actuellement. Il est à présumer qu’il en est à peu près de même dans les autres pays.
– E. ARMAND.
À CONSULTER. – A. Fourgeaud : La rationalisation. – Liefmann : Cartels et trusts. – G. de Nouvion : Le Monopole des assurances. – Marchis : Le monopole de l’alcool. – etc.
MONOTHÉISME
n. m. (de monos, seul, et thêos, dieu)
D’instinct, l’homme projette hors de lui-même ses idées, ses sentiments, son activité ; il les prête aux animaux, aux plantes, aux objets inanimés, peuplant ainsi le monde d’esprits plus ou moins semblables au sien. L’enfant invectivera la table contre laquelle il s’est heurté, la menacera, la frappera, croyant lui rendre le mal par lui éprouvé. Dans la fable, l’homme continue de prêter aux choses, aux plantes, aux animaux surtout, des vices et des qualités qui sont le propre de son espèce. Nous voyons le sauvage fétichiste entretenir, comme l’enfant, des relations amicales ou hostiles avec les esprits logés dans les objets qui l’entourent. Et l’histoire montre que l’animisme inspira les formes primitives du sentiment religieux : totémisme, magie en découlent en droite ligne. Par suite du besoin de simplifier, d’unifier, inhérent à l’esprit humain, une réduction du nombre des dieux devait s’opérer au cours des siècles ; le monothéisme en fut le résultat final. Mais chrétiens, juifs ou musulmans conçoivent toujours Dieu d’une façon essentiellement anthropomorphique ; et nos pires tendances sont bénévolement attribuées à ce prétendu roi du monde. Orgueilleux jusqu’à la folie, il n’est satisfait que si l’on marmotte à son adresse d’interminables compliments ; son nez a besoin d un continuel encens ; du genre humain il fait l’escabeau de ses pieds ; ses yeux se repaissent du spectacle des peuples prosternés. Son mépris de la justice est tel que pour punir Adam et Ève, il se venge sur leurs malheureux descendants ; il condamne à mort tous les premiers-nés des Égyptiens, en haine du pharaon ; Il frappe Huza qui, mû par une excellente intention, retient l’arche d’alliance prête à tomber. Après avoir fait tuer les madianites mâles, Moïse ajoutera au nom de Jahveh : « Tuez donc maintenant les mâles d’entre les petits enfants et tuez toute femme qui aura eu compagnie d’homme ». Jésus, dieu pourtant plus pitoyable, continue de tourmenter en enfer quiconque transgresse les innombrables lois promulguées au profit des puissants. Il ordonne de pardonner, mais se venge avec une cruauté qui dépasse de loin celle de Néron ou de Caligula : digne fils du Père Éternel qui n’hésita pas a le sacrifier lui-même et à le faire mourir sur une croix, tant il était altéré de sang, au dire des théologiens. Le rite essentiel de catholicisme reste de nos jours, la manducation du corps de Jésus, « bien que dévorer cette chair, déclare saint Augustin, paraisse plus affreux que de tuer un homme ». La messe est le renouvellement des angoisses du Calvaire ; la cène, de l’aveu de saint Cyrille, est un banquet de cannibales. Par bonheur, cette anthropophagie, devenue symbolique, se borne présentement à manger un bout de pain où Jésus demeure invisible. Ajoutons que Dieu s améliore avec le temps ; simple reflet des tendances humaines, il change et se transforme comme ces dernières. Le développement du cordicolisme, les transports d’amour prêtés par Marie Alacoque au successeur de Jahveh, en fournissent un exemple frappant. Après de longues hésitations, l’Église a fait siennes les élucubrations de cette hystérique, n’osant pas s’attarder à la conception, passée de mode, d’un dieu éternellement grincheux. Déjà la thèse du petit nombre des élus, admise par tous au moyen-âge, est répudiée par des théologiens très orthodoxes ; ne désespérons pas de voir le pape éteindre le feu de l’enfer ou presque et mettre a sa place un brasier d’amour. Loin d’être devancés par Dieu, les hommes le traînent péniblement à la remorque du progrès.
Ceux qui considèrent la Bible comme un livre inspiré soutiennent que le monothéisme est antérieur au polythéisme. D’après ce livre, disent-ils, Adam et Ève apprirent de la bouche de Jahveh qu’il était le seul dieu, l’unique créateur du ciel etc de la terre ; c’est plus tard que leurs descendants oublièrent ces vérités pour tomber dans les erreurs de l’idolâtrie. Rien de plus faux historiquement ; chez tous les peuples anciens, la croyance en un dieu unique résulta d’un long travail de l’esprit, quand elle ne fut pas le fait de penseurs isolés. On hiérarchisa les dieux sur le modèle des fonctionnaires de l’État ; à leur tête, l’un deux fit office de monarque et sa puissance finit par absorber celle de tous les autres dieux. Le monothéisme marqua le triomphe de la royauté absolue, non plus sur terre seulement, mais dans le ciel. En Égypte, la pluralité des cultes locaux ne permit jamais de constituer un ensemble parfaitement logique ; l’aspiration vers le monothéisme s’arrêta à mi-chemin, dégageant au-dessus des antres quelques personnalités : Horus, Râ, Osiris, Isis, Sérapis. À Babylone, l’animisme prêta de bonne heure la vie au soleil, à la lune, aux étoiles, à la terre, au feu, à la mer. La Phénicie, ignorante jusqu’à la fin de l’unité politique, n’eut jamais de dieu principal, mais elle regorgea de petits dieux (el, baal, melek, adon). Quant aux aryens, ils ne conçurent pas la divinité indépendante de son œuvre ; dans les phénomènes naturels ils virent les manifestations passagères d’une substance divine et, des forces diverses, ils firent des personnalités multiples qui se séparaient et se confondaient tour à tour. Loin de limiter cette conception, ils la suivirent dans l’infinie variété de la nature et l’homme ne fut pour eux qu’une forme éphémère, une émanation d’un jour, un anneau de la chaîne sans fin des apparences. Rien dans la théologie aryenne qui rappelle le monothéisme occidental. Du moins, affirment les croyants, les juifs firent exception à la règle générale et reconnurent ]‘existence d’un seul dieu, dès la plus haute antiquité. Aucun doute pourtant sur le polythéisme primitif des Hébreux ; la Bible nous en fournit la preuve. « Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre », dit-on au début de la Genèse. Or, Elohim est un pluriel signifiant les dieux ; plus loin, le créateur dira : « faisons l’homme à notre image », et encore : « l’homme est devenu comme l’un de nous ». Les hébraïsants sont unanimes pour affirmer qu’il ne s’agit pas d’un pluriel de majesté. Malgré les suppressions, les adjonctions, les remaniements nombreux que les prêtres d’Esdras se permirent, la Bible conserve des traces du totémisme primitif et de cultes longtemps en honneur, ceux d’El et de Baal, en particulier. Jahveh fut conçu comme un feu. « Le seigneur, votre dieu, est un feu dévorant et un dieu jaloux », dit l’Exode, et le Deutéronome parle en ces termes : « Tout le Sinaï était couvert de fumée parce que le seigneur y était descendu au milieu des feux. La fumée s’en élevait comme d’une fournaise ». Mais, à côté du feu, principe fécondant, les anciens sémites plaçaient l’eau, principe fécondé, d’où les allusions de la genèse aux eaux ténébreuses sur lesquelles plane le souffle d’Elohim. Job et Jérémie rappelleront cette lutte du créateur avec la mer. Dans la trinité chrétienne, nous trouverons un essai de conciliation entre le polythéisme ancien et le monothéisme triomphant : dieu est tout ensemble un et multiple, chacune des trois personnes est dieu, sans qu’il soit permis de parler de trois dieux. Nous avons négligé les mythologies grecque et romaine parce qu’elles sont connues de tous. Elles comportaient une hiérarchie des dieux, avec Zeus ou Jupiter à leur tête ; et lorsqu’apparu le christianisme, nombre de penseurs grecs et romains considéraient les dieux particuliers comme des aspects différents d’un dieu unique. De nos jours, les catholiques invoquent ainsi la Vierge sous des vocables divers, selon les temps et les régions. Au point de vue philosophique, tous les arguments du théisme, en faveur de l’unité divine, reposent sur les idées d’infini et de parfait. Impossible, dit-on, que coexistent plusieurs êtres infinis ou parfaits, puisque chacun d’eux manquerait de ce que les autres détiennent. Or Dieu, par définition, est l’être sans limite dans la substance comme dans les perfections ; d’où l’on conclut, en bonne logique, à son unité. Malheureusement, on oublie que le même argument permet de démontrer que dieu et le monde constituent un tout indivisible, que l’univers observable et l’homme par conséquent sont parties intégrantes de la substance divine. Si deux infinis ne peuvent coexister parce que l’un manquerait des perfections de l’autre, il est non moins impossible, pour la même raison, qu’un être fini quelconque coexiste à côté de l’infini. Pour minimes que soient les qualités du monde, elles manquent à la substance divine et limitent sa perfection. Aucune réalité ne subsiste hors de Dieu, s’il est la perfection infinie à qui rien ne manque et que rien ne saurait accroitre ; inexorablement, l’on doit conclure à la vérité du panthéisme. Les penseurs catholiques ont répondu par une comparaison qu’ils jugeaient profonde et qui achève simplement de les condamner. Dieu, disent-ils, est le louis d’or, la créature une minuscule pièce d’argent ; de même que le louis d’or contient, et au-delà, la valeur de la pièce d’argent, de même Dieu renferme en puissance toutes les qualités des êtres finis sans s’identifier avec eux. Mais ils oublient qu’une parcelle infime ajoutée au louis d’or en accroît le volume, que la pièce d’argent de cinquante centimes jointe à la pièce de vingt francs donne vingt francs cinquante centimes, au lieu de vingt francs et que Dieu ne saurait être infini s’il laisse vivre à côté de lui un monde dont la réalité reste distincte de la sienne. La créature est peu de chose, mais le peu qu’elle est enrichirait Dieu, en supposant qu’on l’ajoute à lui ; admettre l’existence d’un être absolu, c’est nier la possibilité de personnes ou de choses qui ne se résolvent pas en son infinie substance. On s’explique donc la vogue du monisme parmi les spiritualistes modernes ; et d’autre part la croyance de certains à la multiplicité des dieux conçus comme des êtres imparfaits et limités. Fechner fut de ces derniers et William James aussi, ce philosophe américain que les apologistes citent, en faveur de la religion, avec une particulière complaisance. « Fechner, écrit-il, avec son âme de la terre fonctionnant séparément et jouant pour nous le rôle d’un ange gardien, me semble franchement polythéiste. » Lui-même se déclare contre l’existence de l’absolu, partisan du pluralisme et persuadé « qu’en fin de compte, il ne peut aucunement ni jamais y avoir aucune forme qui soit celle du tout ; qu’il se peut que la substance de la réalité n’arrive jamais à former une collection totale ; qu’il est « possible que quelque chose de cette réalité reste en dehors de la plus vaste combinaison d’éléments qui se soit jamais produite pour elle ». Ainsi le polythéisme des anciens, rajeuni et plus discret, a trouvé des partisans convaincus parmi les philosophes religieux de notre époque. En réalité, aucun argument rationnel ne légitime la croyance en l’unité divine ; mais notre esprit vise à clarifier l’apparent fouillis des faits dont le monde est encombré, il simplifie ce qui est complexe, schématise, unifie : cette croyance a son origine dans une tendance subjective de l’intellect humain. Tendance souvent malheureuse ; dans le domaine religieux et politique elle fit dresser les bûchers de l’Inquisition, pour maintenir l’unité catholique, et permit l’éclosion des monarchies absolues. « Un dieu, un pape, un roi », telle fut la formule longtemps chère au clergé romain, et toujours caressée par les réacteurs de notre époque. Admettre que les idées s’opposent et que les esprits restent divers, voila qui répugne aux intolérants de toutes écoles, qu’ils soient blancs ou qu’ils soient rouges. Si le consentement unanime des peuples constituait un signe, un critérium infaillible de la vérité, comme le soutint Lamennais, il faudrait croire au polythéisme, car cette conception domina le monde entier chez les anciens ; il en fut de même, il est vrai, concernant la fixité de la terre, la rotation du soleil et des étoiles autour de notre planète. Ajoutons qu’après le triomphe du monothéisme, jamais l’entente n’a pu se faire, entre les penseurs, sur la nature divine. Petit malheur, puisqu’aucune hypothèse n’est moins prouvée, disons même plus contraire à l’expérience et à la raison, que celle de l’existence de Dieu.
– L. BARBEDETTE.
MORALE (RECHERCHE D’UNE RÈGLE DE VIE)
n. f. du latin moralès, de mores, les mœurs
La morale est l’ensemble des règles dont s’inspirent les mœurs, dans un groupement social quelconque, en vue du bien commun. Elle est forcément en rapport, non seulement avec les aspirations intellectuelles et sentimentales du groupement qui lui a donné naissance, mais encore avec ses besoins économiques, et les conditions particulières qui lui sont faites par le milieu naturel dans lequel il est appelé à se développer. La morale est, pour l’harmonie dans le groupement, ce que l’hygiène est pour la préservation des maladies dans la collectivité. Elle tend à éviter ce qui, dans la conduite de chacun, serait susceptible d’entraîner, pour les autres et pour soi-même, de la souffrance inutile, des dissentiments graves, la déchéance et la ruine. Elle se propose de favoriser, au contraire, ce qui est de nature à développer dans le groupement la concorde, l’estime mutuelle, le bonheur et la prospérité. Elle éclaire, complète, et cultive ce que la pratique millénaire de l’entr’aide, parmi les générations successives, a placé en nous d’instinct de sociabilité.
Mais, précisément parce que le contenu et la portée de chaque morale sont conditionnés par les degrés d’intelligence, de savoir, et de culture du groupement dont elle est originaire, il ne s’ensuit pas que toute morale soit forcément rationnelle, largement humaine et respectable en ses préceptes, les milieux sociaux superstitieux, ignorants et cruels étant encore, hélas, les plus nombreux. Il est évident, d’autre part, que la morale étant appelée à tenir compte des exigences du milieu naturel et des nécessités de la vie pratique, elle ne peut comporter en toute région, comme en tout temps, des indications absolument identiques, sinon quant a son principe même, du moins quant à ses modalités d’application. Ainsi, tout en répondant au même objet, les précautions d’hygiène ne sauraient-elles être complètement les mêmes pour l’homme, selon qu’il vit en Norvège ou sous l’Equateur.
Se déclarer amoraliste, ou même immoraliste, simplement parce que l’on répudie les moralités officiellement admises dans la société qui nous environne, est une erreur grave, quand ce n’est pas une boutade dangereuse, parce que cela peut donner lieu dans l’enseignement, et non sans raison, à des interprétations inexactes, aux suites regrettables.
Être amoral, en effet, c’est être totalement dépourvu de directives quant à ce que doivent être les relations nécessaires dans la vie de société ; se laisser aller à toutes ses impulsions, sans aucun souci des conséquences que notre conduite pourrait avoir pour autrui et, par répercussion fréquente, pour nous-même. C’est une des formes de l’inconscience. Être immoraliste, c’est avoir conscience de ce qu’est la morale mais, par orgueil, scepticisme, ou misanthropie, s’en faire l’adversaire sous toutes ses formes, même les plus séduisantes et les plus raisonnables.
Quand on reconnaît que certaines règles, dictées non par l’arbitraire, mais par l’utilité, sont indispensables à la vie en société ; lorsqu’on admet qu’il est — ne serait-ce qu’à l’égard de nos proches amis — des manières de se comporter qui sont bonnes, et d’autres, par contre, qui sont méprisables, on est, qu’on le veuille ou non, partisan d’une morale, même si, considérant les choses sous un angle très personnel, il se trouve que cette dernière n’a rien de commun avec celle qui est enseignée dans les écoles.
D’ailleurs, à la vérité, personne n’est totalement immoraliste. Ceux qui se prétendent tel, et le sont en effet, ne sont en réalité immoralistes que lorsque ceci favorise leur intérêt propre. Cependant les reproches amers, voire les invectives, dont ils accablent autrui, chaque fois qu’autrui se permet d’agir à leur égard avec la même désinvolture, prouvent surabondamment qu’ils ne sont dépourvus de sens ni du bon et du mauvais, ni du juste et de l’injuste. Mais ils réservent pour les autres les obligations que cela comporte, et s’accordent licence de ne faire que ce qui leur convient.
Le banditisme le plus vulgaire a sa morale, très estimable à certains points de vue. Ne pas livrer à la police les amis ; assister les prisonniers ; ne pas les dépouiller de leur part de butin. Quand, sous prétexte de liberté, on ne veut même pas se plier à des données aussi élémentaires, la vie en commun devient une triste chose, une sorte de suicide collectif, le profiteur malhonnête de la veille étant appelé à devenir la victime du lendemain. Comme perspective, on n’a pas devant soi l’harmonie rêvée, mais les brutalités de la jungle.
La liberté de l’amour elle-même, lorsqu’elle n’est pas recherchée pour soi uniquement, comporte une morale : celle de la réciprocité dans la tolérance à l’égard du compagnon ou de la compagne choisis, dût-on, sans une plainte, en souffrir cruellement.
L’idéal d’une transformation sociale, lorsqu’il n’est point pur prétexte à controverses philosophiques, comporte, lui aussi, une morale : ce n’est pas forcément de s’offrir en holocauste a son entourage, en pratiquant à son profit un communisme unilatéral. Mais c’est ne négliger rien, dans l’ordre de nos possibilités pratiques immédiates, de ce qui serait susceptible d’en hâter l’avènement.
Quant au communisme anarchiste, il est, jusque dans ses moindres détails, toute une doctrine de morale sociale qui peut être résumée ainsi : — Ne te crée pas du luxe aux dépens de la misère de ton prochain, mais renonce à exploiter son labeur pour te procurer des biens. — Rends-toi utile suffisamment pour n’être point à charge, mais veille à rendre à la société en bienfaits ce que tu as reçu d’elle sans effort. Ne fais point violence à autrui pour le contraindre à servir tes desseins, mais respecte sa vie privée et ses opinions, même lorsque tu ne les partages point. Cependant exige pour toi-même les avantages que tu admets pour autrui, et dont tu lui as permis de bénéficier, car il n’est pas dû au despote la tolérance, au parasite le bien-être, à l’autocrate la liberté.
Jean MARESTAN.
* * *
MORALE (ÉTHIQUE INDIVIDUELLE ET SOCIALE)
Avec raison, Nietzsche et un très grand nombre d’écrivains anarchistes, ou même simplement honnêtes, ont insisté sur la nocuité des morales, de toutes les morales qui, depuis si longtemps, oppressent les consciences humaines. Variables selon les époques et les contrées,. prescrivant aujourd’hui ce qu’elles condamnaient hier, audacieusement imposées au nom des dieux ou soi-disant conseillées par la raison, elles se bornent en général à forger des chaînes, destinées à paralyser les forts selon Nietzsche, à maintenir les faibles dans l’obéissance selon moi. Que de vies manquées, que de mutilations volontaires du corps ou de l’esprit, quelle plate docilité à l’égard des maîtres, combien de renoncements aussi sots qu’inutiles, parce qu’on inculque, dans le cerveau des individus, les préceptes d’un divin décalogue ou les règles édictées par des philosophes ambitieux. Et la société multiplie les crimes au nom d’une morale qui, toujours, favorise le riche aux dépens du subordonné. C’est une faute irrémissible de délester un milliardaire de quelques francs, mais ce dernier peut, sans remords, s’approprier une large part du travail quotidien de ses ouvriers ; afin de rendre l’homicide légitime, obligatoire même, il suffit que roi ou président signe une bonne petite déclaration de guerre ; et pour que l’accouplement soit honorable, maire et curé doivent intervenir. Vraie muselière pour prolétaire en liberté, la morale enserre dans le réseau de ses prescriptions le vouloir même des individus, dès lors tout pareils aux ours bien dressés qui, sur une invite, gesticulent, dansent ou se tiennent en repos. Ils se transforment en vigoureux étalons, si les maîtres réclament plus d’ouvriers pour l’usine, plus de soldats pour les holocaustes guerriers ; et, afin de grossir le « magot du patron », ils triment sans répit de l’aurore à une heure avancée de la nuit. Incontestablement les inventeurs de morales sont à cataloguer parmi les pires malfaiteurs, dès qu’ils prêchent aux individus l’obéissance, aux peuples la résignation.
Ajoutons que les morales ne parviennent ni à étayer sérieusement les règles qu’elles proclament, ni à démontrer la valeur des principes par elles adoptées. Instabilité des bases, arbitraire des constructions, mauvaise qualité soit du ciment, soit des matériaux, voilà ce qu’un examen approfondi révèle dans les plus fameuses éthiques. Suppose-t-on l’existence d’un principe supérieur à la nature humaine : Bien absolu, Perfection suprême, d’où l’on devra déduire toute la moralité, il est clair que nous abordons le nébuleux séjour des chimères et de la fantaisie. Croyants et métaphysiciens s’y complaisent. Il existe un Dieu tout-puissant, répètent les chrétiens, et ses commandements doivent être suivis par les hommes sous peine de tortures effroyables ; avec des variantes, juifs, musulmans, bouddhistes, théosophes tiennent un langage presque pareil, plusieurs remplaçant l’enfer par des afflictions terrestres ou les menaces de la réincarnation. En somme tous ces faux prophètes, qu’ils se nomment Jésus, Moïse, Mahomet, Boudha ou Krishnamurti, et tous les prêtres, qui les font parler lorsqu’ils sont morts, se bornent à menacer le révolté qui refuse de leur obéir.
J’aime examiner de près les mouvements spiritualistes qui éclosent nombreux à notre époque ; et je ne voudrais pas décourager les rares croyants qui ont l’audace de s’élever contre Rome ou les autres Églises établies. En secouant le joug des dogmes et des autorités, ils opèrent inconsciemment un travail de destruction dont l’importance n’apparaîtra que plus tard. Seulement, lorsque je vois les épouvantails à moineaux que ces pauvres gens agitent : karma, vies successives, bon dieu que ce courageux Dr Mariavé lui-même n’arrive pas à rendre sympathique, je ne puis que sourire devant le vide de ces conceptions, fort vieilles, mais soigneusement badigeonnées avec un vernis nouveau. Trop de mensonges, de sophismes, d’évidentes contradictions se rencontrent dans les morales religieuses pour qu’il soit nécessaire d’insister davantage. Elles sont, d’ailleurs, mises à nu en maints endroits de cet ouvrage.
Logeons presque à la même enseigne les éthiques fabriquées par des métaphysiciens. C’est dans l’Idée du Bien que Platon situe la réalité suprême ; dès lors la moralité consiste à en présenter une image aussi parfaite que possible, à rompre avec les apparences sensibles pour vivre de la vie intelligible des Idées. Pour Aristote, Dieu est le but auquel aspire toute la nature, même la matière qu’un secret désir pousse vers la perfection ; l’homme ne saurait avoir une fin différente, c’est à s’affranchir des passions, à s’élever par la contemplation des vérités éternelles, qu’il doit tendre. Plotin, Malebranche, Leibnitz, etc., invoquent eux aussi le dieu des spéculations métaphysiques comme suprême législateur et suprême gardien d’une morale qu’ils prétendent inspirée par la raison et qui n’est, en définitive, qu’un ramassis de préjugés. Bâtissant des châteaux en Espagne, au gré de leur imagination, ces malheureux ont eu le tort d’oublier l’univers sensible pour s’appuyer sur un dieu dont le moins qu’on puisse dire c’est qu’il n’existe pas. Quel monstre, en effet, s’il existait, même à l’état d’embryon, quel bourreau implacable, quel ogre assoiffé de sang ! Loin de flagorner sa vaniteuse suffisance, de le prier vainement d’approcher de son nez des encensoirs fumants, l’humanité devrait le maudire pour ses crimes quotidiens. Et quand Emerson, après bien d’autres, nous invite à imiter Dieu, il veut rire probablement, car le dernier criminel humain s’avère moralement supérieur au pourvoyeur de l’enfer ; de plus, nul ne conseillerait au ver de prendre modèle sur l’éléphant, et nous sommes infiniment moins que des vers, assurent les amateurs de métaphysique, si l’on compare Dieu à l’éléphant.
Auguste Comte remplaça, il est vrai, l’invisible tout-puissant des prêtres et des philosophes par l’Humunité, « grand être » dont l’existence serait moins problématique à ce qu’il assure. A la société, l’individu devrait tout ce qui fait de lui un homme : pensées, vouloirs, sentiments, bien-être ; qu’elle vienne à disparaître, seule son animalité subsistera. D’où l’obligation de vivre pour la collectivité, non pour nous-mêmes, d’aimer l’Humanité, de la servir comme un croyant aime son dieu et le sert. Durkheim et ses disciples tiennent un langage presque pareil ; pour eux, l’acte qui vise exclusivement à la conservation de l’individu ou à son perfectionnement ne saurait être qualifié moral. « L’individu que je suis, écrit Durkheim, en tant que tel, ne saurait être la fin de ma conduite morale. La morale ne commence donc que quand commence le désintéressement, le dévouement... là où commence la vie en groupe, car c’est là seulement que le dévouement et le désintéressement prennent un sens. » En somme, les partisans de la morale sociologique sacrifient l’individu à l’État. Rien d’étonnant qu’une doctrine pareille charme ceux qui désirent un pouvoir fort ; fascistes italiens et communistes de Russie l’adoptent pour des fins opposées ; en France elle est particulièrement chère aux pontifes qui dirigent notre enseignement. Chose étrange, mais indéniable, socialistes et nationalistes s’accordent pour n’attacher d’importance qu’à la collectivité, les premiers ramenant tout à l’état, les seconds à la patrie. Pour nous, quel que soit le nom dont on baptise cette divinité nouvelle, nous la répudions au même titre que le dieu des croyants ou des métaphysiciens. Opprimés par les prêtres de Jahveh, de Jésus, de la Nation ou de l’État, que nous importe si l’oppression reste la même. Point d’idole, à notre avis, qui mérite d’être adorée, fût-elle peinte en rouge écarlate et servie par des révolutionnaires authentiques. Et vraiment le prolétaire n’est pas difficile si, dans la société qui l’enchaîne, il consent à voir une mère dévouée. Bonne seulement pour les riches et les dirigeants, elle se comporte, à l’égard de l’ensemble, comme une marâtre insensible à la douleur de ses prétendus enfants. Nous savons l’association fort utile, indispensable même si l’on veut parvenir à un haut degré de spécialisation, soit dans le travail ordinaire, soit dans les recherches spéculatives, mais l’association peut rester libre, n’impliquer aucune hiérarchie et par conséquent exclure la majorité des caractères que les étatistes lui prêtent arbitrairement. Ainsi croule le dieu nouveau qu’Auguste Comte et Durkheim voulaient hisser sur le pavois à la place des anciens dieux défunts.
Le Devoir, cher au philosophe de Kœnisgberg, apparaît non moins incapable de fonder une morale exempte d’incohérences et de contradictions. D’après Kant, le devoir est un impératif catégorique qui commande sans condition ; le rattacher à une réalité supérieure et extérieure à lui, Dieu par exemple, c’est le rendre conditionnel et le faire disparaître. La morale ne repose pas sur la métaphysique, c’est au contraire la métaphysique qui repose sur la morale ; ce n’est pas le bien qui est le fondement du devoir, mais le devoir qui est le fondement du bien. Une seule chose s’avère bonne en soi, absolument, la bonne volonté ou volonté d’obéir au devoir par respect pour le devoir, sans considérations d’intérêts soit terrestres, soit même spirituels. Depuis Kant, les moralistes officiels, les politiciens véreux et les larbins des Académies ne cessent de nous parler du Devoir avec un trémolo dans la voix. Tuer autant d’adversaires que possible, puis mourir, c’était le devoir du soldat durant la guerre ; payer des impôts, faire des enfants, c’est le devoir de l’ouvrier d’aujourd’hui. Un mot, aussi creux que sonore, suffit à remuer l’âme du populaire, éternelle dupe des beaux parleurs. Pourtant l’idole sculptée par Kant, et que ses successeurs affublèrent d’oripeaux religieux et patriotiques, s’avère depuis longtemps éborgnée, manchote, digne d’être reléguée dans un placard soigneusement cadenassé.
Le devoir n’est qu’une survivance du sentiment religieux ; il résulte du caractère obligatoire que revêtaient aux yeux de nos pères les préceptes émanés, disait-on, des dieux. Pour obtenir les faveurs de ces derniers ou pour éviter leur colère, il importait d’obéir sans hésitation, sans arrière-pensée. Puis, lentement, les hommes oublièrent l’origine céleste des règles transmises par la tradition ; le souvenir des châtiments qui devaient suivre leur violation s’évanouit, ainsi que l’espoir de se concilier la bienveillance des dieux par leur accomplissement. Mais une mystérieuse terreur continua d’environner les lois impératives édictées par les prêtres ou les législateurs inspirés ; la volonté divine disparut, le devoir a subsisté. Un devoir n’ayant d’ailleurs ni l’universalité, ni l’immutabilité ; ni le caractère définitif que Kant lui attribuait faussement. Et ses variations selon les lieux, les temps et les personnes, ses mille contradictions démontrent à l’évidence que, simple reflet du milieu, il est loin d’être un absolu intangible, la suprême norme de la moralité. Ajoutons que, pour le rendre compréhensible, il faut le rattacher à une entité qui nous dépasse et peut nous commander : « Kant postule Dieu, écrit Durkheim, parce que, sans cette hypothèse, la morale est inintelligible. Nous postulons une société spécifiquement distincte des individus, parce que, autrement, la morale est sans objet, le devoir sans point d’attache. » Ainsi, qu’on le veuille ou non, la morale du devoir aboutit à l’asservissement de l’individu ; c’est assez pour qu’un esprit libre la répudie. Reprochons encore à la morale de Kant comme à toute morale, d’ailleurs, qui sacrifie le cœur et les sens à la raison, à la stoïcienne par exemple, d’oublier que l’homme possède des sentiments et un corps, qu’il n’est pas pure intelligence et que le bonheur vrai suppose d’humbles plaisirs à côté de joies très hautes. Il se mutile sottement celui qui, sous prétexte de s’en tenir à la raison, répudie tous les biens périssables, néglige sa santé, ignore volontairement la douceur d’aimer.
A l’inverse de Kant ou des stoïciens, Adam Smith, Schopenhauer et les autres partisans d’une éthique sentimentale ont fait au cœur une place prépondérante. Alors que Fourier accorde un droit égal aux diverses inclinations et qu’il imagine l’organisation phalanstérienne pouvant permettre à toutes les passions de se développer librement, Adam Smith choisit la sympathie parmi les autres sentiments. Pour lui la suprême règle morale c’est de susciter le maximum de sympathie chez le maximum d’individus. Avant d’agir nous devons nous demander quelle émotion notre acte suscitera dans la conscience des autres, ou mieux encore ce qu’en penserait un « spectateur impartial » installé à demeure dans le fond de notre âme. Schopenhauer préfère la pitié. S’inspirant des idées de Bouddha, il estime que la vie est essentiellement désir et souffrance. L’idéal, pour le sage, sera donc de supprimer le vouloir vivre, vraie raison de notre existence, par l’ascétisme et le renoncement ; mais devant la douleur universelle de tous les êtres, il se sentira, de plus, envahi par une immense compassion. Son cœur s’ouvrira à une pitié sans bornes pour tous les hommes, ses frères ; et cette pitié lui dictera sa conduite dans ses rapports avec eux. Bien d’autres philosophes invoquent le sentiment comme base de la moralité ; Hutcheson et Ferguson admettent l’existence d’un « sens moral » d’un « bon amour » ; Jacobi estime qu’il suffit de s’abandonner aux mouvements du cœur pour être vertueux ; « ama et fac quod vis » (aime et fais ce que tu veux), disait déjà saint Augustin.
Les éthiques sentimentales ne manquent ni de grandeur ni de vérité ; elles ne sauraient toutefois nous satisfaire pleinement. L’amour est aveugle, il conduit fréquemment à des injustices ou à des fautes ; loin de pouvoir être pris comme règle universelle, il a souvent besoin d’être dirigé. D’ordinaire les âmes les plus nobles, parce qu’elles ont le courage de braver les idées courantes et les préjugés, sont loin d’être les plus sympathiques à leurs contemporains ; il suffit de dépasser son temps pour être méconnu, persécuté. Une pitié mal comprise, celle qui consiste à réchauffer la vipère engourdie, n’a rien non plus de recommandable. Arrière la bonté qui se confond avec la sottise ; si la générosité a mauvais renom c’est qu’elle ferme les yeux, en général, et devient une duperie. Puis les morales du sentiment ont tort de ne faire aucune place à l’intérêt personnel, à l’invincible besoin d’être et d’être toujours mieux qui anime chacun de nous. S’il est bon que l’individu songe à autrui, il serait mauvais qu’il s’oublie, qu’il abdique toute volonté de vivre et de parfaire son moi. Ce dernier reproche, il ne semble pas, du moins de prime abord, qu’on puisse le faire aux morales du plaisir et de l’intérêt (voir ces mots). Pour l’hédonisme, le plaisir constitue la fin dernière de toute vie. Avec Epicure, Bentham, Stuart-Mill, Spencer, il reste le bien suprême, mais il se transforme en intérêt que la raison délimite et précise. Une sorte d’intellectualisation du plaisir s’opère grâce à l’acceptation voulue des douleurs fécondes, à l’éloignement intentionnel des joies dangereuses. Epicure classe nos besoins et préconise l’ataraxie ; Bentham crée une arithmétique des plaisirs ; Stuart Mill introduit la notion de qualité dans le domaine des jouissances ; Spencer compte sur l’adaptation au milieu social et l’hérédité pour substituer un altruisme toujours accru à l’égoïsme primitif. Ce désir de substituer l’intérêt général à l’intérêt particulier apparaît déjà chez Epicure, qui accorde une place de choix aux douceurs de l’amitié ; chez Bentham et chez Stuart-Mill, il est beaucoup plus manifeste, sans aller jusqu’à admettre la disparition totale de l’égoïsme, comme Spencer le prévoit pour un avenir lointain.
Mais les utilitaristes sont-ils parvenus à des conceptions qui s’imposent indiscutablement ? Nous devons répondre par la négative, malgré les mérites certains de leurs idées. Il est faux d’abord que, dans les sociétés actuelles, l’intérêt particulier concorde d’une manière habituelle avec l’intérêt général ; c’est le contraire qui semble vrai. Puis c’est une illusion de vouloir forger un bonheur-type, de modèle uniforme, à l’usage de tous les individus ; ce qui plaît à l’un déplaît à l’autre, les hommes placent leurs meilleures satisfactions dans des joies opposées. Ajoutons que l’égoïsme voulu, systématique, le continuel repli sur soi-même, dans le but de s’interroger sur le bonheur ressenti, conduit rapidement à une neurasthénie aiguë. Si le plaisir est une fin pour l’homme, pour la nature il n’est qu’un signe et suppose un travail plus profond de perfectionnement. Nourriture et boisson visent à restaurer l’organisme affaibli ; les plaisirs qu’elles engendrent restent un accessoire. Certaines joies, celles de la procréation, par exemple, ont toute l’apparence d’un appât auquel il est bon, parfois, de ne point mordre.
Ainsi, non seulement les morales sont devenues des instruments d’oppression, mais elles ne peuvent légitimer leurs principes les plus essentiels. Et pourtant la morale serait utile si, oubliant le sens que l’on donne d’ordinaire à ce terme, l’on entendait par là une synthèse des techniques capables de rendre la vie meilleure et plus harmonieuse, un art raisonné du bonheur individuel et général. L’animal qui choisit soigneusement sa nourriture, qui fuit êtres et choses représentant pour lui un danger, qui recherche la compagnie de ses pareils, qui, dans les espèces supérieures du moins, connaît les diverses passions éprouvées par les hommes, conforme sa conduite aux nécessités du moment et s’efforce d’obtenir tout le bien-être que l’instant qui passe paraît capable de lui procurer. Mais il ne prévoit pas, ou prévoit à un degré trop infime pour modifier de façon efficace la trame du futur un peu lointain. L’homme prévoit grâce à la raison ; dépassant les apparences, il saisit l’enchaînement des causes et des effets ; pour agir et sur le monde inorganique et sur son corps et sur son esprit, il possède des techniques perfectionnées. Utiliser les moyens dont on dispose au mieux du but qu’on s’est fixé, organiser son existence avec art, mais dans le style conforme aux désirs de chacun, voilà en quoi consiste, à mon avis, l’aspect pratique de la moralité. L’éthique doit se borner à donner des conseils, à montrer les avantages ou les inconvénients de tel mode d’activité, à découvrir les secrets ressorts qui meuvent cœur et pensée ; sa tâche restera belle, puisqu’elle permettra aux individus de construire l’idéal qui leur sied et de le vivre dans la mesure du possible. N’en doutons pas : si les hommes apprenaient à comprendre, ils deviendraient dans l’ensemble meilleurs qu’ils ne sont.
De même que la chimie moderne a pu utiliser certaines découvertes de l’antique alchimie, de même l’éthique que nous préconisons rencontre parfois de bonnes choses, et dont elle fait son profit, dans les morales admises autrefois. Mais le point de vue général, la façon d’aborder les problèmes, de résoudre les difficultés doivent être modifiés. S’il s’agit d’éthique individuelle, l’idée de bonheur (d’un bonheur tout relatif, qui n’a rien de fixe et qui résulte de la satisfaction d’un faisceau de besoins), s’avère absolument centrale. Descendu du ciel inaccessible où i1 resta logé longtemps, le bonheur, soumis à l’analyse psychologique, a livré son secret et révélé la nature des éléments qui le constituent ainsi que leur mode de coordination. Il requiert des biens extérieurs, non excessifs, mais suffisants, un corps sain, une intelligence ouverte, une volonté forte, un cœur aimant. Chacune de ces conditions mériterait d’être étudiée longuement ; nous l’avons tenté dans une série d’essais auxquels nous renvoyons le lecteur. Remarquons néanmoins que les inclinations humaines ne sauraient pratiquement être satisfaites tomes simultanément et d’une façon complète ; en conséquence le bonheur vécu s’avère toujours relatif, il comporte de petites douleurs à côté de grandes joies, même aux instants les meilleurs. Une thérapeutique morale permet de soulager l’esprit souffrant, comme la médecine ordinaire permet d’atténuer les douleurs du corps. Si invraisemblable que cela paraisse, l’éthique disposera de laboratoires, comme la physique et la bactériologie, dans un avenir moins lointain qu’on le suppose. Les vains discours, dont les moralistes nous assomment, seront remplacés par des poudres et des injections ; à volonté, grâce à des potions adéquates, l’on pourra calmer les passions ou les exalter ; ni châtiments ni récompenses pour modifier le caractère des anormaux, un traitement médical suffira. Mais, dans ce domaine, beaucoup reste à faire. L’éthique sociale est actuellement très étudiée. L’école de Durkheim amasse des matériaux d’un grand intérêt, par contre son œuvre constructive est d’une faiblesse irrémédiable : en définitive, elle se borne à remplacer Dieu par l’État. Nous trouvons, chez les écrivains anarchistes, une réfutation de la morale courante dont nul penseur sérieux ne saurait faire fi ; ils ont l’immense mérite d’observer sans parti-pris et de tenir compte des aspirations intimes de l’individu. Une synthèse des vérités déjà mises en lumière semble même possible.
Pour la majorité des hommes, l’association s’avère condition indispensable du plein épanouissement de la personnalité. Division du travail et solidarité, inutiles pour l’individu capable de se suffire a lui-même, interviennent donc manifestement. L’entr’aide : voilà le précieux avantage que l’on attend de l’association. Mais les collectivités modernes sont oppressives ; elles enchaînent celui qu’elles prétendent servir. Concilier l’indépendance et l’entr’aide, voilà le problème essentiel que l’éthique sociale doit examiner. Je le crois si peu insoluble, qu’à mon avis la conciliation est, sur plusieurs points, en voie de se réaliser. Les libertaires auraient tort de croire que leurs idées subissent une éclipse : les partis, les groupements qui les soutiennent peuvent prospérer ou décroître selon l’époque et les circonstances, le besoin d’indépendance (un besoin plus ou moins éclairé, plus ou moins conscient, c’est vrai), subsistera autant que la race humaine. « L’individu compta d’abord exclusivement comme membre d’une famille, d’une tribu : pour venger un meurtre pas besoin de frapper l’assassin, il suffisait d’atteindre un homme de sa parenté ou de son clan. Jahveh, modèle du juste, punit Adam et Eve dans leurs descendants ; il tue les premiers-nés d’Egypte par haine du pharaon. Ce fut un progrès de n’imputer le crime qu’au coupable seulement ; ruine du dogmatisme, liberté de conscience, toujours précaire il est vrai, en furent d’autres. Quant à l’entr’aipe, elle ne joua d’abord qu’à l’intérieur de groupes restreints. En Grèce, à Rome, elle reliait fortement nobles et magistrats, se relâchait beaucoup s’il s’agissait de simples citoyens, n’intervenait plus en faveur du troupeau désuni des esclaves. Si l’Evangile proclame l’égalité de tous devant Dieu, la société chrétienne se borna à transformer l’esclavage ancien en un servage presque aussi dur. Au moyen-âge, noblesse et clergé connurent les bienfaits d’une entr’aide qui ne déshonorait pas ; bourgeois des villes, artisans, maîtres et compagnons s’organisèrent en association dont les membres étaient solidaires ; mais à la masse populaire on réserva une charité inefficace et humiliante. Puis l’altruisme s’étendit à des groupes plus larges ; à l’aumône fut substituée une assistance rationnelle, garantie contre l’arbitraire ; la solidarité devint respectueuse de la liberté des individus. » C’est justement parce qu’elle concilia l’entr’aide et l’indépendance dans une synthèse supérieure, parce qu’elle suppose le libre développement de chacun dans l’harmonieux accord de l’ensemble, que la fraternité s’avère l’ultime fondement de l’éthique sociale. Mais il ne saurait être question de cette fraternité hypocrite qui sert aux profiteurs à masquer leurs usurières exploitations : ainsi comprise elle n’est qu’une méprisable duperie. La nôtre n’est rendue possible que par l’union librement voulue de ceux qui entendent la pratiquer ; fleur très rare encore, elle ne pousse que sur les sommets où la contrainte cède la place à l’amitié.
— L. BARBEDETTE
* * *
MORALE (SES BASES ILLUSOIRES ; SA DUPERIE ACTUELLE)
La morale se confond avec la religion dans le confusionnisme idéologique primitif. Le bien c’est ce que Dieu commande ; le mal ce que Dieu défend.
Dieu commande parfois des actes d’utilité générale :
« Qui donne au pauvre prête à Dieu » ...
Mais, le plus souvent, ce que Dieu ordonne est d’accord avec l’intérêt des forts. Il enjoint à l’Hindoue de se brûler vive sur le bûcher où se consume le cadavre de son mari. Dieu ordonne les tueries guerrières ; c’est au cri de « Dieu le veut ! » que s’ébranlaient les croisés. L’empereur d’Allemagne écrivait sur ses obus :
« Got mit Uns ! » (Dieu est avec nous !)
Les progrès de la raison font douter de Dieu. On s’aperçoit que l’existence de Dieu ne peut pas se démontrer. Quand on s’y essaie, on n’aboutit qu’à des sophismes. Sur quoi alors établir la morale ?
On l’établit sur l’impératif catégorique qui a lui-même une cause mystérieuse.
« Devoir, d’où tires-tu ton origine » ?
En réalité, nous voyons l’impératif soi-disant catégorique transgressé constamment. Et il varie selon les latitudes. Sans doute certains sauvages ont un impératif catégorique qui leur ordonne de tuer leurs vieux parents pour ne pas avoir à les nourrir. L’impératif catégorique, plus familièrement la voix de la conscience, n’est autre que la suggestion du milieu où on a été élevé, c’est pourquoi toutes les consciences ne sont pas pareilles.
C’est perdre son temps et son énergie que de chercher une base à la morale ; elle n’en a pas. La morale est un ensemble de conventions plus ou moins importantes et plus ou moins stables.
Pour être conventionnelle, la morale n’est pas pour cela inexistante. Que deviendrait-on si les hommes, au lieu de vivre du travail, décidaient de demander leur subsistance au vol et au meurtre ; la civilisation et l’humanité elle-même disparaîtraient.
Cependant, on ne peut pas ne pas voir la duperie de la morale dans la société présente. Celui qui est riche n’a pas beaucoup de mérite à être honnête et vertueux. Mais que penser d’une morale qui commande au misérable de se laisser mourir de faim plutôt que de voler ? La fonction primordiale de la morale apparaît être de protéger la propriété. L’impératif catégorique est un gendarme psychique.
Depuis la guerre, nous assistons à un bouleversement profond des valeurs morales.
Pour la première fois, la guerre a eu comme participants des bourgeois cultivés qui n’étaient pas des militaires professionnels. La guerre de 1870 s’était faite sous le régime du remplacement ; celle de 1914 se recrutait d’après le service militaire obligatoire.
Certes, nombre de fils de bourgeois ont réussi soit à être ajournés, soit à se faire embusquer ; mais il y en a eu dans les tranchées. Ils y ont compris qu’on pouvait tuer sans que la terre s’entr’ouvre, ils en ont conclu que la morale qu’on leur avait enseignée dans les collèges n’a pas de valeur réelle.
La seconde cause importante de l’écroulement de la morale a été l’inflation monétaire suivie de la chute du franc.
La bourgeoisie vivait sur les idées de Franklin, le théoricien de la morale et de la vie bourgeoise. On croyait au travail honnête et régulier, à la culture intellectuelle acquise par l’effort et productrice d’honneurs ainsi que d’argent. On croyait à l’économie. On pensait que quiconque mène une vie sérieuse, laborieuse et ordonnée ne peut pas ne pas réussir. La chute du franc a fait fondre les économies dans les banques. La bourgeoisie en a conclu qu’elle avait vécu sur des principes faux.
Aujourd’hui, on peut dire que l’honnêteté commerciale a disparu. De vieilles maisons séculaires qui demandaient le succès à la renommée de leur marchandise (« bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée ») vendent aujourd’hui des articles de mauvaise qualité. On se moque de la renommée qui est avantageusement remplacée par une publicité à grand tapage. Qu’importe que les clients soient mécontents si la réclame nous en amène de nouveaux par milliers. La fortune n’est pas, comme autrefois, le couronnement d’une longue vie ; on peut la faire en quelques années.
La qualité ne correspond plus au prix ; les hôtels les plus cotés donnent à leur clientèle une nourriture détestable. Le luxe extérieur attire les snobs ; c’est tout ce qu’il faut. La tromperie en matière de commerce s’est à tel point généralisée qu’on en a adouci le vocabulaire. On ne dit pas qu’on a été volé par un commerçant malhonnête ; mais qu’on a été arrangé par un homme qui sait y faire...
La littérature s’est complètement commercialisée, on vante un livre comme on vante un café ou un chocolat. Sur la bande, qui sert à attirer l’acheteur, on annonce parfois tout autre chose que ce qu’il y a dans le livre.
Les savants les plus titrés, les plus décorés, lancent, à grand renfort de publicité, des produits qui, ils le savent fort bien, ne donneront pas ce qu’ils promettent. Leur situation scientifique qui inspire confiance leur est une monnaie cotée d’autant plus haut que la célébrité et la confiance sont plus grandes. Au bout d’un certain temps on s’apercevra que l’appareil est inefficace, que le médicament ne guérit pas : qu’importe ; ils auront fait fortune. Un autre savant, tout aussi honorable, viendra proposer un autre produit.
Dans la presse, le chantage, la publicité dissimulée sont devenues monnaie courante. L’idée la plus générale en apparence sert de couverture à des intérêts mercantiles. On combat le régime sec des Américains, on met à la mode l’alcoolisme pour vendre le vin et l’alcool. L’écrivain, l’orateur sont payés par les intéressés.
Aussi voyons-nous l’alcoolisme faire fureur dans la bourgeoisie. Les gens qui veulent être modernes ont leur bar à domicile. L’homme en habit titube en sortant d’un café et on trouve cela tout naturel. La pédérastie et le maquereautage passent dans les moeurs de la jeunesse dite « bien élevée ». Le jeune littérateur, pour arriver, se prête aux passions homosexuelles d’un homme riche ou puissant. Des étudiants se font entretenir par des prostituées.
La fidélité aux opinions est considérée comme une marque de faiblesse intellectuelle. On soutient non pas l’idée que l’on a (on n’en a aucune), mais celle qui nous rapporte. Quand l’idée ne rapporte plus, on en change.
On pourrait objecter que c’est seulement la bourgeoisie qui est corrompue à ce point et que la guerre, qui a amené la gangrène des classes dirigeantes, n’a pas touché le prolétariat. Ce n’est pas tout à fait vrai. Les crimes et notamment les crimes passionnels et familiaux se sont grandement développés depuis que, à la guerre, les hommes ont appris à tuer. Ces crimes sont, à vrai dire, le fait de toutes les classes des deux sexes. On tue la maîtresse ou l’amant qui vous laisse, le ou la rivale, la belle-mère ennuyeuse, le vieux père qui s’obstine à vivre... L’acquittement des criminels passionnels entre en ligne de compte dans la préméditation. On supporte cet acquittement et on se débarrasse de celui dont on veut se venger ou de celle qui vous gêne.
Dans son ensemble, néanmoins, le prolétariat est moins touché que la bourgeoisie. Mais c’est, avant tout, parce qu’il ne pense pas. Son ignorance, le travail de chaque jour, bornent son horizon. A peu de chose près, il continue de vivre la vie rudimentaire qu’il vivait avant la guerre.
Les catholiques ne manquent pas, bien entendu, ... d’accuser l’irréligion de la faillite de la morale. Erreur grossière. C’est précisément la classe corrompue, la bourgeoisie qui revient au catholicisme, tout au moins qui affecte d’y revenir pour accroître les forces de la réaction.
A vrai dire, la morale et la religion elle-même n’ont qu’une influence limitée sur la pratique de la vie. Pour que la religion influe, il faudrait une foi très vive qui n’est plus au cœur de personne. Quant à la morale, son impératif soi-disant catégorique l’est très peu en réalité, « Video meliora proboque deteriora sequor. » (Je vois le bien et je le prouve, et cependant je fais le mal.)
La morale est-elle nécessaire ? Non ; du moins, pas autant qu’on le pourrait croire. Une société rationnellement organisée rendrait la morale inutile ; car la morale n’a d’autre but que de pallier à une mauvaise organisation sociale et d’en abuser les victimes.
L’adage « qui donne aux pauvres prête à Dieu » n’a plus de sens dans une société où il n’y a plus de pauvres. Le dévouement à un parent ou à un ami frappé par la maladie est inutile si des hôpitaux bien aménagés soignent les malades. Recueillir les enfants abandonnés n’est pas nécessaire si la société les entretient convenablement. Même l’aide morale, le fait de compatir au chagrin d’autrui, d’encourager une personne déprimée n’aura plus d’objet. La société rationnelle connaîtra le psychologue, professionnel bienveillant, qui sera le médecin de l’âme.
La morale de l’avenir ne sera plus qu’une urbanité, une conduite à tenir dans les rapports avec ses semblables, édictée de telle sorte que ces rapports puissent être une source de plaisir et non de désagrément. Ne pas mentir sans utilité. Ne pas écraser ses compagnons d’une supériorité qu’à tort ou à raison on se confère. Supporter les défauts d’autrui dans la mesure où ils ne vous rendent pas la vie impossible. Ne pas vouloir tout ramener à soi, penser que les autres, eux aussi, existent et qu’ils ont leur personnalité, comme nous avons la nôtre...
Tous ces préceptes ne viennent ni de Dieu ni d’un au-delà nouménal. Ils sont relatifs, conventionnels, mais n’en sont pas moins nécessaires. Ce sont des règles de bonne vie dont la société humaine, comme les sociétés particulières, a besoin pour fonctionner normalement. Mais, en général, moins nécessaire sera la morale, meilleure sera la société.
— Doctoresse PELLETIER.
* * *
MORALE
-
ORIGINES ET ÉVOLUTION
-
LES RELIGIONS ET LA MORALE
-
LA MORALE ET LES MŒURS
-
MORALE INDIVIDUELLE ET MORALE COLLECTIVE
I. Historique succinct des systèmes de morale.
La morale est la règle de jeu pratiquée entre individus vivant en groupe ou en société. Elle n’existe pas pour des êtres vivant isolément et se suffisant entièrement à eux-mêmes. Elle est nécessaire pour les espèces animales grégaires fourmis, abeilles, hommes, etc. La règle du jeu n’est autre chose que la coutume. Et c’est cette coutume qui détermine les mœurs de chaque pays ou de chaque époque. Les individus s’y conforment inconsciemment presque toujours, et d’ailleurs l’opinion publique, plutôt que l’appareil coercitif, est là pour les rappeler à l’ordre.
Primitivement la morale (ou la coutume) s’est établie par tâtonnements pour la meilleure sauvegarde de la tribu. Mais dans l’ignorance où étaient les hommes primitifs de la plupart des causalités, leurs mesures de sauvegarde ne correspondent guère à notre logique actuelle. La terreur sacrée fut la principale cause de règles morales où l’imagination prenait sans doute la plus grande part.
La religion, issue de la terreur sacrée, continua d’englober la morale, c’est-à-dire la coutume tout entière. Mais peu à peu les questions d’intérêt, les rapports économiques, tout ce qui peut être compté ou pesé, tout ce qui peut être enfermé dans un contrat, devint une législation indépendante, qui aboutit chez les Romains à la constitution du Code. Cependant tout ce qui dans la coutume était fondé sur les sentiments restait du domaine religieux. Pour la première fois, Socrate, aidé par le travail de démolition que les sophistes avaient .entrepris avec entrain, sépare la morale de la religion en introduisant la méthode rationaliste d’observation dans l’étude des phénomènes moraux. Après lui, Zénon et Epicure s’efforcent de dégager les lois morales qui règlent les rapports des hommes et élaborent, l’un la doctrine stoïcienne, l’autre la doctrine épicurienne qui se partagent l’adhésion des esprits libres et cultivés, et dont l’influence triomphe dans toute la civilisation hellénistique et romaine. Mais, sous le régime d’oppression où tombe plus tard l’empire romain, le libre exercice de la pensée est supprimée. L’épicurisme devient la seule recherche des plaisirs matériels. Le stoïcisme s’enferme dans une tour d’ivoire, et, malgré les efforts et la réforme de Marc-Aurèle, n’a plus aucune influence sur la vie sociale.
Sur ces entrefaites, le christianisme se répand dans le bas peuple de l’Empire. Son mysticisme, qu’il a emprunté aux religions orientales voisines, satisfait l’imagination des gens ignorants. Sa morale s’adapte à l’humilité et aux espoirs de la classe pauvre. En pénétrant peu à peu dans les classes aisées il s’imprègne de la morale stoïcienne. Mais la morale est de nouveau retombée sous le joug de la religion... Il faut arriver à l’époque de la Renaissance pour voir surgir quelques velléités de rendre à la morale son indépendance. Mais les esprits étaient encore trop imbus de religiosité pour avoir d’autre ambition qu’une réforme qui débarrassât là morale d’une partie des rites sous lesquels elle disparaissait. Le protestantisme vient s’opposer au catholicisme. Mais la morale reste toujours religieuse. Elle est ébranlée quelque peu par les critiques des philosophes du XVIIIè siècle et par la Révolution française. Le progrès scientifique démolit la valeur des rites du catholicisme, et celui-ci, malgré un renouveau apparent, est obligé de se réfugier dans une métaphysique mystique. L’affaiblissement du pouvoir religieux permet enfin à une minorité d’individus et pas dans tous les pays, de pratiquer une morale non confessionnelle.
A vrai dire, cette morale laïque est la même que celle de la religion catholique débarrassée de ses rites, que celle du protestantisme ou du judaïsme actuel. C’est une sorte de néo-stoïcisme adapté au milieu moderne, ou, plus exactement, aux idées, aux sentiments et aux intérêts de la classe au pouvoir.
Une morale ne saurait, en effet, se détacher des mœurs mêmes. Devenue une entité abstraite, elle maintient autant que possible les mœurs dans les limites du système doctrinal ; mais elle est influencée par elles et elle évolue avec elles, quoique avec plus de lenteur. Sinon, si la morale se fossilise dans des formules religieuses désuètes, il y a rupture. Les religions attribuent toujours plus d’importance à la stricte observance des rites qu’à la pratique de la morale sociale. Celle-ci en évoluant est étouffée. La vie sociale est gênée. Une bonne action, qui obligerait à enfreindre un rite sacré, peut être condamnée comme sacrilège. C’est à ce moment qu’apparaissent des novateurs qui prêchent une morale plus conforme aux mœurs de l’époque, en avance même sur elles, car ce n’est pas tant une morale qu’apporte la prédication nouvelle qu’un idéal nouveau libéré des entraves des vieilles croyances.
Si l’on excepte la révolution socratique, le progrès moral s’est fait grâce à des révolutions religieuses. Elles furent presque toujours difficiles et sanglantes. La religion ancienne ne veut pas lâcher son autorité et sa puissance, et cette puissance est grande. Elle est, en outre, toujours associée au pouvoir politique. Bien des essais de réforme ont ainsi été écrasés. En somme, les révolutions ont été rares et on peut les compter sur les doigts. L’Avesta, sorti des méditations de Zoroastre, fut certainement une réforme de la vieille religion médique, ce qui n’alla pas sans heurts. Le bouddhisme fut l’effort de Câkya Mouni contre l’enserrement des rites et une aspiration à une morale plus humaine et plus vivante. Il y a des flux et des reflux. Le nationalisme des Parthes rejette l’influence de la philosophie hellénique ou de la propagande chrétienne pour remettre en honneur la religion de Zoroastre qui commençait à s’effriter. Le nationalisme hindou élimine le bouddhisme, religion universelle et, à ses débuts, sans armature rituelle, d’autant plus facilement que le brahmanisme est une religion joliment constituée et tenant fortement en main une masse ignorante et crédule.
Le judéo-christianisme primitif fut une révolte contre les rites, alors qu’une partie de la population se trouvait déjà pénétrée par les idées de la civilisation hellénique. Le christianisme des gentils diffusa dans des populations déracinées et mélangées, qui avaient perdu leur religion nationale et n’étaient plus attachées qu’à quelques rites sans valeur morale. Ils adoptèrent la nouvelle religion encore en formation et ils l’adaptèrent à leurs aspirations. Elle fut pour eux, pour les déshérités sans foyer et sans patrie, le lien qui devait unir leurs espoirs. Mais se refusant à adorer Rome et l’Empereur comme divinités et, dans les débuts, ignorant l’État, ils furent longtemps persécutés.
A l’époque où vivait Mahomet, la Mecque était un nœud commercial où quelques marchands grecs, syriens, égyptiens, de religion chrétienne, venaient au-devant des caravanes. Des familles juives étaient établies à Médine. Les croyances de la population autochtone, ou d’une partie de cette population, commençaient a se détacher de l’animisme grossier des Arabes nomades. Pourtant il est possible qu’il n’en fût rien résulté si un mystique, à demi-civilisé, n’eût été l’animateur de la révolution. La doctrine de Mahomet fut un compromis, dont l’armature se rapprochait de la morale judéo-chrétienne, enserrant et conservant la sauvagerie des mœurs bédouines.
Faut-il encore citer la naissance du protestantisme et les guerres de religion ? Mais en dehors des révolutions successives, l’évolution de la morale est manifeste à l’intérieur de chaque religion. Depuis leur naissance le christianisme et même le mahométisme ont beaucoup évolué. Le statut des femmes dans l’islamisme actuel est bien différent du statut primitif, surtout dans les nations en contact avec l’Occident. Le catholique le mieux pensant et le plus orthodoxe de notre époque a une mentalité qui l’aurait fait excommunier au XVIè ou au XVIIè siècle. Un homme est toujours obligé d’être de son temps... Il n’en est pas moins vrai que l’évolution de la morale est terriblement gênée par les religions constituées. Celles-ci sont avant tout conservatrices. Au point de vue social elles consolident l’autorité, elles légitiment l’inégalité. Les entraves à l’évolution de la morale en sont augmentées d’autant.
La morale laïque, née de nos jours, n’est pas non plus une morale émancipée. Elle est sous le contrôle de l’État au lieu d’être sous celui de l’Église, elle est nationaliste au lieu d’être religieuse. Pour le peuple, le nationalisme est devenu la nouvelle religion. On est obligé de se découvrir, devant le drapeau, on ne l’est plus devant le Saint Sacrement ; la différence de réaction du public autrefois et aujourd’hui est manifeste à cet égard . Il est curieux que les églises chrétiennes aient suivi l’évolution des esprits. L’église catholique de chaque pays s’appuie sur le nationalisme. La condamnation de l’Action Française par le pape n’infirme pas cette constatation. Le clergé français conserve sa tendresse aux camelots du roi. Le clergé italien est fasciste. Le cardinal Dubois, au moment des fêtes en l’honneur de Renan, apporte comme principal argument contre l’auteur de « la vie de Jésus » qu’il a glorifié l’Allemagne !
La morale laïque est un enseignement d’État, elle prêche les vertus civiques et patriotiques, l’obéissance à la loi et à l’ordre établi. Nos aspirations la dépassent de beaucoup.
* * *
II. Genèse et évolution de la morale individuelle.
Un fossé profond sépare nos conceptions de celles des gens religieux. Pour eux, la Morale est à priori et absolue, elle a été révélée et édictée par Dieu, elle est hors de la portée des hommes.
Beaucoup de personnes, qui sont affranchies de toute foi confessionnelle et qui ne se contentent pas non plus de la morale bassement utilitaire dispensée par l’État, considèrent la Morale comme une fonction innée de la Conscience. Tout en acceptant que la morale n’est pas révélée, elles croient qu’elle est en quelque sorte pré-établie et au-dessus des passions humaines. Le Devoir de l’homme et sa récompense sont de tendre à la recherche de cet Idéal, de cet Absolu. Notre âme immortelle, parcelle du Divin, participe à l’harmonie de l’Univers, et il suffit de nous abîmer dans la méditation pour trouver en nous-mêmes le Vrai et le Juste... D’où il résulte que la morale pourrait suffire à résoudre la question sociale. Tout l’effort utile serait dans l’éducation.
Nous aussi, nous pensons que l’éducation morale n’est pas chose négligeable. Nous pensons que cette éducation, dirigée dans le sens de la liberté, doit permettre aux enfants de développer leur personnalité, leur donner, autant que possible, la maîtrise de soi, le sentiment de dignité, le sens de la responsabilité, susciter en eux la bonté et la générosité. Nous pensons qu’elle doit être idéaliste, mais sans imposer aucun dogme : chrétien, fasciste. Socialiste ou anarchiste. Mais nous pensons aussi, et c’est l’expérience humaine qui le montre, qu’elle est incapable, à elle seule, d’instaurer l’ordre social et la justice. La pire des utopies, c’est de croire qu’ils pourront être réalisés l’un et l’autre avec la bonté des patrons, touchés par la grâce et la reconnaissance des ouvriers, eux-mêmes bons, respectueux, obéissants. L’éducation morale serait-elle générale, les intérêts reprennent le dessus. L’appât du lucre enlève aux hommes d’affaires les scrupules qu’on avait essayé de leur inculquer, et presque tous n’ont que mépris à l’égard des faibles et des pauvres ; le pouvoir de l’argent fait réapparaître chez les parasites le laisser-aller, le manque de maîtrise de soi, l’asservissement à leurs propres caprices. Les préoccupations matérielles font oublier à la plupart des jeunes gens toute préoccupation morale ; la servitude donne la bassesse, la ruse, l’envie ou la haine. L’inégalité sociale s’oppose au développement de la dignité humaine. Ce qui n’empêche que l’éducation morale est nécessaire pour former, et d’ordinaire chez les moins misérables, les caractères qui seront dans la lutte sociale la force grandissante des opprimés.
C’est débarrassée des contraintes sociales actuelles qu’une morale meilleure pourra être pratiquée par l’immense majorité des hommes. Est-ce la morale définitive ? De progrès en progrès sommes-nous nécessairement orientés vers une forme morale prédestinée ?
Il nous apparaît, en étudiant l’évolution des mœurs, que des morales successives se dégagent lentement au cours des siècles. Elles sont la résultante des tâtonnements des hommes. Elles varient suivant les conditions de vie et les arrangements sociaux. Les hommes tendent vers le plaisir, plaisirs matériels, plaisirs intellectuels, plaisirs artistiques, plaisirs affectifs, plaisirs idéalistes, suivant le tempérament de chacun, suivant les possibilités sociales, suivant la forme de la civilisation du moment et son influence sur les esprits. Ils ont des aspirations et des espérances, ils ont un idéal, qui n’a pas toujours été le même, qui est le fruit de leur imagination, et qui n’est qu’une hypothèse, quoique cette hypothèse agisse à son tour sur la morale elle-même et son évolution. Certes, nous croyons connaître dès maintenant la forme idéale de la morale future, mais nous ne savons pas si les hommes de l’avenir ne modifieront pas encore cet idéal, et, si nécessaire qu’il soit à notre esprit, si élevé, si beau qu’il nous paraisse, nous n’avons pas la prétention que lui ou tout autre soit inscrit d’avance au haut des Cieux ou même dans la Conscience. L’absolu n’existe pas et il n’y a rien que de relatif.
En fait, si nous considérons la morale comme la science des mœurs, nous avons à étudier d’une part la coutume elle-même, d’autre part le contrôle pour l’observance des règles. Dans les deux cas ce n’est pas la conscience individuelle, c’est l’opinion publique qui a créé les règles morales et le contrôle.
On peut suivre son évolution à travers les âges : très dure pour la souffrance humaine, acceptant et exigeant les sacrifices humains, tenant l’esclavage pour légitime avec une telle certitude et une telle conviction que même à l’époque de la civilisation grecque il n’est pas mis en question, tenant comme nécessaire la torture en matière judiciaire et les châtiments corporels en matière d’éducation, ayant comme principe de justice la peine du talion : « œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie », ne connaissant pas le pardon que de nos jours encore beaucoup de gens se refusent a reconnaître. La justice officielle moderne en est toujours au stade de vengeance et de punition. Aujourd’hui, si la fille-mère n’est plus dans la situation d’une excommuniée devant le mépris public, elle est encore dans une situation d’infériorité très marquée.
D’une façon générale, l’évolution est dans le sens de l’adoucissement des mœurs, à cause du développement de la sensibilité affective, et celle-ci n’a pu se développer qu’au fur et à mesure que la vie matérielle devenait moins dure, moins incertaine ; alors les hommes, plus sûrs du lendemain, commencèrent à respirer plus librement, la « terreur sacrée » diminua, la douceur relative de la vie amena davantage de bienveillance dans les rapports sociaux.
D’une façon générale aussi, l’opinion a toujours été respectueuse de la hiérarchie sociale, mais avec l’affaiblissement progressif du respect, affaiblissement lié à l’apparition et au développement du sentiment de liberté et plus tard à celui d’égalité. Nous ne comprenons plus très bien la vassalité et sa mentalité qui pourtant ont duré si longtemps dans l’histoire sociale. Puis l’opinion a continué à reconnaître comme d’ordre moral la suprématie de la naissance. Aujourd’hui elle accepte comme légitime la suprématie de l’argent, transmissible, elle aussi, par droit d’héritage avec pouvoir de faire travailler les autres à son profit. Nous avons le droit de penser que cette hiérarchie sera considérée à son tour comme immorale dans un avenir que nous espérons prochain.
L’évolution de l’opinion publique correspond à des changements et à des mutations dans les sentiments humains. Il ne faut pas croire que les hommes soient nés d’emblée avec le complexus sentimental qu’on observe chez l’homme moderne. Il est probable que les primitifs n’avaient que des sentiments assez peu développés. et que même beaucoup de ces sentiments n’ont pris peu à peu naissance qu’avec la vie sociale, et pas tous en même temps.
Laissant ici de côté les sentiments primaires, l’égoïsme individuel, l’amour maternel, générateur du besoin de tendresse, et la fraternité entre individus du même âge, s’étant élevés ensemble et vivant dans l’entr’aide, il semble que le premier sentiment qui a été créé par la vie en commun, a dû certainement être le sentiment d’infériorité. Son apparition est due à la réaction violente de la tribu, quand un de ses membres risquait de la mettre en péril par maladresse, lâcheté ou par manquement à la coutume sacrée. Les huées, les coups, la mort devaient imprimer dans l’esprit de tous la terreur d’être pris en défaut.
C’est ainsi que l’opinion publique a créé des états émotifs qui furent les sentiments primitifs de l’humanité : d’une part sentiment de supériorité, quand l’opinion est approbative ou admirative et qui est à l’origine du besoin moral deprotection, à condition d’être associé à un sentiment affectif, d’autre part, sentiments ressortissant à l’infériorité. Ceux-ci sont de beaucoup plus forts que ceux qui ressortissent à la supériorité, en ce sens qu’ils entraînent des états émotifs beaucoup plus violents et qu’ils ont eu ainsi et qu’ils ont encore sur la morale sociale et sur le comportement individuel les plus grands effets : la honte, qui est l’acceptation de la situation d’infériorité, et a un effet déprimant, la colère qui est au contraire un état d’excitation, une réaction violente de défense contre une atteinte à la supériorité de l’offensé ou de la tribu, la timidité qui est l’appréhension d’un affront possible. Tous ces états se manifestent physiologiquement par des troubles brusques, comme pâleur, rougeur, sueurs, angoisse, tremblements, mouvements convulsifs ou incoordonnés, inhibitions, etc., qui nous prouvent quelle était la brutalité horrifiante qui déterminait de telles émotions.
Pour éviter la mise en état d’infériorité, pour échapper aux conséquences pénibles du contrôle public, on cherche à se contrôler soi-même. L’amour-propre est apparu qui s’oppose au sentiment d’infériorité, tout en dérivant de lui. Il met l’attention en éveil. C’est ce contrôle personnel qui est devenu ce que les philosophes appellent la conscience morale, pour eux fonction de l’âme, pour nous petite-fille de l’opinion publique et fille de l’amour-propre, sans rien de divin.
Cette conscience a subi une évolution. D’abord simple amour-propre vis-à-vis d’autrui, elle est devenue, par l’exercice même de la fonction de contrôle, un amour-propre vis-à-vis de soi. L’individu en reportant sur soi la responsabilité de ses actes a appris à s’estimer ou à se mépriser (remords), et il lui est souvent plus pénible de se trouver en état d’infériorité en face de sa propre opinion que vis-à-vis de l’opinion publique qui ignore le plus souvent ses pensées et ses mobiles. Mais il est d’une constatation banale que l’amour-propre n’est pas le même chez tous les hommes et que la conscience, comme valeur de contrôle, varie dans des limites assez larges.
Mais l’amour-propre n’est pas seulement un contrôle, c’est aussi un mobile humain très puissant, en tant qu’exaltation du moi. Très souvent il l’emporte sur l’intérêt, même à notre époque de mercantilisme. Il est vrai que de nos jours une satisfaction d’amour-propre est presque toujours liée à un profit.
La conscience représente, elle aussi, une force. Impliquant le contrôle, elle oblige à la comparaison et à la critique, et par là même elle peut devenir agissante. La conviction morale peut suffire à former un caractère sans désir de domination et même sans vanité... La personnalité humaine devient donc chez quelques-uns tout au moins, une force morale, et elle prend peu à peu assez de puissance pour réagir sur le milieu. La conscience individuelle, par l’assurance qu’elle prend dans une conviction réfléchie, peut influer sur l’opinion publique, l’opinion veule, inconsciente et traditionaliste de la masse, et ainsi modifier la morale sociale. Mrs Beecher Stove, écrivant La Case de l’oncle Tom, a ému la sensibilité publique en faveur des noirs et fut la promotrice de l’abolition de l’esclavage aux États-Unis. Il n’en est pas moins vrai que la personnalité humaine, même dirigée par la conscience, est enserrée, protégée, ou maintenue dans une armature morale, le plus souvent religieuse, et dans une armature sociale, et que, si elle a réagi pour adoucir les règles morales, si même elle a été la promotrice des révolutions religieuses ou sociales, elle a dû se soumettre le plus souvent et pendant de longues périodes de silence, à la loi commune, à la tradition, à la coutume et aux rites.
C’est, en effet, l’habitude qui gouverne la plupart des actions de la plupart des hommes. Ceux-ci obéissent machinalement à la coutume, c’est-à-dire aux habitudes traditionnelles, sans être tentés de la mettre en question. C’est grâce à cette observance inconsciente de la morale qu’il n’y a pas besoin d’un surveillant derrière chaque individu, même lorsque la « terreur sacrée » se relâche. C’est encore l’opinion, sa longue action, son influence prolongée, c’est la vie en commun-qui ont enraciné chez les hommes ces habitudes communes et inconscientes, qu’on appelle maintenant les instincts et qui sont, suivant Pavlof, des réflexes conditionnels (voir ce mot).
L’action de l’opinion a été continuée par les religions. Celles-ci ont remplacé l’opinion. Plus exactement celle-ci est devenue l’humble servante de la religion... En même temps, les religions, tout au moins les plus évoluées, s’efforcent de cultiver et de développer le contrôle de soi. Ainsi l’obéissance au devoir, par habitude inconsciente d’abord, renforcée ensuite par l’adhésion des consciences, n’a plus besoin de la violence coercitive des temps primitifs. Elles remplacent la contrainte par la protection. Mais toutes ont beau s’adresser a la conscience, elles ne sont pas une morale de liberté. Leur protection se change rapidement en autorité et en contrainte, d’abord pour amener leur triomphe, ensuite pour conserver leur domination. Elles ne peuvent tolérer l’esprit critique et le poursuivent sans merci... L’influence de la conscience est aussi limitée par l’armature sociale. La première morale individuelle, le stoïcisme, n’a pu naître que lorsque la liberté était déjà en plein exercice dans les cités grecques. Et cette morale n’a jamais été pratiquée que par une minorité de gens cultivés. Elle est morte avec la réapparition d’un régime de servitude.
A vrai dire, la morale individuelle n’est guère qu’un contrôle qui remplace celui de l’opinion ou de la religion pour l’observance des règles sociales. Celles-ci étaient nées depuis longtemps. L’opinion publique avait déjà lutté contre l’égoïsme primaire de tout individu avec ses tendances à la nonchalance, à la lâcheté, à l’accaparement. Elle l’avait en partie transformée en amour-propre qui n’est en somme qu’un égoïsme purifié.
Pour régler l’égoïsme, l’amour-propre, les passions et tous les mobiles humains, le contrôle de soi, dans une morale individuelle, se substitue à celui de l’opinion ou, au devoir imposé par la religion. A la contrainte exercée par une opinion autoritaire et ignorante, par les prêtres, par les lois, par un roi ou une classe dominante, à la morale fondée sur la peur, que ce soit la crainte de Dieu, du Gendarme ou de la Vérole, succède une morale de liberté où l’observance des régies est laissée au contrôle et à la conscience de chacun.
Mais les morales individuelles, comme le stoïcisme et celles qui se sont inspirées de son esprit, comme le protestantisme, n’acceptent pas d’être de simples morales de contrôle. Elles réalisent l’Individu comme abstraction et le mettent ainsi à l’abri de la morale empirique, changeante et ondoyante. Elles érigent une doctrine du Devoir, qui vient de Dieu ou de la Nature, et à laquelle l’individu doit son consentement complet. Elles finissent par être, elles aussi, une morale de contrainte, avec cette aggravation que la contrainte de la conscience est souvent plus sévère encore que la contrainte extérieure à, l’individu, et elles peuvent aboutir à un puritanisme desséchant chez les uns, à l’hypocrisie chez les autres.
Sans doute une morale de liberté est-elle obligée de renforcer son armature dans une société déséquilibrée. D’ailleurs tout progrès (voir ce mot) comporte un risque, et le risque apparaît nettement quand le progrès donne l’affranchissement à des hommes qui n’ont que des appétits de jouissance sans aucun sens de la responsabilité (voir ce mot) et sans scrupules. Parmi ceux, par exemple, qui se disent individualistes, il y en a qui érigent leur propre personne au-dessus de l’humanité et qui sont simplement des égoïstes anti-sociaux. Gênés par la vie sociale, ils sont revenus à un égoïsme primaire, n’ayant pour morale que la satisfaction de ses appétits et celle de sa vanité. Ils se vantent de n’avoir pas d’idéal.
En réalité, l’individualisme ne saurait créer la morale. Il est simplement la défense de l’autonomie individuelle contre l’exagération oppressive de la coutume.
La mentalité de l’individu a été créée par la vie sociale. Lui-même, s’il s’imagine trouver en soi la conduite morale de sa vie, n’y trouvera que ce que les siècles passés ont déposé dans les générations successives et qui est transmis par l’hérédité, c’est-à-dire des instincts, des habitudes inconscientes ou subconscientes, des préjugés traditionnels. Il y trouve aussi ce qu’a imprimé l’éducation. Il n’aura pas les mêmes sentiments, ni, par conséquent, les mêmes idées aux différents âges de la vie. I1 subit enfin l’influence du milieu, dans lequel aussi sentiments et idées sont soumis à des variations dans la suite des générations.
Une morale de liberté ne peut vraiment s’épanouir que dans un milieu social où les classes et leurs inégalités auraient disparu. L’individu ne peut pas vivre en dehors du milieu ; s’il ne s’y sent pas à l’aise, il est obligé de participer à l’évolution ou à la transformation des règles morales et de l’armature sociale dans le sens de l’idéal où vont ses espoirs et ses aspirations. Il ne peut espérer vivre libre si les autres ne le sont pas. II ne peut pas être pleinement heureux si les autres souffrent. Il éprouve de la joie à rendre service. Et la plus grande joie est dans la générosité, qui n’est autre chose que l’effet d’une force morale exubérante, tandis que l’égoïsme est une marque de faiblesse, la défense des faibles contre la vie.
Certes, il y aura toujours (heureusement) des mécontents, mais leur action ne pourra avoir de danger pour la liberté. Il y aura toujours des déséquilibrés, mais en beaucoup moins grand nombre si l’alcoolisme et la syphilis ont à peu près disparu, et il est à croire qu’on pourra mieux s’occuper d’eux.
L’opinion publique, une opinion débarrassée de la plupart de ses préjugés, donc plus éclairée, mieux éduquée, aura toujours une grande influence sur les actions des hommes. Il faut y ajouter l’influence de l’éducation morale. Quels sont les hommes d’aujourd’hui qui ont reçu dans leur enfance une éducation qui puisse leur permettre de se gouverner librement ? Même si la famille et l’école se sont gardées de toute influence nocive, l’enfant reçoit aussi ses impressions et ses jugements du cinéma et des journaux. On ne fait pas assez attention à la lecture des journaux. Ceux qui déplorent leur immoralité n’ont en vue que les exemples de dévergondage sexuel. Il y a bien d’autres immoralités ; ce sont les commentaires des journalistes sur les actions humaines, leur sentiment de l’honneur, leurs préjugés sur la vengeance, leur mépris de la bonté et du pardon, leur chauvinisme, leurs flatteries envers les puissants, leur incompréhension de tous les problèmes moraux.
L’éducation (voir ce mot) doit avoir pour but de donner aux enfants l’instruction et l’éducation morale : la première pour développer l’intelligence et leur donner le plus grand bagage de connaissances, la seconde pour leur apprendre les règles de vie tirées de l’expérience humaine et les moyens de se guider eux-mêmes plus tard. Mais ni l’une, ni l’autre ne doivent se borner à la simple transmission des connaissances, ce qu’on appelle vulgairement un bourrage de crâne, elles doivent, avant tout, donner aux enfants le goût de l’effort, favoriser, en tenant compte de l’âge de l’enfant ou de l’adolescent, leur esprit critique et leur initiative libre, leur faire comprendre que leur personnalité, la liberté de leurs actes, c’est-à-dire la finesse consciente et la justesse de leur détermination, dépend de leur propre expérience, de l’effort qu’ils feront pour contrôler les mobiles subconscients de leurs actes et leurs conséquences possibles, pour connaître les autres hommes, les réactions de leur caractère, leurs conditions de vie, leurs souffrances et leurs aspirations, pour étudier le milieu social et les conditions économiques, pour comparer les civilisations anciennes et les civilisations modernes, pour se faire un idéal d’embellissement de la vie qui sera pour eux un espoir et les aidera à s’élever au dessus des préoccupations journalières.
Nous ne pouvons juger pleinement des possibilités futures d’après la mentalité de l’humanité actuelle. Dans une société où chaque individu aurait pu recevoir une éducation suffisante et trouver plus tard une situation et un travail conformes à ses capacités et à ses goûts, les rapports moraux seraient tout autres que ceux d’aujourd’hui. Dans une société où l’inégalité sociale aurait disparu, une nouvelle morale pourrait s’établir, une morale de liberté fondée sur le plaisir et la confiance.
Car il n’y a pas qu’un seul individualisme (voir ce mot). Le cynique, qui prend indûment ce nom, n’est autre qu’un égoïste, un égoïste esclave de ses impulsions sous prétexte de vivre sa vie. Le puritain suit une morale fondée sur le Devoir, une morale a priori, et il risque de tomber dans le fanatisme d’orgueil et dépourvu d’indulgence. Entre le cynisme des esclaves sans scrupules et sans éducation et le puritanisme des stoïciens, des protestants et de quelques anarchistes, n’y a-t-il pas place pour un autre individualisme, un individualisme affectif et idéaliste. Il ne s’oppose pas aux tendances de l’être et il ne leur obéit pas aveuglement.
On pourrait définir la vertu, en disant qu’elle consiste pour l’individu à être assez maître de soi pour choisir son plaisir, y compris la satisfaction morale. Cette définition ne s’oppose à aucune volupté. La véritable vertu est de chercher un plus grand plaisir, un plaisir plus complet, en réfrénant les impulsions aveugles, et, dans chaque espèce de plaisir, elle choisit ceux qui ne laissent que les plus agréables souvenirs, surtout dans la conscience affective. Le développement de l’affectivité est d’ailleurs la source des plus grandes joies, et il assure en même temps la sécurité morale.
* * *
III. — Genèse et évolution de la morale collective.
Si nous remontons de nouveau à travers les âges, nous voyons que la morale change avec l’armature sociale, et que des sentiments qui nous paraissent inhérents à la nature humaine sont nés sur le tard, tandis que d’autres ont pour ainsi dire disparu, tout au moins dans la civilisation européenne actuelle.
Dans les tribus primitives, la liberté, surtout la liberté morale, était inexistante. L’individu faisait étroitement partie du groupe, sans pouvoir s’en évader. Le sentiment de la liberté vis-à-vis du groupe ne s’entendait même pas. L’indépendance de la tribu constituait, en somme, la liberté de chacun, comme la propriété de la tribu était celle de chacun.
Certes, l’égoïsme primaire, le besoin d’avoir ses aises sans tenir compte des aises d’autrui, et qu’on observe chez le jeune enfant, a dû être le point de départ de l’individualisme, dont l’ambition future sera d’acquérir l’indépendance en respectant celle d’autrui. Mais l’égoïsme du primitif — désir de supériorité plutôt que désir d’une liberté impossible — était constamment et violemment refoulé par l’intérêt collectif ou par l’idée que se faisait la tribu des mesures nécessaires à sa sauvegarde... Le sentiment collectif d’indépendance s’associait avec le sentiment de supériorité de la tribu sur toutes les autres. Les hommes ont toujours tendance à considérer le groupe, le clan, la nation, la corporation, l’équipe dont ils font partie, comme supérieurs aux autres ; et ils acceptent difficilement le résultat malheureux d’un « fair play », ils donnent comme excuse d’avoir été trahis.
L’individu échappe au sentiment d’infériorité en projetant son besoin de supériorité dans le groupe auquel il appartient. L’esclave lui-même s’enorgueillit, auprès des pauvres gens, de la puissance ou de la richesse de ses maîtres. Tel est le fondement du sentiment patriotique, assez semblable, quoique inférieur, à celui d’une équipe de sport... Dans la tribu primitive il n’y a pas non plus de sentiment d’égalité. C’est la vie en fraternité — surtout une fraternité entre individus du même âge s’étant élevés ensemble, continuant à vivre en familiarité et en entr’aide, avec protection des plus forts sur les plus faibles... — La rivalité, qu’elle s’exerce dans le domaine de la force ou dans celui de l’adresse, c’est-à-dire de l’intelligence, cherche à obtenir, non pas l’égalité, mais la supériorité. Il s’agit de l’emporter sur les autres compétiteurs pour la conquête d’une femme ou pour celle de la gloire. Les hommes n’ont jamais considéré l’égalité que comme un point de départ, par exemple dans les jeux, et non comme un aboutissement.
Lorsque l’autorité héréditaire d’une famille s’est établie dans les tribus, on passe au stade patriarcal qui est le début du système féodal et se confond avec lui (la féodalité du moyen-âge mise à part, car elle représente une phase à son déclin). Le patriarche, le pater familias, le roi achéen, le seigneur, etc., est le protecteur ou le suzerain des autres membres du clan qui sont des hommes libres, mais vivant dans les liens de la vassalité La fidélité à la tribu s’est reportée au chef, qui est, d’autre part, le possesseur nominal des terres, sans être le possesseur effectif. En tout et pour tout ce chef est le représentant symbolique de la tribu dans ses prérogatives, la propriété, les liens sociaux. Ceux-ci sont de nature affective, tout en étant souvent très brutaux.
C’est cette protection affective, cette vie en familiarité même avec le chef, cette fraternité effective dans le malheur, qui ont fait la force de cette forme sociale qui a duré si longtemps. Ce qui, dans cette même société rend l’esclavage tolérable, c’est une certaine indifférence pour la liberté individuelle, et surtout parce que l’esclave fait partie de la famille, comme les autres domestiques, et comme ceux-ci le resteront longtemps encore. La peur du risque maintient dans l’état de clients ou de vassaux une humanité, toute prête à admirer l’homme d’action et le protecteur. Encore de nos jours beaucoup de gens préfèrent être fonctionnaires que de courir les aléas, les soucis et les responsabilités d’une vie indépendante.
Il ne faudrait pourtant pas faire un tableau idyllique du patriarcat féodal. L’autorité du chef va parfois jusqu’au despotisme. Mais, tout le clan vivant ensemble, l’opinion publique peut encore s’exercer, et le chef est obligé de partager la bonne ou la mauvaise fortune de tous.
Plus tard, lorsqu’une inégalité croissante a séparé les hommes libres du seigneur, lorsque le sentiment familial, qui existait entre eux, a disparu, lorsque la protection s’est changée en autorité despotique, que les descendants du chef ont pris les terres de la tribu comme leur propriété privée et qu’ils ont accumulé des richesses de toute sorte, alors la scission morale se produit. Les pauvres diables travaillant aux champs se plaignent, mais continuent à respecter et à honorer le seigneur et sa lignée. Mais les habitants des villes, artisans et marchands plus rapprochés et plus unis, plus évolués, moins misérables, plus audacieux, ayant déjà le besoin d’un bien-être moral, prennent conscience du sentiment de la liberté. A Rome, la plèbe n’arrive jamais à l’affranchissement complet parce qu’elle est une plèbe paysanne ; elle s’appauvrit au cours des guerres continuelles, tandis que celles-ci enrichissent l’aristocratie. L’abaissement des patriciens se fait plus tard au profit d’une classe de nouveaux riches, protégés par les empereurs. Mais en Grèce, la classe moyenne des villes avait réussi à conquérir la liberté et le pouvoir politique. Les communes du moyen-âge, quoique n’étant pas venues de la même évolution sociale, ont obtenu leurs franchises.
Partout c’est la classe moyenne qui a été la créatrice du sentiment moral de la liberté. Partout c’est elle qui a été le soutien de la civilisation. Aujourd’hui encore elle joue le même rôle, à condition d’entendre par classe moyenne les artisans, les techniciens, les ouvriers qualifiés (mécaniciens, électriciens, ouvriers du livre, ouvriers du bois, etc., etc.), les intellectuels, les artistes, etc., exception faite de ceux qui se considèrent comme une soi-disant élite et font cause commune avec les privilégiés. La bourgeoisie moderne n’est plus la classe moyenne, elle est devenue classe dominante.
Le respect de la hiérarchie sociale s’est maintenu très longtemps au cours des âges. L’inégalité sociale fut parfaitement tolérée dans les siècles de vassalité. Plus tard, au moment de l’émancipation de la classe moyenne, celle-ci ne demandait qu’à pouvoir travailler en paix, à l’abri des exactions, des accaparements et de l’arbitraire de la classe dominante.
Athènes, seule, mais c’est une exception unique, a eu le sentiment d’un certain équilibre entre les classes, et la démocratie antique se défendit par les impôts contre la suprématie d’une ploutocratie envahissante. Encore faut-il se souvenir que les esclaves ne comptaient pas dans les préoccupations démocratiques...
A Rome, la plèbe, pour sa sauvegarde, ne réclamait que des droits politiques, qui furent d’ailleurs insuffisants. La classe moyenne n’échappa nullement à l’appauvrissement progressif et à une disparition à peu près complète.
En Angleterre, où les libertés publiques sont conquises de bonne heure, cette conquête ne bouleverse pas l’ordre établi, sauf passagèrement au temps de Cromwell, ni la hiérarchie sociale.
Donc, longtemps après que le patriarcat féodal eût disparu pour faire place à une féodalité oppressive, l’esprit d’obéissance persiste, et le respect des catégories sociales, et mêmes le culte des droits du sang. Certes, l’envie et l’ambition existaient, mais comme caractères prédominants de quelques individus, qui, par désir de supériorité, cherchaient à s’élever jusqu’à la classe privilégiée. Il ne faut pas confondre le sentiment d’égalité avec le sentiment de justice. Celui-ci n’est que le respect de la coutume, de la règle du jeu, quelle qu’elle soit. Mais il n’y avait aucun sentiment d’égalité des classes — même après la mort. La croyance à la vie future était d’ordinaire assez vague et n’imaginait d’autre existence que celle d’ici-bas. Dans la religion primitive de l’ancienne Egypte où la croyance à une autre vie était très développée, les morts continuaient les mêmes occupations qu’ils avaient eues de leur vivant. Le christianisme, religion d’esclaves, croit déjà à une égalité des morts devant le jugement de Dieu, mais pour aboutir, par désir inconscient de représailles, à une nouvelle inégalité : les premiers seront les derniers et les derniers les premiers — il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume des Cieux.
Cette religion d’humilité et d’obéissance portait ainsi en elle-même des germes de revendications, qui ne mûrirent qu’avec le lent développement mental des individus et qui apparurent avec le mouvement des communes. Les révoltés des bourgs, descendants de serfs, ne pouvaient arguer de leur qualité d’hommes nés libres pour faire reconnaître leurs droits. Il leur fallait acquérir cette liberté de disposer de leur corps, et ils disaient :
« Tous les hommes sont frères. Nous avons yeux, bras et jambes comme eux (les seigneurs), même force, même courage. »
Ce sentiment d’égalité ne reçut que plus tard, en France, une nouvelle impulsion avec les idées de Jean-Jacques Rousseau (qui croyait à l’égalité naturelle des hommes et à leur bonté primitive) et s’est épanoui avec la Révolution française. On s’imagina alors qu’il suffisait d’avoir donné aux citoyens l’égalité des droits civiques et d’avoir inscrit « égalité » dans la devise révolutionnaire pour qu’elle devînt une réalité.
Le sentiment d’égalité est resté très vif en France, peut-être parce que le peuple a surtout lutté pour obtenir cette égalité, de même qu’en Angleterre l’effort fait pour conquérir l’habeas corpus a développé chez les Anglais le sentiment de la liberté, si bien qu’on peut dire que la liberté ou l’égalité ne se donnent pas, il faut qu’on les conquierre et qu’ainsi elles deviennent, l’une ou l’autre, un besoin moral, un sentiment.
Le développement du machinisme et de l’inégalité économique a montré bientôt l’insuffisance de l’égalité démocratique. On a vu naître les utopies socialistes, dont la philosophie imprègne toutes les revendications sociales modernes, en ce sens qu’elles aspirent à l’affranchissement complet de l’humanité tout entière. Cet affranchissement ne peut se faire qu’avec la suppression de l’inégalité économique et du droit, qu’ont les possédants et qu’ils transmettent à leurs héritiers, de faire travailler les autres à leur profit.
Dans la lutte contre les privilèges, les opprimés n’ont pas des revendications exactement semblables, ni des aspirations identiques. Ils diffèrent surtout dans la façon de concevoir l’action. Les uns vont au socialisme, d’autres à l’anarchie, d’autres au syndicalisme. Le socialisme se mêle à la politique dans l’espoir de s’emparer du pouvoir ; en s’inféodant au parlementarisme, son action le conduit nécessairement vers l’étatisme. Il s’intéresse peu à la liberté des individus, il n’a guère en vue que de leur assurer le bien-être matériel. Il peut même abandonner toute idée démocratique de liberté et devenir tout à fait despotique comme dans la Russie bolchevique.
L’anarchie s’intéresse, avant tout, à la liberté. Elle réagit contre l’asservissement des individus. Son antiparlementarisme n’est pas anti-démocratique, comme celui des royalistes ou des fascistes ou des bolcheviks, il est anti-étatiste... Le syndicalisme mène la lutte de classes. Il est théoriquement hors de l’ingérence des partis politiques. Mais leur influence se fait parfois sentir, et alors c’est l’orientation vers l’étatisme. D’autre part, le syndicalisme corporatif, sans idéal révolutionnaire, n’est qu’un ouvriérisme égoïste. Le syndicalisme anarchiste est plus complet, car il lutte aussi pour le bien-être moral des individus.
Quoi qu’il en soit, l’action de ces efforts d’émancipation a eu pour résultat de changer, en grande partie, la mentalité populaire, en affaiblissant le respect de la hiérarchie sociale. La plupart des travailleurs n’éprouvent plus de gratitude obéissante envers ceux qui leur donnent du travail. Ils savent qu’ils sont la portion utile de l’humanité. Ils prennent sentiment de leur dignité et conscience de leurs droits. Le travail prend dans la morale sociale la place qu’occupait autrefois le courage guerrier, c’est-à-dire la valeur de premier plan.
Certes, les hommes naissent inégaux en intelligence et en adresse, ou, peut-être plus exactement, ils diffèrent en aptitudes diverses. Les théories d’émancipation réclament non l’égalité des hommes, mais l’égalité des classes. La décadence de toutes les sociétés humaines est venue d’une inégalité grandissante, corrompant les riches, avilissant les miséreux, donnant à tous l’indifférence pour le corps social. Ce qu’il y a au fond du socialisme, c’est la recherche d’un équilibre qui ne peut exister que si disparaît le pouvoir de faire travailler les autres à son profit et de transmettre ce privilège par droit d’héritage, si tous les enfants reçoivent une éducation et une instruction complètes suivant leurs aptitudes, de façon à choisir plus tard leurs occupations selon leurs goûts et leurs capacités.
Telle est la véritable égalité, telle qu’elle se dégage des aspirations modernes. Personne ne songe à nier la supériorité de l’intelligence, ni l’autorité du technicien. Il semble, en tout cas, que le sentiment d’égalité qui tend à se développer de plus en plus, tout en reconnaissant les droits de l’intelligence et de la technique, ne permettra pas d’instaurer de nouveaux privilèges, même en faveur du mérite qui se suffit souvent a lui-même.
Quelle que soit la forme que prendra plus tard l’arrangement social, l’opinion s’élèvera sans doute contre des rémunérations disproportionnées entre les diverses catégories de travailleurs, comme celle qui existe entre le gérant du familistère de Guise et les simples ouvriers. Si des différences existent, il est possible qu’elles consistent dans plus d’indépendance dans le travail, plus de facilité de loisirs et de déplacements, sans compter la joie de l’initiative et de la recherche, la conscience de la valeur propre et de l’influence acquise, et que ce soit là une récompense assez grande, même pour les créateurs de génie.
Comme le progrès technique qui aboutit ou devrait aboutir à plus de loisirs, comme le progrès social, le progrès moral se résoud dans la tendance à la liberté, une liberté qui n’est possible que dans une société où la disparition de l’inégalité des classes permettrait l’épanouissement de la morale de confiance.
— M. PIERROT.
* * *
MORALE (DE LA MORALE DE MAITRE A L’HARMONIE DU SAGE)
J’ai montré déjà dans cet ouvrage, à propos de l’individualisme, en quel sens mes préoccupations éthiques m’amènent à dénier à la morale toute prétention d’inclure en ses cadres ma vie multiple et, à leur égard, si indisciplinée. En même temps, j’ai dit aussi vers quelle sagesse il me plaît d’en orienter la marche harmonieuse.
Vis-à-vis des formes qui présentent à ma curiosité sympathique quelque face engageante, j’ai situé la tendance dont la plénitude me sourit davantage. Quelque générosIté qui flotte sur leur seuil, ne peuvent être la demeure de qui veut être un homme complet, les vases au sein desquels se débat l’existence amputée ou captive. Ces vases sont encore, nonobstant les promesses encloses aux lignes de certains, des moules de morale aux fins impératives. Et ma pensée, qui regarde plus loin que leurs bords séducteurs, n’accepte de voguer, vers quelque chaîne, sous leurs auspices...
* * *
A côté des morales théologiques ou métaphysiques, politiques ou civiques, l’antiquité me présente des sagesses indépendantes et qui, si on s’intéresse uniquement à la pratique, manifestent toutes un caractère individualiste. Vers elles m’entraînent mon cœur et ma raison... Sans oublier complètement leurs alliances avec des disciplines étrangères, je désire maintenant, les comparer d’après leur contenu.
Je crois les voir se distribuer en quatre groupes. Au fond de la vallée, d’humbles morales se tapissent comme des chaumières. En voici qui, sur des sommets peut-être artificiels et sur des mottes, dressent des châteaux d’orgueil. Les premières montrent le salut dans l’obéissance ; les secondes le font voir dans la domination. D’un groupe émouvant monte un parfum et un cantique d’amour. Un autre fait entendre le plus viril des hymnes et je distingue ce refrain :
« Connais-toi afin que tu te réalises. »
Pour la facilité de l’exposition, je vais imposer un nom à chaque groupe. J’appellerai servilismes les doctrines d’obéissance ;dominismes les systèmes de domination ; fraternismes, les éthiques qui prêchent directement l’amour et la fraternité... Je désignerai les individualismes qui ne songent pas aux conquêtes extérieures par le nom de subjectivismes.
Les morales théologiques, qui nous commandent d’obéir à la volonté divine, paraissent d’abord toutes des servilismes. Cependant, dans la mesure où nous pouvons dégager l’enseignement de Jésus, condamné par les clergés contemporains, ridiculement déformé par les clergés postérieurs, il y aurait injustice à le confondre avec les morales cléricales. Autant qu’on la peut connaître ou deviner, la doctrine que les sociaux durent crucifier présente plusieurs caractères de la sagesse indépendante.
Les morales loyalistes me soumettent directement à des maîtres. Les morales civiques me soumettent à des lois fabriquées et appliquées par des hommes. Elles n’ont rien de plus indépendant que les morales cléricales. Pour Hobbes la morale se réduit entièrement à l’obéissance au prince. Ce qu’ordonne le prince est juste dès qu’il l’ordonne et par cela seul qu’il l’ordonne. Seule la loi — l’ordre du chef — crée le caractère moral ou immoral de nos actes. Notre unique devoir, et notre intérêt, est de maintenir le prince. Selon la fameuse formule de Sarpi :
« D’autre part, la première justice du prince est de se maintenir. »
Pour Hobbes, cette justice-là n’est pas la première ; elle est la seule.
Morales cléricales et morales civiques ont ce caractère commun de grouper non point tous les hommes, mais une partie des hommes ; de les grouper non en tant qu’hommes, mais en tant que fidèles d’une même croyance ou en tant que compatriotes... Ce sont là morales de troupeaux, dit Nietzsche avec trop d’indulgence. Plutôt disciplines d’armées ou de bandes.
* * *
Contre ces prédications d’obéissance qui éteignent dans l’individu toute lumière personnelle et amortissent tout ressort éthique, s’élèvent les exhortations contraires des Calliclès, des Stendhal, des Nietzsche. Ceux-là veulent nous enseigner, ou s’enseigner, non plus la servitude, mais la domination. Leur point de départ est individualiste. Zarathoustra s’écrie :
« Ceci est mon bien que j’aime... »
Mais ce bien qu’il veut c’est la puissance et la puissance sur d’autres hommes. Il ne voit rien de plus « universel et de plus profond dans la nature que le besoin de dominer... ». Il dit :
« Partout où j’ai trouvé quelque chose de vivant, j’ai trouvé de la volonté de puissance ; même dans la volonté de celui qui obéit, j’ai trouvé la volonté d’être maître. »
Peut-il y avoir des maître sans esclaves ? Pas plus que des esclaves sans maîtres ? Les servilistes sont forcés d’admettre implicitement deux morales : celle des maîtres à côté de celle des esclaves. La même nécessité s’impose aux doministes. Nietzsche, qui en a conscience, l’accepte joyeusement. Il proclame parmi des fanfares, l’inégalité des hommes et que cette inégalité est un grand bien. Il ne songe pas à la diminuer, mais à l’accroître. Et il définit la société « une tentative, une longue recherche, mais elle cherche celui qui commande ». Il dit, dans Le Gay-Savoir :
« Nous réfléchissons à la nécessité d’un ordre nouveau et aussi d’un nouvel esclavage, car pour tout renforcement, pour toute élévation du type homme, il faut une nouvelle espèce d’asservissement. »
Les individualistes de la mesure et de la volonté d’harmonie repoussent les individualistes de l’appétit et de la volonté de puissance plus énergiquement encore qu’ils n’écartent les servilistes. Mais ceux-ci pourraient accueillir les doministes et prêcher à leur profit... Quand on a appelé individualisme la doctrine harmonieuse d’un Socrate, d’un Epicure, d’un Epictète, ce n’est pas sans répugnance qu’on accorde le même nom à la pensée d’un Nietzsche, d’un Stendhal, d’un Calliclès, brusque comme un ressort et gloutonne comme un fauve. On est tenté d’affirmer qu’il ne saurait y avoir individualisme là où il n’y a pas respect de tous les individus. Celui qui, à un seul être, — l’Unique, dit Stirner, — sacrifie tous les autres, on préférerait le nommer, s’il reste peu actif et peu malfaisant, égoïste. Dès qu’il est avide, conquérant, brutal et autoritaire, il devient un doministe, allié nécessaire des servilistes, maître appelé par les bêlements du troupeau et qui appelle le troupeau.
Le véritable individu, celui qui par chacune de ses pensées, de ses paroles et de ses gestes, se proclame homme libre ; celui qui dit à son frère : « Tu es libre, si tu veux l’être » repousse également servilisme et dominisme. Ces deux systèmes n’ont plus de sens pour qui échappe ensemble à la lâcheté de s’incliner devant des maîtres et aux besoins lâchement serviles qui font désirer la domination. Servilisme et dominisme lui paraissent, avers et revers, la même médaille infâme ; les mensonges inscrits aux deux faces d’une même monnaie sociale et banale ; les corollaires d’une même convention ridicule et odieuse...
Même à un point de vue purement égoïste, ces doctrines ne sont point libératrices ; elles me soumettent à des désirs que je ne puis réaliser qu’avec l’aide d’alliés ou de dupés ; elles me troublent de craintes et de dangers que je ne puis combattre seul. Si je ne suis point né sur le trône, elles font longtemps de moi l’esclave plus rampant qui recherche la protection du maître... Le doministe ne rampe-t-il pas vers le commandement à force d’hypocrisie obéissante ? Chacune de ses actions, chacune de ses paroles est la servante d’un protecteur et d’un appétit... Qu’on se rappelle les formules de J.-J. Rousseau : « La domination même est servile quand elle tient à l’opinion ; car tu dépends des préjugés de ceux que tu gouvernes par des préjugés. Pour les conduire comme il te plaît, il faut te conduire comme il leur plaît. Ils n’ont qu’à changer de manière de penser, il faudra bien par force que tu changes de manière d’agir. » Le maître est esclave de ses esclaves...
Si je regarde la destinée d’un Napoléon, ce maître qui, pour Nietzsche, est déjà sur la voie du surhomme, que vois-je ?... Une vie d’extériorités lourdement brillantes et, au centre, la continuité d’un bâillement. Esclavage sans trêve, cabotinage sans repos, l’effort de plaire, l’effort de tromper, l’effort de reconstruire mille fois la victoire qui toujours s’écroule, l’effort agonisant de limiter et de chicaner la défaite. Accumulation de toutes les laideurs et de toutes les rancœurs. Plutôt être l’esclave d’un maître qu’être le maître, cet esclave de tous les hommes et de toutes les choses... Et puis, exiger l’obéissance, moi qui refuse d’obéir ? Empêcher les autres de se réaliser, moi qui veux me réaliser !... Je souffrirais trop de cette contradiction intérieure, de ce déchirement, de ce cri de moi-même contre moi-même... La méditation vaillante refoule toutes les doctrines d’étable : celles qu’on bêle pour les moutons et celles qui aboient dans la tête des surmoutons : chiens ou pâtres.
* * *
Deux éthiques prononcent les mêmes paroles libératrices. Deux doctrines me disent : « Qu’ils cessent de s’avilir à leurs violences ou à leurs mensonges et les fous qui osent se proclamer tes maîtres deviendront noblement tes égaux... Pourvu qu’ils ouvrent les yeux sur eux et sur toi, pourvu qu’ils regardent tout homme sans haine et sans crainte, ils sont tes égaux, ceux que ton orgueil cruel où la cité menteuse déclarent tes inférieurs. Tu es un individu parmi des individus, un égal parmi les égaux, un frère parmi des frères... » Ainsi parlent le subjectivisme d’Èpictète et le fraternisme de Jésus. Me voici hésitant devant cette fermeté douce et cette douceur ferme...
L’un dit plus souvent et plus volontiers : « Aime » ; l’autre recommande plutôt : « Connais-toi toi-même » et « Sois un homme libre » et : « Réalise ton harmonie ». Mais les sentiments des grands fraternistes et des grands subjectivistes sont semblables ; semblables leurs gestes ; aussi forte leur patience héroïque ; aussi profonde leur miséricorde pour les bourreaux qui ne savent ce qu’ils font. Puisque, ici comme là, cœur et cerveau sont satisfaits, qu’importe que les pensées directrices paraissent ici descendre du cerveau au cœur, là monter du cœur au cerveau ?... Pourquoi écarterais-je l’une ou l’autre des deux grandes paroles ? Me donner, n’est-ce pas un admirable moyen de me créer ? Me connaître et me réaliser de plus en plus permet de donner mieux, de donner davantage, de donner un être plus pur et plus ardent : les richesses intérieures sont des généreuses qui ont joie à se répandre. Loin de s’exclure, la doctrine grecque et la doctrine orientale paraissent, à ce point de ma méditation, s’appeler et se compléter. Fraternisme et subjectivisme se supposent et se soutiennent comme servilisme et dominisme. Ceux-ci les deux faces d’un même mensonge. Ceux-là les deux aspects de la même vérité.
Oui, la sagesse réalisée doit unir, harmonie souveraine, le cantique de liberté et l’hymne d’amour. Il y a peut-être cependant, pour choisir entre les deux doctrines, une raison de méthode. Dans le chef-d’œuvre, qu’il s’appelle Epictète ou Jésus, je trouve les mêmes éléments d’indépendance et de bonté. Mais, si je ne suis pas le grand artiste né, si je dois apprendre a me sculpter moi-même, par où faut-il que je commence ?
« Aime ton prochain comme toi-même et ton Dieu par-dessus toute chose. »
Selon ce que sera mon Dieu, je risque de retomber au servilisme et à ses doucereuses cruautés. Je connais des saints catholiques qui tourmentent et tuent leur prochain par folie d’amour, pour faire, coûte que coûte, son salut... D’autre part, puisque je dois aimer mon prochain comme moi-même je me demande, non sans inquiétude, comment je m’aime. Tout est-il aimable en moi aux yeux de la sagesse... Le précepte d’amour a besoin d’être précédé d’un ou de plusieurs autres. Jésus commence par la fin et il veut moissonner ce qu’il a négligé de semer. « Aime », a-t-il dit. Peut-on s’ordonner d’aimer ? Ai-je sur mes sentiments un pouvoir direct. Artiste trop doué qui n’a pas eu d’effort à faire, Jésus veut me jeter pour mon début en plein ouvrage sublime. Celui qui se commande efficacement d’aimer aime déjà... Plus j’y songe plus je trouve dangereuse la trop grand hâte à se donner...
Un fraternisme hâtif et étourdi risquerait de me livrer à des forces mauvaises, aussi de me faire aimer dans le prochain et dans moi-même ce qui n’est pas aimable. D’autre part, si je ne suis pas un être en qui domine l’instinct d’amour, son commandement reste inutile. Pour tout cela, et pour d’autres raisons encore, la méthode subjectiviste me paraît plus efficace. Le pouvoir que je n’ai à aucun degré sur mes sentiments, je l’ai en quelque mesure sur ma pensée... Je ne saurais tenter directement d’aimer ; je puis, me semble-t-il, essayer de me connaître.
* * *
D’autres individualismes de la sensibilité, les sereines doctrines d’Aristippe et d’Epicure, sans m’émouvoir d’amour pour tous mes frères m’empêchent du moins de faire du mal à personne et me rendent l’ami de quelques-uns... Le cyrénaïque, malgré son goût du plaisir, ne s’asservit point au plaisir. Epicure est bien supérieur qui, à ce plaisir en mouvement, préfère la paix épanouie du plaisir en repos, m’affranchit des erreurs et des excès du plaisir. De la conception épicurienne du plaisir, qui s’élève à la sagesse, je ne referai pas ici l’examen, ni l’éloge (voir individualisme). Ecarter, rappellerai-je seulement, les obstacles qui s’opposent à la pureté, à la continuité et à la plénitude du plaisir ; ne craindre ni la mort qui anéantit tout sentiment, ni la divinité qui, si elle existe, ne se préoccupe point de l’homme ; mépriser la douleur, légère quand elle se prolonge, brève et destructrice d’elle-même quand elle est forte ; ne pas laisser échapper les voluptés passées, mais les retenir et les alimenter par un souvenir assidu ; engloutir et annihiler dans cet océan, la petitesse ridicule du présent dès que le présent, isolé, serait souffrance : voilà la sagesse, le souverain bien, voilà l’art subtil et délicat de l’épicurien.
Il reste peut-être dans cette doctrine quelque odeur d’égoïsme et je crois qu’elle ne me satisferait point comme discipline exclusive et définitive... Plus tard, quand les matériaux amassés et éprouvés me permettront de construire mon subjectivisme, peut-être utiliserai-je Epicure. Considéré comme un degré vers la perfection stoïcienne et comme la douceur des heures de repos, l’épicurisme orthodoxe me paraîtra, je crois, utile et sans danger... Que le jardin fleurisse qui monte vers l’imprenable citadelle..
Je ne m’appesantirai (l’espace manque et le lecteur pourra me retrouver, ailleurs, en leur compagnie) ni sur les sophistes, ni sur les cyniques. Je me refuserai la joie de m’entretenir avec Socrate, si grand. Je ne ferai même pas, près de Diogène, une halte pourtant réconfortante. Mais leur souvenir et leur lumière m’accompagneront sur la voie qui monte vers les hauteurs où brille la pensée antique... C’est toujours la sagesse stoïcienne que je salue, sinon avec plus d’émotion, du moins avec plus de confiance. Sans doute tel ou tel détail des théories ne me satisfait point. Mais je contemple chez Epictète le plus efficace des exemples et, pour reprendre une expression qui fut à la mode, le plus sûr professeur d’énergie...
Les stoïciens n’avaient pas tort, qui considéraient l’espérance objective comme une faute et un consentement à la servitude. Alfred de Vigny est dans la grande vérité individualiste quand il appelle l’espérance la pire de toutes nos lâchetés... Il ne peut rien manquer au sage qui déclare indifférent tout ce qui ne dépend pas de lui, qui étanche joyeusement à sa sagesse la soif de sa raison qui, en un voluptueux orgueil rassasie à sa justice et à son indulgence la faim de son cœur. Projeté tout entier à ces deux sommets, il ne daigne plus apercevoir ce que les basses circonstances refusent peut-être à son corps.
Dans l’objectif, le reste ne sera donné par surcroît que lorsque la majorité des hommes montera jusqu’à la sagesse. Sagesse universelle égalera bonheur universel et ce bonheur contiendra, dans sa mutualité et sa plénitude, jusqu’au surcroît des biens matériels... Le sage ne se promet pour demain ni les extériorités un peu lourdes d’un paradis terrestre, ni les extériorités un peu légères d’un paradis d’outre-tombe... Sa vertu ne repose pas sur le calcul imbécile et vite branlant qui croit la vertu la meilleure des politiques. Elle est le victorieux amour de sa propre beauté et de sa propre force. I1 s’éloigne, dédaigneux, de toute politique. Parce que toute politique est laide par ses gestes, par le lieu où se font ses gestes, par le but vers quoi tendent ses gestes. Odieuse par ses moyens, elle se précipite âprement, agressivement, vers la fange impérialiste des désirs bas et grossiers...
D’ailleurs, à regarder plus profond, la vraie sagesse individualiste peut-elle survivre en moi si je me tourne vers l’avenir extérieur et l’espoir objectif ? Si je travaille au Progrès, non plus à mon progrès, si j’oublie l’effort de me sculpter pour dédier mes coups de ciseau à la statue Humanité... Dans les siècles éclairés à la torche fumeuse de l’histoire, je ne découvre nul progrès éthique ou social. Les formes politiques qui nous écrasent sont déjà discutées dans Hérodote, condamnées par Platon. La foule se convertira-t-elle jamais au stoïcisme, à l’épicurisme, ou au christianisme de Jésus ou de Tolstoï ? Elle a pu répéter les formules de l’une ou de l’autre de ces doctrines, mais ce fut pour les avilir et les vider de tout contenu. Les sages furent toujours des êtres exceptionnels : le sage est un anachronisme dans tous les temps connus...
Aucun homme récent — ni un Tolstoï déchiré mais velléitaire, ni un Ibsen inaffranchi dans ses actes et dont le rêve s’alourdit d’eudémonisme parfois grossier — aucun moderne peut-être ne paraît un suffisant chef-d’œuvre subjectiviste... Pourtant, ceux-là émeuvent en moi amour, admiration et émulation qui réalisent sur les sommets l’harmonie véritable ; qu’élèvent d’une même ascension hautaine leurs actes et leurs pensées ; qui, au lieu d’abandonner leurs gestes, comme des réflexes, à toutes les irritations venues du dehors, en font les expressions et les rayonnements de leur être intime...
Autant la soumission à une métaphysique ou à une sociologie est mortelle pour l’éthique, autant l’obéissance à une morale empoisonne la science ou l’art. L’artiste, dans la réalisation de son œuvre, le savant, dans ses recherches, n’ont pas à se préoccuper de prêcher ou de confirmer une doctrine... A s’inquiéter de justifier une morale, une politique, une religion ou une cosmologie apprises, on cesse d’être un savant ; on devient un avocat ou, comme on dit au pays du pire servilisme, un apologiste. On n’est plus un trouveur de vérités, mais un inventeur d’arguments... L’homme est une harmonie. Il tient à conserver sa beauté équilibrée et ne se donne pas sans quelque noble réserve à la plus noble des passions. Le vrai savant ne permet pas à son intelligence de détruire sa sensibilité. Sacrifier une de ses puissances, c’est déséquilibrer et, à la longue, amoindrir les autres. Savant et artiste sont des adjectifs devant quoi j’aime à sous-entendre le substantif homme. Pour l’homme véritable, il n’existe pas de fin qui justifie les moyens inhumains. Je puis immoler mes intérêts, ma santé, ma vie même à un but qui me paraît supérieur. La divinité la plus belle et la plus abstraite devient ignoble et orde idole si elle ose me réclamer ce qui n’est pas à moi. La vie, même la plus humble et la plus élémentaire, obtient mon respect et je ne consens pas a créer volontairement de la souffrance...
La science et l’art sont des affranchissements. Pendant qu’il cherche la vérité, le savant oublie les hommes, leurs préjugés et leurs désirs. Aussi l’artiste, pendant qu’il réalise son œuvre... La sagesse, elle aussi, est une méthode d’affranchissement : l’effort de modeler sa propre vie selon la beauté au lieu de la laisser modeler aux fantaisies voisines. Je la considère comme un art ou comme quelque chose de très voisin de l’art. L’art et la science vraiment désintéressés sont des sagesses partielles. Ils n’ont pas à se préoccuper de morale, supérieurs qu’ils sont à toutes les morales qui les voudraient asservir. Pour se soumettre l’art et la science, les infâmes morales, qui sont des méthodes de servitude, détruisent, autant qu’il est en elles, science et art. La sagesse subjectiviste se garde de pénétrer aux domaines de l’activité désintéressée. Le sage se rit des impératifs et méprise les ordres. La sagesse peut conseiller autrui, elle ne commande à quiconque...
Je veux le bonheur. Si j’essaie de l’enfermer dans une matière quelle qu’elle soit, le bonheur glisse et fuit. Mais les eudémonismes formels, sagesse et subjectivismes, échappent, eux, à l’objection. Pour l’épicurien et le stoïcien, le bonheur est une forme que l’artiste moral donne à la matière de sa vie... Et l’expérience montre que les matières les plus communes, les plus pauvres, les plus malheureuses aux yeux vulgaires sont les plus faciles à sculpter, donnent les formes les plus nobles. Socrate, Cléanthe, Spinoza vivent dans ce qu’un terrassier appellerait la misère. Si les deux premiers sont doués d’une santé d’athlète le troisième est maladif, toujours mourant. Epictète est un esclave infirme. Tous sont arrivés au sommet du bonheur...
Pour l’épicurien ou le stoïcien, le bonheur est l’accord, l’harmonie, l’équilibre de tout l’être intérieur. L’art qui le réalise exige trop d’autonomie pour avoir, comme les morales religieuses ou la morale kantienne, les naïves prétentions à l’universalité. Le vrai subjectiviste ne se préoccupe pas de savoir si la maxime de son action peut devenir un principe de législation universelle... Le sage est exempt de toute manie législatrice. Il sait qu’on n’impose pas le bonheur.
La première méthode d’affranchissement à laquelle on songe, la conquête de l’objet du désir est la plus aléatoire et souvent la plus longue. Employée régulièrement, elle aggrave chaque jour la servitude dont le subjectiviste se veut libérer... Elle nous fait désirer pour la fin mille moyens dont plusieurs sont pénibles, elle nous heurte à mille obstacles, multiplie les inquiétudes. L’objet premier est-il enfin atteint, le retard l’a dépouillé de son charme ou sa fraîcheur devient vite entre nos mains tiédeur indifférente. Autre chose, c’est autre chose maintenant que réclame la vague immensité de notre vague appétit. Si, par grand hasard, l’objet continue de plaire, la crainte de le perdre tourmente notre cœur. Et toujours on s’aperçoit que la conquête excite l’appétit au lieu de le rassasier. Le pauvre bien, considéré tout à l’heure comme un but et un couronnement, n’est plus qu’un moyen de conquêtes nouvelles...
J’ai admiré par quels degrés savants s’est affranchi Epicure. J’aime sa distinction entre les besoins naturels (nécessaires ou non) et les besoins artificiels. Les premiers sont limités et généralement faciles à satisfaire. Les besoins artificiels, au contraire, sont ceux dont nous avons vu fuir les limites et qui, à mesure qu’on tente de les remplir, s’élargissent. Il les faut tuer en leur refusant tout. Délivré de tous les besoins qui ne s’imposent pas au corps, l’épicurien laisse peu de place à la fortune et à la tyrannie... J’ai dit ailleurs (voir individualisme) qu’Epicure m’enseigne en souriant à ne plus craindre mort et douleur, que, par un art subtil, il transmute la douleur même en plaisir. L’expérience personnelle m’apprend que, pour moi, aux combats un peu rudes, cette alchimie ne réussit pas toujours. Dans les crises, la discipline stoïcienne s’adapte mieux soit à mon caractère, soit à mes conditions de vie... Ainsi j’utilise, selon les cas la discipline d’Epicure ou celle de Zénon. A chacun de s’examiner soi-même et de savoir ce qui lui réussit. Je crois que, dans une mesure qui variera, beaucoup feront une place à l’éducation épicurienne de la sensibilité, une place à l’éducation stoïcienne de la volonté. D’autres trouveront peut-être tout ce qui leur est nécessaire dans l’une des deux disciplines...
L’éthique subjectiviste, éthique de la sagesse et non du devoir, éthique tout autonome qui me fait chercher en moi-même mon but et mes moyens, est une méthode d’affranchissement et de paix intérieure. Je l’aime parce qu’elle me délivre de tous les maux. Elle me libère du dehors et des servitudes. Elle m’épargne la douleur du chaos intellectuel. Elle m’arrache enfin à l’odieuse inharmonie entre ma pensée et ma vie. Elle appelle vertu mon effort pour réaliser de mieux en mieux mon harmonie personnelle ; elle appelle bonheur cette harmonie réalisée ; elle appelle joie le sentiment de chacune de mes victoires successives, le sentiment, dit Spinoza, du passage d’une perfection moins grande à une perfection plus grande.
— Han RYNER.
* * *
MORALE
-
LE BOULET DE LA MORALE
-
DE LA MORALE A L’ÉTHIQUE
-
L’EXISTENCE « ŒUVRE D’ART »
-
LA SAGESSE ET LA MORALE
-
MORALE ET SOCIOLOGIE
-
LA MORALE ET LA PHILOSOPHIE MODERNE
Malgré notre répugnance pour les systèmes de morale, nous ne pouvons les passer sous silence. Il faut étudier la morale, ne fut-ce que pour se rendre compte de son « immoralité ». La morale des « honnêtes gens » a reçu de rudes assauts, cependant, elle n’est point morte, et le philosophe doit constamment la tenir en respect. Combattre la morale, ou mieux l’ignorer, c’est diminuer son action dans le monde. Kropotkine fait remarquer que « plus on sape les bases de la morale établie, ou plutôt de l’hypocrisie qui en tient lieu, plus le niveau moral se relève dans la société ». C’est quand on la critique et la nie que le sentiment moral fait les progrès les plus rapides. Donc nous n’avons pas d’autres moyens d’être « moraux » que de combattre la morale actuelle, qui est le contraire de la morale : c’est une caricature de morale que les hommes sociaux veulent nous imposer.
Nous entrons, avec la morale, dans un terrain mouvant, capricieux, fuyant, hétéroclite, composite, amorphe. Rien de moins solide que ce terrain-là. On y rencontre de tout : des clichés, des lieux communs, des commandements, des préceptes, des devoirs, des « il faut, il ne faut pas », tout un arsenal de contradictions, d’incohérences, de stupidités sans nombre. Tâchez donc de vous y reconnaître si vous pouvez ! La morale de tel peuple n’est pas celle de tel autre peuple. La morale d’une époque n’est pas la même que celle d’une autre époque. La morale est une question de tempérament. La morale du voisin ne saurait être la mienne. La morale archiste ne peut s’entendre avec la morale anarchiste. La première est immorale, c’est une pseudo-morale. La seconde est amorale, elle est au-dessus et en dehors de la morale.
En morale, rien de plus vrai que l’adage « Tout est vanité ». Morales de la sympathie ou de l’intérêt, morales égoïstes ou altruistes, et toutes les variétés issues de leurs combinaisons, se choquent, s’entrechoquent, se combattent, s’annihilent au sein d’une humanité désemparée, qui ne sait ce qu’elle veut et s’agite perpétuellement. Il n’est pas nouveau de démasquer le mensonge de la morale : d’autres, avant nous, se sont chargés de cette besogne. Cependant, il ne faut pas se lasser de dénoncer l’immoralité de la morale. Les préceptes des moralistes sont remplis d’équivoques, prêtent à différentes interprétations. Que faire ? En maintes circonstances, les gens se posent cette interrogation ? Car, pour eux il importe de ne pas choquer la morale courante... Quant aux morales individuelles, elles ne sont guère individualistes. Rien ne les distingue des morales grégaires, dont elles sont une, variété. Que de sentiments ont été déformés, caricaturés, souillés par ces morales qui constituent « la Morale ». L’amour, la beauté, la justice, sont devenus quelque chose d’odieux : on a pratiqué sous ce nom leur contraire. La vie est devenue un supplice quotidien. Entre la morale intérieure et la morale extérieure existe un conflit aigu. On est à la merci de tous ces « pragmatismes » nouveau-nés ne considérant l’existence qu’au point de vue pratique, ramenant tout à l’intérêt, proclamant que tout ce qui n’est pas utile est une erreur.
Quand nous lisons cette affirmation du philosophe éclectique Victor Cousin : « Les principes de la morale sont des axiomes immuables comme ceux de la géométrie », nous nous demandons si nous ne rêvons pas, et ce qu’il entend par morale. Car rien n’est plus « ondoyant » et divers que la morale. Le dernier mot, en cette matière, a été dit par Pascal : « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». Le même geste est un vice ou une vertu, selon qu’il est pratiqué de l’un ou de l’autre côté de la barricade, et par tel degré de latitude, selon qu’il a pour auteur un Français ou un Allemand, un noir ou un blanc, un juif ou un chrétien... Ainsi, la morale, loin d’être absolue, est essentiellement relative. Où l’on met l’universel et le général, il n’y a que du particulier et de l’individuel. Le relativisme de la morale est un fait que seul les fanatiques peuvent nier. Pour eux, il n’y a point de pluralisme moral : il leur faut je ne sais quel monisme moral, ou plutôt ce dualisme du bien et du mal, cercle vicieux dans lequel les générations tournent sans trouver d’issue. Or ni le bien ni le mal n’existent : quand nous employons ces mots, nous leur faisons dire ce que nous voulons. Sur cette distinction arbitraire repose la morale, laquelle est le domaine du caprice, qu’il ne faut pas confondre avec l’originalité. Si différentes que soient leurs morales, les individus se ressemblent. Il n’est pas question pour eux de se différencier dans l’harmonie et par l’harmonie ; la morale esthétique est trop élevée pour ceux qui ne connaissent, en fait de morale, que la bêtise codifiée.
La plupart des gens ont besoin de vivre en troupeau pour se croire quelque chose ; la morale grégaire est la seule que connaissent maints individus enchaînés. Incapables d’initiative, n’ayant aucune originalité, c’est un besoin chez eux d’imiter et de copier sans comprendre ce qu’ils ont sous les yeux, d’employer les mêmes mots que leurs voisins, et de ne pas avoir une pensée qui leur appartienne. Abandonnés à eux-mêmes, ces individus se croient perdus !... Retenus dans le réseau de leurs traditions et de leurs habitudes, la plupart des êtres n’existent pas, ou mieux ils n’existent que par le mal qu’ils font autour d’eux. Ces êtres, à la fois « moraux » et « sociaux », qui paralysent tout ce qui essaie d’aller de l’avant, ont fait de la vie un mécanisme d’une uniformité et d’une monotonie désespérantes... La morale à laquelle se réfère leur comportement, et qui est celle de la généralité, ne vise qu’à faire entrer l’individu dans le groupe, qu’à l’immoler au profit du groupe, qu’à réaliser le rêve des sociologues : tuer la vie dans l’individu. Elle ordonne qu’il se sacrifie dans l’intérêt de la société. Son bonheur dépend du bonheur du groupe auquel il sacrifie son propre bonheur. Le raisonnement est captieux.
La morale est le fruit des mœurs, institutions et préjugés sociaux, elle est un produit social, avarié au plus haut degré. L’individu n’a pas de pire ennemi que la morale. Ses prohibitions sont sans nombre. Elle oppose une barrière à son intelligence, à sa sensibilité, à sa volonté, à son être tout entier. La morale est un NON lancé à tous nos désirs d’émancipation et de progrès : c’est un non à l’enthousiasme, à l’amour, à la sincérité, à la vérité.
Cette morale bourgeoise est un tissu d’équivoques et d’expédients dans lequel on ne se reconnaît plus. Laïque ou religieuse, la morale d’aujourd’hui, aussi arriérée que la morale d’hier, n’est en aucune façon la « morale » de l’avenir, si l’on peut encore donner ce nom aux modalités de vie dégagées de tous les préjugés. Les philosophes spécialisés dans la morale ont quelquefois dit des vérités à leurs contemporains, comme ce La Rochefoucauld qui avait le courage d’affirmer que l’intérêt est le mobile des actions humaines, mais ils ont été, à toutes les époques, beaucoup plus préoccupés de suivre leur temps que de le précéder. Quelques moralistes n’ont pas craint de dévoiler les faiblesses de l’humanité : nous aimons les relire. Quant aux autres, ils nous donnent la nausée ; Toutes les variétés de morales proposées par ces « bourreurs de crâne » que furent les moralistes ont laissé leur empreinte dans les consciences. Leurs « impératifs » n’ont rien apporté de bien précieux aux hommes. Leurs morales furent des trompe-l’œil et des pis-aller. La morale des « pères de famille » qui représente l’esprit bourgeois dans toute sa laideur est la morale qui régit l’humanité actuelle. En elle viennent se fondre les morales antérieures dans ce qu’elles ont de plus étroit. Les moralistes avec les fondateurs de religion et autres surhommes possèdent le don de mystifier les foules. La morale est une forme d’autorité que l’individualiste rejette. L’homme intelligent ne peut se plier aux exigences de cette morale tyrannique, dont le dessein est d’étouffer la vie et de lui substituer sa contrefaçon. Le but de la morale, de toutes les morales, c’est de faire de l’individu un esclave assujetti aux lois de son milieu, un semblant d’homme, incapable de secouer ses chaînes, docile aux ordres qu’il reçoit. Qui ne voit que la morale est un moyen d’asservir les masses, de les dominer et de les tenir en laisse, dans l’intérêt de quelques jouisseurs qui vivent de la bêtise et de l’ignorance du nombre ?
Combien plus morale est la morale individualiste qui se veut amorale et consiste dans l’effort que fait l’individu pour s’évader de l’emprise du social. Louis Prat, un des rares philosophes qui ne parlent point pour ne rien dire, a appelé « noergie » la volonté qui résiste à l’envahissement des choses en nous. C’est l’énergie de la raison, contre laquelle viennent se briser les petites raisons des hommes. Soyons noergiques, c’est-à-dire énergiques dans le combat que nous livrons chaque jour contre les milieux dont nous faisons partie.
La morale est un poison nécessaire à la vie des êtres : supprimer ce poison, c’est les tuer. Il faut les habituer graduellement à s’en passer ; en en diminuant chaque jour un peu plus la dose, un jour viendra où ils pourront vivre sans faire usage de la funeste drogue. Mais c’est une éducation qui demandera des siècles ! Jusque là les prostitués de la morale ne changeront rien à leurs habitudes et à leurs petites combinaisons. Ils ne renonceront point à leurs privilèges. La morale qui contient tous les préjugés, toutes les traditions, toutes les laideurs, se transformera afin de durer ; elle est bâtie avec la bêtise des hommes, et la bêtise est plus solide que le granit... La morale n’est qu’un mot, mais ce mot a perverti les individus. L’animal est plus moral que l’homme, car il ne s’embarrasse ni de commandements ni de scrupules. L’homme met une barrière entre la vie et lui : cette barrière, c’est le mensonge.
Comment, nous demandons-nous, une morale si fragile peut-elle encore guider les hommes ? C’est bien simple : elle a son explication dans leur ignorance. En morale, l’imitation et le plagiat sont des vertus. Ce qui s’est toujours fait doit continuer à se faire. Il n’y a pas plus de place pour l’imprévu dans le domaine de la morale que dans celui de la logique. C’est un monde pareillement figé. Là aussi il est défendu d’être soi-même. On doit suivre la tradition aveuglément.
Non seulement la majorité des individus est incapable de vivre sans morale, mais le malheur est qu’ils imposent aux autres leur morale, au lieu de se contenter de la pratiquer pour leur propre compte. Et encore ne leur est-elle supportable que parce qu’ils la violent à chaque instant. Les défenseurs de la morale sont en effet les premiers à ne pas l’observer. Spectacle fertile en enseignements pour le philosophe ! Il se fait par là une idée juste de la sincérité des individus. Il importe de jeter bas le masque dont ils se parent, et de montrer qu’ils sont autres que ce qu’ils paraissent être. Ces ennemis de l’assassinat sont des assassins, ces esprit pudiques sont des sadiques en tous genres, ces âmes bien pensantes ne rêvent que plaisirs, noces, jouissances « défendues », toutes les apostasies morales ! Alors ? Alors cessons de prendre au sérieux ces préceptes qui sont bafoués constamment, ces conseils qui ne sont pas suivis, ces appels à l’honneur et à la vertu qui ne sont que des appels à la résignation et à la mort. Morale de renoncement et d’obéissance, morale de régression qui fait de l’homme un être servile et borné ; nous n’avons rien a attendre d’elle pour l’embellissement, pour l’ennoblissement de l’individu. Il faut être avec elle ou contre elle. Point de juste milieu. Combien nous devons être reconnaissants envers un Stirner, un Nietzsche, d’avoir, en révisant la table des « valeurs morales » contribué à déboulonner de son piédestal, l’Idole !
Ce n’est pas dans les préceptes de la morale bourgeoise, violés par ceux-là mêmes qui les ont formulés, que nous trouvons une méthode pour nous perfectionner, pour enrichir notre personnalité, pour nous développer en plus d’harmonie et de beauté. Aussi lui opposerons-nous une morale hautement individualiste, sans obligation ni sanction, une morale qui augmente la vie au lieu de la diminuer, qui, loin de prêcher le sacrifice de l’individu, contribue à son épanouissement, à son affranchissement total... D’ailleurs, en fait de morale, la meilleure c’est encore celle qu’on se donne, non celle qu’on reçoit ; c’est la façon originale dont on conçoit la vie et le monde ; c’est le courage d’être soi-même en mettant ses actes en harmonie avec ses idées. Cette morale-là est toute personnelle. Est le plus moral l’être qui s’est le plus complètement dégagé de tous les préjugés, qui a renoncé à penser et à agir comme tout le monde, qui n’entend subir aucun esclavage, et reste maître de lui en toute circonstance. Si c’est être immoral devant les bourgeois, c’est être moral devant la vie. Voilà la vraie morale individualiste. De tous les individualismes, l’individualisme éthique est le seul qui ne soit pas une tare, le seul qui comporte un entier désintéressement, car il ne vise qu’à enrichir spirituellement l’individu. Le refus d’enchaîner et de se laisser enchaîner est le début de la sagesse. Même si mon voisin agit « en beauté », il n’a pas le droit de me contraindre à en faire autant. Un bel acte obligatoire cesse d’être beau. Quand je veux accomplir un geste libre, je ne consulte personne : c’est moi seul que j’interroge. Je préfère un individu qui commet une sottise de sa propre autorité qu’un individu qui fait un beau geste commandé par un autre. La conscience est le seul guide des individus, et encore faut-il entendre par conscience autre chose que ce que les bourgeois sans conscience désignent sous ce nom. Il n’y a d’obligation et de sanction que dans la conscience. Là seulement est ma récompense ou mon châtiment. Je suis seul juge de mes actes. Si chacun conserve le droit de les critiquer, combien ai-je celui de me critiquer moi-même afin de m’enrichir intérieurement, de m’évader, par la raison et le sentiment harmonieusement associés, de la non-harmonie sociale.
La crise de la morale, dont on parle sans cesse, nous indiffère. Nous ne savons ce qu’on entend par là. Qu’elle traverse ou non une crise, la morale est pour nous une chose du passé. A la morale nous opposons l’art, qui est sans morale et qui réalise, par là même, une surmorale apolitique et asociale. La morale inesthétique, sur laquelle repose la société, convient aux faibles et aux dégénérés. C’est une morale d’esclaves. La morale sociale ne peut convenir à des êtres libres, pour lesquels vivre c’est agir, et agir harmonieusement.
Cette morale immorale punit et récompense les individus pour le même acte, selon qu’il est accompli dans tel milieu, à tel moment. Le même acte est légal ou illégal selon les circonstances. Tantôt, il mérite les honneurs, tantôt il mérite l’échafaud. C’est le caprice qui fait la loi en morale. Au fond tous les dogmes se ressemblent, toutes les causes sont les mêmes, tous les drapeaux symbolisent la même tyrannie. Quand on est sincère, on est bien obligé d’admettre que la morale laïque ne vaut guère mieux que la morale religieuse, c’est la même morale à rebours, nous donnant à adorer d’autres dieux aussi malfaisants... Il n’est pas difficile de se rendre compte, quand on n’est pas absolument dépourvu de bon sens, que « tout ce que l’on a exalté jusqu’à présent sous le nom de morale » (Nietzsche), mérite d’être traité par le mépris.
L’un des points sur lesquels insiste tout particulièrement la morale traditionnelle, c’est celui de l’obligation et de la sanction. Une morale sociale ne peut s’en passer : c’est son fondement et sa raison d’être La morale « archiste » s’évanouit dès que la sanction et l’obligation disparaissent. Et c’est bien ce qui prouve son immoralité : c’est par la crainte et l’obéissance que s’établit sa domination. La morale « archiste » se préoccupe des mobiles qui font agir les individus : plaisir, sentiment, raison, intérêt personnel ou général. Elle place très haut, ce qu’elle appelle le « devoir ». Mot magique, miroir aux alouettes que chacun interprète à sa façon. Il n’y a point de devoir universel et nécessaire. Nul homme n’a le droit de m’imposer sa conception du devoir pas plus que je n’ai le droit de lui imposer la mienne... La morale « archiste » se subdivise en morale personnelle, domestique, sociale, civile ou politique. Elle résoud à sa façon les problèmes que soulèvent la famille, la justice, la solidarité, l’association, le droit et les droits, la propriété, le travail, le luxe, le capital, la nation, la loi, la patrie, l’État, et l’incorruptible démocratie, mère de l’égalité, de la liberté et de la fraternité. L’alcoolisme, le suicide, l’avortement, etc... sont examinés au même point de vue étroit, anti-individualiste, autoritaire et étatiste. Quant aux rapports des individus entre eux, à l’échange, à la réciprocité et autres questions non moins importantes, il lui est impossible de les résoudre dans un sens rationnel. Sa myopie lui interdit d’introduire un peu d’esprit de suite, de générosité et d’amour dans l’examen de ces problèmes. Il lui faudrait pour cela l’envergure qu’elle n’a pas.
* * *
La morale est une mystification. Elle s’acoquine avec la religion pour châtrer les individus Elle s’allie avec la science pour se faire prendre au sérieux. Elle prend le masque de l’art pour se substituer à lui. Partout elle s’immisce, pour tout dénaturer. Au moindre examen, on s’aperçoit que les « menottes » de la morale sont bien fragiles. Il suffirait d’un peu de volonté pour les briser.
La société a inventé la morale pour maîtriser l’individu et supprimer en lui toute indépendance. Elle vise avant tout à en faire un eunuque. « Un homme qui moralise est ordinairement un hypocrite, et une femme qui moralise est invariablement laide », disait Oscar Wilde. Comme il avait raison, ce pauvre Adolphe Retté, sombré depuis dans le mysticisme, quand il disait : « Ce que les bourgeois appellent la morale, c’est le droit à l’hypocrisie »... La morale n’est ni une preuve d’honnêteté, ni plus ni moins. C’est aussi la peur du gendarme, ni plus ni moins. C’est aussi la peur de l’opinion, du qu’en dira-t-on. Aussi les moralistes se cachent-ils pour accomplir leurs saletés. Tant de gens qui se prétendent vertueux le sont par force, parce qu’ils ne peuvent pas faire autrement...
La morale et l’intérêt s’accordent parfaitement. Quand, par hasard, ils sont en conflit, c’est toujours l’intérêt qui a le dessus. Les honnêtes gens n’hésitent pas à mettre de côté leurs « principes ». Faire des affaires, à cela se réduit toute la morale de certaines personnes. Et, dans ce but, intriguer, sacrifier les amis et les trahir. Se vendre est le plus sûr moyen, à la portée du premier venu, de réussir dans la vie. Il n’y a pas d’autre morale pour les arrivistes.
Rejeter ce boulet de la morale, qui paralyse l’essor des êtres, ce serait vivre normalement. Tout progrès moral véritable consiste dans la révolte de l’individu contre la morale courante. Cette révolte se traduit tantôt par l’action, tantôt par l’inaction. La seule morale, en fin de compte, c’est de s’affranchir de la morale. C’est de rompre les liens sociaux qui font de chacun de nous des mannequins. C’est de vivre en harmonie avec nous-mêmes. Tout le reste est immoral.
* * *
Substituons au vocable « morale » celui d’éthique. Il n’est point équivoque, il a une signification précise. L’éthique est autre chose que la morale. Elle constitue l’art de vivre par excellence. La morale, c’est l’art de ne pas vivre, le mot art étant ici pris dans le sens de faux-art, dépourvu de toute beauté. Pour nous, il n’y a point d’éthique en dehors de la sagesse. Nous appelons éthique une morale basée sur la sagesse, morale sans rapport avec la morale ordinaire. Nous désignons sous ce nom une morale sans « la morale ». L’éthique n’est pas autre chose que l’autonomie de la conscience délivrée de toutes les chaînes.
L’action et la pensée s’associent étroitement dans l’éthique individuelle. Elles sont solidaires. Les séparer, c’est mutiler la vie. C’est pourtant ce que fait la morale ordinaire qui, en isolant la pensée de l’action, aboutit à la fausse pensée et à la fausse action.
Tandis que la morale est grégaire, l’éthique est individuelle. La morale exige des imitateurs ; l’éthique veut des créateurs. Avec Han Ryner, j’envisage la sagesse « comme un art ». Je crois que l’éthique est une esthétique. J’oppose, avec l’auteur des Voyages de Psycho-dore, la sagesse à la morale sans sagesse des moralistes. L’éthique a tout à gagner à se passer de la science au sens étroit. Loin de se subordonner à la science, c’est la science qui lui est subordonnée. L’éthique individualiste — que nous appelons sagesse — n’utilise qu’à bon escient les méthodes de la science. Elle en use, n’en abuse point. La morale enlaidit sa vie. La sagesse découvre pour l’individu les moyens de faire de son existence une œuvre d’art.
L’éthique rejoint l’art, la morale le fuit. Entre l’art digne de ce nom et la morale, nulle conciliation n’est possible. Ils ne poursuivent pas le même but. La morale est le contraire de l’art ; l’art est le contraire de la morale. Morale et esthétique s’excluent. Ce que j’ai longtemps désigné sous le nom de « morale esthétique » n’a rien de commun avec la morale traditionnelle. Cessons d’associer ces vocables. L’art est au centre de l’éthique, comme un flambeau pour l’éclairer. L’art de vivre, c’est l’art de vivre en beauté. L’éthique tend à faire passer dans l’existence humaine l’équilibre et l’harmonie contenue dans toute œuvre d’art, témoignage de l’harmonie et de l’équilibre de son créateur. L’artiste de sa propre vie rectifie sans cesse son œuvre, la corrige et l’embellit. Il n’est jamais satisfait. Il vise à être chaque jour meilleur, plus beau.
Si l’éthique ne peut se passer de l’art, elle conserve sa liberté en face de la science. Elles peuvent s’allier, non se confondre. Une éthique individualiste ne professe point pour la science une admiration sans bornes, mais ne la méprise point. Elle l’estime à sa juste valeur. Elle en tire le meilleur parti Seulement, l’éthique, qui ne veut pas de chaînes, repousse les dogmes scientifiques, comme les autres dogmes. Elle emprunte quelques-uns de ses moyens à la science, elle refuse de se servir de tous ses moyens. Quand la science n’est point sagesse, comment la sagesse consentirait-elle à faire alliance avec elle ?
L’éthique est indépendante de la sociologie. Quand elle consent à faire alliance avec elle, ce n’est pas pour recevoir des ordres, mais pour suggérer des conseils. La sociologie bien pensante n’aura jamais d’ailleurs ses préférences... Biologie et sociologie ne sauraient être des prisons pour le sage. Les prisons, de quelque nom qu’on les décore, le sage n’en veut point. Biologie et sociologie sont des pis-aller. Elles ne suffisent pas à étayer l’éthique. Elles peuvent très bien, par contre, faire le jeu de la morale.
L’éthique n’impose pas de règles aux individus. La seule règle qu’elle leur demande d’observer, c’est d’être eux-mêmes. Elle s’efforce de mettre en valeur ce qui les différencie des autres, ce qu’il y a de meilleur en eux. Elle fait de l’individu un être libre. Une éthique purement scientifique en ferait un automate. Elle cesserait d’être une éthique. Elle ne demanderait aux individus aucune initiative, exigeant d’eux mêmes façons de penser et d’agir communes. L’éthique repousse la morale scientifique, comme constituant le plus grand obstacle à la morale individuelle...
Métaphysique, biologie ou sociologique, la morale a usé de tous les expédients pour se rajeunir, mais elle n’a fait que s’enlaidir un peu plus sous ses vêtements d’emprunt. Aux impératifs catégoriques de la morale, à ses commandements mort-nés, la sagesse substitue de modestes conseils. La morale ordonne ; la sagesse suggère. Là est leur principale différence. Il n’y a pas d’injonctions pour la sagesse. L’harmonisation de toutes les facultés humaines dans l’individu, tel est le but qu’elle poursuit. A l’encontre de la politique et de la morale, ces deux sœurs jumelles, qui ne visent qu’à créer du désordre dans l’individu, elle est l’art de l’individu.
Sagesse et morale sont deux choses qui s’excluent. La sagesse est un art, et l’on sait que la morale est le contraire de l’art. La sagesse n’a pas l’autoritarisme de la morale, qui aspire à diriger la vie de chacun de nous. Les prétentions de la fausse éthique qui a nom morale sont injustifiées. Elle aboutit à une pseudoscience de la vie. Sa technique est en défaut. La sagesse n’a d’autre ambition que de nous révéler à nous-mêmes, que de nous aider à nous ressaisir au sein des influences, bonnes ou mauvaises, qui agissent sur nous. Cette pseudo-sagesse qui a nom morale nous fait. commettre bien des bêtises. Elle nous jette dans des situations inextricables. Elle complique notre existence et fausse notre jugement. Avec elle on trébuche, on finit tôt ou tard par se casser les reins.
Pouvons-nous nous contenter de trébucher avec la morale, quand la sagesse s’avance pour guider nos pas ? Celle-ci est aussi large que celle-là est bornée. A la morale il sied d’opposer la sagesse, non ce masque de sagesse qui est un déguisement de la morale, mais une sagesse réelle, à la fois belle et vivante. La morale enchaîne ; la sagesse libère. Entre les deux, l’homme libre n’hésite pas. Aucun compromis d’ailleurs n’est possible entre la sagesse et la morale. On n’accorde point le néant et la vie. Le domaine où se meut la morale, c’est l’équivoque. La sagesse est clarté. La morale est tyrannie ; la sagesse est délivrance...
* * *
Les philosophes contemporains, spécialisés dans l’étude de la morale, l’envisagent à un point de vue objectif. Ils ont constitué une « science des mœurs ». C’est un fait assez nouveau. Mais cette « science des mœurs » qu’est-elle, sinon une dépendance de la sociologie, qui sacrifie l’individu au soi-disant bonheur de la collectivité ? Elle constate des faits, et ces faits sont invoqués en faveur du régime social. Que nous voila loin de la morale « sans obligation ni sanction » préconisée par Guyau, de l’anomie libératrice...
Après avoir été métaphysique, puis médicale et biologique avec Metchnikoff, la morale est devenue sociologique. Mais elle n’est guère devenue plus « positive » pour cela. Les faits moraux ont été étudiés comme des faits physiques. Cependant, les morales a posteriori, à prétention scientifiques, ne valent guère mieux que les morales a priori. Elles sont imprégnées du même dogmatisme. Ces morales sont réactionnaires, malgré leurs allures révolutionnaires. Les adversaires de la « métamorale » prétendent soustraire la morale à la métaphysique, et ils rétablissent sous une autre forme la métaphysique en morale.
La morale du sociologisme ne souffre aucune discussion. Elle se résume en cet impératif : « J’ai dit ». Il n’y a qu’à s’incliner devant ses commandements. C’est le dernier mot de la morale préconisée par Durkheim. Pour ce dernier, la morale est la servante de la sociologie. Ces deux disciplines se prêtent main-forte pour le but qu’elles poursuivent : réduire à néant l’individu. Impossible de les séparer. Les moralistes-sociologues, et les sociologues-moralistes aboutissent aux mêmes conclusions, leurs systèmes renferment les mêmes contradictions. Critiquer la morale sociologique et la sociologie morale, c’est accomplir le même geste d’émancipation. Il faut nous libérer à la fois de la sociologie et de la morale si nous voulons être des vivants.
La morale, selon la nouvelle école, n’est plus qu’une « branche de la sociologie ». Les faits moraux doivent être étudiés comme les faits sociaux. Il y a une « nature morale » comme il y a une « nature physique ». C’est ce qui est, non ce qui doit être, qui est l’objet de la morale. Analyser la réalité morale donnée, tel est le but du moraliste. Morale et sociologie obéissent aux mêmes règles et emploient les mêmes méthodes. Elles renoncent l’une et l’autre à améliorer la réalité, bien qu’elles affirment le contraire. Les moralistes-sociologues, ou les sociologues-moralistes, ont prévu l’objection, et ils répondent avec Durkheim : « De ce que nous nous proposons avant tout d’étudier la réalité, il ne s’ensuit pas que nous renoncions à l’améliorer. » En attendant, ils reculent aux calendes grecques cette amélioration. Au fond ils s’en désintéressent.
La morale cesse d’être théorique : elle se contente d’étudier les faits moraux. La morale est une réalité donnée, un objet de science, à laquelle on appliquera la méthode de la sociologie scientifique. Or, Fouillée fait remarquer aux sociologues que « la morale n’est pas une science d’observation portant sur des choses faites. » Elle n’est pas une réalité donnée, mais une réalité qui se donne elle-même. Les inconvénients de la morale sociologique sont ceux de la sociologie positive, objective et scientifique, dont elle est un chapitre. Cependant, l’esprit libre saura toujours trouver, même dans cette conception défectueuse de la morale, matière à s’augmenter, la « réalité donnée » l’obligeant à faire certaines constatations.
Il n’y a pas, dit Lévy-Bruhl (La morale et la science des mœurs), de morale théorique. Lévy-Bruhl a montré que la morale a d’abord été, dans les société primitives, une « particularisation » des pratiques morales, qu’elle est ensuite devenue l’universalisation des principes de la morale, qu’enfin de nos jours elle serait une étude scientifique, objective et comparative de la pluralité des morales. Il y aurait, en face de la morale dogmatique une « science de mœurs » appelée à rendre les plus grands services. La « science des mœurs » a raison quand elle affirme que la nature humaine n’est pas identique à elle-même partout et en tout temps. Prévoyant le reproche qu’on ne manquerait pas de faire à la science des mœurs de se borner à l’étude de la réalité sans chercher à la modifier, Lévy-Bruhl, auquel nous devons un ouvrage récent sur Jaurès, se défend d’une conception aussi étroite :
« Dire que nous concevons la réalité morale comme un objet de science, implique précisément que nous n’acceptons pas tout l’héritage du passé avec un sentiment uniforme et religieux de respect. »
Albert Bayet a essayé de donner à l’éthologie ou science des faits moraux une direction différente, et d’en assouplir les rugosités. Pour ce philosophe, l’art moral classique, n’est basé ni sur l’intérêt ni sur la société. Il laisse l’individu se développer librement et n’ajourne pas indéfiniment l’entreprise de modifier la réalité. La « science des mœurs » est ainsi dépassée. Pour Albert Bayet, il y a des idées mortes et des idées vivantes. L’idée du bien existe, mais est variable. L’esprit scientifique en morale, fait-il observer, n’aboutit qu’à l’immoralité, et la morale universelle est le dernier des dieux.
Les penseurs anarchistes ne nient pas la morale, mais elle est autre chose pour eux que la morale traditionnelle. Kropotkine croyait que la morale est une « science », mais une science qui dicte à l’individu libre son devoir. Elle lui sert à se perfectionner et à perfectionner le milieu dans lequel il vit. Errico Malatesta déclare de son côté :
« On appelle morale la science de la conduite de l’homme dans ses rapports avec les autres hommes, c’est-à-dire l’ensemble des préceptes que, à une date donnée, dans un certain pays, dans une classe, dans une école ou un parti, l’on considère bons pour conduire au plus grand bien de la collectivité et des particuliers. »
Or, les anarchistes, dit-il, ont une morale, et ne peuvent pas ne pas en avoir, mais elle ne saurait constituer pour eux qu’un idéal, car personne, dans la société actuelle, ne peut vivre vraiment en anarchiste, étant exploité et opprimé on même temps qu’exploiteur et oppresseur. Il aboutit en somme à la même conclusion que Kropotkine, qui est de rompre avec le milieu en se perfectionnant.
J. M. Guyau, dans son Esquisse d’une Morale sans obligation ni sanction, lue et annotée par Nietzsche, s’était proposé « de rechercher ce que serait et jusqu’où pourrait aller une morale où aucun « préjugé » n’aurait aucune part, où tout serait raisonné et apprécié à sa vraie valeur, soit en fait de certitudes, soit en fait d’opinions et d’hypothèses simplement probables ». En véritable précurseur qu’il était, il préparait la voie aux recherches portant sur une morale scientifique : « Rien n’indique, disait-il qu’une morale purement scientifique, c’est-à-dire uniquement fondée sur ce qu’on sait, doive coïncider avec la morale qu’on sent ou qu’on préjuge ». Il introduisait la liberté en morale et faisait sa part à la spéculation philosophique. Au lieu de regretter la disparition de « l’impératif » absolu et catégorique et la variabilité morale qui en résulte, il considérait cette dernière comme la caractéristique de la morale future. Écartant toute loi antérieure et supérieure aux faits, il partait de la réalité pour en tirer un idéal, de la nature pour en tirer une moralité, et il faisait de la vie seule, morale et physique, le principe de la conduite humaine, comme il avait fait de la vie le principe de l’art et de la religion....
— Gérard DE LACAZE-DUTHIERS.
* * *
MORALE (La) ET L’INDIVIDUALISME ANARCHISTE
Les dictionnaires de philosophie donnent à peu près tous la définition suivante de la morale : c’est une science qui nous fournit des règles pour faire « le bien » et éviter « le mal » — ou qui nous enseigne nos « droits » et nos « devoirs » — ou encore qui nous fait connaître notre « fin » et les moyens de la remplir. Il est important de remarquer ici que les moralistes ne considèrent pas la morale comme une science indépendante et capable de se suffire à elle-même. C’est une science d’application et de déduction. C’est une pratique bien plus qu’une théorie.
Quelle opinion peut émettre sur la morale le milieu individualiste anarchiste, milieu constitué par des humains qui, d’un côté, relativisent tous les aspects, toutes les attitudes de l’activité humaine aux avantages et aux inconvénients qu’ils peuvent leur procurer et, de l’autre côté, nient et rejettent la nécessité de l’État et des institutions gouvernementales, l’utilité de leurs interventions, de leurs obligations, de leurs sanctions pour asseoir les rapports et régler les accords qui peuvent s’établir entre eux ?
Le milieu individualiste anarchiste ne saurait se montrer hostile à l’adoption d’une règle de conduite envers soi et envers autrui, dès lors que cette règle de conduite sauvegarde l’autonomie de l’individu ou de l’association, qu’elle ne lui crée de responsabilités autres que celles qu’il a acceptées.
Comme nous l’avons vu aux mots « bien » et « mal », les individualistes anarchistes savent très bien que la morale actuelle, telle qu’on la conçoit communément, a pour fin d’assujettir l’unité humaine à la conception que, à une époque donnée, les constituants moyens d’une société civilisée se font des rapports entre les hommes. Cette conception moyenne est bien plus souvent un produit de l’enseignement, de la coutume, du fonctionnement politique ou religieux du milieu que le résultat ou des instincts ou de la réflexion. La morale apparaît surtout comme un moyen de maintenir en leur situation dirigeante, au point de vue temporel : l’État ; au point de vue spirituel : l’Église. Nous avons vu que par « bien », ces deux représentants des sociétés humaines entendent ce qui est « autorisé » et par « mal » ce qui est « prohibé ». Tout ce qui est autorisé actuellement, ou maintient en bon état de fonctionnement les rouages de la société organisée et étatisée, ou sembleapparemment ne lui porter aucun dommage. Et c’est cela le bien. Il n’est pas une action prohibée qui, si elle était permise, ne risque de mettre en péril l’existence de l’organisation politique, de la civilisation, de la culture, de la religion du groupe humain où elle se perpétrerait. Et c’est le mal, ce péril. La fin de tous les membres des sociétés organisées de tous les temps, c’est de jouer le rôle de conservateur social, politique et religieux du milieu humain où il naît et se développe, de n’accomplir que des actes permis. Cette fin est d’ailleurs obligatoire : il n’a ni à la critiquer, ni à la discuter, sous peine de sanctions. La morale n’est pas proposée aux croyants ou aux citoyens : elle leur est imposée.
Il en a toujours été ainsi et la fin a toujours été la même. Tous les moralistes s’accordent pour reconnaître que chez tous les peuples actuels civilisés, les principes les plus généraux de la morale sont les mêmes. « Nous devons les retrouver à toutes les époques de l’histoire, s’écrie dans son livre, La Morale et les morales, M. S. Gillet, professeur à l’Institut catholique de Paris. Nous les retrouvons, en effet, solidement établis dans les lois et les écrits des philosophes en remontant à travers le moyen-âge jusqu’à l’époque gréco-romaine. Remontons encore, ils sont inscrits dans les monuments égyptiens, dans le code Mosaïque, dans les lois de Manou et les livres sacrés de la Chine, documents qui sont eux-mêmes l’écho d’une tradition plus ancienne. »
Ces considérations font comprendre pourquoi une règle quelconque de conduite individualiste anarchiste ne saurait emprunter quoi que ce soit à la morale archiste actuelle, puisque celle-ci repose sur l’obligation. Contrairement à ce qui a pu être énoncé par certains doctrinaires, il n’y a rien à conserver de la Morale actuelle, dont l’enseignement et la pratique sont basés sur l’imposition, la contrainte, la crainte des sanctions. L’idée de « devoir » qui est à la base de la Morale courante est en abomination à l’individualiste anarchiste.
L’individualiste anarchiste ne doit rien à personne et personne ne lui doit rien. Ce n’est pas parce qu’il le doit qu’il respecte intégralement la liberté d’action tant que la sienne n’est pas compromise, c’est parce que cette « morale » de l’égale libertéou de la réciprocité est encore ce qu’il y a de mieux, une fois annihilée la conception de la nécessité de l’État. Cette « morale » n’est ni religieuse, ni politique, ni économique, ni scientifique, ni sentimentale, ni sociologique : elle n’existe que pour et par l’individu, isolé ou associé. Fondez votre ligne de conduite ou règle sur la base que vous voudrez, pourvu que vous n’empiétiez pas sur la mienne, sur la nôtre. Vivez et mourez à votre guise, pourvu que vous n’interveniez pas dans notre façon de vivre et de mourir, même si elle est aux antipodes de vos conceptions, même si vous la considérez comme anormale.
La « morale » individualiste anarchiste n’est pas universelle, elle est particulière. Elle n’est pas absolue, elle est relative. C’est un instrument au service de l’individu ou de l’association, non une conception mystique de « droit » et de « devoirs »automatisant l’unité humaine.
En d’autres termes, les individualistes anarchistes relativent ce qu’on appelle éthique, ligne ou règle de conduite soit au tempérament individuel, lorsqu’il s’agit d’isolés ; soit aux affinités instinctives, naturelles ou acquises qui peuvent conduire des unités humaines à s’associer pour des buts déterminés et pour un temps fixé. Les individualistes anarchistes ne rapportent pas leur façon de se comporter à une injonction ou à un impératif supérieur ou extérieur à l’isolé ou à l’association. Voilà pourquoi on peut les considérer comme amoraux relativement à toute morale tirée de la religion, de la science, de la sociabilité, de la nature même, qui contrarierait leurs aspirations, leurs désirs, leurs appétits. Ceci dit, antiautoritaires, ils se refusent, dans tous les cas à l’égard des leurs, pour assouvir leurs désirs ou satisfaire leurs besoins, à avoir recours au vol, à la fraude, à la violence ou à une coaction quelconque rappelant la coercition gouvernementale ou étatiste. « Les leurs », c’est-à-dire les négateurs de la domination et de l’exploitation de l’homme par son semblable ou par tout milieu social, ou vice-versa.
Pour les individualistes anarchistes, c’est de l’unité ou de l’association que part la règle de conduite à observer pour atteindre au maximum de sociabilité, sociabilité qui ne correspond nullement à une conception préétablie du bien et du mal, à un a priori transcendant, mais qui se fonde sur cette constatation égoïste et intéressée qu’autrui n’est, ne peut ou ne veut être « objet de consommation » pour moi que dans la mesure où je le suis ou le puis ou le veux être pour lui.
En anarchie, selon les individualistes anarchistes, il y a autant de « morales » ou règles de conduite qu’il y a d’anarchistes, pris individuellement, ou de groupes ou d’associations d’anarchistes. Voilà, pourquoi les individualistes anarchistes se qualifient volontiers d’amoraux, autrement dit : toute « morale » présentée ne peut engager que l’unité ou le groupe qui la propose ou la pratique. Il n’est pas de « morale anarchiste » absolue, aucune dont on puisse logiquement dire qu’elle résume ou incorpore les revendications, les desiderata, les relations entre eux de tous les anarchistes.
« Ma ou notre ligne de conduite — dit l’individualiste anarchiste — ne vaut que pour moi ou notre groupe ou notre association — ou encore pour tous ceux auxquels elle donne satisfaction, chez lesquels elle existait en germe, à qui il fallait que je l’expose ou que nous la proposions pour qu’ils y trouvent l’objet de leurs recherches, peut-être bien sans qu’ils s’en soient rendu compte. Ma « morale », notre « morale » ne vaut que pour celui, celle, ceux auxquels elle convient non pas pour tout le monde, non pas pour les autres. »
Plus disparaît l’idée qu’une morale imposés et commune est nécessaire pour vivre heureux, moins les hommes sentent le besoin d’instructeurs moraux. Telle est la base de la propagande « amoralisatrice » des individualistes anarchistes. A mesure donc, que le milieu humain s’amoralise, plus les hommes sentent et comprennent l’inutilité des gardiens de la morale religieuse ou laïque, la malfaisance de ceux qui veulent maintenir les sociétés humaines au-dedans de règles de conduite uniformes ou de morales absolues, qui postulent la nécessité d’un organisme central de conservation morale. L’amoralisation — au sens que lui donnent les individualistes anarchistes -. mène logiquement à la négation de Dieu et de l’État.
Les individualistes anarchistes reprochent aux animateurs de l’anarchisme traditionnel — appelé ordinairement « communisme anarchiste » — non seulement d’avoir voulu fonder un anarchisme orthodoxe, mais de stabiliser le concept anarchiste en l’intégrant dans l’aspiration de l’humanité en général. Prenons Kropotkine comme type représentatif de cette tendance. Qu’on lise avec soin l’Entr’Aide, la Science Moderne et l’Anarchie, l’Ethique, on se rendra très rapidement compte du dessein de leur auteur : démontrer à ses lecteurs que les principales revendications de l’anarchisme s’accordent avec les besoins, les connaissances, les expériences, les faits de l’évolution humaine, de l’histoire des organismes vivants. A en croire Kropotkine — et si je l’ai bien compris — toutes les observations, tous les événements de l’histoire des êtres vivants tendent à l’établissement d’une morale sociale, à tel point que la nature elle-même ne saurait plus être considérée comme amorale. On voit la conclusion : le communisme anarchiste, comme l’entendaient Kropotkine et ses amis ou ses disciples, est en germe dans l’aspiration de l’humanité vers un état de choses meilleur que l’actuel.
Je ne puis ici passer au crible d’une critique serrée le concept kropotkinien et vider à fond — pour nous rendre compte de sa valeur comme facteur d’évolution individuelle — le contenu des trois éléments sur lesquels Kropotkine édifiait la morale : l’entr’aide, la justice, l’esprit de sacrifice. Je ne nie pas, d’ailleurs et jusqu’à un certain point, cette valeur, dès lors que c’est au point de vue de la sociabilité et non de la socialité qu’on l’envisage. Je ne veux pas non plus m’appesantir sur le caractère mystique et trop souvent abstrait de l’Éthique kropotkinienne, montrer que le langage et la culture scientifique ne suffisent pas toujours à nous empêcher de faire de la métaphysique, de prendre de purs fantômes pour des êtres de chair et d’os. Individualiste anarchiste et associationniste, je comprends qu’on se serve de sa sensibilité propre pour se créer une ligne de conduite personnelle ; je comprends qu’on s’associe entre individus doués d’une sensibilité à peu près semblable, qu’on agisse alors selon une ligne de conduite de groupe. Mais ériger la façon de se comporter d’un individu ou d’un groupe en morale universelle, absolue, voila ce que je ne puis accepter, en tant qu’individualiste en premier lieu, en tant qu’anarchiste en second lieu. Supposons que Kropotkine ait réussi à persuader tous les anarchistes que le communisme anarchiste était la forme de système économique vers lequel tendait incontestablement l’humanité dans ses rêves et ses aspirations d’un meilleur devenir et voilà l’anarchisme stabilisé, cristallisé, pétrifié. C’est-à-dire qu’il n’existerait plus, dynamiquement parlant.
En effet, le jour où il sera admis qu’il n’y a qu’une seule morale anarchiste, qu’une ligne unique de conduite anarchiste, il s’ensuivra que quiconque actera à l’encontre ou se situera en dehors de cette ligne de conduite et « morale » ne pourra plus être considéré comme anarchiste, quand même il se montrerait, dans ses gestes quotidiens, l’irréconciliable négateur et contempteur des institutions archistes. A ce moment-là, l’Anarchisme n’aurait plus rien à envier à l’État ou à l’Église : il posséderait sa morale une et indivisible, sa morale ne varietur, intangible et stagnante.
Beaucoup d’individualistes anarchistes se demandent comment des penseurs du genre de Kropotkine ont pu ne pas s’apercevoir qu’en cherchant à établir une morale anarchiste unique, ils retournaient à l’exclusivisme, à l’étatisme. Pour que l’anarchisme ne se mue pas en outil de conservation sociale ou morale, il est évident qu’il est nécessaire qu’en son sein se concurrencent toutes les éthiques antiautoritaires, toutes les façons acratiques (alégales, asociales, amorales, etc.) de vivre la vie.
On m’objectera que la pratique de « la camaraderie », terme qui revient si souvent dans la terminologie individualiste anarchiste n’est pas concevable si l’on nie l’entr’aide et une réciprocité qui peut aller jusqu’au sacrifice, bien que — à l’instar de la reconnaissance — ce mot ne figure pas au dictionnaire individualiste. Sans doute, mais il ne vient à l’esprit d’aucun individualiste de prétendre ou de démontrer que « l’esprit de camaraderie » est latent au sein de l’humanité considérée en général, surtout si par camaraderie, on entend « une assurance volontaire que souscrivent entre eux les individualistes pour s’épargner toute souffrance inutile ou inévitable » et « un effort volontaire fait en vue de se procurer, entre assurés, la satisfaction des besoins et des désirs, de quelque nature qu’ils soient, que pourraient manifester les participants au contrat de camaraderie... » Il s’agit là d’une éthique particulière, spéciale à un milieu sélectionné, qui ne se recommande d’aucune antériorité, que ses protagonistes ne présentent pas comme un « devoir » universel, qui ne demande, pour être pratiquée, ni la protection de l’État ni la sanction de la loi ; qui ne veut s’imposer à personne et dont l’application dépend uniquement du bon vouloir de ceux à qui elle convient. La pratique de la « camaraderie » qu’on lui donne ce sens-là ou un autre plus restreint, reste donc l’ordre volontaire et, de ce fait, s’intègre dans le cadre des « morales » individualistes anarchistes.
— E. ARMAND.
* * *
MORALE (POINT DE VUE DU SOCIALISME RATIONNEL)
La morale est la science qui enseigne les règles à suivre pour faire le bien et éviter le mal, dit le dictionnaire, et la définition, en un sens, nous agrée. La question est de savoir si les règles proposées par cette science peuvent orienter l’humanité vers le bonheur relatif où le bien dominera. La définition que nous avons donnée ne peut se justifier que si l’homme n’est pas entièrement matière et s’il existe autre chose enfin que le phénomène et le mouvement. S’il en était autrement, il n’y aurait que fonctionnement et le bien et le mal figureraient par l’attraction et la répulsion et se confondraient dans le mouvement de l’universelle matière. Avec cette conception du monde, la morale n’a d’autre valeur que l’utilité individuelle, et cette utilité est mise à profit par les classes possédantes et dirigeantes, imprégnées de ce principe, afin d’assurer l’exploitation des masses.
La raison et sa manifestation : le raisonnement, constituent, dans l’ordre social, le moral pris dans un sens opposé au physique. Les passions comme les besoins, comme les organes, comme la vie, comme le mouvement, comme la matière, constituent le physique au sens propre, le physiologique, l’objet de l’observation que le raisonnement classe, coordonne et subordonne conformément à la raison, expression de nécessite sociale.
Cette Raison, que certains contestent tout en l’utilisant, prime tout, comme elle donne naissance à tout, parce qu’elle est la conséquence de l’union d’un sentiment réel d’existence et d’une partie de la force universelle, au-delà desquels il n’y a rien et il ne saurait rien y avoir. La règle des actions ne pourra être conforme à la Raison que lorsque la réalité de celle-ci sera démontrée. Enfin, la morale sera déterminée par la foi tant qu’il y aura croyance sociale, comme elle dépendra du raisonnement de chacun tant qu’il y aura doute et de l’assentiment général quand il y aura connaissance du droit et de son éternelle sanction.
S’il n’y a de réel, pour l’homme, que la vie présente, le raisonnement prescrit pour règle à chacun de se sacrifier tous les autres, alors que si l’âme est éternelle, la règle lui impose, même dans son intérêt, de se sacrifier aux autres. Mais, à notre époque de doute général, il s’ensuit que la morale est la non-conformité avec la raison, ou que le matérialiste, honnête homme, qui se méfie pour bien faire est un fou, de sorte qu’il ne résulte que le trouble et l’incertitude quand ce n’est pas le despotisme des passions déchaînées.
Par rapport à l’immédiat, le matérialiste a tout avantage à se sacrifier les autres et, pour lui, le succès tient lieu de morale, alors que l’honnête homme, dans ses actions réfléchies, se sent entravé de toutes parts. A notre époque de doute, la morale commune ou sociale fait défaut ; de sorte qu’il y a autant de morales que d’individus et qu’il n’y a pas de place logique pour une règle d’action dans la communauté des intérêts qui reste à réaliser.
Pour sauver les apparences, les classes dirigeantes font enseigner une morale qui a cours parmi les gens de bon ton ; mais celle-ci varie avec les circonstances et n’a rien de commun avec la théorie du devoir vrai. Voici du reste comment Proudhon la caractérise :
« La morale, c’est de n’avoir qu’une femme légitime à peine des galères et vingt maîtresses si vous pouvez les nourrir ; la morale c’est de vous battre en duel à peine d’infamie, et de ne pas vous battre à peine de cour d’assises ; la morale c’est de vous procurer le luxe et les jouissances à tout prix, sauf à échapper aux cas prévus par les codes. Mon plaisir c’est ma loi, je n’en connais pas d’autre. »
Toutes ces morales de bon ton, instituées pour protéger les riches, sont et seront sans portée sociale durable. Expérimentalement, le déshérité s’aperçoit qu’il est dupe de sophismes ; et, comme les grands, il fait sa loi quand il en entrevoit la possibilité. C’est le désordre dans cet ordre d’idées comme dans bien d’autres. D’autres moralistes ont prêché la morale gratuite avec l’idée d’orienter la mentalité générale de l’Humanité vers le bien. Là encore, l’expérience a démontré qu’elle aboutissait à un tout autre but qu’à celui qu’on cherchait à atteindre, les masses étant devenues sceptiques.
Pour peindre la société de son époque, et qui est aussi la société présente, Lamennais a tracé un admirable tableau qu’il est utile de reproduire : « Philosophes qui exaltez avec tant d’orgueil, dans vos phrases pompeuses, la raison de l’homme, il faut que vous comptiez étrangement sur son imbécillité ». Quel langage à lui tenir que le vôtre : « nul n’a le droit de te commander, en conséquence reconnais un maître. Ton unique règle est ta volonté, en conséquence obéis aux lois qui contrarient toutes tes volontés. Ton seul devoir est de te rendre aussi heureux que possible ici-bas, en conséquence renonce à tous tes intérêts, étouffe la voix du désir et celle même du besoin ; sois juste à tes dépens, soumets-toi sans murmurer aux plus dures privations, à l’indigence, au travail, à la douleur, à la faim. Tu ne dois rien espérer après cette vie, en conséquence agis comme si tu en attendais une autre ; respecte religieusement l’ordre établi contre toi, sois notre victime expiatoire et nous te payerons en retour d’un profond mépris. » Impossible d’être plus explicite pour dénoncer l’hypocrisie de ce qu’on appelle les élites... Les gouvernements affectent d’avoir une religion, et la morale qu’ils font enseigner est toujours la conséquence logique de la religion de l’époque ; rien de plus, rien de moins. Du fait de l’enseignement social relatif aux diverses époques, chaque période a reflété les mœurs de la société et il en sera toujours ainsi.
A l’hypocrisie de notre époque doit succéder la sincérité. En réalité c’est parce que les hommes ont mal raisonné jusqu’à ce jour que la morale n’a pu être le guide du devoir. Quand l’ossature de la Société repose sur l’injustice sociale, l’Humanité se dégrade en maintenant la servitude et l’exploitation générale des majorités par les minorités. La nécessité sociale, qui est l’expression temporaire de l’éternelle justice et constitue le droit humanitaire devant lequel tout droit individuel doit fléchir comme étant le salut de l’Humanité, obligera la Société à créer la vraie Morale qui donnera à chacun la liberté individuelle en harmonie avec la fatalité des événements. Il est aussi impossible à l’Humanité de vivre sans morale, c’est-à-dire sans ordre social, qu’il est impossible aux bêtes et aux choses d’exister sans ordre physique.
— Elie SOUBEYRAN.
* * *
MORALE (et Éducation)
I. DÉFINITION DE LA MORALE.
On a donné de multiples définitions de la morale. Voici l’une de ces définitions, que nous cueillons dans « Les Annales de l’Enfance » (mars 1928) : « De même que la santé peut se définir : l’adaptation parfaite de l’organisme au milieu dans lequel il vit (la maladie étant la réaction de cet organisme aux modifications survenant dans ce milieu, qu’il s’agisse de modifications physiques, traumatiques, toxiques ou infectieuses), de même on peut définir la morale, l’adaptation de l’individu au milieu familial, professionnel ou social dans lequel il devra vivre. Enfin au stade supérieur auquel ne parvient que le sujet déjà éduqué, se situe le sens moral envers soi-même, qui n’est, en dernière analyse, qu’une synthèse faite des éléments précédents et dont le résultat sera encore une plus parfaite adaptation au milieu ». (Dr Robert Jeudon.) Cette définition n’est peut-être pas parfaite, mais elle a au moins les mérites suivants : 1° elle tient compte de ce fait primordial : la morale est un produit de la vie sociale ; 2° elle distingue sans les opposer la morale individuelle et la morale collective ; 3° elle permet de comprendre qu’il n’y a pas qu’une morale puisque les milieux sociaux diffèrent dans l’espace et dans le temps.
II. ON PEUT MORALISER. LIBERTÉ, VOLONTÉ ET FORCE DES IDÉES.
La variabilité de la morale dans l’espace et son évolution dans le temps (examinées déjà dans les études qui précèdent) sont des faits tellement indiscutables que nous n’en reparlerions pas s’ils ne corroboraient pas cette vue de notre esprit : « La morale de demain ne ressemblera pas entièrement à la morale d’aujourd’hui » et ne venaient ainsi justifier notre position vis-à-vis de l’éducation morale.
Mais la moralité humaine ne changera-t-elle pas uniquement sous l’influence des transformations des conditions naturelles et économiques ? S’il en était ainsi, il serait vain de vouloir modifier la moralité humaine et bien inutile de remuer des idées morales. Toute discussion sur la morale, tout effort moralisateur sont vains pour qui n’admet pas que les idées sont aussi une force et qui ne croit pas que les individus possèdent une certaine liberté, une certaine volonté et une certaine responsabilité.
Pouvons-nous modifier la moralité humaine ? Certains se réclament du marxisme pour le nier. C’est oublier que le « Manifeste communiste » est venu à un moment où régnait un spiritualisme sociologique, où le sentimentalisme régnait en maître et où les théoriciens socialistes faisaient appel aux bons sentiments de la bourgeoisie au lieu de vivre plus intimement avec le prolétariat. Que Marx ait voulu réagir contre une idéologie sentimentale ne fait nul doute et c’est une erreur de juger sa pensée par quelques extraits de ses œuvres sans tenir compte de toute son action politique, de ses pamphlets et de ses circulaires.
Comme nous avons montré par ailleurs (voir : Éducation) que liberté et déterminisme ne se contredisent pas, nous pouvons conclure : il nous est possible de contribuer à la modification de la moralité des individus.
III. CONNAISSANCE DES RÉALITÉS. MARCHE DU PROGRÈS. EGOÏSME ET ALTRUISME.
Mais, pour agir utilement, il faut savoir, et plus d’un utopiste pourra méditer utilement ces paroles de Lévy-Bruhl :
« Lorsque la connaissance des réalités psychologiques et sociales est rudimentaire, l’imagination n’est pas retenue et il lui est aisé de construire un ordre idéal qu’elle peut opposer à ce qui est ou lui parait être du désordre. Par contre, plus de connaissance nous évite de considérer comme souhaitable ou obligatoire ce qui est impossible, de poursuivre une chimère en croyant s’efforcer d’atteindre un idéal. »
Tout d’abord, il est utile d’avoir quelques notions sur la marche du progrès. Le progrès paraît consister en une différenciation et en une concentration de plus en plus grande, ce qui, au point de vue des mœurs, se traduit par de plus en plus d’individualisme et de plus en plus de solidarité. Suivant Kirckpatrick, écrit Rouma dans sa Pédagogie sociologique, la sympathie réelle n’apparaît que lorsque l’enfant, non seulement éprouve ce que les autres éprouvent, mais se représente consciemment les autres comme ayant des sentiments identiques aux siens ; cette représentation consciente apparaît au cours de la troisième année.
« A cet âge, l’enfant sympathise avec toute la nature. L’enfant augmentant en expérience, il arrive à faire une distinction entre son propre moi et celui des autres, entre ses expériences personnelles et celles d’autrui. La tendance individualiste reprend alors le dessus et l’enfant apparaît comme profondément égoïste et indifférent aux sentiments des autres. En réalité, il est complètement dominé par ses propres expériences, par ses sensations présentes. Pour sympathiser avec la douleur de quelqu’un il faut se retrouver en lui, il faut revivre des sensations éprouvées en ce moment par lui. Il faut donc un fonds d’expérience et de douleur que l’enfant ne possède pas, il faut également assez d’imagination productrice pour se représenter l’état émotionnel éprouvé par la personne avec laquelle nous sympathisons...
« ...Il y a lieu de distinguer entre deux groupes de manifestations altruistes. Les premières sont le résultat d’une compréhension plus ample de la vie en société, elles constituent une extension raisonnée et rationnelle de l’égoïsme ; elles demandent pour être comprises et pratiquées une forte culture intellectuelle... Les secondes sont plus spécialement d’ordre sentimental et émotionnel, elles sont par cela même moins solides, moins durables, et dominées par l’impulsivité et la suggestibilité... L’enfant est essentiellement égoïste et individualiste, et cet égoïsme ne doit pas effrayer, car il constitue une phase importante du développement de l’enfant et une nécessité biologique. »
Kirckpatrick affirme également :
« L’utilité de chaque individu dépend de ce qu’il est, des connaissances et de la puissance (corporelle ou autre) qu’il possède et de l’usage qu’il en fait. Il est donc nécessaire que la première loi de la vie soit un appel à l’accroissement et au développement personnel. »
Tout comme l’enfant, le primitif a une conscience confuse. « La conscience, dit Lévy-Bruhl, est vraiment celle du groupe ; localisée et réalisée dans chacun des individus » ; « il est permis de parler de conscience collective et de prendre le groupe pour le véritable individu ». Selon le même auteur, « les individus ont dû prendre une conscience d’eux-mêmes de plus en plus nette, bien que la « socialisation » de chaque esprit n’ait fait que croître ».
En résumé :
-
au début de l’enfance, comme au début de l’humanité, on ne trouve ni égoïsme, ni altruisme, mais un état d’amoralité qui se différencie, par la suite, en égoïsme et en altruisme ;
-
la personnalité de l’individu est due à la vie en société et c’est par les contacts, les heurts de son moi avec le moi d’autres individus que chaque homme prend conscience de son moi et le développe, par suite l’opposition de l’individu à la société ne se justifie pas et un idéal anti-individualiste est aussi un idéal anti-social ;
-
la forme supérieure de l’altruisme étant aussi la forme supérieure de l’égoïsme, l’égoïsme actuel ne peut être considéré comme un excès du développement de l’individualité, mais comme une insuffisance de ce même développement.
IV. SCIENCE ET RAISON.
La science des mœurs est encore dans un état embryonnaire et s’appuie principalement sur deux sciences presque aussi jeunes qu’elle, en tant que sciences : la psychologie et la sociologie. De plus, même si ces sciences étaient parfaites elles ne pourraient nous imposer un idéal moral incontestable.
Henri Poincaré disait, en 1910 :
« Si les prémisses d’un syllogisme sont toutes deux à l’indicatif, la conclusion sera également à l’indicatif. Pour que la conclusion pût être mise à l’impératif, il faudrait que l’une des prémisses au moins fût elle-même à l’impératif. Or les principes de la science, les postulats de la géométrie sont et ne peuvent être qu’à l’indicatif ; c’est encore à ce même mode que sont les vérités expérimentales, et à la base des sciences, il n’y a, il ne peut y avoir autre chose. »
Il disait encore :
« Le moteur moral, ce ne peut-être qu’un sentiment. »
Mais dans la même conférence, H. Poincaré montrait que la science peut cependant jouer un rôle utile à la morale, ainsi que le montrent les deux exemples suivants :
« Les psychologues nous expliqueront pourquoi les prescriptions de la morale ne sont pas toujours d’accord avec l’intérêt général. Ils nous diront que l’homme, entraîné par le tourbillon de la vie, n’a pas le temps de réfléchir à toutes les conséquences de ses actes ; qu’il ne peut obéir qu’à des préceptes généraux ; que ceux-ci seront d’autant moins discutés qu’ils seront plus simples et qu’il suffit, pour que leur rôle soit utile et pour que, par conséquent, la sélection puisse les créer, qu’ils s’accordent le plus souvent avec l’intérêt général. »
« Les historiens nous expliqueront comment des deux morales, celle qui subordonne l’individu à la société, et celle qui a pitié de l’individu et nous propose pour but le bonheur d’autrui, c’est la seconde qui fait d’incessants progrès, à mesure que les sociétés deviennent plus vastes, plus complexes, et, tout compte fait, moins exposées aux catastrophes. »
A côté de la science, ou plus exactement des sciences, la réflexion philosophique a été utile au progrès moral. Lévy-Bruhl dit :
« La pratique morale enveloppe toujours des contradictions latentes, qui se font sentir peu à peu, sourdement, et qui se manifestent enfin, non seulement par des luttes dans le domaine des intérêts, mais par des conflits dans la région des idées. L’effort conscient pour résoudre ces contradictions n’a pas peu contribué au progrès moral. »
En résumé : ni la science, ni la raison ne peuvent nous fournir des lois morales impératives et cependant l’une et l’autre pourront nous aider dans la détermination de notre idéal moral.
V. MORALE ET SATISFACTION DES BESOINS.
Pratiquement, malgré toutes les discussions théoriques, il est des fins morales tellement universelles et instinctives qu’il n’est guère besoin de la science ou de la raison pour les fixer. Il est même une fin générale que l’on retrouve au fond de toutes les morales et qui est imposée aux individus par les nécessités biologiques et sociales. On peut ainsi, en un certain sens, parler de la fixité de la morale : les buts particuliers et les moyens varient dans l’espace et dans le temps, mais la fin générale demeure.
Cette fin n’est-elle point — ainsi que le prétendent certains moralistes — le bonheur ? Evidemment les hommes recherchent leur bonheur, mais ceux qui le cherchent le plus consciemment ne l’atteignent pas toujours le plus sûrement.
En réalité, on obtient le bonheur quand on atteint un but poursuivi : le bonheur est un produit surajouté de notre activité, le but réel est toujours la satisfaction d’un besoin, d’une tendance. C’est donc la satisfaction des besoins qui formera la base de notre morale.
Sans doute le principe de la satisfaction des besoins est moins généralement apparu dans la littérature morale que le principe de l’utilité. Les religions ont même d’ordinaire posé à la base de leur morale l’utilité et la non-satisfaction des besoins. Mais nous ne nous inquiétons pas d’une utilité future en vue d’un paradis céleste auquel nous ne croyons plus et si les lois religieuses ont prêché, pour les pauvres et les esclaves, la non-satisfaction des besoins et des tendances, il n’empêche que, dans la pratique humaine, toujours et toujours, les hommes se sont efforcés de satisfaire leurs besoins et leurs tendances et que les sociétés humaines n’ont progressé que dans la mesure où elles n’ont pas tenu compte de cette loi religieuse soi-disant morale et soi-disant divine.
A chaque instant le prêtre catholique se dresse devant nous et prêche son idéal : supprimer des besoins ou ne les satisfaire que maigrement. Supprimer les besoins, mutiler l’être, tel ne saurait être notre but ; nous voulons, au contraire, que la vie soit vécue pleinement et nous croyons que nous devons satisfaire nos besoins dans la mesure où cette satisfaction, n’est pas contraire à notre idéal égalitaire nécessaire à l’harmonie sociale. Notre idéal est un idéal d’harmonie : harmonie dans l’individu, par la satisfaction des besoins utiles de cet individu ; harmonie sociale, par la satisfaction des besoins utiles de tous les individus.
VI. MORALE ET CRÉATION DE BESOINS NOUVEAUX.
Tenant compte de la loi de différenciation du progrès, nous croyons même que nous devons nous créer des besoins nouveaux et plus particulièrement des besoins intellectuels.
Se créer des besoins nouveaux peut paraître un idéal peu enviable, si l’on songe à certains besoins que les individus se sont précédemment créés : au besoin de l’alcoolique, par exemple. Mais lorsque l’on veut juger de l’utilité ou non de la création de nouveaux besoins, il est peu logique de ne tenir compte que de quelques besoins artificiels et anormaux qui, la plupart du temps, n’ont pris naissance que parce que les individus ont cherché un dérivatif à la non satisfaction de besoins utiles.
Constatons que, conformément à la loi du progrès, le nombre des besoins des individus n’a cessé de croître et qu’en définitive il est né plus de besoins utiles que de besoins inutiles.
VII. DOUBLE ROLE DES ÉDUCATEURS : BUTS ET MOYENS.
Le rôle des éducateurs, parents ou pédagogues professionnels, est double : d’une part, convaincus de la possibilité d’une action moralisatrice efficace, ils doivent fixer les buts de cette action, c’est-à-dire s’efforcer de déterminer pour eux un idéal moral qui ne soit pas chimérique et qui n’aille pas à rencontre du progrès ; d’autre part, il leur faut rechercher et employer les moyens qui conviennent aux buts poursuivis. Nous avons consacré quelques pages à la première partie de ce rôle et nos lecteurs pourront s’aider également des diverses études consacrées ici à la morale. Il nous reste à parler des moyens.
VIII. POURQUOI L’ÉDUCATION MORALE EST NÉGLIGÉE. CONNAISSANCE DE L’ENFANT.
Pour exercer une action moralisatrice efficace, il faut d’abord le vouloir et le bien vouloir. Or, on ne le veut pas, ou on le veut mal, lorsqu’on sacrifie l’éducation morale à l’instruction. Cette négligence de l’éducation morale est générale et tient à des causes diverses.
En premier lieu, pour moraliser autrui, il faut se moraliser soi-même. Il le faut, si nous voulons prêcher d’exemple et vaincre, notre propre égoïsme, qui est peut-être le plus important obstacle qui se présente à nous. N’est-il point égoïste celui qui néglige de consacrer quelque temps à l’étude des questions éducatives ? Egoïste encore celui qui laisse ses enfants agir à leur fantaisie pour être tranquille. Egoïste aussi le père despote pour qui ordres, défenses, punitions sont des moyens commodes de gouvernement familial.
En second lieu, l’éducation morale est négligée, parce qu’on ne sait pas.
Binet écrit :
« Ne confondons pas les méthodes de l’éducation avec le but de l’éducation. Le but est de faire des hommes libres, mais la méthode ne peut pas consister à traiter un enfant en homme libre, ni a faire appel à sa raison, quand il est encore à un âge où il n’a pas de raison. »
Benoit Bouché écrit :
« On peut enseigner avec de réels résultats sans connaître l’âme de son élève, on ne peut éduquer dans la même ignorance. »
Ce dernier pédagogue écrit encore :
« Les enfants et les adolescents de même âge ont des caractères généraux ou communs et des caractères individuels.
Tous les enfants normaux de six ans, de huit ans, de dix ans, de douze ans, de quinze ans, sont aux mêmes stades successifs du développement et les lois de cet accroissement physique, mental, affectif, jouent pour tous les individus. Mais tous les enfants normaux considérés ont en propre des hérédités congénitales et des hérédités acquises ou éducations différentes d’un sujet à l’autre. Il en résulte que cette double évolution vitale de l’enfant, des enfants, l’une spécifique et l’autre individuelle, est une indication de première importance pour l’éducateur. Celui-ci doit avoir égard pour chaqueenfant à cette double évolution spécifique et individuelle qui fait que chaque enfant ressemble à tout autre et en diffère. »
Pour faire l’éducation morale des enfants, il faut donc apprendre à connaître l’enfant, en général, et on y parviendra surtout par l’étude, puis apprendre à connaître chaque enfant par une observation attentive et sympathique. Nos lecteurs voudront bien se reporter au mot « Enfant » pour l’étude de l’enfant normal moyen, aux divers stades de son développement. A ce mot (comme aussi à : Éducation, Liberté, École, Coéducation, etc...) ; ils trouveront déjà de nombreuses indications relatives à l’Éducation morale qui nous permettront d’abréger les conseils que nous voulons leur donner maintenant.
IX. EXTENSION DU BESOIN D’ATTACHEMENT.
S’il ne faut pas confondre le but de l’éducation morale et les moyens éducatifs, il ne faut pas non plus perdre de vue ce but au commencement de l’oeuvre éducative. Rappelez-vous qu’il s’agit tout à la fois de développer chez l’enfant l’aptitude à la vie en société et la personnalité.
« Le grand précepte, qu’il ne faut jamais perdre de vue jusqu’aux environs de la septième année, écrivait A. Baumann, peut se formuler ainsi : fortifier assez la nature morale de l’enfant pour que, chez lui, le besoin d’attachement se sépare de l’instinct conservateur et s’étende à d’autres êtres que la mère, celle-ci demeurant tout de même le point central de son affection.
De là, dans la pratique, une double tâche. D’abord il faut habituer le tout petit à supporter l’éloignement de la mère. Elle se mettra loin de lui en restant visible. Puis elle deviendra invisible, mais fera entendre sa voix. Finalement, elle s’absentera pour une durée progressivement accrue, et l’enfant devra en arriver à se sentir relié moralement à elle, même pendant une absence prolongée. Le point délicat consiste à mesurer ce que les forces de l’enfant lui permettent de supporter en fait de séparation. Le danger serait que l’instinct conservateur ne s’affolât chez lui... D’un autre côté, l’affection maternelle, par sa, vivacité, éveille toujours un mouvement réciproque chez le petit et, si cette réciprocité venait à manquer trop, l’enfant ne sortirait pas assez vite de la pure animalité...
La deuxième partie de la tâche... consiste à étendre l’attachement à d’autres êtres que la mère... Comme l’habitude de supporter l’absence de la mère, celle de se trouver en compagnie de gens autres que celle-ci ne s’acquiert que par étapes successives. Les divers membres de la famille, les amis, les voisins se trouvent naturellement désignés pour cet apprentissage. Mais une condition indispensable est à observer. Pour que l’instinct conservateur ne s’alarme point, il faut, surtout au début, surtout si l’enfant s’annonce craintif, le rassurer par beaucoup de douceur dans l’attitude et le ton de voix. »
II faut que, peu à peu, l’enfant s’habitue à la société de ses égaux (ses petits camarades), des grandes personnes qui doivent « se faire elles-mêmes un peu enfants » et des animaux.
« Tous ceux qui ont observé de jeunes enfants savent que ceux-ci prêtent aux animaux une âme semblable à la leur, qu’ils leur adressent des discours remplis de conviction, et que ces mouvements de sympathie se trouvent souvent payés de retour. Pareils jeux me semblent très favorables à cette extériorisation de la personnalité, où je vois le premier résultat qu’il faille se proposer d’atteindre. Mais on fera en sorte que l’enfant se comporte avec douceur... »
X. IL FAUT CRÉER DES HABITUDES MORALES. AUTORITÉ ET EXEMPLE. QUELQUES CONSEILS.
La culture et l’extension du besoin d’attachement n’est pas seulement la première préparation de l’enfant à la vie sociale, elle est encore un moyen d’agir sur l’enfant avec un minimum de contrainte.
L’enfant n’est pas un être totalement mauvais qu’il faut corriger mais sa nature n’est pas non plus foncièrement bonne et il ne faut pas trop s’en rapporter à la vie et aux sanctions naturelles — souvent dangereuses — pour sa formation morale. Il y a, en tout enfant, des tendances naturelles qui sont mauvaises, au moins sous la forme où elles se présentent, il faut modifier ces tendances si l’on veut obtenir quelques changements dans la manière d’agir de l’enfant.
Binet dit :
« L’éducation morale ne consiste pas seulement à suggérer des idées justes, larges et humaines ; elle ne consiste pas seulement à faire naître, au moyen de paroles appropriées, des sentiments louables. Ni les idées, ni les sentiments ne suffisent ; il faut encore que l’action s’ensuive. Un être bien éduqué moralement est celui qui agit d’une manière morale... L’action isolée ne suffit pas... Il faut que l’action se répète qu’elle s’organise, qu’elle devienne une manière d’agir qui n’exige point d’effort, qui se fait naturellement. Le résultat n’est pas atteint tant qu’on n’a pas créé une habitude. » (Les Idées Modernes sur les Enfants, pp. 309–310.)
L’emploi des idées, l’utilisation de la sensibilité enfantine, sont sans doute des moyens de parvenir à ce résultat, mais ils ne conviennent pas avec des jeunes enfants : « l’enfant, avant sept ans, ne saurait discuter, ni comprendre ces mystérieuses règles morales qui déroutent parfois la réflexion des adultes eux-mêmes. » (M. Prevost)
L’enseignement moral aux petits enfants n’a que deux procédés efficaces : L’un est l’affirmation. L’autre est l’exemple.
... L’enfant s’accroche volontiers à une main solide ; il se laisse emporter joyeusement dans des bras fermes.
Mais il se méfie des mains qui tremblent ; il pleure quand des bras débiles veulent le lever de terre. L’enfant respecte et chérit la force physique, dès qu’il sait que cette force est coalisée avec sa propre faiblesse. Pareillement, dans le domaine moral, l’enfant apprécie la netteté, la fermeté, la décision, la force de ceux qui le gouvernent. Son instinct lui révèle qu’avec de tels gouverneurs, il a plus de sécurité...
... Les deux préceptes essentiels qui contiennent toute la morale enfantine, c’est :
-
« Il faut obéir » ;
-
« Il ne faut pas mentir. »
... Ces deux préceptes contiennent bien toute la morale enfantine, car ils sont la condition essentielle de l’éducation, c’est-à-dire du perfectionnement moral de l’enfant. Si l’enfant désobéit ou s’il ment, vos moyens d’agir sur lui seront paralysés...
... L’exemple. Ce second agent de l’éducation morale des enfants... est assurément le plus énergique. Seulement, la paresse éducatrice de bien des parents, une paresse qui mérite ici le nom de lâcheté, en rend l’usage moins commun. Trop souvent même l’exemple contredit l’affirmation. » (Lettres à Françoise, maman.)
Tout ce que nous venons d’extraire des « Lettres à Françoise maman » nous paraît fort juste, mais nous n’en saurions dire autant des moyens employés par le même auteur pour combattre la désobéissance et le mensonge. Plus utiles aux parents éducateurs seraient les conseils de D. C. Fisher (Les enfants et les mères), et ceux que nous avons trouvés dans une brochure publiée par le Comité national suisse d’hygiène mentale :
« Comment l’enfant prend ses habitudes.
Les habitudes, chez l’enfant, dépendent beaucoup des influences que le milieu ou les circonstances ont sur son esprit. En effet, sa mentalité est extrêmement formable plastique et prompte à accepter des suggestions ainsi qu’à imiter ce qu’il voit et entend. C’est pourquoi l’enfance est le meilleur moment pour tacher d’établir les habitudes désirables et changer ou éliminer les tendances qui, dans la vie ultérieure, pourraient se révéler désavantageuses. La plasticité de l’esprit humain diminuant rapidement avec les années, c’est donc dans l’enfance qu’il faut prévenir l’éclosion des mauvaises habitudes. »
De cette brochure, extrêmement riche en conseils, nous allons extraire presque tout ce qui a trait à l’obéissance, non seulement parce que le problème de l’obéissance est l’un des plus importants qui se posent à qui veut faire l’éducation des jeunes enfants, mais encore parce que nos lecteurs anarchistes risquent de confondre la liberté et le développement de la personnalité, qui sont des buts, avec les moyens éducatifs appropriés, puis, à la suite d’un échec, de revenir à des moyens de pure contrainte également mauvais.
« I. — Vous employez peut-être une mauvaise méthode pour vous faire obéir.
Observez-vous si l’enfant fait attention à ce que vous dites quand vous lui donnez un ordre ? Un enfant occupé à jouer peut parfaitement ignorer que vous lui parlez.
Lui donnez-vous des ordres sans avoir l’intention ferme de les faire exécuter ? L’enfant s’en aperçoit bien vite et ne se donne plus la peine de les écouter.
Lui permettez-vous aujourd’hui une chose pour laquelle vous le punirez demain ? Si l’enfant ne sait pas exactement et toujours ce qu’il doit faire, il sera fortement tenté d’essayer la chose défendue.
Promettez-vous à l’enfant des récompenses pour le faire obéir ? Si vous avez cette habitude, c’est une bonne affaire pour lui que de ne pas obéir et de se faire payer toujours plus cher son obéissance.
Essayez-vous d’effrayer l’enfant pour lui faire exécuter ce que vous commandez ? Au début il est possible que la peur le fasse obéir vivement, mais, ou bien il s’habituera, assez vite à l’objet de sa peur et n’y fera plus attention ou bien il deviendra un enfant timide et nerveux.
Rendez-vous la désobéissance intéressante par l’excitation des conséquences éventuelles que vous évoquez ? Les enfants désobéissent quelquefois « pour voir » ce qui adviendra.
Donnez-vous des ordres auxquels la nature même de l’enfant l’empêche d’obéir ? Grondez-vous, par exemple, constamment l’enfant qui se trouve à l’âge où l’on a un besoin absolu de mouvement ? A chaque instant, vous criez : « Tiens-toi donc tranquille » ; « Ne fais pas de bruit » ; « As-tu fini », etc., etc. Sachez que son système nerveux a autant besoin d’activité que son corps a besoin de nourriture. Vous feriez mieux de lui donner l’occasion de jouer ou d’être utilement actif.
II. Vous êtes-vous demandé ce qu’il faut faire pour mériter l’honneur que vous fait un petit enfant en vous obéissant ou. en ayant confiance en vous ?
Tenez-vous toujours vos promesses ? Pourquoi l’enfant aurait-il confiance en quelqu’un qui le trompe ? Et quand la confiance s’en va, l’obéissance s’en va également. Si l’enfant continue parfois à obéir, c’est parce que vous êtes plus grand et plus fort que lui.
Prenez-vous garde de ne pas favoriser l’un ou l’autre de vos enfants, de ne demander à chacun d’eux que ce que ses capacités lui permettent de faire et de donner à chacun suivant ses besoins particuliers ?
Vous gardez-vous de donner des ordres et de punir dans la colère ? La colère est contagieuse : si vous êtes furieux, il y a des chances pour que l’enfant le devienne ou soit terrorisé et fasse alors des choses qu’il ne ferait pas de sang-froid.
Donnez-vous quelquefois des ordres inutiles, simplement pour montrer votre autorité ? Un enfant sait très bien quand on abuse de l’autorité contre lui et se révolte.
Vous donnez-vous la peine de considérer les motifs des actions de l’enfant ou le punissez-vous simplement parce que son acte a des conséquences fâcheuses ? Exemple : Un enfant qui a fait une maladresse ou casse quelque chose en essayant de rendre service n’est pas méchant pour autant.
Exposez-vous l’enfant à des tentations auxquelles il peut difficilement résister à son âge ? Et si vous le punissez trop sévèrement, ne sera-t-il pas tenté de mentir pour échapper à la punition ? Si vous laissez traîner des choses dont vous savez qu’il a envie, n’est-ce pas être un peu trop exigeant que de s’attendre à ce qu’il ne les prenne pas ? Les parents doivent aider l’enfant à bien agir et non lui rendre facile de mal faire.
III. Vous êtes-vous demandé POURQUOI les enfants doivent obéir à leurs parents ?
— Il y a des parents qui obéissent à leurs enfants. Aussi ces enfants sont-ils habitués à penser que la vie leur donnera tout ce qu’ils demanderont. Et quand ils apprennent, à leurs dépens, que ce n’est pas le cas, cela leur est très dur... Il y a aussi des enfants qui obéissent trop bien. On ne leur permet ni de penser ni d’agir pour leur propre compte. Adultes, ils sont des hommes, des femmes incapables de se diriger eux-mêmes et ayant besoin toujours de quelqu’un qui leur dise ce qu’ils ont à faire. »
Les autres conseils de cette brochure ne sont pas moins précieux, mais, pour ne pas allonger démesurément notre étude, nous nous contenterons de glaner ceux qui nous paraîtront les plus utiles.
« Comment faut-il traiter les crises de colère chez l’enfant ? Le traitement doit être adapté à chaque enfant (chaque enfant est différent d’un autre). Il faut donc tenir compte de la cause des crises de colère. Si les crises sont causées par l’habitude qu’a l’enfant d’imposer sa volonté, cessez de la lui accomplir. Si c’est pour attirer l’attention sur lui, ne faites plus attention à ses crises. Par contre, essayez peut-être de faire attention à lui quand il fait quelque chose de bien. S’il a ses crises pour obtenir un avantage, cessez de lui accorder ces avantages. Si les crises sont dues à des causes physiques, comme manque de sommeil, manque d’exercice, efforcez-vous de faire cesser ces causes. Si la cause est en vous-même il vous faudra évidemment du courage pour renoncer à vos propres mauvaises habitudes... Tâchez de contrôler vos colères et vos habitudes... »
« Comment pouvez-vous favoriser le développement intellectuel de vos enfants ?
Leur donnez-vous l’occasion de jouer avec des camarades de leur âge ?... Quant un enfant vit trop exclusivement avec des adultes qui le cajolent, il ne trouve pas dans cette société la stimulation dont il a besoin. Si ces adultes sont au contraire stricts et sévères, il prendra l’habitude d’une trop grande dépendance. S’il ne joue et ne se plaît qu’avec des enfants plus jeunes que lui, il n’aura pas assez de peine à se donner pour jouer un rôle important ;
Essayez-vous d’encourager leur sens d’initiative et de responsabilité ? On ne naît pas avec un sens de responsabilité. Donnez-leur l’habitude de tâches qui exigent du jugement et laissez-leur trouver tout seuls les moyens de s’en tirer. »
« Il faut aider l’enfant jaloux à surmonter la jalousie qui est une forme particulière d’égoïsme. 1° Apprenez-vous aux enfants à prêter leurs jouets et à respecter les droits des autres enfants ? 2° Les encouragez-vous à aimer et protéger leurs petits frères et sœurs ? 3° Ou bien, au contraire, trouvez-vous amusant qu’un enfant soit jaloux de son cadet. Essayez-vous de l’exciter à ce propos, de le mettre en colère ou de le faire pleurer en cajolant l’autre devant lui ? 4° Vous pouvez aussi stimuler la jalousie en vantant d’autres enfants devant les vôtres et en les citant constamment comme modèles, surtout si vos enfants ont déjà tendance à être jaloux. 5° Avez-vous des favoris et vous montrez-vous partial ? »
Voici quelques conseils donnés aux parents pour leur permettre...
« ...d’éviter les fautes les plus fréquentes :
Vous faites-vous des soucis exagérés à propos de la santé de vos enfants ?...
Dorlottez-vous excessivement vos enfants ?...
Vous empressez-vous de satisfaire les désirs de vos enfants tout simplement parce qu’ils veulent qu’il en soit ainsi ?...
Croyez-vous qu’on peut dire n’importe quoi aux enfants, leur raconter des mensonges, leur faire des menaces illusoires pour les amener à faire ce qu’ils doivent ? Mentir aux enfants est une chose très sérieuse. Il ne faudra pas vous étonner plus tard s’ils perdent leur confiance en vous ou s’ils mentent eux-mêmes.
Enlevez-vous toute initiative à vos enfants ? Comment voulez-vous alors que leur volonté se développe ? Comment apprendront-ils à décider les choses par eux-mêmes quand ils seront grands ?
Mettez-vous constamment des freins à l’activité de l’enfant ? Un enfant qui est arrêté à chaque instant par des observations, des ordres, des défenses, est un peu dans la situation d’un individu auquel on a lié les mains. Ce n’est pas en s’attachant les mains qu’on apprend à s’en servir.
Etes-vous trop ambitieux pour vos enfants ?...
Etes-vous trop raides, sévères, grondeurs avec vos enfants ? Repoussez-vous leurs confidences en leur disant de ne pas vous ennuyer avec leurs bêtises ? Et pourtant, leur esprit leur sentiment désirent que vous, parents, soyez un peu leurs camarades. Ils voudraient un papa qui soit aussi leur ami et une maman qui comprenne tout...
Voici trois choses importantes à retenir :
1. Gardez votre sang-froid.
Le bon sens et la bonté sont les meilleurs facteurs de l’éducation.
Apprenez tous les jours davantage à être de bons parents. Ne pensez pas que vous savez tout ce qu’il faut pour cela : il y a toujours quelque chose à apprendre. Si l’on vous révèle une vérité un peu dure pour vous, parce qu’elle vous montre vos fautes d’éducation, ne permettez pas à votre vanité offensée de vous empêcher de devenir de meilleurs parents. »
Les auteurs, après avoir parlé de certaines anomalies de conduite, terminent ainsi leurs conseils :
« Dans tous ces cas, faites de votre mieux pour comprendre l’enfant et gagner sa confiance absolue. Vous pourrez alors, en suivant les principes que nous avons donnés, entreprendre de réformer ses mauvaises habitudes. Mais, si vous ne réussissez pas ou ne savez pas comment vous y prendre, ne vous obstinez pas, par fausse honte, à garder votre souci pour vous seuls. Consultez quelqu’un qui puisse vous aider ! »
Ainsi dans leurs « conclusions », les auteurs de cette brochure ne manquent pas d’insister sur la nécessité de « comprendre l’enfant », c’est-à-dire de rechercher quelles sont les tendances qui provoquent sa manière d’agir — et de « gagner sa confiance absolue », — ce qui est tout à la fois un moyen de le mieux connaître et un moyen de l’améliorer moralement sans entrer en lutte avec sa propre volonté.
« On n’éprouvera pas de bien grandes difficultés », dit Baumann, à corriger l’enfant de ses petits défauts, « si on a pris le soin préalable de développer l’attachement pour la mère et le milieu familial. Ce penchant va de pair avec cette inclination égoïste qu’on nomme la vanité et qui nous fait rechercher l’approbation de ceux dont la société nous agrée. Un enfant sérieusement attaché à ses parents tiendra beaucoup à leur approbation. Il suffira parfois de froncer les sourcils pour le faire changer d’attitude ; comme il suffira de l’inviter à « faire plaisir » pour qu’il obéisse... Mais il faut bien se mettre ceci en tête : tous ces moyens et tous les moyens similaires n’aboutiront que dans la mesure où on aura donné au besoin d’attachement une intensité faute de laquelle les plus habiles resteraient sans prise sur les jeunes natures. »
Claparède dit :
« L’acquisition de bonnes habitudes constitue la part peut-être la plus importante de l’éducation morale. »
Mais, ajoute le psychologue, elle pose un problème délicat :
« Ne risque-t-on pas, en pliant l’enfant à certaines habitudes, de porter atteinte à l’indépendance et à l’originalité de son caractère ? « La seule habitude qu’on doit laisser prendre à l’enfant, disait Rousseau, est de n’en contracter aucune. » L’auteur d’Émile voulait que l’enfant restât toujours « maître de lui-même » et qu’on ne portât pas atteinte à ses dispositions naturelles en leur substituant cette « seconde nature » qu’est l’habitude. Le problème revient donc à ceci : les habitudes doivent être pour nous des auxiliaires, non une chaîne. Elles doivent s’harmoniser avec le caractère, non en entraver la libre expression. Elles doivent faciliter le jeu de la volonté et non le détruire. Elles doivent rendre plus aisée l’adaptation aux événements habituels, sans empêcher l’adaptation aux circonstances nouvelles et se transformer en routine. »
Concluons. L’un des buts de l’éducation, le plus important jusque vers sept ou huit ans, est la formation de bonnes habitudes. Cette formation doit être réalisée en tenant compte des tendances de chaque individu. Il s’agit, tout en respectant la personnalité de chacun, de préparer les individus a des comportements variés, mais cependant tous compatibles avec une vie aussi harmonieuse que possible.
XI. FACTEURS DU COMPORTEMENT. ÉTAT PHYSIOLOGIQUE. FACTEUR AFFECTIF : BESOINS, TENDANCES.
Les conclusions qui précèdent nous amènent à nous demander quels sont les facteurs du comportement d’un individu adulte. Remarquons que le comportement n’est autre chose que la réaction de l’individu à des excitations externes ou internes. Ces excitations peuvent être physiques, sociales et personnelles.
Les instituteurs peuvent constater que leurs élèves sont plus irritables, plus turbulents lorsqu’il fait grand vent ou quand le temps est orageux ; qu’ils sont plus nonchalants lorsque la température est chaude et lourde. « Une névralgie, un rhumatisme, un trouble intestinal transforment la gaieté en mélancolie, la bonté en méchanceté, la volonté en nonchalance. » La joie ou la tristesse peuvent résulter du plus ou moins d’activité sanguine, la colère d’un certain état nerveux, la peur d’un état de débilité fonctionnelle, etc. L’air que nous respirons, nos aliments agissent aussi sur notre comportement.
L’influence du milieu social : « Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es », est également indéniable. Enfin, comme nous l’avons montré au mot « liberté », l’individu adulte est capable de se déterminer lui-même en une certaine mesure. Mais le comportement de l’enfant est déterminé par l’hérédité et le milieu. Dans notre pensée nous ne devons donc pas considérer l’enfant comme responsable de ce comportement. Cependant, dans nos rapports avec lui il en va tout autrement, car il importe de cultiver en lui le sentiment de la responsabilité qui est, lui aussi, une cause déterminante de la conduite. Traitons les enfants comme des êtres responsables de leurs actes, puisque c’est utile à leur formation morale, mais faisons-le avec mesure et indulgence en nous disant bien, s’il nous faut réprimander ou punir, que les réprimandes et les punitions ne doivent pas être des châtiments, mais des moyens de perfectionnement moral.
Le comportement de l’enfant dépendant dans une large mesure de son état physiologique (état musculaire, nerveux, fonctions organiques, système endocrino-sympathique, etc.), rappelons-nous aussi la vieille maxime : Mens sana in corpore sano (une âme saine dans un corps sain) Pour corriger ce que nous appelons les défauts de nos enfants, pour leur faire acquérir de bonnes habitudes il est toujours utile et souvent indispensable d’agir sur leur corps. On moralise par l’hygiène et aussi par la médecine.
Le docteur Decroly écrit :
« Chez la plupart des humains, le moteur par excellence de tout l’appareil nerveux supérieur est le facteur affectif, la sensibilité comme on dit encore, c’est-à-dire l’ensemble des inclinations, tendances, appétits, besoins, sentiments, dont l’action est variable d’individu à individu et chez le même individu d’un moment à l’autre. Lorsque M. Coué, de Nancy (dont la méthode dite de suggestion par auto-suggestion consciente fait en ce moment le tour de l’Europe occidentale), dit que la volonté n’est pas le moteur de nos actes, mais attribue ce rôle à l’imagination, il entend par imagination ce que le vulgaire exprime le plus souvent par là, c’est-à-dire l’activité mentale inconsciente ; or, cette activité inconsciente est orientée, gouvernée par les désirs, les aspirations, la foi, l’idéal, c’est-à-dire par le côté affectif de l’être. »
Ajoutons, avec Vermeylen, — et ceci nous ramène à ce que nous avons dit du comportement et de l’état physiologique — que :
« La vie affective élémentaire plonge ses racines dans la vie organique dont elle n’est au début qu’une sorte de transcription psychique. »
« A chaque fonction organique correspond une tendance particulière : à la nutrition la faim, à la vision le besoin de voir, à la locomotion le besoin d’exercice et chacune de ces tendances se manifeste lorsque la fonction ne s’exerce pas régulièrement ou lorsqu’elle s’exerce insuffisamment... » (Traité de Psychologie, de Dumas, p. 431.)
Lorsque les tendances répondent à des fonctions organiques qui demandent à être satisfaites d’une façon pressante on leur donne le nom de besoins : besoin de chaleur, besoin de nourriture, besoin d’oxygène, besoin de repos, besoin de mouvement, etc. Si les tendances répondent à des fonctions psychiques complexes, elles admettent généralement un assez long retard dans leur satisfaction ou peuvent même être abandonnées et on leur donne le nom d’inclinations.
Vermeylen écrit :
« Entre les besoins et les inclinations, il y a place pour toutes les tendances qui viennent se greffer sur les fonctions les plus diverses. »
On réserve donc d’ordinaire le nom de tendances à celles qui sont intermédiaires entre les besoins et les inclinations, ces trois mots expriment donc surtout une différence de degré.
Or, il y a chez tout individu des tendances favorables et d’autres tendances qui ne le sont pas, non seulement pour la société, mais aussi pour l’individu lui-même, par exemple la colère, la peur, etc., et ceci nous explique que le docteur Decroly nous dise que le but de l’éducation est surtout « de créer de bonnes habitudes, c’est-à-dire de renforcer des dispositions affectives innées quand celles-ci sont favorables, et d’aider au développement de dispositions affectives acquises pour combattre celles qui sont défavorables. »
Résumons-nous à nouveau :
-
Pour moraliser un enfant il faut surtout lui faire acquérir de bonnes habitudes ;
-
pour faire acquérir de bonnes habitudes à cet enfant, il faut favoriser le développement harmonieux de ses tendances utiles et combattre ses tendances nuisibles.
Ceci nous pose de nouveaux problèmes : Peut-on, vraiment, combattre une tendance ? N’y a-t-il pas danger à le faire ?
« Spontanée ou dirigée, l’éducation en vient ainsi à réprimer certaines tendances naturelles. Il se produit, dès lors, des conflits entre des instincts, particulièrement l’instinct sexuel ou l’instinct de conservation et de défense, et des tendances acquises, imposant le respect de la pudeur. L’inhibition incomplète, le « refoulement » des instincts peut, dans des organismes mal équilibrés, orienter des désordres mentaux, des obsessions... » (Piéron : Psychologie expérimentale)
« Les psychanalystes constatent que les instincts refoulés ne sont pas tués, mais continuent dans le subconscient une vie souterraine, cause directe de troubles, de névroses et de psychoses de toute espèce. » (Ferrière : Le Progrès spirituel)
« Mais l’influence éducative, qui ne peut vraiment créer des sources d’énergie, et qui, en réalité utilise, en les dirigeant, en les dérivant, les forces profondes des instincts, ne combat réellement certaines tendances innées qu’en leur assurant une certaine satisfaction, sous des formes compatibles avec l’équilibre social. » (Piéron)
Le seul moyen d’éviter un refoulement, lorsque le libre jeu d’un instinct est rendu impossible pour une cause péremptoire et inchangeable, d’ordre matériel ou moral, est de lui trouver un débouché ailleurs, un emploi utile et qui canalise l’énergie inemployée. Ainsi les jeux sportifs sont une canalisation de l’instinct combatif. Et si l’on ne peut prévenir le mal, s’il y a refoulement, la méthode thérapeutique sera, en principe, la même : il faut essayer :
-
de découvrir la tendance refoulée (c’est affaire au médecin) ;
-
de la canaliser comme il vient d’être dit ;
-
de mettre le sujet à même de la « sublimer ». Ce dernier terme... signifie ceci : mettre l’instinct, jadis refoulé, jadis cause de troubles affectifs ou mentaux, au service d’un idéal élevé ; en faire, sous cette forme, une partie intégrante, non seulement de notre vie quotidienne, mais de notre meilleur moi (Ferrière).
Tout instinct, toute tendance, a un rôle biologique utile, ce qui est mauvais, c’est l’excès, ou l’insuffisance ou l’action hors de propos.
Le docteur Allendy dit :
« Il faut seconder l’effort de la Nature qui tend spontanément à la perfection, il ne faut rien détruire, mais tout conduire, ne rien supprimer, mais tout utiliser..., ne rien contrarier, mais tout guider. Si un homme est né violent... il doit transmuer sa violence en élans généreux. »
Mais pour canaliser ou sublimer les tendances il faut connaître la signification biologique de chacune d’elles.
Laissant de côté les besoins nous pourrons utiliser avec profit la classification de Decroly-Vermeylen :
-
TENDANCES LIÉES A LA CONSERVATION DE L’INDIVIDU :
-
Tendances défensives :
-
colère ;
-
prudence ;
-
timidité ;
-
-
Tendances offensives :
-
colère ;
-
irritabilité ;
-
violence ; brutalité, cruauté ;
-
taquinerie, moquerie ;
-
rancune.
-
-
-
TENDANCES LIÉES A LA VIE DE RELATION :
-
Tendances groupales :
-
sympathie, antipathie ;
-
esprit de famille, de clan, de parti, de classe etc. ;
-
-
Tendances éducatives :
-
curiosité ;
-
jeu ;
-
imitation ;
-
-
Tendances extensives :
-
amour-propre : orgueil, ambition, vanité, susceptibilité ;
-
propriété : jalousie, convoitise, collectionnisme ;
-
concurrence : émulation, envie ;
-
approbation ;
-
-
Tendances supérieures :
-
intellectuelles ;
-
éthiques ;
-
religieuses ;
-
esthétiques.
-
-
-
TENDANCES LIÉES A LA CONSERVATION DE L’ESPÈCE :
-
Tendances sexuelles.
-
Tendances familiales et parentales.
-
Cette classification, bien incomplète, appelle quelques remarques. D’abord les tendances varient considérablement d’intensité, par exemple certains auteurs parlent du besoin de propriété ; ensuite nous constatons, par exemple, que le collectionnisme est une forme de la tendance à la propriété et ceci nous permet de comprendre qu’une certaine tendance (ou besoin) à la propriété nuisible à notre idéal social peut être canalisée vers le collectionnisme. Il y a une échelle de valeur dans les besoins et les tendances et nous devons être très circonspects dans nos jugements sur un besoin qui ne nous paraît pas primordial, mais qui est cependant vivement ressenti par l’enfant, sur la genèse de ce besoin, l’utilité ou non de sa conservation et, le cas échéant, sur les moyens à mettre en œuvre pour le canaliser ou le sublimer.
Un exemple montrera mieux la complexité des problèmes sociologiques, psychologiques et pédagogiques que pose l’étude d’un seul besoin.
XII. UN EXEMPLE : L’ÉDUCATION MORALE ET LE BESOIN DE POSSÉDER CHEZ LES ENFANTS.
Chez le petit enfant on constate le besoin de posséder. Si nous en croyons le tableau précédent ce besoin serait une tendance extensive. Est-ce bien exact ? Ce besoin est-il biologique ou est-il seulement héréditaire ? Est-il un besoin primordial ou un besoin secondaire né plus particulièrement du besoin d’alimentation ? Il nous parait impossible de répondre à ces questions avec certitude. Le sentiment de révolte que nous éprouvons en présence de l’injustice sociale pourrait nous suggérer des réponses. Nous nous défions de telles réponses qui, si elles étaient inexactes, justifieraient des applications pédagogiques dont les résultats ne seraient pas ceux que nous désirons. Notre société est, à certains égards, une société malade et sous les apparences il faut trouver le mal réel, profond, tout comme le médecin qui ne considère la fièvre que comme un symptôme.
Le docteur Boigey écrit :
« Au fur et à mesure de leurs progrès nos ancêtres cherchèrent d’abord à s’approprier les aliments, ensuite ce qui en fournit, c’est-à-dire la terre, les troupeaux, les armes plus tard, les choses utiles, enfin les choses agréables, presque aussi nécessaires que celles-ci, plus nécessaires même pour les civilisés. Cette succession de biens excita les désirs de l’homme et peu à peu une véritable jouissance fut attachée à leur possession. »
Cette explication est évidemment vraisemblable, mais est-elle vraie ? Ne nous faut-il pas, pour expliquer ce besoin, remonter à ces temps lointains de la préhistoire que Niceforo appelle « cette aurore magique qui éclaire, dans toutes les formes de sa survivance, notre vie civilisée d’aujourd’hui ». Ne trouverions-nous pas l’explication des origines de ce besoin dans l’un des deux principes de la magie que cet auteur énonce ainsi :
« Ce qui a fait partie d’un être ou d’un objet, ou ce qui a été en contact avec lui continue pour toujours à faire partie de cet être ou de cet objet, à rester en rapport avec lui et à en présenter les qualités et les défauts. »
Peut-être faut-il rechercher plus loin encore et remonter à ces temps où la conscience individuelle n’existait pas encore, où l’individu, amoral et alogique, était seulement une fraction du groupe. Qui nous prouve que dans l’éveil du moi ce moi ne s’est pas tout d’abord borné à se distinguer des moi qu’il voyait semblables à lui et n’a pas englobé en lui les objets ou êtres différents avec lesquels il était plus particulièrement en contact, ayant ainsi à se différencier encore des objets ou êtres qui continuaient de former un prolongement à son propre individu, non par suite d’une extension, comme l’indiquent Decroly-Vermeylen, mais à cause d’une différenciation encore imparfaite.
Cette distinction du « mien » et du « moi » est-elle maintenant toujours bien établie ? « Au sens le plus large du mot, dit James, le moi enveloppe tout ce qu’un homme appelle sien. » Et Ch. Blondel :
« Il est tout à fait théorique d’arrêter, sans plus d’examen, les limites du moi à la surface du corps... Le vrai psychologue ne sait pas si le mien est ou non la plus noble partie du moi : c’est bien, du reste le moindre de ses soucis. Pour rattacher provisoirement le mien au moi, il lui suffit de l’impossibilité où il est de les distinguer clairement. Les rapports qu’ils entretiennent sont même si constants, si étroits qu’on a pu soutenir que la conception du moi se dégageait à la longue du concept du mien, né lui-même au cours de l’expérience infantile du sentiment des pouvoirs que nous avons et de l’action que nous exerçons sur ce qui nous entoure. »
Qui peut nous dire laquelle de ces hypothèses est la vraie ? N’est-il pas vraisemblable que le besoin de posséder est un besoin complexe et que ces hypothèses sont toutes partiellement exactes ?
Frappé des maux que cause le régime capitaliste actuel et désireux de changer ce régime, l’éducateur révolutionnaire, ou même réformiste, peu au courant des données de la psychologie et de la sociologie et des incertitudes de ces sciences, n’hésite pas à proclamer la nécessité de combattre l’instinct de propriété et imagine des moyens de lutte inefficaces ou même dangereux.
Mieux averti, connaissant ce que nous venons d’exposer à propos de la genèse de ce besoin ; n’ignorant pas que le droit de propriété individuelle est en recul incessant (disparition du droit de propriété sur les individus, expropriations, droits sur l’héritage, etc.) ; sachant que la tendance à la possession est un véritable besoin, c’est-à-dire est particulièrement intense, lors de ces périodes affectives que l’on observe au début de l’enfance et au début de l’adolescence, il saurait mieux quel est le but qu’il est possible et désirable de poursuivre, quand il faut agir et comment il faut le faire.
Précisons. I1 nous semble utopique de vouloir chasser de l’esprit des individus normaux toute idée du « mien » ; il ne nous semble pas non plus désirable de le faire puisqu’au demeurant le « mien » est une étape vers le « moi » et qu’il paraît contradictoire de vouloir tout à la fois combattre la tendance à la possession et aider à l’épanouissement de la personnalité ; mais l’histoire et la psychologie nous montrent que cette tendance à la propriété peut être modifiée dans un sens favorable à. la vie sociale. Nous pensons qu’il est bon qu’au début de l’enfance l’individu ait des choses qui soient à lui, bien à lui ; il serait vain d’ailleurs à ce moment de vouloir combattre le besoin naissant ; l’égocentrisme enfantin rendrait la chose impossible et l’on ne pourrait obtenir que des refoulements dangereux. Le début de l’adolescence est aussi une période critique où il serait mauvais de combattre ce besoin vivement ressenti, mais où l’on peut préparer sa canalisation et sa sublimation.
Contre le besoin de possession ou plutôt contre ses.. excès il sera peu efficace d’employer les sermons, les prêches et les raisonnements. I1 ne sera pas inutile cependant d’amener les grands élèves de nos écoles à réfléchir aux questions morales. Une institutrice de Genève, pédagogue au grand cœur, s’est efforcée de savoir ce que les enfants pensaient de la richesse et de la pauvreté. Son ouvrage : « Ce que pensent les enfants : Richesse et Pauvreté » (Editions Forum, Neuchàtel et Genève, Paris, 33, rue de Seine), pourrait rendre de grands services à tous ceux qui veulent, par leurs leçons, combattre l’injustice sociale et magnifier le travail. Mais Mlle Descœudres, auteur de l’ouvrage dont nous venons de parler, ne compte pas seulement sur la parole pour moraliser les enfants ; elle écrit :
« Ce n’est pas le moindre mérite de l’école active, justement parce qu’elle fait agir l’enfant, de le mettre à même de mieux apprécier tout le talent et l’intelligence des travailleurs manuels et de vaincre cette sotte manie — vestige elle aussi d’un autre âge — d’un mépris plus ou moins avoué pour le travail manuel.. »
L’éducateur dispose encore de deux moyens principaux d’action. D’abord il peut faire dériver la tendance à la possession vers une voie où elle ne risque pas d’être une gêne pour la collectivité tout en donnant satisfaction à l’individu. L’instinct du collectionneur, qui est une forme dérivée de l’instinct de propriété, est un de ces moyens et il est d’autant plus recommandable que, sagement employé, il peut rendre des services appréciables a l’éducation intellectuelle.
Dans les classes où l’on distribue gratuitement des fournitures et des livres, on peut user d’un autre moyen. Puisque les idées morales naissent surtout des nécessités sociales, il est possible de combattre la tendance à la propriété individuelle en organisant les classes de telle façon que les enfants y sentent la nécessité de la possession collective. Transformer les classes livresques en écoles actives ce sera lutter contre la tyrannie de la tendance à la propriété individuelle. Faites qu’en ces écoles les enfants coopèrent, qu’ils aient à se servir d’un matériel à usage collectif. Par exemple, au lieu de donner à vos élèves des dictionnaires tous semblables, remettez-leur de petits dictionnaires différents, faites-les leur échanger parfois pour comparer les définitions des mots — l’éducation intellectuelle n’aura qu’à y gagner — et permettez-leur de consulter, lorsqu’il sera utile, un dictionnaire plus complet, et partant plus coûteux, prévu pour l’usage de tous.
Quelques remarques me paraissent utiles pour clore cette étude du rôle de l’école à l’égard du besoin de possession. D’abord c’est que nous avons indiqué seulement les moyens qui nous paraissaient les plus efficaces. Il en est d’autres, par exemple l’appel au sentiment à l’aide de lectures ou de récits, etc... Ensuite, c’est que clans le choix des moyens il faut tenir compte du développement intellectuel et affectif des enfants : par exemple, ce n’est que vers neuf ans que l’enfant devient vraiment capable de sociabilité, i1 est donc inutile de vouloir faire l’éducation sociale des tout jeunes enfants et l’appel à la coopération ne doit être fait qu’au moment le plus favorable.
XIII. QUELQUES PRÉCISIONS SUR LE DÉVELOPPEMENT AFFECTIF.
Il faut, comme nous venons de l’indiquer à propos du besoin de posséder, tenir compte du développement de l’enfant. Ce n’est, dit Mme Vauzelle qu’à sept ans à peu près que l’enfant sent l’injustice, et la pitié est beaucoup plus tardive encore. Tout sentiment compatissant, dit-elle, naît d’une privation, il faut vivre assez longtemps, c’est-à-dire laisser croître ses muscles et enrichir son intellect de sensations multiples, avant d’atteindre à la vie sentimentale. « En vain, ajoute t-elle, la vieille école multiplie-t-elle les leçons de morale et d’histoire... elle ne fait autre chose que le bruit d’un grelot, si elle ne suit pas étroitement la ligne du développement mental des élèves, si elle ne se conditionne pas, en un mot, à leur vie réelle. »
Le Docteur Crichton Miller a étudié le développement sentimental des garçons et des filles. D’après lui, ce développement semblerait passer par les phases suivantes :
-
Pour les garçons : Jusque vers 7 ou 8 ans : la phase de la Mère. De 8 ans vers 12 ans : la phase du Père. De 12 ans vers 18 ans : la phase de l’École. A partir de 18 ans : la phase de la Femme.
-
Pour les filles : Jusque vers 8 ou 9 ans : la phase de la Mère. De 9 ans vers 15 ans : la phase de l’École. De 15 ans vers 18 ans : la phase du Père. A partir de 18 ans : la phase du Mariage.
L’intérêt qui prédomine à chacune de ces phases n’est pas le seul, mais il importe « que nous veillions au sentiment prédominant dans chaque phase, car c’est celui-là qui, à ce moment, déterminera le développement de l’enfant ».
Les observations du Docteur Crichton Miller, en ce qui concerna la phase de la Mère, justifient les conseils de A. Baumann, que nous avons indiqués à propos de l’extension du besoin d’attachement. Lors de la phase du Père, c’est l’exemple donné par celui-ci qui dirige les sentiments du garçon. Remarquons que cette phase se produit chez les filles après celle de l’École, à l’inverse de ce qui se passe chez les garçons. Observons aussi, avec l’auteur, qu’il existe chez les filles un instinct permanent : l’instinct maternel. (Lire à ce sujet : Alice Descœudres : Le sentiment maternel chez la jeune fille, éditions Forum.)
« La petite fille, poussée inconsciemment par l’instinct maternel, parle à ses poupées des foules d’enfants qu’elle aura plus tard, mais déclare qu’un mari ne serait qu’une gène. »
Plus tard, elle apprend la nécessité du père et d’un acte physique assez mystérieux et terrifiant. Si alors l’exemple de son père lui montre que l’homme peut être pour elle un bon compagnon, son développement se poursuivra normalement jusqu’à la phase du Mariage. Cette terreur peut résulter aussi d’un manque d’éducation sexuelle » (voir ce mot). Mme Béatrice Webb, dans sa brochure : L’Enseignement aux enfants quant à la reproduction de la vie, nous dit :
« Un enfant assez âgé pour une intelligente question, est assez âgé pour une intelligente réponse. »
« Aussi, répondons, dès les premiers pourquoi ; à 3, 4 ou 5 ans, l’enfant peut savoir qu’il vient de sa mère, et il l’en aimera davantage : et puis, ce sera mis de côté, dans un coin de son cerveau, pour être retrouvé plus tard. Le principal n’est pas de tout dire, mais de ne rien dire de faux qu’il faudra démolir par la suite, et qui contribuera à creuser l’abîme qui éloignera l’enfant de nous, qui fera perdre la confiance qu’il a en nous. Des quatre périodes de pourquoi, la première est la plus délicate (3 à 7 ans). C’est là que nous consolidons l’édifice dès la base, ou, qu’irrémédiablement, nous perdons la confiance de l’enfant. C’est la plus importante.
Vers 12 ou 13 ans, l’enfant doit connaître par nous ce qu’est la paternité. Nous devons oser avouer la grande et belle loi de la reproduction. Nous devons commencer à éveiller la conscience hygiénique, le sens de la responsabilité vis-à-vis de la famille, de la descendance, le sentiment de contrôle et de respect de soi-même. Il ne faut pas attendre le tournant de la puberté, où l’enfant prend conscience de lui-même et devient timide. Tout cela doit être dit pendant que l’enfant est enfant et qu’il ne voit de mal à rien. » (Mme B. Weill.) « Toutes ces peurs, dit aussi Mme Guéritte qui résume le Docteur Miller, persistent dans l’inconscient des petites filles et ruinent souvent leur vie à l’adolescence ou à la maturité, parce qu’elles ne peuvent confier leurs craintes à personne, si elles n’ont pas près d’elles une mère, ou une autre femme, assez intelligente et avertie pour leur donner les explications voulues et les rassurer. Veillez de près ajoute-t-elle, sur la petite fille qui, dans ses jeux, prend toujours un rôle d’homme, ou sur celle qui a des allures de « garçon manqué ». Ce sont les signes de la peur du mariage. »
Le développement harmonieux du garçon peut être également compromis, quoique pour une cause différente. Entre les deux phases extrêmes « intervient dans la vie normale de tout garçon une longue période d’homo-sexualité psychologique où il ne s’occupe que des individus de son propre sexe, et où le père et les camarades sont les facteurs prédominants de ses sentiments. Il importe que, pendant cette période, la mère sache se tenir à l’écart et admette que son influence doit subir momentanément une éclipse. Si elle veut continuer à dominer la vie sentimentale de son fils, à y tenir la première place, elle risque de paralyser totalement son développement ; car tant que la mère maintient avec son fils les mêmes relations que pendant son enfance, il est impossible à celui-ci de transformer son attitude envers l’autre sexe... Le garçon court alors le danger d’avoir vis-à-vis des femmes dans l’avenir, l’attitude du petit garçon vis-à-vis de sa mère... Le cas de ces fils qui adorent tant leur mère qu’ils ne peuvent ni être amoureux normalement, ni se marier, rentrent dans cette catégorie des garçons dont le développement a été bloqué par la sollicitude exagérée et pernicieuse de leur mère.
Mais cette faiblesse maternelle est souvent causée par la sévérité paternelle... Si le père présente à ses garçons une image de la vie masculine trop dure, ou trop rigide, ou trop parfaite et trop difficile à atteindre, ceux-ci reculent d’effroi. Si l’autorité est trop dure pour l’enfant, il devient un mouton docile ou un rebelle ; si c’est la réalité qui est trop dure, il y échappe en se créant un monde de rêves ou en se jetant dans la grossièreté matérialiste. »
Les psychologues sont d’accord sur le point suivant : il ne peut y avoir de morale sans respect de règles ou respect de celui qui impose des règles. Mais comment l’enfant parvient-il à ce sentiment de respect, mélange de crainte et d’amour, qui est le fondement du sens moral ? Un psychologue suisse, Piaget, s’étant efforcé d’analyser le respect de l’enfant, a reconnu qu’il y avait deux sortes de respects, éveillant deux attitudes morales différentes : I° le respect unilatéral que l’enfant éprouve pour son aîné, son supérieur ; 2° le respect mutuel, qui lie deux égaux, « par exemple deux enfants de 11 ou 12 ans jouant ensemble et respectant chacun les conventions de leurs jeux. »
Les plus jeunes enfants en sont au stade du respect unilatéral, c’est-à-dire de l’obéissance envers les règles qui leur sont imposées. Ils aiment d’ordinaire obéir à ces règles à la lettre, à la condition cependant que ces règles soient simples et peu nombreuses ; ils trouvent tout naturel d’être punis lorsqu’ils n’ont pas respecté une règle imposée, mais cherchent beaucoup plus à éviter une nouvelle punition qu’à observer la règle. Au contraire, parvenus au stade du respect mutuel, ils ont beaucoup de respect envers de multiples règles qui sont pour eux des conventions mutuelles qui peuvent être changées par accord de la majorité. Ce qui compte pour les plus grands, ce ne sont plus les apparences, mais les intentions : il faut obéir volontairement à l’esprit des règles actuelles.
Piaget dit :
« Nous voyons donc que ceux qui appliquent le plus mal une règle sont ceux qui la respectent le plus, tandis que ceux qui l’appliquent le mieux considèrent que cette loi est relative et peut être modifiée...
Nous avons là les deux sortes de respect : l’un qui est unilatéral et n’a aucune part dans la conscience morale des enfants, l’autre qui est mutuel et fait partie de leur personnalité. C’est ici que nous trouvons la véritable obéissance, le vrai sentiment du bien... Le respect unilatéral engendre le sentiment du devoir, mais il reste extérieur à l’enfant. D’autre part, le respect mutuel crée l’autonomie morale, le sentiment du bien. »
Il mène à la coopération, à l’indépendance et à une compréhension de la vie morale meilleure que l’autre.
Cette distinction du respect unilatéral, qui résulte d’un rapport de contrainte, et du respect mutuel qui caractérise un rapport de coopération est d’une grosse importance pour le choix des techniques propres à l’éducation morale. Par suite du développement mental du jeune enfant, au caractère égocentrique, il faut tout d’abord savoir se contenter du respect unilatéral, et user de la contrainte en imposant jusque vers sept ou huit ans des règles aussi peu nombreuses que possible et qui n’admettent pas d’exception. Ces règles seront d’autant mieux respectées que nous saurons prêcher d’exemple. Mais il faut aussi que nous comprenions que le respect mutuel ne peut s’acquérir que par des relations entre égaux. C’est par l’école active — et non pas seulement les méthodes actives — que l’on peut le mieux permettre aux enfants de dégager des règles et des habitudes morales, de leurs jeux, de leurs travaux collectifs, de l’entr’aide qui devrait prendre dans nos écoles la place qu’y tenait autrefois la concurrence.
Mais l’école active est une exception et la plupart des maîtres songent bien plus à enseigner et imposer des règles morales qu’à faire naître de telles règles de la vie scolaire mieux organisée. « La sagesse, la docilité, l’attention, dit Baucomont, sont pour le maître les vertus capitales de l’écolier modèle. Ce ne sont pas celles de l’enfant. Qu’à cela ne tienne : il adoptera, six heures par jour, respectera et pratiquera une morale de façade pour l’école et pour le maître. Nous avons la paix. Cela nous suffit si nous n’avons cure de ce qui se passe au fond.
« Au fond, cependant, chaque enfant a édifié peu à peu, à l’insu des adultes, parents et maîtres, une conception de la morale, une somme plus ou moins riche des règles de la vie collective. Et cette morale, pratiquée par tous les enfants, dans leurs occupations et leurs jeux, hors de la présence des adultes, n’est pas tout à fait la nôtre. Elle n’accorde pas la primauté aux vertus qui nous semblent les plus importantes : elle en révèle d’autres que nous laissons, à l’école du moins, au second plan, souvent parce que la pratique de ces vertus troublerait notre tranquillité ou atteindrait au vif notre orgueilleuse assurance. »
Nous ne possédons actuellement, en France, que des esquisses de l’étude sociologique des groupes enfantins qui nous permettrait de connaître quels sont les caractères, les modalités, les constantes de la moralité de fait, pratiquée spontanément par les enfants et que nous pourrions considérer comme les solides fondements sur quoi édifier leur moralité future : la morale des société adultes.
On trouvera une amorce de cette sociologie enfantine dans les travaux de G. Varendonck : Recherches sur les sociétés d’enfants (Misch et Thron, Bruxelles. 1914) ; R. Cousinet : La Solidarité enfantine (Revue philosophique, 1908) ; Ad. Ferrière : L’Autonomie des Ecoliers (Delachaux et Niestlé) ; F.-W. Foerster : L’École et le Caractère (Delachaux et Niestlé). » (Baucomont oublie de citer : Rouma : Pédagogie sociologique (Delachaux et Niestlé) et M. Lejeune :L’observation du caractère dans les associations d’adolescents. (Document 9 de l’Union Belge d’Éducation morale.)
« Si peu avancées que soient les recherches en ce sens, elles permettent néanmoins déjà de déceler quelques-unes des tendances morales dominantes parmi les groupes d’enfants :
-
L’esprit de camaraderie et d’entr’aide (aider les autres, au travail et au jeu, leur prêter les objets dont ils ont besoin) ;
-
L’esprit de justice (donner raison à celui qui le mérite) ;
-
L’esprit de solidarité (prendre le parti de son groupe, ne pas le trahir) ;
-
L’esprit de conformisme (ne pas se distinguer des autres ; ne pas poser) ;
-
L’esprit d’initiative (savoir se débrouiller, se tirer d’affaire dans les circonstances difficiles) ;
-
La confiance en soi, l’énergie morale, la volonté (oser, ne rien craindre) ;
-
L’esprit de conciliation (chercher à accorder ses désirs à ceux des autres) ;
-
L’enthousiasme (communiquer passionnément ses idées et ses sentiments aux autres). » On pourrait ajouter :
-
Le respect de la parole donnée ;
-
L’amour de l’approbation, etc... »
Baucomont ajoute :
« Ces vertus sont celles que l’enfant apprécie entre toutes, puisque ce sont celles que l’on trouve le plus souvent réunies chez les meneurs, les leaders et chefs de clans, et ce sont elles qui assurent leur prestige et établissent leur autorité.
Or, si ce ne sont pas là des vertus spécifiquement scolaires, de celles qui conquièrent à l’élève les louanges, les récompenses et les faveurs du maître, on accordera qu’elles constituent pourtant les éléments non négligeables d’une morale susceptible d’orienter d’une façon très élevée et très féconde la conduite de la vie.
Le rôle de l’éducation morale scolaire peut donc être nettement tracé : pour qu’il n’y ait pas antagonisme entre la morale du maître et celle des enfants, l’éducateur, non seulement ne doit pas ignorer ou méconnaître les sentiments, opinions et jugements moraux des enfants, mais il doit, au contraire, les utiliser, les laisser pratiquer et les pratiquer pour son propre compte dans ses rapports avec les enfants.
Cette conciliation de la morale des adultes (celle que nous voulons enseigner aux enfants et leur faire adopter avant l’heure) et de la morale enfantine ne peut évidemment pas s’opérer par le moyen d’un enseignement didactique, de prêches et de leçons. Ce ne peut être qu’une pratique, un mode d’agir et de vivre. »
XIV. LES DÉFAUTS DES ENFANTS.
L’enfant, dit le Docteur Gilbert Robin, « n’a pas de défauts : il est mal élevé ou malade ». (Dr G. Robin : L’enfant sans défauts, Flammarion, édit,). Pour corriger les enfants de leurs prétendus défauts, il faut d’abord faire l’éducation des parents et c’est ce que nous allons tenter de faire, aussi brièvement que possible. Tout d’abord il faut que chacun soit bien convaincu que l’intervention d’un médecin compétent est souvent utile, qu’elle est même indispensable dans les cas graves, où il est bon que le médecin soit aussi psychologue. C’est donc au psychiâtre qu’il faut, si besoin est, demander conseil.
-
Paresse. — Causes :
-
d’origine physiologique : soit le fonctionnement morbide du cerveau, soit un ralentissement de la nutrition provenant, le plus souvent d’une mauvaise hygiène alimentaire, soit maladie du système nerveux (neurasthénie infantile) ; dans tous ces cas, l’enfant ne peut fournir l’effort qu’on lui demande ;
-
d’origine mentale : l’enfant, bien portant, se refuse à un travail contraire à ses goûts. Remèdes : Suivant les cas : meilleure hygiène alimentaire (choisir de préférence des aliments qui se digèrent facilement) ; exercice physique modéré (la fatigue physique s’ajoute à la fatigue mentale) ; emploi du temps bien régulier ; emploi de toniques, après avis du médecin, massages, douches, etc. ; enseignement intéressant, motivé, aussi peu abstrait que possible, réservant une place aux activités manuelles.
-
-
Peur. Timidité. Bouderie. — Causes : a. Constituent souvent des réactions de défense passive. Parmi les causes de la peur les unes sont externes : obscurité ; animaux ; hommes ; impression fortes (scènes de famille, etc.) ; imagination surexcitée (récits et lecture) ; souvenirs de souffrances éprouvées, de peurs antérieures ; sollicitude excessive des parents. D’autres causes sont internes et résultent d’un état maladif (faiblesse générale), des prédispositions héréditaires, d’une trop grande suggestibilité (la peur est extrêmement contagieuse). Remèdes : Faire disparaître les causes ; agir sur le physique en fortifiant l’individu — mais en évitant les abus alimentaires du soir, causes de bien des terreurs nocturnes ; rechercher l’origine des habitudes de peur, puis raisonner l’enfant à leur sujet, procéder avec patience et sans brusquerie, utiliser la suggestion.
La vraie timidité est cependant distincte de la peur ; elle résulte le plus souvent d’une éducation trop sévère et despotique ; elle est aggravée par la conscience d’une infériorité (bègues), la tendance à s’analyser et la débilité. On la traite par un régime fortifiant et une éducation affectueuse, encourageante. Alors que la timidité est surtout un défaut d’adolescent, la bouderie est fréquente au cours du jeune âge.
« Au cours de la bouderie, l’enfant ne peut changer d’attitude ou obéir : rien ne peut brusquement modifier son état émotionnel. Abstenez-vous et ne raisonnez pas. Discutez dans quelques heures ou demain. N’essayez pas de combattre son émotion, car vous l’amènerez souvent à commettre des actes graves pour lesquels il est irresponsable et à propos desquels vous ne pourrez intervenir qu’avec injustice... Observons et intervenons après la crise. » (Demoor et Jonckheere)
-
Tristesse. — Les causes de la tristesse sont à peu près les mêmes que celles de la paresse et de la peur, partant, les remèdes sont également analogues.
-
Colère. Esprit de révolte. Brutalité. Cruauté. — Peuvent être le plus souvent considérées comme des réactions de défenseactive et d’attaque.
Causes de la colère. — La colère a des causes très variées et parfois opposées ; ses causes externes peuvent être : des contrariétés provenant de réprimandes, punitions (voir ce mot), etc. ; des blessures d’amour-propre ; la jalousie ; des injustices ; les exemples du milieu ; l’excès de faiblesse ou l’excès de sévérité ; un temps orageux, etc., etc. ; les causes internes résultent soit de tempéraments faibles, mais très nerveux et facilement irritables, soit d’un excès de vigueur et de tares héréditaires (alcooliques, etc.).
Remèdes à la colère. — Dans tous les cas, il faut opposer à la colère de l’enfant la douceur, la patience et la fermeté. Il faut éviter tous les motifs de crise, et lorsqu’une crise éclate la limiter autant que possible : s’il se peut ne pas punir et dans le cas contraire ne jamais menacer d’une punition qui ne pourra être appliquée. Eviter les punitions corporelles et la répression au cours de l’accès. Rechercher les causes de la colère pour y adapter les remèdes, par exemple traiter la colère du débile nerveux par une hygiène alimentaire convenable, un emploi du temps bien régulier, des fortifiants musculaires et, au contraire, pour les enfants vigoureux en excès, atténuer cette vigueur par une alimentation surtout végétarienne, lui permettre de se dépenser dans des exercices physiques et des jeux, employer des calmants nerveux (bromure de potassium, etc., etc.)
L’esprit de révolte est le plus souvent une colère légitime de l’enfant contre des éducateurs maladroits ou trop sévères ou injustes... La cruauté de l’enfant est causée le plus souvent, par un défaut de développement intellectuel et affectif, l’enfant est alors cruel par ignorance. Elle peut aussi résulter de la peur, de la colère, de l’exemple.
Il est d’autres défauts, mais ceux que nous venons de citer sont, avec la désobéissance, le mensonge, la jalousie, dont nous avons déjà parlé (X) — voir aussi études correspondantes, — les plus fréquents et les plus graves.
XV. LES DÉFAUTS DES PARENTS.
Notre étude des défauts des enfants nous a permis de montrer que ces défauts résultent fort souvent d’une mauvaise éducation, c’est-à-dire des défauts des parents.
Beaucoup d’erreurs éducatives résultent de l’égoïsme des parents éducateurs et de leur sentiment de l’autorité. Certes, il faut que les petits enfants obéissent, mais il faut aussi que ce soit dans leur propre intérêt et il est nécessaire également que les parents, tenant compte de l’évolution de leurs rejetons les préparent peu à peu à l’indépendance, il faut qu’ils abdiquent peu à peu leur tutelle et développent l’aptitude de l’enfant à se conduire seul.
Même lorsque les parents doivent obtenir l’obéissance ils usent trop souvent de moyens qu’ils devraient éviter : punitions et récompenses, menaces et promesses, crises de colère et de tendresse, ordres et sermons sont des choses également néfastes comme aussi la contradiction des deux époux, mais quelle qu’en soit la cause, l’enfant sait fort bien en tirer parti au grand dommage de son éducation.
Il faut d’abord que les parents pensent que leurs enfants ne sont pas leur propriété et qu’ils veuillent peu à peu les aider à devenir des individus libres. Mais l’éducation est une œuvre de confiance et les parents trop souvent encore perdent la confiance de leurs enfants par des maladresses dont voici les plus fréquentes : écarter les enfants de la conversation des grandes personnes ; ne pas répondre intelligemment aux questions intelligentes des enfants ou y répondre sans souci de la vérité et sans penser que l’enfant s’il découvre la tromperie perdra confiance en qui l’a trompé ; railler les enfants ou les traiter avec dédain pour leurs remarques ou leurs questions naïves, l’enfant sent que l’adulte veut s’élever en l’abaissant et cherche ailleurs un confident ; être trop sermonneurs, trop critiques ; être d’humeur variable : tolérant aujourd’hui ce qu’on punira demain, etc.
Troisième défaut, non moins important que les deux précédents : on prêche en parole, mais pas par l’exemple.
Enfin, si les parents sont généralement, pleins de bonne volonté, s’ils aiment leurs enfants ils ignorent trop souvent comment ils devraient remplir leur rôle d’éducateurs et, le pis, c’est qu’ils ignorent leur propre ignorance ; ils supposent que pour bien élever leurs enfants beaucoup d’amour et un peu de logique suffisent. Or, cela ne suffit pas toujours. Les parents ont le défaut de ne point consulter assez souvent ceux qui pourraient utilement les conseiller : médecins, psychologues et pédagogues.
XVI. LES DÉFAUTS DE L’ÉCOLE.
L’École devrait, s’efforcer de donner une éducation et une instruction qui assurent à chaque individu un développement convenable. — Nous renvoyons aux mots : école, éducation, enfant, instruction, liberté, etc. pour de plus amples explications sur notre conception de ce rôle de l’École. Elle devrait aussi s’efforcer de préparer les enfants qui lui sont confiés à la vie sociale. En résumé, son rôle est double ; 1° elle doit éduquer et instruire chaque individu de façon que chacun puisse développer harmonieusement sa personnalité ; 2° elle doit développer chez tous l’aptitude à la vie sociale.
Si nous tenons compte de ce double rôle nous pouvons faire à l’École actuelle les reproches suivants :
-
L’École n’accorde pas une importance suffisante aux besoins, aux tendances, aux intérêts des enfants et de chaque enfant en particulier. Il faudrait, pour cela, que les éducateurs :
-
apprennent à mieux connaître chacun de leurs enfants , fassent place à des travaux individuels libres. De ceci il résulte que les travaux que l’on exige des élèves ne sont pas suffisamment motivés pour eux, d’où la nécessité pour le maître de faire appel à des motifs extrinsèques : récompenses punitions, concurrence. Ces motifs extrinsèques sont de faible valeur et souvent plus nuisibles qu’utiles ;
-
-
A l’école on se préoccupe beaucoup plus de faire apprendre que de développer les pouvoirs actifs, les facultés créatrices, l’esprit de recherche ;
-
L’École est naturellement conservatrice. Les dirigeants, veulent que les éducateurs forment de bons citoyens, adaptés d’avance à la vie sociale actuelle et ne désirant pas la changer (v. individualisme : éducation). Tout au contraire, l’enseignement de l’École devrait avoir pour but de procurer aux enfants l’intelligence sociale, c’est-à-dire la capacité d’observer et de comprendre leur milieu tout en développant leur esprit critique et leur volonté. Ceci leur permettrait d’être, plus tard, aptes à concourir utilement aux modifications qu’ils jugeraient utiles d’apporter à cet état social. Il faudrait, pour parvenir à ce résultat, modifier les programmes et les méthodes en usage ;
-
L’École ne procure pas davantage aux enfants l’aptitude à la vie sociale. Tout notre système scolaire est basé sur l’autorité, la réceptivité et la concurrence, alors qu’il faudrait, en tenant compte du développement des enfants, réaliser : l’autonomie scolaire qui formerait des individus libres ; l’école active qui tendrait à se rapprocher de la vie sociale réelle, ferait une plus large place aux activités manuelles et à l’entr’aide.
XVII. CONCLUSION.
Œuvre de confiance et d’amour, l’Éducation morale est aussi une œuvre de savoir. A cette œuvre devraient collaborer les parents et les maîtres qui trop souvent encore s’ignorent. Les instituteurs pourraient, s’ils le voulaient, mettre bien des parents en garde contre des erreurs éducatives dont nous avons signalé ici les plus fréquentes. De leur côté, ils apprendraient, au contact des travailleurs, a mieux comprendre la vie sociale. Luttant coude à coude contre les forces d’oppression, parents et instituteurs comprendraient qu’ils ne doivent pas être des oppresseurs ; que la paternité, ne donne pas un droit de propriété ; que le mot maître ne doit plus signifier celui qui commande et punit, mais celui qui stimule, conseille et aide ; que les uns et les autres doivent favoriser l’entr’aide des enfants et cultiver leur idéalisme. « Donnons aux enfants, écrivait Roorda, un élan pour la vie. Et si cet élan doit les porter au-delà du point où notre lassitude et notre prudence nous ont fixés ; si un jour, avec l’ardeur et la liberté d’esprit qu’ils nous devront, ils attaquent les dogmes de notre imparfaite sagesse, — tant mieux. » En ce sens, une véritable éducation morale ne peut être que révolutionnaire.
— E. DELAUNAY.
A CONSULTER. — Chez Flammarion, édit. : Les Idées modernes sur les Enfants (A. Binet) ; Les Enfants et les mères(Dorothy Canfied-Fisher) ; L’enfant sans défauts (Dr Gilbert Robin). — Chez A Colin : Le corps et l’âme de l’enfant (Dr Maurice Fleury). — Chez Alcan : Éducation et hérédité (M. Guyau). — Chez Delachaux et Niestlé : L’École et l’Enfant (J. Dewey) ; L’école et le caractère (F.-W Foerster) ; Pédagogie sociologique (G. Rouma), etc. Voir également les bibliographies des sujets d’éducation et la bibliographie ci-après sur morale.
* * *
<biblio>MORALE. — BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE.
Aristote : Ethique à Nicomaque. — G. Aslan : L’expérience et l’invention en morale.
Boistel : Le droit dans la famille. — Bakounine : Œuvres diverses. — S. Barni : La morale dans la démocratie ; Histoire des idées morales et politiques en France au XVIIIe s. ; Les moralistes français au XVIIIè siècle. — Bouillier : La vraie conscience ; Morale et progrès. — Beaussire : Le fondement de l’obligation morale ; Principes du droit. — Bacon : De augmentis scientiarum ; La dignité et les progrès de la science ; Nouvel organe. — J. Bentham : Traité de législation ; Théorie des peines et récompenses ; Déontologie. — A. Bayet : L’idée de bien ; La science des faits moraux ; Les morales de l’Evangile ; Le suicide et la morale. ; Notre morale ; La morale laïque. — J. Baldwin : Le darwinisme dans les sciences morales. — A. Bauer : La conscience collective et la morale. — Bautain : La philosophie morale. — Boutroux : Aristote (grande Encyclopédie) ; Morale et Religion. — Blackie : L’éducation de soi-même. — L. Barbedette : Pour l’Ere du cœur ; A la recherche du bonheur ; Par-delà l’intérêt. — Bain : Science mentale et morale — L. Bourgeois : La solidarité. — Belot : Études de morale positive. — Berthelot : Science et morale. — Bresson : Les trois évolutions (intellectuelle, sociale morale). — H. Baudrillart : Des rapports de l’économie polit, et de la morale. — Etc...
Aug. Comte : La. philosophie positive ; Catéchisme positiviste ; La morale positiviste, etc. — A. Coste : Les conditions sociales du bonheur et de la force. — Condorcet : Progrès de l’esprit humain. — F. de Coulanges : La cité antique. — Mme Coignet : La morale indépendante. — Courdaveaux ; Entretiens d’Epictète. — Clamageran : Philosophie morale et religieuse. — Ludovic Carrau : La morale utilitaire. — Caro : Probl. de morale sociale. — A. Cresson : La morale de la raison théorique.
Descartes : Discours de la méthode ; Lettres à la princesse Elisabeth ; Méditations métaphysiques. — Darwin : Descendance de l’homme. — E. Durkheim : L’éducation morale, etc... — A. Dumont : La morale basée sur la démographie. — Dauriac :Lettres à Lucilius — Delvove : L’organisation de la conscience morale. — Darlu : Pour la liberté de conscience. — Denis . Histoire des idées morales dans l’antiquité. Epictète : Maximes. — Engels : Origines de la famille, etc...
Mme J. Favre : La morale des stoïciens ; de Socrate ; d’Aristole. — A. Fouillée : Critique des systèmes de morale contemporains ; L’idée moderne du droit ; La science sociale contemporaine ; Eléments sociologiques de la morale ; Morale des idées forces ; Nietzsche et l’immoralisme ; Le moralisme de Kant et l’immoralisme contemporain. — Fonsegrive ; Le libre-arbitre. — Fulliquet : Essai sur l’obligation morale. — V. Franck : La morale pour tous. — Ch. Fourier ;Œuvres. — Frazer : Le Totémisme. — S. Faure : La douleur universelle ; La morale officielle et l’autre. — Folkmar :Anthopologie et morale positive. — Etc...
Guyau : Esquisse d’une morale sans obligation ni sanction ; L’irréligion de l’avenir ; La morale d’Epicure : La morale anglaise contemporaine. — Guelly : La nature et la morale. — C. Gide : Histoire des doctrines économiques. — Goblot :Justice et Liberté. — Gillet : Le fondement intellectuel de la morale. — Etc...
Hume : Traité de la nature humaine ; Essais de morale. — Hobbes : Sur le citoyen ; Léviathan. — Huxley : Les sciences naturelles et les probl. qu’elles font surgir. — Höffding : Morale. — Halleux : L’évolutionnisme en morale. — Herckenrath :Probl. d’esthétique et de morale. — Chatterton Hill : La physiologie morale. — Etc...
Izoulet : La Cité moderne.
P. Janet : Hist. de la science politique dans ses rapports avec la morale ; La morale ; La famille. — Jouffroy : Cours de droit naturel. — Joussain : Fondement psychol. de la morale. — Etc...
Kant : Fondement de la métaphysique des moeurs ; Critique de la raison pratique ; Doctrine de la Vertu ; Principes métaphysiques du droit, etc... — Kropotkine : La morale anarchiste ; L’Ethique ; L’Entr’aide. — Etc...
Lombroso : L’Homme criminel. — G. Le Bon ; Psychologie de l’éducation, etc... — Leibniz : La monadologie. — Lubbock : Les origines de la civilisation. — La Rochefoucauld : Maximes et Réflexions morales. — Lalo : L’art et la morale. — Landry :Principes de morale rationnelle. — De Lanessan : La morale des religions ; la morale naturelle. — Lévy-Bruhl : La morale et la science des mœurs. — Letourneau. — Evolution de la morale. — Lavollée : Études de morale sociale. — Lalande : Morale pratique. — De la Laurencie : Ethique et esthétique. — Etc...
Malebranche : Morale. — Stuart Mill : L’utilitarisme. — Marion : Leçons de morale. — De la solidarité morale. — Summer Maine : L’ancien droit. — G. de Molinari : La morale économique. — Martha : Les moralistes ; sous l’empire romain. — Marceron : La morale par l’Etat. — Maeterlinck : Sagesse et destinée, etc... — Maxwell : Le Crime et la Société. — B. Malon :La morale sociale. — Etc...
Nietzsche : La généalogie de la morale ; Zarathoustra ; Humain, trop humain ; Le crépuscule des idoles ; La volonté de puissance, etc... — J. Novicow : La morale et l’intérêt dans les rapports individuels et internationaux. — J. Noël : L’athéisme, base rationnelle de l’ordre. — M. Nordau : La biologie de l’éthique. — Etc...
Platon : Protagoras ; Phèdre ; Gorgias ; Dialogues socratiques. — Pascal : Pensées. — Proudhon : Œuvres. — Pillon : La morale inductive et le principe d’utilité (Rev. philos. 1867) ; Critique philosophique. — Parodi : Le probl. moral et la pensée contemporaine ; Les bases psychologiques de la vie morale. — C. Piat : La morale du bonheur. — Docteur Pioger : La vie sociale, la morale et le progrès. — Palante : Les antinomies.
Queyrat : Le caractère et l’éducation morale. J.-J. Rousseau : Emile ; Le contrat social. — Renan : Vie de Jésus. — Rambaud :Histoire de la civilisation. — Ravaisson : La philosophie en France au XIXe siècle ; Mémoire sur le stoïcisme. — Rabier :Leçons de Philosophie. — Van der Rest : Platon et Aristote. — F. Rauh : L’expérience morale. — Rignano : Probl, de psychol. et de morale. — De Roberty : Le fondement de l’éthique ; La constitution de l’éthique. — Renouvier : La science de la morale, — Han Ryner : Véritables entretiens de Socrate ; Le fils du. silence ; Le Père Diogène ; Les Paraboles cyniques ; La Sagesse qui rit ; Le Subjectivisme : Les Voyages de Psychodore, etc... — Rogatcheff : L’idole et sa morale. — Etc...
Stirner : L’Unique et sa propriété. — Sénèque : De vila beata. — H. Spencer : Qu’est-ce que la morale ; Les bases de la morale évolutionniste (The data of Ethics) ; De l’éducation intellectuelle, morale et physique ; Essais de morale, etc... — Schopenhauer : Le fondement de la morale ; Aphorismes sur la sagesse ; Le libre arbitre. — Spinoza : Ethique.- Secrétan :Philosophie de la Liberté. — G. Séailles : Les affirmations de la consc. moderne. — Docteur Sollier : Morale et moralité. — J. Simon : Le devoir ; La liberté. — Sidgwick : Les méthodes en morale. — Etudiants soc. rév. : Comment l’Etat enseigne la morale. — Etc... Tolstoï : Œuvres sociales et religieuses. — Tylor : Civilisation Primitive.. — Tissot : Principes de morale. _ J. Thomas : Principes de philosophie morale. — Thamin : Un probl. moral dans l’antiquité ; La casuistique stoïcienne. — Taine : De l’intelligence, etc... — Tarde : Les lois de l’imitation ; Transformation du pouvoir ; La philosophie pénale. — Etc...
Voltaire : Essais sur les mœurs ; Œuvres philosophiques. — Volney : La loi naturelle. — Vacherot : Science et conscience ; Essais de philos. critique. — Vallier : L’intention morale.
Zeller : Philosophie des Grecs. — Etc...
Voir également, dans L’Encycl. les études suivantes : bien, mal, devoir, plaisir, utile, sympathie, etc..., et aussi : famille, mariage, mœurs, m*oi*, sexe, sociologie, etc., ainsi d’ailleurs que tous les exposés ayant trait aux Systèmes philosophiques, religieux ou sociaux. Se reporter également, pour cette partie spéciale du problème moral aux articles et bibliographies de morale et éducation sexuelles (au mot : sexuel).
MORALITÉ
« La moralité consiste dans un certain ensemble d’idées, de croyances, de sentiments, de tendances naturelles ou acquises dont il est possible de déterminer les formes, les causes et les effets. »
« ...On peut concevoir une sorte de morale sans moralité. Supposons, en effet, que la moralité humaine se montre à qui l’étudie dans la conscience et dans l’histoire comme un fait éminemment variable, susceptible de prendre les formes les plus diverses, contradictoires même, sans qu’on puisse démêler de loi fixe et générale qui permette d’expliquer ces variations. Dans cette hypothèse, il sera impossible de tirer de l’étude de la moralité aucune indication pratique : c’est la conclusion du scepticisme moral. Pourtant, même dans cette hypothèse, un art de vivre reste encore possible, mais à la condition d’en placer les bases en dehors de la moralité. »
« Aristote enseigne que la moralité existe avant la morale et en dehors d’elle. — Epicure fait complètement abstraction de la moralité donnée dans la nature humaine et ne se préoccupe en aucune façon de la justifier ou de l’expliquer. — Le christianisme a donné pour base à la moralité, non la science, mais la foi ; non l’esprit, mais le cœur. » (Encycl.)
« Rapport de la conduite avec la morale (moralité des actions). Mœurs (homme sans moralité). » (Larousse)
Antonyme : immoralité (voir ce mot).
Dans un milieu social où une morale, règle (ou est censée régler), les actions des individus, est d’une haute moralité, celui qui vit (ou qui a l’air de vivre) en se conformant strictement aux lois qu’impose cette morale ; est sans moralité celui qui transgresse ces lois. Entre ces extrêmes s’échelonnent tous les degrés. La moralité a varié et varie selon les époques et les milieux. Le Carthaginois qui sacrifiait son fils au Dieu Moloch, le nègre qui mangeait son vieux père pour lui assurer une sépulture honorable ; le patriote qui est parti, en 1914, vers les frontières, plein de foi et d’ardeur étaient loin de se croire immoraux. Pour un amoral, pour celui qui « ne fait pas à autrui ce qu’il ne voudrait pas qu’on lui fit », la moralité d’un individu a pour critérium sa loyauté. Je ne me permets pas de juger autrui lorsque ses actes n’ont, sur moi, aucune répercussion. Au nom de quoi me permettrais-je d’apprécier sa moralité lorsqu’il ne porte pas le moindre ombrage au libre épanouissement de ma personnalité ? Par contre, si je passe un libre contrat avec lui, il est indispensable que les modalités de ce contrat s’accomplissent loyalement de part et d’autre. Sans cela rien de possible... fors les rapports immoraux de la société présente.
On a, de tout temps, écrit pour moraliser les individus, c’est-à-dire pour créer ou renforcer en eux une moralité. Certaines œuvres comiques du moyen-âge portaient même le nom de moralités. Elles avaient pour but de :
« Corriger les mœurs par le ridicule et de présenter non pas un vice particulier, un travers personnel, mais des travers et des vices généraux en rassemblant sur un même individu les traits épars qui caractérisent tel ridicule ou tel défaut, en créant des types de tel ou tel vice, qui représentent ce vice dans sa généralité. » (Encycl.)
On dit encore : la moralité d’une fable, d’une pièce de théâtre, d’un livre. Dans la fable (voir ce mot), la moralité vient en conclusion du récit pour éclairer, conseiller, faire toucher du doigt la réalité de la vie. Dans l’œuvre d’art (roman, théâtre, poésie), la moralité est le but apparent ou caché que l’auteur a poursuivi. Il est arrivé que des pudibonds — ou des hypocrites — se sont effarouchés de « l’immoralité » de certains écrits. C’est au nom de la « moralité outragée » qu’on a condamné de purs chefs-d’œuvre. C’est également au nom de la moralité du jour qu’on inculque aux jeunes générations, à l’église ou à l’école, cette masse effarante de préjugés qui entravent d’un poids si lourd l’évolution de l’humanité.
Rejetons donc ce vocable périmé et sachons nous rendre maîtres de nos destinées en nous affranchissant de toute tyrannie.
— CH. B.
MORALITÉISME ANARCHISTE (le)
Lorsqu’en 1900 j’entrai en contact avec les anarchistes, je venais d’un milieu chrétien. Maintes fois, depuis cette époque, j’ai été stupéfié en comparant les déclamations matérialistes de certains théoriciens anarchistes avec les jugements qu’ils prononçaient sur la conduite de compagnons qui avaient pris au sérieux les formules comme : « ni dieu ni maître », « sans foi ni loi », lesquelles concrétisent sous une forme brève et limitée la conception anarchiste individuelle de la vie. Je ne pouvais comprendre comment, après avoir combattu la loi et les prophètes, religieux et laïques, on pouvait porter, sur certaines manières de se comporter individuellement, des condamnations qui n’auraient pas déparé, les attendus de certaines sentences de juges correctionnels. Par la suite je me suis convaincu que ces jugements reflétaient simplement l’éducation bourgeoise (primaire ou secondaire) reçue par ces théoriciens, de l’influence de laquelle ils n’avaient pu ou voulu se débarrasser. Un peu plus tard, heureusement, j’ai rencontré d’autres anarchistes, libérés et affranchis de l’éducation des écoles, qui évitaient, en général, de porter jugement sur les gestes de leurs camarades. Lorsqu’ils se hasardaient, par hasard, à émettre une opinion sur la façon de se conduire de celui-ci ou celui-là, cette opinion ne se basait jamais sur un étalon quelconque de moralité adopté par les souteneurs de la moralité bourgeoise.
Les individualistes anarchistes à notre façon pensent que tout véritable anarchiste devrait tenir pour offensif et blessant qu’un agent quelconque de l’exécutif gouvernemental ait une bonne opinion de lui, qu’électeurs et élus aient de la considération pour lui, que le « bon citoyen », le prêtre, et le professeur de civisme le tiennent pour honorable et respectable. Non point que, forcé par les circonstances, l’individualiste anarchiste ne se déguise, mais à la façon du brigand calabrais, qui se camouflait en carabinier pour détrousser les diligences. Toute concession faite par lui au milieu social, toute concession qu’il a l’air de faire à l’État, il la rachète en minant chez autrui la notion du « pouvoir nécessaire », en démontrant à tous ceux qu’il peut approcher qu’il n’est nul besoin de moralistes, de chefs, de magistrats — imposés, obligatoires — pour remplir les fonctions organiques individuelles et pour s’entendre entre humains.
Certains de ceux qui font aujourd’hui du moralitéisme anarchiste oublient par trop « les compagnons, âmes ardentes » des Briseurs d’Images dont le rythme salua, pour plusieurs camarades de ma génération, leur prise de contact avec le milieu anarchiste. « Tout : statues, emblèmes, mirages » tombaient sous leurs bâtons. Qu’étaient pour eux :
Qu’ont inventé les égoïstes ?
Que nous ont dorés les sophistes -
Et dont se sont épris les sots. »
Ils méprisaient « tous préjugés », vivant « libres dans le monde — où partout le vil et l’immonde -Jusqu’au pinacle sont juchés ». Et si la honte couvrait leurs visages, ce n’était point « pour le maître et l’enrichi — mais pour l’ouvrier avachi ! »
Nous sommes un certain nombre à avoir conservé la mémoire de tout cela. Nous ne pouvons rien au fait que « notre » anarchisme puisse blesser, heurter, froisser constamment ce qui est social, moral, légal au sens où l’entendent les « honnêtes gens » et leurs représentants les plus en vue : procureurs généraux, directeurs de conscience de toutes les religions, académiciens, parlementaires et autres seigneurs. Sans nous immiscer dans les affaires privées de quelque anarchiste que ce soit, nous nous réservons cependant, au nom de la « liberté de choix », de répudier « l’esprit moralitéiste » et de dire à tous en général et à chacun en particulier : « Si votre mental ou votre moral privé vibre à l’unisson du mental ou du moral public d’un préfet de police ou d’un lauréat de prix Monthyon, votre place est chez les jésuites ou dans la brigade des mœurs, non parmi des anarchistes... » Et cette opinion en vaut bien une autre, après tout.
— E. ARMAND.
MORMONISME, MORMONS
n. m.
Au Congrès des Religions Philosophiques, qui fut tenu à San-Francisco, en 1915, du 29 au 31 juillet, on consacra le premier jour aux religions chrétiennes, le second jour aux religions hindoues, le troisième jour aux religions orientales. Le programme consacré aux religions chrétiennes ne retint que trois systèmes religieux : le catholicisme, le protestantisme et le mormonisme. C’est que ce que l’on appelle le Mormonisme, bien qu’il prétende se rattacher au christianisme, diffère de l’orthodoxie catholique et protestante sur de nombreux points. À vrai dire, le mormonisme apparaît, après examen, comme constituant une religion à part, américaine, influencée peut-être au début par le saint-simonisme, dont sa fondation est contemporaine, et mêlant, dans une mesure équilibrée, le mysticisme ou l’idéalisme à une conception très pratique de la vie.
Le fondateur de cette religion fut un garçon de ferme du nom de Joseph Smith, né en 1805, dans l’État de Vermont, aux États-Unis. La tradition se plait à le considérer comme inculte, un semi-illettré. Ce paysan était un grand lecteur de la Bible, comme les Américains de souche anglo-saxonne en général ; il était, de plus, beau parleur et la nature l’avait doué d’une haute taille, deux mètres environ, ce qui lui conférait une prestance qui n’était pas sans influence sur les foules. Peut-être Smith entendit-il parler, par les journaux de son pays, d’Owen, de Saint-Simon ? Quoi qu’il en soit, tout comme le fait s’était produit pour les patriarches de l’Ancien Testament, pour Saint Paul, Saint Pierre et certains chrétiens de l’église primitive, pour François d’Assises et autres saints et saintes de l’église catholique, une nuit « un ange » lui apparut. Le fait même que Smith n’était ni très instruit ni très recommandable, – au point de vue bourgeois, s’entend, – ne préjuge rien contre cette apparition, à en croire la tradition chrétienne, et si l’on accepte les visions des patriarches, des prophètes, des saints et des camisards, on ne voit pas pourquoi on récuserait celle de Smith.
Le nom de cet ange était Moroni, tout à fait ignoré du panthéon orthodoxe. Joseph Smith ne fut pas étonné outre mesure de cette apparition. À l’âge de 15 ans, dans les champs – tout comme Jeanne d’Arc – il avait aperçu deux personnages dont l’un n’était autre que le Christ lui-même et l’un de ces êtres surnaturels lui avait enjoint de se tenir à l’écart de toutes les sectes existantes, les unes et les autres n’étant que des contrefaçons du véritable christianisme.
Or il avait maintenant 23 ans. « Moroni » lui raconta, comme c’est l’usage quand les envoyés du ciel s’adressent aux fondateurs de religions, que, lui, Joseph Smtih, avait été choisi par Dieu pour accomplir une œuvre immense et que son nom serait répandu par toute la terre, pour être exalté par les uns, méprisé et haï par les autres ; il ajouta que dans un certain lieu de l’état de New-York se trouvait un livre consistant en plaques d’or sur lesquelles étaient gravées l’histoire des premiers habitants du nouveau continent et leur origine et que près de ce livre se trouvaient deux pierres encerclées d’argent, l’urim et le thummim, qui n’étaient autres que le pectoral du grand prêtre des Juifs, et qui feraient de lui un voyant, lui permettant de déchiffrer la langue en laquelle était écrit le livre en question. Avant de s’en aller dans les sphères supérieures, par un chemin ressemblant à « un conduit » ménagé dans l’atmosphère et, cela va sans dire, après avoir récité un chapelet de citations bibliques, Moroni enjoignit à Smith de ne montrer le livre et les pierres à personne, exception faite pour ceux à qui on lui ordonnerait de les communiquer. Moroni revint deux fois et avertit le prophète que Satan le pousserait à déterrer les plaques prématurément.
Cet ange connaissait bien la nature des hommes, car Joseph Smith n’eût rien de plus pressé que de raconter sa vision à son père, membre de l’église presbytérienne. Le digne homme fut d’avis de ne pas attendre plus longtemps pour se rendre compte de l’exactitude du récit du messager céleste. Moroni avait si bien indiqué l’endroit du dépôt sacré que c’est sans peine aucune que le prophète découvrit la boîte renfermant les plaques, les plaques elles-mêmes et les précieuses pierres. Il ne se proposait rien moins que d’emporter le tout, mais Moroni apparut de derechef et lui ordonna d’attendre encore quatre ans... Joseph Smith ne sut pas tenir sa langue. On commença, dans son milieu, à parler de ses visions et à lui rendre la vie insupportable, ce qui l’obligea, lorsqu’il eût déterré les fameuses plaques (le 22 septembre 1827), à émigrer en Pennsylvanie, ses frais de voyage étant en partie couverts par un certain fermier du nom de Martin Harris.
Qu’y avait-il donc sur ces plaques dont Moroni, de la part de Dieu, a réclamé plus tard la restitution (ainsi que de l’urim et du thummim) ? Des caractères que Smith disait être de « l’égyptien réformé ». Une copie en a été présentée au professeur Charles Ashton de New-York, il y a démêlé de l’égyptien, du chaldaïque, de l’assyrien, de l’arabe et a rédigé un certificat en ce sens ? Comment le semi-illettré qu’était Smith a-t-il pu comprendre quelque chose à cet amalgame ? La traduction s’en opérait d’ailleurs de façon mystérieuse : un rideau séparait Smith et les plaques du traducteur, que ce fût Martin Harris ou Olivier Cowdery, lequel écrivait sous la dictée du prophète... Trois hommes : Cowdery, Whitmer et Martin ont certifié avoir été témoins d’une apparition angélique, avoir vu les plaques et distingué les caractères qui y étaient gravés. Ils ont cessé de faire partie de l’église mormone, ils ne se sont jamais démentis, même à leur lit de mort... Au cours de la traduction, « Jean Baptiste » apparut, dans les bois, à Smith et à Cowdery, qui était un maître d’école ; il leur conféra la prêtrise aaronique et leur ordonna de se baptiser l’un l’autre.
C’est la traduction de ces plaques qui constitue Le livre de Mormon : il est mortellement ennuyeux et rédigé en un style tendant visiblement à pasticher celui de la version ordinaire de la Bible anglaise. Il narre qu’un certain Lehi, un israélite selon le cœur de l’Éternel, fut prévenu, par une vision céleste, des malheurs qui allaient fondre sur son peuple ; il quitta alors la Judée et, nouveau Noé, s’en fut avec les siens en Amérique, qu’il découvrit le premier parmi les Blancs.
Lehi fit souche dans le Nouveau-Monde, jusque là inhabité et désertique. Il vécut très vieux. Lui mort, ses descendants se partagèrent en deux rameaux, issus de ses deux fils : Laman et Nephi. Les Lamanites se mirent à adorer les idoles et à faire le mal et Dieu les en punit... en bronzant leur peau : ce sont les ancêtres des Peaux-Rouges. Les Néphites restèrent au contraire fidèles à la foi judaïque : ils devinrent même des chrétiens avant la lettre, ayant su, par la grâce de l’esprit, interpréter comme il convient, les prophètes et les prophéties. Après sa crucifixion, Jésus apparut en Amérique, institua douze apôtres et la majeure partie du peuple se convertit. Les Lamanites refusèrent finalement d’embrasser le christianisme et guerroyèrent sans cesse contre les Néphites qui finirent – et leur foi avec eux – par être à peu près anéantis, non sans que Mormon, leur dernier grand chef, ait pu écrire la chronique de leurs faits et gestes et l’enterrer dans le sol. Quant à Moroni, c’était le fils de Mormon, resté chrétien malgré tout, « errant de lieu en lieu pour sauver sa vie » ; c’était lui qui avait conversé, sous une forme incorruptible, avec Joseph Smith. Le reste des Néphites était retourné à la barbarie, reniant le Christ et allant jusqu’à faire prisonnières les filles des Lamanites, les violer, les torturer et les dévorer. Ceci était censé se passer en 400 après J.-C.
Les critiques du Mormonisme racontent qu’un pasteur du nom de Salomon Spaulding, devenu plus tard commerçant, avait écrit, en 1809, un roman où il assignait aux indiens d’Amérique une origine fabuleuse, reposant probablement sur des analogies entre certains symboles chrétiens (la croix, etc.), et des découvertes archéologiques faites chez les anciens Aztèques. Dans ce roman fondé sur l’idée légendaire, déjà exprimée par certains, que les Peaux-Rouges étaient les descendants des dix tribus perdues d’Israël, apparaissent les noms de Mormon et de son fils Moroni. Spaulding avait remis son manuscrit à un libraire de Pittsburgh du nom de Paterson, en lui donnant comme titre The Manuscript Found (le manuscrit découvert) mais il mourut avant de passer contrat avec ce libraire. Ce Paterson prêta le manuscrit à un de ses compositeurs nommé Stanley Rigdon, qui en prit copie et communiqua cette copie, assure-t-on, à Joseph Smith, dont il devint par la suite, l’un des principaux disciples. Ce fait a toujours constitué une charge contre le prophète, bien que les Mormons aient toujours nié les analogies existant entre l’histoire de Spaulding et le livre de Mormon, Le roman de Spaulding est même en vente à Salt Lake City, mais comme le manuscrit a été égaré puis retrouvé, on ne sait s’il s’agit de l’original exact.
Bref, le 6 avril 1830, à La Fayette, dans l’État de New-York, Joseph Smith fonda l’église des Saints du Dernier Jour – Latter day Saints Church – qui est la dénomination officielle de l’église mormone, ce dernier nom leur ayant été attribué dans un sens dérisoire. Mais l’ambiance était hostile. L’année suivante, Joseph Smith conduisit ses disciples, nombrant quelques centaines, à Kirtland dans l’État d’Ohio, qui devint la capitale de la Nouvelle Église. On y érigea un temple, et Élie et Élisée y « apparurent » à Joseph Smith et à Oliver Cowdery.
À partir de ce moment, Joseph Smith et « les Saints du dernier jour » sont en butte à toutes les persécutions imaginables. En juillet 1831, Smith fonde une ville, la Nouvelle-Sion, dans un lieu appelé Indépendance, situé dans le Missouri, état nouvellement créé. Il y lance même un journal : « The Evening Morning Star ». Sion est mise à sac, la presse détruite et il faut aller ailleurs. Partout où les Mormons s’établissent, on les attaque, on dévaste et on incendie leurs maisons, on outrage leurs compagnes, on les lynche ; Boggs, le gouverneur du Missouri, donne même l’ordre d’exterminer les malheureux et des milliers de volontaires sont levés pour en finir avec la maudite secte. On va jusqu’à présenter, comme nourriture, à Smith et aux principaux de l’église, jetés en prison, la chair de leurs frères massacrés. Il fallut que le général Doniphan menaçât de retirer son régiment pour qu’on se contentât de chasser du Missouri les indésirables. De là, ils se rendirent à Nauvoo, dans l’Illinois, sur les rives du Mississipi, qui grâce au talent d’organisateur de Joseph Smith (qui apparaît de moins en moins comme un inculte) et à la foi de son troupeau durement éprouvé, devint rapidement une ville comptant 20 000 habitants, et cela à l’époque où Chicago était une bourgade sans importance. Les fidèles accouraient de toutes les parties de l’Union Américaine et même de la Grande-Bretagne. L’administration municipale de la ville pouvait être donnée en exemple aux autres cités des États-Unis. Joseph Smith était élu maire de la cité, une milice avait été organisée ; le prophète ajoutait à ses titres celui de lieutenant-général et il proclamait son intention de se porter candidat à la présidence.
Entre temps, Rigdon avait introduit le dogme de « l’épouse spirituelle » ; malgré une opposition très vive, il persista et prétendit, paraît-il, avoir reçu une révélation sanctionnant « la séduction systématique ». On raconta que J. Smith appuyait ce dogme, il le nia, tout en professant la polygamie lui-même et ses adversaires lui reprochaient la possession d’un harem « faisant concurrence » à celui de Mahomet.
Un beau jour, en 1844, un édit du gouverneur de l’Illinois, décréta l’arrestation de Joseph Smith et les principaux d’entre les Mormons. Le prophète ne se faisait pas d’illusion sur le sort qui lui était réservé, malgré la promesse de protection du gouverneur. Il avait été arrêté 50 fois et 49 fois acquitté. Il se rendit à Carthage, accompagné de son frère Hyrum et de deux « apôtres » – John Taylor et Willard Richards, – en prononçant ces paroles :
« Je m’en vais comme un agneau à la boucherie, mais je suis aussi calme qu’un matin d’été. J’ai la conscience pure devant Dieu et devant les hommes ; je mourrai innocent et il sera dit de moi : Il a été assassiné de sang-froid. »
Tout cela se réalisa à la lettre. La populace clamait :
« Que si la loi n’y pouvait rien, la poudre et les balles auraient bien raison d’eux. »
Le 27 juin 1844, à 5 h. de l’après-midi, une bande de 150 à 200 personnes, le visage barbouillé de suie, força les portes de la prison où Smith et les siens étaient détenus. Hyrum Smith qui avait 44 ans, tomba le premier sous la fusillade ; Joseph, qui en avait 39 sauta par la fenêtre, mais fut tué au cours de sa tentative. John Taylor, qu’avaient atteint 4 balles, survécut. Willard ne reçut aucun projectile... Loin d’abattre le Mormonisme, cet inqualifiable assassinat l’achemina vers le succès.
Il se trouvait parmi les. Mormons un vitrier du nom de Brigham Young, qui était président des « Douze », – préféré à Sydney Rigdon pour cette fonction – homme d’une grande énergie, de beaucoup de sang-froid, très opiniâtre et très diplomate. Il reçut la révélation ou inspiration que ce qui restait de son église devait émigrer vers l’Ouest, l’Ouest lointain, hors des frontières de l’Union américaine, dans les déserts qui n’appartenaient pas encore aux États-Unis. Les Saints se mirent alors à vendre ou à échanger leurs terres et leurs maisons pour se procurer du blé, du seigle, du lard, des pommes de terre, du bétail, des bœufs, des chariots...
Nouveau Moïse, Brigham Young rassembla ce qu’il put de son peuple, 143 hommes, 3 femmes et 2 enfants et partit d’abord un peu à l’aventure, ensuite vers la région du Grand-Lac-Salé, plateau de 1200 m d’altitude, glacé l’hiver par des vents polaires, brulé l’été par un soleil torride, maudit par le Grand Esprit, disaient les Pawnies, à cause des guerres de leurs ancêtres... Parti durant février 1846, Brigham Young pénétra le 24 juillet 1847 dans la vallée du Grand-Lac-Salé. Les 143 Mormons du début étaient devenus 2000 et formaient une longue caravane ; ils voyageaient dans des chariots à bœufs, que les hommes conduisaient à pied les bagages, les femmes et les enfants, les invalides demeurant à l’intérieur des véhicules. Il fallut lutter d’abord contre l’hiver, très rude, contre l’incertitude de la direction (la prairie n’était pas encore défrichée), se méfier de la flèche de l’indien, franchir les Montagnes-Rocheuses. Des enfants naissaient en route.
Au bout d’un mois, Salt-Lake-City était fondée. Le terrain où la ville devait s’élever fut partagé en îlots ou block s de 10 acres chacun, chacun d’eux étant distribué en lots égaux de 1 acre 1/4. Aux barrières de la ville, la terre arable fut partagée en lots de 5 acres, un peu plus loin les lots étaient de 10 acres, plus loin encore ils comptaient 20 acres. Aucune spéculation ne fut permise ; on demanda à chaque chef de famille de faire rendre au lot qui lui était échu tout ce qu’il pouvait donner, d’être un producteur autant qu’un consommateur... En 1848, Salt-Lake-City n’était même pas un village, c’était une enceinte entourée d’une muraille, mi-bois mi-boue, dans l’intérieur de laquelle se dressaient huttes, tentes, charriots et où campaient 1.800 habitants.
Brigham Young était reparti dans le Missouri pour réunir les Mormons qui s’y trouvaient encore et les ramener vers la Terre promise. En mai et juin, il y eût une invasion de sauterelles menaçant de réduire à rien la récolte, alors que l’on attendait 25 immigrants. C’était un véritable fléau. Hommes, femmes, enfants se mirent sur la défensive ; ils arrivaient bien à écraser les sauterelles, mais ils piétinaient en même temps les jeunes pousses de blé ; on avait beau creuser des fossés, les remplir d’eau et y pousser les dévastatrices à coups de balai et de bâton, cela ne faisait pas plus que les brandons enflammés qu’on projetait là où les insectes étaient massés. Tout faisait présager que la famine allait envahir le camp des Saints du dernier jour... Un matin, quand tout espoir semblait perdu, voici que, venant des îles du Lac-Salé, des bandes de mouettes apparurent, remplissant l’air de leurs cris plaintifs. Elles se précipitèrent sur les sauterelles et ne partirent pas avant que le dernier des orthoptères eût été dévoré. C’est « le miracle des mouettes ». On a élevé à Salt-Lake-City un monument en mémoire de ce vol mémorable. La loi de d’État d’Utah punit celui qui tue les mouettes sans absolue nécessité : elles sont devenues aussi sacrées pour les Mormons que les oies pour les Romains.
Aujourd’hui, Salt-Lake-City est l’une des villes les plus prospères dos États-Unis, capitale de l’État d’Utah, aux rues larges de 40 mètres. Les édifices religieux y sont les plus importants ; on cite parmi eux le Grand Temple, le sanctuaire mormon – l’Assembly Hall, la salle des réunions – enfin le Tabernacle, construction immense et basse, de forme elliptique où peuvent prendre place de 10 à 12 000 personnes et qui possède un orgue comptant 8 000 tuyaux et mu par l’électricité.
Pour revenir à l’histoire des Mormons, le Mexique céda aux États-Unis les provinces des Montagnes-Rocheuses et du Pacifique. Le pays du Lac-Salé devint territoire de l’Union et Brigham Young en fut nommé gouverneur. Ce fut une sorte d’état théocratique, auquel son éloignement procura la tranquillité pendant plusieurs années. Mais bientôt cette quiétude fut troublée par l’accusation portée contre les Mormons de pratiquer la polygamie, ce qui était vrai, et le meurtre rituel, que les dirigeants de leur église ont toujours combattu. Les 20, 21 ou 25 femmes de Brigham Young justifiaient amplement les hurlements des méthodistes et autres puritains des états de l’est et du centre. Le leader mormon fut destitué de son poste de gouverneur, mais Brigham Young rendit la vie impossible à ses successeurs. Le gouverneur Cumming étant arrivé avec 2 500 hommes de troupe à Salt Lake City, Young proclama la loi martiale et il y eut un moment danger de conflit. Une détente se produisit cependant et le gouvernement fédéral retira ses troupes. Elles réoccupèrent la capitale de l’Utah lors de la guerre de Sécession, le gouvernement de Washington soupçonnant les Mormons de sympathies avec les Sudistes.
Le 2 juillet 1862, un décret spécial (ayant un effet rétroactif de trois ans) fut promulgué par le président des États-Unis, alors Abraham Lincoln, sans aucun avertissement ; il interdisait la pratique de la polygamie, sous peine d’une amende de 500 dollars et d’un emprisonnement de cinq ans. Comme les Mormons gardaient secrets les registres d’état-civil de leur église, ce décret resta inapplicable, car on ne put jamais prouver qu’une union polygamique avait été célébrée depuis moins de trois ans. La polygamie continua donc comme par le passé... En 1882, elle avait pris une telle extension que le gouvernement fédéral se résolut à sévir vigoureusement et avec une rigueur telle que la répression fut, par la suite, désignée sous le nom de « persécutions dioclétiennes ». Une loi spéciale fut votée le 22 mars 1882, punissant de six mois de prison, de la perte du droit de vote et de certains droits civils, celui qui cohabitait avec plus d’une femme. La chasse aux cohabs – cohabitants – devint une des occupations favorites des anti-Mormons et des fonctionnaires.
« L’Utah fut alors le théâtre de scènes affreuses : il y eut des assassinats de « cohabs », des condamnations de vieillards qui, brisés et malades, ne sortaient de prison que pour mourir, des emprisonnements de femmes qui, voulant sauver leur mari et rester fidèles à leur religion, observaient un mutisme absolu devant les tribunaux, ou se parjuraient sans hésitation. Telle jeune femme, son bébé dans les bras, affirmait ignorer le père de son enfant, quand celui-là, le plus souvent, était à quelques pas à peine sur le banc des accusés ; tel enfant déclarait ignorer son père ; telle vieille mère jurait ne pas connaître le père de l’enfant de sa fille, disant que cela regardait sa fille et non elle ; telle jeune femme, se sauvant dans la campagne pour éviter des poursuites à son mari, vit son bébé mourir dans ses bras et dut, creusant elle-même la terre en un lieu sauvage et solitaire, ensevelir dans son châle le corps de l’enfant. »
En 1890, le gouvernement fédéral, considérant l’église mormone comme une association illégale, prêchant la révolte contre les lois de l’État, confisqua ses biens. L’Église des Saints du dernier jour dût céder et en 1891 son président, Wilford Woodruff, abolit, par un manifeste, la pluralité des femmes. Son église rentra alors en possession de ses biens et le 4 janvier 1896, l’Utah était admis parmi les États de l’Union. Il fut toutefois introduit dans la constitution du nouvel état une clause irrévocable, interdisant la pluralité des femmes. De ce fait, le gouvernement fédéral perdit tout droit de juridiction sur toutes les questions relatives au mariage... Plus tard, le président Joseph Fielding Smith déclarait que le meurtre rituel, les sacrifices humains, la théorie identifiant Salt-Lake-City avec Jérusalem étaient des doctrines inspirées du diable.
La théologie mormone est très curieuse et rappelle les doctrines gnostiques (cela donne à réfléchir quand on nous présente Joseph Smith et son entourage comme un ramassis d’illettrés). Cette théologie enseigne qu’il y a dans « le ciel » une infinité de divinités mâles et femelles, dirigée par un Dieu en chef, qui possède, comme l’homme, un corps de chair, mais incorruptible. Il est immortel et le Christ-Jéhovah est né du mariage réel du chef des Dieux avec une déesse. Au-dessous des Dieux viennent les anges, puis les hommes. Tous sont des esprits dans un tabernacle de chair et seul le Saint-Esprit, véritable moteur du monde, est immatériel. Le Mormonisme professe d’ailleurs le dogme de l’immortalité de la matière...
D’après la théologie mormone, l’homme est doué du libre-arbitre. (Dans le conseil des Dieux et des anges, Satan avait proposé que l’homme fût sauvé des dangers et des péchés de l’état de mortalité par force et non par le mérite de la lutte et de l’effort, tandis que Christ-Jéhovah était d’avis de garantir à l’homme la libre disposition de ses actions : il s’offrait d’ailleurs comme rançon des péchés que pourrait alors commettre le genre humain. Son plan fut adopté et celui de Satan repoussé.) L’Église des Saints du dernier jour admet la chute ; la résurrection du Christ ; trois état la glorification pour le fidèle : le céleste, le terrestre, le téleste ; la possibilité pour l’homme de devenir Dieu, le baptême pour les morts. Jarnes-E. Talmage, qui fut délégué des Mormons pour exposer la philosophie de sa religion au Congrès des Philosophies religieuses, décrit :
« Dieu lui-même, Elohim, comme un être progressif, avançant éternellement d’une perfection à une autre, parce que possédant cet attribut caractéristique, qui sera le don de tous ceux qui atteignent l’exaltation céleste – le pouvoir de s’accroître éternellement. »
Selon la théologie mormone, c’est littéralement que l’homme et la femme sont les images de Dieu.
Venons-en maintenant au dogme de la pluralité des femmes ou plutôt des épouses – plurality of wives – qui fut la cause de toutes les persécutions que subirent les Mormons, la pierre d’achoppement de leur église. La section 132 de « Doctrine and Covenants » expose qu’à Nauvoo, le 12 juillet 1843, Joseph Smith reçut une révélation concernant une nouvelle et éternelle alliance comportant l’éternité du mariage contracté selon la loi de Dieu et la pluralité des épouses. Les versets 19 et suivants promettent à l’homme qui obéit à la loi de Dieu, concernant le mariage éternel, qu’il deviendra un dieu. Plus loin, on trouve que Moïse, Abraham, Jacob, Salomon reçurent des femmes et des concubines, que cela leur fut « imputé à justice », parce que dans toutes ces choses, ils accomplirent ce qui leur avait été commandé. Le verset 61 dit :
« Si un homme épouse une vierge et désire en épouser une autre, et que la première donne son consentement, et s’il épouse la seconde et qu’elle soit vierge, ne s’étant promise à aucun autre homme, cet homme-là est justifié. Il ne peut commettre d’adultère avec ce qui lui appartient, à lui, et à personne d’autre. »
Et le verset 62 :
« Et si dix vierges lui sont données, de par ladite loi, il ne peut pas commettre adultère, car elles lui appartiennent et lui sont données à lui. C’est pourquoi il est justifié. »
Cette révélation ne faisait que justifier un état de fait, car Joseph Smith et plusieurs des principaux d’entre les Mormons pratiquaient la polygamie à Nauvoo. Brigham Young, lorsqu’il proclama solennellement la révélation de Joseph Smith, le 2 août 1852, le reconnut lui-même. Il ajouta que « sans la doctrine contenue dans cette révélation, il est impossible à personne ici-bas de s’élever jusqu’à devenir un dieu ». Voyons les amplifications que l’église mormone donnait à cette doctrine :
« D’après la religion mormone – qui, on l’a vu ci-dessus, est polythéiste – la polygamie est nécessaire au salut : Jésus-Christ, né de la polygamie, fut polygame lui-même : les Noces de Cana étaient ses noces. Marie et Marthe étaient ses femmes et il put ainsi satisfaire à la loi imposée aux hommes et se créer une descendance avant d’être crucifié. (Des Mormons prétendent que J.-C. avait trois femmes). »
Quant au sacrement du mariage, la religion mormone, qui admet le divorce (mais ne l’octroie que rarement), célèbre trois sortes d’union : l’union pour la vie terrestre, l’union pour la vie céleste, l’union pour les deux. Il arrive donc qu’une femme peut être mariée à deux époux : à l’un pour la vie actuelle – avec lequel elle vit, – à l’autre pour la vie ultérieure, la vie céleste. Il est admis que si l’on n’a pu (pour l’homme ou la femme) vivre ici-bas la vie polygamique, l’union pour la vie future suffit pour que l’on soit sauvé.
« La cérémonie du mariage peut revêtir deux caractères différents :
-
S’il s’agit du premier mariage, la cérémonie rappelle un mariage protestant ;
-
S’il s’agit d’une nouvelle union pour un homme déjà marié, le caractère de cette cérémonie est tout autre.
Tout Mormon déjà marié doit, avant de pouvoir contracter un nouveau mariage, et même avant de demander la main de la personne sur laquelle il a jeté son dévolu obtenir le consentement de sa première épouse, du président suprême de l’Église, enfin des parents de celle qu’il veut épouser. Si la première femme refuse de donner son consentement, elle doit donner à l’autorité ecclésiastique mormone les raisons de son refus. Si ces raisons ne sont pas reconnues assez sérieuses, on passe outre, et le mari est autorisé à s’unir à la nouvelle élue de son cœur. Si, au contraire, le refus de la première femme est fondé sur un motif reconnu valable, le mari n’est pas autorisé à contracter un second mariage... Le Mormon polygame doit veiller au bien-être de toutes ses femmes : il doit toujours agir avec une impartialité et une justice absolues. Il doit, s’il est bon Mormon, se donner tour à tour à chacune de ses épouses, qui se considèrent comme sœurs. On regarde toutefois la première femme comme supérieure aux autres, comme une sorte de reine, dans cette vie comme dans la vie future ; c’est pourquoi beaucoup de Mormones ont vivement désiré être la première épousée. Toutes les femmes d’un même mari doivent aimer tendrement tous ses enfants, qui appellent mère leur propre mère, et tantes les autres femmes de leur père... »
Notons en passant que les Mormons ont grandement augmenté le nombre des parents que l’on peut épouser, par exemple la mère et la fille, les sœurs nées du même père et de la même mère, une demi-sœur (consanguine sans doute), etc...
La procuration substitutive n’est pas la moins curieuse des coutumes qu’avait engendrées la polygamie mormone :
« Tout Mormon qui se rend en mission plusieurs années est, le plus souvent, obligé de se séparer de sa femme ou de ses femmes, quelquefois assez nombreuses pour atteindre la douzaine ; or, cette séparation entraîne nécessairement une perte d’enfants et, par suite, un grand sacrifice de gloire éternelle, d’après le principe admis que la famille de l’homme constitue son royaume dans l’autre monde. On aurait donc obvié à cet inconvénient, en substituant un agent ou fondé de pouvoirs qui remplacerait le mari absent, auprès de sa femme ou de ses femmes. On prétend que plus d’un enfant a vu le jour de la sorte dans l’empire mormon... »
Il est intéressant de remarquer que si le devoir marital est absolu pour tout Mormon, il est toutefois un cas dans lequel il est non pas restreint, mais absolument interdit :
« Pendant les périodes de grossesse et de lactation, les Mormons, en effet, considèrent cette abstention comme meilleure pour la femme et l’enfant, et plus digne pour la pudeur de la femme. C’est là, à côté des exemples tirés de la Bible, un argument fondamental mis en avant en faveur de la polygamie, celle-ci facilitant à l’homme l’abstention totale pendant les périodes que nous venons d’indiquer. »
Examinons maintenant comment vivait un Mormon et ses femmes (nous nous situons au passé, car il est difficile de savoir ce qui se passe aujourd’hui, puisque les Mormons sont censés avoir abandonné la polygamie). Les trois cas suivants pouvaient se présenter :
-
« Toutes les femmes sont réunies sous le même toit, en une sorte de harem, chaque femme recevant la visite de l’époux suivant le bon plaisir de celui-ci, qui a son domicile personnel. Si le mari va en voyage, il choisit dans son harem une compagne qui le suivra ; s’il est malade, il mande près de lui, pour le soigner, l’une de ses femmes ;
-
Toutes les femmes sont réunies sous le même toit, comme dans le cas précédent, et le mari vit au milieu d’elles. C’est l’exemple le plus fréquent. La vie générale est en commun, mais chaque femme a sa chambre à coucher particulière, le mari se donnant à tour de rôle à chacune d’elles ;
-
Chaque femme a sa demeure particulière où le mari vient passer vingt-quatre heures. »
Mais que disait la femme mormone ? Élevée dans l’idée que le salut dépend de la polygamie, elle regardait avec dédain et pitié les mariages monogamiques ; considérant que, par sa nature, l’homme est essentiellement polygame, elle déclarait préférer la polygamie à la monogamie, dont découle fatalement la prostitution ; elle apportait dans sa foi un mysticisme et une exaltation peu communs. Elle facilitait le mariage de son mari avec d’autres femmes, persuadée que son propre bonheur devait en résulter. Une dame mormone fit au professeur Jules Rémy, qui visita le pays des Mormons vers 1860, certaines déclarations dont nous retiendrons les suivantes, les autres étant saturées de réminiscences bibliques :
« La polygamie, quoique vous puissiez penser, place la femme de notre société dans une situation plus morale que celle qui lui est faite par les sociétés chrétiennes où l’homme, riche de ses moyens, est tenté de les dépenser en secret avec une maîtresse, d’une façon illégitime, tandis que la loi de Dieu la lui aurait donnée comme une honorable épouse. Tout cela engendre le meurtre, l’infanticide, le suicide, les remords, le désespoir, la misère, la mort prématurée en même temps que leur cortège inséparable, les jalousies, les déchirements de cœur, les défiances au sein de la famille, les maladies contagieuses, etc. ; enfin, cela conduit à cet horrible système de tolérance légale, dans lequel les gouvernements prétendus chrétiens délivrent des patentes à leurs filles de joie pour les autoriser, je ne dirai pas à imiter les bêtes, mais à se dégrader bien au-dessous, car tous les êtres de la création, à l’exception de l’homme, s’abstiennent de ces abominables excès et observent dans leur reproduction les sages lois de la nature... J’ai pour mari un homme bon et vertueux que j’aime de toute mon âme et dont j’ai quatre petits enfants qui nous sont chers au-delà de toute expression. En outre, mon mari a sept autres femmes vivantes et une qui est allée vers un meilleur monde ; et avec cela il n’a pas moins de 25 enfants. Toutes ces mères et tous ces enfants me sont attachés par de doux liens, par une mutuelle affection, par nos rapports et notre association. Les mères me sont devenues particulièrement chères à cause de leur tendresse fraternelle pour moi et des fatigues et des souffrances que nous avons partagées en commun... »
On a vu, raconte M. Raymond Duguet, dans son livre sur « Les Mormons, leur religion, leurs mœurs, leur histoire » (de date récente), une femme unique, presser spontanément son mari de prendre une seconde femme, se donner toute la peine imaginable pour décider des jeunes filles à l’épouser et pleurer sincèrement de ne pouvoir y parvenir.
Le chef de la justice fédérale dans l’Utah, Read, avoua lui-même que les Mormons possédaient une moralité très élevée. Il ajoutait :
« Il me faut reconnaître que la très grande majorité des Saintes déclarent être heureuses et qu’un grand nombre d’entre elles ont l’air d’être parfaitement satisfaites. »
Tous les Européens qui visitèrent les Mormons à l’époque où la pluralité des épouses florissait sans entraves, se sont accordés à reconnaître et à vanter la supériorité morale des Mormons... Tant que le gouvernement fédéral ne les eût pas pas dépossédés de l’administration de l’Utah, il n’y avait chez eux ni prostitution, ni bars, ni lieux de débauche. Aujourd’hui, alors que des éléments qui leur sont tout à fait étrangers ont introduit ces pratiques à leurs cotés, ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour en restreindre les effets.
En se plaçant à un autre point de vue, sans leurs nombreuses familles, les Mormons ne seraient jamais parvenus à faire, en si peu de temps, de la région désertique qui entoure le Grand-Lac-Salé, le pays prospère et producteur qu’est l’Utah d’aujourd’hui ; il est à noter d’ailleurs que le gouvernement fédéral n’est intervenu sérieusement pour abolir la polygamie que lorsque le territoire fut à peu près défriché... On prétend que c’est seulement extérieurement que les Mormons ont renoncé à la polygamie. Ils la pratiqueraient clandestinement et, chez les plus riches d’entre eux, ce sont les soi-disant servantes qui joueraient le rôle de « concubines ».
De 1910 à 1912, il y eut une violente campagne anti-mormone où se distinguèrent le « Mac Clure Magazine » et l’« Everybody’s Magazine ». On donna le nom de cinq apôtres ayant célébré des unions polygames. En février 1911, la « Salt Lake City Tribune » publia une liste de 274 mariages polygamiques célébrés depuis le manifeste Woodruff : l’église mormone ne protesta pas et il y eut à peine un ou deux démentis individuels. Le 12 janvier 1912, à un grand meeting anti-mormon, à New-York, le sénateur Cannon déclara que les apôtres mormons ont chacun 5 ou 6 femmes. Quand expira le président Joseph Fielding Smith, dont il a été plus haut question, l’agence Radio annonça que, décédé à 80 ans, il avait épousé 6 femmes, laissé 5 veuves ; 30 de ses 53 enfants étaient encore vivants... Quand il s’est agi d’apaiser le gouvernement fédéral et les clameurs puritaines de l’est de l’Union américaine, les docteurs mormons ont publiquement substitué à la polygamie réelle, le mariage mystique des fidèles soit avec les âmes des mortes, soit le mariage pour l’éternité avec des femmes déjà en possession de mari sur cette terre. Mais était-ce autre chose qu’une feinte ? Il existerait un paragraphe ou verset secret – dans la section 132 du livre Doctrine and Covenants – dans la Révélation faite à Joseph Smith, lequel déclare que le Saint qui pratique la pluralité des épouses, ne peut plus commettre de péché, sauf en cas de meurtre (c’est ce privilège qui fait de lui... un dieu). Il s’ensuit qu’un Mormon pouvait se parjurer devant les tribunaux des « Gentils », mentir aux non-Mormons, pratiquer la polygamie et déclarer ou prêcher le contraire sans commettre de péché.
Nous touchons ici à un point obscur de la vie intérieure du mormonisme. À côté de sa doctrine exotérique, possède-t-il une doctrine ésotérique, réservée à certains initiés ? On pourrait le déduire de certaine, expressions des Révélations prétendument faites à Joseph Smith, d’où il semble qu’il existe des clauses secrètes, dont la connaissance est réservée uniquement aux plus dignes. Un théologien mormon, Jedediah Grant, a formulé, par exemple, la théorie du blood atonement, c’est-à-dire de l’expiation par le sang, selon laquelle l’assassinat, dans certains cas, cessait d’être un crime pour devenir un instrument de salut pour ceux qui en étaient victimes. (Certains docteurs catholiques ont défendu des thèses qui s’apparentent à cette doctrine). Un ex-Mormon, le révérend Hyde, a raconté, vers 1360, qu’il y avait une initiation mormone à des mystères religieux entre autres ceux de la création et de la chute ; de plus, le nouvel initié promettait l’obéissance passive, « perinde ac cadaver », aux ordres de l’Église, à laquelle il consacrait sa vie pour qu’elle devint maîtresse du monde. Cette initiation comportait un serment vouant à la haine divine et terrestre et « les gentils » en général et le président des États-Unis en particulier. On conférait alors au nouveau Mormon la prêtrise de Melchisédek. Il va sans dire que les plus cruels supplices, puis la mort, étaient réservés aux traîtres dévoilant les mystères de leur initiation... Des assassinats de voyageurs traversant l’Utah, chercheurs d’or ou autres, ont paru confirmer cette idée d’une doctrine ésotérique très dangereuse pour la sécurité sociale. Il est évident que vers 1860 et les années qui ont suivi, les Américains et leur gouvernement ont tenu en grande suspicion les doctrines et des actions des Saints du dernier jour.
À l’heure actuelle, les Mormons se montrent fort respectueux des lois de l’Union américaine. Certains d’entre eux sont de hauts fonctionnaires et jouent même un rôle politique, comme sénateurs et représentants au Congrès. L’Utah compte, aujourd’hui, 450 000 habitants dont 300 000 Mormons, parmi ceux-ci, un certain nombre de Scandinaves. Le pays est bien cultivé et l’irrigation, poursuivie méthodiquement, a donné de merveilleux résultats. La culture des arbres fruitiers a également été vigoureusement poussée. L’instruction est très développée et l’église mormone fait de grands sacrifices dans ce sens. 80 p. 100 des impôts de l’État sont consacrés aux écoles, si bien que le nombre des illettrés est infime... On compte qu’il existe 50 000 Mormons dans le monde entier, dont une importante colonie au Mexique. Ils assurent qu’ils ont 2000 missionnaires à l’œuvre au Canada, en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, en Suisse, dans les pays scandinaves, aux Antilles, dans l’Afrique du Sud, au Japon, en Polynésie, dans l’Amérique du Sud, en Turquie, en Palestine enfin.
Au point de vue ecclésiastique, l’église des Saints du dernier jour est compliquée et théocratique ; à la base se trouve le ward ou paroisse (il en existe 700 dans toute l’église), ayant à leur tête un évêque et deux conseillers.
Au point de vue social, les Mormons ont fondé leur société sur trois grandes bases : la coopération qui permet à chaque individu de se développer autant que ses facultés le lui permettent ; la dîme, qui prescrit à chaque Mormon de verser 10% de ses revenus à un fonds commun, dont le but est, en venant en aide aux membres les plus pauvres de leur société, d’en éliminer la misère ; l’arbitrage, qui supprime le recours aux tribunaux séculiers et réduit les litiges à leur plus simple expression en les soumettant à de hauts conseils quels qu’ils soient, et sans aucune dépense.
Les Mormons ont un sens aigu de la solidarité qui doit unir les membres d’une même association. Ils ont été jusqu’à prévoir des excursions pour les vieillards et c’est ainsi que se met en route, plusieurs fois par an, vers les sites pittoresques de l’Utah, une caravane d’excursionnistes de plus de 70 ans.
Faut-il croire M. Léon Abensour, lorsqu’il dit : « Les résultats obtenus par les Mormons dans l’Utah montrent ce qu’auraient pu faire les Saint-Simoniens si, au lieu de vouloir rénover la société européenne, ils avaient pu trouver un coin du vieux monde, où seuls occupants, ils eussent pu, en toute tranquillité, appliquer leurs idées » ? C’est que justement on n’a pas laissé les Mormons appliquer leurs idées en toute tranquillité, et nous craignons fort qu’ils se soient laissés américaniser comme le reste du pays. Quoi qu’il en soit, et sans prendre à la lettre les récits de voyageurs auxquels on ne laisse voir que ce que l’on veut, les Mormons ont donné au monde un inégalable exemple de courage, d’énergie, de ténacité, de volonté de réussite. C’est avec des moyens de locomotion primitifs qu’ils ont traversé l’Amérique de l’est à l’ouest, c’est avec des outils rudimentaires qu’ils ont creusé leurs premiers canaux, bâti leurs premières écoles, construit leurs premières salles de réunions, c’est avec de maigres ressources qu’ils ont transformé un désert en une contrée fertile ; longtemps ils ont ouvertement tenu tête à l’un des plus puissants gouvernements du globe et peut-être auraient-ils pu prolonger davantage la résistance s’ils avaient été moins patriotes, moins citoyens des États-Unis, davantage hors-la-loi. Mais il ne faut demander à personne plus qu’il ne peut fournir et ce qu’ont fourni les Mormons est déjà assez consistant.
– É. ARMAND.
MORPHOLOGIE
n. f. (du grec morphê, forme, et logos, discours)
Étude des formes de la matière, de la physionomie des corps : morphologie minérale, végétale, animale. En histoire naturelle, la morphologie (ce mot pris dans son sens le plus large) est à peu près synonyme d’organographie. Mais celle-ci vise davantage la description ; celle-là, plus complète, recherche le processus même de la formation ; elle compare les organes et en établit l’histoire. D’abord utilisée en botanique, par de Saint-Aulaire, l’expression de morphologie est devenue courante en zoologie. Elle s’appuie en particulier, dans les sciences naturelles, sur le grand principe de la métamorphose...
Elle s’applique, en biologie, à l’étude de la forme extérieure des êtres vivants et de la forme de leurs organes intérieurs. À côté de la physiologie qui s’intéresse aux fonctions, elle étudie les êtres et leurs organes dans leurs éléments (histologie) dans leur structure et leur conformation (anatomie), dans leur développement (embryologie). Depuis Darwin et surtout Haeckel, la morphologie est regardée surtout comme « l’ensemble des données synthétiques qui résultent des recherches de l’embryologie, de l’histologie et de l’anatomie comparées ». Elle poursuit ainsi « l’explication des phénomènes relatifs à la forme et à la structure, et à leur évolution et leurs modifications ». (Larousse).
Envisagée sous cet angle, la morphologie a proposé quelques grandes lois. Citons, entre autres : la loi de « l’assimilation fonctionnelle » (Le Dantec) à laquelle se rattache le principe de l’« excitation fonctionnelle » (W. Roux) ; la loi de « la division du travail physiologique » (H. Milne-Edwards) et de « la corrélation des formes » (Cuvier) ; la loi « biogénétique » (Serres et Müller) qui établit les rapports de l’ontogénie et de la phylogénie... (Voir biologie, métamorphose, sciences naturelles, etc.).
BIBLIOGRAPHIE. – W. Gœthe : Zür rnorphologie. – E. Haeckel : Generelle Morphologie der Organismen. – Cope : The Mechanical Causes of the dévelopment of the hard parts of the mammalia. – Houssay : La Forme et la Vie. – etc.
En GRAMMAIRE (v. ce mot), la morphologie est l’histoire de la forme des mots et de leur transformation. Elle comprend à la fois « l’étude de la formation des mots par voie de dérivation et de composition », appelée plus spécialement étymologie et celle des « modifications des désinentielles que subissent les thèmes pour devenir des noms, des verbes, etc. », cette seconde branche constituant la morphologie proprement dite... La morphologie diffère de la phonétique dont elle n’a pas les lois générales... Ici, comme dans les sciences, la morphologie ne se borne pas à constater les variations, mais elle s’ attache à les expliquer par comparaison avec des phénomènes antérieurs. Dans les langues indo-européennes, la morphologie est essentiellement la science des formes de déclinaison et de conjugaison. Elle n’existe pas dans les langues monosyllabiques où la grammaire se réduit à la phonétique et à la syntaxe.
MORT
Subst. m. et f. (du latin mors, mortis)
Suivant l’interprétation qu’on donne à ce mot, mort indique, soit l’action accomplie, c’est-à-dire le fait de mourir, soit un état spécifique : celui qui succède à cette action... Au masculin, il désigne la personne qui a cessé de vivre. Du point de vue religieux, la mort est le commencement d’une autre vie, du point de vue philosophique c’est le saut dans l’inconnu, l’exil éternel selon Horace, le néant suivant Sénèque, une nuit sans rêve et sans conscience pour le biologiste.
Dès que l’être humain nous a quittés, son corps se refroidit et ce dans un temps proportionnel à la nature de la maladie ou à la température dans laquelle il vient de mourir. Généralement, 8 ou 10 heures après la mort, un cadavre est froid, mais ce froid, constaté au toucher, n’est qu’apparent ; le thermomètre, lui, continue à marquer une certaine température durant au moins 24 heures.
Durant quelques heures il semble qu’une certaine vitalité subsiste chez le mort, des expériences physiologiques ont démontré que, sous l’influence d’un courant électrique, les muscles du mort pouvaient se contracter et exécuter des mouvements divers.
Selon le docteur Caltier-Boissière, il y aurait cinq signes immédiats et sept signes tardifs qui permettraient de savoir si nous nous trouvons en présence d’une mort réelle. Dans la première catégorie, il place :
-
l’abolition de l’intelligence ;
-
l’absence de la sensibilité ;
-
l’abolition de la respiration ;
-
l’absence des battements du cœur ;
-
l’insensibilité de la cornée.
Pour la seconde catégorie, il y a :
-
le relâchement des sphincters de la vessie et de l’anus ;
-
la rigidité ;
-
le refroidissement ;
-
les taches rouge-bleuâtre ;
-
l’aspect spécial de la face ;
-
l’absence de contraction musculaire ;
-
la putréfaction. (Voir signes de la mort).
Qu’est-ce que la mort ? La mort est la cessation de coordination entre les cellules d’un organisme.
Est-ce un phénomène extraordinaire ? Marc-Aurèle, dans le Manuel du Stoïcien écrivait : « Si on la considère en elle seule, si, par abstraction de la pensée, on la sépare des images dont nous la revêtons, on verra que la mort n’est rien qu’une opération de la nature. Or, quiconque a peur d’une opération de la nature est un faible enfant. Il y a plus : non seulement c’est là une opération de la nature, mais c’est une opération utile à la nature... Mirabeau nous a donné une définition aussi juste que consolatrice :
« J’ai souvent pensé que la mort était la plus belle invention de la nature ; mais c’est quand elle frappe nous et non pas les nôtres... »
Frédéric Nietzsche, dans La Volonté de Puissance s’exprimait ainsi :
« La défection, la décomposition, le déchet n’ont rien qui soit condamnable en soi ; ils ne sont que la conséquence nécessaire de la vie, de l’augmentation vitale. Le phénomène de décadence est aussi nécessaire que l’épanouissement et le progrès de la vie ; nous ne possédons pas le moyen de supprimer ce phénomène. Bien au contraire, la raison exige de lui laisser ses droits. »
Aussi multiples qu’elles soient, les causes de la mort peuvent cependant être classées en mort naturelle et mort accidentelle. Tantôt subite, tel est le cas des morts survenues par accidents, tantôt longue et pénible en cas de maladie. La mort s’insinue dans la vie s’en empare, se confond avec elle au point de pouvoir donner à la mort la seule vraie signification qu’elle doit avoir : la mort c’est la vie.
Mais, il n’est pas si facile de mourir, et, je ne sais si une autre pensée a inspiré à l’être humain autant de crainte. Le jour où l’être s’est mis à réfléchir sur cette idée, si naturelle pourtant, faisant d’un être animé, pensant, respirant, se mouvant, en un mot vivant à ses côtés une vie commune, un objet inerte, ce jour fut, pour lui, un jour malheureux, car il ne sut pas comprendre ce phénomène quelque peu troublant. La crainte est la grande pourvoyeuse des déifications. En présence d’une vie finie, l’être humain ne trouva d’autre consolation que l’espérance. Il imagina une croyance en un prolongement de l’existence. Il se refusa à admettre la disparition définitive, et se persuada qu’il reverrait ceux qui venaient de le quitter. Ainsi prit naissance cette foi en la vie future avec l’immortalité de l’âme et les chimères de l’enfer, du purgatoire et du paradis. Ces idées, l’être finit par les tenir pour certaines, et ce sont là les préjugés dont nous retrouvons les traces dans toutes les religions et plus particulièrement dans la religion catholique romaine.
Pour le croyant, la mort devient donc la séparation du périssable avec l’immortel, de l’âme avec le corps. Une destinée commence quand l’autre prend fin ; voici la vie éternelle et notre parution devant la divinité... Quel sera son jugement ? Prions en attendant, allumons des cierges, portons de l’argent en offrande aux saints pour qu’il nous soit beaucoup pardonné, car nous avons peut-être péché. Telles sont les grandes préoccupations des croyants à l’approche de la mort.
Ceci témoigne de la crainte qu’éprouvent ces personnes avant de comparaître en face de leur « Dieujuge ». J’ai souvent remarqué que les personnes les plus croyantes semblaient avoir de la mort une véritable frayeur. Cependant, n’est-elle pas, pour eux, la fin des maux d’ici-bas, la vie présente n’étant qu’un court passage, une infime portion de la vie éternelle. Mais il est vrai qu’un jugement les attend au terme du séjour terrestre. Paradis, enfer ; la crainte d’entrer dans celui-ci pour n’avoir pas mérité l’autre n’est pas pour les réconforter.
Dans ce cas, de deux choses l’une : ou elles ont « mal agi » durant leur court séjour sur cette terre tout en voulant se montrer bons chrétiens, c’est l’hypocrisie ; ou elles n’ont pas confiance en leur Dieu, juste et miséricordieux.
« Si j’avais la force de tenir une plume, je voudrais m’en servir pour exprimer combien il est facile et agréable de mourir », disait William Hunter... Qu’il est doux de mourir quand, vieilli, fatigué, usé par les luttes de la vie, l’on s’éteint en songeant au bonheur que l’on a pu semer dans son existence. La mort apparaît alors comme un repos bien mérité, un repos demandé ; car de même que, le soir, après la journée bien remplie, l’on éprouve le besoin de dormir, il est un âge où l’on peut sentir le besoin de se reposer pour toujours... »
D’ailleurs, puisque la vie continue après nous, sachons faire place à des vies nouvelles, plus ardentes, plus enthousiastes, capables d’apporter par leur travail plus de bien-être et plus de bonheur à l’humanité. Savoir mourir quand l’heure nous y invite, c’est l’idéal vers lequel nous devons nous élever.
En effet, savoir mourir, c’est comprendre la vie. Ainsi que Platon, Marc-Aurèle, Epictète, c’est se rendre compte du but final de la vie comme le génial musicien Mozart le faisait en écrivant à son frère, le 4 avril 1787 :
« Je me suis, depuis quelques années tellement familiarisé avec cette vraie, cette meilleure amie de l’homme, que son image, non seulement n’a plus rien d’effrayant pour moi, mais est même, au contraire, très calmante et très consolante... et pourtant aucun de ceux qui me connaissent ne pourra dire que je sois chagrin ou triste. »
Savoir mourir, c’est se rapprocher de ce qu’écrivait Tolstoï :
« Je pense de plus en plus à la mort et toujours avec un nouveau plaisir : tout s’apaise. »
C’est la concevoir comme Léonard de Vinci :
« Si la mort n’était pas, il n’y aurait, au monde, rien de plus misérable que l’homme. »
Nous n’avons, il est vrai ni la force de caractère d’un Socrate, ni la puissance de raisonnement d’un Epictète ; nous ne pouvons envisager la mort comme Mozart, ou l’attendre comme Tolstoï, ou bien encore l’apprécier comme Léonard de Vinci, mais nous devons nous en faire une idée assez nette pour ne pas être effrayés à son approche.
Mais pourquoi devons-nous mourir ? me direz-vous. Parce que la mort est une forme nouvelle de la vie, de la marche de celle-ci elle est la conséquence naturelle et logique ; et c’est une transformation, en somme, nécessaire à l’équilibre des forces de la matière. Notre vie n’est-elle pas faite de la mort d’une foule d’êtres et tout le mouvement de la nature n’est-il pas basé sur la lutte continuelle qui se traduit si cruellement par cette pensée : Tout ne vit que par la mort. Comme l’a très bien dit Hosphile :
« L’Univers se détruit lui-même pour se survivre, la vie crée la mort pour rester la vie et revivre sans fin... »
Mais les religions jusqu’à ce jour n’ont cessé d’enseigner aux peuples qu’au ciel seulement règnent l’égalité, la justice, la fraternité, en un mot la vraie vie, harmonieuse et droite. Et ce baume et ces promesses n’ont fait qu’abuser les faux « vivants », illusionnés par la perspective d’un bonheur éternel. Bonne aubaine pour les puissants !
Consolés par ce mirage, les esclaves ont accepté la détresse de leur sort, regardé même comme une épreuve bienfaisante les souffrances de cette « vallée de misères », antichambre de la béatitude éternelle... Alfred de Vigny disait, avec raison :
« La religion du Christ est une religion de désespoir, puisqu’il désespère de la vie et n’espère qu’en l’éternité. »
La science a amené les individus à méditer sur leur sort, en précisant le sens et la portée de la vie. Elle les a préparés à lutter pour l’amélioration de leur condition présente et c’est là un résultat heureux des recherches persévérantes de la pensée humaine.
« Le seul effort qui compte est de coopérer avec les grandes forces spirituelles qui donnent à l’Univers sa signification, et quand on s’élève à cette conception de la vie, on sent qu’on ne peut pas plus cesser d’être que n’ont cessé d’être Pythagore, Socrate, Platon, Aristote et tous les grands esprits qui continuent à vivre dans toute intelligence qui s’ouvre à la vérité. Pythagore est penché sur tout enfant qui cherche combien il y a de décimètres cubes dans un mètre cube. La seule mort éternelle, c’est de n’avoir pas fait sa tâche... » (Payot dans La Conquête du Bonheur)
Avec Lebrun Pindare, disons :
« Je ne meurs pas, je sors du temps » ;
Avec G. Adolphe :
« À d’autres le monde ! » ...
Dans l’état actuel de nos connaissances, la mort nous apparaît comme un phénomène plus fort que nos volontés, mais dont la vie même tire encore profit. Si inéluctable, d’ailleurs, qu’il nous semble aujourd’hui, cela n’implique pas que nous ne pouvons chercher à en reculer l’échéance, à assurer toujours plus, sur la mort, le triomphe de la vie. Nous nous devons seulement d’envisager la défaite avec sérénité. Quand notre rythme vital s’interrompt, que l’individu épuisé ou inapte s’efface devant de nouveaux arrivants, il importe de donner à la retraite toute sa valeur, de la rendre claire, généreuse et digne. La mort regardée en face, bien située et comprise, cesse d’être un objet de crainte et d’horreur. D’en pénétrer la signification et de reconnaître qu’elle s’accompagne aussi de bienfaits, cela ne peut que nous rendre meilleurs.
– Hem DAY
MORT
S’il fallait écrire ici une monographie proportionnée à l’importance attachée par l’humanité à la mort, l’encyclopédie tout entière n’y suffirait pas. Le rôle joué par l’idée de la mort dans la vie des peuples, comme dans la vie privée est formidable (voir le mot : vie). Pour tous, la mort, en effet, n’est pas seulement l’envers de la vie. Elle suggère, par voie d’association tout un monde d’idées et de sentiments. Philosophie, religions, morales, ethnologie, folklorisme, physiologie, médecine, poésie, art, mœurs, toutes ces disciplines, et combien d’autres encore, ont tenu à s’occuper du problème. Peu d’hommes y sont indifférents et si quelques-uns ont pu l’envisager comme un problème bio-pathologique aussi peu émouvant que la vie elle-même, l’accepter avec une sérénité impassible et souriante il est une infinité d’êtres humains pour qui la mort reste un sujet de terreur et d’angoisse qui ne le cède à aucun autre problème.
L’intensité de cette angoisse est en raison inverse du développement culturel de l’individu et de son émotivité, celle-ci considérée, dans l’espèce, déjà comme morbide, car l’on voit des intellectuels pour qui la mort est, quoi qu’ils fassent, un objet de phobie douloureuse.
Le fait historique est que ce phénomène banal de bio-pathologie a débordé sur la vie morale et sociale beaucoup plus que d’autres problèmes tels que celui de respirer, de manger ou d’aimer. C’est que, de très bonne heure, la mort a soulevé un problème d’ordre moral, uniquement comme conséquence de la croyance à l’existence d’une Âme, substance différente du Corps.
L’homme simple que fut le primitif, objective avant de penser et d’approfondir. Les impressions de plaisir et de peine sont à la base de toutes les philosophies. La seule contemplation du Phénomène « Mort », suivi de l’anéantissement, jugé absolu, de ce qui fut l’enveloppe de l’être, laquelle enveloppe tangible donnait seule l’idée de la vie ; la disparition parfois brutale et subite de cette manifestation dénommée vie ; sa cause apparemment immédiate dans la maladie, l’infirmité, l’usure ; l’idée d’une fin vraiment finale dans la souffrance, tout cela était bien de nature à épouvanter. La cessation du mouvement, dans l’ignorance du mécanisme et de la cause de ce mouvement qui incarnait la vie, la rupture définitive de tout rapport intellectuel ou affectif entre ce cadavre et l’ambiance, tout cela devait suggérer fortement l’idée d’une substance immatérielle étrangère à la guenille qu’elle habitait.
Et qui sait si, parmi les phénomènes générateurs du mysticisme, du dualisme substantiel, le phénomène Mort n’a pas été le plus influent ?... Il est certain que la Religion a beaucoup exploité ce phénomène pour établir l’autorité, l’empire de ses prêtres. On connait bien encore l’influence émouvante, irrésistible, d’un De Profundis et d’un Dies Irœ sur l’imagination humaine, même des mécréants. Ne fait-on point tout ce qu’on veut d’un être meurtri par la terreur ?
Dès l’origine, il fut naturellement impossible de nier l’immatériel. Qui pouvait animer ce cadavre, hier encore agissant et donnant, suivant le mot courant, l’expression de la vie ? Toutes les théories spiritualistes, animistes, etc., reposent sur de telles bases, dont l’importance fait illusion.
Le positif en cette matière est la conquête du savoir humain. Mais quel bloc de préjugés doit-il soulever avant de pénétrer dans les esprits et de métamorphoser l’Idée ! Allez donc dégager la pensée d’un Breton de la superstition relative à l’Âme, à la mort, à l’éternité d’un Au-delà, différent de l’En-deça ! Cette révolution commence à peine et l’on peut à peine entrevoir les conséquences de ce bouleversement si nécessaire.
Le dualisme de la substance devait conduire à cette définition inscrite encore comme un truisme dans les livres sacrés : la mort est la séparation de l’Âme et du Corps, de même que la vie est un souffle divin qui anime la matière. Le Monisme, à l’encontre, concevra que le souffle ne soit pas séparable de son support et que la vie, de définition toute relative n’est autre chose qu’un attribut de la matière, dont l’irritabilité est le témoin et l’activité sa manifestation. L’éternité même de la matière remplit un des postulats des dualistes pour qui l’Immortalité est un dogme inattaquable.
Il y a dans la mort deux objets à exposer, à discuter : d’un côté, le néant de la dépouille dite mortelle, autrement dit la mort matérielle et, ce qu’on lui oppose : la survie de l’Âme, ce qui ramène le problème de la mort à un problème de reviviscence possible, fait important, car monistes et dualistes se posent la même question : que devient l’objet complètement ou partiellement mort, l’Âme ne mourant point, par définition ?
DE LA MORT MATÉRIELLE.
Soyons toujours objectifs et dégageons-nous de l’a priori, car c’est uniquement par l’observation directe, abstraction faite de toute hypothèse imprudente, qu’il est permis à l’homme de découvrir quelque embryon de vérité.
Et, tout d’abord, définissons : qu’est-ce que la mort, objectivement parlant ? C’est un changement d’état des êtres définis vivants (la mort est la cause de la cessation de la vie). La mort étant, par définition même, un état négatif, personne ne sera surpris qu’on la définisse par une négation, fait qui ne manquera point de déconcerter les imaginatifs pensant voir dans la mort quelque chose de concret, parfaitement délimité, quand il n’y a encore que relativité. Car pour savoir ce qu’est la mort, encore faudrait-il savoir ce qu’est la vie. Sur ce chapitre ni la science ni la métaphysique ne nous ont fourni aucune précision. La vie ne se définit que par certaines de ses qualités : le mouvement, l’activité physique, l’irritabilité de la matière, les échanges biochimiques, etc... L’esprit fait une synthèse de cet agrégat de propriétés et cet amalgame devient pour lui la vie. Pour d’autres, la vie est qualifiée par les échanges, la transformation, l’évolution. Elle serait l’apanage exclusif de la matière organique du protoplasme (voir ce mot), de tout ce qu’il est impossible à l’homme de créer in vitro ou dans son laboratoire, Seuls les règnes végétal et animal seraient capables de vie. Point capital. Car alors il faudrait dénier toute vie au minéral, à raison de son apparente inertie, nul n’ayant eu le pouvoir d’assister à la fin du végétal sous la forme de la tourbe ou de la houille. Il faudrait refuser la qualité de vivre au soleil, qui pourtant est le principe de toute vie : comment donner ce qu’on n’a point ?
Le lecteur comprendra maintenant combien complexe apparaît le problème de la mort quand celui de la vie défraie toutes les fantaisies et reste si discuté, si mal résolu dans son essence. Tout ce que nous savons est que la vie, telle que nos faibles moyens nous la font concevoir n’est qu’un moment dans l’immense évolution de la matière cosmique. Qu’est la disparition d’une mouche ou d’un homme dans le cosmos ? C’est à cette humble interrogation que se réduit l’incommensurable vanité de celui qui prétend émerger du torrent indomptable des atomes.
Biologiquement, la mort n’a point de commencement ; nul ne sait davantage quand elle est accomplie. L’image de la Mort que notre œil contemple figure un paroxysme ; un état de révolte suprême, bruyant, poignant, mais qui cache ses débuts plus ou moins loin en arrière et qui s’estompe, le silence une fois fait vers un lointain sans limite. Ce paroxysme global a été précédé d’extinctions partielles ; il est l’origine, à son tour, de transformations nouvelles. Il n’est que la stupéfaction brusque de milliards de cellules infiniment petites associées coopérativement, grâce à la brutale désharmonie des règles physico-chimiques hiérarchisées dont l’équilibre avait donné jusque là l’illusion d’une personnalité sur laquelle une convention sociale avait appliqué une désignation patronymique. Tout cela se désagrège, mais pour initier un nouveau cycle. C’est une séparation de corps, un divorce dont les facteurs vont chercher fortune ailleurs.
En fait, la mort que nous contemplons avec effroi n’est que la multiplication subintrante de morts partielles qui s’échelonne la vie durant. Que de fois n’a t-on pas dit que la vie n’est qu’une longue agonie, que le début de la vie n’est que le commencement de la mort ! Voyez cet homme parvenu au déclin de sa vie de météore – telle une nébuleuse qui surgit pendant quelques siècles à notre horizon, pour disparaître à jamais ; on la croit éteinte : elle vit intensément. Voyez cet homme au moment où, ballotté depuis toujours par les orages de la vie, il a collectionné dans son enveloppe toutes les causes possibles de désorganisation. Voyez son cerveau soumis déjà à des processus pathologiques localisés en des régions plus ou moins importantes de sa masse. Ramollies ou traumatisées par l’hémorragie, ces parties sont détruites pour jamais. Voyez son foie, ses reins, voyez son cœur dont les éléments anatomiques composants se sont épuisés, envahis par la graisse, par la sclérose : deux agents bien connus de la mort cellulaire. Et jugez l’ensemble de ce cadavre ambulant, qualifié vivant encore jusqu’au jour où les millions de petits cadavres que nous traînons en grimpant notre lent calvaire conquièrent à leur tour les imposantes unités cellulaires, spécifiquement résistantes, et préposées par une longue sélection à la régulation de la vie coloniale : centre de la circulation, centre de la respiration, le fameux nœud vital de Flourens. Alors éclate la bourrasque, l’orage qui frappe nos sens après avoir grondé depuis toujours dans l’obscurité de notre enveloppe. Et, à ce moment, il y a souvent beau jour que les éléments cellulaires dits supérieurs de notre cerveau ont cessé de fonctionner. Ce grand cadavre qu’une pompe ridicule va conduire à sa dernière demeure était mort depuis longtemps.
Notre naissance est une illusion ; notre mort en est une autre.
Ce que nous savons encore c’est que la mort dite totale sera le signal de vies nouvelles. La désagrégation physico-chimique du corps commence instantanément. Elle se manifeste par l’entrée en lice de myriades d’infiniment petits parasites, autant de nourrissons affamés, tenus en respect jusque-là, et dont l’activité dévorante va se traduire extérieurement par les signes de la putréfaction. La faune des tombeaux, qui achève l’heureuse disparition de l’ancien être défini vivant, fait une œuvre d’assainissement lente. Car notre substance hyper toxique serait un danger social n’était le parasitisme utile qui nous pousse au tout à l’égout pour l éternité. Tels, autrefois, les chiens de Constantinople accomplissaient un travail de voirie en dévorant les immondices. Mettez une grenouille morte au voisinage d’une fourmilière. En quelques heures elle est réduite à ses parties calcaires et inorganiques non nuisibles, dont la dissolution plus lente sera l’œuvre du temps.
Néant tout cela ? OUI, mais en apparence, car rien ne se crée, rien ne se perd. Et ce zéro est l’aurore de vies nouvelles, dont personne ne saurait prévoir l’organisation. Et, quoi que nous fassions pour justifier notre orgueil, nous ne valons ni mieux ni pire que cette grenouille au regard de la mort.
LA MORT DE L’ÂME. – Les dualistes, aveuglés par le préjugé et convaincus par de frêles apparences, n’ont été que des observateurs superficiels, quand ils ont négligé d’approfondir les phénomènes tangibles que j’ai rappelés. Pas plus qu’ils n’ont défini la vie, ils n’ont défini l’âme et, pour faire de l’immatériel quelque chose de mystique revêtu du simple mot « Âme » qui ne dit rien, ils ont réalisé de prodigieux efforts qui reculent simplement la solution du problème. Le royaume des mots donne bien l’idée du désert. La définition qu’ils ont donnée de la mort en disant qu’elle est la séparation de l’Âme et du Corps ne répond à rien de positif. Car le moment présumé de la mort totale n’est que le spasme, la convulsion suprême de toute une colonie solidariste vivante, porteuse déjà d’innombrables nécropoles. Le dernier soupir, si poétique, le dernier battement du cœur, signal conventionnel de la mort du point de vue de l’état-civil, n’a pris d’importance malgré son irréalité de fait, qu’à raison de toutes les légendes dont l’humanité s’est complu à aggraver la vie.
L’être humain répugne à croire qu’il disparait à tout jamais, comme un ver de terre dont il ne songe pas à concevoir la résurrection. Il ne saurait admettre, tant il se croit le nombril de l’Univers, que la désintégration de sa substance atteint du même coup ce que son ignorance gonflée de vanité lui a représenté comme son être conscient.
Il faut reconnaître que la vie sociale elle-même s’est gravement compliquée de tout ce qu’on a qualifié de moral, vie sentimentale, affective, esthétique etc., qui, pour la grosse majorité de citoyens alourdis par la tradition, ne saurait être de même essence que la vie organique. Il faut avouer que l’organisation sociale de la vie en commun a inventé une foule de contingences que l’on s’est cru obligé de prendre en considération pour donner des assises au groupe humain ; que, conventionnellement, on a créé une morale, une science du Devoir et surtout une Responsabilité ; que tous ces artifices forment un bloc rigoureusement charpenté, sous forme d’un contrat très vieux que, seuls, les fous ou les aveugles qualifient d’imposture. Il faut avouer enfin que le prêtre a proclamé des devoirs conventionnels, non plus seulement vis-à-vis des autres hommes, mais vis-à-vis d’une fiction dénommée Dieu ou Être suprême, à qui nous devons tout, le mal comme le bien, mais à qui il faut rendre hommage quand même.
Il faut reconnaître qu’une telle évolution séculaire a créé une notion, disons mieux : une phobie sur laquelle les ignorants, les timorés ont apposé l’étiquette d’Au-delà ; que la croyance à une vie future est venue imprimer au phénomène « Mort » un caractère spécial dont il n’est pas donné à tout le monde de s’abstraire et qui, finalement, fait de la mort apparente un drame humain familial et social, au lieu de la laisser confinée parmi les phénomènes naturels, normaux, comme le début d’une trêve qui représente, pour le plus grand nombre, plutôt une délivrance qu’une souffrance. Les mortels fort nombreux pour qui la vie n’aura pas été un bienfait ne sauraient envisager la mort comme une transition.
Et c’est cependant ce qui subsistera longtemps encore dans la pensée de ceux à qui la conception étroite de l’idée de justice, a pu faire croire à la réparation, ne serait-ce que par besoin d’équilibre et d’harmonie.
Ce n’est pas ici le lieu de décrire, ni de discuter les vues diverses de l’« Au-delà », suivant les religions, depuis le ciel et l’enfer chrétiens jusqu’à la métempsychose et à l’épuration progressive des âmes migratrices à travers de nouveaux corps, jusqu’au repos suprême, et éternel au sein du Bouddha. De toute cette poésie, fille de la Peur, rien ne résiste à la critique.
Mais n’ignorons point l’objection des spiritualistes à cette conception navrante de la mort sans phrase tout aussi bien de l’immatériel que du solide : les monistes détruiraient tout idéal, toute idée de compensation, partant de justice ; ils ravalent l’homme au niveau du chien. Et l’idée d’Un enterrement sans prêtre plonge la foule dans l’épouvante.
L’objection n’est point sans valeur aux yeux de ceux qui, avancés dans la carrière de la philosophie positive et réelle, capables de contempler sereinement sans crainte ni illusion, les pires événements, conservent une tendresse, une pitié pour les attardés à qui il faut une consolation. Mais à cette objection, l’on peut dénier hardiment une réelle portée, car la conception matérialiste de la mort est loin d’être sans poésie, sans idéal, sans pureté. L’idée du repos, de l’oubli n’a-t-elle pas déjà valeur d un soulagement, celle du narcotique après la douleur ? J’engage les camarades à l’âme heureusement portée vers l’idéal à méditer longuement devant le plus émouvant édifice que je connaisse, le monument aux morts, de Bartholdi, au Père Lachaise. Je sais des gens qui ont bien souffert et qui en reviennent retrempés quand ils ont vu le calme, la sublime simplicité avec laquelle ces groupes de malheureux humains voient s ouvrir devant eux la porte de l’éternel Nirvana, à deux pas de ce crématoire où leur dépouille évaporée prendra son vol vers l’infini.
Les spectacles de la nature, vue dans son ensemble, et de très haut, grâce au privilège de notre imagination, restent grandioses et magnifiques quand même l’homme se voudrait réduire au niveau de l’atome. Quoi de plus beau, de plus génial, de plus esthétique, que ce tableau de l’évolution cosmique à laquelle l’homme le plus humble peut être fier de participer. Pour les orgueilleux, la pensée peut être satisfaite de savoir qu’ils sont une partie infime du Grand Tout et que le retour au sein du cosmos, après son éphémère vie, a pour l’imagination quelque chose de prodigieusement captivant. Les créations les plus luxuriantes sont sorties de ce rêve splendide. La pensée d’être un atome constructif du grand édifice mondial ; la pensée que, demain, tout ou partie de ma substance peut constituer les éléments de la rose ou du jasmin m’ouvre des perspectives dont je jouis à volonté présentement, grâce aux ressources de la folle du logis, plus près cependant de la réalité que les billevesées des croyants. Ces vues dépasseront à coup sûr en intérêt la vision où j’aperçois mon âme en contemplation perpétuelle de Dieu, ou rôtissant in œternum dans le grill-room de Satan.
La morale conventionnelle a-t-elle perdu ses droits en l’occurrence ? Le matérialiste prétendra le contraire et sa morale est juchée en des régions singulièrement plus élevées que celles où l’on voit l’idée du Devoir simplement adéquate à l’idée de sanction pénale ou de récompense. Le devoir basé sur l’intimidation ou l’intérêt manque de grandeur. Avoir peur est démoralisant. Accomplir son devoir fièrement, pour l’amour du devoir, conduit l’homme en un lieu éthéré, dont les morales de convention lui interdisent l’accès.
Or l’homme n’est qu’un chaînon dans la chaîne des êtres. Il est un moment dans l’évolution. Comme tel il est l’héritier de millions d’ascendants dont il subit fatalement l’influence. Il en souffre à certains points de vue, parce que l’évolution mal conduite, fille de l’erreur, de la vanité ou de l’égoïsme a fait de lui un pauvre esclave. L’humanité est fille de ses œuvres. Mais il en tire avantage à d’autres points de vue et c’est encore de son histoire qu’il tire tout ce qui dans sa vie présente peut être qualifié : joie, bonheur, satisfaction physique ou morale.
D’où dérive pour lui cette formidable notion de la solidarité raciale, qui cheville en lui cette autre notion que nous devons à autrui la part de mal et de bien que nous avons en partage, que, par suite, la fraction de mal et de bien qui est notre œuvre propre prépare pour nos descendants la vie future. L’humanité de demain sera notre œuvre. Or, qui est-elle cette humanité si ce n’est l’être qui sort de nous-mêmes, ainsi que ses descendants. Qui est-elle si ce n’est nous-mêmes sous d’autres apparences ?
Le mal que je m’inflige volontairement ou par insouciance, ou par méconnaissance de mes obligations de solidarité, c’est le mal de mes fils. Comme le mal que j’ai subi, c’est le mal de mes ancêtres. Mais aussi le bien que je triture de mes mains, par mon effort combiné et raisonné, c’est le bien que je rêve pour mes successeurs et dont je jouis par avance, dans une anticipation d’un au-delà qui est mon œuvre. C’est ma part de paradis réalisée sur terre.
Quel admirable aiguillon pour le bien est une semblable conception, qui montre l’atome humain véhicule éternel des propriétés qui feront la vie et la mort de la race, de ses jouissances comme de ses misères. Et quelle supériorité caractérise l’intelligence de l’homme qui, dès la jeunesse, prend conscience d’un pareil devoir !
À la peur, aiguillon des morales artificielles se substitue l’amour, fécondant un altruisme issu, d’ailleurs, d’un égoïsme rationnel et bien compris. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas recevoir toi-même, est un prétexte, religieux dans son origine, mais d’essence très humaine dans sa réalité. Et ce précepte n’est-il pas adéquat à l’idée de justice réparatrice ?
Mais pour concevoir la mort, comme je l’ai dépeinte, pour la confondre avec la vie et par suite pour la nier, Il ne faut pas être hypnotisé par le médiocre microbe que nous sommes, il faut envisager l’humanité elle-même, dans l’histoire successive des longues périodes qu’elle traverse, venant on ne sait d’où allant on ne sait où, mais pourtant digne dans la lutte pour l’existence, d’accéder à une somme de bien-être d’autant plus précieux que tous les vivants en auront été les artisans.
La mort n’est qu’une apparence. Car la mort est encore la vie. C’est une roue qui tourne indéfiniment. Et cette infinité est le symbole de l’éternité.
– Docteur LEGRAIN.
MORT
Le problème de la mort, tout comme celui de la vie, est un de ceux qui ont reçu le plus d’explications et d’interprétations finalistes, non seulement de la part de tous les mystiques et métaphysiciens mais encore de la part d’innombrables philosophes et même de nombreux savants. Quelques-uns de ceux-ci n’arrivent point à se débarrasser de la notion d’utilité et de raison d’être de ce qui est. Pour eux, il faut absolument que l’univers ait un sens.
D’autre part, l’homme rapportant inévitablement tout objet de connaissance à son propre fonctionnement vital, et il est tout naturel que chaque humain, chaque croyant, ou athée, ou curieux ; chaque groupe, ou clan, ou peuple, ou race se fasse de la mort un concept conforme à sa constitution particulière à son sens propre de la vie. Mais cette manière toute subjective d’envisager la mort n’exclut nullement l’examen objectif de ce phénomène considéré comme un des effets du fonctionnement universel s’exerçant sur les hommes sur les races et les diverses civilisations.
Ce qui caractérise nettement l’univers, c’est le mouvement. Mouvement d’une substance inconnaissable dont les cycles évolutifs seuls nous sont connus en partie, et dont les transformations successives peuvent être considérées comme autant de naissances et autant de morts. Remarquons qu’à moins de contradiction avec le postulat de l’incréation ou de l’absence de miracle, nous ne pouvons admettre de création ou de disparition extraordinaire de substance ou de mouvement, mais seulement des changements d’état synthétiques, déterminés par les réactions réciproques des éléments entre eux. Ce dynamisme perpétuel est incompatible avec toute stabilité, avec toute durée ou conservation définitive des équilibres formés par les groupements plus ou moins compliqués de la substance en mouvement.
Cette éternelle instabilité nous indique également qu’il n’y a aucune finalité dans l’univers puisque aucun état n’est définitif et qu’il est impossible d’assigner une borne à l’espace et au mouvement générateur du temps humain. L’infinité du temps et de l’espace est la négation même de la notion d’âme et de la notion de divinité, car il est profondément absurde d’essayer d’imaginer la suppression ou la création, par qui ou quoi que ce soit de l’espace et du temps. Ce sont là des inepties. De même la notion d’éternité détruit toute existence possible d’une âme, car ou bien cette âme a eu un commencement (et dans ce cas elle subit toutes les vicissitudes des transformations de la substance, se confond avec elle, nait et meurt comme toute forme qui commence et qui finit), ou bien elle est éternelle (et alors il faut reconnaître que de toute éternité l’âme a été une fort triste chose, puisqu’elle ignore encore le secret des mondes et n’a pas su réaliser la fraternité et l’amour). Un si maigre résultat pour une éternité d’efforts, prouve l’absurdité de l’immortalité de l’âme et démontre que sa seule réalité ne peut-être qu’une synthèse de la fonction vitale, modifiable et périssable comme elle.
L’origine de la croyance en la survivance remonte probablement aux premiers essais de compréhension et d’explications des rêves, du sommeil, des évanouissements, des morts sans lésions apparentes, etc., etc. ; explications unissant et confondant les diverses ressemblances de la vie et de la mort, sans possibilité de fixer la frontière où commence l’imagination et où finit la réalité.
Peut-on correctement parler de vie et de mort en désignant tous les phénomènes de l’univers ? Il ne le semble pas car la nécessité de distinguer les phénomènes entre eux, pour ne point les confondre, nous oblige à reconnaître les différences qui les séparent et les caractérisent. Or, le phénomène vital tel que nous le connaissons objectivement, se différencie des autres phénomènes par la propriété que possède la substance, dite vivante, de reproduire de la substance identique à la sienne dès qu’elle peut agir sur d’autres substances ; tandis que les autres combinaisons physicochimiques dans leurs réactions réciproques perdent leurs caractères particuliers, se détruisent pour former de nouvelles combinaisons.
Autrement dit, la vie est un mouvement conquérant qui se différencie de tous les autres mouvements en ce sens qu’il persiste dans toutes ses réactions et tend à convertir à son rythme propre toute substance susceptible d’être assimilée. La durée la caractérise également, car, tandis que chaque réaction nouvelle efface de la matière non vivante les effets des réactions précédentes, ne laissant subsister qu’une mémoire primitive et empêchant tout souvenir complexe de se coordonner dans le temps, la matière vivante conserve les empreintes successives de ses réactions, et son rythme propre, coordonnant tous ses souvenirs, construit une sorte de recueil des événements subis dans le temps, et qui constitue la durée.
Il ne saurait donc être réellement question de vie et de mort cosmique autrement qu’en un langage figuré.
La vie, avons-nous dit, est un système conquérant. C’est ainsi que si les trois mille générations d’infusoires cultivés par Woodruff pendant cinq ans avaient pu se développer intégralement sans causes destructives, ni manque d’aliments, le volume de protoplasma ainsi formé aurait égalé dix mille fois celui de la terre. Mais ce système conquérant se heurte à d’autres mouvements ou à d’autres systèmes qui le limitent ou le détruise sans cesse, créant ces états transitoires, que nous apprécions relativement à notre propre durée et que nous dénommons équilibre et harmonie, ou cataclysme et chaos, selon qu’ils s’effectuent à notre échelle dynamique ou hors de notre rythme vital.
Notre compréhension, déterminée par notre durée appelle donc harmonie tous les mouvements qui ne détruisent point notre vie et comme celle-ci n’est possible précisément, que parce que ces mouvements l’ont créée, nous voyons que tant qu’un être est vivant, tant qu’il dure, et qu’il se meut dans un monde qui dure, il peut croire a un finalisme accordant toute chose dans l’univers. Sa mort lui ôtant toute possibilité de constater les éternels et chaotiques recommencements et la fragilité, transitoire de son moi, il vit et meurt après s’être construit un concept des choses proportionné au seul aspect de l’univers connu, ou des représentations plus ou moins exactes qu’il s’en fait.
Comme la connaissance humaine est essentiellement sensorielle et que tout mouvement trop rapide ou trop lent, tout phénomène d’une durée trop grande ou trop petite n’affecte point nos sens, nous ignorons le mécanisme intime de la substance ainsi que le mécanisme total de l’univers. Nous ne connaissons que des synthèses extrêmement compliquées et nullement les éléments analytiques les composant.
C’est ainsi que nous ne connaissons de la vie que quelques effets, qu’il nous est très difficile de dire analytiquement pourquoi elle est conservatrice et conquérante et que nous ne pouvons de même connaître réellement la mort que par ses effets : la fin de l’assimilation, la destruction du système conquérant, la désagrégation de sa substance et de tout ce qui constituait son acquis, sa mémoire, sa durée, ses réactions, etc., etc.
Il semblerait au premier abord, que la mort, ou fin d’un système conquérant, fût une chose toute naturelle puisque tout évolue dans l’univers et qu’aucun système n’y dure éternellement. C’est en abondant dans ce sens que l’on dit habituellement que la vie crée de la mort, et que la mort crée de la vie. Le tout en des cycles sans fin. Un examen plus méthodique nous montre qu’il n’en est rien, que la mort n’est nullement la conséquence de la vie et qu’elle en est même l’opposé. En effet, les systèmes conquérants sont formés de matières protoplasmiques limitées actuellement sur la terre et ils se conquièrent les uns les autres en se détruisant mutuellement ; mais il est bien évident que la première matière protoplasmique elle-même a été formée de substance non vivante et que, par conséquent, la lutte du vivant contre le vivant n’a pas toujours eu lieu. La vie n’est donc point sortie de la mort mais du non-vivant, ce qui est tout autre chose. La mort ne peut d ailleurs en aucun cas donner de la vie. La vie vient d’un vivant et non d’un mort. Celui-ci ne donne que des matériaux à des êtres vivants issus d’un vivant et non issus d’un mort.
Il serait donc très important, de rechercher si les causes de mort sont d’ordre biologique ou d’ordre physicochimique. Dans le premier cas, les systèmes conquérants disparaîtraient par destruction mutuelle. Dans le deuxième, ils seraient détruits par le fonctionnement même de l’univers. Si la première hypothèse est exacte, l’homme peut entreprendre la lutte contre les êtres hostiles à sa durée et reculer, sinon supprimer la mort. Si la deuxième est seule vraie, tout espoir de triomphe de l’humanité sur les forces aveugles de la nature est à rejeter définitivement.
* * *
Les hypothèses sur les causes déterminant la mort sont assez nombreuses, car de tout temps l’homme a cherché a en pénétrer le secret pour prolonger sa vie mais ce n’est guère qu’avec la méthode scientifique que ces hypothèses ont pris un caractère plus positif par la multiplication des expériences et des observations.
La reproduction des êtres s’effectuant par de simples cellules formées en chaque reproducteur et transmettant, de génération en génération, ce pouvoir générateur inépuisable, il semble que l’immortalité soit par cela même, un fait évident. L’observation de la cellule libre ne nous montre point d’exemples de sénilité et de mort ; et les petits animaux unicellulaires microscopiques se reproduisant éternellement par simple division, ne paraissent point soumis aux causes destructives physicochimiques. Certes comme dans toute cellule vivante il y a déchets de fonctionnement, désassimilation, perte d’énergie, rayonnement, etc..., mais l’assimilation répare précisément tout cela, puisqu’il y a finalement augmentation de volume, puis division et pullulement.
Maupas, qui les étudia il y a une quarantaine d’années, crut, qu’à moins de conjugaisons entre eux, il y avait réellement sénilité et mort au bout de trois cents générations environ. D’autres biologistes le crurent également, mais Woodruff reprit en 1907 ces mêmes expériences, et pendant 13 ans put éviter la conjugaison et le vieillissement et obtenir 8 400 générations par simple division. Métalnikov est parvenu aux mêmes conclusions après dix ans d’expérimentation et cela était facile à prévoir puisque d’innombrables protozoaires se reproduisent ainsi naturellement sans signe de vieillissement. La seule condition a observer consiste en un renouvellement permanent du milieu où baigne l’animal. On sait, d’autre part, que Carrel est parvenu à conserver vivant, pendant plus de dix ans, et à faire proliférer divers tissus d animaux, sous conditions de renouvellement incessant du milieu ; ce qui démontre bien l’immortalité de la cellule. Ainsi, ces animaux ne connaîtraient point la mort biologique. Pourquoi alors les animaux supérieurs, que l’on peut considérer comme des colonies de cellules, meurent-ils après un vieillissement plus ou moins tardif ?
Pour Hertwigt la cause serait dans l’agglutination des cellules, obligeant celle-ci à un accroissement de dimensions au lieu de permettre la multiplication indéfinie qui est leur fonction propre. En fait, les observations embryogéniques montrent l’activité extraordinaire des premières multiplications cellulaires se ralentissant progressivement jusqu’à la formation complète du fœtus. Ce ralentissement se continue jusqu’à la naissance où le nombre des cellules paraît définitivement limité. Celles-ci augmentent alors de volume jusqu’à la fin de la croissance, puis vient, lentement, la dégénérescence et la mort. Un autre biologiste, Mainot, paraît de cet avis et pense que la différenciation cellulaire, la spécialisation, née de l’agglutination, est la cause de la sénilité et de la mort. Delage a également émis une théorie de la mort basée sur la différenciation cellulaire, dans laquelle seuls les éléments indifférenciés telles les cellules sexuelles, ne meurent point. Retterer, qui a combattu ce point de vue, a objecté que les cellules sexuelles sont hautement indifférenciées, ce qui ne leur enlève point leur caractère d’immortalité. Ceci est plus ou moins exact et Le Dantec pensait que les éléments sexuels sont, au contraire, des éléments morts réduits à un seul pôle, c’est-à-dire incapables, désormais d’assimiler et de se reproduire isolément. Il supposait que chaque cellule vitale est le siège d’un phénomène bipolaire (bisexuel) indispensable à l’assimilation et que celle-ci, jamais parfaitement réalisée entraîne une certaine modification de l’être qu’il appelait assimilation fonctionnelle. Cette fonction vitale nécessite le renouvellement constant du milieu et l’élimination des substances de désassimilation sous peine d’intoxication, de maladie, de sénilité et de mort. Cette désassimilation produit également la substance squelettique agglutinant les milliards de cellules et cette accumulation entraîne la vieillesse et la mort. La théorie de Loeb admet également l’immortalité des cellules libres et l’intoxication réciproque des cellules organisées. C’est à peu près la théorie de Delage et Retterer, aurait dû admettre que, par différenciation cellulaire, il fallait entendre une destruction graduelle de certaines propriétés vitales chez les éléments des organismes supérieurs, conservées, au contraire, par d’autres cellules et que retrouvent les cellules sexuelles en se conjuguant.
A. Lumière émet une théorie tout aussi pessimiste. La matière vivante est de nature colloïdale (et par conséquent instable), c’est-à-dire composée de micelles, ou granules formées d’un noyau et d’un revêtement mince, en suspension dans un liquide. Ces noyaux et leurs revêtements sont de structures différentes et chargés d’électricité contraire. La disparition du revêtement entraîne un précipité des granules, la floculation et la mort. D’autres biologistes, tels que Hodge et Conklin, pensent que la vieillesse provient d’une altération des cellules, lesquelles diminuent de volume, perdent progressivement leur noyau, tandis que la pigmentation les envahit lentement et détruit leur fonctionnement.
La mort se présenterait donc ainsi, comme un phénomène physicochimique inévitable.
Metchnikoff n’est pas de cet avis. Selon lui, le vieillissement provient bien d’une intoxication, mais celle-ci n’est que la conséquence du pullulement des microbes malfaisants dans le gros intestin. Il en résulterait une sorte de dégénérescence des cellules nobles ou spécialisées : musculaires, nerveuses, viscérales, etc., plus sensibles aux poisons que les autres cellules : phagocytes et tissus conjonctifs, lesquels, plus mobiles, plus indépendants conservent leur faculté de défense beaucoup plus longtemps. En temps normal ces cellules luttent contre les microbes, réparent les plaies, reforment les, tissus, mais, dans un organisme vieilli, elles s’attaquent aux cellules nobles, les détruisent, ruinent la coordination générale et déterminent la mort. Cette guerre civile expliquerait certaines affections telles que les tumeurs, cancer, sarcome, etc., qui constituent une sorte de révolte cellulaire effectuée par des cellules extrêmement vigoureuses, soustraites aux lois coordinatrices de l’organisme. Enfin, après les travaux de Brown-Séquard, sur les sécrétions internes de certaines glandes, de nouvelles recherches ont démontré leur influence dans tout l’organisme sur la croissance, l’accélération de la maturité, l’équilibre général, le vieillissement, l’intelligente, etc. Les travaux de Steinach et de Voronoff sur la greffe des glandes sexuelles ont démontré des possibilités évidentes de rajeunissement, tandis que Jaworski, par des transfusions de sang jeune, est également parvenu, en ce sens, à des résultats intéressants.
De tous ces faits il est possible de dégager les quatre remarquables suivantes :
-
le fonctionnement de la cellule vivante est immortel en milieu renouvelé ;
-
l’agglutination des cellules limite le renouvellement du milieu, gêne le fonctionnement vital, crée l’accumulation des déchets, tandis que la spécialisation rend progressivement chaque cellule impropre à l’activité totale de la vie et au maintien du rythme initial ;
-
l’unité cellulaire ignore les longues durées par suite de ses fréquentes divisions. Il n’y a donc pas immortalité proprement dite de la cellule puisqu’il n’y a pas individualité permanente, mais incessants recommencements. L’acquisition expérimentale est donc limitée par le temps et les dimensions mêmes de la cellule et se trouve toujours réduite à elle-même sans grande possibilité d’enrichissement ;
-
l’agglomération cellulaire arrête la multiplication, stabilise l’activité, prolonge la durée réelle de chaque cellule et favorise son accroissement expérimental. La spécialisation permet à certaines d’entre-elles d’accumuler des modifications, se coordonnant dans le temps et constituant la connaissance, le savoir.
Ici encore nous pouvons constater l’absence de finalité des choses, car, tandis que l’indépendance préserve la cellule de la mort et lui conserve une grande vitalité, elle ne lui permet aucun perfectionnement expérimental par insuffisance de durée et impossibilité de connaître d’autres expériences que la sienne. Par contre les êtres pluricellulaires acquièrent une grande connaissance par suite de leur durée et de leurs spécialisations, mais il ne peuvent profiter de cet avantage, puisqu’ils meurent et perdent cet acquis...
* * *
Certains savants encore empêtrés dans les explications finalistes et cherchant un but à cet état de choses ont pensé que la mort était avantageuse pour l’espèce. Weisman a défendu ce point de vue absurde : les espèces immortelles mais séniles auraient été éliminées dans la lutte pour la vie par les espèces mortelles, mais composées de sujets plus jeunes et plus vigoureux, plus aptes à vivre. D’où utilité bienfaisante de la mort. La vieille erreur finaliste de « l’Espèce », entité vivante, persiste encore. Elle oppose l’espèce à l’individu, celui-ci devant être sacrifié à celle-là. Comme il n’y a, en réalité, que des individus, le sacrifice à l’espèce devient un sacrifice de l’individu à l’individu. Ce qui est proprement absurde. Chaque être se sacrifiant à un autre être, c’est l’espèce tout entière qui se sacrifie au néant, puisque le dernier être est voué, tout comme le premier, à la mort. C’est l’apologie grandiose du suicide.
De nombreux philosophes ont également défendu ce concept contradictoire en chantant les louanges de l’anéantissement. Les forces aveugles de la nature ne leur demandant point leur avis leur approbation est de trop. Ce qui est se justifie de lui-même, puisqu’il est ainsi et non autrement. Pourtant il est de toute évidence que si l’immortalité des êtres supérieurs était un fait il ne pourrait y avoir sénilité, qui est un commencement de mort. La vieillesse n’existant point, nul ne pourrait célébrer la joie des éternels recommencements. Le monde serait autre, tout simplement, en vertu de ce fait bien compréhensible que pour qu’un être immortel fut viable et put durer, il faudrait absolument qu’il y eût, préalablement, les conditions nécessaires à sa réalisation. Nous retombons toujours dans cet axiome évident que, ce qui est étant le résultat du fonctionnement de l’univers, il est tout naturel de trouver réunies les conditions nécessaires pour que cela soit tel que c’est et pas autrement. La mort des êtres supérieurs est le produit du monde tel que nous le connaissons et il faut reconnaître qu’il n’est pas extraordinaire. L’immortalité ne serait possible que dans d’autres conditions, avec d’autres équilibres biologiques.
L’immortalité est-elle possible, est-elle désirable et quelles en seraient les conséquences pour l’individu et la collectivité ?
D’après ce qui précède, le mécanisme même du fonctionnement cellulaire nous échappe, car aucun des expérimentateurs n’a pu trouver la cause intracellulaire des phénomènes auxquels il a attribué la sénilité et la mort. Nous n’avons qu’une certitude : la mort biologique, c’est-à-dire la lutte entre systèmes conquérants, n’est point inévitable et l’homme pourrait créer une certaine harmonie entre systèmes affinitaires et détruire définitivement les autres.
La mort physicochimique paraît plus rebelle. Pourtant il est un fait qui démontre que la vie est bien une transformation de l’énergie ambiante ; c’est le pouvoir minime d’énergie initiale nécessaire à une seule cellule pour en engendrer des milliards d’autres. Une telle énergie totale ne peut être empruntée qu’au milieu physicochimique et non à la cellule mère ; celle-ci ne pouvant que jouer le rôle de transformateur, de catalyseur et de coordonnateur des forces substantielles du milieu. L’organisation seule paraît responsable de la mort par stabilisation, « arrêt de développement », accumulation de déchets, difficulté de renouvellement du milieu intérieur. D’autre part, il est impossible de songer à détruire cette organisation, source de l’intelligence et de la conscience humaine. La solution future est peut-être dans la connaissance exacte du mode d’accaparement et de transformation de l’énergie ambiante par la cellule et dans la découverte des moyens propres à son utilisation pour le renouvellement indéfini de l’organisme et l’élimination des toxines mortelles.
La vie future réaliserait ainsi une nouvelle forme d’équilibre dans l’univers ; équilibre formé :
-
de la conservation des éléments utiles au double fonctionnement physiologique et psychologique ;
-
de l’élimination des élémentls nuisibles au corps (toxines) et à l’intelligence (erreurs) ;
-
de l’évolution, c’est-à-dire transformation progressive du corps et du psychisme sans solution de continuité.
Ainsi se trouveraient conciliés les deux facteurs contraires de l’univers : l’évolution et la durée, ou, si l’on préfère : le mouvement et la stabilité. Rien n’est écrit d’avance. Toutes les possibilités sont dans la substance en mouvement et l’intérêt de l’homme est d’en connaître les lois pour les utiliser à son profit...
* * *
L’immortalité n’est pas impossible a priori. Est-elle désirable ?
Pour répondre à cette question, il est nécessaire de rechercher sur quelle base on peut établir la légitimité d’un désir, d’une raison d’agir, d’une volonté. Autrement dit : y a-t-il une démonstration logique et rigoureuse de l’utilité ou de l’inutilité de l’existence des êtres ? Peut-on établir la nécessité de la continuation de la vie ou celle de sa disparition ?
Remarquons que la vie et la mort font partie des choses naturelles, et qu’un choix de pure raison, entre ces deux solutions, ne change rien au fonctionnement universel. Mais qu’est-ce qu’une pure raison ? Le fait même que cette question ne se pose que parce qu’on est vivant et que l’on porte un intérêt à sa résolution prouve que toute question humaine est déterminée par quelque chose de vital, d’animal, de physiologique, antérieur à la raison et la déterminant. Notre fonctionnement nous détermine à l’optimisme ou au pessimisme. C’est une question d’humeur, de compositions chimiques et de combinaisons colloïdales. Ainsi, celui qui vit et aime la vie agit par suite de son fonctionnement biologique qui le détermine à continuer de vivre. Celui qui se suicide fonctionne de telle manière qu’il accomplit un geste qui met un terme à son fonctionnement. À dire vrai, si paradoxal que cela soit, le suicidé ne se tue pas : il supprime une cause de souffrance. Il ne se rue pas consciemment contre son moi pour le détruire ; il lutte contre des représentations mentales désagréables qu’il supprime à la manière de l’ours écrasant la mouche du dormeur.
La question de préférer le néant à l’existence, ou vice-versa, n’a donc aucun sens puisque ce qui vit ne peut se placer dans la condition de la non-existence ; et que la non-existence n’étant rien, ne peut se comparer à l’existence qui est quelque chose. Nous comparons tout simplement deux de nos états mentaux. Dans l’un, nous nous représentons (ou croyons nous représenter) l’absence de l’inharmonie universelle par la disparition de la conscience humaine seule capable de la juger et d’en souffrir. Et dans l’autre, nous nous représentons cette souffrance comme étant un effet de notre volonté qui pouvait ne pas l’engendrer car, créer de la vie, c’est engendrer un futur mort. Tout se ramène en fin de compte à une sorte de balancement entre le plaisir que l’on a de vivre et la peine qu’on en éprouve.
Ainsi tout être sentimental peut désirer la fin de l’humanité comme conclusion d’un phénomène malfaisant et douloureux pour la conscience humaine ; mais sentimentalement, il est tout aussi possible de s’enthousiasmer pour ses dons merveilleux et de vouloir sa conservation et sa durée. D’ailleurs, le fait seul que l’on critique l’état des choses et qu’on lutte pour son amélioration indique que l’on s’intéresse à sa continuation et qu’on est partisan de créer de la vie.
* * *
Une des raisons de désirer la mort peut provenir du mauvais fonctionnement vital : pathologie, sénilité, usure, affaiblissement, etc., déterminant dans la conscience humaine l’amertume, le dégoût, la lassitude, le désintéressement de l’effort, l’amour du repos, l’attirance vers le néant. Le suicide philosophique ne se justifie que par l’imminence d’une fin inévitable que l’on veut choisir à son gré. L’immortalité certaine changerait probablement quelque chose à ce genre de détermination. L’homme sain, en pleine vitalité, en plein fonctionnement, hors des contraintes déprimantes aime donc la vie. Pourquoi alors ne désirerait-il pas l’immortalité ?
On objecte la nécessité des renouvellements et rajeunissements biologiques par l’enfance ; le pullulement des êtres ; l’utilité de faire de la place aux autres ; la malfaisance des vieux organismes cristallisés et fossilisés. Ces objections n’ont aucune valeur, puisque l’immortalité ne pourrait qu’être le résultat d’organismes éternellement jeunes, possédant la faculté d’évolution et d’assimilation intellectuelle propre à la juvénilité. De même l’immortalité n’est conciliable qu’avec une suppression presque totale des naissances ; celles-ci ne suppléant qu’aux morts accidentelles ou volontaires des immortels.
Cela étant, quelle utilité y aurait-il à remplacer ces êtres vivants en pleine conscience, par d’autres êtres à venir, n’existant pas encore, lesquels seront à leur tour remplacés par d’autres qui ne feront pas mieux que vivre et mourir comme leurs devanciers ? Est-ce que la non-existence conférerait des droits ? N’est-ce pas là le travail aveugle et incohérent de la nature qui crée et détruit sans cesse et sans but ?
N’est-il pas plus intéressant d’opposer à ces destructions perpétuelles l’action intelligente des systèmes conquérants harmonisés entre eux et conscients de leur durée ?
Rien ne dure dans l’univers. Tout se transforme. Seule la vie, conservatrice des rythmes, réalise la merveille de la durée et de la contemplation des choses ; seule elle permet et le spectacle du monde et sa compréhension.
La mort c’est le morcellement de l’expérience.
Est-ce la mort qui a enrichi l’humanité, ou est-ce l’activité vitale, l’accumulation du savoir, la conservation des efforts, la durée des connaissances transmises de générations en générations ? Le pullulement, les naissances successives, la mort permanente ont-ils rendu les humains meilleurs, plus savants, plus sages, plus fraternels ?
Chaque génération ignorant le savoir vécu des générations précédentes recommence les mêmes errements de termites bornés. L’homme parvenu à une grande connaissances des choses meurt, détruisant avec lui toute la science amassée, toute la continuité compréhensive qui donnait un sens à son expérience individuelle, transmissible seulement après synthèse et que la mort supprime totalement.
Cette immortalité n’est point désirable avec des humains inconscients et criminels, incapables d’harmonie. La mort est ici plus bienfaisante que nuisible, mais il ne faut pas oublier que le tout se tient et que d’autres lois biologiques détermineraient, probablement, une autre psychologie.
Les méfaits de la mort individuelle se retrouvent dans la mort des sociétés. Celles-ci meurent par la trop grande différenciation des humains, leurs déformations professionnelles, leurs spécialisations, nées du développement excessif des densités humaines nécessitant de formidables organismes et de vastes organisations, le tout formant une sorte d’ossature peu modifiable, s’opposant à toute variation et amélioration. Chaque peuple, ou parti, ou caste, ou clan, trust, syndicat, corporation, groupe ou individu cristallisé, incapable de vivre seul désormais, lutte pour son propre compte, impose son rythme aux autres et détruit la coordination générale par le parasitisme et l’insouciance de l’harmonie collective.
Les déchets sociaux, sous forme de traditions, lois, traités règlements, coutumes, s’accumulent comme des toxines mortelles, détruisent l’équilibre, paralysent l’activité individuelle et acheminent les collectivités vers les désordres et la sénilité. Par contre, l’isolement excessif limite l’expérience et la transmission et conservation du savoir par le recommencement et le réapprentissage vital de chaque individu. La communication des connaissances augmente la durée humaine et l’enrichit.
L’immortalité sociale, avantageuse pour les œuvres collectives de longue durée et l’enrichissement de l’individu, ne se réalisera que par la limitation des humains, le développement de la puissance individuelle au sein de multitudes de groupements réduits et indépendants, à rythme particulier, participant volontairement, et facultativement, à des rythmes productifs de plus en plus vastes et plus généraux. Aucune sénilité n’atteindrait ces organismes évoluant indéfiniment, par la plasticité même de leur organisation, excluant toute cristallisation administrative. Cette durée bienfaisante permettrait la conservation des acquisitions utiles, tandis que les catastrophes sociales détruisent aveuglément les bonnes et les mauvaises choses comme autant de multiples morts appauvrissant infailliblement l’humanité.
La mort n’est donc qu’un fait qui s’impose à l’homme. L’approuver, c’est acquiescer à l’écrasement de l’intelligence ; c’est approuver le fonctionnement du chaos.
La vie est source de toute conscience et il est naturel de vouloir durer. Le spectateur, le curieux peut trouver de la joie à se perpétuer en ses enfants. Il peut envisager sereinement sa mort et la fin transitoire de son moi sans trouble et sans émoi, telle la fin d’un phénomène cosmique. Mais, en vrai spectateur des choses, il peut lui être agréable d’imaginer le triomphe de l’ingéniosité humaine sur le mécanisme aveugle de l’univers.
Peut-être l’accumulation des souvenirs et des variations individuelles effacerait-elle, par des oublis progressifs, les personnalités successives des humains, détruisant ainsi leur unité dans le temps et limitant leur durée totale faite, on le sait, de tous les souvenirs. En ce cas l’immortalité effective serait une suite de morts supprimant le « moi » éternel, remplacé par des « moi » successifs, s’ignorant dans le temps comme autant d’étrangers. Le moi, synthèse perpétuellement variable des rythmes subjectifs, n’est qu’une suite de présents conscients. Il ne connait ni passé, ni futur réels ; il les vit sous forme de présent et sa durée, ou spectacle des souvenirs, est à la fois dans l’espace et dans le temps, c’est-à-dire déterminé par l’espace cérébral et le rythme vital. La continuité du moi est une apparence ; il se transforme inévitablement. Il ne peut donc y avoir d’immortalité absolue.
D’autre part, la volonté de réalisation étant proportionnée à la durée des êtres, il est probable qu’une longévité de quelques milliers de siècles laisserait encore les humains insatisfaits, avec des désirs exigeant mille fois plus de temps pour leur satisfaction.
Toutes ces constatations nous démontrent bien qu’il n’y a aucune finalité dans le monde. Chaque instant de l’éternité est un centre, un sommet, qui ne peut être autre, puisqu’il est ainsi. Affirmer l’harmonie nécessaire de ce qui est, c’est ignorer toutes les harmonies contradictoires, infinies, successives ou simultanées contenues dans la substance éternelle. Approuver l’aspect visible de l’univers, c’est le stabiliser, l’immobiliser en soi. C’est approuver servilement le chaos. La mort fait partie de l’équilibre actuel des choses. Un autre équilibre serait crée par une autre vie, une autre longévité une autre harmonie. Cela nous démontre que l’homme est un accident de l’univers et qu’il n’en est ni la justification, ni le but. Mais l’homme est un centre de mouvement, un transformateur puissant d’énergie. Aucune finalité n’existant, il peut mépriser les adorateurs du stagnant, rejeter l’ordre des choses tel qu’il est, ne s’incliner devant aucune souffrance, aucune inharmonie. L’homme doit utiliser à son usage un univers sans finalité et sans dieux... Le monde sera ce qu’il pourra le faire, et il le fera en œuvrant, non en se résignant.
– IXIGREC
MORT (SIGNES DE LA)
Pour compléter la documentation donnée à inhumation et maisons (mortuaires), voici l’énumération de quelques signes et moyens qui permettent de reconnaître la mort avec quelque certitude et de réduire, si l’on n’a recours à la crémation, les risques d’être enterré vivant.
L’injection de fluorescine (28 c/c), d’ammoniaque (14 c/c) – proportions variant avec la corpulence du sujet – provoque, à des degrés d’appréciation suffisants, et dans la demi-heure qui suit, une certaine coloration de la peau (jaune foncé et vert intense chez le moribond) pouvant éviter une autopsie plus ou moins opportune.
L’examen de l’œil, les manifestations de la circulation, de la respiration, de la sensibilité, même provoquées s’il le faut, par pinces spéciales, sont susceptibles de dénoncer les cas de léthargie ou de mort simplement apparente.
Le parcheminement de la peau, découpée et soulevée sur un point du corps, est aussi un moyen de contrôle. Le parcheminement des cuisses, provoqué par friction à la brosse, s’obtient facilement dans les 6 à 12 heures qui suivent l’expérience. Chez les pendus, le parcheminement du sillon de la corde est constamment observé, la dessiccation de la peau du sillon s’opère 5 à 6 heures après cessation de la vie.
La brûlure d’ammoniaque qui fait ampoule sur le vivant ne fait pas ampoule sur le cadavre.
En approchant la flamme d’une bougie, à 1 cm du doigt de la main du cadavre, une ampoule se produit et elle éclate ; sur le vivant il y ampoule mais pas d’éclatement.
La rigidité cadavérique s’observe d’abord sur les régions déclives, deux ou trois heures après le décès : en arrière des cuisses par exemple.
Sur le cadavre, le sang veineux se transforme en sang artériel par absence d’oxygène et la putréfaction commence. Quand on déplace un cadavre, les lividités se déplacent un certain temps, c’est ainsi qu’il est permis au médecin légiste de voir si la scène a été truquée, la lividité nouvelle ne correspondant plus à la situation première du cadavre.
La chute de la température, par rapport au milieu ambiant, est aussi un signe peu négligeable ; cependant on a vu des malades atteindre 27°4 !
Après la mort, on observe, en certaines circonstances, une élévation de température au-dessus de 40° (tétanos), de 55° (crise d’alcoolisme, délirium tremens) ; 50° (méningite tuberculeuse) ; 50° (pachyméningite alcoolique) ; 50° (pneumonie) ; certains alcooliques ont marqué, après cessation de vie, 53° et jusqu’à 59° !
Dans certaines maladies par invasion de microbes putréfacteurs – chez les cholériques, par exemple – l’état de rigidité cesse après les 3 ou 4 heures succédant à la mort.
La rigidité est aussi de faible durée chez les affaiblis par durcissement des fibres musculaires lisses et striées qui, en cassant, font cesser l’état de rigidité. L’acidité précipite la rigidité ; la contracture de la mâchoire s’obtient dans les 3 heures, mais en position déclive ; chez les pendus même avec un bandeau, ce phénomène ne s’accomplit pas.
L’état de rigidité, contrairement à l’état de lividité qui ne dure que très peu de temps, dure de 60 à 75 heures ; dans les pays froids, la rigidité dure 5, 6 et 7 jours et jusqu’à 10 jours dans les pays de glace. On peut lutter contre la rigidité par des mouvements en flexion des bras ou en extension des membres inférieurs.
La rigidité musculaire des vésicules séminales s’accomplit pendant l’agonie ; la rigidité de l’utérus expulse le fœtus ; le sperme, chez l’homme, se loge dans l’urètre par contraction plus que par rigidité ; le cœur s’arrête en diastole, le ventricule gauche vide. Chez les épuisés, il n’est pas rare de voir l’état de rigidité (et de lividité l’accompagnant) précéder la mort ; en général, dans ce cas, l’état de rigidité s’établit instantanément avec la mort. On a vu, dans la dernière guerre, nombre de soldats tués au moment où ils accomplissaient certaines actions, rester figés dans la situation qu’ils occupaient avant d’être frappés à mort : soldats buvant à leur quart, soldats russes en prière, etc.
Hors la guerre, ces cas sont plus rares et n’existent que par plaies au crâne : suicidé restant debout devant une glace et figé dans cette attitude.
Certains criminels ont pensé faire tenir un revolver dans la main de ceux qu’ils tuaient ; l’arme, toujours mal tenue, ne peut l’être quand la mort est dû à une plaie du crâne.
L’expression de la physionomie du cadavre : terreur, angoisse, ne doit jamais être confondue avec les expressions caractéristiques du phénomène de la rigidité provoqué par les spasmes cadavériques. La rigidité, elle-même, peut donner au visage une expression d’horreur succédant à un état extatique.
– L. RIMBAULT.
MORT (CULTE DES MORTS)
Le culte des morts à été universel. Tous les peuples, à part quelques hordes humaines qui abandonnaient, sans plus y prendre garde, les cadavres des leurs, ont honoré les morts, leur ont rendu un culte fervent et, ajoutons-le, souvent intéressé.
Les rites et les cérémonies funèbres offrent une grande variété qui toujours se trouve être en relation avec l’idée que les hommes se faisaient de la vie d’outre-tombe. Aux yeux des primitifs, comme d’ailleurs aux yeux de beaucoup de nos contemporains, la mort, loin d’être la destruction de l’individu, n’est qu’un accident, un événement qui donne à l’existence un cours nouveau. La croyance en l’immortalité, d’où résultent les cultes funéraires, provient avant tout de la conception animiste du monde. L’homme primitif doue tous les objets, tous les êtres, tous les phénomènes d’intentions et de facultés analogues aux siennes. Cette tendance est encore si forte, si durable, si spontanée qu’elle se traduit toujours par des actes et des paroles inconsidérées. Nous attribuons aux choses l’intention de nous nuire ou de nous aider. Nous rudoyons l’objet qui nous blesse comme nous bénissons le soleil qui nous réchauffe ou que nous maudissons la pluie et le froid qui s’éternisent. Incapable de distinguer les phénomènes subjectifs des phénomènes objectifs, l’imaginaire du réel, le sauvage ignorant a peuplé la terre entière d’âmes et d’esprits, logeant dans chaque objet, dans chaque être, dans chaque phénomène, une entité vivante et agissante, capable de lui nuire ou de le servir. Cette croyance générale s’est trouvée considérablement renforcée par l’influence du rêve et de la vision qui ramènent devant les yeux du sauvage l’âme des êtres et des choses. L’homme voit un autre lui-même accomplir des actes extraordinaires, éprouver des joies et des peines inconnues. Il voit ses compagnons, ses amis, ses parents participer à une vie qui diffère et se rapproche à la fois de l’existence ordinaire. Il voit défiler devant ses yeux la foule des êtres et des choses qui ont une place marquée dans ses préoccupations et ses souvenirs. Les morts ne sont pas exclus de cette revue. C’est donc que les morts sont vivants, du moins par leurs âmes ; car s’ils n’existaient plus comment les verrait-on ? Certes, le genre de vie qui les anime est quelque peu différent de celui qu’ils vivaient autrefois, mais ils vivent puisque dans le rêve et l’extase on les voit agir, on les entend causer. L’infirmité intellectuelle des âges précédents ne permettait pas aux hommes de soupçonner que les perceptions du rêve n’ont pas la même réalité que celles de la veille. Aussi, pour les primitifs, le dédoublement des êtres et des choses, l’existence d’un double attaché au corps à certaines heures et capable de liberté était un fait précis, indiscutable, dont la réalité ne laissait aucun doute. De cette croyance à l’existence d’une âme immortelle ou plutôt des âmes – car les peuples qui ont doté l’homme d’une seule âme sont en nombre restreint – découlent les rites funéraires aussi variés que baroques. L’âme est, parait-il, le moi conscient de l’individu qui recommence après la mort une nouvelle vie calquée sur l’ancienne. Elle n’a rien qui ne lui soit prêté par les vivants. Elle voit, elle entend, elle conserve toutes les facultés dont elle a perdu les conditions organiques. Elle n’est que le décalque du corps qu’elle a quitté ; elle a toutes les qualités de la matière, mais elle est immortelle.
L’ homme a traversé plusieurs âges géologiques avant de s’intéresser aux morts. L’abandon a été le premier régime funéraire, mais il a dû insensiblement s’accommoder aux croyances animistes et revêtir un caractère liturgique. Déjà les hommes de l’époque moustérienne semblent avoir eu une vision de survie qui les a poussés à inhumer leurs morts selon un rite particulier. Mais ce n’est que plus tard, beaucoup plus tard, que les hommes ont pris un soin de plus en plus précieux des morts. Quand la croyance en l’immortalité des âmes fut devenue un fait précis et que la crainte qu’inspiraient les revenants de toute nature fut assez puissante pour imposer le respect des morts. Le premier hommage que les morts ont reçu est celui de la peur. De la peur qu’inspiraient les esprits libres, séparés de leur corps, qui étaient coutumiers de tours cruels. Une fois en liberté, les mânes effrayaient les vivants, les entraînaient hors du bon chemin, les tourmentaient de toutes façons, surtout quand il s’agissait d’esprits dont les corps, pour une raison ou pour une autre, avaient été privés de sépultures ou n’avaient point reçu les honneurs funèbres. De là proviennent toutes ces légendes de vampires, de larves, de lémures, de goules, toutes plus acharnées les unes que les autres à meurtrir les humains ; de là aussi sont issus tous les procédés magiques dont usent les sorciers pour capturer les âmes errantes et pour détourner leurs colères sur les ennemis de la peuplade. (Voir sorcellerie)
Anciennement, la crainte des esprits était si forte que les morts ont été jetés dans les gouffres naturels : cratères, chutes d’eau, fleuves, etc., ou abandonnés dans les cavernes, dans des abris artificiels, portés au sommet des arbres où ils pourrissaient sur les branches. Certains peuples donnaient les corps d’enfants et même d’adultes à manger aux chiens ou les abandonnaient aux vautours et aux poissons. Souvent, dans ces deux derniers cas, les ossements étaient soigneusement recueillis et pieusement conservés. Rappelons à ce sujet les coutumes des Parsis de l’Inde qui placent les corps des enfants, des hommes et des femmes dans trois étages concentriques de cases superposées. Lorsque les vautours ont convenablement nettoyé les corps exposés dans « la tour du silence », ils recueillent précieusement les ossements qui sont remis à la famille du mort. Nombre de peuples ont mangé les cadavres de leurs ennemis tués à la guerre et même les corps de leurs plus proches parents. Certains avaient même soin de les tuer avant qu’ils ne soient trop vieux ou débilités par la maladie. Cette anthropophagie d’un genre spécial n’avait, à leurs yeux, rien de criminel ; au contraire, les victimes, vieillards et malades, envisageaient avec plaisir le moment où ils seraient immolés. Cette coutume n’excluait aucunement la piété filiale, le respect des survivants ; si l’on mangeait les morts c’était avant tout pour s’assimiler une part importante de leurs esprits et profiter ainsi de leur sagesse et de leurs qualités.
D’autres peuples au contraire s’ingéniaient à conserver le corps tout entier en évitant, autant que possible, la putréfaction. Le mort était le plus souvent desséché à l’air libre, les intestins ayant été préalablement enlevés. Lorsque la dessiccation était complète, la momie était installée, couchée ou assise, dans une enceinte sacrée ou dans une caverne funéraire. Ces usages se pratiquent chez un grand nombre de peuples. Les habitants de l’antique Égypte avaient poussé plus loin que les autres peuples l’art de l’embaumement et l’architecture du logis funéraire : pyramides, hypogées, mastabas. Qui ne connait les préparations raffinées, les pratiques minutieuses, les travaux méticuleux qui avaient pour but d’assurer la conservation et la parure intégrale du mort : homme ou animal sacré. Ces peuples divers de la Polynésie, de l’Amérique, de l’Égypte qui s’ingéniaient à conserver si précieusement les dépouilles mortelles des leurs, s’étaient arrêtés plus longuement que les autres peuples à l’idée d’une résurrection corporelle. Ils s’attachaient à garder aux âmes absentes les formes et les organes qu’elles avaient connus et de cette croyance antique procède toute la conception de la vie future. Les soins plus ou moins efficaces données à la conservation des corps ont nécessité partout l’emploi de demeures funéraires, la construction des caveaux très variés qui presque toujours ont été ornés de sculptures, de bas-reliefs, de peintures somptueuses. Pyramides d’Égypte ; hypogées de la vallée du Nil, tertres artificiels de l’Amérique, tumulus recouvrant les dolmens et les chambres sépulcrales de l’âge mégalithique, tombeaux magnifiques des rois et des puissants chez les peuples ayant connu un certain degré de civilisation, autant d’indices que l’homme s’est partout préoccupé de la vie future. Autant de preuves qu’il s’est imaginé un au-delà mystérieux, image embellie de la vie terrestre, suprême refuge où l’on jouit des biens que l’on a pas connu ici-bas. Et qu’il s’est cramponné à ce songe avec d’autant plus d’énergie que c’est, au milieu des soucis et des revers quotidiens, un réconfort puissant, un opium intellectuel qui console en engourdissant. Plus tard, quand le sens moral fut né, que de nouveaux besoins de justice se créèrent, la vie future devint sanction de la morale ; chacun étant traité après sa mort selon ses œuvres. Hélas ! en rêvant aux délices de l’au-delà, les malheureux prennent patience et se laissent mieux tromper, plus facilement spolier ! Il est inutile d’ajouter que l’inhumation proprement dite, à même la terre, se retrouve dans tous les temps et dans tous les milieux. La crémation a été aussi largement répandue. Anciennement le culte du feu a dû en faire un acte religieux d’une importance spéciale, car l’incinération généralement réservée aux chefs, aux rois, aux puissants a coexisté avec d’autres modes funéraires.
Il nous reste à parler des pratiques et des cérémonies qui accompagnent tous les modes de funérailles quels qu’ils soient. L’homme est pour lui-même la mesure de toutes choses. C’est pourquoi la vie imaginaire d’outre-tombe est considérée comme la continuation de la vie réelle. Cette conception impose aux vivants le devoir de pourvoir aux besoins du mort. La vie ne se soutient que par la nourriture, il importe donc de nourrir les âmes. Aucun peuple ne manque à ce devoir ; tous sont convaincus que les mânes mangent les aliments déposés sur la tombe ou jetés dans le bûcher. Le plus grand nombre renouvellent même régulièrement le repas des morts. À la nourriture sont souvent joints des ustensiles de cuisines ; ustensiles que l’on brise pour que leurs âmes accompagnent celle des morts. Il est également utile d’immoler sur la tombe le plus grand nombre possible d’animaux comestibles puisque les âmes ont de quoi les faire cuire. Mais il ne suffit pas seulement d’assurer les morts contre la faim et la soif. Il faut aussi leur éviter le froid et la chaleur. Il faut donc les vêtir et les chausser. Les vêtements, les étoffes, les chaussures ne sont pas oubliées. Ni les peuples de l’Amérique, de la Polynésie, de la Chine, de l’Égypte, de la Grèce et de l’Europe n’ont garde de manquer à ces graves devoirs. Partant de ce principe que la vie d’outre-tombe n’est que la continuation de la vie d’ici-bas, les hommes ont de tout temps assuré aux morts le moyen de tenir leur rang dans l’autre monde. Les outils, les armes, les bijoux, les ornements d’or et d’argent et parfois des messages destinés à d’autres défunts, voisinant avec les amulettes chargées de préserver l’âme du mort, accompagnent le cadavre dans la tombe ou sont jetés sur le bûcher. Comme la propriété mobilière, individuelle, ne consistait pas seulement dans les choses inanimées, les animaux favoris, les troupeaux, les esclaves, les épouses appartenant aux morts étaient immolés sur la tombe ou brûlés sur le bûcher et leurs âmes faisaient une suite honorable à celle du défunt, s’en allant au royaume des ombres. Sur la terre entière, pendant des siècles, les funérailles ont été l’occasion de véritables hécatombes. Les « sutties » de l’Inde sont assez connues pour que nous citions d’autres exemples. Heureusement que de tels usages n’étaient pas à la portée du vulgaire, car le globe eût été dépeuplé en l’honneur des morts. Ces rites compliqués et cruels, ce luxe de cérémonies sanglantes, d’hécatombes animales et humaines étaient le seul privilège des puissants et des riches. Jadis, comme aujourd’hui, l’inégalité régnait après la mort comme pendant la vie. Les petites gens ont toujours été privées de ce qui était nécessaire aux morts de condition.
Nous venons de passer brièvement en revue les divers modes de funérailles en évoquant les cérémonies qui les ont accompagnés. Aujourd’hui le culte des morts est toujours aussi puissant que par le passé. Si les funérailles modernes se marquent par plus de simplicité ; si elles ne s’entourent plus, comme jadis, de rites majestueux, de cérémonies grandioses, les hommes n’en ont pas moins conservé tout le côté commémoratif et symbolique. Actuellement quand nous attachons au char funéraire l’uniforme, l’épée, les décorations du mort, nous imitons le primitif qui place près du cadavre les armes favorites du défunt. Nous ne sacrifions plus les femmes et les esclaves du mort, mais les pleureuses à gages les remplacent. Le pain et la boisson que les peuples antiques posaient sur les tombes sont devenus le viatique chrétien ; les provisions de voyage, jadis déposées dans le cercueil, sont avantageusement remplacées par le pain eucharistique que le prêtre administre aux mourants. Et le sacrifice de la messe, offert à l’âme du mort peut être considéré comme l’équivalent des sanglantes cérémonies que célébraient les sorciers cherchant à garantir aux âmes les faveurs des divinités d’outre-tombe ! Mais ce culte du cadavre qui persiste, tenace et inutile, nous a conduit au culte des erreurs. En adorant les morts nous nous ingénions à conserver, à perpétuer leurs croyances. Nous conservons d’eux les enseignements moraux, les préjugés antiques, nous en avons les tares et les qualités. Pour peu que l’un d’eux ait été illustre, ses enseignements nous sont soigneusement conservés, même s’ils sont en contradiction avec les faits les plus positifs. La mémoire des morts, leurs faits, leurs gestes obstruent le cerveau des survivants. L’histoire ne nous cause d’ailleurs que de ceux qui ne sont plus et qui, lorsqu’ils étaient, étaient la plaie de l’humanité ! Les morts de la dernière guerre préparent la tombe de ceux qui feront la prochaine. Et il en est ainsi dans tous les domaines. Les morts nous conduisent, nous dominent. Par le legs, précieusement recueilli, de leur morale de leurs croyances, de leur foi ! Culte des antres, des morts et des vivants, des conquérants, des rois et des empereurs, des hommes et des femmes divinisés ; droit divin, théocratie, légende de conquêtes, principe d’autorité infaillibilité papale, autant d’anneaux d’une gigantesques chaine qui rattache les hommes civilisés aux sauvages et aux primitifs. L’explication animiste du problème funéraire a été étendue par l’homme à tous les actes des êtres qui agissent et des choses qui n’agissent pas. C’est par la mort que l’homme a commencé l’étude de la vie et il s’est donné, en même temps que des dieux, des maîtres spirituels ! Il s’est incliné en tous temps et en tous lieux devant les enseignements des morts. Ce sont eux qui ont réglementé la vie, et qui, hélas ! la réglementent encore. Quand nous nous découvrons devant un enterrement nous ne saluons pas la mémoire d’un homme, non, nous perpétuons, par notre geste, la somme immense des mensonges et des erreurs que l’homme a soigneusement conservés depuis le jour où les premiers anthropoïdes humains se sont imaginés qu’ils étaient immortels.
– Ch. ALEXANDRE
MORT (CULTE DES MORTS)
Les hommages rendus aux morts sont parmi les coutumes les plus enracinées, les préjugés les plus tenaces. L’esprit d’imitation, la superstition, le souci de l’opinion, l’hypocrisie, l’intérêt et maints autres mobiles assurent aux grimaces mortuaires une vitalité que le ridicule même n’a pu réduire. La presque totalité de nos contemporains continue à s’y plier avec une docilité qui ne fait guère honneur au courage et au jugement humains. Plus encore que « l’immoralité » qui préside aux accouplements bénis et légalisés, celle qui fait cortège au trépas s’avère d’une fidélité qui ne souffre que d’infimes dérogations. Si l’amour s’affranchit parfois des autorisations rituelles, il est peu de foyers où la mort ne s’entoure d’un appareil carnavalesque. On connaît, sur le mariage, la satire mordante et colorée de Chaughi. En quelques pages vigoureuses, claires et délivrées de toute réticence, Girault et Libertad ont montré à la fois le vide, le grotesque et l’odieux du cérémonial dressé autour de la dépouille humaine...
C’est chaque jour que de telles scènes se déroulent sous nos yeux et il n’est guère de personne auprès de qui nous n’ayons à dénoncer l’emprise de gestes aussi surannés qu’ils sont faux ou absurdes. Ne manquons pas d’opposer au conventionnel funéraire quelques arguments sans répliques, arguments de bon sens, de science et de raison. On ne balaiera jamais assez tôt les miasmes de toute nature qui salissent la simplicité de ce changement naturel qu’est la mort...
* * *
« Respect aux morts ! Telle est la formule universelle clamée à l’envi par les libres-penseurs, les socialistes, voire par certains anarchistes. Formule religieuse cependant, formule spiritualiste dont se servent indistinctement les plus rouges et les plus noirs quand ils s’écrient sur la tombe du défunt :
« Repose en paix ! – Emporte en ta dernière demeure... – si tu nous entends... – Je t’envoie un dernier adieu... – Sois persuadé, ô regretté Tartempion... – Écoute une dernière fois... », etc., etc.
Qu’y a-t-il de plus ridicule et de plus grossier que cette mascarade à l’occasion de la désagrégation d’un être organisé, d’un individu quelconque ? Est-ce que vous promenez en grande pompe l’enfant qui vient d’apparaitre à la vie ? Il y aurait là plus de logique, il me semble, car la mort est triste et laide, tandis que de la naissance jaillissent presque toujours la beauté et la joie.
Qu’est-ce donc qu’un enterrement ?
Quelque chose d’aussi bête, d’aussi faux et immoral qu’une communion ou un mariage. La dernière pulsation vient-elle de s’accomplir qu’aussitôt les simagrées commencent. On place autour du cadavre une quantité de bougies comme si le nerf optique en histolyse pouvait encore recevoir les vibrations lumineuses ; les commères, la plupart du temps, se hâtent aussi de voiler les glaces, s’il y en a, d’étoffes noires. Tout le monde pleure ou s’y efforce ; les voix chuchotent, on marche sur la pointe des pieds ; les gens s’agenouillent ; voisins et survivants défilent devant le mort qu’ils aspergent d’une eau salée (dénommée bénite), et avec une branche de buis, s’il vous plaît. Sur un registre déposé à l’entrée du logis viennent écrire leur nom en signe de douleur ou de regret, ceux qui, la veille, le matin même, traitaient de salaud et de mufle celui qui vient de mourir. Devant la mort, il faut tout pardonner. Autre hypocrisie ; autre ânerie ; ce n’est pas devant un cadavre que doivent s’apaiser les haines, mais bien dans un instant de bon sens et de raison, quand le vivant a besoin de fraternité, de camaraderie, de solidarité.
La cérémonie continue. C’est le jour de l’ensevelissement : des parents, des amis, qui, en la circonstance, peuvent avoir un réel chagrin, reçoivent lettres, cartes, dépêches, contenant toujours le même cliché, celui qu’on nomme condoléances. Sur vingt, il y en a peut-être deux de sincères. Si la famille du mort éprouve une peine réelle, elle désire plutôt qu’on la laisse en paix... Il est vrai qu’elle l’a voulu, puisque, aussitôt la mort survenue, elle a envoyé de tous côtés, par douzaines ou par cent, de ces papiers bordés de noir, de ces faire-part dont la rédaction est, vous ne l’ignorez pas, un poème d’originalité...
Couronnes et fleurs abondent. Les héritiers ne cessent de pleurer. Évidemment, certains ont une douleur véritable, mais combien se frottent les yeux pour sauver les apparences !... La voisine a mis 50 centimes pour la couronne des amis ou des locataires qui, huit jours auparavant, criait sur chaque pail1asson : y’n’ crèvera donc pas celui-là ! Les parents, brouillés depuis des années viennent, au prix d’une jolie gerbe de fleurs, faire la paix sur la tombe. Les copains d’atelier, malgré toutes les méchancetés et les mauvais tours qu’ils ont joué au mort, se sont faits généreux d’un gros cerceau d’immortelles. Les ouvriers n’oublient jamais de faire inscrire : « Le personnel de la maison Untel à son regretté patron » qui les a exploités sa vie durant, et toujours en pareil cas le patron rend « hommage à son bon serviteur ». L’entrée du logis est drapée de noir. Celui qui, tout à l’heure, sera descendu dans le trou, fait un stage à l’entrée du couloir de sa turne, ou devant sa propriété, juché sur un tréteau avec réédition de cierges allumés et de buis qui fait trempette. Ce spectacle s’appelle exposition du corps.
Voici venir les Pompes funèbres, et c’est du comique qui vient s’ajouter à l’hypocrisie. Tout de noir habillés ; munis de bottes, d’un tricorne les pompiers funèbres conduisent le noir corbillard, plus ou moins orné selon la classe...
L’enterrement est-il religieux ? On trimbale le cadavre dans l’église ; le curé y grimace une messe plus ou moins longue, suivant le prix fait. Pour les purotins, ça ne dure pas dix minutes. Est-ce un enterrement civil au contraire ? On fait la même chose encore que s’il était religieux avec cette seule différence qu’on n’entre pas à l’église ni au temple. Souvent, des femmes comme il faut, bien que faisant partie d’un cortège d’athées, se signent en passant devant l’édifice du culte, pendant que des F** et des socialos suivant un enterrement religieux, font les cent pas devant le porche ou vont sucer un demi-setier, en attendant que le copain ressorte.
Au cimetière tout le monde est triste. La bière étant descendue, les cléricaux jettent de l’eau bénite dessus et les libres-penseurs une poignée de terre ou des immortelles. Parfois, la gorge obstruée de sanglots, on discourt et, jusqu’à la porte de sortie, on s’éponge les yeux copieusement. Mais à ce moment, le portail franchi, on se reprend. La cérémonie est terminée : on a fait son devoir, maintenant on peut bien chasser un moment le chagrin et la tristesse. Allons en face... Les gens convenables, eux, ne vont pas chez le bistrot en sortant du cimetière. Ils retournent généralement chez eux régler leurs affaires. Si cela ne va pas tout seul, huit jours plus tard, harnachés de noir, ils se retrouvent chez un magistrat...
Avez-vous bien réfléchi, vous les malheureux, les travailleurs, les humbles, à ce que vous allez faire en donnant vos pauvres économies pour ensevelir dignement l’être que vous aimiez par dessus tout ? Ah ! je comprends fort bien votre douleur ; mais réfléchissez : est-ce que les tentures, les couronnes, les fleurs, les voitures feront ressusciter celui qui n’est plus ? – Vanité ! Il faut qu’on lui rende un « dernier hommage » ! Mais, les petiots, mais ceux qui restent : la veuve, le vieillard, l’infirme, les hôtes de la chaumière ou de la mansarde endeuillée n’ont-ils besoin de rien ? Des couronnes, quand les mioches n’ont pas de souliers pour aller à l’école ! Des crêpes et des voiles, quand demain le pain manquera à la huche ! De l’argent au prêtre, de l’argent pour une messe, pour des voitures, pour des écussons, des draperies, quand pendant des semaines, vous allez pâtir ! Que dis-je, votre imbécilité ira même jusqu’à contracter des dettes afin d’acquérir un terrain où vous planterez des fleurs que la pourriture humaine aidera à s’épanouir. Et si les lois permettaient qu’on gardât chez soi les cadavres, et que les bocaux ad hoc coûtassent des milliers de francs, c’est votre lit, votre dernière chemise, que vous vendriez pour pouvoir chaque jour pieusement vous agenouiller devant des viandes en putréfaction.
Et vous, braves gens dont le visage se détourne des faméliques, des malfrais, des frugueuses ; vous qui claquez la porte au nez du chemineau moulu ; vous qui jubilez du malheur d’autrui, de la faillite du voisin ; qui n’avez jamais donné un verre d’eau au vivant malheureux ; vous pour qui communisme, solidarité, sont de dangereuses et niaises utopies ; qui justifiez votre cruelle opulence par le qu’ils fassent comme nous ; vous qui n’avez jamais frémi de révolte devant des gosses en haillons, que faites-vous donc là ? – Ah ! Ah ! Vous apportez des fleurs et des couronnes, hypocrites ! C’est maintenant, devant l’organisme abattu, que vous manifestez vos sentiments, votre sympathie. Et vous, les honnêtes gens, les moralistes, qui rédigez les arrêts de l’opinion publique ; vous qui n’avez jamais manqué de jeter l’anathème sur les criminels et sur les voleurs ; vous pour la sécurité desquels fonctionnent les tribunaux et grincent les verrous ; vous, les braves citoyens qui avez besoin de l’ordre ; vous tous qui jamais ne sûtes ce qu’est le besoin, la misère ; pourquoi cette subite pitié devant la mort, misérables qui n’eûtes jamais le culte, le respect, la pitié pour la vie... Et vous, riches gredins et nobles catins, ventres dorés, canailles du trust et de la haute banque, vous êtes émus de compassion lorsque frôle vos équipages le cercueil d’un jeune derrière lequel il n’y a qu’une mère qui sanglote : Pauvre femme ! dites-vous. Vos femelles se signent et vous abaissez vos gibus. Jésuites, triples jésuites, n’est-ce pas votre œuvre ? N’est-ce donc pas vous qui faites crever les enfants au berceau, les adolescents à l’usine ? Cette chair pourrie que vous saluez maintenant, elle est vôtre ; c’est elle que vous méprisez, que vous insultez, que vous exploitez quand elle vibre, quand elle vit : c’est la chair à patron.
La mort n’a besoin de culte ; c’est la vie qu’il faut exalter, fêter : c’est elle qui a besoin de fleurs, c’est pour elle qu’il faut fraterniser, se cotiser ; C’est à la veuve, aux orphelins, que doivent aller les secours, la solidarité.
Gardez, gardez vos gros sous pour l’œuvre utile, pour l’œuvre de vie, de bonté et de camaraderie et laissez les couronnes et les fleurs aller sur la charogne des preux. Prolétaires ne soyez pas aussi bêtes que les riches : vaniteux et insolents ; ne donnez pas vos économies à la mort, donnez-les à la vie. Que les corps aillent à la terre ou au feu. Simplement, naturellement, discrètement si le mort fut un humble, et en manifestation s’il fut un militant et si sa dépouille doit servir de prétexte à propagande. Mais pas d’insignes, pas de couronnes, pas de chapeaux, pas de fleurs, pas de deuil ; tout cela est profondément illogique et bête. Et puis c’est du culte : culte rouge au lieu de culte noir, et l’un est aussi dangereux que l’autre. Mêmes superstitions grossières.
Habillez-vous donc comme d’habitude, ne changez rien à votre mise parce que quelqu’un est mort, et si le défunt était un être aimé et chéri, que le deuil soit dans votre cœur, dans votre pensée, et non pas dans vos habits. Avez-vous réfléchi à tout ce qu’il y a de ridicule et de faux dans le port du noir de circonstance ?
Les sensations pénibles éprouvées devant la mort sont choses physiologiques et très compréhensibles ; tout être normalement constitué ne saurait s’y soustraire. Mais la douleur n’a rien à voir avec les simagrées du culte, avec le deuil, les fleurs, les couronnes, les panaches, les étoffes écussonnées, et les chevaux caparaçonnés qui pissent et excrémentent insolemment devant le défunt...
Ne vous agenouillez plus devant les sépultures, camarades, mais penchez-vous sur les berceaux ; les richesses des tombeaux sont une insulte à la vie. Que vos joies compensent vos tristesses ; la mort ne doit pas bannir l’amour de votre cœur. Vivez, vivez fortement, puissamment ; en guerre, en lutte continuelle avec la souffrance, la douleur et la misère. Les hommes ont bien d’autres choses à accomplir, à chercher et à connaître que d’aller s’incliner devant les pierres sépulcrales. N’y a-t-il donc pas des douleurs à diminuer ; des peines à supprimer ; des misères à faire disparaître, des fléaux à combattre ; des maux à terrasser ; des erreurs à détruire ; des haines à calmer ?
Vous aimiez ceux qui ne sont plus ? Eh bien quel plus bel hommage à rendre à leur mémoire, s’ils furent des êtres utiles, bons, intelligents et justes, que de prolonger leur vie, leur action, leur puissance, leur savoir, dans le temps et dans l’humanité. Si le défunt était poète, invoquez sa muse et chantez par le monde ses rêves et ses espoirs ; si votre ami d’idéal bâtissait une Icarie, d’amour et de fraternité, répandez au sein des foules, anxieuses de libération, sa généreuse utopie ; si le camarade était un agitateur, un tribun, clamez son verbe d’espérance au-dessus des bassesses contemporaines ; s’il était un écrivain, un sociologue, un historien, un penseur, proclamez ses vérités, répandez ses idées, ses conceptions, prolongez son œuvre en semant ses écrits à profusion ; le plus beau piédestal c’est le livre ; s’il était un savant, révélez ses découvertes, perfectionnez, multipliez ses inventions afin qu’elles contribuent au bonheur universel. Oui, intensifiez l’œuvre, élevez la pensée, bâtissez une Cité d’ultime amour et de féconde amitié, où les morts n’auront de postérité et de gloire que dans le souvenir de leurs actions fraternelles et bonnes et où la vie sera devenue large et belle pour tous les humains. » – (E. Girault.)
* * *
Par quelle aberration les peuples ont-ils depuis des millénaires placé les morts au premier plan, prodigué pour les ruines funèbres la matière dont manquaient les vivants, tourné l’art vers les tombeaux ? Terreur des au-delà d’ignorance dont les humains apeurés jalonnaient de présents le chemin redouté. Dévoiement voulu des religions de renoncement exaltant la mort pour juguler la vie. Règne de toutes les forces assez astucieuses pour s’adjoindre le concours des ténèbres, de la routine et de la peur...
Rendre un culte à la mort, à l’être mort !
« Le mort n’est pas seulement un germe de corruption par suite de la désagrégation chimique de son corps, empoisonnant l’atmosphère. Il l’est davantage par la consécration du passé, l’immobilisation de l’idée à un stade de l’évolution. Vivant, sa pensée aurait évolué, aurait été plus avant. Mort, elle se cristallise. Or, c’est ce moment précis que les vivants choisissent pour l’admirer, pour le sanctifier, pour le déifier.
Les morts nous dirigent ; les morts nous commandent, les morts prennent la place des vivants... Toutes nos fêtes, toutes nos glorifications sont des anniversaires de morts et de massacres. On fête la Toussaint pour glorifier les saints de l’Église ; la fête des trépassés pour n’oublier aucun mort. Les morts s’en vont à l’Olympe ou au Paradis, à la droite de Jupiter ou de Dieu. Ils emplissent l’espace « immatériel » et ils encombrent l’espace « matériel » par leurs cortèges, leurs expositions et leurs cimetières. Si la nature ne se chargeait pas elle-même de désassimiler leurs corps et de disperser leurs cendres, les vivants ne sauraient maintenant où placer les pieds dans la vaste nécropole que serait la terre.
La mémoire des morts, de leurs faits et gestes, obstrue le cerveau des enfants. On ne leur parle que des morts, on ne doit leur parler que de cela. On les fait vivre dans le domaine de l’irréel et du passé. Il ne faut pas qu’ils sachent rien du présent. Les enfants savent la date de la mort de Madame Frédégonde, mais ignorent la moindre des notions d’hygiène, Telles jeunes filles de quinze ans savent qu’en Espagne, une madame Isabelle resta pendant tout un long siège avec la même chemise, mais sont étrangement bouleversées lorsque viennent leurs menstrues... Telles femmes qui pourraient réciter la chronologie des rois de France sur le bout des doigts ne savent pas quels soins donner à l’enfant qui jette son premier cri de vie... Alors qu’on laisse la jeune fille près de celui qui meurt, qui agonise, on l’écarte avec un très grand soin de celle dont le ventre va s’ouvrir à la vie.
Les morts obstruent les villes, les rues, les places. On les rencontre en marbre, en pierre, en bronze ; telle inscription nous dit leur naissance et telle plaque nous indique leur demeure. Les places portent leurs titres ou celui de leurs exploits.
Dans la vie économique, ce sont encore les morts qui tracent la vie de chacun. L’un voit sa vie toute obscurcie du « crime » de son père ; l’autre est tout auréolé de gloire par le génie, l’audace de ses aïeux. Tel naît un rustre avec l’esprit le plus distingué ; tel naît un noble avec l’esprit le plus grossier. On n’est rien par soi, on est tout par ses ascendants...
Des nuées d’ouvriers, d’ouvrières, emploient leurs aptitudes, leur énergie à entretenir le culte des morts. Des hommes creusent le sol, taillent la pierre et le marbre, forgent des grilles, préparent à eux tous un habitat pour qui n’est plus. Des femmes tissent le linceul, font des fleurs artificielles, préparent les couronnes, façonnent les bouquets pour orner la maison où se reposera l’amas en décomposition de l’humain qui vient de finir... Pour entretenir le culte des morts, la somme d’efforts, la somme de matière que dépense l’humanité est inconcevable. Si l’on employait toutes ces forces à recevoir les enfants, on en préserverait de la maladie et de la mort des milliers et des milliers.
Ne voyons-nous pas, au centre des villes, de grands espaces que les vivants entretiennent pieusement : ce sont les cimetières, les jardins des morts. Les vivants se plaisent à enfouir, tout près des berceaux de leurs enfants, des amas de chair en décomposition, les éléments de toutes les maladies, le champ de culture de toutes les infections. Ils consacrent de grands espaces plantés d’arbres magnifiques, pour y déposer un corps typhoïdique, pestilentiel, charbonneux, à un ou deux mètres de profondeur ; et les virus infectieux, au bout de quelques jours, se baladent par la ville, cherchant d’autres victimes. Les hommes qui n’ont aucun respect pour leur organisme vivant, qu’ils épuisent, qu’ils empoisonnent, qu’ils risquent, prennent tout à coup des mesures comiques pour leur dépouilles mortelles alors qu’il faudrait s’en débarrasser au plus vite, la mettre sous la forme la moins encombrante et la plus utilisable. Au lieu de se hâter de faire disparaître ces foyers de corruption, d’employer toute la vélocité et toute l’hygiène possible à détruire ces centres mauvais dont la conservation et l’entretien ne peuvent que porter la mort autour de soi, on truque pour les conserver le plus longtemps qu’il se peut, on promène ces tas de chair en wagons spéciaux, en corbillards, par les routes et par les rues.
Sur leur passage, les hommes se découvrent. »
Eux qui tout à l’heure foulaient aux pieds un estropié vivant, passaient, indifférents ou railleurs, devant la souffrance, se sentent soudain de l’émotion devant ces restes insensibles. Ils respectent la mort ! Le riche salut sa victime qui s’en va, le pauvre se découvre devant le meurtrier des siens qu’emporte le convoi. Mensonges et duperies d’union sacrée :
« Tel qui suit respectueusement un corbillard, s’acharnait la veille à affamer le défunt, tel autre se lamente derrière un cadavre, qui n’a rien fait pour lui venir en aide, alors qu’il était peut-être encore temps de lui sauver la vie. Chaque jour la société capitaliste sème la mort, par sa mauvaise organisation, par la misère qu’elle crée, par le manque d’hygiène, les privations et l’ignorance dont souffrent les individus. En soutenant une telle société, les hommes sont donc la cause de leur propre souffrance et au lieu de gémir devant le destin, ils feraient mieux, de travailler à améliorer les conditions d’existence, pour laisser à la vie humaine son maximum de développement et d’intensité. » (A. Libertad)
Trop de siècles ont été empoisonnés par la mort, terrifiés par son attente subjugués par ses rites. Que les hommes cessent, devant le phénomène enfin situé dans l’activité universelle, des momeries sottement répétées. Qu’ils débarrassent la mort de son théâtre, de tout ce qu’elle ébranle d’apparat, de pensées et de propos mensongers, de gestes lâches et vains, odieux ou pitoyables. Qu’elle ne prenne, devant leurs yeux dessillés, que la part d’attention et de soins, minimes, qu’elle exige. Arrière les sépulcres et les humains agenouillés sur eux en travesti. Hommes, reprenez des mains des nécrophages, les luminaires voilés. Offrez toute à la vie leur flamme délivrée. Et que les énergies, résolument – rythmées par des vivats, non des sanglots contraints – se tournent vers ses œuvres, jusque-là honteusement délaissées !
– L.
MORT (PEINE DE)
Personne en Occident, et ceci permet de mesurer la sottise humaine ne s’est élevé ni dans l’antiquité, ni au moyen-âge, soit contre la peine de mort et les nombreuses applications qu’en faisaient les législateurs, soit plus simplement contre les supplices abominables dont on accompagnait certaines exécutions. Les lois de Moïse consacrent la peine de mort et même la prodiguent. Sans doute l’Évangile ordonne de rendre le bien pour le mal ; mais les Pères et Docteurs de l’Église ont légitimé cette peine au moins par leur silence ; de plus, papes et princes chrétiens du moyen-âge, l’ont appliquée sans retenue, en y joignant des rigueurs dont le seul souvenir provoque l’épouvante. C’est à partir du XVIème siècle que des protestations s’élèvent contre le nombre et la cruauté des supplices. Dans son Utopie, Thomas Morus montre qu’il est injuste de réprimer le vol par la même peine que l’assassinat ; pour Jean de Wier, les sorciers sont des malades qu’il faut guérir et non brûler. Mais Jean Bodin réfuta ce dernier dans un livre, la Démonomanie, que les contemporains couvrirent d’éloges, que tous jugent insensé aujourd’hui. Augustin Nicolas, un magistrat, protesta au XVIIème siècle contre la torture ; Beccaria, au XVIIIème siècle, attaqua le principe même de la peine de mort. Ni Montesquieu, ni Voltaire, ni Rousseau ne se laissèrent convaincre. Rousseau écrivait dans le Contrat Social :
« Tout malfaiteur attaquant le droit social, devient par ses forfaits rebelle et traître à la patrie ; il cesse d’en être membre en violant ses lois, et même il lui fait la guerre... Il doit en être retranché par l’exil comme infracteur du pacte, ou par la mort comme ennemi public ; car un tel ennemi n’est pas une personne morale, c’est un homicide, et c’est alors que le droit de guerre est de tuer le vaincu. »
Montesquieu réservait la peine de mort aux assassins :
« Un citoyen mérite la mort lorsqu’il a ôté la vie ou qu’il a entrepris de l’ôter. Cette peine de mort est comme le remède de la société malade. » (L’Esprit des Lois)
Pourtant l’idée de Beccaria rencontra des sympathies ; et le duc de Toscane, Léopold Ier, abolit la peine capitale dans ses états.
Pendant la Révolution française, Lepelletier-Saint-Fargeau proposa, au nom du comité de législation, de la supprimer en matière civile. Mais il la maintenait en matière politique :
« Le citoyen qui aura été déclaré rebelle par un décret du Corps Législatif, ce citoyen doit cesser de vivre, moins pour expier son crime que pour la sûreté de l’État. »
La peine de mort, même en matière civile, fut d’ailleurs maintenue, à la presque unanimité des membres de l’Assemblée Constituante. Robespierre, à cette époque, était pour la mansuétude :
« Aux yeux de la vérité et de la justice, ces scènes de mort que la société ordonne avec tant d’appareil ne sont autre chose que de lâches assassinats, que des crimes solennels commis, non par des individus, mais par des nations entières, avec des formes légales. »
Après la Terreur et la réaction du 9 thermidor, la Convention décréta, le 14 brumaire, an IV, que « la peine de mort serait abolie dans toute l’étendue de la République française », mais seulement à partir du jour où l’on proclamerait la paix générale. Elle reprenait là un projet que Condorcet avait déposé le lendemain de l’exécution de Louis XVI. Le Code pénal de 1810 prodigua la peine de mort, même lorsque la vie des personnes n’avait couru aucun risque ; elle s’appliquait dans vingt-deux cas, auxquels on ajouta plus tard le sacrilège, avec ce monstrueux commentaire du grand chrétien de Bonald : « Renvoyons le coupable devant son juge naturel ». Dans une brochure parue en 1822, Guizot s’éleva contre la peine de mort en matière politique ; Lafayette, de Tracy, Déranger, Charles Lucas, Rossi demandèrent qu’on la supprime aussi en matière civile. Victor Hugo, Lamartine écrivirent plus tard d’émouvants plaidoyers en faveur des condamnés à mort ; et par ailleurs, les travaux des criminalistes établirent que, chez bien des coupables, la responsabilité était fort limitée, sinon nulle. On sait le retentissement obtenu par les écrits de Lombroso.
À la fin du XIXème siècle et au début du XXème, un mouvement très net se dessina contre la peine de mort ; il aboutit à sa suppression dans plusieurs pays, en Italie par exemple et dans de nombreux cantons suisses. Mais le principe d’autorité a relevé la tête depuis ; glorifié comme une action méritoire pendant les années de guerre, l’homicide légal ne choque plus l’opinion contemporaine. Un Gustave Le Bon, un Maxwel, etc., l’ont d’ailleurs légitimé au nom d’une pseudo-science, qui s’applique uniquement à justifier les vieux abus. Et naturellement, elle obtient la sympathie de tous les partisans d’un pouvoir fort, de tous ceux qui sacrifient par principe l’individu à l’État. Pourtant, du point de vue philosophique, nul penseur n’est jamais parvenu à établir le bien-fondé de la peine de mort. Ce problème se rattache à un autre plus vaste, celui du droit de punir (voir ce mot). Dans les Soirées de Saint-Pétersbourg, Joseph de Maistre a résumé la doctrine et les arguments de Tertullien, de Saint-Augustin et de l’ensemble des théologiens catholiques. Afin d’étayer le pouvoir absolu des rois et les privilèges de la noblesse, il invoque la Providence divine. Toute faute appelle une expiation même en ce monde ; et Dieu, pour satisfaire son implacable vengeance, exige que princes et juges répandent le sang à profusion. Échafauds, instruments de torture, fureurs de la guerre, bûchers de l’Inquisition sont particulièrement chers au tout-puissant, car ils couvrent la terre d’hécatombes humaines et s’avèrent les meilleurs auxiliaires de la mort. Une telle doctrine ne peut supporter un instant la critique ; elle apparaît comme une dangereuse extravagance à tout esprit sensé. Ses bases métaphysiques et religieuses sont réduites en poussière, depuis longtemps ; ses monstrueuses conclusions ne charment, aujourd’hui, que des patriotes professionnels ou d’ignares militaires.
Non moins fragile s’avère la thèse de Cousin qui ramène le droit de punir à la rétribution du mal par le mal. Il écrit :
« C’est un fait incontestable qu’à la suite de tout acte injuste l’homme pense et ne peut pas ne pas penser qu’il a démérité, c’est-à-dire mérité une punition. Dans l’intelligence, à l’idée d’injustice correspond celle de peine, et quand l’injustice a lieu dans la sphère sociale, la punition méritée doit être infligée par la société. La société ne le peut que parce qu’elle le doit. Le droit ici n’a d’autre source que le devoir, le devoir le plus étroit, le plus évident et le plus sacré, sans quoi ce prétendu droit ne serait que celui de la force, c’est-à-dire une atroce injustice quand même elle tournerait au profit moral de qui la subit, et en un spectacle salutaire pour le peuple. »
Cousin agite de vieux pantins qu’il croit sacrés : la conscience morale, le droit, le devoir. Ils sont actuellement descendus de leur piédestal : la conscience morale n’est qu’un reflet du milieu social ; le droit n’a pas besoin de sanction légale ; le devoir n’est qu’une forme sécularisée de l’antique volonté divine. Seuls les naïfs ou les amateurs de pathos métaphysique sont encore séduits par ce verbalisme sonore. Pas besoin, d’ailleurs, de réfuter une telle doctrine, car elle s’appuie uniquement sur des phrases éloquentes et n’invoque aucun argument sérieux.
C’est sur l’intérêt social que l’on fonde de préférence le droit de punir, à notre époque. Avec des variantes, Hobbes, Machiavel, Bentham et bien d’autres ont défendu cette conception. Dès lors nul besoin de faire intervenir la responsabilité individuelle Gustave Le Bon écrit :
« Sous peine de périr, une société doit se défendre et n’a pas à se préoccuper de subtilités métaphysiques. Très certainement, ce n’est pas la faute de l’apache assassin s’il possède une mentalité d’apache au lieu de celle de Pasteur. Cependant l’apache et Pasteur jouissent d’une considération fort différente. Le mouton, lui non plus, n’est pas responsable de sa qualité de mouton et cependant elle le condamne fatalement à se voir dépouiller de ses côtelettes par le boucher. »
Bien des médecins aliénistes professent des idées semblables. Ils déclarent :
« Peu importe que le criminel ait agi avec conscience ou avec inconscience : il est également dangereux dans un cas comme dans l’autre et il doit être chassé de la société pour laquelle il est un danger. Nul ne doit échapper à la responsabilité sociale (voir ce mot). Elle est et doit rester un fait inattaquable, un fait sacré. Sans la responsabilité sociale, aucune civilisation n’est possible. »
À propos de Soleilland, Faguet écrivait aussi :
« Soleilland est-il coupable moralement ? Pas du tout, pas plus qu’un chien, tant il est évident qu’il est une brute... Il n’est pas coupable, seulement il est furieusement dangereux. Pour faire ce qu’a fait Soleilland, il faut une moelle épinière tout à fait particulière. Mais c’est justement parce qu’il a une moelle épinière tout il fait particulière qu’il convient de la lui couper... Pour moi, la peine de mort est une question d’opportunité. Elle sert :
-
à supprimer la bête féroce qui est un danger permanent ;
-
à terroriser les autres bêtes féroces.
Je suis pour la répression très sévère des criminels et tout particulièrement des criminels malades parce que ce sont les plus dangereux. »
Ces déclarations brutales ont le mérite de la franchise ; avec elles disparaissent les appels à la justice, au bien, à la vertu (voir ces mots) dont les juristes chrétiens ont si longtemps abusé. Mais le droit de punir n’est alors qu’une question de force ; les prétentions de la morale traditionnelle croulent lamentablement. Se laisser prendre par manque d’adresse ou d’énergie, voilà l’unique reproche qu’un criminel puisse encourir. Sacrifier un innocent devient légitime si sa mort peut-être utile à la collectivité. On doit admettre la formule que l’Évangile reproche aux prêtres juifs :
« Il vaut mieux qu’un seul homme périsse que tout un peuple. »
En réalité, il n’existe plus ni coupable, ni innocent ; le condamné que la société livre au bourreau est sacrifié à l’intérêt public au même titre que le soldat qui meurt sur le champ de bataille. C’est vrai pour d’autres motifs que nous ne développerons pas ici ; mais quel sursaut d’indignation, chez les partisans de la peine de mort, lorsqu’on s’avise d’opérer cette assimilation. Quant à l’effet salutaire obtenu par les exécutions capitales, à la crainte qu’elles inspirent aux criminels endurcis, les penseurs impartiaux n’y peuvent croire présentement. Histoire et statistique démontrent le contraire. « C’est un mauvais quart d’heure à passer », disait sans s’émouvoir le fameux Cartouche, parlant de son prochain supplice ; d’ordinaire les assassins se recrutent parmi ceux qui affectionnent les spectacles sanglants donnés par la guillotine ; et si l’on a supprimé la publicité des exécutions, c’est qu’elles surexcitaient les pires instincts des spectateurs. Tous les sophismes d’un Le Bon se brisent contre ce faits indéniables.
Aussi ceux que n’aveuglent pas les passions politiques fondent-ils volontiers le droit de punir sur le droit de légitime défense. Locke dit :
« La nature a mis chacun en droit de punir les violations de ses droits. Ceux qui les violent doivent pourtant être punis seulement dans une mesure qui puisse empêcher qu’on ne les viole de nouveau. Les lois de la nature, ainsi que toutes les autres lois qui regardent les hommes en ce monde, seraient entièrement inutiles si personne, dans l’état de nature, n’avait le pouvoir de les faire exécuter, de protéger et de conserver l’innocent et de réprimer ceux qui lui font tort. »
Ce droit de légitime défense, les individus l’auraient dit-on, cédé à la collectivité, pour être exercé par les pouvoirs qui la représentent. Mais remarquons d’abord que le droit de légitime défense est épuisé lorsqu’on a mis son ennemi hors d’état de nuire ; dès que l’attaque cesse, il disparait. Loin d’être justifiée, la peine de mort se trouve condamnée puisque d’autres moyens existent d’empêcher l’assassin de nuire. En effet, la société ne commence son œuvre de prétendue justice que lorsqu’un coupable est désarmé, couvert de chaînes. Tuer un agresseur qui en veut à votre vie, chacun le peut, pris individuellement, s’il ne dispose d’un autre moyen de défense ; c’est la force repoussée par la force. Les tribunaux, eux, ne frappent que des ennemis désarmés ; ils ne s’opposent pas à l’accomplissement d’un mal imminent, comme l’individu en état de légitime défense ; ils punissent un mal irréparable. Preuve qu’ils veulent faire œuvre d’intimidation seulement, et qu’ils s’appuient, non sur le droit de légitime défense, mais sur la doctrine de l’intérêt que nous avons critiqué plus haut.
Dira-t-on que la société, disposant d’une existence réelle, distincte de celle des individus qui la composent, exerce le droit de conservation départi à toute personne morale ? D’abord la peine de mort resterait parfaitement injustifiée, la collectivité pouvant toujours maîtriser son agresseur sans l’assassiner et sans concevoir de crainte pour sa propre vie. Il s’agirait uniquement d’une question de force ; et c’est une mince victoire pour un être collectif de parvenir à écraser des individus isolés. Prêter une existence personnelle à la société, comme le font Izoulet et de nombreux disciples de Durkheim, c’est de plus oublier qu’elle n’existe que grâce aux individus ; c’est confondre le réel avec l’abstraction. Ajoutons qu’il est profondément injuste de réclamer à quelqu’un plus qu’on ne lui prêta ; la société impuissante à donner la vie n’a droit de la réclamer à quiconque, en aucun cas. Ainsi se trouve condamnée radicalement la peine de mort, sans que nous ayons même eu besoin de rappeler les innombrables erreurs judiciaires – argument si puissant déjà, à lui seul – dont se rendent coupables les tribunaux.
– L. BARBEDETTE.
MORTALITÉ
(Voir population, et aussi les mots longévité, malthusianisme, naissance, natalité, prophylaxie, etc.).
MORTIFICATION
(Voir macération, jeûne, etc.).
MOSAÏSME
(Voir israélite, judaïsme, judéo-christianisme, etc.).
MOT
(Voir idée, intelligence, grammaire, pensée, etc.).
MOUVEMENT
n. m. (rad. mouvoir, du latin movere)
Dans l’étude scientifique des mouvements, il est aujourd’hui indispensable de distinguer, au moins pour la commodité des recherches, ceux qui répondent aux faits visibles et s’avèrent d’une lenteur relative et ceux dont les vitesses très grandes concernent des phénomènes placés en-deçà de l’expérience sensible ordinaire. Notre mécanique classique étudie les premiers, ceux qui rentrent ou à peu près dans l’échelle de nos observations quotidiennes, qui répondent à nos perceptions coutumières ou ne s’en éloignent pas trop. Mais elle n’est vraie que dans une certaine limite et, de l’univers, ne saisit que la surface, l’enveloppe, directement accessible à des sens d’une portée restreinte.
Du mouvement absolu il ne saurait être question ; une pareille idée s’avère contradictoire puisque tout mouvement est inséparable d’un système de comparaison et que sa notion implique celle de repère. Fonction de l’espace, que l’on se représente sous la forme d’une trajectoire indéfiniment prolongée et géométriquement analysable, le mouvement est aussi fonction du temps, car les points de cette trajectoire n’apparaissent pas coexistants mais successifs. Aussi, la vitesse dépend t-elle du rapport entre la portion d’espace parcouru et le temps que le mobile a mis pour le parcourir. Unité de longueur et unité de temps doivent être déterminées au préalable, pour que la cinématique opère la mesure du mouvement. Et, si le choix de l’unité de longueur, le mètre présentement, ne soulève que des difficultés facilement résolues, il n’en va pas de même lorsqu’il s’agit de trouver l’unité de mesure du temps. Impossible de la découvrir en nous-mêmes, car l’appréciation subjective de la durée varie d’individu à individu ; alors qu’elle paraît courte à certains, d’autres l’estiment interminable. Souffrance, ennui, attente l’allongent, mais elle devient brève lorsqu’elle est remplie d’événements agréables ou intéressants ; aussi, chez le même homme, jours, mois, années laissent-ils une impression très variable selon les circonstances et les préoccupations du moment. Dans le rêve, dans la rêverie, l’appréciation de la durée devient d’une inexactitude incroyable. Mais, en vertu de l’universelle causalité, l’esprit a pensé que les mêmes événements astronomiques, physiques, mécaniques, etc., devaient, dans des conditions semblables, mettre un même temps à s’accomplir. Une clepsydre, un sablier pour se vider, l’aiguille d’une horloge pour faire le tour du cadran, la terre pour accomplir sa révolution autour du soleil exigent un temps toujours identique. D’où l’idée d’obtenir, par leur moyen, une appréciation objective de la durée, qui rende possible la coordination des efforts humains. D’ailleurs on constate qu’à des époques différentes, les mêmes rapports subsistent entre des phénomènes simultanés ; ainsi coïncident invariablement un nombre fixe d’oscillations du pendule avec tel ou tel déplacement de la lune, de la terre, du soleil. En divisant d’une manière régulière l’espace que parcourt un mobile, astre ou aiguille, il devient donc possible d’avoir une représentation figurative du temps qui se prête aisément au calcul. Et dès lors, pour l’étude du mouvement, il importera de trouver des repères capables, si possible, de servir pour tous les mouvements de l’univers. Un trièdre, avec le soleil pour centre et trois directions partant de là vers des étoiles données, constitue le meilleur mode de repérage ; car l’énormité des distances rend les erreurs de calcul généralement négligeables et garantit, d’une façon pratiquement suffisante, la fixité des directions. Dans la détermination du mouvement, il importe d’éliminer le point de vue subjectif et de choisir des repères relativement fixes et indépendants de nous. Arbres et maisons paraissent se déplacer, lorsqu’on les voit d’un wagon en marche. Mais, si je choisis pour repères des rectangles invariablement liés au sol, le plancher et deux murs verticaux d’une salle par exemple, la position d’un objet sera connue lorsque j’aurai précisé sa distance à chacun des trois plans.
Les mouvements que la cinématique mesure, la dynamique s’efforce de les expliquer. Idées de masse et de force prennent alors une importance de premier ordre ; elles commandent toutes les déductions de la mécanique rationnelle. C’est à la différence résultant de leur masse que des corps de même volume, placés dans des conditions identiques, doivent de se mouvoir diversement. Nous admettons qu’à chaque point matériel l’on peut faire correspondre un nombre, caractéristique de sa résistance au mouvement ; et la masse d’un corps sera, en conséquence, la somme des masses de tous ses points. On voit qu’une telle notion présente un aspect étrangement conventionnel et qu’Henri Poincaré n’avait pas tort de définir la masse, « un coefficient qu’il est commode d’introduire dans les calculs ».
Par ailleurs les corps ne pouvant, d’eux-mêmes, passer du repos au mouvement ou du mouvement au repos, ni modifier soit leur direction soit leur vitesse, c’est par la force que ces effets sont expliqués. Conçue sur le modèle d’une volonté capricieuse et spontanée par les peuples primitifs et les enfants, elle n’est pour le savant actuel, éclairé par des siècles d’efforts, que le substitut, l’équivalent des effets qu’elle produit dans l’espace et le temps. Si, au principe de l’inertie de la matière, nous joignons celui de l’égalité de l’action et de la réaction, énoncé par Newton ainsi que celui de l’indépendance des effets des forces, entrevu par Galilée, il devient possible de construire tout l’édifice de la mécanique traditionnelle. Mais cette dernière repose sur la notion euclidienne d’un espace absolu, homogène et isotrope, dont tous les points, dans toutes les directions, possèdent des propriétés identiques, immuables et indépendantes des corps voisins. Or ces propriétés de l’espace n’apparaissent plus certaines aux yeux des savants actuels : « la mécanique classique, remarque Einstein, est incompatible avec les lois de l’électromagnétisme » ; ses formules ne valent que pour les phénomènes de l’expérience ordinaire. Soit a la vitesse dont l’observateur A est animé et b la vitesse dont le véhicule B, qui le transporte, est animé dans la même direction. La somme a + b représentera la résultante de ces deux mouvements d’après la mécanique traditionnelle ; et ceci est vrai pour les faibles vitesses dont nous disposons dans la vie courante, même celle de l’avion le plus rapide. Mais s’il s’agit des vitesses atteintes par les corpuscules cathodiques ou les rayons B (bêta) du radium, la formule applicable est la suivante (v représentant la vitesse et c la vitesse de la lumière) :
v = (a + b) / (1 + ab / c²)
En donnant une valeur de 150 000 kilomètres par seconde à a et b respectivement, nous obtenons 300 000 kilomètres d’après la première formule et 240 000 d’après la seconde.
Comme l’espace, le temps devient relatif, aux yeux d’Einstein ; il dépend de l’observateur et se voit dilaté par la vitesse. Que deux observateurs immobiles M, N possèdent un bâtonnet inflammable, dont la durée de combustion est normalement dune minute, soit m et n, et que N prenne place dans un véhicule qui tourne, à une vitesse de 260 000 kilomètres par seconde, autour de M resté au centre, ce dernier remarquera que la combustion de n dure deux minutes, celle de m une seule. « L’espace et le temps dépendent de l’observateur en chaque point de l’univers sensible, de sorte qu’aucun événement physique ne peut s’exprimer indépendamment du temps. » Aux trois coordonnées habituelles permettant de définir un point, il est indispensable d’ajouter le temps écoulé depuis un « événement » origine. L’écart entre la vitesse de la lumière, qui parcourt 300 000 kilomètres à la seconde, et l’immobilité, soit partielle soit absolue, d’un objet quelconque, voilà ce qui nous donne la mesure du temps scientifique. Espace en soi, temps en soi doivent être remplacés par l’harmonieuse union des deux, associés dans un rythme commun, l’espace-temps, qui englobe la totalité des événements. Quant à l’espace, ou ensemble des événements simultanés, c’est à tort qu’on le considère comme infini ; Einstein nous le montre pareil à une sphère monstrueuse de plus d’un milliard de millions de kilomètres. Pour se produire, la simultanéité exige un même système de référence : « deux événements simultanés pour un observateur donné, ne sont pas simultanés pour un autre observateur en mouvement par rapport au premier ».
Au lieu d’être une action à distance presque instantanée, comme le pensait Newton, la gravitation se propage avec la vitesse de la lumière. Énergie et masse s’identifient ; et les vieux principes se trouvent profondément modifiés. Le relativisme, en montrant la faible portée de la mécanique classique, ouvre à nos esprits des horizons insoupçonnés. La thermodynamique avait déjà accompli un premier pas dans cette direction ; la méthode énergétique continua mais en restant purement descriptive ; elles cèdent aujourd’hui le pas au cinétisme électromagnétique. Joule avait mis en lumière les relations invariables et mathématiquement évaluables qui existent entre le travail mécanique et la chaleur. Ce qui se perd d’un côté se retrouve de l’autre bien qu’il s’agisse de qualités différentes. D’où la grande loi de l’Équivalence, étendue par la suite à l’ensemble des phénomènes dynamiques et qui aboutit au principe de la Conservation de l’Énergie. Mouvement mécanique, chaleur, électricité, lumière, etc., ne sont plus que les modalités d’une même réalité constitutive de l’univers, l’Énergie. Mais s’il est vrai que, dans un système fermé, cette dernière ne peut que prendre des formes différentes, en quantité équivalente, sans être créée ni disparaitre, les travaux de Carnot complétés par Clausius ont conduit par ailleurs à admettre le principe de sa dégradation. Dans un système physiquement isolé, l’énergie utilisable devient finalement nulle, alors que l’énergie totale reste constante. Car une énergie de forme quelconque tend à se transformer en chaleur ; et la chaleur constitue de l’énergie dégradée en ce sens que, dans un cycle réversible et continu, elle ne peut restituer sa capacité originelle de travail. Les conséquences tirées du principe de Carnot conduisirent les physiciens à concevoir l’univers sur le type d’une machine à feu et non comme le résultat de mouvements exclusivement mécaniques ; jointes aux découvertes opérées dans le domaine électromagnétique, elles devaient aboutir à la théorie électromagnétique de la matière, qui dans ses grandes lignes s’accorde avec la doctrine de relativité.
Mais avant de pousser plus loin, il importe de relever les sophismes débités par les écrivains religieux concernant la dégradation de l’énergie. Quittant le domaine expérimental pour s’égarer dans celui des fantaisies métaphysiques, ils prétendent en effet que ce principe requiert impérieusement la croyance en un dieu créateur. Voici ce que déclare l’abbé Moreux, astronome à l’eau de rose dont la partialité insigne fait la joie des dévotes et des sacristains, sa clientèle préférée ; depuis qu’elle s’est convertie au catholicisme la grande presse fait passer ce charlatan grotesque pour un savant digne d’être écouté : « On a prétendu, affirme cet esprit superficiel, que le mouvement a existé de toute éternité. Mais nous savons d’autre part, à n’en pas douter, que l’énergie mécanique utilisable diminue sans cesse, et c’est précisément la raison pour laquelle l’Univers tend vers un état final où toute l’énergie sera dégradée, comme on dit en Mécanique ; c’est-à-dire qu’il arrivera un moment où toute cette énergie utilisable sera employée ; si donc cette énergie durait depuis une infinité de temps, le monde serait déjà arrivé à cet état final, ce qui n’est pas, évidemment... Le mouvement constaté dans le monde actuel a nécessairement commencé. La matière, à un moment donné, à l’origine des temps, a reçu le mouvement d’un être extérieur à elle et qui le lui a donné : nier cette proposition, c’est, bon gré mal gré, vouloir se mettre en désaccord avec les principes les mieux établis de la Science moderne. Car encore une fois, rien ne se fait sans cause, et, en résumé, si nous constatons du mouvement, comme ce mouvement a forcément commencé, il faut nécessairement une cause qui l’ait fait naitre. » Il est heureux, pour l’écrivassier en jupon, que ses lecteurs habituels soient des esprits bornés, qu’on éblouit facilement ; affirmations saugrenues, mensonges intentionnels pullulent dans un pareil morceau ; et la saine logique ne permet pas d’admettre que tout ayant une cause il existe pourtant un être qui n’en a pas (le dieu non-causé des croyants). Un devenir sans fin, telle est la seule conclusion légitime qui découle du principe d’universelle causalité. Mais, délaissant tout le reste, plaçons-nous sur le terrain de la science exclusivement. Le principe de la dégradation de l’énergie vaut seulement pour un système isolé. Est-ce le cas du globe terrestre ? Non, puisqu’il reçoit constamment de l’énergie venue des astres, du soleil en particulier, sons forme de radiations. Et de nombreux faits démontrent que ce même principe cesse d’être vrai lorsqu’il s’agit de l’ensemble de l’univers. Comme les animaux et les hommes, les étoiles passent par un maximum de vitalité. Or la vitesse de translation d’un astre croît à mesure que son rayonnement diminue ; son énergie cinétique augmente aux dépens de son énergie radiante. Ce qui contredit le principe de Carnot manifestement. Par ailleurs, l’énergie cinétique des molécules étant productrice de chaleur, dans un gaz, les plus grandes vitesses devraient répondre aux plus grandes chaleurs. Or, remarque Arrhénius, dans les nébuleuses formées de gaz légers, à masse faible, l’attraction ne parvient pas à retenir les couches éloignées dont les molécules légères se dirigent vers des astres plus chauds que la nébuleuse abandonnée. Contrairement au principe de Carnot, la chaleur a circulé d’un corps plus froid vers un corps plus chaud. D’autres observations encore ne peuvent cadrer avec l’ancienne doctrine de la dégradation de l’énergie ; et les savants sérieux ont fini par adopter cette formule prudente, qui rune les déductions métaphysiques dont nous avons parlé précédemment : « les phénomènes se produisent généralement avec augmentation d’entropie ». (Entropie étant le nom donné par Clausius à la fonction Q/T toujours croissante dans un système isolé ; Q représentant la quantité totale d’énergie thermique.)
Applicable aux phénomènes observés à l’échelle de notre expérience ordinaire, le principe de Carnot ne cadre plus exactement avec la théorie cinétique des gaz et la mécanique statistique qu’elle engendre. Alors que l’énergétisme restait une simple description de l’expérience, n’exigeant aucun recours à des mouvements ou à des fluides invisibles, la théorie cinétique des gaz, sans pénétrer dans le mystérieux domaine des atomes, jette un pont entre notre monde moyen et celui qui échappe à l’observation coutumière des sens. « Nous n’avons, écrivait Ostwald, à propos de l’Énergétique, à nous occuper que des d’énergie ; il ne saurait y en avoir d’autres : en dehors du temps et de l’espace, l’énergie est la seule grandeur commune à tous les ordres de phénomènes. » Et, ailleurs, il déclare : « La recherche des équations qui lient un ou plusieurs ordres de phénomènes, les rapports de grandeurs mesurables, voilà tout l’objet de la science ». En somme, la méthode énergétique consistait à d’écrire, non à expliquer. Au contraire la théorie cinétique des gaz explique la loi de Mariotte par l’agitation désordonnée et les chocs continuels des atomes, agrégés ou non en molécules, dont les gaz sont constitués. La pression n’étant que le choc de l’ensemble des particules contre la paroi, il suffit de diminuer la capacité de l’enceinte qui les contient pour que la pression augmente proportionnellement. Et l e principe de Carnot, vrai en tant que loi de moyenne portant sur un nombre formidable d’éléments, n’aurait plus de raison d’être si l’on pouvait suivre chaque particule isolément. Nous tomberions dans un monde purement mécanique où la dégradation de l’énergie n’a pas de sens. L’expérience a d’ailleurs vérifié cette supposition. Dans le mouvement Brownien, de très petites particules sont dans une agitation qui sans cesse viole le principe de Carnot ; d’autres faits encore démontrent que si l’on descend aux éléments ultimes de la matière, la conservation de l’énergie devient rigoureuse. Quand on admet que la chaleur résulte de mouvements très petits, mécanique traditionnelle et thermodynamique se trouvent ainsi conciliés. Mais à l’intérieur de l’atome ce sont les théories électromagnétiques qu’il convient d’appliquer.
Déjà nous devons faire appel à la théorie des quanta, lorsque nous descendons très au-dessous de nos températures ordinaires, vers la zone du 0 absolu, et cette théorie postule que l’énergie ne varie pas de manière continue. Principe de la conservation de la masse et partant principe classique de l’inertie ne s’appliquent plus dans la mécanique électronique qui régit l’intra-structure de l’atome. Dans ce monde de l’extrêmement petit, règnent les plus grandes vitesses que nous connaissions. Celle des particules cathodiques est de 40 000 à 60 000 kilomètres par seconde ; elle est cent mille fois plus grande que celle des obus les plus rapides. Les rayons a (alpha) du radium atteignent une vitesse de 15 000 à 30 000 kilomètres à la seconde ; quant aux rayons b (bêta) émis par le même corps, ils se divisent en rayons mous dont la vitesse de propagation est de 30 000 kilomètres à la seconde et en rayons durs pouvant atteindre la vitesse de 200 000 à 300 000 kilomètres à la seconde. Les ondes électromagnétiques produites par les oscillations électriques parcourent 300 000 kilomètres à la seconde, comme la lumière. Or des expériences mirent en évidence que le théorème de la composition des vitesses, conséquence du principe de l’indépendance des mouvements, ne s’appliquait point dans ce dernier cas. Ce fut le mérite d’Einstein de résoudre cette difficulté ainsi que bien d’autres, d’une façon logique, sans recourir à des expédients comme on le faisait avant lui. Ses théories de relativité restreinte et généralisée n’ont rien des mystiques et fumeuses conceptions d’un Bergson, elles restent d’ordre strictement rationnel et nous en avons déjà indiqué les idées directrices. Il a développé le principe de relativité de la mécanique classique, en substituant à l’ancienne formule des changements d’axes, en géométrie analytique, la formule de Lorenz exprimant la contraction de l’espace et la dilatation correspondante du temps : avec elle la vitesse de la lumière entre en ligne de compte nécessairement. Dès lors le temps, fonction du mouvement, n’est plus uniforme, ni universel ; pas plus que l’espace n’est absolu, vide, homogène et isotrope. Espace et temps sont des propriétés du réel ; en fait il existe seulement des événements étendus et qui durent. C’est par des simultanéités, départ d’un train et position de l’aiguille d’une horloge par exemple, que nous définissons le temps ; ce qui le rend fonction du mouvement et le lie indissolublement à l’espace ; aussi toute modification dans la mesure de ce dernier provoque-t-elle une modification dans sa propre mesure. Notre univers a quatre dimensions : longueur, largeur, profondeur et temps. Enfin il existe une relation nécessaire entre l’énergie et la masse ; toute masse est énergie et toute énergie a une masse.
Dans sa théorie de relativité généralisée, Einsten, poussant plus loin, fait dépendre la gravitation des seules mesures du mouvement. Le continuum espace-temps, trame véritable de notre univers, cesse d’être euclidien, sauf lorsqu’on s’arrête à des éléments infiniment petits. Un super-monde, celui de l’électromagnétisme, régissant les astres comme les atomes, enveloppe et conditionne le monde du sens commun. Accomplissant un nouveau pas dans la voie de l’unité. Le célèbre physicien vient, récemment, de fondre en une seule les deux qualités primitives qu’il avait dû conserver dans sa doctrine de relativité : la gravitation cause de tout mouvement et base de la mécanique d’une part, l’électromagnétisme fondement de l’optique, ainsi que des phénomènes d’électricité et de chaleur d’autre part. Grâce à une construction de l’espace différente de toutes celles qu’il avait imaginées jusqu’ici, il parvient à exprimer, par les mêmes formules mathématiques, changements et lois tant du champ électromagnétique que du champ de gravitation. Au spectre merveilleux qui, parti des ondes ultra-violettes de quelque dix millièmes de millimètre de longueur, passe par les rayons visibles de la lumière et ceux invisibles de la chaleur, pour atteindre les rayons électriques dont la longueur d’onde est parfois de plusieurs kilomètres, en T, S, F, par exemple, il ajoute la seule forme d’énergie jusqu’à présent réfractaire : la pesanteur. La force qui nous donne la lumière est la même qui fait circuler l’électron autour du noyau atomique et tourner la terre autour du soleil. Aux veux du savant ébloui, l’univers n’est plus que le résultat des innombrables transformations d’une même énergie, un prodigieux complexe où tout est mouvement. Et les découvertes de Millikan, de Jeans et d’Eddington démontrent, par ailleurs, que ce jeu des forces cosmiques est éternel, n’ayant nul besoin d’une première origine et ne pouvant connaitre de fin. C’est avec les éléments dispersés d’atomes anciens que se forment les atomes nouveaux.
-
« Des électrons positifs et négatifs, déclare Millikan, existent en quantités incommensurables dans l’Espace interstellaire. Pour cela nous avons l’évidence du spectroscope ;
-
Ces électrons se condensent en atomes sous l’influence des conditions qui existent dans l’Espace interstellaire, c’est-à-dire dans les conditions du froid de zéro absolu et le phénomène de dispersion extrême. Pour cela nous avons l’évidence de nos années d’expérimentation sur les rayons cosmiques ;
-
Ces atomes forment des agrégations sous l’influence de la force de la gravitation, et ainsi deviennent des étoiles. Pour cela nous avons l’évidence basée sur des observations télescopiques ;
-
À l’intérieur des étoiles, grâce aux pressions formidables, aux densités énormes et aux températures surélevées, les électrons positifs (probablement dans le nucleus des atomes lourds) tombent en affinité parfaite avec les électrons négatifs, c’est-à-dire qu’ils transforment leur masse entière en pulsations d’éther, lesquelles, de suite transformées en chaleur, soutiennent la température de l’étoile et sont la cause de la lumière et de la chaleur qui émanent d’elle. Pour cela nous avons l’évidence basée sur la périodicité et la duré de la vie des étoiles. »
Quant aux électrons existant dans l’espace intersidéral, ils résultent de la dématérialisation de la matière, de son retour, lent ou brusque, aux élérnents indestructibles dont tout corps tangible est un agglomérat. Dans La Synthanalyse, notre ami G. Kharitonov a donné un original et lumineux exposé du cycle des transformations successives que la matière parcourt sans fin. Il a démontré de façon scientifique l’éternité du mouvement. Sans doute beaucoup reste à trouver ; et, dans un avenir prochain peut-être, des théories céderont la place à d’autres plus proches encore de la vérité ; mais dès aujourd’hui il appert qu’astronomie, physique et chimie s’unissent pour éliminer, comme irrationnelle et inutile l’action d’un dieu créateur ou providence de notre univers. Si la médiocre science, dont se repaissent un trop grand nombre de professeurs d’Université et de membres de l’Institut, s’accorde, tant bien que mal, avec des idées religieuses volontairement imprécises, la science, à son degré supérieur, ruine irrémédiablement la croyance non seulement en une révélation surnaturelle, mais en l’existence d’un Être Supérieur. Seulement très peu ont le courage de l’avouer explicitement.
De l’inorganique, passons au domaine de la vie et nous constaterons de même que la science n’a besoin ni de l’âme ni de Dieu pour expliquer les phénomènes qui déroutaient le plus nos pères. Animisme et vitalisme nous font sourire aujourd’hui ; et la finalité interne, que Claude Bernard admettait encore, est exclue par les biologistes sérieux. L’être organisé ne se distingue du corps brut que par sa complication ; leurs constituants sont identiques et tout phénomène vital se ramène à un événement d’ordre physicochimique. « La formation d’un cristal, d’une plante, d’un animal, disait Tyndall est un simple problème de mécanique, qui diffère simplement des problèmes de mécanique ordinaire par la petitesse des masses et la complexité des éléments. » Déjà Descartes, supprimant les vaines entités de la scolastique, n’avait vu dans le vivant qu’une machine prodigieusement compliquée ; et la science moderne a confirmé cette doctrine, en démontrant qu’il n’est pas un fait, dans les corps organisés, dont la physique et la chimie ne rendent compte. Quant à l’idée directrice, invoquée par Claude Bernard, et capable de provoquer la convergence de toutes les fonctions vers une fin unique, la solidarité de tous les éléments, elle est définitivement éliminée par la biologie. Gley déclare :
« Comment, en effet, agirait ce principe directeur des phénomènes vitaux pour leur donner le sens dans lequel nous les voyons se produire ? Les phénomènes se réduisent tous en définitive, à des phénomènes physicochimiques ; or, on ne comprend pas qu’il soit possible d’agir sur la direction de phénomènes de cette nature, autrement que par une action effective qui ne peut consister que dans l’intervention d’une force de même nature. Car la direction des faits n’est pas quelque chose d’extérieur aux faits. »
Sans méconnaître le génie de Pasteur en chimie bactériologique, nul savant impartial ne saurait admettre, présentement, les conclusions que les spiritualistes ont tiré de ses expériences sur la génération spontanée, en faveur du créationnisme biblique. Rabaud, professeur de biologie en Sorbonne, écrit :
« Les données actuelles les mieux établies amènent à concevoir les substances vivantes comme une émanation nécessaire du milieu, tout aussi nécessaire, suivant la très juste expression de Verworn, que la formation de l’eau, en fonction de conditions réalisées, à un certain moment, à la surface du globe. Ces substances sont le produit d’une véritable génération spontanée dérivant d’un déterminisme physicochimique précis et non des conditions indéterminées, constamment réalisables. À cette façon de voir, on oppose quelquefois les expériences de Pasteur. Mais si ces expériences démontrent que des Infusoires ou des Bactéries ne naissent pas spontanément dans de l’eau bouillie dépourvue de germes et maintenue à l’abri d’un ensemencement, elles ne démontrent pas qu’une substance vivante ne puisse apparaître lorsque ces éléments simples se trouvent réunis dans des conditions définies. Tout nous conduit, au contraire, à admettre la nécessité de cette apparition ; rien ne nous oblige à accepter l’hypothèse d’une substance née d’une façon spéciale, douée d’attributs spéciaux, qui serait animée et dirigée par un principe immatériel, le principe vital sous quelque nom qu’on le désigne. Outre que cette hypothèse ne repose sur aucune donnée positive, elle est inutile pour l’explication des phénomènes vitaux. »
Reconnaissons, à la décharge de Pasteur, qu’à l’encontre des idées qu’on lui prête d’ordinaire, il ne déclarait pas impossible la synthèse du protoplasme (voir ce mot) vivant. Et le triomphe de la conception mécaniste a fait éclore des doctrines du plus puissant intérêt. Celle des colloïdes d’abord qui rapproche si intimement matière organique et matière brute. Véritable atomisme biologique, la théorie cellulaire admet que tous les tissus vivants sont composés de cellules extrêmement complexes, dont les atomes et les molécules se trouvent dans cet état spécial que les chimistes dénomment colloïdal. Alors que dans une solution ordinaire, les molécules du corps dissous sont petites, uniformément distribuées et constituent un tout homogène avec le liquide dissolvant, dans une solution colloïdale, les molécules très grosses, souvent agglomérées en amas de tailles diverses, sont animées de mouvements browniens et deviennent même visibles à l’ultra-microscope. À de forts grossissements et à l’état frais, le protoplasma colloïdal apparaît comme une véritable émulsion, formée de fines gouttelettes accolées, avec des granulations nombreuses et instables, les mitochondries, de forme filamenteuse ou sphérique et constituées par une substance albuminoïde associée à des lipoïdes. La stabilité des colloïdes d’émulsion est très grande parce que les granules se repoussent et ne se précipitent pas, étant toutes chargées d’électricité de même signe. Dans les processus vitaux essentiels : absorption, assimilation, immunisation, etc., l’adhésion moléculaire qui fixe un sel ou un colloïde sur un autre colloïde, comme l’adhésion physique retient les gaz à la surface des solides, joue un rôle essentiel. Ainsi la vie s’avère la résultante des processus physicochimiques dont les complexes colloïdaux sont le siège et non une propriété ou un ensemble de propriétés irréductibles à des éléments connus. Si nous examinons un organisme compliqué, les manifestations vitales donnent, de prime abord, l’impression d’appartenir à un ordre de phénomènes particuliers, n’ayant qu’un lointain rapport avec ceux qu’étudient les sciences de la matière inanimée. Mais si on les analyse avec précision, on doit convenir que, malgré leur complexité extrême, ces processus ne dissimulent aucun élément étranger soit à la physique, soit à la chimie.
La fécondation elle-même, l’une des plus mystérieuses manifestations de la vie, se ramène à des procédés strictement physicochimiques. C’est à un accroissement d’oxydation probablement que la cellule primitive doit de se multiplier rapidement pour constituer l’embryon ; et, dans certaines espèces, le rôle de l’agent qui féconde se borne à dissoudre la couche corticale de l’œuf, afin de permettre cette oxydation accrue. En fait, des œufs d’oursins, d’étoiles de mer, de grenouilles ont pu être fécondés sans aucune intervention du mâle par des procédés purement chimiques ou physiques. Ils se sont développés jusqu’à’ un stade avancé et même jusqu’à complète maturité. Ayant laissé quelque temps des œufs d’oursins dans de l’eau de mer additionnée de sel, puis les ayant replacés dans de l’eau de mer ordinaire, Loeb vit éclore des larves chétives, qui mouraient avant leur évolution définitive, d’une façon générale. Il se persuada que la membrane vitelline, qui se forme autour de l’œuf normalement fécondé, possède un rôle chimique ; par le moyen d’un acide gras, il provoqua la formation d’une membrane artificielle. Et dès lors les larves obtenues avec des œufs vierges furent aussi viables et aussi bien constituées que celles qui résultent des œufs fécondés par un mâle. Bataillon se borne à percer la couche corticale des œufs de grenouilles avec une aiguille, pour en provoquer le développement. C’est encore à des procédés d’ordre physicochimique : oxydation, osmose, diosmose, etc., que se ramène le processus de croissance de l’embryon. Et c’est eux, pareillement, qui expliquent la multiplicité des espèces tant animales que végétales. Pour des raisons qui n’ont généralement rien à voir avec la science, le transformisme fut attaqué de divers côtés, ces derniers temps. Bien en vain ; Rabaud, un biologiste officiel pourtant, n’hésite pas à le déclarer.
« Malgré les oppositions qu’il suscite périodiquement et qui sont presque toujours guidées par des considérations extra-scientifiques le transformisme (voir ce mot) est et reste la seule théorie utile et féconde, à la fois parce qu’il rend compte des faits sans les déformer ni les mutiler, et parce qu’il anime la recherche. Sans doute la théorie, telle qu’elle est sortie des travaux de Lamarck, de Darwin et de leurs successeurs immédiats doit subir des retouches ; mais l’idée centrale et le fait fondamental demeurent, que tout contraint d’accepter. La recherche rigoureuse, indépendante de toute idée préconçue, conduit à un enchaînement de faits, qui montre les êtres vivants se dégageant les uns des autres, de toutes les manières et dans de multiples directions, sous l’influence des actions directes qui s’exercent sur eux. »
Lamark expliquait l’évolution par une adaptation du vivant au milieu, Darwin, par la lutte pour la vie et la sélection naturelle. C’était le début des explications mécanistes ; aujourd’hui, grâce surtout à de Vries, l’interprétation physicochimique du transformisme a fait d’immenses progrès. Ses recherches ont montré que des changements s’opèrent non par une lente évolution, mais par des transformations brusques, des mutations. Comme il existe des séries chimiques qui diffèrent d’un seul coup, grâce à un groupe d’atomes, il existerait des séries biologiques différentes entre elles, grâce soit à un groupe de colloïdes, soit à la position dans le complexus vivant de ce groupe de colloïdes. De Vries rencontra des Œnanthères ou Onagres, aux formes absolument anormales, dans un champ abandonné depuis dix ans. Il utilisa ces plantes monstrueuses et obtint des espèces nouvelles à caractères fixes. On put dès lors classer parmi les mutations brusques, certains faits, connus jusque là sous le nom de jeux de la nature et dont plusieurs étaient célèbres : par exemple le fraisier à feuilles simples de Duchesne, le mouton loutre né dans le Massachusetts en 1791 et qui fit souche d’une espèce nouvelle, l’homme porc-épic né en ??, en Angleterre, dont les enfants et petits-enfants furent dotés, comme lui, d’une carapace hérissée de piquants. Depuis de Vriès de nombreuses variations de même genre ont été découvertes dans le règne végétal, et quelques-unes dans la série animale. L’observation démontre que l’action du milieu, les traumatismes, les infections, tout ce qui modifie le chimisme intérieur de l’être en général, favorisent l’apparition de ces changements transmissibles par hérédité. Et dès lors l’expérimentation devient possible, dans ce domaine qui parut si longtemps fermé à l’interprétation physicochimique.
Les mœurs mêmes des animaux, leurs réflexes, leurs instincts, ce qu’on dénomme aujourd’hui leur comportement, auraient pour origine une excitation physique ou chimique, d’après la théorie des tropismes. Directement ou indirectement leurs mouvements seraient liés, en dernier ressort, à des influences extérieures. C’est d’une action photo-chimique que résulterait la tendance de certains animaux comme de certaines plantes à se diriger vers la lumière. Lorsqu’on observe, non plus en poète comme Fabre, mais en savant, les merveilles de l’instinct, on remarque combien énorme le rôle des tropismes, combien illusoire la prescience que les spiritualistes y découvrent si volontiers. « Si l’on place côte à côte, écrit Loeb, un morceau de viande et un morceau de graisse du même animal, la mouche (commune) déposera ses œufs sur la viande sur laquelle les larves peuvent vivre, et non sur la graisse où elles périraient de faim. Nous avons affaire ici à l’action d’une substance azotée volatile, qui détermine par réflexe les mouvements de ponte des œufs chez la mouche femelle ». Les piqûres paralysantes de certains insectes, qui semblent impliquer des connaissances anatomiques invraisemblables, résultent seulement d’une luminosité invisible pour nous, ou d’une sensation olfactive dénotant la présence du liquide rachidien dans telle et telle partie du corps de la victime. Pour se documenter sur le réflexe instinctif nous renvoyons le lecteur au bel article de Stephen Mac Say sur l’Instinct.
Dans le mendélisme, il faut voir de même un effort heureux pour introduire le probabilisme mécanique et le jeu des lois physicochimiques, en matière d’hérédité. Un moine tchécoslovaque, dont les contemporains n’apprécièrent pas le mérite, Johann Gregor Mendel, fut le premier auteur de cette doctrine qui arracha au caprice divin un domaine où il régnait, jusque là, sans conteste. De Vries, Correns, Tschermard, qui redécouvrirent séparément, vers 1900, la théorie mendélienne, restée inconnue ou presque du monde savant, lui ont fait attribuer la place qu’elle mérite. Son principe essentiel peut se formuler de la sorte :
« Si nous croisons deux formes qui ne diffèrent que par un seul caractère, tout hybride issu de cette union forme en nombre égal deux espèces de cellules sexuelles, deux espèces d’œufs si c’est une femelle, d’agents fécondants si c’est un mâle. L’une des espèces est de type purement paternel, l’autre de type purement maternel. »
Par une simple application des lois de la probabilité mathématique, qui commandent les combinaisons possibles, on pourra donc, en partant d’un couple primaire, déterminer la distribution des caractères de variation dans la lignée. Des expériences faites dans le règne végétal, croisement de pavots pourvus d’une tache noire, à la base des pétales, et de pavots pourvus d’une tache blanche par exemple, et aussi dans le règne animal, croisement de souris noires et blanches, etc. ont pleinement vérifié les résultats prévus grâce au calcul des probabilités. Le sexe n’échappe pas à la loi mendélienne. Dès aujourd’hui la technique qu’elle inspire permet d’aboutir à des résultats remarquables dans le monde des végétaux et des animaux ; cette technique jouera un rôle de premier plan, quand les hommes, gagnés par les incontestables avantages de l’eugénisme rationnel, (voir naissance) se décideront à l’appliquer à eux-mêmes. Quoi qu’il en soit, là encore, le merveilleux cède la place à une explication d’ordre mécanique. Dès que ses recherches deviennent assez profondes, la biologie permet de rattacher les phénomènes vitaux les plus compliqués à de simples processus physicochimiques. Que les théories d’aujourd’hui cèdent la place à d’autres dans un avenir prochain, qu’importe ! Si nous ne possédons pas la vérité totale, du moins nous progressons vers une lumière sans cesse accrue. Et déjà il appert que les fables théologiques, que les explications brumeuses des métaphysiciens ne conviennent plus à l’humanité sortie de ses langes. Pour le penseur moderne, l’univers n’est qu’un vaste théorème où de nombreuses inconnues subsistent mais où tout se réduit en définitive à l’énergie, au rayonnement.
La vie mentale n’échappe point à cette loi générale, puisque la conscience psychologique requiert le mouvement pour naître et qu’elle disparaît toujours avec lui. Nulle activité psychique ne se manifeste hors des organismes vivants ; et c’est de la richesse du système nerveux que dépend la richesse de la pensée. L’on peut poser en principe que la mentalité d’un être sera d’autant plus obtuse que ses mouvements seront moins nombreux, moins variés. Assurément il n’existe pas de rapport simple entre le degré d’intelligence et la quantité de matière cérébrale ; les spiritualistes crurent à tort que le triomphe de leur doctrine était définitif parce que l’intelligence d’un homme n’est pas toujours proportionnelle au poids de son encéphale ou parce que les moutons, espèce assez sotte, possèdent un cerveau très riche en circonvolutions. Ils oubliaient que le perfectionnement des cellules, la qualité de la substance grise, sa composition chimique, etc, sont plus importants encore et qu’ils suffisent à expliquer toutes les anomalies apparentes. Conditionnée par les innombrables vibrations et oscillations des cellules nerveuses, la vie mentale de l’homme est nettement supérieure parce que les six cent millions de cellules et, les milliards de tentacules qui constituent son système nerveux central assurent à ses mouvements cérébraux une étendue et une puissance que l’on ne rencontre dans aucune autre espèce animale. Mais, pour une raison identique, il y a plus de différence entre le psychisme du chat et celui d’un ver qu’entre le psychisme des singes anthropoïdes et celui des sauvages d’Australie. Lorsqu’on a ainsi contemplé les mécanismes secrets, dont dépendent les scènes qui, sans fin se jouent sur le théâtre de l’univers, les conceptions d’un Bergson font sourire, malgré les comparaisons poétiques et le feu d’artifice des jolies phrases, qui dérobent au lecteur le vide obscur de leur contenu.
– L. BARBEDETTE.
MOUVEMENT SOCIAL
La définition exacte de cette locution : « Mouvement social » est assez délicate et imprécise. Dans son sens complet, elle signifie tout ce qui comporte un changement, une transformation, une évolution ou une révolution dans la constitution de la société, ainsi que l’activité des classes ouvrières... Il embrasse donc toute la vie sociale dans ses multiples formes, ses nombreux organismes, et ses perpétuelles transformations.
Le déterminisme est aussi vrai sur le terrain social que dans tous les autres domaines des connaissances humaines. Une découverte scientifique mise en pratique industriellement, une machine inventée, une nouvelle méthode de travail, ont des répercussions (plus ou moins étendues et profondes suivant leur importance) sur la vie économique, et par contre-coup sur les modalités et la constitution des organismes sociaux et sur les conditions d’existence des populations.
La découverte ou la mise en exploitation de nouveaux territoires ou de nouvelles richesses minières, provoquant la naissance, en certains pays, d’une agriculture, d’une industrie, d’un commerce, entraine des modifications dans les positions économiques, commerciales, financières et autres des peuples. Elle pose de nouveaux problèmes sociaux et transforme les anciens.
La formations de groupements financiers : trusts, cartels consortiums, organisations capitalistes, aussi bien que la création de groupements ouvriers (syndicaux, coopératifs ou autres), ont pour résultat de déterminer dans la société de nouveaux courants, et de créer une nouvelle situation sociale.
Les systèmes de gouvernement et d’administration publique, la forme des gouvernements, la constitution et la transformation des patries, etc., tout ce qui, dans un régime, ébranle des mouvements regardés comme proprement politiques, ont aussi avec le social, des rapports plus ou moins étroits. Ils peuvent le faire dévier, le pousser dans telle ou telle autre voie, le réfréner ou l’accentuer.
Les croyances religieuses, politiques, philosophiques et autres ont également une portée considérable sur la vie sociale. Sous l’emprise d’une religion, un peuple ne se comportera pas comme une population en grande partie libre-penseuse, même si les conditions économiques sont les mêmes. Parmi les fondements des sociétés, les bases psychologiques (croyances, préjugés, traditions, etc.) tiennent une place de premier plan. Et cela explique les fortes dépenses consenties par les castes régnantes et exploitantes pour maintenir les castes pauvres dans un état d’esprit propre à conserver leur règne. Les grandes secousses sociales ont toujours été précédées d’une lutte idéologique acharnée. Voltaire, J,-J. Rousseau, les Encyclopédistes ont préparé la révolution française de 1789.
C’est une erreur profonde des purs marxistes de croire que comptent seules les formes économiques, malgré leur importance, peut-être primordiale. Méconnaître les conditions psychologiques est une grande faute qui peut aboutir à de graves mécomptes. L’évolution des méthodes de production a été formidable durant ces cinquante dernières années ; le rendement du travail a été intensifié dans des proportions colossales, mais la constitution de la société n’a point accompagné cette transformation, parce qu’il a manqué une évolution morale correspondante, parce que les populations ouvrières demeurent imbues des vieux préjugés de hiérarchie, de soumission, d’infériorité.
L’exemple de la Russie nous a montré qu’il ne suffit point, à la faveur d’événement favorables, de se rendre maître de l’organisation politique et de commander aux rouages économiques d’un pays. Tant qu’une mentalité nouvelle ne s’y est pas développée, il est impossible d’y instaurer – profondément et durablement – un régime social nouveau. Les ambitions de ceux d’en-haut, la résignation séculaire de ceux d’en-bas, tendent à ramener rapidement, après la secousse, à leur position première, les formes sociales qu’on a voulu et cru abolir.
En résumé, le mouvement social – l’expression étant prise dans son sens le plus large, – est un inextricable amalgame de toutes les forces morales, politiques, religieuses de toutes les transformations techniques dans le domaine de la production, des échanges, des transports, etc., de toutes les constitutions de groupements et d’organismes économiques, corporatifs, financiers, coopératifs et autres. La vie sociale est en perpétuel mouvement.
Il est cependant assez aisé de reconnaître, au sein des multiples courants sociaux qui agitent actuellement la société humaine, une poussée qui s’affirme sous des formes diverses, mais suivant une ligne générale, prépondérante sur toutes les autres formes d’organisation : c’est l’orientation vers l’entente toujours plus libre.
Jusqu’à présent, et davantage en remontant dans le passé, la solidarité sociale a été plus imposée que voulue. Si toutefois l’on peut appeler solidarité sociale des relations entre maître et esclave, chef et subordonné, patron et salarié, qui ont jusqu’ici été les seules formes du contrat social. Ces relations, basées sur l’autorité d’en haut et la soumission d’en bas, l’opulence des supérieurs et la misère des inférieurs, n’ont pu être maintenues dans leur injustice que par l’empoisonnement des esprits, l’ignorance des masses, par la violence des chefs et de l’État et par l’institution de la discipline sociale, sous la forme de lois, de codes et d’institutions policières, administratives et judiciaires coordonnées en vue de faire respecter les dites lois œuvre des maitres. L’injustice, le privilège, la hiérarchie, l’inégalité, l’autorité imposée par la violence brutale ou méthodique, telles sont les bases du contrat social actuel.
Néanmoins, nous l’avons dit, se dessine, caractéristique, la tendance à l’association, plus ou moins imprégnée d’esprit égalitaire et aspirant vers la liberté. Dans tous les domaines de l’activité humaine, des groupements divers se fondent, se développent et prospèrent. Ce sont, dans les campagnes, les syndicats et coopératives agricoles, qui permettent aux petits cultivateurs de se libérer de certaines exploitations et de profiter des méthodes modernes de la technique. C’est, dans l’industrie, la formation de syndicats corporatifs ouvriers, de syndicats patronaux, de trusts, cartels et autres coalitions capitalistes. C’est la création de nombreuses coopératives de consommation, de production, de transports, d’électrification, etc., etc. C’est la vitalité d’innombrable associations artistiques, scientifiques, littéraires, sportives, touristiques, etc. Ce sont des ligues de défense d’usagers pour la protection de certains intérêts, des ligues pour la propagande ou pour des projets. C’est la mutualité par en bas, l’assurance par en haut. Certes toutes ces formes de groupement laissent bien à désirer. La mentalité ambiante les pénètre. Beaucoup n’ont en vue que le lucre, les bénéfices accrus, la sauvegarde d’avantages particuliers. L’ambition, l’arrivisme, la hiérarchie les vicient et les divisent bien souvent. Mais le fait principal, c’est que ces groupements ne sont pas imposés, les adhérents y entrent et en sortent avec une relative facilité. Ils peuvent, plus ou moins, y exprimer leurs opinions...
Cette propension actuelle à l’association relativement libre est, en un sens, représentative de notre époque ; elle se développe continuellement, conquiert tous les champs où se meuvent les humains et gagne toutes les classes. Au point de vue pratique, malgré ses déviations, son esprit, ses imperfections, elle apporte à ses membres des satisfactions appréciées. Elle a l’avenir devant elle, et tout indique que la méthode autoritaire du contrat social est appelée à disparaître devant cette forme nouvelle : l’association librement consentie. C est incontestablement là la figure générale que prendra demain la vie sociale de l’humanité. Fatigués d’attendre, en vain, le bonheur des miracles divins, de la bonne volonté des chefs, des décisions de l’État, les hommes pensent, de plus en plus, à s’organiser, afin de réaliser eux-mêmes ce qu’ils désirent.
* * *
Dans les milieux d’avant-garde, l’expression « Mouvement social » a pris un sens plus restreint, mais aussi beaucoup plus précis. Il signifie la poussée des classes sociales inférieures pour obtenir des améliorations à leur sort, et pour parvenir à l’égalité et à la justice sociales. Il englobe donc toutes les formes d’organisation des pauvres, des exploités, des gouvernés pour tenter de substituer un nouveau contrat social à l’ancien. Il comprend toutes les actions, les propagandes, les luttes, les grèves, les manifestations, les révolutions qu’anime le dessein de secouer le joug des maîtres et de supprimer l’exploitation du capitalisme. Le mouvement social est ainsi le mouvement de la classe ouvrière en marche vers la liberté, le bien-être, l’égalité et la justice.
Il y a eu, à toutes les époques, des mouvements sociaux. En faire l’historique dans ses détails entraînerait à écrire plusieurs ouvrages aussi conséquents que l’Encyclopédie. Et encore, que d’obscurités ! Les historiens nous ont laissé maintes relations qui souvent sont pures légendes (v. histoire), sur la vie des maîtres, des rois, des chefs de guerre, des princes de l’Église, des grands personnages, des guerres et des conquêtes, des déplacements de frontières, etc., mais ils ont, presque tous, laissé dans l’ombre la vie du peuple, comme si celui-ci n’existait pas, ou n’était pas digne d’occuper leur plume et leur esprit. Ce n’est que ces dernières années que des savants, historiens consciencieux, chercheurs tenaces, se sont mis à la tâche avec l’intention de rechercher et d’écrire la vie sociale des temps passés. Rares, du reste, demeurent ces investigateurs. Et la bibliothèque qui contiendrait tous les ouvrages du genre ne serait pas très garnie.
La question sociale s’est pourtant posée de tous temps, on tout au moins depuis que les humains vivent en groupes organisés, depuis que, sur les contrats imposés par les maîtres – à leur profit naturellement – les intéressés se sont mis à réfléchir, à l’instigation souvent de libres esprits, et que se sont dessinées, longtemps tremblantes et chaotiques des rébellions parmi les asservis.
L’Égypte des Pharaons a connu des soulèvements sociaux formidables, une véritable révolution sociale qui a bouleversé l’autorité traditionnelle et atteint une exploitation forcenée. Le peuple s’est plus ou moins affranchi économiquement ; le sort des esclaves a été amélioré ; certains droits politiques et économiques ont été reconnus aux individus. Conquête typique : l’embaumement des momies, qui assurait « la vie éternelle aux âmes » et qui était le privilège des puissants – les pauvres n’avaient pas droit à une âme ni à la survie, proclamaient les prêtres – fut accordé à tous ! Naturellement, le mysticisme grossier de ces temps d’ignorance et l’esprit profondément hiérarchisé de cette époque n’ont pas permis une émancipation plus complète, mais le mouvement fut profond et ses résultats relativement conséquents.
Le christianisme a ébranlé, lui aussi, un mouvement social de grande envergure. Avant lui, la condition du bas peuple et des esclaves était épouvantable. Aucun droit ne leur était reconnu. Ils étaient propriété du maître, propriété dont on pouvait user et abuser à sa guise. Ce n’est pas pour rien que la légende chrétienne primitive a pris un homme du peuple comme fils de Dieu. En ces âges de puissant symbolisme, l’égalité de tous devant Dieu et le droit égal au paradis était une revendication importante – si futile que la chose puisse nous apparaître aujourd’hui.
Si la foi religieuse a été la figure persistante du christianisme, son essor connut d’autres aspects et il paraît avoir traduit, à son enfance, de profondes revendications sociales. Si ténébreuse que soit restée l’histoire de ces temps, on en dégage des tendances vers l’égalité économique, un communisme agissant, l’avènement des esclaves au plan humain, un rêve touchant de fraternité universelle, l’essor d’une idéologie humanitaire.
Plus tard devenue officielle et alliée des maîtres temporel, l’Église a canalisé ce vaste mouvement social pour l’amener dans les voies de la résignation, de la soumission, de la hiérarchie et de l’autorité acceptée. Il n’en reste pas moins que ce fut un ardent mouvement populaire préoccupé d’émancipation, à travers son assujettissement religieux. Sans les prêtres qui l’ont dénaturé en s’en faisant un piédestal, qui sait ce que ce mouvement eut réalisé ? Il en sera ainsi de tout mouvement social dirigé par une caste sacerdotale ou politique. Si le socialisme (ce mot pris dans le sens de transformation sociale avec ses luttes conséquentes) devenait une église, ses prêtres tueraient aussi le socialisme ; ils l’incorporeraient par les subterfuges coutumiers dont le peuple est toujours dupe, à la domination établie, à point légitimée.
Plus près de nous, s’est développé un mouvement social très important également, quoiqu’encore peu connu : celui des corporations et des communes du moyen-âge. Ici, l’esprit religieux est encore puissant, mais il tend à céder le pas à des considérations d’ordre matériel plus nettement exprimées. Les artisans des cités, éveillés les premiers à la liberté, dans presque toute l’Europe veulent se débarrasser du brigandage féodal. Ils s’organisent en corporation et en communes pour lutter contre le seigneur – qui était souvent l’évêque – pour conquérir des libertés, des franchises, pour administrer eux-mêmes leurs villes. Poussée vers l’indépendance et le bien-être. Le soulèvement communal dans les villes, la jacquerie dans les campagnes. Les paysans écrasés facilement. Les communes triomphantes plusieurs siècles... Il a fallu la création des patries modernes, des royaumes et des États, pour que les corporations perdent leurs libertés et, une grande partie de leur bien-être. La Patrie prenait la place de Dieu, pour tenir les populations dans l’esclavage. Quelques écrits dont un très documenté de Pierre Brizon, sur l’histoire ouvrière à travers les âges, et un de Kropotkine, sur l’Entraide, avec les pages de Michelet, nous ont donné des aperçus des résultats acquis par le mouvement communal du moyen-âge. Les membres ouvriers des corporations (v. corporation, métier) y jouissaient d’un bien-être et d’une liberté que bien des prolétaires d’aujourd’hui ne connaissent pas.
C’est l’Église qui a tué le mouvement social chrétien, c’est l’État qui a tué le mouvement social des Communes. Rapprochements édifiants, concluantes leçons de l’histoire !
* * *
Le mouvement social actuel s’est débarrassé, en grande partie, des préjugés religieux. Mais, il est encore trop imprégné des préjugés politiques et de la mystique étatiste. Les classes inférieures de la société – si longtemps portées par leur faiblesse à s’en remettre à leurs maîtres du soin d’assurer leur bonheur – n’ont pas encore compris cette vérité pourtant évidente : c’est que la constitution d’une autorité a toujours été et sera toujours le plus grand obstacle à leur émancipation.
Le mouvement social d’aujourd’hui revêt de multiples formes. Mais, dans l’ensemble, on peut dire qu’il place les libérations matérielles au premier plan, et en cela sa logique est sûre. La liberté politique et la liberté morale ou d’opinion ne sont et ne resteront que de pures abstractions, vides de tout sens précis et surtout de réalité, tant que l’assujettissement économique prévaudra. Un homme qui doit se soumettre, afin de pouvoir manger, s’habiller et se loger, ne peut affirmer qu’il est libre.
La révolution de 1789 et toutes les révolutions politiques ultérieures ont pu proclamer solennellement les droits de l’homme et du citoyen, instituer le suffrage dit universel, affirmer mensongèrement la liberté de pensée ; par le fait que la richesse sociale, les moyens de travail, sont restés le monopole d’une classe, tout le reste, les proclamations de liberté, d’égalité et de fraternité sont et demeurent des aspirations utopiques.
C’est ce qu’avaient déjà compris, vers la fin de la grande révolution, Babœuf et quelques autres. C’est ce qu’ont compris les écrivains socialistes, communistes et anarchistes qui ont reconnu pour guides les Fourier, les Blanqui, les Proudhon, les Marx, les Bakounine, les Kropotkine...
Déjà, la révolution de 1848, puis ensuite la Commune de 1871, puis la Révolution russe ont montré que les revendications matérielles occupaient la première place dans les préoccupations des masses travailleuses. On parle moins aujourd’hui de conquête du pouvoir politique et davantage d’émancipation économique, d’expropriation des classes possédantes et gouvernantes, et d’administration de la vie sociale par les organisations ouvrières.
Il existe encore des partis politiques (socialiste, bolcheviste) étroitement mêlés à la lutte des classes ouvrières, au mouvement social en général. Mais déjà, en beaucoup d’endroits et en bien des groupements, on tient la politique en suspicion, on la combat, on cherche à la bouter dehors comme indésirable et pernicieuse. Il y a bien des retours en arrière, des contre-offensives des partis politiques, lesquels reconquièrent pour un temps leur influence, mais l’effet de ces reculs est toujours d’affaiblir les groupements où se livrent de tels combats. On peut dire qu’il y a méfiance générale à l’égard de la politique. Au point que les politiciens eux-mêmes se défendent d’en faire. Tout groupement sérieux, dans n’importe quelle classe sociale, met la politique à la porte. Être politicien est une tare mal portée. Le fascisme, rempart du capitalisme décadent, exploite d’ailleurs aujourd’hui ce dégoût et cette désaffection avec une habile démagogie et tente de les dévoyer vers le « salut » d’un pouvoir fort, ramenant l’ordre et tarissant les abus... Notons cependant comme de bon augure le déclin des solutions politiques : il montre que le mouvement social a su, partiellement tout au moins, se libérer de néfastes espérances et d’une dangereuse et stérile méthode.
Parallèlement, avec plus ou moins de franchise et de bonheur le mouvement social actuel fait effort pour se débarrasser de la religion, du patriotisme, de l’étatisme. Plus il est libéré de ces entraves, et plus il apparaît énergique, actif et puissant.
Les formes principales du mouvement social sont : le syndicalisme, le coopératisme et le mutualisme (voir ces mots).
Le syndicalisme ouvrier a mené de rudes batailles durent ce dernier demi-siècle. Par des grèves, des manifestations, des campagnes de propagande, il est arrivé à certaines améliorations très appréciables sur les salaires, la durée du travail, la protection des travailleurs. Il a contraint, en beaucoup de pays, le législateur à s’intéresser aux questions ouvrières. Mais lorsqu’il se contente d’obtenir le vote d’une loi et ne bataille pas pour son application, celle-ci reste lettre morte. Le syndicalisme ne s’est pas contenté de grouper les travailleurs pour la lutte et les améliorations immédiates, il a dressé un programme de rénovation sociale, affirmant le droit des travailleurs à reprendre la richesse sociale et à organiser le travail, qui restera un des idéaux les plus vivants et les plus pratiques de réalisation de l’émancipation sociale.
Le syndicalisme est universel : il existe partout des syndicats ouvriers. Il est tantôt à caractère réformiste, modéré, cherchant à réaliser, petit à petit, des améliorations et tantôt d’esprit révolutionnaire, combatif et visant à la transformation du mode de production. Il est devenu une force sociale qui joue un grand rôle dans la société, et en jouera un plus conséquent encore lors des secousses révolutionnaires.
Plus pondéré et plus terne est le mouvement coopératif. Il a différentes formes : consommation, production, crédit. Son but immédiat est de défendre le consommateur écrasé par le commerce. Non seulement il combat le mercanti, mais tend à lui substituer ses magasins de répartition. De même que les coopératives de production tendent à remplacer le patronat.
Quoiqu’imprégné, en général, de la mentalité bourgeoise, le coopératisme sous toutes ses formes est en même temps qu’un moyen pratique et pacifique de défense actuelle, un effort positif d’administration autonome qui prépare des cadres pour une société transformée. Dans le monde, il y a des millions de coopérateurs et les opérations réalisées par leurs groupements se chiffrent par dizaines de milliards.
Le mutualisme est une autre forme du mouvement social, quoique effacé et timidement revendicatif ; très pénétré aussi de bourgeoisie, il réalise néanmoins un premier stade vers l’organisation de la solidarité sociale. Dans beaucoup de petites localités les travailleurs, n’osant former des syndicats, ni même de coopératives, ont constitué des sociétés mutualistes. Nous lui accordons peu d’attention et cependant ce mouvement est plus important que nous le pensons, et, animé d’un autre esprit, il pourrait rendre de grands services, et apporter sa part appréciable à l’établissement d’un contrat social. Le mutualisme a souvent été le premier pas vers le syndicalisme et la coopération.
Ces trois formes, syndicaliste, coopératiste et mutualiste, du mouvement que nous étudions, sont spécifiquement économiques. Elles représentent la figure d’ensemble actuelle d’un mouvement social qui va des associations de pur réformisme aux groupements d’opposition et de lutte anticapitaliste. Les influences religieuses en sont en généralement écartées ; parfois, elles sont combattues avec force. Ce qui domine, c’est un positivisme pratique et réalisateur.
La grande cause de faiblesse de ces divers groupements est que le plus grand nombre n’a pas encore su se libérer des croyances séculaires dans la hiérarchie. On y parle beaucoup d’égalité, mais les faits contredisent ces propos. L’esprit d’inégalité, de corporation, de privilège même entre ouvriers, persiste. De là des divisions, des haines, des jalousies réciproques. On continue à attendre les interventions d’en haut, on ne s’anime vraiment que pour se choisir des chefs chargés de suppléer aux activités défaillantes. Indifférence, expectative pleine d’apathie, soumission, crédulité, voilà qui caractérise la mentalité générale. Malgré qu’il soit beaucoup question de liberté, la réalité est toute imprégnée d’errements autoritaires. La forme théorique apparente de ces organismes est une large démocratie. Mais on s’aperçoit vite que presque partout on s’en remet à quelques individualités du soin de mener le bon combat et qu’elles exercent, de ce fait, une sorte de dictature. Nombre de ces associations sont la proie du régime personnel, que contrecarre à peine un contrôle illusoire et périodique.
Et lorsque ces groupements s’agglomèrent en fédération, organismes régionaux et nationaux on assiste au triomphe des méthodes de centralisations qui, dans tous les domaines, ont donné de si déplorables résultats. La grande plaie du mouvement social est de vouloir toujours calquer l’organisation politique des États, comme si les organismes de rébellion et d’affranchissement pouvaient avoir – utilement pour les masses – la même structure que les édifices de conservation et de privilèges et que les armes qui se sont révélées si aptes à maintenir les peuples dans l’esclavage pouvaient être aussi celles de leur libération.
On commande, alors qu’il faudrait enseigner. On impose, au lieu de convaincre. Et cet esprit d’initiative qu’il faudrait éveiller, les chefs s’emploient à l’étouffer, lorsqu’il se manifeste, de crainte de perdre leur prestige... Aussi, division, suspicions éparpillement des forces, affaiblissement de l’esprit de lutte, découragement, stagnation, voilà ce que rencontre sur sa route un mouvement social qui devrait être si puissant.
L’idéal qui apparait le plus capable de donner au mouvement social l’unité et l’ardeur qui lui manquent pour se lancer avec efficacité à l’assaut de la société bourgeoise, c’est l’idéal libertaire. Celui-ci fait appel à la recherche et à l’activité de tous et de chacun ; il fait table rase des sentiments de hiérarchie ; il n’accepte aucune direction tyrannique : il ne retient que l’autorité morale du talent, de la compétence technique ou générale, du dévouement éclairé. Il demande à chacun de s’occuper personnellement des questions qui l’intéressent ; il s’efforce de secouer cette paresse individuelle qui conduit aux délégations d’abandon. D’autre part, plus profondément que toute autre, la philosophie libertaire vise à débarrasser le mouvement social des attaches et des préjugés qui le paralysent.
Ne voulant imposer sa dictature à personne, mais laisser au contraire à chaque groupement toute son autonomie, afin qu’il réalise la part d’émancipation sociale qui lui incombe, l’idéal libertaire représente la synthèse morale des différents courants du mouvement social, susceptibles d’élever l’humanité marchant vers une liberté, une égalité et une justice effectives.
– Georges BASTIEN.
MOYEN AGE
On appelle moyen âge la période des temps dits « historiques » de l’humanité qui s’est écoulée entre l’antiquité et la Renaissance, commencement des temps modernes. Cette division des temps est particulière à l’Europe occidentale ; l’Orient ne la connaît pas ou ne l’a pas adoptée.
Les historiens font généralement commencer le moyen âge à l’an 395, date du partage de l’empire romain entre les fils de Théodose, et le font finir en 1453, l’an de la prise de Constantinople par les Turcs. Cette délimitation du moyen âge par deux dates est absolument arbitraire, comme le sont le plus souvent les précisions de ce genre. Elles sont un moyen mnémonique commode pour conserver le souvenir des événements, mais elles ont le grave défaut, comme c’est le cas ici, de laisser ignorer sinon de fausser le véritable caractère de ces événements en faisant croire qu’ils ont été spontanés, sans relations antérieures alors qu’ils ont eu au contraire des causes lointaines, profondes, auxquelles ils ont été étroitement liés.
Les temps historiques sont ceux sur lesquels on possède des documents suffisants pour établir, avec plus ou moins d’exactitude, mais d’une façon continue l’histoire de l’humanité. C’est dire que les commencements de ces temps reculent de plus en plus dans le lointain passé appelé préhistoire (voir ce mot) à mesure que de nouveaux documents toujours plus anciens sont découverts. Pendant longtemps on n’a vu l’origine des temps historiques que d’après la Bible et l’histoire du peuple Hébreu qu’elle raconte. Les découvertes de documents beaucoup plus anciens, dont la Bible a été tirée en grande partie, on démontré qu’avant les Hébreux d’autres peuples, autrement grands et puissants, s’étaient manifestés et avaient préparé cette civilisation dont ils avaient recueilli les fruits. Les connaissances actuelles font remonter, d’après de Morgan « la première œuvre historique à 10 000 ans environ ». On ne peut dire si les trouvailles incessantes de l’archéologie ne feront pas reculer encore cette origine à de nombreux siècles en arrière.
L’antiquité, première période de l’histoire, a vu la formation, l’apogée et l’effondrement, parallèles ou successifs, des grands empires des régions orientales d’où sont sortis, puisés aux sources iraniennes des temps mythiques, les éléments de notre civilisation. Celui des Elamites, considérable il y a quarante siècles, a été célébré par la légende de Gigalmès. Sa capitale était Suse et sa domination s’étendait jusqu’aux bords méditerranéens. Les Assyriens lui disputèrent pendant quinze siècles la souveraineté sur les pays de la Mésopotamie. Suse fut pillée par Assurbanipal 650 ans avant J.-C. En face de l’empire assyrien et de sa plus célèbre capitale, Ninive, était le royaume de Babylone, dont les documents archéologiques constatent l’existence 4 000 ans avant J.-C. et les empires des Mèdes et des Perses. Pendant cinquante siècles, les races se combattirent et se mélèrent dans les pays d’Iranie, avant qu’elles fussent en rapport avec l’Occident et que, de celle communication, l’antiquité produisit, en Grèce, la plus admirable floraison de pensée et d’art que l’humanité eût connue. Il y avait eu des contacts divers par des expéditions guerrières et les déplacements de tribus nomades, mais la rencontre historique, celle qui détermina le courant des relations et des influences ininterrompues depuis, se fit lorsque Alexandre le Grand, entreprenant la conquête de l’Asie, alla jusqu’à l’Indus après avoir dépassé les pays de l’Iranie orientale, la Bactriane et l’Arachosie. D’autres expéditions d’Alexandre mirent l’Occident en contact avec l’Égypte qui était depuis longtemps en relation avec la Chaldée.
L’unité de la pensée humaine, transmise par les vieilles civilisations orientales à l’Occident, est manifeste (voir Littérature). Elle a été une fois de plus démontrée dans les ouvrages de M. Victor Bérard resumés dans sa Résurrection d’Homère, récemment publiée. Aussi, est-ce dans la rencontre, et dans la compénétration qui s’ensuivit, des civilisations orientale s avec l’Occident qu’on devait voir les commencements du moyen âge occidental, plutôt que dans ma victoire – qui n’en est qu’une conséquence bien secondaire quoique des plus néfastes pour ceux qui l’ont subie et la subissent encore – des imposteurs du christianisme sur le vieux monde païen. Le christianisme n’a tant d’importance pour nous que parce qu’il se manifeste encore dans la période très relative du temps où nous vivons. Combien de religions, différentes dans les apparences, mais semblables dans le fond, avaient avant lui installé leurs frelons dans la ruche humaine sans réussir à arrêter le véritable travail de la pensée et de l a connaissance ! Dans quelques centaines d’années, la religion judéo-grecque, qui porte le nom du Christ comme celles qu’elle a remplacées portaient ceux de Mithra, de Jupiter etc., sera aussi oubliée qu’elles, et les charlatans qui courbent encore de nos jours des millions de têtes sous leur signe de la croix ne compteront pas plus, dans la mémoire des hommes, que leurs ancêtres, les prêtres de Cybèle qui dansaient dans les rues de Rome en l’honneur de cette déesse, ou que les sorciers du centre africain qui vantent la puissance mystérieuse de leurs gri-gris. Le véritable moyen âge devrait être considéré avec une portée plus haute l’étendant à une humanité plus vaste que celle parcellaire de l’Europe, et à un temps moins conventionnellement délimité, car on devrait enfin tenir compte que l’Europe n’est pas le monde entier malgré sa mégalomanie impérialiste, et que les trois quarts des hommes se sont toujours passés du christianisme malgré tout ce qu’on a fait pour le leur imposer par le feu et par le sang. Pour nous, qui ne voulons tenir compte que des grands courants humains, le moyen âge a commencé aux temps homérides qui ont vu la première manifestation en Occident, des idées dont il ferait sa civilisation et qui l’uniraient spirituellement avec l’Orient. Nous le voyons se prolonger dans notre temps, et plus loin dans l’avenir tant que la raison humaine ne se sera pas libérée de toutes les superstitions qui perpétuent l’esclavage de l’homme et retardent l’avènement des temps nouveaux.
Lorsqu’on limite le moyen âge entre ces deux dates, ou d’autres qui n’ont pas plus de raisons d’être choisies : 395, partage de l’empire romain – 1453, chute de l’empire d’Orient, on le renferme entre deux murs, on l’isole comme s’il n’avait pas eu de communication avec les temps qui l’ont précédé et suivi, comme s’il avait été le produit d’une génération spontanée que rien ne faisait prévoir, et comme s’il avait été arrêté brusquement pour s’évanouir dans le passé en ne laissant aucune trace. De telles précisions de dates historiques sont incompatibles avec les faits sociaux qui ont eu, au contraire, entre-eux, de très étroites et très complexes relations, ayant été à la fois, dans leur succession, des effets de causes précédentes et des causes d’effets ‘subséquents. Tel événement qui parait avoir été subit, auquel personne ne semblait s’attendre, a eu parfois des siècles de préparation. La relation entre les événements sociaux est aussi étroite qu’entre les phénomènes naturels.
Il y a plus d’apparence d’exactitude chez ceux qui font coïncider le commencement du moyen âge avec celui de l’ère chrétienne. Mais ils ne tiennent pas compte que le début de ce qu’on appelle « l’ère chrétienne » a été tout aussi arbitrairement fixé, pour des raisons politiques étrangères à l’évolution sociale dont le christianisme n’a été que le résultat, et qui l’ont fait attribuer à la révélation d’un homme et d’une vérité qu’on ne soupçonnait pas.
Si, comme on le prétend aujourd’hui, le christianisme a eu une telle importance que son avènement a changé la face du monde et a inauguré une autre époque de l’histoire de l’humanité, pourquoi n’a-t-on pas fait commencer l’ère chrétienne, et avec elle le moyen âge, au moment où le christianisme est devenu religion officielle à la place du paganisme ? C’est que l’événement ne présentait pas alors l’importance et n’avait pas surtout cette netteté qu’on lui a donnée depuis en en faisant une cause alors qu’il n’était qu’un effet. Le christianisme n’était pas du tout une révélation nouvelle apportée par un homme-dieu venu sur la terre à un moment donné ; il était l’écho de multitudes de voix venues de tous les côtés depuis des siècles, il était la nouvelle forme de l’aspiration fraternitaire des hommes que le paganisme avait déçus, il était né de ce paganisme dont il avait reçu la substance foncière, substance qu’il dénaturerait lui aussi par ses dogmes pour tromper à son tour l’humanité. Ce ne fut qu’en composant longtemps avec la vieille religion que le christianisme put lui être substitué, et il ne put se maintenir sans continuer à s’en assimiler les moyens, c’est-à-dire en se faisant païen quand le paganisme refusait de se faire chrétien. Il en fut tellement ainsi que, malgré toutes les victoires du christianisme, lorsqu’il s’agit de fixer le commencement de l’ère chrétienne, ce fut celle païenne d’Auguste qui fut proposée à plusieurs reprises et définitivement adoptée en l’an 800 par Charlemagne. On a voulu justifier ce choix en faisant coïncider l’époque présumée de la naissance du Christ avec le début de l’ère d’Auguste. En fait, il n’y eut là qu’une adaptation au paganisme montrant que le personnage du Christ n’était qu’une nouvelle incarnation du mythe solaire auquel appartenaient déjà Osiris, Mithra, Jupiter, Bouddha, et une foule d’autres. Tous les noms des mois sont demeurés ceux du calendrier d’Auguste. Plusieurs célèbrent des dieux ou de grands personnages : Janvier (Janus), Mars (le dieu de ce nom), Mai (Maïa-nus-Jupiter), Juin (Junius-Junon), Août (particulièrement le mois d’Auguste). L’imitation servile fut continuée et poussée si loin que, contre toute logique, september, october, november et décember qui désignaient normalement les septième, huitième, neuvième et dixième mois dans le calendrier romain, ne furent pas changés et demeurèrent les noms des quatre derniers mois, bien que leur nombre fut porté à douze, dans le calendrier grégorien composé en 1582.
Bien avant qu’il prît un caractère de secte de plus en plus particulier, d’abord chez les juifs, puis en se dégageant d’eux pour faire une religion nouvelle, le christianisme avait eu une longue préparation dans l’antiquité, il était dans l’esprit de révolte universel avant que la mystique juive lui donnât la forme messianique et que l’imposture religieuse s’en servit pour en faire un nouveau moyen de domination. C’est parce que le christianisme promettait la justice sociale que les foules plébéiennes et esclaves vinrent à lui. Il les déçut encore plus que les autres religions. Le prêtre chrétien remplaça ceux du paganisme et rien ne fut changé. Lorsque, en 325, soixante-dix ans avant la date officielle de la chute de l’empire romain, le concile de Nicée se réunit et formula les principes politiques qui seraient ceux de l’Église catholique, le nouveau programme d’asservissement humain fut établi. Les dieux païens pouvaient disparaitre, l’empire pouvait crouler dans le sanglant crépuscule de l’antiquité : tout se préparait pour maintenir les hommes dans la géhenne sociale et perpétuer leur exploitation au profit de nouveaux maitres, sous de nouvelles formes d’autorité. Au nom d’un Christ venu « pour les sauver !... » ce serait l’Église, puissance à la fois spirituelle et temporelle, ce serait la Féodalité, ce serait la Royauté qui détermineraient ces formes, en attendant que les temps modernes apportassent celles fallacieusement appelées « démocratiques » dans lesquelles la blagologie des anciens esclaves devenus les maîtres est aussi malfaisante que l’imposture religieuse. « Les droits aux grands, les devoirs aux petits » (J, Andrieu), voilà la formule que prononça dans des termes moins nets, mais suffisamment démontrée par les faits, le concile de Nicée, comme l’avaient déclaré tous les autocrates et théocrates passés, comme le déclareraient tous les autocrates et théocrates futurs. Les démocrates changeraient la formule mais laisseraient subsister les actes.
Le christianisme, sur lequel il y a lieu d’insister, parce qu’il est considéré par les historiens comme la pierre d’angle de la nouvelle formation sociale succédant au paganisme et à l’empire romain, ne fut donc pas une création spontanée et n’eut pas, dans les premiers siècles, l’importance que lui ont attribuée des légendes aussi fausses que nombreuses. La chute de l’empire romain ne fut pas davantage un événement imprévu et subit. Au contraire. Lorsqu’elle fut enregistrée historiquement, il y avait déjà longtemps qu’elle était accomplie, et elle avait été l’œuvre de plusieurs siècles. Tous les événements qui caractérisent le moyen âge ne furent que le résultat de longues élaborations qui ne paraissent mystérieuses que parce qu’on ne les a pas suffisamment étudiées. Les historiens ont néglige généralement la recherche des causes profondes et lointaines des événements qu’ils ont racontés pour s’en tenir aux faits superficiels. Renfermés dans un esprit étroit de classification chronologique, et n’ayant surtout que le désir de flatter les puissants du jour en célébrant ceux du passé, ils ont fait des deus ex machina de personnages qui n’étaient que des minus-habens soumis à toutes les contingences. Les notions historiques ont été ainsi complètement faussées et l’histoire est devenue du plutarquisme. (Voir ce mot). Elle a été réduite aux faits et gestes des rois et de leurs satellites. Pour M. Maurras, par exemple, l’histoire des « quarante rois qui ont fait la France » est toute celle du pays. En raison du même principe, l’histoire a particulièrement négligé les quatre premiers siècles de l’ère chrétienne et l’enchevêtrement si complexe de leurs évènements, pour ne mettre en évidence que quelques dates et quelques faits favorables surtout à l’Église. Elle ne s’est presque pas occupée entre-autres de la lutte engagée entre Rome et les barbares dès le temps d’Auguste. Ces barbares furent, bien autrement que le christianisme, les instruments de la fin de l’empire. Le christianisme n’arriva que pour parachever leur œuvre en tuant l’esprit là où ils n’avaient que bouleversé les institutions.
Nous ne pouvons écrire ici une histoire de cette période de quinze siècles, si particulièrement agitée, qu’on appelle le moyen âge. Elle a, dans la formation du monde occidental européen, la même importance que les bouleversements géologiques dans celle des continents. Nous indiquerons seulement ses faits principaux pour donner une idée de son caractère général.
L’événement principal du moyen âge fut dans les invasions des Barbares, nom qu’on donna aux nombreux peuples étrangers qui se répandirent dans l’empire romain et multiplièrent leurs incursions pendant près de dix siècles. Ces invasions furent le facteur principal de la chute de l’empire. On leur doit le développement du christianisme qui, très probablement, n’aurait jamais existé si l’empire était demeuré puissant. De l’état social nouveau qu’elles amenèrent sortirent la Féodalité et la Royauté comme puissances dominantes, les Communes comme centres de résistance de l’esprit de liberté.
La décadence et l’agonie de l’empire furent longues ; elles durèrent plus de cinq cents ans, paraissant parfois arrêter leur marche dans des périodes si brillantes qu’elles furent celles de la plus grande puissance romaine. Mais le colosse tremblait sur des pieds d’argile, le ver était dans le cœur de l’arbre. Le cœur de l’arbre était la liberté. Le ver était le despotisme avec tous ses abus d’autant plus dangereux qu’ils affectaient des formes démocratiques. Lorsque le ver eut complètement rongé le cœur, l’arbre s’écroula. La victoire des Barbares, puis de l’Église dont ils se firent les dociles instruments, fut alors facile.
La véritable force de Rome, celle d’où elle tira tout ce qu’elle eut de réellement grand fut dans l’organisation de la République et la liberté de ses citoyens. Cette force lui avait permis de résister à toute l’Italie, puis de vaincre Carthage et de se soumettre à la Grèce. Elle commença à se désagréger dans les conséquences des guerres qui aggravèrent la différence des situations entre nobles et prolétaires. Des luttes intérieures favorisèrent de plus en plus les entreprises dictatoriales des consuls et Octave accomplit sous le nom d’Auguste ce que le poignard de Brutus n’avait pas laissé le temps à Jules César de réaliser : l’établissement de l’empire. Dès ce moment, la liberté romaine qui agonisait depuis César, fut morte. Le Sénat fut soumis à l’empereur. Le citoyen, qui n’avait été soldat qu’aux moments de la défense de la patrie pour reprendre ensuite la charrue ou le marteau, fut remplacé par l’armée permanente des légions de mercenaires qui mirent l’empire à l’encan pour augmenter leur solde (donativum) et furent prêtes à servir toutes les entreprises des prétoriens pour ou contre Rome. Le citoyen, laboureur et ouvrier, devint l’esclave écrasé d’impôts. La corruption se développa avec la puissance militaire et aventurière. Les temps d’Auguste, célèbrés par le plutarquisme, donnèrent, sous leurs apparences glorieuses, le signal des turpitudes où s’enfoncèrent de plus en plus les sanglants histrions devenus maîtres de l’empire et dont on ne peut dégager que quelques belles figures d’hommes : Marc Aurèle, disciple d’Epictète, Julien, Majorien. Ceux-ci n’étaient pas à leur place en étant au pouvoir et ils semblent n’y avoir été mis que pour « empêcher la prescription contre la vertu ». (J. Andrieu.) L’empire n’était plus qu’un immense et somptueux décor de théâtre ; il éblouissait le monde, mais ses constructions s’effondreraient lorsqu’il serait attaqué sérieusement. Néron mourant disait que le monde perdait en lui un grand artiste !... Le dernier qui donna à Rome cette gloire théâtrale, Dioclétien, qui se faisait appeler Jupiter, enterra définitivement les restes de la République sous les pompes asiatiques de son pouvoir absolu. Le partage qu’en 395 Théodose fit de l’empire entre ses deux fils consacra un état d’épuisement auquel les Barbares portèrent les coups suprêmes. Ils donnèrent à Rome ses derniers empereurs et signèrent sa mort officielle en déposant, en 475, cet Augustule qui en clôtura définitivement la série.
Déjà, dans les années 102 et 101 avant J.-C., les Cimbres et les Teutons ayant envahi la Gaule et l’ayant traversée, avaient été une menace pour Rome. Ils avaient été arrêtés par les légions de Marius à Pourrières et à Verceil. Leur invasion avait été le premier débordement sur les territoires romains du flot des populations que poussaient vers l’Occident, depuis plusieurs siècles, la terrifiante émigration des Huns descendus du désert du Kobi. Ils avaient rejeté devant eux les Vandales et les Germains qui s’étaient répandus dans le Nord européen. La pression de cette émigration devenant plus forte, les invasions furent plus fréquentes et plus impétueuses. Au IVème siècle, le gouvernement de Constance Chlore dut soutenir l’assaut, en Gaule, des Alamans. Une nouvelle expédition du même peuple fut arrêtée par Julien à la bataille de Strasbourg. Mais il ne fut bientôt plus possible de résister. La Gaule vit s’installer chez elle les Franks qu’elle avait déjà subis comme mercenaires au service de Dioclétien et de Julien. Dès le milieu du Vème siècle, ils avaient cinq établissements sur son territoire. La Gaule fut ravagée par les peuples qui la traversèrent pour aller en Espagne, les Suèves, les Vandales, les Alains (405–406). Les Burgondes s’établirent entre la Saône et le Jura pendant que les Wisigoths, descendant vers les Pyrénées, devinrent maîtres du sud-ouest et passèrent en Espagne où ils refoulèrent les Vandales. Ceux-ci allèrent dans l’Afrique du Nord fonder une nouvelle Carthage.
Dans le Vème siècle, Rome fut prise cinq fois et fut plus ou moins détruite par les Wisigoths, les Vandales, les Hérules, les Ostrogoths et les Suèves dont les invasions se succédèrent. L’Église, qui avait favorisé ces invasions et s’établissait peu à peu sur les ruines de l’empire, obtint d’Attila que les Huns respectassent la ville. Les Huns, arrivés les derniers dans la Gaule, ne purent s’y faire leur place. Ils furent battus dans les Champs Catalauniques, près de Châlons, et quittèrent le pays. La Gaule vit encore venir, par la Loire, les Saxons qu’elle refoula. Ils s’établirent en Grande-Bretagne avec les Angles qui donnèrent au pays le nom d’Angleterre. Au VIème siècle, les Avares furent arrêtés en Gaule par les Austrasiens, et les Lombards par les Burgondes. Les invasions cessèrent en Gaule jusqu’au VIIIème siècle où les Arabes, venus par l’Espagne, furent vaincus par Charles Martel à Poitiers. Les Normands s’installèrent en Normandie au IXème siècle et firent ensuite la conquête de l’Angleterre au XIème siècle.
Les Barbares s’étaient répandus et établis dans l’Europe entière et dans l’Afrique du Nord. Leur mélange avec les populations allogènes fit des peuples nouveaux chez qui les caractéristiques des races primitives se fondirent de plus en plus, et produisit une civilisation nouvelle dont la formation fut plus ou moins précoce et rapide, suivant que la paix le permit. Les Barbares avaient généralement les qualités et les défauts des peuples primitifs et, sauf les Arabes, ils n’avaient apporté aucune forme de civilisation ; au contraire. Bien que venus de l’Orient, ils ne furent nullement les messagers de sa lumière – ce rôle glorieux fut dévolu aux Arabes ; – ils ne la perçurent et ne la sentirent que plus tard, lorsque leur assimilation aux peuples conquis les eut assagis et leur eut fait prendre contact avec cette générosité de pensée et ce sentiment de la beauté répandus dans le monde antique par la Grèce, après les avoir reçus elle-même de l’Asie. Les Barbares furent surtout des vainqueurs préoccupés d’affermir leur domination. Ces hommes de la nature d’une rusticité primitive et à la fois candides et féroces, se corrompirent vite dans la corruption de l’empire continuée par celle de l’Église. Leur défaut de culture intellectuelle était trop conforme aux intérêts de cette dernière pour qu’elle ne se servît pas habilement d’eux. Après avoir appelé elle-même leurs invasions contre l’empire, elle leur donna l’absolution de leurs turpitudes. Ils ne se firent que mieux ses complices. C’est grâce a elle que, durant le moyen âge, puis dans les temps modernes :
« Le crime heureux fut juste et cessa d’être crime » comme dans l’antiquité. Ses prêtres ayant accepté de donner à Constantin l’absolution refusée par les prêtres païens, il se fit baptiser et fut ainsi le premier empereur chrétien. L’Église, cynique, en fit de plus un saint ! Dans les mêmes conditions, elle a absous aussi Clovis et sa femme Clotilde – faisant de celle-ci une de ses saintes les plus honorées – malgré les crimes de ce couple d’aventuriers barbares ; mais ils avaient accepté le baptême et elle les avait sacrés rois de France. Elle devait ainsi absoudre tous les criminels, pourvu qu’ils fussent puissants et la fissent participer aux avantages de leur puissance. « Protectrice des faibles », elle fut toujours avec les forts si méprisables fussent-ils. Elle justifia l’esclavage et le servage, la guerre et le pillage, pourvu qu’elle y eût sa part, celle du lion le plus souvent. En échange de cette part, elle disait : « Dieu permet aux rois de tuer ceux qui refusent de payer l’impôt », et les rois lui laissaient poursuivre les hérétiques et les tuaient pour elle. Elle associa ainsi, pour les siècles à venir, la fourberie du spirituel à la violence du temporel, l’imposture de sa cléricature à l’iniquité des laïques indignes. La croix s’allia au sabre au nom de cette morale exécrable qui justifie le « crime heureux » et qui demeurera celle de tous les gouvernements, tant qu’ils ne seront que des moyens d’exploitation humaine.
On comprend comment, grâce aux Barbares et à l’Église, le moyen âge a été « l’époque la plus triste de l’humanité » (J. Andrieu), et quelle lutte incessante, désespérée, l’idée de liberté demeurée au cœur des hommes asservis, l’esprit de civilisation enseveli sous les ruines du monde antique sauvagement amoncelées, le sens de l’éternelle beauté de la vie en renouvellement perpétuel, la soif de science, de progrès et de bonheur, durent soutenir contre le pacte d’ignorantisme, de fanatisme, d’asservissement et de mort formé par ces puissances. Ce n’est pas que l’Église et les grands furent toujours d’accord ; ils se firent au contraire une guerre féroce. Ils ensanglantèrent le monde de leurs querelles pendant quinze siècles, mais ils finirent toujours par s’entendre sur le dos des peuples, payant de leur liberté et de leur vie le lourd tribu des famines, des épidémies, des combats, des conquêtes et des annexions de territoires.
Ce qui fit la puissance de l’Église fut son adaptation à l’organisation hiérarchique qui avait permis à l’empire romain de dominer le monde. Elle en imposa le respect et en donna l’exemple aux envahisseurs tumultueux. De là naquit la féodalité à laquelle furent soumis suivant un code dit « de l’honneur », pour ne pas dire de la fourberie, et « de la chevalerie », pour ne pas dire de la force, tous les organismes sociaux et tous les individus. Mélange étrange de barbarie et de civilisation ; les mœurs d’honneur et de chevalerie s’inspirèrent de la double attitude de l’Église, impitoyable à la faiblesse, conciliante et rampante devant la force, mais toujours avec l’hypocrite souci de paraître respecter la justice et la morale. Ainsi, pour ne pas déclarer brutalement que le droit n’était que la force, on institua le duel judiciaire et les serfs purent même y recourir contre les seigneurs. Mais de quelle façon ? Pendant que le noble, bardé de fer, avait pour se défendre son épée ou sa lance, le serf, à moitié nu, n’avait que son bâton pour l’attaquer ! Le duel judiciaire a disparu, mais le même principe ne subsiste-t-il pas, au nom de cette fallacieuse liberté du travail qui livre, dans les conflits actuels, les prolétaires affamés aux manœuvres du patronat caparaçonné dans ses coffres-forts ?...
À partir du VIème siècle, le régime féodal s’organisa en faveur des amis de l’Église et dans des formes de plus en plus légalisées pour rendre définitive et héréditaire la possession des fiefs qui n’était que précaire. La hiérarchie aristocratique s’établit en même temps, suivant le degré de puissance de chacun des spoliateurs du sol. Ils furent plus ou moins nobles d’après l’importance de leur fief et de leur état particulier de vasselage. En haut fut le roi dont l’autorité fut souvent discutée par ses grands vassaux ; en bas fut le peuple conquis, ne possédant rien. Après avoir été dépouillé par les Romains qui en avaient fait des esclaves attachés aux maitres, il le fut par la féodalité qui en fit des serfs attachés à la glèbe. Le servage fut réglementé comme la hiérarchie seigneuriale par la coutume féodale. Montesquieu a constaté qu’au VIIème siècle, tous les laboureurs et presque tous les habitants des villes se trouvèrent serfs Des lois féroces leur étaient appliquées. On arrachait les yeux à celui qui avait brûlé quelque chose appartenant à l’Église. Des esclaves existaient encore qui n’appartenaient pas à la glèbe et se vendaient par l’entremise des juifs. On coupait la main droite à celui qui aidait un esclave dans sa fuite. On punissait de mort le serf et la femme libre qui s’aimaient. L’Église n’était pas la moins inflexible dans cette défense de la propriété des hommes. Lors de la Révolution Française, c’est sur ses terres, dans le Jura, que se trouvèrent les derniers serfs.
La puissance féodale et celle de l’Église grandirent pour atteindre toutes deux leur apogée entre les Xème et XIIème siècles. À cette époque, soutenue par les sergents qui la redoutaient, l’Église faisait et défaisait les royautés à son gré. Elle plaçait ses créatures sur les trônes, excommuniait les rois rebelles, imposait au plus grand empereur de toute l’Europe, Henri IV d’Allemagne, l’humiliation de Canossa et commandait dans toute la chrétienté les entreprises de brigandage qu’on a appelées les croisades. Mais la puissance royale grandit et, à côté d’elle, celle des Communes, pour amener un affaiblissement parallèle de la féodalité et de l’Église. Michelet a remarquablement mis en lumière la « révolution économique » du XIVème siècle qui amena ces événements. Le fait économique domina le fait militaire par le développement du commerce et de l’industrie. Les financiers et les légistes serrèrent de plus en plus à la gorge l’orgueilleuse chevalerie, pendant que des brasseurs et des marchands de drap la battaient à plate couture à Crécy, à Poitiers, à Azincourt. L’Église subit cruellement le contre-coup de la déchéance féodale. Dès le commencement du XIVème siècle, Philippe-le-Bel avait vengé les rois de l’humiliation de Canossa et imposé aux papes le séjour d’Avignon. Le grand schisme qui sépara l’Église d’Orient de celle de l’Occident fut un nouveau coup porté à la papauté romaine et à ses prétentions à la domination universelle, au moins spirituelle si elle ne pouvait être temporelle. Mais toujours habile, l’Église arriverait à s’entendre avec les rois sur le dos des peuples, tandis que la féodalité s’effondrerait de plus en plus devant le pouvoir royal grandissant. Ses châteaux-forts démolis par le canon, ses lances et ses cuirasses impuissantes contre les flèches et les arquebusades, son oisiveté parasitaire appauvrie à côté de l’enrichissement d’une bourgeoisie laborieuse et active qui se formait dans les communes, son mépris orgueilleux du savoir l’isolant du progrès intellectuel, tout cela la rendant archaïque et de plus en plus impuissante, la réduirait à déposer sa chevalerie aux antiquailles. Le loup féodal deviendrait le chien courtisan ; il apprendrait l’étiquette de cour à l’école des mignons d’Henri III, et se changerait en quémandeur, en flagorneur, en plat valet pour encombrer les antichambres du Louvre, puis de Versailles.
Politiquement, le moyen âge ne fut qu’une longue période de crimes où l’Église, puissance spirituelle et temporelle à la fois, eut la plus grande part. L’histoire des rois, des empereurs, des papes, les annales de la féodalité et de la religion, ne sont qu’une longue énumération d’infamies de tous genres : meurtres, rapts, viols, adultères, confiscations, simonies, exactions de toutes sortes. Comme les empereurs romains, rois et papes n’arrivèrent au pouvoir qu’au moyen du fer ou du poison. Sous prétexte de réprimer l’hérésie, de « délivrer le tombeau du Christ », dont l’emplacement s’était perdu depuis longtemps s’il avait jamais existé, mais en réalité pour massacrer et pour piller, rois et papes s’entendirent pour organiser la croisade des Albigeois, puis celles de Terre Sainte, et pour faire des procès comme celui des Templiers, dont les richesses avalent excité la convoitise du roi Philippe-le-Bel et du pape Clément V.
Ce qui est plus intéressant à étudier que les démêlés entre les malfaiteurs couronnés, casqués et mitrés qui sévirent contre les peuples avec une rigueur encore plus terrible que la peste et les famines périodiques, c’est l’effort persévérant de ces peuples dans les voies du progrès humain, pour l’organisation du travail dans les corporations de métiers et celle de la vie sociale bourgeoise et artisane, pour la recherche scientifique impatiente à se dégager de l’obscurité où l’Église la tenait systématiquement ; c’est la lutte fiévreuse et ardente pour la vérité comme pour la liberté, et c’est l’éclatement d’une sève populaire nouvelle traduisant dans les arts et la littérature une pensée collective qu’on ne retrouve plus dans les temps modernes. (Voir Art et Littérature). Contre les violences des envahisseurs, contre la puissance féodale et contre l’obscurantisme de l’Église, l’esprit de libre pensée et de liberté populaire ne cessa de lutter, particulièrement dans la Gaule qui devint la France.
Il est d’usage, dans l’histoire officielle, parce que son rôle est, non de montrer la vérité sur les événements et leurs conséquences, mais de justifier les faits accomplis, si exécrables qu’ils eussent été, de considérer comme un triple bienfait pour la Gaule la conquête romaine, puis l’établissement des Franks et celui du christianisme. Non. Ils furent plutôt des calamités. On ne peut savoir ce qui serait arrivé si ces trois fléaux ne s’étaient pas abattus sur la Gaule pour la livrer à des rois qui en feraient « la France fille aînée de l’Église », mais on peut présumer qu’elle aurait eu un plus remarquable destin. Avant la conquête romaine, la Gaule était occupée par une population formée d’Ibères et de Celtes auxquels se mêlèrent, quelques siècles après, différents peuples Kymris (Edues, Arvernes, Bituriges, Aulerces, Carnutes, etc...) et autres tels que les Bolgs, ou Belges, venus d’Irlande, et des Helvètes. Or, il est tout à fail inexact que cette population était barbare et que les légions de Jules César – qui ne s’établirent d’ailleurs que sur une faible partie de leur territoire – lui apportèrent la civilisation. Elle avait fondé des villes qui étaient des cités libres et non des camps militaires à la romaine. La résistance opiniâtre que César rencontra devant Bourges et Alésia montra leur organisation puissante. La plus célèbre parmi celles qui demeurent encore, Paris, fut établie par les Bolgs de la tribu des Parisii qui lui donnèrent leur nom. Les Celtes étaient les Grecs du Nord par le génie de leur langue demeurée dans le français, et par leur culture intellectuelle. Le druidisme apporté par les Kymris était grec par son rite. Au Vème siècle, lorsque le breton Pelasge, dans ses controverses avec l’africain Augustin, défendait le libre arbitre contre la tyrannie de la grâce et raillait le dogme du péché originel, il soutenait sans le savoir les mêmes « hérésies » que les Pères grecs avaient opposées aux fondateurs de l’Église romaine. Tout ce qui constitue le véritable caractère français lui est venu de ces peuples qui furent les Gaulois et dont les qualités l’ont fait plus proche parent du grec que du latin. Contrairement aux Romains, les Celtes mettaient les penseurs et les poètes au-dessus des gens de guerre. Leur littérature est celle qui a eu la plus universelle influence avec celle des Grecs. Elle a inspiré et rempli le moyen âge comme la littérature grecque à inspire et rempli l’antiquité. Les temps modernes, dans leur asservissement « classique », eurent le tort de la mépriser. Après la Grèce, ce fut la Gaule qui fournit à l’empire romain ses hommes les plus remarquables. On peut dire que la Gaule domina Rome.
« Au premier siècle de l’empire, la Gaule avait fait des empereurs, au second elle avait fait des empereurs gaulois, au troisième elle essaya de se séparer de l’empire qui s’écroulait. » (J. Andrieu.)
Les barbares et le christianisme l’arrêtèrent dans cette œuvre. Les rapports des Gaulois et des Grecs, commencés par l’installation toute pacifique des colonies helléniques sur le littoral méditerranéen, démontraient entre eux de véritables affinités. Les Grecs n’eurent pas besoin des armes pour s’établir dans la Gaule. Ils y furent accueillis et non subis comme les Romains. Si Grecs et Gaulois avaient été en état, militairement, de résister à Rome et d’opposer aux Barbares une forte civilisation gréco-celtique, combien le progrès humain aurait pu être plus vaste et plus fécond ! Le christianisme, probablement tué dans l’œuf, n’aurait pas produit l’Église, et peut-être n’aurait-on pas vu la terreur féodale, l’absolutisme autocratique et le fanatisme religieux.
C’est le vieil esprit celtique, demeuré comme le sel de la terre gauloise, qui a animé de son souffle les grands mouvements populaires qu’on a vus en France, des Bagaudes soulevés si souvent au cours de trois siècles contre les exactions romaines, des Jacques, des Pastoureaux, des Tuchins en révolte contre la féodalité, des communiers qui, dès le Xème siècle, fondèrent leurs cités libres, portèrent les plus rudes coups aux féodaux et les atteignirent dans leur principe en attendant qu’ils fussent vaincus dans la guerre. Ces communiers rédigèrent les cahiers déjà républicains des États généraux de 1356 et firent avec les Cabochiens et les Maillotins, avec Etienne Marcel, la première révolution parisienne. Ils dressèrent les beffrois en face des châteaux-forts et des églises, ils soutinrent tous ceux qui introduisirent et entretinrent l’esprit de libre examen dans l’Université, éveillèrent les hérésies contre le joug catholique de plus en plus pesant, défendirent farouchement le pays d’Oc contre les « barbares du Nord » (Stendhal) déchaînés dans la croisade des Albigeois. Tous ceux-là, qui furent des révoltés pour la défense de la liberté pendant le moyen âge, sont les ancêtres directs et les inspirateurs des Réformés, des Camisards, des hommes de 1789, des sans-culottes de 1793, et de tous ceux qui firent les barricades de 1830, de 1818 et de 1871. C’est la vieille Gaule celtique qui s’est levée en 1791 à l’appel de la Révolution en danger comme elle s’était levée pur défendre le Tractus armoricanus, son territoire indépendant, contre les légions de Jules César, comme elle s’était levée pour chasser l’Anglais à la voix de Jeanne d’Arc. C’est l’esprit de cette vieille Gaule qui a produit la magnifique littérature française du moyen âge. Passant de Pelasge aux hérétiques de la première Université, à Abeilard, aux savants de l’École de Chartres, à Oresme, à tous les universitaires qui se rallièrent à l’occanisme, il s’est transmis par Montaigne, La Boétie, Bonaventure des Périers, Rabelais, à La Fontaine et à Molière, puis à Voltaire et aux Encyclopédistes pour aboutir à Michelet, à Quinet, à P. L. Courier, à Proudhon, à Renan, à Anatole France. Cet esprit que quinze siècles de tortures barbares et chrétiennes n’avaient pu écraser, retrouverait sa parenté et respirerait un air plus libre lorsque la Renaissance le remettrait en contact avec Homère, Socrate et Platon, c’est-à-dire avec la pensée universelle, Désormais, il ne pourrait plus être étouffé.
Nous n’avons pu présenter dans tous leurs détails le travail de la pensée et la lutte laborieuse et persévérante de l’esprit de liberté qui se poursuivirent dans l’Occident soumis, dès sa formation, à la théocratie et à l’autocratie les plus oppressives. Mais nous avons tenu à protester, avec quelques arguments autres que de simples affirmations, contre l’imposture qui attribue à ces puissances malfaisantes ce que le moyen âge a eu de bon et les possibilités qu’il a léguées aux temps modernes de poursuivre leur route vers une meilleure humanité.
– Édouard ROTHEN.
NOTA. – Nous renvoyons, pour une connaissance plus complète du moyen âge, aux différents articles de l’E. A. dont le sujet comporte un développement historique sur cette époque et aux ouvrages suivants : Jules Andrieu : Histoire du moyen-âge. — Pierre Gosset : Histoire du moyen-âge. – Michelet : Histoire de France. – Elisée Reclus : L’Homme et la Terre. – Ph. Chasles : Études sur l’antiquité ; le moyen âge. – Frédéric Morin : La France au moyen âge. – M. Lachâtre : Histoire des papes et crimes des rois, des reines et des empereurs. – Paul Lacroix : Les arts au moyen âge ; Mœurs, usages et coutumes au moyen âge. – Félix Sartiaux : Foi et Science ou moyen âge.
MUFLISME
n. m.
Néologisme qui vient de mufle, nom donné à la partie nue terminant le museau de certains animaux : le mufle du lion du bœuf, etc... Le langage populaire a appelé mufle un visage laid, vieilli, désagréable. Saint-Amant a parlé de
Où Madame s’ensevelit
Loin du jour, de peur qu’on ne voie
Que son mufle est une monnoye
Qui n’est plus de mise en ce temps ! »
Avec plus d’extension, mufle est devenu une forme de mépris et une injure à l’adresse d’un individu brutal, malappris, désagréable. Molière, dans le Dépit Amoureux, a fait dire, contre un personnage exaspérant par la sénilité de ses propos :
De faire sur ce mufle une application. »
Dans Tartufe, Orgon, non moins exaspéré par M. Loyal, donnerait volontiers les cent plus beaux louis qui lui restent encore pour :
Le plus grand coup de poing qui se puisse donner. »
Ces détails ne sont pas superflus quand on voit ceux qu’on peut appeler « les mufles du nationalisme », attribuer aussi tendancieusement qu’inexactement pour le seul besoin de la propagande haineuse qu’ils poursuivent, une origine de leur crû au mot mufle qu’ils écrivent pour la circonstance avec deux f.
Dans le Figaro du 18 février 1926, il a été raconté que la qualification de muffle, donnée aux personnes, ne viendrait pas du mufle d’un animal mais aurait été employée en 1815, par les Parisiens, du nom du général prussien von Muffling, qui avait particulièrement excité leur mépris par sa vanité grossière et ses procédés brutaux. C’est ainsi que les nationalistes écrivent l’histoire. Nous avons vainement cherché dans des ouvrages sérieux une confirmation de cette origine du mot mufle et un emploi de muffle. Nous avons seulement trouvé, sur le baron Muffling, qu’il se montra fort arrogant en réclamant, au nom des « Alliés », la restitution des œuvres d’art et de bibliothèque dont leurs pays avaient été dépouillés par les armées de Napoléon. Von Muffling fut peut-être un mufle ou un muffle, mais autrement mufles que lui furent ces princes, rentrés en France dans ses fourgons, qui ne se rétablirent sur « leur trône » qu’à la faveur de son arrogance, et tous leurs partisans pour qui la défaite et l’humiliation de la France furent des motifs d’allégresse et de profit. Voici, d’après Louis Blanc, dans son Histoire de Dix ans, ce que l’on vit à Paris, lors de l’entrée des « Alliés » :
« Une foule de femmes élégantes attirées aux fenêtres, saluaient avec des cris le passage des vainqueurs et agitaient des écharpes en signe d’allégresse ; les riches préparaient leurs appartements les plus somptueux pour y recevoir les officiers anglais ou prussiens ; et les marchands, dans l’ivresse d’une joie cupide, étalaient à l’envi ce qu’ils avaient de plus précieux... On dansa sur le gazon des Tuileries... Pour dernier trait d’avilissement, les vaincus se laissèrent gorger d’or par les vainqueurs... Les marchands décuplaient leurs recettes habituelles ; tous les jeunes officiers avaient des maitresses coûteuses, des loges au théâtre, des dîners chez Véry. C’est de cette année 1815 que datent la plupart des fortunes marchandes de la capitale. »
Jusqu’à ces derniers temps, l’Académie Française ignorait, comme le Figaro, l’usage populaire du mot mufle, appliqué aux personnes. Elle lui a fait récemment une place dans son dictionnaire et elle l’a défini ainsi : « Homme dont le caractère est un mélange de cynisme et de brutalité ». Elle a admis aussi le néologisme muflerie, d’emploi non moins courant qui qualifie les agissements du « mufle ». L’Académie a-t-elle eu peur de se compromettre par une définition plus complète et plus précise, en un temps où le mufle et la muflerie sont tellement répandus qu’ils sont arrivés à caractériser une époque de l’humanité, comme nous le verrons plus loin ?
J. de Pierrefeu avait déjà défini le mufle actuel que paraît vouloir ignorer l’Académie :
« Tout individu qui n’a aucune notion du respect d’autrui, qui cherche uniquement son intérêt ou son bien-être, les autres dussent-ils en pâtir. Bref, c’est l’égoïste doublé du malotru et du pignouf. »
Pour le mufle, le contrat social est unilatéral ; il en veut les bénéfices, mais il en laisse les charges aux autres. « Chacun pour soi et chacun chez soi », disait son prototype le plus complet, M. Thiers. On peut admettre, à la rigueur, que l’individu ayant réussi à s’installer dans un parasitisme avantageux, demeure indifférent au sort des autres ; ce n’est pas lui qui a fait le monde, et il n’a pas demandé à y venir. Mais le mufle ne se borne pas à cette indifférence. Bien pourvu pour, lui-même, il s’indigne que d’autres ne soient pas satisfaits et réclament. Il prétend même avoir droit à la reconnaissance et à l’amour de ceux qu’il malmène et qu’il dépouille. Durant la guerre, confortablement « embusqué », il dénonçait les « défaitistes » qui réclamaient la paix. Valet de plume des puissants, il morigène « les grincheux de profession et les grognons de vocation ». Il classe parmi les « hargneux » ceux qui ne font pas leur cour aux fripons satisfaits et ne sollicitent pas leur sportule. Le mufle, maître ou larbin, n’a pas le sens du ridicule et manque de la plus élémentaire circonspection.
La Fouchardière, commentant la définition académique, s’est exprimé ainsi :
« La muflerie n’est pas dans le caractère. On ne naît pas mufle. On le devient par la vertu de l’éducation ; ce n’est pas une façon d’être, c’est une façon de se tenir en société... Jamais on ne dit d’un homme grossier, primitif, qu’il est un mufle. La muflerie est l’acquisition récente et avantageuse d’une civilisation avancée. L’homme grossier, dès l’abord, révèle sa brutalité cynique ; à le fréquenter, après l’avoir supporté, on peut découvrir par la suite qu’il est loyal et bon sous des dehors peu engageants. Le mufle est ordinairement un monsieur bien élevé ; toujours un monsieur bien habillé. Il se présente sous l’aspect le plus séduisant : et c’est à l’usage qu’on finit par le connaître... Il spécule sur tous les inconnus et, du jour au lendemain, ne connaît plus ceux dont il n’a plus rien à tirer. Le mufle est un personnage qui manque de mémoire ; il oublie les promesses qu’il a faites et les services qui lui furent rendus. Il pratique l’art des préparations, qui est l’art de se faire valoir, mais n’apporte aucun ménagement dans l’art de laisser tomber... Il montre une telle force sereine que ses victimes ont parfois des inquiétudes qui prennent la valeur de vagues remords, et qu’elles se demandent : « Qu’est-ce que je lui ai donc fait ? ». »
Ce sont là les caractéristiques du mufle et de la muflerie considérés individuellement. Mais au-dessus il y a leurs manifestations collectives qui les ont généralisés, variés, étendus à l’infini et leur ont fait prendre un caractère social. Comme la mode, qui est souvent une de ses formes, la muflerie se répand alors chez un nombre de plus en plus grand d’individus même mal habillés, qui y trouvent aises et profits, et d’inconscients qui la pratiquent avec une parfaite innocence croyant bien faire puisqu’ils font « comme tout le monde ». L’homme grossier, primitif, qui ignore les mensonges conventionnels avec la manière de s’en servir, et qu’on appelait un « héros » quand il « nettoyait les tranchées », ne comprend plus lorsque, ayant assassiné hors des circonstances rituelles, il se voit envoyé au bagne ou à la guillotine. Le « nervi », que son audace et son absence de scrupules, s’exerçant tour à tour en marge ou avec la complicité du code, ont érigé parmi les ventres solaires et les consuls de l’ochlocratie, s’étonne de se trouver un jour devant une chose interdite qui lui causera des ennuis. C’est la somme des mufleries conscientes et inconscientes qui fait le muflisme.
Ce mot, muflisme, a été employé pour la première fois, croyons-nous, par Flaubert, quand il a dit : « Paganisme, christianisme, muflisme, voilà les trois grandes évolutions de l’humanité ». Rarement, invention d’un néologisme fut aussi heureuse. Muflerie manquait d’envergure dans le triple sens intellectuel, moral et social que voulait exprimer Flaubert. Il voyait, dans cette troisième grande évolution de l’humanité, le règne du « bourgeois » de celui qui ne se borne pas à « penser bassement », mais qui agit de même, égoïstement, férocement, à l’encontre de toute grandeur, de toute bonté, de toute beauté, de tout idéalisme.
Le muflisme, c’est le triomphe du moi-égoïste sur le moi-humain. C’est la multiplication de cet individualisme qui dit :
« Moi d’abord!... les autres s’il en reste. »
C’est le puffisme appuyé sur l’argent et l’absence de scrupules. C’est la suppression de toute aménité dans les rapports sociaux. C’est la muflerie élevée à la hauteur d’un principe et d’une institution, par la loi de la majorité. C’est la muflerie, bien ou mal habillée, instruite ou ignorante, de race et de nation, de caste et de classe. Certes il y eut des mufles dans tous les temps, et aussi dans tous les pays, quoique prétendent leurs « professeurs d’énergie », les Barrès pour qui « gentillesse » n’est que chez eux, « barbarie » que chez les autres ; mais il appartenait à notre temps de réaliser dans sa plénitude, on peut dire spécifique et constitutionnelle, la muflerie qui est le muflisme et nous fait assister à cette troisième évolution de l’humanité dont Flaubert, et Renan avec lui, ont été les clairvoyants prophètes. Des gens se préoccupent de donner un nom à l’époque actuelle, ils font des enquêtes à ce sujet. Ce nom, Flaubert l’a trouvé il y a soixante ans ; c’est le muflisme. L’époque en a commencé il y a un siècle, elle est aujourd’hui dans son plein épanouissement.
Le muflisme est la marque, le vice rédhibitoire peut-on dire, de la fausse élite dirigeante qui s’est éduquée à rebours, hors des voies de l’intelligence et de la conscience de la véritable élite. Il a toujours été la tare des « parvenus » ne sachant pas se montrer dignes de leur fortune en s’élevant intellectuellement et moralement en même temps que socialement. Ses oscillations ont suivi celles des formes sociales suivant qu’elles étaient plus ou moins soumises à la fausse élite. Mais c’est dans les formes dites « démocratiques » que sa courbe a toujours été la plus élevée. Ceci parait paradoxal en raison de la supériorité de principe de la démocratie sur l’aristocratie. Les faits sont là, indiscutables. La fausse aristocratie n’a que les tares de l’aristocratie ; la fausse démocratie ajoute aux tares de l’aristocratie celles de l’ochlocratie. Si toutes les formes dirigeantes de la fausse élite ont à leur base la ruse, la violence et l’arbitraire, du moins les théocraties et les autocraties ne reposent-elles par leur pouvoir sur un fallacieux respect des droits de l’homme ! Le muflisme aristocratique a son explication, sinon son excuse, dans la prétendue supériorité qu’il tient de Dieu, de la puissance ou de la fortune. Il ne prétend pas faire le bonheur de tous les hommes ; l’assentiment du « suffrage universel » lui est tout à fait indifférent et il a au moins cette franchise de ne pas le solliciter tout en le méprisant. Le droit du plus fort qu’il applique est la conséquence de ses principes ; il n’a pas l’hypocrisie de dire que ce droit lui vient de ses victimes qui le lui ont conféré. « Avoir des esclaves n’est rien ; mais ce qui est intolérable, c’est d’avoir des esclaves en les appelant citoyens », a écrit Diderot.
Quelles que soient les prétentions à une supériorité de sang, de caste ou d’élection dont l’humanité a toujours subi la tutelle artificieuse, aucun homme n’est jamais sorti des cuisses d’un Jupiter. Tous sont passés par le même moule et sont venus au monde aussi nus. Il n’en fut jamais dont l’origine eût été différente de celle de ce vilain dont on disait avec dégoût au moyen âge qu’il était « un être puant sorti du pet d’un âne ». Mais il y a eu de tout temps ceux dont les qualités d’esprit et surtout de coeur, dont la générosité de sentiment et la droiture de conscience, ont fait une élite réelle, une véritable aristocratie qui s’est rencontrée dans toutes les conditions sociales. Il n’y a pas de noblesse de sang, de race et de caste, mais il y a une noblesse de l’âme que peut posséder, ou se former, le plus pauvre, le plus socialement déchu. Les parvenus qui ne savent pas acquérir la noblesse de l’âme restent des « êtres puants », c’est à dire des mufles, quelles que soient les hauteurs qu’ils atteignent. Le vilain — et tous furent des vilains à l’origine – pouvait acheter « blason, lambel, bastogne », se changer en grand bourgeois, en patricien, en magistrat, être dans ses maisons somptueuses le commensal des rois, couvrir ses femmes et ses filles de vêtements si riches que des reines en pâliraient de jalousie, devenir lui-même évêque, prince, pape, empereur : il demeurait « un être puant sorti du pet d’un âne » s’il conservait l’âme d’un mufle. Et il peut aujourd’hui, par la faveur démocratique, étaler la bedaine précieuse d’un roi du dollar, du cochon ou du pétrole, montrer l’insolence d’un « capitaine d’industrie » ou d’un « fermier général de l’estomac national », il peut-être président de République, ministre, député, sénateur, ambassadeur, maréchal, académicien : il reste toujours le même « être puant » s’il ne sait exercer sa puissance et son intelligence que dans les voies du muflisme. C’est moins que jamais en la circonstance, l’habit qui fait le moine.
Le muflisme de la théocratie et de l’autocratie est particulier à certaines classes privilégiées. Celui de la démocratie s’étend à toutes les classes, lorsqu’elle en laisse subsister. La muflerie des parvenus y est renforcée de la muflerie de tous ceux qui cherchent à parvenir à leur tour par les mêmes moyens, l’éducation faussement démocratique n’ayant, le plus souvent, remplacé dans leur cervelle les mensonges anciens que par des mensonges nouveaux, au lieu de leur apprendre l’usage de la raison et la pratique de la liberté. Comment expliquer sans cela le spectacle actuel, que donne surtout la jeunesse, de la divinisation de la richesse par laquelle « on obtient tout », même des diplômes d’intelligence alors qu’on n’est qu’un crétin, de la soif de « réussir » sans contrôle des moyens, de l’exaltation de la force par les sports et par la guerre, du mépris de toute pensée qui n’aboutit pas à des succès d’argent. Comment comprendre ce vertige qui entraîne les hommes vers toujours plus de vitesse, de bruit, d’éclairage violent, d’agitation trépidante et hurlante ; ce besoin de jouir abondamment, intensément, sans discernement, à la façon d’un ivrogne que la crainte de ne pas assez boire ferait se noyer dans une cuve de vin ? Des gens qui ont fait le tour du monde en avion, parcouru des milliers de kilomètres en automobile, ne savent que répondre si on leur demande de dire leurs impressions. Ils sont allés si vite!... au risque d’écraser des gens, de se tuer eux-mêmes, de causer des catastrophes ; mais ils ne cherchaient pas et ils n’ont pas vu autre chose. Certes, la succession rapide des découvertes scientifiques les plus étonnantes a été pour beaucoup dans la formation de ce nouvel « état d’âme » ; mais s’il n’y avait pas eu déjà dans les cerveaux un détraquement latent que ces découvertes précipiteraient, on n’assisterait pas aujourd’hui à ce spectacle effarant qui multiplie le champ de la pathologie. De même que l’immense développement du machinisme industriel a aggravé l’esclavage ouvrier au lieu de le soulager, les inventions modernes : télégraphie, téléphonie, télévision, phonographie, cinématographie, automobilisme, aviation, navigation sous-marine et cent autres, ont développé à l’infini des activités inutiles, le surmenage, l’abrutissement, et n’ont apporté à l’homme qu’un illusoire bien-être. C’est à une véritable faillite qu’ont abouti ces inventions au point de vue humain ; mais ce n’est pas à cette faillite de la science que Mr Brunetière prétendait constater, c’est à celle de la conscience humaine. Elle est l’œuvre du muflisme et elle est d’autant plus lamentable que jamais l’homme n’eut tant de possibilités de réalisation de ses plus beaux rêves. Le muflisme a fait une turpitude de la rayonnante utopie.
L’aristocratie cantonne son muflisme dans les manifestations d’un nombre limité de mufles venus d’une lointaine révélation divine ou des croisades. Celui de la démocratie est ouvert comme une halle, un marché, à tous les chalands qui peuvent se payer le luxe d’être des mufles, aux « drôles venus de la plus sordide populace, du maquerellage et du stellionat à la richesse en même temps qu’aux « bons principes », aux « mignons opulents, retraités et pieux », aux « prêteurs à la petite semaine tombés dans la dévotion et le patriotisme » à toutes ces « charognes », comme les a appelées Laurent Tailhade dans son Pays du Mufle, pour lesquelles il ne voulait pas écrire mais dont il a fait si crûment la peinture d’après le Satiricon de Pétrone. Zeller, dans ses Entretiens sur l’Histoire, a tracé le tableau suivant de leurs mœurs au temps de Rome :
« Enflés des noms redondants de Raburrus, Pagunius ou Tarrasiusus, dans leurs robes de soie et d’or, ils ne savent qu’énumérer leurs biens, villas, fermes, etc. Ils n’ont d’amis, de clients, que parmi le personnel des cirques et des théâtres ; de bibliothèques que pour les tenir closes comme des tombeaux ; de voitures que pour ébranler le pavé des rues, de valets que pour en faire montre au milieu de Rome. S’ils donnent des repas, c’est pour faire peser dans des balances les poissons de leur table et pour faire noter et publier par leurs secrétaires la composition des repas, le nombre des mets et la splendeur du service. Pour délasser leur esprit, au lieu d’attirer la société des gens de lettres ou des philosophes, ils font venir des joueurs de flûte, de lyres colossales et d’orgues hydrauliques. Une mouche qui se place sur la frange de l’éventail de ces voluptueux leur est une fatigue, et ils se vantent d’avoir visité leur campagne de Gaëte, comme César le ferait d’avoir conquis le monde. »
On voit que M. Lechat, qui partage la publicité mondaine du Figaro avec le marquis de Porcellet, a des ancêtres aussi lointains et non moins fameux que ce gentilhomme. Mais il y a mieux depuis la guerre de 1914, ainsi que nous le verrons. Ibsen a écrit dans Un Ennemi du Peuple :
« La populace ne se trouve pas seulement tout à fait au fond ; elle vit et grouille autour de nous, on en trouve même des échantillons au sommet de la société. »
La populace parvenue s’est singulièrement multipliée au sommet de la société.
Athènes fut le premier champ historique du muflisme démocratique. Il y a été un essai assez timide, comparé à ses développements postérieurs mais la ville de Périclès en a gardé une trace ineffaçable : la mort de Socrate. La tyrannie aristocratique avait épargné le philosophe, malgré les railleries dont il l’avait accablée et ses sarcasmes contre les dieux. Il fallut un homme riche, parvenu à un rang « d’ami du peuple » — un Coty de ce temps-là — pour que Socrate fût condamné. Athènes paya cruellement les défaillances de sa véritable élite devant le muflisme de ceux qui disaient :
« C’est l’argent qui fait l’homme!... »
Avec beaucoup plus d’envergure, le muflisme se manifesta dans les formes dites « démocratiques » de la dictature impériale romaine. On vit alors, non sans phrases, car le muflisme démocratique est particulièrement salivaire, le triomphe de la plus basse populace faisant escorte à Néron et autres « grands artistes » qui incendiaient Rome pour leur plaisir en attendant de la livrer aux Barbares dont ils recevraient leur couronne. Pendant que le muflisme des parvenus s’étalait avec l’affectation grotesque que Zeller a décrite, le peuple n’était plus « qu’un amas cosmopolite de fainéants, de va-nu-pieds, croupissant dans une paresse incurable, abrutis par l’ivrognerie et la débauche, n’ayant qu’une passion qui leur fasse oublier le jeu et le cabaret, la passion du cirque, et essayant de temps en temps de petites émeutes, non plus pour avoir du pain, mais du vin » (Zeller). De leur côté, les esclaves, successeurs dégénérés des compagnons de Spartacus, étaient réduits à des déchéances de plus en plus fangeuses. Mais Auguste et ses successeurs étaient des « démocrates », ce que n’a pas cessé d’affirmer le plutarquisme mis au service du muflisme. Si l’élite d’aujourd’hui en est à l’état où était celle du bas-empire romain, et même la dépasse dans le muflisme, le peuple « démocratisé » n’est pas encore arrivé à celui de la populace de Rome, mais on ne peut savoir jusqu’où le muflisme le conduira. Il ne fait, lui aussi, plus guerre d’émeutes pour le pain et la liberté ; il en fait de plus en plus sur les champs de courses et aux spectacles du stade et du cirque.
Mirabeau avait entrepris ; dans son Erotika Biblion, de démontrer que les mœurs antiques furent plus dépravées que les mœurs modernes. C’est possible. Mais les anciens ne se posaient pas en pratiquants d’une religion qui avait « apporté la morale dans le monde ». Les mœurs antiques pouvaient être plus dépravées au sens que la morale chrétienne donne à la dépravation ; elles possédaient sur les mœurs modernes une incontestable supériorité : elles n’avaient pas inventé la tartuferie des flamidiens catholiques et des momiers protestants. Le muflisme n’a pris toute son ampleur que de la conjugaison des deux époques : paganisme et christianisme. Il est le produit d’une copulation immonde de Messaline et de Tartufe. Son temps est celui de tous les dieux et de tous les cultes, de Mercure et du Sacré-Cœur, de Vénus, de Notre-Dame de Thermidor et de l’Immaculée Conception, de sainte Jeanne d’Arc, de sainte Thérèse de Lisieux et de Mme Joséphine Baker, qui ont les dévots à la Bourse, dans les lupanars et dans les églises.
C’est par la combinaison de la barbarie païenne et de l’hypocrisie chrétienne que le muflisme démocratique exerce sa pire honte, dans l’exploitation de ce qu’il appelle son « empire colonial », comme on disait déjà aux temps païens d’Annibal et aux temps catholiques de Philippe II. Ce muflisme se vante de ne pas imiter Carthage ; il fait pire, car lorsque Carthage recrutait parmi les indigènes coloniaux des mercenaires et des esclaves, quand elle les spoliait et les proscrivait, elle n’ajoutait pas à tous ces maux l’abrutissement par le catéchisme et l’alcool, elle ne prétendait pas leur apporter la morale et la liberté. Carthage n’avait pas appris du christianisme à être barbare par charité, à pratiquer l’esclavagisme « pour le bonheur des esclaves », à les tuer « pour sauver leurs âmes ! » Enfin, Carthage ne faisait pas écrire par des rhéteurs des choses comme ceci :
« Nous avons traité avec assez de libéralisme et de fraternité bienveillante nos populations indigènes africaines et asiatiques pour pouvoir légitimement prétendre à leur reconnaissance. » (Le Temps, 28 mai 1920)
Renchérissant sur le muflisme aristocratique, le muflisme démocratique veut que sa main soit bénie par celui qu’elle frappe. Il a appris cela dans la Bible d’un Dieu qui ne se punit pas lui-même d’avoir fait le monde mauvais, mais qui punit tout le monde. Et il veut être aimé pour lui-même!... C’est le comble de l’outrecuidance.
De la même conception de la justice et de la charité, le muflisme a composé toute la gamme de sa clémence, de sa magnanimité, de sa bienveillance de sa bienfaisance, de sa philanthropie, par lesquelles il veut bien condescendre à pardonner aux autres ses propres crimes ou à leur faire largesse d’une partie de ce qu’il leur a volé. A cette hauteur, le muflisme atteint sa quintessence, et on comprend que son sens échappe aux êtres grossiers, primitifs, barbares, aux pourceaux auxquels « il ne veut pas jeter ses perles », et qui dise avec A. Karr :
« Que MM. les assassins commencent ! »
Il oublie qu’il devrait commencer le premier. Mais s’il fait assez volontiers « grâce » pour paraître magnanime, il refuse énergiquement de faire « justice » en reconnaissant et en réparant ses erreurs et ses fautes. Nous avons vu déjà à l’article liberté individuelle, comment il entend la justice. Les dossiers de la Ligue des Droits de l’Homme sont bourrés d’histoires de gens innocents, condamnés dans des conditions scandaleuses, qui attendent vainement une révision de leurs procès. Il est dans la morale ordinaire des gens grossiers et primitifs que le premier devoir d’un honnête homme est de reconnaître qu’il s’est trompé et de réparer le mal qu’il a fait. Mais le muflisme n’est pas honnête homme. Il méprise cette justice élémentaire et lui substitue la « Raison d’ Etat » qui n’est que la raison des puissants. Violant même ses propres lois, il a érigé cette « infaillibilité » que l’Eglise ne reconnait qu’au pape, pour tous les distributeurs de sa vindicte, même quand ils se rendent coupables des abus les plus flagrants. Il proclame « l’irrévocabilité de la chose jugée », pour laisser tremper dans le bouillon d’infamie où il les a plongées, ses victimes innocentes. Ses ministres bateleurs disent, avec les airs angéliques d’un Thomas d’Aquin, qui « se réjouissait des souffrances des damnés » : « La justice doit être secourue par la bonté » (M. Herriot), « toute rigueur inutile est une injure à la justice » (M. Barthou), et ils s’occupent de faire réviser les procès de... Socrate et de Baudelaire ! Quant aux milliers de malheureux contre qui la justice n’est, tous les jours, que de la haine et en qui elle est à tout instant injuriée, ils peuvent attendre puisqu’ils ne sont pas encore morts!...
Renan, par les connaissances que lui apportaient sec recherches historiques, Flaubert, plus intuitivement guidé par son sens de l’art et de la beauté, avaient observé l’évolution du muflisme. Renan avait la méfiance de la démocratie, bien qu’il la préférât à la théocratie et à l’autocratie. Il en eût été enthousiaste si elle eût fait prévoir l’avènement d’une véritable élite présidant la véritable République de tous les hommes. Mais il voyait trop la faiblesse de Caliban, du peuple grossier, primitif et naïf, en face de ses ennemis rusés et subtils, et sa facilité à tomber dans leurs pièges. Il craignait que Caliban, après s’être gardé si mal du prince Prospero, se gardât encore plus mal des phraseurs, des casuistes de robe courte, des politiciens déchaînés dans toutes les traverses de la blagologie démocratique et qu’il voyait se lever pour une ruée farouche. Il avait de sombres pressentiments, déjà trop justifiés par les évènements. N’avait-il pas vu comment Caliban, poussé à la Révolution, avait été dupé, et comment le grand mouvement de libération s’était retourné contre lui pour le replonger dans de nouvelles servitudes, avec cette aggravation ironique que plus on l’accablait, plus on lui disait qu’il était maintenant le Roi ! Pauvre roi!... Malgré tant de pensées généreuses tant de dévouements héroïques, tant de projets et d’espérances idéalistes dont elle avait embrasé le monde, la Révolution de 1789 avait avorté dans la victoire d’une classe : la bourgeoisie ; son idéalisme s’était flétri dam cette putréfaction : le muflisme.
Caliban ignore toujours trop les conditions dans lesquelles le muflisme se développa à ses dépens. Il les soupçonne seulement d’instinct ; s’il les connaissait mieux, il apprendrait à s’en défendre efficacement. Dès le Directoire, ahuri par le jeu de massacre dont la Terreur lui avait donné le spectacle, et fatigué de tant d’héroïsme inutile, il laissait étouffer la Révolution « entre les cuisses de la Cabarrus » (Michelet), et il abandonnait à la guillotine le plus noble et le plus pur de ses fils, Babeuf. Celui-ci, avant de mourir, avait dénoncé la nouvelle classe des profiteurs de 93 installée « sous le règne des catins ». Les Legendre, les Tallien, les Barras gorgés de sanglantes rapines, menaient, avec leur complices, la vie fastueuse et orgiaque du Palais-Egalité. Les « Incroyables » du « Petit Coblentz », précurseurs des camelots de M. Daudet, décervelaient les républicains sous l’œil complaisant de la police, tout en exhibant leurs éventails, leurs « oreilles de chiens », leurs gilets à dix-huit boutons et leurs femmes sans chemise vêtues de bijoux, d’or et de pierreries.
« Le Paris riche grossissait d’heure en heure comme un ballon qu’on gonflait. » (Ilya Ehrenbourg)
Pendant ce temps, Caliban n’ayant pas de pain à manger, bien qu’il travaillait quatorze et seize heures par jour, n’avait que la consolation de chanter :
Sans peine, ni soins, ni travaux,
S’emparent de la ruche ;
Et toi, peuple laborieux,
Mange et digère, si tu peux,
Du fer comme l’autruche ».
L’ère napoléonienne, issue de cette situation, consolida celle de la tourbe des renégats révolutionnaires et des nouveaux riches. Elle créa l’aristocratie de ses maréchaux pillards de l’Europe et de ses Mme Angot, reines de la nouvelle cour, leur donna des lettres de noblesse et paya leur servilité de la Légion d’honneur, de dotations et de pensions. Elle ouvrit ainsi les plus rassurantes et souriantes perspectives pour tout ce monde qui tremblait encore au souvenir du tribunal révolutionnaire. Un Dictionnaire des Girouettes, paru en 1815, et qu’on peut appeler le premier « Gotha du muflisme », a conservé les noms et les états de services de la nouvelle aristocratie où anciens nobles et sans culottes parvenus se confondaient, associés dans la bassesse et la cupidité pour les plus honteux reniements. Ralliés à la Restauration au lendemain de Waterloo, ils furent les initiateurs, les soutiens politiques de la nouvelle bourgeoisie pour qui 1815 ouvrit en France « l’ère des intérêts matériels », et qui allait établir « le régime sans entrailles de la concurrence et de l’individualisme » (Louis Blanc).
D’abord hésitante, malgré tant de garanties, incertaine de ses forces devant la double menace d’un retour de dictature militaire ou d’un triomphe légitimiste qui pourrait lui faire rendre gorge, la bourgeoisie ne se sentit réellement solide sur ses bases qu’après 1830, quand elle put compter sur la corruption parlementaire pour obtenir ce que ne lui donnerait pas la force. 1830 fut l’ultime écho de 1789 ; les « Trois Glorieuses » turent son suprême rayon. Pour la dernière fois, les 27,28, 29 juillet 1830, Caliban se retrouva aux côtés de la bourgeoisie, sur des barricades dont le canon était tiré par des polytechniciens avec la mitraille charriée par Gavroche. Pour la dernière fois, l’ouvrier et son propriétaire célébrèrent, inter pocula, la « chute de la tyrannie. Louis Diane a fait de cette idylle sans lendemain ce touchant tableau :
« Les premiers moments du triomphe appartiennent à la joie et à la fraternité, une exaltation sans exemple faisait battre tous les cœurs. L’homme du monde abordait familièrement l’homme du peuple dont il ne craignait pas alors de presser la main. Des gens qui ne s’étaient jamais vus s’embrassaient comme d’anciens amis. Les boutiques s’ouvraient aux pauvres ce jour-là. Sur divers points, des blessés passaient portés sur des brancards, et chacun de les saluer avec attendrissement et respect. Confondues dans un même sentiment d’enthousiasme, toutes les classes semblaient avoir déposé leurs vieilles haines et, à voir la facile générosité des uns, la réserve et la discrétion des autres, on eût dit une société rompue à la pratique de la vie commune. Cela dura quelques heures. Le soir, la bourgeoisie veillait en armes à la conservation de sa propriété. »
Un an et demi après, ce serait les massacres de Lyon et, en 1834, la rue Transnonain, en attendant 1848, 1851, la Semaine sanglante de 1871 et la « Guerre du Droit » de 1914. Car la bourgeoisie a ceci de particulier qui caractérise son muflisme : plus sa puissance est assise, plus elle pourrait mettre son élégance à se montrer généreuse, plus elle se fait exigeante et féroce.
En 1830, Joseph Prudhomme, dont Henri Monnier écrivit les Mémoires en 1857, jetait sa gourme romantique dans le sillage des Victor Hugo et des Delacroix. Il était encore un beau jeune homme qui arborait le gilet rouge des « Jeune France » et le chapeau de cuir des « bousingots ». Il séduisait Fantine mais épousait Cosette. Werther et Chatterton lui arrachaient des larmes et il conservait quelques scrupules à se faire le greluchon des Dames aux camélias avant de monnayer leur agonie. Il n’était pas encore « maire et père de famille » (Verlaine) ; le sabre qui serait « le plus beau jour de sa vie » (H. Monnier), quand il l’aurait trempé dans le sang ouvrier, était encore au fourreau. Mais il ne tarda pas à se ranger définitivement des barricades, à faire une descente de lit de la peau de ce « lion superbe et généreux » qu’il avait été un moment, quand il eut installé an pouvoir un roi-soliveau possédant, sous un air hypocritement bonhomme, les plus solides qualités de la bourgeoisie et de son muflisme montant. Le banquier Jacques Laffitte a raconté dans ses Mémoires comment la « farce » fut jouée devant le peuple réclamant une République, avec la complicité de La Fayette qui ne voulait pas plus de la République en 1830 qu’il n’en avait voulu sous la Révolution.
« L’amour de l’argent était dans les mœurs ; la tyrannie de l’argent passait dans les institutions et la transformation de la société en devenait la décadence. Les esprits honnêtes durent avoir de tristes pressentiments, car une domination d’un genre tout nouveau allait peser sur le peuple sans le consoler en l’éblouissant. » (Louis Blanc)
Déjà, la grande banque — la haute finance balzacienne – s’était solidement établie à la faveur de l’invasion de 1815. A la France saignée par la curée napoléonienne, elle avait prêté, au taux de 20 à 22 % l’argent nécessaire pour la libération du territoire. Pour se mettre à l’abri de tout retour révolutionnaire, elle organisa la corruption parlementaire. Une semaine après les journées de juillet, le 9 août 1830, la Chambre des Députés proclamait Louis Philippe « Roi des Français », sans en avoir reçu aucun mandat du peuple. Ce furent, ô ironie ! des royalistes, Chateaubriand à la Chambre des pairs, et le comte de Kergolay, qui protestèrent contre « la violation de la volonté nationale » ! On leur opposa la théorie du « consentement tacite du peuple », comme on le ferait en 1851, quand Louis Bonaparte « sortirait de la légalité pour entrer dans le droit », comme on le ferait encore en 1914 pour décréter une « mobilisation qui ne serait pas la guerre », comme on le fait constamment, chaque fois que la « Raison d’Etat » s’avise de bousculer la légalité et le droit réunis. Le peuple se satisfit d’avoir un « roi des Français » au lieu d’un « roi de France » et un drapeau tricolore au lieu du drapeau blanc.
La Chambre de ces députés, dont Béranger avait chansonné les « bons dîners » chez les ministres, devint sous Louis Philippe ce ventre législatif que peignit Daumier. Elle fut la représentation nationale des appétits immoraux et des digestions honteuses en dressant l’opulente rotondité de sa bedaine majoritaire contre toutes les oppositions. Elle commença, avec la loi du 9 mars 1831, par repousser le suffrage universel. Les scandales financiers se multiplièrent à la Bourse, « hospice ouvert aux capitaux sans emploi et repaire de l’agiotage » (Louis Blanc). Mais la Chambre ne faisait rien contre ces scandales ; elle comptait déjà trop de gens dont ils avaient fait la fortune. Ce fut le temps où les « loups cerviers » de la finance et de l’industrie, répandant les « pots de vin » parmi les parlementaires, établirent les grands privilèges capitalistes. Pour être favorable à M. Casimir Périer, possesseur des mines d’Anzin, on interdisait l’introduction des charbons belges en France. On maintenait des droits sur les fers parce qu’ils étaient profitables à vingt-six députés et à deux ministres associés à M. Decazes, directeurs des mines de l’Aveyron. La prime protectionniste des sucres était partagée entre six maisons, dont celle des frères Périer qui en retirait à elle seule 900.000 francs. On livrait à des compagnies privées la propriété des chemins de fer, inaugurant ainsi le système qui a mis entre les mains d’une oligarchie capitaliste, pillarde et routinière, toutes les richesses nationales pour les exploiter coutre la collectivité et reconstituer un véritable servage de la classe ouvrière. Cent vingt-deux députés-fonctionnaires touchaient des appointements pour des fonctions qu’ils ne remplissaient pas, mais ils étaient les gardiens de la majorité gouvernementale.
Le roi-citoyen et sa famille n’étaient pas en retard pour prendre leur part de cette curée. Ils avaient commencé par se faire allouer une liste civile de 20 millions et des biens immenses comme propriété privée, cela, au moment où, dans le seul XIIème arrondissement, à Paris, 24.000 personnes manquaient de pain et n’avaient que des défroques de l’armée pour se vêtir, de la paille pour se coucher. La misère physiologique était telle dans le peuple qu’en 1834, sur 10.000 conscrits, on comptait dans les départements manufacturiers 8930 infirmes ou difformes et, dans les départements agricoles, 4.029 de ces malheureux. Le nombre des enfants trouvés, qui avait été de 40.000 le 1er janvier 1784, s’élevait à 130.000 en 1834. Le Figaro, qui n’était pas encore le moniteur du muflisme aristocratique et « bien pensant », avait écrit à ce sujet :
« On a autorisé dernièrement la fondation d’une vingtaine de couvents de femmes ; l’établissement des Enfants Trouvés ne désemplit pas. »
La condition ouvrière était retombée au-dessous des pires époques de détresse populaire.
« Le pauvre, dans les grandes villes, est un être enterré vivant et qui s’agite au fond d’un tombeau. On passe, on repasse sur sa tête sans entendre ses cris ; on le foule et on l’ignore ! » (Louis Blanc)
Le choléra se mit aussi de la partie, comme au moyen âge. Ce fut le moment que choisit la cour pour présenter la loi d’apanage augmentant les revenus de la famille royale ! M. de Cormenin protesta dans un pamphlet violent contre cette loi. Des révoltes populaires éclatèrent qui furent impitoyablement réprimées (voir Révoltes ouvrières).
M. Prudhomme, qui sortait son grand sabre contre le peuple affamé, se montrait au contraire si lâche devant l’étranger qu’il s’attirait le mépris de toute l’Europe. En même temps qu’il noyait dans le sang ouvrier les promesses de fraternité nationale faites en période révolutionnaire, il abandonnait tous les projets de libération des peuples pour se faire complice de leurs bourreaux. Il laissait se perpétrer le partage de la Pologne étouffant ses derniers scrupules sous le mot cynique de son ministre Sébastiani :
« L’ordre règne à Varsovie ! »
Il décevait par son attitude la Belgique qui avait rêvé de se réunir à une France révolutionnaire. Il soutenait la réaction en Espagne et en Portugal. Il abandonnait l’Italie aux Autrichiens et au pape, en attendant d’envoyer à ce dernier une armée pour maintenir son pouvoir temporel. Il déployait enfin un tel zèle pour l’observation du traité de 1815 qui avait livré la Révolution française à la réaction européenne, qu’en 1836 il allait jusqu’à exiger de la Suisse l’expulsion des réfugiés politiques de la « Jeune Europe »!... Partout la bourgeoisie, qui devait son succès à la Révolution se faisait le champion de la contre-révolution. Partout elle soulevait l’indignation des peuples en s’employant à détruire cette liberté dont elle était née. Comme l’a constaté Edgar Quinet, elle obligeait la France à s’armer contre ses doctrines, à combattre contre ses convictions et ses lois ; elle tournait son épée contre elle-même et se dégradait par ses apostasies. D’instinct, la bourgeoisie allait à tout ce qui était bassesse et trahison, indifférente à tout déshonneur, insensible à toute humanité, n’ayant de volonté d’activité, d’intelligence que pour étendre la puissance de son argent et abaisser les consciences.
Elle avait trouvé les dirigeants qu’il lui fallait dans les Casimir Périer et autres grands seigneurs de la féodalité capitaliste, mais surtout dans M. Thiers et les politiciens de son école. M. Thiers fut l’incarnation de l’espèce, le grand homme et le valet à tout faire de la bourgeoisie, celui qui l’a conduite à la définitive infamie en 1871. Caliban ne connaîtra jamais assez cet homme sinistre demeuré depuis cent ans, parmi tant de renégats qui l’ont trahi, le type de « l’être puant » , bas et féroce, principal animateur du muflisme contemporain. Il ne le connaîtra jamais trop, alors que de prétendus démocrates osent tenter aujourd’hui une réhabilitation populaire de ce Foutriquet et proposer à la classe ouvrière de le statufier!... Ce M. Thiers est le grand modèle des Soulouques actuels. Républicain la veille des journées de juillet et signataire de la protestation des journaux contre les Ordonnances de Charles X, ce fut par la Révolution qu’il arriva au pouvoir, après avoir donné son concours le plus empressé à la « farce » banquo-orléaniste. Il ne tarda pas à déclarer que « l’arbitraire est nécessaire au régime pour se maintenir ». C’est à propos de lui que Berryer disait : « Il est quelque chose de plus odieux que le cynisme révolutionnaire, c’est le cynisme des apostasies ». En 1834, il s’opposa à l’amnistie pour les républicains. Il fit voter les lois de répression de 1835 et favorisa par tous les moyens le gouvernement personnel de Louis-Philippe qui voulait réaliser des ambitions dynastiques. Si, durant le Deuxième Empire, il fit facilement figure de républicain, il avait toutes les qualités voulues pour faire sombrer la vraie République dans la répression criminelle de la Semaine sanglante.
La bourgeoisie trouvant trop lourde une monarchie qui ne se bornait plus à assurer la sécurité de ses spoliations et cherchait à se rétablir dans la légitimité des droits monarchiques, favorisa jusqu’à un certain point la formation du parti catholique libéral et le développement des idées socialistes, mais tout juste assez pour faire dresser les barricades de février 1848. M. Prudhomme commençait à avoir le ventre trop lourd pour procéder lui-même. Tout ce qu’il fit, quand il eut déclenché le mouvement, fut d’empêcher la garde nationale de marcher contre le peuple. Celui-ci dont l’ardeur s’exaltait aux magnifiques promesses socialistes, se leva dans l’Europe entière pour balayer les derniers tyrans. En France, il conquit en principe le « suffrage universel » ; ce fut toute sa victoire. Quand il prétendit s’en servir pour obtenir des réformes sociales, la bourgeoisie, hérissée devant tant d’audace, riposta par les journées de juin avec, comme aboutissant, une République de capucins et de prétoriens qui décideraient l’expédition de Rome, voteraient la loi Falloux soutenue par M. Thiers, « épureraient le suffrage universel » pour empêcher les élections de socialistes, supprimeraient la liberté de la presse et prépareraient le coup d’Etat de 1851.
Si les leçons de l’histoire servaient mieux à Caliban, plus attentif et moins indifférent à sa destinée, cette histoire ne se répéterait pas avec une si constante régularité par le retour des mêmes événements où seuls sont changés les protagonistes. Or toujours, parmi ceux-ci de même que les anciens braconniers font les meilleurs gardes-chasse, ce sont les anciens aventuriers, échappés à la corde, qui font les meilleurs gouvernants. Les Barras et les Fouché, qui déshonorent les révolutions par leurs crimes, deviennent les plus sûrs « défenseurs de l’ordre ». Les révolutionnaires les plus farouches se changent en conservateurs sinon en réactionnaires du lendemain. Caliban ne cesse pas d’être leur dupe.
En 1851, la bourgeoisie, fille ingrate de la Révolution, était arrivée à une telle haine de sa mère que tous les républicains, même les plus modérés, lui étaient suspects. La terreur du socialisme la poussa dans les bras des aventuriers bonapartistes avec qui elle trouva — ou retrouva plutôt, car elle avait été déjà celle des Badinguet de l’ancienne Rome — la formule de la démocratie « dont la nature est de se personnifier dans un homme ». Pour faire croire à la pureté de ce personnage et de ses complices, « tas d’hommes perdus de dettes et de crimes », comme les appela Gambetta citant Corneille lors du procès Baudin, elle couvrit d’injures et de calomnies, tout en les faisant assassiner ou proscrire, tous ceux qui se soulevèrent contre leur coup de force. Un La Guéronnière écrivait contre les « rouges » défenseurs de la République : « Aux nouvelles arrivées des départements, un mouvement unanime de douleur et d’indignation avait éclaté dans Paris. La Jacquerie venait de lever son drapeau. Des bandes d’assassins parcouraient les campagnes, marchaient sur les villes, envahissaient 100 maisons particulières, pillaient, brûlaient, tuaient, laissant partout l’horreur de crimes abominables qui nous reportaient aux plus mauvais jours de la barbarie. Ce n’était plus du fanatisme comme il s’en trouve malheureusement dans les luttes de partis ; c’était du cannibalisme tel que les imaginations les plus hardies auraient pu à peine le supposer » (Biographies politiques, Napoléon III). On croirait lire une page des journaux d’aujourd’hui sur « l’homme au couteau entre les dents ». Seulement, en 1851, les « gens de l’ordre » n’étaient pas encore renforcés de radicaux, de socialistes et de chefs de l’Internationale Ouvrière assagis et installés dans de confortables sinécures !
Si, avec le Deuxième Empire, la bourgeoisie se paya le luxe d’un dictateur, elle ne laissa pas de le tenir à l’attache pour ne le lâcher que contre les libertés populaires. Le César, ancien greluchon miteux de miss Howard et tous les rufians de son entourage avant pu payer leurs dettes, et bien gavés, furent les meilleurs gendarmes de l’ordre. Ils eurent la « générosité » de se pardonner leur propre crime en offrant à leurs victimes proscrites une amnistie que Quinet, Clément Thomas, Schœlcher, Charras et Victor Hugo refusèrent fièrement, mais ils servaient mieux la bourgeoisie qu’ils ne se servirent eux-mêmes en laissant se reformer un parti républicain d’hommes de gouvernement qui seraient tout prêts à prendre leur place quand la bourgeoisie les abandonnerait après Sedan. 1870 et 1871 furent une double victoire pour cette bourgeoisie malgré la défaite militaire ; elles lui permirent de liquider le bazar napoléonien et d’en finir pour cinquante ans avec la menace révolutionnaire. Ayant fait la Semaine sanglante et encaissé ses loyers, elle pouvait sans risque pour sa fortune et son avenir, se déclarer républicaine et se livrer à la blagologie démocratique. Elle n’avait plus besoin que la démocratie fût « personnifiée dans un homme », elle pouvait la laisser « couler à pleins bords ». Ses Thiers lui firent une Constitution passe-partout pouvant aussi bien servir à une royauté, un empire, qu’à une république. On abusa le peuple en mettant la troisième étiquette sur l’orviétan, et pendant que ce peuple vivrait dans l’illusion d’être enfin « souverain » s’acharnant à voter pour le « bon député », la bourgeoisie tiendrait les ficelles du pantin. Le meilleur moyen de ne pas voir réaliser le programme républicain de 1869 fut pour elle de donner le pouvoir à ceux qui avaient fait ce programme ; de même le meilleur moyen d’en finir avec le socialisme, quand elle le voudra sera de mettre les socialistes au gouvernement. Car le pantin, qu’il soit opportuniste, radical, socialiste, voire communiste, sera inévitablement un servant du muflisme en étant au pouvoir. « Même s’il est honnête, même s’il est de bonne foi, il sera envahi, pénétré, gangrené par ce que Proudhon appelait la « pourriture parlementaire », a dit Séverine en tirant la Dernière leçon de la Commune. Tous ceux qui aspirent à un mandat sont comme les rois dont A. Dumas disait qu’ils acceptent tout ce qu’on veut et jurent encore plus facilement, quitte à être parjures. La démocratie, au lieu de faire disparaître l’espèce des renégats, en a multiplié le nombre. C’est ainsi que votant de mieux en mieux, depuis soixante ans, pour des candidats de plus en plus « à gauche », le peuple attend toujours la République qu’on lui a promise.
Après les élections de 1921, qui furent le triomphe du « bloc des gauches », l’Œuvre écrivait :
« Enfin, nous sommes en République ! »
On n’y était pas plus qu’en 1870, quand elle fut proclamée, mais le muflisme qui règne sous ses apparences allait s’étaler encore plus cyniquement grâce à l’impunité définitive assurée aux profiteurs de la guerre, aux fauteurs de la vie chère, aux aventuriers enrichis dans de sales affaires et tenus jusque là en suspicion par l’opinion publique. Ce furent de nouvelles équipes d’écumeurs qui montèrent au pouvoir, et la « technicité » spéciale d’un socialiste, membre de l’Internationale Ouvrière, présidant la Chambre des Députés, assura définitivement à Thénardier, devenu Président du Conseil, ses majorités encore douteuses. C’est depuis, grâce à la collusion de tous les partis, la subordination de plus en plus humiliante de tout ce qui avait un caractère républicain à l’arbitraire policier, à la dictature du Sabre, à un retour de l’Eglise annihilant progressivement et systématiquement l’œuvre de laïcité. « Fortifier le parti des révolutionnaires contents et repus d’un corps de gendarmes en soutane, à cause de l’insuffisance manifeste des autres », était le programme proposé par Veuillot il y a quatre-vingts ans. C’est celui qu’on a repris depuis 1924, à défaut du programme républicain de 1869 et de celui, socialiste, de l’Internationale Ouvrière. On a de plus paré à l’insuffisance des gendarmes et la mitraille ne manque pas.
Est-ce ça la République?... Il paraît que oui, puisque la victoire du « bloc des gauches » a eu ce résultat de faire taire l’opposition démocratique qui s’exprimait encore. Seuls ceux que les « lois scélérates » appellent indistinctement des « anarchistes » protestent toujours. L’Œuvre est si convaincue qu’on est en République depuis 1924, qu’après les élections de 1928, ne voyant plus que des républicains dans la nouvelle Chambre, elle a demandé ironiquement à certains de « se dévouer pour former une droite »!... On a vu depuis comment ces messieurs se sont « dévoués » et continuent à se dévouer tous les jours!...
Puisqu’on est enfin en République, les travailleurs n’ont évidemment plus rien à revendiquer et leur émancipation est faite. S’ils n’ont pas encore tout ce qu’ils veulent c’est non moins évidemment leur faute, parce qu’ils sont impatients, violents et grossiers, qu’ils ne possèdent pas les bonnes manières du muflisme. On a toujours d’excellents prétextes pour ne pas faire la République de tous et se satisfaire de celle des apostats et des mufles. En 1830, c’était la faute à Voltaire et à Rousseau ; en 1848, celle des « partageux » socialistes ; en 1851, celle des « rouges » ; en 1871, ce fut celle des « communards », et aujourd’hui c’est celle des bolchevistes!... De tout temps ce fut celle des anarchistes qui ne s’accommodent pas des turpitudes souveraines, et qui « em... le gouvernement », suivant l’expression parlementaire du ministre Constans.
Tels ont été, depuis la Révolution française, les prolégomènes du muflisme et les conditions de développement qui l’ont amené aujourd’hui au plein de son évolution. Il était utile, à notre avis, de les exposer comme une contribution de la vérité historique, au moment ou se célèbrent les centenaires romantiques et où le plutarquisme dont on les maquille, depuis celui d’Hernani jusqu’à celui de la prise d’Alger, s’efforce d’étouffer les derniers souvenirs révolutionnaires dans l’apothéose des apostasies bourgeoises.
Malgré son triomphe, la « bête puante » n’est pas heureuse. Un frisson court sur son échine. Elle, qui voudrait être adorée et ne sentir que l’encens de la flagornerie, se voit parfois mettre le nez dans son ordure, comme un chat malpropre. Car il est encore des gens pour troubler sa digestion, mêler de l’insomnie et du cauchemar à son sommeil. Il en est toujours qui peuvent répondre fièrement : « Non ! » à cette question que Séverine indignée posait un jour à ceux qui tiennent une plume : « Sommes-nous des larbins ? » et ceux qui étrillent la « bête puante », assombrissant son bonheur. Mais elle a trouvé dernièrement un moyen de rasséréner son ciel — Oh ! ne croyez pas que ce sera en apportant un peu plus de justice sur la terre. Au contraire ! — C’est celui d’une loi « super-scélérate », dite « contre la diffamation » qui lui permettra de réduire au silence et sans discussion possible les révélateurs de vérité, de mater les caractères rebelles, de châtier les consciences irréductibles. La loi de 1881 sur la liberté de la presse, déjà si culbutée par l’arbitraire, laisse encore trop de liberté. Il ne faut plus de liberté, sauf celle écrite sur les murs des prisons, pour que la « bête pante » puisse digérer et dormir en paix. Hélas ! ça ne marelle pas tout seul ; le projet présenté est resté en route. Est-ce un morceau trop gros pour passer?... La « démocratie » en a avalé d’autres ; elle avalera bien aussi celui-là.
Il faudrait des volumes pour passer en revue toutes les manifestations de la muflerie érigée socialement et démocratiquement en muflisme. Bornons-nous à quelques constatations générales.
L’effort le plus important et le plus soutenu du muflisme se porte évidemment sur le terrain économique pour le maintien de la subordination du travail à son parasitisme. Il a non seulement à son service les cadres réguliers de l’organisation sociale qu’il dirige, mais aussi des volontaires de plus en plus nombreux, que lui amènent l’inconscience, la misère, la cupidité et la trahison : gardes civiques, délateurs et mouchards amateurs, jaunes, décerveleurs de manifestations publiques, « collaborationnistes » syndicaux, etc. Nous verrons au mot « Ouvriérisme » que le muflisme prolétarien est digne du muflisme bourgeois dont il s’annonce comme la continuation, aggravée, dans l’avènement du quatrième état.
Aux déclamations intéressées de tous les satisfaits sur le progrès démocratique et le bien-être du prolétariat, s’oppose froidement cette réalité : le « prolétaire libre » de la démocratie subit une servitude de fait que ne connurent pas les serfs de droit d’avant 1789. Les hommes qui détruisirent les premières machines dans lesquelles ils voyaient, d’instinct, des ennemies, seraient épouvantés au spectacle de ce que la machine fait aujourd’hui de leurs descendants « mécanisés » par l’organisation méthodique du taylorisme, de la rationalisation, de la standardisation et autres procédés barbares qui épuisent les corps, vident les cervelles, empêchent le travailleur de penser et le livrent perinde ac cadaver à ses maîtres. L’homme ne chante plus en travaillant la chanson joyeuse d’un travail sain. La machine chante à sa place et raille sa servitude par ses rugissements, ses miaulements, ses pétarades, tout ce qui a été imité par cette musique sans âme, qui devait agiter jadis les convulsionnaires ou les rondes du sabbat et que le muflisme a mise à la mode pour l’abrutissement universel : le jazz-band. Le travail que le forçat accomplissait le boulet au pied ou le carcan au cou, lui laissait parfois l’espoir d’une libération à plus ou moins longue échéance. Le travail « à la chaîne », dans l’usine moderne enlève tout espoir de ce genre à l’homme « mécanisé » qu’il conduit à la folie ou à la mort et qu’à quarante-cinq ans, s’il a tenu le coup, il rejette comme une inutile scorie. Mais le muflisme a fait les « assurances sociales » avec retraites à soixante ans!... Cramponnes-toi jusque-là si tu le peux, vieux débris « rationalisé » !...
En face du « matériel humain » broyé, sacrifié, le muflisme capitaliste s’est fait un cerceau d’acier, un cœur de bois, des rognons en caoutchouc. Ses nerfs et ses muscles sont des câbles d’alimentation électrique, son sang est du pétrole, sa pensée un conseil d’administration et ses tendresses un carnet de chèques. M. Citroën, qui perd dans une nuit des millions à la roulette, laisserait mettre Paris à feu et à sang plutôt que d’accorder à ses ouvriers une augmentation de salaires que n’aurait pas décidée son conseil d’administration. Il sait qu’il ne redoute rien d’une grève de son personnel à qui la démocratie a accordé ce qu’elle appelle « la liberté du travail », mais qu’elle ramènerait bientôt à l’usine par la faim et au besoin à coups de mitrailleuses. Le muflisme américain, toujours en tête du « progrès démocratique » vient d’inaugurer, comme des mineurs en grève le bombardement par avion réservé jusqu’ici au « bétail humain » des colonies.
Aucun pouvoir ne peut tenir tête au muflisme capitaliste parce qu’aucun pouvoir n’existe aujourd’hui que par sa volonté. Quand un ministre dit : « Je ne tolèrerai pas que les banquiers, que les industriels, que les commerçants abusent, etc... », il se livre à un grossier battage. Il sait mieux que personne que s’il mettait ses menaces à exécution, ces messieurs auraient vite fait de le renvoyer, sans même lui donner ses huit jours. Des concussionnaires, appelés à s’expliquer chez les ministres en sortent libres et décorés. Des affameurs, convoqués pour s’entendre dire qu’on ne « tolèrera pas » les hausses illicites, disent, en riant au nez des journalistes qui les attendent à la sortie : « Annoncez que demain le lait, le pain, le sucre, le vin coutera deux, ou quatre, ou six sous de plus ! » Un roi pouvait jadis résister aux financiers dont il était tributaire, il lui arrivait de leur payer ses dettes en leur faisant couper le cou. Aujourd’hui ce serait impossible ; ce sont les financiers qui font et défont les lois quand ils ont encore besoin de ces fantoches. Ils font de même, dans ce qu’on appelle les « démocraties » de ces autres fantoches qu’on appelle les « ministres ». Autrefois, c’était en tremblant que des féodaux tenaient tête à l’Eglise et lui faisaient la guerre avec leur chevalerie. Ils redoutaient son anathème et son excommunication. Aujourd’hui les féodaux de l’argent lui font à l’occasion une guerre autrement sérieuse, si elle s’avise de contrecarrer leurs desseins, et ils sont plus sûrs de la vaincre en lui coupant les vivres que ne l’étaient les barons armés de lances et d’épées. Ils se rient depuis longtemps des foudres « spirituelles » que peuvent lancer contre eux le pape et ses sorciers imposteurs. Il y a longtemps qu’il leur est égal de « perdre leur âme » puisqu’ils « gagnent le monde », et le pape, avec ses sorciers, n’est d’ailleurs pas différent. Tout ce monde s’entend comme larrons en foire. Dans l’orgueil de son insolent despotisme, le muflisme capitaliste en est arrivé à faire de la mort d’un des siens un deuil national.
Malherbe dirait auhjourd’hui :
N’en défend point leurs rois.
On voit, alors, le drapeau de la nation, en berne, à la façade des établissements de la finance, et on se demande quelle calamité publique est ainsi lamentée. C’est plus qu’un tremblement de terre, un incendie ou un naufrage faisant des centaines de victimes ; c’est la mort d’un « ventre doré » qui est annoncée aux âmes sensibles. Saluez, manants démocratisés!...
Dégradation physique, intellectuelle et morale ; voilà l’œuvre que le muflisme poursuit avec grandiloquence. « Vous êtes le rempart de la dignité et de la prospérité nationale », disent des ministres aux marchands d’alcool dont l’industrie multiplie les dégénérés et les criminels, mais fait les « bons électeurs ». – « Vous êtes les bons serviteurs du public », disent d’autres ministres aux marchands de tabac qui empoisonnent ce public, mais font entrer des milliards dans les caisses de l’Etat. Le premier souci administratif, quand un troupeau d’Arabes, de Polonais ou de Chinois est amené dans une région pour une exploitation industrielle, n’est pas d’ouvrir pour eux des écoles et des hôpitaux, mais il est d’installer des maisons de « tolérance ». Les sports qui « empêchent de penser » ceux que la mécanisation n’en rend pas tout à fait incapables, le cinéma qui leur fait admirer les prouesses des « belles brutes », les spectacles de sang tels que les corridas de toros présidées par des députés et des maires socialistes : voilà ce que le muflisme offre au peuple pour faire son éducation démocratique. Aux femmes, déjà réduites par la condition ouvrière au sort des bêtes de somme, les journaux où elles cherchent des distractions « intellectuelles » proposent sans cesse les séductions les plus variées qui conduisent à la prostitution, empanachée et insolente d’abord, mais vite misérable et victime des rufians de haut et bas étages. Ils leur chantent « la grâce des bras nus en ces soirs alanguis, tandis que chacun doucement se repose et délaissant sports ou excursions, s’abandonnent au plaisir d’un concert ou d’une causerie coupés de danses sur la terrasse d’un Casino ». Ils troublent leur imagination avec les histoires merveilleuses des « reines de beauté », des « stars » de cinéma, des jolies parfumeuses qui épousent des Aghakan. Ils leurs vantent les « takoloneries » qui mettront tous les hommes à leurs pieds et leur permettront de choisir parmi les millionnaires. Mais ils passent sous silence les réveils sur le chemin de Buenos-Aires qui s’ensuivent généralement.
La division économique des classes sociales nécessite leur division intellectuelle. Il s’agit moins d’empêcher le prolétaire de penser que de lui faire accepter sa déchéance et l’observation méthodique de tous les mensonges sociaux. C’est un trait caractéristique du muflisme d’avoir établi, dans l’enseignement, une différenciation de classe, au temps où l’état social se constitua sur le plan individualiste, pour creuser définitivement le fossé qui séparerait l’aristocratie de la roture. L’enseignement appelé « classique », à l’usage exclusif de la première, fit plus pour sa séparation des classes populaires que tous les préjugés nobiliaires. La démocratie de la fausse élite a eu grand soin de maintenir les deux enseignements, celui à l’usage des jeunes riches, pour leur apprendre à commander, celui à l’usage des jeunes prolétaires, pour leur apprendre à obéir.
Mais les jeunes riches eux-mêmes ne doivent pas être incités à s’évader de la carapace du muflisme et à s’élever trop haut dans les régions supérieures de la pensée et de l’art où ils risqueraient de se faire une âme humaine. Le muflisme fait de son élite intellectuelle une collection de pauvres croûtons qu’il tient en lisière dans les marécages de son pseudo-classicisme officiel pour professer la haine de tout ce qui est libre et grand. « Pas de chef-d’œuvre, mais une bonne moyenne, c’est ce qui convient à notre démocratie », disait un Président de la République visitant le Salon.
Le muflisme abandonne à la charité publique les facultés, les laboratoires, les bibliothèques et les écoles. Une Melle Curie doit aller quêter en Amérique le prix de quelques grammes de radium nécessaire à ses expériences. Des savants meurent victimes de leur dévouement à la science et à l’humanité ; les journaux les enterrent en quatre lignes parmi des colonnes entières de calembredaines sur les crimes du jour, les scandales de la finance, les avatars des rastaquouères plus ou moins titrés, des aventuriers de haut vol, des cabotins de la politique, du théâtre et de la littérature, dont ils amusent la badauderie publique. D’autres savants, des professeurs, des étudiants, doivent, à côté de leurs travaux, de leurs cours et de leurs études, écrire des articles de journaux, copier des bandes d’adresses, se faire ouvreurs de portières ou plongeurs de restaurants, des artistes et des écrivains meurent de faim, pendant que des milliards sont gaspillés pour la guerre et des entreprises cabotines, que la gabegie règne dans les administrations, que les apanages sont rétablis pour des familles de maréchaux et qu’on couvre d’or les boxeurs, les toréadors, les danseurs mondains, les gueules photogéniques du cinéma, les proxénètes, les flibustiers de toutes les eaux sociales et leurs complices de la politique et de la presse. Pour le muflisme, il y a trop de savants, de penseurs, d’artistes, de médecins, d’ingénieurs, d’instituteurs, de gens dont le travail est utile ; il n’y a jamais assez de militaires, d’histrions, de garde-chiourmes, de policiers, de gens de toutes les professions parasitaires.
Voici deux faits, actuels en l’an du muflisme 1931, qui caractérisent mieux que les plus éloquents commentaires l’attitude de ce muflisme parasite, détrousseur et imposteur à l’égard de l’intelligence créatrice. On sait que le savant Branly est l’inventeur de la TSF. On sait aussi que l’ouvrier mécanicien Forest fut celui de tous les perfectionnements qui ont rendu pratique l’emploi de l’automobile et possible sa rapide extension. Des financiers, des industriels des commerçants, des intermédiaires de toute sorte, ont gagné et gagnent encore, non seulement des millions, mais des milliards, grâce aux inventions de Branly et de Forest. Eh bien ! pendant que ces mufles profiteurs étalent le luxe le plus effréné, font écrire leurs noms en lettres de feu dans le ciel et voient se trainer à leurs pieds toute la racaille prostituée du pouvoir, de la presse, de la galanterie et des « bons citoyens », Branly, vieillard de 86 ans, et la veuve de Forest, vieille femme de 76 ans, vivent à Paris dans la misère, délaissés par tous et menacés d’aller finir leurs jours, sans abri et sans pain, dans un asile de nuit!...
Le muflisme ne considère plus les grands écrivains et artistes de tous les temps que comme de « nobles poussahs » qui se sont attachés à une œuvre vaine. Il ne s’intéresse plus à un Hugo, un Byron, un Delacroix, un Baudelaire, un Wagner, un Tolstoï, un Zola, un A. France, que dans la mesure où il a été pédéraste, cocu, syphilitique ou converti. De là le succès du genre littéraire dit de « vies romancées » qui ne sont, la plupart du temps, que des maquillages audacieux de l’histoire et des introspections vicieuses dans l’existence des morts. Flaubert, qui eut à se défendre de son vivant contre tant de mufles, ne se doutait pas de l’acharnement que mettraient tant de fouille-chose à livrer à la malignité publique le secret de sa vie privée, et de l’ardeur qui serait apportée au tripatouillage de son œuvre. Le muflisme a une censure, mais il ne l’emploie pas contre ces malfaiteurs. Il en a même deux, l’une exercée officiellement, au nom du gouvernement « gardien des bonnes mœurs », par de lamentables cuistres descendus au métier déshonorant de dépeceurs de la pensée nouvelle et indépendante ; l’autre officieuse, des cafards bien-pensants et des domestiques des puissances financières et politiques formant des congrégations de « moralistes » bénévoles tant laïques que religieux, tant démocrates que réactionnaires. Le muflisme juge le talent suivant le cours de la Bourse, l’œuvre d’art à son prix de vente. Un Pierre Grassou, dont Balzac a écrit l’histoire et dont la postérité pullule aujourd’hui, qui sait peindre indifféremment des Raphaël, des Rembrandt, des Watteau, ou des Corot, des Daumier, des Cézanne est aussi grand que tous ces maîtres réunis, et si les maîtres meurent souvent de faim, en attendant d’enrichir les mufles, les Pierre Grassou font par contre, de beaux mariages, sont décorés et étalent pompeusement à l’Académie leur puffisme triomphant.
Le mépris de l’intellectualité qui ne s’emploie pas au service de l’imposture, la haine de la pensée qui ne conduit pas à la folie et au meurtre, sont devenus une discipline sociale et une orthodoxie rigoureuse. Il y a vingt ans, on préparait 1914 avec des élucubrations comme celle-ci :
« Pour ma part, je ne suis pas éloigné de croire que si, aujourd’hui, un jeune, à vingt ans, révélait soudain du génie, s’affirmait grand écrivain, grand musicien, grand philosophe, il serait socialement moins utile que ne l’est actuellement le grand gamin que vous savez (Georges Carpentier), devenu grand boxeur par le don, la discipline et la volonté. » (Mr Frondaie)
Aujourd’hui, après une guerre que tout le monde, sauf de sombres crétins et de monstrueux responsables, reconnait avoir été aussi stupide que criminelle, on pense encore, plus que jamais, que :
« Savoir appliquer un coup de poing au bon endroit est plus utile dans la vie que tout ce que l’on enseigne dans les classes. » (J. de Lacretelle)
Les « clercs qui trahissent » se sont faits boxeurs, dans la crainte de se « déshonorer » et de perdre leurs prébendes. Ils viennent lécher le sang, comme les chacals après la bataille, approuvent et bénissant au nom de Dieu, de Platon, de Thomas d’Aquin de Spinoza, de Karl Marx de Kropotkine et... de Déroulède. M. Bergson, lumière du ciel sorbonique, est descendu jusqu’à écrire la préface d’un livre de M. Viviani ; mais il a été fait commandeur de la Légion d’honneur, ce qui ne serait pas arrivé à Spinoza. Sont aussi commandeurs de la Légion d’honneur, Mme de Noailles qui représente, parait-il, la poésie, et les grands affairistes des journaux à tout faire. Singulières promiscuités!... Des revues procèdent à des enquêtes sur ce que sera la littérature « au lendemain de la prochaine dernière guerre ». Le muflisme fait vivre les gens dans la pensée de cette « prochaine » comme d’un événement normal, naturel, et qu’il s’agit de voir venir aussi gaiement que possible. La précédente « dernière » ne fut-elle pas le « bon temps » (M. Dorgelès), la « régénératrice » (MM. Bourget et Hervé)?... Avec le plus calme sang-froid on envisage que, « par précaution », chacun devrait avoir chez lui son masque à gaz, « comme il a son parapluie ».
Le muflisme a « rationalisé » le sacrifice de l’intérêt général aux intérêts particuliers d’une caste qui ne tient plus sa puissance que de l’argent, produit du brigandage social. Alors que la houille blanche et le pétrole permettraient de remplacer le charbon dans tous ses usages, on continue à faire descendre des hommes dans l’enfer des mines. En 1925–1926, sur 203.444 ouvriers travaillant dans les mines françaises, il y a eu 234 tués et 74.504 blessés, soit 37 pour 100 de travailleurs victimes d’accidents. Mais il faut maintenir les privilèges et les bénéfices de la ploutocratie houillère constituée depuis cent ans, quand on ne connaissait pas l’électricité et le pétrole. Les actions des mines d’Anzin, réparties entre quelques centaines de propriétaires et émises à cent francs au temps où se fonda la dynastie des Casimir Périer, valent aujourd’hui des centaines de mille francs. On comprend qu’il faut faire tuer et mutiler des hommes pour aller chercher du charbon dans ces mines.
Pour favoriser les « fermiers généraux de l’estomac national » et la vermine des spéculateurs qui grouille dans leur sillage, on laisse faire la vie de plus en plus chère, et le bon peuple attend toujours ces lois contre la spéculation que des ministres ont pris rengagement « d’honneur » de faire voter ! Par exemple, pour le blé. Les spéculateurs exportent le plus possible et au prix fort, bien entendu. Le blé manquant alors pour le pays, on augmente le prix du pain bien qu’on y mêle toutes sortes de cochonneries comme au temps de guerre. Il y a de gros traitants qui gagnent des milliards à ce commerce, et les ministres qui avaient pris l’engagement « d’honneur » de faire réprimer leurs agissements, leur donnent de hauts grades dans la Légion d’honneur et se mettent à leur service pour justifier, par leurs déclamations, les malhonnêtetés de ces forbans. Certains, qui faillirent connaître le sort d’un Foulon pendant la guerre, sont les maîtres du gouvernement et des journaux les plus démocratiques.
Les compagnies concessionnaires de services publics (transports, forces motrices, éclairage, etc...) ont organisé la plus formidable gabegie qui se puisse imaginer, grâce à la jurisprudence de « l’imprévision » qu’elles ont fait établir par le Conseil d’Etat. Alors qu’il y a déficit pour la collectivité qui paie les centaines de millions qui manquent, il y a bénéfice pour les compagnies qui distribuent à leurs actionnaires dividendes et nouvelles actions gratuites. La France va avoir un de ces jours à payer plus de 4 milliards de déficit de ses chemins de fer ! Les rois avaient jadis les moyens de prouver devant les parlements les concussions des Semblançay et des Fouquet qu’ils faisaient envoyer au gibet et aux oubliettes ; mais en démocratie, il n’y a pas, paraît-il, de moyen comptable d’établir, devant les tribunaux la malhonnêteté des compagnies et de punir leur gabegie. Par contre, l’ingénieur Archer a été poursuivi et condamné pour avoir fourni du courant électrique à meilleur marché que les compagnies.
Sur les marchés, on interdit la vente des produits au-dessous des cours fixés par les mercantis officiels. Des Chambres de Commerce, assemblées solennelles des plus importants et honorables commerçants, présentent elles-mêmes des statistiques truquées pour favoriser les spéculateurs. Les pouvoirs publics, qui n’en ont d’ailleurs aucun souci, ne peuvent exercer aucune action pénale contre les destructeurs de denrées. Pendant que des gens meurent de faim, que des troupeaux de pauvres hères mendient à la porte des casernes, des hôpitaux, des restaurants, les résidus de leurs cuisines, des tonnes de poisson, de légumes, de fruits frais, sont rejetés tous les jours à la mer, mis au fumier et à l’égout par les pêcheurs, les maraîchers, les commissionnaires aux halles, pour que l’abondance des produits ne fasse pas baisser les prix ! Un homme courageux, réagissant contre la lâcheté générale et ayant eu la naïve audace de se porter partie civile dans une comédie de poursuite judiciaire contre des spéculateurs du lait, se vit condamné à payer 60.000 francs de frais de justice. Il n y a pas de loi contre les affameurs mais il y en aura une pour faire payer cet homme qui a cru à la justice en temps de muflisme.
Des régions entières sont expropriées pour l’établissement d’usines. Les populations qui y vivaient relativement libres depuis des centaines d’années sont chassées ou doivent s’atteler à la chaîne de la nouvelle fabrique. Déboisement, aridité du sol, empoisonnement des cours d’eau, inondations, catastrophes et ruines résultent de ces nouvelles invasions capitalistes plus terribles qu’au temps de Charles V les incursions des Grandes Compagnies. Mais de nouvelles sociétés industrielles ont leurs actions cotées à la Bourse ; la destruction nationale favorise les filouteries du « boursicotage » et quelques douzaines de « ventres dorés » s’arrondissent plus démocratiquement que jamais. Quels scrupules pourraient les retenir, aux colonies, sur les domaines du caoutchouc, du riz, des arachides, du coprah, de l’or du nickel etc. et vis-à-vis des « peuples conquis », quand on voit leurs procédés dans leur pays à l’égard de leurs « libres concitoyens »?...
Le muflisme est l’ennemi de la libre nature et de ses paysages. Quand il ne les détruit pas pour établir des usines, il les souille de ses panneaux de publicité pour recommander ses camelotes : automobiles, apéritifs, bretelles, moutarde, insecticides, ou ses lupanars à la mode sur la Manche ou la Méditerranée : casino, roulette, petits chevaux, boule, le claquedent et le tripot pour toutes les bourses, car la démocratie veut que « le peuple s’amuse » et se fasse vider par l’amour et le jeu de ce que le travail et les mercantis lui ont laissé de rognons et d’argent. L’arbre, même à la campagne, est un objet encombrant et inutile s’il ne fait pas des planches. On y met le feu volontiers quand il appartient au voisin ou à la commune, par vengeance ou pour le plaisir et pour le remplacer par du pâturage. Dans les villes, des municipalités « réalistes » qui adaptent, disent-elles, les nécessités édilitaires aux principes utilitaires, abattent les arbres des boulevards pour les remplacer par des étalages et des tables de bars. Il y a encore plus d’encombrement et plus de chaleur sur l’asphalte, aussi on boit mieux. Les arbres ne sont pas électeurs, les amis des arbres ne le sont guère, mais les « bistros » et leurs clients le sont beaucoup.
L’écrasement des gens, au propre comme au figuré, est le mot d’ordre du muflisme. C’est devenu un sport à la portée du bourgeois le plus moyen et de l’ouvrier « américanisé », grâce à l’automobile et à un bon contrat d’assurance. Une charge du Canard Enchaîné dit :
« Combien consommez-vous aux cent kilomètres ? — Deux piétons. »
Quand l’homme n’est pas complètement mort, on l’abandonne sur la route pour qu’il soit achevé par un confrère ou on le transporte sur une voie ferrée où il sera encore plus sûrement écrasé par un train. La statistique des accidents d’automobile constitue le plus impressionnant tableau de chasse du muflisme, après celui de la guerre. En 1929, aux Etats-Unis, 33.060 personnes ont été tuées, 1.200.000 blessées. En Angleterre, 6.696 tuées et 170.917 blessées. La France arrive modestement au troisième rang avec 3.707 morts et plus de 70.000 blessés. En six ans, elle a vu 14.912 morts. Sous l’ancien régime, quand un carrosse bousculait les gens dans la rue, il provoquait une émeute. Aujourd’hui, devant ces milliers d’écrasés, on ne dit rien, la faculté de payer conférant le droit à tous les abus et chacun ayant l’espoir d’encaisser. Les Compagnies d’assurances paient... quelquefois. Que faut-il de plus ? Le muflisme dit à la victime, si elle n’est pas morte :
« Heureux veinard, vous voilà rentier!... »
Car en démocratie, ce n’est pas comme sous l’ancien régime. Il y a le Code Civil avec ses articles 1382 et suivants qui veulent que quiconque a causé un dommage à autrui lui en doive réparation. L’interprétation juridique est des plus circonstancielle suivant la qualité de l’écraseur et celle de l’écrasé. mais le principe y est, et c’est l’essentiel en régime de blagologie. Les écraseurs riches ne vont pas en prison, même lorsqu’un tribunal qui n’est pas à la page les condamne à en faire. Leurs chauffeurs y vont à leur place, de même que l’aiguilleur de trains ou le boiseur de galeries y va pour le directeur de chemins de fer ou de mines. Ce directeur dit à son conseil d’administration émerveillé :
« Les catastrophes nous coûtent moins cher que l’entretien du matériel ; laissons arriver les catastrophes. »
Pourrait-on envoyer en prison un si parfait technicien, alors qu’on a sous la main l’aiguilleur et le boiseur?...
On a vu, jadis, des nobles et des riches monter à l’échafaud pour des crimes de droit commun. On n’en a plus vu depuis cent ans. La « grâce » démocratique veille sur leurs jours. Par contre, on guillotine journellement de pauvres diables qu’une tare physiologique, l’abandon moral, l’ignorance et la misère ont conduits infailliblement au crime. « Tu peux tuer cet homme avec tranquillité », disent au bourreau douze individus conventionnellement vertueux qui ne sont pas toujours des bourgeois bien habillés. Les mêmes acquittent, presque avec félicitations, le virtuose du revolver qui a tué sa conjointe « parce qu’il l’aimait trop ! » ce qui est la manifestation grégaire de l’esprit propriétaire. Ils admirent ce gaillard qui tirera de son acquittement la meilleure réclame politique, industrielle, commerciale ou artistique, car le muflisme ne dédaigne aucune publicité si scandaleuse soit-elle. Le sang et la boue sont le meilleur engrais de la réclame. Ne lit-on pas des quantités d’annonces de ce goût :
« Le fournisseur du soldat inconnu. Le soldat inconnu, dont la tombe est fleurie journellement, a reçu jusqu’à ce jour plus de 1.500 couronnes sortant de chez X ... »
Mais voici qui donne encore mieux la mesure de toute la délicatesse du muflisme :
« Gagnez beaucoup en vendant à vos amis les chaussettes Y... »
Pour le mufle, les amis sont des poires que la Providence a fait mûrir pour qu’il les cueille. Il ne peut lui venir à l’idée que l’amitié est sacrée plus que l’amour, étant plus durable, et qu’elle doit être le dernier domaine inviolé parce que, même égoïstement elle pourra être le suprême refuge pour le réprouvé et le maudit. Le mufle s’enfuit, emportant la montre du copain qui lui a donné l’hospitalité. Il va même raconter à la police les secrets d’intimité que le copain naïf lui a confiés. Il est ce Pierre a qui renia Jésus livré aux gens « bien pensants » et qui ne pleure plus « amèrement » depuis qu’il est la pierre d’une boutique qui n’a pas cessé de crucifier Jésus depuis 1900 ans.
Malheur à l’homme qui va encore à pied sur les routes, pour ses affaires ou son plaisir. Il est d’ailleurs, de plus en plus, un personnage de la préhistoire que les gendarmes étonnés interpellent sans aménité quand les automobilistes le ratent. Le temps n’est plus aux « rêveries d’un promeneur solitaire », pas plus qu’aux auberges accueillantes où l’on mangeait avec la famille la soupe trempée pour elle. Le Touring-Club a réalisé pour le muflisme l’hôtel et les repas interchangeables sur toutes les routes, du Nord au Midi, de Paris à Yokohama. En même temps que le voyageur « logé à pied et à cheval ». L’homme honnête, scrupuleux, poli, modeste, sachant se tenir à sa place, ne sera bientôt plus qu’une pièce de musée archéologique, une figure de musée Grévin pour l’amusement des mufles. Quant au goût de la pauvreté, ou à la pauvreté elle-même, soit par indifférence, soit par incapacité de s’enrichir, ils sont devenus des crimes. On outrage le muflisme en méprisant la richesse comme en faisant preuve d’intelligence, et il s’en venge comme de la plus grave offense. « Malheur au pauvre ! » est, dans la démocratie qui a proclamé l’égalité des hommes, un cri plus sinistre que « Malheur aux vaincus ! » Le vaincu a été un combattant qui a pu avoir un moment l’espoir de la victoire ; le plus souvent, le pauvre n’a pas même pu combattre. Le muflisme aristocratique se bornait à dire avec Lantin de Damery, un brave homme qui fut courtisan plus par préjugé que par intérêt :
« Une personne dans l’indigence est plus facile à corrompre que celle qui est riche. »
Il oubliait que l’indigent peut n’être pas corruptible tandis que le riche a été corrompu du moment où il a été enrichi. Le muflisme bourgeois, pour qui la pauvreté est « une névrose » (Lumbroso), en a fait de plus en plus un crime en se démocratisant. Il en coûte plus aujourd’hui de voler un pain que de tuer quelqu’un. Le pauvre qui a manqué de respect à la fortune subit cette contrainte par corps que Saint Louis, il y a 800 ans, n’admettait que pour les dettes envers la couronne. La couronne est devenue tout ce qui s’appelle propriété, et elle est plus sacrée que la vie humaine. Un propriétaire qui tire sur un maraudeur pour deux prunes volées, un garde-chasse qui tue un braconnier pour un lapin pris au collet, sont plus sûrement acquittés que s’ils ont défendu leur existence.
Le muflisme organise des « Semaines de bonté ». Il déborde tellement de « bonté » que son usage quotidien ne lui suffit pas. Il faut qu’il en fasse parade dans des journées et des fêtes spéciales, comme il accroche son honneur à sa boutonnière, tant il en a de trop en lui-même. Sa bonté et son honneur sont comme un eczéma qui a besoin de s’extérioriser. Il danse, il s’amuse, au profit, dit-il, des victimes des catastrophes et des calamités publiques. Il danse sur les morts de la guerre, comme les parents des victimes de la Révolution dansaient sur les leurs. Il pousse la délicatesse des sentiments jusqu’à organiser des fêtes de la « super-élégance » et de la « grâce féminine » au bénéfice des « gueules cassées » de la guerre. C’est à croire que si les tremblements de terre, les inondations et les grandes tueries n’existaient pas, il faudrait les inventer pour permettre au muflisme de s’amuser et de découvrir la beauté. Après avoir obligé les ouvriers à accomplir des travaux meurtriers, les avoir fait périr de misère physiologique, les avoir livrés aux maladies sociales, le muflisme qui leur a réclamé en outre, « pour la patrie », les enfants qu’il ne fait pas lui-même, s’amuse encore pour répandre sa « bonté » sur les orphelins que ces misérables ont laissés. Ce sont alors les bals des « petits lits blancs », de la « cuillerée de lait », de la « bouchée de pain », de « l’assiette de soupe », etc. Ce sont aussi les bals de « la misère noire », des « galas apaches », du « Royaume des fous », parades crapuleuses où les mufles vomissent leur dernière bave sur la détresse humaine.
Quand il a ainsi dansé, mangé, bu, forniqué, quand il a donné sa souscription pour les malheureux qui ne verront souvent pas un sou du produit de la fête, le mufle estime qu’il a fait tout son devoir, plus que son devoir, tout le monde n’étant pas obligé d’être « philanthrope », surtout quand on ne s’en fait pas des rentes. C’est bien d’avoir une « belle âme », mais il faut que ça rapporte. Le mufle serre sa « bonté » dans son coffre, avec les bijoux de sa femme, jusqu’à la prochaine fête. Un homme peut tomber d’inanition dans la rue ou se jeter de désespoir à la rivière ; ça ne le regarde plus. Bon débarras pour la société qui n’avait que faire de cet inutile. Mort, il servira au moins à quelque chose. Il ira à l’amphithéâtre où les carabins apprendront sur sa vieille carcasse à guérir les maux des riches. Car l’Assistance Publique, qui l’a abandonné vivant, a des droits sur le macchabée — ceux de la Science, Monsieur ! — ceux de la Science qui tue les pauvres pour mieux faire vivre les riches. Parmi toutes les épaves humaines qui traînent lamentablement une existence de chien errant, combien pourraient être sauvées par un geste de simple bonté, de celle qui n’a pas besoin de la publicité des journaux et de grands patronages pour se manifester. Mais si l’on s’occupait du sauvetage des épaves humaines, les mufles du journalisme ne pourraient plus s’amuser à écrire des choses comme ceci :
« Record ! On a arrêté en flagrant délit de vol à la tire la veuve Mathieu, âgée de 71 ans, sans domicile, titulaire de nombreuses condamnations et de 200 années d’interdiction de séjour. Elle a été envoyée au dépôt. »
Le dépôt, c’est tout ce que le muflisme qui organise des « semaines de bonté » trouve pour une vieille femme de 71 ans, sans domicile, et qui détient le « record » de l’interdiction de séjour !
Parmi les moyens d’abrutissement, habitudes ou vices contractés par la faiblesse humaine, le muflisme encourage particulièrement le tabagisme. Jusqu’à la guerre de 1914, le fumeur avait été assez discret. Dans les trains et les tramways, il se tenait dans des compartiments spéciaux et on ne le tolérait pas dans les salles de restaurant ou de spectacles autres que les cafés-concerts. Aujourd’hui, il faut subir le fumeur partout et jusque chez soi où le mufle visiteur allume sa cigarette sans même demander si ça ne vous gêne pas. Le fait est courant dans le monde des affaires où l’on ne peut pas toujours mettre à la porte un malotru. Des médecins ne disent plus au malade qu’ils auscultent : « Toussez!... » Ils lui soufflent au nez la fumée de leur cigarette. Ces jeunes gens parlant à une femme à qui ils veulent plaire lui envoient au visage l’odeur du mégot collé au coin de leurs lèvres. Les femmes d’ailleurs ne détestent pas ça puisqu’elles le supportent. Il en est qui fument en faisant leur ménage et en allaitant leurs enfants. Elles ne sont plus comme Pétronille qui sentait la menthe, et l’horreur du tabac ne les pousse plus à préférer à sa fumée celle de Belzébuth aux nuits du sabbat (Michelet).
Les anglo-américains ont apporté en France l’habitude de fumer en mangeant, et par imitation stupide les Français se sont mis à faire comme eux. Le muflisme des hôteliers, restaurateurs et gastronomes professionnels qui leur font de la publicité, ont trouvé un tel profit à ce nouveau snobisme qu’ils l’ont encouragé au lieu de le combattre. Les Français y ont perdu, avec une des formes de la politesse, le véritable goût de la table et surtout du vin, celui-ci ne s’accommodant nullement de l’odeur du tabac pour un vrai gourmet ; mais cette odeur s’accorde parfaitement avec le tord-boyaux des cocktails dont on s’abrutit de plus en plus.
Honteusement servile chaque puisqu’il y a un profit à tirer, le muflisme s’est appliqué à adopter les mauvaises choses anglo-américaines parce que la livre et le dollar primaient le franc. Il se rend méprisable au point de tolérer que les Américains fassent en Europe la chasse aux noirs comme ils la font chez eux ! On ne supporte pas encore que des noirs soient brûlés après avoir été arrosés de pétrole ; ça viendra peut-être. Dernièrement trente Américains ont été expulsés pour avoir chassé d’un restaurant un ouvrier nègre ; mais ça s’est passé en Russie. Les bolcheviks sont en retard dans les voies du muflisme. Pour attirer dans leurs rets la clientèle dorée du tourisme cosmopolite, les mercantis de « l’hostellerie » se font partout les plus féroces antibolchevistes et les plus ardents fascistes. On écarte des stations de montagne, où ils pourraient être efficacement soignés, les tuberculeux et les gazés du travail et de la guerre. Dans les villes de luxe et de plaisir, sur la « Côte d’Emeraude » et la « Côte d’Azur », il n’y a pas, il ne doit pas y avoir de malades, hors ceux qui paient dans les palaces 500 ou 1.000 francs par jour pour eux et 100 francs pour leur chien. A ce prix, les chiens ont aussi le droit d’être malades, mais pas la population indigène pauvre à qui les riches de tous les pays viennent apporter leurs microbes. « Il n’y a pas de tuberculeux chez nous ! » a répondu curieusement le maire d’une de ces villes-lupanars de la « Côte d’Azur » à une œuvre antituberculeuse qui demandait à organiser une fête au profit de ses malades. Dans ces villes, il n’y a que les « maîtres du monde », leurs maîtresses, leurs hommes d’affaires et leurs larbins qui comptent quand ils apportent leur argent à la roulette.
Faut-il continuer ? L’Encyclopédie tout entière n’y suffirait pas, tant son devenues universelles les formes du muflisme et tant elles ont contaminé la vie individuelle et sociale dans toutes ses manifestations. Le muflisme est infini, comme la sottise dont il est l’aspect le plus détestable. On n’a aucun mérite à distinguer ses turpitudes ; nous en sommes envahis, aveuglés, étreints, empoisonnés, assassinés. Il les étale avec l’affectation de l’ordure qui fume au soleil, en pleine route ; il faut qu’on les voie, qu’on les sente et même qu’on y mette le pied. Peut-on les ignorer quand on observe la place qu’il donne aux valeurs sociales : l’oisiveté dans les palais avec l’abondance et le luxe, le travail dans les taudis avec la privation et la misère !
On n’est pas moins édifié par le choix qu’il fait de son « élite » et sa façon de la « distinguer ». Cette élite, jadis, remplissait les pages du Gotha ; on la trouve maintenant, avec tons ses titres et qualités, dans l’Annuaire Officiel de la Légion d’Honneur. C’est un Bottin de 150.000 personnes dont les mérites sont tellement spéciaux qu’elles en portent le signe à leur boutonnière, afin que nul ne les ignore. Mais cherchez combien il y a de gens d’un vrai mérite attesté par leur vie ou leur œuvre, dans cette interminable liste de gens trop « distingués » où l’on rencontre, en revanche, toutes les variétés de parasites sociaux et de malfaiteurs publics évoluant dans les assemblées politiciennes, à la Bourse, dans les journaux, dans les lupanars à la mode, et même la valetaille de ces lupanars — n’est-on pas en démocratie ? — des surveillants de la roulette et des rinceurs de bidets ! Il y a plus de dignitaires de la Légion d’honneur dans les prisons que dans les assemblées savantes. Les journaux débordent des récits de leurs scandales, et ce n’est pas toujours sur les plus malpropres qu’on a ainsi la révélation de mérites bien « spéciaux » au-dessus de ceux du vulgaire ; c’est le plus souvent sur les moins adroits et les moins puissants, ceux qui n’ont pas su friponner assez dans le grand pour que leur malhonnêteté devienne de la vertu. Ainsi, l’âne payait pour le lion chez Les animaux malades de la peste.
Caliban n’ayant pas su réaliser une véritable démocratie capable de se diriger — nous ne disons pas : de se laisser gouverner — dans les voies d’une véritable élite, il était inévitable que le muflisme dominât de plus en plus cette démocratie et la fît tomber à sa forme la plus basse : l’ochlocratie, où règne le « nervi » parvenu. C’est sa façon de nous faire revivre les temps de la Rome antique. On a assisté, depuis 1914, à la montée fangeuse de cette ochlocratie. Toute une racaille, « réhabilitée » dans l’emploi des « nettoyeurs de tranchées » et enrichie des dépouilles des charniers est arrivée à l’assaut. Des traine-savates qui faisaient jadis leur dimanche d’une portion de chat à cinq sous dans une gargote infâme et couchaient à la corde ou sous les portes, sont devenus des nababs pour qui rien n’est assez bon, assez choisi, assez cher dans les restaurants, les palaces, les casinos, où ils étalent leurs élégances de « bête puante » non décrassée. Thénardier, que tous les parfums de Coty ne peuvent purifier de l’odeur des cadavres dont il a fait les poches, mais échappé à la vermine de la rue Blomet et au bagne, grâce à son argent, est devenu le Pétrone de ce que M. Thomson a appelé « l’aristocratie républicaine » au lendemain de Panama. Il n’en demeure pas moins obséquieux devant tout aventurier à particule, respectueux, par suite d’une vieille frousse atavique, de toutes les formes aristocratiques périmées qu’il voudrait voir ressusciter pour lui. Il veut que tout soit « royal » ou « impérial » de ce qui est à son usage et dans ses fréquentations ; ses châteaux, ses automobiles, ses meutes que des évêques bénissent, car il n’est plus maintenant un mécréant. Ses chemises, ses chaussettes, ses cure-dents, sortent de chez des fournisseurs royaux. Il pisse dans un pot de chambre armorié et, couchant dans un lit authentique de Mme Dubarry, il rêve qu’il fait l’amour à la façon de Louis XV. Les fesses offertes à tout plus puissant que lui qui voudra bien mettre son pied dedans, il se rattrape sur ses administrés, ses ouvriers, ses domestiques. Jadis, il voulait « troubler la fête » avec eux ; maintenant il y participe avec un mépris souverain pour les « espèces inférieures » qui répugnent à ses escroqueries ou sont des « cavés » qui « ne savent pas y faire » ! Contre ces « espèces », avec lesquelles il serrait les poings et se tenait les coudes dans les bagarres contre la police, il rêve maintenant de voir travailler les mitrailleuses. C’est lui d’ailleurs qui devenu ministre les commandera aux prochaines bagarres.
Cicéron disait :
« Ceux qui commandent doivent tout rapporter au bonheur de ceux qui sont placés sous leur autorité. »
Les bateleurs du muflisme mettent volontiers cette phrase en manchette dans leurs journaux ; en même temps ils favorisent les coups de force et les usurpations des mauvais commandants dont, ils reçoivent la sportule. Louis Blanc a dit de façon moins lapidaire :
« Je sais bien que le commandement devrait être modeste. Entre le plus grand et le plus petit des hommes, la différence n’est pas telle que la volonté de l’un puisse légitimement absorber celle de l’autre. L’orgueil n’est permis qu’à celui qui obéit ; quant à celui qui commande, il ne saurait se faire pardonner cet excès d’insolence qu’à force d’humilité. Mais de telles vérités sont trop hautes pour une société ignorante et corrompue. »
Elles le sont trop pour le muflisme, sauf en paroles, car il les adopte dans sa blagologie démocratique, mais il les nie dans les faits. Lamartine, de son côté, disait à ce muflisme, en1834, quand il débutait dans la politique :
« Ce n’est point pour les vertus qu’il possède qu’on peut aimer le peuple, on doit l’aimer vicieux et grossier, on doit l’aimer pour les vertus qu’il n’a pas et qu’il aurait certainement si on ne lui eût ravi sa part d’éducation et mesuré d’une manière inique son droit au bonheur. »
Il eût été plus facile d’attendrir un tigre sur le sort de sa proie que de faire entendre ces choses là aux fusilleurs des canuts de Lyon et aux conquérants de l’Algérie. Il serait encore plus vain de vouloir les faire entendre aujourd’hui aux applicateurs des « lois scélérates » et aux guillotineurs des révoltés de Yen-Bay. Aussi bien sont-elles impossibles sous quelque gouvernement que ce soit. Tout gouvernement est un dictateur en puissance, un pouvoir toujours arbitraire quelle que soit son étiquette, sous peine de ne plus subsister devant la libre manifestation des opinions et des volontés. Les gouvernements ne peuvent que servir le muflisme et nous venons de voir que plus ils sont démocratiques, plus ils sont ses valets. Au contraire de ce que disait A. Dumas, même sans ministres, il n’ y a pas de bon gouvernement.
L’humanité arrivera-t-elle un jour à une quatrième évolution qui mettra fin à la muflerie collective, socialisée dans le muflisme ? Pour cela, il faudra plus qu’une révolution remplaçant une classe par une autre classe, des dictateurs par d’autres dictateurs, des mufles par d’autres mufles. Il faudra que se forment des consciences possédant avec le sens de leur dignité celui de la dignité des autres et ayant la volonté de la justice et de la liberté. Quand Caliban saura ne plus obéir aux « êtres puants » qui l’exploitent, quand il ne s’adaptera plus à leur muflisme, quand il aura compris surtout que rien ne servira de mettre à la place du muflisme bourgeois et démocratique un muflisme prolétarien : alors, la quatrième évolution, celle de la libération de l’humanité par l’intelligence et la bonté pourra commencer.
Pour ne pas avoir à se mépriser soi-même, il faut lutter de toutes ses forces contre le muflisme, lui résister le dénoncer le ridiculiser, le flétrir en toutes circonstances. Ce n’est pas toujours agréable. En terminant cet article nous en avons un mauvais goût à la bouche et une tristesse à l’esprit ; nous éprouvons une sorte d’humiliation à nous dire qu’un si piteux tableau est celui de la sottise humaine. Mais cette lutte est indispensable ; elle est une œuvre de prophylaxie sociale, de défense de la dignité humaine à laquelle tout individu qui n’est pas un « être puant » doit travailler, quitte à mettre des bottes et à se boucher le nez, comme lorsqu’on descend dans un égout.
— Edouard ROTHEN
MUSIQUE
n. f.
Le mot vient du grec mousiké qui a fait le latin musica. Ce qu’il désigne est bien antérieur, car il a été, dès le premier souffle de la vie, la voix du rythme universel. Movetur musica mundus, a dit Apulée :
« Le monde se meut harmonieusement. »
Dès que l’on a donné un nom à la musique et que l’on en a fait un art particulier, on a restreint sa portée et on lui a appliqué des définitions plus ou moins arbitraires aussi nombreuses que celles de l’art en général et encore plus conventionnelles. Car la musique, de par sa nature et son caractère universel, est l’art le plus indépendant de la création humaine, le plus objectif par son existence propre, le plus subjectif par l’influence qu’il exerce et il échappe aux assujettissements de la représentation plastique comme à la fixité et à l’insuffisance des matérialisations. Le sens de l’œuvre musicale, son interprétation, sa compréhension, sont variables à l’infini, même pour ce qu’on appelle « la musique à programme », et l’imagination leur ouvre un champ illimité. Par contre, ceux de l’architecture, de la sculpture, de la peinture, sont fixés dans la matière, les formes, les couleurs qui composent l’édifice, la statue, le tableau. L’imagination la plus libre ne peut faire que l’édifice soit en métal s’il est en pierre, que la statue ait les caractéristiques du corps de l’homme si elle représente une femme, et que, sur le tableau, le noir soit du blanc. C’est poétiquement — musicalement — que le nuage changeant d’Hamlet est une belette, une baleine, un chameau, et pourrait être mille autres choses encore, mais plastiquement il n’est rien, il n’existe pas.
Si l’art est la vie parce qu’il en est la matérialisation dans le faire universel, la musique est encore plus la vie parce qu’elle en est le principe animateur, qu’elle est l’âme universelle. Entendons-nous ici sur le mot âme qui reviendra souvent dans ce qui suit. L’âme, en dehors de toutes théories conventionnelles, est l’élément spirituel de la vie, le « moi » intime, la sensibilité particulière de chacun des êtres, quels qu’ils soient et quelle que soit leur place dans les classifications des règnes et des états de la nature tout entière. Nous admettons fort bien, dût l’insane vanité humaine s’en indigner, qu’un caillou, un brin d’herbe, une huître, le vent qui passe, peuvent posséder une âme plus complexe et plus sensible que celle de certains hommes. La musique est l’expression la plus intime, la plus profonde, la plus caractéristique de la vie parce quelle est le langage le plus intime, le plus profond, le plus caractéristique de cette âme, de toutes les âmes sensibles en qui elle crée et multiplie l’intensité et l’éloquence des sentiments. C’est pourquoi tout langage est musique et, lorsque l’homme, en particulier, ne trouve plus dans la parole articulée, écrite ou mimée, un exutoire suffisant à ses émotions, il chante, il ajoute le langage musical proprement dit à la poésie, à la pantomime, à la danse, ou il n’a recours qu’au chant, à la « musique pure », pour mieux exprimer l’intimité de son émotion. Le chant, la toute simple mélodie qui jaillit spontanément des profondeurs de l’être, dit plus pleinement, plus directement que n’importe quel mot ou geste, ce qui déborde de lui : douleur ou joie, agitation ou calme, inquiétude ou sérénité, colère ou paix.
On a méconnu la musique, on l’a diminuée et rabaissée on peut dire indignement lorsqu’on l’a définie ainsi :
« L’art de combiner les sens pour le plaisir de l’oreille. »
On en a fait une sorte de titillation auriculaire mettant en bonne humeur, comme d’autres, pratiquées sous le menton ou sur l’épigastre, provoquent le rire. C’est là une définition de dilettanti, de petits maîtres, de mondains qui « musiquent » pour se distraire, et il faut avoir la cervelle vide d’un snob, la sentimentalité éculée d’un satisfait installé dans la bauge sociale, il faut être impénétrable à toute véritable émotion pour s’en satisfaire. Voit-on un Beethoven, qui portait en lui toutes les douleurs, toutes les joies, toutes les révoltes et joutes les extases, qui saisissait « le destin à la gueule » lorsqu’il « frappait à la porte », qui révélait à l’humanité une étendue d’émotion et une puissance d’expression encore inconnues d’elle, qui possédait une idée si sublimement haute de sa mission de musicien qu’il disait :
« Celui qui sentira pleinement ma musique, celui-là sera délivré des misères que les autres hommes traînent après eux. »
Voit-on ce Beethoven, dont l’ouïe était abolie, « combinant les sons pour le plaisir de l’oreille »?... Mais cette définition a toujours été celle des académies, des dictionnaires, des manuels scolaires, des professeurs et de tous ceux qui, disent-ils, n’ont pas de temps à perdre à la « bagatelle » de la musique, ou qui en vivent. Elle a fait réduire, pour l’immense majorité des hommes, le plus admirable langage de l’âme à un objet futile, la plus vivante source d’activité humaine à une distraction inférieure bien moins intéressante, aujourd’hui, que la boxe et la belote. Elle en a fait un « art d’agrément » pour les personnes « distinguées », un amusement plus ou moins canaille pour la masse des hommes déshabitués de chercher en eux la flamme toujours vivante au sanctuaire de leur subconscient. « Est-ce donc un crime si grand d’écouter la voix de son âme ? » demande Wotan, dans la Walkyrie. Le crime est de ne pas écouter cette voix. Wotan cause la chute des dieux en restant sourd à la sienne. C’est le pire malheur pour les hommes de ne pas savoir entendre la leur ; ils y perdent la direction d’eux-mêmes et leur liberté.
Dans le domaine du sentiment, la musique est l’art optimiste par excellence. Combien d’abandonnés, de désespérés, n’a-t-elle pas sauvés, alors que plus rien ne les rattachait à une vie qui « ne méritait plus d’être vécue » ! Combien d’âmes elle a ressuscitées en leur apportant la révélation d’une intimité de l’être ignorée jusque là ! A combien de cœurs généreux, rendus insensibles et indifférents par l’acuité de la douleur, elle a ouvert les espaces illimités de ce panthéisme sublime où l’être meurtri et désespéré, n’attendant plus rien d’un particularisme grégaire et égoïste, se fond dans l’âme universelle pour un grand rêve d’amour ! Berlioz dit :
« La musique et l’amour sont les deux ailes de l’âme. »
Et quand la douleur a épuisé les cris, les clameurs, toutes les violences du désespoir, n’a-t-elle pas le chant pour trouver son suprême apaisement ? Sombrées dans la folie, des mères qui, comme Rachel, « ne veulent pas être consolées », chantent sur le corps de leur enfant avec l’illusion qu’elles bercent son dernier sommeil. Ophélie chante en apportant des fleurs à celui qui a « à sa tête un tertre d’herbe verte et sur ses pieds une pierre ».
Berlioz voyait dans la musique « l’art d’émouvoir par des combinaisons de sons les hommes intelligents et doués d’organes spéciaux et exercés ». Il ajoutait :
« Définir ainsi la musique, c’est avouer que nous ne la croyons pas, comme on dit, faite pour tout le monde. »
Il observait que :
« Un grand nombre d’individus ne pouvant ressentir ni comprendre sa puissance, ceux-là n’étaient pas faits pour elle et, par conséquent, elle n’était point faite pour eux. »
Nous verrons mieux au mot Sens comment des individus ne ressentent et ne comprennent pas la musique ; disons seulement ici que lorsque Berlioz la définit l’art d’émouvoir « les hommes intelligents et doués d’organes spéciaux et exercés », lorsqu’il déclare qu’elle n’est pas « faite pour tout le monde », il ne la voit que dans ses rapports avec le groupe restreint d’hommes qui la cultivent comme un art et, compositeurs, exécutants ou amateurs, sont, sinon intelligents et doués d’organes spéciaux, du moins exercés dans la musique et en possèdent plus ou moins bien la technique. Il est certain qu’un grand nombre d’individus ne sont pas faits pour la musique, — ce sont souvent ceux qui s’en occupent le plus — ; il est inexact de dire qu’elle n’est pas faite pour tout le monde et qu’il est nécessaire d’être particulièrement intelligent et doué d’organes exercés pour être ému par elle. Comme l’a écrit M. Jean d’Udine :
« La musique vit beaucoup plus de ses communications mystérieuses avec le cosmos, qu’elle rend, pour ainsi dire, perceptible à nos sens, que par les arrangements ingénieux des douze notes de la gamme chromatique. »
Plus simplement nous dirons : la musique, comme tous les arts et encore plus que les autres arts, s’adresse à la sensibilité. Comme l’a dit Berlioz lui-même, elle est « à la fois un sentiment et une science », mais elle est, avant tout un sentiment, et c’est pourquoi des hommes, parmi les plus grossiers, les plus dépourvus de culture, et des animaux mêmes, la sentent avec une intensité parfois inconnue même à des maîtres de la science musicale.
La musique, voix de l’âme universelle, est dans toute la nature. Elle puise la variété de ses accents dans le rythme particulier aux éléments et aux êtres. (Voir Rythme). Elle est la parole secrète, tumultueuse ou caressante, de 1’ouragan et du zéphyr, de la mer et de la source, de la forêt et du brin d’herbe, le rugissement du grand fauve et le murmure imperceptible de l’insecte, l’éruption du volcan et la respiration de la fleur. Le langage des animaux est musical ; il est donc incontestable qu’ils sont sensibles à la musique. Certains le sont tout particulièrement. On a cité de nombreux cas de leur hypersensibilité musicale. Berlioz a parlé d’une chienne qui hurlait de plaisir en entendant certaines tonalités sur le violon.
« Le docteur Mead a raconté l’histoire d’un chien que l’on fit mourir au milieu de convulsions en prolongeant un air joué sur le violon, constamment dans la même tonalité. » (Dr Ph. Maréchal)
Grétry, Paganini, ont observé des araignées que la musique attirait. Les exemples sont connus de prisonniers ayant apprivoisé des rats et des araignées par des chants. Des serpents se balancent sur leur queue au rythme de la musique. Des chats sont attentifs à des concerts plus que des personnes. Ils attendent quand le morceau de musique est terminé et leur regard semble demander qu’il recommence. Il en est qui grognent et se hérissent en entendant certains instruments, la mandoline en particulier, montrant ainsi bien plus de goût que tant de gens qui raclent lamentablement les cordes de ce pauvre instrument.
Comme les animaux, l’homme a trouvé la musique en lui, dans la circulation rythmée de son sang. Elle a été son premier langage lorsqu’il a eu besoin d’extérioriser son rythme intérieur, bien avant qu’il eût trouvé le langage articulé. Comme toute la nature, il s’est mis à chanter, non seulement par imitation de ce qu’il entendait autour de lui, mais surtout parce qu’il avait quelque chose de personnel à exprimer et sa partie à tenir dans le concert universel. Le sens musical est, chez l’homme primitif, comme les autres sens, beaucoup plus développé que chez les civilisés. M. Delafosse a raconté que chez les nègres, « quels que soient les chanteurs, hommes ou femmes, professionnels ou amateurs, les voix et les oreilles sont toujours remarquables par leur justesse ; il est extrêmement rare d’entendre une fausse note et, s’il s’en produisait une, elle est aussitôt couverte par les huées des autres chanteurs ou simplement des auditeurs. Que les chœurs soient exécutés à l’unisson ou en parties, l’harmonie est généralement impeccable ».
D’après Darwin, l’homme a appris à produire des sons musicaux comme moyen de séduction, pour répondre au besoin de l’amour aussi impérieux que ceux de manger, de boire et de dormir. Ainsi qu’aux animaux, ce besoin lui a fait découvrir le sens de la beauté. Il s’est ingénié à briller et à triompher dans les tournois d’amour par sa parure, l’expression passionnée de sa physionomie, de ses gestes et de sa voix. Mais tandis que la parure, la physionomie, les gestes, avaient des moyens limités, la voix pouvait multiplier à l’infini les nuances de ses sentiments. Lorsque l’homme eut trouvé le langage articulé qui devait lui permettre de donner un sens de plus en plus précis à l’expression de sa pensée, il conserva le son musical pour mettre son âme dans son langage. Ce son musical est dans les intonations de la prononciation. Les unes sont particulières à l’individu et variables suivant les états de son âme. Les autres, qui constituent l’accent, sont plus générales, communes aux habitants d’une région ; elles expriment l’âme collective transmise à l’individu par son hérédité. L’accent donne sa couleur au langage. Il en fait une mélodie gazouillante ou une morne mélopée ; il donne aux mots, qui ont grammaticalement, pour tous les hommes, un sens exactement déterminé, une variété de tons si grande que, « plaisir de l’oreille » pour les uns, il est insupportable aux autres, suivant les latitudes. Ainsi, l’accent donne au français une infinité de nuances musicales, sympathiques ou désagréables, suivant qu’il est parlé en Picardie ou en Provence, en Bretagne ou en Lorraine, en Angleterre, en Russie, en Chine ou dans le Centre Africain. Il en est de même pour la musique proprement dite et pour toutes les formes de la beauté ; elles ne sont pas également agréables et admirées dans toutes les contrées et chez tous les peuples (Voir Beauté).
Par son double caractère individuel et collectif, contradictoire en apparence, complémentaire en réalité, la musique est l’art social par excellence. Il n’est pas de circonstances de la vie des individus, et des sociétés où elle n’ait sa place ; il n’est pas de peuples qui ne soient ou n’aient été musiciens. Ceux qui ne le sont plus ont perdu leur âme, c’est-à-dire le véritable sens de la liberté et de la vie. Tous les peuples primitifs ont été musiciens et le sont demeurés. La musique continue à s’associer chez eux à la poésie et à la danse. C’est à eux qu’on doit le folklore, ces chants populaires dont la musique n’a pas changé, mais sur lesquels les siècles ont mis des paroles différentes. Chez tous les peuples, jadis, on chantait en travaillant, quelle que fut la besogne. Le chant rythmait et allégeait l’effort physique. La machine a tué le chant ouvrier ; la société moderne a tué le chant populaire avec la liberté. On chantait non seulement pour épancher sa joie, mais aussi pour calmer son mal pendant les opérations douloureuses : tatouage, circoncision, infibulation, accouchement, et durant les cérémonies funéraires. Depuis les récits d’anciens voyageurs jusqu’au roman contemporain de Jean Giono : Un de Baumuges, on a raconté l’influence profonde de la musique sur les natures primitives, ce qu’elle éveille en elles d’élan, de compréhension, d’affinités insoupçonnées, les entraînant avec une force invincible à une élévation et une pureté de sentiment, à un infini de miséricorde qu’aucune foi religieuse ne pourrait produire. C’est par des chants que les missionnaires artificieux obtenaient les conversions des populations américaines et non par leur hypocrite morale. C’est par le tam-tam et le marimba des noirs transportés comme esclaves en Amérique que se lièrent leurs sympathies et que se fit leur accord avec les indigènes exploités comme eux. Le poète allemand Seume, qui avait beaucoup voyagé, disait, dans un de ses poèmes :
A l’unisson des voix, il n’est point de méchants. »
Et la paysanne de la Douloire, qui ne sait pas trouver ses mots pour s’exprimer, dit au joueur d’harmonica dont la musique apporte le pardon et le bonheur dans la maison consternée :
« Tu dois avoir le cœur bon et blanc. » (Jean Giono)
La musique des primitifs n’est pas seulement vocale.
Ils ont des instruments différents suivant les régions. On en trouvera l’énumération et la description par Mr Zaborowski, dans la Grande Encyclopédie (article Musique). Les instruments des peuples civilisés ne sont que ceux, perfectionnés, des primitifs.
La musique fut donc la voix de l’homme comme de toute la nature avant de devenir l’art des sons. Elle ne se séparait pas alors, de la poésie et de la danse. Les premiers poètes furent des chanteurs dans tous les pays du monde, et les premières danses s’accompagnèrent partout de chansons. Le vers déclamé, la prose littéraire, la danse silencieuse et hallucinante, ne vinrent qu’après et sortirent d’un art de plus en plus conventionnel, de mœurs de plus en plus étrangères a la nature. De l’union intime de la poésie et de la danse avec la musique, de leur commune participation à l’expression des sentiments humains, naquit le théâtre (voir ce mot), représentation multipliée de ces sentiments dans le lyrisme collectif. Mais de bonne heure le théâtre ne traduisit plus la vie que dans des formes artificieuses où la poésie, la danse et la musique ne trouvèrent plus un libre épanouissement.
La musique devint un art quand l’homme voulut varier les moyens d’expression du langage musical par l’imitation esthétique des voix de la nature et des intonations du langage, notamment au moyen des inventions et des applications de la musique instrumentale. Elle arriva ainsi à être « dans nos sociétés raffinées quelque chose d’un peu monstrueux », comme l’a dit Mr Zaborowski, mais ce n’est pas à la musique elle-même qu’on doit attribuer cette monstruosité, pas plus que la démoralisation de l’humanité reprochée aux arts en général par J.-J. Rousseau et Tolstoï.
L’étroite relation qui lie la musique à la vraie civilisation fait comprendre pourquoi et comment on la dédaigne dans la civilisation à l’envers qui sévit actuellement. Le dédain serait toutefois moins grand sans la méconnaissance qu’on entretient chez ceux qui seraient susceptibles d’éprouver l’action de la musique. Mais on ignore la place immense qu’elle a occupée dans l’histoire de l’humanité et qu’elle occupe toujours, loin du bruit de la foule, dans la retraite méditative et enchantée des âmes.
HISTOIRE DE LA MUSIQUE.
Romain Rolland, au début de son ouvrage Musiciens d’autrefois, dit :
« La musique commence à prendre dans l’histoire générale la place qui lui est due. »
Il a ajouté :
« Chose étrange qu’on ait pu prétendre à donner un aperçu de l’évolution de l’esprit humain, en négligeant une de ses plus profondes expressions. »
Plus que tous les autres arts, la musique est indicatrice de la vie générale et mérite d’être connue dans l’influence qu’elle a exercée. Car si les arts ne fleurissent généralement que dans les temps de paix et de prospérité, lorsque les peuples goûtent un bien-être et des satisfactions relatifs, la musique ne cesse en aucun temps d’être l’exutoire des âmes, d’exprimer la sensibilité humaine. C’est souvent aux époques les plus calamiteuses qu’elle exerce sa plus grande action, qu’elle est avec le plus de pathétisme la glande voix de la Miséricorde, qu’elle sonne avec le plus d’éclat la fanfare de la nouvelle Espérance. R. Rolland, dont l’œuvre sur la musique est si hautement éclairée de science et si chaudement inspirée d’amour, a montré les rapports « constants » qui lient la musique aux formes de la société et les « relations étroites » de son histoire avec celle des autres arts. Loin d’être séparés par les limites où voudraient les enfermer les théoriciens, les arts « se pénètrent mutuellement », suivant le temps et les circonstances, l’un ou l’autre parle parfois pour tous. N’ont-ils pas tous la même source, celle du cœur et de l’esprit ? « La bonne peinture est une musique, une mélodie », disait Michel Ange. Plus que les autres arts, la musique nous livre « l’expression toute pure de l’âme, les secrets de la vie intérieure, tout un monde de passions qui longuement s’amassent et fermentent dans le cœur avant de surgir au grand jour. Souvent, grâce à sa profondeur et à sa spontanéité, la musique est le premier indice de tendances qui, plus tard, se traduisent en paroles, puis en faits ». Ainsi, « la Symphonie héroïque devance de plus de dix ans le réveil de la nation germanique ». Le geste de Beethoven déchirant sa dédicace de cette symphonie à Bonaparte lorsqu’il découvrit que celui-ci n’était « qu’un empereur », fut celui, dix ans après, de l’Allemagne levée contre le tyran.
Dans certains cas, « la musique est le seul témoin de toute une vie intérieure, dont rien ne se traduit au dehors ». Alors que l’histoire ne fait connaître que les sottises dirigeantes qui firent la déchéance de l’Italie et de l’Allemagne au XVIIème siècle, l’œuvre de leurs musiciens fait comprendre le relèvement de leurs peuples aux XVIIIème et XIXème siècles. En Allemagne, cette œuvre accumulait en silence « les trésors de foi et d’énergie des caractères simples et héroïques... amassant lentement, opiniâtrement, des réserves de force et de santé morale », malgré toutes les misères apportées par la Guerre de Trente ans. En Italie, le génie qui avait donné tant d’éclat à la Renaissance et semblait épuisé, se continuait dans la musique et se répandait dans l’Europe entière, attestant « l’austère grandeur d’âme et la pureté de coeur qui pouvaient se conserver parmi la frivolité et le dévergondage des cours italiennes ». Dans les temps plus lointains appelés ceux de la « barbarie », au milieu des dévastations et des horreurs de toutes sortes qui firent la décomposition de l’Empire romain, « la passion de la musique rapproche les vainqueurs barbares et les vaincus gallo-romains ». C’est en pleine époque barbare que naquit, au IVème siècle, le plain chant, « art aussi parfait, aussi pur, que les créations les plus accomplies des âges heureux » et qu’il donna, dans les deux siècles suivants, les chefs-d’œuvre du chant grégorien. Alors que le monde était bouleversé, « tout respire, dans ces chants, la paix et l’espoir en l’avenir. Une simplicité pastorale, une sérénité grave et lumineuse des lignes, comme dans un bas-relief grec ; une poésie libre, pénétrée de nature ; une suavité de cœur infiniment touchante : voilà cet art sorti de la barbarie et où rien n’est barbare ». Comment peut-on prétendre écrire l’histoire quand on ignore ce que fut cet élément si important de la psychologie humaine, la musique, et ce qu’elle produisit en entretenant « la continuité de la vie sous la mort apparente, l’éternel renouveau sous la ruine du monde ? » R. Rolland, à qui nous avons emprunté les citations qui précèdent, constate avec raison que la place de la musique est « infiniment plus considérable qu’on ne le dit d’ordinaire » dans la suite de l’histoire.
Les Grecs, chez qui toutes les formes de la vie étaient exaltées dans leurs expressions les plus pures, ne pouvaient manquer de faire une très grande place à la musique. Elle avait pour eux ce sens si magnifiquement large qu’ils donnaient à la grammaire et dont les limites, dans le domaine de l’esprit, n’étaient que celles de la nature. Elle englobait tout ce qui concourait au perfectionnement des rapports humains et à l’embellissement de la vie. En même temps que l’art des sons, elle comprenait la poésie, l’éloquence, la danse et toutes les sciences présidées par les Muses. Le mot muse venait d’un verbe dont le sens était : penser, exalter, désirer. Mousikè venait de muse et embrassait toute la pensée dans la multiplicité de ses activités. Tout était musique dans le vaste panthéisme qui faisait l’âme grecque fondue dans l’harmonie du ciel, de l’air, des couleurs, des formes et de l’esprit. Elles participaient à la politique par son influence sur les mœurs. Platon disait qu’on ne pouvait faire de changement dans la musique qui n’en fût un pour l’Etat, et prétendait que chez les Egyptiens on appelait musique le règlement des mœurs et des bonnes coutumes. Il faisait dans l’éducation deux parts, celle du corps (gymnastique), celle de l’âme (musique). Ignorer la musique était un défaut d’éducation. Son enseignement était très soigné en raison de son influence morale. On prétendait qu’elle guérissait de nombreuses maladies. Il n’est pas douteux que sur bien des malades elle exerce une influence bienfaisante, comme on l’a vérifié de nos jours, et il est encore moins douteux que beaucoup de choses sont à réapprendre aujourd’hui sur l’influence physiologique et psychologique de la musique, ce qu’on réapprendra lorsqu’on voudra bien voir en elle un art supérieur à celui de tirer le canon. La légende est demeurée que la musique adoucissait les mœurs rudes des Arcadiens. Les nourrices avaient des chants, les nœnia, dont elles berçaient les nourrissons. La musique présidait à toutes les circonstances de la vie antique : naissances, mariages, décès, fêtes particulières et publiques. Ces dernières étaient souvent des concours où musiciens et chanteurs étaient couronnés. Le travail, à la ville et à la campagne, s’effectuait avec des chants. Les nomes accompagnèrent d’abord la promulgation des lois avant de devenir des poèmes à la gloire d’Apollon. Des hymnes et péans célébrèrent les dieux. Les dithyrambes en l’honneur de Dionysos furent la première forme de la musique dramatique.
La musique ne tint pas une moins grande place chez les peuples orientaux. Chez les Egyptiens, et surtout les Assyriens, elle participa à la pompe des cérémonies. Les monuments de ces peuples ont fréquemment représenté des troupes d’instrumentistes et de chanteurs accompagnant les armées en marche ou les cortèges des prêtres et des rois. Leurs instruments de musique semblent avoir eu plus de puissance que chez les Grecs et les modernes. On commit celle attribuée aux trompettes des Hébreux qui firent tomber les murailles de Jéricho. Préférons à cette légende de la barbarie biblique qu’accompagne le récit du massacre de toute une population, celles grecques, autrement poétiques, d’Orphée, poète-philosophe-musicien, image du « bon berger », qui charmait de ses chants les animaux, les plantes et les rochers, et d’Amphion, qui faisait s’élever magiquement les murailles de Thèbes au son de sa lyre. En Chine, la musique parait avoir eu, jadis, un grand éclat et avoir été plus parfaite qu’aujourd’hui. Depuis les temps les plus anciens de sa civilisation, ce pays a eu dans son gouvernement une organisation officielle, véritable ministère, chargée des choses de la musique et que l’empereur Fou-Hi aurait fondée en 3.300 ans avant J-C.. Tous les peuples asiatiques ont été musiciens de bonne heure et paraissent avoir possédé un art musical aujourd’hui arrêté dans son développement par la décadence de leur civilisation. L’Indochine a des chanteuses professionnelles. Au Siam, les populations out conservé l’usage de se réunir pour former es chœurs et chanter en voyageant. Nous ne savons si, au Japon, l’adaptation aux mœurs européennes, poursuivie depuis un demi-siècle, a modifié les formes antiques de la musique qui étaient celles de la Chine. Les Arabes avaient une musique non moins caractéristique que leur art en général. Elle fut très brillante au temps des califes, mais elle fut diversement influencée par les différents peuples dont ils firent la conquête. Par contre, l’Espagne a gardé dans sa musique, comme dans sa langue, ses mœurs et ses autres arts, leur marque profonde. En Occident, les peuples avaient des traditions musicales non moins lointaines. Les bardes étaient les musiciens nordiques ; leurs chants entraînaient les guerriers, célébraient la victoire, la gloire des héros et animaient la joie populaire. La Gaule avait eu des écoles publiques de musique bien avant que Charlemagne et les rois Carolingiens fissent enseigner le chant d’église. Ce n’est pas l’Eglise qui a appris la musique au peuple, elle l’a reçue de lui.
On peut faire remonter le commencement de l’histoire de la musique dans le monde européen à celui des temps historiques. On ne possède aucun document musical de ce commencement, mais il est conté dans les légendes homériques, et il n’est pas plus audacieux de prétendre que certaines mélodies transmises par la voix populaire nous viennent du temps de ces légendes que d’affirmer la transmission de certaines de ses formes poétiques et de certaines danses. Orphée, représenté sous les traits d’un joueur de cithare, est la première personnification de ce fonds poétique et musical en même temps que philosophique et religieux. Plus ou moins mythiques furent aussi les musiciens Amphion, Arion, Linus, Musée, dont les noms nous sont parvenus. Avec Alcée, Sapho, Archiloque, Alcman, Coltinas, Tyrtée ct les rapsodes Phémius, Thamyris, Terpandre, la musique reçut ses premiers perfectionnements techniques. Stésichore, Simonide, Pindare, Bacchylide, Anacréon, la firent briller d’un éclat aussi vif que celui des autres arts au siècle de Périclès. Epiménide aurait été l’introducteur du chant dans les cérémonies religieuses, Thales de Milet, Solon, Platon, Empédocle, et l’on peut dire tous les philosophes et poètes, furent des musiciens en raison des principes dont nous avons parlé. On a retrouvé certains textes musicaux de l’antiquité, mais ils sont indéchiffrables pour notre temps qui n’en possède pas la clef et cette musique, malgré toutes les affinités que l’antiquité a transmises au monde moderne, lui est aussi étrangère que celle des Arabes des Chinois ou des Polynésiens.
Les moyens d’expression de la musique antique ne pouvaient être que des plus simples ; on en était réduit aux voix humaines et à quelques instruments dont le rôle ne pouvait guère dépasser l’accompagnement du récitatif ou mélopée. Cette mélopée, dont le genre est aujourd’hui perdu, était, d’après Aristote dans sa Poétique, une partie essentielle de la tragédie et consistait dans un chant uni et simple comme le chant grégorien. Au XVIème siècle, lorsque les Italiens ressuscitèrent la tragédie, les acteurs chantèrent les vers comme une mélopée, et la tradition se transmit entre eux. Ce ne fut qu’après Corneille et Racine que l’on se mit à déclamer le vers à la façon actuelle. Voltaire a comparé la mélopée tragique au récitatif de Lulli.
Les théories musicales des Grecs se transmirent aux Romains avec les autres formes des arts. Le goût de la musique fut très grand à Rome. Les empereurs, Néron, Titus, Hadrien, Caracalla, Héliogabale, Sévère, etc..., furent des musiciens, compositeurs et virtuoses. Les théories gréco-romaines de la musique sont définies dans une vingtaine de traités allant d’Aristote à l’Institutio musica, de Boèce (VIème siècle) en passant par De Architectura, de Vitruve, et le Dialogue sur la musique, de Plutarque. Ces théories sont restées obscures pour les temps modernes. Ce qui valut mieux, ce fut la musique elle-même qui se transmit de l’antiquité au moyen âge par le plain-chant pour donner aux aspirations populaires l’instrument qui les exprimerait avec tous les élans et les ferveurs de l’âme. Lorsque l’Eglise, centre intellectuel dominateur de l’époque, s’emparerait du plain-chant pour servir à ses pompes, il resterait au peuple la chanson (voir ce mot). C’est elle qui a été son âme. Cette âme a été morte quand elle n’a plus chanté ; elle a été pis que morte lorsqu’elle s’est laissé flétrir par ce qu’on appelle la « musique populaire », forme la plus captieuse de l’art populaire imaginé pour l’abrutissement des foules.
La chanson a été la grande expression lyrique du moyen âge par la réunion de la musique, de la poésie et de la danse. Ce lyrisme, alors collectif, exprimait toutes les espérances humaines ; l’individualisme des temps modernes ne l’avait pas encore étouffé. Le peuple enter avait gardé dans les premiers siècles chrétiens l’habitude des hymnes latines qui se chantaient aux fêtes religieuses et qui produisirent le plain-chant. Mais l’amour y tenait la plus grande place. La satire s’y mêla de bonne heure au point que dès le VIème siècle, les conciles éprouvèrent le besoin de fulminer contre les licences dont les églises étaient le théâtre. Les chants satiriques étaient si audacieux que Charlemagne prit la décision de les interdire, même hors des églises. Les plus anciennes chansons françaises appartenaient, suivant leur origine ou leur forme, aux genres de la rotruenge (chanson à refrain, apparemment d’origine celtique), la serventois (venue du Midi et dont le caractère primitif s’est perdu), l’estrabot (ou strambotto italienne, estribote espagnole, d’esprit satirique). Plus ou moins sorties de ces trois genres, et de plus en plus influencées par l’esprit courtois, se formèrent les chansons d’histoire ou de toile qui furent les premières romances et, on peut dire, la première forme de la musique dramatique. Elles étaient chantées par les femmes cousant ou filant, telle Marguerite chantant la chanson du Roi de Thulé. De même les chansons à personnages ou chansons de mal mariée, dont le sujet était le mariage et les plaintes des femmes mécontentes de leurs maris ; l’aube, chant de séparation des amants avertis par l’alouette de l’arrivée du jour et dont le genre a été immortalisé par Shakespeare dans Roméo et Juliette ; la pastourelle ou pastorale, chanson villageoise disant généralement la rencontre d’une bergère et d’un galant, dont le développement avec d’autres personnages a produit le Jeu de Robin et de Marion, pastorale d’Adam de la Halle jouée en 1283 ou 1285 devant la cour de Naples, et qui est considérée comme le premier opéra-comique français ; le rondet ou refrain qui était la chanson de danse dont s’ accompagnait la carole (voir danse). Toutes ces chansons avaient l’amour pour principal objet. D’un caractère parfois sérieux et tragique, elles devinrent de plus en plus vives, légères, satiriques, en même temps que les transformations du langage fournissaient des moyens d’expression plus variés. Les chansons de danse, en particulier, sortirent des « fêtes de mai ». Les reverdies chantaient le renouveau du printemps et les danses qui les accompagnaient ; elles conservèrent un caractère rituel hérité des anciennes fêtes de Vénus tant qu’elles ne furent dansées que par des femmes.
L’esprit courtois fut apporté dans la chanson par les troubadours qui furent les premiers musiciens et chanteurs professionnels. Le résultat de cet esprit courtois fut de faire perdre à la chanson la spontanéité et autres qualités naturelles de son inspiration, de corriger son insouciance légère, non que les mœurs fussent devenues d’une moralité plus haute, mais parce que l’esprit prenait la place du sentiment et que le cœur se mettait à raisonner. Elégance, raffinement des sentiments et du langage, la chanson gagna dans la forme ce qu’elle perdit de naturel sous cette influence. Elle devint, par les transformations des genres populaires : le nouveau rondet ou rondeau, l’estampie, la ballette, de l’italien balada, d’où sortit la balade, le lai, d’origine bretonne, le descort provençal, le motet, d’abord religieux puis de plus en plus profane. Dans les genres dialogués, ce furent la tenson provençale et le jeu-parti du Nord. Enfin, de la serventois naquirent plusieurs genres de pièces historiques, satiriques, morales et religieuses. Dans ces transformations de la chanson, la musique suivait, en même temps que la poésie et la danse, révolution de la société féodale et la montée des classes aristocratiques et bourgeoises qui se séparaient de plus en plus du peuple. L’art simple, jailli spontanément du génie populaire, fit place à un art de plus en plus savant que développèrent les premiers maitres du contrepoint. L’esprit métaphysique s’y mêla avec toutes les inventions courtoises dans les œuvres de Gauthier d’Espinan, Blondel de Nesles, Conon de Béthune, Gace Brulé, Thibaut de Champagne, le châtelain de Coucy, Bernard de Ventadour, Pierre d’Auvergne et cent autres trouvères et troubadours maitres de la ménestrandie, puis celles d’Adam de la Balle et surtout de Guillaume de Machaut, que J. Marnold a appelé « le plus grand musicien et le plus grand poète de son temps ». On était alors au milieu du XIVème siècle. Une révolution sociale profonde s’accomplissait qui atteindrait de plus en plus les libertés communales, la vie populaire, et dessécherait le lyrisme collectif. Des mœurs nouvelles feraient l’art plus cérébral, plus savant, plus individuel, et la musique, comme la poésie perdrait ses sources naturelles d’inspiration pour devenir un art de composition et de technique.
Le plain-chant fut la première musique savante ; il fut à la musique, ce que le latin était au langage et si, avec certains, il demeura pur, avec le plus grand nombre il devint macaronique comme ce « pauvre latin » que Rabelais défendait contre ses « écorcheurs ». D’abord exclusivement mélodique et monodique, comme la musique antique, le plain-chant s’enrichit de l’harmonie, c’est-à-dire, suivant la définition d’Isidore de Séville au VIème siècle, d’ « une concordance de plusieurs sons et leur union simultanée », mais il se compliqua aussi d’une polyphonie plus ou moins barbare. L’invention de l’orgue au Xème siècle, puis celle de la notation musicale qui fut appelée gamme par Gui d’Arezzo, au XIème siècle, permirent de rapides progrès qui conduisirent d’abord au déchant, première forme du contrepoint. Les progrès de l’art musical furent dus en grande partie à des gens d’église.
Au moyen âge, la musique fut enseignée dans les écoles et pratiquée dans les couvents. Le monastère de Saint-Gall était le centre musical du monde au IXème siècle. Ses moines composaient de la musique en collaboration avec le roi Charles le Chauve. Chartres eut, du XIème au XIVème siècle, une grande école de musique. Il en exista une chaire à l’Université de Toulouse au XIIIème siècle. Celle de Paris compta parmi ses professeurs les théoriciens les plus fameux de la musique aux XIIIème et XIVème siècles. La musique était, avec l’arithmétique, la géométrie et l’astronomie, un des sciences supérieures du quadrivium qui formait, avec les sciences élémentaires du trivium, le programme scolastique. A côté des écoles religieuses qui établissaient les premières routines académiques, les écoles de ménestrandie ou Scholae Mimorum enseignaient l’art plus libre des trouvères et des troubadours continuateurs des anciens rapsodes, des scaldes et des bardes. Musique religieuse et musique profane ne se distinguaient guère. De même que la première musique de la messe avait été des hymnes antiques consacrés à Vénus, les développements qu’elle prit avec le plain-chant furent de source populaire comme la vie qui se manifestait dans l’Eglise.
La musique participa d’une façon moins apparente mais non moins active que les autres arts au magnifique épanouissement de la période gothique des XIIème et XIIIème siècles. Il y a lieu d’insister sur ce que cet art était inséparable de la poésie et de la danse nu moyen âge. Le poète était à la fois bien disant et bien chantant. Alain Chartier disait adieu à la musique en même temps qu’à la poésie. Charles d’Orléans était aussi bon musicien que bon poète. Arnoul Gréban, le prolixe auteur d’un Mystère de la Passion, était organiste à Notre-Darne et il écrivit pour son mystère une œuvre musicale qui en faisait une sorte d’opéra et d’oratorio, tel que les Sacra Rappresentazione, drames sacrés italiens. La Renaissance, qui distinguerait le poète et le musicien, maintiendrait toutefois l’union des deux genres.
Lorsqu’au XIVème siècle Guillaume de Machaut inventa le mode de notation musicale qui est actuellement employé, l’art du contrepoint était arrivé à sa forme définitive. De nouveaux instruments multipliaient les moyens d’exécution. Mais cette époque fut surtout celle de la musique vocale qui devait apporter à la Renaissance un de ses plus beaux fleurons artistiques, peut-être le plus beau, en brisant toutes les résistances scolastiques pour répandre, même dans la musique d’église, le souffle de la vie et les plus pures émotions. On a été étonné, au XIXème siècle, quand on a découvert cette merveilleuse polyphonie vocale que le classicisme avait ensevelie sous les pompes solennelles de son prétendu « bon goût », comme il avait rayé en quelques vers de Malherbe la littérature du moyen âge. L’histoire, même celle des arts, avait ignoré la musique, « art inférieur ». Elle avait jugé important d’enseigner au monde qu’Henri III jouait au bilboquet et à d’autres jeux moins innocents, que François 1er disait : « souvent femme varie », mais elle ne s’était nullement intéressée à la place occupée par la musique de la société de leur temps. Ce fut pourtant l’époque de l’école des musiciens français et flamands, incomparable par le nombre et la valeur de ses maîtres parmi lesquels furent Guillaume de Fay, Danstaple, Gilles Binchois, Jean Gekeghem, Obrecht, Joaquin de Prez, Clément Jannequin, Adrien Villaert, Michelet qui vit dans l’histoire autre chose que des joueurs de bilboquet et des rois galants, a célébré cet épanouissement dans le pays wallon du « vieux génie mélodique » qui était alors « la vraie voix de la France, la voix même de la liberté ». Le XVIème siècle couronna cette admirable floraison musicale avec l’œuvre de Roland de Lassus. « Jamais la France ne fut aussi profondément musicienne ; la musique n’était pas l’apanage d’une classe, mais de toute la nation : noblesse, élite intellectuelle, bourgeoisie, peuple, église catholique, églises protestantes. La même surabondance de sève musicale se fit sentir dans l’Angleterre d’Henry VIII et d’Elisabeth, dans l’Allemagne de Luther, dans la Genève de Calvin, dans la Rome de Léon X. La musique fut le dernier rameau de la Renaissance, le plus large peut-être, il couvrit toute l’Europe (R. Rolland).
En France, les poètes de la Pléiade marièrent la musique et la poésie au point que Ronsard disait : « Sans la musique, la poésie est presque sans grâce, comme la musique sans la poésie des vers est inanimée et sans vie ». En Italie, où tous les autres pays avaient été devancés dans la musique comme dans les autres arts, tous les artistes étaient musiciens, les Giorgione, Tintoret, Sébastien del Piombo, Titien, Véronèse, Le Vinci, et de moins célèbres. Tous les arts étaient musique, pour eux comme pour Michel Ange, et les princes les entretenaient fastueusement ; Le Tasse fut pour la musique, en Italie, ce que Ronsard fut en France, ce que Shakespeare fut en Angleterre, ce que Goethe serait en Allemagne, quand il verrait dans la musique « l’âme de la poésie » et serait « le plus génial des musiciens » (R. Rolland). Pendant que les sonnets de Ronsard inspiraient les musiciens Pierre Certon, Claude Goudimel, Clément Jannequin, Pierre Cléreau, Muret, Cusiétey, Nicolas de la Grotte, Roland de Lassus, Philippe de Monte et François Regnard, Le Tasse donnait trente-six madrigaux à mettre en musique à Gesualdo, prince de Venosa, qui avait institué dans sa maison une Académie de musique.
Ce fut à cette époque que naquit la musique dramatique dont nous parlerons plus loin. Jusque là, il n’y avait eu que la musique de concert appelée « musique pure », parce qu’elle ne tire ses effets que d’elle-même. C’est à cette musique pure que la Renaissance eut « la gloire de donner sa forme définitive et parfaite ». C’est en cela qu’elle fut « l’âge d’or de la musique polyphonique » (H. Quittard). Palestrina en Italie, Roland de Lassus en Flandre, apportèrent à cette musque, avec le sentiment de la nature dans lequel ils furent dépassés par Joaquin de Prez, Vittoria, Jakobus Gallus, une perfection de style et une beauté de la forme que seuls, selon R. Rolland, Haendel et Mozart ont égalées dans certaines pages.
L’expression musicale état en puissance dans la chanson populaire transformée successivement en canzone, ballade villanelle, jeu-parti, madrigal, et avait trouvé une première forme dramatique dans l’œuvre d’Adam de la Halle. La Renaissance fit se rencontrer cette expression avec celle de la tragédie antique et il en sortit la tragédie musicale ou opéra. Tout d’abord on essaya d’accompagner de musique la déclamation dramatique. Les tentatives de Baïf, de Ducauroy, de Mauduit furent sans succès, la musique polyphonique du XVIème siècle étant peu favorable à cet usage, et la mélopée des acteurs demeura la seule expression vraiment musicale de la tragédie. Les musiciens italiens trouvèrent la solution qui allait conduire la tragédie à l’opéra et au prodigieux succès qui en fit la forme la plus brillante, sinon la plus parfaite, de l’expression musicale aux époques du classicisme et surtout du romantisme, malgré les développements et les hauteurs qu’atteignit la musique de concert à partir du XVIIIème siècle. Les musiciens florentins qui créèrent l’opéra : Caccini, Peri, Emilio del Cavalieri, Vincenzo Galiéi, etc., recoururent à la mélodie et au chant à une voix seule suivie et soutenue par les instruments. Déjà, en 1474, le poète Politien et le musicien Germi avaient commencé en composant un Orfeo, dont le succès avait été éclatant à Mantoue. En 1486, une Dafné, de Gian Pietro della Viola, avait suivi. Ces auteurs s’étaient inspirés eux-mêmes des Sacra Rappresentazione, spectacles populaires religieux qui étaient des mystères avec musique. D’abord mimés, ces mystères avaient formé ensuite de véritables spectacles d’opéra avec paroles déclamées et chantées, soli, chœurs, orchestre, danses, costumes et mise en scène à laquelle les plus grands artistes du temps n’avaient pas dédaigné d’employer leur talent : Brunelleschi, Raphaël, Léonard de Vinci, et d’antres. Toutes les formes de la chanson et de la danse populaires participaient aux Sacra Rappresentazione et sont à l’origine de l’opéra, du ballet, et des deux réunis. Les premiers véritables opéras sont de la fin du XVIème siècle et du commencement du XVIIème. Les musiciens, particulièrement Monteverde, étaient arrivés alors, par les progrès apportés dans l’harmonie, à atteindre une expression que la musique moderne n’a guère dépassée. L’œuvre du Tasse fournit à leur inspiration de nombreux poèmes.
La premier opéra, joué à Paris fut l’Orfeo, de Luigi Rossi, au théâtre du Palais Royal, le 2 mars 1647. Il fut interprété par là troupe italienne des Barberini, attirée en France par Mazarin et qui avait eu le plus grand succès dans de nombreux concerts. Une très vive opposition de l’Eglise s’étant manifestée contre les nouveaux spectacles apportés par les Italiens, l’opéra, malgré sa réussite, dut attendre pour commencer sa véritable carrière jusqu’en 1654. On joua alors le Triomphe de l’Amour, de Michel de la Guerre et de Charles de Beys, puis la Pastorale, de Perrin et Cambert (1659), le Serse, de Cavalli (1660). En 1671, la Pomone, de Cambert, inaugura l’Académie d’opéra. Le nouveau genre de spectacle, auquel le ballet ajouterait sa somptuosité quand il passerait du théâtre de la cour à celui de la ville, allait avoir en France un succès grandissant en même temps qu’il se perfectionnerait. Lulli, en particulier, en serait l’animateur sous le règne de Louis XIV. Il se dégagerait de l’influence italienne avec les musiciens français Cambert, Campra, et surtout Rameau qui a donné, avec Gluck et Mozart, ses chefs-d’œuvre définitifs à l’opéra du XVIIIème siècle. Mais avant que leur valeur fût reconnue, ils eurent longuement à lutter contre l’influence italienne des Paisiello, Sadi, Cimarosa, Sacchini, Salieri, Piccini. La querelle des gluckistes et des piccinistes passionna la cour de Versailles au temps de Marie Antoinette. Ils convient de ne pas oublier, parmi les musiciens qui s’illustrèrent dans l’opéra au XVIIIème siècle, un des compositeurs les plus grands et les plus féconds, Haendel. Allemand et peu connu alors en France, il composa une cinquantaine d’opéras, de caractère italien pour la plupart, qui furent joués surtout en Angleterre où il s’était établi. Mais la véritable gloire d’Haendel fut dans ses oratorios.
A côté de l’opéra proprement dit s’était formé l’opéra buffa, où la verve italienne excellait. Il se mêla en France aux différents genres exploités par le Théâtre de la Foire (voir Théâtre), vaudevilles à couplets, comédies à ariettes, parodies d’opéras, plus ou moins agrémentés de jongleries, de pantomimes et de danses. Tout cela donna naissance à l’opéra comique. Le genre fut appelé bien improprement « éminemment français », car ses chefs-d’œuvre, la Serva Padrone, les Noces de Figaro, le Barbier de Séville, le Mariage secret, sont de musiciens étrangers : Pergolèse, Mozart, Rossini ct Cimarosa. L’opéra comique français n’a fourni que des comédies trop mauvaises pour être représentées sans musique, et sa musique est des plus médiocres, très souvent inférieure à celle de l’opérette dont le genre, moins prétentieux, a plus de verve et de gaieté. Mais l’ opéra comique convenait remarquablement à la distraction des bons bourgeois qui ne demandaient à la musique que le « plaisir de l’oreille » ; aussi eut-il un succès considérable pendant plus de cent ans. Il eut même deux théâtres à Paris, à la fin du XVIIIème siècle, dans les salles Feydeau et Favart. Son répertoire était abondamment pourvu par une foule de musiciens dont les plus connus furent Duni, Philidor, Monsigny, Laruette, créateurs du genre, puis Grétry, Dalayrac, Nicolo, Méhul, Lesueur, Boieldieu, Hérold, Auber, Halévy, A. Adam, Maillart, Meyerbeer, Flotow, Massé, A. Thomas, et plusieurs parmi les contemporains.
Gluck, en renouvelant l’antiquité musicale par des moyens modernes où s’étaient essayés déjà Carissimi et Métastase, Mozart, en mettant dans les formes italiennes de son Don Giovani les accents les plus profonds des pulsions humaines, avaient ouvert la voie à l’opéra romantique. Beethoven en produisait le premier chef-d’œuvre, Fidelio, en 1822, et Weber en donnait le modèle définitif dans Freychutz, en 1823. Auber, Meyerbeer, Halévy suivirent à des degrés de valeur bien différents la voie de Weber. Ils furent continués par F. David, Gounod, Reyer, Saint Saëns, Massenet, qui s’adaptèrent avec plus ou moins de bonheur à la « musique de l’avenir » dont Berlioz et Wagner furent les deux protagonistes. En même temps, l’opéra italien continuait sa brillante carrière avec Spontini, Rossini, Bellini, Mercadante, Donizetti, Verdi, pour échouer, depuis trente ans, dans ce lamentable vérisme où il patauge toujours, encouragé par un succès de mauvais aloi.
Les Sacra Rappresentazione, ou mystères, qui avaient (donné naissance à l’opéra profane, se continuèrent durant un certain temps dans l’oratorio. Il fut à l’origine un opéra religieux avec chant, chœurs, orchestre, danse, et toutes les attractions du costume et du décor. Le nom de ce spectacle, « oratorio », lui vient de l’église de l’Oratoire où les Oratoriens l’organisèrent au XVIème siècle, sous l’impulsion du fondateur de leur ordre, Philippe de Néri, pour attirer les fidèles. Le genre se développa au XVIIème siècle, en Italie, et son premier grand compositeur tut Carissimi, auteur de nombreux ouvrages dont les sujets furent puisés dans la Bible ; mais ce fut Haendel qui lui fit atteindre sa plus complète expression dans la grandeur de la pensée et la beauté de la forme. Haendel était physiquement un géant, il le fut aussi comme artiste. Il lui fallut une force et une Énergie extraordinaires pour triompher dans la lutte qu’il soutint en Angleterre où l’on fit de lui un dieu a près l’avoir abreuvé d’avanies. L’oratorio prit avec lui les proportions des grandes œuvres dramatiques et cessa d’être un spectacle ; il devint de la musique pure exécutée au concert. Son intérêt, dépouillé du mouvement et de la décoration scéniques, n’exista plus que dans la musique et l’interprétation des chanteurs et des instrumentistes. Haendel composa une vingtaine d’oratorios, véritables cathédrales de l’architecture musicale, tant par la majesté et l’harmonie de leurs proportions que par la beauté de leurs lignes et de leur expression. Israël en Egypte, le Messie, Samson., Joseph, Judas Macchabée sont les plus connus. Dans le même temps qu’Haendel, J. S. Bach composait la Passion selon Saint Mathieu, la Passion selon Saint Jean, une Nativité et l’oratorio de Pâques. L’oratorio devint l’élément le plus important des grands concerts appelés « spirituels » donnés dans les églises ou les salles de concert plus ordinaires, et de nombreux musiciens en écrivirent. Haydn produisit sa création ; Beethoven, le Christ au Mont des Oliviers. Le genre avait été continué en Italie par Jomelli, Scarlatti, Salieri, Sacchini, Cimarosa. Il fut traité en France par MondonvilIe, Rigal, Cambini, Gossec, Berton, Lesueur et, en Allemagne, par Mendelssohn, Spohr, Hiller, Himmel, Kiel. Berlioz composa l’Enfance du Christ, Félicien David, Moïse au Sinaï et l’Eden, Gounod, Rédemption et Mors et Vita ; César Franck, Ruth, Rédemption, les Béatitudes ; Paladhile, les Saintes Maries de la Mer ; G. Pierné, Saint François d’Assise. D’autres encore, jusqu’aux Œuvres récentes d’Honegger, le Roi David et Judith illustrèrent le genre.
La musique de concert, développée depuis le XVIIIème siècle dans les formes instrumentales, fut longtemps de la musique vocale pure. Les gréco-latins de la dernière période avaient connu une musique de concert indépendante de la voix humaine, et jouée dans des salles appelées odéons par des instrumentistes plus ou moins nombreux. Mais c’est de la chanson que sortit le concert d’oreille. Les premiers furent en Italie ceux de la musica da samera ou musique d’ensemble uniquement vocale, sans accompagnement instrumental. La Renaissance fut la grande époque de cette musique avec les madrigaux des Palestrina, Marcuzio, Monteverde, Gesualdo. L’évolution du madrigal vers la musique dramatique produisit la cantate. Elle fut introduite en France à l’occasion des concerts de musica da camera que Mazarin y fit donner par la troupe de musiciens venue de Rome et dont la célèbre chanteuse, Léonore Baroni, était la grande virtuose. R. Rolland a le premier raconté les origines de la cantate qui sont du XVIIème siècle. Elle naquit de l’introduction dans le madrigal du chant solo et de son développement grandissant aux dépens du chant polyphonique. Elle suivit ainsi la même phase que l’opéra, ce qui explique la communauté de leur création par les mêmes musiciens, Manelli, Ferrari, les frères Mazzochi, Monteverde dont le combat de Tancrède et de Clorinde, chanté dès 1624 à Venise, est une vraie cantate. Après 1649, ce genre pris un développement rapide, grâce surtout à Carissimi. L’un des premiers, il introduisit dans la cantate l’accompagnement du clavecin et l’alternance de cet instrument avec les voix. Mais l’intérêt musical n’était toujours que dans la voix qui conservait la prédominance. Il se déplacerait de plus en plus par la suite en suivant le progrès instrumental. Pergolèse ajouterait des violons à l’accompagnement du clavecin, puis la cantate de plus en plus développée avec de nombreux soli, chœurs et orchestre deviendrait à la musique profane ce que l’oratorio serait à la musique religieuse. Ils seraient même souvent confondus. C’est particulièrement dans la cantate que la musique mondaine, aristocratique, trouva sa forme. Réservée aux concerts de la musica da camera qui se donnaient dans les salons et dans l’intimité d’auditoires composés des princes et de leurs familiers, elle devait surtout refléter les conventions de cette société spéciale, les apparences brillantes et superficielles du « bon goût » et du « bel esprit ». Elle se perfectionna pour cela dans la technique musicale, mais elle perdit la vérité dramatique qu’elle avait d’abord exprimée et, dès Carissimi, si elle fut un chef-d’œuvre de construction et d’élégance musicale, elle s’égara de plus en plus dans la fadeur sentimentale. Elle trouva alors son plus brillant écrivain dans J.-B. Rousseau qui fut le poète le plus dépourvu de vérité dans les sentiments. Carissimi, Rossi, Cesti furent au classicisme musical ce que furent Voiture et Chapelain au classicisme littéraire. Monteverde et Cavalli, qui conservèrent à la musique le sentiment de la vie, en furent le Molière et le La Fontaine. Après Carissimi, les plus célèbres auteurs de cantates furent Stradella, dans le même siècle, puis, au XVIIIème, Scarlatti qui fit prendre au genre sa forme classique définitive, Pergolèse, Metastase, poète-musicien de la cour de Vienne. Les musiciens français de la fin du XVIIème siècle et ceux du XVIIIème : Campra, Colasse, Clérembault dont l’Orphée eut un succès considérable, Mouret, Bernier, Montéclair, Rameau, Colin de Blamont, donnèrent à la cantate toute sa majesté classique.
J.-S. Bach et Haendel firent sortir la cantate des salons ; ils en composèrent de religieuses et leur donnèrent les développements symphoniques qui les feraient confondre avec l’oratorio. La Fête d’Alexandre de Haendel, les Saisons, de Haydn, sont souvent considérées comme des oratorios. Mozart composa plusieurs cantates. Beethoven donna dans ce genre Adélaïde et Armide. L’inspiration abondante de Méhul trouva un plus heureux emploi dans la cantate que dans l’opéra. La Révolution favorisa le genre. Les hymnes dont elle fit le sujet furent de véritables cantates exécutées avec soli, chœurs et orchestre dans les théâtres et dans les fêtes publiques. Certains de ces hymnes étaient joués à chaque représentation théâtrale. Un arrêté du Directoire du 4 janvier 1796 prescrivait « à tous les directeurs, entrepreneurs et propriétaires des spectacles de Paris, sous leur responsabilité individuelle, de faire jouer chaque jour, par leur orchestre, avant la levée de la toile, les airs chéris des Républicains, tels que la Marseillaise, Ça ira, Veillons au salut de l’Empire, Le Chant du Départ ». Les principales cantates révolutionnaires furent : l’Hymne pour le 14 juillet, de Chénier et Gossec, l’Hymne à l’Etre suprême, de Désorgues et Gossec, l’hymne à la République pour le 1er vendémiaire, musique de Jadin, le Chant de victoire, de Méhul, l’Hymne pour la fête de la jeunesse, de Cherubini, l’ Hymne à la Fraternité, de Désorgues et Cherubini, le Chant du 10 août, de Catel, l’Hymne pour la fête de l’agriculture, de Lesueur, l’Hymne pour la fête de la vieillesse, de Lesueur, le Chant du 1er vendémiaire, de Chénier et Martini, l’Hymne du 20 prairial, de Gossec, l’Hymne à la Nature, de Gossec, l’Hymne du18 fructidor, l’hymne à la Raison, l’Hymne pour la fête des Epoux, le Chant funèbre, tous quatre de Méhul, l’Hymne à la statue de la Liberté, de Gossec, l’Hymne funèbre du général Hoche, de Cherubini, l’Hymne à la Liberté, de Gossec, le Chant de Vengeance, de Rouget de l’Isle, etc...
Depuis la Révolution, la cantate, complètement délaissée comme musique de chambre, est devenue un genre de plus en plus froid et ennuyeux. Réservé à des cérémonies officielles et aux concours du Prix de Rome.
En Allemagne, la chanson transmit son caractère populaire au choral. Il fut le chant de la Réforme et, autant que celui de la nouvelle religion, le chant de guerre des paysans révoltés. C’est dans la bouche de ces paysans qu’il prit toute son ampleur en s’élevant vers un Dieu libérateur au-dessus de toutes les églises. Le « rempart qu’est notre Dieu » du choral de Luther fut chanté par le peuple, autant contre ses persécuteurs protestants que catholiques. Luther avait compris la valeur éducative de la musique, sa puissance d’entraînement et d’enthousiasme sur les foules ; il savait qu’elle ferait plus pour la Réforme que toutes les prédications. Il la voyait « apparentée à la théologie ». Il avait constaté que dans la Bible « la vérité s’échappe en psaumes et en hymnes ». Il n’était pas comme les Anabaptistes anglais qui voulaient détruire tous les arts. Il disait de la musique :
« Qui la connaît est de bonne race. Ceux qu’elle n’affecte pas, je les prise autant que cailloux, autant que billes de bois. »
Il voulait qu’on y exerçât la jeunesse et repoussait le maître d’école qui ne saurait pas chanter, les ministres qui n’auraient pas appris à s’appliquer de leur mieux à la musique (Elie Reclus, La doctrine de Luther). Les premiers chorals furent des airs populaires adaptés à des paroles religieuses, comme il s’était produit pour les chants d’église ; mais alors que ceux-ci, composés sur des paroles latines incompréhensibles au peuple et de plus en plus enveloppés de formules rituelles, avaient été peu a peu réservés au culte, le choral, chanté dans le langage vulgaire fut le chant populaire par excellence. Il le demeura tant qu’il exprima les espoirs révolutionnaires et soutint la lutte pour la liberté. Quand le peuple fut vaincu et la liberté jugulée une nouvelle fois, le choral privé de l’enthousiasme populaire se momifia dans les temples avec les formules d’un protestantisme qui ne protestait plus et faisait de Dieu le rempart des riches.
En France, le choral ne fut qu’aristocratiquement représenté par les Psaumes, traduits par Clément Marot, Th. de Bèze, et mis en musique par Claude Goudimel. Mais, en Allemagne, il exprima le caractère et l’âme du peuple tout entier. Après l’échec révolutionnaire, il prit des formes nouvelles. De la première, uniquement mélodique et qui resta dans l’église comme le plain-chant, il passa à toutes celles de l’harmonie. L’activité des musiciens allemands et leurs recherches d’une expression incessamment renouvelée, ouvrirent le champ du plus grand progrès musical qui se fît dans les XVIIème et XVIIIème siècles et qui est la plus belle gloire de l’Allemagne. Il semblait que les ultimes hauteurs avaient été atteintes avec les chefs-d’œuvre, d’ailleurs toujours indépassés, de la polyphonie vocale souveraine jusque là. La musique instrumentale allait s’élever aussi haut en même temps qu’elle multiplierait l’infini les moyens d’expression au point qu’elle ne cesserait pas d’en découvrir de nouveaux encore aujourd’hui.
Si l’homme a inventé depuis très longtemps des instruments de musique, il y a à peine trois siècles qu’il existe une musique instrumentale ayant une vie propre, indépendante de la musique vocale. Les instruments sonores avaient été cherchés par l’homme pour imiter les voix de la nature et donner plus de puissance à la sienne. Ils servirent ensuite à accompagner le chant humain pour multiplier et varier ses effets, mais tout en restant étroitement sous sa dépendance. La forme antique de cet accompagnement était la mélopée, du nom que les Grecs donnaient aux règles générales de l’harmonie, du chant et de la déclamation. Dans les temps modernes, la mélopée fut la notation de la déclamation, puis la première forme du récitatif tant qu’il ne fut pas accompagné d’un véritable orchestre et qu’il conserva le caractère régulier de la déclamation. Les récitatifs des œuvres d’Haendel, Mozart, Gluck, Méhul, Bellini, sont les formes les plus parfaites de la mélopée moderne. Elle disparut, ou ne fut plus qu’un archaïsme, lorsque le drame lyrique donna à l’orchestre une vie mélodique parallèle à celle du chant vocal, ou dominante, en faisant passer le drame dans l’orchestre et en ne considérant plus la voix que comme une partie fondue dans l’ensemble orchestral. Ce furent Haendel et Bach qui apportèrent à la musique instrumentale une vie propre, indépendante de la musique vocale.
Les organistes de la fin du XVIème siècle et du commencement du XVIIème s’étaient inspirés des progrès de la polyphonie vocale de leur temps. Quand la musique instrumentale voulut chanter elle-même sans le concours de la voix ou parallèlement à elle, la mélodie lui en fournit les moyens en lui donnant une expression indépendante. Le chant fut à l’orchestre comme chez les chanteurs ; la musique n’avait plus besoin de la voix humaine pour chanter. Les premiers progrès dans cette direction furent dus à l’italien Fuscobaldi, aux français Chambonnières et Couperin, aux allemands Froberger et Buxtehude. Ce fut l’œuvre du XVIIème siècle de préparer la musique instrumentale, tant dans son expression que dans sa technique ; la révolution de Haendel et de Bach l’élèverait aux hauteurs atteintes par la musique vocale et lui ouvrirait un champ illimité.
Haendel et Bach furent les véritables initiateurs de la musique moderne. Le plus merveilleux de la révolution qu’ils déterminèrent fut dans l’incroyable multiplication des genres de la musique purement instrumentale, au point que l’imposant ensemble des chefs-d’œuvre de Bach contient toute la musique ; « son évolution moderne était terminée dès 1750 » (H. Quittard).
Devenue capable de vivre sur son propre fonds, d’avoir son existence et son expression propres, la musique instrumentale eut devant elle les perspectives sans limites de la musique de chambre, succédant à la musica da camera, puis celles de la fugue à laquelle Bach apporta une étonnante virtuosité, enfin, celles de la symphonie. La fugue permettrait de varier les thèmes ; la symphonie introduirait une variété encore plus grande de développement et d’expression en même temps que d’utilisation des instruments.
La musique de chambre avait commencé sa carrière dans l’accompagnement du madrigal et de la cantate ; elle se libéra complètement de la voix avec la sonate, le concerto, le trio, le quatuor et autres pièces uniquement instrumentales. La sonate, composition pour piano seul ou pour deux instruments, était, en Italie, d’église on de chambre. Celle de chambre était une suite de morceaux de danses. Elle prit un autre caractère en Allemagne où Ph.-Emmanuel Bach lui donna la division en trois parties qu’elle a gardée. Le caractère de la sonate se retrouve avec plus de variété dans le trio, le quatuor, le quintette et autres œuvres pour instruments plus ou moins nombreux, arrivant à former de petites symphonies, tels le septuor, de Beethoven, la Sérénade nocturne pour huit instruments, de Mozart, la Rhapsodie pour six instruments, d’Honegger, l’Aubade pour piano accompagné de dix-huit instruments, de Francis Poulenc. Le concerto était d’abord la symphonie de trois instruments prépondérants que d’autres accompagnaient : il est devenu la symphonie de tout un orchestre joint à un instrument solo. Haendel et J.-S. Bach furent grands dans tous les genres de la musique de chambre, puis Haydn et Mozart ; mais Beethoven l’éleva aux hauteurs les plus sublimes de la musique, dans ces régions où « elle se tient si haut qu’aucune raison ne peut siéger à ses côtés, où elle produit des effets qui dominent tout et dont personne n’est en état de rendre compte » (Gœthe).
La symphonie occupa au concert une place prépondérante à partir de Haydn qui en fut appelé « le père » et en donna, dans la forme, les plus parfaits modèles. Il en a composé un grand nombre dont on ne joue plus, à grand tort, que quelques-unes, toujours les mêmes. La symphonie de Haydn est le type classique du genre par la science du développement des idées et de la richesse des effets. Au point de vue des sentiments, elle a la sécheresse de la période classique. Mozart mit dans la symphonie une émotion bien supérieure, mais sa technique est peut-être moins impeccable. Il possédait la puissance et le sentiment dramatiques qui manquaient à Haydn et qui rendent son théâtre si émouvant. Il annonça cette humanité qui remplit l’œuvre de Beethoven dont la sincérité, le don fougueux de soi, l’amour de la ature et des hommes, rompirent avec les conventions du classicisme. Beethoven fut un novateur, tant dans l’esprit que dans la forme, un hérétique et un révolté que le monde musical officiel mit un siècle à comprendre et à adopter. Aujourd’hui, on le dit dépassé ! Ceux qui émettent cette opinion sont de la même école que ceux qui lui reprochaient ses audaces. Comme Rousseau en sociologie, Beethoven demeure l’éternel précurseur dont la pensée est toujours jeune parce qu’elle est l’éternelle expression de l’âme humaine délivrée des conventions fausses et hypocrites. En France, on ne commença à découvrir Beethoven que vers 1830, grâce au mouvement romantique qui recherchait ses affinités dans toutes les branches de l’art. Le romantisme de Beethoven rejoignait un Michel Ange et un Shakespeare par-delà toutes les formules, et il n’y eut guère alors qu’un Berlioz pour le comprendre et le sentir profondément. Un faux esprit, celui d’un romantisme de façade et de parade qui faisait la vogue de l’opéra, entretenait cette incompréhension dont subirent les effets Weber lui-même, malgré ses succès, et davantage encore Schumann et Schubert, puis, malgré leur caractère plus français, Berlioz, César Franck et tous ceux dont l’art a été de sensibilité profonde plus que d’éclat superficiel. Car le romantisme français ne fut pas musical. La musique pure, c’est à dire la musique de chambre et la symphonie qui n’étaient pas de caractère dramatique, n’existèrent pas en France jusqu’au moment où la musique instrumentale s’imposa à côté du bel canto, c’est-à-dire jusqu’à l’avènement de ce qu’on a appelé « la musique de l’avenir ». On commença alors à comprendre Beethoven, et avec lui Schuman, Schubert et toute l’œuvre symphonique ; mais aujourd’hui encore, auprès du « grand public », un « air de bravoure » couronné d’un ut de poitrine, des vocalises apprises à ce que Berlioz appelait « l’école du petit chien », ou un concerto avec des acrobaties sur la chanterelle ou le clavier, l’emportent toujours sur la plus émouvante pensée exprimée par une sonate ou une symphonie. Il est des gens qui ont eu besoin de passer par Wagner, de subir sa discipline les obligeant à écouter l’orchestre, pour écouter et comprendre Beethoven.
Haydn et Mozart ont créé 1’orchestre moderne, donnant ainsi à la musique son moyen d’expression le plus étendu. Beethoven lui a apporté la liberté sans rivages, celle de la pensée et celle de l’art. Les énormes masses orchestrales qui ont été réunies après eux, les variétés infinies des rythmes et des timbres inventées depuis, n’ont le plus souvent servi qu’à masquer le vide d’une véritable pensée musicale, à créer un « dynamisme » factice ; elles ont pu multiplier les moyens et la puissance de l’expression, elles ne l’ont pas rendue plus parfaite que l’orchestre réduit d’Haydn et de Mozart, plus émouvante et plus humaine qu’une sonate de Beethoven.
MUSIQUE RELIGIEUSE.
Avant de parler de la musique contemporaine, depuis ses origines dans ce qu’on a appelé, il y a quatre-vingts ans, la « musique de l’avenir », jusqu’à ses plus récentes manifestations, il y a lieu de voir ce qu’on appelle la musique religieuse.
L’influence de la musique sur les hommes était trop profonde et trop universelle pour que, de tout temps, les religions n’eussent pas cherché à en tirer parti, encore plus que des autres arts, pour exercer leur pouvoir sur les âmes. Avec elle, il n’était besoin d’aucun appareil technique, d’aucune sorcellerie ; l’improvisation vocale suffisait. Mais si la musique est susceptible d’inspirer et d’entretenir un mysticisme vague et indéfini par son action spéciale sur la sensibilité, elle n’est nullement mystique en elle-même et, lorsqu’elle n’est pas l’appoint d’une mise en scène spectaculeuse, elle est l’art le moins favorable aux représentations concrètes indispensables aux religions pour atteindre les foules d’une façon durable. La peinture, la sculpture, l’architecture représentent matériellement, par des couleurs, des formes, des lignes, les conventions de l’idée qui les a inspirées, mais la musique ne matérialise aucune idée sans le concours de l’imagination, et celle-ci peut les lui prêter toutes. On a dit le plus faussement du monde que la musique est « l’art religieux par excellence » en raison de la ferveur et de la sublimité des sentiments qu’elle peut inspirer. On n’a pas tenu compte qu’étant en dehors et au-dessus de toutes les représentations, elle s’évade de toutes les interprétations dogmatiques et ne peut en avoir d’autre que celle que lui donne chaque sensibilité particulière. Elle échappe à la fixité et à la relativité des matérialisations comme des éthiques et des esthétiques. Elle est l’esprit en qui tous les hommes, où qu’ils soient et quels qu’ils soient, retrouvent leur être spirituel et communient non avec une église quelconque, mais avec le monde entier. Beethoven disait :
« La musique est une révélation plus haute que toute sagesse et toute philosophie. »
Il a fallu échafauder une métaphysique aussi trouble que particulière pour arriver à dire que le christianisme a élevé la musique au plus haut point qu’elle pouvait atteindre, parce qu’elle était devenue avec lui l’expression de la plus parfaite des religions. La musique est bien indifférente à cela. Ce qui le prouve, c’est qu’il n’est pas une note de musique qui soit spécifiquement religieuse et se distingue des autres pour une spiritualité particulière, Le christianisme, qui apportait, disait-on, un esprit nouveau, une conception du divin qui ne s’était jamais vue et dont les prodiges les plus extraordinaires : miracles, résurrections, ascensions, don des langues et autres, démontraient la merveille, ce christianisme fut absolument incapable de produire une musique qui serait l’expression de cette merveille. Il faut être aveuglé par un enthousiaste prosélytisme, sinon par le fanatisme, pour dire avec Jean Chrysostome :
« Notre nature se complaît tellement aux cantiques et aux hymnes, elle y trouve des délices qui lui sont tellement sympathiques, qu’on ne parvient à calmer les enfants qui pleurent qu’en leur en chantant. »
Non, les nœnia grecques produisaient le même résultat, comme aujourd’hui : « J’ai du bon tabac », ou « Viens Poupoule ! » Les cantiques et les hymnes n’étaient pas autre chose que les chansons de l’époque. Qu’était cette hymne la plus ancienne, dont il est fait mention dans le Nouveau Testament et qu’après la Cène Jésus chanta avec les apôtres en marchant vers le mont des Oliviers ? — On n’en sait rien, pas plus qu’on ne sait si Jésus exista. Ce qui n’est pas douteux, c’est que les premières hymnes dites chrétiennes étaient des hymnes païennes. Lorsque saint Augustin disait : « Quand j’écoute un cantique, les vérités chrétiennes affluent dans mon cœur », il se moquait du monde. Quelles vérités particulièrement chrétiennes pouvait-il y avoir dans des cantiques qui avaient chanté jusque là la vérité selon Vénus ou Apollon et la chantaient encore pour les païens qui demeuraient?...
Non seulement la théorie de la musique dite « chrétienne », mais celle de tous les arts dits « chrétiens » est basée sur cette mystification, et elle est particulièrement sensible en musique. Non seulement il n’y a pas d’art chrétien, mais il est impossible qu’il y en ait un car, comme l’a écrit Rémy de Gourmont : « Le christianisme évangélique est essentiellement opposé à toute représentation de la beauté sensible ». C’est ainsi que l’entendaient les iconoclastes depuis saint Paul jusqu’à Zwingle et les Réformateurs. Mais, s’il n’y a pas d’art chrétien, il y a un art catholique. L’art catholique n’est pas autre chose que l’art du paganisme, et comme lui, il n’est de l’art que dans la mesure où il est vivant et humain, c’est-à-dire aussi peu catholique que possible.
En 1563, le pape Pie IV entreprit de réformer la musique religieuse, à l’instigation des conciles de Bâle et de Trente. A cette époque « le chant sacré était encroûté de rouille scolastique, hérissé de difficultés, de complications, d’extravagances... chaque partie chantant des paroles différentes et parfois des chansons mondaines. Le compositeur prenait un air gai ou graveleux, l’Homme armé ou l’Ami Baudichon, madame, et au-dessus, avec force recherches et bizarreries de contrepoint, il brodait une messe » (Taine : Italie et la vie italienne). Ce fut Palestrina qui fut chargé de la réforme et, a-t-on dit, il « sauva la musique sacrée » en y introduisant « la grâce et la vie ». Sur ce que fut cette réforme, il est curieux de lire l’opinion de Berlioz dans ses Mémoires (I.p. 231–236), lorsqu’il fut à Rome en 1831 et lorsqu’il vit comment la musique y était traitée, même à Saint-Pierre et dans la chapelle Sixtine. Il s’interrogea sur la qualité supérieure, religieuse, divine de cette musique, et voici ce qu’il dit entre autre :
« Nous accordons que les trente-deux chanteurs du Pape, incapables de produire le moindre effet, et même de se faire entendre dans la plus vaste église du monde, suffisent à l’exécution des œuvres de Palestrina dans l’enceinte bornée de la chapelle pontificale ; nous dirons que cette harmonie pure et calme jette dans une rêverie qui n’est pas sans charme. Mais ce charme est le propre de l’harmonie elle-même et le prétendu génie des compositeurs n’en est pas la cause, si toutefois on peut donner le nom de compositeurs à des musiciens qui passaient leur vie à compiler des successions d’accord ... Dans ces psalmodies à quatre parties où la mélodie et le rythme ne sont point employés, et dont l’harmonie se borne à remploi des accords parfaits entremêlés de quelques suspensions, on peut bien admettre que le goût et une certaine science aient guidé le musicien qui les écrivit ; mais le génie ! allons donc, c’est une plaisanterie. En outre, les gens qui croient encore sincèrement que Palestrina composa ainsi à dessein sur les textes sacrés, et mû seulement par l’intention d’approcher le plus possible d’une pieuse idéalité, s’abusent étrangement. Ils ne connaissent pas, sans doute, ses madrigaux, dont les paroles frivoles et galantes sont accolées par lui, cependant, à une sorte de musique absolument semblable à celle dont il revêtit les paroles saintes. Il fait chanter par exemple : Au bord du Tibre, je vis un beau pasteur, dont la plainte amoureuse, etc., par un chœur lent dont l’effet général et le style harmonique ne différent en rien de ses compositions dites religieuses. Il ne savait pas faire d’autre musique, voilà la vérité ; et il était si loin de poursuivre un céleste idéal, qu’on retrouve dans ses écrits une foule de ces sortes de logogriphes que les contrepointistes qui le précédèrent avaient mis à la mode et dont il passe pour avoir été l’antagoniste inspiré. Sa missa ad fugam en est la preuve. »
Après Palestrina, les Nanini, Cifra , Allegri, Marcello, Pergolèse, et surtout Haendel et J.-S. Bach, enrichirent la musique d’église de nombreuses œuvres nouvelles, mais qui ne furent pas plus religieuses. La fugue, par exemple, à laquelle Bach donna un souverain essor, était plus brillante qu’émouvante ; elle atteignait intelligence de l’artiste plus que le cœur du fidèle, et Bach ne pensait pas plus au Dieu du pape qu’à celui de Luther, quand il composait les siennes, ou ses trois cents cantates, ses Messes, ses Sanctus, ses Magnificats, ses Passions. Aucune église ne peut s’annexer l’anglican Haendel pas plus que le protestant J.-S. Bach, tous deux allemands, nourris de l’esprit de la Réforme encore palpitant de ses luttes et humilié de la domestication de son clergé. D’ailleurs leurs œuvres valent par la perfection de l’art plus que par l’expression. Haendel et surtout Bach furent les plus parfaits des contrepointistes mais ils furent d’une solennité glaciale. On trouve difficilement chez eux l’émotion et on comprend, en somme, que leur perfection s’accorde avec les religions, catholique ou protestantes, mais inhumaines. Un concert à la Schola de M. Vincent d Indy, qui est le Conservatoire de la musique religieuse, une audition du Messie de Haendel ou d’une Passion de Bach, sont des fêtes musicales incomparables pour l’esprit, mais le cœur est étonné de n’y avoir aucun tressaillement.
La Création, de Haydn, a apporté un premier air romantique dans la musique dite religieuse. Elle est d’une effusion panthéiste qui donne sur les premiers temps du monde une idée autrement vivante que la niaise élucubration biblique. La Messe en ré et le Christ au Mont des Oliviers, de Beethoven, ont des sanglots humains qui font penser à Prométhée plus qu’au Christ résigné à une prétendue mission divine. Parlera-t-on de la religiosité qui anima Berlioz écrivant l’Enfance du Christ dans les formes archaïques de la musique ancienne ? Son Requiem n’est pas plus religieux. Composé comme une œuvre de circonstance, à la demande du ministre de Gasparin qui voulait mettre à la mode la musique religieuse, il n’est nullement une manifestation de foi. Berlioz ne croyait à rien sauf à la musique. Le Requiem n’est pas d’une autre inspiration que celle de la « marche au supplice » et de la « nuit de sabbat » de la Symphonie fantastique, que celle aussi da cœur fugué, sur le mot : « Amen », de la Damnation de Faust. Quant à Wagner, qui fut peut-être le plus religieux de tous les compositeurs de musique et dont les tendances chrétiennes soulevèrent Nietzsche contre lui, il fut dans toute son œuvre le musicien dramatique de la Tétralogie, même lorsqu’il s’inspira d’idées religieuses, celle entre autres de la rédemption par le sacrifice. Cette idée du sacrifice rédempteur, qui est dans plusieurs œuvres de Wagner : le Vaisseau fantôme (Senta), Tannhäuser (Elisabeth), les Maitres Chanteurs (Hans Sachs), Parsifal (Kundry), n’a rien d’ailleurs de spécialement chrétien. Elle est dans toutes les religions et, en particulier, dans la mythologie scandinave dont Wagner était imprégné plus que de catholicisme. Il s’est retrouvé avec Ibsen dans cette hérédité nordique. Dans ce terrible drame, Tristan et Yseult, où la passion n’atteint son entier assouvissement que dans le « retour au divin néant originel » et qu’on peut appeler le drame de la malédiction de l’amour, il y a, a écrit R. Rolland, « une conviction quasi religieuse, plus religieuse encore peut-être, par sa sincérité, que celle de Parsifal ». Par contre, dans ce Parsifal, dont Wagner a voulu faire une Œuvre mystique avec l’intention de servir le catholicisme, la scène du Graal n’est que du théâtre dans la cathédrale, — elle choque même certains esprits religieux par son paganisme -, et l’Enchantement de Vendredi-Saint fait penser à Joachim de Flore sortant de l’église avec les fidèles pour célébrer la messe dans l’épanouissement de la nature. Si, enfin, nous descendons de Wagner à Massenet, nous constatons que les personnes de ses drames sacrés : Eve, la Vierge, Marie-Madeleine, sont non moins païennement troublantes que Thaïs, Esclarmonde et Hérodiade. La musique religieuse n’est grande que dans la mesure où elle est humaine.
LA « MUSIQUE DE L’AVENIR ».
Jean-Jacques Rousseau, qui faisait de la musique à la façon des oiseaux et eut le tort de vouloir être un théoricien musical, disait :
« La mélodie seule peut peindre les passions, la mélodie seule est la musique des cœurs sensibles ; l’harmonie n’est qu’un bruit, plaisir de Welches et de barbares. »
Les Welches et les barbares ont montré, trop tard pour Rousseau, combien l’harmonie était musique en ouvrant sa voie à la mélodie égarée dans les champs de cette sensibilité artificielle que l’auteur du Devin du village condamnait d’autre part quand il ne parlait pas de musique. Un siècle après Rousseau, en un temps où Vitet déclarait qu’on ne pouvait, « physiquement », dépasser Rossini dans la « progression harmonique », se produisait une révolution démontrant qu’au contraire, même physiquement, il n’était pas de limite à cette progression. Cette révolution, dont les « pompiers » rossinistes puis gounodistes se gaussèrent en raillant la « musique de l’avenir », fut l’œuvre, d’une part de Berlioz, d’autre part de Wagner. Leurs voies ne furent pas les mêmes, elles furent différentes et même opposées ; toutes deux ne dirigèrent pas moins la musique vers un monde si nouveau, et surtout si étendu, qu’on ne l’a pas encore, aujourd’hui, entièrement exploré. Si le voyage est à peu près terminé avec Wagner, il y a encore à marcher avec Berlioz. Ainsi se vérifie sa prédiction qu’il sera connu et compris vers 1940. On reconnaîtra alors en lui le génie le plus incontestable de la période romantique française où il passa inaperçu dans le tapage des « Jeune France ».
C’est vers 1830 que parut Berlioz. La France qui tombait de l’admiration de Rossini à celle de Meyerbeer, apprenait seulement, avec une quasi indifférence et une incompréhension presque totale, l’existence de Beethoven dont les symphonies, rarement jouées, avaient soulevé des protestations dès 1807, lorsqu’on les exécuta pour la première fois à Paris. Schumann et Schubert étaient encore moins connus que Beethoven.
C’est dans le monde bruyant et artificiel où se heurtaient les « Jeune France » et les vieilles momies du classicisme que Berlioz apporta à la musique la flamme du véritable romantisme, ses passions et son génie. La jeunesse resta incompréhensive, mais les momies galvanisées ressuscitèrent pour se dresser contre lui. S’il n’avait fait que formuler des théories et produire une œuvre que son temps ne pouvait comprendre, on l’eût sans doute regardé un maniaque inoffensif et on l’eût laissé tranquille ; mais le musicien se doublait d’un homme de combat qui apportait dans la critique musicale ce qu’on n’y avait pas encore vu, l’opinion de quelqu’un qui connaissait la musique dont il parlait ! Et ce quelqu’un était de plus un maître de la plume, ardent, satirique, impitoyable à ceux qui prétendaient qu’un musicien n’avait pas le droit d’écrire sur la musique ! Il braconnait dans la chasse gardée des plumitifs « qualifiés ». Dans des pages lumineuses, il expliquait Beethoven que ces plumitifs accablaient de sarcasmes sans même l’avoir lu ou entendu. Il apprenait leur métier à ceux qu’il appelait les grotesques de la musique ; il fustigeait leur ignorance prétentieuse. Son œuvre de critique contre l’ignorance et la malhonnêteté pontifiantes est toujours à lire pour apprendre à mépriser une sottise qui est de tous les temps. De même qu’il avait révélé Beethoven à la France, il fut le premier à comprendre Wagner comme Wagner fut le premier à le comprendre. Ils ne s’aimèrent pas pour cela ; autant que la différence de leurs caractères, celle de leurs œuvres les séparait. Mais ils apportèrent tous deux les éléments d’une révolution qui les dépassait, étant dans l’air, depuis Gluck pour l’opéra, depuis Beethoven pour la symphonie. L’esprit de cette révolution venait incontestablement d’Allemagne ; ses « Welches » et ses « barbares » étaient plus musiciens que les Français, et c’est chez eux que Berlioz voyait le pays de la musque. Si l’Allemagne ne comprit pas mieux Berlioz que la France dans la pensée de sa musique du moins vit-elle tout de suite la grandeur de son génie musical. Elle sut lui être accueillante et attentive au point que M.F. Weingartner a fait, sur la musique allemande, cette constatation :
« En dépit de Wagner et de Liszt, nous ne serions pas où nous en sommes si Berlioz n’avait pas vécu. » (Cité par R. Rolland)
La France n’a pas encore reconnu une telle place à Berlioz, et ce n’est qu’en passant par Liszt que certains musiciens français, tel M. Saint-Saëns, ont subi son influence.
A la « musique de l’avenir », Berlioz donna la symphonie dramatique ; Wagner lui apporta le drame lyrique. La réforme de Wagner a produit depuis tout ce qu’on en pouvait attendre ; celle de Berlioz aura encore beaucoup à réaliser lorsque se dissipera le confusionnisme où l’on est plongé aujourd’hui. Il a manqué à Berlioz l’autorité dominatrice qui a amené à Wagner les plus réfractaires, cette volonté de discipline dont même les plus libertaires ont besoin pour faire œuvre de liberté. Tout était impulsion chez Berlioz, tout était méthode chez Wagner. Les passions étalent aussi ardentes, la foi dans l’art aussi profonde, chez l’un que chez l’autre, mais tandis que Berlioz s’abandonnait à elles, Wagner savait les dominer. Aucun artiste ne fut plus contradictoirement opposé à lui-même, dans sa vie et dans son œuvre, que le fut Berlioz ; aucun ne montra comme Wagner une plus inébranlable unité dans la continuité de la direction et de l’effort. R. Rolland a dépeint admirablement l’opposition de ces deux caractères. Berlioz eut le génie de la musique, sa force créatrice au point que, dit R. Rolland :
« Qu’on l’aime, ou qu’on ne l’aime pas, une seule de ses œuvres, une seule partie d’une seule de ses œuvres, un morceau de la Fantastique ; l’ouverture de Benvenuto, révèle plus de génie que toute la musique française de son siècle. »
Et R. Rolland ajoute :
« Quand j’ai nommé Beethoven, Mozart, Bach, Haendel et Wagner, je ne lui connais dans l’art musical, pas un supérieur, et même pas un égal. »
Mais s’il fut « un des génies les plus audacieux du monde », il lui manqua « la grandeur d’âme, la hauteur de caractère, la puissance de volonté et surtout l’unité morale » qui font le « grand homme » et que posséda Wagner, comme les possédèrent un Gluck et un César Franck, quoique inférieurs en génie.
Berlioz était plus qu’un musicien, il était « la musique même » et voulait l’émanciper de toutes ses contraintes. Personne ne fut plus révolutionnaire, même aujourd’hui où l’on croit l’être tant mais où on l’est si peu. Beethoven avait dit :
« Il n’y a pas de règles qu’on ne puisse blesser à cause de plus de beauté. »
Berlioz les blessa toutes et s’attaqua à toutes les routines. Mettant au-dessus de tout le sentiment et la passion, il délivra la musique de la « domination de la parole », de son « rôle humilié au service de la poésie ». Il rejoignit Mozart qui avait fait de la poésie « la fille obéissante de la musique ». Il s’insurgea contre Gluck qui avait cherché à réduire la musique à ce qu’il appelait « sa véritable fonction, celle de seconder la poésie pour fortifier l’expression des sentiments et l’intérêt des situations », et contre Wagner pour qui « la musique ne saurait exprimer l’action sans le secours de la parole et du geste ». On a ainsi les deux pôles que présentaient à « la musique de l’avenir » la symphonie dramatique de Berlioz et le drame lyrique de Wagner.
Pour rendre la musique libre, Berlioz voulait l’émanciper de la parole. Il avait raison contre Gluck et Wagner ; leur révolution est terminée, la sienne continue. Comme disait Banville, la poésie a sa musique propre, La parole qui a besoin de la musique pour se trouver une âme n’est pas de la poésie. La musique qui ne vit pas indépendamment de la parole n’est pas de la musique. Par contre, le geste, c’est-à-dire l’action, se sépare difficilement autant de la musique que de la poésie, et c’est lui qui entretient, avec toutes les conventions théâtrales, leur lien factice dans l’opéra et le drame lyrique ; intrinsèquement séparées, sinon hostiles, le geste les réunit.
Wagner, après avoir voulu théoriquement cette réunion, l’a réalisée au plus haut point possible ; nul autre n’aurait plus fait, tout autre serait probablement allé à un échec plus éclatant, car ce fut un échec, on ne peut que le constater aujourd’hui. Si Wagner a prolongé l’existence de l’opéra et lui a donné un siècle de plus d’existence en en faisant le drame lyrique, ce n’est nullement à ses théories qu’on le doit, c’est uniquement à son génie musical,
Wagner a exposé et défendu ses théories dans une œuvre écrite considérable. Elles sont d’une remarquable grandeur philosophique, dans leur idée du progrès parallèle de la nature et de l’homme ; elles sont profondément révolutionnaires en ce qui concerne les formes et la marche de ce progrès, particulièrement dans l’art. Wagner a dit :
« C’est par le peuple que l’Art progresse. Le Peuple est le seul créateur de l’œuvre d’art, créateur inconscient dont l’artiste saisit et exprime la création pour la rendre au Peuple. Le Peuple, c’est l’ensemble de tous les hommes qui s’efforcent d’échapper à la vie larvée, c’est tout homme qui « plus ou moins cultivé, savant ou ignorant, placé au plus haut ou plus bas de l’échelle sociale, éprouve et entretient en lui une aspira tian qui le force à sortir d’un lâche accommodement à la connexion criminelle liant notre Société et notre Etat, ou de l’obtuse soumission d’esprit à cet ordre de choses ; une aspiration qui lui fasse ressentir le dégoût des joies vides de notre civilisation, ou la haine d’un utilitarisme profitable seulement à ceux qui n’ont besoin de rien et non ceux qui manquent de tout... Le Peuple est l’ensemble de tous ceux qui éprouvent une commune détresse... »
C’est par l’Art que les hommes expriment leurs aspirations, leur commune détresse. Au temps des Grecs l’Art était l’expression de la conscience publique ; aussi était-il l’Art véritable, l’Art du Peuple. Depuis, il ne l’est plus, il est devenu l’expression particulière de certaines castes, de certains privilégiés, l’apanage d’une aristocratie plus ignorante et malveillante qu’éclairée et généreuse. Il faut que l’Art redevienne populaire, qu’il soit de nouveau l’expression de la conscience publique et, pour cela, qu’il soit révolutionnaire. Voilà le schéma très concis, de la théorie d’art, basée sur ses principes sociaux, que Wagner a développée dans ses écrits : Art et Révolution (1849), l’Œuvre d’Art de l’Avenir (1850), Opéra et Drame (1851), Lettre à M. Frédéric Villot sur la Musique (1860). Le théâtre était le moyen par lequel il voulait accomplir l’œuvre d’art révolutionnaire. Celui de la Grèce antique lui offrait « le modèle et le type des relations idéales de l’art et de la vie publique », car il voyait dans le drame tragique grec « l’œuvre d’art noble, parfaite, réunissant toutes les différentes méthodes d’expression artistique, toutes les branches de l’art aujourd’hui séparées ». Tous les arts doivent se réunir pour former le Drame, « fin véritable de l’expression d’art ». Le Drame doit recréer la Vie sous la forme symbolique et populaire du Mythe, poème primitif et anonyme du Peuple dans lequel la vie est humaine et non conventionnelle. Pour cette création nouvelle, la poésie et la musique, la parole et le geste, le décor et le mouvement de la scène doivent également coopérer. La musique ne saurait exprimer l’action dramatique sans le concours de tous ces éléments. Si grand que soit le développement qu’elle a pris depuis l’antiquité où elle n’était que l’accompagnement de la danse, la symphonie à laquelle elle est arrivée n’est que « l’idéal réalisé de la mélodie de danse ». Le drame ne peut exister sans elle, elle ne peut exister sans le drame. Telle est la théorie du drame wagnérien, complément de la théorie d’art social. Elle n’est qu’une belle théorie d’un « quarante-huitard » de l’art sur la musique et le théâtre. En pratique, elle se heurte non seulement à des conditions sociales différentes de celles de l’antiquité, mais surtout à des difficultés de réalisation encore plus grandes que celles de l’ordinaire opéra.
Heureusement, la musique de Wagner dépasse ses théories, et l’on peut dire qu’elle s’en évade malgré lui, pour rejoindre dans les espaces libres la symphonie dramatique de Berlioz. C’est pourquoi elle leur survivra et de nombreuses générations iront encore, comme celle de R. Rolland il y a quarante ans, « boire la joie, l’amour, la force dans les Meistersinger (les Maîtres Chanteurs), dans Tristan, dans Siegfried ». N’est-ce pas un véritable malaise qu’on éprouve lorsque la voix humaine, fût-ce celle d’une Litvinne, vient se mêler à l’inexprimable symphonie de la mort d’Yseult ? Et combien de fois, au cours de la Tétralogie, n’a-t-on pas la tentation de crier : « Silence ! » à un Wotan ou à une Fricka, insupportables bavards qui brisent l’action dramatique autrement claire et compréhensible à l’orchestre que dans leurs discours incohérents hachés de coupures!... Combien, pour peu qu’on soit familiarisé avec les leitmotiv wagnériens et qu’on puisse suivre la marche du drame dans ses développements harmoniques, le bonheur est plus complet d’écouter Wagner dans quelque coin obscur d’une galerie ou d’une loge dite « d’aveugle », à l’écart des élégances qui s’ennuient avec distinction et d’un snobisme qui ne sait « entendre et comprendre que le côté le plus efféminé de l’œuvre de Wagner ». (R. Rolland.)
Dans un monde d’artistes et de littérateurs indifférents à la musique, Baudelaire eut, le premier, le sens véritablement moderne de ce qu’elle était, comme il eut celui de la poésie et de tous les arts. Ce fut avec une intelligence pénétrante qu’il comprit Wagner. Il le défendit avec le plus beau courage contre « la badauderie publique qui en avait fait sa proie », contre la cabale des hommes « qui peuvent se donner le luxe d’une maîtresse parmi les danseuses de l’Opéra », et des « polissons qui se mouchent avec les doigts à cette fin de les essuyer sur le dos d’un grand homme qui passe » (Baudelaire : « l’Art romantique). Les symbolistes, à la suite de Baudelaire, imposèrent au snobisme la curiosité, sinon la compréhension de Wagner, au point que toutes les branches de l’art ne furent bientôt plus envisagées que sous un point de vue wagnérien (Voir Symbolisme). Wagner exerça alors un véritable envoûtement sur le monde musical. Il n’est pas de musiciens, considérés connue plus ou moins « réformateurs » du vieil opéra et constructeurs du nouveau drame musical, qui ne subirent son influence. Gounod, Verdi, Reyer, qui avait germanisé son nom Rey et fit une véritable bouillabaisse marseillaise de la Tétralogie dans son Sigurt, Saint Saëns, Massenet, Lalo, Chabrier, V. d’Indy, Bruneau, Chausson, Déodat de Séverac, Magnard, Fauré, Ropartz, Dukas, et nombre d’autres, même parmi les plus jeunes sur qui César Franck eut une influence plus déterminante. Presque seul, Bizet rejoignant Berlioz, sut demeurer purement français. Il n’en fut pas mieux compris par les Sarcey et autres fossiles pour qui Gounod avait fait la révolution définitive en musique.
Le wagnérisme eut ce résultat excellent de réveiller le goût musical et de multiplier l’activité des musiciens : il en sortit une réaction contre lui. D’abord timide elle se fit plus audacieuse lorsqu’elle eut trouvé en César Franck l’appui solide qu’il lui fallait. César Franck avait accompli une œuvre remarquable dans une quasi-solitude remplie par l’art, avec une conscience et une grandeur d’âme qui ne se démentiront jamais devant la mauvaise fortune et l’hostilité de son temps. S’il n’avait pas le génie de Berlioz, il avait une connaissance historique de la musique qui manquait à ce dernier. Il était nourri de Bach ; il en fut le continuateur dans la symphonie dramatique à laquelle il donna une sorte de pureté classique, tout en lui apportant une nouveauté hardie qui souleva contre lui les animosités. César Franck fut le maître de toute une école de jeunes musiciens pénétrés de sa science et de son esprit novateur. Ils formèrent les groupes des Chanteurs de Saint-Gervais (1892) et de la Schola Cantorum (1894), puis l’Ecole Supérieure de Musique, dirigée par V. d’Indy.
Les musiciens continuateurs de l’œuvre de C. Franck furent en quelque sorte les « chartistes » de la musique en ce qu’ils étudièrent ses anciens textes et les répandirent. En même temps, ils firent connaître la musique moderne, la russe en particulier, mais ils travaillèrent surtout à donner à la nouvelle musique une personnalité française en la dégageant du joug wagnérien Le mouvement aboutit, en 1902, à Pelléas et Mélisande, de Debussy. Cette œuvre fut le moment le plus caractéristique de la réaction antiwagnérienne ; elle rompit d’autant mieux le charme wagnérien qu’elle s’accordait avec les tendances et les goûts à la fois morbides et indépendants alors à la mode. Plus voluptueuse que virile, plus délicate que puissante, l’œuvre de Debussy est la formule d’un aristocratisme de l’esprit. Pelléas et Mélisande a de plus la faiblesse, malgré ses novations aux formules antérieures, de ne pouvoir se passer de la scène ; elle est par-dessus tout du théâtre. Elle a ouvert cependant des voies nouvelles nécessaires.
Plus que dans le drame lyrique, le théâtre musical s’est renouvelé dans la danse. Autant la collaboration de la poésie et de la musique est arbitraire et contradictoire, autant celle de la danse et de la musique est complémentaire et nécessaire. Le rythme commun scelle leur union. Il n’est pas une danse sans musique, il n’est pas une musique qui ne puisse être dansée, même la plus grave, la plus solennelle. La musique est 1’âme de la danse ; la danse est la réalisation plastique de la musique. La révélation que furent les ballets russes détermina un bouleversement complet dans les conceptions de la mise en scène et de l’interprétation dramatique musicale. Celle-ci prit alors sa véritable expression et toute son importance.
Commencée pur Debussy, et on peut dire en marge du monde musical par Erik Satie, vrai novateur toujours incompréhensiblement écarté des concerts, bien qu’il soit compréhensiblement écarté des concerts, bien qu’il soit mort, l’œuvre de renouvellement musical est continuée pur les Dukas, Ravel, Florent Schmitt, Roussel,. Honegger, Darius Milhaud, Poulenc, les russes Stravinsky et Prokofiev, l’espagnol De Falla, qui sont les plus notoires parmi les vivants actuels, et d’autres plus jeunes. Elle s’étend à toute la musique dramatique et symphonique et à tous les genres, depuis le drame lyrique (opéra), le ballet, l’oratorio, jusqu’à la symphonie et la musique de chambre. Mentionnons, en regrettant de ne pouvoir nous y arrêter davantage, les musiciens russes dont l’œuvre a eu une part si considérable d’influence dans la nouveauté du mouvement musical actuel, les Glinka, Dargomisky, Tchaïkovski, Balakireff, Borodine, Rimski-Korsakov, Moussorgski. C’est dans le folklore russe dans son inépuisable source populaire d’inspiration, que la musique russe a pris l’originalité et l’intensité de vie qui la caractérisent. En Allemagne, formant la transition entre Liszt-Wagner et les jeunes musiciens actuels, Brahms, le plus opposé aux novateurs, Bruckner, le plus hardi parmi ceux-ci et son disciple Hugo Wolf, véritable génie musical mort trop jeune, à qui R. Rolland a consacré un article plein d’émotion, Richard Strauss, Mahler, Humperdinck.
LA MUSIQUE ART SOCIAL.
R. Rolland a écrit, en parlant de la portée sociale des œuvres de Berlioz :
« Comment de pareilles œuvres sont-elles négligées par notre démocratie, comment n’ont-elles pas leur place dans notre vie publique, comment ne sont-elles pas associées à nos grandes cérémonies ? — C’est ce qu’on se demanderait avec stupéfaction, si l’on n’était habitué, depuis un siècle, à l’indifférence de l’Etat à l’égard de l’art. Que n’aurait pu faire Berlioz, si les moyens lui en avaient été offerts, ou si une telle force avait trouvé son emploi dans les fêtes de la Révolution ! »
L’indifférence de l’Etat à l’égard de l’art est celle de la démocratie qu’il représente. Pour qu’il réalisât cette œuvre populaire que R. Rolland voudrait lui voir accomplir, il faudrait d’abord qu’une véritable démocratie ne continuât pas « la sale et stupide République » que Berlioz voyait déjà dans celle de 1848. Berlioz ne se dressait pas contre la révolution et la démocratie, mais lorsqu’il invectivait « l’infâme racaille humaine », il avait, comme Renan, comme Flaubert, l’intuition de ce qu’elle ferait de cette révolution et de cette démocratie (voir Muflisme).
L’Etat suivant la platitude de son élite gouvernante, « ne peut permettre qu’un certain degré d’art » (M. Leygues, ministre des Beaux-arts). Le fait qu’un Berlioz peut faire partie de l’Institut ne change rien à ce principe pas plus que celui d’un César Franck égaré dans le professorat du Conservatoire où il scandalisait les Massé les Reber les Bazin, producteurs de rogatons musicaux, parce qu’il avait « l’audace de voir dans l’art autre chose qu’un métier lucratif » (R. Rolland). Depuis un siècle et demi que l’Académie des Beaux Arts a fait une place à la musique dans l’aréopage en y admettant six musiciens, on se demande quelle espèce de services elle lui a rendus.
Si, en Chine, depuis des milliers d’années, il y a au gouvernement un ministère de la musique, en France on n’a jamais eu un ministre que la musique ait intéressé, sauf en dilettante et comme protecteur de certaines de ses vestales. Malgré l’importance de la musique, la pédagogie officielle l’ignore ou ne s’en occupe que suivant des méthodes absolument incohérentes. L’organisation de son enseignement est d’une lamentable pauvreté, abandonnée à des initiatives parfois généreuses, trop souvent fantaisistes, sans programme sérieux qui la mettrait à sa vraie place dans la culture générale. L’enseignement démocratique, de plus en plus préoccupé de préparation guerrière et patriotique, aurait probablement banni la musique des écoles primaires si elle ne servait à apprendre aux enfants les exercices militaires en chantant :
Qui marchez comme de vieux braves... »
On a vu, dans les premiers jours de la guerre de 1914 ces défilés d’écoliers, conduits dans les rues par leurs instituteurs en « service commandé », piaillant une Marseillaise qu’ils n’avaient jamais appris à chanter ensemble et en mesure. L’éducation musicale populaire est le dernier souci de la démocratie. Elle estime faire tout son devoir quand elle subventionne quelque orphéon ou quelque musique de pompiers, et encore ne le fait-elle pas pour la musique. Quand l’orphéon a bien chanté, quand les pompiers ont bien soufflé dans leurs embouchures, ils ont soif et ils vont boire ; cela fait marcher le commerce des bistrots, « remparts de la dignité nationale ».
En 1927, dans les nouveaux programmes de l’enseignement secondaire, on oublia tout simplement d’inscrire la musique. On ne l’ignore pas moins dans les ouvrages en usage dans cet enseignement. Après avoir longuement raconté des niaiseries sur les faits et gestes des rois et de leur séquelle, exalté leurs victoires, dissimulé leurs crimes, « plutarquisé » effrontément l’histoire, on fait une petite place à la science, aux lettres, aux arts. On cite quelques noms de ces savants, de ces poètes, de ces artistes qui purifient le passé de toutes ses infamies, mais on ne fait aucune mention des musiciens. L’histoire officielle n’a jamais connu que le tambour, et elle met une sorte de pudeur à dire que les vainqueurs de Valmy chantaient la Marseillaise. Dans les lycées, les cours de musique sont le plus souvent des séances d’épouvantable « chahut » où le malheureux professeur, qui n’a rien d’un Orphée, est impuissant à charmer les jeunes fauves déchaînés contre lui. La musique, « art d’agrément », n’est pas une matière du baccalauréat, et la jeunesse qui se prépare dans des voies « réalistes » n’a pas à s’embarrasser la cervelle de cette « futilité ». Dans un état social où la civilisation ne serait pas le triomphe de la flibusterie financière et de la barbarie guerrière, on ne comprendrait pas que dans les établissements d’enseignement il n’existât pas des chœurs capables d’apporter leur concours à des fêtes musicales, et que ces chœurs n’existassent pas au moins dans les conservatoires, avec obligation pour tous les élèves de chant d’en faire partie. Mais les conservatoires ne sont que des écoles de vanité cabotine où tous professeurs et élèves, sauf quelques honorables exceptions qui n’influencent aucunement l’ensemble, ne cherchent qu’à se faire une situation personnelle aux dépens de leurs camarades et surtout de la musique. Quelle autre besogne pourrait-on demander à ces conservatoires lorsqu’ on voit les conditions matérielles de leur existence ? Il y en avait trente-six en 1914, il y en a actuellement quarante-quatre appelés pompeusement « nationaux ». En 1914 la subvention que l’Etat leur accordait était de 121.675 francs ; elle n’est, en 1930, que de 138.000 francs avec huit établissements en plus et le franc à quatre sous!... Certains de ces conservatoires, qui comptent plus de quatre cents élèves, reçoivent une subvention de 100 frs ! Aucun crédit n’est prévu pour le l’emplacement du matériel, l’achat de partitions, celui de pianos qui coûtent aujourd’hui 10 à 18.000 francs, etc... Des professeurs ont des traitements inférieurs à 1.200 francs par an. (Rapport de M. Bousquet, président de t’Association des directeurs des conservatoires nationaux).
L’enseignement supérieur n’est pas mieux partagé que le primaire et le secondaire. Nous avons vu qu’au moyen âge il y avait des chaires d’enseignement musical dans les Universités. La seule chaire de ce genre qui existait en France, avant 1914, état celle de la Sorbonne où avait enseigné R. Rolland. Il y en a une seconde, héritée de l’Allemagne, depuis que Strasbourg est redevenue une ville française. En Allemagne, il n’est pas une Université où la musique ne soit enseignée. Celle de Berlin compte sept professeurs et cinq cents étudiants suivent leurs cours. En une semaine, il se fait horairement, à l’Université de Berlin, autant de travail pour la musique que dans toute une année à la Sorbonne ! On voit que la France est de plus en plus « le pays des arts », comme disait ironiquement Daumier.
On assiste parfois, il la Chambre des Députés, à des joutes oratoires au sujet des « humanités », les classes dominantes ayant un intérêt majeur à maintenir un enseignement classique qui entretient leur séparation d’avec les prolétaires, à la faveur d’Aristote tripatouillé par Thomas d’Aquin. Mais on n’y parle jamais de la musique, art populaire par excellence qui fait les hommes égaux par les sentiments qu’elle inspire et qui serait la plus souveraine inspiratrice de la véritable société future comme elle le fut du communisme de Platon et de l’ l’Utopie de Thomas More.
Le seul et véritable progrès musical de notre époque se fait en dehors des institutions officielles, grâce à des entreprises privées d’enseignement et de concerts. Seules des entreprises particulières, aussi modestes que désintéressées, sont parvenues à entretenir dans l’âme populaire la faible flamme musicale qui y brûle encore. Ce n’est pas à l’Etat, c’est à Bocquillon-Wilhelmm, professeur de musique dans les écoles de Paris, dont la méthode d’enseignement mutuel donnait des résultats remarquables, qu’on dut, en 1836, la fondation du premier orphéon. Méthode et institution se répandirent dans toute la France, grâce aux efforts d’un disciple de Wilhelm, Eugène Delaporte. C’est ainsi qu’une œuvre d’éducation musicale pour le peuple, admirable dans ses intentions sinon dans ses résultats, fut fondée il y a un siècle. Elle continue de vivre, mais dans des conditions déplorables, abandonnée aux bonnes volontés qui, si nombreuses et si ardentes qu’elles soient, ne peuvent suffire à l’élever au niveau qui devrait être le sien. Béranger écrivait à son ami Wilhelm :
Quand les voix ont fraternisé ! »
Mais les pouvoirs publics ont autre chose à faire qu’à encourager la fraternisation des voix et l’entente des cœurs.
C’est toujours par les seules initiatives privées que des groupes de travailleurs sont arrivés à des résultats bien supérieurs à ceux des orphéons ordinaires, telle la phalange qui groupe deux cents exécutants instrumentistes et choristes des Forges et Aciéries d’Unieux (Loire), et interprète avec une intelligence et une précision remarquables un répertoire qui va des œuvres de Roland de Lassus à celles de Bach et de Wagner. L’initiative de M. Roger Ducasse a créé, parmi les élèves des écoles primaires de Paris, un groupe choral assez instruit pour interpréter dans de bonnes conditions de belles œuvres. M. Ducasse a fondé aussi la Chorale des professeurs et instituteurs de la Ville de Paris, dévouée avec ferveur à la musique. D’autres éléments non moins intéressants sont dispersés à travers la France, qui pourraient faire une œuvre considérable mais manquent de moyens, restant abandonnés des pouvoirs publics et de la foule livrée par ces pouvoirs à des joies musicales dégradantes. Aussi, la France est-elle largement distancée par l’étranger, l’Allemagne, en particulier, et même la « barbare » Russie où la musique populaire est d’une extraordinaire vitalité.
Tout l’effort de l’Etat, pour l’art musical, se concentre sur l’Opéra et l’Opéra-comique. Le premier, établissement somptuaire, pompeux et inutile, coûte très cher et rend de moins en moins de services à l’art musical. Mais il continue à faire partie du décor officiel, comme au temps des rois. Il est « de plus en plus un fastueux salon, un peu défraîchi, où le public s’intéresse plus à lui-même qu’au spectacle » (R. Rolland). Sa faillite artistique serait définitive si, depuis trente ans, le répertoire wagnérien, bien qu’il y soit fort maltraité, ne l’avait pas soutenu. Il chemine cahin-caha, perpétuant la gloire fanée des Rigoletto et des Faust anachroniques, incapable de donner une interprétation simplement correcte des chefs-d’œuvre du passé : Armide, Don Juan, Freychutz, etc., et de ne pas étouffer sous l’ennui mortel que fait peser son atmosphère les œuvres nouvelles, même les plus vivantes. Déjà, il y a deux cents ans, une nouvelliste écrivait :
« J’ai trouvé l’Opéra en assez mauvais état, à la danse près qui est plus parfaite que jamais. »
Seule encore aujourd’hui, la danse réussit parfois à mettre de la gaieté dans cet hypogée de la musique, comme elle met son sourire sur sa morne façade par l’admirable groupe de Carpeaux,
Le véritable théâtre musical est, à Paris, l’Opéra-comique, depuis qu’il a rompu avec les traditions du temps de Louis Philippe et que don José y a poignardé Carmen en 1875. Les œuvres les plus caractéristiques, à des degrés de valeur divers, de la musique française moderne, y ont été jouées : Carmen, de Bizet, Manon, de Massenet, le Roi d’Ys, de Lalo, Louise, de Charpentier, Pelléas et Mélisande, de Debussy, Ariane et Barbe Bleue, de Dukas, Bérénice, d’A. Magnard, Pénélope, de Fauré, la Lépreuse, de S. Lazzari, l’Heure Espagnole, de Ravel, etc... Il est fâcheux que l’art inférieur du vérisme, des Cavalleria Rusticana, des Tosca, des Navarraise, des Habanera et autres, y tienne tant de place. Par contre, les chefs-d’œuvre anciens y ont une interprétation plus exacte qu’à l’Opéra. Des représentations d’Iphigénie en Tauride, avec Mme Caron, d’Orphée, avec Mme Delna, de Fidelio, avec Mme Raunay, y ont été remarquables. Il est à regretter que l’orchestre et les chanteurs de l’Opéra-comique, pas plus que ceux de l’Opéra, n’arrivent à prendre le ton et le mouvement que réclament les œuvres de Mozart. Et ceci suffit à démontrer que le véritable rythme musical n’est pas dans le hourvari moderne où cet orchestre et ces chanteurs se trouvent plus à leur aise, sans doute parce qu’il s’y fait généralement plus de bruit que de musique. Parlerons-nous du théâtre musical en province ? Sauf de très rares exceptions, il y coûte aussi cher qu’à Paris et il est au-dessous de tout, son exploitation échappant à tout contrôle sérieux des municipalités et à toute critique, soit du public, soit de la presse qui prétend « éduquer » ce public.
Il n’y a que cent ans que la musique de concert a commencé à se répandre en France pour atteindre le grand public. Depuis cinquante ans, les entreprises se sont multipliées, et trop multipliées depuis trente ans, pour n’être bien souvent que des « affaires » où 1a musique à plus à perdre qu’à gagner, livrée qu’elle est à tous les procédés du banquisme.
Les premiers grands concerts furent ceux de la Société des Concerts du Conservatoire de Paris, fondée en 1828, sous la direction d’Habeneck. Bien que souvent retenue par la routine académique, cette société fit beaucoup pour le progrès musical. Elle commença la vulgarisation des symphonies de Beethoven dont le lumineux sillon ouvrit la voie à la musique symphonique quasi-ignorée en France. Elle admit Berlioz à ses programmes avant qu’il fût membre de l’Institut. Ce ne fut que vingt ans après, en 1848, qu’on vit le premier essai d’une entreprise de concerts indépendante. Seghers la créa sous le titre de Société de Sainte-Cécile. Elle dura jusqu’en 1854. En 1861, Pasdeloup fonda les premiers concerts populaires de musique classique. L’intention était remarquable et, si les résultats artistiques furent assez médiocres, l’entreprise n’en favorisa pas moins le goût musical qui s’éveillait dans les milieux intellectuels. L’intérêt soulevé par ces concerts provoqua la formation de la Société Nationale, en 1871, puis des Concerts Colonne, en 1871, et des Concerts Lamoureux en 1882. La Société Nationale répandit véritablement la connaissance de la musique symphonique et celle surtout des nouveaux musiciens français. Colonne s’appliqua à faire connaître Berlioz ; Lamoureux se voua à Wagner. Le vrai concert populaire où la musique, consciencieusement interprétée fut offerte au peuple, fut chez Colonne. Ses concerts ont fait une œuvre admirable pour la jeunesse studieuse et laborieuse que « l’ouvriérisme » ne détournait pas de la recherche intellectuelle et de la joie spirituelle. Les concerts Lamoureux avaient une clientèle plus aristocratique, mais pas plus intelligente ni plus vibrante d’un pur enthousiasme. Depuis, diverses sociétés de concerts se sont formées, se faisant une concurrence souvent plus boutiquière qu’artistique et dont les destinées n’ont pas toujours été heureuses. C’est que la musique ne trouve, parmi l’immense population parisienne, qu’un public assez restreint ; il serait insuffisant à faire vivre les entreprises musicales sans l’appoint important des étrangers de passage. En province se fondèrent aussi des sociétés de concerts qui plus ou moins prospérèrent et suivirent généralement les programmes des concerts parisiens.
Le public populaire qui ne s’abandonne pas aux basses productions de la musique théâtrale, du café-concert et du cinéma plus ou moins « sonorisé », fréquente quelque peu ces concerts, lorsqu’ils ne lui sont pas fermés par le snobisme. Il y met même une bonne volonté qui mériterait les encouragements sérieux d’un état social moins appliqué à l’abrutir. Mais tout se tient. On ne peut vouloir embellir l’existence intellectuelle et morale d’hommes qu’on veut tenir économiquement dans l’esclavage ; au travail-machine correspond la distraction-machine, au travail qui épuise le corps correspond le plaisir qui stérilise l’esprit. Plutôt que d’embellir la vie du travailleur, ses maîtres et leurs domestiques trouvent toujours que sont assez bons pour lui les ersatz, des sous-produits que des entrepreneurs d’ignominies fabriquent à son usage, estimant que la bonne musique n’est pas plus faite pour lui qu’une nourriture saine ou un bon pardessus. Si, « démocratiquement », on lui fait la faveur de lui offrir de la bonne musique, il ne faut pas qu’il soit trop difficile sur la qualité. C’est ainsi qu’on lit dans des journaux même socialistes, des opinions de ce genre :
« Pour attirer le public au concert, il n’est pas indispensable de lui donner des exécutions parfaites, mais simplement de lui présenter des œuvres dont il comprend la valeur et dont il goûte la beauté, même à travers les imperfections qui résultent surtout d’une trop hâtive préparation. »
Eh bien, nous disons énergiquement : Non!...
Pas d’art du tout, plutôt qu’un art « socialisé » de cette façon. C’est là une manière de faire « l’éducation musicale » du peuple, aussi pernicieuse que celle dont on fait son « éducation politique » ; la première lui fait perdre le sens du beau comme la seconde lui enlève toute vertu civique. Les démocrates-éducateurs suivent ainsi le courant général qui fait la contusion des classes dans le marais intellectuel du muflisme où il n’est plus rien que de bas. On s’habitue à des approximations, en musique comme en toutes choses, parce que l’utilitarisme tue le goût et que la mécanisation asservit l’intelligence et détruit le sentiment.
Il faudrait que les travailleurs comprissent bien toute la puissance éducative et émancipatrice de la musique. Elle rend l’individu plus fort, elle enrichit sa valeur collective, elle élargit sa puissance d’association et d’action. L’exemple le plus caractéristique de ce que peut faire la volonté populaire associée à une noble idée nous est donné aujourd’hui par les Fêtes du Peuple qui offrent aux travailleurs parisiens les plus magnifiques concerts qu’ils aient jamais eus. Ces fêtes sont nées de l’effort d’Albert Doyen, grand musicien et véritable artiste pour qui l’art n’a de signification que s’il est social. Après avoir commencé, il y a douze ans, en groupant pour chanter une centaine de travailleurs de toutes les professions, il a peu à peu élargi son œuvre, adjoint à son chœur un orchestre, et il est arrivé à offrir au public populaire qu’il convie dans les faubourgs, des fêtes musicales et poétiques qu’aucun grand concert ne lui offre. Aucun snobisme ne se mêle à l’élan spontané des prolétaires qui y participent, exécutants et auditeurs. Ils réalisent ainsi la grande pensée que Wagner a fait exprimer à Hans Sachs dans ses Maîtres Chanteurs de Nuremberg : « Le Peuple et l’Art sont solidaires ; ensemble ils fleurissent et prospèrent ». Ils poursuivent ainsi le but non moins magnifique de Berlioz qui voulait la liberté de la musique par la liberté humaine. Ils montrent la voie de la véritable émancipation au prolétariat tout entier, lorsqu’ils chantent l’hymne sublime de Beethoven :
De son radieux palais,
Que sur nous elle répande
La concorde avec la paix...
...Plus de haines, plus de guerres,
Grâce à son pouvoir vainqueur :
Tous les hommes sont des frères
Et n’ont plus qu’un même cœur. »
— Edouard ROTHEN.
NOTA. — Nous nous sommes tenus, dans cet article, pour ne pas lu i donner des développements hors de proportion avec le cadre de l’E.A. à parler de l’histoire de la musique, de ses transformations et de son importance sociale. Nous n’avons pu parler que superficiellement de l’usage qui en est fait, d’abord par les trafiquants qui l’exploitent en faisant servir habilement les instincts et les sentiments humains au négoce qui est le leur, ensuite comme moyen d’abrutissement social et de démoralisation humaine. Tout cela se tient avec le système de médiocratie avilissante auquel est tombée la société actuelle et que nous avons dénoncé dans différents articles, notamment dans Art, Beauté, Lettres, Littérature, Muflisme.
— E. R.
MUSULMANS (LES) NON CONFORMISTES : ISMAÏLIENS ET HASCHISCHINS
Si l’Islam devint la religion du proche Orient et même d’une partie de l’Afrique et de l’est Asiatique, il s’en faut de beaucoup qu’il fut accepté avec enthousiasme par tous ceux auxquels il s’était imposé manu militari. Son monothéisme rigide, son rigorisme alimentaire, sa discipline dogmatique n’allèrent pas sans provoquer des protestations et soulever des révoltes chez ceux des conquis qui n’avaient pas perdu le souvenir des cultes voluptueux du paganisme oriental.
Une des sectes les plus curieuses du monde musulman est certainement celle des Ismaïliens ou Ismaïliehs, pour lesquels le septième iman (ou descendant d’Ali, gendre de Mahomet), Ismaïl, fils de Djaffar, est l’incarnation de Dieu apparue sur la terre pour faire connaitre la vraie parole, ce qui réduit le Prophète à un rôle de second plan. Les Ismaïliehs sont mieux connus sous le nom de Haschischins — fumeurs de haschich — vocable rendu imparfaitement par celui d’ « assassins ». Cette secte eut son heure de célébrité au temps des Croisades, quand son grand maitre Rachid Sinan, le « vieux de la montagne » avait à sa dévotion de fanatiques séides, qui se chargeaient des missions les plus dangereuses, dès lors qu’étaient menacées leur croyance et leur organisation. Cette secte existe encore aujourd’hui, comme nous le verrons par la suite.
C’est dans le deuxième siècle qui suivit la mort de Mahomet que, en Syrie, en Perse et jusque sur les bords du Gange, une religion secrète se fonda, tendant à concilier les enseignements de Zoroastre et les préceptes de Mahomet, les mélangeant même avec les rites des anciens cultes syriens. Cette religion secrète ne se développa pas aussi rapidement que l’avaient rêvé ses grands maîtres, résidant en Perse, à l’ombre de l’Islam. Elle végéta longtemps et il fallut attendre jusqu’un XIème siècle pour que les « Haschischins » remplissent un rôle sur le théâtre de l’histoire de l’Orient. A ce moment, mal avisé est l’émir qui entreprend de les persécuter. Les sicaires du Grand Maître, les Fidawis (les dévoués) le surveillent et l’avertissent qu’il ait à interrompre sa poursuite, sinon c’est la mort : un feuillet piqué d’un poignard qu’il trouve dans sa tente, voilà 1’avertissement.
Personne ne sait comment et où atteindre les « Fidawis », mais eux savent comment et où atteindre l’ennemi condamné par le Grand Maître. Vivant auprès de l’homme désigné, ils seront, s’il le faut, soldats de sa garde, serviteurs de sa suite ; ils joueront un rôle quelconque dans son entourage ; ils auront recours à une ruse et à une volonté d’une ténacité prodigieuse : ils attendront des jours, des semaines, des mois : ils emploieront le poignard, voire le poison ; mais si celui qu’ils visent n’interrompt pas ses agissements, il sera exécuté. Les émirs ont des armées à leur disposition, les « Fidawis » sont quelques-uns : ce sont les émirs qui cèdent.
Les Ismaïliens eurent à se défendre contre les agressions franques. Quelques exécutions ôtèrent aux Croisés l’envie de les considérer comme ennemis et les relations avec le comte de Tripoli devinrent plus amicales. Le traité conclu avec Richard Coeur de Lion et Saladin, qui avait renoncé à combattre les « Haschischins », libérait leurs montagnes de toute occupation franque. Quelques temps après, Conrad de Montferrat viola de façon éhontée une des clauses du traité en faisant assassiner des prisonniers sarrasins. Sur la demande de Saladin, Rachid Sinan fit tuer le parjure.
Dans les jardins du Grand Maître, les « Fidawis » fumaient le haschich — l’herbe — qu’on appelle aussi kief — l’extase -. C’était une de leurs récompenses. Sous la voûte épaisse des grands noyers, à l’ombre des orangers enivrants, ils se délassaient donc de leurs expéditions en fumant l’herbe des extases.
Et sa demeure était comme un paradis.
Et tout était beau et l’on se sentait meilleur.
C’est pourquoi ils l’appelèrent le Paradis, mot dérivé de l’ancien persan pairideza ou du chaldéen pardes, et qui signifie jardin délicieux.
Les Ismaïliehs célébraient des rites érotiques et dans certaines occasions pratiquaient la communauté sexuelle. Il paraît qu’ils les célèbrent encore, à en croire un érudit, J. Bruna, qui nous a fourni des détails sur les scènes qui se déroulent lors de ces cérémonies et qui sont un reflet, bien atténué sans doute, de ce qui se passait aux temps où la secte brillait de tout son éclat !
Les Ismaïliehs — plutôt leurs descendants — sont assis, les jambes croisées à l’orientale, écoutant leur cheikh lire des passages du Bir Sadine, leur livre doctrinal. Cette lecture dure plusieurs quarts d’heure. Sur un piédestal aménagé exprès, une jeune fille, entièrement nue, se tient debout. Elle est le seul ornement de la salle. Elle demeure immobile, dans une pose hiératique, devant les auditeurs recueillis. La lecture achevée, chacun des assistants se lève l’un après l’autre et se met à genoux devant la jeune vierge en appuyant sa tête sur le « triangle sacré » de son origine.
Dans d’autres réunions auxquelles prenaient part les hommes et les femmes, qui avaient encore lieu il y a un demi siècle et moins encore, les fidèles se dépouillaient de leurs vêtements et toute lumière était proscrite. Au hasard des contacts, les couples s’enlaçaient dans l’extase d’un délire sacré ; seule, la compagne du cheik était laissée intacte. A observer qu’à l’instar de ce qui se passait dans les mystères païens ou parmi les sectes érotico-chrétiennes, ces rites étaient ou sont accomplis dans le recueillement et l’esprit le plus pur. La prostitution sacrée chez les Grecs et les Adonisiès de Byblos possédait ce caractère.
L’accouplement des sexes symbolise l’éternité. Il n’y a, pour s’en convaincre, qu’à se reporter un dernier verset de la deuxième leçon, « de la grande leçon du vénérable seigneur Rached ed Edine » aux croyants, ses disciples :
« Dieu a dit : Olivier qui n’est ni à l’Est ni à l’Ouest, il se trouve entre le genou et le nombril.
En vérité, en vérité : de lui viennent la Mort, la Vie, la Pauvreté, la Fortune.
La vérité, toutes les vérités, c’est le Kaf et le Sin (Le kèss ou sexe de la femme). »
Ce culte porte bien la marque de son origine persane et du IXème siècle, début des « Haschischins » ; c’est l’époque d’Omar Khayyam et des soufis première manière. Khayyam est l’ami d’enfance de Hassam ben Sabbah, grand maître des Ismaïliehs. S’il a chanté les jardins, les beaux vers, le haschich, le vin et les femmes, ce n’est pas seulement par tempérament, c’est qu’il incarne la réaction de l’épicurisme iranien contre le Coran et les bigots musulmans, contre l’oppression de la nature par la loi religieuse. Aussi, toute la secte est-elle derrière lui.
Lassés de poursuivre un idéal stérile, désespérés de prier un dieu insensible, Omar Khayyam et les Persans Ismaïliehs s’inclinent devant la grande loi de fatalité : les êtres comme les mondes suivent une courbe tracée par avance. On ne change rien à sa destinée : les vies succèdent aux vies, continuellement, indéfiniment, et conformément à une loi d’évolution inéluctable.
Le grand maître des Ismaïliehs actuels porte le nom d’Aga Khan ; il réside, personnellement ou représenté, à Bombay et il préside une société spirituelle qui vit en marge des sociétés temporelles. Il n’y a pas qu’en Syrie (Druses), dans le Liban (Nocairis), dans l’Inde (Ismaïlis), qu’on trouve des descendants des « Haschischins » ; on rencontre des Ismaïliehs au Zambèze, en Abyssinie et, assure-t-on, en Allemagne, en Angleterre et même en France. L’Aga Khan est considéré comme l’incarnation d’Ismaïl et il tranche, chaque année, dans le « Pharamane », le livre sacré de la doctrine, toutes les interprétations auxquelles peuvent donner lieu les dogmes. En Syrie le grand maître est représenté par un émir qui a, dans chaque village, un subordonné, élu par le peuple. Les Ismaïliehs n’ont pas le faciès sémite, ce sont des aryens, à la stature puissante, au teint clair, aux yeux bleus, ce qui avait donné lieu à l’hypothèse d’une origine due à un croisement de la race indigène avec les « croisés » du moyen âge. L’opinion actuelle est qu’ils sont d’origine exclusivement iranienne.
— E. ARMAND
MUTINERIE (MUTINS, MUTINES)
Subst. f. et m.
Mutin vient du vieux français meute ou muete : trouble, insurrection. Familièrement, ce mot signifie espiègle, vif (enfant mutin) ; mais nous retiendrons surtout ici le sens d’insoumis, de rebelle, de révolté ou porté à la révolte (les mutins de Calvi). Se mutiner : s’insurger, se révolter (le peuple est lent à se mutiner). Le nom de mutiné a été donné, dans les Pays-Bas, au XVIème siècle, aux soldats espagnols qui se révoltaient pour obtenir le paiement de leur solde arriérée. Ces révoltes revêtaient le caractère de véritables grèves militaires. Répudiant leurs chefs ordinaires, les mutinés choisissaient parmi eux celui qui devait les commander. L’élu (électo) soutenait devant les autorités les revendications des troupes mécontentes. Bientôt les mutinés voulurent s’indemniser eux-mêmes. Les Flamands achetèrent leur retraite, en 1606, moyennant 400.000 écus...
Des sens divers de mutinerie (où nous retrouvons : caractère espiègle, tournure vive, physionomie éveillée, etc.), nous intéresse surtout : mouvement, sédition de mécontents, explosion plus ou moins concertée de révolte qui affecte, en général, les milieux militaires. L’histoire est parsemée de ces gestes qui ont leur source dans des compressions maladroites ou excessives, des manquements aux promesses, des abus de pouvoir on de discipline coïncidant avec des périodes de lassitude, de surexcitation, où les hommes, excédés, se laissent plus facilement gagner par l’effervescence. Simples sursauts de mécontentement, au début, les mutineries menu courant d’agitation — grandissent parfois jusqu’à la révolte et elles sont presque toujours à l’aube des révolutions. Dignité humaine qui se réveille, lueurs qui montent au sein de la conscience populaire, elles animent souvent d’un frémissement les mutineries et idéalisent jusqu’à celles qui n’ont à leur base que les plaintes d’un corps affamé et des revendications matérielles. Rien ne dira mieux avec quel esprit nous les abordons et les enseignements que nous entendons en dégager que la narration, en bref, de quelques mutineries caractéristiques.
Nous ne remonterons pas aux séditions guerrières qui ont pu troubler les tribus primitives, nous ne regagnerons même pas l’antiquité qui vit des rebellions d’esclaves, des soulèvements de barbares et de vaincus enrôlés, des insurrections de bandes mercenaires. Nous prendrons des exemples modernes, des actes qui sont à peine du passé, dont la secousse a marqué sa trace dans la mémoire des dernières générations...
Si elle peut être le premier acte de l’insurrection, comme l’émeute prélude d’ordinaire aux révolutions, la mutinerie ne s’accompagne pas toujours d’une pensée d’émancipation, à quelque égard pour nous sympathique. Il est des mutineries qui furent des gestes de réaction, telles celles des galonnés cléricaux criant au martyre du clergé lors des inventaires consécutifs de la loi de séparation et des expulsions de congréganistes, sous le ministère Combes. Sous la Révolution française, la Vendée, fanatisée par les prêtres et les nobles, se mutina et fit une guerre obstinée et parfois sanglante de guérillas au nouveau régime.
* * *
Les mutineries abondent pendant la grande Révolution. C’est par une mutinerie militaire que le Peuple de Paris, en 1780, s’émut au point que, sur une motion votée au Palais-Royal (dont le jardin était la salle des Assemblées populaires), les prisons de l’Abbaye avaient été forcées, et les grenadiers des gardes françaises enfermés pour avoir refusé de tirer sur le peuple, avaient été délivrés et ramenés en triomphe. Cette émeute n’eut pas de suite. Une députation sollicita en faveur des prisonniers l’intérêt de l’Assemblée Constituante ; celle-ci les recommanda à la clémence du roi. Et ces grenadiers s’étant remis en prison reçurent leur grâce. Mais ce régiment, l’un des plus complets et des plus braves, était devenu favorable à la cause du peuple. Cela se passait aux premiers jours de juillet. Le 12, alarmées par la nouvelle du renvoi de Necker, plus de 10.000 personnes s’assemblaient de nouveau au Palais-Royal. Monté sur une table, un pistolet à la main, Camille Desmoulins les exhorte à soutenir le ministre déchu. Il s’écrie :
« Citoyens, il n’y a plus un moment à perdre ; le renvoi de Necker est le tocsin d’une Saint-Barthélemy de patriotes, ce soir même tous les bataillons suisses et allemands sortiront du Champ de-Mars pour nous égorger. Il ne nous reste qu’une ressource, c’est de courir aux armes ! » ...
Excitée par cette harangue hardie, la foule se répand dans les rues, réclamant le rappel du ministre réformateur Elle est assaillie par un détachement du Royal-Allemand (mercenaires étrangers), alors qu’elle promène en cortège les bustes de Necker et du duc d’Orléans et qu’elle a déjà gagné à elle le guet à cheval rencontré sur sa route et qui lui sert à présent d’escorte (autre mutinerie). Dispersée, celle foule se divise : une partie, sur la place Louis XV, est à nouveau attaquée par les dragons du prince de Lambèse et poursuivie dans le Jardin des Tuileries. Sabres au clair, les dragons frappent et tuent manifestants ou promeneurs. Le cri : « Aux armes ! » retentit alors dans les faubourgs comme au Palais-Royal.
Voici comment Mignet décrit la mutinerie des gardes françaises : « Le régiment des gardes françaises était, nous l’avons dit, bien disposé pour le peuple : aussi l’avait-on consigné dans ses casernes. Le prince de Lambesc, craignant, malgré cela, qu’il ne prit parti, donna ordre à soixante dragons d’aller se poster en face de son dépôt, situé dans la Chaussée-d’Antin. Les soldats des gardes, déjà mécontents d’être retenus comme prisonniers, s’émeuvent à la vue de ces étrangers, avec lesquels ils avaient eu une rixe peu de jours auparavant. Ils voulaient courir aux armes, et leurs officiers eurent beaucoup de peine à les retenir en employant tour à tour les menaces et les prières. Mais ils ne voulurent plus rien entendre lorsque quelques-uns des leurs vinrent annoncer la charge faite aux Tuileries et la mort d’un de leurs camarades. Ils saisirent leurs armes, brisèrent les grilles, se rangèrent en bataille à l’entrée de la caserne, en face des dragons et leur crièrent :
« Qui vive ? — Royal-Allemand. — Etes-vous pour le Tiers-Etat ? — Nous sommes pour ceux qui nous donnent des ordres. »
Alors les gardes-françaises firent sur eux une décharge qui leur tua deux hommes, leur en blessa trois et les mit en fuite. Elles s’avancèrent ensuite au pas de charge et la baïonnette en avant jusqu’à la place Louis XV, se placèrent entre les Tuileries et les Champs-Elysées, le peuple et les troupes, et gardèrent ce poste pendant toute la nuit. Les soldats du Champ-de-Mars reçurent aussitôt l’ordre de s’avancer. Lorsqu’ils furent arrivés dans les Champs-Elysées, les gardes-françaises les reçurent à coups de fusil. On voulut les faire battre, mais ils refusèrent : les Petits-Suisses furent les premiers à donner cet exemple, que les autres régiments suivirent. Les officiers, désespérés, ordonnèrent la retraite. La défection des gardes-françaises et le refus des troupes étrangères de marcher sur la capitale firent échouer les projets de la cour contre le peuple ». Une mutinerie militaire, en pareil cas, se transforme vite en fraternisation...
Pour la prise de la Bastille, le surlendemain, c’est encore aux mutins des gardes-françaises qu’on dut le succès, puisque, suivant Mignet :
« Il y avait plus de quatre heures qu’elle était assiégée, lorsque les gardes-françaises survinrent avec des canons. Leur arrivée fit changer le combat de face. La garnison elle-même pressa le gouverneur de se rendre. Le malheureux Delaunay, craignant le sort qui l’attendait, voulut faire sauter la forteresse, et s’ensevelir sous ses débris et ceux du faubourg. Il s’avança en désespéré, avec une mèche allumée à la main, vers les poudres. La garnison l’arrêta elle-même, arbora pavillon blanc sur la plate-forme et renversa ses fusils, canons en bas, en signe de paix. Mais les assaillants combattaient et s’avançaient toujours en criant : Abaissez les ponts ! A travers les créneaux, un officier suisse demanda à capituler et à sortir avec les honneurs de la guerre. — Non, non ! s’écria la foule. Le même officier proposa de mettre bas les armes si on leur promettait la vie sauve. — Abaissez les ponts ! lui répondirent les plus avancés des assaillants ; il ne vous arrivera rien. Sur cette assurance, ils ouvrirent la porte, abaissèrent le pont, et les assiégeants se précipitèrent dans la Bastille. Ceux qui étaient en tête essayèrent de sauver le gouverneur, les Suisses et les invalides, mais la foule criait : Livrez-nous les, ils ont fait feu sur les concitoyens, ils méritent d’être pendus ! »
* * *
Empruntons à Ange Pitou, le roman de Dumas père, ces pages qui dépeignent, en traits suggestifs, l’éclosion de la mutinerie des gardes qui précéda la prise de la Bastille (Chap. XI — La nuit du 12 au 13 juillet) :
« La rue avait d’abord paru vide et déserte à Billot et à Pitou, parce que les dragons, s’engageant à la poursuite de la masse des fuyards, avaient remonté le marché Saint-Honoré et s’étaient répandus dans les rues Louis-le-Grand et Gaillon ; mais à mesure que Billot s’avançait vers le Palais-Royal en rugissant instinctivement et à demi-voix le mot vengeance, des hommes apparaissaient au coin des rues, à la sortie des allées, au seuil des portes cochères qui, d’abord muets et effarés, regardaient autour deux, et assurés de l’absence des dragons, faisaient cortège à cette marche funèbre, en répétant d’abord à demi-voix, ensuite tout haut, enfin à grands cris, le mot : « Vengeance ! Vengeance ! »
La soldatesque criminelle s’était dispersée au loin.
Billot allait toujours, tenant dans ses bras le Savoyard sans mouvement. Derrière lui venait Pitou, le bonnet de la victime à la main... Ils arrivèrent ainsi, funèbre et effarante procession, sur la place du Palais-Royal, où tout un peuple ivre de colère, tenait conseil, et sollicitait l’appui des soldats français contre les étrangers...
Qu’est-ce que c’est que ces hommes en uniforme ? demanda Billot en arrivant sur le front d’une compagnie qui se tenait l’arme au pied, barrant la place du Palais-Royal, de la grande porte du château à la rue de Chartres.
— Ce sont les gardes-françaises ! crièrent plusieurs voix.
— Ah ! dit Billot, en s’approchant et en montrant aux soldats le corps du Savoyard, qui n’était plus qu’un cadavre. Ah ! vous êtes Français et vous nous laissez égorger par des Allemands!... Les gardes-françaises firent, malgré elles, un mouvement eu arrière.
— Mort ! murmurèrent quelques voix dans les rangs.
— Oui, mort ! Mort assassiné, lui et bien d’autres.
— Et par qui ?
— Par les dragons du Royal-Allemand. N’avez-vous donc pas entendu les cris, les coups de feu, le galop des chevaux ?
— Si fait ! Si fait ! criaient deux ou trois cents voix ; on égorgeait le peuple sur la place Vendôme.
— Et vous êtes du peuple, mille dieux ! s’écria Billot, en s’adressant aux soldats ; c’est donc une lâcheté à vous de laisser égorger vos frères !
— Une lâcheté ! murmurèrent quelques voix menaçantes dans les rangs.
— Oui, une lâcheté ! Je l’ai dit et je le répète. Allons, continua Billot, en faisant trois pas vers le point d où étaient venues les menaces ; n’allez-vous pas me tuer, moi, pour prouver que vous n’êtes pas des lâches ?
— Eh ! bien, c’est bon... c’est bon... dit un des soldats ; vous êtes un brave, mon ami, mais vous êtes bourgeois, et vous pouvez faire ce que vous voulez ; mais le militaire est soldat et il a une consigne.
— De sorte, s’écrie Billot, que si vous receviez l’ordre de tirer sur nous, c’est-à-dire sur des hommes sans armes, vous tireriez, vous les successeurs des hommes de Fontenoy, qui rendiez des points aux Anglais en leur disant de faire feu les premiers !
— Moi, je sais bien que je ne ferais pas feu, dit une voix dans les rangs. — Ni moi, ni moi, répétèrent cent voix.
— Alors, empêchez donc les autres de faire feu sur nous, dit Billot. Nous laisser égorger par les Allemands, c’est exactement comme si vous nous égorgiez vous-mêmes ! »
— Les dragons ! les dragons ! crièrent plusieurs voix en même temps que la foule, repoussée, commençait à déborder sur la place, en fuyant par la rue Richelieu. Et l’on entendait, encore éloigné, mais se rapprochant, le galop d’une lourde cavalerie retentissant sur le pavé.
— Aux armes ! Aux armes ! criaient les fuyards.
— Mille dieux ! dit Billot, tout en jetant à terre le corps du Savoyard qu’il n’avait pas encore quitté, donnez-nous vos fusils, au moins, si vous ne voulez pas vous en servir.
— Eh ! bien, si fait, mille tonnerres ! nous nous en servirons, dit le soldat auquel Billot s’était adressé, en dégageant des mains du fermier son fusil que l’autre avait déjà empoigné. Allons, allons, aux dents la cartouche ! et si les Autrichiens disent quelque chose à ces braves gens, nous verrons.
— Oui, oui, nous verrons, crièrent les soldats, en portant leur main à leur giberne et la cartouche à leur bouche.
— Oh ! tonnerre ! s’écria Billot piétinant, et dire que je n’ai pas pris mon fusil de chasse. Mais il y aura peut-être bien un de ces gueux d’Autrichiens de tué, et je prendrai son mousqueton.
— En attendant, dit une voix, prenez cette carabine, elle est toute chargée. »
Et, en même temps, un homme inconnu glissa une riche carabine aux mains de Billot.
Juste à ce moment, les dragons débouchaient sur la place, bousculant et sabrant tout ce qui se trouvait devant eux. L’officier qui commandait les gardes-françaises fit quatre pas en avant.
— Holà ! Messieurs les dragons, cria-t-il, halte-là ! s’il vous plaît.
Soit que les dragons n’entendissent pas, soit qu’ils ne voulussent pas entendre, soit enfin qu’ils fussent emportés par une course trop violente pour s’arrêter, ils voltèrent sur la place par demi-tour à droite, et heurtèrent une femme et un vieillard qui disparurent sous les pieds des chevaux.
— « Feu donc ! feu ! » s’écria Billot : il était près de l’officier, on put croire que c’était l’officier qui criait.
Les gardes-françaises portèrent le fusil à l’épaule, ils tirèrent un feu de file qui arrêta court les dragons.
« — Eh ! Messieurs les gardes, dit un officier allemand, s’avançant sur le front de l’escadron en désordre, savez-vous que vous faites feu sur nous ? Pardieu ! si nous le savons, dit Billot. »
Et il fit feu sur l’officier qui tomba.
Alors les gardes-françaises firent une seconde décharge, et les Allemands, voyant qu’ils avaient à faire, cette fois, non plus à des bourgeois fuyant au premier coup de sabre, mais à des soldats qui les attendaient de pied ferme, tournèrent bride, et regagnèrent la place Vendôme au milieu d’une si formidable explosion de bravos et de cris de triomphe, que bon nombre de chevaux s’emportèrent et s’allèrent briser la tête contre les volets fermés.
— Vivent les gardes-françaises ! cria le peuple. Vivent les soldats de la patrie ! cria Billot.
— Merci, répondirent ceux-là, nous avons vu le feu et nous voilà baptisé...
Après cela, la foule s’en fut piller les armuriers. Quelqu’un s’est écrié : Courons aux Invalides, il y a vingt mille fusils et d’autres armes ! A l’Hôtel de Ville ! s’exclament d’autres, il y a des armes aussi ! Et le Peuple, vite armé, marcha sur la Bastille. »
C’est à dessein que j’ai pris le récit d’une mutinerie dans l’œuvre d’un romancier comme Alexandre Dumas, qui ne peut être taxé d’avoir voulu servir, à sa manière, la cause révolutionnaire. Cet épisode correspond assez exactement à l’état d’esprit du peuple de 1789, à la veille du 14 juillet. Et il est à remarquer que souvent les écrivains romanciers, avec leur imagination, ont l’art de dépeindre des événements historiques par des détails plus exacts, plus véridiques, plus vivants que ne le font ordinairement les historiens, si réputés soient-ils.
* * *
Chaque révolution apporterait suffisamment d’exemples à l’appui de ce que j’ai avancé, à savoir : qu’une mutinerie militaire est très souvent le prélude d’événements considérables. Les faits cités pour la Révolution de 1789, se sont renouvelés pour la Révolution de 1830, où les jeunes gens des écoles militaires eux-mêmes se sont mêlés aux gens du peuple défendant leurs barricades. La révolution de 1848 eut bien aussi, quoique moins connus, quelques épisodes de mutineries militaires. Quant à la Révolution de 1871, nous ne pouvons oublier que ce fut la mutinerie du 88ème de ligne qui, le 18 mars, à Montmartre, donna naissance à la Commune. Très brièvement, narrons les faits :
— Dans la nuit du 17 au 18 mars, le général Lecomte, à la tête de gendarmes et de policiers déguisés, se glissant comme des bandits à travers les rues de Paris, devait s’emparer des canons de la garde nationale. Ce guet-apens, qui avorta, eut pour conséquence que le 18 mars 1871, à la première heure, Paris fut réveillé pur ce coup de tonnerre : Vive la Commune ! Dès sept heures et demie, le tocsin sonnait, les tambours battaient la générale, et les clairons se faisaient entendre sur la Butte en émoi. Policiers et gendarmes avaient ordre de faire feu sur quiconque résisterait à leur tentative. Les compagnies de gardes nationaux alertés se réunissaient à la hâte sur les points divers de Montmartre. La foule constamment s’augmentait de femmes, d’enfants, de badauds pour assister à cet enlèvement des canons que le peuple lui-même avait hissés sur la Butte, à l’annonce de l’entrée de l’armée allemande à Paris. Vers sept heures un quart, une véritable barricade humaine s’était formée entre les soldats et la garde nationale armée et décidée à la résistance. Situation grave. Le général Lecomte avait compris, trop lard, le danger d’un tel contact. Déjà la foule, mêlée à une compagnie du 88ème de ligne, exhortait les soldats à faire cause commune avec elle. La situation était devenue désastreuse pour le général qui voyait ses hommes entourés d e toutes parts et semblant déjà fraterniser. Devant cette mutinerie naissante, il ordonne aux soldats de charger. Gardiens de la paix, gardes républicains et gendarmes se préparaient à obéir, mais les soldats, auxquels s’était mêlée plus intimement la foule, étaient fort hésitants. Les femmes leur criaient :
« Est-ce que vous tirerez sur nous, sur vos frères, sur nos maris, sur nos enfants ? »
Les officiers menacèrent les soldats, mais ils furent aussitôt entourés et injuriés par les femmes. C’est alors que les soldats du 88ème de ligne, mettant crosses en l’air, fraternisèrent avec les gardes nationaux. Et la foule, frénétiquement, cria « Vive la ligne ! A bas Vinoy ! A bas Thiers ! » — Enfin, le général Lecomte qui avait reçu l’ordre de prendre les canons aux gardes nationaux fut désarmé par ses propres soldats et collé au mur, ainsi que le général Clément Thomas qui avait fait fusiller la foule en 1848.
La mutinerie du 88ème de ligne fut le baptême de la Commune. Le geste du 18 mars 1871 ne se renouvela malheureusement pas en mai et la Commune fut vaincue (voir Commune).
Mais nous ne pouvons tout citer et la nécessité d’abréger nous oblige à passer sous silence des épisodes édifiants, des mutineries éparses à travers un demi-siècle des régimes les plus divers et faussement prometteurs de justice. Combien, en France et ailleurs, de mutineries dont la presse stylée par ceux, maîtres et possédants, qui redoutaient la contagion, s’est bien gardée de se faire l’écho !
* * *
La guerre russo-japonaise ne nous a guère fourni d’exemples sérieux de mutineries militaires, mais il est certain qu’il s’en produisit de part et d’autre. Ces deux peuples aux prises n’ont pas été sans avoir, çà et là, quelques sursauts de conscience et des manifestations plus ou moins étendues d’indiscipline. Cette guerre, terminée par le triomphe des troupes et de la stratégie nipponnes sur l’armée et la flotte du tsar, commença la révolution russe. Plus que jamais, l’esprit de révolte planait sur la terre de Russie. Une profonde et mystérieuse transformation s’accomplissait dans les cœurs et les cerveaux innombrables du peuple russe ; Les mêlées atroces avaient donné le mépris du danger à ceux qui les avaient affrontées pour rien et les disposaient à les affronter pour quelque chose.
C’est alors que se dessinèrent les formidables mouvements populaires, pacifiques, de 1905. En juin, éclata le mémorable élan du Potemkine. L’exemple en fut salutaire et contagieux puisqu’il suscita contre la tyrannie les mutineries magnifiques de la flotte rouge.
Sans nous étendre outre mesure sur les événements de 1905 en Russie, nous croyons utile de rappeler un des plus grands de cette fameuse année. Il se produisit entre la grève d’octobre et les barricades de décembre, à Petersbourg : ce fut la révolte militaire de Sébastopol, qui commença le 11 novembre. Le 17 du même mois, l’amiral Tchouknine, dans son l’apport au tsar, écrivait :
« La tempête militaire s’est apaisée, la tempête révolutionnaire continue. »
À Sébastopol, les traditions du Potemkine n’étaient point mortes, dit Léon Trotsky (dans son ouvrage curieux et instructif : « 1905 ») ; Tchouknine avait exercé de cruelles représailles sur les mutins du cuirassé rouge : 5 furent fusillés, 2 furent pendus et plusieurs dizaines envoyées aux travaux forcés. Le Potemkine avait été rebaptisé et était devenu le Pantéleïmon. Mais les violences répressives ne laissèrent point les marins atterrés, elles stimulèrent leur combativité. Dans les meetings des grèves d’octobre, matelots et soldats d’infanterie assistaient, non seulement comme auditeurs, mais comme orateurs. En tête des manifestations révolutionnaires, la fanfare des matelots se plaçait et jouait la Marseillaise. Les bons sujets du tsar observaient anxieusement ce qu’ils appelaient une « démoralisation » complète. L’autorité voulut réagir en interdisant aux militaires d’assister aux réunions populaires. La conséquence en fut que des meetings purement militaires s’organisèrent dans les cours des équipages de la flotte et dans les cours des casernes. Les officiers n’osaient protester. Les militants révolutionnaires entraient à toute heure du jour et de la nuit et, nous dit Trotsky, les représentants du Comité réprimaient de leur mieux l’impatience des matelots qui voulaient en venir immédiatement aux actes. Le Pruth, flottant à quelque distance et transformé en bagne, rappelait que des hommes souffraient pour avoir participé à la mutinerie du Potemkine. Le nouvel équipage de ce dernier se déclarait prêt à conduire ce vaisseau à Batoum pour soutenir la révolte du Caucase. Les meetings ouvriers se multipliaient et comme on défendait aux soldats de se rendre en ville pour y assister, les masses ouvrières se rendirent aux réunions des soldats et des marins. Il y avait des assemblées de dizaines de milliers d’assistants. Les officiers, à leur tour, voulurent prendre la parole et prononcer des discours « patriotiques » dont le résultat fut pitoyable. Les matelots, devenus experts dans la discussion, ridiculisaient leurs chefs par des arguments qui mettaient ceux-ci en déroute. Alors, on décida d’interdire toute réunion. Le 11 novembre, devant la porte des équipages, dès le matin, fut mise une compagnie de fusiliers. Le contre-amiral Pissarevsky déclara à haute voix, s’adressant au détachement :
« Qu’on ne laisse personne sortir des casernes. En cas de désobéissance, je vous commande de tirer. »
De la compagnie sortit alors un matelot nommé Pétrov : devant tout le monde, il arma sa carabine et, d’un premier coup, tua le lieutenant-colonel du régiment de Brest : Stein ; d’un second coup, il blessa Pissarevsky. On entendit l’ordre donné par un officier :
« Qu’on l’arrête ! »
Personne ne bougea. Pétrov laissa tomber sa carabine.
« Qu’est-ce que vous attendez ? Prenez-moi. »
Il fut arrêté. Les matelots qui accouraient de tous côtés exigèrent son élargissement, disant qu’ils répondaient de lui. — Pétrov, tu ne l’as pas fait exprès ? demandait un officier, cherchant à sortir de cette situation. — Comment, pas exprès ? Je suis sorti du rang, j’ai armé ma carabine, j’ai visé. Est-ce que cela s’appelle « pas exprès » ? — L’équipage demande ton élargissement... Et Pétrov fut mis en liberté. Les matelots, impatients d’agir, arrêtèrent, désarmèrent et envoyèrent dans le local du bureau tous les officiers de service. Finalement, après avoir fait garder toute la nuit ces officiers par quarante hommes, ceux-ci décidèrent de les mettre en liberté, mais de ne plus les laisser entrer dans les casernes. De plus, comme par le passé, les matelots assurèrent le service estimé par eux nécessaire.
D’autres mutineries seraient encore à décrire ici, car les soldats continuèrent à gagner à eux les soldats et à désarmer les officiers. Ils obtenaient de tous les soldats la promesse de ne pas tirer. Il y eut des manifestations sans pareilles. Les soldats, sans chefs, musique en tête, en bon ordre, sortirent des casernes et leurs troupes se mêlèrent aux cortèges ouvriers. C’était un enthousiasme indescriptible. Ainsi donc, des mutineries militaires, collectives et individuelles, se succédaient, préludant à la révolte et la révolution semblait inévitable.
La soirée du 13 novembre fut un moment décisif dans le cours de ces événements : la commission des députés invita à prendre la direction militaire le lieutenant Schmidt, officier de marine en retraite, qui s’était acquis une grande popularité dans les assemblées populaires d’octobre. Il accepta courageusement l’invitation et se trouva ainsi à la tête du mouvement, embarqua le lendemain soir sur le croiseur Otchakov, y arbora le pavillon amiral et lança le signal : « Je commande la flotte Schmidt », comptant ainsi attirer toute l’escadre à lui. Puis il dirigea son croiseur vers le Pruth, afin de mettre en liberté les « mutins du Potemkine ». Aucune résistance ne lui fut opposée ; l’Otchakov prit à son bord les matelots forçats et fit avec eux le tour de l’escadre. Sur tous les vaisseaux retentissaient des hourras, des acclamations. Quelques navires, et, parmi eux, les cuirassés Potemkine et Rostislavl arborèrent le drapeau rouge. Ayant ainsi pris la direction de la révolte, Schmidt fit connaitre sa conduite par la déclaration suivante adressée au Maire de la ville :
« J’ai envoyé, aujourd’hui, à Sa Majesté l’Empereur, un télégramme ainsi conçu : La glorieuse flotte de la Mer Noire, gardant saintement sa fidélité à son peuple, exige de vous, Souverain, la convocation immédiate d’une Assemblée Constituante et cesse d’obéir à vos ministres. — Le Commandant de la Flotte : Citoyen Schmidt. »
On ordre arriva de Pétersbourg par télégraphe :
« Ecraser la révolte. »
Alors, ce fut l’anéantissement de la révolution. Mais (comme écrit Trotsky dans « 1905 », où nous puisons ces renseignements), quel immense pas en avant, quand on compare cette révolte avec la mutinerie de Cronstadt!...
* * *
De la défaite de 1905 aux prémisses révolutionnaires de 1917, douze années d’oppression tsariste n’ont cessé de peser sur le peuple russe. Puis, refoulant les tergiversations de la bourgeoisie mencheviste enlisée dans une caricature de république, s’est affirmée la révolution bolchevique s’attaquant au système de la propriété, appelant ouvriers et paysans à prendre la succession de classes défaillantes et périmées. Sous l’impulsion des Lénine et des Trotsky, elle instaurait le nouveau régime dit de « dictature du prolétariat ». A travers tous ces événements, des mutineries importantes ont surgi. Il faut en connaitre les causes. Rappelons-les :
Sur les ordres de Londres et de Paris, malgré la volonté de paix du peuple russe épuisé, fut déclenchée la sanglante offensive du 18 juin 1918. Le premier soin des révolutionnaires au pouvoir fut d’entamer les négociations de paix de Brest-Litovsk. De ce fait, en dépit de sa collaboration douloureuse à la guerre de 1914–1918, en dépit de ses sacrifices antérieurs, sans souci de son épuisement, la Russie fut abandonnée de ses alliés de la veille et livrée à la brutalité, victorieuse alors, du militarisme allemand. De cette paix séparée, signée par la Révolution russe, date la haine mortelle que lui ont vouée la France et l’Angleterre. Tous les moyens vont être employés contre elle, car elle est un danger permanent pour les nations dont les peuples souffrent toujours des maux sociaux, dont le peuple russe s’est, au moins partiellement, libéré... Il fallait donc abattre la Révolution par la guerre sourde, sournoise et détournée, qui ne se découvre, qui ne se déclare pas. Les provocations par voie diplomatique, les hostilités par intermédiaires, l’étouffement par blocus, l’espionnage, la trahison, tout, enfin, fut mis en œuvre ou préparé.
Pour l’exécution de desseins inavouables, il fallait surtout disposer d’une flotte redoutable et créer dans les équipages un état d’esprit aussi favorable à l’intervention en Russie qu’il l’était déjà parmi les officiers dé marine. Malheureusement pour les ennemis de la Révolution russe, la flotte française avait beaucoup souffert pendant la guerre : on avait abusé de la fatigue des matelots, sans compensation aucune. La nourriture, non seulement était insuffisante, mais encore elle était exécrable ; il y avait aussi pénurie de vêtements, rareté des permissions, arrogance et brutalité des chefs, enfin mille sujets matériels et moraux de mécontentement ajoutés à l’anxiété de ne jamais savoir où l’on allait et pourquoi faire et quand ça finirait. Ces dispositions n’étaient pas un terrain bien favorable « à la propagande civilisatrice de mission humaine contre les Soviets », ainsi que disent les descendants de la Révolution française. Les matelots, qui savaient que la guerre n’avait pas été déclarée à la Russie, s’étonnèrent qu’on les dirigeât contre cette nation et comprirent le rôle odieux qu’on voulait leur faire jouer.
La mutinerie déjouerait cet infernal calcul aussitôt que l’occasion s’en présenterait. Déjà des régiments français désignés pour aller combattre les Russes furent envoyés à Odessa. Ces régiments composés en majeure partie d’hommes venus du front occidental s’étaient embarqués à contre-coeur pour une expédition lointaine. Le 8 mars 1919, deux compagnies d’un régiment de la 156e division, cantonnées à Odessa et envoyées à Kherson, quand elles s’aperçurent qu’on voulait les employer contre la Révolution russe, refusèrent de se battre. On les ramena à Odessa.
Et, le 11 mars, neuf hommes, arbitrairement choisis, furent arrêtés et condamnés à cinq ans de travaux publics pour refus d’obéissance en présence de rebelles armés (les rebelles, c’étaient les Russes : ils n’acceptaient pas la dictature des envahisseurs). Le Conseil de guerre, sans instruction préalable, et refusant d’entendre les témoins à décharge, condamna ces courageux soldats au nom de la « justice » militaire ! Mais cela n’empêcha pas le mécontentement et l’indignation de se manifester dans la flotte, de façon virulente, d’avril à juin 1919 : des mutineries devaient éclater à Galatz, Sébastopol, Odessa, Toulon, Bizerte, Itéo.
Un crime du commandement français à Kherson allait hâter l’explosion de toutes les colères. Après que les soldats français eurent refusé de se battre contre les Russes, on fit venir à Kherson des régiments grecs. Les Russes qui s’étaient mis à reculer devant les Français, ne voulant pas, disaient-ils, répandre un sang précieux, quand ils virent la sauvage attaque des Grecs, décidèrent de se défendre : un combat s’engagea pour la possession de Kherson. Les Grecs, renforcés de détachements allemands et polonais, tenaient la ville, commandés par un officier allemand. Dans le port, un cargo français se tenait prêt à débarquer des tanks destinés à appuyer les troupes grecques ; des femmes de la ville avec leurs enfants s’étaient réfugiées sur ce cargo pour échapper au bombardement. Voyant que la ville allait être prise par les Russes, l’amiral français donna l’ordre au cargo de s’éloigner pour que les tanks ne tombassent pas aux mains des bolcheviks victorieux ; les femmes et les enfants réfugiés furent mis en demeure de quitter le bateau sous la mitraille et, comme elles hésitaient, effrayées, on les poussa dehors à coups de crosses. Les malheureuses se réfugièrent sous des hangars. Alors les deux canonnières françaises, pour se venger sans doute de la perte de la ville, bombardèrent les hangars avec des obus incendiaires. Et comme des femmes, folles de terreur sous ce bombardement, fuyaient les hangars dans leurs vêtements enflammés, elles furent impitoyablement achevées par les mitrailleuses des deux canonnières. Les hauts politiciens de France n’ont pas ignoré ces hauts faits, que nous pouvons appeler de honteux forfaits, d’épouvantables actes de sauvagerie justifiant toutes les révoltes, de véritables défis à la conscience humaine et font comprendre combien beaux sont les gestes de mutinerie des héros de la Mer Noire.
* * *
Le torpilleur Protêt qui appartenait, pendant la guerre, à la division des flottilles de l’Adriatique si durement éprouvée, fut envoyé, après l’armistice, à Constantinople et dans la Mer Noire. En 1918, ce torpilleur fut mis à la disposition du général Berthelot pour transporter à Odessa, Sébastopol et Novorossisk les officiers de l’état-major chargés de missions importantes : ainsi, au début d’avril 1919, le Protêt transporta quatre officiers, dont un intendant général, de Galatz à Sébastopol, via Odessa et retour, pour leur permettre de... visiter le Musée de l’Armée de Sébastopol ! Ce voyage ne coûtait que 200 tonnes de mazout à 1.000 francs la tonne... Parmi l’équipage, le mécontentement, un moment apaisé parce que la détente formidable de l’armistice faisait oublier les souffrances passées, allait s’aggravant du fait de multiples corvées, stupides et inutiles, reculant toujours la libération. L’indignation d’une partie de l’équipage grandissait. Un officier mécanicien, André Marty, déjà mis à l’écart des autres officiers qui le méprisaient parce qu’il avait une mentalité différente, osa se montrer écœuré de l’ignoble besogne politique à laquelle on le mêlait contre le peuple russe. Les meilleurs marins de l’équipage du Protêt, après avoir supporté fatigues, privations, intempéries, dangers, ajournements de libération, partageaient le noble sentiment de Marty sur l’abominable attentat que la République Française leur faisait commettre contre la République des Soviets. Ces fils de travailleurs, travailleurs eux-mêmes, ne pouvaient se faire à l’idée qu’on leur fît porter une main sacrilège sur la liberté de frères de misère œuvrant révolutionnairement pour leur émancipation. Marty trouva, en la personne du quartier-maître Badina un camarade intelligent et instruit, homme de coeur et de caractère. Ayant tous deux la même haine de l’injustice et le même généreux idéal, Marty et Badina se comprirent. Ajoutons que, dans toute la flotte, parmi les marins pour qui la guerre n’était pas terminée, la révolte fermentait sourdement. En mars, allant à terre, les deux hommes furent mis au courant par des soldats que les 176ème et 158ème bataillons avaient refusé de marcher contre les Russes. Ils approuvèrent le geste de ces mutins en disant :
« Nous aussi, nous en avons assez ! »
Mutuellement, les marins s’instruisaient sur la Révolution russe et ses causes et ils s’enthousiasmèrent aux succès de la République des Soviets. Quand ils eurent connaissance des radios de protestation de Tchitcherine sur les massacres commis par les alliés, notamment contre les 200 femmes et enfants de Kherson par les canons de vaisseaux français, ils refusèrent d’abord d’y croire. Mais, comme pour les convaincre, le vice-amiral Amet tint à venir lui-même apporter des aveux, en félicitant les canonniers du Mameluck, tristes héros de cet infâme exploit ; les officiers et une partie de l’équipage du Protêt avaient été conviés à entendre le discours de l’amiral qui traita les Russes de « bandes d’assassins conduits par des canailles », et il conclut ainsi :
« Vous n’avez pas hésité à tirer, c’est très bien ! »
Marty, qui était présent, ne craignit pas, entendant les propos tenus par celui qui avait fait bombarder une ville ouverte, de manifester son indignation au commandant du Protêt, un nommé Welfélé. Les équipages, qui ne doutaient plus de la véracité des radios de Tchitcherine étaient exaspérés des lâchetés commises contre les Russes. Ceux du Protêt se groupèrent autour de Marty et de Badina et, le 12 avril, ceux-ci arrêtèrent un plan de mutinerie pour faire cesser l’intervention en Russie et pour provoquer le retour en France, il s’agissait de s’emparer du Protêt en enfermant les officiers et de se réfugier dans un port bolchevik pour s’y organiser, puis de gagner Marseille avec les bateaux qui se seraient joints au Protêt, afin d’exiger la cessation de la guerre criminelle et anticonstitutionnelle faite à la Russie. Mais un certain matelot-canonnier, nommé Durand, entré dans le complot, dès le 13 avril, et sur lequel on croyait pouvoir compter, car il devait de la reconnaissance à Marty, trahit en compagnie de deux de ses amis... Donc, le 15 avril, les conspirateurs réunis à Galatz entendirent Marty dénoncer l’illégalité criminelle de l’intervention en Russie, commenter l’article 35 de la Constitution de 1780 qui laisse en dernier ressort au peuple le moyen de l’émeute pour sauvegarder la légalité. Puis Marty confia la première partie de son plan : se rendre en Russie avec le torpilleur. L’exécution de ce plan fut fixée au surlendemain. Le lendemain, 16 avril 1919, les traîtres avaient dénoncé le complot au commandant du Protêt. Le soir même, Marty, rentrant à bord un peu avant minuit, fut arrêté, injurié, maltraité. Sans s’émouvoir, il revendiqua hautement la responsabilité de son projet, mais refusa d’indiquer ceux qui s’y étaient montrés favorables. Du quai de Galatz, Badina avait assisté à l’arrestation de Marty ; il ne songea qu’à venir prendre sa part de responsabilité. A peine eut-il mis le pied à bord qu’il se vit menacer des revolvers de quatre sous-officiers qui l’attendaient :
« C’est trop. Un seul suffit », remarqua Badina, imperturbable.
Comme le commandant semblait vouloir se servir de lui contre Marty, il le pria de le traiter en accusé et non en témoin à charge. Mené en prison, à terre, Badina s’en échappa quelques heures plus tard, persuadé qu’il ne pourrait pas présenter une défense utile dans les conditions où l’on se trouvait. Marty, plusieurs fois menacé de mort pendant sa prévention par ses gardiens, puis mis à l’isolement absolu, supporta tout avec le plus grand courage. Privé des garanties d’une défense normale, il fut condamné par un conseil de guerre bien stylé à vingt ans de travaux forcés et vingt ans d’interdiction de séjour, Badina fut condamné à la même peine par contumace ; lorsqu’il se livra, en octobre 1920, sa peine fut abaissée à quinze ans de détention.
Ainsi avorta la première tentative de révolte des marins de la Mer Noire. Mais l’importance de la mutinerie ébauchée subsiste du seul fait du complot. Elle ne fut ni inutile ni stérile. Le message de T. S. F. annonçant à Odessa la découverte du complot et l’arrestation de Marty et Badina ne contribua pas peu au déclenchement des protestations et aux mutineries qui suivirent, contre l’intervention en Russie. Marty et Radina, ces deux héros, parmi les héros de la Mer Noire, ont glorieusement agi pour l’humanité.
Le 17 avril 1919, le cuirassé France gagne Sébastopol et exécute ce que l’équipage croit être des tirs de réglage avec ses pièces de 140. Dès le 18, les matelots apprennent que le prétendu tir de réglage de la veille a tué 180 civils à Sébastopol et en a blessé un grand nombre. Cette nouvelle lâcheté exaspère les mécontents : le moindre incident devait faire éclater la révolte. Il se produisit le lendemain, 19 avril : dans l’après-midi, la nouvelle se répand à bord que le France doit faire le charbon le lendemain dimanche, jour de Pâques ; c’est une corvée longue et fatigante, et les marins comptaient se reposer ces deux jours fériés. La nouvelle est commentée et provoque des murmures. Sur une observation maladroite d’un gradé, les manifestants entonnent l’Internationale et ils se précipitent vers la plage arrière. Ils rencontrent le commandant-adjoint Gauthier de Kermoal, qui propose de transmettre les réclamations au commandant Robez-Pagillon. Mais comme les matelots, sous le coup d’une fureur longtemps contenue, crient tous ensemble, il conseille de désigner des délégués qui lui porteront le lendemain matin les revendications de l’équipage. Il donne sa parole d’honneur qu’aucune sanction ne sera prise contre ces délégués. L’équipage repart vers l’avant, toujours chantant, descend aux prisons et délivre les prisonniers. Parmi eux, se trouve un jeune matelot, à peine âgé de 20 ans, nommé Vuillemin. Il est des trois délégués qui sont nommés. Nous le verrons à l’œuvre sur le cuirassé France, faire preuve de courage et de sagesse. Il en impose à ses camarades. Un vent de révolte souffle sur Sébastopol : aux chants révolutionnaires du France, répondent ceux du cuirassé Jean-Bart et ceux du croiseur Du Chaylo qui sont, en rade, côte à côte. Un matelot arrive à bord, annonçant que la compagnie de débarquement, casernée à terre, dans un fort, a également manifesté contre les mauvais traitements. Ces mutins de l’infanterie ont adressé à leur chef un message où ils déclarent entre autres choses ceci :
« Nous ne voulons plus souffrir. Les traitements de jadis doivent être abolis, car ils sont odieux. Si votre instruction est supérieure à la nôtre, il ne faut pas, pour cela, nous considérer comme vos esclaves... Vous, commandant du fort, qui, sur nous, avez exercé votre violence, réfléchissez. Sachez que nous, comme nos frères bolcheviks, poursuivons un idéal et, nos droits naturels, humainement reconnus de tous, nous les réclamons ! » ...
L’équipage du France accueille avec enthousiasme cette nouvelle et les délégués embarquent, malgré l’officier de quart, sur le vapeur du bord pour aller s’entendre avec les délégués des autres bâtiments. Du vapeur, on demande à ceux du Jean-Bart ce qu’ils veulent, et ils répondent :
« À Toulon ! Plus de guerre aux Russes ! »
C’est le mot d’ordre qui circule pour toute la flotte. En l’absence des délégués, vers dix heures du soir, arrive à bord du France l’amiral Amet, en colère. Il harangue les mutins qui ne se gênent pas pour l’interrompre bruyamment. Alors, se sentant faible devant tant d’énergie, il change de ton :
« Mes enfants, je vous en supplie. »
On lui crie :
« Ce n’est pas l’heure de dire la messe ! »
Enfin, il demande ce que veulent les manifestants. Un matelot s’avance vers lui et en termes mesurés énumère les revendications de l’équipage dont les principales sont :
-
Cessation de l’intervention en Russie et l’entrée en France ;
-
Améliorations du régime du bord : nourriture, permissions, courrier, etc., etc. Puis, s’étendant sur l’intervention, le matelot déclare : cette guerre est anticonstitutionnelle, et la flotte est indignée de cette atteinte au droit républicain ; finissons-en, sans délai. »
Comme l’amiral ne fait aucune réponse satisfaisante, les manifestants le laissent et reviennent sur la plage avant en chantant l’Internationale. L’amiral quitte le bord en lançant des menaces. Vers dix heures et demie, le vapeur ramène les délégués et l’on décide une grande réunion pour le lendemain matin. Chacun va se coucher. Mais le délégué Vuillemin rédige et fait afficher à bord cette proclamation :
« Camarades, vous venez de faire, ce soir, une belle manifestation. Je vous recommande instamment d’éviter toute violence et tout sabotage. Nos revendications sont justes et nous aurons gain de cause. »
Puis, ce mutin, arraché de sa prison par la mutinerie de ses camarades, dispose les factionnaires indispensables à la sécurité du bâtiment et retourne dormir à la prison.
Le lendemain, après le café, l’équipage est rassemblé sur la plage avant et, à huit heures, le pavillon rouge est hissé sur le cuirassé au chant de l’Internationale. Aussitôt le Jean-Bart fait de même. Comme convenu, les trois délégués vont trouver le commandant-adjoint et Vuillemin dénonce le crime commis contre la Russie ; le commandant-adjoint se refuse à discuter ce point, s’esquivant en disant qu’il n’est pas au courant, étant à bord depuis peu de temps. Les délégués vont rendre compte de cette rencontre à l’équipage, vers neuf heures arrive le vice-amiral Amet, plus calme que la veille ; sur la plage arrière, il parle. Il dit :
« Mes enfants, vous regretterez ce que vous venez de faire et vous vous en repentirez... »
Un délégué l’interrompt :
« Nous ne regretterons jamais d’avoir fait arrêter cette guerre illégale et criminelle ; nous serions au ban de la classe ouvrière et de l’humanité si nous obéissions aux ordres qui nous prescrivent de tuer nos frères russes ! ... »
Amet, sans plus insister retourne chez ses mutins du Jean-Bart, son vaisseau-amiral. A son tour le commandant-adjoint essaie de retourner les mutins en leur promettant du champagne, la levée de toutes les punitions et la faculté pour les hommes de descendre à terre. Il est accueilli par des sarcasmes et sans rien dire quelques marins quittent le bord avec une chaloupe. La population de Sébastopol qui a suivi toutes les péripéties de la mutinerie, attend sur les quais les matelots français et leur fait un accueil ému, enthousiaste. Les matelots du France rejoignent leurs camarades du Jean Bart, de Justice, Vergniaud, Mirabeau, Du Chaylo. Ils fraternisent entre eux, puis avec la foule qui les porte en triomphe comme des libérateurs. Un vaste cortège se forme et, drapeau rouge en tête, monte lentement les boulevards en chantant l’Internationale. Soudain, le cortège se trouve face à des mitrailleuses abritées derrière des fils de fer barbelés ; un lieutenant de vaisseau, (qui se suicida ensuite) commande le feu. Un crépitement sinistre et quatorze marins gisent assassinés au milieu des Russes (hommes, femmes, enfants) fauchés sans pitié. Ainsi, sous les balles françaises, les mutins scellèrent la fraternité sanglante des enfants du peuple de France et de ceux du peuple russe. (Tous ces détails sont puisés dans la brochure « Les révoltés de la Mer Noire », de Maurice Paz).
Aussitôt qu’à bord du France fut connue la nouvelle du massacre, le délégué Vuillemin exigea du commandant une enquête, puis, en termes énergiques, réclama le retour de la compagnie de débarquement, afin que le vaisseau puisse appareiller sans délai. Il fut obéi : à quatre heures et demie, la compagnie de débarquement et les permissionnaires étaient à bord, joints aux manifestants. Les choses n’allaient pas si bien sur les autres bâtiments en rade. Sauf le Du Chaylo, après avoir manifesté, tous étaient rentrés dans l’ordre. Alors l’amiral Amet croit prudent d’interdire toute communication entre le France et le Jean-Bart. Les manifestants du France, vont s’en plaindre à leur commandant qui déclare ne rien pouvoir contre les ordres de l’amiral.
– « Si vous, commandant, ne le pouvez pas, lui dit un matelot, moi je me charge de l’obtenir de gré ou de force.
– Qui donc commande à bord ? réplique le commandant.
– C’est l’équipage.
– Alors jetez-moi à l’eau.
– Ce n’est pas à l’eau qu’il faut vous jeter, c’est en France. C’est là qu’il faut tous nous mener... »
Et l’équipage décide de reprendre les communications dès le lendemain matin avec le Jean-Bart. Les délégués assurent le service des projecteurs pour prévenir toute surprise de nuit et, de neuf heures et demie à minuit, le délégué Vuillemin discute avec le commandant les revendications de l’équipage, en démontre le bien-fondé et conseille à son chef d’inviter les officiers à ne pas faire usage de leurs armes.
« L’équipage n’est pas armé, dit le délégué, et je m’efforce d’éviter une bagarre. Si un officier prenait sur lui de menacer un homme, le désastre serait inévitable. Et alors, commandant, moi qui suis un prêcheur de calme, je deviendrai le prêcheur de la révolte. »
Le commandant donna sa parole que « il n’y aura ni répression ni sanction », et au cas où malgré lui, il y aurait des poursuites, « il serait le meilleur défenseur de ses hommes » : s’ils passaient en conseil de guerre, il viendrait s’asseoir, à leur côté, au banc des accusés.
– « N’est-ce pas cependant honteux, ne peut-il s’empêcher d’ajouter, qu’un jeune homme qui n’a pas vingt ans, vienne faire la loi à un homme de cinquante-trois ans, qui pourrait être son père ! — N’oubliez pas, commandant, dit le jeune matelot imperturbable, que je suis ici le représentant de l’équipage : coûte que coûte je défendrai ses revendications ».
Ainsi se termina l’entretien. La nuit fut calme. Tout se passa bien, Factionnaires à leur poste. Bon fonctionnement des projecteurs ; service parfait assuré par les délégués qui sont seuls obéis et avec la plus rigoureuse ponctualité.
Le lendemain, 21 avril, dès le matin, le délégué Vuillemin va s’entretenir avec l’amiral Amet, puis il porte à l’équipage assemblé sur la plage-avant, le résultat, de l’entretien. Le commandant a décidé d’appareiller pour le départ, le 31 avril. L’équipage proteste. Il veut faire le charbon de suite et partir le surlendemain. Ils se précipitent pour voir le commandant. Ils rencontrent le médecin-chef et une discussion s’engage entre lui et le délégué Vuillemin sur les responsables de la mutinerie Le délégué s’écrie :
« La caste militaire s’est couverte de honte : en particulier le ministère et nos états-majors qui mènent la marine aux pires destinées... Les capitalistes français sont cause de ce que la France vient de commettre les actes les plus criminels... Cette guerre contre la Russie est, avant tout, anticonstitutionnelle et il faut que la justice frappe les Clemenceau et Pichon qui ont violé la Constitution ; ils sont les principaux responsables de notre mutinerie... »
Le 23 avril, le France quittait Sébastopol, ainsi que l’avait décidé l’amiral Amet, d’accord avec les délégués, en reconnaissant légitimes les revendications de ses matelots et en s’excusant de n’avoir agi que sur l’ordre du ministre de la Marine, Georges Leygues. Le 25 avril, le cuirassé passait devant Constantinople, escorté de la canonnière Escaut, également révoltée. Il arrivait le 1er mai à Bizerte et les autres vaisseaux l’y rejoignirent quelques jours après. Mais, arrivé là, le commandant montra à Vuillemin un ordre de l’amiral Amet lui prescrivant de mener tout l’équipage en forteresse. Vuillemin le prévint que dans ces conditions il n’allait plus prêcher le calme ; et, pour parer à toute éventualité, il fit armer les tourelles et les pièces de 14. Le préfet maritime de Bizerte, le vice-amiral Darien, auquel en référa le commandant du France, décida d’en appeler à une commission d’enquête. L’équipage accepta de s’en rapporter à elle et d’accepter son verdict... Ainsi se termina la mutinerie du cuirassé, dont l’équipage fut maître pendant plus de trois semaines...
Malgré la parole donnée il y eut conseil de guerre et sanctions coutre les mutins ...
Nous arrêtons là le récit de cette sédition causée par le mauvais entretien des hommes et surtout par le crime auquel on voulait les associer. Mais il faut se rappeler qu’il n’y eut pas que les faits rapportés ci-dessus. Il y eut également d’autres affaires plus ou moins graves, d’autres mutineries aussi typiques, aussi enthousiastes et pour les mêmes causes. En outre, des vaisseaux cités, nous voudrions pouvoir relater les affaires du Waldeck-Rousseau, de l’Ernest-Renan, du Justice, du Protêt, du Mameluck, du Fauconneau, où gronde le mécontentement. Il y eut sédition aussi sur le Bruix. Tout cela sur la Mer Noire. Mais à Toulon, aussi l’on protestait. Le Provence à bord duquel avaient eu lieu déjà des manifestations, des mutineries en mars et en septembre 1917, en novembre 1918, à Toulon le 21 mai 1919, pour en repartir le 10 juin, soi-disant pour Constantinople. Le 6 juin, il y eut révolte pour protester contre l’emprisonnement des mutins. L’équipage du Provence hissa le pavillon rouge. En 1919 encore, ce fut le Voltaire en révolte. Puis, ce fut le transport de troupes contre la Révolution russe sur le Guichen que l’équipage déposa en Grèce et décida de ramener en France, sans pourtant y réussir, en raison de la « fidélité » des tirailleurs sénégalais.
Il n’est pas exagéré de qualifier ces mutins de la marine de « héros de la Mer Noire ». Il est nécessaire de donner à ces mutineries toute l’importance qu’elles comportent. Elles indiquent vraiment qu’on aurait tort de désespérer du genre humain... et que la guerre pourra faire faillite un jour, quand les hommes refuseront de s’entretuer.
Nous avons tenu à présenter avec précision quelques mutineries suggestives que l’histoire d’ailleurs retiendra. Cela nous dispense de nous étendre longuement sur la révolte du 17ème de ligne, survenue au cours de l’agitation viticole du Midi, en 1907. On la connaît beaucoup mieux parce qu’à l’époque du soulèvement régional des vignerons frappés par la mévente, régnait la paix extérieure. Et aussi parce que la crise du Midi donna l’occasion au radical Clemenceau de montrer que le pouvoir avait fait de l’individualiste libéral un tyranneau brutal et intransigeant et de s’illustrer — avant Draveil — par un Narbonne sanglant. Cependant la révolte du 17e ne fut qu’une série, toute sporadique, de mutineries légales...
Déjà foncièrement indisciplinés — le Méridional est peu militariste, — ébranlés par l’agitation à laquelle participaient leurs familles (ils étaient d’ailleurs originaires de la région), soldats et réservistes d’Agde, de Béziers étaient tout préparés pour la rébellion ; mutineries des réservistes d’Agde, du 100ème, puis du 17ème de ligne s’enchainent ainsi et se succèdent.
Mis en rumeur par un changement de garnison (pour Agde) auquel résistèrent, à Béziers, plus de dix mille civils, la nouvelle des « dragonnades » provoque l’élan du 17ème et « la marche sur Narbonne »... laquelle devait finir à Béziers, par la reddition. La mutinerie gagne de proche en proche les groupes casernés en divers points de la petite ville ; de concert on s’attaque à la poudrière, on s’empare des cartouches, on délivre les prisonniers. Puis la troupe sans chefs, qu’un caporal exhorte à la cohésion, arrive (ils étaient encore plus de huit cents, malgré les défections du parcours) à l’aube en vue de la cité... Gendarmes dépêchés contre eux tournent bride devant leur allure décidée, puis c’est le 81ème qui vient prendre, sur la route, position de combat, baïonnette au canon. Les gars du 17ème, résolus, imitent le geste de défense, s’engagent, hardiment sur les flancs des soldats hésitants. Et l’avance continue. Un mouvement enveloppant esquissé par les gradés du 81ème n’aboutit pas, le bruit de quelques coups de feu ayant déchaîné la panique parmi les soldats « fidèles ».
L’entrée dans Béziers fut triomphale, mais là, épuisés et désorientés, dépassés d’ailleurs par un geste inaccoutumé, traversés de projets incohérents, les éléments révoltés, à qui manquent aussi la conscience du but et l’exemple de quelques meneurs, apparaissent bientôt désemparés et se laissent circonvenir. Sur la promesse — classique — qu’il n’y aura pas de sanctions, les mutins, après quelque flottement, consentent à entrer à la caserne Mirabel, puis à regagner Agde. Ils le font non sans dignité et même avec une certaine crânerie et une impression de force persiste avec la trace de ce triomphe momentané. Et le souvenir de ce sursaut qui, sans objectif arrêté et aussi sans méthode, devait être sans lendemain, n’a cessé de flotter, comme un avertissement et une menace dans les mémoires... (Voir La Révolte du 17ème, brochure éditée à l’époque par « l’Union des Syndicats »).
* * *
Dans la Revue Europe, du 15 juin 1926, M. Joseph Jolinon a publié un très curieux article intitulé : Les Mutineries de 1917. Il dit ce que fut cette fameuse mutinerie provoquée par les tracasseries, la lassitude, le dégoût, et surtout par les manœuvres de ceux qui en avaient besoin pour légitimer une répression exemplaire susceptible d’enrayer le mécontentement justifié des soldats sur le front. Il y eut, dit-il aux gens de l’Action Française qui accusaient Malvy de les avoir provoquées, plus de cent mutineries : « Plus de cent mutineries, ajoute-t-il, cela vous laisse rêveur, moi pas. Exactement 113 ; 75 régiments d’infanterie, 22 bataillons de chasseurs, 12 régiments d’artillerie, 2 régiments d’infanterie coloniale, 1 régiment de dragons, 1 bataillon sénégalais, sans compter les régiments qui, faute d’occasion, ne se révoltèrent pas, mais n’en pensèrent pas moins. C’est pourquoi j’écris sans exagérer :
« En 1917, l’ensemble de la troupe avait l’âme en révolte. Ce que l’arrière appela plus tard défaitisme, la troupe l’ignorait. Elle sentait venir le refus d’obéissance comme une conséquence fatale de la conduite de la guerre. En fait le gros des révoltes suivit l’échec du 16 avril. Tous les survivants vous diront : ceci entraîne cela. Rien de plus étranger dans l’ensemble à toute passion politique. »
Joseph Jolinon ajoute :
« Pour avoir l’explication du phénomène par ses causes profondes, si naturelles, oubliez donc la guerre écrite, ôtez vos lunettes d’écaille, équipez-vous, quittez Paris le 2 août 1914, suivez ces hommes au pas. Cela va durer 32 mois de 30 jours de 24 heures ; 23.000 heures à raison d’un mort et trois blessés à la minute. »
Enfin, pour expliquer et faire comprendre les causes d’un état d’esprit général favorable à la mutinerie, l’auteur que je viens de citer écrit, évoquant les souvenirs horribles des sanglantes années de guerre :
« Après la Marne on attend la victoire, on se réveille sur des cadavres, le champ d’honneur étale son irrespirable vérité...
Le premier hiver avec ses pieds gelés arrive en terrain découvert, et le poilu grelotte ; et la gloire ne le réchauffe pas. Sur 500 kilomètres, ce ne sont qu’éléments de troupes et d’ouvrages de boue... En 1915, la boue envahit l’âme. Epoque des attaques partielles, tuantes pour le courage. En grignotant l’ennemi on meurt avec profusion. Il y a certainement deux tués de trop sur trois. Les revenants n’oublient pas ces assassinats. Interrogez-les. Ils répondent par des noms devenus sinistres. (Ici tous les lieux de massacres ignobles que je passe.) A la baïonnette contre des mitrailleuses : entre les lignes où gisent des amas d’agonisants lucides atterrés de mourir sans plus de secours que de résultats, les réseaux barbelés sont de déchirantes couronnes d’épines. Alors le moral en certains cas descend déjà au-dessous de zéro. L’affaire des fusillés de Vingré, celle du lieutenant Chappelant, celle des fusillés de Souain en sont les exemples les plus connus, mais on en trouverait d’innombrables, à jamais méconnus, si l’on abordait l’histoire des escouades. Notamment qui dira jamais le nombre de ceux qui recherchèrent « la bonne blessure » et de ceux qui se rendirent avec une joie profonde. On verrait alors à combien d’ordres inexécutables il fallait obéir au péril de sa vie, entre deux feux, je veux dire entre le chef et l’ennemi. »
L’offensive du 16 avril 1917, à elle seule, a donné les chiffres suivants, d’une statistique établie en chiffres ronds le 15 mai : Tués sur le terrain : 28.000 ; morts dans les formations sanitaires de l’avant : 5.000 ; blessés : 80.000 ; prisonniers : 5.000. Au total : 118.000 hommes.
Ce qui étonne, après cela, ce n’est pas le nombre élevé des mutineries : c’est qu’il y en ait eu si peu ! Les premiers manifestants sont les revenants, officiers en tête. L’état d’esprit du guerrier, voué à la vermine et à la mitraille, on le saisit ailleurs que chez les bourreurs de crânes de l’arrière, on l’apprend de la bouche même du poilu. Les rescapés hurlaient en redescendant :
« On nous a fait assassiner. »
On écrivait alors sur les wagons : « Troupes fraîches pour la boucherie » et sur les trains de Sénégalais destinés au général Mangin : « Troupes à consommer avant l’hiver » ; et l’arrière-front pour la première fois entendait sortir de la bouche « poilue » cette parole si humaine, quoique séditieuse :
« À bas la guerre ! Pour en finir avec elle, pas d’autre moyen que de faire grève. »
La contagion gagnait sans peine les seize corps d’armée de cette partie de l’arrière-front. Et ceux des tranchées n’en pensaient pas moins, en attendant la relève.
Ce sont les vieillards qui envoyaient les jeunes au massacre. Ce sont les possédants qui envoyaient contre les envahisseurs menaçant leurs biens les malheureux qui ne possédaient rien, si ce n’est les pauvres corps qu’ils laissaient par milliers sur les champs de souffrance et d’horreur... Il est vraiment formidable et incompréhensible que contre un pareil sort les millions d’hommes jeunes, vigoureux n’aient pas encore songé à se mutiner une fois pour toutes. Attendent-ils la prochaine dernière?...
— Georges YVETOT
MUTUALITÉ
s. f. du latin mutuus, mutuel
Obligation réciproque entre plusieurs individus, en vue de se prêter, dans des occasions déterminées, aide et assistance pour éviter, ou atténuer les conséquences de certaines épreuves. La mutualité se pratique dans les divers systèmes de solidarité créés un peu partout pour adoucir les rigueurs du système social qui accumule toutes les charges sur le travail. L’ensemble des systèmes de sociétés de prévoyance, de solidarité sociale prend le nom de mutualité.
Le socialisme rationnel se présente comme une vaste association mutuelle au moyen de laquelle un homme ne peut être heureux et se développer librement que si les autres peuvent en faire autant.
Par intérêt général aussi bien que par dévouement, il est immoral que des membres de la société puissent être mis à profit pour le seul avantage de quelques-uns comme c’est actuellement le cas. Une mutualité rationnelle ne saurait tolérer un pareil esclavage domestique et social. C’est pourquoi l’égoïsme et l’ignorance sont les deux principaux fléaux que le socialisme doit combattre comme nuisibles à la mutualité.
— E. S.
MUTUALISME
n. m. (rad. mutuel)
Le mutualisme dont nous nous occupons ici est celui de l’école américaine, dont Clarence Lee Swartz a résumé, tout récemment encore, la définition, le programme et les revendications dans « What is Mutualism », édité par Vauguard Press, de New-York. Le mutualisme (qu’on appelle aussi mutuellisme) est un « système social basé sur l’égale liberté, la réciprocité et la souveraineté de l’Individu sur lui-même, ses affaires et ses produits ; il se réalise par l’initiative individuelle, le libre contrat, la coopération, la concurrence et l’association volontaire en vue de la défense contre l’agression et l’agresseur et de la protection de la vie, de la liberté et de la propriété du non-agresseur ». Le mutualisme se réclame, bien entendu, de Proudhon et l’école à laquelle je fais allusion considère comme siens Max Stirner, Josiah Warren, Stephen Pearl Andrews, Henry David Thoreau, Edward Carpenter Benjamin R. Tucker, Charles T. Sprading, Lev Tchorny (qui fut fusillé en 1921 par le gouvernement des Soviets), John Beverley Robinson, nous-mêmes et quelques autres.
Le mutualisme remonte plus haut. Aristote proclamait que « se procurer de l’argent par l’usure est contre nature..., que le profit prend sa source dans l’échange, mais que ce qui l’enfle est l’usure ». Epictète énonçait que...
« Celui-là est seulement libre qui vit comme il désire vivre, qui n’est soumis ni à la contrainte, ni à l’interdiction, ni à la violence ; dont les mouvements ne sont pas entravés et dont les désirs atteignent leur but. »
Le mot mutualisme, sous sa forme anglaise mutualism, semble avoir été employé pour la première fois par l’anglais John Gray en 1812. En 1849, l’américain William B. Greene reprenait ce mot et le définissait ainsi : « Le mutualisme a pour objet, de par sa nature même, de rendre superflu le gouvernement politique, basé sur la force arbitraire, c’est-à-dire qu’il vise à la décentralisation du pouvoir politique et à la transformation de l’Etat en substituant l’autogouvernement, le gouvernement du dedans, au gouvernement extérieur, le gouvernement du dehors ». Dans son livre : « De la capacité politique des classes ouvrières » Proudhon s’est servi à maintes reprises des termes « mutuellisme » et « mutuelliste » (1865). Dans sa « Solution du problème social » 1848), le mot « mutuel » se retrouve fréquemment. Le mutuellisme de Proudhon se basait sur la fameuse maxime :
« Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fît ; faites constamment aux autres ce que vous voudriez en recevoir. »
Les deux grands principes du mutualisme sont ceux-ci :
-
L’individu qui ne s’en prend pas à autrui, le non-agresseur, ne saurait subir de contrainte quelconque ;
-
Aucune portion du travail personnel ne saurait être enlevée à qui que ce soit, sinon de son plein gré.
Ce sont deux postulats d’ordre négatifs, affirmant la souveraineté de l’individu, mais de ces deux postulats découle un corollaire d’ordre positif et constructeur : la réciprocité. La réciprocité implique, à son tour, l’initiative individuelle, la liberté de contrat et l’association volontaire par souveraineté individuelle, il faut entendre le contrôle absolu que l’individu non-agresseur doit pouvoir posséder sur lui-même, ses affaires personnelles et le produit de son travail.
Ces principes sont à la base des revendications du mutualisme actuel, lesquelles sont : au point de vue individuel : égale liberté pour tous, l’individu se trouvant garanti contre l’agression d’autrui ; au point de vue économique : réciprocité sans aucune entrave, comportant liberté absolue d’échange et de contrat, tout monopole ou privilège étant aboli ; au point de vue social : liberté complète d’association volontaire à l’abri de toute organisation coercitive.
Pour les mutualistes, le malaise social provient de ce qu’à l’origine un homme ou un groupe d’hommes voulut s’emparer du produit du travail d’autrui. Depuis lors, du brigandage aux raffinements d’escroquerie des institutions politiques, le mal n’a fait qu’empirer. L’effort accompli par l’individu isolé pour subjuguer et dépouiller son semblable se développa bientôt en un effort accompli par un clan, une tribu, un groupe pour en asservir un autre ; il ne s’agissait plus simplement de s’emparer de la propriété d’une ou de plusieurs personnes, mais de réduire en esclavage et d’emmener captives ces personnes elles-mêmes. De ce premier acte de conquête et d’assujettissement — acte de gouvernement — provient l’Etat, lequel a commencé par le brigandage sous sa forme grossière et qui continue à l’exercer sous la forme plus raffinée, mais aussi brutale de l’impôt obligatoire.
La fonction de l’État (voir ce mot) a été et continue d’être de réduire à l’impuissance et d’assujettir les personnes, d’asseoir et conserver sa domination sur toute l’étendue d’un territoire donné, de se garantir contre la révolte de l’intérieur et contre l’agression de l’extérieur, en un mot de se maintenir à tout prix en existence. Pour y parvenir, il lui fallut dépouiller non seulement le barbare ou l’étranger vaincu, mais encore ses propres administrés en masquant son vol sous l’euphémisme d’impôts. Pour ne pas périr, il lui fallut non seulement comprimer l’ennemi envahisseur, mais opprimer ses propres sujets en les punissant sous prétexte de trahison, lorsqu’ils s’opposaient trop manifestement à sa politique. L’Etat est devenu le principal agresseur de toute l’histoire.
L’Etat est le symbole du pouvoir ; en effet à l’égard de ses sujets, pris individuellement, il est omnipotent. Cette omnipotence produit le privilège. L’Etat peut prendre, mais il peut donner ; il peut punir, mais il peut récompenser ; il peut être tyrannique, mais il peut se montrer libéral. Ses actes, en un mot, peuvent être compensateurs. Il enlève à celui-ci et fait cadeau à celui-là, il opprime celui-ci, mais favorise celui-là. Quelle que soit la forme de l’Etat : en régime étatiste, il y a toujours certaines classes et certaines personnes jouissant de privilèges auxquels le reste des assujettis n’est pas admis à participer. Dans la pratique, et dans presque toutes les classes, il s’agit de privilèges permettant à leurs bénéficiaires de pressurer les personnes ou classes non privilégiées... Le mot Etat vient du latin status qui veut dire fixé et partout où on le rencontre, l’Etat se présente stationnaire, figé, immuable. Il synthétise les forces statiques de la vie sociale, en opposition aux forces dynamiques. Il insiste sur le maintien du statu quo, abhorre le changement, se repose entièrement sur le précédent et la tradition.
En résumé, les mutualistes reprochent au système étatiste : a) De s’immiscer dans la liberté personnelle, empêchant l’individu paisible, non agresseur, de vivre sa vie comme il l’entend ; b) De s’immiscer dans la liberté de la vie économique aux moyens des quatre grands monopoles principaux (monopole de l’émission monétaire, monopole foncier, monopole de la douane, monopole des brevets et patentes), dont les principaux résultats sont : l’exploitation des travailleurs et la restriction artificielle de la production. On passe très souvent sous silence ce dernier résultat de l’étatisme, plus néfaste même pour les travailleurs que l’exploitation ; et cela, alors que nous avons tous les jours sous les yeux le spectacle de l’oisiveté involontaire (ou chômage), des grèves, des lock-outs, du manque de crédit mobile et à bon marché, la horde croissante des parasites non producteurs et de leurs domestiques.
Les mutualistes voient dans le principe de « l’égale liberté » la possibilité de rendre l’Etat inoffensif et de réaliser leurs idéaux. Ce principe, formulé par Herbert Spencer, est que tout être a le droit de revendiquer la liberté la plus complète de faire comme il lui plaît, à condition qu’autrui jouisse de la même liberté. Les mutualistes pensent, que, seule l’éducation permet à l’individu de se rendre compte si l’acte qu’il accomplit permettra à autrui d’exercer sa liberté dans la même mesure que lui. Prenons l’exemple classique de deux personnes regardant un même objet ; si elles sont placées l’une à côté de l’autre, il y a liberté égale de regard pour chacune ; si l’une des deux personnes se place devant l’autre il y a empiètement et atteinte à la liberté de vision de la personne infériorisée. Dans la pratique, la coopération et la concurrence — l’association basée sur le contrat — permet de définir les limites de l’égale liberté. Tout le problème de l’éducation mutualiste consiste en ceci : que l’individu acquière un développement tel qu’il puisse considérer avec autant d’impartialité la situation d’autrui que la sienne propre.
Il ne faudrait pas croire que les mutualistes tiennent à l’écart le curieux, l’expérimentateur, le non-conformiste et cela dans tous les domaines. Ils ne leur demandent que de ne pas contraindre à faire route avec eux ceux qui ne s’y sentent pas disposés. Ils considèrent que le milieu tout entier n’a qu’à gagner à la pratique de la méthode du droit à l’essai et à l’erreur pour tous.
Les propositions du mutualisme sont innombrables. Citons-en quelques-unes : Coopératives de production, de consommation, d’échange. Banques mutualistes, selon la formule proudhonienne ; c’est-à-dire instituant le crédit gratuit grâce à la circulation sans numéraire. Le prix du produit, basé sur l’effort qu’il a coûté, fixé avant sa présentation sur le marché. Libre échange et abolition des octrois et des douanes. Concurrence dans le domaine des transports et des communications. Mise à la disposition de tous ceux qui en sont privés, des terrains que leurs propriétaires ne font pas valoir, des maisons ou logements que leurs possesseurs n’habitent pas. Propriété absolue et absolue disposition des produits du travail de la personne humaine. Solution de toutes espèces de délits ou litiges par le jury. Arbitrage volontaire. Ostracisme et boycottage comme sanctions. Assurance et garantisme dans tous les domaines de l’activité humaine. Non intrusion dans les relations privées entre hommes et femmes de quelque nature qu’elles soient. Liberté pour l’enfant dès qu’il a atteint l’âge de passer contrat (jusque là, selon les mutualistes, il est considéré comme une dépendance de ses parents) de rejeter la tutelle de sa famille et d’en choisit, toute autre consentant à l’accueillir. Instruction et éducation individuelles, non obligatoires, visant à faire de l’élève une personnalité apte à penser par et pour elle-même, hors de toute doctrine ou système préconçu, préparé à vivre plus tard, selon ses idées et non celles de ses professeurs. Liberté absolue d’association ; développement conséquent de toutes les initiatives imaginables : éducatives, « colonies », milieux d’expérimentation ou autres.
Contre l’Etat oppresseur, les mutualistes préconisent volontiers, mais à titre absolument volontaire : l’ignorance des lois, la résistance passive, le refus de payer l’impôt, la non-coopération aux fonctions oppressives et agressives.
— ***E. ARMAND***
BIBLIOGRAPHIE : Les œuvres de Proudhon. — Joseph Warren : True Civilization. — Stephen Pearl Andrews : Science of Society. — Henry-David Thoreau : Duty of Civil Desobedience (traduit en français sous le titre : Désobéir). — William B. Greene : Mutual Banking. — Benjamin-R. Tucker : Individual Liberty. — Hugo Bilgram and L. E. Levy : The Cause of Business Depression. — Charles-P. Isaac : The Menace of the Money Power. — Edward Carpenter : Non Governmental Society. — T. Sprading : Freedom and Its Fundamentals. — Les œuvres de Lev Tchorny (Sociométrie). — Francis-D. Tendy : voluntary Socialism. — John BeverleyRobinson : The Economies of Liberty. — Woodworth Donisthorpe : A Politician in Sight of Heaven. — Auberon Herbert : Individualisim : A System of Politics. — Henry Meulen : Industrial Justice through Banking Reform, etc.
MUTUALISME
n. m.
L’école ou la tendance mutualiste ou mutuelliste qui se rattache au courant d’idées libertaires affirme que c’est Proudhon (1809- 1865) qui a créé le vocable Mutualisme. Pierre-Joseph Proudhon a écrit un très grand nombre d’ouvrages, où il a exposé le principe de la liberté et où il ne s’est pas fait faute d’attaquer les économistes et les réformateurs célèbres de son temps. On sait qu’il a défini la liberté comme étant la mère et non la fille de l’ordre. Son axiome « la propriété, c’est le vol » est devenu classique, mais beaucoup parmi ceux qui usent de cette phrase oublient ou ignorent qu’il s’agit, là, de la propriété-privilège et non de celle dérivant de la possession et de la mise en valeur individuelle. Ses premiers ouvrages furent surtout critiques, plus tard il s’occupa de reconstruction et fournit des plans détaillés d’organisation sociétaire, en particulier concernant le crédit mutuel et l’accession à la possession du sol.
Dans son livre La solution du problème social (1848), le mot « mutuel » revient fréquemment et dans son dernier ouvrage De la capacité des classes ouvrières publié en 1865, après sa mort, les mots mutuel, mutuellisme, mutuelliste, mutualiste se retrouvent très souvent. Il semble d’ailleurs que sous sa forme anglaise mutualism, le vocable mutualisme ait été employé pour la première fois par John Gray, en 1832. Mais nous n’entendons pas, dans cet article, exposer le proudhonisme ni faire de l’érudition ; nous entendons parler du Mutualisme ou Mutuellisme tel qu’il est décrit dans un volume publié en 1927, à New-York, et intitulé What is Mutualism ? — Qu’est-ce que le Mutualisme ? L’auteur de ce livre, Clarence Lee Swartz, se rattache plus ou moins à la tendance individualiste de Benjamin Tucker. Quant au volume lui-même, il a paru sous l’égide de plusieurs groupes mutualistes et libertaires des Etats-Unis, parmi lesquels l’importante association The Mutualist Associates : celle-ci avait même délégué quatre de ses membres pour revoir cet exposé du Mutualisme et assister son auteur, soit : Henry Cohen, avocat et publiciste ; John K. Freeman, éducateur et sociologue ; Virgile Espérance, industriel et économiste distingué ; Hans Rossner, écrivain libertaire. On peut donc considérer What is Mutualism ? comme une sorte de charte du mouvement mutuelliste ou mutualiste, vu sous l’angle anarchiste.
Ce livre résume en ce court programme tout le Mutualisme ou Mutuellisme :
« Mutualisme : Système social basé sur la liberté égale, la réciprocité et la souveraineté de l’individu sur lui-même, ses affaires et sa production, réalisé par l’initiative individuelle, le contrat volontaire pour la défense contre l’agresseur et pour la protection de la vie, de la liberté et de la propriété du non-agresseur et du non-empiéteur. »
Nous pensons que la traduction ci-dessous d’un extrait de What is Mutualism ? fera comprendre clairement les bases sur lesquelles repose ce mouvement qui ne diffère de l’individualisme anarchiste que par le côté constructif. Les mutualistes reprochent volontiers à Tucker, sa déclaration X que « l’anarchie ne possède aucun aspect affirmatif, dans le sens de constructif. Ni comme anarchistes, ni comme individus souverains — ce qui est pratiquement la même chose — nous n’avons d’œuvre constructive à accomplir, bien que, en notre qualité d’êtres progressifs, nous en ayons beaucoup à faire... »
« Le désir d’être libéré de l’oppression a inspiré l’homme dans tous les temps — écrit donc Clareuce Lee Swartz ; mais la conception de ce qui constitue la liberté a varié selon le tempérament racial, le niveau général de l’intelligence, les traditions, l’environnement physique, la nature et l’intensité de l’oppression particulière la plus patente à un moment donné. La conception de la liberté a parcouru toute la gamme qui s’étend de la faible espérance d’être soulagé, même légèrement, de fardeaux insupportables, à l’aspiration passionnée à la liberté absolue ; même de nos jours, la conception de la liberté est sujette à autant d’interprétations qu’il existe de crédos sociaux et politiques.
Poser la question : pourquoi réclame-t-on la liberté — pourquoi n’est-on pas satisfait de ce que l’on a ? C’est rendre nécessaire, avant d’y répondre, la pose d’une autre question : quel est le but principal de l’existence ? Les philosophes ont essayé de résoudre ce problème depuis que l’histoire est histoire — sinon auparavant. Dans son livre Statique Sociale, le grand philosophe anglais Herbert Spencer a répondu à la question d’une façon fort compréhensible. Il fait observer en substance qu’à peu près tout le monde — y compris les éducateurs religieux et les moralistes — enseigne que le bien-être de l’homme est le but de la vie. Il développe très longuement cet argument, puis démontre que pour atteindre cette fin, le seul moyen est d’accorder à chaque être humain la plus grande somme de liberté possible — c’est à dire la liberté d’autrui. De cette conclusion, il déduit sa fameuse formule de l’égale liberté : que chacun puisse revendiquer la liberté la plus complète, de faire comme il lui plait, compatible avec la possession de la même liberté par tous les autres.
La tendance de l’individu moyen vers l’autoritarisme — c’est à dire vers la coercition de l’individu par la société organisée — à sa source, naturellement, dans la crainte de l’agression ou de l’empiètement de la part du prochain. L’individu moyen sent qu’en ce qui le concerne personnellement, il n’a besoin d’aucune contrainte ; c’est le prochain — autrui — qui est à craindre.
Ce sentiment émane de deux sources : en premier lieu, le désir que nourrit tout individu de l’emporter un avantage sur son concurrent ; en second lieu, la surestimation de sa propre liberté par rapport à celle d’autrui.
Le problème sociologique évoqué par le premier point est la façon dont il faut agir pour restreindre l’impulsion à se faire valoir dans une mesure telle qu’elle ne saurait mener à des actes d’empiètement, autrement dit, à enfreindre la liberté égale d’autrui à agir pour atteindre le même objet.
Il n’y a pas d’autre solution que l’éducation. Tant que l’individu ignore la portée précise de tous ses actes et leur effet sur son semblable, il ne possède aucun moyen utile de jauger la mesure d’auto-restriction qui lui convient.
Si on a étudié le problème suffisamment pour être en situation de savoir ou comprendre à quel moment un acte particulier limite la possibilité d’autrui à agir pareillement à une moindre mesure, on est en état de déterminer qu’on a franchi les frontières de l’égale liberté.
L’homme étant un animal grégaire, il vit et s’associe avec d’autres individus appartenant à son espèce. Comme il est obligé de coopérer avec ceux-ci pour mettre en pratique tous les projets qu’enfante son cerveau, force lui est de découvrir une base pour établir ses relations avec ses semblables ; assurant un certain degré de stabilité, l’arrangement pratiqué devra, par dessus toute autre chose, être équitable.
On admet, en général, qu’on a utilisé jusqu’ici de nombreuses bases pour asseoir les relations entre les hommes ; plusieurs d’entre elles ont donné d’assez bons résultats pendant un certain temps. On admet aussi que les bases expérimentées jusqu’ici étaient assez bien adaptées au stade de développement que parcourait alors l’espèce humaine. Finalement, on ne saurait nier que le système en usage actuellement ne soit le meilleur qui ait jamais fonctionné jusqu’ici.
Mais il n’est pas équitable ! C’est pourquoi il n’est pas le meilleur des systèmes concevables ou possibles.
C’est un compromis, me dira-t-on. Certes, tous les systèmes, à partir du premier en date, ont été des compromis. Même un idéal est un compromis. Mais à chaque échelon gravi, il y a — et il en sera toujours de même à l’avenir — une tentative pour introduire plus d’équité dans le compromis.
Acquérir assez de connaissances pour pratiquer pareil compromis est, pour de nombreuses personnes, à ce qu’il semble, un procédé lent et pénible. Il faut le faire, cependant.
L’aspect personnel ou purement physique de la question est extrêmement clair et simple ; un exemple parfaitement compréhensible est celui de deux personnes désirant en même temps, contempler un même objet. Si l’un des deux se place en face de l’autre, il limite, à une mesure moindre que la sienne, la possibilité de l’autre. Si, au contraire, les deux personnes dont il s’agit se tiennent côte à côte, aucun d’eux n’empiète sur la vision de l’autre ; ils jouissent, par conséquent, d’une liberté égale,
Cet état de choses est susceptible d’extension ; cet exemple peut s’appliquer, avec toutes les modifications nécessaires, à tous les changements de circonstances, à toutes les activités de la vie. La question des droits de propriété entraîne, évidemment, de plus grandes complications ; de nombreux facteurs, subtils et contrariants, compliquent le problème. Cependant, ces complications peuvent être résolues en les rapportant à la simple formule de l’égalité dans la liberté.
Si, grâce à son intelligence supérieure, à son habileté, à sa plus grande application, un individu peut produire plus qu’un autre, dans un temps donné, et, par suite peut accumuler plus de produits que cet autre, il ne limite en rien, ce faisant, (à condition qu’il agisse raisonnablement), la liberté égale de cet autre.
D’autre part, si, dans l’intérêt du producteur insuffisant, on essayait d’ôter au premier le surplus de sa production, ce serait une violation du principe de l’égale liberté.
C’est une chose naturelle, pour répéter Whitman, que chacun considère sa peau comme la plus précieuse : c’est pourquoi chacun ressent plus de vexation quand on s’en prend à sa liberté personnelle que lorsqu’ou empiète sur celle des autres. Cet égoïsme varie avec l’équation personnelle, inversement à l’éducation et à la culture individuelle.
Réaliser que le bonheur des autres leur importe autant qu’à vous vous importe le vôtre, est, par sui, le premier pas vers la liberté. Dans la mesure où l’on est inapte à réaliser la situation et les circonstances d’autrui, l’on se trouve peu ou mal disposé à accorder à cet autrui l’égalité dans la liberté.
En d’autres termes, on doit pouvoir s’arracher à son environnement personnel à un point tel qu’on soit capable de contempler impartialement et la situation d’autrui et la sienne propre.
Arriver à cette exactitude de vison n’est pas chose facile, mais il faut y parvenir si l’on veut comprendre complètement le principe de l’égalité dans la liberté.
Quelles sont les raisons qui peuvent être présentées pour faire accepter ce principe ?
Chaque être humain désire le bonheur. En fait, toutes les énergies sont utilisées en vue de se procurer : d’abord, de quoi vivre ; ensuite (selon son ambition), la possibilité, la facilité, ou la puissance complète de satisfaire tous ses désirs.
La satisfaction de tous ses désirs — dans le sens le plus large — représente la somme de bonheur approximative que tout être humain peut concevoir.
L’égale liberté implique que chacun aura une égale occasion pour la recherche des choses qui procurent le bonheur et que ces choses obtenues, chacun sera protégé, afin qu’il puisse en jouir en toute sécurité.
Sans la sécurité et la tranquillité, le bonheur est inconcevable, humainement parlant. Il ne peut y avoir ni tranquillité ni sécurité tant que certaines personnes jouissent de moins de liberté que d’autres. Lorsqu’il y a garantie d’égalité d’occasion pour chacun, l’inviolabilité de la personne et la possession assurée des produits du travail ne seront menacées que par les individus à tendance criminelle et antisociale ; la protection contre ces éléments sera assurée par les mesures ordinaires que la société est toujours dans l’obligation de prendre pour la sauvegarde des vies et de la propriété de ses membres.
Quand la société aura pu obtenir une sécurité approximative du genre de celle esquissée ci-dessus (une sécurité de ce genre n’est jamais absolue) ; lorsqu’elle aura développé la conscience de ses membres à un tel point qu’ils ne trouveront plus aucun plaisir dans la coercition de leurs semblables ou dans leur possession de moins d’occasions d’exercer de leurs facultés qu’ils en possèdent eux-mêmes, nous en serons alors au seuil de l’adhésion du principe de l’égale liberté, et sa mise en pratique sera relativement facile.
La conception la plus élevée de la liberté consiste donc en la plus grande somme de liberté individuelle qui se puisse obtenir ; car vivre sa vie il l’extrême limite possible est ce que chacun désire, ouvertement ou secrètement, qui le réalise ou non. C’est la seule façon de retirer de la vie une satisfaction ; et tous les hommes sont avides de satisfaction et de bonheur.
Il y a divers ismes qui enseignent que la société, en général, peut tirer un meilleur avantage en soumettant (plus ou moins complètement) l’individu à un état central, gouvernement, commune, ou tout autre système, peu importe le nom, de pouvoir contrôlant (lequel se présente toujours comme rationnel et bienveillant). Dans tous ces systèmes, on tient très peu compte de l’individu.
La théorie mutualiste, d’autre part, affirme que les intérêts de la société, en général, sont mieux servis par les systèmes qui garantissent les intérêts de l’individu : absence de contrainte et de restriction aussi longtemps que les activités individuelles sont dépourvues de caractère agressif : élimination de tous les facteurs qui limitent artificiellement les possibilités de l’homme ; organisation volontaire de la société en associations lorsque les activités en vue dépassent la puissance d’un seul individu ; bref, création volontaire et échange mutuel de commodités dans des conditions excluant tous privilèges spéciaux et tous monopoles protégés par l’Etat.
Le Mutualisme ne pourra être mis en application que lorsque l’attitude d’esprit générale le rendra possible. Ceci n’est pas écrit dans le but de ressusciter l’antique querelle concernant le changement de circonstances : s’il vaut mieux qu’il soit intellectuel ou moral, ou encore s’il faut attendre que les hommes naissent bons avant d’espérer des circonstances meilleures.
Quant à la phase économique du Mutualisme, l’analyse peut démontrer que de grandes modifications en vue d’obtenir du mieux sont possibles ; mais il faut que les hommes sachent comment amener ces changements et qu’ils veuillent œuvrer dans cette intention. Cette croyance en une situation meilleure, en un système où les produits et les services sont échangés équitablement — c’est à dire sur une base mutuelle — au lieu de la méthode actuelle où chacun essaye de s’exploiter ou de se piller l’un l’autre ; cette croyance peut être appelée un changement d’attitude.
Le Mutualisme est applicable à toutes les relations humaines. De la naissance à la mort, dans toutes les circonstances, la mutualité, l’association volontaire, pour l’action réciproque, peut s’appliquer partout, à tout moment, et servir à résoudre tous les problèmes des rapports sociaux, tous les litiges que peuvent soulever le commerce et l’industrie. Pour pratiquer le Mutualisme ou Mutuellisme, deux seules conditions sont nécessaires : 1° que l’individu non agresseur ne soit astreint à aucune sorte de coercition ; 2° qu’aucune portion du profit du travail d’autrui ne lui soit ôtée sans son consentement. De ces deux généralisations négatives, affirmant la souveraineté de l’individu, découle ce corollaire positif et constructeur : la réciprocité, lequel corollaire implique initiative individuelle, libre contrat, association volontaire.
Pour qu’il n’y ait aucune incertitude sur la signification du terme souveraineté de l’individu, nous dirons que nous l’employons ici comme synonyme du complet contrôle de l’individu non agresseur sur lui-même, ses affaires et le produit de son travail.
En deux mots, le Mutualisme ou Mutuellisme est un système social fondé sur l’exercice de rapports réciproques et non agressifs entre individus libres.
Les principaux points du programme mutualiste ou mutuelliste sont donc :
Au point de vue individuel : liberté égale pour tous — en l’absence d’agression ou d’empiètement d’autrui ;
Au point de vue économique : réciprocité illimitée, impliquant liberté d’échange et de contrat — en l’absence de tout monopole ou privilège ;
Au point de vue social : liberté absolue d’association volontaire — en l’absence de toute organisation coercitive. »
Nous terminerons cet exposé par un court extrait d’un livre publié en 1875 par William B. Greene, un proudhonien de la première heure, qui, déjà en 1849, propageait la notion de la « banque mutuelle » — extrait où l’auteur décrit la différence existant entre le Communisme et le Mutualisme :
« Le premier pas bien marqué dans le progrès humain résulte de la division du travail. C’est la caractéristique de la division du travail et de la distribution économique des diverses occupations, que chaque individu tend à faire précisément ce que les autres ne font pas. Dès que le travail est divisé, le communisme cesse nécessairement et c’est alors que naît le mutualisme, négation du communisme, — le Mutualisme, c’est-à-dire la corrélation réciproque des unités humaines de chacun à autrui et d’autrui à chacun dans un but commun. La marche du progrès social va du communisme au mutualisme.
Le Communisme sacrifie l’individu pour obtenir l’unité de l’ensemble. Le Mutualisme considère l’individualisme illimité comme la condition primordiale et essentielle de son existence. Le Mutualisme coordonne les individus sans aucun sacrifice pour l’individualité en un ensemble collectif au moyen d’une confédération spontanée — ou solidarité. Le Communisme est l’idéal du passé, le Mutualisme celui de l’avenir. C’est devant nous qu’est le jardin d’Eden, comme une chose à édifier et à atteindre ; ce n’est pas une chose derrière nous, un état perdu le jour où le travail a été divisé, les activités distribuées, l’individualisme encouragé et que le Communisme (ordre social purement animal et instinctif) s’est prononcé contre lui en s’écriant : « Mortel, tu es condamné à mourir. »
L’assurance mutuelle a démontré, par l’exemple pratique, un peu de la nature, de la portée et du fonctionnement du principe mutualiste. Lorsque la monnaie aura été mutualisée grâce aux banques mutuelles, que le taux de l’argent prêté aura été réduit à zéro, il deviendra possible de généraliser l’assurance mutuelle, l’appliquant à toutes les contingences de la vie, de sorte que les hommes, au lieu d’être des ennemis les uns pour les autres — comme ils le sont actuellement- se fédèreront. Si l’un d’entre eux est victime d’une perte accidentelle, cette perte lui sera compensée par tous les autres, partagée par l’ensemble : si un gain accidentel échet à l’un d’eux, il deviendra le lot de l’ensemble, partagé entre tous.
Avec le système mutualiste, chaque individu reçoit le salaire juste et exact de son travail. Tout service qui peut s’équivaloir en coût étant échangeable pour des services s’équivalant en coût, sans bénéfice ni escompte. Tout ce que le travailleur individuel peut ensuite obtenir en surplus de ce qu’il a gagné lui est acquis comme part de la prospérité générale de la communauté dont il est membre. Le principe de la mutualité en économie sociale est identique au principe de la fédération en politique. Notez bien cela. La souveraineté individuelle est le Jean-Baptiste, sans la venue duquel l’idée mutualiste est nulle. Il n’y a pas de mutualisme sans consentement réciproque et, seuls, des individus peuvent contracter des relations mutuelles volontaires. Le Mutualisme est la synthèse de la liberté et de l’ordre » (Socialistic, Communistic, Mutualistic and Financial Fragments).
— ***E. ARMAND***
MUTUALITÉ, MUTUELLISME
n. f., n. m.
La mutualité est le nom donné à un vaste mouvement d’organisations ayant pour but de fournir à leurs adhérents des secours en certains cas : maladies, accidents, vieillesse, etc..., moyennant le versement, par les membres de l’association, de certaines primes ou cotisations.
Mutualité, comme mutuellisme, vient de mutuel ; même, réciproque.
La mutualité ne jouit pas, en général, d’une bonne presse dans les milieux d’avant-garde, révolutionnaires, anarchistes. Ce n’est pas que le principe en soit condamnable. Tout au contraire ; elle représente la plus belle et la plus libre forme d’organisation de la solidarité humaine. Elle est bien préférable à toutes les charités et philanthropies officielles ou privées ; puisque c’est sur leur effort seul, leur soutien mutuel et réciproque, que les membres comptent pour pallier, dans une certaine mesure, aux vicissitudes de la vie. Ce qui lui a le plus aliéné la sympathie des esprits d’avant-garde, c’est que le mouvement mutualiste actuel est animé d’un esprit mesquin, étroit, conservateur.
Bénéficiant dans tous les pays de l’appui officiel, parce qu’il est sage, très sage, nullement subversif, il a grandi et s’est développé en s’adaptant étroitement au cadre social. Ses dirigeants sont, pour la presque totalité, des gens « bien pensants », recherchant les titres, honneurs et décorations, et ne s’occupant guère à donner à leur mouvement une impulsion vers la rénovation sociale, vers de nouvelles formes d’organisation sociale.
La mutualité, qui portait à ses débuts l’étiquette de mutuellisme, avait pourtant une autre allure que celle qu’elle a maintenant.
Sans vouloir faire une excursion dans le lointain passé, qui connut la mutualité sous diverses formes, ni tracer l’histoire détaillée de ce vaste mouvement, ce qui nous entraînerait trop loin, disons qu’une des premières sociétés mutuelles fut celle des ouvriers en soie de Lyon, créée en 1728 ; elle avait une curieuse organisation, bien représentative des mœurs de cette époque. Elle était divisée en loges de moins de 20 adhérents. Chaque loge avait des délégués à une loge centrale.
Au commencement, il s’agissait simplement de faire verser, aux membres, des cotisations, afin de pouvoir secourir les malades, ou les chômeurs, ou les accidentés. Bien vite, ce mutuellisme prit figure de syndicalisme. On s’occupa des questions de salaire, de répartition du travail. L’insurrection de Lyon de 1834 fut, a-t-on dit, préparée par ce mutuellisme.
C’est qu’il ne suffît pas de cotiser plus ou moins régulièrement. Bien vite, dès qu’on se penche sur ces graves et douloureux problèmes des misères de la vie ouvrière, les questions corporatives apparaissent, puis la question sociale dans son ensemble.
S’il n’avait pas été jugulé et détourné de son esprit, le mutuellisme eût dû, logiquement, aboutir à un mouvement de réforme sociale. Le bon médecin n’est pas seulement celui qui calme momentanément la douleur, mais surtout celui qui recherche les causes de la maladie, et dicte un régime pour abolir ces causes.
Certes, la maladie, les accidents, la vieillesse, sont des événements naturels, mais le régime social influe beaucoup sur leur nombre et leur gravité. Combien de personnes, atteintes de tuberculose, anémiées, malades par le surmenage, la privation, l’insalubrité des logis, etc., échapperaient au mal si les conditions d’existence étaient tout autres ! Il coûte moins cher de prévenir que de guérir, et une société bien organisée aurait tout avantage à lutter contre les causes des maladies et des accidents. Naturellement, ce problème conduit à tenter de résoudre la question sociale.
La période qui environna la révolution de 1848 — l’époque du socialisme dit utopique, mais qui se révèle en réalité riche de solutions pratiques et immédiates — vit naître une foule d’associations de tous genres : sociétés ouvrières, coopératives, mutualités.
Proudhon fut un mutuelliste très fervent, et toutes ses théories sociales sont imprégnées d’esprit mutualiste. Il opposait le travail libre, individuel, presque artisanal, dont l’individualisme était contrebalancé par le mutualisme, au communisme ou au collectivisme des socialistes d’Etat.
Le mutuellisme survécut à la réaction de Napoléon III. Il se développa lentement, mais sûrement.
Après la chute de l’Empire, il continua sa progression. Il est vrai que, pondéré, conservateur, il jouissait de la faveur des gouvernants.
Pourtant, un certain nombre de sociétés mutuelles étaient pour ainsi dire des syndicats, avant la lettre. En maintes occasions, elles prenaient figure de sociétés ouvrières de résistance à l’exploitation patronale. Plusieurs participèrent au mouvement de la première Internationale.
Mais la cassure se produisit, inévitable, entre l’esprit conservateur des purs mutualistes, adaptés à la société bourgeoise, et les novateurs qui voulaient pousser le mouvement à sa conclusion logique, sociale. Ce fut la lutte, la grande lutte des premières années du régime républicain entre le mutuellisme et le syndicalisme. Le syndicalisme finit par se séparer complètement du mutuellisme, et prendre le caractère combatif et révolutionnaire de la C. G. T. d’avant-guerre. Le mutuellisme, privé des éléments turbulents et batailleurs, devint de plus en plus conservateur et embourgeoisé, et ce fut la mutualité que nous connaissons aujourd’hui.
Il est pourtant encore bien des coins, de petits centres, où l’on retrouve les mêmes éléments dans le syndicat et la société mutuelle.
Il existe aussi bien des syndicats où l’on pratique la mutualité, et même où c’est l’élément essentiel de l’organisation. Ce sont d’ailleurs les plus arriérés au point de vue « idéal social », les plus bornés, les plus corporatifs, les moins subversifs, en un mot les plus sages. En effet, les dirigeants ont une crainte naturelle de voir dilapider les réserves accumulées, dans une bataille dont on ignore, à l’avance, la durée et l’issue.
Cette évolution de la mutualité vers le conservatisme social n’est d’ailleurs pas spéciale à ce mouvement. La coopération a suivi le même chemin, et une importante fraction du mouvement syndical prend la même voie.
En vieillissant, les mouvements s’assagissent. Ce sont des vieux qui sont à la tête ; ils ont pu avoir leur période juvénile et ardente, mais ils ont évolué avec l’âge, et surtout avec les titres, la hiérarchie, et, quelquefois, les profits.
La mutualité n’est plus guère qu’une forme de l’assurance. Au lieu que ce soient des capitalistes formant une société pour assurer contre l’incendie, le vol, les sinistres, la mortalité du bétail, etc., etc., en se faisant verser des primes et en répartissant chichement et avec toutes les ruses du maquis judiciaire, ce qu’elles doivent aux assurés, ce sont ces derniers qui forment, théoriquement, une assurance mutuelle, une mutualité qu’ils dirigent eux-mêmes ou sont censés diriger, Les primes s’appellent alors cotisations, et les indemnités pour maladies, accouchements, accidents, ou vieillesse, se dénomment secours, prestations ou pensions de retraites.
Le mouvement mutualiste est très puissant, quoiqu’en pensent beaucoup de camarades.
En France, en 1853, il y avait 2.095 sociétés mutuelles diverses, avec 289.000 membres. La progression a été constante et continue. En 1928, il y avait 20.200 sociétés, avec 5.300.000 membres.
Il est vrai d’avouer que, si ces chiffres sont impressionnants, celui des cotisations et des secours l’est beaucoup moins, puisqu’en cette année 1928, les sociétaires ont payé environ 300 millions de cotisations et ont reçu 205 millions de secours, ce qui ne fait pas gros par tête d’adhérent.
Le mouvement mutualiste est également très puissant dans certains pays : Grande-Bretagne, Suisse, Belgique, Pays germaniques et anglo-saxons. Les peuples latins sont beaucoup moins mutualistes.
Les assurances sociales, qui existent actuellement (1931) dans une trentaine de nations, ont considérablement transformé la mutualité. En certains cas même, elles l’ont tuée en tant que mouvement d’organisation libre et spontané.
Les assurances sociales sont, en somme, la mutualité décrétée obligatoire et placée sous la direction totale ou sous le contrôle de l’Etat. Les cotisations sont perçues obligatoirement comme une forme spéciale d’impôt, et les secours ou prestations sont répartis par un organisme plus ou moins officiel. La mutualité devient en un mot service public d’Etat.
Je regrette, pour ma part, que la mutualité ait perdu son caractère initial ; quelle ait évolué dans un sens de conservation sociale, et qu’elle finisse par être absorbée par l’Etat.
Dans son principe et dans son essence, la mutualité aurait pu et aurait dû être la forme la plus humaine, la plus pratique, et la plus libertaire de la solidarité.
Elle est le correctif indispensable à l’individualisme. Si l’on envisage, par anticipation, une société où les humains travailleront, et vivront librement, soit individuellement, soit en des groupements collectifs libres et fédérés, il faut de toute évidence que la solidarité s’organise : pour les malades, les inaptes, les accidentés, les vieux, etc., etc... Le valide d’aujourd’hui sera l’invalide de demain. Or, le principe mutualiste apporte des solutions, des expériences, des réponses qui peuvent concilier à la fois la plus grande liberté possible et la solidarité la plus effective.
Ce n’est pas le principe qui est mauvais, c’est l’application qui en a été faite, c’est la déviation que lui a fait supporter un milieu social comme celui dans lequel nous vivons.
Je crois que la formule de l’avenir est dans ces mots : libre association, libre coopération, solidarité mutuelle garantissant à tous les moyens de vivre, quelle que soit leur position du moment,
Pour si mauvaise qu’elle nous apparaisse, l’expérience mutualiste n’aura pas été inutile.
— Georges BASTIEN
MYSTÈRE
n. m. (latin mysterium ; grec musterion, de mustès, initié)
Au début du XIXème siècle, l’helléniste Creuzer prétendait encore qu’un collège sacerdotal primitif, détenteur de la croyance en un dieu unique et en l’immortalité de l’âme, s’était servi de symboles pour rendre ces idées plus accessibles au peuple. Symboles qui, pris à la lettre et mal compris, donnèrent naissance au polythéisme, alors que la pure doctrine était réservée aux initiés des mystères. Inutile d’insister sur l’erreur de Creuzer, universellement reconnue depuis longtemps. L’existence d’un enseignement ésotérique, de pratiques secrètes, destinés à satisfaire les âmes éprises d’inconnu, assoiffées d’au-delà, n’est, par contre, nullement douteuse ; sous des formes différentes, on les constate chez les peuples anciens et dans les religions les plus diverses. A côté du raisonnement logique, de la dialectique intellectuelle, trop incertaine à leur gré, trop lente aussi et sujette à de brusques éboulements, les croyants firent une place à l’illumination intérieure, aux éclairs de l’extase à l’ivresse des contemplations divines, dès que la religion cessa d’être affaire purement collective pour revêtir un caractère individuel. Mais les phénomènes mystiques, troubles nerveux caractérisés, ne peuvent résulter que de dispositions naturelles rares ou d’un déséquilibre provoqué par le jeûne, les macérations, les stupéfiants en général par ce qui favorise une concentration extrême de l’activité mentale.
Dans l’initiation ordinaire, on réduisit les épreuves et les purifications à la taille de l’humanité normale ; on s’adressa surtout à l’imagination. Des prêtres charlatans, disposant d’ingénieux mécanismes, provoquèrent des visions de circonstance sans danger pour le sujet ; l’enseignement des mystères prit un caractère symbolique accentué. A l’origine toute initiation consistait à expérimenter la mort et la vie qui devait suivre. Plongé dans d’épaisses ténèbres, terrifié par des apparitions macabres, le sujet était brusquement inondé d’une lumière très vive, pendant les mystères d’Eleusis. On le munissait, en outre, de formules permettant l’accès du ciel après la mort ; l’absorption d’une farine et d’une boisson sacrées, la présentation par l’hiérophante d’un épi, symbole de l’union de Pluton avec Déméter, d’autres gestes rituels, d’autres paroles achevaient de le persuader qu’il était muni du sérieux viatique pour le suprême voyage. Les mystères Orphiques avaient pour but d’éviter à l’initié le cycle des renaissances ; ils reposaient sur l’idée de métempsycose, si répandue chez les anciens. Personnage mythologique qui avait gardé le souvenir de ses incarnations successives, Orphée passait aux yeux des grecs pour l’auteur de longs poèmes où l’on montrait l’âme prisonnière dans le corps et soumise à des renaissances : punition du meurtre de Zagreus par les titans, pères des hommes. En Egypte, l’initiation visait à éprouver le degré de courage du récipiendaire, au moins dans les premiers stades, ainsi que sa force de résistance aux passions ; elle s’inspirait encore de l’idée de purification par les éléments : air, eau, feu. En Gaule, elle se poursuivait de longues années, pour les futurs druides lentement formés à la connaissance des doctrines et à la pratique des rites. Au Mexique, le nouveau roi devait seulement jeûner quatre jours, enfermé dans un temple, avant d’être enduit d’un onguent noir et aspergé d’eau lustrale par le grand prêtre ; mais, pour entrer dans un ordre guerrier, il fallait subir une initiation douloureuse et prolongée, Dans ce domaine les peaux-rouges ont fait preuve d’une cruauté exceptionnelle, d’autant plus grande, en général, qu’il s’agissait d’un grade plus élevé. Il est vrai que leur initiation n’avait point pour objet la transmission de dogmes secrets, mais la mesure de l’endurance de la force morale, du courage. Et le candidat roi que certaines tribus colombiennes soumettaient à un long jeûne, couvraient de plaies, livraient à 1a morsure de fourmis venimeuses, enfumaient dans un hamac, sans qu’il dût proférer une plainte, faisait preuve assurément de volonté ; il lui arrivait de mourir en cours de ces tortures successives.
Sous sa double forme d’enseignement secret et d’épreuve, l’initiation antique a laissé des traces dans le monde moderne. Le baptême est un semblant de noyade, suivi d’un retour à la vie ; le voile de la première communiante, de la mariée, s’avère d’un symbolisme évident ; on couvre d’un drap mortuaire le moine qui prononce ses vœux définitifs. Mourir au vieil homme pour renaître à une vie nouvelle, constitue le thème de nombreuses formules rituelles, dont le prêtre a perdu le sens originel et profond, mais qu’il répète machinalement. L’initiation maçonnique n’est pas sans analogie, semble-t-il, avec celle des égyptiens ; elle emprunte ses symboles aux associations médiévales de maçons francs ou libres qui voyageaient de ville en ville. Certains rites ont renoncé aux interprétations métaphysiques et aux sciences occultes pour s’en tenir aux réalisations sociales et aux données du savoir positif ; d’autres continuent, au moins dans les hauts grades, à faire une place aux recherches transcendantales. De cela je ne parle d’ailleurs que par ouï-dire, n’ayant jamais fréquenté les loges. L’idée d’épreuve n’a été retenue par la société moderne qu’au point de vue intellectuel et physique ; d’où les examens universitaires, d’où aussi les visites médicales et les concours athlétiques si en vogue aujourd’hui. Mais elle néglige volontairement les dispositions morales, sachant bien que nos chefs et leurs rejetons feraient piètre figure sous la toise mensuratrice de la vraie vertu. Les associations particulières agissent de même ; ce dont nos successeurs ne s’accommoderont plus, j’aime à le croire. Et si la persécution déclarée ou sournoise oblige encore certains mouvements à se propager dans l’ombre, certaines doctrines à rester secrètes, un jour viendra, je l’espère, où toute pensée s’épanouira libre et soucieuse seulement de vérité.
Au point de vue théologique le mot mystère offre un autre sens très précis : il désigne une vérité qu’il faut croire sans chercher à la comprendre parce qu’inaccessible à la raison. Citons les mystères de la Trinité ou d’un seul Dieu en trois personnes, de l’Incarnation ou du Verbe fait homme, de la Rédemption ou de la mort d’un dieu pour le salut du genre humain. Il en est de moindre importance : celui de la virginité de Marie affirme que les parties sexuelles de la mère de Jésus restèrent celles d’une jeune fille, malgré son enfantement ; celui de la transsubstantiation, tout en maintenant que le corps de Jésus est unique, le déclare, néanmoins, présent dans des milliers d’hosties simultanément et en entier ; celui de la faute originelle soutient que Dieu reste juste en punissant chacun de nous à cause de la désobéissance d’Adam. Dès qu’un dogme apparaît contraire à la raison ou contraire à un autre dogme, dès que la théologie aboutit à une impasse, sans possibilité de retour en arrière, l’Eglise s’empresse de déclarer qu’il s’agit là d’une vérité certaine, mais incompréhensible à notre entendement. Echappatoire suprême qui lui permet d’abandonner le combat en se disant néanmoins victorieuse ! Refus hautain d’une justification qu’elle estime périlleuse pour son infaillibilité ! Preuve manifeste, au fond, des contradictions de sa doctrine ainsi que de la faiblesse des postulats théologiques. Et, dans une religion, le nombre des mystères sera, naturellement, en fonction directe de celui des dogmes : sans importance à Rome, dont le paganisme restait une affaire sociale, du moins aux beaux temps de la République et de l’Empire, ils tiennent également peu de place dans l’islamisme, religion surtout morale et cultuelle. Mais le christianisme, particulièrement la branche catholique, fourmille de mystères plus ou moins avoués. Parti du judaïsme rabbinique, aux spéculations restées fort simples et soucieux avant tout de légalité, il se développa dans le milieu grec, ami des discussions métaphysiques et des explications transcendantales. Par une innovation qui lui valut l’hostilité de Pierre, mais assura le succès futur du christianisme, l’apôtre Paul appela les gentils à la religion nouvelle, en les dispensant des prescriptions mosaïques qui généralement leur répugnaient. Tant que les convertis restèrent des hommes du peuple incultes et simples, leur foi se satisfit d’affirmations peu nombreuses et peu compliquées ; dès qu’ils furent des intellectuels, la pensée théologique devenue fort active dut résoudre les problèmes essentiels posés par la spéculation grecque. De là, d’interminables querelles et les multiples hérésies des premiers siècles. Afin de trancher les difficultés et d’immobiliser la doctrine, on eut recours à des assemblées d’évêques ou conciles, dont les décisions firent loi ; d’où les dogmes prodigieusement nombreux aujourd’hui. On sait que le pape, proclamé infaillible, peut, maintenant, les accroitre à son gré sans réunir de concile. Mais, après une vogue prodigieuse, ces dogmes meurent à tour de rôle lorsqu’ils ne répondent plus aux besoins religieux des croyants. C’est en vain que l’autorité ecclésiastique continue de garantir théoriquement leur vérité ; en fait, ils sont éliminés de la foi vivante et ne répondent qu’à des formules vides de sens, chez le commun des fidèles. Souvent ils deviennent impensables, même pour les théologiens qui les rentrent, prudemment, dans l’arsenal des armes rouillées ; tout naturellement ils passent alors au rang de mystères.
La trinité nous fournit un exemple de la genèse des mystères. Jésus, en admettant qu’il ait existé, se crut favorisé de grâces célestes toutes particulières, il se dit envoyé par Jahvé, mais n’affirma jamais qu’il était dieu ; les Synoptiques en fournissent la preuve lorsqu’on écarte les interpolations ajoutées après coup au texte primitif. Et les premiers chrétiens d’origine juive ne songèrent pas davantage à en faire un dieu véritable ; il était pour eux le Messie, comblé de dons par le Très-Haut et supérieur à l’humanité ordinaire ; mais l’identifier au Créateur leur eût semblé un blasphème. Les Grecs, habitués à la multiplicité des dieux, n’éprouvèrent pas le même scrupule ; que Jésus en fût un leur parut très naturel. Quand fut rédigé le quatrième évangile, ce pas décisif était fait dans l’esprit de plusieurs ; en identifiant Jésus au divin Logos de Philon, le pseudo Jean, qui n’est à coup sûr pas l’apôtre de même nom, acheva de continuer cette croyance et lui donna une base philosophique. Mais, cette divinité admise, comment expliquer la coexistence d’un dieu suprême et d’un homme-dieu sans porter atteinte à l’unité divine ? Comment supposer que dieu s’incarne et meure pour apaiser son propre courroux ? On crut résoudre ces difficultés en affirmant l’existence de deux personnes en dieu : le père demeuré inaccessible au ciel et plein de colère contre le genre humain, le fils ou logos qui, lui, s’est incarné pour donner satisfaction à la justice divine. Afin d’établir un rapport entre ces deux personnes, une troisième leur fut adjointe plus tard, née de leur mutuel amour : le Saint Esprit. Le dogme de la Trinité conciliait ainsi harmonieusement le monothéisme intransigeant des juifs et le polythéisme familier aux gentils ; il donnait, en outre, un semblant de réponse aux nombreuses difficultés soulevées par la croyance en la divinité du Christ. Réponse illusoire, puisque les théologiens durent bientôt ranger le nouveau dogme parmi les mystères inaccessibles à la raison. On raconta qu’un ange, apparu sous la forme d’un enfant, avait détourné Augustin de chercher à comprendre comment l’unité de substance s’allie, en dieu, à la triplicité des personnes ; on savait qu’il était impossible de légitimer une contradiction si manifeste ; d’office, on déclarait cette vérité supérieure à l’entendement humain. Formule aujourd’hui bien morte, la Trinité du symbole, faussement dit d’Athanase, n’éveille aucune idée précise dans l’esprit des croyants ; leur dévotion s’adresse à Jésus, Marie, Joseph, plutôt qu’au Père, Fils et Saint Esprit. Résumer les difficultés que soulèvent soit les textes des livres inspirés, soit la simple logique, soit d’autres spéculations théologiques, dans un dogme que l’on refuse par avance de discuter, voilà l’un des moyens habituels que l’Eglise utilise pour illusionner les naïfs qui cherchent la vérité.
Sans doute, le monde est plein de mystères, si ce terme désigne les lacunes du savoir humain. Mais soyons assez sincères pour reconnaître qu’il s’agit seulement d’ignorances, peut-être transitoires, en tout cas préférables aux mensongères clartés des fausses révélations.
— L. BARBEDETTE
MYSTICISME, MYSTIQUE
n. m. (latin mysticus mystique ; du grec mustikos, de mustès, initié)
Ce mot est un terme générique qui synthétise tout ce qui, dans le langage courant, dans les religions, dans les philosophies, est adéquat à l’idée d’Initiation.
Pourquoi initier, si ce n’est pour communiquer le sens de ce qui resterait caché, ignoré ou incompréhensible, disons tout de suite de mystérieux, quelle que soit l’origine de cette communication, quel qu’en soit l’agent ?
Mais le mot implique encore, historiquement, un autre sens : quiconque est initié jouit d’un privilège, et son initiation, (initium, commencement), n’est qu’un premier pas franchi vers de nouvelles découvertes, dont il possède désormais la clé.
L’initiation a enfin un but utilitaire et pratique : elle suppose un changement de vie. L’apprenti, initié à son métier, deviendra maitre, parce qu’il a la clé des compétences et qu’il peut exécuter le « chef-d’œuvre » témoin de ses mérites. Le franc-maçon est d’abord apprenti, dès qu’il a reçu l’initiation, mais il peut dorénavant s’acheminer vers de nouveaux perfectionnements. Toutes les religions ont leurs apprentis initiés, parce qu’elles ont toutes des parties sinon secrètes du moins inaccessibles à quiconque n’a pas suivi la filière et ne connaît point le mot de l’énigme.
Dans son traité de la Théologie mystique, Denys, l’Aréopagiste, y enseigne à un initié, en l’avertissant de garder sur ces mystères un secret rigoureux — car leur connaissance serait dangereuse à des esprits non préparés – l’entrée dans ce qu’il appelle « la divine obscurité », « l’inaccessible lumière », (Rom. Rolland, Vie de Vivekananda, 2ème vol., p. 255).
L’initiation mystique est un legs des traditions religieuses les plus anciennes. Dans toute religion, quelle qu’elle soit, il y a une initiation, qu’il s’agisse des épreuves physiques et morales qui sont à la base de la sorcellerie, encore en usage chez les primitifs (Afrique, Peaux-Rouges) ; qu’il s’agisse des épreuves purificatrices que Pythagore imposait à ses disciples pour les rendre dignes de recevoir sa doctrine ; qu’il s’agisse de l’entrée en religion au sein d’une Congrégation quelconque ; qu’il s’agisse même de la simple admission devenue rituelle et symbolique, d’un sujet dans une Eglise où l’initiation est dénommée baptême, partout, dès qu’il y a changement d’état dans l’ordre spirituel, il y a cérémonie de réception, succédant à une phase de préparation, de stage, où, pour acquérir plus de dignité, il y a des Purifications. En Égypte, dans les Indes, les pratiques religieuses nécessitaient l’admission à des degrés successifs où, progressivement, le sens du mystérieux devenait plus clair. Pour accéder à la Connaissance Supérieure de plus en plus compliquée, il convient parfois de s’adresser à l’initié en un langage conventionnel, parlant à ses sens. Le mysticisme ainsi envisagé est inséparable du symbolisme si expressif dont toutes les Religions ont usé. C’est une sorte de langue de passe dont les seuls initiés saisissent la signification et qui, par la voie de l’Image, aisément perceptible, concrète, donne accès plus facile à l’Idée abstraite.
Ce n’est que par extension, abusive et même tendancieuse, que le mysticisme a pris, dans le langage courant, le sens de mystère avec la valeur un peu péjorative attachée à ce terme.
Au mysticisme se rattachent encore les sens divers du mot Mystique. Il convient de les délimiter. Mystique se dit de tout ce qui se rattache au mysticisme. Mais de cet adjectif est dérivé un substantif, tantôt masculin, tantôt féminin.
Le Mystique (masc.) désigne tout sujet enclin au mystérieux (occultisme) par nature, par formation d’esprit.
L’inconnu a ses attraits, même il a ses séductions. Mais cette attirance qui est génératrice de la recherche et de la découverte quand elle est le fait d’esprits inductifs voués à la science, pétris du désir ardent de savoir, de projeter la lumière sur ce qui est caché, cette attirance offre des caractères individuels tout différents quand elle est le fait d’imaginatifs, d’émotifs, subissant comme l’envoûtement de l’inconnu, construits en esprits déductifs, par conséquent prêts à recevoir la manne facile de la Révélation, réceptifs du Préjugé et de la Superstition. Enclins à la passivité et à l’hétérosuggestion, ils ont la terreur et le respect automatique de cet Inconnu qui, pour le savant, est un stimulant. Ces sujets, antiscientifiques sont les vrais mystiques, au sens habituel du mot ; les autres sont de simples curieux. Les premiers sont destinés à être les victimes des exploitations religieuses, qu’il ne faut point confondre avec la connaissance, la pratique sincère des Religions dont l’attrait philosophique leur échappe et qui est l’objet même de cette étude.
Le mystique est un fervent, un ardent passionné de tout ce qui revêt des allures anormales, énigmatiques, disons occultes. L’occultisme est toute une thèse dont les adeptes sont de purs mystiques. Il s’est constitué une catégorie de gens qui ne vivent que par le merveilleux : fétichistes, télépathes, sorciers, mages, astrologues, miraculés, tourneurs de tables, liseurs de pensées, voyants, mediums, friands de l’au-delà, spirites de tous acabits, chiromaniaques, graphologues divinateurs, hypnotiseurs fluidiques, fakirs, contemplateurs de nombril, extatiques, avaleurs de sabres, possédés, démoniaques, incubes et succubes, lycanthropes et tutti quanti, toute cette collection d’extravagants, agresseurs du bon sens et de l’humaine raison, jouit d’une mentalité commune (je ne parle que des sincères), faite de crédulité, d’adhésion aprioriste.
Tels sont les mystiques dignes d’intérêt et dont la contrefaçon s’appelle charlatans de toutes catégories, fabricants de poudre aux yeux.
Les uns et les autres sont rencontrés sur les terrains les plus divers où ils trouvent moyen d’appliquer leurs dispositions naturelles. Oserait-on faire, par exemple, la moindre différence entre un flagorneur, un batteur d’estrade, un bateleur de la politique électorale, traînant à sa remorque tout le troupeau compact des gobeurs, et les voyants qui hantent les champs de foire ? Le sauteur de corde est un charlatan. Le gobeur est un mystique. Il est fasciné au même titre que le simple d’esprit écarquillant ses pauvres yeux devant une guérison à Lourdes, ou versant son obole au denier de Saint-Pierre, ou achetant pour quelques francs, une messe ou des indulgences.
Le troupeau humain se subdivise ainsi en deux clans : les Mystiques et les Curieux, les hommes de Foi et les hommes de Raison, les amateurs du Credo quia absurdum et les Saint Thomistes avides de croire, mais après avoir vu, cherché et compris.
Est-ce à dire pourtant qu’en ce vaste domaine de l’occulte il n’y ait qu’illogisme et absurdité, naïveté ou exploitation ? N’y a-t-il point dans l’occultisme, pris dans sa masse, des éléments qui stimulent la recherche sérieuse, et faut-il de plano rejeter en bloc tout ce qui n’est point du ressort des sens et du compréhensible ? Une telle affirmation n’aurait rien de scientifique et, à son tour, elle serait entachée de système. La négation brutale n’honore point l’homme de science. Mais entre l’homme qui doute et interroge et celui qui croit aveuglément, il y a tout un monde. Entre celui qui éprouve une sensation de bien-être à croire sans aller voir, à se donner au Dieu inconnu corps et âme, à trouver dans cet abandon une sorte de jouissance, et celui qui se contente d’opposer une simple froideur sereine à ce qu’il ne saisit point et se borne à attendre, il y a encore un monde. Le merveilleux n’a qu’un attrait, celui de grossir les difficultés auxquelles sourit le chercheur. Celui qui s’aplatirait en adorateur devant ces ondes sonores, capables en traversant la pierre d’apporter aux oreilles du Parisien des mélodies débitées à Berlin, s’assimilerait au nègre adorant le soleil ou au crétin qui éclate en hosannas d’allégresse en apprenant un miracle de la petite Thérèse de l’Enfant-Jésus. L’étonnement n’a rien du stupéfiant ; il n’est, chez l’homme exerçant une maîtrise sur la folle du logis, que le premier stade vers la découverte.
Le monde formidable de l’Inconnu flétrit le croyant aveugle et sourit à la Science dont chacune des découvertes est un gage offert à la Foi lucide et la juste récompense du Travail.
* * *
Et j’en viens au mot Mystique, au féminin. La mystique désigne le dogme conventionnel et provisoire de l’occulte, revêtant, en la complétant, la partie technique d’une thèse. C’est la métaphysique superposée à la physique ; c’est la prolongation, dans le champ de la connaissance des territoires connus vers les régions inconnues on mal explorées, où provisoirement, l’inconnu est schématisé, symboliquement exprimé, un peu comme l’est pour le mathématicien l’hypothèse du problème résolu. Il y a une mystique dans toutes les branches de la spéculation où l’inconnu est arrangé en système.
On le voit : cette mystique n’est point une sorte de vrac, un « caput mortuum » où s’enfouissent pêle-mêle les témoins de notre ignorance. Le symbolisme, réactif d’attente, permet d’y pénétrer et de s’y diriger jusqu’au jour où le chercheur s’y incorporera, y constituera une demeure habitable pour son esprit, parce que les arcanes auront disparu, percés à jour par les progrès mêmes de la technique scientifique. L’hindouisme, dont la connaissance est devenue si impressionnante depuis la vulgarisation de ses prophètes en Occident, est un bel exemple de cette mystique en voie de solution.
Les voies d’accès vers la mystique, telles que les philosophes de l’Inde nous les ont dégagées en liaison avec la science de l’Occident, sont tout aussi séduisantes que ces mêmes voies d’accès tracées par la science du réel seul, fouillant pas à pas avec ses méthodes positives la nuit de l’inconnu, en se dégageant de toute hypothèse mystique. Par l’un ou l’autre procédé, le champ de la mystique s’étrécit de plus en plus au profit de l’accessible. Les curieux du mysticisme feraient bien de se familiariser avec les œuvres formidables que l’hindouisme a répandues dans notre sphère depuis tantôt 50 ans. Elles ont projeté une forte lumière sur le magnifique problème que je ne puis qu’esquisser ici. (Voir Romain Rolland : Vie des Ramakrisna ; Vie de Vivekananda , Vie de Gandhi). Seuls les esprits superficiels ont laissé passer le Gandhisme sans l’approfondir, pour n’en faire qu’une réaction d’ordre nationaliste et politique.
Ainsi comprise, la mystique est une philosophie supérieure, de haute portée. Elle s’applique en de nombreux domaines : il y aura une mystique d’Orient, une mystique d’Europe, une mystique helléno-chrétienne, une autre Judéo-chrétienne, une Alexandrine, comme il y a une mystique de toutes les philosophies : pythagoricienne, socratique, platonicienne, etc., comme il y a une mystique de l’Art. Et, ce qui ne manquera pas de passionner les esprits curieux sera de découvrir qu’il y a au fond de toutes ces mystiques des éléments communs, qu’elles se confondent en somme dans un postulat universel qui n’est autre que l’Unité de la pensée humaine, l’Unité de l’esprit. Quelles que soient les voies d’accès, toutes se rejoignent, partant du connu, vers un carrefour où elles se fusionnent parmi l’Inconnu, s’amalgamant entre elles et avec lui.
C’est ainsi que le problème philosophique religieux du mysticisme s’agrandit démesurément en acquérant surtout le mérite de supprimer toute lumière entre la connaissance du Réel et l’Inconnaissable de l’Irréel (voir Ribot), entre le domaine du relatif et celui de l’Absolu.
* * *
Pour en finir avec l’importante mise au point des définitions, achevons de grouper autour des noyaux Myste et Mysticisme d’autres intéressants dérivés.
Tout de suite le mot Mystère vient sous la plume pour désigner tout ce qui, dans l’inconnu, échappant à notre perspicacité, comporte un élément que nous estimons inaccessible parce que surnaturel, extrahumain, ressortissant à des puissances diaboliques, divines ou autres, autrement dit à une zone d’influence à laquelle l’homme est soumis et ne saurait échapper par ses propres forces. Nous sommes en plein sur le terrain de la Foi, celui où l’on demande au fidèle un acte de pure adhésion ou de soumission. Car il lui est à jamais interdit de sonder cet inconnu, sans avoir reçu l’initiation qui lui permettra de comprendre. Les mystères antiques, ceux d’Orphée, d’Apollon, d’Eleusis, de Delphes ; les mystères chrétiens, toute la mystique religieuse de tous les temps et de tous les pays forment un conglomérat de curiosités dont le monopole fut détenu par un collège de prêtres ou de desservants et fut matière à exploitation facile, à raison de la crédulité indispensable du troupeau récepteur du mystère.
C’est à cette mystique, qui est cependant d’un caractère élevé parfois, que l’on doit d’avoir connu le Prêtre vivant de l’autel. La phase sacerdotale de l’histoire des religions est curieuse à étudier, car elle eut des conséquences exceptionnelles en ravalant au plan humain ce qui, par définition, devait planer dans des régions idéalistes et symbolistes. C’est à savoir qu’un divorce s’est établi par le fait entre deux mondes supposés d’essence différente : celui du connu et celui de l’esprit humain, divorce fort regrettable pour les progrès de l’esprit humain, comme on le verra plus loin, car le mystère devint presque toujours générateur de mystification (initiation à rebours : mensonge, hypocrisie, duperie, action d’arrêt par l’usage de la terreur, etc.).
Telle fut l’œuvre du prêtre, de quelque Orient qu’il se recommande. Vulgus qui decipi.
Mais il est pourtant des esprits à qui répugne le mensonge et qui protestent. Mais alors, la réaction tend à dépasser l’action. On ne saurait nier que le mot de mysticisme de nos jours sonne mal à l’oreille des rationalistes, du libre penseur, comme aussi de beaucoup de gens qui attachent aux mots plus de valeur qu’aux choses qu’ils représentent. On ne saurait trop s’élever contre cette logophobie si commune dans les milieux encore peu cultivés et gagnés à une juste méfiance par carence d’éducation. Des préventions dangereuses s’élèvent partout, parce que l’on manque de sens critique et il est aussi sot pour un anarchiste d’avoir peur du mot mysticisme que pour un bourgeois de se signer à l’audition du mot anarchiste, auquel il n’oserait accorder une minute d’attention.
Tout le mal vient ici de l’exploiteur-né qu’est le Prêtre qui, se souciant peu de vivre de l’air du temps, trafique des prières, mais qui, pire encore, est un condensé d’intolérance. Le prêtre a tué la religion, meurtri l’esprit religieux, comme le porte-sabre a provoqué le dégoût irrémédiable, fort heureusement du reste, du patriotisme armé.
Mais si de tels attentats peuvent être salutaires, en fait ils sont nuisibles quand ils bloquent l’essor conscient de l’esprit en jouant le rôle d’un frein. Les mots de tolérance et d’intolérance sont insupportables, car ils sont en fonction toujours d’un autoritarisme quelconque et de cette immense fatuité humaine qui porte certaines gens à croire qu’ils possèdent seuls la vérité, alors que tout est vérité ou contribue à la vérité. Il n’est aucun effort de l’esprit qui soit négligeable. C’est au nom de l’intolérance, si proche de la tolérance, que les humains se sont tant de fois entredéchirés. Une mutuelle considération eût tout changé.
Un peu de modestie siérait mieux aux détenteurs de mystères, s’ils n’avaient un puissant intérêt à dominer les âmes et si, inversement, ils n’éprouvaient une diabolique jouissance à exploiter ceux dont Romain Rolland dit : « Ils n’ont aucun droit à porter les couleurs de l’Ame religieuse ces millions de lâches croyants des Eglises — cléricales ou laïques — qui ne croient point par eux-mêmes, mais qui restent vautrés dans l’étable où ils ont été vêlés, devant le râtelier plein du foin des croyances commodes, qu’ils n’ont que la peine de remâcher ».
* * *
Ce déblaiement des définitions et des terminologies a déjà clarifié le problème du mysticisme. Je considérerais même l’étude comme terminée si je n’avais à marquer, une fois de plus, la liaison qui existe entre ce problème et celui de la Foi en face de la Raison, de la Science en face de la Religion, problème sous-jacent à celui du mysticisme. Il me faudra dire un mot ensuite de la pathologie du mysticisme qui nous mettra aux prises avec les Dogmes dressés contre l’humaine nature.
Si l’homme était omniscient, s’il avait à sa disposition des sens moins bornés, si la vérité ne se recommandait point de l’effort des conquêtes lentes et progressives, il n’y aurait jamais eu de mysticisme. Jamais les philosophies et, à leur remorque, les religions, n’auraient imaginé une dualité de substance chez l’homme, construit des autels à l’Ame et à l’Esprit et établi une hiérarchie de noblesse entre la guenille périssable que constitue le Corps et sa locataire, l’Âme, jugée d’une autre essence et jouissant, par privilège divin spécial, de propriétés extrahumaines, telles que l’immortalité.
Mais il faut ajouter que, malgré son ignorance fondamentale, l’Homme n’eût jamais inventé le mysticisme ni le divin, s’il n’avait été cloué primitivement d’une Imagination prépondérante, décuplée par un état permanent de crainte, corollaire tant du troublant Inconnu que de sa faiblesse ; s’il n’avait dû, enfin, succomber devant la tyrannie fascinatrice et suggestive du Prêtre ambitieux et famélique.
Il n’en reste pas moins, quoiqu’on fasse, que dans le champ de la Connaissance, deux zones limitrophes, imbriquées l’une dans l’autre, existent encore : l’une dite de la conscience, où l’homme peut se mouvoir parmi des phénomènes accessibles à ses sens ; une autre où, dans un dégradé progressif, la subconscience d’abord, puis inconscience, se trouvent collectés une foule d’états et de faits imprécis que l’Homme ne fait que soupçonner, entrapercevoir ou ignorer totalement, états en liaison forcée, par juxtaposition, avec les faits de pleine conscience. Ce départ est si net que l’on conçoit fort bien que le Primitif ait pu les disjoindre comme deux ordres de choses sans autre rapport que celui du voisinage. L’abstrait et le concret, le relatif et l’absolu sont pourtant, de par la logique, deux formes du même objet. Mais ils sont d’un aspect si différent que leur nature peut être supposée différente. L’homme discerne bien quelque peu ce dont il est imprégné, mais l’essence même de cet agent imprégnateur, et parfois aussi l’imprégnation elle-même, il les ignore.
Bien qu’il ait d’aventure orgueilleusement pensé triompher du mystérieux, « il sait qu’il ne sait pas tout ; qu’il ne saura jamais tout » (Guy Grand). Cet aveu n’est point acte d’humilité, mais prudence, car si un acte de résignation peut s’entendre d’un croyant abîmé devant l’Idole, il ne s’entend plus de l’Homme évolué, fier de sa raison qui justifie ses espoirs, n’adorant que la Vérité, sûr que son passé ascensionnel est la garantie du quo non ascendam, où il met la noblesse de son esprit. Mais, sur le terrain des réalités palpables, l’homme, comme le dit Proudhon : « a beau étendre le cercle de ses idées, sa lumière n’est qu’une étincelle promenée dans la nuit immense qui l’enveloppe » et « il faudrait être bien pauvre de jugement pour ne pas reconnaître que le mysticisme ne fera jamais défaut à notre savoir ».
Et il faut bien qu’il en soit ainsi tant qu’il n’aura pas incorporé sa substance et sa science au Grand Pan, jouissant de l’apothéose finale de son génie vainqueur, sublimité de laquelle il n’a jamais été exclu que de par les droits factices conférés aux dieux de tous les Olympes par notre platitude initiale. Le mysticisme, tel que l’entendit Proudhon, et tel qu’il faut l’entendre, « n’a rien d’opposé à la raison, bien au contraire ».
Mais alors, s’il n’y a point opposition, il y a identité de nature ; il y a continuité et imbrication entre les deux zones de la connaissance, comme entre le jour et la nuit séparés par une zone crépusculaire indécise, une zone où tout est accompli, une autre où tout est potentiel. Entre les deux, un territoire nébuleux, royaume de l’Intuition et de l’Hypothèse, un voile que l’Homme prend plaisir à déchirer parfois.
La pensée n’éclate pas au plein soleil de la connaissance sans conserver des attaches profondes et indestructibles avec un monde de pensées réduites, ou d’embryons de pensées, dont elle n’est que la prolongation et le développement.
Les merveilles de la Pensée humaine ont incité les psychologues de tous les temps à l’analyse des éléments qui la constituent. Doué de réflexion, l’Homme a profité de cette admirable propriété pour projeter dans son monde intérieur des regards curieux et il s’est habitué à l’introspection. A-t-il pu jusqu’au bout suivre les fils conducteurs, indéfiniment bifurqués ou entrelacés comme un écheveau embrouillé vers un noyau primitif ? S’il l’a cru, parfois, il dut pourtant hésiter à l’orée du sanctuaire qui a si justement mérité la qualification de « chambre intérieure », à laquelle il a frappé vainement et les sentiers qui l’y conduisaient se sont perdus dans une brousse inextricable où s’abritent jalousement les premiers linéaments de sa vie mentale. Encore a-t-il douté qu’il puisse jamais les dégager et les illuminer car il eut la prescience qu’ils n’avaient point de fin.
Dès les temps anciens, l’Homme a été frappé par un phénomène : le Rêve, qui eut le don d’émoustiller sa curiosité. On sait le rôle que joua ce monde inconnu dans la vie des peuples et qu’ils n’hésitèrent point à lui attribuer une émanation de vue. Dans leur mysticisme ignorant, ils trouvèrent à ces phénomènes des significations supranaturelles dont le nœud fut l’œuvre du Prêtre. Il a fallu en venir jusqu’au XIXème siècle pour que les psychologues mieux avisés restituassent au Rêve sa valeur de fonction normale et sa liaison d’une part avec la pensée claire de la veille, d’autre part avec des manifestations éloignées d’un psychisme plus profond, plongeant des racines dans une partie du Moi, qu’à défaut de mieux l’on a dénommé Subconscient.
La découverte d’une activité psychique brumeuse constituant une sorte de réservoir caché où la Pensée puise les éléments de sa fabrication, dont les origines se perdent dans la nuit des temps, cette découverte est une date dans l’histoire des Idées. S’il est encore des simples d’esprit capables de feuilleter la clé des songes, il est d’autres esprits qui savent que le Rêve est une création du donneur lui-même et que son incohérence liée à son automatisme, n’est due qu’à la suspension momentanée du contrôle et du jugement. Une science toute nouvelle, la Psychanalyse, a permis de violer les secrets de la subconscience, et déjà les portes du sanctuaire impénétrable sont ouvertes. Le gouffre sans fond de l’Absolu et de l’Irréel s’offre aimablement aux excursionnistes de leur Pensée et l’on ne saurait plus prétendre que le mystérieux est le parc réservé au divin.
La Science et la Religion se sont rejointes et n’apparaissent plus deux spéculations antagonistes. La Pythie et les mediums n’ont plus le don de stupéfier que les nigauds et Lourdes a livré ses secrets à Charcot. L’intuition, les phénomènes de pressentiment n’ont plus figure de faveur accordée à l’Homme par une divinité bienveillante ne livrant ses trésors qu’à des privilégiés. L’extase, la contemplation, la méditation sont facultés à la portée de tous et l’hypothèse est exposée aux coups de sonde de la Raison.
La voyance n’est plus qu’une singerie de charlatans, de forains et de naïfs, au service d’une foule émotive, éprise de merveilleux.
Parce que la connaissance se heurte tout à coup à la mer de nuages qui l’empêche de cheminer autrement qu’à tâtons, a-t-on le droit de dire que cette mer cache un horizon à jamais inaccessible et qu’une lumière plus éclatante ne la dispersera pas ? La découverte est la prime accordée au chercheur, et le croyant ne cherche pas : il capitule.
En deçà du nuage est le monde de la connaissance réalisée qui tient déjà du prodige, c’est le royaume dévolu à la Raison. Au-delà, est le domaine de la Foi. Mais celle-ci n’est point forcément aveugle-né et si son rôle habituel est d’ordre inhibitoire, il est des hommes de science dignes de ce nom pour qui les deux mondes s’interpénètrent et pour qui la zone de la Foi n’est qu’un nouveau champ d’expérience. C’est un fait connu qu’il est des savants rompus aux méthodes scientifiques et qui ne peuvent cependant se dépouiller de cette tare mystique qui est un legs de la race. On s’extasie et l’on prétend triompher quand on cite des hommes de grand renom qui ne craignent point de sacrifier encore aux superstitions religieuses auxquelles ils sont enclins.
On connait à l’opposite des hommes de religion (je ne parle que des sincères) qui cultivent les sciences avec succès et qui savent se servir des facultés de leur entendement pour aller à la découverte.
De tels exemples n’étonnent plus personne, La coexistence du mystique et du scientifique jugés d’essence différente est, à coup sûr, une imperfection et l’on sait des âmes honnêtes et grandes qui comme Pasteur, surent réaliser la cloison étanche qui sépare le réel de l’irréel, travailler au bien de l’Humanité en utilisant de formidables moyens et rester cois à l’entrée du sanctuaire réservé au divin, en s’interdisant d’aller plus loin. L’envoûtement du passé est chose dont on se défend mal, bien qu’il tende à disparaitre le jour où l’on ose briser la cloison étanche et se servir de sa raison pour pénétrer l’impénétrable. Ceux-là seuls sont à plaindre qui se refusent à aborder de front le colosse par crainte de sacrilège. On honore le Dieu inconnu en abordant sa demeure. L’époque des Titans est passée et Prométhée ne serait plus voué au supplice réservé aux violateurs du Ciel. Le Juif n’aurait plus besoin de Moïse pour dialoguer avec Jéhovah.
Mais il est d’autres hommes qui ont voulu et su combler le fossé que les Religions et le mysticisme naturel se sont ingéniés à creuser entre le Réel et l’Irréel, entre la Religion et la Science, entre la Foi et la Raison. Ils n’ont aperçu dans ces diverses antinomies que deux formes d’un même objet. Enorme progrès, capable de féconder l’avenir au lieu de la stérilité du piétinement sur place.
« Il s’est fait de nos jours un absurde divorce entre ces deux moitiés de l’Ame : la Raison et la Foi. On leur a persuadé qu’elles sont incompatibles. Il n’y a d’incompatible que l’étroitesse commune de ceux qui se prétendent abusivement leurs représentants... Et nombre d’esprits qui sont libres ou se croient libres de toute religion, vivent baignés dans un état de conscience supra-rationnel qu’ils étiquettent socialisme, communisme, humanitarisme, nationalisme, voire même rationalisme. Ce n’est point l’objet de la pensée qui détermine sa provenance et permet de décider si elle ressortit ou non à la religion : c’est la qualité de cette pensée. Si elle s’oriente intrépidement vers la recherche de la vérité, à tout prix avec une sincérité entière et prête à tous les sacrifices, je la nomme religieuse. Car elle présuppose la foi en un but de l’effort humain, supérieur à la vie de l’individu, parfois de la communauté présente et même de la totale humanité. » (Romain Rolland, Essai sur la mystique et l’action de l’Inde vivante.)
Suivant Renan :
« La religion est la part de l’idéalisme dans la vie humaine. »
Le voilà, le domaine de la Foi pour le Scientifique, de la Foi toujours armée de l’Espérance qui ne réside point dans la Grâce, mais qui, au contraire, féconde et conditionne l’effort humain en vue de la découverte, en vue de la création toujours renaissante sur des bases toujours de plus en plus solides. Foi vaut Confiance. Confiance en soi d’abord, sans que la présomption y ait sa place, confiance dans les Hommes capables d’œuvrer et de se donner pour le Bien de Tous. Sur le terrain laïque lui-même il y a place pour la fameuse trilogie d’inspiration exclusivement religieuse : Foi, Espérance et Charité. Que de belles Ames d’athées, de rationalistes, de libres-penseurs n’ont jamais eu d’autres directives ! Quiconque manque de foi n’a point cette illumination intérieure qui n’est que l’expression synthétique de cet élan vital inhérent à l’espèce et qui la pousse en avant vers le mieux, est fort à plaindre et voué à la stagnation.
Arrivé au carrefour des routes inconnues qui s’enfoncent vers l’ombre de l’irréel, l’Homme se recueille. Il peut prendre peur comme l’enfant dans la nuit, ou rester l’esclave de sa peur héréditaire. Il peut rester indéfiniment penché sur la glèbe comme le serf sans regarder plus loin et abdiquer au profit du premier berger qui passe. Mais il peut aussi redresser la tête et, comme l’y invite le vieil Ovide, regarder le Ciel : « Cœlumque tueri » non pas avec la candeur du croyant qui implore la force de supporter sa chaine et réclame les gages d’une récompense céleste, mais avec l’amour de plus de liberté, de plus de vérité, n’ignorant point, du reste, que la route est difficile, souvent ingrate pour les pionniers de l’Idée, mais qui sait pourtant que l’erreur elle-même renferme une part de vérité et qu’aucun effort n’est perdu.
Les voies d’accès vers l’Idéal sont multiples et fécondes. Tout chemin qui monte y conduit. La vérité est diffuse en nous comme en l’Univers dont nous ne sommes qu’un atome infime. Et nous marchons vers la grande Unité, vers l’Universelle Synthèse, vers le grand Pan. Qu’y trouverons-nous ? Dieu ou nous-mêmes incorporés au Cosmos dont la substance éternellement métamorphosée est toujours renaissante sans usure possible ? Que nous importe ? L’Inconnu est un tropisme, et Dieu n’est qu’un mot. Qu’il réalise les Postulats des Ames éprises de poésie, des imaginatifs imprégnés de romantisme, rien n’y fait obstacle. Au lieu de trouver Dieu à l’origine du monde, ils s’y heurteront à sa fin.
L’esprit positif, engagé dans la même voie, cherche, cherche toujours et trouve dans la recherche l’aiguillon qui suffit à sa vie. Qu’il soit d’inspiration religieuse ou positive, le monisme s’impose et c’est la fin où tend le mysticisme scientifiquement, humainement envisagé.
* * *
Mysticisme et mystiques en Pathologie. Il y a chez tout mystique un état mental de base sur lequel peuvent éclore des floraisons délirantes perpétuellement menaçantes.
N’est point mystique qui veut. Pour l’être, il faut voir, entendre et surtout sentir avec des organes héréditairement sensibilisés au préjugé, à la superstition ; il faut être réceptif, docile et malléable. On peut comprendre la mentalité du mystique et se l’expliquer, psychologiquement, mais il est impossible de se l’assimiler si l’on n’a point l’âme pétrie comme la sienne, vibrant à son unisson. Je m’explique qu’un daltonien ne perçoive pas le rouge, mais je ne puis avoir la même sensation visuelle que lui. On s’explique la morale, mais il peut advenir qu’on ne la sente point.
Pour être un mystique au sens pathologique du mot, il faudra quelque chose de plus, il faudra réunir des conditions prédisposantes, telles qu’une hérédité similaire, une éducation d’esclave privé de sa liberté d’esprit, avec un cerveau ayant subi de bonne heure de ces plicatures répétées, indélébiles où sévissent ces terribles refoulements que les psychanalystes ont si bien mis à nu ; il faudra une formation morale toute spéciale, par conséquent un milieu que seules les religions dites révélées, sont capables de créer. Il faut donc être d’abord le mystique au cerveau préparé, c’est-à-dire celui qui ne se contente pas de constater le mystère, mais qui en est impressionné, qui tremble devant lui et lui donne son adhésion, qui croit à un surréel actif, doué de puissance et d’influence sur le réel, surréel que l’on ne comprend point, mais que l’on redoute, que l’on aime et respecte pour cela même. C’est la mentalité dont on fait les dévots, les cagots, les Tartufes de tous les cultes, les fervents aveugles de toutes les religions depuis les Primitifs, clients du sorcier et porteur d’amulettes jusqu’aux piliers d’Eglise et punaises de sacristie, chamarrées de grigris et de scapulaires, en passant par les Antiques eux-mêmes qui consultaient les oracles, les Chinois qui brûlent des parfums pour chasser les démons, les exorcistes qui ont infesté notre moyen âge, les marchands d’orviétan de tout acabit.
Renforcez cette prédisposition individuelle par une influence adéquate de milieu, vous créez les inspirés hallucinés, témoins de Dieu, possédés, grands hystériques dont les siècles passés furent si tristement empoisonnés et dont nos asiles exhibent encore de jolis spécimens.
Deux facteurs d’importance concourent à ce résultat : le degré d’intelligence et le degré d’émotivité.
Règle unique : le mysticisme de base prémorbide est en raison directe de l’émotivité (crédulité), et en raison inverse du niveau intellectuel (sens critique). Ces deux éléments psychologiques suffisent à créer la foi en l’absurde et à laisser prendre des vessies pour des lanternes. Plus un homme s’intellectualise, moins il livre de champ à son émotion, moins il a de chance de choir dans le mysticisme morbide. Plus les peuples se cultivent, moins ils offrent de prise à la superstition. Mais les soubassements émotifs de l’homme grégaire sont tellement solides qu’ils compromettent pour longtemps l’édifice intellectuel. L’émotion peut même entraîner au désespoir souvent des sujets eux-mêmes qui ont conscience de leur faiblesse et en rougissent. Une telle carence empiète déjà sur le morbide.
Psychose mystique. Elle est à étudier du point de vue collectif, car il n’y a point de psychose qui soit plus contagieuse.
Il y a des circonstances prédisposantes, d’ordre héréditaire et d’ordre personnel, toutes deux inhérentes au sol où germera la psychose.
Héréditairement, notons la surémotivité et la faiblesse d’esprit, deux états qui fourmillent dans les campagnes arriérées, fief du Prêtre. Mais, pour y voir germer la graine mystique, il faut un ensemencement spécial. Il y a des familles où le dépôt mystique est ancestral déjà. Dans certains groupes sociaux il est de bon ton de servir de pilier d’Eglise ; c’est une sorte d’obligation de race, un snobisme dangereux, un pli cérébral, un tic. Ce sont ces milieux où sont anathèmes l’hérétique, le divorcé, le mort-né sans baptême et qui n’a pas droit à la sépulture de famille chrétienne. Ces foyers de pestilence morale ont la dévotion mystique double et parallèle du goupillon et du sabre. On y est très prolifique et, dès sa naissance, Raoul est voué à l’année, Guy deviendra curé, Thérèse entrera au couvent. C’est de tradition. Cette tunique de Nessus dont on est fier ne fait qu’une avec la peau. Il est clair que le fait de naître en pareil milieu prépare la psychose mystique ; la graine viendra de l’éducation.
L’éducation des familles qui se croient tenues à des pratiques cultuelles détermine l’orientation des esprits vers le délire. C’est d’abord la discipline exemplaire, le dressage à des pratiques automatiques non discutées et incomprises qui s’approprient les sujets et en font des esclaves, dès l’enfance. La folie mystique éclate fréquemment dès la jeunesse. C’est ensuite l’habitude d’hypocrisie où les sujets, sollicités par des penchants, des besoins, des états passionnels naturels, s’obligent à les assouvir en cachette ou, ce qui est pire, à les refouler comme autant de cas de conscience qui surgiront plus tard en la forme d’obsessions, d’angoisses, de scrupules maladifs ; c’est enfin l’éteignoir mis sur le sens critique, l’adoption de l’énorme, de l’extranaturel, comme une émanation normale d’un Dieu rigide et sévère ; c’est la crainte corrélative de châtiments post mortem, rachetés par des soumissions puériles ou des pénitences honteuses ; c’est enfin et surtout la prééminence des Affects sur les processus intellectuels, le dévergondage scabreux des sens, la création de chimères, d’images hallucinatoires qui hantent rêves et cauchemars, semant l’effroi, déterminant de soi-disant vocations religieuses précoces et le suicide moral avec la stérilité. La plupart des grands inspirés, des saints et saintes dont se glorifient les Eglises ont vu naître leur psychose dès l’enfance. On y voit se mésallier dieux et démons, anges et diablotins. Le moyen âge a racolé ses sorciers dans ce monde de prédisposés. De nos jours ils peuplent les maisons de fous.
La forme mystique des psychoses est dominante en certaines régions vouées encore à des pratiques cultuelles automatiques, telles que la Bretagne. Ces pratiques tournent la tète des pauvres d’esprit qui forment le troupeau habituel du Prêtre. Ils grossissent les exodes de pèlerins qui vont promener leur névrose dans les sanctuaires réputés.
Tous les mystiques des Asiles sont des débiles mentaux à délire grotesque où abondent les pratiques superstitieuses. Il s’y mêle ordinairement des préoccupations sexuelles, des pratiques anormales du même genre, des extases, des amours mystiques avec Dieu, le diable, même des animaux. Souvent des phénomènes de grande ou de petite hystérie compliquent le tableau. De tels malades, nés des Eglises, en seraient les victimes expiatoires s’ils vivaient au moyen âge. Un privilège les fait jouir, de nos jours, de la pitié qui s’attache aux simples d’esprit. Les asiles qui les recueillent sont remplis de saintes Thérèses, de Jeannes et de tous les échantillons de saints du calendrier. Heureux si le martyr des Ursulines, Urbain Grandier, eût vécu de nos jours : le cimetière de Saint-Médard serait maintenant un quartier de l’asile Sainte-Anne, sis tout proche !
Une immense crédulité git sous chaque psychose mystique. Elle en est la condition formelle. Cette folie peut jaillir spontanément des recoins ténébreux du subconscient, chargé à bloc d’effluves religieux héréditaires. Mais il faut ordinairement le déclenchement d’une autorité habile qui fascine, hypnotise, impose, telle celle du prêtre, ou l’exemple entraînant des proches.
On ne saurait trop signaler cette influence néfaste du milieu à tous les éducateurs, s’ils ne veulent voir sombrer dès l’aurore des personnes morales intéressantes, car l’évolution de la graine est fatale, et jamais de telles maladies ne reviennent en arrière.
Ajoutons un nouveau facteur à la suggestibilité du débile et à son faible niveau d’intelligence, celui du nombre et nous avons les psychoses mystiques collectives, les épidémies de folie religieuse qui éclatent encore de nos jours, antées sur cet état d’endémicité fondamentale chronique qu’entretiennent les Eglises et l’incurie des libres-penseurs. Ici, l’élément contagieux est tout et il est en fonction même du plus grand nombre. La psychologie des foules, aujourd’hui bien connue, trouve dans la mysticité sa démonstration la plus troublante.
Les sujets se divisent en deux catégories, comme dans toutes psychoses communiquées : les actifs et les passifs, les forts et les faibles, les convaincus et les hésitants, les audacieux et les timorés. L’intelligence dans les foules n’a qu’un rôle effacé, secondaire. Chez cette grande bête qu’est la foule, ce qui domine, c’est l’émotion. Dans une réunion électorale, souffle un vent de mysticisme. C’est le royaume de la poudre aux yeux dont les plus malins sont parfois victimes. Ce qui se manifeste c’est l’émotion et non pas la logique ; le bon sens n’est plus nécessaire. Bon sens et logique sont pour un moment annihilés, suspendus, inhibés par le courant des forts. Déjà sont fréquentes les folies mystiques à deux personnages, trois et quatre participants ; les épidémies de famille ne sont pas rares. Que de familles j’ai dû consoler, trop tard, de pertes qu’elles subissaient, grâce à leur maladresse éducative, d’enfants arrachés à leur tendresse par la vocation religieuse !
Plus graves et plus retentissantes sont les épidémies de couvent.
L’histoire de la mysticité collective est un inépuisable martyrologe, car le propre de l’agent d’influence dans la création du délire est sa violence et son intolérance. Le délire mystique est non seulement contagieux, mais c’est une des formes les plus redoutables de la manie raisonnante et du délire actif de persécution Les folies religieuses à hase de révélation comptent à leur actif des crimes sans nombre. Les Eglises se sont ensanglantées à toutes les époques de leur histoire. Les religions ont perturbé la vie des peuples, organisé le trouble, entretenu des sentiments de sauvagerie instinctive qu’elles avaient pourtant mission de canaliser et de dompter. La Saint-Barthélemy, les Albigeois, la sombre Inquisition qui a sévi en divers pays et dont l’esprit est encore infiltré dans nos mœurs, ont semé dans leurs abattoirs sacrés, sans aucune pitié, les victimes les plus inoffensives comme les plus illustres, Galilée, Michel Servet, Jeanne d’Arc émergent bien au-dessus des charniers les plus engraissés de 1914. Les chrétiens des premiers âges eux-mêmes pavèrent de leur peau leurs croyances enfantines ; ils se sont rattrapés plus tard. Des saints et prophètes improvisés souvent eux-mêmes, des aliénés, n’ont qu’à se présenter pour entraîner à leur suite des foules hallucinées. Aux Indes, Gandhi prépare de nouveaux martyrs.
Çà et là éclatent des réveils mystiques à l’appel d’un illuminé. Celui du Pays de Galles en 1905 est un des plus fameux. Mais les plus extravagants des accès de délire collectif où l’on voit sombrer jusqu’aux dernières lueurs de bon sens sont les pèlerinages organisés autour de miracles, témoins eux-mêmes d’un accès personnel de mysticisme maladif, quand ils ne sont pas œuvres de mystification. Ils sont d’autant plus intéressants qu’ils dénoncent, à l’origine de la crise, l’action de meneurs parfois sans conviction et dont l’influence malfaisante est coupable. Pour triompher de la crédulité des mystiques, il n’est pas besoin d’être un génie.
L’Antiquité elle-même connut ces Temples où les foules s’entassaient, attirées par les superstitions les plus grossières.
Delphes fut le Lourdes de la Grèce ; Ghéel, en Campine traîne depuis trois siècles, sa réputation de guérir les aliénés.
* * *
J’ai donné à ce mot de mysticisme un sens très élargi et j’ai compris dans cette acception tout ce qui, en dehors du thème proprement religieux, consacre une abdication de l’intelligence au profit du mystérieux, une exacerbation passionnelle au détriment de la Raison. Les folies politiques, où les fétiches laïques surabondent, ont mérité une large place dans ce défilé. En tout et partout l’homme se présente comme un conquérant, un despote, et ses victimes sont en proportion de son audace. Les sectes religieuses, politiques, philosophiques, les coteries sociales les plus diverses pourraient illustrer ma description d’une foule d’exemples. Les mystiques abondent autour de nous. Qui sait si nous-mêmes n’avons pas eu nos heures de mysticité contagieuse ou contagionnée ? Faire école, c’est placer sur un piédestal une espèce de fétiche en chair et en os, ou en effigie et agglomérer tout autour des foules qui admirent et disent : Amen.
La célèbre affaire Dreyfus mobilisa, de part et d’autre, des fanatiques. Les guerres sont d’immondes exemples de folie collective, cruelle et bestiale, abondamment pourvues de sujets qui se transfigurent tout à coup à l’audition d’un mot sonore, à la vision d’un signe convenu, d’une oriflamme. Les hurleurs de Marseillaise valent-ils mieux que ceux qui brament au Sacré-Cœur : Sauvez Rome et la France?...
CONCLUSIONS.
Le mysticisme, scientifiquement étudié comme un ensemble de faits, a l’avantage de relier le réel à l’irréel, le connu à l’inconnu et de restaurer la pensée religieuse dans sa pureté idéale, débarrassée du parasitisme des religions dogmatiques. Le temporel et le spirituel s’accordent et s’harmonisent. Unis, ils nous amènent sur le terra.in de l’Idéalisme et du Beau. « L’éthique est une esthétique. Cette éthique est cet Individualisme religieux absolu que Han Ryner appelle depuis longtemps un individualisme de la volonté d’harmonie. C’est l’éthique du Sermon sur la montagne, du plus élevé des commandements ! C’est la libération du sentiment religieux hors des moules étroits et déformant des religions. C’est son réel, son libre épanouissement » (L. Réhaut : Krisnamurti).
Les hommes au sens clair sauront toujours discerner le domaine du religieux du domaine des religions et trouver dans le premier tous les éléments d’élévation vers un plan idéal où par des sortes de distillations successives, s’échelonnent sur le long parcours de l’Histoire de la Pensée, s’est dégagé finalement un prototype de Perfection, dont l’imitation s’impose comme directive.
— Dr LEGRAIN
MYSTIFICATION
n. f. (Etymologie mal connue. La composition de mystifier rappelle mistigouri, mystigorfier, usités, avec un sens à peu près analogue, au XVIème siècle)
Mystifier quelqu’un c’est abuser de sa sottise ou de sa crédulité. Méchanceté et tromperie, voilà ce qu’implique la mystification du côté de l’auteur ; du côté de la victime, elle suppose l’absence d’esprit critique, une naïveté qui prédispose à jouer les rôles de dupe, pour le plus grand profit des charlatans qui dirigent la société. En d’autres termes, les mystifiés sont des poires que les mystificateurs cueillent et savourent dès qu’elles apparaissent suffisamment mûres. Dans l’art de la tromperie, convenons d’ailleurs que les escrocs, qui se bornent à soulager de quelques francs la bourse des grosses commères, restent des bambins de taille minuscule à côté de ces mystificateurs géants que sont prêtres, généraux, politiciens. Une Thérèse Humbert, un Rochette, un Oustric, malgré une adresse qui dépasse et de beaucoup la mesure ordinaire, font infiniment moins de dupes et de victimes qu’un pape ou un chef d’Etat, d’esprit même vulgaire ; et ce sont de petits saints à côté des Foch et des Clemenceau, qui sacrifièrent par millions les vies humaines, sans craindre ni l’échafaud, ni la prison. S’il existait une justice, c’est une corde pour se pendre, non l’habit vert des grenouilles académiques que recevraient maints professeurs célèbres, maints plumitifs illustres, maints savantasses couverts de parchemins des pieds à la tète. Des mystifications, et de la pire espèce, ces titres et diplômes universitaires qui, dans les hauts grades surtout, témoignent seulement du servilisme et de l’absence d’originalité du lauréat. Est-il race plus peureuse et plus sotte que celle des agrégés et des docteurs qui président aux destinées de l’enseignement moyen et supérieur ! Malgré les louanges dont eux-mêmes se couvrent, et les satisfécits que leur octroie volontiers l’administration, il apparaît clairement aujourd’hui que ces enfants sages sont des prétentieux incapables, généralement. Autre farce de haut goût, cette Ecole Unique que le parti radical tend aux masses populaires comme un appât. Nul plus que moi ne désire que soit diffusée l’instruction et j’aurais applaudi à une tentative pour mettre à la portée de tous une science non frelatée. Mais l’étude des projets qui circulent officieusement, m’a démontré qu’il s’agissait surtout d’accentuer une centralisation scolaire déjà trop grande, d’éliminer les autodidactes et d’écrémer le peuple afin d’empêcher toute fermentation révolutionnaire. On veut créer une nouvelle catégorie de privilégiés, que l’on armera davantage pour mieux tenir en bride les exploités. Au règne de l’or succédera celui des parchemins, qui ne vaut pas mieux, comme l’exemple de la Chine l’a démontré. Mais les politiciens ont trouvé là un moyen commode de duper les pères de famille qui compteront sur l’Etat pour faire de leurs fils des intellectuels bien payés. Hélas ! sous la troisième république, les vrais savants, les écrivains probes sont aussi dédaignés, aussi besogneux que sous le plus réactionnaire des souverains. Qu’importe, il est vrai, à l’aspirant député ! Pour lui tout mensonge est légitime qui permet de piper les voix des électeurs (voir politique, politiciens). D’ailleurs, lorsqu’il s’agit de fixer la liste des pensionnaires primés du Palais-Bourbon, le spectacle est instructif, même dans la plus paysanne des circonscriptions. Longtemps avant la foire, les écuries s’ouvrent, les poulains hennissent, tandis que courtiers et maquignons s’agitent près du populaire assemblé. Un beau feu anime le candidat, qu’il soit blanc, bleu ou rouge. Il faut le voir courir la campagne et s’arrêter dans les moindres hameaux : les plus laides commères trouvent en lui galant, il tapote la joue des bambins, et s’appuie sur l’épaule des paysans, tout ébahis d’une si tendre affection. Même s’il fabrique des chapeaux, du drap ou des casseroles, même s’il est avocat ou dirige un café-concert, il n’a rien tant à coeur que l’agriculture. Fumier, purin, vaches, récoltes, tout l’intéresse également, à ce qu’il assure ; et, pour favoriser les cultivateurs, il donnerait volontiers sa dernière chemise. En ville, dans les milieux ouvriers, l’aspirant-député se grime d’autre façon, il tient un langage différent ; mais, roulé dans du vermillon, de l’ocre ou de la farine, il s’agit toujours pour le rodilard parlementaire de tirer parti du raton citadin ou campagnard. Car, bien entendu, pour un parlementaire même élu par des agriculteurs, la campagne se résume dans les douceurs de la buvette ou dans l’excellent pinard de l’hôtellerie du coin. Entre la poire et le fromage, ou lorsqu’il déguste les meilleurs crus de l’arrondissement, il peut même être sincère en déclarant à ses comitards que de tels produits ne le laissent point indifférent. Ajoutons qu’à la Chambre il entonnera l’hymne du retour à la terre avec un glapissement pleurard, qu’il couvrira de fleurs la famille paysanne, qu’il prononcera d’interminables palabres, naturellement suivies d’aucun effet. Pure comédie, qui sauve les apparences !
A la mystification parlementaire se mêle fréquemment la mystification financière. Périodiquement, avec la complicité payée des journaux, les financiers marrons mettent en coupe réglée la naïveté des gogos ; sans contrevenir au code, ou très peu, et avec l’appui de politiciens en renom, généralement. Pour un qui tombe, dix atteignent le but convoité ; beaucoup décrochent titres et décorations. On les remercie, de la sorte, d’avoir subtilisé l’argent du populaire, pour le faire passer dans leurs coffres-forts. Si un scandale trop fort éclate, on calme l’opinion en annonçant que désormais l’on exigera de sérieuses garanties des banquiers. A l’occasion, les Chambres nomment une commission, chargée d’enquêter, à ce qu’on prétend, mais dont le but secret est d’étouffer l’affaire ou de limiter les dégâts. II est vrai que Poincaré fut porté aux nues parce qu’il avait stabilisé le franc ou, en termes moins trompeurs, parce qu’il avait officiellement et définitivement fait perdre au franc les trois quarts de sa valeur ! Si l’on passe en revue les diverses institutions publiques : armée, clergé, magistrature, patronat, presse, etc., l’on s’aperçoit qu’elles ne sont toutes que d’immenses mystifications. Afin que le populaire oublie les millions de cadavres qui lentement se décomposent, l’armée multiplie les parades, couvre ses gradés de dorures qui brillent au loin, fait sonner haut le bruit des sabres et des éperons. Les enterrements de Foch et de Joffre suffiraient à démontrer que le secret, pour être un grand chef, c’est d’être avant tout un excellent cabotin. Dans des occasions pareilles, les robes à queue des cardinaux et des prélats se mêlent, comme de juste, aux brillants uniformes de l’état-major. Nous n’insisterons pas ici sur l’Eglise ; chacun sait qu’en fait de mystification, le bouddha vivant de Rome détient le record. Aujourd’hui l’on n’ose plus faire commerce d’excréments du saint homme qui, séchés, réduits en poudre, constitueraient un incomparable remède, un préservatif efficace contre toutes les maladies. Mais de graves personnages, des dévotes richissimes continuent de lécher ses pantoufles et d’accepter comme relique la fine lingerie qu’il porte sous ses jupons. Quant à Thémis, son palais d’allure si vénérable n’est qu’un antre où la justice n’a rien à voir ; et la robe des magistrats laisse échapper des odeurs qui ne sont pas celles de la vertu, dès qu’un doigt indiscret s’avise de la soulever tant soit peu. Seulement un homme en impose de suite au populaire, s’il marche la tête haute, siège sur une estrade et porte des habits qui ne sont pas ceux du commun. Un simple ruban à la boutonnière, quelquefois suffira pour qu’on vous classe hors de l’humanité ordinaire. A l’infini, nous pourrions multiplier les exemples qui démontrent que, dans nos sociétés, la mystification joue un rôle essentiel, fondamental. Ce serait inutile. Toutefois, à l’inverse de plusieurs, nous espérons que l’espèce humaine ne restera pas en enfance constamment. Il y faudra bien des siècles sans doute, mais lorsqu’elle atteindra l’âge adulte, nous pensons qu’elle répudiera les faux prestiges qui la captivèrent si longtemps. Nos os seront en poussière quand ces heureux jours luiront. Présentement, ils ont à souffrir, et beaucoup, ceux qui, trop en avance sur leur temps, ont percé le mystère de l’universelle mystification. Reconnaissons que, pour qui exploite ou gouverne, cette race est aussi dangereuse que celle des poires est profitable.
— L. BARBEDETTE
MYTHOLOGIE
n. f. (du grec muthos, fable, et logos, discours, étude)
Le terme de mythologie désigne le cercle des divinités, avec leur faisceau de légendes, propres à une race ou à un peuple ; c’est dans ce sens que l’on parle de la mythologie indo-européenne, de la mythologie grecque, etc. La mythologie embrasse ainsi la totalité des récits divers par la forme, semblables par le fond, sur lesquels les poètes ont aimablement brodé (l’Illiade, d’Homère, est un modèle du genre), récits dont les personnages échappent par leur nature même au contrôle du fait positif et qui concernent exclusivement les dieux, les demi-dieux et les héros, lesquels ne sont, en dernière analyse, que des dieux défigurés... Mais la mythologie est aussi la science des mythes : ce sont les recherches consacrées à leur origine, à leur développement ; c’est l’histoire des personnages divins du polythéisme, avec l’explication de leur formation, de leur caractère ; c’est la connaissance et l’éclaircissement des récits émanant du temps et des idées de religions dans lesquelles les êtres divins ne sont pas immuables mais sont soumis, comme les simples mortels, à des changements, sont, comme eux, sujets à des accidents... Les savants, dès le IVème siècle avant l’ère chrétienne, s’essayaient déjà à pénétrer jusqu’à la source des mythes. Parmi les mythographes (autres que ceux dont nous mentionnons les ouvrages à la fin de cette étude) qui se sont ingéniés à construire ou à développer des systèmes explicatifs — philologique, iconographique, anthropologique, psychologique, etc. — citons : Evhémère, philosophe de la Grèce antique. Depuis : E. David, A. Kühn, Clermont-Ganneau, Bérard, H. Spencer, etc...
* * *
C’est une tendance instinctive que de confondre religion et mythologie. Quand on parle de la religion des Grecs, par exemple, on pense volontiers aux fables charmantes que les poètes hellènes ont racontées sur leurs dieux, leurs déesses, leurs héros. Cette confusion résulte de ce que, à la base de toute mythologie, il y a de la religion. Les conceptions religieuses des peuples sont antérieures à toutes mythologies, celles-ci n’en sont que des dérivées. Les dieux sont un produit immédiat de l’ignorance humaine, une résultante de la conception animiste du monde qui prête la vie et la volonté à tout ce qui existe, sans distinction de nature entre les hommes, les animaux, les végétaux et les choses. Cet animisme universel aboutit à la personnification complète de toutes choses, c’est-à-dire à leurs identifications avec l’homme lui-même ; il conduit à reconnaitre dans tous les événements une résultante de l’action et de la volonté d’un être vivant ; à prêter aux êtres et aux choses qui limitent la personnalité humaine des intentions malignes ou bienfaisantes ; à les considérer comme des alliés ou des ennemis doués de facultés que l’homme remarque en lui-même. Les mythologies ne sont que des produits indirects de la religiosité humaine. Elles sont nées à l’époque où l’homme qui, d’abord avait cherché à se créer des alliés dans le monde des invisibles qu’il avait enfanté, en choisissant des gris-gris, des amulettes parmi les multiples objets ou les êtres qui lui paraissaient les plus aptes à remplir cette fonction, essayait petit à petit de substituer aux grossiers fétiches du commencement, les conceptions plus subjectives de puissances indépendantes du monde matériel. L’animisme fétichique prend progressivement une forme nouvelle par cette extension du subjectivisme et sa substitution graduelle à la réalité. Le fétichiste en face de son gri-gri qui est le plus souvent une pierre, un morceau de bois, un animal, un coquillage, peut lui supposer un spectre dont la forme est précisément celle sous laquelle il le voit dans ses rêves, mais le subjectivisme croissant de l’humanité finit par ne plus se contenter de cet animisme indécis. Peu à peu, l’homme détacha les phénomènes naturels de leurs formes visibles et leur en impose une autre qui se trouve être celle de l’homme lui-même. Les esprits du monde terrestre, météorologique et sidéral deviennent autant d’êtres revêtus de la forme humaine, animés des mêmes passions, possédant les mêmes volontés et soumis aux mêmes besoins que le bipède humain, quoique différant de lui par le précieux privilège d’une puissance plus considérable. C’est le règne de l’anthropomorphisme qui ne se produit dans l’histoire que là où le fétichisme proprement dit cesse de dominer, puisqu’il est précisément l’indice de la substitution prochaine du polythéisme au fétichisme.
La conception est polythéiste en même temps qu’anthropomorphique le jour où aux objets eux-mêmes le subjectivisme humain a substitué : Indra, Agni, Vishnu, Jahvé, Cybèle, Jupiter, Apollon, etc. Cette substitution du polythéisme anthropomorphique au fétichisme animique marque encore une autre évolution de l’intelligence humaine. Les phénomènes réguliers et constants prennent dans l’esprit de l’homme la place prépondérante qui lui appartient ; les faits accidentels sont relégués à l’arrière plan. L’observation longtemps tenue en échec par la faiblesse native des facultés intellectuelles s’exerce sur des souvenirs accumulés pendant une longue suite de siècles et finit par établir entre les faits mythologiques une gradation qui entraîne entre les puissances de la terre, de l’atmosphère et du ciel, une hiérarchie correspondante.
Les mythologies qui charmèrent et gouvernèrent nos pères ont été l’apanage de tous les peuples, mais l’émission des mythes préhistoriques de la race indo- européenne a laissé des traces si profondes dans la mentalité et les mœurs des peuples actuels, qu’elle a empêché d’apercevoir le travail analogue qui s’était opéré parmi les autres familles humaines. Aussi ne considère-t-on généralement comme constituant la mythologie que les mythes primitifs des peuples indo- européens : Indous, Perses. Grecs, Latins, Germains, Slaves et Celtes, en y adjoignant tout au plus les traditions religieuses de l’Égypte et de l’Assyrie. Parmi les diverses théories conçues pour l’explication des mythes, trois méthodes connurent, dans les temps modernes connue dans l’antiquité, successivement le succès. Ce sont : la méthode historique, la méthode allégorique, et l’école symbolique.
Les partisans de la méthode historique avaient la prétention de retrouver des faits réels sous les fables, en essayant d’identifier les dieux des mythologies avec les personnages bibliques et les légendaires héros de l’antiquité. L’école allégorique crut que les fables antiques étaient l’apparence des mouvements célestes et des phénomènes de la nature allégorisés et embellis. Les sciences naturelles et la fable, nées d’une commune source, se sont divisées après avoir marché de compagnie pendant très longtemps, en deux branches distinctes, de manière à laisser ignorer aux âges suivants le point commun de réunion ou de départ (mythe solaire). L’école symbolique ne voulait voir dans les mythes que l’expression d’une antique sagesse nous ayant légué, sous le voile de l’allégorie, de profondes vérités morales ou physiques.
Les progrès de l’archéologie et de la linguistique comparées, la connaissance toujours plus précise des étapes de la civilisation et des progrès inégaux des races et des peuples ont créé la mythologie comparée qui, en nous affirmant l’identité originelle de toutes les conceptions religieuses et en mettant en évidence les caractères essentiels des mythologies ont fait table rase de toutes ces assertions abusives, tout en leur reconnaissant les services qu’elles ont rendus dans la découverte toujours plus précise de la vérité.
Après avoir démontré que les dieux ne sont que des appellations d’objets matériels, d’aspects de la nature ou de facultés humaines, passant aux aventures des dieux ou des héros, les mythologues modernes en ont trouvé le germe dans certaines locutions d’usage courant qui exprimaient les événements les plus ordinaires de la vie et du monde et ont établi que les mythologies doivent leur existence autant à la tendance à douer les êtres et les choses de facultés animales et humaines qu’à l’influence prépondérante de la puissance métaphysique inhérente au langage même le plus rudimentaire.
La grande majorité des religions se rattachent à la religion des Arras (Iraniens et Indous) : les unes en proviennent directement, les autres s’y rattachent par une communauté évidente d’origine. De même la plupart des mythes grecs, persans, latins, germains et slaves ont aussi été empruntés à la mythologie védique. Ils se sont transformés au gré des fantaisies locales, des relations internationales et même des conceptions philosophiques. Aussi l’importance prise à la fin du siècle dernier par les études philologiques a démontré que l’origine des mythologies se rapproche de celle du langage et que la nature des dieux nous est révélée très souvent par le nom qu’on leur avait donné. Notre langage est essentiellement animiste et, chez tous les groupes humains, à l’origine comme aux divers moments de l’évolution religieuse, les êtres surnaturels ont dû leur existence, leur activité et leur emprise sur la conduite des humains, à la puissance métaphorique que le langage comporte. Au début des temps historiques, le nom, à la fois substantif et adjectif, faisait des fétiches, des esprits ou des dieux des êtres qualifiés ; le genre leur prêta des sexes. II y en eut des mâles, des femelles et des androgynes, participant à la fois des deux sexes. Le même dieu, chez le même peuple, selon les époques, le caprice du langage, fut femme sous un nom, homme sous un autre et, par conséquent, pourvu de laideur ou de beauté, de bienveillance ou de malignité.
Toute succession de mots implique une action, une impulsion, donnée ou reçue. Le sujet se meut et communique un mouvement. Chaque mot, soit par sa place dans la phrase, soit en vertu d’affixes contient un verbe, ainsi qu’un adjectif ou un nom. Le mot, nom de chose, de qualité ou de concept, de par le verbe qui est en lui ou qui dérive de lui, agit et se comporte comme un être vivant, comme une personne passionnée et volontaire. Cette force animante du langage s’impose malgré nous à la raison comme à l’imagination, elle crée spontanément la mythologie. Ce n’est que difficilement, par un oubli des illusions verbales, par une sorte d’usure et d’épuisement de la vertu métaphorique du langage que la science se soustrait à cette force animante que tout idiome contient. Mille locutions banales, d’usage courant, nous la révèlent : l’eau coule, charrie des sables, transporte des alluvions : le soleil se lève, monte à travers le ciel se couche derrière les montagnes ; le vent chasse les nuages ; la foudre frappe, tue, déchire ; la victoire guide les armées ; la justice et le devoir prescrivent tels actes, défendent telles actions. Autant d’expressions, source de confusions, d’erreurs qui, à l’origine, contribuèrent à former les mythes en fortifiant la métaphysique. N’est-ce pas Alfred de Musset, dans son invocation à Vénus, qui nous donne un exemple frappant de cette force animiste du langage :
Triste larme d’argent du manteau de la nuit
...
Etoile, où t’en vas-tu dans cette nuit immense ?
Cherches-tu sur la rive un lit dans les roseaux ?
Où t’en vas-tu si belle à l’heure du silence
Tomber comme une perle au sein profond des eaux ?
L’étoile est un être doué de mobilité, de désirs, de besoins, qui cherche un endroit où se reposer. Y a-t-il loin de l’état d’esprit qu’accusent ces vers à celui du sauvage qui affirme que l’eau coule « parce que l’esprit de l’eau la pousse à fuir ! » Nous sommes habitués à redresser en nous-mêmes les effets de cette réfraction involontaire, mais combien a dû être grand l’empire du langage aux époques où chaque mot était une image, chaque nom un personnage doué de vie, chaque verbe un acte physique. Exprimés par des mots aussi significatifs, les concepts les plus simples prenaient aussitôt une splendeur extraordinaire et les phénomènes de la nature, rapportés à des êtres qu’on supposait doués d’une vie analogue à celle de l’homme, traduits dans un langage où chaque mot parlait à l’esprit, paraissaient être les actes d’un drame grandiose dont les acteurs, divins par l’origine, étaient semblables à nous par le coeur.
La race indo-européenne fit, des forces de la nature, ses premières divinités ; elle adora, après les grossiers fétiches qu’elle inventa au début de sa vie religieuse, les phénomènes de l’atmosphère et du ciel. Elle prêta au soleil, aux astres, à la pluie, à la tempête, au veut, une intelligence, une volonté libre, des sentiments d’amitié ou de haine pour les mortels. Mais, au début, tout en leur rendant hommage comme à des êtres supérieurs, les hommes ne perdaient pas de vue leurs caractères physiques. Les premiers poètes védiques qui chantèrent « Dyaus » n’ignoraient aucunement qu’il était le ciel déployé sur leurs têtes ; en célébrant la sagesse de « Mitra et de Varouna », ils savaient parfaitement bien qu’ils faisaient l’allusion la plus claire à la succession régulière du jour et de la nuit. C’était le temps où le nom des dieux était encore le nom même du phénomène, c’était l’époque où le peuple en disant : « Képhalos poursuit Séléné » parlait aussi simplement que nous lorsque nous disons :
« Le Soleil se lève en face de la Lune qui se couche. »
C’était la nature vivante que les hommes adoraient, la nature douée par des peuples follement animistes de pensée, de raison, de passions, de sentiments dont ils sont pleins eux-mêmes.
Ceux qui virent les mythes se former de la sorte ne furent pas dupes des illusions du langage, les premiers poètes védiques connaissaient la signification des fables qu’ils répétaient. Mais il n’en fut plus de même aux époques suivantes. Maintes locutions claires pour les rédacteurs du Rig Véda (Véda de la louange, le plus ancien recueil d’hymnes religieux connu) devinrent obscures pour leurs continuateurs, pour les Perses, les Grecs, les Latins, les Slaves qui s’étaient appropriés en les défigurant les principaux mythes védiques.
A mesure que certains termes vieillirent, que le sens mythologique des mots s’oublia, le langage perdit peu à peu de sa transparence, les noms des forces de la nature devinrent des noms propres et les personnages mythiques commencèrent leur évolution. Dyaus-Pitar est encore le ciel pour les Védas ; il devient, chez les Grecs, qui ont emprunté ce nom aux Indous, Zeus pater (Jupiter en latin), maître des dieux. Ces premiers changements, substituant de prétendus personnages aux phénomènes physiques, transformèrent les faits énoncés au sujet des forces de la nature en actions merveilleuses.
Les idiomes jeunes se caractérisent tous par une prodigalité qui leur fait employer pour désigner un seul objet ou un seul être une quantité étonnante de synonymes. Dans les Védas, le soleil est nommé de plus de vingt façons différentes ; chaque terme n’est pas l’équivalent d’un autre, chacun prête à l’astre du jour un caractère physique ou moral. Le soleil est tour à tour : le brillant (Surya), le Généreux (Aryaman). Celui qui nourrit (Pùshan), le maître du ciel (Divaspâti), et ainsi de suite. Lorsque l’homme créa tous ces termes pour désigner un seul être, il savait qu’une confusion entre tous ces synonymes était impossible, une même passion emplissant toutes les âmes. Mais une fois que ce premier âge de l’humanité fut passé, l’époque suivante chercha à mettre de l’ordre dans ce chaos, Elle supposa que tant de termes ne pouvaient s’appliquer à un seul être, au même objet, et elle commença à distinguer Surya d’ Aryaman, Pùshan de Divaspâti. Néanmoins, comme toutes ces figures avaient un air de parenté, connue très souvent elles se substituaient l’une à l’autre, on se tira d’embarras en faisant d’elles le père et le fils ou bien des frères. On dressa des tailles généalogiques, on établit une hiérarchie entre les dieux, on inventa les dynasties célestes, les révolutions violentes en plaçant dans le panthéon, comme autant de rois déchus, les synonymes vieillis, et, pour ce, incompris, des divinités actuelles. Cette classification des mythes a été l’œuvre des prêtres qui, après avoir imposé à la terre la constitution qui s’accordait le mieux avec les intérêts de leur caste, ont organisé l’armée des dieux en y introduisant cette hiérarchie qui, en subordonnant la multitude des dieux de second ordre aux puissances supérieures de l’atmosphère et du ciel, leur ont permis de devenir maitres des dieux. Les prêtres se défient des divinités antérieures qui ne leur appartiennent pas suffisamment. Il leur faut des dieux cachés, mystérieux, dont la puissance s’exerce par des intermédiaires invisibles et qui se prêtent à la métaphysique absurde qu’ils préparent. Le résultat de l’intervention des prêtres a été de jeter dans l’histoire des mythes et de leur développement une multitude de complications, des obscurités souvent impossibles à débrouiller, car souvent ils ont créé des divinités qui faisaient double emploi avec les précédentes, tandis qu’ils s’efforçaient d’accaparer les divinités antérieures en les marquant de leur estampille particulière.
Un second mode de formation, provient aussi de la confusion des différents sens d’un même terme. C’est ainsi que le « Pramantha », le morceau de bois utilisé chez les Aryas, dont la pointe en tournant dans l’arani produisait le feu, est devenu Prométhée, un titan dont la légende a pris des proportions fantastiques. Cette cause a produit un grand nombre de mythes qu’elle a défigurés davantage.
D’autres éléments que ceux que nous venons d’examiner sont venus renforcer, pour les mieux consolider, les mythologies.
Dans la nature, tout paraît à l’homme primitif, imprévu et redoutable. A cette terreur des êtres et des choses vint s’ajouter celle des ombres, des âmes des morts, des fantômes logés dans les objets et les phénomènes, lorsque l’homme s’avisa de prêter la vie et la volonté aux choses et aux morts. Aussi, les premiers, invisibles, méchamment actifs, ne songèrent qu’à faire du mal, se délectèrent de hurles, de larmes et de sang. Reportons-nous à ces temps de la vie pastorale, où chaque famille errait isolée dans les vastes plaines à la suite de ses troupeaux, exposée aux attaques nocturnes des animaux féroces et nous concevrons sans peine par quelles alternatives de terreurs et de joies devait la faire passer la succession des ténèbres et de la lumière. Quelle épouvante lorsqu’elle voyait s’étendre sur elle cette ombre qui la livrait à tous les dangers et contre laquelle elle ne savait pas encore se défendre, Mais avec quelle allégresse les humains saluaient les premières lueurs de l’aube qui, avec, la clarté, leur ramenaient la vie et la sécurité. L’obscurité était pour eux l’image de la mort, du néant, c’était la destruction du monde. Dans le retour de la lumière, ils voyaient une sorte de résurrection, de renaissance comme une création nouvelle qu’ils accueillaient par des cris, des chants, des danses dont le souvenir est resté plus ou moins vivant dans toutes les religions. Si l’on songe que les hommes n’avaient aucune idée, à cette époque, des lois naturelles expliquant les faits astronomiques et météorologiques et particulièrement la production des orages, la succession constante du jour et de la nuit, il est facile de comprendre que leur ignorance les ait poussés à voir dans tous ces phénomènes les effets de causes vivantes et volontaires, ainsi qu’eux-mêmes. Les mythes naissent du besoin instinctif qui pousse l’homme à chercher la raison d’êtres surnaturels, semblables aux humains, par la forme et les traits de leurs caractères, mais supérieurs par leur empire et l’ampleur de leurs qualités ou de leurs défauts. La condition première des hommes a été si longtemps misérable que, jusqu’à des temps relativement rapprochés de nous, la puissance des divinités malfaisantes a été considérée connue supérieure à celle des autres. C’est pourquoi les cultes les plus anciens ont été les plus farouches. Puis, à mesure que l’expérience apprenait aux hommes à se garantir en partie des dangers et des misères des premiers âges, que des coutumes et des institutions plus stables leur apportaient une certaine somme de sécurité, ils remarquaient les effets bienfaisants du vent et de la pluie ; le retour régulier des saisons ; ils voyaient les jours alterner avec les nuits et s’habituaient à l’idée d’un ordre maintenu par des puissances amies.
Comme, d’un autre côté, ces phénomènes échappent à toute puissance humaine, il fallait bien reconnaître que les causes qui les produisaient étaient d’un ordre supérieur à l’humanité et que les invisibles qui présidaient aux phénomènes célestes et météorologiques étaient nécessairement plus forts et plus grands que les multiples petits dieux n’ayant que des attributions locales et que l’on ne pouvait rien en obtenir que par la prière, les sacrifices, les offrandes.
Sans doute, cet ordre était loin d’être parfait, les météores et les astres étaient enclins à de capricieuses violences, les dieux de l’atmosphère et du ciel se plaisaient à inquiéter leurs adorateurs par des colères soudaines, des désastres imprévus. Mais le respect est fils de la crainte. Si les dieux étaient uniquement occupés à répartir également leurs bienfaits, les prières, les génuflexions, les offrandes seraient vaines. Sur quelle autorité, sur quelles menaces, les rois, les magistrats baseraient-ils leur omnipotence ? De quoi vivraient les devins, les prophètes, les prêtres et autres sorciers ? C’est pourquoi le plus débonnaire des dieux a toujours su garder un visage irrité : l’inquiétude ravive la reconnaissance, l’échauffe la tiédeur lorsque la faveur est soulignée par l’opportune calamité !
Et c’est ainsi qu’en face des innombrables puissances malignes, s’est insensiblement constitué le groupe des divinités supérieures foncièrement bienveillantes, capables de largesses dans la mesure compatible avec la dignité et les intérêts du culte. Et sans cesser d’amadouer les premières par toutes sortes de conjurations, de rites, les hommes imploraient et bénissaient les grands dieux de l’atmosphère et du ciel ; ils leurs demandaient secours contre les ennemis invisibles de l’humanité contre les maladies, les menées ténébreuses des démons. De là deux grandes catégories qui, sous des formes diverses, ont persisté dans tous les cultes : les divinités bienfaisantes et les divinités funestes. On adorait également les unes et les autres, les unes pour en obtenir protection active et vigilante, les autres pour désarmer ou adoucir leurs colères.
Ce dualisme est l’aboutissement logique de toutes les religions qui dérivent de l’animisme. Partout où l’on retrouve cette conception des dieux bons luttant contre les dieux méchants, on peut être certain, en remontant aux origines, de retrouver l’opposition de la lumière aux ténèbres. Ce culte des divinités bienfaisantes prit toujours plus de développement et progressivement on arriva à ne plus considérer les autres que comme des mauvais génies en révolte contre les dieux amis de l’humanité. C’est à ce point que les conceptions religieuses en sont arrivées dans les Védas. Indra, le ciel lumineux, est le dieu protecteur de l’homme. C’est lui qui chaque matin combat et détruit la mort que les puissances ténébreuses, sous le nom de Vitra, dissimule dans les nuages et dans l’obscurité.
Ces dieux puissants et débonnaires n’étaient que des hommes, leur vie reproduisait exactement la vie humaine. Industries, arts, occupations, passions et désirs, tout leur était commun avec la race humaine. La guerre, avec son cortège de vengeances, de haines inexpiables, de victoires et de revers, entra dans ce monde calqué sur la société humaine. Tous les personnages des panthéons se trouvèrent classés par paires, deux par deux ; la lumière en face des ténèbres, le feu devant l’eau, la terre contre la mer, le chaos contre l’ordre. Ce fut une lutte acharnée, rarement suspendue, toujours renaissante. La métaphore, propriété fondamentale du langage, multipliait et variait à l’infini les événements de la bataille éternelle livrée entre les dieux. D’un côté, les dragons redoutables, les géants difformes, les démons, les anges rebelles ; de l’autre, les dieux d’en haut et leurs alliés, les héros et les défenseurs de l’ordre universel.
Cette philosophie primitive qui crée les mythologies, résulte du dualisme moral qui a ses attaches au plus profond de l’âme humaine. Il s’est développé et affiné avec les sentiments affectifs et les concepts qui en dérivent. La sensation a deux faces : plaisir et douleur. Comment ne pas rapporter ces sensations contraires à deux causes également contraires soit à la bienveillance, soit à la colère des dieux, les uns amis, les autres ennemis des hommes ? De cette conception dualistique est issue l’idée que les bonnes actions sont agréables aux dieux bienfaisants et déterminent leurs faveurs, que les vices et les crimes exposent à leurs courroux. Considérations qui, si elles ont rarement réprimé chez certains de vils penchants, ont livré la morale aux clergés qui, au nom des dieux, se sont arrogé le droit de punir ou d’absoudre, de mesurer le mérite et le démérite.
II est difficile pour ne pas dire impossible, de débarrasser les mythologies de tous les éléments parasites qui sont venus s’y amalgamer, au point, parfois, d’en altérer le sens primitif. Elles se compliquent de souvenirs historiques, d’arrangements arbitraires, elles s’augmentent de fabuleux récits de conquête où le triomphe des dieux nouveaux rejette au rang de démons, de rebelles, les dieux des nations vaincues. Elles se calquent, se répètent, se fragmentent, se mélangent les unes dans les autres ; parfois elles mettent aux prises des groupes de dieux similaires où chacun est vainqueur sous un nom, vaincu sous un autre qui équivaut au premier, elles se divisent en multiples épisodes que commentent et modifient les fictions des poètes. Mais toujours au fond de chacune d’elles se retrouve l’antagonisme des deux principes : le bien et le mal. Cette opposition à la fois dualistique et cosmogonique, se retrouve dans toutes les mythologies les plus rudimentaires et elle est si puissante que les religions monothéistes en sont toutes imprégnées. Tous les couples naturels ou factices, les sexes, le jour et la nuit, le ciel et la terre, ont été rangés en catégories distinctes. La nature humaine, le corps, la femme, les ténèbres, les enfers, les titans, les vices appartiennent au royaume du mal ; la lumière l’énergie, l’ordre, le ciel, le paradis, les personnages de l’Olympe, etc., appartiennent au royaume du bien. Tous les dieux favorables à la race humaine forment une même famille, le groupe lumineux et céleste, auteur de tous les biens, auxquels on demande la santé, la richesse, la victoire, etc. Le menu peuple des esprits, des héros, des fétiches de tout genre, subordonnés aux dieux supérieurs, leur font cortège, leur servent de ministres, d’intermédiaires, d’alliés fidèles. Dans la multitude des puissances malignes se détachent les grands dieux des « ténèbres et du mal » qui, avec leur troupes d’invisibles hargneux et mauvais, harcèlent les humains et cherchent constamment à ravir aux dieux débonnaires la puissance et le pouvoir. Et des multiples péripéties de cette lutte incessante, implacable entre les puissances du bien et du mal, naissent et évoluent les religions, se créent et se détruisent les mythologies. Aux traditions primitives s’ajoutent constamment des éléments nouveaux, des épisodes multiples qui accrurent considérablement le domaine des mythes. Les prêtres donnèrent un chef à chacune des catégories divines, en assemblant une partie en conseil suprême, sous la présidence d’une triade, d’un couple, ou d’un maître, père des Dieux et des hommes.
De même, les dieux du mal sont réunis en troupes placées sous les ordres des plus puissants d’entre eux. C’est la bataille entre ces deux groupes ennemis. L’Egypte oppose Typhon à Osiris, les Iraniens Indra à Vitra, les Perses Ormuzd à Ahriman, les Grecs Zeus aux Titans, les catholiques Dieu à Satan. Et ironie plaisante, le diable, le prince du mal, cet épouvantail aux multiples noms que connaissent toutes les mythologies, et sur lequel les clergés comptent autant pour leurs coffres que pour courber les fronts sous la teneur des vengeances divines, est, aujourd’hui, vainqueur. Nul clergé n’a vu que Satan allait grouper autour de lui les ennemis de l’obéissance et de l’obscurantisme religieux ; que les opprimés de l’art et de la science — déclarés d’origine diabolique — allaient s’unir aux prétendues puissances du mal pour attaquer victorieusement les religions, en opposant à leurs affirmations gratuites, absurdes autant qu’abstruses, les résultats de l’expérimentation et de l’observation scientifiques.
Les mythologies qui, à un certain moment de l’évolution religieuse des peuples, jouent un rôle prépondérant, ne sont d’abord que le résultat des sensations de l’homme primitif, un timide essai d’implication des phénomènes naturels. Avec les progrès de la civilisation, les mythologies s’affinent, se condensent, font, chez certains peuples, (les Grecs, par exemple), des progrès très rapides. Les dieux trop nombreux, diminuent en nombre, croissent en importance, deviennent plus puissants, plus « spiritualisés ». C’est le règne du polythéisme anthropomorphique qui, tout en attribuant aux invisibles, une vie analogue à celle des hommes, établit dans la cohue des dieux une hiérarchie qui les classe en groupes distincts. Calqué sur la société humaine, le monde des divinités est soumis aux mêmes besoins, aux mêmes désirs, aux mêmes passions que les mortels. Et des multiples conflits, résultant de l’opposition de passions contraires, de besoins différents, résulte cette profusion de récits naïfs ou charmants qui composent l’histoire infiniment touffue des dieux. Le personnel divin est alors au complet ; les dieux ont assez de pensée, de raison, pour permettre à l’homme de leur demander pourquoi ils ont créé l’homme. Et la chaîne indéfinie des fictions séduisantes, qui a pour point de départ l’assimilation du ciel et de la terre au premier couple ancestral, aboutit au dualisme moral du bien et du mal. Entre ces deux principes se joue le drame éternel. L’histoire de leur union, de leur séparation, de leurs rivalités, de leurs triomphes et de leurs défaites constitue la trame même des mythologies.
Mais, à mesure que l’horizon intellectuel des peuples s’élargit, que le domaine de l’inconnu diminua, les dieux subirent les mêmes réductions et on en arriva soit au monothéisme, soit au panthéisme. « A leur tour, ces dernières créations mythiques subissent la destinée de leurs devancières », elles s’effritent sous les attaques répétées de la science, malgré les efforts des prêtres et des métaphysiciens qui veulent, à tout prix, rattacher l’homme au divin, sans vouloir comprendre que ce mot n’explique rien, Et si, aujourd’hui encore, la plupart des humains persistent à admettre l’existence d’un dieu, continuent à croire à un dualisme entre deux principes opposés : dieu et le mal, ils ne font qu’obéir à des habitudes intellectuelles qui leur sont imposées par l’atavisme et que renforcent, dès l’enfance, une éducation et une instruction fermées aux progrès de la science. Parmi ceux qui s’attachent à cette croyance, les uns ne peuvent se résoudre pour eux-mêmes à renoncer aux espérances d’immortalité que les doctrines religieuses font briller à leurs yeux ; les autres y tiennent moins pour eux-mêmes que pour la multitude, ne comprenant pas qu’il puisse exister une morale en dehors de la perspective future des châtiments et des récompenses célestes. Ce qui survit des doctrines religieuses, c’est moins la doctrine elle-même que le besoin qui les a fait imaginer. On s’attache plus aux conséquences en vue desquelles la doctrine a été inventée qu’à la théorie elle-même. C’est dire qu’elle n’existe plus en réalité et que la base chancelante sur laquelle elle repose ne tardera pas à lui faire définitivement défaut.
— Charles ALEXANDRE
BIBLIOGRAPHIE. — Michel Bréal : Hercule et Cacus. — Max Müller : essais sur la mythologie comparée. — Tylor : Civilisations primitives. — And. Lang : La mythologie. — de Milloué : Histoire des religions de l’Inde. — Letourneau : Sociologie ; L’évolution religieuse ; Science et matérialisme. — Hovelacque : d’Avesta, Zoroastre et le magdéisme, — Gérard de Rialle : mythologie comparée. — Preller : Les Dieux de 1’ancienne Rome. — Lefebvre : Essai de mythologie et de religion comparée ; Essai de philologie et de linguistique. — Franz Cumont : Les religions orientales dans le paganisme romain. — P. Decharme : Mythologie de la Grèce antique. — Salomon Reinach : Cultes, mythes, religions ; Orphéus. — Toutain : Etude de mythologie et d’histoire des religions antiques. — A. Haggerty Krappe : Mythologie universelle, etc. Consulter aussi la bibliographie à la fin du mot « Religions ».
[1] Morris Hillquit cite, dans un autre endroit de son ouvrage, qu’à Amana, chez les Harmonistes, les Zoaristes, nombre de personnes atteignent 70, 80 ans et davantage. Chez les Shakers, il n’est pas rare de dépasser 90 ans et à Onéida, on atteignait facilement cet âge. Parmi les fondateurs ou animateurs de colonies, Rapp arriva à 90 ans Baumeler et Noyes à 75 ans. À 87 ans (en 1903) l’Icarien Marchant militait encore activement.